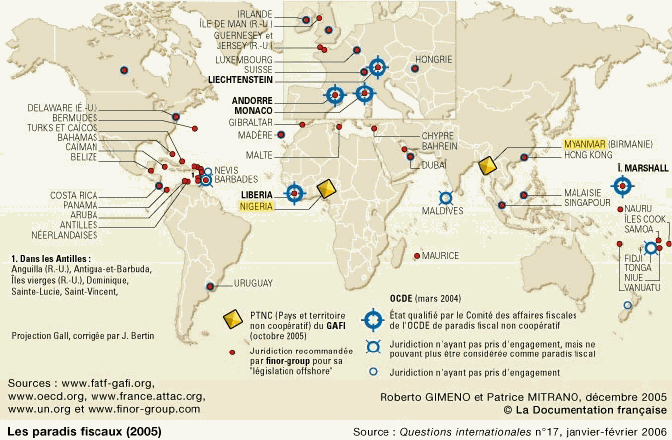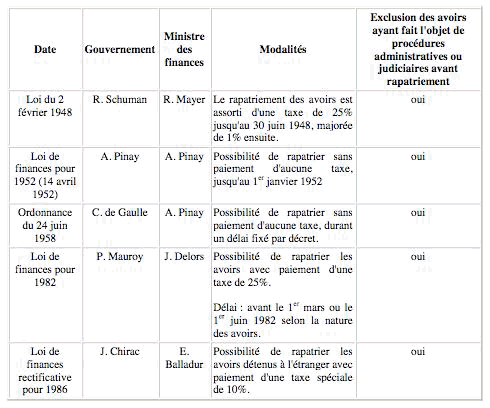TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 septembre 2009
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
sur les paradis fiscaux
ET PRÉSENTÉ
PAR MM. Didier MIGAUD, PrÉsident, GILLES CARREZ, Rapporteur gÉnÉral, Jean-Pierre BRARD, Henri EMMANUELLI,
Jean-François MANCEL et Nicolas PERRUCHOT
Députés
——
I.– UN PROBLÈME MONDIAL 9
A.– CARTOGRAPHIE DES PARADIS FISCAUX, BANCAIRES ET RÉGLEMENTAIRES : LES TROIS CERCLES 9
1.– Les paradis fiscaux 12
2.– Les paradis réglementaires 14
3.– Le blanchiment d’argent sale 16
B.– LES ENTITÉS ÉTABLIES ET LES ACTIVITÉS EXERCÉES DANS LES PARADIS FISCAUX 21
1.– La fraude et l’évasion liées aux paradis fiscaux : un phénomène difficile à quantifier 23
a) Les sommes qui prospèrent ou transitent dans ces territoires 23
b) Fraude, évasion, optimisation : quelles estimations des pertes de recettes ? 25
c) Le nombre d’entités et la présence des résidents français dans les paradis fiscaux 28
2.– Un visage à deux faces : des territoires attractifs boîte noire des opérations douteuses 33
a) Un rôle présenté comme positif dans la mondialisation 33
b) Secret, dérégulation et anonymat : la boîte à outils du fraudeur 36
c) De la concurrence fiscale à la manipulation et la fraude 41
d) Le terrain de jeux des grandes fortunes 43
II.– LA DIFFICILE MISE EN PLACE DE RÉPONSES COORDONNÉES 45
A.– 15 ANS D’AVANCÉES MULTIPLES MAIS DISPARATES 46
1.– Les travaux de l’OCDE : la régulation de l’économie mondialisée 46
a) La détermination des prix de transfert 46
b) Les principes de lutte contre les pratiques dommageables, la fraude et l’évasion fiscales 47
c) Les modalités de mises en œuvre des principes de l’OCDE pour une coopération effective 49
d) Les résultats décevants des engagements pris au début des années 2000 51
2.– Les ambiguïtés de la Communauté européenne dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales 53
a) La lutte contre la concurrence fiscale dommageable et pour la transparence : la trilogie des codes de conduite 54
b) L’assistance mutuelle 56
c) La directive épargne 58
d) La jurisprudence de la CJCE et le dumping fiscal 63
B.– LA DEUXIÈME VAGUE 66
1.– Un contexte propice à une régulation des « trous noirs » de la finance mondiale 66
a) La crise des subprimes : les techniques de titrisation montrées du doigt 66
b) Le changement d’administration américaine 68
c) L’affaire de la fraude fiscale via le Liechtenstein ouvre la voie à de nouvelles initiatives en Europe 71
2.– La lutte contre le secret bancaire et les secteurs non réglementés 72
a) Le G20 : une mobilisation internationale contre les paradis fiscaux 73
b) Les paradis fiscaux poursuivent leur processus de négociation pour sortir de la « liste grise » 76
c) Des efforts relayés par la Conférence de Berlin de l’OCDE 79
d) Des incertitudes quant à la portée réelle de la « liste grise » 80
3.– La relance des négociations européennes sur l’assistance administrative 85
a) La refonte de la directive épargne 87
b) Les propositions de directives « assistance mutuelle » 90
c) La coopération avec les États voisins 93
d) La proposition de directive sur les hedge funds 94
III.– LE CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE FRANÇAIS 99
A.– DES OBLIGATIONS PESANT SUR LES ENTITÉS FRANÇAISES SUJETTES À AMÉLIORATIONS 99
1.– Les obligations générales pesant sur les entités françaises en matière de lutte contre le blanchiment 99
a) Les professionnels assujettis aux obligations anti-blanchiment 100
b) Les apports de la 3ème directive anti-blanchiment 102
c) La mise en œuvre de l’ordonnance de transposition 105
2.– Les règles spécifiques applicables aux établissements de crédit dans leurs relations avec les paradis fiscaux et le rôle de la Commission bancaire 109
a) Le contrôle interne aux établissements de crédit 109
b) Des établissements soumis au contrôle de la Commission bancaire 110
c) Des initiatives récentes qui doivent être poursuivies 113
3.– Les règles applicables aux autres entités 118
a) Les sociétés cotées 119
b) Les produits d’épargne collective et les prestataires de services d’investissement 120
c) Les infrastructures de marché 122
d) Les sociétés d’assurance 123
B.– LES DISPOSITIFS DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET L’ÉVASION FISCALES 125
1.– Quelques considérations juridiques sur le ciblage 126
2.– Les relations avec l’administration : obligations déclaratives et documentation 129
a) Les obligations déclaratives en matière douanière 129
b) Les obligations déclaratives des particuliers envers l’administration fiscale renforcées par la loi de finances rectificative pour 2008 131
c) Les initiatives complémentaires à développer pour détecter les sommes non déclarées 132
d) Les informations portées à la connaissance de l’administration fiscales par les entreprises 139
3.– Les limites aux avantages fiscaux 142
a) L’article 238 A du code général des impôts : la déductibilité des charges, redevances, concessions etc. 142
b) L’article 212 du code général des impôts : la lutte contre la sous-capitalisation 144
c) La fiscalité des sommes versées à des personnes établies dans les paradis fiscaux 145
4.– L’imposition des revenus ou actifs localisés hors de France et la présomption d’évasion fiscale 147
a) L’article 57 du code général des impôts : les prix de transfert 147
b) Le dispositif anti-abus prévu par l’article 209 B du code général des impôts 149
c) L’article 123 bis du code général des impôts pour les personnes physiques 152
d) L’article 155 A du code général des impôts 152
e) La taxe de 3 % prévue à l’article 990 D du code général des impôts 154
f) La fiscalité des trusts 155
C.– LA QUESTION PARTICULIÈRE DU CONTRÔLE ET DE LA RÉPRESSION 157
1.– Les acteurs du contrôle et de la répression : organisation et missions 157
a) TRACFIN : la détection du blanchiment 157
b) L’organisation et les moyens du contrôle fiscal 162
c) Les enquêtes judiciaires 166
d) Le cas particulier des enquêtes douanières 171
2.– Les procédures de contrôle et de répression de la fraude 173
a) La coopération entre les services judiciaires et administratifs 173
b) Des résultats tributaires de la qualité de la coopération avec les administrations étrangères 176
c) La capacité à repérer et déclencher une procédure de coopération dépend des moyens de l’administration fiscale française 179
EXAMEN EN COMMISSION 185
ANNEXE 1 : LISTE DES PROPOSITIONS DE LA MISSION D’INFORMATION 191
ANNEXE 2 : LISTE DES PERSONNES ENTENDUES 195
ANNEXE 3 : AUDITION DE M. ÉRIC WOERTH, MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT PAR LA COMMISSION DES FINANCES 197
Le 15 octobre 2008, le Premier ministre François Fillon annonce devant l’Assemblée nationale : « Des trous noirs comme les centres offshore ne doivent plus exister, et leur disparition doit préluder à une refondation du système financier international ». Le 15 novembre 2008, le G20 à Washington fait de l’adhésion aux standards de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) une condition de l’intégrité des marchés financiers. Le 2 avril 2009, le G20 à Londres valide les listes des paradis fiscaux de l’OCDE.
Le 23 juin 2009 à Berlin, un nouveau pas est franchi dans la lutte contre les paradis fiscaux. Alors qu’à cette date, 83 pays ont annoncé leur ralliement aux standards de l’OCDE, l’accent est mis sur l’application effective des accords d’assistance administrative. L’accès effectif à l’information doit être assuré : « L’information doit exister, l’administration locale doit pouvoir accéder à cette information et un mécanisme de transmission de l’information à l’administration partenaire doit être mis en place » indiquait Éric Woerth, ministre du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État. Toutes les structures juridiques qui protègent l’anonymat (trusts sans bénéficiaires, sociétés offshore sans obligation comptable etc.) sont directement mises en cause. Le communiqué final de la conférence indique que les dix-sept pays se réservent le droit de relever la retenue à la source sur les dividendes, intérêts et redevances transférées à des entités situées dans des juridictions non coopératives, de limiter ou supprimer la déductibilité des paiements et honoraires réglés à des fournisseurs situés dans des paradis fiscaux, de dénoncer les conventions de double imposition existant avec les pays qui ne respectent pas leurs engagements.
En quelques mois, la communauté internationale a pris la mesure de l’importance de la lutte contre les paradis fiscaux. Lors de la création de la mission d’information en décembre 2008, la traduction concrète des annonces du G20 de novembre 2008 paraissait encore relever d’une certaine naïveté. Alors qu’au début des années 2000 les listes noires avaient été vidées de leur contenu et de leur sens, au prix d’engagements non tenus, les États ont semblé vouloir saisir, ces derniers mois, l’opportunité qui était offerte en ces temps de crise pour jeter les bases d’une régulation des paradis fiscaux.
Les enjeux sont considérables, pour la lutte contre le crime et la corruption, pour la stabilité du système financier dans son ensemble et pour la solidité des États fragilisés par l’évasion de leurs recettes fiscales. Le choix a été fait de ne pas dissocier ces différents vecteurs de déstabilisation, afin de ne pas marginaliser une fois encore la question fiscale. Cette démarche est la bonne pour parvenir à maintenir la pression sur les territoires non coopératifs et les sanctionner de façon coordonnée.
Le présent rapport inclut dans son champ d’étude des territoires qui affichent des taux d’imposition raisonnables et pour lesquels la qualification de paradis fiscaux renvoie en réalité à l’environnement réglementaire et au secret, preuve de l’imbrication des différents sujets. La cartographie des paradis fiscaux qu’il dresse et l’analyse qu’il propose des données disponibles sur leur rôle dans l’économie mondialisée ne relèvent donc pas d’un prisme exclusivement fiscal. Toutefois, le présent rapport a vocation à traiter prioritairement des enjeux fiscaux attachés à ces territoires. Il examine donc les actions qui ont été conduites au niveau international depuis une quinzaine d’années pour assainir ces territoires, contenir l’évasion et la fraude fiscales et réguler les transactions. Il fait le point sur les résultats obtenus en mettant en exergue les changements intervenus ces derniers mois. Enfin, il s’attache à présenter l’environnement législatif et réglementaire français, ses forces et ses faiblesses, pour proposer des pistes d’amélioration. Il ne fait aucun doute toutefois que l’effectivité des dispositifs et méthodes de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales est tributaire des résultats qu’obtiendra la communauté internationale et du suivi efficace des engagements qu’elle parviendra à opérer.
A.– CARTOGRAPHIE DES PARADIS FISCAUX, BANCAIRES ET RÉGLEMENTAIRES : LES TROIS CERCLES
Qu’est-ce qu’un « paradis fiscal » ? Si la notion est très couramment utilisée, il n’est pas aisé de la définir, et encore moins de savoir quelles réalités elle recouvre. Désigné en allemand par la métaphore de l’oasis fiscale (Steueroase) et en anglais par le renvoi à la notion de refuge fiscal (tax haven), un paradis fiscal se caractérise avant tout comme un territoire dans lequel le niveau de fiscalité applicable aux résidents étrangers, qu’ils soient des individus ou des entreprises, est particulièrement bas, le rendant ainsi attractif pour ces non-résidents. L’image de la petite économie insulaire, dont l’enclavement et la superficie constituent des obstacles à un développement économique classique, comme celle des Bermudes ou des Bahamas, vient alors immédiatement à l’esprit. Une seconde dimension s’ajoute à cette première définition des paradis fiscaux : il s’agit du manque de transparence et de la réticence à l’échange d’informations qui caractérise généralement ceux-ci et qui se matérialise dans le principe de l’opposabilité du secret bancaire. On comprend donc d’emblée que la problématique des paradis fiscaux ait partie liée avec la question de la concurrence fiscale et de ses limites.
Pour appréhender la spécificité des paradis fiscaux, une approche peut être privilégiée, qui consiste à distinguer trois cercles non concentriques, mais qui peuvent avoir tendance à se recouper – et cela, d’ailleurs, à géométrie variable : le premier recouvre les paradis fiscaux définis strictement à l’aune de critères relatifs à la fiscalité, à la transparence et à l’échange d’informations ; le deuxième concerne les « paradis réglementaires » et met donc l’accent sur le manque de régulation et de contrôle existant dans certains territoires ; le dernier, enfin, est relatif aux lieux de blanchiment de l’argent sale et apparaît comme une conséquence de la conjonction de l’ensemble des critères dégagés : des territoires sous-régulés, où l’opacité des transactions est la règle et dont la politique de prévention, de détection et de répression des délits financiers est défaillante. Chacun de ces trois cercles a d’ailleurs fait l’objet d’actions spécifiques, le premier à l’initiative de l’OCDE, le deuxième se rapportant au Forum de stabilité financière (FSF), tandis que le dernier est l’objet du Groupe d’action financière (GAFI).
Il ne s’agit assurément pas de conclure de cette première approche que les paradis fiscaux sont tous des lieux de blanchiment des capitaux, ni que tout territoire proposant un régime fiscal privilégié doit être assimilé à un paradis fiscal, pas plus d’ailleurs que tout paradis fiscal ne repose uniquement sur un système fiscal favorable.
● Certains territoires présentent en effet des garanties suffisantes tant en matière de régulation des acteurs financiers, de contrôle et de supervision qu’en termes de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ainsi, si la Principauté de Monaco figurait jusqu’en 2009 sur la liste des juridictions non coopératives au sens de l’OCDE, la réglementation et la supervision du système financier monégasque apparaissent satisfaisantes : les établissements de crédit monégasques sont en effet contrôlés par la Commission bancaire française, tandis qu’une cellule spécifique (SICCFIN) est dédiée à la lutte contre le blanchiment. De même, la Suisse dispose d’un système de régulation et de contrôle financiers ainsi que d’un dispositif de lutte contre le blanchiment conformes aux standards internationaux (1). Pour ces deux juridictions, la qualification de paradis fiscal tient essentiellement à la conjonction de deux éléments :
– d’une part, l’utilisation du principe du secret bancaire, en particulier son opposabilité aux demandes d’informations en matière fiscale en l’absence de volet pénal (2) – principe qui vaut également pour le Liechtenstein et le Luxembourg - ;
– et d’autre part, l’existence d’un régime fiscal dérogatoire favorable ou de véhicules juridiques garantissant l’anonymat de leurs bénéficiaires.
Ainsi, les résidents monégasques, de même que les résidents étrangers non français, n’acquittent ni impôts locaux, ni impôts sur le revenu, tandis que le droit monégasque permet la constitution et le transfert de trusts.
La Suisse applique un système de forfait fiscal pour les résidents étrangers en matière d’impôt sur le revenu, et certains cantons leur proposent un régime préférentiel en termes de droits de succession. Si le droit suisse n’autorise pas de construction juridique de type trust exprès (3) ou fiducie, elle reconnaît en revanche les fondations.
Le Liechtenstein exonère d’impôt sur les bénéfices les holdings et les sociétés de domicile ; par ailleurs, si une retenue à la source de 4 % est appliquée lorsqu’une société procède à des distributions, la forme juridique spécifique de l’Anstalt permet d’y échapper. Seul un impôt sur le capital de 0,1 % avec un minimum de 1 000 francs suisses est en réalité acquitté par une Anstalt qui n’exercerait pas d’activité au Liechtenstein.
● Par ailleurs, certains paradis réglementaires ne sont pas des paradis fiscaux. Ainsi, dans certains territoires, les acteurs économiques et les marchés sur lesquels ils opèrent ne sont pas soumis à des règles de régulation suffisamment rigoureuses : les établissements financiers échappent à toute norme prudentielle, la surveillance exercée par les autorités de supervision n’est que de façade, et une relative opacité gouverne l’ensemble des opérations effectuées. Ainsi, si les Bahamas répondent à la définition d’un paradis fiscal et réglementaire, puisque la Banque centrale ne vérifie pas les comptes des sociétés enregistrées sur son territoire et que ses résidents permanents sont exonérés tant d’imposition sur les revenus que sur les sociétés ou le capital, de nombreux pays en voie de développement souffrant d’un dispositif de régulation du système financier lacunaire ou présentant des insuffisances n’entrent toutefois pas pour autant dans la catégorie des paradis fiscaux.
● D’autre part, si un territoire identifié comme un lieu propice au blanchiment d’argent comme Gibraltar est également un paradis fiscal au regard de son régime fiscal incitatif, au vu des exonérations spécifiques qui y sont accordées aux armateurs non résidents, mais également des exonérations d’impôt sur le revenu et de taxe foncière pendant 25 ans en faveur des sociétés non résidentes (« sociétés qualifiées », trusts ou holdings), il existe des territoires présentant des risques importants de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme et qui ne constituent pas des paradis fiscaux : c’est le cas notamment de l’Iran, de l’Ouzbékistan, du Turkménistan ou du Pakistan, pays contre lesquels le GAFI met en garde dans sa déclaration publique du 25 février 2009.
● Enfin, un pays fiscalement attractif ne devient pas ipso facto un paradis fiscal : avec un taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés de 12,5 % et un ensemble de règles fiscales avantageuses pour les groupes multinationaux étrangers (régime des quartiers généraux, transferts de prix, plus-values de cession, holdings), l’Irlande représente un pays à fiscalité particulièrement favorable dans l’Union européenne, sans toutefois n’avoir jamais été recensée comme un paradis fiscal.
L’identification des paradis fiscaux parmi l’ensemble des États présentant des caractéristiques susceptibles de leur conférer cette qualité implique donc de mettre au point une liste de critères précis dont la combinaison est qualifiante par rapport à la combinaison permettant d’identifier un paradis réglementaire ou judiciaire.
Il n’existe pas de définition juridique définitive et absolument incontestable de la notion de paradis fiscal. C’est un ensemble de caractéristiques – presque un faisceau d’indices – qui permet de dire si l’on est ou non en présence d’un paradis fiscal. Quatre facteurs doivent ainsi être pris en considération pour identifier un paradis fiscal, tels que mis en évidence par le rapport de 1998 de l’OCDE sur les pratiques fiscales dommageables (4).
– L’absence d’imposition ou une imposition insignifiante des revenus constitue le premier critère d’identification d’un paradis fiscal. Si elle est une condition nécessaire, elle n’est néanmoins pas suffisante, comme on l’a vu, pour définir un paradis fiscal.
– Le faible degré d’imposition des revenus est souvent doublé par l’existence d’obstacles à l’échange de renseignements effectif sur les contribuables bénéficiant de l’imposition réduite.
– Un autre critère de reconnaissance d’un paradis fiscal est l’absence de transparence dans le fonctionnement des dispositions législatives, juridiques ou administratives du territoire considéré. C’est ici que s’explique l’importance de l’obstacle que constitue le secret bancaire.
– Enfin, l’absence d’obligation d’exercer une activité substantielle assortie d’une présence locale réelle constitue le dernier facteur d’identification d’un paradis fiscal. Les Îles Vierges britanniques abritent par exemple 300 000 sociétés pour une superficie de 153 km².
On parle également de territoire offshore pour évoquer les paradis fiscaux : on entend ainsi généralement un territoire dont la place financière est utilisée comme une plate-forme d’investissement ou de placement par des non résidents. De ce point de vue, un paradis fiscal peut être considéré comme une place offshore sans qu’un territoire offshore soit obligatoirement défini comme un paradis fiscal.
On notera également que la notion de paradis fiscal n’est pas définie, ni reconnue dans le droit français, qui renvoie à ces territoires par le biais de la définition du « régime fiscal privilégié » figurant à l’article 238 A du code général des impôts : « Les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’État ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ».
LA NAISSANCE DE L’OFFSHORE : MOINS-DISANT FISCAL,
RÉSIDENCE FICTIVE ET SECRET BANCAIRE
Trois étapes essentielles marquent l’émergence de l’offshore (5) :
– À la fin du XIX° siècle, des avocats d’affaires new-yorkais conseillent à certains États confrontés à des problèmes budgétaires (New Jersey, Delaware) d’attirer des entreprises en leur proposant un plafonnement des impôts.
– Au début du XX° siècle, la jurisprudence britannique sur l’assujettissement des sociétés à l’impôt se développe : en 1906, la justice britannique affirme ainsi que la multinationale du diamant De Beers doit être soumise à l’impôt anglais, car, bien qu’enregistrée en Afrique du Sud et produisant à partir des mines sud-africaines, elle demeure contrôlée et dirigée depuis le Royaume-Uni. Les multinationales britanniques réagissent alors en installant leur direction à l’étranger : en les déclarant non passibles de l’impôt anglais, la justice britannique ouvre alors la porte au principe de résidence fictive pour raison fiscale. En effet, non seulement les revenus d’une entreprise britannique en provenance de l’étranger étaient désormais exemptés d’imposition, mais les entreprises des autres pays pouvaient dès lors échapper à l’impôt en organisant leurs activités à partir d’une société enregistrée à Londres, mais contrôlée à l’extérieur du Royaume-Uni.
– Enfin, dans le contexte de la crise de 1929 qui pousse à un renforcement de la surveillance bancaire, les banquiers suisses demandent une contrepartie : le renforcement du secret bancaire. Par ailleurs, en juin 1932, en France, un scandale de fraude fiscale via une succursale d’une banque suisse à Paris éclate : il implique de nombreuses personnalités politiques et des grands patrons. Face aux poursuites judiciaires entamées par la France et aux demandes d’entraide judiciaire adressées au gouvernement fédéral suisse, une nouvelle loi bancaire est votée en Suisse en 1934 : elle place le secret bancaire sous la protection du droit pénal et offre ainsi une protection juridique complète contre leur propre gouvernement aux étrangers venant placer leurs avoirs en Suisse.
Les trois piliers des paradis fiscaux sont désormais en place.
C’est dans les années 90, à la suite du mouvement de libéralisation des marchés financiers intervenu dans les années 80 qui s’est accompagné d’un processus de déréglementation et de décloisonnement des marchés, que l’attention de la communauté internationale s’est portée sur la question des paradis fiscaux, dans un contexte de concurrence fiscale croissante. Réuni à Lyon en 1996, le G7 exprimait toute sa préoccupation vis-à-vis du risque de distorsion provoqué par des pratiques fiscales dommageables et du danger d’effritement des assiettes fiscales nationales occasionné par de telles pratiques.
En 2000, l’OCDE a publié, sur le fondement des quatre critères élaborés en 1998, une liste de 35 paradis fiscaux non coopératifs (6). Suite aux engagements pris par 32 d’entre eux, au début de l’année 2009, seules trois juridictions figuraient toujours sur cette liste : la Principauté d’Andorre, la Principauté du Liechtenstein et la Principauté de Monaco.
2.– Les paradis réglementaires
La notion de paradis réglementaire renvoie quant à elle à des territoires qui offrent un régime peu contraignant d’enregistrement des entreprises, qui accordent un niveau de confidentialité des transactions excessif, et dont le système financier, et en particulier les marchés et les acteurs qui y opèrent, font l’objet d’une très faible régulation et supervision. Ces éléments vont souvent de pair avec une absence de condition d’installation physique des personnes et des entités et de délocalisation des activités dans ces territoires. Ils s’accompagnent également souvent d’une pratique renforcée du secret bancaire et d’un régime fiscal attractif.
Ainsi, les paradis réglementaires offrent-ils souvent une procédure d’enregistrement relâchée des entreprises, avec parfois la possibilité de constituer des sociétés avec des titres au porteur permettant de dissimuler l’identité véritable des actionnaires. C’est le cas au Liechtenstein et, pour partie, en Suisse. Cet enregistrement est en outre rapide : ainsi, dans certains territoires, des sociétés peuvent être achetées et mises en activité en cinq jours, avec le cas échéant la nomination d’un résident « homme de paille » comme directeur ou actionnaire (nominee director, nominee secretary ou nominee shareholder) : c’est le cas notamment dans le Delaware (cinq jours), dans les îles Vierges britanniques (quinze jours) et à Panama (quinze jours).
Les obligations comptables et prudentielles imposées aux acteurs financiers sont particulièrement restreintes dans les paradis réglementaires : les sociétés ne sont parfois soumises à aucune obligation de tenue de comptabilité, de certification de leurs comptes, de déclaration de leurs flux ou d’information sur les bénéficiaires réels de leurs opérations ou activités. Ainsi, jusqu’en 2008, les sociétés établies en Andorre n’étaient pas soumises à l’obligation de tenir une comptabilité : deux nouvelles lois, l’une sur les sociétés anonymes, l’autre sur la comptabilité, ont depuis modifié ce régime. Désormais toutes les sociétés de capitaux doivent déposer leurs comptes auprès d’une autorité publique, et les sociétés cotées en bourse et les sociétés à responsabilité limitée doivent faire vérifier leurs comptes lorsque ceux-ci excèdent certains seuils en termes d’actifs, de chiffre d’affaires et de nombre de salariés.
LE CAS PARTICULIER DE LA PLACE FINANCIÈRE LONDONIENNE La place financière de Londres abrite le marché des eurodollars (7), un marché offshore, peu régulé, non taxé, créé en 1957 avec la bénédiction de la Banque d’Angleterre, afin de faire retrouver à la City son rôle de première place financière mondiale. Simple jeu d’écriture comptable, les eurodollars sont des dollars déposés et prêtés par les banques en dehors du territoire des États-Unis, qui rendent ainsi possibles des transactions financières entre deux non-résidents, dans une devise autre que la livre sterling, et qui est par conséquent exempte de tout contrôle de la Banque d’Angleterre ou des autorités de contrôle des autres pays. En 1957, Sir George Bolton, ancien dirigeant de la Banque d’Angleterre, prend la tête de la Bank of London and South America (BOLSA) : il retire la banque des activités internationales en sterling et se lance dans la chasse aux eurodollars. Or, ce nouveau marché non régulé contrevient directement aux plafonds d’engagements extérieurs qui s’imposent aux banques à l’époque. Si les eurodollars servent au tout début à financer le commerce international, notamment dans le secteur agricole, ils sont rapidement utilisés par les banques, pour développer des activités spéculatives sur les marchés des changes. Les banques étrangères installent alors leurs filiales à Londres, puis, s’établissent dans les territoires d’outre-mer britanniques (Bahamas, Bermudes, Îles Caïman) dans lesquels elles peuvent bénéficier des mêmes avantages. Ce marché contribue grandement à réduire la traçabilité des transactions financières internationales et entraîne, d’après Michel Aglietta, la formation « de chaînes de risques opaques aux autorités prudentielles ». Londres est aujourd’hui encore la première place financière mondiale : si, en termes de capitalisations boursières, New York emporte le haut du pavé, la City reste le premier marché de changes, avec un tiers des transactions mondiales qui y sont enregistrées, et s’inscrit également au premier rang en termes de présence de banques étrangères. |
Mis en place en 1999 par le G7 à la suite des crises financières russe et asiatique pour contribuer à la construction d’une nouvelle architecture financière internationale, le Forum de stabilité financière (FSF) a pour mission d’alerter les gouvernements et les autorités de régulation sur les pratiques qui lui paraissent dangereuses pour l’équilibre du système financier mondial, et de recommander les améliorations à apporter à son fonctionnement. Il réunit les ministres des finances, les banques centrales et les organes de supervision financière des pays du G7, mais aussi certaines places financières de poids comme Hongkong, Singapour et la Suisse, et quelques organismes internationaux tels que le fonds monétaire international (FMI).
Le FSF s’attelle dès 2000 aux vulnérabilités structurelles du système financier international, et publie une liste de 42 centres offshore répartis en trois groupes selon le niveau de risque estimé, territoires dont les pratiques de sous-réglementation sont à même de favoriser une montée des risques financiers internationaux. En mars 2005, le FSF considérait que la liste publiée en 2000 avait atteint son but et n’avait plus de raison d’être : la préférence allait désormais à la pression par les pairs.
Les travaux du FSF ont néanmoins été relancés par le G20 de Londres du 2 avril 2009, qui l’a transformé à cette occasion en un « Conseil de stabilité financière » (Financial Stability Board) et l’a élargi aux membres du G20 non encore représentés et à l’Espagne. Afin de surmonter les vulnérabilités du système financier mondial, le Conseil de stabilité financière est en particulier chargé de promouvoir la coordination et les échanges d’informations entre les autorités chargées du maintien de la stabilité financière, d’établir des directives à destination des institutions de supervision et de procéder à l’examen des travaux par les organismes de fixation des normes internationales. Son programme de travail destiné à une meilleure application des standards de supervision et de régulation internationaux devra être précisé lors du prochain sommet du G20 de Pittsburgh en septembre 2009.
3.– Le blanchiment d’argent sale
L’absence de transparence et les lacunes de la supervision et de la réglementation, qui caractérisent certains territoires, se traduisent par la confidentialité et l’opacité des structures juridiques qui permettent de cacher l’identité réelle des donneurs d’ordre, des propriétaires ou des bénéficiaires, ainsi que par l’absence d’échange de renseignements et de coopération, tant avec les autorités fiscales étrangères qu’en matière judiciaire. Ces éléments sont favorables aux activités de blanchiment d’argent sale, qu’il soit issu du trafic de drogue ou d’armes, de la corruption, du grand banditisme, des réseaux de prostitution ou encore du financement du terrorisme.
Le Fonds monétaire international (FMI) a évalué en 1996 le volume agrégé du blanchiment de capitaux dans le monde dans une fourchette de 2 à 5 % du produit intérieur brut mondial, soit entre 590 et 1 500 milliards de dollars américains.
QUELQUES EXEMPLES DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX Des membres d’un réseau de criminalité organisée blanchissent de l’argent grâce à des polices d’assurance-vie (8) Dans le pays X, des agents des douanes ont lancé une enquête qui a permis de révéler qu’une organisation de trafic de drogue avait utilisé le secteur de l’assurance pour blanchir les produits de ses activités. Les enquêtes menées par les autorités opérationnelles de plusieurs pays ont montré que les trafiquants blanchissaient les fonds par l’entremise de la compagnie d’assurance Z, située dans un territoire offshore. La compagnie d’assurance Z propose des produits d’investissement qui s’apparentent à des fonds communs de placement. Le taux de rendement était indexé sur de grands indices boursiers internationaux, si bien que ces polices d’assurance pouvaient servir de placements. Les souscripteurs investissaient un maximum d’argent dans la police d’assurance, et en versaient ou en retiraient afin de couvrir le coût des pénalités de retrait anticipé. Les fonds sortaient alors sous la forme d’un virement ou d’un chèque émanant de la compagnie d’assurance, ce qui leur conférait une apparence de « propreté ». À ce jour, l’enquête a montré que plus de 29 millions de dollars avaient été blanchis par ce biais. En outre, grâce aux efforts déployés conjointement par les agents des douanes du pays Y (pays d’origine des stupéfiants) et du pays Z, plusieurs avis de recherche et mandats d’arrêt ont pu être exécutés concernant les personnes ayant participé aux activités de blanchiment par l’intermédiaire de la compagnie d’assurance Z. Des personnes politiquement exposées (PPE) impliquées dans des affaires de criminalité financière Sani Abacha, ex-dictateur au Nigeria, impliqué dans le pillage de la banque centrale de son pays, a vu ses fonds placés en Suisse saisis en 1999 pour 700 millions de dollars dans sept banques à Genève et à Zurich, dont le Crédit Suisse et l’Union des banques suisses (UBS). 200 millions de dollars ont été restitués, via la Banque des Règlements Internationaux (BRI) en 2003, pour le remboursement de la dette nigériane et 458 millions, en février 2005, par l’intermédiaire de la Banque mondiale, pour des projets de développement. José Eduardo dos Santos, Président actuel de l’Angola, accusé de corruption et de blanchiment dans le cadre de marchés d’armes et du remboursement de la dette russo-angolaise, a vu ses comptes saisis pour la somme de 100 millions de dollars. En définitive, l’enquête genevoise classée en 2004 a été suivie d’un accord a minima prévoyant la restitution de 21 millions de dollars à l’Angola pour déminage du pays sous la surveillance de la Suisse. Un comptable et des avocats prêtent la main à une opération de blanchiment (9) Des mouvements suspects portant sur plus de 2 millions de dollars ont été repérés : l’argent était envoyé par petits montants par différentes personnes qui donnaient des ordres de virement et d’effets bancaires pour le compte d’un cartel de trafiquants de drogue qui devait importer 24 kg d’héroïne dissimulés dans du fret à destination d’un pays Z. Les effets bancaires acquis auprès de différentes institutions financières du pays Y (pays d’origine de la drogue) étaient ensuite utilisés pour acheter des biens immobiliers dans le pays Z. Le cartel avait recours aux services d’un comptable pour ouvrir les comptes en banque et faire enregistrer les sociétés. Ce comptable donnait également des conseils en placement aux dirigeants du cartel. Le cartel faisait également appel à un cabinet d’avocats pour acquérir les biens immobiliers grâce aux effets bancaires rachetés à l’étranger une fois qu’ils avaient d’abord transité par le compte en fiducie des avocats. Ceux-ci avaient également créé des fiducies (trusts) et des sociétés familiales. |
Des progrès importants ont été enregistrés dans les vingt dernières années dans la lutte contre cette dimension d’économie parallèle criminelle. Ainsi, le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) a été créé à Paris en 1989, lors du sommet de l’Arche réunissant le G7, en réponse à la préoccupation croissante que constituait le blanchiment de capitaux. Chargé de concevoir des standards internationaux et d’évaluer les législations nationales, le GAFI a élaboré 40 recommandations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, qui couvrent le système de justice pénale et l’application des lois, le système financier et sa réglementation ainsi que la coopération internationale. Après les attentats du 11 septembre 2001, le mandat du GAFI a été élargi à la lutte contre le terrorisme, donnant lieu à la mise en place de neuf recommandations spéciales destinées à compléter le dispositif existant. L’ensemble de ces recommandations a été aujourd’hui adopté par plus de 130 pays.
Le GAFI a par ailleurs publié en 2000 une liste noire des « pays et territoires non coopératifs » (PTNC), qui comptait 23 entités. Avec le retrait en 2006 du Myanmar, du Nigeria et de Nauru, plus aucun pays ne figure aujourd’hui sur cette liste. Le GAFI contrôle l’application des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par le biais d’un processus d’évaluation mutuelle, désormais étendu à plus de 170 pays via le réseau des organismes régionaux de type GAFI.
Depuis les attentats du 11 septembre 2001, l’activité du GAFI est également relayée par le groupe d’intégrité financière (GIF) créé en 2006 au sein du Fonds monétaire international (FMI), qui a intégré les 40 recommandations dans ses programmes d’évaluation du secteur financier et dans ses rapports sur l’observation des standards et des codes. Ces préoccupations sont désormais également à l’œuvre dans le cadre de l’assistance technique prêtée par le FMI aux États désireux de renforcer leur dispositif de lutte contre l’argent sale. Enfin, un programme spécifique d’évaluation des places financières offshore a été mis en place dès 2000, qui évalue la conformité des centres offshore en fonction des standards financiers et des mesures anti-blanchiment mises en place.
LES TERRITOIRES MONTRÉS DU DOIGT EN 2000
Territoire |
FSF (10) |
OCDE |
GAFI |
Andorre |
II |
X |
|
Anguilla |
III |
X |
|
Antigua et Barbuda |
III |
X |
|
Antilles néerlandaises |
III |
X |
|
Aruba |
III |
X |
|
Bahamas |
III |
X |
X |
Bahreïn |
II |
X |
|
Barbade |
II |
X |
|
Bélize |
III |
X |
|
Bermudes |
II |
||
Îles Caïman |
III |
X | |
Îles Cook |
III |
X |
X |
Costa Rica |
III |
||
Chypre |
III |
||
Dominique |
X |
X | |
Dublin |
I |
||
Gibraltar |
II |
X |
|
Grenade |
X |
||
Guernesey |
I |
X |
|
Jersey |
I |
X |
|
Hong Kong |
I |
||
Îles Vierges britanniques |
III |
X |
|
Îles Vierges des États-Unis |
X |
||
Israël |
X | ||
Labuan |
II |
||
Liban |
III |
X | |
Liberia |
X |
||
Liechtenstein |
III |
X |
X |
Luxembourg |
I |
||
Macao |
II |
||
Malte |
II |
||
Îles de Man |
I |
X |
|
Îles Marshall |
III |
X |
X |
Maurice |
III |
||
Monaco |
II |
X |
|
Montserrat |
X |
||
Nauru |
III |
X |
X |
Niue |
III |
X |
X |
Panama |
III |
X |
X |
Philippines |
X | ||
République des Maldives |
X |
||
Russie |
X | ||
Samoa |
III |
X |
|
Seychelles |
III |
X |
|
Singapour |
I |
||
Saint-Kitts et Nevis |
III |
X |
X |
Saint-Vincent et les Grenadines |
III |
X |
X |
Sainte-Lucie |
III |
X |
|
Suisse |
I |
||
Tonga |
X |
||
Turks et Caicos |
III |
X |
|
Vanuatu |
III |
X |
|
Source : Christian Chavagneux et Ronan Palan, Les paradis fiscaux, Éditions La Découverte, « Repères » n° 448, juillet 2007, pp 92-93. | |||
B.– LES ENTITÉS ÉTABLIES ET LES ACTIVITÉS EXERCÉES DANS LES PARADIS FISCAUX
La fraude fiscale – et plus encore l’évasion fiscale – sont par définition difficiles à évaluer. Elles le sont plus encore lorsqu’il s’agit de déterminer la part qui utilise les paradis fiscaux ou transite par eux, car la capacité à détecter la fraude et l’évasion en lien avec ces pays est très faible et ne rend pas compte des sommes potentiellement en jeu. Plusieurs études ont tenté de reconstituer le montant des avoirs localisés dans les paradis fiscaux, le nombre de sociétés implantées et, partant, les recettes fiscales dont sont privées les États. Cette méthode quantitative butte sur les hypothèses en matière de profits et bénéfices mais aussi de comportement fiscal, c’est-à-dire de répartition entre schémas d’optimisation, d’évasion et de fraude.
La fraude fiscale est en France un délit réprimé pénalement, passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans. Il est défini à l’article 1741 du code général des impôts : « Quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts (...), soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de l’impôt [...] ». Il y a fraude, lorsqu’un contribuable, de façon délibérée, viole les prescriptions de la loi fiscale. Il convient dès à présent de souligner que cette définition de la fraude fiscale n’est pas universelle et ne donne pas lieu à des sanctions identiques dans les autres pays.
Il n’existe pas de définition consacrée de l’évasion fiscale ou d’autres notions telles que l’optimisation fiscale. L’optimisation fiscale relève d’une habilité du contribuable à gérer ses affaires fiscales au mieux de ses intérêts et en conformité avec la législation. L’évasion fiscale va au-delà de la simple optimisation et recouvre une réelle malhonnêteté. Ainsi, lorsque la réalité est occultée sous des apparences juridiques trompeuses ou encore que les opérations réalisées par un contribuable n’ont aucun fondement économique mais visent seulement à réduire le niveau de ses prélèvements, on parle en droit français alors d’un « abus de droit » qui constitue une véritable fraude que l’administration fiscale peut sanctionner.
Zoom sur le rapport du Conseil des prÉlÈvements obligatoires sur la fraude aux prÉlÈvements obligatoires de mars 2007. |
L’IRRÉGULARITÉ, FISCALE OU EN MATIÈRE DE COTISATIONS SOCIALES, REGROUPE L’ENSEMBLE DES CAS OÙ LE CONTRIBUABLE N’A PAS RESPECTÉ SES OBLIGATIONS, QU’IL AIT AGI DE FAÇON VOLONTAIRE OU INVOLONTAIRE, DE BONNE FOI OU DE MAUVAISE FOI. IL S’AGIT EN FAIT DE LA TRADUCTION EN FRANÇAIS DE L’EXPRESSION NON COMPLIANCE, TELLE QU’ELLE A ÉTÉ RETENUE PAR L’OCDE |
LA FRAUDE SUPPOSE UN ACTE INTENTIONNEL DE LA PART DU CONTRIBUABLE, DÉCIDÉ À CONTOURNER LA LOI POUR ÉLUDER LE PAIEMENT DU PRÉLÈVEMENT. POUR REPRENDRE UNE DÉFINITION UTILISÉE PAR LE CONSEIL DES IMPÔTS EN 1977, « IL Y A FRAUDE DÈS LORS QU’IL S’AGIT D’UN COMPORTEMENT DÉLICTUEL DÉLIBÉRÉ ». LA FRAUDE EST DONC UN SOUS-ENSEMBLE DE L’IRRÉGULARITÉ. |
L’ÉVASION FISCALE COMPREND L’ENSEMBLE DES COMPORTEMENTS DU CONTRIBUABLE QUI VISENT À RÉDUIRE LE MONTANT DES PRÉLÈVEMENTS DONT IL DOIT NORMALEMENT S’ACQUITTER. S’IL A RECOURS À DES MOYENS LÉGAUX, L’ÉVASION ENTRE ALORS DANS LA CATÉGORIE DE L’OPTIMISATION. À L’INVERSE, S’IL S’APPUIE SUR DES TECHNIQUES ILLÉGALES OU DISSIMULE LA PORTÉE VÉRITABLE DE SES OPÉRATIONS, L’ÉVASION S’APPARENTERA À DE LA FRAUDE. |
L’OPTIMISATION CONCERNE LES CAS OÙ LE CONTRIBUABLE PARVIENT VOLONTAIREMENT À MINORER LE MONTANT D’IMPÔT OU DE COTISATIONS QU’IL AURAIT DÛ PAYER S’IL N’AVAIT PAS EU RECOURS À L’OPTIMISATION, SANS POUR AUTANT VIOLER LA LOI OU SE SOUSTRAIRE À SES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES. L’OPTIMISATION CONSISTE DONC À TIRER PARTI DES POSSIBILITÉS OFFERTES PAR LA LÉGISLATION, EN UTILISANT ÉVENTUELLEMENT SES FAILLES OU SON IMPRÉCISION ET Y COMPRIS EN L’INTERPRÉTANT DANS UN SENS QUE LE LÉGISLATEUR N’AVAIT PAS NÉCESSAIREMENT PRÉVU, POUR RÉDUIRE LES PRÉLÈVEMENTS DUS, TOUT EN RESTANT DANS LA LÉGALITÉ. |
Source : Direction générale des finances publiques
En l’absence de données quantitatives véritablement pertinentes et de capacité à isoler les comportements de nature frauduleuse, l’analyse qualitative demeure indispensable. Elle permet d’appréhender les mécanismes qui aujourd’hui font de ces territoires des zones d’ombre, offrant des outils de fraude et de dissimulation quasi-parfaits au-delà des justifications de façade. Elle impose d’œuvrer pour une régulation accrue, une transparence minimale et l’établissement de contre-mesures ciblées sur ceux qui s’y refuseraient.
1.– La fraude et l’évasion liées aux paradis fiscaux : un phénomène difficile à quantifier
a) Les sommes qui prospèrent ou transitent dans ces territoires
En 1994, le FMI publie une étude (Marcel Cassard, The Role of Offshore Centers in International Financial Intermediation, 1994) indiquant que la moitié des flux financiers internationaux passerait par les paradis fiscaux et que 20 % de la richesse mondiale privée y seraient gérés. Il évalue le montant annuel des transactions réalisées à partir de ces territoires à quelques 2 000 milliards de dollars annuels. D’après le rapport du Conseil de l’Europe du 6 avril 2001, 22 % des actifs externes des banques y sont gérés.
Selon l’avocat fiscaliste Édouard Chambost, spécialiste du sujet, 55 % du commerce international ou 35 % des flux financiers transitent par les paradis fiscaux. Une autre source estime que l’ensemble des paradis fiscaux draine plus de la moitié (54,2 %) des avoirs détenus hors frontières pour un total de plus de 5 000 milliards de dollars.
La Banque mondiale évalue les flux à 1 à 1,6 trilliard de dollars annuels, dont la moitié proviendrait de pays en voie de développement. En Norvège, la Commission parlementaire sur les flux de capitaux des pays en développement a sorti un rapport le 18 juin 2009 intitulé « Paradis fiscaux et développement » (Tax havens and development). Il propose plusieurs recommandations à mettre en œuvre par le gouvernement norvégien. Se fondant sur les travaux du Global Financial Integrity (GFI) et du Tax Justice Network (TJN), le rapport conclut que les flux sortants illicites dépassent aujourd’hui les flux entrants de développement. Il estime que 20 % des dépôts dans les paradis fiscaux proviennent des pays en voie de développement (environ 2 000 milliards de dollars) et que la fuite des capitaux qui en est à l’origine représente 6 % à 8,7 % de leur PIB, avec une proportion plus élevée égale à 13 % du PIB pour les pays les plus pauvres.
LES ESTIMATIONS DES MONTANTS EN JEU
Source |
Montant |
Champ d’application de l’estimation |
Documents cités |
Tax Justice Network |
11 500 milliards de dollars (2005) |
Actifs détenus à l’étranger par des particuliers |
The Price of Offshore, Tax Justice Network, 2005 |
Oliver Wyman Group |
8 000 milliards de dollars (2008) |
Actifs détenus à l’étranger par des particuliers fortunés (High-Net-Worth Individuals) |
The Future of Private Banking, mars 2008, Oliver Wyman Group |
Boston Consulting Group |
7 300 milliards de dollars (2007) |
Actifs détenus à l’étranger |
Global Wealth 2008, Boston Consulting Group |
Oxfam |
6 000-7 000 milliards de dollars (2000) |
Capitaux détenus dans des centres offshore |
Tax havens : Releasing the Hidden Billions for Poverty Eradication, 2000 |
Merrill Lynch/Cap Gemini |
5 800 milliards de dollars (1997) |
Actifs détenus à l’étranger par des particuliers fortunés |
World Wealth Report 1998, Merrill Lynch/Cap Gemini |
FMI |
1 700 milliards de dollars (2000) |
Investissements de portefeuille acheminés par l’intermédiaire de centres offshore |
IMF Publishing Global Portfolio Investment Survey, 2000 |
Source : OCDE
La capacité à appréhender l’origine et la destination des investissements directs étrangers (IDE) est altérée par les circuits employés. Le montant et les flux des IDE ne sont pas représentatifs des flux réels. Le stock des investissements directs en proportion du PIB est particulièrement élevé dans les paradis fiscaux. Environ 30 % des flux d’IDE des firmes multinationales sont à destination de ces territoires selon les données de la CNUCED, mais seule une petite partie de ces flux est destinée à rester dans ces pays : les filiales des firmes présentes dans les paradis fiscaux réinvestissent l’argent dans les grands pays. Les premiers investisseurs en Chine sont Hongkong et les Îles Vierges britanniques. L’Île Maurice est le premier investisseur étranger en Inde.
Il convient de souligner qu’une transaction ne donne pas systématiquement lieu à un flux financier équivalent : une transaction peut faire l’objet de compensations financières diverses ou de mesures commerciales (rabais, remises, ristournes). Appréhender les transactions avec les paradis fiscaux impliquerait donc de pouvoir disposer d’informations étayées sur les relations commerciales avec des entités ou personnes établies dans ces territoires.
Un rapport du Sénat américain sur les banques établies dans les paradis fiscaux (11) évalue les actifs dissimulés dans ces derniers à plusieurs milliers de milliards de dollars en se fondant sur des rapports d’experts cités dans ce même document, qui contiennent les évaluations suivantes :
– La totalité des actifs offshore localisés par des particuliers fortunés non-résidents dans les paradis fiscaux est estimée à 11 500 milliards de dollars (12). D’autres sources, citées dans le même document, rapportent des montants allant de 4 800 à 7 000 milliards de dollars ;
– Les actifs dissimulés dans quatre paradis fiscaux par des particuliers non-résidents afin d’éviter une taxation dans leur pays de résidence (Guernesey, Jersey, Île de Man et la Suisse) sont estimés à 1 500 milliards de dollars (Guernesey 293, Jersey 491, Man 150, Suisse 807 milliards).
– Les seules Îles Caïman disposaient, début 2008, de liquidités évaluées à 2 000 milliards de dollars dans 10 000 organismes de placement collectif en valeur mobilières tels que des fonds d’investissement spéculatifs (hedge funds) (13).
b) Fraude, évasion, optimisation : quelles estimations des pertes de recettes ?
Au niveau mondial, la fraude fiscale a été évaluée entre 350 et 500 milliards de dollars selon une étude Banque mondiale / CNUCED. La Commission européenne estime qu’en Europe elle correspond à 2 à 2,5 % du PIB européen, avec une dominance de la fraude à la TVA. En France, le Conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport de 2007 avait avancé une fourchette large de 29 à 40 milliards d’euros pour l’ensemble des prélèvements obligatoires.
S’agissant de la fraude et de l’évasion en lien avec les paradis fiscaux, il est évident que ces derniers jouent un rôle important dans les stratégies de fraude en offrant des facilités et, surtout, en rendant quasiment inefficace le contrôle fiscal. Le marché de l’évasion fiscale s’est démocratisé avec Internet, qui offre la possibilité à chacun depuis son poste informatique d’ouvrir des comptes et des sociétés dans de nombreux territoires. On peut donc supposer que la fraude et l’évasion sont des phénomènes en expansion, bien que la crise ait probablement réduit le montant des avoirs.
La perméabilité des paradis fiscaux envers l’argent d’origine douteuse (trafics, fraude et corruption) ne peut guère être vérifiée de manière quantitative en raison de l’absence d’évaluations empiriques des flux. Pour Raymond Baker, fondateur et directeur de l’ONG américaine Global Financial Integrity Program, et Eva Joly (14), les places financières offshore facilitent le développement de flux financiers illicites portant sur des centaines de milliards de dollars. Ils estiment que l’argent qui passe par les paradis fiscaux est destiné pour 3 % à la corruption et au vol, 30 % à 35 % au blanchiment, le reste concernant l’évasion fiscale commerciale et les prix de transfert manipulés.
Un groupe de travail de l’OCDE sur l’évasion fiscale traite spécifiquement des pays à fiscalité nulle ou très faible (15). Il a établi un rapport qui dresse notamment un état des lieux de l’évasion fiscale au moyen des paradis fiscaux. Douze places sont plus particulièrement étudiées en raison des informations qu’elles transmettent à la Banque des règlements internationaux qui ont servi de support à l’étude. Les dépôts d’argent par des non-résidents dans ces juridictions étaient de 4 090 milliards de dollars fin 2007, quelle que soit la qualité du déposant, et de 1 760 milliards de dollars pour les déposants non bancaires. Le sous-groupe de l’OCDE a évalué à plus de 1 000 milliards les montants déposés par des particuliers qui présentent un haut risque d’évasion fiscale. Ce montant se serait accru de 230 milliards de dollars en 2007, correspondant à 36 milliards de produits d’intérêts capitalisés, augmentés d’environ 198 milliards de capitaux déposés. Ces 36 milliards d’euros représentent une part de revenu soustraite aux juridictions à fiscalité normale. La part de la France n’est pas connue.
La mesure de l’impact fiscal des sommes qui sont placées dans les paradis fiscaux ou captées lors du transfert par ces territoires dépend d’hypothèses sur les revenus générés par ces placements et sur le comportement fiscal des propriétaires de ces fonds, c’est-à-dire sur la proportion de ceux qui utilisent ces territoires pour échapper à leurs obligations fiscales dans leur État de résidence. Les pertes annuelles mondiales de recettes fiscales liées à l’évasion fiscale des personnes physiques fortunées étaient évaluées en 2005 à 255 milliards de dollars (16).
Le rapport du Conseil de l’Europe du 6 avril 2001 essaie de quantifier la part des activités des paradis fiscaux liée à la fraude fiscale : elle représenterait de 5 à 25 % des recettes fiscales potentielles dans les pays développés et de 30 à 40 % dans les pays moins développés. Selon John Christensen, directeur du Tax Justice Network, les flux financiers illicites privent les pays pauvres de revenus fiscaux allant jusqu’à 160 milliards de dollars par an.
Au niveau de chaque pays, plusieurs estimations ont été formulées. L’évasion fiscale par les particuliers américains en 2006 était évaluée à une fourchette comprise entre 40 et 70 milliards de dollars par an. Les pertes annuelles de recettes fiscales liées à l’évasion fiscale commerciale par le biais des prix de transfert et l’utilisation de paradis fiscaux étaient évaluées à 60 milliards de dollars pour 2004 et à 53 milliards pour 2001. Le Trésor américain a avancé récemment le chiffre de 100 milliards de dollars de perte de recettes fiscales pour le budget américain du fait de l’existence des paradis fiscaux (17). La perte de recettes fiscales pour l’Allemagne est estimée entre 20 et 25 milliards d’euros. Pour la Belgique, le montant des sommes placées dans les banques du paradis fiscal voisin – le Luxembourg – et qui échappent ainsi à l’impôt est estimé à 160 milliards d’euros. Pour l’Italie, les capitaux exportés illégalement sont estimés à 550 milliards d’euros, dont environ 300 milliards en Suisse. En France, on avance la fourchette de 15 à 20 milliards de pertes de recettes fiscales.
Le montant élevé des sommes en jeu est corroboré par les expériences de rapatriement des capitaux.
LES OPÉRATIONS RÉCENTES DE RÉGULARISATION FISCALE
Descriptions |
Montants en euros (convertis au 22 septembre 2008) |
Valeur : estimée ou réelle | |
Afrique du Sud |
65 milliards de rands d’actifs à l’étranger révélés (amnistie fiscale en 2003) |
5,6 milliards |
Réelle |
Augmentation de 400 millions de rands dans la collecte des impôts prélevés sur les actifs à l’étranger révélés |
34 millions |
Estimée | |
Allemagne |
901 millions d’euros de recettes fiscales (amnistie fiscale en 2004) |
901 millions |
Réelle |
Australie |
300 millions de dollars australiens censés être collectés sous forme d’impôts et de pénalités (amnistie fiscale en 2007 – projet Wickenby) |
172 millions |
Estimée |
Belgique |
496 millions d’euros de recettes fiscales (amnistie fiscale en 2004) |
496 millions |
Estimée |
Canada |
318 millions de dollars canadiens de recettes fiscales (révélations volontaires en 2004-2005) |
209 millions |
Réelle |
Grèce |
20 milliards d’euros d’actifs déclarés (amnistie fiscale en 2004) |
20 milliards |
Estimée |
Irlande |
912 millions d’euros d’impôts impayés récupérés dans le cadre de la révélation volontaire de comptes à l’étranger (2004) |
912 millions |
Réelle |
Italie |
78 milliards d’euros d’actifs rapatriés (bouclier fiscal 2002-2003) |
78 milliards |
Réelle |
2,1 milliards d’euros d’impôts collectés (bouclier fiscal 2002-2003) |
2,1 milliards |
Réelle | |
Pays-Bas |
Plus de 1 milliard d’euros de dépôts révélés sur des comptes bancaires à l’étranger appartenant à quelque 10 000 contribuables |
> 1 milliard |
Réelle |
350 millions d’euros de recettes fiscales |
350 millions |
Réelle | |
Portugal |
41 millions d’euros d’impôts récupérés (amnistie fiscale en 2005) |
41 millions |
Réelle |
Royaume-Uni |
400 millions de livres sterling récupérées (mécanisme de révélation volontaire en 2007) |
504 millions |
Réelle |
Suède |
300 milliards de couronnes suédoises (2007) en épargne non déclarée à l’étranger |
31 milliards |
Estimée |
7,5 milliards de couronnes suédoises (2007) de manque à gagner fiscal en raison de l’épargne non déclarée placée à l’étranger |
785 millions |
Estimée |
Source : OCDE.
L’Italie a ainsi obtenu le rapatriement de 60 milliards d’euros en 2001 et 20 milliards d’euros en 2003, moyennant le paiement d’une taxe au taux de 2,5 %, soit 2 milliards d’euros de recettes. Ces chiffres ne sont pas négligeables si on les compare au PIB. Par ailleurs, deux autres États membres de l’OCDE ont lancé des initiatives pour améliorer le respect des obligations fiscales concernant les revenus réalisés offshore. L’administration fiscale irlandaise a recouvré près d’un milliard d’euros à la suite du lancement de son initiative « Voluntary compliance » portant sur les comptes détenus par des résidents irlandais dans des banques offshore. Une recette d’un milliard d’euros sur trois millions d’habitants laisse à penser que les recettes à récupérer par tous les pays sont considérables. Le Royaume-Uni a quant à lui récupéré près de 500 millions de livres en quelques mois dans le cadre de son dispositif de déclaration volontaire (« voluntary disclosure facility »).
Il semble que l’on puisse classer les paradis fiscaux en deux grandes catégories : les petits territoires éloignés relativement insaisissables et les grandes places situées essentiellement en Europe. Parmi ces dernières, encore conviendrait-il d’isoler la City de Londres qui occupe une place particulière. Si l’on regarde les résultats du contrôle fiscal français en matière de prix de transfert, qui ne concerne donc que les entreprises multinationales, sur les 23 dossiers de la Direction des vérifications nationales et internationales, en 2008, le principal bénéficiaire des transferts est la Suisse (13 dossiers pour 410 millions d’euros), suivie du Luxembourg (4 dossiers pour 10 millions d’euros), de la Belgique (4 dossiers pour 31 millions d’euros) et de Hongkong (3 dossiers). Cela révèle autant la difficulté à appréhender les sommes dissimulées dans les petits paradis « exotiques », que l’importance de la fraude au travers de grands pays de la finance.
c) Le nombre d’entités et la présence des résidents français dans les paradis fiscaux
Les paradis fiscaux hébergent, selon le FMI en 2005, 4 000 banques, les deux tiers des hedge funds et 2 millions de sociétés écrans. Concernant le nombre de sociétés enregistrées offshore, il n’existe pas de répertoire officiel à jour. Quelques données disponibles montrent néanmoins l’importance du problème. À titre d’exemple, les Îles Vierges britanniques, considérées comme un centre pour l’enregistrement de sociétés offshore, compteraient plus de 300 000 sociétés enregistrées. Le cas d’Ugland House à George Town, aux Îles Caïman, avait été mis en avant par la Commission des finances du Sénat américain : cet immeuble, dont une société d’avocats, Maples and Calder, est seule locataire, héberge 18 857 entités juridiques (18). Au cours des cinq dernières années, ce sont plus de 6 000 nouvelles sociétés qui seraient venues s’installer à Ugland House.
D’après les données, non exhaustives, de la Banque des règlements internationaux (BRI), les montants de passifs ou d’actifs des banques localisées dans les centres financiers offshore représenteraient entre 25 et 30 % du total des positions extérieures nettes des banques déclarantes à la BRI en 2006. Cette part est calculée en retenant : les Bahamas, Bahreïn, les Îles Caïman, Guernesey, Hongkong, l’Île de Man, le Luxembourg, les Antilles néerlandaises, Singapour, la Suisse et Taiwan. Il s’agit donc d’une estimation sur base étroite. Citigroup, première banque du monde, possèderait 427 filiales dans des centres offshore, y compris dans les places exotiques de Saint-Kitts-et-Nevis, Macau et des îles Turques-et-Caïques. Bank of America possédait quant à elle 311 filiales dans les paradis fiscaux en 2008.
D’après une enquête du mensuel « Alternatives économiques », les sociétés cotées du CAC 40 (19) totalisent près de 1 470 filiales dans des paradis fiscaux, soit 16 % de leurs sociétés implantées à l’étranger. Toutefois, cette enquête englobe des territoires qui ne figurent pas sur les listes de l’OCDE. Particulièrement, elle inclut le Royaume-Uni, l’Irlande et les Pays-Bas.
Selon cette enquête, les entreprises multinationales non financières utilisent intensément les paradis fiscaux : toutes les multinationales françaises auraient une présence dans les paradis fiscaux, qui hébergent 9 274 de leurs filiales. Cette présence n’est bien sûr pas spécifique aux entreprises françaises. On sait par exemple qu’environ 74 000 entreprises multinationales seraient implantées au Liechtenstein. Toutefois, si l’on exclut le Royaume-Uni (445 filiales), les Pays-Bas (254 filiales) et l’Irlande (109 filiales), le magazine en recense 8 466, ce qui est déjà impressionnant, dans les territoires figurant dans le tableau suivant.
DES MULTINATIONALES TRÈS PRÉSENTES DANS LES PARADIS FISCAUX
États et territoires |
Nombre de filiales établies |
Suisse |
168 |
Luxembourg |
142 |
Singapour |
119 |
Hongkong |
108 |
Îles Caïman |
32 |
Monaco |
19 |
Île Maurice |
14 |
Chypre |
12 |
Jersey |
11 |
Les Bermudes |
7 |
Malte |
5 |
Bahreïn |
4 |
Oman |
3 |
Panama |
3 |
Vanuatu |
3 |
Îles Vierges britanniques |
2 |
Île de Man |
2 |
Macao |
2 |
Andorre |
1 |
Brunei |
1 |
Costa Rica |
1 |
Guernesey |
1 |
Liechtenstein |
1 |
Polynésie française |
1 |
Source : D’après l’enquête conduite par Alternatives économiques
S’agissant des banques, toujours selon cette enquête, toutes les grandes banques françaises ont une présence dans les paradis fiscaux. La BNP arrive en tête avec 189 filiales, soit 23 % de ces filiales. Les territoires qui concentrent le plus d’implantations sont Jersey et le Luxembourg pour l’immatriculation des OPCVM, les Caïman pour les placements à risque, la Suisse, Monaco et Singapour pour la gestion privée. Les banques mutualistes sont également concernées. Ainsi, les Caisses d’épargne sont présentes aux Bermudes via CIFG, leur rehausseur de crédit, et le Crédit mutuel dispose de filiales CIC et Transatlantique à Chypre, Gibraltar et au Liechtenstein. Là encore, ces chiffres recensent des territoires qui ne sont pas classés par l’OCDE en 2009 sur ses listes, particulièrement le Royaume-Uni, l’Irlande et les Pays-Bas.
LES ENTREPRISES ET BANQUES FRANÇAISES DANS LES PARADIS FISCAUX
Nombre de filiales |
En % du nombre total | |
BNP Paribas |
189 |
23 |
LVMH |
140 |
24 |
Schneider |
131 |
22 |
Crédit agricole |
115 |
19 |
PPR |
97 |
17 |
Banque populaire |
90 |
9 |
France Télécom |
63 |
24 |
Société générale |
57 |
17 |
Lagardère |
55 |
11 |
Danone |
47 |
23 |
EADS |
46 |
19 |
Peugeot |
39 |
11 |
Carrefour |
32 |
6 |
Pernod |
32 |
24 |
Capgemini |
31 |
24 |
Unibail |
31 |
20 |
Axa |
28 |
22 |
Michelin |
27 |
18 |
Air liquide |
22 |
8 |
Essilor |
22 |
10 |
L’Oréal |
22 |
9 |
Bouygues |
18 |
18 |
Sanofi Aventis |
18 |
14 |
Renault |
16 |
11 |
Dexia |
15 |
33 |
Accor |
11 |
11 |
Lafarge |
11 |
12 |
Saint-Gobain |
11 |
14 |
GDF Suez |
9 |
13 |
EDF |
8 |
12 |
Veolia |
8 |
7 |
Alstom |
6 |
15 |
Alcaltel Lucent |
5 |
14 |
Vallourec |
5 |
8 |
Suez environnement |
4 |
10 |
Vivendi |
4 |
11 |
Auchan |
3 |
5 |
Arcelor Mittal |
1 |
13 |
Banque postale |
1 |
6 |
Total |
1 470 |
16 |
Source : Alternatives économiques, à partir des documents de référence 2007 ou 2008
Pour sa part, l’hebdomadaire Marianne a publié en mars 2009 la carte suivante, sur les avoirs bancaires français dans les paradis fiscaux.
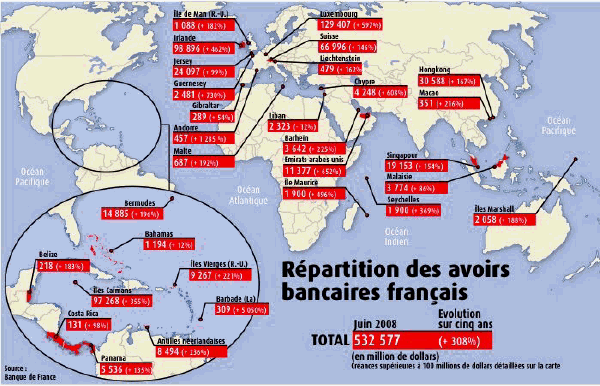
Source : Hebdomadaire Marianne, mars 2009.
L’enquête de la Commission bancaire, introduite par son instruction 2001-2002 sur les implantations bancaires à l’étranger (dite enquête IBE), permet de disposer des données afférentes aux succursales et filiales à caractère financier des banques françaises implantées à l’étranger. Selon les informations collectées auprès des établissements à fin 2008, une trentaine d’établissements ont au moins une implantation dans les pays figurant sur les listes OCDE d’avril dernier (à l’exception de Monaco). Ils comptabilisent 160 filiales et 84 succursales. Le Luxembourg occupe la place principale avec 90 entités, suivi de la Belgique (52 entités), de la Suisse (28 entités) et de Singapour (22 entités). Le total de bilan agrégé de ces entités était de 398 milliards d’euros : elles portaient 106 milliards d’euros de crédits à la clientèle non bancaire, les dépôts de la clientèle s’élevaient à 151 milliards d’euros, les actifs gérés à 151 milliards d’euros. Ces entités ont généré en 2008 un résultat net global de 3,5 milliards d’euros.
Or ces données ne couvrent pas l’ensemble des intérêts et activités de ces établissements dans les paradis fiscaux. Elles excluent notamment les participations dans les sociétés ad hoc (pour des opérations de financement d’actifs par exemple) ou dans des fonds.
SYNTHÈSE DES DONNÉES IBE AU 31 DÉCEMBRE 2008 (en milliers d’euros) | |||||||
Pays |
Filiales |
Succursales |
Crédits clientèle nets |
Dépôts clientèle |
Total de bilan |
Encours Gérés |
Résultat Net |
Andorre |
1 |
1 429 | |||||
Antilles Néerlandaises |
3 |
1 |
282 420 |
163 429 |
894 676 |
2 267 |
16 584 |
Autriche |
5 |
3 |
4 780 228 |
1 829 686 |
10 577 560 |
– 93 428 | |
Belgique |
38 |
14 |
8 964 581 |
4 416 808 |
18 264 534 |
4 652 331 |
406 970 |
Bahrein |
5 |
6 041 288 |
2 201 392 |
12 478 233 |
183 635 | ||
Bermudes |
1 |
1 |
2 519 |
38 819 | |||
Bahamas |
4 |
1 661 085 |
99 | ||||
Suisse |
21 |
7 |
23 950 125 |
36 354 368 |
62 014 987 |
90 759 285 |
633 766 |
Chili |
1 |
10 |
1 794 |
217 | |||
Gibraltar |
1 |
106 876 |
900 939 |
987 786 |
760 806 |
– 574 | |
Caïman (Îles) |
4 |
2 |
20 325 283 |
26 148 488 |
56 110 046 |
34 907 |
113 838 |
Luxembourg |
69 |
21 |
26 628 685 |
71 063 512 |
196 321 468 |
55 877 690 |
1 080 925 |
Panama |
2 |
5 |
1 515 244 |
224 769 |
2 447 471 |
735 000 |
12 009 |
Singapour |
8 |
14 |
13 907 803 |
7 785 905 |
37 927 514 |
7 099 128 |
1 144 612 |
Malaisie |
1 |
6 |
3 088 | ||||
Philippines |
4 |
1 621 |
9 233 |
– 1 103 | |||
Uruguay |
2 |
15 858 | |||||
Totaux |
160 |
84 |
106 504 164 |
151 089 296 |
398 037 821 |
161 582 499 |
3 556 744 |
Source : Commission bancaire
Sur la base des données publiées par la Banque de France, contribuant aux données globales publiées par la BRI, relatives aux engagements consolidés des banques françaises résidant dans un des pays figurant sur la liste de l’OCDE (hors Monaco), on observe que l’ensemble des créances des banques françaises sur ces pays représente 475 milliards de dollars à fin septembre 2008. Après la Belgique et le Luxembourg (115 et 113 milliards de dollars), on relève un encours de près de 90 milliards de dollars sur les Îles Caïman. Viennent ensuite la Suisse (55 milliards de dollars), l’Autriche (27 milliards de dollars), Singapour (17 milliards de dollars), puis les Îles vierges britanniques, les Bermudes, les Antilles néerlandaises et Panama, pour des montants entre 15 et 5 milliards de dollars. Les engagements sur chacun des autres pays et territoires sont inférieurs à 5 milliards de dollars. Ces engagements combinent de l’activité bancaire courante, dans les grands pays européens (Autriche, Belgique, Luxembourg, Suisse) et à Singapour, et de l’activité offshore dans les territoires comme les Îles Caïman où sont créés de nombreux véhicules spécialisés, notamment pour du financement d’actifs.
S’agissant des personnes physiques, le nombre de celles qui utilisent les paradis fiscaux est évidemment impossible à déterminer. Les sociétés, trusts et entités diverses enregistrés dans les paradis fiscaux masquent aussi des personnes physiques, mais dans quelle proportion ? Il se dit que près de la moitié des grandes fortunes du monde (16 000 milliards de dollars) fructifierait dans les paradis fiscaux. Il n’est pas possible de dresser des projections à partir des cas constatés dans les affaires judiciaires car elles sont trop peu nombreuses. Les chiffres des saisies douanières sont également pauvres et limités géographiquement du fait de la prégnance des saisies frontalières. 50 % des sommes saisies par les douanes françaises concernent des flux avec la Suisse ou le Luxembourg au passage des frontières. En 2009, à la fin mars, sur les 77 enquêtes ouvertes par les douanes sur des faits liés à des manquements, plus de la moitié concernait le Luxembourg. Les sommes saisies correspondant à des transferts non déclarés sont de l’ordre de 100 millions d’euros par an. Sans être négligeables, ces montants ne sont pas représentatifs des avoirs non déclarés.
2.– Un visage à deux faces : des territoires attractifs boîte noire des opérations douteuses
Le manque d’information sur l’origine des fonds et des transactions est aberrant si l’on considère que ces territoires occupent une part importante dans les circuits mondialisés de la finance, position qu’ils consolident par une technicité accrue. Loin de les stigmatiser, les listes noires du début des années 2000 leur ont semble-t-il permis, en se vidant, de gagner en légalité et en légitimité. Leur empressement pour certains à appliquer scrupuleusement les recommandations du GAFI y a aussi contribué. De nombreux travaux académiques récents reconnaissent ainsi aux paradis fiscaux un rôle positif : amélioration de la compétitivité des entités implantées dans l’onshore, soupape permettant aux multinationales d’alléger une partie de leur fiscalité et ainsi de maintenir ou accroître leur activité dans le pays d’origine à fiscalité relativement élevée, bases de conquête de nouveaux marchés, centre d’intensification des échanges etc.
Thierry Godefroy et Pierre Lascoume, dans Le capitalisme clandestin, l’illusoire régulation des places offshore (20), en déduisent que les pratiques liées aux ressources offertes par les places offshore sont structurellement liées au fonctionnement du commerce et de la finance internationale. Ils avancent que la rhétorique anti-paradis fiscaux du début des années 2000 n’aurait pas eu pour but d’interdire les opérations avec les places suspectes. Selon eux, les appels à la transparence devaient au contraire permettre leur insertion dans les circuits d’échange officiels au faible prix de la stigmatisation de quelques réfractaires. Ce qui est certain, c’est qu’en 2008 ces territoires étaient complètement intégrés à l’économie mondiale, alors même que les outils qu’ils mettent à disposition sont autant la raison de leur succès que la cause d’une inquiétude renouvelée.
a) Un rôle présenté comme positif dans la mondialisation
Du point de vue des États, surtout des micro-États, l’implantation d’un centre financier favorisant l’installation de services aux non-résidents relève d’une stratégie de diversification ou de réorientation de l’économie locale. Les bénéfices qu’ils sont susceptibles d’en retirer sont nombreux. Outre les revenus fiscaux directs, tirés par exemple de la vente de licences aux sociétés offshore, les autorités en attendent un effet d’entraînement sur le reste de l’économie (tourisme, accueil de conférences internationales, investissements des capitaux locaux) et une insertion qualifiante dans la division du travail internationale. C’est ainsi que sur une réglementation locale favorable à la création d’entités diverses s’est greffée une ingénierie financière en fort développement depuis quelques années : gestion de hedge funds, de dérivés de crédits, de sociétés captives d’assurance, restructurations de dettes, cloisonnement d’éléments d’actif ou de passif dans un but de gestion des risques, et développement de tous types de financement hors bilan.
Ces caractéristiques des paradis fiscaux – soupape fiscale, solutions techniques et innovation – qui leur conféreraient la qualité de rouage essentiel de la mondialisation, sont mises en avant, tant par les établissements financiers, que par les entreprises pour justifier leurs implantations et activités. Du point de vue des utilisateurs des paradis fiscaux, ces territoires ne sont pas considérés comme de simples dépositaires de liquidités de grandes firmes ou de riches individus à la recherche d’un exutoire fiscal, car les plus développés d’entre eux mettent à disposition une expertise financière pour certains types d’opérations et dans certains produits structurés de la finance internationale.
Les activités des banques sont à cet égard éclairantes. Selon les données de la Banque de France, les métiers les plus présents dans les activités des banques françaises ayant cours dans les pays figurant sur les listes de l’OCDE d’avril dernier sont :
– le financement d’actifs notamment le leasing maritime et aérien par l’intermédiaire de SPV ou de trusts (Îles Caïman, Îles Marshall, Libéria, Panama, Luxembourg (21)) ;
– l’activité de banque privée, en Suisse et au Luxembourg d’une part, à Gibraltar et dans les Bahamas (trusts de la clientèle) d’autre part ;
– la conservation et l’administration de fonds et la gestion d’actifs, aux Îles Caïman, notamment pour la clientèle asiatique, et aux Bermudes, notamment par des hedge funds ;
– la réassurance, aux Bermudes notamment.
Plusieurs motivations à l’implantation d’activités dans les paradis fiscaux sont avancées par les établissements bancaires :
– l’héritage du passé avec certaines structures ou implantations intégrées dans des opérations de croissance externes ;
– la rapidité et le faible coût des créations et radiations de sociétés : en matière de structuration les Îles Caïman, de gestion d’actifs les Bermudes, pour la constitution de financements aéronautiques ou de shipping les Îles Caïman, le Libéria et les Îles Marshall ;
– un financement d’actifs facilité par l’environnement réglementaire, notamment la sécurité qu’offre le droit local en matière de cantonnement et « repossession » des actifs (grande facilité d’exercice des hypothèques) pour le financement des avions (sociétés ad hoc des Îles Caïman) et des bateaux (Libéria, Panama, Îles Marshall et Hongkong), ainsi que la rapidité de création d’incorporation et de radiations des SPV ;
– « l’effet cluster », c’est-à-dire l’effet de regroupement générant des externalités positives par la concentration d’entreprises interconnectées, de fournisseurs spécialisés, de prestataires de services et d’institutions associées. La facilité de syndication auprès des grandes banques internationales, habituées à cet environnement, contribue à avantager ces territoires. Il y aussi un effet de notoriété sur les clients qui demandent à bénéficier d’un montage utilisant un certain territoire. On peut enfin rappeler que certaines agences de crédit-export exigeaient que la propriété des biens soit cantonnée dans une entité ad hoc, dans un pays différent de celui du locataire et avec une neutralité fiscale, ce qui a favorisé le financement d’opérations coûteuses dans les paradis fiscaux.
Dans leurs entretiens rapprochés avec la Commission bancaire, certains établissements français font état d’une réorientation de leurs activités vers le territoire européen, dont la fiscalité est devenue plus attractive et les pratiques plus souples. Tous mettent en avant des motivations plus juridiques ou économiques que fiscales. Ils insistent également sur le fait qu’ils appliquent les dispositions fiscales tendant à lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et à ce titre déclarent les revenus des entités qu’ils contrôlent dans les pays à fiscalité privilégiée, sur lesquels ils sont pour partie imposés.
Ces arguments (droit local, spécialisation et effet d’échelle), que l’on retrouve dans le secteur non financier, dessinent une cartographie des paradis fiscaux en fonction du rôle qu’ils jouent dans l’économie mondiale. Certains territoires sont même parvenus à proposer une palette relativement complète. Tel est le cas des Îles Caïman, territoire britannique de 260 km² et peuplé de 40 000 habitants. En 2000, la Banque des règlements internationaux avait évalué les actifs gérés aux îles Caïman à 900 milliards de dollars. Les banques immatriculées aux Îles Caïman gèrent des dépôts évalués à 500 milliards de dollars environ, ce qui en fait la cinquième place financière mondiale. De plus, la législation locale permet l’établissement de banques coquilles puisqu’il n’existe aucune obligation de présence physique sur le territoire au-delà de la désignation d’un représentant local incarné par des cabinets juridiques. Il existe près de 600 banques dont seulement une trentaine sont des banques locales (onze établissements appartiennent à des groupes français), plusieurs milliers de comptables, d’avocats d’affaires et de fiscalistes, ainsi que 780 compagnies d’assurances établies par des multinationales. Quelque 85 000 sociétés écrans, 10 000 hedge funds et 25 000 trusts y seraient immatriculées. Dans cette île, il n’y a ni impôt sur le revenu, ni impôt sur les sociétés, ni impôt sur la fortune.
SPÉCIALITÉS DES TERRITOIRES Jersey regroupe un grand nombre d’opérations de fusion-acquisition en relation avec les banques d’affaires londoniennes. C’est également une place essentielle, avec le Luxembourg, pour l’administration des fonds d’investissement. Les Îles Anglo-Normandes, reconnues pour leurs facilités réglementaires, abritent 225 banques et 820 fonds d’investissement. Le Luxembourg est réputé pour les avantages consentis aux sociétés holding résidentes et est une des premières places d’accueil des fonds de placement mutuels et l’un des principaux centres mondiaux d’inscription des euro-obligations. Les Bermudes sont la première place d’enregistrement des compagnies d’assurance exclusive et un lieu d’implantation apprécié des compagnies de réassurance (40 % des captives d’assurance y étaient établies en 1998 selon le rapport du PNUCID). Axa, AGF, MMA et 16 des 35 plus grands assureurs mondiaux y sont implantés. L’archipel est également réputé pour son management des trusts patrimoniaux. Les Îles Caïman et les Antilles néerlandaises se font une spécialité de l’accueil de special purpose vehicles (SPV) sociétés à objectif limité utilisées par les émetteurs euro-obligataires pour domicilier leurs emprunts obligataires extra-territoriaux et bénéficier ainsi du statut fiscal privilégié des euro-obligations auprès de leurs autorités nationales. Les Antilles néerlandaises rendent possible l’enregistrement d’une société en moins d’un jour. Les Îles Caïman et les Barbades accueillent par ailleurs de nombreux fonds spéculatifs (le fonds spéculatif LTCM était enregistré aux îles Caïmans). Les Bahamas, qui hébergent 4 300 banques, se sont spécialisées dans le commerce en ligne. Les Îles Vierges logent 50 % des sociétés non-résidentes du monde et ont développé un marché de captives d’assurance de petite taille. Moins connu, Nauru est une île située entre le Japon et la Nouvelle-Calédonie qui offre à la fois le secret bancaire, l’absence de contrôle des changes et l’absence de toute réglementation. Le pays compte 450 banques sur un territoire de 20 km². La Suisse est le premier gestionnaire des plus grandes fortunes au monde. Le Libéria et Panama sont les territoires des pavillons de complaisance. Panama offre aux armateurs un enregistrement rapide, une législation favorable, en particulier la garantie de ne pas être inquiétés en cas de manquement aux règles internationales. On y trouve une centaine de banques et plusieurs milliers de sociétés écrans. Le Libéria est le numéro deux des pavillons de complaisance dont nombre d’entre eux, il faut le dire, n’ont jamais vu ses côtes. Tuvalu est le leader mondial du marché du sexe en ligne. |
Toute la difficulté réside dans le fait que l’opacité qui entoure les opérations ne permet pas d’opérer une séparation fine des activités, isolant les activités douteuses du rôle « positif » qui est attribué à ces juridictions offshore. Cette opacité est permise par la mise à disposition d’outils souples, non ou peu régulés et particulièrement protecteurs de l’anonymat.
b) Secret, dérégulation et anonymat : la boîte à outils du fraudeur
— Les special purpose vehicles (SPV), les captives d’assurance et les sociétés écran
Il s’agit de sociétés ad hoc, filiales de grandes entreprises et constituées comme instruments de gestion du risque. Ces sociétés ont pour objet initial de réduire les coûts. Elles présentent toutefois des caractéristiques facilitant la fraude et le blanchiment : elles permettent de modifier la résidence de l’entreprise, l’origine de ses revenus et, partant, diminuent la visibilité sur les opérations et profits. Ces sociétés peuvent être constituées rapidement à peu de frais dans la plupart des paradis fiscaux. Certaines d’entre elles peuvent lever des capitaux par émission sur les marchés financiers mondiaux. Elles ne subissent aucune imposition et dans certains territoires ne sont pas tenues de tenir une comptabilité détaillée. C’est par exemple le cas à Nevis, dans les Caraïbes.
Les entreprises multinationales rappellent qu’elles constituent un instrument souple pour des opérations légales. De fait, les SPV sont d’abord apparues dans les opérations de crédit-bail pour financer de lourds investissements dans le secteur aérien. Elles sont aussi utilisées par exemple pour loger les droits de propriété industrielle dans un but d’optimisation fiscale. De même, les captives d’assurance étaient utilisées par les multinationales dès l’entre deux guerres pour baisser le coût des primes sur leurs activités. Elles se sont développées avec la montée des plaintes aux États-Unis liées au droit du travail.
Mais la prolifération de ces sociétés ne permet pas de penser qu’elles ne sont pas utilisées pour masquer des opérations et flux financiers contestables. Selon Christian Chavagneux et Ronan Palan (22), le nombre de SPV était évalué en 2006 à deux millions avec une croissance de l’ordre de 10 à 15 % par an. Leur utilisation par les sociétés Enron et Parmalat a été mise au jour lors des scandales liés à ces deux sociétés. Enron a eu 881 filiales offshore : 692 aux Îles Caïmans, 119 dans les îles « Turks and Caïcos », 43 aux îles Maurice et 8 aux Bermudes. Enron n’a payé aucun impôt aux États-Unis pendant quatre des cinq années comprises entre 1996 et 2000 et même obtenu une remise sur la base de ses écritures comptables (23). S’agissant des sociétés captives d’assurance, Christian Chavagneux et Ronan Palan en recensaient 5 000 dans le monde, percevant près de 20 milliards de dollars de primes et gérant au total plus de 50 milliards d’actifs.
Il est évident que, de ce point de vue, les paradis fiscaux posent autant un problème d’évasion fiscale par soustraction à l’impôt des activités enregistrées dans ces territoires, que de fraude fiscale sur l’activité de la société dans le pays de résidence fiscale. La question fiscale est alors étroitement imbriquée à la question règlementaire. Nombre de compagnies d’assurance ont aussi été mêlées à des circuits de blanchiment, d’argent de la drogue notamment, par le moyen de contrats d’assurance-vie.
Certaines de ces sociétés sont des sociétés écrans, c’est-à-dire qu’elles ne divulguent pas le nom de leur propriétaire effectif. Une douzaine de juridictions autorisent cet anonymat absolu. On les retrouve sous l’appellation d’International business corporations (ou Private investment companies), coquilles prêtes à employer qui doivent opérer en dehors des juridictions dont elles ressortent. Elles bénéficient de quatre avantages : la confidentialité totale et l’anonymat (aucun rapport n’est à fournir à l’administration à la création ou postérieurement), une fiscalité nulle, une création par télécopie, aucune contrainte de capitaux (pas de capital minimum requis, pas de contrôle des changes, liberté totale de transfert de capitaux). Elles emploient généralement des actions au porteur et des actionnaires et directeurs fournis par la société dans laquelle elles sont incorporées.
Car il s’agit surtout de sociétés incorporées à des groupes. Un des circuits majeurs utilisé et mis à jour dans le rapport du sénateur américain Carl Levin en février 2001 consiste à utiliser indirectement une grande banque correspondante de banques situées à l’étranger (pratique du correspondent banking). La banque correspondante facture ce rôle service en échange notamment d’un accès aux réseaux électroniques de transferts internationaux de fonds ou de titres financiers. La banque qui souscrit au service a pour client une banque écran créée dans un paradis fiscal. Une autre méthode pour se connecter à un réseau légal et dissimuler des flux financiers qui a été révélée récemment était celle des comptes non publiés de la société luxembourgeoise Clearstream, qui représentaient environ 15 % des transactions totales de la société (environ 5 000 dans les paradis fiscaux).
Des compagnies d’actions au porteur sont également légales dans au moins 25 paradis fiscaux, à commencer par les Îles Caïman, Panama, Gibraltar, Nauru et le Vanuatu. Le nom du propriétaire effectif n’est jamais enregistré.
— Fondations, trusts et Anstalt :
Le trust et la fondation présentent de grandes similitudes et permettent d’atteindre les mêmes objectifs. Leur utilisation engendre une séparation juridique entre le patrimoine du constituant et les actifs du trust ou de la fondation. Ces institutions assurent la confidentialité de certaines opérations ou de la propriété des actifs. L’ouverture d’un compte bancaire par un trust discrétionnaire irrévocable permet également de préserver l’anonymat des bénéficiaires tant qu’aucun bénéficiaire effectif n’aura été désigné. Ils peuvent aussi être utilisés pour garantir la protection de certains actifs contre des prétentions futures de créanciers ou des risques politiques (« protective trusts »).
En matière de planification successorale, le recours à un trust ou à une fondation discrétionnaire permet de maintenir au profit de plusieurs générations un patrimoine familial en restreignant le droit des premiers bénéficiaires et en prévoyant une évolution successive en faveur d’autres bénéficiaires, héritiers plus éloignés ou personne n’ayant pas la qualité d’héritier. Un autre objectif peut être la protection des mineurs et jeunes adultes dont l’entretien est assuré par le trust ou la fondation qui diffère alors leur droit de recevoir une part du capital.
En matière fiscale, le recours à un trust ou à une fondation permet d’éviter l’impôt sur la fortune qui grèverait normalement les actifs qui lui sont apportés ainsi que l’impôt sur les gains en capital résultant de leur vente antérieure. L’impôt sur le revenu est différé ou éliminé tant que les actifs sont maintenus dans le trust ou la fondation et qu’aucune distribution n’est faite. Il n’y a pas d’impôt successoral, ni au décès du constituant, ni lorsque de nouveaux bénéficiaires se substituent à des bénéficiaires antérieurs décédés. Seul l’apport des biens au trust ou à la fondation entraîne le paiement d’un impôt sur les donations, sauf si le trust ou la fondation est révocable. Il est toutefois fréquent que les actifs soient vendus à une société offshore contrôlée par le trust si l’impôt sur les gains en capital ou la plus-value qui en résulte est plus faible que l’impôt sur les donations.
TRUST, FONDATION ET ANSTALT Le trust est un concept juridique anglo-saxon. Sa caractéristique principale réside dans la notion de la double propriété sur les avoirs du trust : le constituant transfère la propriété des biens qu’il apporte à un ou plusieurs trustees - personnes physiques ou sociétés spécialisées - qui en acquiert la propriété juridique, à charge cependant pour les trustees de gérer, d’administrer et de contrôler les biens du trust en faveur et dans l’intérêt des bénéficiaires qui en ont la propriété économique. Le trust est constitué, soit par un document appelé « trust deed », soit par un testament. L’acte constitutif détermine le droit applicable au trust, les pouvoirs plus ou moins larges des trustees, les règles d’administration des actifs, la durée maximale du trust et la distribution finale des actifs. Le constituant peut soumettre la validité de certaines décisions des trustees à l’agrément préalable d’un tiers (protector) qui contrôle ainsi leurs activités. Les bénéficiaires sont généralement désignés dans une lettre d’instructions remise par le constituant aux trustees. Leurs droits peuvent porter sur le produit des actifs et/ou sur les actifs eux-mêmes. Cette lettre n’impose toutefois aucune obligation aux trustees qui, en pratique, respecteront néanmoins les désirs du constituant. Le trust peut être révocable ou irrévocable, discrétionnaire ou fixe, modifiable ou non. Sa forme la plus fréquente est celle d’un trust discrétionnaire qui définit simplement une classe de bénéficiaires en laissant aux trustees toute liberté pour la désignation, dans ce cadre, des bénéficiaires effectifs. La fondation est une entité juridique distincte à laquelle le fondateur fait apport d’un patrimoine affecté à un objet déterminé mentionné par l’acte constitutif et les statuts. Ce patrimoine ainsi individualisé acquiert une personnalité juridique propre. La fondation n’a pas d’actionnaires mais des bénéficiaires qui sont les personnes au profit desquelles son objet est réalisé. Le fondateur peut figurer parmi les bénéficiaires, tout comme le constituant dans un trust. L’objet de la fondation peut notamment être l’octroi de prestations aux membres d’une même famille. Une telle fondation est souvent constituée au Liechtenstein dont la législation à cet égard est très libérale (les Stiftung). La fondation y est redevable d’un droit de timbre de 0,2 % de son patrimoine, d’un droit d’enregistrement de 500 francs suisses à la constitution et d’un impôt annuel de 0,05 à 0,1 % du patrimoine annuel. Les bénéficiaires des versements résidant à l’étranger ne supportent pas au Liechtenstein d’impôt sur les revenus distribués ou sur la répartition des biens de la fondation. La fondation est gérée par un Conseil de fondation (équivalent des trustees dans le trust) désigné par le fondateur. Le Conseil est chargé de la gestion du patrimoine ainsi que de l’attribution des prestations aux bénéficiaires, conformément aux statuts et aux règlements. Il peut être assisté d’un Comité de surveillance (équivalent du « protector » dans le trust) qui doit donner son agrément préalable à certaines décisions du Conseil de fondation, notamment en matière d’attributions. Les statuts sont complétés par des règlements internes confidentiels qui précisent la composition et les pouvoirs du Comité de surveillance et le cercle des bénéficiaires. Comme en matière de trust, les fondations peuvent être révocables ou irrévocables, discrétionnaires ou fixes. Les bénéficiaires n’ont aucun droit direct à l’encontre de la fondation, dont la durée n’est pas limitée. L’Anstalt du Liechtenstein est un outil juridique spécifique entre société, fondation et trust. C’est le plus connu en matière de gestion de fortune privée parce qu’il autorise un secret complet : l’établissement bancaire dépositaire du compte ne connaît pas le bénéficiaire effectif. |
Le Liechtenstein est le territoire des fondations, suivi de Panama, dont le statut, défini par une loi de 1995, est d’ailleurs très inspiré de la loi du Liechtenstein de 1926 : la fondation est enregistrée au Registre public de Panama (alors que le trust ne l’est pas), le protecteur et les bénéficiaires restent cependant anonymes – ils ne sont mentionnés que dans le règlement qui n’est pas enregistré –, les procédures judiciaires de succession ne sont pas applicables à la fondation dont le patrimoine est légalement séparé de celui du fondateur, la fondation ne paie d’impôts ni sur les biens, argent et actifs situés à l’étranger, de provenance de l’étranger, ni sur les actions ou titres dont les revenus sont de source étrangère, même s’ils se trouvent sur le territoire panaméen.
— Les fonds spéculatifs ou hedge funds :
La gestion alternative est un mode de gestion de portefeuille appliqué par certains fonds d’investissement dits hedge funds (« fonds de couverture ») ou « fonds alternatifs ». Un hedge fund est un organisme de détention collective d’actifs financiers, dont la particularité réside dans le rendement élevé de ces placements. Ces fonds s’appuient sur des stratégies alternatives à la tendance des marchés classiques, leurs rendements ne sont pas corrélés au marché mais restent globalement liés à la conjoncture. Un hedge fund peut proposer soit d’investir sur les marchés des actions mais aussi sur les obligations, les devises, les matières premières, l’immobilier et les entreprises non cotées ou le marché des œuvres d’art, soit de construire un portefeuille d’actifs dont l’exposition au marché sera relativement faible –, les baisses d’un type d’actif étant compensées par l’augmentation d’un autre – d’où le terme de couverture. Pour obtenir des rendements au-dessus du marché, il utilise des techniques particulières : la vente à découvert, l’effet de levier, les produits dérivés (options, futures ou contrats de gré à gré), l’arbitrage (écarts de prix excessifs).
La majorité des hedge funds sont indépendants, même si certains appartiennent à de grandes banques ou en sont partenaires. Le but est généralement de lisser les courbes de rendement et de les améliorer par rapport au rendement du marché permettant d’avoir un meilleur rapport performance / volatilité. La raison pour laquelle ces « fonds alternatifs » sont considérés comme risqués est liée au fait qu’au-delà du « lissage » des courbes de rendement, ils ont servi à de nombreuses attaques spéculatives, sur les taux de change par exemple, déclenchant des crises (crise russe et crise asiatique notamment).
Le nombre de hedge funds était évalué à près de 10 000 dans le monde en 2007, pour un chiffre d’affaires dépassant les 1 700 milliards de dollars américains. Du fait de la crise et du durcissement des conditions de crédit nécessaire à l’effet de levier, un tiers d’entre eux a probablement déjà disparu. La très grande majorité d’entre eux sont établis dans les paradis fiscaux pour des raisons fiscales. Les risques liés à leur exposition et à leur financement par effet de levier ressortent plutôt d’une problématique de sécurité financière, l’opacité des paradis fiscaux ne permettant pas de disposer d’une information utile et de les contrôler. Cette question se pose alors qu’une régulation de ces entités se met en place aux États-Unis et en Europe. Toutefois la question de la fraude fiscale n’est pas absente. D’une part, ils peuvent être récipiendaires de sommes transférées dans les paradis fiscaux. N’étant pas contrôlés, on ne sait rien de l’origine des fonds qu’ils gèrent. D’autre part, les profits qu’ils génèrent peuvent être maintenus dans le paradis fiscal et non déclarés, ou encore rapatriés par des circuits de blanchiment. On voit bien que le point crucial est l’accès à l’information.
c) De la concurrence fiscale à la manipulation et la fraude
Si les territoires non coopératifs sont pour l’essentiel des paradis fiscaux, c’est-à-dire offrent une fiscalité faible pour les non résidents, ils représentent pour les entreprises de bonne foi un moyen d’abaisser la pression fiscale. L’informatisation des échanges, en effaçant le lien territorial, a contribué à l’accélération des réorganisations des sociétés multinationales à la recherche de coûts rationalisés. Cette question ne concerne pas que le volet fiscal, les délocalisations sociales s’étant aussi multipliées, mais ce volet fiscal est systématique, relativement déconnecté de la productivité et encouragé par des formes de compétition fiscale très agressives y compris en Europe.
Le développement des activités internationales des entreprises génère des problèmes ou des opportunités d’interaction entre les systèmes fiscaux nationaux. Le commerce mondial intragroupe représente plus de 60 % du commerce international. En France, les flux d’investissement directs français à l’étranger ont fortement progressé en 2007 (164 milliards d’euros, après 97 milliards en 2006) du fait de la très forte accélération des « autres opérations » (80 milliards d’euros, après 14 milliards en 2006), qui correspondent aux prêts et flux de trésorerie des entreprises françaises à destination de leurs filiales. Une première méthode d’optimisation consiste à détecter et profiter des failles des conventions fiscales bilatérales. Cette démarche a pour objet unique d’éliminer une partie de l’imposition et peut être couplée à des montages vecteurs de fraude. L’autre pratique courante d’optimisation, d’évasion, voire de fraude est la répartition des implantations des sociétés du groupe entre territoires normalement imposés et territoires à fiscalité privilégiée ou nulle. Les sociétés multinationales opèrent une répartition du revenu global des transactions entre les différentes autorités fiscales, compte tenu de la présence dans différents pays ou territoires de filiales et sociétés mères. Elles cherchent à optimiser cette répartition par une pondération de la masse fiscale mondiale via la localisation des revenus.
La répartition des revenus n’est en effet pas statique. Il existe toutes sortes de prestations ou transactions entre les différentes sociétés. Une société peut ainsi assurer la production pour compte d’autrui avec une rémunération garantie, elle peut payer des redevances dont le taux doit être objectif et dépendre de ce qui est effectivement dû (aspects non commerciaux, rémunération de brevet, coût de l’innovation technologique), elle peut refacturer des frais, par exemple pour la création d’un site Intranet ou Internet du groupe auquel elle appartient. L’investissement dans un pays étranger peut se faire par l’intermédiaire d’une filiale établie dans un paradis fiscal. Certains groupes optent pour l’inversion, c’est-à-dire l’établissement de la maison-mère dans un paradis fiscal. Cette technique récente a beaucoup agité l’opinion publique américaine au début des années 2000, car elle permet d’échapper au paiement de l’impôt sur le revenu mondial du groupe et la réalité de l’implantation est incontrôlable.
La stratégie de fixation des prix s’applique à l’ensemble des filiales du groupe qui sont organisées en fonction de celle-ci. Les prix de transfert sont donc les prix qui sont pratiqués au titre des échanges internationaux de biens, de services ou d’actifs incorporels pratiqués entre entreprises dépendantes ou appartenant à un même groupe et situées dans des pays différents. Pour les entreprises multinationales, les prix de transfert sont devenus une préoccupation majeure, autant pour sécuriser leurs régimes fiscaux que parce qu’ils sont l’aboutissement et le substrat de leur stratégie d’implantation et de satellisation de filiales. Selon le sondage mondial 2007-2008 sur les prix de transfert d’Ernst & Young, étude sur les pratiques et stratégies en matière de prix de transfert menée auprès de 850 multinationales dans 24 pays, les prix de transfert constituent la première préoccupation fiscale pour 40 % des entreprises appartenant à un groupe multinational. 87 % des multinationales sont convaincues que les prix de transfert seront une question cruciale pour la gestion des risques liés à leurs états financiers.
De l’optimisation à la fraude, il n’y a qu’un pas. La répartition des filiales peut être utilisée pour manipuler les prix intragroupes et ainsi transférer artificiellement les revenus positifs vers les territoires les moins taxés. Une filiale située dans un État à fort taux d’imposition a intérêt à vendre un bien à un prix minoré à une société qui lui est liée plus faiblement imposée. À l’inverse, dans l’intérêt du groupe, elle pourrait être tentée de rémunérer fortement un service ou un bien à une société faiblement imposée. L’évaluation des prix de transfert est donc sujette à caution, soit parce qu’il est difficile de fixer un prix de marché – et cela est particulièrement le cas pour les actifs immatériels – soit parce qu’ils peuvent être manipulés pour transférer artificiellement la masse taxable vers les zones sous-imposées.
L’optimisation est déjà parfois très contestable dès lors que l’éclatement en plusieurs sociétés du groupe est opportuniste. Il s’agit d’une évasion fiscale par concurrence dommageable. Aujourd’hui, ce sont des pans entiers de fonctions ou de risques qui sont transférés dans des États à faible taux d’imposition, sans correspondre à une branche d’activité ou un fonds de commerce, au-delà de toute interrogation sur les coûts de production. C’est la matière imposable qui est éclatée et répartie de façon rationnelle. On peut citer le cas de Microsoft qui logeait ses droits de propriété industrielle en Irlande où le taux d’imposition était de 12,5 %. Autre cas connu : News Corporation, la société créée et gérée par Rupert Murdoch qui officie principalement dans trois pays : Australie, États-Unis et Grande Bretagne. La société est composée d’environ 800 filiales dont environ 60 sont enregistrées aux Bermudes, aux Îles Caïman, aux Antilles Néerlandaises et aux Îles Vierges Britanniques. En Angleterre, la principale entité NewsCorp Investments et ses 101 filiales ont réalisé depuis juin 1987 un bénéfice total de 1,4 milliard de livres sterling. Grâce à une optimisation fiscale optimale, NewsCorp Investments a réussi à ne pas payer d’impôts sur les sociétés depuis cette date. La société la plus rentable de cette organisation serait une entité appelée News Publishers enregistrée aux Bermudes avec un bénéfice de 1,6 milliard de dollars au 30 juin 1996, ce qui est tout à fait remarquable pour une société qui ne semble pas avoir d’activité effective propre.
La manipulation des prix pour gonfler les bénéfices dans le pays peu imposé en bénéficiant de la protection que constitue l’absence de contrôle est le stade ultime qui caractérise la fraude. Un État n’a aucun moyen de savoir ce qui se cache derrière des opérations ou implantations concernant des paradis fiscaux et le contribuable est le seul à disposer de l’information permettant de déterminer s’il y a fraude ou optimisation. J.-S. Zdanowicz et S. J. Pak ont étudié les anomalies de prix sous-estimés à l’importation et surestimés à l’exportation et les pertes de revenus que cela a entraînées pour le gouvernement américain. La perte de revenu simplement pour l’État américain est estimée par les auteurs à 50 milliards de dollars pour la seule année 2001. Il faut dire que ces schémas ont été encouragés par les États-Unis : la loi américaine sur les sociétés de vente à l’étranger exonère ainsi les sociétés qui domicilient, de façon tout à fait artificielle mais licite, les profits générés par des contrats internationaux, dans des filiales implantées dans les centres offshore. Il faut noter que grâce à ce mécanisme, neuf des dix plus grandes entreprises américaines n’ont pas payé d’impôts ces dernières années.
d) Le terrain de jeux des grandes fortunes
S’agissant des personnes physiques, les utilisateurs des paradis fiscaux sont des personnes fortunées qui cherchent à réduire leur imposition, sur le revenu et/ou sur le patrimoine, à protéger leurs fonds de l’instabilité de leur pays de résidence et à faire fructifier leurs revenus. C’est la gestion de fortune privée, pour laquelle la Suisse occupe le premier rang, suivie de Singapour. Certains transfèrent leur résidence fiscale dans un paradis fiscal, c’est le cas notamment des célébrités diverses (monde du sport et du spectacle). Mais pour la plupart d’entre eux il s’agit surtout de cacher leur richesse, notamment à leur conjoint (pensions alimentaires), ou encore de placer des revenus non déclarés dans leur pays de résidence.
Plusieurs techniques frauduleuses permettent de transférer des sommes dans les paradis fiscaux. Par exemple, un contribuable créera une société qui y est établie et qui l’emploie. Cette société lui verse une faible rémunération, la majorité des sommes n’étant pas rapatriées. Nombreuses sont aussi les techniques pour rapatrier les fonds placés, utilisant des circuits de blanchiment au travers de multiples entités. L’utilisation de structures permettant l’anonymat du bénéficiaire effectif est de toute évidence indispensable.
Les particuliers peuvent utiliser des techniques de fraude simples, telles que les transferts physiques d’argent liquide, les actions au porteur (c’est celui qui les porte qui est considéré comme le propriétaire légal) ou encore les gérants et PDG de paille. Dans le cadre des saisies aux frontières, plusieurs enquêtes des douanes menées sur des montages impliquent des courtiers en assurance-vie ou des sociétés qui permettent le transfert illégal avec des porteurs et des bons de caisses encaissés au Luxembourg, la compensation s’opérant au sein de la banque. Par exemple, une compagnie d’assurances reçoit 100 000 euros et en contrepartie donne un chèque tiré sur un tiers, par exemple sur le compte d’un avocat ou d’une autre compagnie, au profit du déposant. Ce dernier l’endosse au profit de la société étrangère qui crédite un compte ouvert au bénéfice du déposant.
Mais ce sont bien évidemment les schémas faisant intervenir un empilement de territoires et d’entités opaques (trusts et sociétés-écrans) qui rendent hautement improbable la possibilité de remonter jusqu’à eux. De ce point de vue, l’échange d’informations est largement insuffisant s’il ne concerne que les avoirs et les revenus des personnes physiques. Dans ces paradis fiscaux, la richesse est avant tout contrôlée par des personnes morales ou entités de même nature. C’est toute la question du bénéficiaire effectif final.
Tous ces montages font intervenir des professionnels (conseils, courtiers, comptables, avocats etc.) qui ne sont pas nécessairement établis dans les paradis fiscaux. Le croisement des compétences techniques à la base des produits financiers complexes a conduit à s’interroger sur le rôle de ces « ouvreurs de portes » (gatekeepers). Les grands cabinets de conseil ont proposé des produits dont le caractère frauduleux a parfois été mis en cause. KPMG a ainsi dû trouver un arrangement amiable avec le Trésor américain en août 2005 dans une affaire de fraude fiscale. Les produits ont parfois été vendus par des grandes banques. Le Sénateur Carl Levin pointe dans son rapport les agissements de la Deutsche Bank, d’UBS et de la Barclays Bank. Certains conflits d’intérêts n’ont également pas manqué d’être révélés, notamment lorsque le cabinet d’audit conseillant le montage est celui qui vérifie la comptabilité ou attribue la notation.
II.– LA DIFFICILE MISE EN PLACE DE RÉPONSES COORDONNÉES
Si l’on part du principe qu’il n’est pas envisageable d’atteindre à la souveraineté des États et territoires, deux types de réponses peuvent être apportées :
– une harmonisation des fiscalités et réglementations par consensus, voie que même l’Union européenne n’est pas jusqu’à présent parvenue à appliquer ;
– une pression forte sur la réputation des paradis fiscaux afin que les autorités publiques de ces territoires renforcent leur surveillance sur les opérateurs et s’associent à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales internationales.
Le principal moyen de pression sur les centres offshore afin de les pousser à une mise en conformité à l’égard des recommandations ou normes internationales a consisté à la fin des années 1990 à mener une politique de stigmatisation (« name and shame »). Ce sont bien sûr les recommandations du GAFI, révisées en 1996 et 2003, les travaux du FMI, les évaluations du Forum de stabilité de financière, les travaux de l’OCDE et la publication des listes noires correspondantes. L’existence de coûts de réputation internationale a été prise en compte, renchérissant le coût de la non-conformité ou de contournement des normes (notamment augmentation du taux des commissions payées aux intermédiaires établis dans les paradis fiscaux, réglementation prudentielle de type Bâle II). Le risque de réputation est devenu un enjeu y compris de survie pour certaines places. Les acteurs du monde de la finance ont réagi en prenant des engagements sur leur contrôle interne. On peut citer les « principes de Wolfsberg », charte de bonne conduite mise en place par des banques suisses en 2000 pour fixer leurs engagements contre l’anonymat favorisant le blanchiment.
Le sujet de la fraude et de l’évasion fiscales a cependant été habilement écarté, tant par certains grands États qui ne souhaitaient pas remettre en cause le fonctionnement de la finance mondiale et le mouvement d’abaissement général de la fiscalité, que par les États non coopératifs qui se sont empressés pour nombre d’entre eux de promouvoir et afficher une excellente coopération sur les questions de blanchiment et, à partir de 2001, de terrorisme. Il est frappant de voir la diligence avec laquelle certains territoires coopèrent en matière pénale pour assurer leur réputation de place « propre ». La coopération est ainsi bien meilleure qu’avec certains de nos voisins européens dont les établissements sont pourtant parfois impliqués dans du blanchiment de grande envergure (affaire Abacha pour ne citer qu’un cas célèbre).
Jusque très récemment, une séparation stricte entre questions fiscales et questions de blanchiment s’est établie, alors même que la perméabilité des activités est évidente. L’affaire Enron est là pour démontrer cette imbrication. Plus généralement, comment dissocier une manipulation comptable permise par l’opacité réglementaire et le régime fiscal qui en découle, ou le blanchiment de sommes issues d’activités occultes et la nature imposable (et chargeable) de ces sommes, ou encore l’origine des revenus et la déclaration de ces revenus ?
La lutte contre la fraude et l’évasion fiscales a connu un faux départ. Si les travaux engagés tant par l’OCDE que par la Commission européenne ont permis des avancées certaines, ils n’ont pas attaqué le cœur du système, c’est-à-dire le secret. Leurs travaux ont plus régulé la concurrence fiscale, sans parvenir d’ailleurs à la maîtriser, qu’accru la transparence. C’est donc, rétrospectivement, un véritable renversement de perspective qui s’opère aujourd’hui où priorité est donnée, non pas à la provenance des fonds et activités, mais à leur environnement réglementaire et fiscal, instaurant une forme de soupçon systématique de fraude, de blanchiment, d’activités criminelles, d’évasion fiscale, tant que ces territoires eux-mêmes ne disposent pas d’informations nécessaires et suffisantes leur permettant d’exercer une surveillance ou qu’ils se refusent à les transmettre.
A.– 15 ANS D’AVANCÉES MULTIPLES MAIS DISPARATES
1.– Les travaux de l’OCDE : la régulation de l’économie mondialisée
a) La détermination des prix de transfert
C’est dans le cadre de l’OCDE qu’ont été conduits les travaux relatifs à la réduction des risques de conflits fiscaux, notamment en régulant les bases d’imposition. Deux publications sont ainsi essentielles : le modèle de convention fiscale destinée à éviter la double imposition, posant les principes d’attribution du droit à imposer et comportant une procédure amiable, et les règles applicables en matière de prix de transfert.
Les entreprises multinationales doivent établir leurs prix de transfert en respectant le principe de « pleine concurrence », c’est-à-dire en utilisant des prix qui soient comparables à ceux qui seraient pratiqués entre deux entreprises indépendantes dans des conditions similaires. Ce principe est défini à l’article 9 du modèle de convention relatif aux entreprises associées, ci-après reproduit, qui énonce que les bénéfices d’entreprises associées doivent être déterminés dans des conditions analogues à ce qui serait convenu entre des entreprises indépendantes.
ARTICLE 9 – ENTREPRISES ASSOCIÉES 1. Lorsque : |
a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que |
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. |
2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent. |
L’OCDE a publié des lignes directrices concernant les modalités d’application pratique du principe de « pleine concurrence » dès 1979. Elles ont fait l’objet d’une révision substantielle en 1995. Les biens ou services échangés au sein d’un groupe n’ont souvent pas d’équivalent sur le marché. L’OCDE a publié des méthodes visant à établir et contrôler les prix de transfert, contenues dans le rapport intitulé « Principes applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales », approuvé par le Conseil de l’OCDE le 13 juillet 1995 et mis à jour en 1999.
D’après l’article 9 du modèle de convention précité, lorsqu’un État procède sur son fondement à une correction des bénéfices, ce qui peut être le cas en matière de prix de transfert dans de nombreux États, l’État où est située l’autre entreprise accorde à celle-ci, s’il l’estime justifié, un ajustement permettant d’éviter la double imposition de mêmes opérations. Pour la détermination de cet ajustement, la procédure amiable prévue dans les conventions fiscales bilatérales en cas de double imposition (article 25 de la convention modèle OCDE ci-après reproduit) est mise en œuvre : le contribuable peut demander l’ouverture d’une telle procédure afin que les autorités des pays concernés s’accordent sur la répartition de la compétence d’imposition.
b) Les principes de lutte contre les pratiques dommageables, la fraude et l’évasion fiscales
L’OCDE travaille depuis 1996 sur les pratiques fiscales dommageables dans le cadre du forum sur les pratiques fiscales dommageables. Le rapport Concurrence fiscale dommageable : un problème mondial, datant de 1998, identifie 47 régimes fiscaux préférentiels dommageables au sein de certains des États de l’OCDE et définit les critères qualifiant les territoires non coopératifs, précédemment rappelés. Les États s’engagent en 2004 à ce que tous les régimes fiscaux préférentiels identifiés soient abolis, amendés ou considérés comme non dommageables. Le seul régime encore en vigueur était celui des sociétés holding de 1929 du Luxembourg. En décembre 2006, le Luxembourg a adopté une législation visant à supprimer ce régime d’ici la fin de 2010.
Concernant les juridictions non coopératives, l’OCDE en a identifié 41. 6 ont immédiatement pris un simple engagement d’améliorer leurs pratiques fiscales : les Bermudes, les Îles Caïman, Saint-Martin, l’Île Maurice, Chypre et Malte. Elles ne figurent donc pas dans la liste établie dans le rapport sur « Les progrès dans l’identification et l’élimination des pratiques fiscales dommageables » de 2000. Entre 2000 et 2002, l’OCDE a engagé un dialogue et obtenu leur engagement à appliquer les normes de transparence et d’échanges de renseignements. Sur les 35 juridictions, seules trois ont refusé de s’engager à une plus grande transparence en levant le secret bancaire en matière de fraude puis d’évasions fiscales : Andorre, Monaco et le Liechtenstein (les Îles Marshall, le Libéria, Nauru et Vanuatu figuraient encore dans la liste noire en 2002). Ces trois juridictions constituent la liste noire résiduelle. Les autres ont acquis le statut de « partenaires coopératifs ». Des économies non membres de l’OCDE ont également adopté les principes de transparence : l’Afrique du Sud, l’Argentine, la Chine, les Émirats arabes unis, la Russie, Hongkong, Macao et la Chine.
Les principes de l’OCDE sont notamment énoncés dans le Modèle d’accord d’échange de renseignements adopté en 2002 ainsi que dans l’article 26 du modèle de convention fiscale de l’OCDE, relatif à l’assistance administrative tel qu’actualisé en 2004. En vertu de ces principes, un État ne peut décliner d’échanger de l’information au seul motif que cette information est détenue par une banque ou une institution financière ou que l’administration de l’État requis n’aurait pas besoin de cette information pour asseoir ses propres impôts.
L’article 26 établit une obligation d’échanger des renseignements qui sont vraisemblablement pertinents pour l’application correcte d’une convention fiscale ainsi que pour la gestion et l’application des législations fiscales nationales des États contractants. En formulant leurs demandes, les États requérants doivent démontrer la pertinence prévisible des renseignements demandés. En outre, l’État requérant doit avoir eu recours à tous les moyens dont il dispose dans le cadre national pour se procurer les informations demandées sauf lorsque cela donnerait lieu à des difficultés disproportionnées.
L’article 26 a été mis à jour en juillet 2005, avec l’ajout des paragraphes 4 et 5, qui précisent qu’un État ne peut pas refuser une demande de renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national (paragraphe 4) ou parce que ceux-ci sont détenus par une banque ou un autre établissement financier (paragraphe 5). Une définition restrictive de la fraude ou une législation rendant difficile l’accès à des informations nominatives dans l’État saisi sont sans effet : l’État doit répondre. Le secret bancaire n’est pas incompatible avec les clauses de l’article 26 qui ne prévoit que des exceptions limitées soumises à des règles strictes de confidentialité. Notamment, les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés qu’aux fins prévues dans la convention. L’édition du Modèle de convention fiscale de l’OCDE mise à jour au 17 juillet 2008 indique que l’Autriche, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse avaient émis des réserves sur cet article (24).
ARTICLE 26 : ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l’autre État contractant ; b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant ; c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. 4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national. 5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. |
c) Les modalités de mises en œuvre des principes de l’OCDE pour une coopération effective
Le Forum mondial sur la fiscalité est une enceinte dans laquelle sont associés les paradis fiscaux ayant décidé de coopérer en s’engageant sur les principes de l’OCDE ainsi que d’autres places financières ou des pays non membres de l’OCDE. Il a défini en 2004 et 2005 une série de mesures individuelles, bilatérales et collectives devant permettre de promouvoir la mise en place de règles du jeu équitables, certains pays ne faisant pas preuve de la même volonté dans le respect des engagements souscrits. Il produit depuis 2006 un rapport annuel « Évaluation par le Forum Mondial sur la fiscalité, vers l’établissement de règles du jeu équitables » qui retrace l’état de la situation dans chacune des juridictions examinées.
L’échange de renseignements en matière fiscale est effectif lorsque des renseignements fiables, susceptibles d’être pertinents et respectant les obligations fiscales d’une juridiction requérante sont disponibles ou peuvent être rendus disponibles dans les délais impartis, et lorsqu’il existe des dispositifs juridiques permettant l’obtention et l’échange de renseignements.
Cela suppose d’abord l’existence de règles claires de tenue des registres comptables et d’accès à ces registres. Un document a été élaboré conjointement par des pays membres et non membres de l’OCDE grâce à leur coopération au sein du Groupe ad hoc conjoint sur la comptabilité co-présidé par la France (« groupe JAHGA »), qui se concentre sur l’accès à des renseignements fiables et vraisemblablement pertinents et sur leur disponibilité (25).Les registres comptables sont fiables s’ils exposent correctement l’ensemble des transactions, permettent de déterminer à tout moment la situation financière de l’entreprise avec une certaine précision et enfin permettent la préparation des états financiers. Pour être fiables, les registres comptables doivent par ailleurs inclure les pièces comptables, comme les factures, contrats, etc. et doivent comporter des précisions sur toutes les sommes reçues et versées et l’objet de ces recettes ou versements, toutes les cessions ou acquisitions et autres transactions et les actifs et passifs de l’entité pertinente. L’importance des registres comptables d’une entité pertinente donnée dépend de la complexité et de l’échelle de ses activités mais doit, dans tous les cas, suffire à la préparation des états financiers. Les registres comptables doivent être conservés pendant une durée minimale de cinq ans.
Ensuite, l’accès aux renseignements suppose de mettre fin à l’anonymat des entités diverses qui, de par cette caractéristique, sont utilisées pour le blanchiment d’argent, la corruption, la dissimulation d’actifs au détriment de créanciers, la fraude fiscale, les opérations irrégulières pour compte propre, le financement du terrorisme, les infractions boursières et bien d’autres activités illicites. L’OCDE a publié en mai 2000 un rapport intitulé « Au-delà des apparences : l’utilisation des entités juridiques à des fins illicites ». Il dresse le constat selon lequel les entités juridiques donnant lieu aux abus les plus fréquents sont celles qui assurent à leurs bénéficiaires effectifs un anonymat maximum. Il enjoint les gouvernements à lutter contre ces abus par l’obtention de renseignements sur les bénéficiaires effectifs et le contrôle des entités juridiques et, le cas échéant, à échanger ces informations avec les autorités chargées de l’application des lois, sur le plan national et international. Plus précisément, l’OCDE recommande que les gouvernements étudient les mesures à prendre pour :
– imposer la déclaration préalable des bénéficiaires effectifs et du contrôle aux autorités lors de la création de l’entité juridique ;
– obliger les intermédiaires qui participent à la formation et à la gestion des entités juridiques (notamment les mandataires pour la création d’une société, les agents et sociétés fiduciaires, les avocats et les autres professions juridiques) à recueillir ces informations ;
– mettre en place les infrastructures juridiques qui leur permettront d’enquêter sur les bénéficiaires effectifs et le contrôle en cas de suspicion d’activité illicite.
Enfin, l’accès à l’information suppose que les administrations aient accès et divulguent les informations bancaires. Cela implique une capacité juridique (contrôle, pouvoirs d’enquête, droit d’accès à l’information), une capacité pratique (qualité et exhaustivité des informations, y compris comptables, transparence des données individuelles) et une volonté d’échanger ces informations. Parallèlement aux travaux sur les pratiques dommageables, un rapport a été publié en 2000 intitulé « Améliorer l’accès aux renseignements bancaires à des fins fiscales » qui énonce : « tous les pays membres devraient permettre l’accès aux renseignements bancaires directement ou indirectement à toutes fins fiscales, de façon que les autorités fiscales puissent s’acquitter totalement de leur mission de recouvrement de recettes publiques et procéder à des échanges efficaces de renseignements avec leurs partenaires conventionnels ».
Deux rapports d’étape ont été publiés, en 2003 et 2007. Certains États ou territoires ont une interprétation restrictive de l’accès aux renseignements bancaires. L’OCDE définit des normes d’accès aux standards bancaires, qui supposent la mise en œuvre de mesures pour contraindre les institutions financières à identifier les clients et bénéficiaires de comptes ou opérations, le fait de supprimer la condition d’un intérêt fiscal national qui empêche les administrations d’accéder aux informations, enfin, des procédures qui ne doivent pas être si complexes et si longues qu’elles reviendraient à entraver l’accès aux renseignements bancaires. Le rapport de 2003 a également établi une définition commune de la fraude qui a été adoptée par tous les États membres autres que le Luxembourg et la Suisse.
d) Les résultats décevants des engagements pris au début des années 2000
Des progrès avaient été enregistrés au 1er janvier 2009 :
– Depuis 2000, 47 accords d’échange de renseignements avaient été signés entre des pays de l’OCDE et 11 des juridictions identifiées comme paradis fiscaux. En 2007, 12 accords d’échange de renseignements ont été signés. En 2008, 22 nouveaux accords ont été conclus ;
– À la suite des modifications de la législation de Malte entrées en vigueur en janvier 2008, les autorités fiscales maltaises avaient accès aux informations bancaires en vue d’échanger ces informations dans les affaires fiscales de toute nature, dès lors qu’il existe des mécanismes d’échange réciproque de renseignements ;
– Chypre avait annoncé l’adoption, le 10 juillet 2008, d’une législation supprimant la condition d’intérêt fiscal national et permettant l’échange de renseignements bancaires à toutes fins fiscales dans le cadre d’une convention de double imposition ;
– La Belgique échangeait des informations bancaires sur demande dans les affaires fiscales de nature civile ou pénale, en vertu de sa nouvelle convention fiscale avec les États-Unis ;
– La Suisse avait progressé sur la voie de l’accès aux renseignements bancaires à des fins fiscales pénales en signant un certain nombre de protocoles à ses conventions fiscales bilatérales.
Cependant, en 2008, force était de constater que des obstacles à la levée du secret bancaire à des fins fiscales persistaient dans des places financières importantes, y compris dans les pays membres de l’OCDE, et que l’accès à l’information par les administrations locales demeurait incomplet. Le rapport d’étape « Améliorer l’accès aux renseignements bancaires à des fins fiscales » de 2007 identifie les pays disposant d’un accès aux informations bancaires limité. Le Guatemala, Nauru et Panama sont dans l’incapacité d’obtenir des informations bancaires. Dans certains pays, certaines juridictions n’ont accès à ces informations que s’il existe un intérêt fiscal national. C’est le cas de Chypre, Hong Kong, la Malaisie, les Philippines et Singapour. Certains pays imposent des limites strictes à l’échange de renseignements bancaires à des fins fiscales dans le cadre d’affaires civiles : Autriche, Luxembourg, Suisse. L’édition 2008 du rapport « Évaluation par le Forum Mondial sur la fiscalité, vers l’établissement de règles du jeu équitables » évaluait la situation dans 84 pays. Cette évaluation rappelle que des restrictions à l’accès aux renseignements bancaires à des fins fiscales subsistent dans trois pays de l’OCDE – Autriche, Luxembourg et Suisse – ainsi que dans un certain nombre de centres financiers offshore, parmi lesquels le Liechtenstein, le Panama et Singapour.
Enfin, un certain nombre de juridictions n’avaient tout simplement pas rempli leurs engagements. La pression politique s’était relâchée. Les paradis fiscaux faisaient valoir qu’ils appliqueraient les standards lorsqu’il existerait un level playing field, c’est-à-dire des règles du jeu équitables et s’appliquant de la même façon à tous. Les paradis fiscaux soulignaient à cet égard que quatre États de l’OCDE pratiquaient le secret bancaire et que des centres financiers importants ne participaient pas aux travaux. Seules quelques juridictions avaient en réalité fait de nets progrès : Jersey, Guernesey, Man, les Antilles néerlandaises et Aruba. Cela représentait moins d’une cinquantaine d’accords d’échanges de renseignements au total. La majorité des paradis fiscaux, quoiqu’ils se fussent engagés à appliquer les principes de l’OCDE, n’avaient pas conclu d’accords d’échange de renseignements au 1er janvier 2009. Parmi les juridictions à enjeu pour la France, on peut rappeler que les juridictions suivantes n’avaient pas concrétisé leurs engagements formels : les Îles Caïman, l’Île Maurice, San-Marin, Panama, Gibraltar, Barhein et les Îles vierges britanniques.
2.– Les ambiguïtés de la Communauté européenne dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales
« L’affaire Parmalat a montré la manière dont certaines sociétés recouraient à des structures complexes et opaques afin de rendre leurs activités moins transparentes pour les investisseurs » constatait Frits Bolkestein en 2004. En réaction, en septembre 2004, la Commission adopte une communication intitulée « Prévenir et combattre les malversations financières et pratiques irrégulières des sociétés » établissant une stratégie visant à réduire les risques de malversations financières par une action coordonnée en ce qui concerne les services financiers, le droit des sociétés, la comptabilité, la fiscalité ainsi que la surveillance et l’application effective des règles. En matière fiscale, la Commission préconise plus de transparence et un renforcement de l’échange d’informations dans le domaine de l’impôt des sociétés afin que les autorités fiscales soient mieux armées face aux structures d’entreprise complexes. Les questions soulevées incluent d’éventuelles améliorations de la directive sur l’assistance mutuelle (77/799/CEE), l’élaboration de définitions communes de l’évasion et de la fraude fiscales, l’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre administrations fiscales, l’utilisation des nouvelles technologies pour améliorer l’échange d’informations et, à plus long terme, l’examen, avec les États membres, de la possibilité d’instaurer un numéro d’identification commun pour les sociétés aux fins de l’impôt. La Commission souhaite en outre renforcer la cohérence des politiques de l’Union relatives aux centres financiers offshore, afin d’encourager ces juridictions à évoluer elles aussi vers plus de transparence et un réel échange d’informations. Notamment, la transparence des structures financières ad hoc (SPV) doit ainsi être améliorée dans les bilans.
Voilà où en était l’Union européenne dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales avant l’éclatement de la crise et qui faisait d’elle la zone la plus avancée en la matière. Elle avait forgé et appliqué une doctrine de régulation de la concurrence fiscale sur son territoire. Elle disposait d’outils d’assistance administrative et d’échange d’information entre ses membres et avec certains États ou territoires tiers. Enfin, elle appelait à une position unie en faveur d’une plus grande transparence des acteurs du marché international (sociétés, entités, territoires), terrain sur lequel elle se retrouvait relativement isolée.
a) La lutte contre la concurrence fiscale dommageable et pour la transparence : la trilogie des codes de conduite
Un premier code de conduite fondamental dans le domaine de la fiscalité des entreprises a été présenté dans les conclusions du Conseil des ministres de l’économie et des finances (ECOFIN) le 1er décembre 1997. Bien que ce code ne soit pas un instrument juridiquement contraignant, il comporte l’engagement politique d’éliminer les mesures fiscales qui engendrent une concurrence fiscale dommageable, ainsi que de s’abstenir d’introduire toute nouvelle mesure ayant cet effet. Lors de l’adoption du code, le Conseil a affirmé qu’une concurrence loyale pouvait avoir des effets bénéfiques. C’est pourquoi le code a été spécifiquement conçu pour ne dépister que les mesures qui faussent la localisation des activités économiques dans la Communauté par le fait qu’elles visent uniquement les non-résidents et leur accordent un traitement fiscal plus favorable que celui qui est normalement applicable dans l’État membre en cause. Le code définit des critères pour inventorier ces mesures potentiellement dommageables.
Le code de conduite exige des États membres qu’ils s’abstiennent d’instaurer de nouvelles mesures fiscales dommageables (« gel ») et modifient leurs dispositions ou pratiques considérées comme préjudiciables à la lumière des principes sur lesquels repose le code (« démantèlement »). Il vise les mesures fiscales (législatives, réglementaires et administratives) ayant ou pouvant avoir une incidence sensible sur la localisation des activités économiques au sein de l’Union. Les critères qui permettent de déceler des mesures potentiellement dommageables sont les suivants :
– un niveau d’imposition effective nettement inférieur au niveau général du pays concerné ;
– des facilités fiscales réservées aux non-résidents ;
– des incitations fiscales en faveur d’activités qui n’ont pas trait à l’économie locale, de sorte qu’elles n’ont pas d’impact sur l’assiette fiscale nationale ;
– l’octroi d’avantages fiscaux même en l’absence de toute activité économique réelle ;
– des règles pour la détermination des bénéfices des entreprises faisant partie d’un groupe multinational qui divergent des normes généralement admises au niveau international, notamment de celles approuvées par l’OCDE ;
– le manque de transparence des mesures fiscales.
À l’occasion de la réunion du Conseil du 9 mars 1998, les ministres des finances de l’UE ont créé un groupe « code de conduite », placé sous la présidence de Mme Dawn Primarolo, chargé d’évaluer les mesures fiscales susceptibles d’entrer dans le champ d’application du code de conduite. Dans un rapport de novembre 1999, ce groupe a relevé 66 mesures fiscales présentant des éléments dommageables (40 dans les États membres de l’UE, 3 à Gibraltar et 23 dans les territoires dépendants ou associés).
Les États membres et leurs territoires dépendants ou associés ont aujourd’hui révisé ou remplacé les 66 mesures en question ou s’emploient à le faire. Pour les entités qui bénéficiaient de ces régimes jusqu’au 31 décembre 2000 inclus, une clause de droits acquis a été prévue selon laquelle leurs avantages doivent prendre fin au plus tard le 31 décembre 2005, qu’ils aient ou non été accordés pour une durée fixe. Pour certaines mesures en vigueur dans les États membres et leurs territoires dépendants ou associés, des prorogations au-delà de 2005 ont été convenues pour des durées déterminées. Depuis lors, le groupe « code de conduite » assure le suivi du gel et de la mise en œuvre du démantèlement, et en fait régulièrement rapport au Conseil. Pour autant, aucun rapport n’a paru faisant le point depuis celui du 9 février 2004.
Dans le même temps, le forum conjoint de l’Union européenne sur les prix de transfert a été créé en juillet 2002. Il se compose d’un expert de l’administration fiscale de chaque État membre et de dix experts de haut niveau représentant le secteur des entreprises, ainsi que d’un président. Des représentants de l’OCDE et des pays adhérents y participent en tant qu’observateurs. Dans sa communication du 23 avril 2004 concernant les travaux menés par le forum conjoint de l’Union européenne sur les prix de transfert dans le domaine de la fiscalité des entreprises (COM (2004) 297), la Commission européenne a proposé un code de conduite pour la mise en œuvre effective de la Convention d’arbitrage. La convention 90/436/CEE relative à l’élimination des doubles impositions dans le cas de correction des bénéfices entre entreprises associées, dont le protocole de prorogation du 25 mai 1995 est entré en vigueur à compter du 1er novembre 2004, a la particularité de rendre l’arbitrage obligatoire. Elle s’applique aux cas visés à l’article 9 du modèle de convention OCDE. Le code de conduite comprend des règles procédurales concernant, notamment, les points de départ des périodes fixées pour le traitement des réclamations, les modalités de fonctionnement de la commission consultative et la suspension du recouvrement des dettes fiscales pendant la durée des procédures de résolution des différends.
Enfin, la Commission européenne a adopté en novembre 2005 une autre proposition de code de conduite sur les prix de transfert inspirée des travaux du forum conjoint. Ce code vise à harmoniser la documentation que les entreprises multinationales doivent fournir aux autorités fiscales au sujet de la méthode de fixation des prix de transfert qu’elles utilisent pour leurs transactions intragroupe transfrontalières. La documentation que les entreprises multinationales seraient tenues de fournir aux administrations fiscales pour illustrer la méthode de fixation des prix de transfert appliquée pour leurs activités intragroupe transfrontalières se composerait de deux parties principales :
– un jeu de documents (« masterfile ») fournissant une description générale de l’entreprise et de sa méthode de fixation des prix de transfert, valable et disponible pour tous les États membres de l’UE concernés. Ces documents doivent décrire, dans les grandes lignes, l’entreprise et sa stratégie commerciale ainsi que les transactions impliquant des entreprises associées dans l’UE et la politique de l’entreprise en matière de fixation des prix de transfert ;
– un jeu de documents harmonisés spécifique à chaque pays concerné par les transactions intragroupe. Cette documentation, qui serait uniquement accessible au pays concerné, fournirait des informations sur les montants des flux de transactions au sein de ce pays, de même que sur les clauses contractuelles et les méthodes particulières de fixation des prix de transfert utilisées.
La documentation en matière de prix de transfert au sein de l’UE devait permettre d’améliorer à la fois la qualité des informations fournies par les entreprises et le respect, par les contribuables, des exigences des États membres en matière de documentation relative aux prix de transfert. Le code a un caractère facultatif pour les entreprises. Il couvre toutes les entités du groupe établies dans l’UE, ainsi que les transactions entre ces entités et les entreprises associées établies dans des pays tiers. Ce second code de conduite qui comporte des exigences de transparence fut moins populaire que le premier. L’Espagne et l’Allemagne ont toutefois mis en place des obligations sur cette base.
Pour l’Union européenne, l’assistance administrative mutuelle internationale en matière douanière entre États membres repose sur une double base juridique :
– Le règlement (CE) n° 515/97 prévoit les échanges d’informations sur les infractions douanières et notamment sur les déclarations de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers ;
– La convention relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre administrations douanières dite « Convention de Naples II » permet la mise en œuvre d’une coopération opérationnelle renforcée : transmission d’informations relatives aux contentieux réalisés, aux enquêtes, aux flux financiers intracommunautaires, aux données à caractère personnel.
Au niveau communautaire, la coopération douanière est très satisfaisante. La transmission de certaines informations en matière financière peut toutefois faire l’objet de restrictions. Les délais de réponse peuvent s’avérer assez longs en raison des difficultés rencontrées par nos partenaires pour obtenir les renseignements sollicités (autre administration compétente dans ce domaine, saisine des établissements financiers).
En matière fiscale, la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l’assistance mutuelle dans le domaine des impôts directs, de certains droits d’accises et des taxes sur les primes d’assurance organise les modalités d’échanges d’informations entre les États membres, à savoir un échange sur demande, un échange automatique et un échange spontané d’informations. Récemment, la directive 2003/93/CE du Conseil du 7 octobre 2003 l’a étendue aux taxes sur les primes d’assurance (nouvelles procédures de notification et de contrôles simultanés et élargissement de la procédure d’échange d’informations à la taxe sur les primes d’assurance). La directive 2004/56/CE du Conseil du 21 avril 2004 modifie ou complète les procédures d’assistance mutuelle en prévoyant de nouvelles procédures de notification et de contrôles simultanés.
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA), elle, fait l’objet d’un texte distinct ne nécessitant pas de transposition, en l’occurrence le règlement 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la TVA.
En vue d’un échange de renseignements, des contrôles effectués simultanément par plusieurs États membres peuvent être efficaces lorsque la situation fiscale d’un ou plusieurs contribuables présente « un intérêt commun ou complémentaire ». L’autorité compétente de chaque État membre identifie les contribuables ou redevables pour lesquels elle a l’intention de proposer un contrôle simultané et en informe les autorités de chaque autre État membre. Si celles-ci en sont d’accord, chaque autorité désigne un représentant chargé de diriger le contrôle, qui se déroule pour chacune sur son propre territoire. Les administrations se coordonnent pour suivre les résultats des contrôles et échanger les informations recueillies. Ces contrôles simultanés, existent aussi dans le cadre de plusieurs conventions bilatérales et permettent par exemple de découvrir des minorations des bases imposables dans les deux pays ou encore d’éviter les doubles impositions. En outre, la directive 77/799/CEE prévoit une procédure d’échange de renseignements permettant de communiquer aux administrations des États membres de la Communauté européenne des « renseignements pour l’établissement et le recouvrement des impôts ». La procédure d’échanges d’informations, dite aussi de « coopération administrative » existe pour l’impôt sur le revenu, l’impôt sur la fortune, la TVA et la taxe sur les primes d’assurance.
Par ailleurs, il existe également une directive 2008/55/CE du Conseil du 26 mai 2008 concernant l’assistance en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures. Il s’agit en réalité de la version codifiée de la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant des opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, et relative à la taxe ajoutée. La directive permet à la fois un échange d’informations sur demande entre les États membres afin d’établir les possibilités de recouvrement et une assistance au recouvrement permettant aussi bien la notification de documents que le recouvrement des créances fiscales à la demande d’un État membre par un autre État membre.
La directive 2003/48/CE du Conseil de l’Union européenne du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts est issue du constat de la diversité des régimes fiscaux nationaux, notamment de son caractère dommageable en ce qui concerne le traitement favorable réservé par certains États aux intérêts payés à des non-résidents. Profitant de la libre circulation des capitaux et en l’absence de coordination des régimes nationaux, certains résidents d’États membres échappaient à toute imposition, alors même que ces intérêts constituaient des revenus imposables dans tous les États membres. Outre les distorsions dans l’imposition effective des revenus, l’absence de normalisation favorisait l’évasion fiscale des revenus de l’épargne et accentuait la pression fiscale sur les revenus moins mobiles. La directive vise spécifiquement les intérêts versés à des particuliers, résidents d’un autre État membre que l’État de la source. Elle se fonde sur le modèle dit de la « coexistence » entre deux systèmes : celui de l’application d’une retenue à la source et celui de la fourniture aux autres États membres d’informations sur les revenus de l’épargne de leurs résidents.
La directive s’applique aux intérêts tels que définis par le modèle de convention fiscale concernant les revenus de l’OCDE : il s’agit, ainsi que le prévoit l’article 6 de ce modèle, des « intérêts payés qui se rapportent à des revenus de créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus de fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci ». S’y ajoutent les « intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat de créances », ainsi que les revenus provenant de paiements d’intérêts distribués par des organismes de placement collectif de valeurs mobilières (OPCVM « de distribution ») communautaireset les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d’unités de ces mêmes OPCVM, à condition qu’ils aient investi plus de 40 % de leurs actifs dans des créances telles que définies précédemment (OPCVM « de capitalisation »). Si ce seuil de 40 % est atteint, la directive permet de considérer la totalité du revenu comme un intérêt, entrant donc dans son champ. À compter du 1er janvier 2011, ce pourcentage de 40 % sera abaissé à 15 %.
La directive impose des obligations précises et étendues à l’agent payeur et non au contribuable, bénéficiaire des intérêts, qui reste soumis aux obligations fiscales de son État de résidence, étant précisé que l’agent payeur peut être « soit le débiteur de la créance produisant les intérêts ou l’opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou d’en attribuer le paiement ». Lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts est résident d’un État membre autre que celui où est établi l’agent payeur, celui-ci aura la responsabilité et l’obligation de communiquer à l’État membre où il est établi :
– son nom ou sa dénomination ainsi que son adresse ;
– l’identité et la résidence du bénéficiaire effectif ainsi que « son numéro de compte [...] ou, à défaut, l’identification de la créance génératrice des intérêts » ;
– ainsi que des informations concernant le paiement des intérêts permettant de les identifier par catégorie.
La directive ne s’applique que si le bénéficiaire effectif est une personne physique qui bénéficie du paiement d’intérêts pour son compte propre.
La directive permet à la plupart des pays européens d’échanger des informations sur l’épargne des non résidents placée dans leurs banques et d’améliorer la lutte contre la fraude fiscale. Le Luxembourg, l’Autriche et la Belgique ont cependant choisi de percevoir une retenue à la source sur les revenus, préservant ainsi leur secret bancaire. Ces trois pays reverseront 75 % des recettes au pays d’origine. La retenue a été fixée à 15 % pendant les trois premières années d’application de la directive, c’est-à-dire du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, 20 % pendant les trois années suivantes, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2010 et 35 % par la suite. Cependant, cette dérogation à l’échange d’informations ne pourra perdurer que pendant une période provisoire, prenant fin à la fin du premier exercice fiscal complet qui suit la dernière des dates suivantes :
– l’entrée en vigueur du dernier accord sur l’échange d’informations conclu entre la Communauté européenne, d’une part, et, respectivement, la Suisse, le Lichtenstein, Saint-Marin, Monaco et Andorre, d’autre part ;
– la date à laquelle les États-Unis s’engagent à échanger les informations sur le paiement des intérêts conformément au modèle de convention de l’OCDE.
L’entrée en vigueur de la directive elle-même était conditionnée à l’application de la retenue à la source ou de l’échange d’information par la Suisse, le Liechtenstein, Saint-Marin, Monaco et Andorre, ainsi que par tous les territoires dépendants ou associés visés (îles anglo-normandes, Île de Man et territoires dépendants ou associés des Caraïbes). Elle était effective au 1er juillet 2005.
L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA DIRECTIVE ÉPARGNE L’article 17 de la directive fixe au 1er janvier 2005 l’entrée en vigueur de ces dispositions, mais la conditionne à l’application par la Suisse, le Liechtenstein, Saint-Marin, Monaco et Andorre, ainsi que par tous les territoires dépendants ou associés visés (îles anglo-normandes, île de Man et territoires dépendants ou associés des Caraïbes) de mesures équivalentes, c’est-à-dire l’échange d’informations ou la retenue à la source aux taux précités. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la directive ne semblaient alors pas soulever de difficultés, à l’exclusion de l’accord avec la Suisse, devant intégrer dans son droit interne le principe et le taux de la retenue à la source et dont le système fédéral était susceptible d’allonger les délais d’adoption. Par décision du 16 octobre 2001, le Conseil avait autorisé la Commission à négocier avec les pays tiers précités ainsi que les États-Unis, en vue de conclure des accords stipulant l’adoption par ces pays de mesures équivalentes à celles qui doivent être appliquées au sein de la Communauté européenne, garantissant l’imposition effective des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts. Un accord a été conclu avec tous les pays tiers (accord signé le 26 octobre 2004 suite aux conclusions du sommet Suisse – Union européenne du 19 mai 2004). Ces territoires ont accepté la retenue à la source sous deux conditions : l’absence de réciprocité, et la possibilité pour le contribuable d’échapper à la retenue à la source, avec pour Andorre la possibilité de fournir un certificat à l’agent payeur établi par l’administration de son État, pour les autres la divulgation à la demande du contribuable des informations le concernant à son État membre. C’est en raison de difficultés survenues avec la Suisse que les États membres de l’UE ont finalement convenu d’un report de six mois de la directive européenne sur l’harmonisation de la fiscalité sur l’épargne. La nouvelle échéance a été fixée au 1er juillet 2005 par décision du Conseil du 19 juillet 2004 (26) (27). Dès le début, les négociations avec la Suisse ont été difficiles. La Suisse a adopté un mandat de négociation sur la fiscalité de l’épargne le 30 janvier 2002, mais a refusé d’entamer les négociations avant l’ouverture d’autres mandats, adoptés par le Conseil le 17 juin 2002. Au cours des négociations qui ont suivi, elle a demandé à pouvoir bénéficier des régimes communs relatifs aux sociétés mères et filiales de la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 et aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents. Ces requêtes ont été prises en compte, avec une réserve pour l’Espagne consistant en une condition préalable de conclusion d’un accord bilatéral d’échanges d’informations en cas de fraude fiscale ou de délits assimilés s’agissant de sources de revenus non assujetties à l’accord mais couvertes par des conventions ou accords. Le protocole d’accord auxiliaire qui accompagne le projet définitif de juin 2003 contient d’ailleurs un engagement d’ouverture de négociations en vue d’inclure dans les conventions respectives de telles clauses, ainsi qu’une définition de la catégorie de « délits assimilés ». Cependant, la Suisse a finalement refusé la date d’entrée en vigueur du 1er janvier 2005, invoquant les délais et l’incertitude de la procédure de ratification, du fait de l’existence de référendums d’initiative populaire. |
Les résultats de la directive sont en demi-teinte.
Au niveau européen, la Commission européenne a présenté une évaluation dans un rapport au Conseil le 15 septembre 2008 (COM (2008) 552 final), avec un document de travail annexé (SEC (2008) 2420). Certaines données ont depuis lors été actualisées. Par exemple, l’Italie aurait pour sa part obtenu la rétrocession de 365 millions d’euros de la part de la Suisse en 2008. S’agissant de 2005 et 2006, le rapport indique que :
– Parmi les pays procédant à l’échange d’informations, ce sont les plus grandes économies qui affichent les valeurs les plus élevées. Le Royaume-Uni a ainsi communiqué un montant de 9,1 milliards d’euros pour les paiements effectués au cours de la période allant du 1er juillet 2005 au 5 avril 2006 (fin de l’exercice fiscal) ;
– Le produit de la retenue à la source perçue par les États qui se refusent à l’échange automatique d’informations se répartit ainsi, par ordre décroissant de recette : par la Suisse (255 millions d’euros, soit 45 % du produit total), le Luxembourg (125 millions, soit 22 %), l’Autriche (44 millions, soit 7,4 %), Jersey (32,15 millions, soit 6,2 %), la Belgique (26 millions, soit 4,6 %), suivis de l’Ile de Man (20,35 millions), Guernesey (16,8 millions), Andorre (12,8 millions), Monaco (11,7 millions d’euros), San Marin (7,5 millions d’euros), le Liechtenstein (7,1 millions d’euros) (28).On note que la Suisse et le Luxembourg totalisent 67 % du produit ;
– Les reversements concernent, par ordre décroissant : l’Allemagne (192,7 millions d’euros pour 2005 et 2006), l’Italie (112,9 millions d’euros), le Royaume-Uni (105,2 millions d’euros), la Belgique (71,6 millions d’euros, dont les trois quarts en provenance du Luxembourg), la France (62,8 millions d’euros), l’Espagne (48,8 millions d’euros), les Pays-Bas (22,6 millions d’euros) et la Grèce (13,7 millions d’euros).
Concernant la France, les échanges d’informations réalisés sous l’empire de ce texte sont nombreux : 426 134 informations reçues par la France au titre de 2005 et 580 000 au titre de 2006. Le montant de la retenue à la source perçue n’est pas négligeable : 12 millions d’euros au titre de 2005, 50 millions d’euros au titre de 2006, dont 30 millions d’euros de la Suisse et 10 millions du Luxembourg. Toutefois, les résultats de la directive sont décevants vis-à-vis de certains États tiers et des territoires dépendants :
– Les recettes reversées paraissent peu cohérentes avec le montant des avoirs éventuellement placés. À cet égard, le Liechtenstein a versé une retenue à la source de 40 000 euros en 2005 et 133 000 euros en 2006 ;
– Seuls les versements effectués au profit de personnes physiques sont enregistrés. Ainsi, les intérêts payés à une fiducie ou un Anstalt du Liechtenstein ne sont pas couverts par le texte.
BILANS 2006 ET 2007 DE LA DIRECTIVE ÉPARGNE
Date |
Montant |
Code |
N° encaissement |
Pays |
30/06/06 |
5 762,35 |
L199 |
E27917 |
Guernesey |
03/07/06 |
25 379,56 |
L199 |
E28101 |
Jersey |
03/07/06 |
3 429 160,53 |
L130 |
E28151 |
Luxembourg |
05/07/06 |
39 276,57 |
L199 |
E28829 |
Guernesey |
05/07/06 |
188 629,16 |
L199 |
E28832 |
Guernesey |
11/07/06 |
644 007,14 |
L199 |
E29839 |
Jersey |
11/07/06 |
52 553,90 |
L199 |
E29842 |
Jersey |
11/07/06 |
228 064,66 |
L199 |
E29843 |
Andorre |
18/07/06 |
5 297,49 |
L199 |
E30379 |
Guernesey |
18/07/06 |
40 460,57 |
L199 |
E30382 |
Liechtenstein |
28/08/06 |
113,11 |
L199 |
E36932 |
Guernesey |
31/08/06 |
22 086,20 |
L199 |
E37843 |
Guernesey |
08/09/06 |
1 804 955,05 |
L140 |
E38864 |
Belgique |
25/09/06 |
5 549 224,65 |
L199 |
E41501 |
Suisse |
05/10/06 |
646 633,29 |
L199 |
E49416 |
Guernesey |
06/11/06 |
3 844,92 |
L199 |
E49412 |
Turks Caïcos |
28/11/06 |
205,98 |
L199 |
E53042 |
Guernesey |
25/01/07 |
77 729,83 |
L120 |
E03900 |
Autriche |
26/01/07 |
9,33 |
L120 |
E04121 |
Autriche |
Total |
12 763 394,29 |
Date |
Montant |
Code |
N° encaissement |
Pays |
25/06/07 |
9 736 869,07 |
L130 |
EAM280 |
Luxembourg |
25/06/07 |
98 958,35 |
L199 |
EAM281 |
Guernesey |
29/06/07 |
4 980 296,84 |
L140 |
EAN663 |
Belgique |
03/07/07 |
674 076,46 |
L199 |
EAO323 |
Guernesey |
03/07/07 |
21 259,78 |
L199 |
EAO326 |
Guernesey |
05/07/07 |
804 400,73 |
L199 |
EAP045 |
Andorre |
10/07/07 |
301 698,04 |
L120 |
EAP910 |
Autriche |
10/07/07 |
30 113 330,32 |
L199 |
EAP913 |
Suisse |
10/07/07 |
133 030,00 |
L199 |
EAP917 |
Jersey |
10/07/07 |
40 346,77 |
L199 |
EAP924 |
Guernesey |
19/07/07 |
71 778,00 |
L199 |
EAS828 |
Jersey |
19/07/07 |
13,28 |
L199 |
EAS830 |
Jersey |
19/07/07 |
1 894 432,62 |
L199 |
EAS832 |
Jersey |
24/07/07 |
133 531,80 |
L199 |
EAT979 |
Liechtenstein |
27/07/07 |
49 487,84 |
L120 |
EAV986 |
Autriche |
Total |
49 053 509,90 |
Source : Rapport sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales par le biais des paradis fiscaux, audition du ministre devant la Commission des finances de l’Assemblée nationale, 2008
Outre la question du champ même de la directive, les sommes frappées par la retenue à la source apparaissent donc modestes, particulièrement avec certains paradis fiscaux satellites. En outre, le Luxembourg a maintenu une exonération dans certains cas de figure. Malgré un « avis motivé » de la Commission européenne adressé en 2008, le Luxembourg n’a pas modifié sa législation permettant à des contribuables étrangers d’échapper à toute taxation de leurs capitaux investis dans ce pays. La Commission européenne a décidé en juin dernier de traduire le Luxembourg devant la Cour de justices des communautés européennes pour application incorrecte de certaines dispositions de la législation sur la fiscalité de l’épargne au motif que le Luxembourg exonère de manière abusive de la retenue à la source les personnes qui bénéficient du statut de « résident non domicilié » dans leur pays de résidence (elles ne sont pas imposées dans leur État de résidence fiscale ou elles bénéficient d’une législation qui leur permet de ne pas être taxées dès lors que le patrimoine concerné reste investi à l’étranger). Grâce à l’exonération accordée au Luxembourg, certaines fortunes européennes, particulièrement anglaises, irlandaises ou maltaises peuvent échapper à la retenue à la source, sans que l’État de résidence n’en soit informé.
d) La jurisprudence de la CJCE et le dumping fiscal
Une des ambiguïtés de la législation européenne en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales est que la Communauté européenne repose sur les principes de libertés (liberté d’établissement et de circulation, libre concurrence). Dès lors, sauf à ce qu’elle avantage les non résidents, la législation fiscale d’un État est jugée compatible avec le Traité, même si elle relève d’une logique de compétitivité agressive qui met en péril les recettes fiscales des autres États membres. À l’inverse, les mesures anti-fraude et évasion fiscales d’un État ne peuvent viser que les États qui n’appartiennent pas à la Communauté européenne.
La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes laisse des marges de manœuvre certaines à l’égard des États tiers. Elle considère notamment qu’un avantage fiscal peut être refusé à un contribuable au motif que le contrôle des conditions auxquelles est subordonné l’octroi de l’avantage impliquerait la communication d’informations détenues par un État tiers avec lequel il n’existe pas de clause d’échange de renseignements (arrêt « A » du 18 décembre 2007). En revanche, au sein de l’Union européenne, les États doivent démontrer l’existence de montages artificiels ayant pour but essentiel de se soustraire à l’impôt. Or, les enjeux pour la France de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales sont concentrés chez ses plus proches voisins et quelques centres financiers offshore connus. À l’exception de l’article 238 A du code général des impôts, les dispositifs sont beaucoup moins ciblés sur les paradis fiscaux « exotiques ». Cette jurisprudence restrictive de la CJCE initiée avec l’arrêt « Denkavit » de 1996 a nettement contraint les États membres pour appréhender la fraude et l’évasion fiscales dans un espace communautaire faisant primer la liberté de circulation et d’établissement.
LA JURISPRUDENCE TRADITIONNELLEMENT RESTRICTIVE DE LA CJCE En matière d’entraves pour des raisons fiscales à la liberté d’établissement ou à la libre circulation des capitaux, la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes n’accepte que très peu de justifications. Elle a ainsi toujours rejeté celle tirée de la perte de recettes fiscales. Si elle prend en compte le risque d’évasion fiscale, la Cour a considéré que la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales ne saurait se traduire par un dispositif anti-abus à portée générale et que, pour maintenir une proportionnalité avec le but poursuivi, l’autorité nationale doit donc vérifier concrètement, dans chaque cas, s’il y a des indices de fraude ou d’évasion fiscale (arrêt « Denkavit » du 17 octobre 1996). Dans la lignée de cette jurisprudence, le 11 mars 2004, dans l’affaire « Lasteyrie du Saillant », la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que l’article 167 bis du code général des impôts relatif à l’imposition des plus-values latentes en cas de transfert du domicile du contribuable hors de France restreignait l’exercice de la liberté d’établissement, énonçant que le principe de liberté d’établissement « s’oppose à ce qu’un État membre institue, à des fins de prévention d’un risque d’évasion fiscale, un mécanisme d’imposition des plus-values non encore réalisées ». La législation française a été jugée disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi de lutte contre la fraude fiscale. On peut souligner également qu’une mention expresse d’applicabilité d’une disposition anti-évasion dans une convention bilatérale avec un autre État membre de la Communauté serait sans effet, le droit communautaire prévalant sur les conventions internationales conclues par les États (CJCE, « Compagnie Saint-Gobain », 21 septembre 1999, Affaire C-307/97). De plus, la CJCE considère que toute mesure anti-abus doit avoir pour objet spécifique de sanctionner les arrangements totalement artificiels pour contourner la loi fiscale (arrêt « ICI » du 16 juillet 1998). La Cour a affirmé l’existence d’un principe d’abus de droit communautaire qui permet de sanctionner les opérations dont le but essentiel est la recherche d’un avantage fiscal (arrêts « Halifax » du 21 février 2006 et « Part Service Srl » du 21 février 2008). L’arrêt « Cadbury Schweppes Plc » de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 décembre 2006 écarte cependant la présence d’un montage artificiel dans le but de contourner la législation fiscale lorsqu’il y a réalité de l’implantation et exercice effectif d’une activité économique. Des décisions récentes semblent toutefois témoigner d’une attention plus prononcée aux intérêts des États. La Cour a reconnu des raisons impérieuses d’intérêt général susceptibles de justifier une entrave aux libertés de circulation qui, combinées avec le motif tiré de l’évasion fiscale peuvent assurer la compatibilité au droit communautaire de dispositifs qui ne visent pas strictement les seuls montages artificiels (arrêt « Oy AA » du 18 juillet 2007). C’est alors le caractère proportionné du dispositif qui est déterminant. Mais cette proportionnalité est problématique dès lors que la directive d’assistance mutuelle est généralement considérée comme suffisante pour que soit assuré un contrôle fiscal dans un autre État membre. Si le bénéfice d’un avantage fiscal peut être conditionné à la preuve que le contribuable satisfait aux conditions de son application (arrêt « Persche » du 27 janvier 2009), la Cour considère comme disproportionné tout dispositif qui institue une différence de traitement fondée sur une résomption irréfragable d’évasion fiscale du fait de la localisation des renseignements nécessaires à un autre État membre (29). Or, la convention d’assistance mutuelle n’est en pratique pas une garantie. |
Dès lors, lorsque se combinent lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et d’autres raisons impérieuses d’intérêt général comme la sauvegarde de la répartition équilibrée du pouvoir d’imposer, c’est en pratique la directive d’assistance mutuelle et le cas échéant des règles communautaires complémentaires qui doivent permettre de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. La coordination européenne et la mise au point de procédures efficaces sont donc absolument indispensables. À défaut, la France serait privée de moyens pour appréhender les flux à destination de la Suisse et du Liechtenstein, soit la majorité des flux d’évasion et de fraude.
Dans un tel contexte, la convergence de la fiscalité des entreprises de l’Union européenne constitue un enjeu important. Le taux de l’impôt sur les sociétés est en effet particulièrement disparate d’un État membre à l’autre : certains États, notamment parmi les nouveaux entrants, ont en effet engagé des politiques de réforme fiscale comportant un important volet de baisse du taux de l’impôt sur les sociétés. Ce « dumping fiscal » peut également favoriser les délocalisations intra-communautaires d’entreprises. Si les procédures d’échange d’informations constituent le moyen de lutter contre la fraude, l’évasion fiscale liée au dumping fiscal de certains États membres ne pourra être traitée que par des règles communautaires de fiscalité directe.
À l’initiative de la Commission, un important travail sur la convergence de la fiscalité des entreprises, conduit avec les États membres, s’est engagé en 2004 pour une proposition de directive relative à l’établissement d’une assiette commune consolidée d’impôt sur les sociétés (dite « ACCIS »). Le projet ACCIS vise à permettre à des sociétés membres d’un même groupe et localisées dans différents États membres du territoire communautaire, d’établir leur base d’imposition à l’impôt sur les sociétés selon des règles identiques, de dégager un résultat imposable unique au niveau du groupe, fruit de la somme algébrique des résultats et déficits de chacune des entités, et dont une quote-part sera attribuée à chaque État membre selon un mécanisme de répartition (fonction de trois facteurs : main-d’œuvre, actifs et ventes) pour faire l’objet d’une imposition à son propre taux ; de déclarer ce résultat auprès d’une seule administration. La Commission considère que l’ACCIS doit être, dans un premier temps, optionnelle pour les entreprises, mais que la société mère n’aura pas le choix dans la fixation du périmètre du groupe : dès lors qu’elle opte, elle devra obligatoirement intégrer ses filiales détenues à 75 % au moins.
Le régime aurait notamment pour avantage de faire disparaître les difficultés de facturation entre filiales (prix de transfert). Certains États membres manifestent des réticences fortes à l’égard de ce projet. L’intention initiale de la Commission était de présenter une proposition de directive vers septembre 2008, à temps pour que la France soit en mesure de faire progresser cette proposition au cours de sa Présidence. Le refus de ratifier le Traité de Lisbonne opposé par les Irlandais a contrarié ce projet. Lors du Forum fiscal de Bruxelles réuni à l’initiative de la Commission les 30 et 31 mars derniers sur le thème « Systèmes d’imposition dans un monde en changement », nombre d’intervenants ont souligné le besoin et la faisabilité d’une ACCIS, au risque de voir la concurrence fiscale emporter nos systèmes d’imposition des sociétés dans la tourmente de la concurrence d’après crise. En marge de ces travaux et dans l’attente de l’adoption éventuelle de cette proposition de directive, la Commission a également publié en 2006 une communication incitant les États membres à coordonner leurs systèmes de fiscalité directe en vue d’améliorer, sur des questions ciblées, l’articulation de ces systèmes entre eux et avec le droit communautaire.
1.– Un contexte propice à une régulation des « trous noirs » de la finance mondiale
a) La crise des subprimes : les techniques de titrisation montrées du doigt
La crise financière déclenchée aux États-Unis à l’été 2007 avec l’effondrement du marché des subprimes et qui bascule en crise systémique avec la faillite de la banque d’investissement Lehman Brothers le 14 septembre 2008, met en exergue les défaillances d’un système caractérisé par des poches d’opacité, illustrées par la titrisation massive des crédits hypothécaires contractés par les ménages américains sur le marché immobilier.
LES TECHNIQUES DE TITRISATION À L’ORIGINE DE LA CRISE FINANCIÈRE Les subprimes, qui connaissent un essor fulgurant à partir de 2004, sont des prêts hypothécaires consentis aux ménages américains modestes et qui reposent sur un mécanisme de taux variable élevé dont la révision consiste en une augmentation vertigineuse du taux, qui passe d’environ 1 % les deux premières années jusqu’à 12 % les années suivantes. Ils présupposent une expansion continue du marché immobilier, les emprunteurs ayant aux États-Unis la possibilité de mobiliser la valeur nette du bien immobilier pour bénéficier d’une ligne de crédit ou pour refinancer leur prêt. La titrisation des créances consiste à structurer des crédits dans des produits plus ou moins complexes distribués à des investisseurs. Elle présente, outre l’avantage de conférer de la liquidité à des créances illiquides, celui de mutualiser les risques et d’accroître la capacité d’octroi de crédit. Elle consiste sous sa forme simple à vendre un ensemble de crédits à une société ad hoc qui émet des obligations vendues à des investisseurs. Ces obligations sont remboursées au fur et à mesure que les crédits qu’elles représentent le sont. Dans sa version sophistiquée, la titrisation consiste à créer des placements supposés peu risqués en mélangeant des tranches de crédits risqués qui sont remboursés en priorité. Les titres hypothécaires sont donc groupés en paquets et découpés par tranche de risques, les plus risquées étant les plus rémunératrices. Le titre est constitué de plusieurs tranches auxquelles va correspondre, grâce aux techniques de rehaussement de crédit, un certain niveau de risque de crédit. Par exemple : – la tranche senior, la plus sûre, représentant la plus grande part de l’actif (80 %) avec un risque AAA, bénéficierait d’un rendement relativement faible (7 %) ; – la tranche mezzanine, représentant 15 % de l’actif, avec un risque BB, bénéficierait d’un rendement près de deux fois supérieur (13 %), – enfin, la tranche inférieure, représentant 5 % de l’actif, avec un risque C, bénéficierait d’un rendement de 28 %. En cas de défaillance de l’emprunteur, la tranche inférieure serait bien entendu la première à essuyer les pertes. Les banques créancières ont ainsi titrisé leurs créances auprès de fonds, « conduits », se finançant par l’émission de papier commercial à court terme (les MBS ou Mortgage Baked Securities, vendues, pour un rendement important eu égard au risque que ces titres comportent, à une multitude d’investisseurs) et véhicules d’investissement spécialisés (SIV pour structured investment vehicule) se finançant par l’émission de notes à moyen terme. Ces « conduits » et SIV ont acquis des actifs, pas uniquement des subprimes, en grande quantité. Le papier commercial émis bénéficie d’une ligne de substitution, typiquement accordée par l’établissement à l’origine du crédit et du montage du « conduit », en cas d’incapacité à renouveler son émission à échéance. La dernière étape du schéma de titrisation correspond à l’apparition de nouveaux titres, les CDO ou Collaterized Debt Obligations, qui associent aux titres adossés aux prêts hypothécaires d’autres crédits titrisés, parmi lesquels certains dérivés de crédit destinés à assurer le risque de défaut de paiement du débiteur (les CDS ou Credit Default Swaps). |
L’effondrement du marché des subprimes met ainsi en lumière un mécanisme de transfert du risque, par le biais des techniques de titrisation, qui conduit à opacifier les contreparties réelles des titres ainsi émis. La dilution du risque est en effet permise tant par la fragmentation des titres initiaux, vendus à une multitude d’investisseurs, que par le rehaussement du crédit qui permet de créer plusieurs étages de risque, et enfin, par la fusion des titres adossés à des créances hypothécaires dans des titres comportant une multitude d’autres actifs.
La technique de la titrisation n’implique aucunement l’intervention directe des paradis fiscaux, les défaillances identifiées étant bien liées à des mécanismes générés et gérés par la finance onshore. Il n’en demeure pas moins que plusieurs éléments pointés du doigt comme étant des rouages indispensables au mécanisme de titrisation à l’origine de la crise renvoient aux critiques traditionnellement adressées aux paradis fiscaux.
Il s’agit tout d’abord de la technique de titrisation elle-même, qui passe par la création d’une société ad hoc ou special purpose vehicle (SPV), dont l’actif est constitué des prêts immobiliers consentis par les banques et dont le refinancement se fait par émission de titres constituant son passif. Si ces structures de titrisation existent dans de nombreux pays, à l’instar des fonds communs de créances (FCC) en France, elles sont des instruments privilégiés dans les paradis fiscaux (à Jersey, aux Îles Caïman, dans le Delaware, etc.) pour les raisons précédemment exposées. Par ailleurs, le recours à un SPV répond à l’objectif de reporter la gestion du risque sur une structure juridiquement indépendante, créée spécialement à cette occasion. C’est la vocation même – et avouée – de ces instruments de gestion, qui a néanmoins également pour conséquence de permettre un contournement des règles prudentielles qui s’imposent aux établissements de crédit : en effet, le caractère déconsolidant de la structuration permet aux banques de sortir le sous-jacent de leur bilan comptable. Elles peuvent dès lors émettre des titres à profusion sans aucunement dégrader leur ratio de solvabilité.
Les paradis fiscaux apparaissent de ce point de vue comme des « facilitateurs », contribuant à la mise en place de structures de déconsolidation et à l’opacification des mécanismes de transferts de risque au sein du système financier mondial. On rappellera également que les tranches les plus risquées des CDO sont généralement achetées par des hedge funds, fonds très peu régulés, établis pour plus des deux tiers d’entre eux dans des paradis fiscaux (à elles seules, les Îles Caïman hébergeraient 9 600 hedge funds, soit un tiers des fonds mondiaux).
Le contexte financier et économique est donc propice à l’adoption d’un nouveau train de mesures à l’encontre des paradis fiscaux : en effet, la propagation de la crise à l’économie réelle se révèle douloureuse pour les États qui ont mobilisé des moyens sans précédent pour restaurer la liquidité du système bancaire et soutenir l’activité économique. La crise économique emporte également une perte de recettes fiscales importante : en France, les moins-values sur recettes s’établissent autour de 12,3 milliards d’euros pour 2008 et pourraient s’élever à 20 milliards d’euros pour 2008. Le déficit de l’État, proche de 56 milliards d’euros en 2008, avoisinerait 130 milliards d’euros en 2009. Dans ce contexte, l’évasion et la fraude fiscales vers des territoires offshore qui offrent des conditions fiscales attractives aux résidents étrangers et demeurent rétives à l’échange de renseignements, mettant ainsi en échec tout contrôle de la part des autres États, en deviennent d’autant moins supportables.
b) Le changement d’administration américaine
Ce contexte est également marqué par le changement d’administration américaine : l’administration Bush, globalement favorable à la conclusion d’accords bilatéraux d’échanges de renseignements avec des territoires considérés comme des paradis fiscaux, était relativement réticente à toute démarche multilatérale. Les États-Unis ont ainsi longtemps pu tolérer l’existence des paradis fiscaux qui contribuent à la compétitivité des grands groupes américains, malgré la perte de matière fiscale que représentent les investissements à l’étranger des multinationales qui transitent par des paradis fiscaux. L’élection de Barack Obama à la Présidence américaine change éminemment la donne, l’ancien sénateur Obama ayant été l’auteur en 2007, avec les sénateurs Levin et Coleman, d’une proposition de loi relative à la lutte contre les paradis fiscaux.
LA PROPOSITION DE LOI LEVIN-COLEMAN-OBAMA DE LUTTE CONTRE LES PARADIS FISCAUX
Présentée en février 2007, cette proposition de loi prévoit :
– de renverser la charge de la preuve en matière de titres détenus par des entités privées situées dans des paradis fiscaux. Tout transfert d’argent ou de valeurs en provenance ou vers une entité située dans un paradis fiscal serait présumé constituer un revenu non déclaré par le contribuable américain, celui-ci étant également présumé contrôler cette entité. La loi en vigueur exige que les contribuables déclarent à l’administration fiscale tout compte détenu à l’étranger dépassant 10 000 dollars : la proposition de loi établit la présomption que tout compte détenu dans un territoire offshore dépasse effectivement 10 000 dollars, rendant ainsi la déclaration obligatoire, la charge de la preuve incombant au contribuable.
– de définir les paradis fiscaux, et propose de retenir une liste de 34 juridictions dressée par l’administration fiscale américaine.
Anguilla Dominica Netherlands Antilles
Antigua and Barbuda Gibraltar Panama
Aruba Grenada Samoa
Bahamas Guernsey / Sark / Alderney St. Kitts and Nevis
Barbados Hong Kong St. Lucia
Belize Isle of Man St. Vincent & the Grenadines
Bermuda Jersey Singapore
British Virgin Islands Latvia Switzerland
Cayman Islands Liechtenstein Turks and Caicos
Cook Islands Luxembourg Vanuatu
Costa Rica Malta
Cyprus Nauru
– d’autoriser le Trésor américain à prononcer des sanctions financières à des juridictions étrangères, des institutions financières ou des transactions, en cas d’infraction à la loi fiscale américaine, à l’instar de ce qui existe déjà en matière de blanchiment d’argent. Il serait également possible d’interdire à des banques étrangères d’émettre des cartes de crédit sur le territoire américain ;
– d’allonger de 3 à 6 ans le délai imparti aux enquêtes fiscales impliquant des paradis fiscaux ;
– d’accroître la divulgation des comptes, transactions et entités offshore, en imposant à tout établissement financier de transmettre à l’administration fiscale les données afférentes au titulaire américain d’un compte étranger qui lui est signalé par ses services de contrôle anti-blanchiment., de lui signaler toute transaction qui conduit à l’ouverture d’un compte dans un paradis fiscal au bénéfice d’un client américain ;
– de prévenir l’utilisation de sociétés de gestion étrangères de type trust ou fondation à des fins d’évasion fiscale, en assujettissant les bénéficiaires de ces structures à l’impôt en les considérant comme responsables de ces structures. Il s’agit également d’étendre la liste des distributions soumises à taxation en y incluant les œuvres d’art, les biens mobiliers ou la joaillerie ;
– de limiter la protection pénale de l’instruction en matière de transactions qui concernent des entités domiciliées dans des paradis fiscaux ;
– de porter à un million de dollars les amendes en cas de dissimulation de holdings offshore ;
– de fixer une échéance aux hedge funds pour l’adoption de règles anti-blanchiment ;
– d’appliquer les obligations anti-blanchiment aux professionnels du montage de sociétés ;
– de renforcer les assignations en justice « contre X » dans les affaires qui impliquent des entités domiciliées dans des paradis fiscaux et d’améliorer la communication de l’information financière relative aux comptes bancaires détenus à l’étranger. ;
– de renforcer les obligations déclaratives afférentes aux comptes détenus et revenus réalisés à l’étranger ;
– de renforcer les sanctions applicables aux professionnels faisant la promotion des paradis fiscaux, d’interdire la conception de montages ayant pour but de se soustraire à l’impôt, de dissuader les établissements financiers de participer à des activités d’optimisation fiscale abusives, enfin d’interdire la pratique des frais de service calculés en fonction des économies d’impôt réalisées ;
– de codifier et renforcer la doctrine de la « substance économique », qui permet d’invalider des transactions qui n’ont pas de contrepartie économique réelle ou de finalité commerciale autre que d’échapper à l’impôt ou de favoriser l’évasion fiscale. Cela doit également passer par un renforcement des amendes infligées en cas de transaction sans contrepartie économique réelle.
Le nouveau Président des États-Unis a ainsi présenté le 4 mai dernier les premiers éléments d’une réforme destinée à lutter contre l’évasion fiscale, l’objectif étant de faire rentrer 95,2 milliards d’euros sur dix ans dans les caisses de l’État, par le biais de mesures de lutte contre les paradis fiscaux. Il s’agit notamment :
– d’imposer à toute institution financière internationale offrant ses services aux États-Unis de demander à être immatriculée comme « intermédiaire qualifié » (qualified intermediary), permettant ainsi au fisc américain de se voir délivrer directement des informations sur les clients de celle-ci ;
– de renverser la charge de la preuve pour toute relation d’un client avec une banque non reconnue comme un intermédiaire qualifié, en faisant peser la preuve du caractère légitime des transactions sur la banque et son client ;
– de taxer à hauteur de 20 à 30 % tout transfert vers le compte offshore d’une institution non reconnue comme un intermédiaire qualifié, à charge pour le client de dévoiler son identité et de prouver sa bonne foi ;
– de porter de 3 à 6 ans le délai d’enquête du fisc sur les opérations faisant intervenir un compte offshore ;
– de renforcer les moyens humains de l’Internal Revenue Service (IRS), l’équivalent américain de la direction générale des finances publiques (DGFIP), en le dotant de 800 enquêteurs supplémentaires uniquement destinés à traquer la fraude et l’évasion fiscales internationales ;
– et enfin, de réformer certaines dispositions du code des impôts américain, relatives à la taxation des revenus des entreprises. En effet, le fisc américain ne taxe les profits dégagés par ses entreprises à l’étranger que lorsque ceux-ci sont rapatriés aux États-Unis. Par ailleurs, les multinationales peuvent organiser des échanges de revenus entre filiales sans être imposées. Ces mesures, destinées à favoriser la présence à l’international des entreprises américaines, ont en réalité été largement détournées pour être utilisées comme des outils d’optimisation fiscale.
L’AFFAIRE UBS VS. IRS : LA BANQUE SUISSE CONFRONTÉE AU FISC AMÉRICAIN
En juin 2008, Bradley Birkenfeld, un ancien collaborateur d’UBS, dévoile aux autorités américaines avoir aidé de riches clients américains à échapper au fisc. En février 2009, le géant bancaire suisse a trouvé un accord sur le plan bancaire en livrant l’identité de quelque 250 clients et en versant une amende de 780 millions de dollars, sans toutefois que cela ne permette de clore le volet civil de l’affaire, mené par le fisc américain. Dès lors, la procédure civile contre X dite de « John Doe Summons », qui permet au fisc américain de poursuivre la banque pour obtenir le nom et des informations sur 52 000 titulaires de comptes américains soupçonnés de fraude fiscale, s’est poursuivie. La Suisse a toutefois fait savoir qu’elle s’opposerait à la livraison d’informations au nom de la défense de son secret bancaire qui s’oppose aux demandes trop vagues (fishing expeditions). En effet, si les États-Unis et la Suisse ont paraphé une convention révisée de double imposition permettant l’échange d’informations fiscales dans des cas précis, la demande américaine concernant les 52 000 clients américains d’UBS ne serait en l’espèce pas couverte.
Selon le rapport du ministère public, le groupe suisse a en effet activement encouragé 52 000 contribuables à dissimuler environ 15 milliards de dollars d’actifs, en leur conseillant parfois d’utiliser des sociétés offshore au Panama, à Hongkong ou aux îles Vierges britanniques, et a tout fait pour empêcher l’ensemble des autorités de surveillance américaines (Internal Revenue Service - IRS -, Securities and Exchange Commission – SEC –, Customs and Immigration) de prendre connaissance de ses agissements : « La banque suisse savait qu’elle violait les lois américaines et savait que, si sa conduite était découverte, elle pouvait en être tenue pour responsable civilement et pénalement ».
La banque suisse risquait, dans cette affaire, la saisie ou le séquestre de ses avoirs aux États-Unis. Une demande conjointe de report du procès, qui devait débuter le 13 juillet 2009 devant le tribunal fédéral de Miami, a toutefois été acceptée, afin de permettre aux deux gouvernements de trouver une solution à cette affaire. Le 12 août 2009, UBS et les autorités américaines se sont entendus sur un accord extrajudiciaire. L’accord définitif a été signé le 19 août. Les Etats-Unis retirent la requête visant à obtenir l'identification de 52'000 titulaires de comptes devant le tribunal compétent de Miami dans le cadre de la procédure civile contre UBS. L'accord prévoit une entraide administrative entre les gouvernements suisse et américain sur «quelque 4450 comptes» de clients américains de la banque. La banque suisse n’est redevable d’aucune amende. Dans un premier temps, pour éviter la prescription de l'action pénale en matière fiscale, la procédure civile aux Etats-Unis reste pendante. Son retrait complet et définitif se fera par étapes et sera achevé au plus tard 370 jours après la signature de l'accord. La banque devait avertir les titulaires des 4450 comptes par courrier les encourageant à participer à la pratique de déclaration volontaire du fisc américain, qui leur est ouverte jusqu’au 23 septembre.
c) L’affaire de la fraude fiscale via le Liechtenstein ouvre la voie à de nouvelles initiatives en Europe
En Europe, de nouvelles initiatives ont également vu le jour à la faveur du contexte déjà évoqué : la crise financière met en effet en lumière le caractère déstabilisateur des paradis fiscaux lié à leur opacité. Les paradis fiscaux européens en sont affaiblis pour défendre leurs positions. De même, les pratiques fiscales dommageables qu’ils mènent au détriment des autres États qui perdent de ce fait une partie de leur assiette fiscale stimulent une réaction commune. La cristallisation des préoccupations européennes sur les paradis fiscaux est principalement liée à l’affaire de la fraude fiscale via le Liechtenstein.
FÉVRIER 2008 : L’AFFAIRE DE LA FRAUDE FISCALE VIA LE LIECHTENSTEIN
L’affaire éclate en Allemagne le 14 février 2008, avec l’arrestation du Président du directoire de la Deutsche Post, suspecté d’avoir détourné un million d’euros vers une banque du Liechtenstein par le biais d’un système de fondations. Plusieurs centaines de contribuables dans plus de dix pays – dont la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l’Italie, le Danemark, la Suède et l’Australie – auraient usé de ce système pour soustraire des sommes importantes à l’impôt dû dans leurs pays respectifs. La banque fiduciaire LGT-Treuhand, propriété de la famille princière du Liechtenstein, concentrerait la plupart des opérations d’évasion fiscale dénoncées.
Les informations relatives à cette vaste affaire de fraude ont en réalité été transmises au service fédéral du renseignement allemand, le Bundesnachrichtendienst, par un informateur, ancien employé de banque au Liechtenstein, en contrepartie d’une nouvelle identité, de deux passeports et de quatre millions d’euros. La justice allemande communique alors aux services fiscaux de certains États concernés la liste des contribuables fraudeurs : une liste de 200 contribuables français est ainsi transmise à Bercy par les autorités fiscales britanniques.
À fin juin 2008, la France avait lancé deux vagues de contrôle, soit 150 procédures dans le cadre de l’enquête sur l’évasion fiscale au Liechtenstein. Des informations fournies par le Gouvernement australien lui permettent d’identifier clairement les 64 groupes familiaux clients de la banque du Liechtenstein. Le ministre du budget confirme l’estimation d’un milliard d’euros au titre des sommes placées dans cette banque.
Parallèlement, mi-juillet 2008, dans le cadre de ce dossier, un premier contribuable allemand était condamné par le tribunal de Bochum à une amende de 7,5 millions d’euros hors arriérés et à une peine de prison de deux ans avec sursis. 350 enquêtes seraient en cours et 420 dossiers pendants, alors que 250 personnes ont profité d’une disposition législative pour s’auto-dénoncer.
Cette affaire connaît un retentissement important, notamment dans l’opinion publique, conduisant les autorités à lancer une nouvelle offensive contre les paradis fiscaux.
Le 21 octobre 2008, le ministre français du budget et le ministre des finances allemand ont réuni des représentants d’une vingtaine de pays de l’OCDE dans le cadre d’une conférence contre la fraude et l’évasion fiscales internationales. C’est donc sur l’initiative conjointe franco-allemande que la lutte contre les paradis fiscaux a été relancée. Les représentants des pays de l’OCDE ont, à cette occasion, rappelé l’insuffisance des progrès accomplis en matière de transparence et d’échange de renseignements. Ils se sont engagés à utiliser l’article 26 du modèle de convention fiscale de l’OCDE pour la conclusion de toute nouvelle convention ainsi qu’à entreprendre un travail de renégociation des traités en cours afin d’y inclure cette disposition. La refonte de la directive épargne a été jugée prioritaire, celle-ci devant notamment passer par un réexamen du mécanisme transitoire de retenue à la source actuellement appliqué par certains États. Des critères de transparence et d’échange de renseignements en matière fiscale devaient également être pris en compte par les programmes d’aide au développement. Enfin, les représentants réunis ont donné mandat à l’OCDE pour « définir une méthodologie établissant une distinction claire entre les pays et territoires qui ont mis en œuvre de manière substantielle les normes de l’organisation sur l’échange de renseignements et ceux qui ne l’ont pas fait », cette nouvelle évaluation devant être présentée au cours de l’année 2009. Il a ensuite été convenu que cette présentation serait rendue disponible lors de la réunion du G20 à Londres le 2 avril 2009.
Car les conclusions du sommet du G20, réuni le 15 novembre 2008 à Washington, faisaient en effet état des mêmes préoccupations relatives aux paradis fiscaux : lors de cette réunion, les dirigeants du G20 ont ainsi souhaité que les autorités nationales et régionales mettent en œuvre des mesures nationales et internationales pour protéger le système financier mondial des juridictions non coopératives et non transparentes qui présentent un risque d’activité financière illégale. Ils ont également renouvelé leur soutien au travail du GAFI ainsi qu’aux efforts de l’initiative de restitution des actifs volés de la Banque mondiale et des Nations Unies (STAR). Ils ont enfin rappelé que les autorités fiscales devaient poursuivre leurs efforts de promotion des échanges d’informations dans le domaine de la fiscalité en s’appuyant sur les travaux des organismes appropriés tels que l’OCDE, notamment à destination des « juridictions qui ne se conforment pas encore aux normes internationales en matière de secret bancaire et de transparence ».
Les initiatives se sont donc multipliées dès la fin de l’année 2008 et au début de l’année 2009 pour exiger davantage de transparence et de coopération de la part des paradis fiscaux. Le G20, réuni à Londres le 2 avril 2009, va ainsi sceller l’unité des grandes puissances économiques de la planète contre les pratiques fiscales dommageables qui sont celles des juridictions non coopératives.
2.– La lutte contre le secret bancaire et les secteurs non réglementés
Le tournant qui s’est amorcé à partir de 2008 et qui a trouvé son aboutissement dans les conclusions du G20 du 2 avril 2009 a en réalité été anticipé par de nombreux États traditionnellement considérés comme des paradis fiscaux. Ainsi, l’île de Man s’était-elle engagée dans 13 conventions fiscales d’échanges de renseignements, dont dix d’entre elles ont été signées depuis octobre 2007. De la même manière, Jersey avait conclu un accord d’échange de renseignements avec le Royaume-Uni le 10 mars dernier, ce qui porte à onze le nombre d’accords similaires conclus par cette dépendance de la Couronne britannique. Le 9 décembre 2008, le Liechtenstein signait son premier accord d’échange de renseignements avec les États-Unis. Au total, 22 nouveaux accords avaient été conclus en 2008, mouvement qui s’est encore amplifié en 2009 dans la perspective du G20 de Londres.
Plusieurs réformes engagées par certains États ouvrent également la voie à la conclusion d’accords d’échange de renseignements :
– En vertu de sa nouvelle convention fiscale avec les États-Unis, la Belgique échange désormais des informations bancaires sur demande dans les affaires fiscales de nature civile ou pénale ;
– La Suisse a également progressé sur la voie de l’accès aux renseignements bancaires à des fins fiscales pénales en signant un certain nombre de protocoles à ses conventions fiscales bilatérales afin de permettre l’accès aux renseignements, y compris bancaires, dans les affaires de fraude fiscale ou en cas de fraude fiscale ou infraction équivalente (selon la définition établie par la législation de l’État requis), ainsi qu’une assistance administrative pour les sociétés holding. La Suisse a ainsi signé avec la France, le 12 janvier 2009, un avenant à la convention d’élimination des doubles-impositions qui les lie, prévoyant de telles dispositions, ainsi qu’une clause de la nation la plus favorisée en matière d’échange de renseignements ;
– Gibraltar a signé, le 30 mars 2009, soit trois jours avant le sommet du G20, son premier accord d’échange de renseignements à des fins fiscales avec les États-Unis ;
– Au cours du mois de mars 2009, l’Autriche, le Luxembourg et la Suisse ont annoncé leur intention d’introduire dans leurs futures conventions fiscales l’article 26 du modèle OCDE, relatif à l’échange de renseignements. Singapour et Hongkong se sont également dits prêts à supprimer les obstacles internes à l’échange de renseignements, tandis qu’Andorre (le 10 mars) et le Liechtenstein (le 12 mars) ont indiqué vouloir aller dans la même direction, au même titre que la Belgique et Monaco (le 13 mars).
a) Le G20 : une mobilisation internationale contre les paradis fiscaux
Le sommet du G20 tenu à Londres le 2 avril 2009 fait de la lutte contre les juridictions non coopératives une priorité pour la restauration de la confiance dans notre système financier. En annonçant que « l’ère du secret bancaire est terminée », le G29 confirme donc les intentions dessinées en 2008 et au début de l’année 2009. Ainsi, le communiqué final du sommet fait état de la volonté des États de déployer des sanctions destinées à protéger leurs finances publiques et leur système financier des juridictions non-coopératives, et notamment des paradis fiscaux. Le G20 prend également acte de la publication par l’OCDE d’une liste de ces juridictions.
Une panoplie de sanctions est donc proposée par le G20 à l’encontre des juridictions qui persisteraient à ne pas reconnaître les standards internationaux de transparence en matière fiscale. Il pourrait ainsi être envisagé :
– d’accroître les obligations de déclarations de la part des contribuables et des institutions financières concernant les transactions en relation avec une juridiction non coopérative ;
– d’augmenter la retenue à la source pour une gamme élargie de versements à destination des juridictions non coopératives ;
– de refuser toute possibilité de déduction des frais payés à un bénéficiaire résident d’une juridiction non coopérative ;
– de réviser les conventions fiscales conclues avec les territoires refusant de façon effective l’échange de renseignements en matière fiscale ;
– de demander aux institutions internationales et aux banques de développement régional de réviser leur politique d’investissement pour en exclure les territoires non coopératifs ;
– et enfin, de donner davantage d’importance aux principes de transparence fiscale et d’échange d’informations pour la conception des programmes d’aide bilatérale.
Il s’est engagé à mettre en œuvre un plan d’action destiné à renforcer la supervision et la régulation financières, qui passe notamment par la mise en place d’un Conseil de stabilité financière (Financial Stability Board - FSB) qui doit succéder à l’actuel Forum de stabilité financière (Financial Stability Forum), et se voit élargi à l’ensemble des pays du G20, à l’Espagne et à la Commission européenne. Le FSB se voit confier, aux côtés du FMI, la mise en œuvre d’un dispositif d’alerte précoce sur les risques financiers mondiaux – le FMI ayant un rôle de surveillance des équilibres macroéconomiques et le FSB des marchés financiers, des institutions financières et des règles prudentielles.
Par ailleurs, le renforcement de la supervision et de la régulation financières passe également, pour le G20, par une extension de la réglementation à « tous les instruments, les marchés et les institutions financières d’importance systémique », dont, « pour la première fois, les fonds spéculatifs d’importance systémique ». Il s’agit notamment de prévoir un mécanisme d’enregistrement des gérants de fonds alternatifs ainsi que la communication d’informations relatives à leurs positions aux autorités de supervision et de régulation.
Le G20 appelle le FMI et le nouveau FSB à présenter un rapport d’évaluation des progrès accomplis sur l’ensemble de ces points en vue de la prochaine réunion des ministres des Finances du G20, prévue en Écosse en novembre 2009. Un point des avancées accomplies et d’une éventuelle concrétisation des mesures de sanctions à l’encontre des paradis fiscaux pourrait d’ores et déjà être à l’ordre du jour du prochain sommet du G20 qui se tiendra à Pittsburgh, aux États-Unis, les 24 et 25 septembre 2009.
Comme le prévoyait le mandat qui lui avait été confié le 21 octobre 2008, l’OCDE a donc publié, à l’occasion du sommet du G20 de Londres, une liste des territoires non coopératifs. Il s’agit en réalité de trois listes distinctes : une liste noire, une liste grise et une liste blanche correspondant au degré de coopération en matière fiscale. Seuls quatre territoires figurent sur la liste noire réunissant les pays qui ne se sont jamais engagés à respecter les standards de l’OCDE en la matière : le Costa Rica, la Malaisie, les Philippines et l’Uruguay. La liste grise compte quant à elle 38 juridictions, dont Monaco, le Liechtenstein, la Suisse, le Luxembourg, Andorre et Singapour : elle recense les États qui se sont engagés à respecter les règles de l’OCDE mais ne les ont pas « substantiellement » appliquées, le critère retenu étant la conclusion d’au moins douze conventions fiscales conformes à ses standards. Cette liste grise est elle-même divisée entre, d’une part, les territoires qui avaient été identifiés en 2000 comme répondant aux critères des paradis fiscaux au sens de l’OCDE, et, d’autre part, les autres centres financiers.
LISTES DES TERRITOIRES NON COOPÉRATIFS ÉTABLIES PAR L’OCDE LE 2 AVRIL 2009
Juridictions qui ont substantiellement appliqué les standards internationaux | |||
Afrique du Sud |
Finlande |
Japon |
Russie |
Allemagne |
France |
Jersey |
Seychelles |
Argentine |
Grèce |
Malte |
Slovaquie |
Australie |
Guernesey |
Mexique |
Espagne |
Barbade |
Hongrie |
Nouvelle Zélande |
Suède |
Canada |
Île Maurice |
Norvège |
Turquie |
Chine (30) |
Île de Man |
Pays-Bas |
Émirats Arabes Unis |
Chypre |
Irlande |
Pologne |
Royaume Uni |
Corée |
Islande |
Portugal |
États-Unis |
Danemark |
Italie |
République tchèque |
Îles Vierges américaines |
Juridictions qui se sont engagés à se conformer aux standards internationaux mais qui ne les ont pas encore substantiellement appliqués | |||||
Juridictions |
Année d’engagement |
Nombre d’accords |
Juridictions |
Année d’engagement |
Nombre d’accords |
Paradis fiscaux (31) | |||||
Andorre |
2009 |
(0) |
Îles Cook |
2002 |
(0) |
Anguilla |
2002 |
(0) |
Îles Marshall |
2007 |
(1) |
Antigua et Barbuda |
2002 |
(7) |
Monaco |
2009 |
(1) |
Aruba |
2002 |
(4) |
Montserrat |
2002 |
(0) |
Bahamas |
2002 |
(1) |
Nauru |
2003 |
(0) |
Bahrein |
2001 |
(6) |
Antilles néerlandaises |
2000 |
(7) |
Belize |
2002 |
(0) |
Niue |
2002 |
(0) |
Bermudes |
2000 |
(3) |
Panama |
2002 |
(0) |
Dominique |
2002 |
(1) |
St Kitts and Nevis |
2002 |
(0) |
Gibraltar |
2002 |
(1) |
St Lucie |
2002 |
(0) |
Grenada |
2002 |
(1) |
St Vincent & Grenadines |
2002 |
(0) |
Liberia |
2007 |
(0) |
Samoa |
2002 |
(0) |
Liechtenstein |
2009 |
(1) |
San Marin |
2000 |
(0) |
Îles Vierges britanniques |
2002 |
(3) |
Îles Turks et Caïcos |
2002 |
(0) |
Îles Caïman (32) |
2000 |
(8) |
Vanuatu |
2003 |
(0) |
Autres centres financiers | |||||
Autriche (33) |
2009 |
(0) |
Guatemala |
2009 |
(0) |
Belgique (4) |
2009 |
(1) |
Luxembourg (4) |
2009 |
(0) |
Brunei |
2009 |
(5) |
Singapour |
2009 |
(0) |
Chili |
2009 |
(0) |
Suisse (4) |
2009 |
(0) |
Juridictions qui ne se sont pas engagées à se conformer aux standards internationaux | |||
Juridictions |
Nombre d’accords |
Juridictions |
Nombre d’accords |
Costa Rica |
(0) |
Philippines |
(0) |
Malaysia (Labuan) |
(0) |
Uruguay |
(0) |
Dès le 7 avril 2009, les quatre pays figurant sur la liste noire ont pris l’engagement de se conformer aux normes de l’OCDE et sont donc allés rejoindre les 38 autres États de la liste grise.
b) Les paradis fiscaux poursuivent leur processus de négociation pour sortir de la « liste grise »
La publication de ces listes a signé le départ d’un ample mouvement de « régularisation » de la part des territoires non coopératifs, dont on a vu qu’il s’était amorcé dès le début de l’année. En effet, aussitôt après le sommet du G20, les quatre États figurant sur la liste noire ont d’emblée engagé des discussions avec l’OCDE, ont annoncé leur intention d’endosser ses standards et de les mettre en œuvre dès 2009, et ont donc été retirées de cette liste avant même que des mesures concrètes ne soient décidées par ces Etats.
S’agissant des pays inscrits sur la liste grise, à la date du 7 septembre 2009 :
– Hong Kong, Macao (34) et Singapour ont confirmé leur volonté de modifier leur législation interne pour la mettre en conformité avec les standards internationaux, sans toutefois que des progrès notables n’aient été accomplis. Seule la République de Singapour a traduit ses engagements dans les faits, en concluant deux accords d’échanges de renseignements, dont l’un avec la Belgique le 17 juillet 2009. Elle est également en cours de négociation avec la France.
– Les Bermudes ont dépassé le seuil de 12 conventions fiscales répondant aux normes de l’OCDE, et ont donc été logiquement retirées de la liste grise le 8 juin 2009. Le 3 juillet dernier, une treizième convention était en effet signée avec l’Allemagne.
– Les Îles Caïman et les Îles Vierges britanniques ont atteint le 14 août 2009 le seuil de douze d’accords d’échange de renseignements, et ont donc été rayées de la liste grise de l’OCDE.
– Gibraltar a signé cinq accords bilatéraux pour l’échange de renseignements à des fins fiscales conformes aux standards de l’OCDE.
– Brunei et le Guatemala ont formellement approuvé les standards de l’OCDE et identifié les progrès qu’ils devaient fournir cette année afin de les mettre en application.
– Le Chili, qui a engagé une procédure d’adhésion à l’OCDE, a présenté une réforme législative répondant aux exigences de l’article 26 du modèle de convention fiscale.
Par ailleurs, s’agissant des centres financiers situés en Europe, des progrès notables ont également été accomplis :
– Andorre, Monaco et le Liechtenstein, seuls pays à figurer encore début 2009 sur la liste noire des territoires non coopératifs, en ont été retirés le 27 mai 2009 au regard de leur engagement à se soumettre au modèle de l’OCDE, à procéder à toute modification de leur droit interne qui s’avérerait nécessaire et à s’engager dans un processus de conclusion de conventions fiscales. Le Liechtenstein est ainsi en cours de négociations avec le Luxembourg et le Royaume-Uni en vue de signer ses deuxième et troisième accords d’échange de renseignements dans le respect de l’article 26 du modèle OCDE. La Principauté de Monaco a quant à elle signé son premier accord d’échange de renseignements avec la Belgique le 15 juillet 2009.
– La Belgique a poursuivi son programme de conclusion de conventions fiscales respectant les normes de l’OCDE : elle a ainsi proposé à plus de 80 États avec lesquels elle est déjà partie à une convention fiscale de signer un avenant à cet accord incorporant la clause d’échange d’informations fiscales sur demande. Après les États-Unis, la Grande-Bretagne, l’Australie et les Pays-Bas, la Belgique a signé un tel avenant à la convention bilatérale de double imposition qui la lie à la France le 7 juillet 2009. À la date du 16 juillet 2009, la Belgique avait signé des protocoles amendant ses conventions fiscales avec le Luxembourg, Saint Marin, les Seychelles et Singapour, ainsi qu’une convention fiscale avec l’île de Man et un accord d’échange de renseignements avec Monaco. Du fait de la signature de douze accords, la Belgique a donc franchi le seuil permettant à un pays de sortir de la liste grise.
– Le Luxembourg, quant à lui, a signé le 3 juin dernier un avenant à la convention fiscale d’élimination des doubles impositions qui le lie à la France depuis 1958 afin d’y inclure l’échange d’informations fiscales sur demande. Des dispositions similaires ont d’ores et déjà été incluses dans les conventions fiscales liant le Luxembourg aux États-Unis, à Bahreïn, au Danemark, au Royaume-Uni, à la Finlande et aux Pays-Bas (35). Le Luxembourg s’est fixé un objectif de signature de vingt conventions fiscales répondant aux normes de l’OCDE d’ici le prochain sommet du G20 en septembre 2008. Le Grand-Duché a ainsi conclu, le 7 juillet 2009, un accord d’échange d’informations fiscales conforme aux exigences de l’OCDE avec l’Autriche. Après avoir conclu des accords similaires avec la Norvège, le Luxembourg a finalement été retiré de la liste grise le 8 juillet 2009 et a ainsi rejoint la liste blanche des pays appliquant « substantiellement » les standards internationaux en matière de coopération fiscale.
– La Suisse a enfin finalisé douze avenants à des conventions fiscales qui la lient, destinés à la mettre en conformité avec les standards de l’OCDE, respectivement avec la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Danemark, la Norvège, le Mexique, le Luxembourg, le Japon, les Pays-Bas, la Pologne, l’Autriche, la Finlande et la France. Ces conventions ne seront prises en compte par l’OCDE que lorsque le Conseil fédéral suisse aura décidé de leur signature, ces accords n’ayant à ce stade fait l’objet que d’un paraphe. Or, cette signature n’interviendra vraisemblablement que lorsque ces textes auront été soumis aux cantons et aux associations économiques concernées. En outre, ces accords n’entreront en vigueur qu’après approbation du Parlement suisse. Le Conseil fédéral entend également soumettre la première convention approuvée par le Parlement au référendum facultatif, au titre des engagements supplémentaires importants qu’elle implique par rapport au contenu des conventions conclues précédemment.
– Seule l’Autriche reste pour le moment quelque peu en retrait : elle n’a signé qu’un seul accord d’échange d’informations fiscales, avec le Luxembourg, le 7 juillet 2009. Une réforme législative destinée à alléger les règles du secret bancaire autrichien a été rejetée par le Parlement en juillet 2009.
LE SECRET BANCAIRE AUTRICHIEN
Le secret bancaire autrichien est régi par la loi sur les activités bancaires (Bankwesengesetz). Il est l’un des plus stricts du monde. Les organismes et institutions de crédit, leurs associés, les membres des organes de gestion, les salariés et toute personne exerçant une activité quelconque à leur service ne doivent divulguer aucune information dont ils ont pu avoir connaissance à l’occasion d’une relation d’affaires avec un client.
Le secret bancaire est cependant inopposable aux tribunaux pénaux dans le cadre des procédures introduites pour fraude fiscale. L’obligation de révélation aux magistrats est dans ce cas régie par le code de procédure pénale. La loi sur les activités bancaires stipule que l’obligation de révéler le secret bancaire est limitée à une procédure pénale pendante. Par conséquent il n’est pas possible d’obtenir des informations protégées par le secret bancaire afin d’entamer ultérieurement une procédure pénale.
Par ailleurs, il n’existe aucune obligation de révélation tant devant le juge civil ou administratif que devant les autorités de police.
Le secret bancaire doit aussi être respecté vis-à-vis des autorités fiscales à moins qu’une procédure pénale n’ait été engagée pour un délit fiscal intentionnel (vorsaetzliches Finanzvergehen) tandis qu’une procédure pour une simple infraction fiscale (Finanzordnungswidrigkeit) n’autorise pas à lever le secret bancaire. Comme une infraction fiscale ne peut être sanctionnée que dans le cadre d’une procédure administrative et non par le juge pénal, le seul cas dans lequel les autorités fiscales ont la possibilité d’obtenir des informations protégées par le secret bancaire est celui d’une procédure pénale, non fiscale et pendante.
Il n’est pas sans intérêt pour apprécier la réelle détermination des Etats qui disent vouloir se conformer aux standards de l’OCDE d’examiner avec quels Etats ils choisissent de conclure des conventions. Beaucoup d’annonces ont été faites. Beaucoup d’engagements ont été pris par des territoires jusqu’alors peu ou pas coopératifs. Il convient de rester prudent et d’apprécier l’engagement concret des Etats au regard des mesures prises.
c) Des efforts relayés par la Conférence de Berlin de l’OCDE
Le 23 juin 2009, les représentants de 19 pays de l’OCDE et le secrétaire général de cette organisation se sont réunis à Berlin afin de tirer un premier bilan de la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales internationales par la promotion de la transparence et de l’échange d’informations en matière fiscale.
La Conférence a d’abord salué les récents progrès réalisés par plusieurs centres financiers importants, et en particulier par quatre membres de l’OCDE en vue de se mettre en conformité avec les standards internationaux dans le domaine de l’échange de renseignements, notamment depuis le G20 de Londres du 2 avril 2009. Les membres réunis ont ensuite appelé l’OCDE à renforcer son dispositif de suivi et de surveillance de l’application par les États des standards de transparence et d’échange d’informations à des fins fiscales, afin de s’assurer qu’au-delà des engagements pris, une application réelle de ces normes soit effectivement mise en œuvre. Ce suivi devra faire l’objet d’une publication régulière.
Afin d’accélérer le processus et de favoriser l’accès des pays en voie de développement à ces standards, les membres réunis lors de la Conférence ont également convenu de l’opportunité de l’utilisation de nouveaux outils, qu’il s’agisse d’instruments ou de négociations multilatéraux.
Le dispositif de surveillance par les pairs devra en particulier s’attacher à vérifier que les territoires s’engageant à se mettre en conformité avec les normes de l’OCDE pratiqueront un échange d’informations réel, comme pays demandeur de renseignements et comme pays saisi d’une demande d’échange de renseignements.
Les membres réunis se sont mis d’accord pour développer des initiatives destinées à améliorer la régularisation volontaire des contribuables, notamment par le biais de mesures favorisant la divulgation des avoirs et revenus cachés.
Afin de promouvoir les meilleures pratiques en matière d’échange de renseignements et de protéger leur assiette fiscale contre les territoires non coopératifs, des mesures de défense doivent être prises, et cela notamment pour prévenir un éventuel retard qui pourrait être pris par les paradis fiscaux pour la mise en application des standards de l’OCDE. Selon les États réunis lors de la Conférence, il pourrait s’agir de :
– l’augmentation des retenues à la source concernant une large catégorie de versements à destination des juridictions non coopératives ;
– refuser toute possibilité de déduction des frais payés à un bénéficiaire résident d’une juridiction non coopérative ;
– dénoncer les conventions et accords conclus avec des pays et des territoires qui refusent l’échange d’informations effectif.
En revanche, les États réunis lors de la Conférence de Berlin ont convenu de discuter d’une panoplie de mesures coordonnées et notamment de la possibilité de :
– fixer des obligations de déclarations plus rigoureuses, de la part des institutions financières nationales et internationales et des véhicules d’épargne collective, en matière de transactions impliquant des juridictions non coopératives ;
– refuser toute exonération en matière de participations ;
– demander aux institutions financières internationales de revoir leur politique d’investissement au regard du degré de coopération de ces territoires.
La Conférence de Berlin a enfin souligné l’importance de la disponibilité d’informations relatives aux bénéficiaires et titulaires de comptes bancaires, de véhicules d’investissement et autres avoirs, et a expressément demandé à l’OCDE, au GAFI et à l’Union européenne d’explorer l’ensemble des moyens destinés à faciliter l’accès aux informations relatives aux trusts, fondations, sociétés coquilles et autres montages pouvant être utilisés à des fins d’évasion fiscale.
d) Des incertitudes quant à la portée réelle de la « liste grise »
Au-delà de la publication de ces listes elles-mêmes, se pose la question de leur efficacité : celle-ci repose sur le présupposé qu’une publication est en elle-même efficace, en vertu du principe du « name and shame ». Le fait d’être montré du doigt comme étant un paradis fiscal non coopératif serait en effet insupportable pour les juridictions concernées, attachées à leur réputation qui seule leur permet de drainer les capitaux de l’étranger. Cette efficacité est bel et bien avérée : l’ample mouvement de déclarations et engagements divers à coopérer de la part des territoires concernés qui a précédé et suivi la tenue du G20 le 2 avril 2009 suffit à lui seul à démontrer le poids que revêt la « désignation » des États non transparents et non coopératifs.
Et pourtant, plusieurs reproches ont été adressés à ces listes :
– Celles-ci sont davantage le fruit d’un compromis entre grands États que le résultat d’un travail totalement objectif. En effet, Hongkong et Macao n’ont pas été inclus dans la liste, non pas en raison de leur statut de régions administratives spéciales, mais en raison de leur engagement à se soumettre aux normes de l’OCDE relatives à la coopération en matière fiscale. Or, de nombreux États ont fait part de leur volonté d’appliquer les standards de l’OCDE en amont du G20 de Londres sans pour autant se voir retirer de la liste grise, dont le critère déterminant est la conclusion d’au moins douze accords d’échange de renseignements respectant les normes de l’OCDE. Dès lors, on comprend mal l’absence de ces deux territoires, qui ont rigoureusement adopté la même démarche que de nombreux autres États figurant sur la liste grise, en annonçant une modification de leur législation interne avant la fin de 2009 afin d’être en mesure d’échanger des renseignements bancaires sur demande avec d’autres juridictions.
– Un certain nombre de juridictions figurant sur la liste grise ont également fait valoir que des territoires tels que la City de Londres qui abrite notamment le marché des eurodollars ou l’État du Delaware aux États-Unis auraient théoriquement dû être inscrits sur cette liste grise.
LE DELAWARE : UN PARADIS RÉGLEMENTAIRE À FISCALITÉ PRIVILÉGIÉE
Le principe du fédéralisme aux États-Unis explique les différents niveaux de fiscalité : des impôts sont en effet dus aux niveaux fédéral et fédéré, également parfois au niveau des collectivités locales. En tout état de cause, les États fédérés lèvent leurs propres impôts et taxes.
Le petit État du Delaware (870 00 habitants) a ainsi forgé un système fiscal particulièrement attractif. Si aujourd’hui plus de la moitié des 500 plus grosses fortunes et 43 % des sociétés cotées à la Bourse de New York y sont domiciliées, c’est en grande partie parce qu’il offre un cadre fiscal avantageux.
En effet, toutes les taxes fédérales y sont appliquées, y compris les impôts sur les revenus des personnes physiques et des entreprises, il n’existe pas d’impôt sur les bénéfices au niveau de l’État fédéré pour les entreprises réalisant des profits en dehors de ses frontières, pas plus qu’une obligation de tenir une comptabilité. Chaque année, les entreprises doivent s’acquitter du seul paiement de la taxe annuelle de franchise, « franchise tax », de l’ordre de 200 euros.
Le Delaware offre également un total anonymat : les noms des dirigeants, membres ou actionnaires d’une société ne sont pas sujets à enregistrement public. Une société immatriculée dans le Delaware n’est pas obligée d’avoir son siège social, ni d’exercer une activité réelle dans cet État. Une seule personne peut être actionnaire, administrateur et dirigeant de la même société. Les actions détenues par une personne non-résidente ne font d’ailleurs l’objet d’aucune imposition. La loi des sociétés du Delaware permet que les réunions du Conseil d'Administration se fassent par téléphone.
Par ailleurs, l’accumulation de revenus de placement et les gains en capitaux d’un trust établi pour le bénéfice d’un non-résident de l’État (qu’il soit installé dans un autre État américain, ou originaire de l’étranger) ne sont pas imposés.
Enfin, la « General Corporation Law » du Delaware offre un système juridique favorable aux entreprises et à la liberté contractuelle. Les tribunaux du Delaware, notamment la Cour exclusivement dédiée aux affaires corporatives (« Court of Chancery »), ont développé une jurisprudence particulièrement bien disposée à l’égard des directions de sociétés.
En revanche, le Delaware n’est pas à un territoire pratiquant le secret bancaire et il est formellement coopératif en matière d’échanges d’informations dès lors qu’il doit répondre aux demandes sur le fondement des conventions signées par les États-Unis.
S’agissant du Delaware, si les États fédérés aux États-Unis lèvent leurs propres impôts, ils ne sont pas souverains en matière de négociation des conventions internationales : il est donc logique que la liste grise n’ait pas intégré cet État qui n’est pas signataire des accords d’échange de renseignements qui l’engagent pourtant en application des conventions conclues par l’État fédéral. D’autre part, le secret bancaire est inopposable à l’administration fiscale au Delaware comme dans tous les autres États fédérés.
S’agissant de la City de Londres, l’existence en son sein d’un marché échappant à toute supervision et toute régulation constitue un problème au regard des exigences de transparence : un îlot d’économie offshore au cœur même de l’onshore. Il serait toutefois difficile d’inclure cette problématique spécifique dans le cadre des listes dressées par l’OCDE : en effet, le Royaume-Uni seul détient la capacité de négocier et conclure des conventions fiscales. Il est d’ailleurs partie à plus d’une centaine d’accords d’élimination des doubles impositions, dont la plupart comportent un volet relatif à l’échange d’informations en matière fiscale. Le chef de la division coopération internationale et compétition fiscale de l’OCDE, M. Pascal Saint-Amans, fait également valoir que le véritable obstacle à la transparence qui caractérise la City de Londres consiste dans son utilisation des juridictions de Jersey, Guernesey et de l’île de Man. Or, sur la période 2008-2009, le Royaume-Uni a précisément conclu des accords d’échange de renseignements à la demande avec ces territoires, de même qu’avec les îles Vierges britanniques.
La liste grise élaborée par l’OCDE ne recouvre d’ailleurs pas l’ensemble des juridictions de la planète : en effet, les travaux du Forum mondial sur la fiscalité portent sur 83 pays, desquels ne fait par exemple pas partie le Liban, qui ne figure donc pas sur la liste grise, alors même qu’il était recensé sur la liste noire du GAFI et classé par le FSF en 2000 dans la catégorie des territoires dont le système de réglementation est lacunaire. La supervision, en matière bancaire notamment, demeure aujourd’hui encore insuffisante au Liban : de nombreux superviseurs bancaires internationaux font part de difficultés de coopération avec le Liban.
– On peut également s’interroger sur le seul et unique critère retenu par l’OCDE pour définir la liste des territoires ne respectant pas « substantiellement » les standards internationaux en matière d’échange d’informations : la signature de 12 accords incorporant une clause d’échange de renseignements sur demande. Fallait-il fixer un seuil supérieur ? Ne court-t-on pas le risque que les territoires concernés ne poursuivent pas leur processus de négociation une fois atteint le seuil de douze conventions ? En réalité, le nombre choisi semble pertinent au regard de l’absence de progrès accomplis par les juridictions initialement listées en 2000. D’autre part, comme a pu le souligner le secrétaire général de l’OCDE, M. Angel Gurría, le 8 juillet 2009, si le seuil de douze conventions conformes aux standards internationaux constitue un bon indicateur des progrès accomplis par les territoires figurant sur la liste grise, il ne doit pas se muer en plafond et doit au contraire être considéré tant par les juridictions concernées que par les autres États comme une première étape d’un processus dynamique.
– Plus largement, un point d’interrogation crucial demeure concernant les modalités d’application effective du modèle OCDE au sein des conventions fiscales qui seront négociées. En effet, l’article 26 du modèle de convention fiscale sur le revenu et la fortune élaboré par l’OCDE, qui fournit la norme la plus généralement reconnue pour l’échange bilatéral de renseignements à des fins fiscales, prévoit l’échange illimité de renseignements sur demande dans toutes les affaires fiscales aux fins de l’administration et de l’application de la législation fiscale nationale, sans condition d’intérêt fiscal national ou possibilité d’invoquer le secret bancaire à des fins fiscales.
Cet article ne risque-t-il pas de faire l’objet d’interprétations divergentes de la part des États, en fonction notamment de leur pratique du secret bancaire ?
À cet égard, la notion de soupçon de fraude est ambiguë. À peine la nouvelle convention fiscale signée entre la Suisse et la France, un certain nombre de représentants du monde de la banque suisse faisaient état dans la presse d’une interprétation restrictive de l’article 26. Pour demander et obtenir des renseignements, l’administration française devrait ainsi fournir à la Suisse des indices fondés et documentés, mentionner le nom du client et celui de la banque. L’administration suisse sera juge de la recevabilité des requêtes et elle ne donnerait pas suite à ce qu’elle estimerait être des demandes nominatives insuffisamment justifiées. Pour certains, un nom, une adresse, une indication des renseignements demandés et une période visée ne sont pas suffisants (36). De telles interprétations ne préjugent certes pas de la qualité de la coopération qui sera effectivement pratiquée. Toutefois, elles risquent de conduire à une nouvelle doctrine du « level playing field », chaque signataire d’une convention n’appliquant pleinement l’échange d’informations qu’à partir du moment où les autres États jouent vraiment le jeu. Après l’attentisme manifesté par certains territoires avec des engagements non traduits en conventions, il conviendrait de ne pas basculer dans un autre attentisme avec des conventions insuffisamment appliquées. De ce point de vue, le rôle de suivi de l’OCDE sera essentiel. Le fait d’avoir conclu douze accords d’échange de renseignements était un critère pour sortir de la liste grise, ne pas les appliquer dans de bonnes conditions devra donc être un critère pour y figurer à nouveau.
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 26 : L’EXEMPLE DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE À l’heure actuelle, aux termes de la loi fédérale suisse sur l’assistance mutuelle, seule une entraide judiciaire est possible dans les affaires fiscales si la personne concernée par la procédure intentée par l’autorité étrangère est suspectée d’une conduite relevant de la fraude fiscale dans la législation suisse. L’assistance est octroyée sous condition de réciprocité et est possible même en l’absence de convention internationale avec les pays requérants. L’entraide judiciaire inclut la saisie de documents et la transmission de renseignements bancaires. Toutefois, les informations obtenues peuvent être utilisées exclusivement dans le cadre des poursuites du délit et à aucune autre fin (par exemple, pour le calcul de l’impôt dû). Le dernier rapport de l’OCDE relatif à la coopération fiscale de 2008 fait ainsi état de 72 conventions d’élimination des doubles impositions engageant la Suisse, dont 66 comportent une clause d’échange de portée étroite, c’est-à-dire qu’elles limitent l’échange de renseignements aux informations nécessaires à l’application de la convention, et non à des fins fiscales nationales. Sur les six conventions comportant une clause d’échange de large portée, deux sont limitées aux affaires pénales et quatre concernent également certaines affaires civiles. Par ailleurs, la définition de la fraude fiscale en droit suisse reste très étroite : elle repose sur une trilogie qui tend à distinguer entre l’évasion fiscale, la soustraction d’impôt et la fraude fiscale. La première n’est pas une infraction, mais consiste à utiliser une structure insolite dans le but d’économiser des impôts. En revanche, en matière d’infraction fiscale, la délimitation fondamentale du système suisse est fondée sur la différence entre la soustraction d’impôt et la fraude fiscale. De manière générale, une soustraction d’impôt consiste à faire en sorte qu’une taxation ne soit pas effectuée, ou qu’une taxation entrée en force soit incomplète. La sanction prévue est l’amende. Celle-ci peut aller jusqu’à trois fois l’impôt soustrait. La soustraction n’étant pas passible de l’emprisonnement, elle est qualifiée de contravention. Quant à la fraude fiscale, elle constitue un délit pouvant conduire à l’emprisonnement. Il s’agit d’une soustraction qualifiée, en ce sens que l’auteur utilise un comportement astucieux (typiquement des faux documents) qui a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important d’impôt. Il existe deux formes classiques de fraude fiscale : l’usage de faux (en matière d’impôts directs) et l’escroquerie fiscale (pour les impôts régis par le droit pénal administratif). Le 11 juin 2009, un avenant à la convention franco-suisse d’élimination des doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 1966 a été paraphé par les deux États. Il a été signé par les deux parties officiellement le 27 août 2009. Cet avenant obligera désormais, si les autres conditions sont réunies, non seulement les banques et les établissements financiers, mais aussi les mandataires, les agents et fiduciaires de toute nature à révéler les renseignements demandés par l’administration française en cas de soupçon de fraude fiscale ou d’infraction équivalente. D’après l’administration fiscale suisse, « à l’avenir, il sera possible d’échanger à des fins fiscales des informations avec d’autres pays au cas par cas, en réponse à des demandes concrètes et étayées, et ceci indépendamment de l’existence ou non d’un délit fiscal. Les échanges d’informations selon les normes de l’OCDE seront juridiquement effectifs dès lors que les nouvelles conventions de double imposition seront entrées en vigueur ». Elle interprète comme suit les conditions devant présider à l’échange de renseignements : « La future politique d’assistance administrative en matière fiscale devra impérativement intégrer les éléments suivants : – pas d’échange automatique d’informations ; – assistance administrative limitée aux cas d’espèce justifiés et concrets, en réponse à une demande ; – exclusion de mesures servant uniquement à la recherche de preuves (fishing expeditions) ; – mise en place de solutions transitoires équitables ; – limitation de l’échange d’informations aux impôts tombant sous le coup de la convention de double imposition ». Une telle doctrine devrait permettre une application satisfaisante de la norme OCDE en matière d’échange de renseignements à des fins fiscales. |
Par exemple, l’application de l’article 26 du modèle de la convention OCDE aurait permis d’obtenir de la part des autorités suisses des informations précises sur les comptes détenus par les 3 000 personnes dont l’administration fiscale française vient de se procurer la liste.
– Enfin, une dernière interrogation porte sur la mise en œuvre effective de sanctions à l’encontre des territoires non coopératifs : lors de la Conférence de Berlin, les 19 États réunis ont évoqué la possibilité de telles sanctions à l’encontre des territoires qui persisteraient à ne pas mettre en œuvre leurs engagements à se conformer aux standards internationaux en matière d’échange d’informations à des fins fiscales. Toutefois, de telles sanctions ont été explicitement réservées aux États. Ni l’Union européenne, ni l’OCDE ne pourraient prendre de telles décisions. Par ailleurs, le G20 de Londres a confié à la prochaine réunion des ministres des Finances du G20 en Écosse en novembre 2009 le soin d’entériner d’éventuelles sanctions contre les juridictions non coopératives. Pour être efficaces, il semble en tout état de cause indispensable que de telles sanctions fassent l’objet d’une décision coordonnée, quand bien même leur mise en œuvre passerait par des dispositifs nationaux distincts.
Il conviendrait, en tout état de cause, que la France cherche à tester rapidement l’effectivité de l’échange de renseignements dès l’entrée en vigueur des conventions (ou de leurs avenants) conclus avec les juridictions figurant sur la liste grise. L’absence d’échange réel devrait alors logiquement conduire à dénoncer ces accords.
3.– La relance des négociations européennes sur l’assistance administrative
Sur un plan général, la Commission européenne capitalise l’expérience acquise dans le domaine de la lutte contre les pratiques dommageables en déclinant les positions adoptées au niveau international. Comme le rappelait László Kovács, membre de la Commission chargé de la fiscalité et de l’union douanière : « Les États membres de l’Union européenne ne peuvent pas se permettre d’agir seuls lorsqu’ils conçoivent des politiques visant à empêcher le détournement de leurs recettes fiscales vers les paradis fiscaux ou des juridictions non coopératives. S’ils ne coopèrent pas, en particulier au sein des enceintes internationales, les mesures qu’ils prennent pour protéger leurs recettes resteront sans effets ». L’UE se veut moteur dans la définition de politiques internationales en la matière. Cela passe par l’application avancée des principes de transparence au sein même de l’UE.
La Commission européenne a ainsi adopté le 28 avril 2009 une communication dans laquelle sont recensées les mesures que les États membres devraient prendre pour promouvoir la « bonne gouvernance » dans le domaine fiscal, c’est-à-dire plus de transparence et d’échange d’informations et de nouveaux progrès sur la voie de la concurrence loyale en matière fiscale. Cette communication indique les moyens qui permettraient d’améliorer la bonne gouvernance au sein de l’UE et recense les outils dont la Communauté et les États membres disposent pour veiller à ce que les principes de bonne gouvernance soient mis en oeuvre au niveau international. Enfin, elle invite les États membres à adopter, dans leurs relations bilatérales avec les pays tiers et au sein des enceintes internationales, une approche plus cohérente par rapport aux principes de bonne gouvernance. La communication s’appuie sur la politique poursuivie par l’UE dans le domaine fiscal et les récentes conclusions du G20 en matière de juridictions fiscales non coopératives.
La Commission invite donc les États membres de l’Union à adopter dès que possible ses récentes propositions qui visent à :
– assurer une coopération administrative efficace dans l’évaluation des impôts et taxes, qui empêcherait notamment les États membres d’invoquer à l’avenir la législation sur le secret bancaire pour justifier le fait qu’ils s’abstiennent d’assister les autorités fiscales d’autres États membres ;
– garantir la coopération administrative dans le recouvrement des créances fiscales ;
– améliorer le fonctionnement de la directive sur la fiscalité de l’épargne. Il est en effet nécessaire d’élargir le champ d’application de cette directive aux structures intermédiaires exonérées d’impôts (trusts, fondations etc.) et aux revenus équivalents aux intérêts perçus pour des investissements dans certains produits financiers innovants.
La Commission demande également aux États membres de poursuivre les travaux qu’ils mènent dans le cadre du Code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises aux fins d’abroger les mesures dommageables en matière de fiscalité des entreprises. Elle propose d’améliorer les outils spécifiques dont la Communauté européenne et les États membres disposent pour encourager la bonne gouvernance au niveau international :
– elle recense les moyens d’assurer une meilleure cohérence entre les politiques de l’UE en général, de façon à ce que les partenaires de l’UE s’engagent à mettre en œuvre les principes de bonne gouvernance. À cet effet, il convient notamment d’assurer le respect de ces principes dans les accords entre l’UE et les pays tiers concernés et de prévoir des incitations dans le cadre de la coopération au développement ;
– elle invite les États membres de l’UE à adopter une approche coordonnée et cohérente pour promouvoir les principes de bonne gouvernance vis-à-vis des pays tiers, et, notamment, lorsque cela se justifie, à adopter des mesures coordonnées à l’encontre des juridictions qui refusent d’appliquer les principes de bonne gouvernance.
Voici quelques-unes des mesures concrètes proposées :
– inviter le Conseil à donner le poids politique approprié au mandat confié à la Commission pour intégrer les principes de bonne gouvernance dans les accords entre l’UE et les pays tiers concernés ;
– étudier avec les États membres les mesures de rétorsion qui pourraient être prises à l’encontre des juridictions non coopératives dans le domaine fiscal (le Secrétariat de l’OCDE a proposé une liste de mesures. Ces mesures devront être examinées avec les États membres) ;
– promouvoir un renforcement de la coopération avec les pays tiers dans le cadre de la directive sur la fiscalité de l’épargne ;
– conclure des accords spécifiques dans le domaine fiscal contenant, au besoin, des dispositions relatives à la transparence et à l’échange d’informations aux fins de la fiscalité au niveau de l’UE, afin d’accélérer le processus de mise en œuvre des engagements pris par certaines juridictions pour accroître la transparence et l’échange d’informations ;
– étudier l’opportunité de réaffecter des fonds au profit des pays en développement qui respectent leurs engagements et, inversement, étudier l’opportunité de supprimer les fonds destinés aux pays qui n’auraient pas respecté leurs engagements ;
– accroître la cohérence entre, d’une part, les politiques fiscales bilatérales avec les pays tiers menées par les États membres et, d’autre part, les principes de bonne gouvernance dans le domaine fiscal.
Par ailleurs, le chantier de la directive ACCIS est toujours ouvert : la mise en place d’une assiette commune consolidée d’imposition des sociétés permettrait d’encadrer de façon plus satisfaisante l’activité transfrontalière des entreprises.
Deux propositions de directives sont en outre déjà sur la table.
a) La refonte de la directive épargne
La Commission européenne a adopté le 13 novembre 2008 une proposition de modification de la directive sur la fiscalité de l’épargne en vue de combler les lacunes existantes et de mieux prévenir l’évasion fiscale. Depuis 2005, en vertu de la directive « Épargne », les agents payeurs sont tenus soit de déclarer les intérêts perçus par les contribuables résidant dans d’autres États membres de l’UE, soit de prélever une retenue à la source sur les intérêts perçus. La proposition de la Commission vise à améliorer la directive, principalement de deux manières :
– d’une part, afin de mieux garantir l’imposition des paiements d’intérêts transitant par des structures intermédiaires non imposées ;
– et d’autre part, en étendant le champ d’application de la directive aux revenus équivalents à des intérêts et provenant d’investissements effectués dans divers produits financiers innovants ainsi que dans certains produits d’assurance-vie.
● La détermination du bénéficiaire effectif des paiements d’intérêts constitue le premier objectif de la réforme de la directive : en effet, à l’heure actuelle, il est relativement facile pour les personnes physiques de contourner les règles en utilisant des instruments d’investissement intermédiaires (personnes morales ou constructions juridiques tels que certains trusts ou certaines fondations) qui ne sont pas couverts par la définition officielle actuelle du bénéficiaire effectif (qui fait exclusivement référence aux personnes physiques) et qui ne sont pas tenus actuellement d’agir en tant qu’agents payeurs. Une extension généralisée de la directive à tous les paiements effectués en faveur d’entités et de constructions juridiques n’a pas été retenue par la Commission, qui juge plus efficace de demander aux agents payeurs d’utiliser les informations dont ils disposent déjà dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent (approche par transparence).
Dans le cas des paiements d’intérêts effectués par des agents payeurs (banques, institutions financières, professionnels indépendants, etc.) établis dans l’UE en faveur de certaines structures intermédiaires (figurant dans la liste de l’annexe I de la proposition) établies en dehors de l’UE, la Commission propose donc que les agents payeurs établis dans l’UE (et qui savent, grâce aux mesures existantes dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent, que le bénéficiaire effectif des paiements d’intérêts est une personne physique résidant dans l’Union) appliquent les dispositions de la directive (échange d’informations ou retenue à la source) au moment du paiement en faveur de la structure intermédiaire, comme si ce paiement était directement effectué en faveur de la personne physique concernée.
En ce qui concerne les paiements d’intérêts en faveur de certaines structures intermédiaires établies au sein de l’UE, notamment certains trusts et fondations à but non caritatif, ces structures seront toujours tenues d’agir en tant qu’« agents payeurs à la réception ». En d’autres termes, les dispositions de la directive (échange d’informations ou retenue à la source) doivent être appliquées par ces structures à la réception de tout paiement d’intérêts provenant d’un quelconque opérateur économique situé en amont (banque, institution financière, professionnel indépendant), où qu’il soit établi et indépendamment de la distribution réelle de toute somme au profit des bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques. La définition d’« agent payeur à la réception » proposée inclut toutes les entités et constructions juridiques (trusts, fondations, etc.) dont les revenus ne sont pas imposés en vertu des règles générales régissant la fiscalité directe dans l’État membre dans lequel elles sont résidentes ou établies (une liste indicative de ces entités et structures juridiques figurera à l’annexe III de la directive).
● L’extension du champ d’application de la directive aux revenus équivalents à des paiements d’intérêts constitue le second objectif du projet de refonte. En effet, l’utilisation d’instruments financiers innovants plutôt que d’un compte d’épargne classique dans une banque peut également permettre de contourner la directive sur la fiscalité de l’épargne : il suffit à l’heure actuelle d’organiser son portefeuille d’investissement de manière à ce que certains revenus restent en dehors du champ d’application de la définition du paiement d’intérêts figurant dans la directive, bien que les investissements dont ils proviennent présentent des caractéristiques équivalentes à celles de créances en ce qui concerne la limitation du risque, la flexibilité et la garantie d’un rendement déterminé.
La Commission propose donc d’étendre le champ d’application de la directive aux revenus provenant :
– de titres équivalents à des créances (dont le capital est protégé et le rendement prédéfini) ;
– de contrats d’assurance-vie dont la performance est strictement liée à des revenus provenant de créances ou à des revenus équivalents et qui prévoient une couverture des risques biométriques inférieure à 5 %.
● En outre, la proposition de la Commission vise à garantir des conditions équitables pour tous les fonds ou dispositifs de placement (qu’il s’agisse ou non d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières autorisés conformément à la directive sur les OPCVM),indépendamment de leur forme juridique. En d’autres termes, les revenus provenant de ces fonds de placement perçus par des personnes physiques résidant dans l’UE seront soumis à une imposition effective.
Toute modification du champ d’application de la directive exige en fait un réexamen des accords conclus avec les juridictions des dix territoires dépendants et associés qui appliquent les mêmes mesures. En ce qui concerne les cinq pays non membres de l’UE qui appliquent des mesures équivalentes, la Commission indique qu’il serait souhaitable d’introduire des modifications analogues dans les accords signés. Par ailleurs, il semble essentiel que l’UE poursuive ce travail en concluant de nouveaux accords avec d’autres juridictions afin d’étendre géographiquement, notamment en direction de certaines places financières asiatiques, la zone couverte par des mesures équivalentes et diminuer d’autant les possibilités de fraude fiscale.
Le Parlement européen a adopté, le 24 avril 2009, une résolution sur cette proposition de directive, qui met l’accent sur deux points principaux du texte, mettant en évidence l’enjeu que constituent les mécanismes et montages favorisant l’opacité :
– La réflexion s’est en effet concentrée d’une part sur les listes figurant dans les annexes I et III, recensant, d’une part, les structures et les entités juridiques situées hors de l’UE et qui devront être soumises aux dispositions de la directive et, d’autre part, les structures à l’intérieur de l’UE qui seront considérées comme des « agents payeurs à la réception » et devront donc également se soumettre aux obligations de la directive. Ainsi, s’agissant de l’annexe I, le Parlement propose d’élargir autant la liste des juridictions concernées que celle des entités et constructions juridiques. En échange, une procédure pourrait être mise en place pour que les juridictions en cause puissent demander l’exclusion de la liste de certaines entités et constructions déterminées qui rempliraient certaines conditions. On notera que cette annexe concerne d’ores et déjà les Anstalt et Stiftung au Liechtenstein, ainsi que les trusts et fondations monégasques ou suisses.
– D’autre part, le Parlement européen fait de la remise en cause des retenues à la source, pour lesquelles une période de transition avait été fixée, un enjeu pour la refonte de la directive sur la fiscalité de l’épargne. En effet, à partir de 2011, la retenue appliquée s’établira à 35 % pour les États ayant opté pour cette solution (Autriche, Belgique, Luxembourg, Suisse, Liechtenstein, Saint-Marin, Monaco et Andorre). Or, ce système alternatif n’avait pas vocation à devenir permanent. La refonte du dispositif doit donc passer par la réaffirmation du caractère transitoire de la retenue à la source et la fixation de son échéance. L’intégration des États concernés dans un dispositif de droit commun est d’autant plus logique que la mise en place de la retenue à la source était liée à l’application du secret bancaire dans ces territoires : or, avec la renégociation massive des accords d’échanges de renseignements qui est en cours en 2009, le principe de la retenue à la source devient de facto obsolète.
La refonte de la directive sur la fiscalité de l’épargne apparaît donc aussi comme l’occasion de mettre en pratique la levée du secret bancaire à des fins fiscales. La remise en cause de la retenue à la source est donc indispensable dans le cadre de cette réforme : elle nécessite toutefois l’unanimité du Conseil.
→ Défendre la fin du régime transitoire de retenue à la source dans le cadre de la renégociation de la directive épargne et généraliser l’échange automatique d’informations pour l’ensemble des revenus de l’épargne perçus directement ou indirectement par les particuliers.
b) Les propositions de directives « assistance mutuelle »
Le régime actuel d’assistance mutuelle date de 1977 (directive 77/799/CEE du Conseil) pour ce qui concerne l’établissement du montant des taxes et impôts. À l’époque, la mobilité des personnes et des capitaux n’avait rien de comparable avec celle d’aujourd’hui. De nos jours, les fraudeurs profitent de la limitation territoriale des compétences des autorités fiscales nationales pour dissimuler des revenus obtenus dans d’autres pays ou organiser leur insolvabilité dans les pays où ils ont des dettes fiscales.
Dans le cadre de sa stratégie visant à mieux combattre l’évasion et la fraude fiscales, la Commission européenne a adopté, le 2 février 2009, deux propositions de nouvelles directives visant à améliorer l’assistance mutuelle entre les autorités fiscales des États membres pour l’établissement du montant et le recouvrement des taxes et impôts. Le fait que les États membres ne seront plus en mesure d’invoquer le secret bancaire pour refuser de coopérer les uns avec les autres constitue l’un des éléments clés de ces propositions.
L’une des principales nouveautés de la première proposition visant à améliorer la coopération administrative pour l’établissement du montant des taxes et impôts est son champ d’application élargi, qui couvre l’ensemble des taxes et impôts à l’exception de ceux faisant l’objet d’une réglementation communautaire spécifique, comme la TVA et les droits d’accises. Ainsi, la proposition a pour objet d’aider les États membres à coopérer efficacement au niveau international afin de surmonter les difficultés croissantes auxquels ils sont confrontés pour établir correctement le montant des taxes et impôts qui leur sont dus. La proposition prévoit des règles de coopération plus claires et plus précises. Elle fixe notamment des règles de procédure communes, ainsi que des formulaires, des formats et des canaux communs pour les échanges d’informations. Elle permet aussi aux fonctionnaires de l’administration fiscale d’un État membre de se rendre sur le territoire d’un autre État membre et de participer activement - avec les mêmes pouvoirs d’inspection - aux enquêtes administratives qui y sont menées.
La question du secret bancaire invoqué pour refuser la coopération transfrontalière est l’un des problèmes principaux traités dans le nouveau projet de directive. Fondée sur le modèle de convention de l’OCDE, la proposition dispose qu’un État membre ne peut refuser de fournir des informations concernant un contribuable de l’État membre requérant au seul motif que cette information est détenue par une banque ou une autre institution financière. Ainsi, la proposition abolit le secret bancaire dans les relations entre autorités fiscales lorsqu’un État membre requérant contrôle la situation fiscale d’un de ses contribuables résidents.
Cette proposition introduit un autre élément crucial puisqu’elle oblige les États membres à accorder le même niveau de coopération à leurs partenaires européens que celui consenti à tout autre pays tiers, ce qui souligne la dimension spécifiquement européenne.
Dans ses conclusions du 9 juin 2009, le Conseil « Ecofin » a confirmé que la disposition en question serait mise en conformité totale avec la norme de l’OCDE, ce qui permettra de garantir que la coopération future entre les administrations fiscales de l’Union européenne s’effectue dans le respect des normes internationales.
D’autre part, dans le domaine de l’assistance au recouvrement des créances fiscales, le premier régime juridique communautaire date de 1976 (directive 76/308/CEE du Conseil). Une nouvelle directive n° 2008/55/CE du Conseil du 26 mai 2008 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement de créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures, est entrée en vigueur : elle doit permettre à la fois un échange d’informations sur demande entre les États membres, mais également une assistance au recouvrement permettant aussi bien la notification de documents que le recouvrement de créances fiscales à la demande d’un État membre par un autre État membre. Cette directive comporte également la mise en place d’un titre exécutoire européen uniformisé. Elle ne concerne toutefois que la fiscalité indirecte ainsi que les impôts sur le revenu et sur la fortune.
C’est pourquoi la Commission a introduit cette seconde proposition de directive, qui vise à améliorer l’assistance mutuelle en matière de recouvrement de créances fiscales : elle a pour objet de renforcer et d’améliorer l’assistance au recouvrement entre les États membres, ce qui devrait permettre d’améliorer le taux de recouvrement, qui ne représente actuellement que 5 % environ des montants pour lesquels une assistance est demandée. La Commission propose notamment de :
– couvrir l’ensemble des taxes, impôts et droits perçus par les États membres et leurs subdivisions administratives, de même que les contributions sociales obligatoires ;
– mettre en place un système obligatoire d’échange spontané d’informations concernant les remboursements de taxes et d’impôts effectués par les autorités fiscales nationales en faveur de non-résidents ;
– permettre aux fonctionnaires d’un pays de participer activement à des enquêtes administratives sur le territoire d’un autre pays ;
– permettre qu’une assistance puisse être demandée au début du processus de recouvrement si la probabilité de recouvrement s’en trouve améliorée ;
– simplifier et rationaliser les procédures utilisées pour demander ou fournir une assistance mutuelle.
Outre les dispositions que comportent ces deux propositions de directives destinées à renforcer l’assistance mutuelle au sein de l’UE, l’instauration d’un droit de suite pourrait être envisagé au niveau communautaire, qui permettrait à l’administration fiscale d’un État membre, dans le cadre du contrôle d’une société, d’effectuer des recherches ou vérifications dans un autre État membre où serait implantée une société du même groupe que la société vérifiée, une filiale de la société vérifiée ou une société dans laquelle la société vérifiée détient un certain seuil de participation.
→ Instaurer un droit de suite en matière de contrôle fiscal au niveau de l’Union européenne et renforcer les instruments européens de lutte contre la fraude fiscale.
c) La coopération avec les États voisins
Les deux propositions de directives de renforcement de l’assistance mutuelle entre les États membres de l’Union européenne doivent enfin être logiquement complétées par l’amélioration de la coopération avec les administrations fiscales des pays avec lesquels l’Union entretient des relations très étroites.
Rappelons que plusieurs accords dits « anti-fraude » ont d’ores et déjà été signés entre l’UE et certains États voisins.
– La Principauté de Liechtenstein a ainsi accepté l’assistance administrative et juridique mutuelle en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts au titre de son accord conclu avec la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts. Andorre, Monaco, Saint-Marin et la Suisse ont également conclu des accords à cet effet avec l’Union européenne et ses États membres. Par ailleurs, la Commission européenne est sur le point de finaliser ses négociations avec le Liechtenstein en vue d’un accord relatif à la coopération dans la lutte contre la fraude fiscale : celui-ci tient compte des conclusions du Conseil « Ecofin » du 10 février 2009 qui entend s’assurer d’une assistance administrative et d’un accès à l’information effectifs en ce qui concerne toutes les formes d’investissement, notamment les fondations et les trusts, ainsi que des conclusions du G20 de Londres. Les négociations comportent un volet concernant la coopération en matière fiscale, qui prévoit l’inclusion intégrale de la norme établie à l’article 26 du modèle de l’OCDE.
– La Communauté européenne et ses États membres ont par ailleurs déjà signé un accord avec la Confédération suisse en vue de lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers le 26 octobre 2004. À ce jour, la procédure nationale de ratification est encore en cours dans deux États membres. En ce qui concerne la Communauté, le Conseil a autorisé la signature de l’accord le 18 décembre 2008. Cet accord de lutte contre la fraude contient, en matière d’assistance administrative et juridique, des dispositions qui vont au-delà de celles contenues dans l’acquis Schengen, mais il ne concerne que la fiscalité indirecte (dont les douanes). En d’autres termes, l’accord ne couvre pas les impôts directs et ne tient pas compte de la fraude et de l’évasion fiscales afférentes à ceux-ci. Il est donc nécessaire d’y intégrer de nouvelles dispositions concernant la fraude et l’évasion fiscales ainsi que la coopération fiscale dans le domaine de la fiscalité directe.
Ces accords n’excluent pas la possibilité pour les États membres de revoir leurs propres conventions fiscales bilatérales. Toutefois, il se trouve que certaines des juridictions concernées (principalement la Principauté de Monaco, mais aussi celle d’Andorre) ont émis le souhait de mener des négociations avec l’Union européenne plutôt qu’au niveau bilatéral avec les États membres et que cette démarche renforce l’action de l’Union européenne dans son ensemble sur la scène internationale. Un accord à l’échelon de l’Union contribuera en outre à garantir une égalité de traitement pour tous les pays concernés et, en particulier, pour les activités financières de ces juridictions.
C’est dans cet esprit que la Commission européenne a publié le 24 juin 2009 une recommandation visant à ouvrir des négociations avec Andorre, Monaco, Saint-Marin et la Suisse en vue de la conclusion d’accords portant non seulement sur la lutte contre la fraude afin de protéger les intérêts financiers des États membres de l’Union européenne, mais aussi sur la coopération à la demande dans le domaine de l’évasion fiscale et aux fins de la détermination correcte des impôts et taxes. Pour garantir une coopération effective, il faut veiller à ce que les parties disposent du pouvoir d’obtenir et de fournir à la demande des informations détenues par les banques et d’autres institutions financières, dont les trusts et les fondations, dans le cadre de l’assistance administrative.
Comme cela a été le cas pour le Liechtenstein, il convient donc d’étendre la portée des négociations pour que celles-ci couvrent non seulement la lutte contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des parties, y compris en matière douanière, mais aussi la coopération administrative sous forme d’échange d’informations en vue du calcul et de la perception des impôts directs et indirects.
Cette approche européenne semble désormais privilégiée : elle a l’avantage d’être plus rapide, plus uniforme et de mettre l’ensemble des États concernés sur un pied d’égalité, contrairement à la négociation de conventions bilatérales. Elle n’est toutefois pas exclusive de la conclusion de tels accords : autrement dit, elle ne se substitue pas ipso facto aux accords d’échange de renseignements déjà existants et ne tient pas lieu d’accord bilatéral avec chaque État membre de l’Union européenne. Cela signifie que, dans le cadre de l’objectif de la conclusion de douze accords d’échange d’informations conformes au modèle de l’OCDE, un accord global anti-fraude signé avec l’Union européenne n’équivaut pas à 27 conventions fiscales avec chaque membre de l’UE pris à part.
d) La proposition de directive sur les hedge funds
Le 30 avril 2004, la Commission européenne a proposé d’adopter, sous la forme d’une directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, la première réglementation européenne sur les fonds spéculatifs, mesure qui fait partie d’un plan global visant à combler les lacunes réglementaires qui ont contribué à l’éclatement de la crise financière.
Les fonds spéculatifs (hedge funds) sont en effet des fonds d’investissement à haut risque spéculant sur les mouvements des marchés en vue de maximiser leurs profits. Ils sont réservés aux investisseurs institutionnels et spécialisés. Fin 2008, le secteur des investissements alternatifs gérait environ 2 000 milliards d’actifs. Lors du sommet du G20 qui s’est tenu en avril, les dirigeants des vingt principales économies mondiales ont affiché leur volonté d’encadrer les grands fonds spéculatifs.
LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE SUR LES GESTIONNAIRES DE FONDS D’INVESTISSEMENT ALTERNATIFS
● La directive obligerait les gestionnaires de tous les fonds non-OPCVM à obtenir un agrément. Si les hedge funds et le capital investissement sont sous les feux de l’actualité, la Commission estime toutefois qu’une initiative législative qui se limiterait à ces deux catégories de gestionnaires serait inefficace et traduirait une vision à courte vue : inefficace, parce que toute définition arbitraire de ces fonds risque de ne pas englober tous les acteurs concernés et pourrait facilement être contournée ; à courte vue, car une partie importante des risques sous-jacents existent aussi dans d’autres types d’activités des gestionnaires. La solution de réglementation qui est susceptible de s’avérer la plus durable et la plus productive consiste donc à cibler tous les gestionnaires de fonds non-OPCVM dans l’Union européenne.
● Les obligations applicables à ces fonds. L’ensemble des fonds concernés seraient tenus de divulguer certaines informations, notamment sur l’endettement et les instruments financiers auxquels ils ont recours pour tenter de maximiser leurs profits. Ils devront ainsi communiquer aux autorités de réglementation compétentes des données relatives aux principaux marchés où ils sont actifs, aux instruments financiers qu’ils négocient, à leurs principales expositions, à leurs performances et aux concentrations de risque. Les gestionnaires devront également notifier l’identité des fonds alternatifs gérés, les marchés et les actifs dans lesquels ces fonds investiront et les mécanismes organisationnels et de gestion des risques établis pour ces fonds.
● Cette large couverture n’implique pas l’adoption d’une solution unique. Un ensemble commun de dispositions de base régira les conditions d’octroi de l’agrément initial et de l’organisation de tous les gestionnaires. Ces dispositions centrales seront adaptées aux différentes catégories d’actifs, de façon à éviter que des exigences non pertinentes ou inappropriées soient imposées à des politiques d’investissement pour lesquelles elles n’ont pas de sens. Outre ces dispositions communes, la proposition prévoit une série de dispositions spécifiques, sur mesure, qui ne s’appliqueront qu’aux gestionnaires employant certaines techniques ou stratégies dans la gestion de leurs fonds alternatifs (par exemple, le recours systématique à un levier élevé, l’acquisition du contrôle de sociétés) et qui garantiront un degré approprié de transparence en ce qui concerne ces techniques.
● La proposition de directive prévoit deux exemptions de minimis pour les gestionnaires de petits portefeuilles d’actifs. Les gestionnaires ayant la charge de portefeuilles de fonds d’investissement alternatifs dont les actifs totalisent moins de 100 millions d’euros seront exemptés des dispositions de la directive proposée. La gestion de ces fonds est peu susceptible de faire naître des risques significatifs pour la stabilité financière et l’efficacité des marchés. Dès lors, l’extension de ces exigences réglementaires aux petits gestionnaires imposerait des coûts et une charge administrative qui ne seraient pas justifiés par les avantages qu’on pourrait en attendre. Par ailleurs, pour les gestionnaires qui ne gèrent que des fonds alternatifs ne recourant pas au levier et n’octroyant pas à leurs investisseurs de droits de remboursement pendant une période de cinq ans suivant la date de constitution de chaque fonds alternatif, un seuil d’exemption de minimis de 500 millions d’euros s’applique. Ce seuil nettement plus élevé se justifie par le fait que les gestionnaires de fonds ne recourant pas au levier sont moins susceptibles d’engendrer des risques systémiques. Les gestionnaires exemptés n’auraient pas de droits en vertu de la directive, sauf s’ils choisissent de solliciter un agrément en vertu de celle -ci.
Sur cette base, la surveillance prudentielle s’attachera aux domaines où sont concentrés les risques. Avec un seuil de 100 millions d’euros, environ 30 % des gestionnaires de hedge funds, gérant presque 90 % des actifs des hedge funds domiciliés dans l’UE, seraient couverts par la directive. Celle-ci s’appliquerait en outre à presque la moitié des gestionnaires d’autres fonds non-OPCVM, qui représentent presque la totalité des actifs investis dans ces fonds.
● L’accent est mis sur les entités dotées du pouvoir de décision et qui prennent les risques dans la chaîne de valeur.
● Les gestionnaires seront habilités à commercialiser les fonds d’investissement alternatifs auprès des investisseurs professionnels, y compris dans un cadre transfrontalier. Un gestionnaire qui aura reçu l’agrément sera en droit de commercialiser des fonds alternatifs uniquement auprès d’investisseurs professionnels (tels que définis par la directive MIF). De nombreux fonds alternatifs comportent un niveau de risque élevé (de perte d’une grande partie ou de la totalité du capital investi) et/ou possèdent d’autres caractéristiques qui les rendent inadéquats pour les investisseurs de détail. Ils peuvent notamment contraindre les investisseurs à conserver leur investissement plus longtemps que cela n’est acceptable pour des fonds de détail. Leurs stratégies d’investissement sont habituellement complexes et impliquent souvent des investissements dans des actifs illiquides et dont la valeur est plus difficile à évaluer. La commercialisation de ces fonds se limitera donc aux investisseurs en mesure de comprendre et assumer les risques associés à ce type d’investissement.
La restriction aux investisseurs professionnels est compatible avec la situation actuelle dans de nombreux États membres. Toutefois, certaines des catégories de fonds alternatifs couverts par la directive proposée - telles que les fonds de hedge funds et les fonds immobiliers de type ouvert - sont accessibles aux investisseurs de détail dans certains États membres, moyennant des contrôles réglementaires stricts. Les États membres peuvent permettre la commercialisation aux investisseurs de détail sur leur territoire et peuvent appliquer des garanties réglementaires supplémentaires à cet effet.
Le respect des exigences de la directive proposée serait suffisant pour permettre aux gestionnaires de commercialiser des fonds d’investissement alternatifs aux investisseurs professionnels sur les marchés d’autres États membres. Cette commercialisation transfrontalière ne serait subordonnée qu’à l’obligation de communiquer des informations appropriées à l’autorité compétente du pays d’accueil.
● Les gestionnaires seront autorisés à gérer et à commercialiser des fonds alternatifs domiciliés dans des pays tiers trois ans après la fin de la période de transposition de la directive. Actuellement, de nombreux gestionnaires domiciliés dans l’UE gèrent des fonds domiciliés dans des pays tiers et les commercialisent en Europe. La directive introduit de nouvelles conditions pour traiter tous les risques supplémentaires que ces opérations pourraient entraîner pour les marchés et les investisseurs européens. Elle garantit aussi que les autorités fiscales nationales peuvent obtenir auprès des autorités fiscales de pays tiers toutes les informations requises pour établir l’imposition des investisseurs professionnels qui effectuent des placements dans des fonds d’investissement extraterritoriaux : ainsi, la commercialisation de fonds alternatifs domiciliés dans un pays tiers ne sera autorisée que si ledit pays a conclu avec l’État membre sur le territoire duquel le fonds alternatif doit être commercialisé un accord basé sur l’article 26n du modèle de convention fiscale de l’OCDE.
Les activités de gestion et d’administration de fonds d’investissement alternatifs seront réservées aux gestionnaires domiciliés et agréés dans l’UE, qui ont la possibilité de déléguer des fonctions d’administration (mais non de gestion) à des entités extraterritoriales, moyennant le respect de conditions appropriées. En particulier, les dépositaires nommés pour recevoir en garde des liquidités et des actifs doivent être des établissements de crédit établis dans l’UE, qui ne peuvent sous-déléguer leurs fonctions qu’en respectant des conditions strictes. Les évaluateurs désignés dans les juridictions de pays tiers doivent être soumis à des normes réglementaires équivalentes. Moyennant ces conditions strictes, la proposition envisage donc que les gestionnaires de l’UE puissent commercialiser des fonds alternatifs domiciliés dans des pays tiers auprès d’investisseurs professionnels dans toute l’Europe à l’issue d’une période supplémentaire de trois ans. Dans l’intervalle, les États membres peuvent autoriser ou continuer à autoriser les gestionnaires à commercialiser sur leur territoire, auprès d’investisseurs professionnels, des fonds alternatifs domiciliés dans des pays tiers, conformément à leur droit national.
Plusieurs reproches ont d’ores et déjà été adressés à cette proposition de directive :
– L’enregistrement et les obligations prévues par le texte ne s’appliquent qu’aux gestionnaires de fonds et non aux fonds eux-mêmes.
– La fixation des seuils (notamment celui de 100 millions d’euros en deçà duquel les fonds seront exemptés des obligations posées par la directive) encouragera ces fonds à se scinder en plusieurs entités pour échapper à toute régulation.
– La procédure d’agrément retenue permet en réalité à un gestionnaire de commercialiser ses fonds dans l’ensemble de l’Union européenne sur le fondement de son enregistrement dans un seul des États membres.
– Parmi les obligations d’informations requises de la part des gestionnaires de fonds, aucune ne concerne les exigences de fonds propres.
– Enfin, point non négligeable, les fonds domiciliés dans des paradis fiscaux bénéficieront d’une liberté totale de commercialisation trois ans après l’entrée en vigueur de la directive. Le 2 juillet dernier, la ministre chargée de l’économie, Mme Christine Lagarde, estimait que l’agrément prévu par la proposition de directive, qui se donne comme un véritable « label de qualité » européen, ne devait pas inclure les fonds domiciliés dans des paradis fiscaux.
III.– LE CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE FRANÇAIS
Le cadre législatif et réglementaire français, complété par les règlements des autorités de contrôle, est relativement satisfaisant, une palette large d’outils étant déjà mise en œuvre. De bien entendu, des améliorations peuvent être dessinées, tant concernant les obligations juridiques, notamment de contrôle, auxquelles sont soumises les entités établies en France, qu’en matière de législation fiscale ou encore de contrôle et de répression de la fraude et de l’évasion fiscales. Certaines de ces améliorations sont identifiées de longue date. Les difficultés techniques et organisationnelles peuvent expliquer qu’elles n’aient pas été mises en place. La possibilité de travailler conjointement avec nos partenaires en amont de l’établissement des règles et de disposer d’une meilleure coopération en aval pour le contrôle permettra sans nul doute de faire aboutir certains projets. Surtout, le changement de contexte international devrait permettre de lever d’importants blocages et de renforcer les obligations existantes sans pénaliser au plan concurrentiel l’économie française.
En tout état de cause, aucune amélioration ne sera possible tant que la France ne disposera pas de sa propre liste de territoires non coopératifs.
→ Doter la France de sa propre liste de territoires non coopératifs.
A.– DES OBLIGATIONS PESANT SUR LES ENTITÉS FRANÇAISES SUJETTES À AMÉLIORATIONS
1.– Les obligations générales pesant sur les entités françaises en matière de lutte contre le blanchiment
Le délit de blanchiment, défini à l’article 324-1 du code pénal, est le fait de réintroduire dans le circuit financier des fonds provenant d’actions ou de trafics délictueux en dissimulant leur véritable origine. Depuis 1996, le délit de blanchiment est un délit général qui englobe l’ensemble des infractions de nature délictuelle ou criminelle, y compris la fraude fiscale.
Les règles applicables aux organismes financiers et aux professions juridiques en matière de lutte anti-blanchiment ont été forgées tout au long des années 90 (37) : si le principe de la « déclaration de soupçon », qui rompt le secret, s’impose aux établissements de crédit et aux professions financières depuis 1990, ce dispositif a été progressivement élargi tant s’agissant des professions soumises à ses obligations que s’agissant de son domaine d’application. La fin des années 90 et le début des années 2000 ont vu l’émergence d’autres thématiques, en particulier la lutte contre le financement du terrorisme, et ont été marqués par une extension des obligations aux professions juridiques indépendantes, aux commissaires aux comptes et aux comptables, aux agents immobiliers, aux marchands d’articles de grande valeur tels que pierres et métaux précieux, aux casinos, aux cercles de jeux et aux sociétés de jeux de hasard.
a) Les professionnels assujettis aux obligations anti-blanchiment
Les professions concernées par les règles de lutte anti-blanchiment sont :
– l’ensemble des organismes financiers, qui recouvre en réalité les établissements bancaires et la Banque de France, les entreprises et les intermédiaires d’assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance, les entreprises d’investissement, les sociétés de gestion de portefeuille, les chambres de compensation, les entreprises de marché, les conseillers en investissements financiers et intermédiaires financiers, ainsi que les changeurs manuels ;
– les sociétés de gestion de biens immobiliers ;
– les casinos, cercles de jeux, loteries, paris ou pronostics sportifs ou hippiques ;
– les professions de la vente de pierres précieuses, matériaux précieux, antiquités et œuvres d’art ;
– les entreprises de mise à disposition ou de gestion de moyens de paiement exemptés d’agrément par le CECEI ;
– les experts-comptables et les commissaires aux comptes ;
– les avocats, avoués, notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et commissaires priseurs ;
– ainsi que les sociétés de ventes de meubles aux enchères publiques.
S’agissant des professions juridiques, toutes sont soumises au dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme depuis la transposition de la deuxième directive anti-blanchiment par la loi du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques. Toutefois, ce dispositif est très encadré, notamment pour les avocats qui ne sont soumis aux obligations de vigilance, de déclaration de soupçon et de droit de communication à la cellule de traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) que pour certaines activités de la profession et lorsqu’ils agissent en qualité de fiduciaire. Ces obligations ne s’appliquent pas aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et aux avoués, pour leurs activités qui se rattachent à une procédure juridictionnelle. Elles ne s’appliquent pas non plus, pour l’ensemble de ces professions juridiques, aux informations recueillies à l’occasion d’une consultation juridique, à moins que le client ne souhaite obtenir ces conseils aux fins de blanchiment de capitaux. Tel était aussi le cas, jusqu’à récemment, pour les experts-comptables.
S’agissant des établissements bancaires, conformément aux dispositions du code monétaire et financier et aux règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF), la réglementation applicable aux banques en matière de lutte anti-blanchiment prévoit que les établissements ayant leur siège en France « font toutes recommandations utiles à leurs filiales et succursales à l’étranger pour qu’elles se prémunissent, sous des formes appropriées, contre le risque d’être utilisées à des fins de blanchiment ».
Ces règles obligent donc les banques à disposer d’un dispositif de surveillance interne, qui suppose une formation adéquate du personnel aux techniques de blanchiment et l’existence de correspondants dédiés chargés d’établir les déclarations de soupçon à TRACFIN, ce dispositif devant être donc étendu à l’ensemble de leurs filiales et succursales à l’étranger. Depuis la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, les entreprises d’un même groupe situées dans l’espace économique européen (EEE) doivent en outre transmettre à la société mère l’ensemble des informations nécessaires à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de façon à lui permettre de communiquer aux autorités locales l’ensemble du dispositif. Ces entités doivent communiquer à leur siège social, le cas échéant, les dispositions locales qui s’opposent à la mise en œuvre de tout ou partie de ces recommandations. Il convient de remarquer dès à présent que ces dispositions ont été renforcées récemment par l’ordonnance du 30 janvier 2009 de transposition de la 3ème directive relative à la lutte anti-blanchiment, qui impose à la maison mère d’appliquer dans ses succursales des mesures de vigilance à l’égard du client au moins équivalentes à celles prévues par l’ordonnance et de veiller à ce que de telles mesures soient appliquées dans ses filiales à l’étranger.
Enfin, chaque banque doit transmettre des informations sur son dispositif de prévention du blanchiment des capitaux à la Commission bancaire qui veille à la diligence des établissements bancaires en la matière et applique des sanctions, voire saisit la justice en cas de constatation d’un manquement à ces obligations.
Les banques effectuent des déclarations de soupçon à TRACFIN pour toutes les sommes et opérations qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants, d’activités criminelles organisées, mais également, depuis 2004, de la corruption et de la fraude aux intérêts des Communautés européennes ou qui pourraient participer au financement du terrorisme (depuis la loi Perben 2 de mars 2004). De plus, depuis la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (NRE), les banques déclarent automatiquement à TRACFIN :
– toute opération dont l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les vérifications d’identité auxquels les organismes financiers doivent procéder ;
– toute opération faisant apparaître un fonds fiduciaire (et notamment trust ou fiducies) dont l’identité des constituants ou des bénéficiaires n’est pas connue ;
– ainsi que les opérations d’un certain montant, réalisées avec certains États ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées par le GAFI comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux. Ces obligations déclaratives sont précisées au cas par cas par décret. Toutefois, les décrets de février 2002 et de décembre 2003 qui imposaient aux organismes financiers de déclarer à TRACFIN les opérations de plus de 8 000 euros effectuées avec des personnes physiques ou morales domiciliées, établies ou enregistrées à Nauru et au Myanmar, ont été abrogés par le décret du 24 mai 2005. Depuis cette abrogation, il n’existe pas de texte mettant en œuvre cette mesure.
Les banques sont également tenues à un principe particulier de vigilance : si l’ouverture d’un compte doit obligatoirement passer par la vérification de l’identité du client, une vigilance particulière s’impose vis-à-vis des clients « occasionnels » et des opérations supérieures à 150 000 euros qui ne paraissent pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Par ailleurs, les établissements bancaires doivent s’assurer de l’identité des véritables bénéficiaires économiques des transactions lorsque le contractant n’agit pas pour son propre compte et prendre des dispositions spécifiques dans le cadre d’une relation contractuelle avec un client qui n’est pas physiquement présent pour son identification.
Des obligations spécifiques s’imposent également en matière de contrôle et de vérification pour les chèques, notamment dans le cadre du « correspondent banking », ainsi que dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, pour laquelle les banques sont également soumises à déclaration auprès de TRACFIN en cas de soupçon.
b) Les apports de la 3ème directive anti-blanchiment
Afin de faire face au développement permanent de nouvelles techniques de blanchiment, la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (dite « troisième directive anti-blanchiment » abroge les deux premières directives adoptées en la matière en 1990 et 2001 et renforce le dispositif existant en le conformant aux quarante recommandations formulées par le GAFI en 2003, qui ont adapté le dispositif préventif à l’évolution de la criminalité organisée et des organisations terroristes en mettant en œuvre une approche moins légaliste et plus concrète et pragmatique fondée sur le risque.
L’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 de transposition de la troisième directive anti-blanchiment apporte un certain nombre de modifications au dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Outre une interdiction générale de paiement en espèces au-delà d’un montant fixé par décret – qui se substitue à un dispositif complexe qui ne concernait que certains types de règlements –, l’ordonnance soumet les bureaux de change à un agrément délivré par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI). Mais le cœur de la réforme concerne les obligations de vigilance et de déclaration de soupçon pesant sur les professionnels. Ainsi :
● C’est désormais l’article L. 561-2 du code monétaire et financier qui détaille le champ des professions assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La liste des professions assujetties reprend en grande partie celle actuellement en vigueur et comprend à la fois les professions financières et des professions non financières. Dans cette dernière catégorie, seules ont été ajoutées les sociétés de domiciliation qui sont couvertes par la troisième directive anti-blanchiment en tant que prestataires de service aux sociétés et fiducies et qui, de par leur activité, jouent un rôle important dans la traçabilité des personnes et de leurs fonds. Ces sociétés feront désormais également l’objet d’une procédure d’agrément par le préfet.
● L’ordonnance précise également les conditions dans lesquelles les professions juridiques sont soumises à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Elle confirme que les obligations de déclaration de soupçon ne s’appliquent pas, d’une part, aux avocats lorsque l’activité se rattache à une procédure juridictionnelle, et, d’autre part, aux avocats, avoués, notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et commissaires-priseurs judicaires lorsqu’ils donnent des consultations juridiques, à moins qu’elles n’aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande à de telles fins. Une nouvelle disposition est introduite, qui précise que les personnes physiques ou morales qui exercent une activité financière à titre accessoire sont exemptées des obligations. La liste de ces activités sera définie par décret en Conseil d’État ; il s’agira notamment des activités de change proposées par les hôtels ou campings.
● Les modalités de mise en pratique de l’obligation de vigilance sont également précisées par l’ordonnance, qui pose comme principe de base le fait que le professionnel doit identifier son client et, le cas échéant par la mise en œuvre de moyens adaptés, le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires ; il peut s’agir, d’une part, des principaux actionnaires des personnes morales ou, d’autre part, de la personne pour le compte de laquelle le client agit. À défaut de cette identification, le professionnel ne peut pas entrer en relation d’affaires ou doit y mettre fin. En outre, le professionnel doit déterminer l’objet et la nature de la relation d’affaires et assurer un suivi régulier de celle-ci. Ces informations doivent ensuite être conservées pendant cinq ans, afin d’en assurer la traçabilité. Ces éléments étaient déjà présents dans le droit antérieur. La principale innovation proposée concerne le principe de l’approche par les risques que privilégie l’ordonnance de transposition, en prévoyant que ces obligations de vigilance peuvent être modulées à la baisse ou à la hausse en fonction du risque présenté par le client, le produit ou la nature de la relation d’affaires. Un décret d’application devra établir les critères qualifiant les divers degrés de risques présentés.
● La modification essentielle apportée par la refonte du dispositif de lutte contre le blanchiment concerne l’obligation de déclaration de soupçon qui pèse sur les professions financières et juridiques. Ainsi, son champ est très nettement étendu : aujourd’hui limité aux sommes ou opérations qui pourraient provenir de certaines formes de criminalités d’exception (trafic de stupéfiants, criminalité organisée, financement du terrorisme, fraude aux intérêts des Communautés européennes), il couvrira désormais les sommes ou opérations qui pourraient provenir de toute infraction passible d’une peine de prison supérieure à un an ou qui pourraient participer au financement des activités terroristes. Ainsi étendu à la délinquance de droit commun, le champ de la déclaration de soupçon couvrira désormais la fraude fiscale, passible d’une peine de prison maximale de cinq ans. Cependant, compte tenu de la complexité de cette fraude, la présente ordonnance propose d’assister les professionnels dans la détection de cette infraction par la définition de critères définis par décret.
— Si l’ordonnance se contente de réaffirmer le principe de confidentialité de la déclaration, elle crée une possibilité d’information mutuelle de l’existence et du contenu d’une déclaration de soupçon au sein d’un même groupe, d’un même réseau ou d’une même structure professionnelle. Elle renforce enfin la sécurité juridique du dispositif en prévoyant qu’aucune poursuite civile, aucune poursuite pour dénonciation calomnieuse ou atteinte au secret professionnel ne peut être intentée contre un professionnel assujetti qui a effectué de bonne foi une déclaration auprès de TRACFIN, de même qu’aucune poursuite pénale pour trafic de stupéfiants, recel ou blanchiment ne pourra être intentée contre le professionnel qui a effectué une opération suspecte dès lors qu’il a transmis une déclaration à TRACFIN.
● L’ordonnance procède également à renforcement des compétences du service TRACFIN (38).
– Elle énumère les autorités respectives de contrôle de la mise en œuvre de ces mesures pour chaque type de profession concerné : la Commission Bancaire, l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, ainsi que les ordres professionnels s’agissant de professions juridiques.
– Un droit d’accès indirect des clients aux informations à caractère personnel collectées par les professionnels assujettis aux obligations de vigilance est mis en place.
– La procédure de gel des avoirs de personnes physiques ou morales qui commettent ou tentent de commettre un acte terroriste est étendue aux personnes désignées par une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU ou par une position commune du Conseil européen, tandis que l’accès au fichier national des comptes bancaires (FICOBA) est autorisé aux agents du ministère des finances chargés de l’application des mesures de gel des avoirs.
● Enfin, l’ordonnance de transposition prévoit un circuit d’information spécifique pour le délit de blanchiment de fraude fiscale lorsqu’une déclaration de soupçon a été faite auprès de TRACFIN. Dans ce cas, le ministre chargé du budget transmet au procureur de la République les informations sur des faits susceptibles de relever du blanchiment du seul produit de l’infraction de fraude fiscale après avis conforme de la commission des infractions fiscales (CIF). Cet avis porte sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale sous-jacente. Cette disposition permettra de rationaliser la poursuite des infractions de blanchiment de fraude fiscale engagée à la suite d’un signalement TRACFIN.
c) La mise en œuvre de l’ordonnance de transposition
S’agissant de la mise en œuvre juridique de l’ordonnance, à ce jour, les décrets d’application de l’ordonnance n’ont pas été publiés : en particulier, les dispositions relatives aux « soupçons de fraude fiscale » doivent faire l’objet d’un aménagement par un texte réglementaire, afin de ne pas retenir une définition trop large de la fraude, qui est avérée dès qu’une somme de plus de 153 euros a été soustraite à l’imposition. L’article L. 561-15 du code monétaire et financier, qui régit désormais les obligations de déclaration, dispose que les professionnels concernés déclarent à TRACFIN « les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une fraude fiscale lorsqu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret ».
Le décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009 comporte ainsi une liste de 16 critères permettant d’identifier la fraude fiscale. Figurent notamment l’utilisation de sociétés écran établies dans un État avec lequel la France n’a pas signé de convention permettant l’accès aux renseignements bancaires, la difficulté d’identifier les bénéficiaires effectifs du fait de la structure de l’opération, le dépôt par un particulier de fonds importants au regard de son activité connue, la réalisation d’une transaction immobilière à un prix manifestement sous-évalué ou encore le recours à l’interposition de personnes physiques n’intervenant qu’en apparence pour le compte de sociétés ou de particuliers impliqués dans les opérations financières. Les inquiétudes exprimées par certaines professions n’avaient pas raison d’être : les critères retenus dans le projet de décret en cours font clairement référence à des montages d’évasion ou de fraude fiscale.
CRITÈRES FIXÉS PAR LE DÉCRET N° 2009-874 DU 16 JUILLET 2009 DÉCLENCHANT LA DÉCLARATION DE SOUPÇON |
1° L'utilisation de sociétés écran, dont l'activité n'est pas cohérente avec l'objet social ou ayant leur siège social dans un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention fiscale permettant l'accès aux informations bancaires, identifié à partir d'une liste publiée par l'administration fiscale, ou à l'adresse privée d'un des bénéficiaires de l'opération suspecte ou chez un domiciliataire au sens de l'article L. 123-11 du code de commerce ; 2° La réalisation d'opérations financières par des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires fréquents non justifiés par la situation économique de l'entreprise ; 3° Le recours à l'interposition de personnes physiques n'intervenant qu'en apparence pour le compte de sociétés ou de particuliers impliqués dans des opérations financières ; 4° La réalisation d'opérations financières incohérentes au regard des activités habituelles de l'entreprise ou d'opérations suspectes dans des secteurs sensibles aux fraudes à la TVA de type carrousel, tels que les secteurs de l'informatique, de la téléphonie, du matériel électronique, du matériel électroménager, de la hi-fi et de la vidéo ; 5° La progression forte et inexpliquée, sur une courte période, des sommes créditées sur les comptes nouvellement ouverts ou jusque-là peu actifs ou inactifs, liée le cas échéant à une augmentation importante du nombre et du volume des opérations ou au recours à des sociétés en sommeil ou peu actives dans lesquelles ont pu intervenir des changements statutaires récents ; 6° La constatation d'anomalies dans les factures ou les bons de commande lorsqu'ils sont présentés comme justification des opérations financières, telles que l'absence du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, du numéro SIREN, du numéro de TVA, de numéro de facture, d'adresse ou de dates ; 7° Le recours inexpliqué à des comptes utilisés comme des comptes de passage ou par lesquels transitent de multiples opérations tant au débit qu'au crédit, alors que les soldes des comptes sont souvent proches de zéro ; 8° Le retrait fréquent d'espèces d'un compte professionnel ou leur dépôt sur un tel compte non justifié par le niveau ou la nature de l'activité économique ; 9° La difficulté d'identifier les bénéficiaires effectifs et les liens entre l'origine et la destination des fonds en raison de l'utilisation de comptes intermédiaires ou de comptes de professionnels non financiers comme comptes de passage, ou du recours à des structures sociétaires complexes et à des montages juridiques et financiers rendant peu transparents les mécanismes de gestion et d'administration ; 10° Les opérations financières internationales sans cause juridique ou économique apparente se limitant le plus souvent à de simples transits de fonds en provenance ou à destination de l'étranger notamment lorsqu'elles sont réalisées avec des Etats ou des territoires visés au 1° ; 11° Le refus du client de produire des pièces justificatives quant à la provenance des fonds reçus ou quant aux motifs avancés des paiements, ou l'impossibilité de produire ces pièces ; 12° Le transfert de fonds vers un pays étranger suivi de leur rapatriement sous la forme de prêts ; 13° L'organisation de l'insolvabilité par la vente rapide d'actifs à des personnes physiques ou morales liées ou à des conditions qui traduisent un déséquilibre manifeste et injustifié des termes de la vente ; 14° L'utilisation régulière par des personnes physiques domiciliées et ayant une activité en France de comptes détenus par des sociétés étrangères ; 15° Le dépôt par un particulier de fonds sans rapport avec son activité ou sa situation patrimoniale connues ; 16° la réalisation d'une transaction immobilière à un prix manifestement sous-évalué. |
S’agissant de la mise en œuvre pratique de l’ordonnance de transposition, les modifications apportées ont conduit certains professionnels à faire part de leurs préoccupations face aux nouvelles obligations qui leur incomberont désormais en termes de déclaration de soupçon.
C’est en premier lieu le cas des experts-comptables qui bénéficiaient jusqu’alors d’une dispense de déclaration de soupçon dans le cadre de leurs activités de conseil juridique, dérogation qui a été supprimée par l’ordonnance du 30 janvier 2009. Le rétablissement de cette dérogation pourrait intervenir par voie législative : en effet, un amendement à la proposition de loi tendant à favoriser l’accès au crédit des PME a été adopté à cette fin par le Sénat le 9 juin 2009. Ce texte doit prochainement être examiné en seconde lecture par l’Assemblée nationale.
C’est en second lieu le cas des avocats, qui dénoncent l’élargissement de l’obligation de déclaration aux soupçons de fraude fiscale, qui leur est désormais applicable en dehors de leur pratique juridictionnelle ou de conseil.
LE DISPOSITIF APPLICABLE AUX AVOCATS Le dispositif applicable aux avocats est encadré. Ils ne sont soumis aux obligations de vigilance, de déclaration de soupçon et de communication à TRACFIN que pour certaines activités de la profession et lorsqu’ils agissent en qualité de fiduciaire. Ces obligations ne s’appliquent pas aux activités qui se rattachent à une procédure juridictionnelle, ni aux informations recueillies à l’occasion d’une consultation juridique, à moins que le client ne souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins de blanchiment de capitaux. Les obligations de vigilance et déclaratives pèsent sur l’avocat dès lors qu’une « relation d’affaires » est nouée avec un client. La typologie des activités pour lesquelles les avocats sont soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment Aux termes des dispositions de l’article L. 561-3 I du code monétaire et financier, les obligations de vigilance et déclaratives s’imposent à l’avocat lorsque « dans le cadre de (son) activité professionnelle » : – il participe « au nom et pour le compte de (son) client à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire » ; – il assiste son client « dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant : • l’achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ; • la gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ; • l’ouverture de comptes bancaires, d’épargne ou de titres ou de contrats d’assurance ; • l’organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ; • la constitution, la gestion ou la direction des sociétés ; • la constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre structure similaire ; • la constitution ou la gestion de fonds de dotation ». La définition de la consultation juridique Le Parlement européen a retenu dans les directives du 4 décembre 2001 et du 26 octobre 2005 les termes d’« évaluation de la situation juridique du client ». À l’occasion de la transposition de ces directives, la notion de consultation juridique lui a été substituée. Cette notion correspond de façon plus précise à cette mission de l’avocat. La doctrine a défini la consultation juridique comme « consistant à fournir, sur une question soumise à l’examen du consultant, un avis personnel, parfois un conseil, qui apporte à celui qui le consulte des éléments de décision, le cas échéant des éléments en faveur de sa cause ». Une réponse ministérielle et une décision de la Cour d’appel de Paris du 21 mai 2001 apportent des précisions utiles. Selon la Cour d’appel, qui reprend quasiment les termes de la réponse ministérielle, la consultation est, à partir de l’examen d’un dossier qui suppose un problème de qualification juridique, une prestation intellectuelle, personnalisée, distincte de l’information à caractère documentaire qui tend à fournir un avis, parfois un conseil, qui concourt par les éléments qu’il apporte à la prise de décision de son bénéficiaire. Trois éléments importants ressortent de cette définition : – la consultation se définit par son contenu et par sa finalité ; elle peut être écrite ou orale ; elle ne nécessite ni d’être qualifiée comme telle, ni une forme de rédaction particulière ; – la consultation répond aux besoins d’un client dans un contexte juridique propre à celui-ci (c’est en ce sens qu’elle est personnalisée) ; – la consultation suppose un raisonnement juridique pour aboutir à des avis ou à des conseils. En fonction des échanges avec un client, la consultation peut donner lieu à la rédaction de versions successives qui sont toutes exonérées des obligations de vigilance et de déclaration. L’exception de consultation à l’obligation de déclaration de soupçon connaît elle-même deux limites : – l’avocat ne doit pas savoir que son client souhaite obtenir des conseils aux fins de blanchiment de capitaux ; – l’avocat ne doit pas fournir un conseil aux fins de blanchiment de capitaux. En réalité, cette « exception à l’exception » est une interdiction. Les modalités de communication de la déclaration de soupçon L’ordonnance a tiré les conséquences de l’arrêt du Conseil d’État du 10 avril 2008 en ce qui concerne le rôle du bâtonnier qui se situe entre l’avocat et TRACFIN. Elle a transposé cette solution en plaçant le procureur général près la Cour d’appel entre TRACFIN et le bâtonnier qui ferait une déclaration de soupçon pour des faits découverts dans le cadre de sa mission de contrôle. La fin du « tipping off » et la consécration de la dissuasion du client par l’avocat L’ordonnance du 30 janvier 2009 pose le principe de la confidentialité de la déclaration à TRACFIN (article L. 561-19 du CMF). Tirant les conséquences de la suppression du « tipping off » par la 3ème directive, l’ordonnance retire à l’avocat le droit d’informer son client de l’existence et du contenu de la déclaration de soupçon, sous peine de sanctions pénales. Seuls les ordres et le Conseil national des barreaux peuvent avoir accès à ces informations afin d’exercer leur mission de contrôle. En revanche, le fait pour l’avocat de s’efforcer de dissuader son client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation ou une information au sens des dispositions précitées. |
Source : Extraits du rapport présenté à l’Assemblée générale des 13 et 14 février 2009 du Conseil national des barreaux
Ces oppositions ne sont pas nouvelles mais demeurent préoccupantes alors que les professions du chiffre et du droit sont en première ligne pour connaître du blanchiment, qu’il s’agisse d’opérations criminelles et terroristes ou de fraude fiscale :
– L’exclusion du conseil dispensé par les experts comptables du champ des déclarations de soupçon fait débat. L’intervention des experts-comptables dans le domaine juridique est en effet l’accessoire d’une prestation comptable définie. La situation n’est pas comparable à celle des avocats pour lesquels il est naturel d’exempter de déclaration le conseil juridique. Lorsque le soupçon porte sur du blanchiment de fraude fiscale, la qualité de consultation fiscale accessoire de la prestation d’expertise plaide plutôt en défaveur de l’exclusion.
– S’agissant des avocats, le texte leur permet d’éviter la déclaration de soupçon « pour peu qu’ayant pris conscience de la problématique l’avocat s’applique à lever tout doute, pendant la phase de consultation qui est exempte de toute obligation, ou qu’il exerce avec discernement son droit de dissuader » (39). La défense du secret professionnel ne doit pas obérer une mise en œuvre intelligente du dispositif de lutte contre le blanchiment, y compris dans son volet fiscal.
2.– Les règles spécifiques applicables aux établissements de crédit dans leurs relations avec les paradis fiscaux et le rôle de la Commission bancaire
a) Le contrôle interne aux établissements de crédit
S’agissant de la surveillance des activités engagées à travers des entités situées dans les paradis fiscaux, outre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, il appartient aux établissements de crédit – au-delà des dispositifs d’ordre comptable et prudentiel - de développer un ensemble complet de mesures destinées à assurer un contrôle interne suffisant. Ainsi, le règlement 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d’investissement prévoit :
● la nécessité pour la maison mère d’exercer un contrôle sur base consolidée et de mettre en œuvre les moyens nécessaires de s’assurer du respect au sein de leurs filiales des diligences liées à l’application de ce règlement. Cela implique qu’elle veille attentivement à la qualité du contrôle interne des activités menées dans ses filiales et succursales, qu’elle dispose de la part de celles-ci de l’ensemble des remontées d’informations nécessaires et, enfin, que soient pris en considération à cet égard, outre les aspects relatifs à l’appréciation et au suivi des risques financiers encourus, l’ensemble des risques opérationnels (dont la fraude), juridiques et de non-conformité ;
● la nécessité, depuis 2005, de la création d’une fonction spécifique « Conformité » au sein de chaque grand groupe ; cette fonction a vocation entre autres à examiner particulièrement les activités dans les paradis fiscaux. Le règlement précise de façon générale que :
– les établissements s’assurent que leurs filiales et succursales à l’étranger mettent en place des dispositifs de contrôle de conformité de leurs opérations ;
– ces dispositifs contrôlent le respect des règles locales applicables à l’activité de leurs filiales et succursales ainsi que l’application du présent règlement ;
– lorsque les dispositions de la réglementation locale font obstacle à l’application des règles prévues par le présent règlement, notamment si elles empêchent la communication d’informations nécessaires à cette application, les entités locales concernées en informent le responsable de la conformité ;
– l’établissement assujetti informe la Commission bancaire de ces cas.
En outre le dispositif a été récemment renforcé ou est en voie d’être renforcé sur deux points :
– La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a introduit le devoir d’alerte de la Commission bancaire sur les incidents significatifs relevés par le contrôle interne. Si de tels incidents étaient constatés dans des entités d’un établissement établies dans des paradis fiscaux, l’établissement devrait en informer sans délai la Commission (40).
– Le règlement 97-02 relatif au contrôle interne a été modifié par arrêtés successifs du 14 janvier et du 5 mai 2009, pour introduire l’obligation réglementaire pour les établissements de disposer d’une cartographie complète de leurs risques régulièrement évaluée et mise à jour. Cette cartographie devra bien évidemment prendre en compte l’ensemble des risques financiers, mais également juridiques et de réputation.
Au total, les modalités de mise en œuvre des dispositions réglementaires diffèrent d’un établissement à l’autre, mais de façon générale il apparaît que :
– Les plus grands groupes à vocation internationale ont mis en place des systèmes de contrôle interne en matière de surveillance du blanchiment et de détection de la fraude qui reposent sur une organisation centralisée, la fonction Conformité « groupe » s’appuyant sur des correspondants au sein des pôles / métiers / entités pour assurer la mise en œuvre des procédures localement.
– Les entités situées dans les « paradis fiscaux » sont intégrées dans ces dispositifs centraux de contrôle interne.
– Certains groupes ont défini des procédures internes renforcées relatives à la gestion des entités dans les paradis fiscaux : procédures spécifiques pour la création de nouvelles entités, suivi renforcé des activités de ses entités, de leurs clients, à travers le contrôle permanent et le contrôle périodique.
– De même, certains groupes ont classé les paradis fiscaux, sur la base des listes publiées en 2000, en différentes catégories en fonction de leur appréciation du risque encouru à opérer dans ces zones (par rapport à la nécessité d’opérer de façon sécurisée, conforme aux règles internes et aux obligations légales), ce qui peut les conduire à une interdiction de principe d’ouverture dans certains pays, une préconisation de désengagement s’ils y sont déjà implantés.
b) Des établissements soumis au contrôle de la Commission bancaire
La Commission bancaire contrôle le respect des dispositions législatives et réglementaires par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement. Elle sanctionne les infractions et les manquements. Elle est également compétente pour contrôler les succursales des établissements français installés dans l’Espace Économique Européen (EEE).
Les actions menées par la Commission bancaire, qui n’a pas compétence en matière fiscale, s’inscrivent dans le cadre de l’appréciation des dispositifs de lutte anti-blanchiment et de contrôle interne des groupes bancaires ainsi que de leurs risques. Ces contrôles passent par des contrôles sur pièces (collecte de données, entretiens de surveillance rapprochés, demandes d’information ciblées) ou des contrôles sur place qui peuvent éventuellement être étendus aux filiales et succursales à l’étranger (à condition d’avoir l’accord du superviseur local dès lors qu’il ne s’agit pas de succursales européennes).
S’agissant des territoires considérés comme des paradis fiscaux :
● Lorsqu’il s’agit de relations commerciales avec des contreparties immatriculées dans ces zones se traduisant par l’enregistrement d’opérations au bilan de la banque en France, ou de l’une de ses succursales européennes, les dispositions législatives et réglementaires françaises s’appliquent et la Commission bancaire est chargée d’en vérifier l’application, à l’exception toutefois, pour les succursales européennes, des règles en matière de lutte anti-blanchiment et de surveillance de la liquidité qui sont d’application nationale. Elle le fait au travers du contrôle sur pièces et des enquêtes sur place, qu’elle peut notamment mener dans les succursales européennes.
La Commission s’assure que la surveillance des opérations est correctement effectuée et vérifie notamment que la banque documente de manière satisfaisante la nature des risques ainsi que les modalités de suivi et de mesure de ces risques (en matière de risque de contrepartie, c’est par exemple la problématique du suivi des risques sur les hedge funds ou sur les véhicules spécialisés de type special purpose vehicle (SPV), qui sont très majoritairement logés dans des zones offshore, mais dont la gestion est effectuée depuis d’autres pays).
En matière de connaissance de la clientèle, la Commission vérifie que l’établissement fait preuve de toute la vigilance nécessaire pour identifier les clients résidant dans ces zones, connaître leur activité et, le cas échéant, recueillir les informations sur l’identité des ayants droit économiques. Dans le cadre des enquêtes ciblées sur la prévention du blanchiment des capitaux, ces aspects sont regardés de près.
Dans plusieurs cas, la Commission bancaire a ainsi sanctionné disciplinairement, avec d’autres griefs, des cas de défaut de documentation de la connaissance du véritable bénéficiaire ou de défaut de déclaration de soupçon relevés dans des relations commerciales avec des sociétés immatriculées dans des pays figurant sur la liste OCDE (Liechtenstein, Panama, Îles Vierges britanniques, Îles Caïman, Bermudes, Luxembourg, Suisse). Il s’agit de décisions rendues publiques, ce qui contribue à renforcer la vigilance exigée des établissements de crédit français à ce sujet.
DÉCISIONS DE SANCTIONS RENDUES PAR LA COMMISSION BANCAIRE
PRISES À L’ENCONTRE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
2005 |
2006 |
2007 |
2008 | |
Nombre de décisions |
11 |
5 |
3 |
3 |
Montant le plus élevé |
400 000 euros |
400 000 euros |
200 000 euros |
300 000 euros |
Montant le moins élevé |
50 000 euros |
30 000 euros |
200 000 euros |
100 000 euros |
Source : Commission bancaire
● Lorsqu’il s’agit d’activités engagées par l’intermédiaire de succursales hors Espace Économique Européen (EEE) ou de filiales étrangères, directes ou indirectes, ou logées dans ces territoires, la situation est différente car la supervision individuelle de l’entité relève de la compétence des autorités du pays d’accueil. Par ailleurs, l’autorisation d’implantation relève uniquement de ces autorités, la loi française ne prévoyant pas d’autorisation préalable des autorités bancaires françaises compétentes – actuellement le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI) – lorsqu’une banque française souhaite acquérir une participation ou constituer une filiale ou une succursale hors de l’EEE.
Dans ce cadre, l’action de la Commission, qui est responsable de la surveillance sur base consolidée, porte notamment sur l’appréciation de la bonne couverture des implantations étrangères par le dispositif de contrôle interne du groupe, que ce soit dans l’appréciation et le suivi des risques financiers, des risques opérationnels (dont la fraude), des risques juridiques et de non-conformité. Cette nécessité, qui est rappelée de façon constante aux groupes français à vocation internationale, notamment dans le cadre de lettres de suite aux enquêtes sur place, s’applique tout particulièrement à leurs activités dans des zones considérées comme sensibles. À cet égard, la Commission bancaire a sanctionné disciplinairement des établissements chez qui elle avait constaté des défauts de contrôle et de remontée d’informations de filiales étrangères ou encore des lacunes sérieuses dans l’efficacité des recommandations faites à des entités étrangères en matière de lutte anti-blanchiment. Elle a ainsi notamment retenu un grief dans une sanction publique prononcée en 2004 à l’encontre d’une grande banque portant sur d’importantes lacunes dans l’efficacité des recommandations en matière de lutte anti-blanchiment à des entités étrangères du groupe (à Gibraltar, à Monaco, en Suisse et à Luxembourg) et dans le contrôle de leur application.
LE CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS MONÉGASQUES PAR LA COMMISSION BANCAIRE Au 31 décembre 2008, 29 établissements de crédit sont agréés pour exercer leur activité en Principauté de Monaco (dont six succursales de banques étrangères). Par ailleurs, 13 établissements de crédit français exercent leur activité à Monaco via des guichets permanents (ce qui ne nécessite pas d’autorisation). Les modalités de contrôle par la Commission bancaire des établissements monégasques sont pour l’essentiel identiques à celle des établissements de crédit français : – Le contrôle sur pièces s’effectue à partir d’analyses d’états comptables et financiers remis par les établissements ou d’informations diverses qui sont les mêmes que celles qui sont exigées des autres établissements agréés. L’analyse du dispositif de contrôle interne est réalisée à partir des rapports de contrôle interne et de suivi des risques (articles 42 et 43 du règlement 97-02 du CRBF) remis par les établissements et lors des contrôles sur place. – Les commissaires aux comptes, qui sont choisis parmi les experts comptables inscrits au tableau de l’Ordre monégasque des experts-comptables, sont nommés dans le cadre des dispositions qui prévoient un avis préalable de la Commission bancaire. Ils établissent un rapport sur les comptes annuels. Les incidents de paiement et les risques sur les entreprises sont centralisés sur les fichiers Banque de France (fichier des incidents de paiement et FIBEN), ce qui permet d’affiner l’analyse des risques. Dans le cadre du contrôle sur pièces, chaque année, un certain nombre d’établissements font l’objet d’un entretien dans les locaux du secrétariat général de la Commission bancaire (SGCB). Les établissements sont sélectionnés en fonction de l’ancienneté du dernier entretien, des problèmes rencontrés dans l’année ou en raison de points comptables ou réglementaires à clarifier (6 entretiens prévus en 2009). De plus, la Banque de France de Nice réalise des entretiens avec les banques monégasques à la demande du SGCB. Les établissements monégasques font régulièrement l’objet de missions d’inspection sur place par des inspecteurs de la Banque de France (en moyenne 4 établissements par an). Le programme est déterminé comme pour les autres établissements en fonction du profil de risque. Des entretiens périodiques ont lieu avec les autorités monégasques, et notamment avec le Département des finances et de l’économie, avec le président de l’AMAF (Association monégasque des activités financières). Toutefois, en matière de lutte anti-blanchiment, le dispositif réglementaire et de contrôle des établissements de crédit monégasques est spécifique : – Le contrôle des établissements monégasques en matière de lutte anti-blanchiment n’est pas exercé par la Commission bancaire mais par une autorité de contrôle monégasque, le Service d’information et de Contrôle des Circuits Financiers (SICCFIN) ; – Si le SGCB n’est pas en charge du suivi de la lutte anti-blanchiment, une attention particulière est néanmoins apportée, lors de l’examen sur place du dispositif de contrôle interne, au critère de « connaissance du client » ; – Si des lacunes sont relevées en la matière, le SGCB en informe SICCFIN (par envoi d’extraits du rapport, de la lettre de suite) avec qui un accord de coopération permettant de faciliter l’échange d’informations dans le domaine du contrôle interne et de la connaissance de la clientèle a été signé en 2003. |
c) Des initiatives récentes qui doivent être poursuivies
À l’initiative de la commission des Finances, une disposition créant une nouvelle obligation de reporting des banques françaises en matière de relations avec les paradis fiscaux a été intégrée à la loi n° 2009-715 du 18 juin 2009 relative à l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires : il s’agissait en réalité de généraliser un dispositif similaire qui avait été adopté dans le cadre de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 à destination des établissements bancaires bénéficiaires des prêts de la Société française de financement de l’économie (SFEF) (41). Cette nouvelle obligation générale impose aux établissements de crédit de publier, en annexe de leurs comptes annuels, des informations sur leurs implantations et leurs activités dans les États ou territoires qui n’ont pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires. Un arrêté ministériel doit définir les informations devant figurer dans l’annexe et fixer la liste des États ou territoires concernés. Il conviendra de rester attentif à la publication de ce texte, ainsi qu’aux précisions qu’il apportera afin d’aménager cette nouvelle obligation à la charge des établissements bancaires.
Dans le sillage de cette initiative parlementaire, et à la demande du Président de la République, la Fédération bancaire française (FBF) a rendu publique, le 25 mai 2009, une série de cinq engagements qu’elle a soumis à l’ensemble des banques européennes, qui reposent d’une part sur l’application d’un principe de transparence (sur les implantations et sur les opérations avec les territoires les moins coopératifs) et d’autre part sur des règles de gouvernance particulières et renforcées (extension des règles de contrôle interne applicables en Europe, vigilance accrue des organes de décision des groupes pouvant aller jusqu’à la fermeture d’activités).
LES CINQ ENGAGEMENTS DE LA FÉDÉRATION BANCAIRE FRANÇAISE (FBF)
Premier engagement : Proactivité dans la coopération internationale.
Respecter scrupuleusement les règles et principes dégagés par la communauté internationale, offrir une coopération franche pour leur élaboration afin de leur assurer le maximum d’efficacité et contribuer dans la mesure de leurs moyens à l’élaboration de règles internationales aussi efficaces que possible, notamment en ce qui concerne les listes de pays non coopératifs établies par les autorités.
Deuxième engagement : Extension des règles de contrôle interne applicables en Europe.
Pratiquer dans l’ensemble de chaque groupe bancaire les règles et principes déontologiques applicables dans l’Union européenne, sauf si les prescriptions locales sont plus strictes.
Troisième engagement : Transparence sur les implantations.
Adresser chaque année à l’autorité de supervision un état mentionnant les implantations (filiales, succursales ou bureaux de représentation) dans les pays non coopératifs et décrivant les principales activités effectuées.
Cet état sera présenté au conseil d’administration ou au conseil de surveillance et toute nouvelle implantation dans l’un de ces pays sera soumise à une procédure d’autorisation à haut niveau au sein du groupe.
Si un pays est inscrit sur une liste de pays non coopératifs où il ne figurait pas préalablement, un examen de la situation sera fait et soumis à une instance de haut niveau.
Quatrième engagement. Gouvernance spécifique pour les pays les moins coopératifs.
Dès lors qu’un pays sera inscrit sur une liste spécifique des pays les moins coopératifs, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance se prononcera, dans les trois mois, sur un dispositif de restriction des activités, pouvant aller jusqu’à l’arrêt total de celles-ci, en tenant compte de l’adéquation du dispositif de contrôle.
Cinquième engagement : Transparence sur les opérations avec les pays les moins coopératifs.
S’agissant des pays les moins coopératifs, tenir à disposition des autorités bancaires du pays de la société mère du groupe des informations sur certaines opérations relevant du domaine ayant conduit au classement du pays dans cette catégorie et appliquer à ces opérations le régime de surveillance particulier défini par la communauté internationale.
On remarquera que ces engagements reprennent notamment les obligations d’ores et déjà posées par la loi, en particulier en matière de publication d’informations relatives aux implantations et activités des banques dans les territoires non coopératifs : les banques françaises s’engagent, qui plus est, à transmettre ces éléments – ainsi que ceux relatifs aux opérations menées avec ces pays – à la Commission bancaire, à soumettre à autorisation de leur groupe toute nouvelle implantation dans ces territoires et à surveiller particulièrement leurs opérations avec ces territoires. La communication d’informations détaillées à la Commission bancaire en complément de l’information générale en annexe aux comptes annuels constitue une excellente mesure. Si l’engagement devait ne pas être correctement respecté, une obligation de cette nature devrait être instituée. Enfin, l’engagement le plus significatif de la FBF est celui qui consiste à prévoir une restriction des activités, voire l’arrêt total de celles-ci, dès lors qu’un territoire serait inscrit sur une liste spécifique des pays les moins coopératifs.
Ces efforts consentis par les banques ne doivent toutefois pas masquer l’ampleur des progrès qui peuvent encore être fournis en matière de transparence et de contrôle interne. Ainsi, en février 2006, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a publié un référentiel de bonnes pratiques à destination des établissements de crédit, concernant le renforcement de la gouvernance d’entreprise dans les établissements bancaires et qui comporte huit principes de bonne gouvernance. Le dernier de ces principes, appelé « Connaissez votre structure », recommande au conseil d’administration et à la direction générale de l’établissement bancaire de bien comprendre la structure opérationnelle de la banque, y compris lorsque celle-ci opère dans des juridictions ou par l’intermédiaire de structures qui font écran à la transparence.
En effet, les problèmes de gouvernance d’entreprise surgissent lorsque les banques opèrent par l’intermédiaire de structures qui manquent de transparence ou font obstacle à la transparence. Il arrive que des banques choisissent d’opérer dans certaines juridictions ou bien de mettre en place des structures complexes (véhicules ad hoc ou montages sous forme de fiducie), souvent pour des motifs légitimes justifiés par leur activité. Cela peut toutefois présenter des risques financiers, juridiques ou de réputation pour l’établissement bancaire, empêcher le conseil d’administration et la direction générale d’exercer une surveillance adéquate et nuire à l’efficacité du contrôle bancaire. En conséquence, la direction générale d’une banque devrait s’assurer que ces structures ou activités sont conformes aux lois et règlements applicables. Le conseil d’administration devrait également examiner la nécessité d’opérer dans des juridictions de ce type ou d’employer de telles structures, et établir les limites appropriées à cet égard ; il devrait veiller à ce que la direction générale mette en place des politiques visant à recenser et à gérer toute la gamme des risques associés à ces structures ou activités. Le conseil d’administration, ou la direction générale dans le cadre des orientations édictées par le conseil, devrait documenter toutes ces étapes (examen, autorisation, gestion des risques) afin que le processus soit transparent pour les auditeurs et les autorités de contrôle.
Outre le risque direct associé au fait d’opérer dans les juridictions ou de recourir à certaines structures qui manquent de transparence ou font obstacle à la transparence, les banques peuvent également être exposées à des risques indirects lorsqu’elles offrent certains services ou mettent en place des structures opaques pour le compte de leur clientèle. Parmi les prestations et opérations concernées figurent la constitution d’entreprises ou l’établissement de partenariats, diverses fonctions de mandataire ou des montages complexes de financements structurés. Ces prestations sont souvent lucratives et servent les buts professionnels légitimes de la clientèle, mais il peut arriver, dans certains cas, que ces produits et activités proposés par les banques soient utilisés à des fins illicites ou inappropriées, ce qui peut également présenter d’importants risques juridiques et de réputation pour les banques offrant de tels services. Les banques concernées devraient par conséquent mettre en place des politiques et des procédures visant à déterminer et à gérer l’ensemble des risques significatifs liés aux activités de cette nature.
À cet égard, le conseil d’administration devrait prendre des mesures pour s’assurer que les risques découlant de ces activités sont bien compris et gérés :
– Le conseil d’administration devrait s’assurer que la direction générale suit des politiques claires concernant la conduite d’activités par l’intermédiaire de structures ou dans des juridictions faisant obstacle à la transparence.
– Le comité d’audit de la société mère devrait surveiller l’audit interne des contrôles relatifs à ces structures et activités, et il devrait rendre compte au conseil d’administration des résultats de ses vérifications chaque année, ou chaque fois que sont décelés des événements ou des manquements significatifs.
– Des politiques, procédures et stratégies appropriées devraient régir l’approbation des structures, instruments ou produits financiers complexes employés ou vendus dans toute unité commerciale de la banque. De plus, le conseil devrait établir une politique et une procédure appropriées afin d’évaluer régulièrement, dans le cadre de l’examen périodique de la direction, l’utilisation et/ou la vente de tels structures, instruments ou produits. Les banques ne devraient admettre les structures, instruments ou produits financiers complexes que si les risques financiers, juridiques et de réputation significatifs découlant de leur utilisation/vente peuvent être convenablement évalués et gérés.
Le conseil d’administration et la direction peuvent améliorer l’efficacité de leur action en exigeant que les examens de contrôle interne portent non seulement sur les opérations de « cœur de métier », mais aussi sur celles menées (soit pour compte propre, soit pour le compte de la clientèle) dans des juridictions ou par l’intermédiaire de structures qui manquent de transparence. Ces examens devraient comporter, par exemple, des inspections régulières par les auditeurs internes, un réexamen des activités visant à s’assurer qu’elles restent conformes à leur objet initial, un contrôle de conformité avec les lois et règlements applicables, et une évaluation des risques juridiques et de réputation liés à ces activités ou structures. La fréquence de ces examens devrait être fonction du risque évalué, et la direction devrait s’assurer que le conseil est avisé de l’existence et des modalités de gestion de tout risque significatif recensé.
Bien qu’il appartienne au conseil d’administration de surveiller et d’approuver généralement les politiques, et à la direction générale de recenser et de gérer les risques significatifs découlant de l’ensemble des activités de la banque, ces deux organes devraient exercer plus strictement leur obligation de diligence lorsque la banque opère dans des juridictions non coopératives, par l’intermédiaire de structures, ou fournit des services à ses clients qui limitent la transparence et peuvent s’opposer à un contrôle bancaire efficace. À cet égard, le conseil d’administration - ou la direction générale, dans le cadre des orientations édictées par le conseil – devrait veiller à ce que la banque dispose de politiques et de procédures permettant :
– d’évaluer régulièrement la nécessité de mener des activités dans des juridictions ou par l’intermédiaire de structures complexes qui limitent la transparence ;
– de recenser, mesurer et gérer tous les risques significatifs, y compris les risques juridiques et de réputation, découlant de telles activités ;
– de mettre en place des procédures d’approbation adéquates pour les transactions et les nouveaux produits, en particulier concernant les activités visées ici (par exemple, limites applicables, atténuation du risque juridique ou du risque de réputation, exigences en matière d’information) ;
– de définir clairement les attentes et les responsabilités, sous l’angle de la gouvernance, pour toutes les unités et toutes les lignes de métier au sein de l’établissement bancaire ;
– de définir et de bien appréhender l’objet de ces activités, et de s’assurer que ces dernières sont menées conformément à l’objet visé ;
– de surveiller l’évaluation régulière de la conformité avec l’ensemble des lois et règlements applicables, ainsi qu’avec les politiques internes de la banque ;
– de s’assurer que ces activités sont bien couvertes par les contrôles internes réguliers effectués par le siège de la banque, ainsi que par les audits externes ;
– de s’assurer que les informations relatives à ces activités et aux risques qui y sont associés sont aisément accessibles au siège de la banque, qu’elles font dûment l’objet de rapports au conseil d’administration et de déclarations aux autorités de contrôle ; que ces rapports et déclarations précisent notamment, pour ces activités, leur objet, les stratégies, les structures, les volumes, les risques et les contrôles ; que ces informations sont communiquées comme il convient au public.
Or, à ce jour, force est de constater que ces principes n’ont pas été transposés par les établissements bancaires français du point de vue du renforcement de leur contrôle interne. Il conviendrait donc de faire de ces principes de bonne gouvernance une directive contraignante, qui s’imposerait aux établissements bancaires.
→ Renforcer les règles de bonne gouvernance des établissements de crédit en matière de contrôle interne.
Enfin, avec l’entrée en vigueur du nouveau dispositif prudentiel Bâle II, qui a été aménagé par la directive européenne « fonds propres réglementaires » dite CRD (Capital Requirements Directive) du 30 juin 2006, les banques sont soumises à des règles renforcées depuis le 1er janvier 2008. Celles-ci concernent autant les exigences de fonds propres qui doivent désormais intégrer non seulement les risques de crédits, mais également les risques de marché et le risque opérationnel (ratio Mac Donough), que la procédure de surveillance de la gestion des fonds propres et, enfin, les règles de transparence quant à l’information mise à la disposition du public sur l’actif, les risques et leur gestion.
D’après la Commission bancaire, la mise en place de dispositifs rigoureux d’appréciation du risque opérationnel par les établissements bancaires français est prioritaire, de même que la mise en œuvre de dispositifs spécifiques visant à identifier et à suivre le risque de fraude. On peut à cet égard s’interroger sur l’opportunité d’un renforcement des règles prudentielles s’appliquant aux établissements de crédit, notamment s’agissant de leurs activités ou de leurs implantations dans des territoires non coopératifs. Des contraintes de fonds propres spécifiques, tenant compte de l’importance de l’activité et des relations des banques avec ces territoires, pourraient être instituées.
→ Dans le cadre d’une réforme plus globale des règles prudentielles applicables aux banques, établir des contraintes spécifiques, notamment en termes de fonds propres, pour les établissements en relation avec des territoires non coopératifs.
3.– Les règles applicables aux autres entités
Les établissements bancaires ne sont pas les seuls sujets à réglementation en matière de transparence des activités et d’implantations dans les paradis fiscaux. Il apparaît nettement en revanche que c’est le secteur aujourd’hui le plus avancé dans la réflexion devant conduire à une meilleure régulation de ces territoires. Pourtant, d’autres secteurs utilisent de façon importante les paradis fiscaux, pour des motifs divers. Qu’il s’agisse des entités soumises au contrôle de l’Autorité des marchés financiers, c’est-à-dire les groupes multinationaux, les fonds et les entreprises de marché, ou de celles relevant de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), des améliorations en matière d’information seraient donc tout à fait bienvenues, tant dans une optique de stabilité du système de financier que de prévention et de répression des abus et de la fraude.
En outre, ces obligations permettraient indirectement d’affecter les sociétés ou entités mères ou encore indépendantes établies dans les paradis fiscaux, en durcissant les conditions de leur intervention sur nos marchés. L’opacité dans ce type de schéma est en effet totale, le contrôle de la mère échappant au superviseur. Or, son implantation est motivée par deux considérations : la fiscalité et les facilités réglementaires. Majorer le coût de ses flux (agréments, contrôles, taxation) est donc pertinent. Dans certains cas de figure, des mesures d’interdiction doivent être envisagées : territoires figurant sur toutes les listes après quelques mois ou secteurs dont la réglementation affecte la sécurité des personnes et des biens. Ainsi, l’accès des bateaux battant pavillon de complaisance enregistrés dans les paradis fiscaux et réglementaires devrait être interdit. Pour mémoire, dans l’affaire des déchets toxiques déversés en Côte d’Ivoire en 2006, qui a fait une dizaine de morts et conduit à quelque 42 000 consultations médicales, le Probo Koala, bateau sous pavillon panaméen, était expédié par une société écran, Puma Energy, domiciliée aux Bahamas. L’actionnaire unique de Puma Energy est une société, Trafigura, fondée par deux hommes d’affaires français ; ses bureaux sont à Londres, la filiale en cause (Trafigura Beheer BV) ainsi que l’adresse fiscale à Amsterdam, le siège social à Lucerne en Suisse, la holding qui détient les actions à Malte et les parts du personnel logées dans un trust basé à Jersey (42).
→ Interdire l’accès, aux eaux territoriales françaises, des bateaux battant pavillon de complaisance enregistrés dans les paradis fiscaux et réglementaires.
En France, les sociétés cotées – et les entreprises en général – n’obéissent pas à des règles particulières s’agissant de leurs participations dans des territoires offshore ou de leurs relations commerciales avec des entités qui y sont établies.
S’agissant des opérations et de l’information financières, l’autorité des marchés financiers (AMF) réglemente les opérations financières et l’information diffusée par les sociétés cotées, qui ont en effet l’obligation d’informer le public de leurs activités, de leurs résultats et de leurs opérations financières. Les règles comptables qui s’imposent aux sociétés cotées obligent uniquement ces dernières à communiquer la liste de leurs participations significatives. L’AMF supervise et contrôle l’information délivrée, en veillant à ce qu’elle soit précise, sincère, exacte et diffusée à l’ensemble de la communauté financière.
Il conviendrait d’améliorer significativement l’information apportée par les sociétés cotées, tant vis-à-vis de leurs actionnaires que de leur autorité de surveillance, en prévoyant par exemple la publication, en annexe de leur rapport annuel, de l’ensemble des activités conduites dans les paradis fiscaux, des montages utilisés, des entités impliquées et des risques ainsi induits. Cette obligation pourrait aussi être décomposée, comme pour les banques, en une obligation d’information générale en annexe au rapport annuel et une obligation d’information détaillée à destination de l’AMF.
D’autre part, les centres offshore abritent beaucoup d’entités déconsolidées, qui n’entrent pas dans la liste des informations qui doivent être communiquées. Le règlement encadrant ces obligations, dans le respect des normes IFRS, ne recense en effet que les entités consolidées : par exemple, les trusts, véhicules privilégiés de certains paradis fiscaux, n’entrent pas dans la catégorie des participations. Un certain nombre d’associations préconisent ainsi de conditionner la certification des comptes consolidés à la réalisation d’un contrôle comptable dans l’ensemble des territoires où la société exerce ses activités, quelle que soit la forme juridique des entités. La transmission d’informations détaillées de cette nature au superviseur devrait être privilégiée dans un premier temps.
→ Imposer la publication en annexe du rapport annuel de l’ensemble des activités menées par les sociétés cotées en lien avec des paradis fiscaux et territoires non coopératifs ou la publication d’une information générale faisant figurer les filiales et les activités, complétée par une information détaillée annuelle à destination de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Un autre point problématique concerne les entités étrangères, non résidentes, ou les filles de sociétés mères, établies dans des territoires non coopératifs : si leur installation sur le territoire français les soumet aux normes prudentielles et comptables applicables en France, en revanche, les sociétés mères, elles, ne font l’objet d’aucun contrôle de la part des autorités de supervision françaises. Dès lors, afin de dissuader les sociétés d’héberger leur maison mère dans un paradis fiscal et d’établir leurs filiales en France, il conviendrait de soumettre ces premières aux mêmes règles prudentielles et comptables que leurs filiales et les soumettre aux autorités de contrôle et de supervision françaises.
Il pourrait même être envisagé de conditionner leur accès au marché français au respect des règles prudentielles et comptables françaises et à la soumission au contrôle de l’organe de supervision français.
→ Restreindre l’accès au marché français des filiales de sociétés mères établies dans des territoires non coopératifs et qui ne respectent pas des normes prudentielles et comptables minimales. Assortir ce dispositif d’un droit de suite, permettant à l’autorité des marchés financiers (AMF) de contrôler ces sociétés mères.
b) Les produits d’épargne collective et les prestataires de services d’investissement
L’AMF est également compétente pour autoriser la création de SICAV et de FCP : elle vérifie à ce titre l’exactitude des informations remises au client sur chaque produit, et, s’agissant des produits complexes (fonds à formule, etc.), elle veille à ce que les spécificités du produit, notamment ses risques, soient clairement présentées aux épargnants.
S’agissant des prestataires eux-mêmes, - établissements de crédit autorisés à fournir des services d’investissement, entreprises d’investissement, sociétés de gestion, conseillers en investissement financier, démarcheurs, etc. -, l’AMF fixe les règles de bonne conduite et les obligations que doivent respecter les professionnels autorisés à fournir des services d’investissement. Elle agrée par ailleurs les sociétés de gestion lors de leur création. Pour délivrer l’agrément à une société de gestion de portefeuille, l’AMF vérifie si celle-ci :
– a son siège social et son administration centrale en France ;
– dispose d’un capital initial suffisant et d’une forme juridique adéquate à l’activité de gestion ;
– fournit l’identité de ses actionnaires, dont elle apprécie la qualité, qui détiennent une participation qualifiée ainsi que le montant de leur participation ;
– est dirigée effectivement et voit son orientation déterminée par des personnes possédant l’honorabilité et la compétence nécessaires ainsi que l’expérience adéquate à leurs positions.
Pour être agréées, les sociétés de gestion de portefeuille doivent en outre disposer d’un programme d’activité. Ce programme doit être adapté au périmètre d’activité envisagé et mis à jour régulièrement.
L’AMF agrée en outre les associations professionnelles chargées de la représentation collective, de la défense des droits et des intérêts des conseillers en investissements financiers et contrôle ces conseillers en investissements financiers. Elle surveille enfin les démarcheurs agissant pour le compte des sociétés de gestion.
De ce point de vue, les territoires offshore posent un problème particulier, celui du risque que constituent ces zones pour l’épargne des résidents français qui y est investie. L’un des vecteurs privilégiés pour ces produits complexes est le fonds de fonds, – un fonds français qui sélectionne par exemple plusieurs fonds alternatifs hébergés aux Îles Caïman, dans les Îles Vierges britanniques, à Jersey et à Guernsey. Les épargnants sont dès lors exposés à des risques spécifiques, liés à un moindre contrôle, voire à son inexistence, dans ce type de territoires, ainsi qu’à un régime juridique qui peut être incertain. En France, les fonds de fonds, rangés dans la catégorie des instruments complexes, doivent respecter des obligations de vigilance renforcées, pour pouvoir être commercialisés.
On estime à environ 20 milliards d’euros les sommes gérées par des fonds de fonds français, dont une grande majorité est certainement investie dans des territoires offshore. Par ailleurs, des entités françaises gèrent des fonds de fonds établis dans des paradis fiscaux, dont les produits représenteraient également autour de 20 milliards d’euros.
La réglementation applicable aux fonds français leur interdit d’investir dans des titres émis ou dans des fonds localisés dans des pays ou territoires non coopératifs figurant sur la liste du GAFI. De même, le dépositaire français d’un fonds - une banque – est soumis à l’obligation de restituer immédiatement les actifs en cas de perte. Cette règle, prise en application de la directive 85/611/EEC dite « directive OPCVM », n’a pas été transposée de façon aussi rigoureuse par d’autres États membres de l’Union européenne, notamment par le Luxembourg. Par ailleurs, cette réglementation ne s’applique évidemment pas aux entités françaises qui gèrent directement des fonds dans des paradis fiscaux.
Dans la continuité des dispositions inscrites dans la directive 2004/39/CE concernant les marchés d’instruments financiers (dite directive MIF), entrée en vigueur en 2007, il conviendrait de renforcer la protection de l’épargnant, en particulier lorsqu’il s’agit d’un public non initié. Cette directive pose le principe d’une catégorisation des clients, selon qu’il s’agisse de contreparties éligibles, de clients professionnels ou de clients de détail. Pour ces derniers, il est nécessaire de s’assurer de la bonne adéquation entre les services fournis et la spécificité de ces clients, afin d’améliorer la qualité de l’information transmises : ainsi, doit être évaluée la « compétence financière » du client, par le biais de ses objectifs et critères d’investissement, de sa connaissance en matière d’instruments financiers et de sa situation financière.
Un renforcement de la protection de ces épargnants non initiés pourrait opportunément passer par l’interdiction aux sociétés de gestion de portefeuille exerçant une activité de multigestion alternative et investissant par le biais de fonds de fonds dans des titres émis ou dans des entités établies dans des territoires inscrits sur la liste grise de l’OCDE, de commercialiser leurs produits au grand public.
→ Interdire la commercialisation des produits proposés par des prestataires de services d’investissement qui passent par des entités établies dans des territoires non coopératifs.
c) Les infrastructures de marché
L’AMF définit enfin les principes d’organisation et de fonctionnement que doivent respecter les entreprises de marché (comme Euronext Paris qui organise les transactions sur les marchés des actions, des obligations et des produits dérivés), les systèmes de règlement-livraison et les dépositaires centraux (comme Euroclear France). L’Autorité approuve également les règles des chambres de compensation (comme Clearnet), qui centralisent chaque jour les transactions, et détermine les conditions d’exercice de leurs adhérents.
L’AMF effectue dans ce cadre des enquêtes destinées à détecter les abus de marché (opérations d’initiés, manipulations de cours, diffusion de fausse information) : environ 80 % des cas traités engagent des territoires étrangers, y compris des centres offshore ou des territoires considérés comme des paradis fiscaux.
L’AMF a interdiction de coopérer avec les autorités fiscales françaises : cette interdiction permet justement de garantir une bonne coopération avec les autorités de régulation étrangères, en particulier celles situées dans les paradis fiscaux, afin de détecter les abus de marché. Les centres financiers offshore importants ont globalement entériné l’intérêt à coopérer avec les autorités de régulation des autres États. Ainsi, en 2008, 95 enquêtes ont été menées par l’AMF, dont 46 ont été ouvertes à sa propre initiative. Le tableau suivant retrace le degré de coopération enregistré par un certain nombre de territoires figurant sur la liste grise de l’OCDE, au titre des requêtes adressées par l’AMF.
DEGRÉ DE COOPÉRATION DES AUTORITÉS DE RÉGULATION DES MARCHÉS DE CERTAINS PARADIS FISCAUX AVEC L’AMF
Nombre de requêtes |
Délai de réponse | |
Andorre |
1 requête |
Aucune réponse |
Autriche |
1 requête |
Réponse substantielle en 35 jours |
Bahamas |
n.c |
Réponses entre 250 et 375 jours avec demandes de précisions |
Belgique |
30 requêtes |
Réponse en 35 jours |
Bermudes |
3 requêtes |
Réponse rapide dans deux cas ; pas de réponse dans le 3ème cas. |
Îles Caïman |
5 requêtes |
Réponse en 20 jours en moyenne |
Îles Vierges britanniques |
9 requêtes |
Réponse en 20 jours en moyenne |
Gibraltar |
n.c |
Délai de réponse très long |
Liechtenstein |
5 requêtes |
Réponse en 76 jours en moyenne |
Monaco |
8 requêtes |
Réponse en 52 jours en moyenne |
Source : Autorité des marchés financiers
Un manque de coopération patent est enfin constaté par l’AMF avec l’autorité de régulation des marchés libanaise : aucune réponse n’est fournie aux demandes de l’AMF en matière de soupçons de délits d’initiés.
Outre les règles qui s’appliquent aux sociétés d’assurance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, au même titre, on l’a vu, qu’aux banques et aux professions du chiffre et du droit, les sociétés d’assurance, de réassurance, mutuelles et institutions de prévoyance et de retraite supplémentaire sont soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM).
L’ACAM est principalement chargée du contrôle des organismes d’assurance. Celui-ci est avant tout prudentiel et s’emploie à vérifier que les organismes sont en mesure de tenir leurs engagements envers leurs assurés et adhérents : il suppose une évaluation prudente de leurs engagements, la détention d’actifs suffisamment liquides, rentables et diversifiés pour faire face à ces engagements, et enfin, une « richesse propre » suffisante pour absorber les chocs imprévus. Ce contrôle permanent est assorti d’un contrôle sur place, destiné à apprécier plus précisément le niveau de provisionnement, la qualité de la gestion, les règles de gouvernance, la réassurance, ainsi que la connaissance et la maîtrise des risques d’un organisme donné.
Afin d’assurer l’effectivité du contrôle et de la surveillance de l’ACAM, celle-ci peut se voir transmettre toute données utiles de la part des organismes du marché français de l’assurance. Il s’agit essentiellement :
– des états trimestriels, avec pour le premier trimestre, la transmission du flux trimestriel ; pour le second trimestre, celle de l’encours trimestriel des placements, et pour le troisième trimestre, des simulations portant sur le rapport actif-passif ;
– et d’un dossier annuel comprenant notamment des renseignements généraux, des documents comptables publiés, des rapports de solvabilité, de contrôle interne, sur la politique de réassurance et enfin des états annuels d’analyse tels que l’état de couverture des engagements, l’état relatif à la marge de solvabilité ou des états de liquidation des provisions.
Il est à cet égard intéressant de noter que les pouvoirs de contrôle de l’ACAM s’étendent aux sociétés d’assurance de droit extracommunautaire opérant en France.
S’agissant des informations transmises à l’autorité de contrôle, il serait souhaitable que les organismes d’assurance y fassent figurer l’ensemble de leurs avoirs détenus ou de leurs revenus localisés dans un paradis fiscal, dont le bénéficiaire effectif est un résident français. Ces données pourraient par ailleurs utilement être publiées en annexe du rapport annuel auquel sont tenues les sociétés d’assurance. Il s’agirait donc, sur ce dernier point, d’élargir aux assureurs les nouvelles obligations mises en place pour les banques en matière de reporting, s’agissant des relations entretenues par ces établissements avec des paradis fiscaux.
→ Prévoir la publication d’informations relatives aux avoirs détenus, aux revenus localisés, aux filiales établies et aux activités conduites (y compris commerciales) dans les paradis fiscaux et territoires non coopératifs, complétées par des informations détaillées annuelles à destination de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM).
En outre, s’agissant de l’encadrement réglementaire de la profession, le projet de directive communautaire « Solvabilité II », qui a fait l’objet d’un accord interinstitutionnel le 22 avril 2009, propose une refonte des règles prudentielles encadrant les assurances, selon trois volets :
– Les exigences quantitatives requises de la part des sociétés d’assurance et de réassurance portent sur les normes d’évaluation des actifs et passifs, les provisions techniques, la classification des fonds propres en niveaux et sur deux exigences de capital : le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis ;
– Les exigences qualitatives et les règles de contrôle reposent sur une approche prospective et fondée sur le risque, et permettent aux autorités de contrôle d’exiger que les entreprises d’assurance et de réassurance présentant un profil de risque spécifique détiennent davantage de fonds propres ;
– Enfin, les exigences d’information prudentielle et à destination du public imposent notamment la publication annuelle d’un rapport présentant la situation financière et la solvabilité des entreprises d’assurance et de réassurance.
En l’état, aucune disposition ne concerne les risques spécifiques encourus par les assurances et par conséquent par les souscripteurs et qui sont liés à la détention d’avoirs ou à l’existence de revenus localisés dans des paradis fiscaux. Afin de protéger au mieux les assurés, il pourrait donc être envisagé de faire de l’existence de relations avec un territoire non coopératif un critère conduisant à la classification de l’organisme d’assurance considéré comme présentant un profil de risque spécifique appelant la détention de fonds propres plus importants.
→ Imposer aux sociétés d’assurance et de réassurance qui détiennent des avoirs ou localisent des revenus dans les territoires non coopératifs une exigence de fonds propres supplémentaires.
B.– LES DISPOSITIFS DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET L’ÉVASION FISCALES
Le délit de fraude fiscale donne lieu à des sanctions fiscales : rectifications, majoration et pénalités, intérêt de retard, amendes. De plus, l’article 1741 du code général des impôts énonce : « Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de l’impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’une amende de 37 500 euros et d’un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d’achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu’ils ont eu pour objet d’obtenir de l’État des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d’une amende de 75 000 euros et d’un emprisonnement de cinq ans. Toutefois, cette disposition n’est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros. Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal. […] En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d’une amende de 100 000 euros et d’un emprisonnement de dix ans ».
La France dispose aujourd’hui de plusieurs types d’outils permettant de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales : des obligations déclaratives, des régimes permettant d’imposer en France des revenus localisés à l’étranger, des régimes anti-abus permettant la non application de règles de détermination de l’impôt. L’efficacité des règles fiscales dissuasives et du contrôle fiscal international suppose une crédibilité de l’administration à disposer de l’information nécessaire et suffisante. C’est sur l’accès à l’information que les efforts doivent être portés en accentuant les obligations nationales en présence de territoires non coopératifs. Au niveau international, la France dispose du réseau conventionnel le plus étendu avec 119 conventions fiscales. Le nouvel article 26 du modèle de convention OCDE a été intégré dans les conventions récentes et des conventions ont été renégociées à cet effet, notamment avec des pays à faible fiscalité comme le Qatar et Malte. Les négociations avaient été suspendues avec Hongkong qui refusait cette condition. Pour les places financières d’importance, l’élimination des doubles impositions est un facteur d’attractivité et la France dispose donc d’un levier pour généraliser l’échange d’informations. Habituée à cet exercice, elle a ainsi été le premier pays à conclure une convention conforme aux derniers standards de l’OCDE avec Malte en 2008.
1.– Quelques considérations juridiques sur le ciblage
L’ensemble des dispositifs permettant de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales doit s’appuyer sur le tissu conventionnel français pour cibler les juridictions non coopératives. Cela signifie, d’une part, que l’on ne saurait faire référence à une liste OCDE non représentative des échanges d’informations pouvant être mis en œuvre entre la France et les autres territoires et, d’autre part, que la rédaction choisie pour définir les juridictions non coopératives est essentielle. De nombreuses dispositions fiscales figurant dans le code général des impôts s’appliquent aux non résidents, personnes physiques ou morales, ou à des transactions financières en provenance ou à destination de l’étranger, à la condition que l’État de résidence du bénéficiaire, de provenance ou de destination des flux soit :
– un État lié à la France par convention d’assistance administrative ou contenant une clause d’assistance administrative,
– un État membre de la Communauté européenne,
– un État partie à l’accord sur l’EEE lié à la France par convention d’assistance administrative ou contenant une clause d’assistance administrative (43),
– un État membre de la Communauté européenne ou un État partie à l’accord sur l’EEE lié à la France par convention d’assistance administrative ou contenant une clause d’assistance administrative.
LA DIVERSITÉ DES CATÉGORIES VISÉES PAR LE CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
Catégorie de rédaction visée |
Dispositions de droit interne |
i) Monde |
12 |
ii) EEE |
3 |
iii) UE + EEE |
33 |
iv) UE + Monde |
8 |
Total |
56 |
Source : Direction de la législation fiscale
S’agissant de la référence à la convention, on trouve les rédactions suivantes :
– l’existence d’une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, rédaction qui a pour inconvénient de viser les clauses des conventions fiscales qui ne portent que sur la fraude, ce qui est plus restrictif que l’évasion. Cette rédaction doit être proscrite ;
– l’existence d’une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
– l’existence d’une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, c’est-à-dire un accord d’échange de nature fiscale ;
– l’existence d’une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires.
Cette dernière rédaction est nouvelle, issue de l’article 52 de la loi de finances rectificative pour 2008 relatif au délai de reprise de l’administration en cas de non respect de certaines obligations déclaratives. D’une part, elle met l’accent sur les renseignements bancaires, ce qui est une nouveauté : il doit y avoir une convention « permettant l’accès aux renseignements bancaires ». Le problème essentiel s’agissant de déclarations de comptes, produits bancaires ou de revenus réalisés dans des paradis fiscaux est bien celui de l’obtention de l’information. D’autre part, cette rédaction conduit également à ne pas viser les États ou territoires avec lesquels il existe une convention d’assistance administrative « permettant » l’accès aux renseignements bancaires, qu’il s’agisse ou non d’une convention qui prévoit cet accès. Très peu de conventions fiscales comportent une mention expresse de cette nature, qui n’est apparue dans le modèle OCDE qu’en 2005. Cela ne signifie pas que les États avec lesquels des conventions d’un modèle antérieur ont été passées ne transmettent pas ce type d’informations sur le fondement de l’assistance administrative lorsque celle-ci est prévue dans la convention. À l’inverse, certains États ou territoires ont une interprétation restrictive de l’accès aux renseignements bancaires mise en cause dans le rapport de l’OCDE de 2007 sur l’accès à l’information bancaire à des fins fiscales. Ces pays sont concernés par l’allongement du délai de reprise.
Enfin, dans cette rédaction, la convention permettant l’accès ne doit pas nécessairement prendre la forme d’une convention d’élimination des doubles impositions puisqu’il doit s’agir d’une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Ce peut donc tout aussi bien être un accord bilatéral conclu aux fins de transmission de renseignements bancaires. C’est cette voie qui est aujourd’hui privilégiée avec les paradis fiscaux dès lors que des conventions d’élimination des doubles impositions ne sont pas souhaitées (elles renforceraient l’attractivité des territoires peu imposés) et impliquent de longues négociations.
Il en résulte une liste « blanche » d’États et territoires avec lesquels l’accès aux renseignements bancaires est effectivement permis, cette liste étant susceptible de s’allonger au fur et à mesure des accords conclus et, à l’inverse, de se resserrer si des États pour lesquels le cas de figure ne s’est jamais présenté venaient à s’avérer peu coopératifs dans la mise en œuvre de l’assistance administrative. Il convient de souligner également que la France n’a pas signé de conventions avec certains États, absents donc de la liste « blanche », simplement parce que les enjeux économiques sont limités. Le fait qu’un pays figure ou ne figure pas sur la liste peut donc recouvrir des réalités et pratiques différentes.
Dès lors, avant même d’envisager de modifier sur le fond les différents dispositifs de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, il conviendrait d’uniformiser les rédactions employées, en retenant l’accès aux informations bancaires lorsque sont spécifiquement visés les territoires non coopératifs, et en maintenant une rédaction plus ouverte lorsqu’il s’agit d’appréhender des revenus soustraits à l’impôt français, voire de moduler les dispositifs selon que l’on est dans l’un ou l’autre de ces deux cas de figure.
Cette amélioration théorique du ciblage ne doit pas occulter la difficulté à mettre en pratique une restriction fondée sur l’application concrète de dispositions internationales. En premier lieu, la mise à jour de la liste blanche est contestable. Elle repose sur une appréciation de la qualité de l’échange d’informations au regard de cas déterminés qui emportent application générale d’une restriction. En second lieu, comme indiqué ci-dessus, certains États n’ont pas conclu ce type d’accords avec la France sans que cela ne justifie des mesures de rétorsion. C’est le cas de certains pays d’Amérique latine et du Yémen par exemple. Il n’est pas nécessairement souhaitable de conclure une convention d’élimination des doubles impositions, ce qui pourrait être leur demande. Il semble donc nécessaire de conserver une référence au régime fiscal privilégié, tant pour continuer à imposer des revenus réalisés dans des États sous-imposés, qu’ils coopèrent ou non, que pour ne pas appliquer aveuglément les mesures de rétorsion qui seraient adoptées, notamment en termes de limitation des déductions.
2.– Les relations avec l’administration : obligations déclaratives et documentation
a) Les obligations déclaratives en matière douanière
Afin de lutter contre la criminalité organisée, les filières de fraude internationale, le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme, ont été mis en place des dispositifs de contrôle prévoyant que les transferts d’argent entre la France et les États étrangers d’un montant supérieur à 10 000 euros (ou sa contre-valeur) doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de l’administration des douanes. Sont ainsi soumis à déclaration les transferts d’espèces, les chèques endossables, les lettres de crédit non domiciliées, les bons de caisse anonymes et les bons de capitalisation. Cette obligation est prévue par :
– le règlement (CE) n° 1889/2005 du 26 octobre 2005 du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, qui concerne les mouvements d’argent liquide en provenance ou à destination des États tiers de la Communauté européenne d’un montant supérieur à 10 000 euros ;
– l’article L. 152-1 du code monétaire et financier (et l’article 464 du code des douanes) applicable aux transferts intracommunautaires qui impose aux personnes physiques une obligation de déclaration des transferts de sommes, titres ou valeurs effectués sans intermédiaire. L’article 96 de la loi de finances rectificative pour 2006 a porté de 7 600 à 10 000 euros le montant de transfert à partir duquel la déclaration est obligatoire, par cohérence avec ce que prévoit le règlement européen pour les transferts avec les pays tiers. L’article L. 152-3 du même code prévoit que les personnes doivent communiquer aux administrations fiscales et douanières, sur leur demande, la date et le montant des sommes transférées à l’étranger par les personnes visées à l’article L. 152-2, l’identification de l’auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l’étranger. Ces dispositions s’appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents. Ces organismes sont également tenus de conserver, dans les conditions prévues à l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales, tout document, information, donnée ou traitement relatif aux opérations de transfert mentionnées aux alinéas précédents.
Tout manquement à l’obligation déclarative est sanctionné par une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction (articles L. 152-4 du code monétaire et financier et 465 du code des douanes). L’article 1649 quater A du code général des impôts prévoit également que les sommes, titres ou valeurs ainsi non déclarés constituent des revenus imposables, sauf preuve contraire. Cette présomption de revenus imposables a été confirmée par l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2008 s’agissant des transferts extracommunautaires (44).
Par ailleurs, les agents des douanes consignent la totalité des sommes en cause pendant une durée de trois mois, renouvelable une fois sur autorisation du procureur de la République. Les sommes consignées sont saisies et la confiscation peut être prononcée par les juridictions judiciaires lorsqu’il est établi que l’auteur du manquement est ou a été en possession d’objets laissant présumer qu’il est ou a été l’auteur d’une ou plusieurs infractions douanières ou bien participe ou a participé à de telles infractions, ou encore lorsqu’il y a des raisons plausibles de penser qu’il a commis une ou plusieurs infractions douanières ou a participé à la commission de telles infractions. Ce délai apparaît toutefois très court, et il apparaît justifié de la porter à six mois renouvelables une fois sur autorisation du parquet.
→ Porter la durée du délai de consignation des sommes transférées non déclarées de 3 à 6 mois renouvelables une fois sur autorisation du parquet
INFRACTIONS À L’OBLIGATION DÉCLARATIVE RELEVÉES PAR LA DOUANE
Manquements à l’obligation déclarative |
2006 |
2007 (45) |
2008 |
Nombre de constatations |
1 791 |
1 603 |
1 453 |
Montants saisis (en millions d’euros) |
132,40 |
80,29 |
98,79 |
Montants des sommes saisies en vue de leur confiscation et des amendes transactionnelles (en millions d’euros) (46) |
13,59 |
6,93 |
14,35 |
|
2006 |
2007 |
2008 |
Allemagne |
18,5 |
9,0 |
10,5 |
Italie |
5,2 |
7,9 |
9,8 |
Comores |
8,2 |
7,3 |
8,0 |
Suisse |
5,2 |
6,4 |
7,7 |
Vietnam |
0,9 |
NS |
7,7 |
Luxembourg |
7,7 |
10,6 |
7,5 |
Chine |
8,0 |
12,8 |
6,1 |
Pourcentage d’affaires par pays de provenance |
2006 |
2007 |
2008 |
Allemagne |
6,8 |
3,1 |
5,2 |
Luxembourg |
3,2 |
5,8 |
7,9 |
Espagne |
5,3 |
5,6 |
6,2 |
Italie |
2,5 |
3,9 |
4,7 |
Suisse |
42,3 |
37,6 |
29,8 |
Belgique |
4,2 |
3,4 |
3,7 |
Pourcentage des montants exportés par pays de destination |
2006 |
2007 |
2008 |
Allemagne |
61,7 |
4,1 |
35,9 |
Luxembourg |
8,2 |
28,7 |
28,0 |
Italie |
2,0 |
4,6 |
4,7 |
Espagne |
3,0 |
4,3 |
3,7 |
Suisse |
2,9 |
17,4 |
3,2 |
Belgique |
1,7 |
6,2 |
3,0 |
Chine |
1,9 |
4,4 |
2,9 |
Pays-Bas |
1,5 |
2,9 |
2,5 |
Vietnam |
0,1 |
NS |
1,9 |
Pourcentage des montants importés par pays de provenance |
2006 |
2007 |
2008 |
Suisse |
28,1 |
18,8 |
38,3 |
Luxembourg |
3,7 |
19,4 |
9,8 |
Espagne |
9,0 |
7,8 |
8,0 |
Allemagne |
13,1 |
9,9 |
6,6 |
Chine |
0,5 |
NS |
4,5 |
Belgique |
8,1 |
2,5 |
3,2 |
Source des tableaux : Direction générale des douanes et des droits indirects
b) Les obligations déclaratives des particuliers envers l’administration fiscale renforcées par la loi de finances rectificative pour 2008
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger. Sont également soumises à cette obligation, les personnes de nationalité française qui ont établi à Monaco leur résidence habituelle depuis le 14 octobre 1957. Les comptes à déclarer sont ceux ouverts hors de France auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces. Il doit être procédé au titre de chaque année (ou exercice) à une déclaration par compte ouvert, utilisé ou clos à l’étranger, jointe à la déclaration de revenus ou de résultats. Des dispositifs équivalents existent à l’étranger. Ainsi, en Belgique, en Italie et aux Pays-Bas, les personnes physiques sont tenues de mentionner dans leur déclaration de revenus les comptes bancaires qu’elles détiennent à l’étranger. Aux États-unis, cette règle s’applique si le montant des sommes déposées dépasse 10 000 dollars. Elle concerne également les comptes détenus par l’intermédiaire de trusts.
Conformément au troisième alinéa de l’article 1649 A, constituent sauf preuve contraire des revenus imposables les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés (47). Le IV de l’article 1736 du code général des impôts sanctionne la non-déclaration d’une amende.
Ce dispositif produit des résultats décevants dès lors que l’administration n’a quasiment aucun autre moyen de disposer de l’information. Le nombre de déclarations de comptes bancaires à l’étranger est très faible : moins de 25 000 foyers ont procédé à une déclaration de comptes en 2006 représentant 35 millions d’euros. Afin de renforcer le caractère dissuasif de l’amende, la loi de finances rectificative pour 2008 en a doublé le montant dans les cas communs, le faisant passer de 750 à 1 500 euros, et l’a porté à 10 000 euros lorsque l’obligation déclarative concerne un État ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires.
L’article 1649 AA du code général des impôts oblige les souscripteurs à déclarer en même temps que leur déclaration de revenus les références du (ou des) contrat(s) d’assurance-vie souscrits auprès d’organismes établis hors de France, les dates d’effet et de durée de ces contrats, ainsi que les avenants – tels que versements complémentaires, arbitrage, changement de clause bénéficiaire – et opérations de remboursement effectués au cours de l’année civile (même si ces dernières sont exonérées d’impôts).
L’article 1766 du code général des impôts prévoit que le non-respect de cette obligation est passible d’une amende égale à 25 % des versements effectués au titre des contrats non déclarés. Toutefois, lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n’a subi aucun préjudice, l’amende est abaissée à 5 % des mêmes sommes dans la limite de 1 500 euros, plafond doublé en loi de finances rectificative pour 2008.
L’article 52 de la loi de finances rectificative pour 2008 prévoit que le délai de reprise de l’administration fiscale est porté à dix ans en cas de non-respect des obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A et 1649 AA du code général des impôts (ainsi qu’aux articles 123 bis et 209 B présenté ci-dessous) lorsque ces obligations concernent un État ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires.
c) Les initiatives complémentaires à développer pour détecter les sommes non déclarées
Pour compléter ces obligations, deux types d’actions peuvent être conduites améliorant la connaissance par l’administration des montages et sommes soustraites à l’impôt : une procédure de régularisation peut être instituée au bénéfice des particuliers, d’une part, les obligations déclaratives peuvent être reportées au niveau du concepteur des montages ou de l’hébergeur, d’autre part.
S’agissant des régularisations, deux méthodes peuvent être employées.
La première, que la mission ne recommande pas, consiste à favoriser la régularisation volontaire en l’accompagnant le cas échéant d’une amnistie fiscale. C’est la voie empruntée par l’Italie, qui vient de lancer pour la troisième fois en huit ans une amnistie fiscale pour le rapatriement, avant le 15 avril 2010, des avoirs détenus illégalement à l’étranger, moyennant une amende libératoire au taux de 5 % (texte d’orientation budgétaire 2010-2014 adopté par le conseil des ministres du 16 juillet 2009). La recette attendue est de 3 à 5 milliards d’euros.
La France a choisi une méthode différente en mettant en place une cellule spécifique le 20 avril dernier. Elle a vocation à régulariser la situation des résidents français qui n’auraient pas déclaré des avoirs détenus à l’étranger. Les sommes en cause n’ont pas à être rapatriées et leur déclaration ne donne pas lieu à amnistie fiscale, mais seulement, selon les cas, à plafonnement des pénalités.
LA CELLULE DE RÉGULARISATION DES AVOIRS NON DÉCLARÉS La direction générale des finances publiques (DGFIP) a créé en avril 2009 une cellule de régularisation pour les contribuables possédant des avoirs non déclarés à l’étranger, qui se démarque des initiatives précédentes. |
Les précédents en matière d’incitation au rapatriement des capitaux
|
Les impôts dus (impôt sur le revenu, ISF et droits de succession), les intérêts de retard et les pénalités restent dus. Toutefois, « les pénalités qui peuvent dans certains cas aller jusqu’à 80 % de la somme due seront appliquées avec raison », a affirmé le ministre du budget. L’intérêt du dispositif pour les contribuables en situation de fraude est de pouvoir régulariser leur situation sans poursuites pénales, sous réserve que l’origine des fonds soit licite. |
Ce nouveau guichet est accessible par courriel (cellule-régularisation@dgfip.finances.gouv.fr) et par téléphone (01 53 18 05 62). Les contribuables s’adressent à la cellule directement ou par l’intermédiaire de conseils. Un mois après son lancement, le guichet avait reçu près de 250 appels téléphoniques et ouvert une cinquantaine de dossiers. Début juillet, la cellule recevrait de plus en plus d’appels, de l’ordre d’une vingtaine par jour. Signé récemment, l’accord franco-suisse du 11 juin en matière d’assistance administrative ne serait pas étranger à cette progression. Même si cet accord n’entrera en vigueur qu’en 2010, il a été clairement annoncé que la cellule de régularisation était provisoire. 90 % des demandes concerneraient ainsi des avoirs détenus en Suisse. Le ministre du budget, lors d’une conférence de presse tenue en mai, distinguait trois groupes de « repentis » fiscaux qui prennent contact avec la cellule : – des personnes qui ont mis, sans la moindre justification, leurs économies à l’abri, en Suisse généralement, et pour lesquels la régularisation sera coûteuse ; – ceux qui ont hérité d’un compte non déclaré ; – les expatriés qui ont « oublié » de déclarer un compte ouvert durant leur séjour à l’étranger. Pour ces derniers, il était évoqué des pénalités allégées, au cas par cas. La majorité d’entre eux laissaient ces sommes qui n’ont jamais été déclarées sans véritablement les faire fructifier. Il s’agit souvent de sommes héritées ou au contraire que des contribuables souhaitent transmettre. Quelques demandes proviennent de personnes souhaitant rapatrier ces sommes pour les employer. Dans l’ensemble, les montants en sont pas négligeables – les sommes en cause dépassent la plupart du temps le million d’euros - mais ne relèvent pas pour autant de fraude à grande échelle. Certains dossiers seraient toutefois plus conséquents. |
L’Irlande, le Royaume-Uni et l’Australie ont opté pour une méthode plus radicale : elles ont obtenu de leurs banques et de certains établissements financiers des listes de détenteurs de comptes offshore ou de titulaires de cartes de crédit offshore, conditions indispensables à la réussite du projet. Les contribuables ont été invités à se faire connaître et à déposer des déclarations rectificatives en contrepartie d’une remise de pénalités et d’une renonciation à poursuites pénales.
ZOOM SUR LE PROJET OFFSHORE IRLANDAIS Le projet offshore mené par l’administration fiscale irlandaise en 2003 et 2004 a eu pour objet de lancer des opérations « coup de poing » afin d’amener les contribuables détenant des comptes dans des banques offshore à régulariser volontairement leur situation auprès de l’administration fiscale sur la base d’un droit de communication élargi et grâce à la mise en place d’un plan opérationnel dédié. Au plan juridique, l’administration fiscale irlandaise dispose depuis 1999 d’un droit de communication (48) auprès des banques particulièrement puissant puisqu’il lui permet de demander des informations relatives à des personnes non identifiées. Ce droit de communication connaît une double limite : il est encadré par le juge et il est limité au territoire irlandais. Il ne s’applique bien entendu pas aux filiales offshore de banques irlandaises. Son efficacité suppose l’existence d’un élément onshore à savoir une transaction opérée à partir ou à destination d’un compte domestique. Il ne permet pas d’identifier les clients ayant retiré des fonds d’une banque irlandaise pour les transporter et les déposer sur un compte d’une filiale offshore. L’administration fiscale a mis en place, parallèlement à l’exercice du droit de communication, un plan opérationnel dédié au projet offshore comprenant une structure spécifique chargée de mettre en œuvre ce projet, une campagne nationale de communication sur la mise en œuvre par l’administration du droit de communication auprès des banques et, enfin, une procédure de régularisation volontaire permettant au contribuable de bénéficier de mesures de bienveillance. Le succès de ce projet est avant tout lié à une approche pragmatique de la problématique offshore par les autorités irlandaises et aux pressions amicales que celles-ci ont été en mesure d’exercer à rencontre des filiales offshore situées sur les îles anglo-normandes. Dans les faits, le Directeur général de l’administration irlandaise a demandé aux banques irlandaises, hors de toute procédure, de donner des instructions à leurs filiales étrangères pour qu’elles écrivent à leurs clients afin de les informer des enquêtes imminentes, ce que ces dernières ont accepté de faire au titre d’une démarche d’ordre commercial consistant à transmettre à leurs clients une information les concernant. 14 000 contribuables se sont manifestés et ont fait des déclarations volontaires auprès de l’administration fiscale irlandaise (la différence s’explique par les détenteurs de comptes offshore qui avaient ouvert directement un compte dans une filiale offshore). L’ensemble des enquêtes offshore menées en 2003 et 2004 a permis de recouvrer 928 millions d’euros au 30 août 2008. 852 millions d’euros ont été recouvrés suite à des procédures de régularisation volontaire. |
Source : Direction générale des finances publiques
Ces expériences vont au-delà des dispositifs anti-blanchiment classiques qui ne permettent d’appréhender la fraude que s’il existe des opérations suspectes. L’ouverture d’un compte dans une filiale offshore n’est pas couverte par ces dispositifs, alors que des opérations transitant par des circuits complexes peuvent l’alimenter. De même, l’administration peut effectuer un droit de communication (article L. 96 du livre des procédures fiscales) auprès des établissements financiers pour obtenir des informations sur les opérations de transfert de capitaux à l’étranger, effectués notamment par les personnes physiques. Encore faut-il que l’administration ait le nom d’un contribuable qui le nécessite et donc la connaissance d’un compte bancaire à l’étranger. Or, le fichier FICOBA ne recense par définition que les comptes détenus dans les banques françaises.
Le report de l’obligation déclarative vers les institutions financières (établissements financiers, compagnies d’assurance) permettrait de renforcer les obligations déclaratives des bénéficiaires effectifs, le cas échéant tout simplement mieux informés. De plus, une simple opération comptable n’est pas une opération suspecte. Or, elle peut masquer des opérations frauduleuses. Ces obligations nouvelles trouveraient mieux encore à s’appliquer dans un cadre international d’échanges d’informations, en obligeant à transmettre les informations concernant l’ensemble des résidents des États parties prenantes à un tel mécanisme.
Des enquêtes conduites par les services douaniers français ont par exemple mis à jour l’existence de placements financiers bénéficiant de l’anonymat à l’étranger réalisés par des résidents français dans le but d’échapper à l’imposition au titre de l’ISF. Afin de garantir l’anonymat des souscripteurs des contrats, les courtiers d’une compagnie d’assurance-vie ont proposé à leurs clients :
– d’encaisser directement les versements en espèce pour le montant des contrats souscrits à l’étranger : en contrepartie, la compagnie d’assurance-vie acquittait elle-même le montant des contrats par des chèques à l’ordre de la société étrangère qui proposait ces contrats, supprimant ainsi toute « traçabilité » des opérations ;
– de financer certains contrats par le produit de la revente de bons de capitalisation ;
– de financer une part importante des contrats par l’endossement irrégulier de chèques tirés sur des compagnies d’assurance, des comptes de notaires, d’avocats ou encore d’autres particuliers et libellés à l’ordre du souscripteur : l’endossabilité limitée du chèque français était tenue en échec par le mécanisme de compensation globale des chèques entre pays.
En l’absence d’une obligation de déclarer les transferts de compte à compte, la découverte de l’existence de ces virements et donc de ces placements, ne peut être qu’incidente. Au cas particulier, c’est le contrôle douanier d’une personne de retour de l’étranger qui avait amené la découverte d’un relevé de compte bancaire à l’origine d’investigations au sein de l’établissement bancaire et chez le courtier ayant proposé le placement. Afin de déceler ce type de fraude, il pourrait être envisagé de soumettre à déclaration les mouvements bancaires de fonds entre la France et un paradis fiscal (transferts financiers réalisés par une banque à destination d’un établissement situé dans un paradis fiscal). D’une certaine façon, il s’agirait de transposer ce qui se fait en matière de lutte contre le blanchiment à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Une telle obligation déclarative paraît toutefois très difficile à mettre en œuvre en termes d’efficacité. Le risque est de recevoir un nombre considérable de déclarations et l’administration ne dispose aujourd’hui pas des moyens administratifs de les traiter. Il convient déjà de voir comment se fera l’extension du champ du soupçon de blanchiment à la fraude fiscale qui pourrait apporter des améliorations sensibles. Les pistes d’élargissement du droit de communication qui seront proposées ci-après semblent également plus pertinentes pour atteindre l’objectif d’information. Si elles ne devaient pas être suivies, une obligation déclarative à titre expérimental ne doit pas être écartée.
→ Instaurer une obligation pour les établissements financiers de déclarer tout mouvement financier, tout compte ouvert, tout produit ou montage en lien avec un territoire non coopératif.
S’agissant des déclarations des schémas d’optimisation fiscale, les pays anglo-saxons se sont dotés de législations améliorant la transparence des pratiques fiscales d’optimisation mises en place par les opérateurs privés. Ces dispositifs ont une double finalité : procurer à l’administration une information sur les pratiques agressives des opérateurs (concepteurs et utilisateurs), mais aussi prévenir l’utilisation des schémas les plus agressifs.
Aux États-Unis, l’obligation de déclarer les montages fiscaux pèse à la fois sur les utilisateurs (particuliers, entreprises) et les promoteurs. Ces derniers doivent également conserver une liste des clients auxquels ils ont vendu des montages, en vue de la présenter à l’administration lorsqu’elle en exprime la demande. Après un premier échec, le dispositif n’a fonctionné qu’après la mise en place de sanctions jugées dissuasives par le secteur privé.
Le Royaume-Uni exige quant à lui des personnes qui élaborent des schémas d’optimisation ou certains produits financiers qu’elles les portent à la connaissance de l’Inland Revenue. Ces promoteurs sont des notaires, des conseils ou des avocats, qui doivent avoir été dégagés du secret professionnel par leur client. Le détail du schéma est à expliciter : type de transaction, conséquences fiscales, dispositions juridiques utilisées. Seules sont concernées les transactions faisant intervenir des opérations de financement ou relatives aux droits de timbres sur les propriétés des non résidents. La recherche d’avantages fiscaux est exigée comme en matière de droits indirects. L’administration enregistre ces schémas et leur attribue un numéro de référence que le contribuable est tenu de mentionner sur ses déclarations par la suite. En cas d’acquisition à l’étranger, il incombe à l’utilisateur de les déclarer. Ce dispositif semble avoir été bien accepté par le secteur privé. Toutefois, l’utilisation de filtres trop généreux pour sélectionner les montages est source de nombreuses déclarations, ce qui réduit l’efficacité du dispositif.
En 2008, le ministre des finances allemand avait envisagé de proposer dans un projet de loi l’instauration d’un dispositif obligeant les conseillers fiscaux, les avocats, les banquiers et les sociétés d’investissement à déclarer les schémas d’optimisation fiscale internationale élaborés pour leurs clients ou leurs mandants. Une telle obligation de déclaration des schémas d’optimisation pourrait être instituée en France. Elle suppose de définir préalablement les montages concernés, et de disposer d’une cellule de traitement pour faire face au flot de déclarations.
→ Créer, pour les professions juridiques et financières, une obligation de déclarer les montages réalisés pour leurs clients en lien avec les paradis fiscaux.
Par ailleurs, un nouveau dispositif spécifiquement américain a été mis en place à compter du 1er janvier 2001, qui repose sur un modèle de « contrat d’intermédiaire » agréé par l’IRS (système des « Qualified Intermediaries » ou intermédiaires qualifiés), régi par la législation des États-unis et qui s’applique de manière uniforme à tout établissement financier américain (si les revenus sont perçus directement par son intermédiaire ou si la banque étrangère n’a pas obtenu son contrat d’agrément) et étranger. Ces nouvelles dispositions font désormais peser sur les banques américaines et étrangères la charge du contrôle de la certification de la résidence à l’étranger des investisseurs, sur la base d’un agrément type accordé par l’IRS et accepté par elles, aux termes duquel elles sont responsables, en tant que « Qualified Intermediaries », du différentiel de retenue à la source qui n’a pas été prélevé du fait de l’application d’une convention fiscale. Les intermédiaires financiers étrangers non agréés ne sont pas dispensés des obligations déclaratives pour pouvoir faire bénéficier leurs clients des exonérations ou allégements de retenue à la source conventionnels, au contraire, celles-ci sont beaucoup plus lourdes pour les établissements non agréés que pour les agréés (49). Si le bénéficiaire des sommes, résident ou non-résident américain, ne souhaite pas révéler son identité, l’établissement financier est tenu d’opérer systématiquement une retenue à la source au taux de 31 %.
Le plan Obama présenté le 4 mai dernier prévoit de coupler l’agrément avec une obligation d’informer l’administration fiscale du résident de l’application de la convention. Si un tel système pouvait être mis en œuvre, on disposerait du schéma anti-fraude idéal, puisqu’il permettrait de contourner les États : ce serait le banquier de tel territoire non coopératif qui transmettrait à l’administration fiscale du bénéficiaire du revenu les informations sur ce revenu.
Il existe en France un dispositif très récent d’agrément conférant la qualité d’établissement payeur pour l’application de la retenue à la source aux banques étrangères qui perçoivent le revenu de France (le dispositif n’est pas ouvert aux établissements qui pourraient se situer plus loin dans la chaîne). Il pourrait être élargi pour mettre en œuvre le système d’intermédiaire qualifié. Cela permettrait par exemple d’obtenir d’un banquier suisse qui verse un revenu à un Français sur un compte l’information relative aux montants encaissés, en échange de l’agrément qui permet à son client de bénéficier de la convention franco-suisse. Il s’agit d’un dispositif extrêmement technique, dont la mise en œuvre, hors volet échange d’informations, a été très lourde aux États-Unis. Il semble toutefois l’un des systèmes les plus efficaces dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale et les travaux sur ce sujet doivent être encouragés, notamment au sein de l’OCDE.
→ Mettre en place un système d’agrément fiscal soumettant les établissements payeurs à l’obligation de :
– s’assurer de l’identité du bénéficiaire effectif des revenus, pour l’application des taux de retenue à la source ;
– transmettre les informations à l’administration fiscale de résidence du bénéficiaire.
Plus généralement, et à l’instar de ce que font nos partenaires anglo-saxons, des campagnes de sensibilisation et d’alerte régulières devraient être réalisées. Au-delà d’une communication générale sur la fraude fiscale, certains États, notamment l’Australie et le Royaume-Uni, ont mis en place des campagnes ciblées sur les paradis fiscaux. S’appuyant sur les vecteurs de communication traditionnels, ils informent l’opinion publique des risques liés aux transactions avec des paradis fiscaux, aussi bien pour l’économie nationale que pour le contribuable. Cette pédagogie publique vise à modifier le comportement des contribuables. L’action sur le civisme des contribuables reste dans ces pays un axe stratégique majeur des administrations fiscales. En France, une telle campagne de communication permettrait de rappeler aux contribuables leurs obligations déclaratives et fiscales et de les informer sur les risques que comportent ces juridictions : intermédiaires peu scrupuleux, sous-réglementation, investissements hasardeux etc. Cela permettrait aussi de valoriser les États de la liste blanche en incitant à l’investissement dans ces pays par rapport à ceux des listes grises ou noires et, a contrario, de stigmatiser les États sous-réglementés et / ou non coopératifs, ainsi que l’ensemble des institutions, particuliers, professionnels et entreprises qui utilisent ces territoires.
→ Programmer des campagnes de communication et d’information sur les risques liés aux transactions avec les paradis fiscaux.
d) Les informations portées à la connaissance de l’administration fiscales par les entreprises
Un effort important a été effectué pour améliorer les relations entre l’administration fiscale et les entreprises. Ces efforts se sont traduits par des contraintes de délais, notamment dans le contrôle, la mise en œuvre de procédures de rescrits, y compris en matière de fiscalité internationale, et la création en 2002 du guichet unique que constitue de la Direction des grandes entreprises.
LA DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES Dépendent de la DGE les entreprises : – dont le chiffre d’affaires ou le total de l’actif brut est au moins égal à 400 millions d’euros y compris les établissements stables d’entreprises n’ayant pas leur siège en France. En revanche, ne relèvent pas de la DGE : les entreprises n’ayant pas leur siège en France mais réalisant des opérations soumises à la TVA et ayant désigné un représentant fiscal en France ; les entreprises ayant fait l’objet d’une décision de mise en liquidation judiciaire avant la date de leur entrée dans le périmètre de la DGE ; – ou qui sont liées directement ou indirectement par un lien descendant ou ascendant à plus de 50 % avec une entreprise qui répond aux critères ci-dessus (y compris les filiales à plus de 50 % des établissements stables d’entreprises n’ayant pas leur siège en France) ; – ou qui bénéficient de l’agrément prévu à l’article 209 quinquies du code général des impôts (bénéfice mondial ou consolidé) ; – ou qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l’article 223 A du code général des impôts (régime de l’intégration fiscale) lorsque celui-ci comprend au moins une entreprise mentionnée ci-dessus, y compris s’il s’agit d’un établissement stable d’une entreprise n’ayant pas son siège en France répondant aux critères de chiffres d’affaires ou d’actif brut visés au premier alinéa. Et sur demande expresse des entreprises auprès de la DGE : – les sociétés en participation (SEP), si elles répondent aux critères d’appartenance à la DGE et si elles sont pérennes ; – les sociétés détenues à 50/50 par des entreprises appartenant au périmètre de la DGE ; – les quartiers généraux. Interlocuteur fiscal unique des grands groupes, la DGE réunit des spécialistes de la fiscalité applicable à ces entreprises et s’appuie largement sur la dématérialisation des échanges d’informations et l’utilisation des nouvelles techniques de communication. Au sein de la DGE, une équipe d’une dizaine de spécialistes de la fiscalité des groupes encadrés par un chef d’équipe assure le suivi intégral des dossiers d’un même groupe, y compris le recouvrement amiable. Les groupes sont répartis en fonction de leur métier dominant. |
La règle de l’opposabilité de la doctrine administrative est énoncée aux articles L. 64 B, L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales. L’article L. 80 A interdit à l’administration d’opérer un redressement quand le contribuable s’est conformé à la doctrine en vigueur au moment où il en a été fait application. Le 1 de l’article L. 80 B institué par la loi « Aicardi » relative à l’amélioration des droits et garanties du contribuable (n° 87-502 du 8 juillet 1987) vise spécifiquement les prises de position de l’administration sur des situations de fait au regard de la loi fiscale en leur étendant la garantie prévue à l’article L. 80 A. Cet article permet ainsi aux contribuables de saisir l’administration des éléments d’un montage juridique qu’ils envisagent ou mettent en œuvre et du régime fiscal qu’ils attendent. L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est donc un instrument de sécurité juridique pour les entreprises et les particuliers. Un mécanisme d’accord tacite a été institué pour certaines catégories de demandes : les procédures d’abus de droit avec accord tacite à l’issue d’un délai de six mois et celles visées aux articles L. 80 B et L. 80 C du livre des procédures fiscales.
Deux rescrits récents, créés par la loi de finances rectificative pour 2004, méritent d’être mentionnés. Le premier concerne l’existence d’un établissement stable. La requalification d’une société française en établissement stable d’une société étrangère permet à l’administration française d’imposer les bénéfices de la société mère à raison des opérations réalisées en France au travers de sa filiale. Désormais, un contribuable peut s’assurer auprès de l’administration qu’il ne dispose pas en France d’un établissement stable ou d’une base fixe au sens de la convention fiscale liant la France à l’État dans lequel ce contribuable est résident. L’administration dispose d’un délai de trois mois pour lui répondre. À défaut, l’accord est réputé tacite. Le second rescrit concerne les prix de transfert. De nombreux redressements concernent des politiques de prix non pertinentes ou contestables par un État. L’administration a mis en place des accords préalables de prix de transfert (APP) par instruction du 7 septembre 1999. L’article 20 de la loi de finances rectificative pour 2004 a donné une portée législative à la procédure permettant aux entreprises multinationales d’obtenir de l’administration fiscale un accord préalable, négocié avec l’autorité compétente étrangère, sur la méthode utilisée pour déterminer les prix de transfert applicables à leurs transactions intragroupe. Cet article a également ouvert la possibilité pour l’administration de conclure un accord unilatéral de prix avec un contribuable, qui n’est donc pas opposable à l’administration d’un autre État (50).
La demande de rescrits augmente de 40 % chaque année, preuve de l’utilité de la procédure.
Si de nombreuses améliorations ont été apportées dans les relations de l’administration avec le contribuable, il est patent que l’effort d’information des entreprises sur leurs activités a peu progressé hors de ces cadres. C’est d’autant plus remarquable que les obligations déclaratives des personnes physiques ont encore été récemment renforcées. Pour que le droit fiscal s’applique le plus justement possible et que le contrôle soit le plus efficace possible, c’est-à-dire permette de sanctionner des comportements frauduleux et de recouvrer des sommes ayant abusivement échappé à l’impôt, il faut pouvoir distinguer les opérations et entreprises qui appellent une action de contrôle, de celles qui se soumettent de bonne foi à ce qu’elles pensent être leurs obligations fiscales. C’est donc aux fins de détection et de contrôle, mais aussi dans l’intérêt des contribuables, de porter à la connaissance de l’administration fiscale un certain nombre d’éléments relatifs aux activités conduites. Lorsqu’il s’agit de schémas complexes susceptibles d’entrer dans le champ du contrôle fiscal international, une obligation de documentation et de déclaration est lourde pour les entreprises. C’est pourquoi tant les entreprises concernées que la nature et la précision des informations doivent être définis avec soin.
En tout état de cause, une obligation de documentation des activités et opérations des grandes entreprises mettant en cause des paradis fiscaux devrait être instituée, à l’image de ce qui est en train de se dessiner dans le secteur bancaire. Sur le plan fiscal, une telle obligation devrait prendre la forme d’une documentation très détaillée des prix de transfert pratiqués. Il est à noter qu’un projet de déclaration des prix de transfert existe : l’administration fiscale a proposé en 2008 aux associations représentatives des entreprises un projet d’article (L. 13AA du livre des procédures fiscales) relatif aux obligations déclaratives. Les PME étaient exclues de ce projet.
Conformément aux conclusions du Forum Conjoint sur les Prix de Transfert et au code de conduite de la Commission européenne, la documentation qui devait être fournie, sur demande, dans un délai de 30 jours, serait constituée d’une information générale (description générale du groupe, un aperçu de la stratégie commerciale, la nature des transactions intragroupe et la politique de prix de transfert etc.) et de documentations spécifiques par filiales (description des principales transactions intragroupe qui affectent la filiale, et pour chaque transaction une analyse fonctionnelle, un exposé sur le choix de la méthode qui en découle, les analyses de comparables utilisés etc.) (51). Ce projet, qui concrétise des travaux européens ayant donné lieu à des obligations similaires dans d’autres États membres, devrait pouvoir être adopté en vue d’une application en 2010, au moins dans un premier temps pour les entreprises relevant de la Direction des grandes entreprises.
→ Instaurer une obligation de déclaration systématique des prix de transfert pratiqués par les entreprises.
3.– Les limites aux avantages fiscaux
a) L’article 238 A du code général des impôts : la déductibilité des charges, redevances, concessions etc.
Les sommes payées ou dues par une personne physique ou morale, établie en France, au profit de personnes physiques ou morales domiciliées ou établies dans un État où elles bénéficient d’une fiscalité privilégiée, ainsi que les versements réalisés sur un compte bancaire tenu par un organisme financier établi dans un État ou un territoire à fiscalité privilégiée ne sont admises en charges déductibles qu’à la condition pour le débiteur de prouver que les dépenses correspondent à des opérations réelles et ne présentent un caractère ni anormal ni exagéré. L’application de l’article 238 A conduit à un renversement de la charge de la preuve qui incombe, dès lors, au contribuable. Mais en cas de contestation, l’administration doit justifier de l’existence d’un régime fiscal privilégié hors de France.
D’autres États du sud de l’Europe (Italie, Espagne et Portugal) ont un dispositif de même nature. Ainsi l’Italie refuse la déduction des paiements effectués au profit d’entités non implantées dans des États figurant sur une « liste blanche ». Toutefois ces déductions sont autorisées si la société non résidente exerce réellement une activité industrielle ou commerciale ou si les transactions effectuées ont un caractère industriel ou commercial. En Espagne et au Portugal, les déductions des paiements effectués au profit de sociétés résidentes de certains États sont présumées contestables.
L’article 238 A a vocation à s’appliquer :
– aux personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés,
– aux personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu lorsque la déduction de certaines dépenses est prévue,
– en cas de détermination du passif successoral déductible.
S’agissant des dépenses, l’article 238 A concerne les charges financières, les redevances de cession et de concession de licence d’exploitation de brevets, de marques et de droits analogues, enfin, les rémunérations de services.
L’article 238 A vise les sommes payées ou dues à des personnes domiciliées ou établies dans un territoire dans lequel elles bénéficient d’une fiscalité privilégiée, ainsi que les versements réalisés sur un compte bancaire tenu par un organisme financier établi dans un paradis fiscal. S’agissant de la notion de pays ou territoire à fiscalité privilégiée, l’administration fiscale procède à une comparaison entre l’assujettissement à l’impôt du bénéficiaire dans son pays d’établissement ou domicile et l’imposition à laquelle il aurait été soumis selon les règles françaises du code général des impôts. Les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’État ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. Antérieurement à la loi de finances pour 2005, une personne était réputée soumise à un régime fiscal privilégié dans le territoire considéré lorsqu’elle n’y est pas imposable ou lorsqu’elle y est assujettie à des impôts sur les bénéfices ou sur les revenus notablement moins élevés qu’en France. À titre de règle pratique, l’administration fiscale présumait qu’on se trouvait en présence d’un régime fiscal privilégié lorsque le bénéficiaire était redevable d’un impôt inférieur d’au moins un tiers à celui qu’il aurait à supporter en France. Cet écart d’un tiers était problématique dès lors que dans un certain nombre de situations, la France aurait à son tour été considérée comme le paradis fiscal de ses partenaires.
b) L’article 212 du code général des impôts : la lutte contre la sous-capitalisation
L’article 113 de la loi de finances initiale pour 2006 a modifié en profondeur le régime de lutte contre la sous-capitalisation prévu à l’article 212 du code général des impôts, consistant à réintégrer le montant des intérêts d’emprunts dans le résultat imposable des sociétés sous-capitalisées qui les servent au-delà d’une limite de taux et d’une limite de montant. L’article 212 vise l’intégralité des emprunts auprès de sociétés liées pouvant donner lieu à une sous-capitalisation excessive d’une société imposable en France, sous réserve de certaines exclusions expresses (montants non significatifs, établissements de crédit, opérations de financement réalisées au titre d’une convention de gestion centralisée de trésorerie et certaines opérations de crédit-bail).
Il s’agit de la limite des taux d’intérêt versés aux sommes mises à la disposition par les associés, fixée à l’article 39-1-3° du code général des impôts, ou du taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements financiers indépendants dans des conditions analogues. La limite de montant des intérêts servis à l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement est quant à elle définie par référence à trois limites cumulatives : une limite d’endettement global basée sur le ratio d’une fois et demie le montant des capitaux propres, une limite de couverture d’intérêts correspondant à 25 % du résultat courant avant impôts, majoré de certains éléments, et une limite correspondant aux intérêts reçus des sociétés liées.
Le dépassement de la limite de montant se traduit par un différé d’imputation de la fraction excédentaire, le régime défini pour les déficits étant transposé à ces intérêts différés. La déduction au titre des exercices ultérieurs est conditionnée par une recapitalisation et le respect de la limite de couverture d’intérêts. À compter de l’exercice N+2, une décote de 5 % est appliquée. Le sort des intérêts non déduits par une société membre d’un groupe fiscal est aménagé pour prendre en compte la remontée dans les résultats de la société tête de groupe. Les intérêts demeurent déductibles si l’entreprise apporte la preuve que le ratio d’endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal au sien.
La plupart des États européens ont mis en place des dispositifs comparables de lutte contre la sous-capitalisation qui visent à limiter la déductibilité des intérêts servis aux associés et aux entreprises liées. Des réformes récentes ont, en Allemagne, en Italie et au Danemark, visé à simplifier les règles de sous-capitalisation et à introduire un plafond de déductibilité des intérêts. En Allemagne, à compter du 1er janvier 2008, les règles de sous-capitalisation ont été remplacées par un dispositif visant à introduire un plafond général de déductibilité des intérêts quelle que soit leur origine tant pour les sociétés de personnes que pour les sociétés de capitaux. S’inspirant de l’Allemagne, l’Italie a voté en 2008 le remplacement des règles de sous-capitalisation par un dispositif de plafonnement de la déductibilité des intérêts nets quelle que soit leur origine.
Pour renforcer encore le dispositif de sous-capitalisation français, deux voies peuvent être empruntées : d’une part, prévoir l’impossibilité de déduire les intérêts versés à une société établie dans une juridiction non coopérative, sans considération du taux et du montant ; d’autre part introduire un plafond général qui permet de limiter toute stratégie de sous-capitalisation. Les avantages et les inconvénients de ces réformes sont difficiles à évaluer, notamment sur l’attractivité du territoire français comme lieu d’implantation du siège.
→ Restreindre le champ de la déductibilité, pour une entreprise, des intérêts servis aux associés et aux entreprises liées qui opèrent dans un territoire non coopératif.
c) La fiscalité des sommes versées à des personnes établies dans les paradis fiscaux
Il convient d’indiquer au préalable que les modalités d’imposition ne sont pas toujours identiques selon la provenance ou la destination des sommes en cause mais font référence bien souvent à l’existence ou non de conventions fiscales ou d’assistance administrative. En premier lieu, les taux de retenue à la source prévus au code général des impôts, qui ne s’appliquent qu’en l’absence de conventions fiscales, sont élevés : 25 % ou 33,33 % sur les revenus bruts (et non nets). Une augmentation demeure toujours possible bien entendu.
De plus, certains avantages fiscaux sont bien subordonnés à la provenance des revenus et ce type de mesures est très efficace. Lors de la réforme de l’avoir fiscal, il a été prévu qu’à compter du 1er janvier 2009, l’abattement de 40 % sur les dividendes ne s’appliquerait plus pour les revenus distribués par des sociétés établies dans un État ou territoire ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. Les renégociations conventionnelles en cours n’y sont pas étrangères. La mention de l’accès aux renseignements bancaires doit être ajoutée.
Plus globalement, la plupart des avantages sont réservés aux revenus provenant d’États de la Communauté européenne et de l’Espace économique européen (EEE), hors Liechtenstein. C’est le cas des dispositifs du plan d’épargne en actions (PEA), des réductions d’impôt pour investissements et de l’assurance-vie. L’abattement annuel de 4 600 euros pour les personnes seules et de 9 200 euros pour les couples mariés ou pacsés sur les revenus de capitaux mobiliers est réservé aux produits attachés à des bons ou contrats souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies hors de France dans un État membre de la Communauté européenne, ou partie à l’accord sur l’EEE, hors Liechtenstein (article 122 du code général des impôts).
Pour autant, il serait aussi possible d’introduire des discriminations plus fortes en majorant certaines impositions ou en refusant l’application de certaines modalités de détermination de l’impôt.
Parmi les majorations envisageables, figure la remise en cause de l’exonération des dividendes versés par les filiales aux maisons mères, sous réserve d’assurer l’euro-compatibilité du dispositif. Cette question se posera d’ailleurs pour le régime de l’intégration fiscale, qui aujourd’hui ne permet la consolidation que des résultats des sociétés françaises (52).
LE RÉGIME DES SOCIÉTÉS MÈRES ET FILIALES
Codifié aux articles 145, 146 et 216 du code général des impôts, le régime des sociétés mères et filiales est le dispositif le plus ancien applicable aux groupes de sociétés. Ce régime, sur option, vise à permettre le retranchement du bénéfice net total de la société mère imposée en France des produits nets de ses filiales, où qu’elles soient établies, défalcation faite d’une quote-part de frais et charge. Le montant de cette quote-part a été augmenté de 2,5 % à 5 % du produit total des participations par l’article 20 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).
Une société peut prétendre à la qualité de société mère d’une autre société, et donc à l’exercice de l’option, lorsque le taux de participation qu’elle détient est au moins égal à 5 % ou, pour certains groupes bancaires mutualistes (caisses régionales de crédit agricole, caisses locales de crédit mutuel, caisses d’épargne et de prévoyance, banque populaire), lorsqu’elle atteint le seuil de 22,8 millions d’euros (53). L’autre société est alors considérée comme filiale de la première. Cette condition s’apprécie à la date de mise en paiement des dividendes. Le régime spécial est applicable à toute personne morale ou organisme, quelle que soit sa nationalité, soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal. Ouvrent droit à l’imputation sur le bénéfice net, les produits de titres comportant à la fois un droit de vote et un droit à dividende, souscrits ou attribués à l’émission ou encore, et conservés pendant deux ans. Les produits concernés sont, bien évidemment, les dividendes, mais aussi tous les autres produits nets. Peuvent être cités : les boni de liquidation, les distributions de réserve, les avances, prêts ou acomptes consentis aux associés lorsque les sommes sont considérées comme des sommes distribuées, les intérêts excédentaires versés à la société mère et réintégrés dans le bénéfice imposable de la filiale. Les produits des titres sans droit de vote sont éligibles lorsque la société détient par ailleurs des titres émis par cette même société représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote et à ce titre éligibles au régime. Ne peuvent en revanche donner lieu à retranchement les jetons de présence ou les produits des obligations. Sont également exclus les revenus occultes, ainsi que les revenus réputés distribués qui apparaissent lors de vérifications de comptabilité (avantages à des dirigeants ou à des tiers, tels que l’achat à un prix minoré ou majoré de titres).
Parmi les modalités de détermination de l’impôt qui pourraient être conditionnées à l’existence d’échanges d’informations avec le pays de provenance ou de destination des sommes, figure la déduction des charges et intérêts de toute nature. Il pourrait être considéré qu’aucune règle favorable ne s’applique en présence de flux avec un paradis fiscal, sans préjudice de l’application des dispositifs anti-abus.
Qu’il s’agisse de majoration ou de limitation, les territoires concernés devraient être ceux avec lesquels il n’existe pas de convention d’assistance administrative permettant l’accès aux renseignements bancaires ou qui offrent un régime fiscal privilégié. Deux options sont ouvertes : une exclusion systématique ou une application conditionnée. Dans ce dernier cas, le contribuable devrait apporter la preuve que l’opération ou le transfert n’a pas pour but essentiel d’échapper à l’impôt et accepter de se soumettre à des obligations fortes de transparence, incluant le contrôle sur pièces et sur place par le régulateur, le superviseur et/ou l’administration fiscale. Ceci permettrait par exemple un contrôle de comptabilité, un accès l’information sur la nature et les montant des sommes en cause, ou encore la vérification de la réalité des opérations.
→ En présence de flux en provenance ou à destination de territoires non coopératifs, exclure l’application des règles fiscales favorables ou majorer les taux d’imposition.
Enfin, pour les États avec lesquels il existe une convention d’élimination des doubles impositions (et pas uniquement d’échanges d’information), l’ensemble des dispositions conventionnelles favorables (retenue à la source, exonérations, crédits d’impôts etc.) ne devrait être appliqué qu’à la condition que l’accès aux renseignements bancaires soit effectif. En d’autres termes, la mise à jour de la liste blanche des États coopératifs devrait avoir pour effet de ne pas se priver de la possibilité de dénoncer les conventions fiscales en vigueur, tout en ayant conscience des conséquences lourdes d’une telle décision.
→ Dénoncer les conventions fiscales d’élimination des doubles impositions conclues avec les États qui ne coopèrent pas ou coopèrent insuffisamment en matière d’assistance administrative sur les questions fiscales.
4.– L’imposition des revenus ou actifs localisés hors de France et la présomption d’évasion fiscale
a) L’article 57 du code général des impôts : les prix de transfert
L’article 57 du code général des impôts vise la fixation des prix de transfert. Il consiste à intégrer, pour le paiement de l’impôt dû par les entreprises, les bénéfices transférés par des entreprises par majoration ou diminution du prix d’achat ou de vente ou par tout autre moyen :
– aux entreprises situées hors de France qu’elles contrôlent,
– aux entreprises situées hors de France dont elles dépendent,
– à une entreprise ou un groupe dont elles dépendent et qui possède également le contrôle d’entreprises situées hors de France,
– aux entreprises établies dans un État ou un territoire dont le régime fiscal est privilégié.
L’article 57 fait expressément référence à la majoration ou la diminution des prix d’achat ou de vente. Il inclut néanmoins les autres moyens de procéder au transfert indirect de bénéfices. Peuvent être cités le versement de redevances disproportionnées ou injustifiées, l’octroi de prêt à des conditions de taux d’intérêt très avantageuses, la renonciation au paiement des intérêts de prêt, l’attribution d’un avantage sans proportion avec le service, les transactions sur immobilisations faites pour un prix inférieur à la valeur vénale.
Les notions de contrôle et dépendance pour la procédure de contrôle et le redressement des prix de transfert entre entreprises apparentées ne sont pas définies par l’article et la dépendance peut dès lors être juridique ou simplement de fait. Lorsque les biens ou services facturés le sont par ou à une société établie dans un pays ou territoire à fiscalité privilégiée, le lien de dépendance ou de contrôle n’a pas à être démontré par l’administration. Compte tenu du secret généralement maintenu par les sociétés établies sur ces territoires, la preuve eût été bien difficile à apporter.
La loi du 12 avril 1996 a institué une procédure, décrite à l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales, autorisant l’administration, lorsqu’elle dispose d’éléments dans le cadre d’une vérification de comptabilité lui permettant d’engager la mise en œuvre de l’article 57 (existence de liens de dépendance ou de contrôle ou présence d’un régime fiscal privilégié), à demander aux contribuables des informations et documents portant sur : la nature des relations entre les entreprises, la méthode de détermination des prix de transfert, les activités exercées, le traitement fiscal des opérations de transfert. L’existence d’un avantage fait présumer le transfert de bénéfices. Le contribuable peut néanmoins prouver que l’avantage ne s’est pas traduit par un transfert de bénéfices mais qu’il a répondu à des nécessités commerciales, à une aide à une filiale en difficulté, à une rémunération pour usage de marques nouvelles à un prix non excessif, etc.
À défaut de réponse à une demande d’informations et documents sur le fondement de l’article L. 13 B, les bases d’imposition concernées sont évaluées par l’administration à partir des éléments dont elle dispose et suivant une procédure contradictoire. En outre, l’article 1740 nonies du code général des impôts prévoit une amende de 7 500 euros par exercice visé par la demande, auxquels s’ajoutent les amendes, majorations et intérêts de retard de droit commun. Hors ce cas, le montant des produits imposables est déterminé, soit par incorporation des bénéfices transférés, soit, à défaut d’éléments précis, par comparaison avec les produits imposables des entreprises similaires exploitées normalement. Enfin, l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, relatif à la procédure de répression des abus de droit (54), permet à l’administration de requalifier une opération conclue sous la forme d’un contrat ou d’une convention contenant des clauses dissimulant leur portée véritable qui peut être la réalisation ou le transfert de bénéfices ou de revenus.
Toutefois, l’article 57 du code général des impôts n’établit pas une présomption de transfert, la charge de la preuve étant laissée à l’administration, pour la qualité de régime fiscal privilégié et la pratique de prix de transfert anormaux. Un renversement de la charge de la preuve pourrait être institué en présence de territoires non coopératifs. L’entreprise devrait alors démontrer que les prix pratiqués répondent aux principes OCDE. Cette modification serait envisageable en l’absence de déclaration systématique des prix de transfert.
→ Instaurer une présomption de transferts de revenus dès lors qu’une contrepartie est établie dans un territoire non coopératif, à charge pour l’entreprise de démontrer, comptes à l’appui, que l’implantation est effective et que les prix pratiqués sont des prix de pleine concurrence.
b) Le dispositif anti-abus prévu par l’article 209 B du code général des impôts
La France dispose d’un dispositif anti-abus avec l’article 209 B du code général des impôts qui vise à taxer les bénéfices réalisés par des filiales situées dans des pays à fiscalité privilégiée. Des dispositifs équivalents se retrouvent dans d’autres États européens comme l’Allemagne, le Danemark, l’Espagne, l’Italie, le Portugal, le Royaume Uni, mais aussi aux les États-Unis.
L’article 104 de la loi de finances initiale pour 2005 a réformé l’article 209 B du code général des impôts permettant l’imposition des bénéfices provenant d’entités établies dans un pays à régime fiscal privilégié, afin d’en garantir la comptabilité avec le droit conventionnel et communautaire et d’en assurer une meilleure efficacité au moyen d’un dispositif ciblé sur les cas caractérisés d’évasion et de fraude fiscale. Désormais, les bénéfices ou revenus positifs d’une entreprise ou d’une entité juridique établie ou constituée hors de France et bénéficiant d’un régime fiscal privilégié sont imposables à l’impôt sur les sociétés dû par une personne morale établie en France, dès lors que celle-ci détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité. Ce seuil est abaissé à 5 % lorsque 50 % des titres sont détenus par des entreprises établies en France qui agissent de concert ou par des entreprises placées directement ou indirectement dans une situation de contrôle ou de dépendance.
Il existe une présomption d’inapplicabilité pour les bénéfices provenant d’une activité industrielle ou commerciale effective. Toutefois, cette présomption ne vaut pas si les bénéfices ou revenus positifs de l’entité proviennent pour plus d’un cinquième, soit de la gestion, du maintien ou de l’accroissement de titres, participations, créances ou actifs analogues pour son propre compte ou pour celui d’entreprises appartenant à un groupe avec lequel la personne morale entretient des relations de contrôle ou de dépendance, soit de la cession ou de la concession de droits incorporels relatifs à la propriété industrielle, littéraire ou artistique. Il en est de même si les bénéfices proviennent pour plus de moitié de ces opérations et de prestations de service intragroupe. Néanmoins, la personne morale française peut apporter la preuve que les opérations de l’entité hors de France ont un effet principalement autre que la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle bénéficie d’un régime fiscal privilégié.
S’agissant de la comptabilité avec le droit conventionnel, les revenus appréhendés sont réputés constituer des bénéfices dans le cas d’une entreprise, des revenus de capitaux mobiliers dans le cas d’entités juridiques autres. S’agissant de l’eurocompatibilité, l’imposition à l’impôt français des bénéfices ou revenus positifs des entreprises ou entités juridiques est exclue lorsque ces dernières sont établies ou constituées dans un État de la Communauté européenne et que l’exploitation ou la participation ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.
S’agissant des obligations déclaratives, au titre de la première période d’imposition, la personne morale établit un bilan de départ pour chaque entreprise ou entité juridique concernée, en retenant la valeur nette comptable des éléments au regard de la législation qui leur était applicable à la date d’ouverture de la première période d’imposition. Les bénéfices ou revenus positifs sont convertis au taux de change en vigueur à la clôture de l’exercice. Les dividendes et produits de participation reçus sont retracés dans un compte séparé pour chaque entité juridique faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices ou revenus positifs soumis à l’impôt sur les sociétés et les distributions reçues de cette entité postérieurement à la première application de l’article 209 B.
Par ailleurs, le nouvel article 209 B ne prévoit plus une imposition séparée mais autorise donc la consolidation des bénéfices ou revenus positifs. Ces modifications n’étaient pas exceptionnellement favorables pour les personnes morales concernées : les dispositions dont l’application n’est plus exclue depuis 2006 énoncent des conditions strictes pour leur application et la consolidation ne peut concerner les pertes réalisées à l’étranger. Seules les dispositions de l’article 223 A (régime de l’intégration fiscale) demeurent inapplicables, étant totalement incompatibles. La France était avant la réforme le seul pays à prévoir l’imposition séparée, modalité d’imposition qui n’a pas de sens lorsqu’il s’agit de revenus de capitaux mobiliers (entités juridiques autres qu’entreprises).
L’article 52 de la loi de finances rectificative pour 2008 prévoit que le délai de reprise de l’administration fiscale est porté à dix ans en cas de non-respect des obligations déclaratives relatives à l’article 209 B.
Sur cet article, dont la réforme n’avait vraiment pas été simple, deux types de difficultés se posent. D’une part, le territoire communautaire est en pratique exclu du champ. La possibilité de démontrer l’existence d’un montage artificiel est très réduite. Or de nombreux contrôles concernaient en réalité le territoire européen. D’autre part, la rédaction même du dispositif prive les équipes du contrôle fiscal de leurs moyens lorsque la clause de sauvegarde est invoquée. Dans ce cas de figure, c’est à l’administration de démontrer qu’il n’y a pas d’activité industrielle ou commerciale effective à l’origine des revenus ou bénéfices. De plus, si la charge de la preuve incombe à la société lorsque les seuils de revenus passifs ou prestations intragroupe définis par le dispositif sont franchis, l’administration doit démontrer que ces derniers sont franchis, ce qui s’avère en pratique difficile.
Les résultats du contrôle sur la base du nouvel article ne sont pas connus. L’ancien texte a été appliqué à douze reprises en 2008 pour une base imposable de 75 millions d’euros, dont 75 % proviennent de deux dossiers qui concernent Hongkong et Jersey. La question des opérations financières intragroupe est donc importante. En pratique, ce texte a été exclusivement appliqué à des sociétés contrôlant une entité établie dans un paradis fiscal : Suisse (4 affaires), Luxembourg, Hongkong, Jersey, Îles Caïman, Bahamas et Guernesey. Il permettait donc dans un petit nombre de cas de sanctionner des schémas relativement simples. Il ne faudrait pas parvenir à un résultat plus faible encore ou mobiliser des moyens humains excessifs pour démontrer l’application du dispositif.
Par conséquent, il semble utile d’améliorer la capacité de contrôle de l’administration :
– soit en inversant la charge de la preuve de telle façon qu’en présence de territoires non coopératifs et dans ce seul cas, la société française soit automatiquement soumise à l’article 209 B sauf à ce qu’elle démontre que l’entité qu’elle contrôle exerce une activité industrielle et commerciale effective, que la proportion de revenus passifs et prestations intragroupe est inférieure aux seuils de 50 % et 20 % précités ou qu’elle est justifiée par l’activité déployée ;
– soit en obligeant à la communication des comptes de l’entreprise ou entité établie à l’étranger, ce qui permettrait à l’administration de vérifier l’exercice effectif d’une activité industrielle et le respect des seuils.
→ Renforcer le dispositif de taxation des bénéfices réalisés dans un pays à fiscalité privilégiée, par un renversement de la charge de la preuve ou une obligation de communication des comptes.
c) L’article 123 bis du code général des impôts pour les personnes physiques
Créé par la loi de finances pour 1999, il institue le principe de l’imposition en France des revenus acquis à une personne physique au titre de ses droits sur les bénéfices ou les résultats non distribués par des entités juridiques établies dans un État ou un territoire où elles bénéficient d’un régime fiscal privilégié. Sont visées par l’article 123 bis du CGI les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui détiennent, directement ou indirectement, 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une structure établie ou constituée hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens retenu par l’article 238 A du CGI. Ces dispositions ne sont susceptibles de s’appliquer que lorsque l’actif ou les biens de ces entités sont principalement constitués de valeurs mobilières ou d’actifs financiers.
En application de l’article 123 bis du CGI, le résultat bénéficiaire ou les revenus positifs de la personne morale sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique résidente de France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement. Le montant du revenu de capitaux mobiliers de la personne physique est déterminé par application aux résultats imposables retraités de l’entité du pourcentage des droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une chaîne de participation dans cette structure. Ce revenu doit figurer dans la déclaration d’ensemble après déduction éventuelle de l’impôt étranger. La personne physique est également assujettie au titre du revenu de capitaux mobiliers en cause aux prélèvements sociaux.
L’article 52 de la loi de finances rectificative pour 2008 prévoit que le délai de reprise de l’administration fiscale est porté à dix ans en cas de non-respect des obligations déclaratives de l’article 123 bis.
Cet article, comme à l’époque l’article 209 B, devra être réformé pour garantir sa compatibilité avec la jurisprudence communautaire. C’est ce qui explique qu’il n’ait été utilisé qu’à deux reprises en 2008 pour un montant en base de 93 000 euros. Il a été récemment déclaré incompatible avec le droit communautaire par une décision de la Cour Administrative d’Appel de Nancy. À cette occasion, il semble que la définition des entités puisse être améliorée pour garantir l’application de l’article à certains véhicules d’investissement de type trusts.
d) L’article 155 A du code général des impôts
Cet article prévoit que les sommes perçues par une personne physique ou morale domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables en France au nom de ces dernières :
– lorsque celles-ci contrôlent, directement ou indirectement, la personne qui perçoit la rémunération des services ;
– ou lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services ;
– ou, en tout état de cause, lorsque la personne qui reçoit la rémunération est domiciliée ou établie dans un pays étranger où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts.
L’imposition est établie par l’administration dans la catégorie de revenus correspondant à l’activité exercée ou au titre de l’impôt sur les sociétés si le contribuable relève de cet impôt. La personne qui perçoit la rémunération est solidairement responsable, à hauteur de cette rémunération, du paiement de l’imposition. Cet article vise à sanctionner l’évasion fiscale réalisée par des personnes qui font facturer leurs prestations par des sociétés écrans étrangères qu’elles contrôlent. Cette pratique a cours dans les milieux artistiques et sportifs, notamment pour facturer les droits à l’image ou des galas. Ce dispositif a été mis en œuvre à 26 reprises pour des rehaussements de revenus ou de bénéfices d’un montant de 12 millions d’euros en 2008.
Ce dispositif sort renforcé d’un arrêt récent « Aznavour » du Conseil d’État, datant du 28 mars 2008, sur le principe de subsidiarité des conventions fiscales. L’affaire était la suivante : Charles Aznavour a fait une prestation en France, rémunérée par l’intermédiaire d’une société qu’il détient en Grande-Bretagne. Il est lui-même résident fiscal en Suisse. Si l’on applique la convention fiscale entre la France et la Grande-Bretagne, le montant en jeu (400 000 francs) est imposable exclusivement en Grande-Bretagne. Or, l’article 155A du code général des impôts permet l’imposition du prestataire indépendamment de la personne morale interposée – en l’occurrence un résident fiscal suisse. La convention fiscale avec la Suisse permet cette imposition en France. Le Conseil d’État a estimé qu’il convenait de se référer à la qualification donnée par la loi française à une catégorie de revenus pour déterminer si la convention fiscale invoquée fait obstacle à l’imposition de ce revenu en France. La France ayant une disposition qui permet d’imposer directement le bénéficiaire effectif suisse, la convention franco-suisse est appliquée et il est donc possible de taxer. D’une certaine façon, la disposition interne fait échec à l’application d’une convention (la convention franco-britannique). Depuis, la jurisprudence Chesnel du 11 avril 2008 prévoit que le principe de subsidiarité s’applique même lorsque la convention donne sa propre définition des revenus sans renvoyer au droit interne.
Si les sociétés écrans sont généralement basées dans des territoires assurant un certain anonymat, ce dispositif doit rester de portée générale pour appréhender toutes les dissimulations, y compris par le truchement de sociétés françaises.
e) La taxe de 3 % prévue à l’article 990 D du code général des impôts
La taxe dite de 3 % prévue par l’article 990 D du code général des impôts permet de lutter contre les schémas de fraude et d’évasion fiscale en dissuadant l’acquisition d’immeubles en France via des sociétés constituées dans des États qui garantissent l’anonymat des actionnaires, permettant à ces derniers d’échapper à l’impôt sur la fortune, l’impôt sur les successions ou encore l’impôt sur les plus-values. Cet article a été réformé et renforcé par l’article 20 de la loi de finances rectificative pour 2007. D’une part, est désormais prévu l’assujettissement des entités, y compris sans personnalité morale, possédant des immeubles ou droits réels immobiliers, quels que soient, le cas échéant, la chaîne de participation et le nombre d’entités interposées. D’autre part, la plupart des exonérations sont soumises à la condition que l’entité soit située dans un État membre de l’Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou dans un État ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France. Sont ainsi exonérées :
– les entités pour lesquelles la valeur vénale du ou des immeubles situés en France ou des droits réels sur ces biens est inférieure à 5 % de la valeur de leurs actifs immobiliers ou à 100 000 euros (exonération nouvelle) ;
– les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, ainsi que, ce qui est nouveau, les fonds de placement immobilier ;
– l’ensemble des institutions et non uniquement les caisses de retraite qui gèrent et administrent les régimes de sécurité sociale, les retraites professionnelles et individuelles ;
– l’ensemble des entités reconnues d’utilité publique ou dont la gestion est désintéressée, et dont l’activité ou le financement justifie la propriété des immeubles ;
– les entités autres qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l’engagement de communiquer à l’administration sur demande les renseignements concernant l’identité des actionnaires, associés ou autres membres, dont la participation est supérieure à 1 % ;
– à proportion des actionnaires dont elles ont connaissance, les entités qui déclarent chaque année les renseignements concernant cet actionnariat (exonération partielle nouvelle).
Concernant les exonérations conditionnées à la situation du siège, l’instruction du 7 août 2008 précise que les entités de type trust, fiducie et fonds d’investissement sont réputées être établies dans l’État ou le territoire de la loi à laquelle ils sont soumis. Elle produit en annexe la liste des pays ou territoires ayant conclu au 1er janvier 2008 une convention fiscale comportant une clause d’assistance administrative ou un accord particulier permettant l’échange de renseignements. Toutefois, pour les entités juridiques dépourvues de personnalité morale, il convient de vérifier qu’elles sont bien visées par la convention et à défaut que la clause d’échange de renseignements ne se limite pas aux seules entités visées. Par ailleurs, bien que la Suisse ne figure pas dans la liste, les personnes morales qui y sont établies peuvent bénéficier des exonérations par application du droit conventionnel. L’instruction contient également en annexe la liste des États ou territoires avec lesquels la France a conclu un traité contenant une clause de non discrimination. Les entités doivent alors pouvoir justifier qu’elles sont résidentes de ces États ou territoires, sauf mention contraire des traités.
Outre l’application de la taxe de 3 %, les trusts n’échappent ni à l’imposition des revenus, ni à l’imposition du patrimoine. L’article 120-9 du CGI assimile à des revenus de valeurs mobilières émises hors de France les produits des trusts, quelle que soit la consistance des biens composant ces trusts. En matière successorale, l’administration considère le trust comme une libéralité familiale et les bénéficiaires comme des propriétaires (BODGI 7-G-14-70). S’il s’agit d’un trust révocable ou encore d’un trust testamentaire, dans la mesure où le dépouillement du constituant n’est pas définitif de son vivant et ne le devient qu’à son décès, le corpus du trust doit être soumis aux droits de succession selon le degré de parenté entre le constituant et le bénéficiaire pour sa valeur au jour du décès. S’il s’agit d’un trust irrévocable, la situation peut être plus complexe. Soit l’on considère que le transfert au profit du bénéficiaire ne s’est pas opéré, l’acte est alors enregistré au droit fixe des actes innommés, aucun droit ne pouvant toutefois être exigé au jour du décès du constituant, le corpus du trust étant définitivement sorti de son patrimoine. Soit à l’inverse, et suivant en cela la règle anglo-saxonne, il est établi que le transfert au profit du bénéficiaire s’opère immédiatement par le biais de la « propriété équitable », alors le trust doit être soumis aux droits de donation entre vifs au jour de sa constitution (avec bien entendu application des abattements et réductions en vigueur).
Une jurisprudence de 2005 confirme la définition selon laquelle un trust irrévocable est une donation indirecte imposable en France. « Le défunt, domicilié en France au moment du décès, avait constitué un trust aux États-Unis selon la loi américaine, par apport de biens situés dans ce pays. Ce trust était devenu irrévocable et prévoyait la remise des biens en cas de décès du constituant à ses descendants ou à des bénéficiaires désignés par testament. Jugé que le constituant a bloqué un capital pour en percevoir les revenus sa vie durant tout en chargeant irrévocablement les fiduciaires de le remettre après sa mort aux bénéficiaires désignés par lui à cette date. Cet engagement comporte une intention libérale en faveur des bénéficiaires. Ces dispositions caractérisent une donation indirecte en leur faveur prenant effet au décès du constituant ». Cette donation indirecte est taxable en France en vertu de l’article 784 du code général des impôts (CA Rennes 4 mai 2005 n° 03-4727, 1e ch. A, DSF du Finistère c/ Crts Tardieu de Maleissye).
Un jugement du tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre a précisé que le bénéficiaire d’un trust ne pouvait pas en revanche – faute de présomptions suffisantes - être assimilé à un propriétaire assujetti à l’ISF et que, par ailleurs, les personnes morales ne sont jamais assujetties à l’ISF : « La perception de revenus provenant de deux « trusts » de droit américain ne suffit pas à faire peser sur le bénéficiaire une quelconque présomption de propriété sur des valeurs mobilières, dès lors que l’administration n’apporte aucun élément sur la consistance des actifs sous-jacents auxdits trusts. L’administration n’apporte pas la preuve que le bénéficiaire des trusts en cause a des droits réels représentant une valeur patrimoniale et donc susceptible d’entrer dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune. Au contraire les actes instituant les trusts dénient au bénéficiaire un quelconque droit de propriété ou de créance sur le trust ou sur les biens objet du trust, et même laissent au trustee un pouvoir d’appréciation sur les revenus à distribuer. Le contribuable ne peut donc être assujetti à l’impôt de solidarité sur la fortune en raison de sa qualité de bénéficiaire des trusts américains litigieux. » (TGI Nanterre 4 mai 2004 n° 03-9350, 2ème ch.).
L’administration doit donc démontrer au cas par cas le bien fondé de l’assujettissement à l’ISF. Elle doit analyser si le bien ressortit ou non du patrimoine du constituant, s’il y a ou non des conditions suspensives tenant à la nature des biens transmis ou à la personne des bénéficiaires, la nature des revenus etc. En présence d’un trust révocable, le constituant est réputé seul propriétaire et se trouve donc taxable au titre de la détention d’un actif imposable. En présence d’un trust irrévocable, aucune taxation du constituant n’est envisageable car le dessaisissement de ce dernier est définitif. Pourtant, le constituant peut se trouver dans une situation tout à fait identique en pratique à celle d’un usufruitier, assujetti à l’ISF sur l’intégralité de la valeur du bien démembré. En l’absence de distribution régulière, l’administration ne peut prouver que les bénéficiaires sont titulaires d’un droit de créance et donc imposables à l’ISF à proportion du capital correspondant aux revenus en cause.
Une amélioration pourrait donc consister à imposer à l’ISF les biens ou droits mis en trusts dans le patrimoine des bénéficiaires de leurs produits au sens de l’article 120-9 du code général des impôts. Si le trust ne procède à aucune distribution, les biens ou droits seraient compris dans le patrimoine du constituant, sauf à ce que ce dernier apporte la preuve qu’il s’est dessaisi définitivement de la propriété de ces biens ou droits. Cette présomption de propriété pour l’assujettissement du patrimoine à l’ISF permettrait d’assujettir les biens gérés par des trusts qui ne sont constitués que dans le seul but d’échapper à l’impôt sur le patrimoine.
→ Instaurer une présomption d’assujettissement à l’ISF des biens
ou droits mis en trust ou dans une structure équivalente.
C.– LA QUESTION PARTICULIÈRE DU CONTRÔLE ET DE LA RÉPRESSION
En matière fiscale, les sanctions encourues par les contribuables sont de deux types. En premier lieu, les pénalités fiscales, que sont les intérêts de retard, les majorations de droits et les amendes, ont pour principal but de réparer le préjudice pécuniaire subi par le Trésor public ; elles sont directement appliquées par l’administration, sous le contrôle du juge de l’impôt. En second lieu, les sanctions pénales, qui sont prononcées par le juge pénal, sont encourues par les auteurs d’infractions érigées en délits en raison de leur particulière gravité ou de l’intention frauduleuse qui a présidé à leur commission. Elles s’appliquent principalement, mais non exclusivement, au délit de fraude fiscale.
L’efficacité de la législation aux fins de lutte contre l’évasion et la fraude fiscales n’est assurée que si l’administration et la justice ont la capacité de mettre à jour les pratiques dommageables et de les réprimer. La crédibilité même du système normatif en dépend. Or, en matière de fiscalité internationale, l’efficacité de l’administration repose très largement sur la capacité à obtenir de l’information sur les actifs détenus à l’étranger, ce qui se heurte pour les paradis fiscaux à l’opacité qui entourent les transactions et à l’absence de coopération de leurs administrations. L’essentiel des efforts doit donc être porté à un niveau international pour obtenir une plus grande transparence dans ces territoires, ainsi que la levée des restrictions à l’accès à l’information, notamment bancaire. Il ne pourra y avoir d’amélioration considérable du contrôle fiscal avec les États qui se refuseraient à la régulation et à la coopération.
Pour autant, ces limites et blocages ne doivent pas occulter les écueils du contrôle de la fraude et de l’évasion fiscales en France. À situation internationale équivalente, d’autres États disposent d’outils efficaces, comme l’affaire du Liechtenstein l’a révélé. Par ailleurs, la réflexion sur la création d’un service fiscal judiciaire et la transposition de la troisième directive anti-blanchiment mettent en lumière une organisation du contrôle complexe, faisant intervenir plusieurs ministères et en leur sein plusieurs services, dans leurs champs de compétences propres et avec leurs méthodes et sources propres. S’y ajoutent évidemment les autorités de régulation et de supervision sectorielles. Les questions de procédures sont clairement en cause et appellent des améliorations. Il convient de garantir la coopération des différents services dans le sens de la bonne circulation de l’information et d’un partage efficace des rôles.
1.– Les acteurs du contrôle et de la répression : organisation et missions
a) TRACFIN : la détection du blanchiment
Créée par décret du 9 mai 1990 en application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants, à la suite du sommet de l’Arche du G7, TRACFIN (cellule de traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers clandestins) est la cellule française de lutte anti-blanchiment.
Placé en amont de la phase judiciaire, le service recueille des informations signalant des opérations financières atypiques. À ce titre, les professions concernées par le dispositif anti-blanchiment font parvenir à TRACFIN une déclaration de soupçon. La cellule procède à l’enrichissement de ces signalements, les analyse et effectue des recoupements financiers en recourant, le cas échéant, à des échanges d’informations, y compris sur le plan international. L’analyse des signalements reçus par TRACFIN permet de passer du soupçon à la présomption d’une opération de blanchiment et de transmettre au procureur de la République territorialement compétent.
L’élargissement progressif des professions soumises à déclaration de soupçon (55) a fait passer le nombre de déclarations transmises à la cellule d’environ 1 000 jusqu’en 1998 à 14 565 en 2008. En 2009, le nombre des déclarations de soupçon s’inscrit d’ailleurs en progression de 30 % par rapport à 2008. En réalité, les banques et les assurances représentent près de 90 % des déclarations de soupçon ; au deuxième rang viennent les changeurs manuels avec près de 8 % des déclarations. En 2007, une seule déclaration de soupçon rédigée par un avocat est parvenue à la cellule TRACFIN sur les quelque 12 500 déclarations reçues cette année-là ; ce chiffre serait de trois en 2008, pour près de 350 déclarations issues des notaires. En 2008, TRACFIN aurait également reçu 93 signalements émanant de la sphère publique.
La cellule TRACFIN est chargée du traitement des renseignements fournis par les professionnels, qui passe par l’anonymisation des déclarations : environ les trois quarts des déclarations font l’objet d’un simple enregistrement, soit parce qu’elles sont trop imprécises, soit parce qu’elles recoupent des déclarations plus anciennes, soit enfin parce qu’elles ne trouvent pas d’exploitation judiciaire en France mais peuvent se révéler utiles pour répondre à une demande émanant d’une cellule de renseignements financière étrangère. Un quart seulement des déclarations font l’objet d’une investigation, et sur le flux d’environ 15 000 déclarations, environ 400 d’entre elles font l’objet d’une note de transmission au Procureur de la République. Le graphique suivant retrace la répartition thématique des 410 notes de transmission adressées par TRACFIN à la justice en 2007.
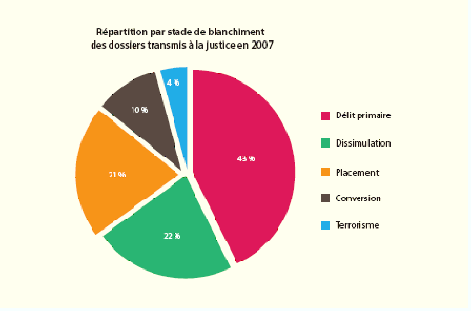
Source : Rapport d’activité TRACFIN 2007
En 2008, le nombre des transmissions en justice s’est établi à 359, recul qui s’explique par les conditions internes du service, en particulier par le déménagement de la cellule et la migration de son système informatique.
Jusqu’en 2009, le champ d’application de la déclaration de soupçon couvrait la criminalité organisée, le trafic de drogue, la corruption, la fraude aux intérêts de la Communauté européenne et la lutte contre le financement du terrorisme. L’ordonnance du 30 janvier 2009 de transposition de la troisième directive anti-blanchiment opère en la matière le passage d’une logique d’exception à une logique de compétence de droit commun, puisque seront désormais soumis à déclaration de soupçon tout délit ou crime susceptible de plus d’un an d’emprisonnement. Aux termes de l’article 1741 du code général des impôts, celle-ci s’étend donc désormais aux soupçons de fraude fiscale, passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans. TRACFIN est en effet désormais autorisé à communiquer à l’administration fiscale des informations sur des faits susceptibles de relever de fraude fiscale et aux services de renseignement des informations pouvant révéler une menace contre les intérêts fondamentaux de la Nation en matière de sécurité publique et de sûreté de l’État.
Les nouveaux articles L. 561-23 à L. 561-31 du code monétaire et financier, introduits par l’ordonnance du 30 janvier 2009, étendent en effet sensiblement les pouvoirs de TRACFIN.
– La cellule continue de saisir par note d’information le procureur de la République des faits susceptibles de relever du blanchiment des capitaux ou du financement du terrorisme, réserve faite de l’hypothèse où la fraude fiscale constituerait la seule infraction sous-jacente à ce blanchiment ;
– Lorsque TRACFIN saisit le procureur de la République de faits susceptibles de relever du blanchiment des capitaux ou du financement du terrorisme, ce dernier doit l’informer en retour des suites qui sont réservées à cette saisine, afin d’en tenir informés les professionnels déclarants. Ce retour d’information doit permettre à TRACFIN d’actualiser ses connaissances des méthodes et techniques utilisées par les blanchisseurs et les financeurs du terrorisme et de les diffuser en retour aux professionnels assujettis aux obligations de vigilance et à leurs autorités de contrôle ;
– La cellule peut, d’une part, retarder de deux jours ouvrables l’exécution d’une opération qui lui a été déclarée par un professionnel, contre douze heures auparavant, et demander au président du tribunal de grande instance de Paris de proroger ce délai ou d’ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration ;
– Elle dispose, d’autre part, d’un droit de communication des pièces conservées par les professionnels assujettis. Pour les organismes financiers, ce droit de communication peut même s’exercer sur place ;
– En outre, TRACFIN peut obtenir des administrations et de tout autre organisme ou personnel chargé d’une mission de service public toutes informations qui lui sont nécessaires à l’accomplissement de sa mission de cellule de renseignement financier ;
– Enfin, elle peut échanger des informations avec les cellules de renseignement financier étrangères et communiquer des informations pertinentes à l’administration des douanes, aux services de police judiciaire, aux services de renseignement spécialisés et aux services fiscaux.
Ainsi, s’agissant des déclarations de soupçon de fraude fiscale, TRACFIN transmet désormais directement la note d’information à la direction générale des finances publiques (DGFIP) et non au Procureur de la République, afin de suivre la procédure spécifique en matière de fraude fiscale, qui suppose une plainte de l’administration fiscale et le passage par le filtre de la commission des infractions fiscales (CIF).
L’élargissement conséquent des pouvoirs de TRACFIN nécessite en tout état de cause un renforcement des moyens humains du service, actuellement doté de 70 agents.
→ Renforcer les moyens humains de TRACFIN.
Les techniques de blanchiment pouvant mettre en jeu des paradis fiscaux, la cellule TRACFIN est conduite à accorder une grande importance à son réseau d’échanges internationaux avec les cellules de renseignements financiers étrangères, désormais régi par le nouvel article L. 561-31 du code monétaire et financier. Ces échanges s’effectuent sous réserve de réciprocité, du respect d’obligations de confidentialité au moins équivalentes à celles qui s’appliquent en France, et à condition que le traitement des informations communiquées garantisse un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes.
Les échanges d’informations s’effectuent dans le respect des recommandations du GAFI, des meilleures pratiques édictées par le groupe Egmont (56) et des accords bilatéraux que le service a signés avec nombre de ses partenaires. Un réseau d’échanges électroniques d’informations a d’ailleurs été mis en place entre les cellules de renseignements financiers (CRF) de l’Union européenne.
Environ 1 000 demandes sont adressées chaque année à TRACFIN pour environ 700 demandes sortantes adressées par TRACFIN à des CRF étrangères. Près de 85 % des demandes sont échangées dans le cadre de l’Union européenne ou de la zone Europe. D’après le service TRACFIN, il n’existe pas de corrélation nette entre le degré de coopération des cellules de renseignements financiers (CRF) et le fait pour certains territoires de répondre à la définition d’un paradis fiscal : ainsi, en matière de lutte anti-blanchiment, TRACFIN fait état d’une coopération remarquable de la part de la CRF luxembourgeoise, la transmission d’informations étant subordonnée à l’existence d’une infraction pénale répréhensible au Luxembourg. De même, les relations avec la CRF belge sont excellentes, en raison principalement de l’existence d’une possibilité légale d’investigation à la demande d’une CRF étrangère. En revanche, les relations sont plus erratiques avec la CRF monégasque, elles sont épisodiques avec la CRF du Liechtenstein et quasiment inexistantes avec la cellule d’Andorre. Le bilan de la coopération internationale menée par TRACFIN révèle donc que les paradis fiscaux ne sont pas forcément non coopératifs sur le plan de la lutte contre le blanchiment des capitaux.
La cellule constate ces dernières années une décrue du nombre de dossiers issus de déclarations de soupçon engageant des transactions internationales : celle-ci pourrait être le signe d’une meilleure dissimulation permise par les techniques sophistiquées de blanchiment international de capitaux, qui passerait par un évitement croissant du système bancaire, notamment par le recours à l’argent liquide. C’est pourquoi le principe d’une interdiction du paiement en espèces au-delà d’un certain montant est essentiel. À cet égard, l’ordonnance du 30 janvier 2009, transposant la 3ème directive anti-blanchiment, a prévu que ce plafond serait fixé par décret, et pourrait vraisemblablement s’établir à 3 000 euros. Il semble toutefois essentiel de ne pas remettre en cause les plafonds actuellement en vigueur, et qui distinguent entre les particuliers (interdiction de paiement en espèces au-delà de 3 000 euros) et les commerçants (interdiction de paiement en espèces au-delà de 1 100 euros).
D’autre part, depuis la disparition du billet de 1 000 dollars, le billet de 500 euros représente la valeur en espèces la plus importante : or, le blanchiment d’argent sale passe très souvent par le recours aux espèces, dans la mesure même où l’argent liquide reste à l’abri des contrôles du circuit financier. Dans cet ordre d’idées, la suppression du billet de 500 euros pourrait être promue par la France à l’échelon européen.
→ Fixer les seuils d’interdiction de paiement en espèces à 3 000 euros pour les particuliers et à 1 100 euros pour les commerçants.
→ Promouvoir, à l’échelle européenne, la suppression du billet de 500 euros.
b) L’organisation et les moyens du contrôle fiscal
Le contrôle fiscal permet de vérifier la situation des contribuables – personnes physiques et morales. S’agissant des paradis fiscaux, il doit permettre de déceler des sommes ou transactions dissimulées, des opérations erronées, des montages falsificateurs. Outre la détection des irrégularités diverses et des conditions de mise en œuvre des dispositifs anti-abus, le contrôle s’exerce sur la matérialité des opérations et la présence hors de France au travers de la domiciliation fiscale, permettant de remettre en cause des installations fictives. Pour les personnes morales, il s’agit de la qualification d’établissement stable qui emporte l’imposition en France. L’administration fiscale peut aussi requalifier des sociétés étrangères « boîtes aux lettres » au motif que le siège de direction effective se situe en France. La Cour administrative d’appel de Nantes a donné raison à l’administration fiscale contre une société belge en 2008 : la société n’avait dans son État de résidence que son siège social, à l’adresse de son commissaire aux comptes. Elle n’y avait ni personnel, ni ligne téléphonique. Elle avait pour organe un gérant domicilié en France, qui signait les contrats en utilisant le chéquier de la société. Pour les personnes physiques, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France :
– les personnes qui ont leur foyer ou leur lieu de séjour principal en France. Il s’agit de la résidence habituelle de la personne ou de sa famille (enfant et conjoint). Une personne travaillant à l’étranger pourra être ainsi considérée comme résident fiscal français si sa famille habite en France. Il suffit de séjourner plus de 183 jours en France (y compris à l’hôtel) pour remplir cette condition.
– les personnes qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins que cette activité y soit exercée à titre accessoire. Est considérée comme principale et donc non accessoire une activité à laquelle l’intéressé consacre plus de la moitié de son temps, ou, à défaut, qui lui procure plus de la moitié de ses revenus mondiaux.
– les personnes qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Cette notion, assez floue, peut concerner, par exemple, la destination des investissements, le siège social de sociétés, le lieu d’activité professionnelle, etc.
On peut indiquer ici qu’il existe en Italie une présomption de résidence fiscale des ressortissants ayant transféré leur domicile dans certains États ou territoire à fiscalité privilégiée, sans équivalent en droit français. Les ressortissants italiens qui quittent l’Italie pour transférer leur résidence fiscale dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée demeurent considérés comme des résidents d’Italie par les autorités fiscales italiennes. Toutefois les contribuables peuvent leur apporter la preuve (par tout moyen) de la réalité de ce transfert. Les États ou territoires visés par cette mesure ont été énumérés dans un décret (États ou territoires ayant des taux d’imposition faibles voire inexistants sur les revenus).
D’une manière générale, la mise en œuvre du contrôle fiscal à l’échelle d’une direction départementale s’insère dans le cadre du plan interrégional de contrôle fiscal (PICF) qui est lui-même une déclinaison des orientations nationales du contrôle fiscal externe (CFE) établies par l’administration centrale. Le PICF fixe les orientations et les axes stratégiques du contrôle et les actions à mettre en œuvre dans les interrégions. Il coordonne l’action des services de recherche et mutualise les compétences des différents acteurs du contrôle fiscal. II établit la répartition des compétences entre les différents niveaux de contrôle. Il organise une couverture équilibrée du tissu, en fonction des enjeux et des risques. La répartition des compétences entre les structures de contrôle s’effectue en fonction de la taille du contribuable vérifié et selon trois niveaux : les directions de niveau national, les directions de contrôle fiscal (DIRCOFI) exerçant leur mission dans un ressort géographique interrégional et les directions départementales (DSF) :
– les grandes entreprises (chiffre d’affaires supérieur à 152,4 millions d’euros pour les entreprises de ventes ou 76,2 millions d’euros pour les prestataires de service) et les grands groupes sont contrôlés par les brigades de vérification de la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI), soit environ 1 300 affaires par an (57);
– les entreprises de taille intermédiaire (chiffre d’affaires compris entre 1,5 et 152,4 millions d’euros pour les entreprises de ventes ou entre 0,5 et 76,2 millions d’euros pour les prestataires de service) sont contrôlées par les brigades de vérification des directions de contrôle fiscal (DIRCOFI), soit environ 15 000 affaires par an. Ces directions ont également un rôle important d’animation du contrôle fiscal interrégional, dans le cadre des plans interrégionaux du contrôle fiscal (PICF) ;
– les petites ou très petites entreprises sont contrôlées par les brigades départementales de vérification ou par les inspections de contrôle et d’expertise au sein de chaque centre des impôts, soit environ 35 000 affaires par an.
En ce qui concerne les particuliers, les ESFP sont réalisées chaque année, en fonction du niveau et de la complexité du revenu, par des brigades spécialisées en contrôle des revenus de la DNVSF (direction nationale de vérification des situations fiscales, compétente sur l’ensemble du territoire pour les contribuables dont le revenu global est supérieur à 762 000 euros ou les dossiers dont la complexité ou la notoriété exige une technicité particulière), des DIRCOFI ou des DSF.
Ces services travaillent ensemble afin d’échanger leurs informations, voire de lancer des opérations coordonnées afin d’assurer les meilleures chances de succès aux procédures engagées (meilleur partage des informations, progression coordonnée des travaux pour une meilleure appréhension de la situation d’ensemble du ou des contribuables vérifiés, etc.).
LES MÉTHODES DU CONTRÔLE FISCAL
La mise en œuvre du plan annuel de contrôle fiscal incombe au directeur local et s’appuie sur les deux étapes essentielles que sont l’analyse du tissu et la définition d’axes de contrôle. La programmation des contrôles fiscaux externes relève de la compétence de chaque directeur, compte tenu de son tissu fiscal et de son PICF. Les services sont chargés de sélectionner par eux-mêmes, les affaires à contrôler. Pour ce faire, ils disposent de trois sources de programmation, dont fa combinaison concoure à fa couverture du tissu :
– l’analyse risque : elle repose sur le croisement des bases de données de la DGFIP et vise à identifier par des requêtes informatiques des incohérences et des ruptures de comportement ;
– la recherche : elle repose sur la mobilisation et la fiscalisation d’informations externes (police, gendarmerie, justice, affaires sociales...) et incombe au plan local aux brigades de contrôle et de recherche (BCR) et au plan national à la Direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF). Cette source de programmation est positionnée sur le terrain répressif. La DNEF est la structure dédiée à la recherche et à l’exploitation de l’information. Elle a un rôle central en matière de « veille fiscale » et de relation avec les administrations étrangères notamment sur le terrain de la fraude carrousel et des paradis fiscaux. Elle met en œuvre des procédures spécifiques telles que le droit de communication à l’égard de certains organismes pour obtenir des informations sur les comptes bancaires et les mouvements de capitaux ou la procédure de perquisition en cas de fraude ;
– l’événementiel : cette source repose sur l’exploitation de faits constatés ou d’informations transmises par les services gestionnaires. Il s’agit généralement d’un événement particulier survenant dans la vie du contribuable et de nature à justifier un contrôle (déclaration de succession d’un héritier, déclaration de cessation d’activité par un chef d’entreprise, demande de remboursement de crédit de TVA par un contribuable au profil atypique, etc.).
S’agissant de contrôle fiscal international en particulier, chaque direction de contrôle doit identifier à son niveau les critères selon lesquels les opérations de contrôle seront orientées. Peuvent être évoquées en exemple quelques problématiques :
– les établissements stables non déclarés pourront être recherchés par la dénomination (58) et l’adressage (59), ou bien par le recensement des structures non assujetties aux impôts commerciaux ou exclusivement assujetties à la TVA ;
– les prix de transfert peuvent faire l’objet d’une programmation issue de l’identification de certaines anomalies, comme les sociétés déficitaires sur le long terme alors qu’elles appartiennent à un groupe bénéficiaire au niveau mondial, ou bien sur la base de l’importance des flux en provenance ou à destination de l’étranger, ou bien encore les sociétés détenant des filiales établies dans des territoires à basse pression fiscale, mais aussi la connaissance des liens capitalistiques des entreprises, l’examen des versements à des non résidents, les évolutions pluriannuelles de certains ratios ;
– les retenues à la source peuvent faire l’objet d’une attention particulière à partir de requête sur nos applications internes à partir des pays (notamment les paradis fiscaux) ou la nature du bénéficiaire (par exemple les sociétés liées),
– la création de structures nouvelles fait l’objet d’un suivi dans les groupes, notamment les structures financières ;
– s’agissant des personnes physiques, la fausse domiciliation à l’étranger reste un outil de fraude important.
L’administration dispose d’un pouvoir général de contrôle des déclarations et des actes utilisés pour l’établissement de l’impôt des particuliers comme des entreprises. Cet exercice du droit de contrôle peut également être exercé sur place selon deux modalités : la vérification de comptabilité et l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle.
En termes de résultats, le contrôle interne en bureau a permis de rappeler 6 milliards de droits en 2007. Le contrôle externe a donné lieu à 52 010 opérations de contrôle au cours de l’année 2008 (cela représente une baisse de 0,5 % par rapport à 2007). Les résultats financiers d’ensemble pour cette même année sont de 11,37 milliards d’euros de droits bruts (en hausse de 39 % par rapport à 2007) et de 7,12 milliards d’euros de droits nets (en augmentation de 1,3 % par rapport à 2007).
ÉVOLUTION DU NOMBRE D’OPÉRATIONS ANNUELLES ÉCLATÉE PAR TYPE DE DIRECTIONS
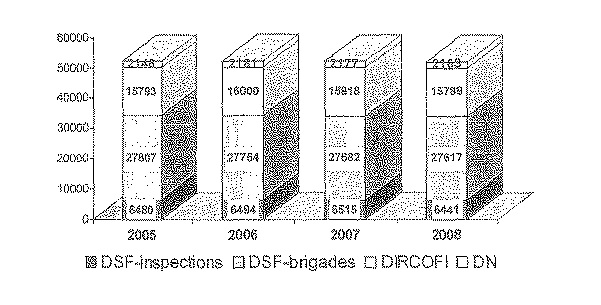 Source : DGFIP
Source : DGFIP
Le bilan du contrôle fiscal international 2008, qui analyse l’ensemble des dossiers achevés au cours de l’année 2008 avant ouverture éventuelle de procédures contentieuses ou amiables, affiche un montant en base de 3,3 milliards d’euros pour 1 200 dossiers. Ce montant ne dit que peu de choses sur les contrôles effectués : il concerne tous les impôts, et la mise en recouvrement peut être suspendue pour ouverture d’une procédure d’élimination des doubles impositions ou rendue impossible par la situation du contribuable. Ces résultats sont concentrés sur le dispositif de l’article 57 (prix de transfert) qui fonde à lui seul 80 % des rectifications effectuées. Il a été mis en œuvre à 357 reprises en 2008 pour un montant de rehaussements en base de 2,6 milliards d’euros. La DVNI fait état de 23 dossiers impliquant des pays non coopératifs pour un montant transféré de 470 millions d’euros, soit environ le cinquième des activités de contrôle fiscal international. Parmi ces juridictions, le principal bénéficiaire des transferts est la Suisse (13 dossiers pour 410 millions d’euros), suivie du Luxembourg (4 dossiers pour 10 millions d’euros), la Belgique (4 dossiers pour 31 millions d’euros) et Hongkong (3 dossiers).
En sus du contrôle interne et externe, figurent les plaintes pour fraude pénale. Ce sont elles qui conduisent au déclenchement d’une procédure judiciaire Les dossiers sont sélectionnés par la Commission des infractions fiscales (CIF) qui évite l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, qui permettrait à toute personne de porter plainte directement auprès du procureur de la République.
Le parquet peut être saisi sur plainte de l’administration fiscale ou de toutes personne soumise à l’article 40 du code de procédure pénale (« toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ») ou sur transmission de TRACFIN. Il peut aussi mettre à jour des opérations de fraude dans le cadre d’une enquête connexe.
LE FILTRE DE LA COMMISSION DES INFRACTIONS FISCALES Article L. 228 du Livre des procédures fiscales : Sous peine d’irrecevabilité, les plaintes tendant à l’application de sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l’administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales. La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé des finances. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l’invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu’il jugerait nécessaires. Le ministre est lié par les avis de la commission. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de fonctionnement de la commission. Les raisons d’une telle procédure L’action publique revêt en matière fiscale une singularité en ce que, par exception aux dispositions de portée générale de l’article 1er du Code de procédure pénale, le Procureur de la République ne peut la mettre en mouvement que dans la mesure où l’administration a préalablement déposé une plainte. Comme le faisaient remarquer les parlementaires au cours des travaux préparatoires à l’adoption de la loi ayant institué la Commission des infractions fiscales (CIF), « le délit de fraude fiscale n’étant pas susceptible d’être poursuivi d’office par le ministère public, c’est dans le droit actuel, à l’administration qu’il appartient de mettre en mouvement l’action publique au moyen du dépôt d’une plainte ». Pour la doctrine administrative, le dépôt préalable d’une plainte par l’administration est une formalité substantielle dont le respect est d’ordre public ; elle en déduit que les juges du fond seraient en droit de déclarer d’office l’irrecevabilité découlant de son inobservation. Cette position est toutefois à relativiser car la Cour de cassation juge de manière constante qu’en application de l’article 385 du code de procédure pénale, le moyen tiré de l’absence de plainte préalable de l’administration fiscale, qui n’est pas d’ordre public, est irrecevable faute d’avoir été soulevé, in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond (Cass. crim., 10 janv. 1994, n° 9380.353, Jammet et SARL « Le Memphis », RJF 7/95, n° 912). Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 771453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties aux contribuables en matière fiscale et douanière, le pouvoir d’appréciation de l’administration quant à l’opportunité des poursuites en matière fiscale était quasi absolu. L’administration pouvait librement saisir les juridictions répressives ; le juge administratif n’exerçant qu’un contrôle restreint sur la décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre, qui était limité à l’erreur de fait, à l’erreur manifeste d’appréciation et au détournement de pouvoir (CE, 5 nov. 1980, no 16.212, RJF 1/80, no 84). Cette solution était d’ailleurs conforme au principe selon lequel l’administration n’est jamais tenue d’engager des poursuites pénales, sauf si un texte particulier le lui prescrit (CE, 7 mai 1971, nos 77669 et 77977, min. des Finances et ville de Bordeaux c/ Sastre, Ass. Lebon, p. 335). La recrudescence des plaintes de l’administration pour infraction fiscale (740 plaintes en 1975) a conduit à la mise en place d’un mécanisme de filtrage des plaintes, accordant des garanties procédurales au contribuable tout en permettant de prévenir les poursuites abusives. L’article 1er de la loi du 29 décembre 1977 a donc créé la Commission des infractions fiscales, dont l’avis conforme subordonne le dépôt d’une plainte par l’administration fiscale à l’encontre du contribuable. Il ressort des travaux parlementaires préparatoires à l’adoption de la loi précitée, que les objectifs du gouvernement et du législateur étaient : – en premier lieu, de limiter le pouvoir de l’administration quant à la mise en mouvement de l’action publique en matière fiscale et d’éviter ainsi que l’administration soit en mesure de poursuivre abusivement un contribuable (« L’objet de l’article 1er est d’enlever à l’administration fiscale la prérogative de décider seule et librement du dépôt d’une plainte pour fraude fiscale. À cet effet, l’article 1er prévoit, dans cette phase de la procédure, l’intervention d’une Commission indépendante de l’administration fiscale », doc. AN 1977, n) 2997) ; – en second lieu, d’offrir des garanties procédurales supplémentaires aux contribuables (« il importe que l’engagement des poursuites correctionnelles se fasse en pleine clarté et selon une procédure offrant aux redevables toutes garanties d’impartialité » doc. AN 1977, no 2997). Pour parvenir à ces objectifs, il fallait doter la CIF d’un statut particulier lui garantissant une certaine indépendance par rapport à l’administration tout en l’empêchant d’exercer, au travers de ses avis, une influence sur la décision à venir de la juridiction pénale saisie du dossier. Cette volonté de ne pas ériger la CIF en un 1er degré de juridiction ressort très clairement des travaux parlementaires préparatoires à la loi du 29 décembre 1977 (« la Commission des lois […] est très soucieuse de ne pas créer, par le biais de la Commission des infractions fiscales, un 1er degré de juridiction qui aurait une influence au moins morale sur le déroulement de la procédure correctionnelle […] très soucieuse également de préserver le caractère administratif de la Commission des infractions fiscales » (JO AN CR, 23 juin 1977, p. 4110). |
Depuis la loi n° 94-89 du 1er février 1994, les dispositions des articles 704 et 705 du code de procédure pénale établissent la compétence d’un ou de plusieurs tribunaux de grande instance par cour d’appel aux fins de poursuivre, instruire et éventuellement juger un certain nombre d’infractions limitativement énumérées ressortissant à la matière économique et financière. Cette compétence n’est pas obligatoire mais concurrente à celle des juridictions non spécialisées situées dans le ressort de la cour d’appel. Elle est limitée aux affaires complexes. Les tribunaux de grande instance de Paris, Marseille, Lyon et Bastia ont été retenus en raison du nombre et de la complexité des procédures qu’ils ont à traiter. Les pôles financiers y sont opérationnels depuis le 1er juin 1999. Celui de Paris, le plus important, est divisé en plusieurs sections :
– la section de la lutte contre la délinquance astucieuse (F1), qui traite les affaires de faux et d’escroquerie et enregistre 600 à 700 affaires nouvelles par mois ;
– la section financière (F2), qui s’occupe des dossiers de droit pénal des sociétés, de droit pénal boursier, de droit pénal fiscal et de lutte contre le blanchiment, et enregistre 60 à 70 affaires nouvelles par mois, bien plus complexes que celles de la section F1 ;
– la section économique et sociale (F3), qui est chargée des dossiers liés au droit du travail, au droit de l’environnement, au droit de l’urbanisme et de la construction, au droit de la consommation (contrefaçons notamment) et à la pollution maritime (affaire de l’Erika notamment), et qui est saisie d’environ 400 dossiers par mois ;
– ainsi que la section commerciale (F4) installée au tribunal de commerce.
Les Juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) traitent des dossiers de délinquance organisée au niveau interrégional. Elles sont chargées des plus gros dossiers de délinquance et de criminalité organisées aussi bien en matière générale qu’économique et financière. C’est une juridiction correctionnelle ou éventuellement une cour d’assises. La juridiction correctionnelle est une juridiction spécialisée puisque là encore les magistrats qui jugent les affaires sont des spécialistes et qu’ils ont été sensibilisés à la matière de la criminalité organisée.
Les JIRS disposent de tous les moyens qui sont prévus par le code de procédure pénale. C’est-à-dire les moyens généraux dont disposent tous les juges d’instruction avec, en plus, des possibilités – notamment l’infiltration et la sonorisation - dans des domaines très spécifiques. S’agissant de la répartition des compétences entre une JIRS et un pôle économique et financier, la distinction s’opère entre les dossiers de grande complexité et les dossiers de très grande complexité, qui résulte du caractère international du dossier, de la multiplicité des parties en cause dans le dossier et le cas échéant du nombre des victimes des infractions qui sont reprochées.
La tendance des condamnations pour fraude fiscale est à la hausse : leur nombre est passé d’environ 1 300 au début de la décennie à 1 800 en 2007. Le nombre de plaintes de l’administration fiscale est d’une stabilité déroutante avec 1 000 dossiers par an. Ces dossiers sont en revanche parfaitement bouclés et expurgés des nullités lorsque la Justice en est saisie. Peu de dossiers judiciarisés d’évasion fiscale sont traités car l’administration fiscale a peu de moyens pour investiguer à l’étranger, contrairement à la justice qui pourtant n’en a pas la compétence (elle agit sur plainte).
Un arrêt de la Cour de cassation du 20 février 2008 (Chambre criminelle, Bull n° 43, pourvoi n° 07-82 977) ouvre des perspectives intéressantes en autonomisant le blanchiment de fraude fiscale de la fraude fiscale elle-même. Cet arrêt tranche ainsi, pour la première fois, la question de savoir si les poursuites du chef de blanchiment de fraude fiscale sont soumises aux dispositions de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales et donc à l’existence d’une plainte préalable de l’administration fiscale, après avis conforme de la Commission des infractions fiscales. En l’espèce, un individu est contrôlé dans une voiture de forte cylindrée appartenant à un ami prête-nom, avec une forte somme d’argent sur lui. Cet argent provenait selon lui de salles de jeu d’où il tirait l’essentiel de ses revenus. Quelque temps plus tard, il est à nouveau contrôlé au volant d’une autre automobile. Il détenait là encore une grosse somme d’argent qu’il prétendait avoir gagné aux jeux. Après enquête, il s’est avéré qu’aucun revenu n’avait été déclaré par cet individu, et qu’il avait déjà été condamné à divers redressements fiscaux. TRACFIN avait ainsi déposé plusieurs rapports montrant que les gains gagnés avaient été dépensés en assurance-vie, bons anonymes et en certificats de dépôts négociables. L’individu est alors poursuivi pour avoir apporté son concours à des opérations de placement, de dissimulation et de conversion des produits du délit de fraude fiscale.
À l’appui de son pourvoi, le prévenu condamné du chef précité se prévalait d’un arrêt du 14 décembre 2000 (Bull. crim. 2000, n° 381, pourvoi n° 99-87.015) dans lequel la chambre criminelle avait jugé qu’encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui déclare un prévenu coupable de recel de fraude fiscale sans caractériser le délit principal de fraude fiscale, faute d’avoir constaté l’existence d’une plainte préalable de l’administration et de la procédure fiscale antérieure. Dans l’arrêt commenté, la chambre criminelle infirme cette jurisprudence en approuvant la cour d’appel d’avoir retenu que l’article 324-1 du code pénal, incriminant le blanchiment, n’impose pas que des poursuites aient été préalablement engagées ni qu’une condamnation ait été prononcée du chef du crime ou du délit ayant permis d’obtenir les sommes d’argent blanchies mais qu’il suffit que soient établis les éléments constitutifs de l’infraction principale ayant procuré les sommes litigieuses. Il est vrai que le caractère distinct et autonome de l’infraction de blanchiment commande une telle solution qui devrait s’imposer également en matière de recel de fraude fiscale.
En érigeant en deux délits autonomes le blanchiment de fraude fiscale et la fraude fiscale, cet arrêt permet désormais d’engager des poursuites sans plainte préalable de l’administration fiscale et permettra d’appréhender des fraudeurs lorsqu’ils sont aussi blanchisseurs. Jusqu’alors, si à l’occasion d’une investigation des faits de fraude fiscale étaient découverts, les informations étaient transmises à l’administration fiscale en vertu de la procédure prévue au livre des procédures fiscales. Désormais, lorsque des faits de blanchiment de fraude fiscale sont mis à jour, il n’est plus nécessaire de passer par une saisine de l’administration fiscale, le filtre de la CIF et une plainte.
Cependant, l’activité des pôles financiers est en baisse. Entre 2007 et 2008, le nombre de dossiers confiés par le procureur à des juges d’instruction est brutalement passé de 467 à 251 pour l’ensemble des affaires, santé publique (quatre juges) et délinquance astucieuse (les escroqueries, neuf juges) comprises. La chute est raide pour les délits financiers les plus complexes, qui ont fait la gloire et la raison d’être du pôle parisien créé en 1999 : 21 informations judiciaires ont été ouvertes en 2008, contre 88 en 2007 (et 101 en 2006). Ces évolutions sont aussi liées au développement des enquêtes préliminaires. Il n’en demeure pas moins que le petit nombre de condamnations qui en résulte est symptomatique d’une vraie difficulté à aboutir dans les affaires complexes qui relèvent de la fraude fiscale internationale.
S’agissant de la police, les structures de répression de lutte contre la fraude sont les commissariats de la Sécurité Publique, les brigades et Sections de Recherches de la Gendarmerie, les services Régionaux et Centraux de la Police Judiciaire, les groupes d’Interventions Régionaux (GIR) et le service de coopération technique internationale de police (SCTIP).
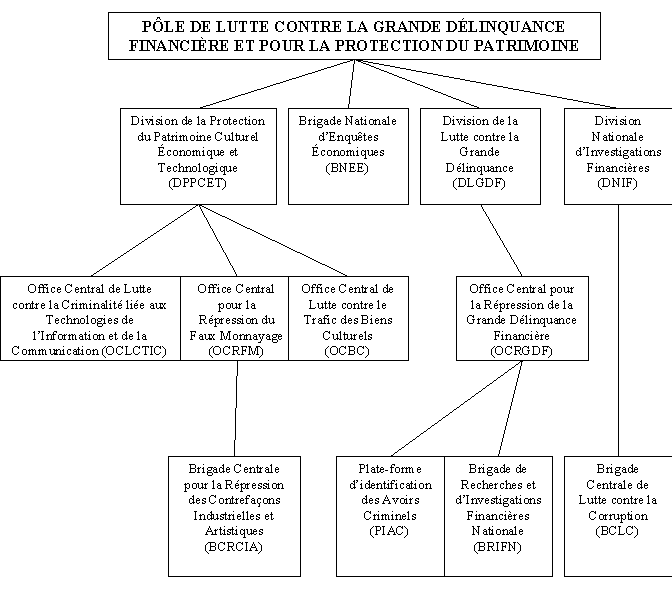
En matière de lutte contre le blanchiment, l’Office central de répression de la grande délinquance financière (OCRGDF) constitue le volet répressif du dispositif français. C’est un service centralisé de la Sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière (SDLCODF) de la Direction centrale de la police judiciaire, chargé de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Créé en 1990 suite au Sommet de l’Arche, son rôle est de coordonner l’action des services de police et de gendarmerie. Il enquête notamment sur les présomptions de soupçon transmises par TRACFIN. Il est également chargé de la coopération avec Europol et Interpol. La Plate-Forme d’Identification des Avoirs Criminels (PIAC) mise en place le 1er septembre 2005 est rattachée à l’OCRGDF. Elle est composée de policiers et de gendarmes et a pour mission d’identifier et de saisir les avoirs illégalement acquis. Elle vise à priver les malfaiteurs du produit de leurs agissements criminels.
La sous-direction des Affaires économiques et financières (SDAEF) de la division de la police judiciaire française comprend notamment la brigade financière (BF), la brigade de recherches et d’investigations financières (BRIF) ; la brigade de répression de la délinquance astucieuse (BRDA) et la brigade de répression de la délinquance économique (BRDE).
Les poursuites pénales des faits de fraudes sont engagées le plus souvent sous les qualifications de faux et d’escroqueries. La notion de « non justification de ressources » prévue à l’article 321-6 du code pénal permet de poursuivre les personnes qui, impliquées dans un crime ou un délit punissable de plus d’un an d’emprisonnement, ne peuvent justifier des ressources correspondant à leur train de vie. Elles encourent alors la peine de trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende ainsi que la confiscation des biens à titre de peine complémentaire (article 321-10-1 du code pénal).
d) Le cas particulier des enquêtes douanières
En application de l’article 28-1 du code de procédure pénale, les officiers de douane judiciaire ont une compétence d’attribution. Ce texte énonce les infractions pour lesquelles ils peuvent effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d’un juge d’instruction (infractions au code des douanes, contrefaçons, contributions indirectes, escroquerie à la TVA, blanchiment de droit commun, protection des intérêts financiers de l’Union européenne, vols de biens culturels, armes munitions et matériels de guerre, et infractions connexes aux infractions précitées ce qui inclut le blanchiment).
L’article 415 du code des douanes punit ceux qui ont, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l’étranger portant sur des fonds qu’ils savaient provenir, directement ou indirectement, d’un délit prévu au code des douanes ou d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants. Les peines encourues sont une peine d’emprisonnement de deux à dix ans, la confiscation des sommes en infraction et une amende comprise entre une fois et cinq fois la somme sur laquelle a porté l’infraction. L’infraction de blanchiment douanier suppose l’existence d’un délit préalable prévu par le code des douanes (article 414 du code des douanes : contrebande, importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées ou fortement taxées) ou à la réglementation sur les produits stupéfiants.
Avec le Service national d’enquêtes judiciaires (SNDJ), le ministère du budget dispose d’un service judiciaire de plus de 200 personnes habilitées à mener des enquêtes dans le domaine de la grande fraude économique et financière. Le SNDJ a compétence sur toutes les fraudes de blanchiment, y compris de fraude fiscale. L’arrêt de la Cour de cassation ayant autonomisé le blanchiment et la fraude fiscale, le SNDJ est potentiellement compétent sur la fraude fiscale. Le SNDJ agit d’ailleurs beaucoup en matière de carrousel TVA. Une enquête peut être diligentée, sur saisine du parquet, sans disposer d’informations sur la fraude à l’origine du transfert. Toutefois, hormis la question de la formation des équipes, le blanchiment de fraude fiscale ne permet pas d’appréhender toute la fraude et l’évasion fiscales.
– Les contrôles immédiats : Les services douaniers peuvent relever des infractions sur les flux physiques de capitaux soit lors du franchissement d’une frontière (par exemple en aéroport), soit sur le territoire national lors d’un contrôle à la circulation. Les agents interviennent dans la plupart des cas à partir de critères de ciblage pouvant porter sur les passagers, la provenance, les véhicules, le comportement de l’individu, etc. et plus exceptionnellement sur la base de renseignements précis transmis par un aviseur. Ces critères sont définis grâce à la réalisation d’analyses de risque établies par les services spécialisés du renseignement (exploitation et enrichissement des informations publiques générales, confidentielles ou encore relatives aux contentieux réalisés). Ces travaux font l’objet soit de fiches techniques de ciblage destinées aux services, soit d’études plus développées sur les caractéristiques générales de fraude.
– Les contrôles a posteriori : Les services régionaux d’enquêtes et la direction des enquêtes douanières peuvent diligenter des investigations sur les transferts d’argent liquide, dans un délai de trois ans après le mouvement. Ces enquêtes peuvent être décidées en prolongement d’autres constatations douanières.
Le contentieux douanier en matière d’infraction sur les capitaux peut faire l’objet soit d’un règlement transactionnel (94 % des cas), soit d’une transmission au parquet en cas de suspicion de blanchiment, soit donner lieu à une enquête menée par les services de la direction des enquêtes douanières (IVe division). Les services d’enquêtes peuvent dans ce dernier cas engager des recherches sur les circonstances de la fraude : informations sur le(s) auteur(s) de l’infraction, sur l’origine des fonds, audition du (des) protagoniste(s), demande de renseignements auprès des services étrangers sur la base des accords d’assistance administrative mutuelle internationale.
Les services de la surveillance opèrent les contrôles relatifs à l’obligation déclarative dans le cadre général de leur activité. Il n’est pas possible de distinguer le nombre de contrôles concernant particulièrement les flux de capitaux parmi l’ensemble des contrôles menés. Toutefois, pour l’année 2008, les brigades des douanes ont réalisé 29 386 missions pour 182 009 heures ; 2,277 % de leur activité ont spécifiquement porté sur l’obligation déclarative d’argent liquide.
En 2008, les services de la direction des enquêtes douanières ont mené 103 enquêtes en matière de blanchiment dont 47 ont abouti à des poursuites contentieuses. En 2009, 77 enquêtes étaient en cours à la fin mars dont 46 en lien avec le Luxembourg. Une quarantaine d’enquêtes concerne du blanchiment de fraude fiscale. Entre 1 400 et 1 800 infractions sont constatées chaque année (à comparer à 25 000 déclarations).
ACTIVITÉ DU SERVICE NATIONAL DE DOUANE JUDICIAIRE EN MATIÈRE D’INFRACTIONS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
Saisines |
2007 |
2008 |
Nombre de saisines |
695 |
845 |
Contrefaçons |
256 |
228 |
Infractions de douane |
219 |
226 |
Blanchiment |
82 |
115 |
Contributions indirectes |
22 |
21 |
Protection des intérêts financiers de la Communauté |
- |
13 |
TVA |
28 |
48 |
Source : Direction générale des douanes et des droits indirects
2.– Les procédures de contrôle et de répression de la fraude
a) La coopération entre les services judiciaires et administratifs
Une instruction commune à la direction générale des finances publiques et à la direction générale des douanes et des droits indirects fixe le cadre juridique et prévoit les modalités d’échanges d’informations utiles à la réalisation des missions des deux directions. La loi de finances pour 1999 a renforcé la collaboration entre la DGFIP et la DGDDI en permettant la communication spontanée de tous renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives (art. L. 83 A du livre des procédures fiscales). La DNEF travaille en étroite collaboration avec la Direction national du renseignement et des enquêtes douanières.
Dans le cadre de la coopération entre la DGFIP et la douane, les échanges d’informations sont réalisés au moyen d’un « bulletin de transmission d’une information » (BTI). La nature des informations transmises concerne en priorité les fraudes à la TVA, les manquements à l’obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs et les infractions à l’admission temporaire.
Années |
Nombre de BTI transmis par la DGDDI à la DGFIP |
Nombre de contrôles réalisés par la DGFIP |
2005 |
2 383 |
416 |
2006 |
2 204 |
365 |
2007 |
1 721 |
227 |
Années |
Nombres de BTI transmis par la DGFIP à la DGDDI |
Nombre de contrôles réalisés par la DGDDI |
2005 |
293 |
63 |
2006 |
398 |
50 |
2007 |
401 |
95 |
Source : Direction générale des douanes et des droits indirects
La collaboration entre la police judiciaire et la DGFIP est assurée notamment par la Brigade Nationale d’Enquêtes Économiques (BNEE), créée en 1948 et composée de 50 inspecteurs des impôts rattachés aux Affaires économiques et financières de la Police Judiciaire (DCPJ) et de la Préfecture de police de Paris (PP). La BNEE a pour mission d’assister la police judiciaire dans ses enquêtes, perquisitions et auditions, en matière financière et criminelle, en mettant à son service les capacités d’expertise financière et fiscale de ses inspecteurs. Elle participe à la programmation du contrôle fiscal externe sur la fraude fiscale à partir des délits financiers ou apparentés (abus de biens sociaux, faux en écritures et usage, banqueroute, faux bilans, activités occultes, détournements de fonds, abus de confiance, escroqueries...) (60). En 2008, la BNEE a conduit 397 opérations pour l’administration fiscale. Par ailleurs, les GIR ont procédé à près de 600 transmissions aux services fiscaux départementaux.
Concernant TRACFIN, outre ses transmissions à l’autorité judiciaire, la cellule peut également échanger des informations avec les officiers de police judicaire de l’Office central de répression de la grande délinquance financière (OCRGDF), les services douaniers et les autorités de contrôle des professions concernées par le dispositif anti-blanchiment. En 2008, TRACFIN a ainsi transmis 35 notes à l’OCRGDF tandis que la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) a reçu 93 signalements de TRACFIN. L’article L. 561-29 du code monétaire et financier, dans sa nouvelle rédaction issue de l’ordonnance du 30 janvier 2009, permet désormais la communication d’éléments à tout service de police judiciaire. On peut donc supposer que le nombre de ces transmissions est appelé logiquement à s’accroître à l’avenir.
De plus, la DGFIP pourra également désormais recevoir des informations en provenance de TRACFIN. Depuis le début de l’année 2009, dans le cadre de la transposition de la troisième directive anti-blanchiment, la fraude fiscale a été ajoutée comme l’une des infractions sous-jacente au délit de blanchiment justifiant une déclaration de soupçon. Aussi, lorsqu’une déclaration de soupçon adressée à TRACFIN fera apparaître des éléments de fait permettant de présumer la réalisation du délit de fraude fiscale, ces informations seront-elles transmises à la DGFIP pour examen. Cette procédure ne vaudra que si les soupçons ne portent que sur de la fraude fiscale. En présence d’autres délits ou de fraude qualifiable autrement (escroquerie par exemple), le dossier sera transmis au procureur. L’ordonnance de transposition autorise aussi la communication directement à la DGFIP des éléments d’un dossier relatif à la fraude fiscale, par exemple quand du travail dissimulé ou un abus de biens sociaux indiquent l’existence d’une fraude fiscale. En d’autres termes, l’article L. 561-29 du code monétaire et financier autorise désormais l’administration fiscale a d’utiliser les informations reçues par TRACFIN et ayant des incidences fiscales pour l’exercice de ses missions de contrôles et vérification et pour les plaintes correctionnelles pour fraude fiscale après avis de la commission des infractions fiscales. En ce qui concerne la fiscalité, il existe donc deux niveaux de suivi des informations :
– le niveau administratif : l’administration fiscale peut utiliser les renseignements fournis par TRACFIN pour ses missions traditionnelles de contrôle ;
– le niveau pénal : en cas de plainte pour fraude fiscale, le procureur de la République n’est saisi par le ministre qu’après avis de la commission des infractions fiscales sauf lorsque, après la transmission d’une note d’information au procureur de la République, l’infraction sous-jacente à l’infraction de blanchiment se révèle celle du délit de fraude fiscale. Dans cette situation, l’avis de la commission des infractions fiscales (CIF) n’a pas à être sollicité.
Ces transmissions directes amélioreront sans conteste la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Ce circuit se heurtera toutefois aux limites de TRACFIN : si le nombre de déclarations de soupçon augmente, grâce notamment à la très forte pression mise sur les banques par la Commission bancaire et – dans une moindre mesure – par le rôle de l’ACAM auprès des assureurs, les professionnels du chiffre et les conseils peinent à être mobilisés. Le refus des experts comptables d’être pleinement soumis à l’obligation de déclaration de soupçon est à cet égard inquiétant. De même, le fait que des avocats puissent appeler à ne pas appliquer la loi et refusent de transmettre des informations contenant des soupçons de fraude est édifiant et ne fait qu’augmenter la suspicion sur un certain nombre de pratiques.
S’agissant de la Justice, une vingtaine d’assistants opérationnels sont mis à sa disposition. Il s’agit d’agents des impôts, des douanes, de la Cour des comptes, de la Banque de France. Ils permettent au juge d’orienter utilement l’enquête et donc de réduire les délais des dossiers complexes. Leur nombre est toutefois très faible. Une circulaire commune DGFIP / Justice est également prévue pour assurer une meilleure coopération sur le terrain en matière de fraude.
Enfin, une Délégation Nationale à la Lutte contre la Fraude (DNLF) a été créée en avril 2008. Sa création résulte du constat que, si beaucoup de services s’occupent de la lutte contre toutes les formes de délinquance, leur action est souvent cloisonnée, ce qui nuit à leur efficacité. La DNLF est une structure légère qui comprend une quinzaine de personnes (commissaire de police, statisticien, informaticien, spécialiste du travail dissimulé ou des carrousels TVA, etc.). Elle a pour mission de veiller à l’efficacité et à la coordination des actions entre les services de l’État, de définir les axes d’une coopération renforcée entre les différents organismes et avec les administrations étrangères, d’améliorer la connaissance des fraudes et de proposer de nouvelles mesures pour enquêter et lutter contre la fraude.
b) Des résultats tributaires de la qualité de la coopération avec les administrations étrangères
En l’absence de convention fiscale ou de traité contenant des dispositions fiscales permettant l’échange d’informations (directive épargne ou directive assistance mutuelle par exemple), la France ne peut pas obtenir d’un État ou d’un territoire d’informations à finalité fiscale. En conséquence, au plan international, la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales est traitée dans le cadre de dossiers d’entraide judiciaire. Il n’y a pas, de ce point de vue, de corrélation évidente entre la nature de paradis fiscal et la qualité de la coopération judiciaire. Les pays qui sont montrés du doigt en matière de fraude et d’évasion fiscales sont de très bonne volonté en matière de blanchiment : identification bancaire, informations sur le patrimoine, saisie de bateaux etc. Le ministère de la justice fait ainsi état d’une bonne coopération avec Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Panama. L’inopposabilité du secret bancaire est quasiment universelle, acquise au sein de l’Union européenne, et cette règle figure dans tous les projets d’accords bilatéraux… du moins pour les infractions de droit commun. Une clause prévoit aussi désormais l’entraide en l’absence d’impôt équivalent. La véritable difficulté réside plutôt dans l’absence fréquente d’un fichier de type FICOBA permettant de répondre aisément aux demandes d’entraide.
→ Mettre en place, au niveau international, un fichier recensant les comptes bancaires sur le modèle du fichier FICOBA.
Le constat est le même s’agissant de TRACFIN qui adresse près de 700 demandes internationales par an, surtout aux pays limitrophes. Il existe peu de demande à l’égard des pays « exotiques » ; l’argent est en effet déjà blanchi avant d’arriver en France lorsqu’il trouve son origine dans ces territoires. Les relations avec le Luxembourg sont très bonnes, la coopération avec la Belgique excellente, sa cellule de renseignement investiguant même sur demande de TRACFIN. Les relations avec le Liechtenstein sont irrégulières. TRACFIN signale en revanche de véritables difficultés avec la Suisse qui demande la démonstration de ce que le soupçon n’est pas exclusivement fiscal. Cette démonstration n’est pas possible : par exemple un notaire a signalé un soupçon mais on ne sait pas quelle opération est derrière. Or le flux est très important avec la Suisse.
Toutefois, en matière fiscale, le ministère de la justice et les services de la police judiciaire mettent en avant deux types d’obstacles. D’abord, des obstacles juridiques perdurent :
– tous les accords sur l’entraide pénale en matière fiscale n’ont pas été ratifiés ;
– la double incrimination nuit aux enquêtes. Le principe est que l’État collabore uniquement si les faits peuvent être poursuivis sur son sol. Or, en Suisse par exemple, on ne peut pas être poursuivi pour non paiement des impôts mais seulement en cas de fraude caractérisée. Il en est de même en Belgique et en Italie où un seuil est fixé au-delà duquel la non déclaration n’est plus considérée comme une omission.
Ensuite, des difficultés pratiques se posent, liées à l’absence de fichiers de type FICOBA, mais aussi à une application imparfaite des conventions. Certains États, notamment Hongkong, répondent que les éléments transmis n’établissent pas suffisamment la preuve de l’infraction. D’autres ne répondent pas, comme Jersey, Guernesey, le Luxembourg, Gibraltar et même parfois la Suisse. Certains pays exigent enfin que le titulaire des comptes soit avisé.
Les services de la police judiciaire estiment à 18 mois la moyenne de réponse par commissions rogatoires. Dès lors que les fraudes complexes utilisent plusieurs territoires, la capacité pratique à prouver la fraude en est fortement réduite. Exemple a été donné à la mission d’un ressortissant étranger ayant reçu 60 000 dollars sur son compte bancaire français, transaction signalée par TRACFIN. Malgré cinq ans d’enquêtes, l’origine illicite des fonds n’a pu être prouvée. De plus la police judiciaire a fait état de difficultés pratiques avec le Royaume-Uni, une demande d’entraide judicaire sur deux n’aboutissant pas.
LA COOPÉRATION JUDICIAIRE INTERNATIONALE Entraide judiciaire pour la recherche de preuve : Sur le plan international, la commission rogatoire est un mandat donné par l’autorité judiciaire d’un État à l’autorité judiciaire d’un État étranger, le but étant que l’autorité de l’État requis fournisse, pour le compte et au nom de l’État requérant, une mesure d’instruction. L’État requis peut se voir demander de procéder à des interrogatoires, des saisies ou de localiser un suspect. En l’absence de convention, les procédures et les délais font qu’il est à la fois difficile et très long de voir une commission rogatoire aboutir. Les commissions sont transmises par voie diplomatique, elles passent par les ministères des Affaires étrangères de chaque État, qui les transmettent aux ministères de la Justice. Convention Européenne d’entraide judiciaire en matière pénale : Adoptée le 20 avril 1959, entrée en vigueur le 12 juin 1962 (47 signatures et 46 ratifications), cette convention prévoit une entraide judiciaire très large quasi-obligatoire, hormis l’exception d’infraction à caractère politique, ainsi que celle de sauvegarde de l’ordre public. Les commissions rogatoires sont transmises entre les chancelleries ou directement entre les autorités judiciaires en cas d’urgence. Les accords de Schengen : Signés le 14 juin 1985, leur convention d’application est entrée en vigueur le 28 septembre 2005. En matière d’entraide judiciaire, ces accords ont été renforcés par l’acte du Conseil du 29 mai 2000 établissant la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne. En règle générale, les demandes d'entraide et les communications sont transmises et exécutées directement par les autorités judiciaires territorialement compétentes. Il est toutefois possible pour des cas particuliers de passer par une autorité centrale d'un État membre. Dans certains cas, le passage par les autorités centrales est même obligatoire (demandes de transfèrement temporaire ou de transit de détenus, transmission d'avis de condamnation). En cas d'urgence, la demande peut être présentée par l'intermédiaire d'Interpol ou toute autre organisation compétente selon les dispositions introduites par le traité sur l'UE. Une autorité judiciaire ou une autorité centrale peut établir des contacts directs avec une autorité policière ou douanière d'un autre État membre, ou, dans le cas de demandes d'entraide relatives à des poursuites, avec une autorité administrative d'un autre État membre. Chaque État membre peut décider de refuser cette clause ou de l'appliquer sous certaines conditions. Un échange spontané d'information (donc sans demande préalable) peut avoir lieu entre les États membres concernant des faits pénalement punissables ainsi que des infractions administratives dont la sanction ou le traitement relève de l'autorité destinataire. L’article 13 de la convention prévoit des équipes communes d’enquêtes à l’initiative du procureur de la République, du juge d’instruction ou à la demande des autorités judiciaires d’un ou plusieurs États membres. Vingt-et-une équipes ont été créées à ce jour entre la France et six États membres, dont l’Espagne, la Belgique ou encore l’Allemagne. Des dispositions spécifiques s'appliquent à L'Irlande et au Royaume Uni (transmission des demandes d'aide), au Luxembourg (protection des données à caractère personnel), à la Norvège et à l'Islande (dispositions liées à l'acquis de Schengen, entrée en vigueur de la convention). EUROJUST EUROJUST est un organe de l’Union européenne, institué en 2002, qui s’applique à organiser le deuxième pilier de l’Union européenne relatif à l’organisation d’un espace de Justice et de Liberté (JAI). Il facilite la coopération européenne en matière de poursuites. EUROJUST a un pendant : EUROPOL, qui se doit d’aider à la prévention du crime en Europe, par le biais de fichiers centraux et d’un apport ponctuel d’expertise. La révision de la décision Eurojust grâce à une initiative française adoptée le 16 décembre 2008 permet de renforcer la fonction de coordination d’Eurojust, de favoriser la transmission d’informations à Eurojust en imposant notamment une transmission obligatoire lorsqu’une autorité nationale est saisie d’un dossier au moins trilatéral, ainsi que d’augmenter les capacités opérationnelles d’Eurojust par la création d’une cellule de coordination d’urgence et l’obligation de nommer un adjoint au membre national. |
En présence d’un traité international permettant les échanges d’informations à visée fiscale, les directions nationales et interrégionales de contrôle fiscal sont habilitées – sur délégation de l’administration centrale – à adresser directement leurs demandes de renseignements aux points de contact des administrations étrangères. Les directions des services fiscaux adressent pour leur part leurs demandes d’informations à leur direction interrégionale de contrôle fiscal de rattachement, cette dernière ayant la compétence pour relayer cette demande auprès des administrations étrangères. Par dérogation, dans le cadre de la directive épargne, les informations relatives aux paiements reçus sous forme d’intérêts par des personnes physiques résidentes de France, sont échangées sous forme de fichiers informatiques entre les services centraux des administrations fiscales. Elles sont ensuite relayées auprès des services locaux par les services informatiques de la DGFIP.
Au sein de l’Union européenne, les États coopèrent pour lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale dans les limites de leurs engagements internationaux. Ainsi, il n’est pas constaté d’États ne respectant pas ces engagements et ne répondant pas aux demandes adressées par la France. Des États pratiquant le secret bancaire comme le Luxembourg, la Belgique ou l’Autriche fournissent ainsi les renseignements demandés par la France sous réserve de cette limite.
Hors du cadre européen, des dysfonctionnements peuvent être rencontrés avec certains États qui répondent avec difficulté aux sollicitations françaises (Tunisie ou Maroc par exemple) ou fournissent des réponses souvent incomplètes (Singapour par exemple). Sauf dans certains cas spécifiques (Suisse, Singapour, pays à secret bancaire), il est toutefois difficile de déterminer si l’absence d’assistance administrative correspond à une stratégie délibérée des États concernés ou à un manque de moyens dédiés à cette mission. Enfin, certaines administrations ne disposent pas des informations afférentes aux bénéficiaires effectifs, ce qui obère la capacité à identifier les fraudeurs. Sur ce point, une centralisation des informations relatives à l’identité réelle des bénéficiaires, propriétaires et dépositaires constituerait une avancée notable.
→ Mettre en place, au niveau international, un registre ou fichier d’informations permettant de connaître l’identité réelle des bénéficiaires, propriétaires et dépositaires.
c) La capacité à repérer et déclencher une procédure de coopération dépend des moyens de l’administration fiscale française
Qu’il y ait ou non coopération administrative en matière fiscale, hors le cas de l’échange automatique d’informations comme il se pratique avec la directive épargne, l’administration fiscale française est tributaire de sa capacité à identifier des fraudeurs potentiels et donc à déclencher une procédure de coopération administrative. La transposition de la 3ème directive anti-blanchiment permettra de disposer d’informations susceptibles de démasquer des fraudeurs. En l’absence de déclarations de soupçon, système dont l’efficacité est en outre inégale en fonction des professions, l’administration utilisera ses procédures de contrôle classiques qui éprouvent des limites s’agissant de la détection de la fraude et de l’évasion.
Au-delà des informations auxquelles elle a directement accès, l’administration peut également avoir recours à d’autres procédures qui lui permettent, dans un cadre précis qui fixe leurs limites, de tenter de trouver d’autres informations par ses propres moyens, éventuellement auprès de tiers. Notamment, pour ce qui concerne les paradis fiscaux, deux procédures peuvent être utiles :
– le droit de visite et de saisie : cette procédure permet à l’administration, sur autorisation du juge, de rechercher la preuve d’agissements frauduleux, en matière de fiscalité directe et de TVA, lorsque la présomption de la réalisation d’une fraude a été établie par l’administration. Elle peut être réalisée en tout lieu et permettre la saisie de pièces et documents, quel qu’en soit le support, mais elle est très strictement encadrée : ordonnance préalable du juge des libertés et des détentions, réalisation interdite en dehors de certaines heures, présence obligatoire d’un officier de police judiciaire, etc ;
– le droit de communication : les agents de l’administration fiscale peuvent obtenir communication de documents ou d’informations détenues par certaines personnes ou organismes. Les demandes de l’administration dans ce cadre sont ponctuelles et ne doivent pas mener à des investigations particulière. Les personnes ou organismes assujettis à l’obligation de communication sont visés par la loi : il s’agit notamment des commerçants, des membres de certaines professions non commerciales, les tribunaux, les autres administrations publiques ou certains établissements et organismes tels que les banques.
Des améliorations ont été apportées dans l’efficacité des procédures administratives de contrôle. La première concerne la transversalité des échanges d’informations. Cela s’est traduit, en 2008, par la sécurisation et l’amélioration de la procédure de visite qui sert notamment à détecter les activités occultes. Elle avait été mise à mal début 2008 par la Cour européenne des droits de l’homme considérant que les voies de recours étaient impropres à garantir le droit à un procès équitable. La loi de modernisation de l’économie a régularisé ces questions puis la procédure a été améliorée : les agents d’administration peuvent recueillir des informations en cours de procédures, c’est-à-dire auditionner l’occupant des lieux, son représentant ou l’auteur présumé de la fraude (uniquement au cours de la visite domiciliaire et pour les seules informations relatives à la fraude présumée). Ensuite, le droit de communication pour lutter contre la fraude via Internet a été élargi. Internet se révèle propice au développement d’activités occultes. Le droit de communication s’étend désormais aux données conservées et traitées par les opérateurs de communication électronique, les fournisseurs d’accès et d’hébergement et les prestataires en ligne. Le caractère privé des correspondances échangées est respecté.
Pour autant, le droit de communication pourrait encore être amélioré pour faciliter la mise à jour d’informations faisant naître des soupçons de fraude. Il pourrait par exemple être étendu sur la base de critères non nominatifs tels que les montants et les territoires concernés. Cela aurait pour mérite d’éviter la mise en place d’obligations déclaratives lourdes pour les établissements et nécessitant des moyens trop importants de traitement des déclarations.
→ Élargir le droit de communication de l’administration fiscale pour lui permettre de se faire communiquer des informations sur une base non nominative.
Surtout, une fois le contribuable soupçonné identifié, l’administration doit pouvoir enquêter par tous moyens utiles aux fins d’étayer les soupçons. Seule la création d’un service fiscal d’enquêtes disposant de pouvoirs judiciaires est à même de le permettre.
La France dispose certes d’un des meilleurs contrôles fiscaux au monde. Il est très protecteur des droits des citoyens, et très encadré. Il comporte notamment un droit d’être assisté, un principe d’impartialité du vérificateur (arrêt du 1er décembre 2008), un principe de la preuve à la charge de l’administration, un principe de loyauté des débats (arrêt du 18 novembre 2008), une obligation de motiver, une obligation de fournir les sources (un arrêt du Conseil d’État a annulé un redressement dans un cadre international, parce que l’administration avait refusé de fournir les renseignements donnés par l’administration américaine), un principe de la primauté du fond sur la forme, les règles du sursis de paiement. De même, les nécessaires procédures coercitives – droit de visite, procédure de flagrance etc. – sont toujours soumises à un contrôle judicaire indépendant.
Toutefois, deux types de questions se posent. La première concerne le contrôle externe et plus particulièrement la question des moyens humains dans un contexte de révision générale des politiques publiques. La part des opérations ayant donné lieu à rappels en fiscalité internationale, tous contrôles confondus, est passée de 10,3 % en 2000 à 8,8 % en 2007. Le nombre de demandes d’assistance administrative internationale représentait 1,4 % des affaires en 2007 contre 1,7 % en 2002. L’amélioration de la coopération avec les autorités étrangères par application des nouveaux accords d’échange de renseignements devrait relever ces chiffres. Il n’est en effet pas utile de procéder à des demandes qui n’ont guère de chances d’aboutir. Pour autant, les schémas complexes de fraude nécessitent du temps et des moyens humains et il ne servirait à rien de faciliter la coopération internationale si tant les procédures internes que l’organisation du contrôle fiscal n’étaient à la hauteur des enjeux. La seconde question concerne le petit nombre de plaintes franchissant le filtre de la CIF (1 000 par an). N’a-t-on pas sacrifié l’efficacité du contrôle fiscal à la protection maximale du contribuable ?
D’une part, au moins dans les cas faisant intervenir des paradis fiscaux, il conviendrait de réfléchir aux modalités d’aménagement de la procédure de saisine de la CIF, en permettant un assouplissement du filtre et en prévoyant que l’intéressé n’est pas averti. Il s’agirait donc d’introduire une procédure accélérée et discrète, dérogatoire à la procédure normale.
D’autre part, il est indispensable que le magistrat en charge de l’enquête après filtre de la CIF dispose de spécialistes de la DGFIP qui auraient la qualité d’officiers de police judiciaire dans la conduite de l’enquête. La mise à jour d’opérations frauduleuses opaques nécessite la mise en œuvre de moyens tels que les écoutes téléphoniques, les gardes à vue et les perquisitions.
Cette proposition n’a rien d’aberrant. La plupart de nos partenaires ont octroyé à certains de leurs agents une compétence en matière de procédures judiciaires. L’organisation de sa mise en œuvre peut prendre différentes formes : administration autonome aux moyens puissants et aux missions variées (Guardia di Finanza en Italie), services dédiés au sein de l’administration fiscale (Allemagne, Pays-Bas, États-Unis, Royaume-Uni), agents placés auprès de structures spécialisées (Belgique). En France, il ne s’agirait pour autant pas de créer un fisc judiciaire. Les agents seraient placés sous l’autorité du juge, mais dans le cadre d’un service dédié au contrôle fiscal composé de fiscalistes.
Cette demande est relayée par les services du ministère de la justice qui apprécient la qualité des dossiers transmis par la CIF mais estiment indispensable que dans le temps de constitution du dossier, l’administration fiscale dispose de pouvoirs judiciaires lui permettant de geler les avoirs, de procéder à des saisies etc. Les services considèrent également qu’une alliance entre la compétence technique des agents des impôts et une compétence de moyens de la police permettrait d’aboutir dans des dossiers qui aujourd’hui n’arrivent pas jusqu’au dépôt de plainte.
Deux scenarii sont envisageables :
– La création d’un service national d’enquêtes judiciaires fiscales, soit rattaché à l’administration fiscale sur le même modèle que le service national de douane judiciaire, soit au ministère de l’Intérieur. La première solution paraît toutefois préférable car elle répond à une logique de compétence au fond ;
– La création d’un office ministériel douanier et fiscal regroupant le service national de douane judiciaire et le service d’enquêtes judiciaires fiscales pour favoriser la synergie.
→ Créer un service fiscal d’enquêtes composé d’agents disposant de la qualité d’officier de police judiciaire sous l’autorité du parquet.
*
* *
Les progrès réalisés en quelques mois dans la lutte contre les paradis fiscaux sont tout à fait encourageants. Ils permettent d’espérer la disparition de zones d’ombres par la combinaison des quatre vecteurs suivants :
– une évolution des paradis fiscaux vers plus de régulation et de transparence, permettant d’identifier les personnes, d’appréhender les activités réelles, de tracer les flux et d’analyser les risques. Compte tenu des risques systémiques associés à l’opacité actuelle des entités établies dans les paradis fiscaux, cette évolution est une avancée significative ;
– une ouverture des paradis fiscaux par la mise en œuvre de procédures performantes d’échange de renseignements, y compris à des fins fiscales. Certains regrettent que la voie choisie n’ait pas été l’échange automatique d’informations. Une telle option aurait condamné à l’échec le processus. Reste toutefois à s’assurer que les engagements seront tenus en pratique par une coopération effective. Tel est l’enjeu majeur et le gage de la crédibilité des États qui ont fait de la lutte contre les paradis fiscaux un impératif de régulation du système financier. Tout laxisme dans la mise à jour des listes grises est susceptible d’être fatal ;
– le contournement des États et territoires par la mise en œuvre de procédures d’information, de documentation et de contrôle directement avec les entités qui y sont établies ou concernant des revenus qui y sont localisés. Ce sont toutes les propositions en matière d’obligations déclaratives, de droit de communication des administrations et d’agréments fiscaux, particulièrement d’un système d’intermédiaire qualifié amélioré ;
– le durcissement des dispositifs de rétorsion en direction des États et territoires non coopératifs, particulièrement concernant les flux et opérations affectant les entreprises.
Dans cette optique, la France doit continuer à participer activement aux travaux conduits au sein de l’OCDE et de l’Union européenne. Elle doit aussi, maintenant que le contexte international s’y prête et en concertation avec ses partenaires, réaménager son droit interne, tant en matière de régulation financière et bancaire, que de législation et de contrôle fiscaux. Enfin, elle doit trouver le moyen approprié de doter ses agents des impôts de pouvoirs leur permettant d’investiguer. Cette condition est indispensable si la France souhaite se doter de toute la palette des outils permettant de mieux appréhender les actifs ou revenus dissimulés dans des zones qui demeureraient opaques, ou tout simplement de pouvoir effectivement utiliser, sur la base de renseignements ainsi obtenus, les conventions d’assistance administrative qui, enfin, voient le jour.
En tout état de cause, sur tous ces fronts, les mois qui viennent seront décisifs.
Au cours de sa réunion du jeudi 10 septembre 2009, la Commission examine, en application de l’article 145 du Règlement, le présent rapport d’information.
M. Didier Migaud, Président. Mes chers collègues, nous sommes aujourd’hui réunis pour l’examen du rapport de la mission d’information mise en place en décembre dernier sur les paradis fiscaux, que j’ai présidée et dont est également membre notre collègue Gilles Carrez, Rapporteur général. Cette mission est en outre composée, dans le respect du pluralisme, par M. Jean-Pierre Brard pour le groupe GDR, M. Henri Emmanuelli pour le groupe SRC, M. Jean-François Mancel pour le groupe UMP et M. Nicolas Perruchot pour le groupe NC.
Ce rapport retrace l’historique des paradis fiscaux, en propose une définition, et fait état des tentatives passées et plus récentes dans le combat contre les paradis fiscaux. Les auditions que nous avons menées ont également permis de soulever des points problématiques. Si les initiatives récentes vont dans le bon sens, elles méritent toutefois d’être concrétisées. En effet, l’adoption de la liste grise de l’OCDE par le G20 en avril dernier est le fruit d’un compromis politique, ce qui suffit à montrer l’insuffisance des initiatives prises, qu’il faut en tout état de cause poursuivre, tant au plan international – je pense au très prochain sommet de Pittsburgh, qui réunira le G20 le 24 septembre prochain –, qu’au niveau européen, avec notamment la refonte de la directive épargne, et enfin, sur le plan interne.
Nous proposons ainsi un ensemble de mesures qui s’inscrivent dans le mouvement global de régulation financière et bancaire tout en préconisant un renforcement des moyens de l’administration fiscale pour lutter contre les paradis fiscaux.
Deux principes ont guidé notre démarche : d’une part, la transparence, qui nous a conduits à préconiser de nouvelles obligations déclaratives concernant l’ensemble des mouvements de fonds vers ces territoires non coopératifs, et d’autre part, l’efficacité de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales via les paradis fiscaux, qui nous a conduits notamment à proposer la mise en place d’un service fiscal judiciaire, composé d’agents dotés des pouvoirs d’officier de police judiciaire.
Ce rapport exprime les opinions de l’ensemble des membres de la mission.
Je signale également que le Rapporteur général et moi-même avons eu des rencontres régulières avec le ministre des comptes publics, notamment depuis l’affaire du Liechtenstein. Sur ce dernier point, des redressements sont en cours et trois dossiers ont été transmis à la justice, dossiers qui représentent 85 % des montants en jeu. Nous avons également pu consulter la liste des 3 000 personnes détentrices de comptes en Suisse, dont Bercy est en possession et sur laquelle des investigations sont en cours.
M. Gilles Carrez, Rapporteur général. Parmi les propositions de la mission d’information, figure un ensemble de dispositions fiscales. L’arme fiscale a un effet dissuasif. Nous avons commencé à en user en loi de finances rectificative pour 2008 avec l’allongement des délais de reprise et la majoration des amendes en cas de non respect des obligations déclaratives. Je tiens à insister sur le fait que les propositions concernent également les personnes morales. On a pu lire ici et là des réflexions sur le fait que seuls les particuliers seraient concernés par la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, notamment suite à l’annonce de la possession d’une liste de 3 000 personnes détentrices de comptes en Suisse, alors que les entreprises organisant des fraudes à grande échelle seraient à l’abri. Le rapport propose de se doter d’un arsenal de mesures équilibrées.
S’agissant des personnes morales, il s’agit d’abord de mettre en œuvre une fiscalité défavorable aux flux en provenance ou à destination des paradis fiscaux (exclusion des régimes favorables, limites de déductions, retenues à la source), complétée par le renforcement des dispositifs anti-abus. Une attention particulière est portée aux prix de transfert pratiqués par les entreprises, qu’elles devront documenter et déclarer. Ensuite, le rapport préconise d’instituer une obligation de déclaration des montages en lien avec les paradis fiscaux. Enfin, les établissements financiers doivent être astreints à des obligations déclaratives nouvelles permettant à l’administration de détecter la fraude et l’évasion fiscales.
Pour établir et réprimer la fraude, comme l’a souligné notre Président, il est aussi nécessaire de disposer d’un service d’enquêtes avec des agents des services fiscaux disposant de la compétence d’officier de police judiciaire, placés sous l’autorité d’un juge.
M. Henri Emmanuelli. Je suis plus sceptique que vous. Les propositions de la mission d’information vont dans le bon sens, mais aucune avancée concrète n’a eu lieu pour l’instant. La dernière opération de communication du ministère du Budget, autour de la liste des 3 000 « évadés fiscaux », n’incite d’ailleurs pas à l’optimisme.
M. le Président Didier Migaud. Le ton de notre rapport d’information est prudent. Il est excessif de dire qu’aucune avancée n’a été réalisée : nous avons par exemple pu le constater à propos de trois importants dossiers relatifs au Liechtenstein. Mais, bien évidemment, il appartiendra à notre Commission de régulièrement interpeller le Gouvernement afin de s’assurer que toutes nos propositions ne restent pas lettre morte.
M. Henri Emmanuelli. La mission d’information suggère de créer, pour les professions juridiques et financières, une obligation de déclarer les montages réalisés pour leurs clients en lien avec les paradis fiscaux. Pourtant, le texte de la proposition de loi adoptée hier ne va guère dans ce sens s’agissant des experts comptables.
M. le Président Didier Migaud. Un amendement est prêt pour revenir sur cette disposition. Il faudra que notre Commission l’adopte.
M. le Rapporteur général. Concernant le Liechtenstein, un accord est en vue pour deux des trois dossiers, tandis qu’un seul nécessiterait une décision judiciaire. Les douanes sont en charge de ce dossier et disposent de pouvoirs judiciaires.
M. Henri Emmanuelli. Les douanes abusent parfois du recours à la transaction.
M. le Président Didier Migaud. Le principe même de la transaction n’est pas condamnable. C’est au cas par cas qu’il faut déterminer s’il est préférable de saisir la justice.
M. Jean-Pierre Brard. La fraude et l’évasion fiscales posent un véritable problème de sanction. La transaction est souvent efficace, mais la discrétion de la procédure empêche tout effet de dissuasion. Une stigmatisation publique, au moyen d’une sanction pénale, est parfois préférable au « secret des services ». Encore faut-il que les magistrats se montrent suffisamment sévères, ce qui est rarement le cas.
Concernant les propositions de la mission d’information, l’optimisme est tempéré et la cohérence assurée avec les orientations suggérées dans le cadre de ce que la presse nomme le « G 24 », c’est-à-dire le groupe de travail Assemblée - Sénat sur la crise financière.
Quant aux décisions arrêtées au plan mondial dans le cadre du G 20, elles apparaissent pour l’instant purement symboliques, dès lors que ni le Delaware, ni Hong Kong et Macao ne figurent parmi les listes d’États non coopératifs. Le fait que Monaco y figure en revanche témoigne de la faible influence de la France au sein du G 20.
M. Daniel Garrigue. Les propositions de la mission d’information complètent utilement celles du rapport que j’ai présenté en juillet avec Mme Elizabeth Guigou au nom de la commission des affaires européennes, à propos notamment de la directive sur la fiscalité de l’épargne. Toutefois, nous n’en sommes encore qu’au début du processus de lutte contre les paradis fiscaux : le risque est que toutes ces bonnes intentions soient dénuées d’effet, comme cela avait été le cas au début des années 2000.
Il y a trois « batailles » distinctes à mener. La première doit être conduite au sein de l’OCDE, à propos de la constitution des listes d’États non coopératifs, ainsi que des modalités de sortie de ces listes. C’est un point très important puisque les propositions de modification de la législation fiscale formulées par la mission d’information renvoient à ces listes d’États. La deuxième bataille concerne l’Union européenne et, en particulier, la directive « épargne ». Avant les élections de juin, le Parlement européen avait proposé d’importants amendements à cette directive afin de lutter contre les paradis fiscaux et de développer des mécanismes de déclaration automatique de renseignements. Il n’est pas sûr que le nouveau Parlement européen reprenne ces amendements, ni qu’ils soient retenus par le Conseil Ecofin qui se réunira en octobre. Enfin, la troisième bataille est à mener au sein du G 20. Elle excède d’ailleurs la seule question des paradis fiscaux. Devront également être abordés les problèmes de blanchiment d’argent ainsi que les « paradis financiers », tels que les marchés de gré à gré de produits dérivés. Il conviendra également d’être particulièrement vigilant quant au devenir de la directive sur les fonds alternatifs (hedge funds) et aux propositions du commissaire Mac Creevy. La réunion du G 20 à Pittsburgh en septembre prochain sera donc décisive.
M. le Président Didier Migaud. Les opinions exprimées sont partagées par la mission. On constate en effet des avancées mais elles restent fragiles et les conditions du succès de la démarche ne sont pas encore réunies. La clé sera notamment dans la mise en œuvre et le suivi des décisions prises. Les trois défis évoqués par Daniel Garrigue se retrouvent dans le rapport. Dans le cas de la directive « épargne » par exemple, il faut que la France défende la suppression de la retenue à la source et force ses partenaires à échanger les informations. La mise en œuvre sera donc primordiale et notamment l’interprétation des nouvelles conventions fiscales sera cruciale. Je rappelle que nous avons voté une disposition prévoyant la remise par le Gouvernement d’un bilan annuel de ces conventions. Nous proposons que les conventions soient dénoncées si l’interprétation qui en est faite est contraire à l’intention initiale exprimée par les parties.
M. Henri Emmanuelli. Les travaux en cours vont dans le bon sens, mais je m’inquiète de l’absence d’avancées sur plusieurs dossiers. La question des bonus, par exemple, demeure. Seuls les Pays-Bas ont pris une décision efficace en les taxant à hauteur de 30 %. Le fait de les étaler sur trois ans ne règle pas le problème, et seule une disposition législative peut avoir une portée. De même, l’affaire de la liste des 3 000 personnes détenant un compte en Suisse a une portée limitée à la communication du Gouvernement.
M. le Président Didier Migaud. Je partage les vues qui ont été exposées, notamment en ce qui concerne les bonus. Sur les paradis fiscaux, des dispositions législatives peuvent être adoptées et je crois que telle est la volonté du ministre des comptes publics. Le but de la mission est de concrétiser ses propositions, et non de se contenter de communiquer sur le sujet.
M. Henri Emmanuelli. Les résultats du contrôle fiscal seront la preuve de la réussite ou de l’échec de la lutte contre les paradis fiscaux.
M. le Rapporteur général. Je partage également les opinions qui ont été exprimées et je crois qu’il convient de rester prudent, le processus engagé n’en étant qu’à ses prémices. L’accent doit être porté sur le suivi. Au début des années 2000, les mesures proposées par l’OCDE n’avaient pas eu d’effet en raison de l’absence de suivi. Aujourd’hui en revanche, l’application des conventions fiscales doit être contrôlée et il devrait être possible de les dénoncer si elles ne sont pas appliquées correctement. Une grande vigilance est requise et une cellule de veille pourrait être mise en place au sein de la Commission, qui travaillerait en coopération avec les services de Bercy. Par ailleurs, en ce qui concerne les bonus, l’arme fiscale constitue également une solution. Enfin, il est nécessaire d’assurer une meilleure documentation sur les prix de transfert et une communication systématique sur les montages d’optimisation.
M. le Président Didier Migaud. En ce qui concerne les stock-options, un texte est nécessaire. Le fait que les réunions des dirigeants des grandes banques se répètent périodiquement montre que le problème n’est pas réglé.
M. Jean Launay. Comment la liste de 3 000 noms de personnes détenant un compte en Suisse a-t-elle été établie ? Quelle est la proportion de ces personnes relevant de la délinquance financière ? Comment mettre en place une police fiscale ? Je pense que ces précisions sont utiles car elles permettent de mieux expliquer notre démarche, d’assurer l’effectivité à long terme des mesures prises, de renforcer la confiance dans la justice fiscale et de participer au rééquilibrage de nos finances publiques.
M. le Président Didier Migaud. La liste de 3 000 noms a été obtenue par des sources non anonymes et non rémunérées, ainsi que par les contrôles exercés par l’administration fiscale, notamment sur l’obligation de déclaration à laquelle les banques sont soumises. Tous ces comptes ne sont pas frauduleux. Ils peuvent par exemple concerner des personnes travaillant en Suisse. Des investigations doivent être menées pour déterminer le caractère délictueux des comptes.
M. Marc Goua. Les mesures proposées qui concernent les établissements de crédit s’appliqueraient-elles également à leurs filiales ?
M. le Président Didier Migaud. Oui.
M. Marc Goua. Je souhaiterais également soulever le problème du contrôle des sociétés de fiducie, installées au Luxembourg ou en Suisse, et qui offrent des produits ou des services en France.
M. Daniel Garrigue. Les sociétés de fiducie pourraient effectivement devenir des structures opaques. Il existe un risque d’affaiblissement de leur encadrement.
M. le Président Didier Migaud. La question est pertinente et montre la nécessité d’un processus de suivi et de l’importance de l’obligation de déclaration et de transparence.
M. François Scellier. On constate un changement d’état d’esprit. Longtemps, il a semblé que le contrôle fiscal concernait les petits contribuables, sans que les gros patrimoines ne soient inquiétés, ce qui semble être en train de changer. Les propositions de la mission sont satisfaisantes mais l’essentiel se jouera dans le suivi.
M. Didier Migaud, Président. Je partage ce point de vue.
M. Jean-François Lamour. Je serais moins optimiste car je crois que les changements constatés sont purement conjoncturels. Le fonctionnement des transactions financières reste un enjeu d’importance. A l’occasion de mon travail sur le projet de loi relatif aux jeux en ligne, j’ai appris que des transactions financières pouvaient être réalisées sans limites et de manière anonyme, ce qui posait de gros problèmes à Tracfin dans sa lutte contre le blanchiment. Ma question porte sur le calendrier et l’éventuelle implication de l’exécutif et de la Commission européenne dans la mise en œuvre des recommandations de la mission.
M. le Rapporteur général. J’aurais pour ma part une question pour Daniel Garrigue sur la directive « épargne ». Existe-t-il des chances d’aboutir à un résultat satisfaisant sur ce texte ? Il semble que le Parlement européen et la Commission aient une réelle volonté d’avancer.
M. Daniel Garrigue. Il est vrai que des éléments positifs sont prévus dans le projet de directive. Une question demeure néanmoins : le nouveau Parlement va-t-il reprendre les amendements qui avaient été déposés avant les élections ? Quoi qu’il en soit, le fond du problème reste l’attitude de la Belgique, de l’Autriche et surtout du Luxembourg. Pour qu’ils renoncent à la retenue à la source, il faut que soient signés des accords avec les paradis fiscaux européens et avec les Etats-Unis, puis que le Conseil européen se prononce à l’unanimité, ce qui laisse un droit de veto au Luxembourg. Une telle avancée pourrait toutefois constituer un premier pas vers une harmonisation fiscale.
M. le Président Didier Migaud. Comme l’indique le rapport, il faut que les propositions de la mission soient défendues au niveau européen. Il existe le risque que le soufflé retombe. A cet égard, l’intérêt du G 20 est de permettre de mesurer le chemin parcouru entre deux sommets. Depuis Londres, peu d’avancées ont été constatées sur le sujet des paradis fiscaux. Une traduction législative paraît nécessaire et pourrait trouver place dans le prochain projet de loi de finances.
M. Henri Emmanuelli. Attention à ne pas faire preuve de naïveté quant aux réactions des paradis fiscaux : ceux-ci ne vont pas se laisser faire ! Par exemple, l’ambassadeur du Luxembourg m’a récemment expliqué que son pays devait faire face à la « concurrence » d’autres États et que le niveau de vie du Luxembourg risquait d’être menacé par les mesures de lutte contre les paradis fiscaux. Une forte pression des autres États sera donc indispensable.
M. le Président Didier Migaud. Nous avons également reçu différentes délégations tenant des discours similaires. Cela n’a pas empêché la mission d’information de leur opposer un langage de fermeté.
La Commission autorise la publication du présent rapport d’information.
ANNEXE 1 :
LISTE DES PROPOSITIONS DE LA MISSION D’INFORMATION
→ Doter la France de sa propre liste de territoires non coopératifs. I.– Renforcer la régulation financière et bancaire 1.– Les établissements de crédit → Renforcer les règles de bonne gouvernance des établissements de crédit en matière de contrôle interne. → Dans le cadre d’une réforme plus globale des règles prudentielles applicables aux banques, établir des contraintes spécifiques, notamment en termes de fonds propres, pour les établissements en relation avec des territoires non coopératifs. 2.– Les sociétés cotées → Imposer la publication en annexe du rapport annuel de l’ensemble des activités menées par les sociétés cotées en lien avec des paradis fiscaux et territoires non coopératifs ou la publication d’une information générale faisant figurer les filiales et les activités, complétée par une information détaillée annuelle à destination de l’Autorité des marchés financiers (AMF). → Restreindre l’accès au marché français des filiales de sociétés mères établies dans des territoires non coopératifs et qui ne respectent pas des normes prudentielles et comptables minimales. Assortir ce dispositif d’un droit de suite, permettant à l’Autorité des marchés financiers (AMF) de contrôler ces sociétés mères. 3.– Les sociétés de gestion de produits d’épargne collective et de services d’investissement → Interdire la commercialisation des produits proposés par des prestataires de services d’investissement qui passent par des entités établies dans des territoires non coopératifs. 4.– Les sociétés d’assurance → Prévoir la publication d’informations relatives aux avoirs détenus, aux revenus localisés, aux filiales établies et aux activités conduites (y compris commerciales) dans les paradis fiscaux et territoires non coopératifs, complétées par des informations détaillées annuelles à destination de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM). → Imposer aux sociétés d’assurance et de réassurance qui détiennent des avoirs ou localisent des revenus dans les territoires non coopératifs une exigence de fonds propres supplémentaires. 5.– Les pavillons de complaisance → Interdire l’accès, aux eaux territoriales françaises, des bateaux battant pavillon de complaisance enregistrés dans les paradis fiscaux et réglementaires. II.– Doter l’administration des moyens de détecter et de réprimer la fraude et l’évasion fiscales 1.– Relancer les négociations européennes sur l’assistance administrative → Défendre la fin du régime transitoire de retenue à la source dans le cadre de la renégociation de la directive épargne et généraliser l’échange automatique d’informations pour l’ensemble des revenus de l’épargne perçus directement ou indirectement par les particuliers. → Instaurer un droit de suite en matière de contrôle fiscal au niveau de l’Union européenne et renforcer les instruments européens de lutte contre la fraude fiscale. 2.– Créer de nouvelles obligations déclaratives → Instaurer une obligation pour les établissements financiers de déclarer tout mouvement financier, tout compte ouvert, tout produit ou montage en lien avec un territoire non coopératif. → Créer, pour les professions juridiques et financières, une obligation de déclarer les montages réalisés pour leurs clients en lien avec les paradis fiscaux. → Mettre en place un système d’agrément fiscal soumettant les établissements payeurs à l’obligation de : – s’assurer de l’identité du bénéficiaire effectif des revenus, pour l’application des taux de retenue à la source ; – transmettre les informations à l’administration fiscale de résidence du bénéficiaire. → Instaurer une obligation de déclaration systématique des prix de transfert pratiqués par les entreprises. → Porter la durée du délai de consignation des sommes transférées non déclarées de 3 à 6 mois renouvelables une fois sur autorisation du parquet. → Programmer des campagnes de communication et d’information sur les risques liés aux transactions avec les paradis fiscaux. 3.– Limiter certains avantages fiscaux → En présence de flux en provenance ou à destination de territoires non coopératifs, exclure l’application des règles fiscales favorables ou majorer les taux d’imposition. → Dénoncer les conventions fiscales d’élimination des doubles impositions conclues avec les États qui ne coopèrent pas ou coopèrent insuffisamment en matière d’assistance administrative sur les questions fiscales. → Restreindre le champ de la déductibilité, pour une entreprise, des intérêts servis aux associés et aux entreprises liées qui opèrent dans un territoire non coopératif. 4.– Étendre la présomption d’évasion fiscale → Instaurer une présomption de transferts de revenus dès lors qu’une contrepartie est établie dans un territoire non coopératif, à charge pour l’entreprise de démontrer, comptes à l’appui, que l’implantation est effective et que les prix pratiqués sont des prix de pleine concurrence. → Instaurer une présomption d’assujettissement à l’ISF des biens ou droits mis en trust ou dans une structure équivalente. 5.– Renforcer les dispositifs anti-abus → Renforcer le dispositif de taxation des bénéfices réalisés dans un pays à fiscalité privilégiée, par un renversement de la charge de la preuve ou une obligation de communication des comptes. 6.– Accroître les moyens de contrôle → Créer un service fiscal d’enquêtes composé d’agents disposant de la qualité d’officier de police judiciaire sous l’autorité du parquet. → Renforcer les moyens humains de TRACFIN. → Fixer les seuils d’interdiction de paiement en espèces à 3 000 euros pour les particuliers et à 1 100 euros pour les commerçants. → Promouvoir, à l’échelle européenne, la suppression du billet de 500 euros. → Mettre en place, au niveau international, un fichier recensant les comptes bancaires sur le modèle du fichier FICOBA. → Mettre en place, au niveau international, un registre ou fichier d’informations permettant de connaître l’identité réelle des bénéficiaires, propriétaires et dépositaires. → Elargir le droit de communication de l’administration fiscale pour lui permettre de se faire communiquer des informations sur une base non nominative. |
ANNEXE 2 :
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LA MISSION D’INFORMATION
OCDE :
– M. Pascal Saint-Amans, chef de la division coopération internationale et compétition fiscale
Transparency International France
– M. Daniel Lebègue, Président
Ministère de l’économie, des finances et de l’emploi :
– M. Jean-Baptiste Carpentier, directeur du service TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
– Mme Marie-Chistine Lepetit, directrice de la législation fiscale, et M. Chistian Comolet-Tirman, sous-directeur de la prospective et des relations internationales
– M. Philippe Parini, directeur général des finances publiques, M. Jean-Marc Fenet, directeur adjoint chargé de la fiscalité, M. Roland Veillepeau, directeur national des enquêtes fiscales, M. Jean-Louis Gautier, sous-directeur du contrôle fiscal, et Mme Maïté Gabet, chef du bureau affaires internationales
– M. Ramon Fernandez, directeur général du trésor et de la politique économique, et M. Renaud Lassus, sous-directeur « Politique commerciale et investissement »
– M. Jérôme Fournel, directeur général des douanes et des droits indirects, et M. Gérard Schoen, sous-directeur des affaires juridiques et du contentieux, du contrôle et de la lutte contre la fraude
Ministère de la justice :
– Mme Delphine Dewailly, sous-directrice de la justice pénale spécialisée
Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales:
– M. Frédéric Pechenard, directeur général de la police nationale, M. Bernard Squarcini, directeur central du renseignement intérieur, et M. Frédéric Veaux, sous-directeur de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière
Autorité des marchés financiers :
– M. Thierry Franck, secrétaire général
Commission bancaire :
– Mme Danièle Nouy, secrétaire générale, et M. Henri de Ganay, directeur du service et du secrétariat juridique
Association française des banques :
– M. Georges Pauget, Président, et Mme Ariane Obolensky, directrice générale
Syndicat national unifié des impôts :
– M. Vincent Drezet, secrétaire national
Solidaires douanes :
– M. Philippe Bock, secrétaire national
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE PRÉSIDENT ET LE RAPPORTEUR GÉNÉRAL
Plate-forme Paradis fiscaux et judiciaires:
– Mme Marina Yung, Transparence International
– Mme Maud Perdriel-Vaissières, Sherpa
– M. Gérard Gourguechon, Attac
– M. Jean Merckaert, CCFD-Terre solidaire / Coordination PPFJ
– M. Harold Heuzé, Anticor
– Mme Maylis Labusquière, Oxfam France
– M. Antoine Dulin, animateur de la Plate-forme paradis fiscaux et judiciaires
ANNEXE 3 :
AUDITION DE M. ÉRIC WOERTH, MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT
PAR LA COMMISSION DES FINANCES
Au cours de sa séance du 22 juillet 2009, la Commission entend M. Éric Woerth, ministre du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’état, sur les moyens de lutter contre les paradis fiscaux.
M. le président Didier Migaud. Je suis très heureux d’accueillir le ministre Éric Woerth pour l’entendre sur les moyens de lutter contre les paradis fiscaux. Notre Commission a mis en place une mission d’information, dont les travaux seront rendus publics à la rentrée et à laquelle appartiennent, outre le rapporteur général et moi-même, MM. Jean-François Mancel, Henri Emmanuelli, Jean-Pierre Brard et Nicolas Perruchot.
Vous avez, Monsieur le ministre, avec le ministre des finances allemand, été à l’origine d’une reprise des travaux de l’OCDE sur le sujet. Le dernier G20 a entériné les listes des paradis fiscaux et posé le principe de sanctions. Une conférence de l’OCDE s’est tenue à Berlin le 23 juin. Enfin, la question a été inscrite à l’ordre du jour du prochain G20, qui se tiendra au mois de septembre à Pittsburgh. Comme elle avait déjà été évoquée au sommet de Londres, il sera intéressant de mesurer le chemin parcouru.
Au moment de l’affaire du Liechtenstein, Monsieur le ministre, vous aviez déclaré à la Commission des finances que la France paraissait moins bien armée que d’autres pays, au niveau de son organisation administrative, pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscale. Est-ce toujours le cas ? Avez-vous à cet égard des propositions à formuler ?
Pouvez-vous aussi commenter les résultats de la conférence de Berlin ? Il est question de sanctions, mais quelles sont celles qui sont réellement envisageables ? Tous les États membres de l’OCDE abordent-ils le problème avec la même volonté ? Ont-ils la même définition de la levée du secret bancaire et de l’échange d’informations ? Quelles sont les perspectives d’avancées au prochain G20 ?
Sur le plan européen, quelle sera la position de la France sur les directives concernant la fiscalité de l’épargne et les échanges d’informations ? Certains plaident au Parlement européen pour un échange automatique d’informations.
Pouvez-vous par ailleurs nous faire part des accords en cours de signature sur des dispositifs de lutte contre l’évasion fiscale ? Comptez-vous renforcer les moyens de lutte dans le prochain projet de loi de finances ? Enfin, où en êtes-vous en ce qui concerne le projet d’un service fiscal judiciaire, sur lequel notre Commission entendra aussi la garde des sceaux et le ministre de l’intérieur.
M. Éric Woerth, ministre du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État. Dans la lutte contre les paradis fiscaux, les centres off shore et les juridictions non coopératives, il est essentiel de disposer d’une vision d’ensemble recouvrant les volets d’évasion fiscale, de dérégulation financière et de blanchiment d’argent. Je n’évoquerai pour ma part que l’aspect fiscal, le reste incombant à Christine Lagarde.
Le 21 octobre 2008, une conférence de l’OCDE s’est réunie à Paris, à mon initiative et à celle de Peer Steinbrück, le ministre des finances allemand, sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales internationales. Elle a permis de commencer à travailler sur les paradis fiscaux, et notamment à en établir la liste. Le G20 a repris nos propositions, ce qui a donné un coup d’accélérateur à notre travail. Comme dans le même temps Américains et Suisses étaient en train de se battre à coups de demandes d’informations, l’idée de la fin du secret bancaire en vue d’évasion fiscale a commencé à s’imposer. Le 23 juin, une nouvelle conférence a eu lieu, toujours en présence de l’OCDE, à Berlin, sur le suivi du G20 de Londres et les perspectives de celui de Pittsburgh. Elle s’est aussi penchée sur les possibilités de contournement des obligations d’échange d’informations fiscales, notamment par le biais des entités qui rendent ces informations très difficilement accessibles, comme les trusts et les fondations.
Il existe une liste noire des paradis fiscaux, qui comprend les quatre États qui ne se sont engagés à rien en matière de transparence fiscale : le Costa Rica, la Malaisie, les Philippines et l’Uruguay. Sur la liste grise figurent les quarante-deux pays ou territoires qui ont pris l’engagement d’appliquer l’article 26 de la convention modèle de l’OCDE régissant les échanges d’informations financières et fiscales, mais qui ne le mettent pas en œuvre en l’état. Or, l’une des conclusions majeures de la conférence de Berlin a été de mettre en place, au sein d’un forum mondial élargi, une procédure d’évaluation de l’effectivité des échanges de renseignements, basée sur une procédure de revue par les pairs. Le défaut d’échange effectif entraînera des mesures de rétorsion. Il est dorénavant très clair qu’il ne suffira pas de signer les accords.
Les conclusions de la conférence de Berlin mentionnent quelques possibilités de mesures de rétorsion, dont l’application dépend toutefois des droits nationaux. Il s’agit principalement de l’augmentation des retenues à la source sur une grande variété de versements effectués à destination des juridictions non coopératives, de la non-déductibilité des charges correspondant à des paiements effectués au profit de leurs résidents – ce qui concerne en particulier le régime des sociétés mères-filles – ou de la dénonciation des traités signés avec des pays ou territoires refusant l’échange effectif d’informations.
Le sujet des paradis fiscaux est aussi traité au niveau européen. La directive sur les revenus de l’épargne instaure une transmission automatique d’informations entre les États membres de l’Union européenne et, à titre transitoire, un dispositif alternatif de retenue à la source pour l’Autriche, le Luxembourg et la Belgique. Les dispositions de cette directive ont été étendues à certains États tiers : Suisse, Liechtenstein, Saint-Marin, Monaco et Andorre. Sont également concernés les territoires associés anglais (Anguilla, Montserrat, Îles Cayman, Jersey, Guernesey, Île de Man, Îles Vierges britanniques, Turks et Caïcos) et les territoires associés néerlandais (Antilles néerlandaises et Aruba).
Les conditions de passage à l’échange automatique pour les pays concernés par la retenue à la source semblent maintenant réunies puisque tous les pays sont conduits à conclure des accords prévoyant l’échange de renseignements selon l’article 26 de la convention modèle de l’OCDE. Cet article 26 est traditionnellement utilisé au cas par cas, mais n’en permet pas moins l’échange automatisé des données.
Nous avons déjà signé de nombreux accords, à un rythme quasi hebdomadaire. La plupart des pays sont bien disposés à l’égard de cette démarche. Dans la majorité des cas, il suffit d’un avenant à la convention fiscale qui nous lie déjà pour intégrer l’article 26 de la convention de l’OCDE. Mais il y a d’autres pays, de véritables paradis fiscaux, avec lesquels nous ne sommes liés par aucune convention fiscale et avec lesquels il ne faut surtout pas en signer car cela reviendrait à accepter leurs propres normes. Avec eux, nous signons des conventions simples – et non fiscales – d’échanges d’informations. Cela a été le cas il y a quinze jours avec les Îles Vierges britanniques.
Enfin, la direction générale des finances publiques a mis en place un service, la fameuse cellule de régularisation fiscale, chargée de répondre aux questions que se posent les gens dont les comptes dans les paradis fiscaux seront dévoilés après la levée effective du secret bancaire. Nous avons déjà reçu six cents appels. Nous en aurions reçu beaucoup plus si ces gens s’attendaient à être amnistiés sans histoires, mais ce n’est pas l’objet de la cellule. Le but est plutôt d’engager la discussion avec eux et de leur proposer une solution de retour, sans quoi ils ne rapatrieront toujours pas leurs fonds. En pratique, ils paieront l’impôt normalement dû, parce qu’il ne peut en aller autrement vis-à-vis des autres contribuables français, mais les pénalités seront négociées. Lorsque le dispositif sera en régime de croisière, après la levée effective du secret bancaire, et que les gens commenceront à savoir comment cela fonctionne, nous aurons un afflux de demandes de régularisation.
Il y a trois grandes catégories de régularisations. La première concerne des personnes ayant hérité ou bénéficié d’une donation d’avoirs à l’étranger et qui les y ont laissés, en connaissant les avantages qu’elles en retirent mais sans les avoir recherchés elles-mêmes. La seconde est celle des expatriés qui ont ouvert un compte tout à fait régulier là où ils vivaient et l’ont conservé sans le déclarer à leur retour en France. La dernière est celle des touristes fiscaux, qui cherchent à optimiser illégalement leur fiscalité. Il y a évidemment des différences de traitement entre ces catégories.
Par ailleurs, un nouveau paquet de mesures est envisagé dans le prochain projet de loi de finances. Il s’agit notamment de l’alourdissement des retenues à la source sur les revenus passifs à destination des juridictions non coopératives, dont le taux serait porté à 50 %, et du renforcement des mesures anti-abus, rendues plus systématiques. Ainsi, la déductibilité de certains paiements effectués à des personnes domiciliées dans des pays au régime fiscal privilégié serait subordonnée à la démonstration par le débiteur de la réalité de la prestation, qui ne doit en outre pas être exagérée. Les versements faits à une personne morale ou physique domiciliée ou établie dans un État non coopératif ne seraient par ailleurs jamais déductibles. Une autre piste serait de soumettre les institutions financières françaises à des obligations accrues en matière de divulgation d’informations.
Quant à la création d’un service fiscal judiciaire, j’y suis très favorable, mais il faut encore faire preuve d’un peu de pédagogie avant que l’idée ne soit acceptée. Il s’agirait en effet d’un pouvoir supplémentaire donné à l’administration fiscale, qui n’a traditionnellement chez nous que très peu d’activité judiciaire. Pour l’instant, lorsqu’ils veulent transmettre un dossier à la justice, les services fiscaux doivent présenter à la commission des infractions fiscales un dossier complet qui prouve l’existence d’un problème pénal nécessitant l’intervention judiciaire. Mais, souvent, leur enquête s’arrête très vite car ils n’ont justement pas de pouvoirs judiciaires. La création d’un service fiscal judiciaire permettrait de répondre à cette situation. Il faut bien faire comprendre que ce service serait destiné à s’attaquer à la grande fraude, qui met en œuvre des montages, des structures et des comportements bien déterminés, mais aucunement à la fraude « de tous les jours », qui est parfaitement traitée par l’administration fiscale ; ce ne serait pas une police nouvelle qui viendrait restreindre les libertés, mais une arme dont nous avons besoin contre la fraude de grande ampleur. La collaboration avec la police judiciaire sera sereine parce que le but de ce service sera de renforcer non pas le pouvoir, mais l’efficacité de l’administration fiscale.
Nous allons continuer de travailler sur le sujet, de rassurer et de montrer que d’autres pays disposent de tels pouvoirs judicaires. Je ne désespère pas d’aboutir.
M. Gilles Carrez, rapporteur général. Beaucoup de choses ont été faites récemment en ce qui concerne les paradis fiscaux, mais toute la question est de savoir si les décisions de principe seront suivies d’effets.
Vous dites que l’article 26 de la convention modèle de l’OCDE autorise les échanges automatiques d’informations entre États signataires. Mais comme ces renseignements doivent être « vraisemblablement pertinents », il sera bien facile à un État de trouver de bonnes raisons pour ne pas les communiquer !
Il existe une convention fiscale franco-suisse, mais la définition de la fraude fiscale n’est pas la même des deux côtés. Les Suisses peuvent donc refuser de donner tout renseignement qui n’entrerait pas dans le cadre de leur propre acception de la fraude fiscale ! Autre exemple : la directive sur l’épargne permet à l’Autriche, la Belgique et le Luxembourg de ne pas communiquer d’informations en échange d’un prélèvement à la source. Cette disposition n’a pas été éliminée dans le cadre de la révision de la directive, alors que son principe même est contraire à l’article 26. Cet article commence-t-il donc vraiment à être appliqué ? Où en est la coopération entre les administrations fiscales ? Les conventions fiscales que vous avez récemment signées seront-elles respectées ?
Quant au fait de donner des pouvoirs judiciaires à l’administration fiscale, cela paraît une idée de bon sens. Depuis très longtemps, les douanes se voient confier par la justice ou la police le soin d’enquêtes à l’aspect fiscal ou financier très important, parce que les ministères de l’intérieur et de la justice n’ont pas les compétences nécessaires. Pourquoi refuseraient-ils de conférer des pouvoirs judiciaires aux services fiscaux, de façon très encadrée et sous l’autorité d’un magistrat ? Pourtant, cette idée suscite une réticence générale. Où est le blocage, et comment pourrions-nous vous aider à progresser ? Trouve-t-il son fondement dans des principes philosophiques ou, une fois de plus, dans une guerre entre services ?
Quoi qu’il en soit, c’est maintenant qu’il faut agir. Tout le monde est conscient du problème et il ne faut pas attendre que l’air du temps s’y prête moins.
M. le ministre. L’article 26 de la convention modèle n’interdit pas l’échange automatique d’informations, mais il ne le requiert pas non plus. Dans la pratique courante, il est utilisé pour des demandes ponctuelles. Lorsqu’un contrôle fiscal fait apparaître des fraudes à l’étranger, l’administration française demande les informations dont elle a besoin à l’administration de l’autre pays. Grâce à l’article 26, elle dispose d’un correspondant : une fois que la demande est transmise, c’est à l’administration étrangère de procéder à toutes les vérifications requises. Il suffit d’affirmer qu’elles sont nécessaires dans le cadre d’un contrôle fiscal, sans avoir à donner de détails. De même, toujours grâce à cet article, il n’y a plus de divergence d’interprétation de la définition de la fraude : il suffit de dire qu’il s’agit d’une fraude fiscale dans votre propre pays. Jusqu’à présent, de tels problèmes d’interprétation étaient fréquents. Par ailleurs, l’État ne peut pas se soustraire à son obligation de renseignement sous le prétexte que l’information n’existe pas, dans le cas d’un trust ou d’une fondation, par exemple. C’est là aussi une évolution considérable ! En conséquence, les États doivent veiller à ce qu’aucun système ne permette l’anonymat et rectifier le cas échéant leur propre législation. Au final, sans prétendre que tout fonctionnera pour le mieux dès le début, je pense que tous ces sujets sont bien traités par l’article 26.
Outre l’échange ponctuel, l’article 26 permet aussi l’échange automatisé de données, mais il est peu utilisé en ce sens. En revanche, le sujet est traité par la directive sur l’épargne, qui est repartie pour une nouvelle négociation, dans laquelle la France est très active, concernant en particulier l’élargissement des produits et personnes concernés par la directive et la question de la diffusion automatique.
Il y a plusieurs types d’échanges automatisés. On peut en prévoir à propos de certains types de produits ou de comportements ou, par exemple, au-dessus de certains seuils de transaction. La directive devrait donner un fondement à ce type d’échange, que nous pratiquons avec les Allemand et les Anglais, mais qui n’est pas possible lorsque les conventions fiscales ne le prévoient pas. C’est pourquoi il faut faire évoluer la directive pour élargir cette pratique.
En outre, de sa propre initiative – et la France le fait – une administration peut envoyer à un pays la liste de l’ensemble de ses ressortissants ayant réalisé un type de transaction déterminé.
Il y a de nombreux progrès à faire pour ces deux types d’échanges, et c’est pourquoi la négociation de la directive est si importante.
Nous pouvons aussi demander aux banques et compagnies d’assurance françaises des informations sur les transactions réalisées vers des pays avec lesquels nous ne sommes liés par aucune convention fiscale ou d’échange d’informations. Les banques y sont bien sûr très réticentes, mais nous y travaillons activement.
Nous sommes donc sur tous les fronts : nous « poussons » l’article 26 de la convention de l’OCDE dans toutes nos relations bilatérales, nous soutenons fortement la directive épargne et nous discutons avec les établissements français.
M. le président Didier Migaud. Ce n’est pas la première fois qu’une volonté s’exprime contre les paradis fiscaux. Le problème est sa concrétisation. Plusieurs listes ont été établies, mais ce qui n’y figure pas est tout aussi édifiant que ce qui y apparaît. Un certain nombre de paradis fiscaux n’y sont pas mentionnés. Nous avons le sentiment que ces listes adoptées par le G20 et l’OCDE sont en fait le résultat d’un compromis entre grands États. Comment améliorer les choses ?
Il faut aussi faire un point d’étape sur le dossier du Liechtenstein.
Par ailleurs, le Parlement a voté une disposition pour faire la transparence sur les antennes dont beaucoup d’établissements financiers et d’assurance français disposent dans des territoires étrangers non coopératifs. En ce domaine, où en sommes-nous ?
M. Jérôme Cahuzac. À vous entendre, monsieur le ministre, on éprouve un sentiment mitigé car, si votre sincérité et votre engagement ne peuvent être mis en doute, il y a quand même loin de la coupe aux lèvres.
Le passé ne nous incite guère à l’optimisme : en 1987, lors du sommet du G7 de Venise, la liste du Groupe d’action financière, le GAFI, a été élaborée et la volonté des autorités publiques, notamment françaises, a été affirmée, de même d’ailleurs qu’aux sommets de Denver, Cologne, Birmingham, ainsi qu’à Lyon. En 2000, la coopération internationale a abouti à l’élaboration de trois listes : outre celle relative à la fraude fiscale, qui vous concerne directement, la liste du forum de stabilité financière, relative aux opérations financières, et la liste du GAFI portant sur le blanchiment. Mais plus rien de 2001 à 2008, à tel point que, et l’excellent rapport de nos collègues Daniel Garrigue et Élisabeth Guigou le montre, à l’automne 2008 la liste du forum de stabilité financière était vide, comme si tous les États assuraient une transparence et une régularité parfaites aux activités financières – la crise a toutefois montré que l’on péchait au moins par optimisme. Et la liste du GAFI était tout aussi vide, les autorités des différents pays, y compris la France, estimant qu’il n’y a plus d’État qui blanchisse de l’argent. Pour sa part, la liste de l’OCDE ne comporte que trois États : Monaco, Andorre, le Liechtenstein, mais aucun de ceux qui viennent d’être cités. Cela ne signifie pas que ces États sont subitement devenus critiquables mais, après que l’on a connu, faute d’une véritable volonté politique, un trou noir de sept années, les choses changent, du moins l’espère-t-on, tout comme on espère que ce changement sera durable, le rapporteur général venant toutefois de faire part de nos doutes.
L’article 26 de la convention de l’OCDE n’induit pas que la notion de fraude fiscale ait la même signification de part et d’autre du lac Léman. Quant à la directive « épargne », rien ne permet de penser que les causes de l’échec précédent ont disparu, et le rapporteur général a eu raison de souligner l’anomalie que constituerait le prélèvement à la source pour prix de l’anonymat. Les autorités françaises sont-elles prêtes à l’accepter dans les négociations européennes ?
S’agissant du retour, il me semble en effet judicieux de distinguer les héritiers, les expatriés et les fraudeurs actifs. Pour autant, vous « négociez », ce qui signifie qu’il y a au moins amnistie partielle dans la mesure où vous ne réclamez pas la totalité de ce qui devrait être dû.
M. le ministre. À l’impôt éludé peuvent s’ajouter des pénalités de retard ainsi que des pénalités liées à la mauvaise foi du contribuable. Les pénalités ne sont jamais automatiques !
M. Jérôme Cahuzac. Estimez-vous qu’un véhicule législatif soit nécessaire pour autoriser la cellule à négocier ?
Enfin, à l’occasion du prochain sommet, la France s’efforcera-t-elle, non seulement pour la liste de l’OCDE, mais aussi pour les deux autres listes, de maintenir l’élan politique impulsé au plus fort de la crise ?
M. Charles de Courson. Même avec l’article 26 de la convention de l’OCDE, on se demande comment lutter contre l’anonymat. Vous avez fait référence, monsieur le ministre, aux fiducies et aux fondations. En Suisse, elles ont à leur tête des hommes et des femmes de paille, souvent de nationalité suisse. Du coup, le citoyen français sur lequel on demande des renseignements est inconnu des services suisses. Qui plus est, les fonds ne sont pas rapatriés dans les pays d’origine par des transferts, mais par le biais de compensations. Comment combattre de tels détournements ?
Que pensez-vous de la solution qui consisterait de porter de 15 à 50 % – soit le niveau du bouclier fiscal – le taux du prélèvement forfaitaire, ce qui priverait l’anonymat de tout intérêt ?
S’agissant de la cellule de régularisation, j’ai ici un document émanant d’un cabinet spécialisé qui explique comment les choses se passent : un avocat prend contact avec la cellule et lui demande comment sera traitée la personne qui déciderait de tout déclarer. En fait, on recalcule l’ISF pour les six dernières années et l’IR pour les trois dernières, puis on ajoute les intérêts et les pénalités. Comme l’a dit le ministre, il n’y a pas de négociation sur le capital mais bien sur les pénalités. Le fisc fait une proposition que l’avocat transmet à son client qui décide à ce moment de révéler son identité. Ne pourrait-on distinguer ceux qui accomplissent une démarche positive de régularisation, par exemple après un héritage, de ceux qui se font prendre, pour lesquels le fisc pourrait être autorisé à remonter deux ou trois fois plus loin dans le temps ?
M. le président Didier Migaud. Le rapporteur général et moi-même nous sommes rendus auprès de la cellule afin de rencontrer les personnels et de voir comment les choses se passent. Nous en ferons état dans le rapport.
M. Daniel Garrigue. Jérôme Cahuzac a mentionné le rapport que j’ai rédigé pour la Commission des affaires européennes en compagnie d’Élisabeth Guigou. Il montre en particulier qu’il ne faut pas minimiser le rôle des paradis fiscaux dans la crise financière car, même s’ils n’en sont pas à l’origine, ils ont souvent servi de refuge à des pratiques financières contestables qui l’ont aggravée.
M. Jérôme Cahuzac. Et ils continuent !
M. Daniel Garrigue. S’agissant des listes, il faut rappeler que celle qui avait été établie en 2000 a été rapidement vidée de son contenu. On peut craindre que le même phénomène ne se reproduise : quelle est la portée réelle des listes noire et grise de l’OCDE s’il suffit pour en sortir de signer douze conventions avec n’importe quels pays ou d’adopter une simple déclaration d’intention ?
En fait, la difficulté tient à la portée réelle de l’article 26. Même s’il a été amélioré en 2006, l’échange d’informations sur demande se heurte à certaines limites, en particulier au fait que ces informations doivent être « vraisemblablement pertinentes » – il faut donc disposer d’indices –, mais aussi au caractère dilatoire de certaines procédures de recours. En fait, ce qui importe, c’est d’évaluer la volonté effective de lever le secret bancaire, donc de prendre des décisions effectives dans le prolongement de la conférence de Berlin.
On a aussi évoqué l’idée de la centralisation des comptes bancaires, mais la France est actuellement le seul pays à y procéder grâce au fichier des comptes bancaires (FICOBA). Ce dispositif a-t-il des chances d’être généralisé en dépit des réticences très fortes de nos partenaires ?
S’agissant de la directive « épargne », pour que l’on passe à l’échange d’informations automatiques avec les pays qui ne l’ont pas accepté jusqu’à présent, il faut préalablement que des conventions modèles de l’OCDE soient passées avec un certain nombre d’autres pays. Si tel est effectivement le cas, pensez-vous qu’il sera véritablement possible d’exercer des pressions suffisamment fortes sur le Luxembourg pour qu’il renonce au statut dont il dispose dans le cadre de la directive « épargne » qui, je le rappelle, suppose une décision unanime du Conseil européen ? Si des progrès ont été accomplis entre la Suisse et les États-Unis, c’est parce que ces derniers ont exercé de fortes pressions dans l’affaire UBS. Au-delà, c’est bien la question de l’harmonisation fiscale au sein de l’Union qui est posée.
Où en est-on par ailleurs de nos relations avec les États-Unis ? Ces derniers font-ils preuve d’une réelle détermination ? On sait que le succès du G20 est étroitement lié à l’existence d’un même niveau d’exigence en Europe et aux États-Unis.
Concernant les sanctions, vous avez évoqué des mesures à caractère fiscal. Mais ne faudrait-il pas aller jusqu’à interdire à nos établissements de fréquenter certains paradis fiscaux, ce qui supposerait une action internationale ?
Enfin, comme le rapporteur général et le président, j’aimerais savoir quelles suites sont données à la liste du Liechtenstein sur laquelle figureraient 200 noms français.
M. Jean-Yves Cousin. Je salue l’ensemble des initiatives prises afin de renforcer la transparence. Le rapporteur général a toutefois évoqué les difficultés rencontrées pour obtenir des réponses claires de la part des établissements. Je souhaite donc savoir de quels moyens de coercition on dispose et quelles sanctions sont prévues.
M. Henri Emmanuelli. Il conviendrait, Monsieur le ministre, que vous nous apportiez plus de précisions sur la question du retour car on a quand même du mal à expliquer à des contribuables qui ont 800 euros de revenu mensuel et qui se voient poursuivis pour une dette de 200 euros que certains parviennent à négocier des pénalités portant sur des dizaines de millions ! Les choses doivent être claires : s’il y a amnistie partielle, il faut un débat public et un cadre législatif afin que les règles soient connues de tous.
Vous vous êtes rendu auprès de la cellule, monsieur le président, mais cette affaire est suffisamment grave pour que l’on nous fournisse des critères précis.
Il est par ailleurs évident que les paradis fiscaux, par lesquels passe la moitié des transactions internationales, sont directement liés à la crise. Même dans un petit département comme le mien, les entreprises en difficulté sont rachetées par des fonds de placements qui continuent à être systématiquement domiciliés au Luxembourg. Cela n’est pas dû au hasard, mais bien au fait qu’ils y trouvent encore un intérêt !
Je crains beaucoup qu’après le grand moment d’émotion liée à la crise le soufflé ne retombe et qu’il ne se passe finalement pas grand-chose. Ne soyons pas naïfs, nous sommes face à un Éverest de difficultés que seule la volonté politique du G20 nous permettra de gravir. Or je nourris beaucoup de doutes sur le caractère pérenne de la volonté qui s’est manifestée à un moment donné. D’ailleurs, les États-Unis évoquent de moins en moins souvent ce sujet et, quand on voit comment se comporte la Banque fédérale américaine, on peut douter des décisions qui seront prises lors du prochain G20.
Quant au contrôle fiscal, aux États-Unis, où l’on ne me semble pas moins soucieux des libertés publiques qu’en France, l’IRS (Internal Revenue Service) est effectivement doté de pouvoirs judiciaires. Chez nous, le ministère de l’économie et des finances le souhaite, de même, et cela m’a surpris, que le ministère de la justice ; mais le ministère de l’intérieur continue de s’y opposer. Comment ne pas penser que, si l’on ne donne pas de pouvoirs suffisants à l’administration, la lutte contre la grande fraude a peu de chances d’aboutir ?
Sur toutes ces questions, nos collègues de la Commission des affaires européennes ont fait un travail très intéressant et je souhaite que la Commission des finances ne soit pas à la traîne.
M. le président Didier Migaud. Ce ne sera pas le cas puisque nous avons créé une mission d’information. Devant se prononcer dans un délai contraint sur une proposition de résolution relative à la directive épargne, la Commission des affaires européennes a jugé nécessaire de creuser quelque peu le sujet. Pour notre part, nous souhaitons aller au fond des choses et remettre, au mois de septembre, un rapport complet comportant un certain nombre de propositions précises. Le rendez-vous de la loi de finances nous permettra ensuite de traiter de ce qui peut être fait à l’échelon national.
Des initiatives doivent également continuer à être prises au sein du G20 comme de l’Union européenne, et nous faisons pression pour que les dossiers avancent.
Des débats comme celui d’aujourd’hui nous permettent de mesurer le chemin parcouru comme celui qui reste à accomplir. On nous dit que la France fait preuve de détermination, mais nous demeurerons bien sûr vigilants.
M. le ministre. Je me réjouis de cette discussion.
Bien sûr, on peut considérer que ce qui a été fait est insuffisant ou risque de ne pas durer, mais jusqu’à présent on n’avait jamais été aussi efficace sur tous ces sujets ! À nous de maintenir la pression et de continuer à avancer de façon rigoureuse au niveau international tout en nous dotant d’armes nationales efficaces !
La cellule de régularisation applique scrupuleusement le code général des impôts. Il y a d’ailleurs quelque paradoxe à nous reprocher de procéder à une amnistie rampante tout en déplorant que la cellule ne reçoive pas davantage d’appels. Il ne s’agit pas pour nous d’ouvrir les vannes, et une amnistie ferait naître un sentiment d’injustice particulièrement intolérable dans ce contexte de crise. Pour autant, si l’on veut que les gens viennent à nous, il faut leur proposer des solutions.
M. Henri Emmanuelli. Mais si l’on applique les textes, il n’y a pas lieu d’ouvrir des discussions !
M. le ministre. Il faut être conscient que, lorsqu’on a un compte en Suisse, on ne se précipite pas vers l’administration fiscale, et qu’il est préalablement nécessaire de tisser des liens. C’est pour cela que la cellule discute et essaie de comprendre la situation, mais elle applique les textes. Dans la mesure où elle n’intervient que depuis le mois d’avril, il m’est difficile de dresser aujourd’hui un bilan de son activité, mais vous pouvez être assurés que je m’y emploierai, par exemple au bout d’un an. J’ajoute que nous avons bien sûr tout intérêt à ce que les fonds soient rapatriés et que le mouvement devrait s’accélérer dès lors que le secret bancaire sera effectivement levé et que les titulaires des comptes s’apercevront que la protection n’est pas celle qu’ils croyaient. Les choses progresseront donc quand la Suisse et le Luxembourg, où se trouvent près de 80 % des comptes français à l’étranger, auront intégré la levée du secret bancaire dans leur droit interne ce qui devrait intervenir, selon le Président de la Confédération suisse, avant la fin de l’année.
Aux termes de l’article 26, dès lors qu’une administration fiscale étrangère est avertie d’un soupçon d’évasion fiscale pesant sur une personne dont le nom lui est communiqué, elle doit être capable de détenir l’information. Dès lors, les fiducies ou les trusts, même s’ils relèvent du droit étranger, ne peuvent pas faire obstacle à la fourniture d’informations, à moins que le pays concerné ne respecte pas le traité fiscal et n’encoure le risque d’être inscrit sur la liste grise.
On ne changera pas le monde d’un coup de baguette magique, mais je vous assure que tout ce qui est fait est fait de façon sérieuse et méthodique !
S’agissant du Liechtenstein, nous pouvons aujourd’hui dresser un bilan presque définitif. Sur le listing qui nous a été remis figurent 64 groupes familiaux français. Deux d’entre eux concernaient des personnes décédées et 20 autres des groupes composés de non-résidents. Quatre groupes familiaux n’ont fait l’objet d’aucune transmission ultérieure d’informations et trois dossiers ont fait l’objet d’une transmission au parquet en application de l’article 40 du code de procédure pénale. Sur les 35 groupes restant, 12 ont pu justifier de leur situation, notamment de la dissolution ancienne des fondations, et 19 ont été régularisés selon le processus que j’ai décrit.
Au total, les régularisations concernent un montant de capitaux de 33 078 686 euros, ce qui correspond à 5 265 000 euros de droits, à 397 635 euros d’intérêts de retard et à 191 154 euros de pénalités. Près de 90 % de ces sommes sont liés aux trois dossiers que nous avons transmis au parquet. Un groupe familial a rompu ses contacts avec l’administration ; nous allons le poursuivre.
Au total, grâce au travail remarquable du fisc, nous avons régularisé les situations et avons perçu les impôts éludés ainsi que les pénalités.
Dans les négociations sur le projet de directive, la France considère que la retenue à la source n’est pas une bonne idée et qu’il vaudrait mieux privilégier les échanges d’informations permettant d’appliquer la fiscalité qui devrait être appliquée. Mais d’autres États s’y opposent. La retenue à la source devrait atteindre 35 % dans deux ans et l’on pourrait aller encore plus loin pour se montrer plus dissuasif. Certes, cela ne s’inscrit pas dans le cadre de la convention de l’OCDE et ce n’est pas une bonne manière de faire, mais c’est mieux que rien. La directive étant remise en chantier, nous avons l’intention de la faire évoluer sur la nature des produits comme sur l’échange automatisé de données.
Les règles relatives à l’entrée et à la sortie de la liste grise sont précises. L’OCDE l’a établie après avoir étudié la situation de 84 pays, et d’autres pourraient y être ajoutés. Pour sortir de cette liste, il ne suffit pas d’en avoir l’intention : il faut en sortir effectivement et ne pas se contenter de signer des conventions avec d’autres paradis fiscaux !
M. Henri Emmanuelli. Lorsque nous avons auditionné les représentants de l’OCDE, je les avais trouvés bien naïf à ce propos !
M. le ministre. Les choses ne sont pas si simples dans le contexte politique du G20 ! Sur la base des 84 pays analysés, la liste est exhaustive et l’on n’en sort qu’avec des conventions en bonne et due forme. Le mécanisme de contrôle des conventions a été précisé à Berlin, notamment avec la procédure de revue par les pairs de la capacité à agir, et il faut espérer qu’il sera repris à l’occasion du prochain G20.
La France attend l’arme au pied que les conventions soient définitivement signées. Nous les testerons immédiatement dans les pays dans lesquels nous pensons que des citoyens français ont pu frauder. Nous le ferons sans naïveté aucune, sur la base de la situation réelle et, si nous n’obtenons pas les informations, nous dénoncerons les conventions. Après 2009, année de la transparence et de l’établissement des listes, 2010 sera celle au cours de laquelle les conventions seront testées.
Enfin, il ne faut pas confondre paradis fiscal et compétitivité fiscale : on est encore loin de l’harmonisation fiscale évoquée par M. Garrigue et chaque pays peut fixer librement son taux d’imposition sur les sociétés, les revenus et le patrimoine. Mais il doit le faire de façon transparente.
M. Charles de Courson. Vous ne nous avez pas dit ce que vous pensez de l’idée de porter à 50 % le taux du prélèvement forfaitaire.
M. le ministre. Pourquoi pas ?
M. Charles de Courson. Comment pourrait-on mieux lutter contre l’anonymat ?
M. le ministre. Nous connaissons les montages propices à l’anonymat. Dès lors qu’il existe une convention en vertu de laquelle l’information doit être tenue à notre disposition, si l’anonymat faisait obstacle à son application, nous la dénoncerions.
M. Jérôme Cahuzac. Passer une convention, la tester puis la dénoncer si elle n’est pas appliquée me paraît de bonne stratégie.
M. Henri Emmanuelli. Au-delà des aspects fiscaux et financiers, il y a un aspect politique. L’ambassadeur du Luxembourg est venu m’exposer les turpitudes d’autres États que le sien, comme le Delaware. Mais on peut se demander si le Gouvernement est prêt à dire au Luxembourg qu’il s’y passe des choses qui nous déplaisent : comment ce pays se sentirait-il menacé quand on laisse Dexia y déplacer son siège social et y créer 1 200 emplois ? Il s’agit bien là de volonté politique, ce qui avive nos craintes.
M. le président Didier Migaud. Nous avons reçu nos homologues luxembourgeois et nous leur avons expliqué clairement que nous considérerions leur pays comme un paradis fiscal dès lors qu’il ne répondrait pas aux demandes d’informations sur la base d’une présomption de fraude fiscale. Les conventions devront déterminer les informations que l’on est en droit d’attendre sur la situation d’un contribuable français ; si les réponses ne nous sont pas apportées, il faudra dénoncer les conventions.
M. le ministre. Ces échanges passionnants montrent que de nombreuses questions restent en suspens, mais que les progrès réalisés en un an sont considérables.
MM. Jérôme Cahuzac, Henri Emmanuelli et Daniel Garrigue. Après un trou noir de sept ans !
M. le ministre. Certes, mais nous l’avons largement rebouché au cours de la dernière année : de nombreuses conventions ont été signées, dont je vous communiquerai la liste.
Faute d’avoir obtenu une réponse de Singapour, je suis allé expliquer à son ministre des finances que l’application de l’article 26 pouvait entraîner des mesures de rétorsion et que son pays pouvait être mis au ban des nations. Il m’est apparu clairement qu’il ne le souhaitait pas et qu’il entendait faire la démonstration que Singapour était une place financière importante en raison de son expertise et non pas uniquement parce qu’on y pratique le secret bancaire. Pour autant, n’avons pas signé la convention parce que le texte nous semblait imparfait. Nous devons faire très attention à ce que nous signons, et contrôler ensuite l’application des conventions.
M. le président Didier Migaud. Monsieur le ministre, nous vous remercions. Nous aurons l’occasion de revenir sur ce dossier. Soyez assuré de notre soutien, mais aussi de notre vigilance.
1 () En matière de régulation et de supervision, le dernier rapport d’évaluation de la stabilité du système financier du FMI consacré à la Suisse, publié en juin 2007, fait état d’un dispositif satisfaisant, malgré des améliorations qui peuvent encore être apportées, notamment s’agissant de l’indépendance de la nouvelle autorité suisse de régulation et de supervision.
En matière de lutte anti-blanchiment, le 3ème rapport d’évaluation mutuelle du GAFI, consacré à la Suisse, publié en octobre 2005, donne un satisfecit au dispositif suisse, malgré des lacunes identifiées s’agissant du contrôle des passeurs de fonds et de l’identification des bénéficiaires effectifs d’actions au porteur.
2 () En dehors des accords qui lient Monaco à la France, la Principauté n’échange des informations dans des affaires fiscales pénales que sur la base du principe de double criminalité. Elle échange également des informations dans les affaires relatives à la fraude fiscale impliquant des revenus de l’épargne en vertu de l’accord signé avec l’Union européenne pour l’application de la directive « épargne ».
De son côté, la Suisse n’échange des renseignements sur demande d’un État que dans les affaires fiscales pénales, lorsque les faits incriminés constituent une conduite frauduleuse passible d’emprisonnement dans les deux États.
3 () Le terme de trust exprès (express trust) désigne un trust clairement établi par la personne le constituant, généralement au moyen d’un document comme un acte de trust écrit. Ce type de trust s’oppose aux trusts nés de l’effet de la loi et qui ne sauraient résulter d’une intention ou décision claire d’une personne constituant un trust de créer un trust ou une construction juridique analogue (par exemple, un trust judiciaire).
4 () Rapport de l’OCDE : « Concurrence fiscale dommageable : un problème mondial », 1998.
5 () Ces étapes sont décrites par Christian Chavagneux et Ronen Palan dans « Les paradis fiscaux », éd. La Découverte, Paris, 2006, pp. 33-43.
6 () Si initialement 41 territoires avaient été identifiés, six États ont immédiatement pris l’engagement d’améliorer leurs pratiques fiscales.
7 () Le développement du marché des eurodollars est minutieusement décrit par Christian Chavagneux et Ronen Palan dans « Les paradis fiscaux », éd. La Découverte, Paris, 2006, pp. 46-52.
8 () Exemple tiré du rapport du GAFI sur les typologies du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme 2003-2004.
9 () Exemple tiré du rapport du GAFI sur les typologies du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme 2003-2004.
10 () Le FSF a classé les pays en trois groupes : ceux avec un système de réglementation de relativement meilleure qualité (I), ceux dont les performances sont inférieures aux standards mondiaux (II) et ceux qui posent problème (III).
11 (1) Permanent Subcommittee on Investigations tax haven banks and U.S. compliance, 17 juillet 2008.
12 () Idem note 2
13 () Cayman islands Monetary Authority “Regulatory framework: statistics”, juin 2008, cité par Raymond Baker et Eva Joly.
14 () Article paru dans la revue « Commentaire », (n°124, hiver 2008-2009).
15 () Draft report on no and nominal tax jurisdictions - CTPA/CAF/WP8/NOE2(2008)13/CONF.
16 () “The price of offshore” Tax Justice Network briefing paper (March 2005).
17 () United States Senate Permanent Subcommittee on Investigations (2008) “Tax Haven Banks and U.S. Tax Compliance – Staff Report” (publié en liaison avec le compte rendu de l’audition du 17 juillet 2008 du Permanent Subcommittee on Investigations. Voir aussi United States Senate Permanent Subcommittee on Investigations (2006) “Tax Haven Abuses : The Enablers, the Tools and Secrecy - Minority & Majority Staff Report” (publié en liaison avec le compte rendu de l’audition du 1eraoût 2006 du Permanent Subcommittee on Investigations).
18 () Rapport du General Accounting Office, 24 Juillet 2008.
19 (1) Périmètre de l'étude : les entreprises du CAC 40 moins Air France-KLM, STMicroelectronics, Total et Vinci, pour lesquelles les informations ne sont pas disponibles. Inclus Auchan, Banques populaires (avant la fusion avec les Caisses d'épargne pour lesquelles les données ne sont pas disponibles) et la Banque postale. Les données BNP Paribas n'intègrent pas la banque Fortis.
20 () La découverte cahiers libres, mai 2004, 264p.
21 () On note ce type d’activité également à Hong Kong, qui ne figure pas sur les listes OCDE.
22 () In Les paradis fiscaux, de Christian Chavagneux et Ronen Palan, éd. La Découverte, « Repères » n°448, juillet 2007.
23 () Enron était en 1999 une société spécialisée dans le courtage d’énergie puis de toute activité possible, reconnue, innovante, avec un chiffre d’affaires de 100 milliards de dollars et des profits élevés. La comptabilité de Enron établie avec l’aide du Cabinet Arthur Andersen aujourd’hui disparu reposait sur de la fraude comptable pure (gonflement du chiffre d’affaires par la prise en compte des recettes de contrats non encore signés), mais aussi le transfert de charges et de dettes dans des structures hors bilan.
24 () En mars 2009, tous ces pays ont indiqué à l’OCDE qu’ils retiraient leurs réserves sur l’article 26
25 () Voir le document « Permettre un échange effectif de renseignements : norme sur la disponibilité et la fiabilité » Groupe ad hoc conjoint sur la comptabilité (JAHGA) (2005).
26 () Décision du Conseil relative à la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts (2004/587/CE du 19 juillet 2004).
27 () La directive a été transposée en droit français par l’article 24 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003). Conformément à la directive, deux dates d’entrée en vigueur ont été prévues : celle du 1er janvier 2004 pour la partie relative à l’identification, donc aux déclarations, celle du 1er janvier 2005 pour tout le reste. Cette dernière date a été reportée par l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2004.
28 () Les sommes versées par Turks et Caicos sont insignifiantes et les données relatives aux Antilles néerlandaises et aux Iles Vierges britanniques sont indiquées comme n’étant pas disponibles.
29 () La situation du Liechtenstein appartenant l’Espace économique européen devrait bientôt être tranchée par suite d’un renvoi préjudiciel de la Cour de cassation à la CJCE sur la compatibilité de la taxe de 3% avec l’accord sur l’EEE lorsque le contribuable est établi au Liechtenstein. La directive sur l’assistance mutuelle ne s’appliquant pas, la jurisprudence relative aux pays tiers devrait pouvoir s’appliquer. Cette question est d’importance dès lors que la France a systématiquement exclut le Liechtenstein du bénéfice des dispositions fiscales applicables aux ressortissants des autres États de la Communauté européenne et de l’espace économique européen (PEA, assurance-vie, réduction d’impôt « Madelin », taxe de 3 % etc.).
30 () À l’exclusion des régions administratives spéciales, qui se sont engagées à appliquer les standards internationaux
31 () Juridictions qui étaient identifiées en 2000 comme territoires non coopératifs sur la base des critères figurant dans le rapport de l’OCDE de 1998.
32 () Les îles Caïman ont modifié leur législation – que l’OCDE doit encore passer en revue – pour permettre l’échange de renseignements et a identifié 12 pays avec lesquels elles se préparent à passer des accords.
33 () L’Autriche, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse ont retiré leurs réserves sur l’article 26 du modèle de l’OCDE.
34 () On notera que ces deux régions autonomes chinoises ne figuraient pas initialement sur la liste grise de l’OCDE, au motif qu’à la date du 2 avril, elles s’étaient d’ores et déjà engagées à respecter les critères de l’OCDE en matière d’échange de renseignements.
35 () Une convention comportant une clause d’échange de renseignements a également été conclue entre l’Inde et le Luxembourg en mai 2009 : un peu en retrait par rapport aux normes de l’OCDE, ce traité sera vraisemblablement le dernier à être ratifié selon les standards anciens, selon le rapporteur du projet de loi à la Chambre des députés.
36 () Propos de Patrick Rodier, associé de la banque suisse Lombard Odier, recueillis par Carole Papazian, Le Figaro, édition du 16 juin 2009.
37 () La loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants et la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ont été complétées par la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime et par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.
38 () Le renforcement du service TRACFIN par l’ordonnance du 30 janvier 2009 est traité dans la partie du présent rapport relative à la cellule de lutte anti-blanchiment.
39 () Conclusion du rapport présenté à l’Assemblée générale des 13 et 14 février 2009 du Conseil national des barreaux précité.
40 () L’article 156 de la loi a introduit un nouvel alinéa à l’article L. 511-41 du code monétaire et financier : « Au sein des établissements de crédit, les conditions d’information des organes de direction, d’administration et de surveillance concernant l’efficacité des systèmes de contrôle interne, d’audit interne et de gestion des risques et le suivi des incidents révélés notamment par ces systèmes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. Cet arrêté prévoit les conditions dans lesquelles ces informations sont transmises à la Commission bancaire ».
41 () Cette obligation spécifique a été supprimée par coordination.
42 () Trafigura a trouvé un accord avec le gouvernement ivoirien en février 2007 mais des poursuites juridiques sont engagées en Angleterre contre la compagnie de courtage.
43 () À noter que la suspension de la convention avec le Danemark du fait de cet État ne pose pas de problème en pratique compte tenu de la directive européenne d’assistance mutuelle du 19 décembre 1977.
44 () Le décret n° 2008–294 du 1er avril 2008 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code avait modifié l’article 1649 quater A du code général des impôts par suite de l’article 96 de la loi de finances rectificative pour 2006, restreignant en pratique son application aux seuls transferts intracommunautaires.
45 () À compter du 15 juin 2007, le seuil déclaratif a été rehaussé à 10 000 € au lieu de 7 600 € impliquant de ce fait une baisse du nombre de contentieux pour le second trimestre 2007 et l’année 2008.
46 () Ces données sont extraites de l’application BIP à partir de l’indicateur P3 « MOD-montant des sommes saisies en vue de leur confiscation et des amendes transactionnelles ».
47 (1) On peut noter qu’il en est de même des sommes, titres ou valeurs transférés vers l’étranger ou en provenance de l’étranger lorsque le contribuable n’a pas rempli les obligations prévues à l’article 1649 quater A, dernier alinéa.
48 () Article 908 de la loi de consolidation des impôts de 1997 telle qu’amendé en 1999. A l’origine, une fraude généralisée d’ouverture de faux comptes de non-résidents avait justifié que le législateur renforce le droit de communication afin de viser des personnes non identifiées.
49 () Ne pas obtenir le statut de QI implique la transmission de tous les formulaires américains requis en matière de retenue à sa source, procédure extrêmement lourde et pouvant s’avérer coûteuse.
50 () Cela permet de répondre à certains cas de figure précis, notamment lorsqu’il n’existe pas de clause de procédure amiable dans la convention liant la France au pays dans lequel une société est implantée, lorsque l’autre État concerné refuse de conclure un APP, ou enfin pour des cas simples mais fréquents, telle que la refacturation des frais de direction générale, pour lesquels une entreprise a besoin uniquement de la validation de la clé de répartition des frais et pour lesquels une procédure bilatérale apparaît trop lourde.
51 () Ce projet d’article est assorti de sanctions assez importantes : l’entreprise devait avoir la documentation prête et la remettre à l’administration en cas de vérification de comptabilité. En cas de manquement, l’administration lui adresse une mise en demeure de produire la documentation dans un délai de trente jours, pouvant être prorogé de deux mois. Il s’agit, dans les faits, d’un délai assez court. Si l’entreprise n’est pas en mesure de produire une documentation complète passé ce délai de trois mois, elle risque une amende de 50 000 euros par exercice vérifié. Après la mise en demeure, l’absence de présentation de la documentation donne lieu à une amende de 5 % du montant des bénéfices transférés à l’étranger.
52 () En France, le régime d’intégration fiscale permet à une personne morale de constituer un groupe avec des filiales françaises détenues au moins à 95 %. Dans cette affaire, une société française détenait 100 % d’une société néerlandaise, qui elle-même détenait 100 % d’une société française. Les deux sociétés françaises avaient constitué une intégration fiscale. L’administration fiscale l’a contestée. Une question préjudicielle du Conseil d’État à la Cour de Justice des Communautés Européennes visait à savoir si cette restriction (l’exclusion des filiales détenues par l’intermédiaire de sociétés étrangères) était ou non contraire au principe de liberté d’établissement. La Cour a suivi dans son arrêt Papillon du 27 novembre 2008 un raisonnement en trois temps. Ainsi, elle a confirmé qu’il y avait bien restriction du principe de la liberté d’établissement. Il existe néanmoins des moyens de s’exonérer de cette liberté d’établissement. L’objectif de l’intégration fiscale en France est d’assimiler un groupe intégré à une entreprise ayant plusieurs établissements. En l’occurrence, la Cour a jugé que la résidence fiscale d’une société intermédiaire n’impactait pas a priori cet objectif. La restriction n’est donc admise que dans deux cadres : la répartition du pouvoir d’imposition et la cohérence du régime fiscal. La Cour a considéré que la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres ne constituait pas un argument en faveur de la France – il ne justifie donc pas l’exclusion des sociétés détenues par une entreprise étrangère. Sur la cohérence du régime fiscal, la Cour a été plus nuancée en estimant que cet argument pouvait être recevable, car le fait d’avoir des personnes morales interposées complique le système. Toutefois, la Cour a considéré qu’en l’espèce, la restriction était disproportionnée par rapport aux objectifs recherchés.
53 () C’est l’article 9-III de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) qui a fixé le seuil à 5 %. Le régime antérieur prévoyait un seuil de participation de 10 % ou un prix de revient de la participation de 22,8 millions pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2000. Cette réforme avait notamment pour objet de simplifier le régime spécial des sociétés mères et filiales en ne retenant qu’un seul critère de seuil de participation pour son application. Le seuil de 22,8 millions d’euros a été réintroduit pour les groupes bancaires mutualistes par l’article 65 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001).
54 () Avis du Conseil d’État n° 192539 du 8 avril 1996, publié à la revue de jurisprudence fiscale (RJF) 5/98 n° 593.
55 () Si seuls les organismes financiers étaient soumis à déclaration de soupçon à partir de 1990, ce dispositif a été progressivement élargi aux courtiers d’assurance et aux bureaux de change à partir de 1996, aux intermédiaires immobiliers en 1998, aux casinos, marchands d’art, d’antiquités, de pierres précieuses et commissaires-priseurs en 2001, aux OPCVM, sociétés de gestion et conseils en investissements financiers en 2003, aux professions du chiffre et du droit (experts comptables, avocats, commissaires aux comptes, huissiers de justice, administrateurs et mandataires judiciaires) en 2004, et la même année, aux sociétés et cercles de jeu, aux institutions de prévoyance et de gestion de retraite complémentaire.
56 () Organe fédérateur des cellules de renseignement financier (CRF) à l’échelon mondial, le groupe Egmont, créé en juin 1995, réunit aujourd’hui 106 CRF de tous les continents. Il concentre ses travaux sur les moyens concrets d’améliorer la coopération internationale dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, notamment l’échange de renseignements opérationnels entre les services anti-blanchiment par l’intermédiaire d’un réseau crypté.
57 () Les autres directions nationales réalisent environ 800 affaires.
58 () Nom incluant les termes France, Europe, International, Limited, ou les autres dénominations à connotation internationale.
59 () En particulier les adresses de domiciliation
60 () En outre, un agent de la BNEE assure les liaisons avec la Plate Forme d’Identification des Avoirs Criminels (PIAC) et répond aux demandes d’informations patrimoniales émanant de ce service
© Assemblée nationale