______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 novembre 2009.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
sur « Les enjeux géostratégiques des proliférations »
et présenté par
MM. Jean-Michel BOUCHERON et Jacques MYARD
Députés
___
INTRODUCTION 9
I – DE LA GUERRE FROIDE AUX NOUVELLES MENACES 15
A – 1945-1963 : L’APPRENTISSAGE D’UNE ARME INCONNUE 15
1) Les Etats-Unis et l’URSS dans une compétition pour la suprématie militaire et politique 15
a) La bombe au service de la puissance 16
b) Surpasser l’ennemi : le nucléaire offensif 18
2) France, Grande-Bretagne et Chine : la sécurité par la dissuasion 20
B – 1963-1991 : LES PREMIÈRES TENTATIVES DE STABILISATION 22
1) La crise de Cuba marque la fin de la conception offensive de l’arme nucléaire 23
2) Etats-Unis et URSS, entre apaisement et course aux armements 25
a) La poursuite de la course aux armements malgré le rapprochement stratégique 25
b) Les années Reagan : un changement de ton plus que de fond 28
3) La gestion de l’arsenal soviétique après 1991 : un exemple de coopération pour la maîtrise des armements 30
C – LE MONDE APRÈS 1991 : VERS UNE NOUVELLE PROLIFÉRATION NUCLÉAIRE ? 31
1) 1993-2009 : illusions et désillusion 33
2) Persistance de la rivalité entre les Etats-Unis et la Russie 35
a) Le maintien d’un contentieux politique entre les Etats-Unis et la Russie 35
b) D’une phase d’apaisement à une politique unilatérale des Etats-Unis 36
c) Le revirement américain 40
3) Vers un nouvel âge des proliférations ? 41
D – LES PROLIFÉRATIONS BALISTIQUE, BIOLOGIQUE, CHIMIQUE ET CYBERNÉTIQUE 45
1) Les programmes balistiques, nouvelle forme de prolifération ? 45
2) Les arsenaux chimiques et biologiques des Etats, un potentiel limité ? 46
a) La disparition programmée des armes chimiques étatiques 46
b) Les armes biologiques connaîtront-elles le même sort ? 48
3) L’arme cybernétique, une arme d’Etat ? 51
II – LES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE, INSTRUMENTS RATIONNELS DES ETATS DANS LEURS RELATIONS INTERNATIONALES 55
A – LE CLUB DES DÉTENTEURS D’ADM 56
1) L’évolution de la politique nucléaire des Etats-Unis 57
a) Le regain d’intérêt des Etats-Unis pour une politique de désarmement 58
b) Le désarmement à l’épreuve des tensions internationales 61
c) Des négociations stratégiques qui dépendent de la résolution de conflits politiques 62
2) La Russie à la recherche de la parité politique 64
a) La dissuasion nucléaire, pour compenser le déclin des forces conventionnelles 65
b) ADM stratégiques et ADM tactiques : éléments particuliers de la doctrine russe 67
c) Le contrôle des armes nucléaires : éviter la supériorité américaine 68
d) Une politique de non prolifération à géométrie variable 69
3) La montée en puissance globale de la Chine 74
a) Mutations économiques et sociales, permanence stratégique 74
b) Un arsenal hétéroclite qui se modernise 76
c) Une doctrine et une action fondées sur la discrétion 77
4) La doctrine nucléaire de la France entre certitude et questionnement 78
a) L’arme de la puissance comme de l’indépendance nationale 79
b) Une doctrine souple dans un contexte mouvant 80
c) La méfiance à l’égard des projets américains de désarmement 82
5) Les forces nucléaires britanniques, entre indépendance et intégration à l’OTAN 84
a) Proximité et divergence doctrinales avec la France 84
b) Une intégration partielle au système américain 85
B – LE CAS PARTICULIER D’ISRAËL, « UN NOUVEL ACTEUR DEPUIS 30 ANS » 86
1) Une stratégie volontairement ambiguë 87
2) Une panoplie complète d’ADM ? 88
3) Les effets de la stratégie d’ambiguïté au Moyen Orient 91
C – LA RATIONALITÉ DES NOUVEAUX ACTEURS 93
1) La bombe indienne, affirmation de son primat en Asie du Sud et de sa parité avec la Chine 93
a) De l’inutilité à l’impératif de la bombe : le choix rationnel de l’Inde 94
b) Le rejet du régime de non prolifération ou l’affirmation de l’indépendance de l’Inde 96
c) De l’affirmation de l’indépendance à la construction d’une politique de puissance ? 97
d) L’affaiblissement du TNP, prix du partenariat stratégique entre les Etats-Unis et l’Inde 99
e) La montée en puissance de l’arsenal indien 101
2) Le Pakistan ou la dissuasion du faible au fort dans un contexte régional tendu 103
a) Une doctrine nucléaire tournée contre la seule Inde 104
b) Le Cachemire, rivalité de trois puissances nucléaires et révélateur de la faiblesse stratégique du Pakistan 105
c) Une course aux armements parallèle à un lent processus de rapprochement diplomatique 107
d) La sécurisation de l’arsenal nucléaire pakistanais 110
3) Pourquoi l’Iran veut maîtriser la technologie nucléaire militaire 112
a) Disposer à court terme d’une capacité de dissuasion 112
b) Un choix stratégique comportant plusieurs options 114
c) Une arme idéologique 116
d) Rappel historique 117
e) La découverte d’un programme clandestin à caractère militaire 119
f) Des négociations utilisées par l’Iran pour gagner du temps 123
g) Des sanctions peu efficaces 125
h) Les implications d’un Iran nucléaire pour les Etats-Unis 128
4) La Corée du Nord ou la survie d’un régime totalitaire 129
a) Un produit de la guerre froide 130
b) Un régime politique épuisé utilisant une stratégie de chantage 131
c) L’exportation des technologies pour élargir le front des proliférations 135
d) Un arsenal chimique et biologique aussi avancé que l’arsenal nucléaire 136
e) L’enjeu géopolitique : assurer la sécurité du Japon, « Etat du seuil » 137
f) Le Japon, allié stratégique des Etats-Unis en cas de conflit contre la Corée du Nord ou contre la Chine 140
g) Un jeu diplomatique entre la Chine, les Etats-Unis, la Corée du Nord, la Corée du Sud, la Russie et le Japon 141
D - VERS D’AUTRES ACTEURS NUCLÉAIRES ? 143
a) Le cas de la Libye, analyse d’une renonciation aux ADM 144
b) Syrie : l’arme nucléaire à objet limité 149
E – LA SIGNIFICATION DE LA MENACE BALISTIQUE ET DE LA DÉFENSE ANTIMISSILE 152
1) La menace balistique, élément de guerre asymétrique 152
2) La défense antimissile, élément structurant du concept stratégique et des alliances des Etats-Unis 154
3) Les enjeux politiques pour l’Europe 155
4) Remise en cause, mais non abandon 157
III – LA DISSÉMINATION DES TECHNOLOGIES PROLIFÉRANTES 171
A – LES RÉSEAUX DE PROLIFÉRATION 171
1) Un phénomène récent contre lequel les textes traditionnels se sont révélés impuissants 172
a) Les réseaux de prolifération dans un contexte de mondialisation 172
b) Une régulation des échanges inefficace pour lutter contre les proliférations 177
2) Des actions inefficaces contre des proliférations encore et toujours étatiques 179
a) Des mesures nouvelles adoptées dans un contexte biaisé 180
b) La contre-prolifération, facteur d’injustice ? 181
c) La lutte contre les réseaux renforce les coopérations entre Etats proliférants 182
B – DISSÉMINATION DES TECHNOLOGIES ET TERRORISME, UN RISQUE RÉEL ? 184
1) « La guerre contre la terreur », effet des attentats du 11 septembre 2001 186
a) Un concept volontairement manichéen 187
b) Une crainte légitime : la difficile sécurisation des matières fissiles et radioactives 188
c) La possibilité d’un attentat terroriste nucléaire : un mythe plus qu’une réalité 191
d) l’arme nucléaire, outil d’un terrorisme d’Etat : une hypothèse peu crédible 193
e) L’attentat par diffusion de matières radioactives : une hypothèse plus réaliste 194
2) La menace terroriste chimique et biologique : une éventualité réaliste, mais difficile à mettre en œuvre 195
a) Quantification des actions et projets terroristes 196
b) Avantages des armes biologiques et chimiques pour des organisations terroristes 197
c) Les limites du recours aux armes biologiques et chimiques 199
d) Un risque réel, contre lequel existent déjà des dispositifs de défense 200
3) Les attentats cybernétiques : un moyen rapide, peu coûteux et dépourvu de risque pour désorganiser les sociétés modernes 201
a) Les attaques cybernétiques : du crime organisé à l’espionnage d’Etat 202
b) Pourquoi la Chine et la Russie recourent aux cyberattaques 204
c) Un phénomène qui ne peut que s’accentuer 205
d) Des réactions auparavant défensives, prochainement offensives 206
e) Invoquer l’article 5 du traité de l’Atlantique Nord ? 208
IV – LE DROIT INTERNATIONAL PEUT-IL EMPÊCHER LA PROLIFÉRATION ? 211
A – L’INTERDICTION DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE, UN ENGAGEMENT INSUFFISANT 212
1) La convention sur les armes chimiques, un outil efficace de lutte contre la prolifération 212
2) Le traité de non prolifération nucléaire, un équilibre maintenu en dépit des évolutions historiques 214
a) De la création de l’Agence internationale de l’énergie atomique à la signature du traité de non prolifération 214
b) Le renforcement progressif des moyens de l’AIEA 215
c) Un traité fragilisé par des contestations croissantes 217
3) La convention sur les armes biologiques ne comporte toujours pas de mécanisme d’inspection 219
4) Le code de conduite de La Haye, un instrument faible contre la prolifération balistique 222
B – DES TEXTES COMPLÉMENTAIRES POUR LUTTER CONTRE LES PROLIFÉRATIONS 223
1) La question des zones exemptes d’armes nucléaires, un enjeu politique 223
2) Les clubs d’exportateurs, des règlements utiles mais insuffisants 225
a) Le groupe Australie, une instance utile à la classification des agents chimiques et biologiques dangereux 225
b) Les clubs d’exportateurs nucléaire et balistique, des groupes de défense d’intérêts stratégiques 226
3) L’interdiction des essais nucléaires et de la production de matières fissiles : des textes déjà appliqués en partie 227
C – LA « COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE » CONTRE LA PROLIFÉRATION : UNE MENACE INSTRUMENTALISÉE ? 230
1) Contre-prolifération et dénucléarisation, deux nouvelles manières de confirmer le statu quo 231
a) La persistance des crises malgré le droit existant 231
b) La contre-prolifération et ses faux semblants 232
c) Le discours sur la « dénucléarisation du monde » : le maintien du statu quo derrière l’affirmation d’un changement 234
2) Revoir l’équilibre actuel pour lutter contre les menaces réelles 236
a) Les échecs des conférences passées : quand les Etats membres du TNP ne respectent pas leurs engagements 236
b) Renforcer le droit pour l’adapter à la réalité des proliférations 237
c) Promouvoir la coopération de tous les Etats contre le terrorisme 238
d) L’élargissement du club du TNP : la question interdite ? 239
CONCLUSIONS 243
CONCLUSIONS : ENGLISH VERSION 251
EXAMEN EN COMMISSION 259
ANNEXES 265
Annexe 1 : Liste des personnes auditionnées 267
Annexe 2 : OTAN, armes nucléaires et lutte contre les proliférations 271
Annexe 3 : Union européenne, armes nucléaires et lutte contre les proliférations 275
Annexe 4 : Fiches pays 277
Annexe 5 : Chronologie de l’actualité nucléaire 2008-2009 301
Annexe 6 : Principaux textes internationaux 317
– Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) 319
– Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction 325
– Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction 329
– Code de conduite international contre la prolifération balistique 357
– Traité d’interdiction complète des essais nucléaires 361
Annexe 7 : Bibliographie 384
« En août 1945, quand les deux premières bombes atomiques américaines frappent Hiroshima et Nagasaki, j’étais parachutiste, chef de la mission militaire française à Calcutta. La capitulation japonaise me donne comme à tous les combattants un immense soulagement : nous savons que nous survivrons à cette guerre. C’est pourquoi l’arme atomique n’a pas pour moi ce caractère d’horreur qu’on lui attache à juste titre » (Pierre Messmer, ancien Premier ministre, discours à l’université d’Oxford, 15 février 2002).
La prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs balistiques, qu’il s’agisse d’armes nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques est au cœur des relations internationales. Depuis l’explosion de la première bombe atomique sur Hiroshima, la communauté internationale n’est pas parvenue à surmonter cette contradiction majeure : comment assurer la survie de l’humanité face aux armes de destruction massive (ADM) alors que les plus grands Etats de la planète cherchent à s’en assurer la maîtrise, en raison des perspectives politiques et stratégiques qu’elles offrent ?
Cette contradiction est d’autant moins en voie d’être résolue – en d’autres termes la survie de l’humanité fait toujours l’objet d’une sérieuse menace – que de plus en plus d’Etats, voire d’individus, maîtrisent partiellement ou totalement les techniques de fabrication des ADM et qu’avec les progrès technologiques, la gamme des outils de destruction ou de déstabilisation s’élargit. Aux ADM s’ajoute désormais le risque présenté par la cybernétique. Les sociétés modernes, gourmandes en informations, gèrent des systèmes complexes en réseau et y porter atteinte peut être tout aussi destructeur matériellement et psychologiquement que n’importe quelle arme.
La manière dont nous orientons nos réflexions et dont nous définissons les questions que nous nous posons sur la prolifération – ou plutôt sur les proliférations – a autant d’importance que le fait même d’analyser ce phénomène. La plupart des publications officielles émanant de Gouvernements ou de Parlements, ainsi que les analyses des spécialistes de la stratégie s’inquiètent en règle générale des proliférations, à juste titre si l’on se souvient des conséquences tragiques des explosions d’Hiroshima et de Nagasaki sur la population japonaise, des attaques au gaz sur les populations kurdes ou lors de la guerre Iran / Irak, mais derrière ces craintes se cachent le plus souvent des considérations stratégiques visant à maintenir un rapport de force hérité de la guerre froide lorsque l’on évoque, par exemple, les Etats-Unis et la Russie, ou un équilibre régional si l’on examine le cas de l’Inde et du Pakistan. Lorsque les Etats-Unis mettent en cause par un incessant discours le programme nucléaire de Téhéran, ils ne nourrissent aucune crainte quant au risque d’être bombardés par l’Iran. Ils savent en revanche que la maîtrise de l’arme nucléaire par Téhéran sanctuarise le territoire iranien et donne à ce pays une capacité croissante d’intervenir dans l’ensemble des dossiers du Moyen-Orient. C’est moins l’émergence d’une nouvelle puissance au Moyen-Orient qui les inquiète que la confirmation d’un monde multipolaire où leur influence se dilue.
L’inquiétude sur les proliférations de toute nature est justifiée en raison du risque qu’elles font encourir à l’humanité. Mais elle l’est moins si on examine cette question sous un angle géostratégique. Pour ce qui concerne l’arme nucléaire, la possession de celle-ci a été jusqu’ici un puissant facteur de paix. Malgré des crises aigues dont Cuba a sans doute constitué le paroxysme, Etats-Unis et URSS ont passé la guerre froide à s’espionner, mettre au point des armes de plus en plus sophistiquées, établir des scenarii de guerre conventionnelle, mais ils ont fondamentalement veillé à éviter la guerre nucléaire. Il en a été de même dans leurs relations avec la Chine. La politique de dissuasion a donc réussi. Dès lors, la question centrale est : faut-il s’inquiéter de la diffusion de l’arme nucléaire dès lors que, jusqu’à présent, les Etats s’en sont servis comme arme de défense et non comme arme d’attaque ?
Ce raisonnement vaut pour les armes nucléaires, qui sont produites, stockées et maintenues par des Etats capables de maîtriser des processus complexes : mise au point et construction d’unités d’enrichissement d’uranium, fission, miniaturisation, balistique... Il vaut moins pour les autres ADM, dont les techniques de fabrication sont moins complexes et dont il est difficile de toujours identifier les détenteurs, qui pourraient être le cas échéant d’autres acteurs que des Etats. La maîtrise technologique n’est plus l’apanage des seuls pays riches et industrialisés, elle peut être à la portée d’Etats en voie de développement comme au sein de groupes terroristes. C’est sans doute sur ce point que la possession d’ADM, actuellement, diffère de la période de la guerre froide. Le duopole américano-soviétique se caractérisait par sa prévisibilité. Les deux Etats porteurs qui de l’idéologie libérale qui de l’idéologie communiste disposaient d’un arsenal nucléaire – et parallèlement d’un arsenal chimique et biologique – afin d’éviter la guerre grâce à l’équilibre des forces. Le régime de non-prolifération instauré, rappelons-le, également sous la guerre froide, avait pour objectif de ne pas altérer cet équilibre. Le risque nucléaire était élevé, mais il était géré par des gouvernements responsables disposant de militaires et de scientifiques disciplinés. Cette prévisibilité a laissé place à une phase d’incertitude en raison de l’apparition de nouveaux acteurs. La diffusion rapide des technologies laisse également supposer que des acteurs supplémentaires pourraient apparaître pour des raisons stratégiques, notamment au Moyen-Orient.
L’inquiétude est d’autant plus grande que les proliférations sont de deux ordres. En premier lieu se trouve la recherche, par des Etats, de la maîtrise d’ADM (toute la panoplie ou une partie de celle-ci). Cette recherche est souvent perceptible par la communauté internationale, grâce aux images prises par satellites. En second lieu, se trouve la diffusion par des Etats, par des entreprises, des scientifiques ou des militaires de technologies sensibles, volontairement ou involontairement. Le cas d’entreprises japonaises qui ont contribué au réseau d’Abdoul Qadir Khan est à cet égard éclairant. Ce type de prolifération est évidemment celui qui inquiète le plus la communauté internationale car autant celle-ci considère que les Etats obéissent à des comportements rationnels, autant la détention de certaines catégories d’ADM par des groupes terroristes pour lesquels la mort est un aboutissement spirituel est difficilement décelable et exige un patient travail de renseignement.
L’Assemblée nationale a déjà travaillé sur ce sujet sous la XIème législature, avec le rapport (n° 2788) déposé le 7 décembre 2000 par MM. Pierre Lellouche, Guy-Michel Chauveau et Aloyse Warhouver, au nom de la commission de la Défense nationale et des forces armées. Ce remarquable rapport portait sur la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs. Il demeure en grande partie d’actualité, tant par sa description des procédés technologiques que par les analyses politiques qu’il contenait. Mais l’environnement international a considérablement évolué en 9 ans, avec les dossiers iranien, nord coréen, syrien, avec les craintes de déstabilisation du Pakistan et avec l’apparition d’une menace terroriste qui ne se contente plus de poser quelques bombes mais qui est susceptible de mettre en place des opérations sophistiquées. Une nouvelle réflexion sur les enjeux stratégiques des proliférations s’impose en conséquence d’autant que les technologies nucléaires vont connaître une nouvelle phase d’expansion.
Après des années de gel de constructions nouvelles, dues en grande partie à la méfiance des opinions publiques après les accidents de Three Miles Island et de Tchernobyl, plusieurs facteurs ont relancé le marché des centrales : crainte de la pénurie d’énergies fossiles, production d’électricité sans émettre de gaz à effet de serre, s’assurer une énergie à prix stable face aux soubresauts des prix des hydrocarbures, desserrement de la contrainte politique qui accompagne certains contrats d’approvisionnement… Si 439 réacteurs nucléaires sont actuellement en service dans 31 pays, 240 sont désormais en projet, y compris dans des Etats producteurs de pétrole au Moyen-Orient, et ce chiffre pourrait s’accroître considérablement. D’après l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la capacité de production, aujourd’hui établie à 375 gigawatts, pourrait passer à 650 gigawatts en 2030. Les perspectives du marché vont aiguiser la concurrence entre Areva, leader mondial (qui a des accords avec Mitsubishi), l’alliance Siemens-Rosatom, l’alliance Toshiba-Westinghouse et l’alliance Hitachi-General Electric.
Même si l’implantation de centrales obéit à un strict cahier des charges afin de respecter le traité de non-prolifération, l’augmentation massive d’unités d’enrichissement constitue un risque de prolifération. Comme l’aéronautique, le nucléaire est une technologie duale, susceptible de passer rapidement d’un usage civil à une application militaire. Si aucun analyste ne s’inquiète d’une augmentation du parc nucléaire au sein, par exemple, de l’Union européenne, il n’en est pas de même lorsqu’il s’agit d’Etats situés dans une zone déstabilisée.
Neuf pays détiennent aujourd’hui environ 25 000 têtes atomiques. La Russie est au premier rang, avec 14 000 têtes (une grande partie étant obsolètes), les Etats-Unis en possèdent 10 500, la Chine en annonce entre 180 et 240, la France et le Royaume-Uni respectivement 280 et 200, l’Inde en détiendrait entre 50 et 100, le Pakistan environ 60. Israël disposerait de 75 à un peu moins de 200 têtes et la Corée du Nord de 5 à 10, mais ces dernières ne sont sans doute pas opérationnelles. Le nombre de têtes déployées et le nombre de vecteurs sont pour leur part largement inférieurs, notamment entre les Etats-Unis et la Russie, le traité START l’ayant limité à 6000 pour les têtes et 1600 pour les vecteurs, pour chacun des deux Etats. Ces neuf pays – six systèmes parlementaires et trois régimes autoritaires – ont toujours résisté à la tentation d’user de leurs armes, même lorsqu’ils étaient engagés dans de lourds conflits ou dans des guerres larvées (guerre de Corée, guerre du Vietnam, conflit israëlo-arabe, guerre indo-pakistanaise au Cachemire et en Afghanistan, question de Taiwan). L’histoire semble nous enseigner que la détention des armes nucléaires rend responsable le comportement de son détenteur sur la scène internationale. Mais l’histoire n’est pas une science exacte et si le nombre de puissances nucléaires devait continuer à s’élargir en violation du traité de non-prolifération nucléaire (TNP), il ne s’agirait pas seulement d’une modification statistique. Le phénomène de prolifération est en effet la manifestation la plus perceptible de la capacité de la diplomatie à construire le monde selon un droit international fondé sur la raison et accepté par toutes les nations. Qu’il faille s’inquiéter ou regretter la poursuite de la prolifération est une question presque secondaire par rapport à la question qui surgira immédiatement après : comment et par qui sera conçu le nouvel ordre international ? Comment gérer la sécurité d’un monde élargi à 11, puis sans doute à 15 puissances nucléaires ?
S’agissant des autres ADM, le contexte est quelque peu différent et nous renvoie à une réflexion sur la sécurité. L’arme nucléaire est une arme stratégique, utilisée par les Etats pour menacer de causer des dommages irréversibles à long terme à leurs ennemis. Les armes chimiques, biologiques radiologiques et la cybernétique ne présentent pas obligatoirement ce caractère. Elles ont été utilisées jusqu’à présent dans un cadre conventionnel, comme lors de la première guerre mondiale et du conflit opposant l’Iran à l’Irak. Mais le succès de la dissuasion peut leur conférer une utilité, à la fois pour les Etats qui détiennent l’arme nucléaire, comme et surtout pour ceux qui n’en disposent pas. Au-delà de leur capacité de destruction, elles peuvent déstabiliser des Etats ou des sociétés entières, à un coût moindre que l’arme nucléaire, pour des résultats politiques analogues, notamment à l’encontre des sociétés développées. C’est un peu l’arme nucléaire du pauvre, à cette différence sensible que celle-ci est technologiquement et financièrement à portée d’autres entités que les Etats, et partiellement de groupements terroristes.
La sécurité d’un Etat ne consiste plus seulement dans la défense d’un territoire ou de sa population. Elle consiste également en la défense des réseaux et des infrastructures sensibles : réseaux de transports, adduction d’eau, lignes électriques, réseaux informatiques, sécurisation des données confidentielles, et de manière plus générale dans la capacité à maintenir quotidiennement le liberté de mouvement de la population. Or, les armes chimiques, biologiques, radiologiques et cybernétiques sont susceptibles de désorganiser une société en portant atteinte à tous les réseaux et en donnant à la population l’impression d’une vulnérabilité permanente alors qu’elle n’est parfois que temporaire. Elles menacent moralement et psychologiquement les sociétés fondées sur la liberté et la confiance, tant dans leur principe (concilier la liberté et la sécurité n’est pas aisé) qu’en d’autres aspects, comme le poids financier de la sécurité.
Le monde est donc en présence de nouveaux acteurs qui souhaitent profiter de la fin de l’ordre hérité de la guerre froide, et face à des technologies qui se diffusent et qui pourraient modifier l’usage des ADM. Ce domaine n’est plus celui des doctrines simples (équilibre de la terreur, dissuasion…) et redevient un objet d’interrogations, de suppositions, d’hypothèses, qui exigent d’analyser l’ensemble des formes des proliférations, les modifications stratégiques qu’elles induisent le cas échéant, tout en faisant la part entre menaces réelles, menaces fictives, menaces fantasmées et menaces instrumentalisées.
La présente étude s’attache en conséquence à décrire les caractéristiques du nouvel âge des ADM (expression utilisée par de nombreux analystes), à comprendre en quoi ces armes constituent toujours l’instrument rationnel de la puissance des Etats et à se demander si leur dissémination constitue de nouveaux risques et modifie les rapports stratégiques. Elle examine enfin la réponse qui peut être apportée à cette mutation, en s’efforçant de faire la part entre la non prolifération et la contre prolifération. Entre inquiétude, diabolisation, propagande, il convient d’appréhender sans a priori une des questions fondamentales des relations internationales.
I – DE LA GUERRE FROIDE AUX NOUVELLES MENACES
Le développement des armes de destruction massive (1) (ADM)
– nucléaire, bactériologique et chimique – est indissociable de la course aux armements à laquelle se sont livré les Etats-Unis et l’Union soviétique dans un contexte bipolaire. L’apparition et la première utilisation de bombes nucléaires en 1945 et la rivalité idéologique entre les deux blocs ont été propices à une accélération des programmes lancés par les deux puissances mondiales dans tous les domaines. La fin de la guerre froide, loin des prophéties optimistes, n’a pas conduit à la disparition des ADM. Au contraire, elle a vu apparaître de nouveaux risques et accéléré l’apparition d’acteurs supplémentaires, faisant entrer le monde dans un nouvel âge des proliférations.
A – 1945-1963 : l’apprentissage d’une arme inconnue
De la première explosion nucléaire connue à la « crise des missiles » de Cuba, la prolifération nucléaire a suivi deux voies parallèles. D’un côté, les Etats-Unis et l’Union soviétique, suivant une logique de puissance, s’efforcent de construire un arsenal stratégique suffisant pour mener et gagner une guerre contre l’autre. De l’autre, les trois autres Etats membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies cherchent à maintenir leur indépendance nationale et à asseoir leur légitimé internationale.
1) Les Etats-Unis et l’URSS dans une compétition pour la suprématie militaire et politique
Initialement, l’arme nucléaire est considérée comme un armement parmi d’autres pour des Etats cherchant à défendre leurs intérêts. Même si les doctrines évoluent, les vingt premières années de la guerre froide restent sous-tendues par l’idée que l’utilisation de la bombe atomique est possible, y compris entre les « deux grands ». Dès lors, les Etats-Unis comme l’URSS vont chercher à se doter de l’arsenal le plus vaste et le plus moderne possible, afin de s’assurer la victoire en cas de guerre ouverte.
a) La bombe au service de la puissance
L’explosion de deux bombes nucléaires au-dessus d’Hiroshima et de Nagasaki, les 6 et 9 août 1945, si elle ne provoque pas d’étonnement de la part des dirigeants des grandes puissances, qui connaissaient l’avancement des travaux américains dans ce domaine, marque profondément les opinions publiques. Pour la première fois, une arme semble donner un pouvoir absolu de destruction à qui la possède (2). Les deux chefs de file des blocs en train de se former autour du « rideau de fer » décrit par Winston Churchill dans son discours du 5 mars 1946 vont dès lors tenter de s’assurer la maîtrise de cette nouvelle arme, et de surpasser l’autre tant par la taille que l’efficacité des arsenaux.
En 1945, les Etats-Unis sont les seuls à disposer des technologies et des connaissances nécessaires à la fabrication d’armes nucléaires. Les travaux menés depuis 1939 par les physiciens européens réfugiés en Amérique, et les fortes inquiétudes concernant la possibilité pour le régime nazi d’utiliser la réaction de fission nucléaire pour construire des bombes d’un nouveau type (3), ont convaincu les autorités de la nécessité d’avancer. Le projet « Manhattan », lancé durant l’été 1942 sous la direction de Robert Oppenheimer et du général Leslie Groves, réunit les travaux et recherches menés séparément, et permet de les intégrer à un processus industriel, nécessaire pour produire les quantités suffisantes d’uranium hautement enrichi.
Le 16 juillet 1945, les Etats-Unis font exploser Trinity, la première bombe atomique de l’Histoire, au Nouveau-Mexique. Il s’agit d’une bombe à fission – dite « bombe A » – utilisant un cœur sphérique de plutonium, compressé par une chaîne d’explosifs déclenchés simultanément, fournissant l’énergie nécessaire au lancement de la réaction atomique en chaîne. L’engin Little boy, lancé sur Hiroshima le 6 août, est une bombe A à l’uranium, dont la réaction en chaîne est provoquée par la projection à haute vitesse d’un cylindre d’uranium sur un autre. Enfin, Fat man, nom donné à la bombe lancée sur Nagasaki, est une bombe A similaire à celle expérimentée en juillet 1945.
Pour l’Union soviétique, décidée à renforcer son influence dans le monde, notamment dans l’Est de l’Europe, il est désormais urgent de montrer à ses alliés, et ses ennemis, qu’elle n’entend pas laisser le monopole de ces moyens militaires nouveaux à l’autre puissance mondiale. Les programmes scientifiques fondamentaux lancés au cours des années 1920, interrompus avant la guerre, sont relancés en 1942, mais le retard est important. L’acquisition de connaissances, par l’espionnage et par l’étude des documents publiés par les Américains (4), permet toutefois aux Soviétiques d’accélérer leurs recherches.
Le passage à la phase industrielle pose plus de problèmes. Les Soviétiques choisissent donc de se concentrer sur le développement d’une arme au plutonium, plus facile à fabriquer puisqu’il résulte des processus de production de l’énergie nucléaire. Une fois réunie la quantité nécessaire de plutonium militaire, l’Union soviétique réussit à faire exploser son premier engin atomique, de conception identique à celui de Nagasaki, le 29 août 1949.
A la date où les Soviétiques font exploser leur bombe A, les débats concernant l’usage de la bombe font rage aux Etats-Unis. Deux grandes options sont mises en avant. Les « idéalistes » souhaitent confier à une autorité internationale l’ensemble des responsabilités concernant l’énergie atomique. Cette nouvelle organisation serait donc gestionnaire des gisements d’uranium, de la construction des centrales et, surtout, serait seule détentrice des connaissances concernant les applications militaires de l’atome. On trouve, parmi les principaux tenants de cette solution, de nombreux scientifiques ayant participé au projet Manhattan. Une proposition dans ce sens a été déposée à l’ONU par Bernard Baruch en juin 1946, mais les travaux de la commission sur l’énergie atomique sont interrompus en 1948, constatant que l’opposition des Etats-Unis et de l’URSS empêche de poursuivre les discussions.
A l’opposé, certains plaident pour l’utilisation rapide de bombes nucléaires contre l’URSS, considérant qu’un conflit est inévitable. Partageant cette analyse, de nombreux responsables militaires multiplient les demandes de moyens nucléaires, et le Conseil national de sécurité décidera même, le 16 septembre 1948, que l’utilisation d’armes nucléaires contre l’URSS doit être envisagée.
L’attitude des décideurs politiques ne correspond à aucune de ces options. S’ils n’encouragent pas les initiatives pacifistes, ils ne choisissent pas non plus d’utiliser l’arme nucléaire contre l’URSS. Les crises de Prague, en février 1948, puis de Berlin, en juin de la même année, ne déclenchent pas d’attaque nucléaire américaine.
L’entrée de l’Union soviétique dans l’âge nucléaire intervient au moment où les blocs dessinent leurs frontières définitives. Mao Ze Dong entre dans Pékin le 1er octobre 1949, et l’invasion de la Corée du Sud survient le 25 juin 1950. Les événements s’accélérant, les Etats-Unis font face à un paradoxe : constatant que l’arme nucléaire n’est pas une arme absolue, puisque leur monopole n’a pas empêché l’Union soviétique d’étendre son influence, ils doivent toutefois répondre au défi que représente un ennemi nucléaire.
La première décision sera la relance de l’industrie nucléaire. Celle-ci avait été confiée, en vertu d’une loi du 1er août 1946, à la commission de l’énergie atomique, composée de civils. Convaincus que la bombe nucléaire doit permettre une victoire totale sur l’URSS, les militaires américains obtiennent que soient remises en service, dès 1950 les installations industrielles nécessaires à la fabrication d’uranium enrichi, et à l’assemblage des bombes. L’industrie russe est également sollicitée, mais le retard technologique reste important.
L’Union soviétique poursuit l’objectif de rattraper le retard pris sur les Etats-Unis dans le domaine nucléaire militaire, afin de triompher dans la guerre à venir. Aux Etats-Unis, la doctrine d’utilisation de la bombe continue de faire l’objet d’âpres discussions. Lors de la guerre de Corée, plusieurs généraux demandent au président Truman d’utiliser ce conflit pour porter la guerre en Chine et, en utilisant l’arsenal américain, détruire les principales villes du pays afin de renverser le régime communiste. Là encore, la présidence préférera ne pas faire usage de ses armes, alors même que la menace nucléaire soviétique est encore loin d’être crédible.
b) Surpasser l’ennemi : le nucléaire offensif
Une fois dotée des connaissances nécessaires à la fabrication d’armes nucléaires, l’Union soviétique s’engage dans la construction d’un arsenal destiné à être utilisé dans le cadre d’une guerre contre le bloc occidental. C’est en tout cas l’engagement pris par Khrouchtchev devant le Comité central, alors que son rival Malenkov estime que l’affrontement entre capitalisme et communisme n’est pas inévitable. En réalité, les moyens dont dispose le pays sont limités. L’objectif poursuivi indirectement par Khrouchtchev est de remplacer les nombreuses divisions de l’armée de terre soviétique par un arsenal nucléaire moins coûteux, afin de redistribuer les ressources vers l’industrie civile.
L’accroissement de l’arsenal soviétique a pour conséquence de pousser les Américains à poursuivre la même politique. Nouvellement élu, le président Eisenhower demande à ce qu’une doctrine précise d’emploi de l’arme nucléaire soit rédigée. Celle-ci prévoit les cas dans lesquels les Etats-Unis recourront aux frappes nucléaires, en fonction du type d’attaque soviétique et de la région touchée. Toutefois, d’autres voix s’expriment, qui confirment que les responsables politiques ne s’estiment pas dépendants de la planification des militaires. Le secrétaire d’Etat John Foster Dulles soutient successivement deux positions. La première, dans un discours au Conseil national de sécurité des Etats-Unis au début de l’année 1953, où il affirme que les représailles massives promises en cas d’agression sur le territoire américain doivent également pouvoir être déclenchées en cas d’attaque soviétique sur un territoire allié. Dans un article de la revue Foreign Affairs, en avril 1954, il précise toutefois que les représailles massives ne sauraient être la seule réponse à une attaque soviétique.
Quelles que soient les éléments de doctrines d’emploi, les deux puissances sont convaincues de la nécessité de devoir augmenter la taille et la qualité des arsenaux. L’arme nucléaire continue d’être considérée comme un outil de la guerre à venir entre les deux blocs.
La percée majeure dans le domaine de la technologie nucléaire est obtenue dès le 1er mars 1954, avec l’explosion de la première bombe nucléaire américaine reposant sur la fusion d’atomes. Baptisé « bombe H », ce type d’armements utilise une réaction de fission, à partir de matériaux nucléaires militaires, afin de faire fusionner des atomes d’éléments légers, le deutérium et le tritium. La réaction de fusion nucléaire dégage une énergie au moins mille fois plus importante qu’une réaction de fission. Ainsi, la bombe expérimentée en 1954 dégage une puissance d’environ 15 MT (méga-tonnes d’équivalent TNT), 1 500 fois plus que la bombe d’Hiroshima. L’URSS réplique, le 22 novembre 1955, faisant exploser une bombe H de 1,6 MT.
L’arme nucléaire ne peut devenir crédible que si l’Etat qui la possède dispose de vecteurs appropriés. Là encore, les Etats-Unis possèdent un avantage initial considérable sur l’URSS. Par une série d’accords, notamment le traité de l’Atlantique Nord du 4 avril 1949, ils disposent de plusieurs bases à l’étranger, sur lesquelles peuvent stationner des bombardiers dont le rayon d’action reste, dans les années 1950, assez modeste. A l’inverse, l’URSS n’a pas de base proche des côtes américaines, et doit donc investir pour fabriquer des vecteurs à plus long rayon d’action.
L’Union soviétique n’arrivant pas à se doter de bombardiers à rayon d’action suffisant pour toucher les Etats-Unis, elle décide de favoriser les recherches lancées dès la fin de la deuxième guerre mondiale dans le domaine des missiles. Le 21 août 1957, elle peut annoncer le lancement du premier missile intercontinental (5), le SS-6, pouvant atteindre une cible distante de plus de 8 800 kilomètres. Surtout, la mise en orbite du premier satellite artificiel Spoutnik le 4 octobre 1957 renforce, aux Etats-Unis, le sentiment d’avoir été dépassés technologiquement, et d’être, par conséquent, menacés.
Afin de combler le « fossé des missiles » (missiles gap), les Américains construisent simultanément plusieurs classes de vecteurs balistiques : Thor (d’une portée de 4 500 kilomètres et d’une précision de 3 kilomètres) et Jupiter (2 800 kilomètres de portée et d’une précision de 800 mètres) pour l’armée de terre, Atlas d’une portée de plus de 9 000 kilomètres pour l’armée de l’air, et Polaris (d’une portée de 1 800 kilomètres) pour équiper les sous-marins.
La mise en service, le 27 octobre 1962, du premier missile Minuteman, d’une portée d’environ 10 000 kilomètres et d’une précision de 2 kilomètres, constitue une avancée importante pour les Américains. En effet, ces missiles fonctionnent grâce à un carburant solide, ce qui raccourcit leur délai d’activation, et réduit la possibilité, pour l’adversaire, de frapper les bases de missiles pendant le remplissage des réserves de carburant. En outre, leur coût est environ trois fois inférieur à celui des précédentes gammes de missiles.
Les sous-marins constituent un autre vecteur permettant de rendre crédibles les arsenaux nucléaires des deux grandes puissances. Là encore, l’Union soviétique fait le premier pas, en mettant à la mer, dès 1959, son premier sous-marin doté de missiles nucléaires tactiques, d’une portée de 250 kilomètres. Les Etats-Unis répondent en lançant, le 15 novembre 1960, les premiers essais du Georges Washington.
Comme pour les missiles, l’arsenal américain apparaît technologiquement plus avancé. En effet, le Georges Washington est un sous-marin à propulsion nucléaire, ce qui lui permet de rester en plongée pendant de longues périodes et donc réduit la possibilité d’être détecté. De plus, il emporte des missiles Polaris de portée largement supérieure aux Scud-A présents sur les submersibles soviétiques.
Les premiers essais de missiles intercontinentaux font franchir un nouveau pallier à la tension entre les deux « superpuissances ». Chacune devient en effet capable de toucher directement le territoire de l’autre. Comme le résume Georges le Guelte (6) : « la guerre devient techniquement possible ». Il faudra attendre 1962 et la crise de Cuba pour que les Etats-Unis et l’URSS constatent que l’arme nucléaire n’est pas une arme comme les autres, idée très éloignée des conceptions dominantes de 1945 à 1963.
2) France, Grande-Bretagne et Chine : la sécurité par la dissuasion
Parallèlement à la mise au point des arsenaux américain et russe, trois Etats ont développé des programmes nucléaires militaires de manière plus ou moins indépendante. Chacun de ces pays avait des raisons spécifiques de développer l’arme nucléaire, mais tous ont bien compris que la maîtrise de l’atome était un élément indispensable à la préservation de l’indépendance nationale.
Le fait que ces pays soient membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies n’est pas une coïncidence. Obligés d’assumer un rôle international majeur, aucun de ces pays ne souhaite dépendre d’une des deux puissances mondiales pour faire face à un conflit nucléaire.
La doctrine stratégique de ces trois Etats explique pourquoi le développement de leurs arsenaux a été relativement limité. Les bombes française, chinoise et britannique sont les premiers exemples de dissuasion dite « du faible au fort », dans laquelle une puissance moyenne assure son autonomie en menaçant de dommages inacceptables un ennemi potentiel.
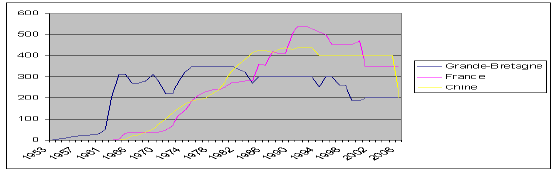
Source : Robert S. Norris and Hans M. Kristensen, « Global nuclear stockpiles, 1945-2006 », Bulletin of the Atomic Scientists 62, no. 4 ( juillet/août 2006)
Le 3 octobre 1952, la Grande-Bretagne réalise son premier essai réussi d’une bombe A, en Australie. Poursuivies pendant la seconde guerre mondiale, d’abord en coopération avec les Etats-Unis, puis de manière autonome à partir de la fin 1942, les recherches britanniques étaient fondées sur des connaissances théoriques acquises dès l’entre-deux-guerres. Le pays se dote d’une bombe H dès 1957, en annonçant la première explosion d’un engin de ce type le 15 mai.
La France, qui a interrompu ses recherches pendant la guerre, rattrape son retard et fait exploser une bombe A le 13 février 1960, dans le Sahara, puis une bombe H, le 24 août 1968 dans le Pacifique.
L’évolution des arsenaux de ces deux pays suit étroitement le cours de leur politique étrangère. Les deux puissances cherchent à s’assurer contre la menace soviétique, et à retrouver une influence sur les grandes questions stratégiques alors même que leurs empires coloniaux disparaissent. Toutefois, leurs doctrines nucléaires vont diverger, du fait de la relation différente qu’elles entretiennent avec leur allié le plus puissant.
En effet, la France et la Grande-Bretagne tirent une analyse diamétralement opposée de la crise de Suez, en octobre 1956. Si la France en déduit qu’elle ne peut mener à bien ses objectifs de politique internationale avec les Etats-Unis, la Grande-Bretagne en conclut au contraire qu’elle ne saurait réussir sans l’aide transatlantique.
Ainsi, la Grande-Bretagne, face à l’échec de ses programmes balistiques, choisit de se doter de missiles Polaris américains, au cours de la conférence de Nassau du 21 novembre 1962. Les forces stratégiques britanniques intègreront donc la force multilatérale de l’OTAN, qui deviendra par la suite le groupe des plans nucléaires. La France choisit pour sa part de poursuivre seule son aventure nucléaire, et refuse, en 1963, d’adhérer à la force multilatérale.
Le développement du programme nucléaire chinois correspond, comme pour la France et la Grande-Bretagne, à un objectif d’affirmation de son indépendance. Certaines déclarations américaines avaient laissé entendre que les bombes nucléaires des Etats-Unis pourraient servir à renverser le régime maoïste (7).
En plus d’une protection contre les Etats-Unis, la bombe chinoise sert également à se prémunir de l’influence soviétique, et à acquérir son indépendance vis-à-vis d’elle. Ainsi, même si la Chine a bénéficié de l’aide soviétique au titre de l’accord de coopération nucléaire du 15 octobre 1957, elle se voit contrainte de continuer seule, après que l’URSS décide d’interrompre leur collaboration au cours du mois de novembre 1959. La première bombe à fission chinoise explose finalement le 16 octobre 1964, suivie, le 17 juin 1967, par la première bombe thermonucléaire.
Alors que de nouveaux programmes nucléaires apparaissent au début des années 1960, une crise diplomatique majeure va bouleverser les conceptions dominantes, au sein des « deux grands », concernant l’arme nucléaire.
B – 1963-1991 : les premières tentatives de stabilisation
Malgré les nombreuses confrontations indirectes qu’ont connues les deux grandes puissances au cours des années 1950, aucun affrontement direct n’a permis de vérifier si l’arme nucléaire était réellement susceptible d’être utilisée, comme les doctrines dominantes le laissaient entendre. Au contraire, les affrontements à distance entre les Etats-Unis et l’URSS ont toujours été réglées sans qu’il fût fait usage des bombes atomiques.
Le début des années 1960 apportera l’indice que l’arme nucléaire ne peut être utilisée dans un conflit entre deux Etats. Confrontés à une menace à proximité de leur propre territoire, les Etats-Unis choisiront ainsi la voie diplomatique pour régler la situation, alors même que leurs capacités de frappe nucléaire sont supérieures à celle de l’Union soviétique. A partir de cette crise la politique nucléaire des deux puissances ne correspond plus à l’état des relations qu’elles entretiennent, mais semble suivre un cours autonome.
1) La crise de Cuba marque la fin de la conception offensive de l’arme nucléaire
L’arrivée au pouvoir de John Kennedy, en 1961, marque une inflexion dans la doctrine d’emploi des armes nucléaires américaines. Les stratèges américains, sous l’influence du secrétaire à la défense Robert Mac Namara, abandonnent le concept de « représailles massives », selon lequel les armes nucléaires devaient servir à détruire définitivement un ennemi coupable d’atteinte aux intérêts vitaux de la nation. L’idée de « riposte graduée » s’impose, afin de confirmer que l’arme nucléaire reste un instrument au service du chef de l’Etat. Kennedy considérait en effet qu’en conservant le principe de représailles massives, les Etats-Unis s’interdisaient, dans les faits, d’avoir recours à leur arsenal nucléaire dans la plupart des cas d’agressions soviétiques.
La présidence Kennedy ne s’accompagne en rien d’une réduction de l’effort nucléaire américain. Au contraire, le programme électoral du candidat Kennedy prévoit de porter l’arsenal américain à un niveau supérieur. Une fois élu, celui-ci annonce, le 28 mars 1961, la construction de 600 Minuteman et 24 sous-marins équipés de Polaris. L’Union soviétique annonce quant à elle la mise au point d’un nouveau missile intercontinental, le SS-7. Utilisant, comme son prédécesseur, du carburant liquide, ce nouvel engin est capable de frapper les Etats-Unis depuis l’intérieur du territoire russe, puisque sa portée est comprise entre 11 000 et 13 000 kilomètres.
L’année 1962 offre donc un visage très paradoxal. Les Soviétiques sont conscients de la fragilité de leur arsenal, et les services de renseignement américains ont fait part de ces faiblesses à l’administration Kennedy. Pourtant, les Etats-Unis continuent de poursuivre des programmes d’armement de grande ampleur, répondant ainsi à une demande de l’opinion toujours inquiète des avancées technologiques soviétiques, vantées par la propagande du pouvoir en place. C’est dans ce contexte particulièrement tendu que va naître la crise des missiles de Cuba.
Au cours de l’été 1962, plus précisément le 22 août, des avions de surveillance américains U-2 détectent la présence d’équipements militaires de grande taille installés par les Soviétiques sur l’île de Cuba, dirigée par Fidel Castro depuis 1959. Le Président Kennedy indique au Président Khrouchtchev, dans un message du 2 septembre, que l’installation d’armes offensives à Cuba serait considérée comme une menace directe à l’encontre des Etats-Unis. Malgré les propos rassurants des dirigeants soviétiques, les services américains confirment, au mois d’octobre, que des bases de lancement de missiles SS-4 (8) sont en train d’être construites.
La décision russe est présentée comme une réponse à la présence de missiles américains en Turquie. Elle vise principalement à prévenir toute nouvelle tentative d’invasion de Cuba par les Etats-Unis (9). Initialement, les proches conseillers du président américain y voient une menace extrêmement grave sur la sécurité de leur pays. Certains préconisent même, reprenant les doctrines traditionnelles, une frappe massive de l’Union soviétique.
Pourtant, au fil des semaines, la position de l’administration évolue. Ce qui apparaissait comme une situation militaire est désormais appréhendée comme un problème politique. En effet, la supériorité nucléaire américaine reste écrasante, et les dirigeants américains estiment improbable que l’URSS choisisse de risquer un affrontement nucléaire. Il s’agira dès lors, pour Kennedy, jeune président fraîchement élu, de ne pas apparaître trop faible face à Khrouchtchev.
La solution finalement adoptée permet aux deux puissances de sauver les apparences. Le 22 octobre, Kennedy annonce la mise en place d’un embargo autour de Cuba. Le 26 octobre, Khrouchtchev indiquait qu’il ne refuserait pas l’affrontement si les Etats-Unis le provoquait. Certains hiérarques soviétiques demandaient même à ce que les missiles soient tirés le plus vite possible, pour bénéficier de l’effet de surprise.
Finalement, Khrouchtchev déclare qu’il acceptera de retirer des missiles si les Etats-Unis s’engagent à ne pas envahir Cuba, et retirent leurs missiles déployés à l’extérieur. L’URSS accepte de démanteler ses installations le 29 octobre, et les Etats-Unis retirent leurs missiles Jupiter du sol turc. Cette dernière concession est en fait toute relative, considérant que l’état-major américain avait en fait déjà prévu de retirer ces missiles.
La crise de Cuba marque un tournant dans la course au nucléaire que se livrent les Etats-Unis et l’URSS. Alors qu’elles semblent engagées dans une confrontation radicale, les deux puissances montreront finalement assez de sagesse pour ne pas aller jusqu’à menacer directement les intérêts vitaux de chacune d’entre elles. En effet, par le retrait de leurs missiles, les Soviétiques indiquent qu’ils admettent que les Etats-Unis ne reculeront pas s’agissant de l’utilisation du territoire cubain.
La résolution de la crise montre que les deux puissances réservent l’utilisation des armes nucléaires à une menace directe et indiscutable sur leurs intérêts vitaux. Dans les mois suivants, les responsables des deux camps vont admettre que l’usage d’armes nucléaires dans des conflits d’influence entre Etats n’est pas acceptable. D’arme offensive, l’arme nucléaire devient une arme de dissuasion.
2) Etats-Unis et URSS, entre apaisement et course aux armements
La tension à la fin de l’année 1962 atteint un paroxysme qu’elle ne retrouvera que rarement par la suite. Sans que l’on puisse parler de rapprochement, les deux puissances américaine et soviétique acceptent progressivement l’existence de l’autre, et admettent son importance stratégique. Dès lors, l’important n’est plus de disposer d’un arsenal nucléaire pour frapper, mais de maintenir l’équilibre vis-à-vis de l’autre afin de ne pas apparaître en position de faiblesse.
Cet objectif est d’autant plus difficile à atteindre que chaque partie rivalise d’ingéniosité afin de contourner les règles, qu’elle a pourtant acceptées, sous la pression d’un lobby militaro-industriel qui ne souhaite pas voir les grands programmes d’armements nucléaires brusquement abandonnés.
a) La poursuite de la course aux armements malgré le rapprochement stratégique
Entre 1964 et la fin des années 1970, l’URSS et les Etats-Unis améliorent et développent leurs arsenaux. Les chiffres suivants indiquent le nombre estimé d’armes nucléaires détenues par les deux Etats (10).
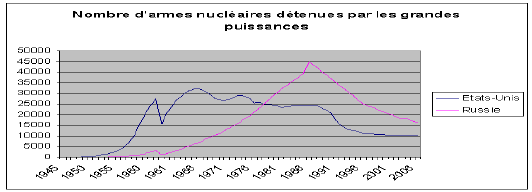
Parallèlement à l’augmentation du nombre d’armes nucléaires, les Etats-Unis et l’URSS poursuivent leurs efforts technologiques concernant les vecteurs. La mise au point des premiers missiles à têtes multiples par les Américains en 1964, puis des missiles à têtes multiples indépendantes en 1970, confère un avantage aux Etats-Unis jusqu’en 1975, date de l’entrée en service des premiers missiles soviétiques « mirvés » (11). La précision des missiles est également accrue, avec la mise au point des missiles de deuxième génération soviétiques, notamment le SS-9 (précision de 2 kilomètres pour une charge de 10 MT). Les Minuteman-II américains disposent également d’une portée et d’une précision augmentées par rapport à la première version.
Ces développements interviennent alors même que les Etats-Unis et l’URSS conduisent des discussions permettant de fixer l’équilibre stratégique entre les deux puissances. D’abord, des efforts sont faits afin de limiter la possibilité, pour chaque bloc, de moderniser ses arsenaux. Un premier traité, signé le 5 août 1963 à Moscou, interdit ainsi les essais nucléaires dans l’atmosphère, dans l’espace extra-atmosphérique et sous l’eau. Il convient toutefois de souligner que les essais souterrains restent autorisés, et sont d’ailleurs considérés comme plus efficaces par les scientifiques dès cette époque. Deux autres traités, du 27 janvier 1967 et du 11 février 1971, interdisent de baser des armes nucléaires dans l’espace ou dans les fonds marins.
Surtout, les deux puissances s’entendent pour réduire le risque d’affrontement nucléaire. En premier lieu, elles s’accordent pour mettre au point le traité de non prolifération, ouvert à la signature le 1er juillet 1968. Devenue une arme de dissuasion, puisqu’elle n’est pas destinée à être employée, la bombe nucléaire est perçue, en France et en Chine notamment, comme garante de l’indépendance nationale. Les deux puissances mondiales ne peuvent tolérer que cette démarche soit suivie par d’autres Etats suffisamment développés pour se doter d’un arsenal stratégique.
En second lieu, conscients que la rivalité entre les blocs n’est pas supprimée, les Etats-Unis et l’Union soviétique décident de marquer leur volonté de préserver l’équilibre mondial en lançant des discussions sur la limitation des armes stratégiques (12). Les accords SALT I et SALT II visent à fixer, pour chaque partie, le niveau maximal d’armement nucléaire nécessaire au maintien de l’équilibre stratégique.
Le premier accord ne concerne que les vecteurs d’armes nucléaires. Il interdit la construction de nouvelles bases de lancement pour des missiles sol-sol (13), et limite le nombre de sous-marins lanceurs d’engins à ceux déjà en service ou en construction. Ce traité reste très limité. Conclu pour cinq ans, il ne fixe pas de limite aux nombres d’armes stratégiques effectivement déployées, a fortiori aux armes effectivement détenues.
L’accord intérimaire SALT I prévoit qu’un nouveau texte soit signé cinq ans après son entrée en vigueur. L’accord SALT II ne sera signé que sept ans plus tard, en 1979. Fondé sur les mêmes principes que son prédécesseur, il innove simplement en imposant une limite au nombre d’ogives portées par un seul vecteur. Pour le reste, un plafond global est fixé pour le nombre de lanceurs, à 2 400 jusqu’en 1981, date à laquelle il est réduit à 2 250.
Les plafonds fixés par les deux accords SALT restent très importants. Il s’agit en effet de garantir que chaque partie conserve la capacité de causer des dommages suffisants à son adversaire pour limiter le risque de première frappe. Ce véritable « équilibre de la terreur » s’appuie par ailleurs sur un traité complémentaire, qui vise précisément à conserver un caractère dissuasif aux arsenaux nucléaires existants.
Le traité sur les missiles anti-balistiques (14) est signé le même jour que l’accord intérimaire issu de SALT I. Il vise à restreindre les capacités de défense des Etats-Unis et de l’Union soviétique contre une attaque nucléaire portée par l’autre partie. Stratégiquement, il permet de maintenir la crédibilité de la menace que chaque puissance fait peser sur l’autre, en limitant les installations de défense antimissiles à deux, puis un seul site, conformément à un avenant signé le 3 juillet 1974 (15).
Malgré les intentions affichées, l’amélioration et le développement des arsenaux nucléaires se poursuivent, tout au long des années 1970, en exploitant toutes les failles des traités de limitation des armements. Ainsi, les Etats-Unis augmentent le nombre de missiles « mirvés » dans leur arsenal, et augmentent considérablement la portée de leurs missiles de croisière, qui ne sont pas visés par les traités SALT.
Les Soviétiques répliquent en déployant des missiles dits de troisième génération, les SS-18, missiles sol-sol dotés de dix ogives indépendantes et d’une portée comprise entre 11 000 et 16 000 kilomètres. Il s’agit du plus gros vecteur balistique jamais construit. Par ailleurs, les nouveaux SS-N-8, équipent les sous-marins et transportent jusqu’à dix ogives.
Les progrès de l’URSS et l’enlisement américain au Viêt-Nam, dont le coût commence à peser sur les autres dépenses militaires, suscitent une forte inquiétude dans les milieux militaires. Le déploiement de missiles SS-20 (16) en Europe de l’Est, commencé en 1978, conduit les Etats-Unis à accélérer un projet de missile resté en suspens, le Pershing II. Le 1er décembre 1979, le Conseil de l’Atlantique Nord s’engage à déployer 108 des ces engins, et plus de 400 missiles de croisière Tomahawk, si les missiles soviétiques ne sont pas retirés d’ici 1983.
L’équilibre obtenu à la fin des années 1970 est donc très paradoxal. Selon l’expression de Robert Mac Namara, il repose sur un principe « fou » de destruction mutuelle assurée(17). La maintien de la capacité de destruction de chacune des deux puissances est même garanti par un ensemble de textes, fixant des plafonds d’armement et interdisant de se protéger contre la menace de l’adversaire. Les doctrines nucléaires ont également changé. Conscient de l’impossibilité de frapper en premier sans subir en retour des dommages irréparables, le secrétaire à la défense James Schlesinger décide de réorienter les équipements nucléaires américains. Désormais, la priorité est donnée aux armes permettant de réduire le potentiel offensif adverse.
b) Les années Reagan : un changement de ton plus que de fond
Le changement opéré par Ronald Reagan semble, avec le recul, plus marqué dans la forme que dans le fond. Certains arguments développés pendant la campagne avaient pu faire craindre un retour aux conceptions offensives de l’arme nucléaire. Pourtant, le développement des Tomahawk et des Pershing II avait été décidé dès 1979 par Jimmy Carter. En fait, Ronald Reagan choisit surtout d’augmenter les moyens des services de renseignement, et ceux de la propagande, et imprime une orientation résolument anti-communiste à la politique étrangère américaine(18), mais la politique nucléaire ne connaît pas de bouleversement notable.
Dans le même temps, l’URSS, en plus du déploiement des SS-18 sur le sol russe et des SS-20 sur le territoire des membres du pacte de Varsovie, lance les programmes de recherche des missiles de troisième génération, les SS-24 et les SS-25 (19). Toutefois, ces matériels n’entreront en service qu’à la fin des années 1980. En revanche, l’Union soviétique se dote de nouveaux sous-marins nucléaires de grande taille, les Typhoon, capables d’emporter 10 missiles de nouvelle génération SS-N-20 (20).
Sur le fond, les relations entre les deux puissances se tendent une nouvelle fois. Des discussions avaient pourtant été engagées, en 1981, d’une part, pour poursuivre l’objectif de maîtrise des armements, conformément aux engagements de SALT II, d’autre part, pour examiner le cas des forces nucléaires intermédiaires (FNI), qui concernent directement les SS-20 déployés en Europe. Elles avaient abouti au constat de positions irréconciliables de part et d’autre de la table de négociation.
Consciente que l’opinion publique américaine reste attachée à des initiatives pouvant réduire le risque de conflit, l’administration Reagan choisit d’afficher une ouverture diplomatique importante, tout en favorisant les éléments de blocage des discussions. Après avoir offert de démanteler tous les missiles de portée intermédiaire en Europe, ce qui avantage les Etats-Unis, puisque les Soviétiques disposent déjà de missiles, alors que les Etats-Unis projettent seulement d’en déployer, Reagan demande que les négociations stratégiques poursuivent un objectif de réduction des arsenaux, et pas seulement de limitation. Le 29 juin 1982, les discussions SALT deviennent ainsi les START (21).
Là encore, les calculs diplomatiques au sein de chaque bloc rendent les discussions quelque peu vaines. Le déploiement des missiles américains en Europe au cours du mois de novembre 1983 incite finalement les Soviétiques à interrompre les deux cycles de négociations. La « crise des euromissiles » aura un impact profond sur les gouvernements des Etats européens, et leurs opinions publiques, et contribuera à bloquer les contacts entre les Etats-Unis et l’URSS pendant plusieurs années.
Les années 1980 voient également apparaître un nouveau thème de discussion entre les deux blocs. Annoncée le 23 mars 1983, l’initiative de défense stratégique, parfois désignée comme la « guerre des étoiles », est un projet américain visant à créer une défense antimissile réellement efficace, fondée sur l’idée qu’une destruction à l’aide de lasers de puissance permettrait d’empêcher les missiles intercontinentaux soviétiques d’atteindre leur cible. On parle alors de système de protection contre des frappes limitées ou GPALS (global protection against limited strikes).
Le lancement de ce programme va volontairement à l’encontre de l’équilibre prévu par le traité ABM. L’administration Reagan assume cette orientation, et l’organisation pour l’initiative de défense stratégique poursuivra donc ses travaux jusqu’en 1994, bien que son objectif ait été drastiquement réduit en 1987, passant de la protection de la totalité du territoire américain à la seule défense des silos de missiles stratégiques.
Malgré la persistance de deux sujets d’affrontement, les euromissiles et la défense antimissile américaine, les négociations stratégiques sont reprises dès 1985 entre les Etats-Unis et l’URSS. A cette date, il apparaît clairement à Gorbatchev, nouveau Premier Secrétaire du Parti communiste d’URSS, que le temps joue désormais en faveur des Occidentaux, dont les capacités de production de missiles sont largement supérieures à celles de son pays. De plus, les développements de la défense antimissile américaine sont perçus, à l’époque, comme une sérieuse menace sur l’équilibre stratégique de la planète.
Le 10 décembre 1987 le traité sur les forces nucléaires intermédiaires est signé. Il prévoit la suppression de tous les euromissiles. Un tel résultat a été permis par la décision, prise en février 1987, de ne plus suspendre la signature soviétique à la condition de l’abandon de l’initiative de défense stratégique. Dans la foulée, l’URSS s’engage également à retirer tous ses missiles à courte portée déployés sur le territoire de pays alliés.
La disparition de l’Union soviétique, en 1991, n’empêche pas la poursuite des négociations entre les Etats-Unis et la Russie, qui succède, du point de vue du droit international, à l’URSS. A très court terme, l’urgence est de proposer un cadre juridique adéquat, et des offres de soutien technique et financier, pour éviter que l’immense arsenal nucléaire soviétique ne devienne l’objet d’un marché parallèle.
3) La gestion de l’arsenal soviétique après 1991 : un exemple de coopération pour la maîtrise des armements
L’effondrement du bloc soviétique fait naître de nouveaux risques. L’arsenal soviétique doit être réduit et sécurisé, et les nouvelles autorités ne semblent pas en mesure d’assurer ces missions. Les Etats-Unis proposent, par la loi Nunn-Lugar du 12 décembre 1991, de lancer un programme de coopération pour la réduction de la menace, qui vise à réunir des fonds pour organiser l’assistance technique. Plusieurs pays participeront à ce programme, notamment la Communauté européenne et le Japon. La majorité de l’aide sera toutefois fournie par les Américains.
Parallèlement, la Russie, héritière de l’Union soviétique, doit récupérer les armes nucléaires, stratégiques et tactiques, disséminées sur l’ensemble des territoires de l’ex-URSS. Des missiles intercontinentaux ont en effet été déployés en Biélorussie, en Ukraine et au Kazakhstan. Des usines de fabrication d’armes nucléaires sont également présentes dans certains de ces pays. Le protocole signé à Lisbonne le 23 mai 1992, par la Russie, les Etats-Unis et les trois anciennes Républiques soviétiques, fait de la Russie la seule héritière de l’arsenal stratégique soviétique. Les trois autres Etats acceptent d’adhérer au traité de non prolifération, en 1993 pour la Biélorussie, 1994 pour le Kazakhstan et l’Ukraine.
Les armes nucléaires tactiques (missiles sol-air pour la défense anti-aérienne, armes antichars, torpilles) posent une difficulté d’une toute autre ampleur. Disséminées sur l’ensemble du territoire soviétique et soumises à une chaîne de commandement extrêmement courte, elles ont été produites par milliers, et pourraient faire l’objet d’un marché noir nucléaire extrêmement dangereux. L’accord de Minsk du 30 décembre 1991 prévoit que toutes les armes nucléaires tactiques doivent être rapatriées en Russie dans un délai de 6 mois. Les autorités russes affirment, le 6 mai 1992, que les engagements de l’accord ont tous été honorés. Des rumeurs persistantes affirment que ces « petites » armes nucléaires seraient au contraire toujours disponibles pour d’éventuels acheteurs, mais aucune preuve n’a été apportée à ce jour.
La situation des milliers de scientifiques travaillant pour le complexe nucléaire militaire soviétique est également prise en compte par les Occidentaux. Afin d’éviter le phénomène de « fuite des cerveaux », deux centres internationaux de la science et de la technologie sont créés à Moscou et à Kiev, financés par les Etats-Unis, la Communauté européenne, le Canada, le Japon, la Norvège et la Corée du Sud.
La nécessité de neutraliser le stock de matériaux nucléaires militaires russes pose de plus amples problèmes. Les accords de réduction des arsenaux, tactiques et stratégiques, conduisent en effet à démanteler un certain nombre d’armes nucléaires, sans prévoir comment les matières fissiles seront ensuite réemployées. Un accord signé le 18 février 1993 entre la Russie et les Etats-Unis prévoit que ces derniers achèteront 500 tonnes d’uranium hautement enrichi à la Russie, afin de le diluer pour le rendre propre à un usage civil. Prévue pour 20 ans, la mise en œuvre de cet accord a été considérablement ralentie en raison de difficultés internes aux Etats-Unis, laissant donc un important stock d’uranium de qualité militaire en Russie au moins jusqu’en 2013.
Concernant le plutonium, les Etats-Unis ont affirmé, en 1995, qu’ils possédaient 50 tonnes excédant leurs besoins, quantité ramenée ultérieurement à 34 tonnes. Les autorités russes ont fourni exactement les mêmes chiffres, à la différence près qu’aucune mesure de retraitement du plutonium excédentaire n’a été proposée par la Russie, contrairement aux Etats-Unis.
C – Le monde après 1991 : vers une nouvelle prolifération nucléaire ?
La fin de la guerre froide, la période de transition qui a suivi, la chute de l’URSS et sa dislocation en quinze Etats ont donné l’espoir que les grandes puissances s’engageraient vers une politique de réduction notable des armements nucléaires. Si cet espoir a pu être entretenu quelques années, il a rapidement laissé place à une nouvelle phase de tension. La Russie et les Etats-Unis n’étaient pas seulement des rivaux idéologiques, porteurs l’un et l’autre d’une idéologie messianique, mais également des grandes puissances ayant leurs intérêts propres. Les ADM sont demeurées en conséquence l’apanage de leur puissance. Parallèlement, d’autres Etats ont souhaité se doter de l’arme nucléaire. Le paradoxe est que la fin de la guerre froide a constitué le départ d’un nouvel âge de prolifération.
1980 – 1993, ou la tentative de mettre fin à la course aux armements
- 20 janvier 1981 : prise de fonction de Ronald Reagan à la présidence des Etats-Unis. Il est soutenu entre autre par les néo conservateurs qui militent depuis les années 70 pour la réalisation du missile mobile MX, qui permettrait aux forces nucléaires américaines de riposter en cas de première frappe soviétique. L’échec des essais sur ce missile conduit le Président américain à lancer en mars 1983 l’Initiative de défense stratégique (IDS) pour rendre le territoire américain invulnérable, ce qui rendraient obsolètes les armes nucléaires. Les premières années de son mandat sont également dominées par la question des SS 20 soviétiques en Europe.
- 23 février 1981 : au XXVIème congrès du Parti Communiste, Leonid Brejnev admet la validité de la doctrine de dissuasion nucléaire, considérant que l’URSS a atteint la parité avec les Etats-Unis et que le niveau considérable d’arsenaux nucléaires conduirait à un anéantissement tel qu’aucune des deux grandes puissances n’oserait prendre l’initiative d’un conflit.
- 18 novembre 1981 : dernière proposition américaine et échec des négociations sur les SS 20 en Europe.
- 9 mai 1982 : Ronald Reagan propose de changer les négociations SALT (strategic arms limitation talks : limitation des armements stratégiques) en négociations START (strategic arms reduction talks / réduction des armements stratégiques), offre acceptée par Moscou en juin.
- 23 mars 1983 : l’IDS, en forgeant une défense antimissile, doit traduire une montée en puissance globale des Etats-Unis et rendrait obsolète la dissuasion soviétique. Ce projet inquiète fortement Moscou qui considère que Washington se prépare en fait à conduire une stratégie de frappe préventive. Le parer exigerait une refonte de l’appareil économique de l’URSS que refusent Leonid Brejnev puis ses successeurs, Youri Andropov et Constantin Tchernenko. L’année est marquée par la crise des euromissiles et par des observations satellites erronées qui font croire à des attaques nucléaires.
- 11 mars 1985 : accession au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev. N’ayant jamais eu de liens étroits avec les responsables de la défense et de l’industrie d’armement soviétiques, il n’adhère à aucune doctrine stratégique spécifique. L’échec de l’Armée rouge en Afghanistan, la solidarité sans faille des Etats de l’OTAN dans la crise des SS 20, l’accident de Tchernobyl et une série d’échecs technologiques dans le domaine balistique le convainquent que le modèle soviétique est à bout de souffle et que seul l’apaisement des relations avec les Etats-Unis permettra à son pays de relancer son économie et de progresser technologiquement.
- 11 et 12 octobre 1986 : la rencontre de Reykjavik entre Reagan et Gorbatchev semble en apparence un échec, les concessions mutuelles qu’ils étaient prêts à faire sur la prolongation du traité ABM, l’interdiction des armes balistiques et la réduction des arsenaux ayant achoppé sur l’IDS. Mais Gorbatchev conserve l’idée de diminuer le nombre des arsenaux et renouvelle son offre en février 1987, sans exiger préalablement la renonciation des Etats-Unis à l’IDS.
- 1987 : échec de l’IDS (hostilité du Congrès, échecs technologiques) qui, de programme défensif, se transforme en programme d’arme de première frappe, conformément aux vœux des néo conservateurs.
- Avril et mai 1987 : l’URSS déclare son intention de supprimer ses missiles à courte portée et à portée intermédiaire. Accord entre les pays du Pacte de Varsovie et de l’OTAN sur les missiles à portée intermédiaire. Adoption d’une nouvelle doctrine par le Pacte de Varsovie, indiquant qu’il ne recourra pas en premier aux ADM. Retrait des Pershings I américains stationnés en Allemagne fédérale.
- 8 décembre 1987 : signature du traité sur les forces nucléaires intermédiaires (FNI). Les Etats-Unis et l’URSS renoncent à leurs missiles ayant une portée de 500 à 5500 km. Chaque pays doit également accepter des inspecteurs de l’autre pays sur son territoire. Le traité sera scrupuleusement appliqué.
- 7 décembre 1988 : Mihaïl Gorbatchev déclare devant l’Assemblée générale de l’ONU que « la force ou la menace de la force ne peuvent plus être les instruments de la politique internationale ».
- 9 novembre 1989 : chute du mur de Berlin.
- Juillet 1990 : divergences de vue au sein de l’OTAN sur l’emploi des armes nucléaires. Alors que la menace d’une invasion de l’Europe par les Soviétiques, par voie conventionnelle, demeure une possibilité en raison du retrait des missiles sur le continent, le Conseil de l’Atlantique Nord (CAN) déclare que tout en jouant un rôle essentiel au sein de l’Alliance, les armes nucléaires doivent être utilisées en dernier recours. Vive opposition de la France et du Royaume Uni, Jean-Pierre Chevènement, ministre de la Défense déclarant qu’il ne faut pas laisser croire aux Soviétiques que l’emploi des armes nucléaires françaises pourrait être différé en cas d’attaque de leur part, quelle qu’en soit la forme. En juillet 1991, le CAN donne satisfaction à la France en décidant que les armes nucléaires, « essentielles à la paix, ne sont pas des armes de dernier recours ».
- 1er juillet 1991 : dissolution du Pacte de Varsovie.
- 31 juillet 1991 : signature du traité START I sur la réduction des armes stratégiques offensives. Le total des lanceurs sol-sol et mer-sol et des bombardiers stratégiques ne doit pas excéder 1600 dans chaque pays, avec un maximum de 6000 ogives répartis sur ces lanceurs.
- 19 août 1991 : échec de la tentative de coup d’Etat en Russie. Le 8 décembre, les Présidents de Russie, d’Ukraine et du Belarus constatent que l’URSS a de facto cessé d’exister. L’obsession des Etats-Unis est d’éviter que la dislocation de l’URSS entraîne la dissémination de milliers d’ADM nucléaires, chimiques et biologiques.
- 12 décembre 1991 : face à l’insécurité qui règne sur la protection des anciens arsenaux stratégiques soviétiques, le Congrès des Etats-Unis vote la loi Nunn – Lugar, afin d’aider la Russie et les pays de la CEI à réduire la menace liée à l’existence d’armes et de matières fissiles, chimiques et biologiques dans l’ex-URSS.
- 30 décembre 1991 : accord de Minsk prévoyant que les armes nucléaires tactiques présentes sur les territoires ukrainiens, belarusses et kazakhs seront rapatriées en Russie.
- 23 mai 1992 : signature du Protocole de Lisbonne entre la Russie, l’Ukraine, le Belarus, le Kazakhstan et les Etats-Unis. La Russie devient juridiquement le seul Etat héritier de l’arsenal nucléaire de l’URSS et signataire du TNP. Les autres pays sont invités à signer rapidement le TNP en échange d’une aide financière américaine.
- 3 janvier 1993 : après de nouvelles propositions russes, signature du traité START II, ramenant le nombre total d’ogives entre 3000 et 3500. Le nombre des lanceurs est porté à 1750, mais les milieux militaires et nationalistes russes s’emportent contre la disposition limitant à 1 le nombre d’ogive par lanceur sol sol, ce qui affaiblit leur dissuasion alors que les missiles américains sont essentiellement tirés des sous-marins, non concernés par cette disposition. Boris Eltsine escompte de cette concession sans contrepartie que les Etats-Unis associeront la Russie à la construction et à la gestion du nouvel ordre mondial.
1) 1993-2009 : illusions et désillusion
Au début des années 90, la logique héritée de la guerre froide semblait devoir se poursuivre. Au paroxysme représenté par la crise de Cuba, avait succédé une période de relative stabilité, au cours de laquelle les principales puissances nucléaires, au premier rang desquelles les Etats-Unis et la Russie, faute de pouvoir acquérir un avantage technologique et stratégique décisif sur l’autre partie, s’étaient efforcées de gérer leurs arsenaux et de prévenir un conflit d’origine accidentelle. La dislocation du bloc soviétique devait théoriquement accentuer la tendance vers la réduction des arsenaux puisque les menaces devaient s’estomper.
Plusieurs signaux renforçaient l’impression d’une sécurisation croissante dans le domaine nucléaire : signature par la France et la Chine du TNP (1992), accord cadre entre les Etats-Unis et la Corée du Nord (1994), traité sur l’interdiction des essais nucléaires (1996), prorogation indéfinie du TNP (1995)… La fin de la guerre froide a également été marquée par la réduction du stock des arsenaux. Les traités START I et START II réduisaient quasiment de moitié le niveau des ADM russes et américains tandis que parallèlement la Chine, le Royaume-Uni et la France s’engageaient dans la même démarche. S’il est vrai qu’une part de ces réductions correspondaient à l’élimination d’armes obsolètes, elles allégeaient incontestablement les menaces pesant sur l’humanité.
L’Inde et le Pakistan s’étaient certes engagés dans la possession d’armes nucléaires à cette période, mais l’apparition de puissances se situant hors du TNP n’a pas inquiété la communauté internationale. Il convient d’une part de rappeler que le Pakistan a développé sa technologie nucléaire civile avec l’aide initiale de la France et avec l’accord tacite des Etats-Unis, qui s’appuyaient sur Islamabad pour affronter via le mouvement taliban les Soviétiques en Afghanistan. D’autre part, la bombe indienne apparaissait comme un contrepoids stratégique à celle de la Chine communiste… Il était clair que les bombes indiennes et pakistanaises constituaient un élément du conflit entre les deux pays, mais qu’elles ne menaçaient pas la paix du monde. Enfin, ces deux pays étaient et sont toujours des démocraties parlementaires qui souhaitaient assurer leur sécurité, protéger leurs frontières comme leurs ressortissants, mais aucun n’avait de visée hégémonique ou n’était porteur d’une vision messianique comme les grands acteurs de la guerre froide.
Faut-il parler, au milieu des années 90, de stabilisation ou de diminution de la menace ? Les spécialistes en stratégie ne s’accordent pas sur la question. Si le niveau des stocks d’ADM a bien diminué, la logique de la dissuasion et de l’équilibre de la terreur a été maintenue, l’arme nucléaire étant toujours l’assurance-vie des Etats qui la détenaient. La question ne semble pas pertinente au regard du pouvoir de destruction des armes nucléaires. Les stocks restaient à un niveau suffisant pour provoquer des dommages irréparables en cas de conflit.
La fin de la guerre froide a entretenu un bref temps l’illusion d’un apaisement généralisé des relations internationales. Mais l’unilatéralisme des Etats-Unis, provenant du constat par certaines élites américaines que leur pays était la seule superpuissance conventionnelle et nucléaire, a entraîné le retour de la tension avec la Russie et l’opposition de nombre de leurs alliés au sein de l’OTAN sur leur politique au Moyen-Orient. Face à une menace jugée stratégique, la Russie n’allait pas s’engager dans une nouvelle phase de diminution de ses ADM. Par ailleurs, les Etats-Unis, malgré leurs moyens, et les Etats membres du TNP ont été incapables de prévenir l’apparition des programmes nord-coréen et iranien, ni d’évaluer le caractère proliférateur du programme pakistanais.
La diminution du stock des armes ne peut non plus masquer les efforts de la plupart des puissances pour moderniser leur arsenal. Si les Etats-Unis et la Russie ont accepté par les traités START de limiter leurs arsenaux pléthoriques, qui constituaient une charge financière très lourde, la Chine, l’Inde et le Pakistan n’étaient pas tenus par de telles obligations et non contents de mieux maîtriser les technologies balistiques complexes, ont élevé le niveau de leurs stocks d’ADM. Enfin, différents documents montrent l’intérêt de plusieurs mouvements terroristes sur l’acquisition de telles armes, même s’ils sont incapables d’en faire usage.
Les intérêts stratégiques des Etats ont donc rapidement prévalu, après une courte période que l’on pourrait qualifier d’illusoire, au cours de laquelle la communauté internationale a espéré voir le stock d’ADM diminuer. De nouveaux Etats nucléaires sont apparus, d’autres s’efforcent d’accéder au statut de puissance nucléaire. Même les Etats-Unis, qui ne cessent d’affirmer leur volonté de limiter la prolifération, ont trahi leurs principes en signant avec l’Inde un accord nucléaire dans le but de contrebalancer la puissance chinoise en Asie et d’accéder aux marchés civils et militaires indiens. La période allant de 1993 à nos jours risque d’apparaître non comme une phase de transition mais comme un âge au cours duquel, libérés des alliances résultant de la guerre froide, les Etats qui souhaitaient se doter d’armes nucléaires ont mis leur projet à exécution, sans que le TNP puisse les en empêcher.
2) Persistance de la rivalité entre les Etats-Unis et la Russie
La fin de la guerre froide a donné aux Etats-Unis l’impression que leur puissance était sans limite – ce caractère étant accentué sous le mandat de M. George W. Bush, sous la pression de néo conservateurs partisans d’une politique d’intransigeance pour la défense des intérêts américains – jusqu’à ce que Washington ait été confrontée au terrorisme, ait rencontré des difficultés en Irak et en Afghanistan et se soit heurtée à la renaissance d’une Russie qui, forte de son rôle de fournisseur de gaz et de pétrole, défend ses intérêts dans les Balkans comme en Asie centrale. A un monde qui semblait dominé par une hégémonie a succédé un monde multipolaire plein d’incertitudes.
La période qui va du milieu des années 90 à nos jours semble donner raison au général de Gaulle, qui affirmait que les nations primaient sur les idéologies. L’effondrement du communisme et le ralliement de la Russie à l’économie de marché devaient théoriquement transformer les Etats-Unis et la Russie en alliés. Il n’en a rien été.
Les deux pays ont en revanche maintenu dans un premier temps un dialogue étroit dans le domaine stratégique car ils avaient un intérêt évident à maintenir leur duopole face à la montée en puissance de la Chine et l’élargissement du nombre des Etats qui disposaient d’ADM nucléaires. C’est ainsi à leur initiative que le TNP a été prorogé pour une période indéfinie le 17 avril 1995.
a) Le maintien d’un contentieux politique entre les Etats-Unis et la Russie
Alors que les deux pays avaient des positions proches sur la lutte contre le terrorisme (lutte contre Al Qaida, guerre en Tchétchénie, aide technique de la Russie aux forces de l’OTAN engagées en Afghanistan), plusieurs dossiers les ont divisés : élargissement de l’OTAN, transformation de l’Alliance en force de projection, guerre contre la Serbie au Kosovo, politique de bases américaines au Moyen-Orient et en Asie centrale, dans un espace que Moscou considère comme sa zone d’influence, politique étrangère américaine centrée sur les approvisionnements en hydrocarbures… La politique américaine d’implantation en Asie centrale et de construction d’oléoducs contournant le territoire russe a provoqué l’inquiétude et la colère de la Russie. Celle-ci a réagi en faisant de Gazprom un élément clé de sa diplomatie, par le contrôle de la production comme de la distribution, et a profité des dissensions entre l’Ouzbékistan et les Etats-Unis pour avancer à son tour ses positions en Asie centrale.
Ce contentieux n’est rien d’autre que celui de grandes puissances rivales. La Russie, membre du Conseil de sécurité et puissance nucléaire, veut retrouver une place que les Etats-Unis lui ont dénié dans la conduite des affaires internationales.
Cet environnement géopolitique a de profondes répercussions sur les relations entre les deux pays dans le domaine nucléaire. La relation américano-russe est une relation issue de la nécessité, débouchant sur des partenariats thématiques, comme la sécurisation des matières fissiles, mais elle ne peut être qualifiée de relation de confiance. Les deux pays aspirent l’un comme l’autre à la maîtrise d’armements sophistiqués. La diminution des arsenaux obtenus par les traités START I et START II n’a ainsi pas signifié la fin de la course aux armements. Ces traités s’appliquaient au volume des arsenaux existants et n’ont interdit en rien la recherche technologique sur de nouveaux vecteurs et de nouvelles ogives. Ils n’ont pas fait obstacle non plus à l’immense programme américain de recherche sur le bouclier anti missiles, auquel le Président Obama vient récemment de renoncer.
b) D’une phase d’apaisement à une politique unilatérale des Etats-Unis
De 1991, juste avant la dissolution de l’URSS, jusqu’en 1997, année de la formalisation des relations entre la Russie et l’OTAN, les relations entre la Russie et les Etats-Unis, et plus généralement avec les pays occidentaux dans le domaine de la sécurité, ont pris le chemin de l’apaisement, malgré la méfiance réciproque bien compréhensible de deux puissances qui s’étaient affrontées depuis un demi siècle. Sans doute la Russie, qui dépendait de l’assistance financière occidentale, n’avait-elle pas d’autre choix… Bien qu’un rapport des services secrets russes ait qualifié en 1993 l’OTAN « de plus grande entité militaire du monde disposant d’un énorme potentiel offensif », la Russie n’a pas opposé de veto à l’élargissement de l’OTAN, ayant reçu la promesse verbale que le territoire de ses anciens satellites ne servirait pas au déploiement d’armes nucléaires. De même, bien que s’étant opposée aux frappes de l’OTAN en 1995 dans le conflit de Bosnie, la Russie a accepté les accords de Dayton et a envoyé en 1996 des troupes dans ce pays, aux côtés des forces de l’Alliance atlantique. En mai 1997, l’Acte fondateur OTAN – Russie a formalisé les relations de deux grandes puissances militaires de la planète.
En 1999, juste avant la fin du mandat de Boris Eltsine, la Russie a suspendu ses relations avec l’OTAN, désapprouvant l’intervention de cette dernière contre la Serbie dans le conflit du Kosovo. Vladimir Poutine a accédé au pouvoir avec l’idée de rebâtir le lien OTAN Russie sur la base du pragmatisme, n’écartant d’ailleurs pas l’idée que la Russie pourrait rejoindre à terme l’Alliance atlantique. Le Kosovo constituait certes un sérieux point de tension entre les deux parties, mais le conflit de Tchétchénie, qui révélait la faiblesse de l’armée russe et le naufrage du sous-marin le Koursk, en août 2000, ne lui laissait guère d’autre choix que la coopération avec les pays occidentaux.
Les attentats du 11 septembre 2001 ont confirmé le rapprochement entre les deux pays, la Russie annonçant qu’elle soutiendrait l’intervention des Etats-Unis et de leurs alliés en Afghanistan. Cette politique lui permettait, en incluant les Tchétchènes dans la liste des forces terroristes, de justifier son intervention dans le Caucase et d’atténuer les critiques sur le comportement de l’armée russe. Vladimir Poutine escomptait ainsi que la Russie ferait jeu égal avec l’Occident dans la détermination d’un ordre mondial qui se redessinait après les attentats. C’est à l’aune de cette stratégie qu’il faut comprendre son opposition très feutrée au projet de missiles anti missiles annoncé par les Etats-Unis en décembre 2001.
Cette relation de confiance s’est lentement dégradée, bien que la Russie ait en permanence maintenu des liens de coopération avec les Etats-Unis et l’Alliance atlantique, notamment dans la guerre en Afghanistan. L’on peut mettre sur le compte de l’unilatéralisme américain affiché par l’administration de George W. Bush, la dégradation de ces relations, dont la majorité républicaine élue au Congrès en novembre 1994, sous la présidence Clinton, avait montré des signes avant-coureurs dans le domaine stratégique. Les républicains tenaient un discours qui englobaient dans la même catégorie les organisations terroristes et les Etats voyous (rogue states), qui mettaient au point des ADM et des missiles de longue portée capables d’atteindre les Etats-Unis. Ils proposaient un système protégeant l’ensemble du territoire américain, sur la base du Missile Defence Act voté en 1991, alors que le Président Clinton était plutôt partisan de l’amélioration de la défense de théâtre d’opérations. La guerre d’Irak avait en effet révélé les lacunes techniques des Patriot Advanced Capabilities 2 et 3, chargés d’intercepter les missiles adverses. Le Président jugeait onéreuse la mise en place d’une couverture du territoire américain, qui n’avait aucune garantie de fiabilité technique alors même que les Etats-Unis ne maîtrisaient pas les vecteurs de théâtre.
Le Président Clinton a néanmoins été contraint d’accepter et de faire partiellement siennes les thèses des Républicains, à l’approche des élections présidentielles de 1996. Il ne pouvait apparaître comme celui qui affaiblissait la défense des Etats-Unis. La Stratégie de défense nationale, présentée au Congrès en février 1995, reprenait le concept d’Etats voyous. Le Congrès votait en 1995 le renforcement de la défense de théâtre et fixait l’objectif d’une défense de l’ensemble du territoire américain en 2003.
Derrière ce débat stratégique s’est déroulée une intense bataille entre groupes de pression. La plupart des experts considéraient que les territoire américain ne pourrait être touché par des missiles intercontinentaux venant d’Etats ennemis potentiels avant 2015, à l’exception de ceux lancés depuis la Russie (travaux préparatoires de la stratégie de défense nationale de 1996), mais une commission indépendante du Congrès présidée par Donald Rumsfeld, alors sénateur, fixait l’horizon de cette menace à 2005. Les industriels de la défense, présents dans de nombreux Etats, cherchaient à convaincre le maximum d’élus de voter des crédits de recherche militaire, alors que ceux liés à l’initiative de défense stratégique s’épuisaient, en raison de l’échec du programme.
Les Etats-Unis se sont orientés au milieu des années 90 vers un système d’interception en vol par percussion des vecteurs. Ce système complexe exigeait de mettre au point techniquement l’identification par radar d’un missile assaillant, le calcul de sa trajectoire, le moment du lancement d’un missile intercepteur et son guidage jusqu’à la cible, l’ensemble étant regroupé sous le vocable de missile anti missile. En matière stratégique, le second mandat du Président Clinton a largement été dominé par ce débat. Tandis que de fortes pressions civiles et militaires s’exerçaient sur le Président pour qu’il accepte l’architecture d’un système comprenant au minimum 2 sites de lancement, 2 ou 3 centres de commandement, une dizaine de radars, une vingtaine de satellites et une centaine intercepteurs, plusieurs experts, relayés par la presse américaine, ont dénoncé les procédés des industriels qui arguaient d’essais fructueux alors que tel n’était pas le cas. Le Président a certes proposé en juillet 2000 un dispositif encore plus ambitieux, mais il s’agissait essentiellement pour lui de gagner du temps face au Congrès. Il a en effet annoncé le 1er septembre 2000, deux mois avant l’élection présidentielle, que la définition de l’architecture du système anti missile devait revenir à son successeur.
Le système antimissile mettait en effet en péril le fragile équilibre stratégique hérité de la guerre froide. Le traité ABM de 1972 prévoyait notamment qu’aucune des deux parties ne devait se doter d’un système qui le protégeât des missiles de l’autre. En remettant en cause le système d’équilibre de la terreur, les Républicains entendaient ne plus mettre sur le même plan les vainqueurs et les perdants de la guerre froide et annonçaient la stratégie d’unilatéralisme qui serait la marque du premier mandat de M. George W. Bush. Le Président Clinton cherchait à maintenir la logique du traité ABM. En Russie, les thèses des Républicains favorisaient les arguments de ceux qui, constatant que Moscou n’avait rien obtenu depuis la fin de la guerre froide, plaidaient pour une renégociation des traités ABM et START II.
En 1997, les deux pays ont abouti à un dernier compromis, en dissociant les armes de défense de théâtre des armes de défense de territoire, avec la signature, le 26 septembre, de plusieurs memoranda annexes au traité ABM et au traité START II. Alors que le Sénat américain avait ratifié START II en 1996, il a refusé de ratifier les memoranda, jugeant abusivement que la Russie n’était pas l’héritière de l’URSS. Ce raisonnement permettait aux Etats-Unis de ne pas appliquer le traité ABM et d’avoir toute liberté de mettre en place une défense antimissile. La réaction russe était inévitable : se fondant sur le même raisonnement que le Sénat des Etats-Unis, la Douma considérait que START I n’était plus applicable et refusa de ratifier START II.
Bien qu’en 1999, à la fin de la présidence Clinton, les Etats-Unis aient offert à la Russie des axes de coopération en matière stratégique (couverture radar notamment), Moscou a logiquement maintenu sa position d’une réduction des arsenaux en échange de la mise en place d’un système antimissile, assorti de strictes conditions. La Russie a en quelque sorte testé les Etats-Unis le 14 avril 2000, quelques semaines après l’élection de Vladimir Poutine, en ratifiant START II, mais en soumettant son entrée en vigueur à la ratification par le Sénat américain des memoranda de 1997. Cette tentative de compromis échoue. Les Présidents Poutine et Bush, qui se rencontrent en novembre 2001, arrivent à un constat d’échec sur la défense antimissile. Le 13 décembre 2001, les Etats-Unis indiquent qu’ils se retirent du traité ABM. Le 14 décembre 2001, la Russie annonce qu’elle n’appliquera pas le traité START II. Le seul point d’accord entre les deux parties a été de fixer à une fourchette de 1700 à 2200 le nombre d’ogives présentes dans chaque arsenal au 31 décembre 2012. Ce point a été entériné dans un traité signé à Moscou le 24 mai 2002.
Cet échec a satisfaisait les Républicains qui rejetaient toute entrave à la liberté d’action des Etats-Unis, alors qu’ils mettaient en place leur doctrine d’action préventive en cas de menace, même hypothétique, sur les Etats-Unis. En Russie, les partisans de la restauration d’un Etat fort et les membres de l’état-major des armées voyaient sans déplaisir la disparition de START II, qui instaurait à leurs yeux un déséquilibre en défaveur de la Russie. Sa non application permettait à cette dernière de conserver les SS 18, dont les ogives multiples avaient pour objet de parer une défense antimissile.
Au début des années 2000, alors que commençaient les mandats de MM. George W. Bush et Vladimir Poutine, les négociations sur la limitation comme sur la réduction des armements aboutissaient à une impasse sans précédent depuis la fin des années 60 :
• Le traité du 24 mai 2002 mettait un terme aux négociations entre les Etats-Unis et la Russie et n’ouvrait aucune perspective pour la réduction des armements.
• Le dialogue stratégique entre les deux pays passait au second plan, derrière d’autres contentieux.
N’étant plus contraints juridiquement, les Etats-Unis ont commencé à intensifier les essais de défense antimissile, en s’appuyant, pour justifier leur démarche, sur les tests de missiles iraniens. A ce jour, ces derniers peuvent certes menacer les intérêts américains au Moyen-Orient, mais ne peuvent toucher le territoire américain. Face à la Corée du Nord, Washington a retenu le dispositif de détection Aegis, embarqué sur des navires croisant dans l’Océan Pacifique. L’architecture du système semblait se mettre en place sans grande opposition jusqu’à ce que les Etats-Unis annoncent en 2006 que leur dispositif en Europe ne serait pas implanté en Grande-Bretagne, mais en République tchèque (radar) et en Pologne (intercepteurs). Pour les Russes, ce dispositif n’était pas dirigé contre l’Iran mais contre leur pays et risquait ainsi de détruire sa capacité de dissuasion. Moscou a proposé dans un premier temps, le 7 juin 2007, de mettre en place une défense antimissile commune en utilisant une ancienne base soviétique, Gabala, située en Azerbaïdjan, mieux placée pour détecter des missiles iraniens. Mais sans attendre formellement la réponse américaine, la Russie a dénoncé le 12 décembre le traité sur les forces conventionnelles en Europe, affaiblissant encore le dispositif international de réduction des armements.
L’unilatéralisme américain a radicalisé les positions de la Russie. Les divergences sur le dossier des missiles antimissiles ont cristallisé l’opposition russe aux initiatives internationales américaines, sauf sur l’Afghanistan, où la Russie a des intérêts communs avec les Etats-Unis. Or Washington s’est aperçue que sur de nombreux dossiers (Corée du Nord, Iran, Kosovo…) l’appui russe lui était indispensable… L’intervention russe en Géorgie en août 2008, qui a détruit une armée équipée par les Etats-Unis a également montré aux Américains les limites de leur puissance.
Constatant les difficultés en Afghanistan comme les blocages diplomatiques sur l’Iran ou la Corée du Nord, l’administration du Président Obama, qui a pris ses fonctions en janvier 2009, a rapidement abandonné la politique d’unilatéralisme qui coupait les Etats-Unis de leurs alliés et de partenaires indispensables comme la Russie.
Parallèlement, le dossier du système antimissile, qui empoisonnait les relations avec la Russie, était de plus en plus contesté. Si Raytheon et Lockheed Martin ont poursuivi un intense lobbying au Congrès, plusieurs études de ce dernier ont révélé le coût financier très élevé qu’entraînait ce système pour des finances publiques américaines mises à mal par la crise, pour une fiabilité technique très relative.
C’est parce que les inconvénients excédaient largement les avantages attendus que le Président Obama a annoncé le 17 septembre 2009 l’abandon du système antimissile, tel que conçu par son prédécesseur. Mais les Etats-Unis ne renoncent pas à une défense antimissile grâce aux progrès de leurs intercepteurs sol-air et mer-air. Leur nouvelle stratégie leur permet en revanche de renouer avec la Russie et de relancer leur dialogue comme celui de l’OTAN avec Moscou.
3) Vers un nouvel âge des proliférations ?
Avec l’apparition d’un monde multipolaire, de nombreux Etats, auparavant prisonniers de la logique d’affrontement Est-Ouest, ont conduit une politique étrangère indépendamment des Etats-Unis ou de la Russie. Dans le domaine stratégique, il faut toutefois se garder d’établir un lien entre la fin de la guerre froide et l’apparition de nouvelles puissances nucléaires, car ces dernières conduisaient pour la plupart leurs programmes depuis les années 50 ou 60. L’objectif de maîtriser les technologies nucléaires militaires était ancien pour plusieurs Etats, pour lesquels il constituait l’affirmation de leur nationalisme comme la garantie de leur sécurité.
Ces Etats peuvent être rangés en plusieurs catégories. Le cas des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies a déjà évoqué. L’Inde, Israël et le Pakistan, qui ont toujours refusé d’adhérer au traité de non prolifération, sont dotés d’armes nucléaires. L’Iran et la Corée du Nord, bien qu’ayant rejoint le traité de non prolifération (22), poursuivent également un programme nucléaire militaire. Enfin, une quinzaine de pays, au premier rang desquels le Japon mais aussi l’Allemagne, les Pays-Bas, le Brésil ou l’Argentine sont aujourd’hui considérés comme disposant des connaissances et des moyens leur permettant de construire des armes à bref délai, ce qui en fait les nouveaux « Etats du seuil ».
L’Afrique du Sud est un cas particulier, qui, après avoir réussi à faire exploser une bombe en 1977, et s’être dotée, selon les services de renseignement, de sept têtes nucléaires conçues sur son territoire, a démantelé l’ensemble de son programme nucléaire militaire.
Depuis les essais nucléaires indiens des 11 et 13 mai 1998, suivie, à quelques jours près, de l’explosion d’une bombe à fission pakistanaise, il est avéré que l’Inde et le Pakistan possèdent une arme nucléaire. C’est le résultat d’initiatives lancées dès leur accession à l’indépendance.
Le programme indien remonte aux années 1950. Il faisait partie intégrante des programmes électoraux du parti du Congrès, et le président Nehru avait exigé que les technologies duales nécessaires à la fabrication d’une arme, notamment l’enrichissement de l’uranium et la militarisation du plutonium, soient développées. L’objectif affiché de ces efforts était de garantir l’Inde contre toute attaque chinoise.
Cas emblématique de prolifération « en chaîne », le Pakistan a choisi de se doter d’armes nucléaires en réaction au programme poursuivi par l’Inde. Le programme nucléaire pakistanais a ainsi été lancé dès le milieu des années 1970.
Enfin, la volonté israélienne d’acquérir une autonomie dans le domaine nucléaire est indissociable du contexte géopolitique régional. Dos à la mer, et se sentant encerclé, l’Etat hébreu a très vite considéré que sa seule défense consistait à menacer ses ennemis d’une destruction immédiate. Il est désormais avéré, en dépit des dénégations officielles, qu’Israël possède un arsenal avoisinant 200 têtes nucléaires.
Aucun chiffre n’a été rendu public concernant les arsenaux indien, pakistanais ou israélien. Il s’agit essentiellement d’arsenaux, pour faire face à des menaces régionales. Les principaux vecteurs balistiques, tant pakistanais qu’indiens, ne dépasseraient pas les 3 500 kilomètres de portée, et la plupart sont encore en cours de développement. Selon les informations actuelles, les Israéliens ne disposeraient pas non plus de missiles de très longue portée. Du point de vue stratégique, les arsenaux des ex-Etats du seuil ne représentent pas une menace immédiate pour le reste du monde.
Ces arsenaux ont été largement développés en accord avec les puissances occidentales. Les programmes indien et israélien ont bénéficié d’une aide technologique occidentale, involontaire dans le cas indien (23). Même l’aide apportée par la France à Israël, de 1956 à 1967, n’était pas en contradiction avec le droit international. Enfin, le programme pakistanais a été implicitement autorisé par des Occidentaux peu désireux de froisser leur principal allié contre l’invasion soviétique en Afghanistan.
En revanche, l’organisation, par le scientifique Abdel Kader Khan, d’un réseau clandestin d’acquisitions de matériaux et de technologies nécessaires à la fabrication d’une arme nucléaire, a été à l’origine de plusieurs cas de prolifération nucléaire, dont certains sont toujours en cours. Deux de ces Etats sont aujourd’hui considérés comme très probablement capables de construire des armes nucléaires, ou engagés dans des programmes permettant de le faire dans un avenir proche.
La Corée du Nord, dont l’installation nucléaire de Yongbyon est soupçonnée depuis longtemps de servir à la fabrication de plutonium militaire, a vraisemblablement bénéficié de l’aide du réseau Khan, en échange d’un soutien au programme balistique pakistanais. L’objectif stratégique de la Corée reste peu clair. En effet, les vecteurs qu’elle développe, de longue voire très longue portée, n’ont pas d’utilité pour la prémunir de la menace la plus immédiate, à savoir la Corée du Sud. Il est vraisemblable que le programme nucléaire nord-coréen est aujourd’hui poursuivi afin de faire « monter les enchères » dans les négociations internationales menées par un régime au bord de la faillite.
L’Iran, qui poursuit la construction d’installations d’enrichissement d’uranium sans finalité civile précise, a également été un client du réseau Khan, tant pour la conception des centrifugeuses nécessaires à l’enrichissement, que pour la militarisation de l’uranium enrichi. Héritier d’un passé glorieux, mais mis au ban de la communauté internationale depuis la révolution de 1979, l’Iran cherche à s’imposer sur la scène régionale en développant un programme nucléaire qui obligerait ses interlocuteurs à lui reconnaître le statut de grande puissance régionale.
Des programmes de recherche en matière nucléaire ont été lancés, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, dans de nombreux pays. Plusieurs Etats disposent ainsi de ressources scientifiques notables, notamment au Moyen-Orient. Par exemple, la Libye, avant de décider de démanteler son programme nucléaire en décembre 2003, a eu recours au réseau Khan pour fabriquer des centrifugeuses. Plusieurs autres Etats sont connus pour avoir lancé des programmes de recherche, comme l’Algérie ou l’Egypte.
Le Japon représente un cas à part. Très avancé en matière de technologie spatiale et nucléaire, sa position officielle reste celle d’un usage purement pacifique de l’atome, bien qu’il soit clair que ce pays puisse, en cas de besoin, détourner aisément ses ressources pour fabriquer des armes nucléaires. La Turquie, qui accueille depuis longtemps des missiles américains sur son territoire, l’Allemagne, sont également à même de lancer un programme nucléaire militaire rapidement.
Le monde est incontestablement entré dans un nouvel âge de proliférations, sans que l’on puisse en établir les contours avec certitude. La stratégie est une discipline aisée quand on l’applique à l’histoire, elle l’est moins quand il s’agit de tracer l’avenir. Quelles tendances semblent cependant claires :
La technologie nucléaire militaire sera accessible à de plus en plus d’Etats, grâce à l’élévation du niveau de leurs scientifiques et en raison du comportement proliférant d’autres Etats. Un plus grand nombre d’Etats nucléaires augmente théoriquement les incertitudes sur l’usage des ADM, bien que l’histoire ait démontré, jusqu’à présent, que les détenteurs de telles armes en disposent pour ne pas s’en servir.
Si la Corée du Nord accède à la technologie nucléaire militaire, le Japon, pays du seuil, exigera des Etats-Unis le droit d’augmenter ses capacités de défense, ce qui provoquera l’inquiétude de la Chine.
L’Asie du Sud, avec l’Inde et le Pakistan, forme une zone de risque, même si les gouvernements des deux pays ont pris soin jusqu’à présent de ne pas céder à la tentation de l’escalade, malgré leur rivalité en Afghanistan et la permanence de leur conflit au Cachemire.
Le risque d’un recours aux ADM nucléaires par des terroristes est infime, mais il ne peut complètement être écarté.
Face à un monde nucléaire considéré comme instable en raison d’un nombre croissant d’acteurs, l’idée d’une option zéro comme objectif de la diplomatie internationale a été à plusieurs reprises avancée (a world free of nuclear weapons/un monde sans armes nucléaires, par George Schulz, William Perry, Henry Kissinger et Sam Nunn, dans le Wall Street Journal du 4 janvier 2007), mais doit être écartée, car elle aurait pour résultat de rétablir l’hyperpuissance des Etats-Unis, seul pays qui dispose de la capacité de projeter des forces conventionnelles modernes à travers le monde. En revanche, la réduction des arsenaux et leur contrôle mutuel en application de règles plus strictes peuvent constituer un objectif réaliste, chaque Etat y trouvant son intérêt.
Compte tenu du volume de leurs arsenaux et de leurs capacités technologiques, les Etats-Unis et la Russie devraient reprendre un dialogue stratégique centré sur la réduction du niveau de leurs ADM, afin de contribuer à un monde plus sûr, donc plus stable. Toutefois, comme ils entretiennent plusieurs contentieux, il n’est pas certain que la limitation de leurs armements soit une priorité comme au temps de la guerre froide.
Le dialogue stratégique devrait inclure la Chine, qui a prouvé récemment ses progrès en matière balistique. Mais Pékin, dont la politique extérieure obéit à des ressorts similaires à celle des Etats-Unis (accès aux matières premières et aux énergies fossiles) n’a pas forcément envie de diminuer ses arsenaux alors que l’Inde augmente ses capacités et ne souhaite pas non plus entrer dans une logique de sanctions contre l’Iran et contre la Corée du Nord, pays avec lesquels la Chine entretient d’importantes relations commerciales.
Face à un Pakistan qui fut récemment (et clandestinement) un Etat proliférateur, face à la Corée du Nord qui joue ostensiblement cette carte pour rendre instable l’ordre international voulu par les grandes puissances, face à un Iran contre lequel toute intervention militaire directe est difficile, face à Israël qui refuse obstinément tout dialogue au sein de la communauté internationale, le régime des sanctions a trouvé ses limites. Si la poursuite de dialogues diplomatiques semble nécessaire, la question de la réforme du TNP devient cruciale. Le droit international n’est en effet rien d’autre que le reflet de rapports de forces. Le TNP traduit la vision d’un ordre nucléaire issu de la guerre froide, mais n’est pas adapté au monde actuel dès lors que les Etats qui y sont parties n’ont pas la volonté ou les moyens de le défendre.
Nous ne savons pas si un monde dans lequel règne plus d’incertitudes est obligatoirement plus dangereux. Depuis Hiroshima, le nombre de pays maîtrisant la technologie nucléaire n’a cessé de croître, sans pour autant déclencher l’apocalypse tant redoutée. La neutralisation mutuelle des Etats a fondé la paix. La crainte d’un nouvel âge des proliférations se fonde sur une modification éventuelle de l’usage de la bombe, combinée à un élargissement du nombre de ses détenteurs. L’hypothèse est envisageable, mais se heurte jusqu’à présent au fait que l’arme nucléaire est une arme d’Etat, et que les Etats obéissent à des comportements rationnels, même quand ils sont mus par des ressorts idéologiques puissants.
D – Les proliférations balistique, biologique, chimique et cybernétique
Trop souvent, la prolifération est considérée comme un phénomène ne concernant que les armes nucléaires. Historiquement, d’autres types d’armements ont été développés par les Etats dans le but d’infliger des dommages très importants à leurs adversaires. De plus, la période contemporaine voit émerger une nouvelle menace, liée à l’emprise croissante des systèmes informatiques sur l’organisation de nos sociétés.
1) Les programmes balistiques, nouvelle forme de prolifération ?
La prolifération des programmes balistiques est facilitée par l’absence de dispositif juridique international concernant la technologie des missiles. Plusieurs Etats se sont ainsi imposés comme de véritables leaders d’un marché noir des vecteurs de longue portée, notamment la Corée du Nord, qui ayant développé plusieurs types de missiles, vise la mise au point de missiles de 10 000 kilomètres de portée (24) et qui a collaboré avec l’Iran pour le développement du programme Shahab.
Plus d’une dizaine d’Etats sont aujourd’hui dotés de missiles de plus ou moins longue portée. En plus des Etats dotés d’armes nucléaires, comme Israël, l’Inde ou le Pakistan, figure la Syrie, dotée d’un arsenal conséquent de missiles russes et chinois de portée intermédiaire. Plusieurs autres Etats ont lancé des programmes de recherche dans le domaine balistique, notamment la Corée du Sud, Taïwan, l’Egypte, l’Argentine ou le Brésil. L’Arabie Saoudite a fait l’acquisition, dans les années 1980, de plusieurs dizaines de missiles chinois, et l’évolution récente de son arsenal est encore sujet à controverses.
La possession d’un nombre limité d’engins ne représente pas une menace en soi. La plupart des missiles déployés dans les pays cités ci-dessus reposent sur des technologies anciennes, et il est difficile d’estimer qu’ils représentent un danger pour les pays occidentaux. Si le développement de programmes de missiles peut peser sur des équilibres régionaux, comme c’est le cas entre Israël et la Syrie, il n’est pas clairement établi que des missiles modifient l’équilibre stratégique mondial.
Toutefois, l’acquisition ou la fabrication de missiles laissent planer un doute sur les intentions réelles de ces Etats. Les missiles ne représentent pas une menace nouvelle lorsqu’ils sont dotés de charges explosives conventionnelles. Ils modifient en revanche les rapports de force politiques en rendant possible une guerre asymétrique.
Les cas de prolifération balistique doivent donc être analysées en relation avec le nombre d’armes de destruction massive qui peuvent être emportées par ces vecteurs. A cet égard, on a longtemps considéré les armes biologiques et chimiques comme des substituts aux armes nucléaires. Cela ne semble plus être le cas aujourd’hui.
2) Les arsenaux chimiques et biologiques des Etats, un potentiel limité ?
Parmi les rapports parlementaires sur la prolifération, celui de MM. Pierre Lellouche, Guy-Michel Chauveau et Aloyse Warhouver, du 7 décembre 2000 (25) insistait tout particulièrement sur la menace que représentait les arsenaux chimiques et biologiques de certains Etats. Toutefois, les guerres menées en Irak, tant en 1991 qu’en 2003, ont montré qu’un pays pourtant doté d’armes chimiques et biologiques en grande quantité n’avait pu utiliser ces armes pour empêcher une déroute militaire. Le régime nazi n’avait osé en faire usage. L’importance des armes biologiques et chimiques a sans doute décru, pour être principalement analysée avec le risque terroriste.
a) La disparition programmée des armes chimiques étatiques
La Convention internationale d’interdiction des armes chimiques de 1972 dispose, en son article deuxième : « On entend par produit chimique toxique […] tout produit chimique qui, par son action chimique sur des processus biologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou les animaux la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents. ». Les armes chimiques désignent dès lors les munitions qui contiennent ce type de produits.
Il faut distinguer, parmi l’ensemble des agents actifs connus, les produits létaux et ceux qui sont simplement destinés à provoquer une incapacité physique ou psychique, temporaire ou permanente.
Les agents non létaux sont principalement les produits irritants, parmi lesquels les gaz lacrymogènes, les produits urticants et les produits dits « sternutatoires » (irritants respiratoires). Les incapacitants psychiques sont moins nombreux. Les deux produits les plus connus sont le LSD 25 et le BZ. Enfin, des herbicides et autres exfoliants ont pu être utilisés contre des êtres humains, notamment l’agent orange au Viêt-Nam. Bien que lourds, les effets physiques de ces produits ne sont pas directement mortels.
Les armes chimiques provoquant la mort sont beaucoup plus nombreuses. Quatre types d’éléments sont à connaître. Les toxiques vésicants, parmi lesquels l’ypérite (le « gaz moutarde »), qui provoquent des lésions sur la peau et les muqueuses pouvant entraîner la mort. Les produits suffocants, utilisant principalement du chlore ou du phosgène, ont été largement utilisés pendant la première guerre mondiale. Ils ont toutefois été remplacés par des produits plus efficaces, parfois appelés « agents suffocants », parmi lesquels l’acide cyanhydrique a fait l’objet des recherches les plus abondantes.
A l’heure actuelle, les armes chimiques les plus redoutables sont sans aucun doute les agents neurotoxiques. Découverts à la fin des années 1930 (26), ces gaz inhibent la production d’un enzyme essentiel à la bonne transmission des informations dans le cerveau humain, aboutissant rapidement à une perte de contrôle du cerveau sur l’ensemble des organes. Pour contrer ces effets, il est nécessaire d’intervenir très rapidement, c’est pourquoi la plupart des armées équipent leurs soldats de premiers secours adaptés à ces gaz.
Les quatre neurotoxiques les plus connus sont le soman, le sarin, le tabun et le gaz A4 (parfois appelé VX). Leur létalité est respectivement 80, 50 et 8 fois supérieure à celle du phosgène, pourtant responsable de la plupart des attaques chimiques mortelles au cours de la première guerre mondiale.
Théoriquement, les armes chimiques représentent donc une menace particulièrement grave. Toutefois, les risques de prolifération étatique sont mieux encadrés depuis l’entrée en vigueur, en 1997, de la convention sur l’interdiction des armes chimiques. Celle-ci regroupe un nombre important d’Etats (cf. infra, partie IV du présent rapport) qui se sont engagés à détruire leurs arsenaux, et à faire inspecter les sites de production de précurseurs pouvant être utilisés pour la fabrication de gaz militaires. Les soupçons se concentrent dès lors sur les cinq Etats n’ayant pas signé la convention – l’Angola, la Corée du Nord, l’Egypte, la Somalie et la Syrie – et ceux ne l’ayant pas encore ratifié, Israël et la Birmanie. Par ailleurs, l’Iran, bien que partie à la CIAC, est fréquemment soupçonné de dissimuler un programme chimique militaire, même si les résultats des inspections de l’organisation internationale contre les armes chimiques semblent indiquer que l’engagement iranien est sincère.
En plus de ces Etats, dont le niveau d’avancement dans le domaine des armes chimiques n’est pas toujours connu, des risques de prolifération subsistent dans le contexte d’affrontements régionaux particuliers. Ainsi, la Corée du Sud semble avoir compté, en cas d’agression nord-coréenne, sur la disponibilité d’armements chimiques américains pour riposter. Taïwan serait dans le même cas. Le Pakistan, en revanche, est parfois présenté comme technologiquement capable de produire des armes chimiques, sans avoir choisi de le faire pour le moment.
L’adhésion de l’Irak à la convention, le 14 janvier 2009, représente un succès considérable. En effet, ce pays a développé un arsenal chimique important, jusqu’à 60 000 munitions chargées et plusieurs centaines de tonnes d’agents toxiques, et en a fait usage contre les armées et la population iraniennes à la fin des années 1980. Or, malgré l’envoi de deux équipes d’inspecteurs de l’ONU, d’abord la commission spéciale de l’ONU (Comsun), de 1991 à 1998, puis la commission de contrôle (Cocovinu) de décembre 2002 à mars 2003, des doutes persistaient sur la réalité du stock irakien.
Le cas irakien est d’ailleurs révélateur de la faible efficacité dissuasive de l’arme chimique. En effet, malgré l’importance supposée de l’arsenal détenu par ce pays, les puissances occidentales n’ont pas hésité à l’envahir en 1991, et les attaques chimiques contre l’Iran en 1988 n’ont pas permis de remporter la victoire. Au contraire, l’utilisation de ces armes a contribué à discréditer le régime irakien.
Du point de vue stratégique, la menace que font peser les armes chimiques a changé de nature. Les principaux arsenaux chimiques étatiques ont été en grande partie démantelés, et ceux qui subsistent, connus ou supposés, ne semblent pas remplir une fonction de dissuasion, ou d’affirmation de puissance. En revanche, l’utilisation d’agents chimiques par des terroristes représente une menace très probable.
b) Les armes biologiques connaîtront-elles le même sort ?
Contrairement aux armes chimiques, le problème posé par l’existence d’arsenaux biologiques est rendu plus aigu en l’absence de mécanisme international de contrôle. Toutefois, il est très peu probable qu’un Etat décide de mener une attaque biologique sur une population, considérant qu’un tel acte lui ferait encourir un risque immédiat de riposte massive et destructrice.
L’arme biologique remonte au Moyen-Âge. En projetant des cadavres de ses soldats ayant succombé à une maladie grave, le général tatar Kiptchäk khän Jambeg réussit à prendre, en 1346, le comptoir génois de Caffa. Toutefois, les programmes de recherche reposant sur l’utilisation offensive d’agents pathogènes ont surtout été lancés avant la seconde guerre mondiale.
Les principaux agents pouvant remplir des fonctions militaires sont au nombre de cinq : les bactéries, les rickettsies (micro-organismes proches des bactéries, responsables notamment du typhus), les virus, les toxines et les « fungi », champignons se développant sur certaines plantes.
Il existe plusieurs classifications des agents pathogènes considérés comme dangereux. La convention sur l’interdiction des armes biologiques ne fournit pas de liste précise, et interdit tout usage militaire des agents microbiens ou viraux. Le groupe Australie, qui réunit les principaux exportateurs de produits liés à des agents pathogènes (cf. infra partie IV), publie trois listes d’agents considérés comme particulièrement dangereux pour les humains, les animaux et les plantes. La première liste comprend une soixantaine de produits, les deux autres, une vingtaine chacune.
Les risques les plus connus concernent le bacille du charbon, les bactéries responsables de la peste, du choléra, de la tularémie (pneumonie mortelle) et de la brucellose (infection très contagieuse et hautement incapacitante), la rickettsie du typhus, les virus responsables de la variole, des fièvres hémorragiques (comme la fièvre Ebola), et divers types de toxines comme la ricine ou des éléments prélevés sur des animaux ou des plantes (comme la saxitoxine, présente sur certains micro-organismes marins).
Contrairement aux armes chimiques, les armes biologiques nécessitent des manipulations importantes avant de pouvoir remplir des objectifs militaires. La « militarisation » des agents pathogènes nécessitent que soient remplis dix critères, conformément à la théorie classique de Theodore Rosebury (27). L’agent retenu doit avoir un pouvoir infectant élevé, une morbidité importante, une résistance élevée aux facteurs de l'environnement, une transmission possible par la voie aérienne, l'eau ou le contact, une contagiosité élevée, une détection et une identification difficile. La maladie ainsi transmise doit être difficile à traiter, et sans possibilité simple d’immunisation. Enfin, l’agent doit pouvoir être produit en grande quantité, et les effets en retour, sur l’utilisateur, doivent être limités.
De conception et de fabrication difficile, les armes biologiques ont historiquement été le fait des Etats. Les puissances européennes ont entrepris les premiers travaux. Les premières tentatives ont été faites dans l’entre-deux-guerres, mais l’absence de programme biologique militaire nazi, dû aux ordres particulièrement restrictifs imposés par Hitler lui-même dans ce domaine, a diminué l’intérêt porté à ce type d’armes par les Européens. Hors d’Europe, plusieurs programmes de grande envergure méritent d’être rappelés.
Le premier programme important d’armes biologiques développé et utilisé par un Etat dans le cadre d’un conflit a été mis en place par le Japon, lors de l’invasion de la Mandchourie en 1932. L’unité 731 a été chargée de l’expérimentation de nombreux agents pathogènes sur les prisonniers chinois. Elle a également fabriqué plusieurs centaines de kilos de bacilles de la peste et du charbon, et a infecté plusieurs villes chinoises. Les scientifiques japonais ont enfin réussi à mettre au point de véritables bombes biologiques, contenant divers organismes infectieux.
Les Etats-Unis ont lancé leur programme biologique en 1942, avec des unités réparties dans le Maryland, le Mississipi, l’Utah et l’Indiana. Il s’agissait initialement, en partenariat avec le Royaume-Uni, de produire le bacille du charbon en quantité importante, mais cette arme n’a pas été utilisée pendant la seconde guerre mondiale.
Le développement de l’arsenal américain a été officiellement arrêté en 1969, en même temps que les expériences d’armes chimiques, et les stocks d’armes progressivement détruits. Toutefois, au début de l’année 2001, des expériences ont été menées pour produire un bacille du charbon génétiquement modifié, afin de tester le vaccin traditionnel inoculé aux soldats américains. Les services de renseignement américains avaient en effet découvert que la Russie cherchait à développer un bacille de ce type.
Héritière de l’URSS, la Russie dispose en effet de connaissances très avancées dans le domaine biologique. Le programme soviétique s’impose en effet comme le plus important jamais conçu dans l’histoire. Lancé en 1926, il est poursuivi après la seconde guerre mondiale, et même après 1972, alors que l’URSS est dépositaire, comme les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, de la convention sur l’interdiction des armes biologiques.
Les découvertes faites immédiatement après 1991, et les révélations des anciens responsables soviétiques, ont permis de mesurer l’ampleur du programme soviétique, concernant plus de 60 000 personnes, réparties au sein de 50 institutions, et associées au sein d’un réseau secret baptisé Biopreparat.
Les Soviétiques avaient développé des moyens industriels permettant de produire, selon les déclarations de scientifiques participant au réseau, plus de 80 tonnes de variole par an, et près de deux tonnes de bacilles du charbon par jour. Les recherches ont été bien plus poussées que dans tous les autres pays, à la fois pour découvrir des agents pathogènes naturels particulièrement actifs (cas de la souche dite « 836 », bacille aux effets plus virulents que les organismes connues jusque là), mais également pour améliorer l’efficacité des agents connus, en utilisant les avancées de la génétique (modification génétique de certaines bactéries, voire combinaison de deux virus pour aboutir aux virus dits « chimères », même si aucun exemple probant n’indique que cette branche de recherche ait permis un succès).
Bien qu’elle n’ait pas franchi la phase d’industrialisation, l’Afrique du Sud a lancé de nombreuses recherches en matière d’armes biologiques. Entre 1981 et 1993, date à laquelle le programme a été officiellement démantelé, les scientifiques sud-africains ont mené des expériences très poussées sur plusieurs agents pathogènes dangereux. Selon plusieurs témoignages recueilli par la commission « Vérité et réconciliation », il aurait existé des projets de fabrication de véritables « armes ethniques », censées ne toucher qu’une partie de la population.
Le dernier programme connu d’armements biologiques a été développé clandestinement par l’Irak à partir de 1973. Dissimulé au sein d’une ferme censée produire de la nourriture animalière, un laboratoire a permis de tester de nombreux agents pathogènes. Malgré les inspections menées par la Comsun et la Cocovinu, plusieurs points du programme irakien restent mystérieux. Il est toutefois certain que l’Irak a produit de grande quantité de bactéries et de toxines dangereuses pour l’homme, et que des recherches ont été mené pour sélectionner des souches de virus plus dangereuses.
La convention sur l’interdiction des armes biologiques ne prévoit pas, contrairement à la convention sur les armes chimiques, un mécanisme d’inspections internationales pour vérifier le respect de ses principales stipulations. Dès lors, il est légitime de s’interroger sur les stratégies poursuivies, dans ce domaine, par les Etats les plus réticents à ouvrir leurs sites de production et de recherche à des agents internationaux. Il est vrai que les progrès de la biologie, notamment dans le domaine de la manipulation génétique, font de certaines informations des données extrêmement sensibles pour des pans entiers de l’industrie. Mais les risques de détournement des biotechnologies sont également nombreux, et pourraient aboutir à créer des menaces particulièrement graves (28).
De plus, plusieurs Etats ne sont toujours pas partie à la convention sur les armes biologiques (voir la liste complète dans la suite du rapport, partie IV). Parmi ceux-ci, certains possèdent un arsenal biologique connu. L’Egypte, qui n’a pas ratifié la CABT, a déclaré, avant même de signer cette convention, qu’elle possédait un arsenal bactériologique. Israël, pour sa part, n’a jamais fait de déclaration relative à son arsenal biologique, mais de nombreuses informations tendent à montrer que l’institut de recherche biologique de Nes Tona, près de Tel Aviv, abrite un programme militaire. Un programme biologique serait également développé en Syrie.
Enfin, un certain nombre d’Etats parties à la CABT, disposent de la technologie suffisante pour fabriquer des armes biologiques. Il s’agit, en plus des Etats ayant poursuivi des programmes connus cités plus haut, de la Chine, de l’Inde, de la Corée du Nord, de l’Iran et, selon certaines sources, de Cuba.
Comme pour les armes chimiques, le rôle stratégique des armes biologiques semble aujourd’hui considérablement réduit pour les Etats. L’horreur suscitée par les découvertes du programme biologique japonais montre bien que celui qui déciderait d’utiliser des armes bactériologiques se verrait immédiatement condamné par l’ensemble des opinions publiques mondiales et, vraisemblablement, la quasi-totalité des autres Etats.
3) L’arme cybernétique, une arme d’Etat ?
L’utilisation croissante de l’outil informatique, dans toutes les activités humaines y compris les plus stratégiques pour les Etats, fait peser une menace nouvelle, qui n’est plus seulement théorique (29). Depuis leurs premiers développements, à la fin des années 1960 (30), les réseaux d’ordinateurs, malgré l’existence de systèmes de sécurisation, ne sont pas conçus pour être totalement imperméables, mais, au contraire, pour faciliter les échanges. Dès lors, il est possible de prendre pour cibles les réseaux informatiques de ses adversaires, pour désorganiser sa défense, ou l’ensemble de la société.
Schématiquement, trois types d’attaques existent, qui dépendent des motivations des pirates. L’intrusion dans un système censé être sécurisé pour détourner, notamment, des supports de communication (principalement les sites Internet de certaines organisations) permet à des groupes de se faire connaître ou de faire connaître leurs causes. Des sites du gouvernement français avaient ainsi été attaqués peu après le vote de la loi reconnaissant le génocide arménien.
Plus gênant du point de vue sécuritaire, le vol de données, voire la prise de contrôle totale d’un système informatique par une personne extérieure à l’organisation, est rendu d’autant plus inquiétant que ces manœuvres peuvent être conduites de manière invisible. Il s’agit là, toutefois, de problèmes classiques liés à la protection des données les plus sensibles. Ce type d’événements semblent toutefois en constante augmentation, souvent dus à des groupes de pirates privés soutenus indirectement par des Etats, voire même des groupes connus pour œuvrer directement pour des services de renseignement.
La principale menace que fait peser l’arme cybernétique sur nos sociétés est le blocage des réseaux informatiques utilisés pour des activités vitales, comme le transport d’électricité ou l’organisation du système de santé. Pour contrer cette menace, la plupart des Etats ont choisi de gérer leurs activités stratégiques à l’aide de réseaux très rustiques totalement déconnectés d’Internet, baptisés « SCADA ». Toutefois, de moins en moins d’activités peuvent aujourd’hui se voir couper de toute communication vers l’extérieur, et adoptent donc des standards de communication beaucoup moins sécurisés. Même les logiciels antivirus ne peuvent répondre qu’aux menaces pour lesquelles ils ont été programmés, et sont donc impuissants face à l’imagination d’éventuels assaillants.
Dans le domaine cybernétique comme dans les autres cas de proliférations non nucléaires, le risque stratégique n’est pas tant une attaque massive contre l’ensemble des systèmes que des opérations couplées à une action militaire, afin de réduire les capacités de défense de l’adversaire.
Alors que les réseaux les plus stratégiques, comme les communications militaires, sont très difficiles à percer, d’autres systèmes offrent des failles beaucoup plus importantes, qui peuvent créer une grande fragilité du fait de leur interconnexion avec d’autres réseaux. La prolifération de la menace suit la prolifération des moyens de communication. Il semble ainsi que la Russie ait utilisé, au cours du conflit qui l’a opposée à la Géorgie, un « cheval de Troie », logiciel espion permettant de s’introduire dans un ordinateur sous couvert d’un fichier parfaitement sain, pour bloquer certains serveurs géorgiens.
Les attaques cybernétiques ne constituent pas en elles-mêmes une arme de destruction massive. Elles représentent toutefois une menace en constante augmentation. Surtout, elles permettent de renforcer les effets psychologiques d’une attaque et seraient, à ce titre, un instrument de choix pour d’éventuels groupes terroristes.
II – LES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE, INSTRUMENTS RATIONNELS DES ETATS DANS LEURS RELATIONS INTERNATIONALES
La question centrale liée aux armes de destruction massive est de savoir si leurs détenteurs seront toujours mus par la rationalité ou si ces armes pourraient tomber aux mains de groupes, voire de dirigeants d’Etat, animés d’objectifs apocalyptiques et disposés à s’en servir. Cette question ne diffère guère en elle-même de celle que se sont posés depuis des millénaires tous les stratèges et chefs militaires, qui de Sun Tzu à Clausewitz, en passant par le Prince de Ligne, Jomini ou Napoléon Bonaparte, ont cherché à dégager des lois dans la conduite de la guerre afin de recourir avec prudence – donc rationalité – à l’acte le plus grave en politique.
Les ADM, quelle qu’en soit la nature, ont introduit un changement de degré dans la réflexion stratégique, car leur usage, principalement celui du nucléaire, signifie la destruction des êtres vivants et des biens à une échelle jamais atteinte. Les explosions d’Hiroshima et de Nagasaki auraient dû d’emblée signifier la mise en place des politiques de non prolifération afin d’éviter une catastrophe à l’humanité, mais il n’en a rien été. Dans un contexte de rivalité idéologique, les Etats-Unis et l’URSS se sont lancés dans une course quantitative et qualitative aux armements, qui a failli déboucher à quelques reprises sur une catastrophe, notamment lors de la crise de Cuba en 1963 et en 1983, lorsque le système de détection soviétique a connu une sérieuse faillite technique, laissant croire aux officiers de veille que l’URSS subissait une attaque américaine. C’est parce que les deux principales puissances de la guerre froide ont échoué dans leurs tentatives de suprématie stratégique qu’elles ont mis en place les éléments d’une politique de contrôle, de limitation et de réduction des armements. Le traité ABM de 1972 traduisait en droit l’impossibilité d’une politique anti missiles, tandis que les accords SALT 1 et 2, puis START 1 et 2, dont les signatures se sont échelonnées des années 70 jusqu’au dernier accord bilatéral de mai 2002, ont établi une forme de parité dans le niveau des arsenaux. Mais à chaque fois, les deux puissances ont recouru à la recherche (notamment sur les ogives multiples) pour tourner la lettre des accords et assurer leur suprématie.
Il y a bien eu tentative américaine et soviétique d’atteindre une suprématie technique pour pouvoir, en cas de crise, déclencher une première frappe, décisive militairement comme politiquement. L’équilibre de la terreur n’a jamais été une notion statique, mais une course permanente. La doctrine de dissuasion n’a été retenue que tardivement aux Etats-Unis et en URSS quand ils ont admis ne pas pouvoir prendre un avantage décisif l’un sur l’autre.
Le régime de non prolifération, lui-même, n’est pas allé de soi… Certes, peu de pays pouvaient après 1945 maîtriser le processus permettant de bâtir un engin nucléaire… Les recherches dans les domaines biologiques et chimiques étaient en revanche plus répandues et relativement avancées dans une vingtaine de pays… Mais la plupart des programmes de recherche nucléaire à des fins militaires sont nés dans les années 50, pour des raisons d’indépendance nationale. L’acquisition d’un savoir-faire en ce domaine figurait ainsi au programme du Parti du Congrès avant l’indépendance de l’Inde. Les Etats-Unis et l’URSS ont compris qu’il valait mieux que le jeu nucléaire mît aux prises un nombre réduit d’acteurs pour limiter les risques (là est le fondement de l’idée de non prolifération), probablement parce que la gestion de la crise de Cuba les a convaincu qu’ils avaient intérêt à gérer ce type de crise, compte tenu du radicalisme affiché par Fidel Castro pendant cet épisode majeur de la guerre froide. L’explosion de la bombe chinoise en 1964, puis de la bombe française en 1960, ont confirmé les propos du Président Kennedy en 1963 : « Nous sommes actuellement 4 puissances nucléaires. Si nous ne faisons rien, nous serons 20 ou 25 dans 20 ans ». Il existe désormais une dizaine d’Etats nucléaires, plus une autre dizaine qualifiée d’Etats du seuil, capables de se doter rapidement d’une bombe. Rétrospectivement, le TNP a peut-être freiné la prolifération. Mais il ne l’a pas empêchée.
Plutôt que de fonder l’analyse sur le maintien d’un statu quo, il convient de rappeler que les Etats ont des intérêts et qu’assurer leur sécurité est le premier d’entre eux. Ce que nous appelons prolifération n’est que l’aspiration à disposer d’une capacité de défense, fondée sur la dissuasion. Il s’agit pour les Etats d’une démarche rationnelle. Les ADM, surtout l’arme nucléaire, sont des armes d’Etat, qui confèrent théoriquement une capacité de puissance globale – en fait, pour certains, il s’agit juste d’une capacité de nuisance – qui dispense de s’en servir.
Comme nombre d’observateurs, nous sommes partisans d’un monde avec peu d’acteurs nucléaires, mais nous constatons l’impasse dans laquelle se trouve le régime de non prolifération. Nous constatons également que même si l’humanité a couru le risque d’une escalade entre 1945 et 1963, lorsque certains responsables politiques comme Robert McNamara, Mao Tsé Toung ou Fidel Castro ont émis, en des circonstances historiques précises, l’idée de se servir des arsenaux, aucun Etat n’y a eu recours… Enfin, à l’ère des guerres asymétriques, la puissance que confèrent les ADM est toute relative sur certains théâtres d’opération.
A – Le club des détenteurs d’ADM
Les traités d’interdiction (principalement le traité de non prolifération nucléaire, le traité d’interdiction des essais nucléaires, la convention sur les armes chimiques, la convention sur les armes biologiques (cf en annexe les Etats parties aux différents traités) rassemblent des Etats détenteurs comme des Etats non détenteurs d’ADM. La logique de ces traités est de maintenir un statu quo, qui gèle le nombre de détenteurs d’ADM.
Pour ce qui concerne l’arme nucléaire, l’attention doit être portée sur les cinq membres du Conseil de sécurité. La période actuelle se caractérise en effet par une évolution sensible de la politique nucléaire russe et américaine, la montée en puissance technologique de la Chine et un débat sur la validité de la théorie de la dissuasion, surtout pour la France. Les autres armes semblent avoir perdu de leur importance depuis la fin de la guerre froide.
1) L’évolution de la politique nucléaire des Etats-Unis
La politique nucléaire des Etats-Unis demeure guidée par la double nécessité de défendre le territoire américain et d’assumer les obligations découlant des alliances multilatérales (OTAN) ou bilatérales (Taïwan, Corée du Sud…), et par l’idée que leur avance technologique doit leur permettre de maintenir leur leadership dans le domaine stratégique, même avec une vision du monde qui se démarque de l’unilatéralisme. Cette politique reste en conséquence fortement marquée par les négociations avec la Russie, les deux pays rassemblant vraisemblablement 96 % de l’arsenal stratégique et tactique nucléaire.
Les Etats-Unis et la Russie sont théoriquement des partenaires à défaut d’être des alliés et entretiennent un dialogue politique d’une part bilatéral, d’autre part dans le cadre du Conseil OTAN-Russie. En pratique, les deux pays coopèrent dans plusieurs domaines (lutte contre le terrorisme, Afghanistan) mais sont aux prises sur plusieurs dossiers comme l’énergie en Asie centrale, le choix des alliances de la Géorgie ou le souhait américain de mettre en place une défense anti missiles. Moscou perçoit maints aspects de la politique américaine comme une atteinte à ses intérêts.
La fin de la guerre froide n’a donc pas mis fin à l’équilibre de la terreur. Elle a rendu nettement plus improbable le recours aux ADM en cas de conflits entre les deux pays dans la mesure où elle n’oppose plus deux systèmes porteurs de valeurs quasi messianiques, mais deux Etats défendant leurs intérêts.
Etats-Unis en bref - Initiateurs et signataires du TNP. - Signataires du TICE, ratifié en 1999. - Disposent actuellement d’environ 2700 ogives stratégiques sur des missiles opérationnels et 5200 en attente de démantèlement. - Signataires en 1972 de la convention sur les armes biologiques, ratifiée en 1975, après avoir conduit un vaste de programme de recherche et de production depuis 1941. - Ont ratifié en 1997 la convention sur les armes chimiques, après avoir conduit un programme de recherche et de production depuis 1918. |
a) Le regain d’intérêt des Etats-Unis pour une politique de désarmement
Dans plusieurs discours de politique étrangère alors qu’il n’était pas encore investi par le Parti Démocrate, Barack Obama a clairement pris le contre-pied de ses prédécesseurs en affirmant la fin de l’unilatéralisme américain. L’administration du Président George W. Bush, prenant acte de la puissance américaine, affirmait le droit des Etats-Unis à intervenir préventivement contre tout pays qui représentait simplement une menace potentielle. Dans le domaine nucléaire, les Républicains ont clairement manifesté leur désintérêt d’une politique de réduction des armements, se contentant in fine de signer avec la Russie l’accord du 24 mai 2002 pour limiter le niveau des arsenaux, estimant qu’ils n’avaient pas à faire des concessions à la Russie après l’avantage qu’ils avaient tiré de la fin de la guerre froide.
Face à l’incertitude stratégique résultant de la politique américaine, la réaction russe a consisté à relancer a minima la tension en Europe en menaçant de se retirer du traité sur les armes nucléaires intermédiaires, en annonçant un moratoire sur l’application du traité sur les forces conventionnelles en Europe, à négocier ardûment toute une série de dossiers diplomatiques comme le Kosovo, l’Iran ou la Géorgie, pour montrer que la communauté internationale ne pouvait faire abstraction de la Russie.
Récemment, plusieurs signaux montrent que la nouvelle administration américaine est prête à faire évoluer sensiblement sa politique nucléaire dans le sens du désarmement. Il ne s’agit pas encore d’une doctrine, mais d’une série de déclarations, rejoignant des analyses qui mettent en lumière l’intérêt que les Etats-Unis retireraient d’une telle politique.
Outre les articles des 4 janvier 2007 et 15 janvier 2008 de MM. Schultz, Kissinger, Perry et Nunn dans le Wall Street Journal, plusieurs discours du Président Obama, lors de sa campagne électorale, ont annoncé l’inflexion de la politique américaine. En juillet 2008, dans l’Indiana, il déclarait ainsi : « Tant que les armes nucléaires existeront, nous conserverons une forte capacité de dissuasion. Mais nous ferons de leur élimination un élément central de notre politique nucléaire ». Ses propos étaient prudents puisqu’ils écartaient l’idée que les Etats-Unis prendraient unilatéralement des initiatives pour réduire leurs arsenaux, mais ils engageaient néanmoins le pays dans une démarche collective, dans un proche avenir.
Cette démarche rappelle celles des premiers âges de l’ère nucléaire, quand Harry Truman ou Andreï Gromyko proposaient dès 1946 l’élimination des armes nucléaires. Celle-ci était techniquement facilement réalisable, d’autant que le niveau des arsenaux était encore faible. Les scientifiques qui avaient contribué à bâtir la bombe américaine s’inquiétaient de la course aux armements que Staline allait lancer et craignaient que la prolifération accroisse l’instabilité du monde. La guerre froide a ruiné cette première tentative, en raison de l’intérêt stratégique que Moscou et Washington ont trouvé dans l’arme nucléaire. Elle a paradoxalement démontré que l’équilibre de la terreur pouvait constituer un concept valide et que des arsenaux trop importants devenaient une charge pour les pays qui les détenaient. Le contrôle des armes nucléaires n’a accompagné aucune solution aux tensions qui régnaient entre les deux grands. Il a constitué une politique en soi, visant simplement à atténuer l’intensité de la menace et le coût budgétaire qui résultait de tels stocks d’armements.
La fin de la guerre froide a été perçue à tort comme un moment favorable à l’élimination des ADM. Cette période a en fait démontré qu’il fallait préalablement éliminer les conflits politiques entre nations pour éliminer les armes. Après une décennie durant laquelle l’URSS, puis la Russie, exsangues économiquement, n’ont pu concurrencer stratégiquement les Etats-Unis, la compétition entre les deux nations a repris. Elle n’est plus idéologique, elle est géographique (contrôle de l’Asie centrale et de l’Arctique, espace Est européen) et thématique (accès aux ressources énergétiques).
L’achèvement du mandat de George W. Bush a montré aux Etats-Unis le décalage qui existait entre leur puissance technologique combinée au niveau de leurs arsenaux et les résultats de leur politique extérieure. Leur primauté n’a empêché ni l’impasse de l’aventure irakienne ou les difficultés croissantes en Afghanistan – deux guerres asymétriques dans lesquelles la technologie n’est que peu de secours – ni l’extension des armes nucléaires en Asie. Les dossiers nord coréen et iranien n’ont pas non plus été résolus. Dans un monde multipolaire où la menace réelle sur les Etats-Unis n’émane pas de grandes puissances, la Russie est une rivale, non une ennemie, et la Chine, même si elle rééquipe son armée, conduit une politique étrangère prudente. La fin de la guerre froide et du condominium russo-américain a considérablement diminué l’utilité de l’arme nucléaire. Les Etats-Unis doivent utiliser d’autres moyens pour atteindre leurs objectifs, le plus souvent non militaires (théorie du soft power).
L’arme nucléaire peut également devenir un obstacle à la puissance américaine quand de petits pays, comme la Corée du Nord, menacent de s’en doter, alors que le décalage entre les forces conventionnelles est immense. Elle atténue l’avantage comparatif dont dispose Washington et oblige en outre les Etats-Unis à étendre à leur frais leur parapluie nucléaire à leurs alliés, dans les zones de prolifération. Paul Nitze, qui a conseillé pendant plus de 40 ans les Présidents des Etats-Unis pour leur politique nucléaire et les relations avec l’URSS, et que l’on qualifiait de « faucon » dans les cercles diplomatiques, n’a pas hésité à écrire en 1999, à l’âge de 92 ans : « Je ne vois pas pourquoi nous ne renoncerions pas unilatéralement aux armes nucléaires… Les maintenir en état coûte cher et n’apporte rien à notre sécurité… Au regard des objectifs que nous pouvons atteindre par des moyens conventionnels, il n’y a rien à gagner à utiliser notre arsenal nucléaire ». D’un point de vue américain, cette position se justifie dans les circonstances actuelles. Mais les responsables des Départements d’Etat et de la Défense rappellent aussi que cet argument se retourne aisément. Les autres Etats n’ont aucun intérêt à laisser aux Etats-Unis un avantage conventionnel qu’ils ne peuvent concurrencer ; l’arme nucléaire est le seul moyen pour les autres puissances de rétablir une parité stratégique (Russie et sans doute Chine) ou d’exister sur la scène internationale (France, Royaume-Uni, Inde).
Le risque de rupture de parité stratégique lié au désarmement n’a pas échappé à la Russie. Celle-ci a certes écouté avec intérêt le discours prononcé à Prague le 5 avril 2009 par le Président Obama, appelant à éliminer les menaces nucléaires. C’est à la suite de ce discours que MM. Obama et Medvedev ont convenu qu’un futur traité réduirait à une fourchette de 1700 à 2200 le nombre de têtes possédées par leur pays. Mais les Etats-Unis semblent vouloir aller plus loin et auraient proposé à Moscou de réduire ce nombre à 1000. Or le décalage technologique entre les deux puissances empêche Moscou d’aller plus loin. Plusieurs analystes ont publiquement relevé que la proposition américaine équivalait à éliminer les capacités de dissuasion russes. « Le nombre d’ogives proposé par Barack Obama ne suffit pas à la Russie pour garantir la dissuasion nucléaire face aux Etats-Unis. Ceux-ci pourraient réduire les missiles ensilés qui sont l’élément principal des forces nucléaires russes, avec des frappes non nucléaires de haute précision, et les missiles que la Russie lancera seront interceptés par l’ABM américain » (Alexandre Khramtchikhine, Institut d’analyse politique et militaire de Moscou). En outre, une réduction trop importante de son arsenal rendrait la Russie vulnérable face à la Chine, dont les missiles à courte et moyenne portée Dong Feng ne représentent pas un danger pour les Etats-Unis, mais peuvent facilement atteindre la Russie.
Jusqu’à l’annonce récente de son abandon sous la forme et l’architecture préconisée par l’administration Bush, le projet de missile anti missile constituait un obstacle à toute politique sérieuse de désarmement. Pour la Russie, qui s’est exprimée sur cette question par la voie de son ambassadeur à l’OTAN Dmitri Rogozine, la réduction du nombre d’ogives nucléaires devait être examinée au regard du bouclier anti missile en Europe de l’Est. « On ne peut proposer de diminuer le nombre total des ogives et construire simultanément à proximité des frontières russes des installations susceptibles de détruire ces ogives » a relevé l’ambassadeur. Mille ogives étaient considérées comme un chiffre trop bas pour maintenir la parité de puissance avec les Etats-Unis. Comme les Etats-Unis ne renoncent pas à une politique anti missile, il y a de fortes chances pour que la Russie refuse de descendre sous le seuil des 1700 à 2200 ogives.
Au-delà du classique rapport de force entre puissances, l’intérêt immédiat que représente une politique de désarmement pour la nouvelle administration américaine consiste en la revitalisation du Traité de non prolifération (TNP) dont la portée est sérieusement affaiblie par les politiques iranienne et nord coréenne, par les bombes indiennes et pakistanaises et par la tentative de la Syrie d’accéder à la technologie nucléaire, dont l’AIEA ne s’était pas aperçue et qui n’a été décelée que par le travail de services de renseignements. Parmi les principales préoccupations de politique étrangère du Président américain, figurent deux dossiers de prolifération qui conditionnent la sécurité au Moyen-Orient et en Extrême-Orient, sans que les Etats-Unis et leurs alliés aient enregistré jusqu’à présent le moindre résultat. Si les Etats-Unis souhaitent restituer au TNP son importance dans l’architecture des relations internationales, ils doivent, en tant que première puissance nucléaire, donner l’exemple d’une application de l’article VI du traité, qui prévoit que les Etats parties dotés d’armes nucléaires doivent les éliminer complètement. C’est en raison de cette disposition que les Etats parties non dotés d’ADM ont accepté de signer ce traité. En s’engageant dans la démarche prévue par l’article VI, Washington retirerait l’argument de la menace à la Corée du Nord et à l’Iran, et entraînerait la nécessaire réflexion internationale sur une réforme du TNP.
b) Le désarmement à l’épreuve des tensions internationales
L’intérêt d’une politique de désarmement trouve ses limites dans l’intérêt des autres nations et dans les rapports de forces actuels. S’il se confirmait, le souhait de Washington d’en faire un axe de sa politique étrangère rencontrerait de sérieux obstacles, à commencer par les responsabilités qu’assument les Etats-Unis comme leaders du monde libre.
La dissuasion nucléaire est un concept auquel la plupart des responsables politiques accordent une trop grande valeur pour qu’ils y renoncent dans le contexte actuel des relations internationales. Il existe au minimum quatre raisons pour lesquelles les Etats-Unis mettront sans doute en œuvre une politique de réduction des armements nucléaires, mais auront des difficultés à les supprimer:
• Si certains des alliés des Etats-Unis – notamment la Corée du Sud, le Japon, Taïwan, l’Arabie saoudite dans une moindre mesure - n’ont pas à ce jour cherché à se doter d’ADM alors qu’ils sont situés dans des zones de prolifération, c’est en raison de la garantie du parapluie nucléaire qui leur est offert. L’extension de la dissuasion évite la prolifération.
• La Russie, la Chine, la France, l’Inde et le Pakistan ont chacun une raison précise de conserver des ADM. Les Etats-Unis sont donc forcés d’en conserver et de poursuivre une politique de suprématie technologique.
• La détention d’armes nucléaires confère un statut à des puissances moyennes, grâce auquel elles peuvent jouer un rôle dans les affaires du monde. Les puissances qui détiennent des ADM n’accepteront pas facilement de s’en séparer, arguant d’une situation internationale tendue, comme l’a fait la France lors du débat au Conseil de sécurité le 24 septembre dernier, avec le vote de la résolution n° 1887. Les ADM conserveront leur attractivité pour les puissances du seuil ou celles au contact d’Etats nucléaires…
• Le processus de désarmement court sur un si long terme, en raison de sa complexité, qu’il est en partie déconnecté des évolutions de la situation internationale. Des phases de tension peuvent apparaître à tout moment, avec pour conséquence une préférence pour les gouvernements qui la détiennent de conserver l’arme nucléaire.
Il est possible que l’administration américaine amorce un mouvement diplomatique vers l’élimination des ADM. S’il réussissait, ce serait un élément novateur de la politique étrangère des Etats-Unis. D’après William Walker, l’idée de faire du désarmement un élément central de la politique américaine ne s’est produite qu’à trois reprises (plan Baruch de 1946, accords McCloy-Zorine de 1961 et Sommet entre MM. Reagan et Gorbatchev à Reykjavik en 1986). A l’aune de l’histoire, ce serait un succès notable que commencer à diminuer la menace nucléaire entre les Etats-Unis et la Russie, ainsi qu’au Moyen-Orient, en Asie du Sud et en Extrême-Orient. Mais les obstacles demeurent importants, le plus notable étant que chaque dossier nucléaire n’est que l’arrière plan de contentieux politiques globaux.
c) Des négociations stratégiques qui dépendent de la résolution de conflits politiques
Les négociations stratégiques étaient consubstantielles à la guerre froide. Elles visaient à éviter une catastrophe, mais ne débouchaient par ailleurs sur aucun compromis sur les dossiers politiques. En 2009, la politique de réduction des armements n’est qu’un élément parmi d’autres de la politique internationale. Nous pouvons quasiment affirmer que les négociations stratégiques, si elles reprennent, n’aboutiront que parce que des conflits politiques seront préalablement résolus.
Les relations russo-américaines conservent toute leur importance dans le domaine nucléaire, même si la diminution du stock d’ADM de Moscou et de Washington n’aura que peu d’influence sur le niveau des armements d’autres Etats, qui obéissent à leur propre logique. Le Pakistan détient par exemple des armes dans une logique de faible au fort, dans le cadre de sa rivalité avec l’Inde. Il reste que la réduction des armes entre les deux grandes puissances nucléaires est un préalable indispensable à la diminution des tensions. Elle ne peut réussir que si les contentieux politiques entre elles sont aplanis.
Il est intéressant de noter que Dimitri Medvedev, dès le lendemain de la victoire de Barack Obama aux élections présidentielles américaines, a annoncé que la Russie déploierait des missiles dans l’enclave de Kaliningrad si les Etats-Unis maintenaient leurs objectifs dans deux dossiers : l’installation d’une défense anti missile en République tchèque et en Pologne, et l’adhésion de la Géorgie et de l’Ukraine à l’OTAN. L’annonce indiquait en quelque sorte le coût militaire, politique et financier que les Etats-Unis auraient à payer en cas de maintien de leur ligne politique.
Les Etats-Unis ont récemment renoncé à l’architecture du bouclier anti missile tel que prévu en Europe centrale, sans renoncer au principe d’une telle défense. Moscou a salué ce geste. Les dossiers géorgiens et ukrainiens sont d’une autre nature. Si les deux pays remplissaient à terme les conditions d’une adhésion et que leurs peuples en manifestaient la volonté, la Russie aurait du mal à s’y opposer. Actuellement, il est clair que les Géorgiens souhaitent devenir membres de l’Alliance atlantique, tandis qu’une majorité du peuple ukrainien s’y refuse. Le dossier ukrainien est d’autant plus sensible que Moscou recherche la primauté dans l’espace de l’ex-URSS et que l’un des objectifs discrets de sa diplomatie est la réintégration du Belarus et de l’Ukraine au sein de la sphère d’influence de la Russie.
Du rapprochement russo-américain dépend en partie le dossier iranien. Sans volonté russe de s’opposer à la prolifération, Téhéran peut être tentée d’aller de l’avant. La Russie a officiellement une position très claire et souhaite un Iran non nucléaire militairement, mais elle hésite à prendre partie en faveur de sanctions plus sévères à l’encontre de Téhéran. Il est de l’intérêt de la Russie que des zones de tensions demeurent à travers le monde pour que les Etats-Unis, constatant l’impasse où les a conduit leur unilatéralisme, réintroduisent la Russie dans la conduite des affaires internationales.
Le dossier nucléaire iranien est pour sa part inséparable de plusieurs problèmes : les relations bilatérales entre les Etats-Unis et l’Iran, la reconnaissance par les Etats-Unis du statut de puissance régionale de l’Iran, l’Afghanistan (Téhéran garantit pour l’heure la paix dans l’Ouest du pays), le Liban et les territoires palestiniens. Téhéran a su tisser une toile avec beaucoup d’intelligence sur chacun de ses dossiers au point d’être un partenaire incontournable dans leur résolution. L’Iran a démontré sa capacité à gagner du temps lors de négociations et à trouver des alliés au sein même du Conseil de sécurité, la Chine étant ainsi largement dépendante de ses importations d’hydrocarbures. Si la situation devait s’aggraver, l’Iran ne serait sans doute pas en mesure de s’opposer à un éventuel raid aérien ou à un bombardement de Natanz par des missiles, mais il pourrait en réaction créer de nombreux foyers de tension au Moyen-Orient et favoriser un regain de violence en Afghanistan. La volonté de dialogue affirmée à plusieurs reprises par les Etats-Unis, et le communiqué final du Sommet de Pittsburgh le 29 septembre dernier, constituent de nouvelles offres à Téhéran. Elles se heurtent vraisemblablement au réflexe de survie et à l’impératif de défense d’une République islamique entourée de puissances nucléaires, qui ne renoncera – à supposer qu’elle le veuille – à son programme qu’en échange d’un prix politique élevé. Pour les Etats membres du TNP, le respect par l’Iran du traité est crucial : il évite l’escalade nucléaire au Moyen-Orient, sous réserve de régler le cas d’Israël dont la politique volontairement ambiguë devient la justification doctrinale des Etats arabes qui souhaitent accéder à la technologie nucléaire militaire…
Il est en effet de plus en plus difficile d’expliquer à la communauté internationale un système de « deux poids, deux mesures » avec les situations iranienne et israélienne. Comment faire comprendre qu’un pays, l’Iran, serait sanctionné pour non-respect du TNP dont il est signataire tandis qu’un autre pays, Israël, serait exonéré de sanctions parce qu’il se situe hors du champ du TNP ?
Le respect du TNP restaurerait l’ordre international tel que conçu par les puissances nucléaires. Mais il n’est pas sûr que l’Iran admette cette logique. Au-delà de sa défense, c’est la remise en cause de l’architecture des relations internationales que recherche Téhéran.
Au printemps dernier, le Pakistan est devenu le dossier prioritaire de la diplomatie américaine, en raison de son rôle crucial dans la résolution politique de la guerre en Afghanistan et du risque de déstabilisation qu’il subit. Les Etats-Unis considèrent que l’arsenal nucléaire pakistanais est bien sécurisé (ils ont contribué à cette sécurisation) mais souhaiteraient que la tension diminue en Asie du Sud, ce qui passe par la normalisation des relations indo-pakistanaises. Malgré les attentats terroristes de l’Assam et de Bombay, Delhi et Islamabad ont évité l’escalade car les deux capitales avaient entamé un prudent processus de rapprochement en 2008. Il reste que l’Afghanistan et le Cachemire demeurent au cœur de leur conflit. Les Etats-Unis s’inquiètent de l’influence croissante de l’Inde en Afghanistan, qui conduit Islamabad à maintenir de son côté sa stratégie de tension avec les talibans pour ne pas subir un encerclement au Nord et à l’Ouest de ses frontières. Si les Etats-Unis ont quelques moyens de pression sur le Pakistan, ils n’en ont aucun sur l’Inde, qui rappelle en permanence que le Cachemire est une question strictement bilatérale avec le Pakistan.
En matière nucléaire, Delhi n’est pas opposée à une réduction des arsenaux, mais à la condition qu’elle s’inscrive dans le cadre d’une diminution globale des niveaux d’armements, y compris conventionnels. Mohmand Singh, Premier ministre indien, a clairement rappelé cet objectif dans une intervention le 9 juin 2008. Washington ne partage pas pour l’heure cette logique, ce qui rend par avance difficile toute démarche de dénucléarisation en Asie du Sud.
La politique de dénucléarisation risque de se heurter rapidement aux rapports de force régionaux qui sont à l’origine du renforcement des arsenaux nucléaires et à la volonté d’Etats de se doser d’ADM. Dans un monde multipolaire où les allégeances de la guerre froide se sont atténuées, il ne suffira pas aux principales puissances du TNP – au premier rang desquelles les Etats-Unis – de faire pression sur les Etats qui souhaitent disposer d’ADM pour les en empêcher. Il faudra que la renonciation à ces armes corresponde à un intérêt politique.
2) La Russie à la recherche de la parité politique
Pour la Russie post soviétique, l’arme nucléaire est avec son siège au Conseil de sécurité la manifestation de la puissance globale. Le traumatisme de la dissolution de l’URSS n’a pas disparu et la Russie, qui s’en veut l’héritière, recherche la restauration de sa puissance. Cet arrière-plan psychologique est crucial pour comprendre pourquoi la Russie, qui accuse un retard technologique sur les Etats-Unis, qui connaît un déclin démographique dangereux (perte de 500 000 habitants annuellement) et dont l’économie a du mal à se diversifier, rappelle régulièrement qu’elle dispose de forces nucléaires, les seules capables de rivaliser avec celles des Etats-Unis, et qu’elle est à ce titre un leader mondial.
Pouvoir s’appuyer sur des forces nucléaires modernes est crucial pour un pays qui s’est interrogé au début des années 90 sur ses orientations de politique étrangère. La Russie a songé brièvement à intégrer les structures euro atlantiques (l’adhésion à l’OTAN avait été évoquée) avant de choisir une politique d’indépendance, hors des alliances existantes. Moscou recherche des relations qu’elle souhaite équitables avec les Etats-Unis et avec l’Union européenne. Les ADM sont le moyen de résister à d’éventuelles pressions.
A l’intérieur du pays, l’arme nucléaire constitue le symbole de l’autorité. L’acte symbolique par lequel Mihaïl Gorbatchev a transmis son autorité à Boris Eltsine a été le passage de la valise noire. Il en a été de même lorsque Vladimir Poutine a succédé à ce dernier. Vladimir Poutine, comme Dmitri Medvedev, donnent force publicité à chacun de leurs déplacements au poste de commandement nucléaire afin de marquer leur rôle de commandant en chef, garant de la sécurité du pays.
Russie en bref - Initiatrice et signatrice du TNP. - Signatrice du Traité d’interdiction des essais nucléaires. - Détiendrait environ 2500 têtes nucléaires stratégiques et 3500 têtes nucléaires tactiques. - Signatrice de la convention sur les armes chimiques. - Signatrice de la convention sur les armes biologiques. - A conduit des programmes de recherche et de production d’armes chimiques et biologiques, en voie de démantèlement. |
a) La dissuasion nucléaire, pour compenser le déclin des forces conventionnelles
Vladimir Poutine a déclaré en octobre 2003 que « la dissuasion nucléaire constituait la base principale de la sécurité de la Russie pour le présent et le futur ». Sur un plan militaire, les ADM nucléaires assurent à la Russie une protection contre une attaque à grande échelle alors que ses forces conventionnelles nécessitent d’être modernisées, comme l’ont révélé de nombreuses lacunes dans la conduite des opérations en Géorgie, en août 2008.
La doctrine de défense de la Russie a écarté ces dernières années l’idée d’une attaque nucléaire massive sur le pays. Celle-ci ne pourrait venir que de Washington, alors que les relations entre les deux pays sont normalisées. Le Président Poutine et ses ministres des Affaires étrangères et de la Défense ont également, à plusieurs reprises, mis en avant le risque de dissémination d’ADM, très sensible dans un espace post soviétique où il fallait sécuriser les stocks d’armes, et la lutte contre le terrorisme, ce point étant fondamental pour obtenir des Occidentaux une liberté de manœuvre en Tchétchénie et dans d’autres régions du Caucase qui se soulèveraient, comme le Daguestan.
Aucune des menaces nouvelles ne justifie un arsenal nucléaire massif, que la Russie est prête à diminuer, mais auquel elle ne renoncera pas. Sa politique nucléaire est en effet dictée par sa relation avec les Etats-Unis. Or, que l’on se place du côté russe ou du côté américain, les relations sont ambiguës : les deux pays sont juridiquement des partenaires qui entretiennent un dialogue notamment au sein du Conseil OTAN-Russie, ils coopèrent en Afghanistan et dans la lutte contre le terrorisme, mais en raison de nombreux différents évoqués supra, chacun se comporte dans le domaine stratégique comme si l’autre était encore le principal ennemi. La Russie a admis dans plusieurs documents que le partenariat avec les Etats-Unis constitue la solution pour les questions de sécurité du monde, mais juge parallèlement que seules les forces armées russes, dont la mission est d’éviter la destruction du pays, permettent d’assurer une stabilité globale et de contribuer à un monde fondé sur le droit international.
Depuis le 11 septembre 2001, la recherche d’un partenariat avec les Etats-Unis s’est estompée car la Russie, pourtant alliée dans la lutte contre le terrorisme, considère qu’elle n’a pas recueilli de résultats dans cette politique et qu’elle a subi au contraire l’unilatéralisme américain, contre ses intérêts. Sans proclamer officiellement que les Etats-Unis constituent une menace, toute la doctrine comme toute l’organisation des forces russes, nucléaires et conventionnelles, est tournée vers une attaque hypothétique des Etats-Unis. Washington est perçue comme la seule puissance en mesure d’attaquer la Russie, c’est en conséquence contre cette éventualité que s’organise la défense russe. Même si deux autres pays membres de l’OTAN, la France et la Grande-Bretagne, disposent d’ADM, la Russie ne les prend pas en ligne de compte dans sa stratégie, en raison de la faiblesse de leur arsenal et des relations politiques cordiales qu’elle entretient avec elles.
Mais à la différence de la guerre froide, il n’y a plus parité militaire entre Moscou et Washington. Malgré des efforts considérables, le budget de défense de la Russie équivaut en valeur à 15 % environ de celui des Etats-Unis. Ces derniers ont pris un avantage technologique considérable dans les technologies de l’espace et dans le guidage des cibles. Géographiquement, les Etats-Unis ont mis en place à travers le monde un réseau de bases qui vient en appui des projections de leurs forces quand la Russie a le plus grand mal à reprendre pied en Asie centrale, dans son ancien espace d’influence. Elle est en position défensive, en ayant conscience du déclin de ses forces conventionnelles.
Dans un tel contexte, les forces nucléaires ont une double mission : militairement, elles assurent la sécurité de la Russie ; politiquement, elles maintiennent la Russie au rang de grande puissance à l’unique condition qu’elles soient en nombre suffisant pour traverser un système américain anti missile et provoquer des dommages appropriés, devant la perspective desquels les Etats-Unis ne peuvent que renoncer à déclencher une guerre nucléaire.
La dissuasion demeure au cœur de la stratégie russe, comme sous la guerre froide, mais l’arme nucléaire est ramenée à un outil défensif alors que quand Moscou dirigeait le Pacte de Varsovie, l’arme nucléaire était longtemps conçue comme une arme offensive de première frappe, avant que Leonid Brejnev admette également son aspect défensif. Compte tenu de la faiblesse (admise par les dirigeants russes eux-mêmes) des forces conventionnelles, l’ADM nucléaire présente l’avantage de sanctuariser le territoire russe, comme sous la fin de la guerre froide. Dans plusieurs documents officiels rendus publics, les Russes affirment vouloir être en mesure de soutenir simultanément deux théâtres d’opérations, l’un à l’Ouest et l’autre en Extrême-Orient, comme s’ils devaient faire face à une attaque coordonnée de l’OTAN et des forces américaines et japonaises.
La dissuasion russe joue aussi à l’égard de la Chine, avec laquelle les relations ont longtemps été tendues après la rupture de la fin des années 60 et en raison du contentieux frontalier en Extrême-Orient. En 1989, la visite de Mihaïl Gorbatchev à Pékin a marqué le début de la normalisation entre les deux pays. En 1996, leurs relations ont été élevées au niveau d’un partenariat stratégique. A la fin de 2004, le différend frontalier était résolu. Pékin et Moscou sont enfin les initiateurs de l’Organisation de coopération de Shanghaï qui, avec quatre autres Etats d’Asie centrale, vise à créer une zone de paix et de sécurité en Asie centrale et en Extrême-Orient. Pour autant, les stratèges russes ne peuvent que constater le gigantesque déséquilibre démographique avec leur voisin, dont 7 millions de ressortissants se sont installés en Sibérie. L’écart d’effectifs des forces conventionnelles ne peut que croître, tandis que la Chine, forte de ses réserves en devises et de ses progrès technologiques, modernise son armée. Dans un tel contexte, les forces nucléaires sont pour la Russie le moyen de rappeler à la Chine sont statut de grande puissance.
b) ADM stratégiques et ADM tactiques : éléments particuliers de la doctrine russe
Compte tenu du contexte stratégique dans lequel évolue la Russie, l’existence de ses ADM nucléaires n’est pas limitée à la dissuasion d’une attaque nucléaire, même si la Russie cherche à se garantir principalement d’une attaque américaine. La longueur de ses frontières et le déclin de ses forces conventionnelles l’ont conduit dès 1993, soit deux ans après la disparition de l’URSS, à déclarer qu’elle utiliserait si nécessaire ses forces nucléaires même en cas d’attaque conventionnelle. La dissuasion russe s’applique autant à l’encontre d’Etats nucléaires, quelle que soit la forme de leur attaque, que d’Etats non nucléaires. Cette position vise à prévenir toute escalade dans les pressions politiques, puis militaires qu’elle pourrait subir. Dans un tel contexte, l’arme nucléaire stratégique demeure un outil, mais l’arme tactique devient un élément essentiel de la doctrine de défense, ce qui explique la réticence traditionnelle de la Russie à réduire le niveau de ce type d’armement.
La Russie s’intéresse fortement à la miniaturisation des armes nucléaires pour mettre les Etats-Unis face à un facteur d’incertitude sur l’utilisation qu’elle ferait de ses armes. Les stratèges russes y voient un moyen de compenser partiellement l’avance technologique prise par les Etats-Unis.
La protection par l’arme nucléaire russe est également étendue aux membres de l’Organisation de sécurité collective (Arménie, Belarus, Kazakhstan, Kirghizistan et Tadjikistan) dont la Russie garantit la sécurité et l’inviolabilité des frontières. Il n’est pas certain que ce parapluie nucléaire soit la solution pour assurer la stabilité d’Etats qui subissent plus des menaces d’ordre interne qu’externe, mais cette organisation donne à la Russie un droit de regard sur la stratégie et la défense de ces pays et maintient donc son influence en Asie centrale comme aux frontières de l’OTAN, via le Belarus et l’Arménie. C’est dans le contexte de son influence en Asie centrale que la Russie a fait allusion une fois à son potentiel nucléaire pour protéger un allié, lorsque le maréchal Chapochnikov, commandant en chef des forces de l’organisation de sécurité collective, a averti en 1992 la Turquie de ne pas s’impliquer dans le conflit du Nagorno-Karabagh.
c) Le contrôle des armes nucléaires : éviter la supériorité américaine
Avec l’échec du traité START 2, signé en 1993 mais jamais appliqué, l’obsession de la Russie a été de conserver la parité stratégique avec les Etats-Unis, alors que la chute de ses capacités de recherche et de production risquait de créer un dangereux écart avec les Etats-Unis. La politique de contrôle des armes est devenue ainsi le moyen pour Moscou de maintenir par des moyens juridiques une parité que Washington semblait prête à remettre en cause, notamment sous l’administration de George W. Bush.
Malgré les contentieux entre Washington et Moscou, cette dernière souhaite disposer d’un cadre juridique qui stabilise sa vision stratégique et sa politique de sécurité. Moscou utilise les dossiers géorgiens ou kosovars pour empêcher l’hégémonie américaine de sa sphère d’influence passée, mais elle ne se soumettra par un traité sur les armes stratégiques préalablement à la résolution de ces dossiers. La Russie a en effet besoin d’un traité de maîtrise des armements qui lui permette de maintenir l’image d’une parité stratégique avec les Etats-Unis.
Le traité du 24 mai 2002 a permis à Moscou de maintenir à 2200 le nombre de têtes stratégiques et par le mécanisme d’inspections mutuelles, de conserver un droit de contrôle sur l’arsenal américain. Les deux parties ont strictement respecté leurs obligations à ce jour. Cet accord, qui est la base des relations russo-américaines dans le domaine nucléaire, a en quelque sorte rassuré Moscou, qui préservait l’essentiel, à savoir un nombre de têtes suffisant pour que sa dissuasion fût crédible. Il a permis à la Russie d’accepter psychologiquement l’assistance américaine pour remplir les obligations de ce traité, dans le cadre de la loi Nunn / Lugar de réduction de la menace nucléaire, puis dans le Partenariat global décidé au Sommet du G 8 de Kananaskis, en 2002 même si la Russie contestait le fait que son arsenal présentait un risque sécuritaire… Les autorités de Moscou ont d’ailleurs à plusieurs reprises refusé certaines inspections quand elles estimaient qu’elles portaient atteinte à leur sécurité.
La Russie a également refusé de négocier sur les armes tactiques, conformément aux principes établis en 1991 entre MM. Bush et Gorbatchev. L’arsenal tactique russe serait proche de 3500 têtes. La Russie affirme ne pas se sentir menacée par les armes tactiques américaines, y compris par celles déployées en Europe, mais souhaite conserver la latitude d’user de telles armes, notamment en cas d’attaque contre la Russie hors d’Europe (Asie centrale, Chine…). La pénétration de l’influence américaine en Asie centrale et la proximité d’un Iran éventuellement nucléaire militent aux yeux des stratèges russes pour le maintien de telles armes.
d) Une politique de non prolifération à géométrie variable
Avec la fin de la guerre froide, la Russie a opéré une inflexion sensible dans sa politique de non prolifération. Celle-ci garantissait un primat stratégique dans un condominium russo-américain. Depuis l’éclatement de l’URSS, la politique de non prolifération est principalement guidée par ses intérêts nationaux. Deux facteurs sont notamment pris en compte :
• Les pays qui aspirent à acquérir ou développer l’arme nucléaire sont tous dans le voisinage de la Russie, qui devient ainsi une cible potentielle pour des Etats qui disposeraient de missiles à moyenne portée : Iran, Pakistan, Inde, Corée du Nord… La prolifération est d’abord pour Moscou une préoccupation pour la sécurisation de son territoire.
• Comme pour le contrôle des armements, la politique de la Russie est conduite au regard de sa rivalité avec les Etats-Unis.
Il n’y a aucun doute que la Russie nourrit les mêmes inquiétudes que les pays occidentaux et la Chine sur la prolifération, comme risque potentiel pour sa sécurité. Elle respecte le TNP et l’ensemble des règles fixées par l’AIEA. Elle a accepté de coopérer dans le cadre du Partenariat global précité à la sécurisation des matières fissiles sur son territoire, à la décontamination de sous-marins à Mourmansk et au démantèlement d’ogives obsolètes pour éviter que des mafias ou des terroristes s’en emparent. Elle est, comme les Etats-Unis et l’Europe, visée par un terrorisme islamiste qui a affirmé dans des documents vouloir user, si l’opportunité s’en présentait, de la bombe nucléaire…
Néanmoins, son attitude à l’égard des pays qui développent l’arme nucléaire est dictée par ses intérêts bilatéraux plutôt que par la recherche à toute force de la sauvegarde du TNP. L’Inde ne pose ainsi aucun problème pour la Russie, même après son rapprochement avec les Etats-Unis. Les deux pays sont de proches alliés de longue date. Moscou fournit une part appréciable des armements conventionnels de Delhi. Il n’existe entre elles aucun contentieux. La Russie admet en conséquence le fait que l’Inde, puissance montante, cherche à protéger ses intérêts, avec une bombe bien plus tournée vers la Chine (pour l’équilibre stratégique en Asie) et le Pakistan (problème du Cachemire) que vers la Russie. La bombe indienne est même intéressante pour Moscou car elle constitue un contrepoids à la puissance chinoise.
Il y a donc identité d’attitude avec les Etats-Unis à l’égard de l’Inde, sans doute parce que la politique étrangère de Delhi n’est pas expansionniste (sauf en Afghanistan). Les raisons de ces attitudes diffèrent en revanche, au sens où la Russie trouve dans la bombe indienne un équilibre stratégique tandis que Washington n’a pas hésité à « oublier » le TNP pour s’ouvrir le marché indien des technologies nucléaires civiles et de l’armement conventionnel…
L’inquiétude russe à l’égard du Pakistan est réelle. Sous la guerre froide, Islamabad était dans le camp américain. C’est au Pakistan qu’a été créé et instrumentalisé le mouvement taliban et qu’ont été armés et entraînés les combattants qui ont affronté l’URSS. Comme la Russie fait face dans le Caucase à un réveil de l’Islam, elle craint que les talibans qui déstabilisent le Nord du Pakistan s’emparent à terme de l’Etat et contrôlent les installations nucléaires.
La Corée du Nord et l’Iran forment deux dossiers sur lesquels la Russie a une attitude plus nuancée que les Etats-Unis, afin de protéger plusieurs de ses intérêts.
La Corée du Nord n’est pas perçue comme une menace. Elle est considérée comme un pays en faillite dont la pérennité n’est plus assurée et qui, avec la dislocation de sa société civile, pourrait se réunifier à terme avec la Corée du Sud. Faisant partie du groupe des Six qui négocie avec Pyong Yang, la Russie, comme la Chine et la Corée du Sud, est partisane d’une politique de persuasion à l’égard de la Corée du Nord plutôt que d’une politique de menace, considérant que Pyong Yang recherche principalement sa survie politique et économique. La Russie n’est également pas disposée à s’aligner sur Washington dans ce dossier, car elle garde en mémoire son éviction, en 1994, du marché nucléaire civil nord-coréen par les Etats-Unis. Plus généralement, Moscou estime que les conséquences de la politique américaine sur la Corée du Nord et sur l’Iran risquent d’affaiblir ses positions sur le marché mondial du nucléaire civil.
L’Iran est un cas plus complexe. La Russie ne souhaite pas officiellement un Iran militairement nucléaire, mais l’histoire et l’attitude des diplomates russes à l’ONU donnent l’impression que Moscou pourrait s’en accommoder. Un Iran nucléaire gène plus les Etats-Unis que la Russie.
La Russie se présente souvent comme un partenaire historique et stable de l’Iran, héritage d’une coopération soviétique importante avec Téhéran. Ces déclarations ne doivent pas faire oublier les siècles d’interférence russe dans les affaires iraniennes. Moscou a toujours nourri une certaine méfiance à l’égard d’un pays situé non loin de son flanc Sud et dont les rouages du pouvoir sont difficiles à décrypter.
Il existe pourtant un partenariat de longue date, avec la centrale de Busher dont l’origine se trouve dans la signature de deux accords en août 1992. La coopération qu’ils instauraient portait sur la construction d’une centrale, la fourniture et le recyclage de combustible, la formation de scientifiques iraniens à l’Institut de physique industrielle de Moscou et la production d’isotopes à des fins médicales. Les services de renseignement russes avaient certes la crainte que l’Iran détournât ces technologies dans un but militaire, mais ils estimaient que Téhéran ne pouvait bâtir la bombe sans aide extérieure. Le 8 janvier 1995, un nouvel accord permettait de terminer les travaux de Busher.
Viktor Mikhaïlov, ministre russe de l’énergie en 1991, a rappelé la motivation de son pays dans la signature de ce contrat, alors que le risque de prolifération était sous-jacent : « Avec quoi la Russie pouvait-elle se présenter sur le marché globalisé ? Nous ne disposions que d’une seule force : notre potentiel scientifique et technique. Notre seule chance était la coopération à grande échelle dans le secteur de l’énergie nucléaire pacifique ». Moscou escomptait que Busher lui ouvrirait d’autres marchés dans la région. En outre, ce projet rapportait de 800 millions à 1 milliard de dollars à une Russie en manque de devises à l’époque.
La relative anarchie qui régnait à Moscou dans les années 90 est à l’origine de nombreux contrats signés par des instituts ou des scientifiques russes sans l’accord de leur gouvernement. Le plus notable est un protocole d’intention de janvier 1995 signé à Téhéran par Viktor Mikhaïlov, destiné à « mener des négociations en vue de conclure un contrat pour la construction d’une unité de centrifugation destinée à l’enrichissement d’uranium ». Le ministre n’avait pas informé le gouvernement russe de cette signature… Or ce protocole violait les obligations internationales de la Russie, notamment celles prises dans le cadre du groupe des pays fournisseurs nucléaires. Il va de soi que la Russie a rapidement annulé cet accord, mais la répétition de tels incidents a irrité les Etats-Unis, le Président Clinton ayant exigé de son homologue Boris Eltsine, lors de sa visite à Moscou en mai 1995, que la Russie mît fin à sa coopération avec l’Iran dans des domaines sensibles.
L’avertissement américain a quelque peu porté ses fruits puisque la Russie, vers 1996, a établi une stratégie à l’égard de l’Iran : strict respect du traité de non prolifération, mais engagement économique résolu avec ce pays. Mais tous les analystes s’accordent pour dire qu’il n’y avait pas unité d’analyse à Moscou. Là où le ministère des Affaires étrangères voyait des perspectives de coopération, le ministère de la Défense voyait une menace. La Russie a pu mesurer au Sommet du G8 d’Okinawa, en 2000, à quel point ses hésitations inquiétaient les Occidentaux quand, sous leur pression, elle a renoncé au projet de fournir à Téhéran un réacteur de recherche pouvant enrichir l’uranium à 20 %.
A la fin des années 90, les Russes étaient prêts à accepter les analyses américaines sur les intentions de l’Iran, mais exigeaient des preuves tangibles que Washington refusait de leur fournir pour ne pas dévoiler les sources de ses renseignements. En conséquence, la Russie craignait d’être associée à une politique américaine influencée –pensait-elle – par Israël.
A partir de l’année 2000, Vladimir Poutine a procédé à la réorganisation de la politique étrangère de son pays. Dans la doctrine de cette époque, la Russie considérait l’Iran comme un acteur incontournable de la région avec lequel il convenait de coopérer plutôt que de conduire une politique de force. En outre, Moscou estimait que Téhéran ne pouvait être soumise à une politique arbitraire. Or, les Etats-Unis souhaitaient vendre à la Corée du Nord des réacteurs civils à eau légère dans le cadre de l’Organisation coréenne de développement de l’énergie, alors que la construction par Moscou de ce type de centrale était critiquée par les Etats-Unis. Dans un contexte où la Russie recherchait un climat de confiance avec l’Iran, elle s’est trouvée en porte à faux avec les révélations sur l’existence de Natanz, qui validait en revanche l’attitude des Etats-Unis. Moscou, qui était la seule capitale à coopérer dans le domaine nucléaire civil avec Téhéran, aurait espéré être informé au minimum des activités de son partenaire. Sa réaction a été en 2003 de ne pas accélérer les travaux de Busher, tactique qui a vite trouvé ses limites car l’Iran a indiqué qu’il pourrait trouver sur le marché d’autres pays pour un marché de 6 centrales.
A la fin de 2003, la Russie a demandé à l’Iran de respecter ses obligations à l’égard du TNP, tandis qu’un document du ministère de la Défense classait la Corée du Nord et l’Iran parmi les pays à statut obscur en matière d’armes nucléaires. Pressentant le risque d’être isolée, Téhéran a appelé au soutien de la Russie, pour la session d’automne 2004 du Conseil des gouverneurs de l’AIEA. Au mois d’octobre de cette même année, la Russie a achevé la construction de Busher, en signe de bonne volonté, sans toutefois que la question du retour vers la Russie du combustible épuisé fût réglée. Il le fut ultérieurement.
Après quelques hésitations, la Russie a accepté à la fin de 2004 de coopérer dans le domaine nucléaire civil avec l’Iran, considérant la situation géostratégique de ce pays sur les routes maritimes et terrestres reliant l’Europe à l’Asie, le poids de ses réserves en hydrocarbures et le niveau d’éducation élevé d’une population en forte croissance démographique. L’ensemble de ces facteurs rendait l’Iran incontournable aux yeux du Kremlin. En retour, Moscou a bénéficié a plusieurs reprises du soutien de Téhéran sur la Tchétchénie, l’Afghanistan et l’Irak, sans que l’on puisse qualifier ce soutien de décisif. L’intérêt de l’Iran de souscrire à la coopération souhaitée par la Russie est de pouvoir disposer, dans son combat diplomatique contre/avec les Etats-Unis et l’Union européenne d’un partenaire (à défaut d’un allié) qui est la deuxième puissance nucléaire militaire et un Etat partie au TNP.
Bien que préoccupée par l’apparition d’un Etat nucléaire sur son flanc Sud, qu’elle considère comme l’un des principaux problèmes de notre temps, la Russie n’a jamais renoncé à sa coopération avec l’Iran, malgré les pressions américaines et européennes. Pour Moscou, qui raisonne souvent en sphère d’influences, renoncer aux relations avec Téhéran, même en contrepartie d’une aide financière, équivaudrait à laisser le terrain aux pays occidentaux. Or la Russie constate que de nombreuses entreprises européennes sont implantées en Iran, dans les domaines de l’énergie comme des industries de consommation. Dénonçant ce qu’il estimait être une hypocrisie européenne, Vladimir Poutine déclarait en juin 2003 : « Nous savons que certaines entreprises d’Europe occidentale coopèrent activement avec l’Iran dans la sphère de l’énergie nucléaire et fournissent de l’équipement qui est au minimum à double vocation. En conséquence, nous contesterons l’utilisation contre l’Iran du thème de la prolifération nucléaire pour évincer les entreprises russes du marché iranien ».
La Russie entretient avec l’Iran des relations fondées sur l’énergie (les deux pays sont fournisseurs d’hydrocarbures) et la livraison d’armements. Téhéran a acquis en 2007 des systèmes de défense antiaérien TOR-M1. Les deux pays sont co fondateurs du cartel du gaz, qui les réunit depuis octobre 2008 dans une organisation dont est également membre le Qatar. Enfin, des manœuvres militaires russo-iraniennes se sont déroulées en Mer Caspienne.
La politique de Moscou à l’égard de l’Iran oscille constamment entre politique de non prolifération et coopération, afin de maintenir en ce pays des positions politiques et économiques. Lors d’une tribune publiée dans Le Monde, le 6 juillet 2009, Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères, a bien évoqué une nouvelle ère de confiance entre les Etats-Unis et la Russie avec de nombreux thèmes de coopération (réduction des armements, non prolifération, Corée du Nord) mais s’agissant de l’Iran, tout en appelant à une solution politique au programme nucléaire iranien, il a souhaité qu’il soit tenu compte du rôle important de l’Iran dans cette partie du monde. Au sein du Conseil de sécurité, la Russie a constamment suivi une ligne consistant à atténuer les sanctions proposées à l’égard de Téhéran. Même si Dmitri Medvedev semble se rallier à l’idée de sanctions renforcées, dans sa déclaration du 24 septembre 2009 à Pittsburgh : « Les sanctions ne sont pas le meilleur moyen de parvenir à un résultat sur l’Iran mais si les autres possibilités étaient épuisées, nous pourrions y avoir recours », les termes sont soigneusement pesés, aucune mesure réellement contraignante n’est préconisée… En outre, il semble qu’il n’y ait pas unité de vue au sein du gouvernement. Sergueï Lavrov a maintenu sur ce dossier une position beaucoup plus traditionnelle.
Stratégiquement, la Russie a sans doute conduit l’analyse selon laquelle la bombe iranienne attente plus aux intérêts américains qu’aux siens. Elle est déjà entourée de puissances nucléaires avec lesquelles elle entretient soit des relations d’amitié, soit des relations méfiantes, mais l’apparition d’une puissance nucléaire sur son flanc Sud ne change pas les objectifs et les moyens de sa défense. Washington, qui se veut l’arbitre du Moyen-Orient, a beaucoup plus à perdre, politiquement, d’un Iran nucléaire. Par ailleurs, la Russie, en dehors des hydrocarbures, a peu d’instruments d’influence sur la scène internationale. Les industries spatiales et nucléaires demeurent les outils de son rayonnement. Ayant opéré le constat d’un déficit en énergie électrique pour les années à venir, la Russie, via Rosatom, veut absolument être présente sur un marché de 600 centrales à construire d’ici 2030. L’Iran représente à la fois pour elle un marché mais aussi l’occasion de moderniser des mécanismes de non prolifération qu’elle considère comme obsolètes, en mettant en place des banques de combustibles qui assurent fourniture et retraitement, pour lesquelles elle dispose, comme la France, d’une technologie éprouvée (cf le centre d’Angarsk, en Sibérie).
3) La montée en puissance globale de la Chine
Du 16 octobre 1964, date à laquelle la Chine est devenue le cinquième pays à détenir l’arme nucléaire, à nos jours, la Chine a cultivé l’opacité sur son arsenal comme sur d’autres types d’ADM. Si la doctrine a été clairement établie – non recours à une stratégie de première frappe et dissuasion suffisante pour éviter toute attaque – l’opacité règne sur le niveau exact des arsenaux chinois et le doute s’est instauré sur la volonté chinoise d’appliquer strictement le TNP, dont elle est un Etat partie, après les révélations sur la fourniture par Pékin du design d’une bombe nucléaire au Pakistan.
Il est néanmoins indéniable que la Chine opère une montée en puissance qualitative et quantitative de l’ensemble de ses armements conventionnels et stratégiques. Avec la place croissante que son économie prend dans le monde, la Chine ne peut asseoir sa puissance sur la seule taille de son territoire et sur sa démographie. Il lui faut les instruments qui garantissent sa sécurité. Cette orientation de la politique chinoise n’a pas échappé aux Etats-Unis, qui voient dans ce pays leur seul véritable rival au XXIème siècle. Il existe une obsession américaine de la puissance chinoise, qui se manifeste par la publication, chaque année, d’un rapport du Département de la Défense à destination du Congrès (annual report to Congress of the military power of the People’s Republic of China), qui, sous les réserves d’usage, évalue les forces militaires de Pékin.
Chine en bref - Dernier Etat nucléaire militaire à avoir signé le TNP (1992). - Signatrice du traité d’interdiction des essais nucléaires (1996) - Détiendrait environ 240 têtes nucléaires, dont 176 déployées. |
a) Mutations économiques et sociales, permanence stratégique
Aucun pays au monde n’a vécu de modifications aussi profondes que la Chine, depuis qu’elle a appliqué une politique d’ouverture économique, en 1978. L’accès de 350 à 400 millions d’hommes à une vie meilleure est le résultat d’un gigantesque effort de la société encore en cours, car il reste environ 700 millions d’habitants à sortir du sous-développement. La Chine a développé à cette fin le principal appareil industriel de la planète (elle est souvent surnommé l’atelier ou l’usine du monde) et malgré d’abondantes ressources en hydrocarbures, charbons et minéraux, se trouve confrontée au même impératif que les Etats-Unis : sécuriser ses approvisionnements en énergie et matières premières nécessaires à son industrie. C’est à l’aune de cet impératif qu’il convient d’analyser ses positions sur certains dossiers comme l’Iran, qui est l’un de ses principaux fournisseurs.
Le discours officiel chinois assigne trois objectifs stratégiques au pays : développer l’économie nationale, réunifier le pays et renforcer la paix dans le monde. S’agissant du premier point, la Chine assure qu’il ne peut que contribuer au raffermissement de la paix et de la stabilité du monde, le commerce valant toujours mieux que la confrontation armée. Pékin considère que les inquiétudes des Occidentaux – principalement en fait des Etats-Unis - sur sa montée en puissance sont sans fondement dans la mesure où elle ne nourrit aucune velléité hégémonique.
La réunification de la Chine continentale et de Taiwan est une donnée permanente de la politique de Pékin depuis 1949. Pékin juge que sa politique à l’égard de Taipeh fait preuve de souplesse depuis les années 90, et que le mécanisme « un pays, deux systèmes » expérimenté à Hong Kong devrait rassurer la population de l’île. Il reste que les Taïwanais semblent bien attachés à leur indépendance et que la tension avec le gouvernement nationaliste renaît périodiquement. Le risque de conflit avec une île placée sous protection américaine demeure latent, dans une zone où sont présentes de nombreuses armes nucléaires. Taiwan est le principal point de friction diplomatique entre Pékin et Washington. Quant au troisième point, relatif à la paix dans le monde, la Chine rappelle qu’elle est membre permanent du Conseil de sécurité et que ses troupes sont engagées dans près d’une dizaine d’opérations de l’ONU. Consciente que sa contribution actuelle n’est pas proportionnelle à son poids démographique et économique, elle affirme souvent sa volonté de s’engager plus intensément dans les missions de maintien de la paix, dans les 20 ans à venir.
Pour Pékin, accomplir les trois objectifs stratégiques nécessite de relever plusieurs défis :
• Assurer un dialogue avec les Etats-Unis au mieux des intérêts de la Chine. Au plan économique, les deux pays sont dépendants l’un de l’autre. Sans les importations américaines, l’industrie chinoise perd d’importants débouchés. Sans la Chine, la dette publique américaine ne trouve pas preneur sur les marchés financiers. Cette interdépendance, qui pourrait être un facteur de paix, ne peut dissimuler ni l’obsession américaine de la montée en puissance chinoise, ni l’hostilité de la Chine envers les Etats-Unis, perçus comme le pays qui empêche la réunification avec Taiwan.
• Apurer le contentieux historique avec le Japon, dont le gouvernement n’a toujours pas reconnu les crimes de guerre commis par son armée en Chine et dans d’autres pays d’Asie. Pour la Chine, la non reconnaissance des crimes de guerre est un obstacle à l’établissement de relations politiques confiantes. La Chine observe également avec inquiétude l’intégration des forces japonaises dans le système anti missile Aegis américain. Théoriquement dirigé contre la Corée du Nord, ce système pourrait servir en cas de conflit entre la Chine et Taiwan.
• Garantir la stabilité de la péninsule coréenne : la Chine aspire au maintien d’un Etat indépendant en Corée du Nord, qui constitue un glacis stratégiquement de moins en moins utile entre elle et les troupes américaines en Corée du Sud. Elle s’inquiète parallèlement de la déliquescence de cet Etat, qui l’oblige à accueillir des milliers de réfugiés sur son sol. Partisane de la dénucléarisation de la péninsule, elle a été obligée d’admettre que la Corée du Nord souhaitait essentiellement négocier avec les Etats-Unis, sans passer par son arbitrage.
• Réunir Taiwan à la Chine. Là où Taiwanais et Occidentaux parlent souvent de nationalistes ou indépendantistes, la Chine évoque des séparatistes… La politique chinoise se fonde officiellement sur une réunification par la paix et l’acceptation de deux systèmes économiques et sociaux. Pékin attend de Taipeh l’ouverture de négociations à cette fin, seul moyen de mettre fin à un état d’hostilité.
La Chine évolue dans un contexte où elle doit assurer la sécurité de ses approvisionnements économiques en plus de ses préoccupations traditionnelles en politique étrangère. Avec les Etats-Unis, elle oscille entre hostilité et partenariat. Elle a en revanche stabilisé ses relations avec la Russie, avec laquelle la plupart des contentieux ont été réglés. Présente sur un continent qui se nucléarise de plus en plus, avec la montée des arsenaux indiens et pakistanais, elle n’a d’autre ressource, pour assurer sa sécurité et être l’acteur politique majeur de l’Asie, que de développer ses forces conventionnelles et moderniser un arsenal stratégique déjà ancien.
b) Un arsenal hétéroclite qui se modernise
A la proclamation de la République populaire, en 1949, la Chine n’avait pas les moyens humains et technologiques de bâtir un engin nucléaire. Impliquée en 1950 dans la guerre de Corée, elle fut explicitement visée à plusieurs reprises dans des déclarations de responsables politiques et militaires américains, qui menaçaient de larguer quelques bombes si elle poursuivait son soutien à Pyong Yang. Ainsi le général Curtis LeMay, commandant des forces stratégiques aériennes américaines indiquait en 1954 : « Il n’y a pas de cible stratégique en Corée… En revanche, je larguerais quelques bombes dans des endroits sélectionnés, comme la Chine, la Mandchourie et le Sud de la Russie ». Forcé de mettre rapidement en place un programme nucléaire, le gouvernement chinois a mobilisé ses scientifiques et obtenu l’aide de l’URSS. Mélange d’espionnage, de coopération russe et de technologie chinoise, l’arsenal de Pékin est hétéroclite, avec au moins six types de bombes : bombe à fission de 15 à 40 kilotonnes ; tête nucléaire de 20 kilotonnes ; tête nucléaire de 3 mégatonnes ; bombe thermonucléaire de 3 mégatonnes ; tête nucléaire de 4 à 5 mégatonnes ; enfin, tête nucléaire de 200 à 300 kilotonnes. A cet arsenal stratégique qui avoisine 250 têtes dont 176 seraient déployées, s’ajouteraient 150 têtes nucléaires tactiques.
La Chine accomplit de rapides progrès dans la technologie des missiles, ce qui assure l’entière crédibilité de sa dissuasion nucléaire. Elle disposerait de 2700 missiles de courte portée et de portée intermédiaire, d’après des estimations américaines, qui correspondent exactement à ses préoccupations stratégiques. Les missiles balistiques à courte portée sont dirigés vers Taïwan, tandis que les missiles à portée intermédiaire, installés au Tibet et dans le désert de Gobi, pourraient servir en cas de conflit –hypothétique pour l’heure – contre la Russie ou l’Inde. Elle possède des missiles intercontinentaux, qui, s’ils étaient produits en plus grand nombre, lui confèreraient une parité politique avec les Etats-Unis et la Russie. Mais il ne semble pas que ce soit la préoccupation majeure de Pékin. En revanche, les Chinois ont récemment opéré un essai balistique d’interception, en détruisant depuis le sol un satellite obsolète, prouvant à nouveau leurs capacités technologiques dans l’éventualité d’une guerre de l’espace.
c) Une doctrine et une action fondées sur la discrétion
En publiant en janvier 2009 un Livre blanc sur sa défense, Pékin a livré quelques informations sur sa doctrine nucléaire et sa méthode d’emploi des forces. La dissuasion est une composante essentielle de la défense chinoise, au même titre que la France, et le pays s’interdit d’user de l’arme nucléaire en premier. Les Chinois, pour le reste, n’alimentent aucun débat sur leurs ADM, convaincus que la discrétion ajoute à leur efficacité.
Il est vrai que la Chine a des intérêts, mais qu’elle subit peu de menaces directes. Etant le premier partenaire commercial des grands ensembles économiques de notre monde, elle est plutôt courtisée. Elle n’a plus de conflits territoriaux avec ses voisins, à l’exception de quelques îles en mer de Chine, pour lesquelles le contentieux avec le Vietnam n’est pas réglé. Elle est en revanche au contact de zones instables (Afghanistan, Asie centrale) et d’un pays proliférant (Corée du Nord), et a pour voisin l’autre grande puissance émergente d’Asie qu’est l’Inde. Les contentieux avec le Japon et avec la Corée du Sud, notamment sur la seconde guerre mondiale, ne sont pas résolus, mais ils n’empêchent pas des relations financières et commerciales très intenses. La Chine doit donc préserver ses frontières, marquer son statut de puissance à l’égard des Etats-Unis, remparts de Taïwan, et de la Russie et assurer la parité stratégique avec l’Inde. Une doctrine de défense fondée sur la dissuasion constitue un ciment défensif face à ses différents voisins, mais Pékin sait qu’aucun n’a d’intention agressive à son égard.
La Chine peut-elle toutefois se contenter de cet élément de doctrine comme fondement de sa défense ? Il est certain qu’un débat se déroule actuellement à Pékin sur cette question. La Chine poursuit en effet un vaste programme de modernisation pour au minimum trois raisons :
– Maintenir la crédibilité de son arsenal.
– Tenir compte des progrès technologiques des Etats-Unis. La Chine a été impressionnée par la capacité de l’armée américaine à atteindre des cibles avec une grande précision lors de la seconde guerre d’Irak, en 2003. Des missiles conventionnels pourraient ainsi détruire partiellement, les rendant inutilisables, les silos chinois et altérer les capacités de dissuasion de Pékin. Elle s’inquiète sérieusement de la mise en place des systèmes anti missiles américains. Elle porte en conséquence ses efforts de recherche sur la guerre dans l’espace (elle a détruit avec succès un satellite en 2007) et développe des missiles intercontinentaux pouvant être placés sur des lanceurs mobiles (DF 21, DF 31 et DF 31A).
– Laisser entendre au reste du monde un glissement de politique, la Chine passant d’une posture défensive vers une posture plus offensive. L’existence d’un important arsenal signifierait que la Chine ne s’interdirait pas d’utiliser des ADM en première frappe lors d’un conflit, ou de réagir avec virulence en cas d’attaque sur son territoire, même si elle n’a procédé officiellement à aucune modification de sa doctrine.
Sur ce dernier point, seule l’existence de l’arsenal américain justifie cette politique. La Chine a en effet apaisé ses relations avec la Russie et avec l’Inde, ses deux grands voisins nucléaires. Taiwan demeure en revanche au cœur de ses dissensions avec les Etats-Unis, avec lesquels un conflit est potentiel… Potentiel, mais évitable, car le gouvernement de Taiwan, élu en mars 2008, a choisi le dialogue avec la Chine et parce que l’on voit mal les Etats-Unis et la Chine, si interdépendants, régler leurs conflits autrement que par la diplomatie… Dans le cas de Taiwan, l’histoire montre que les ADM ont été, là encore, facteur de paix.
4) La doctrine nucléaire de la France entre certitude et questionnement
Il est inutile ici de rappeler l’histoire de la force nucléaire française et le consensus politique autour de l’arme nucléaire comme pivot de notre défense nationale. Depuis la découverte de la radioactivité naturelle (Marie et Pierre Curie), puis artificielle (Irène et Frédéric Joliot-Curie), notre pays a maîtrisé la technologie de la désintégration de l’atome et de l’énergie qui s’en dégage. Il a pu se doter d’armes nucléaires dans un délai assez bref quand il a en a ressenti le besoin pour assurer son indépendance et sa sécurité. Moins connue est la capacité de la France en matière d’armes biologiques… Traumatisé par la première guerre mondiale et soupçonnant l’Allemagne d’avoir cherché à empoisonner des troupeaux et répandre des épidémies, notre pays a mis en place dès 1918 un programme sous l’égide de l’Institut Pasteur. Si la France ne produit ni n’use de l’arme biologique, elle en connaît tous les rouages et serait en mesure d’en fabriquer.
Si le consensus autour de l’arme nucléaire est large, tout observateur constate que depuis environ trois ans fleurissent des articles, des notes, des ouvrages de réflexion sur la validité du concept de dissuasion. Autant il semblait pertinent sous la guerre froide, lorsque des blocs antagonistes se faisaient face mais que notre pays tenait à garder son indépendance de décision en cas de recours à l’arme ultime, autant il a été sujet à interrogations sous le double coup de la fin de l’antagonisme Est-Ouest et de mutations technologiques notables, comme les technologies de l’espace, l’apparition éventuelle de dispositifs anti missile et l’usage par des groupes non étatiques d’ADM nucléaire, radiologique, biologique, ou chimique. Ces interrogations sont légitimes au regard de l’histoire, principalement celle des deux guerres mondiales, dès lors que l’on se souvient que nos concepts stratégiques en 1914 et en 1940 se sont révélés complètement erronés, faute d’avoir pris la mesure des progrès technologiques de notre adversaire et de sa capacité logistique. Pour autant, la force nucléaire française ne se réduit pas à la dissuasion. Tel n’était d’ailleurs pas son fondement politique lors de sa création.
France en bref - Signatrice du TNP. - Signatrice du traité d’interdiction des essais nucléaires. - Détiendrait environ moins de 300 têtes nucléaires. - Signatrice de la convention sur l’interdiction des armes biologiques. - Signatrice de la convention sur l’interdiction des armes chimiques. |
a) L’arme de la puissance comme de l’indépendance nationale
L’arme nucléaire française n’a pas été conçue originellement pour être un outil de dissuasion. Membre de l’OTAN dès les origines et alliée fidèle des Etats-Unis – le général de Gaulle le prouvera par sa fermeté lors de la crise de Cuba – la France bénéficiait de la solidarité atlantique sous la guerre froide. Sa défense était assurée et elle n’avait théoriquement pas besoin d’ADM.
Le général de Gaulle, en revenant au pouvoir, a repris le programme nucléaire commencé sous la IVème République, mais à la différence des gouvernements qui l’avaient précédé et qui n’osaient assumer politiquement ce programme, pourtant largement connu, il a décidé de l’accélérer et de l’amplifier. Deux phrases éclairent ses intentions : « La nécessité de disposer des armes les plus puissantes de l’époque, à moins, bien entendu, que les autres cessent d’en posséder » (19 avril 1963) et « Nous continuerons de toute manière nos essais jusqu’à ce que but soit atteint » (15 mars 1962).
La France n’avait d’autre objectif que la recherche de la maîtrise des armes les plus puissantes. En les détenant, elle consolidait sa place au sein des cinq Grands, membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU. Le général de Gaulle voyait dans l’arme stratégique l’attribut de la grande puissance qu’il voulait que la France restât. C’est pour cette raison qu’à la différence de la Grande-Bretagne, les forces nucléaires françaises n’ont pas été intégrées dans l’OTAN et ne le sont toujours pas.
Il ne faisait en aucun cas référence à la stratégie de la dissuasion, qu’il connaissait bien et qu’il approuvait, alors que les Russes et les Américains la contestaient. L’arme nucléaire constituait l’outil par lequel une nation accédait à la puissance globale, plutôt qu’une garantie de survie. Les observateurs, à cet égard, relèveraient sans peine une grande similitude entre les déclarations du général de Gaulle et celles des responsables politiques d’Iran et du Pakistan bien des années plus tard : à chaque fois, l’objectif était politique et non militaire.
Ses successeurs n’ont jamais remis en cause cette vision, François Mitterrand ayant ainsi déclaré, peu après son accession au pouvoir que l’arme nucléaire était « une réalité, un prestige, un atout pour notre rayonnement ». En revanche, la France n’a évidemment pas reçu le soutien de ses alliés et voisins dans cette quête. Les Etats-Unis, l’URSS et la Grande-Bretagne, qui avaient signé en 1958 un accord interrompant leurs essais, faisaient pression sur la France. Les pays européens membres de l’OTAN voyaient dans un armement nucléaire français une menace à la cohésion de l’Alliance… A raison, puisque la France, tirant les conséquences politiques de la détention de l’arme nucléaire, se retirera des structures de commandement intégré en 1966.
Parmi les alliés européens, la Grande-Bretagne a fait preuve de beaucoup de retenue dans ses critiques à l’égard de la France car elle évoluait dans un contexte historique (perte de l’empire colonial, défaite diplomatique dans l’affaire de Suez) et stratégique similaire. Elle a même quelque peu souffert de la politique française. Lorsque le gouvernement McMillan a décidé l’achat de fusées américaines Polaris pour l’armement de ses sous-marins – ce qui rendait la force nucléaire britannique dépendante des vecteurs américains – lors de la conférence de Nassau en décembre 1962, le général de Gaulle déclarait le 14 janvier 1963 : « Personne ne s’étonnera que nous ne puissions pas y souscrire ». Et dans la même conférence de presse, il opposait son veto à l’entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché commun…
b) Une doctrine souple dans un contexte mouvant
Quatrième pays à s’être doté d’ADM, la France a adapté à sa propre situation la plupart des doctrines d’usage de l’arme qui avaient vu le jour aux Etats-Unis, en Russie et en Grande-Bretagne, où travaillaient de remarquables théoriciens de l’atome. Si l’on doit créditer le général Gallois de réflexions importantes sur la dissuasion, on ne peut le qualifier de père de la stratégie nucléaire de la France.
Cette doctrine est basée sur un élément : la protection de nos intérêts vitaux, tels qu’ils sont déterminés par le Président de la République. La notion est suffisamment vague pour placer tout agresseur devant une incertitude majeure sur l’usage d’ADM par notre pays. Le fait qu’elle repose sur une autorité incarnée par une personne ajoute à cette incertitude. La doctrine n’interdit en rien à notre pays de recourir à des premières frappes ou de lancer des représailles et laisse ouverte, de manière générale, toute possibilité de recours à l’arme. Seule est exclue l’idée d’en faire une arme de théâtre, ce concept affaiblissant l’idée de dissuasion telle que la France veut qu’elle soit comprise.
Depuis les années 90, les spécialistes en stratégie se sont souvent interrogés sur la validité de la doctrine française. Le contexte politique et technologique a considérablement évolué avec la fin de la guerre froide : la France n’a militairement plus d’ennemi et l’art de la guerre a subi de profondes modifications, qui peuvent rendre inopérant le concept de dissuasion. La précision des vecteurs portant des charges conventionnelles est telle qu’ils peuvent toucher les infrastructures les plus importantes d’un pays avec un résultat militaire et surtout politique analogue à celui des armes nucléaires, sans les inconvénients moraux et matériels attachés à ces dernières. La notion de cible a également évolué. Dans des sociétés développés organisées en réseaux (réseaux industriels, nœuds de transport, infrastructures de communication, réseaux d’énergie, etc…), la destruction de quelques éléments suffit à causer des dommages importants au fonctionnement de l’ensemble de la société. « La complexité crée la vulnérabilité » (Bruno Tertrais).
Si notre pays n’a plus militairement d’ennemis, il n’en subit pas moins des menaces, liées aux soubresauts géopolitiques et au terrorisme. A l’unicité du risque sous la guerre froide a succédé la pluralité des risques, rendant plus difficile la détermination des éléments de la défense nationale.
Que vaut l’idée de la dissuasion française après la disparition de l’URSS ? Elle demeure opérationnelle, pour les raisons suivantes :
• La rivalité entre grandes puissances nucléaires n’a pas disparu. La dissuasion française vaut autant comme garantie de notre indépendance que comme élément de défense. Il est logique de pouvoir frapper ceux qui peuvent vous frapper.
• Cette rivalité traditionnelle s’accompagne de l’émergence de puissances nucléaires régionales, qui ne sont pas pour l’heure nos adversaires, mais il nous est impossible de prévoir l’évolution de ces puissances. La notion d’assurance vie attachée au concept de dissuasion conserve sa valeur pour l’avenir.
• Face à tout type de menace, y compris des mouvements terroristes actionnés par des Etats, chaque pays doit savoir que la France est prête à user de ses ADM en cas d’atteinte à ses intérêts vitaux, quel que soit le mode opératoire retenu.
La doctrine française a déjà été modifiée à deux reprises, la dernière révision s’étant produite au début des années 2000, sous la cohabitation. Le Président Jacques Chirac avait préalablement annoncé plus de souplesse dans l’utilisation de l’arme nucléaire, en 1995, en même temps qu’il lançait la fabrication de sous-marins nucléaires pouvant embarquer des missiles à longue portée, pouvant atteindre des pays éloignés de la France. Dans une série d’interventions s’étant échelonnées entre 1998 et 2001, l’élargissement de la palette d’utilisation des ADM a été confirmée, Jacques Chirac indiquant que le ciblage de puissances régionales se concentrerait « prioritairement sur leurs centres de pouvoir politique, économique et militaire » (8 juin 2001).
En 2006, ont été inclus comme atteinte à nos intérêts vitaux les menaces sur nos routes d’approvisionnement et le soutien par des Etats à des mouvements terroristes. Le Président a également indiqué que la défense anti missile pouvait être un élément complémentaire utile de la dissuasion. Le 21 mars 2008, Nicolas Sarkozy a confirmé les orientations de son prédécesseur en rapportant les orientations technologiques de notre pays à leur fonction politique fondamentale : donner au chef de l’Etat « toutes les options pour faire face aux menaces. Nos forces nucléaires ont été adaptées à cette fin, elles continueront de l’être ». Il a confirmé que les ADM pouvaient être utilisées qu’elle que soit l’origine de la menace et qu’elle qu’en soit la forme.
En prenant en compte sur environ 13 années du changement de contexte stratégique, la France a dégagé des axes d’utilisation de ses ADM : maintien du caractère très large (tous azimuts) de la dissuasion, refus d’une stratégie préalable d’emploi, maintien de la première frappe, maintien de l’ultime avertissement, recours à l’arme nucléaire en cas de menace de puissances régionales… Il y a bien maintien de la dissuasion, assurance-vie du pays en cas d’attaque, comme l’a répété à plusieurs reprises le Président Nicolas Sarkozy, mais également adaptation à une donne stratégique mouvante, caractérisée par l’émergence de pays, qui par leurs capacités balistiques, pourraient représenter une menace pour nos intérêts. La France n’exclut pas donc pas un usage offensif de l’arme nucléaire pour vaincre des Etats qui porteraient atteinte à ses intérêts vitaux. Notre pays est trop souvent perçu comme le chantre d’une dissuasion classique, à laquelle il n’a jamais renoncé, mais ses capacités techniques donnent au Président de la République de nombreuses possibilités de choix en cas de crise.
c) La méfiance à l’égard des projets américains de désarmement
Ainsi que l’ont constaté de nombreux observateurs, la France a largement partagé les orientations du Président George W. Bush en matière de non-prolifération. La position très stricte des Etats-Unis à l’encontre de la Corée du Nord comme de l’Iran a rencontré l’assentiment de notre pays, même si la France a été partisane d’un dialogue direct entre Washington et Téhéran, que l’administration américaine a longtemps rejeté. En revanche, la France est relativement méfiante à l’égard des projets de désarmement nucléaire généralisé affichés par l’administration du Président Obama… La Grande-Bretagne, la Russie et la Chine, à des degrés variables, n’hésitent pas à évoquer la question, sans s’engager plus avant…
La France, signataire du TNP, souscrit évidemment aux dispositions de l’article 6 de ce traité, qui prévoit un désarmement nucléaire total. Elle demeure toutefois sceptique sur l’idée qu’un mouvement vers le désarmement dissuadera l’Iran et la Corée du Nord de renoncer à leurs ambitions nucléaires ou diminuera le risque de terrorisme. Elle constate également que l’ambition de l’administration américaine est en contradiction avec les propos du Président, qui a annoncé à Prague, le 6 avril 2009, « un arsenal sûr et efficace pour dissuader tout adversaire » et qui prévoit de moderniser sa flotte de sous-marins nucléaires. Enfin, renoncer totalement aux ADM signifie se trouve face à l’écrasante supériorité conventionnelle américaine.
Notre pays pourrait apparaître isolé sur cette question, par rapport aux autres puissances nucléaires du Conseil de sécurité. Il n’en est rien, car si la Russie et la Chine sont prêtes à étudier les propositions américaines, le contexte dans lequel évoluent leurs relations avec les Etats-Unis ne les prédispose sans doute pas à un désarmement nucléaire complet. La France peut également fonder sa position sur le fait qu’elle a opéré récemment une diminution de son arsenal, tombé « à moins de 300 têtes », pour reprendre les propos du Président de la République. En conséquence, il revient aux Etats-Unis de mettre en accord leurs discours et leurs actes, en réduisant le niveau de leur arsenal.
La méfiance française est également due à l’analyse de la politique américaine. Les Etats-Unis ont beau proclamer une ambition de désarmement, leur politique ne peut les conduire à court terme dans cette voie alors que les contentieux avec la Russie nécessitent qu’ils conservent une dissuasion crédible. Il en est de même avec la Chine, dont le Congrès se méfie de la montée en puissance et avec laquelle un conflit sur Taiwan est toujours possible.
La position française est de travailler à l’accroissement de la sécurité, le désarmement devenant la conséquence de cette politique. Elle porte ses efforts sur la résolution des tensions entre Etats. Cette position a été partagée en décembre 2008 par les autres Etats membres de l’Union européenne ainsi qu’en juillet 2009, par la Grande-Bretagne, puissance nucléaire, Paris et Londres ayant déclaré que la suppression des ADM passait « par la recherche d’un monde plus sûr ».
La position américaine et la position française marquent une différence de perception des menaces. Les Etats-Unis sont certes préoccupés par la prolifération nucléaire, mais ils constatent que le risque lié à l’usage de l’arme a diminué. La conséquence logique est de diminuer les arsenaux. La supériorité américaine en matière conventionnelle pousse ce pays à chercher à diminuer les menaces asymétriques. Le nucléaire par le haut, le terrorisme par le bas établissent des rapports de force qui diminuent spectaculairement l’efficacité politique d’un vaste arsenal conventionnel. La France estime que le contexte géopolitique mondial ne justifie pas une diminution radicale des arsenaux… De toute manière, le sien a été suffisamment réduit au niveau adéquat pour rendre crédible sa dissuasion, ce qui la dispense d’aller plus loin dans cette voie.
5) Les forces nucléaires britanniques, entre indépendance et intégration à l’OTAN
Les forces nucléaires britanniques sont dans une situation originale : elles assurent une dissuasion qui confère à la Grande-Bretagne sécurité et puissance politique, conformément à ses responsabilités internationales, notamment au titre de son siège permanent au Conseil de sécurité. Mais Londres a également fait le choix d’intégrer sa stratégie de défense à l’OTAN. Les Britanniques ont de ce fait intégré l’usage de leurs forces à la réponse qu’apporterait l’OTAN en cas d’agression et renoncé à maîtriser l’ensemble de la filière technologique nucléaire, notamment les lanceurs, ce qui crée de facto une dépendance technologique (donc politique) vis-à-vis des Etats-Unis.
Royaume-Uni en bref - Signataire du TNP. - Signataire du traité d’interdiction des essais nucléaires. - Disposerait d’un peu moins de 200 têtes nucléaires. - Signataire de la convention sur les armes biologiques. - Signataire de la convention sur les armes chimiques. |
a) Proximité et divergence doctrinales avec la France
Si la doctrine britannique a été bâtie compte tenu des intérêts vitaux du pays, il est intéressant de relever quelque proximité comme quelque divergence doctrinale avec la France. Londres et Paris évoluent dans le même contexte historique et géographique, et sont membres fondateurs de l’Alliance atlantique. Ils sont les seuls pays à disposer d’ADM au sein de l’Alliance, avec les Etats-Unis.
Il existe peu de différences essentielles dans les doctrines des deux pays. Ils ont choisi de s’exprimer rarement sur ces questions pour maintenir le maximum d’incertitudes. Ils considèrent l’un et l’autre les armes nucléaires comme stratégiques, c'est-à-dire comme des armes visant à prévenir un conflit, ce qui suppose qu’elles soient utilisables pour être crédibles. S’ils préfèrent la notion de recours ultime, ils n’excluent pas un usage sous-stratégique ou pré stratégique, y compris en première frappe, contre des Etats nucléaires et non nucléaires qui menaceraient leurs intérêts vitaux. Dans un monde incertain, Britanniques et Français considèrent que la dissuasion nucléaire ne s’exerce pas à l’encontre d’un ennemi désigné (la guerre froide est terminée) mais à l’égard de tous les Etats, tous azimuts, pour reprendre l’expression française.
La principale divergence entre Londres et Paris porte sur l’Europe. Les Britanniques jugent que leurs capacités nucléaires ne peuvent s’inscrire dans le cadre européen. L’Union européenne n’apparaît pas pour eux comme une entité politique pouvant s’impliquer dans la dissuasion, c'est-à-dire dans l’éventualité d’une utilisation de l’arme nucléaire. La France est sur la même position, mais les déclarations successives des Présidents Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy ont laissé entendre que la dissuasion française pourrait être étendue à nos partenaires européens, si une attaque contre eux menaçait nos intérêts vitaux. Londres exclut ce schéma et refuse d’en parler pour l’heure, considérant que la politique européenne de défense est suffisamment difficile à mettre en place. Sur le long terme, la Grande-Bretagne n’exclut pas le débat de l’usage de ses forces nucléaires dans le cadre d’une Europe qui existerait politiquement et militairement. Mais il s’agit bien d’une perspective de long terme dans l’esprit des responsables britanniques …
b) Une intégration partielle au système américain
Comme la France, la Grande-Bretagne dispose d’une force pour dissuader tout agresseur. Mais jugeant, plus que la France, que l’OTAN est la garantie de sa sécurité, Londres a intégré ses forces nucléaires au dispositif de réponse de l’OTAN.
La dissuasion britannique, à la différence de la France, n’a pas de composante aérienne, mais repose seulement sur des sous-marins. La fabrication de leurs têtes nucléaires vient de connaître récemment une évolution qui accroît la dépendance envers les Etats-Unis. Les Britanniques maîtrisaient cette fabrication au travers de la société AWE management ltd, dont le capital se répartissait de manière égale entre trois actionnaires : Serco (entreprise britannique), British nuclear fuel PLC (entreprise publique) et Lockheed Martin. Or le gouvernement britannique vient de vendre les parts qu’il détenait via la British nuclear fuel à l’entreprise américaine Jacobs Enginering. Si le ministère a assuré que les intérêts britanniques avaient été préservés dans cette opération (l’opposition conservatrice s’est vivement opposée à cette transaction) il semble bien que la Grande-Bretagne ait perdu tout contrôle sur la fabrication et la maintenance de ses têtes nucléaires.
Depuis l’accord de 1963 sur l’acquisition de missiles Polaris, la Grande-Bretagne s’en remet aux Etats-Unis pour ses vecteurs. L’accord a été révisé en 1982. Ce sont des missiles Trident, fabriqués par Lockheed Martin, qui équipent les sous-marins britanniques.
Londres dispose actuellement de quatre sous-marins Vanguard, placés sous contrôle national. Leur mission est duale : intervenir en cas d’attaque contre la Grande-Bretagne et participer à la réponse de l’OTAN face à une attaque nucléaire (soviétique sous la guerre froide, de toute origine désormais), dans le cadre du Single Integrated Operational Plan (SIOP).
La Grande-Bretagne, élément du SIOP Document hautement classifié au Pentagone, le SIOP est une planification stratégique qui spécifie la manière dont les armes nucléaires des Etats-Unis doivent être utilisées en cas de conflit. Au niveau de l’OTAN, un accord prévoit la participation de la Grande-Bretagne au SIOP. Elaboré par le Président des Etats-Unis et transformé par le secrétaire à la Défense en politique d’emploi des armes nucléaires (nuclear weapons employment policy), le SIOP énumère les objectifs, les cibles et les contraintes opérationnelles des attaques nucléaires. Sous la guerre froide, le SIOP recensait 16 000 cibles environ. Ce chiffre est tombé à 3 000 actuellement, mais 75% des cibles demeurent en territoire russe. Les forces britanniques s’ajouteraient aux forces américaines en cas de déclenchement de ce plan. |
B – Le cas particulier d’Israël, « un nouvel acteur depuis 30 ans »
Première puissance militaire conventionnelle au Moyen-Orient, Israël est actuellement la sixième puissance nucléaire militaire, avec un stock estimé à environ 180 têtes. Ce pays maîtrise la technologie des bombes nucléaire, comme celle des bombes à neutron et à hydrogène. Il a également mené un programme de recherche et de production d’armes chimiques et biologiques. Aucune de ces informations n’est pourtant officielle. Toutes émanent de révélations ou de déductions car le secret, qualifié d’ambiguïté volontairement cultivée, est la pierre angulaire de la stratégie israélienne.
Israël en bref - Ne détient officiellement aucune ADM nucléaire, chimique ou biologique. - Détiendrait environ 180 têtes nucléaires. - Dispose officiellement de missiles (programme Jéricho) - Non signataire du TNP. - Signataire en 1993 de la convention sur les armes chimiques, qu’elle n’a pas ratifiée. - Non signataire de la convention sur les armes biologiques |
Israël constitue un cas très particulier dans l’analyse sur les ADM. Cet Etat n’a jamais publiquement reconnu détenir l’arme nucléaire, ni même toute autre ADM chimique ou biologique. Mais l’ensemble de la communauté internationale a la conviction qu’Israël dispose d’un arsenal légèrement inférieur à celui de la France.
Cette conviction qu’Israël est une puissance nucléaire fondée sur des observations anciennes (renseignement) et sur des révélations, les principales étant celles d’un ingénieur israélien, Mordechaï Vanunu, au Sunday Times, en 1986, et celles du journaliste français Pierre Péan, qui a eu accès aux documents qui établissaient la coopération entre la France et Israël sur la base de recherche de Dimona. Par ailleurs, l’indice classique par lequel un Etat affiche ses prétentions au statut de puissance nucléaire militaire s’applique dans le cas d’Israël, qui n’a pas signé le TNP, au même titre que l’Inde et le Pakistan.
Le programme israélien est très ancien et a commencé au milieu des années 50, dans un contexte où le jeune Etat craignait pour son existence et assistait à la montée d’un nationalisme arabe (panarabisme de Nasser, crise de Suez en 1956, projets balistiques égyptiens en 1957, indépendance de l’Algérie en 1962). Il doit beaucoup à l’aide technique de la France, alors que parallèlement, les Etats-Unis, hostiles à l’élargissement du nombre des Etats détenteurs de la bombe, étaient tenus à l’écart des projets israéliens. Il convient de rappeler que les relations entre Washington et Tel Aviv ont été tendues à la suite de la conclusion du TNP, en 1968, et que les Etats-Unis n’ont renoncé à faire pression sur Israël à l’issue d’une rencontre entre Richard Nixon et Golda Meir, en 1970, qu’à la condition qu’Israël continue à maintenir la confidentialité sur son arsenal nucléaire.
1) Une stratégie volontairement ambiguë
Les raisons de l’accès d’Israël au statut de puissance nucléaire, biologique et chimique sont aisément compréhensibles :
• L’histoire a laissé une empreinte profonde dans la conscience des dirigeants d’Israël. La période qui s’est écoulée entre l’arrivée au pouvoir d’Hitler (1933) et le début de l’holocauste est celle au cours de laquelle de très nombreux juifs qui voulaient fuir l’Allemagne se sont vus refuser l’asile politique dans des pays étrangers, y compris aux Etats-Unis. Plus que l’holocauste, qui a pourtant atteint une échelle sans précédent dans l’histoire de la barbarie humaine, le rejet des demandes d’asile politique a conduit les Israéliens à un attachement viscéral à leur territoire, seul garant de leur survie en tant que peuple. Le Premier ministre David ben Gourion, était persuadé que les peuples en situation de minorité, qui n’étaient pas en mesure de se protéger eux-mêmes, risquaient le génocide et l’histoire venait de le prouver. Comme le reste de l’humanité n’était pas intervenu –ou seulement à la marge- pour sauver les Juifs, cet épisode pouvait se reproduire. Il était donc impératif qu’Israël disposât de capacités autonomes de défense.
• La plupart des pays frontaliers et des Etats du monde arabe n’ont toujours pas officiellement reconnu Israël. Le risque d’une destruction de cet Etat demeure une possibilité à laquelle ses dirigeants ont le devoir de parer.
• L’étroitesse du territoire israélien, son absence de profondeur stratégique pour reprendre une vieille expression, le rend très vulnérable à une attaque conventionnelle conduite avec succès. Le programme nucléaire trouve, militairement, sa source dans « l’asymétrie entre Israël et ses voisins » (Shlomo Brom). Si aucun des pays arabes n’a jusqu’à présent été en mesure de vaincre Israël par des moyens conventionnels, cette hypothèse pourrait se réaliser un jour. La dissuasion pourrait, dans un tel cas, trouver sa pleine valeur.
• Israël est dans une situation de très large infériorité démographique par rapport aux pays du Moyen-Orient.
Le silence israélien sur sa détention d’ADM nucléaires n’est pas total. Pour rendre opérante la théorie de la dissuasion, Israël a rendu publique une forme de doctrine, quand Shimon Peres a déclaré en 1961, alors qu’il était l’adjoint du Premier ministre David Ben Gourion, qu’Israël « ne serait pas le premier pays à introduire l’arme nucléaire au Moyen-Orient ». On ne peut être plus clair pour exprimer officiellement une intention doublée d’une capacité technique. Le doute ne pouvait qu’être levé quand Menahem Begin, alors Premier ministre, a indiqué en 1981, peu après le bombardement du réacteur irakien de recherche Osirak, qu’Israël interdirait à ses adversaires d’acquérir ou de fabriquer des armes nucléaires.
On relèvera que le secret dont font l’objet les activités nucléaires d’Israël met ce pays à l’abri de sanctions internationales alors qu’il retire les bénéfices d’une puissance nucléaire.
Israël cultive volontairement l’ambiguïté, considérant que le masque sur ses capacités stratégiques place d’une part ses adversaires devant une incertitude majeure quant à la politique à suivre à son égard, d’autre part parce que l’arsenal nucléaire garantit la pérennité de son existence en cas de conflit. Mais les dirigeants israéliens insistent souvent sur le fait que l’impossibilité d’être militairement vaincus conduira nécessairement l’ensemble du monde arabe à rechercher en fin de compte la paix. « Nous n’avons pas construit cette option pour arriver à Hiroshima mais bien davantage pour arriver à Oslo » (Shimon Peres).
2) Une panoplie complète d’ADM ?
Les ADM dont dispose Israël couvrent le domaine nucléaire. Les ADM chimiques et biologiques sont à l’état d’hypothèse. Les vecteurs sont en revanche mieux connus.
Israël aurait mis au point son arsenal nucléaire au centre de recherche du Neguev, près de la ville de Dimona, où se trouve un réacteur. Compte tenu des capacités de production de plutonium de ce réacteur, la fourchette d’un stock actuel de 100 à 200 têtes est le plus souvent mise en avant. Il est généralement estimé qu’une douzaine de bombes étaient assemblées et prêtes à être utilisées si nécessaire lors de la guerre du Kippour, en 1973. Le premier test se serait déroulé le 22 septembre 1979 en Afrique du Sud, pays avec lequel Israël entretenait une coopération nucléaire. Un second test a eu lieu en 1980 d’après les observations des satellites américains. En 1981, Moshe Dayan, ministre de la Défense, a déclaré que son pays « avait la capacité de produire des armes nucléaires et si les pays arabes avaient l’intention d’introduire de telles armes au Moyen-Orient, Israël ne serait pas très longue à en détenir à son tour ». En 1985, la mise à jour d’un commerce illégal entre une entreprise californienne et Israël, portant sur des éléments sophistiqués pour des détonateurs (kryptrons) a révélé que ce pays poursuivait sans doute le perfectionnement de son arsenal. En 1987, le Pentagone a jugé que les centres de Dimona et de Soreq jouaient le même rôle que les laboratoires de Los Alamos, Oak Ridge et Lawrence Livermore aux Etats-Unis… De 1988 au milieu des années 90, Israël a marqué un vif intérêt pour la technologie des supercalculateurs, ces instruments pouvant à la fois simuler les effets de choc d’une explosion, mesurer la multiplication des neutrons lors d’une réaction en chaîne, et résoudre les équations relatives au comportement du plutonium et de l’uranium hautement enrichi sous des températures et des pressions élevées. Les Etats-Unis ont été quelque peu hésitants quant à l’attitude à adopter : Alors qu’ils interdisaient la vente de supercalculateurs aux pays non signataires du TNP (Israël, par le biais de l’Université Technion, s’en est procurée discrètement auprès de la compagnie britannique Meiko en 1992), ils ont approuvé la livraison de 9 d’entre eux en 1994, 2 de Cray Research, 2 de Silicon Graphics et 5 d’IBM, alors qu’il était évident, pour les spécialistes, que les utilisateurs (Université Technion, Université hébraïque, Institut Weizmann) travaillaient sur l’implantation de têtes nucléaires sur des missiles intercontinentaux.
A la différence des ADM nucléaires, le programme de missiles n’a rien de confidentiel. Un missile peut en effet porter une charge conventionnelle… Israël a d’ailleurs souvent bénéficié de la coopération technologique américaine pour mettre au point ses vecteurs. Israël a développé les missiles à courte portée (235 à 500 km) Jericho 1 dans les années 60, avec l’aide de Dassault Aviation. Dans les années 70 a été mis au point le missile à portée intermédiaire (1500 à 3500 km, selon le poids de la charge) Jericho 2, à deux étages et propulsé par du carburant solide. Le développement de Jericho 3, missile intercontinental (4000 à 6500 km) demeure encore une hypothèse.
Israël s’est servi de la technologie de Jericho 2 pour bâtir la fusée Shavit, qui lance des satellites depuis la base de Palmachim, près de Tel Aviv. Elle aurait également modifié des missiles de croisières américains Harpoon pour placer des têtes nucléaires dans ses sous-marins.
La détention d’armes biologiques est une hypothèse qui n’a jamais été vérifiée. Il est certain qu’Israël s’est dotée de capacités de recherches. Il est tout aussi certain qu’elle ne détient pas ce type d’armes, ou seulement en très petites quantités. Aucun pays arabe, aucun mouvement palestinien n’a jamais accusé Israël de recourir aux armes biologiques, et la CIA, dans un rapport public de 2006 n’a pas placé Israël sur la liste des Etats possédant ce genre d’ADM. Il reste qu’un Institut israélien de recherche biologique (IIRB) a été bâti dès 1948 à Ness Ziona, et qu’Ehud Avriel, l’un des chefs de l’Agence juive, a eu pour instruction de David ben Gourion de recruter des scientifiques juifs « pour accroître la capacité de tuer comme de guérir des masses humaines. Les deux choses sont importantes ». Le professeur Bergmann et les frères Katachalsky, qui étaient des proches du Premier ministre, ont été placés à la tête de l’IIRB. S’il existe quelques vagues soupçons sur l’utilisation de virus porteurs de la fièvre typhoïde lors du siège de St Jean d’Acre en 1948, aucun indice sérieux ne montre l’utilisation d’ADM biologique par Tsahal. L’IIRB a souvent subi des coupes budgétaires depuis la création de l’Etat d’Israël et constitue un organisme de recherche civil tout autant que militaire. En revanche, l’existence de documents classés « secret » prouve que l’Etat a conduit des expériences, à toutes fins utiles…
L’existence d’un programme irakien d’ADM biologique, sous le régime de Saddam Hussein, est à l’origine de la revitalisation dans les années 90 de l’IIRB, chargé de mettre au point la défense de la population contre des attaques biologiques. Le campus a été considérablement agrandi et les recherches seraient concentrées sur le bacille de l’anthrax.
La détention d’ADM chimique est là encore une hypothèse. S’il existe un programme, il est inconnu, et si des stocks existent, nul n’en connaît la nature, la quantité, les substances…Quelques analystes suggèrent que le centre de Ness Ziona se livre à des recherches sur des armes chimiques. L’accident d’un avion cargo de la compagnie El Al, en octobre 1992 à Amsterdam, alors qu’il transportait du methylphosphonate de dimethyl (un agent utilisé pour des recherches à titre défensif, mais également un précurseur du gaz sarin) constitue également une indication de l’intérêt que porterait Israël aux armes chimiques.
Il est certain que David ben Gourion avait donné l’ordre aux scientifiques de son pays d’étudier les ADM chimiques car l’Etat d’Israël, juste après sa création, était dans une situation d’infériorité démographique et ne disposait pas d’arme nucléaire. Le Premier ministre recherchait une arme non conventionnelle et à bas coût. Comme en matière nucléaire, Israël s’est tournée vers la France et des scientifiques se seraient rendus en 1960 à Beni Ounif, dans le Sahara algérien. Parallèlement, elle a organisé la défense de sa population en distribuant des masques à gaz pendant la guerre des six jours, par crainte que l’Egypte n’use d’armes chimiques, ce qui n’a pas été le cas.
Si Israël poursuit un programme d’ADM chimique, il semble qu’elle n’arrive pas à dégager de doctrine quant à son emploi. Les recherches ont sans doute lieu pour que le pays ne souffre d’aucun retard en ce domaine, compte tenu de son obsession sécuritaire, bien compréhensible. Ses voisins arabes ont à plusieurs reprises émis des déclarations publiques, marquant leur intérêt pour des armes chimiques qualifiées de bombes des pauvres. Israël a toujours pris ces menaces au sérieux, surtout lorsqu’il est devenu évident, à l’orée des années 90, que l’Irak développait intensément ce type d’armes. C’est dans ce contexte que le ministre de la Recherche scientifique Yuval Ne’eman a proposé qu’Israël use d’armes chimiques en représailles contre une attaque du même type, mais cette idée n’a jamais pris corps. Officieusement détentrice de l’arme nucléaire, Israël n’a pas souhaité donner la moindre indication sur l’usage qu’elle pourrait en faire en réponse à une attaque, quelle qu’en soit la nature… Signataire, mais n’ayant pas ratifié la convention sur les armes chimiques, Israël n’a pas complètement écarté l’idée de développer ces armes, parce que plusieurs Etats du Moyen Orient n’ont pas signé la convention. Une réunion du gouvernement en 1997, à laquelle participaient Benyamin Netanyahu, Premier ministre, Itzak Mordechaï, ministre de la Défense, Nathan Charanski, ministre du Commerce et Ariel Sharon, ministre des Infrastructures, a confirmé une position volontairement attentiste, par laquelle le pays ne s’interdit pas de recourir à ces armes tout en se tenant prêt à ratifier la convention.
3) Les effets de la stratégie d’ambiguïté au Moyen Orient
De nombreux appels sont régulièrement lancés pour un Moyen-Orient dénucléarisé… Mais officiellement, le Moyen-Orient n’est pas une zone d’armements nucléaires, sauf si l’on inclut les armes embarquées sur les vaisseaux et sous-marins américains qui croisent en Méditerranée et dans le Golfe persique, ou que l’on inclut dans cette région le Pakistan.
Israël n’a jamais souhaité sortir de son ambiguïté stratégique, considérant que rendre publique l’existence de ses armes nucléaires déclencherait une course aux armements au Moyen Orient. Cette position n’a guère porté ses fruits. Au plan conventionnel, le Moyen Orient est une zone où les stocks d’armement vont croissants. Plusieurs programmes d’armes biologiques et chimiques ont été conduits par des Etats de la région, notamment par l’Irak, parce qu’ils considéraient Israël possédait la bombe et que de telles ADM constituaient pour eux le seul moyen de compenser leur infériorité stratégique.
L’attitude des pays de la région face à la bombe nucléaire israélienne montre également les limites de la stratégie d’ambiguïté. Plusieurs d’entre eux ont tenté ou tentent encore de se doter de l’arme nucléaire : Libye, Irak, Syrie et surtout Iran. Ce dernier est proche de la mise au point d’un engin et il est intéressant de comprendre comment Téhéran se sert de la bombe israélienne dans son discours public. La bombe iranienne, principal dossier du Moyen Orient, n’a évidemment pas pour objet de contrebalancer la puissance israélienne Le programme iranien avait commencé sous le Chah, alors que les services secrets des deux pays entretenaient une étroite coopération. Il convient de rappeler qu’Israël et l’Iran sont avec la Turquie les Etats non arabes du Moyen Orient et qu’ils ont toujours entretenu de difficiles relations avec ces derniers. En outre, il n’existe aucun contentieux territorial entre Tel Aviv et Téhéran et si leurs relations se sont dégradées, c’est en raison de la posture idéologique affichée par l’actuel président iranien.
Le programme iranien n’a pas pour origine la bombe israélienne Sa raison d’être est de marquer l’accès de l’Iran au statut de puissance mondiale et de le garantir contre ce qu’il considère comme la principale menace qui pèse sur la révolution islamique : les Etats-Unis. Mais par un glissement idéologique, l’arsenal nucléaire d’Israël est devenu le fondement de la bombe iranienne. Il sert à alimenter un discours public qui justifie une politique devenue l’objectif central du régime.
Le programme iranien n’est pas neutre pour la région. Il risque d’en changer profondément la donne stratégique. Face à un Iran doté de capacités nucléaires, dont le territoire serait sanctuarisé et qui pourrait accentuer sa politique interventionniste au Liban, à Gaza et en Irak, l’Arabie saoudite et la Turquie, pour des raisons différentes, seraient rapidement conduites à mettre en place un programme nucléaire militaire malgré l’hostilité des Etats-Unis. Ces deux pays invoquent une double raison qui justifierait cette politique : accéder à la parité stratégique avec l’Iran et rétablir l’équilibre avec Israël, qu’ils considèrent comme un Etat qui détient déjà l’arme nucléaire.
Dans nos entretiens en Arabie saoudite, c’est l’arsenal israélien qui a été invoqué comme justification d’un éventuel programme saoudien, et non la politique nucléaire de l’Iran, qui ne représente pas officiellement une menace pour les intérêts du royaume. Comme Téhéran, Riyad se sert de la bombe israélienne dans un but rhétorique. C’est pourtant l’Iran, qui par ses interventions dans le monde arabe, notamment dans le règlement des affaires tribales en Irak, rôle traditionnellement dévolu au roi d’Arabie, porte atteinte à l’influence saoudienne au Moyen-Orient. Mais il est plus commode pour un pays musulman de justifier son action par hostilité au sionisme que par rivalité avec un autre pays musulman, fût-il chiite. Le secret qu’applique Israël sur son programme est éventé de longue date et présente l’inconvénient d’offrir un point d’appui rhétorique et politique aux Etats arabes qui voudraient accéder à la technologie nucléaire militaire.
Les Israéliens connaissent parfaitement les arguments saoudiens, comme ils surveillent de près le programme iranien et l’attitude éventuelle du gouvernement turc. Ils n’ont pour autant procédé à aucune révision stratégique qui feraient d’eux, officiellement, une puissance nucléaire, pour ne pas lancer une course aux armements à laquelle se joindraient sans doute, outre la Turquie et l’Arabie saoudite, l’Egypte et la Syrie, pays qui sont frontaliers d’Israël. Damas disposerait d’un argument politique pour conduire un projet qu’Israël a toujours combattu.
La confidentialité demeure l’élément majeur de la politique israélienne, pour des raisons militaires et politiques. Mais elle pourrait déclencher une nouvelle course aux armements et placer Israël dans une situation de parité stratégique avec ses voisins, dont certains sont toujours des ennemis, et non plus de supériorité. Cette situation la forcerait à négocier la paix sur la base de nouveaux rapports de force alors que sa politique a jusqu’ici consisté à négocier sans subir la moindre pression. Si l’Iran accède à la bombe, la confidentialité du programme israélien deviendra, paradoxalement, une faiblesse stratégique.
La recherche de la parité stratégique avec Israël par certains Etats éloigne la perspective d’un Moyen Orient militairement dénucléarisé. Il s’agit pourtant d’un axe de politique étrangère officiel de plusieurs puissances, comme l’Egypte, l’Arabie Saoudite, le Qatar, les Emirats arabes unis, Bahreïn… Cet objectif ne peut être atteint que si Israël admet détenir des ADM, mais il n’est pas évident qu’elle opère une telle révision dans sa stratégie. Le pays qui peut en effet le plus perdre à un tel accord est… Israël. L’abandon des ADM dans la région signifie le retour au premier plan des rapports de force conventionnels et démographiques. Or les pays arabes ne sont plus dans la situation de 1948 ou de 1967. Leurs armées ont progressé… Les récents conflits au Liban et à Gaza ont montré les limites de Tsahal… Et une réalité intangible demeure : l’étroitesse du territoire israélien et son absence de profondeur stratégique. La bombe joue le rôle d’une assurance vie mais par son existence, interdit à la diplomatie israélienne de donner suite aux propositions des pays arabes.
Quelques analystes comme Bennett Ramberg, qui a servi au Département d’Etat sous le Président George W. Bush, proposent qu’Israël entre dans l’OTAN en contrepartie d’une renonciation aux ADM. L’article 5 du traité de Washington garantirait son existence… Cette idée se heurte à de nombreux obstacles : Israël a toujours considéré que sa politique de défense devait être entièrement autonome car elle joue sa survie à chaque conflit. Or comment être sûr que l’article 5 jouera bien en cas de guerre au Moyen Orient, alors que ses relations avec certains pays de l’Alliance, comme la France, le Royaume-Uni ou la Turquie, ne sont pas toujours au beau fixe, et que les Etats-Unis comme l’Europe ont un intérêt vital à maintenir de bonnes relations avec le monde arabe ?
L’ambiguïté restera sans doute encore longtemps l’axe de la politique de défense israélienne mais elle devient au fil des ans un facteur de course aux armements. La dénucléarisation du Moyen Orient est en conséquence une illusion.
C – La rationalité des nouveaux acteurs
1) La bombe indienne, affirmation de son primat en Asie du Sud et de sa parité avec la Chine
L’Inde, en tant que puissance nucléaire, fait souvent l’objet d’analyses communes avec le Pakistan. En ayant fait exploser en 1998, à quelques mois d’intervalle, plusieurs bombes, les deux pays rivaux sur la scène d’Asie du Sud ont été les principaux acteurs du déclin d’un ordre international que les puissances déjà titulaires d’ADM tentaient de bâtir :
• Ils ont prouvé que l’on pouvait conduire une politique nucléaire militaire hors du TNP. Ils ont en conséquence donné un signal politique très fort aux pays qui, critiques à l’égard du TNP, envisageaient de suivre leur voie.
• Ils ont révélé l’incapacité des Etats parties au TNP de gérer une situation de prolifération quand celle-ci impliquait des Etats non signataires du traité, montrant ainsi que ce dernier ne pouvait ou ne voulait s’adapter à de nouvelles réalités.
• Ils ont prouvé leurs capacités à résister aux pressions américaines.
• Les scènes de liesse populaire dans les grandes villes indiennes et pakistanaises ont rappelé le prestige attaché à l’arme nucléaire et le bénéfice que pouvaient en retirer les gouvernements. Ce message n’est pas passé inaperçu en Iran.
• En marquant leur volonté d’être des puissances nucléaires, les deux pays ont rendu incertaine et très lointaine toute perspective de désarmement généralisé.
Envisagées selon la logique des Etats parties au TNP, les ADM indiennes et pakistanaises constituent des évènements graves, en nucléarisant une région où de fortes tensions politiques n’ont jamais été résolues - conflit du Cachemire – ou se sont accentuées – conflit en Afghanistan, tentative de déstabilisation du Pakistan par des fondamentalistes, résurgence d’une tension indo pakistanaise – L’accès au rang de puissance nucléaire militaire de ces deux Etats a réalisé les pires craintes des partisans d’un régime de non prolifération.
Mais si l’on examine les évènements qui se sont déroulés depuis 1998, notamment l’épisode de Kargil, la détention de l’arme nucléaire a conduit l’Inde comme le Pakistan à s’efforcer de normaliser leurs relations, malgré la subsistance de phases de forte tension (la dernière en date étant celle qui a suivi les attentats de Bombay de décembre 2008) et malgré une rivalité de plus en plus perceptible en Afghanistan.
En revanche, les deux pays se démarquent quant à l’usage qu’ils ont fait de leur savoir technologique. L’Inde, pays isolationniste, cherche à éviter de diffuser sa technologie nucléaire, tandis que le Pakistan, via le réseau Khan, constitue un facteur de prolifération.
Les analyses lient souvent les politiques nucléaires indiennes et pakistanaises, ce qui est logique compte tenu des contentieux qui règnent entre Delhi et Islamabad. Mais il convient aussi de les disjoindre car l’un comme l’autre n’aspiraient pas à l’arme nucléaire à leur indépendance. C’est sur la base d’évènements précis et de rapports de force avec la Chine et les Etats-Unis notamment – donc sur le fondement d’une parfaite rationalité -que l’Inde comme le Pakistan sont devenues des puissances nucléaires.
a) De l’inutilité à l’impératif de la bombe : le choix rationnel de l’Inde
Le programme nucléaire de l’Inde a commencé avant l’indépendance du pays et revêtait un caractère civil. Face aux immenses besoins d’une population très pauvre, une équipe de scientifiques a convaincu les leaders du Congrès national indien de doter l’Inde de capacités nucléaires pour produire de l’électricité à bas prix. Après l’indépendance, le Premier ministre Jawaharlal Nehru a lancé une politique nucléaire afin d’optimiser l’exploitation de thorium que le sous-sol indien recélait en abondance. D’emblée, il a souhaité que soit développée une technologie duale. L’Inde ne souhaitait pas l’arme atomique – il n’était idéologiquement pas évident pour un pays affirmant se fonder sur la non violence de se doter d’ADM - mais voulait être capable de la produire en cas de besoin.
Inde en bref
- Non signatrice du TNP
- Non signatrice du TICE.
- Environ 70 têtes nucléaires opérationnelles.
- Dispose de missiles ayant des portées de 150 à 3000 km.
- Mise en service en juillet 2009 du premier sous-marin nucléaire.
- Officiellement, pas de programme d’ADM biologique ou chimique.
C’est à l’issue de la défaite de 1962 contre la Chine que le gouvernement indien a réfléchi sur le besoin de se doter d’ADM. Le Premier ministre Bahadur Shastri a autorisé en 1964 des études sur des essais souterrains « à des fins pacifiques ». La classe politique indienne a également perçu l’intérêt d’une politique nucléaire qui constituait un outil de construction de l’identité nationale d’un pays où règne les diversités de toute sorte, ethniques, linguistiques ou religieuses. L’Etat indien y a puisé une légitimité supplémentaire. Le 18 mai 1974, sous le gouvernement d’Indira Gandhi, a été expérimenté dans le désert de Thar un engin fondé sur la fission nucléaire, toujours (officiellement) à des fins pacifiques. L’engin n’avait effectivement pas le design d’une arme. De 1977 à 1979, le parti Janata, alors au pouvoir, a abandonné le programme nucléaire, repris par Indira Gandhi lorsqu’elle a repris la tête du gouvernement.
Constituant un monde en soi et ayant pour axe principal, dans sa politique étrangère, la sécurisation de ses frontières, l’Inde, de 1947 à la fin des années 80, a longtemps hésité à fabriquer des ADM nucléaires, dès lors que la nécessité n’apparaissait pas. Jouissant d’une large supériorité conventionnelle sur son rival pakistanais, elle ne subissait aucune menace mettant réellement en jeu ses intérêts vitaux. L’Inde n’a jamais éprouvé le besoin d’adhérer à une alliance de sécurité collective.
Si l’avancement du programme pakistanais a convaincu les dirigeants indiens de se doter de l’arme nucléaire pour conserver leur avantage stratégique sur Islamabad, il était pour eux encore plus impératif d’atteindre la parité avec Pékin s’ils voulaient maintenir le statut de puissance de l’Inde en Asie. Dans le jeu de la prolifération, l’on peut affirmer que la bombe indienne est une réaction à la bombe chinoise, et que la bombe pakistanaise est une réaction à la bombe indienne…
Malgré de nombreuses oppositions internes (absence de majorité parlementaire en 1996 pour soutenir le programme), l’Inde a finalement accompli avec succès deux tests en 1998, à l’issue desquels le Premier ministre Atal Bihari Vajpayee a rendu officiel le statut de puissance nucléaire de son pays et indiqué qu’il bâtirait une dissuasion minimale crédible.
b) Le rejet du régime de non prolifération ou l’affirmation de l’indépendance de l’Inde
La technologie nucléaire avait essentiellement des objectifs civils (contribuer aux progrès économiques, politiques, sociaux et scientifiques d’un pays en voie de développement) et le volet militaire qui a été mis au point devait garantir l’Inde contre toute attaque nucléaire. La doctrine originelle d’emploi de l’arme nucléaire de l’Inde se fonde en conséquence sur le principe des représailles (no first use and retaliation only). L’Inde applique le principe classique de la dissuasion, en promettant des dommages irréparables à l’Etat agresseur. Cette doctrine a été réaffirmée dans un document du 17 août 1999 (draft report on national security advisory board on indian nuclear doctrine). Pendant longtemps, elle a affirmé un strict parallélisme de l’usage d’ADM en indiquant ne vouloir recourir à l’arme nucléaire qu’en cas d’attaque nucléaire, et en écartant cette possibilité en cas d’attaque d’un autre type, même si elle est biologique ou chimique. Dans un document du 4 janvier 2003, cette position a été révisée, l’Inde se réservant désormais le droit d’utiliser ses forces nucléaires en cas d’attaque biologique ou chimique.
L’Inde s’est longtemps définie sur la scène internationale comme un pays non aligné et s’est efforcée de maintenir des relations équilibrées tant avec Moscou qu’avec Washington, même au temps de la guerre froide et alors que son armée était principalement équipée par l’Union soviétique. Cette distance prudente face aux deux grandes puissances poursuivait trois objectifs : garantir sa frontière Nord en disposant avec la Russie d’un contrepoids à la Chine, faire de l’Océan Indien une zone libre de toute marine militaire étrangère et être de facto la puissance dominante en Asie du Sud en écartant toute influence extérieure.
C’est en application de cette politique isolationniste (sauf à l’égard de ses voisins immédiats), doublée d’une claire perception de ses intérêts que l’Inde s’est toujours opposée au TNP, rassemblant l’unanimité de sa classe politique sur cette position. Elle considère que ce traité établit un ordre international inique entre les pays détenteurs et non détenteurs de la technologie nucléaire militaire et qu’il fige une situation qu’elle n’a pas voulu.
Officiellement, l’Inde déclare ne pas s’opposer à un désarmement nucléaire, mais à la condition qu’il prenne place dans le cadre d’un désarmement général à l’échelle mondiale. Elle se place dans une logique qui n’est pas celle du TNP. L’hypothèse d’un tel désarmement est encore lointaine. Théoriquement, étant le premier pays au monde par sa population et disposant de la seconde armée conventionnelle d’Asie, l’Inde ne pourrait que gagner à ce processus qui renforcerait son avantage sur le Pakistan. En revanche, elle perdrait sa parité stratégique avec la Chine, qui dispose de forces classiques plus opérationnelles.
L’Inde figure parmi les premiers pays à avoir signé et ratifié le Traité d’interdiction des essais dans l’atmosphère, en 1963, et après avoir soutenu initialement le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE), elle a décidé de ne pas le signer, considérant qu’il ne s’agissait pas d’un instrument pour contrôler la course aux armements mais qu’il faisait partie de la politique de non-prolifération, dont elle rejetait les modalités.
L’ensemble de cette politique obéit à l’objectif de préserver l’indépendance de l’Inde. Le rejet du système du TNP et du TICE ne transforme pas pour autant l’Inde en pays proliférateur. Consciente des dangers représentés par l’arme nucléaire, à proximité de trois nations nucléaires, soucieuse aussi de ne pas élargir le cercle des puissances nucléaires, l’Inde a mis en place une législation visant à contrôler les exportations pouvant servir à la mise au point d’ADM (weapons of mass destruction and their delivery system Act, 2005) et contrôle tout transfert de technologie pouvant bénéficier au programme iranien (1992).
c) De l’affirmation de l’indépendance à la construction d’une politique de puissance ?
Si l’ensemble des gouvernements indiens, à de rares exceptions, a poursuivi avec détermination la mise en œuvre d’une politique nucléaire militaire, le contexte dans lequel ces politiques ont pris place a profondément évolué. D’un pays rural, sous-développé, qui cherchait simplement à garantir ses frontières et à assurer une parité stratégique avec la Chine, l’Inde est devenue une puissance économique et technologique, dont la population s’urbanise de plus en plus. Elle constitue une puissance globale qui a des intérêts croissants à travers le monde et dont le marché intérieur représente un intérêt pour le reste du monde.
Les axes de la politique étrangère indienne ont également profondément changé depuis Nehru :
• La Chine n’est plus perçue comme un ennemi, même si les deux puissances demeurent rivales sur la scène asiatique. Delhi et Pékin ont aplani leurs différents frontaliers et sont devenus des partenaires économiques importants. Il n’y a plus de contentieux important entre les deux pays.
• Le Pakistan n’est plus en mesure de rivaliser avec l’Inde. Le décalage économique et démographique est trop important pour qu’Islamabad puisse contester la puissance indienne. Il convient de relever d’ailleurs qu’avant les attentats de Bombay de décembre 2008, Delhi et Islamabad s’engageaient dans un processus de normalisation de leurs relations, à la demande de nombreux entrepreneurs indiens et pakistanais. Cette politique n’est pas abandonnée, malgré les soubresauts intérieurs au Pakistan, la méfiance des services spéciaux pakistanais à l’égard de la politique indienne en Afghanistan et le problème du Cachemire.
Parallèlement, les responsables politiques indiens ont pris conscience qu’ils ne pouvaient se contenter de demeurer aux commandes d’une puissance nucléaire rudimentaire, alors que les technologies évoluaient, que l’Asie du Sud demeurait une zone d’instabilité et que leur pays avait des intérêts croissants à travers le monde. D’une force symbolique, ils sont passés à la mise en place d’une force opérationnelle, à la mesure de la grande puissance que l’Inde devient jour après jour. A la suite des essais nucléaires de 1998, le gouvernement indien a réparti en deux entités, l’une civile, l’autre militaire, les départements de recherche sur le nucléaire en fonction de leur finalité. Il a également réfléchi sur sa doctrine d’utilisation de l’arme nucléaire.
Alors que le domaine nucléaire était pendant longtemps de la compétence exclusive de quelques scientifiques et responsables politiques, sa conception et mise en œuvre se sont élargis à d’autres acteurs de la société, principalement des militaires et des experts en stratégie pour lesquels l’Inde ne pouvait se limiter à détenir l’arme juste en raison de son caractère stratégique et symbolique. Partant du principe qu’elle pouvait le cas échéant être utilisée, ils ont agi pour que l’Inde dispose de la panoplie complète des vecteurs et d’une puissance de destruction significative.
Il existe certes une doctrine de l’Inde sur les objectifs et l’emploi des ADM nucléaires, mais on peut la qualifier de prudente, sinon d’hésitante, et rappeler qu’elle n’emporte pas le consensus au sein des partis politiques. Le document de 1999 précité, élaboré lorsque le parti nationaliste hindou Bharatiya Janata Party (BJP) était au pouvoir (ce parti se place sur une ligne dure vis-à-vis du Pakistan) reprenait largement la doctrine constante de l’Inde, le no first use, mais souhaitait logiquement assurer l’opérabilité des forces nucléaires en s’appuyant sur une triade sol / air / mer apte à riposter rapidement en cas d’attaque pakistanaise. Dès l’année suivante, en 2000, a été présenté au Premier ministre Vajpayee le document Vision 2020, proposant une révision des concepts traditionnels. Le ministère de la Défense, notamment l’armée de l’air, appelait à considérer la Chine comme un ennemi nucléaire potentiel au même titre que le Pakistan et se fondant sur l’option de la dissuasion nucléaire maximale, préconisait la parité avec la Chine pour le nombre de têtes nucléaires, ce qui aurait engagé l’Inde dans un programme de fabrication de 350 à 450 têtes.
Plusieurs responsables politiques indiens, notamment au sein du Parti du Congrès, ainsi que des hauts fonctionnaires, ont fait part de leurs réserves sur cette inflexion doctrinale. Celle-ci coïncidait en effet avec la normalisation des relations sino-indiennes, en raison des intérêts commerciaux des deux pays et de la prise de conscience à Pékin de l’existence de l’arsenal indien. La tension n’a jamais été importante entre Delhi et Pékin depuis cette époque, les deux capitales tenant chaque année une réunion de sécurité conjointe baptisée par les Indiens Security Dialogue. Dans un tel contexte, nombreux sont les experts indiens qui ne voient aucune raison de faire monter artificiellement la tension avec la Chine. Il leur suffit d’avoir un minimum de garanties quant à leurs capacités de défense, notamment dans l’Océan indien. Cette attitude prudente l’a finalement emporté et explique pourquoi Delhi n’a pas accéléré ses recherches sur un missile intercontinental, dont son arsenal est dépourvu. Elle montre ainsi clairement à la Chine qu’elle n’a pas d’intention agressive à son égard, que ses vecteurs à courte et moyenne portée sont principalement tournés vers le Pakistan et elle donne des gages aux Etats-Unis en démontrant que son arsenal nucléaire a un objet limité.
Au cours de cette période (1998 – 2000), l’Inde a proposé au Pakistan à plusieurs reprises un accord nucléaire fondé sur le no first use. Islamabad a refusé, considérant que cette démarche stérilisait l’usage de ses ADM en cas de conflit, alors que les forces conventionnelles indiennes sont largement supérieures et que le territoire pakistanais n’a pas de profondeur stratégique, à la différence de l’Inde.
Ayant rejeté le concept de dissuasion maximale, l’Inde n’a jamais défini ce qu’elle qualifie de dissuasion minimale, terme que l’on retrouve dans plusieurs discours et documents publics. Ce flou est logique dans une région où la sécurité dépend de plusieurs paramètres… Elle a en revanche développé une série de vecteurs, avec des missiles à courte et à moyenne portée et a lancé, à la fin du mois de juillet 2009, son premier sous-marin porteur de missiles nucléaires (cf fiche complète en annexe 4). Cette palette d’instruments vise essentiellement à disposer d’une capacité de riposte en cas de menace du Pakistan, même s’il s’agit, à l’instar de la Chine, de bâtir une montée en puissance globale, technologiquement et politiquement, pour peser sur les affaires du monde.
d) L’affaiblissement du TNP, prix du partenariat stratégique entre les Etats-Unis et l’Inde
L’accord sur la coopération nucléaire civile entre l’Inde et les Etats-Unis est souvent présenté comme un affaiblissement du TNP, ce qui est exact… Mais le droit international n’est rien d’autre que la traduction des rapports de force entre Etats et de la prise en compte de leurs intérêts communs. En l’espèce, l’Inde et les Etats-Unis, qui se regardaient avec méfiance, ont couronné un rapprochement stratégique commencé en 2001, via la lutte contre le terrorisme.
Si l’Inde avait marqué sa volonté d’indépendance politique en mettant au point l’arme nucléaire, le fait de ne pas être partie au TNP présentait pour elle de nombreux désavantages, le plus notable étant l’interdiction de commerce qui la frappait sur tous les produits destinés à la technologie nucléaire civile. Or même en étant une puissance nucléaire, l’Inde accuse un grand retard en matière de technologie, d’autant plus préoccupant qu’il lui faut satisfaire une demande estimée à 60 000 megawatts dans les quinze ans à venir pour sa croissance économique. Le marché est estimé à 100 milliards de dollars et les traditionnels compétiteurs que sont Areva, Siemens, Rosatom, Westinghouse ou Mitsubishi souhaitent tous y prendre une part.
De leur côté, les Etats-Unis recherchaient un partenariat global avec l’Inde, pour plusieurs raisons :
• Trouver en Asie un grand partenaire capable d’endiguer la montée en puissance de la Chine.
• Bénéficier de l’expertise indienne pour ce qui concerne le terrorisme islamique (Pakistan, Cachemire, Afghanistan).
• Ouvrir le plus vaste marché du monde à leurs entreprises et y obtenir à terme rapproché des contrats d’armement, notamment pour des avions de chasse. Washington est en effet en compétition pour le remplacement de 126 appareils de l’armée de l’air indienne, soit un contrat estimé à 12 milliards de dollars.
En résumé, les Etats-Unis, plus que l’Inde, ressentaient la nécessité d’un tel partenariat.
Préparé par un projet de protocole levant l’embargo sur une série de produits nucléaires à destination de l’Inde, l’accord de coopération nucléaire civile a été signé le 2 mars 2006, lors de la visite de George W. Bush à Delhi. Il a fallu deux ans pour le finaliser, c'est-à-dire obtenir l’accord du Parlement indien (Lok Sabah) comme du Congrès américain (octobre 2008) ainsi que l’accord du Groupe des pays fournisseurs de l’AIEA. Sans ce feu vert, l’accord était caduc.
Les déclarations de défiance à l’égard de cet accord, tant au sein du Lok Sabah que du Congrès, ont été nombreuses. Le Président Bush a dû user de toute son influence auprès des élus Républicains et Démocrates qui voyaient dans cet accord une mise en cause dangereuse du TNP En Inde, le Premier ministre Manmohan Singh a failli perdre la majorité au Parlement, car la gauche de sa coalition gouvernementale rejetait la disposition relative au contrôle de l’AIEA sur les centrales nucléaires civiles. Parallèlement, les Etats-Unis ont fait de fortes pressions sur certains de leurs alliés du Groupe des pays fournisseurs (Australie, Japon) et ont fait quelques concessions pour que ce Groupe entérine l’accord (septembre 2008).
Au final, l’Inde s’est engagée à dissocier ses activités militaires de ses activités civiles et à placer sous le contrôle de l’AIEA 14 de ses 22 réacteurs nucléaires. Pranab Mukherjee, ministre des Affaires étrangères indien, a également indiqué, pour lever les réticences de la Chine, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, que Delhi s’engageait à geler unilatéralement et sans condition tout essai nucléaire et à ne pas se comporter en puissance proliférante… Les personnes qui critiquent cet accord relèvent toutefois qu’il s’agit d’une déclaration, qui ne figure pas dans les dispositions de l’accord.
En contrepartie, l’Inde a obtenu l’accès aux technologies nucléaires américaines, dans le cadre de l’accord de coopération, y compris aux technologies duales. Cet accord pourrait lui permettre de porter dans un délai de dix ans de 2% à 7 % la part de son électricité d’origine nucléaire.
Les deux pays ont donc signé un partenariat stratégique, mais le volet nucléaire n’est pas le cœur de l’accord. Ce dernier consacre essentiellement le retour des Etats-Unis en Asie du Sud, où ils ne disposaient que d’un allié, le Pakistan, qui est devenu le principal souci de leur politique étrangère en raison de la déstabilisation qu’il subit. De son côté, l’Inde avait un intérêt à sortir de son isolement et les concessions auxquelles elle a consenti sont, somme toute, mineures. Ce qui l’intéressait était le partenariat avec les Etats-Unis, mais elle a pris soin de montrer à la communauté internationale à quel point il n’était pas exclusif. Quelques jours avant de se rendre aux Etats-Unis pour assister à la ratification de l’accord américano indien, le Premier ministre indien s’est rendu en France et a signé avec notre pays, le 30 septembre 2008, un accord de coopération civile dans le domaine nucléaire. On relèvera également que la Russie, soucieuse de vendre des centrales à l’Inde, ne s’est pas opposée à l’accord, alors qu’elle aurait pu bloquer le processus au sein du Groupe des pays fournisseurs, où l’unanimité était requise. Partenaire traditionnel de l’Inde, la Russie a elle aussi intérêt à l’ouverture du marché nucléaire civil indien.
La reprise des relations américano-indiennes s’est clairement faite au détriment du Pakistan, allié traditionnel des Etats-Unis dans la région mais auquel ces derniers ont refusé de signer un accord analogue à celui passé avec l’Inde… Pour montrer qu’elle avait bien compris que l’accord entre l’Inde et les Etats-Unis rebattait les cartes en Asie, la Chine a offert au Pakistan le 10 septembre 2008, soit quelques jours avant la ratification de l’accord par les parlements indien et américain, une coopération dans le domaine nucléaire civil. Deux axes se sont donc créés en Asie du Sud : Delhi / Washington d’un côté, Islamabad / Pékin de l’autre.
L’accord entre les Etats-Unis et l’Inde a consacré le caractère relatif du TNP. L’éthique et les principes n’ont que peu pesé face aux perspectives qu’offrait le marché indien et l’intérêt que présentait un axe Washington / Delhi face à Pékin. L’Inde, non signataire du TNP, a atteint plusieurs de ses objectifs quand au même moment, le Président George Bush annonçait mettre fin à la coopération avec la Russie dans le domaine nucléaire civil, alors que cette dernière est partie au TNP. Dans les deux cas, la realpolitik a battu en brèche le régime de non-prolifération.
e) La montée en puissance de l’arsenal indien
L’arsenal indien a toujours bénéficié de l’expertise technique de l’URSS puis de la Russie, notamment pour la mise au point du premier sous-marin nucléaire, lancé à la fin du mois de juillet 2009. Il s’est développé au fur et à mesure que l’Inde a pris conscience que la dissuasion minimale ne suffisait pas, mais qu’il lui fallait conserver la parité stratégique avec le Pakistan et rester vigilante face à la montée en puissance globale de la Chine. Un document stratégique de 1999 a acté la décision de faire reposer les forces nucléaires sur les forces aériennes, terrestres et navales.
Le nombre de têtes nucléaires indiennes est évidemment secret. Des estimations qui prennent en compte la production de plutonium aboutissent à une fourchette allant de 100 à 150 têtes, dont 70 seraient opérationnelles.
Le vecteur principal demeure la force aérienne, avec les Mirage 2000H Vajra basés à Gwalior. Quatre escadrons de Jaguar IS, les Mig 27 et les Sukhoï SU 30 MKI peuvent aussi jouer le rôle de vecteurs de bombes nucléaires.
Parallèlement, l’Inde a mis au point des missiles à courte portée (Prithvi 1 et Agni 1), et une série de missiles à moyenne portée (Agni 2 et Agni 3) qui lui permettent d’atteindre les territoires pakistanais et chinois. L’Agni 2 a ainsi été déployé au sein des forces stratégiques 334 et 335 le 4 février 2008, trois jours après que le Pakistan eut testé un missile intercontinental.
On relèvera que l’Inde a principalement déployé ses missiles Prithvi et Agni près de la frontière avec le Pakistan. L’ennemi potentiel est clairement désigné. Ce choix a été rendu nécessaire par la courte portée des vecteurs (150 à 700 km), qui oblige l’Inde à rapprocher ses bases de lancement des objectifs qu’elle chercherait sans doute à atteindre en cas de conflit. Comme le territoire pakistanais est étroit, la plupart des grands centres vitaux, Islamabad, Karachi, Lahore, Rawalpindi sont sous le champ des tirs indiens. En revanche, l’Inde ne maîtrise pas la technologie des missiles intercontinentaux, dont elle a volontairement stoppé son programme de recherche et ne peut toucher que la partie la plus septentrionale de la Chine. Celle-ci, de son côté, peut détruire tout point du territoire indien. Il n’y a donc pas parité entre les deux grands d’Asie sur les vecteurs, mais l’Inde, pour l’heure, déclare ne pas en ressentir la nécessité.
La dernière étape du programme indien est plus récente et consiste à équiper sa marine de guerre de missiles nucléaires, qui s’ajouteraient aux vecteurs lancés depuis le sol (Prithvi et Agni) et aux bombes larguées depuis des avions. Ce point est devenu crucial pour l’Inde car si la frontière himalayenne est stabilisée, une compétition s’est engagée avec la Chine pour la maîtrise de l’Océan indien. Les deux pays sont en effet dépendants du Moyen Orient pour leurs approvisionnements pétroliers. Le territoire indien est à proximité du Moyen Orient et peut accueillir en de très nombreux ports les supertankers, au contraire de la Chine, qui n’a pas de façade maritime sur cet océan. Pour écourter le trajet du pétrole, vital pour son économie, Pékin construit des ports en eau profonde sur les côtes de cet océan, notamment à Gwadar, dans la partie la plus occidentale du Pakistan, non loin d’Ormuz. Comme il lui faut sécuriser ce trafic, elle dispose d’une flotte de sous-marins nucléaires dont le nombre est évalué à une dizaine. Ces sous-marins ne se limitent évidemment pas à cette seule mission, et leur caractère stratégique inquiète l’Inde même si officiellement, aucun contentieux important n’assombrit les relations entre les deux pays.
C’est à l’aune de cette rivalité naissante qu’il faut analyser les efforts indiens de mise au point de missiles lancés depuis des bâtiments de guerre, le Dhanush et le K 15, ce dernier étant susceptible d’équiper le premier sous-marin nucléaire indien, INS Arihant (destructeur d’ennemis, en sanscrit). Vaisseau de 6000 tonnes l’Arihant embarquera 12 missiles K 15 d’une portée actuelle de 750 km, munis de têtes nucléaires de 5 tonnes. Les prochains missiles dont devrait être doté le sous-marin atteindraient une portée de 3 500 km.
L’Inde a donc achevé la construction d’un arsenal reposant sur ses forces aériennes, terrestres et navales. De nombreuses zones d’ombres subsistent sur son efficacité car les tests de missiles ont été émaillés de nombreux échecs. Néanmoins, il semble qu’il suffise aux yeux des responsables politiques indiens pour garantir le pays contre d’éventuelles attaques pakistanaises, toujours possibles dans le contexte tendu que vit l’Asie du Sud, et pour ne pas laisser à la Chine la maîtrise des routes maritimes. Il est certain que cet arsenal est en devenir, ce qui conduira Delhi à de nouvelles augmentations de son budget militaire et à accentuer son effort de recherche technologique.
2) Le Pakistan ou la dissuasion du faible au fort dans un contexte régional tendu
Les politiques étrangères et de défense du Pakistan ont une obsession : une attaque de l’Inde. Né dans des conditions chaotiques de la volonté de doter d’un Etat les musulmans de l’empire britannique des Indes, le Pakistan n’a cessé de craindre la mise en cause de son existence. Il est vrai que le pays est périodiquement traversé de crises identitaires –Etat islamique ou Etat de musulmans ? – , qu’il pourrait facilement être démembré simplement parce que l’on trouve des Pendjabis et que l’on parle Ourdou de part et d’autre de la frontière avec l’Inde, qu’il a perdu plusieurs guerres conventionnelles contre son voisin… Après s’être posé un temps en rival de l’Inde à l’issue de la partition de l’empire britannique, le Pakistan ne peut plus faire illusion. Le décalage territorial, démographique et économique est trop important. En outre, alors que l’Inde est un Etat stable, l’Etat pakistanais connaît de sérieux dysfonctionnements, qui suscitent au sein de la communauté internationale des craintes sur la sécurisation de son arsenal nucléaire.
Pakistan en bref - Non signataire du TNP - Non signataire du TICE - Détiendrait environ 90 têtes nucléaires |
a) Une doctrine nucléaire tournée contre la seule Inde
A la différence de l’Inde, le Pakistan a toujours recherché des appuis extérieurs pour assurer sa survie. Il est membre de deux alliances militaires en Asie, l’Organisation du traité de l’Asie du Sud-Est (OTASE) et l’Organisation du traité central (CENTO). Il est un allié proche des Etats-Unis et de la Chine depuis la guerre froide, période où l’Inde avait comme appui principal l’URSS.
La doctrine nucléaire pakistanaise cible l’Inde comme unique objectif d’attaques nucléaires et se réserve la possibilité de l’utiliser en premier, et non à titre de représailles. Il s’agit d’une doctrine originale, qui ne vise pas à affirmer un statut de puissance auquel le Pakistan, par sa population, par l’ancienneté de sa civilisation ou par son tissu économique très dense, pourrait prétendre… Cette position est fondée sur le fait que les forces indiennes conventionnelles sont largement supérieures à celles du Pakistan et que l’étroitesse de son territoire le rend très vulnérable. Elle n’a toutefois jamais été formalisée dans un document, les responsables pakistanais se contentant de déclarations pour entretenir volontairement l’incertitude sur le recours à leurs ADM. Néanmoins, 4 cas d’utilisation ont été traditionnellement envisagés :
• Si l’Inde attaque le Pakistan et occupe une portion importante de son territoire.
• Si l’Inde détruit une partie importante des forces pakistanaises terrestres et aériennes.
• Si l’Inde étrangle l’économie du Pakistan.
• Si l’Inde provoque la déstabilisation du Pakistan ou y crée un mouvement de subversion.
Il s’agit clairement d’une doctrine de dissuasion du faible au fort dont l’Inde fait fi de s’inquiéter, considérant que le Pakistan ne peut lui infliger que des dommages mineurs quand elle dispose de son côté de la capacité de détruire l’ensemble de ses centres vitaux. Le Pakistan ne prétend pas atteindre la parité avec l’Inde mais vise à disposer d’une capacité suffisante pour inquiéter Delhi. Jugeant que sa dissuasion minimale doit être définie en termes relatifs et non en termes absolus, il s’autorise à développer le nombre de ses têtes nucléaires comme de ses vecteurs, ainsi que leurs technologies, chaque fois qu’il estime que l’Inde franchit un saut quantitatif ou qualitatif pour son arsenal nucléaire.
Le développement des capacités indiennes d’un côté, la recherche d’une capacité minimale de dissuasion de l’autre, conduisent à une augmentation des arsenaux nucléaires en Asie du Sud. Le Pakistan aurait accéléré ces dernières années sa production de matières fissiles et s’inquiète des recherches indiennes sur les dispositifs anti missiles, qui pourraient réduire à néant sa stratégie de première frappe. Cette course aux armements inquiète la communauté internationale car l’Inde et le Pakistan, même s’ils ont apaisé leurs relations, n’ont pas résolu leur conflit au Cachemire et ont des intérêts divergents en Afghanistan, qui explique en partie pourquoi la guerre s’y poursuit.
b) Le Cachemire, rivalité de trois puissances nucléaires et révélateur de la faiblesse stratégique du Pakistan
De majorité musulmane au moment de la partition, le Cachemire, une des plus riches terres de l’empire britannique, est passé sous le contrôle de l’Inde après la partition, étant dirigé par un maharadjah de confession hindouiste. Avec l’appui de l’Inde, il a chassé une grande partie des insurgés cachemiris, qui de leur côté, étaient aidés des Pathans (Pachtounes du Pakistan). Le premier affrontement indo-pakistanais a cessé avec la résolution de l’ONU du 1er janvier 1949. Depuis, le Cachemire est au centre d’un jeu stratégique qui met aux prises l’Inde, le Pakistan, mais également la Chine, soit 3 Etats nucléarisés, parmi lesquels les deux plus peuplés du monde.
Le jeu triangulaire au Cachemire et en Himalaya - 1er janvier 1949 : cessez-le-feu voté par l’ONU. - 1950 – 1960 : Echecs des tentatives de règlement politique. L’Inde refuse tout referendum sur l’indépendance tandis que le Pakistan se retrouve devant le fait accompli, ne contrôlant qu’une partie minoritaire de la province. - 1960 : Rupture sino-soviétique, qui conduira la Chine à se rapprocher du Pakistan. - 1962 : Invasion chinoise en territoire indien dans l’Aksai Shin, à l’Est du Karakorum. L’Inde tire de sa défaite la volonté de devenir puissance nucléaire. - 1964 : Explosion de la première bombe nucléaire chinoise. - 1965 : 2ème guerre du Cachemire. Défaite pakistanaise. L’Inde décide de soutenir les revendications afghanes dans les territoires tribaux, de part et d’autre de la Ligne Durand, pour obliger le Pakistan à diviser ses forces sur deux fronts. - 1971 : Nouvelle guerre indo pakistanaise, Delhi soutenant la sécession du Bengladesh. Le Pakistan perd la moitié de sa flotte, 25% de son aviation et 30% de ses forces terrestres. L’accord de Simla reconnaît l’indépendance du Bengladesh et prévoit que le conflit du Cachemire doit être réglé par voie diplomatique entre les deux pays, sans internationalisation de la question qui constituait jusqu’ici le volet principal de la stratégie du Pakistan. Le Pakistan n’est plus de facto le rival de l’Inde, qui ne cache plus son soutien aux insurgés baloutches. Si Ali Bhutto gagne les élections générales au Pakistan, il sera rapidement renversé par les militaires conduits par le général Zia Ul Haq, qui se considèrent comme garants de l’intégrité du pays. - 1974 : L’Inde procède à 6 essais nucléaires souterrains dans le désert de Thar. Début de la course aux armements nucléaires entre les deux pays. - 1978 : Achèvement par la Chine de l’autoroute du Karakorum , qui relie le Cachemire pakistanais à la Chine. Le Pakistan escompte un soutien conventionnel chinois rapide en cas de guerre avec l’Inde. Quant à la Chine, elle peut ainsi rapidement envoyer des troupes au Nord de l’Inde, en cas de conflit sur les territoires d’Himalaya. - 1979 : Invasion soviétique en Afghanistan. Aidés par les Etats-Unis, le Pakistan instrumentalise l’Islam comme moyen de lutte (mouvement taliban) contre l’URSS. Constatant le succès de sa stratégie, il arme des mouvements fondamentalistes au Cachemire, faisant naître une violente terroriste qui s’est maintenue à un niveau élevé depuis les années 80. - 1984 : Répression par l’Inde du séparatisme au Pendjab, par crainte d’une contagion au Cachemire. - 1989 -1992 : Après la chute du Mur de Berlin, l’Inde se tourne vers Israël pour lutter contre le terrorisme. Cette coopération lui permet de se rapprocher des Etats-Unis. - 1996 : Les élections au Cachemire sont marquées par la percée des autonomistes, ce qui constitue un mauvais résultat tant pour Delhi qu’Islamabad. - 1998 : Explosions des bombes indiennes et pakistanaises. Le conflit au Cachemire met désormais aux prises deux puissances nucléaires et le Pakistan souhaite se servir de cette arme pour internationaliser la question. - 1999 : Offensive pakistanaise à Kargil. Nouvel échec de l’armée pakistanaise. La détention de l’arme nucléaire ne lui a rien apporté et le Pakistan connaît une nouvelle crise intérieure pour avoir cédé à la pression des Etats-Unis. - 2000 – 2002 : Recrudescence d’actes terroristes au Cachemire. 1 million d’hommes sont massés de part et d’autre de la frontière indo-pakistanaise. Au printemps, les risques d’un conflit nucléaire apparaissent sérieux jusqu’au moment où la stratégie indienne de surenchère conduit les Etats-Unis à faire pression sur le Pakistan pour qu’il annonce qu’il s’opposera à l’infiltration de terroristes au Cachemire. La même année, les élections au Cachemire sont un succès pour les partisans de la souveraineté indienne. - Depuis 2003 : Réchauffement progressif des relations entre les deux pays, le Pakistan se disant prêt à discuter du sort du Cachemire dans une négociation globale. Les mouvements terroristes cachemiris, marqués par l’islamisme, ont pris leur autonomie et s’opposent à la politique du général Moucharraf, qu’ils cherchent à assassiner en décembre 2003. Le processus de réchauffement entre Delhi et Islamabad, très lent, est mis à mal par les attentats de Bombay de décembre 2008. |
Pour la Chine, le Cachemire a longtemps constitué un moyen de peser sur l’Inde tant que le différend frontalier entre les deux Etats en Himalaya n’était pas résolu. L’autoroute du Karakorum lui permettait d’acheminer des troupes en cas de guerre de grande ampleur. Les tensions entre Pékin et Delhi sont retombées, mais la Chine conserve, en cas de besoin, cet atout.
Pour le Pakistan, la question du Cachemire est centrale : elle constitue la cause de sa première guerre avec l’Inde et de pratiquement tous les conflits qui ont suivi entre les deux pays. Après avoir échoué à reprendre le contrôle de la province par des voies conventionnelles, Islamabad a espéré que son statut de puissance nucléaire obligerait les Nations Unies à internationaliser la question. La guerre qui a été déclenchée à Kargil en mai 1999, par laquelle des indépendantistes cachemiris, soutenus par les forces pakistanaises, s’étaient infiltrés au-delà de la ligne de contrôle, près du glacier de Siachen, s’inspirait du précédent du Kosovo. Le Pakistan escomptait une médiation de l’ONU suivie de négociations sur le statut de la province. Il n’en a rien été. L’Inde a envoyé 20 000 hommes sur le front, à 5000 m d’altitude, des chasseurs et des bombardiers, infligeant une nouvelle défaite au Pakistan. Elle a en sus démontré :
• Qu’elle ne craignait nullement l’arsenal pakistanais. Les deux pays se neutralisant sur le plan nucléaire, c’est le déséquilibre des forces conventionnelles qui a profité à l’Inde.
• Que le Pakistan, même nucléaire, était isolé sur la scène internationale en cas de conflit avec l’Inde. C’est sous la pression de son allié américain, soucieux que la guerre de Kargil ne dégénère pas, que le Pakistan a reculé.
La première crise d’envergure, un an après que les deux pays ont fait exploser leurs premières bombes, n’a donc pas débouché sur l’apocalypse tant redoutée. Elle a principalement révélé l’isolement et la faiblesse stratégique du Pakistan. Si la communauté internationale pourrait admettre qu’Islamabad se serve de ses ADM en cas d’attaque de son territoire, elle n’accepte pas que lesdits ADM soient des moyens de pression politiques. Compte tenu des rapports de force régionaux, au sein desquels le Pakistan, même avec 170 millions d’habitants, est le moins peuplé des grands Etats d’Asie, la bombe pakistanaise est une arme à vocation militaire et défensive. Elle ne peut avoir d’autre objet. La crise de Kargil a démontré que la détention de l’arme nucléaire ne signifiait pas forcément l’accession au rang de grande puissance.
Les mois qui ont suivi le cessez-le-feu du 10 juillet 1999 ont confirmé cette situation. L’armée pakistanaise a traversé une nouvelle crise qui l’a conduit à renverser le pouvoir civil de Nawaz Charif, accusé d’avoir cédé aux Etats-Unis. La communauté internationale n’a en rien été impressionnée par le statut nucléaire du Pakistan, le FMI menaçant de ne pas lui accorder une aide de 1,6 milliard de dollars promise à son prédécesseur. Perves Moucharraf, nouveau chef de l’Etat, a constaté que l’Inde avait placé ses troupes en état d’alerte et a réagi non en invoquant l’arme nucléaire, mais en avertissant Delhi de ne pas tenter de profiter de la situation de faiblesse du Pakistan.
c) Une course aux armements parallèle à un lent processus de rapprochement diplomatique
Lorsque l’Inde et le Pakistan ont procédé aux essais d’armes nucléaires en 1998, l’inquiétude de la communauté internationale provenait du fait que les deux pays, en contact direct, étaient en conflit et qu’aucune procédure n’existait entre leurs chefs d’Etat pour prévenir une frappe accidentelle.
Onze ans après ces essais, le constat est que les deux pays ont poursuivi leur course aux armements, pour des raisons qui ne tiennent pas seulement à leur rivalité, mais à la montée en puissance de la Chine, mais qu’ils se sont efforcés d’opérer un rapprochement diplomatique, malgré des phases de tension. Il existe en effet plusieurs grilles de lecture des relations indo pakistanaises et si les raisons d’un conflit ne manquent pas, il convient de garder également à l’esprit que l’Inde du Nord et le Pakistan forment un espace de civilisation commun (civilisation moghole), illustré par l’usage de l’Ourdou, langue de grand prestige littéraire, et que les dirigeants du vaste tissu d’entreprises de part et d’autre de la frontière aspirent à intensifier les activités industrielles et commerciales. De nombreux pakistanais partagent de moins en moins une vision de l’histoire fondée sur la défense de l’Islam, constatant que l’Inde est le 3ème pays musulman du monde et que leurs coreligionnaires y vivent en paix. A l’instar de l’Inde, le Pakistan est victime d’un terrorisme islamique qui fait des centaines de morts chaque année.
En février 1999, Atal Vajpayee et Nawaz Charif ont adopté la déclaration de Lahore qui propose une coopération et une sécurité régionale renforcée, avec des moyens de contrôle de toute utilisation accidentelle de leur arsenal nucléaire. Deux mois après, en avril, les deux pays ont procédé à des essais de missiles balistiques…
Le conflit de Kargil – tentative maladroite du Pakistan d’internationaliser le conflit du Cachemire en infiltrant des talibans afghans et pakistanais – a gelé ce rapprochement. L’année 2000 a été marquée par une série d’aller retour entre crise et apaisement. L’Inde a proposé la reprise du dialogue à la condition qu’Islamabad combatte le terrorisme islamique. Si Abdoul Majid Dar, commandant de Hizbullah Ul Mudjahidin, mouvement armé le plus important au Cachemire, a annoncé un cessez le feu unilatéral, il a été désavoué quelques semaines après par d’autres mouvements islamistes et sans doute par une partie des services spéciaux. Plus intéressant est l’échec de la tentative de signature par les deux pays du TICE alors que les deux gouvernements étaient d’accord sur cette démarche. Côté pakistanais, les partis religieux s’y sont opposés, ralliant à leur position le général Moucharraf. Côté indien, un groupe de pression groupant les militaires et les entreprises liées au programme nucléaire a obtenu des parlementaires du Lok Sabah non seulement de prendre position contre le TICE, mais également de faire procéder à des essais complémentaires. En octobre 2000 et en janvier 2001, l’Inde a opéré une série d’essais. Victime d’une crise économique et budgétaire, le Pakistan n’a pas répliqué comme il le faisait habituellement.
L’année 2001 a été marquée par une tentative de rapprochement diplomatique très prudente, Vajpayee recevant en juillet Moucharraf à Agra pour discuter du Cachemire, sans grand résultat. Parallèlement, les djihadistes cachemiris du Lashkar e taiba, marquant leur autonomie croissante à l’égard du pouvoir pakistanais (Moucharraf commençait sa politique de désislamisation de l’état-major) n’ont cessé de commettre des attentats spectaculaires pour maintenir la tension : aéroport de Srinagar, Parlement du Cachemire indien, Parlement indien à Delhi, provoquant la colère de la classe politique et de l’opinion publique en Inde.
Cette tactique de la tension a réussi, puisque les deux pays avaient massé un million d’hommes de part et d’autre de la frontière en janvier 2002. Le 5 janvier, le Pakistan déployait au Pendjab, 2 missiles portant des têtes nucléaires, le Shaheen 1 et le Haft 1. Comme pour donner en même temps un signe d’apaisement, le général Moucharraf, le 12 janvier, prononçait le célèbre discours par lequel il annonçait que le sol pakistanais ne pouvait servir aux mouvements terroristes (ce qui constituait l’aveu qu’un tel soutien existait auparavant). Le 14 janvier, les services américains repéraient 5 nouveaux missiles pakistanais près de la frontière indienne. Delhi, en riposte, procédait le 25 janvier à un essai nucléaire, puis à un test du missile Agni 1. En mars 2002, des violences interconfessionnelles en Inde provoquaient le décès de centaines d’hindouistes et de milliers de musulmans. La tension, déjà forte, atteignait un pic avec l’attentat du 14 mai, commis par le Lashkar e taiba au Cachemire, puis avec des essais de missiles pakistanais les 25 et 26 mai. L’un des missiles, le Ghauri (Haft 5) était en mesure de frapper des villes comme Delhi ou Bombay.
Tout en qualifiant les tests de singeries de missiles, l’état major indien procédait à l’équipement de ses bombardiers et de ses missiles avec les ogives nucléaires. Les procédures civiles et militaires étaient en place pour frapper en quelques minutes le Pakistan.
Il a toujours été difficile d’interpréter cette montée de la tension autrement que par la persistance des comportements des deux pays dans la gestion de leurs conflits traditionnels. Les ADM ajoutaient un élément nouveau dans leurs relations et il ne fait nul doute que les deux gouvernements se sont mutuellement mis à l’épreuve. On peut toutefois relever dans le comportement pakistanais les divisions qui agitaient le pouvoir en place, avec des phases d’apaisement, nourris par des discours anti terroristes, précédées ou suivies d’essais de missiles.
Comme à Kargil, ce sont les pressions occidentales, notamment américaines (la Russie avait perdu son influence en Inde) qui ont conduit à l’apaisement de la tension. Moucharraf a annoncé le 6 juin – une nouvelle fois pour ses détracteurs – qu’il empêcherait toute infiltration de terroristes au Cachemire indien et en Inde. En réponse, Delhi saisissait l’opportunité représentée par ce discours pour retirer de la frontière une grande partie de ses troupes épuisées par six mois d’alerte.
En juillet puis en août 2002, de graves attentats au Cachemire indien ont fait craindre une reprise de la tension. Delhi a au contraire choisi la modération réalisant que le pouvoir pakistanais était débordé par les mouvements islamistes qu’il avait formés (lashkar e taiba, talibans pakistanais) et par Al Qaida, sans doute impliquée dans les incidents sur la ligne de contrôle cachemirie. Malgré plusieurs phases de tension depuis, l’Inde et le Pakistan n’ont plus provoqué d’escalade nucléaire d’une telle ampleur et recherchent un modus vivendi qui sera difficile à atteindre tant que l’armée pakistanaise ne sera pas réellement contrôlée par le pouvoir civil, et tant que le Pakistan ne verra dans l’Inde que son ennemi et non un partenaire.
Face à une Inde qui avance ses positions en Afghanistan, axe de profondeur stratégique au Nord du Pakistan, et qui renforce également sa légitimité au Cachemire, Islamabad n’a pu répondre qu’en soutenant clandestinement divers mouvements islamistes. Mais ces derniers ont pris leur autonomie et ont commis de nombreux attentats sur le sol pakistanais. Le Nord du pays (territoires autonomes fédéralement administrés et provinces du Nord Ouest) échappe au contrôle du pouvoir central tandis que le Pendjab et le Baloutchistan font l’objet de tentatives de déstabilisation. A cette situation d’insécurité s’ajoutent de sérieux dysfonctionnement de l’Etat et une crise économique et financière qui ont conduit le Président Ali Zardari à qualifier lucidement son pays d’homme malade de l’Asie et à rechercher un rapprochement avec l’Inde. Ce dernier semblait en bonne voie en 2008, jusqu’aux attentats de Bombay, en décembre. L’Inde y a réagi avec modération, tout en exigeant l’interdiction de la branche civile du Lashkar e taiba, une nouvelle fois impliqué dans les attentats, mais aucune escalade conventionnelle ou nucléaire n’a été relevée. Islamabad a pris conscience qu’elle avait des intérêts communs avec Delhi, mais le plus difficile est de rendre publique cette politique et de la faire accepter par les partis politiques pakistanais.
Depuis 1998, le Pakistan a poursuivi le développement de son arsenal, comme l’Inde. S’il a rendu crédible une dissuasion apte à sanctuariser son territoire, il n’a pas retiré de son statut de puissance nucléaire une parité stratégique avec l’Inde. C’est en fait cette dernière, qui, forte de sa population et de sa croissance économique, a retiré les bénéfices d’une position nouvelle de puissance globale grâce à l’arme nucléaire et a engrangé les effets de son rapprochement avec les deux alliés traditionnels du Pakistan, la Chine et les Etats-Unis. Islamabad n’a remporté aucun des conflits bilatéraux contre l’Inde, a cédé face aux pressions internationales… Le Pakistan suscite en outre l’inquiétude pour deux raisons : la sécurisation de son arsenal nucléaire et son rôle proliférateur auprès d’autres pays candidats à la bombe (cf chapitre III du présent rapport sur le rôle du réseau Khan dans la dissémination des technologies nucléaires).
d) La sécurisation de l’arsenal nucléaire pakistanais
La sécurisation de l’arsenal nucléaire pakistanais est en partie liée à la politique conduite par les Etats-Unis et leurs alliés pour mettre fin au conflit en Afghanistan en luttant à la fois contre le talibanisme, tant afghan que pakistanais, et en stabilisant un Etat pakistanais, qui, s’il n’est pas failli, connaît de sérieux dysfonctionnements. A la suite des attentats du 11 septembre 2001, les Etats-Unis avaient déclaré que si le Pakistan n’accomplissait pas de sérieux efforts pour sécuriser leur arsenal, ils s’empareraient des ogives. Le Pakistan a accepté l’aide financière américaine pour protéger ses sites, plutôt que de voir les Américains s’approcher de ses armes et d’être ensuite capables de les désactiver à distance.
Il est indéniable que l’Etat comme la société pakistanaise sont traversés par de profondes tensions, l’une étant constituée par un mouvement islamiste qui n’a que le terrorisme comme moyen de conquête du pouvoir. Les partis purement islamistes sont en effet très minoritaires aux élections nationales et provinciales (moins de 3% aux élections législatives de 2008).
Les pays occidentaux soupçonnent les islamistes d’être très bien intégrés au sein de l’appareil militaro industriel, héritage de l’époque où le général Zia Ul Haq s’appuyait sur eux pour asseoir son pouvoir. Ils craignent en conséquence qu’une déliquescence de l’Etat conduise la bombe pakistanaise à tomber entre les mains de terroristes ou que des islamistes conquièrent le pouvoir d’Etat et accèdent aux sites où les charges et les missiles sont entreposés.
L’hypothèse de terroristes s’emparant de tout ou partie de l’arsenal nucléaire doit être écartée. Les talibans agissent soit par des embuscades en montagne, soit par des attentats en milieu urbain, mais affrontent rarement l’armée pakistanaise en combat classique. Or s’emparer des sites nucléaires exige ce type de combat. En outre, le Pakistan a bénéficié d’une aide financière importante des Etats-Unis (100 millions de dollars ces dernières années) pour protéger ses sites. L’unité de sécurité des sites comprend désormais 9000 hommes, assistés d’équipes spécialisées à l’intérieur des installations, le tout sous l’autorité d’un commandement qui ne relève ni de l’armée ni des services spéciaux.
Même si la localisation des sites abritant des charges et des missiles n’est pas entièrement secrète, Islamabad déplace périodiquement les engins nucléaires pour ajouter de l’incertitude sur le lieu de leur dépôt. S’emparer d’une arme ne signifie pas que l’on puisse ensuite s’en servir. D’une part, les armes sont entreposées séparément des missiles, et les matières fissiles (plutonium ou UHE) sont elles-mêmes séparées des armes. D’autre part, les armes ne peuvent être activées que selon un système de code complexe, qui relève de la chaîne de commandement, placée sous l’Autorité de commandement national (NCA).
Composée de 10 personnes (les plus hauts responsables civils et militaires du Pakistan), la NCA est l’instance qui décide d’employer l’arme nucléaire. La mise en œuvre est de la compétence de la division des plans stratégiques (SPD) qui contrôle l’ensemble du programme nucléaire, de la conception au lancement éventuel d’un vecteur armé.
D’autres hypothèses sont parfois avancées : la fuite de scientifiques pakistanais dans des pays désireux de se doter d’ADM, la constitution de réseaux radicaux au sein de l’appareil administratif et industriel nucléaire… Mais de tels risques ne sont pas propres au Pakistan. Tout Etat doté d’ADM doit contrôler les personnes qui travaillent dans des installations sensibles. Seule la déliquescence complète de l’Etat et de la société pourraient faire courir un risque réel de prolifération et de terrorisme mais le Pakistan, pour l’heure, malgré ses difficultés, est loin d’être dans ce cas.
Le Pakistan a prouvé à de nombreuses reprises sa volonté de conserver l’entière maîtrise de ses armes nucléaires. Il a réagi violemment contre les talibans lorsque ces derniers, en pénétrant à Buner, se sont approchés de sites nucléaires et a souhaité élargir le nombre de pays avec lesquels il coopère en matière de sécurité nucléaire. Il a ainsi accepté en juillet 2009 la proposition française de sécurisation de ses centrales nucléaires civiles.
3) Pourquoi l’Iran veut maîtriser la technologie nucléaire militaire
L’Iran veut maîtriser la technologie nucléaire militaire. Nous pensons que l’objectif de la République islamique de se doter de l’ensemble des instruments (usines d’enrichissement, unités de fabrication de la bombe, détonique, vecteurs, satellites) qui la feront accéder au rang de puissance nucléaire ne fait aucun doute. La seule question réside dans les intentions ultimes de Téhéran : Etre simplement un Etat du seuil, en mesure de fabriquer des bombes et leurs vecteurs ou bâtir dès les prochaines années une force de dissuasion ?
L’Iran comme la Corée du Nord sont les principaux acteurs de la nouvelle phase de la prolifération nucléaire. Mais autant la bombe coréenne n’a pour objectif que le maintien au pouvoir d’un parti unique, dont le réseau militaro-industriel épuise les ressources d’un pays pauvre, autant la bombe iranienne répond moins à des objectifs de politique intérieure qu’au désir de l’Iran de devenir une puissance globale, qui aura de profondes répercussions stratégiques au Moyen-Orient et en Asie centrale. Les deux pays ne peuvent être placés sur le même plan.
L’analyse du cas iranien exige toutefois une grande prudence. Les lignes qui suivent sont toutes marquées sous le sceau de l’hypothèse. Trente ans après la révolution islamique, nous en savons peu sur le processus de décision au sein du régime. Nous ne savons pas non plus comment les éléments clé du pouvoir iranien perçoivent les Occidentaux, avec lesquels ils négocient.
a) Disposer à court terme d’une capacité de dissuasion
« Je peux garantir à la communauté internationale que l’Iran ne recherche pas la possession de l’arme nucléaire, mais qu’il ne renoncera à aucun de ses droits » (Akbar Hachemi Rasfandjani, décembre 2004).
Nation vieille de 3000 ans, l’Iran est animé d’intentions rationnelles dans sa quête de la technologie nucléaire.
Cette quête correspond aussi à des objectifs de politique intérieure. Le régime théocratique de Téhéran, après 30 ans de pouvoir, est en proie à de nombreuses difficultés sociales et à une contestation politique dont l’élection présidentielle a constitué une illustration. La politique nucléaire représente pour le régime un atout non négligeable d’unité nationale, car elle est psychologiquement source de fierté et politiquement facteur d’indépendance et de sécurité nationale.
Les autorités iraniennes rappellent que la justification première de leur programme est de doter l’Iran d’une capacité nucléaire civile. Ce droit inaliénable est reconnu par le TNP, dont l’Iran est signataire. Il est facile pour les autorités iraniennes de souder leur peuple autour de cet objectif en accusant les Occidentaux d’empêcher leur pays de progresser technologiquement et d’accéder à l’indépendance énergétique. L’instrumentalisation à usage interne de ce dossier par le pouvoir est une évidence. Face au mécontentement croissant de la population, le régime peut mettre en avant les progrès technologiques du pays –chaque fois notamment que l’essai d’un missile est un succès - et indiquer à la population que ses sacrifices ne sont pas vains. Le facteur d’indépendance nationale revêt un impact psychologique non négligeable pour le régime à l’égard de sa population.
Cependant, la raison principale se situe dans le cadre de la rivalité d’un Iran chiite et d’un monde arabe majoritairement sunnite. Il est extrêmement prégnant dans la politique iranienne et se rapporte au souvenir de la guerre contre l’Irak. Ce conflit a laissé des traces considérables au sein de la population iranienne, touchée par 1 millions de morts et des milliers de personnes mutilées. L’impact a été aussi considérable que la première guerre mondiale pour les Européens.
Or l’Iran a été victime d’ADM chimiques pendant cette guerre, les Irakiens ayant su les utiliser avec efficacité. Ce souvenir douloureux est très vivace et l’idée qu’un tel conflit ne se renouvellera pas grâce à la bombe nucléaire emporte aisément l’adhésion des Iraniens. Ceux-ci rappellent en outre que l’Irak a bénéficié de l’appui des Occidentaux dans cette guerre (financements, armes) tandis qu’ils devaient se battre sans alliés. De cette solitude stratégique, volontairement choisie, découle pour les Iraniens le droit de se doter de l’arsenal qui est nécessaire à leur intégrité territoriale et à leur indépendance nationale.
D’autre part, l’attaque américaine lors de la deuxième guerre d’Irak, en dehors de tout mandat de l’ONU, sous le sceau d’un unilatéralisme absolu, a convaincu les éléments les plus sceptiques du régime qu’il fallait se doter de l’outil de sanctuarisation. L’attaque américaine a fédéré la classe politique iranienne sur le seul sujet politique qui ne fasse plus débat.
En résumé, le souhait non avoué de l’Iran est de disposer dans l’immédiat d’une capacité de dissuasion :
– à l’égard de ses voisins immédiats ou proches : l’Iran est en effet entouré d’Etats nucléaires ou à portée de leurs missiles : Russie, Pakistan, Chine, Inde, Israël sans oublier la Vème flotte américaine et ses têtes nucléaires. Les Etats précités ne sont pas tous ses adversaires, certains comme la Chine, la Russie et l’Inde sont d’importants partenaires commerciaux. La Russie, la Chine et le Pakistan ont fait bénéficier de leur expertise le programme iranien… En se dotant de la bombe, l’Iran compenserait au minimum un déséquilibre stratégique régional. Il s’agirait, dans un premier temps, d’une capacité de dissuasion du faible au fort. Il y a encore loin avant d’atteindre la parité, qui exige un arsenal significatif et des capacités balistiques importantes mais les recherches que conduit Téhéran démontrent que ce pays veut maîtriser l’ensemble de la filière : engin, détonique et vecteurs.
– lui permettant de sanctuariser son territoire, notamment en cas de nouvelle attaque de l’Irak. Ce facteur est à prendre en considération compte tenu du profond traumatisme subi par la société iranienne lors de la guerre avec son voisin.
Ainsi que précédemment indiqué, la seule question en suspens est de savoir si l’Iran ira au bout de son programme en s’arrêtant au stade de la mise au point des capacités technologiques (option japonaise) ou s’il fabriquera un engin, en l’expérimentant ou pas, puis un arsenal. Dans le deuxième cas, Téhéran opèrera une montée en puissance qui aura d’importantes conséquences stratégiques au Moyen-Orient.
b) Un choix stratégique comportant plusieurs options
Les observateurs de l’Iran connaissent la complexité des jeux de pouvoir à Téhéran. Sur un sujet aussi fondamental que l’option nucléaire militaire, le débat a été très vif entre conservateurs et « libéraux » (ces deux termes étant simplificateurs). Il semble avoir été tranché vers 2005 en faveur des premiers. Outre les conséquences stratégiques qu’il entraînait pour la politique extérieure iranienne, il comportait un aspect religieux non négligeable dans une république théocratique puisque l’usage des ADM était jugé par les leaders religieux contraires à l’Islam. Ali Khamenei, Mahmoud Ahmadinejad, Ali Khatami, entre autres, ont fréquemment déclaré que l’arme nucléaire n’avait pas sa place dans la doctrine de défense de l’Iran, car elle allait contre les principes de l’Islam. Une fatwa (jamais publiée, semble-t-il) du Guide de la Révolution aurait interdit l’usage d’une telle arme… Mais non son acquisition ou sa mise au point… La portée politique d’une ADM aurait donc bien été prise en compte par les autorités religieuses du pays.
Le clan conservateur, conduit par Ali Khamenei, Guide de la Révolution, épaulé par l’ancien ministre de la Défense Chamkhani, considérait que les pressions américaines et israéliennes menaçaient le pays (surtout après l’invasion de l’Irak, qui plaçait les troupes américaines aux portes de l’Iran) et que la seule manière de préserver les principes de la révolution et l’intégrité territoriale était de se doter d’ADM. Le clan « libéral », mené par Ali Khatami, voyait dans ces armes un risque croissant d’isolement et d’insécurité pour l’Iran. Ali Khatami n’y était guère favorable, tout en considérant que les pressions subies par son pays étaient telles qu’il serait peut-être contraint de se retirer du TNP pour bâtir une arme lui garantissant son indépendance.
Il semble que la poursuite d’un programme nucléaire l’ait emporté au sein du régime, car elle comportait au moins trois avantages pour l’Iran.
Le premier est de démontrer que les grandes puissances ont perdu leur capacité d’influence dans le monde… Voilà près de sept ans que l’Europe et les Etats-Unis négocient avec Téhéran sans grands résultats. Si Washington a sans doute réfléchi à une action militaire, elle n’a pas osé la mettre en œuvre. Les chancelleries occidentales savent certes que le régime ne jouit plus d’une réelle assise populaire, mais il rallierait autour de lui l’ensemble des Iraniens en cas d’intervention étrangère…Même si l’Iran ne conduit pas officiellement de programme et qu’il est signataire du TNP, l’ensemble de son attitude prouve qu’il veut remettre en cause un ordre international perçu à la fois comme un héritage de la guerre froide et de l’ère coloniale. « Si un jour le monde islamique était doté d’une arme comme celle dont dispose Israël actuellement, la stratégie des impérialistes serait stoppée parce que l’usage d’une seule bombe par Israël provoquerait une destruction totale. De quelque manière que l’on envisage cette question, cela renforcera le monde islamique. Ce n’est pas irrationnel de réfléchir à une telle éventualité » (Akbar Hachemi Rasfandjani, décembre 2004).
Le deuxième est de forcer la communauté internationale à négocier avec l’Iran. Or le seul fait de négocier est déjà une victoire pour Téhéran, dont le régime se trouve ainsi renforcé. Ce sont les Européens et les Américains qui se trouvent en situation de demandeurs pour sauver le TNP sans connaître les intentions ultimes de l’Iran, qui de son côté se place dans une situation attentiste pour examiner les offres de coopération politique et économique qui lui sont proposées.
Le troisième est un choix de long terme et porte une politique plus ambitieuse. L’Iran veut appartenir au cercle des puissances globales, qui regroupe les Etats ayant un poids démographique et économique important, dotés de l’arme nucléaire, garante à la fois de leur indépendance et symbole d’un niveau technologique élevé. Il semble bien que cet avantage ait été finalement pris en compte, faisant de la mise au point de l’ADM nucléaire l’axe central de la politique iranienne.
L’arme nucléaire, pour quoi faire ? Cette question est souvent évoquée car les Iraniens ont toujours affirmé le droit inaliénable de leur pays à maîtriser l’ensemble du cycle nucléaire militaire, tout en affirmant ne pas vouloir s’en servir sauf en cas d’attaque contre leurs intérêts vitaux…
L’utilisation offensive de l’arme nucléaire contre l’Etat d’Israël est à écarter. Les propos du Président Ahmadinejad sont incontestablement choquants, notamment à l’égard d’un Etat né d’un génocide, mais sont à usage interne… Les Iraniens savent parfaitement que toute attaque nucléaire contre Israël déclencherait les représailles de ce pays et sans doute celles des Etats-Unis. Or l’Iran est une puissance rationnelle dont les dirigeants ne joueraient en aucun cas la survie de leur peuple.
L’utilisation défensive a été brièvement évoquée par vos Rapporteurs. Elle rétablit la parité avec ses grands voisins et elle constitue un signal clair en direction des Etats-Unis, dont la présence en Turquie (via l’Otan) et en Irak (où ils conserveront des unités), deux pays voisins de l’Iran, ne rassure pas le régime de Téhéran.
Fondamentalement, la politique nucléaire militaire de l’Iran n’a pas une vocation tactique. Comme pour tous les pays détenteurs d’ADM, la possession de telles armes implique de ne pas s’en servir, sauf en cas d’atteinte à leurs intérêts vitaux, mais confère une puissance stratégique qui ouvre une capacité d’influence. Pour l’Iran, la détention d’une arme nucléaire n’est ni une question défensive, ni une arme offensive contre Israël, l’Arabie saoudite ou les émirats du Golfe persique. Elle constitue le moyen de consolider un fait déjà accompli, à savoir que l’Iran est la puissance dominante du Moyen-Orient. Ce pays est le plus peuplé du Moyen-Orient, celui où le niveau d’éducation est le plus élevé, le plus avancé dans la maîtrise des technologies de pointe et même si son économie donne les signes de sérieux dysfonctionnements, il dispose d’importants avoirs financiers.
Qu’il s’agisse de la réconciliation des communautés au Liban, de l’influence sur le Hezbollah et le Hamas, des affaires inter irakiennes, Téhéran est devenue l’arbitre de plusieurs conflits. Par ses moyens de financement, ses livraisons d’armes, ses camps d’entraînement, l’importance de la communauté chiite dans certains Etats (Liban, Irak, Bahreïn, Ouest et Nord de l’Afghanistan), l’Iran a les moyens d’attiser la tension au Moyen-Orient ainsi qu’en Afghanistan, ou de la calmer. Le directeur des affaires politiques du ministère des Affaires étrangères d’Arabie saoudite a reconnu devant nous que l’influence de Téhéran en Irak surpassait désormais celle de Riyad pour le règlement des questions les plus importantes comme pour celui d’affaires en apparence plus marginales, mais fondamentales dans le monde arabe, comme les affaires tribales (justice, mariages) des tribus sunnites, pourtant apparentées à la vaste famille des Saoud. La posture révolutionnaire et anti américaine a également attiré bien des sympathies dans le monde arabe, à la recherche d’un leadership moral.
A l’exception de quelques îles du Golfe persique dont il dispute la possession aux Emirats arabes unis, l’Iran ne nourrit aucun conflit majeur avec ses voisins. Ces derniers ne se sentent d’ailleurs pas menacés officiellement par une ADM iranienne, même s’ils préfèrent un Moyen-Orient non nucléarisé. Ils rappellent que la seule puissance nucléaire de la région n’est ni un Etat arabe, ni l’Iran, mais Israël, alors que l’Iran est leur partenaire commercial depuis des siècles. Si un conflit devait survenir, quelques missiles dotés de charges conventionnelles sur des champs pétroliers suffiraient à Téhéran pour déstabiliser les marchés de l’énergie et par ricochet, les économies occidentales… Le champ de la rivalité est plutôt idéologique, entre des systèmes fondés sur des royautés héréditaires et un système clérical, où l’accès au pouvoir obéit à d’autres ressorts que familiaux.
Au-delà de l’objectif stratégique que représente la bombe pour l’Iran
– objectif somme toute classique de sanctuarisation de son territoire et d’accroissement de son influence – celle-ci renforcerait l’attractivité idéologique de la République islamique.
Si la politique de Téhéran est isolationniste, sans grand conflit avec ses voisins ni revendication territoriale, ni même de contentieux majeur avec les pays européens (en dehors de la question nucléaire), s’il est difficile au chiisme d’être expansionniste dans un environnement sunnite, la nature du régime est d’être marqué d’une forte idéologie. Le régime iranien veut incarner l’Islam, et l’idée millénariste de réunir l’ensemble de l’humanité sous l’Oumma (communauté des croyants) fait quelque part partie du projet du régime. L’arme nucléaire représente à court terme le moyen de défendre l’Islam. A long terme, elle représente un symbole d’invincibilité et de prestige.
L’arme nucléaire consacrerait la prédominance de l’Iran au Moyen-Orient parmi les Etats de la région et permettrait à ce pays d’y contrebalancer à long terme l’influence considérable qu’y tiennent les Etats-Unis. C’est pour cette raison que Washington s’oppose à l’arme nucléaire iranienne, et non en raison d’une hypothétique attaque de missiles nucléaires iraniens sur des villes américaines. Les Etats-Unis ont quelques difficultés à admettre la réalité d’un monde multipolaire… Inquiets de la concurrence de la Chine dans tous les domaines, y compris militaire, ils ne voient pas d’un œil favorable l’émergence d’une nouvelle puissance globale dans un Moyen-Orient instable. Or l’invulnérabilité du territoire iranien accroîtrait le prestige et la capacité d’action de ses dirigeants.
L’ambition de l’Iran doit certainement être prise en compte par les adversaires de son programme nucléaire – après tout, elle n’est que la traduction d’une réalité - mais ces derniers se trouvent alors face à de nouvelles questions, notamment la place à accorder à Téhéran dans les discussions des différents processus de paix ou de réconciliation. Les réponses sont d’autant plus difficiles à donner que Téhéran émet peu de propositions dans ces processus, à l’exception de l’évacuation des forces américaines et de leurs alliés d’Afghanistan et du Moyen-Orient (ce qui consacrerait encore plus sa domination dans la région).
Le programme nucléaire iranien, s’il aboutit, peut modifier les équilibres régionaux, dans un contexte marqué, notamment, par la situation en Irak, par les difficultés de l’OTAN en Afghanistan et par l’absence de perspectives dans le règlement du conflit israélo-palestinien. Les Etats-Unis affirment qu’il peut relancer une dangereuse course aux armements, l’Arabie saoudite et la Turquie ne pouvant admettre être dépourvues de l’arme nucléaire face à un voisin si puissant (cf h) sur les craintes des Etats-Unis face à un Iran nucléaire).
Le premier programme a été élaboré sous le règne du Chah, à la suite du premier choc pétrolier qui avait eu pour effet de donner à l’Iran les moyens de mener la politique ambitieuse à laquelle le souverain aspirait. La réalisation de cette politique fut confiée à un organisme public, l’Organisation iranienne pour l’énergie atomique (OIEA).
Annoncé officiellement en 1974, le programme nucléaire visait officiellement à diversifier les sources d’énergie utilisées par l’industrie iranienne. Les autorités iraniennes s’étaient ainsi fixées un objectif ambitieux de 23 000 mégawatts de puissance installée, à l’horizon de 2000. Un tel niveau de production impliquait la mise en route d’une vingtaine de centrales. A titre de comparaison, la France pouvait compter, en 2000, sur 63 000 mégawatts environ, grâce à une cinquantaine de centrales.
Les premières commandes effectuées par l’Iran dans le cadre de cette politique ont mis en concurrence les acteurs principaux du marché nucléaire civil, afin de lancer huit des vingt chantiers de centrales prévus. L’Allemagne, par l’intermédiaire de la société KWU (groupe Siemens) s’est vu confier, dès 1974, la mise au point de deux réacteurs à construire sur le site de Busher, l’achèvement étant prévu entre 1980 et 1981, ainsi que de quatre autres centrales, faisant de ce pays le partenaire privilégié du régime du Chah en matière nucléaire. La société française Framatome reçut, pour sa part, la commande de deux réacteurs situés près d’Ahvaz, en 1974 et 1975.
Afin de faire fonctionner ce dispositif, l’Iran souhaitait accéder facilement aux matières premières, principalement de l’uranium en vue de l’enrichir. Il s’est ainsi lancé dans l’extraction de l’uranium naturel, en ouvrant notamment plusieurs mines sur son propre territoire.
L’enrichissement de l’uranium fut négocié avec la France, entre 1974 et 1977. L’ex société Cogema (devenue depuis Areva) s’était engagée à fournir à l’Iran le combustible nécessaire au fonctionnement des centrales nucléaires. En 1975, un accord de long terme fut ainsi passé entre les deux pays. L’OIEA et la Cogema acquirent ainsi, respectivement, 40 % et 60 % des parts de la société franco-iranienne pour l’enrichissement de l’uranium par diffusion gazeuse (Sofidif), celle-ci devenant, pour sa part, actionnaire à hauteur de 25 % de l’entreprise Eurodif. En contrepartie de cette prise de participation, et d’un prêt accordé par le Chah à Eurodif pour un montant de 180 millions de dollars, l’Iran se vit reconnaître le droit d’acheter 10 % de la production de la nouvelle usine.
Les finalités des installations étaient (théoriquement) uniquement civiles. Toutefois, l’Iran s’intéressa dès 1974 à la maîtrise de la technologie de retraitement, qui permet d’extraire du plutonium hautement enrichi à partir du combustible irradié. L’Iran exigeait en outre de pouvoir mener ces activités sur son propre sol. Les Etats-Unis, bien qu’alliés de l’Iran, opposèrent un clair refus à ces demandes de transfert de technologies. L’Iran se tourna alors vers la France, en exigeant de ne pas faire l’objet d’un traitement moins favorable que le Pakistan, avec lequel la France avait signé un accord – jamais mis en œuvre – prévoyant la fourniture d’une unité de retraitement. Toutefois, ce projet n’aboutit pas.
Le renversement, en 1979, du régime du Chah et l’arrivée d’un pouvoir religieux modifièrent profondément le programme nucléaire iranien. Les nouveaux responsables du pays avaient d’autres priorités : changer les structures de l’Etat, conduire la guerre contre l’Irak, assurer leur propre pouvoir contre des tentatives de déstabilisation… Sur tous ces fronts, il leur fallait mobiliser de nombreuses ressources humaines et financières. Enfin, l’idéologie islamique réprouvait l’usage d’ADM… Du moins à ce moment de l’histoire iranienne…
En outre, les réactions de la communauté internationale face au changement de régime ont affaibli le programme iranien. Seul fournisseur d’uranium faiblement enrichi, la France a interrompu les livraisons dès 1979. Privé du combustible indispensable à la production d’énergie nucléaire, l’Iran a renoncé progressivement à son programme nucléaire, en annulant successivement les contrats relatifs aux centrales de Busher, puis de Karoun.
C’est la fin de la guerre Iran-Irak qui a marqué la renaissance du programme nucléaire iranien. Traumatisée par ce conflit qui lui a coûté 1 million de morts (les Iraniens ont vécu ce conflit comme les Français lors de la première guerre mondiale) et certaine que l’Occident avait tacitement encouragé Saddam Hussein à l’attaquer, la République islamique a trouvé un regain d’intérêt dans la détention d’ADM. Deux pays ont contribué de façon à la reprise des activités nucléaires iraniennes. La Chine a apporté la conversion de l’uranium sous sa forme gazeuse, l’hexafluorure d’uranium ou UF6, forme utilisée dans le processus d’enrichissement, et a procédé également à des livraisons directes d’UF6. La Russie, quant à elle, a repris le chantier, abandonné par KWU, de la centrale de Busher.
e) La découverte d’un programme clandestin à caractère militaire
Le 14 août 2002, le Conseil national de la résistance iranienne, organisation proche des Moudjahidines du Peuple, révélait l’existence de deux projets inconnus du programme nucléaire iranien. La technologie duale qui semblait y être abritée avait échappé aux inspections pourtant régulières de l’AIEA :
• La construction à Natanz d’une installation secrète d’enrichissement d’uranium. En voie d’enfouissement, cette usine se révélera destinée à accueillir environ 50 000 centrifugeuses, dont les premiers exemplaires auraient été fournis par le réseau clandestin organisé par Abdul Qader Khan.
• La mise au point à Arak d’une centrale nucléaire dite « à eau lourde ». Cette filière était abandonnée par la plupart des Etats exportant la technologie nucléaire civile, car elle est productrice de plutonium en grande quantité, et peut donc facilement être détournée à des fins militaires.
Lors de la réunion du bureau des gouverneurs de l’AIEA de septembre 2002, le représentant iranien admit que son pays souhaitait développer un programme de grande ampleur avec la construction de centrales et l’acquisition de technologies relatives au cycle du combustible et à son retraitement. Autorisée à mener des inspections sur les sites jusque là secrets de Natanz et Arak, l’AIEA disposera rapidement d’une vision étendue du programme nucléaire iranien, dont les visées militaires ne pouvaient faire de doute. Seule demeure une interrogation sur l’usage et l’ampleur que fera l’Iran de la technologie nucléaire militaire quand il en maîtrisera toutes les étapes.
La mission de la commission des Affaires étrangères sur l’Iran (31) a décrit les éléments du programme iranien. Le premier indice est le caractère dual de l’enrichissement :
« Pour produire de l’uranium enrichi à 3 %, destiné aux centrales nucléaires civiles, des groupes de 164 centrifugeuses peuvent fonctionner en parallèle. Pour produire de l’uranium militaire enrichi à 85 % au minimum, il faut que ces « cascades » de centrifugeuses fonctionnent en série. Cette dualité a conduit à limiter le transfert de technologies d’enrichissement, et la plupart des pays dotés d’installations électronucléaires importent de l’uranium déjà enrichi.
Refusant cette limitation, l’Iran a acquis, auprès du réseau clandestin du pakistanais A.Q. Khan, des centrifugeuses permettant d’enrichir de l’uranium sur son sol. Le programme le plus avancé concerne l’usine de Natanz. Celle-ci dispose, à l’heure actuelle, d’une unité de 4 500 centrifugeuses, inspirées de modèles pakistanais. Celles-ci sont organisées en « cascades », structures qui associent plusieurs centrifugeuses afin de répéter plusieurs fois l’opération d’enrichissement permettant d’obtenir les taux souhaités. Cinq cascades de 164 machines sont disponibles, et douze cascades supplémentaires sont en cours d’installation. Depuis février 2007, les centrifugeuses ont permis de traiter environ 7,5 tonnes d’hexafluorure d’uranium, pour une production d’environ 600 kilogrammes d’uranium faiblement enrichi. Par ailleurs, des installations annexes ont été dotées de centrifugeuses de conception beaucoup plus récente, impliquant la maîtrise de technologies avancées.
Parce qu’il met en jeu une technologie qui peut être très facilement détournée de ses fins affichées, le refus catégorique de l’Iran opposé aux demandes visant à une interruption du programme d’enrichissement est un premier indice tendant à montrer que ses visées en matière d’énergie nucléaire ne sont pas seulement civiles ».
Le second indice provient de programmes annexes :
A elle seule, la détention, par l’Iran, d’une vaste unité d’enrichissement d’uranium permet d’émettre des doutes sur le caractère uniquement civil de son programme nucléaire... Ces doutes sont renforcés par l’absence de réponses aux questions posées par l’AIEA sur d’autres éléments qui sont liés, directement ou indirectement, à la fabrication d’une arme nucléaire.
Elargissant son contrôle à des projets industriels menés parallèlement au programme nucléaire, l’AIEA a successivement mis au jour plusieurs éléments qui laissent à penser que l’Iran cherche à utiliser ses infrastructures nucléaires à des fins militaires. Ces divers points font l’objet de questions répétées, de plus en plus précises, auxquelles l’AIEA n’obtient pas de réponses satisfaisantes.
Dans son rapport du 19 novembre 2008, le directeur général de l’AIEA récapitule les principaux points du programme nucléaire iranien qui tendraient à confirmer son caractère militaire. Il convient de rappeler, comme le note l’AIEA, que ces diverses critiques sont d’autant plus fortes que, du fait du refus iranien de ratifier le protocole additionnel au traité de non prolifération, l’Agence n’a pas accès à toutes les installations industrielles iraniennes, et ne peut donc certifier qu’aucun projet nucléaire secret n’est actuellement poursuivi.
D’abord, des infrastructures à même de fournir du matériau nucléaire militaire, en l’espèce du plutonium, sont présentes sur le sol iranien. Le réacteur de recherche de Téhéran est ainsi apte à procéder au retraitement de combustibles usagés. Même si les contrôles tendent à montrer que ce réacteur n’a pas été utilisé, la capacité de retraitement demeure. De plus, selon l’Agence, la construction d’un réacteur à eau lourde, plutonigène, se poursuit sur le site d’Arak. L’Iran s’oppose à ce que tous les renseignements qu’il a fournis puissent être vérifiés sur le site.
Ensuite, la difficulté rencontrée par l’Agence pour obtenir des informations sur les projets de construction d’une centrale nucléaire à Darkhovin, la fabrication de nouvelles centrifugeuses, la recherche et développement concernant l’enrichissement, et les activités d’extraction et de préparation du minerai, contribuent encore à renforcer l’impression qu’une partie du programme iranien a des visées qui n’ont rien de civiles.
Enfin, d’autres éléments tendent à montrer que l’Iran, qui refuse de fournir les explications demandées par l’AIEA, prépare un programme nucléaire à capacité militaire. Le rapport du 15 septembre 2008, auquel le rapport du 19 novembre fait référence, fournit une liste exhaustive de ces indices conférant au programme nucléaire iranien un caractère militaire probable, et fait état de la difficulté des discussions les concernant.
En 2005, la découverte, par hasard, d’un document, en possession des autorités iraniennes, relatif à la production d’uranium métal est d’une importance primordiale. En effet, la fabrication d’une arme nucléaire implique que soit maîtrisé ce processus particulier, qui n’a, par ailleurs, aucune utilité civile. Provenant vraisemblablement du réseau du docteur Khan, cette notice fait l’objet de questions de la part de l’AIEA sans que des réponses convaincantes ne soient apportées par les Iraniens.
D’autres points concentrent les inquiétudes de l’Agence. Le projet dit « green salt », mené clandestinement au moins jusqu’en 2003, associe des recherches sur la conversion de l’uranium, des explosifs, et la conception d’une tête nucléaire. Par ailleurs, un projet de développement d’explosifs dits « brisants », dont un centre de tests souterrains et des expériences visant à associer plusieurs explosifs selon un schéma utilisé dans les bombes atomiques, fait l’objet de questions. Enfin, le « projet 111 », destiné à doter certains missiles iraniens d’un corps de réentrée dans l’atmosphère pouvant emporter une charge utile importante, fait partie des points que l’AIEA considère comme étant des indices de la militarisation du programme iranien.
L’ensemble de ces questions, dites « en suspens », constitue un faisceau d’indices concordants tendant à montrer que l’Iran s’est engagé dans la militarisation de son programme nucléaire. La nature de ces éléments ne fait plus de doute, même si leur état d’avancement a pu faire l’objet de discussions.
A l’impossibilité, pour l’AIEA, d’obtenir des réponses sur l’état d’avancement de ces activités, qui tendent à prouver la militarisation du programme nucléaire iranien, s’ajoutent les développements récents du programme balistique, qui viennent conforter les soupçons de développement d’un programme nucléaire militaire.
Le programme nucléaire clandestin est complété par un programme de recherche dans le domaine balistique. Celui-ci n’a rien de confidentiel, la République islamique recourant à des essais pour marquer entre autre objectif le primat de sa puissance dans le Golfe persique.
L’Iran est doté de plusieurs modèles de missiles, inspirés notamment de modèles chinois et nord-coréens. La plupart de ceux déjà déployés ne répondent pas aux critères qui pourraient en faire le vecteur d’une éventuelle arme nucléaire. Toutefois, les projets poursuivis actuellement sont beaucoup plus adaptés à l’emport d’une arme de destruction massive. L’Iran met ainsi au point un missile de 2 000 kilomètres de portée sans intérêt pour des charges conventionnelles. On peut en déduire qu’il est lié à l’emport d’ADM… Les missiles Shahab 3, d’une portée d’environ 1 500 km, peuvent contenir une charge utile de 800 kg, ce qui correspond au poids des armes nucléaires de modèle pakistanais. Une quatrième version du Shahab est en cours d’étude. Inspirée du missile nord-coréen Taepo Dong 2, avec une portée estimée à 2 500 km, il est doté de la technologie dite « bi-étage », qui permet d’accroître considérablement la portée du missile en dotant chacun de ses étages d’un moteur propre.
Avec le missile Ashoura, l’Iran cherche à maîtriser une autre technologie, celle des missiles à propulsion solide. Egalement bi-étage, le missile Ashoura, d’une portée d’environ 2 000 km mais disposant apparemment d’une charge utile limitée, pourrait néanmoins permettre à l’Iran de construire, à l’avenir, des missiles à propergol solide, qui ont pour principal avantage de ne nécessiter qu’un faible délai de préparation avant d’être lancés.
Niant les finalités militaires de leur programme, les autorités iraniennes avancent leurs besoins en électricité pour les années à venir… Or il n’existe aucun rapport entre la dimension de leurs installations, notamment les unités abritant les centrifugeuses, et des objectifs civils. Par ailleurs, l’Iran ne projette aucun programme électro-nucléaire, qui justifierait leur politique nucléaire.
f) Des négociations utilisées par l’Iran pour gagner du temps
Dès la découverte d’indices sur la dimension militaire du programme nucléaire iranien, l’inquiétude a été grande dans la communauté internationale. Bien qu’il fût difficile de percer les objectifs véritablement poursuivis par l’Iran, il avait apparemment violé les règles du TNP, dont il avait pourtant été l’un des premiers Etats parties, ce qui le différencie d’Israël, de l’Inde et du Pakistan. Le dossier iranien constitue un défi diplomatique car il met en cause l’ordre international conçu par le TNP. Que l’Iran se dote de la bombe et le TNP apparaîtra comme inutile…
Or l’Iran a bien l’intention de maîtriser l’ensemble des technologies nucléaires militaires. Il n’a accepté de discussions qu’avec la volonté de ne pas les voir aboutir à un quelconque contrôle, ralentissement ou abandon de son programme. Il n’existe pas d’autres raisons à l’échec des négociations. La stratégie des Iraniens consiste à gagner du temps jusqu’au moment où ils disposeront d’un système opérationnel. Leur tactique consiste à étudier les propositions qui leur sont faites, puis à les refuser, puis à protester contre les sanctions qui leur sont appliquées. Si ces sanctions constituent bien une gêne pour l’économie iranienne, elles n’ont guère d’effet politique car un pouvoir autoritaire, par nature, poursuit ses objectifs sans se soucier des conditions de vie de sa population, du moins tant qu’il n’encourt pas de risque politique.
Il convient en outre de rappeler que le pouvoir iranien dispose de l’appui de sa population sur le programme nucléaire. Même s’il existe une opposition au régime des religieux et des conflits internes au sein du régime, les Iraniens sont unis derrière un objectif qui renforcera leur pays dans un Moyen-Orient arabe qu’ils considèrent comme leur étant hostile.
Après la confirmation par l’AIEA des révélations relatives au programme nucléaire iranien, Européens et Américains, tout en s’accordant sur sa dangerosité (déclaration du G8 au Sommet d’Evian des 1er au 3 juin 2003), ont divergé sur l’attitude à adopter : les premiers souhaitaient privilégier la voie de la négociation, alors que les seconds voulaient faire immédiatement appel au Conseil de sécurité des Nations unies.
Les Iraniens ont gagné six mois en tirant profit de la première phase de négociations avec la troïka européenne (France, Allemagne et Grande-Bretagne). Après la visite des trois ministres des affaires étrangères à Téhéran à l’automne 2003, et l’adoption avec leur homologue iranien d’une déclaration conjointe le 21 octobre, l’Iran s’était engagé à signer le protocole additionnel au traité de non-prolifération. En contrepartie de la reconnaissance du droit iranien à l’énergie nucléaire civile, l’Iran s’engageait donc à suspendre ses activités d’enrichissement et de retraitement.
L’Iran a signé ce protocole additionnel le 18 décembre 2003. Ensuite, il ne l’a pas ratifié, preuve que le pouvoir iranien n’avait nullement l’intention de respecter sa parole. La tentative d’application du protocole a donné lieu à plusieurs controverses entre l’AIEA et l’Iran, car ce dernier souhaitait disjoindre, au sein des activités qu’il s’était engagé à suspendre, certains éléments, notamment les équipements étrangers au site de Natanz.
En juin 2004, l’Iran a indiqué qu’il réactiverait son programme nucléaire si l’AIEA ne lui donnait pas raison. Il a mis sa menace à exécution pendant l’été. La riposte du Conseil des gouverneurs de l’AIEA s’est limitée à l’adoption d’une résolution soulignant les omissions faites par l’Iran concernant ses activités nucléaires.
A la suite de la menace de l’AIEA de transférer le dossier au Conseil de sécurité, les négociations entre la troïka et l’Iran ont repris à l’automne 2004. Elles ont permis à l’Iran de gagner quasiment 18 mois. L’Iran s’est engagé, par un accord de novembre 2004, signé à Paris, à suspendre toutes les activités liées à l’enrichissement, à la conversion et au retraitement. En contrepartie, l’Union européenne proposait de reprendre les discussions concernant la conclusion d’un accord de coopération et de développement, et affirmait son soutien à la candidature de l’Iran à l’Organisation mondiale du commerce.
L’Iran entrait en cette période dans la campagne des élections présidentielles, au cours de laquelle aucun candidat sérieux n’a déclaré qu’il renoncerait au programme nucléaire. L’élection de M. Mahmoud Ahmadinejad, issu de la mouvance des Gardiens de la Révolution, a révélé l’inanité de l’accord de Paris, l’Iran annonçant, le 8 août 2005, la reprise de la conversion du minerai d’uranium en hexafluorure dans les usines d’Ispahan. Constatant que les négociations n’aboutissaient à aucun résultat, les chefs d’Etat de la troïka et le Haut représentant de l’Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité commune proposaient de saisir le Conseil de sécurité des Nations unies via l’AIEA, à l’issue de la réunion de la troïka et de l’Union européenne du 12 janvier 2006.
En voyant son dossier transmis aux Nations Unies, l’Iran pouvait nourrir quelques inquiétudes face aux sanctions qui risquaient d’être votées. Toutefois, ses craintes étaient relativisées par le fait que l’un des membres permanents du Conseil de sécurité, la Chine, avait un intérêt vital à importer le pétrole et le gaz iranien pour son industrie. Il ne restait plus à la délégation iranienne qu’à appliquer la même tactique dilatoire, consistant à négocier longuement puis à faire échouer les négociations, tandis que ses centrifugeuses enrichissaient l’uranium…
Le Conseil de sécurité des Nations unies a officiellement été saisi par le Conseil des gouverneurs de l’AIEA, le 4 février 2006. Comme prévu, les négociations ont principalement été conduites par les Etats-Unis, la Russie et les principaux Etats européens, tandis que la Chine adoptait une position de retrait, se limitant à donner son avis in fine. De février à juin 2006, une série d’offres de coopération a été présentée à l’Iran dans tous les domaines (nucléaire, agriculture, commerce…) et des garanties lui ont été offertes pour sa sécurité. Téhéran n’a donné suite à aucune de ces propositions et a refusé de suspendre l’enrichissement d’uranium, phase clé de son programme nucléaire.
L’attitude des autorités iraniennes, dès lors que le sujet de l’enrichissement de l’uranium est abordé, conduit les observateurs les plus lucides au pessimisme sur l’issue des négociations. D’après M. Mohamed el Baradei, directeur général de l’AIEA, les Iraniens ne renonceront pas à la centrifugation, car ce serait pour eux une humiliation qui leur rappellerait une autre humiliation, celle subie par Mossadegh. Téhéran veut au minimum atteindre la parité technologique avant de décider l’utilisation politique qu’elle en fera.
g) Des sanctions peu efficaces
L’Iran a subi deux types de sanctions : celles décidées bilatéralement par les Etats-Unis et celles prises à son encontre dans un cadre multilatéral. Dans les deux cas, ces sanctions visent à entraver son accès aux technologies sensibles et en faisant comprendre au peuple iranien que la politique de ses dirigeants a un prix, à faire pression sur le régime.
Les Etats-Unis ont adopté les sanctions suivantes :
– l’embargo économique de 1995 : il interdit les activités commerciales, les transactions financières et les investissements avec l’Iran, conduits à partir des Etats-Unis ou par des personnes physiques ou morales américaines établies à l’étranger ;
– les sanctions économiques de portée extraterritoriale : à l’Iran Lybia sanctions act de 1996, a succédé en 2006 l’Iran sanctions act, tous deux dirigés contre les personnes réalisant des investissements dans le secteur pétrolier ou conduisant des activités permettant à l’Iran d’acquérir ou de développer des armes chimiques, biologiques, nucléaires ou conventionnelles avancées ; elles ont été complétées en 2000 par l’Iran nonproliferation act visant les exportations de biens à double usage, puis, en 2001, par l’USA patriot act rendant obligatoire la notification des transactions suspectes ;
– les sanctions économiques de portée extraterritoriale mises en place par des executive orders de 2001 et 2005 traitant respectivement le soutien au terrorisme et la participation à la prolifération, qui visent des entités dont les avoirs et intérêts sont gelés ;
– les consignes discrètes et efficaces d’abstention, informellement communiquées par les autorités américaines : ces dernières ont entrepris de convaincre les acteurs du système bancaire international de ne plus travailler avec les clients iraniens dont ils ne pourraient pas se porter pleinement garants. Pour les banques, notamment occidentales, le choix est clair : continuer à travailler avec l’Iran au risque d’être perçus par les Américains comme traitant avec des partenaires réputés dangereux, pouvant entraîner la perte de la licence bancaire leur permettant de travailler sur l’immense marché américain ; ou bien réduire leurs relations avec l’Iran afin de préserver leurs positions aux Etats-Unis.
Les sanctions multilatérales ont été prises par les Nations Unies ainsi que par l’Union européenne.
• Résolution n° 1696 du Conseil de sécurité (31 juillet 2006) : celui-ci travaillera à l’adoption de sanctions internationales croissantes si l’Iran ne respecte pas ses engagements internationaux, notamment au sein de l’AIEA et/ou ne suspend pas ses activités sensibles avant le 31 août. Le 22 août, l’Iran a annoncé son refus de suspendre ses activités sensibles.
• Résolution n° 1737 (23 décembre 2006) du Conseil de sécurité, prise à l’unanimité, qui rendait obligatoire la suspension de toutes les activités liées à l’enrichissement et à l’eau lourde en Iran, y compris en recherche et développement, et qui a mis en place, en application de l’article 41 du chapitre VII de la Charte des Nations unies, les premières sanctions, sans portée réelle : interdiction de toute contribution extérieure aux activités sensibles de l’Iran, sanctions financières à l’encontre des entités – organismes ou individus – liées aux programmes balistique et nucléaire.
L’AIEA a constaté deux mois après que l’Iran ne remplissait pas ses obligations au titre de la résolution 1737. Le Conseil des gouverneurs a donc décidé de suspendre 22 de ses 55 projets d’assistance technique à l’Iran.
• Résolution n°1747 du Conseil de sécurité (24 mars 2007), portant essentiellement sur deux domaines : l’armement et les relations financières du gouvernement iranien avec d’autres Etats ou avec les institutions financières internationales.
• Résolutions n°1803 (3 mars 2008) et 1835 (27 septembre 2008), prises parce qu’aucun progrès n’avait été enregistré en provenance de Téhéran. La liste des sanctions a été étendue : restriction des déplacements d’une liste étendue de personnes et interdiction de visa pour certaines d’entre elles, gel des avoirs des entités et des personnes liées aux activités proliférantes de l’Iran, appel à la vigilance à l’égard des activités financières de toutes les banques domiciliées en Iran, en particulier les banques Melli et Saderat, interdiction de l’exportation vers l’Iran d’une liste très étendue de biens à double usage, vigilance sur l’octroi de crédit export à destination de l’Iran, inspection des cargaisons des deux principales compagnies aériennes de transport, vigilance sur l’accès des étudiants iraniens aux formations sensibles.
L’Union européenne, directement engagée dans la négociation au travers du Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune et des Etats de la troïka, a pris des mesures complémentaires, comme la vigilance à l’égard des exportations de produits sensibles ou les relations avec les banques. Toutes s’inscrivaient dans le cadre des résolutions des Nations Unies.
L’impact des sanctions est difficile à mesurer. Il existe une abondante littérature sur le degré de gêne subi par l’économie et la société iraniennes. Le rapport n° 1324 précité de nos collègues M. Jean-Marc Roubaud et Jean-Louis Bianco a fait le point des résultats comme des limites de cette politique et des manières multiples par lesquelles il a été possible de le contourner. Pour l’essentiel, il convient de rappeler les éléments suivants :
• L’Iran représente un partenaire commercial (énergie, cultures vivrières, mécanique…) indispensable et incontournable pour plusieurs pays, au premier rang desquels se trouvent la Chine, le Pakistan, les Emirats arabes unis. A des titres divers, ces pays ne se sont pas empressés d’appliquer les résolutions de l’ONU. Ainsi, dans le domaine financier, il a suffi aux banques iraniennes de recourir à la traditionnelle technique des lettres de change avec des établissements de Dubaï, par le téléphone, pour continuer presque normalement leurs activités internationales. Les Etats-Unis eux-mêmes ont vu leur commerce courant s’accroître avec l’Iran sous la présidence de George W. Bush (cigarettes, instruments de musique).
• Le programme nucléaire iranien est clandestin et s’est poursuivi selon ce mode.
• Le régime des sanctions a certes un impact sur l’économie du pays (crédit plus cher, restriction de l’accès aux technologies du raffinage, pénurie de certains produits), mais le régime de Téhéran n’en a cure. Il n’est pas dans la nature des régimes autoritaires de s’occuper du bien-être de leur population. Croire que des sanctions économiques feront dévier le régime de son objectif principal, pour lequel il a en outre le soutien de sa population, est une illusion.
Il existe deux lectures du bilan des sanctions. La première en montre les limites, dans la mesure où elles n’ont ralenti en rien le programme nucléaire. Il continue de se développer, accompagné de progrès substantiels dans le domaine balistique, et la plupart des experts s’accordent à penser que l’Iran sera en mesure de conduire une explosion souterraine dans une période allant de la fin 2009 au début 2011. La seconde en analyse les effets politiques. Il est indéniable que la montée en puissance des sanctions a créé un doute au sein du régime et qu’un débat s’est ouvert entre ceux qui parient qu’il n’y aura pas in fine d’intervention de type militaire (les pays occidentaux étant déjà engagés en Afghanistan, où ils ont besoin du soutien iranien, et sortant à peine du conflit irakien) et ceux qui la craignent, et qui jugent dangereux pour le régime le ralentissement de l’économie. Il est certain, comme l’ont montré les récentes élections présidentielles, que les Iraniens s’accommodent de moins en moins d’un régime dur (la plupart d’entre eux aspirent à la normalisation des relations avec les pays occidentaux) mais parallèlement, ils sont majoritairement partisans d’un Iran nucléaire.
Il serait toutefois naïf de penser que des sanctions ralentiront ou arrêteront le programme iranien. L’enjeu est à la fois stratégique et historique pour les dirigeants de ce pays. Tant que les intérêts vitaux du pays ne sont pas touchés, ils n’ont aucune obligation de renoncer à leur objectif. Or les principaux opposants à la bombe iranienne (Etats-Unis, pays européens, Israël…) ne peuvent attaquer l’Iran militairement sans provoquer en retour une crise dans le Golfe persique, qui aura des conséquences graves pour leur économie, par la hausse du prix des hydrocarbures. L’Iran peut aussi attiser la tension sur trois dossiers dans lesquels il exerce une large influence : la situation au Liban, l’évolution de la bande de Gaza et l’Ouest de l’Afghanistan (région d’Herat où se trouve une grande communauté chiite) dans laquelle il exerce pour l’heure une influence modératrice et pacificatrice, mais dans laquelle il pourrait aussi offrir un nouveau front aux taliban (32). Il existe une contradiction majeure entre les souhaits des occidentaux sur le rôle qu’ils souhaitent voir jouer à l’Iran (puissance régionale non interventionniste), les objectifs des dirigeants iraniens (puissance intervenant dans les affaires du monde arabe) et le besoin vital qu’a l’économie mondiale de consommer le pétrole et le gaz iranien. En jouant sur cette contradiction, les dirigeants de Téhéran sont en position de force pour mener à bien leur programme nucléaire.
h) Les implications d’un Iran nucléaire pour les Etats-Unis
Puissance militaire dominante au Moyen Orient, les Etats-Unis observent avec attention l’évolution du programme nucléaire iranien. Ils craignent moins le risque d’un conflit (le rapport de force conventionnel et stratégique est largement en leur faveur) que la compétition idéologique avec un régime iranien qui accroîtrait son influence.
La priorité des Etats-Unis est d’assurer la liberté de circulation au détroit d’Ormuz et d’éviter qu’un Iran nucléaire relance la course aux armements au Moyen Orient. La présence de la Vème flotte, dotée de têtes nucléaire, est censée répondre à la première priorité. Quant à la seconde, la Turquie (publiquement, par la voix de plusieurs responsables) et l’Arabie saoudite (discrètement), toutes deux proches alliées des Etats-Unis, ont laissé entendre qu’elles réagiraient face à un Iran nucléaire.
Les Etats-Unis ont deux options face à l’Iran.
La première consiste à poursuivre le dialogue avec Téhéran en renforçant le régime des sanctions, à un degré tel qu’il menacerait les fondements du pouvoir à Téhéran. Au début du mois d’août 2009, des membres du Département d’Etat ont ainsi proposé un embargo sur l’exportation de produits pétroliers raffinés vers l’Iran. Pour n’avoir pas suffisamment investi dans ses capacités de raffinage, l’Iran dépend de l’étranger pour son approvisionnement en essence. Washington escompte que la crise sociale qui en résulterait serait telle que l’Iran pourrait négocier une sortie de crise. Les Etats-Unis accepteraient un programme nucléaire civil iranien mais exigeraient le strict respect des règles du TNP en retour, ce qui annoncerait le démantèlement de certaines installations, comme Natanz.
A défaut d’intervention directe contre l’Iran, la seconde option serait de s’accommoder d’une nouvelle puissance nucléaire. Ce serait un grave échec diplomatique, mais la stratégie militaire américaine ne s’en trouverait pas fondamentalement modifiée. Le rapport de force entre un Etat disposant de plusieurs milliers de têtes et un autre qui n’en aurait qu’un petit nombre est trop disproportionné. Le rapport de force balistique mettrait également Téhéran dans une situation d’impuissance. Les Etats-Unis pourraient revoir parallèlement avec l’ensemble de leurs alliés de la région leurs accords de défense, qui comprendraient une garantie en cas d’attaque nucléaire. La détention de la bombe serait alors facteur d’isolement pour l’Iran et renforcerait paradoxalement l’influence américaine auprès de pays à la recherche de protections.
Les Etats-Unis ont proposé à plusieurs reprises de reprendre un dialogue direct avec Téhéran, sans réaction favorable de cette dernière. La diabolisation de Washington est en effet un facteur de politique intérieure en Iran.
4) La Corée du Nord ou la survie d’un régime totalitaire
Corée du Nord en bref - Signatrice en 1985 du TNP, dont elle s’est retirée en 2003. - Conduit un programme nucléaire et balistique - Signatrice de la Convention sur les armes chimiques en 1987 - Conduit probablement un programme d’armes chimiques et biologiques. |
La politique étrangère de la Corée du Nord se résume en quelques mots : mettre en œuvre une stratégie de la prolifération qui n’a d’autre objet que la survie de son régime.
Le deuxième essai nucléaire (quelques doutes subsistent sur sa nature, cf encadré sur seize années de tensions) de l’histoire de la Corée du Nord, le 25 mai 2009, précédé le 5 avril du lancement d’une fusée, a alourdi un climat d’insécurité régionale en Extrême Orient. Cette tension est volontairement entretenue par Pyong Yang, qui y voit plusieurs intérêts, le principal étant la survie d’un régime totalitaire à bout de souffle. La population de la Corée du Nord vit dans des conditions dramatiques, marquées par des famines sporadiques et seul fonctionne le système militaro-industriel, qui capte l’essentiel des ressources du pays.
La stratégie de prolifération se décline en deux volets. Doter ou faire croire que le pays se dote de l’arme nucléaire pour exercer un chantage sur la communauté internationale et en retirer des avantages ; exporter les technologies nucléaires et balistiques afin d’en retirer des devises et de mettre à mal l’ordre du TNP, considéré comme un instrument de la politique des Etats-Unis.
a) Un produit de la guerre froide
La Corée du Nord s’est intéressée à la technologie nucléaire, ainsi qu’aux recherches sur la biologie et la chimie, dès le début de la guerre de Corée, puis dans les années qui ont suivi, notamment lorsque les Etats-Unis ont déployé en 1958 des armes nucléaires en Corée du Sud. Pyong Yang a toujours affirmé que son programme était une réponse à la menace américaine, qui « a pointé près de 1000 têtes vers son territoire ».
Le réseau d’instituts administratifs et de recherches a été mis en place au cours des années 50, avec notamment l’Institut de recherche sur l’énergie atomique, mais le programme n’a concrètement commencé qu’avec l’aide de l’URSS. Des techniciens nord-coréens ont été envoyés en URSS en 1956. Les deux pays ont signé un accord de coopération en 1959 sur les usages pacifiques de l’atome, avec l’engagement des Soviétiques à mettre en place une unité de recherche à Yongbyon-Kun. La coopération s’est intensifiée jusqu’à la crise de Cuba, en 1962.
Bien qu’étant proche sous la guerre froide de l’URSS et de la Chine avec lesquels il avait signé des traités d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle, Kim Il Sung s’interrogeait sur la crédibilité de telles alliances. Il n’était pas satisfait du dénouement de la guerre de Corée et doutait de la détermination soviétique après le recul de Krouchtchev lors de la crise de Cuba. Par ailleurs, la Chine, qui avait conduit avec succès son premier test nucléaire en octobre 1964, refusait de partager sa technologie avec la Corée du Nord. Le comité central du parti communiste nord-coréen a donc décidé au début des années 60 de réduire sa dépendance en armements conventionnels et de recourir aux propres capacités du pays pour accéder aux technologies nucléaires civiles et militaires.
Au début des années 70, la Corée du Nord a acquis un niveau technologique lui permettant de gérer un réacteur de recherche (IRT 2000). Pyong Yang a alors acquis des matériaux pour le retraitement du plutonium auprès de l’URSS. En juillet 1977, la Corée du Nord a signé avec l’AIEA et l’URSS un accord de garantie sur l’utilisation de ce plutonium, qui en plaçait l’utilisation sous la surveillance de l’Agence. Les années 80 ont vu un très rapide développement des capacités nord-coréennes de maîtrise de l’ensemble du cycle nucléaire civil (réacteur gaz graphite analogue au réacteur Calder Hall de la Grande-Bretagne, dans les années 50), ainsi que l’acquisition de technologies duales. En 1985, Pyong Yang a signé le TNP en contrepartie de l’aide soviétique pour la construction du quatre centrales à eau légère.
En septembre 1991, le climat s’est considérablement détendu dans la péninsule coréenne, avec l’annonce par le Président Bush du retrait prochain des ADM américaines stationnées en Corée du Sud. En décembre 1991, le Président sud-coréen Roh Tae Woo déclarait que son pays n’abritait plus d’armes nucléaires. Les deux Corée ont alors signé une Déclaration conjointe de dénucléarisation de la péninsule coréenne, par laquelle elles s’engageaient à ne pas « tester, fabriquer, produire, recevoir, abriter, déployer ou utiliser des armes nucléaires ». L’accord devait initialement prévoir des procédures bilatérales d’inspection, mais les deux parties n’ont pas trouvé d’accord en ce domaine. La Corée du Nord a signé un accord de garantie de l’AIEA le 30 janvier 1992, ratifié par l’Assemblée suprême du peuple le 9 avril de la même année. Après six inspections de l’Agence entre mai 1992 et février 1993, la communauté internationale a commencé à nourrir de forts soupçons lorsque l’AIEA s’est vu refuser l’accès à deux sites, déclarés sites militaires par la Corée du Nord et ne pouvant en conséquence entrer dans le champ de l’accord de garantie.
b) Un régime politique épuisé utilisant une stratégie de chantage
L’encadré ci-dessous résume les principales étapes de seize années de tensions :
1993 – 2009 : Seize années de tensions - 12 mars 1993 : en désaccord avec l’AIEA, la Corée du Nord annonce son retrait du TNP. Après des négociations avec les Etats-Unis, Pyong Yang renonce à ce retrait mais exige un statut spécial, autorisant l’AIEA à inspecter ses activités actuelles, mais lui déniant le droit de vérifier ses activités passées. - Printemps 1994 : à la suite d’un incendie à la centrale de Yongbyon, la Corée du Nord déplace des crayons combustibles, sans la supervision de l’AIEA. Cet acte aggrave les relations entre les deux parties car elle rend impossible pour l’AIEA la possibilité de procéder à l’historique du réacteur. Le Président Clinton annonce que des sanctions économiques pourraient être demandées au Conseil de sécurité, ce que Pyong Yang qualifie d’acte de guerre. -Juin 1994 : dénouement de la crise, avec la visite à Pyong Yang de l’ancien Président américain Carter. La Corée du Nord accepte de geler la construction de réacteurs gaz graphite, d’autoriser l’AIEA à constater ce gel, de mettre en œuvre la déclaration conjointe de dénucléarisation de la péninsule coréenne et de rester au sein du TNP. En contrepartie, les Etats-Unis acceptent de conduire un consortium international pour la construction de deux centrales à eau légère et à fournir d’ici leur entrée en service 500 000 tonnes de fuel lourd par an. - 1994 – 2001 : difficile application de l’accord. Les Etats-Unis comme l’AIEA se plaignent des reports constants de la Corée du Nord pour la visite de ses installations, tandis que Pyong Yang s’irrite des retards de construction des deux centrales. - 2001 : révision de la politique à l’égard de la Corée du Nord par la nouvelle administration du Président George W. Bush. Washington souhaite notamment une application plus stricte de l’accord de 1994 et la suppression des exportations nord-coréennes de missiles. Cela signifie l’intensification des missions d’inspection de l’AIEA. - 2002 : Les services américains soupçonnent Pyong Yang et Islamabad d’échanger leurs technologies d’enrichissement d’uranium et de missiles. (Un rapport de 2004 jugera que le docteur Khan a vendu des centrifugeuses à la Corée du Nord, à la Libye et à la Syrie). Au mois d’octobre, visite à Pyong Yang de James Kelly, secrétaire d’Etat adjoint pour l’Extrême Orient et l’Océan Pacifique, qui indique à ses homologues coréens Kang Sok Chu et Kim Kye Kwan que Washington est au courant de leur programme d’enrichissement d’uranium. Les Coréens admettent qu’ils conduisent un tel programme, considérant qu’ils ont le droit, s’ils le souhaitent, de fabriquer des armes nucléaires pour se défendre. Les Etats-Unis suspendent leurs livraisons de fuel. La Corée du Nord déclare reprendre l’ensemble de ses activités nucléaires et expulse les inspecteurs de l’AIEA. - 10 janvier 2003 : la Corée du Nord se retire du TNP, tout en déclarant que la reprise de ses activités nucléaires correspond à un objectif civil, sans intention de produire des armes nucléaires. - Printemps 2003 : les services américains détectent des activités d’enrichissement à Yongbyon-Kun. - Avril – août 2003 : le dialogue tripartite (Chine, Corée du Nord, Etats-Unis) commencé à Pékin se transforme en dialogue à six, avec la participation de la Corée du Sud, du Japon et de la Russie. Pyong Yang admet conduire un programme nucléaire mais se tient prête à y mettre fin si les Etats-Unis « cessent leur politique hostile, arrêtent de porter atteinte à la croissance économique nord-coréenne et contribuent aux besoins en énergie de la Corée du Nord ». - Février 2004 – Juillet 2005 : négociations sans résultats. - Avril 2005 : Arrêt par la Corée du Nord d’un réacteur de 5 megawatts et transfert du combustible nucléaire. Mis en service en Février 2003, il a pu produire du plutonium pour 1 à 3 bombes. En Septembre 2005, une image satellite indique que le réacteur reprend ses activités. - 19 septembre 2005 : signature par les six parties d’une déclaration de principes. La Corée du Nord renoncerait à son programme nucléaire et réintègrerait le TNP tandis que les Etats-Unis affirment leur intention de ne procéder à aucune attaque conventionnelle ou nucléaire à l’encontre de la Corée du Nord. Les parties réitèrent leur engagement à ce que la déclaration de dénucléarisation de la péninsule coréenne soit réellement appliquée. - Septembre 2005 – octobre 2006 : remise en question de la déclaration de principes. La Corée du Nord juge que les réacteurs à eau légère ne sont pas dans le champ de l’accord et doivent être construits tandis que Washington considère qu’ils ne peuvent l’être qu’après le démantèlement du programme nord-coréen. Parallèlement, le gouvernement américain annonce des sanctions à l’encontre d’une banque de Macao, Banco Delta Asia, soupçonnée de contrefaçon de dollars au profit de la Corée du Nord. Celle-ci exige que les sanctions soient levées et annonce qu’à défaut, elle ne mettra pas en œuvre l’accord du 19 Septembre. - 9 octobre 2006 : test nucléaire souterrain nord-coréen au mont Mant’Ap. Les experts estiment que la charge était d’un kilotonne alors que la Corée du Nord semblait se diriger vers un test de quatre kilotonnes, ce qui indique qu’elle n’avait pas résolu plusieurs problèmes techniques. Le Conseil de sécurité de l’ONU vote la résolution n° 1718 qui place le pays sous un régime de sanctions. A l’initiative de la Chine, et après d’intenses tractations, les six parties acceptent de reprendre leur dialogue en décembre 2006. Aucun résultat ne sort de cette négociation. - Février 2007 : nouvel accord entre les six parties. La Corée du Nord accepte de renoncer à l’arme nucléaire et de réintégrer le TNP. En contrepartie, les autres pays signataires s’engagent à lui porter assistance dans le domaine de l’énergie. Les Etats-Unis acceptent en outre de restituer 25 millions de dollars à la banque Banco Delta Asia. - Mars 2007 : une délégation de l’AIEA conduite par M. Mohamed El Baradei rencontre les officiels nord-coréens à Pyong Yang pour discuter du programme de démantèlement. - 31 décembre 2007 : non respect par la Corée du Nord de la date limite à laquelle elle devait fournir à l’AIEA la déclaration sur son programme nucléaire. L’AIEA admet néanmoins que de substantiels progrès sont constatés dans le démantèlement d’installations à Yongbyon-Kun. - 26 juin 2008 : la Corée du Nord envoie sa déclaration avec 6 mois de retard. Le document est censé demeurer confidentiel, mais la presse relaie des fuites. La Corée du Nord aurait omis de mentionner son programme d’enrichissement faible d’uranium et son assistance à la Syrie. Le gouvernement américain accepte néanmoins de retirer la Corée du Nord de la liste des Etats terroristes. La Corée du Nord détruit une tour de refroidissement du réacteur de Yongbyon. - Août 2008 : nouvelle phase de tension. La Corée du Nord déclare la remise en route d’activités nucléaires à Yongbyon et en empêche l’accès aux inspecteurs de l’AIEA. Elle critique les Etats-Unis pour le retard pris dans la procédure consistant à la retirer de la liste des Etats soutenant le terrorisme. - 11 octobre 2008 : la Corée du Nord est supprimée de la liste des Etats soutenant le terrorisme. Nouvel échec sur la mise en œuvre d’un protocole permettant la vérification du démantèlement du programme nord-coréen. - 5 avril 2009 : essai d’un missile Taepodong 2 de longue portée, qualifié de tir spatial. Mise en alerte des systèmes anti missiles au Japon. L’essai du 5 avril montre que la Corée du Nord maîtrise la technologie de la séparation d’étages d’un lanceur. - 25 mai 2009 : la Corée du Nord annonce un second test nucléaire. Les Etats-Unis indiquent qu’il a causé une activité sismique d’une magnitude de 4,7 sur l’échelle de Richter, ce qui laisse entendre que la charge oscillait entre 4 et 8 kilotonnes. En France, peu de temps après l’enregistrement sismique, le CEA indique ne détenir aucun élément concret, comme des radionucléides, prouvant la nature nucléaire du test. En août 2009, il n’existe toujours pas pour le CEA de preuve formelle de son caractère nucléaire. La plupart des experts internationaux s’interrogent sur le design de l’engin. Les diplomates des pays membres du Conseil de sécurité estiment pour leur part que l’onde sismique correspond à 2000 tonnes d’explosifs conventionnels placés au fond d’un puit, ce qui exige un travail à la fois considérable et inutile. Même s’il manque la détection de radionucléides, les pays membres du Conseil de sécurité en concluent qu’il s’agit bien d’un essai nucléaire. La France estime que la charge était de 2 kilotonnes. |
Le comportement de la Corée du Nord est rationnel. En analysant les seize années de tensions qui viennent de se dérouler (et qui devraient se poursuivre), il est relativement aisé de dégager les motivations et la tactique de Pyong Yang.
La Corée du Nord est un pays économiquement et socialement épuisé, où seul fonctionne le complexe militaro-industriel. Il existe sans nul doute une exacte coïncidence entre l’appartenance au parti communiste nord-coréen et le fait de travailler au sein de ce complexe. Les deux organes aspirent toutes les ressources de la nation, qui subit des famines périodiques. 200 000 nord-coréens fuient chaque année clandestinement leur pays pour gagner la Chine.
Idéologiquement, politiquement et militairement, la Corée du Nord se sent isolée depuis la disparition de l’URSS et la conversion de la Russie et de la plupart des anciens pays du bloc soviétique à l’économie du marché. Elle assiste avec inquiétude à l’évolution de la Chine, qui bien qu’étant toujours officiellement communiste, s’est également ralliée à l’économie de marché et dont elle dépend étroitement pour l’énergie, l’alimentation et les bien de première nécessité. En dehors de quelques Etats qui lui manifestent verbalement leur sympathie (Cuba, Iran, Belarus…), elle ne dispose d’aucun allié pouvant lui porter une assistance réelle. Les dirigeants nord-coréens veulent l’arme nucléaire pour assurer à la fois la sanctuarisation de leur pays et la survie de leur régime. Lorsqu’ils ont admis en 2003 conduire un programme pour se doter d’ADM, ils ont toujours invoqué l’objet défensif de ce dernier et leur droit inaliénable à se défendre.
Ce programme est loin d’être achevé, au sens où la Corée du Nord a prouvé qu’elle pouvait fabriquer des vecteurs et un engin rudimentaire, mais la plupart des experts s’accordent pour en relever les lacunes techniques. Pyong Yang n’a pas actuellement d’ADM nucléaire opérationnelle. L’intérêt stratégique est le même pour les dirigeants nord-coréens, car le flou entretenu sur leurs capacités nucléaires leur permet de négocier la survie de leur régime.
Le programme nucléaire constitue donc l’instrument d’une politique de chantage pour obtenir des avantages immédiats. La Corée du Nord manque dramatiquement de sources d’énergie pour développer son économie et agite la menace nucléaire pour se faire livrer du pétrole ou arracher la promesse de la construction de centrales sur son sol. Cette politique de nuisance, de chantage, fait peser une menace permanente sur la communauté internationale, qui jusqu’à présent a toujours privilégié le dialogue. Il est vrai qu’elle n’est pas unanime quant au traitement à réserver au régime de Pyong Yang, qui sait jouer des divisions au sein du groupe des six (cf g) ci-après).
La tactique de négociation de la Corée du Nord est proche de celle de l’Iran et consiste à gagner du temps. Depuis seize ans, comme l’a indiqué devant la commission des Affaires étrangères M. Martin Briens, sous-directeur du désarmement et de la non-prolifération au Quai d’Orsay, « plusieurs cycles ont eu lieu selon le même schéma. La Corée du Nord fait monter les enchères avant d’accepter le dialogue et d’en tirer des bénéfices ; puis au moment d’exécuter ses engagements, elle retourne dans un cycle de provocation. Les Sud-Coréens considèrent que c’est là le 5ème ou 6ème cycle de ce type. L’inconvénient est qu’entre temps la Corée du Nord a accompli des progrès techniques ».
Cette stratégie de chantage pourrait néanmoins rencontrer de sérieuses limites. Outre l’aggravation d’un régime de sanctions qui pourrait mettre à mal l’économie nord-coréenne, l’on voit mal comment le régime de Pyong Yang pourrait transformer à terme ses progrès techniques en avantage politique, à l’exception une nouvelle fois d’une capacité de nuisances via les exportations de technologie balistique. Pour le reste, la bombe nucléaire nord-coréenne est loin d’atteindre un design qui en permette l’implantation sur un missile. Elle est pour l’heure inutilisable. A supposer qu’elle le devienne et qu’une vingtaine de têtes soient fabriquées, Pyong Yang disposera d’une capacité de dissuasion du faible au fort, mais la survie du régime n’en sera pas pour autant assurée s’il ne se réforme pas et si son isolement économique se poursuit. L’URSS était une puissance nucléaire quand elle s’est effondrée…
c) L’exportation des technologies pour élargir le front des proliférations
Tout en tirant avantage des incertitudes sur l’état d’avancement de son programme, la Corée du Nord se place résolument en pays proliférateur, en exportant sa technologie nucléaire et balistique. Cette politique lui permet en premier lieu d’acquérir des devises dont le régime a un besoin vital. En second lieu, elle élargit le front des proliférations, qui porte atteinte au TNP, assimilé à un instrument de la politique américaine.
La Corée du Nord a ainsi répondu favorablement à la demande syrienne d’assistance dans le domaine nucléaire au milieu des années 90, après que Moscou puis Pékin eurent décliné l’offre de Damas. Une photographie de la CIA montrait le chef de l’Agence syrienne de l’énergie nucléaire, Ibrahim Othman, aux côtés d’un des responsables du programme nord-coréen Chon Chibu, que l’AIEA connaissait bien et qu’elle n’a plus revu à partir de l’époque où l’on estime que le programme syrien a commencé.
Le réacteur clandestin d’Al Kibar, détruit le 6 septembre 2007 par l’aviation israélienne était construit selon le modèle de celui de Yongbyon et fonctionnait au gaz/graphite, une technologie maîtrisée par la Corée du Nord. La Syrie a rapidement évacué les débris résultant du bombardement pour rendre impossible l’établissement d’un lien entre elle et la Corée… Pour autant, Damas et Pyong Yang nourrissaient des relations de longue date sur les missiles. Les deux pays sont soupçonnés d’avoir placé sur des vecteurs des agents chimiques, pour un usage de théâtre comme pour un usage stratégique.
La Corée du Nord porte également assistance à l’Iran. Le missile iranien Shahab 3 est dérivé du Nodong nord-coréen, et les deux pays rencontrent des difficultés similaires pour les missiles dont la portée est supérieure à 130 km ainsi que pour ceux à plus longue portée.
Au-delà des difficultés comme des résultats techniques, la Corée du Nord, par cette politique, vise à élargir les rapports de dissuasion auxquels les Etats-Unis et dans une moindre mesure les Etats européens, Russie incluse, pourraient se heurter dans leur politique au Moyen-Orient et en Asie. Cette stratégie n’a pas abouti en Syrie, les capacités nucléaires de ce pays ayant été détruites. Elle fonctionne en revanche avec l’Iran, d’autant que les deux pays ont les mêmes intérêts face aux Etats-Unis. En complexifiant la situation dans la péninsule coréenne comme dans le Golfe persique, Pyong Yang accroît les incertitudes auxquelles sont confrontés les stratèges quant aux modalités d’engagement éventuel de leurs forces sur ces théâtres d’opérations. Face à la possibilité pour la Corée comme pour l’Iran de disposer d’une capacité de dissuasion, une partie de la classe politique américaine affirme que le seul moyen pour les grandes puissances de conserver une supériorité stratégique serait la mise en œuvre d’un programme antimissiles.
d) Un arsenal chimique et biologique aussi avancé que l’arsenal nucléaire
La Corée du Nord a toujours dénié avec la dernière énergie être détentrice d’armes chimiques et biologiques. Pourtant, un faisceau d’indices, constitué notamment des témoignages de citoyens ayant fait défection et de saisies de substances sur des cargos, la place parmi les premières puissances disposant de telles ADM.
Dans le domaine chimique, la Corée du Nord entretiendrait de 2500 à 5000 tonnes des principaux gaz (moutarde, sarin, cyanide d’hydrogène…). La production en aurait été accrue ces 20 dernières années. D’après des militaires ayant fui le régime, le missile à courte portée KN 2, le missile à longue portée Nodong et les éléments d’artillerie d’un calibre supérieur à 80 mm seraient en mesure de porter des charges chimiques. Pour sa part, le gouvernement sud-coréen estime qu’un tiers des missiles Scud B, Scud C, Frog 5 et 7…) et de l’artillerie est capable d’emporter une charge chimique. Si ces informations sont véridiques, ces systèmes d’armes créent une menace importante pour la Corée du Sud et le Japon, qui sont des pays dont le territoire est réduit et où la densité de population est importante.
Mis en œuvre dès 1947, le programme chimique s’est d’abord développé avec l’aide chinoise, puis à partir de 1966 avec l’assistance soviétique. D’après les services de renseignement américains, l’arsenal chimique était principalement défensif jusqu’en 1979. C’est après cette date qu’ont été développés des usages offensifs, via les vecteurs balistiques et l’artillerie. Une douzaine d’installations (cf annexe) procèderaient à la fabrication et au stockage des agents chimiques et de leurs précurseurs.
Dans un contexte où les armes chimiques constituent un élément de la survie du régime, au même titre que les ADM nucléaires, le gouvernement sud-coréen n’a jamais pu convaincre les dirigeants de Corée du Nord de signer la Convention sur les armes chimiques. Il semble, toujours d’après des personnes ayant fait défection, qu’un débat ait bien eu lieu au sein des instances dirigeantes de Pyong Yang au début des années 90 sur l’intérêt stratégique de disposer d’un tel arsenal. Kim Jong Il se serait rallié à l’option défendue par les militaires, tendant à le renforcer.
Dans le domaine biologique, la Corée du Nord est signataire de la Convention sur les armes biologiques depuis 1987, mais elle est soupçonnée de ne pas respecter sa signature et d’avoir commencé dans les années 60, puis intensifié dans les années 80, un programme sur de telles armes. C’est par recoupement de témoignages, de saisies en mer et d’analyses de renseignement que la communauté internationale suppose, sans en détenir la preuve formelle, que la Corée du Nord conduit un programme de grande envergure. Le ministère de la Défense de la Corée du Sud évalue de 2000 à 5000 tonnes le stock d’agents biologiques. La Corée du Nord serait en mesure de fabriquer des bactéries diverses : anthrax, choléra, fièvre jaune, peste, salmonelle… Le nombre d’installations les fabriquant et les conservant est inconnu. Le Jane’s les évalue à une dizaine… Comme pour les armes chimiques, la Corée du Sud considère qu’un tiers des vecteurs balistiques et de l’artillerie est en mesure de projeter des charges biologiques.
Les programmes sur les armes chimiques et biologiques seraient conduits par la seconde commission économique et par le cinquième bureau sur l’industrie mécanique, tous deux placés sous la tutelle du ministère des Forces armées du peuple.
e) L’enjeu géopolitique : assurer la sécurité du Japon, « Etat du seuil »
Le programme nucléaire nord-coréen comporte, comme au Moyen-Orient, un risque de prolifération dans les Etats voisins. Il serait en effet difficile pour certains Etats de la région de demeurer sans réaction face aux capacités nucléaires et balistiques de Pyong Yang, notamment le Japon, qui présente la double particularité d’avoir subi le feu nucléaire et d’être, technologiquement, un « Etat du seuil ».
Ce volet du dossier nord-coréen prend place dans un contexte historique et stratégique complexe, dont les principaux éléments sont :
• Le contentieux issu de la colonisation de la Corée par le Japon, de 1905 à 1945, avec son cortège d’évènements douloureux, constitutifs de l’identité nationale coréenne.
• Le refus du Japon de considérer que son occupation de la Corée a constitué un dommage qui légitime des réparations.
• Le contentieux des Japonais enlevés par des Coréens du Nord dans les années 70.
• L’hostilité de principe de Pyong Yang envers Tokyo, considérée comme un allié inconditionnel des Etats-Unis.
Bien que les deux pays entretiennent un commerce relativement actif ainsi que des relations financières (la Corée du Nord est débitrice du Japon), les relations politiques demeurent tendues, marquées par une méfiance réciproque et se limitent à des contacts réduits au minimum. Les tentatives de rapprochement, notamment celle de l’ancien Premier ministre Koizumi en septembre 2002, ont toujours échoué face aux aspects passionnels qui grèvent les relations entre Pyong Yang et Tokyo.
Le Japon est pour sa part dans une situation particulière. La constitution japonaise interdit au pays d’avoir d’autres forces que d’autodéfense. Sa politique nucléaire est strictement civile. Le pays a adopté une politique de désarmement et de non prolifération fondée sur trois piliers : La loi de 1955 sur l’énergie atomique, qui restreint la technologie nucléaire japonaise à un usage exclusivement pacifique, les trois principes de 1968, votés par la Diète (le Japon s’interdit de fabriquer, de détenir ou d’accepter l’introduction sur son sol d’armes nucléaires) et enfin le respect par Tokyo du régime du TNP, auquel elle est partie.
Issu de l’histoire, ce cadre juridique, élaboré à l’époque de la guerre froide et alors que Pyong Yang n’avait pas encore développé son programme nucléaire, a fait l’objet de nombreux débats. Le Japon a en effet la particularité d’être l’un des Etats les plus avancés au monde technologiquement. Il est avec Toshiba et Mitsubishi l’un des leaders mondiaux de l’industrie nucléaire civile et bien que l’alliance américaine ne soit pas remise en question, il existe un courant partisan d’une politique japonaise plus indépendante des Etats-Unis. Celle-ci s’exprime par la réussite économique et par des études constantes sur la revitalisation des forces d’autodéfense japonaises. La signature du TNP par Tokyo avait ainsi donné lieu en 1968 à une étude tenue à l’époque secrète, à l’initiative du Premier ministre M. Sato, afin de déterminer si la nature discriminatoire du traité pouvait avoir un impact sur la sécurité future du Japon et si ce dernier avait intérêt à développer l’arme nucléaire. Le rapport, rendu public en 1994, 26 ans après son élaboration, concluait que l’extension du parapluie nucléaire américain suffisait à assurer la sécurité de l’archipel.
Il reste que le Japon constitue un « Etat du seuil », disposant de toutes les capacités humaines, technologiques et industrielles pour bâtir en quelques mois plusieurs bombes nucléaires et des vecteurs… Une situation que Tokyo, partie au TNP, déclare officiellement ne pas envisager, et qui créerait immédiatement une grave tension avec Pékin, en raison du contentieux non réglé de la seconde guerre mondiale, et également avec Washington, qui n’accepterait pas une nouvelle entorse au TNP et surtout l’émergence d’un Japon redevenue une puissance globale.
Parallèlement, Tokyo ne peut rester sans réagir face à la menace nucléaire et balistique nord-coréenne, alors qu’elle dispose de capacités technologiques supérieures à celles de Pyong Yang. Tout compromis, toute reconnaissance du fait nucléaire nord-coréen serait considéré comme une menace directe. Les alliés du Japon, au premier chef les Etats-Unis, doivent lui garantir sa sécurité pour qu’il ne cède pas à une tentation nucléaire militaire en raison du changement du contexte stratégique en Asie.
L’officialisation de son programme nucléaire par la Corée du Nord et les essais balistiques qui l’ont accompagnés, qui, pour certains, ont frôlé l’espace aérien du Japon, ont en effet radicalisé la position japonaise. Le régime de Pyong Yang, perçu comme imprévisible et auteur d’un chantage diplomatique, représente une menace directe pour la sécurité de l’archipel. Les essais nord-coréens placent en outre à chaque fois Tokyo dans une situation inconfortable, car ils ont lieu dans un environnement de guerre froide, dans lequel le Japon subit les avantages, mais aussi les inconvénients d’être l’allié des Etats-Unis. Le Japon dispose de peu de marges de manœuvre pour une politique autonome avec la Corée du Nord et doit s’en remettre aux Etats-Unis, malgré la crispation de son opinion publique.
C’est sur le terrain balistique que s’est portée la réaction japonaise face à la politique nord-coréenne. L’essai du missile Taepodong 1 par la Corée du Nord en 1998 avait éveillé l’intérêt de Tokyo pour la technologie anti missile. L’accélération du programme nucléaire et balistique de Pyong Yang a concomitamment conduit à l’accélération du programme balistique japonais.
Pour des raisons autant juridiques que stratégiques, le programme anti missile de Tokyo est conduit en totale intégration au programme des Etats-Unis, ces derniers bénéficiant en sus de l’apport non négligeable des hautes technologies japonaises. L’on peut donc parler de stratégie anti missile américano-japonaise même s’il s’agit officiellement de la seule politique de défense du Japon. En décembre 2003, le gouvernement japonais a décidé l’acquisition de matériels de défense balistique, avant de se joindre en 2005 au programme de recherche conduit par les Etats-Unis. En octobre 2006, après avoir adapté sa législation, le gouvernement a accepté le déploiement de missiles PAC 3 américains (Patriot advanced capabilities 3) sur son sol, à la base Kadena dans l’île d’Okinawa, en réaction quasi immédiate au test balistique de la Corée du Nord de juillet 2006. Il s’agissait de la première phase d’un programme gouvernemental consistant à sécuriser d’ici à mars 2011 les principales villes japonaises, la force d’autodéfense ayant en effet conduit avec succès un test d’interception avec un PAC 3 le 17 septembre 2008 à White Sands, au Nouveau Mexique.
Le Japon est également partenaire du système anti missile américain Aegis, qui se déclenche à partir d’unités navales. Il a été le second pays après les Etats-Unis à conduire, en décembre 2007, avec succès un test à l’encontre d’un missile conçu comme le vecteur nord-coréen Nodong. Le test a été effectué en coopération avec l’Agence américaine anti missile, à partir du navire militaire Kongo. Bien qu’un second test ait échoué en octobre 2008, le Japon envisage de développer le système Aegis sur 3 autres destroyers (Chokai, Myoko et Kirishima).
A la suite du test de missile opéré par la Corée du Nord en juillet 2006, et constatant parallèlement les progrès de la Chine dans le domaine spatial, le Japon a publié une nouvelle législation sur l’utilisation de l’espace, le 27 août 2008, l’autorisant à fabriquer, acquérir et déployer tous les moyens (vecteurs, satellites) pour assurer sa défense.
Le test balistique nord-coréen du 5 avril 2009 a créé une vive tension entre Tokyo et Pyong Yang. Tokyo a déployé des batteries de missiles anti missiles en prévision de ce test, en demandant à Pyong Yang de s’en abstenir, tandis que cette dernière avertissait qu’elle considèrerait comme un acte de guerre toute interception. La tension n’est pas allée au-delà de la joute verbale.
La politique américano-japonaise anti missile n’a pas dissuadé pour l’heure la Corée du Nord de poursuivre son programme nucléaire. Tel n’est d’ailleurs pas son objet. Elle est en revanche suffisante pour écarter la plus grande partie de l’opinion publique et des forces politiques japonaises de la tentation de mettre au point une arme nucléaire qui signerait un retour de Tokyo à une politique d’indépendance nationale en matière de défense.
f) Le Japon, allié stratégique des Etats-Unis en cas de conflit contre la Corée du Nord ou contre la Chine
Si les essais nucléaires et balistiques de Pyong Yang ont convaincu les responsables japonais et leurs alliés américains d’accélérer la protection de l’archipel, ils ont induit d’autres changements, qui ont renforcé le lien opérationnel entre Tokyo et Washington, et placé le Japon au premier rang des alliés stratégiques des Etats-Unis face à la Corée du Nord ou à la Chine.
Bien qu’étant technologiquement un pays très avancé, le Japon ne pouvait mettre en œuvre seul, dans des délais rapides, un programme anti missiles. Sa seule solution était de s’intégrer au système américain pour assurer sa défense face à la menace nord-coréenne. Cette intégration a de facto modifié la nature de la politique de défense du Japon.
Le déploiement de missiles PAC 3 autour des principales villes japonaises, évoqué par vos Rapporteurs, avait au départ un caractère purement symbolique, car il ne s’accompagnait d’aucun système d’alerte national dont le pays était dépourvu. Seule l’intégration au système américain permettait la détection puis la réaction à une menace éventuelle de la Corée du Nord.
Le prépositionnement de forces américaines sur le territoire japonais et à proximité (VIIème flotte), dotées de vecteurs anti missiles d’un niveau équivalent à ceux utilisés pour la défense des Etats-Unis, a notablement modifié la donne stratégique en Asie. D’une part, les forces étrangères stationnées sur le territoire japonais peuvent servir à d’autres objectifs que la défense de l’archipel. D’autre part, le Japon devient le premier élément d’un système anti missiles que les Etats-Unis espèrent étendre à d’autres parties du monde, notamment à l’Europe de l’Est.
Dans l’immédiat, le système américano-japonais peut avoir d’importantes implications régionales. L’objectif déclaré est certes la protection contre la Corée du Nord, mais la géographie permet d’inclure la Chine parmi les menaces contre lesquelles le Japon comme les Etats-Unis souhaitent se défendre.
La montée en puissance globale de la Chine est l’une des principales préoccupations de la politique extérieure des Etats-Unis. En janvier 2007, Pékin a démontré une nouvelle fois ses capacités en testant avec succès un missile contre l’un de ses satellites météorologiques. Or détruire un tel objet, défilant à 7 km par seconde, suppose un niveau optimal en matière de guidage, qui mettrait à mal en cas de conflit les moyens d’observation et d’alerte des Etats-Unis. Les craintes américaines se portent sur Taiwan, malgré la stratégie affichée par Pékin d’un retour pacifique de l’île au sein de la Chine selon le processus observé à Hong Kong. Les missiles PAC 3 comme les vecteurs du système Aegis pourraient devenir un élément de défense en cas d’attaque chinoise sur Taiwan au moyen de missiles… Il s’agit pour l’heure, évidemment, d’une simple hypothèse...
g) Un jeu diplomatique entre la Chine, les Etats-Unis, la Corée du Nord, la Corée du Sud, la Russie et le Japon
… Autrement appelé le dialogue à six, qui met aux prises des Etats dont les intérêts divergent, ce qui ne favorise pas l’obtention d’une solution diplomatique… La Chine veut à la fois éviter une crise régionale qui suivrait l’effondrement du régime de Pyong Yang et diminuer l’influence américaine en Extrême-Orient, qui constitue son voisinage immédiat. Les Etats-Unis veulent empêcher l’accès de la Corée du Nord à la technologie nucléaire militaire et maintenir leur influence dans une région où ils ont des intérêts cruciaux. La Corée du Nord recherche à toute force sa survie. La Corée du Sud rejette l’idée d’un Etat nucléaire sur sa frontière Nord tout en aspirant à la poursuite d’une politique d’ouverture avec Pyong Yang, indispensable à une éventuelle réunification. La Russie a des positions proches de la Chine sur l’influence américaine en Asie mais n’est pas partisane d’une Corée du Nord nucléarisée. Le Japon, comme la Corée du Sud, rejette également cette idée et par sa coopération avec les Etats-Unis dans le domaine balistique, est devenu un élément de la politique américaine de défense contre Corée du Nord et contre la Chine.
Le jeu chinois est fondamental dans le dossier nord-coréen. L’efficacité de sanctions renforcées contre la Corée du Nord souffre en effet de la faiblesse constituée par l’ambiguïté de la politique de la Chine à l’égard de son voisin. Même si la proximité idéologique entre Pékin et Pyong Yang a été mise à mal ces dernières années par la politique volontairement autarcique de la Corée du Nord, la Chine soutient son voisin, qui présente pour elle l’avantage de constituer un glacis face à la Corée du Sud où stationnent des troupes américaines.
Les intérêts de la Chine en Corée du Nord sont importants et croissants. Compte tenu de l’obsession chinoise d’accéder à des matières premières pour alimenter son industrie, Pékin a multiplié les investissements dans le secteur minier. Le commerce entre les deux pays s’est établi à 3 milliards de dollars en 2008, soit une augmentation de 40% en un an. Le commerce sino-nord-coréen atteint désormais en valeur et en volume un niveau supérieur à celui enregistré entre les deux Corée, ce qui rend problématique la stratégie de réunification par l’économie prônée par Séoul et Washington. Le Premier ministre chinois a récemment appelé à un renforcement de ce partenariat économique.
La Chine a également opéré le constat de la faillite du modèle nord-coréen, avec le flux constant de réfugiés qui, chaque année, entrent clandestinement sur son territoire (ce flux est estimé à 200 000). Or tout affaiblissement supplémentaire de l’économie nord-coréenne ne peut qu’accélérer l’effondrement du régime de Pyong Yang, avec le double risque d’une catastrophe humanitaire et d’une politique aventuriste des autorités. Pékin ne souhaite pas d’une crise régionale à ses frontières
Pour ces raisons liminaires, la Chine n’aspire pas à aller plus avant dans le régime de sanctions. Officiellement, elle multiplie les déclarations sévères à l’encontre des dirigeants nord-coréens, mais ses condamnations ne dépassent pas un stade verbal. Pékin a ainsi approuvé la déclaration du Conseil de sécurité qui avait suivi l’essai balistique d’avril 2009 parce que celle-ci n’était pas contraignante et ne comportait pas de nouvelles sanctions. La Chine avait en outre dénié à ce tir la qualité d’essai balistique. Elle propose une stratégie de modération envers la Corée du Nord et considère que la tension dans la région doit autant aux activités prolifératrices de Pyong Yang qu’aux visées dominatrices de Washington. La Chine déclare que sa principale préoccupation demeure l’attitude des Etats-Unis, qui, par ses alliances avec Taiwan et le Japon, maintient une situation de guerre froide en comparaison de laquelle l’accès de la Corée du Nord à la technologie nucléaire est une affaire secondaire. La Chine affirme comprendre la volonté de la Corée du Nord de se doter de l’arme nucléaire pour se préserver des menaces extérieures et maintenir en place son régime. Elle s’est donc limitée à condamner verbalement l’essai nucléaire du 25 mai dernier tout en ajoutant qu’elle comprenait les inquiétudes légitimes de la Corée du Nord.
Il existe clairement une différence d’attitude entre la Chine et les pays occidentaux sur le dossier nord-coréen, due à des divergences d’intérêts. La renonciation de la Corée du Nord à son programme nucléaire en échange de la levée des sanctions ne présente aucun avantage pour Pékin. Elle constituerait un succès diplomatique pour les seuls Etats-Unis, dont les Chinois veulent diminuer l’influence en Extrême Orient. La Chine joue un jeu plus large que le seul dossier nord-coréen. Pékin tient à faire partie d’un règlement de cette question, afin de réaffirmer son rôle en Asie et dispose à cette fin de moyens de pression considérables, le principal étant qu’elle est l’unique fournisseur de pétrole de la Corée du Nord. L’armée nord-coréenne est totalement dépendante du carburant chinois… Elle fournit également 80% des biens de consommation courante et 45% de l’alimentation de son voisin.
Force est de constater qu’elle n’a guère retiré d’avantages de son rôle modérateur. Les tests de 2008 et de 2009 ont été conduits contre son avis. Les divergences idéologiques entre Pyong Yang et Pékin sont si fortes, et la Corée du Nord si jalouse de son indépendance qu’elle préfère un dialogue direct avec Washington, malgré des déclarations permanentes d’hostilité aux Etats-Unis. Pour la Corée du Nord, les Etats-Unis constituent bien la première puissance en Asie et si elle obtenait un accord global sur les questions bilatérales entre les deux pays, cet accord légitimerait le régime et garantirait son indépendance. Cette éventualité ne convient guère à la Corée du Sud, qui recherche la réunification et qui considère que la politique américaine n’a jusqu’à présent obtenu aucun résultat.
Le format d’éventuelles et futures négociations dépend de plusieurs paramètres. Pyong Yang semble souhaiter la reprise d’un dialogue direct avec les Etats-Unis… Les Chinois ne l’acceptent pas, mais feront-ils jouer leurs moyens de pression ? La Corée du Nord hésite à accepter l’entrée de la Chine dans une recherche de règlement, tant par souci d’indépendance que par méfiance envers les visées millénaires de la Chine sur la péninsule coréenne.
Malgré son hostilité à la présence américaine dans la région, la Chine pourrait durcir sa position à l’égard de la Corée du Nord, pour s’affirmer comme l’acteur régional incontournable. Elle pourrait obtenir le soutien de Moscou, hostile à l’apparition d’une nouvelle puissance nucléaire militaire. En revanche, la Corée du Sud comme le Japon craignent la radicalisation qu’un train de sanctions provoquerait en Corée du Nord. Le processus de dialogue à six semble de moins en moins évident…
D - Vers d’autres acteurs nucléaires ?
En dehors des Etats que l’on qualifie d’Etats du seuil, disposant des capacités technologiques pour bâtir un engin nucléaire (Allemagne, Japon, Brésil) sans pour autant s’en doter, existent plusieurs Etats qui souhaitent disposer d’ADM pour des raisons stratégiques. L’Irak a ainsi conduit pendant de longues années un programme qui devait lui assurer une prééminence au Moyen-Orient. Un pays retient actuellement l’attention, la Syrie, revenue sous les feux de l’actualité après le bombardement du réacteur d’Al Kibar, pour laquelle la détention d’une arme stratégique serait un élément capital pour peser sur un règlement de paix au Moyen-Orient. Mais il est également intéressant d’analyser pourquoi un autre pays, la Libye, a renoncé aux ADM pour retrouver des marges de manœuvre sur la scène internationale. L’exemple libyen pourrait en effet s’appliquer à la Syrie dans quelques années, les deux pays ayant comme caractéristique d’avoir une population trop faible pour mener une véritable politique de puissance au-delà de leur voisinage immédiat.
a) Le cas de la Libye, analyse d’une renonciation aux ADM
La Libye a signé le TNP en 1968 sous le régime du roi Idriss. Le colonel Kadhafi, qui l’a renversé l’année suivante, l’a fait ratifier en 1975, tout en étant soupçonné par la communauté internationale de conduire clandestinement un programme nucléaire par hostilité envers Israël et pour prendre le leadership du monde arabe.
Libye en bref - Signatrice du TNP en 1968. - A reconnu en 2003 avoir conduit un programme nucléaire clandestin. - A démantelé en 2004 ses installations nucléaires avec l’assistance des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne. |
Le cas libyen montre les limites qu’un pays peut rencontrer dans la mise au point des technologies nucléaires. Avec une population trop faible et un niveau technologique très bas, la Libye ne devait qu’aux revenus tirés du pétrole la possibilité d’acquérir des stocks d’uranium et des centrifugeuses. Lorsque les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont démantelé les installations libyennes en 2004, ils ont constaté que Tripoli, malgré 30 ans d’efforts, n’avait guère avancé dans la maîtrise de l’atome.
Chronologie résumée de l’histoire nucléaire libyenne - 1970 – 1980 : La Libye cherche à se doter d’ADM en recourant à la fois à l’enrichissement d’uranium et au plutonium. Elle tente de mettre en place une coopération avec le Pakistan en lui fournissant de l’uranium du Niger en échange d’une aide technique. Elle importe ainsi clandestinement 1200 tonnes de minerais d’uranium tirées de mines contrôlées par la France, sans les déclarer à l’AIEA. La période est également marquée par l’échec de sa tentative d’acquisition d’ADM à la Chine et par le refus de la France en 1973, d’accepter une transaction avec Thomson-CSF pour la fourniture de matériels servant à l’enrichissement d’uranium. En 1976, la France et la Libye négocient la vente d’un réacteur nucléaire de 600 megawatts, projet que la France doit abandonner sous les pressions internationales. En revanche, la Libye obtient en 1979 le droit de coopérer avec l’URSS pour des objectifs civils, dans le cadre fixé par l’AIEA. L’URSS achève la construction d’une unité de recherche à Tadjourah, qui permet aux techniciens libyens d’accroître leurs compétences. - 1982 : La Libye cherche à acquérir une unité de fabrication de tetrafluorure d’uranium avec l’aide de la compagnie Belgonucléaire. Les Etats-Unis soupçonnent qu’il s’agit de fabriquer de l’hexafluorure d’uranium, utilisé dans les centrifugeuses à des fins d’enrichissement. Comme la Libye ne dispose d’aucune installation nucléaire justifiant l’installation d’une telle unité, la vente lui est refusée. - 1984 : La Libye réussit à acquérir une unité de recherche sur l’uranium (provenance inconnue). Dans les années 80, elle se livre également à des expériences d’enrichissement d’uranium dans l’unité de recherche nucléaire de Tadjourah. Elle parvient à fabriquer de très petites quantités de plutonium. - 1985 : La Libye exporte quelques kilos d’uranium à un Etat nucléaire et reçoit de cet Etat en retour 39 kilos d’hexafluorure d’uranium. Cet échange n’est pas déclaré à l’AIEA. Les experts américains considèrent que l’Etat en question serait l’URSS ou la Chine. - 1990 – 2003 : Au cours de cette période, la Libye accélère son programme nucléaire. En raison des sanctions dont elle fait l’objet de la part de l’ONU comme des Etats-Unis, et cherchant à profiter des opportunités issues de l’effondrement de l’URSS, elle acquiert de différents pays des éléments pour mettre au point un engin. Elle importe ainsi quelques dizaines de centrifugeuses en provenance d’Europe en 2000 pour les installer à Al Hachan (seules 9 seront en état de marche), puis commande 10 000 centrifugeuses au Pakistan en 2002. En 2003, des composants fabriqués par la société malaise Scomi Precision sont saisis dans un port de Méditerranée, ce qui laisse entendre que la Libye recourt au réseau Khan pour s’équiper. Ce réseau utilise en effet beaucoup la technologie d’entreprises malaises. En 2002, le réseau Khan aurait fourni à Tripoli les plans d’un engin, dont le design était celui d’une bombe chinoise des années 60, repris plus tard par le Pakistan. La Libye déclarera ultérieurement à l’AIEA qu’elle ne disposait à l’époque d’aucun technicien compétent pour exploiter ce plan. - 2003 : Etranglée par l’embargo international et craignant d’être envahie par les Etats-Unis, sous le même prétexte invoqué pour l’attaque de l’Irak, la Libye renonce à son programme nucléaire militaire. |
Il n’est jamais aisé pour un Etat d’opérer un revirement radical de sa politique étrangère, a fortiori quand il s’agit de conduire une montée en puissance globale. La période au cours de laquelle la Libye a voulu se doter d’ADM correspond à sa tentative d’affirmation sur la scène internationale : hostilité à l’égard d’Israël, panafricanisme, souhait d’assurer le leadership du monde arabe… Au début des années 2000, cette politique n’avait donné aucun résultat. Elle isolait le pays et menaçait son régime. A la différence de l’Iran, la Libye n’avait aucun moyen de résistance face aux pressions américaines.
Au milieu des années quatre-vingt, le Président des Etats-Unis Ronald Reagan s’était référé à plusieurs reprises au concept « d’Etat voyou » (Rogue State). Le premier pays auquel il l’a appliqué a été la Libye (conférence de presse du 7 mai 1986). Aucune définition précise n’a été donnée, au départ, de ce concept, pouvant être utilisé à l’encontre de tout pays menaçant la sécurité des Etats-Unis ou ne se conformant pas au système de normes internationales. Il s’est ensuite appliqué à trois autres – Iran, Irak et Corée du Nord – accusés avec la Libye de vouloir acquérir des armes de destruction massive, de soutenir le terrorisme, de gouverner leur population par la terreur et de déclarer publiquement leur animosité à l’égard des Etats-Unis. Face à ces pays, les Etats-Unis ont décidé de mettre en place une politique en deux volets : s’efforcer d’y favoriser un changement de régime ou à défaut, modérer l’attitude des gouvernements en place ; empêcher ces régimes d’acquérir des armes de destruction massive, considérées comme une menace pour la sécurité des Etats-Unis.
L’instrument privilégié de la politique américaine a été l’embargo économique unilatéral en vue d’isoler chaque pays incriminé (même s’il faut garder en mémoire que les Etats-Unis avaient frappé Tripoli, lors d’un raid de F 111 en avril 1986). Ce type d’embargo s’ajoutait, le cas échéant, à des sanctions internationales déjà mises en œuvre et pouvait concerner des compagnies non américaines. Le Congrès a ainsi voté en 1996 la loi de sanctions contre l’Iran et la Libye (Iran/Libya sanctions Act) qui pénalisait les sociétés étrangères qui investissaient dans les industries pétrolières de ces deux pays.
La politique à l’encontre des « Etats voyous » a montré ses limites et n’est plus guère à l’honneur aux Etats-Unis, mais le seul pays qui ait réellement souffert de l’embargo international et des sanctions américaines a été la Libye, dont l’économie s’est effondrée. Par ailleurs, l’intervention américaine en Irak a fait réfléchir les dirigeants libyens sur la pérennité de leur pouvoir, alors même que le colonel Kadhafi, traditionnellement hostile au fondamentalisme islamique, avait été l’un des premiers chefs d’Etat à condamner les attentats du 11 septembre.
Les revirements libyens en politique étrangère n’ont pas eu pour origine une nouvelle conception du monde. Ils tirent leur origine d’un constat de trente ans d’échecs sur la scène internationale, qui ont mis en danger le régime du colonel Kadhafi, menacé à l’extérieur, contesté à l’intérieur. Les changements de politique étrangère ont suivi trois axes :
• la normalisation des relations avec les pays occidentaux ;
• le repositionnement dans le monde arabe ;
• la poursuite d’une politique d’influence en Afrique, mais en utilisant la médiation plutôt que l’intervention militaire.
Le renoncement au terrorisme a été une politique de petits pas, qui a été fonction des pressions que subissait la Libye. Le colonel Kadhafi a commencé par créer un fonds pour les familles des victimes de l’attentat de Lockerbie. Ce n’est que cinq ans après, le 5 avril 1999, après une médiation de M. Nelson Mandela, que la Libye a remis à l’ONU deux suspects (Al-Megrahi et Fhimah) pour qu’ils soient jugés par une juridiction écossaise. La condamnation à la réclusion à perpétuité a été prononcée le 31 janvier 2000 à l’encontre d’Al-Megrahi, Fhimah ayant été acquitté. L’indemnisation des familles des victimes est intervenue plus tardivement, après l’accord du 15 août 2003 entre la Libye, le Royaume-Uni et les Etats-Unis, par lequel la Libye reconnaissait officiellement sa responsabilité dans l’attentat et acceptait de verser 10 millions de dollars par passager ayant péri. Le coût total de l’indemnisation pour l’Etat libyen s’élevait à 2,7 milliards de dollars.
Le règlement de l’affaire du DC-10 d’UTA a suivi un chemin similaire. Après que la Cour d’assises de Paris a condamné le 10 mars 1999 par contumace les six agents libyens reconnus coupables de l’attentat, la France a exigé et obtenu un accord d’indemnisation, signé le 1er septembre 2003. Cette négociation a été néanmoins très ardue car le propre beau-frère du colonel Kadhafi, Abdallah Senoussi (n° 2 des services secrets) figurait parmi les condamnés et la Libye n’était pas disposée au départ à indemniser les victimes françaises à la même hauteur que les victimes anglaises et américaines. Il a fallu que M. Jacques Chirac, Président de la République, menace de recourir au veto dont disposait la France au Conseil de sécurité sur le vote relatif à la levée des sanctions à l’encontre de la Libye pour que l’indemnisation soit établie à un montant considéré comme acceptable par Paris. Le 12 septembre 2003, le Conseil de sécurité vote la fin de l’embargo, par 13 voix pour et 2 abstentions, celles de la France et des Etats-Unis.
Le renoncement aux armes de destruction massive a constitué le second volet de la normalisation des relations avec les Etats-Unis et les autres pays occidentaux. La reprise des liens, notamment avec Washington, était soumise à cette condition. Après réflexion, la Libye a en effet acquis la conviction que le gain politique résultant de l’abandon de l’arme nucléaire était largement supérieur au risque de voir le pays subir le même sort que l’Irak. Renoncer à ce type d’arme était en outre relativement aisé car la Libye n’avait pas atteint un stade très avancé dans son programme, par défaut de techniciens en nombre suffisant. L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), après avoir inspecté les sites libyens, a considéré, dans son rapport du 20 février 2004, que la Libye avait acquis une expérience en matière de conception et de fonctionnement des centrifugeuses mais qu’elle avait mené peu d’expériences avec des matériaux nucléaires.
Le processus de rapprochement avec les Etats-Unis a commencé en 1999, à la fin du mandat du Président Clinton, quand le chef des services secrets libyens a rencontré un envoyé du Président américain. Le colonel Kadhafi a ensuite saisi l’opportunité politique que représentaient pour lui les attentats du 11 septembre 2001 pour déclarer sa solidarité avec les Etats-Unis contre le fondamentalisme et pour déclencher la répression à l’encontre des islamistes libyens. A la fin de l’année 2001, les services secrets libyens ont commencé à coopérer avec les services américains dans la lutte contre le terrorisme.
Pendant l’année 2002, alors que les Etats-Unis cherchaient à constituer une coalition et travaillaient à convaincre l’ONU de déclencher une intervention en Irak, les experts s’accordent à dire que M. Abderrahmane Chalgam, ministre libyen des affaires étrangères, aurait acquis la conviction, après un court passage à Londres, que les Américains auraient abandonné leurs visées sur l’Irak si ce pays avait officiellement déclaré renoncer aux armes de destruction massive. Il semble que ce facteur ait été déterminant dans l’esprit du gouvernement libyen.
La Libye a informé discrètement les Etats-Unis de sa possession de matériaux et de centrifugeuses, sans doute vers l’automne 2003. Les installations où ils étaient rassemblés ont été visitées par les services secrets américains avant l’annonce officielle par la Libye, le 19 décembre 2003, de sa renonciation aux armes de destruction massive. De la fin du mois de décembre 2003 jusqu’à la fin du printemps de 2004, les inspecteurs de l’AIEA (apparemment assistés d’agents américains et britanniques) ont inspecté et démantelé plusieurs sites d’assemblage et évacué de Libye plus d’un millier de centrifugeuses, des centaines de conteneurs d’hexafluorure d’uranium, 20 kg d’uranium enrichi, quelques grammes de plutonium, des missiles à longue portée ainsi que des kilos de documents qui ont permis d’établir les liens de Tripoli avec le réseau Khan ainsi qu’avec des experts allemands, suisses et sud-africains. Le coût de l’opération (démantèlement, transfert du combustible aux Etats-Unis et en Russie, transformation d’unités à objet militaire e installations civiles) a été acquitté par les Etats-Unis et l’AIEA.
Le 23 mars 2004, M. William Burns, secrétaire d’Etat adjoint, effectuait un bref passage à Tripoli pour féliciter la Libye de sa nouvelle attitude sur la scène internationale et promettre le réchauffement des relations avec Washington. Il est vrai que l’attitude libyenne validait la stratégie du Président George W. Bush, qui déclarait laisser aux Etats le choix de s’isoler de la communauté internationale ou d’en respecter les règles et de coopérer avec les Etats-Unis pour assurer leur développement. Le 25 mars, M. Tony Blair, Premier ministre britannique, en visite officielle à Tripoli, s’entretenait avec le colonel Kadhafi. Le 26 mars, Royal Dutch Shell recevait par contrat l’autorisation d’explorer de nouveaux champs pétroliers.
Le processus de démantèlement a néanmoins été assorti d’un incident lorsque l’AIEA a révélé que la Libye avait continué à se faire livrer clandestinement des centrifugeuses 3 mois après avoir renoncé à son programme nucléaire. Tripoli a-t-elle voulu tester l’efficacité des contrôles internationaux ? L’incident n’a pas empêché le Conseil des gouverneurs de l’AIEA de délivrer un satisfecit à la Libye dans son rapport du 10 mars 2005, tout en notant quelques lacunes dans les informations livrées à l’Agence sur le design des engins.
La normalisation des relations entre la Libye et les pays occidentaux a permis la relance des coopérations politiques et des accords commerciaux. La levée de l’embargo européen sur les ventes d’armes à destination de la Libye, le 11 octobre 2004, a en quelque sorte consacré le retour à la Libye sur la scène internationale. Plusieurs contrats commerciaux, civils et militaires ont alors été signés : 26 mars 2004 : contrat de prospection et d’exploitation pétrolière en faveur de Royal Dutch Shell. 11 au 14 avril 2005 : mission du Commissariat à l’énergie atomique en vue d’analyser les coopérations possibles avec la Libye, suivie, en août 2005, d’un projet de mémorandum sur les isotopes médicaux et le dessalement de l’eau de mer. 24 août 2005 : signature d’un accord entre le Bureau libyen de recherche et de développement et les laboratoires américains du département de l’énergie. Novembre 2005 : vente par Boeing de deux 737-800. Décembre 2005 : vente d’hélicoptères italiens par Agusta. 14 au 16 mars 2006 : signature à Tripoli du mémorandum entre le Commissariat à l’énergie atomique et le Bureau libyen de recherche et de développement portant, comme prévu, sur les isotopes médicaux et le dessalement de l’eau de mer à partir d’installation nucléaire. Août 2006 : étude de fabrication en Libye de radio-isotopes par la société Cis-Bio. Septembre 2006 : vente par Boeing d’un 737-800. Mai 2007 : signature par British Petroleum d’un contrat de prospection gazière avec la Libye… Cette liste n’étant pas exhaustive…
Le cas libyen est révélateur de l’analyse rationnelle conduite par un Etat pour assurer sa survie. Dépendante des technologies étrangères pour des problèmes aussi cruciaux que l’énergie et l’eau, incapable de faire face à une éventuelle invasion par une grande puissance, l’intérêt de la Libye était de réintégrer la communauté internationale et de se servir de ses atouts pour se développer. Les ADM ne représentaient plus d’intérêt pour elle.
b) Syrie : l’arme nucléaire à objet limité
Jusqu’en 2007, la Syrie ne figurait dans aucun dossier de prolifération. Signataire dès 1968 du TNP qu’elle a ratifié en 1969, Etat à l’initiative de la proposition sur un Moyen-Orient dénucléarisé, son programme nucléaire civil, considéré comme nécessaire en raison de son manque de ressources pétrolières ou gazières, se déroulait sous la supervision de l’AIEA. C’est donc avec une surprise certaine que la communauté internationale a appris qu’Israël avait bombardé le 6 septembre 2007 une unité dénommée Al Kibar, considérée par les Israéliens et les Américains comme un centre de production de plutonium. Cet évènement a été quasiment passé sous silence (juste de brèves dépêches de presse à l’époque) car il embarrassait à la fois Israël, qui ne voulait pas afficher une nouvelle fois une posture militariste, la Syrie, qui violait le TNP si les informations américaines et israéliennes étaient confirmées, et enfin, l’ensemble des Etats membres de l’AIEA, gardiens du TNP, qui n’avaient rien décelé. C’est en effet un travail de services de renseignements qui a mis au jour l’existence et l’objet de l’unité.
Une fois la surprise passée, l’existence d’Al Kibar trouvait son sens au regard du contexte géopolitique de la Syrie. Certes Damas, confrontée à des menaces extérieures, conduisait une politique étrangère visant à rompre son isolement, notamment auprès des pays occidentaux, afin d’assurer la survie de son régime. Mais parallèlement, ce dernier n’a mené que peu de réformes, a fermement maintenu une alliance de 30 ans avec Téhéran et se trouve toujours juridiquement en état de guerre avec Israël, Etat officieusement nucléaire.
Syrie en bref - Signatrice du TNP dès 1968. - Aurait conduit un programme clandestin de fabrication de plutonium avec l’aide nord-coréenne. |
Le programme civil nucléaire syrien est ancien (depuis les années 70) et n’a jamais inquiété la communauté internationale. L’unique réacteur de recherche (SRR 1), construit par la Chine, est sous surveillance de l’AIEA, de même que les 60 programmes nucléaires civils en cours sur son territoire, en coopération avec la Russie, la Chine, la Belgique et la Suisse. Il est certain (et légitime) que Damas a souhaité bâtir une filière nationale par souci d’indépendance, mais le manque d’experts syriens, d’infrastructures industrielles comme de moyens financiers l’en a constamment empêché. C’est ainsi un problème financier qui a empêché dans les années 80 que soit fabriqué un réacteur, initialement avec la France, puis avec l’URSS.
Dans les années 90, plusieurs projets de coopération avec l’Inde ou l’Argentine ont échoué, en raison des pressions américaines à leur encontre, pour des raisons de politique étrangère. Le seul aboutissement des efforts de Damas a été la fourniture par la Chine du réacteur de recherche SRR 1 précité. Certains experts craignaient une dérive du programme vers un usage militaire, mais aucune preuve n’a jamais été apportée à cette époque. En revanche, Bachar El Assad, actuel chef de l’Etat, a affirmé en 2007 qu’il avait été approché par le réseau Khan en 2001, dont il avait rejeté l’offre.
Si le site d’Al Kibar constituait une unité de production de plutonium, il faut donner acte au gouvernement syrien de sa remarquable discrétion, fort compréhensible dès lors que l’on se souvient que le régime du voisin irakien est tombé sous le prétexte, démenti depuis, de détenir des ADM. Mais les constantes de la politique étrangère de Damas et son environnement géopolitique expliquent aisément pourquoi, malgré son retard technique, la Syrie a cédé à une tentation nucléaire, vraisemblablement avec l’aide de la Corée du Nord.
La Syrie est juridiquement en état de guerre avec Israël, qui a conquis le plateau du Golan. Cette prise place les blindés de Tsahal à moins d’une journée de Damas. Depuis l’arrêt des négociations en 2000, la Syrie s’inquiète de voir les autorités israéliennes invoquer à son encontre la guerre globale contre le terrorisme et répandre périodiquement des menaces d’intervention.
Incapable de reconquérir le plateau du Golan par ses forces conventionnelles, la Syrie recherche sans doute avec Israël une parité de stratégique susceptible d’être prise en considération dans le cas d’un règlement global de paix au Moyen-Orient, plutôt que la fabrication d’un arsenal de théâtre. Mais une partie de la position israélienne, en cas d’un règlement de paix, sera conditionnée par les assurances (certains diront les concessions) que donnera la Syrie sur sa sécurité. D’une importance cruciale en cas de conflit conventionnel, le plateau du Golan perd son intérêt stratégique militaire pour Israël si la Syrie devient une puissance nucléaire. Sa restitution pleine et entière, avec retour des 500 000 réfugiés syriens et pleine souveraineté sur l’eau, pourrait alors être négociée contre un système de prévention des conflits conventionnels (postes d’observation internationaux).
Damas, qui joue un rôle considérable au Moyen-Orient depuis des siècles (sous réserve de l’éclipse qu’ont représentée l’occupation ottomane, puis le mandat français), souhaiterait accroître son rôle de puissance majeure, notamment avec deux partenaires : la Turquie, avec laquelle ses relations sont apaisées, malgré le conflit toujours latent du partage des eaux de l’Euphrate, et l’Iran avec lequel l’unit une alliance d’intérêt de 30 ans. Il n’y a rien de commun entre un pays sunnite dominé par un parti nationaliste laïc et gouverné par une minorité alaouite que l’Ayatollah Khomeiny ne considérait même pas comme musulmane, et une république islamique chiite, si ce n’est la volonté conjointe de contrecarrer les projets américains dans leur région et de favoriser un chaos contrôlé (Denis Bauchard) dans les territoires palestiniens et au Liban pour peser sur Israël comme sur les Etats-Unis. L’Iran, avec la Corée du Nord, aide en outre la Syrie à mettre en place un arsenal balistique. Ces rapprochements ne sont toutefois pas pérennes. La Turquie demeure proche des Etats-Unis et recherche surtout un rôle de médiateur entre Washington et Damas. Son poids démographique, de plus en plus important, est crucial dans le dossier de l’eau. Quant à l’Iran, son interventionnisme en Irak, y compris auprès de la communauté sunnite, peut à terme irriter la Syrie, qui a constaté dans un passé récent qu’un mouvement palestinien qu’elle contrôlait originellement (le Hamas) était désormais plus sensible à l’influence de Téhéran. Elle a donc intérêt à atteindre une parité stratégique de principe avec l’Iran si ce dernier met au point l’arme nucléaire.
Enfin, le régime syrien, que Washington considère toujours avec circonspection, pourrait se garantir d’une intervention américaine grâce à la détention d’ADM.
D’après les photographies de satellites américains, l’unité d’Al Kibar présentait de sérieuses similitudes avec celle de Yongbyon. L’AIEA, qui s’est saisie du dossier, n’a pu recueillir les preuves de l’activité qui y régnait car la Syrie a évacué rapidement les gravats issus du bombardement et a indiqué qu’Al Kibar constituait un site militaire, interdit à toute puissance étrangère et à l’AIEA. Cette dernière n’a rien pu conclure sur ce dossier.
Le cas syrien est emblématique de la tentation de nombreux Etats d’acquérir l’arme nucléaire pour un objet limité et non pour le statut de puissance globale. Malgré la nostalgie d’un passé glorieux (Damas fut l’un des grands foyers économiques et culturels sous la dynastie des Omeyyades), la Syrie, avec 11 millions d’habitants, une base industrielle réduite et des capacités scientifiques limitées, ne peut espérer jouer qu’un rôle régional que personne ne lui conteste. Mais dans ce contexte, la détention d’ADM représente l’atout qui lui confère l’élément de puissance dont elle manque à l’égard de ses principaux voisins. Le déséquilibre conventionnel avec Israël et son incapacité à défendre son propre espace aérien sont tels qu’elle aura de grande difficulté, même clandestinement, à mener à bien de nouveaux programmes sans subir un bombardement. Ce dernier est sans risque pour Israël et les Etats-Unis car à la différence de l’Iran, la Syrie ne peut déstabiliser à elle seule le Moyen-Orient.
Le dossier syrien constitue donc un précédent et un avertissement pour les Etats qui chercheraient à se doter d’armes nucléaires sans moyens conventionnels importants, notamment pour la couverture aérienne de leur territoire, et qui ne disposent pas d’outils de représailles.
Il reste que la réaction israélienne pose une grave question : une fois Al Kibar détectée, pourquoi ne pas avoir alerté l’AIEA ? Les Etats-Unis, qui ont certainement soutenu le bombardement de la centrale, ont-ils voulu lancer un avertissement voilé à d’autres Etats proliférants ?
E – La signification de la menace balistique et de la défense antimissile
Partant du principe que la détention d’ADM est une décision rationnelle des Etats, nous avons privilégié une approche des proliférations par pays plutôt qu’une approche thématique, par type d’arme. Les armes biologiques et chimiques sont en effet en déclin, n’ayant que peu d’effet stratégique. Les attaques cybernétiques sont en revanche appelées à se développer, mais leur ampleur est encore trop faible pour dépasser le cadre d’attaques ponctuelles et géographiquement limitées. Il reste en revanche à évaluer la prolifération balistique, qui constitue le phénomène le plus important dans ce domaine, en raison de ses implications stratégiques.
Si la menace balistique peut être analysée dans le cadre d’une guerre conventionnelle, elle ne prend d’importance que si elle est reliée à des capacités nucléaires, les charges chimiques et biologiques constituant pour l’heure un risque marginal. C’est en effet au regard de cette menace qu’a été développé le concept de défense antimissile.
1) La menace balistique, élément de guerre asymétrique
Contrairement à une idée répandue, la défense antimissile n’est pas l’héritière du programme de guerre des étoiles. Celui-ci, qui visait à élever les capacités stratégiques des Etats-Unis, élargissait le champ de la guerre à l’espace, forçant l’URSS à se lancer dans une course aux équipements militaires qu’elle ne pouvait plus suivre. La défense antimissile part d’un constat opéré en 1998 par le Congrès des Etats-Unis (rapport de la commission présidée par Donald Rumsfeld, alors sénateur), sur la modification des menaces. Alors que pendant longtemps, la technologie des missiles était détenue par les puissances nucléaires, les années 90 ont vu l’apparition de pays capables de mettre au point des missiles à moyenne portée, et s’engageaient aussi dans des programmes de vecteurs à longue portée, alors que la plupart appartenait aux pays en voie de développement. Outre les traditionnelles puissances nucléaires du Conseil de sécurité de l’ONU, l’Iran, la Corée du Nord, Israël, l’Inde, le Pakistan, l’Irak, la Syrie, et dans une moindre mesure la Turquie, l’Arabie saoudite et l’Egypte ont acquis des capacités balistiques, soit en les mettant au point, soit en les achetant plus ou moins ouvertement à la Russie, à la Chine et à la Corée du Nord. Cette nouvelle donnée des relations internationales, qualifiée de prolifération balistique, a montré que des pays à l’économie encore fragile pouvaient maîtriser des technologies considérées comme difficiles comme les lancements, les séparations d’étages, l’usage de carburants solides, le guidage…
Tant que les missiles étaient à courte portée, ils n’étaient considérés que comme des armes tactiques ou de théâtres. A partir du moment où leur portée dépasse 1000 km (Seiji iranien) et que les recherches s’orientent clairement vers des portées de 5000 km, ils deviennent des armes stratégiques.
Même dépourvus de charge nucléaire, les missiles balistiques permettent aux Etats qui les détiennent de conduire des conflits asymétriques. Face à la supériorité conventionnelle ou à la détention d’ADM de leurs adversaires, ils leur permettent de frapper leurs territoires. Ils constituent, en théorie, une forme de dissuasion, encore que celle-ci soit largement sujette à discussion. On ne peut qualifier pour l’heure de menace les capacités balistiques de l’Iran et de la Corée du Nord. S’ils sont proches de mettre au point un engin nucléaire, ils sont loin de pouvoir les produire en quantité significative pour que l’addition de leurs engins nucléaires et de leurs missiles représente un danger. La question peut en revanche trouver son sens s’ils produisaient un arsenal d’une centaine de têtes.
Nous rappelons qu’une menace combine moyens technologiques et intentions agressives. Technologiquement, le Moyen-Orient, l’Europe du Sud et l’Asie du Nord-Est se trouvent désormais sous la menace balistique de nouveaux acteurs, mais l’on observera que ces régions pouvaient déjà être touchées par les missiles des grandes puissances en cas de conflit. Politiquement, la menace reste à démontrer. La Corée du Nord use d’un chantage nucléaire pour sauver son Etat et maintenir une économie sous perfusion. Si un Iran nucléaire représente un rival pour les Etats-Unis et l’Arabie saoudite dans le règlement des affaires du Moyen-Orient, il ne constitue pas une menace pour les pays européens avec lesquels il ne nourrit aucune dissension justifiant une guerre, ni même, au risque que nous soyons perçus comme provocateurs, pour Israël.
La stratégie est néanmoins une discipline qui cherche à percer l’avenir en extrapolant les données du présent. Si les Etats aptes à mettre au point des missiles intercontinentaux fabriquaient un arsenal nucléaire significatif, ils atteindraient une parité stratégique avec les cinq puissances nucléaires du Conseil de sécurité, l’Inde, le Pakistan et Israël. C’est le risque qu’envisagent les Etats-Unis vers 2020 ou 2030. Compte tenu du délai nécessaire à la mise au point d’un système antimissile et sa production industrielle, Washington souhaite poursuivre son programme. La prolifération balistique ne modifie qu’à la marge la doctrine d’emploi des forces nucléaires de chaque Etat. Mais elle signifie la fin de l’ordre international voulu par les pays signataires du TNP.
2) La défense antimissile, élément structurant du concept stratégique et des alliances des Etats-Unis
Les Etats-Unis se sont engagés dans des programmes de défense antimissile sous les mandats du Président Clinton (sous la pression d’un Congrès majoritairement Républicain qui a voté le national missile defense act en 1999) et sous ceux du Président George W. Bush. Près de 80 milliards de dollars ont été dépensés au titre des programmes de recherche depuis 2000. En mettant unilatéralement un terme à leur participation au traité ABM, les Etats-Unis se sont affranchis de toute limite technique dans la conduite de leurs recherches.
Le résultat technique est médian : il est admis que Washington est en mesure de détruire un missile intercontinental avec un missile antimissile par impact direct. Les Américains ont atteint un niveau technologique notable, mais n’ont pas mis en place une défense antimissile capable de parer une attaque massive de la Russie (notion de frappe saturante), seule puissance qui rivalise avec eux. Cette défense demeure en projet, et se trouve même depuis quelques mois sous le feu des critiques d’une partie du Congrès, dont les services de recherche ont mis en cause la fiabilité des résultats livrés par les industriels de l’armement.
Il semble bien que les Etats-Unis poursuivront leurs efforts, malgré (ou en raison) des obstacles techniques qui demeurent. Un tel programme ne peut en effet que bénéficier à l’ensemble de l’industrie américaine, par diffusion du progrès. Cet aspect est majeur. Mais sa réussite permettrait aux Etats-Unis de retrouver dans le domaine nucléaire militaire une supériorité complète. En annihilant la capacité de frappe de tous les Etats qui détiennent des ADM, ils réduiraient à néant le concept de dissuasion. La défense antimissile deviendrait ainsi l’élément central du concept stratégique américain.
Elle devient également l’élément structurant des alliances. Si Washington se préoccupe de sa propre sécurité, plusieurs de ses alliés qui sont à portée de missiles de moyenne portée souhaitent bénéficier de la technologie américaine, notamment la Turquie, les Etats du Golfe persique, le Japon ou Taiwan. Or cette technologie est une addition de systèmes de détection (radar) et de lancement d’intercepteurs. En étant étendue aux alliés des Etats-Unis, elle permet à ces derniers de contrôler les éléments les plus essentiels de leur défense et par ce biais, d’intégrer la stratégie de défense de ces pays à la stratégie américaine. La dépendance des alliés des Etats-Unis à leur égard en est accrue, notamment celle des Etats du Golfe, de Taiwan, du Japon et de l’Est de l’Europe.
L’aspect politique de la défense antimissile, conséquence de l’intégration croissante à un système américain, a été illustré par l’inclusion initiale dans le système de la Pologne et de la République tchèque. L’installation de radars de détection et de lanceurs sur le territoire de deux membres de l’OTAN ne pouvait être considérée comme une agression militaire contre la Russie, car leur position géographique, en Europe de l’Est, rend inefficace l’interception d’un vecteur projeté depuis l’Ouest de la Russie. Elle permettait avant tout de disposer de puissants radars intrusifs « scannant » la totalité de l’espace aérien de l’Ukraine et de l’Ouest de la Russie ; mais elle permettait, aussi, aux Etats-Unis, à la Pologne et à la République tchèque d’établir des relations politiques et militaires très étroites presque aux frontières de la Russie, avec la pérennisation de la présence américaine, ce que ne pouvait admettre Moscou.
Il faut enfin garder à l’esprit que l’architecture d’un système technologiquement intégré est « vendu » clé en main aux pays qui s’y associent. Il s’agit pour les industriels des Etats-Unis d’un avantage compétitif important, la protection de Washington ayant pour contrepartie la vente de matériels américains.
3) Les enjeux politiques pour l’Europe
Alors que la plupart des pays européens sont membres de l’OTAN, donc alliés des Etats-Unis, le développement du système antimissile est d’initiative américaine, unilatéralement, et place l’Europe devant plusieurs questions.
La première d’entre elle consiste à déterminer si l’Europe peut accepter d’être instrumentalisée pour assurer la protection des Etats-Unis contre un ennemi qui n’est pas le sien. La défense antimissile en Europe est tournée vers le Sud, et non contre la Russie, envers laquelle elle est balistiquement inopérante. Elle exige la coordination de plusieurs fonctions : détection, alerte, poursuite et interception. Dans l’architecture retenue pour l’Europe, avant la révision demandée par le Président Obama, les pays concernés étaient la République tchèque, la Pologne, le Royaume-Uni (radars de Fylingdales) et le Danemark (radars de Thulé, au Groenland), mais l’ensemble était (et sera) supervisé par le commandement stratégique américain, dans le Colorado, avec pour objectif la protection du territoire américain.
Plus que le danger iranien encore hypothétique, la seconde interrogation renvoie aux relations de l’Europe avec la Russie. Techniquement, le système anti missile ne vise pas la Russie, et même si cela devenait le cas, 10 à 20 missiles intercepteurs auraient quelques difficultés à parer l’attaque de 1500 missiles russes. En revanche, Washington a donné un prétexte que Moscou a saisi pour remettre en cause l’architecture de sécurité en Europe. Outre la tension verbale qui a présidé aux rapports de Moscou avec Varsovie et Prague, la Russie en a profité pour menacer de se retirer du traité sur les forces nucléaires intermédiaires. Il s’agit certainement d’une demande de l’armée, qui n’a jamais accepté un texte qui la prive de missiles tactiques très utiles sur le théâtre européen, alors qu’elle a mis au point le SS26 Iskander, dont la portée, selon les versions, variera de 300 à 450 km. Le déploiement d’un tel arsenal créerait une menace militaire réelle aux frontières de l’Europe, contre laquelle l’OTAN a peu de capacités de réaction. Compte tenu de la crainte de Moscou de voir les Etats-Unis développer une capacité stratégique supérieure à celle de la Russie, cette dernière n’aurait guère comme autre option que de positionner les SS26 en direction de l’Europe.
Comme l’écrit Guillaume Schlumberger, « l’impact éventuel sur l’Europe… mérite d’être étudié… Le déploiement d’un système de défense américain pourrait requérir dans le futur une coordination à plusieurs niveaux – l’OTAN, l’UE, bilatérale – puisqu’elle offre assurément une protection aux pays européens. Mais il reste à voir si les Etats-Unis seront disposés à engager des pourparlers qui réduiraient en fait leur capacité à utiliser l’élément européen comme ils l’estiment nécessaire pour leur propre protection. En d’autres termes il existe très peu de chances qu’un élément américain déployé en Europe soit intégré dans une défense antimissile européenne … sachant que cette intégration exigerait probablement une quelconque forme européenne de décision quant à l’utilisation du système. Lors d’une conférence de presse le 9 mars 2007, le Président Chirac a mis en garde contre le fait qu’un futur déploiement américain en Europe pourrait créer de nouvelles divisions en Europe. ».
… Sans oublier le fait que chaque pays européen, bilatéralement ou via l’Union européenne, a ses propres intérêts politiques et économiques avec Moscou et que si la sécurité ne se négocie pas – le signal doit être clairement perçu par la Russie – il existe un partenariat entre l’OTAN et la Russie, afin que le dialogue soit permanent et que les tensions soient réduites. La stratégie américaine actuelle n’est pas de nature à rassurer Moscou, et présente l’inopportunité de donner des prétextes politiques à la Russie pour réarmer. Le projet antimissile comportait le risque de relancer la tension sur le continent européen alors qu’il s’agissait de défendre le territoire américain.
La France a longtemps ignoré le débat sur la défense antimissile, au point d’être accusée de surdité intellectuelle. Accepter une telle défense serait donner à nos adversaires l’impression que nous abandonnerions notre politique de dissuasion… Parallèlement, notre pays n’a jamais cessé de suivre le programme de recherche de Washington, avec une parfaite compréhension des enjeux pour notre allié américain. La France ne cherche pas à faire renoncer les Etats-Unis à leur programme de défense antimissiles envers lequel elle est pour sa part réticente, compte tenu de la large majorité qui règne dans la classe politique américaine pour le poursuivre. Elle a également admis qu’un accord serait sans doute conclu avec Moscou sur les missiles stratégiques comme tactiques. Elle a enfin analysé la défense antimissile dans son état actuel, sans lui donner la portée excessive que les lobbies industriels voudraient lui conférer : il s’agit d’un outil supplémentaire, que l’on pourrait utiliser dans l’avenir si son coût financier est supportable et si sa fiabilité technique est prouvée, mais il ne se substitue pas à la dissuasion.
Notre pays souhaite en revanche éviter deux écueils politiques :
– Ne pas être protégé malgré lui par un système dont il n’a pas la maîtrise. La France veut conserver une politique de dissuasion indépendante, ce qui signifie qu’elle détermine elle-même qui menace ses intérêts vitaux et qu’elle décide quand elle déclenche le feu nucléaire, hors de toute intervention de l’OTAN.
– Eviter que le programme de défense américain structure la défense européenne via l’otanisation de la défense antimissile et se substitue à l’émergence d’une Europe de la défense à laquelle elle aspire. Les financements alloués à ce programme risquent de manquer à ceux qui pourraient structurer l’Europe de la défense, et surtout, les Européens financeraient un programme dont ils n’auraient pas la clé de fonctionnement.
4) Remise en cause, mais non abandon
En renonçant au déploiement du système antimissile en Pologne et en République tchèque, les Etats-Unis n’ont pas abandonné leurs projets de défense. Ils en ont juste modifié les modalités. Ils ont constaté avec pragmatisme qu’étendre un système à l’Europe contre un hypothétique Iran nucléaire qui ne dispose encore pas de missiles intercontinentaux leur apportait plus de problèmes que de solutions politiques, alors qu’ils ont besoin de la Russie sur une série de dossiers, notamment pour renforcer si nécessaire les sanctions contre l’Iran, soutenir la guerre en Afghanistan et aboutir avec Moscou à la signature d’un nouveau traité de réduction des armements stratégiques.
La crise financière n’est pas étrangère à cette décision, elle qui impose de réduire les dépenses budgétaires.
Moscou a bien entendu approuvé cette décision, mais sans enthousiasme, puisqu’il s’agit pour les Russes non d’une concession, mais de la réparation d’une erreur. La Russie ne proposera rien en échange, dans l’immédiat, sinon le renoncement à la menace symbolique d’implantation de missiles à Kaliningrad. Les Etats-Unis n’attendent non plus rien de leur côté, estimant qu’il faut préalablement rassurer Moscou avant de rallier les Russes à une vision commune sur le terrorisme et la prolifération nucléaire, malgré le contentieux entre les deux pays. Les Etats-Unis font le pari qu’un accord est possible sur des questions essentielles, parce que les deux pays y trouveront intérêt.
Les Etats-Unis n’ont pas déclaré renoncer au système antimissile. Ils le considèrent indispensable en Asie du Nord-Est et contre l’Iran à long terme, et dans la zone Pacifique contre la Chine, ainsi que pour conserver une supériorité stratégique sur la Russie et la Chine. Dans les mois qui vont suivre, ils vont réfléchir aux nouvelles modalités de son déploiement.
CARTES
Arabie saoudite
Portée maximale du missile CSS-2
(portée maximale estimée 2650 km)
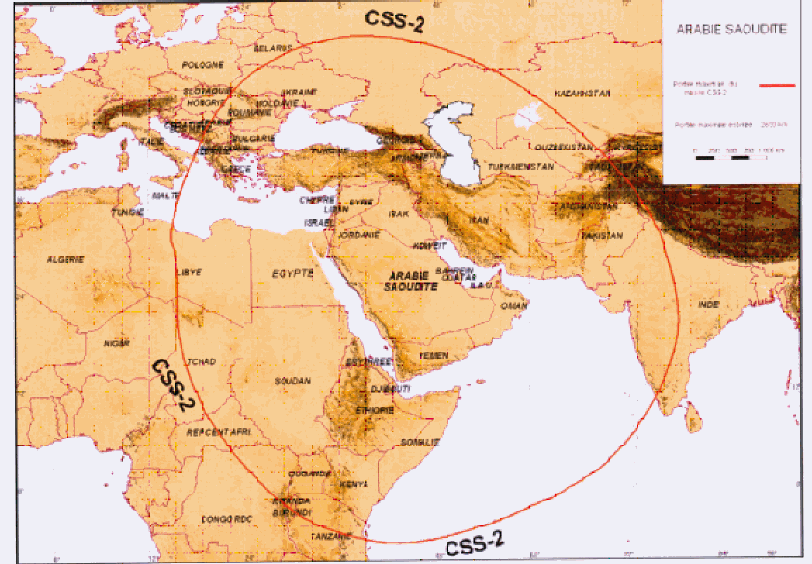
Carte des distances à partir de la Chine
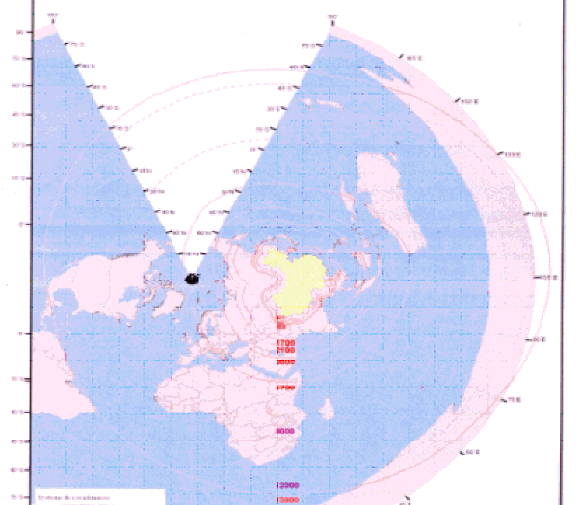
Corée du Nord
Menace balistique en développement
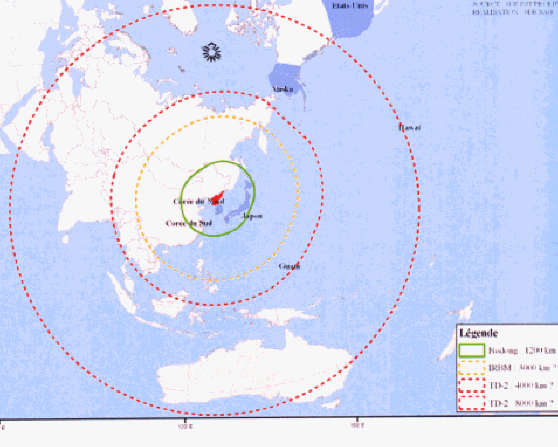
Etats-Unis
Portée de missiles stratégiques ICBM
(portée 13000 km)
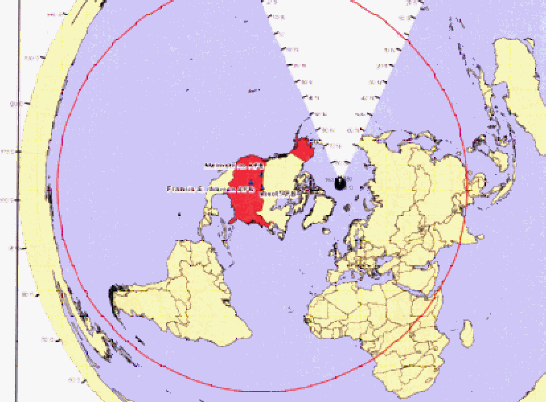
Carte des distances à partir de l’Inde
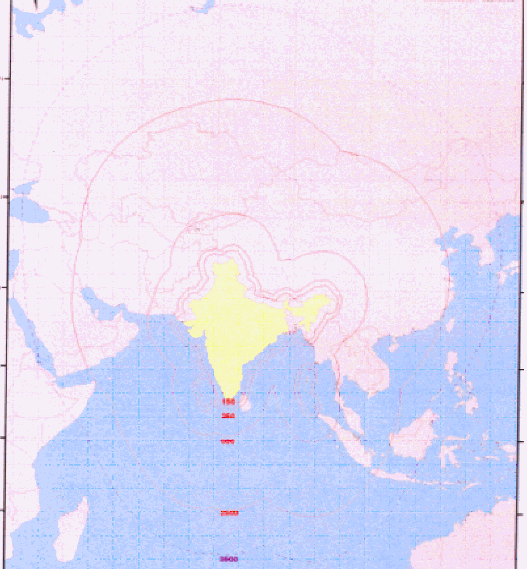
Carte des distances à partir des frontières de l’Iran
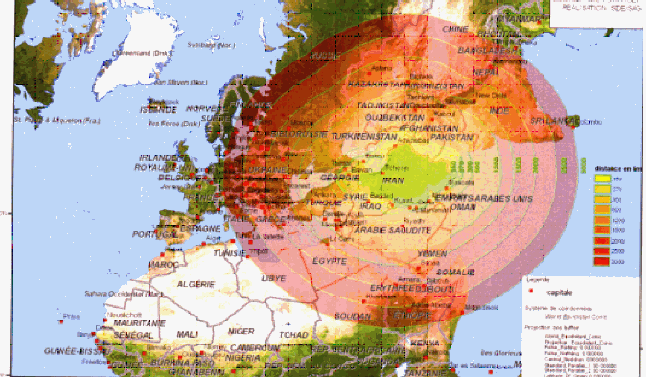
Carte des distances à partir des frontières d’Israël
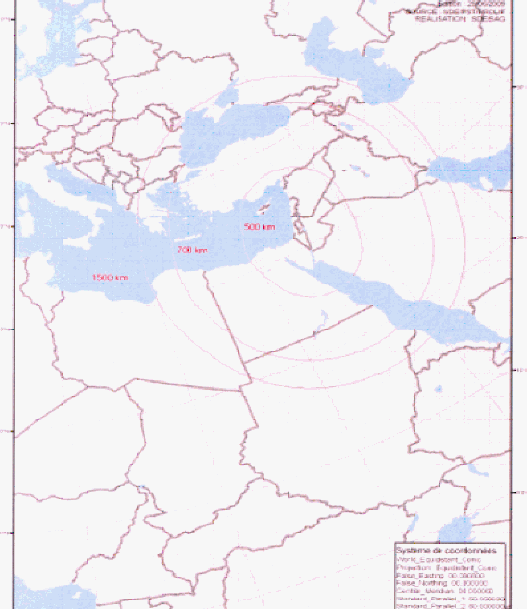
Carte des distances à partir du Pakistan
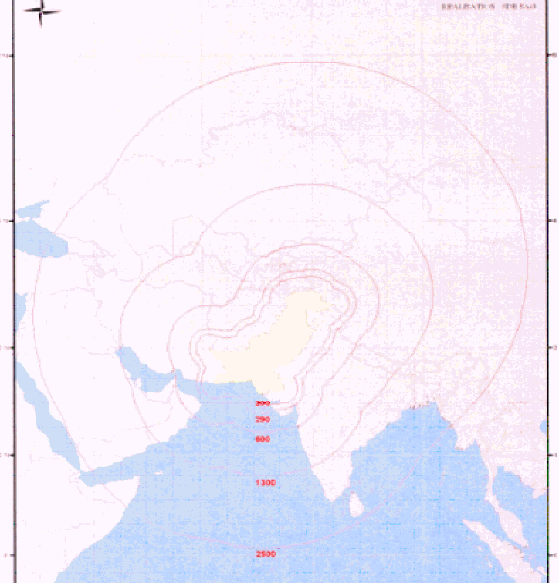
Carte des distances à partir de la Fédération de Russie
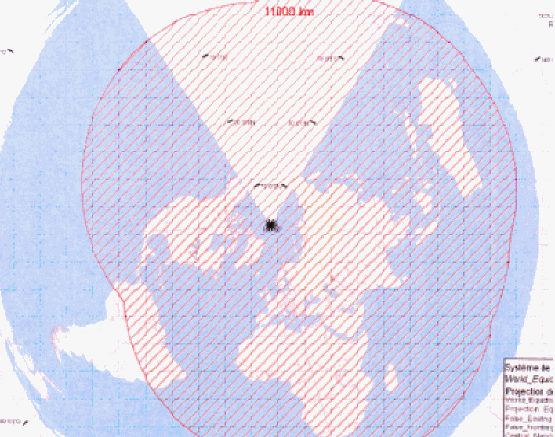
III- LA DISSÉMINATION DES TECHNOLOGIES PROLIFÉRANTES
Les Etats les plus développés ont longtemps été considérés comme les seules puissances capables de mettre au point des armes de destruction massive. L’importance des infrastructures industrielles nécessaires, les difficultés d’approvisionnement frappant les matériaux critiques, la rareté des ressources scientifiques indispensables à la construction d’armes nucléaires, chimiques ou biologiques, rendaient illusoires les tentatives d’appropriation par d’autres acteurs.
Cette situation semble avoir changé, sous l’effet de plusieurs phénomènes. De véritables réseaux de prolifération sont apparus, dont la constitution a été facilitée par la libéralisation des échanges internationaux et la disponibilité croissante des connaissances scientifiques. Ces nouvelles entités ont fait resurgir la menace d’un « terrorisme de destruction massive », qui s’appuierait sur des Etats en marge de la communauté internationale.
En réalité, les terroristes n’ont pas nécessairement besoin d’armes chimiques ou biologiques pour atteindre leurs objectifs, et ils sont, par ailleurs, incapables de fabriquer seuls des armes nucléaires. La dissémination des technologies proliférantes, si elle est aujourd’hui mieux connue après la découverte des réseaux irakien et pakistanais, reste avant tout une affaire d’Etats.
A – Les réseaux de prolifération
L’arraisonnement du navire allemand BBC China, en octobre 2003, qui transportait des centrifugeuses à destination de la Libye, a permis de prendre conscience de l’ampleur du trafic illicite de technologies proliférantes. En Irak comme au Pakistan, de véritables réseaux de prolifération ont été mis sur pied, associant des sociétés écrans contrôlées par l’Etat et des acteurs privés, et jouant sur les failles de la régulation d’un commerce international libéralisé pour poursuivre des objectifs stratégiques.
De nouvelles mesures de contrôle ont été adoptées pour rendre plus difficiles l’organisation de tels réseaux de prolifération, sans réussir pour autant à les supprimer. Au contraire, ces derniers évoluent (33). En revanche, contrairement à ce qui est souvent affirmé, l’existence de réseaux de prolifération totalement privés, et mus par de simples objectifs commerciaux sans lien avec aucune autorité étatique, relève largement de l’illusion.
1) Un phénomène récent contre lequel les textes traditionnels se sont révélés impuissants
L’existence de réseaux parallèles de commerce est concomitante à la mise en place d’embargos sur certains pays ou certains produits. La multiplication des règles internationales de non-prolifération a ainsi conduit certains Etats à développer divers moyens pour contourner les règles qui leur sont imposées, contournements facilités par un contexte général de libéralisation du commerce. La communauté internationale s’est saisie de ce dossier et a adopté des mesures visant explicitement les réseaux de prolifération.
Les réseaux de prolifération peuvent être schématiquement regroupés en deux catégories : les réseaux d’acheteurs et les réseaux de fournisseurs. Bien que ces deux types d’organisations doivent surmonter des contraintes du même ordre, leur structure diffère selon qu’elles doivent répondre à un besoin exprimé par leurs dirigeants (réseaux d’acquisition) ou trouver des demandeurs et adapter leur offre aux besoins (réseaux de vente). L’Irak a dû développer un réseau afin d’acheter les technologies qu’il ne possédait pas. En revanche, la tolérance dont ont fait preuve les autorités vis-à-vis du docteur Abdul Qader Khan lui a permis de transformer son organisation, initialement conçue pour aider le programme nucléaire pakistanais, en réseau mondial de vente de technologies nucléaires.
a) Les réseaux de prolifération dans un contexte de mondialisation
Amorcé durant les années 1980, le succès du libéralisme économique, tant dans les questions intérieures qu’en matière de commerce international, a été grandement accéléré à la chute de l’Union soviétique en 1991. Fortes de l’idée, qui remonte au moins à Montesquieu, que les échanges économiques empêchent la guerre, les grandes puissances ont cherché à promouvoir le libre échange entre tous les territoires, et pour un nombre croissant de produits.
Moins de vingt-cinq ans après ce « triomphe du libre-échange », le Président Chirac, lors du sommet du G8 de 2003 choisit pourtant de faire de la sécurité des échanges un thème central de son intervention. Une telle évolution est liée sans aucun doute aux grave événements intervenus entre 1991 et 2003, qui ont montré comment un commerce dérégulé facilitait l’acquisition d’armes de destruction massive, notamment les technologies nucléaires militaires.
Les éléments rassemblés par l’Iraqi survey group montrent ainsi que l’Irak, a cherché, entre 1991 et 2003, à acquérir des technologies balistiques afin de renforcer son arsenal d’armes de destruction massive. Rendu nécessaire du fait de l’embargo décidé par l’ONU, un réseau clandestin de fournisseurs s’est développé en deux phases, utilisant d’abord des banques jordaniennes pour son financement, puis utilisant les ressources tirées de la vente illicites de pétrole malgré le lancement du programme « Pétrole contre nourriture » en mai 1996 (34).
Dirigé par Saddam Hussein, seul décideur concernant les orientations stratégiques de son pays, le réseau de prolifération irakien reposait sur plusieurs types d’acteurs. Le secrétariat présidentiel et le « Diwan », cabinet du président, exécutaient les décisions du chef de l’Etat. Par ailleurs, le réseau mobilisait des agents des services secrets, utilisés comme coursiers, intermédiaires ou facilitateurs pour l’entrée des marchandises sur le sol irakien. Un rôle primordial a été joué par le MIC, le comité de l’industrie militaire, qui définissait la majeure partie des demandes.
A l’extérieur, des sociétés écrans directement contrôlées par le MIC étaient utilisées pour organiser et couvrir les transactions. L’entreprise Al Basha’ir Trading Company aurait contrôlé plus de 50 % des programmes noués avec la Syrie, qui représentaient l’essentiel des contrats passés par l’Irak. D’autres entreprises, comme Al-Mafakher for Commercial Agencies and Export Company, jouaient un rôle plus marginal.
L’Etat s’appuyait également sur des multinationales détenues par des Irakiens. La société familiale Al Eman aurait ainsi été sollicitée pour faire transiter dans ses comptes les sommes destinées aux programmes proliférants.
Le réseau de prolifération irakien visait principalement à acquérir des éléments technologiques essentiels pour la mise au point de missiles modernes. Entre 1991 et 1996, des sociétés roumaines (Aerofina, Romania Uzinexport) et ukrainiennes (MontElec) ont été sollicitées. Des entreprises et des banques jordaniennes servaient de relais principaux.
A partir de 1996, les ressources apportées par les exportations clandestines de pétrole (qui auraient fourni 8 des 11 milliards de dollars consacrés par l’Irak à son réseau de prolifération) ont permis d’élargir le champ des contacts. La société syrienne SES International remplaça les traditionnels intermédiaires jordaniens, et de nouveaux fournisseurs furent contactés.
La firme bulgare JEFF Company a fourni des biens duaux nécessaires au développement d’un programme balistique (machine-outil, composants de propergols). La création d’une société irako-russe en 1998, ARMOS, a permis de lancer des partenariats avec plusieurs entreprises russes, notamment Rosoboronexport et, dans une moindre mesure, TECHNOMASH. Enfin, la société nord-coréenne Changwang Trading Company a signé des contrats avec plusieurs entités irakiennes en vue de livrer des missiles de longue portée de type Nodong. Tous les contacts noués n’ont pas forcément abouti à des livraisons de matériels ou de technologies. Ainsi, la société chinoise NORINCO a été sollicitée à partir de 2000, sans qu’aucune livraison n’ait été relevée.
Finalement, le réseau irakien a permis d’accélérer le développement de certains missiles, mais les programmes ont été interrompus à la suite de l’invasion américaine de 2003. La chute du régime a fait disparaître les principaux acteurs de ce réseau, dont il n’a pas été prouvé qu’il ait cherché à aider des groupes terroristes, contrairement à ce qui a été avancé lors de la guerre d’Irak.
Parallèlement au réseau irakien se développait le réseau pakistanais, coordonné par le docteur Khan. Son organisation est plus complexe, et évolue dans le temps. Toutefois, malgré une autonomie apparente de plus en plus importante, les décisions stratégiques restent prises en accord avec les autorités, notamment les services secrets pakistanais.
Le docteur Abdul Qader Khan commence ainsi à développer un réseau de fournisseurs, d’intermédiaires et de contacts divers, scientifiques et techniciens, dès les années 1970. En effet, le Pakistan a lancé un programme nucléaire pour répondre à l’essai nucléaire indien en 1974. A la tête des laboratoires de recherche Kahuta (KRL : Kahuta research laboratories), A. Q. Khan connaît personnellement de nombreux spécialistes et des acteurs industriels intervenant à certaines étapes du cycle du combustible.
Dès les années 1980, Khan semble avoir eu l’idée d’utiliser ses contacts pour mettre en place un réseau de fournisseurs de technologies nucléaires. Toutefois, les KRL restent intégrés dans le vaste programme étatique pakistanais, qui repose également sur les infrastructures de la Pakistan Atomic Energy Commission. A partir du milieu des années 1990, Khan décide d’utiliser une partie de ses ressources dans un but purement commercial.
L’originalité du réseau Khan est sa capacité à adapter parfaitement l’offre à la demande de clients que les intermédiaires vont parfois démarcher directement. L’organisation du réseau repose en effet sur un petit nombre de contacts personnels d’A. Q. Khan, et une séparation de certaines fonctions.
Dirigé par une personne privée, ce qui n’est pas une mince originalité, le réseau Khan utilise les infrastructures publiques des KRL mais laisse croire que l’Etat n’intervient pas dans sa gestion. En fait, il est évident que les services secrets ont, au moins, toléré les activités du réseau, et sont sans doute intervenus directement dans les décisions prises, notamment pour le dossier nord-coréen.
Le chef du réseau, A. Q. Khan, joue quant à lui un rôle commercial. Il conclut les principaux contrats, et laisse ensuite ses adjoints utiliser les ressources du réseau pour remplir les obligations contractuelles.
Le principal bras droit de Khan est un Sri-lankais, Buhary Seyed Abu Tahir. Rencontré dans le cadre d’un contrat de climatisation des KRL, B. S. A. Tahir contrôle plusieurs sociétés dubaïotes, notamment le groupe SMB, qui sera l’une des principales sociétés écrans du réseau Khan.
D’autres personnes physiques sont employées par le réseau pour des besoins spécifiques. Le Britannique Peter Griffin, le Suisse d’origine sud-africaine Urs Tinner (qui a participé au programme nucléaire de Pretoria), l’Allemand Gotthard Lerch participent notamment au contrat libyen, en supervisant le travail des sous-traitants sud-africain, malaisien, turc et suisse employés par le réseau Khan pour fournir les plans et les matériels nécessaires à la mise au point d’un centre d’enrichissement pouvant contenir 11 000 centrifugeuses.
Enfin, une myriade de sociétés participent aux activités du réseau. Celles-ci peuvent être classées en trois catégories (35). Certaines sont de pures sociétés écrans, comme le groupe GMB ou Gulf Technical Industries. D’autres, comme les individus cités au paragraphe précédent, assurent un rôle d’intermédiaire entre ces sociétés écrans et les fournisseurs, parfois inconscients de la destination finale des produits qu’ils exportent.
En effet, de nombreuses entreprises ont été utilisées par les intermédiaires pour fournir les ressources nécessaires afin de répondre à la demande des clients, sans toujours savoir la destination des produits qu’elles livraient. L’une des plus actives est située en Malaisie. Il s’agit de Scomi Precision Engineering (SCOPE). Toutefois, si beaucoup de ces entreprises se trouvent dans des Etats où le contrôle des exportations souffre d’imperfections, il est plus étonnant de trouver, dans cette catégorie, plusieurs entreprises européennes, ou leurs filiales.
Ainsi, le réseau Khan est suffisamment bien organisé pour prévoir des systèmes de livraisons et de transferts financiers adaptés à ses interlocuteurs. Les contrats entre intermédiaires, par exemple entre la SMB et la SCOPE, sont payés de manière régulière, par lettres de change ou de crédit. En revanche, à l’intérieur du réseau, la majorité des transactions sont faites en liquide.
Il en va de même pour le transport des marchandises, qui utilise soit des moyens directs depuis le Pakistan, soit une livraison indirecte du Pakistan via Dubaï, soit une livraison indirecte depuis le pays du fournisseur via Dubaï. Dans ce dernier type de trajet, il est très difficile de connaître la destination finale du produit ainsi exporté.
Le réseau Khan propose principalement à ses clients potentiels des solutions complètes dans le domaine de l’enrichissement de l’uranium. Les modalités de l’offre sont ensuite adaptées aux clients. Trois dossiers majeurs ont été mis à jour depuis l’interruption, par la justice, des activités du réseau.
Entre 1994 et 1995, B. S. A. Tahir organise, via sa société dubaïote, la livraison de centrifugeuses vers l’Iran, pour un montant d’environ 3 millions de dollars. Les contacts auraient été pris dès le milieu des années 1980 par Khan lui-même. Il s’agit de centrifugeuses de première génération, baptisées P-1. Les Iraniens obtiennent également les plans des centrifugeuses P-2, ainsi qu’un document expliquant comment transformer l’uranium hautement enrichi en uranium « métal », processus nécessaire à la fabrication de bombes nucléaires.
Les liens avec la Corée du Nord datent également des années 1980. Ils ont été définitivement noués dans le cadre des relations officielles entre Islamabad et Pyongyang au cours de la visite de Benazir Bhutto en Corée, fin 1993. Le réseau Khan aurait fourni à la Corée du Nord des capacités d’enrichissement de l’uranium, de transformation d’uranium en hexafluorure d’uranium (étape préalable nécessaire pour lancer le processus d’enrichissement) ainsi que plusieurs plans d’armes nucléaires. Des ingénieurs des KRL assurent un suivi de ces différentes prestations.
Le contenu de ce contrat a fait l’objet de l’interprétation suivante. La Corée du Nord garantit au Pakistan la vente de plusieurs dizaines de missiles longue portée Nodong avec un lanceur, et accepte également des transferts de technologies importants dans le domaine balistique. Dans le même temps, le gouvernement pakistanais maintient que la transaction nucléaire a été conduite par Khan sans intervention des autorités, ce qui laisse ouvertes les spéculations quant aux contreparties obtenues par la Corée du Nord en échange de son transfert de technologies balistiques, alors même que le Pakistan traversait à cette époque une grave crise économique et financière. L’idée d’un troc technologique paraît donc plausible.
L’opération la plus importante du réseau Khan est sans doute l’aide apportée au programme nucléaire libyen. Les premiers contacts semblent dater de 1997. Quatre missions seront menées par le réseau Khan pour le compte de la Libye :
– Livraison de près de deux tonnes d’hexafluorure d’uranium ;
– Fourniture de centrifugeuses P1 et P2, déjà assemblées ou en pièces détachées ;
– Mise au point des infrastructures nécessaires à la fabrication de centrifugeuses ;
– Vente de plans d’armes nucléaires.
Le montant total des contrats s’élève à plusieurs centaines de millions de dollars. Khan mobilise l’ensemble de son réseau pour honorer cette commande d’un véritable programme intégré d’enrichissement et de militarisation de l’uranium enrichi. C’est à cette occasion que le réseau contacte les experts sud-africain et les intermédiaires britanniques et suisses, notamment pour acheter les produits nécessaires à la construction de l’atelier de fabrication de centrifugeuses.
La démission forcée de Khan, en 2001, de la direction des KRL n’empêche pas son réseau de poursuivre le contrat libyen. Toutefois, l’interception d’une livraison de centrifugeuses en octobre 2003 place l’Etat pakistanais dans une situation très inconfortable. En effet, en 2004, Khan avoue avoir participé à un réseau clandestin d’acquisition de l’arme nucléaire. Pourtant, Khan conserve un statut de héros national au Pakistan, et il est considéré, dans le monde entier, comme le père de la « bombe nucléaire musulmane ».
Le régime pakistanais n’a pas poursuivi le docteur Khan dont les activités de réseau ont été interrompues. Après que Pervez Musharraf lui « pardonne » ses agissements, en février 2004, la Cour suprême pakistanaise lui rend une totale liberté de mouvement au Pakistan par une décision du 2 février 2009. Ses activités ont été trop longtemps liées au programme d’armes de destruction massive pakistanais pour qu’une reprise des poursuites soit envisageable.
La découverte du réseau d’A. Q. Khan a créé un véritable effet de panique. Les experts y ont vu la source d’une prolifération immaîtrisable, et, potentiellement, la possibilité pour des groupes terroristes de mettre la main sur des armes de destruction massive, puisque ces réseaux de prolifération de nouvelle génération n’étaient conduits que par l’appât du gain. Une forte pression a vu le jour en faveur de l’adoption de mesures visant à empêcher la constitution de tels réseaux de prolifération, constatant que les textes existant n’avaient pas suffi.
b) Une régulation des échanges inefficace pour lutter contre les proliférations
Les règles commerciales concernant les technologies et les matières dites « sensibles » touchaient principalement les exportations militaires d’Etats à Etats. Ainsi, dans le domaine nucléaire, quinze Etats ont choisi de mener des discussions entre 1971 et 1974 afin de définir un régime permettant de contrôler les exportations des technologies visées par le traité de non prolifération nucléaire, notamment celles permettant la fabrication de matériaux nucléaires spéciaux. En 1972, deux listes sont adoptées par le groupe, baptisé « comité Zangger » du nom de son premier président. La première vise les matériaux spéciaux, la deuxième concerne les équipements permettant de les produire.
Le 3 septembre 1974, le directeur général de l’AIEA informe tous les Etats membres de l’existence du comité Zangger. Aujourd’hui composé de 37 membres, celui-ci permet donc d’encadrer les exportations à destination des Etats parties au TNP. Dès lors que celles-ci concernent des éléments d’une des deux listes approuvées par le comité, l’AIEA doit être saisie (36).
Cependant, l’absence de tout contrôle des exportations à destination des Etats n’ayant pas signé le TNP est restée une faille majeure du système alors en place. A la suite de l’essai nucléaire indien de 1974, les principaux Etats exportateurs de technologies nucléaires se sont alors réunis pour former le groupe des fournisseurs nucléaires, parfois appelé « club de Londres » en mémoire du lieu de sa première réunion, en novembre 1975.
Le club de Londres vise à faire respecter deux textes concernant, en premier lieu, les exportations de technologies et de matériaux nucléaires, et, en second lieu, plusieurs équipements et éléments technologiques à double usage pouvant être utilisés dans le cadre d’un programme nucléaire. Là encore, un mécanisme de saisine de l’agence internationale pour l’énergie atomique est prévu en cas d’exportations d’un bien visé par ces listes.
Les contrôles mis en place par le groupe des fournisseurs nucléaires couvrent donc un champ matériel et géographique bien plus large que le régime du comité Zangger. Ce dernier n’est toutefois pas tombé en désuétude, car le caractère plus limité des engagements qu’il requiert permet aux Etats encore hésitants de le rejoindre en attendant de décider d’une éventuelle adhésion aux autres éléments du système international de lutte contre la prolifération nucléaire. Toutefois, c’est le club de Londres, aujourd’hui rejoint par 46 Etats, qui constitue l’enceinte la plus active en matière de contrôle des exportations relatives aux technologies nucléaires.
Dans les domaines chimique et biologique, la possibilité de mettre au point un arsenal est largement liée à la production de matériaux duaux. Afin de contrôler ces proliférations, les principaux Etats exportateurs de ces matériaux et technologies avaient choisi de mettre au point un régime multilatéral de contrôle des exportations de produits chimiques dès 1985. Son objet a été étendu au contrôle des exportations de produits bactériologiques en 1990.
Cette instance informelle, baptisée « groupe Australie », réunit aujourd’hui plus de 40 pays, tous parties aux conventions sur les armes biologiques et sur les armes chimiques. Bien qu’il ne puisse adopter de normes contraignantes, le groupe ainsi formé a élaboré, en janvier 2009, des lignes directrices permettant d’orienter les réglementations nationales pour renforcer l’efficacité de la lutte contre la prolifération dans le domaine biologique.
Il existe enfin, dans le domaine balistique, un système encadrant les exportations : le régime de contrôle des technologies missiles, parfois désigné par son acronyme anglophone « MTCR ». Créé en 1987 par sept Etats, dont la France, le MTCR a vocation à encadrer la circulation des technologies permettant la fabrication de vecteurs balistiques d’armes de destruction massive. Regroupant aujourd’hui 34 pays, ce groupe informel a édicté plusieurs lignes directrices visant à contrôler les échanges de technologies balistiques. L’exportation de missiles permettant le transport d’une charge utile de plus de 300 kg à des distances supérieures à 500 km est interdite au titre du MTCR.
Dans tous les domaines, les régimes de contrôle des exportations sont apparus dépassés par l’inventivité des organisations proliférantes. Ces textes ont donné l’impression de contrôler une menace inexistante, à l’instar de ce qui est reproché à l’arrangement de Wassenaar, signé en 1995 et regroupant quarante pays pour contrôler l’exportation de toute technologie militaire ou simplement duale. Celui-ci est souvent regardé plutôt comme un héritage du comité de coordination pour le contrôle des exportations multilatérales (37) (COCOM, coordinating committee for multilateral exports control) qu’un instrument de lutte contre les réseaux de prolifération.
L’appel à des mesures nouvelles s’est donc fait d’autant plus pressant que les réseaux de prolifération ont été regardés, sans doute à tort, comme une première étape conduisant vers le « terrorisme nucléaire ».
2) Des actions inefficaces contre des proliférations encore et toujours étatiques
La découverte du réseau Khan semblait ouvrir un chapitre nouveau, et effrayant, dans l’histoire des proliférations. Des réseaux de prolifération purement privés étaient censés aider des groupes terroristes internationaux pour causer le maximum de dommages dans le seul but de déstabiliser nos sociétés. Aux yeux d’observateurs peu avisés, cette approche semblait crédible, alors même que le réseau Khan peut difficilement être considéré comme étranger à l’appareil étatique pakistanais.
Les mesures adoptées pour faire face à une menace largement mal comprise ont, dès lors, eu un effet contre-productif. En effet, au lieu d’inciter les Etats, qui restent les seules puissances capables et réellement intéressés de se doter d’armes de destruction massive, les textes internationaux les plus récents ont favorisé l’émergence de cercles de prolifération dits « de second rang », associant des Etats qui estiment que le traitement qui leur est réservé est injuste.
Ainsi, la chute du réseau Khan a été considérée, au Pakistan, comme un événement dramatique. Pour de nombreux Pakistanais, le docteur Khan s’est comporté exactement comme les experts occidentaux au cours des années 1930 et 1940. Le programme nucléaire pakistanais a simplement utilisé tous les moyens à sa disposition pour se développer, et les contrats ultérieurs n’ont été conclus que parce qu’une demande d’armes de destruction massive existait en provenance des Etats. La découverte du réseau Khan n’aurait pu faire croire à la naissance d’une prolifération privée si le contexte général n’avait pas été celui d’une crise liée au terrorisme.
a) Des mesures nouvelles adoptées dans un contexte biaisé
En effet, l’apparition de réseaux de prolifération a été mal combattue par les Etats-Unis, qui ont, dans un premier temps, imaginé pouvoir y mettre un terme en assimilant les Etats impliqués à un nouvel « axe du mal ». Employée pour la première fois par Georges W. Bush lors de son discours sur l’état de l’Union du 29 janvier 2002, l’expression désigne expressément les trois Etats accusés de ne pas se plier aux obligations du traité de non prolifération, à savoir l’Irak, l’Iran et la Corée du Nord. De plus, ces Etats étaient considérés comme liés au groupe Al-Qaïda, ce qui revenait à intégrer la lutte contre la prolifération à la « guerre contre le terrorisme ».
Sous la pression des Américains, plusieurs coopérations ont été lancées afin de mettre en commun les moyens étatiques de lutte contre les proliférations, et faisant dès lors de tous les Etats refusant d’y participer de potentiels Etats cibles. Ces initiatives se sont finalement vues donner un cadre par l’Organisation des Nations Unies.
La résolution 1540, adoptée le 28 avril 2004 par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, marque ainsi un tournant dans la lutte contre la prolifération, en ce qu’elle considère, en plus de la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, le trafic de ces armes et des matières connexes comme une menace en soi sur l’équilibre international, du fait de l’accroissement du risque de « terrorisme de destruction massive » qui en découle.
Elle impose donc aux Etats de prendre des mesures effectives dans ces nouveaux domaines de la lutte contre la prolifération. Les Etats sont ainsi obligés d’adopter des législations contraignantes, un comité spécifique, baptisé « comité 1540 » (38), étant chargé de suivre la mise en œuvre de ces stipulations. La résolution prévoit d’apporter une aide aux Etats qui n’arriveraient pas à mettre en place un tel régime de contrôle.
D’autres instances internationales ont également accompagné cette évolution. La stratégie européenne de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, adoptée le 12 décembre 2003 à la demande du Conseil européen de Thessalonique des 19 et 20 juin 2003, permet ainsi de mettre en commun les efforts des Etats européens au titre de la résolution 1540. Elle permet également de mener une action européenne autonome de lutte contre les réseaux de prolifération, puisque les accords de coopération de l’Union européenne avec des Etats tiers contiennent obligatoirement, depuis novembre 2003, une clause de non-prolifération. Les « nouveaux axes d’action de l’Union européenne en matière de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs », adoptés par le Conseil de l’Union le 8 décembre 2008, réactualisent ces objectifs sans changer les outils mis à la disposition de l’Union.
La lutte contre les réseaux de prolifération semblait donc, à l’orée du XXIème siècle, s’imposer comme le nouveau paradigme de la lutte contre les proliférations, au point de parler d’une évolution, du droit de la non-prolifération à celui de la contre-prolifération (39). Il suffisait de s’attaquer aux méthodes employées par les Etats proliférants pour supprimer les risques. C’est d’ailleurs au titre de sa détention d’armes nucléaires et biologiques, et de ses liens supposés avec Al Qaïda, que le régime irakien a été attaqué par une coalition menée par les Etats-Unis.
b) La contre-prolifération, facteur d’injustice ?
Cependant, en se concentrant sur les réseaux de prolifération, une telle réorientation oubliait de traiter le phénomène à la racine. Les réseaux de prolifération n’existent que pour satisfaire une demande latente de la part de certains Etats, chacun poursuivant un objectif particulier. L’Iran cherche ainsi à asseoir sa puissance régionale, et à se prémunir contre des menaces nucléaires proches. La Syrie, juridiquement en guerre avec Israël, cherche autant la parité stratégique avec ce pays, qu’une possibilité d’affirmer son autonomie vis-à-vis de la Turquie ou de l’Iran. En Corée du Nord, le régime poursuit surtout un objectif de survie, non pas tant des structures existantes, mais plutôt du train de vie des dirigeants actuels.
La lutte contre les réseaux de prolifération associant des Etats renvoie, in fine, aux considérations géopolitiques qui entourent la course aux armes de destruction massive. Preuve en est, par exemple, le traitement particulièrement favorable offert par les Etats-Unis à l’Inde. Non signataire du TNP et détentrice avérée d’un arsenal nucléaire, l’Inde a malgré tout pu engager dès 2005 des négociations avec les Etats-Unis pour élaborer un accord de coopération nucléaire civile, dit accord « 123 ».
L’AIEA a approuvé, le 1er août 2008, l’accord de garanties spécifiques proposé par l’Inde. Au titre de l’accord, l’agence sera ainsi habilitée à inspecter les seules installations nucléaires civiles indiennes. Un accord a finalement été signé entre les deux parties le 2 février 2009.
De plus, le 10 septembre 2008, le « club de Londres », autre nom du groupe des fournisseurs nucléaires qui réunit les 47 Etats exportateurs de technologies nucléaires, avait levé l’interdiction d’exportation de produits nucléaires vers l’Inde, seul non signataire du TNP qui bénéficie d’un tel régime.
Forts de ces garanties, la Chambre des représentants, puis le Sénat, ont approuvé la ratification de cet accord par des votes du 28 septembre et du 1er octobre 2008. La signature du texte final de l’accord a eu lieu le 10 octobre 2008.
L’accord américano-indien n’est pas un accord proliférant en tant que tel. Au contraire, il permet d’intégrer un Etat autrefois totalement en-dehors du système international de lutte contre la prolifération, même si les premiers engagements restent partiels. Pour ces mêmes raisons, la France a signé un accord de coopération nucléaire civile avec l’Inde le 30 septembre 2008 dont l’approbation fait actuellement l’objet d’un projet de loi d’autorisation (40).
Si les concessions faites à l’Inde peuvent avoir un effet bénéfique sur la lutte contre les réseaux, épiphénomènes de la prolifération, elles ne modifient pas fondamentalement la situation des Etats demandeurs de technologies. Au contraire, elles indiquent à ces Etats qu’il est possible de développer un programme nucléaire militaire sans pour autant être tenu au ban de la communauté internationale pour une durée indéfinie. Le traitement de faveur indien est d’autant plus critiqué qu’il intervient alors même que l’Inde, qui a noué des liens forts avec les Occidentaux depuis la disparition des blocs, cherche à moderniser sa force armée par l’acquisition de plus de 100 avions de combat. Un accord de coopération de défense et en matière d’armements a d’ailleurs été signé avec les Etats-Unis le 20 juillet 2009.
La crédibilité des mesures lancées après 2003 pour lutter contre la dissémination des technologies proliférantes a été fortement atteinte par certaines décisions ultérieures, laissant apparaître un traitement très différent selon les Etats accusés de prolifération. Leur efficacité est aujourd’hui mise en cause, tant elles paraissent inaptes à empêcher les Etats qui le souhaitent de se doter de technologies militaires.
c) La lutte contre les réseaux renforce les coopérations entre Etats proliférants
Les nouvelles mesures visant à lutter contre les réseaux de prolifération n’ont pas eu les effets escomptés. Au contraire, la structure des réseaux de prolifération de « second rang », qui associe des pays en développement pour l’acquisition d’armes de destruction massive, tend à évoluer. Ainsi, dans le domaine balistique, le schéma suivant illustre bien l’apparition, depuis un modèle traditionnel de prolifération centré autour de la Corée du Nord, de multiples flux de prolifération entre Etats ayant développé avec l’aide de la Corée un programme balistique.
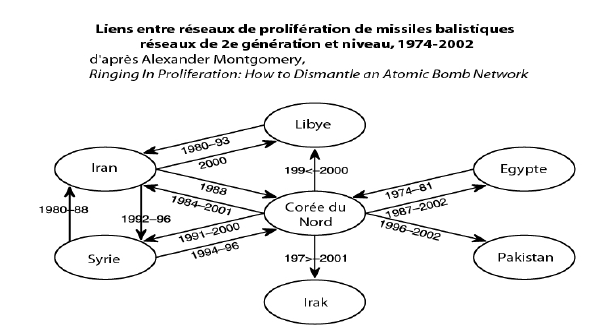
Une telle évolution est plus difficile dans le domaine nucléaire. Aujourd’hui, le programme pakistanais reste le plus avancé. Les difficultés avérées rencontrées par les Nord-Coréens pour achever leurs recherches, en dépit du très relatif succès du dernier essai nucléaire en date, le 25 mai 2009, prouvent que Pyongyang n’est pas encore capable de proposer des offres aussi intégrées que celles du réseau Khan à la fin des années 1990.
Toutefois, la découverte, dans le désert syrien, d’une installation apparemment destinée à un programme nucléaire, a relancé les spéculations. En avril 2008, un raid aérien israélien a procédé à la destruction d’une infrastructure industrielle (Al Kibar) sur le site de Dair Azour, en Syrie. Israël affirmait qu’il s’agissait d’une usine nucléaire, destinée à expérimenter les étapes les plus dangereuses du cycle du combustible, à savoir l’enrichissement et le retraitement du combustible.
Plusieurs missions d’inspection de l’AIEA seront alors dépêchées sur place, et aucun indice sur place ne correspond aux affirmations syriennes selon lesquelles l’uranium trouvé par les premiers inspecteurs serait celui contenu dans les munitions employées par l’armée de l’air israélienne. Depuis cette date, les rapports du directeur général de l’AIEA au bureau des gouverneurs rappellent que la Syrie ne répond pas aux demandes précises qui lui sont adressées concernant l’installation de Dair Azour.
Selon plusieurs services de renseignement, l’usine nucléaire syrienne aurait été construite par des Nord-Coréens. Des ingénieurs et des techniciens étaient présents lors de l’attaque aérienne. Si cette coopération était avérée, elle tendrait à montrer que la prolifération nucléaire, comme celle des missiles, est entrée dans le « nouvel âge » des réseaux de prolifération.
Ainsi, malgré l’existence de textes nouveaux contre les proliférations, la Corée du Nord a aidé de nombreux pays à se doter de technologies balistiques modernes, comme l’Iran ou le Pakistan. Elle serait en train d’élargir son offre à la prolifération nucléaire.
Force est de constater que la demande sur ce véritable « marché noir » de la prolifération reste donc limitée aux Etats, seuls capables de se doter des équipements nécessaires à la fabrication d’armes nucléaires. Or, l’importance accordée à la lutte contre les réseaux de prolifération a longtemps été justifiée par l’idée que ces derniers risquaient de rendre possible l’émergence d’un « terrorisme nucléaire », aux conséquences désastreuses. Il faut pouvoir apprécier la réalité de cette menace avant de déterminer si les mesures destinées à la combattre sont ou non inefficaces.
B - Dissémination des technologies et terrorisme, un risque réel ?
Evoquer le terrorisme dans un rapport sur les proliférations semble disproportionné au premier abord. Concevoir, expérimenter, stocker, sécuriser et mettre le cas échéant en action des armes de destruction massive (ADM) nucléaires, chimiques ou biologiques exige un réseau de scientifique et de techniciens et des capacités de logistiques que seuls les Etats maîtrisent.
Il reste que des indices recueillis par des services de renseignement montrent l’intérêt des groupes terroristes pour les ADM. Cet intérêt met à l’épreuve la pensée stratégique classique, celle développée en Occident. La stratégie moderne, américaine comme européenne, qui garde le souvenir de la seconde guerre mondiale, repose sur l’idée que la vie humaine est précieuse. Le postulat de base de la dissuasion part du principe que l’adversaire ne prendra pas le risque du suicide collectif de sa population en raison des représailles qu’il pourrait encourir.
Or le terrorisme utilise ces dernières années des hommes qui acceptent ou recherchent la mort. Ils y trouvent la noblesse de leur action. La menace de sanctions individuelles graves, comme la peine de mort, est inopérante face à un univers mental différent du nôtre. Nos pays se trouvent face à un combat asymétrique où les méthodes les plus opérantes sont variées : travail de renseignement, usage de la psychologie et de la persuasion pour « retourner » d’éventuels candidats au terrorisme (tactique en usage en Arabie saoudite) et plus généralement, affirmation que notre modèle de société est ouvert et tolérant et qu’il permet à chaque être humain de satisfaire ses aspirations.
Le combat contre le terrorisme a toutefois emprunté d’autres chemins, avec les attentats du 11 septembre 2001. Elle a conduit les Etats-Unis et certains de leurs alliés à conceptualiser une menace réelle – le terrorisme – en lui conférant une portée jusque là jamais atteinte, pour justifier une série d’actions politiques comme l’intervention en Irak qui n’avait trouvé aucun fondement jusqu’à cette date. D’autres pays, notamment la Russie, ont usé du concept à des fins de politique intérieure avec la guerre en Tchétchénie.
Le terrorisme est aussi ancien que la politique, il en constitue l’une des formes. Il a de tout temps usé d’actions spectaculaires et su se servir à l’ère moderne de la presse écrite, audiovisuelle et télématique pour donner le plus large écho à ses objectifs.
On relèvera que si le 11 septembre 2001 nous apparaît comme une date importante dans l’histoire récente, l’intérêt du terrorisme pour toute technologie à fort effet destructeur lui est largement antérieur. La secte Aun, à l’origine des attaques au gaz sarin dans le métro de Tokyo, s’était intéressée à l’arme nucléaire.
Les attentats du 11 septembre 2001 diffèrent de ceux qui les ont précédé par leur mode opératoire. Les membres d’Al-Qaïda ont été en mesure de s’entraîner, puis de coordonner quatre actions dont les cibles étaient politiques (Maison blanche, Capitole, Pentagone), économiques et civiles (World Trade Center). Si le nombre de victimes (plus de 3000) est considérable et suscite une légitime émotion, c’est avant tout le mode opératoire consistant à planifier une opération complexe qui a retenu l’attention des observateurs et des responsables de la sécurité à travers le monde. Al-Qaïda n’a jamais caché son souhait de renouveler un attentat de cette ampleur et de mettre à disposition son savoir-faire à l’ensemble des groupes terroristes, islamistes ou non, afin de créer une internationale terroriste d’autant plus redoutable qu’elle est décentralisée, voire filialisée. La « guerre contre la terreur » est la conséquence logique de la volonté de mouvements terroristes d’agir comme des acteurs globaux. Elle est ainsi devenue un concept couramment usité dans la panoplie de défense des Etats.
L’inquiétude a été d’autant plus grande que plusieurs éléments laissaient penser qu’Al-Qaïda s’intéressait à l’arme nucléaire. Anthony Loyd, journaliste au Times, écrivait dans l’exemplaire du 15 novembre 2001 que des notes écrites en Arabe, Allemand, Anglais et Ourdou avaient été retrouvées à Kaboul, après la chute des taliban, et qu’elles portaient sur la compression du plutonium et sur les réactions des neutrons. George Tenet, ancien directeur de la CIA, a indiqué tenir des preuves de cet intérêt, tandis que Mohamed El Baradei, directeur de l’AIEA, s’adressant le 28 octobre 2008 à l’Assemblée générale des Nations Unies, a déclaré : « La possibilité que des terroristes détiennent du matériel nucléaire ou radioactif demeure une grave menace… Le nombre d’incidents rapportés par l’AIEA, impliquant le vol ou la perte de matériel nucléaire ou radioactif est si élevé qu’il en est préoccupant ». Il semble bien que l’idée d’un attentat nucléaire existe au sein de groupes terroristes. Elle n’est pas pour autant réalisable aussi facilement que certains analystes souhaitent le faire croire… Mais elle n’est pas non plus totalement impossible. En résumé, il importe de faire la part des choses, en distinguant les fantasmes de la réalité.
1) « La guerre contre la terreur », effet des attentats du 11 septembre 2001
La violence des attentats du 11 septembre, qui les apparentent à un acte de guerre, a provoqué en retour une réaction très vive des Etats-Unis. Le Président George W. Bush, 10 jours après les attentats, a déclaré la guerre au terrorisme, avec l’objectif que cette guerre serve à éradiquer ce phénomène qualifié de diabolique. Au-delà de la rhétorique, logique dans des circonstances aussi douloureuses, les Etats-Unis ont forgé un concept qui a été repris par plusieurs Etats. Des attentats de grande ampleur (Londres, Madrid, Moscou) ont en effet montré l’aptitude des groupes terroristes à agir avec succès, créant ainsi un nouveau front pour la sécurité des Etats, obligés de développer leurs services de renseignement et leurs techniques de surveillance pour prévenir de telles attaques et protéger leurs populations.
« Juste cause, mais concept erroné », pour reprendre les termes de l’ambassadeur Gilles Andréani, qui rappelle que le mot « guerre » s’applique essentiellement entre Etats, et qu’il suppose surtout que le conflit ait une fin. Or combattre le terrorisme est d’une part une œuvre de longue haleine surtout lorsqu’il trouve ses racines dans la société ; d’autre part parler de guerre équivaut à donner le statut de combattants aux terroristes – ce qui légitime leur violence – alors qu’il vaudrait mieux les cantonner au rôle de criminels. Les gouvernements français, italiens et allemands, qui faisaient face respectivement dans les années 70 à Action directe, aux Brigades rouges et à la Fraction armée rouge, avaient soigneusement évité d’user de ce qualificatif. Toute l’histoire de la lutte contre le terrorisme est en effet une succession d’actes répressifs, mais aussi d’actes d’ouverture, afin de couper les terroristes de leur base sociale et de trouver une solution politique aux origines du phénomène.
Il est aisément compréhensible que les Etats-Unis, pour des raisons psychologiques, aient invoqué la guerre pour combattre Al-Qaïda et que le concept ait été repris par d’autres pays occidentaux et par la Russie. Il est tout aussi compréhensible que le concept n’ait pas seulement été forgé en réaction au terrorisme international, mais qu’il ait illustré une nouvelle conception des relations internationales, au sein desquelles certains Etats, considérés comme voyous (rough states) pouvaient faire l’objet de frappes préventives simplement parce que Washington estimait qu’ils pouvaient représenter une menace.
L’Europe a une longue habitude des échanges avec l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie du Sud Est. Des millions de ressortissants de ces régions vivent et travaillent sur son sol. Aussi n’admet-elle pas une vision manichéenne, qui ne correspond pas à la réalité et s’apparente à un écho maladroit de la guerre de civilisation telle que décrite par Samuel Huntington. Une telle vision pourrait induire des répercussions entre et à l’intérieur de nos sociétés, en cristallisant des réflexes religieux ou identitaires. Or, comme le souligne Laurent Palou Lacoste, « le facteur culturel dans les relations internationales ne peut être isolé des autres, ni promu sans dommage au rang d’ultima ratio » (41). La guerre contre la terreur est un concept utile lorsqu’elle permet, entre autre, une bonne coordination entre services spéciaux, mais il faut le limiter à ce rôle et non en faire une idéologie. Malheureusement, de 2001 à 2008, les Etats-Unis ont surtout cherché à en faire le fondement idéologique de leur politique extérieure, usant du concept comme d’un paravent pour masquer d’autres objectifs, notamment la nouvelle architecture qu’ils souhaitaient pour le Moyen-Orient.
a) Un concept volontairement manichéen
Les attentats du 11 septembre 2001 ont eu deux effets psychologiques majeurs : ils ont démontré que le territoire américain n’était plus un sanctuaire et ils ont révélé qu’une nouvelle échelle pouvait être atteinte par la violence terroriste. Alors que le terrorisme tuait en moyenne chaque année environ 500 personnes, quelques minutes ont suffi pour faire plus de 3000 victimes au cœur du symbole de la puissance américaine. Seul le concept de guerre était en mesure de s’appliquer à une telle opération pour l’opinion publique, ce qui explique que le Président George W. Bush ait pu l’invoquer si facilement et montrer à la nation américaine qu’il faisait de la lutte contre le terrorisme sa priorité.
En faisant de la guerre contre la terreur la priorité absolue de la politique étrangère américaine, le concept présentait le double avantage de mobiliser l’ensemble de la nation américaine autour du Président et de son programme de sécurité (Patriot Act), et d’exiger des alliés la même solidarité. On relèvera que les alliés de l’OTAN ont effectivement répondu aux attentes américaines en invoquant l’article 5 du traité de Washington et en participant au renversement du régime taliban qui, depuis Kaboul, constituait la principale base arrière d’Al-Qaïda, mais qu’ils ont ensuite agi en ordre dispersé dans l’affaire d’Irak. Le fait que « la mission a fait la coalition » pour reprendre les propos de l’ancien secrétaire d’Etat à la Défense Donald Rumsfeld, et que les Etats membres de l’OTAN n’aient pas constitué la coalition dont rêvaient les Etats-Unis démontre que le concept répondait essentiellement à une stratégie américaine dont l’ensemble des alliés avait parfaitement décodé l’aspect unilatéral, mais que tous n’approuvaient pas.
A la décharge de l’administration des Républicains, fortement critiqué pour son action de cette époque, le manichéisme de sa pensée répondait au manichéisme d’Al Qaida. La nébuleuse terroriste ne cherchait pas en effet à renverser des gouvernements dont elle aurait pris la place ou à s’approprier des richesses stratégiques (motifs classiques de la guerre) mais à détruire une civilisation qu’elle détestait. Face à une idéologie de destruction, l’erreur américaine est sans doute d’avoir opposé une idéologie de guerre là où une réponse politique traitant les sources du terrorisme et prenant en considération l’Islam aurait été plus appropriée.
L’intervention contre le régime taliban du mollah Omar ne constituait que la première phase d’un plan d’ensemble visant à remodeler le Moyen-Orient selon la vision des théoriciens néo-conservateurs. La guerre contre la terreur devenait donc le fondement idéologique d’une action de plus grande ampleur tendant entre autre à sécuriser les approvisionnements pétroliers et à isoler l’Iran. Cette stratégie a débouché sur un échec, mais elle a mis en lumière une réalité objective rarement évoquée par les observateurs : s’il était logique pour les dirigeants d’Al-Qaïda de revendiquer le statut de combattants au nom d’une guerre du monde musulman contre les Etats-Unis et leurs alliés, les Etats-Unis se sont nourris du djihadisme pour bâtir une politique étrangère qui allait au-delà de la seule lutte contre le terrorisme. Quelques uns des dossiers les plus importants en matière de prolifération découlent du concept de guerre contre la terreur, parmi lesquels l’Iran et le bouclier antimissile.
La nouvelle administration américaine met actuellement en place une nouvelle stratégie pour le Moyen-Orient et l’Asie du Sud, mais même si le Président Obama, en déclarant que la lutte contre le terrorisme devait assurer la sécurité des Américains, mais sous l’autorité de la règle de droit, a semblé se démarquer du Patriot Act et du Homeland Security Act votés par le Congrès sous le mandat de son prédécesseur, il n’infléchit que progressivement le concept, en veillant surtout à ne plus faire du terrorisme une caractéristique du monde musulman. La crainte d’un attentat demeure vive en effet aux Etats-Unis et les publications des pouvoirs publics et des think tanks donnent une large place à la possibilité du recours aux ADM par des groupes terroristes. Aussi convient-il d’examiner si cette inquiétude repose sur des fondements rationnels.
b) Une crainte légitime : la difficile sécurisation des matières fissiles et radioactives
La crainte d’un attentat terroriste utilisant des ADM nucléaires vient d’un faisceau de présomptions. Oussama Ben Laden aurait qualifié de devoir religieux le fait d’en acquérir, tandis que George Tenet, ancien directeur de la CIA a indiqué que la direction d’Al-Qaïda était particulièrement désireuse de s’en procurer. Ce type de déclaration vaut à lui seul de mettre sous tension permanente les services de renseignement des pays ciblés par le terrorisme, en application de l’adage selon lequel « nous devons avoir de la chance en permanence tandis que les terroristes, eux, ne doivent en avoir qu’une fois ».
Pour accomplir un attentat nucléaire, les terroristes peuvent procéder de deux façons : s’emparer d’une bombe ou en fabriquer.
Il faut clairement écarter la première possibilité : les armes nucléaires existantes à travers le monde semblent solidement gardées par les Etats qui les détiennent et aucun cas de vol n’a jusqu’ici été constaté. La seule véritable inquiétude concerne le Pakistan, pour lequel les Etats-Unis se veulent en apparence rassurants, tout en faisant preuve de prudence… L’amiral Michael Mullen, chef d’état-major interarmées, a déclaré le 4 mai 2009 que l’arsenal nucléaire d’Islamabad était en sécurité et qu’il ne tomberait pas entre les mains des extrémistes. Il a rappelé que les Etats-Unis avaient lourdement investi dans la sécurisation de cet arsenal. Parallèlement, le gouvernement comme le Congrès américains craignent la déstabilisation possible du régime d’Islamabad, sous la menace des taliban. Washington n’envisage pas réellement que les taliban s’emparent de l’arsenal nucléaire, « mais c’est une inquiétude stratégique que nous partageons tous » a déclaré l’amiral. Les fréquents voyages des diplomates et militaires américains au Pakistan démontrent à quel point il est devenu leur préoccupation centrale en politique étrangère, et l’on peut supposer que les Américains réfléchissent à un nouveau plan de sécurisation des armes pakistanaises si le gouvernement de M. Ali Zardari ne pouvait mettre fin à la guerre civile au Nord du pays.
L’autre véritable inquiétude provient –une nouvelle fois – des Etats-Unis, où les Sénateurs Richard Lugar et Sam Nunn, fondateurs du think tank Nuclear Threat Initiative (NTI), regrettent le fait que la Russie continue à déployer des armes nucléaires tactiques mobiles plutôt que de les regrouper dans des entrepôts étroitement surveillés. La Russie disposerait de 8000 à 10 000 armes de ce type. Mais les Etats-Unis en détiennent environ 3000 sans susciter l’inquiétude du NTI… Faut-il penser que les déclarations des deux Sénateurs précités n’ont pas pour unique objet de combattre la prolifération mais qu’elles visent à affaiblir le dispositif de défense de la Russie ?
Fabriquer une bombe nucléaire est aisé sur le papier. La technologie et les étapes de fabrication en sont largement connues. La réalisation effective est en revanche extrêmement délicate, ce qui exclut qu’un groupe d’individus puisse y procéder (cf le § c du présent chapitre). La première étape pour des terroristes consisterait à trouver de la matière fissile. C’est sans doute l’étape la plus facile du processus de fabrication car celle-ci se trouve en abondance sur notre planète, d’où la nécessité d’en sécuriser le stockage comme le transport. Les stocks mondiaux d’uranium hautement enrichi (UHE) sont évalués entre 1400 et 2000 tonnes et sont dans leur grande majorité gardés par les autorités militaires. 600 à 1200 tonnes se trouveraient dans les armes nucléaires américaines et russes, et quelques centaines de tonnes serviraient à alimenter la propulsion des sous-marins nucléaires pour les décennies à venir. Les militaires ne sont toutefois pas les seuls à détenir de la matière fissile. L’on trouve en effet de l’uranium hautement ou faiblement enrichi au sein de quantités d’organismes civils, à des fins de recherche ou de production d’isotopes médicaux : universités, laboratoires de recherche, hôpitaux… Actuellement, 142 laboratoires de recherche utilisent de l’UHE, dont la moitié se situent en Russie. 28 pays abritent des réacteurs de recherche contenant suffisamment d’UHE pour fabriquer au moins une bombe nucléaire. Ce qui inquiète les organismes travaillant sur la non prolifération est que les campus universitaires et les laboratoires médicaux ne sont pas aussi bien gardés que des centrales nucléaires… Quelques cas de vols, le plus souvent recensés par le NTI, ont été signalés à travers le monde, soit en des quantités minimes, soit en des quantités plus préoccupantes comme à l’Institut Vekua, en Géorgie, dans la province d’Abkhazie.
Outre l’uranium, le plutonium existe en abondance, les réserves mondiales s’élevant environ à 500 tonnes, ce qui permet de fabriquer plus de 60 000 têtes nucléaires. On rappellera que le plutonium n’est pas disponible dans la nature sous forme de minerais, mais qu’il est issu de l’uranium, à l’aide de techniques très complexes. L’on obtient, selon le processus choisi, soit un plutonium de qualité militaire, soit un plutonium qui mélangé à des oxydes d’uranium irradié (MOX) servira de combustible dans des centrales nucléaires. Il est quasiment exclu que des terroristes puissent fabriquer du plutonium. Ils pourraient en revanche s’en procurer car ce combustible doit être retraité lors des phases de transport vers les rares pays qui maîtrisent cette technologie (France, Russie, Royaume-Uni). Or tout transport induit un risque. Il faut surtout veiller à sécuriser les stocks de plutonium militaire et de MOX qui, pour moitié, se trouvent au sein d’unités civiles.
En dehors des matières fissiles, des matières radioactives pourraient être utilisées par des terroristes, notamment le cobalt qui est très répandu dans les hôpitaux pour traiter des maladies comme le cancer. Il est inutile de préciser qu’un hôpital est en général moins bien gardé qu’une centrale nucléaire…
Sécuriser la totalité des stocks de matières fissiles et radioactives s’avère donc une tâche difficile, compte tenu de leur tonnage important et de leur dispersion dans des milliers d’installations. Aussi, sans céder à la moindre psychose, convient-il de saluer à leur juste valeur et d’encourager les politiques tendant à contrôler parfaitement le stockage et le transport de ces matières.
Plusieurs actions ont été mises en œuvre à cette fin, la principale étant le Partenariat mondial de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et des matières connexes, programme créé lors du sommet du G8 de Kananaskis, au Canada. Ce programme comporte 4 volets, dont l’un consacré à la lutte contre le terrorisme. Les Etats signataires, à savoir les membres du G8 auxquels se sont joints 14 autres Etats, se sont engagés à verser 20 milliards de dollars de 2002 à 2012 pour décontaminer des sites et surtout sécuriser le stockage de matières fissiles qui étaient facilement accessibles. La France s’est engagée à verser 750 millions de dollars sur cette période. Notre pays, via AREVA, la DGEMP et le CEA travaille principalement à rénover l’incinérateur de déchets nucléaires solides de Severodvinsk, près d’Arkhangelsk et à contribuer à la fermeture en 2015, après décontamination de l’environnement et sécurisation des matières fissiles, du complexe d’Andreeva et de Gremikha. Cette base désaffectée était utilisée pour la maintenance des sous-marins d’attaque soviétiques, notamment ceux de la classe Alpha propulsés par un réacteur à neutrons rapides refroidi par du métal liquide (alliage bismuth/plomb).
La France agit également dans le cadre du Partenariat mondial en Ukraine où son financement doit permettre, à partir de 2009, de récupérer et reconditionner 5 dépôts de matières radioactives qui ne correspondent plus aux normes actuelles de sûreté.
Le Partenariat global pour l’énergie nucléaire (global nuclear energy partnership, GNEP) agit selon une logique différente de celle du G8. D’initiative américaine, annoncé en février 2006 par le Secrétaire d’Etat à l’Energie Samuel Bodman, il comporte certes un volet de lutte contre le terrorisme par une action sur le recyclage du combustible, mais vise principalement à distinguer la détention de fuel nucléaire de son utilisation, en limitant le nombre d’Etats producteurs, les autres étant utilisateurs. S’il rassemble 26 pays, parmi lesquels les 5 membres du Conseil de sécurité de l’ONU, sa crédibilité est entamée par son objectif politique. Le Congrès des Etats-Unis a toujours été très critique à son encontre et n’a accordé que 120 millions de dollars sur les 250 millions que demandait la présidence.
Le cas de la baie d’Andreeeva
Les sous-marins nucléaires russes déclassés se trouvent dans le Grand Nord de la Russie, dans la région de Mourmansk. La plupart du temps, le combustible irradié est demeuré à bord et présente un intérêt pour des terroristes désireux d’acquérir des bombes sales. Le cas le plus préoccupant demeure la baie d’Andreeva, site de stockage de déchets radioactifs provenant des sous-marins. Le combustible est stocké dans des blocs de bétons eux-mêmes à l’air libre.
La baie d’Andreeva, située sur la mer de Barents, à quelques kilomètres de la frontière septentrionale qui sépare la Russie de la Norvège, concentre des quantités extrêmement dangereuses de matières radioactives, recensées en 1990 par l’association écologiste Belladonna, basée à Saint-Petersbourg. Les déchets (solides, liquides, barres de combustibles usés), issus de la maintenance des réacteurs à eau pressurisée ou du renouvellement du fuel nucléaire, sont concentrés sur des sites pour la plupart saturés. Les solides sont stockés sur la presqu’île de Kola et à Severodvinsk, sur 11 sites différents. Celui de Zapadnaya Litsa est le plus inquiétant, avec 6000 mètres cubes sans réelle protection. Les cuves de stockage ne permettent pas d’éviter les ruissellements qui empoisonnent le sol, la nappe phréatique, l’air… Les liquides sont pour la plupart stockés dans des tankers à l’amarrage, ces navires étant assez anciens (25 ans en moyenne) et n’ayant jamais été conçus pour une telle mission.
La sécurisation et le traitement des sites de stockage sont en cours, mais à un rythme très lent, grâce à la mise en œuvre de partenariats bilatéraux, notamment celui de la Russie avec la Norvège, et de programmes multilatéraux, comme celui du G8.
c) La possibilité d’un attentat terroriste nucléaire : un mythe plus qu’une réalité
La crainte d’un attentat nucléaire par un groupe terroriste est une menace fréquemment évoquée en raison de révélations sur les intentions de certains de ces groupes d’y recourir. S’il faut prendre toute menace au sérieux, il convient d’emblée de rappeler que pour des terroristes, faire part d’une telle intention, en rendre publique l’idée revêt à elle seule un intérêt direct en raison du climat de crainte que leur propos peuvent susciter.
La réalité d’un attentat par des groupes terroristes fabricant une arme nucléaire est largement sujette à caution, dès lors que l’on rappelle qu’il faut au moins une équipe de 200 personnes de haut niveau pour fabriquer une telle arme, à la condition que ces personnes disposent de pièces usinées à quelques microns près, notamment pour les opérations d’enrichissement et qu’elles maîtrisent des technologies aussi sophistiquées que la compression de la matière fissile et son explosion :
– Le préalable indispensable est de se procurer de l’uranium enrichi à 80% ou du plutonium, et d’être capable de comprimer ces matières, à raison de 25 à 30 kg pour l’uranium et 10 kg pour le plutonium. La possession de matière fissile est inutile sans la capacité de la comprimer pour créer une réaction en chaîne. Or comprimer la matière fissile est une technologie très complexe maîtrisée par les seuls ingénieurs des puissances nucléaires.
– L’amorçage comme la mise à feu de cette masse comprimée est encore plus complexe. La technique la plus courante – bombarder du tricium par du deuterium – exige une synchronisation sur 3 milliardièmes de seconde.
Un individu ou un groupe réduit d’individus ne peuvent en aucun cas assurer la fabrication d’une arme nucléaire. Le design d’une bombe (sa taille comme son poids) et la détermination de sa cote (charge qu’elle portera) sont à l’extrême rigueur possibles par quelques personnes disposant des connaissances scientifiques requises. Mais ensuite, le tir froid, qui permet de connaître le comportement de la matière comprimée, nécessite des installations d’essai dont le coût est de plusieurs millions d’euros. Le lancement par missile et la détermination du moment où l’engin explosera sont hors de portée de terroristes qui ne maîtrisent ni la technologie balistique, ni la détonique. En résumé, il existe trop d’obstacles techniques pour que des groupes terroristes envisagent de recourir à l’arme nucléaire.
On rappellera que la mise au point d’une arme nucléaire est une action de long terme. Ainsi, au moment de la première guerre du Golfe, l’Irak, qui disposait d’importants moyens financiers, n’avait pu mettre au point ses techniques d’enrichissement dix ans après avoir lancé son programme. Or les terroristes agissent plutôt en prise avec l’actualité, avec des revendications plus ou moins précises, des exigences de libération de prisonniers, des opérations de représailles. La gamme des armes qu’ils peuvent utiliser, disponibles sur le marché à des coûts très bas, est vaste et le recours à des stratégies complexes, comme des attentats simultanés dans une même ville (Londres, New York) leur permet d’atteindre l’effet qu’ils recherchent, en l’occurrence un important retentissement médiatique.
Il reste la question des groupes terroristes qui ont une vision de long terme, « la catégorie de terroristes de type religieux, millénariste ou génocidaire basée sur la négation d’autrui ». De tels groupes peuvent souhaiter un attentat apocalyptique, mais il existe une trop grande marge entre cet objectif et sa mise en œuvre.
Le cas d’Al-Qaïda est longtemps demeuré à part dans ce débat, tant il était difficile de déterminer si ce groupe a pour seul objectif de vider la péninsule arabique de toute présence occidentale ou s’il agit dans le but d’imposer à l’échelle mondiale une vision fondamentaliste de l’Islam. La crainte que suscite ce groupe est désormais moindre, car l’intervention des Occidentaux en Afghanistan l’a privé de ses bases principales, mais surtout, les services de renseignement ont une connaissance exacte de son mode de fonctionnement. Les attentats en Afrique de l’Est (Nairobi et Dar Es Salam en 1998), les tentatives avortées d’attaques contre des navires à Gibraltar (2002), les attentats de Bali, montrent qu’Al-Qaïda n’agit directement que très rarement, mais qu’elle met en revanche à disposition de groupes locaux qui partagent son idéologie son savoir-faire technique et de larges moyens financiers. Ce système de franchise terroriste lui permet une diffusion de la violence à travers le monde, ancrée dans les tissus sociaux locaux pour recruter constamment de nouveaux volontaires. C’est donc moins Al-Qaïda qu’il faut craindre que la généralisation d’une idéologie islamique radicale, comme l’a relevé le Président syrien Bachar el Assad : « Nous mettons tout sur
Al-Qaïda, mais ce qui se produit est bien plus dangereux que Ben Laden ou
Al-Qaïda. L’enjeu porte sur une question d’idéologie et non d’organisation ».
Le fonctionnement d’Al-Qaïda ne lui permet pas la mise au point d’une arme nucléaire. Cette organisation est à la fois nomade et décentralisée, alors que bâtir une telle arme nécessite de disposer d’installations techniques sur le long terme. L’échelle du temps sur laquelle elle agit est certes infinie, mais même si le martyr comme l’apocalypse peuvent constituer pour elle un mode d’action, il est pour elle plus utile de diffuser son idéologie partout dans le monde, notamment dans les zones en crise, plutôt que d’investir à fonds perdus dans une technologie qu’elle ne pourra maîtriser. Al-Qaïda a parfaitement compris qu’un satellite peut déceler une installation d’enrichissement, mais qu’il lui est difficile de saisir ce qui se passe dans les consciences de millions de personnes.
d) l’arme nucléaire, outil d’un terrorisme d’Etat : une hypothèse peu crédible
L’une des hypothèses couramment avancée en matière de terrorisme est qu’à défaut de pouvoir dérober ou fabriquer une bombe nucléaire, un groupe terroriste puisse en obtenir une de la part d’un Etat. Cette crainte est évoquée de temps à autre dans le cas où un mouvement taliban arrivait au levier de l’Etat au Pakistan ou si un Iran devenu puissance nucléaire militaire voulait déstabiliser profondément le Moyen-Orient.
Cette hypothèse ne peut évidemment être complètement écartée, mais elle résiste mal à l’analyse. Il convient de rappeler la nature profonde de l’arme nucléaire, à savoir une arme de défense stratégique, qui confère la puissance à l’Etat qui la détient, qui offre une garantie d’invulnérabilité mais qui en aucun cas ne sert d’arme offensive en raison du risque de représailles qu’elle induit. C’est une arme de non emploi qui ne peut être détenue que par l’appareil d’Etat pour être en permanence sous surveillance, et qu’aucun Etat ne mettra à disposition d’un tiers, fût-il un groupe terroriste allié.
Par la manière dont elle explose et par les éléments radioactifs qui demeurent après l’explosion, une bombe nucléaire laisse une signature qui permet d’en déterminer l’origine. En outre, la complexité de la détonique nécessite la mise à disposition d’ingénieurs auprès des groupes terroristes. Aucun Etat ne peut transférer d’arme nucléaire à un groupe terroriste en alléguant un quelconque vol. Toute explosion serait automatiquement assimilée par l’Etat qui en serait victime à une attaque par un autre Etat, et déclencherait en représailles un tir nucléaire de sa part ou d’un de ses alliés. Le risque est démesuré pour qu’une telle action entraîne pour son auteur un quelconque avantage politique.
e) L’attentat par diffusion de matières radioactives : une hypothèse plus réaliste
Les matières radioactives se trouvent en abondantes quantités sur notre planète : cobalt, césium 137, strontium 90 sont utilisés par la médecine et l’industrie et reposent dans les hôpitaux ou dans des usines. A ces produits s’ajoutent des combustibles irradiés, stockés dans des installations plus ou moins bien surveillées. Le caractère nocif de ces produits est réel. Rappelons ainsi qu’en 1987, une barre de césium 137 utilisée en médecine fut accidentellement abandonnée dans une décharge de la ville de Goiana, au Brésil, et provoqua la mort de 4 personnes sur 240 qui furent contaminées, et obligea les autorités à mettre sous observation 34 000 personnes.
Deux types de bombes peuvent en théorie être fabriqués : les engins à dispersion (EDIS) et les engins à uranium faiblement enrichi (EDEN). Les EDIS se composent d’une charge de cobalt, présente dans les hôpitaux pour soigner le cancer, que l’on combine à une charge explosive. Les terroristes pourraient ainsi dégager de la radioactivité sur plusieurs centaines de mètres, avec un effet double : le traumatisme des populations et la paralysie de la zone contaminée pendant les mois nécessaires pour la nettoyer. S’il s’agit d’une gare ou d’un aéroport, on mesure sans peine les dommages économiques et sociaux qui en résultent. Les EDEN se composent d’une matière fissile de mauvaise qualité, peu enrichie (U 235 à 35%). Son faible enrichissement en fait une arme malcommode à utiliser car il faut en contrepartie un important poids de matière, jusqu’à 800 kg pour un minimum d’efficacité. Or comprimer 800 kg est difficile, et en outre, manier de l’U 235 est dangereux car il chauffe naturellement et sa forte émission de rayons gamma risque d’irradier les personnes qui le manipulent hors des installations prévues à cet effet.
Autant les pouvoirs publics peuvent sécuriser des sites spécifiquement consacrés aux activités nucléaires militaires ou civiles, autant il est impossible de surveiller la totalité des lieux contenant des matières radioactives. Sans doute faut-il que les mesures de sécurité de chaque établissement soient draconiennes, mais certains d’entre eux ont pour vocation à recevoir un public nombreux, ce qui les rend vulnérables.
La radioactivité fait partie de ces phénomènes dont la dangerosité est plus ou moins variable, mais dont les effets psychologiques auprès de l’opinion sont intenses. Apprendre que des matières radioactives sont diffusées provoque inévitablement la panique de la population concernée. Il s’agit donc d’un moyen commode pour des terroristes car il peut faire de nombreuses victimes par contamination, mais même si cet objectif n’est pas atteint, la crainte qui en résulte, liée à l’angoisse du nucléaire, peut leur permettre d’atteindre leurs objectifs : pression sur l’Etat, désorganisation sociale au plan local, publicité de leur action et de leurs revendications…
La chute de l’URSS, puis son éclatement, et la désorganisation militaire et civile qui ont suivi ont suscité la crainte que des matières radioactives fassent l’objet d’une contrebande lucrative au profit de groupes terroristes. Cette crainte était fondée puisque plusieurs cas de vols et de contrebande ont été prouvés, mais il est presque étonnant qu’aucun attentat majeur utilisant des substances radioactives n’ait été commis au cours des vingt dernières années. Là encore, de nombreuses difficultés techniques font obstacle à la fabrication d’une bombe radioactive : nécessité de se procurer plusieurs dizaines de kg de matière, configuration de l’engin explosif. Dérober du cobalt n’a rien d’aisé, car cette matière est très radioactive, ce qui exige des terroristes qu’ils disposent d’une valise de 50 kg de plomb pour se protéger du danger représenté par quelques centaines de grammes.
Bien que disposant d’experts de haut niveau, un Etat comme l’Irak a ainsi échoué en 1987 en testant 3 bombes à dispersion radioactive, bâties à partir de zirconium 95 provenant de matériel irradié de la centrale nucléaire de Tuwaitha, et dont le taux de radiation, après explosion, est demeuré très bas. La mise au point d’un tel engin n’a donc rien d’évident et se révèle hors de portée de groupes ne disposant pas d’experts scientifiques et de moyens importants de tests.
L’hypothèse d’un attentat par diffusion de matières radioactives est réaliste, même si elle exige plusieurs conditions : existence d’un réseau de physiciens et de techniciens, de locaux pour configurer la bombe et sa détonique, enfin d’aires de tests. Un groupe terroriste disposant d’importants moyens financiers et d’une large assise au sein des milieux scientifiques pourrait fabriquer un engin de ce type… S’il était chargé par un Etat de faire exploser un engin, il y parviendrait sans nul doute, mais cet Etat endosserait alors le risque politique. Les experts n’auraient aucun mal, en analysant les fragments qu’ils recueilleraient après l’explosion, à identifier l’Etat qui aurait porté assistance aux terroristes.
2) La menace terroriste chimique et biologique : une éventualité réaliste, mais difficile à mettre en œuvre
On appelle bioterrorisme toute utilisation ou menace de recours à des virus, des bactéries, des champignons, des parasites ou des toxines comme une arme en vue d’empoisonner ou de tuer des êtres humains. Ce terme diffère de celui de guerre bactériologique, hypothèse dans laquelle les forces de pays officiellement en conflit utilisent des virus et autres bactéries précitées.
Il en est de même pour la menace terroriste chimique, par opposition à la guerre chimique, dont la première manifestation de grande ampleur se déroula en 1915, avec le recours au gaz à Ypres, qui fit 5000 morts en une journée.
En comparaison de la menace nucléaire, la menace terroriste biologique et chimique est une réalité, car des attaques par ces deux modes se sont déjà produites, et les services de renseignement ont mis en lumière, dans un passé récent, d’autres projets, non réalisés.
La gamme des produits chimiques utilisables correspond à la combinaison des éléments retracés dans la table de Mendeleiev, certaines combinaisons étant totalement inoffensives quand d’autres sont extrêmement dangereuses. Pour ce qui concerne les agents viraux, qui rappelons-le, existent à l’état naturel mais peuvent faire l’objet de cultures en laboratoires, un consensus international s’est dégagé pour les classifier en trois catégories, en fonction de leur dangerosité et de l’impact qu’ils peuvent avoir sur l’ordre public.
CLASSIFICATION DES AGENTS VIRAUX DANGEREUX
|
A B C Agents Charbon, peste, botulisme, fièvres hémorragiques virales (Ebola, Marburg), aneravirus (Lassa, Machupo) Brucellose, toxine epsilon de clostridium perfrigens, salmonelle, melioïdose, ricin, fièvre Q, entérotoxine B, typhus, encéphalite virale, choléra Maladies infectieuses émergentes (virus nipah, hautavirus) Risques Transmission de personne à personne, dissémination aisée, mortalité élevée, risque d’impact sur l’ordre public Dissémination plus ou moins facile, morbidité modérée, mortalité faible Risque de dissémination de masse dans le futur, facilité de production, fort taux de morbidité et de mortalité Actions Nécessitent des actions spécifiques avec une forte mobilisation des pouvoirs publics Nécessitent des capacités de surveillance et de diagnostiques (veille sanitaire) Nécessitent une veille sanitaire attentive |
Source : Center for disease control, Atlanta
a) Quantification des actions et projets terroristes
La menace terroriste n’est pas utopique. Le tableau ci-après recense les principales actions terroristes commises par des moyens biologiques et chimiques et les projets rendus publics par des services de renseignement. Par nature, cette partie du tableau est loin d’être exhaustive. L’expert américain Harvey McGeorge évalue à 200 à 250 le nombre d’incidents biologiques et chimiques liés à des usages politiques (militaires, recherche) des substances ou des virus. 20% de ces incidents seraient liés à du terrorisme, tandis que le reste se répartit entre des accidents au sein des forces armées, des criminels de droit commun, des sujets psychotiques ou des employés voulant se venger des dirigeants de leur entreprise.
Le constat qui ressort de ce tableau est très simple. Si les projets n’ont pas manqué, les attentats effectivement réalisés sont peu nombreux et ont causé peu de victimes, sauf dans les cas des attaques perpétrées par la secte Aun. Ils n’ont en aucune façon provoqué de troubles massifs à l’ordre public, malgré une couverture médiatique importante. En comparaison, les attentats à la bombe à la gare de Madrid, dans le métro de Londres ou à Moscou ont causé plus de victimes et ont eu un impact sur le public comme sur l’économie beaucoup plus important. L’attentat classique aux explosifs demeure plus usité. Pour autant, il ne faut pas négliger les avantages que des terroristes pourraient trouver à l’avenir en recourant aux armes chimiques et biologiques.
PRINCIPAUX PROJETS ET ACTES TERRORISTES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES
Action ou projet / Année |
Lieu |
Auteur |
Victimes |
Substance/Agent |
Projet - 1970 |
Etats-Unis |
Weathermen (1) |
||
Projet - 1972 |
Chicago, St louis |
Order of the rising sun (2) |
Bacille de la fièvre typhoïde | |
Projet -1980 |
France |
Fraction armée rouge |
Toxine botulique | |
Attentats - 1984 |
Oregon |
Secte Rajneeshee |
1000 personnes contaminées |
Salmonelle |
Projet - 1994 |
Minnesota |
Minnesota Patriot Council (3) |
Ricine | |
30 attentats environ de 1989 à 1994 |
Japon |
Secte Aun |
Environ 27 morts et 280 blessés |
Sarin, gaz VX, phosgène, acide cyanhydrique, B anthracis, toxine botulique, |
Attentat - 20 mars 1995 |
Métro de Tokyo |
Secte Aun |
12 morts, 1500 blessés |
Sarin |
Attentat - 5 mai 1995 |
Métro de Tokyo |
Secte Aun |
0 |
Acide cyanhydrique |
Septembre et octobre 2001 |
Floride, New Jersey, Washington DC (Sénat des Etats-Unis) |
Non connu (4) |
5 morts, 22 personnes contaminées |
Charbon, anthrax, variole |
(1) Organisation américaine d’extrême gauche.
(2) Organisation américaine néo nazie
(3) Organisation américaine d’extrême droite
(4) L’auteur des attentats est connu, mais le FBI ne souhaite pas révéler les preuves qu’il détiendrait. Survenus quelques jours après les attentats du 11 septembre 2001, les attaques à l’anthrax contre diverses personnalités publiques, parmi lesquelles des Sénateurs américains, ont d’abord été attribuées aux islamistes. Après enquête, ils semblent être le fait d’un expert en biologie de l’armée américaine, qui craignait la remise en cause de son programme de recherche.
b) Avantages des armes biologiques et chimiques pour des organisations terroristes
L’utilisation d’armes biologiques et chimiques par des terroristes présente un intérêt évident : en recourant à des armes considérées comme stratégiques, des terroristes opèreraient une montée en puissance globale, comparable aux bénéfices que les Etats retirent lorsqu’ils maîtrisent la technologie nucléaire militaire. Ils deviennent alors des acteurs incontournables sur la scène internationale. Pour les démocraties, ils posent alors un dilemme. Autant il est envisageable de négocier avec un Etat nucléaire selon les modes en usage entre Etats, autant il est difficile de discuter avec des groupes qui portent des idées radicales, millénaristes ou prophétiques, car outre la confiance limitée qu’on peut leur porter, le simple fait d’entamer de telles discussions leur donnerait une légitimité politique et justifierait, pour d’autres groupes, le recours à des ADM chimiques et biologiques.
Un attentat par ADM présente par ailleurs un caractère nettement plus politique que par tout autre mode. Si des terroristes pouvaient y recourir, l’évènement, par l’ampleur des destructions subies, donnerait lieu à une couverture médiatique considérable. Le pouvoir politique ne pourrait se contenter de qualifier d’assassins les auteurs d’attentats, comme il le fait, par exemple, lors des explosions de l’ETA. Il lui faudrait également prendre des décisions à la mesure du dommage subi, décisions qui confèreraient automatiquement une importance politique au groupe qui aurait commandité l’attentat.
Outre les avantages politiques, les ADM chimiques et biologiques présentent une série d’avantages techniques :
• Leur relative facilité de fabrication, par des personnes moyennement éduquées, avec un minimum d’outils et d’espace, dans un temps relativement court.
• Leur faible coût financier.
• La facilité à camoufler des installations de cultures virales ou de fabrication de cocktail chimique. Un appartement ou une simple cave suffisent.
• L’inutilité de faire des essais préalables, alors qu’il s’agit d’une nécessité absolue pour l’arme nucléaire.
• La vaste palette pour répandre les agents : contamination d’aliments et de liquides, dispersion sous forme de vapeur ou d’aérosol, contact humain direct…
• La nature particulièrement horrible de leurs effets, génératrice de panique et de désordre social.
• La difficulté à les détecter.
• Le laps de temps entre la libération de l’agent biologique ou chimique et la perception de ses effets permet le plus souvent aux auteurs de limiter la probabilité d’être capturés.
• Le choix, enfin, de la cible : militaires dans une caserne, population civile en milieu urbain, atteinte au bétail, empoisonnement des réseaux d’adduction d’eau… Ce type d’ADM permet de viser les êtres humains ou les facteurs de fonctionnement de l’économie. Il offre une souplesse plus grande que l’arme nucléaire, qui détruit indifféremment les êtres comme les objets qu’elle atteint.
La plupart des experts en défense et en stratégie considèrent que les capacités requises pour manipuler des agents chimiques ou biologiques sont largement répandues, cette tâche pouvant se comparer à la production clandestine de narcotiques ou au raffinement de l’héroïne. Il existe potentiellement des milliers de personnes dans le monde – du préparateur au docteur es-sciences qui officient dans les laboratoires – aptes à fabriquer des ADM. La phrase de l’ancien secrétaire d’Etat américain à la marine Richard Danzig « seul un mur très fin d’ignorance et d’inexpérience nous protège » n’est sans doute plus d’actualité. La véritable protection contre ce type d’attaque semble être d’ordre moral. Les groupes terroristes semblent avoir des difficultés à recruter des scientifiques prêts à s’engager dans des activités susceptibles de tuer des milliers de personnes. Plus que l’ignorance, c’est plutôt un voile très fin de moralité qui semble nous préserver.
c) Les limites du recours aux armes biologiques et chimiques
Le principal obstacle pour des terroristes pour utiliser des ADM chimiques et biologiques se trouve dans l’efficacité de la dispersion. Autant la fabrication est relativement aisée, autant la dispersion des produits exige de connaître la virulence des agents employés, leur durée de vie, le sens et l’intensité de l’écoulement de l’air… Des attentats contre des petits groupes humains semblent faciles à réaliser, comme l’a montré l’attaque de la secte Aun dans le métro de Tokyo, alors que l’objectif de plusieurs milliers de morts apparaît plus difficile.
Les experts ne sont toutefois pas unanimes. Aux Etats-Unis, Berkowitz qualifie de fantasme le scénario d’empoisonnement de l’eau, considérant que « peu de méthodes sont moins efficaces que de verser une substance dans un réservoir. D’abord, il n’y a pas nécessairement de rapport entre la capacité des réservoirs alimentant des bassins de retenue destinés à une collectivité et sa consommation d’eau… Deuxièmement, la plus grande partie de l’eau tirée d’un approvisionnement urbain ne vient jamais en contact avec la population, elle sert à arroser les pelouses, à laver les voitures, à chasser les toilettes, à refroidir de l’équipement industriel. Un réservoir constituant la seule source d’eau de 10 000 habitants et ne retenant que des réserves pour deux ans renferme 1,8 milliard de gallons. Si chaque habitant consommait une pinte d’eau par jour, 7 milliards de doses létales seraient nécessaires dans ce réservoir pour administrer une dose par victime… ». Ses collègues Douglass et Livingstone sont moins optimistes et imaginent l’hypothèse de terroristes utilisant de vieux navires citernes pour diffuser des substances dans l’atmosphère des grandes villes portuaires américaines. Ils admettent la relative sophistication du dispositif mais jugent qu’il est réalisable et qu’une fois la diffusion d’un gaz annoncée, la publicité qui en résulterait créerait un chaos sans précédent.
L’exemple de la secte Aun et de l’affaire de l’anthrax aux Etats-Unis montre qu’un attentat biologique et chimique a plus d’efficacité en milieu fermé, ce qui limite le nombre potentiel de victimes. La diffusion de produits dans l’atmosphère est plus aléatoire. Constatons, au passage, qu’Hitler, qui disposait des stocks nécessaires ne les a jamais utilisés, notamment lors des bombardements de Londres.
Cet aspect aléatoire est aussi à l’origine du peu d’usage que font les terroristes de ce type d’ADM. Les organisations terroristes ont en général pour habitude de choisir leurs cibles et leurs victimes. Une fois diffusés, virus et agents chimiques obéissent à leurs lois physiques et chimiques et ne se comportent pas obligatoirement comme l’espèrent les auteurs d’attentats. En comparaison, ils maîtrisent totalement les effets d’une charge explosive.
d) Un risque réel, contre lequel existent déjà des dispositifs de défense
Le nombre peu élevé d’attentats biologiques ou chimiques ne doit pas faire illusion. La possibilité d’un recours à ce type d’ADM est réel car leur usage ne demande pas des capacités d’organisation extraordinaires. On peut approuver les grandes lignes du rapport de la Chambre des Représentants des Etats-Unis (Bob Graham et Jim Talent, world at risk, décembre 2008) qui estime que le risque d’un attentat biochimique avant 10 ans sur le sol américain est largement supérieur à celui d’un attentat nucléaire. Pour autant, il convient de faire la part entre la crainte irraisonnée et le risque réel. Les exemples français et américains montrent que les pouvoirs publics ont pris ce risque en compte avec sérieux. En France, l’Etat a mis en place le plan Piratox dès 1970 et l’a actualisé en 1995, 2003 et 2005. Aux Etats-Unis, plusieurs exercices de défense se sont déroulés à l’échelle de villes (Denver), tandis que le Président Clinton, à la fin de son mandat, a multiplié par 18 les crédits alloués à la recherche sur le terrorisme biologique. La loi de 1997 Domestic Preparedness Program, initiée par les Sénateurs Lugar, Nunn et Dominici a décentralisé la défense civile américaine pour renforcer les capacités des forces de défense comme des services de santé. Enfin, le Homeland Security Act signé par le Président George W. Bush comportait un volet de recherche scientifique sur les agents chimiques et biologiques utilisés par les terroristes.
Au plan international, le Programme du G8 précité, visant à sécuriser les matières fissiles, comporte un volet pour les substances chimiques et biologiques. La France a institué dans ce cadre une coopération particulièrement active avec la Russie, par le canal du Centre international des sciences et de la technologie de Moscou, afin de mettre en place les outils de lutte contre l’utilisation malveillante d’agents pathogènes. 4 projets ont vu le jour en 2006, avec les laboratoires d’Obolensk et de Koltsovo ainsi qu’avec l’Institut de biochimie organique de Moscou. Ils visent à sécuriser les installations de conservation des souches pathogènes, mais également à préparer de nouvelles molécules thérapeutiques et à mettre au point des outils de surveillance et de diagnostic.
Néanmoins, la principale arme contre le terrorisme biologique et chimique demeure le renseignement, ce qui, en ce domaine, ne distingue en aucune manière ce type de terrorisme des autres terrorismes.
3) Les attentats cybernétiques : un moyen rapide, peu coûteux et dépourvu de risque pour désorganiser les sociétés modernes
Inclure la cybermenace dans un rapport sur les proliférations peut apparaître curieux au premier abord. Les armes de destructions massives revêtent en effet un caractère stratégique en raison des dommages physiques massifs et à long terme (radiations, empoisonnement viraux frappant non seulement les victimes mais leur descendance) qu’elles infligent aux êtres vivants comme aux infrastructures. On ne trouve rien de tel dans les attaques cybernétiques. Les spécialistes de la défense comme, plus récemment les responsables politiques, y voient pourtant, avec raison, « une menace aussi importante que les menaces nucléaire ou biologique » comme le déclarait le Président Barack Obama pendant la campagne électorale américaine. Les attaques cybernétiques couvrent un large faisceau, allant de l’accès à des données économiques ou technologiques sensibles (espionnage industriel et commercial) à la pénétration de sites intranet de la défense nationale, en passant par l’implantation de virus informatiques pour désorganiser un réseau sensible. Il s’agit d’un moyen rapide, peu coûteux, dépourvu de risque physique pour ses auteurs dont les attaques s’opèrent à distance, pour désorganiser des sociétés modernes, avec des résultats qui peuvent être économiquement et socialement similaires à un attentat radiologique ou chimique. Les atteintes aux personnes ne sont pas à exclure si une cyberattaque altère, par exemple, la sécurité des atterrissages des aéronefs, la régulation des centrales nucléaires, la maintenance des matériels hospitaliers, les données bancaires, les centres de communication ou de transport d’énergie…
La cybernétique est à l’origine la science qui modélisait les échanges par l’étude des informations et des principes d’interaction. Le terme fut inventé en 1947 par le mathématicien Norbert Wiener, qui travaillait sur les interactions des systèmes autorégulés et non sur leurs seules composantes. La définition a connu dans les années qui suivirent plusieurs évolutions. La cybernétique est en effet une science largement interdisciplinaire, qui puise ses éléments dans l’intelligence artificielle, dans les sciences cognitives, dans l’économie et la psychologie. Elle est généralement considérée aujourd’hui comme la science constituée par l’ensemble des théories sur les processus de commande et de communication chez l’être vivant, dans les machines et dans les systèmes sociologiques et économiques. Son champ principal d’étude est l’interaction entre les systèmes gouvernants (les systèmes de contrôle) et les systèmes gouvernés (systèmes opérationnels), qu’il s’agisse de systèmes vivants ou non vivants, et qui sont régis par des processus de rétroaction. Ce terme renvoie à l’action d’un élément sur un autre, qui entraîne en retour une réponse.
L’étymologie du terme le rapproche de la politique, cybernétique provenant du grec kybernesis, que Platon utilisait symboliquement pour désigner le pilotage d’un navire et auquel le physicien français André-Marie Ampère recourait en 1834 pour désigner l’art de gouverner les hommes
L’ensemble des systèmes complexes, parmi lesquels figurent les ordinateurs et autres machines dotées d’une intelligence artificielle comme les robots, sont des applications de la cybernétique. Par l’ampleur que ces systèmes ont pris dans la société, la cybernétique a débordé depuis longtemps du champ technologique pour entrer dans les domaines économiques et sociaux. Elle a façonné de nombreux aspects des sociétés développées, en robotisant la production, en mettant en réseau les systèmes financiers, en réorganisant les modes de fonctionnement des administrations et des entreprises... Les sociétés modernes sont devenues des sociétés de la connaissance et de l’information, qui bien qu’étant immatérielles, revêtent une valeur marchande. Elles se caractérisent par l’échange, le stockage et la sauvegarde, chaque jour, de milliards de données sans lesquelles il n’y aurait plus de vie économique et sociale.
Assurer la circulation de ces données permet le fonctionnement de la société. Avoir accès ces données permet de disposer d’un contrôle sur celle-ci… La circulation comme le contrôle des données, quel qu’en soit l’objectif, sont un enjeu stratégique de nos sociétés et l’on relèvera que le gouvernement américain en avait perçu toute l’importance quand il souhaitait classer dès 1947 secret défense l’invention de Norbert Wiener, qui s’y est opposé, estimant que les multiples implications de la cybernétique devaient bénéficier à l’ensemble du corps social.
Dans des sociétés de liberté, qui tolèrent réduit au minimum le contrôle social par l’Etat ou par tout autre organe (entreprise, entre autre), la protection des données est un enjeu qui revêt de multiples facettes. Il s’agit tout autant de sanctuariser contre toute intrusion les secteurs jugés vitaux pour l’Etat (défense nationale, police) ou pour l’économie (données confidentielles des entreprises, fichiers de protection sociale) que d’assurer les libertés publiques et individuelles et la fluidité de la circulation des données. Le général Keith Alexander, chef de l’Agence de sécurité nationale (NSA) des Etats-Unis, pays où règne l’économie de l’information, résume bien l’importance de la cyberdéfense : « Maintenir la liberté d’action dans le cyberespace au XXIème siècle est aussi important pour les intérêts américains que la liberté de naviguer en mer au XIXème siècle et l’accès à l’air et à l’espace au XXème siècle ».
a) Les attaques cybernétiques : du crime organisé à l’espionnage d’Etat
La cybermenace a pris son essor il y a environ dix ans, avec le développement d’internet et d’intranet. En dehors des pirates (hackers), qui sont des particuliers (souvent talentueux) animés de malveillance envers certaines structures de la société ou désireux de monnayer leur intelligence en démontrant les défauts des systèmes de protection, l’origine des attaques émane soit du crime organisé, soit de certains Etats. En revanche, aucune attaque terroriste d’envergure n’a eu lieu pour l’heure par un moyen cybernétique, malgré les affirmations de certains groupes, comme Al-Qaïda ou le Djihad islamique, de s’en prendre aux intérêts américains et israéliens.
Il est impossible de quantifier le nombre d’attaques des réseaux mafieux et les dommages qu’ils causent à l’économie. Les entreprises qui en sont victimes répugnent à les révéler pour ne pas affoler leur clientèle. Il suffit de rappeler que les tentatives d’intrusion dans le système bancaire – principale cible du crime organisé - sont de plusieurs centaines de milliers par jour à travers le monde pour avoir conscience de l’ampleur du défi qui est posé à nos économies. Les établissements financiers dépensent des centaines de millions de dollars ou d’euros chaque année pour protéger leurs données, et ce coût est répercuté sur la clientèle, au travers de la tarification bancaire.
Le centre d’études stratégiques et internationales (CSIS), dans une étude publiée en décembre 2008 (securing cyberspace for the 44th presidency) a jugé que le risque de la cybermenace portait bien sur l’économie, alors qu’initialement, il était considéré que les attaques informatiques auraient pour objet des dommages physiques, débouchant sur des catastrophes, comme l’ouverture de digues ou la délivrance de fausses informations pour provoquer des accidents d’avion. Le CSIS constate que les cyberattaques ont surtout touché le monde de l’information (au sens d’échange et de stockage des données). Joël Brenner, haut responsable du renseignement américain, estime, dans cette étude, qu’une cyberattaque d’envergure contre le système bancaire américain aurait pour l’économie de son pays des conséquences plus dommageables que les attentats du 11 septembre 2001.
Les attaques d’origine étatique commencent pour leur part à être bien connues. Le recensement qui suit n’est pas exhaustif mais rappelle les cyberattaques les plus significatives :
– Avril 2007 : attaque russe contre l’Estonie, avec interruption pendant deux heures des services bancaires. La Russie a longtemps dénié être à l’origine de cette attaque avant d’admettre qu’il s’agissait de l’action d’une organisation patriotique de jeunes Russes (ces termes ont été utilisés par des responsables du ministère des Affaires étrangères russe en avril 2009), mécontente de la politique du gouvernement estonien à l’égard de la minorité russophone. Officiellement, la Russie ne cautionne évidemment pas ce cyberattentat, mais l’organisation patriotique qui en est à l’origine n’a fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire.
– Mai 2007 : Piratage informatique à l’encontre d’ordinateurs du gouvernement allemand par les services chinois, au moment même où Mme Angela Merkel effectuait une visite officielle à Pékin. Les services de sécurité allemands sont parvenus à éviter la disparition de 160 gigabytes de données alors que les attaques vidaient les postes de travail du gouvernement.
– Novembre 2007 : Les services britanniques ont fait état d’attaques chinoises à l’encontre de compagnies privées.
– Au premier semestre de 2008, la Belgique a révélé des attaques d’origine chinoise contre des sites gouvernementaux, tandis que la Lituanie a fait face à une attaque russe, à la suite du veto qu’elle avait émis à l’encontre du partenariat énergétique entre l’Union européenne et la Russie.
– Août 2008 : Alors que l’armée russe envahit la Géorgie, des sites russes « patriotiques » mettent à disposition des internautes des logiciels leur permettant d’attaquer l’internet du gouvernement géorgien et celui de l’ambassade américaine à Tbilissi.
– Novembre 2008 : Attaque contre tous les ordinateurs du Pentagone.
– Décembre 2008 : A la suite de la rencontre entre M. Nicolas Sarkozy et le Dalaï Lama, le site internet de l’ambassade de France à Pékin a été mis hors service pendant plusieurs jours.
– 4 juillet 2009 : Attaques contre des sites du Pentagone et de la Bourse de New York, le jour de la fête nationale américaine, ainsi que contre des sites de la Corée du Sud. La coïncidence de ces attaques avec les protestations de Washington et de Séoul à l’encontre des essais nucléaires et balistiques nord-coréens fait peser de forts soupçons sur Pyong Yang.
b) Pourquoi la Chine et la Russie recourent aux cyberattaques
Si nombre de services de renseignements, y compris les services français, possèdent une compétence offensive dans le domaine informatique, ne serait-ce qu’en matière d’écoute passive des flux d’information, leur implication dans des attaques n’a jamais été avérée.
Bien que l’on ne dispose bien évidemment d’aucune preuve, la Chine aurait concentré au sein de l’Armée populaire de libération la totalité de ses capacités étatiques, tant défensives qu’offensives.
D’après le sénateur Roger Romani, citant le Département de la défense américain, la Chine aurait intégré depuis longtemps la lutte informatique comme une partie intégrante de sa stratégie militaire. Elle y voit le moyen de compenser, par des moyens peu coûteux, l’infériorité de ses moyens conventionnels. Elle dispose à cet effet d’un immense réservoir humain, et n’est donc pas entravée par les limites physiques tenant au nombre d’opérateurs qui pourraient rendre moins efficaces des attaques de grande ampleur. Toujours selon les militaires américains, les planifications d’un éventuel conflit avec Taïwan intégreraient le ciblage des systèmes d’information, notamment ceux utilisés pour les flux logistiques, moins protégés que les systèmes opérationnels.
Si l’armée chinoise semble disposer d’un département spécialisé doté de moyens conséquents, on ne peut exclure que le gouvernement chinois s’appuie également sur de nombreux groupes de pirates informatiques. L’internet est très étroitement contrôlé par les autorités chinoises qui disposent de ce fait d’un important moyen de pression sur ces groupes.
Le cas de la Russie est différent. Si l’attaque contre la Géorgie, en août 2008, a révélé de nombreuses faiblesses dans la conduite d’opérations conventionnelles, reconnues par les autorités russes, le recours à des cyberattaques n’est pas le paravent de lacunes chez une puissance qui maîtrise la technologie nucléaire et balistique et qui dispose d’un vaste réservoir de chercheurs. La Russie, comme d’ailleurs les Etats-Unis, a toujours expérimenté l’ensemble des techniques pouvant avoir un usage militaire et a vu dans les cyberattaques un moyen commode de désorganiser les communications de ses adversaires en cas de conflit futur. Ses actions contre la Géorgie s’apparentaient à un test grandeur nature pendant son intervention armée. Quant à celles contre les pays baltes, elles sont un moyen commode de porter une réelle menace sans que celle-ci revête, stricto sensu, un caractère militaire qui pourrait déclencher une réaction collective de l’OTAN. Les cyberattaques ne sont pas juridiquement, pour l’heure, assimilées à des actes de guerre. Elles présentent donc un intérêt réel dès lors que, pour paraphraser Clausewitz, elles sont « la continuation de la politique par d’autres moyens… ».
c) Un phénomène qui ne peut que s’accentuer
Il est indéniable que les événements survenus en Estonie ou les attaques contre la Géorgie, les Etats-Unis et plusieurs Etats européens ne sont que de premières manifestations d’un phénomène appelé à s’accentuer, et ce pour au moins trois raisons.
Premièrement, les systèmes d’information et l’internet prennent une place grandissante dans tous les domaines de la vie et du fonctionnement de nos sociétés, devenant de ce fait une cible potentielle. Il est en effet particulièrement tentant pour un agresseur, qu’il s’agisse d’un groupe non étatique ou d’un Etat, d’utiliser l’arme informatique pour perturber la vie courante, générer des troubles, accéder à des informations sensibles du point de vue politique, économique et militaire, et amoindrir nos capacités d’action.
Deuxièmement, ce mode opératoire est relativement accessible et peu coûteux. Il s’appuie sur des technologies dont la maîtrise est aisée. L’ouverture et l’interconnexion croissantes des réseaux, de même que la généralisation de produits standards dont les vulnérabilités sont en permanence scrutées par les communautés de pirates informatiques, en facilitent l’usage. Il s’avère relativement peu coûteux et s’affranchit très facilement des distances et des frontières. Enfin, l’existence de nombreux spécialistes tentés par le piratage pour des raisons politiques ou mercantiles offre aux Etats, aux organisations terroristes ou aux mafias un vivier dans lequel ils peuvent puiser pour commettre des cyberattaques, tout en se plaçant en retrait.
Troisièmement, l’anonymat derrière lequel se dissimulent les agresseurs rend la menace plus complexe. A la différence des systèmes téléphoniques qui, pour s’assurer la rémunération par le client, sont équipés d’un dispositif efficace d’identification et de facturation de l’appelant, l’internet est, de par sa conception, un système ouvert de partage de l’information dépourvu de systèmes standard d’identification ou de localisation des utilisateurs. De l’avis de certains experts, il n’est pas certain que l’on arrive à concevoir un mécanisme qui mettrait l’internet totalement à l’abri de la menace inhérente à sa conception initiale, dont les auteurs ont omis de prévoir une fonctionnalité « localisation ».
Etant données les difficultés rencontrées pour établir l’identité des agresseurs, des gouvernements hostiles peuvent lancer ou cautionner des attaques dont ils nient ensuite être les auteurs. Ainsi, alors que les chars russes envahissaient la Géorgie, on a vu apparaître sur des sites internet pro-russes des logiciels permettant de s’en prendre aux sites du gouvernement géorgien, évoqués par vos Rapporteurs. Bien que l’on ne dispose d’aucun élément concluant donnant à penser que les cyberattaques menées en Géorgie ont été lancées ou cautionnées par le gouvernement russe, rien ne vient prouver, par ailleurs, que ce dernier ait tenté d’y mettre un terme. En effet, le gouvernement géorgien et plusieurs experts indépendants ont mis en avant un « lien russe » solide avec les attaques, du fait notamment que les instructions à suivre étaient libellées en russe, qu’une organisation mystérieuse appelée « russian Business Network » et basée à Saint-Pétersbourg était peut-être impliquée, et que le trafic de données sur l’internet avait, de manière certaine, été redirigé via des firmes de télécommunications russes. Plus concrètement, certains ont avancé, lors des attaques menées en Estonie en 2007, qu’une organisation patriotique active sur les serveurs télématiques libellés en russe avait des liens avec le Service fédéral russe de sécurité.
d) Des réactions auparavant défensives, prochainement offensives
Les auteurs des cyberattaques sont particulièrement difficiles à identifier autrement que par des présomptions et un travail de renseignement. Les attaques utilisent une succession d’adresses relais qui transitent parfois par plusieurs pays. S’il est possible de localiser le serveur d’origine, il est quasiment impossible de remonter au commanditaire. Or une société de droit ne peut qualifier les actes et entamer des poursuites judicaires que sur la base de preuves.
Les réactions des pays attaqués sont largement décrites dans deux rapports d’information de M. Roger Romani, au nom de la commission des Affaires étrangères du Sénat (n° 449, 2007-2008) et de M. Sverre Myrli (Norvège), au nom de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN. La défense contre les cyberattaques relève à la fois de stratégies nationales et d’un commencement de coopération internationale.
Stratégies nationales de cyberdéfense
Etats-Unis : 155 millions de dollars inscrits au budget du Département de sécurité intérieure en 2008. Mise en place de stratégies nationales depuis 1998 pour promouvoir la sécurité cybernétique. Nouvelle stratégie en cours d’élaboration, à la suite du rapport de la CSIS « Securing cyberspace for the 44th presidency ».
Estonie : Mise en œuvre depuis octobre 2008 d’une stratégie nationale de sécurité informatique, avec l’application de mesures de sécurité, le développement d’une expertise estonienne, l’élaboration d’un cadre juridique national et la promotion de la coopération internationale L’Estonie héberge le centre d’excellence de l’OTAN pour la cyberdéfense en coopération.
Royaume-Uni : Adoption en 2005 d’un plan national pour la protection des infrastructures d’information, avec un partenariat entre secteur public et secteur privé. Le Communications and electronic security Group est l’organe central de la cyberdéfense, avec 450 agents.
Allemagne : Adoption en 2005 d’un plan similaire à celui du Royaume-Uni. Le Bundesamt für Sicherheit des Informationtechnik accomplit des missions de sensibilisation et une veille technologique.
Les stratégies nationales évoluent rapidement, avec la prise de conscience de la menace que représentent les cyberattaques, et la nécessité de ne pas se cantonner à des réactions défensives.
La France vient ainsi d’instituer l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi), destinée à renforcer la sécurité des moyens de communications de l’Etat, par décret du Premier ministre. Prévue par le Livre blanc de la défense et de la sécurité nationale, l’Anssi remplacera l’actuelle direction centrale de la sécurité des systèmes d’information au Secrétariat général de la défense nationale (SGDN). Ce nouveau service « à compétence nationale », autorité nationale en matière de sécurité des systèmes d’information, doté de compétences élargies et de moyens renforcés, reste sous la tutelle du SGDN.
Il sera notamment chargé de la mise en œuvre des moyens interministériels sécurisés de communications électroniques nécessaires au Président de la République et au gouvernement, de leur protection et de la mise en place d’un système de détection des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information de l’Etat. Cette agence aura ainsi sous sa responsabilité le Centre de transmissions gouvernementales, installé sous les Invalides, qui abrite les réseaux interministériels sécurisés Rimbaud (téléphone) et Isis (intranet) qui permettent aux rouages essentiels de l’Etat de communiquer en toute confidentialité.
Ses effectifs seront progressivement augmentés pour atteindre 250 personnes d’ici trois ans. L’actuelle DCSSI compte 110 personnes. En outre, un comité stratégique de la sécurité des systèmes d’information a été institué auprès du secrétaire général de la défense nationale, qui en assurera la présidence. Ce comité propose les orientations stratégiques en matière de sécurité des systèmes d’information et en suit la mise en œuvre.
Aux Etats-Unis, le Pentagone a annoncé le 23 juin l’institution d’un commandement militaire chargé de réagir aux attaques informatiques et de mener des offensives dans le cyberespace. Comme la France, les Etats-Unis voient désormais le cyberespace comme un champ de conflit, au même titre que les océans ou l’espace et estiment devoir y mener non seulement des actions défensives, mais à leur tour des attaques.
La mise en place de ce cybercommandement intervient alors que les six premiers mois de l’année 2009 ont été marqués par l’augmentation des attaques sur les 15000 réseaux numériques militaires américains et que les tentatives d’intrusion s’élèvent à plusieurs milliers par jour. La réparation des dommages a coûté près de 100 millions de dollars au Pentagone depuis janvier 2009.
e) Invoquer l’article 5 du traité de l’Atlantique Nord ?
Le ministre estonien de la Défense, M. Jaak Aaviksoo, a établi un parallèle entre la cyberguerre et les blocus portuaires qui, il y a deux siècles, pouvaient priver les pays d’une ouverture sur le monde. Cette analogie l’a conduit à demander s’il n’était pas opportun de placer les cyberattaques dans la même catégorie que les actes de guerre.
Après les attaques qu’elles a subies, l’Estonie a indiqué vouloir étendre la clause de défense de l’Alliance atlantique, prévue par l’article 5 du traité de Washington, aux cyberattaques. Pour que l’article 5 couvre ce champ d’attaque, il faudrait l’accord des autres membres de l’Alliance, à la condition de clarifier certaines questions juridiques.
Les attaques cybernétiques ne sont pas actuellement des actes de guerre. Elles sont assimilées à de la criminalité par une convention du Conseil de l’Europe adoptée en 2004. Cette convention oblige les Etats signataires à se doter des instruments juridiques de base indispensables à la lutte contre la cybercriminalité et les engage à prêter assistance aux autres pays signataires dans le cadre des enquêtes sur les cybercriminels et des poursuites à leur encontre. Il s’agit d’une convention ouverte, ce qui signifie que les pays non membres du Conseil de l’Europe sont également invités à la ratifier. En février 2009, les pays non signataires les plus notables étaient la Russie, la Chine et la Turquie, cette dernière étant membre de l’Alliance atlantique.
La convention définit les différentes formes que peut prendre la cybercriminalité et énonce la marche à suivre par les pays pour aligner leurs législations respectives sur ses dispositions. L’accès illégal aux données, l’interception illégale de données et les interférences entre données et entre systèmes informatiques sont assimilés à des délits. La convention fixe aussi les grands principes de la coopération internationale contre la cybercriminalité et propose un cadre juridique pour l’extradition des personnes soupçonnées de se livrer à ces pratiques. Mais elle présente des lacunes, s’agissant de la question spécifique de la cyberdéfense. Premièrement, en assimilant les attaques contre les systèmes d’information à des délits contre la propriété publique et privée, elle omet de les traiter sous l’angle de la sécurité nationale. Deuxièmement, elle n’établit pas de distinction entre systèmes informatiques ordinaires et systèmes d’information des infrastructures essentielles. Enfin, elle ne fait pas la différence entre attaques à petite et à grande échelle.
On ne peut reprocher à une convention du Conseil de l’Europe de ne pas envisager une question sous un angle militaire. Ce n’est pas la vocation de cette organisation, qu’il faut au contraire féliciter pour avoir, la première, mis en place un corpus juridique permettant de définir des délits et d’incriminer des personnes.
L’OTAN, qui a mis en place son programme de cyberdéfense en 2002 à la suite d’actions de pirates serbes lors du conflit du Kosovo, a institué plusieurs centres techniques d’études et de réaction, notamment à Mons et à Tallinn. Il lui manque en revanche la base juridique lui permettant d’assimiler à des actes de guerre les cyberattaques visant les infrastructures essentielles des Etats. Il n’existe en fait pas de consensus politique sur cette question. Celui-ci émergera peut-être de la répétition des attaques que subissent les grands pays membres de l’Alliance. Ils dégageront peut-être le concept d’un champ de bataille virtuel, qu’il convient de protéger, au même titre que des installations réelles comme les infrastructures de transports et d’énergie.
Les membres de l’Alliance se sont actuellement basés sur une position prudente pour définir les principes de la cyberdéfense de l’OTAN, à savoir la solidarité alliée et la reconnaissance de la souveraineté nationale. Autrement dit, ils se sont donné pour objectif commun de faire en sorte que tous les alliés soient prêts et aptes à se soutenir mutuellement en cas de cyberattaque, et ont prévu, pour ce faire, de développer chacun leurs propres capacités de cyberdéfense. Les responsables de l’OTAN ont été attentifs à replacer les mesures de cyberdéfense de l’OTAN, non dans le cadre de l’article 5, mais dans celui de l’article 4, selon lequel « les parties se consulteront chaque fois que, de l’avis de l’une d’elles, l’intégrité territoriale, l’indépendance politique ou la sécurité de l’une des parties sera menacée ». Jaap de Hoop Scheffer, ancien secrétaire général de l’OTAN, a également rappelé que de l’avis unanime des ministres de la Défense des pays de l’OTAN, la cyberdéfense « relève de la compétence des pays ».
La cyberdéfense présente pour l’heure des difficultés particulières pour les responsables de l’OTAN, qui s’emploient à maximiser l’action dissuasive de l’Alliance dans un domaine présentant une combinaison inédite de situations. Certes, le recours éventuel à l’article 5 du Traité de Washington pour parer aux cyberattaques pourrait pousser des agresseurs potentiels à réfléchir à deux fois avant d’agir, mais une telle démarche ne restreindrait-elle pas à l’excès la marge de manœuvre de l’OTAN dans un scénario de gestion de crise ? Comment parer au risque d’identification erronée d’un agresseur ? A supposer que la source d’un acte malveillant puisse être identifiée avec certitude, quelles seraient les formes d’agression à considérer comme des attaques directes et, partant, indirectes à l’encontre d’un membre ? Et quels seraient les moyens les plus appropriés à la disposition de l’OTAN pour contrer l’activation, par certains Etats, de groupes volontaires informels qu’ils chargeraient de mener des cyberattaques dont ils pourraient eux-mêmes nier être les auteurs ?
Il semble néanmoins difficile que les pays de l’Alliance atlantique, dont plusieurs responsables ont affirmé que les auteurs des cyberattaques pouvaient être les mêmes que des attentats nucléaires ou chimiques, se dispensent encore longtemps d’une réflexion approfondie sur le défi posé par la guerre cybernétique. Si les dommages sont susceptibles de désorganiser la société, les cyberattaques sont à ranger dans la catégorie des armes stratégiques et, partant, doivent faire l’objet d’une réaction appropriée. De la même manière que le concept de dissuasion a empêché la guerre nucléaire, des attaques délibérées de l’OTAN contre des sites sensibles des pays qui altèrent l’usage pacifique du cyberespace conduiraient ces derniers à réfléchir avant de conduire de telles actions.
IV – LE DROIT INTERNATIONAL PEUT-IL EMPÊCHER LA PROLIFÉRATION ?
Toutes les proliférations font l’objet de textes internationaux, à l’exception de la menace cybernétique. Inégalement contraignants, ces textes se rangent globalement en trois catégories : les interdictions d’un type d’armement, les textes visant à empêcher le développement clandestin de programmes proliférants, et les initiatives, plus récentes, destinées à organiser très concrètement la lutte contre les réseaux de prolifération.
Les grandes conventions d’interdiction sont sans doute les textes les plus connus. Elles offrent plusieurs particularités, certaines autorisant des Etats à posséder les armes qu’elles concernent (c’est le cas du traité de non prolifération nucléaire de 1968), certaines se limitant à demander aux Etats de ne pas développer excessivement leurs programmes d’armement, comme pour le domaine balistique.
Ces conventions n’ont pas permis d’empêcher les proliférations. Dès lors, plusieurs Etats possédant des arsenaux, ou les capacités technologiques de les fabriquer, ont choisi de compléter l’interdiction de posséder des armes de destruction massive par des règlements portant sur les étapes nécessaires à leur construction. Ils ont ainsi créé des « clubs d’exportateurs » destinés à encadrer le commerce des technologies duales. Certains de ces Etats se sont également engagés pour interdire les essais nucléaires ou la production de matière fissile.
Malgré ces textes nouveaux, des « crises de prolifération » (42) sont régulièrement apparues, par exemple en Corée du Nord, en Iran ou en Syrie. Constatant l’imperfection du système international de lutte contre la prolifération, les Etats-Unis, bientôt rejoints par les membres du G8 et de nombreux autres pays, ont choisi de lancer des coopérations très concrètes pour agir sur les réseaux de prolifération.
Cette approche nouvelle a l’avantage de cibler la menace présentée comme la plus inquiétante. Toutefois, elle sert également à masquer l’acceptation tacite du statu quo nucléaire : sans remise en cause de l’équilibre fixé en 1968, le risque est grand que les textes juridiques ne suffisent pas à empêcher les proliférations.
A – L’interdiction des armes de destruction massive, un engagement insuffisant
Quatre conventions internationales interdisent aux Etats d’encourager la prolifération des armes chimiques, biologiques, nucléaires et balistiques. Pour les deux premières, le droit impose une interdiction totale. Les deux autres autorisent certains Etats à posséder des armes, ou bien se contentent d’exiger un développement raisonné des arsenaux.
Ces textes peuvent être classés en fonction du niveau de contrainte qu’ils font peser sur les Etats. Cependant, les normes existantes ne suffisent pas à empêcher les proliférations, sauf peut-être pour les armes chimiques. On peut ainsi parler d’un échec pour les grandes conventions d’interdiction d’armes de destruction massive.
1) La convention sur les armes chimiques, un outil efficace de lutte contre la prolifération
L’interdiction d’utiliser des armes chimiques fait partie des premières règles de droit international humanitaire, véritable droit de la guerre qui connaît un développement important à la fin du XIXème siècle et dans l’entre-deux-guerres. Malgré l’existence de la déclaration du 29 juillet 1899 interdisant l’emploi de projectiles ayant pour but unique de répandre des gaz suffocants ou délétères, ces armes seront toutefois largement utilisées lors du premier conflit mondial.
L’horreur provoquée par les attaques chimiques conduit les principales puissances à renouveler leur engagement en faveur de l’interdiction de ces armes. Faisant l’objet d’un article du traité de Versailles du 28 juin 1919, la renonciation à l’emploi de gaz toxiques ou asphyxiants est expressément rappelée par le traité relatif à l'emploi des sous-marins et des gaz asphyxiants en temps de guerre du 6 février 1922.
Les armes chimiques sont également visées par le protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925.
L’utilisation de gaz asphyxiants ou neurotoxiques sera moins fréquente au cours de la seconde guerre mondiale que lors de la première. Dès lors, les Etats semblent se satisfaire d’engagements internationaux interdisant l’usage de ce type d’armements, sans qu’aucune règle ne restreigne leur production ou leur détention.
L’utilisation d’armes chimiques par l’Irak, à la fin du conflit l’ayant opposé à l’Iran entre 1980 et 1988, accélère les discussions relatives à ces équipements, relancées au sein de la conférence du désarmement des Nations Unies. Les dégâts causés sur les troupes et les civils iraniens, provoquant, selon certaines estimations, la mort de 20 000 personnes, ont conduit à renforcer les règles encadrant leur fabrication et leur détention.
La convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'usage des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris le 13 janvier 1993, permet de franchir un cap dans la réglementation relative aux armes chimiques. Désormais, celles-ci ne font plus seulement l’objet d’une interdiction d’emploi, mais sont frappées d’une interdiction globale. La convention internationale sur les armes chimiques (CIAC) donne d’ailleurs aux Etats parties les moyens de contrôler l’effectivité de ces dispositions.
En effet, dès son entrée en vigueur le 29 avril 1997, la CIAC permet la mise au point d’un régime de vérification de ses principales dispositions, reposant sur l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), basée à La Haye aux Pays-Bas.
Employant plusieurs centaines de fonctionnaires internationaux, l’OIAC vérifie que l’utilisation de dizaines de substances chimiques (43), ainsi que leurs précurseurs, est réservée à des fins pacifiques. Les installations où ces substances sont utilisées doivent pouvoir être contrôlées par les autorités nationales, et font l’objet d’inspections de l’OIAC.
Par ailleurs, l’OIAC s’efforce de prévenir la réapparition des arsenaux chimiques, et œuvre en faveur de l’universalisation de la convention. Cinq pays n’avaient pas, à la fin de l’année 2008, signé la CIAC (44), et deux Etats, pourtant signataires dès le 13 janvier 1993, n’avaient pas procédé à sa ratification (45).
Parallèlement à ce régime de vérifications, l’OIAC conduit des inspections visant à s’assurer que les engagements de destruction des arsenaux chimiques existant sont bien respectés. Six Etats ont publiquement fait part à l’organisation de leur intention de détruire leurs stocks d’armes chimiques : l’Albanie, l’Inde, l’Irak, les Etats-Unis, la Russie et la Libye. Un septième Etat, la Corée du Sud, a fait part à l’OIAC de l’existence d’un arsenal chimique sur son territoire, et s’est engagé à procéder à sa destruction.
Le système international d’interdiction des armes chimiques constitue sans doute l’un des succès diplomatiques les plus importants en matière de lutte contre les proliférations. En effet, les règles qu’il impose sont désormais applicables à la quasi-totalité des Etats membres des Nations Unies. De plus, leur mise en œuvre repose sur un système international de contrôle qui n’existe pas dans le domaine des armes bactériologiques.
2) Le traité de non prolifération nucléaire, un équilibre maintenu en dépit des évolutions historiques
Le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) est une pièce essentielle du dispositif international de lutte contre les proliférations, à tel point qu’il y est souvent fait référence comme « le traité de non prolifération ». Son importance est pourtant moins liée à son caractère contraignant, finalement proche de celui de la CIAC, qu’à ses conséquences sur l’équilibre mondial.
En autorisant cinq Etats à détenir des armes nucléaires, le TNP crée une inégalité, que les dispositions complémentaires n’ont pas su résoudre jusqu’à présent. Dès lors, les Etats revendiquant l’accès à un niveau de puissance important ont employé tous les moyens pour contourner les dispositions du traité, le plus souvent avec succès. Le TNP est donc devenu, avec le temps, l’instrument le plus contesté de la lutte contre les proliférations.
a) De la création de l’Agence internationale de l’énergie atomique à la signature du traité de non prolifération
Avec l’aboutissement du projet américain dit « Manhattan » et l’explosion des premières bombes atomiques au Japon en août 1945, puis la première utilisation d’une bombe soviétique en 1949, la communauté internationale a pris conscience qu’elle était désormais entrée dans l’âge nucléaire. L’Organisation des Nations Unies, et notamment le Conseil de sécurité, ont cherché à élaborer un cadre juridique permettant de limiter la prolifération des armes nucléaires tout en permettant l’utilisation de l’énergie de l’atome à des fins civiles.
Dans son discours Atoms for peace prononcé le 8 décembre 1953 devant l’Assemblée Générale des Nations Unies, le président américain Dwight Eisenhower résume bien l’état d’esprit de l’époque : « nous sommes entrés si vite dans l’âge atomique que tous les citoyens du monde doivent pouvoir comprendre à quel point ce processus change profondément nos conditions de vie […] nous savons que, si l’évolution inquiétante des stocks d’armes nucléaires peut être inversée, cette force de destruction, la plus terrible jamais possédée, peut également être développée pour le bien de tous ».
C’est au cours de ce discours que sera proposée la création d’une agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), dépendant de l’ONU, et la constitution, sous son contrôle, d’un stock international d’uranium afin de faciliter l’exportation des technologies électro-nucléaires. Adopté le 23 octobre 1956, le statut de l’AIEA est entré en vigueur le 29 juillet 1957. S’il prévoit effectivement que l’agence est habilitée à contrôler l’usage qui est fait des technologies nucléaires, afin d’éviter leur détournement à des fins militaires, il ne tranche pas la question de la constitution d’un stock international d’uranium.
Composée initialement de 81 pays, la conférence générale de l’AIEA regroupe aujourd’hui 150 Etats. La Corée du Nord s’est retirée de l’agence en 1994, et le Cambodge en 2003, avant, pour ce dernier, de réintégrer la conférence en 2009.
Le Conseil des gouverneurs de l’agence, principal organe décisionnaire, est une instance qui ne se renouvelle que partiellement. Malgré des règles édictées pour favoriser une représentation équilibrée des différentes régions du monde, la possibilité pour les membres sortants de désigner 13 des 35 membres du conseil favorise une certaine stabilité. Les autres membres sont élus par la conférence générale.
Les premières années de l’AIEA sont difficiles. La montée des tensions politiques ne permet pas à l’agence de remplir ses missions, et il faudra attendre le lendemain de la « crise de Cuba » en 1962 pour la voir reprendre son activité. De plus, malgré la relance des travaux de l’agence, le premier essai nucléaire réussi par la France en 1960 puis celui réalisé par la Chine en 1964 montrent clairement que les dispositions initiales du statut de l’agence ne permettent pas de limiter le développement d’arsenaux nucléaires militaires.
En effet, l’article III.A.5 des statuts de l’Agence indique que celle-ci a vocation à contrôler l’utilisation des produits fissiles dits spéciaux (uranium enrichi ou plutonium issu de la production d’électricité thermo-nucléaire) afin de garantir que ceux-ci ne sont pas détournés de leur usage civil. Toute autre intervention de l’agence doit être demandée par un Etat partie, ce qui limite fortement les pouvoirs d’inspection de l’agence. Pourtant, c’est dans ce contexte que débutent les discussions pour l’élaboration d’un traité visant expressément à interdire l’usage militaire de l’atome.
Ouvert en 1968 à la signature des Etats, le traité de non prolifération entre en vigueur en 1970, trois Etats parties assumant le statut d’Etat dépositaire – les Etats-Unis, l’Union soviétique et le Royaume-Uni. Les adhésions se succèdent à un rythme rapide : 96 en 1975, 135 en 1995. Son adoption va modifier sensiblement le rôle joué par l’AIEA.
b) Le renforcement progressif des moyens de l’AIEA
Le traité de non prolifération de 1968 reprend les objectifs énoncés dès 1953 par la communauté internationale : arrêt de la prolifération des technologies nucléaires militaires, réduction de la menace nucléaire mondiale, développement contrôlé des technologies civiles. On parle des trois « piliers » du traité.
Ces piliers représentent en réalité des concessions réciproques accordées par les Etats officiellement détenteurs de l’arme nucléaire (46), à la date d’entrée en vigueur du TNP, mais également par les Etats non détenteurs. Ainsi, alors que les Etats détenteurs s’engagent à poursuivre, à long terme, l’objectif de « désarmement nucléaire dans le cadre d’un désarmement général et complet », et à ne pas aider d’autres Etats à acquérir d’armes nucléaires, les autres parties s’interdisent de développer tout type de technologie nucléaire militaire. Ces stipulations sont rappelées aux articles 1, 2 et 6 du traité (47).
Les piliers « non-prolifération » et « désarmement » sont complétés par un troisième pilier, de« développement des technologies civiles ». L’article 4 affirme ainsi : « Aucune disposition du présent Traité ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inaliénable de toutes les Parties au Traité de développer la recherche, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques ». Allant au-delà de ces stipulations, le second paragraphe de l’article 4 oblige les parties à développer les échanges de technologies et d’équipements en matière de technologies nucléaires civiles, et rappelle que les Etats les plus avancés dans ce domaine s’engagent à prendre part à des initiatives favorisant le développement de l’énergie nucléaire civile, notamment dans les régions du monde les plus en retard.
Conçu pour garantir un équilibre entre les Etats détenteurs et les Etats dépourvus d’armes nucléaires, le traité de non prolifération est initialement prévu pour une durée de 25 ans. Celle-ci sera prorogée indéfiniment par la conférence d’examen de 1995.
L’adoption du TNP implique nécessairement un renforcement des pouvoirs de l’agence internationale pour l’énergie atomique. En effet, l’article 3 charge l’agence d’établir des mesures de surveillance afin d’empêcher tout détournement des technologies nucléaires à des fins militaires, et incite tous les Etats parties à signer des accords avec l’agence permettant d’apporter les garanties nécessaires à ce contrôle. L’extension progressive du régime international des garanties constitue sans aucun doute un succès important du traité de non prolifération (48).
Pour faire face aux nouvelles obligations qui reposent désormais sur l’agence, un nouveau modèle d’accord de garanties dites « généralisées » est élaboré (49). Il permet de couvrir toutes les activités nucléaires menées par les Etats, et autorise l’AIEA à inspecter tout type de matières nucléaires, et plus seulement les produits fissiles spéciaux. Parallèlement, certains Etats non parties au TNP signent des accords de garanties semblables à ceux existant avant l’entrée en vigueur du traité de non prolifération, désormais considérés comme « accords restreints » (50).
Mais l’extension des pouvoirs de contrôle de l’AIEA laisse ouvertes plusieurs failles que fait apparaître la découverte du programme nucléaire clandestin irakien, dont l’étendue n’a pu être entièrement mesurée qu’en 1991. A l’époque, l’agence n’est pas autorisée à inspecter tous les bâtiments qu’elle soupçonne pourtant d’abriter des installations nucléaires, et l’effet de surprise des inspections est loin d’être assuré. Un nouveau train de réformes est alors adopté, allant dans le sens d’une nouvelle extension du champ de compétences de l’AIEA.
Conduit entre 1992 et 1997, le programme intitulé « 93+2 » vise à renforcer les pouvoirs d’inspection de l’AIEA. Désormais, celle-ci a vocation à intervenir en amont, afin de prévenir toute tentative de conduite clandestine d’un programme nucléaire proliférant. Une fois encore, les pouvoirs de contrôle de l’agence font l’objet d’accords avec chacun des Etats membres, qui sont invités à conclure des « protocoles additionnels » (51) aux accords de garanties qu’ils ont déjà ratifiés.
A l’heure actuelle, 124 protocoles additionnels ont été signés par l’AIEA, dont 92 sont déjà en vigueur. Les Etats soumis à ce régime de vérifications s’engagent à fournir à l’agence des déclarations étendues sur l’ensemble de leurs programmes nucléaires, passés, présents et futurs, même si ces activités n’impliquent pas l’utilisation de matériaux nucléaires. De plus, tous les bâtiments situés sur un site nucléaire identifié doivent être déclarés, qu’ils soient ou non utilisés dans le cadre d’activités nucléaires.
Les inspecteurs de l’agence peuvent désormais se rendre sur des sites ayant un lien avec les activités nucléaires même si aucun matériau fissile n’est présent. Enfin, ils peuvent procéder à des échantillonnages afin de vérifier qu’aucune activité sensible n’est menée dans une région particulière.
c) Un traité fragilisé par des contestations croissantes
L’équilibre fixé par le TNP est aujourd’hui critiqué par plusieurs Etats, qui accusent le traité de 1968 de ne pas lutter assez efficacement contre la prolifération nucléaire.
En premier lieu, les pays technologiquement proches de la capacité nucléaire estiment que leur signature de protocoles additionnels ne peut être acquise en l’absence d’un désarmement nucléaire réel. Ces affirmations interviennent dans un contexte de réduction des arsenaux, mais elles portent une part de vérité, dans la mesure où aucun Etat doté n’a véritablement renoncé à l’arme nucléaire.
Les Etats-Unis semblent ainsi avoir atteint le plafond de 3 800 têtes nucléaires imposé par la Quadriennal defense review de 2006, en préalable à un processus devant conduire à une réduction de l’arsenal américain entre 1 700 et 2 200 têtes. De plus, les Etats-Unis ont accompli dès 2007 leurs obligations au titre du traité SORT (Strategic offensive reduction treaty) et ont retiré et éliminé 13 types d’armes nucléaires depuis 1992.
La Russie a également mis en œuvre d’importantes mesures de démantèlement, notamment au début de l’année 2008. En procédant à l’élimination de 3 000 missiles stratégiques et intercontinentaux, 46 sous-marins nucléaires lanceurs d’engin et 66 bombardiers stratégiques, en annonçant la réduction de 75 % de l’arsenal nucléaire tactique par rapport au niveau atteint en 1991, elle a donné des gages certains de son engagement en faveur de la réduction des arsenaux nucléaires mondiaux.
La France a fourni un effort particulièrement important pour réduire son arsenal. Elle est le seul Etat doté d’armes nucléaires à avoir démantelé ses missiles nucléaires sol-sol, et elle a, en outre, réduit d’un tiers le nombre de ses sous-marins nucléaires lanceurs d’engins. Dans un discours prononcé à Cherbourg le 11 mars 2008, le Président de la République a annoncé, en plus de ces mesures, une réduction d’un tiers, pour la composante aéroportée, du nombre de têtes nucléaires, de missiles et d’avions, et le maintien de l’arsenal français en dessous de 300 têtes, soit moins de la moitié du nombre maximal possédé pendant la guerre froide.
La Grande-Bretagne a réduit le nombre de ses têtes nucléaires déployées à moins de 160, depuis la fin de l’année 2007, soit une réduction annoncée de 75 % de ses capacités nucléaires explosives par rapport au pic de la Guerre froide. Sa composante aéroportée ayant été démantelée, le Royaume-Uni ne met plus en œuvre que la composante océanique.
Seule la Chine n’a pas apporté de preuve de sa volonté de désarmer, affirmant que le rôle purement dissuasif qu’elle assigne à son arsenal nucléaire l’exonérait de toute nécessité de réduction.
Toutefois, malgré ces programmes ambitieux, il est manifeste que les Etats dotés souhaitent conserver des moyens de dissuasion nucléaire suffisants. La France va ainsi renouveler les missiles équipant les sous-marins et met en service la nouvelle gamme d’avions emportant des missiles nucléaires. Elle a lancé, comme les grandes autres puissances, des programmes de simulation permettant de moderniser ses armes sans avoir à effectuer d’essais nucléaires.
La Russie, la Chine et les Etats-Unis, poursuivent également de vastes programmes de modernisation de leurs arsenaux. De nouveaux missiles sol-sol, des sous-marins plus modernes, des missiles air-sol adaptés, des têtes modernisées font l’objet de recherches permanentes dans tous ces pays. Seule la Grande-Bretagne paraît moins avancée dans ces domaines, bien qu’elle ait malgré tout lancé un vaste chantier de renouvellement de sa flotte de sous-marins nucléaires.
Enfin, les négociations du traité START III n’ont pas permis d’obtenir, pour l’instant, des résultats significatifs. Le projet d’accord signé par les présidents Obama et Medvedev le 6 juillet 2009, qui devait marquer une étape clé dans les discussions, ne pose que de faibles obligations. Il ramène ainsi le plafond de têtes nucléaires à un chiffre compris entre 1 500 et 1 675, contre 1 700 – 2 250 pour le précédent. De même, le nombre de vecteurs devra être compris entre 500 et 1 100 ce qui, au-delà de l’ampleur de la fourchette ainsi négociée, permet aux Etats-Unis de se trouver déjà pratiquement en conformité avec l’accord, puisqu’ils ne disposent que de 1 198 vecteurs déclarés.
En réalité, en l’état actuel des discussions, la négociation de START III permet surtout aux deux grandes puissances de retrouver le chemin, qui semblait perdu depuis quelques années, de la table de discussions. Il ne va pas trop loin dans les exigences adressées à chacun des deux Etats, privilégiant le rétablissement de la confiance commune afin de remettre en œuvre des procédures d’inspections bilatérales, que le traité SORT ne prévoyait plus.
Face à ces comportements, les Etats non dotés membres du TNP jugent qu’il n’est pas de leur intérêt de contribuer à renforcer le système international de lutte contre la prolifération nucléaire. Cette attitude leur paraît d’autant plus légitime que des Etats possédant des armes nucléaires hors du cadre légal international acquièrent aujourd’hui une légitimité nouvelle.
En effet, l’accord de coopération nucléaire civile entre les Etats-Unis et l’Inde du 11 octobre 2008 permet à un Etat possédant des armes nucléaires, qui n’a pas voulu coopérer au système international de lutte contre la prolifération, de se voir offrir un traitement particulier. Ainsi, une exemption aux règles du club de Londres lui est accordée, ce qui ouvre la possibilité de coopérations bilatérales en matière nucléaire, sous réserve que ces activités soient placées sous garantie AIEA. En contrepartie, l’Inde ne s’est pas engagée à supprimer ses installations nucléaires militaires.
3) La convention sur les armes biologiques ne comporte toujours pas de mécanisme d’inspection
Les premiers textes portant sur les armes biologiques remontent à l’après première guerre mondiale. Malgré l’utilisation ancienne d’organismes pathogènes à la guerre, les avancées scientifiques et les dommages constatés pour une autre catégorie d’armes, les munitions chimiques, accélèrent la prise de conscience des Etats quant à la dangerosité des armes biologiques pour leurs propres soldats.
Le premier texte international visant à l’interdiction de l’utilisation d’armes biologiques est ainsi signé 1925. Il s’agit du protocole déjà cité concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin de cette même année. Toutefois, ce traité ne portant qu’une interdiction d’emploi, le développement des programmes d’armes bactériologiques sera poursuivi, et accéléré durant le second conflit mondial.
Pourtant, malgré les techniques permettant de militariser plusieurs sources bactériologiques, notamment le bacille du charbon, l’effectivité de ces armements dans le cadre de conflits interétatiques restait assez limitée. Aucun usage confirmé d’armes biologiques en dehors de la guerre sino-japonaise de 1937-1945 n’a été enregistré, et les grandes puissances constatent que les conséquences de ces armements sur les populations sont si terribles que leur utilisation amènerait un discrédit absolu sur les Etats qui y auraient recours.
Progressivement, il devint possible, alors même que l’Union soviétique plaidait pour des discussions portant simultanément sur les armes chimiques et les armes biologiques, de séparer les deux thèmes. Par sa décision, en novembre 1969, d’interrompre le programme bactériologique militaire américain, et le choix ultérieur de détruire les stocks déjà constitués, Richard Nixon, alors président des Etats-Unis, donna l’impulsion nécessaire à l’ouverture de négociations dans le seul domaine des armes biologiques.
L’Union soviétique ayant fait savoir, en mars 1971, qu’elle consentait à mener des discussions séparées sur la lutte contre la prolifération des armes biologiques, l’Assemblée Générale des Nations Unies put adopter, le 16 décembre 1971, le texte de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction. Ouverte à la signature le 10 avril 1972, elle est entrée en vigueur le 26 mars 1975 après la ratification de 22 Etats. Elle constitue aujourd’hui l’instrument juridique majeur de la lutte contre la prolifération des armes biologiques.
A l’instar de la convention sur les armes chimiques, la convention sur l’interdiction des armes bactériologiques et à toxines (CABT) marque une avancée notable dans la lutte contre la prolifération de ce type d’armements, puisque les Etats parties s’interdisent désormais de les détenir, de les fabriquer ou de les transférer. La CABT réunit ainsi un nombre important d’Etats (52) derrière l’objectif de disparition des arsenaux biologiques et bactériologiques.
Toutefois, la CABT ne prévoit aucun mécanisme international d’inspection, les deux grandes puissances de la guerre froide refusant d’envisager la mise en place d’un système international de contrôle. Les différentes conférences de révision de la convention n’ont toujours pas permis de lever cette réserve.
Dès 1986, les Etats parties avaient ainsi accepté de déposer annuellement, auprès des Nations Unies, la liste des mesures engagées pour lutter contre la prolifération bactériologique. A la chute de l’Union soviétique, et forts de l’existence de ces mesures de confiance – confidence building measures – les Etats partisans de la création d’un corps d’inspecteurs, dont la France, avaient relancé l’idée au sein des groupes de travail oeuvrant à la modernisation de la CABT.
La conférence de révision de 1991 aboutit ainsi à la création d’un groupe d’experts, baptisé « VEREX », avec pour mandat de proposer les contours d’un système de vérification. Des discussions furent menées entre 1995 et 2001, mais le projet proposé par le groupe VEREX rencontra l’opposition des Etats-Unis. A défaut de vérification, c'est un mécanisme de suivi multilatéral qui a été mis en place en 2002, fondé sur des réunions d'experts chargés de discuter des méthodes permettant de réduire le risque biologique.
Les réunions sont organisées selon des cycles de cinq ans. La session 2002 – 2005 avait couvert les mesures nationales de surveillance des agents pathogènes, l’amélioration des capacités internationales de réponse à l’utilisation d’armes bactériologiques, l’amélioration des capacités des institutions internationales pour faire face à de graves épidémies, et la mise au point d’un code de conduite pour les scientifiques oeuvrant dans les Etats parties.
Défini lors de la conférence de révision de 2006, le nouveau cycle de conférences a permis, lors d’une réunion d’experts organisée du 18 au 22 août 2008, d’examiner les mesures nationale, régionale et internationale pour améliorer la biosécurité et la biosûreté et des mesures de sensibilisation des scientifiques au risque de prolifération.
Malgré le changement à la tête du pays, la position des Etats-Unis ne semble pas devoir évoluer à très court terme. L’organisation, en août 2009, d’une réunion d’experts de la prolifération biologique à la Maison Blanche n’a pas donné lieu à des déclarations nouvelles de la part des responsables de l’administration Obama.
En l’absence d’un soutien marqué de la part des Etats-Unis, il est illusoire de penser que la CABT pourra être bientôt dotée d’un mécanisme de vérification comparable à celui qui existe pour le TNP, ou la CIAC. Les réflexions menées à Washington se prolongent, alors que la conférence d’examen de la convention est attendue en 2011. La mise en œuvre des principes de la CABT semble donc condamnée à rester durablement affaiblie.
4) Le code de conduite de La Haye, un instrument faible contre la prolifération balistique
Loin de susciter la même attention que les proliférations nucléaire, radiologique, biologique et chimique, la poursuite de programmes de conception et de fabrication de missiles fait l’objet de textes internationaux organisant un système de surveillance reposant essentiellement sur la bonne volonté des acteurs.
L’utilisation de la technologie missile par les Etats est encadrée par le code international de conduite contre la prolifération des missiles balistiques ou « code de conduite de La Haye » (HCOC) (53), texte adopté par 96 Etats le 25 novembre 2002, dont le secrétariat est assuré par le ministère autrichien des affaires étrangères, la présidence étant assurée par les parties sur la base d’une rotation pluriannuelle. La France assurera ainsi la présidence lors de la neuvième conférence régulière d’examen du HCOC, qui aura lieu en 2010.
L’engagement consenti par chaque Etat au titre du HCOC n’est pas très contraignant. Il s’agit simplement de limiter le développement des programmes de développement de missiles capables d’emporter des armes de destruction massive, mais pas de réduire les arsenaux existant, ni d’interdire les recherches ou la fabrication d’armements.
Signé par 130 pays, le HCOC rassemble des Etats très différents, les grandes puissances dotées de missiles performants – Etats-Unis, Russie, France, Grande-Bretagne – et une majorité de membres ne possédant pas de programmes balistiques connus. Parmi les non signataires se trouvent la plupart des pays développant des programmes balistiques actuellement : Israël, la Syrie, l’Arabie Saoudite, l’Iran la Chine, l’Inde, le Pakistan.
Le code de La Haye repose sur un double système de vérifications. Les Etats parties au HCOC doivent d’une part soumettre un rapport annuel portant sur les programmes balistiques qu’ils développent. De plus, afin de limiter les essais balistiques, les Etats parties s’obligent à notifier chacun des lancements de missiles qu’ils souhaiteraient effectuer.
Malgré le soutien apporté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, par une résolution du 8 décembre 2005, le code de conduite de La Haye continue de souffrir de nombreuses faiblesses qui en limitent actuellement la portée. D’abord, son universalisation n’est pas acquise, plusieurs pays, notamment au Moyen-Orient, repoussant toujours leur adhésion. De plus, les systèmes de vérification ne sont pas dépourvus de failles. Ainsi, les Etats-Unis avaient renoncé, en 2008, à remettre leur rapport annuel du fait du refus opposé par la Russie aux demandes du secrétariat. De plus, la part d’essais balistiques faisant l’objet de notifications a été évaluée à moins de la moitié.
B – Des textes complémentaires pour lutter contre les proliférations
L’entrée en vigueur d’interdictions internationales n’ayant pas suffi à empêcher les proliférations, certains Etats se sont efforcés de compléter les textes existant par des accords plus ciblés. C’est ainsi que sont apparus les accords déclarant des régions « zones exemptes d’armes nucléaires », mais également les accords limitant certaines exportations, ainsi que les textes portant sur les étapes nécessaires au développement d’armes nucléaires.
La négociation et la mise en œuvre de ces accords a été et reste difficile. En effet, il s’agit là de textes limitant considérablement la marge de manœuvre des Etats dans des domaines souverains. Ces régimes apparaissent dès lors comme un renforcement de la position dominante de certaines puissances, et les pays proliférants n’ont eu de cesse de les contourner, avec succès.
1) La question des zones exemptes d’armes nucléaires, un enjeu politique
Allant au-delà des engagements visant à réduire le stock d’armes nucléaires, certains Etats ont souhaité s’engager en faveur de l’interdiction absolue du développement d’armes nucléaires sur leurs territoires. Le choix d’exempter une zone d’armes nucléaires est, en général, la conséquence d’une situation géopolitique locale particulière, plutôt qu’un premier pas en faveur d’un monde dénucléarisé.
Plusieurs traités ont ainsi été élaborés afin de déclarer certaines régions « zones exemptes de toute arme nucléaire ». Six sont aujourd’hui en vigueur :
– Le traité sur l’Antarctique, signé 1er décembre 1959 et entré en vigueur le 23 juin 1961, dont l’article 1er interdit toute activité militaire dans la région ;
– Le traité de Tlatelolco, signé le 14 février 1967 et entré en vigueur le 25 avril 1969, dont les 33 Etats parties, situés en Amérique du Sud et en Amérique centrale, s’engagent à interdire sur leurs territoires l’essai, la fabrication, la détention ou l’emploi d’armes nucléaires ;
– Le traité de Rarotonga, signé le 6 août 1985 et en vigueur depuis le 11 décembre 1986, qui vise à faire du Pacifique Sud une zone exempte d’armes nucléaires et compte treize Etats parties ;
– Le traité de Bangkok, signé le 15 décembre 1995 et entré en vigueur le 28 mars 1997, négocié dans le cadre de l’ASEAN et regroupant dix Etats de la région ;
– Le traité de Semipalatinsk, signé le 8 septembre 2006 par les cinq anciennes Républiques soviétiques d’Asie centrale, est entré en vigueur le 26 décembre 2008, un mois après la cinquième et dernière ratification.
– Le traité de Pelindaba, négocié dans le cadre de l’Union africaine, ouvert à la signature depuis 1996, est entré en vigueur à l’été 2009 à la suite de sa ratification par 28 Etats.
Afin de garantir le respect des conditions prévues par ces traités, et pour se prémunir contre les Etats dotés d’armes nucléaires, les traités créant des zones exemptes d’armes nucléaires prévoient la signature, avec les puissances nucléaires, de protocoles bilatéraux prévoyant le respect, par ces puissances, du caractère « dénucléarisé » de la zone.
Les zones exemptes d’armes nucléaires peuvent être limitées à un pays. C’est le cas, par exemple, de la Nouvelle-Zélande, qui s’est déclarée zone exempte d’armes nucléaires en 1987, et de la Mongolie, qui a adopté une loi similaire en 1992.
Ces traités recouvrent des réalités très différentes. Tous ces accords reflètent en réalité une appréciation des rapports de force locaux, dont la conclusion est que la présence d’arme nucléaire serait plus dangereuse que son absence. A l’inverse, on constate que les demandes, plusieurs fois répétées, de négociations pour un accord de dénucléarisation au Moyen-Orient achoppent, certes sur le cas de l’arsenal israélien, mais également sur la conviction de certains Etats, comme aujourd’hui l’Iran, que leur sécurité et leur place dans la région dépendent de leur détention d’un arsenal stratégique. Les zones exemptes d’armes nucléaires montrent bien que les arsenaux stratégiques sont un élément au service d’une volonté de puissance qui, lorsqu’elle trouve d’autres instruments pour se développer, s’empresse d’interdire la bombe à ses éventuels concurrents.
Ainsi, dans le cas de l’accord de Tlatelolco, il s’agit d’un sous-continent où des Etats ayant déjà poussé assez loin leurs recherches nucléaires, le Brésil et l’Argentine, ont convenu de ne pas lancer une course aux armements nuisible à l’équilibre de la région.
Le traité de Semipalatinsk garantit à Moscou que les anciennes Républiques soviétiques ne deviendront pas des rivales sur le plan nucléaire, de même que la dénucléarisation du Pacifique Sud sonne comme un reproche aux puissances occidentales, notamment la Grande-Bretagne, la France, qui ont utilisé cet espace pour effectuer des essais nucléaires. Le cas de l’Antarctique est encore plus particulier, puisqu’il s’agit là d’un espace censé être partagé par la communauté internationale.
2) Les clubs d’exportateurs, des règlements utiles mais insuffisants
Face aux difficultés rencontrées par les traités d’interdiction d’armes de destruction massive, les Etats maîtrisant les technologies en cause, soucieux de développer le commerce des applications civiles sans remettre en cause leurs avantages stratégiques, ont choisi de se réunir au sein de groupes restreints avec pour objectif de réglementer les exportations des produits à usage dual.
Les décisions adoptées par ces clubs ont permis, dans certains cas, d’avancer dans la connaissance des substances réellement dangereuses pour l’être humain, et susceptibles de faire l’objet de proliférations. Dans l’ensemble, les décisions adoptées par les clubs d’exportateurs restent toutefois marquées par des considérations stratégiques, notamment dans le cas des technologies nucléaires.
a) Le groupe Australie, une instance utile à la classification des agents chimiques et biologiques dangereux
Tant les armes chimiques que biologiques reposent sur des matériaux et des équipements également utilisés dans l’industrie et la recherche. Le régime d’inspection mis en place par la convention sur les armes chimiques distingue d’ailleurs les éléments chimiques ayant pour seule finalité la fabrication d’armes, et ceux dont l’objet peut être à la fois civil et militaire.
Le groupe Australie, qui réunit depuis 1985 les Etats souhaitant lutter contre la dissémination des technologies chimiques militaires, et dont l’objet a été étendu aux armes biologiques en 1990, permet ainsi de pallier en partie l’absence de système de vérification prévu pour la CABT. Il complète également le système de la CIAC, qui n’est pas universelle. Il n’en reste pas moins vrai qu’il permet aux Etats fondateurs de régler selon leurs intérêts la diffusion de certaines technologies, hors de tout contrôle universel. Les choix d’exportations de certains produits non classés, notamment certains éléments issus de manipulations génétiques, restent en grande partie le fait des Etats membres et parfois, de leurs seules administrations en charge du commerce.
Malgré son caractère informel, le groupe Australie joue un rôle important de classification des agents biologiques susceptibles de détournement. La convention sur l’interdiction des armes chimiques comprend, dans ses annexes, une liste de produits chimiques et de précurseurs particulièrement dangereux. La CABT se contente, pour sa part, de rappeler l’engagement des Etats parties de ne pas développer d’agents pathogènes à des fins militaires sans attirer l’attention sur certains organismes en particulier.
Les listes du groupe Australie sont donc utilisées comme référence pour déterminer si des activités industrielles liées à certains agents pathogènes sont susceptibles de détournement. Elles facilitent la surveillance des activités des Etats non parties à la CABT, et même de ceux qui en font partie, en l’absence de système international de contrôle dans ce domaine.
b) Les clubs d’exportateurs nucléaire et balistique, des groupes de défense d’intérêts stratégiques
L’idée de réunir les Etats maîtrisant les technologies liées aux armes de destruction massive pour organiser les échanges des produits à usage dual révèle une approche bien plus modeste que les ambitions universalistes des premiers chercheurs du secteur nucléaire, qui voulaient confier ce rôle à une agence internationale représentant tous les Etats. Dès lors, les groupes de régulation des exportations n’arrivent pas à remplir leur rôle, car ils sont considérés comme un outil de domination des puissances disposant de ces technologies sur les autres Etats.
Ce constat, et l’instrumentalisation des clubs d’exportateurs à des fins stratégiques, sont encore plus visibles dans les domaines nucléaire et balistique, qui concentrent les ambitions des Etats cherchant à affirmer leur puissance internationale.
Ainsi, le 10 septembre 2008, soit quelques mois après la signature d’un projet d’accord américano-indien de coopération nucléaire, le « groupe des fournisseurs nucléaires », instance la plus active en matière de contrôle des exportations nucléaires, a adopté une décision autorisant la coopération de ces membres avec l’Inde en vue du développement de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, alors même que l’Inde ne participe pas au TNP, et qu’elle refuse que ses installations nucléaires militaires soient contrôlées.
De la même manière, le régime MTCR, censé pallier les manques du régime d’interdiction qu’instaure le code de La Haye (54), est en fait largement focalisé sur le risque de prolifération nucléaire, puisque les technologies qu’il vise sont plus précisément celles qui permettent de monter une tête nucléaire sur un vecteur balistique. Il s’agit donc d’empêcher les Etats non-alliés de se doter d’arsenaux stratégiques, et non pas de lutter contre la prolifération d’une technologie militaire en tant que telle.
Ainsi, le MTCR, considéré par beaucoup d’Etats comme un club restreint aux grandes puissances et à leurs alliés, continue de buter sur la disponibilité de technologies balistiques sur un marché « parallèle ». Acteur central de ces réseaux, la Corée du Nord a conclu plusieurs contrats avec des Etats souhaitant se doter de missiles, notamment le Pakistan et l’Iran. Par ailleurs, des programmes nationaux sont poursuivis avec les ressources propres des Etats, comme en Inde et sans doute en Iran. Il est clair que les missiles des Etats les plus avancés ne seront pas vendus à toutes les puissances émergentes, par simple réflexe d’autoprotection (certains missiles, notamment ceux disposant de têtes multiples, sont très difficiles à intercepter). Pour autant, le club des exportateurs réunis au sein du MTCR est impuissant à arrêter la prolifération balistique.
Tant le groupe des fournisseurs nucléaires que le MTCR montrent clairement que les accords entre exportateurs, destinés à compléter les conventions d’interdiction des armes nucléaires et balistiques, ne sont pas suffisants. Les décisions pour le moins ambiguës adoptées par ces groupes d’Etats, notamment l’autorisation d’exporter des technologies nucléaires en Inde, renforcent le sentiment dominant, qui voit dans ces clubs une démarche élitiste, vouée à maintenir le statu quo au profit des Etats possédant des armes de destruction massive.
3) L’interdiction des essais nucléaires et de la production de matières fissiles : des textes déjà appliqués en partie
Afin de réduire encore les risques liés à la prolifération nucléaire, deux approches complémentaires ont été poursuivies par la communauté internationale. Il s’agit d’empêcher les Etats de construire des armes nucléaires et de moderniser celles qu’ils possèdent, en interdisant la conduite d’essais et la production de matières fissiles à des fins militaires.
Les deux traités phares dans ce domaine ne sont toujours pas en vigueur. Les Etats-Unis, comme pour la CABT, n’ont pas encore ratifié le traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE), et n’ont pas, jusqu’à une période récente, souhaité accélérer les négociations pour parvenir à un texte interdisant la production de certaines matières fissiles. L’opposition américaine, résultat des rapports de force au sein du Sénat dans le cas du TICE, pourrait être partiellement levée par l’administration Obama. Cependant, une telle évolution n’apporterait pas de changements techniques majeurs, bien qu’elle permette sans doute de modifier le paysage diplomatique dans un sens favorable aux Etats-Unis.
L’interdiction des essais nucléaires vise à limiter la capacité des Etats à améliorer leurs éventuels programmes proliférants. Cette question a mobilisé les puissances non dotées d’armes nucléaires dès les premières années de la mise en place du système international de lutte contre cette prolifération. C’est en 1957 que s’ouvrent des négociations internationales sur la question des essais, notamment sous la pression de l’Inde. Celles-ci aboutissent à la conclusion d’un accord partiel sur les essais nucléaires, le 10 octobre 1963. Parfois désigné sous ses acronymes anglophones – PTBT ou LTBT : partial ou limited test ban treaty – cet accord initialement signé par les Etats-Unis, la Russie et le Royaume-Uni vise à limiter les essais nucléaires aux seuls explosions souterraines. Sont donc interdits tous les essais atmosphériques, sous-marins ou extra-atmosphériques.
La mise en œuvre du PTBT ne représente toutefois qu’un demi-succès, les principaux Etats visés par ses dispositions, notamment la France et la Chine, ayant refusé de le signer. Ce texte représente toutefois la première initiative internationale dans le domaine, qui sera suivie, le 3 juillet 1974, par la signature du traité de limitation des essais nucléaires souterrains, entre les Etats-Unis et l’Union soviétique. Un second accord bilatéral, signé le 28 mai 1976, vise à élargir le champ d’application du traité de limitation. Ces deux accords bilatéraux, qui n’entreront en vigueur qu’en 1990, prévoient la mise en place d’un système de vérification, et donc l’accès des inspecteurs nommés par chacune des parties aux sites d’essais de l’autre.
Prolongeant les avancées déjà enregistrées, les parties au PTBT proposent, en 1991, la transformation de ce traité en accord d’interdiction complète des essais nucléaires. Les discussions formelles sur ce projet commenceront en 1993, mais elles sont rendues difficiles par la sensibilité des questions abordées. Le développement de méthodes de simulation d’essais nucléaires permet en effet aux Etats dotés d’armes nucléaires de poursuivre leurs programmes de modernisation de leurs arsenaux stratégiques.
Le renvoi à l’Assemblée Générale des Nations Unies d’un projet de traité d’interdiction complète des essais nucléaires – TICE – permet finalement de sortir de l’impasse. Le 10 septembre 1996, une large majorité des Etats membres adoptent finalement le texte proposé.
Le nouveau traité prévoit de confier à une organisation internationale, l’OTICE – organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires – des pouvoirs étendus de contrôle, impliquant la mobilisation de plusieurs centaines de stations de détection sismiques, hydroacoustiques, par radionucléides ou par infrasons. Au cas où un événement détecté laisserait supposer qu’un essai nucléaire a été réalisé, l’OTICE se réserve le droit de dépêcher une équipe d’inspection sur place, avec des pouvoirs étendus.
Toutefois, l’entrée en vigueur de ce traité continue de poser problème. L’article 14 prévoit en effet que celle-ci ne pourra être déclarée qu’une fois que les 44 Etats listés dans l’annexe II auront ratifié le TICE. A l’heure actuelle, 41 Etats de l’annexe II ont signé le traité (55), et 39 l’ont ratifié (56). Une telle situation pourrait évoluer. Le président Obama a ainsi laissé entendre que la ratification du TICE, qui faisait partie de ses engagements de campagne, pourrait avoir lieu d’ici mai 2010. La pression sur les 5 autres Etats de l’annexe II n’ayant toujours pas ratifié ce traité serait alors considérable.
Du point de vue technique, les avancées à attendre de cette éventuelle ratification américaine ne seraient pas forcément décisives. En effet, en dépit de la situation actuelle, les principales dispositions du TICE font déjà l’objet de mesures d’application, décidées par la commission provisoire qui prépare, depuis 1997, l’entrée en vigueur du traité. Une partie du réseau de surveillance est déjà en place, la France ayant joué un rôle moteur puisqu’elle fait partie, avec la Russie et les Etats-Unis, des seuls Etats disposant d’un réseau de stations de surveillance utilisant toutes les technologies disponibles, telles qu’énumérées plus haut. La carte suivante recense les stations existantes.
Stations de surveillance de l’OTICE
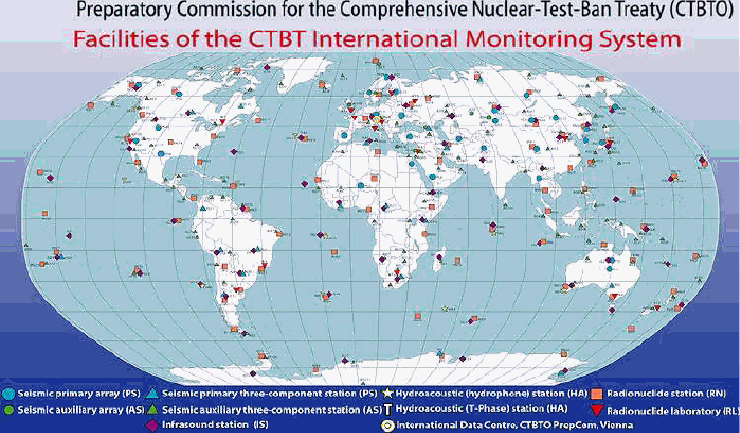
En fait, l’OTICE sert aujourd’hui à alerter la communauté internationale sur l’existence d’essais nucléaires, et permet de mutualiser les moyens de détection et de contrôle. Pour autant, les Etats technologiquement capables d’une capacité d’appréciation autonome utilisent leurs moyens pour confirmer le jugement commun. Surtout, les réactions internationales à chaque essai détecté montrent que le TICE seul ne saurait empêcher la prolifération nucléaire. Ainsi, le récent essai nord-coréen, le 25 mai 2009, n’a pas conduit à l’adoption de nouvelles mesures contre le régime de Pyongyang, qui s’est même permis de lancer des missiles à des fins expérimentales le 12 octobre de la même année.
En plus des règles touchant à la réalisation d’explosions expérimentales, la lutte contre la prolifération nucléaire passe par des règles concernant les matériaux utilisés par les technologies nucléaires militaires. Lors de la conférence d’examen du TNP en 1995, les parties s’étaient ainsi entendues pour élaborer un traité d’interdiction de production de matières fissiles à des fins militaires, dit parfois « traité cut off ». Cet objectif a été réitéré lors du sommet du G8 à Denver en 1997.
Cependant, malgré l’engagement des principaux pays détenteurs de l’arme nucléaire, les discussions menées sur le sujet au sein de la conférence des Nations Unies sur le désarmement restent dans l’impasse. Un projet de texte proposé en 2006 par les Etats-Unis, s’il a permis de rallier un certain nombre d’Etats auparavant hostiles à l’idée même d’un traité touchant la production de matériaux nucléaires militaires, n’a pas levé toutes les résistances pour autant.
L’administration Obama a fait de ce projet de traité un autre de ses objectifs centraux, avec la ratification du TICE. Des avancées restent possibles puisqu’en mai 2009, la conférence du désarmement a adopté la négociation du « cut off » dans son programme de travail. Il n’en reste pas moins que les principales mesures de réduction de la production de matériaux nucléaires militaires (plutonium militaire ou uranium hautement enrichi) sont le fait des engagements unilatéraux des Etats.
Le traité d’interdiction complète des essais nucléaires, comme le traité interdisant la production de matières fissiles à des fins militaires, seraient des compléments utiles au TNP. Toutefois, les discussions à leur sujet sont comme biaisées, dans la mesure où les proliférations qu’ils visent à réduire, qui concernent les seuls programmes étatiques, n’apparaissent pas comme les menaces principales pesant sur l’équilibre international. Conscients de cette insuffisance, les membres du G8, réunis derrière les Etats-Unis, ont choisi d’orienter leurs efforts dans une nouvelle direction, elle-même sujette à critiques.
C – La « communauté internationale » contre la prolifération : une menace instrumentalisée ?
Largement inspirée par les Etats-Unis, une nouvelle approche de la lutte contre la prolifération a été adoptée au début des années 2000. Elle consiste à organiser les actions des Etats contre les réseaux de prolifération, en présentant ces organisations comme l’avant-poste du terrorisme nucléaire.
L’élection du Président Barack Obama a permis d’inscrire cette démarche dans un discours nouveau, en faveur d’un monde « libre de toute arme nucléaire ». Paradoxalement, ces propositions s’accompagnent de gestes diplomatiques à destination d’Etats qui ont proliféré, et refusent toujours de participer au régime international de lutte contre la prolifération.
Il semble en réalité que les récentes initiatives, et le discours nouveau adopté par les Etats-Unis et une grande partie de la communauté internationale, permettent simplement de masquer la réalité de déséquilibres mondiaux persistants. Le TNP est bâti sur une architecture conçue à la fin des années 1960, dans un monde bipolaire, où trois puissances avaient réussi, fortes de leur place au rang des vainqueurs de la deuxième guerre mondiale, à imposer leur position de puissance globale. Le monde multipolaire d’aujourd’hui tient de plus en plus mal dans un cadre fixé il y a quarante ans.
1) Contre-prolifération et dénucléarisation, deux nouvelles manières de confirmer le statu quo
La période de l’après-guerre froide voit un renouveau certain des proliférations, loin des espoirs de stabilisation qui ont pu être nourris. Les crises qu’a connues le système juridique, pourtant développé depuis les années 1970 afin d’éviter justement une multiplication des arsenaux, ont souligné les imperfections des normes en vigueur.
Certains événements ont permis de lancer des réformes visant à renforcer le système en place. Le programme « 93+2 » a ainsi suivi la découverte des programmes nucléaires irakien et nord-coréen, de la même manière que la mise au jour des installations chimiques et biologiques soviétique et irakienne a soulevé des questions de fond sur les régimes existant.
Toutefois, ces réformes n’ont pas supprimé définitivement les tentations proliférantes, pas plus qu’elles n’ont empêché les Etats de se doter de moyens de destruction de masse. Ce constat a conduit les Etats-Unis, bientôt suivis par d’autres pays, à modifier leur approche de la lutte contre les proliférations.
a) La persistance des crises malgré le droit existant
La révélation par un groupe d’opposants, en 2002, de l’existence d’un programme nucléaire conduit en grand secret par la République d’Iran a ouvert la voie à une succession de véritables « crises de prolifération » (57). Ainsi, dès janvier 2003, la Corée du Nord a annoncé qu’elle se retirait du traité de non prolifération, après avoir expulsé les inspecteurs de l’AIEA en décembre 2002.
Les crises de prolifération ne limitent pas au domaine nucléaire. Des agents chimiques à destination de la Corée du Nord ont ainsi été interceptés au milieu du mois d’août 2003. Ce même pays s’est trouvé à l’origine d’un envoi de missiles de moyenne portée Scud à destination du Yémen, finalement interceptés en décembre 2002.
Le système international de lutte contre la prolifération fait preuve de plusieurs faiblesses, dont la première tient à l’essence du droit international. Les Etats, principaux sujets de ce droit, en sont également les auteurs, ce qui laisse dès lors une large place à la négociation dans l’exécution des règles.
Plus spécifiquement, dans le domaine de la prolifération, les traités à vocation universelle semblent buter sur la résistance d’acteurs en nombre limité, mais dont on voit mal comment les faire rejoindre le groupe des Etats parties. C’est notamment le cas de la Corée du Nord et de l’Iran, mais également d’Israël et de la Syrie.
Dès lors, l’appréciation du comportement des Etats non parties au traité ouvre la voie à une instrumentalisation des notions mêmes de menace et de prolifération. En la matière, la notion « d’axe du mal » développé par Georges W. Bush, qui trouve en écho les qualificatifs de « grand et petit Satans » adressés par l’Iran aux Etats-Unis et Israël, montrent bien que le jugement porté sur les comportements proliférants ou non d’autres Etats dépend des objectifs stratégiques poursuivis.
La concentration sur ses trois dossiers, et, de manière croissante, sur le programme iranien, a même conduit à accuser de laxisme le directeur général de l’AIEA, M. Mohamed El Baradei, soupçonné de faiblesse vis-à-vis de l’Iran. Or, les travaux menés par les inspecteurs de l’agence concernant l’Iran n’ont jamais été pris en défaut, et l’agence affirme régulièrement, depuis la fin de l’année 2007, que plusieurs indices tendent à montrer que l’Iran poursuit un programme nucléaire militaire.
Dernière critique adressée aux traités actuels, ceux-ci ne permettraient pas toujours d’adapter les réponses aux cas concrets de proliférations. Ainsi, l’organisation pour l’interdiction des armes chimiques n’a pas encore utilisé la possibilité d’inspection par mise en demeure que lui offre le texte, ce qui réduit le caractère dissuasif des inspections.
Afin de contourner ces difficultés, plusieurs Etats ont choisi de développer une nouvelle approche de la lutte contre la prolifération, parfois baptisée de « contre-prolifération », à l’inverse de la « non-prolifération » qui désignerait le régime antérieur.
b) La contre-prolifération et ses faux semblants
Afin de compléter les textes universels et les règlements édictés par les clubs d’exportateurs, de nouveaux programmes de lutte contre la prolifération sont apparus au cours des dix dernières années. Plus proches de politiques de coopération que de textes formels encadrant les relations inter-étatiques, ils visent à traiter les problèmes concrets de prolifération, notamment les réseaux de prolifération parallèles.
La contre-prolifération associe contrainte, coopération et sanction, là où la non-prolifération faisait confiance aux principes d’interdictions universelles et aux mécanismes de sanction. Il s’agit en effet d’empêcher des personnes d’agir, et pas seulement d’influencer le comportement des Etats.
Le sommet du G8 organisé à Kananaskis, en juin 2002, a marqué la première étape de ce renouveau des actions de lutte contre la prolifération. Prenant acte des difficultés à faire respecter les textes existants, il a permis le lancement du Partenariat mondial du G8 contre la prolifération des armes de destruction massive et des matières connexes. Ce dernier vise à « « empêcher les terroristes et ceux qui les abritent, d'acquérir ou de mettre au point des armes nucléaires, chimiques, radiologiques et biologiques, des missiles, ainsi que les matières, le matériel et la technologie qui s'y rattachent ». Il a été rejoint, depuis 2002, par quatorze autres pays, et par l’Union européenne.
Les premiers bénéficiaires de ce partenariat ont été la Russie et l’Ukraine. Des moyens importants ont été mobilisés pour mener, sur une base bilatérale ou multilatérale, des actions dans les domaines suivants : démantèlement des sous-marins nucléaires, destruction des armes chimiques, élimination de matières fissiles dangereuses, reconversion d’anciens chercheurs du secteur de l’armement. Le sommet de L’Aquila, en juillet 2009, a rappelé que le Partenariat mondial du G8 pourrait voir son champ étendu dans le futur. D’autres initiatives similaires ont été adoptées antérieurement à ce sommet.
Le sommet du G8 d’Evian, en juin 2003, a permis aux Etats-Unis de faire accepter par leurs partenaires le principe de l’Initiative de sécurité contre la prolifération (PSI : proliferation security initiative) proposée par le Président Bush le 31 mai 2003 à Cracovie. Sans créer de textes ou d’institutions spécifiques, la PSI vise à rassembler des projets concrets pour lutter contre les proliférations nucléaire, chimique, biologique ou balistique, à destination d’Etats ou de groupes non-étatiques.
La PSI reprend l’idée du Partenariat mondial du G8, en l’élargissant à l’ensemble de la planète et à toutes les proliférations. 91 pays participent aujourd’hui à l’initiative de sécurité. Après la dissolution du « noyau dur », qui rassemblait 15 des 17 Etats fondateurs, les 20 Etats les plus actifs se sont regroupés au sein d’un groupe opérationnel d’experts. Leur dernière réunion, en septembre 2008 à Paris, a permis d’avancer quelques propositions pour sensibiliser les Etats partenaires aux risques existants.
Principalement axée sur la surveillance des trafics existants, la PSI a permis l’adoption de principes communs d’interception, en septembre 2003. Elle sert depuis de cadre à l’organisation d’exercices communs périodiques d’interception. Elle s’accompagne, depuis le sommet du G8 de Saint-Petersbourg du 15 juin 2006, d’une Initiative globale pour combattre le terrorisme nucléaire, lancée par les Etats-Unis et la Russie. Treize Etats ont, par la suite, élaboré une déclaration de principes, approuvée par 76 pays aujourd’hui.
Lancées par le G8, le partenariat mondial et la PSI ont vu leurs principes légitimés par l’Organisation des Nations Unies, à travers la résolution 1540 du Conseil de Sécurité, qui vise à interdire aux Etats d’aider les acteurs privés à acquérir des armes de destruction massive.
La contre-prolifération est aujourd’hui érigée en véritable paradigme des nouvelles actions de lutte contre les proliférations. Comme le résume Serge Sur (58), elle s’apparente à un régime de « coûts à l’encontre des pays récalcitrants et d’avantages pour les pays qui coopèrent ». Il est significatif que la Russie et les Etats-Unis, propriétaires des deux premiers arsenaux nucléaires mondiaux, soient les avocats les plus actifs des initiatives de contre-prolifération. Il n’est pas interdit de se demander si ces mesures ne servent pas de contre-feux visant à masquer le combat que livrent les Etats avantagés par la situation actuelle pour maintenir le statu quo.
c) Le discours sur la « dénucléarisation du monde » : le maintien du statu quo derrière l’affirmation d’un changement
La promotion d’un monde dépourvu d’armes nucléaires est régulièrement relancée depuis les années 1990, par des personnalités importantes de la scène internationale, notamment Henry Kissinger (59). Le gouvernement britannique s’est même officiellement engagé en faveur de cette perspective, ainsi que le président Obama, dans un discours prononcé à Prague le 5 avril 2009 (60). Elle connaît un regain d’actualité à l’approche de la conférence d’examen du TNP.
Par elle-même, cette idée n’est pas exempte de critiques (61). En effet, l’histoire de l’arme nucléaire montre que celle-ci s’est imposée comme une arme de dissuasion. Elle a d’ailleurs très bien rempli ce rôle, puisqu’elle a empêché tout conflit ouvert de grande échelle même entre deux ennemis régionaux frontaliers comme l’Inde et le Pakistan.
Or, à l’heure actuelle, aucun autre type d’armement ne peut assumer cette fonction. L’arme nucléaire, dans ses déclinaisons les plus modernes, possède une capacité de destruction incomparable, et provoque donc un effet de terreur inégalé. Les tentatives de « dissuasion conventionnelle » n’ont pas réussi à empêcher l’apparition de conflits majeurs au cours des siècles précédents.
Dès lors, la disparition de l’arme nucléaire ne peut être envisagée que dans le cadre d’une baisse généralisée des tensions internationales. Dans le cas contraire, la tentation serait alors encore plus forte, pour les « petits » Etats, de développer des armes nucléaires, considérées comme des « égalisateurs de puissance ».
Surtout, la vision d’un monde « libre » de toute arme nucléaire sert les intérêts des Etats-Unis, conscients que la suppression des arsenaux nucléaires renforcerait considérablement leur puissance en ôtant toute possibilité d’équilibrer leur écrasante supériorité conventionnelle.
Quelle que soit l’appréciation théorique que l’on porte sur la volonté de « dénucléariser » le monde, la réalité des efforts dans ce domaine ne résiste pas vraiment à l’analyse. En premier lieu, les programmes unilatéraux de désarmement des Etats dotés d’armes nucléaires ne portent jamais jusqu’à la suppression des arsenaux, et s’accompagnent, bien au contraire, de la modernisation des équipements existants.
Comme souvent en politique étrangère, les discours prononcés ne reflètent pas la volonté profonde des acteurs. Ainsi, la résolution 1887, adoptée le 24 septembre 2009 par le Conseil de sécurité des Nations unies, a été présentée comme marquant un pas vers un monde exempt d’armes nucléaires. A la lecture de ce texte, il est permis d’en douter.
Ainsi, la Chine et la France, soucieuses du poids militaire conventionnel des Etats-Unis et jugeant que le monde était incertain, ont opposé des demandes précises pour faire inscrire des éléments garantissant la possibilité de maintenir un arsenal dissuasif. Le texte de la résolution indique que le Conseil de sécurité est « déterminé à œuvrer pour créer les conditions pour un monde sans armes nucléaires », mais que celles-ci devront être établies « sur la base d’une sécurité non diminuée pour tous ». Les déclarations du Président de la République à l’issue du Conseil de Sécurité n’ont laissé planer aucun doute sur le maintien des capacités de dissuasion nucléaire de la France, et aucune demande américaine de suppression de cet arsenal n’a été formulée.
Il apparaît, en réalité, que les initiatives de contre-prolifération et le renouveau des discours en faveur du désarmement nucléaire sont utilisés par leurs avocats pour servir les intérêt des membres permanents du Conseil de sécurité, à savoir le maintien de l’équilibre prévu par le TNP, qui donne à cinq Etats une position dominante. A la veille d’une conférence d’examen de ce traité, il est possible d’avancer quelques pistes pour promouvoir une réforme plus profonde du droit international des proliférations, afin d’amener tous les Etats à coopérer pour limiter les phénomènes proliférants.
2) Revoir l’équilibre actuel pour lutter contre les menaces réelles
Le triptyque sur lequel repose le traité de non prolifération est resté inchangé : interdiction pour les Etats non dotés de développer l’arme nucléaire, coopération entre Etats pour généraliser l’usage civil de l’énergie nucléaire, désarmement des Etats disposant d’armes nucléaires. Toutefois, les différentes conférences d’examen sont venues rappeler que le TNP gravait dans le marbre un ordre international déséquilibré, et que cette situation était difficile à modifier.
Afin d’avancer dans le domaine de la lutte contre les proliférations, il conviendrait, contrairement à ce qui a été fait jusqu’à présent, de s’attaquer aux causes réelles des proliférations, qui surgissent en raison de perturbations géopolitiques régionales, plutôt que chercher à maintenir en place un équilibre ancien.
a) Les échecs des conférences passées : quand les Etats membres du TNP ne respectent pas leurs engagements
La conférence de 2000 avait abouti, malgré des blocages initiaux importants dus notamment à la proximité des essais nucléaires réussis par l’Inde et le Pakistan en 1998, à une déclaration finale très ambitieuse.
Celle-ci définissait treize étapes pour aboutir à un désarmement général :
– (1) L’entrée en vigueur du traité d’interdiction complète des essais nucléaires et (2) l’adoption d’un moratoire sur les explosions nucléaires en attendant cette date
– (3) Le lancement de négociations sur un traité d’interdiction de production de matières fissiles à des fins militaires
– (4) L’extension des travaux de la conférence sur le désarmement aux armes nucléaires et (5) l’adoption d’un principe d’irréversibilité pour toute mesure de désarmement nucléaire
– (6) L’engagement des Etats dotés d’armes nucléaires à éliminer totalement leur arsenal, (7) l’entrée en vigueur de START II, la signature de START III et la préservation du traité ABM, (8) la mise en œuvre de l’initiative trilatérale Etats-Unis / Russie / AIEA visant à l’élimination de toutes les armes nucléaires tactiques et (9) l’adoption de mesures spécifiques (désarmement, transparence) par les Etats dotés
– (10) Le placement sous contrôle international des matières fissiles pouvant avoir une utilité militaire
– (11) Le maintien d’un objectif final de désarmement total et général, (12) la soumission par les Etats dotés de rapports réguliers sur le désarmement aux autres parties et (13) le développement de moyens de contrôle effectif concernant les initiatives de désarmement.
Nombre de ces obligations n’ont pu être remplies avant la conférence d’examen de 2005. Trois écueils principaux ont ralenti le processus engagé en 2000. D’abord, le traité d’interdiction complète des essais nucléaires tarde à entrer en vigueur. En deuxième lieu, la conférence du désarmement, seule enceinte qui réunisse les membres du TNP et les Etats non signataires, n’a toujours pas réussi à obtenir un consensus sur l’étendue des thèmes qu’elle doit couvrir. Enfin, les efforts de désarmement ont été, au court de cette période, plutôt limités, à la suite notamment de la rupture des relations entre les Etats-Unis et la Russie.
Ces échecs tiennent en grande partie à la résistance apportée par les Etats favorisés par le statu quo actuel. C’est notamment le cas pour le TICE, que la France n’a ratifié qu’une fois sa dernière campagne d’essais nucléaires accomplis, et que le Sénat américain continue de bloquer. Les discussions sur le traité interdisant la production de matières fissiles, abordées dans le cadre de la conférence de désarmement, ont été pour leur part ralenties notamment du fait des désaccords régnant au sein du « groupe des 21 », pays neutres et non alignés, incapables de s’entendre sur la ligne à tenir concernant le traitement de la question des stocks déjà produits.
Prenant acte de ces difficultés, la conférence d’examen qui s’est tenue du 2 au 27 mai 2005 a abouti à des résultats très en retrait par rapport à la précédente réunion. Aucun texte n’a été adopté à l’issue de cette conférence, et la déclaration de 2000 a été présentée par plusieurs délégations, dont celles des Etats-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne, comme caduque. Les propositions avancées, dans le domaine des essais, de la production de matière fissile ou des garanties négatives de sécurité, n’ont pas réussi à générer un consensus.
La conférence de 2005 a donné l’impression que les équilibres de 1968 étaient irrévocables. Les engagements pris en 2000, très forts, n’ont pas résisté à l’épreuve du temps. Afin de rendre le droit international réellement efficace pour lutter contre les proliférations, il conviendrait de cibler les menaces qui pèsent réellement sur les populations, et d’y apporter des solutions partagées par tous les Etats.
b) Renforcer le droit pour l’adapter à la réalité des proliférations
Si les textes existants ne remplissent pas toujours leur but, ils n’en restent pas moins des références indispensables pour penser la lutte contre la prolifération. Dès lors, leur mise en œuvre doit être encouragée, s’agissant en tout cas des menaces les plus sensibles sur la sécurité de nos populations.
Ainsi, les risques que font courir les arsenaux biologiques ou chimiques des Etats ne participant pas aux conventions en vigueur dans ces domaines pourraient être sensiblement réduits. De la même manière, la création d’un régime de vérifications efficace, au service de la CABT, permettrait de connaître l’étendue des programmes existants, et réduirait sans doute la menace d’une fuite ou d’une utilisation accidentelle de ces armements.
La prolifération balistique, qui ne représente pas une menace en soi si elle n’est pas associée à des programmes nucléaires, est peu encadrée aujourd’hui. L’application des régimes existants suffirait juridiquement à empêcher une explosion des programmes de missiles, sans que de nouveaux textes soient forcément nécessaires.
En revanche, l’adoption d’un traité sur l’interdiction de la production de matières fissiles à des fins militaires représenterait une garantie importante dans le domaine des proliférations nucléaire et radiologique, puisqu’elle conduirait à la suppression d’une source d’approvisionnement de groupes terroristes intéressés par l’acquisition de ce type de matériaux.
En effet, c’est bien l’avènement d’un terrorisme « de destruction massive » qui est présenté comme la menace la plus inquiétante, alors que nous avons estimé que les risques étaient faibles, sauf dans le domaine radiologique. Il est paradoxal que les efforts du G8, repris par une grande partie de la communauté internationale, se soient focalisés sur des programmes étatiques limités, au lieu de chercher à développer une coopération universelle contre ce risque.
c) Promouvoir la coopération de tous les Etats contre le terrorisme
L’utilisation par des terroristes d’armes de destruction massive représente le scénario « noir » pour tous les gouvernements. De nombreuses initiatives internationales ont été adoptées au nom de la lutte contre cette menace. Toutefois, si certains programmes récents ont permis de lancer des partenariats concrets utiles, ils restent entièrement soumis à la bonne volonté des Etats. Malgré l’adoption de la résolution 1540, nombre d’Etats n’ont pas encore fourni de rapports concernant les mesures mises en place pour prévenir le risque de « terrorisme de destruction massive ».
Pourtant, la coopération dans ce domaine est absolument nécessaire. Il s’agit en effet, pour les Etats, de garder l’entier contrôle sur les mouvements de technologies proliférantes. Un tel objectif ne peut être atteint sans une association très étroite des moyens étatiques, notamment le partage d’informations sensibles.
Or, la méfiance qui s’est installée dans les relations internationales semble repousser un groupe de pays dans la marginalité. Chacun est suspecté d’utiliser le thème de la lutte contre la prolifération pour faire avancer ses intérêts, rendant illusoire une véritable association des Etats pour éviter l’émergence de réseaux réellement dangereux. Il est illusoire de penser que les Etats renonceront à ce comportement. Une telle évolution impliquerait un changement radical du contexte international actuel. C’est dans ce contexte que la question du nombre d’Etats autorisés à détenir une arme nucléaire peut être posée.
d) L’élargissement du club du TNP : la question interdite ?
Fondamentalement, les Etats proliférants voient le système international de lutte contre la prolifération comme la survivance d’un ordre international figé, dépassé et injuste. Les cas de prolifération les plus récents montrent que l’arme nucléaire n’est pas recherchée dans un but offensif, mais comme un élément de la puissance ou comme le meilleur garant de la sécurité.
Pourtant, le nombre de détenteurs de l’arme nucléaire n’évolue pas, à l’exception de l’Afrique du Sud, seul Etat ayant expérimenté et renoncé à la bombe. La prochaine conférence d’examen du TNP pourrait être l’occasion de débattre de la possibilité d’augmenter le nombre d’Etats membres nucléaires.
La reconnaissance du droit d’un Etat d’accéder au nucléaire militaire renvoie à un changement de conception global de l’ordre international, mis en place par le TNP. En l’absence d’initiatives dans ce domaine, on peut craindre pour la capacité de survie d’un ensemble de textes dont la clef de voûte repose sur l’équilibre international défini à leur profit par les grandes puissances à la fin de la seconde guerre mondiale. Pour le moment, les travaux du comité préparatoire de la conférence d’examen n’ont apparemment pas pris cette option en compte.
Ce préalable est pourtant indispensable à la mise en œuvre de plusieurs propositions très importantes pour faire du TNP un outil efficace de lutte contre la prolifération, et qui concerne l’utilisation à des fins civiles de l’énergie nucléaire.
En l’état actuel du texte, un Etat peut faire valoir son droit à l’énergie nucléaire civile et à la recherche pour développer des moyens d’enrichissement et de retraitement. C’est la stratégie qu’a poursuivie l’Iran, mettant initialement l’AIEA en position difficile, puisque la seule présence de centrifugeuses ne constituait pas en tant que telle une atteinte au TNP. Le site de Natanz ayant été tenu secret, une telle décision portait en revanche clairement atteinte au principe d’application de bonne foi des textes internationaux, et fait partie des éléments incitant à penser que le programme nucléaire iranien comporte des visées militaires.
Depuis, des propositions ont été faites pour faire valoir le droit à l’énergie nucléaire civile de l’Iran tout en supprimant les craintes suscitées par son programme d’enrichissement. Initialement, la Russie seule avait offert d’enrichir sur son sol la totalité de l’uranium iranien. Plus récemment, le groupe des « 5+1 » (France, Royaume-Uni, Etats-Unis, Russie, Chine et Allemagne) ont proposé à l’Iran de le faire bénéficier de leurs infrastructures pour porter le taux d’enrichissement de l’uranium à 20 % afin de faire fonctionner le réacteur expérimental de Téhéran (TTR). Les échanges de matières et leur utilisation au sein du TTR seraient placés sous le contrôle de l’AIEA.
Après une première réunion le 18 octobre 2009 à Vienne, la position iranienne n’a pas évolué.
Pour éviter d’aboutir à des blocages de ce type, des proposition globales ont été mises sur la table depuis plusieurs années par les Etats disposant de technologies d’enrichissement. Présenté le 22 février 2005 à l’AIEA, le rapport Pellaud énumère ainsi plusieurs pistes qui permettraient d’améliorer la disponibilité d’uranium enrichi pour les Etats dotés de technologies nucléaires civiles :
– Renforcer les mécanismes du marché commercial ;
– Mettre en oeuvre des garanties de fournitures internationales avec l’AIEA ;
– Promouvoir la conversion d’installations existantes en entités multinationales ;
– Créer par des accords volontaires des approches multilatérales pour les nouvelles installations.
S’inspirant de ces recommandations, les six Etats enrichisseurs (France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne, Etats-Unis, Chine, Russie) ont émis une proposition qui distingue trois niveaux. Le premier, celui du marché commercial de l’uranium enrichi, qui fonctionne plutôt bien dans l’ensemble, resterait la principale source d’approvisionnement. Le deuxième niveau serait constitué par des engagements collectifs de la part des industriels, garantissant la disponibilité d’uranium enrichi. Le troisième niveau serait plus politique, et reposerait sur l’engagement des Etats enrichisseurs à ne pas s’opposer au fonctionnement de la garantie commerciale sauf pour des raisons de lutte contre la prolifération.
Sur la base d’une proposition américaine, 25 Etats, dont la France, sont désormais réunis au sein du Global nuclear energy partnership (GNEP), partenariat global pour l’énergie nucléaire qui vise à favoriser le développement d’un cycle du combustible dit « fermé », permettant le retraitement du combustible irradié. Le GNEP reprend les orientations de la proposition des six Etats enrichisseurs, en soulignant l’importance de développer des cadres juridiques internationaux pour les activités liées à l’enrichissement et au retraitement.
Enfin, la Russie a proposé, le 25 janvier 2006, de mettre au point sur son territoire un prototype d’infrastructure globale d’enrichissement, permettant à tous les Etats parties au TNP d’utiliser des centres internationaux du cycle du combustible nucléaire, au sein desquels seraient conduits les processus d’enrichissement et de retraitement.
Au-delà des arguments juridiques liés à la crise iranienne, les arguments en faveur de systèmes internationaux de type « banque du combustible », ou des propositions apparentés, soulignent la nécessité d’un cadre international renforcé pour permettre aux Etats parties au TNP de tirer un réel bénéfice du respect des clauses de non-prolifération, sans craindre de rupture d’approvisionnement d’uranium enrichi.
De telles options seront vraisemblablement discutées lors de la prochaine conférence d’examen du TNP au printemps 2010. Toutefois, il est vraisemblable qu’aucune avancée concrète ne sera possible tant que les discussions n’associeront pas les Etats disposant d’armes nucléaires sans y être autorisés par le droit existant, dont le nombre équivaut à celui d’Etats dotés conformément au TNP. C’est donc à un renouvellement des conditions de ce débat qu’il convient de travailler dès maintenant, par exemple en incitant les pays disposant de capacités nucléaires à les rendre publiques et à s’engager dans des discussions sur l’avenir de la lutte contre la prolifération nucléaire.
Le traité de non prolifération des armes nucléaires doit changer de nature. Il doit intégrer en tant que tels tous les Etats qui maîtrisent les éléments du fonctionnement de l’arme nucléaire en leur conférant par ce statut les devoirs liés aux responsabilités internationales qu’ils recherchent. Il s’agit là de la seule voie pour que le protocole additionnel « 93+2 » soit largement ratifié, ce qui constitue le seul moyen de maîtriser les proliférations.
Nous avons souhaité, par la présente étude, analyser comment les différentes formes de prolifération pouvaient avoir des conséquences géopolitiques, savoir si elles représentaient un réel danger pour la sécurité internationale et faire la part des choses entre la réalité et les constats alarmistes. Au terme de celle-ci, nous concluons aux éléments suivants :
Dissuasion nucléaire
1- Nous réaffirmons que le concept de dissuasion est le fondement de la politique de défense de la France et qu’il garantit notre indépendance nationale.
2- Nous rappelons que même si certains responsables militaires et politiques ont été tentés par le recours à l’arme nucléaire, notamment sous la guerre froide, l’arme nucléaire n’a jamais été utilisée depuis l’explosion d’une bombe au-dessus de Nagasaki. Elle constitue fondamentalement une arme stratégique, ultime recours dont les Etats n’ont normalement pas vocation à se servir, sauf si leurs intérêts vitaux – en fait leur existence même – étaient en jeu. L’arme nucléaire est un facteur de paix dans les relations internationales. Les Etats n’ont pas le goût du suicide.
Prolifération : Moyen-Orient
3- Nous considérons qu’il sera difficile d’empêcher l’Iran d’avoir la capacité de mettre au point un engin nucléaire. A l’heure où nous écrivons ces lignes (novembre 2009), nous avons la certitude que l’Iran a au minimum la volonté d’être un Etat du seuil. Savoir s’il veut faire exploser une bombe et bâtir un arsenal est une autre question. Ses progrès dans la mise au point de missiles balistiques montrent qu’il veut maîtriser l’ensemble du processus qui va de l’enrichissement de l’uranium au lancement de vecteurs porteurs de charges.
4- L’Iran, entouré d’Etats nucléaires (Russie, Pakistan, Israël, flotte américaine) et victime d’armes chimiques lors du conflit qui l’a opposé à l’Irak, veut se doter des capacités de sanctuariser son territoire et de garantir son indépendance. Cette réflexion est la même que celle à laquelle la France avait procédé dans les années 50 et 60, après le traumatisme de la défaite de 1940 et de l’occupation, et dans le contexte de la menace soviétique et de l’incertitude du parapluie américain, afin de garantir sa sécurité et son indépendance.
5- Un Iran doté de la technologie nucléaire militaire ne modifiera pas les stratégies d’usage de la bombe. Il ne représentera aucune menace militaire pour la sécurité de l’Europe, des Etats-Unis ou d’Israël, dans la mesure où les dirigeants iraniens savent qu’ils se heurteraient à des représailles massives en cas d’utilisation de leur bombe.
6- En conséquence, le déploiement d’un bouclier antimissile pour protéger l’Europe et les Etats-Unis n’est pas indispensable. Il peut éventuellement constituer un outil utile, mais la dissuasion est le moyen essentiel de rappeler aux dirigeants iraniens la nature fondamentale de l’arme nucléaire.
7- Un Iran doté de la technologie nucléaire militaire constitue en revanche une atteinte à l’ordre juridique constitué par le Traité de non prolifération (TNP), dont l’objectif est d’une part de ne pas élargir le nombre de puissances nucléaires militaires, d’autre part d’aboutir à un désarmement nucléaire. En conséquence, il convient de convaincre l’Iran de ne pas mettre au point une bombe nucléaire et de lui garantir, conformément au TNP, un usage pacifique de l’atome pour son développement économique et social.
8- Un Iran doté de la technologie nucléaire militaire modifie surtout la donne politique au Moyen-Orient en renforçant son rôle actuel d’acteur incontournable dans l’arbitrage des affaires interarabes et dans le conflit israélo-palestinien. Cette perspective est celle qui gêne le plus les intérêts des Etats-Unis.
9- La politique d’ambiguïté volontaire d’Israël quant à la possession de la bombe est aisément compréhensible mais en empêchant tout dialogue entre Israël et ses voisins sur les questions nucléaires, elle donne un prétexte idéologique à l’Iran pour se doter d’ADM. Téhéran pourra aisément affirmer que sa bombe ne sera pas dirigée contre ses voisins arabes et qu’elle n’aura pas pour fonction d’attaquer Israël, mais qu’elle servira à contrebalancer la puissance stratégique d’Israël par un jeu d’équilibre assimilable à celui qui opposait les Etats-Unis et l’URSS sous la guerre froide.
10- Dans l’hypothèse où l’Iran se doterait de l’arme nucléaire, nous pensons que le seul choix d’Israël sera de rendre publique l’existence de son arsenal puis d’entamer des négociations avec Téhéran, ne serait-ce que pour éviter le déclenchement accidentel d’une guerre nucléaire. En revanche, la perspective d’un Moyen-Orient dénucléarisé s’éloignera encore car d’autres Etats, notamment la Turquie, souhaiteront peut-être se doter d’ADM.
11- La révélation de l’existence d’une unité clandestine d’enrichissement en Syrie, à Al Kibar, est due au travail de services de renseignements. La Syrie a violé ses engagements au regard du TNP, en dissimulant ce bâtiment à l’AIEA. Israël, en choisissant de procéder au bombardement de cette unité au lieu de transmettre préalablement ses informations à l’agence, a également affaibli l’AIEA, en l’empêchant de jouer pleinement son rôle d’inspection et d’établir les faits.
Prolifération : Corée du Nord
12- La tentative de la Corée du Nord de mettre au point l’arme nucléaire est préoccupante car elle révèle que le régime de ce pays, dont les motivations sont rationnelles, est prêt à provoquer une crise majeure en Asie pour assurer sa survie. L’enjeu des négociations est d’éviter une course aux armements dans une région où les tensions sont encore vives. La Corée du Nord joue un rôle également inquiétant dans la prolifération de technologies nucléaires et balistiques. L’un des enjeux stratégiques de la crise nord-coréenne est de ne pas conduire à la mise au point d’armes nucléaires au Japon, Etat du seuil, ce qui par ricochet provoquerait une crise majeure avec la Chine.
Asie du Sud
13- L’accord entre les Etats-Unis et l’Inde dans le domaine nucléaire civil révèle les ambiguïtés et les limites du droit international. Pour s’ouvrir le marché indien, les Etats-Unis ont accepté de signer un accord avec un Etat qui conteste l’ordre juridique du TNP. La justification politique des Etats-Unis est que l’Inde est une démocratie et qu’elle ne dissémine pas de technologie nucléaire. La France a procédé à la même analyse en signant avec l’Inde un accord similaire.
14- Les Etats-Unis ont refusé au Pakistan ce qu’ils ont accordé à l’Inde, marquant ainsi leur défiance à l’égard d’Islamabad.
15- Nous considérons nécessaire de fournir au Pakistan toute l’assistance dont il a besoin pour sécuriser son arsenal nucléaire. Ce dernier ne risque pas dans l’immédiat de tomber aux mains des terroristes, mais il convient de rester vigilant tout autant que de respecter la souveraineté pakistanaise.
16- L’échec du Pakistan lors de la crise de Kargil, en 1999, démontre que l’arme nucléaire ne confère pas la puissance globale attendue par un Etat s’il ne dispose pas par ailleurs de forces conventionnelles conséquentes et/ou de moyens de pression économique.
Défense antimissile
17- La défense antimissile résulte du constat, opéré par les Etats-Unis, que les missiles balistiques détenues par un nombre croissant d’Etats permettent à ces derniers de conduire des conflits asymétriques. En étant capables de détruire ces missiles lors de leur trajectoire, les Etats-Unis rétablissent leur supériorité stratégique.
18- A l’heure actuelle, les recherches sur les vecteurs et les charges antimissile ont permis aux Etats-Unis de franchir un cap technologique, mais l’ensemble des études indépendantes, notamment celles du Congrès, révèlent que la fiabilité du système n’est pas optimale. Leur défense antimissile ne peut ainsi parer une attaque massive russe. En conséquence, la défense antimissile n’altère pas la validité du concept de dissuasion.
19- Le concept de dissuasion serait en revanche remis en cause si le système antimissile avait une fiabilité absolue et pouvait numériquement faire face à une attaque massive.
20- La défense antimissile est principalement un moyen qui structure les alliances des Etats-Unis. Les pays qui souhaitent participer au bouclier préconisé par Washington soumettent au contrôle américain les éléments les plus essentiels de leur défense en échange de la protection dont ils bénéficient. Ils ne peuvent plus qualifier leur défense nationale d’indépendante.
21- Le projet d’implantation d’installations de détection et de lanceurs en République tchèque et en Pologne n’était pas dirigé contre la Russie, mais les radars permettaient de surveiller la partie occidentale du territoire de la Russie. Son abandon par l’administration Obama fait tomber un élément inutile de tension avec la Russie, au moment où il est plus important qu’Occidentaux et Russes coopèrent sur des dossiers essentiels.
22- Les Etats-Unis proposent de remplacer ce dispositif par un système reposant sur des missiles intercepteurs emportés par des frégates. Le secrétaire général de l’OTAN a souhaité intégrer ce nouveau système aux programmes communs de l’Alliance. Une telle option reviendrait pourtant à faire financer par les alliés un système dont la clé de fonctionnement serait détenue par les Etats-Unis.
Désarmement nucléaire
23- Le désarmement nucléaire est un objectif inscrit dans le TNP, applicable à toutes les parties qui en sont signataires.
24- La perspective d’un nouvel accord de réduction des arsenaux entre les Etats-Unis et la Russie constitue un pas supplémentaire et nécessaire vers cet objectif et un moyen de rétablir la confiance entre ces deux pays.
25- La proposition américaine d’une suppression généralisée des armes nucléaires doit en revanche être examinée avec circonspection. Une telle suppression aurait pour effet de donner aux Etats-Unis, et demain à la Chine, une écrasante supériorité stratégique et politique compte tenu de leur puissance conventionnelle. Cette proposition ne peut constituer un réel facteur de paix que si elle s’accompagne d’une proposition de réduction massive des armements conventionnels.
26- Nous considérons que la France, qui a choisi de disposer d’une dissuasion suffisante et proportionnée à ses besoins, n’a pas à réduire une nouvelle fois un arsenal composé de quelques centaines de têtes quand les Etats-Unis et la Russie en détiennent encore plusieurs milliers.
Dissémination des technologies de destruction massive
27- La libéralisation des échanges a favorisé et continuera de favoriser la dissémination des technologies nucléaires et balistiques. La mondialisation a pour caractéristique de faciliter la diffusion des connaissances. Aucune mesure juridique et pratique n’a empêché pour l’instant le développement de ce phénomène.
28- Au contraire, les tentatives de lutte contre la dissémination des technologies ont conduit au renforcement de la coopération occulte entre Etats proliférants.
Terrorisme et armes de destruction massive, un risque réel ?
29- Il est avéré que les principaux groupes terroristes s’intéressent aux ADM, ce qui constitue théoriquement une menace pour la sécurité des populations des pays qu’ils visent. L’intention ne vaut toutefois menace que si elle s’accompagne de la maîtrise des technologies.
30- Cette menace est réelle dans les domaines chimique et biologique, comme l’ont prouvé les attentats dans le métro de Tokyo et l’attaque à l’anthrax aux Etats-Unis. Elle est envisageable par des moyens biologiques, bien que nous ne considérions pas que le risque soit aussi élevé que l’affirment nos collègues du Congrès américain dans le rapport qu’ils ont publié en décembre 2008.
31- L’abondante dissémination des matières fissiles à travers le monde rend hypothétiquement possible un attentat par un moyen radiologique.
32- La complexité de la technologie nucléaire, notamment de la détonique, rend en revanche hautement fantaisiste l’hypothèse qu’un groupe terroriste puisse provoquer un attentat nucléaire, sauf s’il bénéficiait de l’aide d’un Etat… Ce qui changerait la nature de l’acte et provoquerait des représailles contre cet Etat. Nous considérons qu’un tel attentat est un mythe, que des gouvernements ou des groupes de pression ont parfois intérêt à agiter pour atteindre d’autres objectifs politiques, comme un contrôle croissant sur l’ensemble de la société au nom de la sécurité, au détriment des libertés individuelles et publiques.
33- Nous sommes en revanche beaucoup plus inquiets quant à la possibilité d’un attentat par diffusion de matières radioactives, par engin à dispersion ou engin à uranium faiblement enrichi. Cette hypothèse est réaliste compte tenu du nombre de matières radioactives présentes dans des centaines de lieux publics, comme les hôpitaux. Nous appelons en conséquence à la mise en place d’un plan national de recensement et de protection de l’ensemble des lieux où se trouvent de telles matières et demandons que le gouvernement propose à nos partenaires de l’OTAN et de l’Union européenne d’en faire de même.
34- Les attaques cybernétiques ne provoquent pas de destruction massive mais peuvent désorganiser des sociétés de plus en plus dépendantes de la circulation des données. Des plans se mettent progressivement en place pour parer de telles attaques, mais il semble évident qu’il faille en faire un élément majeur de la défense nationale.
35- La suprématie cybernétique est également une arme de domination économique et politique. Au-delà des attaques portées au système, la maîtrise et le tri des systèmes d’information confèrent un avantage stratégique majeur aux Etats qui disposent des capacités les plus avancées.
Traité de non prolifération et autres traités
36- Nous considérons que le TNP a subi ces dernières années de sévères atteintes, en raison notamment des programmes nucléaires nord-coréens et iraniens mais aussi des efforts encore insuffisants des deux principales puissances nucléaires pour réduire leurs arsenaux, compte tenu de leurs objectifs stratégiques.
37- Nous considérons que le TNP doit néanmoins être réformé pour être renforcé, car il constitue le cadre juridique et politique qui permet d’éviter une catastrophe nucléaire, tout en permettant à chaque pays de bénéficier pacifiquement de l’atome pour son développement économique et social. Nous estimons également que l’extension du protocole additionnel (protocole 93+2) de l’AIEA à tous les Etats parties au TNP constitue un objectif diplomatique crucial pour renforcer le régime juridique de non prolifération.
38- Alors que le TNP sera renégocié en 2010, nous constatons que ce traité est le reflet d’une situation politique héritée de la guerre froide et que son inadaptation à la réalité internationale d’aujourd’hui est patente. Il conduit à une vision du monde où seules les 5 puissances du Conseil de sécurité ont droit à la technologie nucléaire militaire et interdisent aux autres Etats d’assurer leur survie par le même moyen. Une révision du TNP s’impose, qui permette d’insérer dans un dispositif juridique toutes les autres puissances nucléaires militaires.
39- Le caractère non officiel de l’arsenal nucléaire israélien pose un problème juridique et politique. Les Etats parties du TNP peuvent certes demander à Israël de reconnaître publiquement son arsenal, encore faudrait-il que cette reconnaissance permette ensuite d’engager un processus conduisant à un Moyen-Orient dénucléarisé. Or seule Israël dispose de la bombe dans cette région. Il lui est difficile d’y renoncer unilatéralement tant que ses voisins ne reconnaissent pas son existence et ne signent pas un traité de paix. Mais cette reconnaissance est liée à l’établissement d’un Etat palestinien… L’Etat d’Israël, pourtant non signataire du TNP, s’il reconnaissait la possession d’armes nucléaires, porterait atteinte à l’ordre politique du traité au même titre que l’Iran, le Pakistan et l’Inde. Paradoxalement, dans le contexte politique qui est celui du Moyen-Orient, la confidentialité de l’arsenal israélien arrange les puissances du TNP en leur évitant d’avoir à se pencher sur un problème bien plus complexe que l’existence de cet arsenal. Cette reconnaissance est toutefois un élément essentiel d’un accord de paix global au Moyen-Orient.
40- En conséquence, la légitimité du TNP et donc sa survie ne passent-elles pas par l'intégration au traité, lors de sa rénovation, de tous les Etats nucléaires militaires, en tant que tels, leur conférant par ce statut les devoirs liés aux responsabilités internationales qu'ils recherchent?
41- Nous jugeons primordial que tout Etat partie au TNP soit également signataire du traité d’interdiction des essais nucléaires.
42- L’internationalisation du cycle du combustible nucléaire est sans nul doute le meilleur moyen de renforcer le TNP en garantissant en pratique à chaque Etat l’usage de la technologie nucléaire civile.
43- Bien que les armes biologiques soient en déclin, il est indispensable que la convention sur ces armes soit dotée d’un mécanisme de vérification comparable à celui mis en œuvre par le TNP ou par la convention sur l’interdiction des armes chimiques.
Our aim in this study has been to analyse how the various forms of proliferation could have geopolitical consequences, determine whether they represent a real danger for international security and strike a balance between reality and alarmist statements. Our conclusion to the study includes the following elements:
Nuclear deterrence
1- We reaffirm that the concept of deterrence is the basis of the defence policy of France and guarantees its national independence.
2- We recall that even if some military officials and politicians have been tempted by recourse to the nuclear weapon, especially during the Cold War, the nuclear weapon has never been used since the explosion of a bomb over Nagasaki. Basically it is a strategic weapon, the ultimate recourse which states are not normally meant to use unless their vital interests – in fact their very existence – are at stake. The nuclear weapon is a factor of peace in international relations. States don't have a liking for suicide.
Proliferation: Middle East
3- We feel it will be difficult to prevent Iran from having the capability to develop a nuclear device. At the time of writing (November 2009), we are certain that Iran has at least the determination to be a threshold state. Knowing whether it wants to explode a bomb and build an arsenal is another matter. Its progress in the development of ballistic missiles shows that it wants to master all the process from uranium enrichment to the launch of warhead delivery vehicles.
4- As Iran is surrounded by nuclear states (Russia, Pakistan, Israel, American fleet) and was a victim of chemical weapons during its conflict with Iraq, it wants to provide itself with the capabilities to sanctuarise its territory and guarantee its independence. This thinking is the same as that of France in the 1950s and 1960s, after the trauma of the 1940 defeat and Occupation, and in the context of the Soviet threat and the uncertainty of the American umbrella, so as to guarantee its security and independence.
5- An Iran with military nuclear technology will not modify bomb-use strategies. It won't represent any military threat to Europe's or Israel's security insofar as the Iranian leaders know they would face massive retaliation should they use their bomb.
6- Consequently, the deployment of an antimissile shield to protect Europe and the United States is not essential. It may form a useful instrument, but deterrence is the major means of reminding the Iranian leaders of the fundamental nature of the nuclear weapon.
7- An Iran with military nuclear technology does however form an infringement of the legal order set up by the Non-Proliferation Treaty (NPT), whose aim is to contain the number of military nuclear powers and also to reach nuclear disarmament. It is therefore important to convince Iran to refrain from developing a nuclear bomb and, in accordance with the NPT, it should be assured of a peaceful use of the atom for its economic and social development.
8- An Iran with military nuclear technology changes above all the political order in the Middle East by strengthening its present role as a key player in the arbitration of inter-Arabian affairs and in the Israeli-Palestinian conflict. This prospect is that which most hinders the interests of the United States.
9- Israel's voluntary policy of ambiguity regarding its possession of the bomb is easily understandable but, by preventing any dialogue between Israel and its neighbours on nuclear matters, it gives Iran an ideological pretext to equip itself with WMD. Tehran will be easily able to affirm that its bomb will not be directed against its Arabian neighbours and that it will not have the purpose of attacking Israel but of serving to counterbalance Israel's strategic power by a balancing game that can be likened to that between the United States and the USSR at the time of the Cold War.
10- Should Iran equip itself with the nuclear weapon, we feel that Israel's sole choice will be to publicly disclose the existence of its arsenal and then start negotiations with Tehran, if only to avoid the accidental triggering of a nuclear war. On the other hand, the prospect of a denuclearised Middle East will become remoter because other states, especially Turkey, will perhaps want to equip themselves with WMD.
11- The revelation of the existence of a secret enrichment facility, at Al Kibar, is due to the work by intelligence services. Syria has infringed its commitments under the NPT by hiding this building from the IAEA. Israel, by choosing to proceed to bomb this facility instead of previously transmitting this knowledge to the agency, has also weakened the IAEA, by preventing it from fully playing its role of inspection and of establishing the facts.
Proliferation: North Korea
12- North Korea's attempt to develop the nuclear weapon is worrisome as it reveals that this country's regime, whose motivations are rational, is ready to cause a major crisis in Asia to ensure its survival. The challenge of the negotiations is to avoid an arms race in a region where tensions are still live. North Korea is also playing a worrisome role in the proliferation of nuclear and ballistic technologies. One of the strategic issues of the North-Korean crisis is to avoid the development of nuclear weapons in Japan, a threshold state, which would cause a major crisis in China by a knock-on effect.
South Asia
13- The agreement between the United States and India in the civilian nuclear field reveals the ambiguities and limits of international law. To open up the Indian market to itself, the United States accepted to sign an agreement with a state that challenges the NPT legal order. The political justification put forward by the United States is that India is a democracy and that it doesn't disseminate nuclear technology. France made the same analysis by signing a similar agreement with India.
14- The United States has refused to Pakistan what is has granted to India, thereby showing its mistrust of Islamabad.
15- We feel it is necessary to provide Pakistan with all the help it needs to secure its nuclear arsenal. The latter is not likely to fall into the hands of terrorists for the time being, but vigilance should be exercised and Pakistani sovereignty should equally be respected.
16- Pakistan's failure in the Kargil conflict in 1999 shows that the nuclear weapon does not grant the global power expected by a state if it does not also have substantial conventional forces and/or economic means of pressure.
Antimissile defence
17- Antimissile defence has resulted from the observation made by the United States that the ballistic missiles held by an increasing number of states allow these to conduct asymmetric conflicts. By being able to destroy these missiles during their trajectory, the United States re-establishes its strategic supremacy.
18- At present, the research on carriers and antimissile warheads has allowed the United States to cross a technological threshold. However, independent studies as a whole, especially those by the Senate, underscore that the reliability of the system is not optimal. For instance, the US antimissile defence cannot parry a massive Russian attack. Therefore, antimissile defence does not detract from the validity of the concept of deterrence.
19- The concept of deterrence would however be challenged if the antimissile system were to have absolute reliability and could cope numerically with a massive attack.
20- Antimissile defence is mainly a means structuring the alliances of the United States. Countries wishing to participate in the shield recommended by Washington submit to American control the most essential elements of their defence in exchange for protection. They can no longer describe their national defence as independent.
21- The project to site detection facilities and launchers in the Czech Republic and in Poland was not directed against Russia, but the radars allowed the western part of the territory of Russia to be monitored. Its abandonment by the Obama administration has wiped out a pointless factor of tension with Russia at a time when it is more important that Westerners and Russians cooperate on essential matters.
22- The United States proposes to replace this system by one based on frigate-borne interceptor missiles. NATO's Secretary General has expressed the desire to integrate this system in joint NATO programmes. Such an option would be tantamount however to getting the allies to fund a system whose decisional process would be controlled by the United States.
Nuclear disarmament
23- Nuclear disarmament is a goal enshrined in the NPT and applicable to all its signatory parties.
24- The prospect of a new agreement between the United States and Russia on the reduction of arsenals is an additional and necessary step towards this goal and a means of re-establishing confidence between these two countries.
25- The American proposal for a generalised elimination of nuclear weapons must however be examined with caution. Such elimination would lead to giving the United States, and tomorrow China, overwhelming strategic and political superiority given their conventional power. This proposal cannot form a real factor of peace unless combined with a proposal for the massive reduction of conventional weapons.
26- We feel that France, which has chosen to have sufficient deterrence proportional to its needs, does not have to reduce once again an arsenal composed of a few hundred warheads whereas the United States and Russia still hold several thousand of them.
Dissemination of mass destruction technologies
27- Trade liberalisation has promoted and will continue to promote the dissemination of nuclear and ballistic technologies. Globalisation leads to facilitating the circulation of knowledge. No legal and practical measure has prevented for the time being the development of this phenomenon.
28- On the contrary, attempts to combat the dissemination of technologies have lead to strengthening secret cooperation between proliferating states.
Terrorism and weapons of mass destruction, a real risk?
29- It is known that the main terrorist groups are taking an interest in WMD, which theoretically forms a threat to the security of the populations of the countries they target. Their intention is not however tantamount to a threat unless they also master these technologies.
30- This threat is real in the chemical and biological fields as demonstrated by the Tokyo underground attacks and the anthrax attack in the United States. However we feel that the biological risk, although conceivable, is not as high as affirmed by our colleagues at the American Congress in the report they published in December 2008.
31- The abundant dissemination of fissile materials worldwide makes an attack by a radiological means hypothetically possible.
32- The complexity of nuclear technology, especially of detonics, however makes the hypothesis of a terrorist group being able to perpetrate a nuclear attack highly fanciful, unless they received the help of a state... which would change the nature of the act and would lead to reprisals against that state. We feel that such an attack is something of a myth, which governments or pressure groups sometimes find it in their interest to brandish to reach other political goals, such as increasing control over society as a whole in the name of security, to the detriment of individual and public freedoms.
33- On the other hand we are far more worried about the possibility of an attack by the diffusion of radioactive materials, by a dispersion device or by a lowly-enriched uranium device. This hypothesis is realistic given the number of radioactive materials present in hundreds of public places such as hospitals. We therefore call for the roll-out of a national plan taking an inventory of and protecting all places where such materials are to be found and ask the government to propose to our NATO and European Union partners to follow suit.
34- Cybernetic attacks do not cause massive destruction but can disorganise societies increasingly dependent on data circulation. Plans are progressively being set in place to parry such attacks, but it appears obvious that they should be made a major element of national defence.
35- Cybernetic supremacy is also a weapon of economic and political domination. Apart from attacks against the system, the mastery of information systems grants a major strategic interest to the states that have the most advanced capabilities.
Non-Proliferation Treaty and other treaties
36- We feel that the NPT has undergone severe infringements in recent years, owing in particular to the North Korean and Iranian nuclear programmes but also to the still insufficient efforts of the two main nuclear powers to reduce their arsenals, given their strategic objectives.
37- We feel that the NPT must nevertheless be overhauled in order to be strengthened, as it forms the legal and political framework allowing a nuclear disaster to be avoided while enabling each country to peacefully enjoy the atom for its economic and social development. We also feel that the extension of the IAEA additional protocol (93+2 protocol) to all the states parties to the NPT forms a crucial diplomatic goal to strengthen the legal non-proliferation regime.
38- While the NPT will be renegotiated in 2010, we note that this treaty reflects a political situation inherited from the Cold War and that its lack of adaptation to today's international reality is obvious. It leads to a vision of the world where only the five powers of the Security Council are entitled to military nuclear technology and forbid other states from ensuring their survival by the same means. A revision of the NPT is a necessity which will allow all the other military nuclear powers to be included in a legal regime.
39- The unofficial nature of the Israeli nuclear arsenal raises a legal and a political problem. The states parties to the NPT may well ask Israel to publicly acknowledge its arsenal, but then it would be necessary that this acknowledgement would allow a process to be started leading to a denuclearised Middle East. However only Israel has the bomb in this region. It is difficult for it to relinquish it unilaterally as long as its neighbours do not recognise its existence and do not sign a peace treaty. But this recognition is tied to the establishment of a Palestinian state... If the state of Israel, although a non-signatory of the NPT, admitted the possession of nuclear weapons it would infringe the political order of the treaty in the same way as Iran, Pakistan and India. Paradoxically, in the political context which is that of the Middle East, the confidentiality of the Israeli arsenal suits the NPT powers by allowing them to avoid addressing an issue far more complex than the existence of this arsenal. This recognition is however an essential factor of a global Middle East peace agreement.
40- Consequently, when the NPT is overhauled don't its legitimacy and therefore its survival require that all military nuclear states, as such, be integrated in it, which status will grant them the duties related to the international responsibilities they are seeking?
41- We consider it is vital that any any state party to the NPT should also be a signatory of the Nuclear Test Ban Treaty.
42- The internationalisation of the nuclear fuel cycle is no doubt the best means of strengthening the NPT by guaranteeing in practice to each state the use of civilian nuclear technology.
43- Although biological weapons are in decline, it is essential that the convention on these weapons should be given a verification mechanism comparable to that implemented by the NPT or by the convention on the prohibition of chemical weapons.
La commission examine le présent rapport d’information au cours de sa séance du mercredi 18 novembre 2009.
Après l’exposé de vos deux rapporteurs, un débat a lieu.
M. le président Axel Poniatowski. Je remercie les rapporteurs pour le sérieux de leur travail très détaillé, et la qualité des réflexions qu’ils ont menées. Je partage votre appréciation sur le risque de prolifération appliqué à l’Iran : quand bien même cet État en arrivait à détenir l’arme nucléaire, les mesures de rétorsion à son encontre en cas d’emploi seraient très destructrices. En revanche, ne sous-estimez vous pas le risque induit de prolifération, à commencer par les États sunnites du Golfe ? Sur ce point, j’arrive à une conclusion inverse de la vôtre : si rien n’est fait, le danger est grand d’une prolifération immédiate en Arabie Saoudite, mais aussi en Égypte et en Turquie. Par ailleurs, j’adhère entièrement à vos propositions concernant la révision du TNP, en particulier pour inclure les États dotés du nucléaire militaire. Sans cette novation, le TNP déjà de peu d’influence disparaîtra complètement. J’y insiste : c’est l’une des propositions les plus importantes de ce rapport.
Mme Marie-Louise Fort. Je veux à mon tour féliciter les rapporteurs. Pendant très longtemps on a connu un sentiment de crainte à l’égard de l’arme nucléaire, d’où la lutte contre la prolifération. L’arme biologique a également suscité de grandes inquiétudes. Quelles menaces voyez-vous à l’avenir ? Verra-t-on se multiplier des guérillas très sophistiquées utilisant les nouvelles technologies ? Assistera-t-on à des « guerres virtuelles », des guerres cybernétiques ? Comment s’en prémunir ? Des recherches sont-elles en cours dans ce domaine ?
Mme Nicole Ameline. Ce rapport est un document de référence, digne d’éloges. Je souhaiterais interroger les rapporteurs sur l’appréhension de ce sujet au sein de l’OTAN, à la lumière de la place nouvelle que la France y occupe. Quelles implications ce retour de la France emporte-t-il en termes de dissuasion ? Alors que nombre d’États de l’UE se placent sous la protection américaine, comment promouvoir une vision européenne de la dissuasion ?
M. Jean-Paul Lecoq. J’analyserai avec la plus grande attention les présupposés du rapport car je crains d’y trouver un biais. Aujourd’hui, il n’est pas de réflexion sur les sujets d’importance mondiale qui ne souligne la prédominance de la Chine ; l’économie a pris le pas sur le politique. Or le rapport continue à s’inscrire dans une logique dépassée, celle de l’équilibre de la terreur. Je suis en profond désaccord avec une telle vision, qui oublie de s’intéresser aux causes du comportement belliqueux d’un État envers un autre. Ces causes sont à rechercher dans l’économie, dans la situation de misère où vivent les populations. Mais nous préférons agiter des menaces : celle des prétendues armes de destruction massives qui ont justifié la guerre en Irak, ou celle du virus H1N1 qui n’a d’autre but que de préparer la France à une éventuelle attaque biologique, contrairement à ce que l’on fait croire à nos concitoyens. Enfin, je récuse l’attitude consistant à récompenser les délinquants en adaptant le droit international – le TNP en l’espèce – aux États qui ne respectent pas les règles existantes, comme Israël par exemple.
M. André Schneider. J’adresse moi aussi mes félicitations aux rapporteurs pour les nombreux éclaircissements fournis. Comment voyez-vous la sécurité mondiale évoluer dans un proche avenir ? Quelles tendances pour le nombre de têtes nucléaires ? Quel risque majeur ? Et que peut faire la France face à cette situation ?
Mme Martine Aurillac. Ce rapport est extrêmement intéressant. Je vous suis notamment reconnaissante de nous mettre en garde contre les chimères du bouclier anti-missiles. Pouvez-vous nous dire quels sont les États qui refusent les contrôles de l’AIEA, hormis l’Iran ?
M. Michel Terrot. Félicitations pour ce travail. M. Myard a écarté la possibilité pour des groupes terroristes de fabriquer des armes nucléaires et je souscris à cette analyse. Mais quid de la capacité de tels groupes à se procurer des armes nucléaires en profitant de la faiblesse de tel ou tel État en détenant ? Que se passerait-il par exemple si un régime islamiste plus ou moins inféodé à Al Qaida s’emparait du pouvoir au Pakistan ?
M. Dominique Souchet. Comment mesurez-vous le risque proliférant au Moyen-Orient à partir du cas iranien ? En particulier, pouvez-vous préciser ce qui vous amène à minimiser ce risque pour la Turquie et l’Arabie Saoudite ? Que penser des recherches réactivées en Égypte ? Je comprends votre analyse sur l’effet mécanique de l’élévation du niveau culturel mais ce raisonnement apaisant tient-il toujours dans un contexte d’accélération du processus d’accession à l’arme nucléaire en Iran ? La prolifération dans un grand État sunnite aura-t-elle un effet plutôt stabilisateur ou déstabilisateur ?
M. Jean-Michel Ferrand. Ce rapport est passionnant mais inquiétant. On peut se demander s’il existe vraiment un droit international dans le domaine de la prolifération. Chaque fois qu’un sujet délicat se présente, on nous explique qu’aucun droit n’est applicable, qu’il s’agisse de l’intervention militaire des États-Unis en Irak, de la reconnaissance du Kosovo ou du régime de contrôle des armes biologiques. En définitive, le seul élément de stabilité semble être la dissuasion nucléaire. Hommage soit donc rendu au Général de Gaulle ! Mais n’y a-t-il d’autre rempart aujourd’hui que la dissuasion ?
M. Paul Giacobbi. Je suis reconnaissant aux rapporteurs de la qualité de leurs propos, clairs et nets. Je veux souligner le caractère fondamentalement inégalitaire du TNP. D’une part il n’incluait à l’origine que les États détenteurs et gelait ce fait accompli. D’autre part il n’empêche pas que l’on ratifie à présent un accord avec l’Inde, récompensant un comportement que l’on reproche justement à l’Iran… L’hypocrisie est manifeste : souvenons-nous que les premiers essais nucléaires indiens étaient justifiés par de prétendus travaux de canalisation au Rajasthan ! Quant au Pakistan, il est dans la dénégation. Le problème est que le TNP est en contradiction avec la nature même de l’arme nucléaire : comment la réserver aux grands États alors que le pouvoir égalisateur de l’atome donne à cette arme un intérêt considérable pour les petits et moyens États ? Et prétendre endiguer le phénomène par une sorte de confinement technologique est illusoire, tant les systèmes électroniques les plus sophistiqués ou les capacités de puissance de calcul nécessaires se répandent à travers le monde à l’heure actuelle. J’observe que le mécanisme du TNP consiste à s’en remettre entièrement à l’AIEA. Or son action – notamment celle de la direction générale actuelle finissante – ne me semble pas très convaincante, même lorsque l’agence a accès aux informations qu’elle demande. Certaines pratiques sont même choquantes de la part d’un directeur général que l’on a trop tendance à porter aux nues, dans les choix de diffusion ou de non-diffusion de certains rapports. Monsieur le Président, la commission ne pourrait-elle, à partir de ce rapport d’information, porter une contribution propre sur la position française à l’égard du futur TNP ?
M. Jean-Claude Guibal. J’adresse mes compliments aux rapporteurs, qui décrivent un monde dangereux, immaîtrisable en apparence. Les risques de nature biologique et cybernétique sont patents. Que pouvez-vous nous dire du rôle de l’OTAN à l’égard du TNP ? L’organisation a-t-elle une doctrine en la matière ? Enfin, je souhaiterais savoir si la dissémination de l’arme nucléaire peut se trouver mécaniquement favorisée par les liens que les chercheurs spécialisés dans ce domaine entretiennent, par-delà les États. Quels sont les principaux bénéficiaires de la dissémination ?
M. Christian Bataille. Je veux féliciter à mon tour les rapporteurs pour la qualité de leur travail. Je voudrais aborder un domaine qui est à la marge de ce rapport. Jean-Michel Boucheron et Jacques Myard ont tous deux insisté sur la question de la dissémination et sur les menaces pour la planète, mais se pose aussi la question des dégâts environnementaux considérables qui ont été causés entre les années 1940 et 1960, voire plus, lors des campagnes d’essais nucléaires. La France a été exemplaire ici, en témoigne la situation aujourd’hui au Sahara ou en Polynésie. En revanche, la situation est terrifiante en Russie, que ce soit au Kazakhstan ou en Arctique ; c’est la même chose du côté américain, dans le Pacifique, sur l’atoll de Bikini ou dans le désert du Nevada, du Nouveau-Mexique où, encore aujourd’hui, de larges zones sont restent interdites d’accès. De leur côté, les Britanniques, toujours prompts à nous donner des leçons dans le Pacifique, n’ont pas hésité à polluer le sud australien, plus précisément le désert de Matalinga. En d’autres termes, tout autour de la planète, les dégâts environnementaux dus aux essais nucléaires militaires sont considérables, et je ne parle pas de la Chine sur laquelle on ne sait toujours rien. Y a-t-il une autorité internationale chargée de faire l’inventaire qui serait nécessaire, ou d’intervenir pour la dépollution de ces zones contaminées depuis les années 1940 ou 1960 ?
M. Jacques Myard, rapporteur. Le droit international est imparfait et la société internationale n’a pas tout résolu. On ne peut pas dire pour autant qu’il est inefficace. A preuve, le fait que sur la question du contrôle des armes chimiques, la dissuasion a effectivement joué entre 1939 et 1945, même si on ne peut oublier que Saddam Hussein en ait ensuite utilisé contre les Kurdes et les Iraniens. C’est un problème réel. Cela dit, je ne partage pas l’avis de Jean-Paul Lecoq : il y a des pays qui n’ont pas signé le TNP, sans être pour autant dans l’illégalité. Israël et le Pakistan y échappent car ils n’y ont pas adhéré, tout comme la France d’ailleurs pendant longtemps. En ce qui concerne l’Iran, c’est différent : il a signé et a caché des informations à l’AIEA ; il a de même signé l’article 92-3 sans le ratifier. L’important est qu’il faut continuer de développer le système, et prendre en compte la réalité : le système risque effectivement d’imploser mais quand il fonctionne, il le fait bien et il a toute son utilité. C’est un socle dans lequel il y a des imperfections mais sur lequel il faut continuer de bâtir malgré ses défauts.
Quant à la dissuasion européenne, c’est très clairement une utopie ; la dissuasion de la France ne peut pas servir à tout le monde. Il n’y aura pas de dissuasion européenne, c’est une position que tous les présidents de la République ont partagée.
Pour répondre à Michel Terrot, si les talibans prennent le pouvoir au Pakistan, la dissuasion jouera entre Etats et les choses se calmeront. Le nucléaire a cet avantage d’être un réducteur d’intensité des conflits. Pour reprendre une formule du général Gallois, l’atome rend sage ; c’est même un des éléments de l’enjeu. Les contrôles peuvent être améliorés, mais cela reste un domaine sur lequel les certitudes n’existent pas. Le monde est dangereux, c’est la seule réalité et toute faiblesse est coupable. Il faut donc avoir la capacité de maintenir nos forces.
Quant à la question de la dépollution, je n’ai pas d’élément particulier, sauf le fait que la France participe à des programmes sur l’ancienne flotte de sous-marins de Mourmansk. En ce qui concerne le Kazakhstan, c’est une tout autre histoire.
M. Jean-Michel Boucheron, rapporteur. En termes de sécurité, les conclusions de notre rapport sont rassurantes : la dissuasion relève des Etats et les terroristes n’ont pas accès aux armes de destruction massive.
Sur ces dernières, une lecture approfondie fait apparaître que cette problématique est d’abord une lutte politique et stratégique. Dans le monde multipolaire actuel, les Etats cherchent à s’affirmer comme des puissances régionales. C’est cette perspective de leadership régional qui justifie éventuellement la possession de ces armes.
Sur l’évolution de la prolifération au Moyen-Orient, nous n’avons pas de certitudes. Cependant, l’Arabie Saoudite ne semble pas redouter une attaque nucléaire iranienne et s’estime sous la protection des Etats-Unis grâce à ses ressources pétrolières. Quant à la Turquie, elle ne se sent pas menacée par l’Iran mais aspire à dominer la région : cette volonté stratégique pourrait éventuellement amener la Turquie à développer ses capacités.
La France est insuffisamment préparée à la guerre cybernétique. A titre de comparaison, la Chine est sur le point de construire « une grande muraille numérique » pour se protéger contre ce type d’attaques tandis que le Président Obama a nommé 1000 spécialistes pour travailler sur cette question et commander un rapport sur ce qu’il appelle le « cinquième espace stratégique » (après la terre, l’air, la mer et l’espace). Notre pays vient de créer l’agence nationale de sécurité des systèmes d’information mais il faut la doter des moyens nécessaires.
La dissuasion ne peut être entre les mains que d’un pouvoir centralisé à l’image du Président de la République sous la Vème République. Or, l’Europe est loin de satisfaire ce critère aujourd’hui.
Mme Nicole Ameline. Ma question ne portait pas sur la capacité de dissuasion de l’Europe mais sur le point de savoir comment renforcer l’influence française dans la définition du nouveau concept stratégique de l’OTAN.
M. Jean-Michel Ferrand. M. Boucheron est devenu gaulliste.
M. Jacques Myard. Il l’a toujours été.
M. Jean-Michel Boucheron. Je suis un des rares députés à avoir une photo du général de Gaulle dans mon bureau.
Le nouveau concept de l’OTAN est en cours d’élaboration. La véritable préoccupation concerne la défense européenne mais il faudrait plus de temps pour développer ce sujet.
Je ne crois pas à la doctrine du « soft power » qui ne semble pas la réponse adaptée aux problèmes futurs, posés notamment par la pénurie des ressources et d’énergie. A cet égard, la politique chinoise est instructive : son budget militaire explose de même que ses capacités nucléaires. Je suis convaincu que ce n’est pas parce que le rapport de forces existe qu’on utilise la force.
Pour conclure, il me semble que le monde d’aujourd’hui est plus rassurant que celui d’hier car la question des armes de destruction massive relève d’un rapport entre les puissances rationnelles que sont les Etats.
La commission autorise la publication du rapport d’information.
Annexe 1 : Liste des personnes auditionnées 267
Annexe 2 : OTAN, armes nucléaires et lutte contre les proliférations 271
Annexe 3 : Union européenne, armes nucléaires et lutte contre les proliférations 275
Annexe 4 : Fiches pays 277
Annexe 5 : Chronologie de l’actualité nucléaire 2008-2009 301
Annexe 6 : Principaux textes internationaux 317
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) 319
Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction. 325
Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction 329
Code de conduite international contre la prolifération balistique 357
Traité d’interdiction complète des essais nucléaires 361
Annexe 7 : Bibliographie 384
Annexe 1 : Liste des personnes auditionnées
1) à Paris
- M. Jacques Bouchard, conseiller auprès de l’Administrateur général du Commissariat à l’énergie atomique (15 novembre 2007).
- Mme Ellen Tauscher, membre de la Chambre des Représentants des Etats-Unis, Présidente de la sous-commission des Forces .stratégiques (19 février 2008).
- M. Alain Bugat, administrateur général du Commissariat à l’énergie atomique - CEA (17 juin 2008).
- M. Pierre Brochand directeur général de la sécurité extérieure (DGSE) (9 juillet 2008).
- M. Patrick Pailloux, directeur de la sécurité des systèmes d’information (17 décembre 2008).
- M. Daniel Verwaerde, directeur des applications militaires (DAM) du Commissariat à l’énergie atomique, accompagné de MM. Dominique Monvoisin, directeur-adjoint, Général Xavier Jarry, conseiller militaire, François Geleznikoff, directeur « armes nucléaires », François Bugaut, direction « matière et environnement », Etienne Pochon, directeur « sûreté et non prolifération », Jacques Chenais, directeur « propulsion nucléaire », de Mme Alexandra Thévenot, direction des relations internationales et de M. Jean-Pierre Vigouroux, chef du service des affaires publiques(14 mai 2009).
2) à Londres (20 et 22 mai 2008)
- M. James Arbuthnot, Président du Comité de Défense à la Chambre des Communes.
- Mme Mariot Leslie, Directrice Générale « Defence and Intelligence », au Foreign office (ministère des affaires étrangères).
- Prof. Wyn Bowen, King’s College.
- Prof. James Acton, King’s College.
- M. Malcom Chalmers, Royal united services institute for defence and security studies.
- M. Mark Fitzpatrick, Senior Fellow for Non-Proliferation, International institute for security studies.
- Dr John Noble, Directeur « Nuclear counter Proliferation and Arms control » au MoD (ministère de la défense).
3) à Bruxelles (16 juin 2008)
- M. Colin Stockman, Bureau des plans nucléaires.
- MM Axel Angely et Vesselin Garvalov, Centre des armes de destruction massive.
- Lieutenant Colonel V. Milenkov, Division renseignement de l’Etat-Major international.
- M. Peter Flory, Secrétaire général adjoint en charge de la division Investissement de défense.
- Mme Christine Roger, Ambassadeur, Représentante de la France auprès du Comité politique et de sécurité de l’Union européenne, Mme Anna-Lisa Giannella, Représentante personnelle du Haut représentant pour les questions de non proliferation, M. Andreas Strub, adjoint de Mme Giannella et Mme Hélène Duchene, Représentant permanent de la France auprès du Conseil atlantique nord.
- M. Patrice Bergamini, Chef de cabinet adjoint du SG/HR.
- M. William Shapcott, Directeur du Centre de situation de l’Union européenne.
4) à Vienne (17 et 18 juin 2008)
- S. Exc. M. François-Xavier Deniau, ambassadeur de France.
- S. Exc. Mme Györgyi Zanathy, ambassadeur de Hongrie, présidente du HCOC.
- S. Exc. M. Sune Danielsson, chef du secrétariat de l’arrangement de Wassenaar.
- S. Exc. M. Peter Gottwald, ambassadeur d’Allemagne.
- S. Exc. Mme Taous Feroukhi, ambassadeur d’Algérie.
- S. Exc. M. Antonio José Vallim Guerreiro, ambassadeur du Brésil.
- S. Exc. M. Alexander Zmeyevskiy, ambassadeur de Russie.
- S. Exc. M. Volodymyr Yu Yel’chenko, ambassadeur d’Ukraine.
- S. Exc. M. Simon Smith, ambassadeur du Royaume-Uni.
- S. Exc. M. Saurabh Kumar, ambassadeur d’Inde.
- M. Olli Heinonen, directeur des garanties à l’agence internationale pour l’énergie atomique.
- M. Alexander Kmentt, chargé de mission auprès du secrétaire exécutif de l’organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires.
5) à Washington (10 – 13 décembre 2008)
- M. John Rood, sous-secrétaire d’Etat au contrôle des armements et à la sécurité internationale.
- M. Jamie Fly et Mme Joyce Connery, directeurs de la stratégie de contre-prolifération au Conseil national de sécurité (présidence des Etats-Unis).
- M. Don MacDonald, directeur de la sous-commission sur le terrorisme, la non prolifération et le commerce de la Chambre des Représentants.
- M. Eric Fanning, sous-directeur de la commission sur la lutte contre les armes de destruction massive, la prolifération et le terrorisme.
- M. David Fite, expert à la commission des affaires étrangères de la Chambre des Représentants.
- M. Simon Limage, assistant de Mme Ellen Tauscher, Chambre des Représentants.
- M. Stephen Rademaker, ancien conseiller à la présidence des Etats-Unis, associé chez BGR Holding.
- Mme Joan Rohlfing, vice-présidente en charge des programmes au NTI.
- Mme Carey Hinderstein, directrice des programmes internationaux au NTI.
- Mme Sharon Squassoni, associée de la Fondation Carnegie.
- M. Stephen Cohen, Fondation Brookings.
- M. Bruce Riedel, Fondation Brookings.
6) à Moscou (15 au 17 mars 2009)
- M. Anatoly Antonov, directeur des questions de sécurité et de désarmement au ministère des affaires étrangères.
- Général Gras, attaché de défense à Moscou, ambassade de France.
- Mme Julie Schatzkine, assistante du conseiller nucléaire, ambassade de France.
- M. Dmitri Trenin, directeur de la fondation Carnegie.
- M. Ivan Safrantchouk.
- M. Ruslan Pukhov, directeur du centre d’analyse des stratégies et des technologies au ministère des affaires étrangères.
- M. Spasski, directeur-adjoint de Rosatom.
- Dr Alexeï Ubeev, directeur de la coopération internationale de Rosatom.
- M. Vladimir Varonkov, directeur de la coopération européenne au ministère des affaires étrangères.
- M. Vladimir Pozdniakov, directeur du bureau de la sécurité nationale au Conseil de sécurité.
- M. Pouzanov, député, membre de la commission de la défense de la Douma.
- Prof. Valery Ignatiev, conseiller à la commission de la défense de la Douma.
*
* *
Nous adressons nos remerciements à MM. les ambassadeurs de France aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Russie et auprès des organisations internationales à Vienne, ainsi qu’à Mmes les représentantes permanentes auprès du Conseil de l’Atlantique Nord et auprès du Comité politique et de sécurité de l’Union européenne. Nous remercions également l’ensemble des experts du CEA pour leur assistance constante tout au long de nos travaux.
Annexe 2 : OTAN, armes nucléaires et lutte contre les proliférations
La présente étude s’est peu penchée sur la relation entre l’Alliance atlantique, les armes nucléaires et la lutte contre la prolifération, en raison de l’approche que nous avons retenu, à savoir que les ADM sont essentiellement des armes d’Etat que ces derniers conservent pour assurer leur survie.
En application de l’article 51 de la Charte de San Francisco instituant l’ONU (26 juin 1945), tout Etat dispose d’un droit naturel de légitime défense individuelle ou collective. L’article 5 du traité de Washington instituant l’OTAN (4 avril 1949) fait explicitement référence à la Charte de San Francisco lorsqu’il dispose que « les Parties conviennent qu’une attaque armée contre l’une ou plusieurs d’entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties ».
Au sein de l’OTAN, trois Etats disposent du feu nucléaire : les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France. Pour cette dernière, qui maîtrise l’ensemble du processus qui va de l’enrichissement au lancement et à la détonique, l’usage de l’arme est strictement national, ce qui ne signifie pas qu’il soit cantonné à une réponse à une attaque du sol national. La notion d’intérêts vitaux est suffisamment large pour inclure une réaction en cas d’attaque sur un allié. En outre, le concept stratégique de l’Alliance reconnaît le rôle de la force nucléaire française pour la défense collective.
Le fait que la France soit membre de l’OTAN n’entre que marginalement en ligne de compte dans sa doctrine d’emploi de l’arme. Il convient de rappeler que notre force de dissuasion assure l’indépendance de notre pays, y compris à l’égard de ses alliés, notamment les Etats-Unis. La force nucléaire française est autant conçue contre un adversaire potentiel ou déclaré (URSS, sous la guerre froide) que pour le cas où les Etats-Unis cesseraient de considérer que l’Europe présente un intérêt pour leur sécurité nationale. Dans l’hypothèse d’une dissolution de l’OTAN, d’un retrait des Etats-Unis d’Europe ou d’un refus américain de mettre en œuvre l’article 5 du traité de 1949, la France conserverait intacte sa capacité de défense, à la différence de ses autres alliés européens de l’Alliance atlantique.
Cette situation particulière explique pourquoi notre pays ne siège pas au Comité des plans nucléaires de l’OTAN, même après être revenu au sein de la quasi-totalité des structures intégrées.
Le Royaume-Uni ne peut plus être qualifié de puissance nucléaire indépendante, car il ne maîtrise plus la technologie des lanceurs, pour laquelle il dépend des Etats-Unis. Sa force nucléaire est théoriquement duale : d’une part au service de l’OTAN, d’autre part en cas d’atteinte à ses intérêts vitaux, mais en ce dernier cas, le lancement des missiles dépend des officiers américains présents dans les sous-marins de la Royal Navy. Washington a donc un droit de regard sur les intérêts vitaux du Royaume-Uni. Cette position n’est pas spécialement critiquable. Elle signifie politiquement que le Royaume-Uni a fait le choix de coupler intégralement sa sécurité à celle des Etats-Unis.
Les Etats-Unis constituent la puissance nucléaire majeure de l’Alliance. En conséquence, ils en influencent largement la doctrine nucléaire même si celle-ci émane théoriquement de l’ensemble des Etats membres.
La doctrine d’usage de l’arme est prévue dans le concept stratégique de l’Alliance, en date du 24 avril 1999, actuellement en cours de révision.
Les points 25 et 26 rappellent l’approche de la sécurité de l’Alliance pour le XXIème siècle.
25- L'Alliance est attachée à une approche globale de la sécurité, qui reconnaît l'importance des facteurs politiques, économiques, sociaux et environnementaux en plus de l'indispensable dimension de défense. Elle se fonde sur cette approche globale pour accomplir efficacement ses tâches de sécurité fondamentales, et pour déployer un effort croissant afin de développer des relations de coopération efficace avec d'autres organisations européennes et euro-atlantiques ainsi qu'avec les Nations Unies. Notre but collectif est de mettre en place une architecture de sécurité européenne dans laquelle la contribution de l'Alliance à la sécurité et à la stabilité de la région euro-atlantique et la contribution de ces autres organisations internationales se complètent et se renforcent mutuellement, à la fois dans l'approfondissement des relations entre pays euro-atlantiques et dans la gestion des crises. L'OTAN reste le forum essentiel de consultation entre les Alliés et l'enceinte où ceux-ci s'accordent sur des politiques touchant à leurs engagements de sécurité et de défense au titre du Traité de Washington.
26- L'Alliance cherche à préserver la paix et à renforcer la sécurité et la stabilité euro-atlantiques de différentes façons : en préservant le lien transatlantique ; en maintenant des capacités militaires efficaces suffisant à assurer la dissuasion et la défense et à remplir la gamme complète de ses missions ; en développant l'Identité européenne de sécurité et de défense au sein de l'Alliance ; en conservant la capacité globale de gérer les crises avec succès ; en restant ouverte à de nouvelles adhésions ; et en poursuivant le partenariat, la coopération et le dialogue avec d'autres pays dans le cadre de son approche coopérative de la sécurité euro-atlantique, notamment dans le domaine de la maîtrise des armements et du désarmement.
Le lien transatlantique est réaffirmé dans les points 7 et 27. Le point 7 « établit un lien permanent entre la sécurité de l’Amérique du Nord et la sécurité de l’Europe », qui partagent les mêmes valeurs (énumérées au point 6) et accomplissent un effort collectif en vue de la défense de leurs intérêts communs. Le point 27 rappelle que l’indivisibilité de la sécurité de l’Europe et de l’Amérique du Nord est le fondement politique de l’Alliance atlantique.
27- L'OTAN est attachée à un partenariat fort et dynamique entre l'Europe et l'Amérique du Nord, venant à l'appui des valeurs et des intérêts qu'elles partagent. La sécurité de l'Europe et celle de l'Amérique du Nord sont indivisibles. Ainsi, l'attachement de l'Alliance à l'indispensable lien transatlantique et à la défense collective de ses membres revêt une importance fondamentale pour sa crédibilité de même que pour la sécurité et la stabilité de la région euro-atlantique.
Les caractéristiques des forces nucléaires sont prévues aux points 62 à 64 :
62- L'objectif fondamental des forces nucléaires des Alliés est politique : préserver la paix et prévenir la coercition ainsi que toute forme de guerre. Elles continueront à jouer un rôle essentiel en maintenant tout agresseur dans le doute quant à la façon dont les Alliés riposteraient en cas d'agression militaire. Elles démontrent qu'une agression, quelle qu'en soit la forme, n'est pas une option rationnelle. La garantie suprême de la sécurité des Alliés est apportée par les forces nucléaires stratégiques de l'Alliance, en particulier celles des Etats-Unis ; les forces nucléaires indépendantes du Royaume-Uni et de la France, qui ont un rôle de dissuasion propre, contribuent à la dissuasion globale et à la sécurité des Alliés.
63- La crédibilité du dispositif nucléaire de l'Alliance et la démonstration de la solidarité de ses membres ainsi que de leur volonté commune de prévenir la guerre exigent toujours que les Alliés européens concernés par la planification de la défense collective participent largement aux rôles nucléaires, au stationnement en temps de paix de forces nucléaires sur leur territoire, et aux dispositions de commandement, de contrôle et de consultation. Les forces nucléaires basées en Europe et destinées à l'OTAN constituent un lien politique et militaire essentiel entre les membres européens et les membres nord-américains de l'Alliance. C'est pourquoi celle-ci maintiendra des forces nucléaires adéquates en Europe. Ces forces doivent réunir les caractéristiques nécessaires et avoir la flexibilité et la capacité de survie appropriées pour qu'elles soient perçues comme un élément crédible et efficace de la stratégie des Alliés visant à prévenir la guerre. Elles seront maintenues au niveau minimum suffisant à préserver la paix et la stabilité.
64- Les Alliés concernés estiment qu'en raison des changements radicaux de la situation sur le plan de la sécurité, avec notamment la réduction des niveaux de forces conventionnelles en Europe et l'allongement des délais de réaction, l'OTAN est désormais bien mieux à même de désamorcer une crise par des moyens diplomatiques et autres ou, si le besoin s'en présentait, de mettre en œuvre une défense conventionnelle efficace. Les circonstances dans lesquelles ils pourraient avoir à envisager une utilisation quelconque de l'arme nucléaire sont de ce fait extrêmement éloignées. C'est pourquoi, depuis 1991, les Alliés ont pris une série de mesures qui reflètent l'environnement de sécurité de l'après-Guerre froide. Il s'agit notamment d'une réduction spectaculaire des types et de l'importance numérique des forces substratégiques de l'OTAN, y compris l'élimination de l'artillerie nucléaire et des missiles nucléaires sol-sol à courte portée ; d'un assouplissement marqué des critères de préparation des forces ayant un rôle nucléaire ; et de la fin des plans de circonstance nucléaires permanents du temps de paix. Les forces nucléaires de l'OTAN ne sont aujourd'hui dirigées contre aucun pays. L’OTAN n’en maintiendra pas moins , au niveau minimum compatible avec l’environnement de sécurité existant, des forces substratégiques adéquates basées en Europe, qui assureront une liaison essentielle avec les forces nucléaires stratégiques, renforçant ainsi le lien transatlantique. Ces forces substratégiques seront constituées d’avions à double capacité et d’un petit nombre d’ogives Trident du Royaume-Uni. Cependant, en temps normal, aucune arme substratégique ne sera déployée sur un navire de surface ou sur un sous-marin d’attaque.
Le point 62 réaffirme le caractère stratégique de l’arme nucléaire et crée un doute pour tout agresseur, qui, quel que soit le mode de son attaque contre tout allié, risque des représailles de type nucléaire. La force nucléaire américaine est évidemment érigée en force stratégique essentielle de l’Alliance –il ne pourrait en être autrement – les forces britanniques et françaises contribuant également à cette sécurité collective, sans qu’il soit précisé de quelle manière, ce qui est logique, afin de placer tout adversaire potentiel dans une incertitude supplémentaire.
Le point 63 rappelle le rôle politique et militaire des forces nucléaires (américaines) basées en Europe. Le point 64 tire le constat de la diminution des tensions en Europe en indiquant que les arsenaux à courte portée et substratégiques sont réduits tout en demeurant à un niveau adéquat.
Sur l’insistance de la France, l’OTAN n’a pas indiqué si elle utiliserait l’arme nucléaire comme arme d’attaque ou comme arme de représailles seulement (no first use). Il s’agit, là encore, de placer tout adversaire devant une incertitude majeure.
Pour ce qui concerne le contrôle et la réduction des armements, l’OTAN a réaffirmé a plusieurs reprises son engagement pour une diminution des arsenaux et pour la lutte contre la prolifération. Le point 40 en fait un élément du concept stratégique de l’Alliance :
40- La politique de soutien de l'Alliance à la maîtrise des armements, au désarmement et à la non-prolifération continuera de jouer un rôle majeur dans la réalisation des objectifs de sécurité de l'Alliance. Les Alliés cherchent à accroître la sécurité et la stabilité au niveau de forces le plus bas qui puisse être atteint tout en maintenant la capacité de l'Alliance d'assurer la défense collective et d'accomplir la gamme complète de ses missions. Comme il s'agit d'un élément important de son approche globale de la sécurité, l'Alliance continuera de veiller à ce que les objectifs en matière de défense et de maîtrise des armements, de désarmement et de non-prolifération restent en harmonie. Elle continuera de contribuer activement à l'élaboration d'accords sur la maîtrise des armements, le désarmement et la non-prolifération, ainsi que de mesures de confiance et de sécurité. Les Alliés accordent beaucoup d'importance au rôle spécifique qu'ils jouent pour favoriser un processus international de maîtrise des armements et de désarmement plus larges, plus complets et plus vérifiables. L'Alliance accentuera les efforts qu'elle déploie sur le plan politique en vue de réduire les risques découlant de la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs. Le but principal de l'Alliance et de ses membres dans le domaine de la non-prolifération consiste à prévenir la prolifération ou, si elle se produit, à en inverser le cours par des moyens diplomatiques. L'Alliance attache une grande importance au maintien de la validité et à la pleine application par toutes les parties des dispositions du Traité FCE, en tant qu'élément essentiel pour assurer la stabilité de la région euro-atlantique.
Le Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de Washington de 1999 a lancé une initiative sur les ADM pour faire face aux risques liés à leur prolifération. Elle s’est principalement traduite par la mise en place en 2000, au siège de l’Alliance, d’un Centre sur les ADM. Le Sommet de Prague, en 2002, a confirmé cet élément essentiel de la politique de sécurité de l’OTAN. Il reste qu’en pratique, l’OTAN n’est pas un acteur dans les négociations. Sur le dossier essentiel que constitue la réduction des arsenaux américains et russes, seule négocie Washington. En revanche, le Sommet de Prague a acté 5 initiatives en matière de défense nucléaire, biologique et chimique, avec :
– la mise en place d’une équipe d’évaluation conjointe pour analyser les effets d’un incident NBC et conseiller les commandements de l’OTAN sur la conduite à tenir ;
– la création d’un laboratoire d’analyse déployable pouvant être acheminé sur tout théâtre pour rechercher, prélever ou analyser des prélèvements NBC ;
– un stock de moyens de défense NBC mutualisé entre les membres de l’Alliance ;
– une formation améliorée dans le domaine NBC ;
– un système de surveillance épidémiologique.
L’OTAN a également mis en place un bataillon multinational de défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire, opérationnel depuis décembre 2003.
S’agissant de non prolifération, tous les membres de l’Alliance atlantique sont des Etats parties au TNP. Tous, sauf les Etats-Unis, sont également signataires du traité interdisant les essais nucléaires (TICE) et tous s’accordent sur le fait que le TICE entrera en vigueur lorsque les 44 Etats énumérés à l’annexe II1 auront déposé leurs instruments de ratification auprès des Nations Unies.
Les Etats membres de l’Alliance ont enfin affirmé l’importance des traités tels que la convention sur les armes biologiques ou à toxines, la convention sur les armes chimiques et le code de conduite de La Haye contre la prolifération des missiles balistiques. Ils ont tous souscrit sans réserve à la résolution n° 1540 du Conseil de sécurité des Nations Unies appelant chaque Etat à établir au niveau national des contrôles efficaces aux exportations et à faire appliquer des lois sanctionnant pénalement tout acte ou comportement favorisant la prolifération.
Annexe 3 : Union européenne, armes nucléaires et lutte contre les proliférations
Comme l’OTAN, l’Union européenne (UE) n’a pas tenu une place centrale dans notre étude. D’une part, la défense de l’UE repose sur l’Alliance atlantique; d’autre part, la politique européenne de sécurité et de défense (PESD), malgré ses quelques progrès, n’a pas dépassé le stade d’opérations ponctuelles. L’objectif capacitaire d’Helsinki (60 00 hommes en 2010 disponibles en moins de 60 jours pour au moins un an) peine à être atteint. Le traité de Lisbonne a certes l’ambition de faire de l’UE un acteur global des relations internationales, mais son entrée en vigueur est trop récente pour en tirer la moindre conclusion.
Sans volonté des Etats membres de faire de l’Europe une puissance politique, ce qui n’est nullement incompatible avec une solidarité transatlantique sans faille, il est inutile de concevoir que l’UE joue un rôle quelconque dans le domaine stratégique. Au demeurant, les seules forces nucléaires françaises et britanniques ne peuvent à elles seules garantir la sécurité de l’Europe et leur doctrine d’emploi ne concerne nos alliés qu’à la marge.
L’UE est totalement absente des grandes négociations stratégiques, y compris celles qui la concernent au premier chef comme la mise en place d’un système anti missile, que les Etats-Unis font avaliser par le Conseil de l’Atlantique Nord et qui ne donne lieu à aucun véritable débat au sein de l’Alliance. Il existe bien une stratégie européenne de sécurité depuis 2003 mais ses objectifs (prévention des conflits, politique de voisinage) reflètent plus la faiblesse de l’UE en politique internationale qu’une véritable ambition. Qu’on le regrette ou non, il n’existe pas au niveau des Etats de réflexion stratégique européenne, malgré d’intenses échanges intellectuels au sein des Parements nationaux, des assemblées parlementaires internationales et de nombreux think tanks.
Le seul domaine où l’UE joue un rôle est la lutte contre les proliférations. Elle apporte un soutien actif aux mécanismes du TNP et la troika (France, Allemagne, Royaume-Uni) qui négocie depuis plusieurs années avec l’Iran constitue la plus notable des initiatives européennes.
A la suite du conseil européen de Thessalonique (19 et 20 juin 2003) sur la non prolifération, l’UE a adopté la stratégie européenne de lutte contre la prolifération des ADM le 12 décembre 2003. La prolifération desdites armes était considérée comme une des cinq principales menaces pour la sécurité européenne. Mme Annalisa Gianella a été désignée représentante personnelle de M. Javier Solana sur cette question. L’UE a dégagé six priorités :
• renforcer le volet multilatéral de lutte contre la prolifération ;
• poursuivre l’universalisation des accords multilatéraux (TNP, protocole de l’AIEA, TICE…);
• agir en faveur du strict respect de ces accords ;
• renforcer les régimes et pratiques de contrôle aux exportations ;
• assister les pays tiers dans ces domaines ;
• coopérer avec les partenaires de l’Europe qui partagent ces mêmes objectifs, comme les Etats-Unis.
L’UE a accompli plusieurs actions pour mettre en œuvre cette stratégie : soutien au vote de la résolution n° 1540 des Nations Unies, action commune n° 2007/753/PESC du 19 novembre 2007 de soutien à l’AIEA pour ses activités de surveillance en Corée du Nord, action commune n° 2007/468/PESC du 28 juin 2007 de soutien aux activités de la commission préparatoire de l’OTICE, position commune n° 2007/140/PESC du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, coopération avec la Russie sur la non prolifération et le désarmement en Russie…
Elle a également institué un centre de surveillance des ADM, pour contrôler et renforcer l’application de la stratégie européenne précitée.
Enfin, en application du règlement CE n° 1717/2006 du 15 novembre 2006, l’un des dix instruments de l’aide extérieure de l’UE dans le cadre de la réponse aux crises est l’assistance à l’atténuation des risques chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires.
Armes de destruction massive dans les principaux pays mentionnés dans l’étude
(par ordre alphabétique)
Nota : les informations rapportées dans les pages qui suivent ont été établies à partir de recoupements d’informations sur des sites internet spécialisés dans les ADM ainsi qu’à partir d’articles ou d’études de revues militaires et stratégiques… Les éléments relatifs aux ADM sont par nature tenus secrets par les Etats qui les détiennent, aussi faut-il considérer que la présente annexe est susceptible de contenir quelques inexactitudes.
Arabie saoudite
- A signé le TNP en 1988.
- A signé le traité sur les armes biologiques et toxiques en 1972.
- A ratifié le traité sur les armes chimiques en 1996.
Si l’Arabie saoudite ne détient pas d’armes nucléaires, il semble qu’elle ait à plusieurs reprises marqué son intérêt pour ces armes, en finançant le programme pakistanais et en y collaborant. Elle n’a pas pour autant souhaité se doter d’ADM, sans doute sous la pression des Etats-Unis et par le souci d’éviter des représailles israéliennes. Fondamentalement, Ryiadh ne considère pas que le royaume puisse faire l’objet d’attaques nucléaires mais si cette éventualité devait se présenter, les forces américaines sont là pour assurer la protection du royaume saoudien. Pour autant, nos interlocuteurs nous ont laissé entendre que l’Arabie saoudite serait obligée de réagir si l’Iran accédait au rang de puissance nucléaire militaire. Ses liens avec le Pakistan lui permettraient sans doute de disposer rapidement de quelques engins, placés sur des Shaheen-2, mais les Américains accepteraient-ils une Arabie saoudite nucléarisée ? Quelle serait la réaction des Israéliens, avec lesquels Ryiadh entretient de très discrets canaux de négociation ?
Si l’Arabie saoudite ne détient pas pour l’heure de bombe nucléaire, elle dispose d’une cinquantaine de missiles CSS-2 acquis depuis 1986 auprès de la Chine, de portée de 2600 km environ capables d’emporter 2000 kg de charge conventionnelle. Comme ces missiles ont été conçus dans les années 60, leur obsolescence graduelle réduit leur intérêt opérationnel.
L’Arabie saoudite n’avait aucune raison stratégique de disposer d’une telle force, n’étant nullement menacée militairement par ses voisins, notamment l’Irak, l’Iran, Israël et le Yémen, qui en disposaient. Ryiadh s’en est néanmoins doté par précaution. Face aux inquiétudes que cet arsenal balistique suscitait en Israël, les Saoudiens ont signé le TNP en 1988 sur le conseil des Etats-Unis.
Les images satellites indiquent que Ryiadh aménage des sites et des infrastructures pour pérenniser sa capacité balistique, en réponse aux progrès constants de l’Iran dans ce domaine. Les CSS-2 actuellement aux mains des Saoudiens n’ont pas un niveau de précision cohérent avec la charge conventionnelle qu’ils portent. Pour les renouveler, Ryiadh a deux options : poursuivre la coopération avec la Chine ou, compte tenu de ses liens particuliers avec Islamabad, acquérir des missiles Shaheen 2.
Les missiles sont stationnés sur la base aérienne d’Al Kharj, au Sud de Ryiadh et dans l’oasis d’As Sullayil, au Sud-Ouest de Ryiadh.
Chine
- Signataire du TNP en 1992.
- Détient environ 240 à 250 têtes nucléaires, dont 176 seraient déployées
- Signataire de la convention sur les armes biologiques et toxiques en
- Signataire de la convention sur les armes chimiques en
Forces et installations nucléaires
La Chine a adopté la doctrine du no first use et limite l’usage de l’arme nucléaire à la dissuasion et aux représailles. Son arsenal comprend 6 types de bombes à fission. 176 têtes nucléaires seraient déployées. D’après le Département d’Etat américain, la montée en puissance globale de la Chine se traduit dans le domaine nucléaire par une augmentation de 25% par an de ses capacités. Elle disposerait de matières fissiles (uranium hautement enrichi et plutonium) lui permettant de tripler son arsenal actuel, soit un stock oscillant de 1 à 5 tonnes pour le plutonium et de 15 à 25 tonnes pour l’uranium hautement enrichi..
L’arsenal actuel est le résultat de la modernisation entreprise dans les années 80, avec la miniaturisation des têtes et le développement de leur mirvage. Il semblerait que Pékin veuille passer d’une capacité de dissuasion minimale à une capacité de dissuasion limitée, ce qui explique l’augmentation de son arsenal.
La répartition des installations nucléaires est évidemment secrète. Celles relevant de l’armée sont sous le contrôle du président de la Commission militaire centrale (CMC). Le second corps d’artillerie de l’Armée populaire chinoise (APC) est responsable du déploiement des forces et relève directement de la CMC. Au sein de cette dernière, un département élabore la doctrine d’emploi des armes.
La Chinese national nuclear corporation est compétente pour les réacteurs civils. Elle supervise à ce titre une série d’organismes en charge de la recherche et de l’enrichissement. Elle est en lien avec le ministère de l’industrie et des technologies de l’information sur toutes les questions nucléaires, via l’administration d’Etat pour la science la technologie et l’industrie pour la défense nationale.
La Chine dispose actuellement de 11 réacteurs nucléaires à usage civil, mais cette capacité doit plus que doubler avec la construction de 14 réacteurs en cours, ainsi que par le démarrage des travaux de 10 réacteurs supplémentaires en 2009. Les unités d’enrichissement à but militaire ont été initialement implantées dans le Setchuan et dans le Guanzhu. Les mines d’uranium, dont le sous-sol chinois est riche, sont dans les provinces du Fujian, du Jianxi, du Xinjiang, du Shanxi et du Liaoning.
La ville d’Harbin est souvent citée comme lieu possible de fabrication de têtes nucléaires. L’Académie chinoise de physique gère 12 instituts en charge des recherches et du design des armes tandis que l’Institut de recherches nucléaires de Shanghai s’occupe du programme des missiles.
Armes biologiques
Il convient de rappeler que la Chine a été victime d’armes biologiques pendant la seconde guerre mondiale. Sous l’occupation, l’unité 731 de l’armée japonaise a conduit de sinistres expériences sur des civils chinois et des prisonniers alliés. 250 000 Chinois sont morts à la suite de ces expériences.
De cette histoire, la Chine a constamment affirmé dans tous ses documents officiels son hostilité aux armes biologiques même si les Etats-Unis la soupçonnent de détenir un petit arsenal de cette nature. Ils n’ont avancé aucune preuve tangible en appui de cette thèse. Elle a signé la convention sur les armes nucléaires et toxiques en 1984.
Armes chimiques
La Chine a également été victimes d’attaques chimiques japonaises de 1937 à 1945 (plus de 2000 cas recensés). Les troupes japonaises ont abandonné 350 000 munitions chimiques lorsqu’elles ont quitté le territoire. Leur recherche et leur traitement continue d’être un problème en Chine, même si le Japon a accepté d’apporter son aide à Pékin dans ce domaine.
En ratifiant la convention sur les armes chimiques en 1997, la Chine a déclaré qu’elle avait détenu dans le passé un petit stock d’armes offensives qu’elle avait démantelé. Les Etats-Unis la soupçonnent toujours de posséder des ADM chimiques en quantité limitée et d’exporter des produits issus de technologie duale vers la Syrie et l’Iran. Il existe effectivement un faisceau de présomption, représenté par les cargaisons saisies dans des ports et les flux commerciaux de certaines substances exportés depuis la Chine vers le Moyen-Orient, mais il manque aux Américains des preuves sérieuses.
Moyens balistiques
La Chine dispose d’importants moyens balistiques et maîtrise l’ensemble des technologies y afférant. Elle a également prouvé sa capacité de détruire un satellite en vol, se posant ainsi en rivale future des Etats-Unis pour une éventuelle guerre de l’espace.
Moyens balistiques de la Chine en 1988
Sol sol |
Nombre |
Mise en service |
Portée (km) |
Têtes et kilotonnes |
Têtes |
DF 3A |
17 |
1971 |
3100 |
1 / 3300 |
17 |
DF 4 |
17 |
1980 |
5400 |
1 / 3300 |
17 |
DF 5A |
20 |
1981 |
13000 |
1 / 4000 |
20 |
DF 21 |
55 |
1991 |
2100 |
1 / 250 |
55 |
DF 31 |
Env. 6 |
2008 |
7200 |
1/ 250 ? |
Env. 6 |
DF 31A |
Env. 6 |
2008 |
1120 |
1 / 205 ? |
Env. 6 |
Missiles depuis des SNLE |
|||||
JL 1 (1) |
0 |
1986 |
1000 |
1 / 250 |
0 |
JL 2 |
0 |
2009 / 2010 |
7200 |
1 / 250 ? |
0 |
Missiles depuis des aéronefs |
|||||
Hong 6 |
20 |
1965 |
3100 |
1 bombe DH 10 |
15 à 20 |
Qian 5 |
nc |
1972 ? |
nc |
nc |
Env. 20 |
(1) n’a jamais été opérationnel.
Source : Bulletinof atomic scientists.
Corée du Nord
- A signé le TNP en 1985.
- S’est retirée du TNP le 10 janvier 2003.
- A accompli deux essais nucléaires les 9 octobre 2006 et 25 mai 2009 (ce dernier restant à confirmer, en l’absence d’isotopes radioactifs autour du site).
- Signataire de la convention sur les armes chimiques en 1987.
- Non signataire de la convention sur les armes biologiques et toxiques.
Installations proliférantes (hypothèses) :
Sites servant à l’enrichissement nucléaire: Yongjo-Ri, Ch’onma San, Taechon, Pakchon, Pyongyang.
Sites miniers: Sonbang, Naji, Kusong, Sunchan, Hungnam, Shinp’o, Musan, Pyongsan.
Infrastructures nucléaires: Kumchangri (dépôt souterrain), Kumpung-Ri (centrale nucléaire et site d’essai), Pyongyang (faculté des sciences, université Kim Il Sung, université Kumchak de technologie, cyclotron MGE 20, unité nucléaire souterraine), Hamchung (université de chimie), Kumho-Chigu (réacteur à eau légère), Yong Byong (enrichissement).
Sites d’armes biologiques : Oujong-Ri (unité de test d’armes), Munchon (n.c.), Pyongyang (centre national pour la santé et contre les épidémies, institut de microbiologie industrielle), unité du 25 février.
Sites dotés de technologies duales pouvant produire des armes biologiques : Pyongyang (société Taedonggang Reagent, institut d’ingénierie des cellules et des gênes, institut vétérinaire DPRK, institut Aeguk d médecine préventive, institut d’endocrinologie de Choe Kyong Tae, centre Aeguk sur les microbes, centre Aeguk Mangyongdae de fertilisants microbiens), Kwalsan, Changiu, Hamhung, Hamju, Kaepung, Panmu (usines de fertilisants microbiens), Hamhung (institut de médecine, division pharmaceutique).
Unités de production et de stockage d’armes chimiques : Wonsan, Chiha-Ri (société de matériels), Wangjaebong, Sanwon, Sanum-Ri (stockage), usines n°s 108 et 279, Kanggye (usine chimique).
Sites dotés de technologies duales pouvant produire des armes chimiques : Hyesan (usine chimique), Aoji-Ri, Chongsu (complexe chimique), Hwasong, Hungnan, Sunchon (complexes de fertilisants chimiques), Shiniju, Chongjin (complexes de fibres chimiques), Hamhung (institut chimique, université de l’industrie chimique, unité de recherche chimique de la deuxième université de sciences naturelles), Pyongyang (laboratoire central d’analyses, département n° 32, institut de recherche n° 338), Shinuju, Kanggye (instituts de chimie).
Unités militaires : 14ème, 17ème et 18ème bataillons de défense nucléaire et chimique, institut de recherche n° 338.
Bases de missiles : Chiha-Ri (unité de soutien technique des scuds), Shingye-Kun, Togol, Pyongsan-Kun, Sariwon, Chungwa-Kun, Onju-Dong, mont Kanggamchan, Shino-Ri, Hwajin-Ri, Paekung-Dong, Chunggan-up, Sangnam-Ri, Toksong-Kun, Yongnim-up, Kalgol-Dong, Mont Komdok, Musudan-Ri (tests de missiles).
Sites de production de missiles : Kim Chaek, Hwanghae (aciérie), usine d’électricité de la mer de l’Est, Tanchon (semi conducteurs), Pyongyang (usine n° 7), centre de recherche et de développement Sanum-Dong, usine Mangyongdae, unité de semi conducteurs, Nampo (assemblage de missiles), Kumsong, Taepyong (fusées), Tokhyonku (motorisation), collège nord-coréen de défense (recherche et développement), usine du 18 janvier, usine automobile de Sungni, usine de Sunchon.
Arsenal (hypothèses)
Engin nucléaire en cours de développement
Moyens balistiques
Ils sont résumés dans le tableau ci-après :
Missiles nord coréens
Noms |
Kn 02 |
Hwasong 5 |
Hwasong 6 |
Hwasong 7 |
Nodong |
Taepodong |
Taepodong 1 SLV |
Taepodong 2 |
Musudan |
Autres noms |
Scud Mod B |
Scud Mod C |
Scud Mod D |
Scud Mod E |
R27 / SS N 6 | ||||
Statut |
R/D |
Op |
Op |
Op |
Op |
Proto |
R/D |
R/D | |
Carburant |
Solide |
Liquide |
Liquide |
Liquide |
Liquide |
Liquide |
n.c. |
Liquide |
Liquide |
Portée |
< 150 km |
300 km |
500 km |
700 km |
1200 km |
1600 km |
1600 km |
4000 à 6000 km |
n.c. |
Charge |
1000 kg |
770 kg |
565 kg |
700 kg |
700 kg |
n.c. |
500 à 1000 kg |
n.c. | |
ECP |
1000 m |
1500 à 2000 m |
1500 à 2000 m |
2000 m |
n.c. |
n.c. |
n.c. |
n.c. | |
Capacité nucléaire |
Non |
Non |
Non |
Non |
Oui |
Sans doute |
n.c. |
Oui |
n.c. |
Nombre d’étages |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
2 |
1 |
Divers |
Dérivé du SS 21 russe |
Exporté en Iran et en Syrie |
Exporté en Iran et en Syrie |
Assemblage possible en Syrie |
Composants exportés en Iran et au Pakistan |
En cours de test |
Dérivé du SS N 6 russe |
Abréviations : R/D (recherche et développement), Op (opérationnel), Proto (prototype), nc (non connu).
Le programme balistique trouve son origine en 1976, avec la tentative de mise au point avec la Chine d’un missile SRBM DF-61. A la suite de son interruption en 1978, la Corée du Nord a acquis en Egypte des missiles Scud B d’origine soviétique ainsi que leurs lanceurs. C’est à partir de ces éléments que Pyong Yang a été en mesure de développer ses propres versions de Scud, sous l’appellation Hwasong.
Le dernier développement de cette filière est le missile Nodong, amorcé dans les années 90. Il aurait été en partie financé par l’Iran, puis des missiles et des moteurs auraient été exportés vers l’Iran et le Pakistan. D’après les experts militaires, la Corée du Nord maîtriserait la plupart des technologies pour la mise au point de missiles sauf les systèmes de guidage et de pilotage, les matériaux spéciaux (céramiques, carbones et graphites) et certains éléments du système de propulsion.
L’arsenal rassemblerait environ 150 Scud Mod-B et 200 Scud Mod-C.
Pyong Yang teste depuis plusieurs années le missile Taepodong-2, qui peut emporter une arme nucléaire. Issu des travaux sur le Taepodong-1 qui avait survolé le Japon le 31 août 1998, le premier essai, le 4 juillet 2006, a été un échec. L’essai du 5 avril 2009 a révélé le bon fonctionnement du propulseur du 1er étage et l’étagement entre les deux premiers étages. En revanche, la capacité de résistance de la tête militaire lors de la rentrée dans l’atmosphère n’a pas été validée.
Etats-Unis
- Signataires du TNP en 1968.
- Détiennent 5200 têtes nucléaires, dont 2700 sont déployées.
- Signataires en 1972 de la convention sur les armes biologiques et toxiques, ratifiée en 1975.
- Ont ratifié en 1997 la convention sur les armes chimiques.
Les Etats-Unis sont le seul pays à avoir utilisé l’arme nucléaire dans un conflit en ayant fait exploser des bombes sur Hiroshima et Nagasaki en août 1945. Ils forment avec la Russie la principale puissance nucléaire.
Forces nucléaires
En 1966, les Etats-Unis alignaient 31 700 têtes nucléaires, soit le chiffre le plus élevé de leur arsenal au cours de l’histoire. En janvier 2009, ce chiffre était tombé à 5200 têtes dont 2700 déployées (2200 têtes stratégiques et 500 non stratégiques) en application du traité START. Une part de cette force est déployée en Europe, dans 6 pays de l’OTAN (Allemagne, Belgique, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni et Turquie), avec environ 480 têtes, dont 70 en Allemagne sur la base de Büchel, à la frontière du Luxembourg.
Outre le TNP, les Etats-Unis sont parties à une série de traités liés à la réduction et au contrôle des armes nucléaires avec la Russie, notamment START et SORT, ce dernier datant de mai 2002. Washington est également membre des organismes qui contrôlent les exportations de technologies sensibles, comme le Groupe des fournisseurs nucléaires et le Comité Zangger.
Armes biologiques
C’est en 1941 que le secrétaire d’Etat à la guerre Henry Stimson a commandé une étude à l’Académie des sciences sur les dangers des armes biologiques. Cette dernière a préconisé que les Etats-Unis se dotent d’un programme d’armes biologiques offensives, tout en organisant la défense du pays contre de telles armes. Des années 40 à la fin des années 60, Washington a disposé d’un arsenal rassemblant la plupart des agents pathogènes connus : anthrax, turalemie, encéphalite équine, dengue, dysenterie, etc… Le Président Nixon, jugeant leur intérêt stratégique faible, a renoncé à leur production le 25 novembre 1969 et a signé en 1972 la Convention sur les armes biologiques et toxiques. Entre mai 1971 et février 1973, les Etats-Unis ont détruit leur stock entier, ne conservant que de petites quantités pour la recherche.
Armes chimiques
C’est en réponse aux attaques chimiques allemandes au cours de la première guerre mondiale que les Etats-Unis ont institué le Chemical Warfare Service (CWS) en 1918. Jusqu’en 1980, ce service a développé toute la gamme des produits classiques pouvant avoir un usage militaire : sarin, VX, cyanure, agent orange (utilisé au Vietnam et au Laos)… Après le réexamen de leur utilité stratégique par le Président Reagan, qui a conclu à leur maintien, les Présidents Bush et Gorbatchev ont signé un accord bilatéral de destruction de leurs stocks. Les Etats-Unis ont ratifié en 1997 la convention sur les armes chimiques, s’engageant à détruire leur stock au 31 décembre 2007. Ils n’ont pu respecter cette échéance et ont obtenu un délai supplémentaire courant jusqu’à décembre 2012. En décembre 2007, 14 000 tonnes de produits chimiques avaient été détruites, soit 51% de leur arsenal.
Moyens balistiques
Placées sous l’autorité de l’US strategic command (STRATCOM), les forces nucléaires stratégiques se répartissent en 3 composantes : sol sol, avec les missiles intercontinentaux ; air sol, avec les bombardiers stratégiques ; mer sol, avec les SNLE. Les infrastructures accueillant les forces nucléaires sont principalement sur territoire américain, mais outre les SNLE en patrouille, les bases avancées de Guam et Diego Garcia peuvent accueillir des bombardiers stratégiques.
Missiles intercontinentaux
L’arsenal s’élève à 488 missiles Minuteman III, dont la durée de vie expirera vers 2040. 90% de cet arsenal est prêt à être utilisé. Ils sont basés au Montana, au Wyoming, en Californie et dans le Dakota du Nord.
Bombardiers
Washington dispose de 76 B 52 H, dont 57 sont qualifiés à effectuer une mission nucléaire.
SNLE
Les 14 SNLE rassemblent la moitié de l’arsenal stratégique américain, soit 1152 missiles Trident. 6 sont basés à Kings Bay (Géorgie) et 8 à Bangor NSB (Washington). En temps de paix, 4 sont généralement déployés en permanence à la mer.
Forces nucléaires américaines en 2008 (1)
Type |
Nombre |
Déploiement |
Têtes / kilotonnes |
Têtes déployées / stockées |
LGM 30G Minuteman III |
||||
MK 12 |
138 |
1970 |
1 / 170 |
214 / 20 |
MK 12 A |
250 |
1979 |
1 – 3 / 335 (mirv) |
450 / 20 |
MK 21 SERV |
100 |
2006 |
1 / 30 |
100 / 10 |
Total |
488 |
764 / 50 | ||
Mer sol |
||||
Trident II D 5 |
288 |
|||
MK 4 |
1992 |
6 / 100 (mirv) |
1344 / 80 | |
MK 5 |
1990 |
6 / 455 (mirv) |
384 / 20 | |
Total |
288 |
1728 / 100 | ||
Bombardiers |
||||
B 52 H |
94 |
1961 |
5 / 150 |
528 / 25 |
B 2 Spirit |
21 |
1994 |
nc |
555 / 25 |
Total |
115 |
1083 / 50 | ||
Forces non stratégiques |
||||
Tomahawk |
325 |
1984 |
5 / 150 |
100 |
B 61 |
nc |
1979 |
nc |
400 |
Total |
325 |
500 | ||
Total général |
4075 / 200 |
(1) Ce tableau ne concorde pas exactement avec les chiffres de 5200 têtes en janvier 2009 mais donne une image à peu près exacte de la répartition des forces et vecteurs nucléairs américains. Les auteurs du tableau indiquent que 1260 têtes additionnelles sont en réserve. En tenant compte de celle-ci, on retrouve le chiffre de 5200 têtes.
Source : Bulletin of Atomic Scientists, 2008.
France
- A ratifié le TNP en 1992.
- A signé la convention sur les armes biologiques et les toxines en 1984.
- Etat dépositaire de la convention d’interdiction des armes chimiques, ratifiée en 1995.
- A signé le traité d’interdiction complète des essais nucléaires en 1996, ratifié en 1998.
- Membre du comité Zangger, du groupe des fournisseurs nucléaires, du groupe Australie, du MTCR.
- Soutient la mise au point d’un traité d’interdiction de la production de matières fissiles à des fins militaires.
Etat doté de l’arme nucléaire, la France affiche une doctrine de dissuasion du faible au fort, menaçant tout ennemi potentiel de représailles massives en cas d’atteinte à ses intérêts vitaux. Elle a renoncé à développer des arsenaux offensifs, tant chimiques que biologiques, et les programmes balistiques stratégiques qu’elle conduit vise en grande partie à conserver à son arsenal nucléaire une crédibilité technologique suffisante.
En effet, l’arme nucléaire française ne remplit pas seulement un objectif de dissuasion. Elle s’intègre également à une stratégie visant, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, à préserver l’indépendance nationale du pays. Ainsi, les forces nucléaires françaises n’ont jamais été intégrées au groupe des plans nucléaires de l’OTAN. Le choix de retourner dans les structures de commandement intégrées de l’OTAN, acté lors du sommet de Strasbourg – Kehl en avril 2009, n’a pas modifié cette situation.
Arsenal nucléaire
La France fait partie des cinq Etats dotés au sens du TNP. Elle est donc autorisée à détenir des armes nucléaires, qu’elle consacre principalement, mais pas exclusivement, à une mission de dissuasion. La France a déjà adopté plusieurs décisions visant à réduire son arsenal stratégique, notamment le démantèlement de sa composante terre avec la disparition des missiles nucléaires sol-sol du plateau d’Albion, décidée en 1996 et achevée en 1998.
En septembre 1998 à Cherbourg, le Président de la République a annoncé de nouvelles mesures de réduction, avec la réduction d’un tiers de la composante nucléaire aéroportée, tant en termes de nombres de têtes que de vecteurs. Avec 300 têtes nucléaires disponibles et déployées (la France ne dispose d’aucun stock d’armes nucléaires et a cessé de fabriquer de la matière fissile militaire depuis 1996), l’arsenal français est considéré maintenu au niveau de stricte suffisance.
A l’heure actuelle, la France dispose donc de 4 SNLE (sous-marins nucléaires lanceurs d’engins) : le Triomphant, le Téméraire, le Vigilant et le Terrible. Seul ce dernier est équipé du missile M51, d’une portée estimée supérieure à 8 000 km contre 6 000 pour le modèle M45, qui équipera les trois autres SNLE jusqu’en 2014, avant son remplacement définitif par le M51. Par ailleurs, elle met en œuvre une composante aéroportée reposant actuellement sur les aéronefs Mirage-2000 N K3 et les Rafale F3, emportant le missile ASMP-A (air-sol moyenne portée). A terme, les forces aériennes stratégiques françaises seront uniquement composées de Rafale.
La France participe au régime d’interdiction des essais nucléaires. Elle a conduit son dernier essai en janvier 1996, après avoir réalisé plus de 200 essais au Sahara et dans le Pacifique.
La direction des applications militaires du commissariat à l’énergie atomique dispose de plusieurs installations visant à maintenir les armes nucléaires françaises à niveau : le pôle principal de Bruyères-le-Châtel (conception des têtes nucléaires, études sur l’environnement, fonctions de soutien), les centres de Valduc en Bourgogne (matériaux nucléaires et simulation), Le Ripault en Touraine (recherches sur les nouveaux matériaux nucléaires), le centre d’études scientifiques et techniques d’Aquitaine (CESTA) pour la mise au point de l’architecture industrielle des programmes de têtes nucléaires.
Arsenal biologique
Après avoir mené des recherches sur divers pathogènes, notamment le bacille du charbon, les salmonelles ou le virus du choléra, la France a rejoint la convention sur les armes biologiques et les toxines, en 1984. Si elle ne détient plus d’armes biologiques, elle conduit des recherches dans le domaine des armes biologiques afin d’améliorer son plan de protection de la population et du territoire en cas d’attaque bactériologique, baptisé « BIOTOX ».
Arsenal chimique
La France a déjà fait usage d’armes chimiques au cours du premier conflit mondial, notamment du gaz moutarde et du phosgène. Elle a produit et stocké des agents neurotoxiques « sarin » et « VX » au cours des années 1960. Après avoir annoncé, en septembre 1988, la destruction de son arsenal chimique, la France a accueilli la conférence inaugurale de la convention d’interdiction des armes chimiques le 1er janvier 1993.
Arsenal balistique
Avec le retrait des missiles mobiles Pluton et Hadès, respectivement de 120 et 480 km de portée, la France dispose aujourd’hui de deux systèmes de missiles pouvant emporter des charges non conventionnelles. Le missile M51, remplaçant le missile M45, est une arme stratégique de portée supérieure à 8 000 km et d’une précision inférieure au demi-kilomètre. Missile de trois étages à propulsion solide, il sera lancé depuis les quatre SNLE français, quand les adaptations techniques auront été apportées. Chacun des sous-marins sera doté de 16 vecteurs, chacun pouvant emporter de 6 à 10 têtes nucléaires.
Le missile ASMP-A (air-sol moyenne portée – amélioré), d’une portée supérieure à 500 km et d’une précision inférieure à 10 mètres, est en train de remplacer l’ancien missile ASMP. Il équipera les forces aériennes stratégiques françaises constituées de Mirage 2000 N K3 et de Rafale F3.
Grande-Bretagne
- Etat dépositaire du TNP, signé en 1968.
- Etat dépositaire de la convention sur les armes biologiques et les toxines, signée en 1972.
- A ratifié la convention d’interdiction des armes chimiques en 1996.
- A signé le traité d’interdiction complète des essais nucléaires en 1996, ratifié en 1998.
- Membre du comité Zangger, du groupe des fournisseurs nucléaires, du groupe Australie, du MTCR.
- Soutient la mise au point d’un traité d’interdiction de la production de matières fissiles à des fins militaires.
Le Royaume-Uni a choisi très tôt d’intégrer ses forces nucléaires au système de l’OTAN. Elle est d’ailleurs partiellement dépendante des Etats-Unis, auxquelles elle a acheté les missiles Polaris pour en faire le cœur de son appareil de dissuasion. Ainsi, la Grande-Bretagne est partie prenante du groupe des plans nucléaires de l’OTAN, et du single integrated operational plan, document secret prévoyant les modalités d’utilisation des armes nucléaires américaines et de celles de leurs alliés.
Le Royaume-Uni fait partie des Etats les plus engagés dans le processus de désarmement nucléaire. Dans les autres domaines, les arsenaux britanniques ont également connu des réductions drastiques.
Arsenal nucléaire
A l’heure actuelle, le Royaume-Uni dispose de moins de 200 têtes nucléaires, après avoir atteint un maximum de 350 pendant la guerre froide. Ayant renoncé en 1998 à sa composante aérienne, la force de dissuasion nucléaire britannique est désormais uniquement constituée de quatre SNLE (sous-marins nucléaires lanceurs d’engin) de classe Vanguard.
Le Royaume-Uni s’est imposé ces dernières années comme l’un des pays les plus actifs dans le domaine du désarmement nucléaire. Dans la ligne des déclarations de la ministre des affaires étrangères du gouvernement précédent, le premier ministre Brown a été l’un des premiers chefs d’Etat doté d’armes nucléaires en exercice à affirmer être prêt à œuvre pour le démantèlement des arsenaux nucléaires existants, en janvier 2007 au cours d’un déplacement en Inde.
Accompagnant la suppression des forces aériennes stratégiques britanniques, les Etats-Unis ont retiré les bombes B-61 de la base de Lakenheath en juin 2008, mettant fin à 44 ans de présence nucléaire américaine sur le sol britannique.
Les sous-marins Vanguard emportent 16 missiles Trident II (D5). Ceux-ci peuvent théoriquement emporter douze têtes nucléaires. En application des traités START, puis SORT (conçus et fabriqués aux Etats-Unis, ces missiles sont en effet concernés par les stipulations des traités russo-américains), les Trident britanniques contiennent trois têtes chacun.
Du fait de l’obsolescence des Vanguard, le gouvernement britannique a lancé, au début de l’année 2007, un programme permettant de mettre en service une nouvelle classe de bâtiments. Le Parlement a adopté le projet en mai de la même année. Prévue pour entrer en service autour en 2017, la nouvelle flotte devrait assurer la dissuasion nucléaire britannique jusqu’en 2050. Si le nombre de missiles par sous-marins devrait être ramené à 12, l’augmentation du nombre de têtes par missiles permettrait de conserver une force globalement stable et d’un niveau plutôt bas, d’environ 160 têtes en 2020.
L’entretien des armes nucléaires britanniques est assuré par une entreprise, l’AWE : atomic weapons establishment. Dépendant du ministère de la défense, qui détient une part de son capital et des droits privilégiés, l’AWE est contractuellement liée à l’Etat britannique jusqu’en 2025. Elle dispose de deux structures principales, à Aldermaston et Burghfield, à l’ouest de Londres.
Arsenaux biologique et chimique
La Grande-Bretagne a démantelé ses arsenaux offensifs à la fin des années 1950. La décision de détruire les stocks d’armes chimiques britanniques remonte à 1957. Elle conserve des capacités importantes pour adapter son appareil de défense à cette menace, qu’elle développe dans son centre de recherche militaire de Porton. Rebaptisé « laboratoire scientifique et technologique de la défense » à la suite de la privatisation partielle de l’agence de recherche et d’évaluation du ministère de la défense britannique, « Porton Down » est au centre de plusieurs controverses concernant les expériences qui y auraient été conduites au cours des années 1970.
Arsenal balistique
D’une portée estimée à 8 300 kilomètres, pour une précision inférieure au demi-kilomètre, les missiles Trident sont les seuls armes stratégiques actuellement disponibles pour le Royaume-Uni.
Achetés sur étagère à l’entreprise américaine Lockheed Martin, ces missiles ont été mis en service en 1990. Il n’est pas prévu de les renouveler, malgré l’existence d’un programme important de renouvellement de la flotte de sous-marins nucléaires lanceurs d’engins Vanguard.
Inde
- Officiellement, pas d’ADM chimique ou biologique.
- Détiendrait environ une centaine de têtes nucléaires, dont 70 seraient opérationnelles.
- Non signataire du TNP et du TICE.
- A ratifié la convention sur les armes chimiques en 1996.
- A ratifié la convention sur les armes biologiques et toxiques en 1974.
Principales implantations administratives et technologiques pour la production et l’utilisation d’ADM.
Energie nucléaire
- Pokharan (Rajasthan): site d’essais nucléaires.
- Kota (Rajasthan): centrale nucléaire et unité d’eau lourde.
- Nangal (Pendjab) : unité d’eau lourde.
- Baroda (Gujarat) : unité d’eau lourde, Gujarat state fertilizers and chemicals ltd.
- Ahmedabad (Gujarat) : Institut de recherche sur le plasma.
- Hazira (Gujarat) : unité d’eau lourde, société Larsen et Toubro.
- Kakrapar (Gujarat) : centrale nucléaire.
- Tarapur (Maharashtra) : unité de fabrication de combustible nucléaire, centrale nucléaire de Tarapur, unité de retraitement de combustible nucléaire.
- Bombay (Maharashtra) : Beryllium machining, direction nationale des achats, Bureau de l’eau lourde, Institut Tata de recherche fondamentale.
- Thal Vaishet (Maharashtra) : unité d’eau lourde, Rashtriya chemicals and fertilizers ltd.
- Pune (Maharashtra) : centre de développement informatique, Kirloskar brothers ltd, Walchandnagar industries ltd.
- Kaiga (Karnataka) : centrale nucléaire.
- Bengalore (Karnataka) : Bharat heavy electrical ltd, HMT machine tools ltd, Institut indien des sciences.
- Mysore (Karnataka) : unité d’enrichissement d’uranium de Ratehali.
- Alwaye (Kerala) : compagnie indienne des terres rares.
- Tuticorin (Tamil Nadu) : Southern petrochemical industries, unité d’eau lourde.
- Kalpakkam (Tamil Nadu) : générateur d’essai de réacteur, unité de retraitement de combustible nucléaire, organisation générale des services, centre Indira Gandhi de recherche atomique, réacteur de recherche de Kamini.
- Chennai (Tamil Nadu) : Institut des sciences mathématiques.
- Manuguru (Andhra Pradesh) : unité d’eau lourde.
- Hyderabad (Andhra Pradesh) : direction pour l’exploration et la recherche de minerais radioactifs, unité de fabrication de céramiques, Electronics corporation of India ltd, Mishra Dhatu Nigam ltd, centre national d’analyse des matériaux, unité de fabrication de zircon, complexe de combustible nucléaire, unité des matériaux spéciaux, unité de fabrication de combustible nucléaire.
- Bhubaneswar (Orissa) : Institut de physique.
- Talcher (Orissa) : unité d’eau lourde.
- Jaduguda (Orissa) : Uranium corporation of India ltd, unité de traitement d’uranium.
- Calcutta (Bengale occidental) : Institut Saha de physique nucléaire.
- Indore (Madhya Pradesh) : Centre des technologies de pointe.
- Narora (Uttar Pradesh) : centrale nucléaire.
- New Delhi: Bharat heavy electricals ltd.
Missiles
- Jammu (Cachemire): stockage des Prithvi 1.
- Jalandhar (Pendjab) : stockage des Prithvi 1.
- Chandigarh (Pendjab) : laboratoire de recherche balistique, semiconductor complex ltd.
- Dehradun (Uttaranchal) : Defense electronics applications laboratory.
- New Delhi : laboratoire de recherche de défense, centre de recherche sur le laser, laboratoire de physique sur les combustibles solides, centre pour la sécurité des explosions.
- Ranchi (Jharkhand): Metallurgical and engineering consultants ltd.
- Chandipur (Orissa): centre de test.
- Hyderabad (Andhra Pradesh): Bharat dynamics ltd, laboratoire de recherche pour la défense, centre Imarat de recherche, laboratoire de recherche métallurgique, laboratoire de recherche en électronique, Mishra dhatu Nigam ltd, Electronics corporation of India, SKM tools private ltd, Pantex gee bee fluid power ltd.
- Sriharikotra (Andhra Pradesh) : missiles à longue portée.
- Nasik (Maharashtra) : IBP ltd.
- Bombay (Maharashtra) : Larson et Toubro, Godrej et Boyce Mfg co. Ltd,
- Ahmednagar (Maharashtra) : unité de recherche et de développement sur les vecteurs.
- Pune (Maharashtra) : recherche sur les motorisations, Institut des technologies de l’armement, établissement de recherche et de développement des armements, high energy materials ltd, systèmes de contrôle Srijan.
- Thiruvananthapuram (Kerala) : centre spatial Vikram Sarabhai.
- Palakkad (Kerala): Instrumentation ltd.
- Bengalore (Karnataka): centre de recherche sur les tubes à micro ondes, centre de recherche sur les radars, centre de recherche sur les turbines à gaz, Aeronautical development est, Bharat electronics ltd, Bharat earth movers ltd, Hindustan aeronautics ltd.
Principales administrations, entreprises publiques ou privées participant au programme nucléaire
- Commandement stratégique nucléaire (sous l’autorité du Premier ministre) : gestion et mise en oeuvre de l’arsenal nucléaire.
- Commission à l’énergie atomique : gestion des matières fissiles.
- Organisation de recherche et de développement de la défense: intégration des charges aux ogives, recherché sur les vecteurs.
- Entreprises privées contractantes du gouvernement indien ou de partenaires étrangers : Bharat, Larson et Toubro, Beryllium machining, Instrumentations ltd, Hindustan aeronautics, IBP, SKM, Uranium corporation of India
Arsenal
Têtes nucléaires: nombre oscillant de 100 à 150, dont 70 seraient opérationnelles.
Moyens balistiques
Missiles et avions
Type |
Portée |
Nombre estimé |
Charge |
Mise en service |
Terrestres |
||||
Prithvi 1 |
150 km |
20 à 50 |
800 kg |
Mise en service en 1994. Entre 20 et 50, déployés près du Pakistan |
Prithvi 2 |
250 km |
25 |
800 kg |
n.c. |
Agni 1 |
700 km |
25 |
1000 kg |
Tests effectués en 2007 et 2008. Déployés au sein du groupe de missile 334 |
Agni 2 |
2000 km |
20 |
1000 kg |
Dernier test en octobre 2004. Incertitude sur son déploiement |
Agni 3 |
3000 km |
n.c. |
1500 kg |
En test. Déploiement attendu en 2010 ou 2011. |
Naval |
||||
Dhanush |
350 km |
n.c. |
1000 kg |
En cours |
K 15 |
700 |
n.c. |
500 ou 600 kg |
Aurait été testé en 2008 |
Aérien |
||||
Mirage 2000H Vajra |
1850 km |
35 |
6300 kg |
Equipé pour porter des bombes nucléaires |
Mig 27 et Mig 29 |
1650 km |
211 |
n.c. |
n.c. |
Jaguar IS Shamshir |
1400 km |
88 |
4760 kg |
Sans doute équipé pour porter des bombes nucléaires |
Iran
- Signataire du TNP en 1968.
- Signataire du traité sur les armes biologiques en 1973.
- A ratifié la convention sur les armes chimiques en 1997.
Sites nucléaires
Enrichissement
Lashkar-Abad et Ramandeh : enrichissement d’uranium.
Eslamslahr : société Kalaye Electric, composants de centrifugeuses.
Natanz : enrichissement d’uranium.
Arak : mécanique
Recherche et développement
Téhéran : centre de recherche nucléaire, société Kalaye Electric, université Sharif de recherche, agence de l’énergie atomique de l’Iran.
Jabr Iban Hagan : recherche et transformation.
Damarand : recherche sur les plasmas.
Natanz, Ramandeh, Lashkar-Abad et Gorgan, Bonab: recherche.
Ispahan : unité de recherche sur l’enrichissement d’uranium, réacteur à neutron.
Saghand, Zarigan et Narigan : mines d’uranium.
Fasa : transformation d’uranium.
Bushehr : réacteur à eau légère.
Darkhouin : enrichissement d’uranium.
Arak et Khondab: réacteur à eau lourde.
Tabriz : recherche et ingéniérie de défense.
Chalus : unité de recherche et développement sur les armes.
Mo Allem Kalayeh : recherche nucléaire.
Karaj : accélérateur cyclon.
Missiles
Téhéran : Fabrication de machines outils, groupe industriel Shahid Hemmat, base aérienne Fajr pour les tests et la recherche, Organisation industrielle aérospatiale.
Parchin et Machad : production de missile et de carburant.
Aliabad, île Abou Mousad, Arak : recherche.
Tabas, Sharud, Semnan, Garmsar: stockage et test.
Qom: test.
Ispahan: assemblage de composants liquids et solides pour le carburant.
Sirjan et manzariyah : recherche et développement, production de carburant et stockage.
Kuhestak : production de carburant.
Ile Sirri : missiles anti navires.
Bandar Abbas et Khorramabad : fabrication, test et stockage.
Chiraz : production.
Gostaresh : recherche sur la motorisation.
Armes biologiques
Bien que signataire de la convention sur l’interdiction des armes, l’Iran est soupçonné de conduire au minimum un programme de recherche dual conduisant à la fabrication d’armes biologiques. Le niveau de ses scientifiques et la qualité de ses unités de recherche lui permettent de nourrir un tel programme. L’Iran aurait manifesté son intérêt pour l’anthrax et le ricin.
Téhéran aurait développé son programme pendant la guerre l’opposant à l’Irak, alors que les Iraniens subissaient des attaques chimiques. Des scientifiques néerlandais et canadiens auraient été approchés pour la mise au point de toxines. Un faisceau d’indices conduit à penser que Téhéran poursuit ses recherches, sans pour autant produire d’ADM biologiques ou toxiques.
Armes chimiques
Avant de porter tout jugement, il convient de rappeler que l’Iran est un des pays dont des milliers de soldats ont subi des attaques chimiques entre 1980 et 1988, lors de la guerre contre l’Irak. Téhéran a certes signé la convention d’interdiction des armes chimiques mais dans de telles circonstances, il est inévitable que l’Iran ait poursuivi un programme de recherche… Même si pacta sunt servanda…
Les unités de Parchin, Ispahan et Qazvin sont à même de produire des centaines de tonnes d’agents chimiques chaque année. L’Iran détiendrait des stocks de gaz sarin, de gaz moutarde, de phosgène et de cyanide, mis au point grâce à des compagnies occidentales (allemande, américaine, près de Baltimore) indiennes et chinoises. Les usines pharmaceutiques et d’engrais serviraient de couverture à cette production.
Il manque des preuves formelles à l’appui de cette thèse, même si des déclarations d’officiels iraniens la corroborent. Rajai Korassani, représentant permanent d’Iran aux Nations Unies déclarait ainsi en 1987 que « si le régime irakien ne cessait pas ses crimes, l’Iran lancerait des représailles selon le même mode… ». Téhéran aurait ainsi développé la production de chlorure de thionyle, de sulfate de phosphore, de cyanure et de phosgène. Elle a acheté auprès de la Chine, de l’Espagne, de la Corée du Sud et des Pays-Bas des agents chimiques pour produire des substances toxiques ou au contraire pour s’en protéger. Les missiles Shahab sont sans dote capables d’emporter des têtes chimiques.
Moyens balistiques
Le programme balistique a un objectif principal: pouvoir atteindre l’Irak et Israël, ce qui explique la concentration des efforts iraniens sur les missiles à courte et moyenne portée. Les recherches sur les missiles intercontinentaux sont pour leur part évidemment liées à la mise au point potentielle d’un engin nucléaire afin de rendre la dissuasion iranienne crédible.
Il existerait 5 brigades de missiles composées de Scud B et C et de Shahab-3. Chacune est susceptible d’être employée de manière indépendante comme arme de dissuasion ou de représailles, mais elles peuvent aussi être coordonnées en appui d’une opération d’envergure. Elles sont mises en œuvre non par l’armée mais par le corps des Pasdarans. Elles sont placées principalement au sein de la composante aérienne du corps.
L’effectif serait de 200 Scud B / Shahab-1, de 150 à 170 Scud C / Shahab-2, auxquels s’ajoute un nombre inconnu de Shahab-3, dont la portée est de 1300 km. Le nouveau missile à courte portée (200 km) Fateh serait également en passe d’être mis au point.
Téhéran a lancé en 2009 pour la troisième fois un missile balistique à deux étages et à propergols solides de capacité stratégique de 2000 km, ce qui montre le franchissement d’un cap technologique. Elle a également placé avec succès un satellite sur orbite avec le lanceur Safir, qui illustre la capacité d’étagement et de réalisation de missions au profil de vol complexe.
Israël
- Ne détient officiellement aucune ADM nucléaire, chimique ou biologique.
- Détiendrait environ 200 têtes nucléaires.
- A sans doute conduit des programmes de recherche sur les armes chimiques et biologiques.
- Dispose officiellement de missiles (programme Jéricho)
- Non signataire du TNP.
- Signataire en 1993 de la convention sur les armes chimiques, qu’elle n’a pas ratifiée.
- Non signataire de la convention sur les armes biologiques et toxiques.
Principales implantations administratives et technologiques pour la production et l’utilisation d’ADM
- Tel Aviv : agence nucléaire et agence spatiale israéliennes, Israël Atomic Energy Commission.
- Tirosh et Eilabun : stockage de matières fissiles.
- Haïfa : design et assemblage des bombes, recherche et design des missiles.
- Dimona : réacteur nucléaire servant à l’enrichissement d’uranium, à la fabrication de plutonium et au retraitement.
- Soreq : réacteur de recherche nucléaire.
- Base aérienne de Palmachim : lancement de satellites et essais de missiles.
- Be’er Yakov : assemblage des missiles Jericho et Arrow, ainsi que des fusées Shavit.
- Kfar Zehatya : base de missiles Jericho 1 et peut-être Jericho 2.
- Ness Ziona : Institut israélien de recherche biologique et chimique.
Principales entreprises publiques ou privées participant au programme nucléaire
- Israël Aircraft Industry (Tel Aviv).
- Israël Military Industries (Hashonon).
- Tadiran Electronic Industries (Holon).
- Elbit System Ltd (Haïfa)
Arsenal
Têtes nucléaires: nombre avoisinant 200.
Moyens balistiques
Missiles
Nom |
Etages |
Carburant |
Rayon d’action |
Mise en service |
Stock |
Lance |
1 |
Solide |
Env. 130 km |
1975 |
n.c. |
Jericho 1 |
1 |
Solide |
235 / 500 km |
1970 |
50 |
Jericho 2 |
2 |
Solide |
1500 /3500 m |
1990 |
50 |
Popeye Turbo |
1 |
n.c. |
200 km |
2000 |
12 |
L’arsenal balistique s’élèverait à environ 50 missiles Jericho-1 et 50 missiles Jericho-2. Leur portée permet à Israël de toucher presque tout le Moyen-Orient, dans un arc qui relie l’Est de la Libye au Nord du Soudan, le Nord de l’Iran aux deux tiers de l’Arabie saoudite, et qui inclue l’Ouest de l’Irak, la Syrie, l’Egypte et le Sud de la Turquie. Leur précision est considérée comme excellente.
Pakistan
- Non signataire du TNP.
- Non signataire du TICE
- Signataire de la convention sur les armes chimiques en 1993, ratifiée en 1997.
- Signataire de la convention sur les armes biologiques en 1972, ratifiée en 1974.
- Détiendrait de 60 à 120 têtes nucléaires.
Capacités et sites nucléaires
Le Pakistan a commencé son programme clandestin au milieu des années 70. Il a mis au point une unité d’enrichissement dans les années 80. Il déploie actuellement de 60 à 120 têtes nucléaires et disposerait en outre de 580 à 800 kg d’uranium hautement enrichi, ce qui lui permettrait de fabriquer 30 à 50 bombes à fission supplémentaires. Les sites nucléaires principaux sont le Pakistan Institute of Science and Technology (PINSTECH) pour l’enrichissement d’uranium et le complexe nucléaire de Dera Ghazi.
Armes biologiques
Le Pakistan a souvent été accusé de conduire un programme d’armes biologiques, mais aucune preuve n’a été avancée à l’appui de cette hypothèse. Les Etats-Unis ont soupçonné 4 entités d’abriter des laboratoires de recherche : le centre de biologie moléculaire de Lahore, l’Institut de recherche de Karachi, l’Institut de Karachi de recherche militaire et l’Institut national d’ingénierie biotechnologique et génétique de Faisalabad, sans non plus apporter de preuve.
Armes chimiques
Les adversaires du Pakistan l’ont souvent accusé de conduire un programme d’armes chimiques, sans en apporter la preuve tangible. Islamabad dispose d’une industrie chimique diversifiée, apte à produire la plupart des armes connues. Dans les années 80, les Soviétiques ont accusé les Pakistanais de fournir aux insurgés afghans des grenades avec des substances toxiques, puis la même accusation a été émise par le gouvernement afghan à propos d’armes fournies aux taliban.
Moyens balistiques
Missiles et avions
Type |
Portée |
Nombre estimé |
Charge |
M 11 |
280 km |
100 à 150 |
n.c. |
Shaheen |
600 – 750 km |
10 à 15 |
800 kg |
Shaheen 2 |
2000 – 3000 km |
Moins de 10 |
1000 kg |
Ghauri |
1300 – 1500 km |
20 à 30. |
70 kg |
Ghauri 2 |
2000 km |
n.c. |
n.c. |
Mirage 3 |
4000 km |
107 |
n.c. |
Mirage 5 |
4000 km |
64 |
n.c. |
F 16 |
2500 km |
32 |
C’est principalement grâce à l’aide de la Chine et de la Corée du Nord que le Pakistan, qui accusait un retard technologique, a pu acquérir des composant électroniques nécessaires à la mise au point des Ghauris et des Shaheens. La Chine, qui soutient le Pakistan en raison de la rivalité des deux pays avec l’Inde, fournit toujours des capacités d’assemblage de matière première pour les propulseurs de système de guidage et accueille dans ses instituts technologiques des délégations pakistanaises. En outre, Le Pakistan s’est récemment tourné vers la Corée du Nord pour acquérir le missile Nodong, dont la portée et la capacité d’emport lui permettrait de crédibiliser sa dissuasion nucléaire face à l’Inde.
Russie
- Membre fondateur du TNP, en 1968.
- Signataire du TICE en 1996, ratifié en 2000.
- Détenait 3909 têtes nucléaires au 1er janvier 2009 et disposait de 8150 têtes en attente de démantèlement.
- A ratifié en 1975 la convention sur les armes biologiques et toxiques.
- Signataire de la convention sur les armes chimiques en 1993, ratifiée en 1997.
Forces nucléaires
A la chute de l’URSS, en 1991, la Russie a hérité d’un stock de 35 000 armes nucléaires, ce qui constituait le principal arsenal au monde.
En application du traité START de 1991 et du traité SORT de 2002, la Russie a réduit à 3909 têtes son arsenal, 8150 têtes restant en attente de démantèlement. La réduction concerne parallèlement l’arsenal des Etats-Unis, les deux pays opérant des inspections réciproques de leurs installations.
START, qui expire le 5 décembre 2009, est en cours de renégociation. A la différence de SORT, ce traité contient des dispositions précises pour le contrôle du processus de réduction des armements. Les Présidents Medvedev et Obama examinent la proposition américaine d’une limitation à 1500 têtes, qui ne rencontre pas totalement l’adhésion de l’état-major des forces russes.
Moscou déploie actuellement le nouveau missile intercontinental à tête unique Topol-M. Les forces navales conduisent pour leur part des tests du nouveau missile intercontinental Bulava, lancé depuis les sous-marins. Enfin, la flotte aérienne de bombardier Tupolev est en cours de modernisation depuis 2004.
En application de START 1, la Russie était face à l’obligation de détruire des stocks en excès ou obsolètes, ainsi que les arsenaux nucléaires situés au Belarus, en Ukraine et au Kazakhstan. L’aide internationale, notamment le programme d’application de la loi Nunn – Lugar et le partenariat du G8, ont été nécessaires, dans le climat politique et financier si particulier des années 90. Mais il est indéniable que la Russie s’est montré un partenaire fiable en respectant sa signature et en réduisant la menace que son arsenal faisait peser (contrebande, terrorisme, etc…).
Exportations
La Russie, pays exportateur de technologies nucléaires (centrales, combustible) a pour principaux clients la Chine, l’Inde et l’Iran. Elle a renforcé son système de contrôle aux exportations et établi la liste des produits qu’il est illicite de vendre à l’étranger et des technologies interdites de transfert. Elle est également membre du Groupe des fournisseurs nucléaires.
Capacités et sites nucléaires
La gestion des installations du complexe nucléaire russe est principalement placée sous l’autorité de la société d’Etat Rosatom. Depuis 2006, le gouvernement a entrepris une réforme du secteur pour séparer les installations civiles des installations liées aux armements. L’autorité de régulation Rostethnadzor supervise la construction comme l’activité des unités nucléaires existant dans le pays.
Unités de production de têtes nucléaires
Après la chute de l’URSS, la Russie a hérité de la quasi-totalité du complexe de fabrication de têtes nucléaires. La mise au point et la fabrication des têtes se concentrent dans 10 villes nucléaires fermées. L’ensemble des opérations (recherche, fabrication, maintenance, démantèlement) est sous l’autorité du ministère de l’Energie atomique. Le ministère de la Défense contrôle toutes les opérations impliquant des armes dès qu’elles quittent les installations du ministère de l’Energie atomique. Les unités du complexe de fabrication se répartissent en quatre branches : recherche et développement, production de matière fissile, production des têtes nucléaires et sites de test.
La recherche et le développement des têtes nucléaires a des installations à Sarov (Institut panrusse de recherche scientifique), à Sneshinsk (Institut panrusse de recherche scientifique en physique), à Moscou (Institut de recherche sur les systèmes automatiques et Institut sur les technologies des vibrations) et à Nijni-Novgorod (Institut de recherche sur les systèmes de mesure).
La production de matière fissile est concentrée à Ozersk (unité Mayak, armes à plutonium), à Zheleznogorsk (Krasnoyarsk 26, mine et chimie), à Seversk (Tomsk 7, unité chimique sibérienne et unité électrochimique) et à Novouralsk (Sverdlovsk 44, unité électrochimique de l’Oural). Depuis 1992, le gouvernement russe a fermé 10 des 13 unités de plutonium. Mayak continue retraiter le combustible. Ozersk et Seversk sont également des sites de stockage de différents matériaux radioactifs qui, dans le cadre de l’accord américano-russe du 1er septembre 2000, sont immobilisés ou transformés en combustible à usage civil.
La production des têtes nucléaires est située, pour ce qui concerne la fabrication des composants des matériaux fissiles, à Ozersk (unité Mayak) et à Seversk. L’assemblage et le désassemblage sont à Sarov (unité avant-garde d’électromécanique), Lesnoï (Sverdlovsk 45), Trekhgorny (fabrication d’instruments) et Zarechnyy (assemblage de base). Les composants non nucléaires sont produits à Moscou (Molniya), Novossibirsk, Iekaterinenburg et Nizhnaya Tura.
S’agissant des tests, la Russie a signé en 1963 le traité d’interdiction partielle des essais nucléaires et a conservé deux sites, Semipalatinsk au Kazakhstan et Novaya Zemlya en Russie. Depuis 1990, date de ratification du TICE, la Russie conserve juste Novaya Zemlya pour des essais sous le seuil critique.
Armes biologiques et toxiques
L’URSS a ratifié en 1975 la convention sur les armes biologiques et toxiques. Mais elle a poursuivi activement un programme commencé en 1920 pour doter puissamment ses forces de larges quantités d’agents biologiques. Le programme était conduit et coordonné par un organisme d’Etat, Biopreparat, qui gérait une quarantaine d’unités. Les établissements principaux étaient le Centre scientifique d’Etat de microbiologie appliquée, à Obolensk, l’Institut d’études immunologiques de Lyubychany, le Centre de virologie et de bactériologie de Novossibirsk et l’Institut de préparations biologiques de Saint Petersbourg. En raison de la complexité de l’appareil administratif soviétique, le nombre exact d’unités de recherche et de production n’est pas connu avec exactitude.
Le Président Boris Eltsine a reconnu officiellement en 1992 que l’ex URSS avait violé ses engagements au regard du traité sur les armes biologiques et a interdit tout type de programme à vocation militaire. Une grande partie des unités de recherche demeure en fonction aujourd’hui, mais les objectifs sont civils et les activités s’effectuent le plus souvent dans le cadre de coopérations internationales. Il existe également un programme de démantèlement d’installations et de renforcement de celles existantes, avec le concours des Etats-Unis, de l’Union européenne et d’organisations telles que la Société royale britannique, l’organisation néerlandaise de recherche scientifique ou le NTI.
Toutefois, les installations sous tutelle du ministère de la Défense demeurent interdites aux étrangers. Ce manque de transparence inquiète les responsables occidentaux qui s’interrogent sur la survivance de stocks d’ADM biologiques et de leur possible usage par l’armée russe en cas de conflit.
Armes chimiques
Comme pour les armes biologiques, l’URSS a commencé un programme d’armes chimiques en 1920. Des gaz innervants aux gaz asphyxiants, avec des charges projetées par des pièces d’artillerie et des missiles, il semble bien que toutes les technologies aient été explorées et que Moscou ait bâti l’arsenal chimique le plus vaste et le plus diversifié de tous les temps.
Sous l’autorité du ministère de la Défense, l’administration des forces chimiques comprenait environ 40 installations. Les unités principales étaient l’Académie militaire de protection chimique (Moscou), le Centre de test (Shikhany), les centres d’expérimentation de Mer Caspienne et du Lac Baikal, ainsi que Nijni-Novgorod.
Les ministères de la Santé, de l’Agriculture (pesticides et herbicides) et de l’Industrie ont également apporté leur concours à un programme qui a abouti à la détention d’un stock évalué à 40 000 tonnes de produits en 1993.
Après la signature de la Convention sur les armes chimiques, Moscou, compte tenu de ses difficultés financières, a accepté l’aide occidentale pour démanteler son arsenal chimique, selon un échéancier retracé dans le tableau ci-dessous :
Destruction des stocks russes d’armes chimiques
Lieu |
Agent chimique |
Tonnage |
Quantité détruite |
Echéancier |
Gornyy |
Moutarde |
1143 |
1143 |
Décembre 2002 |
Kambarka |
Lewisite |
6349 |
5752 |
Décembre 2005 |
Maradikovsky |
Sarin |
6890 |
4394 |
Fin 2009 |
Pochep |
Sarin |
7498 |
2012 | |
Leonidovka |
Sarin, VX |
6885 |
2012 | |
Shchuchye |
Sarin, VX |
5457 |
2012 | |
Kizner |
Sarin, VX |
5745 |
2012 | |
Total |
39 967 |
11 289 |
2012 |
Source : NTI
Moyens balistiques
D’après le traité START et les documents publiés pour le contrôle de son application, la Russie dispose de 680 lanceurs déployés, porteurs potentiels de 3278 têtes ainsi réparties :
Lanceurs et têtes nucléaires russes
ICBM |
SLBM |
Aéronefs | |
Lanceurs |
386 |
215 |
79 |
Têtes |
1 366 |
982 |
930 |
Ce chiffre devrait diminuer car un grand nombre de lanceurs ont atteint leur durée limite de vie. Parallèlement, le nouveau lanceur Topol-M n’est déployé qu’au rythme lent de 7 à 8 par an. Il est décliné en version fixe et mobile. Le déploiement sur silo devrait s’établir à 60. Les éléments mobiles sont en cours de déploiement depuis 2006 et leur mirvage devrait intervenir en 2009.
La réduction des moyens balistiques russes s’accompagne de leur modernisation, notamment celle de la composante océanique, avec les essais sur le nouveau missile Bulava. Les essais ont commencé en 2005, avec 11 tirs, dont 5 ont été des échecs. Les travaux se poursuivent et le missile, qui sera mirvé à 6 têtes sera placé dans les SNLE de type Borey. Les moyens aériens sont également en cours de modernisation, notamment les bombardiers Tupolev TU-160.
Moyens balistiques russes
Missiles |
SS-18 |
SS-19 |
SS-25 |
SS-27 |
SS-N-18 |
SS-N-20 |
SS-N-23 |
Bulava |
Emploi |
Sol-sol |
Sol-sol |
Sol-sol |
Sol-sol |
Mer-sol |
Mer-sol |
Mer-sol |
Mer-sol |
Masse totale |
211,1 t |
105,6 t |
45,1 t |
47,2 t |
35,3 t |
90 t |
40,3 t |
- |
Masse vectorisablee |
8 800 kg |
4 350 kg |
1 000 kg |
1 200 kg |
1 650 kg |
2 550 kg |
2 800 kg |
- |
Nombre d'étages propulsifs |
2 liquides |
2 liquides |
3 solides |
3 solides |
3 liquides |
3 solides |
3 liquides |
- |
Nombre de têtes et énergie |
10 TN de 550 a 750kt |
6 TNde 750kt |
1 TN de 550kt |
1 TNde 550kt |
3 TN de 500kt |
L0 TN de 200kt |
3 TN de 100kt |
6 TN de kt |
Mode de lancement |
Silo |
Silo |
TEL |
Silo/TEL |
SNLE |
SLNE |
SLNE |
SLNE |
Portée maximum |
11000 km |
10 000 km |
10 500 km |
10 500 km |
6 500 km |
8 300 km |
8 300 km |
+ 8 000 km |
Syrie
- Signataire du TNP en 1968, ratifié en 1969.
- Signataire du traité sur les armes biologiques et toxiques en 1972.
- Non signataire de la convention sur les armes chimiques.
La Syrie n’est pas une puissance nucléaire militaire et ne détient officiellement qu’une unité de recherche, le réacteur SRR-1 de technologie chinoise. Damas ne fait pas mystère de ses ambitions dans le domaine civil et a signé des programmes de coopération avec la Chine, la Russie, l’Iran et la Corée du Nord, sous l’égide de l’AIEA.
La Syrie est néanmoins soupçonnée de vouloir se doter d’un engin nucléaire, dans un contexte géopolitique marqué par les ambitions de l’Iran et l’arsenal secret d’Israël. L’invasion américaine de l’Irak a sans doute accéléré la volonté des dirigeants syriens de sanctuariser leur territoire. Compte tenu de sa faiblesse démographique, la Syrie manque de scientifiques de haut niveau pour conduire seule un programme et a dû faire appel à la Corée du Nord.
Sites nucléaires
Outre le réacteur SRR 1 qui opère sous contrôle de l’AIEA et qui est géré par la commission syrienne de l’énergie atomique, les installations nucléaires sont situées près de Damas : le Centre de recherche nucléaire d’Al Hadjar et le Centre de recherches et d’études scientifiques. Les travaux de ces centres, au nombre d’une quinzaine, portent sur les isotopes médicaux et l’activation des neutrons et s’effectuent sous le contrôle de l’AIEA. Il convient également de mentionner le département de physique de l’université de Damas qui travaille sur la désalinisation (il existe sur le papier des projets de centrales nucléaires couplées à des usines de désalinisation, qui intéressent les pays qui manquent d’eau comme la Libye, les Emirats arabes unis ou ma Syrie). Enfin, la Syrie dispose d’une mine d’uranium à Waadi Qasser, près de l’Euphrate.
Le site d’Al Kibar, bombardé par les Israéliens (cf chapitre II de la présente étude) semble avoir abrité un réacteur de 20 à 25 megawatts de technologie nord-coréenne, d’un design analogue à celui de Yongbyon. Il aurait été en mesure, une fois achevé, de produire du plutonium pour produire une bombe par an.
Armes biologiques et chimiques
Il existe peu d’informations sur la possession par la Syrie d’armes biologiques. Elles sont trop parcellaires pour soupçonner Damas d’un quelconque programme même si, comme tout Etat, elle a sans doute conduit quelques recherches en ce domaine.
La détention d’un arsenal chimique fait en revanche l’objet d’un consensus national, la Syrie y voyant le moyen de contrebalancer la puissance d’Israël, même si ce choix a des conséquences sur le commerce syrien, qui subit en ce domaine des embargos limités.
Damas a acquis des stocks d’armes chimiques en 1972 ou 1973 auprès de l’Egypte. Une partie de ces stocks a été prise par les troupes israéliennes lors de la guerre du Kippour, alors que la Syrie n’avait pas osé s’en servir, malgré la défaite de ses forces terrestres. En 1982, après l’invasion du Liban par Tsahal, le pouvoir semble avoir décidé d’intensifier son programme chimique pour équilibrer autant que possible la supériorité stratégique d’Israël. Les travaux ont été placés sous l’égide du Centre d’études et de recherches scientifiques, qui s’occupe théoriquement de travaux de nature civile. Le priorité première a été la production de gaz sarin. Placé à l’origine sur des missiles portés par des bombardiers, le gaz a été transféré sur des missiles Scud C après 1997, en raison de la supériorité aérienne d’Israël. Damas s’est ensuite tourné vers la production de VX.
A l’instar du programme nucléaire d’Israël, le programme chimique de Damas est confidentiel, tout en étant suffisamment connu pour que tout agresseur qui souhaiterait envahir le territoire syrien soit obligé de mesurer les risques qu’il encourt. Comme le programme n’existe pas officiellement, il n’existe non plus aucune doctrine publique d’usage d’ADM chimiques.
Les sites d’études, de production et de stockage d’armes chimiques seraient les suivants : Centre d’études et de recherches (Damas), Furqlus, Palmyre (stockage), Lattaquieh, Banias, Abou Khan Chamat, Dumayr (production), Homs (unité chimique).
Moyens balistiques
La Syrie a commencé l’acquisition de missiles dans les années 70 et dispose actuellement d’un des plus importants arsenaux de vecteurs sol sol du Moyen-Orient, porteurs de charges conventionnelles et sans doute chimiques. Le pays a tiré les leçons de l’échec de son artillerie, lors de la guerre de 1973, pour se doter de capacités capables de frapper le territoire israélien Si Damas ne maîtrise pas l’ensemble des technologies, elle a acquis grâce à la coopération avec ses partenaires un savoir-faire dans la production de carburants solides.
De 1960 à 1970 puis de 1979 à 1987, la Syrie a principalement bénéficié de l’aide soviétique. Depuis 1988, ses partenaires sont la Chine, la Corée du Nord et l’Iran, la Russie demeurant toujours un acteur important du programme syrien.
Les installations liées aux missiles se situeraient à Alep (quartier général, production et stockage), Homa (unité de fabrication de missiles à carburant solide et à carburant liquide) et à Homs (production de Scuds, essais et montage de charges conventionnelles). Il est également fait état de silos dissimulés dans certaines montagnes pour abriter les SS21 et Scuds.
L’arsenal syrien fait l’objet d’évaluations par les instituts spécialisés (Jane’s, CSIS, Institut international d’études de Monterey sur la non prolifération). Les conclusions ne concordent pas toujours. Il semblerait qu’un arsenal de 260 à 300 missiles de tous types constitue un chiffre crédible.
La Syrie semble être en mesure d’assembler les Scuds B et C au rythme d’une trentaine par an pour ces derniers. Elle aurait également testé des missiles Scud D en janvier 2007. A courte portée, ces vecteurs ont pour objectif Israël. Des missiles à plus courte portée encore (M-1B, d’origine chinoise, SS N 3) sont placés sur la flotte aérienne composée de 20 chasseurs Sukhois 24, 44 Migs 23BN d’attaque au sol, 20 Sukhois 20 et 90 Sukhois 22 d’attaque au sol également. Damas négocie avec la Chine l’achat de missiles M9, de 400 à 800 km de portée. Elle a également marqué son intérêt pour le missile russe Iskander, en cours d’essai.
Annexe 5 : Chronologie de l’actualité nucléaire 2008-2009
(par zones géographiques)
Afrique du Nord et Moyen Orient
Algérie
25 mars 2008 : signature, à Alger, d’un accord de coopération dans le domaine nucléaire civil entre l’Algérie et la Chine. Cet accord est similaire à celui signé par l’Algérie avec la Russie, les Etats-Unis et la France.
Bahreïn
24 mars 2008 : les Etats-Unis et Bahreïn signent un accord de coopération pour l’énergie nucléaire civile.
Egypte
En réunion au Caire, les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe déclarent que leurs pays quitteront le Traité de non prolifération nucléaire si Israël reconnaît détenir des armes nucléaires.
25 mars 2008 : signature, à Moscou, d’un accord russo-égyptien de coopération pour un usage pacifique de l’énergie nucléaire par les Présidents Vladimir Poutine et Hosni Moubarak. L’accord autorise la Russie à participer aux appels d’offres en vue de la construction de centrales nucléaires en Egypte. L’Egypte prévoit de faire construire à terme 4 centrales.
Emirats Arabes Unis
20 avril 2008 : déclaration du Cheikh Abdullah Zayed Al Nayan, ministre des Affaires étrangères des Emirats Arabes Unis, sur la nécessité pour son pays de se doter de capacités nucléaires civiles pour faire face aux besoins de son économie dans les années à venir.
15 mai 2008 : signature d’un mémorandum entre les Emirats Arabes Unis et le Royaume-Uni pour une coopération entre les deux pays sur l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire.
21 mai 2009 : approbation par le Président Barack Obama d’un projet d’accord bilatéral de coopération dans le domaine de l’énergie nucléaire civile entre les Etats-Unis et les Emirats.
6 août 2009 : approbation de 3 conventions sur la sécurité nucléaire, afin de mettre le droit émirien en conformité avec les règles de l’AIEA et permettre l’implantation de centrales nucléaires civiles dans l’Emirat.
Iran
3 mars 2008 : nouveau train de sanctions voté par le Conseil de sécurité de l’ONU à l’encontre de l’Iran, par 14 voix contre 0.
12 mars 2008 : les Etats-Unis annoncent des sanctions à l’encontre de la Future Bank, établie à Bahreïn, en raison de son rôle supposé dans la prolifération d’armes de destruction massive. La Future Bank est contrôlée par la banque iranienne Melli, déjà sanctionnée par le Trésor américain en raison de son rôle dans le financement d’activités proliférantes.
26 mars 2008 : l’Iran menace de sanctions les Etats occidentaux après l’embargo et les sanctions de l’ONU votées le 3 mars. Par une note de 20 pages, transmise par Manouchehr Mottaki, ministre des Affaires étrangères à Ban Ki Moon, secrétaire général de l’ONU, Téhéran rejette ces sanctions, qu’elle considère comme illégales.
8 avril 2008 : célébration de la 2ème journée nationale du nucléaire. Visite de l’usine de Natanz par le Président Mahmoud Ahmadinejad, qui annonce « le début du processus d’installation de 6000 centrifugeuses ».
17 avril 2008 : M. Mohamed El Baradei appelle l’Iran à reprendre les négociations sur son programme nucléaire.
2 juillet 2008 : dans une interview à l’Associated Press, Manouchehr Mottaki estime qu’il ne croît pas à un bombardement américain ou israélien sur l’Iran, en raison des conséquences qui s’ensuivraient sur le prix du pétrole, qui atteindrait des hauteurs insoupçonnées. La hausse du prix de l’énergie aggraverait les difficultés de l’économie américaine, alors que les Américains demeurent engagés en Irak et en Afghanistan.
10 juillet 2008 : les gardiens de la révolution testent 9 missiles lors de manœuvres militaires, dont l’un est décrit comme pouvant atteindre Israël.
13 juillet 2008 : visite en Iran d’Alexei Miller, président de Gazprom, après que Total ait annoncée le gel de ses investissements dans le pays en raison des risques politiques. M. Miller déclare son souhait d’augmenter son volume d’affaires avec Téhéran.
19 juillet 2008 : annonce par le gouvernement des Etats-Unis, que le n° 3 du Département d’Etat, M. Williams Burns, se rendra à Genève, pour participer à une rencontre en présence du négociateur iranien en charge du dossier nucléaire, M. Saïd Jalili. Le communiqué du Département d’Etat précise que M. Burns sera présent pour écouter et non négocier. Néanmoins, cette annonce signifie que Washington accorde toute son importance à la voie diplomatique pour un règlement du différent avec l’Iran sur l’énergie nucléaire.
21 juillet 2008 : le ministre des Affaires étrangères turc Ali Babacan indique que l’Iran et les Etats parties à la négociation avec la République islamique ont sollicité la médiation de la Turquie.
5 août 2008 : par lettre adressée à Javier Solana, l’Iran apporte une réponse vague aux offres européennes de coopération en échange d’un gel de ses activités nucléaires.
23 septembre 2008 : le chef des inspecteurs de l’AIEA estime que l’Iran pourrait actuellement dissimuler certaines de ses activités nucléaires. L’Iran répond qu’il s’agit d’une manœuvre des Etats-Unis, qui instrumentalisent l’AIEA contre lui.
2 octobre 2008 : l’AIEA indique dans un rapport que l’Iran détient 3820 centrifugeuses, fonctionnant à 85% de leur efficacité et à produit environ 520 kilos d’uranium faiblement enrichi. Cette quantité correspond aux trois quarts nécessaires, après un nouvel enrichissement, pour fabriquer sa première bombe nucléaire.
13 novembre 2008 : après avoir appelé de ses vœux des négociations directes avec les Etats-Unis, les conservateurs iraniens se placent sur la réserve après l’élection de Barack Obama à la présidence des Etats-Unis. La perspective de discussions avec Washington semble susciter leur méfiance, si l’on en croit les propos d’Hossein Taeb, commandant en second des gardiens de la révolution : « Ceux qui arborent le masque de l’amitié dans un but de tromperie, et qui se déclarent prêts à négocier sans condition préalable, sont plus dangereux que d’autres… ».
18 novembre 2008 : en réponse à une proposition d’Ankara, l’Iran déclare qu’il ne s’opposera pas à une éventuelle médiation turque entre Téhéran et Washington, mais que ses désaccords avec les Etats-Unis sont très profonds.
20 novembre 2008 : un rapport de l’AIEA considère que l’Iran a accumulé suffisamment de matière fissile pour fabriquer une bombe nucléaire.
1er décembre 2008 : l’Iran déclare vouloir construire deux nouvelles centrales nucléaires plutôt que d’agrandir celle de Busher.
23 décembre 2008 : Moscou dément avoir accepté une offre de l’Iran qui souhaite acquérir des missiles anti aériens russes, mais des diplomates affirment que les négociations ont commencé.
5 février 2009 : Motjaba Samareh-Hachemi, proche conseiller de Mahmoud Ahmadinejad, déclare dans une interview au Financial Times que le dialogue entre les Etats-Unis et l’Iran n’aboutira que si Washington accepte le droit de Téhéran à conduire un programme nucléaire. Il énumère une série de griefs comme de demandes à l’égard des Etats-Unis sur l’Afghanistan et la Palestine. Il indique que les sanctions bancaires internationales, en isolant son pays, l’ont mis à l’abri de la crise financière, et que l’effet des sanctions commerciales a été largement atténué par les cours élevé du pétrole, avant la crise.
Février 2009 : lancement réussi d’un satellite par l’Iran. Si le satellite est d’une conception peu sophistiquée, la réussite du lancement montre que Téhéran maîtrise la technologie balistique.
25 février 2009 : Gholamreza Aghazadeh, chef de l’Agence nucléaire iranienne, déclare, en réaction à un rapport de l’ONU, que l’Iran ne rencontre aucune difficulté pour développer son programme nucléaire, et qu’il escompte porter en 5 ans de 6000 à 50 000 le nombre de centrifugeuses en activité. « Les Etats-Unis doivent accepter la réalité d’un Iran nucléaire ».
8 avril 2009 : célébration de la 3ème journée nationale du nucléaire. Déclaration du Président Ahmadinejad sur des essais de centrifugeuses de nouvelle génération, « aptes à mieux enrichir l’uranium que les actuelles », lors de l’inauguration de l’unité de production de combustible nucléaire d’Ispahan. Cette unité est en mesure de produire annuellement 10 tonnes de combustible pour alimenter la réacteur d’Arak (40 megawatts). Golamreza Aghazadeh annonce que 7000 centrifugeuses sont désormais en action à Natanz et que l’Iran est entré dans une nouvelle phase de maîtrise de l’enrichissement. Il ajoute que le réacteur d’Arak est destinée à produire des isotopes pour l’agriculture et la santé, ce que Robert Wood, porte-parole du Département d’Etat considère « avec un certain scepticisme, les chiffres donnés par l’Iran sur le nombre de ses centrifugeuses n’ayant jamais concordé avec les estimations de l’AIEA ».
15 avril 2009 : le Président Ahmadinejad annonce que l’Iran présentera prochainement une série de propositions sur le nucléaire et les sujets de tension avec l’Ouest.
26 août 2009 : les inspecteurs de l’AIEA estiment que l’Iran ralentit son programme nucléaire et coopère plus avec l’Agence, sans doute parce qu’approchent les discussions visant à renforcer le régime de sanctions à l’encontre de Téhéran.
21 mai 2009 : Mahmoud Ahmadinejad annonce que l’Iran a testé avec succès un missile à moyenne portée, à carburant solide, capable de toucher Israël et les installations américaines au Moyen-Orient.
26 mai 209 : d’après les services de renseignement israéliens, le Vénézuéla fournirait de l’uranium à l’Iran.
23 juillet 2009 : Hillary Clinton, Secrétaire d’Etat, déclare que les Etats-Unis pourraient étendre leur parapluie nucléaire aux pays du Moyen-Orient si l’Iran se dotait de l’arme atomique.
8 septembre 2009 : Mohamed El Baradei, directeur général de l’AIEA, déclare que l’Agence est dans une situation d’impasse avec l’Iran, après que le Président Mahmoud Ahmadinejad ait réaffirmé la poursuite du programme d’enrichissement d’uranium iranien.
Octobre-novembre 2009 : nouvelles offres des pays occidentaux et de la Russie pour que l’Iran accepte de placer une partie de son combustible nucléaire sous contrôle international.
Israël
14 avril 2008 : annonce d’une coopération entre Israël et les Etats-Unis sur la sécurité nucléaire.
1er avril 2009 : en visite en Israël, Robert Gates, secrétaire d’Etat américain à la Défense, déclare qu’il serait très surpris qu’Israël « attaque l’Iran cette année », étant donné qu’il reste du temps à la communauté internationale pour persuader Téhéran de renoncer à un programme nucléaire militaire.
15 avril 2009 : en réponse à plusieurs analystes qui prônent une intervention d’Israël contre l’Iran, Robert Gates avertit qu’une telle attaque serait dangereuse et déclencherait des réactions incontrôlées de l’Iran.
14 mai 2009 : Benyamin Netanyahu, Premier ministre, reçoit un message discret de Barack Obama, Président des Etats-Unis, lui demandant de ne pas déclencher de frappe inopinée contre l’Iran de sa seule initiative.
23 juillet 2009 : des officiels israéliens admettent l’échec d’un essai de missile anti missile pour des raisons techniques.
19 août 2009 : à l’issue d’un entretien avec Dimitri Medvedev, Shimon Peres indique que la Russie est prête à reconsidérer la vente par la Russie à l’Iran de missiles sol air, qui pourraient renforcer la défense de sites nucléaires iraniens contre une attaque aérienne. Le Président israélien précise que son pays n’a pas l’intention d’attaquer lesdits sites.
Jordanie
30 juillet 2009 : Khaled Tukan, chef de l’autorité nucléaire, indique l’intérêt de son pays pour l’énergie nucléaire civile afin de devenir exportateur d’électricité.
Liban
1er décembre 2008 : le Liban est le 185ème pays à signer le traité d’interdiction des armes chimiques.
Libye
3 novembre 2008 : signature d’un accord de coopération en matière de nucléaire civil entre la Libye et la Russie
Syrie
24 avril 2008 : le Washington Post révèle qu’un enregistrement vidéo, pris en secret dans une installation syrienne, a convaincu les gouvernements américains et israéliens que la Corée du Nord aidait la Syrie à construire un réacteur capable de produire du plutonium. La vidéo aurait montré des techniciens nord-coréens dans le site, dont le nom de code syrien était Al Kibar. Elle aurait joué un rôle décisif dans la décision d’Israël de bombarder le site, le 6 septembre 2007.
8 mai 2008 : les Etats-Unis étendent leur régime de sanctions à l’encontre de Damas, après la confirmation que les installations syriennes bombardées par Israël bénéficiaient de l’assistance nord-coréenne.
25 juin 2008 : le gouvernement israélien estime que le site d’Al Kibar, en Syrie, visait à fournir à l’Iran du combustible nucléaire pour fabriquer des armes.
5 novembre 2008 : la Syrie déclare que les traces d’uranium recueillies près du site d’Al Kibar proviennent des bombes israéliennes qui ont détruit ce site.
24 février 2009 : l’AIEA déclare avoir de fortes suspicions, mais pas de preuves formelles, à l’encontre de la Syrie. Ce pays construirait en effet un réacteur nucléaire sur le site de Dair Alzour, du même type que celui détruit par les Israéliens à Al Kibar.
5 mars 2009 : en se fondant sur des documents des services de renseignement américains, l’AIEA estime que les preuves sérieuses s’accumulent quant à des activités nucléaires clandestines par la Syrie.
23 mars 2009 : un Iranien qui fuit le régime de Téhéran révèle que l’Iran finance la Corée du Nord afin qu’elle aide la Syrie à devenir une puissance nucléaire.
6 juin 2009 : des inspecteurs de l’AIEA déclarent avoir trouvé des traces d’uranium enrichi près d’un réacteur de recherche, à Damas.
3 septembre 2009 : un rapport de l’AIEA critique vivement la Syrie, accusée de dissimuler ses activités nucléaires et de faire obstacle aux inspecteurs de l’AIEA.
Turquie
15 avril 2009 : le Président Abdullah Gul appelle à un Moyen-Orient sans armes nucléaires.
Afrique
Afrique du Sud
3 mars 2008 : signature au Cap d’un accord entre Areva et la Nuclear energy corporation of South Africa (NECSA), sur le développement de l’énergie nucléaire civile.
5 décembre 2008 : Eskom, compagnie électrique sud-africaine, annule plusieurs projets d’investissement (deux EPR à court terme, d’une valeur de 9 milliards d’euros, et dix autres d’ici 2025) en raison de la crise financière internationale. L’Afrique du Sud demeure néanmoins intéressée par la filière nucléaire, étant menacée par une pénurie d’énergie.
Amérique
Argentine
23 février 2008 : l’Argentine et le Brésil annoncent le projet de construire un réacteur nucléaire civil commun pour faire face à leurs besoins énergétiques.
Etats-Unis
18 mars 2008 : le Président Bush propose à son homologue russe Vladimir Poutine un nouveau cadre stratégique entre les Etats-Unis et la Russie, incluant la défense antimissiles. Le document américain est qualifié de « très sérieux » par Vladimir Poutine. Son successeur, Dimitri Medvedev, note néanmoins que des divergences importantes demeurent entre les deux nations.
17 avril 2008 : les directeurs des 3 laboratoires nationaux de recherche sur les armes nucléaires déclarent que les coupes budgétaires du Congrès et du Président Bush réduisent leurs capacités à conduire leurs travaux et mettent en péril la crédibilité de l’arsenal nucléaire américain.
23 avril 2008 : arrestation d’un Américain de 84 ans, Ben-Ami Kadish, suspecté d’avoir livré à Israël, dans les années 80, des informations sur les armes nucléaires et les missiles.
6 mai 2008 : l’accord entre les Etats-Unis et la Russie sur le nucléaire civil déclenche l’opposition immédiate de deux Sénateurs américains : Norman Coleman (Républicain, Minnesota) et Evan Bayh (Démocrate, Indiana).
12 mai 2008 : débat à Washington au sein des professionnels du renseignement, qui admettent que la centrale d’Al Kibar en Syrie était bâtie de telle manière que même des images satellites ne pouvaient laisser croire qu’il s’agissait d’une installation nucléaire. Ce constat constitue un nouveau problème pour la lutte contre la prolifération nucléaire.
26 mai 2008 : conférence de presse de l’ancien Président Jimmy Carter qui affirme qu’Israël possède « environ 150 armes nucléaires ».
30 mai 2008 : le sénateur Richard Lugar et l’ancien sénateur Sam Nunn (qui préside le Nuclear threat initiative) appellent les Etats-Unis à se rapprocher de la Russie pour que les deux pays luttent ensemble contre la prolifération nucléaire.
3 juillet 2008 : débat dans la presse américaine. En réponse à une lettre ouverte du sénateur John Kerry (Démocrate, Massachussetts), ancien candidat à la présidence, appelant à un monde sans armes nucléaires, le sénateur Jon Kyl (Républicain, Arizona) appelle les Etats-Unis à combattre la prolifération et à moderniser leur arsenal nucléaire, en prenant exemple sur la France et le Royaume-Uni.
8 juillet 2008: en analysant les statistiques du commerce extérieur américain, l’Associated Press révèle que malgré les mesures de sanctions, le commerce des Etats-Unis avec l’Iran s’est accru sous les deux mandats du Président George W. Bush. Les Etats-Unis exportent notamment des cigarettes, des vêtements, des cosmétiques et des instruments de musique.
Juillet Août Septembre 2008 : vifs débats au Congrès et au sein des think tanks américains sur l’accord nucléaire civil avec l’Inde (cf Inde).
30 octobre 2008 : Robert Gates, secrétaire d’Etat à la Défense, suggère que le prochain Président des Etats-Unis ouvre des négociations avec la Russie sur la réduction des arsenaux nucléaires.
1er décembre 2008 : la sous-commission sur la prévention des armes de destruction massive de la Chambre des Représentants remet son rapport, dans lequel elle indique que le risque d’attentat par des moyens conventionnels, notamment biologiques, est plus élevé que le risque d’attentat nucléaire.
30 décembre 2008 : le Président Bush signe l’accord avec l’AIEA, portant Protocole additionnel sur les inspections d’installations nucléaires aux Etats-Unis.
3 mars 2009 : l’administration américaine révèle que le Président Obama a envoyé en février une lettre au Président Medvedev, lui proposant de reconsidérer le projet de missiles anti missiles en échange d’un appui russe sur la question iranienne. Le Président Medvedev indique que la Russie travaille étroitement avec les Etats-Unis sur l’Iran, mais pas dans le contexte du dossier des missiles anti missiles.
4 juin 2009 : le gouvernement américain publie accidentellement un rapport classé « hautement confidentiel » sur une centaine d’installations nucléaires à travers le monde.
8 septembre 2009 : Robert Gates, secrétaire d’Etat à la Défense, appelle les pays arabes à renforcer leurs liens militaires avec Washington pour faire pression sur l’Iran.
8 septembre 2009 : au conseil des gouverneurs de l’AIEA, les Etats-Unis, soutenus par l’Union européenne, appellent au renforcement des sanctions contre la Corée du Nord.
14 septembre 2009 : les Etats-Unis soumettent aux membres permanents du Conseil de sécurité une proposition de résolution qui prévoit l’engagement des Etats détenteurs de l’arme nucléaire de ne pas l’utiliser contre des Etats non détenteurs, et de réaffirmer le droit des Etats à conduire des programmes nucléaires civils dès lors qu’ils sont conformes au TNP
17 septembre 2009 : déclaration du Président Obama annonçant l’abandon du projet de système antimissile tel qu’il était originellement conçu, avec un radar en République tchèque et des intercepteurs en Pologne.
Asie, Asie du Sud et du Sud-Est
Chine
27 mai 2008: lors de sa visite officielle à Pékin, Dimitri Medvedev, Président de la Fédération de Russie, signe avec la Chine des contrats dans le domaine nucléaire civil pour un montant de 1,5 milliard de dollars.
Corée du Nord
20 février 2008 : la Corée du Nord dénie l’existence de tout programme nucléaire clandestin (entretien à Pékin de Kim Kye Gwan, négociateur nord-coréen, avec son homologue américain Christopher Hill).
9 avril 2008: la Corée du Nord et les Etats-Unis s’accordent sur une proposition de déclaration sur le programme nucléaire nord-coréen, à l’issue de discussions à Singapour.
9 mai 2008 : L’administration américaine déclare avoir reçu de la Corée du Nord un dossier de 18 000 pages sur les activités de Pyong-Yang sur le retraitement du plutonium depuis 1990.
21 avril 2008 : le quotidien japonais Tokyo Shimbun révèle que l’envoyé nord-coréen auprès des Etats-Unis, Kim Kye-Gwan, aurait révélé à son homologue américain Christopher Hill que son pays aurait produit 30 kg de plutonium. 18 kg auraient été utilisés pour le développement des capacités nucléaires coréennes et 6 kg pour le test souterrain d’octobre 2007.
4 juin 2008 : Robert Gates, secrétaire d’Etat américain à la défense, déclare qu’il n’existe aucune preuve que la Corée du Nord ait participé à l’édification de l’installation nucléaire d’Al Kibar, en Syrie, et que les Etats-Unis continueront en conséquence de négocier avec Pyong-Yang, même si les discussions sont très difficiles.
26 juin 2008 : Pyong-Yang remet à l’AIEA de la documentation sur ses activités nucléaires depuis ses origines. Les Etats-Unis suspendent la procédure de sanctions à l’égard de la Corée du Nord. Celle-ci espère être retirée de la liste des Etats terroristes. Au début du mois de juillet, la Corée du Nord commence le démantèlement de la cheminée de refroidissement de la centrale de Yongbyon, en signe (symbolique) de bonne volonté.
22 juillet 2008 : les Etats-Unis proposent un mécanisme de vérification sur place des affirmations nord-coréennes sur les questions nucléaires. Refus de la Corée du Nord.
22 septembre 2008 : à la demande du gouvernement nord-coréen, mécontent que le pays demeure sur la liste des Etats terroristes, les équipements de surveillance de l’AIEA sont retirés de la centrale de Yongbyon. Washington et Séoul annoncent leur préoccupation, sans s’en alarmer outre mesure.
23 septembre 2008 : le gouvernement nord-coréen demande à l’AIEA de retirer les caméras de l’ensemble de ses installations nucléaires. Cette demande constitue le signal d’un redémarrage du programme nucléaire de Pyong-Yang, selon l’AIEA.
25 septembre 2008 : l’interdiction d’accès des inspecteurs de l’AIEA aux sites nord-coréens est interprété par Washington comme le signe d’un prochain redémarrage de l’enrichissement d’uranium.
12 octobre2008 : les Etats-Unis s’engagent à retirer la Corée du Nord de la liste des Etats terroristes, en échange de l’acceptation par Pyong-Yang d’une modification du protocole de vérification de l’arrêt de ses activités nucléaires. Le Japon demeure réticent devant cette décision américaine.
13 octobre 2008 : les Etats-Unis retirent la Corée du Nord de la liste des Etats terroristes, malgré l’opposition de plusieurs sénateurs du parti Républicain et les protestations du Japon.
16 octobre 2008 : les Etats-Unis admettent que le protocole de vérification des installations nucléaires de la Corée du Nord n’est pas optimal, qu’il se situe dans un contexte de négociations tendues, mais que le retrait de la Corée du Nord de la liste des Etats terroristes est un geste qui permet de tester la bonne volonté de Pyong-Yang.
5 novembre 2008 : la Corée du Nord déclare qu’elle interdira aux inspecteurs de l’AIEA de recueillir des échantillons de son sol près de ses installations (un moyen de détecter le stade de ses expérimentations). L’attitude de Pyong-Yang est interprétée comme un geste de défi à l’égard du Président Obama, nouvellement élu.
12 mars 2009 : Pyong-Yang informe les organisations internationales de son intention de lancer un satellite entre le 4 et le 8 avril.
29 mars 2009 : déclaration de Robert Gates, secrétaire d’Etat américain à la Défense, indiquant que les Etats-Unis n’avaient pas de plan militaire spécifique pour empêcher Pyong-Yang de procéder à un essai balistique intercontinental.
5 avril 2009 : Tir de fusée par Pyong-Yang (missile balistique intercontinental).
13 avril 2009 : le Conseil de sécurité de l’ONU condamne le tir de fusée. La Corée du Nord annonce son retrait des négociations internationales, l’arrêt de sa coopération avec l’AIEA et la réactivation des ses installations nucléaires.
14 avril 2009 : les inspecteurs de l’AIEA quittent la Corée du Nord.
18 avril 2009 : accusant les Etats-Unis et ses alliés de mener une guerre contre l’Etat communiste, la Corée du Nord fait part de sa volonté de se doter d’une force de dissuasion nucléaire.
22 avril 2009 : visite à Pyong-Yang de Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, pour tenter de relancer les négociations sur le nucléaire.
29 avril 2009 : la Corée du Nord menace de procéder à un nouvel essai nucléaire, à moins que l’ONU ne présente ses excuses. Le porte-parole du Département d’Etat américain, Robert Wood, déclare que « les menaces de la Corée du Nord ne font que l’isoler davantage ».
29 avril 2009 : la Corée du Nord annonce mettre en route un programme d’enrichissement d’uranium.
23 juillet 2009 : Au forum régional de l’ASEAN, Hillary Clinton dénonce la « résistance inquiétante » de la Corée du Nord à se dénucléariser. Elle propose « une normalisation pleine et entière des relations, un régime de paix permanent et une aide énergétique et économique conséquence, tout cela étant possible dans le cadre d’une dénucléarisation complète et vérifiable ». La Corée du Nord juge ces propositions absurdes, tant que Washington « n’abandonnera pas sa politique hostile ».
Inde
24 mars 2008 : test du missile à courte portée Agni 1, au-dessus du Golfe du Bengale.
27 mars 2008 : le ministre indien du commerce, Jairam Ramesh, transmet au Premier ministre de la Namibie Nahas Angula le souhait du gouvernement indien d’acheter de l’uranium à la Namibie.
19 avril 2008: le secrétaire indien aux Affaires étrangères, Shiv Shankar Menon, indique que son pays est disposé à participer à une banque internationale du combustible nucléaire.
22 juillet 2008 : le gouvernement indien obtient le vote de confiance du Parlement (Lok Sabha) avec une confortable majorité, lui permettant de poursuivre les négociations finales sur l’accord en matière de nucléaire civil avec les Etats-Unis.
27 septembre 2008 : la Chambre des Représentants des Etats-Unis adopte le pacte nucléaire civil Inde-Etats-Unis. Le pacte met en place pour 40 ans une coopération sous forme de transferts de technologies et de fournitures par les Etats-Unis à l’Inde de matériel nucléaire et non nucléaire, y compris des réacteurs.
29 septembre 2008 : En visite à Marseille, Manhoman Singh, Premier ministre d’Inde, rencontre Nicolas Sarkozy, Président de la République et Président en exercice du Conseil européen. Ils annoncent le lancement d’une coopération nucléaire civile plus étroite entre l’Union européenne et l’Inde.
1er octobre 2008 : Le Sénat américain adopte à son tour le pacte nucléaire civil Inde-Etats-Unis, à une large majorité (86 voix contre 13), mais après de vifs débats.
14 octobre 2008 : Pranab Mukherjee, ministre des Affaires étrangères, déclare que son pays est favorable à une coopération américano-pakistanaise dans le domaine de l’énergie nucléaire civile.
3 novembre 2008 : à la demande des Etats-Unis, l’Inde annonce avoir interdit le survol de son territoire par un avion cargo nord-coréen, suspecté par Washington d’acheminer vers l’Iran du matériel servant à son programme nucléaire.
18 décembre 2008 : Signature d’un contrat d’exportation d’uranium entre Areva et l’Inde, portant sur 300 tonnes, afin d’alimenter deux réacteurs nucléaires de la société d’électricité NPCIL pendant deux ans.
8 janvier 2009 : les Etats-Unis ouvrent avec l’Inde des discussions visant à vendre un New Delhi un système antimissiles.
27 janvier 2009 : signature d’un accord de fourniture d’uranium à l’Inde par le Kazakhstan.
31 mars 2009 : 1ère application de l’accord de coopération bilatérale entre la France et l’Inde dans le domaine de l’énergie nucléaire civile, avec la livraison au Nuclear Fuel Complex d’Hyderabad de 60 tonnes d’uranium par Areva. L’accord prévoit la fourniture totale de 300 tonnes d’uranium. L’Inde attend également 120 tonnes en provenance de Russie. Le combustible d’Areva est destiné à la centrale nucléaire située dans le Rajasthan.
Japon
12 juin 2008 : d’après le quotidien Yomiuri, l’AIEA aurait alerté le gouvernement japonais de la présence de pompes japonaises dans des installations nucléaires nord-coréennes, servant à l’enrichissement de l’uranium. Le gouvernement japonais a lancé une enquête à l’encontre de 5 sociétés pouvant produire ce type de matériel ainsi qu’à l’encontre d’une société d’import – export.
19 février 2009 : le journal Kyodo news révèle, après enquête à Tokyo et Islamabad, que plusieurs sociétés japonaises ont volontairement ou involontairement contribué au programme nucléaire pakistanais. Le journal s’appuie notamment sur les révélations d’Abdoul Qader Khan, « père de la bombe pakistanaise ». Western trading, société établie à Tokyo, a ainsi exporté 6000 anneaux magnétiques, un élément clé pour la fabrication de centrifugeuses, sans apparemment connaître l’objet de cette acquisition par le Pakistan. En revanche, un employé de Japan Electron Optics Laboratory, indique sous couvert d’anonymat que son laboratoire a vendu deux microscopes électroniques alors qu’il connaissait la nature des travaux de Khan.
21 avril 2009 : toujours d’après le Kyodo news, le cargo nord coréen retenu dans un port indien en 1999, alors qu’il devait se rendre au Pakistan, transportait des instruments de précision et des aciers spéciaux japonais.
Kazakhstan, Turkmenistan, Kirghizie, Tadjikistan et Ouzbekistan
21 mars 2009 : entrée en vigueur du traité faisant des 5 pays d’Asie centrale une zone non nucléaire.
Pakistan
4 juin 2008 : Abdoul Qader Khan déclare n’avoir pas aidé l’Iran et la Libye à accéder aux technologies nucléaires, mais s’être limité à présenter des hommes d’affaires aux autorités de ces deux pays.
24 juillet 2008 : le Pakistan annonce que si l’accord entre l’Inde et l’AIEA facilitait l’accès de l’Inde au combustible nucléaire, cela relancerait la course aux armements entre les deux pays. L’ambassadeur des Etats-Unis en Inde, David Mulford, indique que son pays devrait pouvoir convaincre le Pakistan de ne pas voter contre l’Inde au Conseil des gouverneurs de l’AIEA.
31 juillet 2008 : le Pakistan se range aux arguments des Etats-Unis et ne s’oppose pas à l’accord entre l’Inde et l’AIEA.
29 avril 2009 : le Président américain Barack Obama déclare que l’arsenal nucléaire pakistanais, estimé à 100 têtes, est en mains sûres.
19 mai 2009 : un rapport de l’ISIS, se fondant sur des images prises par satellites, indique que le Pakistan étend deux sites consacrés à la fabrication nucléaire, ce qui provoque des interrogations au Congrès des Etats-Unis, où plusieurs élus estiment qu’Islamabad a détourné à des fins militaires l’aide économique des Etats-Unis.
19 mai 2009 : tandis que Shah Mahmoud Qureishi, ministre des Affaires étrangères du Pakistan, affirme que la France est prête à coopérer avec Islamabad dans les mêmes dispositions que celles contenues dans l’accord indo-américain, un porte-parole de la présidence de la République rappelle que la France ne peut entamer une telle démarche sans violer l’accord des pays fournisseurs et qu’elle a juste proposé de sécuriser l’arsenal nucléaire pakistanais.
11 août 2009 : la presse pakistanaise révèle l’étude de Shaun Gregory, professeur à l’université de Bradford (Royaume-Uni) sur 3 attaques d’extrémistes pakistanais contre des sites nucléaires (unité de stockage de missiles le 1er novembre 2007, base aérienne stratégique de Kamra le 10 décembre 2007 et complexe d’armement de Wah le 20 août 2008). Shaun Gregory rappelle que le Pakistan a implanté ses sites nucléaires non loin de la frontière avec l’Inde, au Nord Est de son territoire, au cas où il devrait se servir de ses ADM contre New Delhi. Or cette zone est désormais sous forte influence de musulmans radicaux.
13 août 2009 : réaffirmation , par le Président Ali Zardari et son prédécesseur Pervez Moucharraf, que l’arsenal nucléaire pakistanais est bien protégé. Tous deux nient par ailleurs qu’Al Qaida ait cherché à s’emparer de têtes nucléaires pakistanaises.
25 août 2009 : le Pakistan essuie de sévères critiques des principales puissances nucléaires, y compris la Chine, alors qu’il bloque des négociations de l’ONU sur le désarmement, à Genève.
Europe
Bulgarie
22 juillet 2008 : La Bulgarie annonce l’envoi de son stock d’uranium enrichi en Russie, pour mieux le protéger contre le terrorisme.
France
26 novembre 2007 : à l’occasion de la visite officielle de M. Nicolas Sarkozy en Chine, Areva signe avec la compagnie chinoise d’électricité CGNPC le plus gros contrat nucléaire civil, en vendant deux réacteurs pour une valeur de 8 milliards d’euros.
4 décembre 2007 : signature d’un accord avec l’Algérie sur l’utilisation et le développement de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, lors de la visite d’Etat de M. Nicolas Sarkozy à Alger.
11 décembre 2007 : signature d’un accord similaire avec la Libye lors de la visite de M. Mouammar Khadafi à Paris.
14 janvier 2008: signature d’un accord sur l’énergie nucléaire civile avec le Qatar.
15 janvier 2008 : signature d’un accord similaire avec les Emirats arabes unis.
29 avril 2008 : signature d’un accord sur l’énergie nucléaire civile avec la Tunisie.
17 juin 2008: le discours de M. Nicolas Sarkozy, Président de la République, sur la défense et la sécurité (livre blanc) mentionne la prolifération nucléaire parmi les menaces pouvant affecter l’Europe et la France.
14 juillet 2008 : Lors d’une conférence de presse commune avec les Présidents de Syrie, du Liban, ainsi qu’avec l’Emir du Qatar, donnée dans le cadre de la mise en place de l’Union pour la Méditerranée, M. Nicolas Sarkozy, Président de la République, demande à la Syrie « de convaincre l’Iran d’apporter les preuves qu’il ne cherche pas à se doter de l’arme nucléaire ».
27 août 2008 : signature d’un accord sur l’énergie nucléaire civile avec la Jordanie.
Juillet 2008 : série d’incidents à la centrale de Tricastin.
17 septembre 2008 : signature d’un accord sur l’énergie nucléaire civile avec la Slovaquie.
30 septembre 2008 : signature d’un accord de coopération nucléaire civile avec l’Inde.
16 février 2009: révélations sur la collision de deux sous-marins nucléaires français et britanniques. Les deux bâtiments portaient plus de 100 têtes thermonucléaires.
Hongrie
14 octobre 2008 : les Etats-Unis révèlent qu’une quantité d’uranium permettant la fabrication de 6 bombes nucléaires a été secrètement transportée d’un institut de recherche de Budapest vers la Russie, où l’uranium sera mieux protégé d’éventuelles tentatives de vol.
Italie
24 juillet 2008 : Dans une tribune publiée par le Corriere della Serra, Massimo d’Alema (ancien Premier ministre), Gianfranco Fini (ancien ministre des Affaires étrangères, Président en exercice de la Chambre des Députés), Giorgio La Malfa (ancien ministre des Affaires européennes), Arturo Parisi (ancien ministre de la Défense) et Francesco Calogero (professeur de physique à l’université de Rome) appellent à un monde sans armes nucléaires.
21 février 2009 : l’Italie souhaite développer un programme nucléaire civil et compte s’appuyer sur la France.
Norvège
29 février 2008 : le ministre des Affaires étrangères Jonas Stoere annonce le soutien de son pays à l’idée d’une banque de combustible nucléaire faiblement enrichi.
République tchèque
17 mars 2009 : le gouvernement est contraint de retirer de l’ordre du jour du Parlement le projet d’accord avec les Etats-Unis sur l’installation du dispositif anti missiles, par crainte de ne pas réunir une majorité sur le vote.
Roumanie
30 juin 2009 : Annonce du transfert vers la Russie, à Tcheliabinsk et Dimitrovgrad, de 54 kg d’uranium, utilisés dans les deux réacteurs de recherche de Magurele et Pitesti. L’uranium sera stocké dans des entrepôts sécurisés. Ce transfert prend place dans le cadre de l’Initiative de réduction de la menace globale mis en place depuis 2004.
Royaume-Uni
26 février 2008 : le Royaume-Uni devient le 21ème membre du Partenariat global sur l’énergie nucléaire.
26 juin 2008 : retrait des armes nucléaires américaines stockées sur la base de la Royal Air Force de Lakenheath. Il n’y a plus de bombes américaines sur le territoire britannique.
30 juin 2008 : quatre anciens responsables de la défense et de la diplomatie britannique, Sir Malcolm Rifkind, Lord David Owen, Sir Douglas Hurd et Lord George Robertson, appellent dans une lettre ouverte publiée par le Times à un monde sans armes nucléaires, considérant que la prolifération, combinée aux tensions géopolitiques, fait entrer notre planète dans une phase extrêmement dangereuse.
Russie
12 mars 2008 : un document du gouvernement annonce que la Russie construira 4 centrales nucléaires au centre du pays et dans la région de l’Oural d’ici à 2020.
26 mars 2008 : Atomenergoprom (Russie) et Toshiba (Japon) décident de s’allier dans l’énergie nucléaire civile, pour l’implantation de centrales comme pour la production de combustible. L’accord prévoit que la compagnie russe enrichira l’uranium du Kazakhstan tandis que Toshiba produira l’énergie nucléaire et procèdera à l’installation de centrales. Il s’agit d’une concurrence sérieuse pour Areva.
20 avril 2008 : la Russie annonce la fermeture d’un réacteur produisant du plutonium.
13 mai 2008 : l’agence de presse Ria Novosti interprète le vote favorable de la Russie à la résolution 1803 du Conseil de sécurité de l’ONU sur l’Iran comme la contrepartie de l’accord américano-russe sur les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire. Cet accord est un vœu de longue date des exportateurs russes de combustible nucléaire faiblement enrichi afin de pouvoir exporter aux Etats-Unis sans intermédiaire.
7 août 2008 : l’ambassadeur de Russie au Belarus indique que son pays pourrait réviser les modalités de sa coopération militaire avec le Belarus, en réponse à l’installation de missiles américains en Europe centrale, mais que la Russie ne réinstallera pas d’armes nucléaires au Belarus.
24 septembre 2008 : Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères, déclare que son pays a rejeté une proposition américaine de réunir les parties intéressées à la question iranienne, en représailles au refus américain de réunir les ministres des Affaires étrangères des 8 pays les plus industrialisés. Il s’agit pour Moscou de montrer aux Etats-Unis ce qu’il en coûte de vouloir marginaliser la Russie sur la scène internationale, un mois après son intervention en Géorgie.
5 novembre 2008 : dans un discours devant le Parlement, Dmitri Medvedev salue la victoire de Barack Obama à l’élection présidentielle américaine, indique que son pays n’a pas de contentieux majeur avec les Etats-Unis mais avertit que si les Etats-Unis maintiennent leur programme de missiles anti missiles, la Russie réagira en installant des missiles à courte portée sur ses frontières occidentales.
1er décembre 2008 : un porte-parole du gouvernement déclare que la Russie commence la fabrication d’un nouveau missile intercontinental, après des tests fructueux.
19 décembre 2008 : le chef des forces stratégiques russes Nikolaï Solovtsov indique que la Russie est prête à renoncer au déploiement de missiles dans l’enclave de Kaliningrad si les Etats-Unis stoppent l’installation de missiles antimissiles en République tchèque et en Pologne.
12 février 2009 : La Russie signe avec l’Inde un accord d’un montant de 700 millions de dollars pour la fourniture d’uranium à New Delhi.
16 mars 2009 : Dimitri Medvedev annonce que la modernisation de l’arsenal nucléaire russe est une priorité de la réforme des forces militaires.
21 avril 2009 : Sergueï Ryabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, indique que la Russie installera des missiles Iskander dans l’enclave de Kaliningrad, après avoir un temps abandonné ce projet, si les Etats-Unis persistent à vouloir mettre en place le bouclier antimissiles en République tchèque et en Pologne.
14 juillet 2009 : déclaration de Dimitri Medvedev, qui rejette toute renégociation du traité START en contrepartie d’un accord de la Russie sur des sanctions plus strictes contre l’Iran.
Union européenne
7 mai 2008 : communiqué commun de l’UE et de l’AIEA pour accroître la coopération des deux organisations dans le domaine nucléaire.
16 mai 2008 : les Etats de l’UE s’accordent sur la nécessité d’un nouveau train de sanctions contre l’Iran, visant les secteurs pétroliers et gaziers. Le Royaume-Uni, pour sa part, gèle les avoirs de la principale banque iranienne, la Banque Melli.
24 mai 2008 : mise en application des sanctions européennes à l’égard des établissements de la Banque Melli situés à Londres (City), Paris et Hambourg.
AIEA
28 octobre 2008 : Mohamed El Baradei déclare que le nombre de matériaux nucléaires ou radioactifs volés à travers le monde l’an dernier est extrêmement préoccupant.
2 juillet 2009 : Yukiya Amano, représentant du Japon auprès de l’AIEA depuis 2005, est élu à la tête de l’agence. Son mandat commencera en décembre 2009.
Annexe 6 : Principaux textes internationaux
Conventions multilatérales
Signature |
Entrée en vigueur |
Etats parties |
Signataires n’ayant pas ratifié | |
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires |
1er juillet 1968 |
5 mars 1970 |
190 |
0 |
Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction |
10 avril 1972 |
26 mars 1975 |
163 |
16 |
Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction |
13 janvier 1993 |
29 avril 1997 |
188 |
2 |
Traité d’interdiction complète des essais nucléaires |
24 septembre 1996 |
(1) |
182 |
32 |
Code de La Haye sur la prolifération balistique |
25 novembre 2002 |
25 novembre 2002 |
128 |
(1) L’entrée en vigueur du TICE est conditionnée par la ratification des Etats listés dans l’annexe 2. Parmi ces derniers, la Chine, l’Egypte, l’Indonésie, l’Iran, Israël et les Etats-Unis ont signé mais pas ratifié le traité. La Corée du Nord, l’Inde et le Pakistan n’en sont toujours pas signataires.
Régimes de contrôle des exportations
Produits contrôlés |
Début des travaux |
Membres | |
Comité Zangger |
Nucléaires |
1971 (1) |
37 |
Groupe des fournisseurs nucléaires |
Nucléaires |
1974 (2) |
46 |
Groupe Australie |
Chimiques et biologiques |
Juin 1985 |
40 |
Régime de contrôle de la technologie des missiles |
Balistiques |
1987 (3) |
34 |
Arrangement de Waasenaar |
Conventionnels et à double usage |
13 décembre 1996 (4) |
40 |
(1) : Bien que des réunions aient eu lieu dès 1971, l’existence du comité Zangger fut officialisée auprès du directeur général de l’AIEA par une lettre de son secrétaire général en date du 3 septembre 1974 ; (2) : La première réunion de ce groupe informel de pays exportateurs de technologies nucléaires s’est tenue à Londres en novembre 1975, l’initiative ayant été lancée dès 1974. Ce groupe est souvent appelé « club de Londres » ou NSG pour Nuclear suppliers group ; (3) : Le MTCR (Missile technologies control regime) a tenu sa première réunion plénière en septembre 1988 ; (4) : L’arrangement de Wassenaar est issu de l’association, décidée en mars 1994, des membres de l’ancien Coordinating Committee for Multilateral Export Controls (COCOM) et des membres de l’ex-Pacte de Varsovie ; la date d’entrée en vigueur fait référence à la première réunion plénière de tous ces membres
Initiatives récentes de lutte contre la prolifération
Objet de la décision |
Date |
Participants | |
Partenariat mondial du G8 contre la prolifération des armes de destruction massive et des matières connexes |
Conventionnels et à double usage |
27 juin 2002 |
19 (1) |
Initiative de sécurité contre la prolifération |
Coopération internationale pour la surveillance des réseaux de prolifération |
31 mai 2003 |
91 |
Résolution 1540 Conseil de Sécurité |
Harmonisation des législations nationales pour lutter contre les réseaux de prolifération |
28 avril 2004 |
195 |
Résolution 1887 Conseil de Sécurité |
Poursuite du désarmement et renforcement du traité de non prolifération nucléaire |
24 septembre 2009 |
195 |
(1) : Le partenariat mondial du G8 regroupe des actions menées dans plusieurs régions, seuls 10 Etats participent au financement de ces actions.
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP)
Les Etats qui concluent le présent Traité, ci-après dénommés les "Parties au Traité",
Considérant les dévastations qu’une guerre nucléaire ferait subir à l’humanité entière et la nécessité qui en résulte de ne ménager aucun effort pour écarter le risque d’une telle guerre et de prendre des mesures en vue de sauvegarder la sécurité des peuples,
Persuadés que la prolifération des armes nucléaires augmenterait considérablement le risque de guerre nucléaire,
En conformité avec les résolutions de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies demandant la conclusion d’un accord sur la prévention d’une plus grande dissémination des armes nucléaires,
S’engageant à coopérer en vue de faciliter l’application des garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) aux activités nucléaires pacifiques,
Exprimant leur appui aux efforts de recherche, de mise au point et autres visant à favoriser l’application, dans le cadre du système de garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique, du principe d’une garantie efficace du flux de matières brutes et de produits fissiles spéciaux grâce à l’emploi d’instruments et autres moyens techniques en certains points stratégiques,
Affirmant le principe selon lequel les avantages des applications pacifiques de la technologie nucléaire, y compris tous les sous-produits technologiques que les États dotés d’armes nucléaires pourraient obtenir par la mise au point de dispositifs nucléaires explosifs, devraient être accessibles, à des fins pacifiques, à toutes les Parties au Traité, qu’il s’agisse d’États dotés ou non dotés d’armes nucléaires,
Convaincus qu’en application de ce principe, toutes les Parties au Traité ont le droit de participer à un échange aussi large que possible de renseignements scientifiques en vue du développement plus poussé des utilisations de l’énergie atomique à des fins pacifiques, et de contribuer à ce développement à titre individuel ou en coopération avec d’autres États,
Déclarant leur intention de parvenir au plus tôt à la cessation de la course aux armements nucléaires et de prendre des mesures efficaces dans la voie du désarmement nucléaire,
Demandant instamment la coopération de tous les États en vue d’atteindre cet objectif,
Rappelant que les Parties au Traité de 1963 interdisant les essais d’armes nucléaires dans l’atmosphère, dans l’espace extra-atmosphérique et sous l’eau ont, dans le préambule du dit Traité, exprimé leur détermination de chercher à assurer l’arrêt de toutes les explosions expérimentales d’armes nucléaires à tout jamais et de poursuivre les négociations à cette fin,
Désireux de promouvoir la détente internationale et le renforcement de la confiance entre États afin de faciliter la cessation de la fabrication d’armes nucléaires, la liquidation de tous les stocks existants desdites armes, et l’élimination des armes nucléaires et leurs vecteurs des arsenaux nationaux en vertu d’un traité sur le désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace,
Rappelant que, conformément à la Charte des Nations Unies, les États doivent s’abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, et qu’il faut favoriser l’établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationales en ne détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et économiques du monde,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Tout État doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à ne transférer à qui que ce soit, ni directement ni indirectement, des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, ou le contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs ; et à n’aider, n’encourager ni inciter d’aucune façon un État non doté d’armes nucléaires, quel qu’il soit, à fabriquer ou acquérir de quelque autre manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, ou le contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs.
Article II
Tout État non doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à n’accepter de qui que ce soit, ni directement ni indirectement, le transfert d’armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires ou du contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs ; à ne fabriquer ni acquérir de quelque autre manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs ; et à ne rechercher ni recevoir une aide quelconque pour la fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs.
Article III
1. Tout État non doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à accepter les garanties stipulées dans un accord qui sera négocié et conclu avec l’Agence internationale de l’énergie atomique, conformément au statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique et au système de garanties de ladite Agence, à seule fin de vérifier l’exécution des obligations assumées par ledit État aux termes du présent Traité en vue d’empêcher que l’énergie nucléaire ne soit détournée de ses utilisations pacifiques vers des armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires. Les modalités d’application des garanties requises par le présent article porteront sur les matières brutes et les produits fissiles spéciaux, que ces matières ou produits soient produits, traités ou utilisés dans une installation nucléaire principale ou se trouvent en dehors d’une telle installation. Les garanties requises par le présent article s’appliqueront à toutes matières brutes ou tous produits fissiles spéciaux dans toutes activités nucléaires pacifiques exercées sur le territoire d’un tel État, sous sa juridiction, ou entreprises sous son contrôle en quelque lieu que ce soit.
2. Tout État Partie au Traité s’engage à ne pas fournir :
a) de matières brutes ou de produits fissiles spéciaux, ou
b) d’équipements ou de matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, à un État non doté d’armes nucléaires, quel qu’il soit, à des fins pacifiques, à moins que lesdites matières brutes ou lesdits produits fissiles spéciaux ne soient soumis aux garanties requises par le présent article.
3. Les garanties requises par le présent article seront mises en œuvre de manière à satisfaire aux dispositions de l’article IV du présent Traité et à éviter d’entraver le développement économique ou technologique des Parties au Traité, ou la coopération internationale dans le domaine des activités nucléaires pacifiques, notamment les échanges internationaux de matières et d’équipements nucléaires pour le traitement, l’utilisation ou la production de matières nucléaires à des fins pacifiques, conformément aux dispositions du présent article et au principe de garantie énoncé au Préambule du présent Traité.
4. Les États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité concluront des accords avec l’Agence internationale de l’énergie atomique pour satisfaire aux exigences du présent article, soit à titre individuel, soit conjointement avec d’autres États conformément au statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique. La négociation de ces accords commencera dans les 180 jours qui suivront l’entrée en vigueur initiale du présent Traité. Pour les États qui déposeront leur instrument de ratification ou d’adhésion après ladite période de 180 jours, la négociation de ces accords commencera au plus tard à la date de dépôt dudit instrument de ratification ou d’adhésion. Lesdits accords devront entrer en vigueur au plus tard 18 mois après la date du commencement des négociations.
Article IV
1. Aucune disposition du présent Traité ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inaliénable de toutes les Parties au Traité de développer la recherche, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination et conformément aux dispositions des articles I et II du présent Traité.
2. Toutes les Parties au Traité s’engagent à faciliter un échange aussi large que possible d’équipement, de matières et de renseignements scientifiques et technologiques en vue des utilisations de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, et ont le droit d’y participer. Les Parties au Traité en mesure de le faire devront aussi coopérer en contribuant, à titre individuel ou conjointement avec d’autres États ou des organisations internationales, au développement plus poussé des applications de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, en particulier sur les territoires des États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité, compte dûment tenu des besoins des régions du monde qui sont en voie de développement.
Article V
Chaque Partie au Traité s’engage à prendre des mesures appropriées pour assurer que, conformément au présent Traité, sous une surveillance internationale appropriée et par la voie de procédures internationales appropriées, les avantages pouvant découler des applications pacifiques, quelles qu’elles soient, des explosions nucléaires soient accessibles sur une base non discriminatoire aux États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité, et que le coût pour lesdites Parties des dispositifs explosifs utilisés soit aussi réduit que possible et ne comporte pas de frais pour la recherche et la mise au point. Les États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité seront en mesure d’ obtenir des avantages de cette nature, conformément à un accord international spécial ou à des accords internationaux spéciaux, par l’entremise d’un organisme international approprié où les États non dotés d’armes nucléaires seront représentés de manière adéquate. Des négociations à ce sujet commenceront le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du Traité. Les États non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité pourront aussi, s’ils le souhaitent, obtenir ces avantages en vertu d’accords bilatéraux.
Article VI
Chacune des Parties au Traité s’engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire, et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace.
Article VII
Aucune clause du présent Traité ne porte atteinte au droit d’un groupe quelconque d’États de conclure des traités régionaux de façon à assurer l’absence totale d’armes nucléaires sur leurs territoires respectifs.
Article VIII
1.Toute Partie au Traité peut proposer des amendements au présent Traité. Le texte de tout amendement proposé sera soumis aux gouvernements dépositaires qui le communiqueront à toutes les Parties au Traité. Si un tiers des Parties au Traité ou davantage en font alors la demande, les gouvernements dépositaires convoqueront une conférence à laquelle ils inviteront toutes les Parties au Traité pour étudier cet amendement.
2. Tout amendement au Présent Traité devra être approuvé à la majorité des voix de toutes les Parties au Traité, y compris les voix de tous les États dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité et de toutes les autres parties qui, à la date de la communication de l’amendement, sont membres du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique. L’amendement entrera en vigueur à l’égard de toute Partie qui déposera son instrument de ratification dudit amendement dès le dépôt de tels instruments de ratification par la majorité des parties, y compris les instruments de ratification de tous les États dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité et de toutes les autres Parties qui, à la date de la communication de l’amendement, sont membres du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique. Par la suite, l’amendement entrera en vigueur à l’égard de toute autre Partie dès le dépôt de son instrument de ratification de l’amendement.
3. Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Traité, une Conférence des Parties au Traité aura lieu à Genève (Suisse), afin d’examiner le fonctionnement du présent Traité en vue de s’assurer que les objectifs du Préambule et les dispositions du Traité sont en voie de réalisation. Par la suite, à des intervalles de cinq ans, une majorité des Parties au Traité pourra obtenir en soumettant une proposition à cet effet aux gouvernements dépositaires, la convocation d’autres conférences ayant le même objet, à savoir examiner le fonctionnement du Traité.
Article IX
1. Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les États.Tout État qui n’aura pas signé le présent Traité avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.
2. Le présent Traité sera soumis à la ratification des États signataires. Les instruments de ratification et les instruments d’adhésion seront déposés auprès des gouvernements des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont par les présents désignés comme gouvernements dépositaires.
3. Le présent Traité entrera en vigueur après qu’il aura été ratifié par les États dont les gouvernements sont désignés comme dépositaires du Traité, et par quarante autres États signataires du présent Traité, et après le dépôt de leurs instruments de ratification. Aux fins du présent Traité, un État doté d’armes nucléaires est un État qui a fabriqué et a fait exploser une arme nucléaire ou un autre dispositif nucléaire explosif avant le 1er janvier 1967.
4. Pour les États dont les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés après l’entrée en vigueur du présent Traité, celui-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion.
5. Les gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les États qui auront signé le présent Traité ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur du présent Traité et de la date de réception de toute demande de convocation d’une conférence ainsi que de toute autre communication.
6. Le présent Traité sera enregistré par les gouvernements dépositaires, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies.
Article X
l. Chaque Partie, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, aura le droit de se retirer du Traité si elle décide que des événements extraordinaires, en rapport avec l’objet du présent Traité, ont compromis les intérêts suprêmes de son pays. Elle devra notifier ce retrait à toutes les autres Parties au Traité ainsi qu’au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies avec un préavis de trois mois. Ladite notification devra contenir un exposé des événements extraordinaires que l’État en question considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes.
2. Vingt-cinq ans après l’entrée en vigueur du Traité, une conférence sera convoquée en vue de décider si le Traité demeurera en vigueur pour une durée indéfinie, ou sera prorogé pour une ou plusieurs périodes supplémentaires d’une durée déterminée. Cette décision sera prise à la majorité des Parties au Traité.
Article XI
Le présent Traité, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé dans les archives des gouvernements dépositaires. Des copies certifiées conformes du présent Traité seront adressées par les gouvernements dépositaires aux gouvernements des États qui auront signé le Traité, ou qui y auront adhéré.
En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Traité.
Signé à Londres, Moscou et Washington, le premier juillet mil neuf cent soixante-huit.
Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction.
Ouvert à la signature à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972.
Les Etats parties à la présente Convention,
Résolus à travailler en vue de la réalisation de progrès effectifs sur la voie du désarmement général et complet, y compris l'interdiction et la suppression de tous les types d'armes de destruction massive, et étant convaincus que l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage d'armes chimiques et bactériologiques (biologiques), ainsi que leur destruction, par des mesures efficaces, contribueront à la réalisation du désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace.
Reconnaissant la grande importance du Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925, ainsi que le rôle que ledit protocole a joué et continue de jouer en atténuant les horreurs de la guerre.
Réaffirmant leur fidélité aux principes et aux objectifs de ce protocole et invitant tous les Etats à s'y conformer strictement,
Rappelant que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a condamné à plusieurs reprises tous les actes contraires aux principes et aux objectifs du Protocole de Genève du 17 juin 1925,
Désireux de contribuer à accroître la confiance entre les peuples et à assainir en général l'atmosphère internationale,
Désireux également de contribuer à la réalisation des buts et des principes de la Charte des Nations Unies,
Convaincus de l'importance et de l'urgence d'exclure des arsenaux des Etats, par des mesures efficaces, des armes de destruction massive aussi dangereuses que celles comportant l'utilisation d'agents chimiques ou bactériologiques (biologiques),
Reconnaissant qu'une entente sur l'interdiction des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines représente une première étape possible vers la réalisation d'un accord sur des mesures efficaces tendant à interdire également la mise au point, la fabrication et le stockage d'armes chimiques, et étant résolus à poursuivre des négociations à cet effet,
Résolus, dans l'intérêt de l'humanité tout entière, à exclure totalement la possibilité de voir des agents bactériologiques (biologiques) ou des toxines être utilisés en tant qu'armes,
Convaincus que la conscience de l'humanité réprouverait l'emploi de telles méthodes et qu'aucun effort ne doit être épargné pour amoindrir ce risque,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à ne jamais, et en aucune circonstance, mettre au point, fabriquer, stocker, ni acquérir d'une manière ou d'une autre ni conserver :
1) Des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, ainsi que des toxines quels qu'en soient l'origine ou le mode de production, de types et en quantités qui ne sont pas destinés à des fins prophylactiques, de protection ou à d'autres fins pacifiques;
2) Des armes, de l'équipement ou des vecteurs destinés à l'emploi de tels agents ou toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés.
Article II
Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à détruire ou à convertir à des fins pacifiques, aussi rapidement que possible et en tout cas pas plus tard que neuf mois après l'entrée en vigueur de la Convention, tous les agents, toxines, armes, équipements et vecteurs dont il est question dans l'article premier de la Convention qui se trouvent en sa possession ou sous sa juridiction ou son contrôle. Lors de l'exécution des dispositions du présent article, il y aura lieu de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires pour protéger les populations et l'environnement.
Article III
Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à ne transférer à qui que ce soit, ni directement ni indirectement, l'un quelconque des agents, toxines, armes, équipements ou vecteurs dont il est question dans l'article premier de la Convention et à ne pas aider, encourager ou inciter de quelque manière que ce soit un Etat, un groupe d'Etats ou une organisation internationale à fabriquer ou à acquérir de toute autre façon l'un quelconque desdits agents, toxines, armes, équipements ou vecteurs.
Article IV
Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à prendre, selon les procédures prévues par sa constitution, les mesures nécessaires pour interdire et empêcher la mise au point, la fabrication, le stockage, l'acquisition ou la conservation des agents, des toxines, des armes, de l'équipement et des vecteurs dont il est question dans l'article premier de la Convention, sur le territoire d'un tel Etat, sous sa juridiction ou sous son contrôle en quelque lieu que ce soit.
Article V
Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à se consulter et à coopérer entre eux pour résoudre tous problèmes qui pourraient éventuellement surgir quant à l'objectif de la Convention, ou quant à l'application de ses dispositions. Les consultations et la coopération prévues dans le présent article pourront également être entreprises au moyen de procédures internationales appropriées dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies et conformément à sa Charte.
Article VI
1. Chaque Etat partie à la présente Convention qui constate qu'une autre partie agit en violation des obligations découlant des dispositions de la Convention peut déposer une plainte auprès du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Cette plainte doit fournir toutes les preuves possibles de son bien-fondé et comporter la demande de son examen par le Conseil de sécurité.
2. Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à coopérer à toute enquête que peut entreprendre le Conseil de sécurité conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies à la suite d'une plainte par lui reçue. Le Conseil de sécurité fait connaître aux Etats parties à la Convention les résultats de l'enquête.
Article VII
Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à fournir une assistance, conformément à la Charte des Nations Unies, à toute Partie à la Convention qui en fait la demande, si le Conseil de sécurité décide que cette Partie a été exposée à un danger par suite d'une violation de la Convention, ou à faciliter l'assistance fournie à ladite Partie.
Article VIII
Aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme restreignant ou amenuisant de quelque façon que se soit les engagements assumés par n'importe quel Etat en vertu du Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925.
Article IX
Chaque Etat partie à la présente Convention affirme l'objectif reconnu d'une interdiction efficace des armes chimiques et, à cet effet, s'engage à poursuivre, dans un esprit de bonne volonté, des négociations afin de parvenir, à une date rapprochée, à un accord sur des mesures efficaces en vue d'une interdiction de leur mise au point, de leur fabrication et de leur stockage et en vue de leur destruction, et sur des mesures appropriées concernant l'équipement et les vecteurs spécialement destinés à la fabrication ou à l'emploi d'agents chimiques à des fins d'armement.
Article X
1. Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à faciliter un échange aussi large que possible d'équipement, de matières et de renseignements scientifiques et techniques ayant un rapport avec l'emploi d'agents bactériologiques (biologiques) et de toxines à des fins pacifiques et ont le droit de participer à cet échange. Les parties à la Convention qui sont en mesure de le faire coopéreront également en apportant, individuellement ou en commun, avec d'autres Etats ou des organisations internationales, leur concours à l'extension future et à l'application des découvertes scientifiques dans le domaine de la bactériologie (biologie), en vue de la prévention des maladies ou à d'autres fins pacifiques.
2. La présente Convention sera appliquée de façon à éviter toute entrave au développement économique ou technique des Etats parties à la Convention ou à la coopération internationale dans le domaine des activités bactériologiques (biologiques) pacifiques, y compris l'échange international d'agents bactériologiques (biologiques) et de toxines, ainsi que de matériel servant à la mise au point, à l'emploi ou à la production d'agents bactériologiques (biologiques) et de toxines à des fins pacifiques conformément aux dispositions de la Convention.
Article XI
Tout Etat partie peut proposer des amendements à la présente Convention. Ces amendements entreront en vigueur, à l'égard de tout Etat partie qui les aura acceptés, dès leur acceptation par la majorité des Etats parties à la Convention et, par la suite, à l'égard de chacun des autres Etats parties, à la date à laquelle cet Etat les aura acceptés.
Article XII
Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention, ou avant cette date si une majorité des parties à la Convention le demande en soumettant une proposition à cet effet aux gouvernements dépositaires, une conférence des Etats parties à la Convention aura lieu à Genève (Suisse), afin d'examiner le fonctionnement de la Convention, en vue de s'assurer que les objectifs énoncés dans le préambule et les dispositions de la Convention, y compris celles relatives aux négociations sur les armes chimiques, sont en voie de réalisation. A l'occasion de cet examen, il sera tenu compte de toutes les nouvelles réalisations scientifiques et techniques qui ont un rapport avec la Convention.
Article XIII
1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée.
2. Chaque Etat partie à la présente Convention a, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, le droit de se retirer de la Convention s'il estime que des événements extraordinaires, touchant l'objet de la Convention, ont mis en péril les intérêts supérieurs du pays. Il notifiera ce retrait à tous les autres Etats parties à la Convention et au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies avec un préavis de trois mois. Il indiquera dans cette notification les événements extraordinaires qu'il considère comme ayant mis en péril ses intérêts supérieurs.
Article XIV
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats. Tout Etat qui n'aura pas signé la Convention avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.
2. La présente Convention sera soumise à la ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification et les instruments d'adhésion seront déposés auprès des Gouvernements du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, des Etats-Unis d'Amérique et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques qui sont par les présentes désignés comme étant les gouvernements dépositaires.
3. La présente Convention entrera en vigueur lorsque vingt-deux gouvernements, y compris les gouvernements qui sont désignés comme étant les gouvernements dépositaires de la Convention, auront déposé leurs instruments de ratification
4. Pour les Etats dont les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés après l'entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion.
5. Les gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les Etats qui auront signé la présente Convention ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur de la Convention, ainsi que de la réception de toute autre communication.
6. La présente Convention sera enregistrée par les gouvernements dépositaires conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article XV
La présente Convention, dont les textes anglais, russe, espagnol, français et chinois font également foi, sera déposée dans les archives des gouvernements dépositaires. Des copies dûment certifiées de la Convention seront adressées par les gouvernements dépositaires aux gouvernements des Etats qui auront signé la Convention ou qui y auront adhéré.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT en trois exemplaires, à Londres, Moscou et Washington, le dix avril mil neuf cent soixante-douze.
Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction
Les Etats parties à la présente Convention,
Résolus à agir en vue de réaliser des progrès effectifs vers un désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace, y compris l'interdiction et l'élimination de tous les types d'armes de destruction massive,
Désireux de contribuer à la réalisation des buts et principes de la Charte des Nations Unies,
Rappelant que l'Assemblée générale des Nations Unies a maintes fois condamné tous les actes contraires aux principes et aux objectifs du Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925 (Protocole de Genève de 1925),
Reconnaissant que la présente Convention réaffirme les principes et les objectifs du Protocole de Genève de 1925 et de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, signée à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972, ainsi que les obligations contractées en vertu de ces instruments,
Ayant présent à l'esprit l'objectif énoncé à l'article IX de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction,
Résolus, dans l'intérêt de l'humanité tout entière, à exclure complètement la possibilité de l'emploi des armes chimiques, grâce à l'application des dispositions de la présente Convention, complétant ainsi les obligations contractées en vertu du Protocole de Genève de 1925,
Reconnaissant l'interdiction de l'emploi d'herbicides en tant que moyens de guerre, telle que la traduisent les accords pertinents et les principes du droit international en la matière,
Considérant que les progrès dans le domaine de la chimie devraient être utilisés exclusivement au profit de l'humanité,
Désireux de faciliter la liberté du commerce des produits chimiques ainsi que la coopération entre pays et l'échange international d'informations scientifiques et techniques dans le domaine des activités chimiques à des fins non interdites par la présente Convention, dans le but de renforcer le développement économique et technologique de tous les Etats parties,
Convaincus que l'interdiction complète et efficace de la mise au point, de la fabrication, de l'acquisition, du stockage, de la conservation, du transfert et de l'emploi des armes chimiques et leur destruction représentent une étape nécessaire vers la réalisation de ces objectifs communs,
Sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE PREMIER : OBLIGATIONS GENERALES
1. Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à ne jamais, en aucune circonstance :
a) Mettre au point, fabriquer, acquérir d'une autre manière, stocker ou conserver d'armes chimiques, ou transférer, directement ou indirectement, d'armes chimiques à qui que ce soit;
b) Employer d'armes chimiques;
c) Entreprendre de préparatifs militaires quels qu'ils soient en vue d'un emploi d'armes chimiques;
d) Aider, encourager ou inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à entreprendre quelque activité que ce soit qui est interdite à un Etat partie en vertu de la présente Convention.
2. Chaque Etat partie s'engage à détruire les armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle, conformément aux dispositions de la présente Convention.
3. Chaque Etat partie s'engage à détruire toutes les armes chimiques qu'il a abandonnées sur le territoire d'un autre Etat partie, conformément aux dispositions de la présente Convention.
4. Chaque Etat partie s'engage à détruire toute installation de fabrication d'armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, conformément aux dispositions de la présente Convention.
5. Chaque Etat partie s'engage à ne pas employer d'agents de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre.
ARTICLE II : DEFINITIONS ET CRITERES
Aux fins de la présente Convention :
1. On entend par "armes chimiques" les éléments ci-après, pris ensemble ou séparément :
a) Les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs, à l'exception de ceux qui sont destinés à des fins non interdites par la présente Convention, aussi longtemps que les types et quantités en jeu sont compatibles avec de telles fins;
b) Les munitions et dispositifs spécifiquement conçus pour provoquer la mort ou d'autres dommages par l'action toxique des produits chimiques toxiques définis à l'alinéa a), qui seraient libérés du fait de l'emploi de ces munitions et dispositifs;
c) Tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi des munitions et dispositifs définis à l'alinéa b).
2. On entend par "produit chimique toxique" :
Tout produit chimique qui, par son action chimique sur des processus biologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou les animaux la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents. Cela comprend tous les produits chimiques de ce type, quels qu'en soient l'origine ou le mode de fabrication, qu'ils soient obtenus dans des installations, dans des munitions ou ailleurs.
(Aux fins de l'application de la présente Convention, des produits chimiques toxiques qui ont été reconnus comme devant faire l'objet de mesures de vérification sont énumérés aux tableaux figurant dans l'Annexe sur les produits chimiques.)
3. On entend par "précurseur" :
Tout réactif chimique qui entre à un stade quelconque dans la fabrication d'un produit chimique toxique, quel que soit le procédé utilisé. Cela comprend tout composant clé d'un système chimique binaire ou à composants multiples.
(Aux fins de l'application de la présente Convention, des précurseurs qui ont été reconnus comme devant faire l'objet de mesures de vérification sont énumérés aux tableaux figurant dans l'Annexe sur les produits chimiques.)
4. On entend par "composant clé d'un système chimique binaire ou à composants multiples" (ci-après dénommé "composant clé") :
Le précurseur qui joue le rôle le plus important dans la détermination des propriétés toxiques du produit final et qui réagit rapidement avec d'autres produits chimiques dans le système binaire ou à composants multiples.
5. On entend par "armes chimiques anciennes" :
a) Les armes chimiques qui ont été fabriquées avant 1925; ou
b) Les armes chimiques fabriquées entre 1925 et 1946 qui se sont détériorées au point de ne plus pouvoir être employées en tant qu'armes chimiques.
6. On entend par "armes chimiques abandonnées" :
Les armes chimiques, y compris les armes chimiques anciennes, qui ont été abandonnées par un Etat après le 1er janvier 1925 sur le territoire d'un autre Etat sans le consentement de ce dernier.
7. On entend par "agent de lutte antiémeute" :
Tout produit chimique qui n'est pas inscrit à un tableau et qui peut provoquer rapidement chez les êtres humains une irritation sensorielle ou une incapacité physique disparaissant à bref délai après qu'a cessé l'exposition.
8. L'expression "installation de fabrication d'armes chimiques" :
a) Désigne tout matériel, ainsi que tout bâtiment abritant ce matériel, qui a été conçu, construit ou utilisé à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946 :
i) Pour la fabrication de produits chimiques au stade ("stade technologique final") où le flux de matières contient, quand le matériel est en service :
1) Un produit chimique inscrit au tableau 1 de l'Annexe sur les produits chimiques; ou
2) Un autre produit chimique qui, sur le territoire de l'Etat partie ou en un autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de l'Etat partie, n'a pas d'utilisation à des fins non interdites par la présente Convention au-dessus d'une tonne par an, mais qui peut être utilisé à des fins d'armes chimiques;
ou
ii) Pour le remplissage d'armes chimiques, y compris, entre autres : le chargement de produits chimiques inscrits au tableau 1 dans des munitions, des dispositifs, ou des conteneurs de stockage en vrac; le chargement de produits chimiques dans des conteneurs qui font partie de munitions et de dispositifs binaires assemblés ou dans des sous-munitions chimiques qui font partie de munitions et de dispositifs unitaires assemblés; et le chargement des conteneurs et des sous-munitions chimiques dans les munitions et les dispositifs correspondants;
b) Ne désigne pas :
i) Une installation dont la capacité de synthèse des produits chimiques visés à l'alinéa a) i) est inférieure à une tonne;
ii) Une installation dans laquelle l'un des produits chimiques visés à l'alinéa a) i) est ou a été obtenu comme sous-produit inévitable d'activités menées à des fins non interdites par la présente Convention, pour autant que la quantité de ce sous-produit ne soit pas supérieure à 3 % de la quantité totale du produit et que l'installation soit soumise à déclaration et à inspection en vertu de l'Annexe sur l'application de la Convention et la vérification (ci-après dénommée "l'Annexe sur la vérification");
iii) L'installation unique à petite échelle servant à la fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins non interdites par la présente Convention, visée à la sixième partie de l'Annexe sur la vérification.
9. On entend par "fins non interdites par la présente Convention" :
a) Des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins médicales, pharmaceutiques ou d'autres fins pacifiques;
b) Des fins de protection, à savoir les fins ayant un rapport direct avec la protection contre les produits chimiques toxiques et la protection contre les armes chimiques;
c) Des fins militaires sans rapport avec l'emploi d'armes chimiques et qui ne sont pas tributaires de l'emploi, en tant que moyen de guerre, des propriétés toxiques de produits chimiques;
d) Des fins de maintien de l'ordre public, y compris de lutte antiémeute sur le plan intérieur.
10. On entend par "capacité de production" :
La quantité d'un produit chimique déterminé qui pourrait être fabriquée annuellement à l'aide du procédé technique que l'installation visée utilise effectivement ou qu'elle a l'intention d'utiliser, si ce procédé n'est pas encore opérationnel. Elle est considérée comme étant égale à la capacité nominale ou, si celle-ci n'est pas disponible, à la capacité prévue. Par capacité nominale, on entend la quantité de produit fabriquée dans des conditions optimisées pour que l'installation de fabrication produise une quantité maximale, quantité établie après un ou plusieurs essais d'exploitation. Par capacité prévue, on entend la quantité de produit fabriquée correspondante, telle qu'elle a été déterminée par des calculs théoriques.
11. On entend par "Organisation" l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques dont porte création l'article VIII de la présente Convention.
12. Aux fins de l'article VI :
a) On entend par "fabrication" d'un produit chimique l'obtention d'un corps par réaction chimique;
b) On entend par "traitement" d'un produit chimique une opération physique, telle que la préparation, l'extraction et la purification, où le produit n'est pas transformé en une autre espèce chimique;
c) On entend par "consommation" d'un produit chimique la transformation de ce corps par réaction chimique en une autre espèce chimique.
ARTICLE III : DECLARATIONS
1. Chaque Etat partie présente à l'Organisation, au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, des déclarations dans lesquelles :
a) En ce qui concerne les armes chimiques, il :
i) Déclare s'il est propriétaire ou détenteur d'armes chimiques ou s'il se trouve des armes chimiques en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle;
ii) Indique l'emplacement exact, la quantité globale et l'inventaire détaillé des armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle, conformément aux paragraphes 1 à 3 de la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification, exception faite des armes chimiques visées au point iii);
iii) Signale toute arme chimique qu'il a sur son territoire, dont un autre Etat est le propriétaire et le détenteur et qui se trouve en un lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d'un autre Etat, conformément au paragraphe 4 de la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification;
iv) Déclare s'il a transféré ou reçu, directement ou indirectement, des armes chimiques depuis le 1er janvier 1946 et spécifie le transfert ou la réception de telles armes, conformément au paragraphe 5 de la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification;
v) Présente son plan général de destruction des armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle, conformément au paragraphe 6 de la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification;
b) En ce qui concerne les armes chimiques anciennes et les armes chimiques abandonnées, l'Etat partie :
i) Déclare s'il a sur son territoire des armes chimiques anciennes et fournit tous les renseignements dont il dispose à leur sujet, conformément au paragraphe 3 de la quatrième partie (B) de l'Annexe sur la vérification;
ii) Déclare s'il se trouve sur son territoire des armes chimiques abandonnées et fournit tous les renseignements dont il dispose à leur sujet, conformément au paragraphe 8 de la quatrième partie (B) de l'Annexe sur la vérification;
iii) Déclare s'il a abandonné des armes chimiques sur le territoire d'autres Etats et fournit tous les renseignements dont il dispose à leur sujet, conformément au paragraphe 10 de la quatrième partie (B) de l'Annexe sur la vérification;
c) En ce qui concerne les installations de fabrication d'armes chimiques, l'Etat partie :
i) Déclare s'il est ou a été propriétaire ou détenteur d'une installation de fabrication d'armes chimiques, ou s'il se trouve ou s'est trouvé une telle installation en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946;
ii) Spécifie toute installation de fabrication d'armes chimiques dont il est ou a été le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve ou s'est trouvée en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946, conformément au paragraphe 1 de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification, exception faite des installations visées au point iii);
iii) Signale toute installation de fabrication d'armes chimiques qu'il a ou a eue sur son territoire, dont un autre Etat est ou a été le propriétaire et le détenteur et qui se trouve ou s'est trouvée en un lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d'un autre Etat à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946, conformément au paragraphe 2 de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification;
iv) Déclare s'il a transféré ou reçu, directement ou indirectement, du matériel de fabrication d'armes chimiques depuis le 1er janvier 1946 et spécifie le transfert ou la réception d'un tel matériel, conformément aux paragraphes 3 à 5 de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification;
v) Présente son plan général de destruction de toute installation de fabrication d'armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, conformément au paragraphe 6 de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification;
vi) Spécifie les mesures à prendre pour fermer toute installation de fabrication d'armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, conformément au paragraphe 1, alinéa i), de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification;
vii) Présente son plan général de toute conversion temporaire d'une installation de fabrication d'armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, en installation de destruction d'armes chimiques, conformément au paragraphe 7 de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification;
d) En ce qui concerne les autres installations : L'Etat partie indique l'emplacement exact, la nature et la portée générale des activités de toute installation ou tout établissement dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle et qui, depuis le 1er janvier 1946, a été conçu, construit ou utilisé principalement pour mettre au point des armes chimiques, la déclaration incluant, entre autres, tout laboratoire ainsi que tout site d'essai et d'évaluation;
e) En ce qui concerne les agents de lutte antiémeute : l'Etat partie spécifie le nom chimique, la formule développée et le numéro de fichier du Chemical Abstracts Service (CAS), s'il a été attribué, de chaque produit chimique qu'il détient aux fins de lutte antiémeute; cette déclaration est mise à jour au plus tard 30 jours après qu'un changement est effectivement intervenu, le cas échéant.
2. L'Etat partie est libre d'appliquer ou non les dispositions du présent article et les dispositions pertinentes de la quatrième partie de l'Annexe sur la vérification aux armes chimiques qui ont été enfouies sur son territoire avant le 1er janvier 1977 et qui le restent, ou qui ont été déversées en mer avant le 1er janvier 1985.
ARTICLE IV : ARMES CHIMIQUES
1. Les dispositions du présent article et les procédures d'application détaillées qui s'y rapportent s'appliquent à toutes les armes chimiques dont un Etat partie est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle, exception faite des armes chimiques anciennes et des armes chimiques abandonnées auxquelles s'applique la quatrième partie (B) de l'Annexe sur la vérification.
2. Les procédures d'application du présent article sont détaillées dans l'Annexe sur la vérification.
3. Tous les emplacements dans lesquels les armes chimiques visées au paragraphe 1 sont stockées ou détruites sont soumis à une vérification systématique par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place, conformément à la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification.
4. Chaque Etat partie, immédiatement après avoir présenté la déclaration prévue au paragraphe 1, alinéa a), de l'article III, donne accès aux armes chimiques visées au paragraphe 1 aux fins de la vérification systématique de cette déclaration par l'inspection sur place. Ensuite, l'Etat partie ne déplace aucune de ces armes chimiques, si ce n'est pour la transporter dans une installation de destruction d'armes chimiques. Il donne accès à ces armes aux fins de la vérification systématique sur place.
5. Chaque Etat partie donne accès à toute installation de destruction d'armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, ainsi qu'à toute zone de stockage que comporte cette dernière, aux fins de la vérification systématique par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place.
6. Chaque Etat partie détruit toutes les armes chimiques visées au paragraphe 1 conformément à l'Annexe sur la vérification, ainsi qu'au rythme et dans l'ordre convenus (ci-après dénommés "ordre de destruction"). Leur destruction commence au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat partie et s'achève au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la Convention. Rien n'empêche qu'un Etat partie détruise ces armes chimiques à un rythme plus rapide.
7. Chaque Etat partie :
a) Présente des plans détaillés de destruction des armes chimiques visées au paragraphe 1 au plus tard 60 jours avant le début de chaque période de destruction annuelle, conformément au paragraphe 29 de la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification - ces plans détaillés englobent tous les stocks à détruire au cours de la période de destruction annuelle suivante;
b) Présente annuellement des déclarations concernant la mise en oeuvre de ses plans de destruction des armes chimiques visées au paragraphe 1 au plus tard 60 jours après la fin de chaque période de destruction annuelle;
c) Certifie, au plus tard 30 jours après l'achèvement du processus de destruction, que toutes les armes chimiques visées au paragraphe 1 ont été détruites.
8. L'Etat qui ratifie la présente Convention ou qui y adhère après la période de dix ans prévue pour la destruction, aux termes du paragraphe 6, détruit les armes chimiques visées au paragraphe 1 dès que possible. Le Conseil exécutif établit à l'égard de cet Etat partie un ordre de destruction des armes et les procédures à suivre pour vérifier rigoureusement leur destruction.
9. Toute arme chimique que découvre un Etat partie après la déclaration initiale est signalée, mise en lieu sûr, puis détruite conformément à la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification.
10. Chaque Etat partie accorde la plus haute priorité à la sécurité des personnes et à la protection de l'environnement pendant le transport, l'échantillonnage, le stockage et la destruction des armes chimiques. Il transporte, échantillonne, stocke et détruit ces armes en respectant ses normes nationales en matière de sécurité et d'émissions.
11. Tout Etat partie ayant sur son territoire des armes chimiques dont un autre Etat est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous la juridiction ou le contrôle d'un autre Etat, fait tout son possible pour s'assurer que ces armes sont enlevées de son territoire au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard. Si elles ne sont pas enlevées dans un délai d'un an, l'Etat partie peut demander à l'Organisation et à d'autres Etats parties de lui venir en aide pour les détruire.
12. Chaque Etat partie s'engage à coopérer avec d'autres Etats parties qui demandent des renseignements ou une assistance à l'échelon bilatéral ou par l'intermédiaire du Secrétariat technique concernant des méthodes et des techniques de destruction sûres et efficaces des armes chimiques.
13. Quant aux activités de vérification à exécuter conformément au présent article et à la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification, l'Organisation étudie les possibilités d'éviter qu'elles ne fassent double emploi avec ce que prévoient des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des Etats parties en vue de la vérification des stocks d'armes chimiques et de leur destruction.
A cette fin, le Conseil exécutif décide de limiter la vérification à des mesures complétant celles qui sont entreprises conformément à un accord bilatéral ou multilatéral de cette nature, s'il constate que :
a) Les dispositions relatives à la vérification de l'accord considéré sont compatibles avec les dispositions correspondantes du présent article et de la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification;
b) L'application de l'accord apporte une garantie suffisante du respect des dispositions pertinentes de la présente Convention;
c) Les parties à l'accord bilatéral ou multilatéral tiennent l'Organisation pleinement informée de leurs activités de vérification.
14. Si le Conseil exécutif décide ce que prévoit le paragraphe 13, l'Organisation a le droit de surveiller l'application de l'accord bilatéral ou multilatéral considéré.
15. Rien dans les paragraphes 13 et 14 n'affecte l'obligation où se trouve l'Etat partie de présenter des déclarations conformément à l'article III, au présent article et à la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification.
16. Les coûts de la destruction des armes chimiques qu'un Etat partie est tenu de détruire sont à la charge de cet Etat. Les coûts de la vérification du stockage et de la destruction de ces armes chimiques le sont également, à moins que le Conseil exécutif n'en décide autrement. Si le Conseil exécutif décide, conformément au paragraphe 13, de limiter la vérification effectuée par l'Organisation, les coûts des mesures de vérification et de surveillance complémentaires qu'exécute l'Organisation sont couverts selon le barème des quotes-parts de l'Organisation des Nations Unies, comme indiqué au paragraphe 7 de l'article VIII.
L'Etat partie est libre d'appliquer ou non les dispositions du présent article et les dispositions pertinentes de la quatrième partie de l'Annexe sur la vérification aux armes chimiques qui ont été enfouies sur son territoire avant le 1er janvier 1977 et qui le restent, ou qui ont été déversées en mer avant le 1er janvier 1985.
ARTICLE V : INSTALLATIONS DE FABRICATION D'ARMES CHIMIQUES
1. Les dispositions du présent article et les procédures d'application détaillées qui s'y rapportent s'appliquent à toutes les installations de fabrication d'armes chimiques dont un Etat partie est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle.
2. Les procédures d'application du présent article sont détaillées à l'Annexe sur la vérification.
3. Toutes les installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1 sont soumises à une vérification systématique par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place, conformément à la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification.
4. Chaque Etat partie met immédiatement fin à toute activité dans les installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1, excepté à celle qui est requise pour les fermer.
5. Aucun Etat partie ne construit de nouvelles installations de fabrication d'armes chimiques ni ne modifie d'installations existantes aux fins de la fabrication d'armes chimiques ou de toute autre activité interdite par la présente Convention.
6. Chaque Etat partie, immédiatement après avoir présenté la déclaration prévue au paragraphe 1, alinéa c), de l'article III, donne accès aux installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1, aux fins de la vérification systématique de cette déclaration par l'inspection sur place.
7. Chaque Etat partie :
a) Ferme, au plus tard 90 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, toutes les installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1, conformément à la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification, et le fait savoir;
b) Donne accès aux installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1, après leur fermeture, aux fins de la vérification systématique par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place, vérification qui a pour but de s'assurer que les installations restent fermées et sont par la suite détruites.
8. Chaque Etat partie détruit toutes les installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1 ainsi que les installations et le matériel connexes, conformément à l'Annexe sur la vérification ainsi qu'au rythme et dans l'ordre convenus (ci-après dénommés "ordre de destruction"). Leur destruction commence au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat partie et s'achève au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la Convention. Rien n'empêche qu'un Etat partie détruise ces installations à un rythme plus rapide.
9. Chaque Etat partie :
a) Présente des plans détaillés de destruction des installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1 au plus tard 180 jours avant que la destruction de chaque installation ne commence;
b) Présente annuellement des déclarations concernant la mise en oeuvre de ses plans de destruction de toutes les installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1 au plus tard 90 jours après la fin de chaque période de destruction annuelle;
c) Certifie, au plus tard 30 jours après l'achèvement du processus de destruction, que toutes les installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1 ont été détruites.
10. L'Etat qui ratifie la présente Convention ou qui y adhère après la période de dix ans prévue pour la destruction, aux termes du paragraphe 8, détruit les installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1 dès que possible. Le Conseil exécutif établit à l'égard de cet Etat partie un ordre de destruction des installations et les procédures à suivre pour vérifier rigoureusement leur destruction.
11. Chaque Etat partie accorde la plus haute priorité à la sécurité des personnes et à la protection de l'environnement pendant la destruction des installations de fabrication d'armes chimiques. Il détruit les installations en respectant ses normes nationales en matière de sécurité et d'émissions.
12. Les installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1 peuvent être temporairement converties pour la destruction d'armes chimiques conformément aux paragraphes 18 à 25 de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification. L'installation ainsi convertie doit être détruite aussitôt qu'elle n'est plus utilisée pour la destruction d'armes chimiques et, en tout état de cause, au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la Convention.
13. L'Etat partie peut demander, dans les cas exceptionnels de nécessité impérieuse, l'autorisation d'exploiter l'une des installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1 à des fins non interdites par la présente Convention. La Conférence des Etats parties décide, sur la recommandation du Conseil exécutif, s'il y a lieu de faire droit à la demande et fixe les conditions auxquelles l'autorisation est subordonnée, conformément à la section D de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification.
14. L'installation de fabrication d'armes chimiques est convertie de telle manière qu'elle ne soit pas plus à même de fabriquer des armes chimiques à l'avenir que toute autre installation exploitée à des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins médicales, pharmaceutiques ou d'autres fins pacifiques ne mettant pas en jeu de produits chimiques inscrits au tableau 1.
15. Toutes les installations converties sont soumises à la vérification systématique par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place, conformément à la section D de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification.
16. Quant aux activités de vérification à exécuter conformément au présent article et à la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification, l'Organisation étudie les possibilités d'éviter qu'elles ne fassent double emploi avec ce que prévoient des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des Etats parties en vue de la vérification des installations de fabrication d'armes chimiques et de leur destruction.
A cette fin, le Conseil exécutif décide de limiter la vérification à des mesures complétant celles qui sont entreprises conformément à un accord bilatéral ou multilatéral de cette nature s'il constate que :
a) Les dispositions relatives à la vérification de l'accord considéré sont compatibles avec les dispositions correspondantes du présent article et de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification;
b) L'application de l'accord apporte une garantie suffisante du respect des dispositions pertinentes de la présente Convention;
c) Les parties à l'accord bilatéral ou multilatéral tiennent l'Organisation pleinement informée de leurs activités de vérification.
17. Si le Conseil exécutif décide ce que prévoit le paragraphe 16, l'Organisation a le droit de surveiller l'application de l'accord bilatéral ou multilatéral considéré.
18. Rien dans les paragraphes 16 et 17 n'affecte l'obligation où se trouve un Etat partie de présenter des déclarations conformément à l'article III, au présent article et à la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification.
19. Les coûts de la destruction des installations de fabrication d'armes chimiques qu'un Etat partie est tenu de détruire sont à la charge de cet Etat. Les coûts de la vérification prévue par le présent article le sont également, à moins que le Conseil exécutif n'en décide autrement. Si le Conseil exécutif décide, conformément au paragraphe 16, de limiter la vérification effectuée par l'Organisation, les coûts des mesures de vérification et de surveillance complémentaires qu'exécute l'Organisation sont couverts selon le barème des quotes-parts de l'Organisation des Nations Unies, comme indiqué au paragraphe 7 de l'article VIII.
ARTICLE VI : ACTIVITES NON INTERDITES PAR LA PRESENTE CONVENTION
1. Chaque Etat partie a le droit, sous réserve des dispositions de la présente Convention, de mettre au point, de fabriquer, d'acquérir d'une autre manière, de conserver, de transférer et d'utiliser des produits chimiques toxiques et leurs précurseurs à des fins non interdites par la présente Convention.
2. Chaque Etat partie adopte les mesures nécessaires pour que les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs ne soient mis au point, fabriqués, acquis d'une autre manière, conservés, transférés ou utilisés sur son territoire ou en tout autre lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle qu'à des fins non interdites par la présente Convention. Dans ce but, et pour donner l'assurance que ses activités sont conformes aux obligations qu'il a contractées en vertu de la présente Convention, chaque Etat partie soumet les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs qui sont inscrits aux tableaux 1, 2 et 3 de l'Annexe sur les produits chimiques ainsi que les installations liées à ces produits chimiques et les autres installations visées à l'Annexe sur la vérification qui sont situées sur son territoire ou en tout autre lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle à des mesures de vérification selon les dispositions de l'Annexe sur la vérification.
3. Chaque Etat partie soumet les produits chimiques inscrits au tableau 1 (ci-après dénommés les "produits chimiques du tableau 1") aux interdictions concernant leur fabrication, leur acquisition, leur conservation, leur transfert et leur utilisation, telles que spécifiées dans la sixième partie de l'Annexe sur la vérification. Il soumet ces produits et les installations visées à la sixième partie de l'Annexe sur la vérification à une vérification systématique par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place, conformément à cette partie de l'Annexe sur la vérification.
4. Chaque Etat partie soumet les produits chimiques inscrits au tableau 2 (ci-après dénommés les "produits chimiques du tableau 2") et les installations visées à la septième partie de l'Annexe sur la vérification au contrôle des données et à la vérification sur place, conformément à cette partie de l'Annexe sur la vérification.
5. Chaque Etat partie soumet les produits chimiques inscrits au tableau 3 (ci-après dénommés les "produits chimiques du tableau 3") et les installations visées à la huitième partie de l'Annexe sur la vérification au contrôle des données et à la vérification sur place, conformément à cette partie de l'Annexe sur la vérification.
6. Chaque Etat partie soumet les installations visées à la neuvième partie de l'Annexe sur la vérification au contrôle des données et, éventuellement, à la vérification sur place, conformément à cette partie de l'Annexe sur la vérification, à moins que la Conférence des Etats parties n'en décide autrement, conformément au paragraphe 22 de la neuvième partie de l'Annexe sur la vérification.
7. Chaque Etat partie fait, au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, une déclaration initiale concernant les produits chimiques et les installations pertinents, conformément à l'Annexe sur la vérification.
8. Chaque Etat partie fait des déclarations annuelles concernant les produits chimiques et les installations pertinents, conformément à l'Annexe sur la vérification.
9. Aux fins de la vérification sur place, chaque Etat partie donne aux inspecteurs accès à ses installations comme le stipule l'Annexe sur la vérification.
10. En exécutant ses activités de vérification, le Secrétariat technique évite toute intrusion injustifiée dans les activités chimiques que mène l'Etat partie à des fins non interdites par la présente Convention et, en particulier, il se conforme aux dispositions de l'Annexe sur la protection de l'information confidentielle (ci-après dénommée "l'Annexe sur la confidentialité").
11. Les dispositions du présent article sont appliquées de manière à éviter d'entraver le développement économique ou technologique des Etats parties, de même que la coopération internationale dans le domaine des activités chimiques à des fins non interdites par la présente Convention, y compris l'échange international d'informations scientifiques et techniques ainsi que de produits chimiques et de matériel aux fins de la fabrication, du traitement ou de l'utilisation de produits chimiques à des fins non interdites par la présente Convention.
ARTICLE VII : MESURES D'APPLICATION NATIONALES
Engagements d'ordre général
1. Chaque Etat partie adopte, conformément aux procédures prévues par sa Constitution, les mesures nécessaires pour s'acquitter des obligations qu'il a contractées en vertu de la présente Convention. En particulier :
a) Il interdit aux personnes physiques et morales se trouvant en quelque lieu de son territoire ou en tout autre lieu placé sous sa juridiction telle qu'elle est reconnue par le droit international, d'entreprendre quelque activité que ce soit qui est interdite à un Etat partie par la présente Convention et, notamment, promulgue une législation pénale en la matière;
b) Il n'autorise aucune activité interdite à un Etat partie par la présente Convention, en quelque lieu qui soit placé sous son contrôle;
c) Il applique la législation pénale qu'il a promulguée en vertu de l'alinéa a) à toute activité interdite à un Etat partie par la présente Convention, qui est entreprise en quelque lieu que ce soit par des personnes physiques possédant sa nationalité, conformément au droit international.
2. Chaque Etat partie coopère avec les autres Etats parties et apporte, sous la forme appropriée, une assistance juridique pour faciliter l'exécution des obligations découlant du paragraphe 1.
3. En s'acquittant des obligations qu'il a contractées en vertu de la présente Convention, chaque Etat partie accorde la plus haute priorité à la sécurité des personnes et à la protection de l'environnement et coopère, selon que de besoin, avec d'autres Etats parties dans ce domaine.
Rapports entre l'Etat partie et l'Organisation
4. Pour s'acquitter des obligations qu'il a contractées en vertu de la présente Convention, chaque Etat partie désigne ou met en place une autorité nationale, qui sert de centre national en vue d'assurer une liaison efficace avec l'Organisation et les autres Etats parties, et en informe l'Organisation au moment où la Convention entre en vigueur à son égard.
5. Chaque Etat partie informe l'Organisation des mesures législatives et administratives qu'il a prises pour appliquer la présente Convention.
6. Chaque Etat partie traite de façon confidentielle et particulière l'information et les données qu'il reçoit en confidence de l'Organisation concernant l'application de la présente Convention. Il traite cette information et ces données exclusivement dans le cadre des droits et obligations qui sont les siens aux termes de la Convention et en se conformant aux dispositions de l'Annexe sur la confidentialité.
7. Chaque Etat partie s'engage à coopérer avec l'Organisation dans l'accomplissement de toutes ses fonctions et, en particulier, à prêter son concours au Secrétariat technique.
ARTICLE VIII : L'ORGANISATION
A. DISPOSITIONS GENERALES
1. Les Etats parties créent par les présentes l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, afin de réaliser l'objet et le but de la présente Convention, de veiller à l'application de ses dispositions, y compris celles qui ont trait à la vérification internationale du respect de l'instrument, et de ménager un cadre dans lequel ils puissent se consulter et coopérer entre eux.
2. Tous les Etats parties à la présente Convention sont membres de l'Organisation. Aucun Etat partie ne peut être privé de sa qualité de membre de l'Organisation.
3. L'Organisation a son siège à La Haye (Royaume des Pays-Bas).
4. Sont créés par les présentes la Conférence des Etats parties, le Conseil exécutif et le Secrétariat technique, qui constituent les organes de l'Organisation.
5. L'Organisation exécute les activités de vérification prévues par la présente Convention de sorte que leurs objectifs soient atteints de la manière la moins intrusive possible dans les délais et avec l'efficacité voulus. Elle ne demande que les informations et données qui lui sont nécessaires pour s'acquitter des responsabilités qui lui sont confiées par la Convention. Elle prend toutes les précautions qui s'imposent pour protéger la confidentialité des informations relatives à des activités et des installations civiles et militaires dont elle a connaissance dans le cadre de l'application de la Convention et, en particulier, elle se conforme aux dispositions de l'Annexe sur la confidentialité.
6. L'Organisation cherche à tirer parti des progrès de la science et de la technique aux fins de ses activités de vérification.
7. Les coûts des activités de l'Organisation sont couverts par les Etats parties selon le barème des quotes-parts de l'Organisation des Nations Unies, ajusté compte tenu des différences entre le nombre des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et celui des Etats membres de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, et sous réserve des dispositions des articles IV et V. Les contributions financières des Etats parties à la Commission préparatoire sont déduites de manière appropriée de leurs contributions au budget ordinaire. Le budget de l'Organisation comprend deux chapitres distincts, consacrés l'un aux dépenses d'administration et autres coûts, et l'autre aux dépenses relatives à la vérification.
8. Un membre de l'Organisation en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l'Organisation ne peut pas participer au vote à l'Organisation si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. La Conférence des Etats parties peut néanmoins autoriser ce membre à participer au vote si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
B. LA CONFERENCE DES ETATS PARTIES
Composition, procédure et prise de décisions
9. La Conférence des Etats parties (ci-après dénommée "la Conférence") se compose de tous les membres de l'Organisation. Chaque membre a un représentant à la Conférence, qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers.
10. La première session de la Conférence est convoquée par le dépositaire au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention.
11. La Conférence tient des sessions ordinaires, qui ont lieu chaque année à moins qu'elle n'en décide autrement.
12. Des sessions extraordinaires de la Conférence sont convoquées :
a) Sur décision de la Conférence;
b) A la demande du Conseil exécutif;
c) A la demande de tout membre appuyée par un tiers des membres; ou
d) En vue d'un examen du fonctionnement de la présente Convention, conformément au paragraphe 22.
Excepté dans le cas visé à l'alinéa d), la session extraordinaire est convoquée au plus tard 30 jours après réception de la demande par le Directeur général du Secrétariat technique, sauf indication contraire figurant dans la demande.
13. La Conférence se réunit aussi en conférence d'amendement conformément au paragraphe 2 de l'article XV.
14. Les sessions de la Conférence ont lieu au siège de l'Organisation, à moins que la Conférence n'en décide autrement.
15. La Conférence adopte son règlement intérieur. Au début de chaque session ordinaire, elle élit son président et d'autres membres du bureau, en tant que de besoin. Les membres du bureau exercent leurs fonctions jusqu'à ce qu'un nouveau président et d'autres membres soient élus, lors de la session ordinaire suivante.
16. Le quorum pour la Conférence est constitué par la majorité des membres de l'Organisation.
17. Chaque membre de l'Organisation dispose d'une voix à la Conférence.
18. La Conférence prend les décisions relatives aux questions de procédure à la majorité simple des membres présents et votants. Les décisions sur les questions de fond devraient être prises dans la mesure du possible par consensus. S'il ne se dégage aucun consensus lorsqu'il faut se prononcer sur une question, le Président ajourne le vote pendant 24 heures, ne ménage aucun effort entre-temps pour faciliter l'obtention du consensus et fait rapport à la Conférence avant l'expiration du délai d'ajournement. S'il est impossible de parvenir au consensus au terme de ces 24 heures, la Conférence prend la décision à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à moins que la présente Convention n'en dispose autrement. En cas de doute sur le point de savoir s'il s'agit ou non d'une question de fond, la question visée est traitée comme une question de fond, à moins que la Conférence n'en décide autrement à la majorité requise pour les décisions sur les questions de fond.
Pouvoirs et fonctions
19. La Conférence est le principal organe de l'Organisation. Elle examine tous points, toutes questions et tous problèmes entrant dans le cadre de la présente Convention, y compris ceux qui ont un rapport avec les pouvoirs et fonctions du Conseil exécutif et du Secrétariat technique. Elle peut faire des recommandations et se prononcer sur tous points, toutes questions et tous problèmes intéressant la Convention qui seraient soulevés par un Etat partie ou portés à son attention par le Conseil exécutif.
20. La Conférence supervise l'application de la présente Convention et oeuvre à la réalisation de son objet et de son but. Elle détermine dans quelle mesure la Convention est respectée. Elle supervise également les activités du Conseil exécutif et du Secrétariat technique et peut adresser des directives, qui sont conformes aux dispositions de la Convention, à l'un ou l'autre de ces organes dans l'accomplissement de ses fonctions.
21. La Conférence :
a) Examine et adopte à ses sessions ordinaires le rapport et le budget-programme de l'Organisation que lui présente le Conseil exécutif et examine d'autres rapports;
b) Décide du barème des quotes-parts revenant aux Etats parties conformément au paragraphe 7;
c) Elit les membres du Conseil exécutif;
d) Nomme le Directeur général du Secrétariat technique (ci-après dénommé le "Directeur général");
e) Approuve le règlement intérieur du Conseil exécutif que lui présente ce dernier;
f) Crée les organes subsidiaires qu'elle estime nécessaires pour exercer les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Convention;
g) Favorise la coopération internationale à des fins pacifiques dans le domaine des activités chimiques;
h) Passe en revue les innovations scientifiques et techniques qui pourraient avoir des répercussions sur le fonctionnement de la présente Convention, et, à cette fin, charge le Directeur général de créer un conseil scientifique consultatif pour lui permettre, dans l'exercice de ses fonctions, de fournir à la Conférence, au Conseil exécutif ou aux Etats parties des avis spécialisés dans des domaines scientifiques et techniques intéressant la Convention. Le Conseil scientifique consultatif est composé d'experts indépendants désignés conformément aux critères adoptés par la Conférence;
i) Examine et approuve à sa première session tout projet d'accord, de disposition et de principe directeur élaboré par la Commission préparatoire;
j) Crée à sa première session le fonds de contributions volontaires pour l'assistance, comme prévu à l'article X;
k) Prend les mesures nécessaires pour assurer le respect de la présente Convention et pour redresser et corriger toute situation qui contrevient aux dispositions de la Convention, conformément à l'article XII.
22. La Conférence tient des sessions extraordinaires au plus tard un an après l'expiration d'une période de cinq ans et de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention et à tous autres moments dans cet intervalle dont il serait décidé, pour procéder à l'examen du fonctionnement de la Convention. Les examens ainsi effectués tiennent compte de tous progrès scientifiques et techniques pertinents qui seraient intervenus. Par la suite, à moins qu'il n'en soit décidé autrement, la Conférence tient tous les cinq ans une session qui a le même objectif.
C. LE CONSEIL EXECUTIF
Composition, procédure et prise de décisions
23. Le Conseil exécutif se compose de 41 membres. Chaque Etat partie a le droit de siéger au Conseil exécutif suivant le principe de la rotation. Les membres du Conseil exécutif sont élus par la Conférence pour deux ans. Afin d'assurer l'efficacité du fonctionnement de la présente Convention, et compte dûment tenu, en particulier, du principe d'une répartition géographique équitable, de l'importance de l'industrie chimique ainsi que des intérêts politiques et de sécurité, le Conseil exécutif comprend :
a) Neuf Etats parties d'Afrique désignés par les Etats parties situés dans cette région. Comme critère de leur désignation, il est entendu que, sur ces neuf Etats, trois sont, en principe, les Etats parties dont l'industrie chimique nationale compte parmi les plus importantes de la région, fait qui est établi à partir de données communiquées et publiées internationalement; de plus, le groupe régional convient de prendre en considération d'autres facteurs régionaux pour désigner ces trois membres ;
b) Neuf Etats parties d'Asie désignés par les Etats parties situés dans cette région. Comme critère de leur désignation, il est entendu que, sur ces neuf Etats, quatre sont, en principe, les Etats parties dont l'industrie chimique nationale compte parmi les plus importantes de la région, fait qui est établi à partir de données communiquées et publiées internationalement; de plus, le groupe régional convient de prendre en considération d'autres facteurs régionaux pour désigner ces quatre membres ;
c) Cinq Etats parties d'Europe orientale désignés par les Etats parties situés dans cette région. Comme critère de leur désignation, il est entendu que l'un de ces cinq Etats est, en principe, l'Etat partie dont l'industrie chimique nationale compte parmi les plus importantes de la région, fait qui est établi à partir de données communiquées et publiées internationalement; de plus, le groupe régional convient de prendre en considération d'autres facteurs régionaux pour désigner ce membre ;
d) Sept Etats parties d'Amérique latine et des Caraïbes désignés par les Etats parties situés dans cette région. Comme critère de leur désignation, il est entendu que, sur ces sept Etats, trois sont, en principe, les Etats parties dont l'industrie chimique nationale compte parmi les plus importantes de la région, fait qui est établi à partir de données communiquées et publiées internationalement; de plus, le groupe régional convient de prendre en considération d'autres facteurs régionaux pour désigner ces trois membres ;
e) Dix Etats parties du groupe des Etats d'Europe occidentale et autres Etats, désignés par les Etats parties qui sont membres de ce groupe. Comme critère de leur désignation, il est entendu que, sur ces dix Etats, cinq sont, en principe, les Etats parties dont l'industrie chimique nationale compte parmi les plus importantes de la région, fait qui est établi à partir de données communiquées et publiées internationalement; de plus, le groupe régional convient de prendre en considération d'autres facteurs régionaux pour désigner ces cinq membres ;
f) Un autre Etat partie que désignent à tour de rôle les Etats parties de la région de l'Asie et de celle de l'Amérique latine et des Caraïbes. Comme critère de cette désignation, il est entendu que les Etats parties de ces régions choisissent par rotation l'un des membres de leur groupe.
24. Lors de la première élection du Conseil exécutif, 20 Etats parties seront élus pour un an, compte dûment tenu des proportions numériques énoncées au paragraphe 23.
25. Après que les articles IV et V auront été intégralement appliqués, la Conférence pourra, à la demande de la majorité des membres du Conseil exécutif, réexaminer la composition de ce dernier à la lumière des événements ayant un rapport avec les principes régissant sa composition qui sont spécifiés au paragraphe 23.
26. Le Conseil exécutif élabore son règlement intérieur et le soumet à l'approbation de la Conférence.
27. Le Conseil exécutif élit son président parmi ses membres.
28. Le Conseil exécutif tient des sessions ordinaires. Entre les sessions ordinaires, il se réunit aussi souvent que l'exige l'exercice de ses pouvoirs et fonctions.
29. Chaque membre du Conseil exécutif dispose d'une voix. Sauf disposition contraire de la présente Convention, le Conseil exécutif prend les décisions sur les questions de fond à la majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres. Le Conseil exécutif prend les décisions relatives aux questions de procédure à la majorité simple de l'ensemble de ses membres. En cas de doute sur le point de savoir s'il s'agit ou non d'une question de fond, la question visée est traitée comme une question de fond, à moins que le Conseil exécutif n'en décide autrement à la majorité requise pour les décisions sur les questions de fond.
Pouvoirs et fonctions
30. Le Conseil exécutif est l'organe exécutif de l'Organisation. Il relève de la Conférence. Le Conseil exécutif exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués par la présente Convention, de même que les fonctions qui lui sont déléguées par la Conférence. Ce faisant, il agit en conformité avec les recommandations, les décisions et les directives de la Conférence et veille à ce qu'elles soient appliquées comme il se doit et de manière suivie.
31. Le Conseil exécutif oeuvre à l'application effective et au respect de la présente Convention. Il supervise les activités du Secrétariat technique, coopère avec l'autorité nationale de chaque Etat partie et facilite la consultation et la coopération entre Etats parties, à leur demande.
32. Le Conseil exécutif :
a) Examine et présente à la Conférence le projet de budget-programme de l'Organisation;
b) Etudie et présente à la Conférence le projet de rapport de l'Organisation sur l'application de la présente Convention, le rapport sur l'exécution de ses propres activités et les rapports spéciaux qu'il juge nécessaires ou que la Conférence demanderait;
c) Prend les dispositions nécessaires pour l'organisation des sessions de la Conférence et notamment pour l'établissement de l'ordre du jour provisoire.
33. Le Conseil exécutif peut demander la convocation d'une session extraordinaire de la Conférence.
34. Le Conseil exécutif :
a) Conclut des accords ou prend des arrangements avec les Etats et les organisations internationales au nom de l'Organisation, sous réserve de l'approbation préalable de la Conférence;
b) Conclut des accords avec les Etats parties au nom de l'Organisation en ce qui concerne l'article X et supervise le fonds de contributions volontaires mentionné dans cet article;
c) Approuve les accords ou les arrangements concernant l'exécution des activités de vérification négociés par le Secrétariat technique avec les Etats parties.
35. Le Conseil exécutif examine tout problème ou toute question relevant de sa compétence qui a des répercussions sur la présente Convention et sur son application, y compris les motifs de préoccupation quant au respect de la Convention et les cas de non-respect, et, selon qu'il convient, en informe les Etats parties et porte le problème ou la question à l'attention de la Conférence.
36. Lorsqu'il examine des doutes ou des préoccupations quant au respect de la présente Convention et des cas de non-respect, notamment un usage abusif des droits énoncés dans la Convention, le Conseil exécutif consulte les Etats parties intéressés et, selon qu'il convient, demande à l'Etat partie de prendre des mesures pour redresser la situation dans des délais fixés. Pour autant que le Conseil exécutif juge nécessaire de poursuivre l'affaire, il prend entre autres une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) Il informe tous les Etats parties du problème ou de la question;
b) Il porte le problème ou la question à l'attention de la Conférence;
c) Il fait des recommandations à la Conférence touchant les mesures à prendre pour redresser la situation et assurer le respect de la Convention.
Si la situation est particulièrement grave et urgente, le Conseil exécutif porte directement le problème ou la question, y compris les informations et les conclusions pertinentes, à l'attention de l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Il informe en même temps tous les Etats parties de cette démarche.
D. LE SECRETARIAT TECHNIQUE
37. Le Secrétariat technique aide la Conférence et le Conseil exécutif dans l'accomplissement de leurs fonctions. Il exécute les mesures de vérification prévues par la présente Convention. Il exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées par la Convention, de même que les fonctions qui lui sont déléguées par la Conférence et le Conseil exécutif.
38. Le Secrétariat technique :
a) Etablit et présente au Conseil exécutif le projet de budget-programme de l'Organisation;
b) Etablit et présente au Conseil exécutif le projet de rapport de l'Organisation sur l'application de la présente Convention et tous autres rapports que la Conférence ou le Conseil exécutif demanderait ;
c) Fournit un appui administratif et technique à la Conférence, au Conseil exécutif et aux organes subsidiaires ;
d) Adresse et reçoit au nom de l'Organisation des communications destinées aux Etats parties ou émanant de ceux-ci et portant sur des questions relatives à l'application de la présente Convention ;
e) Fournit une assistance technique aux Etats parties en vue de l'application des dispositions de la présente Convention et établit pour eux à cette même fin des évaluations techniques, notamment de produits chimiques inscrits et non inscrits.
39. Le Secrétariat technique :
a) Négocie avec les Etats parties des accords ou des arrangements concernant l'exécution des activités de vérification, qui sont soumis à l'approbation du Conseil exécutif ;
b) Au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la présente Convention, coordonne la constitution et le maintien de stocks permanents destinés aux secours d'urgence et à l'aide humanitaire fournis par les Etats parties conformément au paragraphe 7, alinéas b) et c), de l'article X. Le Secrétariat technique peut inspecter les éléments en stock pour s'assurer qu'ils sont utilisables. La Conférence examine et approuve les listes d'éléments à stocker, conformément à l'alinéa i) du paragraphe 21 ;
c) Administre le fonds de contributions volontaires visé à l'article X, recueille les déclarations présentées par les Etats parties et enregistre sur demande les accords bilatéraux conclus entre des Etats parties ou entre un Etat partie et l'Organisation aux fins de l'article X.
40. Le Secrétariat technique informe le Conseil exécutif de toute difficulté qu'il a pu rencontrer dans l'exercice de ses fonctions, y compris des doutes, ambiguïtés ou incertitudes quant au respect de la présente Convention qu'il a constatés dans l'exécution de ses activités de vérification et qu'il n'a pu lever ou éclaircir par des consultations avec l'Etat partie intéressé.
41. Le Secrétariat technique est composé d'un directeur général, qui en est le chef et en dirige l'administration, d'inspecteurs et de collaborateurs scientifiques, techniques et autres, selon les besoins.
42. L'inspectorat fait partie du Secrétariat technique et est placé sous la supervision du Directeur général.
43. Le Directeur général est nommé par la Conférence sur recommandation du Conseil exécutif, pour quatre ans; son mandat peut être renouvelé une seule fois.
44. Le Directeur général est chargé de la nomination des membres du personnel ainsi que de l'organisation et du fonctionnement du Secrétariat technique, et en répond auprès de la Conférence et du Conseil exécutif. La considération dominante dans le recrutement et la définition des conditions d'emploi du personnel est la nécessité d'assurer les plus hautes qualités d'efficacité, de compétence et d'intégrité. Seuls des nationaux des Etats parties peuvent être nommés directeur général ou engagés comme inspecteurs, collaborateurs, cadres ou employés d'administration. Est dûment prise en considération l'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible. Aux fins du recrutement, il est tenu compte du principe suivant lequel les effectifs doivent être maintenus au minimum nécessaire pour que le Secrétariat technique puisse s'acquitter convenablement de ses responsabilités.
45. Le Directeur général est chargé de l'organisation et du fonctionnement du conseil scientifique consultatif visé à l'alinéa h) du paragraphe 21. Il nomme, en consultant les Etats parties, les membres de ce conseil, qui siègent à titre personnel. Les membres du Conseil scientifique consultatif sont recrutés sur la base de leurs compétences dans les domaines scientifiques particuliers ayant un rapport avec l'application de la présente Convention. Le Directeur général peut aussi, en consultant les membres de ce conseil, établir à titre temporaire et selon que de besoin des groupes de travail d'experts scientifiques pour faire des recommandations concernant des problèmes particuliers. Dans ce contexte, les Etats parties peuvent soumettre des listes d'experts au Directeur général.
46. Dans l'exercice de leurs fonctions, le Directeur général, les inspecteurs et les autres membres du personnel ne demandent ni ne reçoivent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autre source extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte qui pourrait nuire à leur statut de fonctionnaires internationaux relevant uniquement de la Conférence et du Conseil exécutif.
47. Chaque Etat partie respecte la nature exclusivement internationale des responsabilités confiées au Directeur général, aux inspecteurs et aux autres membres du personnel et ne cherche pas à les influencer dans l'accomplissement de leurs fonctions.
E. PRIVILEGES ET IMMUNITES
48. L'Organisation jouit, sur le territoire et en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d'un Etat partie, de la capacité juridique et des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions.
49. Les représentants des Etats parties ainsi que leurs suppléants et conseillers, les représentants nommés au Conseil exécutif ainsi que leurs suppléants et conseillers, le Directeur général et le personnel de l'Organisation, jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions dans le cadre de l'Organisation.
50. La capacité juridique et les privilèges et immunités mentionnés dans le présent article sont définis dans des accords entre l'Organisation et les Etats parties ainsi que dans un accord entre l'Organisation et le pays dans lequel est situé le siège de l'Organisation. La Conférence examine et approuve ces accords, conformément à l'alinéa i) du paragraphe 21.
51. Nonobstant les paragraphes 48 et 49, le Directeur général et le personnel du Secrétariat technique jouissent, durant l'exécution des activités de vérification, des privilèges et immunités énoncés dans la deuxième partie, section B, de l'Annexe sur la vérification.
ARTICLE IX : CONSULTATIONS, COOPERATION ET ETABLISSEMENT DES FAITS
1. Les Etats parties se consultent et coopèrent, directement entre eux ou par l'intermédiaire de l'Organisation ou encore suivant d'autres procédures internationales appropriées, y compris des procédures établies dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies et conformément à sa Charte, sur toute question qui serait soulevée touchant l'objet et le but de la présente Convention ou l'application de ses dispositions.
2. Sans préjudice du droit de tout Etat partie de demander une inspection par mise en demeure, les Etats parties devraient, chaque fois que possible, commencer par tout mettre en oeuvre pour éclaircir et régler, par un échange d'informations et par des consultations entre eux, toute question qui susciterait un doute quant au respect de la présente Convention ou une préoccupation au sujet d'une question connexe qui serait jugée ambiguë. L'Etat partie qui reçoit d'un autre Etat partie une demande d'éclaircissements au sujet d'une question dont l'Etat partie requérant croit qu'elle suscite un tel doute ou une telle préoccupation fournit à cet Etat, dès que possible, et en tout état de cause au plus tard dix jours après réception de la demande, des informations suffisantes pour lever ce doute ou cette préoccupation ainsi qu'une explication de la façon dont les informations fournies règlent la question. Aucune disposition de la présente Convention n'affecte le droit de deux ou de plusieurs Etats parties d'organiser par consentement mutuel des inspections ou de prendre entre eux tous autres arrangements pour éclaircir et régler toute question qui susciterait un doute quant au respect de la Convention ou une préoccupation au sujet d'une question connexe qui serait jugée ambiguë. De tels arrangements n'affectent pas les droits et obligations qu'a tout Etat partie en vertu d'autres dispositions de la présente Convention.
Procédure à suivre dans le cas d'une demande d'éclaircissements
3. Un Etat partie a le droit de demander au Conseil exécutif de l'aider à éclaircir toute situation qui serait jugée ambiguë ou qui suscite une préoccupation quant au non-respect éventuel de la présente Convention par un autre Etat partie. Le Conseil exécutif fournit les informations pertinentes qu'il possède à ce sujet.
4. Un Etat partie a le droit de demander au Conseil exécutif d'obtenir d'un autre Etat partie des éclaircissements au sujet de toute situation qui serait jugée ambiguë ou qui suscite une préoccupation quant au non-respect éventuel de la présente Convention par ce dernier. En pareil cas, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) Le Conseil exécutif transmet la demande d'éclaircissements à l'Etat partie intéressé par l'intermédiaire du Directeur général au plus tard 24 heures après sa réception ;
b) L'Etat partie requis fournit des éclaircissements au Conseil exécutif dès que possible et en tout état de cause au plus tard dix jours après réception de la demande ;
c) Le Conseil exécutif prend note des éclaircissements et les transmet à l'Etat partie requérant au plus tard 24 heures après leur réception ;
d) S'il juge ces éclaircissements insuffisants, l'Etat partie requérant a le droit de demander au Conseil exécutif d'obtenir de l'Etat partie requis des précisions supplémentaires ;
e) Pour obtenir les précisions supplémentaires demandées au titre de l'alinéa d), le Conseil exécutif peut demander au Directeur général de constituer un groupe d'experts en faisant appel aux collaborateurs du Secrétariat technique ou, si ceux-ci n'ont pas les compétences requises en l'occurrence, à des spécialistes extérieurs. Ce groupe est chargé d'examiner toutes les informations et données disponibles se rapportant à la situation qui suscite la préoccupation. Il présente au Conseil exécutif un rapport factuel dans lequel il apporte ses conclusions ;
f) Si l'Etat partie requérant estime que les éclaircissements obtenus au titre des alinéas d) et e) ne sont pas satisfaisants, il a le droit de demander la convocation d'une réunion extraordinaire du Conseil exécutif, à laquelle les Etats parties intéressés qui ne sont pas membres du Conseil exécutif sont habilités à participer. A cette réunion extraordinaire, le Conseil exécutif examine la question et peut recommander toute mesure qu'il juge appropriée pour régler la situation.
5. Un Etat partie a aussi le droit de demander au Conseil exécutif d'éclaircir toute situation qui a été jugée ambiguë ou qui a suscité une préoccupation quant au non-respect éventuel de la présente Convention par cet Etat. Le Conseil exécutif accède à une telle demande en fournissant l'assistance appropriée.
6. Le Conseil exécutif informe les Etats parties de toute demande d'éclaircissements faite conformément au présent article.
7. Si le doute ou la préoccupation d'un Etat partie quant à un cas de non-respect éventuel de la Convention n'a pas été dissipé dans les 60 jours suivant la présentation de la demande d'éclaircissements au Conseil exécutif, ou si cet Etat estime que ses doutes justifient un examen urgent, il a la faculté, sans nécessairement exercer son droit à une inspection par mise en demeure, de demander la convocation d'une session extraordinaire de la Conférence, conformément au paragraphe 12, alinéa c), de l'article VIII. A cette session extraordinaire, la Conférence examine la question et peut recommander toute mesure qu'elle juge appropriée pour régler la situation.
Procédure à suivre dans le cas d'inspections par mise en demeure
8. Chaque Etat partie a le droit de demander une inspection sur place par mise en demeure de toute installation ou de tout emplacement se trouvant sur le territoire d'un autre Etat partie ou en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de cet Etat à seule fin d'élucider et de résoudre toutes questions liées au non-respect éventuel des dispositions de la présente Convention, et de faire effectuer cette inspection sans retard en quelque lieu que ce soit par une équipe d'inspection désignée par le Directeur général et en conformité avec l'Annexe sur la vérification.
9. Chaque Etat partie est tenu de veiller à ce que la demande d'inspection par mise en demeure ne sorte pas du cadre de la présente Convention et de fournir dans cette demande toute l'information pertinente qui est à l'origine de la préoccupation quant au non-respect éventuel de la Convention, comme il est spécifié dans l'Annexe sur la vérification. Chaque Etat partie s'abstient de demandes d'inspection sans fondement, en prenant soin d'éviter des abus. L'inspection par mise en demeure est effectuée à seule fin d'établir les faits se rapportant au non-respect éventuel de la Convention.
10. Aux fins de vérifier le respect des dispositions de la présente Convention, chaque Etat partie autorise le Secrétariat technique à effectuer l'inspection sur place par mise en demeure conformément au paragraphe 8.
11. A la suite d'une demande d'inspection par mise en demeure visant une installation ou un emplacement, et suivant les procédures prévues dans l'Annexe sur la vérification, l'Etat partie inspecté a :
a) Le droit et l'obligation de faire tout ce qui lui est raisonnablement possible pour démontrer qu'il respecte la présente Convention et, à cette fin, de permettre à l'équipe d'inspection de remplir son mandat ;
b) L'obligation de donner accès à l'intérieur du site requis à seule fin d'établir les faits en rapport avec la préoccupation quant au non-respect éventuel de la présente Convention ;
c) Le droit de prendre des mesures pour protéger les installations sensibles et d'empêcher la divulgation d'informations et de données confidentielles, sans rapport avec la présente Convention.
12. La participation d'un observateur à l'inspection est régie par les dispositions suivantes :
a) L'Etat partie requérant peut, sous réserve de l'accord de l'Etat partie inspecté, envoyer un représentant observer le déroulement de l'inspection par mise en demeure; ce représentant peut être un ressortissant de l'Etat partie requérant ou d'un Etat partie tiers ;
b) L'Etat partie inspecté accorde alors à l'observateur l'accès, conformément à l'Annexe sur la vérification ;
c) En principe, l'Etat partie inspecté accepte l'observateur proposé, mais si cet Etat oppose son refus, le fait est consigné dans le rapport final.
13. L'Etat partie requérant présente sa demande d'inspection sur place par mise en demeure au Conseil exécutif et, simultanément, au Directeur général afin qu'il y soit donné immédiatement suite.
14. Le Directeur général s'assure immédiatement que la demande d'inspection satisfait aux exigences stipulées au paragraphe 4 de la dixième partie de l'Annexe sur la vérification, et aide au besoin l'Etat partie requérant à formuler sa demande en conséquence. Lorsque la demande d'inspection satisfait à ces exigences, les préparatifs de l'inspection par mise en demeure commencent.
15. Le Directeur général transmet la demande d'inspection à l'Etat partie inspecté au moins 12 heures avant l'arrivée prévue de l'équipe d'inspection au point d'entrée.
16. Après avoir reçu la demande d'inspection, le Conseil exécutif prend connaissance des mesures prises par le Directeur général pour donner suite à la demande et reste saisi de l'affaire tout au long de la procédure d'inspection. Toutefois, ses délibérations ne doivent pas retarder le déroulement de l'inspection.
17. Le Conseil exécutif peut, au plus tard 12 heures après réception de la demande d'inspection, se prononcer contre la réalisation de l'inspection par mise en demeure à la majorité des trois quarts de l'ensemble de ses membres, s'il estime que la demande est frivole ou abusive ou qu'elle sort manifestement du cadre de la présente Convention, au sens des dispositions du paragraphe 8 du présent article. Ni l'Etat partie requérant ni l'Etat partie inspecté ne prennent part à une telle décision. Si le Conseil exécutif se prononce contre l'inspection par mise en demeure, les préparatifs sont interrompus, il n'est donné aucune autre suite à la demande d'inspection, et les Etats parties intéressés sont informés en conséquence.
18. Le Directeur général délivre un mandat d'inspection pour la conduite de l'inspection par mise en demeure. Ce mandat traduit la demande d'inspection visée aux paragraphes 8 et 9 en termes opérationnels et est conforme à cette demande.
19. L'inspection par mise en demeure est effectuée conformément à la dixième partie de l'Annexe sur la vérification ou, dans le cas d'une allégation d'emploi, conformément à la onzième partie de cette annexe. L'équipe d'inspection est guidée par le principe suivant lequel il convient qu'elle effectue l'inspection par mise en demeure de la manière la moins intrusive possible et compatible avec l'accomplissement de sa mission de façon efficace et dans les délais.
20. L'Etat partie inspecté prête son concours à l'équipe d'inspection tout au long de l'inspection par mise en demeure et facilite sa tâche. Si l'Etat partie inspecté propose, conformément à la dixième partie, section C, de l'Annexe sur la vérification, à titre d'alternative à un accès général et complet, des arrangements propres à démontrer qu'il respecte la Convention, il fait tout ce qui lui est raisonnablement possible, au moyen de consultations avec l'équipe d'inspection, pour parvenir à un accord sur les modalités d'établissement des faits dans le but de démontrer qu'il respecte la Convention.
21. Le rapport final contient les faits constatés ainsi qu'une évaluation par l'équipe d'inspection du degré et de la nature de l'accès et de la coopération qui lui ont été accordés aux fins de la bonne exécution de l'inspection par mise en demeure. Le Directeur général transmet sans tarder le rapport final de l'équipe d'inspection à l'Etat partie requérant, à l'Etat partie inspecté, au Conseil exécutif et à tous les autres Etats parties. En outre, il transmet sans tarder au Conseil exécutif l'évaluation de l'Etat partie requérant et de l'Etat partie inspecté ainsi que les vues d'autres Etats parties qui ont pu lui être indiquées pour les besoins de la cause, et les communique ensuite à tous les Etats parties.
22. Le Conseil exécutif, agissant conformément à ses pouvoirs et fonctions, examine le rapport final de l'équipe d'inspection dès qu'il lui est présenté et traite tout motif de préoccupation afin de déterminer :
a) S'il y a eu non-respect ;
b) Si la demande ne sortait pas du cadre de la présente Convention ;
c) S'il y a eu abus du droit de demander une inspection par mise en demeure.
23. Si le Conseil exécutif, agissant en conformité avec ses pouvoirs et fonctions, parvient à la conclusion, eu égard au paragraphe 22, qu'il peut être nécessaire de poursuivre l'affaire, il prend les mesures appropriées en vue de redresser la situation et d'assurer le respect de la présente Convention, y compris en faisant des recommandations précises à la Conférence. En cas d'abus, le Conseil exécutif examine la question de savoir si l'Etat partie requérant doit assumer la totalité ou une partie des incidences financières de l'inspection par mise en demeure.
24. L'Etat partie requérant et l'Etat partie inspecté ont le droit de prendre part à la procédure d'examen. Le Conseil exécutif informe les Etats parties et la Conférence, lors de sa session suivante, du résultat de cette procédure.
25. Si le Conseil exécutif lui fait des recommandations précises, la Conférence étudie la suite à donner, conformément à l'article XII.
ARTICLE X : ASSISTANCE ET PROTECTION CONTRE LES ARMES CHIMIQUES
1. Aux fins du présent article, on entend par "assistance" la coordination et la fourniture aux Etats parties d'une protection contre les armes chimiques, qui porte notamment sur les éléments suivants : matériel de détection et systèmes d'alarme; matériel de protection; matériel de décontamination et décontaminants; antidotes et traitements médicaux; conseils sur chacune de ces mesures de protection.
2. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme portant atteinte au droit de tout Etat partie de se livrer à des recherches sur des moyens de protection contre les armes chimiques et de mettre au point, de fabriquer, d'acquérir, de transférer ou d'utiliser de tels moyens à des fins non interdites par la présente Convention.
3. Chaque Etat partie s'engage à faciliter l'échange le plus complet possible de matériel, de matières et d'informations scientifiques et techniques concernant les moyens de protection contre les armes chimiques, et a le droit de participer à un tel échange.
4. Pour accroître la transparence des programmes nationaux menés à des fins de protection, chaque Etat partie fournit annuellement au Secrétariat technique des renseignements concernant son programme, selon les procédures qui seront examinées et approuvées par la Conférence conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII.
5. Le Secrétariat technique crée, au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la Convention, une banque de données contenant des informations librement disponibles sur divers moyens de protection contre les armes chimiques, ainsi que les informations que fourniraient les Etats parties, et exploite cette banque de données à l'usage de tout Etat partie demandeur.
Dans la limite des ressources dont il dispose, et à la demande d'un Etat partie, le Secrétariat technique fournit également des conseils d'experts et aide cet Etat à trouver les moyens d'exécuter ses programmes concernant la mise en place et l'amélioration d'une capacité de protection contre les armes chimiques.
6. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme portant atteinte au droit des Etats parties de demander et de fournir une assistance à titre bilatéral et de conclure des accords individuels avec d'autres Etats parties en ce qui concerne la fourniture d'urgence d'une assistance.
7. Chaque Etat partie s'engage à fournir une assistance par l'intermédiaire de l'Organisation et à prendre à cette fin une ou plusieurs des mesures suivantes, à son gré :
a) Il contribue au fonds de contributions volontaires pour l'assistance que la Conférence créera lors de sa première session ;
b) Il conclut avec l'Organisation, si possible dans les 180 jours suivant l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, des accords concernant la fourniture d'une assistance sur demande ;
c) Il déclare, au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, le type d'assistance qu'il pourrait fournir si l'Organisation lui en faisait la demande. Cependant, si l'Etat partie n'est pas à même par la suite de fournir l'assistance indiquée dans sa déclaration, il reste soumis à l'obligation de prêter son concours conformément aux dispositions du présent paragraphe.
8. Chaque Etat partie a le droit de demander et, sous réserve de la procédure énoncée aux paragraphes 9, 10 et 11, de recevoir une assistance et une protection contre l'emploi ou la menace d'armes chimiques s'il estime :
a) Que des armes chimiques ont été employées contre lui ;
b) Que des agents de lutte antiémeute ont été employés contre lui en tant que moyens de guerre ;
c) Qu'il est menacé par des actes ou des activités d'un Etat quel qu'il soit, qui sont interdits aux Etats parties en vertu de l'article premier.
9. La demande, étayée par les informations pertinentes, est adressée au Directeur général, qui la transmet immédiatement au Conseil exécutif et à tous les Etats parties. Le Directeur général fait immédiatement suivre la demande aux Etats parties qui se sont offerts, conformément aux alinéas b) et c) du paragraphe 7, à fournir des secours d'urgence en cas d'emploi d'armes chimiques ou d'agents de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre, ou une aide humanitaire en cas de menace grave d'emploi d'armes chimiques ou d'agents de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre, et qui sont susceptibles de fournir une telle assistance à l'Etat partie intéressé au plus tard 12 heures après réception de la demande. Au plus tard 24 heures après réception de la demande, le Directeur général ouvre une enquête sur laquelle reposeront les mesures à prendre par la suite. Il achève l'enquête dans les 72 heures et remet un rapport au Conseil exécutif. S'il faut davantage de temps pour achever l'enquête, un rapport intérimaire est présenté dans les mêmes délais. La prolongation accordée pour les besoins de l'enquête ne dépasse pas 72 heures. Toutefois, elle peut être étendue d'une ou plusieurs périodes de même durée. Un rapport est présenté au Conseil exécutif à l'expiration de chaque délai supplémentaire. Selon que de besoin, et conformément à la demande et aux informations qui l'accompagnent, l'enquête établit les faits pertinents pour la demande ainsi que la nature et la portée de l'assistance supplémentaire et de la protection requises.
10. Au plus tard 24 heures après avoir reçu un rapport sur les résultats de l'enquête, le Conseil exécutif se réunit afin d'examiner la situation et prend, dans les 24 heures qui suivent, une décision à la majorité simple afin de déterminer si le Secrétariat technique doit être chargé de fournir une assistance supplémentaire. Le Secrétariat technique transmet immédiatement à tous les Etats parties et aux organisations internationales pertinentes le rapport d'enquête et la décision prise par le Conseil exécutif. Si le Conseil exécutif se prononce pour une assistance, le Directeur général la fournit immédiatement. A cet effet, le Directeur général peut coopérer avec l'Etat partie requérant, d'autres Etats parties et les organisations internationales pertinentes. Les Etats parties font tout leur possible pour fournir une assistance.
11. Si les informations recueillies pendant l'enquête ou provenant d'autres sources dignes de foi donnent la preuve suffisante de l'existence de victimes d'un emploi d'armes chimiques et qu'il est indispensable d'agir immédiatement, le Directeur général le fait savoir à tous les Etats parties et prend des mesures d'assistance d'urgence en utilisant les ressources que la Conférence a mises à sa disposition pour de tels cas d'urgence. Le Directeur général tient le Conseil exécutif informé des mesures prises conformément au présent paragraphe.
ARTICLE XI : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TECHNOLOGIQUE
1. Les dispositions de la présente Convention sont appliquées de manière à éviter d'entraver le développement économique ou technologique des Etats parties et la coopération internationale dans le domaine des activités chimiques à des fins non interdites par la Convention, y compris l'échange international d'informations scientifiques et techniques, de produits chimiques et de matériel pour la fabrication, le traitement ou l'utilisation de produits chimiques à des fins non interdites par la Convention.
2. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, et sans préjudice des principes et des règles applicables du droit international, les Etats parties :
a) Ont le droit, individuellement ou collectivement, de se livrer à des recherches sur des produits chimiques et de mettre au point, de fabriquer, d'acquérir, de conserver, de transférer et d'utiliser de tels produits ;
b) S'engagent à faciliter l'échange le plus complet possible de produits chimiques, de matériel et d'informations scientifiques et techniques touchant le développement et l'application de la chimie à des fins non interdites par la présente Convention, et ont le droit de participer à un tel échange ;
c) N'appliquent pas entre eux de restrictions incompatibles avec les obligations qu'ils ont contractées en vertu de la présente Convention - ni même celles qui figureraient dans des accords internationaux -, qui imposeraient des limites ou feraient obstacle au commerce ou au développement et à la promotion des connaissances scientifiques et techniques dans le domaine de la chimie à des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins médicales, pharmaceutiques ou d'autres fins pacifiques ;
d) Ne s'autorisent pas de la présente Convention pour appliquer des mesures autres que celles qui sont prévues ou permises par la Convention et ne s'autorisent d'aucun autre accord international pour poursuivre un objectif incompatible avec la présente Convention ;
e) S'engagent à revoir leur réglementation nationale en matière de commerce des produits chimiques pour la rendre compatible avec l'objet et le but de la présente Convention.
ARTICLE XII : MESURES PROPRES A REDRESSER UNE SITUATION ET A GARANTIR LE RESPECT DE LA PRESENTE CONVENTION, Y COMPRIS LES SANCTIONS
1. La Conférence prend, ainsi qu'il est prévu aux paragraphes 2, 3 et 4, les mesures nécessaires pour assurer le respect de la présente Convention et pour redresser et corriger toute situation contrevenant aux dispositions de la Convention. Lorsqu'elle envisage de telles mesures, conformément au présent paragraphe, la Conférence tient compte de toutes les informations et recommandations en la matière qui lui ont été soumises par le Conseil exécutif.
2. Dans les cas où un Etat partie auquel le Conseil exécutif a demandé de prendre des mesures propres à redresser une situation qui met en cause son respect de la Convention ne satisfait pas à cette demande dans les délais fixés, la Conférence peut, entre autres, sur recommandation du Conseil exécutif, restreindre ou suspendre les droits et privilèges dont jouit cet Etat partie au titre de la présente Convention jusqu'à ce qu'il fasse le nécessaire pour se conformer aux obligations qu'il a contractées en vertu de la Convention.
3. Dans les cas où un préjudice grave risque d'être porté à l'objet et au but de la présente Convention du fait d'activités interdites par la Convention, en particulier par l'article premier, la Conférence peut recommander aux Etats parties des mesures collectives, conformément au droit international.
4. Si la situation est particulièrement grave, la Conférence porte la question, y compris les informations et les conclusions pertinentes, à l'attention de l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies.
ARTICLE XIII : RAPPORTS AVEC D'AUTRES ACCORDS INTERNATIONAUX
Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme restreignant ou amoindrissant de quelque façon que ce soit les obligations contractées par un Etat en vertu du Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925, et en vertu de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, signée à Londres, Moscou et Washington, le 10 avril 1972.
ARTICLE XIV : REGLEMENT DES DIFFERENDS
1. Les différends qui naîtraient au sujet de l'application ou de l'interprétation de la présente Convention sont réglés suivant les dispositions pertinentes de la Convention et d'une manière conforme aux dispositions de la Charte des Nations Unies.
2. En cas de différend entre deux ou plusieurs Etats parties, ou entre un ou plusieurs Etats parties et l'Organisation, quant à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, les parties se consultent en vue de régler rapidement ce différend par la voie de négociations ou par tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris en ayant recours aux organes appropriés de la Convention et, par consentement mutuel, en saisissant la Cour internationale de Justice conformément au Statut de cette dernière. Les Etats parties en cause tiennent le Conseil exécutif informé des mesures prises.
3. Le Conseil exécutif peut contribuer au règlement d'un différend par tout moyen qu'il juge approprié, y compris en offrant ses bons offices, en invitant les Etats qui sont parties au différend à entamer le processus de règlement qu'ils ont choisi et en recommandant un délai d'exécution de toute procédure convenue.
4. La Conférence examine, quant aux différends, les points qui sont soulevés par des Etats parties ou qui sont portés à son attention par le Conseil exécutif. Si elle le juge nécessaire, la Conférence crée, conformément au paragraphe 21, alinéa f), de l'article VIII, des organes chargés de contribuer au règlement des différends ou confie cette tâche à des organes existants.
5. La Conférence et le Conseil exécutif sont habilités séparément, sous réserve de l'autorisation de l'Assemblée générale des Nations Unies, à demander à la Cour internationale de Justice de donner un avis consultatif sur tout point de droit entrant dans le cadre des activités de l'Organisation. L'Organisation conclut un accord avec l'Organisation des Nations Unies à cette fin, conformément au paragraphe 34, alinéa a), de l'article VIII.
6. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de celles de l'article IX ou des dispositions relatives aux mesures propres à redresser une situation et à garantir le respect de la présente Convention, y compris les sanctions.
ARTICLE XV : AMENDEMENTS
1. Tout Etat partie peut proposer d'apporter des amendements à la présente Convention. Tout Etat partie peut aussi proposer d'apporter des modifications, telles que spécifiées au paragraphe 4, aux annexes de la Convention. Les propositions d'amendement sont régies par la procédure énoncée aux paragraphes 2 et 3. Les propositions de modification, telles que spécifiées au paragraphe 4, sont régies par la procédure énoncée au paragraphe 5.
2. Le texte d'une proposition d'amendement est soumis au Directeur général, qui le fait tenir à tous les Etats parties et au Dépositaire. Une telle proposition ne peut être examinée que par une conférence d'amendement. Cette conférence est convoquée si un tiers au moins des Etats parties notifient au Directeur général, au plus tard 30 jours après la distribution du texte, qu'ils sont favorables à la poursuite de l'examen de la proposition. La conférence d'amendement se tient immédiatement après une session ordinaire de la Conférence, à moins que les Etats parties ne demandent la convocation d'une réunion dans un délai plus rapproché. En aucun cas une conférence d'amendement ne se tient moins de 60 jours après la distribution de la proposition d'amendement.
3. Les amendements entrent en vigueur à l'égard de tous les Etats parties 30 jours après le dépôt des instruments de ratification ou d'acceptation par tous les Etats parties visés à l'alinéa b) ci-dessous :
a) Lorsque la conférence d'amendement les a adoptés par un vote positif d'une majorité de tous les Etats parties sans vote négatif d'aucun Etat partie;
b) Lorsqu'ils ont été ratifiés ou acceptés par tous les Etats parties ayant exprimé un vote positif à la conférence d'amendement.
4. Afin de maintenir la viabilité et l'efficacité de la Convention, les dispositions des annexes sont susceptibles d'être modifiées suivant la procédure énoncée au paragraphe 5 si les modifications proposées n'ont trait qu'à des questions d'ordre administratif ou technique. Toutes les modifications apportées à l'Annexe sur les produits chimiques doivent être faites conformément au paragraphe 5. Cette procédure de modification ne s'applique ni aux sections A et C de l'Annexe sur la confidentialité, ni à la dixième partie de l'Annexe sur la vérification, ni aux définitions de la première partie de l'Annexe sur la vérification qui ont trait exclusivement aux inspections par mise en demeure.
5. Les propositions de modification visées au paragraphe 4 suivent la procédure ci-après :
a) Le texte de la proposition de modification, accompagné des informations nécessaires, est transmis au Directeur général. Tout Etat partie et le Directeur général peuvent fournir un complément d'information en vue de l'examen de la proposition. Le Directeur général transmet sans retard cette proposition et ces informations à tous les Etats parties, au Conseil exécutif et au Dépositaire;
b) Au plus tard 60 jours après réception de la proposition, le Directeur général l'examine afin de déterminer tous les effets qu'elle peut avoir sur les dispositions de la présente Convention et son application, puis communique toute information à ce sujet à tous les Etats parties et au Conseil exécutif;
c) Le Conseil exécutif étudie la proposition à la lumière de toutes les informations dont il dispose, notamment pour déterminer si elle remplit les conditions énoncées au paragraphe 4. Au plus tard 90 jours après réception de la proposition, il notifie sa recommandation, avec les explications appropriées, à tous les Etats parties pour examen. Les Etats parties en accusent réception dans un délai de dix jours;
d) Si le Conseil exécutif recommande à tous les Etats parties d'adopter la proposition, elle est considérée comme étant approuvée si aucun Etat partie ne s'oppose à ladite proposition dans les 90 jours qui suivent la réception de la recommandation. Si le Conseil exécutif recommande de rejeter la proposition, elle est considérée comme étant rejetée si aucun Etat partie ne s'oppose au rejet de la proposition dans les 90 jours qui suivent la réception de la recommandation;
e) Si une recommandation du Conseil exécutif ne recueille pas l'approbation requise aux termes de l'alinéa d), la Conférence se prononce à sa session suivante sur cette proposition quant au fond, notamment sur la question de savoir si elle remplit les conditions énoncées au paragraphe 4;
f) Le Directeur général notifie à tous les Etats parties et au Dépositaire toute décision prise en vertu du présent paragraphe;
g) Les modifications approuvées conformément à cette procédure entrent en vigueur à l'égard de tous les Etats parties 180 jours après la date à laquelle le Directeur général a donné notification de leur approbation, à moins qu'un autre délai ne soit recommandé par le Conseil exécutif ou arrêté par la Conférence.
ARTICLE XVI : DUREE ET DENONCIATION
1. La présente Convention a une durée illimitée.
2. Chaque Etat partie, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, a le droit de dénoncer la présente Convention s'il juge que des événements extraordinaires, en rapport avec l'objet de la Convention, ont compromis ses intérêts suprêmes. Il notifie cette dénonciation, avec un préavis de 90 jours, à tous les autres Etats parties, au Conseil exécutif, au Dépositaire et au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Il expose dans cette notification les événements extraordinaires qu'il considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes.
3. La dénonciation de la présente Convention n'affecte en rien le devoir des Etats de continuer à s'acquitter des obligations assumées en vertu de toutes normes pertinentes du droit international, en particulier du Protocole de Genève de 1925.
ARTICLE XVII : STATUT DES ANNEXES
Les annexes font partie intégrante de la présente Convention. Toute référence à la Convention renvoie également à ses annexes.
ARTICLE XVIII : SIGNATURE
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats avant son entrée en vigueur.
ARTICLE XIX : RATIFICATION
La présente Convention est soumise à ratification par les Etats signataires suivant la procédure prévue par leurs constitutions respectives.
ARTICLE XX : ADHESION
Tout Etat qui n'a pas signé la présente Convention avant son entrée en vigueur peut y adhérer à tout moment par la suite.
ARTICLE XXI : ENTREE EN VIGUEUR
1. La présente Convention entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour qui suit la date de dépôt du soixante-cinquième instrument de ratification, mais en aucun cas avant un délai de deux ans à compter de la date de son ouverture à la signature.
2. A l'égard des Etats dont les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés après l'entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt de ces instruments.
ARTICLE XXII : RESERVES
Les articles de la présente Convention ne peuvent pas donner lieu à des réserves. Ses annexes ne peuvent pas donner lieu à des réserves qui sont incompatibles avec son objet et son but.
ARTICLE XXIII : DEPOSITAIRE
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné par la présente disposition comme dépositaire de la Convention et, entre autres, il :
a) Notifie sans retard à tous les Etats qui ont signé la Convention ou qui y ont adhéré la date de chaque signature, la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion, la date d'entrée en vigueur de la Convention et la réception de toute autre communication;
b) Transmet aux gouvernements de tous les Etats qui ont signé la Convention ou qui y ont adhéré des copies certifiées conformes du texte de la Convention;
c) Enregistre la présente Convention conformément aux dispositions de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.
ARTICLE XXIV : TEXTES FAISANT FOI
La présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le treizième jour du mois de janvier mil neuf cent quatre-vingt-treize.
ANNEXE SUR LES PRODUITS CHIMIQUES
A. Principes directeurs pour les tableaux de produits chimiques
B. Tableaux de produits chimiques.
Code de conduite international contre la prolifération balistique
The Subscribing States :
Reaffirming their commitment to the United Nations Charter ;
Stressing the role and responsibility of the United Nations in the field of international peace and security ;
Recalling the widespread concern about the proliferation of weapons of mass destruction and their means of delivery ;
Recognizing the increasing regional and global security challenges caused, inter alia, by the ongoing proliferation of Ballistic Missile systems capable of delivering weapons of mass destruction ;
Seeking to promote the security of all states by fostering mutual trust through the implementation of political and diplomatic measures ;
Having taken into account regional and national security considerations ;
Believing that an International Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation will contribute to the process of strengthening existing national and international security arrangements and disarmament and non-proliferation objectives and mechanisms ;
Recognising that subscribing States may wish to consider engaging in co-operative measures among themselves to this end ;
1. Adopt this International Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation (hereinafter referred to as ’the Code’) ;
2. Resolve to respect the following Principles :
a) Recognition of the need comprehensively to prevent and curb the proliferation of Ballistic Missile systems capable of delivering weapons of mass destruction and the need to continue pursuing appropriate international endeavours, including through the Code ;
b) Recognition of the importance of strengthening, and gaining wider adherence to, multilateral disarmament and non-proliferation mechanisms ;
c) Recognition that adherence to, and full compliance with, international arms control, disarmament and non-proliferation norms help build confidence as to the peaceful intentions of states ;
d) Recognition that participation in this Code is voluntary and open to all States ;
e) Confirmation of their commitment to the United Nations Declaration on International Cooperation in the Exploration and Use of Outer Space for the Benefit and in the Interest of All States taking into particular Account the Needs of Developing Countries, adopted by the United Nations General Assembly (Resolution 51/122 of 13 December 1996) ;
f) Recognition that states should not be excluded from utilising the benefits of space for peaceful purposes, but that, in reaping such benefits and in conducting related cooperation, they must not contribute to the proliferation of Ballistic Missiles capable of delivering weapons of mass destruction ;
g) Recognition that Space Launch Vehicle programmes should not be used to conceal Ballistic Missile programmes ;
h) Recognition of the necessity of appropriate transparency measures on Ballistic Missile programmes and Space Launch Vehicle programmes in order to increase confidence and to promote non-proliferation of Ballistic Missiles and Ballistic Missile technology ;
3. Resolve to implement the following General Measures :
a) To ratify, accede to or otherwise abide by :
* the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies (1967),
* the Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects (1972), and
* the Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space (1975) ;
b) To curb and prevent the proliferation of Ballistic Missiles capable of delivering weapons of mass destruction, both at a global and regional level, through multilateral, bilateral and national endeavours ;
c) To exercise maximum possible restraint in the development, testing and deployment of Ballistic Missiles capable of delivering weapons of mass destruction, including, where possible, to reduce national holdings of such missiles, in the interest of global and regional peace and security ;
d) To exercise the necessary vigilance in the consideration of assistance to Space Launch Vehicle programmes in any other country so as to prevent contributing to delivery systems for weapons of mass destruction, considering that such programmes may be used to conceal Ballistic Missile programmes ;
e) Not to contribute to, support or assist any Ballistic Missile programme in countries which might be developing or acquiring weapons of mass destruction in contravention of norms established by, and of those countries’ obligations under, international disarmament and non-proliferation treaties ;
4. Resolve to implement the following :
a) Transparency measures as follows, with an appropriate and sufficient degree of detail to increase confidence and to promote non-proliferation of Ballistic Missiles capable of delivering weapons of mass destruction :
i) With respect to Ballistic Missile programmes to :
* make an annual declaration providing an outline of their Ballistic Missile policies. Examples of openness in such declarations might be relevant information onBallistic Missile systems and land (test-) launch sites ;
* provide annual information on the number and generic class of Ballistic Missiles launched during the preceding year, as declared in conformity with the pre-launch notification mechanism referred to hereunder, in tiret iii) ;
ii) With respect to expendable Space Launch Vehicle programmes, and consistent with commercial and economic confidentiality principles, to :
* make an annual declaration providing an outline of their Space Launch Vehicle policies and land (test-) launch sites ;
* provide annual information on the number and generic class of Space Launch Vehicles launched during the preceding year, as declared in conformity with the pre-launch notification mechanism referred to hereunder, in tiret iii) ;
* consider, on a voluntary basis (including on the degree of access permitted), inviting international observers to their land (test-) launch sites ;
iii) With respect to their Ballistic Missile and Space Launch Vehicle programmes to :
* exchange pre-launch notifications on their Ballistic Missile and Space Launch Vehicle launches and test flights. These notifications should include such information as the generic class of the Ballistic Missile or Space Launch Vehicle, the planned launch notification window, the launch area and the planned direction ;
b) Subscribing States could, as appropriate and on a voluntary basis, develop bilateral or regional transparency measures, in addition to those above.
c) Implementation of the above Confidence Building Measures does not serve as justification for the programmes to which these Confidence Building Measures apply ;
5. Organisational aspects
Subscribing States determine to :
a) Hold regular meetings, annually or as otherwise agreed by Subscribing States ;
b) Take all decisions, both substantive and procedural, by a consensus of the Subscribing States present ;
c) Use these meetings to define, review and further develop the workings of the Code, including in such ways as :
* establishing procedures regarding the exchange of notifications and other information in the framework of the Code ;
* establishing an appropriate mechanism for the voluntary resolution of questions arising from national declarations, and/or questions pertaining to Ballistic Missile and/or Space Launch Vehicle programmes ;
* naming of a Subscribing State to serve as an immediate central contact for collecting and disseminating Confidence Building Measures submissions, receiving and announcing the subscription of additional States, and other tasks as agreed by Subscribing States; and
* others as may be agreed by the Subscribing States, including possible amendments to the Code.
Traité d’interdiction complète des essais nucléaires
Les Etats parties au présent Traité (ci-après dénommés les "Etats parties"),
Se félicitant des accords internationaux et autres mesures positives qui sont intervenus au cours de ces dernières années dans le domaine du désarmement nucléaire, notamment les réductions des arsenaux nucléaires, ainsi que dans le domaine de la prévention de la prolifération nucléaire sous tous ses aspects,
Soulignant l’importance de la pleine et prompte application de tels accords et mesures,
Convaincus que la situation internationale offre aujourd’hui la possibilité de prendre de nouvelles mesures pour avancer réellement dans la voie du désarmement nucléaire et pour lutter efficacement contre la prolifération des armes nucléaires sous tous ses aspects, et déclarant leur intention de prendre de telles mesures,
Soulignant par conséquent la nécessité d’efforts continus, systématiques et progressifs pour réduire les armes nucléaires à l’échelle mondiale, l’objectif final étant l’élimination de ces armes et un désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace,
Reconnaissant que la cessation de toutes les explosions expérimentales d’arme nucléaire et de toutes autres explosions nucléaires, en freinant le développement et l’amélioration qualitative des armes nucléaires et en mettant fin au développement de nouveaux types d’arme nucléaire, encore plus évolués, concourra efficacement au désarmement nucléaire et à la non-prolifération sous tous ses aspects,
Reconnaissant également que l’arrêt définitif de toutes les explosions nucléaires de cette nature constituera de ce fait un progrès significatif dans la réalisation graduelle et systématique du désarmement nucléaire,
Convaincus que le moyen le plus efficace de mettre fin aux essais nucléaires est de conclure un traité universel d’interdiction complète de ces essais qui soit internationalement et effectivement vérifiable, ce qui constitue depuis longtemps l’un des objectifs auxquels la communauté internationale accorde la priorité la plus haute dans le domaine du désarmement et de la non-prolifération,
Notant que les Parties au Traité de 1963 interdisant les essais d’armes nucléaires dans l’atmosphère, dans l’espace extra-atmosphérique et sous l’eau ont exprimé le voeu d’assurer l’arrêt de toutes les explosions expérimentales d’arme nucléaire à tout jamais,
Notant aussi les vues exprimées selon lesquelles le présent Traité pourrait contribuer à la protection de l’environnement,
Affirmant le dessein de susciter l’adhésion de tous les Etats au présent Traité et l’objectif de celui-ci de contribuer efficacement à la prévention de la prolifération des armes nucléaires sous tous ses aspects, au processus de désarmement nucléaire et partant au renforcement de la paix et de la sécurité internationales,
Sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE PREMIER : OBLIGATIONS FONDAMENTALES
1. Chaque Etat partie s’engage à ne pas effectuer d’explosion expérimentale d’arme nucléaire ou d’autre explosion nucléaire et à interdire et empêcher toute explosion de cette nature en tout lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle.
2. Chaque Etat partie s’engage en outre à s’abstenir de provoquer ou d’encourager l’exécution - ou de participer de quelque manière que ce soit à l’exécution - de toute explosion expérimentale d’arme nucléaire ou de toute autre explosion nucléaire.
ARTICLE II : L’ORGANISATION
A. DISPOSITIONS GENERALES
1. Les Etats parties établissent par les présentes l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (ci-après dénommée "l’Organisation"), afin de réaliser l’objet et le but du Traité, d’assurer l’application de ses dispositions, y compris celles qui s’appliquent à la vérification internationale du respect du Traité, et de ménager un cadre dans lequel ils puissent se consulter et coopérer entre eux.
2. Tous les Etats parties sont membres de l’Organisation. Un Etat partie ne peut être privé de sa qualité de membre de l’Organisation.
3. L’Organisation a son siège à Vienne (République d’Autriche).
4. Sont créés par les présentes la Conférence des Etats parties, le Conseil exécutif et le Secrétariat technique, lequel comprend le Centre international de données, qui constituent les organes de l’Organisation.
5. Chaque Etat partie coopère avec l’Organisation dans l’accomplissement de ses fonctions, conformément au présent Traité. Les Etats parties tiennent des consultations directement entre eux ou par l’intermédiaire de l’Organisation ou encore suivant d’autres procédures internationales appropriées, notamment des procédures établies dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies et conformément à la Charte des Nations Unies, sur toute question qui serait soulevée touchant l’objet et le but du Traité ou l’exécution de ses dispositions.
6. L’Organisation exécute les activités de vérification prévues par le présent Traité de la manière la moins intrusive possible, compatible avec l’accomplissement de leurs objectifs dans les délais et avec l’efficacité voulus. Elle ne demande que les informations et les données qui lui sont nécessaires pour s’acquitter des responsabilités qui lui sont confiées par le Traité. Elle prend toutes les précautions qui s’imposent pour protéger la confidentialité des informations relatives à des activités et des installations civiles et militaires dont elle a connaissance dans le cadre de l’application du Traité et, en particulier, elle se conforme aux dispositions de celui-ci touchant la confidentialité.
7. Chaque Etat partie traite d’une façon confidentielle et particulière les informations et les données qu’il reçoit confidentiellement de l’Organisation concernant l’application du présent Traité. Il traite ces informations et ces données exclusivement dans le cadre des droits et obligations qui sont les siens aux termes du Traité.
8. L’Organisation, en tant qu’entité indépendante, s’efforce d’utiliser selon qu’il convient les compétences techniques et les installations existantes et de maximiser le rapport coût-efficacité en prenant des arrangements de coopération avec d’autres organisations internationales telles que l’Agence internationale de l’énergie atomique. Les arrangements pris à cet effet, excepté les arrangements courants d’importance secondaire qui sont de nature purement commerciale ou contractuelle, doivent être stipulés dans des accords qui sont ensuite soumis à la Conférence des Etats parties pour approbation.
9. Les coûts des activités de l’Organisation sont couverts annuellement par les Etats parties selon le barème des quotes-parts de l’Organisation des Nations Unies, ajusté compte tenu des différences entre le nombre des Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et celui des Etats membres de l’Organisation.
10. Les contributions financières des Etats parties à la Commission préparatoire sont déduites d’une manière appropriée de leurs contributions au budget ordinaire.
11. Un membre de l’Organisation en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de celle-ci ne peut pas participer au vote à l’Organisation si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. La Conférence des Etats parties peut néanmoins autoriser ce membre à voter si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
B. CONFERENCE DES ETATS PARTIES Composition, procédure et prise de décisions
12. La Conférence des Etats parties (ci-après dénommée "la Conférence") se compose de tous les Etats parties. Chaque Etat partie a un représentant à la Conférence, qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers.
13. La session initiale de la Conférence est convoquée par le Dépositaire au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur du présent Traité.
14. La Conférence tient des sessions ordinaires, qui ont lieu chaque année, à moins qu’elle n’en décide autrement.
15. Une session extraordinaire de la Conférence est convoquée :
a) Sur décision de la Conférence;
b) A la demande du Conseil exécutif; ou
c) A la demande de tout Etat partie appuyée par la majorité des Etats parties.
La session extraordinaire est convoquée dans les 30 jours qui suivent la décision de la Conférence, la demande du Conseil exécutif ou l’obtention de l’appui requis, sauf indication contraire figurant dans la décision ou la demande.
16. La Conférence peut aussi se réunir en conférence d’amendement, conformément à l’article VII.
17. La Conférence peut aussi se réunir en conférence d’examen, conformément à l’article VIII.
18. Les sessions de la Conférence ont lieu au siège de l’Organisation, à moins que la Conférence n’en décide autrement.
19. La Conférence adopte son règlement intérieur. Au début de chaque session, elle élit son président et d’autres membres du bureau en tant que de besoin. Les membres du bureau exercent leurs fonctions jusqu’à ce qu’un nouveau président et d’autres membres soient élus, lors de la session suivante.
20. Le quorum pour la Conférence est constitué par la majorité des Etats parties.
21. Chaque Etat partie dispose d’une voix.
22. La Conférence prend les décisions relatives aux questions de procédure à la majorité des membres présents et votants. Les décisions relatives aux questions de fond doivent être prises autant que possible par consensus. S’il ne se dégage aucun consensus lorsqu’il faut se prononcer sur une telle question, le Président ajourne le vote pendant 24 heures, ne ménage aucun effort entre-temps pour faciliter l’obtention du consensus et fait rapport à la Conférence avant l’expiration du délai d’ajournement. S’il n’est pas possible d’arriver au consensus au terme de ces 24 heures, la Conférence prend la décision à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à moins que le présent Traité n’en dispose autrement. En cas de doute sur le point de savoir s’il s’agit ou non d’une question de fond, la question visée est traitée comme une question de fond, à moins qu’il n’en soit décidé autrement à la majorité requise pour les décisions sur les questions de fond.
23. Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées en vertu du paragraphe 26, alinéa k), la Conférence décide de l’inscription du nom de tout Etat sur la liste qui figure à l’Annexe 1 du présent Traité suivant la procédure énoncée au paragraphe 22 pour la prise de décisions sur les questions de fond. Nonobstant les dispositions du paragraphe 22, la Conférence décide par consensus de toute autre modification à apporter à l’Annexe 1 du Traité.
Pouvoirs et fonctions
24. La Conférence est le principal organe de l’Organisation. Elle examine, conformément au présent Traité, tous points, toutes questions et tous problèmes entrant dans le champ d’application du Traité, y compris ceux qui ont trait aux pouvoirs et fonctions du Conseil exécutif et du Secrétariat technique. Elle peut faire des recommandations et se prononcer sur tous points, toutes questions et tous problèmes entrant dans le champ d’application du Traité qui seraient soulevés par un Etat partie ou portés à son attention par le Conseil exécutif.
25. La Conférence supervise l’application du présent Traité, fait le point de la situation en ce qui concerne le respect de ses dispositions et oeuvre à la réalisation de son objet et de son but. En outre, elle supervise les activités du Conseil exécutif et du Secrétariat technique et peut adresser des directives à l’un ou l’autre de ces organes dans l’accomplissement de leurs fonctions.
26. La Conférence :
a) Examine et adopte le rapport de l’Organisation sur l’application du présent Traité ainsi que le budget-programme annuel de l’Organisation, que lui présente le Conseil exécutif, et examine d’autres rapports;
b) Décide du barème des quotes-parts revenant aux Etats parties conformément au paragraphe 9;
c) Elit les membres du Conseil exécutif;
d) Nomme le Directeur général du Secrétariat technique (ci-après dénommé le "Directeur général");
e) Examine et approuve le règlement intérieur du Conseil exécutif que lui présente ce dernier;
f) Examine et passe en revue les innovations scientifiques et techniques qui pourraient avoir des répercussions sur le fonctionnement du présent Traité. Dans ce contexte, la Conférence peut charger le Directeur général de créer un conseil scientifique consultatif qui permette à celui-ci, dans l’exercice de ses fonctions, de fournir à la Conférence, au Conseil exécutif ou aux Etats parties des avis spécialisés dans des domaines scientifiques et techniques ayant un rapport avec le Traité. Le conseil scientifique consultatif ainsi créé est composé d’experts indépendants siégeant à titre personnel et désignés conformément au mandat donné par la Conférence, sur la base de leurs compétences et de leur expérience dans les domaines scientifiques particuliers ayant un rapport avec l’application du Traité;
g) Prend les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent Traité et pour redresser et corriger toute situation qui contreviendrait aux dispositions de l’instrument, conformément à l’article V;
h) Examine et approuve à sa session initiale tous projets d’accord, d’arrangement, de disposition, de procédure, de manuel opérationnel ou de directive ainsi que tous autres documents élaborés et recommandés par la Commission préparatoire;
i) Examine et approuve les accords ou arrangements que le Secrétariat technique négocie avec des Etats parties, d’autres Etats et des organisations internationales et que le Conseil exécutif est appelé à conclure ou à prendre au nom de l’Organisation conformément au paragraphe 38, alinéa h);
j) Etablit les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires à l’accomplissement des fonctions qui lui sont attribuées par le présent Traité;
k) Met à jour l’Annexe 1 du présent Traité selon les besoins, conformément au paragraphe 23.
C. LE CONSEIL EXECUTIF Composition, procédure et prise de décisions
27. Le Conseil exécutif se compose de 51 membres. Chaque Etat partie a le droit, conformément aux dispositions du présent article, de siéger au Conseil.
28. Compte tenu de la nécessité d’une répartition géographique équitable des sièges, le Conseil exécutif comprend :
a) Dix Etats parties d’Afrique;
b) Sept Etats parties d’Europe orientale;
c) Neuf Etats parties d’Amérique latine et des Caraïbes;
d) Sept Etats parties du Moyen-Orient et d’Asie du Sud;
e) Dix Etats parties d’Amérique du Nord et d’Europe occidentale;
f) Huit Etats parties d’Asie du Sud-Est, du Pacifique et d’Extrême-Orient.
Tous les Etats des régions géographiques susmentionnées sont énumérés dans l’Annexe 1 du présent Traité. L’Annexe 1 est mise à jour par la Conférence selon les besoins, conformément au paragraphe 23 et au paragraphe 26, alinéa k). Il ne peut pas lui être apporté d’amendements ou de modifications suivant les procédures énoncées à l’article VII.
29. Les membres du Conseil exécutif sont élus par la Conférence. Pour cela, chaque groupe régional désigne des Etats parties de la région considérée aux fins de leur élection au Conseil, comme suit :
a) Au moins un tiers des sièges attribués à chaque région géographique sont pourvus, compte tenu des intérêts politiques et de sécurité, par des Etats parties de la région considérée qui sont désignés sur la base des capacités nucléaires ayant un rapport avec le Traité telles qu’elles sont déterminées par les données internationales ainsi que de l’ensemble ou d’un quelconque des critères indicatifs ci-après, dans l’ordre de priorité que fixe chaque groupe régional :
i) Le nombre d’installations de surveillance du Système de surveillance international;
ii) Les compétences et l’expérience dans les domaines que recouvrent les techniques de surveillance;
iii) La contribution au budget annuel de l’Organisation;
b) L’un des sièges attribués à chaque région géographique est pourvu suivant le principe de la rotation par l’Etat partie qui, selon l’ordre alphabétique anglais, vient en tête parmi les Etats parties de la région considérée qui n’ont pas siégé au Conseil exécutif pendant le plus grand nombre d’années à compter de la date d’expiration de leur dernier mandat ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils sont devenus parties. L’Etat partie désigné sur cette base peut décider de passer son tour, auquel cas il remet au Directeur général une lettre de renonciation; est alors désigné l’Etat partie qui occupe le deuxième rang, établi suivant les dispositions du présent alinéa;
c) Le reste des sièges attribués à chaque région géographique sont pourvus par des Etats parties désignés parmi tous ceux de la région considérée, suivant le principe de la rotation ou par des élections.
30. Chaque membre du Conseil exécutif a un représentant à cet organe, qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers.
31. Chaque membre du Conseil exécutif exerce ses fonctions de la fin de la session de la Conférence à laquelle il est élu à la fin de la deuxième session annuelle ordinaire que la Conférence tient par la suite, si ce n’est que, lors de la première élection du Conseil, 26 Etats parties seront élus qui exerceront leurs fonctions jusqu’à la fin de la troisième session annuelle ordinaire de la Conférence, compte dûment tenu des proportions numériques énoncées au paragraphe 28.
32. Le Conseil exécutif élabore son règlement intérieur et le soumet à l’approbation de la Conférence.
33. Le Conseil exécutif élit son président parmi ses membres.
34. Le Conseil exécutif tient des sessions ordinaires. Entre les sessions ordinaires, il se réunit aussi souvent que l’exige l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.
35. Chaque membre du Conseil exécutif dispose d’une voix.
36. Le Conseil exécutif prend les décisions relatives aux questions de procédure à la majorité de l’ensemble de ses membres. Il prend les décisions sur les questions de fond à la majorité des deux tiers de l’ensemble de ses membres, sauf disposition contraire du présent Traité. En cas de doute sur le point de savoir s’il s’agit ou non d’une question de fond, la question visée est traitée comme une question de fond, à moins qu’il n’en soit décidé autrement à la majorité requise pour les décisions sur les questions de fond.
Pouvoirs et fonctions
37. Le Conseil exécutif est l’organe exécutif de l’Organisation. Il relève de la Conférence. Il exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par le présent Traité. Ce faisant, il agit en conformité avec les recommandations, les décisions et les directives de la Conférence et veille à ce qu’elles soient appliquées comme il se doit et de manière suivie.
38. Le Conseil exécutif :
a) Oeuvre à l’application effective et au respect des dispositions du présent Traité;
b) Supervise les activités du Secrétariat technique;
c) Fait à la Conférence des recommandations, selon que de besoin, relatives à l’examen de nouvelles propositions visant à la réalisation de l’objet et du but du Traité;
d) Coopère avec l’autorité nationale de chaque Etat partie;
e) Examine et présente à la Conférence le projet de budget-programme annuel de l’Organisation, le projet de rapport de l’Organisation sur l’application du Traité, le rapport sur l’exécution de ses propres activités et les autres rapports qu’il juge nécessaires ou que la Conférence demanderait;
f) Prend les dispositions nécessaires pour l’organisation des sessions de la Conférence et notamment pour l’établissement du projet d’ordre du jour;
g) Examine des propositions tendant à apporter des modifications d’ordre administratif ou technique au Protocole ou à ses Annexes, en application de l’article VII, et fait aux Etats parties des recommandations concernant leur adoption;
h) Conclut au nom de l’Organisation, sous réserve de l’approbation préalable de la Conférence, les accords ou arrangements avec les Etats parties, les autres Etats et les organisations internationales, hormis ceux qui sont visés à l’alinéa i), et supervise leur application;
i) Approuve les accords ou les arrangements avec les Etats parties et les autres Etats concernant l’exécution des activités de vérification et supervise leur fonctionnement;
j) Approuve tous nouveaux manuels opérationnels que proposerait le Secrétariat technique et toutes modifications que celui-ci suggérerait d’apporter aux manuels opérationnels existants.
39. Le Conseil exécutif peut demander la tenue d’une session extraordinaire de la Conférence.
40. Le Conseil exécutif :
a) Facilite, par des échanges d’informations, la coopération entre les Etats parties, et entre les Etats parties et le Secrétariat technique, concernant l’application du présent Traité;
b) Facilite la consultation et la clarification entre les Etats parties conformément à l’article IV;
c) Reçoit et examine les demandes d’inspection sur place ainsi que les rapports d’inspection et arrête son action au sujet des premières et des seconds, conformément à l’article IV.
41. Le Conseil exécutif examine tout motif de préoccupation d’un Etat partie concernant l’inexécution possible du présent Traité et l’usage abusif des droits établis par celui-ci. Pour ce faire, il consulte les Etats parties impliqués et, selon qu’il convient, demande à un Etat partie de prendre des mesures pour redresser la situation dans des délais fixés. Pour autant que le Conseil exécutif juge nécessaire de poursuivre l’affaire, il prend notamment une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) Il informe tous les Etats parties du problème ou de la question;
b) Il porte le problème ou la question à l’attention de la Conférence;
c) Il fait à la Conférence des recommandations ou prend une décision, selon qu’il convient, touchant des mesures pour redresser la situation et assurer le respect des dispositions du Traité conformément à l’article V.
D. LE SECRETARIAT TECHNIQUE
42. Le Secrétariat technique aide les Etats parties à appliquer le présent Traité. Il aide la Conférence et le Conseil exécutif dans l’accomplissement de leurs fonctions. Le Secrétariat technique exerce les fonctions de vérification et les autres fonctions qui lui sont attribuées par le Traité ainsi que celles qui lui sont déléguées par la Conférence ou le Conseil exécutif conformément aux dispositions du Traité. Il comprend le Centre international de données, qui en fait partie intégrante.
43. En ce qui concerne la vérification du respect des dispositions du présent Traité, le Secrétariat technique, conformément à l’article IV et au Protocole, entre autres fonctions :
a) Est chargé de superviser et de coordonner l’exploitation du Système de surveillance international;
b) Exploite le Centre international de données;
c) Reçoit, traite et analyse régulièrement les données du Système de surveillance international et fait régulièrement rapport sur ces données;
d) Fournit une assistance et un appui techniques pour l’installation et l’exploitation de stations de surveillance;
e) Aide le Conseil exécutif à faciliter la consultation et la clarification entre les Etats parties;
f) Reçoit les demandes d’inspection sur place et les examine, facilite l’examen de ces demandes par le Conseil exécutif, assure la préparation des inspections sur place et fournit un soutien technique pendant qu’elles se déroulent, et fait rapport au Conseil exécutif;
g) Négocie et, sous réserve de l’approbation préalable du Conseil exécutif, conclut avec les Etats parties, les autres Etats et les organisations internationales des accords ou des arrangements concernant les activités de vérification;
h) Aide les Etats parties, par l’intermédiaire de leur autorité nationale, relativement à d’autres problèmes que pose la vérification de l’exécution du Traité.
44. Le Secrétariat technique élabore et tient à jour, sous réserve de l’approbation du Conseil exécutif, des manuels opérationnels conçus pour guider l’exploitation des diverses composantes du régime de vérification, conformément à l’article IV et au Protocole. Lesdits manuels ne font pas partie intégrante du Traité ni du Protocole et peuvent être modifiés par le Secrétariat technique, sous réserve de l’approbation du Conseil exécutif. Le Secrétariat technique informe sans retard les Etats parties de tous changements apportés aux manuels opérationnels.
45. En ce qui concerne les questions d’ordre administratif, le Secrétariat technique, entre autres fonctions :
a) Etablit et présente au Conseil exécutif le projet de budget-programme de l’Organisation;
b) Etablit et présente au Conseil exécutif le projet de rapport
c) de l’Organisation sur l’application du Traité et tous autres rapports que la Conférence ou le Conseil exécutif demanderaient;
d) Fournit un appui administratif et technique à la Conférence, au Conseil exécutif et aux organes subsidiaires;
e) Adresse et reçoit au nom de l’Organisation des communications portant sur l’application du Traité;
f) Accomplit les tâches administratives en rapport avec tous accords conclus entre l’Organisation et d’autres organisations internationales.
46. Toutes les demandes et notifications adressées à l’Organisation par les Etats parties sont envoyées au Directeur général par l’intermédiaire des autorités nationales. Les demandes et notifications doivent être rédigées dans l’une des langues officielles du Traité. La réponse du Directeur général est formulée dans la même langue.
47. Aux fins de l’établissement du projet de budget-programme de l’Organisation et de la présentation de celui-ci au Conseil exécutif, le Secrétariat technique arrête et tient une comptabilité claire de tous les coûts afférents à chaque installation du Système de surveillance international. Il procède d’une manière analogue pour toutes les autres activités de l’Organisation qui sont reflétées dans le projet de budget-programme.
48. Le Secrétariat technique informe sans retard le Conseil exécutif de tous problèmes qu’il a pu rencontrer dans l’exercice de ses fonctions qu’il a constatés dans l’exécution de ses activités et qu’il n’a pu lever par des consultations avec l’Etat partie intéressé.
49. Le Secrétariat technique comprend un directeur général, qui en est le chef et en dirige l’administration, ainsi qu’un personnel scientifique, technique et autre, selon les besoins. Le Directeur général est nommé par la Conférence sur recommandation du Conseil exécutif pour quatre ans; son mandat peut être renouvelé une seule fois. Le premier directeur général est nommé par la Conférence à sa session initiale sur la recommandation de la Commission préparatoire.
50. Le Directeur général est chargé de la nomination des membres du personnel ainsi que de l’organisation et du fonctionnement du Secrétariat technique, et en répond auprès de la Conférence et du Conseil exécutif. La considération dominante dans le recrutement et la définition des conditions d’emploi du personnel est la nécessité d’assurer les plus hautes qualités de connaissance professionnelle, d’expérience, d’efficacité, de compétence et d’intégrité. Seuls des nationaux des Etats parties peuvent être nommés directeur général ou engagés comme inspecteurs, cadres ou employés d’administration. Est dûment prise en considération l’importance d’un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible. Aux fins du recrutement, il est tenu compte du principe suivant lequel les effectifs doivent être maintenus au minimum nécessaire pour que le Secrétariat technique puisse s’acquitter convenablement de ses responsabilités.
51. Le Directeur général peut, après consultation du Conseil exécutif, établir à titre temporaire et selon que de besoin des groupes de travail d’experts scientifiques pour faire des recommandations concernant des problèmes particuliers.
52. Dans l’exercice de leurs fonctions, le Directeur général, les inspecteurs, les assistants d’inspection et les membres du personnel ne sollicitent ni ne reçoivent d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre entité extérieure à l’Organisation. Ils s’abstiennent de tout acte qui pourrait nuire à leur statut de fonctionnaires internationaux relevant uniquement de l’Organisation. Le Directeur général assume la responsabilité des activités d’une équipe d’inspection.
53. Chaque Etat partie respecte le caractère exclusivement international des responsabilités confiées au Directeur général, aux inspecteurs, aux assistants d’inspection et aux membres du personnel et ne cherche pas à les influencer dans l’accomplissement de leurs fonctions.
E. PRIVILEGES ET IMMUNITES
54. L’Organisation jouit, sur le territoire et en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d’un Etat partie, de la capacité juridique et des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions.
55. Les représentants des Etats parties ainsi que leurs suppléants et conseillers, les représentants des membres élus au Conseil exécutif ainsi que leurs suppléants et conseillers, le Directeur général, les inspecteurs, les assistants d’inspection et les membres du personnel de l’Organisation jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l’Organisation.
56. La capacité juridique et les privilèges et immunités mentionnés dans le présent article sont définis dans des accords entre l’Organisation et les Etats parties ainsi que dans un accord entre l’Organisation et le pays dans lequel est situé le siège de l’Organisation. Ces accords sont examinés et approuvés conformément au paragraphe 26, alinéas h) et i).
57. Nonobstant les paragraphes 54 et 55, le Directeur général, les inspecteurs, les assistants d’inspection et les membres du personnel du Secrétariat technique jouissent, durant l’exécution des activités de vérification, des privilèges et immunités énoncés dans le Protocole.
ARTICLE III : MESURES D’APPLICATION NATIONALES
1. Chaque Etat partie prend, conformément aux procédures prévues par sa Constitution, toutes mesures requises pour s’acquitter des obligations qu’il a contractées en vertu du présent Traité. En particulier, il fait le nécessaire :
a) Pour interdire aux personnes physiques et morales se trouvant en quelque lieu de son territoire ou en tout autre lieu placé sous sa juridiction telle qu’elle est reconnue par le droit international d’entreprendre quelque activité que ce soit qui est interdite à un Etat partie par le présent Traité;
b) Pour interdire aux personnes physiques et morales d’entreprendre quelque activité de cette nature en quelque lieu qui soit placé sous son contrôle;
c) Pour interdire aux personnes physiques possédant sa nationalité, conformément au droit international, d’entreprendre quelque activité de cette nature en quelque lieu que ce soit.
2. Chaque Etat partie coopère avec les autres Etats parties et procure l’assistance juridique voulue pour faciliter l’exécution des obligations énoncées au paragraphe 1.
3. Chaque Etat partie informe l’Organisation des mesures qu’il a prises en application du présent article.
4. Afin de s’acquitter des obligations qu’il a contractées en vertu du Traité, chaque Etat partie désigne ou établit une autorité nationale et en avise l’Organisation au moment où le Traité entre en vigueur à son égard. L’autorité nationale sert de centre national en vue d’assurer la liaison avec l’Organisation et les autres Etats parties.
ARTICLE IV : VERIFICATION
A. DISPOSITIONS GENERALES
1. Afin de vérifier le respect des dispositions du présent Traité, il est établi un régime de vérification qui s’appuie sur les éléments suivants :
a) Un système de surveillance international;
b) La consultation et la clarification;
c) Les inspections sur place;
d) Les mesures de confiance.
A l’entrée en vigueur du Traité, le régime de vérification est capable de satisfaire à ses exigences concernant la vérification.
2. Les activités de vérification sont fondées sur des informations objectives, sont limitées à l’objet du présent Traité et sont menées dans le plein respect de la souveraineté des Etats parties et de la manière la moins intrusive possible, compatible avec la réalisation de leurs objectifs dans les délais et avec l’efficacité voulus. Chaque Etat partie s’abstient d’abuser de quelque façon que ce soit du droit de vérification.
3. Chaque Etat partie s’engage, conformément au présent Traité, à coopérer, par l’entremise de l’autorité nationale établie en application du paragraphe 4 de l’article III, avec l’Organisation et d’autres Etats parties afin de faciliter la vérification du respect du Traité, notamment :
a) En créant les dispositifs nécessaires pour participer à ces mesures de vérification et en établissant les communications nécessaires;
b) En fournissant les données obtenues des stations nationales intégrées au Système de surveillance international;
c) En participant, selon qu’il convient, à un processus de consultation et de clarification;
d) En autorisant les inspections sur place;
e) En participant, selon qu’il convient, à des mesures de confiance.
4. Quels que soient leurs moyens techniques et financiers, les Etats parties
ont tous, dans des conditions d’égalité, un droit de vérification et l’obligation d’accepter la vérification.
5. Aux fins du présent Traité, il n’est interdit à aucun Etat partie d’utiliser l’information obtenue par les moyens techniques nationaux de vérification d’une manière compatible avec les principes généralement reconnus du droit international, y compris celui du respect de la souveraineté des Etats.
6. Sans préjudice du droit des Etats parties à protéger des installations, des activités ou des lieux sensibles sans rapport avec le présent Traité, les Etats parties ne font pas obstacle à des éléments du régime de vérification du Traité ni aux moyens techniques nationaux de vérification qui sont exploités conformément au paragraphe 5.
7. Chaque Etat partie a le droit de prendre des mesures pour protéger des installations sensibles et empêcher la divulgation d’informations et de données confidentielles sans rapport avec le présent Traité.
8. En outre, toutes les mesures voulues sont prises pour protéger la confidentialité de toute information concernant les activités et les installations civiles et militaires qui a été obtenue au cours des activités de vérification.
9. Sous réserve du paragraphe 8, les informations obtenues par l’Organisation dans le cadre du régime de vérification établi par le présent Traité sont mises à la disposition de tous les Etats parties conformément aux dispositions pertinentes du Traité et du Protocole.
10. Les dispositions du présent Traité ne doivent pas être interprétées comme restreignant l’échange international de données à des fins scientifiques.
11. Chaque Etat partie s’engage à coopérer avec l’Organisation et d’autres Etats parties à l’amélioration du régime de vérification et à l’étude des possibilités qu’offrent d’autres techniques de surveillance sur le plan de la vérification, comme la détection de l’impulsion électromagnétique ou la surveillance par satellite, en vue de mettre au point, le cas échéant, des mesures spécifiques visant à renforcer l’efficacité et la rentabilité des opérations de vérification de l’exécution du Traité. Lorsqu’elles sont convenues, ces mesures sont incorporées dans les dispositions existantes du Traité et dans celles du Protocole ou font l’objet de nouvelles sections du Protocole, conformément à l’article VII, ou encore, s’il y a lieu, sont reflétées dans les manuels opérationnels conformément au paragraphe 44 de l’article II.
12. Les Etats parties s’engagent à promouvoir une coopération entre eux-mêmes pour aider et participer à l’échange le plus complet possible concernant les technologies utilisées dans la vérification du présent Traité afin de permettre à tous les Etats parties de renforcer leur mise en oeuvre nationale des mesures de vérification et de bénéficier de l’application de ces technologies à des fins pacifiques.
13. Les dispositions du présent Traité doivent être mises en oeuvre de façon à éviter d’entraver le développement économique et technologique des Etats parties en vue du développement des applications de l’énergie atomique à des fins pacifiques.
Tâches du Secrétariat technique en matière de vérification
14. Pour s’acquitter de ses tâches en matière de vérification telles qu’elles sont spécifiées dans le présent Traité et le Protocole, le Secrétariat technique, en coopération avec les Etats parties et pour les besoins du Traité :
a) Prend des arrangements pour recevoir et distribuer les données et rapports intéressant la vérification de l’exécution du Traité, conformément à celui-ci, et pour disposer d’une infrastructure de télécommunications mondiale adaptée à cette tâche ;
b) Dans le cadre de ses activités régulières et par l’intermédiaire de son Centre international de données, qui est en principe l’élément central du Secrétariat technique pour le stockage des données et le traitement des données :
i) Reçoit et présente des demandes de données issues du Système de surveillance international ;
ii) Reçoit, selon qu’il convient, les données résultant du processus de consultation et de clarification, des inspections sur place et des mesures de confiance ;
iii) Reçoit d’autres données pertinentes des Etats parties et des organisations internationales conformément au Traité et au Protocole ;
c) Supervise, coordonne et assure l’exploitation du Système de surveillance international et de ses composantes, ainsi que du Centre international de données, conformément aux manuels opérationnels pertinents ;
d) Dans le cadre de ses activités régulières, traite et analyse les données issues du Système de surveillance international et fait rapport à leur sujet selon les procédures convenues, afin de permettre une vérification internationale efficace de l’exécution du Traité et de faciliter la dissipation rapide des préoccupations quant au respect des dispositions du Traité ;
e) Met toutes les données, tant brutes que traitées, ainsi que tous rapports établis, à la disposition de tous les Etats parties, chaque Etat partie prenant la responsabilité de l’usage des données du Système de surveillance international conformément au paragraphe 7 de l’article II, et aux paragraphes 8 et 13 de cet article ;
f) Assure à tous les Etats parties, dans des conditions d’égalité et à temps, un accès libre et commode à toutes les données stockées ;
g) Stocke toutes les données, tant brutes que traitées, ainsi que tous les documents et rapports ;
h) Coordonne et facilite les demandes de données supplémentaires issues du Système de surveillance international ;
i) Coordonne les demandes de données supplémentaires adressées par un Etat partie à un autre Etat partie ;
j) Fournit à l’Etat qui les requiert une assistance et un appui techniques pour l’installation et l’exploitation des installations de surveillance et des moyens de communication correspondants ;
k) Met à la disposition de tout Etat partie qui le demande les techniques que lui-même et son centre international de données utilisent pour rassembler, stocker, traiter et analyser les données recueillies dans le cadre du régime de vérification et faire rapport à leur sujet ;
l) Surveille et évalue le fonctionnement global du Système de surveillance international et du Centre international de données et fait rapport à ce sujet.
15. Les procédures convenues que doit suivre le Secrétariat technique pour s’acquitter des tâches de vérification visées au paragraphe 14 et détaillées dans le Protocole sont précisées dans les manuels opérationnels pertinents.
B. LE SYSTEME DE SURVEILLANCE INTERNATIONAL
16. Le Système de surveillance international comprend des installations pour la surveillance sismologique, pour la surveillance des radionucléides, y compris des laboratoires homologués, pour la surveillance hydroacoustique et pour la surveillance par détection des infrasons, ainsi que les moyens de communication correspondants; il est appuyé par le Centre international de données du Secrétariat technique.
17. Le Système de surveillance international est placé sous l’autorité du Secrétariat technique. Toutes les installations de surveillance de ce système sont la propriété des Etats qui en sont les hôtes ou en assument la responsabilité d’une autre manière et sont exploitées par eux, conformément au Protocole.
18. Chaque Etat partie a le droit de participer à l’échange international de données et d’avoir accès à toutes les données mises à la disposition du Centre international de données. Chaque Etat partie coopère avec le Centre international de données par l’entremise de son autorité nationale.
Financement du Système de surveillance international
19. En ce qui concerne les installations incorporées dans le Système de surveillance international et inscrites aux tableaux 1-A, 2-A, 3 et 4 de l’Annexe 1 du Protocole ainsi que leur fonctionnement, dans la mesure où l’Etat concerné et l’Organisation sont convenus qu’elles fourniraient des données au Centre international de données conformément aux exigences techniques énoncées dans le Protocole et les manuels pertinents, l’Organisation, comme il est spécifié dans les accords conclus ou les arrangements pris en application du paragraphe 4 de la première partie du Protocole, prend à sa charge le coût des opérations suivantes :
a) L’établissement de toutes nouvelles installations et la mise à niveau des installations existantes à moins que l’Etat qui en est responsable ne prenne lui-même à sa charge les coûts correspondants ;
b) L’exploitation et l’entretien des installations du Système de surveillance international, y compris le maintien de leur sécurité matérielle, le cas échéant, et l’application des procédures convenues d’authentification des données ;
c) La transmission des données (brutes ou traitées) issues du Système de surveillance international au Centre international de données par les moyens les plus directs et les plus rentables disponibles, notamment, si nécessaire, via des noeuds de communication appropriés, à partir des stations de surveillance, des laboratoires, des installations d’analyse ou des centres nationaux de données; ou la transmission de ces données (y compris des échantillons, le cas échéant) aux laboratoires et installations d’analyse à partir des installations de surveillance ;
d) L’analyse d’échantillons pour le compte de l’Organisation.
20. En ce qui concerne les stations sismiques du réseau auxiliaire inscrites au tableau 1-B de l’Annexe 1 du Protocole, l’Organisation, comme il est spécifié dans les accords conclus ou les arrangements pris en application du paragraphe 4 de la première partie du Protocole, ne prend à sa charge que le coût des opérations suivantes :
a) La transmission des données au Centre international de données ;
b) L’authentification des données provenant de ces stations ;
c) La mise à niveau des stations afin que celles-ci satisfassent aux normes techniques requises, à moins que l’Etat qui en est responsable ne prenne lui-même à sa charge les coûts correspondants ;
d) Si nécessaire, l’établissement de nouvelles stations aux fins du Traité là où il n’en existe pas encore qui conviennent, à moins que l’Etat qui est appelé à en être responsable ne prenne lui-même à sa charge les coûts correspondants ;
e) Toutes autres dépenses relatives à la fourniture des données requises par l’Organisation comme il est spécifié dans les manuels opérationnels pertinents.
21. En outre, l’Organisation prend à sa charge le coût de la fourniture, à chaque Etat partie, des rapports et services que celui-ci a choisis dans la gamme standard du Centre international de données, conformément à la section F de la première partie du Protocole. Le coût de la préparation et de la transmission de tous produits ou données supplémentaires est à la charge de l’Etat partie qui les demande.
22. Les accords conclus ou, le cas échéant, les arrangements pris avec des Etats parties ou avec les Etats qui sont les hôtes d’installations du Système de surveillance international ou en assument la responsabilité d’une autre manière contiennent des dispositions relatives à la prise en charge de ces coûts. Ces dispositions peuvent prévoir des modalités au titre desquelles un Etat partie prend à sa charge une partie quelconque des coûts visés au paragraphe 19, alinéa a), et au paragraphe 20, alinéas c) et d), pour des installations dont il est l’hôte ou dont il est responsable et bénéficie en échange d’une réduction appropriée de la contribution financière qu’il doit à l’Organisation. Le montant de cette réduction ne peut pas être supérieur à la moitié de celui de la contribution financière annuelle due par cet Etat, mais peut être réparti sur plusieurs années consécutives. Un Etat partie peut partager une telle réduction avec un autre Etat partie par accord ou arrangement avec celui-ci et avec l’assentiment du Conseil exécutif.
Les accords ou arrangements visés au présent paragraphe sont approuvés conformément au paragraphe 26, alinéa h), et au paragraphe 38, alinéa i), de l’article II.
Modifications apportées au Système de surveillance international
23. Toute mesure visée au paragraphe 11 qui a une incidence sur le Système de surveillance international du fait qu’elle consiste à compléter celui-ci par d’autres techniques de surveillance ou à éliminer une ou plusieurs des techniques utilisées est incorporée, une fois convenue, dans les dispositions du présent Traité et du Protocole suivant la procédure énoncée aux paragraphes 1 à 6 de l’article VII.
24. Les modifications suivantes qu’il serait proposé d’apporter au Système de surveillance international sont considérées, sous réserve de l’accord des Etats directement visés, comme se rapportant à des questions d’ordre administratif ou technique aux fins des paragraphes 7 et 8 de l’article VII :
a) Les modifications du nombre d’installations utilisant une technique de surveillance donnée, tel qu’il est fixé dans le Protocole ;
b) Les modifications à apporter à d’autres indications concernant une installation donnée, telles qu’elles figurent dans les tableaux de l’Annexe 1 du Protocole (notamment l’Etat responsable de l’installation, l’emplacement de l’installation, son nom ou son type, ainsi que son affectation au réseau sismologique primaire ou auxiliaire).
En principe, s’il recommande, conformément au paragraphe 8, alinéa d), de l’article VII, que de telles modifications soient adoptées, le Conseil exécutif recommande également que ces modifications entrent en vigueur dès que le Directeur général a donné notification de leur approbation, conformément au paragraphe 8, alinéa g), de cet article.
25. En ce qui concerne toute proposition visée au paragraphe 24, le Directeur
général remet au Conseil exécutif et aux Etats parties, outre les informations
et l’évaluation prévues au paragraphe 8, alinéa b), de l’article VII :
a) Une évaluation technique de la proposition ;
b) Un état des incidences administratives et financières de la proposition ;
c) Un rapport sur les consultations qu’il a tenues avec les Etats directement visés par la proposition, où est indiqué notamment l’accord éventuel de ceux-ci.
Arrangements provisoires
26. En cas de panne importante dans une installation de surveillance inscrite aux tableaux de l’Annexe 1 du Protocole ou de détérioration irrémédiable d’une telle installation, ou encore afin de compenser la réduction temporaire du champ couvert par les installations de surveillance, le Directeur général prend, après consultation et avec l’accord des Etats directement visés ainsi qu’avec l’approbation du Conseil exécutif, des arrangements provisoires qui ne durent pas au-delà d’une année, mais qui peuvent être reconduits une seule fois au besoin, avec l’accord du Conseil exécutif et des Etats directement visés.
Le nombre d’installations du Système de surveillance international en exploitation ne doit pas, du fait de tels arrangements, dépasser le chiffre fixé pour le réseau considéré. De tels arrangements satisfont autant que faire se peut aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans le manuel opérationnel pour le réseau en question; ils sont exécutés sans dépassement des crédits budgétaires de l’Organisation. En outre, le Directeur général prend des mesures afin de redresser la situation et fait des propositions en vue de la régler définitivement. Il notifie à tous les Etats parties toute décision prise conformément au présent paragraphe.
Installations nationales coopérantes
27. Les Etats parties peuvent aussi prendre séparément des arrangements de coopération avec l’Organisation afin de mettre à la disposition du Centre international de données des données complémentaires provenant de stations de surveillance nationales qui ne font pas officiellement partie du Système de surveillance international.
28. Ces arrangements de coopération peuvent être établis comme suit :
a) Sur demande d’un Etat partie et aux frais de celui-ci, le Secrétariat technique fait le nécessaire pour certifier qu’une installation de surveillance donnée satisfait aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans les manuels opérationnels pertinents pour les installations du Système de surveillance international et prend des dispositions pour l’authentification de ses données. Sous réserve de l’accord du Conseil exécutif, il désigne alors officiellement cette installation comme installation nationale coopérante. Il fait le nécessaire pour reconfirmer, s’il y a lieu, sa certification ;
b) Le Secrétariat technique tient à jour une liste des installations nationales coopérantes et la communique à tous les Etats parties ;
c) Si un Etat partie le lui demande, le Centre international de données a recours aux données provenant d’installations nationales coopérantes pour faciliter les consultations et la clarification ainsi que l’examen des demandes d’inspection sur place, les coûts de transmission des données étant pris en charge par ledit Etat partie.
Les conditions dans lesquelles les données complémentaires provenant de ces installations sont mises à la disposition du Centre et dans lesquelles celui-ci peut demander communication de telles données ou leur transmission accélérée ou une clarification sont précisées dans le manuel opérationnel pour le réseau de surveillance correspondant.
C. CONSULTATION ET CLARIFICATION
29. Sans préjudice du droit de tout Etat partie de demander une inspection sur place, les Etats parties devraient, chaque fois que possible, commencer par tout mettre en oeuvre pour clarifier et régler entre eux ou avec l’Organisation ou encore par l’intermédiaire de celle-ci toute question qui susciterait des préoccupations au sujet d’une inexécution possible des obligations fondamentales établies par le présent Traité.
30. L’Etat partie qui reçoit directement d’un autre Etat partie une demande en application du paragraphe 29 fournit des éclaircissements à l’Etat partie requérant dès que possible et en tout état de cause au plus tard 48 heures après réception de la demande. L’Etat partie requérant et l’Etat partie requis peuvent tenir le Conseil exécutif et le Directeur général informés de la demande et de la suite qui y a été donnée.
31. L’Etat partie a le droit de demander au Directeur général de l’aider à clarifier toute question qui susciterait des préoccupations au sujet d’une inexécution possible des obligations fondamentales établies par le présent Traité. Le Directeur général fournit les informations pertinentes que le Secrétariat technique possède à ce sujet. Il fait part au Conseil exécutif de la demande, ainsi que des informations fournies pour y donner suite, si l’Etat partie requérant le demande.
32. L’Etat partie a le droit de demander au Conseil exécutif d’obtenir d’un autre Etat partie une clarification de toute question qui susciterait des préoccupations au sujet d’une inexécution possible des obligations fondamentales établies par le présent Traité. En pareil cas, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) Le Conseil exécutif transmet la demande de clarification à l’Etat partie requis par l’intermédiaire du Directeur général au plus tard 24 heures après sa réception ;
b) L’Etat partie requis fournit des éclaircissements au Conseil exécutif dès que possible et en tout état de cause au plus tard 48 heures après réception de la demande ;
c) Le Conseil exécutif prend note des éclaircissements et les transmet à l’Etat partie requérant au plus tard 24 heures après leur réception ;
d) S’il juge ces éclaircissements insuffisants, l’Etat partie requérant a le droit de demander au Conseil exécutif d’obtenir de l’Etat partie requis des précisions supplémentaires.
Le Conseil exécutif informe sans retard tous les autres Etats parties de toute demande de clarification faite conformément au présent paragraphe ainsi que de toute réponse apportée par l’Etat partie requis.
33. Si l’Etat partie requérant estime que les précisions obtenues au titre du paragraphe 32, alinéa d), ne sont pas satisfaisantes, il a le droit de demander la convocation d’une réunion du Conseil exécutif, à laquelle les Etats parties impliqués qui ne sont pas membres du Conseil exécutif ont le droit de participer. A cette réunion, le Conseil exécutif examine la question et peut recommander toute mesure prévue à l’article V.
D. INSPECTIONS SUR PLACE
Demande d’inspection sur place
34. Chaque Etat partie a le droit, conformément aux dispositions du présent article et à la deuxième partie du Protocole, de demander une inspection sur place sur le territoire ou en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de tout autre Etat partie, ou dans une zone ne relevant de la juridiction ou du contrôle d’aucun Etat.
35. L’inspection sur place a pour seul but de déterminer si une explosion expérimentale d’arme nucléaire ou toute autre explosion nucléaire a été réalisée en violation des dispositions de l’article premier et, dans la mesure du possible, de recueillir toutes données factuelles susceptibles de concourir à l’identification d’un contrevenant éventuel.
36. L’Etat partie requérant est tenu de veiller à ce que la demande d’inspection sur place ne sorte pas du cadre du présent Traité et de fournir dans cette demande les renseignements visés au paragraphe 37. Il s’abstient de demandes d’inspection sans fondement ou abusives.
37. La demande d’inspection sur place repose sur les données recueillies par le Système de surveillance international, sur tous renseignements techniques pertinents obtenus d’une manière conforme aux principes de droit international généralement reconnus par des moyens de vérification techniques nationaux, ou sur une combinaison de ces deux types d’informations. La demande d’inspection sur place contient les renseignements visés au paragraphe 41 de la deuxième partie du Protocole.
38. L’Etat partie requérant présente sa demande d’inspection sur place au Conseil exécutif et, simultanément, au Directeur général afin que ce dernier y donne immédiatement suite.
Suite donnée à la demande d’inspection sur place
39. Le Conseil exécutif commence son examen dès réception de la demande
d’inspection sur place.
40. Le Directeur général accuse réception de la demande d’inspection sur place adressée par l’Etat partie requérant dans les deux heures et transmet celle-ci dans les six heures à l’Etat partie dont on requiert l’inspection. Il s’assure que la demande satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 41 de la deuxième partie du Protocole et aide au besoin l’Etat partie requérant à présenter la demande en conséquence; il transmet celle-ci au Conseil exécutif et à tous les autres Etats parties dans les 24 heures.
41. Lorsque la demande d’inspection satisfait à ces conditions, le Secrétariat technique commence sans tarder les préparatifs de l’inspection sur place.
42. Lorsqu’il reçoit une demande d’inspection sur place visant une zone placée sous la juridiction ou le contrôle d’un Etat partie, le Directeur général demande immédiatement une clarification à ce dernier en vue d’élucider les faits et de dissiper les préoccupations qui sont exprimées dans la demande.
43. L’Etat partie qui reçoit une demande de clarification en application du paragraphe 42 fournit au Directeur général des explications et tous autres éléments d’information pertinents disponibles dès que possible et au plus tard 72 heures après réception de ladite demande.
44. Avant que le Conseil exécutif ne se prononce sur la demande d’inspection sur place, le Directeur général lui transmet immédiatement tous renseignements supplémentaires disponibles auprès du Système de surveillance international ou fournis par un Etat partie quel qu’il soit au sujet de l’événement indiqué dans la demande, notamment tous éclaircissements fournis conformément aux paragraphes 42 et 43, ainsi que toutes autres informations provenant du Secrétariat technique qu’il juge utiles ou qui sont demandées par le Conseil exécutif.
45. A moins que l’Etat partie requérant ne considère que les préoccupations exprimées dans la demande d’inspection sur place ont été dissipées et ne retire celle-ci, le Conseil exécutif se prononce sur la demande conformément au paragraphe 46.
Décisions du Conseil exécutif
46. 46. Le Conseil exécutif se prononce sur la demande d’inspection sur place au plus tard 96 heures après l’avoir reçue de l’Etat partie requérant. Il prend la décision d’approuver l’inspection sur place par 30 voix au moins. Si le Conseil exécutif n’approuve pas l’inspection, les préparatifs sont interrompus et il n’est donné aucune autre suite à la demande.
47. Au plus tard 25 jours après que l’inspection sur place a été approuvée conformément au paragraphe 46, l’équipe d’inspection fait rapport au Conseil exécutif par l’intermédiaire du Directeur général sur la marche de l’inspection. La poursuite de l’inspection est réputée approuvée à moins que le Conseil exécutif, au plus tard 72 heures après réception du rapport intérimaire, décide à la majorité de l’ensemble de ses membres que l’inspection ne doit pas continuer. Si le Conseil exécutif décide qu’elle ne doit pas continuer, il y est mis fin et l’équipe d’inspection quitte la zone d’inspection et le territoire de l’Etat partie inspecté, dès que faire se peut conformément aux paragraphes 109 et 110 de la deuxième partie du Protocole.
48. Au cours de l’inspection sur place, l’équipe d’inspection peut proposer au Conseil exécutif par l’intermédiaire du Directeur général d’effectuer des forages. Le Conseil exécutif se prononce sur une telle proposition au plus tard 72 heures après l’avoir reçue. Il prend la décision d’approuver des forages à la majorité de l’ensemble de ses membres.
49. L’équipe d’inspection peut demander au Conseil exécutif par l’intermédiaire du Directeur général de prolonger l’inspection de 70 jours au maximum au-delà du délai de 60 jours fixé au paragraphe 4 de la deuxième partie du Protocole, si elle juge que cela est indispensable à l’exécution de son mandat. L’équipe d’inspection indique dans sa demande celles des activités et techniques énumérées au paragraphe 69 de la deuxième partie du Protocole qu’elle entend mener ou mettre en oeuvre pendant la période de prolongation. Le Conseil exécutif se prononce sur la demande de prolongation au plus tard 72 heures après l’avoir reçue. Il prend la décision d’approuver une prolongation de l’inspection à la majorité de l’ensemble de ses membres.
50. A tout moment après que la poursuite de l’inspection sur place a été approuvée conformément au paragraphe 47, l’équipe d’inspection peut recommander au Conseil exécutif par l’intermédiaire du Directeur général de mettre fin à l’inspection. Cette recommandation est réputée approuvée à moins que le Conseil exécutif, au plus tard 72 heures après l’avoir reçue, décide à la majorité des deux tiers de l’ensemble de ses membres qu’il ne doit pas être mis fin à l’inspection. S’il est mis fin à l’inspection, l’équipe d’inspection quitte la zone d’inspection et le territoire de l’Etat partie inspecté dès que faire se peut conformément aux paragraphes 109 et 110 de la deuxième partie du Protocole.
51. L’Etat partie requérant et l’Etat partie dont on requiert l’inspection peuvent participer aux délibérations du Conseil exécutif relatives à la demande d’inspection sur place sans prendre part au vote. L’Etat partie requérant et l’Etat partie inspecté peuvent aussi participer sans prendre part au vote à toutes délibérations ultérieures du Conseil exécutif relatives à l’inspection.
52. Le Directeur général informe dans les 24 heures tous les Etats parties de toute décision prise par le Conseil exécutif conformément aux paragraphes 46 à 50 et de tous rapports, propositions, demandes et recommandations adressés à celui-ci conformément à ces mêmes paragraphes.
Suite donnée à l’approbation par le Conseil exécutif d’une inspection sur place
53. Une inspection sur place approuvée par le Conseil exécutif est réalisée sans retard et conformément aux dispositions du présent Traité et du Protocole par une équipe d’inspection désignée par le Directeur général. L’équipe d’inspection arrive au point d’entrée au plus tard six jours après que le Conseil exécutif a reçu de l’Etat partie requérant la demande d’inspection.
54. Le Directeur général délivre un mandat pour la conduite de l’inspection sur place. Ce mandat contient les renseignements visés au paragraphe 42 de la deuxième partie du Protocole.
55. Le Directeur général donne notification de l’inspection à l’Etat partie à inspecter au moins 24 heures avant l’arrivée prévue de l’équipe d’inspection au point d’entrée, conformément au paragraphe 43 de la deuxième partie du Protocole.
Conduite de l’inspection sur place
56. Chaque Etat partie autorise l’Organisation à procéder à une inspection sur place sur son territoire ou en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle, conformément aux dispositions du présent Traité et du Protocole. Toutefois, aucun Etat partie n’est tenu d’accepter des inspections simultanées sur son territoire ou en de tels lieux.
57. L’Etat partie inspecté a, conformément aux dispositions du présent Traité et du Protocole :
a) Le droit et l’obligation de faire tout ce qui lui est raisonnablement possible pour démontrer qu’il respecte le Traité et, à cette fin, de permettre à l’équipe d’inspection de remplir son mandat ;
b) Le droit de prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour protéger des intérêts relevant de sa sécurité nationale et empêcher la divulgation d’informations confidentielles sans rapport avec le but de l’inspection ;
c) L’obligation de donner accès à l’intérieur de la zone d’inspection à seule fin d’établir les faits en rapport avec le but de l’inspection compte tenu des dispositions de l’alinéa b) et de toutes obligations constitutionnelles auxquelles il aurait à satisfaire en matière de droits exclusifs ou en matière de perquisition et de saisie ;
d) L’obligation de ne pas invoquer les dispositions du présent paragraphe ou du paragraphe 88 de la deuxième partie du Protocole pour couvrir un manquement quelconque aux obligations qui sont les siennes en vertu de l’article premier ;
e) L’obligation de ne pas empêcher l’équipe d’inspection de se déplacer à l’intérieur de la zone d’inspection et de mener des activités d’inspection conformément au présent Traité et au Protocole.
Dans le contexte d’une inspection sur place, on entend par "accès" à la fois l’accès proprement dit de l’équipe d’inspection et de son matériel à la zone d’inspection et la conduite des activités d’inspection à l’intérieur de ladite zone.
58. L’inspection sur place est effectuée de la manière la moins intrusive possible, compatible avec l’exécution du mandat d’inspection dans les délais et avec l’efficacité voulus et conformément aux procédures établies dans le Protocole. Chaque fois que possible, l’équipe d’inspection commence par les procédures les moins intrusives et ne passe à des procédures plus intrusives que dans la mesure où elle le juge nécessaire pour recueillir suffisamment de renseignements afin de dissiper les préoccupations quant à une inexécution possible du présent Traité. Les inspecteurs ne recherchent que les renseignements et données requis aux fins de l’inspection et s’efforcent de perturber le moins possible les opérations normales de l’Etat partie inspecté.
59. L’Etat partie inspecté prête son concours à l’équipe d’inspection tout au long de l’inspection et facilite sa tâche.
60. Si l’Etat partie inspecté, agissant conformément aux paragraphes 86 à 96 de la deuxième partie du Protocole, restreint l’accès à l’intérieur de la zone d’inspection, il fait tout ce qui lui est raisonnablement possible, en consultation avec l’équipe d’inspection, pour démontrer par d’autres moyens qu’il respecte le présent Traité.
Observateur
61. La participation d’un observateur est régie par les dispositions suivantes :
a) Sous réserve de l’accord de l’Etat partie inspecté, l’Etat partie requérant peut envoyer un représentant observer le déroulement de l’inspection sur place; celui-ci est un ressortissant soit de l’Etat partie requérant, soit d’un Etat partie tiers ;
b) L’Etat partie inspecté fait part au Directeur général, dans un délai de 12 heures à compter de l’approbation de l’inspection sur place par le Conseil exécutif, de son acceptation ou de son refus de l’observateur proposé ;
c) En cas d’acceptation, l’Etat partie inspecté accorde à l’observateur l’accès, conformément au Protocole ;
d) En principe, l’Etat partie inspecté accepte l’observateur proposé, mais si cet Etat oppose son refus, le fait est consigné dans le rapport d’inspection.
Lorsque les Etats parties sont plusieurs à demander l’inspection, les observateurs qui y participent ne sont pas plus de trois.
Rapports de l’inspection sur place
62. Les rapports d’inspection comprennent :
a) Une description des activités réalisées par l’équipe d’inspection ;
b) Les faits ayant un rapport avec le but de l’inspection qui ont été constatés par l’équipe d’inspection ;
c) Un compte rendu du concours prêté pendant l’inspection sur place ;
d) Une description factuelle de l’étendue de l’accès accordé, notamment les autres moyens donnés à l’équipe, pendant l’inspection sur place ;
e) Tous autres détails ayant un rapport avec le but de l’inspection. S’il y a des observations divergentes de la part des inspecteurs, celles-ci peuvent être reproduites dans une annexe du rapport.
63. Le Directeur général met les projets de rapport d’inspection à la disposition de l’Etat partie inspecté. L’Etat partie inspecté a le droit de communiquer au Directeur général, dans un délai de 48 heures, ses observations et explications et d’indiquer tous renseignements et données qui, à son avis, sont sans rapport avec le but de l’inspection et ne devraient pas être diffusés en dehors du Secrétariat technique. Le Directeur général examine les propositions de modification d’un projet de rapport faites par l’Etat partie inspecté et, autant que possible, les intègre au projet. Il fait aussi figurer les observations et explications communiquées par l’Etat partie inspecté dans une annexe du rapport d’inspection.
64. Le Directeur général transmet sans retard le rapport d’inspection à l’Etat partie requérant, à l’Etat partie inspecté, au Conseil exécutif et à tous les autres Etats parties. En outre, il transmet sans retard au Conseil exécutif et à tous les autres Etats parties les résultats de toutes analyses d’échantillons faites par des laboratoires désignés, conformément au paragraphe 104 de la deuxième partie du Protocole, les données pertinentes provenant du Système de surveillance international, l’évaluation de l’Etat partie requérant et celle de l’Etat partie inspecté, ainsi que tous autres renseignements qu’il jugerait pertinents. Le Directeur général transmet le rapport intérimaire dont il est fait mention au paragraphe 47 au Conseil exécutif dans les délais indiqués dans ce même paragraphe.
65. Le Conseil exécutif, agissant conformément à ses pouvoirs et fonctions, examine le rapport d’inspection et tout document fourni en application du paragraphe 64, et traite tout motif de préoccupation afin de déterminer :
a) S’il y a eu inexécution du Traité ;
b) S’il y a eu abus du droit de demander une inspection sur place.
66. Si le Conseil exécutif, agissant en conformité avec ses pouvoirs et fonctions, parvient à la conclusion qu’il peut être nécessaire de poursuivre l’affaire eu égard au paragraphe 65, il prend les mesures qui s’imposent conformément à l’article V.
Demande d’inspection sur place téméraire ou abusive
67. S’il n’approuve pas l’inspection sur place au motif que la demande d’inspection est téméraire ou abusive, ou s’il met fin à l’inspection pour les mêmes raisons, le Conseil exécutif se penche et se prononce sur le point de savoir s’il convient de prendre des mesures en vue de redresser la situation et notamment :
a) D’exiger de l’Etat partie requérant qu’il prenne à sa charge le coût de tous préparatifs qu’aurait faits le Secrétariat technique ;
b) De suspendre, pour la période qu’il fixe lui-même, l’exercice par l’Etat partie requérant du droit de demander une inspection ;
c) De suspendre, pour une période déterminée, l’exercice par l’Etat partie requérant du droit de siéger au Conseil.
E. MESURES DE CONFIANCE
68. Afin :
a. D’aider à dissiper rapidement toutes préoccupations au sujet du respect du Traité que pourrait faire naître une interprétation erronée de données enregistrées par les moyens de vérification, concernant les explosions chimiques,
b. D’aider à l’étalonnage des stations qui font partie des réseaux constituant le Système de surveillance international, chaque Etat partie s’engage à coopérer avec l’Organisation et avec d’autres Etats parties à l’exécution des mesures voulues telles qu’elles sont énoncées dans la troisième partie du Protocole.
ARTICLE V : MESURES PROPRES A REDRESSER UNE SITUATION ET A GARANTIR LE RESPECT DES DISPOSITIONS DU TRAITE, Y COMPRIS LES SANCTIONS
1. La Conférence, tenant compte notamment des recommandations du Conseil exécutif, prend les mesures nécessaires, ainsi qu’il est prévu aux paragraphes 2 et 3, pour assurer le respect des dispositions du présent Traité et pour redresser et corriger toute situation contrevenant aux dispositions du Traité.
2. Dans les cas où un Etat partie auquel la Conférence ou le Conseil exécutif a demandé de redresser une situation qui soulève des problèmes concernant son respect du présent Traité ne satisfait pas à cette demande dans les délais fixés, la Conférence peut notamment décider de restreindre ou suspendre l’exercice, par cet Etat, des droits et privilèges dont il jouit en vertu du Traité jusqu’à ce que la Conférence en décide autrement.
3. Dans les cas où un préjudice risque d’être porté à l’objet et au but du présent Traité du fait d’un manquement aux obligations fondamentales établies par celui-ci, la Conférence peut recommander aux Etats parties des mesures collectives qui sont conformes au droit international.
4. La Conférence ou, s’il y a urgence, le Conseil exécutif peut porter la question, y compris les informations et les conclusions pertinentes, à l’attention de l’Organisation des Nations Unies.
ARTICLE VI REGLEMENT DES DIFFERENDS
1. Les différends qui naîtraient au sujet de l’application ou de l’interprétation du présent Traité sont réglés suivant les dispositions pertinentes du Traité et d’une manière conforme aux dispositions de la Charte des Nations Unies.
2. En cas de différend entre deux ou plusieurs Etats parties, ou entre un ou plusieurs Etats parties et l’Organisation, quant à l’application ou
3. à l’interprétation du présent Traité, les parties concernées se consultent en vue de régler rapidement ce différend par la voie de négociations ou par un autre moyen pacifique qui leur agrée, notamment en ayant recours aux organes appropriés du Traité et, par consentement mutuel, en saisissant la Cour internationale de Justice conformément au Statut de cette dernière. Les parties impliquées tiennent le Conseil exécutif informé des mesures prises.
4. Le Conseil exécutif peut contribuer au règlement d’un différend portant sur l’application ou l’interprétation du présent Traité par tout moyen qu’il juge approprié, notamment en offrant ses bons offices, en invitant les Etats qui sont parties au différend à rechercher un règlement par la voie qui leur agrée, en portant la question à l’attention de la Conférence et en recommandant un délai d’exécution de toute procédure convenue.
5. La Conférence examine, quant aux différends, les points qui sont soulevés par des Etats parties ou qui sont portés à son attention par le Conseil exécutif. Si elle le juge nécessaire, la Conférence crée des organes chargés de contribuer au règlement des différends ou confie cette tâche à des organes existants, conformément au paragraphe 26, alinéa j), de l’article II.
6. La Conférence et le Conseil exécutif sont habilités séparément, sous réserve de l’autorisation de l’Assemblée générale des Nations Unies, à demander à la Cour internationale de Justice de donner un avis consultatif sur tout point de droit entrant dans le cadre des activités de l’Organisation. L’Organisation conclut un accord avec l’Organisation des Nations Unies à cette fin, conformément au paragraphe 38, alinéa h), de l’article II.
7. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de celles des articles IV et V.
ARTICLE VII AMENDEMENTS
1. A tout moment suivant l’entrée en vigueur du présent Traité, tout Etat partie peut proposer d’apporter des amendements au Traité, au Protocole ou aux Annexes du Protocole. Tout Etat partie peut aussi proposer d’apporter des modifications au Protocole ou aux Annexes y relatives en application du paragraphe 7. Les propositions d’amendement sont régies par la procédure énoncée aux paragraphes 2 à 6. Les propositions de modification faites en application du paragraphe 7 sont régies par la procédure énoncée au paragraphe 8.
2. L’amendement proposé ne peut être examiné et adopté que par une conférence d’amendement.
3. Toute proposition d’amendement est communiquée au Directeur général, qui la transmet à tous les Etats parties ainsi qu’au Dépositaire et demande aux Etats parties s’il y a lieu selon eux de convoquer une conférence d’amendement pour l’examiner. Si une majorité des Etats parties avisent le Directeur général, au plus tard 30 jours après la distribution du texte de la proposition, qu’ils sont favorables à la poursuite de l’examen de celle-ci, le Directeur général convoque une conférence d’amendement à laquelle tous les Etats parties sont invités.
4. La conférence d’amendement se tient immédiatement après une session ordinaire de la Conférence, à moins que tous les Etats parties favorables à la convocation d’une conférence d’amendement ne demandent qu’elle se tienne à une date plus rapprochée. La conférence d’amendement ne se tient en aucun cas moins de 60 jours après la distribution du texte de l’amendement proposé.
5. Les amendements sont adoptés par la conférence d’amendement par un vote positif d’une majorité des Etats parties, sans vote négatif d’aucun Etat partie.
6. Les amendements entrent en vigueur à l’égard de tous les Etats parties le trentième jour qui suit le dépôt des instruments de ratification ou d’acceptation par tous les Etats ayant exprimé un vote positif lors de la conférence d’amendement.
7. Pour maintenir la viabilité et l’efficacité du présent Traité, les première et troisième parties du Protocole et les Annexes 1 et 2 du Protocole sont susceptibles d’être modifiées conformément au paragraphe 8 si les modifications proposées se rapportent uniquement à des questions d’ordre administratif ou technique. Aucune autre disposition du Protocole ou des Annexes y relatives n’est susceptible d’être modifiée en vertu du paragraphe 8.
8. Les propositions de modification visées au paragraphe 7 suivent la procédure ci-après :
a) Le texte de la proposition de modification est transmis au Directeur général accompagné des renseignements nécessaires. Tout Etat partie et le Directeur général peuvent fournir un complément d’information aux fins de l’examen de la proposition. Le Directeur général transmet sans retard à tous les Etats parties, au Conseil exécutif et au Dépositaire cette proposition et ces informations ;
b) Au plus tard 60 jours après réception de la proposition, le Directeur général l’examine pour déterminer toutes les conséquences qu’elle pourrait avoir sur les dispositions du présent Traité et leur application et communique toutes informations à ce sujet à tous les Etats parties et au Conseil exécutif ;
c) Le Conseil exécutif étudie la proposition à la lumière de toutes les informations à sa disposition et détermine notamment si elle remplit les conditions énoncées au paragraphe 7. Au plus tard 90 jours après réception de la proposition, il notifie à tous les Etats parties sa recommandation, assortie des explications voulues, pour examen. Les Etats parties en accusent réception dans les dix jours ;
d) Si le Conseil exécutif recommande à tous les Etats parties d’adopter la proposition, celle-ci est réputée approuvée si aucun Etat partie ne s’y oppose dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la recommandation. Si le Conseil exécutif recommande de rejeter la proposition, celle-ci est réputée rejetée si aucun Etat partie ne s’oppose à son rejet dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la recommandation ;
e) Si une recommandation du Conseil exécutif ne recueille pas l’approbation requise conformément aux dispositions de l’alinéa d), la Conférence se prononce à sa session suivante sur cette proposition quant au fond, notamment sur le point de savoir si elle satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 7 ;
f) Le Directeur général notifie à tous les Etats parties et au Dépositaire toute décision prise en vertu du présent paragraphe ;
g) Les modifications qui ont été approuvées conformément à la procédure énoncée ci-dessus entrent en vigueur à l’égard de tous les Etats parties le cent quatre-vingtième jour qui suit la date à laquelle le Directeur général a donné notification de leur approbation, à moins qu’un autre délai ne soit recommandé par le Conseil exécutif ou arrêté par la Conférence.
ARTICLE VIII : EXAMEN DU TRAITE
1. Sauf si une majorité des Etats parties en décide autrement, dix ans après l’entrée en vigueur du présent Traité, une conférence des Etats parties a lieu pour examiner le fonctionnement et l’efficacité du Traité, en vue de s’assurer que les objectifs et les buts énoncés dans le préambule et les dispositions du Traité sont en voie de réalisation. Cet examen tient compte de toutes innovations scientifiques et technologiques ayant un rapport avec le Traité. Sur la base d’une demande présentée par l’un quelconque des Etats parties, la conférence d’examen envisage la possibilité d’autoriser la réalisation d’explosions nucléaires souterraines à des fins pacifiques. Si la conférence d’examen décide par consensus que de telles explosions nucléaires peuvent être autorisées, elle commence sans attendre ses travaux en vue de recommander aux Etats parties un amendement approprié du Traité, qui empêche que des avantages militaires ne soient retirés de ces explosions nucléaires. Toute proposition d’amendement à cet effet est communiquée au Directeur général par l’un quelconque des Etats parties et suit la procédure énoncée dans les dispositions correspondantes de l’article VII.
2. Par la suite, à des intervalles de dix ans, d’autres conférences d’examen ayant le même objet peuvent être convoquées si la Conférence en décide ainsi l’année précédente à la majorité requise pour les questions de procédure.
Une conférence ayant cet objet peut être convoquée après un intervalle de moins de dix ans si la Conférence en décide ainsi selon la procédure prévue pour les questions de fond.
3. Les conférences d’examen se tiennent normalement immédiatement après la session annuelle ordinaire de la Conférence prévue à l’article II.
ARTICLE IX DUREE ET RETRAIT
1. Le présent Traité a une durée illimitée.
2. Chaque Etat partie, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, a le droit de se retirer du présent Traité s’il juge que des événements extraordinaires en rapport avec l’objet du Traité ont compromis ses intérêts suprêmes.
3. Le retrait s’effectue en adressant avec un préavis de six mois une notification à tous les autres Etats parties, au Conseil exécutif, au Dépositaire et au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies. Ladite notification contient un exposé de l’événement ou des événements extraordinaires que l’Etat partie considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes.
ARTICLE X : STATUT DU PROTOCOLE ET DES ANNEXES
Les Annexes du présent Traité, le Protocole et les Annexes du Protocole font partie intégrante du Traité. Toute référence au Traité renvoie également aux Annexes du Traité, au Protocole et aux Annexes du Protocole.
ARTICLE XI : SIGNATURE
Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les Etats avant son entrée en vigueur.
ARTICLE XII :RATIFICATION
Le présent Traité est soumis à ratification par les Etats signataires suivant leurs règles constitutionnelles respectives.
ARTICLE XIII :ADHESION
Tout Etat qui n’a pas signé le présent Traité avant son entrée en vigueur peut y adhérer à tout moment par la suite.
ARTICLE XIV :ENTREE EN VIGUEUR
1. Le présent Traité entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour qui suit la date de dépôt des instruments de ratification de tous les Etats indiqués à l’Annexe 2 du Traité, mais en aucun cas avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de son ouverture à la signature.
2. Si le présent Traité n’est pas entré en vigueur trois ans après la date de l’anniversaire de son ouverture à la signature, le Dépositaire convoque, à la demande de la majorité des Etats ayant déjà déposé leur instrument de ratification, une conférence desdits Etats. Ceux-ci déterminent à cette conférence dans quelle mesure la condition énoncée au paragraphe 1 a été remplie, puis se penchent et se prononcent par consensus sur les mesures qui pourraient être prises suivant le droit international en vue d’accélérer le processus de ratification et de faciliter ainsi l’entrée en vigueur du Traité à une date rapprochée.
3. A moins qu’il n’en soit décidé autrement à la conférence visée au paragraphe 2 ou lors d’autres conférences de cette nature, cette procédure est engagée de nouveau à l’occasion des anniversaires ultérieurs de l’ouverture du présent Traité à la signature, jusqu’à ce que celui-ci entre en vigueur.
4. Tous les Etats signataires sont invités à assister en qualité d’observateur à la conférence visée au paragraphe 2 et à toutes conférences ultérieures qui seraient tenues conformément au paragraphe 3.
5. A l’égard des Etats dont l’instrument de ratification ou d’adhésion est déposé après l’entrée en vigueur du présent Traité, celui-ci entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt de cet instrument.
ARTICLE XV : RESERVES
Les articles et les Annexes du présent Traité ne peuvent pas donner lieu à des réserves. Les dispositions du Protocole et les Annexes du Protocole ne peuvent pas donner lieu à des réserves qui sont incompatibles avec l’objet et le but du Traité.
ARTICLE XVI : DEPOSITAIRE
1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Traité; il enregistre les signatures et reçoit les instruments de ratification ou d’adhésion.
2. Le Dépositaire informe sans retard tous les Etats qui ont signé le présent Traité ou qui y ont adhéré de la date de chaque signature, de la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion et de la date d’entrée en vigueur du Traité et de tous amendements ou modifications y relatifs, ainsi que de la réception de toutes autres notifications.
3. Le Dépositaire fait tenir aux gouvernements des Etats qui ont signé le présent Traité ou qui y ont adhéré des copies certifiées conformes du texte du Traité.
4. Le présent Traité est enregistré par le Dépositaire en application de l’Article 102 de la Charte des Nations Unies.
ARTICLE XVII : TEXTES FAISANT FOI
Le présent Traité, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Annexe 1 du traité : Liste d’Etats établie en application du paragraphe 28 de l’article II :
Annexe 2 du traité : Liste d’Etats établie en application de l’article XIV et dont la ratification est nécessaire à l’entrée en vigueur du traité : Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Bangladesh, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Colombie, Egypte, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Israël, Italie, Japon, Mexique, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Pologne, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Slovaquie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine, Vietnam, Zaïre.
Protocole se rapportant au traite d’interdiction complète des essais nucléaires :
Première partie : le système de surveillance international et les Fonctions du centre international de données
A. Dispositions générales
B. Surveillance sismologique
C. Surveillance des radionucléides
D. Surveillance hydroacoustique
E. Surveillance des infrasons
F. Fonctions du centre international de données
Deuxième partie : inspections sur place
A. Dispositions générales
B. Arrangements permanents
C. Demande d’inspection sur place, mandat d’inspection et notification d’une inspection
D. Activités précédant l’inspection
E. Conduite des inspections
Troisième partie : mesures de confiance
Annexe 1 du protocole
Tableau 1-a liste des stations sismologiques constituant le réseau primaire
Tableau 1-b liste des stations sismologiques constituant le réseau auxiliaire
Tableau 2-a liste des stations de surveillance des radionucléides
Tableau 2-b liste des laboratoires radionucléides
Tableau 3 liste des stations hydroacoustiques
Tableau 4 liste des stations de détection des infrasons
Annexe 2 du protocole
Liste des paramètres de caractérisation pour le filtrage standard des événements au centre international de données.
Annexe 7 : Bibliographie
Gilles Andréani : The “war on terror”, good cause, wrong concept (Survival / IISS), 2004.
Robert Ayson : Thomas Schelling and the nuclear age strategy as social science, 2004.
Denis Bauchard : La Syrie au carrefour des risques (IFRI), 2009.
Jean-Philippe Baulon : L’Amérique vulnérable (1946-1976), 2009.
Jean-Philippe Baulon : Défense contre les missiles balistiques, 2006.
Lionel Beehner : Israël nuclear’s program and Middle East peace (Council on foreign relations), 2006.
Lionel Beehner : The impact of North Korea’s nuclear test on Iran crisis (Council on foreign relations), 2006.
Patrick Berche : L’histoire secrète des guerres biologiques, 2009.
Jacques Bouchez, Martin Briens, Valérie Niquet : Table ronde sur la Corée du Nord (compte rendu n° 62 de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale), 3 juin 2009.
Chaim Braun et Christopher F. Chyba : Proliferation rings ; new challenges to the nuclear non proliferation regime (International security), 2004.
William Broad : Documents reveals 1987 bomb test by Iraq, (New York Times), 29 avril 2001, sur la base des travaux du professeur Gary Milhollin, du Wisconsin project.
Martine Bulard : L’Inde, le nucléaire et les principes à géométrie variable (Planète Asie), 2008.
Jacques Chirac : Discours de clôture de la 53ème session de l’Institut des hautes études de la défense nationale, 8 juin 2001.
Shahram Chubin : Iran’s power in context (Survival/ IISS), 2009.
CSIS : Securing cyberspace for the 44th presidency, décembre 2008.
Avner Cohen : Israël and the bomb, 1998.
Avner Cohen : Israël and biological/chemical weapons: history, deterrence and arms control, 2001.
Barthélémy Courmont : L’accord nucléaire Inde/Etats-Unis (IFRI), 2006.
Paul Dahan : De la non-prolifération à la contre-prolifération (Annuaire français des relations internationales) 2006.
François Danjou : Corée du Nord, misères du dialogue à six (QuestionChine.net), 2009.
Stéphane Delory : Etat de la menace balistique dans les pays proliférants susceptibles de confronter les systèmes anti missiles déployés (Fondation pour la recherche stratégique), 2009.
Isabelle Facon : Désarmement et maîtrise des armements nucléaires, les positions russes et leurs déterminants nationaux et internationaux (Fondation pour la recherche stratégique), 2009.
Lawrence Freedman : The evolution of nuclear strategy, 3ème édition, 2003.
François Géré : A la recherche du chaînon manquant : terrorisme nucléaire et contrebande nucléaire (Stratégique n° 66-67), 1997.
Camille Grand : La France face au débat sur la défense antimissile (Fondation pour la recherche stratégique), 2009.
Bob Graham et Jim Talent : World at risk (rapport de la commission de la prévention de la prolifération des armes de destruction massive et du terrorisme de la Chambre des Représentants des Etats-Unis), 2008.
Colin Gray : Defining and achieving decisive victory (strategic studies institute), 2002.
Bruno Gruselle : L’accélération du programme japonais de défense antimissile (Fondation pour la recherche stratégique), 2007.
Bruno Gruselle : Réseaux et financement de la prolifération (Fondation pour la recherche stratégique), 2002.
Steven Hildreth : Iran’s ballistic missile programs : an overview (service de recherche du Congrès des Etats-Unis), 2009.
Rex Hugues : NATO and global cyberdefence, mars 2008
Marie Jégo et Nathalie Nougayrède : Atermoiements russes dans le dossier iranien (le Monde), 29 septembre 2009.
Sergueï Kirienko : Le nucléaire pour sortir de l’impasse (Les Echos), 8 juillet 2009.
Henry Kissinger : Obama’s foreign policy challenge (Washington Post), 4 mai 2009.
Georges Le Guelte : Les armes nucléaires, mythes et réalités, 2009.
Pierre Lellouche, Guy-Michel Chauveau et Aloyse Warhouver : La prolifération des armes de destruction massive et leurs vecteurs (rapport n° 2788 de la commission de la Défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale), 7 décembre 2000.
Pierre Lellouche : Pacifisme et dissuasion (IFRI), 1983.
Ariel Levite : Heading for the fourth nuclear age (IFRI), 2009.
Gaël Marchand : De la menace NRBC à la menace NRBCE, glissement sémantique ou changement de perspective ? (Institut français d’analyse stratégique), 2007.
Michael Mates : Réduire la menace nucléaire globale (rapport au nom de la commission de la Science et des Technologies de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN), 2008.
Pierre Messmer : La dissuasion nucléaire française, genèse et actualité (discours à l’université d’Oxford), 15 février 2002.
Claude Meyer et Dominique Leglu : La menace chimique et biologique, 2003.
Jacques Myard (dir.) : La France à l'ère de la mondialisation (L'Harmattan) 2009.
Jacques Myard : La France dans la guerre de l'information, (L'Harmattan), 2006.
Sverre Myrli : L’OTAN et la cyberdéfense / NATO and cyberdefence (rapport au nom de la commission de la Défense et de la Sécurité de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN), 2009.
Paul Nitze : A threat mostly to ourselves (New York Times), 28 octobre 1999.
Robert Norris et Hans Kristensen : Chinese nuclear force (Bulletin of the atomic scientists), 2008.
Robert Norris et Hans Kristensen : Global nuclear stockpiles 1945-2006 (Bulletin of the atomic scientists), 2006.
Nathalie Nougayrède : Révélations sur la filière nucléaire secrète nord-coréenne en Syrie (Le Monde), 19 juin 2008.
Vladimir Orlov et Alexander Vinnikov : Le grand jeu de devinette, la Russie et la question nucléaire iranienne (Washington Quarterly), 2005.
Karim Pakzad : Nicolas Sarkozy, Mahmoud Ahmadinejad et l’ONU (Affaires stratégiques info), 25 septembre 2009.
Laurent Palou Lacoste : Le choc des civilisations, fantasme ou réalité ? (Fondation Jean Jaurès), 2009.
Pierre Péan : Les deux bombes, 1982.
Benoit Pélopidas : Du fatalisme en matière de prolifération nucléaire, retour sur une représentation opiniâtre ( Swiss political science review), 2009.
George Perkovich : India’s nuclear bomb (université de Californie / Berkeley), 1999.
Marianne Peron Doise : Corée du Nord, la stratégie de la prolifération (Sciences-Po, CERI / CNRS), 2009.
Marianne Peron-Doise : La redéfinition des relations Japon / Corée du Nord, un nouvel enjeu pour l’Asie du Nord-Est ? (Revue internationale et stratégique), 2003.
Daniel Pipes : Al Qaeda’s limits, New York Post, 28 mai 2003.
Michael Quinlan : Thinking about nuclear strategy, 1997.
Pr Didier Raoult : Rapport au ministère de la santé sur le bioterrorisme, 2003.
Pr Didier Raoult : Le concept des maladies émergentes et les maladies infectieuses au XXIème siècle, 2003.
Roger Romani : Cyberdéfense, un nouvel enjeu de sécurité nationale (rapport n° 449 au nom de la commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat), 2008.
Jean-Christophe Romer : La pensée stratégique russe au XXème siècle, 1997.
Damien Romestant : Commerce et sécurité, les exportations sensibles dans la mondialisation, 2003.
Nicolas Sarkozy : Discours de Cherbourg, 21 mars 2008.
Charles Savage : Obama and the war on terror (New York Times), 17 Février 2009.
Guillaume Schlumberger et Bruno Gruselle : Pour une politique cohérente de lutte contre les réseaux de prolifération (notes de la Fondation pour la recherche stratégique), 4 janvier 2007.
Guillaume Schlumberger et Bruno Gruselle : Le risque balistique, causes et conséquences d’un déploiement américain de la défense antimissile en Europe (notes de la Fondation pour la recherche stratégique), 13 avril 2007.
Julianne Smith : Europe, Russia and United States, finding a new balance (CSIS), 2008.
Ray Takeyh : Iran builds the bomb (Survival, IISS), 2004.
Bruno Tertrais : Les islamistes et la bombe pakistanaise (Politique internationale), 2009.
Bruno Tertrais : Le marché noir de la bombe, enquête sur la prolifération nucléaire, 2009.
Bruno Tertrais : Un monde sans arme nucléaire est-il souhaitable ? (Fondation pour la recherche stratégique), 2009.
Anne de Tinguy : La Russie et ses frontières, vingt ans après l’éclatement de l’empire soviétique (Sciences-Po / CERI), 2009.
Dmitri Trenin : Russia’s nuclear policy in the XXI century (IFRI), 2005.
William Walker : Obama and nuclear disarmament (Université de St Andrews / IFRI), 2009.
Judith Yaphe et Charles Lutes : Reassessing the implications of a nuclear-armed Iran (Institute for national strategic studies, National Defence University, Washington DC), 2005.
Général Zhang Changtai : Les défis stratégiques de la Chine (Défense nationale), 2006.
1 () Cette expression est utilisée pour la première fois par l’archevêque de Canterbury, pour décrire le bombardement de Guernica, en 1937. La première résolution de l’Assemblée Générale des Nations Unies, en 1946, crée une commission chargée de traiter les problèmes liées aux armes nucléaires et à toutes les armes « adaptées à la destruction de masse ». Le traité sur l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique du 27 janvier 1967 constitue la première occurrence officielle du terme « armes de destruction massive ». Toutefois, le terme n’a pas reçu de définition technique officielle. Le bureau des Nations Unies pour le désarmemement rappelle les catégories classiques (nucléaires, biologiques, chimiques) et renvoie aux textes existant pour chaque catégorie d’armes.
2 () Après avoir constaté la réussite du premier essai nucléaire américain, en juillet 1945, le physicien Robert Oppenheimer aurait déclaré : « Je suis Shiva, le destructeur des mondes ».
3 () Albert Einstein, à la demande de physiciens hongrois travaillant sur la réaction de fission, envoie une lettre à Roosevelt, datée du 2 août 1939, l’avertissant de ce danger.
4 () Le rapport sur le développement de la bombe atomique d’Henry De Wolf Smyth, publié en août 1945, contient nombre d’informations utiles pour un pays déjà au fait de certains éléments concernant la fabrication des armes nucléaires.
5 () Aux termes de l’accord dit « SALT II » du 18 juin 1979, un missile balistique est dit intercontinental lorsque sa portée dépasse 5 500 kilomètres.
6 () G. le Guelte, « Les armes nucléaires, mythes et réalités », Actes Sud, 2009.
7 () Lors de l’invasion d’une des îles de l’archipel Chousan par les troupes de Mao en janvier 1955, les communistes et les nationalistes avaient fait appel respectivement à l’URSS et aux Etats-Unis pour intervenir avec l’ensemble de leurs moyens militaires.
8 () D’une portée de 2 000 kilomètres pour une précision de 5 kilomètres, ces missiles emportent des têtes nucléaires d’une puissance de plus de 2 MT.
9 () Au mois d’avril 1961, l’armée américaine avait tenté de renverser le régime castriste lors d’une opération militaire connue sous le nom du débarquement de la Baie des cochons.
10 () D’après Robert S. Norris and Hans M. Kristensen, "Global nuclear stockpiles, 1945-2006," précité.
11 () Ce néologisme permet de désigner les missiles disposant de plusieurs têtes nucléaires dotés de systèmes de guidage autonomes lors de la réentrée dans l’atmosphère. Ce système est appelé « MIRV » en anglais, pour « multiple independant reentry vehicules ».
12 () Ces discussions sont connues sous leurs acronymes anglais (Strategic Arms Limitation Talks) : SALT I du 17 novembre 1969 au 26 mai 1972, SALT II de novembre 1972 au 18 juin 1979
13 () Le nombre de bases est donc fixé à 1416 pour l’URSS et 1054 pour les Etats-Unis.
14 () Connu sous son acronyme anglais « ABM » pour anti-ballistic missiles.
15 () Une telle clause permet d’organiser la protection des sites de décision de chaque pays, afin d’assurer l’adversaire de la capacité de seconde frappe en cas d’agression.
16 () Missiles de portée intermédiaire, entre 600 et 5000 kilomètres, bien que les dernières versions puissent atteindre des cibles situées à 7 500 km. Il s’agit de missiles à carburant solide, nécessitant donc peu de temps pour être rendus opérationnels, et pouvant rester déployés pendant de longues périodes.
17 () L’expression anglaise « mutual assured destruction » (MAD) est un jeu de mots avec l’adjectif signifiant fou.
18 () L’expression « Empire du mal » pour désigner l’Union soviétique a été employée pour la première fois le 8 mars 1983 devant l’association nationale des évangélistes.
19 () D’une portée de 10 000 kilomètres, ces missiles sont d’une précision respectivement de 250 et 500 mètres. Le SS-24 est mirvé, et existe en version mobile ou en silos, le SS-25 est uniquement mobile mais ne contient qu’une tête nucléaire.
20 () Missile mirvé (10 têtes nucléaires) de 10 000 kilomètres de portée.
21 () Strategic Arms Reduction Treaty, traité de réduction des armes stratégiques.
22 () La Corée du Nord s’est retirée en 2003.
23 () C’est en utilisant un réacteur à eau lourde livré par le Canada en 1955 que l’Inde a pu lancer la production de plutonium militaire, à partir de 1974.
24 () Il s’agit de versions avancées du Tae Po Dong 2, encore à l’état de projet. Les seuls essais, d’ailleurs ratés, ont montré une portée inférieure à 5 000 kilomètres.
25 () « La prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs », rapport présenté à la Commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale le 6 décembre 2000, n° 2788.
26 () Le chimiste allemand Gerhard Schrader est le premier à avoir synthétisé le tabun et le sarin, en 1936 et 1939.
27 () Scientifique américain spécialiste des armes biologiques, auteur notamment de « Peace or pestilence. biological warfare and how to avoid it. », 1949, Whittlesey House.
28 () En 2001, deux chercheurs australiens ont ainsi provoqué un vif émoi dans la communauté scientifique en créant, par erreur, un virus « tueur » contre lequel aucune thérapie ne semblait fonctionner. Si ces chercheurs ont immédiatement contacté le ministère de la Défense australien, l’épisode a illustré les risques que génère le développement des biotechnologies, dont l’essor mondial est considérable depuis quelques années.
29 () Les cas les plus connus d’attaques contre des systèmes informatiques publics ont concerné l’Estonie, pays en pointe dans le développement de « l’e-gouvernement », dont les principaux sites ont été bloqués plusieurs jours au cours de l’été 2007. La plupart des autres pays sont régulièrement victimes d’attaques, y compris la France.
30 () Arpanet, ancêtre du réseau Internet, est opérationnel au sein de l’armée américaine depuis 1969.
31 () Rapport n° 1324 de M. Jean-Marc Roubaud sur l’Iran et l’équilibre géopolitique régional.
32 () Le rapport de MM. Jean Glavany et Henri Plagnol « Afghanistan, un chemin pour la paix » ( n° 1772 Assemblée nationale – XIIIe législature) évoque notamment le rôle que l’Iran pourrait être amené à jouer sur le dossier afghan.
33 () Chaim Braun et Christopher F. Chyba emploient le terme de « first tier proliferation » pour désigner la prolifération utilisant des technologies vendues ou volées à des entreprises ou des Etats nucléaires, ou les cas d’assistance d’Etats nucléaires à des Etats non-nucléaires. La « second tier proliferation » s’applique aux cas d’assistance et de commerce entre les pays en développement pour accélérer leurs programmes d’armes stratégiques Voir C. Braun et C. F. Chyba, « Proliferation Rings. New challenges to the Nuclear nonproliferation regime », International Security, 2004, n°29:2.
34 () Le programme « Pétrole contre nourriture » visait à restreindre l’utilisation des recettes provenant de la vente de pétrole en bloquant les sommes sur des comptes gérés par les Nations Unies. Contournant ce système, Bagdad a signé des protocoles de fourniture clandestine avec ses principaux voisins : Syrie, Jordanie, Turquie, Egypte, Yemen.
35 () B. Gruselle, « Réseaux et financement de la prolifération », Fondation pour la recherche stratégique « Recherches & documents », 3 mars 2007.
36 () On parle ainsi de listes « gâchettes » - trigger lists – puisque celles-ci déclenchent automatiquement la saisine de l’agence.
37 () Créé à la demande des Etats-Unis en 1949, ce groupement d’exportateurs visait à faire respecter l’interdiction de transferts de technologies militaires vers un membre du pacte de Varsovie.
38 () Initialement limitée à deux ans, la durée d’activité du comité a été étendue en 2006 (résolution 1673 du 27 avril 2006 renouvelant le mandat du comité pour deux ans) et en 2008 (résolution 1810 du 25 avril 2008 renouvelant le mandat du comité jusqu’au 27 avril 2011).
39 () Paul Dahan : « De la non-prolifération à la contre-prolifération », Annuaire français des relations internationales, volume VII, 2006.
40 () Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde pour le développement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire (n° 1982 Assemblée nationale – XIIIe législature).
41 () Laurent Palou Lacoste, Le choc des civilisations, fantasme ou réalité, 2009.
42 () Paul Dahan : « De la non-prolifération à la contre-prolifération », précité.
43 () Les listes de produits interdits font l’objet de trois tableaux distincts : le premier porte sur les produits chimiques aux seules fins militaires, le deuxième sur des substances à usage dual ne nécessitant pas une production à grande échelle pour les usages civils, le troisième concernant les éléments à usage dual dont la production en grande quantité est nécessaire à l’industrie civile.
44 () Il s’agit de l’Angola, de la Corée du Nord, de l’Egypte, de la Somalie et de la Syrie.
45 () Israël et la Birmanie.
46 () Parfois désignés comme Etats détenteurs de l’arme nucléaire – EDAN.
47 () On ajoute souvent, aux garanties ici évoquées, l’assurance que les EDAN porteraient assistance à un Etat non doté victime d’une attaque nucléaire sur son sol. En réalité, cette « garantie » n’est pas contenue dans le traité, mais ressort de la résolution n°255 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, du 19 juin 1968.
48 () Selon les données de l’AIEA, seuls 26 Etats parties au traité de non prolifération n’ont pas encore mis en œuvre d’accord de garanties.
49 () Il s’agit du modèle INFCIRC/153, dont la dernière rédaction date de 1983.
50 () Accords de type INFCIRC/66, dont le modèle a été définitivement prolongé en 1968.
51 () Approuvé en mai 1997, ce modèle d’accord est parfois désigné par le terme INFCIRC/540.
52 () Dix-neuf Etats membres des Nations Unies n’ont pas signé la convention : Andorre, l’Angola, le Cameroun, les Comores, Djibouti, l’Erythrée, la Guinée, Israël, Kiribati, les Îles Marshall, la Mauritanie, la Micronésie, le Mozambique, la Namibie, Nauru, Niue, les Samoa, le Tchad et Tuvalu.
53 () Abréviation anglophone, HCOC pour Hague Code Of Conduct.
54 () Alors que le HCOC se contente d’indiquer que l’engagement à limiter la prolifération balistique doit être concilié avec le droit des Etats à effectuer des recherches spatiales, le régime MTCR indique précisément les technologies qui sont susceptibles d’être détournées à des fins militaires, et permet donc de préciser les soupçons que certains programmes civils pourraient déclencher.
55 () Seuls la Corée du Nord, l’Inde et le Pakistan n’ont pas signé.
56 () Aux trois Etats précédents s’ajoutent la Chine, l’Indonésie, l’Iran, Israël, l’Egypte et les Etats-Unis.
57 () Paul Dahan : « De la non-prolifération à la contre-prolifération », précité.
58 () Le Conseil de sécurité de l’après-11 septembre, LGDJ, 2004.
59 () Voir les articles, cosignés avec George Shultz, Bill Perry et Sam Nunn « Ending the threat of nuclear weapons », Wall Street Journal, 4 janvier 2007 et « Towards a nuclear free world », Wall Street Journal, 15 janvier 2008.
60 () « J’affirme, ici, l’engagement des Etats-Unis en faveur de la paix et de la sécurité d’un monde dénué d’armes nucléaires ».
61 () Voir par exemple : B. Tertrais, « Un monde sans arme nucléaire est-il souhaitable ? », Notes de la Fondation pour la recherche stratégique, n°09/09.
© Assemblée nationale
