N° 2208
——
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 décembre 2009.
RAPPORT D’INFORMATION
déposé
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE
sur les défaillances de la régulation bancaire et financière,
ET PRÉSENTÉ
PAR M. Sébastien HUYGHE,
Député,
en conclusion des travaux d’une mission d’information présidée par
M. Jean-Luc WARSMANN (1)
Député.
——
La mission d’information sur les nouvelles régulations de l’économie est composée de : M. Jean-Luc Warsmann, président ; M. Claude Goasguen et M. Philippe Vuilque, vice-présidents ; M. Philippe Houillon, rapporteur sur les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux et des opérateurs de marché ; M. Sébastien Huyghe, rapporteur sur les défaillances de la régulation bancaire et financière ; M. Jean-Michel Clément, M. Éric Diard, M. René Dosière, M. Arnaud Montebourg (2) , M. Éric Straumann.
INTRODUCTION 9
PREMIÈRE PARTIE : UNE CRISE SANS PRÉCÉDENT DE LA FINANCE GLOBALISÉE 11
I. DES CAUSES MULTIPLES À L’ORIGINE D’UN DÉRÈGLEMENT MAJEUR DE LA FINANCE INTERNATIONALE 11
A. UN EXCÈS DE LIQUIDITÉS ET DES DÉSÉQUILIBRES STRUCTURELS GÉNÉRATEURS DE BULLES 12
1. « L’argent facile » : une politique monétaire très accommodante de soutien systématique à la croissance 12
2. Les subprime, élément déclencheur de la crise 13
3. La sophistication financière : une promesse de hauts rendements pour un niveau de risques très élevé 16
a) L’ambivalence originelle de l’innovation financière 16
b) La titrisation : courroie de transmission de la crise 17
c) Les produits structurés : un terrain d’élection pour l’innovation financière 19
d) L’innovation financière, promesse de rendements démesurés 21
4. Les excès des modes de rémunération dans le secteur bancaire et financier 22
B. LA DISPARITION DU RISQUE 23
1. Le risque transféré 23
2. Le risque systémique 24
3. La dérégulation bancaire et financière 26
C. LA FAILLITE DE LA RÉGULATION 27
1. Des règles déstabilisatrices et procycliques 27
2. Des régulateurs déficients 29
a) Les régulateurs publics n’ont pas su contrôler l’innovation financière 29
b) Les régulateurs n’ont pas su encadrer l’activité des banques d’investissement 31
c) Les régulateurs privés ont été gravement défaillants : l’exemple des agences de notation 31
II. LA PROPAGATION DU CHOC DE LA CRISE À L’ENSEMBLE DE L’ÉCONOMIE MONDIALE 33
A. LA CRISE DE SOLVABILITÉ AUX ÉTATS-UNIS 34
B. LA CRISE DE LIQUIDITÉ EN EUROPE OU LA DÉFIANCE GÉNÉRALISÉE 35
C. L’AMPLIFICATION DE LA CRISE FINANCIÈRE ET SON EXTENSION À L’ÉCONOMIE RÉELLE 37
DEUXIÈME PARTIE : UNE MOBILISATION MASSIVE ET RAPIDE DES ÉTATS AU SECOURS DE L’ÉCONOMIE 42
I. UN SOUTIEN MASSIF DES ÉTATS AU SECTEUR BANCAIRE POUR PRÉSERVER LE FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE 42
A. DES PLANS DE SAUVETAGE MASSIFS ET CONVERGENTS EN VUE DE PRÉSERVER LA PÉRENNITÉ DU SYSTÈME BANCAIRE 42
1. Racheter les actifs toxiques pour assainir les marchés 43
2. Recapitaliser les banques pour prévenir les risques de faillite 44
3. Garantir les émissions de dettes afin de restaurer la confiance 44
B. LA RÉPONSE EUROPÉENNE AU SAUVETAGE DU SECTEUR BANCAIRE : LE CHOIX DE LA CONVERGENCE ET DE LA CONCERTATION 45
C. UN PLAN FRANÇAIS DE FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE ÉQUILIBRÉ ET EFFICACE 48
1. Le refinancement des banques avec la garantie de l’État 49
2. La recapitalisation des banques 50
3. Le plan de financement de l’économie à l’épreuve des faits : un succès incontestable 53
a) Une amélioration de la solvabilité des banques françaises 53
b) Un assouplissement de la contrainte de liquidité 54
c) Un impact limité sur les finances publiques 55
d) Un remboursement anticipé des aides de l’État : signe de la bonne santé des banques françaises 56
4. Les établissements de crédit bénéficiaires de ces mesures d’aide se sont engagés en contrepartie à respecter certaines obligations 58
a) L’engagement relatif à la croissance du crédit à l’économie 58
b) L’engagement relatif au crédit à l’exportation 60
c) L’engagement relatif au crédit aux entreprises 60
d) Les engagements éthiques relatifs à la politique de rémunération 62
II. UNE ACTION DÉTERMINANTE DES BANQUES CENTRALES 63
A. UN ASSOUPLISSEMENT MASSIF DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE 63
B. LE RECOURS AUX MESURES NON CONVENTIONNELLES POUR RELANCER LE CRÉDIT 65
TROISIÈME PARTIE : REFONDER ET MIEUX RÉGULER LA FINANCE MONDIALE 67
I. LES G20 DE LONDRES ET DE PITTSBURGH : DES AVANCÉES FONDATRICES À CONCRÉTISER 67
A. LE G20 DE LONDRES DU 2 AVRIL 2009 68
1. Une lutte accrue contre les paradis fiscaux 68
2. Une extension majeure du champ de la régulation 68
3. La sécurisation des banques et l’encadrement de la rémunération des traders 69
4. L’assouplissement des normes comptables 70
5. Le renforcement des institutions financières internationales 71
a) Le Forum de stabilité financière devient le Conseil de stabilité financière 71
b) Le Fonds monétaire international est placé au centre de la régulation internationale 72
B. LE G20 DE PITTSBURGH DU 24 SEPTEMBRE 2009 75
1. La poursuite de la réforme des institutions multilatérales et de leur mandat 75
a) Le renforcement des pouvoirs des pays émergents au sein du Fonds monétaire international 75
b) Une coordination accrue de la supervision financière confiée au Conseil de stabilité financière 76
c) La pérennisation des réunions périodiques du G20 76
2. Le renforcement de la régulation de la finance internationale 76
a) Une application à tous les pays des règles de Bâle II d’ici 2011 76
b) La réforme des normes comptables 78
c) L’encadrement des bonus 78
d) La fin annoncée des paradis fiscaux 80
e) Les dérivés de crédits sous surveillance 80
3. Les questions restant en suspens après Londres et Pittsburgh 81
II. REDÉFINIR LES CONTOURS D’UNE FINANCE MONDIALE RÉGULÉE ET MAÎTRISÉE AU SERVICE DE L’ÉCONOMIE 81
A. RÉGULER LE CONTOURNEMENT DES RÈGLES PRUDENTIELLES ET LA TRANSMISSION DES RISQUES 82
1. Le contournement des règles prudentielles par la titrisation 82
2. Mieux contrôler les activités de titrisation 82
B. ATTÉNUER LA PROCYCLICITÉ DES NORMES ET MIEUX PRÉVENIR LE RISQUE SYSTÉMIQUE 83
1. L’assouplissement et la convergence des normes comptables 83
a) Assouplir le contenu des normes comptables 83
b) Parvenir à une convergence rapide des normes comptables internationales et américaines 85
c) Améliorer la gouvernance de l’IASB 86
2. L’amélioration et le renforcement des normes prudentielles 87
a) Atténuer la procyclicité de Bâle II : le provisionnement dynamique 87
b) Renforcer les exigences de fonds propres… 88
c) … tout en tenant compte de la spécificité des banques coopératives et mutualistes, acteurs majeurs du financement de l’économie 89
3. Une meilleure prévention du risque systémique 93
a) Une réforme déjà bien engagée tant au niveau international qu’européen 93
b) Réduire l’aléa moral qui entoure la faillite d’un établissement d’importance systémique par la mise en place de « testaments » 95
c) Tarifer la garantie implicite de l’État par une « prime d’assurance » du risque systémique 96
C. RÉÉQUILIBRER LES INCITATIONS INDIVIDUELLES AUX PROFITS DE LONG TERME ET RESPONSABILISER LES OPÉRATEURS DE MARCHÉ 98
1. La France en première ligne de la lutte contre les abus en matière de rémunération des traders 99
2. De nouvelles perspectives d’encadrement de la rémunération des traders avec la taxation à hauteur de 50 % des bonus 101
D. AMÉLIORER ET RENFORCER LA TRANSPARENCE DES MARCHÉS ET DE L’INFORMATION FINANCIÈRE 102
1. Mieux encadrer le fonctionnement des agences de notation 102
a) Adapter la notation à la complexité financière 103
b) Réduire les conflits d’intérêts en matière de notation 104
c) Accroître la concurrence sur le marché de la notation 105
d) Mettre en œuvre une véritable supervision européenne consolidée et efficace des agences de notation 106
2. Renforcer la protection des épargnants et des consommateurs 107
3. Mettre fin aux « trous noirs » de la finance 108
E. REDÉFINIR L’ORGANISATION DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE TANT EN FRANCE QU’EN EUROPE 110
1. Au niveau national : remédier à l’organisation encore trop cloisonnée et fragmentée des autorités de contrôle et de régulation 110
2. Au niveau européen : se doter d’une nouvelle supervision macro et micro-prudentielle 113
a) Les trois autorités européennes de surveillance 114
b) Les limites du « paquet supervision financière » de la Commission européenne 116
EXAMEN EN COMMISSION 119
SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS DE LA MISSION D’INFORMATION 121
LEXIQUE 127
GLOSSAIRE 133
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 137
Mesdames, Messieurs,
Dix ans seulement après la crise qui a ébranlé les économies asiatiques, l’économie mondiale doit aujourd’hui faire face à une violente et profonde récession. Parce qu’elle ne pouvait rester à l’écart des réflexions en cours sur la plus grave crise financière depuis la grande dépression de 1929, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a décidé, le 16 décembre 2008, de créer une mission d’information sur les nouvelles régulations de l’économie, composée de dix membres.
Après avoir remis, le 7 juillet 2009, son premier rapport sur la question de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux et des opérateurs de marché, la mission a souhaité poursuivre ses travaux en se consacrant plus particulièrement aux lacunes de la réglementation bancaire et financière à l’origine de la crise. Au cours des dix auditions et des deux tables rondes qu’elle a organisées ainsi que du déplacement à la Commission européenne et au Parlement belge qu’elle a effectué, l’ambition constante de la mission a été de répondre à deux questions majeures : comment en sommes-nous arrivés là ? Quelles réformes devons-nous mettre en œuvre afin de prévenir toute nouvelle crise d’une ampleur comparable ?
S’agissant de la première question, votre rapporteur est parvenu à la conclusion que la crise actuelle s’expliquait par de multiples causes qui, en conjuguant leurs effets, ont précipité l’économie mondiale dans la plus grave récession jamais enregistrée depuis 1929. Si le secteur bancaire et le monde de la finance sont en partie à l’origine de ce « séisme » économique et financier sans précédent, ils ne peuvent être tenus pour seuls responsables.
Le diagnostic clair et partagé, que pose le présent rapport sur les causes de la crise, interdit d’ailleurs de désigner tel ou tel comme responsable unique. Alors que l’innovation financière et la libéralisation des mouvements internationaux de capitaux ont profondément transformé la manière dont les risques circulent dans l’économie, les régulateurs, nationaux comme internationaux, publics comme privés, n’ont pas su répondre efficacement à ces nouveaux enjeux.
Ainsi, alors que nous nous pensions être définitivement à l’abri de toute vicissitude, dans un contexte d’épargne et de liquidité abondantes, d’innovations financières sources de rendements élevés, de progrès techniques constants et de croissance économique mondiale soutenue, nous avons en définitive perdu de vue que les cycles économiques étaient consubstantiels au capitalisme.
S’agissant de la seconde question, votre rapporteur est parvenu à la conclusion qu’à l’aune des conséquences désastreuses de la crise (explosion du chômage, chute du PIB et de l’investissement, dégradation des comptes publics…), nous mesurons désormais tous à quel point le maintien du statu quo en matière de régulation bancaire et financière est aujourd’hui impossible. En effet, par son ampleur inédite, la crise a ravivé les discussions sur les fondements et l’architecture de la supervision bancaire et financière. Sous l’impulsion décisive du Président de la République, les Européens plaident désormais pour la fondation d’un nouveau « Bretton Woods », c’est-à-dire d’un nouvel ordre financier international que le G20, regroupant les grands pays industrialisés et les grands pays émergents, a repris à son compte lors des sommets de Londres et de Pittsburgh.
Il apparaît donc plus que jamais nécessaire de repenser les fondements de la réglementation bancaire et financière tant la crainte est aujourd’hui grande que, si la reprise se confirme, nous n’assistions à un retour de la spéculation sur les marchés, alors même que nous ne disposons pas encore de tous les outils de régulation nécessaires. Une meilleure régulation apparaît dès lors indispensable dans plusieurs domaines, qui vont des normes prudentielles et comptables à la gestion des risques et aux agences de notation, en passant par l’organisation des marchés ou encore la question des rémunérations des traders.
Si les sommets du G20, qui se sont tenus à Londres et à Pittsburgh en avril et en septembre derniers, comportent des avancées majeures en la matière, les efforts entrepris doivent être poursuivis et amplifiés afin de poser les jalons d’une finance internationale régulée et maîtrisée au service de l’économie et des citoyens. Avec ses propositions, la mission d’information de la commission des Lois sur les nouvelles régulations de l’économie entend ainsi prendre activement part à l’entreprise de moralisation et de refondation du capitalisme en cours.
PREMIÈRE PARTIE : UNE CRISE SANS PRÉCÉDENT DE LA FINANCE GLOBALISÉE
Si les banques et, plus généralement, le secteur de la finance sont aujourd’hui au cœur de la crise économique, ils ne peuvent être tenus pour seuls responsables. En effet, la crise actuelle s’explique par de multiples causes, qui, en se cumulant, ont permis l’émergence et la propagation de ce choc économique sans précédent.
Alors que l’innovation financière et la dérégulation des marchés financiers ont sensiblement accru l’opacité ainsi que la complexité des produits financiers, les régulateurs, nationaux comme internationaux, n’ont pas su répondre efficacement à ces nouveaux enjeux.
Dix ans seulement après la crise qui avait ébranlé les économies asiatiques, l’économie mondiale a donc été plongée dans une violente et profonde récession, qui nécessite que soit présenté l’ensemble des facteurs à l’origine de ce « séisme » d’une ampleur inégalée depuis la crise de 1929. En effet, jamais cette onde de choc n’aurait pu se propager aussi rapidement et aussi massivement à l’ensemble de l’économie mondiale sans un cumul et un enchaînement de multiples facteurs.
I. DES CAUSES MULTIPLES À L’ORIGINE D’UN DÉRÈGLEMENT MAJEUR DE LA FINANCE INTERNATIONALE
Si la crise des « subprime » est généralement considérée comme le facteur essentiel d’émergence et de propagation de la crise financière à l’ensemble de la sphère économique, il serait cependant caricatural d’en faire la seule et unique cause de celle-ci. En effet, la crise financière a des causes beaucoup plus diverses et profondes, qui ont cependant pour point commun d’impliquer, de près comme de loin, les secteurs bancaire et financier.
En outre, si les banques et les marchés financiers sont, pour partie, responsables de la crise économique actuelle, il convient de souligner qu’ils demeurent utiles à la croissance de nos économies. En effet, la vigueur de la croissance observée pendant une grande partie des années 2000 s’explique notamment par les apports de la finance internationale, et notamment de ses innovations, en faveur d’une allocation optimale des risques dont profitent les entreprises et les citoyens.
Ainsi, sans occulter sa responsabilité, force est de reconnaître que la finance internationale « a doté l’économie mondiale de dispositifs d’une puissance étonnante, mais aussi d’une grande vulnérabilité » (3). C’est le fonctionnement de ces nouveaux dispositifs et les enchaînements qui ont conduit à une crise historique de la finance mondiale qu’il convient donc d’éclaircir.
A. UN EXCÈS DE LIQUIDITÉS ET DES DÉSÉQUILIBRES STRUCTURELS GÉNÉRATEURS DE BULLES
Comme l’a souligné, lors de son audition (4), M. Michel Pébereau, président du conseil d’administration de BNP Paribas, la crise bancaire et financière, que traversent actuellement tous les États, a pris sa source, d’une part, dans la manière dont le krach boursier de 1987 a été surmonté, à savoir la politique systématique d’« argent facile » de la Réserve fédérale américaine, et, d’autre part, le déséquilibre structurel global des balances des paiements courants, américaine (déficits) et asiatiques (excédents).
1. « L’argent facile » : une politique monétaire très accommodante de soutien systématique à la croissance
Afin de lutter contre la crise boursière du 16 octobre 1987, M. Alan Greenspan, alors à la tête de la Réserve Fédérale, décida de mener une politique monétaire expansionniste, injectant massivement des liquidités dans l’économie. Il s’agit là, pour reprendre les termes utilisés par M. Daniel Cohen, de « l’acte fondateur responsable de la séquence qui conduit à la crise, (…) la politique extrêmement libérale des taux d’intérêt du crédit menée par la Réserve fédérale ». La crise de 1987 est alors temporellement limitée, géographiquement cantonnée et économiquement maîtrisée.
Pendant les vingt années qui vont suivre, quelle que soit la question posée, quelle que soit la situation internationale considérée, quelle que soit la politique budgétaire menée, quel que soit le niveau du dollar, M. Alan Greenspan a mené la même politique, consistant à injecter autant que de besoin des liquidités. Ainsi, après de l’éclatement de la « bulle Internet » et les attentats du 11 septembre 2001, il a conduit une politique monétaire active et laxiste, qui s’est traduite par des taux d’intérêt relativement bas : le principal taux directeur de la Federal Reserve Bank (Fed) est ainsi passé de 6,5 % en mai 2000 à 3,5 % en août 2001 pour atteindre un plancher à 1 % en juin 2003.
Ce faisant, capitalisant sur cette politique monétaire très accommodante, les marchés ont progressivement intégré l’idée que leurs erreurs seront toujours corrigées par la banque centrale. Leur aversion au risque diminuant, ils n’ont pas hésité à prendre des positions de plus en plus extravagantes et à se tourner vers des placements offrant un rapport rendement/risque a priori attractif mais peu transparent, comme les dérivés de crédits (cf. infra).
Le résultat de cet excès de liquidités a été d’accélérer le crédit, de conduire à un excès d’endettement et in fine d’aboutir à la formation de bulles spéculatives, à l’instar de la « bulle Internet » à la fin des années 1990 et de la bulle immobilière après les attentats du 11 septembre 2001. Il convient de noter que ce choix de soutien continu à la croissance est une constante de la politique économique américaine, alors même qu’elle conduit à nier la notion de cycles économiques et contribue à l’accentuation des déséquilibres structurels de l’économie américaine.
Comme le souligne très justement M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des Finances du Sénat, dans son rapport sur la crise financière et la régulation des marchés, « le desserrement monétaire a ainsi contribué à accentuer les déséquilibres structurels de l’économie américaine – faible épargne et endettement élevé des ménages (dont une forte hausse de la composante hypothécaire), « déficits jumeaux » (budget fédéral et balance des paiements courants) largement financés par l’épargne asiatique – et à entretenir l’anesthésie de la croissance par endettement » (5).
En définitive, la politique monétaire très accommodante conduite aux États-Unis et consistant à injecter des liquidités dans l’économie afin de lisser le cycle économique a eu une double conséquence : diminution de l’épargne des ménages américains et détérioration de la balance des paiements du pays. Ce contexte d’aisance monétaire, qui s’apparente à une politique d’« argent facile », a conduit à un emballement du crédit et à la formation d’une bulle immobilière.
2. Les subprime, élément déclencheur de la crise
Comme votre rapporteur l’a déjà indiqué, après les attentats du 11 septembre et l’éclatement de la « bulle Internet », M. Alan Greenspan, afin de prévenir la récession, a massivement injecté des liquidités venues alimenter une bulle dans le secteur de l’immobilier américain. Ainsi, entre 2002 et 2006, la croissance annuelle moyenne de l’économie américaine a été de 5,4 % quand celle de l’immobilier était de 15 %. Mais cette bulle présentait une dimension particulière : elle se nourrissait de l’endettement des ménages. Pour continuer à consommer et à vivre le « rêve américain », les ménages américains ont alors substitué de l’endettement aux revenus qu’ils n’avaient pas.
Or, le mécanisme qui a permis cette croissance de l’endettement aux États-Unis – en particulier des ménages les moins solvables –, ce sont principalement les subprime loans. Le modèle du marché de l’immobilier est, en effet, très différent aux États-Unis de celui qui existe en France. Lorsqu’une banque américaine analyse la solvabilité d’un ménage qui sollicite un prêt pour acquérir un logement, elle ne prend pas en compte les revenus des emprunteurs, mais leur patrimoine. Des revenus significatifs ne sont pas nécessaires, dans la mesure où la valeur du logement couvre la valeur du crédit pour que celui-ci soit accordé. Un tel mécanisme, associé à des taux d’intérêt bas, a soutenu la croissance du marché de l’immobilier aux États-Unis. Lorsque le prix des maisons progresse, les propriétaires deviennent davantage solvables et profitent de la valeur – purement virtuelle – de leur maison pour contracter d’autres crédits à la consommation. En définitive, l’endettement des ménages américains a explosé en raison de liquidités abondantes et peu chères : il a ainsi bondi de 90 % de leur revenu disponible brut en 1997 à 140 % en 2007.
Profitant de ce contexte d’aisance monétaire, les banques et les intermédiaires financiers américains se sont alors engagés dans une distribution intensive de prêts hypothécaires immobiliers à taux variable aux ménages américains, quel que soit leur niveau de revenus. Octroyés sur la valeur estimée des biens et non sur la capacité de remboursement, nombre de ménages sont ainsi devenus propriétaires sans en avoir les moyens.
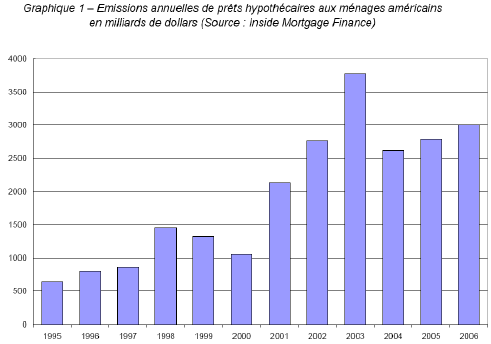
Source : René Ricol, Rapport sur la crise financière, Mission confiée par le Président de la République dans le contexte de la présidence française, septembre 2008.
C’est dans ce cadre qu’ont été consentis des prêts immobiliers en grand nombre à des ménages peu solvables. En effet, lorsque la clientèle classique des ménages ayant accès au crédit « prime » a commencé à se tarir, les prêteurs américains ont alors courtisé, grâce aux crédits subprime, une clientèle moins solvable. La distribution de prêts subprime a crû rapidement à partir du milieu des années 2000. En 2006, le volume global des prêts subprime octroyés aux États-Unis représentait environ 13 % de l’encours total des prêts immobiliers américains, soit 1 300 milliards de dollars.
LES CRÉDITS SUBPRIME
Les prêts hypothécaires « subprime » étaient destinés aux ménages à faible revenu et dont la note de crédit était médiocre (en général inférieure à 620, sur une échelle allant de 300 à 850) en raison d’événements de crédit antérieurs. Selon certains économistes, le développement de ces prêts a été facilité par une législation favorable à l’octroi de crédit aux communautés défavorisées (marginalisées par la pratique discriminatoire du « redlining »), en particulier le Community Reinvestment Act, adopté en 1977 et élargi en 1997. Ce dispositif ne concernait toutefois que les banques assurées au niveau fédéral.
Les prêts « subprime », en général d’une maturité de 30 ou 35 ans, prévoyaient un taux variable indexé sur le taux directeur de la Fed ou le taux interbancaire du marché londonien (Libor). Une modalité fréquente (prêts dits « reset » 2/28 ou 3/27) consistait à proposer un taux fixe promotionnel durant les deux ou trois premières années, puis un taux variable élevé. L’amortissement pouvait également être négatif ou le remboursement ne porter dans un premier temps que sur les intérêts. La garantie apportée par l’hypothèque sur le logement financé permettait, dans un marché immobilier fortement haussier jusqu’en 2007, de limiter optiquement le risque de défaut de l’emprunteur.
Source : Rapport d’information (n° 59, session ordinaire de 2009-2010) de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des Finances du Sénat, sur la crise financière et la régulation des marchés.
Le développement de ces prêts subprime a permis à une nouvelle catégorie d’emprunteurs, dont la solvabilité était moins assurée, d’accéder au crédit immobilier, grâce à un relâchement continu des règles de prudence appliquées par ceux qui distribuent ces crédits : au fil des mois, les exigences d’apport personnel se réduisent, la part des prêts accordés sans preuve de revenu augmente, comme celle des prêts à taux d’appel bas, destinés à être revisités en hausse de plusieurs centaines de points de base, au bout de deux ou trois années. En définitive, les crédits subprime avaient au minimum une caractéristique très risquée.
FACTEURS DE RISQUE DES SUBPRIME
Crédits subprime |
% total des subprime |
Intérêts seulement |
37% |
Pas d’apport personnel |
38 % |
Pas de documentation sur le revenu de l’emprunteur |
43 % |
Taux d’intérêt bas d’amorce et reset à deux ans |
80 % |
Risque combiné |
26 % |
Source : Deutsche Bank, cité par Michel Aglietta et Sandra Rigot, dans Crise et rénovation de la finance, Odile Jacob, 2009.
Cette dégradation continue de la qualité des prêts subprime se traduira rapidement dans celle des performances des différents millésimes : après un an, la fréquence des incidents de paiements sur les prêts accordés en 2006 était environ quatre fois plus élevée que sur ceux faits en 2003 et même deux fois plus élevée que sur ceux faits en 2001, lorsque l’économie américaine était en récession. L’annonce par HSBC de pertes importantes sur des créances adossées à des prêts subprime, détenues par des fonds d’investissement gérés par elle, déclenchera, au début de mars 2007, la première poussée de fièvre sur les marchés financiers.
Or, grâce à l’innovation financière, près des deux tiers de ces crédits subprime ont été titrisés. Ainsi, le risque, dont ils étaient porteurs, a été disséminé dans toute l’économie, ouvrant la voie à un effet de contagion rapide et massif en cas de retournement du marché immobilier américain.
3. La sophistication financière : une promesse de hauts rendements pour un niveau de risques très élevé
a) L’ambivalence originelle de l’innovation financière
Au cœur de la crise bancaire et financière, l’innovation financière occupe une place importante. Utilisée pour répondre à des exigences croissantes de rentabilité, elle est devenue, selon l’expression de Warren Buffet, une « arme de destruction financière massive » en raison d’une complexité croissante pour les opérateurs comme pour les investisseurs.
Néanmoins, l’innovation financière ne saurait être perçue uniquement comme une menace. En permettant une meilleure allocation tant de l’épargne que des risques, elle permet de lever les contraintes de financement et de soutenir la croissance économique, dont profitent les entreprises et les citoyens. Ambivalente par nature, l’innovation financière n’est pas mauvaise en soi, dès lors qu’elle est maîtrisée et régulée.
Or, comme le soulignent certains auteurs, il s’est opéré une « prise de pouvoir des mathématiques financières dans les salles de marché, notamment pour évaluer les produits dérivés » (6).
Comme l’a indiqué M. Christian de Boissieu, Président délégué général du Conseil d’analyse économique, lors de son audition par votre rapporteur (7), les produits dérivés représentent un marché considérable dont la somme des transactions a atteint 600 000 milliards de dollars en 2007. Ils s’apparentent à des paris sur l’avenir en donnant le droit d’acheter un actif (une action, une matière première, une devise…) à un certain prix à une échéance donnée. Les modèles mathématiques ont alors été utilisés pour essayer de déterminer l’évolution possible des marchés et fonder les décisions d’achat et de vente des produits dérivés. Ces modèles reposent sur l’idée que les mouvements de prix des produits dérivés sont aléatoires et répondent à un mouvement aléatoire : ces modèles n’étaient donc nullement fondés sur la connaissance des fondamentaux d’une entreprise ou d’un actif pour déterminer son prix ou son évolution.
« Les modèles mathématiques se chargeaient de tout, au prix d’une complexité telle que tout contrôle devenait purement et simplement impossible » (8). La sophistication des modèles mathématiques, à l’origine de l’innovation financière, a parfois fait oublier que connaître le risque et le modéliser ne suffisent pas à le maîtriser. La titrisation et le développement des produits structurés sont autant d’exemples d’une innovation financière non maîtrisée qui a, en partie, conduit à la crise économique que nous traversons actuellement.
b) La titrisation : courroie de transmission de la crise
La titrisation de créances est un exemple emblématique de cette dérive par laquelle l’innovation financière perd ses qualités originelles. La technique de la titrisation, qui est au centre de la crise actuelle, est une innovation des années 1970 qui permet à une banque de transférer à d’autres agents économiques le risque de crédit.
LA TITRISATION
La titrisation est une transformation de crédits en titres financiers par la succession de trois opérations :
• Le pooling : l’assemblage par une institution financière d’un portefeuille composé de créances bancaires et/ou d’instruments financiers négociables (obligations, autres titres de créances…) et/ou de dérivés de crédit. Ce portefeuille provient soit de l’activité d’octroi de crédit de la banque, soit de l’achat par la banque de ces actifs sur les marchés financiers.
• L’offloading : la déconnexion entre le risque de crédit du portefeuille et celui de la banque initiatrice du montage via le recours à un véhicule ad hoc (un special purpose vehicle – SPV) émettant des titres et portant les actifs sous-jacents. Les crédits mis en pool et titrisés sont sortis du bilan de la banque d’investissement pour être logés dans ces véhicules ad hoc.
• Le tranching : le découpage en tranches de l’émission de titres, selon une hiérarchie précise quant aux droits des différentes tranches émises sur les revenus tirés des actifs ou des dérivés de crédit sous-jacents. En effet, les pools de crédits sont notés par les agences de notation et les titres émis en contrepartie sont classés en tranches hiérarchisées selon un principe de subordination. Ces tranches — senior, mezzanine, equity — bénéficient ainsi d’un rang de priorité décroissant sur les revenus des actifs et présentent symétriquement des niveaux de risque (et donc de rendement) croissants. Les pertes liées aux défauts éventuels de paiement seront absorbées par les tranches dans l’ordre de leur subordination : c’est la structuration du crédit. La tranche equity est la première à absorber des pertes dans l’éventualité d’un ou plusieurs défauts au sein du portefeuille. Si les pertes excèdent le montant de cette tranche, c’est au tour de la tranche mezzanine d’être affectée. Enfin, ce n’est que si les défauts se révèlent nombreux et importants, que la tranche senior sera affectée et subira des pertes.
Source : Banque de France, La crise financière, Documents et débats, février 2009, n° 2.
Travaillant en collaboration avec les agences de notation qu’elle rémunère, l’industrie de la titrisation va produire en grande quantité des titres aux rendements attrayants. La titrisation s’est alors appliquée à une gamme toujours plus élargie d’actifs, pourvu que ceux-ci puissent générer une séquence de revenus suffisamment prévisibles pendant une période donnée.
C’est ainsi que des actifs de plus en plus risqués ont été inclus dans les montages de titrisation, alors même que le marché de la titrisation était réputé pour sa sécurité, dans la mesure où il s’appuyait sur du collatéral (9) de première qualité (notamment des prêts immobiliers de bonne qualité). Certains facteurs de demande ont cependant aussi joué un rôle, certaines institutions, notamment des compagnies d’assurances, fonds de pension, petites banques mais aussi des entreprises et même quelques États, cherchant à dynamiser leurs rendements et à diversifier leurs portefeuilles d’investissement, à l’image des grandes banques.
Dans ces conditions, l’écoulement des titres adossés à des prêts subprime n’a, dès lors, posé aucun problème : inattentifs au risque, les investisseurs ont été attirés par le surcroît de rendement auquel ils pouvaient accéder pour des titres de note donnée. En laissant titriser des prêts dont la qualité n’a cessé de se dégrader, on a alimenté les chaînes de prises de risque en titres qui allaient se révéler d’autant plus corrosifs que leurs acquéreurs (hedge funds, grandes banques d’investissement, etc.), étaient souvent aussi preneurs d’un risque de liquidité.
Par le biais de la titrisation, les expositions risquées se trouvent largement dispersées auprès de nombreux investisseurs, et dans plusieurs zones géographiques. Même des investisseurs perçus comme présentant une aversion au risque (OPCVM « monétaires dynamiques » en France par exemple) peuvent en détenir à titre de diversification ou d’amélioration du rendement.
La stabilité du système reposait ainsi sur une attitude complaisante face au risque. Le choc du subprime va, en quelques semaines, la faire changer radicalement. La perception du risque sur les titres détenus comme l’aversion au risque de tous les maillons des chaînes de prises de risque vont brusquement et fortement monter. Par ce biais, le choc du subprime va rapidement se propager à l’ensemble du système financier international.
Comme le soulignent très justement Michel Aglietta et Sandra Rigot, « la titrisation sans contrôle ni supervision des autorités prudentielles, dans la croyance aveugle de l’autorégulation des marchés, a été la porte ouverte à l’irresponsabilité » (10).
Avec le développement de la titrisation, s’est opéré un changement radical dans le business model de l’intermédiation bancaire, qui est passée du modèle Originate and hold au modèle Originate and distribute. Ce processus bancaire « d’initiation et de distribution » du crédit est ainsi devenu, pour reprendre l’expression de M. Philippe Marini, « un paradigme aveuglant de marchéisation du crédit et de dissociation entre la croissance du crédit et le portage du risque y afférent » (11). Dans ce modèle, la banque n’a plus désormais à détenir et donc à financer les crédits qu’elle a initiés, dans la mesure où elle peut les revendre et donc faire supporter par d’autres (fonds de placement, compagnies d’assurance) les risques et le financement de ces crédits.
Modèle « Originate and hold » Initier les crédits et porter le risque |
Modèle « Originate and distribute » Initier et vendre les crédits ou garder les crédits, mais vendre le risque |
- Le profit du prêteur est fonction croissante du risque pris ; |
- Le profit du prêteur est fonction croissante du volume des crédits vendus ; |
- Incitation à évaluer la solvabilité de l’emprunteur ; |
- Incitation au crédit contre collatéral : la hausse anticipée de la valeur du bien ; |
- Asymétrie d’information réduite par la proximité de l’emprunteur et du prêteur qui fait le monitoring pendant la vie du prêt ; |
- Asymétrie d’information accrue par la faible incitation à considérer le profil de risque du débiteur ; |
- Offre de crédit par des banques munies d’une capacité à évaluer des crédits ; |
- Offre de crédit par les banques et par une variété d’officines non bancaires ; |
- Contrôle prudentiel : provision du capital en face du crédit. |
- Aucun contrôle prudentiel, aucune provision en capital. |
Aléa moral contenu |
Aléa moral maximisé |
Source : Michel Aglietta, Sandra Rigot, op. cit., p. 37.
c) Les produits structurés : un terrain d’élection pour l’innovation financière
Devant le succès rencontré par la titrisation, se sont développés des produits structurés, instruments sophistiqués qui regroupent en « paquets » différentes obligations et les découpent en tranches en fonction du goût pour le risque de chaque investisseur. Au nombre de ces produits structurés, on trouve les asset-backed securities (ABS) ou bien encore les collateralized debt obligations (CDO). L’opacité de ces produits complexes a été à l’origine des très graves turbulences financières qui ont secoué l’économie mondiale ces deux dernières années.
S’agissant plus particulièrement des CDO, ces derniers correspondent à la structuration d’actifs titrisés moins standards car plus hétérogènes que les actifs traditionnellement titrisés (prêts hypothécaires subprime ou cartes de crédit). En particulier, des CDO ont été conçus sur des actifs soit moins liquides, à l’image des prêts octroyés dans le cadre d’opérations de rachat avec effet de levier — leveraged buy-out (LBO) — ou sur des actifs eux-mêmes déjà issus d’une première titrisation et qui ont été retitrisés. Le CDO est souvent conçu sur mesure, pour s’adapter aux besoins précis de l’investisseur et à son profil de risque et potentiellement avec un fort effet de levier.
CARACTÉRISTIQUES DES COLLATERALISED DEBT OBLIGATIONS (CDO)
Fruits d’innovations financières relativement récentes, les CDO sont des titres représentatifs de portefeuilles de créances bancaires ou d’instruments financiers de nature diverse. Au confluent de la titrisation et des dérivés de crédit, ces produits de finance structurée, en plein essor, recouvrent des montages répondant à différentes motivations des institutions financières, celles-ci pouvant chercher aussi bien à réduire leur coût de refinancement ou à exploiter des opportunités d’arbitrage qu’à se défaire de risques de crédit. Toutefois, quelle que soit leur forme, les CDO ont en commun d’être émis en différentes tranches dont le découpage obéit aux techniques de la titrisation et permet de redistribuer de manière ad hoc aux investisseurs les revenus et le risque de crédit de leur portefeuille sous-jacent.
Les CDO participent du mouvement de fond de marchéisation du risque de crédit, un processus inauguré par la titrisation, puis soutenu par le développement de la notation financière, du marché obligataire privé et, plus récemment, par celui des dérivés de crédit. Si les émissions de CDO représentent tout au plus l’équivalent du sixième des émissions du marché obligataire corporate, l’influence de ces produits est bien plus significative du fait de l’ampleur des transferts de risque de crédit qu’ils permettent, compte tenu de l’importance prise par les montages synthétiques à l’appui de dérivés de crédit, en particulier en Europe.
L’essor des CDO a facilité l’accès des investisseurs non bancaires aux marchés de crédit et leur a permis de s’abstraire des contraintes posées par la taille et la diversification limitées du marché obligataire privé, notamment en Europe où l’intermédiation bancaire reste dominante. Ceux-ci peuvent désormais sélectionner des portefeuilles de signatures correspondant au profil de rendement/risque de leur choix et s’exposer à des risques de crédit auparavant cantonnés dans les bilans bancaires, comme, par exemple, ceux des petites et moyennes entreprises.
En tant qu’instruments de transfert du risque de crédit, les CDO facilitent la redistribution de ce risque au sein ou en dehors de la sphère bancaire et financière, tout en renforçant le degré de complétude du marché de crédit. Ils sont donc de nature à exercer une influence a priori favorable du point de vue de la stabilité financière. Cependant, comme tel est souvent le cas pour les innovations financières, l’évaluation des CDO et de leurs risques fait appel à des techniques complexes et plus ou moins éprouvées. Les investisseurs, tout comme les intervenants du marché, peuvent ainsi être exposés à des pertes plus ou moins sévères.
Source : Extrait de la Revue d’économie financière, n° 92, 2008.
Néanmoins, après avoir été loué pour avoir conduit à une répartition plus large du risque, le modèle au gré duquel les établissements de crédit restructurent le risque sous forme de « produits structurés » (notamment en réorganisant les portefeuilles pour vendre différentes « tranches » de risque aux investisseurs en fonction de leur aversion pour le risque) a été fortement critiqué.
En premier lieu, l’évaluation des produits structurés fait appel à des techniques quantitatives complexes et d’autant plus difficiles à maîtriser qu’elles n’ont pas encore été éprouvées sur une période suffisamment longue. Les intervenants de ce marché peuvent donc être exposés, quel que soit leur degré d’expertise, à des risques de pertes plus ou moins sévères.
En deuxième lieu, les produits structurés sont constitués pour s’adapter parfaitement aux caractéristiques et au profil de risque requis par leur acquéreur. Ces propriétés limitent leur aptitude à être revendus à d’autres investisseurs dont les préférences ou les besoins peuvent être différents. Du fait de la faible liquidité des produits structurés sur les marchés secondaires, ceux-ci ont posé un problème particulier de valorisation. Dans ce cas, la « valorisation en valeur de marché » (fair value) se résume, en fait, très souvent à une « valorisation en valeur de modèle ». Or en raison de la complexité des modèles, il est plus difficile pour les investisseurs de comprendre les propriétés intrinsèques des actifs et de mesurer les variations de leur valeur en réponse aux chocs. Par ailleurs, plus le produit est récent, plus les séries chronologiques utilisées pour mesurer les corrélations historiques et quantifier les risques sont insuffisantes et plus sa valorisation est incertaine. Au total, quand les investisseurs ont perdu confiance dans les produits titrisés, leur valorisation est devenue quasiment impossible à déterminer.
En troisième et dernier lieu, la composition de ces produits structurés reste quasiment incompréhensible pour les particuliers qui y souscrivent. Ainsi, comme le rappelle M. Jacques Attali, « certains établissements financiers offrent ainsi à leurs clients de placer leur épargne en des titres de ce genre dont la description tient en un manuel de cent cinquante pages qu’aucun cadre supérieur de banque ne peut comprendre ni donc contrôler » (12).
d) L’innovation financière, promesse de rendements démesurés
L’innovation financière, dans un contexte d’excès de liquidités injectées dans l’économie, a conduit les investisseurs à exiger peu à peu des rémunérations du capital démesurées au regard des principaux agrégats économiques. C’est ce que MM. Mathieu Pigasse et Gilles Finchelstein appellent « l’argent fou » (13).
En effet, pendant la dernière décennie, le taux de retour sur investissement (Return on Investment – RoI), qui permet de mesurer la rémunération attendue pour chaque euro investi, a été régulièrement fixé à des niveaux jamais atteints auparavant : de l’ordre de 15 % à 20 % par an, parfois même 25 %.
Or, cette exigence de rentabilité repose sur une illusion : une économie mondiale qui progresse de moins de 5 % par an ne peut produire une rémunération du capital de 15 à 20 % par an. En outre, y parvenir à un coût économique à moyen terme : toutes les mesures, en effet, tendent à privilégier le court terme et à négliger le long terme, les investissements, l’innovation, la recherche.
Ces exigences de rentabilité ont progressivement commencé à servir de références et de normes pour toutes les entreprises suivies par les analystes financiers, c’est-à-dire par les équipes qui travaillent dans les départements de recherche des grandes banques et qui analysent les titres des grandes entreprises.
4. Les excès des modes de rémunération dans le secteur bancaire et financier
La structure et le niveau des rémunérations atteints dans l’industrie financière sont l’une des explications ayant conduit à la crise économique actuelle. En effet, l’analyse des rémunérations dans les banques et les institutions financières montre que les modes de rémunération tendent à privilégier systématiquement la création de richesses à court terme au détriment des investissements de long terme.
C’est notamment le cas des bonus, apparus au sein des grandes banques anglo-saxonnes dans les années 1980 : il s’agit de primes salariales, versées chaque année en fonction des performances de l’entreprise et de chaque individu, qui s’apparentent à un système de partage des résultats individuels entre l’institution financière et ses salariés. Or, ces bonus ont connu une double dérive.
En premier lieu, les montants en jeu sont colossaux. En 2006, les cinq premières banques américaines ont versé à leurs salariés, sous forme de bonus, 25 milliards de dollars, dont 53 millions pour le patron de Goldman Sachs et 11 millions pour celui de Lehman Brothers. En 2007, alors que la crise vient d’éclater à l’été, ces montants passent à 65 milliards de dollars, dont 68 millions pour le président de Goldman Sachs et 35 pour celui de Lehman. Dans son rapport sur la régulation de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux et des opérateurs de marché, M. Philippe Houillon, s’appuyant sur les données fournies par le Conseil d’analyse économique, rappelait ainsi que « le bonus moyen des traders et des vendeurs équivaut à quatre fois le montant de la rémunération fixe moyenne » (14).
En second lieu, les bonus poussent à une prise de risque excessive. Leurs montants ne sont pas toujours fonction de ce que vont rapporter à terme les produits complexes placés par les opérateurs de marché. Ces bonus sont, au contraire, indexés sur le produit immédiat de la vente. La logique individuelle est donc de vendre le maximum de produits à court terme, sans prendre en compte les risques de moyen et long terme. En définitive, comme le résume Joseph Stiglitz, « le système des bonus a très certainement contribué d’une manière importante à la crise. Il a été conçu pour encourager la prise de risques, mais il a encouragé la prise de risques excessifs » (15).
Souscrivant pleinement aux conclusions du rapport précité de M. Philippe Houillon, votre rapporteur constate que « le secteur de la finance, et tout particulièrement celui de la finance d’investissement ou de la banque d’affaires, s’illustre par des rémunérations parfois vertigineuses. […] Pareilles sommes révèlent une certaine déviance du système financier, dont la finalité s’est peu à peu muée en une accumulation de plus-values au détriment du financement du développement des entreprises » (16). M. Patrick Artus et Mme Marie-Paule Virard ne disent pas autre chose lorsqu’ils affirment que « comme la soif de l’or autrefois, la soif de rendement a entraîné la planète finance aux confins de la crise systémique » (17).
Il n’est pas possible de comprendre le sens profond de la crise sans revenir sur la finalité d’une banque. Le cœur du métier de banquier est de prêter de l’argent et pour ce faire d’évaluer les risques afférents à cette activité. En fonction de cette évaluation, qui doit être la plus fine possible, il lui revient de décider s’il convient d’accorder un crédit et de décider à quel taux.
L’État, quant à lui, doit remplir une double fonction : éviter que les banques prennent des engagements qui, pris globalement, puissent les mettre en danger et encourager les banques à prêter suffisamment pour faire fonctionner l’économie. Or, dans une économie qui finançait sa croissance par l’endettement, les banques ont oublié leur cœur de métier, en ignorant voire en masquant le risque.
Deux mécanismes ont permis d’immuniser en partie les banques de tout risque.
En premier lieu, comme votre rapporteur l’a déjà souligné, la titrisation a donné la possibilité à une banque de céder à d’autres le risque qu’elle a pris. En effet, la titrisation permet de faire sortir du bilan des banques ceux des crédits qui sont considérés comme risqués et de les transférer à d’autres investisseurs. Les avantages de la titrisation sont multiples. Les banques transfèrent à d’autres le risque de crédit qu’elles ont pris en distribuant les prêts. Le produit de la vente de ces crédits, sous forme d’obligations – ABS ou CDO – leur fournit une source de revenus supplémentaires. Enfin, la titrisation présente pour les banques l’avantage de leur faire économiser du capital, puisqu’elles n’ont ainsi plus besoin d’immobiliser des fonds propres comme les règles prudentielles le leur imposent lorsqu’elles conservent des crédits dans leurs bilans. Dès lors, tout actif vendu via la titrisation permet de prêter à un niveau équivalent.
En second lieu, les Credit Default Swap (CDS) ont également permis de transférer le risque. Il s’agit de primes d’assurance payées par une banque à un tiers assureur pour se protéger contre la faillite d’un emprunteur. Le CDS permet donc à une banque de prêter à un débiteur en qui elle n’a pas confiance et auquel elle ne prêterait normalement pas, moyennant le versement d’une prime d’assurance. À l’instar de la titrisation, les CDS ont permis de prêter toujours plus en transférant le risque à d’autres, la banque croyant ainsi ne plus supporter le risque. En effet, l’achat d’un CDS par une banque modifie les exigences prudentielles en fonds propres de cette banque. Dans la mesure où il constitue une garantie contre le défaut de l’émetteur de l’obligation, la détention d’un CDS diminue les exigences en fonds propres. Par ailleurs, comme pour tous les marchés de gré à gré, le risque de contrepartie y est élevé car il n’existe pas de chambres de compensation assurant la garantie des engagements via un système d’appels de marge et de collatéraux.
Le marché des dérivés de crédit s’est considérablement développé ces dernières années, disséminant ainsi le risque dans toute l’économie. Ainsi, les encours notionnels (18) de CDS ont été multipliés par quinze depuis cinq ans, passant de 3 780 milliards de dollars en 2003 à 62 170 milliards de dollars en 2007.
L’ensemble de ces mécanismes présente des avantages indéniables, ce qui explique en partie leur développement considérable. S’agissant de la titrisation, l’encours d’ABS est passé de 1 200 milliards de dollars en 1999 à près de 4 000 milliards de dollars en 2007 aux États-Unis. Quant aux CDS, le système était à ce point attractif qu’il a été progressivement étendu à des risques de plus en plus divers et pour des montants de plus en plus importants. En 2004, les encours de CDS représentaient 6 000 milliards de dollars, soit un peu moins de la moitié du PIB des États-Unis. En juin 2008, ils s’élevaient à près de 60 000 milliards de dollars, soit dix fois plus en trois ans et un peu plus de la totalité du PIB mondial.
Or, le problème majeur vient de ce que l’ensemble des opérateurs économiques a négligé et sous-évalué les risques véhiculés par l’innovation financière.
Ainsi, la titrisation présente de nombreux dangers pour l’économie dans son ensemble. Tout d’abord, elle déresponsabilise les banques : dès lors qu’un actif est rapidement transféré, celui qui accorde un prêt n’examine quasiment plus le risque que le créancier représente. Ensuite, la titrisation permet de contourner les règles prudentielles. Elle autorise, en effet, les banques à ne pas constituer de fonds propres en fonction des prêts réellement accordés, dans la mesure où les exigences prudentielles ne s’appliquent pas aux crédits sortis du bilan des banques. Enfin, la titrisation contribue à la dissémination des risques dans l’économie, notamment par l’opacité qui l’accompagne. Certaines obligations agrégeaient parfois 20 000, voire 30 000 contrats différents, au point que l’acheteur ne savait pas ce qu’il achetait et que le vendeur ne savait pas ce qu’il vendait.
Les risques dont est porteuse la titrisation ont permis à M. Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France, de parler à propos de l’actuelle crise financière d’une « crise de la titrisation. Vous le savez, la titrisation est une technique ancienne et en réalité très efficace et utile. La nouveauté dans cette crise est que dans la période qui l’a précédée, la titrisation a été utilisée dans des structures financières très instables, qui finançaient à court terme des produits complexes et structurés très peu liquides et à la valeur très incertaine. L’instabilité de telles structures était largement masquée. L’abondance de la liquidité permettait en effet de refinancer même les créances de qualité médiocre ou de valeur incertaine. En outre, une notation favorable et une garantie assurantielle permettaient de rehausser artificiellement la qualité de ces créances. La montée des défauts, d’abord sur les crédits subprime, déclencha une réaction en chaîne dont les conséquences continuent de se faire sentir aujourd’hui. Les diverses protections mises en place se sont révélées inefficaces. La liquidité s’est évaporée beaucoup plus vite qu’elle n’était apparue. Les dégradations de notes par les agences se sont succédées en cascade, avec une rapidité et, surtout, une brutalité sans commune mesure avec la qualité présumée des actifs en question » (19).
Les CDS souffraient d’une seule limite : ils n’étaient pas financés. Celui qui vendait sa protection n’avait pas pour obligation de constituer la garantie au niveau de la protection qu’il vendait. Il touchait la prime d’assurance, mais ne préfinançait pas la protection. La garantie était, en réalité, virtuelle.
Finalement, les banques pensaient être immunisées contre les risques qu’elles prenaient. Soit elles les sortaient de leurs bilans par la titrisation. Soit elles les assuraient en contractant un CDS. En vérité, alors que le volume de prêts accordés par les banques n’a cessé d’augmenter, personne n’avait la capacité de mesurer les risques qui étaient supportés par les banques. La Banque de France (20) a ainsi souligné à juste titre que « du fait d’un environnement économique extrêmement favorable (inflation faible, croissance forte, solidité financière des entreprises), les investisseurs ont sous-estimé les risques attachés à ces produits. Cette sous-évaluation du risque par les marchés financiers, visible dans des primes de risques historiquement faibles sur presque tous les marchés, avait été relevée à plusieurs reprises, notamment dans la Revue de la stabilité financière de la Banque de France (21) ».
3. La dérégulation bancaire et financière
Alors que l’activité bancaire et financière était auparavant extrêmement encadrée, les États-Unis sont entrés, à la fin des années quatre-vingt-dix, dans une démarche systématique de dérégulation.
Comme l’a rappelé M. Christian Stoffaës (22), le Glass-Steagall Act ou Banking Act de 1933 était la législation adoptée à la suite des enquêtes en recherche de responsabilité conduites par le Congrès après le krach de 1929. Le Congrès avait alors estimé que l’implication des banques de dépôt dans les marchés financiers était la grande responsable de la spéculation boursière et des faillites bancaires consécutives au krach. Le principe de cette législation était d’interdire aux banques de dépôt régulées l’accès aux marchés financiers libres, de leur prohiber la détention et le commerce des titres et de restreindre leur activité à la gestion des dépôts monétaires de leurs clients et aux opérations classiques de prêts commerciaux à court terme.
Le Glass-Steagall Act avait donc fermé aux banques l’accès à Wall Street, en édictant une incompatibilité entre les métiers de la banque de dépôt (commercial banking) et de la banque d’investissement (investment banking), donc entre le métier bancaire et le métier des marchés financiers. En application de cette loi, les géants de Wall Street ont dû opérer un choix radical entre l’une ou l’autre des deux activités. Le Banking Act de 1933 a été complété en 1956 par un autre texte qui a prohibé la confusion des métiers de banque et d’assurance. Ainsi, l’industrie financière américaine avait été coupée en deux : le secteur régulé, celui de la banque ; le secteur non régulé, celui des marchés financiers.
Le régime réglementaire du Glass-Steagall Act est resté en vigueur pendant soixante-six ans, jusqu’à son abrogation en novembre 1999 par le Gram-Leach-Bliley Act (ou Financial Services Modernization Act), qui a autorisé la constitution de holdings financiers conduisant simultanément des activités de banque commerciale, de banque d’investissement, de courtier en titres, d’assurance. Cette loi a donc « déspécialisé » l’activité bancaire. « Les banques de dépôt peuvent dès lors à nouveau être présentes à Wall Street, comme elles l’étaient avant 1929 » (23).
La dérégulation des marchés financiers s’inscrit alors dans un mouvement général de libéralisation des secteurs réglementés (transports aériens, télécommunications…). Le Glass-Steagall Act paraissait devenu obsolète et inadapté, alors que les métiers financiers avaient profondément changé. Pendant ce temps, les banques européennes et japonaises se transformaient en géants mondiaux, entraînant le déplacement progressif, de New York vers la City de Londres, du pôle de référence financier de la planète.
Cette volonté de dérégulation a, ce faisant, très largement touché l’Europe. Les banques européennes ont souvent cédé à la tentation de développer les mêmes instruments spéculatifs que les banques américaines. Elles ont aussi pris part au développement des rémunérations inconsidérées et des « paradis fiscaux », particulièrement à partir de la place financière de Londres.
La période de finance « facile » a engendré la tentation des investisseurs de prendre davantage de risques et d’avoir plus largement recours à l’endettement. L’élimination de barrières structurelles entre banque d’investissement et banque de dépôts a également favorisé la fluidité du crédit. Il en est résulté une concurrence accrue au sein du secteur financier et une stimulation de l’innovation financière. Or, il est très largement admis aujourd’hui que les innovations financières ont à leur tour facilité la prise de risques.
C. LA FAILLITE DE LA RÉGULATION
Le paradoxe le plus étonnant de la crise actuelle réside dans le fait que les règles qui ont été édictées, aux États-Unis comme en Europe, ont contribué non pas à prévenir, à empêcher ou à contenir la crise, mais bien au contraire, à l’amplifier.
1. Des règles déstabilisatrices et procycliques
Tel est le cas, en premier lieu, des normes comptables avec la généralisation des normes IFRS. Afin d’évaluer la valeur d’une entreprise dans le bilan d’un établissement financier, en France notamment, on prenait en compte jusqu’à récemment le « coût historique », c’est-à-dire la valeur d’acquisition des actifs de l’entreprise. Ce système a été remplacé le 1er janvier 2006, dans toute l’Union européenne, par les normes IFRS. Désormais, chaque actif est comptabilisé à sa valeur du jour. C’est le mark-to-market, le prix de marché devant refléter la juste valeur des actifs. Ainsi, lorsqu’une banque a des participations dans une entreprise, la valeur de cette participation varie en fonction de l’évolution du cours de bourse. Or, si le cours baisse significativement, la valeur comptable des actifs détenus par les banques diminue également de façon tout aussi significative. Les établissements bancaires doivent alors enregistrer des dépréciations. Mais leur bilan devant rester équilibré, ils doivent dans le même temps faire des provisions, donc constater des pertes et éventuellement céder des actifs ou lever du capital.
Aux normes comptables s’ajoutent les normes prudentielles applicables aux banques. En effet, une banque ne peut évidemment pas consentir n’importe quel volume de crédits. Il doit y avoir un équilibre, résumé sous le terme de « normes prudentielles », entre ce qu’elle prête – soit les risques auxquels elle s’expose – et ce qu’elle possède – soit les fonds propres dont elle dispose. L’enjeu que sous-tend la question des normes prudentielles est de savoir à quel niveau fixer ces normes et, surtout, par quelles méthodes évaluer les crédits et donc les actifs des banques. Les accords de Bâle I (1988) prévoyaient, sous l’égide de la Banque des règlements internationaux (BRI), la mise en place d’un dispositif prudentiel destiné à mieux appréhender le risque de crédit et les exigences en fonds propres des banques. Pour ce faire, le ratio Cooke imposait aux banques de conserver un volant de liquidité égal à 8 % de leurs engagements de crédits, sous la forme de fonds propres disponibles.
Les accords de Bâle II, publiés le 26 juin 2004, tendent à mieux prévenir les faillites bancaires individuelles grâce à des normes de fonds propres plus flexibles et mieux proportionnées aux risques et à leurs évolutions. Ainsi, applicable depuis 2007, le ratio Mac Donough a remplacé le ratio Cooke en Europe, mais non aux États-Unis. Pour évaluer les risques pris par une banque, on ne se limite plus à les rapporter à ses fonds propres. On intègre deux risques supplémentaires : le risque opérationnel, c’est-à-dire « les risques de pertes liés à des systèmes ou des personnes inadéquats ou défaillants » et le risque de marché.
La valeur de l’actif de la banque, c’est-à-dire la valeur du crédit qu’elle a consenti, doit elle aussi être ajustée à sa valeur de marché. Si la valeur du marché diminue, parce que les cours boursiers baissent, les normes prudentielles imposent à la banque de détenir moins d’actifs risqués. Elle doit alors céder une partie de ces actifs risqués et ce faisant, elle alimente la spirale à la baisse du marché. Ainsi, apparaît l’une des principales critiques adressées au ratio Mac Donough, à savoir son biais pro-cyclique.
Le régulateur a voulu favoriser l’harmonisation et la transparence. Il a, en réalité, accru la volatilité non seulement du bilan des institutions financières – banques y compris – mais aussi des marchés dont la baisse se traduit mécaniquement, pour respecter les nouvelles normes IFRS ou le nouveau ratio Mac Donough, par une spirale à la baisse des marchés.
LE DISPOSITIF DE BÂLE II
Le nouveau ratio de solvabilité (24) Bâle II repose sur trois piliers :
Pilier 1 : améliorer le calcul des risques et leur couverture par des fonds propres ; assurer une meilleure stabilité micro-prudentielle avec un ratio mieux proportionné aux risques.
Les exigences en fonds propres sont la somme des exigences au titre du risque de crédit, des risques de marché et des risques opérationnels. Cette exigence a nécessité d’abandonner le ratio Cooke (où : Fonds propres de la banque > 8 % des risques de crédits) au profit d’un ratio Mac Donough où :
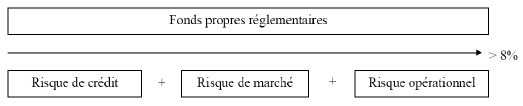
Pilier 2 : procédure de surveillance de la gestion des fonds propres et dialogue structuré entre banques et superviseurs.
Le deuxième pilier comprend trois types d’action : analyse par la banque de l’adéquation de son capital économique par rapport à son profil de risque ; examen par les autorités de supervision nationales des mécanismes de contrôle interne de la banque ; possibilité pour les autorités d’imposer des fonds propres supérieurs aux minimums réglementaires.
Pilier 3 : améliorer la transparence financière pour permettre une plus grande discipline du marché.
La communication financière des banques est renforcée sur la composition des fonds propres, la ventilation par secteur économique et géographique des actifs, le système de notation interne et les allocations de fonds propres affectés aux différents risques.
La régulation a laissé subsister des zones de métiers ou de produits non régulées et ces zones ont pris une importance considérable dans le cas des dérivés de crédits (CDS par exemple), mettant ainsi en péril l’ensemble du système financier.
a) Les régulateurs publics n’ont pas su contrôler l’innovation financière
Pour qu’une régulation soit efficace, les pouvoirs publics doivent en assurer le plein respect. Or, les régulateurs sont souvent dispersés : le cas extrême est celui des États-Unis où une dizaine d’institutions sont chargées de la supervision de certains segments des marchés financiers, bancaires ou d’assurances. Alors que la régulation des marchés au comptant relève de la Securities and Exchange Commission (SEC) et celle des marchés à terme de Commodities and Futures Trading Commission (CFTC), la régulation des banques, suivant leur statut, leurs activités et la fonction de régulation concernée, est exercée par six autorités fédérales. M. Philippe Marini, dans son rapport, souligne que « l’organisation et la supervision des activités financières aux États-Unis fournissent un exemple emblématique de grande segmentation et de complexité », ajoutant, en outre, que « cette segmentation […] multiplie les risques de déresponsabilisation et de discordance entre régulateurs et crée des espaces non régulés » (25).
En France, également, les autorités de régulation sont multiples : Commission bancaire, Autorité des marchés financiers, Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles… M. Bruno Deletré, dans son rapport sur la supervision des activités financières en France, soulignait à ce titre que « la dispersion actuelle des autorités de supervision dans le secteur financier n’est pas un avantage en termes de crédibilité face à des groupes significatifs, actifs dans plusieurs secteurs financiers. Un regroupement ne pourrait qu’avoir des effets positifs dans ce domaine » (26).
Au niveau international, l’insuffisance de coordination des superviseurs est aussi un handicap. Ainsi, si la coopération entre les principaux régulateurs européens et de ces derniers avec leurs homologues américains a progressé, elle « ne se traduit guère par des avancées juridiques concrètes et trouve ses limites dans la défense des modèles nationaux de régulation » (27). Dans le cas plus spécifique de l’Europe, la primauté de la régulation nationale n’est pas en adéquation avec des marchés financiers à réguler de plus en plus intégrés (tels Euronext).
Cette dispersion dans l’organisation de la régulation explique pourquoi les divers régulateurs n’ont pas vu, lors de leurs contrôles, l’importance de la bulle qui se formait au niveau mondial sur les dérivés de crédits et, de ce fait, n’ont pas su alerter, avec la vigueur nécessaire, les autorités publiques sur le risque systémique de la crise, son ampleur et ses conséquences sur l’économie.
En outre, les régulateurs publics n’ont pas su contrôler l’hypersophistication financière. Ils n’ont pas eu la capacité ou la volonté de comprendre ce qui se cachait derrière la titrisation et les CDS. Ils ont même encouragé la titrisation, avec pour principal argument : en diluant le risque dans toute l’économie, on le mutualise et on le réduit. Mais en pratique, cette idée a été dévoyée : la titrisation a pris une telle ampleur qu’un risque considérable s’est disséminé dans toute l’économie, créant un risque systémique. Or, c’est là que réside la responsabilité des pouvoirs publics, qui n’ont pas tenté d’empêcher ce développement exponentiel, ni même d’alerter sur les risques de ce développement.
b) Les régulateurs n’ont pas su encadrer l’activité des banques d’investissement
De même, les régulateurs n’ont pas su encadrer l’activité des banques d’investissement. Ainsi, depuis le début des années 1980, les banques d’investissement agrègent toutes sortes de métiers, parfois contradictoires et porteurs de conflits d’intérêts. Tour à tour, ces établissements financent des entreprises dans le département de la banque de financement et d’investissement (BFI), conseillent les entreprises dans un département chargé notamment des opérations de fusion et d’acquisition, achètent des participations de telle ou telle entreprise dans un département de trading qui prend des positions pour le compte de clients ou pour le compte de la banque elle-même.
Les conflits d’intérêts entre ces différents départements sont nombreux, notamment entre ceux qui financent ou conseillent une entreprise et ceux qui font des recommandations sur la même entreprise aux investisseurs, ou bien entre ceux qui conseillent ou recommandent une entreprise et ceux qui spéculent sur le marché sur les titres de cette même entreprise. Afin de prévenir ces conflits d’intérêts, des règles de fonctionnement ont été fixées, à l’instar des lois Sarbanes-Oxley, adoptées aux États-Unis, après le scandale Enron, ou de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière. Elles instituent notamment une séparation qui interdit aux uns – activités de conseil – de parler aux autres – activités de notation. Cette « muraille de Chine » est cependant mal respectée et souvent contournée. Elle est notamment insuffisante, voire inexistante, dans la séparation entre les équipes de recherche et celles qui travaillent pour le compte propre de la banque.
c) Les régulateurs privés ont été gravement défaillants : l’exemple des agences de notation
Les régulateurs privés, quant à eux, ont été gravement défaillants. Tel est, au premier chef, le cas des agences de notation. Il s’agit d’un marché mondial très important quant à son objet et très concentré quant à ses acteurs, puisque trois grandes agences – Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch – contrôlent plus de 90 % du marché mondial. Le rôle des agences de notation est d’améliorer la transparence de l’information financière pour que chacun bénéficie de la même information et qu’il n’y ait pas d’asymétrie d’information entre les différents acteurs. Leur rôle est principalement de servir de référence dans l’évaluation du risque supporté par les banques, les entreprises, les collectivités locales, les États. Pour ce faire, elles attribuent des « notes » en fonction du niveau de risque associé à chaque emprunteur.
La mission des agences de notation est donc cruciale à la fois pour ceux qui sont notés et pour l’économie dans son ensemble. Or, l’expérience a montré que ces agences ont globalement failli à leur mission. Face à la complexité des produits à noter, les agences se sont contentées d’appliquer des règles standards, valables pour des produits classiques, sous-estimant ainsi gravement les risques. Le contrôle était trop lacunaire, reposant sur une grille de lecture superficielle qui ne prenait pas en compte l’environnement de l’entreprise considérée et qui ne parvenait pas à appréhender correctement les produits structurés. En outre, dans la mesure où elles contribuaient souvent à la conception des produits financiers et où elles étaient rémunérées par les banques d’investissement qui les distribuaient, elles se trouvaient clairement en situation de conflit d’intérêts.
Dans cette perspective, M. Jacques Attali a rappelé que « les agences de notation, soucieuses de tirer un maximum de bénéfices de leurs clients, voulant participer à cette richesse venue de nulle part, ont noté avec une indulgence coupable, sans même aller les visiter toutes ces firmes et leurs produits […] : comment être critique vis-à-vis de clients qui rapportent tant ? De fait, le revenu total des trois principales agences a doublé entre 2002 et 2007, passant de 3 à 6 milliards de dollars. Les profits de Moody’s ont même quadruplé entre 2000 et 2007 ! Pendant cinq années consécutives, la marge de Moody’s est même la plus élevée de celles des cinq cents plus grandes entreprises analysées par le magazine Fortune, entreprises qu’elle est supposée contrôler… » (28). Le contrôle était donc partial, dans la mesure où il était difficile de révéler les risques qui sont portés par ceux qui vous financent.
La Banque de France parle « d’un immense malentendu » (29) entre certains investisseurs et les agences à propos de la notation de ces produits structurés. En révisant brutalement à l’été 2007 leurs notes et leurs méthodologies sur les produits structurés relatifs aux subprime, les agences de notation ont en effet révélé deux aspects de leurs travaux qui avaient été mal pris en compte par certains investisseurs.
D’abord, leur notation ne porte que sur le risque de défaillance et n’intègre pas d’autres risques comme le risque de marché ou d’illiquidité, alors même que ces autres risques sont apparus déterminants dans l’évolution récente des prix des produits structurés. Ainsi, Michel Aglietta souligne que « les agences de notation ont fait preuve d’une grande légèreté dans leurs hypothèses. Pour obtenir des notes aussi élevées sur les titres structurés, […] il fallait supposer que les pools de crédits étaient de bonne qualité. Or, […] les crédits subprime avaient été accordés à des ménages aux revenus précaires et sans avoir fait l’objet du moindre audit de ressources » (30). Force est de reconnaître que les investisseurs auraient dû connaître la vraie nature de la notation. Mais l’expérience a montré que pour la plupart des investisseurs la notation AAA d’un produit était suffisante et qu’il n’y avait pas d’incitation à analyser plus en détail la nature d’une telle notation.
Ensuite, le fait de retenir une même échelle de notation pour ces produits structurés et pour les produits obligataires classiques s’est avéré trompeur car la nature des produits et des risques était bien différente. Les produits structurés ont du fait de leur construction même une volatilité bien supérieure à celle des obligations comme l’a montré l’évolution des cours lors de la crise. Une échelle de notation différente aurait aidé les investisseurs à comprendre la différence des risques attachés aux produits issus de la titrisation. Ainsi, des CDO étaient notées AAA comme les titres d’État et présentaient même un rendement substantiellement supérieur aux obligations d’État de même échéance. « Dans ces conditions, les investisseurs étaient persuadés qu’on leur offrait un free lunch, un rendement plus élevé, sans prendre plus de risque, puisque ces titres avaient la meilleure note. Ils se sont donc précipités sur ces titres qui ont provoqué des pertes énormes lorsque les pools d’actifs sous-jacents ont été dégradés » (31).
Finalement, le système s’est révélé inefficace. Les investisseurs se sont référés aveuglément aux notes attribuées, sans conduire leurs propres analyses. Les agences de notation ont pour leur part surréagi, lorsque la crise financière a éclaté : dégradant trop fortement et trop rapidement des notes qui auraient dû être ajustées progressivement, elles ont ajouté de la volatilité à la volatilité.
II. LA PROPAGATION DU CHOC DE LA CRISE À L’ENSEMBLE DE L’ÉCONOMIE MONDIALE
Comment en est-on arrivé là ? La crise financière puis économique qui s’est développée depuis l’été 2007 s’est déroulée en trois temps : une crise de solvabilité aux États-Unis (les subprime), une crise de liquidité en Europe (le marché des refinancements à court terme) et une transmission de la crise à l’économie réelle.
Dans cette chaîne d’événements en cascade, la faillite de la banque d’investissement Lehman Brothers, le 15 septembre 2008, a marqué un tournant décisif dans la crise. Ce « séisme » s’est traduit par une aggravation nette de la crise de confiance dans le système financier. La faillite a provoqué une paralysie accrue des marchés interbancaires, les banques craignant plus encore d’être exposées au risque qu’une contrepartie fasse défaut.
La faillite de Lehman Brothers a enfin précipité la dégradation de la situation financière, puis le sauvetage exceptionnel de la plus grande compagnie d’assurance américaine, AIG. Très rapidement d’importantes institutions financières européennes se sont retrouvées en grande difficulté. L’incertitude ainsi créée a fait naître le risque d’un « effet de dominos », affectant l’une après l’autre les institutions financières.
A. LA CRISE DE SOLVABILITÉ AUX ÉTATS-UNIS
Les éléments de fragilité qui viennent d’être évoqués et le retournement du marché immobilier américain ont provoqué des turbulences financières importantes au cours de l’été 2007. Les premiers signes de retournement du marché immobilier américain sont apparus dans le courant de 2006, avec le déclenchement de procédures de saisie contre des propriétaires emprunteurs incapables d’honorer leurs échéances. Or, lorsque le prix des maisons diminue, les conséquences négatives s’enchaînent.
En premier lieu, les ménages ne sont plus solvables car, si leur dette n’a pas bougé, la valeur de leur patrimoine s’est effondrée. Or, c’est sur la valeur du patrimoine que sont adossés les prêts hypothécaires. Ainsi, lorsqu’un ménage devient insolvable, les banques peuvent saisir ses biens. Les ventes aux enchères qui en ont résulté, dans un marché « qui était passé brutalement de l’euphorie à l’atonie » (32), se sont révélées décevantes. Le système des crédits « subprime » était bâti sur des anticipations de défaut de 1 ou 2 % des emprunteurs. Or le taux de défaillance des ménages qui avaient un prêt « subprime » a atteint 14 % fin 2006, 18 % fin 2007 et 25 % fin 2008.
En second lieu, la baisse des prix immobiliers oblige les banques à déprécier considérablement les actifs qui figurent à leurs bilans. Les pertes liées à l’immobilier s’élèvent ainsi à 28 milliards de dollars au troisième trimestre 2007 puis à 75 milliards de dollars au quatrième trimestre. Après deux trimestres de pertes autour de 100 milliards chacun, le mouvement s’accélère et s’amplifie au troisième trimestre 2008 avec 170 milliards de dépréciations. L’ampleur de ces pertes s’explique par la mise en place d’un cercle vicieux. En cas de défaut sur les prêts hypothécaires, les banques saisissent les maisons qui ont servi de gage puis les vendent. Comme le prix de l’immobilier baisse, le produit des ventes ne permet pas de compenser le montant des prêts qui ont été accordés. Il s’ensuit donc une première source de perte pour les banques. Or, le phénomène s’aggrave, car plus les banques vendent de maisons, plus elles tirent le marché de l’immobilier vers le bas. Plus le prix de l’immobilier baisse et plus elles enregistrent de pertes.
LA CRISE DE SOLVABILITÉ AUX ÉTATS-UNIS (2006-2008)
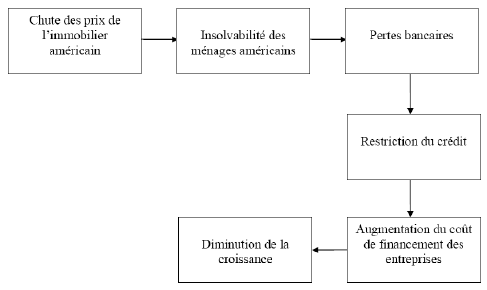
Le retournement d’un marché immobilier est un phénomène très classique mais celui-ci a été amplifié par la spéculation et l’augmentation considérable des prêts et des acquisitions. Les crédits de mauvaise qualité ayant été largement disséminés via la titrisation, ils ont « contaminé » un nombre important d’investissements, bien au-delà des États-Unis. Ainsi, la contagion gagne toute la sphère financière avec un effet domino : les crédits « subprime » ne sont pas seulement détenus par les banques. Celles-ci n’en détiennent que moins de la moitié, à peu près 45 %, le reste ayant été disséminé dans l’ensemble de l’économie.
Les investisseurs se sont mis à considérer avec plus de méfiance les produits complexes (crédits structurés…) qu’ils avaient acquis sans être trop vigilants quant au risque encouru au cours de la période d’euphorie. La défiance s’installe alors, paralysant le marché interbancaire à l’été 2007 lorsque les banques ont commencé à systématiquement se soupçonner les unes les autres de dissimuler des « subprime » sans valeur dans leurs produits financiers. Les différents « véhicules » ne trouvant plus preneur, les banques et les maisons de titres détentrices d’actifs suspects invendables ont été contraintes de les rapatrier dans leurs comptes et d’en provisionner les moins-values latentes dans leurs bilans. Le fait que les notations AAA soient apparues moins fiables que ce qui était normalement attendu pour cette classe d’actifs, avec des exemples de révision à la baisse des notations de plusieurs niveaux en une seule journée, a conduit les investisseurs à mettre en doute la valorisation de tous les types de crédits, autres qu’hypothécaires.
B. LA CRISE DE LIQUIDITÉ EN EUROPE OU LA DÉFIANCE GÉNÉRALISÉE
Comme aux États-Unis, les banques sont les premières touchées dans l’Union européenne. Mais la crise arrive plus tard – été 2007 là-bas, début 2008 ici. En outre, la crise arrive dans un contexte qui comporte une différence majeure : les taux d’intérêt sont, depuis plusieurs années, plus élevés dans la zone euro qu’aux États-Unis.
Pour comprendre de quelle manière la crise a touché l’Europe, il convient de partir du mode de fonctionnement du système bancaire, et plus précisément du mode de financement des banques. Les engagements des banques – les crédits qu’elles consentent aux entreprises et aux particuliers – se font sur une longue période : dix, quinze ou vingt ans. Ces créances ne sont donc pas liquides. Pour financer ces crédits, les banques disposent des dépôts des particuliers et des entreprises ou des prêts que leur font les autres banques. Ces ressources, à la différence de leurs engagements, sont extrêmement liquides : les clients peuvent retirer leur argent quand ils le souhaitent et les prêts interbancaires se font en partie au jour le jour.
Le risque lié à ce mode de financement est double. D’une part, si tous les déposants retirent en même temps leur épargne par crainte d’une faillite de la banque, celle-ci n’a alors plus assez de ressources pour faire face à ses engagements. Ce phénomène, qui a été à l’origine de la crise de 1929, est plus connu sous le nom de « bank run » ou de « ruée vers l’or ». D’autre part, si les banques refusent de se prêter entre elles de l’argent ou le font à des prix prohibitifs sur le marché interbancaire, elles sont alors dans l’incapacité de faire face à leurs engagements.
C’est ce qui s’est passé en 2008 lorsque le coût de financement d’une banque à une autre a été brutalement multiplié par quatre. Le marché interbancaire s’est peu à peu contracté. Puis il s’est totalement asséché. Le danger, alors, est que les banques ne soient plus en capacité de faire face à leurs engagements et de rembourser leurs clients : elles font faillite. Cette asphyxie a pour cause principale la généralisation de la défiance au sein du système bancaire et financier. Les banques européennes, à l’instar de leurs consœurs américaines, ont également enregistré des pertes. Nombre d’entre elles avaient des engagements aux États-Unis. D’autres, notamment en Espagne ou au Royaume-Uni, avaient importé le modèle des prêts hypothécaires subprime des États-Unis. Alors, lorsque les banques européennes voient le marché américain se retourner violemment et les banques américaines enregistrer des pertes massives, nul ne sait quelle est la réalité des engagements et des risques. Dès lors, chacun se replie sur soi : les banques refusent de se prêter de l’argent, de peur que l’emprunteur ne fasse faillite dans la nuit. La défiance était désormais mondialisée.
Ainsi, M. Christian Noyer a très justement souligné que « cette crise est d’abord apparue comme une crise de liquidité. On peut en dater le début au mois d’août 2007 quand des perturbations sévères sont apparues sur le marché interbancaire. Plus d’un an après, ces tensions étaient toujours présentes sur les marchés monétaires. En témoignent, le niveau très anormal des spreads (33), le raccourcissement des maturités, ainsi que le rétrécissement, voire la disparition de certains segments du marché. Par contagion, ces tensions ont affecté également les sociétés non financières et le financement de l’économie » (34).
C. L’AMPLIFICATION DE LA CRISE FINANCIÈRE ET SON EXTENSION À L’ÉCONOMIE RÉELLE
Crise de solvabilité aux États-Unis et crise de liquidité en Europe se conjuguent pour donner à la crise économique et financière une ampleur inégalée depuis la Grande Dépression des années 1930. La chronologie de la crise peut se résumer ainsi : pendant plusieurs mois, la crise commence à prendre une dimension concrète – des banques rencontrent des difficultés parfois insurmontables – et une dimension internationale – plusieurs pays sont touchés des deux côtés de l’Atlantique. Puis, pendant deux jours, la crise bascule avec la décision prise par les autorités américaines de laisser la grande banque Lehman Brothers faire faillite. Dès lors, pendant deux semaines, la crise change de nature : elle devient globale et systémique.
Tout commence à l’été 2007 avec l’échec de la tentative de placement par Bear Stearns d’un titre CDO qui a suscité une défiance généralisée. Incapable de placer ses titres, Bear Stearns, la cinquième banque d’investissement de Wall Street, reconnaît publiquement le 16 juillet 2007 que deux de ses fonds ont perdu l’essentiel de leur valeur et les déclare en faillite. Le 9 août, la Réserve fédérale révèle au grand jour l’étendue de l’inquiétude en décidant d’une injection massive de liquidités sur le marché des transactions interbancaires, qui venait de s’assécher.
Au troisième trimestre 2007 surgissent d’autres révélations du même type dans le secteur hypothécaire : Countrywide aux États-Unis, Northern Rock au Royaume-Uni, IKB et Sachsen LB en Allemagne, etc. Le 16 mars 2008, la quasi-faillite de Bear Stearns amène son rachat par JP Morgan, rachat pour lequel le Trésor américain a offert à JP Morgan une ligne de crédit de 30 milliards de dollars.
À ce stade, les risques de faillite bancaire qui se manifestent ont pu être colmatés dans l’urgence (notamment pour Northern Rock, nationalisée le 17 février 2008), ce qui a empêché la défiance généralisée de dégénérer en risque systémique effectif. Mais comme le constate, en avril 2008, M. Nicolas Véron, « depuis août [2007] la crise a semblé faire la navette entre les deux rives de l’Atlantique (…). Aux États-Unis le marché immobilier connaît un retournement sans précédent qui affecte l’ensemble du pays, l’économie est sans doute entrée en récession, et une vague de faillites d’entreprises est probable. En Europe, l’environnement économique s’est dégradé aussi, mais pas autant (…). En revanche, l’Europe bancaire s’est découverte depuis huit mois des vulnérabilités insoupçonnées et préoccupantes » (35).
En septembre 2008, les organismes de refinancement hypothécaire Fannie Mae et Freddie Mac sont placés sous contrôle public, et la faillite de Lehman Brothers, également en septembre 2008, marque l’accélération et l’amplification radicales de la crise.
En effet, le 7 septembre, Freddie Mac et Fannie Mae sont placés sous administration judiciaire et leurs dirigeants sont remplacés. Le 12 septembre, les autorités américaines constatent que deux banques d’affaires, Merrill Lynch et Lehman Brothers, sont au bord de la faillite. Bank of America se déclarant intéressée pour racheter la première, le rachat se fait, mais Lehman Brothers ne trouve finalement pas de repreneur et le Secrétaire d’État au Trésor, Henry Paulson, prend la décision de laisser la banque faire faillite le 15 septembre 2008.
La faillite de Lehman Brothers marque un tournant majeur dans la crise, à la suite duquel les tensions sur les marchés financiers ont atteint leur paroxysme. Elle a, en effet, déclenché une crise de confiance profonde dans la solvabilité des institutions financières : les primes de risque sur le défaut du secteur bancaire ont atteint des records avant de refluer en réponse aux actions des banques centrales. Cette faillite a également suscité un climat de défiance généralisée sur l’ensemble des marchés financiers, caractérisé par une forte progression de la volatilité, une forte aversion au risque et un blocage des marchés monétaires. Dans ce contexte, on a assisté à un phénomène de fuite vers la qualité marqué par une forte préférence des investisseurs pour les titres d’État, alors que, dans le même temps, les investisseurs se sont massivement désengagés des actifs les plus risqués, notamment des marchés actions et aussi des hedge funds. En outre, la montée de la défiance entre intervenants de marché et entre banques en particulier a entraîné un grippage du marché monétaire interbancaire, réduisant fortement les transactions entre institutions et une progression envolée de la prime de risque de contrepartie.
Cette faillite, la plus importante de l’histoire des États-Unis (36), va déclencher une chaîne d’événements en cascade, avec notamment la menace de faillite de l’assureur AIG, le Trésor américain étant intervenu pour le sauver le 16 septembre, de fortes baisses des cours boursiers et un mouvement général de « paris » sur la faillite d’autres banques. On recense également la faillite d’une dizaine de banques régionales américaines. Fin septembre, le rejet par le Congrès d’une première version du « plan Paulson » aggrave le sentiment de panique sur les marchés financiers.
LE « MYSTÈRE » LEHMAN BROTHERS
Face aux conséquences majeures induites par la faillite de la banque américaine Lehman Brothers, il convient de revenir plus en détail sur la décision américaine de laisser cette banque faire faillite. Nombre d’économistes s’accordent en effet à dire qu’il s’agit là d’une grave erreur sur le plan économique de la gestion de crise.
La thèse de l’imprévisibilité ne peut être raisonnablement défendue. Cela faisait en effet des semaines que l’on mesurait que Lehman était au bord de l’asphyxie, que les pertes s’accumulaient et que son président cherchait des repreneurs.
La thèse de l’impossibilité, défendue par Henry Paulson lors de son audition par le Congrès, n’est guère plus probante. Il a expliqué qu’il n’avait pas les pouvoirs nécessaires car Lehman ne disposait pas de suffisamment d’actifs à apporter en garantie à l’octroi d’un prêt. Or, la taille du bilan de Lehman ne permet pas de justifier un tel argument.
La véritable raison est tout autre : le gouvernement américain a voulu faire un exemple et ainsi montrer que des comportements irresponsables avaient non seulement un prix mais un coût. La démonstration était ainsi faite qu’il n’était pas moralement acceptable que tous les contribuables assument les erreurs de quelques-uns. Mais en voulant faire un exemple, le gouvernement américain a envoyé un signal extrêmement négatif aux marchés : si le gouvernement a laissé Lehman faire faillite, aucun acteur bancaire n’est désormais à l’abri. C’est pourquoi, la liquidité interbancaire s’est brutalement tarie.
Source : Mathieu Pigasse, Gilles Finchelstein, Le monde d’après. Une crise sans précédent, Plon, 2009, p. 81-83.
Immédiatement après la faillite de Lehman Brothers, l’Europe est à son tour touchée, avec la faillite au Royaume-Uni de la banque immobilière HBOS le 17 septembre 2007.
Après les cas des banques islandaises, de la Roskilde Bank au Danemark, de Fortis, de Bradford & Bingley, de Hypo Real Estate, il apparaît évident, à la fin du mois de septembre 2008, que le risque de faillite d’une grande banque européenne n’est pas à exclure, et ce, même si les fondamentaux des grands acteurs du secteur bancaire en Europe semblent suffisamment solides (notamment ceux des grandes banques françaises). Les États du Benelux ont dû injecter le 29 septembre plus de 11 milliards d’euros dans le capital de Fortis, et le lendemain les États français et belge sont intervenus une première fois pour secourir Dexia, avant d’intervenir une nouvelle fois le 9 octobre. Quant aux banques de plus petite taille, elles sont nombreuses à traverser de graves difficultés, qu’il s’agisse des caisses d’épargne espagnoles, des banques russes de taille moyenne ou de certaines banques régionales allemandes (Landesbanken).
Contrairement aux différentes crises financières des vingt dernières années, la crise est « systémique », car elle touche l’ensemble du fonctionnement de l’industrie financière. Cependant, la crise n’a pas touché toutes les banques : au vu des rachats effectués par le groupe espagnol Banco Santander ou par Bank of America, par exemple, il a été démontré que certaines banques étaient plus solides que d’autres.
La crise n’a également pas touché uniquement les banques qui avaient investi dans des créances liées aux crédits hypothécaires à risque américains. Et il apparaît que la crise n’est pas seulement une crise bancaire, mais que tous les métiers de la finance sont concernés, notamment dans le domaine de l’assurance. Ainsi les grands groupes d’assurance européens ont à leur tour été affectés, notamment à cause de la dévaluation de leurs placements et de la dépréciation de leurs actifs liée à la chute des cours boursiers. Aux Pays-Bas, trois entreprises d’assurance, le « bancassureur » ING, l’assureur Aegon et le « bancassureur » SNS Reaal, ont reçu des apports de capitaux de l’État (respectivement 10 milliards, 3 milliards et 750 millions d’euros).
Dans une étude publiée le 2 octobre 2008, le FMI souligne que la spécificité de cette crise financière tient moins à sa brutalité (des crises financières très violentes ont frappé certains pays à la suite de l’éclatement de la bulle spéculative dans les années 1990, en particulier le Japon, la Suède, la Finlande) qu’à son étendue géographique.
En effet, la crise n’a épargné aucun continent : suspensions répétées des cotations à la Bourse de Moscou, interventions sur les marchés financiers du gouvernement chinois pour soutenir la capitalisation des trois principales banques du pays, engagement du gouvernement brésilien de subvenir aux besoins des entreprises en cas de raréfaction des financements internationaux…
Les flux mondiaux d’investissements directs à l’étranger (IDE) sont affectés : en septembre 2008, la CNUCED prévoit que ces flux baisseront de 10 % sur l’année 2008, alors qu’en 2007 toutes les régions du monde avaient bénéficié d’une hausse des IDE.
Les conséquences de la crise financière affectent également l’aide aux pays en développement, ce qui s’est traduit par exemple, au sein de l’Union européenne, par des tensions persistantes autour de la négociation sur la création d’une « facilité de réponse rapide » à la crise alimentaire dans les pays en développement les plus gravement touchés (37).
Selon le FMI, à l’exception du Canada, tous les pays du G7 sont en récession en 2009. De nombreux établissements financiers ont mis en place des plans de licenciement importants, notamment l’américain Citigroup qui a supprimé 52 000 postes au premier semestre 2009 après en avoir supprimé 23 000 entre janvier et septembre 2008.
Les entreprises ont été durablement fragilisées car se financer est devenu difficile et coûteux. La situation de certaines catégories d’entreprises suscite une inquiétude particulière. C’est le cas notamment des entreprises qui ont fait l’objet d’un « leverage buy-out » (LBO), c’est-à-dire qui ont été rachetées par des fonds d’investissement avec un fort recours à l’emprunt, et qui pourraient se trouver en situation de surendettement.
La chute généralisée des places boursières a été considérable et durable, tant dans les pays développés que sur les bourses des pays émergents, et ce, en dépit des différentes mesures qui ont déjà été prises et sur lesquelles on reviendra dans la suite du présent rapport. Au cours de l’année 2008, la Bourse de Paris a cédé près de 47 %, celle de Moscou de 71 %, et la Bourse islandaise s’est littéralement écroulée (- 94 %).
Aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, près d’un foyer sur deux détient des actions. Pour ces ménages, la chute de près de 40 % des cours de la bourse au cours de l’année 2008 a souvent détruit d’autant la valeur de leur patrimoine mobilier. En France, les particuliers, qui sont plus réticents à l’égard de l’investissement boursier, sont donc moins affectés. Toutefois, des millions d’épargnants qui détiennent des Sicav, des fonds communs de placement, des produits d’assurance-vie, sont directement touchés. Dans les pays où les pensions de retraite sont financées largement ou essentiellement par capitalisation, comme aux États-Unis, les conséquences d’un krach boursier sont considérables. Là encore, la France est moins affectée.
LE FMI ÉVALUE LE COÛT DE LA CRISE FINANCIÈRE
À PLUS DE 4 000 MILLIARDS DE DOLLARS
Le 21 avril 2009, le FMI a revu à la hausse le coût de la crise financière mondiale et estime qu’il s’établit désormais à hauteur de 4 054 milliards de dollars sur la période allant de 2007 à 2010. Si l’on détaille ce coût global, deux conclusions peuvent être tirées. En premier lieu, ce sont les banques qui ont subi l’essentiel de ces dépréciations d’actifs : en effet, 61 % des pertes leur sont imputables tous pays confondus. En second lieu, les États-Unis ont pour leur part enregistré les deux tiers des pertes de valeur contre à peine 30 % pour l’Europe.
Répartition des 4 054 milliards de dollars de dépréciations d’actifs financiers selon le FMI
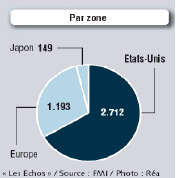
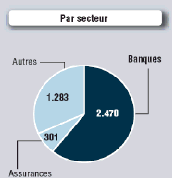
Source : Les Échos
DEUXIÈME PARTIE : UNE MOBILISATION MASSIVE ET RAPIDE DES ÉTATS AU SECOURS DE L’ÉCONOMIE
Les banques sont au cœur du financement des économies et lorsque leur situation financière ne leur permet plus d’assurer cette mission, la croissance est durablement et gravement compromise. C’est la raison pour laquelle, dans tous les pays, des plans de soutien au secteur bancaire ont été mis en place.
En effet, face à la crise sans précédent qui a frappé les banques et les marchés financiers internationaux, les États ont été contraints d’agir rapidement afin de parvenir à stabiliser le système bancaire international. La mise en œuvre de ces « thérapeutiques d’urgence » (38) et d’une ampleur inédite est intervenue dès l’automne 2008, suivant des modalités distinctes : rachat d’actifs toxiques, recapitalisation des banques et/ou refinancement des banques.
Afin de préserver la stabilité et la confiance, les banques centrales nationales et la Banque centrale européenne, en coordination étroite avec les banques centrales des pays partenaires, sont également parvenues à assurer la liquidité du système financier.
I. UN SOUTIEN MASSIF DES ÉTATS AU SECTEUR BANCAIRE POUR PRÉSERVER LE FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE
Les mesures prises pour lutter contre la crise financière et bancaire ont été différentes d’un continent à l’autre et même d’un pays à un autre. Elles ont, au surplus, évolué au fil du temps, s’adaptant à l’évolution de la situation et aux difficultés de mise en œuvre.
Le plan d’action concertée des pays de la zone euro du 12 octobre 2008, adopté à l’initiative du Président de la République, a constitué un tournant décisif dans le soutien apporté par les États au secteur bancaire, puisqu’il marque le choix de la convergence et de la coordination.
Déclinant au niveau national les grands principes définis au niveau communautaire, le plan français de financement de l’économique, comme l’a souligné M. Christian Noyer lors de son audition, a montré toute son efficacité à l’épreuve de la crise.
A. DES PLANS DE SAUVETAGE MASSIFS ET CONVERGENTS EN VUE DE PRÉSERVER LA PÉRENNITÉ DU SYSTÈME BANCAIRE
Afin de préserver la pérennité de leur système bancaire, les États ont mis en œuvre des plans de soutien reposant sur trois leviers : défaisance d’actifs toxiques, recapitalisation en vue de renforcer les fonds propres, soutien à la liquidité et au refinancement.
1. Racheter les actifs toxiques pour assainir les marchés
Le principe est relativement simple : l’État, via ce qu’on appelle une « structure de défaisance », rachète les titres dits « toxiques » qui grèvent l’actif des banques – actifs issus de la titrisation ou des dérivés de crédit – et les revend à plus ou moins brève échéance. Tel est, aux États-Unis, l’esprit du « plan Paulson ».
LE « PLAN PAULSON » ET LE « PLAN GEITHNER »
Le « plan Paulson », inclus dans l’Emergency Economic Stabilization Act et parfois dénommé TARP (Troubled Assets Relief Program, soit « programme de soutien aux actifs toxiques »), a été adopté par la Chambre des représentants des États-unis le 3 octobre 2008, après un rejet initial, découlant de l’opposition de la majorité des représentants républicains. Il permet au Trésor américain d’acquérir des actifs toxiques aujourd’hui illiquides, à hauteur de 700 milliards de dollars, correspondant à 5 % du PIB des États-Unis.
Initialement, la mise à disposition de cette somme devait se faire par étapes : une première tranche de 250 milliards de dollars sera débloquée immédiatement, suivie d’une seconde de 100 milliards de dollars, complétée par une dernière tranche de 350 milliards de dollars, ce déblocage requérant alors l’assentiment du Congrès.
Mais dès la fin du mois d’octobre 2008, le « plan Paulson II » a succédé au « plan Paulson I », transférant ainsi 250 millions de dollars pour la recapitalisation des banques. Le 12 novembre 2008, le « plan Paulson III » a succédé au « plan Paulson II », abandonnant l’idée de sortir les actifs toxiques des banques pour deux raisons : d’une part, il est quasiment impossible d’évaluer correctement ces actifs devenus illiquides ; d’autre part, il existe un risque sérieux de léser fortement soit les banques, soit les contribuables.
Ce plan, dans sa version initiale, a été critiqué par de nombreux économistes en ce qu’il ne prévoyait pas de recapitalisation directe des banques en difficulté. Il dispose cependant que les institutions financières qui céderont des actifs illiquides au Trésor devront en contrepartie émettre en sa faveur des warrants (c’est-à-dire des titres lui conférant le droit d’acheter des titres pour un prix fixé à l’avance), ce qui permettrait au Trésor de devenir actionnaire des banques secourues. Finalement, seule la moitié du « plan Paulson » (soit 350 milliards) a été dépensée, pour l’essentiel en injections de capitaux dans la recapitalisation des banques et en prêts pour les constructeurs automobiles, ce qui n’était pas son objectif initial. Ce sont 125 milliards de dollars qui ont été utilisés pour monter au capital des neuf principales banques américaines et 125 autres milliards qui ont été mobilisés pour les banques régionales américaines.
Adopté le 24 mars 2009, le « plan Geithner » de soutien financier au secteur bancaire, du nom de l’actuel secrétaire au Trésor des États-Unis, rénove et complète le « plan Paulson » de 700 milliards de dollars grâce à la création d’une structure à capitaux mixtes public-privé, pour inciter des investisseurs privés à acheter les actifs douteux qui grèvent les bilans des banques. En effet, toute la philosophie du « plan Geithner » consiste à délester les banques de leurs actifs toxiques grâce à un partenariat public-privé. Avec un investissement direct du Trésor limité entre 75 et 100 milliards de dollars, ce nouveau plan mise sur le concours de la Réserve Fédérale et du secteur privé pour « absorber » entre 500 et 1 000 milliards de dollars d’actifs toxiques. Aussi ce plan mise-t-il sur la participation des firmes de capital-investissement (Blackrock, Carlyle, KKR…) et des fonds spéculatifs, mais aussi des fonds de pension et des assureurs privés.
Le plan prévoit également une nouvelle vague de recapitalisation à l’aide de fonds publics des banques qui en ont besoin ainsi que la création d’un holding pour regrouper les divers investissements réalisés par l’État dans les banques : le Finance Stability Trust.
Le prix Nobel d’économie, Paul Krugman, qui milite ardemment pour une nationalisation temporaire des banques sur le modèle suédois des années 1990, juge irréaliste ce plan, qui vise à « utiliser l’argent du contribuable pour gonfler le prix des actifs toxiques ». Toute la question reste de savoir si les investisseurs privés jugeront le mécanisme suffisamment attractif pour délester les banques de leurs actifs douteux. Le pari est d’autant plus osé qu’il intervient au moment où la Chambre des représentants vient de voter, à une très large majorité, une taxe de 90 % sur les bonus des entreprises qui ont bénéficié d’aides fédérales.
Outre les États-Unis, ces mesures de rachat des actifs toxiques ont, de manière limitée, été reproduites en Suisse afin de sauver UBS et en Espagne, qui avait adopté le modèle américain des prêts hypothécaires. Ces deux pays ont recouru à ce type de mesures pour une cinquantaine de milliards de dollars chacun.
2. Recapitaliser les banques pour prévenir les risques de faillite
Face à une éventuelle insolvabilité des banques, les États ont cherché à renforcer leurs fonds propres, afin qu’elles puissent poursuivre le financement de l’économie, par l’octroi de crédits. L’objectif est donc dans ce cas, soit d’injecter du capital pour rééquilibrer le passif des banques. Les masses sont à peu près équivalentes ici et là : 167 milliards d’euros dans l’Union européenne et 185 milliards d’euros aux États-Unis.
En revanche, les modalités sont assez différentes : en Grande-Bretagne, l’État est entré au capital des banques et, en contrepartie de son intervention, a imposé aux actionnaires des conditions strictes : suppression du versement des dividendes et contrôle de l’évolution des rémunérations des dirigeants. Parfois, la recapitalisation a pu aller jusqu’à la « nationalisation-sanction » (39) totale ou partielle de plusieurs établissements particulièrement touchés par la crise (40).
Dans tous les cas, cette méthode confère à l’État des titres qu’il pourra ensuite revendre : il s’agit donc bien d’un investissement, qui, potentiellement, peut lui permettre de réaliser une plus-value.
3. Garantir les émissions de dettes afin de restaurer la confiance
Face à la double crise de liquidité et de confiance qui a sévèrement touché le marché interbancaire à l’automne 2008, les États ont choisi d’apporter leur soutien à la liquidité et au refinancement des banques, grâce à l’octroi de garanties pour rétablir la confiance.
Comme le soulignent à juste titre MM. Mathieu Pigasse et Gilles Finchelstein : « financièrement, l’engagement le plus important a concerné les banques : 2 370 milliards d’euros à travers le monde par la garantie des nouvelles émissions de dettes des banques (garanties des États aux crédits interbancaires) ou l’ouverture de lignes de crédits directes. Symboliquement, l’engagement le plus spectaculaire a concerné les particuliers, puisque, en Europe comme aux États-Unis, il a été décidé de relever la garantie des dépôts ». Cette mesure remplit un objectif majeur, à savoir éviter le fameux bank run, qui peut conduire à la faillite des banques, alors même que leur situation financière était initialement solide.
Dans l’Union européenne, la directive 2009/14/CE du 14 mars 2009, présentée par la Commission, a contraint les États membres à relever en 2009 de 20 000 à 50 000 euros le seuil minimal de garantie par déposant et par banque, puis à 100 000 euros d’ici le 31 décembre 2010. Elle a également réduit de trois mois à vingt jours le délai de restitution. Certains États membres, comme l’Allemagne, le Danemark ou l’Irlande, ont appliqué une solution maximaliste en garantissant l’intégralité des dépôts. En France, le plafond demeure inchangé à ce jour à 70 000 euros. Les États-Unis ont pour leur part adopté une démarche résolument plus ambitieuse que l’Europe, puisqu’ils ont relevé ce seuil par client et par banque de 100 000 à 250 000 dollars.
B. LA RÉPONSE EUROPÉENNE AU SAUVETAGE DU SECTEUR BANCAIRE : LE CHOIX DE LA CONVERGENCE ET DE LA CONCERTATION
Dans les jours qui ont suivi la faillite de Lehman Brothers, la quasi-nationalisation de l’assureur AIG et l’annonce du « plan Paulson », la nécessité d’une réponse concertée au niveau international, jusqu’alors limitée aux banques centrales, s’est imposée. La France qui présidait alors l’Union européenne pour six mois a joué un rôle très actif et décisif dans l’organisation de cette réponse.
Le Conseil des ministres chargés de l’économie et des finances – Conseil « Ecofin » – du 7 octobre 2008 s’est engagé à prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la solidité et la stabilité du système bancaire et à ne laisser aucune banque paneuropéenne faire faillite. Le 10 octobre, lors des réunions annuelles du Fonds monétaire international, le G7 a, pour sa part, défini des principes clairs afin de coordonner la réponse internationale à la crise bancaire et financière.
PRINCIPES DÉFINIS PAR LE G7 DU 10 OCTOBRE 2008 À WASHINGTON
— Assurer la viabilité du système financier ;
— Éviter la faillite des institutions financières importantes ;
— Garantir l’accès à la liquidité ;
— Recapitaliser les institutions financières publiques et privées, en cas de besoin ;
— Restaurer la confiance des épargnants par des garanties publiques sur les dépôts ;
— Soutenir le marché des financements hypothécaires ;
— Travaux sur la valorisation, la transparence des pools de crédit et les règles comptables.
Source : Banque de France, La crise financière, Documents et débats, février 2009, n° 2.
Dès le 12 octobre, à l’initiative du Président de la République, l’Eurogroupe élargi au Premier ministre du Royaume-Uni a adopté un plan anti-crise fondé sur les principes définis au G7 (protéger les épargnants, assurer le financement de l’économie, éviter la faillite d’institutions financières systémiques) et appelé à se décliner dans chaque État membre. Le lendemain, la France annonçait son plan de soutien (cf. infra).
Avec ce sommet, la zone euro est apparue, au niveau politique, comme un pôle attractif de convergence au sein de l’Union européenne, tout en faisant valoir dans le domaine économique et financier la force que représente la monnaie unique face à la crise financière.
LA DÉCLARATION DE PARIS DU 12 OCTOBRE 2008
Un engagement clair des gouvernements :
— Assurer le financement de l’économie, notamment des PME et des ménages ;
— Aucune institution financière ne fera faillite. Les épargnants et les déposants sont donc protégés.
Des actions de l’État suivant plusieurs axes :
— En renforçant les fonds propres des organismes financiers pour assurer leur solvabilité ;
— En intervenant, le cas échéant, en capital dans une banque qui serait en difficulté ;
— En octroyant une garantie de l’État pour aider les banques à trouver des ressources à long terme afin de relancer le financement de l’économie ;
— En relevant la garantie des dépôts ;
— En modifiant les règles comptables.
Source : Banque de France, La crise financière, Documents et débats, février 2009, n° 2.
Le 16 octobre 2008, le Conseil européen, qui a réuni les chefs d’État et de gouvernement a approuvé, à son tour, à l’échelle de l’Union européenne tout entière, le plan anti-crise défini le 12 octobre par les États de la zone euro dans la déclaration de Paris : « Le Conseil européen salue le plan d’action concertée des pays de la zone euro du 12 octobre, dont il fait siens les principes. […] Le Conseil européen réaffirme l’engagement qu’en toutes circonstances les mesures nécessaires seront prises pour préserver la stabilité du système financier, soutenir les institutions financières importantes, éviter les faillites et assurer la protection des dépôts des épargnants. […] Le Conseil européen considère que les mesures de soutien aux institutions financières en difficulté devraient s’accompagner de mesures permettant d’assurer la protection des contribuables, la responsabilisation des dirigeants et des actionnaires et la protection des intérêts légitimes des autres acteurs de marché » (41).
La déclinaison nationale de ces axes s’est traduite dans chaque État membre par des spécificités, selon le niveau d’exposition du secteur bancaire aux actifs toxiques et, plus rarement, par des actions concertées dans le cas de banques transnationales (Dexia et Fortis, par exemple).
De manière générale, si la plupart des États membres ont choisi de garantir les émissions obligataires des établissements de crédit (Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, France…), ils ont, dans le même temps, procédé à des recapitalisations importantes, pouvant aller, comme votre rapporteur l’a déjà souligné, jusqu’à la nationalisation temporaire de certaines banques (Northern Rock et Royal Bank of Scotland au Royaume-Uni).
En définitive, au sein de l’Union européenne, ce sont 22 plans de soutien et 40 mesures individuelles représentant un montant global de 3 213 milliards d’euros – soit près du tiers du PNB communautaire – qui ont été approuvés par la Commission européenne entre octobre 2008 et juillet 2009. Plus de 90 % de ces aides – soit 2 900 milliards d’euros – sont consacrés au système de garantie, alors que les 10 % restant sont dédiés aux dispositifs de recapitalisation.
Le tableau ci-dessous, qui détaille le montant des différents plans de sauvetage bancaire mis en œuvre en Europe, permet de constater que « les volumes d’aides effectivement octroyés représentaient fin juin 2009 12,6 % du PNB européen ». Alors que des pays comme le Danemark ou l’Italie n’ont presque pas recouru aux aides autorisées par la Commission, l’Irlande, pays le plus affecté par la crise, les a très massivement utilisées afin de soutenir son secteur bancaire.
SITUATION DES AIDES PUBLIQUES AU SECTEUR BANCAIRE DÉCIDÉES
DANS LES PRINCIPAUX ÉTATS DE L’UNION EUROPÉENNE AU 29 JUIN 2009
(en % du PIB)
Injections de capital |
Garantie du passif |
Allègement d’actifs douteux |
Soutien direct à la liquidité |
Total décidé |
Total consenti | |
Allemagne |
4,4 |
18,6 |
1,4 |
0 |
24,4 |
9,1 |
Belgique |
5,3 |
76,6 |
10,1 |
N.D. |
92 |
26,7 |
Danemark |
6,1 |
253 |
0 |
0,3 |
259,4 |
0,5 |
Espagne |
0 |
9,3 |
0 |
2,8 |
12,1 |
5 |
France |
1,2 |
16,6 |
0,2 |
0 |
18,1 |
5,6 |
Irlande |
6,6 |
225,2 |
0 |
0 |
231,8 |
229,4 |
Italie |
1,3 |
N.D. |
0 |
0 |
1,3 |
0 |
Pays-Bas |
6,4 |
34,3 |
3,9 |
7,5 |
52 |
25,4 |
Royaume-Uni |
3,5 |
21,7 |
0 |
16,4 |
41,6 |
26,8 |
Suède |
1,6 |
48,5 |
0 |
0, |
50,2 |
8,9 |
Moyenne UE |
2,6 |
24,8 |
0,8 |
2,9 |
31,2 |
12,6 |
Source : Rapport de la DG Concurrence « Panorama des schémas de garantie et de recapitalisation au profit du secteur financier dans la crise actuelle », 7 août 2009.
En définitive, face à l’urgence dans laquelle se sont trouvées de nombreuses banques de pays européens, avant comme après la faillite de Lehman Brothers, les États membres de l’Union européenne ont apporté, comme ils avaient le devoir de le faire, une réponse coordonnée et encadrée au niveau européen, tout en tenant compte d’un impératif de rapidité absolue.
C. UN PLAN FRANÇAIS DE FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE ÉQUILIBRÉ ET EFFICACE
Comme l’Allemagne et le Royaume-Uni, la France a mis en place une solution adaptée aux spécificités de son secteur bancaire, grâce à un plan de soutien bancaire combinant des garanties de financement et des recapitalisations.
Le plan français pour assurer le financement de l’économie et restaurer la confiance a été adopté par le gouvernement le 13 octobre 2008 et s’est concrétisé par le vote – dans des délais record, ce qui montre bien la capacité de réaction du Parlement quand les circonstances l’exigent – de la loi n° 2008-1061 de finances rectificative du 16 octobre 2008. La mise en œuvre de ce plan, qui constitue la déclinaison pour la France du plan d’action concerté des pays de la zone euro adopté à l’issue du sommet des États de la zone euro du 12 octobre 2008, repose sur deux volets : le refinancement et la recapitalisation des établissements de crédits.
1. Le refinancement des banques avec la garantie de l’État
Afin d’assurer le financement de l’économie dans de bonnes conditions, le premier volet du plan prévoit la création d’un dispositif destiné à garantir le refinancement des banques françaises pour des maturités moyennes (jusqu’à cinq ans).
Le refinancement des banques est, à ce titre, confié à la société de financement de l’économie française (SFEF), qui lève des fonds sur le marché, avec la garantie de l’État, afin d’accorder des prêts aux établissements de crédit dans la limite d’une enveloppe globale de 320 milliards d’euros. La loi prévoit toutefois que la garantie de l’État est accordée aux titres de la SFEF qui seront émis avant le 31 décembre 2009. La durée de vie du dispositif de garantie a donc été limitée à un peu plus d’un an. Cette approche a pour objectif direct, non pas de faire refonctionner le marché interbancaire, mais de permettre aux banques de prêter de nouveau aux entreprises et aux particuliers.
En 2009, l’État a ainsi contribué au refinancement des banques à hauteur de 105,1 milliards d’euros de prêts octroyés par la société de financement de l’économie française (SFEF) depuis novembre 2008.
L’État est actionnaire de la SFEF à hauteur de 34 %, ce qui lui donne une minorité de blocage, les 66 % restants étant détenus par sept grandes banques françaises (42). La SFEF est présidée par Michel Camdessus, ancien directeur général du Fonds monétaire international (FMI). Un commissaire du gouvernement assiste aux séances de l’organe d’administration de cette société avec un droit de veto sur toute décision de nature à affecter les intérêts de l’État, au titre de sa garantie.
Les établissements éligibles aux prêts de refinancement de la SFEF sont les établissements de crédits établis en France y compris les filiales de groupes étrangers. Les prêts octroyés aux banques portent sur des maturités moyennes allant jusqu’à 5 ans. Le taux d’intérêt facturé comprend deux composantes : d’une part, un taux correspondant au coût de financement de la SFEF et, d’autre part, une rémunération additionnelle correspondant à la tarification de la garantie de l’État apportée au refinancement de la SFEF. Le prix de cette garantie est défini de telle sorte que le coût du refinancement de chaque établissement de crédit soit équivalent à celui d’un refinancement sur le marché dans des conditions normales de fonctionnement.
En garantie des fonds prêtés, la SFEF se fait remettre des titres de créance de bonne qualité émis par les établissements emprunteurs : prêts immobiliers assortis d’une hypothèque de premier rang ou d’une sûreté équivalente ; prêts immobiliers pour l’acquisition d’un bien situé en France, assortis d’une sûreté ou d’un cautionnement d’un organisme financier ; prêts aux collectivités publiques ; prêts aux entreprises bénéficiant d’un bon rating ; prêts à la consommation consentis aux particuliers résidant en France.
2. La recapitalisation des banques
Le renforcement des fonds propres des banques est apparu comme une condition nécessaire au rétablissement de la confiance. Aussi la France a-t-elle fait le choix de donner à une société détenue par l’État, la société de prise de participations de l’État (SPPE), la possibilité de souscrire, dans la limite de 40 milliards d’euros (43), à des titres de fonds propres (44) émis par les établissements bancaires. Ainsi les banques peuvent disposer, grâce à ce dispositif de recapitalisation, de fonds propres et de réserves plus importantes destinées à rétablir la confiance et à assurer un financement normal de l’économie.
La société de prise de participations de l’État (SPPE) a conduit son action autour de deux axes. D’une part, elle a assuré une recapitalisation de l’ensemble des banques dans le but de soutenir la production de crédits. D’autre part, elle a servi d’instrument pour apporter un soutien ciblé sur deux établissements qui ont particulièrement souffert de la crise, Dexia et le nouveau groupe Banques populaires-Caisses d’épargne (BPCE) dont la filiale Natixis a essuyé des pertes de plusieurs milliards d’euros.
En effet, la SPPE a d’abord été créée pour porter la participation de l’État dans Dexia, à hauteur de 5,7 % du capital, soit 1 milliard d’euros, en vue de renforcer le capital de cet établissement financier, en partenariat avec la Caisse des dépôts, la CNP et les États belge et luxembourgeois.
Elle a ensuite été mise à contribution pour assurer des injections de capital au profit des banques françaises. Sur les deux tranches qui avaient été prévues à la fin de l’année 2009, elle a souscrit pour 16,75 milliards d’euros d’actions de préférence ou de titres super subordonnés à durée indéterminée (TSSDI), dont la rémunération est garantie et s’établit à environ 8 %. Par ailleurs, elle a également souscrit trois milliards d’euros d’actions de préférence émises par le nouveau groupe Banques populaires-Caisses d’épargne. Ces souscriptions sont intervenues dans des conditions financières tenant compte des références de marché disponibles pour les établissements concernés. Le tableau suivant retrace l’activité de la SPPE depuis sa création.
SOUSCRIPTIONS RÉALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ DE PRISE DE PARTICIPATIONS DE L’ÉTAT
(en milliards d’euros)
Établissement |
Montants souscrits par la SPPE |
BPCE |
7,05 |
BNP Paribas |
5,1 |
Crédit Agricole |
3 |
Crédit Mutuel |
1,20 |
Société Générale |
3,4 |
Dexia |
1 |
Total |
20,75 |
Source : rapport (n° 1967, session 2009-2010) fait au nom de la commission des Finances sur le projet de loi de finances pour 2010 par le rapporteur général, M. Gilles Carrez.
En septembre 2009, l’État, via la SPEP, détenait ainsi 5,7 % du groupe Dexia en actions ordinaires, 15,19 % du capital de BNP Paribas en actions de préférence sans droit de vote, 7,2 % du capital de la Société générale en actions de préférence.
Les injections de capital réalisées par la SPEP ont permis à ce jour d’augmenter les fonds propres des banques afin qu’elles soutiennent pleinement le développement du crédit aux ménages, aux entreprises, notamment aux PME et aux collectivités locales tout en maintenant un haut niveau de solvabilité.
Le tableau ci-dessous synthétise les principes et les modalités qui ont présidé à la définition et à la mise en œuvre du plan français de financement de l’économie, dont le plafond a été fixé à 360 milliards d’euros.
LE PLAN FRANÇAIS POUR ASSURER LE FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE
ET RESTAURER LA CONFIANCE
Mesures de renforcement des fonds propres des organismes financiers français |
Mesures destinées à améliorer le refinancement des établissements financiers français | |
Objectif poursuivi |
Renforcer les fonds propres des organismes financiers français afin de rétablir la confiance dans le système financier. Le cas échéant, intervenir en capital dans une banque qui serait en difficulté et dont la défaillance créerait un risque pour l’ensemble du système financier. |
Permettre aux établissements de crédit d’améliorer le refinancement à moyen terme de leurs activités en obtenant des prêts (contre sûretés) consentis par la société de financement de l’économie française (SFEF) bénéficiant de la garantie de l’État. |
Mesures législatives |
Octroi de la garantie de l’État aux émissions de la société de prise de participation de l’État (SPPE). |
La loi de finances rectificative pour le financement de l’économie du 16 octobre 2008 prévoit : — la création de la SFEF destinée à refinancer les établissements de crédit ; — les grandes lignes des modalités de fonctionnement de la société ; — les modalités d’octroi de la garantie de l’État à cette société afin qu’elle puisse lever des fonds sur les marchés. |
Contrôle de la société par l’État |
L’État est l’unique actionnaire de la SPPE. Ses dirigeants sont nommés par décret. |
L’État agrée les dirigeants et les statuts de la SFEF et dispose de la minorité de blocage (34 %). Un commissaire du gouvernement siège au conseil d’administration. Il dispose d’un droit de veto. La SFEF est soumise au contrôle de la Commission bancaire pour le compte de l’État. |
Période d’activité de la société |
Non limitée, mais les interventions ont vocation à être temporaires. |
Clôture de l’activité de refinancement, bénéficiant de la garantie de l’État, le 31 décembre 2009. |
Conditionnalité de l’aide |
Des contreparties peuvent être demandées par l’État aux organismes financiers utilisant le dispositif, notamment sous forme d’engagements de volumes de prêts à l’économie, et du respect par les organismes et leurs dirigeants de règles éthiques conformes à l’intérêt général. |
Des contreparties peuvent être demandées par l’État aux organismes financiers utilisant le dispositif, notamment sous forme d’engagements de volumes de prêts à l’économie, et du respect par les organismes et leurs dirigeants de règles éthiques conformes à l’intérêt général. Ces contreparties sont fixées au moyen de conventions passées avec l’État. |
Ressources de la société |
La SPPE lève de la dette sur les marchés. Cette dette bénéficie de la garantie de l’État. |
La SFEF lève de la dette sur les marchés. Cette dette bénéficie de la garantie de l’État. |
Gestion des émissions de dette |
L’agence France Trésor (AFT) assure la gestion administrative et la planification des émissions de dette par la SPPE. |
L’agence France Trésor (AFT) assure la gestion administrative et la planification des émissions de dette par la SFEF. |
Utilisation des ressources de la société |
La SPPE souscrit les titres constitutifs de fonds propres de catégorie 1 d’organismes financiers. |
La SFEF accorde des prêts aux établissements de crédit. Ces prêts de la SFEF sont nantis par des actifs apportés par les banques en garantie. |
Caractéristiques |
• Des titres souscrits par la SPPE : — s’il s’agit d’un renforcement des fonds propres des banques pour renforcer la confiance : titres hybrides, actions de préférence admis dans la catégorie des fonds propres réglementaires de catégorie 1 des organismes financiers ; — s’il s’agit d’intervenir dans une banque en difficulté : actions ordinaires, titres donnant accès au capital. En tout état de cause, ces titres donneront des droits spécifiques à l’État vis-à-vis de l’organisme financier et de ses dirigeants. |
• Des prêts aux banques : — maturité jusqu’à 5 ans ; — taux d’intérêt comprenant deux composantes : a) un taux correspondant au coût de financement de la société auquel viendra s’additionner b) une rémunération additionnelle qui correspond à la tarification de la garantie de l’État. |
3. Le plan de financement de l’économie à l’épreuve des faits : un succès incontestable
a) Une amélioration de la solvabilité des banques françaises
Dans son rapport sur l’évaluation du plan de financement de l’économie (45), la Cour des comptes porte un jugement positif sur les opérations de recapitalisation réalisées par la SPPE. Elle estime ainsi qu’ « à la fin de l’année 2008, la première tranche d’apports de la SPPE a permis de redresser les ratios de solvabilité et, globalement, les augmentations de capital, les émissions de titres hybrides et les apports de la SPPE ont un peu plus que compensé au 31 décembre 2008 les dépréciations enregistrées à cette date ».
RATIOS DE SOLVABILITÉ DES SIX GRANDS GROUPES BANCAIRES FRANÇAIS
(en milliards d’euros et en %)
Fonds propres de base |
Risques pondérés |
Ratio fonds propres de base | |||
au 30.06.08 |
au 31.12.08 |
au 01.01.09 | |||
Crédit agricole |
51,5 |
615 |
8,3 % |
8,4 % |
9,4 % |
BNP Paribas |
41,8 |
535 |
7,6 % |
7,8 % |
7,9 % |
Société générale |
30,3 |
361 |
8,2 % |
8,4 % |
8,8 % |
Crédit mutuel |
25,6 |
261 |
9,7 % |
9,8 % |
11,1 % |
Caisse d’épargne |
18,6 |
229 |
8,3 % |
8,1 % |
8,4 % |
Banque populaire |
14,4 |
188 |
9,6 % |
7,6 % |
8,6 % |
Source : Cour des comptes, Rapport public sur les concours publics aux établissements de crédit : premiers constats, premières recommandations, juin 2009, p. 36.
À l’instar du constat posé par la Cour des comptes, le rapporteur général de la commission des Finances de l’Assemblée nationale, M. Gilles Carrez, a souligné, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2010, « l’efficacité des injections de capital réalisées par la SPPE. Elles ont en effet donné aux banques les moyens d’assurer la croissance du crédit, tout en générant des ressources substantielles » (46).
b) Un assouplissement de la contrainte de liquidité
Lors de son audition par votre rapporteur (47), M. Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France, a estimé que « les mesures de soutien à la liquidité, ainsi que l’intervention de la Banque centrale européenne et de la Banque de France depuis le début de la crise, ont permis de détendre considérablement la situation de liquidité des banques, particulièrement après la faillite de Lehman Brothers ».
Signe manifeste que la confiance revient progressivement, les banques françaises sont graduellement passées de l’émission d’une dette garantie par l’État à des émissions sans cette garantie. En effet, l’article 6 de la loi n° 2008-1061 de finances rectificative du 16 octobre 2008 pour le financement de l’économie prévoit qu’aucune émission ne peut plus être garantie après le 31 octobre 2009. La SFEF est donc arrivée aujourd’hui au bout de sa mission. L’article 119 du projet de loi de finances pour 2010, tel qu’il a été adopté en dernière lecture par l’Assemblée nationale (48), prévoit toutefois sa « mise en sommeil » pour un an.
Cet allégement de la contrainte de liquidité a permis aux banques de desserrer les conditions de crédit. À la fin août 2009, les taux d’intérêt moyens des crédits aux entreprises et aux ménages ont baissé respectivement de 227 points de base et de 80 points de base en un an pour atteindre 5,32 % et 3,18 %. Le rapporteur général de la commission des Finances, M. Gilles Carrez, estime pour sa part que « la SFEF a prouvé son efficacité en ramenant les marchés interbancaires à la normale et en permettant d’éviter la faillite de Dexia, qui aurait eu des conséquences sur l’ensemble de l’économie et sur les collectivités territoriales » (49).
c) Un impact limité sur les finances publiques
Les différentes mesures de financement de l’économie présentent, en outre, l’avantage d’avoir un impact très modéré sur les finances publiques, preuve indéniable que le plan de soutien au secteur bancaire, efficace et équilibré, a été capable de préserver le financement de l’économie sans pour autant compromettre la soutenabilité de nos finances publiques.
L’impact global et définitif de ces mesures de financement de l’économie sur les finances publiques ne peut être aujourd’hui connu avec certitude : le bilan financier du dispositif ne pourra en effet être établi que lorsque celui-ci aura pris fin, en raison des différents aléas qui peuvent l’affecter. Toutefois, la Cour des comptes, dans son rapport public pour 2009, a d’ores et déjà identifié quelques éléments de réponse.
En premier lieu, elle souligne que le plan de financement de l’économie est surtout composé « de prêts ou d’apports en capital, dont le rendement pourrait être suffisant pour que leur effet sur le déficit public reste assez limité ». En revanche, « leur impact sur la dette publique au sens du Traité sur l’Union européenne sera sensible, bien qu’il soit encore incertain » (50).
En deuxième lieu, la Cour estime que les emprunts émis par la société de financement de l’économie française « n’auront probablement pas d’impact sur la dette publique » (51). En outre, d’un point de vue budgétaire, le refinancement des banques par la SFEF procure à l’État l’essentiel des recettes qu’il tire de l’octroi de sa garantie. Ainsi, M. Gilles Carrez, rapporteur général de la commission des Finances, indique que le refinancement assuré par la SFEF, loin d’accroître la dépense publique, permettra à l’État en 2009 de percevoir plus de 1,5 milliard d’euros de recettes au titre des intérêts perçus sur les fonds prêtés.
En troisième et dernier lieu, la Cour estime qu’à l’inverse des emprunts émis par la SFEF, « les mesures destinées au renforcement des fonds propres des banques à travers la société de prise de participation de l’État (SPPE) pèseront à hauteur de 1 point de PIB sur la dette publique » (52). Cependant, « cet endettement nouveau du secteur public aura pour contrepartie des actifs financiers qu’il servira à financer (prêts et dotations en capital) et la dette nette ne devrait pas augmenter sensiblement » (53). En outre, les apports de fonds propres par la SPPE, rémunérés par un taux d’intérêt élevé et croissant avec la durée de détention des capitaux (54), vont permettre à l’État de percevoir environ 1,2 milliard d’euros de produits financiers en 2009, auxquels il convient de retrancher le coût de son financement évalué à 350 millions d’euros, soit un gain net d’environ 850 millions d’euros.
En définitive, les concours publics de l’État aux établissements de crédit, via la SFEF et la SPPE, vont générer, en 2009, 1,6 milliard d’euros de recettes au titre des intérêts perçus sur les fonds ainsi prêtés. À terme, « l’ensemble de ces dispositifs de financement pourrait avoir un impact faible sur le déficit, mais plus sûrement un effet durable, de 1 à 2 point de PIB […], sur la dette publique » (55). Loin de compromettre le caractère soutenable des comptes publics à long terme, le plan de financement de l’économie est parvenu à restaurer la confiance et à assurer tant la liquidité que la solvabilité du système bancaire français.
d) Un remboursement anticipé des aides de l’État : signe de la bonne santé des banques françaises
Au début du mois de novembre 2009, les grandes banques françaises, ayant bénéficié des concours financiers de l’État, ont annoncé leur volonté de rembourser les aides perçues afin de les remplacer par des capitaux privés. Au total, les banques françaises ont remboursé à ce jour 13,3 milliards d’euros sur les 20,8 milliards d’euros de fonds propres injectés par l’État. Or, comment expliquer que les banques françaises aient pu s’engager si vite dans cette voie, à peine plus d’un an après la mise en œuvre du plan de financement de l’économie ?
En premier lieu, comme l’a souligné M. Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France, lors de son audition (56), force est de constater que les remboursements ont nécessité un accord préalable de la Commission bancaire. Celle-ci s’est à chaque fois assurée que les remboursements ne détérioraient pas la solvabilité des groupes bancaire. Elle vérifie à ce titre que des émissions d’instruments de fonds propres (57) pour des montants au moins équivalents aux aides perçues par l’État ont été réalisées préalablement au remboursement. C’est un aspect sur lequel la Commission bancaire reste très vigilante, chaque demande de remboursement étant examinée à l’aune de différents critères, comme l’évolution à moyen terme des fonds propres.
En deuxième lieu, le remboursement anticipé des aides perçues par l’État s’explique également par les résultats positifs dégagés par les principaux groupes bancaires au premier semestre 2009. En effet, ces résultats ont non seulement contribué à renforcer l’assise financière des grandes banques françaises, comme en atteste l’augmentation des ratios de fonds propres de base dits « Core Tier One » observée au 30 juin 2009 par rapport à la même période de l’année précédente, mais ils ont également constitué un signal positif à l’égard des marchés. Ceux-ci sont désormais moins réticents à souscrire aux émissions de titres bancaires, qu’il s’agisse de produits de fonds propres ou de dettes, signe que la confiance des investisseurs a été restaurée.
En troisième et dernier lieu, l’objectif initial poursuivi par l’intervention de l’État était de substituer provisoirement des fonds publics aux marchés défaillants, à des conditions qui rétribuent le risque pris par l’État, et non pas de créer un financement pérenne. C’est pourquoi, pour les banques bénéficiaires, le coût du remboursement des apports de fonds propres de la SPPE croît avec la durée. L’incitation à rembourser est donc avant tout économique : les banques sont en effet incitées à rembourser les aides perçues dès lors que les nouvelles ressources disponibles sur les marchés financiers sont moins coûteuses que les titres d’État, dont le coût croît avec la durée de détention.
Plus généralement, M. Christian Noyer a estimé qu’il fallait voir dans cette évolution une volonté des banques françaises de privilégier des solutions de marché lorsque toutes les conditions sont réunies, ce qui est aujourd’hui de nouveau le cas. Vis-à-vis des investisseurs, par ailleurs, la capacité d’une banque à se désengager des aides d’État peut constituer un facteur de différenciation à l’égard des autres établissements. Ce n’est pas le seul élément pris en compte par les investisseurs pour apprécier la robustesse d’une banque, mais il est certain que celui-ci revêt une importance toute particulière.
Ce faisant, les banques françaises participent à un mouvement plus large en Europe visant tout à la fois à se défaire des aides publiques et à augmenter leurs fonds propres, en quantité comme en qualité. Bernard de Longevialle, responsable du secteur bancaire chez Standard & Poor’s, résume ainsi la situation : « avec le rebond des marchés d’actions et la réouverture du marché des titres hybrides, qui leur était complètement fermé il y a un an, les banques ont profité de conditions de marché favorables. En substituant des ressources de marché aux ressources publiques, elles envoient un signal clair aux investisseurs, montrant qu’elles sont capables de se passer du soutien de l’État et de tenir sur leurs deux jambes » (58).
4. Les établissements de crédit bénéficiaires de ces mesures d’aide se sont engagés en contrepartie à respecter certaines obligations
Parce que la faillite du système bancaire aurait représenté un coût insupportable pour les déposants, pour l’économie et pour l’emploi, une réponse des États était absolument nécessaire. Les plans de soutien aux banques sont, en effet, toujours préférables à l’inaction.
Ce dispositif de soutien au secteur bancaire impliquait de facto des contreparties, en particulier la progression des encours de crédit accordés par les banques. C’est pourquoi l’État a demandé aux établissements de crédit de poursuivre le financement des entreprises, des ménages et des collectivités territoriales, en fonction d’un objectif chiffré.
Dans cette perspective, les treize établissements de crédit bénéficiant de concours publics ont dû prendre plusieurs engagements, dont la logique repose sur l’idée que le métier bancaire est de prêter et qu’en conséquence, le plan de soutien doit avoir une contrepartie dans le financement de l’économie.
a) L’engagement relatif à la croissance du crédit à l’économie
Mme Christine Lagarde, ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi a demandé aux différents établissements bancaires bénéficiaires de concours publics de s’engager sur des objectifs de progression des encours de crédit à l’économie de nature à garantir un financement adapté aux besoins des particuliers, des professionnels, des entreprises et des collectivités locales.
Aussi les établissements bancaires et financiers ont-ils pris l’engagement d’assurer la croissance de leurs encours de crédits à un rythme de 3 à 4 % annuel jusqu’à fin 2009. Cet engagement est global, pour l’ensemble des encours de crédit aux particuliers (consommation et immobilier), aux entreprises et aux collectivités locales.
Toutefois, au vu des informations disponibles à l’issue du troisième trimestre 2009, M. Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France, a confirmé, lors de son audition que l’objectif du maintien d’un rythme de croissance annuel des crédits à l’économie compris entre 3 % et 4 % était hors d’atteinte en 2009. Dès juin 2009, la Cour des comptes, dans son rapport sur les concours publics aux établissements de crédit, avait indiqué que « si les prévisions de contraction du PIB se confirment, il semble probable que les objectifs fixés dans les conventions ne seront pas atteints » (59).
Cette situation peut s’expliquer par une plus grande sélectivité des banques, dans un contexte de hausse du coût du risque, mais surtout par des effets liés au ralentissement de la conjoncture et de la demande de crédit, ce que tendent à confirmer les dernières enquêtes trimestrielles de la Banque de France sur la distribution du crédit en France. La Cour des comptes a posé le même constat, en rappelant qu’« il est difficile de distinguer, dans la variation des chiffres du crédit, ce qui est imputable à une restriction de l’offre de crédit ou à la baisse de la demande liée à la crise économique. Les enquêtes disponibles sont trop fragiles et globales pour permettre de le déterminer » (60). Par ailleurs, le ralentissement du crédit est en partie compensé par le dynamisme de l’endettement de marché dont le taux de croissance annuel s’élève à 19,7 % à fin septembre 2009.
Toutefois, il faut constater que, comparativement à nos principaux partenaires économiques, le ralentissement du crédit aux entreprises situe la France dans la moyenne des autres grands pays de la zone Euro (Allemagne, Espagne, Italie). En revanche, la dynamique reste plus favorable pour les ménages en France qu’en Allemagne ou en Espagne.
Cependant, votre rapporteur demande que les banques bénéficiaires des concours publics de l’État, dans le cadre du plan de financement de l’économie, se justifient en fin d’année sur le non-respect de cet engagement. En outre, parce qu’il a contribué à améliorer de manière décisive la mobilisation des banques, l’indicateur d’encours de crédit ne doit pas être abandonné, dès lors que les banques ont remboursé les aides de l’État. En effet, l’incertitude qui entoure la reprise économique dans notre pays, comme dans le reste du monde, est telle que l’engagement relatif à la croissance du crédit à l’économie doit être maintenu au-delà de l’arrivée à échéance du plan de soutien au secteur bancaire. Parce qu’il ne peut y avoir de croissance économique forte sans un secteur bancaire sain et robuste, parce que la reprise économique ne peut être vigoureuse sans investissement, votre rapporteur propose donc que l’engagement des banques d’assurer une croissance de leurs encours de crédit de 3 à 4 % en rythme annuel soit maintenu jusqu’à ce que la France soit définitivement sortie de la crise et ait durablement retrouvé le chemin de la croissance.
Proposition n° 1 :
Exiger des banques ayant bénéficié des concours publics de l’État, dans le cadre du plan de financement de l’économie, de se justifier avant la fin de l’année 2009, sur le non-respect de l’engagement d’une croissance de 3 à 4 % des encours de crédit à l’économie.
Proposition n° 2 :
Maintenir, au-delà de l’arrivée à échéance du plan de financement de l’économie, l’engagement des banques d’assurer une croissance de leurs encours de crédit de 3 à 4 % en rythme annuel jusqu’à ce que la France soit définitivement sortie de la crise et ait durablement retrouvé le chemin de la croissance.
Cependant, votre rapporteur est pleinement conscient que si l’indicateur de croissance des encours de crédit constitue un élément majeur de surveillance et de mobilisation des banques, il ne peut être considéré comme l’objectif unique que devraient respecter les établissements bancaires. C’est pourquoi, conformément aux recommandations adressées par la Cour des comptes en juin 2009, votre rapporteur propose que l’indicateur de croissance du crédit à l’économie soit complété par des indicateurs complémentaires, comme les taux d’intérêts pratiqués, afin d’offrir une vision plus complète de l’offre de crédit en France. De surcroît, ces indicateurs complémentaires devraient être moins agrégés et préciser les données par type de crédit ou par secteur d’activité (ménages, entreprises, collectivités locales, etc.).
Proposition n° 3 :
Compléter l’indicateur de croissance du crédit à l’économie par de nouveaux indicateurs, comme les taux d’intérêts pratiqués, moins agrégés et déclinés par type de crédit ou par secteur d’activité, afin d’offrir une vision plus complète de l’offre de crédit en France.
b) L’engagement relatif au crédit à l’exportation
Outre les engagements pris sur la croissance des encours de crédit, le 15 avril 2009, quatre banques (61) ont signé avec l’État une convention pour le financement des exportations. En effet, en contrepartie du soutien public dont ils bénéficient, ces acteurs du secteur bancaire se sont engagés à proposer des financements pour des projets d’exportation à hauteur de 7 milliards d’euros en 2009. Dans ce cadre, les banques concernées pourront bénéficier de prêts de la SFEF afin de faciliter le financement de ces exportations, qui est aujourd’hui largement affecté par les difficultés rencontrées par les banques pour lever des fonds à moyen terme sur les marchés.
c) L’engagement relatif au crédit aux entreprises
Afin que les banques continuent d’accompagner l’activité économique et d’anticiper les conséquences de la crise pour les entreprises, le Président de la République a nommé le 23 octobre 2008 un médiateur du crédit aux entreprises, dans le prolongement des mesures prises pour assurer la stabilité du système bancaire et le soutien à l’activité des entreprises.
Le 12 novembre 2008, le médiateur du crédit, M. René Ricol, et la fédération bancaire française ont conclu un accord précisant les modalités de leur coopération, modalités qui viennent concrétiser les engagements pris par les établissements financiers dans le cadre du plan de soutien aux banques. À cette occasion, les banques se sont engagées à ne pas réduire, pour chacune de leurs entreprises clientes, l’enveloppe globale des encours, sans augmenter les garanties personnelles. En cas de rupture de la relation bancaire, l’entreprise doit être informée de la possibilité de recourir au médiateur du crédit.
La médiation du crédit apporte à ce titre aux entreprises confrontées à des problèmes de financement un soutien et une réponse immédiate. Elle poursuit deux objectifs prioritaires : d’une part, ne laisser aucune entreprise seule face à ses problèmes de trésorerie ou de financement et, d’autre part, veiller au respect des engagements pris par les établissements financiers dans le cadre du plan de soutien à l’économie.
Elle examine la situation de chaque entreprise, de manière à rapprocher les positions divergentes à partir d’une expertise technique des dossiers et à proposer des solutions concertées.
La médiation est accessible aux entreprises qui rencontrent des difficultés de financement bancaire, d’assurance-crédit ou de fonds propres. Cette institution qui s’est mise en place très rapidement coordonne les efforts des préfets, des trésoriers-payeurs généraux et des directions départementales de la Banque de France. Elle s’appuie sur un réseau de 800 tiers de confiance de la médiation, désignés dans chaque département au sein des réseaux professionnels (chambres de commerce et d’industrie, chambres des métiers et de l’artisanat, MEDEF, CGPME, UPA, APCE et réseaux professionnels d’accompagnement à la création/reprise d’entreprises).
Le premier bilan annuel publié par le médiateur indique qu’en octobre 2009, près de 17 000 entreprises l’ont saisi, 14 167 dossiers ont été acceptés et pris en charge, 11 674 sont instruits et clôturés en médiation. Le taux de succès s’établit donc à 64,4 %. Lors de son audition par votre rapporteur (62), Gérard Rameix, actuel médiateur du crédit aux entreprises, a rappelé que, depuis son lancement, le dispositif aurait contribué à conforter dans leur activité près de 7 515 sociétés, à débloquer 1,57 milliard d’euros de crédit (hors écrasement des dettes) et à préserver 151 000 emplois en France.
Compte tenu des limites, déjà soulignées, que présente l’objectif global de progression des encours de crédit, l’existence de la médiation est une composante importante du dispositif d’ensemble. Votre rapporteur tient à ce titre à saluer le rôle majeur du médiateur du crédit dans l’amélioration des relations entre les banques et les entreprises.
Fort de ces succès, l’accord de place, signé le 27 juillet 2009 à l’Élysée avec les partenaires de la médiation, pérennise le dispositif de la médiation en le maintenant dans sa forme actuelle jusqu’au 31 décembre 2010. Il prévoit par la suite et sauf prorogation sur décision du gouvernement, la poursuite dans la durée d’un dispositif de médiation allégé s’appuyant pour l’essentiel sur les services de la Banque de France.
d) Les engagements éthiques relatifs à la politique de rémunération
Les établissements bancaires bénéficiaires des concours publics de l’État ont également pris, en contrepartie, certains engagements éthiques. En particulier, la rémunération des dirigeants des établissements bancaires aidés doit obéir aux recommandations du code AFEP-MEDEF du 6 octobre 2008, et notamment respecter les sept principes suivants :
— l’adoption d’une politique de rémunération qui reflète la performance réelle des dirigeants et leur contribution effective à la réussite de l’établissement ;
— l’abandon du cumul des fonctions de mandataire social et d’un contrat de travail, au prochain renouvellement ou nouveau mandat ;
— le plafonnement des indemnités de départ à deux ans de rémunération (en incluant la part fixe et la part variable) ;
— l’interdiction du versement des indemnités de départ en cas de situation d’échec du dirigeant ou de l’entreprise, ou en cas de départ volontaire ;
— l’intégration dans la politique de rémunération des mandataires sociaux des régimes de retraite supplémentaires ;
— l’interdiction de distribuer des actions gratuites sans conditions de performance, ou toute décote en cas d’attribution d’options d’achat ou de souscription d’actions par les mandataires sociaux ;
— la mise en place d’un comité de rémunération au sein du conseil d’administration ou de surveillance.
En outre, un groupe de travail associant la Fédération bancaire française, la fédération française des sociétés d’assurance, l’association française de la gestion financière, l’Association française des investisseurs en capital, l’association française des marchés financier, l’AMF, la Commission bancaire et la direction générale du Trésor et de la politique économique, a spécialement été mis sur pied afin d’élaborer un guide de bonnes pratiques sur les rémunérations des professionnels des marchés. Cette démarche a débouché sur l’adoption d’un code d’éthique validé par le Haut comité de place en février 2009. Ces règles s’appliqueront aux bonus relatifs aux exercices 2009 et 2010. Dans son rapport sur les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux et des opérateurs de marchés, M. Philippe Houillon a souligné qu’« incontestablement, le code d’éthique sur la rémunération des professionnels des marchés constitue une avancée importante. Sans doute n’est-il pas parfait. Il présente néanmoins l’avantage de tracer une voie, d’autant plus que peu de pays se sont engagés jusqu’ici sur ce chemin de la moralisation de la finance » (63).
Au-delà des engagements spécifiés dans la convention qui le lie à chaque établissement bénéficiaire, l’État a demandé aux dirigeants des banques bénéficiant de concours publics de renoncer à la part variable de leur rémunération, et d’affecter en priorité les résultats de l’année 2009 au renforcement des fonds propres.
Enfin, le groupe Dexia s’est également engagé, à la demande de l’État, à respecter ces dispositions dans le cadre d’une convention signée avec lui.
II. UNE ACTION DÉTERMINANTE DES BANQUES CENTRALES
Si l’action des États pour éviter la faillite du système bancaire a été déterminante, il convient de souligner qu’ils ne sont pas les seuls à être intervenus. En effet, les banques centrales, comme la Fed, la Banque centrale européenne ou la Bank of England, ont également joué un rôle majeur dans le traitement de la crise bancaire et financière.
Afin de restaurer la confiance et de normaliser le fonctionnement des marchés monétaires, les banques centrales ont apporté une réponse rapide au déclenchement de la crise et sans précédent dans l’histoire tant par la durée que par les montants injectés.
Dans son discours de Nice du 21 octobre 2008, M. Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France, résumait ainsi les quatre axes ayant présidé à l’ajustement de la politique monétaire des banques centrales : « premièrement, la maturité de leurs facilités a été allongée, pour aider à débloquer le marché monétaire au-delà du compartiment de court terme ; deuxièmement, la gamme des contreparties éligibles a été élargie pour permettre une diffusion maximale de la liquidité dans le système ; troisièmement, le périmètre du collatéral admissible au refinancement a été étendu ; enfin, une coordination internationale extrêmement étroite entre autorités monétaires assure que les actions prises par chacune s’inscrit dans une stratégie d’ensemble cohérente, tout en tenant compte des spécificités propres à chaque zone ».
A. UN ASSOUPLISSEMENT MASSIF DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE
Dès le 9 août 2007, les tensions observées sur le marché interbancaire ont conduit la Fed et la BCE à infléchir leur politique monétaire : l’Eurosystème a fourni pendant quelques jours des liquidités en quantités illimitées au jour le jour (opérations de réglage fin), avant d’allonger la durée des opérations de refinancement. La Fed a, pour sa part, étendu de un à trente jours la maturité maximale de sa facilité d’emprunt permanente. Le montant total de refinancements accordés aux banques par l’Eurosystème dépasse aujourd’hui 960 milliards d’euros contre 450 milliards avant la crise.
Face à l’intensification de la crise, les banques centrales ont renforcé leur coopération à la fin de l’année 2007, comme cela avait été le cas en septembre 2001. Ainsi, le 12 décembre 2007, la Fed, la BCE et la Banque nationale suisse ont pris des mesures permettant notamment un financement à un mois en dollars.
Le « séisme » financier causé par la faillite de Lehman Brothers à l’automne 2008 a par la suite induit un « changement de paradigme monétaire avec des actions sans précédent tant par leur ampleur – comme en témoignent la baisse rapide des taux directeurs et le gonflement des bilans des banques centrales – que par leur diversité – le recours aux « mesures non conventionnelles » étant devenu inévitable » (64). Les banques centrales ont donc pris la mesure du désastre, mais elles ont aussi pris des risques, en particulier la Fed qui a innové en créant une panoplie de facilités permettant à différents intermédiaires financiers d’accéder à la monnaie centrale, d’échanger des titres illiquides contre des titres d’État ou encore de lui céder directement des actifs qui ne trouvaient plus preneurs sur le marché.
Afin d’assurer la liquidité du marché interbancaire et de permettre à chaque établissement bancaire de se refinancer, les banques centrales ont ajusté leur politique de taux d’intérêt et d’intervention sur les marchés suivant quatre modalités.
En premier lieu, les banques centrales ont choisi de baisser sensiblement leurs taux directeurs, la baisse la plus importante ayant été enregistrée aux États-Unis, où la cible du taux directeur a été ramenée à une cible comprise entre 0 et 0,25 % en décembre 2008 contre 5,25 % en août 2007. De la même manière, la Banque centrale européenne a fait le choix, le 7 mai 2009, d’abaisser son taux de refinancement à niveau sans précédent de 1 %.
En deuxième lieu, les banques centrales ont décidé d’allonger graduellement la maturité des facilités de financement jusqu’à douze mois. « Le 25 juin 2009, la BCE a ainsi initié une opération de refinancement sur un an au taux de 1 %, qui a rencontré un vif succès puisqu’elle a été souscrite à hauteur de 442,24 milliards d’euros. Un second appel d’offres a été lancé le 30 septembre, mais cette opération a semblé intervenir à contretemps puisque la demande ne s’est élevée qu’à 75,2 milliards d’euros, signe d’une certaine normalisation des marchés » (65). En définitive, alors qu’avant la crise, 60 % du refinancement de l’Eurosystème était à une semaine, en octobre 2008, 60 % du refinancement était à trois mois. Les modalités techniques d’adjudication ont également été profondément modifiées en octobre 2008 au sein de la zone euro : les banques ont désormais accès en quantité illimitée à taux fixe aux prêts de l’Eurosystème, y compris pour des opérations de refinancement à plus long terme qui peuvent aller jusqu’à six mois.
En troisième lieu, les banques centrales ont graduellement élargi la gamme des contreparties et des collatéraux éligibles en contrepartie des financements auprès des banques centrales, moyennant une augmentation du « haircut », c’est-à-dire de la décote appliquée aux titres remis en garantie en fonction de leur notation (66). Le potentiel de collatéral mobilisable en contrepartie des financements auprès des banques centrales était ainsi estimé, fin octobre 2008, à 1 700 milliards d’euros, alors que le montant ne dépassait pas 200 milliards d’euros à la fin du mois de septembre 2008.
En quatrième lieu, la coopération internationale a été renforcée, en particulier par des accords de swaps permettant, par exemple, aux banques européennes de bénéficier de refinancements en dollars et en francs suisses pour des durées pouvant aller jusqu’à 84 jours (67). Preuve de ce renforcement de la coopération internationale, certaines baisses de taux ont été réalisées de manière concertée. Ainsi, le 8 octobre 2008, un assouplissement des conditions monétaires a été décidé au niveau mondial, la Banque du Canada, la Banque d’Angleterre, la Banque centrale européenne, la Fed, la Banque de Suède et la Banque nationale suisse ayant baissé le même jour leurs taux directeurs.
B. LE RECOURS AUX MESURES NON CONVENTIONNELLES POUR RELANCER LE CRÉDIT
Au fur et à mesure que la crise bancaire et financière s’est aggravée, toutes « les grandes banques centrales ont mis en œuvre des mesures non conventionnelles dans le cadre d’une politique d’« assouplissement quantitatif » du crédit, ayant pour objectif de neutraliser directement le durcissement des conditions du crédit au secteur non bancaire et d’assouplir les conditions de financement » (68). Cette politique d’« assouplissement quantitatif » a consisté, d’une part, à octroyer des fonds aux entreprises, en vue d’améliorer la liquidité et de réduire les primes de risque sur certains segments ciblés (comme les titres adossés à des actifs et les obligations d’entreprise en particulier), et, d’autre part, à réaliser des achats fermes de titres du secteur public, afin influencer plus généralement les rendements de référence.
Il convient à cet égard de souligner combien la Fed a été particulièrement active en la matière. En effet, en janvier 2009, elle s’est ainsi engagée, à racheter d’ici la fin de l’année jusqu’à 1 450 milliards de dollars de titres adossés à des créances immobilières et des créances émises par les agences de refinancement hypothécaire Fannie Mae et Freddie Mac. « Elle a également acquis des titres d’État, et surtout des actifs d’AIG et Bear Stearns, sociétés qu’elle avait déjà subventionnées (dans le cas d’AIG) ou dont elle avait organisé l’acquisition, et qui lui ont causé une perte de 5,25 milliards de dollars au premier trimestre de 2009 » (69).
La BCE s’est en revanche montrée plus prudente et a été la dernière à réaliser ce genre d’opérations. Il faudra ainsi attendre juin 2009 pour qu’elle lance un programme de rachat d’obligations sécurisées émis par les banques européennes (« covered bonds »), pour 60 milliards d’euros.
Comme le note M. Philippe Marini, « tous ces dispositifs ont conduit à une forte croissance du bilan des banques centrales : celui de la Fed a été multiplié par 2,4 entre le point haut et le point bas, et celui de la BCE a quasiment doublé entre août 2007 et octobre 2008 » (70). En effet, l’élargissement de la gamme des collatéraux admissibles et l’introduction des mesures non conventionnelles, par lesquelles les banques centrales tendent à se substituer aux banques commerciales voire, dans le cas de la Fed, aux banques d’investissement, ont conduit à une profonde modification de la structure même du bilan des banques centrales et à une dégradation de leur profil de risque.
Enfin, en fournissant des liquidités à bas coût sur des maturités plus longues, dont une partie vient s’investir dans les importants volumes d’émission de dette publique à court et moyen termes, « elles contribuent indirectement au financement des déficits publics, et donc à accroître la dépendance des États à l’égard des marchés » (71).
TROISIÈME PARTIE : REFONDER ET MIEUX RÉGULER
LA FINANCE MONDIALE
La crise a mis en évidence la nécessité de repenser les fondements de la régulation des systèmes financiers. Elle a ravivé les discussions sur l’architecture de leur supervision. Sous l’impulsion du Président de la République, les Européens plaident pour la fondation d’un nouveau « Bretton Woods », c’est-à-dire d’un nouvel ordre financier international que le G20, regroupant les grands pays industrialisés et les grands pays émergents a repris à son compte lors des sommets de Londres et de Pittsburgh.
Il apparaît donc nécessaire de repenser les fondements de la réglementation financière. Il faut le faire sans précipitation, mais également sans tabou. Une meilleure régulation apparaît nécessaire dans plusieurs domaines, qui vont des agences de notation, à la gestion des risques, en passant par l’organisation des marchés ou encore la question des rémunérations.
Si les sommets du G20, qui se sont tenus à Londres et à Pittsburgh en avril et en septembre derniers, comportent des avancées majeures en matière de régulation bancaire et financière, les efforts entrepris doivent être poursuivis et amplifiés afin de poser les jalons d’une nouvelle régulation bancaire et financière, tant au niveau national qu’européen et mondial.
I. LES G20 DE LONDRES ET DE PITTSBURGH : DES AVANCÉES FONDATRICES À CONCRÉTISER
Par son ampleur inédite, la crise, a nécessité une coordination sans précédent de l’ensemble des économies et a eu, à ce titre, le mérite de mettre en lumière le rôle nouveau joué par le G20.
Constitué à la suite de la crise asiatique, celui-ci se tenait initialement au niveau des seuls ministres des finances et non des chefs d’État. Or, comme le Président de la République, M. Nicolas Sarkozy, en avait eu l’intuition, ce G20, qui représente à lui seul quelque 85 % du PIB mondial, a été l’instance capable de répondre aux défis lancés à l’ensemble des économies de la planète. C’est fort de cette conviction qu’il avait suggéré au président Bush de convoquer un premier G20, réunissant les chefs d’État à Washington, qui allait être suivi par ceux de Londres le 2 avril et de Pittsburgh les 24 et 25 septembre 2009.
C’est par cette transgression des règles ordinaires que le G20 a acquis un rôle-pivot nouveau, s’auto-légitimant par sa représentativité et sa crédibilité. C’est à ce prix que les dirigeants des vingt pays les plus riches au monde sont ainsi parvenus aux sommets de Londres et de Pittsburgh à un compromis ambitieux pour améliorer le système de régulation du système financier international.
A. LE G20 DE LONDRES DU 2 AVRIL 2009
Le G20, qui s’est tenu à Londres au printemps dernier, a été l’occasion pour les chefs d’État et de gouvernement des vingt économies les plus riches non seulement de prendre des décisions majeures pour la réforme du système financier international, mais également d’envoyer un signal politique fort aux marchés. Le G20 a pris, à cette occasion, cinq orientations décisives, afin d’enrayer la dérive de l’économie mondiale : lutte contre les paradis fiscaux, extension du champ de la régulation, sécurisation des banques et encadrement de la rémunération des traders, assouplissement des normes comptables et, enfin, renforcement des institutions financières internationales.
1. Une lutte accrue contre les paradis fiscaux
Aux termes du communiqué final du G20 de Londres, les chefs d’État et de gouvernement ont déclaré que l’époque du secret bancaire était « révolue ». Cette déclaration a constitué une rupture forte avec les décennies passées d’acceptation tacite des paradis fiscaux par les grandes puissances économiques. Aussi ces derniers ne peuvent-ils plus, depuis le sommet de Londres, opposer le secret bancaire aux enquêtes de l’administration fiscale ou de la justice d’un pays étranger, sous peine d’être fichés sur la liste établie par l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE).
En outre, les vingt chefs d’État sont tombés d’accord sur le fait que les paradis fiscaux devaient être sanctionnés à l’avenir. Les ministres des Finances du G20 ont, depuis lors, la lourde tache de définir « une palette de sanctions », mais il est déjà acquis, depuis avril 2009, que les grandes organisations internationales ne pourront pas travailler avec les États récalcitrants. Les engagements de coopération pris, notamment par la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, le Liechtenstein, seront contrôlés par le Fonds monétaire international (FMI) et le Conseil de stabilité financière.
DÉCLARATION DES DIRIGEANTS LORS DU SOMMET DU G20 DE LONDRES
EXTRAIT RELATIF AU SECRET BANCAIRE ET AUX PARADIS FISCAUX
« Nous convenons de prendre des mesures à l’encontre des juridictions non-coopératives, y compris les paradis fiscaux. Nous sommes prêts à appliquer des sanctions pour protéger nos finances publiques et les systèmes financiers. L’ère du secret bancaire est révolue. Nous notons que l’OCDE a rendu publique aujourd’hui une liste de pays évalués par le Forum mondial en fonction de la norme internationale applicable aux échanges d’informations fiscales ».
2. Une extension majeure du champ de la régulation
Lors du sommet de Londres, les vingt économies les plus riches du monde ont souhaité que les établissements, produits et marchés financiers qui représentent un risque systémique pour le système financier mondial soient à l’avenir contrôlés. Or, à Londres comme à Pittsburgh (cf. infra), le G20 ne s’est précisément engagé que sur les fonds spéculatifs « d’importance systémique », c’est-à-dire dont la faillite menacerait d’écroulement l’ensemble du système bancaire et financier. La seule avancée réside dans le fait que ces fonds spéculatifs ou « hedge funds » doivent désormais être immatriculés auprès d’un superviseur et avoir une gestion plus transparente. Toute la difficulté de la mise en œuvre de cette mesure, encore aujourd’hui, est de déterminer, suivant des critères objectifs et exhaustifs, les fonds qui doivent être contrôlés en raison d’un risque systémique et ceux qui ne doivent pas l’être.
DÉCLARATION DES DIRIGEANTS LORS DU SOMMET DU G20 DE LONDRES
EXTRAIT RELATIF À LA RÉGULATION FINANCIÈRE
« Nous convenons d’étendre la régulation et la surveillance à toutes les institutions financières, à tous les instruments et à tous les marchés d’importance systémique. Cela inclura, pour la première fois, les fonds spéculatifs d’importance systémique ».
3. La sécurisation des banques et l’encadrement de la rémunération des traders
Pour éviter que les banques ne restreignent trop brutalement les crédits aux particuliers et aux entreprises en période de crise, le G20 de Londres a insisté sur la nécessité pour les banques d’augmenter leurs fonds propres dès le retour de la croissance économique. Par ailleurs, afin de les responsabiliser aux risques qu’elles prennent, les banques ont été contraintes de conserver dans leur bilan une partie des actifs qu’elles titrisent (5 %). Les autorités de contrôle se sont également vues reconnaître la possibilité de prendre en compte le « hors bilan » des banques dans le calcul de leurs exigences en capital.
DÉCLARATION DES DIRIGEANTS LORS DU SOMMET DU G20 DE LONDRES
EXTRAIT RELATIF AUX NORMES DE FONDS PROPRES
« Nous convenons de prendre des mesures, une fois que la reprise sera assurée, pour améliorer la qualité, la quantité et la cohérence internationale des fonds propres dans le système bancaire. À l’avenir, la régulation devra empêcher les effets de levier excessifs et nécessitera de constituer, en période de croissance, des réserves de ressources ».
S’agissant des agences de notation, accusées de ne pas avoir anticipé la crise et d’avoir accéléré la chute de certains établissements en dégradant brutalement leur note, les chefs d’État et de gouvernement ont estimé, à l’issue des négociations, qu’elles devaient être enregistrées auprès d’une autorité chargée de les surveiller. De surcroît, elles doivent se conformer au code de bonne conduite de l’Organisation internationale des commissions de valeur (OICV) et adopter une échelle de notation spécifique pour les produits complexes, tout en assurant impérativement la transparence sur la performance de leurs notations.
DÉCLARATION DES DIRIGEANTS LORS DU SOMMET DU G20 DE LONDRES
EXTRAIT RELATIF AUX AGENCES DE NOTATION
« Nous convenons d’étendre le contrôle réglementaire et l’enregistrement aux agences de notation pour nous assurer qu’elles respectent les codes internationaux de bonne pratique afin notamment de prévenir les conflits d’intérêt inacceptables ».
A également été annoncée, le 2 avril 2009, une série de mesures visant à réglementer les bonus des traders. Les chefs d’État et de gouvernement n’ont pas seulement voulu limiter les rémunérations excessives ; ils ont également entendu éviter que celles-ci n’encouragent des prises de risque inconsidérées. Ainsi, les bonus des traders, qu’ils soient employés par des banques, des compagnies d’assurance ou des sociétés de courtage, ne peuvent plus être discrétionnaires et doivent être approuvés par les conseils d’administration de ces établissements, ces derniers étant, en effet, investis d’un rôle actif dans la définition de la politique de bonus. Toutes les rémunérations, y compris les bonus, ont désormais pour obligation de respecter la politique de risque de l’entreprise et leur paiement doivent, à ce titre, être en rapport avec l’horizon des risques pris par celle-ci. À l’issue du G20 de Londres, quand le risque est calculé sur longue période, le paiement sur courte période n’est donc plus possible. Les banques se sont également vues reconnaître l’obligation de rendre publique leur politique de bonus.
Il est enfin demandé aux superviseurs nationaux du secteur financier de participer au contrôle de la mise en œuvre de ces principes et d’en tenir compte dans leur évaluation globale des banques. Aussi doivent-ils prendre en considération les salaires octroyés aux traders dans leur évaluation de la solidité financière d’un établissement. Si nécessaire, ils peuvent accroître les exigences de fonds propres imposées aux établissements, qui, ne se conformant pas à ces principes, prennent trop de risques.
DÉCLARATION DES DIRIGEANTS LORS DU SOMMET DU G20 DE LONDRES
EXTRAIT RELATIF A LA RÉMUNÉRATION DES TRADERS
« Nous convenons d’entériner et de mettre en œuvre les nouveaux principes rigoureux du FSF sur les rémunérations et les bonus, et de favoriser des régimes de rémunération soutenables ainsi que la responsabilité sociale de toutes les entreprises ».
4. L’assouplissement des normes comptables
Les normes comptables ont obligé les banques à évaluer une partie de leurs actifs à la valeur de marché (mark-to-market), c’est-à-dire à une valeur dépréciée, voire quasi nulle en plein krach boursier. Le G20 de Londres a appelé les organismes qui les élaborent – des cabinets privés (IASB et FASB) – à travailler de manière « urgente » avec les régulateurs pour les assouplir. L’objectif ainsi poursuivi par les chefs d’État et de gouvernement était, au printemps 2009, de pouvoir freiner au plus vite les dépréciations d’actifs massives qui ont fragilisé les banques depuis l’été 2007, conduisant certaines d’entre elles à faire faillite.
DÉCLARATION DES DIRIGEANTS LORS DU SOMMET DU G20 DE LONDRES
EXTRAIT RELATIF AUX NORMES COMPTABLES
« Nous convenons de demander aux organismes édictant les normes comptables de travailler de toute urgence en collaboration avec les superviseurs et les régulateurs pour améliorer les normes en matière d’évaluation et de provision et pour parvenir à un ensemble unique de normes comptables mondiales de grande qualité ».
5. Le renforcement des institutions financières internationales
La crise financière dessine les contours d’un nouvel ordre économique mondial. Prenant acte de cette évolution, le G20 s’est efforcé le 2 avril 2009 de refonder la gouvernance économique et financière au niveau mondial. Le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale, le Forum de stabilité financière (FSF) et l’Organisation mondiale du commerce (OMC) vont constituer, à l’avenir, les quatre piliers de cette nouvelle architecture. Leurs moyens ont pour ce faire été renforcés et leurs pouvoirs élargis. Les pays émergents sont également appelés à y jouer un rôle à la hauteur de leur poids économique.
a) Le Forum de stabilité financière devient le Conseil de stabilité financière
Créé à la suite de la crise asiatique, le Forum de stabilité financière regroupe depuis 1999 les autorités de tutelle du secteur financier des pays du G7. Le rôle qui lui était ainsi dévolu était d’alerter sur les pratiques dangereuses pour l’équilibre du système financier international. Or, il apparaît assez clairement aujourd’hui qu’il n’a pas eu le poids suffisant pour prévenir la crise financière actuelle.
C’est pourquoi, le G20 de Londres a décidé d’installer un nouveau Conseil de stabilité financière, avec un mandat renforcé et une structure permanente, même si les autorités chinoises ont fait part de leurs réticences. Ce Conseil succédera au Forum de stabilité financière qui comprendra les pays du G20, l’Espagne et la Commission européenne. Il s’agit d’en faire le « gendarme mondial » des marchés et des institutions financières, avec pour mission de promouvoir la stabilité financière internationale, d’améliorer le fonctionnement des marchés et de réduire les risques systémiques. Pour ce faire, le Conseil de stabilité financière devra « collaborer avec le FMI pour signaler les risques macroéconomiques et financiers et indiquer les actions pouvant les contrer ».
LE FORUM DE STABILITÉ FINANCIÈRE
Le Forum de Stabilité Financière internationale (FSF) a été créé en février 1999 à l’initiative des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales des pays du G7. C’est le résultat d’une réflexion menée à la suite des perturbations financières survenues en 1997 et 1998, ces dernières ayant montré l’utilité, pour les différentes autorités financières des grands pays et les principales institutions financières internationales, de croiser leurs analyses.
Rassemblant les autorités monétaires et financières, les superviseurs et les régulateurs des grandes places financières, ainsi que diverses institutions ou organisations internationales, le Forum constitue une instance de coopération et de discussion, qui a pour mission d’apprécier les facteurs conjoncturels et structurels de vulnérabilité et les dynamiques du système financier mondial, en vue d’identifier et de coordonner les actions à entreprendre.
La présidence du Forum est assurée depuis mai 2006 – et pour une durée de trois ans – par M. Mario Draghi (gouverneur de la Banque d’Italie) et le secrétariat, par la Banque des règlements internationaux (BRI). Le Forum se réunit, en session plénière, deux fois par an. En outre, les membres du Forum et les autorités locales se rencontrent périodiquement lors de réunions régionales en Amérique latine, en Asie Pacifique et dans les pays d’Europe centrale et orientale. Le Forum organise également des « tables rondes » thématiques avec le secteur privé sur des questions spécifiques d’actualité ayant trait à la stabilité financière, et des groupes de travail ad hoc non permanents ; il peut aussi commander des travaux aux différents comités techniques qui participent à ses travaux (Comité de Bâle, CGFS...).
b) Le Fonds monétaire international est placé au centre de la régulation internationale
Grâce au triplement de ses ressources et à l’élargissement de ses missions, le FMI est le « grand gagnant » de la réforme de la gouvernance financière et économique au niveau mondial initiée par le G20 de Londres.
En effet, les vingt pays les plus puissants au monde ont reconnu la prééminence du Fonds dans la lutte contre la crise en le dotant de nouveaux moyens d’intervention. Il a donc été décidé que les ressources du Fonds seraient triplées, portées à 750 milliards de dollars grâce à 500 milliards de dollars de ressources supplémentaires provenant de prêts de pays membres. En outre, le FMI s’est vu reconnaître la possibilité d’augmenter son capital de 250 milliards de dollars sous forme de droits de tirages spéciaux, disponibles pour tous les États membres. Finalement, le triplement des moyens du FMI doit lui permettre d’exercer un nouveau rôle de vigie des déséquilibres macro-économiques mondiaux et de soutenir plus activement les pays en difficulté.
Par ailleurs, le G20 donne mandat au FMI pour surveiller les économies : « Nous soutenons, maintenant et dans le futur, le principe d’une surveillance indépendante du FMI sur nos économies et nos secteurs financiers, sur l’impact de nos politiques sur les autres États et sur les risques menaçant l’économie ». Il partagera ce rôle de surveillance des déséquilibres macroéconomiques avec le Conseil de stabilité financière. Il travaillera, en particulier, de concert avec ce dernier pour élaborer un mécanisme d’alerte sur les risques. L’articulation de cette coopération s’annonce cependant délicate, dans la mesure où la supervision des banques et des marchés financiers reste décentralisée au niveau des États.
1 100 MILLIARDS DE DOLLARS POUR LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES MULTILATÉRALES
Le 2 avril 2009, le G20 a décidé d’accroître de 1 100 milliards de dollars les moyens financiers qui pourront être accordés à l’économie via les institutions financières internationales et le financement du commerce.
Ainsi, les ressources du Fonds ont été triplées, portées à 750 milliards de dollars grâce à 500 milliards de dollars de ressources supplémentaires (72) provenant de prêts de pays membres. En outre, le Fonds va augmenter son capital de 250 milliards de dollars sous forme de droits de tirages spéciaux (DTS) (73).
Les banques multilatérales de développement reçoivent, quant à elles, 100 milliards de dollars supplémentaires en faveur des pays les plus pauvres et un soutien financier de 250 milliards de dollars sur deux ans est apporté au commerce international, notamment par le biais de crédit à l’export.
Au-delà du simple renforcement des moyens des institutions financières internationales, les pays du G20 ont décidé de réformer ces mêmes institutions. Ils se sont ainsi engagés à leur redonner toute leur légitimité, « à réformer leur mandat, leur champ d’action et leur gouvernance pour refléter les changements dans l’économie mondiale ». La réforme des droits de vote au FMI devra notamment être achevée d’ici à janvier 2011. En outre, le G20 reconnaît que les dirigeants de ces institutions « devraient être nommés et sélectionnés via un mécanisme transparent et basé sur le mérite », signifiant concrètement la fin de l’accord tacite qui existait entre Européens et Américains (74).
DÉCLARATION DES DIRIGEANTS LORS DU SOMMET DU G20 DE LONDRES
EXTRAIT RELATIF AU RENFORCEMENT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES INTERNATIONALES
« 17. Les pays émergents et en développement, qui ont été le moteur de la croissance mondiale ces dernières années sont eux aussi confrontés maintenant à des défis qui aggravent la récession actuelle de l’économie. Il est indispensable pour la confiance et la reprise économique dans le monde qu’ils continuent à bénéficier des flux de capitaux. Cela nécessitera de renforcer de manière substantielle les institutions financières internationales, notamment le FMI. C’est pourquoi nous sommes convenus aujourd’hui de fournir 850 milliards de dollars en sus des moyens dont disposent les institutions financières internationales afin de soutenir la croissance des marchés émergents et des économies en développement en les aidant à financer les dépenses contracyliques, la recapitalisation des banques, les infrastructures, le financement du commerce, le soutien à la balance des paiements, le renouvellement des lignes de crédit et les politiques sociales. À cette fin :
« Nous sommes convenus d’augmenter les ressources mises à disposition du FMI par un financement immédiat par ses membres de 250 milliards de dollars, qui seront intégrés ultérieurement dans de nouveaux accords d’emprunt élargis et plus flexibles, abondés de 500 milliards de dollars au maximum, et d’envisager des emprunts sur le marché si nécessaire ; et
« Nous préconisons une augmentation substantielle d’au moins 100 milliards de dollars des prêts des banques multilatérales de développement, notamment au profit des pays à faible revenu, et nous veillerons à ce que toutes les banques multilatérales des développement (BMD) disposent des capitaux appropriés.
« 18. Il est essentiel que ces ressources puissent servir de manière efficace et flexible à soutenir la croissance. Nous nous félicitons à cet égard des progrès accomplis par le FMI avec sa nouvelle Ligne de crédit modulable (LCM) et son cadre de prêt et de conditionnalité réformé, qui lui permettra de faire en sorte que ses instruments traitent efficacement les causes sous-jacentes des besoins de financement de la balance des paiements des pays, en particulier le retrait des flux de capitaux extérieurs destinés au secteur bancaire et aux entreprises. Nous nous félicitons de la décision prise par le Mexique de solliciter un arrangement dans le cadre de la Ligne de crédit modulable.
« 19. Nous sommes convenus d’appuyer une allocation générale de DTS qui injectera 250 milliards de dollars dans l’économie mondiale et augmentera les liquidités mondiales, et nous demandons la ratification rapide du quatrième amendement.
« 20. Pour que nos institutions financières internationales contribuent à gérer la crise et à prévenir de futures crises, nous devons renforcer leur compétence, leur efficacité et leur légitimité à long terme. C’est pourquoi, au-delà de l’important accroissement de leurs moyens décidé aujourd’hui, nous sommes résolus à réformer et à moderniser les institutions financières internationales afin de faire en sorte qu’elles puissent efficacement venir en aide à leurs membres et à leurs actionnaires face aux difficultés nouvelles qui se présentent à eux. Nous réformerons leur mandat, leur champ d’action et leur gouvernance de manière à tenir compte des mutations de l’économie mondiale et des défis nouveaux de la mondialisation ; les économies émergentes et en développement, notamment les plus pauvres, doivent pouvoir se faire mieux entendre et représenter. Cela devra aller de pair avec une action visant à accroître la crédibilité et la responsabilité de ces institutions par un meilleur contrôle stratégique et une prise de décision améliorée. À cette fin :
« Nous nous engageons à mettre en œuvre le paquet des réformes des quotes-parts et de la représentation au FMI que nous avons arrêté en avril 2008 et nous demandons au FMI d’achever le prochain réexamen des quotes-parts d’ici à janvier 2011 ;
« Nous reconnaissons que, parallèlement, la question d’une plus grande participation des gouverneurs du Fonds à la définition de l’orientation stratégique du FMI et au renforcement de sa responsabilité doit être envisagée ;
« Nous nous engageons à mettre en œuvre le paquet des réformes à la Banque mondiale que nous avons arrêté en octobre 2008. Nous attendons avec intérêt de nouvelles recommandations, lors des prochaines réunions, sur l’accélération de la réforme de la représentation, qui devra intervenir d’ici les réunions de printemps de 2010 ;
« Nous sommes d’accord sur le fait que les directeurs et hauts responsables des institutions financières internationales doivent être désignés dans le cadre d’un processus de sélection transparent et ouvert, reposant sur le mérite ; et
« Sur la base des examens en cours au FMI et à la Banque mondiale, nous avons demandé au Président de procéder, de concert avec les ministres des finances du G20, à de larges consultations et d’en faire rapport à la prochaine réunion en émettant des propositions de nouvelles réformes destinées à améliorer la réactivité et la capacité d’adaptation des institutions financières internationales ».
B. LE G20 DE PITTSBURGH DU 24 SEPTEMBRE 2009
Les vingt dirigeants des principales économies industrialisées et émergentes se sont retrouvés, le 24 septembre 2009, à Pittsburgh en Pennsylvanie pour le troisième sommet du G20 en un an, afin de poursuivre la dynamique de réforme engagée quelques mois auparavant à Londres. Deux sujets ont été au cœur des préoccupations de ce sommet : la réforme des institutions multilatérales, d’une part, et le renforcement de la régulation du système financier international, d’autre part.
1. La poursuite de la réforme des institutions multilatérales et de leur mandat
De la pérennisation des réunions du G20 au renforcement des pouvoirs du FMI, la réforme des institutions multilatérales s’est invitée au cœur des négociations du G20 de Pittsburgh.
a) Le renforcement des pouvoirs des pays émergents au sein du Fonds monétaire international
Le FMI, sorti largement renforcé du G20 de Londres, l’est encore davantage après celui de Pittsburgh. Il dispose désormais d’outils de financement lui permettant de faire face à des crises financières spécifiques. Des lignes de crédit flexibles, dont le représentant de la France demandait depuis longtemps la création, ont été mises en place : la Pologne, la Colombie, le Mexique en ont déjà bénéficié.
Il avait été décidé à Londres de tripler les ressources du FMI. C’est désormais chose faite, grâce notamment à l’allocation de droits de tirage spéciaux (DTS). En outre, la Grande-Bretagne et la France ont décidé conjointement de prêter à son fonds fiduciaire deux milliards de dollars de DTS, à condition qu’il les prête à taux zéro aux pays les moins avancés.
Le sommet de Pittsburgh du 24 septembre 2009 a également permis d’octroyer plus de pouvoirs aux pays sous-représentés au sein du FMI, comme la Chine qui apparaît comme la grande gagnante de cette redistribution des cartes au détriment des pays européens.
Le FMI voit enfin son rôle renforcé pour promouvoir la stabilité financière et assurer une croissance mondiale équilibrée. Les chefs d’État lui ont, pour ce faire, donné mandat d’établir un rapport pour le prochain sommet du G20 concernant les possibilités de contribution du secteur financier à la stabilisation du système financier international.
b) Une coordination accrue de la supervision financière confiée au Conseil de stabilité financière
Le Conseil de stabilité financière, qui, depuis le G20 de Londres, a remplacé le Forum de stabilité financière, est un autre organe important à la disposition du G20 afin de coordonner la supervision financière. En effet, le Conseil travaille en étroite coopération avec le FMI et joue, à ce titre, un rôle-clé en matière de supervision, d’identification des risques et de prescription des normes en matière de capitaux et de fonds propres que doivent détenir les établissements financiers. Depuis Pittsburgh, le Conseil de stabilité financière, dont la charte a été avalisée à cette occasion, est chargé de veiller à l’application de la nouvelle régulation financière.
c) La pérennisation des réunions périodiques du G20
Au nombre des acquis de Pittsburgh, la pérennisation des réunions du G20 figure en bonne place. En effet, le 24 septembre dernier, le G20 a décidé de pérenniser ses réunions au niveau des chefs d’État. Deux sommets sont, d’ores et déjà, prévus en 2010, l’un au Canada, l’autre en Corée du sud – comme il avait été initialement prévu que les ministres des finances des vingt pays s’y réunissent. Et ses partenaires ont demandé à la France, où devait se tenir le G8 en 2011, de mener le processus à son terme en organisant un seul sommet, celui du G20.
L’un des enseignements de Pittsburgh est que cette structure à 20 est désormais plus pertinente que le G8. Il faut d’ailleurs souligner que le G20 comporte plus de 20 membres puisque, comme l’avait souhaité la France l’an passé, l’Espagne et les Pays-Bas y sont désormais conviés et qu’à la demande du Président de la République française, le directeur général de l’Organisation internationale du travail (OIT) était également présent à Pittsburgh, faisant pour la première fois des questions sociales un élément de dialogue et de décision au G20. Ce G20 élargi, inscrit dans la durée, sorte de tour de contrôle du fonctionnement des économies et des circuits financiers mondiaux, possède avec le FMI un satellite d’observation et avec le Conseil de stabilité financière, mis en place au sommet de Londres, un organe susceptible d’édicter, à tout le moins de suggérer, des normes.
2. Le renforcement de la régulation de la finance internationale
Outre la réforme des institutions multilatérales et de leur mandat, les avancées ont été considérables sur le chapitre de la régulation financière à l’échelle internationale.
a) Une application à tous les pays des règles de Bâle II d’ici 2011
À Pittsburgh, des avancées importantes ont été réalisées en matière de normes prudentielles. En effet, les États-Unis ont pour la première fois accepté que leurs établissements bancaires se soumettent, à compter de 2011, aux règles de Bâle II, beaucoup plus contraignantes en matière de mesure des risques ainsi que de définition des fonds propres et de capitaux minima que celles actuellement en vigueur chez eux (cf. supra).
Si, à la grande satisfaction des Européens, les règles de Bâle II sur la mesure des risques vont s’appliquer à tous d’ici à 2011, les Américains ont obtenu que soit mis en place un nouveau ratio d’effet de levier complémentaire aux exigences de Bâle II. Il est, par ailleurs, demandé aux banques de consacrer une plus grande part de leurs bénéfices au renforcement de leurs fonds propres et aux prêts au bénéfice des entreprises et des ménages.
Cependant, à l’issue du sommet de Pittsburgh, le débat reste encore vif entre Européens et Américains sur le niveau de capital requis pour les banques de taille significative, les Américains souhaitant éviter un risque systémique en demandant davantage aux institutions les plus importantes. Quoiqu’il en soit, l’augmentation des fonds propres ne sera requise qu’une fois que le rétablissement de l’économie sera jugé suffisant, mais, d’ores et déjà, les Européens tiennent à ce que la notion de risque soit prise en compte quand il s’agira de déterminer les niveaux de capitaux appropriés.
DÉCLARATION DES DIRIGEANTS LORS DU SOMMET DU G20 DE PITTSBURGH
EXTRAIT RELATIF AUX NORMES DE FONDS PROPRES
« Nous nous engageons à élaborer d’ici la fin 2010 des règles internationalement reconnues pour améliorer à la fois la quantité et la qualité des capitaux bancaires et décourager des leviers financiers excessifs. Ces règles seront appliquées progressivement au fur et à mesure que la situation financière s’améliorera et que la reprise s’installera, l’objectif étant une mise en œuvre d’ici la fin 2012.
« La mise en œuvre à l’échelle nationale d’exigences en capital plus strictes en termes de niveau et de qualité, des réserves de capitaux anticycliques, des exigences en capital plus élevées pour les produits à risques et les activités hors bilan, en tant qu’éléments du cadre de Bâle II sur les fonds propres, ainsi que des exigences spécifiques relatives aux risques de liquidité et au provisionnement dynamique, réduiront pour les banques l’incitation à prendre des risques excessifs et permettront de créer un système financier mieux préparé à résister aux chocs adverses. Nous nous félicitons des mesures essentielles récemment adoptées par l’organe de direction du Comité de Bâle pour renforcer la surveillance et la régulation du secteur bancaire.
« Nous sommes favorables à l’introduction d’un ratio d’effet de levier en tant que mesure complémentaire au cadre de Bâle II fondée sur la prise en compte des risques, avec la possibilité de le faire ensuite évoluer vers un traitement en pilier 1 sur la base d’un examen et d’une calibration appropriée. Pour assurer la comparabilité, les détails du ratio devront être internationalement harmonisés, en tenant pleinement compte des différences de normes comptables. Tous les grands centres financiers du G20 s’engagent à avoir adopté le cadre de Bâle II sur les fonds propres d’ici 2011. »
b) La réforme des normes comptables
Les organismes de normalisation comptable (IASB et FASB) sont encouragés à redoubler d’efforts pour atteindre un corpus unique de standards de comptabilité globaux, en vue de finaliser un projet de convergence en juin 2011.
Lors de son audition par la commission chargée des Affaires européennes et la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale (75), la ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, Mme Christine Lagarde, a estimé que « pour ce qui est des normes comptables, nous n’avons pas obtenu tous les résultats escomptés et du chemin reste à parcourir. Même s’il existe un objectif de convergence concernant ces normes, les États-Unis et l’Europe ne sont pas encore sur la même ligne. Je regrette que continue de prévaloir le principe de la fair market value, plutôt que celui de la valeur réelle. C’est, hélas, un accélérateur de crise puisque si leurs actifs baissent sur les marchés financiers, les banques et les entreprises sont obligées de diminuer en conséquence leur valorisation dans leur bilan comptable, indépendamment des réalités économiques, ce qui auto-alimente la crise. Nous n’avons, hélas, pas réussi à convaincre mais je continuerai de mener un combat déterminé sur ce point car il est fondamental de travailler à partir d’étalons pertinents, convergents et, en toute hypothèse, cohérents avec l’activité économique. Je ne manquerai d’ailleurs pas de rappeler au président de l’International Accounting Standards Board (IASB), que la révision de la norme IAS 39 doit s’opérer dans un sens conforme à l’intérêt général et viser à la stabilité financière ».
Signe de cet échec relatif, le communiqué final du sommet du G20 à Pittsburgh n’a consacré que quelques lignes à la réforme et à l’assouplissement des normes comptables, les chefs d’État et de gouvernement ayant ainsi déclaré : « nous invitons nos organismes en charge des normes comptables internationales à redoubler d’efforts pour élaborer un ensemble unique de normes comptables mondiales de grande qualité dans le cadre de leur processus indépendant de fixation des normes, et à achever leur projet de convergence d’ici juin 2011. Le cadre institutionnel de l’IASB doit encore améliorer la participation des différentes parties prenantes ».
Autre acquis fondateur de ce sommet du G20 de Pittsburgh : un cadre, commun à l’ensemble des vingt principales économies industrialisées et émergentes du monde, a été défini pour la rémunération des banquiers et des traders. Les engagements pris à cette occasion par les chefs d’État et de gouvernement reprennent pour une large part les orientations défendues par l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France, à l’initiative de cette dernière et du Président de la République. Le CSF est également chargé du suivi de la mise en œuvre de ces nouvelles normes et de proposer, d’ici mars 2010, d’éventuelles mesures supplémentaires.
Les régulateurs de chacun des pays du G20 ont désormais la possibilité d’examiner les rémunérations des banquiers et d’appliquer les mesures correctives le cas échéant, comme la hausse des fonds propres. Les bonus garantis au-delà d’un an sont bannis. Ils doivent être liés à la performance, payables sur plusieurs années, dont la moitié en actions.
Alors que nombre d’observateurs étaient sceptiques sur le règlement de cette question lors des négociations, les vingt chefs d’État présents, y compris le président des États-Unis, se sont engagés à encadrer les bonus, interdire les bonus garantis au-delà d’un an, différer sur trois ans le paiement de 40 % à 60 % de la rémunération variable et instaurer un système dit de « claw back » permettant d’opérer jusqu’à l’année n+3 une retenue sur les sommes versées en différé dès lors que les résultats ne sont pas à la hauteur de ceux escomptés pour calculer le montant du bonus à l’année n. La mise en place de comités des rémunérations constitue une autre avancée. Enfin, le communiqué final du sommet reprend le principe selon lequel, dans chaque État, le superviseur national peut examiner en détail la comptabilité des banques et exiger des modifications dans leur politique de rémunérations, dès lors que leurs fonds propres sont insuffisants ou peuvent menacer la stabilité du système financier. Comme l’a souligné la ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, lors de son audition précitée (76) : « La détermination à agir est réelle ».
DÉCLARATION DES DIRIGEANTS LORS DU SOMMET DU G20 DE PITTSBURGH
EXTRAIT RELATIF AUX POLITIQUES DE RÉMUNÉRATION
« Les rémunérations excessives dans le secteur financier ont à la fois reflété et favorisé une prise de risque excessive. La réforme des politiques et des pratiques de rémunération est un élément essentiel de notre volonté d’accroître la stabilité financière. Nous souscrivons entièrement aux normes de mise en œuvre du Conseil de stabilité financière visant à assujettir les rémunérations à la création de valeur à long terme, à une prise de risque qui ne soit pas excessive, notamment :
« (i) en évitant les bonus garantis sur plusieurs années ;
« (ii) en demandant qu’une partie significative des rémunérations variables soit étalée dans le temps, liée aux performances, soumise à un dispositif de malus et versée sous forme d’actions ou de titres similaires et sous la condition que cela crée des incitations alignées sur la création de valeur à long terme et l’horizon de temps du risque ;
« (iii) en veillant à ce que la rémunération des cadres dirigeants et des autres employés ayant un impact matériel sur l’exposition de l’entreprise aux risques soit alignée sur les performances et les risques ;
« (iv) en rendant les politiques et les structures de rémunérations des entreprises transparentes par le biais d’obligations de publication ;
« (v) en limitant la rémunération variable à un pourcentage des revenus nets totaux lorsque celle-ci n’est pas compatible avec le maintien d’une base de capital solide ;
« et (vi) en veillant à ce que les comités des rémunérations agissent en toute indépendance.
« Les superviseurs doivent être chargés d’examiner les politiques et les structures de rémunération des entreprises en ayant à l’esprit les risques institutionnels et systémiques et, si cela est nécessaire pour désamorcer des risques supplémentaires, d’appliquer des mesures correctives, telles que des exigences accrues en matière de fonds propres, aux entreprises qui ne mettent pas en œuvre des politiques et des pratiques de rémunération saines. Les superviseurs doivent pouvoir modifier les structures de rémunération dans le cas d’entreprises défaillantes ou qui nécessitent une intervention exceptionnelle des pouvoirs publics.
« Nous demandons aux entreprises de mettre en œuvre immédiatement ces pratiques de rémunération saines. Nous chargeons le CSF d’assurer le suivi de la mise en œuvre des normes et de proposer d’ici mars 2010 les mesures supplémentaires qui seraient nécessaires. »
d) La fin annoncée des paradis fiscaux
Autre point sur lequel le G20 de Pittsburgh est parvenu à un accord d’envergure : les paradis fiscaux. En effet, afin de poursuivre la lutte contre les juridictions non coopératives, les membres du G20 se sont dits prêts à utiliser des mesures de rétorsion contre ces dernières à partir de mars 2010. Depuis le sommet de Londres, plus de 150 accords d’échange d’information en cas de soupçon de fraude ou de dissimulation fiscale ont été signés entre des paradis fiscaux et d’autres pays. Ainsi la Suisse ne pourra-t-elle plus s’abriter derrière le secret bancaire pour refuser de fournir les informations que nous pouvons être amenés à lui demander lors d’un contrôle fiscal.
e) Les dérivés de crédits sous surveillance
Au sommet de Pittsburgh, les chefs d’État et de gouvernement ont acté le principe suivant lequel les dérivés de crédits standardisés devaient être échangés sur des plateformes électroniques et leurs ventes réalisées par des contreparties centralisées avant la fin de 2012. Les produits dérivés non standardisés seront, pour leur part, soumis à des exigences supérieures de capital. Le Conseil de stabilité financière devra, à ce titre, veiller à l’amélioration de la transparence sur ce marché.
DÉCLARATION DES DIRIGEANTS LORS DU SOMMET DU G20 DE PITTSBURGH
EXTRAIT RELATIF AUX PRODUITS DÉRIVÉS DE GRÉ À GRÉ
« Tous les contrats de produits dérivés de gré à gré normalisés devront être échangés sur des plates-formes d’échanges ou via des plates-formes de négociation électronique et compensés par des contreparties centrales d’ici la fin 2012 au plus tard. Les contrats de produits dérivés de gré à gré doivent faire l’objet d’une notification aux organismes appropriés (« trade depositories »).
« Les contrats n’ayant pas fait l’objet de compensation centrale devront être soumis à des exigences en capital plus élevées. Nous demandons au CSF et à ses membres d’évaluer régulièrement la mise en œuvre de ces mesures et déterminer si elles sont suffisantes pour améliorer la transparence sur les marchés de produits dérivés, atténuer les risques systémiques et assurer une protection contre les abus des marchés. »
3. Les questions restant en suspens après Londres et Pittsburgh
Si, en avril 2009 à Londres, les membres du G20, dans leur communiqué final, se sont félicités des mesures prises pour renforcer la régulation et la supervision des « hedges funds », à Pittsburgh, aucune décision concrète n’a été prise en matière d’harmonisation des règles qui régissent ces fonds spéculatifs.
Parmi les défis qui demeurent après Pittsburgh, outre celui du contrôle des « hedges funds » ainsi que celui de la révision des normes comptables, il y a le défi de la déclinaison et de la mise en œuvre dans chacun des pays des principes adoptés. Comme Mme Christine Lagarde, ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi l’a rappelé, lors de son audition précitée (77), la « crainte est aujourd’hui que dans les mois à venir, surtout si la reprise se confirme – ce que nous espérons tous – , nous n’assistions à un emballement et une spéculation sur les marchés (…) alors que nous ne disposons pas encore des outils de régulation nécessaires, notamment pour les produits financiers dérivés ». Il est donc plus que jamais urgent et indispensable de doter la finance d’un cadre de régulation et de supervision homogène et pleinement opérationnel.
II. REDÉFINIR LES CONTOURS D’UNE FINANCE MONDIALE RÉGULÉE ET MAÎTRISÉE AU SERVICE DE L’ÉCONOMIE
Si la crise suscite de vives critiques à l’encontre de la finance, il convient cependant de partir du constat selon lequel cette dernière demeure utile à la société et donc que l’opposition entre l’économie réelle et l’économie financière est artificielle. Non seulement la finance est nécessaire au bon fonctionnement de l’économie, mais l’innovation financière est indispensable à la croissance économique.
Si, à l’aune des conséquences désastreuses de la crise (montée du chômage, récession…), nous mesurons aujourd’hui à quel point le maintien du statu quo en matière de régulation bancaire et financière est impossible, l’écueil majeur serait de faire succéder au choc de la crise financière un choc réglementaire qui risquerait de pénaliser durablement l’activité économique. Le défi aujourd’hui lancé par la crise aux principales économies développées et émergentes est donc bien de mieux réguler.
Afin de tirer toutes les conséquences de la crise bancaire et financière en matière de régulation, sans pour autant enserrer la finance dans un « étau » qui compromettrait durablement le bon fonctionnement de l’économie, votre rapporteur estime que cinq orientations décisives doivent être poursuivies avec conviction et détermination : réguler le contournement des règles prudentielles et la transmission des risques ; atténuer la procyclicité des normes et mieux prévenir le risque systémique ; rééquilibrer les incitations individuelles aux profits de long terme et responsabiliser les opérateurs de marché ; améliorer la transparence des marchés et de l’information financière ; redéfinir l’organisation de la supervision financière en France et en Europe.
A. RÉGULER LE CONTOURNEMENT DES RÈGLES PRUDENTIELLES ET LA TRANSMISSION DES RISQUES
La nécessité pour les banques de respecter les ratios de fonds propres imposés par la régulation et de dégager des ratios élevés de rentabilité les a poussées à titriser les crédits qu’elles accordaient aux entreprises ou aux ménages.
1. Le contournement des règles prudentielles par la titrisation
Or, comme votre rapporteur l’a déjà souligné, la titrisation présente l’inconvénient de déresponsabiliser les banques. En effet, la titrisation permettait aux établissements bancaires de contourner les règles prudentielles, dans la mesure où les crédits titrisés apparaissent dans le « hors bilan » des banques. Les exigences prudentielles, qui initialement visent à créer un mécanisme stabilisateur de l’expansion du crédit, ne s’appliquent pas aux crédits sortis du bilan des banques. Au final, les banques ne sont pas obligées de constituer des fonds propres en fonction des prêts réellement accordés. En outre, en titrisant leurs crédits, les établissements bancaires et financiers transfèrent à d’autres le risque qu’ils ont pris. Or, dès lors qu’un actif est rapidement transféré, la banque qui accorde un prêt n’examine plus le risque dont le créancier est potentiellement porteur.
C’est pourquoi, votre rapporteur estime qu’il est à l’avenir indispensable de mieux maîtriser le levier de l’endettement au sein du système bancaire lui-même en exerçant pour ce faire un contrôle plus vigilant et plus exhaustif sur l’accroissement du volume de crédits. Il convient donc de repenser le lien qui existe entre fonds propres réglementaires et titrisation, en envisageant que les besoins en fonds propres des banques soient liés et étroitement corrélés à leurs actifs même titrisés. Sans imposer le même ratio de capital à un crédit qu’il soit destiné à être porté au bilan, qu’il soit destiné à être vendu ou que son risque soit vendu, les établissements de crédit doivent mieux assumer les risques des produits structurés dont ils sont à l’origine (en tant qu’initiateurs ou « sponsors »), et conserver à l’actif de leur bilan une part des créances sous-jacentes.
2. Mieux contrôler les activités de titrisation
Des initiatives ont, d’ores et déjà, été prises en la matière. La Commission européenne a ainsi proposé, le 1er octobre 2008, des amendements (78) à la directive « fonds propres » du 14 juin 2006 afin de prévoir, entre autres mesures, que les banques européennes devront désormais conserver dans leur bilan au moins 5 % des crédits qu’elles titrisent.
Lors de son audition (79), M. Jérôme Cazes, directeur général de Coface, a indiqué que ce niveau de 5 % était utile, même s’il risque de s’avérer insuffisant pour changer les comportements des banques. En effet, si les crédits titrisés sont très rémunérateurs, les 5 % seront très vite absorbés par les importantes marges bénéficiaires. Parce que cette règle de 5 % risque de s’avérer insuffisante pour des prêts offrant des marges très importantes, votre rapporteur propose que ce taux minimal de « rétention » des actifs titrisés dans les bilans des banques soit relevé à 10 % au niveau européen.
Proposition n° 4 :
Au niveau européen, exiger des banques qu’elles conservent dans leurs bilans, non plus seulement 5 %, mais 10 % des crédits qu’elles titrisent.
B. ATTÉNUER LA PROCYCLICITÉ DES NORMES ET MIEUX PRÉVENIR LE RISQUE SYSTÉMIQUE
1. L’assouplissement et la convergence des normes comptables
La crise financière a clairement mis en lumière les imperfections de la « juste valeur » (80), ravivant ainsi un large débat sur la pertinence et les modalités de recours à cette règle. En effet, une des principales conséquences de la généralisation de la comptabilité en juste valeur est que tout choc de liquidité se répercute très rapidement sur les fonds propres des banques. Or, comme l’a souligné M. Christian Noyer, Gouverneur de la Banque de France, le 11 décembre 2008, lors des rencontres européennes de la profession comptable, « il va sans dire que la plus grande sensibilité des bilans aux fluctuations de marché qu’induit une comptabilité en juste valeur n’est évidemment pas sans incidence pour la stabilité financière ».
a) Assouplir le contenu des normes comptables
C’est pourquoi, au nombre des défis lancés par la crise en matière de régulation, l’assouplissement des règles comptables – en particulier de la « juste valeur » – figure en bonne place. Le point essentiel de la réforme, qui cristallise aujourd’hui toutes les préoccupations, concerne la norme IAS 39 relative à la valorisation et à la comptabilisation des instruments financiers.
L’IASB, organisme privé chargé d’élaborer les normes comptables internationales (81), est engagée depuis quelques mois dans un processus de consultation sur la réforme, en trois phases, de la norme IAS 39, censée aboutir d’ici 2010 et pour une application escomptée en 2012.
LA RÉVISION DE LA NORME IAS 39 PAR L’IASB
Après avoir introduit en urgence, le 13 octobre 2008, des mesures ponctuelles d’assouplissement de la juste valeur, l’IASB a lancé une vaste révision d’ici 2010 de la norme IAS 39 et, en particulier, des critères d’utilisation de la valeur de marché. Cette réforme est structurée en trois phases :
— la classification et la mesure des instruments financiers, qui a fait l’objet d’un « exposé-sondage » (consultation publique) le 14 juillet 2009. L’IASB propose de simplifier le dispositif en ne retenant plus que deux catégories, soit la juste valeur et le coût amorti, au lieu des cinq niveaux de valorisation actuels. Les options pour l’une ou l’autre seraient, en revanche, asymétriques : il serait possible de choisir la juste valeur pour des instruments financiers éligibles au coût amorti, mais un reclassement inverse ne serait pas admis ;
— la méthodologie de dépréciation (« impairment methodology ») des actifs financiers comptabilisés au coût amorti (prêts en particulier), selon une logique plus cohérente avec les normes prudentielles. Un document a été publié le 25 juin 2009 sur la faisabilité de l’approche des « pertes attendues » (« expected losses »), en tant qu’alternative à la méthode des « pertes encourues » (« incurred losses »). Une telle évolution permettrait de provisionner au plus tôt les pertes futures, en fonction de l’évaluation continue de leur probabilité de survenance, et non lorsque se produit un événement susceptible d’exercer un impact négatif sur les flux futurs de trésorerie. Cette méthodologie de dépréciation des actifs financiers a fait l’objet d’un exposé-sondage en novembre 2009 ;
— enfin la comptabilité de couverture, qui devait donner lieu à un exposé-sondage en décembre 2009.
Source : Rapport d’information (n° 59, session ordinaire de 2009-2010) de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des Finances du Sénat, sur la crise financière et la régulation des marchés, p. 56.
Cette refonte des règles de valorisation et de comptabilisation des instruments financiers et, plus généralement, la réforme de la comptabilité en juste valeur « revêt la plus haute importance car elle détermine, pour une large part, la stabilité du système financier et traduit la volonté ou l’inertie des régulateurs quant à la mise en place d’un cadre harmonisé au niveau mondial » (82).
Or, alors qu’elle a cristallisé tous les débats européens ainsi que les discussions au G20, la réforme de l’IAS 39, destinée à faire disparaître les risques de procyclicité apparus depuis le début de la crise financière, n’est pas encore achevée, nombre d’observateurs se montrant inquiets sur l’issue de réforme. Ainsi, M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des Finances du Sénat, a estimé, pour sa part, que « le projet de nouvelle classification comptable des instruments financiers, tel qu’il a été publié par l’IASB en juillet 2009, n’incite pas à l’optimisme, malgré une intention louable de simplification, car il contribuerait à élargir le champ des instruments comptabilisés à la valeur de marché. Il semble donc que perdure un certain dogmatisme de la juste valeur, qui n’est pas plus souhaitable que celui du coût historique » (83).
Lors de son audition par la mission (84), Mme Christine Lagarde, ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi avait estimé que, s’agissant du retard pris par l’IASB en matière d’assouplissement des normes prudentielles et comptables, il était impératif de ne pas perdre de temps. Alors que le FASB a mis entre parenthèses pour le livre bancaire l’application de la fair value (norme IAS 39) quatre jours seulement après que le Sénat américain le lui a demandé, l’IASB mène depuis des mois un travail de concertation et de consultations. Aussi louable soit-il, ce travail de fond ne répond pas à l’urgence de la situation.
C’est pourquoi, joignant sa voix à celle de M. Philippe Marini ainsi qu’à celle de Mme Christine Lagarde, ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, votre rapporteur estime que l’ensemble des États européens, de concert avec la Commission européenne, doivent maintenir une pression politique forte sur l’IASB, afin de parvenir d’ici 2010 à une réforme pragmatique de la juste valeur, offrant une valorisation des instruments financiers plus réaliste et qui serait fonction de l’horizon de détention et du niveau de liquidité.
Proposition n° 5 :
Inviter l’ensemble des États européens, de concert avec la Commission européenne, à maintenir une pression politique forte sur l’IASB, afin de parvenir d’ici 2010 à une réforme pragmatique de la juste valeur, reposant sur une valorisation des instruments financiers plus réaliste et fonction de l’horizon de détention et du niveau de liquidité.
b) Parvenir à une convergence rapide des normes comptables internationales et américaines
Comme votre rapporteur l’a déjà indiqué, le G20 a posé le principe d’une convergence, d’ici juin 2011, des normes comptables internationales et a demandé, aux deux grands normalisateurs comptables international (IASB) et américain (FASB) de parvenir à un ensemble de normes comptables communes et de qualité pour la comptabilisation des instruments financiers : la définition de ce référentiel commun doit notamment être l’occasion de simplifier les règles existantes.
Or, comme l’a très justement noté M. Philippe Marini, « les initiatives distinctes de l’IASB et de son homologue américain, le FASB, accentuent également le risque de distorsions de concurrence, d’une nouvelle compétition normative et d’un éloignement de la perspective d’une harmonisation au niveau mondial » (85). Votre rapporteur juge qu’il est donc impératif de poursuivre la convergence entre le FASB et l’IASB vers de vraies normes internationales qui, directement ou par équivalence, s’appliqueraient partout. Cette convergence est d’autant plus nécessaire que les États-Unis font preuve d’une certaine réticence : la SEC, après avoir pris des engagements sur l’équivalence des normes à échéance 2011, est revenue en arrière cet automne et se montre beaucoup moins engageante.
Un objectif politique de la France, dont les grandes entreprises, très internationalisées dans leurs activités et dans leur capital, ont besoin des financements aux États-Unis, doit plus que jamais être de maintenir la pression sur la Commission européenne et sur l’IASB pour avancer vers la convergence dans les délais initialement prévus. Là aussi, la volonté et la détermination politique de notre pays devront continuer à inciter un organisme comme l’IASB à parvenir à une vraie convergence.
Proposition n° 6 :
Maintenir une pression politique forte de la France sur la Commission européenne et l’IASB afin de parvenir, d’ici juin 2011, à une convergence des normes comptables internationales.
c) Améliorer la gouvernance de l’IASB
Indépendamment de ces enjeux techniques, une polémique, de nature plus « politique », concerne actuellement la légitimité de l’IASB, dans sa gouvernance actuelle, à émettre des normes susceptibles d’avoir des effets systémiques. « Le processus d’adoption des normes comptables et la gouvernance de l’IASB illustrent l’emprise des organes techniques privés et de la culture économique anglo-saxonne sur un aspect fondamental de la vie des entreprises, sans droit de regard des responsables politiques ni des parlements nationaux » (86).
Lors de son audition (87) par votre rapporteur, M. Christian de Boissieu, président délégué du Conseil d’analyse économique, a souligné que la normalisation comptable était une chose trop importante pour la laisser dans les seules mains de spécialistes. Or, les régulateurs bancaires n’ont, à ce jour, qu’un rôle d’observateurs à l’IASB. Autre point faible de l’IASB : il n’existe pas de procédure officielle demandant à l’IASB de justifier ses décisions.
Au début de l’année 2009, la gouvernance de l’IASB a toutefois connu quelques évolutions institutionnelles, qui se sont traduites notamment par la création d’un comité de surveillance (« monitoring group »), chargé de mieux superviser les travaux de l’IASB. Or, ce comité n’est, pour l’heure, guère doté de réels pouvoirs. « Il s’agit donc pour l’instant plutôt d’un alibi » (88).
Parce que les normes comptables ont aujourd’hui des implications politiques et systémiques concrètes, ces dernières doivent être prises en compte et reflétées dans la composition des organes dirigeants de l’IASB. Parmi les réformes qui peuvent être envisagées, il faudrait a minima que les régulateurs bancaires aient rapidement un statut de membre à part entière. Au-delà, il serait également souhaitable d’établir un lien de responsabilité plus fort entre l’IASB et ses principaux mandants – Commission européenne et G20 – comme il en existe un aux États-Unis pour le FASB envers la SEC.
Cependant, si, depuis le début de la crise financière, l’Europe a été le « fer de lance » de la réforme de la gouvernance de l’IASB, elle ne pourra faire triompher seule ses vues en la matière : il lui faudra, pour ce faire, nouer de solides alliances avec d’autres zones importantes qui appliquent elles aussi les normes IFRS.
Proposition n° 7 :
Améliorer la gouvernance de l’IASB, afin que son cadre institutionnel assure le prise en compte et le reflet de l’ensemble des parties prenantes (responsables politiques, régulateurs bancaires, etc.).
2. L’amélioration et le renforcement des normes prudentielles
Comme votre rapporteur l’a déjà souligné, la crise financière a révélé les insuffisances des normes prudentielles et comptables censées, en théorie, limiter, entre autres, le risque systémique et qui, dans les faits, l’ont accentué. C’est pourquoi l’amélioration et le renforcement des normes prudentielles sont aujourd’hui au cœur de la régulation bancaire. Trois actions doivent être menées avec détermination en la matière : atténuer la procyclicité de Bâle II, renforcer les exigences de fonds propres et préserver, dans ce vaste mouvement de régulation, la spécificité de nos banques coopératives et mutualistes.
a) Atténuer la procyclicité de Bâle II : le provisionnement dynamique
Les critiques portant sur la procyclicité des normes prudentielles et des règles de Bâle II rendent aujourd’hui nécessaire de passer au plus vite à un dispositif de provisionnement dynamique. Le paragraphe 13 du communiqué final du G20 de Pittsburgh s’inscrit d’ailleurs pleinement dans cette démarche, puisqu’il pose clairement le principe du passage à un provisionnement dynamique.
Ayant un effet contracyclique, le provisionnement dynamique obligera les banques à renforcer leurs exigences de fonds propres en périodes fastes afin de leur permettre d’affronter les crises de liquidité mieux capitalisées. En imposant aux banques de disposer à l’avance de fonds propres supplémentaires liés à la détention d’actifs risqués, les banques ne manquent alors pas de capitaux au moment où l’économie et les prix d’actifs se retournent à la baisse. Parce qu’elles ne seront pas obligées de provisionner des fonds en bas de cycle, les banques n’accentueront pas l’ampleur de la récession.
Lors de son audition (89) par votre rapporteur, M. Christian de Boissieu a souligné l’intérêt d’un tel système, en s’appuyant notamment sur l’exemple de l’Espagne, dont les banques pratiquent le provisionnement dynamique depuis de nombreuses années : alors que l’économie espagnole doit aujourd’hui faire face à une grave et profonde récession, les banques ibériques, quant à elles, se portent bien.
Or, pour être efficace, ce provisionnement dynamique doit être pris en compte par l’administration fiscale : lorsqu’elles provisionnent, en haut de cycle, les crises futures, l’administration fiscale doit reconnaître la déductibilité de ces provisions, si elle n’entend pas pénaliser sévèrement l’industrie bancaire française et, partant, le financement de l’économie. En outre, afin d’éviter toute distorsion de concurrence en Europe, la mise en œuvre du provisionnement dynamique doit passer par l’adoption d’une directive communautaire, seule capable d’assurer une application homogène de ces nouvelles règles dans l’ensemble de l’Union.
Proposition n° 8 :
Systématiser et harmoniser au niveau de l’Union européenne la démarche de provisionnement dynamique, consistant pour les banques à mettre de côté en haut de cycle le capital qui leur sera nécessaire en bas de cycle pour respecter les ratios.
b) Renforcer les exigences de fonds propres…
L’hypertrophie de certains risques de crédit et de marché, mise en lumière par la crise financière, a rendu nécessaire une révision précoce des exigences de fonds propres et, en particulier, du dispositif de « Bâle II », qui n’était applicable en Europe que depuis le 1er janvier 2007 et dont l’entrée en vigueur aux États-Unis avait été reportée au 1er janvier 2009 pour les principales banques, avant d’être mise entre parenthèses par la crise.
Fortes de ce constat, les organisations prudentielles, que sont le Comité de Bâle et le Comité européen des superviseurs bancaires (CEBS), se sont engagés dans une vaste réflexion sur la modernisation des normes prudentielles et un renforcement des exigences de fonds propres, afin d’améliorer la résistance aux chocs et de réduire les incitations des banques à prendre des risques excessifs. Le ratio global de solvabilité, qui fixe les fonds propres à 8 % minimum de la somme des actifs pondérés par les risques (risques de crédit, de marché et opérationnel), demeure inchangé mais les travaux en cours se concentrent sur :
— l’amélioration de la qualité et de la solidité des fonds propres « de base » (ratio dit « Tier One ») ;
— l’introduction de nouveaux instruments de mesure des risques bancaires (effet de levier et couverture de la liquidité) ;
— de nouvelles exigences en capital pour mieux appréhender les activités les plus risquées (la négociation pour compte propre – dont le coût en capital pourrait tripler – et la titrisation en particulier), la nécessité d’une nouvelle dimension contracyclique et la prévention du risque systémique.
Cette approche du Comité de Bâle a été validée lors du sommet du G20 de septembre 2009. Les dirigeants ont toutefois mis l’accent sur le calendrier d’élaboration et d’application des nouvelles normes, respectivement d’ici fin 2010 et fin 2012, ainsi que sur la mise en œuvre des futures normes par tous les membres du G20, donc y compris les États-Unis.
Cependant, il ressort des auditions et déplacements menés par votre rapporteur que ces mesures auraient vocation à s’appliquer à court terme – soit sous deux à trois ans – à l’ensemble des établissements bancaires. Or elles pourraient conduire à des besoins supplémentaires extrêmement importants de fonds propres et entraver la capacité des banques de financer l’économie à un moment où le crédit doit venir consolider la reprise qui s’amorce. Ce risque sera d’autant plus élevé que la contribution du secteur bancaire au financement de l’économie est relativement importante en France, ce qui est tout particulièrement le cas des banques mutualistes (cf. infra).
Si votre rapporteur fait siens les objectifs de stabilité financière et de renforcement de la solidité des établissements bancaires, notamment rappelés lors du dernier sommet du G20 à Pittsburgh, il juge, en revanche, plus que jamais nécessaire que chacune des mesures destinées à renforcer les exigences de fonds propres dans le cadre des travaux du Comité de Bâle et du CEBS fasse l’objet, après une évaluation précise de leur impact, d’une application progressive et étalée dans le temps, afin d’éviter de grever lourdement, à court terme, le financement de l’économie, sous l’effet de ce que l’on pourrait appeler un « choc réglementaire ».
Proposition n° 9 :
Dans le cadre des travaux du Comité de Bâle et du Comité européen des superviseurs bancaires, prévoir que toutes les mesures envisagées afin de renforcer les exigences de fonds propres des banques fassent l’objet, d’une part, d’une étude d’impact exhaustive et, d’autre part, d’une application progressive et étalée dans le temps, afin de ne pas menacer durablement le financement de l’économie et de la croissance, sous l’effet d’un « choc réglementaire ».
c) … tout en tenant compte de la spécificité des banques coopératives et mutualistes, acteurs majeurs du financement de l’économie
Parce que les banques coopératives et mutualistes occupent une place singulière dans le paysage bancaire français et qu’elles contribuent de manière irremplaçable au financement de nos territoires, votre rapporteur estime que la refonte de la surveillance prudentielle des établissements financiers doit tenir compte de leurs spécificités.
Or, il ressort de l’ensemble des travaux conduits par la mission depuis sa création en décembre 2008 qu’une application relativement indifférenciée à l’ensemble des établissements de crédit des nouvelles mesures destinées à renforcer les exigences de fonds propres pourrait menacer l’activité bancaire sous forme coopérative et mutualiste, particulièrement présente en France.
En effet, comme votre rapporteur l’a déjà mentionné, la crise financière a contraint les régulateurs financiers internationaux, que sont le Comité de Bâle et le Comité européen des superviseurs bancaires (CEBS), à engager un vaste chantier de redéfinition des fonds propres de base. L’objectif est de parvenir, à terme, à la définition de nouveaux critères, normés internationalement, d’éligibilité des instruments de fonds propres au « capital dur » dit « Core Tier One » des banques et ce, afin d’exclure, entre autres, les titres trop exotiques ou complexes de cette catégorie de fonds propres. Dans cette perspective, le Comité de Bâle et le CEBS ont publié, le 17 décembre 2009, deux documents sur la définition des instruments de capital « Core Tier One ». C’est sur la base de ces propositions que sont organisées des consultations publiques jusqu’au 31 mars 2010 pour le CEBS et jusqu’au 16 avril 2010 pour le Comité de Bâle.
Sans préjuger de l’issue de ces consultations, votre rapporteur souhaite attirer, dès aujourd’hui, l’attention toute particulière qui doit être portée à la nécessaire prise en compte de l’activité bancaire dans sa forme coopérative et mutualiste. En effet, d’aucuns craignent que la nouvelle définition des fonds propres durs des banques conduise à ne plus classer, à l’avenir, les titres de capital des banques coopératives et mutualistes, que sont les parts sociales et les certificats coopératifs (90), en capital « Core Tier One ».
Or, les quatorze critères d’éligibilité des instruments de fonds propres au « capital dur » dit « Core Tier One », tels qu’ils sont actuellement définis et proposés par le Comité de Bâle, confirment en partie ces inquiétudes. En effet, il est précisé que les actions ordinaires doivent constituer le noyau dur des fonds propres de base. Seule une note de bas de page (91) ouvre la possibilité aux superviseurs nationaux de prendre en compte les instruments de capital des banques coopératives et mutualistes en tant que fonds propres de base. Une telle approche, qui consisterait à remettre en cause le caractère de fonds propres aux parts sociales des banques coopératives et mutualistes, pourrait entraîner la disparition de près de quarante milliards d’euros de fonds propres bancaires en Europe, avec des conséquences considérables pour le financement des économies, qui se verraient privées sans justification d’environ 500 milliards d’euros de crédits.
La France est concernée au premier chef par cette question, puisque ce sont plus de vingt milliards d’euros de capital qui pourraient être déclassés. Une telle évolution déstabiliserait fortement le système bancaire français au sein duquel les établissements de crédit à statut coopératif occupent une place majeure et à laquelle votre rapporteur est particulièrement attaché. En effet, les banques coopératives y représentent près des deux tiers de l’activité de détail et comptent, au total, plus de 17 millions de sociétaires et plus de 65 millions de clients. Le groupe Banques Populaires-Caisses d’épargne (BPCE) assure ainsi à lui seul 20 à 25 % du financement de l’économie française. Le Crédit agricole est la première banque de détail en France tant par la taille de son réseau que le nombre de ses clients, alors que le Crédit mutuel est le banquier d’un professionnel sur trois et de la moitié des cent premières entreprises françaises.
En outre, le document soumis par le Comité de Bâle à la consultation, le 17 décembre 2009, prévoit un régime de déduction des participations minoritaires particulièrement défavorable aux banques coopératives et mutualistes. En effet, il semblerait effet que l’on s’oriente, en l’état actuel, vers une déduction intégrale des participations minoritaires (92) des fonds propres de base dits « Core Tier One ». Une telle perspective ne peut que menacer le modèle décentralisé des banques mutualistes et coopératives. En effet, la structure de ces groupes bancaires repose sur des participations croisées des banques régionales dans l’organe central et inversement. Ces participations garantissent à la fois l’unité du groupe et son organisation décentralisée, indispensable au maintien des centres de décision au plus près des territoires.
Or, ces participations croisées sont assimilées à des participations minoritaires de droit commun sans que ne soit reconnue leur spécificité. Ainsi, l’obligation de déduction intégrale de ces participations minoritaires des fonds propres de base dits « Core Tier One » aurait pour effet de déclasser des fonds propres, qui ne pourront alors contribuer au financement de la croissance économique. De surcroît, les objectifs prudentiels poursuivis sont garantis par d’autres mécanismes propres aux groupes coopératifs : une surveillance au niveau consolidé et des mécanismes de solidarité financière croisés entre l’organe central et les banques régionales. C’est pourquoi, votre rapporteur juge qu’il est impératif de tenir compte de ces spécificités et, par conséquent, de permettre aux entités d’un même groupe coopératif et mutualiste de ne pas déduire les participations croisées de leurs fonds propres.
La prise en compte des spécificités des banques coopératives et mutualistes est d’autant plus nécessaire qu’en France, le respect des règles bancaires et coopératives leur a permis de proposer, même en période de crise, un modèle de banque stable et sécurisé garantissant la protection de l’épargne et une menant une politique de distribution du crédit. Comme l’a souligné M. Étienne Pfimlin, président du Crédit mutuel, dans un courrier en date du 11 décembre 2009 adressé à votre rapporteur, « des capitaux élevés comme ceux des banques coopératives françaises renforcent la solidité d’un établissement, contribuent à rassurer les sociétaires ainsi que les clients et participent ainsi pleinement au développement de l’économie. Un excès unilatéral de charges dans les exigences de fonds propres ferait durablement obstacle à la croissance des économies à l’heure où tous les acteurs doivent mobiliser leurs efforts pour maîtriser les risques tout en renforçant les capacités de crédit ».
En effet, les banques coopératives et mutualistes ont joué un rôle stabilisateur majeur dans la crise et ce, pour plusieurs raisons. En premier lieu, l’indisponibilité des réserves et la rémunération modérée du capital permettent de consacrer une large part des résultats à la constitution de fonds propres. En deuxième lieu, la structure décentralisée des banques coopératives et mutualistes assure une répartition adaptée des risques ainsi qu’une responsabilisation accrue des gestionnaires. En troisième et dernier lieu, les mécanismes de garanties croisées au sein des groupes bancaires coopératifs contribuent largement à leur sécurité financière. Parce qu’ils disposent de mécanismes stabilisateurs importants, les modèles mutualistes et décentralisés méritent de la part des régulateurs européens et internationaux une reconnaissance pleine et entière.
De surcroît, la qualité du capital des banques coopératives et mutualistes a déjà été soulignée au début de l’année 2008 par le Comité européen des superviseurs bancaires, qui a ainsi affirmé que « du point de vue prudentiel, il n’y a aucune raison de mettre en question le traitement actuel des parts sociales coopératives comme des fonds propres réglementaires. Au sein du CEBS, il existe un accord général pour dire que les parts sociales des banques coopératives constituent du capital Core Tier One » (93). Le Parlement européen a également pris position pour « que soit reprise dans l’IAS 32 une définition des fonds propres permettant à toutes les formes de sociétés, notamment les coopératives et les sociétés de personnes, de déclarer comme fonds propres au bilan les capitaux apportés par les membres et à adopter pour la comptabilité de couverture une solution fondée sur les pratiques de gestion des risques des organisations bancaires » (94). Il y a peu, le 7 septembre 2009, le Comité de Bâle a annoncé qu’il veillerait à ce que les sociétés non-actionnariales ne soient pas affectées par les nouveaux principes de définition des fonds propres.
S’il est possible d’être raisonnablement optimiste sur l’issue des travaux conduits par le Comité de Bâle sur l’éligibilité au « Core Tier One » des parts sociales, émises par les banques coopératives et mutualistes, votre rapporteur estime qu’il faut maintenir une pression politique forte afin que soient pleinement prises en compte les spécificités du modèle coopératif auquel plusieurs millions de Français sont attachés. En effet, le processus de mise en place de la nouvelle réglementation n’en est qu’à ses débuts. À cet égard, une solution qui renverrait le traitement des parts sociales à la discrétion des régulateurs nationaux, à partir d’une note de bas de page, ne semble pas pertinente car elle ferait peser une menace permanente sur les établissements coopératifs et mutualistes. Il est donc important que les spécificités des établissements coopératifs soient clairement reconnues dans un texte applicable de la même manière à toutes les banques européennes. En effet, la diversité des modèles bancaires joue un rôle fondamental en Europe pour garantir une offre d’épargne et de crédits diversifiée ainsi que l’accès du plus grand nombre aux services bancaires et à l’innovation financière. C’est un élément fondamental de saine concurrence au sein du marché unique qu’il convient donc aujourd’hui de défendre.
Proposition n° 10 :
Maintenir une pression politique forte sur le Comité de Bâle afin que :
— d’une part, la nouvelle définition des fonds propres durs (« Core Tier One ») des banques continue de prendre en compte les spécificités des banques coopératives et mutualistes et incorporent, à ce titre, les parts sociales émises par ces établissements, sans que le règlement de cette question soit laissé à la discrétion des régulateurs nationaux ;
— d’autre part, la spécificité des participations croisées entre les entités d’un même groupe bancaire coopératif soit pleinement reconnue, en les autorisant notamment à ne pas déduire ces participations de leurs fonds propres durs (« Core Tier One »).
3. Une meilleure prévention du risque systémique
Soulignant avec acuité l’importance des interactions existant entre produits, acteurs et marchés, la crise a rappelé avec vigueur la nécessité de compléter la réglementation actuelle par un suivi macroprudentiel destiné à gérer les conséquences macroéconomiques des comportements individuels et, à ce titre, déterminant pour la stabilité financière.
a) Une réforme déjà bien engagée tant au niveau international qu’européen
Ayant suscité une attention soutenue des gouvernements et des régulateurs au plus fort de crise, le risque systémique a fait l’objet de nombreux groupes de travail et travaux académiques depuis 2008, une première étape ayant consisté à identifier ou créer des structures investies du mandat et des moyens de surveiller le risque systémique.
Au niveau international, cette surveillance du risque systémique est désormais exercée par le nouveau Conseil de stabilité financière (CSF), qui a succédé le 2 avril 2009 au Forum de stabilité financière et, au plan prudentiel, par le Comité de Bâle dans le cadre de la réforme des normes de solvabilité. Le mandat que les membres du G20 ont confié au Conseil prévoit, entre autres, une coopération étroite avec le FMI dans le cadre d’un processus d’ « alerte rapide », un suivi des meilleures pratiques, l’établissement de lignes directrices pour les collèges de superviseurs et la mise en œuvre d’un cadre d’action pour les crises transfrontalières, en particulier celles impliquant des établissements de taille systémique.
Au niveau européen, le groupe de travail de haut niveau sur la supervision financière, présidé par M. Jacques de Larosière, a remis un rapport le 25 février 2009, dont les conclusions ont été rapidement adoptées par le Conseil et la Commission européenne et servent de référence pour la mise en place d’un nouveau cadre institutionnel. La Commission a ainsi présenté, le 23 septembre 2009, cinq propositions de textes législatifs tendant notamment à la création d’un Conseil européen du risque systémique et de trois nouvelles autorités européennes de surveillance micro-prudentielle (cf. infra).
LE CONSEIL EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE (CERS)
Le premier volet de la réforme de la surveillance macro-prudentielle au sein de l’Union européenne est constitué par la mise en place d’un Comité européen du risque systémique (CERS), complétée par une proposition de décision confiant à la BCE des missions spécifiques relatives au fonctionnement du CERS. Ce comité ne dispose pas de la personnalité juridique ni d’aucun pouvoir contraignant sur les États membres, et est conçu comme un organisme d’influence et de « réputation », institutionnellement proche de la BCE. L’organisation interne du CERS comprend :
— un conseil général, organe décisionnel de 61 membres (95), dont 28 ne disposent pas du droit de vote. Avec 29 représentants sur 33, les banques centrales sont largement majoritaires au sein des membres disposant du droit de vote. Les décisions du conseil général sont prises à la majorité simple et son président est élu pour cinq ans parmi les membres du Conseil général de la BCE ;
— un comité directeur (« steering committee ») de douze membres (dont cinq gouverneurs de la BCE (96)), sous-ensemble du conseil général qui prépare ses réunions et surveille la progression des travaux du CERS ;
— un secrétariat, assuré par les services de la BCE et un comité consultatif de 61 membres.
Les deux grandes attributions du CERS sont :
— collecter, échanger et analyser des informations sur les risques systémiques, ce qui implique un large accès aux données de la BCE, des futures Autorités européennes de surveillance (AES), et le cas échéant des autorités de surveillance et banques centrales nationales. Sur demande motivée auprès des AES, qui constitue l’exception, le secrétariat du CERS aura accès à des données individuelles sur des établissements de nature systémique ;
— émettre des alertes et des recommandations générales ou spécifiques sur les mesures correctives à prendre, adressées à l’ensemble de la Communauté ou à un ou plusieurs États membres, ou à une ou plusieurs autorités nationales ou européennes de surveillance. Elles ne peuvent être ignorées dans la mesure où le destinataire doit appliquer le principe « se conformer ou expliquer ». Toutes les alertes et recommandations sont transmises au Conseil européen (97), et le CERS décide au cas par cas de leur publicité, une majorité des deux tiers du conseil général étant requise.
Source : Rapport d’information (n° 59, session ordinaire de 2009-2010) de M. Philippe Marini, op. cit., p.93.
b) Réduire l’aléa moral qui entoure la faillite d’un établissement d’importance systémique par la mise en place de « testaments »
Clairement affirmée par les chefs d’État et de gouvernement lors du G20 de Pittsburgh, la surveillance du risque systémique ne saurait se concevoir sans le traitement a priori – par la mise en place de « testaments » – des crises et faillites susceptibles d’affecter des établissements financiers d’importance systémique.
En effet, si les gouvernements et les régulateurs entendent mieux traiter les crises financières lorsqu’elles surviennent, ils ont, pour ce faire, le devoir d’anticiper leur éventualité. Or, comme le souligne M. Philippe Marini, « la complexité du traitement de la faillite de Lehman Brothers, banque aux multiples ramifications dont une multitude de créanciers se retrouve bloqués alors que les principaux ont été en partie remboursés dans les mois qui ont suivi la défaillance, illustre cependant la nécessité de prévoir des procédures de traitement ordonné des faillites d’établissements financiers systémiques et disposant d’un grand nombre de filiales » (98). Or, sous l’effet de la crise, la concentration du secteur bancaire s’est accrue, renforçant d’autant la taille des grands groupes présents sur le marché. Il est donc fort à craindre que ce mouvement de restructuration du secteur se soit accompagné, en parallèle, d’une concentration du risque systémique au sein de quelques établissements de grande taille.
C’est pourquoi, votre rapporteur souhaite apporter son soutien à la démarche, initiée aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni puis consacrée par le sommet de Pittsburgh, de mise en place de « testaments » pour les institutions financières d’importance systémique. Ces plans anticipés de crise (d’où l’expression anglaise de « resolution plans ») doivent permettre de mieux répartir les responsabilités et pertes entre filiales, actionnaires et créanciers, de limiter le recours aux fonds publics et d’inciter les établissements à simplifier leurs structures et à réduire leur taille.
Proposition n° 11 :
Afin de mieux anticiper les crises financières et d’améliorer la surveillance du risque systémique, mettre en place dans les établissements bancaires et financiers d’importance systémique des « testaments » permettant de traiter a priori les crises et faillites susceptibles de les affecter.
c) Tarifer la garantie implicite de l’État par une « prime d’assurance » du risque systémique
Certains établissements bancaires, considérés comme étant trop importants pour faire faillite (« too big to fail ») anticipent que l’État les soutiendra en cas de difficultés majeures et adoptent par conséquent un comportement trop risqué. Après la faillite de Lehman Brothers, les États et banques centrales sont de facto devenus les réassureurs en dernier ressort des grandes institutions financières, qu’ils ne pouvaient laisser faire faillite. Une telle situation est susceptible de se reproduire à l’avenir. Or cette garantie implicite de l’État n’est aujourd’hui pas tarifée à ces établissements d’importance systémique, qui font potentiellement courir d’importants risques à la stabilité financière.
Votre rapporteur propose donc que l’assurance d’être secouru par le prêteur en dernier ressort soit désormais tarifée, en soumettant les établissements bancaires d’importance systémique au versement d’une prime d’assurance systémique qui viendrait abonder un fonds de garantie des faillites bancaires aux niveaux national et européen. En cas de faillite de l’un de ces établissements, les pouvoirs publics pourraient solliciter les fonds ainsi collectés pour mettre en œuvre, comme ce fut le cas à l’automne 2008, des plans de soutien bancaire. Cette prime d’assurance systémique permettrait ainsi de tarifer l’intervention publique en cas de faillite bancaire majeure. Comme le propose M. Philippe Marini dans son rapport, cette prime d’assurance systémique pourrait se substituer, à produit fiscal constant, à la taxe sur les salaires ; son taux serait progressif et l’assiette spécifique, par exemple le produit net bancaire et la taille relative du portefeuille de négociation.
Or, comme le rappelle M. Philippe Marini, « si les objectifs de détection et de prévention du risque systémique sont relativement consensuels, des incertitudes et difficultés surgissent inévitablement sur le terrain méthodologique et suscitent des controverses au sein de la communauté bancaire » (99).
S’il est vrai que les principaux critères permettant de déterminer une institution financière ou un marché systémique sont de prime abord relativement intuitifs, comme « la taille relative et le degré de concentration du secteur, le risque individuel (mesuré par la probabilité de défaut dans le cas d’une institution financière), l’interconnexion avec d’autres acteurs similaires ou secteurs distincts, ou l’exposition à des facteurs de risque communs […], l’opportunité de définir a priori des établissements systémiques peut aussi être contestée, car elle contribue à restaurer l’aléa moral » (100).
Il semble toutefois opportun de s’appuyer sur une récente étude de la BRI (101), qui « propose une méthodologie flexible et conclut notamment que la contribution individuelle d’une entité au risque systémique croît en général plus que proportionnellement à sa taille » (102). Aussi ces réserves techniques ne sont en aucun cas de nature à remettre en question la proposition de votre rapporteur.
Proposition n° 12 :
Afin d’améliorer le traitement du risque systémique, soumettre les établissements bancaires et financiers d’importance systémique qui, en cas de faillite, bénéficient de la garantie implicite de l’État, au paiement d’une prime d’assurance systémique, qui viendrait abonder un fonds de garantie des faillites bancaires aux niveaux national et européen.
Par ailleurs, les critères prudentiels, s’ils doivent être exigeants, n’ont pas à être nécessairement communs à tous les acteurs. En effet, des règles trop générales neutralisent les risques inhérents à l’innovation financière et à la diversification des risques. Il peut donc être envisagé d’imposer des règles plus contraignantes aux établissements à mesure que leur impact systémique s’accroît.
En effet, outre la tarification de la garantie implicite de l’État, votre rapporteur propose que les établissements bancaires et financiers d’importance systémique soient soumis à des exigences plus strictes de fonds propres et de liquidité au fur et à mesure de la croissance de leurs actifs et donc du risque qu’ils font courir à l’ensemble du système. Les établissements qui préfèrent poursuivre des stratégies plus risquées que celle permises par le régulateur pourront toujours opter pour une scission car l’effet de dilution préviendrait l’impact systémique. Cette proposition de votre rapporteur s’inscrit d’ailleurs pleinement dans les recommandations du G20 de Pittsburgh, dont le communiqué final dispose : « Nos normes prudentielles pour les institutions financières d’importance systémique doivent être à la mesure du coût que représente leur faillite. Le CSF doit examiner d’autres mesures possibles, y compris une supervision renforcée et des exigences spécifiques supplémentaires en termes de capitaux, de liquidité et d’autres exigences prudentielles ».
Proposition n° 13 :
Afin d’améliorer la surveillance du risque systémique, soumettre les établissements bancaires et financiers à des exigences plus strictes de fonds propres et de liquidité à mesure que leur impact systémique s’accroît.
C. RÉÉQUILIBRER LES INCITATIONS INDIVIDUELLES AUX PROFITS DE LONG TERME ET RESPONSABILISER LES OPÉRATEURS DE MARCHÉ
Comme l’a écrit M. François Ewald, la crise actuelle est une « immense crise de la responsabilité » (103) des grandes institutions bancaires et financières et, notamment, de leurs opérateurs de marché, plus connus sous le nom de traders.
Ces derniers, rémunérés sous forme de « bonus », dont les sommes prodigieuses suscitent régulièrement une totale incompréhension de l’opinion publique, sont souvent considérés comme les principaux responsables de prises de risques excessives à l’origine de la crise. Ils ont été incités en cela par une rémunération asymétrique, puisqu’ils se voient verser de telles primes aussi bien en cas de gain que de perte sur les opérations financières réalisées. Le montant de ces bonus n’est donc en aucun cas fonction de ce que vont rapporter à terme les produits financiers.
Tarifer la prise de risque et réhabiliter la responsabilité individuelle des opérateurs de marché sont les deux principes cardinaux qui ont présidé, en France notamment, à l’encadrement des bonus. Si notre pays a constamment été en première ligne de la lutte contre les abus en matière de rémunération des traders, l’initiative conjointe de la France et de la Grande-Bretagne sur la taxation des bonus ouvre aujourd’hui de nouvelles perspectives pour mettre fin aux excès de la finance.
1. La France en première ligne de la lutte contre les abus en matière de rémunération des traders
Comme votre rapporteur l’a déjà indiqué, les chefs d’État et de gouvernement sont parvenus, lors du sommet du G20 de Pittsburgh, à un accord précis en matière d’encadrement des bonus (cf. supra). Ainsi, les « standards » internationaux du Conseil de stabilité financière adoptés par le G20 de Pittsburgh exigent de lier le système de rémunération aux objectifs de maîtrise des risques et de faire en sorte que les superviseurs contrôlent davantage ces systèmes. Comme l’a, à juste titre, souligné M. Christian Noyer, il s’agit là de l’une des principales avancées à mettre à l’actif du G20 même si force est de reconnaître que certaines modalités techniques de mise en œuvre n’ont pas été totalement arrêtées.
De manière générale, votre rapporteur tient à saluer la détermination avec laquelle le Président de la République et le gouvernement ont fait de la France un pays pionner en matière de lutte contre les abus de rémunérations des opérateurs de marché. Lors de son allocution télévisée du 12 février 2009, le Président de la République observait ainsi que le système de rémunération de « ceux que l’on appelle traders, ces jeunes gens qui jouaient à spéculer (…) a conduit à la catastrophe que l’on sait ». Et M. Nicolas Sarkozy de conclure : « C’est cela qu’il faut interdire ». La préoccupation des pouvoirs publics a finalement été relayée jusqu’au plus haut niveau des établissements financiers français.
En premier lieu, un code d’éthique sur la rémunération des professionnels de marché a été élaboré conjointement par la Commission bancaire, la direction générale du Trésor et de la politique économique, l’AMF, le Haut comité de place et la Fédération bancaire française (FBF). Comme votre rapporteur l’a déjà indiqué, les principes visent notamment à limiter la pratique des parts variables garanties, à modifier l’assiette de la rémunération – à ce titre, on ne doit pas anticiper des bénéfices futurs et on intègre différents éléments de coût dans la rémunération de l’opérateur (coût du risque et de liquidité, et coût du capital notamment) – à différer une partie de la part variable de la rémunération et à privilégier la rémunération en titres plutôt qu’en numéraire. Ces principes s’appliquent dès 2009 sur les rémunérations variables à verser en 2010.
En deuxième lieu, les autorités ont cherché à renforcer la réglementation relative au contrôle interne des banques. Ainsi, depuis le 30 juillet 2009, les banques ont l’obligation de s’assurer de l’adéquation entre leur politique de rémunération et leurs objectifs de maîtrise des risques. Ce dispositif a été complété par un arrêté du 3 novembre 2009 relatif aux rémunérations des personnels dont les activités sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’exposition aux risques des établissements de crédit et entreprises d’investissement. Cet arrêté prévoit de nouvelles mesures relatives : à la rémunération des agents chargés du contrôle des risques, aux grands principes de gestion et de contrôle interne des politiques de rémunération, au rôle du conseil d’administration et de son comité spécialisé chargé des rémunérations, aux règles de différé, de malus, de paiement en actions et d’interdiction des bonus garantis au-delà d’un an. Ces mesures précisent également suivant quelles modalités les informations relatives à la politique générale en matière de rémunération doivent être communiquées à la Commission bancaire, puis publiées. Finalement, cet arrêté a permis une mise en œuvre rapide et efficace des mesures prises à l’issue de la réunion qui s’est tenue le 25 août 2009 à l’Élysée avec les dirigeants des grandes banques françaises ainsi que les « standards » internationaux du Conseil de stabilité financière adoptés par les membres du G20 lors du sommet de Pittsburgh des 24 et 25 septembre 2009.
En troisième lieu, les pouvoirs publics ont mis en place des contrôles renforcés en matière de rémunération avec, depuis le début du mois de septembre 2009, des missions sur place de la Commission bancaire dans les grands groupes bancaires français. Ces missions constituent une première et ont pour objet de vérifier le respect, par ces groupes, des principes et règles ainsi que de dégager les meilleures pratiques. Elles donneront lieu à un rapport de synthèse qui devait être remis à la fin de l’année 2009 à la ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi.
En quatrième et dernier lieu, la possibilité de prendre de nouvelles sanctions à l’encontre des établissements bancaires a été élargie. Ainsi, l’État n’accordera plus de mandats aux banques qui n’appliqueront pas les règles internationales en matière de rémunération des traders. En outre, une fonction de supervision des rémunérations des professionnels de marché, couvrant les banques bénéficiant d’un soutien de l’État en fonds propres, a été créée et permet d’exercer un pouvoir de recommandations. Si ces recommandations ne sont pas suivies, la Commission bancaire et l’organe délibérant de l’établissement, ainsi que, le cas échéant, l’assemblée générale des actionnaires, peuvent être saisis.
Ne pouvant rester à l’écart des réformes en cours, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a également été une force de proposition en la matière. En effet, M. Philippe Houillon a ainsi proposé, en juillet 2009, d’inscrire dans la loi le principe d’une véritable transparence sur les rémunérations des opérateurs de marché dans les institutions bancaires et financières (104).
Rappelant que « le fait que les rémunérations des opérateurs financiers des établissements de crédit ou d’assurance français ne fassent l’objet d’aucune transparence à l’égard des actionnaires constitue indéniablement un facteur qui a contribué à l’emballement que leur part variable a connu ces dernières années » (105), il considère « que, si l’ensemble des banques et des compagnies d’assurance des pays développés étaient astreintes à rendre publiques les rémunérations de leurs traders et vendeurs, de leurs ingénieurs de marchés et de leurs analystes financiers – pas nécessairement de manière nominative, mais au moins sous la forme de rémunérations moyennes au sein de chaque métier assorties d’indications sur les montants les plus élevés et les moins élevés –, la tendance haussière de ces dernières années n’aurait sans doute pas été aussi forte » (106). C’est pourquoi, il propose que le rapport annuel de gestion présenté sur le fondement de l’article L. 225-102 du code de commerce par le conseil d’administration ou le directoire des banques et des compagnies d’assurance contienne les indications relatives aux rémunérations des responsables de services de « trading », soit qu’une disposition spécifique du code monétaire et financier prévoie la publication annuelle des enveloppes globales dévolues par chaque prestataire de services financiers à la rémunération des opérateurs financiers et des sommes réparties entre les différentes catégories d’opérateurs. Votre rapporteur souhaite, à ce titre, rendre un hommage au remarquable travail de M. Philippe Houillon.
2. De nouvelles perspectives d’encadrement de la rémunération des traders avec la taxation à hauteur de 50 % des bonus
Cependant, le contexte économique et financier a fortement changé depuis juillet 2009 si bien qu’il semble aujourd’hui nécessaire d’ouvrir de nouvelles perspectives à l’encadrement de la rémunération des traders.
En effet, la volonté d’encadrer les bonus, non seulement pour des raisons « morales », mais également pour des raisons de stabilité financière, a pris une nouvelle dimension sous l’impulsion décisive de la France et de la Grande-Bretagne. En effet, au début du mois de décembre 2009, Londres et Paris ont créé la surprise en annonçant vouloir taxer à hauteur de 50 % les bonus versés en 2010 au titre de l’année 2009. Dans une tribune conjointe dans le Wall Street Journal du 10 décembre 2009, MM. Nicolas Sarkozy et Gordon Brown ont ainsi souligné qu’ « un impôt exceptionnel assis sur les primes versées devra être envisagé en priorité parce que les bonus pour 2009 sont en partie le résultat du soutien apporté par les États au système bancaire ».
À l’issue du conseil des ministres du 16 décembre 2009, Mme Christine Lagarde, ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi a précisé les modalités de cette taxe exceptionnelle. Sur le même modèle que celui annoncé par le gouvernement britannique, les bonus versés en France par les banques en 2010 au titre de l’année 2009 seront taxés à 50 % à partir de 27 500 euros.
Si votre rapporteur se réjouit de cette mesure, qui témoigne encore une fois de l’engagement sans faille de la France à inciter les banques à la modération, il estime toutefois que, dans un souci de compétitivité des places européennes, il faut que les vingt-sept autres pays de l’Union européenne adoptent un dispositif analogue. En effet, afin de garantir l’égalité des conditions de concurrence entre places financières et d’éviter la fuite des meilleurs opérateurs de marché d’une place vers une autre, votre rapporteur estime que la France doit désormais parvenir à convaincre l’ensemble des partenaires européens, à commencer par l’Allemagne, d’adopter la mesure. Il s’agit là de l’un des principaux défis que la France devra relever sur la scène européenne dans les tous prochains mois, car encadrer les bonus au niveau européen, c’est inciter collectivement à réduire les prises de risques ne servant pas directement l’économie.
Proposition n° 14 :
Conformément à l’accord conclu avec le gouvernement britannique, taxer à 50 % et à partir de 27 500 euros les bonus versés en France par les banques en 2010 au titre de l’année 2009.
Proposition n° 15 :
Afin de garantir l’égalité des conditions de concurrence entre places financières, tout en incitant à une réduction collective des prises de risque, convaincre, dès aujourd’hui, l’ensemble des partenaires européens, et notamment l’Allemagne, d’adopter la mesure franco-britannique consistant à taxer fortement les bonus en 2010 versés au titre de l’année 2009.
D. AMÉLIORER ET RENFORCER LA TRANSPARENCE DES MARCHÉS ET DE L’INFORMATION FINANCIÈRE
Parce que la transparence est la clé du rétablissement de la confiance et d’un fonctionnement efficient des marchés financiers, elle doit être au cœur des projets de régulation. En effet, la crise actuelle a révélé que c’est le manque d’informations fiables sur les marchés financiers qui peut conduire tantôt à des prises de risques inconsidérées, tantôt à des mouvements de défiance généralisée.
C’est pourquoi, la transparence et la qualité de l’information financière doivent être améliorées suivant trois axes. Tout d’abord, il convient de mieux réguler et encadrer ceux qui sont chargés de produire cette information : les agences de notation. Ensuite, il est indispensable de protéger le destinataire final de cette information : l’épargnant. Enfin, il convient de mettre fin aux « trous noirs » de la finance internationale : les transactions de gré à gré de produits dérivés.
1. Mieux encadrer le fonctionnement des agences de notation
Force est de reconnaître que les principales agences de notation – Moody’s, Standard & Poors et Fitch – n’avaient pas prévu la survenue de trois des grandes crises financières de ces quinze dernières années : la crise asiatique de 1997, les scandales financiers début 2000 et la crise des subprime. Or, comme le souligne M. Christian de Boissieu, « ces agences exercent des missions de service public en améliorant la transparence de l’information financière, en réduisant des asymétries d’information entre les émetteurs et les instruments, en servant de références pour l’évaluation du risque de crédit » (107).
En outre, lorsque les premières manifestations de la crise des subprime sont apparues au printemps et à l’été 2007, elles ont eu tendance à surréagir, abaissant très vite des notes qu’elles auraient dû ajuster bien auparavant et rajoutant ainsi de la volatilité à une volatilité financière déjà élevée. C’est pourquoi, loin de faire des agences de notation les seules responsables du « séisme » économique et financier actuel, votre rapporteur estime qu’il est nécessaire d’améliorer leur fonctionnement, afin qu’elles remplissent dans les meilleures conditions la mission de service public qui leur incombe : assurer la transparence de l’information financière.
a) Adapter la notation à la complexité financière
Comme votre rapporteur l’a déjà indiqué, la première critique adressée aux agences de notation porte sur le fait qu’elles ont appliqué à des produits financiers complexes, comme les produits structurés, les mêmes règles de notation que celles appliquées pour des produits classiques et sûrs. Elles ont ainsi gravement sous-estimé les risques dont ces produits financiers complexes étaient porteurs. Lors de la publication en janvier 2009 du rapport de l’AMF sur les agences de notation, son Président, M. Jean-Pierre Jouyet, n’a pas hésité à déclarer que « le processus de notation des agences demeure des boîtes noires ».
Lors de son audition (108) par votre rapporteur, M. Jérôme Cazes, directeur général de la Coface, a rappelé que « l’utilisation pour les produits structurés de crédit d’une échelle de notation identique à celle des produits classiques a entretenu une confusion dans l’esprit des investisseurs qui ont pu croire que la qualité, notée AAA, d’un produit financier complexe était la même que celle d’un titre émis par l’État français, lui-même noté AAA ». La note donnée a donc pu pousser les acheteurs à traiter les produits complexes comme des produits simples, c’est-à-dire sans prendre en compte les risques de liquidité ainsi que les risques opérationnels liés à leur complexité.
Il est donc indispensable que les agences de notation mettent en œuvre, dès aujourd’hui, des méthodologies transparentes, claires et compréhensibles, s’appuyant sur des statistiques robustes. Pour ce faire, faisant siennes les recommandations du Forum de stabilité financière dans son rapport publié le 12 avril 2008, votre rapporteur propose que les agences utilisent une échelle de notation différente selon qu’il s’agit de produits structurés complexes ou de produits simples et classiques. De manière générale, les agences de notation, qui assurent une mission de service public, doivent à l’avenir affiner leurs notations en intégrant dans leurs évaluations le risque de liquidité et les risques opérationnels, à côté des risques de crédit. Si la crise des subprime a mis en évidence qu’il était pour le moins difficile de modéliser les risques de liquidité, les agences de notation doivent s’y atteler.
Proposition n° 16 :
Afin d’améliorer la transparence de l’information financière, obliger les agences de notation, d’une part, à utiliser une échelle de notation différente selon qu’il s’agit de produits structurés complexes ou de produits simples et classiques et, d’autre part, à affiner leurs notations en intégrant dans leurs évaluations le risque de liquidité et les risques opérationnels, à côté des risques de crédit.
b) Réduire les conflits d’intérêts en matière de notation
Les conflits d’intérêts naissent d’un excès de dépendance à une source particulière de revenus. Or, dans la mesure où elles contribuaient souvent à la conception des produits financiers et où elles étaient rémunérées par les banques d’investissement qui les émettaient, les agences de notation se sont trouvées clairement en situation de conflits d’intérêts. Ces derniers sont inhérents à leur « business model », qui repose sur une rémunération des agences par les émetteurs d’instruments financiers et non par les investisseurs.
Aussi le système actuel de tarification incite-t-il les agences à « faire du volume », puisque leurs recettes sont directement proportionnées au montant des émissions de leurs clients et sur lesquels ils sollicitent une note. Or, la recherche légitime d’un maximum de chiffre d’affaires peut, dans certains cas, se retourner contre la qualité de l’évaluation elle-même, conduisant les agences à retarder voire à éviter la dégradation de la note de son client.
Afin de remédier à cette situation, le Parlement européen a, d’ores et déjà, apporté des améliorations substantielles à la prévention et à la gestion des conflits d’intérêts. L’article 5 du règlement sur les agences de notation de crédit, tel que modifié en première lecture par le Parlement européen, expose, en effet, le principe de prévention des conflits d’intérêts dans les termes suivants : « Les agences de notation prennent toute mesure nécessaire pour garantir qu’aucun conflit d’intérêts existant ou potentiel ou relation commerciale les impliquant en tant qu’émetteur d’une notation de crédit ou impliquant leurs dirigeants, leurs analystes de notation, leurs salariés ou toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle de l’agence de notation ou toute personne directement ou indirectement liée à elles par une relation de contrôle, n’affecte l’émission de ladite notation de crédit ».
Parce qu’il est sain et nécessaire de prévenir en amont les conflits d’intérêts susceptibles d’apparaître entre les émetteurs et les agences de notation, votre rapporteur estime qu’il convient d’aller plus loin. C’est pourquoi, s’appuyant sur les recommandations faites par M. Christian de Boissieu dans son rapport sur la crise des subprime (109), il propose la mise en place d’une tarification au forfait des agences de notation. En effet, les émetteurs, qui sont les clients des agences de notation, leur paieraient un abonnement annuel indépendamment des volumes émis. L’institution d’un paiement au forfait des agences permettrait ainsi d’éviter toute « course » à la notation, qui pousse trop souvent les agences à privilégier la quantité à la qualité des notes émises. Cependant, afin de tenir compte de la réalité et de l’étendue du travail des notateurs, il convient d’envisager qu’au-delà de ce forfait annuel correspondant à une large palette de prestations, pourraient s’ajouter des frais supplémentaires qui pourraient dépendre davantage de la nature des opérations concernées que de leur montant.
Proposition n° 17 :
Afin de mieux prévenir et gérer les conflits d’intérêts, ne plus lier les recettes des agences de notation au montant des émissions notées grâce à la mise en place d’un paiement au forfait des agences de notation : les émetteurs paieraient ainsi un forfait annuel indépendamment des volumes qu’ils émettent et sur lesquels ils sollicitent une notation. Au-delà de ce forfait annuel correspondant à une large palette de prestations, pourraient s’ajouter des frais supplémentaires qui pourraient dépendre davantage de la nature des opérations concernées que de leur montant.
c) Accroître la concurrence sur le marché de la notation
La notation représente aujourd’hui un marché mondial très important quant à son objet et très concentré quant à ses acteurs, puisque trois grandes agences – Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch – contrôlent plus de 90 % du marché mondial.
Comme le constate M. Christian de Boissieu, « il n’existe guère d’autres industries avec un tel taux de concentration » (110). L’arrivée de nouvelles agences comme l’américaine A.M Best (spécialisée sur l’assurance et la réassurance) ou la canadienne DBRS (Dominion Bond Rating Services) a introduit un peu de concurrence, sans changer réellement la donne. Le marché de la notation est fort peu contestable, car les barrières à l’entrée sont décisives (nécessité d’une réputation et d’un « track record » pour démarrer, ce qui est contradictoire dans les termes). En France, c’est toute l’ambition de Coface qui, spécialisée dans l’assurance-crédit, s’est récemment positionnée comme agence de notation et entend bousculer les grandes agences de notation qui dominent le marché.
Ce souci d’accroître la concurrence sur le marché de la notation est d’ailleurs assez largement partagé. Lors de la table ronde (111), M. Jérôme Cazes, directeur général de Coface, et Mme Carole Sirou, présidente de Standard & Poor’s France ont souligné, de concert, la nécessité qu’il y avait aujourd’hui de faciliter l’arrivée, sur le marché de la notation, de nouveaux acteurs, davantage spécialisés sur certains secteurs d’activité, dans la mesure où l’accroissement de la concurrence contribue à l’amélioration de la qualité des notations ainsi qu’à la baisse des prix, permettant ainsi de noter les moyennes entreprises, qui sont à la base du tissu économique de notre pays. Comme pour tout autre secteur d’activité, une vraie concurrence aurait des effets vertueux à la fois sur la qualité des notes et sur la baisse de leur prix. Elle favoriserait l’émergence d’acteurs aux « business models » différents, moins coûteux, et moins sujets au risque de conflits d’intérêts. Or, la réglementation à venir, destinée à tirer les leçons de la crise, ne doit pas créer de nouvelles barrières à l’entrée sur ce marché difficilement contestable.
Parce que davantage de concurrence sur le marché obligerait les agences à plus d’efficacité et de transparence, il importe dans l’immédiat de créer les conditions d’une véritable concurrence et de rompre avec une logique oligopolistique. Pour ce faire, les autorités publiques doivent clairement affirmer que leurs obligations, en matière de réglementation bancaire ou de l’épargne notamment, peuvent être satisfaites par d’autres agences que les trois agences historiques. Elles doivent, en outre, encourager les investisseurs à diversifier davantage leurs sources d’information. Enfin, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique européenne de la concurrence, la Commission européenne devra à l’avenir faire preuve d’une très grande vigilance, en veillant notamment à favoriser l’émergence de nouveaux acteurs européens davantage spécialisés sur certains secteurs d’activité que ne le sont les trois grandes agences généralistes qui dominent aujourd’hui le marché.
Proposition n° 18 :
Créer les conditions d’une véritable concurrence entre agences de notation et favoriser l’émergence de nouveaux acteurs européens, plus spécialisés sur certains secteurs d’activité que ne le sont les grandes agences généralistes :
— d’une part, en affirmant que les obligations requises par les autorités publiques, en matière de réglementation bancaire ou de l’épargne notamment, peuvent être satisfaites par d’autres agences que les trois agences historiques ;
— d’autre part, en encourageant les investisseurs à diversifier leurs sources d’information.
d) Mettre en œuvre une véritable supervision européenne consolidée et efficace des agences de notation
Parce que les agences de notation ont souvent été désignées comme étant en partie responsables de la propagation des risques sur les marchés financiers, l’Union européenne a souhaité renforcer de manière décisive la supervision de ce secteur, notamment grâce à l’institution d’un dispositif européen d’enregistrement et d’agrément des agences. Un règlement européen sur l’encadrement des agences de notation, définissant, entre autres, les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle procédure, a été définitivement approuvé, le 23 avril 2009 par le Conseil et le Parlement européen.
Ce règlement, dont l’adoption rapide constitue un indéniable progrès, prévoit en l’état actuel la mise en place d’un régime transitoire : le CESR ne fait que centraliser et coordonner les demandes d’enregistrement, qui sont ensuite instruites par l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’agence. De l’avis de plusieurs observateurs, dont le président de l’AMF, M. Jean-Pierre Jouyet, cette responsabilité revenait logiquement au comité des régulateurs européens des valeurs mobilières (CESR).
Toutefois, un acte modifiant le règlement sur l’encadrement des agences de notation devrait être présenté d’ici le 1er juillet 2010 afin de remédier à ce schéma un peu complexe. Ainsi, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), qui sera créée dans le cadre du futur système européen de supervision financière, sera investie du pouvoir d’enregistrer les agences de notation et aura une compétence directe sur elle. Elle sera, à ce titre, habilitée à prendre des mesures en matière de surveillance, telles que le retrait de l’enregistrement ou la suspension de l’utilisation des notes de crédit à des fins réglementaires. Elle pourrait également demander des informations et mener des enquêtes ou inspections sur place.
Soucieux d’assurer une régulation pleine et entière des agences de notation à l’échelle européenne, votre rapporteur estime que doivent être précisés au plus vite le rôle de la future AEMF et son articulation avec les autorités nationales, lorsque le régime transitoire actuel cessera de s’appliquer. Il importe en effet qu’à terme, l’AEMF dispose en la matière d’un réel pouvoir décisionnel concernant l’accréditation, le retrait d’agrément, le contrôle et la sanction des agences de notation dans l’Union européenne.
Proposition n° 19 :
Préciser le rôle de la future Autorité européenne des marchés financiers et son articulation avec les autorités nationales, afin qu’elle dispose, à terme, d’un réel pouvoir décisionnel concernant l’accréditation, le retrait d’agrément, le contrôle et la sanction des agences de notation à l’échelle européenne.
2. Renforcer la protection des épargnants et des consommateurs
Avec le constat du développement inconsidéré des prêts « subprime » et de l’opacité de certains produits de placement et de prêts structurés, l’amélioration de la protection des emprunteurs et des épargnants non professionnels contre le risque de vente abusive ou inadaptée est devenue un enjeu important de l’après-crise.
Si le consommateur doit s’informer, faire preuve de prudence et se donner les moyens de son propre discernement, le fournisseur de crédit ou de produits financiers a naturellement une responsabilité forte dans l’acte de conseil et de commercialisation. Cette responsabilité doit être pleinement intégrée dans les étapes afférentes au produit, qui vont de la conception à la promotion et à la présentation au client. La proposition commerciale d’un prêt ou d’un produit d’épargne doit être intelligible, adaptée au profil de risque et aux objectifs de placement ou de financement du client.
Parce que certains établissements bancaires financiers offrent à leurs clients de placer leur épargne en des titres dont la description tient en un manuel de cinquante pages, il est impératif de parvenir dès 2010, à l’échelle de l’Union européenne, à une présentation simplifiée et standardisée de tous les produits financiers qui peuvent être souscrits par les épargnants. En effet, votre rapporteur estime qu’il est indispensable qu’à côté de la description technique et le plus souvent volumineuse des produits d’épargne, les banques présentent à leurs clients un document de quelques pages seulement, récapitulant les principales caractéristiques et informations du produit financier ainsi offert. Ces documents de synthèse doivent être normés, afin d’offrir à l’épargnant une plus grande lisibilité et une meilleure comparabilité entre tous les produits financiers. En outre, cette description normée et synthétique des produits financiers obligera les banques à simplifier leurs produits, souvent très complexes.
Proposition n° 20 :
Afin d’accroître la protection et l’information des épargnants, exiger des banques européennes, par voie de directive communautaire, qu’elles présentent à leurs clients un document normé de quelques pages seulement, récapitulant les principales caractéristiques et informations des produits financiers qu’elles offrent.
3. Mettre fin aux « trous noirs » de la finance
Comme votre rapporteur l’a déjà souligné, une asymétrie supplémentaire dégradant l’information nécessaire à un bon fonctionnement des marchés financiers est née de la multiplication des transactions de gré à gré – effectuées sans passer par un marché cotant les produits ainsi échangés – notamment sur des produits dérivés.
Les prises de risque liées à ces derniers seraient plus transparentes si l’on avait recours à une chambre de compensation pour ces opérations, qui agrégerait les informations concernant l’exposition des contreparties sur tout le marché. Elle permettrait d’assurer une gestion mutualisée et bien renseignée des risques individuels tout en limitant les comportements trop risqués par un mécanisme de surveillance mutuelle. Pour certains analystes, la visibilité qui en découlerait constituerait une réponse plus flexible que des restrictions d’activité trop étroites imposées aux établissements bancaires et financiers.
De nombreuses initiatives concomitantes, publiques et privées, ont été prises et poursuivent deux objectifs majeurs que sont la centralisation de la compensation en aval et l’établissement d’un registre des positions permettant de mieux évaluer les effets systémiques potentiels. Le G20 de Pittsburgh a pris des engagements très clairs sur les produits dérivés de crédit et a notamment affirmé que les contrats, dès qu’ils sont standardisés, devaient passer par une chambre de compensation.
S’agissant de la centralisation de la compensation en aval, force est de constater que plusieurs chambres de compensation ont été lancées et offrent des services pour les Credit Default Swap (CDS) : Intercontinental Exchange Trust (ICE) aux États-Unis, ICE Clear Europe et Eurex Clearing (filiale conjointe des bourses allemande et suisse) en Europe. LCH.Clearnet SA (filiale française de LCH.Clearnet) a annoncé le lancement de sa plate-forme de compensation de contrats sur sous-jacents européens pour la fin de l’année 2009. Cependant, comme le note, à juste titre, M. Philippe Marini, « l’Europe a pris un important retard dans la structuration économique et la réglementation des produits dérivés » (112), le marché « étant largement dominé par des acteurs américains, et accessoirement britanniques » (113). Ainsi, la principale chambre de compensation est ICE, actuellement en position de quasi-monopole sur les CDS, alors que l’activité d’Eurex Clearing était quasi nulle en septembre 2009. C’est pourquoi, souscrivant pleinement aux recommandations faites par l’AMF et M. Philippe Marini, votre rapporteur propose de promouvoir la création d’une chambre de compensation dans la zone euro.
Proposition n° 21 :
Afin que l’Europe ne perde pas son leadership dans la structuration économique et la réglementation des produits dérivés, mettre en place à brève échéance une chambre de compensation pour les dérivés de crédit en zone euro.
S’agissant de l’établissement d’un registre des positions permettant de mieux évaluer les effets systémiques potentiels, il convient de souligner qu’un Forum des régulateurs internationaux sur les dérivés de gré à gré a vu le jour en septembre 2009. Il regroupe 35 autorités nationales et banques centrales, dont la FSA, la Fed et la BCE, et a vocation à devenir un cadre de coopération entre superviseurs et de partage de l’information sur ce marché. Cependant, là encore, l’inquiétude est grande de voir se constituer progressivement un monopole américain sur tous les maillons de la chaîne de traitement de ces produits dérivés. En effet, la Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC, constituée sous forme de coopérative), qui domine le segment du règlement-livraison, dispose depuis 2006 d’une base de données irremplaçable avec la Trade Information Warehouse, seule centrale d’enregistrement des contrats CDS dans le monde.
Parce que l’accès à ces informations constitue un enjeu majeur en termes de stabilité financière et de souveraineté économique, votre rapporteur, à l’instar des propositions faites par l’AMF et M. Philippe Marini, appelle de ses vœux la mise en place à brève échéance d’une base de données centralisée pour les dérivés de crédit en zone euro, qui serait une alternative à la Trade Information Warehouse de la DTCC. Comme l’a, à juste titre, souligné M. Philippe Marini, « à défaut, il est impératif que le Conseil de stabilité financière ou l’OICV défende et fasse respecter un principe d’accès libre et non-discriminatoire à l’information, en tant que bien public participant de la stabilité financière » (114).
Proposition n° 22 :
Afin que l’Europe parvienne à contrebalancer le monopole américain qui est en train de se constituer sur tous les maillons de la chaîne de traitement des produits dérivés, mettre en place à brève échéance une base de données centralisée pour les dérivés de crédit en zone euro.
E. REDÉFINIR L’ORGANISATION DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE TANT EN FRANCE QU’EN EUROPE
Sans attendre le nécessaire renforcement des règles internationales en matière de fonds propres ou de normes comptables, l’évolution du système français et européen de contrôle et de régulation est aujourd’hui indispensable.
L’ampleur prise dans l’économie par les activités financières et les risques induits par les innovations constantes en matière d’instruments et de produits financiers commercialisés confrontent la régulation financière à de nouveaux défis qui nécessitent une vigilance accrue des autorités publiques en charge de la régulation. Tant au niveau européen que national, l’État doit rester fortement impliqué dans la supervision financière dès lors qu’il est garant en dernier ressort de la stabilité financière et de la résolution des crises.
Alors qu’en France, une réforme d’assez grande ampleur est en cours afin de mieux identifier le pôle prudentiel et le pôle de contrôle des pratiques commerciales et de marché, la Commission européenne, avec l’appui déterminé de la France, a présenté, en septembre 2009, un plan ambitieux destiné à renforcer la supervision financière en Europe
1. Au niveau national : remédier à l’organisation encore trop cloisonnée et fragmentée des autorités de contrôle et de régulation
Comme votre rapporteur l’a déjà souligné, les régulateurs sont souvent dispersés, le cas extrême étant celui des États-Unis. Mais la France, en l’état actuel, n’échappe pas à ce constat. Les autorités de régulation y sont multiples (Commission bancaire, Autorité des marchés financiers, Commission de contrôle des assurances…) et la Cour des comptes, dans son rapport public annuel pour 2009 (115), a rappelé que les autorités de contrôle du secteur financier forment actuellement un ensemble « trop cloisonné » et « trop hétérogène », concentrant à des degrés divers une pluralité de pouvoirs d’attribution : réglementation, contrôle, sanction. Afin de remédier à cette architecture complexe et fragmentée, héritée du passé, la Cour a recommandé de renforcer les coopérations entre les différentes autorités de régulation. La Cour des comptes a également demandé aux autorités de contrôle d’être plus sévères et de prononcer « des sanctions d’un montant réellement dissuasif », évoquant sans les nommer de « récents incidents » (116). En effet, la Commission bancaire avait infligé une amende de 4 millions d’euros à la Société générale après l’affaire Kerviel.
Forte de ce constat, Mme Christine Lagarde, ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi a confié à M. Bruno Deletré une mission de réflexion et de propositions sur l’organisation et le fonctionnement de la supervision des activités financières. Le rapport (117), qu’il a remis en janvier 2009, préconise une architecture de type « twin peaks », reposant sur deux piliers : le pôle prudentiel, d’une part, et le pôle de contrôle des pratiques commerciales et de marché, d’autre part. Il propose dans cette perspective :
— une fusion de la Commission bancaire, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI, soit l’autorité d’agrément dans le secteur bancaire), du Comité des entreprises d’assurance (CEA, soit l’autorité d’agrément dans le secteur de l’assurance) et de l’Autorité de contrôle des assurances et mutuelles (ACAM) ;
— la séparation du contrôle et de la sanction : à la Commission bancaire comme à l’ACAM, le contrôle et la sanction demeurent « dans la main d’un même collège ». Aussi le rapport Deletré propose-t-il de « dissocier les commissions de sanction des collèges de supervision », sur le modèle de ce qui existe pour l’Autorité des marchés financiers (AMF) ;
— un élargissement des missions de l’AMF au contrôle du respect des obligations professionnelles à l’égard de la clientèle dans l’ensemble du secteur financier, afin de mieux garantir la protection du consommateur de services financiers ou d’assurance. M. Deletré, aux termes de son rapport, indique que cela constituerait « une véritable transformation » pour le gendarme de la Bourse, un tel projet nécessitant « plusieurs années pour devenir pleinement opérationnel ».
La création d’une nouvelle autorité de contrôle prudentiel, commune aux secteurs des banques et des assurances, a été actée le 27 juillet 2009. L’ordonnance correspondante devait être finalisée d’ici la fin de l’année 2009 et fait toujours l’objet d’une consultation publique. Cette autorité serait dotée d’un collège unique de seize membres, de deux sous-collèges sectoriels – banques et assurances – et d’une commission des sanctions de quatre membres.
À l’instar de la Commission bancaire, elle serait logée à la Banque de France et profiterait donc pleinement de sa connaissance du secteur bancaire. Elle disposera du statut d’autorité administrative indépendante, et son mandat devrait être explicitement axé sur la préservation de la stabilité du système financier et la protection des clients, assurés et bénéficiaires. Comme l’a souligné M. Christian Noyer lors de son audition (118), « on attend aussi de cette réforme une simplification et un renforcement du dispositif français de supervision par la fusion des quatre autorités de contrôle et d’agrément, ce qui créera ainsi une autorité qui aura à sa disposition une concentration d’expertises tout à fait remarquable ».
Cependant, le projet d’ordonnance ne fait qu’initier une démarche de régulation par objectif (119) selon une architecture en « deux piliers » (modèle dit « twin peaks »), sans en tirer toutes les conséquences institutionnelles. Plutôt que de confier la surveillance de l’ensemble des obligations déontologiques à l’AMF, il est proposé que l’AMF et la nouvelle autorité conservent chacune leurs prérogatives pour les produits financiers qui les concernent.
La coopération entre les deux autorités serait cependant développée, du fait de l’imbrication croissante entre les produits d’épargne (assurance-vie et OPCVM notamment) et du développement d’acteurs distribuant toute la gamme des produits d’assurance et bancaires. La nouvelle autorité et l’AMF créeraient ainsi un pôle qui élaborerait une politique commune sur les contrôles et suites à donner, assurerait une veille sur l’évolution des produits et une surveillance conjointe de la publicité. Il constituerait un point d’entrée unique pour les demandes des consommateurs, mais toute décision serait prise uniquement par chaque autorité, selon les cas traités.
Toutefois, votre rapporteur regrette qu’en l’état actuel, le projet français de réforme de la régulation ne consacre pas pleinement l’AMF comme pôle déontologique chargé de contrôler le respect des obligations professionnelles à l’égard de la clientèle de l’ensemble du secteur financier. S’il est vrai qu’un tel projet nécessiterait plusieurs années pour devenir pleinement opérationnel, il existe actuellement une réelle fenêtre d’opportunité – qui pourrait ne pas durer – pour étendre le champ de surveillance de l’AMF aux conditions et pratiques d’octroi du crédit.
Proposition n° 23 :
Dans le cadre de la réforme des autorités de supervision au niveau national, profiter de cette fenêtre d’opportunité pour consacrer l’AMF comme pôle déontologique chargé de contrôler les pratiques commerciales et de marché de l’ensemble du secteur financier.
2. Au niveau européen : se doter d’une nouvelle supervision macro et micro-prudentielle
La multiplication des faillites bancaires en Europe a semé le doute sur l’efficacité du contrôle opéré sur des établissements ayant le plus souvent des activités transfrontalières, soulevant ainsi la question de l’opportunité d’une véritable supervision à l’échelle européenne des banques et des marchés financiers. En effet, les activités des institutions financières s’étendent de plus en plus au-delà des frontières alors que le contrôle reste toujours national. Ainsi Fortis a-t-elle été renflouée par l’action concertée des trois États du Benelux. En effet, comme le souligne la Cour des comptes dans son rapport public annuel pour 2009, « alors que les grands groupes bancaires et d’assurance ont fortement développé leur présence à l’étranger, ce mouvement ne s’est pas accompagné d’un renforcement de la régulation au niveau européen et international, ce qui a pour effet de limiter l’action des régulateurs nationaux » (120).
Afin de remédier à ce décalage croissant entre la dimension internationale des activités bancaires et le cadre trop souvent national de la régulation, la Commission européenne a publié, le 23 septembre 2009, cinq propositions législatives – soit quatre règlements et une décision (121) – destinées à renforcer la supervision financière à l’échelle européenne sur la base des recommandations du groupe de travail présidé par M. Jacques de Larosière, qui avaient été remises le 25 février 2009 et approuvées par la Commission et le Conseil en mars. La réforme européenne de la supervision macro et micro-prudentielle prévoit la création :
— d’un Comité européen du risque systémique (CERS), responsable de la surveillance macro-prudentielle du système financier afin de prévenir ou atténuer les risques systémiques (cf. supra) ;
— d’un Système européen de surveillance financière (SESF), consistant en un réseau d’autorités nationales travaillant en coordination avec trois nouvelles autorités européennes de surveillance (AES). Ces autorités sectorielles succéderaient aux trois comités actuels (122) qui, dans le cadre de la « comitologie », relèvent du « niveau 3 » du processus Lamfalussy, et amélioreraient l’harmonisation des normes et pratiques de surveillance.
a) Les trois autorités européennes de surveillance (123)
Afin de renforcer la régulation du secteur financier en Europe, la Commission a proposé que soient mises en place, à l’échelle de l’Union, une Autorité bancaire européenne (ABE), une Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP), appelées à fonctionner à partir de 2011, disposant de la personnalité morale et dont l’essentiel des caractéristiques de fonctionnement sont communes.
Conformément aux réflexions engagées en 2008, les missions et responsabilités de ces nouvelles autorités seront plus étendues que celles des actuels « comités Lamfalussy » et permettront à l’avenir :
— l’élaboration de normes techniques d’application de la législation sectorielle concernée, correspondant au niveau 3 du processus Lamfalussy et donnant lieu à l’adoption de règlements ou décisions par la Commission. À la différence des comités actuels, ces normes sont adoptées à la majorité qualifiée (et non par consensus) et ont une portée contraignante pour la Commission, qui ne peut refuser ces normes, les adopter partiellement ou les modifier que « lorsque l’intérêt communautaire l’impose », et en motivant sa décision auprès de l’Autorité concernée. Les AES conservent la faculté de publier des orientations et recommandations non contraignantes à destination des autorités nationales et intermédiaires financiers ;
— une garantie d’application cohérente des règles communautaires lorsque le comportement d’une autorité nationale est jugé contraire à la législation européenne, selon un mécanisme en trois phases. Néanmoins si l’autorité nationale ne se conforme pas à la recommandation émise par l’AES, c’est la Commission, après avoir informé l’AES compétente ou de sa propre initiative, qui peut prendre une décision imposant à cette autorité nationale de prendre des mesures spécifiques ou de s’abstenir d’agir ;
— l’adoption de décisions individuelles imposant aux autorités nationales compétentes ou à un établissement financier de prendre des mesures correctives (notamment la cessation d’une pratique) en situation d’urgence transfrontalière (124), dont l’appréciation est du seul ressort de la Commission européenne ;
— un mécanisme de règlement des différends entre autorités nationales de régulation (125), en trois phases : conciliation par l’AES, décision en l’absence d’accord, et décision directement à l’égard des établissements financiers en cas de non-respect par l’autorité nationale concernée ;
— la promotion des meilleures pratiques et d’une culture commune en matière de surveillance et la détermination de tâches et responsabilités susceptibles d’être déléguées entre autorités nationales. Les AES doivent faciliter la mise en place d’équipes conjointes et mener régulièrement des analyses réciproques des autorités nationales ;
— l’analyse micro-prudentielle des tendances, risques et vulnérabilités dans chacun des trois secteurs, selon une logique ascendante, l’analyse macro-prudentielle du CERS étant descendante. À cet égard, des procédures sont prévues pour garantir la collecte et la communication d’information entre les autorités nationales, les AES et le CERS ;
— un rôle de coopération internationale et de conseil : les AES ont enfin vocation à être des points de contact pour les autorités de surveillance des pays tiers et peuvent donc conclure des accords administratifs bilatéraux et contribuer aux décisions portant sur l’équivalence des régimes des pays tiers. Elles peuvent également, sur demande ou de leur propre initiative, conseiller les institutions européennes et publier des avis, notamment sur l’évaluation prudentielle des fusions et acquisitions transfrontalières.
Une des principales limites à l’action des AES réside dans la clause de sauvegarde budgétaire, réclamée par le Royaume-Uni et enjeu politique majeur des négociations, qui est destinée à préserver les compétences budgétaires des États membres et permet, le cas échéant, à une autorité nationale de ne pas appliquer une décision d’une AES (126). Cette clause pourrait en particulier être invoquée en cas de difficultés ou faillite d’un groupe bancaire transfrontalier, qui poserait la question du « partage de la charge » financière entre États membres.
Chaque autorité est dotée d’un conseil, organe décisionnel composé de 32 membres (127) et d’observateurs, d’un conseil d’administration, d’un président (dont le mandat est de cinq ans, renouvelable) et d’un directeur exécutif. Deux organes communs aux trois AES sont prévus : un comité mixte destiné à favoriser la coopération et la cohérence des approches des trois autorités, et une commission de recours de six membres susceptible de statuer sur l’application du droit communautaire, les interventions d’urgence et le règlement des différends.
La transformation des comités actuels en agences autonomes requerra des ressources humaines et budgétaires supplémentaires, évaluées avec précision en annexe de chaque directive (128). Les sources de financement de chaque agence ne sont pas encore arrêtées, mais devraient se fonder sur une subvention du budget de l’Union européenne, une contribution obligatoire des autorités nationales de surveillance et une redevance des principaux établissements européens pour chaque secteur.
Le travail accompli par la Commission européenne sur les autorités européennes de supervision fixe le cadre d’une véritable régulation à l’échelle européenne et marque l’aboutissement de la réforme des comités de niveau 3 initiée sous la présidence française de l’Union européenne, au second semestre de 2008.
b) Les limites du « paquet supervision financière » de la Commission européenne
Si le projet européen de réforme de la supervision financière est porteur d’indéniables avancées, certains points font encore débat et gagneraient à être rapidement précisés.
S’agissant du futur Comité européen du risque systémique, la portée des alertes et recommandations non individuelles (au niveau d’un État ou d’un établissement) du conseil général risque d’être durablement affaiblie, dans la mesure où la décision de les publier ne pourra être prise demain qu’à la majorité qualifiée. Comme l’a, à juste titre, proposé M. Philippe Marini dans le rapport précité, l’effectivité de la prévention des risques serait sans doute renforcée si la décision de publier les alertes et recommandations non individuelles était prise à la majorité simple plutôt que qualifiée, à l’instar des autres décisions du conseil général du CERS.
Proposition n° 24 :
Dans le cadre de la mise en place du Comité européen du risque systémique, prévoir une adoption à la majorité simple – et non pas qualifiée – de la publication des alertes et recommandations non individuelles émises par le conseil général afin d’améliorer et de renforcer l’effectivité de la prévention des risques à l’échelle européenne.
En outre, comme l’a indiqué M. Philippe Marini, « l’articulation entre les pouvoirs des autorités européennes de surveillance et les prérogatives de la Commission demeure complexe et laisse encore une impression d’inachevé ou de transition, l’étape vers des autorités dotées de véritables pouvoirs contraignants ou d’initiative (129) n’ayant pas été complètement franchie » (130). Joignant sa voix à celle de M. Philippe Marini, votre rapporteur regrette notamment que les autorités européennes de surveillance ne puissent pas, à l’avenir, s’autosaisir pour prendre des mesures d’urgence. En effet, seule la Commission aura le pouvoir de constater une situation d’urgence, soit de sa propre initiative, soit à la demande d’une AES, du Conseil ou du CERS. Au moment où l’Union européenne se dote, pour la première fois de son histoire, d’une véritable régulation à l’échelle communautaire, il convient de profiter pleinement de cette fenêtre d’opportunité pour permettre aux autorités européennes de surveillance de s’autosaisir en cas de situation d’urgence, faute de quoi la prévention des risques à l’échelle européenne se saurait être pleinement effective.
Proposition n° 25 :
Dans le cadre de la mise en place des trois autorités européennes de surveillance, prévoir que ces dernières puissent s’autosaisir pour prendre des mesures d’urgence, afin de ne pas laisser à la Commission européenne le monopole de l’appréciation de l’urgence et permettre in fine une meilleure prévention des risques bancaires et financiers à l’échelle de l’Union européenne.
Le 22 décembre 2009, la Commission procède à l’examen du rapport de la mission. Un débat suit l’exposé du rapporteur.
M. Manuel Valls. À la demande de M. Philippe Vuilque, qui a dû s’absenter, je tiens à souligner tout l’intérêt de ce rapport, qui est le fruit d’un travail important. Je souhaiterais néanmoins indiquer qu’il soutient parfois de manière excessive la position du gouvernement et, par conséquent, qu’il ne va pas assez loin dans ses préconisations.
En ce qui concerne la loi bancaire et la réglementation portant sur les établissements de crédit, le rapport propose de légiférer par ordonnances. A notre sens, il faudrait simplement légiférer.
En tout état de cause, nous sommes bien entendu favorables à la publication du rapport.
M. le président Jean-Luc Warsmann. Je tiens à féliciter notre rapporteur et les députés de la mission pour la qualité de leur travail. Il me semble important que la commission se soit penchée sur un sujet technique mais essentiel.
M. Sébastien Huyghe, rapporteur. Je souhaiterais apporter quelques précisions.
Tout d’abord, si le groupe socialiste trouve que le présent rapport ne va pas assez loin, il faut, à mon sens, éviter toute confusion. L’objet de ce rapport n’est pas de revenir sur le travail de Philippe Houillon relatif à la rémunération des dirigeants mandataires sociaux et des opérateurs de marché. Sur la base du rapport qu’il a remis en juillet dernier, j’ai décidé de faire miennes ses recommandations et même de franchir une nouvelle étape en proposant, conformément à l’accord conclu avec le gouvernement britannique, de taxer à 50 % et à partir de 27 500 euros les bonus versés en France par les banques en 2010 au titre de l’année 2009. On ne peut que se féliciter de cette mesure et inciter le Gouvernement à être une force de proposition en Europe.
Ensuite, le rapport ne recommande nullement de légiférer par voie d’ordonnance en matière de réforme de l’organisation de la régulation bancaire et financière en France. Si le gouvernement élabore actuellement un projet d’ordonnance réformant le système français de régulation sur la base des principales préconisations du rapport de M. Bruno Deletré, le présent rapport ne se prononce pas sur la méthode mais sur le fond. Ainsi, je tiens à souligner que je propose d’aller bien au-delà du projet d’ordonnance. Alors que celui-ci prévoit, en l’état actuel, que l’Autorité des marchés financiers (AMF) et la nouvelle autorité de contrôle prudentiel conservent chacune leurs prérogatives pour les produits financiers qui les concernent, je propose de consacrer pleinement l’AMF dans le rapport de M. Bruno Deletré comme pôle déontologique chargé de contrôler le respect des obligations professionnelles à l’égard de la clientèle de l’ensemble du secteur financier. S’il est vrai qu’un tel projet nécessiterait sans doute plusieurs années pour devenir pleinement opérationnel, il existe actuellement une réelle fenêtre d’opportunité – qui pourrait ne pas durer – pour étendre le champ de surveillance de l’AMF aux conditions et pratiques d’octroi du crédit dans toutes ses dimensions.
Je souhaite enfin attirer l’attention de la commission des Lois sur les menaces qui pèsent aujourd’hui sur les banques coopératives et mutualistes françaises. En effet, une application relativement indifférenciée à l’ensemble des établissements de crédit des nouvelles mesures destinées à renforcer les exigences de fonds propres pourrait, demain, menacer l’activité bancaire sous forme coopérative et mutualiste, à laquelle des millions de Français sont particulièrement attachés. C’est pourquoi, je pense qu’il est impératif de maintenir une pression politique forte sur le Comité de Bâle, afin que la refonte de la surveillance prudentielle des établissements financiers tienne compte des spécificités des banques coopératives : inclusion des parts sociales dans les fonds propres de bases et non déduction des participations croisées des fonds propres. Je suis persuadé que tous les membres de la commission partagent mon sentiment.
Conformément à l’article 145 du Règlement, la Commission autorise le dépôt du rapport d’information en vue de sa publication.
SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS DE LA MISSION D’INFORMATION
Conforter les engagements pris par les banques en contrepartie du plan de soutien bancaire
Proposition n° 1 :
Exiger des banques ayant bénéficié des concours publics de l’État, dans le cadre du plan de financement de l’économie, de se justifier avant la fin de l’année 2009, sur le non-respect de l’engagement d’une croissance de 3 à 4 % des encours de crédit à l’économie.
Proposition n° 2 :
Maintenir, au-delà de l’arrivée à échéance du plan de financement de l’économie, l’engagement des banques d’assurer une croissance de leurs encours de crédit de 3 à 4 % en rythme annuel jusqu’à ce que la France soit définitivement sortie de la crise et ait durablement retrouvé le chemin de la croissance.
Proposition n° 3 :
Compléter l’indicateur de croissance du crédit à l’économie par de nouveaux indicateurs, comme les taux d’intérêts pratiqués, moins agrégés et déclinés par type de crédit ou par secteur d’activité, afin d’offrir une vision plus complète de l’offre de crédit en France.
Réguler le contournement des regles prudentielles et la transmission des risques
Proposition n° 4 :
Au niveau européen, exiger des banques qu’elles conservent dans leurs bilans, non plus seulement 5 %, mais 10 % des crédits qu’elles titrisent.
Atténuer la procyclicite des normes et mieux prévenir le risque systémique
Proposition n° 5 :
Inviter l’ensemble des États européens, de concert avec la Commission européenne, à maintenir une pression politique forte sur l’IASB, afin de parvenir d’ici 2010 à une réforme pragmatique de la juste valeur, reposant sur une valorisation des instruments financiers plus réaliste et fonction de l’horizon de détention et du niveau de liquidité.
Proposition n° 6 :
Maintenir une pression politique forte de la France sur la Commission européenne et l’IASB afin de parvenir, d’ici juin 2011, à une convergence des normes comptables internationales.
Proposition n° 7 :
Améliorer la gouvernance de l’IASB, afin que son cadre institutionnel assure le prise en compte et le reflet de l’ensemble des parties prenantes (responsables politiques, régulateurs bancaires, etc.).
Proposition n° 8 :
Systématiser et harmoniser au niveau de l’Union européenne la démarche de provisionnement dynamique, consistant pour les banques à mettre de côté en haut de cycle le capital qui leur sera nécessaire en bas de cycle pour respecter les ratios.
Proposition n° 9 :
Dans le cadre des travaux du Comité de Bâle et du Comité européen des superviseurs bancaires, prévoir que toutes les mesures envisagées afin de renforcer les exigences de fonds propres des banques fassent l’objet, d’une part, d’une étude d’impact exhaustive et, d’autre part, d’une application progressive et étalée dans le temps, afin de ne pas menacer durablement, en cette période de reprise, le financement de l’économie et de la croissance, sous l’effet d’un « choc réglementaire ».
Proposition n° 10 :
Maintenir une pression politique forte sur le Comité de Bâle afin que :
— d’une part, la nouvelle définition des fonds propres durs (« Core Tier One ») des banques continue de prendre en compte les spécificités des banques coopératives et mutualistes et incorporent, à ce titre, les parts sociales émises par ces établissements, sans que le règlement de cette question soit laissé à la discrétion des régulateurs nationaux ;
— d’autre part, la spécificité des participations croisées entre les entités d’un même groupe bancaire coopératif et mutualiste soit pleinement reconnue, en les autorisant notamment à ne pas déduire ces participations de leurs fonds propres durs (« Core Tier One »).
Proposition n° 11 :
Afin de mieux anticiper les crises financières et d’améliorer la surveillance du risque systémique, mettre en place dans les établissements bancaires et financiers d’importance systémique des « testaments » permettant de traiter a priori les crises et faillites susceptibles de les affecter.
Proposition n° 12 :
Afin d’améliorer le traitement du risque systémique, soumettre les établissements bancaires et financiers d’importance systémique qui, en cas de faillite, bénéficient de la garantie implicite de l’État, au paiement d’une prime d’assurance systémique, qui viendrait abonder un fonds de garantie des faillites bancaires aux niveaux national et européen.
Proposition n° 13 :
Afin d’améliorer la surveillance du risque systémique, soumettre les établissements bancaires et financiers à des exigences plus strictes de fonds propres et de liquidité à mesure que leur impact systémique s’accroît.
Rééquilibrer les incitations individuelles aux profits de long terme et responsabiliser les opérateurs de marché
Proposition n° 14 :
Conformément à l’accord conclu avec le gouvernement britannique, taxer à 50 % et à partir de 27 500 euros les bonus versés en France par les banques en 2010 au titre de l’année 2009.
Proposition n° 15 :
Afin de garantir l’égalité des conditions de concurrence entre places financières, tout en incitant à une réduction collective des prises de risque, convaincre dès aujourd’hui l’ensemble des partenaires européens, et notamment l’Allemagne, d’adopter la mesure franco-britannique consistant à taxer fortement les bonus versés en 2010 au titre de l’année 2009.
Améliorer et renforcer la transparence des marchés et de l’information financière
Proposition n° 16 :
Afin d’améliorer la transparence de l’information financière, obliger les agences de notation, d’une part, à utiliser une échelle de notation différente selon qu’il s’agit de produits structurés complexes ou de produits simples et classiques et, d’autre part, à affiner leurs notations en intégrant dans leurs évaluations le risque de liquidité et les risques opérationnels, à côté des risques de crédit.
Proposition n° 17 :
Afin de mieux prévenir et gérer les conflits d’intérêts, ne plus lier les recettes des agences de notation au montant des émissions notées grâce à la mise en place d’un paiement au forfait des agences de notation : les émetteurs paieraient ainsi un forfait annuel indépendamment des volumes qu’ils émettent et sur lesquels ils sollicitent une notation. Au-delà de ce forfait annuel correspondant à une large palette de prestations, pourraient s’ajouter des frais supplémentaires qui pourraient dépendre davantage de la nature des opérations concernées que de leur montant.
Proposition n° 18 :
Créer les conditions d’une véritable concurrence entre agences de notation et favoriser l’émergence de nouveaux acteurs européens, davantage spécialisés sur certains secteurs d’activité que ne le sont les grandes agences généralistes :
— d’une part, en affirmant que les obligations requises par les autorités publiques, en matière de réglementation bancaire ou de l’épargne notamment, peuvent être satisfaites par d’autres agences que les trois agences historiques ;
— d’autre part, en encourageant les investisseurs à diversifier leurs sources d’information.
Proposition n° 19 :
Préciser le rôle de la future Autorité européenne des marchés financiers et son articulation avec les autorités nationales, afin qu’elle dispose, à terme, d’un réel pouvoir décisionnel concernant l’accréditation, le retrait d’agrément, le contrôle et la sanction des agences de notation à l’échelle européenne.
Proposition n° 20 :
Afin d’accroître la protection et l’information des épargnants, exiger des banques européennes, par voie de directive communautaire, qu’elles présentent à leurs clients un document normé de quelques pages seulement, récapitulant les principales caractéristiques et informations des produits financiers qu’elles offrent.
Proposition n° 21 :
Afin que l’Europe ne perde pas son leadership dans la structuration économique et la réglementation des produits dérivés, mettre en place à brève échéance une chambre de compensation pour les dérivés de crédit en zone euro.
Proposition n° 22 :
Afin que l’Europe parvienne à contrebalancer le monopole américain qui est en train de se constituer sur tous les maillons de la chaîne de traitement des produits dérivés, mettre en place à brève échéance une base de données centralisée pour les dérivés de crédit en zone euro.
redefinir l’organisation de la régulation financière tant en France qu’en Europe
Proposition n° 23 :
Dans le cadre de la réforme des autorités de supervision au niveau national, profiter de cette fenêtre d’opportunité pour consacrer l’AMF comme pôle déontologique chargé de contrôler les pratiques commerciales et de marché de l’ensemble du secteur financier.
Proposition n° 24 :
Dans le cadre de la mise en place du Comité européen du risque systémique, prévoir une adoption à la majorité simple – et non pas qualifiée – de la publication des alertes et recommandations non individuelles émises par le conseil général afin d’améliorer et de renforcer l’effectivité de la prévention des risques à l’échelle européenne.
Proposition n° 25 :
Dans le cadre de la mise en place des trois autorités européennes de surveillance, prévoir que ces dernières puissent s’autosaisir pour prendre des mesures d’urgence, afin de ne pas laisser à la Commission européenne le monopole de l’appréciation de l’urgence et permettre in fine une meilleure prévention des risques bancaires et financiers à l’échelle de l’Union européenne.
ABS Asset Backed Securities : titre adossé à des actifs. Généralement obtenu par titrisation de crédits bancaires ou de créances commerciales. L’ABS est un produit structuré.
Actifs toxiques Actifs financiers complexes devenus non négociables sur leur marché, qui ne fonctionne plus normalement. Ces actifs sont donc illiquides : leur valeur intrinsèque est difficile à établir. Ils sont dits toxiques, car ils contaminent les bilans de plusieurs banques.
Actions de préférence Actions dont les droits attachés sont librement fixés. Elles peuvent par exemple donner droit à des avantages pécuniaires particuliers (dividende prioritaire ou majoré) ou à un droit de vote double, ou être privées de droit de vote.
Agences de notation Entreprises dont le rôle est d’évaluer le risque supporté par les investisseurs. Elles attribuent une « note » à chaque emprunteur (entreprises, collectivités locales, États…) en fonction de son niveau de risque. Cette note détermine la qualité de la signature de chaque emprunteur et son coût d’accès au marché. Les agences de notation les plus importantes sont Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch.
« Bâle II » Règles prudentielles qui encadrent les conditions dans lesquelles les établissements de crédit prennent des risques. Elles portent notamment sur les risques de crédit, de marché, opérationnels, et de liquidité. Elles sont entrées en vigueur en France depuis le 1er janvier 2008.
Bank run Ou « ruée vers les dépôts » : c’est le phénomène par lequel les clients d’une banque retirent massivement et en même temps leurs dépôts par crainte d’une faillite de leur banque et donc d’une perte de leurs avoirs.
CDO Collateralized Debt Obligation : ce sont des obligations sécurisées par un ensemble d’actifs de natures diverses, notamment des crédits de type subprime. Elles regroupent le plus souvent de l’ordre de 100 à 250 actifs différents et sont émises par une société de titrisation qui achète et détient en contrepartie des prêts bancaires ou des obligations émises par des banques, des institutions financières ou des entreprises. Ce mécanisme permet de « repackager » et de revendre à des investisseurs le risque de crédit initialement pris par les banques. Les CDO qui comprenaient notamment des crédits de type subprime ont été particulièrement affectés par la crise de ce marché depuis l’été 2007.
CDS Credit Default Swap : c’est un contrat financier, assimilable à un contrat d’assurance, qui vise à se protéger contre la faillite d’un emprunteur. L’acheteur d’un CDS paie une prime annuelle, en contrepartie de laquelle le vendeur s’engage à compenser la perte de valeur d’un actif ou le cas de défaut d’un emprunteur. Contrairement à un assureur classique, le vendeur de CDS n’est pas tenu de mobiliser ex ante les fonds nécessaires pour couvrir la dépréciation d’actifs.
Collatéral Actif transférable ou une garantie apportée, servant de gage au remboursement d’un prêt dans le cas où le bénéficiaire de ce dernier ne pourrait pas satisfaire ses obligations de paiement.
Core Tier One Noyau dur des fonds propres de base. Il regroupe les actions ordinaires, les réserves, les résultats accumulés et non distribués, les actions de préférence sous certaines conditions et les intérêts minoritaires provenant de la consolidation des filiales opérationnelles. Une banque ayant un Core Tier One élevé obtiendra des prêts à un taux plus avantageux.
Credit crunch Ou contraction du crédit : c’est une chute brutale du crédit, c’est-à-dire de la dette, distribué par les banques. Elle intervient dans les contextes de crise financière.
Crise systémique Effondrement du système bancaire résultant de l’enchaînement de faillites de banques.
Défaisance Opération financière consistant à céder simultanément des actifs de mauvaise qualité et les dettes associées à une structure spécialement créée à cet effet, afin d’améliorer le bilan d’une banque ou d’une entreprise.
Dérivé de crédit Un dérivé (produit ou contrat dérivé) est un contrat de gré à gré, qui définit des flux financiers futurs entre l’acheteur et le vendeur, et dont la valeur dérive d’un actif sous-jacent. Il existe différents types de dérivés comme les futures, les swaps, les options…
Effet de levier Le levier mesure le degré d’endettement atteint pour acquérir un actif. L’effet de levier est positif si la rentabilité de l’actif est supérieure au coût de l’endettement. Dans ce cas, la rentabilité des capitaux propres augmente fortement avec l’endettement. Dans le cas contraire, un effet de levier négatif dégrade rapidement la rentabilité des capitaux propres.
Fonds propres Sont constitués des fonds propres de base et des fonds propres complémentaires tels que définis par le règlement n°90-02 modifié du 23 février 1990. Ils sont garants de la solvabilité de la banque face aux pertes que les risques pris à l’actif sont susceptibles d’engendrer. Ils sont, au plan comptable, égaux à la différence entre la valeur totale de l’actif et celle des dettes financières et d’exploitation.
Hedge funds Ce sont des fonds d’investissement dits alternatifs, dont la stratégie vise à décorréler les performances de leur portefeuille de l’évolution générale de la Bourse en intervenant sur les marchés des actions mais aussi sur les obligations, les devises, les matières premières, l’immobilier, les entreprises non cotées… L’objectif est de rechercher un « rendement absolu », c’est-à-dire de lisser les courbes de rendement et de les améliorer par rapport au rendement du marché.
IAS 39 Norme comptable relative aux instruments financiers du référentiel comptable international IFRS.
IFRS International Financial Reporting Standards : il s’agit de normes comptables édictées au niveau international par l’International Accounting Standard Board (IASB), obligatoires depuis le 1er janvier 2006 dans l’Union européenne, qui définissent les règles d’évaluation et de présentation des comptes des entreprises. Elles reposent notamment sur le principe de la juste valeur des actifs et des passifs des entreprises, par opposition au principe de comptabilisation au coût historique.
Juste valeur Montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre parties bien informées, consentantes, et agissant dans des conditions de concurrence normale. Ceci implique la valorisation d’actifs et de passifs sur la base de la valeur de marché (mark-to-market) ou d’une estimation à partir d’un modèle (mark-to-model), par actualisation des flux de trésorerie estimés attendus de leur utilisation.
LBO Leverage buy out. Opération d’achat avec effet de levier. Un groupe d’investisseurs (souvent des fonds de private equity) rachète une entreprise, principalement au moyen d’une dette remboursée par les profits futurs réalisés par la société.
Liquidité Capacité d’un agent économique à faire face à ses échéances financières dans le cadre de son activité courante. Pour une banque, avoir suffisamment de liquidités signifie disposer à tout moment de suffisamment de monnaie pour faire face aux retraits éventuels de ses clients, aux remboursements de ses emprunts et aux demandes de règlement des autres banques qui lui demandent d’honorer les chèques et virements de leurs propres clients. Pour faire face à ces demandes, au-delà de ses propres liquidités, une banque peut emprunter sur le marché, ou auprès d’autres banques ou encore auprès de la Banque centrale.
Mark to market Méthode de comptabilisation des titres financiers à leur valeur instantanée de marché (par opposition à la comptabilisation à leur valeur historique).
Notation Ou rating : note attribuée à un État, une entreprise ou un actif titrisé par une agence de notation en fonction de sa solidité financière et destinée à indiquer au marché le spread de taux d’intérêt (prime de risque) qu’il convient d’appliquer.
Normes prudentielles C’est l’équilibre entre d’une part les capitaux propres d’une banque et d’autre part ses engagements, c’est-à-dire les risques qu’elle prend et les crédits qu’elle consent. Le ratio fixe un seuil minimal de 8 % de capitaux propres.
Ratio de capital Ou ratio de solvabilité, ou ratio prudentiel, ou ratio Cooke (ou Mac Donough). Ratio des capitaux propres d’une banque par rapport au total de ses engagements risqués (crédits et actifs divers). Les accords de Bâle fixent son seuil minimal à 8 %.
Risque de contrepartie Risque lié à la disparition (faillite) d’une des parties à une transaction qui ne peut plus payer ou livrer à l’autre ce qu’elle s’était engagée à acheter ou vendre.
Risque de crédit Risque lié au défaut de paiement d’un débiteur sur sa dette.
Risque de liquidité Le risque pour la banque de ne pas pouvoir couvrir ses échéances à court terme. Pour un actif, risque de ne pas pouvoir l’acheter ou le vendre rapidement sur un marché.
Risque de marché Variations de valeur des positions de négociation d’une banque liées à des paramètres de marché.
Risque opérationnel Risques de pertes qui résultent des erreurs du personnel au sens large, des systèmes ou processus, ou des évènements externes, tels que les risques technologiques, les risques climatiques, ou encore les risques environnementaux.
Risque systémique Situation dans laquelle une faillite locale entraîne collatéralement par activation des risques de crédit et des risques de contrepartie une série divergente d’autres faillites, avec menace d’effondrement global du système financier.
Solvabilité Elle traduit la capacité d’un agent économique (entreprise, ménage, banque) à payer ses dettes et à faire face à ses engagements sur le moyen et long terme.
Spread Ecart entre le taux d’un titre de dette et d’un emprunt sans risque (emprunt d’Etat) de même durée.
Structuré (produit) Différenciation d’une ligne de titre obligataire en tranches portant différentes caractéristiques de risque et de rendement et dont certaines sont subordonnées aux autres.
Subprime Prêts hypothécaires à risque et à taux variable, octroyés à des ménages à faibles revenus et peu solvables. Ces crédits s’étaient considérablement développés aux États-Unis depuis le début des années 2000 dans un contexte de forte progression des prix immobiliers. La hausse des taux d’intérêt et le retournement du marché immobilier ont conduit à une crise profonde à partir de l’été 2007, marquée par une multiplication des défauts de paiement des emprunteurs et des pertes bancaires importantes, compte tenu de la chute des valeurs des biens hypothéqués.
Titres super-subordonnés Obligations de durée de vie illimitée dont le remboursement interviendrait, en cas de liquidation de l’émetteur, après celui des autres créanciers et dont le paiement annuel de coupon est conditionné, comme un dividende, par la réalisation d’un bénéfice.
Titrisation Technique financière permettant à une banque ou une institution financière de transférer à des investisseurs des actifs financiers tels que des prêts ou des créances. Ces actifs sont transformés en titres négociables sur les marchés financiers via une société ad hoc créée à cet effet. Cette société achète ces actifs et finance cette acquisition en émettant des titres négociables qui sont souscrits par des investisseurs. La titrisation permet ainsi aux établissements financiers de transférer à des tiers le risque qu’ils ont pris en distribuant des crédits.
US GAAP United States Generally Accepted Accounting Principles. Règles comptables en vigueur aux Etats-Unis qui sont définies par le FASB (Financial Accounting Standards Board).
ABE Autorité bancaire européenne (proposition de la Commission européenne de créer trois nouvelles autorités sectorielles)
ABS Asset-backed securities (titre financier créé par titrisation et adossé à un actif)
ACAM Autorité de contrôle des assurances et mutuelles
AEAPP Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (proposition de la Commission européenne de créer trois nouvelles autorités sectorielles)
AEMF Autorité européenne des marchés financiers (proposition de la Commission européenne de créer trois nouvelles autorités sectorielles)
AES Autorités européennes de surveillance (proposition de la Commission européenne de créer trois nouvelles autorités sectorielles)
AFT Agence France Trésor
AFEP Association française des entreprises privées
AMF Autorité des marchés financiers
APCE Agence pour la création d’entreprises
BCE Banque centrale européenne
BMD Banque multilatérale de développement
BPCE Banques populaires-Caisses d’épargne
BRI Banque des règlements internationaux
CDO Collateralized debt obligations (titre de dette utilisé dans les montages de titrisation)
CDS Credit Default Swap (« contrat d’échange sur risque de défaut »)
CEA Comité des entreprises d’assurance
CEBS Committee of European Banking Supervisors (Comité européen des superviseurs bancaires)
CECAPP Comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles
CECEI Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
CERS Comité européen du risque systémique
CERVM Comité européen des régulateurs de valeurs mobilières
CESR Committee of European Securities Regulators (Comité des régulateurs européens des valeurs mobilières)
CFTC Commodities and Futures Trading Commission (autorité américaine de supervision des dérivés sur marchandises et matières premières)
CGFS Committee on the Global Financial System (comité sur le système financier international)
CGPME Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises
CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
CSF Conseil de stabilité financière (qui a succédé en avril 2009 au Forum de stabilité financière)
DBRS Dominion Bond Rating Services (agence de notation canadienne)
DTCC Depository Trust and Clearing Corporation (organisme coopératif qui domine le segment du règlement-livraison aux États-Unis)
DTS Droits de tirages spéciaux
FASB Financial Accounting Standards Board (organisme américain de normalisation comptable)
FBF Fédération bancaire française
FED Federal Reserve Bank (banque centrale américaine)
FMI Fonds monétaire international
FSA Financial Services Authority (autorité britannique de régulation des services bancaires et financiers)
FSF Forum de stabilité financière
IAS/IFRS International Accounting Standards / International Financial Reporting Standards (normes comptables et d’information financière)
IASB International Accounting Standards Board (organisme de normalisation comptable internationale)
IASCF International Accounting Standards Committee Foundation (fondation à but non lucrative qui exerce la tutelle sur l’IASB)
IDE Investissements directs à l’étranger
LBO Leverage buy-out (opération d’achat avec effet de levier)
LCM Ligne de crédit modulable
MEDEF Mouvement des entreprises de France
OCDE Organisation de coopération et de développement économique
OICV Organisation internationale des commissions de valeurs
OIT Organisation internationale du travail
OMC Organisation mondiale du commerce
OPCVM Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
RoI Return on Investment (retour sur investissement)
SEC Securities and Exchange Commission (régulateur boursier américain)
SESF Système européen de surveillance financière
SFEF Société de financement de l’économie française
SPPE Société de prise de participations de l’État
SPV Special Purpose Vehicle (fonds commun de titrisation)
TARP Troubled Assets Relief Program (plan d’allègement des actifs toxiques)
TSSDI Titres super subordonnés à durée indéterminée
UPA Union professionnelle artisanale
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
Mardi 28 avril 2009
§ M. Georges PAUGET, directeur général du Crédit Agricole SA, président de la Fédération bancaire française ;
§ Mme Valérie OHANNESSIAN, directrice générale adjointe de la Fédération bancaire française ;
§ Mme Céline de COMPREIGNAC, directrice des relations institutionnelles de la Fédération bancaire française.
Mardi 12 mai 2009
§ M. Michel PÉBEREAU, président du conseil d’administration de BNP-Paribas.
Mercredi 10 juin 2009
- Autorité des marchés financiers
§ M. Jean-Pierre JOUYET, président de l’Autorité des marchés financiers ;
§ M. Thierry FRANCQ, secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers ;
- Axa
§ M. Henri de CASTRIES, président du directoire d’Axa ;
§ M. Emmanuel TOUZEAU, directeur du service de presse d’Axa.
Mardi 30 juin 2009
§ Mme Christine LAGARDE, ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi.
Mardi 6 octobre 2009
§ Mme Carole SIROU, présidente de Standard Poor’s France ;
§ M. Bernard de LATTRE, président de Fitch France ;
§ M. Frédéric DREVON, responsable de Moody’s Europe ;
§ M. Jérôme CAZES, directeur général de la Coface.
Mardi 13 octobre 2009
§ M. Gérard RAMEIX, médiateur du crédit ;
§ M. Nicolas JACQUET, directeur général de la médiation du crédit.
Mercredi 21 octobre 2009
§ M. Jean-Pierre FERRET, président du Conseil supérieur du notariat.
Mardi 3 novembre 2009
§ M. Christian NOYER, gouverneur de la Banque de France ;
§ Mme Danièle NOUY, secrétaire générale de la Commission bancaire.
Mardi 10 novembre 2009
§ M. Christian de BOISSIEU, président délégué général du Conseil d’analyse économique.
Mercredi 2 décembre 2009
§ M. Arnaud de BRESSON, directeur général de Paris Europlace ;
§ M. Edouard-François de LENCQUESAING, conseiller spécial de Paris Europlace.
Vendredi 4 décembre 2009 (131)
§ M. David WRIGHT, directeur général adjoint à direction générale du marché intérieur et des services de la Commission européenne ;
§ M. Pierre PONTET, conseiller « banques, marchés financiers et assurance » à la Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne ;
§ MM. Hermann DE CROO et John CROMBEZ, membres de la Commission spéciale du Parlement belge sur la crise bancaire et financière ;
§ M. Etienne PFIMLIN, président du Crédit mutuel ;
§ M. Jean-Marie SANDER, président de la Fédération nationale du Crédit agricole.
Mercredi 9 décembre 2009
§ M. Gérard LESEUL, responsable des relations institutionnelles et internationales du Crédit mutuel ;
§ M. Jeremy ALLAM, chargé des relations institutionnelles et internationales du Crédit mutuel ;
§ M. Alain DAVID, directeur financier exécutif du groupe Banque Populaire-Caisses d’épargne ;
§ Mme Marie-Anne BARBAT-LAYANI, directrice générale adjointe, chargée des affaires bancaires, financières et européennes de la Fédération nationale du crédit agricole ;
§ Mme Delphine BRES, chargée de la coordination des affaires européennes de la Fédération nationale du crédit agricole ;
§ Mme Séverine MESSIER, chargée des relations avec le Parlement de la Fédération nationale du crédit agricole.
1 () La composition de cette mission figure au verso de la présente page.
2 () Jusqu’au 1er juillet 2009.
3 () Anton Brender, Florence Pisani, La crise de la finance globalisée, La Découverte, Collection Repères, Paris, avril 2009, p. 3-4.
4 () Audition du 12 mai 2009.
5 () Rapport d’information (n° 59, session ordinaire de 2009-2010) de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des Finances du Sénat, sur la crise financière et la régulation des marchés, p. 18-19.
6 () Mathieu Pigasse, Gilles Finchelstein, Le monde d’après. Une crise sans précédent, Plon, 2009, p. 31-33.
7 () Audition du 3 novembre 2009.
8 () Mathieu Pigasse, Gilles Finchelstein, op. cit., p. 32.
9 () Un collatéral est un actif transférable qui sert de gage pour le remboursement d’un prêt, dans le cas où le bénéficiaire du prêt ne pourrait pas honorer ses obligations de paiement (situation de défaut de l’emprunteur).
10 () Michel Aglietta, Sandra Rigot, Crise et rénovation de la finance, Odile Jacob, Paris, 2009, p. 36.
11 () Rapport d’information (n° 59, session ordinaire de 2009-2010) de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des Finances du Sénat, sur la crise financière et la régulation des marchés, p. 20.
12 () Jacques Attali, La crise, et après ?, Fayard, 2009, p. 71-72.
13 () Mathieu Pigasse et Gilles Finchelstein, op. cit., p. 28.
14 () Rapport d’information (n° 1798, session 2009-2010) de M. Philippe Houillon sur les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux et des opérateurs de marché, p. 26.
15 () Joseph Stiglitz, Quand le capitalisme perd la tête, Fayard, 2003, p. 31.
16 () Rapport d’information (n° 1798, session 2009-2010) de M. Philippe Houillon sur les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux et des opérateurs de marché, p. 27.
17 () Patrick Artus et Marie-Paule Virard, Globalisation : le pire est à venir, La Découverte, 2008.
18 () Les encours notionnels désignent les montants auxquels les CDS s’appliquent.
19 () Extrait du discours de Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France, « Réflexions sur la crise », Tokyo, 17 novembre 2008.
20 () Banque de France, La crise financière, Documents et débats, février 2009, n° 2.
21 () « Les risques sont-ils correctement évalués par les marchés financiers ? », Chronique de la Revue de la stabilité financière, n° 9, décembre 2006.
22 () Christian Stoffaës, « Glass-Steagall : chasse aux sorcières et régulation bancaire », in « La crise financière – Causes, effets et réformes nécessaires » (Cahiers du Cercle des économistes, avril 2008, p. 35-37).
23 () Christian Stoffaës, op. cit., p. 38.
24 () Un ratio de solvabilité est le rapport entre les fonds propres réglementaires au passif de la banque et la somme de ses actifs pondérés par leur degré de risques. Ce ratio doit être de 8 % au minimum.
25 () Rapport d’information (n° 59, session 2009-2010) de M. Philippe Marini, op. cit., p. 24.
26 () Rapport sur l’organisation et le fonctionnement de la supervision des activités financières en France, établi par Bruno Deletré (janvier 2009), p. 60.
27 () Rapport d’information (n° 59, session 2009-2010) de M. Philippe Marini, op. cit., p. 24.
28 () Jacques Attali, op. cit., p. 78-79.
29 () Banque de France, La crise financière, Documents et débats, février 2009, n° 2, p. 24.
30 () Michel Aglietta, Sandra Rigot, op. cit., p. 43-44.
31 () Ibid.
32 () Christian Stoffaës, art. cit, p. 43.
33 () Les spreads sont des primes de risque.
34 () Extrait du discours de Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France, « Réflexions sur la crise », Tokyo, 17 novembre 2008.
35 () La Tribune, 7 avril 2008.
36 () Six cents milliards de dettes étaient en défaut avec la faillite de la banque Lehman Brothers.
37 () Un accord sur le financement de cet instrument a finalement pu être trouvé le 21 novembre 2008.
38 () Rapport d’information (n° 59, session 2009-2010) de M. Philippe Marini, op. cit., p. 35.
39 () Rapport d’information (n°59, session 2009-2010) de M. Philippe Marini, op. cit., p. 36.
40 () Tels que Bradford & Bingley, Lloyds TSB et Royal Bank of Scotland au Royaume-Uni, Citigroup (à hauteur de 36 %) aux Etats-Unis ou Glitnir en Islande.
41 () Conseil européen de Bruxelles des 15 et 16 octobre 2008, conclusions de la Présidence, 14308/68.
42 () BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, les Caisses d’Epargne, Crédit Mutuel, Banques Populaires et HSBC.
43 () Ce montant a été revu à la baisse à 24 milliards d’euros, lors de l’adoption par la Commission européenne du plan français le 8 décembre 2008.
44 () Ces titres de dette peuvent être des titres subordonnés ou des actions de préférence.
45 () Cour des comptes, Rapport public sur les concours publics aux établissements de crédit : premiers constats, premières recommandations, juin 2009, p.36.
46 () Rapport (n° 1967, session 2009-2010) fait au nom de la commission des Finances sur le projet de loi de finances pour 2010 par le rapporteur général, M. Gilles Carrez, p. 95.
47 () Audition du 3 novembre 2009.
48 () Projet de loi de finances pour 2010, adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 3, de la Constitution par l’Assemblée nationale le 18 décembre 2009 , TA n° 383.
49 () Rapport (n° 1967, session 2009-2010) de M. Gilles Carrez, op. cit., p. 93.
50 () Cour des comptes, Rapport public annuel pour 2009, p. 8.
51 () Ibid.
52 () Ibid.
53 () Ibid.
54 () De 7,65 % au départ et jusqu’à 14,8 % à terme.
55 () Ibid.
56 () Audition du 3 novembre 2009.
57 () Ces émissions d’instruments de fonds propres peuvent être des augmentations de capital sur le marché ou réservées aux salariés, des paiements des dividendes en actions ou bien des émissions de titres hybrides.
58 () Les Échos, Finance, jeudi 15 octobre 2009, p. 29.
59 () Cour des comptes, Rapport public sur les concours publics aux établissements de crédit : premiers constats, premières recommandations, juin 2009, p. 82.
60 () Ibid.
61 () BNP Paribas, Calyon, la Société Générale et Natixis
62 () Audition du 13 octobre 2009.
63 () Rapport d’information (n° 1798, session 2009-2010) de M. Philippe Houillon, op. cit., p. 48.
64 () Rapport d’information (n° 1798, session 2009-2010) de M. Philippe Houillon, op. cit., p. 43.
65 () Ibid.
66 () Ibid.
67 () Ibid.
68 () Ibid.
69 () Rapport d’information (n° 1798, session 2009-2010) de M. Philippe Houillon, op. cit., p. 44.
70 () Ibid.
71 () Rapport d’information (n° 1798, session 2009-2010) de M. Philippe Houillon, op. cit., p. 45.
72 () Montant affecté aux réserves de liquidités du FMI, ce qui porte le total des fonds du FMI à 750 milliards de dollars.
73 () Somme que les gouvernements peuvent utiliser pour augmenter leur réserve monétaire s’ils en font la demande au FMI selon un système de quote-parts.
74 () Aux termes de cet accord tacite, la direction du FMI revenait à un Européen, tandis que la Banque mondiale était dirigée par un Américain.
75 () Compte rendu n° 120 (session 2009-2010) de la commission chargée des Affaires européennes de l’audition, commune avec la commission des Affaires étrangères, de Mme Christine Lagarde, ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi (14 octobre 2009).
76 () Ibid.
77 () Ibid.
78 () Ces amendements ont été intégrés par les directives précitées 2009/27/CE du 7 avril 2009 et 2009/83/CE du 27 juillet 2009.
79 () Audition du 6 octobre 2009.
80 () Les normes internationales d’information financière (IFRS) comme les normes américaines US GAAP* imposent que de plus en plus d’éléments du bilan soient comptabilisés à leur « juste valeur », définie comme « le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale » (« mark-to-market »).
81 () L’IASB est placé sous la tutelle d’une fondation à but non lucratif, l’IASCF, créée en février 2001, immatriculée dans l’Etat du Delaware et composée de 22 membres.
82 () Rapport d’information (n° 59, session ordinaire de 2009-2010) de M. Philippe Marini, op. cit., p.93.
83 () Ibid.
84 () Audition du 30 juin 2009.
85 () Rapport d’information (n° 59, session ordinaire de 2009-2010) de M. Philippe Marini, op. cit., p. 58.
86 () Ibid., p. 57.
87 () Audition du 3 novembre 2009.
88 () Ibid., p. 58.
89 () Audition du 3 novembre 2009.
90 () Dont les caractéristiques ont été définies dans la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
91 () Document de consultation du Comité de Bâle, Renforcer la résilience du secteur bancaire : « Les critères s’appliquent également aux sociétés autres que les sociétés par actions, telles que les mutuelles, institutions coopératives ou caisses d’épargne, en prenant en compte leur constitution spécifique et leur structure juridique. L’application des critères doit préserver la qualité des instruments, avec l’exigence qu’ils soient considérés comme entièrement assimilables à des actions ordinaires en ce qui concerne l’absorption des pertes et qu’ils ne possèdent pas de caractéristiques de nature à affaiblir la situation de la banque pendant les périodes de stress. Les superviseurs échangeront des informations sur la façon dont ils appliquent les critères aux sociétés autres que les sociétés par actions afin d’assurer une mise en œuvre cohérente », décembre 2009, p. 18.
92 () Participations de moins de 50% d’une banque dans une autre banque.
93 () Courrier du CEBS à l’Association européenne des Banques coopératives du 12 février 2008.
94 () Rapport A6-0032/2008 de 2008 sur « les normes internationales d’information financière IFRS et la gouvernance du Conseil des normes comptables internationales (IASB).
95 () Soit les gouverneurs des banques centrales nationales, le président et le vice-président de la BCE, un membre de la Commission européenne, les présidents des trois autorités européennes de surveillance, un représentant de chaque autorité nationale de surveillance compétente, et le président du Comité économique et financier.
96 () Ainsi que le président et le vice-président du conseil général, les présidents des trois autorités européennes, le président du Comité économique et financier et le membre de la Commission européenne.
97 () Il s’agit par ce moyen, selon les termes de l’exposé des motifs de la proposition, d’accroître la « pression morale » sur le destinataire final.
98 () Rapport d’information (n° 59, session ordinaire de 2009-2010) de M. Philippe Marini, op. cit., p. 102.
99 () Rapport d’information (n° 59, session ordinaire de 2009-2010) de M. Philippe Marini, op. cit., p. 50.
100 () Ibid.
101 () Étude intitulée « L’importance systémique des institutions financières » (Borio, Tarashev et Tsatsaronis), publiée dans le bulletin trimestriel de septembre 2009.
102 () Rapport d’information (n° 59, session ordinaire de 2009-2010) de M. Philippe Marini, op. cit., p. 50-51.
103 () Les Échos, mardi 7 octobre 2008.
104 () Rapport d’information (n° 1798, session 2009-2010) de M. Philippe Houillon sur les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux et des opérateurs de marché.
105 () Ibid., p. 73.
106 () Ibid., p. 73.
107 () MM. Patrick Artus, Jean-Paul Betbèze, Christian de Boissieu et Gunther Capelle-Blancard, La crise des subprime, Conseil d’analyse économique, septembre 2008, p.120.
108 () Audition du 6 octobre 2009.
109 () MM. Patrick Artus, Jean-Paul Betbèze, Christian de Boissieu et Gunther Capelle-Blancard, La crise des subprime, Conseil d’analyse économique, septembre 2008, p.123.
110 () MM. Patrick Artus, Jean-Paul Betbèze, Christian de Boissieu et Gunther Capelle-Blancard, op. cit., p.124.
111 () Table ronde sur les agences de notation du 6 octobre 2009, à laquelle étaient présents Standard & Poor’s, Fitch, Moody’s et Coface.
112 () Rapport d’information (n° 59, session ordinaire de 2009-2010) de M. Philippe Marini, op. cit., p. 68.
113 () Ibid.
114 () Ibid., p. 87.
115 () Cour des comptes, Rapport public annuel, 2009, p. 388.
116 () Ibid., p. 406.
117 () Bruno Deletré, Rapport de la mission de réflexion et de propositions sur l’organisation et le fonctionnement de la supervision des activités financières en France, La Documentation française, janvier 2009.
118 () Audition du 3 novembre 2009.
119 () La régulation par objectif témoigne de la primauté désormais accordée à deux grands objectifs : la préservation de la stabilité financière et la protection du consommateur de produits et services financiers (épargne, assurance ou crédit). À ces deux objectifs répond une architecture de la régulation en « deux piliers » (modèle dit « twin peaks ») : d’une part, le contrôle prudentiel des intermédiaires financiers et, d’autre part, le contrôle des marchés, des produits et des règles de conduite.
120 () Cour des comptes, Rapport public annuel, p. 399.
121 () Ces propositions sont les suivantes :
- proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la surveillance macro-prudentielle du système financier et instituant un Comité européen du risque systémique (E 4777) ;
- proposition de décision du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (E 4778) ;
- proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité bancaire européenne (E 4779) ;
- proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (E 4780) ;
- proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne des marchés financiers (E 4781).
122 () Le Comité européen des régulateurs de valeurs mobilières (CERVM), le Comité européen des superviseurs bancaires (CEBS) et le Comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles (CECAPP).
123 () Source : rapport d’information (n° 59, session ordinaire de 2009-2010) de M. Philippe Marini, op. cit., p. 77-79.
124 () Soit « lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans la Communauté ».
125 () Par exemple, si des mesures ou l’absence de mesures prises par une autorité de surveillance nuit fortement à la capacité d’une autre autorité de protéger l’intérêt des dépositaires, des assurés, des investisseurs ou des clients de services financiers.
126 () Si un Etat membre estime qu’une décision d’une AES empiète sur ses compétences budgétaires, il peut informer l’autorité et la Commission de sa décision de ne pas appliquer cette décision. Si l’AES la maintient, l’Etat membre peut porter l’affaire devant le Conseil (avec effet suspensif), qui dans un délai de deux mois décide à la majorité qualifiée de maintenir ou annuler cette décision. Une procédure accélérée est prévue s’il s’agit d’une mesure d’urgence.
127 () Soit le président de l’AES concernée (sans droit de vote), le directeur de chaque autorité nationale de surveillance concernée, un représentant de la Commission européenne (sans droit de vote), et un représentant de chacune de deux autres AES (sans droit de vote).
128 () Pour leur première année de fonctionnement (2011), le budget prévisionnel des autorités est ainsi évalué à 13,01 millions d’euros pour l’ABE, 13,67 millions d’euros pour l’AEMF et 10,59 millions d’euros pour l’AEAPP. Les effectifs prévisionnels de l’ABE et de l’AEAPP seront de 40 en 2011 puis 90 en 2014, et ceux de l’AEMF de 43 en 2011 et 89 en 2014.
129 () L’Autorité bancaire européenne et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles peuvent en revanche prendre l’initiative de publier un avis sur une évaluation prudentielle d’une opération de fusion ou acquisition réalisée par toute autorité d’un État membre.
130 () Rapport d’information (n° 59, session ordinaire de 2009-2010) de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des Finances du Sénat, sur la crise financière et la régulation des marchés, p. 80.
131 () Déplacement à Bruxelles de la mission.
© Assemblée nationale