______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 février 2010.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
en conclusion des travaux d’une mission d’information constituée le 28 janvier 2009,
sur la situation au Soudan et la question du Darfour
et présenté par
MM. Serge JANQUIN et Patrick LABAUNE
Députés
___
INTRODUCTION 9
I – LE SOUDAN EXISTE-T-IL ? 13
A. – DIVERSITÉS DU SOUDAN 15
1) Un patchwork africain 15
a) Une mosaïque ethnique 15
b) Des populations très mobiles 17
2) Des territoires pour un Etat ? 19
a) Le Soudan, terre d’asile () 20
b) La question sudiste,… 21
c) … le cas du Darfour,… 23
d) … et la nature de l’Etat 26
3) La très inégale répartition des richesses 28
a) Le Soudan, géant parmi les plus pauvres 28
b) La part du dérèglement climatique 29
c) Des ressources importantes 31
d) Une domination sans partage de Khartoum 34
B. – LE SOUDAN CONTEMPORAIN : D’UN COUP D’ETAT À L’AUTRE 38
a) Du mahdisme fondateur… 40
b) … à la sharî’a et au jihad 42
3) Une démocratie impossible ? 44
a) Une réelle tradition démocratique 45
b) L’islamisme en politique 46
c) Les autres formations politiques 48
C. – LE SOUDAN, OBJET DE TOUTES LES ATTENTIONS 50
1) « Avec de tels amis… » 51
a) L’Egypte 51
b) Les frères ennemis : la Libye et le Tchad 54
c) A l’Est : l’Ethiopie et l’Erythrée 56
d) Le Mikado régional : déstabilisation et interactions 58
2) Le jeu des grandes puissances 59
a) La Chine et l’Asie : Sus au pétrole ! 59
b) Les Etats-Unis… 62
c) … et le rôle d’Israël 65
3) Les troublantes affinités de la France et du Soudan 66
a) Le Soudan et la francophonie 66
b) La lune de miel franco-soudanaise 68
c) Les années 2000 : les amours déçues 70
II – KHARTOUM ET SES PÉRIPHÉRIES : UNE TRAGIQUE HISTOIRE SANS FIN 73
Chronologie : le conflit du Sud Soudan 73
A – LA PLUS LONGUE GUERRE CIVILE AFRICAINE : LE CONFLIT NORD-SUD 74
1) Les fondements du conflit 75
a) La question de la régionalisation 75
b) Le facteur religieux et culturel 78
c) La question des ressources 80
2) Les positionnements politiques des mouvement sudistes 83
a) D’une approche globale dans le cadre d’un Soudan uni… 83
b) … à la tentation séparatiste 85
3) Avant toute chose : une guerre du pétrole 86
a) Un conflit civil qui s’abreuve au pétrole… 86
b) La guerre déclarée aux populations 89
B – LES AUTRES CONFLITS AUX MARCHES DU SOUDAN 90
1) Le conflit de l’Est 90
a) Des causes qui s’apparentent à celles à l’origine des autres conflits soudanais 91
b) Un conflit moins violent… 92
c) … Et plus aisément résolu 93
2) La guerre des Monts Nouba 93
a) La toile de fond 94
b) De nombreux traits communs avec les autres conflits soudanais 94
c) Un génocide avant l’heure ? 96
d) La résolution du conflit 98
C – LA CRISE DU DARFOUR 100
a) Un contexte identique à celui des autres conflits soudanais 102
b) La terre disputée 104
c) La lente dégradation de la situation locale 105
d) Un conflit « opportuniste » 107
2) Les forces en présence 109
a) Des mouvements rebelles divisés 109
b) Forces gouvernementales et milices janjawids 111
3) Le déroulement du conflit 112
a) Une politique de la terre brûlée 113
b) L’évolution du conflit et le bilan de la terreur 114
c) Les interférences étrangères 116
d) Les raisons d’une telle violence 117
III – LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE ET LE SOUDAN 121
A – LA FIN DE LA GUERRE CIVILE NORD-SUD : UNE AFFAIRE DE DIPLOMATIES BILATÉRALES 121
1) L’entrée en lice des Etats-Unis 121
a) Quand Khartoum était la plaque tournante du terrorisme international 122
b) L’art de se refaire une virginité 123
2) Les parrainages internationaux du processus de paix 125
a) Des médiations pas toujours désintéressées 126
b) Les premiers pas du sénateur Danforth 128
3) Le « Comprehensive Peace Agreement » 130
a) La phase finale des négociations de Machakos 131
b) Les dispositions du Protocole de Machakos 133
c) Les protocoles additionnels : les détails du CPA 135
4) Le Comprehensive Peace Agreement est-il viable ? 138
a) Les motivations de Khartoum 138
b) La fragilité du CPA : le germe de la partition 140
B – LA LONGUE LÉTHARGIE DES NATIONS UNIES 142
1) Les préoccupations de l’Assemblée générale pour le Soudan 143
a) Traiter l’urgence humanitaire 143
b) La prise en compte de la situation des droits de l’Homme 144
2) La Commission des droits de l’homme et les conclusions des rapporteurs spéciaux 146
3) Le silence assourdissant du Conseil de sécurité 147
4) Le réveil : la communauté internationale enfin concernée 148
a) Le soulagement 148
b) Dérangeant Darfour… 150
c) L’emballement du Conseil de sécurité 152
C – UN GÉNOCIDE AU DARFOUR ? 154
1) Quand la société civile impose son tempo 154
a) Les mésaventures de Talisman 154
b) « Save Darfur », Hollywood et les chiffres du génocide 156
c) De Bush à Obama, les réactions diplomatiques 159
2) « Génocide » ou crimes de guerre et crimes contre l’humanité ? 161
a) Les définitions du droit international 161
b) Les conclusions de la Commission Cassese 164
c) Les incidences de la controverse 167
IV – COMMENT RÉUSSIR LA PAIX AU DARFOUR ? 169
A – INTROUVABLE PAIX 170
1) La cessation des hostilités : un processus lent et cahotant 171
a) Des cessez-le-feu aux missions de paix 171
b) Les omissions des pourparlers d’Abuja 172
c) De la MUAS à la MINUAD, le bras de fer diplomatique entre le Soudan et la communauté internationale 173
d) Des opérations complexes et difficiles 175
2) L’échec du Darfur Peace Agreement, DPA 177
a) Une occasion gâchée 178
b) Comment rebondir sur un échec ? 180
B – LA JUSTICE OU LA PAIX ? LA JUSTICE ET LA PAIX 182
1) La procédure devant la Cour pénale internationale : un impératif de justice 182
a) L’enquête du procureur Luis Moreno Ocampo 183
b) L’affaire « Le procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir » 185
c) La décision de la chambre préliminaire I et ses suites 187
2) Le mandat d’arrêt contre Al-Bachir : un risque pour la paix ? 188
a) Les réactions : provocations et défis 189
b) Une justice internationale à deux vitesses ? 191
c) La justice contre la paix ?... 193
3) Jeter un pont entre justice et paix : Le Rapport Mbeki 195
a) L’insuffisance de la procédure devant la CPI 196
b) La nécessité d’articuler justice, paix et réconciliation 197
C – LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE EN MAL DE STRATÉGIE 200
1) Les rebelles veulent-ils la paix ? 201
a) La division des forces rebelles : état des lieux 201
b) D’intransigeance en surenchères 203
2) Comment surmonter la division des rebelles ? 205
a) Les Nations Unies et l'Union africaine main dans la main, mais jusqu’où ? 206
b) L’impatience des grands acteurs 207
3) Le conflit du Darfour, un rôle pour la France sur le théâtre soudanais 210
a) La toile de fond tchadienne 210
b) Le rôle joué par la France 212
V – L’AVENIR DU SOUDAN SE JOUE AU SUD 213
A – PEUT-ON ENCORE ÉVITER LA PARTITION DU SOUDAN ? 213
1) Le Comprehensive Peace Agreement, Janus juridique 213
a) La paix « globale » : une première illusion 213
b) L’attractivité de l’unité : une seconde illusion 216
c) Le coût des illusions 217
2) Les occasions perdues 218
a) L’inapplication du CPA durant la période transitoire 218
b) Les données objectives : le rapport de la Commission d’évaluation et de contrôle 221
c) La communauté internationale et ses engagements 222
d) L’« effet Darfour » 224
3) Le différend d’Abyei 226
a) Abyei, un point névralgique 227
b) La résolution du différend par la Cour permanente d’arbitrage et ses conséquences 228
B – LE SUD SOUDAN INDÉPENDANT SERA-T-IL VIABLE ? 230
a) Les assises fragiles du développement du Sud Soudan 233
b) La conjonction de la faible institutionnalisation et de la corruption 235
3) Le Sud Soudan est-il au bord de la guerre civile ? 236
a) L’impossible désarmement des milices 236
b) Incidences des tensions interethniques 238
c) Le risque d’une guerre entre sudistes ? 239
C – UNE COURSE CONTRE LA MONTRE 241
1) Le temps perdu se rattrape-t-il jamais ? 241
a) Les avancées récentes 241
b) La situation sur le terrain et l’état d’esprit de l’opinion sudiste 242
c) Un jeu « perdant-perdant » 244
d) Et si le CPA n’intéressait personne ? 246
2) La dynamique enclenchée d’une crise majeure 249
a) Un sentiment soudain d’urgence 249
b) La perspective d’un face à face tendu entre deux Etats faillis 251
c) Les possibles dommages collatéraux 253
CONCLUSION 255
EXAMEN EN COMMISSION 259
ANNEXES 265
Liste des personnes rencontrées par la mission 267
Chronologie générale du Soudan 273
Conclusion du Conseil européen du 15 septembre 2009 277
Accord de N’Djamena sur la normalisation des relations entre le Tchad et le Soudan 279
Mesdames, Messieurs,
Premier en 2006 et 2007 ; deuxième en 2008 ; troisième en 2009. A l’évidence, le Soudan occupe toujours une place de choix à l’« Index des Etats faillis » que publie chaque année la revue Foreign Policy.
Ce simple indicateur suffit à caractériser la situation du pays et à mettre en évidence la gravité des problèmes que le Soudan affronte, année après année : Gigantesque, potentiellement riche mais néanmoins parmi les plus pauvres ; Complexe, stratégiquement situé, traversé par le Nil blanc et du Nil bleu qui se rejoignent à Khartoum, mais écartelé entre de violentes forces centrifuges. Le Soudan, déchiré au long de son histoire par d’interminables et terribles conflits internes, méritait assurément que la Commission des affaires étrangères s’y intéressât, d’autant que ce qui s’y joue en ce moment est crucial, tant pour son devenir que pour celui de l’Afrique.
Ces dernières années, le conflit du Darfour a brutalement mis le Soudan sous les feux de l’actualité. Bouleversée par la révélation de l’ampleur des atrocités qui ont été commises aux confins du pays, la communauté internationale s’est fortement mobilisée au point d’y déployer la plus grande mission que les Nations Unies aient jamais engagée et de lancer une procédure devant la Cour pénale internationale qui vaut aujourd’hui au Soudan d’être le seul pays dont le chef d’État en exercice est sous mandat d’arrêt international. Crimes de guerre, crimes contre l’humanité, voire génocide, sont les accusations portées contre les autorités soudanaises qui ont placé ce pays au ban des nations.
Pour autant, ce n’est pas sous un angle exclusivement humanitaire que vos rapporteurs ont souhaité traiter de la situation du Soudan.
Car ce qui s’est passé au Darfour est loin d’être inédit dans ce pays. Tout au contraire : ce conflit n’est en fait que le dernier en date des épisodes d’une histoire sans fin, qui se répète de tragédie en tragédie. Les centaines de milliers de morts et de déplacés que cette crise a provoqués ont malheureusement été précédés de centaines de milliers d’autres, de millions d’autres victimes au cours de guerres successives qui ont ruiné les différentes régions du Soudan.
En d’autres termes, cette réalité justifiait que le regard porté sur le Soudan soit global pour espérer en appréhender toute la complexité. Il était donc essentiel de mettre en lumière que le gouvernement central, monopolisé depuis toujours par quelques tribus arabes de la vallée du Nil, s’applique à laisser hors du développement les périphéries du pays, à en déposséder de leurs terres et de leurs cultures les populations qui s’y trouvent. Il fallait aussi montrer la volonté imperturbable de mener à bien l’islamisation de la société soudanaise, alors même qu’une grande partie de la population n’est pas musulmane. Il fallait enfin prendre conscience d’une réalité : depuis plus de vingt ans, le gouvernement soudanais ne réagit jamais autrement que par la barbarie à la résistance des populations qu’il marginalise.
Mais le Soudan, au carrefour de tant de chemins et d’intérêts, est aussi l’objet de toutes les convoitises. Son histoire récente est en effet marquée par les prétentions fortes de la plupart de ses voisins immédiats qui n’ont cessé de s’immiscer dans ses rivalités et tensions internes. A son tour, la découverte de pétrole dans le sous-sol soudanais a avivé l’intérêt des grandes puissances. Cet aspect complémentaire et essentiel devait aussi faire partie de la grille d’analyse.
Vos rapporteurs ont tenté de mettre en perspective l’ensemble de ces éléments pour pouvoir analyser les causes des crises soudanaises, comprendre ce pays. Pendant près d’un an, ils ont rencontrés plus d’une centaine d’interlocuteurs, acteurs ou observateurs, universitaires, diplomates, responsables d’ONG et personnalités politiques, d’hier et d’aujourd’hui, à Paris, La Haye, Genève ou Bruxelles, mais aussi à Addis Abeba, Doha, Khartoum, Juba et El Fasher.
Au terme de ce périple, leurs conclusions ne sont pas optimistes. Le Soudan est aujourd’hui dans une situation particulièrement grave et la persistance des causes qui sont à l’origine de ces multiples conflits ne permet pas d’envisager qu’elle s’améliore durablement : les négociations de paix piétinent à régler le conflit du Darfour, et des échéances d’une importance majeure attendent désormais le Soudan au bord de la partition, qui jusqu’à aujourd’hui ne s’y est pas préparé comme il aurait dû. Il est désormais de la responsabilité de la communauté internationale, au chevet du Soudan depuis longtemps, de l’aider dès à présent à franchir ces obstacles.
La stabilité de l’Afrique en dépend.
Remerciements
Vos rapporteurs souhaitent adresser leurs plus sincères remerciements à M. Jacques Chirac, ancien président de la république et M. Abdou Diouf, ancien président de la république du Sénégal, ainsi qu’aux différentes personnalités et experts qui les ont reçus au cours de leur mission et leur ont apporté de très précieux éclairages sur la situation complexe du Soudan.
Ils remercient chaleureusement les diplomates qui les ont assistés dans l’organisation de leurs différents déplacements au cours de cette mission :
o Son Exc. M. Patrick Nicoloso, ambassadeur de France au Soudan et M. Othman El Kachtoul, deuxième conseiller.
o Son Exc. M. Jean-Christophe Belliard, ambassadeur de France en Ethiopie et M. Romain Vuillaume, premier conseiller.
o Son Exc. M. Jean-François Blarel, ambassadeur de France aux Pays-Bas et M. Patrick Comoy, Premier secrétaire.
o Son Exc. M. Jean-Baptiste Mattéi, ambassadeur, représentant permanent de la France auprès des Nations unies et des organisations internationales en Suisse et Mme Caroline Grandjean, Conseiller humanitaire.
o Son Exc. M. Gilles Bonnaud, ambassadeur de France au Qatar et M. Issa Maraut, envoyé spécial pour le processus de paix au Darfour.
o M. Nicolas Croizer, premier secrétaire, ambassade de France au Royaume Uni.
Dixième pays au monde par la superficie, plus vaste des pays d’Afrique et du monde arabe, le Soudan couvre une surface de quelque 2,5 millions de kilomètres carrés, soit près du dixième de la surface du continent. Il partage des frontières avec neuf pays : l’Egypte au nord, la Libye au nord ouest, le Tchad, à l’ouest, la République centrafricaine au sud-ouest, la République démocratique du Congo, l’Ouganda et le Kenya au sud, l’Ethiopie et l’Erythrée à l’est, et dispose d’une importante façade maritime sur la Mer rouge, de 720 kilomètres de long.
En d’autres termes, le Soudan, géographiquement situé à la charnière des mondes noir et arabe, a depuis toujours fait le lien entre Afrique de l’ouest, Afrique centrale et Afrique septentrionale - ne serait-ce que par ses routes caravanières du désert de Nubie ou de pèlerinage vers La Mecque via la Mer rouge -, entre désert au nord, et forêt tropicale au sud.
Le pays est aujourd’hui officiellement (1) peuplé d’un peu plus de 39 millions d’habitants, dont quelque 40 % vivent en zone urbaine. Il s’agit d’une population jeune, situation classique des pays en développement, dont 40 % sont âgés de moins de 15 ans (2).
Si l’islam est la religion majoritaire, notamment au nord, l’animisme et le christianisme sont fortement présents, en particulier au sud. Immense pays de plaines pour l’essentiel, aux massifs montagneux peu nombreux mais néanmoins élevés, irrigué du sud au nord par le Nil blanc et le Nil bleu qui s’unissent à Khartoum, le Soudan est surtout un pays de particularismes ethniques forts qui ont profondément marqué son histoire. Ils expliquent sans doute pour partie une vie politique tourmentée depuis l’indépendance jusqu’à nos jours, à tel point que les différents conflits internes, que ce soit celui entre le Nord et le Sud, qui s’est achevé en 2005, ou celui du Darfour, ont souvent été décrits en termes ethniques, voire raciaux.
A cela s’ajoute enfin le fait que les richesses naturelles du Soudan ne sont pas étrangères aux convoitises : ses ambitieux et entreprenants voisins, de même que les grandes puissances, y sont présents ou souhaitent l’être.
Un regard rapide, pour partie historique, sur ce qui constitue l’identité du Soudan est par conséquent utile.
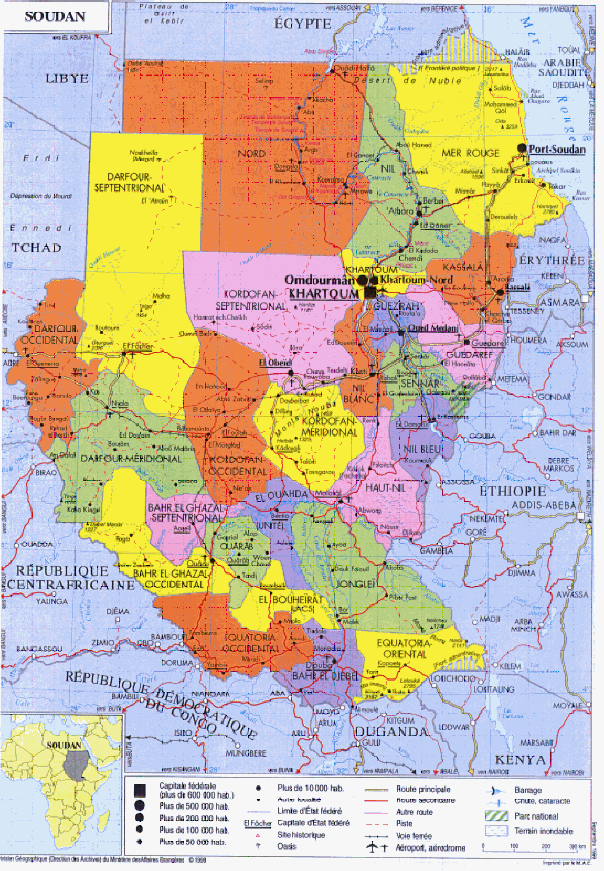
Quels que soient les critères retenus, le Soudan apparaît comme un pays multiple, peut-être plus marqué par ce qui fait sa diversité que par ce qui pourrait constituer son unité, au point que les éléments centrifuges semblent même dominer. Un rapide survol montre que des questions religieuses, ethniques, culturelles, notamment, voire même géographiques, divisent en effet le Soudan. Vos rapporteurs se sont plus particulièrement intéressés à ceux de ces particularismes qui apparaissent comme les plus déterminants dans l’analyse des crises que connaît le Soudan, qui d’une certaine manière, n’est pas éloigné en cela de nombreux autres pays dont les contours résultent aussi de l’héritage du colonialisme.
Schématiquement, la population du Soudan se répartit entre Africains, pour les deux tiers, et Arabes, pour un tiers. 70 % des soudanais sont musulmans, les traditions animistes sont pratiquées par le reste de la population, dont un dixième environ est chrétienne. L’une des principales caractéristiques du Soudan réside dans sa très grande diversité ethnique (3) : ce sont en effet 57 groupes ethniques qui coexistent sur son territoire, répartis en quelque 570 tribus différentes. En d’autres termes, le panorama humain du Soudan est fort complexe, qui entremêle critères linguistiques – près de 180 langues et dialectes sont parlés (4) -, culturels et religieux, modes de vie, pratiques et comportements socioéconomiques divers. La mixité des populations soudanaises est donc forte, qui mêle ethnies et territoires ; ainsi, comme on a pu la faire remarquer, « peu d’Arabes soudanais échappent à une origine mêlée : arabe, nubienne et africaine. » (5) Ce panorama est d’autant plus complexe que la répartition territoriale entre les groupes ethniques, voire les tribus, n’a cessé d’évoluer au fil du temps et s’est même révélée être d’une grande instabilité ces dernières décennies, à mesure que des changements, en partie d’ordre écologique, imposaient des bouleversements aux ancestrales pratiques agropastorales.
Schématiquement, le groupe des populations arabes occupe à l’origine plutôt le nord du pays, considéré, notamment au cours de la période coloniale, comme une entité culturelle arabo-musulmane, tandis que le sud du Soudan est à prédominance noire et animiste. Les populations arabes sont divisées en nombreuses tribus, dont certaines, tels les Ja’aliyin, sont principalement installées sur les territoires initialement nubiens, qui marquent la frontière avec l’Egypte, et composées d’agriculteurs sédentaires, tandis que d’autres, tels les Juhayna, pratiquent essentiellement le nomadisme de bovins ou chamelier, et peuplent plutôt le Kordofan, le Darfour, ainsi que les régions de l’Est et du Nil bleu.
Au-delà de ces premières distinctions entre nomades et sédentaires arabes, il faut signaler que ces différents groupes, dont les principaux sont les Baggara et les Kababish, ont leurs particularismes et se distinguent par une organisation sociale, politique ou économique propre.
Néanmoins, si les populations arabes, initialement du nord, ont migré comme on le voit vers d’autres territoires comme le Darfour, inversement, le Nord apparaît aussi peuplé de nombreuses ethnies notamment de Nubiens, de Beja, de Nouba, qui, bien qu’également islamisées et parlant arabe, ne sont pour autant pas arabes.
Il en est de même du Darfour où vivent de nombreuses tribus non arabes, dont les Four au premier chef, les Masalit, les Zaghawa ou les Bidayat, pour ne citer que les groupes les plus importants. Egalement islamisés, utilisant aussi l’arabe comme langue véhiculaire, ils ont leur culture propre.
Au Sud Soudan, où trois grandes zones de peuplements sont généralement identifiées, - le centre, l’est et l’ouest -, la diversité ethnique est tout aussi grande. Le groupe le plus important, non seulement du Sud mais aussi du Soudan est celui des Dinka, du centre, qui occupent un large territoire jusqu’au Kordofan. Les Nuer, les Shilluk constituent les autres ethnies principales du Sud.
Ce très bref survol de quelques éléments de la réalité ethnique du Soudan, qui pourrait être complété d’une réflexion sur les incidences de l’esclavagisme, suffit néanmoins à traduire une très grande diversité socioculturelle : ce pays est une véritable mosaïque de populations aux identités fortes, dont la démographie, les langues, les cultures, les modes de vie, les conditions socioéconomiques sont profondément diverses et variées. C’est ainsi qu’on a pu parler de processus parallèles de « soudanisation » des arabes et d’« arabisation » des noirs (6). On fera simplement remarquer ici que la question d’une identité soudanaise, d’une nation soudanaise ne peut que se trouver sérieusement affectée d’une telle diversité. Ainsi, deux personnalités aussi différentes et éloignées que peuvent l’être Hassan al-Turabi(7), chantre de l’islamisme radical, et Luka Tombekan Monoja (8), ministre des affaires du cabinet, – i.e. Premier ministre –, du gouvernement du Sud Soudan, (GoSS), rencontrées par vos rapporteurs, considèrent qu’il ne peut y avoir de nation soudanaise, qu’il s’agit d’un territoire sans conscience nationale. A cet égard, la seule question linguistique s’est révélée d’une importance cruciale dans l’histoire récente : c’est précisément la politique d’arabisation et d’islamisation forcée menée par Khartoum qui a entraîné, entre autres effets, la rébellion sudiste pour la défense de ses particularismes et de son identité africaine ; raison pour laquelle le premier accord de paix, signé en 1972, contenait des dispositions précises sur cette question et stipulait expressément que l’arabe était la langue officielle du Soudan tout en reconnaissant l’anglais comme langue principale du sud (9).
b) Des populations très mobiles
Le second élément qu’il est nécessaire de relever touche à la forte mobilité, volontaire ou forcée, des populations soudanaises, et consécutivement, leur très grande mixité. L’histoire récente du Soudan a contraint de larges parts de la population à se déplacer et à s’installer dans d’autres régions du pays, entraînant de forts brassages. Il s’agit là d’un fait essentiel et de très grande ampleur : que ce soit pour des raisons économiques ou pour fuir les combats, des centaines de milliers et même des millions de personnes ont dû quitter leurs régions d’origine ces dernières décennies.
Ainsi, la mécanisation de l’agriculture dans le centre du Soudan a-t-elle non seulement entraîné le déplacement d’ouvriers agricoles vers des zones irriguées mais aussi celui de populations de nomades vers d’autres horizons, notamment vers le sud, où elles se sont installées au contact de populations d’éleveurs ou d’agriculteurs, avec lesquelles elles n’avaient traditionnellement pas de liens et dont elles ne partageaient pas les modes de vie. C’est le cas tout particulièrement de l’Est du Soudan, dans la province de Kassala, sur la frontière Erythréenne, dans laquelle les progrès de la mécanisation de l’agriculture intensive au cours de la seconde moitié du XXe siècle ont bouleversé, dès les années 1960, l’écologie et l’économie régionales. Les effets en ont été considérables, entraînant déforestation massive, dégradation de l’environnement, assèchement, marginalisation et paupérisation des pasteurs, dans une zone dans laquelle l’absence de structures administratives empêchait la prise en compte des besoins sociaux, décuplés par ailleurs par l’afflux massif de réfugiés Ethiopiens, qu’on a estimés à quelque 750 000 personnes (10). De même, dès l’indépendance, une importante migration économique « classique » de travailleurs avait déjà commencé du Sud Soudan ou du Darfour vers les grandes villes du pays, et notamment Khartoum.
En second lieu, les périodes de grave sécheresse et de famine, qui sont intervenues dès la fin des années 1960 et au cours des années 1980, indépendamment du grand nombre de victimes qu’elles ont provoquées, ont également été un facteur à la fois de sédentarisation de certaines populations mais aussi de mobilité très important : faute de pâtures et de ressources en eau suffisantes, des tribus de pasteurs ont été amenées à investir de manière permanente des terres qu’autrefois elles n’occupaient que temporairement lors des transhumances saisonnières. D’amples mouvements de populations se sont pour ces raisons produits du Darfour et du Kordofan vers le sud. On a ainsi pu souligner « l’incroyable vitalité de cet espace migratoire » (11) au cours de cette période, comme réponse à l’ensemble des défis rencontrés.
D’un autre côté, le conflit entre le Nord et le Sud a entraîné à son tour d’épouvantables déplacements de populations. On estime ainsi que ces mouvements vers les villes du Nord ou les pays voisins, seul moyen d’échapper à la mort par famine ou maladie pour les populations sudistes, ont touché entre un tiers et la moitié de la population du Sud Soudan en 1988 (12). Ce que confirment les données réunies par les Nations Unies au début des années 1990, pour lesquelles les migrations internes ont concerné plusieurs millions d’habitants du Sud Soudan vers le Kordofan et le Darfour : en 1993, le rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme de l’ONU, établissait ainsi que « 5 millions de Soudanais ont été déplacés à l’intérieur de leur propre pays par le conflit et par des catastrophes naturelles » (13), auxquels s’ajoutaient 500 000 réfugiés dans les pays voisins.
Aujourd’hui encore, cette réalité perdure : selon les données fournies par le PNUD, dans son dernier Indice de développement humain, en 2006 le total des populations déplacées à l’intérieur du pays s’élève à 5,355 millions (14). En outre, selon les résultats du dernier recensement, 520 000 Sudistes vivraient dans le Nord, la population du Sud étant désormais officiellement de 8,2 millions d’habitants, soit 21 % du total national.
On conçoit l’ampleur des bouleversements que de tels déplacements ont pu entraîner dans la société soudanaise et l’augmentation des tensions interethniques que la raréfaction et le partage obligé des terres utiles résiduelles a pu susciter. On verra plus loin que, précisément, aux conflits civils s’ajoutent des dimensions tribales ou ethniques non négligeables, que ce soit en ce qui concerne le Darfour ou la guerre entre le Nord et le Sud.
Cela étant, pour avoir été aggravés par les circonstances récentes, ces phénomènes de migrations internes n’en sont pas moins fort anciens. S’intéressant plus particulièrement au cas du Darfour, Gérard Prunier note ainsi que « la population du Darfour est ethniquement incroyablement complexe et consiste en un ensemble de tribus tant "arabes" qu’"africaines" étroitement enchevêtrées. Le paysage ethnique est d’autant plus complexe que certaines tribus "africaines" ont abandonné leur langue pour adopter l’arabe tandis que d’autres sont installées dans une diglossie structurelle et que d’autres encore ont pleinement conservé leur idiome tribal. » (15) Il précise que ce fait résulte de mouvements de fond historiques, au terme desquels le Darfour « a été peuplé par des mouvements migratoires surtout venus de l’ouest et de l’est », facilités par un relief naturel et de bonnes conditions, à savoir le désert au nord, vide de population, et le sud, offrant tout à la fois pluviosité abondante et terres nourricières. De telle sorte que la population du Darfour s’est constituée de vagues successives de migrations, notamment arabes, dont les plus anciennes remontent au XIVe siècle, puis au XVIIe et enfin au XVIIIe siècle. On verra toute l’importance de ces précisions lors de la présentation du conflit du Darfour, souvent analysé, sans doute de manière excessive, en terme de question ethnique entre populations arabes et noires.
2) Des territoires pour un Etat ?
Inévitablement, ces particularismes ethniques, culturels et sociaux en recouvrent et traduisent d’autres, qui touchent au développement institutionnel du pays.
Si le Soudan a acquis son indépendance le 1er janvier 1956, la construction de ce qui allait devenir l’Etat soudanais contemporain, dans des frontières qui, à la différence de nombreux Etats africains, ne résultent pas de la conquête européenne et n’ont, pour le moment, pas été modifiées, est une donnée qui n’allait pas forcément de soi. L’histoire des régions qui composent aujourd’hui le Soudan est en effet telle que le territoire aurait pu être bien différent, compte tenu précisément des spécificités de périphéries récemment, et peut-être pas encore définitivement, intégrées. Pour illustrer cette réalité, vos rapporteurs se sont plus particulièrement intéressés au sud et au Darfour qui sont au cœur des conflits récents. Cela étant, des facteurs exogènes doivent aussi être mentionnés car la présence de réfugiés étrangers sur le sol soudanais ne doit pas non plus être occultée.
a) Le Soudan, terre d’asile (16)
Le premier élément qui mérite d’être souligné porte sur les mouvements de populations depuis les pays riverains du Soudan. Historiquement, le Soudan est non seulement une terre de passage, comme on l’a noté, mais aussi d’accueil. De tous temps, les réfugiés en provenance des environs en proie à des crises politiques violentes ont afflué au Soudan, y compris, alors même que ce pays lui-même connaissait des troubles.
Sans remonter aux siècles passés, un regard sur la période contemporaine permet de juger de l’ampleur du phénomène. Ce sont surtout les régions périphériques du Soudan, et tout particulièrement le Sud, qui ont reçu les réfugiés en provenance des pays voisins. Ainsi, le Sud accueillit dans les années 1960 des milliers de Congolais fuyant les troubles du Katanga, et qui près de trente ans plus tard, étaient en grande partie toujours sur place. Pour sa part, le très long conflit entre l’Erythrée et l’Ethiopie a provoqué entre les années 1970 et 1980 l’afflux de centaines de milliers d’Erythréens au Soudan, estimés à plus de 400 000 en 1986. Les affrontements qui ont suivi la chute de l’empereur Hailé Sélassié ont entraîné l’exode vers le Soudan de plus de 300 000 Ethiopiens. A l’ouest, la tension récurrente que connaît le Tchad depuis des lustres, dans laquelle se mêlent effets de la sécheresse et rivalités internes aux factions en lutte pour la prise du pouvoir central, avaient entraîné plus de 120 000 Tchadiens à migrer vers le Soudan au milieu des années 1980. Enfin, les Ougandais qui avaient dû fuir la terreur des régimes d’Idi Amin Dada et de Milton Obote pour se réfugier au sud ont été jusqu’à 350 000. En 1990, le nombre total de réfugiés depuis l’étranger était estimé à 950 000.
Ces quelques données suffisent à entrevoir l’ampleur des défis auxquels la société et l’Etat soudanais doivent faire face depuis des décennies, dans la mesure où, confrontés eux-mêmes à de très graves difficultés internes, d’ordre naturel ou politique, ils ont dû accueillir dans les conditions que l’on imagine, des centaines de milliers de réfugiés qui se s’installés durablement. Sans qu’il soit ici nécessaire d’entrer dans les détails, on mentionnera l’ensemble des bouleversements induits sur les communautés d’accueil dont certaines ont hébergé des réfugiés représentant jusqu’au tiers de leur population, en termes de surpopulation de certaines régions, au Sud et à l’Est en premier lieu, d’incidences sur le niveau de vie, les infrastructures, la couverture des besoins sanitaires et sociaux, l’approvisionnements en nourriture, l’accès aux services de base dans les villages et cités, etc. De même, les incidences en termes culturels, tant pour les communautés soudanaises que pour les communautés réfugiées sont indubitablement fortes (17).
Si l’on s’en tient aux seuls aspects « internes » au Soudan, il faut tout d’abord souligner que la séparation entre nord et sud est géographique et écologique, grossièrement à hauteur du 10e parallèle. Longtemps, le Sud, qui couvre quelque 650 000 km2, est resté physiquement isolé, séparé du Nord par une vaste zone de marécages, et véritable « terra incognita » pour les nordistes qui n’y faisaient que des incursions en quête de bétail et d’esclaves, l’esclavage étant un élément clef de l’économie des agriculteurs et nomades du Nord Soudan. Les relations entre les populations noires et arabes se sont limitées à ces « échanges » jusqu’au milieu du XIXe siècle, sans véritable circulation. Par la suite, la colonisation britannique aura pour effet de cristalliser et renforcer cette coupure et l’opposition entre le nord et le sud du Soudan que la période précoloniale avait définies et entretenues.
En premier lieu, en effet, le Sud a longtemps été exclusivement une zone de traite des esclaves, « de véritables campagnes saisonnières de chasse à l’homme » étant organisées depuis Khartoum (18). L’esclavage est d’ailleurs précisément l’une des raisons pour lesquelles le vice-roi d’Egypte entreprit la conquête du Soudan – le « pays des noirs » en arabe –, à partir de 1820. Méhémet Ali réussira à occuper pour l’essentiel les territoires du nord qui correspondaient aux anciens sultanats souverains étendus de la Nubie jusqu’au Kordofan qu’il avait réussi à défaire, lesquels menaient déjà traditionnellement, vis-à-vis des populations noires vivant plus au sud, la même politique de razzia. Consécutivement, comme elles le faisaient déjà par le passé, les populations des tribus Nouba et Dinka essentiellement, ou encore Shilluk, continueront de faire les frais de raids désormais égyptiens au long de cette période, avec peut-être même plus d’ampleur encore, compte tenu des besoins de l’armée turco-égyptienne de l’époque. La période de la Mahdiya, à la fin du XIXe siècle, ne changea rien à cet état de fait et les populations du Bahr el Ghazal, du Haut-Nil et d’Equatoria, trois des principales provinces du Sud, resteront victimes de la traite jusqu’à la chute du Mahdi. On conçoit les traces indélébiles que ces décennies de razzias ont dû laisser dans la mémoire collective des peuples concernés.
C’est seulement l’arrivée de la domination anglaise, en 1898, qui mettra un coup d’arrêt au trafic d’esclaves, que Charles Gordon, « Gordon Pacha », avait déjà tenté quinze ans plus tôt. Cela étant, c’est essentiellement sur la politique de protection des populations du Sud, développée par l’administration britannique dans les années 1920, qu’il est ici intéressant de s’arrêter. Fondée alors sur un « Closed District Order », elle sera précisément destinée à isoler les populations du sud des influences arabes et islamiques ; à les isoler également d’autres influences possibles, notamment françaises : Fachoda, aujourd’hui Kodok, sur le Nil blanc, se situe à quelque 650 kilomètres au sud de Khartoum (19)...
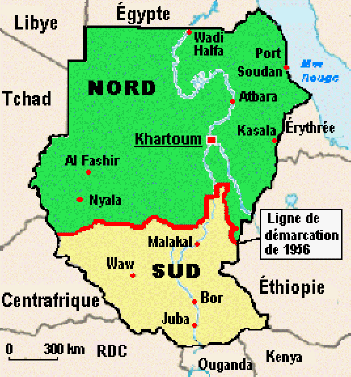
Le sud Soudan (20)
Prétendant revivifier le sud et préserver son autonomie, cette politique a en fait fortement contribué à son isolement. On estime généralement que « la politique coloniale britannique a eu des effets très négatifs sur le sud Soudan, notamment en retribalisant des régions entières du sud qui évoluaient bien différemment après les rafles d’esclaves et en isolant le sud Soudan du reste du pays. » (21) Elle a en tout cas empêché l’évolution socioéconomique du Sud : le confinement a nui au développement de l’agriculture sudiste et a sans doute exacerbé les divisions économiques, culturelles et religieuses entre le Nord et le Sud, d’autant que l’enseignement de l’arabe et de l’Islam y sont alors interdits, et l’anglais promu par les missionnaires chrétiens (22). Pour autant, la fin de la traite imposée par les Anglais ne s’est pas accompagnée par une adhésion des sudistes à cette nouvelle domination militaire : cette période a, au contraire, été marquée par des expéditions punitives contre ces mêmes tribus - Nuer et autres Dinka -, promptes à se rebeller et développant déjà des sentiments nationalistes. De ce fait, les initiatives britanniques n’ont eu de cesse d’accentuer la spécificité de la région par rapport au reste du pays, islamisé et arabisé : création d’un corps d’armée uniquement sudiste dès 1917, l’Equatoria Corps ; imposition de l’anglais au sud en 1918 ; politique de préservation des cultures indigènes en 1921 ; restriction d’accès à toute région à ceux qui n’en sont pas originaires, en 1922 ; interdiction aux nordistes de commercer avec le sud en 1925, etc. (23)
Consécutivement, lorsque les Britanniques révisèrent brusquement leur politique au sortir de la Seconde Guerre mondiale et envisagèrent, avec les nordistes, la réunification du Soudan, les sudistes plaidèrent, non sans une certaine cohérence, pour un système fédéral. Ils y voyaient une garantie de préserver leurs spécificités et intérêts propres, d’autant plus opportune que les nordistes avaient déjà en vue l’indépendance du Soudan, qu’ils négocieront officiellement avec l’Egypte et le Royaume-Uni à partir de 1953. La perspective pour le Sud de se retrouver seul à court terme, dans un tête-à-tête avec le Nord dans le cadre d’un Soudan indépendant et unitaire, dans lequel compte tenu des disparités de développement, il serait inévitablement étouffé, ne pouvait en revanche, et à raison comme on le verra plus loin, que l’inquiéter.
En d’autres termes, il n’est sans doute pas abusif de dire que le Soudan, tel qu’il se dessine au sortir de la colonisation, semble résulter d’un marché de dupes pour ce qui est de la relation entre le Nord et le Sud. D’une certaine manière, s’ébauche un mariage contraint, dans lequel les partenaires n’ont pas les mêmes ambitions, ni ne regardent dans la même direction pour construire un futur commun.
Pour être islamisé en totalité, à l’instar du reste du Nord du pays, le Darfour n’est cependant sans doute pas dans une situation fondamentalement différente de celle du Sud Soudan, en termes d’isolement. Dans ce cas aussi, en effet, le fait géographique a également été amplifié par une conjonction de facteurs politiques au long de l’histoire.
Un peu plus grand que l’Espagne, bordé au sud-ouest par les forêts tropicales de la Centrafrique, à l’ouest surtout et au nord-ouest par le désert saharien du Tchad et de la Libye, le Darfour est tout d’abord une province éloignée du centre : aux confins du Soudan, elle marque la frontière avec le Tchad et se trouve séparée de la capitale par le très vaste territoire du Kordofan. Cette localisation en fait une des zones les plus enclavées d’Afrique, quasiment à équidistance de l’Atlantique, de la Méditerranée et de la Mer rouge, et qualifie le Darfour de « région extraordinairement isolée, même si l’on tient compte des difficiles communications du continent africain. » (24).
Cet isolement géographique n’a cependant pas totalement empêché le Darfour d’être, au long de son histoire, sans doute plus en relation avec son voisinage que le Sud ne l’a été avec le Nord. En effet, malgré une économie essentiellement autarcique, la région, sultanat indépendant dès le début du XVIe siècle, a non seulement longtemps commercé avec les sultanats voisins, participant notamment très activement à la traite des esclaves en provenance du Sud, mais a aussi bénéficié du fait d’être un lieu de passage des grandes caravanes du désert ainsi que des pèlerinages en direction de La Mecque.
Le Darfour, qui a longtemps constitué l’un des deux seuls véritables Etats sur le territoire qui deviendrait ultérieurement celui du Soudan actuel, n’a perdu son indépendance qu’en 1916, lorsque les troupes anglaises défirent le dernier sultan. Le second Etat, le sultanat de Sennar, au nord-est, avait en revanche été conquis dès 1821 par Méhémet Ali, tout comme le Kordofan voisin du Darfour. Pour leur part, les sultans successifs du Darfour avaient réussi à développer un Etat qui subsista jusqu’au XXe siècle, menant une politique que l’on pourrait sans doute aujourd’hui qualifier d’impérialiste : après leur propre conversion à l’islam, les sultans successifs du Darfour, originaires du Djebel Marra, au sud de la région, pratiquèrent en effet à grande échelle l’islamisation des différentes populations alentours, la conquête territoriale, les migrations forcées et la chasse à l’esclave.
En d’autres termes, c’est donc d’une histoire propre, longue de quatre siècles, dont il s’agit, qui ont vu la construction et l’expansion d’une importante puissance régionale, militaire et culturelle. Au final, pour reprendre les termes de Gérard Prunier, « Au-delà de l’image de la mosaïque ethnique, le Darfour présentait une très forte cohérence tant historique que géographique, (…) constituait une entité immédiatement identifiable pour ses voisins. » (25)
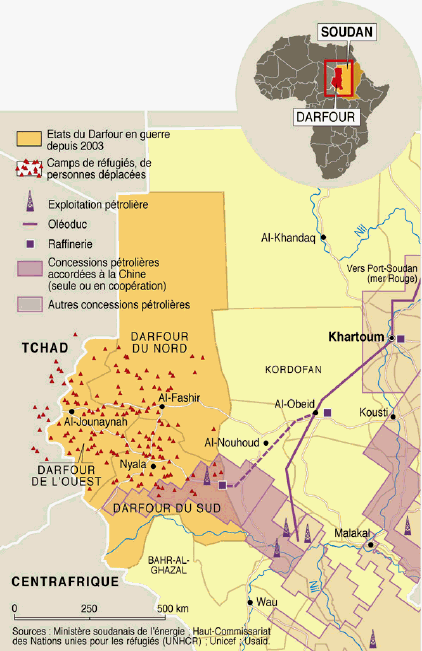
Le Darfour (26)
D’une certaine manière, c’est la perte de son indépendance en 1916 qui fut fatale au Darfour. En premier lieu, parce que l’administration coloniale britannique, même si elle laissa en l’état le système administratif et juridique du Darfour (27), se soucia essentiellement du développement administratif et économique du centre, à savoir de la région de Khartoum et du Nil bleu. Consécutivement, les régions périphériques, dont le Darfour, basculèrent dans un état d’abandon profond, notamment en termes d’investissements économiques, sociaux ou éducatifs : on a ainsi pu souligner que, à la fin de la colonisation, une seule école secondaire était ouverte au Darfour, région qui, sur l’ensemble de la période coloniale, n’a par ailleurs reçu que de 5 à 6 % du total des investissements réalisés au Soudan. Ensuite parce que, à la première rébellion mahdiste des années 1880 qui mena jusqu’aux portes de Khartoum, succédèrent d’autres mouvements nationalistes qui trouvèrent aussi leur origine au Darfour, s’alimentant du mécontentement des populations, que les forces coloniales réprimèrent. Gérard Prunier résume la question du Darfour en concluant qu’il « avait fini par tomber sous la coupe du plus gros des pouvoirs de la région qui n’en voulait même pas. Lointaine périphérie d’une colonie qui ne se souciait pas de lui, le Darfour fut oublié dès l’instant qu’il fut conquis. » (28) C’est également l’analyse de Marc Lavergne (29), qui remarque de plus que la population du Darfour a décuplé au cours des 80 premières années du XXe siècle, passant de 300 000 à 3 millions d’habitants, et qu’elle a doublé au cours des 20 dernières années, sans que les ressources disponibles augmentent, bien au contraire.
En d’autres termes, si la « vocation » du Sud a été d’être séparé du Nord et relégué dans son rôle de pourvoyeur d’esclaves aux marches du pays, celle du Darfour était originellement tout autre. Néanmoins, de son insertion dans l’ensemble soudanais au cours du XXe siècle date un processus de marginalisation, aux effets finalement proches sinon identiques. Le processus de construction même de l’Etat soudanais à partir de l’indépendance de 1956 s’en est trouvé pour partie affecté.
Ces particularismes régionaux ne pouvaient rester sans incidence sur le processus de construction étatique. Vos rapporteurs ont souligné comment la politique coloniale britannique avait entretenu la coupure du pays entre le Nord et le Sud. La question de l’unité nationale ne pouvait donc que revêtir une acuité particulière à compter de l’indépendance et, non seulement marquer d’une empreinte forte les débats politiques et institutionnels des dernières décennies, mais aussi entretenir une fragilité intrinsèque du pays.
Alors que la politique initiale d’isolement menée par les Britanniques aurait dû, plus logiquement, se conclure par une séparation des deux secteurs nord et sud, c’est au contraire l’unité soudanaise qui a finalement été imposée au Sud à partir de 1945, cette option permettant au Royaume Uni d’espérer ainsi mieux faire contrepoids aux visées de l’Egypte. Alors que l’argument officiellement avancé par les Britanniques soutenait que le développement économique et social du Sud serait mieux assuré dans une relation égalitaire avec le Nord, les Sudistes, dont les sentiments indépendantistes avaient mûri au cours de la première moitié du XXe siècle, ne réussirent pas à faire prévaloir leur préférence et craignirent une nouvelle forme de colonisation. Les dernières années de la période coloniale confirmèrent leur appréhension, dans la mesure où tout se joua sans eux, dans une négociation entre Britanniques, Egyptiens et Nordistes dont ils furent exclus. De fait, les premières mesures du gouvernement de transition traduisirent le peu de cas qui était fait du Sud : toute idée de fédéralisme disparut, l’administration et l’armée furent immédiatement « soudanisées » et les premiers troubles éclatèrent avant même l’indépendance, à laquelle les leaders sudistes se rallieront néanmoins, tout en maintenant les revendications qu’ils espéraient toujours réussir à négocier (30).
Dès lors, la question de la spécificité du Sud deviendra la pierre d’achoppement de l’Etat unitaire islamiste qu’ambitionnaient de construire les Nordistes, désireux au contraire d’imposer leur modèle arabo-musulman homogène à tout le territoire : Les premiers appels à une islamisation complète du droit soudanais datent de 1956, année même de l’indépendance, ceux à la transformation du Soudan en république islamique, avec la sharî’a comme seule source juridique, de l’année suivante. Comme on a pu le dire, « pour les premiers gouvernements du Soudan indépendant, la construction de la nation ne pouvait se faire qu’au moyen d’une forte centralisation et par l’unification culturelle. (…) Le modèle arabo-musulman qui avait contribué à la formation d’une société culturellement « homogène » dans la vallée du Nil et les régions adjacentes au nord du 11e parallèle, devait poursuivre son expansion et former la Nation soudanaise. » (31). Répondirent bien sûr à ces appels les souhaits renouvelés par le Sud d’un système fédéraliste qui permettrait le respect des identités de chacun dans un Soudan néanmoins uni, puis, très vite, dès lors que Khartoum apporta la preuve qu’il y restait sourd, des revendications plus affirmées, en faveur de l’autodétermination.
La première décennie qui suivit l’indépendance sera ainsi marquée d’une incertitude forte et d’oscillations entre ces deux options, à mesure que les soubresauts politiques, entre civils et militaires, portent au pouvoir les partisans plus ou moins déterminés de l’une ou l’autre : à la répression brutale des velléités fédérales sudistes de 1965, suivie de nouvelles surenchères islamistes en faveur d’une constitution et d’un Etat islamistes, succèdera, au début des années 1970, une période de sécularisation de l’Etat, impulsée par les militaires socialistes, par laquelle le Sud se voit reconnaître une esquisse d’autonomie régionale, néanmoins limitée aux plans administratif et culturel. Avant même que les années 1980 n’aient commencé, le pendule sera cependant revenu en arrière : un nouveau revirement vers un Etat unitaire islamiste était intervenu, qui avait coupé les ailes au développement économique du Sud qui s’ébauchait. Le « Southern Province Regional Self Government Act » de 1972 était de nouveau violé, notamment par la promulgation d’un code pénal islamique, applicable à tout le pays, tandis que le Sud réitérait ses demandes en faveur d’un Soudan uni, laïc et démocratique, qui serait viable moyennant l’instauration d’un véritable régionalisme.
En 1989, lorsque surviendra le coup d’Etat du général Al-Bachir (32), le conflit armé avait repris depuis plusieurs années déjà, et la question entre Etat fédéral ou Etat unitaire était encore loin d’être tranchée, non plus que celles de la reconnaissance de la spécificité régionale du Sud et du statut général de l’Islam. Les positions du Nord ne cessaient de se radicaliser. C’est cependant ce gouvernement islamiste, issu du coup d’Etat, qui finira par faire un premier pas vers le système fédéraliste réclamé en vain depuis si longtemps par les Sudistes, en créant notamment neuf Etats, aux prérogatives limitées. La timidité de cette avancée, sans réelle dévolution de pouvoirs, sans que laïcité et pluralisme démocratique soient envisagés, était telle que les Sudistes ne se refusèrent désormais aucune option et envisagèrent de nouveau la perspective d’une autodétermination, leur vision paraissant décidément ne rencontrer aucun écho chez leur partenaire du Nord (33).
Des années de violents affrontements militaires seront encore nécessaires, sur fond de négociations chaotiques, avant que les accords de paix signés en 2005 sous égide internationale proposent une issue à ce différend fondamental pour l’avenir et l’existence même du pays, que le Soudan n’a à ce jour cependant pas encore définitivement tranché : comme on le verra plus loin (34), le fossé entre Khartoum et ses périphéries reste large et profond. Il ne repose pas uniquement sur les particularismes qu’on a jusqu’ici privilégiés, mais également sur des fondements économiques, dont l’importance ne doit pas être occultée.
3) La très inégale répartition des richesses
Pour être le plus grand des pays africains, le Soudan n’en figure pas moins parmi les plus pauvres du monde malgré d’importantes ressources inégalement réparties.
a) Le Soudan, géant parmi les plus pauvres
Selon l’Indice de Développement Humain, IDH, pour 2007/2008 publié par le PNUD, sur un total de 177 pays, le Soudan figure au 147e rang, entre Haïti, 146e, et le Kenya, 148e. Les pays moins bien classés que lui sont tous africains, à deux exceptions près – le Yémen et le Timor Est. Ils sont surtout, dans la plupart des cas, de superficie sans comparaison, mis à part le cas notable de la République démocratique du Congo qui s’en approche. Ainsi classé, le Soudan répond aux critères définis par les Nations Unies (35) pour figurer parmi les Pays les Moins Avancés, PMA, sur la liste desquels il se trouve aux côtés de 48 autres pays, dont 32 africains.
En premier lieu, on note que la population du Soudan, jeune, a une espérance de vie faible, d’un peu plus de 57 ans. Le taux de mortalité infantile est élevé : 90 pour mille pour les enfants de moins de 5 ans, tout comme celui de malnutrition : 26 % de la population est sous-alimentée et 41 % des enfants de moins de 5 ans présentent une insuffisance pondérale. En d’autres termes, ces données laissent clairement prévoir qu’en 2015, à l’instar de la plupart des pays d’Afrique subsaharienne, le Soudan sera encore loin d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement, notamment celui relatif à la réduction de la mortalité infantile et maternelle.
Ces premières données brutes permettent de situer l’ampleur, considérable, des défis à relever, alors même que le Soudan bénéficie de réels atouts, comme le verra, qui sont néanmoins contrebalancés par certains facteurs aux profondes conséquences.
b) La part du dérèglement climatique
Le dérèglement climatique, dont les manifestations sont sensibles en Afrique depuis plusieurs décennies, n’est en effet pas sans incidences fortes sur les déséquilibres territoriaux entre régions du Soudan, dans la mesure où les calamités naturelles dont le pays a souffert, notamment au cours des années 1960, puis des années 1980 et au début des années 1990, peuvent en effet être géographiquement discriminées : si ce sont Khartoum et le nord du pays qui ont été frappés par les pluies torrentielles et les inondations de l’été 1988, en revanche, ce sont des sécheresses graves et durables qui ont touché prioritairement, et assez logiquement, les zones nord et ouest du pays, aux portes du désert saharien. C’est d’ailleurs à cette époque, comme on le verra plus loin (36), que les Nations Unies ont commencé à s’intéresser au Soudan et ont défini les premiers programmes d’assistance d’urgence pour venir en aide aux populations sinistrées, qui allaient devoir être reconduits d’année en année, faute de réussir à améliorer durablement la situation.
Les catastrophes humanitaires qui en ont résulté ont incontestablement été dans chaque cas dramatiques : la famine de 1984-1985, consécutive à la sécheresse, a tué 300 000 personnes ; celle de 1988-1989, sans doute plus encore, tandis que les pluies, cette même année 1988, ont rayé de la carte plus de 600 villages, détruit plus de 300 000 habitations, inondé plus de 120 000 hectares de terres agricoles, et laissé sans abri ni ressources plus de 1,5 million d’habitants des environs de Khartoum. En parallèle, les sécheresses des années antérieures affectaient plus de 2 millions de personnes d’autres zones géographiques. Ces désastres reviennent avec une certaine récurrence (37), mais, au-delà de leurs effets immédiats, les sécheresses ont eu des effets à beaucoup plus long terme, affectant de manière définitive les populations, contraintes à des migrations internes sans retour, dont on a vu précédemment l’ampleur à l’échelle du pays et les bouleversements en termes de rapports sociaux.
A cet égard, le cas du Darfour est à ce point significatif que certains voient la sécheresse et la désertification de la région parmi les causes de la crise qui a éclaté en 2003. C’est notamment le cas du Programme des Nations Unies pour l’environnement dont un rapport de juin 2007 (38) cite la dégradation environnementale et le changement climatique comme facteurs majeurs du conflit. Les causes de la désertification sont certainement multiples, mais la part de la croissance démographique est sans doute importante (39), que ce soit à l’échelle du pays ou d’une région comme le Darfour : en 1898, la population totale du Soudan était de 2 millions d’habitants, contre près de 40 aujourd’hui ; celle du Darfour a été multipliée par 20 en un siècle : de 300 000 personnes en 1903 à 6 millions de nos jours. Depuis les années 1930, époque à laquelle des relevés ont commencé à être effectués, la ligne de partage entre zones semi désertiques et désert selon les régions du Darfour, s’est ainsi déplacée vers le sud de 50 à 200 Kms (40). On a pu faire remarquer que « l’échelle du changement climatique enregistrée au Darfour nord n’a pratiquement pas de précédent. La chute des précipitations a transformé des millions d’hectares de pâtures semi désertiques en désert. » (41) Le fait que durant les 40 dernières années, le désert ait ainsi gagné en moyenne une centaine de kilomètres (60 milles), que les précipitations aient chuté de 16 à 34 %, selon les régions du Darfour concernées, a eu des incidences directes sur les tensions entre populations, brutalement exacerbées par la raréfaction des ressources disponibles nécessaires à leur mode de vie agricole ou pastoral.
Consécutivement, le déséquilibre socioéconomique entre les régions soudanaises ne peut qu’en être durablement renforcé. Les projections telles qu’elles ressortent des études du PNUE n’augurent bien évidement pas d’une amélioration : tout au contraire, les modélisations effectuées, unanimes, concluent à une sensible aggravation de la désertification ainsi qu’à une sécheresse accrue sur les prochaines décennies. L’impact sur les activités humaines, notamment en terme de productivité agricole et pastorale, ne se démentira pas, y compris sur les régions plus humides, dans la mesure où la désertification renforce l’érosion des rives des fleuves et amplifie les effets des inondations. Selon le rapport du PNUD précité, une augmentation moyenne des températures de 1,5° C et une diminution des précipitations de 5 % pourraient entraîner une diminution des rendements de sorgho de 70 %, entre 2030 et 2060, de telle sorte que « l’interaction du changement climatique et de la dégradation de l’environnement risque d’exacerber un grand nombre de conflits, et de faire obstacle aux efforts d’édification de la base d’une paix et d’une sécurité humaine durables. » (42).
L’histoire politique récente du Soudan ne fait que confirmer cet ensemble d’impressions, glanées au fil de l’analyse.
Le PIB du Soudan, qui était en 2005 de 27,5 milliards de US$, soit nettement plus que tous les pays moins bien classés que lui sur l’Indice de développement humain, à la notable exception du Nigeria et, dans une moindre mesure, de l’Angola, témoigne des atouts du pays. Comme ceux-ci, le Soudan bénéficie en effet de ressources pétrolières importantes qui tirent depuis peu vers le haut son potentiel de croissance. En revanche, toujours par comparaison avec le Nigeria et l’Angola, sa dette extérieure handicape le Soudan ; elle est incomparablement plus élevée, de l’ordre de 30 milliards de US$, contre respectivement 5,8 et 8,8 milliards pour ceux-ci.
Ce sont très largement ses ressources en hydrocarbures qui constituent aujourd’hui la première richesse du Soudan. S’il est certes encore loin de prétendre rivaliser avec les quelque 2,6 millions de barils de pétrole extraits chaque jour par le Nigeria, ou le 1,3 million de barils quotidiens angolais, le Soudan en produit néanmoins d’ores et déjà selon les estimations entre 460 000 et 500 000 barils par jour (43). Cette production est de surcroît en hausse constante et, si elle n’est pas encore très significative au regard des 85 millions de barils produits actuellement dans le monde chaque jour, elle devrait néanmoins s’approcher à court terme de 1 % de la production mondiale.
Surtout, le Soudan est aujourd’hui le cinquième producteur africain d’or noir, dont il retire aujourd’hui la quasi-totalité de ses revenus : selon le dernier rapport de l’Energy Information Administration, EIA (44), qui publie les statistiques américaines officielles en matière d’énergie et cite en l’espèce le FMI, plus de 95 % des ressources d’exportation du Soudan sont aujourd’hui tirées de l’exportation pétrolière. Vos rapporteurs mettent ce chiffre en relation avec deux données : d’une part, l’estimation antérieure, selon laquelle cette proportion n’était que de 70 % en 2007 (45). D’autre part, le fait que, au début des années 1990, c’est l’agriculture qui assurait encore au Soudan 95 % de ses recettes d’exportation (46).
On mesure donc le profond bouleversement que le Soudan aura vécu en quelques années, comme d’autres avant lui, consécutif à la découverte de pétrole dans son sous-sol. C’est en effet au milieu des années 1970 que les tout premiers sites furent découverts, au Sud Soudan, suite notamment, aux campagnes d’exploration menées par la compagnie américaine Chevron ; d’autres gisements l’ont ensuite été, en 1982, au sud Kordofan. Il a cependant fallu attendre la fin des années 1990, pour voir l’exploitation débuter. C’est donc en fait en moins de dix ans que le Soudan est devenu à la fois un important producteur et exportateur d’hydrocarbures, basculant de ce fait même dans une dépendance forte par rapport à cette mono ressource.
Les réserves d’hydrocarbures estimées à ce jour font également du Soudan un pays avec lequel il faudra compter dans l’avenir : selon le Oil and Gas Journal, cité par l’étude de l’EIA mentionnée, les réserves prouvées se montent aujourd’hui à 5 milliards de barils, plaçant ainsi le Soudan au cinquième rang des pays africains, derrière la Libye, le Nigeria, l’Algérie et l’Angola.
Compte tenu de l’importance que l’exploitation des hydrocarbures a d’ores et déjà pris dans l’économie soudanaise, la localisation des champs de pétrole sur le territoire constitue un enjeu d’autant plus sensible que l’histoire du pays et la relation entre ses principales composantes ont le caractère conflictuel que l’on a vu. En premier lieu, compte tenu des retombées immédiates en termes de ressources financières ; en second lieu, compte tenu des perspectives à moyen et long terme que permettent d’espérer les réserves. Il n’est donc pas surprenant que ce soit de cette question que la tension entre le Nord et le Sud se soit aussi nourrie durant de longues années, dès lors que l’essentiel des gisements se trouvent au sud : Elle a en effet eu, très directement, un rôle majeur dans le retournement de la politique du Nord vis-à-vis du Sud à la fin des années 1970 et ensuite dans la résurgence du conflit en 1983 (47). Plus récemment, l’un des différends les plus aigus entre le Nord et le Sud Soudan a ainsi porté sur le rattachement à l’un ou l’autre de la zone pétrolifère d’Abyei, charnière. Il n’a été tranché qu’à la fin du mois de juillet 2009, par la Cour permanente d’arbitrage de La Haye, plus de quatre ans après que le Comprehensive Peace Agreement, CPA, signé en janvier 2005, eut posé les principes du règlement de la question. Vos rapporteurs auront l’occasion de revenir sur cet aspect, en abordant l’étude des conflits qui ont meurtri le Soudan ces dernières années.
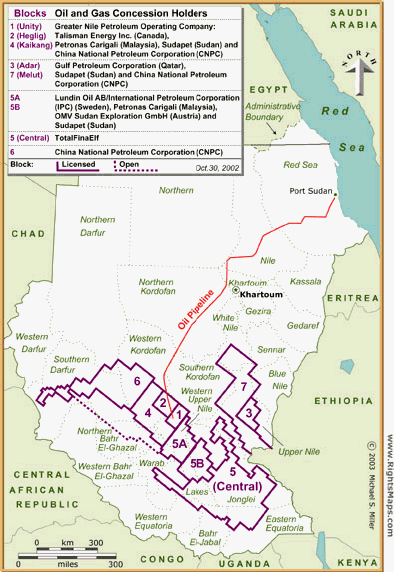
Les concessions pétrolières au Soudan (48)
Le Soudan bénéficie également dans une moindre mesure de ressources complémentaires non négligeables. Elles sont en premier lieu de nature hydraulique. Irrigué du sud au nord essentiellement par les Nil bleu et blanc qui se rejoignent à Khartoum avant de poursuivre vers l’Egypte, le Soudan, malgré une large proportion de son territoire, au nord et à l’ouest, désertique, compte deux bassins fluviaux majeurs, sans oublier celui de l’Atbara, qui, venant d’Ethiopie, se jette dans le Nil à hauteur de la ville du même nom, au nord de Khartoum.
Cette situation donne plusieurs atouts au Soudan. Tout d’abord, le bénéfice, depuis longtemps, d’une production hydroélectrique non négligeable, grâce à des ouvrages bâtis sur le Nil bleu, au sud-est de Khartoum. Le pays continue d’ailleurs de développer ses infrastructures et en mars 2009, la veille même de son inculpation par la CPI, le président Al-Bachir inaugurait le barrage de Méroé, à 400 Kms au nord de la capitale, à hauteur de la quatrième cataracte. Cet ouvrage, qui est décrit comme le plus important investissement réalisé depuis l’indépendance et le plus grand chantier sur le Nil depuis Assouan, devrait à terme fournir 1250 MW et permettre ainsi de doubler la production électrique soudanaise.
Parmi les autres bienfaits résultant de ces bassins fluviaux, ceux qui touchent à l’agriculture sont tout aussi remarquables. Malgré une localisation aux portes du désert, malgré un relief en grande partie de plaines et de savanes semi désertiques, le Soudan est un pays dont l’irrigation permet des productions agricoles riches et relativement variées. C’est précisément ce qui a permis la mécanisation de l’agriculture, que vos rapporteurs ont mentionnée plus haut, essentiellement autour de Khartoum, ainsi que dans l’Est du pays, autour du Nil bleu, et, partant, le développement de productions intensives.
Si l’agriculture n’occupe que 10 % des terres cultivables, soit moins de 100 000 km2, mécanisation et irrigation permettent néanmoins des cultures céréalières importantes, notamment de sorgho, de millet ou de blé. Ce sont surtout les produits d’exportation qui se détachent cependant, tels que le coton ou la gomme arabique, dont le Soudan est le premier producteur mondial.
Enfin, la production animalière est également notable, à telle enseigne que « le Soudan serait ainsi le deuxième grand pays d'élevage du continent derrière l'Éthiopie. » (49). Bovins, ovins, caprins et enfin dromadaires, essentiellement exportés vers l’Egypte, constituent l’essentiel du cheptel soudanais.
Pour autant, ce tableau général rapidement brossé ne doit pas faire illusion, car les écarts de développement, dus à l’inégale répartition de la richesse, sont considérables entre les régions du pays.
d) Une domination sans partage de Khartoum
On l’a évoqué, le Darfour et le Sud sont, aujourd’hui encore, des régions très fortement déshéritées au sein du Soudan. A cet égard, sans doute la situation du Sud, qui peine à se relever de la guerre civile qui l’a opposé au Nord, est-elle pire que celle du Darfour. En effet, pour pâtir d’un certain éloignement et n’avoir bénéficié de la part du gouvernement central d’aucune attention ni politique de développement socioéconomique depuis son incorporation au Soudan, le Darfour n’en a pour autant pas été victime d’un isolement et d’une fermeture comparables à ceux qui ont confiné le Sud. Les effets en sont durables et profonds.
Quoi qu’il en soit de ces deux régions, il faut voir dans ces décalages ou déséquilibres en matière de développement tout à la fois l’effet de la conjonction de la politique de marginalisation ancestrale et constante de la part du gouvernement central envers ses périphéries et de l’inégale répartition des richesses naturelles du pays.
A titre d’exemples, vos rapporteurs peuvent mentionner le fait que c’est très nettement la région centrale et son environnement proche qui ont bénéficié, depuis l’indépendance, si ce n’est même avant, des politiques d’investissements du gouvernement soudanais. Cela est vrai que ce soit dans le secteur des grands projets d’agriculture intensives, essentiellement mis en œuvre dans la région de El Gezira, sur le Nil bleu, au sud-est immédiat de Khartoum, ou en ce qui concerne l’industrialisation : non seulement la zone de El Gezira était-elle ainsi considérée comme le grenier à blé du monde arabe dès le début des années 1970, mais elle abritait aussi, entre autres, l’un des plus grands complexes sucriers au monde, tirant de l’exploitation de 43 000 hectares de canne à sucre une production de 365 000 tonnes annuelles.
De manière identique, et malgré le fait que la plupart des champs pétrolifères soient situés au Sud Soudan, c’est uniquement Khartoum qui, en terme d’industrialisation et jusqu’à aujourd’hui, a bénéficié des retombées pétrolières, encore moins bien réparties que celles de l’agriculture : les raffineries sont ainsi installées autour de Khartoum ; seul Port-Soudan, sur la Mer rouge, terminal du principal oléoduc et unique port pétrolier du pays, qui permet l’exportation du produit, en dispose d’une autre, d’une capacité cinq fois inférieure à celles de la capitale. De même en est-il des autres entreprises industrielles. La production d’hydrocarbures de ces dernières années a également fait du Soudan un des plus forts pôles d’attractivité des investissements directs étrangers en Afrique. Les nombreuses joint-ventures qui ont été signées, notamment avec des entreprises internationales des secteurs automobile, électroménager ou d’armement, se sont ainsi concrétisées par l’installation de chaînes de montage exclusivement autour de la capitale (50).
En d’autres termes, les éléments permettant de juger du développement économique et social, faible, du Soudan traduisent un net déséquilibre entre la région capitale et les périphéries du pays.
D’une certaine manière, et en cela tous les chercheurs sont unanimes, est ainsi mise en évidence la domination exclusive des tribus arabes de la vallée du Nil qui n’ont eu de cesse au cours de l’histoire, seules ou avec l’appui, volontaire ou non, des occupants étrangers, d’asseoir leur domination en écartant et spoliant les régions éloignées. Cette marginalisation constante, historique, se retrouve, dans la plupart, si ce n’est la totalité des secteurs de la vie sociale. Trois exemples le démontrent.
Celui du système éducatif, en premier lieu, dont les caractéristiques n’ont pas fondamentalement évoluées depuis les années 1940. Aujourd’hui, « le sud est encore presque totalement privé d’un quelconque appareil éducatif » (51). De même, à la fin de l’année 2002, la plupart des écoles des 9 000 villages du Darfour n’avaient-elles pas d’enseignants (52). Il est à cet égard significatif que les populations qui seront hébergées dans les camps de déplacés à partir des années 2005 et 2006, auront un accès aux services éducatif et de santé nettement supérieur à celles restées en dehors de l’assistance humanitaire fournie par les organisations internationales. Inversement, les quelques Etats autour de Khartoum et des bords du Nil bénéficient d’une densité d’établissements d’enseignement incomparable et, consécutivement, des taux d’alphabétisation et de scolarité correspondants.
De même en est-il en ce qui concerne l’eau potable, secteur pour lequel les investissements se sont également concentrés sur les régions de Khartoum et de El Gezira : si la quasi-totalité des habitants dans ces Etats y a un accès aisé, voire immédiat, la proportion est en revanche infiniment moindre dans les régions périphériques, où les populations se trouvent fréquemment très éloignées des points d’eau et autres forages. D’où il ressort, entre autres conséquences, que les taux généraux de morbidité dans ces régions ne sont pas non plus les mêmes, fortement corrélés qu’ils sont tant à l’accès à l’eau, qu’au système de santé.
Dans un autre ordre d’idées, néanmoins complémentaire, la question du régime foncier confirme de manière impressionnante cette domination du Nord sur ses différentes périphéries. Dès le XVIe siècle, les tribus riveraines de la vallée du Nil étaient ainsi les seules à bénéficier de la propriété privée du sol, en ce qui concerne les terres irriguées, que l’occupation anglo-égyptienne étendit aux villes de Khartoum et Dongola à la fin du XIXe siècle. Dans les régions périphériques, inversement, prédominait un système de propriété collective des terres, d’ailleurs moins favorable à une dynamique d’investissement. Cette maîtrise initiale sur le foncier des tribus centrales n’a fait que s’accentuer ensuite en raison de l’évolution d’ensemble du système qui a mis en place un mécanisme de dépossession des populations périphériques, dont les tribus du Darfour ont tout particulièrement été victimes. Dans une première étape, une fois défaits les sultanats et royaumes indépendants, les bénéfices du commerce de longue distance sur lequel reposaient leurs économies ont été transférés à l’occupant. Ensuite, dans les années 1920, l’administration britannique a introduit des innovations majeures, en souhaitant que les chefs des grandes tribus arabes aient au Darfour les mêmes titres et droits fonciers que ceux des groupes non arabes, décision dont les effets se font sentir aujourd’hui encore. Au début des années 1970, enfin, avec l’adoption de l’« Unregistred Land Act », toutes les terres alors non enregistrées comme privées devinrent propriété de l’Etat. Ainsi en fut-il de la quasi-totalité de celles du Darfour (53). Les compétences du droit coutumier qui, traditionnellement, réglait l’usage des terres, ont alors été réduites au profit de la puissance publique qui a désormais disposé d’un droit de redistribution du sol, favorable aux grands investissements, auquel s’est ajouté la possibilité de remettre en cause les décisions des chefs coutumiers, limitées à l’usage des terres communes (54).
Les mécanismes de spoliation des tribus périphériques ont été articulés sur la longue durée. Leur cohérence et leur logique ressortent finalement et clairement avec les lois de 1971 portant abolition de l’administration indigène (« Abolition of Native Administration Act ») et sur le gouvernement populaire local (« People’s Local Government Act ») par lesquelles les systèmes traditionnels de chefferie ont été mis hors-la-loi. Si l’administration locale a retrouvé quelque lustre en 1986 avec une nouvelle législation redonnant aux chefs traditionnels certaines de leurs prérogatives, les droits fonciers antérieurs n’ont en revanche pas été rétablis. De sorte que, aujourd’hui, la question de la terre est au Darfour évidemment centrale.
Ce survol de quelques aspects des réalités soudanaises montre la domination continuelle d’une région sur les autres, plus précisément de la part de quelques tribus qui n’ont jamais considéré leur détention du pouvoir central comme un moyen de participer au développement du pays dans son entier, mais bien plutôt comme le moyen de satisfaire leurs propres intérêts, non seulement politiques, mais aussi économiques et sociaux. Depuis que le Soudan existe, tout n’a jamais été fait par le pouvoir central aux mains des tribus du Nil qui ne soit dans le but exclusif d’entretenir cette situation. On verra plus loin (55) que l’analyse montre que les crises récurrentes entre Khartoum et ses périphéries s’alimentent précisément de ces déséquilibres qui sont au cœur des tensions, voire entretenus : il en est toujours ainsi, que ce soit dans la guerre civile entre le Nord et le Sud, dans le conflit entre Khartoum et le Darfour, ou enfin, dans ceux entre le Nord et l’Est ou dans les Monts Nouba.
Il n’est pas autrement surprenant, dans ces conditions, de remarquer que, d’une manière générale, le sort des populations ne semble pas avoir jamais été une préoccupation majeure des élites, qu’elles soient nationales ou régionales : nombre de crises humanitaires sévères, notamment de famines, ont ainsi surgi au Soudan parce que les acteurs du conflit, quels qu’ils soient, faisaient, à propos, porter le fardeau de la guerre sur les populations civiles, harcelant les communautés, pratiquant une politique de terre brûlée, empêchant l’acheminement des organisations humanitaires. Comme le montrent plusieurs études, les famines des années 1986 et 1991 au Sud Soudan ont été considérablement aggravées pour ces raisons, dont la responsabilité est partagée par les belligérants (56). En d’autres termes, la résolution des déséquilibres socioéconomiques interrégionaux ne figure peut-être pas parmi les priorités des responsables soudanais.
B. – Le Soudan contemporain : d’un coup d’Etat à l’autre
La transition vers l’indépendance sans heurt, négociée avec le Royaume Uni dès le début des années 1950, aurait pu donner au Soudan les chances d’un développement politique harmonieux. Les institutions adoptées dans le Statut d’autonomie voté en avril 1952, bien avant que l’indépendance ne soit effective (57), auraient pu servir de cadre d’apprentissage à la jeune démocratie parlementaire bicamérale qu’elles prétendaient instaurer. La réalité s’est néanmoins éloignée d’un tel scénario.
1) Une profonde instabilité politique
Les trois premières décennies de l’histoire du Soudan indépendant ont été marquées par une succession de coups d’Etat militaires interrompant des épisodes civils de plus ou moins longue durée. De 1956 à 1989, date du coup d’Etat qui porta le général Al-Bachir au pouvoir, aucun changement de gouvernement n’est intervenu à la suite d’une alternance faisant suite à des échéances électorales normales.
Ainsi, le gouvernement de coalition qui assurait la transition depuis la fin de la période coloniale laissa-t-il la place dès la mi-novembre 1958, après moins de trois ans d’exercice sur fond de tensions croissantes avec le Sud, à un premier épisode militaire, dirigé par le général Ibrahim Abboud, chef d’Etat major de l’armée, appelé par le Premier ministre Abdullah bey Khalil, quelques mois après les premières élections législatives de février. Le fragile système parlementaire, inspiré de celui de Westminster, fut dissous avant d’avoir pu exister vraiment, la constitution provisoire suspendue et le multipartisme aboli.
Ce premier régime militaire de l’histoire du Soudan indépendant durcit notamment le ton envers le Sud et sa population avant de chuter à son tour devant le soulèvement populaire d’octobre 1964 : l’incompétence économique du gouvernement, incapable également de résoudre le conflit avec les sudistes, alimenta un mécontentement généralisé, et la rue de Khartoum renversa les militaires. Un nouveau gouvernement provisoire, dans lequel communistes, islamistes et sudistes se côtoyèrent un temps, rétablit la démocratie, le multipartisme et la liberté de la presse et organisa les élections législatives d’avril 1965. Une forte instabilité continua néanmoins de marquer les années suivantes : diverses coalitions sans avenir, issues d’une consultation difficilement organisée sur fond de guerre civile, se succédèrent au pouvoir sur un rythme rapide. Leur incapacité à régler les problèmes auxquels elles étaient confrontées, la fracture forte, déjà, entre les partis islamistes et les progressistes du Nord alliés aux sudistes sur la question de l’introduction de l’islamisation du pays dans le projet de nouvelle constitution, ouvrirent la voie au général Gaafar Nemeyri, qui, en mai 1969, profitant de nouvelles révoltes populaires, prit à son tour le pouvoir, sur fond de nassérisme régional ambiant, pour revenir aux idéaux dévoyés de la révolution de 1964.
Progressiste dans les premiers temps, incarnant une forme de socialisme soudanais, incluant des communistes, dont l’un chargé des affaires du sud dans le gouvernement de la « République démocratique du Soudan » et de mettre en œuvre une politique d’autonomie administrative régionale et un programme de développement économique et social, le nouveau régime n’allait cependant pas tarder à se radicaliser.
Dès la fin de 1970 en effet, un projet de constitution d’un Etat fédéral unissant la Libye, l’Egypte et le Soudan suscitait la vive opposition des communistes qui échouaient dans une tentative de coup d’Etat. Nimeyri réussira à conserver le pouvoir jusqu'en 1985 avant d’être à son tour défait par le troisième coup d’Etat militaire depuis l’indépendance, mené par son ministre de la défense, le général Siwad al-Dahab. Entre-temps, après l’échec des communistes, il avait contrecarré deux autres tentatives, menées par des coalitions islamistes, en 1975 et 1976. Néanmoins, les mêmes causes produisant les mêmes effets, c’est encore la détérioration de la situation économique, la crise politique endémique et la tension sociale qui justifient ce nouveau putsch : le général al-Dahab, à la tête d’un Conseil militaire transitoire, soutient les émeutiers de Khartoum et des grandes villes du pays plutôt que de les réprimer et dépose Nimeyri en déplacement aux Etats-Unis.
Un nouveau gouvernement de transition, associant de nouveau les partis autrefois coalisés, organisa en 1986 les premières élections législatives depuis les années 1960 (58). Le gouvernement civil qui en fut issu, dirigé par Sadeq el-Mahdi, déjà Premier ministre entre 1966 et 1967, ambigu dès les premières semaines sur la question de l’abrogation des lois islamiques, fut confronté à la pression des rebelles sudistes, dut compter avec la surenchère des Frères musulmans qui cherchèrent à en imposer de nouvelles. Il se maintiendra tant bien que mal jusqu’en juin 1989, date à laquelle le général Omar Al-Bachir finira par le renverser après un lent travail de sape islamiste et militaire, au cours duquel FNI et forces armées lui imposèrent de réviser ses priorités pour accentuer l’islamisation du pays et l’effort de guerre contre le Sud (59).
En d’autres termes, ainsi que tous les analystes le remarquent : l’histoire politique et institutionnelle du Soudan contemporain ne cesse de balbutier en ces premières années, au rythme de cette oscillation pendulaire entre régimes militaires et civils. Elle est aussi marquée par l’instabilité profonde des périodes de gouvernement civil : ainsi entre 1956 et 1969, hors période militaire, y aura-t-il sept gouvernements de coalition ; de même, quatre gouvernements se succèderont entre 1986 à 1989 (60), soit sur l’ensemble de ces deux périodes, en moyenne un gouvernement nouveau par an, à peine.
Il est surtout essentiel de faire remarquer que, par delà des aspects économiques et sociaux à l’origine des grèves et émeutes qui sont les éléments déclencheurs directs qui provoquent le renversement des gouvernements, la question du sud et la question religieuse constituent les points d’achoppement récurrents sur lesquels bute systématiquement cette première période. Autrement dit, l’articulation de ces deux questions constitue selon vos rapporteurs la grille de lecture sur laquelle doit reposer l’analyse des crises que traverse le Soudan sans avoir encore réussi à les surmonter.
2) Un projet islamiste de toujours
La question du sud Soudan ne serait peut-être pas aussi aigue, et depuis si longtemps, si elle n’était directement alimentée par la question religieuse, dont il n’est pas indifférent de rappeler qu’elle est en quelque sorte consubstantielle au Soudan.
La volonté d’un Soudan théocratique vient de loin et Christian Delmet rappelait ainsi à vos rapporteurs (61) que le projet islamique est inhérent au Soudan même, dont le mahdisme, première révolution en terre africaine, au tout début des années 1880, doit être considéré comme l’acte fondateur.
Ce soulèvement fut conduit par Mohamed Ahmed Bin Abdallah, qui se déclara Mahdi en 1881 et guerroya victorieusement contre la domination coloniale turco-égyptienne. Le khalife Abdallahi succéda au Mahdi en 1885, ne réussissant toutefois à se maintenir au pouvoir que jusqu’en 1898, lorsque les anglo-égyptiens reprirent le contrôle du Soudan.
Malgré la relative brièveté de son passage au pouvoir, le mahdisme n’en a pas moins fondé la légitimité et la prégnance du mouvement islamiste sur la vie politique soudanaise et, en ce sens, il aura joué un rôle important, notamment dans la marche vers l’indépendance, jusqu’à aujourd’hui encore (62). Dans un premier temps, parce que, comme on a pu le souligner, « cet épisode ancra dans l’imaginaire politique soudanais l’idée d’un Etat soudanais islamique et indépendant, bien au-delà des partisans du Mahdi qui se recrutaient pour l’essentiel dans les tribus du Centre et de l’Ouest. » (63). Ensuite, car cette légitimité historique née de la lutte initiale contre la première colonisation, fut ensuite, bon gré mal gré, entretenue par les Britanniques qui, au long du XXe siècle et ce, dès la première guerre mondiale, durent non seulement composer avec le descendant du Mahdi, qui servait de fait leurs intérêts pour faire pièce aux ambitions égyptiennes, mais aussi le soutenir pour cette raison même.
Avant même le mahdisme, une autre confrérie islamique, la Khatmiya, avait été constituée par Osman al-Mirghani, avec l’ambition d’essaimer hors de sa zone géographique initiale. Développant une stratégie de coopération avec les pouvoirs en place plus que d’affrontement, à la différence du mahdisme, elle sera néanmoins comme celui-ci à l’origine de la politisation de l’islam soudanais, dès les débuts du XXe siècle et de la fondation, dans les années 1940, de l’un des deux partis politiques traditionnels du Soudan qui ont dominé la vie politique du pays depuis l’indépendance (64).
Consécutivement, il n’est pas étonnant que les gouvernements qui se sont succédés à Khartoum depuis 1956 aient souvent ambitionné de faire de l’Islam la religion de tout le Soudan, indépendamment de ces réalités. Il y a à ce sujet au moins une forte ambiguïté dans les politiques qui sont conduites, notamment par les gouvernements militaires, des allers et retours incessants dans la relation avec le Sud Soudan, sur un fond de volonté d’islamisation jamais totalement absent. Si, parfois, le Nord a pu sembler lâcher du lest, ce fut pour mieux le récupérer quelques années plus tard, lors de revirements généralement brutaux. Ainsi, déjà, le premier régime militaire, du général Abboud, tente-t-il, vainement, une politique d’islamisation et d’arabisation forcée du Sud. Ce sera un échec, et la part de cette question dans son renversement en 1964 n’est sans doute pas anodine, dans la mesure où, parmi les griefs contre lui, son incapacité à mettre fin à la guerre civile que sa politique avait considérablement aiguisée, lui fut notamment reprochée.
A son tour, le général Nimeyri, arrivé au pouvoir en 1969 en bloquant l’adoption d’une constitution islamiste, tentera dans un premier temps de trouver une solution politique au problème, en accordant une autonomie régionale aux provinces du Sud Soudan, dans le cadre d’un accord négocié à Addis Abeba en 1972, qui réussit à mettre fin à la guerre civile. L’ambition de cet accord, sur lequel vos rapporteurs auront l’occasion de revenir, était de réussir à vivre en paix dans un Soudan uni, de définir un partage du pouvoir entre le Nord et le Sud, celui-ci se voyant reconnaître le bénéfice d’une autonomie politique et économique.
Cela étant, sous la pression de l’opposition croissante des partis islamistes du Nord, Frères musulmans et mahdiste, qui tenteront, comme on l’a vu, de le renverser en 1975 et 1976, le général Nimeyri fut contraint de réviser ses positions, d’autant plus facilement, d’ailleurs, que les premières découvertes de pétrole se faisaient alors au Sud. De telle manière que, malgré l’article 47 de la constitution de 1973 qui garantissait notamment la liberté de croyance et de religion, un comité pour l’islamisation des institutions fut mis en place en 1977, qui aboutira non seulement à la perte de l’autonomie du Sud avec la dénonciation finale de l’Accord d’Addis Abeba en 1983, mais à une réorientation du régime dans une direction radicalement islamiste, dont l’aspect le plus spectaculaire fut l’adoption de la sharî’a comme principe juridique de base du droit soudanais (65) : les « lois de septembre » (1983) proclament ainsi, pour la première fois, l’arabe comme langue officielle du Soudan, et établissent que « le droit islamique et la coutume doivent être les principales sources de la législation » (66). Certes, certaines dispositions, tout en reconnaissant que « dans la République démocratique du Soudan, l’Islam est la religion et la société doit être guidée par l’Islam », mettaient en parallèle le christianisme. Néanmoins, l’application effective de la sharî’a aux populations sudistes et non musulmanes vivant au Nord fut la meilleure manière d’attiser la tension, dans la mesure où le Sud ne cessait d’affirmer ses revendications en faveur d’un Etat unitaire, démocratique et laïque. L’imposition d’un code pénal islamique sur tout le territoire alors même qu’un tiers de la population n’était pas musulmane pouvait difficilement s’analyser – et être perçue, surtout – comme une politique d’apaisement.
On voit par conséquent sur la longue durée une constante de la part des élites nordistes : non seulement le refus de toute idée de sécularisation de l'Etat, mais aussi, au-delà, la volonté d’islamiser le pays tout entier, y compris de force, et sans craindre la réaction des intéressés, dont on sait qu’elle sera nécessairement violente de la part des sudistes, dans la mesure où l’ancienneté de la rébellion armée marque suffisamment leur détermination. La preuve en est que c’est précisément en 1983 que la guerre civile, à laquelle les Accords d’Addis Abeba avaient mis fin, reprendra.
Finalement, le projet politique du Nord en faveur d’un Soudan islamiste apparaît tout autant gravé dans le marbre que la volonté sudiste de voir reconnues ses particularités au sein de cet ensemble disparate. On a pu ainsi noter que l’agenda islamiste du Nord avait été poursuivi au Soudan plus avant que dans des républiques islamiques pourtant plus connues quant à la question de l’islamisation de leur droit (67) : Dans un premier temps, les soutiens du Conseil militaire qui en 1985, sous la houlette du général al-Dahab, renversa le général Nimeyri, réussirent à maintenir les lois de septembre en vigueur malgré l’adoption d’une constitution provisoire en 1985 qui rétablissait les principes antérieurs. Mais c’est même clairement la perspective de leur prochaine abrogation qui détermina les islamistes du Front national islamiste, FNI, à fomenter le coup d’Etat qui porta Al-Bachir au pouvoir.
La constitution du 1er juillet 1998 placera ensuite au premier rang des sources de la loi la sharî’a, avant même la constitution (68). Et ce n’est pas la politique menée depuis vingt ans désormais par le gouvernement du général
Al-Bachir, qui peut démentir ce sentiment, non plus que les récentes et spectaculaires peines de coups de fouet infligées à plusieurs jeunes femmes soudanaises pour « tenues indécentes ».
Bien logiquement, au fil de ses deux décennies de pouvoir, celui-ci n’a cessé de se référer au panarabisme et aux valeurs islamistes, notamment pour se rallier les soutiens des pays arabes ou musulmans, de l’Irak à l’Iran, qui, dans les années 1990, l’ont soutenu financièrement et militairement dans le cadre de la guerre civile contre le Sud. L’évolution civile du régime, à partir de 1993, n’a pas fondamentalement changé la donne ni l’agenda islamiste : c’est notamment en termes de jihad que jusqu’aux négociations de paix du début des années 2000, la guerre était appréhendée par les dirigeants soudanais : ainsi, entre autres exemples, peut-on rappeler qu’en octobre 2001, le premier vice-président Ali Osman Mohamed Taha réitérait l’engagement du gouvernement envers le jihad et sa volonté de maintenir haut sa flamme (69).
Dans leur introduction au numéro spécial que la revue Politique africaine consacra au Soudan en 1997, Marc Lavergne et Roland Marchal voyaient dans le régime soudanais « une volonté radicale de transformation qui n’est pas seulement visible dans le champ culturel et religieux. Le discours du pouvoir met l’accent sur une nouvelle identité soudanaise visant à une intégration nationale (…) Ce projet dessine les contours d’une réforme radicale de l’individu par une pratique religieuse rénovée [et] ne s’applique pas seulement à l’individu mais également à la société politique.» (70).
Sans anticiper sur les développements futurs du présent rapport, il n’est pas infondé, dans ces conditions, de montrer un certain scepticisme quant aux chances de succès des négociations en cours, voire un pessimisme quant aux perspectives qui s’offrent au Soudan. Fondamentalement, en effet, le mouvement islamiste soudanais, sans qu’il soit pour autant ici question de l’accabler, seul, de tous les torts ni de tous les maux du Soudan, a prouvé au long de son histoire son refus de toute évolution sur ces questions fondamentales, ainsi que son absence d’ouverture et son habileté à contrecarrer toutes les avancées qui ont jamais pu intervenir, qui ont toutes été suivies d’autant de sabotages et de reculs. Comme Hassan al-Turabi a pu le dire : « Si on regarde comment l’islam est arrivé au pouvoir dans certains pays comme l’Iran ou le Soudan, on constate que l’avancée islamique est inéluctable comme le destin. » (71) Consécutivement, on peut sans mal s’aventurer à soutenir que tant que les islamistes domineront le gouvernement central comme ils le font encore aujourd’hui, le rapprochement avec les positions séculières défendues par les sudistes paraît pour le moins difficile.
A cet égard, un regard additionnel, notamment sur la nature des partis politiques soudanais permet d’apporter un éclairage complémentaire utile.
3) Une démocratie impossible ?
Cette histoire, à la fois chaotique et violente, pourrait laisser croire que le Soudan, à l’instar d’autres pays anciennement colonisés, rencontre de grandes difficultés à entrer dans un cadre politique démocratique. Le fait que le général Al-Bachir soit toujours au pouvoir, plus de vingt après son coup d’Etat, peut le confirmer. Pourtant, nombreux sont ceux qui estiment que « la démocratie et la culture démocratique sont bien plus qu’une parenthèse dans l’histoire post-coloniale du Soudan. » (72) Le fait que, à plusieurs reprises, des manifestations populaires de mécontentement aient été à l’origine de la chute du gouvernement suffit à indiquer la vigueur de la société civile soudanaise, au sein de laquelle les milieux étudiants, professionnels et syndicalistes ont eu un rôle majeur dans ces divers épisodes.
a) Une réelle tradition démocratique
Cette vigueur se note également au nombre de partis politiques qu’a connus le Soudan : dès avant l’indépendance, les partis ont occupé le paysage politique soudanais, tant au Nord qu’au Sud. Ceux du Nord, essentiellement structurés sur des bases religieuses, ont logiquement tenu le devant de la scène nationale, voire internationale, compte tenu du déséquilibre entre les deux régions. Parmi ceux-ci, les plus importants, qui de fait, se sont partagés le pouvoir au fil du temps depuis l’indépendance, figurent le Parti de l’Union démocratique, de Ibrahim al-Mirghani, le Parti de l’Umma, héritier du mouvement mahdiste, de Sadeq el-Mahdi, arrière petit-fils du Mahdi, et le Front national islamique, de Hassan al-Turabi, formations politiques sur lesquelles vos rapporteurs auront l’occasion de revenir.
Ce sont des partis qui, non seulement pour la plupart sont anciens, puisqu’ils ont été fondés dès avant l’indépendance : le Parti de l’Union démocratique, par exemple, a été créé dès 1943, deux ans avant le Parti de l’Umma. Ce sont aussi des formations qui sont nombreuses : Au total, lors des dernières élections démocratiques organisées en 1986, 46 partis politiques avaient été recensés, dont 11 avaient obtenu des sièges au parlement, dont le Parti communiste (73), lequel dispose d’ailleurs toujours aujourd’hui de trois députés au parlement. Dans le même esprit, on remarquera enfin que les périodes d’interdiction, parfois longues, n’ont jamais réussi à éradiquer les partis politiques : après 17 ans d’interdiction, les deux principaux partis traditionnels, le Parti de l’Umma et le parti de l’Union démocratique ont resurgi en 1986 pour de nouveau occuper le devant de la scène nationale et parlementaire et remporter respectivement 100 et 63 sièges d’une assemblée de 260 élus. Les partis originaires du Sud ont également été tout sauf absents : lors des quelques scrutins qui furent organisés, en 1965, en 1968 ou en 1985, ils ont même été plus nombreux que les partis nordistes à participer aux consultations (74).
La démocratie politique soudanaise présente donc une étonnante faculté à renaître de ses cendres malgré les interruptions fréquentes et durables. Favorisés par les Britanniques dès les années 1940 (75), la liberté d’expression et le foisonnement traditionnel de la presse soudanaise, sans conteste plus libre et plus active que dans « des pays arabes plus riches, plus urbanisés et moins isolés des grands flux internationaux » (76) s’inscrivent dans la même logique et méritent tout autant d’être soulignés.
L’arrivée au pouvoir du général Al-Bachir en juin 1989 va marquer le dernier coup d’arrêt, le plus long, à cette vie démocratique. Ses méthodes ne diffèreront pas de celles des auteurs des précédents coups d’Etat : interdiction des partis politiques, suspension de l’institution parlementaire, répression. Elle peut également être analysée comme le triomphe de l’islamisme au Soudan dont a vu précédemment la nature du projet politique.
A cet égard, si le mahdisme est le mouvement dont tout est parti dans les années 1880, et qui, par son rôle historique fondateur, a dominé et influencé durablement la scène politique avant même l’indépendance, de fait, l’islam politique se partage entre diverses tendances. Deux partis traditionnels des plus importants se sont notamment structurés, chacun sur une base sociologique propre.
Les deux partis traditionnels les plus importants du Soudan, rivaux de toujours, sachant néanmoins parfois s’allier pour un partage du pouvoir, le Parti de l’Umma et le Parti de l’Union démocratique, fondés tous deux, sous leur forme actuelle, dans les années 1940, se sont constitués l’un comme l’autre en opposition à la domination étrangère. Le premier est issu du mahdisme de la confrérie des Ansar, qui historiquement s’est opposée à l’Egypte en s’appuyant sur le Royaume Uni ; le second, de la confrérie rivale de la Khatmiya, liée à l’Egypte contre la Grande Bretagne (77). Il s’agit de mouvements structurés sur les bases d’un islam populaire et militant. C’et surtout le cas du Parti de l’Umma, qui a eu l’occasion de gouverner le Soudan à deux reprises, Sadeq al-Mahdi étant Premier ministre de gouvernements de coalition entre 1966 et 1967, puis de 1986 à 1989. Le Parti unioniste, toujours dirigé à l’heure actuelle par la famille de Ahmed al-Mirghani, Président de la république lors du coup d’Etat de 1989, se présente plus comme une machine électorale que comme un parti de masse et là réside vraisemblablement le fait que sur les dernières années de la vie politique démocratique, le Front national islamique lui ait pris des voix et l’ait considérablement affaibli.
Puisant leurs racines dans la tradition la plus ancienne de l’islamisation du pays, les deux partis traditionnels ont dominé la vie religieuse et politique du Soudan depuis la seconde moitié du XIXe siècle (78). Ils ne s’en sont pas moins heurtés très tôt à la concurrence de l’islamisme radical issu des Frères musulmans, organisation initialement égyptienne, dont la branche soudanaise n’est, dans les premières années, qu’une dépendance, créée à la fin des années 1920. La scission avec le mouvement égyptien originel intervient lors de la répression du mouvement des Frères musulmans par le Président Sadate en 1954.
Dès l’indépendance, malgré une base sociologique plus étroite qui leur valut d’être assimilés au parti de l’élite intellectuelle islamique, les Frères musulmans avaient réussi à acquérir une importance nationale. Plaidant dès les débuts du Soudan indépendant pour une islamisation des institutions, ils promouvront activement au sein de l’Assemblée constituante de 1958 un Etat islamiste. Dans la clandestinité durant la période du premier régime militaire qui prétend pourtant comme eux à l’islamisation et l’arabisation de la société, ils réussissent à profiter du déclin de l’audience des partis traditionalistes, notamment dans les milieux universitaires.
Les différences, tant sociologiques qu’idéologiques, entre les trois tendances, n’ont pas empêché les partis islamiques de se retrouver lorsque leurs intérêts communs l’exigeaient. Ce fut tout d’abord le cas à la fin des années 1960, lorsque Sadeq al-Mahdi, Premier ministre, lança en 1967 un projet d’islamisation où déjà, la sharî’a apparaissait comme source principale du droit et l’Islam religion d’Etat ; ce fut donc logiquement encore le cas contre le général Nimeyri au début des années 1970 où, depuis leur exil à l’étranger, Parti al-Umma, Frères musulmans et PUD, constituèrent un Front commun et fomentèrent les tentatives de coups d’Etat de 1975 et 1976. Après leur échec, dès 1977, ensemble aussi, ils se rapprochèrent du régime, pendant la période de « Réconciliation nationale », souhaitée par Nimeyri, pour tenter de le réformer de l’intérieur, avec le succès qu’on a vu : Hassan al-Turabi, devenu ministre de la justice, sera à un poste clef pour promouvoir des dispositions législatives islamistes et placer ses partisans dans l’administration publique (79).
Inversement, ils se sont aussi parfois affrontés violemment : le fait que Sadeq al-Mahdi, chef de l’Umma, se soit ensuite détourné du général Nimeyri jusqu’à être exilé, condamné à mort par contumace, que les Frères musulmans eux-mêmes soient écartés du pouvoir par le général Nimeyri au crépuscule de son règne, n’empêcha pas qu’ils s’opposent ensuite les uns aux autres sans pitié : c’est l’aile militaire du Front national islamique, FNI, nom pris par les Frères musulmans d’Hassan al-Turabi, qui a organisé le coup d’Etat de juin 1989, après avoir consciencieusement sapé les coalitions gouvernementales, ne serait-ce que par des campagnes d’agitation sociale, dès 1987. Quelles qu’aient pu être les arrangements de façade, sur lesquels vos rapporteurs reviendront incidemment, Hassan al-Turabi est en effet le véritable inspirateur et orchestrateur du coup d’Etat du général Al-Bachir qui renversa le gouvernement de Sadeq al-Mahdi, premier ministre issu des élections démocratiques de 1986. Plus précisément, c’est toujours le Front islamique, pourtant officiellement interdit, qui a fourni l’essentiel des cadres au nouveau régime dès ses premières semaines, occupant plus de postes d’encadrement dans l’appareil d’Etat que les militaires (80).
Au vu de cette évolution et de son parcours politique, il n’est pas interdit de considérer le mouvement de Hassan al-Turabi comme particulièrement opportuniste et conduisant sans en dévier malgré les aléas une stratégie propre sur le long terme. Certes, le pragmatisme n’est pas le seul fait de son mouvement, en témoignent les renversements d’alliances fréquents des deux autres partis islamistes, depuis toujours. Cela étant, force est de reconnaître la très grande habileté tacticienne de Hassan al-Turabi, dès les origines, qui l’ont vu savoir s’allier avec ses ennemis politiques naturels, tels les communistes qu’il contribuera à faire interdire ultérieurement, ou passer dans les années 1970 en très peu de temps des geôles et de la clandestinité aux allées du pouvoir sans autres formalités, ce que l’épisode de 1989, qui est son triomphe, confirme aussi. En termes électoraux, ses stratégies ont été particulièrement payantes et son influence n’a cessé de s’étendre, la consultation de 1986 lui étant très favorable et marquant une forte progression de l’audience de ses idées, sur fond de nationalisme islamo-arabe, sans que son adhésion à la dictature du général Nimeyri lui soit reprochée par le corps électoral. Cela traduit aussi l’enracinement de la mouvance islamiste dans la société civile comme dans l’appareil d’Etat. Comme on a pu le souligner « la force politique qui a soutenu et planifié le coup d’Etat est un parti bien organisé, disposant de moyens importants, qui a infiltré les syndicats, les organisations professionnelles et autres institutions de la société civile » (81). A l’instar de nombre de mouvements comparables, ses contacts internationaux et ses financements lui ont permis de pouvoir développer des institutions sociales et culturelles, notamment, qui sont autant de relais renforçant l’efficacité de son action politique (82) : « D’une certaine façon, mieux que d’autres mouvements de même nature, le FNI a compris tout ce qu’il pouvait retirer d’une transnationalisation de l’islamisme. (…) On ne dira jamais assez comment l’économie politique de l’islamisme soudanais est liée à la mobilisation de réseaux financiers dans la péninsule arabique ou en Asie. » (83).
c) Les autres formations politiques
Le Parti communiste soudanais, PCS (84), a longtemps été le plus puissant du monde arabe, jusqu’à son interdiction en 1971 par le général Nimeyri. Il est apparu dès les années 1940, tout d’abord comme « Mouvement soudanais de libération nationale », issu du mouvement communiste égyptien des années 1930, dont le programme incluait la question du Soudan (85). En cela, il se rapproche de certaines des tendances islamistes décrites plus haut : tout d’abord, comme les Frères musulmans, il n’est, dans les premières années de son existence, qu’une branche « locale » d’un mouvement égyptien ; ensuite car la question nationale, pour le PCS, avant le socialisme, est également primordiale, le second axe fort de leur action tournant autour du développement : dans les premières manifestations de rue contre l’occupant britannique par lesquelles le mouvement se fera remarquer en 1946, c’est la première des priorités, bien avant la revendication ouvrière. C’est la raison pour laquelle, très tôt, le communisme soudanais a pu mener une politique d’ouverture envers les partis traditionnels et s’allier temporairement aux islamistes au cours de diverses périodes : dès avant l’indépendance, dans les années 1950, puis ensuite, contre la dictature du général Abboud d’abord, au sein d’un Front de l’opposition ou encore dans le cadre d’un Front national des partis politiques, à la fin de 1964, au moment de la période révolutionnaire où le PCS eut trois ministres. Par ailleurs, de nombreux cadres communistes ont longtemps joué un rôle important dans les cabinets ministériels ou au parlement, jusqu’en 1989.
Pour autant, se sont également les partis islamistes et traditionnels qui poussèrent à son interdiction, inquiets de ses succès électoraux, dès les élections législatives de 1965, notamment. Décimés par la répression nimeyriste, notamment après la tentative de coup d’Etat de 1971, les communistes ont lors des élections de 1986 considérablement souffert de la concurrence d’autres formations, et se sont trouvés laminés, notamment par le FNI.
Enfin, il est à noter que, malgré le fait que la base sociologique urbaine du PCS lui « interdise » en quelque sorte d’avoir prise sur les électeurs du Sud, en majorité éleveurs et cultivateurs, c’est néanmoins la seule formation politique du Nord à développer une réflexion vis-à-vis du Sud en termes de priorité nationale, à avoir dénoncé les visées arabisantes et islamisantes défendues par les partis traditionnels et à s’être prononcée, dès avant l’indépendance de 1956, pour un Sud Soudan bénéficiant de l’autonomie régionale que les députés sudistes au parlement national réclamaient (86).
A cet égard, il serait réducteur de limiter l’analyse aux seuls partis politiques du Nord Soudan. D’autres existaient également dans les différentes régions du pays, à l’est, à l’ouest et au sud du Soudan, dont on a vu l’importance numérique lors des consultations électorales. Le fait est que leur rôle sur la vie politique nationale n’a pas été aussi déterminant et que ce sont bien plutôt les mouvements rebelles qui se sont imposés comme acteurs majeurs du dialogue, ou plus précisément, de la lutte, entre Khartoum et ses périphéries, et ce, très tôt.
Au Sud, l’Union nationale africaine du Soudan, SANU, sera tout d’abord la voix des réfugiés du sud dans les pays voisins, exilés pour fuir la répression conduite par le général Abboud dans le cadre de sa politique d’islamisation. Parallèlement, un mouvement militaire sudiste, l’Anyanya émergeait pour prendre les rênes de la guerre civile naissante jusqu’à la signature de l’Accord d’Addis Abeba de 1972.
Le Mouvement de libération des peuples du Soudan, SPLM, lui a succédé dans ce rôle lors de la reprise des hostilités en 1983, flanqué d’une branche militaire, l’Armée de libération des peuples du Soudan, SPLA. Cela étant, pour être également originaire du sud, le SPLM n’en a pas moins toujours affirmé des ambitions nationales : son manifeste, publié en 1983 s’inscrit résolument dans une perspective politique nationale, socialiste, en ambitionnant de libérer le territoire national, d’établir un « nouveau Soudan », démocratique, laïc, et de mettre en œuvre une politique de développement nationale, qui concerne aussi bien les régions du Sud délaissées que celles du Nord également défavorisées. En conséquence de quoi, il se considère représentatif des mouvements de l’Est, de l’Ouest, des Monts Nouba, et ne lutte pas uniquement pour le Sud.
Pour être traversé de nombreux courants, qui reprennent pour partie les clivages ethniques, ce mouvement reste néanmoins aujourd’hui le principal du Sud.
A l’Est, le Congrès Beja, plus récent, a néanmoins suivi une trajectoire parallèle à celle du SPLM, en ce sens qu’il s’est opposé à la politique d’islamisation forcée de Khartoum et a développé également une branche militaire qui a combattu les forces gouvernementales dans sa région.
D’autres formations existent encore, dans d’autres régions du pays, notamment à l’ouest, au Darfour, ou au Kordofan, qui appelleraient d’autres développements. Vos rapporteurs ont choisi de les présenter plus en détail au fil de leur analyse, notamment en ce qui concerne le conflit du Darfour. Elles se sont parfois créées sur des thématiques régionalistes, voire indépendantistes, s’inscrivant en opposition à Khartoum, pour répondre à l’isolement ou la marginalisation de leurs régions, que vos rapporteurs ont précédemment décrits. D’une certaine manière, comme il a été dit, des forces centrifuges importantes interagissent au Soudan. Clairement, le rôle que jouent ses différents voisins depuis longtemps ne contribue pas à calmer les inquiétudes.
C. – Le Soudan, objet de toutes les attentions
C’est peu dire que les relations du Soudan avec ses voisins immédiats ne sont pas des plus apaisées. Vers quelque pays qu’on se tourne, sauf peut-être vers le Kenya, surtout intéressé aujourd’hui dans sa relation avec Khartoum par les perspectives commerciales, il apparaît que sur une question ou une autre, le Soudan est ou a été en opposition parfois vive, avec chacun de ses voisins immédiats. Ces tensions, voire ces conflits, se nourrissent des difficultés internes du Soudan et les alimentent à leur tour. C’est même une constante : il n’y a sans doute pas un seul des conflits que le Soudan aura traversés au cours de ces dernières décennies qui n’ait eu à pâtir de quelque intervention extérieure, en faveur de l’un ou l’autre belligérant. Cela est vrai de la crise du Darfour, du conflit entre le Nord et le Sud, voire d’autres, plus marginaux, tel celui des Monts Nouba. En d’autres termes, l’analyse de ces crises et la recherche de solutions pérennes n’ont de sens que dans une perspective régionale. Vos rapporteurs y reviendront le moment venu.
A ce stade, il n’est donc pas inutile de situer historiquement les relations que le Soudan entretient avec un voisinage qui n’est à l’évidence pas de tout repos. Reste ensuite à savoir si le jeu des grandes puissances vis-à-vis du Soudan, dont les richesses en hydrocarbures attisent la convoitise, est de nature à apaiser les tensions.
1) « Avec de tels amis… » (87)
Compte tenu de leur passé commun et du rapport de colon à colonisé qu’ils ont entretenu durant des décennies, depuis le début des années 1820, Egypte et Soudan ne peuvent qu’avoir des relations particulières. Depuis l’indépendance l’Egypte a toujours porté sur le Soudan un regard emprunt d’une sollicitude intéressée, et peut-être même gardé la nostalgie de ses ambitions initiales. On a vu ainsi ce que le processus de décolonisation, lentement et patiemment construit par les Britanniques, devait au poids de l’Egypte, à l’influence qu’elle entendait y conserver et, consécutivement, au contrepoids qu’il leur fallait exercer. Le simple fait que les frontières du Soudan actuel soient celles résultant de l’occupation turco-égyptienne n’est d’ailleurs en soi pas insignifiant.
Plusieurs tentatives d’intégration interviendront entre les deux pays, qui appellent l’attention : après un premier « programme d’action politique et d’intégration économique », signé en février 1974, une « Charte d’intégration liant la République arabe d’Egypte et la République démocratique du Soudan » entrait en vigueur en mai 1983, après avoir été signée par les présidents Hosni Moubarak et Jaafar Nimeyri. Partant notamment de l’idée que « l’histoire, tant ancienne que moderne, témoigne de l’unité, de la sécurité et de l’intégrité de l’Egypte et du Soudan » (88), cette Charte organisait la coordination et l’intégration de l’action diplomatique et militaire, des affaires sociales et de l’économie et des finances des deux pays. Des institutions bilatérales d’intégration étaient prévues et comprenaient notamment un Conseil suprême de l’intégration, coprésidé par les deux chefs d’Etat, ainsi qu’un « parlement de la Vallée du Nil », dont l’intitulé même paraît traduire la véritable préoccupation des promoteurs de l’intégration.
D’une manière générale, plusieurs facteurs se combinent pour marquer fortement, aujourd’hui encore, la relation entre les deux pays. On se souvient tout d’abord que la fourniture d’esclaves en grand nombre fut l’un des principaux arguments de la conquête du Soudan par l’Egypte. Cet aspect a non seulement affecté très directement les populations noires du Sud Soudan, mais il a nourri un ressentiment très durable, encore perceptible. D’un autre côté, le simple fait que le mahdisme initial ait de son côté conquis ses lettres de légitimité historique en traçant une ligne d’opposition frontale avec le colon du Nord, jusqu’à la victoire, positionne également le mouvement dans une ligne de conduite de long terme, tout comme le fait, inversement, que certains des partis politiques qui ont eu un rôle essentiel dans l’histoire contemporaine du Soudan, tels le PCS ou le FNI, soient directement issus des « branches égyptiennes » des courants qu’ils représentent aujourd’hui. En d’autres termes, leur histoire commune lient étroitement le Soudan à l’Egypte par de multiples attaches.
Cela étant, pour importantes qu’elles soient, s’agissant de sentiments touchant à des considérations nationalistes, ces données historiques doivent être complétées. D’autres facteurs touchant aux intérêts vitaux de l’Egypte entrent fortement en ligne de compte. Ainsi que l’ambassadeur d’Egypte en France, M. Nasser Kamel, a pu le confirmer à vos rapporteurs (89), le Soudan a une importance stratégique pour l’Egypte, et la question de l’eau, tout particulièrement, est un enjeu de sécurité nationale, le seul pour lequel elle pourrait même déclarer la guerre.
En ce sens, en premier lieu, le Nil cristallise cette relation : l’Egypte et le Soudan sont indissolublement liés par le fleuve qui, à la fois, les irrigue tous deux et avive leur rivalité. Les questions de la répartition des eaux, de l’incidence humaine, économique et écologique des ouvrages hydrauliques sur l’un ou l’autre territoire, de l’irrigation des zones agricoles, etc., ont de tout temps été thèmes de disputes récurrentes que les négociations internationales ont tenté de régler depuis bien avant l’indépendance : le premier accord de partage des eaux du Nil entre le Soudan et l’Egypte est intervenu en 1929, sous administration coloniale. Le second, toujours en vigueur, a été signé en 1959, sur des bases bien moins léonines que les précédentes pour le Soudan qui en avait demandé la renégociation dès son indépendance acquise. A ce jour, l’Egypte est le seul pays à avoir signé un tel accord avec le Soudan. De même, Assouan en Egypte, Sennar au Soudan, les développements de l’irrigation intensive dans l’un et l’autre pays, sont autant de questions qui, en leur temps, ont crispé les relations égypto-soudanaises. Sans doute en a-t-il été de même avec Méroé aujourd’hui.
Preuve supplémentaire, s’il en était besoin, l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique commune dans les domaines de l’agriculture et de l’irrigation, prévue dans le cadre de la Charte de 1983 (90), aux côtés des secteurs industriels, énergétiques ou de ressources minérales. Selon les estimations, le canal de Jonglei, au Sud Soudan, sur lesquels vos rapporteurs reviendront, aurait ainsi permis à l’Egypte de bénéficier de quelque 4 à 8 milliards de m3 d’eau annuels supplémentaires pour l’irrigation de ses terres ; on comprend qu’aujourd’hui encore elle plaide vivement pour la réactivation de ce projet.
La question des eaux du Nil est aussi l’une des raisons pour lesquelles l’Egypte craint par-dessus tout une sécession du Sud Soudan : le fait de garder une relation privilégiée avec Khartoum dans le cadre d’un Soudan uni lui permettrait d’éviter d’avoir à mener un dialogue avec un Sud Soudan indépendant qu’elle connaît nécessairement moins et avec lequel la relation sera moins fluide qu’avec le « frère arabe » : Pour l’Egypte, le Soudan est avant tout un pays arabe et la perspective de cette sécession est consécutivement source de perturbation (91). De ce point de vue, ni l’accord de paix de 2005 entre le Nord et le Sud Soudan, ni la mort de John Garang, quelques mois plus tard, promoteur de toujours d’un « nouveau Soudan », uni, n’ont constitué de bonnes nouvelles pour la diplomatie égyptienne, dans la mesure où ce qui s’est alors dessiné a ouvert plus vraisemblablement la voie à une séparation qu’à une réconciliation entre les deux régions : l’intérêt objectif, historique, de l’Egypte aura été de voir le CPA réussir et de voir l’unité du Soudan l’emporter sur les ferments de la division. C’est évidemment dans cet ordre d’idées que se sont inscrites les différentes tentatives de l’Egypte de contrecarrer les initiatives de paix régionales qui ont eu tendance à lui échapper : en premier lieu celles engagées par l’InterGovernemental Authority on Development, IGAD (92), entre le Nord et le Sud, à la fin des années 1990, face aux propositions de laquelle, avec la Libye, qui partage sur ce point son intérêt, elle a un temps proposé une « Initiative conjointe » en dix points qui tendait notamment à préserver l’unité du Soudan, alors que la Déclaration de Principes de l’IGAD posait à l’inverse celui de l’autodétermination du Sud (93). De même, plus récemment, le processus conduit par le Qatar en ce qui concerne le Darfour s’est-il heurté à quelques manœuvres de la part de la diplomatie égyptienne, destinées à fomenter, sans réel fondement, des alternatives considérées de toute part comme un pur travail de sape, sans autre but que de retarder, au mieux, le processus.
Cela étant, depuis qu’elle a éclaté, l’Egypte a toujours considéré que la crise du Darfour était une affaire interne au Soudan. Il ne semble pas qu’elle soit entrée dans un jeu déstabilisateur comparable à celui que le Tchad ou la Libye ont pu jouer à plusieurs reprises. Au contraire, l’Egypte a officiellement appuyé, dès le début, les médiations internationales en faveur d’un règlement du conflit, et privilégiant particulièrement la voie de l’Union africaine, dont elle a été l’un des promoteurs sur ce dossier, de préférence à celle des Nations Unies.
Les relations entre les deux capitales sont actuellement au beau fixe, en témoigne l’invitation du président Al-Bachir par son homologue égyptien quelques jours après l’émission du mandat d’arrêt international de la CPI en mars 2009 et la réception avec tous les honneurs qui lui a été réservée par le président égyptien. S’il y avait sans doute dans ce geste du défi à la communauté internationale de la part de l’Egypte, qui ainsi pouvait réassurer sa légitimité comme leader tiers-mondiste, il s’agissait aussi de marquer fortement la solidarité de la communauté arabe et de souligner l’arabité du Soudan.
La qualité de cette relation n’a cependant pas toujours été telle. En témoignent les hauts et les bas des années 1970 et, ultérieurement, la tentative d’assassinat dont le Président Moubarak a été victime en 1995 alors qu’il se trouvait en voyage officiel à Addis Abeba. Sans que rien n’ait semble-t-il jamais pu être prouvé quant au degré d’implication réelle des services secrets soudanais dans cet attentat, les soupçons de la communauté internationale ont toutefois été suffisamment forts et précis pour que Khartoum fasse l’objet de sanctions internationales décidées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, sur lesquels vos rapporteurs auront l’occasion de revenir.
b) Les frères ennemis : la Libye et le Tchad
On ne s’étonnera pas de devoir ici considérer également la Libye comme un acteur à part dans la région depuis maintenant plus de 40 ans, dans la mesure où le colonel Kadhafi a eu, depuis son accession au pouvoir, un rôle des plus ambigus vis-à-vis du Soudan, alternant velléités médiatrices et intentions belliqueuses. De son côté, le Tchad fait peut-être figure de frère ennemi « préféré » du Soudan : le fait que certaines des tribus tchadiennes et soudanaises, les Zaghawa, vivent de part et d’autre de la frontière séparant les deux pays, donne en effet parfois à cette relation, et à ses épisodes de rivalités, surtout, l’allure d’une querelle de famille à grande échelle. Quoiqu’il en soit, il est difficile de ne pas traiter ensemble les relations que tous deux entretiennent avec le Soudan, dans la mesure où les tensions successives du Soudan avec l’un ont, la plupart du temps et jusqu’à aujourd’hui encore, été alimentées par les manœuvres de l’autre, et vice-versa.
Le Soudan et la Libye ont entretenu des relations qui ont sans cesse oscillé du meilleur au pire, les dirigeants de l’un ou l’autre manifestant une certaine tendance à soutenir les opposants de son voisin immédiat, alternant rupture des relations diplomatiques, voire menaces d’agression armée, et fraternité proclamée. Ainsi en fut-il tout particulièrement dans les années 1970 : En 1971, la Libye avait aidé Nimeyri à se débarrasser des communistes qui venaient de tenter de le renverser pour faire barrage au projet de constitution d’Etat fédéral unissant l’Egypte, la Libye et le Soudan que Sadate, Kadhafi et Nimeyri venaient de signer. Le colonel Kadhafi lui avait même remis quelques uns des putschistes qui s’étaient imprudemment réfugiés sur son sol. Néanmoins, les liens du président libyen avec les fondamentalistes musulmans, son soutien à leurs menées contre le président soudanais entre 1975 et 1976 refroidirent quelque peu les relations. La politique de « Réconciliation nationale », conduite à partir de 1977 par le président Nimeyri, contribuera logiquement à la reprise des liens diplomatiques, mais le soutien soudanais aux Accords de Camp David de 1978 signés par l’Egypte y mit cependant de nouveau un frein quelques mois plus tard (94). D’une certaine manière, le baromètre des relations soudano-libyennes fluctue nettement au gré de l’intensité des relations de l’Egypte avec Khartoum et des tentatives déstabilisatrices réciproques, comme au début des années 1980, lorsque le général Nimeyri appuyait les opposants au colonel Kadhafi, lequel soutenait à cette époque les rebelles sudistes du SPLM/SPLA.
Certains dirigeants soudanais ont été plus ouverts que Nimeyri aux intentions libyennes. Sadeq al-Mahdi, à la fin des années 1980, permettra un temps aux forces du colonel Kadhafi de stationner au Darfour pour qu’il puisse intervenir plus aisément contre le gouvernement tchadien d’Hissen Habré, en bute à la rébellion d’Idris Déby, positionnée en territoire soudanais. A l’instar de ce qui avait été tenté avec l’Egypte, Khartoum et Tripoli envisagèrent également une forme d’intégration au début des années 1990, plus centrée sur les aspects économiques que celle avec l’Egypte. Les pourparlers furent d’ailleurs à ce point avancés entre les deux capitales que le général Al-Bachir déclara en mars 1990 que l’« union totale avec la Libye serait accomplie dans les quatre années à venir et qu’elle marquerait la première étape d’une unification globale de l’ensemble du monde arabe. » (95) On ne peut d’ailleurs manquer de mentionner ici que le colonel Kadhafi avait par ailleurs depuis longtemps exprimé le plus vif intérêt pour le Darfour dans lequel il agissait en fait à sa guise dans le cadre de ses soutiens aux rebelles tchadiens. Le Darfour fut un temps une véritable base arrière des forces armées libyennes, au point que des témoignages rapportaient à la fin des années 1980 : « La monnaie libyenne circule au Darfour, des colonnes de camions font la navette entre Koufra et El Fasher, les gouverneurs soudanais du Darfour traitent directement avec Tripoli sans en référer à Khartoum et la province est noyée par les armées libyennes qui sont distribuées aux nomades. » (96)
Cet exemple à lui seul montre à son tour l’extrême imprégnation de la conflictualité soudanaise par l’environnement immédiat du pays. Il est par conséquent nécessaire d’avoir une lecture globale des événements et de l’histoire du Soudan, qui prenne impérativement en compte l’ensemble des acteurs régionaux, tant en ce qui concerne le passé, lointain et récent, que les perspectives, au risque de perdre de vue la logique et la cohérence des faits. Ainsi, les prémices du conflit du Darfour apparaissent-ils sans doute au début des années 1990, à une période où, déjà, pointent l’implication des forces armées tchadiennes et celle de milices Zaghawa et arabes soutenues par le mouvement d’Idris Déby contre l’ethnie Four.
Depuis le milieu des années 1980, jusqu’à aujourd’hui, la période actuelle est tout autant marquée par une tension permanente, ouverte ou latente, entre le régime de N’Djamena et celui de Khartoum : le soutien d’Idris Déby aux rebelles du JEM, celui du général Al-Bachir aux rebelles tchadiens, contribuent à alimenter la crise et font porter de très réels risques à chacun des deux gouvernements, en témoignent l’attaque contre Omdurman, aux portes de Khartoum, en mai 2008, qui fit suite à celle qu’avait dû repousser Déby à N’Djamena même au mois de février précédent. Ce ne sont là que les épisodes les plus récents d’une relation difficile depuis les années post-indépendance, si l’on se rappelle l’aide soudanaise au Frolinat, fondé en 1966 au Darfour et la bienveillance de Khartoum envers la rébellion et les réfugiés tchadiens de cette période (97), ou encore que Goukouni Oueddeï, au début des années 1980, appuyé par le colonel Kadhafi, tentait de repousser les assauts d’Hissen Habré, basé au Darfour. Vos rapporteurs auront l’occasion de revenir longuement sur ces questions lors de leur présentation de la crise du Darfour, qu’on ne peut évidemment analyser que dans une perspective régionale tant la question tchadienne influe sur celle du Darfour (98), tant le Tchad a contribué à la déstabilisation de cette région des années avant que n’éclate la crise de 2003 (99). Un bref regard sur d’autres acteurs régionaux confirme ce sentiment et l’intérêt d’une analyse globale.
c) A l’Est : l’Ethiopie et l’Erythrée
Dans la Corne de l’Afrique, dans un passé récent, l’Ethiopie et l’Erythrée ont également été pour le Soudan de tumultueux voisins. Ils n’ont pas agi seuls, et plus pour que d’autres acteurs sans doute, il importe d’y voir le rôle joué en arrière plan par les grandes puissances, les Etats-Unis et l’ancienne Union soviétique, lesquelles, comme on le verra ultérieurement, ne sont pas non plus sans appétit vis-à-vis du géant soudanais.
Proximité géographique, culturelle et religieuse oblige, l’Ethiopie s’est de tout temps intéressée à son grand voisin et a même soutenu la rébellion du Sud Soudan qui, longtemps, avait ses quartiers à Addis Abeba. Avant même que l’Ethiopie ne bascule un temps dans le camp soviétique, sous Mengistu, Hailé Sélassié était par exemple intervenu comme médiateur dans la première négociation fructueuse entre Khartoum et les mouvements sudistes et l’accord de 1972 fut précisément signé à Addis Abeba. En échange, Khartoum tentera à son tour des médiations pour apaiser le conflit entre l’Erythrée et l’Ethiopie, sans grand succès cependant.
Le soutien, quelques années plus tard, de la dictature éthiopienne à la rébellion sudiste du SPLA eu pour effet d’accroître la tension frontalière entre les deux voisins, que l’appui de Khartoum aux rebelles érythréens entretenait parallèlement. Dans le même ordre d’idées, le Soudan oeuvra patiemment à l’affaiblissement de l’Ethiopie, sur un autre front en aidant les insurgés du FDRPE à renverser les forces gouvernementales de Mengistu, à un moment où les scissions internes affaiblissaient opportunément le SPLA (100).
Indépendamment des aspects politico-militaires qui ont alimenté la rivalité entre les deux géants de la Corne dans les années 1990, il faut signaler que la question nilotique est aussi vitale pour l’Ethiopie qu’elle l’est pour l’Egypte. Cet aspect doit être évalué à sa juste mesure et pèse assurément dans la problématique régionale. L’Ethiopie considère en effet que les accords de partage des eaux entre le Soudan et l’Egypte sont inéquitables, en ce qu’ils la défavorisent considérablement, dès lors que 85 % des eaux du Nil proviennent directement de rivières qui prennent leurs sources sur son territoire, le Nil bleu et l’Atbara et qu’elle se voit privée de possibilités d’irrigation. C’est d’ailleurs pour régler cette question que les tout premiers accords de partage des eaux du Nil, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, portaient notamment sur celles de la rivière Atbara, important affluent du Nil en provenance de l’Ethiopie, et sur le fait que l’Ethiopie s’engageait à ne pas y construire de barrage afin de ne pas contrarier le débit en aval, pour que l’Egypte n’en pâtisse pas. Depuis, au long du XXe siècle, l’Ethiopie n’a eu de cesse de dénoncer ces accords qui lui avaient été imposés et de réclamer de pouvoir bénéficier à son tour de possibilités d’irrigation dont elle ne profite toujours actuellement que pour une part infinitésimale (101). Significativement, c’est d’ailleurs aussi sur le Nil bleu que l’Ethiopie avait tracé la ligne de démarcation au nord de laquelle les forces sudistes ne devaient pas intervenir dans leur conflit avec le Nord.
Les relations entre l’Ethiopie et le Soudan sont aujourd’hui meilleures qu’elles ne l’ont jamais été. A preuve, le fait que le président Al-Bachir ait été reçu avec tous les honneurs peu de temps après l’émission du mandat d’arrêt de la CPI, comme il l’avait été au Caire, ainsi qu’en Libye ou en Erythrée. En d’autres termes, le jeu trouble auquel ces trois voisins se sont livrés dans les années 1990, les uns et les autres soutenant les rebelles de chacun, semble s’être enfin achevé. Pour autant, selon les impressions qu’ont pu recueillir (102) vos rapporteurs sur place, une forme d’incertitude subsiste quant aux intentions ou aux suspicions des uns et des autres quant au futur proche, une inquiétude aussi, du côté éthiopien, forte, quant au risque d’éclatement du Soudan, non seulement en ce qui concerne les perspectives au Sud, mais aussi à l’Ouest. Les forces centrifuges à l’œuvre au Soudan sont aujourd’hui regardées avec préoccupation depuis Addis Abeba qui a pourtant contribué à les entretenir pendant longtemps. Le fait que l’Ethiopie ait une frontière à la fois avec le Nord Soudan et le Sud ne lui facilite pas les choses et sa position est nécessairement délicate entre les deux, comme M. Tekeda Alemu, ministre délégué aux affaires étrangères éthiopien a pu le dire à vos rapporteurs (103). Le fait, enfin, que l’Ethiopie importe désormais du Soudan 80 % de ses besoins en hydrocarbures (104) ne peut évidemment qu’ajouter à l’attention qu’Addis Abeba porte à l’évolution de la situation de son voisin.
d) Le Mikado régional : déstabilisation et interactions
Enfin, on ne peut terminer ce survol des acteurs régionaux sans en mentionner deux autres dont l’un, l’Ouganda, n’est pas le plus inactif. De manière comparable à ce qui s’est joué avec l’Ethiopie, la relation du Soudan et de l’Ouganda, depuis près de trente ans, est en effet un jeu trouble de soutien réciproque aux rébellions que chaque capitale affronte. Le régime du président Museveni a ainsi été un indéfectible soutien aux sudistes du SPLA, il s’est plus récemment intéressé au conflit darfouri, tandis que, de son côté, Khartoum appuyait l’« Armée de résistance du Seigneur », LRA, en lutte ouverte contre Kampala. Avant même Museveni, d’ailleurs, Idi Amin Dada était déjà également connu pour être un sympathisant et un soutien de la rébellion sudiste (105).
Si le gouvernement soudanais a sans doute aujourd’hui cessé son soutien à la LRA, le Sud Soudan n’en reste pas moins encore durement affecté par les incursions des rebelles ougandais qui y ont leurs bases arrières et, surtout, mènent une politique de terreur indiscriminée envers les populations sudistes. Par le fait aussi que des centaines de milliers de personnes ont dû fuir la barbarie de la LRA ces dernières années sévissant dans le nord de l’Ouganda pour se réfugier au Sud Soudan. De son côté, la République centrafricaine est également déstabilisée depuis plusieurs années par la situation régionale, ne serait-ce que par les troupes tchadiennes ou soudanaises qui se servent ou se sont servi de son territoire comme base arrière.
En résumé, au-delà de ces événements, cette région, depuis les indépendances respectives des pays qui la composent, est le théâtre d’un inextricable nœud de conflits armés, d’interactions des uns et des autres, sur fond de rivalités ethniques et tribales, religieuses ou culturelles, d’intérêts économiques et de sécurité nationale, de tentatives internes d’accaparement réciproque du pouvoir et de manipulations diverses.
On conçoit qu’une toile de fond de cette nature incite à la perplexité quant à la viabilité des solutions envisageables pour éviter un embrasement de la région dont les effets de contagion pourraient être redoutables. Que les intérêts des grandes puissances viennent compliquer la donne n’est pas non plus pour inciter à regarder l’avenir avec sérénité.
2) Le jeu des grandes puissances
Indépendamment du rôle historique de la Grande Bretagne au Soudan et dans cette région de l’Afrique, la période récente a vu débarquer à Khartoum et dans ses environs un certain nombre d’acteurs nouveaux qui n’y seraient peut-être pas aussi assidus si le sous-sol soudanais n’avait révélé au cours de ces dernières années des potentialités alléchantes. Malgré le fait que la situation interne soit aujourd’hui tout sauf stabilisée, que le Soudan et son gouvernement soient au pilori des nations, les regards sont attentionnés, les relations parfois soutenues et se joue une partie dont l’issue viendra peut-être finalement plus de New York que d’ailleurs. S’il est isolé par certains, le Soudan est aussi regardé avec bienveillance par d’autres.
Quoiqu’il en soit, c’est bien au cours de la période récente que le Soudan a retenu l’attention : l’antériorité du Royaume Uni fait figure d’exception. En contrepoint, en effet, l’intérêt des Etats-Unis pour l’Afrique en général et pour le Soudan en particulier est relativement récent ; d’autres pays, comme la France, se sont intéressés très tôt à la Corne, sans que le Soudan soit non plus leur priorité. Enfin, le rôle de certains a surtout été déterminé par des considérations géopolitiques touchant indirectement le Soudan, comme en ce qui concerne la Russie, par exemple.
Vos rapporteurs remarquent que la question de la richesse pétrolière, qui a provoqué cet intérêt pour un pays relativement ignoré jusque-là, sauf de ses voisins immédiats, devient un thème incontournable s’agissant de la place du Soudan en Afrique. A cet égard, ce pourrait être un facteur de stabilisation à terme, dans la mesure où la conflictualité actuelle n’est pas la situation idéale ; la venue de la Chine comme observatrice du processus de Doha en cours pourrait en être une illustration. Cela étant, d’autres facteurs interviennent aussi, qui conduisent les grandes puissances à voir en ce géant de la Corne une pièce majeure de la stabilité régionale.
a) La Chine et l’Asie : Sus au pétrole !
L’Asie, et tout particulièrement la Chine et la Malaisie, auxquelles se joint désormais l’Inde, ont porté un intérêt croissant au Soudan ces dernières années, essentiellement motivé par les ressources pétrolières que le sous-sol soudanais recèle. Si ce sont des entreprises occidentales qui ont débuté l’exploration dans les années 1960 et 1970, comme vos rapporteurs l’ont rappelé, et qui ont fait les premières découvertes, ce ne sont pas elles en revanche qui se sont lancées dans l’exploitation : L’américaine Chevron a rapidement cédé ses concessions, dès 1984, pour des raisons de sécurité, après que trois de ses employés eurent été tués lors d’attaques armées des rebelles Anyanya peu après la reprise des combats entre le Nord et le Sud. Une entreprise canadienne, Talisman, puis d’autres encore, également occidentales se sont toutes plus ou moins retirées ou ont mis leurs activités en suspens. La française Total, de son côté, titulaire d’une concession de quelque 125 000 Kms2, dans une zone à fort potentiel qui lui a été âprement disputée, est la dernière des majors occidentales encore présente sur le terrain, mais elle a également suspendu ses activités pour les mêmes raisons, à la reprise de la guerre. A la différence des entreprises chinoises, uniquement exploitantes, Total peut aussi intervenir sur la prospection. L’entreprise a récemment vu son contrat renouvelé, et reste en attente de jours meilleurs, la situation étant toujours actuellement par trop instable (106).
Profitant du vide ainsi créé, les entreprises chinoises et malaises du secteur ont investi massivement au Soudan, à l’invitation du gouvernement: c’est en 1992 que les premiers contacts sont pris, et au tout début 1994 que les entreprises signent les premiers contrats (107). Compte tenu de la position internationale que la Chine occupe aujourd’hui dans la mondialisation, il s’agit pour les deux partenaires d’un jeu « gagnant – gagnant » : La Chine dispose à bon compte des exportations pétrolières soudanaises qui lui permettent de combler une part croissante de ses besoins énergétiques ; accessoirement, elle trouve au Soudan un débouché supplémentaire pour ses propres exportations, non seulement en infrastructures, mais surtout en matériel militaire dont ce pays est un consommateur friand compte tenu des besoins que sa situation intérieure entretient : les armes chinoises, ainsi que russes, ont permis à Khartoum d’accroître considérablement son potentiel militaire, en hélicoptères de combat et bombardiers, utilisés dans les conflits du Sud et du Darfour.
Le Soudan trouve dans ce partenariat d’autres avantages que ces approvisionnements, avec certaines facilités qui lui conviennent : des coûts modérés pour ses propres achats ; des ressources d’exportation assurées, alors qu’il y a encore dix ans son crédit international était des plus faibles et, last but not least, un allié précieux, au demeurant peu regardant, à la différence des autres grandes puissances, sur la situation interne du pays, au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. D’autant plus précieux aujourd’hui que les développements de ces dernières années ont pris une tournure désagréable pour les dirigeants soudanais. Comme de coutume, la Chine n’a jamais imposé à son partenaire soudanais quelque conditionnalité que ce soit à leurs échanges commerciaux quant au respect des droits de l’homme, à la situation humanitaire en général ou à la manière dont Khartoum essayait de régler ses conflits internes. En cela, elle diffère notablement des Etats-Unis, par exemple, qui ont au contraire mené une politique de sanctions bilatérales et dont la législation a contraint ces dernières années les entreprises à désinvestir du Soudan sous peine de pénalités.
La Chine profite du champ libre que lui laisse la stratégie des occidentaux : en premier lieu, désormais deuxième importateur mondial d’hydrocarbures, ses besoins sont devenus énormes, et l’accès aux ressources est pour elle aujourd’hui un enjeu stratégique vital comparable, toutes choses égales par ailleurs, à celui de l’Egypte vis-à-vis des eaux du Nil. Sa stratégie vis-à-vis de l’Afrique en général, et du Soudan en particulier, s’inscrit dans le processus de sécurisation et de diversification de ses approvisionnements qu’elle mène et qui explique également sa forte présence depuis plusieurs années sur d’autres marchés africains majeurs, comme le Nigeria, l’Angola ou la Guinée équatoriale (108), pour ne citer que ces exemples, ainsi que les intérêts qu’elle marque pour bien d’autres zones sur un continent qui lui permet de réduire sa dépendance énergétique (109) : Au passage, on ne peut ainsi manquer de remarquer pour le propos qui intéresse ce rapport, qu’elle regarde également du côté des gisements tchadiens. En second lieu, l’intérêt chinois pour le Soudan est d’autant plus immédiat que l’absence des majors occidentales lui permet précisément d’obtenir à bon compte des droits d’exploitation en jachère, dans un pays dont l’économie se fonde depuis peu sur le développement de ce secteur, à la différence des grands producteurs africains du Golfe de Guinée et de la côte atlantique dont certains sont par ailleurs déjà en déclin. Selon les données citées par le rapport de l’EIA de septembre 2009, ce sont désormais plus de 50 % des exportations soudanaises de brut qui partent à destination du marché chinois, soit, en 2008, quelque 214 000 barils/jour.
Quoi qu’il en soit, en ce qui concerne le Soudan, compte tenu des circonstances et de la position actuelle des autres grands importateurs, la Chine est clairement en train de se constituer un monopole dont il sera difficile de la déloger, si tant est que l’évolution de la situation permette un jour aux occidentaux d’envisager cette hypothèse. En effet, à l’heure actuelle, la China National Petroleum Company, CNPC, est d’ores et déjà le premier investisseur étranger au Soudan. On estime qu’elle y a investi quelque 15 milliards de dollars depuis son entrée en lice au milieu des années 1990 et son activité au Soudan est la plus importante de celles qu’elle mène à l’étranger. En consortium avec Petronas, entreprise malaisienne, et Sudapet, entreprise nationale soudanaise, elle a formé en décembre 1996 la Great Nile Petroleum Operating Company, GNPOC, dont elle est majoritaire, et a notamment racheté les droits canadiens ainsi que ceux de Chevron sur plusieurs blocs. Cette politique de rachat de droits d’exploitation inutilisés a été systématique, elle continue, et la Chine, ayant développé en peu de temps une relation politique, économique et militaire étroite avec Khartoum, a vu les positions de la CNPC, seule ou en consortium, croître considérablement (110). Désormais, ce n’est plus seulement dans l’exploitation pétrolière que les entreprises chinoises sont positionnées, mais aussi sur les secteurs connexes : pétrochimie ou distribution, notamment.
Le jeu « gagnant – gagnant » que l’on évoquait plus haut a donc effectivement fonctionné à plein dans la mesure où d’un côté, les positions de la CNPC sont aujourd’hui sans doute intouchables et que de l’autre, Khartoum a trouvé en la Chine l’alliée qu’il escomptait : Très concrètement, bien qu’elle en ait agité la menace à plusieurs reprises, notamment en 2004, si la Chine n’est encore jamais allée jusqu’à user de son droit de veto au sein du Conseil de sécurité, Beijing a clairement mené une diplomatie tendant à tempérer les ardeurs des Etats-Unis et d’autres occidentaux en matière de sanctions économiques et politiques (111).
Mutatis mutandis, la politique de la Malaisie est identique à celle de la Chine. Les compagnies nationales malaisiennes sont entrées au Soudan en 1997 et ont pris rapidement des parts de plus en plus importantes dans le secteur. Intervenant sur les différentes activités de l’industrie pétrolière, jusqu’au raffinage, aspect dans lequel elles ont investi 1 milliard de dollars US, les opérations qu’elles y mènent sont aujourd’hui, comme en ce qui concerne les entreprises chinoises, les plus importantes qu’elles ont à l’étranger (112). A l’instar de la CNPC, les entreprises malaises agissent en partenariat, parfois majoritaire, au sein de différents consortia pour l’exploitation de champs ou d’autres activités connexes.
Pour être plus modeste, un troisième acteur notable, également asiatique, doit être mentionné : l’ONGC. La compagnie nationale indienne n’est pas en reste, que ce soit au niveau des montants investis ou des secteurs dans lesquels elle intervient, au sein de consortia constitués avec Petronas et Sudapet, notamment, dans lesquels elle n’apparaît en revanche pas majoritaire, à la différence de ses consoeurs chinoises et malaises.
En d’autres termes, la question pétrolière au Soudan est clairement devenue un enjeu de toute première importance, tant pour le pays que ses partenaires industriels et commerciaux, et, à l’heure actuelle, tout spécialement pour les pays asiatiques.
Avant qu’ils ne prennent à bras le corps le conflit du Darfour et ne lui donnent notamment un écho médiatique international considérable à partir de l’année 2004, thème sur lequel vos rapporteurs reviendront, les Etats-Unis n’étaient pas particulièrement présents au Soudan, non plus d’ailleurs, d’une manière générale, qu’en Afrique.
Il n’est pas toutefois pas inutile de rappeler tout d’abord que la Corne de l’Afrique a longtemps été le théâtre de la rivalité américano-soviétique durant la Guerre froide. Par acteurs régionaux interposés, Etats-Unis et Union soviétique ont eu les différents pays de la région pour pièces sur leur échiquier, mais l’enjeu n’était alors pas tant sur le Soudan que sur l’Ethiopie. Le Soudan apparaissait plus en toile de fond que réellement au centre des préoccupations. Pour se limiter à la période la plus récente, vos rapporteurs ont rappelé les liens entre le régime « progressiste » de Nimeyri et le camp socialiste : à peine arrivé au pouvoir, Nimeyri reconnaissait la RDA, renforçait ses relations avec l’URSS, la Chine et l’Europe de l’Est. Cette lune de miel ne durait certes pas, puisque dès la tentative de coup d’Etat communiste en 1971, Nimeyri se tournait résolument vers l’occident, rejoignant l’Egypte, alliée s’il en est des Etats-Unis, jusqu’à se froisser avec les autres Etats arabes lors du soutien résolu qu’il manifestera aux Accords de Camp David.
L’Ethiopie a toujours peu ou prou mené la même politique vis-à-vis du Soudan : à savoir un regard bienveillant vis-à-vis des revendications sudistes. Que ce soit dans sa période marxiste, soutenu par l’Union soviétique, où la guérilla soudanaise avait son sanctuaire à Addis Abeba et ses bases arrières en territoire éthiopien d’où elle lançait ses offensives contre les forces de Khartoum (113) ; que ce soit ensuite, certes dans une moindre mesure, après la chute du régime Mengistu, facilitée par les Etats-Unis. Comme si, l’un comme l’autre, Russie et Etats-Unis avaient joué par acteur éthiopien interposé contre un Soudan uni, sans oublier le rôle direct plus actif de ces mêmes Etats-Unis au cours de ces dernières années et notamment dans le cadre de la négociation qui mènerait aux accords de paix signés en 2005 et à l’option claire qu’ils ont portée en faveur de l’autodétermination du Sud.
Plus précisément, depuis une quarantaine d’années, la diplomatie américaine vis-à-vis de Khartoum a évolué au gré des gouvernements en place et des pics de tension. Dans les années 1970, par exemple, le basculement de Nimeyri dans le camp occidental permettra un réel rapprochement entre les deux capitales, en froid depuis la Guerre des Six jours. Khartoum trouvera même un soutien déterminé de la part des Etats-Unis dans la mesure où le dirigeant soudanais paraissait alors à même de faire pièce dans la région au colonel Kadhafi. Globalement, cette période, malgré l’assassinat de l’ambassadeur américain en 1973 (114), est plutôt constructive entre les deux pays, de telle sorte que dans la décennie suivante, le Soudan sera même le premier bénéficiaire de l’aide au développement américaine en Afrique subsaharienne.
En revanche, à compter du coup d’Etat de Al-Bachir, les années 1990 vont être celles d’un refroidissement sensible entre Washington et Khartoum, lorsque le régime soudanais fait rapidement figure de soutien aux ennemis de l’Amérique, - l’Irak en guerre contre le Koweït -, et au terrorisme international islamiste. D’une certaine manière, plus que la question du conflit entre le Nord et le Sud, c’est à l’époque celle du soutien soudanais au terrorisme international, - polymorphe : de l’hébergement d’Oussama ben Laden, de Carlos et d’Abu Nidal à l’appui au Hamas ; du rôle du Soudan dans la radicalisation du mouvement islamiste aux liens avec les mouvements terroristes -, qui conditionne l’évolution de la diplomatie américaine envers Khartoum. Il s’agissait dès lors d’éviter de consolider le gouvernement soudanais et même de l’affaiblir, ce en quoi leurs alliés de la Corne les rejoignaient, pour peu fréquentables que fussent les rebelles sudistes (115) pour Washington. Un temps, les relations diplomatiques seront suspendues, le Soudan sera inscrit sur la liste des Etats soutiens du terrorisme, des sanctions économiques bilatérales seront instaurées ; une usine pharmaceutique dans les faubourgs de Khartoum, supposée, à tort, fabriquer des armes chimiques, sera même bombardée en 1998. Néanmoins, une certaine ambiguïté dans la politique américaine n’a pas manqué d’être soulignée, puisque, si d’un côté, John Garang était reçu à Washington, de l’autre les services de sécurité des deux pays commencèrent aussi à coopérer lorsque Khartoum chercha à améliorer sa position vers la fin des années 1990. Les attentats du 11 septembre 2001 facilitèrent la reprise des relations auxquelles la répression du conflit du Darfour par le gouvernement et ses affidés mit fin.
D’une certaine manière, le Soudan illustre parfaitement les deux objectifs principaux de long terme de la politique africaine des Etats-Unis : la lutte contre l’islamisme terroriste et la diversification de leurs approvisionnements pétroliers. Bien que les compagnies américaines soient aujourd’hui encore toujours absentes du Soudan et, qu’en Afrique, elles se concentrent essentiellement sur les pays producteurs du Golfe de Guinée, le potentiel de la région Centre-Est, autour du Soudan, du Tchad, demain de l’Ouganda et peut-être de la RDC, est tel qu’il ne peut rester étranger à leurs préoccupations.
Le Soudan n’est bien sûr pas encore éligible aux critères définis dans l’African Growth and Opportunity Act, AGOA, adopté en 2000 pour développer les relations commerciales entre les Etats-Unis et l’Afrique. Pour autant, peut-on raisonnablement imaginer que les Etats-Unis et les majors américaines resteront longtemps sans réagir à la mainmise chinoise sur le pétrole africain, et en l’espèce sur les réserves soudanaises ? Il semble être de leur intérêt bien compris de revenir sur la scène locale ; le fait par exemple, qu’en 1996, l’administration américaine avait suspendu la loi antiterroriste pour le Soudan afin de permettre à une major de négocier l’exploitation d’un important champ de pétrole tendrait à le prouver (116). Toutes choses égales par ailleurs, c’est encore et toujours la question pétrolière qui motiva en partie à la fin des années 1990 la Grande Bretagne à tenter de renouer le dialogue avec Khartoum, compte tenu des possibles intérêts de British Petroleum sur place.
Enfin, on ne peut ignorer la présence d’un autre acteur international important au Soudan, qu’on ne s’attendrait pas forcément à voir figurer dans la liste des plus actifs. Or, de nombreuses informations au long de ces dernières années, laissent entendre que Tel Aviv suit avec une particulière attention ce qui se passe au Soudan, alors même que les deux pays n’entretiennent toujours pas de relations diplomatiques.
En premier lieu, vos rapporteurs remarquent que la presse internationale s’est fait l’écho ces derniers mois de bombardements sur le sol soudanais, dont la paternité est vraisemblablement israélienne, dans la mesure où les cibles étaient des convois illégaux d’armes, supposés être à destination de Gaza. Plusieurs attaques, probablement trois, ont ainsi été effectuées, en janvier et février 2009, dont notamment une, au nord de Port-Soudan, sur la mer Rouge (117), à quelque 1400 Kms d’Israël. D’une manière plus générale, le fait que Khartoum ait été considéré comme une base importante du terrorisme islamiste, comme on l’a vu plus haut, ne pouvait évidemment laisser Israël indifférent et en cela, positions américaine et israélienne se rejoignent.
Au-delà de ces opérations ponctuelles de sécurité que peut mener Israël, les forces centrifuges à l’œuvre au Soudan avaient toutes les raisons de retenir son attention. La rébellion du Sud Soudan bénéficia ainsi de l’aide israélienne soit par l’Ouganda, soit via l’Ethiopie avec laquelle il entretenait de bonnes relations. Israël a pu ainsi, en soutenant le Sud, contribuer comme d’autres à affaiblir opportunément le gouvernement central de Khartoum, notamment à une époque où, à l’aube des années 1970, il était pronassérien (118).
Pour être certes historiques, ces rappels ne sont sans doute pas inutiles dans la mesure où, aujourd’hui encore, Israël entretient des liens étroits avec certaines des tendances de la rébellion darfouri. Le Mouvement de libération du Soudan, MLS, d’AbdelWahid al-Nour, notamment, dispose ainsi d’un bureau de représentation à Tel-Aviv, peut-être de sources de financements. Il n’est sans doute pas illogique de voir dans ces positions israéliennes une continuité et la confirmation du fait que la sécurité d’Israël passe par l’affaiblissement de Khartoum, qu’on a pu jadis qualifier d’être devenu « le Moscou des mouvements fondamentalismes arabes » (119). Ce n’est donc pas un hasard si son implication dans la région est à la fois longue et ancienne, d’autant plus légitime que, de leur côté, les islamistes soudanais, Hassan al-Turabi au premier chef, ne s’étaient pas privés dans le passé d’intercéder entre le Fatah et les factions islamistes radicales du Hamas et d’autres mouvements (120).
Enfin, reste le fait que, selon les informations qui ont pu être recueillies par vos rapporteurs, plusieurs milliers de soudanais ont émigré depuis quelques temps en Israël, qui ne sont pas juifs, sans qu’on sache précisément leurs motivations.
En d’autres termes, est-il déraisonnable de considérer que toute solution durable apportée aux problèmes du Soudan, avant même d’être entérinée par les bénéficiaires ou principaux concernés, devra nécessairement obtenir l’aval des grandes puissances et autres pays influents de la région ? Au vu des scénarios en discussion depuis maintenant plusieurs années, qu’il s’agisse du Sud Soudan et de l’application du CPA ou du conflit du Darfour, une solution qui ne se traduirait pas par une certaine diminution du poids du pouvoir de Khartoum a-t-elle quelque chance de rencontrer un soutien international qui en garantisse l’application, tant il semble de l’intérêt de tous les intéressés qu’il en soit ainsi.
3) Les troublantes affinités de la France et du Soudan
La relation de la France avec le Soudan semble tout aussi complexe que celle que ce pays entretient avec ses autres partenaires ou avec les grandes puissances, alternant périodes apaisées et vives tensions.
Longtemps, les rapports de la France et du Soudan ont été cordiaux sinon excellents. Incomparablement meilleurs que ceux que le Soudan, dans la situation d’isolement international que l’on a vue, entretenait alors avec d’autres pays occidentaux, tout spécialement les Etats-Unis. Plusieurs indices le confirment, qui se situent à divers niveaux.
a) Le Soudan et la francophonie
Dans un premier temps, on peut tout d’abord s’arrêter sur l’un des aspects les plus symboliques, même s’il pourra finalement apparaître comme presque anecdotique : la demande de Khartoum à la fin des années 1990 d’adhérer à l’Organisation internationale de la Francophonie. Sans être un pays de tradition francophone, notre langue est cependant loin d’être absente du Soudan. En effet, le français a commencé à y être enseigné dans les années 1960. Il est même devenu un enseignement obligatoire pour les élèves du secondaire et figure aujourd’hui au programme de plusieurs centres universitaires soudanais. S’il représente aujourd’hui la deuxième langue européenne dans le pays, après l’anglais (121), hors des circuits scolaires et universitaires, c’est essentiellement dans l’ouest du pays que le français est parlé, aux frontières avec les pays francophones de la région, Tchad, République centrafricaine et République démocratique du Congo, compte tenu des échanges socioculturels et économiques traditionnels entre tribus et ethnies vivant de part et d’autres des tracés frontaliers.
Cela étant, outre la proximité des voisins de l’ouest, on peut ajouter aussi le fait que d’autres, telle l’Egypte, ont depuis longtemps une tradition francophone et francophile affirmée, que d’autres membres de la Ligue arabe sont également francophones, ou encore que les principales institutions africaines ou de coopération ont le français comme langue de travail. Selon les informations fournies à vos rapporteurs (122), l’intérêt du Soudan, à l’époque, de rejoindre l’OIF répondait à plusieurs préoccupations : d’une part, intégrer un nouvel espace de dialogue qui pourrait lui permettre d’améliorer ses rapports internationaux avec certains de ses voisins immédiats, la République centrafricaine et le Tchad notamment, avec lesquels ils n’étaient alors pas les meilleurs, surtout en ce qui concerne ce dernier ; avoir également la possibilité de rejoindre le noyau dur des bénéficiaires de l’aide publique au développement de la France, en pouvant intégrer alors la zone de solidarité prioritaire ; enfin, échapper à l’enfermement d’un dialogue exclusif avec les anglo-saxons, en ce qui concerne le traitement de la question du Sud.
Malgré la faiblesse du nombre de locuteurs français au Soudan, le gouvernement français soutenait la démarche de Khartoum. Les attentats du 11 septembre 2001 et le souhait consécutif du Soudan d’apparaître comme participant au premier chef à la lutte contre le terrorisme international, pour retrouver une position plus appréciable, renforcèrent, si besoin était, cette position. La répression de la crise du Darfour est venue remettre en question la dynamique enclenchée et finalement la demande d’adhésion fut logiquement refusée : accepter l’entrée du Soudan dans la Francophonie au moment même où des accusations de génocide commençaient de prendre forme aurait été en contradiction avec les valeurs de démocratie et d’Etat de droit que promeut l’OIF, à l’évidence peu en accord avec celles défendues par le gouvernement de Khartoum.
Cela étant, l’épisode autour de la Francophonie n’est pas le seul qui permette d’illustrer la qualité de la relation bilatérale entre la France et le Soudan à cette époque. D’autres éléments sont à prendre en compte et à mettre en perspective.
b) La lune de miel franco-soudanaise
Cette décennie 1990 apparaît en effet comme une période durant laquelle la diplomatie française a notablement été active en faveur du Soudan, et tout particulièrement de Khartoum, alors même que ce pays apparaissait pour le moins isolé, comme on l’a vu, eu égard aux liens qui lui étaient reprochés avec le terrorisme islamiste.
Plusieurs exemples concrets viennent corroborer ce sentiment, que vos rapporteurs veulent rappeler. Deux événements sont en effet significatifs, qui permettent, à quelques années d’intervalle, d’illustrer une continuité dans la diplomatie de notre pays, quels que soient les présidents et majorités politiques au pouvoir durant ces années 1990 : en premier lieu, la remise aux autorités françaises le 14 août 1994, par les services secrets soudanais, du terroriste vénézuélien Ilitch Ramírez Sánchez, « Carlos », réfugié à Khartoum depuis 1991. En second lieu, la levée en septembre 2001 de la série de sanctions internationales contre le Soudan qui avaient été adoptées en 1996, que la France s’était fixée parmi les objectifs de sa présidence du Conseil de sécurité (123).
Les titres de la presse française de l’époque sont éloquents : « La France aux petits soins pour la junte islamiste du Soudan » (124) ; « Le prix de Carlos » (125), voire : « Soudan, le marché de la honte » (126). Toutes les enquêtes alors menées proposent des analyses dont les conclusions, démenties par le ministre de l’intérieur, Charles Pasqua, comme par les autorités soudanaises (127), sont cependant unanimement concordantes, à savoir que la France est un des soutiens internationaux les plus actifs du Soudan et qu’elle lui apporte une aide aux multiples facettes.
Ainsi, selon Stephen Smith « La France continue de soutenir la junte islamiste au pouvoir à Khartoum, dont elle a réorganisé et rééquipé les services secrets et dont l’armée, grâce à l’entremise de Paris, s’apprête à lancer une grande offensive contre les rebelles du Sud Soudan depuis le Zaïre voisin. Selon une source militaire occidentale, " près de 3000 soldats gouvernementaux " auraient été acheminés dans le nord-est du Zaïre depuis que la France a obtenu, du maréchal président Mobutu, un droit de passage pour l’armée soudanaise (128). En même temps, la collaboration entre les services français et soudanais s’est activement poursuivie depuis la "livraison " par Khartoum, il y a cinq mois, du terroriste présumé Carlos. »
Parmi les éléments entrant en ligne de compte dans cette politique, pour la France, quelques contrats économiques sont mentionnés : au fil de leur lecture de la presse de cette époque et des informations qu’ils ont recueillies, vos rapporteurs ont ainsi glané des ventes d’Airbus, le fait que des entreprises françaises étaient présentes sur le terrain, dans les domaines minier, pétrolier, de la gomme arabique, des infrastructures ou autres : BRGM, Iranex, GTM, et bien sûr, Total sont concernées ; d’autres encore, tel Alsthom, ont pu être favorisées lors de grands travaux, comme lors de la construction du barrage de Méroé, par exemple, récemment mis en eau.
Les éléments du « marché » entre Paris et Khartoum sont convaincants, surtout si l’on y ajoute d’autres indices : sur un plan politique, en effet, cette époque est aussi celle où, en parallèle, le Front islamique du Salut, (FIS), mène en Algérie le combat que l’on sait. Selon certaines analyses (129), la France a donc pu avoir un intérêt à une médiation soudanaise, profitant de l’aura et du pouvoir de Hassan al-Turabi sur le monde islamique radical, en relation étroite notamment avec le mouvement algérien. Dans le même esprit, enfin, le fait que la France apparaisse ainsi comme l’interlocuteur occidental privilégié d’un régime islamiste ostracisé par les autres, n’est sans doute pas non plus à négliger en termes de bénéfice diplomatique qu’un pays comme le nôtre peut retirer vis-à-vis des alliés du Soudan.
De sorte que la France, au cours de ces années cruciales, compte tenu aussi de sa position clef auprès des autres acteurs, a pu ainsi jouer un rôle diplomatique complet sur la scène régionale, en élargissant l’éventail de sa politique arabe grâce à cette relation privilégiée avec le Soudan (130) : La question du Tchad, par exemple, est alors centrale, tant vis-à-vis de la France que pour le Soudan. Paris, au long de ces années, a contribué à calmer le jeu déstabilisateur du Soudan sur le Tchad et la RCA, modérant les « appétits » soudanais, consolidant le régime Déby à N’Djamena ainsi que le nord de la république centrafricaine. En d’autres termes, il s’agissait d’une action diplomatique multiforme, avec les différentes parties prenantes de la région, dans laquelle les implications régionales sont prises en compte tout comme la question du Sud Soudan en arrière plan. Pour ces bons offices, outre la remise de Carlos, une modération du prosélytisme islamiste de Khartoum dans les pays d’Afrique francophone pouvait être obtenue.
En échange, pour le Soudan, le bénéfice d’un appui international résolu de la France dans quelques dossiers épineux a été acquis : la négociation de sa dette vis-à-vis du FMI, notamment, ainsi qu’une aide apportée pour y faire face ; la sécurisation de ses frontières ; quelques facilités militaires, aussi, dans son conflit avec le Sud : indépendamment du « droit de passage » en territoire zaïrois ou centrafricain pour que les troupes d’Al-Bachir puissent prendre à revers les rebelles du SPLA, vos rapporteurs se sont ainsi vus reprocher, quinze ans plus tard, la remise par les services français aux forces armées du Nord de photos satellites SPOT indiquant les positions des sudistes, comme prix de la remise de Carlos (131), ce que la presse mentionnait déjà en août 1994 (132). In fine, la levée des sanctions internationales en 2001 n’en prend que plus de relief.
Reste en tout cas que dans sa relation avec le Soudan, Paris a très nettement privilégié Khartoum sur Juba : si l’on en croit Libération (133), qui rapporte des contacts initiaux entre officiers de la DGSE et du SPLA sudiste, si des velléités d’aide à la rébellion de John Garang ont eu lieu à la fin des années 1980, elles ont été interrompues, ou fortement atténuées, après le coup d’Etat de juin 1989 et l’arrivée du régime islamiste présidé par le général Al-Bachir. Dès lors, la relation entre la France et le Soudan a clairement et durablement été entre Paris et Khartoum, ce qui sera confirmé à vos rapporteurs (134).
Sans qu’il s’agisse ici de discuter les choix alors faits par la France, force est de constater que ce soutien unilatéral lui vaudra en tout cas ultérieurement quelques revers ou déboires lors du lancement des négociations internationales de paix qui conduiront à la signature de l’accord de 2005 : non seulement les anglo-saxons, Etats-Unis, Grande Bretagne, auxquels était alliée la Norvège, se refuseront à voir la France y participer comme elle le souhaitait, mais l’envoyé spécial du président Jacques Chirac aura les plus grandes peines à s’introduire dans le processus et à se faire aussi accepter des sudistes d’un John Garang hostile qui n’avait pas oublié les facilités de la France à Khartoum quelques années plus tôt lors de l’affaire Carlos (135). Il ne lui sera finalement accordé qu’un siège d’observateur et la France ne sera pas considérée comme partie prenante aux négociations.
c) Les années 2000 : les amours déçues
Ces rappels permettent de mieux saisir le fait que cette bonne relation ait brutalement fraîchi au cours des années 2000 et l’ampleur de la désillusion soudanaise vis-à-vis de Paris. Comme si Khartoum était resté sur sa perception initiale et comprenait mal le rôle joué par la France dans le durcissement ultérieur des positions internationales. Aujourd’hui, le Soudan accuse notamment la France d’avoir été à l’origine de la résolution 1593 de mars 2005 qui a déclenché la mise en œuvre de l’action de la Cour pénale internationale.
De l’avis de vos rapporteurs, la réalité sur cette résolution est sans doute plus équilibrée. Il est certain que la France a été à l’initiative de ce projet de résolution devant le Conseil de sécurité, qui a été cependant officiellement soumis par la Grande Bretagne seule. Force est aussi de remarquer que cette résolution a été adoptée à une large majorité des membres du Conseil de sécurité. Seuls quatre pays se sont en effet abstenus : d’une part, l’Algérie et le Brésil, et, parmi les membres permanents, les Etats-Unis et la Chine. Surtout, comme l’argumentait à juste titre le représentant de la France lors du débat (136), il s’agissait par l’adoption de ce texte, de tirer les conclusions du rapport de la commission d’enquête internationale remis quelques semaines plus tôt, qui avait recommandé « instamment que le Conseil de sécurité défère sans tarder la situation au Darfour à la Cour pénale internationale », dans la mesure où « nombre de crimes dont il est allégué qu’ils ont été commis au Darfour revêtent un caractère systématique et généralisé. Ils remplissent toutes les conditions que prévoit le Statut de la Cour pour l’exercice de sa compétence à leur égard. Les institutions judiciaires soudanaises se sont avérées n’avoir ni la capacité, ni la volonté de rechercher et poursuivre les responsables de ces crimes. » (137) En conséquence, il fallait clore le troisième volet de la politique du Conseil vis-à-vis de la question du Darfour : après avoir mis en œuvre la semaine précédente un premier volet, relatif au renforcement du dispositif de surveillance et de protection de l’Union africaine, puis un second, concernant le règlement politique du conflit, restait pour le Conseil de sécurité à actionner celui de la lutte contre l’impunité des coupables. Accabler la France de tous les maux du Soudan paraît donc quelque peu excessif, compte tenu des circonstances collectives et de la position respective des différents membres du Conseil de sécurité qui ne sont pas fondamentalement éloignées de celle de notre pays. Vos rapporteurs auront l’occasion de revenir sur ces questions.
Plusieurs autres griefs sont également portés par le gouvernement du Soudan contre la France qui ne sont pas acceptables. Il est ainsi reproché à la France le fait que le ministre des affaires étrangères ait un passé de militant de la cause humanitaire, notamment engagé au Sud Soudan, ce qui donne nécessairement à sa politique une connotation idéologique ou le fait que notre pays héberge AbdelWahid al-Nour, leader politique du peuple Four, sans contrepartie et sans réussir à l’inclure dans les négociations de paix. Il n’est pas inutile de mentionner ici les positions les plus dures qui ont été exprimées devant vos rapporteurs lors de leur mission par les autorités soudanaises (138) : en premier lieu, la position de la France, en ce qui concerne le Darfour, notamment, serait conditionnée par un agenda politique, en liaison avec ses propres intérêts au Tchad, et non basée sur l’analyse impartiale des faits.
En d’autres termes, les autorités soudanaises « regrettent » aujourd’hui que la France, autrefois amie du monde arabe et appréciée dans la région pour ses positions en faveur des Palestiniens ou pour sa position lors du conflit en Irak, ait changé de politique depuis l’élection du président Sarkozy. Les responsables soudanais estiment que notre pays a désormais une position négative vis-à-vis du Soudan, pire même que celles des Etats-Unis et de la Grande Bretagne.
En résumé, comme Patrick Nicoloso, ambassadeur de France au Soudan, a pu le faire remarquer à la commission des affaires étrangères (139), du point de vue soudanais, pour cet ensemble de raisons éparses, aujourd’hui, le principal ennemi c’est la France, mue par le souhait de dépecer le Soudan, pour mieux profiter de ses richesses, notamment pétrolières.
Pour autant, ces mêmes interlocuteurs estiment que le fait que la France soit présente en Afrique, à la différence de la Grande Bretagne, lui donne une position meilleure pour intervenir d’une manière constructive et impartiale, ce qui est souhaité. Il a été dit à vos rapporteurs qu’il serait opportun que la France intervienne car elle a un rôle central à jouer, compte tenu de ses liens avec le Tchad et du fait que la solution au problème du Darfour ne se fera qu’en impliquant les différents acteurs régionaux, dont celui-ci. Sa tradition et son histoire politique, lui donnent une meilleure compréhension de la situation par rapport à d’autres puissances comme, notamment, les Etats-Unis. En d’autres termes, la France, porteuse de valeurs universelles, ne saurait se renier (140). Elle doit retrouver le cap qui est le sien.
II – KHARTOUM ET SES PÉRIPHÉRIES : UNE TRAGIQUE HISTOIRE SANS FIN
Chronologie : le conflit du Sud Soudan
1922 : Début de la politique officielle de closed district dans le Sud.
1955 : Début du conflit entre le gouvernement de Khartoum et la rébellion sudiste Anyanya.
1er janvier 1956 : Indépendance du Soudan.
Mars 1972 : Accords d’Addis-Abeba avec les sudistes : autonomie des trois provinces, réunies en une seule.
Mai 1973 : Approbation de la nouvelle Constitution : les accords d’Addis-Abeba en font partie.
Juillet 1976 : Échec d’une tentative de coup d’État islamiste.
Juillet 1977 : Politique de Réconciliation nationale envers les islamistes ; amnistie générale ; islamisation de la législation.
1981-1982 : Le projet de redivision du Sud accentue les divergences entre sudistes. En 1982, reprise de la guérilla (maquis Anyanya II).
Mai-Juin 1983 : Répression de la sédition de la garnison de Bor ; reprise de la guerre civile.
Juin 1983 : Décision de diviser le Sud en trois provinces.
Juillet 1983 : Manifeste du Mouvement de libération des peuples du Soudan de John Garang.
Septembre 1983 : Promulgation du nouveau code pénal « islamique ».
1984 : Proclamation de l’état d’urgence.
30 juin 1989 : Coup d’État militaire du général Omar Al-Bachir.
Juillet 1989 : Gouvernement islamiste.
Décembre 2000 : Le général Al-Bachir est élu président de la République.
19 juin 2002 : Cessez-le-feu dans les Monts Nouba.
20 juillet 2002 : Signature du protocole de Machakos.
25 septembre 2003 : Accords de sécurité Nord-Sud.
7 janvier 2004 : Signature du protocole sur le partage des richesses.
26 mai 2004 : Signature des protocoles sur les partage du pouvoir, sur les Monts Nouba, et la région d’Abyei.
9 janvier 2005 : Signature d’un accord de paix entre le SPLA et le gouvernement soudanais.
31 juillet 2005 : Mort accidentelle de John Garang, leader du SPLA, devenu vice-président du Soudan en juillet.
Septembre 2005 : Constitution du gouvernement d’union nationale, GUN, aux termes du CPA.
Octobre 2007 : le SPLM suspend sa participation au gouvernement d'unité nationale.
22 juillet 2009 : Décision de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye sur le différend frontalier de la région d'Abyei.
Avril 2010 : élections générales au Soudan.
Janvier 2011 : Référendum d’autodétermination au Sud Soudan.
Le Soudan est un donc pays de particularismes forts à l’histoire politique tourmentée. C’est surtout un pays de forts déséquilibres. C’est enfin un pays qui, paradoxalement, apparaît à la fois fragile et solide.
Fragile, tout d’abord, dans la mesure où le bruit des armes n’a quasiment jamais cessé depuis 1956. Que la crise du Darfour survenue en 2003 ait mis le pays sous les feux de l’actualité internationale, plus qu’il ne l’avait jamais été, ne doit en effet pas faire oublier que d’autres conflits internes, sans doute moins connus mais tout aussi sérieux, l’ont marqué durablement, dont certains risquent de reprendre à brève échéance.
Solide, envers et contre tout, car malgré cette situation et de telles forces centrifuges, le Soudan n’a pas encore éclaté : à titre de comparaison régionale, si de son côté, l’Ethiopie a dû concéder son indépendance à l’Erythrée il y a presque 20 ans au terme d’une guerre également interminable, le Sud Soudan reste encore jusqu’à aujourd’hui, soudanais, malgré les blessures.
Cela étant, il est tout aussi impressionnant de constater que, en plus de cinquante années d’indépendance, Khartoum n’a jamais eu avec ses différentes périphéries que des relations tendues et conflictuelles, qui se sont le plus souvent traduites par des guerres civiles extrêmement dures et coûteuses. Peut-être ce trait constitue-t-il d’ailleurs une caractéristique profonde du Soudan contemporain : d’une part, l’impossibilité pour le pouvoir central soudanais d’entretenir avec ses périphéries des relations autres que conflictuelles et, d’autre part, de systématiquement tenter de résoudre ces différends par la violence armée.
A – La plus longue guerre civile africaine : le conflit Nord-Sud
Le conflit entre Khartoum et le Sud Soudan est la plus longue guerre civile que le continent africain ait connue depuis les indépendances. En cela seul, il mérite une analyse détaillée, d’autant que, loin d’être définitivement réglé, ce conflit risque fort de resurgir à court ou moyen terme tant les circonstances s’y prêtent. Jusqu’à présent, indépendamment de quelques ricochets relativement isolés et sans effet durable, il n’a heureusement pas eu de répercussion régionale majeure, mais aujourd’hui vos rapporteurs voient dans la situation sur le Sud-Soudan un risque pour la stabilité de la région est-africaine, risque dont les accords de paix signés en 2005 ont involontairement posé les jalons. En cela, vos rapporteurs considèrent que, plus que le Darfour, la question du Sud Soudan, compte tenu de ses implications géopolitiques, constitue le véritable enjeu, non seulement pour l’avenir du Soudan lui-même, mais au-delà, pour celui de la Corne de l’Afrique. Ils auront l’occasion d’y revenir longuement dans la dernière partie de ce rapport.
Sans qu’il soit nécessaire de s’appesantir, il est néanmoins utile de rappeler, pour mémoire, que la part jouée dans l’exacerbation des tensions entre le Nord et le Sud par le poids de l’histoire et les effets de la marginalisation de la région, que vos rapporteurs ont précédemment évoqués, est évidemment essentielle : la politique britannique a eu pour conséquence de marquer encore plus ce qui distinguait le Nord du Sud et d’entretenir les germes de l’impossibilité de la réconciliation que des siècles de razzias d’esclavagistes avaient semés.
Plusieurs autres facteurs, plus récents, sont également à prendre soigneusement en compte par qui veut analyser et mettre en perspective les conflits entre le Nord et le Sud du Soudan, telles que la question des inégalités socioéconomiques, ou la domination politique et sociale. Les effets des unes et des autres se sont conjugués pour contribuer à l’isolement de deux mondes que tout sépare. Plus près de nous, des facteurs de deux ordres, également liés, sont déterminants, sur lesquels vos rapporteurs souhaitent plus particulièrement insister.
a) La question de la régionalisation
Historiquement, la régionalisation est sans soute le premier élément de crispation autour duquel le conflit du Sud Soudan s’est articulé de manière récurrente. Vos rapporteurs ont précédemment abordé ce thème et son rôle dans les difficultés de la construction de l’Etat soudanais au sortir de la colonisation, voire même avant, dans le jeu des forces politiques. Au-delà de son caractère central, récurrent mais jamais définitivement tranché, dans le débat institutionnel, le va-et-vient perpétuel entre décisions décentralisatrices de Khartoum et phases de reprise en mains brutale et de recentralisation, entre fédéralisme et unitarisme, n’a en effet jamais cessé de jeter le trouble et de priver le Sud d’une véritable possibilité d’administration autonome, au mépris des accords négociés.
En d’autres termes, la relation entre le Nord et le Sud a été marquée, sur cette question politico-administrative, par une autre constante : celle du non-respect de ses différents engagements par Khartoum, dont les conflits armés ont très directement découlés.
Que les premiers troubles armés datent d’avant la déclaration d’indépendance suffit à montrer l’enracinement du problème entre le Nord et le Sud. C’est entre 1954 et 1956, en effet, qu’est entreprise la politique de « soudanisation » de l’administration, en d’autres termes, la substitution de fonctionnaires nationaux aux administrateurs britanniques qui commencent déjà à quitter peu à peu le pays. Le souhait sudiste d’envisager la mise sur pied d’un système fédéral qui tienne compte de l’hétérogénéité des différentes régions suscite une première réaction violente de la part de Khartoum qui « menace de la force de l’acier tout sudiste qui osera attenter à l’unité nationale. » (141) Cette véritable déclaration de guerre a été immédiatement confirmée dans les faits puisque la soudanisation de l’administration publique s’est résumée à une arabisation caricaturale, seuls 6 postes administratifs, au demeurant subalternes, étant réservés à des Noirs du Sud (142). En réaction, la région bascula dans une agitation sociale aisément compréhensible ainsi que dans des troubles raciaux visant les civils arabes, qui ne tardèrent pas à être violemment réprimés par les forces nordistes.
L’indépendance n’était pas encore proclamée que, pour apaiser la tension, une première promesse était faite aux sudistes de prendre en compte leur revendication d’un statut fédéral dans la future constitution : néanmoins, moins d’un an plus tard, à la fin de 1956, une commission, composée à 95 % d’élus nordistes, déclarait finalement que le fédéralisme était irréalisable au Soudan.
En toute logique, ces toutes premières années allaient confirmer cette orientation sans demi-mesure : le projet constitutionnel s’articulait sur un Soudan unitaire, ayant l’arabe pour langue officielle et l’islam pour religion d’Etat… Avant même la prise du pouvoir par le général Abboud en novembre 1958, les députés sudistes, élus au mois de février précédent lors de la première élection générale, quittèrent l’Assemblée nationale, voyant leur demande d’une fédération ignorée par la majorité, représentant les confréries Ansar et Khatmiya. On a vu que le régime militaire du général Abboud fera à son tour de l’arabisation l’axe central de sa politique. Il poussera la provocation jusqu’à substituer le vendredi au dimanche comme jour de repos hebdomadaire dans les provinces du Sud. En d’autres termes, tous les ferments d’un accroissement de la tension se mettaient en place, pour qu’elle bascule irrémédiablement vers un conflit ouvert qui allait malheureusement se révéler sans fin et effroyablement meurtrier.
La première guerre sudiste débutait ainsi, menée par le mouvement « Anyanya ». Elle durera jusqu’en 1972, de plus en plus violente, sur fond de velléités de négociation sur la question de l’autonomie à accorder au Sud, mais au final sans véritable intention de la part du Nord de rien céder qui fut définitif. Une alternance d’épisodes de discussions avortées et de phases de répression militaire, comme en 1965 notamment, rythmait la vie politique soudanaise tandis que les positions se radicalisaient : en 1967, un gouvernement provisoire du sud Soudan était constitué, pluriethnique, qui se prononçait, pour la première fois, en faveur de la sécession et d’un Etat indépendant du Sud Soudan. La pluriethnicité de ce premier gouvernement est importante à relever compte tenu de l’extrême division et des tensions propres aux mouvements sud soudanais, sur lesquels vos rapporteurs auront l’occasion de revenir : jusqu’à trois gouvernements sudistes coexistèrent ainsi avant que Joseph Lagu ne réussisse à réaliser l’unité du mouvement.
La véritable négociation débuta en 1969 lorsque le général Nimeyri prit la tête de l’Etat à Khartoum. Progressiste dans ses débuts, allié aux communistes dont on a vu la proximité de la vision politique avec celle des sudistes en faveur de l’autonomie régionale, nationaliste opposé à la sécession et soucieux d’une solution négociée, le général Nimeyri nomma un communiste sudiste à la tête d’un ministère des affaires du Sud, Joseph Garang (143). Jusqu’à la tentative de putsch du PCS contre Nimeyri, qui lui valu, avec de nombreux autres, d’être passé par les armes, il développa sans trop de succès des propositions tournant autour de la question du développement économique du Sud, d’un rééquilibrage au sein de l’administration en faveur des Noirs et des relations entre le Nord et le Sud.
D’une certaine manière, c’est la répression contre les communistes suite à leur échec qui donna sa première chance à la paix, dans la mesure où l’Union soviétique supprimant ses subventions, notamment militaires, au régime de Khartoum, imposa de facto au gouvernement central d’entrer dans une réelle négociation avec la rébellion qu’il lui devenait difficile, eu égard au coût de la guerre, de continuer à combattre sans soutien extérieur. Cette nécessité coïncida heureusement avec celles des rebelles sudistes, lesquels, toutes choses égales par ailleurs, devaient également tenir compte de la diminution de leurs ressources extérieures, en provenance de l’Ouganda, notamment. En sorte que les conditions étaient enfin réunies d’un règlement politique de la question sudiste, qui se concrétisa, comme on l’a vu, par la signature de l’accord d’Addis Abeba de février 1972, qui sera annexé à la constitution de 1973, et prévoyait notamment un Etat fédéral.
En résumé, la thématique de la régionalisation, de l’autonomie du Sud dans un cadre institutionnel accordé, n’a cessé d’être l’objet d’un mouvement de balancier : promesses non tenues ; autisme du Nord, sourd aux revendications sudistes ; exigences maintenues des sudistes échaudés, aux revendications logiquement croissantes ; répression et violences armées auront été au final les seules voies réelles du « dialogue » au long de ces années.
Ce survol historique, que l’on complètera plus loin par l’analyse de la seconde phase du processus de paix, négociée au tournant des années 2000 et non encore achevée, montre que, tous gouvernements confondus, l’attitude du Nord a été constante en opposant une fermeté inaltérable aux prétentions du Sud au rééquilibrage, à fortiori à l’autonomie et à l’indépendance. Historiquement, ce n’est finalement que lorsqu’il est trouvé acculé, sans autre moyen ni échappatoire, que le Nord a consenti à quelque avancée durable, avant de revenir sur ses positions dès que l’occasion s’est offerte à lui ou qu’il a entrevu des opportunités ou en a eu le sentiment.
D’une certaine manière, sur la longue durée, tout se passe comme si le Nord n’avait jamais fait que mener des politiques ambiguës, provocatrices, remettant en cause ce qui était accordé, violant les accords signés. La mise en perspective des éléments saillants de cette longue période montre une volonté constante de la part du Nord d’affaiblir le Sud, de ne rien faire qui contribue à lui donner les moyens de se gouverner ou de promouvoir sa culture : la violation de l’accord, constitutionnel, d’Addis Abeba est sur ce point éclairante. Les développements institutionnels ultérieurs qui ont été faits unilatéralement par le gouvernement central, à savoir la création de neuf Etats sudistes en 1993, répondent-ils à une autre logique, lorsque l’on sait que l’accord d’Addis Abeba prévoyait que toute proposition de changement dans l’administration du Sud devait être approuvée par référendum auprès des habitant du Sud à la majorité des deux tiers, ainsi qu’à une majorité des trois quarts des votes à l’Assemblée nationale (144) ?Cette constante dans la politique de Khartoum vis-à-vis du Sud se retrouve aussi en ce qui concerne la question religieuse.
b) Le facteur religieux et culturel
Comme il a été dit, l’autre principal point de crispation entre le Nord et le Sud du Soudan porte sur la question religieuse : la prétention de faire du Soudan une république islamiste, dans laquelle l’islam serait religion d’Etat, qui inspirerait l’ensemble de la législation nationale et régulerait la vie de toute la société, à quelque religion qu’appartiennent ses habitants, est une constante idéologique des partis islamistes du Nord, traditionnels comme radicaux, depuis dès avant l’indépendance. Prétention dont ils ne se sont à aucun moment départis.
Comme vos rapporteurs l’ont précédemment montré, les différentes tendances de l’islamisme soudanais se sont en effet toujours rejointes ici pour défendre la même ambition et tenter de la mettre en pratique. En cela, les Frères musulmans ou leurs successeurs du Front national islamique, pour avoir été les plus extrémistes dans leur action, n’en ont pas moins été sur une ligne commune avec les autres tendances, telle celle de Sadeq al-Mahdi, dont on a vu le rôle et la communauté de pensée avec le mouvement de Hassan al-Turabi lorsqu’il était Premier ministre à la fin des années 1960. Plus récemment, et pour la période contemporaine, c’est précisément pour éviter la remise en cause de la sharî’a que, comme on l’a vu, par coup d’Etat interposé du général Al-Bachir, les radicaux du FNI ont, de fait, pris le pouvoir en juin 1989 : en d’autres termes, après avoir imposée la sharî’a, - les « lois de septembre » -, sous le régime du général Nimeyri en 1983, il leur était inconcevable de revenir sur cette décision. Dans la mesure où d’autres partis islamistes, plus ouverts à la négociation dans le cadre de la conférence constitutionnelle prévue pour se tenir en septembre 1989, acceptaient la question religieuse comme thème de discussion, ils se devaient de prendre les devants : « Le moment était venu, pour le FNI et ses supporters dans l’armée, d’empêcher la renaissance d’un Etat bâti sur le modèle occidental, fut-ce au prix d’un prolongement de la guerre civile. » (145) Ce qu’ils firent sans vaciller et avec le succès que l’on sait.
De fait, la question religieuse et de l’identité culturelle est à ce point cruciale qu’elle se conjugue avec celle de la régionalisation pour venir rythmer les phases de guerre et de négociation entre Khartoum et les mouvements rebelles sudistes. La prétention islamiste a donc joué comme d’un chiffon rouge vis-à-vis des sudistes, en majorité chrétiens ou animistes.
Sur un plan moins immédiatement politique, c’est en fait une question qui est aussi essentielle aux musulmans soudanais que celle de la sécularisation de l'Etat et de la société l’est aux sudistes. Il s’agit des deux faces de la même médaille. Pour les musulmans, comme le FNI l’a exprimé dans sa charte pour le Soudan en 1987, le sécularisme est vu comme un obstacle à leur liberté religieuse, en ce sens qu’il « les prive de la pleine expression de leurs valeurs en matière de droit et dans la vie publique » (146) Le fait que les autres religions n’aient pas de prolongement dans la sphère sociale et politique, à la différence de l’islam, n’interdisant pas, en revanche, qu’« une jurisprudence et une politique islamiques [puissent] être imposées sans porter préjudice aux minorités dont les droits religieux et le statut personnel et familial (…) sont respectés. » (147) .
Inversement, la sécularisation de la société et de l'Etat est, pour les sudistes, la seule manière de voir reconnue et garantie leur spécificité dans un pays majoritairement islamique. En d’autres termes, à la dimension strictement religieuse s’ajoute celle de la négation de l’identité culturelle des populations du Sud. Pour s’en tenir à la période la plus récente, à savoir la reprise des hostilités à partir de 1983, il n’est pas surprenant, dans ces conditions, de constater que c’est entre autres facteurs, mais très précisément, l’instauration des « lois de septembre », code pénal islamique et autres textes de même inspiration, qui met de nouveau le feu aux poudres.
De même, ultérieurement, si le coup d’Etat de 1989 intervient à un moment où risque d’être remise en cause la sharî’a, il précède aussi de quelques semaines le calendrier de reprise des négociations entre le Nord et le Sud, tel qu’il avait été accordé avec le mouvement de John Garang. Cette négociation devait aussi inévitablement impliquer le renoncement à la sharî’a, et entrait de ce fait frontalement en opposition avec le projet d’islamisation de la société soudanaise dans son entier (148). Ce qui n’aurait pas pu être accepté par les plus radicaux d’entre les Nordistes. Et ne l’a effectivement pas été.
Enfin, on ne peut faire l’impasse sur la question des ressources qui est le troisième élément, permanent, de la discorde entre le Nord et le Sud, qu’il s’agisse des ressources en eaux, agricoles ou, last but not least, des ressources pétrolières.
La question de l’eau, en premier lieu, est cruciale dans la région, non seulement pour le Soudan mais pour ses riverains, comme vos rapporteurs ont eu l’occasion de le montrer plus haut. Elle l’est aussi dans la relation entre le Nord et le Sud.
En effet, le taux d’évaporation des eaux dans cette région des plus chaudes est considérablement aggravé par la lenteur du cours du Nil, tortueux dans la zone marécageuse du Sudd, au Sud Soudan, de sorte que, au total, la perte annuelle est estimée à quelque 2 milliards de m3, sur un débit moyen de l’ordre de 80 milliards de m3. Consécutivement, avant même qu’il s’agisse de satisfaire les besoins en irrigation induits par le modèle d’agriculture mécanisée développé au Nord, le déficit en eau du Nord Soudan, aride, est tel qu’un canal qui drainerait plus rapidement les eaux du Nil blanc avait été envisagé par les Britanniques dès la fin du XIXe siècle. Le percement du « canal de Jonglei », d’une longueur prévue de 360 Kms, entre Bor et Malakal, dans l’Etat de Jonglei, fut finalement entamé en 1978.
Les travaux ont été interrompus en 1984 pour n’être ensuite jamais repris, suite aux bombardements dont l’ouvrage fut la cible (149). Près de 270 Kms avaient déjà été creusés. Quels qu’aient été les responsables de l’attaque, il importe surtout de souligner ici que les sudistes y étaient hostiles depuis toujours (150) : en captant les eaux du Sud et en les dirigeant vers le Nord, ce canal contribuerait à augmenter les capacités de l’agriculture extensive du Nord au détriment de celle du Sud, sans que celui-ci en tire un quelconque bénéfice en échange ; des incidences écologiques ainsi que sur les populations étaient notamment vivement redoutées ; des rumeurs d’installation de 2 millions d’Egyptiens en lieu et place des populations locales déplacées ajoutèrent un temps à la confusion. En cela seul, il ajoutait au ressentiment sudiste envers Khartoum, d’autant que, en asséchant les marais, son percement permettait incidemment d’ouvrir une nouvelle voie de pénétration pour les forces armées soudanaises contre la guérilla. La signature, à la même époque, de la Charte d’intégration entre le Soudan et l’Egypte, qui attendait impatiemment ce canal pour voir améliorée l’irrigation de ses propres terres, ne pouvait évidemment contribuer à apaiser l’inquiétude des sudistes sur ce qui se jouait chez eux et contre eux.
Pour être plus récents, les hydrocarbures que recèle le sol soudanais n’en sont pas moins aujourd’hui la plus importante des ressources disputées, eu égard aux enjeux qu’ils représentent. Lorsque les premiers gisements sont découverts, le Soudan se trouve dans une situation économique et financière particulièrement difficile, compte tenu, notamment, de l’importance de ses dépenses militaires et du coût de la guerre civile. Accablé par une dette de quelque 9 milliards de US$, par un déficit commercial annuel de plus de 500 millions, la perspective de tirer de nouveaux revenus de l’exploitation pétrolière apparaît comme une opportunité inespérée, d’autant que, comme on l’a vu, les soutiens internationaux se sont alors pour le moins raréfiés. C’est la raison pour laquelle, dès le début, le gouvernement ne perdra pas de temps et s’engagera dans une coopération avec les principales compagnies multinationales du secteur : canadiennes, malaisiennes, chinoises et françaises, peu après que l’américaine Chevron eut découvert le premier gisement. Le fait que les dépenses militaires de Khartoum aient cru à due proportion, à mesure qu’augmentaient ses exportations de brut, et ce, dès les premières années d’exploitation et au long des années 1990 (151), suffit à montrer l’extrême intérêt du gouvernement central pour les ressources extraites des champs situés au Sud en vue d’un accaparement de ces dernières à son seul profit, sans jamais considérer le développement socioéconomique qui pourrait en résulter, tant au Sud qu’au Nord, d’ailleurs.
L’histoire de l’exploration pétrolière au Soudan semble sur ce point suffisamment éclairante. Si les premières découvertes de gisement de pétrole au Soudan datent de 1978, - période décidément charnière dans la relation entre le Nord et le Sud -, l’exploration avait en revanche débutée bien plus tôt : les premières recherches avaient en effet été concédées à l’italienne Agip dès 1959 ; Chevron était déjà sur place dans les années 1960 et ses premières découvertes prometteuses, de gaz, au Nord-Est du pays, tout d’abord, datent de 1974. En ce qui concerne le pétrole, l’entreprise s’était vue attribuer une concession de plus de 170 000 Kms2 en 1975, sur les secteurs de Muglad et Melut, au sud et sud est. D’autres majors internationales étaient également chargées de prospecter.
Assurément, il y aurait donc quelque ingénuité ou angélisme à ne voir qu’une simple coïncidence dans le fait que, après quelques années de relations plus apaisées, d’« état de grâce » (152) entre le président Nimeyri et le Sud Soudan, commencé après la signature de l’accord d’Addis Abeba de février 1972, ce soit précisément au moment même où les toutes premières découvertes se font que la crise se soit réactivée.
Vos rapporteurs voient au contraire dans ce qui se joue à partir de ce moment-là la marque d’une absolue cohérence politique de la part de Khartoum.
Qu’on en juge : En premier lieu, la politique de rapprochement, - « la Réconciliation nationale » -, que le général Nimeyri entreprend vis-à-vis des islamistes en 1977, un an après la dernière des tentatives de coup d’Etat qu’il eut essuyée de leur part, réintègre soudain ses ennemis d’hier dans le jeu politique national. Les emprisonnés, tel Hassan al-Turabi, sont libérés ; les exilés, tel Sadeq al-Mahdi, condamné à mort par contumace, sont amnistiés et rentrent au pays. Surtout, en leur confiant les rênes d’une commission chargée d’adapter l’ensemble de la législation aux principes de la sharî’a, la Réconciliation nationale remet brutalement en question les bénéfices de l’accord de 1972. Dès lors, les liens entre Khartoum et le Sud recommencent à se distendre, les rares ministres sudistes au sein du gouvernement central sont marginalisés en quelques mois à peine, à mesure que les islamistes montent en puissance. Tirant parti des divisions politiques vives entre ethnies sudistes, offrant, dès 1979, une politique d’autonomie à d’autres régions du pays, Nimeyri propose peu après un projet de nouvelle division administrative du Sud en trois régions distinctes. La province de Unity, directement rattachée au pouvoir central, se voit ainsi dessinée de manière à inclure plusieurs régions dont celle de Bentiu, la première dans laquelle Chevron confirmait la découverte d’un gisement. Une autre tentative de rectification des frontières interviendra dès l’année suivante (153). En conséquence, non seulement les divisions entre mouvances sudistes sont immédiatement accentuées, mais l’arrêt brutal et le recul dans les réformes jusqu’alors entreprises sont ainsi signifiés au Sud, privé de contrôle sur les ressources de son sol. Accessoirement, on peut remarquer que le projet de loi sera de la main même de Hassan al-Turabi, devenu ministre de la justice après son retour en grâce.
La décision concomitante d’installer la première raffinerie au Nord et non au Sud, celle de tracer un oléoduc jusqu’à un terminal pétrolier à Port Soudan, ont conforté les sudistes dans l’idée que leur région serait exclue des retombées espérées de l’exploitation pétrolière. Dans une période de confusion extrême, les germes de la reprise des combats étaient semés ; la mèche vers les barils de poudre qui ne demandaient qu’à exploser était soigneusement déroulée. En janvier 1983, la répression militaire de la dissidence de la garnison de Bor, qui refusait d’être déplacée au Nord, fut l’étincelle qui l’alluma.
Autrement dit, comment ne pas voir, au terme de cette analyse, une seule et même logique, encore et toujours à l’œuvre, dans cette conjonction implacable de multiples éléments concordants, - institutionnels, culturels et religieux, économiques ? Quels que soient les voies et moyens utilisés, on y trouve sans fin « l’obsession primordiale du Nord : affaiblir politiquement le Sud pour contrôler ses ressources naturelles qui deviennent de plus en plus vitales pour le "développement" du Nord et la survie du régime. » (154).
Vos rapporteurs auront l’occasion de montrer plus loin que, non seulement la question pétrolière a servi de principal point de cristallisation de la rivalité entre Nord et Sud, mais que l’évolution du conflit, ainsi que ses divers aspects, épouseront en fait très exactement l’avancée des recherches géologiques et les perspectives d’exploitation et ce, tant du côté des forces de Khartoum que des rebelles sudistes du SPLM/A.
2) Les positionnements politiques des mouvement sudistes
C’est à un véritable « dialogue de sourds » que ce sont livrés les acteurs de ce conflit au fil des années, en tout cas depuis la reprise des hostilités en 1983, dans lequel, si le Sud prétend régler « les problèmes du Soudan », dans une approche politique par conséquent globale, Khartoum entend régler le « problème du Sud » (155).
a) D’une approche globale dans le cadre d’un Soudan uni…
C’est en effet toujours en ces termes que John Garang a invariablement répondu aux offres du gouvernement central qui lui proposait de régler leurs différends communs, le leader sudiste argumentant que « toute négociation dans le cadre du soi-disant « problème du sud » va à l’encontre de l’intérêt national et conduit au désastre. » (156) De fait, force est de reconnaître que le discours des rebelles du Sud, s’il a nécessairement dû évoluer en fonction de la situation, a toujours été, en tout cas aussi longtemps que possible, prioritairement tourné vers la recherche d’une solution politique qui intéresserait le Soudan dans son ensemble. Plus précisément, en faveur d’une solution qui non seulement traiterait les différends entre le Nord et le Sud, mais prendrait également en compte ceux entre Khartoum et les autres périphéries soudanaises. Vos rapporteurs montreront d’ailleurs plus loin (157) le rôle que le Sud a joué dans le conflit des Monts Nouba, tant au plan militaire qu’au plan de la médiation lors des négociations de paix, ainsi que dans celui de l’Est.
Au cours de la première étape, à savoir dès la période autour de l’indépendance, les représentants du Sud plaidèrent incessamment pour un modèle étatique fédéré. Les députés sudistes élus à la première Assemblée en 1958 réaffirmèrent ainsi que le Sud n’avait aucunement l’intention de se séparer du Nord, que son ambition n’était que de pouvoir administrer ses propres affaires dans le cadre d’un Soudan uni et que, consécutivement, la solution institutionnelle passait par l’instauration d’un modèle fédéré (158). Des années plus tard, lorsque que le Mouvement de libération du peuple du Soudan, SPLM, de John Garang, prendra la relève de l’Anyanya des années 1960 et publiera son manifeste en 1983, il réaffirmera que « le Sud est une partie intégrante et inséparable du Soudan » (159), précisant que toutes les divisions dont a souffert l’Afrique n’ont jamais bénéficié qu’à ses ennemis.
En d’autres termes, le langage tenu par les dirigeants politiques sudistes a toujours été en faveur d’une redistribution des pouvoirs et d’un partage équitable des richesses entre les provinces du pays, dans la perspective d’un développement harmonieux de tout le Soudan. On remarque incidemment que, en cohérence avec son propos d’établissement d’un « nouveau Soudan », uni, démocratique et laïque, le SPLM ne se présente pas comme « mouvement de libération des peuples du Sud » mais « du Soudan ». Aujourd’hui encore, le programme du SPLM, disponible sur son site Web (160), adopté en mars 1998, continue de proposer cette ambition nationale pour un pays dans lequel, notamment, le droit et l’exercice de l’autodétermination sont reconnus aux peuples du Soudan. Le but du mouvement est politique et vise clairement à la prise du pouvoir central à Khartoum, à savoir « à la complète destruction du régime minoritaire et oppressif du Vieux Soudan dans toutes ses formes et à son remplacement par le nouveau Soudan, qui reposera sur un système de gouvernance libre, juste, démocratique et séculier, basé sur la libre volonté et la participation populaire de tous les peuples du Soudan. » (161).
En d’autres termes, le SPLM conteste la domination de la mosaïque des peuples soudanais par les tribus de la vallée du Nil, privilégiées depuis la colonisation britannique et qui se sont ingéniées à confisquer à leur profit exclusif l’ensemble des instruments de pouvoir et à consolider pierre après pierre leurs positions politique, économique, culturelle sur le Soudan contemporain. Raison pour laquelle le SPLM, dans un souci de cohésion nationale, se pose en représentant des différentes périphéries défavorisées et écartées par Khartoum de toute possibilité de profiter des maigres bénéfices du développement et prétend s’exprimer en leur nom (162).
En d’autres termes, les questions de laïcité, de démocratie, de régionalisation - quelque forme qu’elle prenne -, et d’autodétermination, qui ont de tout temps été objectées par le Nord, sont clairement centrales dans le projet politique sudiste originaire d’un Soudan uni.
b) … à la tentation séparatiste
Pour autant, les choses ne sont pas des plus simples et la tentation séparatiste des sudistes s’est sans doute en partie alimentée de ses positions politiques d’origine. En effet, le mouvement Anyanya, initiateur de la lutte du Sud contre le Nord, sur lequel John Garang prendra le pas au début des années 1980, a très tôt clairement été en faveur de la séparation. John Garang aura les plus grandes difficultés à imposer sa ligne et sa stratégie sur l’ensemble des sudistes, et les affrontements armés de sa fraction contre les troupes d’anciens commandants de l’Anyanya, au demeurant soutenus par Nimeyri, s’ajouteront aux combats du SPLA contre les forces armées de Khartoum.
De même, l’affaiblissement du SPLM consécutif à la chute du régime Mengistu en Ethiopie au début des années 1990 apportera à l’opposition interne l’occasion de contester une nouvelle fois John Garang, jusqu’à le déposer. Ce n’est alors pas uniquement sa stratégie militaire et politique, sa dictature sur le mouvement et le fait que la révolution ait été transformée en « régime de terreur » (163), basé « sur la haine et la racisme », qui sont en cause et contestées. L’option politique en faveur d’un Soudan uni, laïc et démocratique est alors considérée comme une lutte à contre courant et la séparation et l’indépendance du Sud Soudan sont au contraire prônées par ses opposants en décembre 1991. Au point que deux factions rebelles sudistes se feront de nouveau violemment face, jusqu’à l’affrontement armé, qui prit aussi clairement un caractère ethnique, Nuer contre Dinka. Des tentatives de réconciliation seront bien sûr menées qui échoueront. Khartoum, témoin de cette rivalité, l’a naturellement vue sans déplaisir et ne s’est bien sûr pas privé d’alimenter les divisions (164). Les opposants à John Garang, Riek Machar ou Lam Akol (165) en premier lieu, prendront même l’initiative d’un rapprochement avec le gouvernement islamiste de Khartoum dont certaines tendances penchent alors désormais aussi vers une séparation entre le Nord et le Sud.
En conséquence, quelques années plus tard, alors même que John Garang aura repris les rênes de son mouvement, la réponse quelque peu « autiste » du Nord aux revendications sudistes facilitera un nouveau basculement des intéressés vers la tentation séparatiste qu’ils avaient déjà caressée et pour laquelle nombre d’entre eux avaient pris les armes. L’option de l’autodétermination sera alors officiellement discutée lors des négociations sous parrainage international, celles d’Abuja en premier lieu, prémices aux accords de paix conclus en 2005, sur lesquelles vos rapporteurs reviendront. Ainsi, le projet d’un Soudan uni et séculier défendu par John Garang, qui l’avait imposé en défaisant la mouvance séparatiste de l’Anyanya, n’est plus dès lors qu’une option, ce que traduira finalement le CPA. Entre temps, les principales formations politiques du Nord, le parti Umma, le parti démocratique unioniste, l’Alliance démocratique nationale et finalement, même le Congrès national, avaient les uns après les autres, reconnu le droit à l’autodétermination comme une solution possible permettant de régler le conflit (166).
En résumé, la rigidité des positions de Khartoum entraîna les sudistes vers des revendications progressivement plus orientées vers l’autodétermination par référendum des populations de la région, auxquelles étaient associées celles d’autres régions défavorisées, tels que les Monts Nouba. Les négociations conduites sous l’égide de l’IGAD et la signature du Comprehensive Peace Agreement, CPA, devaient ensuite aller dans ce sens, qui établirent la partition du Soudan en point de mire.
3) Avant toute chose : une guerre du pétrole
Des différentes causes que vos rapporteurs ont mises en évidence comme facteurs explicatifs des tensions et conflits qui ont eu lieu entre le Nord et le Sud Soudan, la question pétrolière est celle qui apparaît primordiale, avant celles de la régionalisation et du partage du pouvoir. L’appropriation des ressources en hydrocarbures est d’une telle importance que les phases de la guerre, l’intensité des combats, les avancées des pourparlers, l’évolution des positions des uns et des autres, et même les tensions internes aux forces sudistes sont très clairement conditionnées et rythmées par les découvertes de gisements et les perspectives d’exploitation. De telle sorte que l’on peut soutenir que la guerre civile s’est nourrie du pétrole.
Après d’autres pays, de toute évidence, la « malédiction du pétrole » a touché le Soudan.
a) Un conflit civil qui s’abreuve au pétrole…
Qu’une question d’ordre institutionnel et religieux ait remis le feu aux poudres en 1983, lorsque le maréchal Nimeyri imposa les lois de septembre, n’empêche pas que, fondamentalement, ce soit le pétrole qui ait alimenté en profondeur et de manière durable le conflit et qui en ait été l’enjeu premier.
D’une certaine manière, Chevron fut la première à faire les frais de la tension entre Nord et Sud sur fond d’ambitions pétrolières : c’est après que ses relations se soient détériorées – d’abord avec les sudistes, qui attaquèrent ses installations en février 1984, puis avec Khartoum – que l’entreprise américaine a suspendu ses activités au Soudan avant d’être contrainte, en 1992, de céder ses 170 000 Kms2 de concessions.
Sur le terrain militaire, dès la réactivation du conflit, les objectifs des sudistes, alors encore unis, visaient à s’assurer le contrôle des gisements principaux. Les troupes du SPLA se sont donc concentrées principalement et avec succès sur les régions du Sud dans lesquelles se trouvaient les plus importantes concessions. De telle sorte que, se sentant en position de force après de belles avancées sur le terrain, après avoir aussi quasiment réussi l’unité des différents mouvements et l’incorporation dans les forces militaires des anciennes milices Anyana, le SPLM/A engagera des pourparlers de paix avec le gouvernement de Khartoum en 1988 (167).
Selon vos rapporteurs, c’est dans ce contexte marqué par ces succès sudistes et la prise de contrôle sur les concessions pétrolières par le SPLM/A qu’il faut aussi chercher les raisons du coup d’Etat militaro-islamiste de juin 1989 et la nécessité pour Khartoum de tenter de reprendre la main pour reconquérir le terrain perdu avant qu’il ne soit trop tard.
Toujours est-il que, immédiatement après le coup d’Etat, le gouvernement de Al-Bachir mena de main de maître une politique de division et « retourna » notamment un important commandant sudiste de milice Nuer, Paulino Matiep, non encore intégré au SPLA. Alors même que des populations déplacées avaient commencé de revenir sur leurs terres depuis les récentes victoires sudistes, ce renversement d’alliance en 1990 amorça un mouvement inverse, sur fond de politique de terreur, de harcèlements des populations civiles, de bombardements, menés par les forces armées gouvernementales et leurs alliées, les milices Baggara, les Muraheleen, « inventées » par le Premier ministre Sadeq el-Mahdi quelques années plus tôt, qui, chargées de soutenir les forces armées alors en difficulté, contribueront à accentuer la tournure tribale des conflits.
Dans le même esprit, force est de constater que la division des sudistes, en 1991, qui entraîne la scission du SPLM, la mise à l’écart de John Garang et la prise du pouvoir sur le mouvement par Riek Machar, n’illustre pas seulement la rupture avec le choix initial en faveur de l’unité d’un Soudan socialiste au profit de l’indépendance du Sud, ou le triomphe de la contestation sur la stratégie politique face à Khartoum. D’autres considérations sont également à l’œuvre, ethniques notamment, qui verront ainsi des regroupements temporaires entre Machar et Matiep, Nuer tous deux, face aux Dinka de John Garang. En effet, des intérêts pétroliers entrent également en ligne de compte dans ces recompositions, qui expliquent sans doute que, à aucun moment entre 1991 et 1999, Riek Machar n’attaquera les forces armées soudanaises du gouvernement central et que, dans ses propres négociations avec Khartoum, dès 1993, un accord de partage des revenus pétroliers sera envisagé.
C’est ainsi qu’en 1996, une charte politique était adoptée, aux termes de laquelle notamment, les mouvements des forces rebelles dans les secteurs pétroliers antérieurement détenus par Chevron étaient neutralisés, de manière à ce que « les choses sérieuses » puissent commencer, à savoir essentiellement la constitution du consortium « Greater Nile Petroleum Operating Company », GNOPC, que vos rapporteurs ont déjà mentionné, entre entreprises étatiques chinoise, malaisienne et soudanaise. La GNOPC sera notamment chargée, dès mars 1997, de la construction de l’oléoduc de plus de 1 500 Kms, opérationnel dès 1999, vers le nouveau terminal pétrolier de Port Soudan. Dans la foulée, Paulino Matiep intégrait l’armée soudanaise, Riek Machar devenait président du Conseil de coordination des Etats du Sud.
En parallèle, depuis 1992, date à laquelle Chevron avait dû vendre ses concessions « dormantes », des milliers de civils, essentiellement Dinka, étaient systématiquement soumis aux offensives armées des milices Muraheleen et des forces du Nord, auxquelles s’étaient jointes ensuite celles de Riek Machar. Agressés par une politique de terre brûlée, déplacés de leurs zones d’habitat, desquelles les ONG humanitaires étaient interdites d’accès (168), les Dinka étaient regroupés dans des camps de concentration, identiques à ceux que le gouvernement de Khartoum avait mis en place lors de sa politique de nettoyage ethnique à l’encontre des populations des Monts Nouba. Sur les ruines de leurs villages, vidés de leurs habitants, les champs pétroliers pouvaient alors être développés sous protection militaire et milicienne.
Les années 1997 et 1998 ont été une période charnière à bien des égards : la perspective de l’achèvement prochain de l’oléoduc rendait intéressante l’exploitation de zones antérieurement délaissées, faute alors d’infrastructures. De nouvelles compagnies pétrolières entrèrent dans le jeu, telle Lundin, suédoise, à partir de 1996, pour affiner les données d’exploration laissées par Chevron, et commencer l’exploitation. Ce sont les blocs 5A et 5B (169) qui seront notamment au centre de l’intérêt du gouvernement de Khartoum, des entreprises concernées, pétrolières ou de sécurité, et partant, le lieu des principaux combats de cette époque. Consécutivement c’est de cette zone aussi que partiront les grandes vagues de déplacements forcés des communautés, cette fois-ci de dizaines de milliers de Nuer : en effet, les perspectives désormais ouvertes entraînèrent l’éclatement de la coalition Machar/Matiep et leur rivalité ouverte pour le contrôle de ces richesses. De sorte qu’un déplacement du conflit s’est produit, que Khartoum eut naturellement tôt fait de qualifier de guerre tribale, l’un comme l’autre des deux chefs de guerre participant au nettoyage de zones pour s’en attribuer l’exclusivité, tandis que Khartoum, de son côté, maintenait sa propre politique d’exclusion.
En d’autres termes et en résumé, cette période, troublée entre toutes, de la guerre civile soudanaise, a vu se cumuler ou se succéder trois types de conflits : le Nord face au Sud ; les Dinka face aux Nuer ; les Nuer entre eux, Paulino Matiep, indéfectible allié de Khartoum, s’opposant à Riek Machar pour le contrôle politique et territorial, et consécutivement pétrolier, du Western Upper Nile/Unity State sur lequel les blocs 5A et 5B se trouvaient.
Très vite, dès 1999, une escalade du conflit intervint, sur d’autres zones, le bloc 1 devenant le nouvel eldorado du gouvernement de Khartoum et, consécutivement, l’objet de toute son attention militaire : bombardements massifs, aériens et terrestres, déplacements forcés de populations, ici majoritairement Dinka, destructions.
b) La guerre déclarée aux populations
En d’autres termes, vos rapporteurs sont convaincus que la présence de pétrole au Sud a imposé une dynamique propre à cette interminable guerre, que la seule question institutionnelle, autour de la plus ou moins large autonomie régionale accordée au Sud, ou encore que les seules considérations culturelles ou religieuses, pour essentielles qu’elles soient pour l’identité tant des sudistes que des nordistes, n’auraient sans doute pas exacerbé à ce point.
Sans doute plus qu’ailleurs, les populations civiles ont été des victimes toutes désignées, de la particulière barbarie exercée par les belligérants des différents camps. Les cortèges d’atrocités commises contre les populations, de quelque côté que l’on regarde, ont été d’une ampleur rarement atteinte : les déplacements massifs de populations, les raids d’esclavage, ont été systématiques. Il en a été de même des viols, des tueries de masse, de l’enrôlement des enfants, des bombardements aériens, de la politique de terre brûlée, du minage des terres, qui ont été le lot commun, dont les responsabilités ont été partagées entre belligérants ; la faim est enfin apparue comme une arme de guerre, de même que l’impossibilité d’accès aux populations nécessiteuses par les organisations caritatives ou internationales. Les ONG ou le rapporteur spécial des Nations Unies pour les Droits de l’homme au Soudan ont inlassablement documentés ces faits, des années durant, sans autre effet (170). De la part de Khartoum, la brutalité et la politique de terreur à l’encontre des populations civiles ont été parties intégrantes de la stratégie gagnante : au cours du dernier trimestre de 2001, par exemple, des bombardements massifs de plusieurs semaines permirent à Khartoum de reprendre différents points du Bahr al-Ghazal, cruciaux dans sa stratégie de ne pas perdre définitivement le Sud (171).
On a pu logiquement remarquer une intensification des opérations lorsque de nouveaux gisements devaient passer sous contrôle pour être exploités, et que tout spécialement, ce sont des déplacements de populations qui ont été systématiquement opérés ; inversement, les pourparlers de paix n’ont été engagés à l’initiative de l’une ou de l’autre partie que si la situation sur le terrain le lui permettait ; l’échec ou la relance des combats ont la plupart du temps évolué en fonction des rapports de force qui permettaient ou non d’espérer plus sûrement que par la négociation de meilleurs résultats.
A ce sujet, il n’est enfin pas indifférent de noter ici que les méthodes qui seront vivement reprochées au gouvernement central quelques années plus tard lorsque aura éclaté le conflit du Darfour, sont systématiques dès le conflit entre le Nord et le Sud. Vos rapporteurs considèrent qu’on ne peut décemment faire de différence sur ce point entre les deux conflits majeurs qu’a connus le Soudan. D’une certaine manière, le Sud a en quelque sorte constitué comme une répétition à grande échelle de la politique que Khartoum mènerait au Darfour quelques années plus tard.
B – Les autres conflits aux marches du Soudan
Le conflit entre le Nord et le Sud, comme on l’a vu, est d’une ampleur que l’on peut qualifier d’historique : tant par sa durée que par les pertes humaines qu’il a causées, il s’apparente rien moins qu’à la guerre du Vietnam… Avec 2,2 millions de morts estimés, il est même considéré comme le deuxième conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. (172) Par ses implications, aussi, qui ne concernent pas que le Soudan lui-même, mais aussi la Corne de l’Afrique, voire l’Afrique dans son ensemble.
Objet d’une couverture médiatique et d’une campagne de mobilisation sans doute sans précédent, le conflit du Darfour est pour sa part venu faire écran, à partir de 2004, aux autres conflits internes, plus anciens, que le Soudan a connus ces dernières décennies et qui, malheureusement, n’ont rien à lui envier. Or, ceux-ci doivent également être évoqués car ils démontrent, comme vos rapporteurs l’ont mentionné, le fait que se répète dans ce pays, guerre après guerre, exactement le même schéma.
L’histoire au Soudan semble destinée à balbutier inlassablement.
Faisant office de triple frontière – géographique entre le désert et les montagnes d’Erythrée et d’Ethiopie ; culturelle entre monde islamique et chrétien ; enfin économique entre pastoralisme et agriculture extensive mécanisée –, l’Est soudanais, peuplé de quelque 3,7 millions d’habitants, répartis en trois Etats, vit depuis toujours dans un état de pauvreté extrême, qu’aucune politique de développement n’est jamais venue atténuer.
a) Des causes qui s’apparentent à celles à l’origine des autres conflits soudanais
C’est peu dire que les raisons du conflit de l’Est sont similaires à celles des autres foyers de tensions qu’a connus le Soudan. Ici comme ailleurs, c’est encore et toujours la marginalisation exacerbée de la région qui a une fois de plus déclenché un conflit interne. Peut-être même, à en croire certaines études, s’agit-il de la région du pays la plus défavorisée (173).
Cette politique de marginalisation n’a fait au fil des années qu’ajouter aux difficultés naturelles : Entre autres, à la pluviosité très faible alliée à la nature des sols de la région qui n’ont tout d’abord jamais permis qu’une très pauvre agriculture. De même peut-on mentionner les sécheresses récurrentes qui ont entraîné la migration progressive des pasteurs appauvris vers les villes, accroissant ainsi la déforestation et l’extension des bidonvilles.
En parallèle, dès les années 1960, l’aménagement d’ouvrages hydrauliques sur le Nil a contraint nombre de Nubiens déracinés à une migration forcée et sans retour, leurs terres se trouvant inondées par les lacs de retenue. De même, l’introduction par Khartoum de l’agriculture irriguée extensive dans la région, notamment du coton, a-t-elle conduit à l’expulsion des communautés Beja de leurs terres au profit de propriétaires extérieurs, soudanais ou investisseurs des pays arabes du Golfe (174). On retrouve par conséquent, ici comme ailleurs, comme on le verra encore s’agissant du conflit des Monts Nouba, la spoliation des populations locales parmi les causes du conflit.
En complément, une politique systématique d’affaiblissement politique, culturel ou économique n’a cessé d’être mise en œuvre par Khartoum à l’encontre de l’Est. Ainsi, l’arabe, pour n’être parlé que par une minorité d’habitants, est-il néanmoins la seule langue enseignée dans les écoles publiques. De même les pratiques soufi de la majorité de la population ont-elles été non seulement découragées par le régime (175), mais aussi parfois violemment combattues, des attaques armées contre des mosquées Beja et des écoles religieuses ayant été commises dans les années 1990, selon les témoignages recueillis par l’Organisation soudanaise des droits de l’homme.
La pauvreté intrinsèque de la région, ainsi que les conditions socioéconomiques, notamment durant le conflit, ont été telles de tout temps que l’accès aux services de base, nourriture, eau potable, soins, éducation, n’était pas assuré, laissant les populations extrêmement vulnérables, en proie à la malnutrition, la famine et les maladies, dans une région où le taux d’analphabétisme atteignait les 95 % (176).
En complément, on ne peut manquer de soulever parmi les facteurs de tension, l’ampleur des mouvements humains dans l’Est du Soudan. Que ce soit pour fuir des causes « naturelles », telles que les famines, inondations ou sécheresses ou des causes « humaines », tels les conflits, les migrations sont d’autant plus impressionnantes qu’il s’agit d’une région relativement peu peuplée : La famine des années 1984-1985 a ainsi contraint au déplacement 1,2 million de personnes et la destruction consécutive des économies pastorales en a forcé des centaines de milliers à s’installer de manière définitive dans les villes, notamment à Port Soudan, sans moyen de subsistance assuré. Ils se sont ajoutés aux centaines de milliers d’autres réfugiés qui, à partir des années 1960, avaient fui la guerre d’indépendance de l’Erythrée contre l’Ethiopie, ainsi qu’aux déplacés internes, dus aux autres conflits, du Sud et des Monts Nouba. Les autorités de l’Etat de Genaref ont ainsi estimé qu’au moins 60 % de la population était composée de migrants.
D’une certaine manière, c’est encore l’autisme du gouvernement de Khartoum face aux revendications du Congrès Beja, son refus d’accéder à la moindre de ses demandes, qui déclencha les hostilités au début des années 1990.
Malgré des soutiens internationaux importants, l’entraînement des jeunes rebelles en Erythrée notamment, le conflit de l’Est du Soudan a ceci de particulier qu’il aura toujours été de « basse intensité » (177) à la différence des autres. Les massacres à grande échelle, la terreur systématique et les différentes exactions qui ont maintes fois été observées et dénoncées tant par les ONG que par les Nations Unies dans les autres régions n’ont heureusement pas eu cours dans l’Est du Soudan. Le conflit aura opposé pendant une vingtaine d’années les rebelles de l’Alliance Démocratique Nationale, ADN, coalition de mouvements autour du Congrès Beja, alliés au SPLA sudiste. Il avait pris quelque vigueur au début des années 1990, à mesure que les exigences dues à la revendication sur la spoliation des terres devenaient plus fortes. Des exactions sporadiques, déplacements forcés de populations, attaques contre les civils, ont certes été menées par les forces armées soudanaises, mais sans jamais atteindre l’ampleur de celles qui ont été constatées ailleurs. Sur le terrain, se sont opposées les forces armées soudanaises et le Front de l’Est, apparu à la fin des années 1950, ainsi que par les soutiens en provenance de l’étranger, tout particulièrement de l’Erythrée voisine.
De la même manière, à la différence notable de ce qui s’est produit pour les conflits du Sud et du Darfour, Khartoum a ici échoué dans ses tentatives de fomenter des milices armées, en raison, semble-t-il de l’unité tribale que le Congrès Beja a réussi à maintenir envers et contre tout dans cette région.
S’il a été moins violent, le conflit de l’Est a également été plus aisé à résoudre : si les négociations de Naivasha qui conduisirent au CPA, ou celles d’Abuja, dont est sorti le Darfur Peace Agreement (DPA), ont été longues et tortueuses, celles d’Asmara, conclues le 19 juin 2006, ont été nettement plus brèves. Sans doute le fait que, à la différence des autres fronts, celui de l’Est n’ait jamais revendiqué la prise de pouvoir à Khartoum, a-t-il joué en ce sens. De même le fait que, d’une certaine manière, le combat ait cessé en partie faute de combattants : les uns et les autres des protagonistes ou soutiens de la rébellion étaient en effet mobilisés à la mise en œuvre du Comprehensive Peace Agreement (CPA) alors signé depuis un an et demi, dont les enjeux étaient autrement importants ; cet élément doit nécessairement être pris en compte dans la façon dont les accords de paix ont été obtenus, tout comme l’a été, inévitablement, le surgissement peu auparavant de la crise du Darfour, qui a monopolisé et l’attention du gouvernement central, à compter du début de 2003, et celle de la communauté internationale quelques mois plus tard. En cessant de retenir l’attention, si tant est qu’il l’ait véritablement retenu antérieurement, le conflit de l’Est soudanais ne pouvait que trouver une fin rapide, dans l’intérêt de tous.
Pour autant, il n’est pas certain que la paix qui a été signée à Asmara soit très solide. Il convient de noter en effet que les analyses convergent pour estimer que le Front de l’Est avait finalement peu de marge de manœuvre ou d’alternatives pour exiger plus que ce qu’il a réussi à obtenir de Khartoum : le gouvernement s’est en effet opposé à nombre de ses revendications tenant à la dévolution du pouvoir, à la reconnaissance de l’Est comme région et même à celles tenant à la protection de la culture et de la langue de l’Est. Ces frustrations sont en soi porteuses de futures nouvelles tensions.
Ce conflit, qui déchira la région des Monts Nouba pendant une quinzaine d’années, jusqu’en 2002, ressemble à s’y méprendre aux précédents : par certains côtés, il s’apparente à celui qui oppose le Nord au Sud, par d’autres à celui du Darfour, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Il illustre, ici comme ailleurs, la domination impitoyable et sans partage d’une petite caste qui, pour étendre et assurer son pouvoir, ne recule devant aucun moyen, usant de préférence des plus terrifiants.
Occupant un petit territoire de quelque 77 000 Km2 au sud du Kordofan, quasiment au centre géographique du Soudan, peuplé d’une très grande diversité de communautés ayant chacune leurs particularités ethniques, religieuses, culturelles et linguistiques, - on y a dénombré plus de 50 langues et dialectes -, les Monts Nouba ont souffert d’une des guerres les plus meurtrières qui se puissent concevoir.
Schématiquement, on peut rappeler que, à 90 %, la population du territoire était constituée de Nouba, noirs africains, les 10 % restants des habitants appartenant aux tribus Baggara, arabes, donc (178). Nouba et Baggara ont coexisté tant bien que mal pendant près de deux siècles dans la région, après l’arrivée de ces derniers au début du XIXe siècle en provenance du Darfour et du Kordofan : En recherche de pâturages et d’eau pour leurs troupeaux, les Baggara investirent les terres basses des Monts Nouba, repoussant dans les montagnes les agriculteurs noirs, occupants ancestraux, qui durent alors se tourner vers des modes de culture en terrasse pour continuer de vivre sur leur terre.
Sur un plan général, la cohabitation entre communautés s’est longtemps accommodée de hauts et de bas. Des rapports commerciaux ou de troc existaient entre tribus Baggara et Nouba, mais aussi de protection, au niveau local, certains sous-groupes Baggara protégeant « leurs » Nouba, tout en se livrant de manière incessante à des raids pour effectuer des razzias sur les autres, les Nouba étant un gibier de choix pour les trafiquants d’esclaves. De sorte que la coexistence tendue entre Baggara et Nouba s’est jouée sur ce fond de rivalités. Les premiers heurts, et massacres, contre les populations Nouba se produisirent au tournant du XXe siècle lorsque le gouvernement central mahdiste réprima leur velléités de résistance. Les premières tensions et scissions internes entre Noubas, à 40 % musulmans, à 30 % chrétiens, datent aussi de cette époque. Néanmoins, cette situation n’a pas empêché une interpénétration entre cultures Baggara et Nouba au fil du temps.
b) De nombreux traits communs avec les autres conflits soudanais
Comme ailleurs antérieurement, c’est-à-dire au Sud, ce sont les « lois de septembre », en d’autres termes l’imposition de la sharî’a à partir de 1983 par le général Nimeyri et l’abolition de l’administration tribale, qui ont exacerbé la tension et provoqué les premiers troubles violents de l’époque moderne entre Arabes et non Arabes, et réactivé pillages et razzias.
Pour le reste, la question foncière, dont on a vu l’importance dans la crispation des sentiments des populations périphériques régies par le droit coutumier, dès avant l’adoption, au début des années 1970, des dispositions restreignant la possession et l’usage des terres non enregistrées, occupe ici aussi une place centrale dans le conflit (179). Elle en a même très clairement été l’élément déclencheur.
En effet, les Nouba ont été inexorablement dépossédés de leurs terres, confisquées au profit de l’expansion de l’agriculture mécanisée, au bénéfice non tant des Baggara, déjà sur place depuis deux siècles, que des Jellaba, riches marchands du Nord, hauts fonctionnaires centraux et officiers supérieurs, propriétaires terriens, au demeurant souvent absents, mais tenants de l’agriculture mécanisée intensive qui a essaimé dans la région à partir de la fin des années 1960, expulsant les Nouba de leurs petites exploitations familiales traditionnelles, qui n’ont dès lors eu qu’une alternative : quitter leur région natale ou résister.
Dans la mesure où le développement de l’agriculture mécanisée répondait à une politique décidée par Khartoum, avec l’aide un temps de financements internationaux, de la Banque mondiale entre autres, toute velléité de résistance ne pouvait que se heurter à la répression militaire.
Dans le même ordre d’idées, des richesses supposées ne sont pas non plus étrangères au conflit. Indépendamment du fait que le nom « Nouba » vient peut-être d’un mot de l’Egypte ancienne signifiant « or », la présence de possibles gisements pétroliers et de diamants dans la région est sans doute pour partie à l’origine des revendications et des tentatives d’appropriation de ces terres.
Les questions culturelles et religieuses, quoique différentes de celles en discussion entre le Nord et Sud, ont également leur part, le Nord intégriste restreignant la tolérance et les pratiques socioculturelles ancestrales des populations Nouba, qu’il s’agisse de leur langue, qui sera interdite dans les écoles, de leur religion ou d’autres coutumes, telle la nudité.
Sur un plan plus politique et institutionnel, outre l’application des lois islamiques et du code pénal de 1983 au peuple Nouba, le débat portera une fois encore sur la question de l’autodétermination, avec l’opposition des thèses de l’unité du Soudan et de l’autonomie des Monts Nouba. Au long des années 1990, le statut des Monts Nouba au sein du Soudan a ainsi été à plusieurs reprises objet de négociations et d’accords de paix, et c’est finalement l’option en faveur d’un gouvernement autonome Nouba dans le cadre de l’unité d’un Soudan décentralisé qui, vers la fin des années 1990, avait la préférence des rebelles.
Enfin, la domination raciste pluriséculaire dont les Noubas, victimes traditionnelles des razzias arabes esclavagistes, n’a pu qu’ajouter au sentiment de révolte grondante et participer au déclenchement de ce nouveau foyer de conflits entre Khartoum et l’une des provinces du Soudan. Cette guerre, comme les autres, n’est finalement que la rançon du traitement inéquitable par le gouvernement central d’une province particulière (180).
Finalement, si l’on devait retenir une différence entre le conflit des Monts Nouba et les autres, la seule qui apparaît, majeure, réside peut-être dans le fait qu’ici, l’interférence régionale de la part de voisins ambitieux, aussi importante pour le conflit de l’Est qu’elle l’est pour le Sud ou le Darfour, semble être moins visible si ce n’est même absente.
c) Un génocide avant l’heure ?
Suite à l’apparition des premiers troubles, les sudistes du SPLA intervinrent pour la première fois en territoire Nouba contre un village arabe en 1985. En 1987, le Premier ministre Sadeq al-Mahdi constitua les premières milices arabes d’autodéfense, les « Murahaleen », entraînées et approvisionnées par Khartoum, contre le SPLA. Devenues « Forces populaires de défense », (FPD), en 1988, le gouvernement islamiste du général Al-Bachir les légalisa par décret en novembre 1989. Consécutivement, le fait que la population de la région soit divisée entre Arabes et non Arabes l’a mise dans la pire des positions qui soient : entre le marteau de Khartoum et l’enclume du SPLA. Aux Nouba, en révolte armée contre Khartoum pour les raisons qu’on a vues, alliés aux sudistes du SPLA qui ont fait cause commune avec eux, ont fait face les Arabes, soutenus et armés par le gouvernement central. Dès lors, comme le rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies a pu l’écrire en 1993, « des centaines de milliers de civils non armés se trouvent maintenant complètement sans défense, et exposés à toutes sortes d’atrocités commises d’une part par les FPD, l’armée ainsi que d’autres organes du Gouvernement du Soudan et, d’autre part, par les troupes du SPLA qui contrôlent une grande partie des monts Nouba. » (181).
Incidemment, il n’est pas inutile ici de remarquer que l’utilisation des milices par les différents belligérants a considérablement renforcé le caractère tribal des conflits, et notamment celui des Monts Nouba,. Les Murahaleen, recrutés parmi les jeunes Baggara des tribus de pasteurs arabisés et islamisés, victimes de la désertification de leurs terres au Nord, ont été équipées par Khartoum. Ce sont elles, également, qui se sont lancées à l'assaut des communautés Dinka du Bahr el-Ghazal, installées sur de meilleurs pâturages. « Ces razzias ont dévasté le pays Dinka, faisant environ 300 000 victimes entre 1986 et 1989, et des centaines de milliers de réfugiés dans les villes du Nord et les pays voisins ». Les sudistes n’étaient pas en reste, qui de leur côté, recrutèrent aussi des milices « dans les tribus ou les clans qui avaient à souffrir de la suprématie Dinka : Fertit dans le Bahr el-Ghazal, Mundari en Equatoria, Anuak dans le Haut-Nil... » On imagine aisément les effets à long terme quant aux possibilités d’envisager la réconciliation des communautés après un tel conflit, eu égard à la violence de ces pratiques qui se sont traduites d’un côté comme de l’autre par la réapparition de l'esclavage, des politiques de terre brûlée, etc. (182)
En 1992, profitant des divisions sudistes et de l’affaiblissement du SPLA de John Garang, qui doit alors diminuer ses approvisionnements en munitions aux rebelles Nouba, Khartoum est passé à une échelle supérieure, en lançant le jihad, alors même que la majorité de la population Nouba était musulmane, et a entrepris de dépeupler la région par tous les moyens. En août 1996, Jean Hélène, alors correspondant du journal Le Monde dans la Corne de l’Afrique, pouvait ainsi écrire que, sur une population d’un million d’habitants au début de la décennie, quelque 350 000 vivaient encore sur leur territoire, « où ils s’accrochent à leurs villages malgré l’insécurité et la pauvreté. » (183) Trois ans plus tôt, le rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme de l’ONU avait pour sa part déjà indiqué que « si le processus actuel qui consiste à déraciner les communautés Nouba n’est pas rapidement arrêté, il risque de devenir irréversible. » (184)
Les témoignages de l’époque concordent et décrivent un nettoyage ethnique méthodique, pour lequel Khartoum utilise tous les moyens de terreur aveugle à sa disposition : bombardements aériens massifs et systématiques contre les populations, - y compris des camps de déplacés -, famine, pillages organisés. S’y ajoutent les tortures, les exécutions sommaires, les viols et mutilations sexuelles systématiques, la déportation et les travaux forcés dans les fermes mécanisées, « l’enrôlement des hommes dans les milices et d’enfants chrétiens placés dans les écoles coraniques. » (185) Les villages, les lieux de culte, – églises comme mosquées –, les cultures sont systématiquement détruits ou incendiés par une politique de terre brûlée aggravée par un blocus humanitaire, qui empêche les ONGs internationales d’apporter l’assistance indispensable, notamment sanitaire, les observateurs indépendants de témoigner, voire les marchands arabes de commercer avec les insurgés. Il est par ailleurs troublant de lire sous la plume du rapporteur spécial des témoignages selon lesquels, globalement, jusqu’en 1989, « les Nouba formaient une seule communauté » et coexistaient de façon pacifique avec les autres (186) et que les premiers déplacements de population sont intervenus à partir d’août 1989, moins de deux mois après le coup d’Etat du général Al-Bachir… Ce n’est qu’en mai 1998 que finalement les Nations Unies furent autorisées par le gouvernement à intervenir au plan humanitaire, mais de manière si parcimonieuse qu’aucune suite ne put être donnée aux recommandations que des missions exploratoires formulèrent en 1999. Ainsi, en septembre 2001, une seconde mission, de la FAO, fut tout aussi restreinte et ne put que conclure que « le gouvernement du Soudan est concrètement en train d’affamer le peuple des Monts Nouba dans les zones contrôlées par le SPLM ajoutant à la famine liée à la guerre un blocus efficace de l’aide humanitaire. » (187) Ce n’est qu’après la signature du cessez-le-feu que les Nations Unies purent intervenir, via le PNUD, pour promouvoir « la paix par le développement » en tentant notamment de revenir à la question foncière initiale.
Comme vos rapporteurs l’ont relevé, pour être en grande partie musulmans, les Nouba, alors même que leur territoire a toujours été considéré comme étant situé au Nord Soudan, ne s’en sont pas moins alliés avec les sudistes du SPLM au long du conflit qui les a opposés à Khartoum. Apparent paradoxe supplémentaire, qui ajoute à la complexité de la réalité soudanaise et, indirectement, permet de conforter l’idée selon laquelle, plus que des rivalités sur fonds ethniques, raciaux ou religieux, comme on a pu l’écrire, les racines des conflits internes au Soudan se situent avant tout entre le centre et ses périphéries, articulées sur des thématiques tenant à la domination de Khartoum sur les autres régions. Très schématiquement, dans la mesure où de multiples éléments s’y mêlent, on peut les résumer aux termes d’injustice, d’exclusion et d’accaparement des richesses.
A l’instar encore des autres conflits soudanais, c’est aussi, et même exclusivement, la pression internationale qui mit fin à celui des Monts Nouba. En l’occurrence, les médiations finales ont essentiellement été américaine et suisse, et le cessez-le-feu est intervenu en janvier 2002, avec la signature à Bürgenstock, en Suisse, du Nuba Mountain Cease-Fire Agreement, pour six mois renouvelables. Pour être tout à fait précis, il faut souligner que le conflit des Monts Nouba a bénéficié d’une conjoncture internationale particulière qui lui a été très favorable. En effet, ostracisé par les Etats-Unis depuis longtemps, comme vos rapporteurs l’ont souligné, Khartoum souhaitait revenir en grâce auprès de Washington ; le Soudan avait ainsi fait plusieurs offres en ce sens aux services secrets américains dans leur lutte contre le terrorisme islamiste, y compris celle de livrer Oussama ben Laden comme ils avaient remis Carlos à la France quelques années plus tôt, sans qu’elles soient acceptées. La nomination du sénateur John Danforth comme représentant spécial du président George W. Bush pour le Soudan quelques jours avant les attentats du 11 septembre 2001 ouvrit pour Khartoum une fenêtre d’opportunité dans la mesure où, bien que son action se centrât sur le Sud, John Danforth proposa, pour tester la bonne volonté soudanaise, un plan en quatre points, sur lequel vos rapporteurs auront l’occasion de revenir, dont l’un portait sur un cessez-le-feu dans les Monts Nouba. Opportunité que le gouvernement de Al-Bachir sut saisir.
Au-delà de l’intervention sudiste en appui aux rebelles des Monts Nouba durant le conflit, il faut souligner que le SPLM a essentiellement été le promoteur et a finalement négocié et signé l’accord de paix. C’est en effet le « SPLM/Nouba » qui apparaît dans le cessez-le-feu de janvier 2002. Ensuite, si ce cessez-le-feu sera reconduit régulièrement, aucun accord de paix spécifique n’interviendra et la question nouba ne sera réglée que dans le cadre des négociations du CPA et incluse dans le protocole d’accord global. Cette « médiation » sudiste sera à plusieurs reprises prise comme prétexte par Khartoum pour rejeter les revendications spécifiques des Nouba.
Aujourd’hui, sur ces bases, la région est pacifiée, gérée en application du protocole de Naivasha de 2004, selon des modalités bipartisanes établies, les différentes institutions, exécutif, législatif, armée ou commission foncière, fonctionnant sur des bases paritaires et un travail important, sous auspices internationaux, tendant à la réconciliation des communautés est en cours.
Concrètement, cet accord est intervenu dans le cadre plus général du Comprehensive Peace Agreement, CPA, de janvier 2005, dont il est l’un des protocoles. Il repose sur l’affirmation des mêmes principes que ceux qui ont guidé la négociation des autres accords de paix entre Khartoum et ses périphéries. Des institutions politiques transitoires sont donc prévues, avant qu’une constitution définitive du pays soit approuvée. De même, la question de la répartition des allocations, du partage équitable des richesses et des mécanismes nécessaires pour les garantir, font-ils l’objet de développements particuliers, notamment en ce qui concerne le thème de la détention de la terre dont il a été montré l’importance dans ce conflit. En application de la réaffirmation des principes démocratiques, le protocole a enfin prévu la consultation des populations intéressées, ressortissantes des deux Etats du Sud Kordofan et du Blue Nile, quant à leur acceptation de l’accord conclu entre le gouvernement central et le SPLM, qui fera aussi l’objet d’une évaluation régulière dans les deux Etats de la part des institutions locales compétentes.
Chronologie : le conflit du Darfour
1874 : Conquête du Darfour.
Mars-Avril 1985 : Manifestations et émeutes à Khartoum et Omdourman, puis dans l’Ouest. Renversement de Nimeyri.
Mai 1988 : Gouvernement de coalition de Sadeq el-Mahdi, entrée des islamistes du FNI ; Hassan al-Turabi, ministre de la Justice. Violents affrontements entre populations arabes et Four dans le Darfour.
Février-mars 2003 : Violents combats dans le Darfour entre troupes gouvernementales et rebelles.
Septembre 2004 : Adoption de la résolution 1564 ; création d’une commission d’enquête internationale pour déterminer si un génocide a été commis au Darfour.
25 janvier 2005 : Remise du rapport de la commission internationale d’enquête sur le Darfour.
31 mars 2005 : Adoption de la résolution 1593 : le Conseil de sécurité défère « la situation au Darfour » au procureur de la CPI.
5 mai 2006 : Echecs des négociations du DPA. Poursuite des combats au Darfour.
Avril 2006 : Rupture des relations diplomatiques avec le Tchad.
31 août 2006 : Adoption de la résolution 1706 par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Crispation des relations ONU-Soudan.
Décembre 2006 : Le Soudan accepte, du bout des lèvres, le déploiement d’une force d’interposition ONU – Union africaine au Darfour.
14 février 2007 : Opposition du Soudan au déploiement de Casques bleus.
Février 2007 : Inculpation d'Ahmed Haroun et d'Ali Kosheib par la CPI pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre au Darfour.
Avril 2007 : Accord entre le Soudan, l'ONU et l'UA sur le déploiement des Casques bleus.
Mai 2007 : Réconciliation avec le Tchad ; Sanctions économiques de la part des Etats-Unis ; Mandats d'arrêt internationaux de la CPI contre Ahmed Haroun et Ali Kosheib.
31 juillet 2007 : Résolution 1769 du Conseil de sécurité, déploiement de la force conjointe ONU-UA, MINUAD, au Darfour.
31 décembre 2007 : La Minuad prend le relais de la MUAS.
13 mars 2008 : A Dakar, accord de réconciliation et non-agression par rebelles interposés entre le Tchad et le Soudan.
Mai 2008 : Attaque des rebelles du JEM sur Omdurman, proche banlieue de Khartoum.
14 juillet 2008 : Requête du procureur Luis Moreno Ocampo pour un mandat d'arrêt international contre le président Omar Al-Bachir.
Septembre 2008 : Offensive contre les rebelles au nord du Darfour.
Novembre 2008 : Le président Al-Bachir annonce un cessez-le-feu au Darfour ; Appel au désarmement des milices. Rétablissement des relations diplomatiques avec le Tchad.
17 février 2009 : Signature à Doha d'un accord cadre entre le gouvernement et le JEM.
4 mars 2009 : Inculpation du général Al-Bachir de crimes de guerre et crimes contre l’humanité ; mandat d’arrêt international ; Expulsion de 13 ONG humanitaires internationales en représailles. Le JEM suspend la négociation de Doha.
3 mai 2009 : Nouvel accord de réconciliation entre le Tchad et le Soudan signé à Doha.
Janvier 2010 : Reprise des négociations de Doha entre le JEM et le gouvernement.
Avril 2010 : Elections générales au Soudan.
Il convient de souligner d’emblée que, à l’inverse du conflit du Sud Soudan où elles sont un élément de la problématique, les considérations religieuses ne peuvent entrer en ligne de compte pour la compréhension de la crise que connaît le Darfour. En effet, comme il a été dit, les populations du Darfour, pour être extrêmement diverses, n’en sont pas moins en totalité musulmanes depuis plusieurs siècles, à l’instar de celles du reste du Nord du Soudan : qu’elles soient « africaines », à savoir Four, Masalit, Zaghawa, Bideyat, Tama ou autres, au centre du Darfour, vivant de cultures traditionnelles, ou « arabes », - c'est-à-dire Rizeigat, Mahariyya, Mahamid, Zabalat ou Beni Hussein pour n’en citer que quelques unes -, dans les parties septentrionale et occidentale de la région, à l’économie pastorale, toutes sont de culture islamique « et fières de l’être » (188). Leurs différenciations se fondent essentiellement sur d’autres critères, notamment socio-économiques, sur lesquels repose la véritable réalité de leurs rivalités.
Les racines du conflit sont donc autres que religieuses. Vos rapporteurs ont largement détaillé dans la première partie de ce rapport l’ensemble des éléments qui ont concouru à la marginalisation du Darfour comme des autres régions du pays par Khartoum, notamment sur les plans économiques et sociaux. L’analyse historique aide à comprendre la crise actuelle, qui ne surgit pas en 2003 sans signes avant-coureurs ni sans précédents, mais au contraire plonge ses racines dans ce délaissement dont elle est a de tout temps été victime. Elle montre en ce sens que ce qui se joue au Darfour est étrangement semblable à ce qui s’est passé dans le cadre des autres guerres civiles soudanaises, comme si Khartoum avait décidément une relation particulière avec ses différentes périphéries.
1) Des causes de la crise au déclenchement du conflit
A la fin de l’année 2003, des rumeurs selon lesquelles un génocide était en cours au Darfour ont circulé. Vos rapporteurs reviendront ultérieurement sur ce thème essentiel, ne serait-ce qu’en regard des multiples conséquences internationales et diplomatiques qu’il a eues. Il est néanmoins important de le mentionner d’entrée car il a contribué à surestimer lourdement certains facteurs potentiels de la crise au détriment des plus déterminants, et d’imposer par là même les solutions peut-être les moins pertinentes. Cela étant, sans ces rumeurs et cette campagne, le sort de la crise du Darfour aurait sans doute été celui des autres conflits soudanais : interminable et oublié. L’écho médiatique quasi immédiat qu’elle a eu lui a donné un relief inédit et une mobilisation internationale sans précédent pour la recherche de solutions.
a) Un contexte identique à celui des autres conflits soudanais
Pour être pour partie un conflit « opportuniste », comme on le verra, la crise n’en a pas moins surtout des origines lointaines et profondes, qui s’apparentent fortement à celles qui ont suscité le surgissement des autres rebellions périphériques. Ces raisons sont sans doute loin de devoir autant au facteur ethnique ou racial que ce que l’on a pu soutenir. Pour être en partie fondé, cet aspect ne constitue sans doute pas la plus déterminante des causes, à l’inverse de ce qui a été trop rapidement avancé : à l’instar de ce qu’on a constaté ailleurs, les revendications des rebelles du Darfour pourraient en effet surtout se résumer à la volonté de voir corrigés les déséquilibres multiples existant entre Khartoum et l’ouest du pays.
Dans ce registre, de multiples facteurs ont joué dans le déclenchement de ce qui allait devenir une des crises politiques, militaires et surtout humanitaires les plus aiguës de ces dernières décennies. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, on retrouve sans surprise en ce qui concerne le Darfour, un ensemble de questions identiques à celles qui courent au long de l’histoire contemporaine du Soudan. Ce qui a provoqué le conflit avec le Sud notamment, mine tout autant la relation de Khartoum avec l’Ouest, à savoir le fait que cette région ne bénéficie pas de la moindre des retombées espérées du développement, même des plus modestes, du pays, qu’elle n’a pas voix au chapitre dans une quelconque répartition des richesses ; que la marginalisation politique et institutionnelle est semblable à ce qu’elle a été de tout temps pour les sudistes ou pour les populations des autres régions ; le fait, enfin, que la sécheresse croissante et la désertification ont entraîné des migrations de pasteurs nomades vers des terres cultivées dans les proportions qu’on a vues.
Le « Black Book », publié anonymement en 2001 sur le site Web (189) du principal mouvement rebelle darfouri qui prendra les armes contre Khartoum au début de 2003, le JEM, expose à cet égard l’ensemble des griefs à l’endroit de la capitale et développe une argumentation précise sur les déséquilibres sociaux, économiques, institutionnels criants qui condamnent le Darfour à la plus extrême pauvreté.
Ce Livre noir détaille ainsi entre autres les taux de scolarisation, les conditions d’assistance médicale, présente les indices de développement et se livre à une analyse comparée avec la situation qui prévaut dans les autres régions du Soudan et tout particulièrement Khartoum. Il met de manière indiscutable en lumière le fait que l’état d’abandon du Darfour, que Gérard Prunier soulignait, n’a absolument pas changé. En d’autres termes, le Darfour, à l’instar des autres périphéries du Soudan, a souffert de l’accaparement par la région capitale de l’ensemble des ressources à son seul profit et d’une politique de domination absolue dans laquelle le « sens de l’Etat » qu’on pourrait espérer du gouvernement central n’a clairement aucune place.
Consécutivement, il n’est pas surprenant de noter que, de manière également comparable aux positions que le SPLM sudiste défend, les mouvements rebelles du Darfour se présentent eux aussi comme œuvrant pour le Soudan dans son entier et ne défendent pas des options qui seraient purement régionalistes, voire séparatistes. Avant même de se convertir en « Mouvement de libération du Soudan », SLM ou SLM/A, le Front de libération du Darfour avait ainsi élargi son programme initial centré sur la population du Darfour à l’ensemble du pays. De son côté, le « Mouvement pour la justice et l’égalité », JEM ou MJE, montre dans le Livre noir que son intérêt n’est pas non plus exclusivement porté sur les populations du Darfour, et s’attache à prouver que d’autres régions du Soudan sont également fort défavorisées. Dès cette époque, et encore aujourd’hui, son ambition est par conséquent la recherche d’une solution nationale pour le Soudan dans son entier, même si « l’étincelle a surgi du Darfour » (190).
Au cours des nombreuses rencontres qu’ils ont eues dans le cadre de ce travail, vos rapporteurs ont d’ailleurs pu noter que la part que ces disparités ont joué dans le déclenchement de la crise n’est désormais niée par personne, y compris par les autorités de Khartoum qui reconnaissent pour partie la validité des griefs exprimés par les rebelles. Le chef de la délégation soudanaise aux négociations conduites par le Qatar analyse ainsi la dégradation de la situation au Darfour en termes de marginalisation, conjuguée aux effets de la sécheresse et de la désertification et considère que la question de la terre est effectivement cruciale, comme on le verra ci-après. Le fait qu’aux modes de résolutions traditionnels des conflits se soient substituées les Kalachnikov a rendu la situation difficilement gérable et la recherche de solutions compliquée. Toutefois, le problème date des années 1970 et ne saurait être imputé au gouvernement actuel (191). Nafi’ Ali Nafi’, pour sa part, ajoute que le développement économique et la pacification entre tribus sont les seules voient de résolution de la crise du Darfour (192).
En d’autres termes, il n’est sans doute pas exagéré de soutenir que le mode de relation centre – périphérie qui prévaut au Soudan produit toujours les mêmes effets, à savoir de la conflictualité, au Darfour comme dans les autres provinces extérieures du Soudan (193).
Parmi les éléments les plus déterminants, s’agissant du Darfour, la question de la terre occupe le premier plan, en ce qu’elle est traditionnellement « au centre de la vie économique et sociale du Darfour » (194).
Les bouleversements écologiques induits par la désertification et la sécheresse ont rendu la cohabitation des populations nomades et sédentaires nécessairement délicate, en multipliant les sources de conflits d’intérêt sur des surfaces d’autant plus réduites que les modes de production agricoles évoluaient aussi dans cette région et requéraient, entre autres, des systèmes d’irrigations fortement consommateurs de ressources en diminution (195). Les tensions qui en on résulté ont été d’autant plus difficiles à gérer que, ayant bouleversé les systèmes traditionnels de propriété et de gestion de la terre et démantelé les modes ancestraux de résolutions des conflits, Khartoum n’a non plus rien fait pour y remédier. Tout au contraire, le gouvernement soudanais a, dès les années 1980, que ce soit sous la dictature de Nimeyri ou durant la période démocratique dirigée par Sadeq el-Mahdi, montré un désintérêt pour la région, alors même que les tensions intercommunautaires s’aggravaient déjà du fait du manque d’eau, que les premiers affrontements apparaissaient et que la situation alimentaire devenait tendue (196). En d’autres termes, de fortes pressions écologiques, à l’œuvre depuis les années 1970, ont joué pour faire peu à peu du Darfour un lieu de fracture intercommunautaire, une poudrière dans laquelle l’insécurité n’a cessé de monter, attisée à propos par le gouvernement central : dès la fin des années 1980, le gouvernement de Sadeq el-Mahdi contribue ainsi à exacerber les tensions en prenant partie et en soutenant les tribus arabes nomades unies lors du premier conflit avec les Four (1987-1989), qui sera déjà terriblement meurtrier, avec la terre pour enjeu premier (197). De même, à la fin des années 1990, le gouvernement actuel fomentera-t-il un autre conflit en créant des émirats arabes au sein du Dar Masalit, à l’ouest du Darfour (198).
Enfin, on peut aussi rappeler que le désintérêt de Khartoum pour le Darfour avait d’ailleurs été tout aussi criminel dès les famines de 1984 et 1985 au cours desquelles quelque 100 000 personnes moururent par la faute exclusive du gouvernement central. Ces famines, outre qu’elles marquèrent inévitablement par leur ampleur un temps fort de la tension entre nomades et sédentaires, révélèrent l’incurie de Khartoum et l’absence de volonté politique de venir en aide aux populations de la région, alors même que des dizaines de milliers de tonnes d’aide alimentaire livrée par la communauté internationale étaient entreposées à Port Soudan (199).
Ayant été déterminante lors de la crise des années 2000, la terre restera inévitablement un élément clef de la résolution ; la question du retour à la terre des spoliés sera à cet égard cruciale, comme elle le sera pour la réconciliation entre tribus.
c) La lente dégradation de la situation locale
Tchad et Libye ont de longtemps constitué un voisinage difficile pour le Soudan, et la quasi inexistence des frontières administratives dans des régions aussi éloignées des capitales respectives, et en l’occurrence de Khartoum, a facilité les mouvements de populations en tous sens, incontrôlés car incontrôlables.
En ce sens, sans doute quelques facteurs régionaux se sont-ils ajoutés aux tensions socio-écologiques que l’on vient de brosser. En effet, la crise politique sans fin que connaît le Tchad depuis la fin des années 1970 a eu pour théâtre, et depuis longtemps, les terres du Darfour. En premier lieu, des migrations forcées se sont produites depuis le Tchad dans les années 1980, dues à la fois aux sécheresses sahéliennes et à la violence politique, qui ont conduit des populations tchadiennes à trouver refuge et à s’installer au Darfour voisin, aggravant par le fait même la situation déjà difficile.
Surtout, à partir de 1982, le soutien armé du colonel Kadhafi à l’opposition tchadienne à Hissen Habré, également réfugiée au Darfour, introduisit dans la région un autre facteur de tension ainsi que des moyens militaires supplémentaires pour régler les conflits. Avec le soutien en retour du président tchadien aux groupes qui, au Darfour, pouvaient lutter contre ses propres ennemis, les germes de l’escalade étaient semés : « Les Four, notamment, bénéficièrent alors d’une aide militaire substantielle car ils étaient entrés en conflit contre leurs voisins Zaghawa. » (200) Ce ne fut d’ailleurs pas uniquement par soutiens militaires interposés que le Darfour servit de terrain de manœuvre à la crise politique tchadienne : l’armée tchadienne intervenait directement, les milices s’affrontaient, la population du Darfour voyait la tension interethnique et le degré de violence atteindre des sommets, de sorte que, vers la fin des années 1980, « on en était arrivé à un point où il était devenu impossible de distinguer ce qui relevait de la guerre civile tchadienne de ce qu’il fallait bien désormais appeler la guerre civile au Darfour. » (201) Le renversement de Hissen Habré par Idriss Déby à la fin de 1990, après une offensive menée depuis le Darfour, ne devait cependant pas apaiser la situation. Ses soutiens Zaghawa se délitèrent et formèrent à leur tour une opposition armée, qui s’installa encore une fois au Darfour, d’où elle commença de mener ses propres opérations. La dimension tchadienne prendra un relief plus fort encore après le déclenchement de la crise du Darfour, comme on le verra plus loin.
Parallèlement, Khartoum contribuait à la dégradation de la situation locale en armant de son côté des groupes arabes au Sud Darfour, pour faire pièce à la pénétration des Dinka du SPLA venus du Sud Soudan. Les milices Muraheleen du gouvernement intervinrent dès cette époque, la fin des années 1980, comme elle le faisaient au Sud Soudan. La répression de la part de Khartoum au début des années 1990 à la tentative du SPLA de susciter un nouveau foyer d’opposition à l’ouest du pays fut alors d’une brutalité qui augurait celle des années 2003 et suivantes (202). Elle s’accompagna aussi peu après d’une politique administrative et institutionnelle qui n’est pas non plus sans rappeler celle conduite au Sud Soudan quelques années plus tôt par Nimeyri : le Darfour jusqu’alors uni fut séparé en 1994 en trois Etats, Nord Darfour, Darfour occidental et Sud Darfour, plus facilement contrôlables car divisés. Les Four, notamment, répartis dans les trois Etats, voyaient ainsi leur influence diminuer, d’autant que l’administration locale traditionnelle subissait de nouveau une véritable humiliation.
En d’autres termes, les causes du conflit du Darfour s’apparentent fortement à celles des autres régions du Soudan. Ce conflit n’apparaît pas en 2003 (203), il a été précédé d’épisodes antérieurs, que vos rapporteurs ont rappelés, et qui sont anciens, nombreux et d’une très grande violence. On a ainsi pu calculer que trois conflits traditionnels, fondés sur des questions de ressources avaient éclaté entre 1968 et 1976 ; cinq, entre 1976 et 1980 et 21 de 1980 à 1988 (204). En conséquence, si le conflit, tel qu’il est apparu comme préoccupation de la communauté internationale, est effectivement d’une singulière gravité, il n’en reste pas moins qu’il faut sans doute plus le considérer comme un tournant vers une nouvelle phase d’une situation récurrente qui n’a cessé d’empirer, que comme une guerre civile réellement nouvelle.
Compte tenu des similitudes avec les conflits des autres régions, il eut en tout cas été surprenant qu’une insurrection armée n’éclatât pas à son tour, après celles du Sud, des Monts Nouba et de l’Est qui, en leur temps, surgirent pour des raisons identiques. Cela étant, d’autres facteurs, plus spécifiques à la région et à son environnement immédiat, ont également pu jouer un rôle particulier. En 1983 le pétrole était l’élément déclencheur de la seconde guerre du Sud Soudan ; Vingt ans plus tard, c’est la négociation de paix qui sera celui du Darfour.
d) Un conflit « opportuniste »
Ce n’est en effet pas une question de partage de ressources qui a poussé les opposants darfouri à Khartoum à prendre les armes en 2003. Rien ne dit aujourd’hui qu’il y ait du pétrole au Darfour, rien ne dit non plus qu’il n’y en ait pas, - la région se trouvant entre le Sud Soudan et le Tchad, l’hypothèse qu’on en découvre n’est assurément pas absurde (205) -, mais cette éventuelle perspective est trop lointaine pour être un facteur déclenchant d’un conflit.
Comme on a pu le faire remarquer (206), depuis longtemps, au Darfour, tous les indicateurs étaient « au rouge », et de plus en plus, mais aucun des éléments de la tension ne suffisait à lui seul à déclencher l’embrasement qui allait avoir lieu. La situation était certes préoccupante, violente contre les populations locales, victimes du banditisme des bandes armées, mais déjà « habituelle ».
Autour de 2000-2002, il n’y avait rien de plus dans la tension latente qui justifie, à ce moment là, le déclenchement d’une insurrection. Pourtant, à cette époque, des escarmouches éclatent, fomentées par quelques centaines de Zaghawa qui attaquent, se rebellent contre des Arabes Les médiations traditionnelles, préalablement affaiblies, ici comme ailleurs, échouent, au demeurant sabotées par Khartoum. Des groupes armés se forment alors, Zaghawa essentiellement, qui s’en prennent notamment avec un certain succès, à des symboles gouvernementaux. En février 2003, pour la première fois, les incidents armés sont revendiqués par une nouvelle organisation politique, le « Front de libération du Darfour » (207).
En fait, parallèlement, les négociations de Naivasha commençaient de prendre une tournure prometteuse entre le Nord et le Sud. Les délégations venaient de signer en juillet 2002 à Machakos le premier des différents protocoles qui constitueraient le Comprehensive Peace Agreement (CPA). Ce premier texte en définissait l’ossature, les principes sur lesquels devrait reposer le processus de paix ainsi que la transition. En d’autres termes, le SPLM/A sudiste semblait en passe de tirer enfin les bénéfices politiques de vingt ans de guerre contre Khartoum. N’était-il pas tentant pour les exclus darfouri de décider de prendre alors eux aussi les armes pour essayer à leur tour de forcer le gouvernement soudanais à négocier ce qu’il leur refusait depuis des dizaines d’années (208) ? Cette donnée est d’autant plus importante que, comme on le verra plus loin, le CPA prétendait précisément à un accord global, qui réglerait les problèmes de l’ensemble du Soudan et non le seul conflit entre le Nord et le Sud ; notamment les questions cruciales entre toutes du partage du pouvoir et des richesses étaient abordées et bénéficiaient du parrainage de la communauté internationale. « Manquer le coche » pour les darfouri, alors même que pas une seule fois le Darfour n’était cité dans le texte signé à Machakos, pouvait alors signifier le maintien de la situation dans la région pour des lustres, sans que l’attention ne soit attirée sur les difficultés et l’abandon des populations à leur sort (209).
Profiter de ce moment pouvait également laisser penser que Khartoum, tout occupé, comme le verra plus loin, à revenir en grâce auprès de la communauté internationale, non seulement en marquant sa bonne volonté vis-à-vis du Sud dans le cadre de ces négociations sous parrainage international mais aussi en se rapprochant des Etats-Unis dans le cadre de leur lutte contre le terrorisme islamiste, serait d’autant plus enclin à se montrer ouvert à la revendication. Erreur de jugement des stratèges darfouri ? La réalité a bien évidemment été tout autre et la violence de la répression exercée par Khartoum, aveugle.
Cela étant, il n’est pas indifférent non plus de faire remarquer que, parmi les causes peu commentées du déclenchement de l’insurrection, des tensions internes au régime soudanais ont également eu leur part : en ce début des années 2000 où les Zaghawa commencent à élever le niveau de leur action, Hassan Al-Tourabi de son côté, alors en disgrâce à Khartoum, évalue en effet la possibilité d’une révolte civile qui répéterait les épisodes de 1964 et 1985 contre le gouvernement. Ses troupes fomentent des émeutes à l’Ouest du pays, sans succès ; il signe même un accord en parallèle avec le SPLA sudiste qui prévoit la coordination de leurs efforts respectifs (210). Les forces du SPLA lanceront d’ailleurs de nouvelles attaques sur le Sud Darfour, repoussées, déjà, par les milices Muraheleen à la solde du gouvernement, qui répriment indistinctement populations Zaghawa, Four ou Masalit. C’était au premier semestre 2002. En 2004, Hassan al-Turabi soutiendra publiquement la cause rebelle et le gouvernement en tirera profit pour se refuser aux négociations avec le JEM, qualifiant l’insurrection de manœuvre tactique détournée des buts qu’elle déclare défendre (211).
Quoi qu’il en soit, que ce soit du fait de militants Zaghawa impatients d’en découdre, des manœuvres de Hassan Al-Tourabi dans le cadre de sa lutte au sein du régime, ou pour d’autres facteurs encore, la tension latente depuis des années s’alourdissait au tournant des années 2000. Les éléments se mettaient en place peu à peu pour que la guerre prenne une toute autre ampleur que celle que la région connaissait depuis une quinzaine d’années.
Schématiquement, les belligérants du Darfour sont répartis, d’un côté, en forces rebelles, à l’heure actuelle toujours désunies, et d’un autre côté, en forces armées soudanaises, appuyées de milices.
a) Des mouvements rebelles divisés
D’une certaine manière, les différents aspects soulevés précédemment sont loin de constituer le seul point de ressemblance entre le conflit du Darfour et celui du Sud Soudan : Les divisions internes aux sudistes trouvent en effet leur pendant dans celles des rebelles du Darfour qui, jusqu’à aujourd’hui encore, n’ont pas réussi à s’unir dans leur combat contre un même objectif. De la même manière qu’au Sud, ils ont sans doute tout autant pâti du jeu savamment exercé par Khartoum, habile manipulateur, sachant attiser à son profit les dissensions entre factions rivales. Incidemment, on peut d’ores et déjà faire remarquer que cette désunion, sur laquelle vos rapporteurs reviendront, quelles qu’en soient les raisons, rend plus complexes les négociations de paix.
Au tout début de 2003, lorsque l’insurrection a éclaté, deux mouvements sont apparus de manière quasi simultanée : Le Front de libération du Darfour, d’une part, qui deviendra quelques semaines plus tard le « Mouvement de libération du Soudan », SLM, flanqué d’une branche militaire, l’Armée de libération du Soudan, SLA ; d’autre part, le « Mouvement pour l’égalité et la justice », JEM. Leurs revendications respectives ne sont pas éloignées, et l’un comme l’autre s’inscrit, comme on l’a dit, sur la thématique de la marginalisation de la région et sur l’opposition au gouvernement de Khartoum, pour ces raisons précises : un meilleur partage des richesses et du pouvoir est réclamé, non seulement pour le Darfour, mais à l’échelle nationale. Consécutivement, leur approche entend dépasser les clivages ethniques soudanais, bien qu’eux-mêmes soient composés très majoritairement de non Arabes (212).
Pour autant, la relation entre les deux sera des plus difficiles et elle complique singulièrement la donne.
En effet, Abdel Wahid Mohamed al Nour, président, Four, du SLM, inscrit clairement sa démarche sur la trace de John Garang, et la structure du mouvement, ainsi que les thématiques qu’il défend, reprennent celles du SPLM/A dont il partage l’objectif d’œuvrer pour un nouveau Soudan, démocratique et uni, laïc : « Nous avons voulu reconstruire le pays à partir des idéaux que nous partagions : le respect des droits de l'homme et du droit international ; l'égalité des droits des citoyens ; la promotion de la démocratie chez nous et dans la région ; et la sécularisation de l'État. Nous estimons, en effet, que la nation appartient à tous et la religion à chacun. C'est autour de ce programme que nous avons mobilisé la population dans tout le pays. On oublie souvent, en Occident, que le combat du SLM est d'abord national, qu'il concerne l'ensemble de notre pays. » (213) Lorsqu’il surgit sur la scène, le SLM, composé de Zaghawa, de Four et de Masalit, s’oppose donc à la fois au régime de Khartoum ainsi qu’aux islamistes de la mouvance de Hassan al-Turabi dont on a vu les récentes tentatives pour faire du Darfour un foyer de rébellion contre le gouvernement d’Al-Bachir. Les uns comme les autres sont néanmoins jugés responsables de la répression au Darfour et les chefs du mouvement, et AbdelWahid al-Nour ainsi que Mini Arkoi Minawi, secrétaire général et principal chef militaire, Zaghawa, se refusent par conséquent à transiger avec le JEM.
Il faut noter que, à l’identique du SPLM/A aussi, le SLM/A apparaît quelque peu divisé en termes ethniques et des tensions se feront jour entre les différentes composantes sur ces bases. Au-delà de ces similitudes, des liens plus effectifs existent entre les deux mouvements, le SPLM sudiste, « principal allié » (214) du SLM, aidant son homologue du Darfour en fournitures d’armes, entraînement et appui stratégique.
En contrepoint, le JEM, est conduit par Khalil Mohamed Ibrahim, également Zaghawa, qui a tout comme son proche entourage un long engagement politique au sein du Front national islamique, et bénéficie de ce fait de la sympathie naturelle de Hassan al-Turabi. Cela étant, la thèse selon laquelle le JEM serait la branche darfouri du mouvement de Hassan al-Turabi, ce dont celui-ci s’est toujours défendu, malgré le parcours personnel de Khalil Ibrahim, ne fait pas l’unanimité. Parmi les témoignages recueillis par vos rapporteurs, certains interlocuteurs se sont montrés dubitatifs. Pour ce qui les concerne, et bien que devant la Commission d’enquête des Nations Unies, Khalil Ibrahim ait nié tout lien, allant même jusqu’à considérer que Hassan al-Turabi était « la principale cause des atrocités commises au Darfour » (215), vos rapporteurs inclinent à privilégier la thèse du JEM comme mouvement islamiste : les coïncidences dans les séquences qui se déroulent autour des années 2000 sont trop nettes pour ne pas refléter une part de réalité. Que le lien aujourd’hui entre Hassan al-Turabi et Khalil Ibrahim se soit ou non distendu, importe sans doute finalement peu par rapport à cet aspect de fond (216).
Il n’est pas non plus inutile de préciser ici que Khalil Ibrahim a par ailleurs été ministre et qu’il a également combattu au sein des forces armées au Sud contre le SPLA, à l’instar de nombre de darfouri qui ont constitué le gros des troupes armées soudanaises ou des milices alliées de Khartoum, envoyées au front sudiste.
Quoi qu’il en soit, les parcours politiques des leaders de ces deux formations sont nettement différents, et expliquent la relation tendue que les deux mouvements entretiendront au fil du conflit, voire l’irréductibilité de leur antagonisme, y compris sur des aspects tactiques. Ainsi, dès les débuts du conflit, le SLM refusa la proposition du JEM de se joindre à lui dans des actions communes, arguant d’un agenda propre. Selon AbdelWahid al-Nour, le JEM « a le même maître à penser que le gouvernement : Hassan Al-Tourabi. Ce mouvement est aidé par la Libye, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et même, pour des raisons tribales, par le Tchad. Il ne représente pas de force sur le terrain ; avec l'argent du Golfe et de la Libye, il achète des gens dans les camps de réfugiés. » (217)
D’une certaine manière, seul l’objectif commun, la lutte contre le pouvoir central, pourrait les rapprocher, mais à ce jour, comme on le verra par la suite, ils ne se sont pas vraiment retrouvés, que ce soit sur le terrain ou ultérieurement lors des négociations sous parrainage international.
Outre ces deux mouvements, qui sont les principaux sur le théâtre du Darfour, d’autres existent, dont l’importance et le rôle ne sont cependant pas tels qu’il soit justifié ici de les détailler.
b) Forces gouvernementales et milices janjawids
Face aux rebelles désunis, Khartoum a développé une stratégie éprouvée, qui permet au gouvernement de multiplier ses moyens, en recourrant, ici comme ailleurs, à des milices. Ces milices, armées et soutenues par le gouvernement soudanais, viennent compléter l’effort des Forces armées, dirigées par le général Al-Bachir, commandant en chef.
Les janjawids, « démons à cheval » dans la langue courante, ne sont pas une nouveauté au Darfour. Le terme est ancien qui désignait autrefois des bandits de grand chemin, ciblant leurs attaques sur les populations villageoises, volant leur bétail. Aujourd’hui, dans le cadre du conflit, ce sont des milices composées d’assaillants issus essentiellement de tribus arabes, intervenant à cheval ou chameau, plus sûrement en 4x4, et à l’arme automatique. La composition des milices janjawids est de fait complexe, dans la mesure où il apparaît que des non Arabes en sont également membres tandis que certains groupes arabes se refusent à les rejoindre et restent neutres ; tous les membres ne sont pas non plus Soudanais et le recrutement a semble-t-il été fort varié : bandits de grand chemin et criminels amnistiés en échange de leur incorporation ; soldats démobilisés ; membres de petites ethnies arabes défavorisées, etc., qui reçurent ainsi équipements et soldes (218). Une lecture exclusivement « ethnique » du conflit se révèlerait par conséquent ici aussi quelque peu rapide et erronée, à l’instar de ce que vos rapporteurs indiquent par ailleurs concernant les autres conflits soudanais.
Certaines de ces milices sont organisées en unités paramilitaires, voire même encadrées par des officiers de l’armée soudanaise ; d’autres ont une relation plus distante avec les autorités de Khartoum qui les équipent et pour le compte duquel elles agissent, mais de manière plus autonome, en mercenaires se payant en nature, à l’inverse d’autres, directement rétribuées par le gouvernement (219). En effet, bien que le gouvernement soudanais ait nié avoir des liens avec elles, l’articulation des milices janjawids au gouvernement a été parfaitement documentée par de nombreuses enquêtes, officielles, d’ONG ou de chercheurs, et ne fait aucun doute : La Commission d’enquête des Nations Unies notamment, en a ainsi fait la démonstration, Human Rights Watch également. De même, pour Gérard Prunier, « en dépit des dénégations ultérieures des autorités, il était évident que tous ces groupes opéraient en pleine coordination avec l’armée régulière, qui souvent les accompagnait dans leur sinistre mission. » (220) D’autres analyses concluaient sur le même mode que « les Janjawids procèdent selon un plan d’ensemble élaboré par les services de sécurité militaires qui gèrent ces mercenaires d’un genre particulier : ils jouissent d’une grande liberté d’action, sévissant en toute impunité (…) » (221)
En cela, comme on a dit, Khartoum reprenait une politique entreprise auparavant sur d’autres théâtres, telles les milices Muraheleen, envoyées dans les Monts Nouba notamment. Le gouvernement le fit d’autant plus volontiers dans le cas du Darfour que les forces armées soudanaises, de retour du Sud Soudan, étaient majoritairement composées de soldats originaires du Darfour. En d’autres termes, des problèmes de loyauté étaient envisageables qui incitèrent, dès le mois de mai 2003, Khartoum à accentuer le recours aux milices janjawids.
Si ce conflit ressemble décidément tant aux autres que le Soudan a précédemment connus, c’est aussi par un autre aspect, et non des moindres : la brutalité des engagements militaires ou, plus précisément, la barbarie dont a fait preuve le gouvernement soudanais dans la répression qu’il a conduite.
a) Une politique de la terre brûlée
La réaction du gouvernement, alors en pleines négociations Nord-Sud, fut en premier lieu de minimiser la portée des événements qui avaient éclaté entre janvier et février 2003. Une mission fut envoyée au Darfour pour négocier, tandis qu’on posait un ultimatum de dix jours aux rebelles pour déposer les armes, assurant que, faute de dialogue, 24 heures suffiraient pour écraser dans l’œuf le mouvement et rétablir la situation.
Puis, très rapidement, le président Al-Bachir réagit avec une très grande fermeté. Dans une déclaration publique du 31 décembre 2003, il déclarait notamment que « notre priorité dorénavant est d’éliminer la rébellion, et tout hors-la-loi est notre cible […] Nous utiliserons l’armée, la police, les moudjahidin, les hommes à cheval pour nous débarrasser de la rébellion » (222), déclaration qui contredisait d’ailleurs, ipso facto, les dénégations gouvernementales quant aux liens de Khartoum avec les janjawids.
Entre temps, bien avant de tenir ces propos belliqueux, la situation sur le terrain était devenue sérieuse et les rebelles avaient montré de réelles capacités militaires (223) : les pertes humaines et en matériel de guerre, conséquentes, avaient surpris les forces gouvernementales qui avaient essuyé en trois mois des attaques efficaces, notamment sur El Fasher, capitale du Darfour Nord. Les notables de la région, dont les députés du parti gouvernemental, dans une démarche collective, avaient demandé au président Al-Bachir l’ouverture de négociations axées sur les points suivants : dialogue politique avec les rebelles ; cessez-le-feu ; libération de prisonniers politiques ; aide humanitaire ; arrêt de la répression confiée aux janjawids. En vain.
Car le gouvernement avait au contraire déjà opté pour la réponse armée la plus brutale, réitérant ici les pratiques qu’il menait ailleurs, apportant une politique de terre brûlée en réponse aux quelques victoires de la SLA. Comme on a pu le dire par la suite, « il y avait déjà eu des violences au Darfour. Mais à la fin de juillet 2003, les choses changèrent radicalement d’échelle, et la province explosa littéralement. » (224) La brutalité de la répression gouvernementale est bien connue, imaginée à tout le moins : le fait qu’on ait pu la qualifier de « génocide » suffit à mettre en lumière sa dimension exceptionnelle.
Dans le cadre d’un scénario fréquemment répété, l’armée soudanaise commençait par effectuer des raids de bombardements sur les villages avec des moyens certes rudimentaires, et même inefficaces en termes strictement militaires, mais terribles pour les populations : « Il s’agissait donc non pas d’une arme militaire mais d’un instrument de terreur. (…) Il était clair que ce qui était recherché était une destruction totale des cibles civiles visées. » (225) A ces raids, succédaient ceux visant à détruire les infrastructures villageoises, puis ceux des milices janjawids lancées par Khartoum qui prenaient dès lors les populations villageoises, supposées soutenir les rebelles, pour cible des pillages, tueries indistinctes et autres massacres et viols de masse systématiques, pour lesquels elles avaient reçu carte blanche. Sur ces faits, les témoignages recueillis sont innombrables et la littérature est suffisamment abondante et détaillée pour qu’il ne soit plus nécessaire à vos rapporteurs d’y insister (226).
Quoi qu’il en soit, il apparaît que le gouvernement avait mis à profit une culture traditionnelle de razzia ainsi que les tensions ethniques existantes pour renforcer sa terrible guerre contre des forces rebelles et des populations civiles, engageant lui-même des moyens exorbitants en regard des objectifs strictement militaires exigés dans le cadre de la lutte armée. Ainsi qu’on l’a vu, en cela Khartoum n’innovait en rien : les populations des Monts Nouba avaient déjà en leur temps fait les frais de telles pratiques.
La méthode était assurément efficace, comme le confirme l’analyse de l’évolution du conflit.
b) L’évolution du conflit et le bilan de la terreur
L’analyse du conflit (227) permet de distinguer plusieurs phases, deux essentiellement, dont la première se caractérise par l’aspect méthodique de la conquête du territoire par les janjawids : si la réplique frappe dans les premiers mois le pays Zaghawa, - l’axe El Fasher-El Geneina -, et la frontière tchadienne, d’où proviennent les armes, les territoires Four et Masalit, aux terres fertiles et denses en populations, sont les deuxièmes cibles : Le Djebbel Marra et les environs de El Geneina sont systématiquement pilonnés et leurs populations déplacées. Après une trêve de quelques semaines décrétée par Al-Bachir, la guerre reprend et se déplace en mars 2004 vers l’Est et le Sud du Darfour. L’intensité des massacres et des déplacements de populations fléchit à l’automne 2004 dans ces régions du Darfour, le gouvernement de Khartoum ayant alors achevé sa politique de terre brûlée. Dès ce moment, les organisations humanitaires remarquent que la nature de la crise humanitaire change ; les civils ne sont dès lors plus les victimes de la violence aveugle, mais plus généralement de malnutrition et de maladies. Un peu plus tard, on pourra même dire que la situation sanitaire est sous contrôle, qu’elle a cessé de se dégrader, voire qu’il n’y a plus de crise sanitaire (228). La violence, elle, commence à devenir plus sporadique, à la mesure du fractionnement des forces en présence.
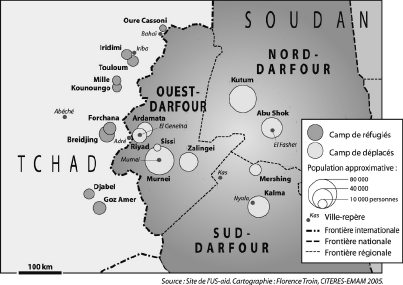
Carte : Les camps de déplacés et de réfugiés, août 2004 (229)
Dans l’intervalle, des négociations sous parrainage international auront été tentées, avec plus ou moins de succès et les premiers accords, difficilement conclus à Abuja, auront été violés ou inappliqués. A l’automne 2006, les janjawids reprennent néanmoins l’offensive, se concentrent sur le Nord du Darfour, puis au premier trimestre 2007, attaquent le Sud du Darfour, jusqu’alors épargné.
Ensuite, le conflit est entré dans une phase de « basse intensité », l’essentiel étant fait et les objectifs de nettoyage atteints, tandis que les rivalités entre forces rebelles, un temps coalisées, sont réapparues : comme suite directe des négociations d’Abuja, les années 2006-2007 voient le SLM se diviser en deux factions, l’une dirigée par AbdelWahid al-Nour, l’autre par Minni Minawi, qui ne tardera d’ailleurs pas à s’allier au gouvernement et à prendre les armes contre ses anciens proches. Un « Front uni de la résistance », URF, apparaîtra, fusionnant notamment des dissidences du SLM et du JEM, lequel ne réussit pas à fédérer les mouvements comme il le souhaiterait.
Quoi qu’il en soit, la situation s’est parallèlement traduite par une insécurité généralisée, les affrontements brutaux des janjawids laissant la place à des attaques ponctuelles, dans une optique de razzia de bandits de grands chemins, qui est devenu le principal facteur de violence (230). Les bombardements et les raids de grande ampleur s’espaçant, les déplacements de populations se sont aussi stabilisés. Le Darfour est entré dans une zone de « ni guerre ni paix », « avec des violences sporadiques que les civils considèrent désormais comme faisant partie de leur quotidien. » (231) Devant le Conseil de sécurité, Rodolphe Adada, chef de la MINUAD déclarait ainsi en avril 2009 que sur les quinze derniers mois, quelque 2000 personnes avaient été tuées au Darfour, dont un tiers de civils, 573 combattants étaient morts, 569 autres du fait de combats intertribaux (232) Rodolphe Adada fut cependant vivement critiqué peu après, juste avant la fin de ses fonctions, pour avoir même considéré que, au plan militaire, le conflit était terminé. Cela, alors même que la situation sur le terrain était moins bonne, du fait du banditisme, que deux ans auparavant. (233) Néanmoins, malgré cette violence latente, des retours spontanés, sans incitation aucune, de déplacés ont commencé à se produire, signe que la perception par les populations de l’évolution de la situation a commencé de changer.
Bien évidemment, un conflit d’une telle nature ne peut présenter qu’un bilan humain terrifiant. Qu’un génocide ait été planifié et commis ou pas importe peu face à la réalité et à l’ampleur de la tragédie : c’est par dizaines de milliers de tués, par centaines de milliers de déplacés et de réfugiés que l’on compte en parlant du Darfour. Une polémique, quelque peu stérile, a surgi quant au chiffrage des victimes, pour étayer la thèse selon laquelle un génocide avait eu lieu, sur laquelle vos rapporteurs reviendront plus loin. A cela s’ajoute le cortège des dommages annexes dont les effets se font et se feront sentir sur le moyen voire sur le long terme, en termes de générations perdues, de destruction des tissus sociaux, d’opportunités de développement anéanties, pour n’en citer que quelques uns.
Si la division des forces rebelles est une donnée permanente de ce conflit, comme elle l’a longtemps été de celui entre le Nord et le Sud, l’implication des voisins du Soudan en est une autre.
c) Les interférences étrangères
L’un des éléments que l’analyse se doit de prendre en compte s’agissant du conflit du Darfour porte sur le degré d’implication des pays riverains du Soudan, comme cela était déjà le cas, on s’en souvient, dans le cadre des conflits du Sud ou de l’Est. Avant même que la crise du Darfour n’éclate, et depuis longtemps, le jeu du Tchad et de la Libye a été considéré comme fortement perturbateur, et l’on a vu précédemment les ambitions anciennes du colonel Kadhafi sur le Darfour, ou encore les répercussions directes de la crise politique tchadienne des années 1980 sur la situation interne au Darfour.
La question, ici, a d’autant plus de pertinence que de fortes solidarités ethniques existent, les tribus Zaghawa vivant de chaque côté de la frontière avec le Tchad. De fait, il est de notoriété publique que le JEM, essentiellement composé de Zaghawa, est intimement lié à N’Djamena (234), et porté par le régime tchadien du président Idriss Déby, également Zaghawa. La base arrière du JEM se trouve en territoire tchadien d’où il lance ses contre-offensives. En d’autres termes, on ne peut sans doute comprendre la problématique darfouri sans prendre en compte la question de la relation désormais conflictuelle entre les gouvernements de ces deux pays : si Idriss Déby et Omar Al-Bachir ont été proches pendant une quinzaine d’années, jusqu’en 2005, ce sont aujourd’hui des rivaux qui se mènent une guerre par rébellions interposées.
Il faut à cet égard garder comme facteur explicatif le fait que le conflit du Darfour, dans la mesure où il a entraîné des déplacements de population considérables vers le côté tchadien de la frontière (235), qui fuyaient les massacres des janjawids, a eu aussi pour contrecoup une inévitable et forte déstabilisation sociopolitique de l’est tchadien, auparavant déjà fragile. Cet afflux de réfugiés soudanais, Zaghawa et Masalit, a entraîné à la fois un renforcement des solidarités ethniques transfrontalières, - les Zaghawa tchadiens s’appropriant le conflit du Darfour -, tout en ayant des effets sur la rébellion tchadienne contre Déby (236). En effet, confronté à sa propre opposition, à la défection d’élites Zaghawa, dont nombre de militaires de son entourage, Idriss Déby, affaibli, dut alors composer et renverser ses alliances pour réussir à se maintenir au pouvoir ; il commença par conséquent de soutenir le JEM, ce à quoi Khartoum réagit en appuyant les opposants de Déby. (237) Des tentatives de déstabilisation ont alors eu lieu, N’Djamena en appui des milices du JEM dans leur lutte contre le gouvernement soudanais, Khartoum appuyant en retour les milices rebelles tchadiennes contre le gouvernement d’Idriss Déby. C’est ainsi qu’en mai 2008, le JEM put mener une attaque de grande envergure qui le conduisit à Omdourman, en d’autres termes, à Khartoum, après que les rebelles tchadiens, soutenus par Khartoum se soient approchés du palais présidentiel de Deby au mois de février précédent.
d) Les raisons d’une telle violence
La politique de terreur qui a été menée au Darfour appelle d’autant plus à la réflexion que vos rapporteurs ont montré la récurrence de ces pratiques de la part du gouvernement militaro-islamiste de Khartoum. D’une certaine manière, comme on l’a vu, la même brutalité, les mêmes outils ont systématiquement été mis en œuvre. Au-delà des moyens utilisés, des constantes apparaissent également lors de chacun des conflits périphériques, quant aux causes, aux effets ou à l’environnement général, ne serait-ce que l’affaiblissement préalable des structures traditionnelles de médiation. De sorte que, pour disproportionnée qu’elle paraisse, cette politique est en fait parfaitement adaptée aux objectifs réellement poursuivis par ses auteurs.
En effet, la question de la terre au Darfour, tout comme celle du pétrole au Sud, était devenue d’une telle prégnance que la répression de Khartoum contre les rebelles s’est de fait très rapidement transformée en véritable contre-insurrection pour terroriser, expulser les habitants de leurs terres afin de se les approprier. Comme on a pu le faire justement remarquer, « Pour peu qu’on laisse de côté les témoignages les plus spectaculaires faisant état, par exemple, d’exécutions collectives, les attaques des villages non arabes du Darfour, en général menées conjointement par l’armée soudanaise et les milices progouvernementales appelées Janjawids, sont plus marquantes par le nombre de déplacés que par celui des morts. Moins qu’une conséquence des attaques, les déplacements massifs semblent être pour les combattants un but de guerre : il s’agit de vider des espaces de leurs habitants, et c’est bel et bien une guerre pour le contrôle de la terre qui semble se dérouler. » (238)
Encore une fois, ici comme ailleurs, le propos est identique de la part du régime de Khartoum et de ses soutiens : la domination et l’accaparement des ressources. En d’autres termes, la violence de la répression n’a été ni gratuite ni fortuite mais menée fort à propos. Les témoignages et les analyses coïncident en effet pour conclure à la coordination, à la planification des attaques de grande envergure subies par les populations villageoises dès les premiers mois du conflit, visant à les massacrer, à défaut à les terroriser pour les faire fuir. De fait, aujourd’hui et depuis déjà plusieurs années, des centaines de villages ont été systématiquement vidés de leurs populations et des centaines de milliers de personnes ont été déplacées ou ont dû se réfugier dans les zones limitrophes, au Tchad, notamment, où elles ont reçu l’assistance humanitaire de la communauté internationale. En ce sens, la contre argumentation gouvernementale n’est pas crédible lorsqu’elle soutient qu’il s’est agi de violences tribales spontanées et incontrôlées.
Il est essentiel de remarquer que ces témoignages et analyses sont unanimes et précis non seulement en ce qui concerne le drame du Darfour, mais aussi dans le cas des autres conflits, ceux du Nord-Sud ou des Monts Nouba. En d’autres termes, il ne s’agit pas, selon vos rapporteurs, de considérer qu’au Darfour Khartoum a planifié et commis un génocide contre une population donnée, comme cela a été trop souvent dit et maintenu même après les conclusions de la Commission d’enquête internationale des Nations Unies dès janvier 2005, sujet sur lequel ils reviendront plus loin.
Il s’agit au contraire de porter un regard d’ensemble sur ce qui se joue au Soudan d’une manière générale depuis 1956 et de l’analyser dans sa récurrence et sa cohérence pour conclure que le gouvernement islamiste, par cette attitude, montre son refus de régler les questions soulevées par ses différentes périphéries autrement que par la violence, sauf à y être contraint par la communauté internationale lorsque la pression que celle-ci exerce pèse par trop sur ses intérêts et risque de lui nuire.
Que ce soit avec les provinces de l’Est, avec le Sud Soudan, avec les Monts Nouba, ou enfin avec le Darfour, Khartoum ne fait qu’apporter la preuve, crise après crise, de son incapacité quasi ontologique au dialogue politique, au partage et à une gestion des affaires publiques autre que sur un mode prédateur. Toutes choses égales, c’est ce que le rapport de la Commission d’enquête internationale sur le Darfour confirmera à son tour en janvier 2005. Par conséquent, d’une certaine manière, lors de la crise du Darfour, le gouvernement soudanais n’a pas ouvert la « boite de Pandore » d’une violence dont les débordements, janjawids intervenant, lui auraient finalement échappés. Le Darfour n’est que le dernier des conflits en date entre les périphéries et le centre du Soudan que celui-ci ne peut, compte tenu de la logique dans laquelle il se trouve, régler autrement.
Comme Gérard Prunier l’a résumé fort justement, « depuis qu’il a pris le pouvoir en 1989, c’est l’ensemble de la philosophie et des politiques du gouvernement islamiste qui ne cesse de frôler le génocide dans le traitement de la question nationale au Soudan. (…) La pratique du génocide ou du quasi-génocide au Soudan n’a jamais été une politique délibérée ou calculée mais plutôt un outil employé sans frein pour maintenir la domination arabe sur un pays où ils ne sont qu’une minorité. Le Soudan n’est d’ailleurs pas un " pays ", si par ce mot on entend un Etat-nation, c’est un des derniers empires multinationaux de la planète et, du point de vue de son élite centrale, la contre-insurrection au Darfour était " rationnelle ". » (239) Il précisait ainsi son propos : « Qu’il s’agisse de l’accord de paix signé à Nairobi le 9 janvier avec les sudistes ou du quasi-génocide à tempérament au Darfour, nous sommes dans la même logique, celle du maintien du pouvoir et de la domination économique d’une petite clique " arabe " de la vallée du Nil sur un ensemble multiethnique et multiculturel. Les moyens importent peu et de toute manière la rationalité systématique n’a jamais été le point fort d’une culture politique soudanaise pour laquelle le principe aristotélicien de non-contradiction n’a jamais existé. » (240).
La recherche de solution à ces conflits ne peut dans ces conditions que requérir d’immenses efforts. On conçoit également la difficulté à garantir la pérennité des accord obtenus. Comment ne pas craindre non plus, leçons de l’histoire aidant, les risques de résurgences de ces conflits ou leur réplication sur de nouveaux théâtres ?
III – LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE ET LE SOUDAN
Le Soudan est sans doute aujourd’hui l’un des pays sur lequel sont portés les regards les plus sévères. Nul autre, ni en Afrique ni sur aucun continent, ne peut se prévaloir d’un chef d’Etat en exercice sous mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale, et cela seul résume la gravité de la situation interne. Pour autant, malgré l’ancienneté des crises, force est de constater que l’attention que la communauté internationale porte au Soudan est relativement récente et que cet intérêt pour les crises soudanaises est quelque peu sélectif : si la situation du Darfour n’est plus ignorée, la résolution du conflit entre le Nord et le Sud ne retient guère l’attention du grand public pas plus qu’elle ne suscite de grands efforts diplomatiques au point que l’observateur peut être amené à se demander ce que sont devenues les Nations Unies.
A – La fin de la guerre civile Nord-Sud : une affaire de diplomaties bilatérales
Autant la communauté internationale avait été indifférente à prendre réellement la mesure de la situation interne au Soudan au long des premières décennies suivant l’indépendance de 1956, autant la fin des années 1990 va-t-elle marquer un tournant radical et commencer de placer le pays sous les feux d’une actualité qu’il n’a toujours pas quittée dix ans plus tard.
Plusieurs facteurs se sont conjugués en ces années-là, qui ont contribué à de profonds changements. Deux, surtout, ont mis le Soudan et les Etats-Unis en situation de discuter et de donner une impulsion déterminante à la recherche de solutions pour la paix : d’un côté, le souhait du Soudan de sortir de son isolement international dans lequel son soutien au terrorisme islamiste l’avait confiné ; de l’autre, celui des Etats-Unis de renforcer leur lutte contre l’islamisme radical au lendemain du 11 septembre 2001.
Certes, à l’échelle du Soudan, cela se passait il y a bien longtemps, avant l’irruption de la crise du Darfour, qui est venue de nouveau bouleverser la donne des rapports, non seulement américano-soudanais, mais plus largement, de ce pays avec l’ensemble de la communauté internationale pour le remettre de nouveau au ban des nations. Peut-être les aléas interminables des processus de paix actuels pourraient-ils néanmoins y trouver matière à réflexion.
1) L’entrée en lice des Etats-Unis
Ainsi que vos rapporteurs l’ont montré, les relations entre les Etats-Unis et le Soudan ont longtemps été des plus fraîches, quand elles n’ont pas été temporairement interrompues. Lorsque l’intérêt américain pour le continent africain s’est ravivé, il ne s’est pas non plus d’emblée tourné vers le Soudan, eu égard à la situation, notamment humanitaire, qui y a toujours prévalu. Sans doute les perspectives pétrolières n’ont-elles pas été absentes dans la stratégie de retour américaine, et dans le soutien apporté aux rebelles du Sud : aujourd’hui présentes dans plusieurs pays de l’Ouest africain, aucune major américaine n’a encore pied au Soudan mais il semble difficile de croire que les Etats-Unis pourraient longtemps rester sans réagir face à la mainmise chinoise sur les ressources du pays. Cela dit, c’est en tout premier lieu la position centrale du Soudan par rapport à la question du terrorisme islamiste international qui a motivé les Etats-Unis, que ce soit en matière de sanctions, notamment bilatérales, ou plus tard, de reprise du dialogue.
a) Quand Khartoum était la plaque tournante du terrorisme international
Les années 1990 sont celles durant lesquelles le Soudan, juste après le coup d’Etat du FNI, mené par le général Al-Bachir, va se tourner vers le radicalisme et tenter de prendre un leadership international sur les positions islamistes les plus extrêmes. Comme on l’a vu, certains éléments et faits attestaient clairement de cette orientation radicale du régime, que la présence d’Oussama ben Laden au Soudan ou d’autres terroristes, ainsi que l’attentat contre Hosni Moubarak en 1995 à Addis Abeba, devaient confirmer.
Surtout, de manière plus subtile, cette époque est celle au cours de laquelle la tendance radicale, pilotée par Hassan al-Turabi, domine la scène politique soudanaise, qui, cherchant à promouvoir un panislamisme radical, organise notamment une « conférence populaire arabe et islamiste ». Hassan al Tourabi a développé depuis le milieu des années 1970 un réseau international de relations islamistes dans les pays de la région, jusque dans le Golfe, qui lui a assuré les soutiens nécessaires à son ambition, notamment au plan économique et financier et lui a permis, entre autres, d’acquérir un poids politique suffisant pour, par exemple, pouvoir persuader le général Nimeyri de remettre en cause les accords d’Addis Abeba, diviser le Sud en trois régions et imposer la sharî’a.
L’arrivée au pouvoir des Frères musulmans/Front national islamique, par coup d’Etat interposé en juin 1989, donna tout son sens aux relations internationales développées et entretenues par Hassan Al-Tourabi dans les années antérieures, puisque dès lors, des mouvements islamistes, y compris des organisations terroristes, ont accouru à Khartoum, en provenance d’Afrique, d’Asie ou même d’Europe. Le gouvernement soudanais leur a fourni aide et assistance, dans la perspective d’un mouvement islamique global qui, en réaction aux pétromonarchies conservatrices du Golfe, aurait Khartoum comme centre névralgique (241). L’accueil d’Oussama ben Laden à Khartoum en est l’illustration la plus spectaculaire et sa relation avec Hassan Al-Tourabi sera particulièrement étroite entre 1991 et 1996. Elle se traduira par un soutien logistique des services secrets soudanais à Al-Qaeda, par des investissements considérables de ben Laden dans l’économie soudanaise, - infrastructures, agriculture ou finance islamiste -, notamment. C’est aussi du territoire soudanais que ben Laden lancera certaines des actions qui feront connaître son nom dès cette époque, tel l’attentat contre le World Trade Center à New York en 1993. (242)
C’est bien ainsi que les Etats-Unis percevaient le Soudan, qui l’ont dès lors isolé de la scène internationale, sous la présidence de Bill Clinton qui a œuvré au plan diplomatique avec ses alliés régionaux, au plan économique ainsi qu’au sein des organisations internationales, où les représentants américains votaient systématiquement contre le Soudan. Le soutien soudanais à l’Irak durant la guerre du Golfe n’avait certes pas calmé la tension entre les deux pays et dès 1993, le Soudan était considéré comme un Etat sponsor du terrorisme par le département d’Etat, et sujet de ce fait à des sanctions bilatérales.
En contrepartie, les Etats-Unis menèrent une politique de soutien actif aux pays voisins du Soudan – Ethiopie, Erythrée et Ouganda –, confrontés à des rébellions intérieures appuyées par Khartoum. Il apparaît que pour partie au moins, le bénéficiaire réel de l’aide américaine était en fait le SPLM et sa branche armée, SPLA. Outre des mesures internes, tel que « l’Antiterrorism Act », adopté en 1996, qui restreignait les relations commerciales avec les Etats soutiens du terrorisme international, la politique américaine envers Khartoum s’est logiquement durcie après les attentats de Nairobi et de Dar-es-Salaam : le Soudan fut directement touché via le bombardement de l’usine pharmaceutique d’Al-Shifa, dans la proche banlieue de Khartoum, suspectée, sans doute à tort d’ailleurs, d’avoir été liée à la préparation de ces attentats.
En d’autres termes, la relation entre les Etats-Unis et le Soudan est à cette époque bien différente que celle que la France entretient parallèlement avec Khartoum.
b) L’art de se refaire une virginité
La fin des années 1990, à compter de 1998, va cependant marquer pour le Soudan un revirement politique et diplomatique assez net, qui traduit un nouvel équilibre interne au pouvoir et surtout, de nouvelles préoccupations. Renversement de l’équilibre interne qui se traduira notamment par la mise à l’écart de Hassan al-Turabi, les purges internes effectuées au sein du Parti du Congrès national dont sont alors exclus les partisans de Tourabi, ou encore la suspension de l’Assemblée nationale.
Comme vos rapporteurs l’ont évoqué plus haut, ce changement aura des traductions concrètes au plan de la diplomatie soudanaise : Ainsi, avant même que John Danforth ne vienne formuler les premières propositions américaines de paix à la fin de 2001, le Soudan, dans son désir de sortir de son isolement, avait fait quelques tentatives de rapprochements qui n’avaient cependant pas eu l’heur de retenir l’attention de l’administration Clinton. La plus spectaculaire de ces offres, rétrospectivement, est la proposition, en 1996, de remettre Oussama ben Laden aux Etats Unis, finalement refusée (243), comme celle, ultérieurement, de fournir à la CIA des informations sur Al-Qæda.
Ce sont les lendemains du 11 septembre 2001 qui vont donner au Soudan l’occasion de prouver sa bonne volonté vis-à-vis des Etats-Unis, en proposant alors immédiatement de collaborer avec le FBI et la CIA. A la différence de celle de 1996, cette offre de services a été acceptée par les services américains et, dès lors, la relation a radicalement changé.
Sur le fond, il est essentiel pour vos rapporteurs de souligner que ce revirement politique soudanais épouse très précisément l’évolution des intérêts du régime à ce moment-là. En effet, cette époque charnière est un moment au cours duquel une approche plus pragmatique (244) est engagée par le gouvernement soudanais qui se départit quelque peu de sa rhétorique islamiste extrémiste, après le bombardement sur l’usine d’Al-Shifa en 1998. Comme vos rapporteurs l’ont montré plus haut, la perspective de toucher dans un proche avenir les bénéfices de l’exploration pétrolière est alors de plus en plus nette : entre autres, des joint-ventures se constituent à la même date avec des majors chinoises et malaisiennes, la construction de l’oléoduc vers Port Soudan est décidée.
En conséquence, l’isolement diplomatique, économique et financier dont pâtit le pays apparaît alors aux dirigeants soudanais comme particulièrement pénalisant. En sortir, pour pouvoir espérer tirer les bénéfices attendus, devient l’urgence et donner des gages de bonne volonté, la première des priorités. Cela est d’autant plus important pour le Soudan que, comme on l’a vu, la charge de la dette extérieure est accablante et pose une contrainte extrême sur le développement économique. La normalisation des relations avec les Etats-Unis est par conséquent considérée comme un impératif et selon le gouverneur de la banque centrale soudanaise, elle permettra précisément d’avoir « un impact très positif sur la question de la dette » (245).
De sorte que, à la peur des représailles internationales ou américaines, concrètement perceptibles dès le bombardement d’Al-Shifa, à l’inconfort des mesures d’isolement, s’ajoute l’intérêt immédiat du régime à offrir sa pleine et entière coopération à la lutte contre le terrorisme islamiste. Ce qui n’empêche toutefois pas en parallèle ce même gouvernement de mener sur le plan intérieur la politique brutale de répression précédemment décrite à l’encontre des populations des Monts Nouba, d’accroître l’effort de guerre pour réprimer la rébellion du Sud et même d’y réitérer le jihad ou de marquer sa solidarité avec l’Afghanistan lorsque les Etats-Unis lancent leur campagne militaire contre le régime taliban en octobre 2001.
En d’autres termes, vos rapporteurs considèrent que s’est sans doute joué à cette époque un épisode particulièrement illustratif des ambivalences du régime de Khartoum, qui n’a pas hésité à mener de façon brutale et impitoyable à l’intérieur de ses frontières une politique d’islamisation de la société et des populations mais qui s’est aussi montré d’un pragmatisme des plus cyniques lorsque le besoin s’en est fait également sentir, comme peut en témoigner l’offre de remise de ben Laden aux Etats Unis.
Ces quelques éléments sont essentiels aux yeux de vos rapporteurs et il leur semble prudent de les garder précieusement à l’esprit pour analyser les échéances futures du Soudan.
2) Les parrainages internationaux du processus de paix
Ainsi qu’on a pu le faire remarquer (246), l’une des originalités du conflit entre le Nord et le Sud est que les acteurs ont rarement cessé de discuter entre eux au long de deux décennies d’affrontements. C’est en effet dès 1984-1985, que les premiers échanges entre belligérants ont eu lieu. On se rappelle aussi que Sadeq el-Mahdi, alors Premier ministre, préparait en 1989 une conférence constitutionnelle qui aborderait la question de la régionalisation et, partant, le statut du Sud, lorsqu’il fut renversé par Omar Al-Bachir, à quelques jours d’une rencontre avec John Garang.
Vingt ans de conflit reposant sur des questions de pouvoir, de ressources, de culture, de religion, d’idéologies, ne peuvent se régler sans une parfaite connaissance de ce qui se joue, d’autant qu’aux revendications initiales s’ajoutent celles dues à la guerre elle-même ; la question de l’esclavage est par exemple une de celles qui ont surgi du fait même du conflit ; celle du sort des déplacés et des réfugiés également, par la force des choses.
Cela étant, avant que les Etats-Unis n’entrent en scène avec un certain succès, nombre de médiateurs s’étaient offerts de résoudre le conflit soudanais qui, en fait, n’ont pas forcément contribué à l’apaisement des tensions. Selon certains analystes, ces tentatives de médiation ont sans doute « souvent plus contribué à accentuer les problèmes qu’à les résoudre » (247) et à les rendre aussi difficiles à régler. D’autant que « l’un des inconvénients de la plupart des tentatives de médiation est que leur objectif principal n’est pas la paix. » (248) Si ce jugement peut paraître sévère, il n’est san doute pas dénué de fondement.
a) Des médiations pas toujours désintéressées
Les « amis » du Soudan se sont en effet souvent rappelés à son bon souvenir. Dans cette impossibilité à résoudre un conflit civil sur une aussi longue période, de multiples intérêts se sont en effet confrontés, non seulement soudanais, mais aussi internationaux, chaque médiation apportant son agenda mâtiné d’arrières pensées. Il n’est pas inutile dans ces conditions, à l’heure où le futur du Soudan s’écrit sur la base de décisions prises il y a maintenant cinq ans, de revenir sur les aléas qui ont traversé ces périodes de négociations longues et difficiles : Comme vos rapporteurs l’ont indiqué, au long de son histoire, le Soudan n’a cessé de susciter la convoitise de ses voisins. Il aurait donc été surprenant que les négociations de paix ne soient l’occasion pour ceux-ci de se manifester : pour les uns de formuler telle exigence ; pour les autres de proposer tel schéma irréaliste ou inacceptable, sans autre but que de torpiller les avancées du processus, si tant est qu’il ait eu alors de réelles chances de succès. Des tentatives éparses et individuelles surgirent ainsi de temps à autre. Celle de l’Erythrée, par exemple, qui, à partir de 2000, quitta les pourparlers de l’IGAD dont elle est membre pour lancer sa propre initiative, laquelle fit cependant long feu devant les réticences du gouvernement de Khartoum.
Chronologiquement, c’est au début des années 1990 que le Nigeria entra pour la première fois sur la scène des médiations internationales en faveur du Soudan en réunissant les parties au conflit sur un accord de partage du pouvoir. En juin 1992, au terme du premier round de négociations tenu à Abuja, le Nord et le Sud s’accordaient simplement sur le fait qu’un règlement militaire du conflit était voué à l’échec, que le Soudan était un pays pluriel aux plans ethnique, culturel, religieux, linguistique et que les solutions institutionnelles à inventer se devaient de prendre en compte ces réalités. Khartoum rejetait encore l’autodétermination, ce que mettaient à profit les sudistes pour se retrouver et faire de nouveau front commun, encore que cette réconciliation ait connu par la suite des hauts et des bas. Une seconde session de négociations se tint à Abuja en 1993, sans plus de succès concret, sans que Khartoum ne lâche rien d’essentiel aux yeux des sudistes alors même que ceux-ci considérèrent faire de grandes concessions. Plus récemment, alors même que l’envoyé spécial américain John Danforth esquissait ses premières propositions, le président Obasanjo, chargé des médiations régionales dans le cadre du Plan pour le Millenium, tentait de son côté de réunir l’ensemble des fractions sudistes, militaires et non militaires, dont on a vu la violence des antagonismes, pour qu’une approche commune soit définie face à Khartoum, avant qu’une conférence de réconciliation nationale soit ultérieurement convoquée. Ce scénario tomba à l’eau par la maladresse des propres médiateurs nigérians qui braquèrent les deux parties par une précipitation à conclure qui ne convenait à personne. Néanmoins, le travail préparatoire contribua au rapprochement des positions de Riek Machar et de John Garang et à la réunification de leurs forces, d’autant que l’initiative d’Abuja prenait le conflit soudanais sous une approche Nord-Sud plus que nationale et se trouvait, de facto, plus en phase avec les positions de Khartoum.
Vos rapporteurs ont déjà souligné l’extrême intérêt que la Libye et l’Egypte portaient chacune au Soudan. A plusieurs reprises, dans le passé, elles avaient toutes deux montré leur appétit pour leur voisin du sud. Le conflit civil était bien sûr une occasion trop belle pour être délaissée. Surtout lorsque, dans les années 1990, les belligérants semblèrent trouver un terrain d’entente sur la question de l’autodétermination du Sud, grâce au parrainage nigérian. D’une certaine manière, cette question fut l’élément déclencheur de l’initiative diplomatique conjointe égypto-libyenne et de l’élaboration de leur plan en dix points (249), qui prenait l’exact contre-pied d’autres propositions : quand certains, les soudanais en premier lieu, avaient finalement acté le principe de l’autodétermination comme étant un élément essentiel du dialogue, l’Egypte et la Libye entrèrent en scène avec pour objectif essentiel de voir garantie l’unité du Soudan.
En affichant ainsi une solution conforme à leurs propres intérêts, les deux Etats, ipso facto, adoptaient une position partiale qui confortait très directement l’un des belligérants, Khartoum. Dans ces conditions, les sudistes ne pouvaient voir dans cette démarche autre chose qu’un moyen de saper de réelles tentatives de paix. On verra, avec le conflit du Darfour, que Le Caire et Tripoli ne sont décidément pas avares de telles approches qui exploitent les forces centrifuges soudanaises et la fragilité du voisin.
Cela étant, si l’initiative conjointe en dix points s’articulait notamment sur la préservation de l’unité du Soudan, elle reconnaissait simultanément la diversité du pays et la nécessité de sauvegarder le pluralisme démocratique. Le plan envisageait aussi un gouvernement décentralisé, et intérimaire. Par cette dernière suggestion, Le Caire s’aliénait l’écoute de Khartoum qui ne pouvait accepter de se voir remis en question, Al-Bachir étant tout au plus ouvert à l’élargissement de la base de son gouvernement, dans la seule mesure où d’autres forces politiques adhéreraient à son programme, dont la réalisation restait sa première préoccupation. Parallèlement, le SPLM/A signifiait clairement en août 2001 qu’il ne pourrait être partie prenante à un accord qui ne prendrait pas en compte la sécularisation de l’Etat, le droit à l’autodétermination, et une constitution transitoire avec un gouvernement intérimaire.
Tout comme l’initiative égypto-libyenne, celle de l’IGAD, indépendamment de la qualité de ses promoteurs, n’était pas non plus de nature à susciter l’adhésion immédiate des belligérants notamment parce qu’elle était conduite par quatre pays dont l’Ouganda, l’Ethiopie et l’Erythrée, qui chacun en leur temps avaient appuyé le SPLM/A dans son combat contre Khartoum, voire avaient positionné leurs forces armées sur le territoire soudanais. L’Ethiopie a été un soutien constant du SPLA sous le régime de Mengistu alors que Khartoum appuyait au même moment la rébellion érythréenne, cependant qu’au Sud Soudan, le président Museveni, proche de John Garang, faisait face à la LRA appuyée par le gouvernement soudanais.
L'IGAD est néanmoins à l’origine de la plus ancienne des initiatives de paix au Soudan : lancée en 1993, sa Déclaration de Principes, approuvée en 1994, s’articulait en sept points principaux et envisageait un accord de paix notamment structuré autour des questions d’un Soudan démocratique et séculaire et du partage des ressources. En seconde option, si l’objectif prioritaire de l’unité du Soudan ne pouvait être atteint, une période intérimaire suivie d’un référendum d’autodétermination du Sud Soudan était proposée.
Khartoum abandonna même la table des négociations durant trois ans avant d’accepter en 1997, pour des raisons essentiellement tactiques et parce qu’il devenait prudent pour le gouvernement d’envisager alors une solution négociée, la Déclaration de Principes comme base de négociations avec les sudistes après de lourds revers militaires. C’est néanmoins cette base qui, pression internationale accrue aidant, constituera peu ou prou l’essentiel de l’ossature du Comprehensive Peace Agreement qui sera ultérieurement signé.
b) Les premiers pas du sénateur Danforth
Clerc anglican, sénateur républicain du Missouri de 1977 à 1995, John Danforth a été nommé le 6 septembre 2001 par le président George W. Bush représentant spécial des Etats-Unis pour la paix au Soudan. Il représentera ultérieurement les Etats-Unis comme ambassadeur auprès des Nations Unies. Sa mission était en premier lieu d’étudier dans quelle mesure les belligérants soudanais, gouvernement de Khartoum et SPLM/A, étaient prêts, après vingt ans de guerre ininterrompue, à s’engager dans de véritables négociations de paix, que les Etats-Unis pourraient alors décider de parrainer et de superviser.
Au terme de sa mission exploratoire, le sénateur Danforth articulera ses propositions en quatre axes, présentés comme autant de tests destinés à confirmer les bonnes intentions des parties : cessation des bombardements, des tirs d’artillerie et des raids aériens contre les populations et les objectifs civils ; cessez-le-feu dans les Monts Nouba, supervisé par une équipe d’observateurs internationaux ; création de zones de sécurité permettant à des agences médicales humanitaires de mener des campagnes de vaccinations ; ouverture d’une commission d’enquête internationale sur la réalité de l’esclavage.
A cet égard, les mouvements et lobbies religieux conservateurs américains ont joué un rôle certain dans la prise de conscience de l’administration américaine sur l’aspect humanitaire de la crise. Depuis longtemps, les ONG, - Amnesty International, Human Rights Watch -, et les Nations Unies, rapporteurs spéciaux pour les Droits de l’homme, Institut de recherche pour le développement social -, avaient amplement documenté les pratiques d’esclavage au Soudan. Les uns comme les autres avaient notamment mis en évidence le fait que les raids contemporains étaient indissociables de la stratégie de Khartoum de dépeuplement des régions qui l’intéressaient : les centaines de milliers de déplacés du Bahr al-Ghazal, notamment les dizaines de milliers de personnes, - femmes et enfants, essentiellement -, réduites à l’esclavage (250), étaient les victimes directes de la stratégie militaire de Khartoum d’appropriation des ressources pétrolières du Sud, mise en œuvre par ses propres forces armées et les milices à sa solde.
Le surgissement en 2001 de la question du terrorisme international a permis aux Etats-Unis d’entrer en scène en pouvant jouer sur plusieurs tableaux complémentaires, en articulant préoccupations humanitaires, géopolitiques – la guerre civile soudanaise pouvant entraîner une déstabilisation de la région –, et lutte contre le terrorisme : le Soudan pouvait donc difficilement continuer à échapper à l’attention de la diplomatie américaine. Les axes définis par la mission Danforth répondaient par conséquent autant à des considérations internes aux Etats-Unis – satisfaire les lobbies et répondre à leur forte pression politique – qu’à de réelles préoccupations des acteurs soudanais (251). Cet aspect de la question devait être rappelé par vos rapporteurs car ce qui se jouera ultérieurement en ce qui concerne le Darfour n’en est pas éloigné et a influencé fortement l’analyse de la crise et la recherche de solutions pérennes. D’une certaine manière, les peuples du Darfour, le Soudan et la région en pâtissent sans doute encore aujourd’hui.
Cela étant, vos rapporteurs ne reviendront pas ici sur le bénéfice immédiat qu’ont retiré les populations des Monts Nouba des initiatives du sénateur Danforth, dans la mesure où le cessez-le-feu interviendra effectivement très vite, comme preuve de la bonne volonté du gouvernement de Khartoum. D’autres aspects ont en revanche été moins immédiatement positifs, telle la question de l’interruption des bombardements, à laquelle Khartoum s’est refusé, tandis que de son côté le SPLA s’y conformait (252).
De sorte que si l’initiative américaine a incontestablement marqué un réel pas en avant dans la recherche de la paix, force est néanmoins de constater que le chemin qui a conduit à la signature du Comprehensive Peace Agreement n’a pas été simple. L’entrée des Etats-Unis dans le processus de l'IGAD ne fut pas dans les premiers temps couronnée de succès ; c’est l’arrivée de John Danforth, qui coïncida avec l’allègement de la pression américaine sur le Soudan résultant de la volonté de coopération de ce dernier dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Pour autant, les Etats-Unis adoptèrent dans les premiers temps un « profil bas », refusant le rôle de médiateur, proposant un agenda exploratoire, minimaliste, tendant surtout à essayer de rétablir la confiance entre les parties et mettre en œuvre une stratégie d’avancées à petits pas, tel le cessez-le-feu dans les Monts Nouba.
3) Le « Comprehensive Peace Agreement »
Au début des négociations, les positions des belligérants pouvaient difficilement être plus antagonistes (253) : sharî’a d’un côté contre sécularisation de l’Etat ; volonté de John Garang d’une présidence tournante entre lui et Al-Bachir ; répartition des postes ministériels et administratifs ; élections ou nominations par Khartoum des gouvernements régionaux dans les provinces du Sud ; statut des Monts Nouba et de la région d’Abyei ; et, last but not least, répartition des richesses pétrolières, cause directe du conflit depuis 1983.
Leurs revendications respectives rendaient donc les positions des nordistes et des sudistes peu compatibles et malgré le fait que les premières négociations aient été engagées depuis une dizaine d’années, la volonté d’aboutir et de conclure un accord n’existait pas, ni d’un côté, ni de l’autre. A cela s’ajoutait le fait que les deux principales options proposées par les médiations internationales, celle de l’IGAD et le plan égypto-libyen, étaient elles aussi en profonde contradiction.
En l’espèce, les Etats-Unis présentaient l’avantage d’être à la fois en phase de resserrement de leurs liens avec le gouvernement soudanais tout en étant proches du SPLM/A. Khartoum exprima donc le souhait que l’administration américaine s’implique plus dans le processus de paix, en espérant qu’elle réussirait à faire pression sur John Garang (254).
La synthèse entre l’approche de l’IGAD et celle de l’Egypte et de la Libye, bien que difficile à réaliser, apparaissait comme la solution capable de concilier les positions des deux belligérants : Khartoum refusait la Déclaration de principes de l’IGAD et John Garang de s’engager dans une négociation qui ne prévoirait pas le droit à l’autodétermination du Sud Soudan (255). Mais dans le même temps, moins de six mois avant la signature de Machakos, l’Egypte se refusait toujours à accepter la fusion des deux propositions comme hypothèse de négociations, s’opposant à la question de l’autodétermination (256).
Sans vouloir trop entrer dans le détail de cette négociation qui s’étend sur une période longue de plusieurs années, vos rapporteurs souhaitent se concentrer sur les quelques mois qui ont conduit à la signature du Protocole de Machakos, essentiel, non seulement en ce qu’il constitue le premier accord intervenu entre les belligérants depuis 1989, mais aussi parce qu’il pose le cadre des accords de paix futurs, qui seront adoptés en 2005. Ils veulent souligner que cette conjonction d’intérêts entre le gouvernement soudanais et John Garang sur l’utilité d’une médiation américaine à ce moment-là a permis à la négociation de s’ouvrir et de déboucher sur ce premier texte, pierre angulaire sur laquelle reposera ensuite la discussion et la signature de plusieurs autres qui, ensemble, constitueront le Comprehensive Peace Agreement.
a) La phase finale des négociations de Machakos
C’est à la forte implication des Etats-Unis que l’on doit finalement la signature du protocole de Machakos le 20 juillet 2002 (257), par Ghazi Salahuddin Atabani, au nom du gouvernement du Soudan, et Salva Kiir Mayardit, pour le SPLM/A, sous le parrainage international de l’IGAD. Cinq autres accords suivront, que l’on détaillera plus loin, signés entre septembre 2003 et mai 2004. Enfin, le 9 janvier 2005, était signé le CPA proprement dit, qui plaçait les précédents protocoles sous un « chapeau » et donnait le parrainage international le plus large au processus qui se concluait alors. Kenya, Ouganda, Egypte, Italie, Pays-Bas, Royaume uni, Norvège, Etats-Unis, Union africaine, Union européenne, IGAD, Ligue arabe et Nations Unies joignaient leurs signatures à celle d’Ali Osman Mohamed Taha, premier vice-président de la république du Soudan, et de John Garang de Mabior, président du SPLM/A. Celle de la France était en revanche absente.
En effet, la France, par sa proximité avec le gouvernement du Soudan, au cours des années 1990 notamment, s’était coupée de toute relation avec le SPLM. Alors même qu’elle souhaitait instamment apporter son soutien au processus de paix, elle ne put le moment venu se faire admettre à la table des négociations. Mis à part l’Italie, occupant alors la présidence de l'IGAD, le processus resta d’autant plus concentré entre les mains des Etats-Unis, du Royaume Uni et de la Norvège que, d’une part, John Garang manifesta son opposition ferme à ce que la France soit partie prenante et que, d’autre part, les grandes puissances ne firent rien pour infléchir la position du leader sudiste (258).
Ces négociations ont été menées difficilement, compte tenu des enjeux et de l’antagonisme des positions, mais John Danforth, à l’instar du cessez-le-feu qu’il avait réussi à obtenir dans les Monts Nouba, pût les mener à bien, sous l’égide de l’IGAD, en centrant les discussions sur la reconnaissance de l’autonomie et le partage des richesses pour le développement du Sud Soudan.
Il est important de noter que ces négociations ont aussi coïncidé avec certains changements ou évolutions majeurs, d’ordre politique, militaire et diplomatique, qui n’ont sans doute pas été sans influence sur la fin du processus et, peut-être, ont pu l’accélérer.
En premier lieu, figure la réconciliation des sudistes, profondément divisés depuis plusieurs années : les rivalités touchant à la stratégie à adopter par rapport au Nord et au futur statut du Sud Soudan ne se sont terminées qu’en janvier 2002 avec la réintégration des troupes du SPDF de Riek Machar dans le SPLA de John Garang, quelques mois, par conséquent, avant la fin des discussions de Machakos (259). Grâce à cet accord politique, la stratégie de John Garang envers un « nouveau Soudan », reprenait l’avantage parmi les forces sudistes réunies. Ceux qui l’avaient combattue, partisans d’une stratégie privilégiant les besoins de développement propres du Sud Soudan, la défendaient de nouveau.
Cette réconciliation se traduisit aussi par un regain de la violence militaire durant quelques mois : aux attaques des sudistes coalisés, concentrées sur des objectifs pétroliers, le Nord répliqua par de nouvelles vagues d’atrocités et de terreur contre les populations civiles pour tenter de casser la nouvelle union en réactivant les dissensions ethniques. Cette période, qui précédait donc immédiatement la signature du protocole de Machakos, fut à ce point terrible sur le terrain, que pour la première fois, les compagnies pétrolières Lundin, OMV et surtout Petronas suspendirent leurs activités et que la CNPC retira un temps son personnel chinois (260).
Dans le même temps, une forme d’évolution du discours politique se produisait au sein de certaines franges de la mouvance islamiste. On a vu que Hassan Al-Tourabi en disgrâce tentait de fomenter une rébellion au Darfour ; en parallèle, anticipant la résolution du conflit Nord-Sud, il révisait son discours, se posant désormais comme le chantre des luttes de libération, assimilant celles des sudistes à celles de l’ANC en Afrique du Sud, cherchant à rassurer le SPLA et à se positionner en seule autorité apte à user de son influence pour régler la question religieuse (261)… Le parti Umma n’était pas en reste qui se positionnait pour sa part sur une thématique de développement démocratique.
Enfin, au plan régional, cette période est aussi marquée par le rapprochement de Khartoum avec certaines capitales : un accord est signé avec Kampala concernant la manière de contrer les attaques de la LRA, qui permet des opérations militaires transfrontalières et un droit de suite en territoire voisin ; alors même que l’industrie pétrolière est balbutiante, des accords pétroliers sont signés entre le gouvernement soudanais et ceux de l’Ethiopie et du Kenya, intéressés tous deux par une relation bilatérale avec Khartoum sur cette question.
En d’autres termes, si progrès des négociations il y a alors, c’est avant tout parce que Khartoum y trouve son compte et joue de toutes les circonstances et profite de toutes les opportunités en cette phase de la guerre : ainsi, depuis janvier 2002, l’acceptation du cessez-le-feu dans les Monts Nouba, opportunément, permet à Khartoum par exemple de pouvoir redéployer des forces militaires, des Antonov de bombardements et autres hélicoptères de combat, pour mieux pilonner les villages du Sud, ce qui provoquera dès février, la suspension des pourparlers par Washington ; le rapprochement avec les Etats-Unis répond à des considérations économiques et financières et à la nécessité de dénouer les lacets de l’étranglement de la dette en tirant profit des recettes pétrolières ; les accords pétroliers avec les voisins laissent augurer des retombées supplémentaires ; etc.
Pour autant, force est de constater que certaines ambiguïtés ressortent du texte signé au mois de juillet suivant, qui n’ont pas été levées avec la signature des protocoles ultérieurs, ne le sont toujours pas près de dix ans plus tard et hypothèquent considérablement, de l’avis de vos rapporteurs, les chances d’une paix réelle et durable entre le Nord et le Sud. Cette remarque appelle toutefois un bémol : un autre accord était-il possible et envisageable, compte tenu des antagonismes initiaux et, par conséquent, pouvait-on faire mieux avec ces partenaires là ?
b) Les dispositions du Protocole de Machakos
Le Protocole de Machakos est à lui seul un document clef dans la mesure où il pose les bases d’un accord de principes fondamentaux entre Khartoum et le Sud sur l’ensemble des points de conflit. Sont ainsi successivement affirmés :
- le fait que l’unité du Soudan, basée sur la libre volonté de son peuple, sur la gouvernance démocratique, la responsabilité, l’égalité, le respect et la justice pour tous les citoyens du Soudan « est et sera la priorité des parties » et qu’il sera possible de traiter les doléances des peuples du Sud Soudan et de répondre à leurs aspirations dans un tel cadre ;
- que les peuples du Sud Soudan ont le droit de gouverner et de contrôler les affaires de leur région et de participer équitablement au gouvernement national ;
- que les populations du Sud Soudan ont le droit à l’autodétermination, moyennant un référendum pour déterminer leur futur statut ;
- que la religion, les coutumes et traditions sont une source de renforcement moral et d’inspiration pour le peuple soudanais ;
- que les peuples du Soudan partagent un héritage et des aspirations communs et sont disposés à travailler ensemble pour :
• établir un système démocratique de gouvernance qui prenne en compte la diversité culturelle, ethnique, raciale, religieuse et linguistique des peuples du Soudan ainsi que l'égalité de genre ;
• trouver une solution globale, qui traite de la détérioration économique et sociale et ne substitue pas seulement la paix à la guerre, mais aussi la justice sociale, politique et économique dans le respect de droits politiques et fondamentaux de tout le peuple soudanais ;
• négocier et appliquer un cessez-le-feu global pour mettre fin aux souffrances des populations ;
• établir des plans pour le rapatriement, la réhabilitation, la reconstruction et le développement, pour traiter les besoins des zones affectées par le conflit et redresser les déséquilibres du développement et de l’allocation des ressources ;
• rédiger et appliquer l’accord de paix qui fasse de l’unité du Soudan une option attractive spécialement pour les peuples du Sud Soudan.
En d’autres termes, ce premier protocole est le cadre général, la véritable pierre angulaire du dispositif global, celle sur laquelle tout repose. Sans prétendre réduire leur importance, dans la mesure où fréquemment les détails figurant dans ce type d’accords sont essentiels au succès sur la longue durée du processus, on peut néanmoins souligner que les fondements de la paix sont définis dès juillet 2002. Les principes cardinaux figurent tous dans cet accord et les suivants en sont les déclinaisons pratiques, point par point.
Le Protocole de Machakos prévoyait également une période pré-intérimaire de six mois au cours de laquelle seraient établis un cessez-le-feu, les mécanismes d’application de l’accord de paix, et les institutions provisoires du pays. Au-delà, une période intérimaire de six ans, sous supervision internationale des membres de l’IGAD, ainsi que des Etats-Unis, de la Norvège, de l’Italie et du Royaume Uni, était prévue pour la préparation de la mise en place définitive des conditions de la paix. Au terme de cet intérim, un référendum serait organisé « pour le peuple du Sud Soudan », conjointement par le gouvernement national et le SPLM/A, sous supervision internationale, pour « confirmer l’unité du Soudan en votant pour adopter le système de gouvernement établi dans l’accord de paix ou voter pour la sécession ». (262)
Diverses questions institutionnelles étaient également traitées dans le Protocole, quant à la rédaction d’une Constitution nationale, qui devrait notamment garantir la liberté de croyance et de pratique religieuse pour tous les citoyens soudanais, et quant au gouvernement national, dont l’action devrait prendre en compte la diversité culturelle et religieuse des peuples du pays. De manière précise, le texte posait que seules les lois nationales ne concernant pas le Sud Soudan pourraient avoir la sharî’a comme principe. Un gouvernement du Sud Soudan, GoSS, était institué par l'accord, logiquement conduit par le SPLM.
La question de l’Etat et de la religion faisait l’objet d’un accord particulier au sein du protocole de Machakos, tout comme celle du droit à l’autodétermination des peuples du Sud Soudan. En ce qui concerne le premier point, dont on a vu l’importance, eu égard à la constante volonté d’islamisation du Soudan mise en œuvre par Khartoum depuis l’indépendance, le Protocole reconnaissait ainsi que le Soudan était un pays « multiculturel, multiracial, multiethnique, multi religieux et multi linguiste », dans lequel la religion ne devait pas être utilisée comme un facteur de division, et explicitait les droits et libertés que le texte de la constitution aurait à garantir.
c) Les protocoles additionnels : les détails du CPA
Comme son nom l’indique, le Comprehensive Peace Agreement, CPA, a eu pour ambition de traiter l’ensemble des problèmes du Soudan et pas seulement de régler le différend entre le Nord et le Sud. Vos rapporteurs ont par exemple indiqué que le conflit des Monts Nouba avait également trouvé sa solution dans cet accord : le texte signé en janvier 2002 à Bürgenstock, dû à l’initiative de John Danforth, n’était qu’un cessez-le-feu semestriel, renouvelable et la résolution finale du conflit est l’un des aspects abordés par le CPA. D’autres, tel le différend sur la région d’Abyei, quant à son appartenance au Nord ou au Sud Soudan, point déterminant en ce qui concerne les retombées financières de l’exploitation pétrolière sur lequel vos rapporteurs auront à revenir, a également été traité dans le CPA.
Long de quelque 260 pages, le CPA est par conséquent un document, qui clôt une longue série de négociations entamées à Machakos, en mai 2002, et poursuivies depuis lors de manière quasi ininterrompue. Mis à part le « Protocole de Machakos », signé le 20 juillet 2002, qui se trouve inclus dans le CPA dont il constitue le premier chapitre, l’accord agrège les divers autres protocoles conclus lors de cette période. Il se décompose finalement en quatre parties portant sur le partage du pouvoir (chapitre 2), le partage des richesses (chapitre 3), la résolution du conflit d’Abyei (chapitre 4) et celle du conflit des deux Etats du Sud Kordofan et du Blue Nile, autrement dit, le conflit des Monts Nouba.
Ce texte est d’une importance capitale. L’avenir du Soudan en dépend, sans doute bien plus que de la résolution du conflit du Darfour. Au-delà, l’avenir de la région est également suspendu à ce qui se jouera dans les prochains mois en application des dispositions du CPA, car les voisins du Soudan, qui ont eu une telle attention pour les belligérants, qu’ils les aient soutenus ou combattus, avec leurs propres arrières pensées, ne peuvent évidemment rester indifférents aux développements futurs de la situation.
Cela étant, on ne règle pas vingt ans de conflit ininterrompu aux causes complexes, multiples et imbriquées, sans que des efforts et des concessions considérables soient faits de part et d’autres. Ainsi que vos rapporteurs l’ont souligné, les défis à surmonter étaient d’une ampleur impressionnante : ce sont des enjeux non seulement politiques ou territoriaux, mais aussi économiques, financiers, culturels et religieux, qui s’étaient accumulés pour rendre cette guerre civile insoluble.
En premier lieu, un premier accord portant sur la question de la sécurité était intervenu le 25 septembre 2003, aux termes duquel les troupes nordistes se retiraient du Sud et celles du SPLA du Nord. Des unités mixtes, avec commandement mixtes, étaient prévues, composées à parité de soldats des deux armées pour assurer la paix dans les régions du Sud. Vos rapporteurs auront le loisir de revenir sur ces thèmes.
En ce qui concerne le partage du pouvoir, le protocole correspondant a été signé à Navaisha le 26 mai 2004. Il débute par la présentation des principes d’administration décentralisée et de coordination gouvernementale que les deux parties s’engagent à respecter au cours de leur cohabitation durant la période intérimaire de six années. Une déclaration des droits y est jointe. Sur un plan strictement institutionnel, l’accord de partage du pouvoir prévoit le schéma classique d’un Etat fédéral, avec un parlement national bicaméral dans lequel la seconde chambre représente les Etats. Dans la mesure où le système qui s’instaure est transitoire, la répartition des sièges au sein de l’Assemblée nationale est expressément prévue : le Parti du Congrès national (PCN) est majoritaire, avec 52 % des sièges ; le SPLM en détient 28 % ; les « autres forces politiques du Nord » 14 % et les « autres forces politiques du Sud » 6 %. En d’autres termes, ces précisions traduisent le fait que l’exercice du pouvoir national au long de cette période intérimaire reste concentré aux mains de Khartoum. Le pouvoir militaro-islamiste issu du coup d’Etat de juin 1989 est donc assuré de conserver le pouvoir au Soudan. Cet accord est par ailleurs global et ne concerne pas uniquement les deux belligérants principaux que sont Khartoum et le SPLM.
L’accord prévoit également la composition du gouvernement d’unité nationale, GUN, et du gouvernement du Sud Soudan, GoSS, et la répartition de leurs pouvoirs. Le général Al-Bachir reste président de la république et chef d’Etat major de l’armée du Soudan, tandis que John Garang devient président du GoSS, 1er vice-président du Soudan et chef d’Etat major du SPLA. La répartition des sièges, tant au sein des exécutifs que des législatifs, au niveau national comme au niveau du Sud Soudan, est précisément détaillée, et, sans surprise, le PCN domine le Nord, tout en étant présent au Sud, dominé par le SPLM, et vice-versa. Les différentes institutions étatiques font également l’objet de développement précis.
Un troisième protocole, signé le 7 janvier 2004, traite de la question du partage des richesses et pose en premier lieu les principes devant guider la propriété de la terre et la gestion équitable des ressources communes naturelles, le pétrole faisant l’objet de précisions très détaillées. A cet égard, l’accord pose comme principe que le partage des ressources pétrolières du Sud Soudan doit se faire dans un cadre équilibré entre les besoins de développement national et la reconstruction du Sud Soudan. De telle manière qu’un mécanisme de péréquation est instauré, qui attribue au moins 2 % de revenus aux Etats et régions productrices, à due proportion de leur part dans la production. Au-delà, 50 % des revenus nets tirés du pétrole seront attribués au GoSS, d’une part et 50 % au GUN et aux Etats du Nord Soudan, d’autre part (263). En complément, en ce qui concerne les revenus publics, taxes et autres, collectés au niveau national, un mécanisme équitable d’allocation est prévu entre les différents niveaux de gouvernement.
On fera remarquer que le partage équilibré des richesses portait sur celles du Sud Soudan, mais que l’éventualité de gisements futurs, au Sud Darfour ou au Sud Kordofan, par exemple, n’était pas prise en compte, non plus que la question du partage des eaux, alors même qu’elle avait eu une part importante, via le percement du canal de Jonglei, dans la réactivation du conflit en 1983, qui n’est en aucune manière abordée (264).
La résolution du conflit d’Abyei fait pour sa part l’objet d’un protocole signé le 26 mai 2004, à Naivasha. Abyei, « un pont entre le Nord et le Sud, qui lie les peuples du Soudan » (265), est une zone d’intérêt crucial tant pour le Nord que le Sud, non pour la seule raison que rappelle ce considérant, mais principalement car il s’agit d’un secteur particulièrement riche en ressources pétrolières. Situé à la charnière du Nord et du Sud, Abyei est l’objet de toutes les convoitises, et son rattachement à l’une ou l’autre partie change considérablement la donne de la répartition des recettes. Telle qu’elle est prévue, elle se fait non pas à parts égales entre le Nord et le Sud comme dans le cas des ressources tirées des puits se situant au Sud, mais à 50 % au profit du GUN, 42 % des ressources étant affectées au GoSS et les 8 % restants, à parts égales entre, d’une part, les régions de Bahr el Ghazal, du Western Kordofan et d’autre part, localement, les populations Dinka Nok et Misseriya. Un référendum est prévu, devant se tenir simultanément à celui concernant le Sud Soudan, pour que les habitants de cette région se déterminent en faveur de leur rattachement à l’Etat du Bahr el Ghazal ou à leur maintien au Nord sous statut administratif spécial.
Dans cet ordre d’idées, la délimitation géographique de la zone d’Abyei est un des points évidemment essentiel, qui a été parmi les plus discutés, compte tenu de son importance et de l’ancienneté des solutions qui y avaient été apportées, et la question fait l’objet d’un chapitre spécial du protocole. Une Commission des Frontières d’Abyei, ABC (266), devait définir et tracer la démarcation des neuf chefferies Dinka Ngok, qui constituent la zone proprement dite d’Abyei, transférées au Kordofan en 1905. La Commission devait rendre ses conclusions dans les deux premières années de la période transitoire ; ce n’est en fait que très récemment – vos rapporteurs auront à y revenir – que le différend a finalement été tranché par la Commission permanente d’arbitrage de La Haye.
Le conflit des Monts Nouba, a enfin fait l’objet d’un protocole particulier, également signé le 26 mai 2004, comme vos rapporteurs ont eu l’occasion de le présenter.
Ce qui a été décidé dans le cadre de ces protocoles et finalisé en janvier 2005 au Kenya, à Naivasha, est potentiellement explosif. Sans faire preuve d’un pessimisme exagéré, que l’autodétermination du Sud Soudan soit votée ou rejetée à l’issue du référendum prévu pour 2011, pour que le futur du Soudan soit harmonieux et pacifique, il faudra que les ex-belligérants fassent preuve d’une sagesse encore inédite. Or, à ce jour, ni les uns ni les autres n’ont encore apporté la moindre preuve qu’ils étaient capables de vivre en paix et de partager les ressources de leur sol encore commun, ni montré de réelles dispositions à tenter de le faire.
4) Le Comprehensive Peace Agreement est-il viable ?
L’ampleur de la tâche qui attend les parties au lendemain de la signature du CPA laisse perplexe et appelle à la réflexion pour en évaluer les chances de succès et, si faire se peut, garder présent à l’esprit quelques aspects essentiels.
a) Les motivations de Khartoum
Monopolisation du pouvoir, accaparement des richesses, marginalisation des périphéries, islamisation de l’ensemble du pays, ont été, comme on le sait, des constantes de la politique menée par les gouvernements soudanais successifs, dont ils ont toujours refusé de s’écarter depuis l’indépendance. En d’autres termes, est-il exagéré de considérer que le CPA revient très concrètement pour Khartoum à renoncer à tout ce pour quoi il s’est battu, depuis l’origine, avec la plus extrême détermination ?
Inversement, ce sont pour ces mêmes raisons qu’ont eu lieu l’ensemble des conflits soudanais, et que se sont battues avec la même détermination toutes les régions marginalisées du Soudan, le Sud en premier lieu. Peut-on douter, dans ces conditions, que les rebelles n’hésiteraient pas à reprendre les armes si les promesses de l’accord n’étaient pas tenues, s’ils se voyaient par exemple spoliés de nouveau et privés du bénéfice des ressources de leur sol ? Même en tenant compte de la lassitude et des souffrances d’un peuple qui a supporté vingt années de guerre effroyable, il est peu probable qu’ils renonceraient à leurs combats de toujours.
On le voit, les chances de succès à long terme de cet accord passent nécessairement par une pression internationale de tous les instants, non seulement durant la période intérimaire, mais au-delà. Pour ne prendre que ce seul exemple, l’importance prise par les revenus de l’extraction pétrolière ces toutes dernières années a, comme on l’a vu, bouleversé l’architecture de l’économie soudanaise. Comment Khartoum pourrait-il envisager d’y renoncer à la suite de l’éventuelle sécession du Sud Soudan ? Il suffit de se souvenir que la première paix entre le Nord et le Sud avait été difficile (267), alors même qu’à l’époque les perspectives pétrolières étaient encore lointaines. On sait comment elle s’est achevée au moment précis où s’aiguisaient les intérêts de Khartoum, pour douter aujourd’hui de la réaction du gouvernement soudanais.
Cette impression est confortée par le fait que les parties prenantes à la négociation de Naivasha, dans la ligne de leurs positions respectives depuis le milieu des années 1990, n’étaient pas véritablement enthousiastes ni même disposées à la signature de l’accord dont le mérite essentiel revient à la pression des Etats-Unis. Plus précisément, si l’on se concentre sur le protocole de Machakos, accord-cadre sur lequel le schéma de Naivasha s’est articulé, force est de constater que le chemin conduisant à la signature a été des plus ardus. Comme on l’a rappelé, les Etats-Unis avaient même suspendu la discussion en février. Il est par conséquent opportun de s’interroger sur les raisons qui ont conduit les belligérants, Khartoum au premier chef, à signer pour des engagements qui représentent des concessions d’une telle ampleur.
Il n’est pas indifférent de noter à ce sujet que, à Machakos, en 2002, les observateurs ont été surpris par la rapidité avec laquelle le gouvernement soudanais avait finalement accepté les concessions qu’on lui demandait, en ce qui concerne le partage des ressources, d’une part mais surtout l’autodétermination qu’il avait alors toujours refusée : ses représentants n’avaient cessé de répéter la position classique du gouvernement, en privé comme en public, qu’un texte qui remettrait en question l’unité du pays ne serait jamais accepté. De telle sorte que John Danforth s’était rapproché de la position égypto-libyenne et s’attachait à tempérer les ardeurs des sudistes pour les amener à réviser leurs exigences (268).
La connaissance des motivations du gouvernement soudanais, qui l’ont conduit à accepter des exigences auxquelles il s’était toujours refusé est donc essentielle pour analyser les chances de succès de la paix au Soudan. Vos rapporteurs sur ce point y voient une fois de plus la preuve du pragmatisme du gouvernement soudanais et situent le revirement de sa position dans la lignée de son rapprochement politique et tactique avec les Etats-Unis, dans la stratégie de sortie d’isolement qu’il a mis en œuvre dans les mois précédant la négociation de Machakos.
Le vice président Mohamed Taha aura ainsi l’occasion d’avancer comme raison de ce virage soudain l’intérêt américain pour le pétrole soudanais qui imposait une situation pacifiée, et le fait que sans que cette paix serait impossible tant que la question du droit à l’autodétermination ne serait pas prise en compte (269). En d’autres termes, l’analyse pragmatique par le gouvernement de la meilleure manière de maintenir ses intérêts l’a conduit à renoncer à ce à quoi il tenait le plus. Dans le même ordre d’idées, on rappellera la nécessité pour Khartoum de pouvoir accéder à l’aide des institutions financières internationales pour alléger la dette qui l’étrangle. Sur un plan plus politique, on a pu aussi interpréter le ralliement du gouvernement de Khartoum à l’autodétermination du Sud comme la manière de réduire à sa plus stricte dimension le conflit Nord-Sud pour pouvoir continuer la stratégie de division pour mieux régner vis-à-vis des autres régions périphériques. En effet, tout en se présentant comme accord global, – « comprehensive » –, le CPA privilégie très fortement la relation entre le SPLM et le gouvernement. De sorte que, tant l’alliance politique des sudistes avec les partis d’opposition du Nord au sein de l'Alliance démocratique nationale, NDA, peu considérés par John Garang dans ce processus, que celle, surtout, entre le Sud Soudan et les autres régions marginalisées, peuvent se trouver considérablement affaiblies dans l’intérêt du parti au pouvoir et du régime. On sait que c’est même leur exclusion de la table des négociations et le fait que leurs revendications ne soient une nouvelle fois pas prises en compte qui a incité les Darfouri à prendre les armes pour se faire enfin entendre dès février 2003, au moment où les choses se précisaient à Naivasha entre Nord et Sud.
En d’autres termes, les conditions qui ont amené le gouvernement de Khartoum à signer ces accords incitent pour le moins à la prudence.
b) La fragilité du CPA : le germe de la partition
Cette analyse sans doute pessimiste semble en tout cas corroborée par le fait que, une fois de plus, comme on le verra d’ailleurs de nouveau s’agissant du Darfour, l’encre à peine sèche du protocole de Machakos n’empêchait pas les signataires de reprendre les armes dès le mois d’août 2002, des tendances et intérêts centrifuges existant tant au sein du SPLM/A que du gouvernement, soit en faveur de la paix, soit en faveur de la guerre.
Avant même que ne surgisse en 2003 le conflit du Darfour pour compliquer la situation et noircir les perspectives, le chemin de négociations était décidément semé d’embûches, à la hauteur des enjeux qui venaient d’être fixés, ou des exigences fondamentalement inacceptables pour les uns, auxquelles les autres ne pouvaient renoncer. Par conséquent, la paix s’annonçait des plus fragiles.
Le CPA ne consacre certes pas de longs développements à la question de l’autodétermination non plus qu’à ses conséquences. Il se contente d’indiquer que les populations concernées auront à se déterminer le moment venu, entre le maintien d’un Soudan uni, fonctionnant selon les règles établies dans le CPA et la sécession du Sud. L’unité du Soudan est non seulement considérée comme une solution viable mais aussi souhaitable : comme on l’a vu dès Machakos, elle « est et sera la priorité des parties », et elle constitue un cadre d’avenir qui permettra de prendre en compte et de répondre à l’ensemble des aspirations des populations sudistes.
Dans cette logique, le droit à l’autodétermination par référendum pouvait effectivement être affirmé en parallèle, en manière d’option. Dans le prolongement de revendications qui n’avaient cessé de se conforter au fil des ans, à mesure que le Nord se refusait de manière continue à toute concession, il n’aurait pu y avoir d’accord sans qu’il apparût. En ce sens, on note aussi que la formulation retenue répond habilement aux exigences de tous les sudistes : celles de John Garang, plus en faveur d’un Soudan uni et démocratique ; celles de la dissidence de son mouvement, Lam Akol, Riek Machar et autres, qui s’étaient opposés à lui sur ce thème, en faveur de la solution de l’autodétermination.
En d’autres termes, le défi impossible que se donnent les parties, est de rendre cette « unité attractive » pour les populations du Sud Soudan. Malgré l’histoire commune, les contentieux multiples et des décennies de guerre ; malgré le fait que le Sud Soudan manquerait de ressources et de cadres pour occuper la place que lui réservait le CPA, notamment dans l’administration centrale. Par conséquent, entre autres aspects, « peut-on penser que le régime de Khartoum procédera, dans la transparence nécessaire, au transfert de sa part des revenus pétroliers ? » (270), alors qu’il n’a cessé de se battre pour les accaparer.
De fait, aujourd’hui, à un peu moins d’un an de l’échéance fixée pour l’organisation du référendum d’autodétermination, force est de constater que l’attractivité de l’unité n’a pas encore été démontrée. Tout indique au contraire que la sécession sera proclamée, si tant est que le référendum puisse être organisé, hypothèse ouvrant la voie aux craintes les plus vives. Mais tout se passe comme si, entre-temps, Khartoum avait campé sur ses positions, incapable de sortir de sa logique prédatrice, constance de sa politique vis-à-vis des périphéries du pays. Ce, alors même que le scénario de l’indépendance du Sud représente le pire cauchemar pour le Nord, pour lequel le territoire de la patrie est d’ordre sacré, malgré tout (271).
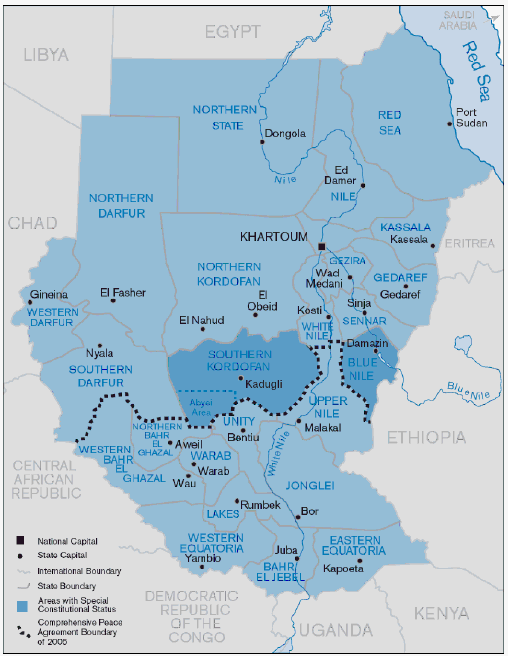
Nord et Sud Soudan aux termes du Comprehensive Peace Agreement (272)
B – La longue léthargie des Nations Unies
Au risque de paraître sévères, vos rapporteurs considèrent que, longtemps, les Nations Unies ne se sont pas véritablement intéressées au Soudan. Il est singulier en effet qu’à aucun moment, elles n’interviennent à quelque titre que ce soit dans la résolution d’un des conflits les plus terribles que le monde ait connus.
En fait, l’intérêt que les Nations Unies ont manifesté au Soudan, essentiellement axé sur les aspects humanitaires et l’assistance que la communauté internationale devait lui apporter, a tardé à aborder les questions politiques pourtant au cœur de tous les problèmes auxquels doit faire face ce pays depuis toujours et, surtout, à tenter d’y apporter des solutions.
Au long des années 1980 et 1990, notamment, les Nations Unies ont été singulièrement peu réactives vis-à-vis de la situation au Soudan ; leur action n’a jamais non plus visé à une réelle effectivité, dans la mesure où seule l’Assemblée générale s’est saisie des différentes questions, sans intervention, à une exception près, comme on le verra, du Conseil de sécurité. Jusqu’en 2004, les Nations Unies semblent donc n’avoir pas perçu l’urgence de mettre en œuvre des moyens plus efficaces que ceux qu’elles se contentaient de mobiliser depuis la fin des années 1980.
1) Les préoccupations de l’Assemblée générale pour le Soudan
L’Assemblée générale des Nations Unies a eu l’occasion à plusieurs reprises d’exprimer sa préoccupation. Dès la fin des années 1980, elle a notamment adopté plusieurs résolutions par lesquelles elle se déclarait alarmée par la situation catastrophique du pays, consécutive aux diverses calamités l’affectant de manière récurrente : présence de plus d’un million de réfugiés étrangers sur son territoire depuis le début des années 1960 ; sécheresse et famine de 1984 ; inondations et infestation acridienne en 1988 ; sécheresse et pénuries alimentaires en 1990.
a) Traiter l’urgence humanitaire
A la fin de 1988, deux résolutions (273) lancèrent ainsi une aide d’urgence, puis un programme spécial d’assistance, complétés en mars 1989 par l’« Opération Survie au Soudan », pour aider le pays à surmonter les conséquences des catastrophes naturelles qu’il venait de subir. Avec l’adoption de la résolution 44/12, le 24 octobre 1989, l’Assemblée générale se déclara « solidaire du gouvernement et du peuple soudanais aux prises avec des problèmes complexes d’ordre humanitaire » et exprima « sa profonde gratitude aux Etats et aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales qui ont secondé et soutenu le gouvernement soudanais dans son œuvre de secours et de relèvement. » En décembre 1991, les mêmes termes seront employés dans la résolution 46/178 pour appeler la communauté internationale à maintenir active la solidarité à l’égard du Soudan et continuer de soutenir les efforts de reconstruction entrepris par le gouvernement. Entre temps, l’année précédente, la résolution 45/160, de décembre 1990, avait mis l’accent sur les difficultés du gouvernement qui « doit non seulement faire face aux graves problèmes économiques et sociaux qui se posent actuellement, mais aussi s’occuper de plus de 3,7 millions de personnes déplacées par suite des calamités successives et de la guerre civile dans le sud du pays. » Profondément préoccupée par les effets « graves et multiples » de cette conjonction de facteurs sur la situation intérieure et la stabilité du pays, sur son développement socio-économique, l’Assemblée générale demandait alors aux Etats membres de fournir au gouvernement du Soudan, auquel elle rendait hommage pour ses efforts, les ressources nécessaires pour l’aider à s’acquitter de ses obligations à l’égard de sa propre population et vis-à-vis des réfugiés.
En 1992, toutefois, la perception de l’Assemblée générale a commencé à évoluer.
b) La prise en compte de la situation des droits de l’Homme
Si elle a continué de s’intéresser à l’assistance d’urgence, l’Assemblée générale a en effet commencé de porter un regard parallèle sur la situation des Droits de l’homme dans le pays. Ainsi, tout en réitérant la nécessité de poursuivre la solidarité internationale à l’égard du Soudan, la résolution 47/162 (274) appelait pour la première fois les parties prenantes au conflit armé à mettre un terme aux hostilités et, incidemment, à faciliter le travail humanitaire. Simultanément, la résolution 47/142, adoptée le même jour, prenait note, pour la première fois également, « avec une profonde préoccupation des informations selon lesquelles de graves violations des Droits de l’homme seraient commises au Soudan », ainsi que les rapports de la Commission des Droits de l’homme les relataient alors. Déjà, l’impossibilité pour les populations civiles d’accéder librement à l’assistance humanitaire, les déplacements forcés, les exodes massifs de populations vers les pays voisins, la torture, les exécutions sommaires et autres détentions sans jugement étaient mentionnés.
Désormais, les résolutions suivantes de l’Assemblée générale continueront la plupart du temps de maintenir ce parallèle entre solidarité humanitaire et vigilance en matière de Droits de l’homme. Vos rapporteurs remarquent que les résolutions relatives à l’assistance internationale au Soudan (275) montrent que, au fil de la décennie, la situation humanitaire reste stable dans l’urgence, avec parfois de nouveaux besoins, comme à partir de 1997, suite à des inondations catastrophiques. Les bienfaits de l’assistance internationale sont néanmoins insuffisants pour justifier l’arrêt de l’Opération d’urgence et de l’Opération « Survie au Soudan », qui, en conséquence, se voient prorogées d’année en année. La bonne volonté et la coopération du gouvernement soudanais sont régulièrement soulignées par l’Assemblée générale, qui se félicite aussi des progrès naissants pour tenter de mettre un terme à la guerre civile entre le Nord et le Sud, mais certaines inquiétudes restent en permanence sous-jacentes voire vives, quant à la sécurité des personnels humanitaires et au libre accès des populations civiles aux secours et à l’aide humanitaire, constamment entravés, quels qu’en soient les responsables.
Si la tonalité globale des résolutions quant à la situation humanitaire au Soudan est à l’inquiétude, celle des résolutions relatives aux droits de l’homme est à la fois nettement plus grave et plus préoccupée. L’Assemblée générale, reprenant les conclusions de la Commission des droits de l’homme et des rapporteurs spéciaux, ne cesse de dénoncer, au long de ces années 1990, la gravité des violations des droits de l’homme au Soudan, en soulignant d’ailleurs que les autorités gouvernementales ne sont pas seules en cause et que les parties prenantes au conflit civil doivent trouver une solution qui permette à la population soudanaise de bénéficier des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’articulation régionale de la situation est en permanence soulignée par l’Assemblée générale qui rend hommage aux efforts de médiation des pays voisins du Soudan, qui pâtissent aussi de l’exode de réfugiés soudanais vers leurs propres territoires. L’absence de coopération avec le système des Nations Unies de la part des autorités soudanaises qui contrecarrent la mission des rapporteurs spéciaux, de même que les représailles qu’elles exercent sur leurs contacts, sont en revanche l’objet d’une très vive préoccupation de la part de l’Assemblée générale.
Vos rapporteurs remarquent que, malgré les prises de positions constantes de l’Assemblée générale, la situation des droits de l’homme, loin de s’améliorer, s’aggrave au fil des années.
De nouvelles violations sont régulièrement dénoncées qui s’ajoutent aux précédentes, objets des premières résolutions : ainsi en est-il des allégations de travail forcé ou obligatoire, puis d’esclavage, notamment à l’encontre de femmes et d’enfants qui, « appartenant à des minorités raciales et religieuses du Soudan méridional, de la région des monts Nouba et de la région des collines d'Ingassana, sont enlevées et vendues comme esclaves, réduites à la servitude et soumises au travail forcé, au su du Gouvernement soudanais » (276) ; de l’enrôlement de force des enfants, utilisés comme soldats ; des « attaques aériennes aveugles » que le gouvernement « mène délibérément contre des objectifs civils dans le sud du pays » (277) ; des persécutions religieuses, « notamment les conversions forcées de chrétiens et d'animistes qui continuent d'être signalées dans les régions du Soudan contrôlées par le gouvernement » ; ou encore de « l'emploi de la force armée par toutes les parties au conflit pour entraver l'acheminement des secours ou attaquer les convois » (278).
Les résolutions de l’Assemblée générale ne sont ainsi qu’une longue litanie d’inquiétudes, de préoccupations et d’indignations, sans véritable effet concret sur le terrain. Si l’Assemblée générale se félicite un an des bonnes intentions exprimées par le gouvernement soudanais, c’est pour mieux l’année suivante regretter d’avoir à constater que les engagements qu’il avait pris sont peu ou pas respectés, notamment quant à l’accès des populations civiles à l’assistance humanitaire ou en ce qui concerne les enquêtes judiciaires, que de nouvelles atteintes apparaissent et que, au final, une situation dramatique perdure.
2) La Commission des droits de l’homme et les conclusions des rapporteurs spéciaux
C’est sur la base des informations émanant des rapports du Haut Commissariat aux droits de l’homme qui avaient déjà alerté l’Assemblée générale, que, au mois de mars 1993, une résolution de la Commission des droits de l’homme (279) demandait la nomination d’un Rapporteur spécial, eu égard à la particulière gravité de la situation.
Ainsi que vos rapporteurs l’ont noté, ce qui serait plus tard au cœur de la mobilisation des opinions publiques sensibilisées par la tragédie du Darfour, constituait, dès cette époque, la trame des préoccupations de la Commission, attentive à la situation des droits de l’homme au Soudan depuis 1991 : déplacements internes de populations, notamment de minorités, exode en masse de réfugiés vers les pays voisins, exécutions sommaires, aide humanitaire empêchée, détentions arbitraires, tortures, discriminations…
Rétrospectivement, le premier rapport intérimaire du Rapporteur spécial, publié en novembre 1993, paraît singulièrement actuel. Il se penche sur les violations des droits de l’homme commises depuis le 30 juin 1989, date du coup d’Etat du général Al-Bachir, et s’intéresse tant aux exactions commises par les autorités gouvernementales qu’à la situation dans les zones contrôlées par l’Armée de libération du peuple soudanais (SPLM/A). Parmi les informations qu’il livre, vos rapporteurs relèvent notamment :
• Le fait que quelque 5 millions de personnes sont alors déjà déplacées du fait du conflit entre le Nord et le Sud, auxquelles s’ajoutent près de 500 000 réfugiés à l’étranger, répartis entre le Zaïre, l’Ouganda, l’Ethiopie, la République centrafricaine et le Kenya ;
• Que les bombardements aériens par le gouvernement soudanais sur des objectifs civils dans les villes ou les camps de déplacés sont attestés ;
• Que les forces armées, auxquelles se joignent des milices arabes et des unités paramilitaires, se livrent à des massacres de populations civiles, des pillages, des destructions massives, des enlèvements.
• Que, à la publication du rapport, la situation dans les Monts Nouba ne cesse d’empirer depuis déjà près de dix ans : affrontements entre groupes arabes et non arabes ; pillages, razzias et autres atrocités, tant de la part de milices alliées au gouvernement central que des troupes du SPLM/A qui contrôlent une grande partie de la région, conduisent des centaines de milliers d’habitants à fuir, dans un véritable processus de déracinement des communautés Nouba, commencé dès août 1989 et sans doute déjà alors lors irréversible.
En d’autres termes, encore une fois, plus de dix ans avant que n’éclate la crise du Darfour, les plus graves violations des droits de l’homme ainsi qu’une situation humanitaire des plus tragiques, qui ne diffèrent en rien de celles qui serviraient de toile de fond à la mobilisation internationale de 2004, étaient largement connues de la communauté internationale et parfaitement documentées.
Cette connaissance n’a alors provoqué ni indignation ni réaction de la communauté internationale. L’Assemblée générale, au long de cette période, reste seule à s’émouvoir de la situation décrite rapport après rapport. Tous les rapports qui suivront, ne feront qu’alimenter les débats et étayer les résolutions annuelles de l’Assemblée générale que vos rapporteurs ont présentées. Sans qu’il soit besoin d’insister, il leur suffit de remarquer que le Conseil de sécurité restera longtemps silencieux, pour n’intervenir vraiment qu’en 2004, date à partir de laquelle l’Assemblée générale se consacrera exclusivement au financement des MINUS et MINUAD.
3) Le silence assourdissant du Conseil de sécurité
Le Conseil de sécurité ne s’est jamais saisi d’aucun dossier soudanais avant le 31 janvier 1996. Pourtant les crises qui frappent le Soudan sont récurrentes depuis l’indépendance, le conflit entre le Nord et le Sud du pays, commencé en 1983, s’avère terriblement coûteux pour les populations civiles, et le conflit dans les Monts Nouba a été l’objet des rapports les plus alarmants de la part des rapporteurs spéciaux de la Commission des droits de l’homme depuis 1993, attirant sans ambiguïté l’attention sur le nettoyage ethnique en cours.
Ce ne sont cependant pas ces crises-là qui motiveront son intervention avec la résolution 1044, la toute première à avoir été adoptée par le Conseil de sécurité contre ce pays, à l’unanimité des quinze membres. Elle condamnait la tentative d’assassinat dont avait été victime le président égyptien Hosni Moubarak à Addis Abeba le 26 juin 1995, et demandait au gouvernement soudanais de prendre les mesures pour extrader vers l’Ethiopie les trois suspects ayant trouvé refuge sur son territoire, de renoncer à soutenir les activités terroristes et enfin de respecter les principes des Chartes de l’ONU et de l’OUA dans ses relations de voisinage.
Devant l’inertie des autorités soudanaises, deux autres résolutions du Conseil de sécurité (280) seront votées peu après, qui, pour le première fois, établiront des sanctions contre le Soudan, portant, dans un premier temps, sur les facilités accordées à ses diplomates, puis interdisant le trafic aérien aux compagnies d’aviation soudanaises vers les pays membres des Nations Unies. Il faudra plus de cinq ans pour que, à l’unanimité moins l’abstention des Etats-Unis, elles soient levées fin septembre 2001 durant la présidence française du Conseil de sécurité (281), après que le Soudan eut montré sa bonne volonté en adhérant notamment aux conventions internationales relatives au terrorisme et que les Etats africains, de la Ligue arabe et du Mouvement des non-alignés, unanimes, eurent appuyé son retour en grâce.
Entre temps, l’attention du Conseil de sécurité était retombée et, sans même parler de décision ou de résolution, aucun débat sur le Soudan n’y sera même simplement organisé durant cette période, allant de 1995 à 2001.
L’attention du Conseil de sécurité ne se ravivera que quelques années plus tard, lorsque la crise du Darfour aura éclaté ; plus précisément, lorsque la perspective d’un accord de paix entre le Nord et le Sud commencera de prendre forme.
4) Le réveil : la communauté internationale enfin concernée
L’entrée en jeu des Nations Unies sur la question du Darfour peut s’analyser en trois séquences successives. On peut en premier lieu considérer que la réaction du Conseil de sécurité fut tardive puisque c’est seulement le 11 juin 2004 (282), soit près d’un an et demi après le début de l’insurrection rebelle et de sa répression par le gouvernement soudanais, que le Conseil a abordé la question du Darfour. Ce délai, bien long, voire excessif, si l’on prend en compte la connaissance par la communauté internationale des réalités soudanaises nécessite un retour sur cette période, et notamment sur la chronologie des interventions des Nations Unies.
L’intérêt renouvelé du Conseil de sécurité au début des années 2000 en ce qui concerne le Soudan est tout d’abord marqué du sceau d’un très réel soulagement de voir enfin à portée de main la solution de l’effroyable conflit civil entre le Nord et le Sud, après des années d’efforts et de médiation diplomatiques.
En octobre 2003, un peu plus d’un an après la signature du Protocole de Machakos, le président du Conseil de sécurité demande au Secrétaire général de commencer, avec l’ensemble des parties prenantes, dont les facilitateurs et observateurs internationaux, les « travaux préparatoires en vue de déterminer les meilleurs moyens, pour les Nations Unies, d’aider à l’application de l’accord global de paix » (283). Les négociations se poursuivent alors à Naivasha entre le gouvernement soudanais et les rebelles sudistes du SPLM/A, et personne ne doute désormais plus que l’accord final sera conclu. Il importe donc, à l’époque, pour les Nations Unies, d’agir sans tarder pour accompagner le processus, compte tenu de l’ampleur des chantiers que le Soudan aura à traiter simultanément.
De fait, quelques mois plus tard (284), le Secrétaire général expose au Conseil de sécurité son analyse des énormes difficultés auxquelles risque de se heurter la mise en application du futur accord de paix Nord-Sud. Il fournit également un schéma de travail et d’appui logistique pour que les Nations Unies contribuent à son succès. Il rappelle à cet égard qu’« un petit groupe d’experts techniques de l’ONU se trouve au Soudan depuis la fin d’avril 2004 pour entreprendre une planification logistique et des évaluations sur le terrain (…) dans l’éventualité d’une opération future » de soutien à la paix qui, souligne-t-il, se ferait dans les conditions les plus difficiles mais qu’il appelle néanmoins sans ambiguïté de ses vœux : l’accord de paix sera un document extrêmement complexe, qui affectera « en profondeur les réalités politiques actuelles au Soudan » et nécessitera tout à la fois une grande confiance entre les ex-belligérants, ainsi que soutien et patience de la part de la communauté internationale qui sera là « confrontée à la tâche véritablement redoutable consistant à aider le gouvernement soudanais et le SPLM/A à surmonter leurs divergences ».
Ce n’est qu’en conclusion de ce premier mémoire que Kofi Annan attire l’attention du Conseil de sécurité sur ses préoccupations : non seulement des combats font toujours rage dans certaines régions au Sud, mais « la situation catastrophique à Darfour est un problème qui rendra un accord de paix infiniment plus difficile à appliquer » (285).
En d’autres termes, d’une certaine manière, pour grave et préoccupante qu’elle soit alors, depuis au moins un an que dure la contre-insurrection de Khartoum, la crise du Darfour n’est alors appréhendée par le Secrétaire général que de façon incidente : il s’agit simplement d’une difficulté supplémentaire à laquelle les parties prenantes doivent s’atteler au risque de voir rendus vains leurs efforts pour l’application des futurs accords de paix Nord-Sud.
Ce sera d’ailleurs en ce sens que se prononcera le Conseil de sécurité dans la résolution 1547 du 11 juin 2004, qui fait siennes les conclusions de Kofi Annan sur le Darfour. Cette résolution sera donc essentiellement centrée sur l’accord de Naivasha dont elle souligne l’importance non seulement pour la perspective de paix qu’il ouvre enfin entre le Nord et le Sud mais aussi pour la stabilité globale du pays, dans la mesure où il est considéré comme représentant une solution viable pour tous les soudanais.
Pourtant, quelques jours avant l’adoption de cette première résolution, le président du Conseil de sécurité était revenu sur la situation dramatique du Darfour, mettant notamment l’accent sur des informations relatives à de graves actes de violations des droits de l’homme « à caractère ethnique », sur l’engagement, non encore respecté, du gouvernement soudanais de désarmer les milices janjawids ainsi que sur les entraves logistiques faisant obstacle à une intervention rapide « face à une crise majeure qui ne cesse de s’aggraver » (286).
D’une certaine manière, un tournant s’est opéré dès ce moment dans la politique du Conseil de sécurité. Non seulement, il condamnait ces violations des droits de l’homme et réitérait son appel à la protection des civils et au respect des engagements des autorités soudanaises mais il commençait d’élaborer des décisions d’une toute autre force, une fois réellement prise la mesure de ce qui se jouait alors au Darfour.
Très vite, en effet, trois autres résolutions seront votées par le Conseil de sécurité, au cours de cette même année 2004, qui porteront cette fois-ci l’essentiel de l’attention sur la situation au Darfour. A compter de cette date, le Conseil sera d’ailleurs seul à prendre position sur les différents aspects des dossiers soudanais, en déclarant agir en vertu du Chapitre VII de la Charte.
C’est donc quelques semaines seulement après la résolution 1547, que la résolution 1556 (287), viendra d’une certaine manière cristalliser les préoccupations que l’Assemblée générale n’avait cessé d’exprimer au cours des années antérieures au sujet des désastres que vivait le Soudan, pour en tirer, sur la base de la tragédie qui se joue au Darfour et pour la première fois, des conséquences juridiques d’une certaine effectivité.
Les risques de catastrophe humanitaire pour les populations civiles du Darfour, la nécessité de permettre l’acheminement de l’aide internationale, la dimension régionale du conflit et les risques de déstabilisation internationale ainsi que la nécessité de soutenir les efforts de médiation engagés par l’Union africaine et d’autres parties prenantes, sont les arguments avancés qui justifient que le Conseil de sécurité ouvre en effet la voie d’une première vague de mesures contraignantes à l’encontre du Soudan, dans l’hypothèse où son gouvernement n’honorerait pas ses engagements.
« La situation au Soudan constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales et à la stabilité de la région », affirme le Conseil de sécurité, qui se limite néanmoins, dans l’immédiat, à un embargo sur les armes et autres matériels militaires vers les trois Etats constituant le Darfour.
Avec l’adoption de cette résolution, les décisions du Conseil de sécurité vont devoir s’équilibrer en un exercice des plus délicats. Dès ce moment, en effet, le Conseil mène deux actions en parallèle : l’une relative au soutien international et résolu d’un processus de paix prometteur entre le Nord et le Sud, dans lequel le gouvernement soudanais a montré son engagement ; l’autre relative à l’attention à porter à la répression par ce même gouvernement d’une rébellion nouvelle, contre laquelle il fait preuve d’une brutalité et de l’utilisation de moyens inacceptables, susceptibles de l’exposer à des sanctions internationales. Les deux résolutions du Conseil de sécurité votées à l’été 2004 illustrent bien l’incommodité de la position du Conseil de sécurité, dont le gouvernement soudanais saura jouer habilement dans son activité diplomatique.
En premier lieu, alors que quelques semaines auparavant, comme vos rapporteurs l’ont souligné, l’application des futurs accords de paix constituait la promesse d’un avenir meilleur pour le Soudan, la perception soudaine de l’urgence absolue de la situation au Darfour conduit le Conseil de sécurité à instaurer un premier mécanisme de sanctions susceptible d’être rapidement étoffé faisant corrélativement moins porter son attention sur le processus de paix en cours entre le Nord et le Sud. En effet, si le Conseil « réaffirme son appui à l’Accord de Naivasha », il « envisage avec intérêt l’application effective de cet accord, et un Soudan, pacifique et unifié, œuvrant en harmonie avec tous les autres États à son propre développement, et demande à la communauté internationale d’être prête à apporter un concours soutenu, notamment en fournissant les fonds nécessaires pour appuyer la paix et le développement économique au Soudan. » (288).
De fait, s’il aura plus tard l’occasion de se féliciter de l’enregistrement de certains progrès, le Conseil de sécurité continuera de manifester sa préoccupation et de hausser le ton. Depuis le début de l’été, un mécanisme conjoint d’application des accords de paix avait été instauré entre le gouvernement soudanais et le Secrétaire général. Son attention se portait sur la vérification des engagements du gouvernement de Khartoum quant aux milices janjawids, aux activités des forces armées soudanaises comme aux différents autres aspects des problèmes : situation militaire sur le terrain ; situation humanitaire ; processus de négociation ; fourniture et accès de l’aide internationale notamment.
Consécutivement, malgré certains éléments positifs, l’insuffisance constatée des moyens mis en œuvre par le gouvernement conduit rapidement le Conseil de sécurité à accroître sa pression. La résolution 1564, dès le 18 septembre 2004, mentionnera ainsi le secteur pétrolier soudanais comme cible possible de sanctions au cas où serait avéré le manque de coopération du gouvernement, notamment avec la mission de l’Union africaine au Darfour. Dans l’intervalle en effet, non seulement le gouvernement n’a pas ralenti son activité militaire aérienne sur les villages du Darfour, mais ses milices janjawids, loin d’avoir été désarmées, ont pour leur part poursuivi leurs exactions. Raison pour laquelle le Conseil de sécurité demande alors au Secrétaire général de constituer d’urgence une « commission internationale d’enquête pour enquêter immédiatement sur les informations faisant état de violations du droit international humanitaire et des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme par toutes les parties dans le Darfour, pour déterminer également si des actes de génocide ont eu lieu et pour identifier les auteurs de ces violations afin de s’assurer que les responsables aient à répondre de leurs actes. » C’est la première, et unique, fois que l’éventualité qu’un génocide soit commis au Darfour est évoquée dans une résolution du Conseil de sécurité. Cet aspect du problème fera ensuite l’objet des développements considérables que l’ont sait sur lesquels vos rapporteurs reviendront.
Quelques semaines plus tard, le 19 novembre 2004, le Conseil, très exceptionnellement déplacé à Nairobi pour l’occasion afin de marquer sa plus vive préoccupation (289), adopte lors d’une séance solennelle la résolution 1574, qui réitère l’attention portée au processus de Naivasha et tout le soutien que les Nations Unies sont prêtes à apporter à l’application du futur accord de paix, d’autant plus espéré qu’il contribuera « à résoudre la crise au Darfour. » En d’autres termes, comme la résolution le souligne par ailleurs, c’est une approche nationale, syncrétique, associant tous les intéressés « y compris les femmes », qu’il est nécessaire d’adopter pour travailler à la paix et à la réconciliation nationales.
c) L’emballement du Conseil de sécurité
Alors que le Conseil de sécurité, comme vos rapporteurs l’ont souligné, n’avait porté aucune réelle attention au Soudan par le passé, sa soudaine prise de conscience de la gravité de la situation au Darfour va l’entraîner dans une sorte d’emballement au cours des années suivantes : entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, ce ne sont en effet pas moins d’un total de 107 réunions qu’il aura consacré directement au Soudan (290).
En complément, sur un plan institutionnel, une enquête internationale aura été diligentée ; 29 résolutions du Conseil de sécurité, portant exclusivement sur les conflits soudanais, auront été adoptées, sans compter le grand nombre d’autres, traitant de questions régionales affectant pour partie la crise du Darfour ou la situation au Soudan, qui seront également votées ; la Cour pénale internationale, saisie par le Conseil de sécurité (291), aura de son côté lancé des procédures et mandats d’arrêt internationaux visant à l’arrestation de certains hauts responsables de l’appareil répressif soudanais ainsi que du président Omar Al-Bachir lui-même pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité ; des forces d’interposition de l’Union européenne, de l’Union africaine et des Nations Unies auront été constituées pour se déployer sur le terrain et contribuer à la pacification de la région et à la sécurisation des camps de réfugiés et de déplacés, ainsi que de la population civile Darfouri.
En d’autres termes, la crise du Darfour aura finalement été l’occasion d’une activité et d’une mobilisation de la diplomatie onusienne d’une exceptionnelle importance, à la hauteur des enjeux humains et géopolitiques qu’elle a créés, révélés ou amplifiés.
On ne peut toutefois s’empêcher de penser que ce conflit a aussi été comme une épine dans le pied des Nations Unies, fort inopportunément plantée à un moment où toute l’attention devait se concentrer sur un effort commun pour enfin réussir une paix si longtemps attendue. D’une certaine manière, la communauté internationale s’est trouvée embarrassée par cette nouvelle crise, et contrainte d’y plonger malgré elle alors qu’elle croyait voir l’interminable dossier soudanais se clore enfin. Le Darfour a risqué de tout faire capoter, de mettre à bas l’édifice péniblement construit. N’est-ce pas pour cette raison, aussi, que les solutions qui seront envisagées pour le résoudre, que ce soit par les Nations Unies, l’Union africaine, ou les initiatives des médiateurs bilatéraux, seront si uniment consacrées en premier lieu aux aspects humanitaires, en occultant en quelque sorte les fondements politiques de cette crise ? Comme s’il fallait tenter d’apaiser le feu à l’Ouest sans rien remettre en cause de ce que l’on avait difficilement réussi à construire.
Certes, les informations épouvantables en provenance du Darfour, dix ans à peine après que le Rwanda eut écrit à l’été 1994 en quelques semaines l’une des pages les plus horribles de l’histoire de l’humanité, faisaient resurgir le spectre d’un nouveau génocide en terre africaine. Il y avait de quoi bousculer les chancelleries occidentales, attisées par l’opinion publique.
La mobilisation de l’opinion publique internationale sur la situation au Soudan ne surgit pas en 2003 en réaction aux massacres commis au Darfour. Quelques années auparavant, la guerre entre le Nord et le Sud avait, elle aussi, fait l’objet de campagnes d’opinion qui, pour avoir été sans doute moins médiatisées, n’en ont moins pas rencontré un certain écho. Il est utile de s’arrêter sur ces prémices, desquels naîtra directement quelques années plus tard la perception de la crise du Darfour par la communauté internationale. Ce l’est d’autant plus que la réaction internationale en sera d’une certaine manière sans doute conditionnée.
1) Quand la société civile impose son tempo
La mobilisation de la société civile occidentale apparaît en fait au milieu des années 1990 en réaction à certains des aspects les plus insoutenables du conflit Nord-Sud. Certaines entreprises, compagnies pétrolières en premier lieu, en subissent directement les contrecoups. La canadienne Talisman présente l’exemple le plus intéressant.
a) Les mésaventures de Talisman
La campagne qui visait Khartoum était essentiellement menée par les mouvements chrétiens conservateurs américains, et reprise à Washington par les élus du Congressional Black Caucus. La question des pratiques esclavagistes, des déplacements et massacres des populations des Monts Nouba et des civils du Sud Soudan notamment, étaient au cœur de leurs préoccupations.
En d’autres termes, il s’agissait d’un mouvement de solidarité, nord-américain essentiellement, international pour partie, fondé sur une identification aux victimes, noires et chrétiennes. Il était relayé par des mouvements et personnalités religieuses, chrétiennes, juives ou musulmanes, tel Louis Farrakan, dirigeant controversé de The Nation of Islam, qui avaient pris fait et cause dès le milieu des années 1990 contre la politique esclavagiste de Khartoum et de ses alliés.
Les compagnies américaines ou occidentales opérant au Soudan, pétrolières en tout premier lieu, commencèrent alors d’être considérées comme complices de la mort de centaines de milliers de civils. La campagne, ayant des relais politiques facilités grâce à l’implication des sénateurs et représentants américains membres du Black Caucus, était promise à une traduction législative rapide. En effet, lorsque le Congrès étudia le « Sudan Peace Act », l’interdiction de pouvoir lever des fonds au New York Stock Exchange fut adoptée (292).
Malgré ces développements, Talisman, ancienne branche canadienne de British Petroleum, était entrée tardivement, en août 1998, sur le marché soudanais en partenariat avec la GNPOC, à la faveur des ennuis de certaines autres majors. Compte tenu des implications financières de la future loi lui interdisant de recourir au marché financier new-yorkais, elle préféra finalement vendre ses parts dans le consortium dès 2002. Elle le fit d’autant plus facilement que la contestation de ses activités soudanaises prenait aussi un tour judiciaire, puisqu’elle était parallèlement assignée en justice. Talisman était en effet mise en cause devant une cour fédérale de New York par l’Eglise presbytérienne du Soudan « au nom d’un grand nombre d’Africains vivant dans un rayon de 80 Kms autour de ses champs pétrolifères », pour avoir « délibérément et intentionnellement » soutenu une « opération brutale de nettoyage ethnique contre la population civile. » (293) La plainte avait été déclarée recevable par le juge.
Il est intéressant de noter que, à cette époque, quelque soit l’ampleur des atrocités commises au Sud Soudan, la question d’un génocide n’était quasiment pas abordée. Ce qu’ont souffert les populations des Monts Nouba ou celles du Sud Soudan ne diffère en rien de ce que les Four, Masalit et autres Zaghawa subiront à partir de 2003, mais très peu d’auteurs se risquent alors à nommer les massacres, les déplacements forcés de populations comme des actes de génocide. C’est de guerre civile qu’il s’agit alors avant tout (294).
C’est également de ce réseau que naîtrait une « Commission américaine indépendante sur la liberté religieuse », qui classerait le Soudan comme le régime le plus répressif en matière de liberté de religion et de croyance. Au nom de la lutte contre l’esclavagisme, d’autres ONG américaines, telle que « Christian Solidarity International », menaient en parallèle une campagne active en faveur d’esclaves soudanais, en rachetant leur liberté. (295)
Cette mobilisation de la société civile a rencontré une oreille particulièrement attentive en George W. Bush, qui lors de sa première campagne électorale, a perçu la capacité d’action de cette frange importante de son électorat. La situation soudanaise a été pour George W. Bush une occasion de répondre aux attentes de l’important électorat conservateur chrétien, fortement sensibilisé. La nomination en septembre 2001 de John Danforth, clerc épiscopalien, comme envoyé spécial pour le Soudan s’inscrira donc parfaitement dans ce contexte et les premières propositions qu’il formulera seront précisément marquées au sceau de ces préoccupations, puisque, parmi les quatre points de son plan d’urgence figuraient la constitution d’une mission d’enquête internationale sur l’esclavage au Soudan et l’arrêt des attaques contre les civils des Monts Nouba.
D’une certaine manière, cette campagne, fortement articulée autour d’aspects religieux et raciaux, allait servir de base au mouvement qui se déclencherait lorsque surgirait le drame du Darfour.
b) « Save Darfur », Hollywood et les chiffres du génocide
Au tout début de la crise du Darfour, lorsque la rébellion éclate en février 2003 du côté d’El Fascher, personne ne s’en soucie. Personne ne s’en rend même compte : Le Darfour est inconnu, loin et isolé et surtout, les préoccupations internationales, lorsqu’elles portent sur le Soudan, conduisent à tourner les regards vers le Sud où continue de se négocier difficilement la paix, après la première avancée réalisée à Machakos en juillet de l’année précédente.
Consécutivement, les premiers mois de la crise du Darfour se déroulent dans une indifférence internationale totale. Cette crise, qui connaît pourtant à ce moment-là sa pire période, passe totalement inaperçue des medias, de l’opinion publique internationale ainsi que des chancelleries diplomatiques et des Nations Unies : En octobre 2003, lorsque le président du Conseil de sécurité demande à Kofi Annan que l’organisation étudie un plan d’aide à la mise en œuvre du futur accord de paix global, il ne mentionne dans la feuille de route qu’il lui trace rien qui s’écarte du processus de paix entre le Nord et le Sud, qui fasse référence à une quelconque urgence politique ou humanitaire à traiter en parallèle. Rétrospectivement, on saura pourtant que lorsque la crise du Darfour aura enfin réussi à capter l’attention, et que la mobilisation internationale aura commencé, l’essentiel du drame était quasiment terminé.
C’est à la même date, en octobre 2003, que les spécialistes les plus attentifs du Soudan, - le Britannique Eric Reeves en premier lieu, activiste de la cause anti-Khartoum s’il en est -, commencent à mentionner que quelque chose se passe au Darfour, tout en continuant de centrer leurs principaux commentaires sur les négociations Nord-Sud. La prise de conscience qu’une crise humanitaire majeure était en train de se produire à l’Ouest du Soudan s’opère quelques semaines plus tard, grâce à des informations enfin plus documentées, à partir de novembre 2003, alimentées par l’afflux de réfugiés soudanais au Tchad.
Comme le montre notamment Gérard Prunier dans l’historique qu’il relate (296), certains angles d’analyse sont d’emblée privilégiés par les analystes et commentateurs : Arabes contre Noirs ; génocide ; catastrophe humanitaire. Alors mêmes qu’ils sont parfois contradictoires, simplification médiatique aidant, le schéma religieux ne pouvant s’appliquer ici, c’est autour de ces éléments de perception que la mobilisation internationale va se développer. En revanche, la dimension politique, la question des raisons du surgissement soudain d’une rébellion en lutte pour sortir une région de sa marginalisation séculaire, sont absentes.
C’est au cours de l’année 2004 que les mouvements de la société civile qui s’étaient mobilisés pour le conflit du Sud Soudan vont se ranimer. Des ONG vont se coaliser, constituer notamment « Save Darfur » aux Etats-Unis, qui aura rapidement les relais internationaux et médiatiques les plus importants. Coalition de plus de 190 organisations, notamment confessionnelles, Save Darfur revendique plus de un million de militants actifs et la possibilité de mobiliser quelque 150 millions d’habitants aux Etats-Unis. Les stars d’Hollywood se mettront de la partie : George Clooney, Angelina Jolie, Mia Farrow et d’autres seront notamment à la pointe de la médiatisation de la campagne pour le Darfour dès son début ; elles le sont toujours. Leurs relais médiatiques, notamment aux Etats-Unis seront aussi très importants, du New York Times à Oprah Winfrey, et la thématique du génocide prendra ainsi racine.
Or, le drame du Darfour a également ceci de remarquable dans la phase médiatique qui a précédé l’action internationale, qu’il a été l’objet, pour mieux étayer l’argumentation du génocide, d’affirmations chiffrées quant au nombre des victimes civiles. Affirmations cependant le plus souvent non vérifiées, mais néanmoins prises pour des certitudes. Les chiffres les plus alarmistes ont été avancés pour justifier la nécessité de la mobilisation de la communauté internationale. On a ainsi très rapidement, dès les premiers mois, parlé d’un nombre de victimes terrifiant, repris avec plus ou moins de prudence par les décideurs, pour étayer leurs décisions. Le Département d’Etat américain a basé son intervention sur une fourchette de 90 000 à 180 000 tués entre mars 2003 et janvier 2005. Certaines ONG, surtout, chercheurs individuels ou mouvements d’opinion de la société civile, ont repris et diffusé nombre de chiffres, comme autant de slogans mobilisateurs. Enfin, les représentants de la communauté Four, Abdul Wahid al-Nour, en premier lieu, mais c’est là plus compréhensible, ont également parlé en 2007 de 400 000 civils tués au Darfour (297) auxquels s’ajoutaient autant de femmes violées (298).
Ainsi la tragédie du Darfour considérée dès le départ par l’opinion publique internationale comme un génocide a finalement été l’objet d’une controverse portant sur le nombre réel des victimes civiles sans qu’il ait été possible de faire marche arrière pour essayer de traiter la crise autrement que sous ce seul prisme mobilisateur et choquant de la bataille des chiffres.
Indépendamment des chiffres donnés pour des raisons d’ordre polémique, force est de constater une certaine confusion au niveau des institutions internationales les moins soupçonnables de partialité, due en grande partie aux différences de méthodes employées selon les institutions concernées, pour procéder aux extrapolations à partir de sondages et d’enquêtes effectués dans les camps de déplacés et de réfugiés. Comme le résume Gérard Prunier dans son ouvrage (299), après qu’il eut lui-même tenté de réaliser sa propre estimation en recoupant l’ensemble des données alors existantes qui le conduisent à une estimation de 300 000 morts au début de 2005, « la marge d’erreur est forte et on pourrait s’apercevoir avec des travaux détaillés qu’il n’y a peut-être eu " que " 220 000 ou 250 000 morts. Mais peut-être aussi se rendrait-on compte qu’il y en a eu 350 000. »
Les enquêtes les plus rigoureuses effectuées ensuite laissent penser que la réalité des massacres, pour terrible qu’elle soit, est fort heureusement sans doute moindre que celle qui était annoncée. Il ne s’agit évidemment pas ici pour vos rapporteurs de tenter d’atténuer de quelque façon que ce soit ni l’ampleur du drame, ni la responsabilité écrasante des belligérants et en premier lieu, celle du gouvernement soudanais et des milices janjawids à sa solde. Mais il leur semble important de rappeler que le United States Government Accountability Office, GAO, soit la Cour des comptes fédérale américaine, a montré que certaines des données qui ont servi de support à la définition de politiques d’intervention, avaient effectivement été avancées pour des considérations en partie militantes, sans reposer sur des bases prouvées. Certains experts ont ainsi reconnu ultérieurement avoir lancé des chiffres estimés très grossièrement, sans réelle étude de terrain ni méthodologie rigoureuse, dans le but principal de produire un choc et une prise de conscience humanitaire des opinions publiques occidentales et des gouvernements. Or, comme le remarque fort opportunément le GAO, dans une étude réalisée à la demande du Congrès, la détermination du nombre de victimes lors d’une crise humanitaire requiert de méthodes rigoureuses qui permettent de déterminer les dimensions de la crise et par conséquent, de pouvoir adapter la réponse institutionnelle et politique à y apporter. (300)
Sans prétendre apporter une réponse définitive, le GAO s’appuie sur le Centre pour la recherche l’épidémiologie des désastres, CRED, de l’école de santé publique de l’université catholique de Louvain, pour étayer ses conclusions. Crédité de la méthodologie scientifique la plus rigoureuse et d’une très grande objectivité, le CRED avait publié une première analyse en 2005, au terme de laquelle le nombre de décès excédentaires, dans l’Est du Tchad et au Darfour, dus à la crise, était approximativement de 110 000 sur une période de 17 mois, comprise entre septembre 2003 et janvier 2005, dont 35 000 dus à la violence, les autres décès étant dus aux maladies (301). Très précisément, selon les comptages scientifiques alors effectués, la surmortalité estimée au Darfour au cours de cette période oscille entre 63 000 et 146 000 décès, selon les modes de calcul, et le nombre total de décès durant cette même période varie de 98 000 à 181 000. Il n’est pas inutile de rappeler aussi que le taux de mortalité de référence des Nations Unies en ce qui concerne l’Afrique subsaharienne est fixé depuis les années 1990 à 0,44 décès/10 000 habitants par jour soit 16 décès/1000 habitants par an. Selon les informations communiquées à vos rapporteurs par le CRED (302), l’estimation concernant le Darfour se situerait actuellement entre 0,6 et 0,7 pour 10 000 habitants/jour, soit un taux élevé mais néanmoins inférieur au seuil d’urgence de 1/10 000.
Enfin, selon les données consultables aujourd’hui sur le site Web du CRED (303), après actualisation de l’étude initiale, il ressort que le conflit a sans doute effectivement tué au total quelque 300 000 personnes, mais sur l’ensemble de la période comprise entre septembre 2003 et décembre 2008. Encore le CRED avance-t-il que ces données doivent être considérées comme des estimations prudentes : il s’agit précisément d’une fourchette de 180 000 à 460 000 décès, dont la principale cause n’est pas la violence mais les maladies.
c) De Bush à Obama, les réactions diplomatiques
Quoi qu’il en soit, c’est sur cette toile de fond générale, avec ces données en mains, que les chancelleries occidentales ont commencé de réagir à la crise. Des mots avaient été lancés, qu’il était impossible d’effacer ou dont les gouvernements ne pouvaient pas ne pas tenir compte. D’une certaine façon, ils prirent le train en marche, se coulant dans le moule médiatique ainsi tracé : un génocide était en cours au Darfour, dix ans après celui du Rwanda.
Ainsi, dès le mois de juillet 2004, le Congrès américain adoptait une résolution (304) déclarant que les atrocités se déroulant au Darfour étaient un génocide et en accusait le gouvernement soudanais. La résolution, qui indiquait « qu’environ 30 000 habitants innocents avaient été brutalement assassinés, plus de 130 000 forcés à quitter leurs maisons et s’étaient enfui au Tchad voisin, et plus de un million de personnes avaient été déplacées », rappelait à la communauté internationale, les obligations découlant de la Convention de 1948 des Nations Unies sur la prévention et la répression du génocide. Regrettant que la Commission des Droits de l’homme des Nations Unies n’ait pas su prendre d’action appropriée et ait notamment échoué à soutenir les efforts des Etats-Unis pour condamner fermement les violations des Droits de l’homme, elle enjoignait les Nations Unies et son Secrétaire général de prendre le leadership qui leur incombait en nommant désormais les atrocités commises au Darfour comme elles le devaient : « génocide » (« calling the atrocities being committed in Darfur by their rightful name: génocide »). Les parlementaires américains appelaient ensuite la communauté internationale, et notamment l'Union africaine, la Ligue arabe et l’organisation de la Conférence islamique de prendre des mesures pour empêcher l’aggravation du génocide et félicitait l’administration américaine pour son propre leadership dans la recherche de solution. Des sanctions étaient enfin demandées par le Congrès, en matière de visa et de gel des intérêts pour les personnes directement responsables des atrocités. Enfin, le volet de la reconstruction du Darfour devait être envisagé d’ores et déjà par l’USAID.
Le Secrétaire d’Etat américain, Colin Powell, sera le premier responsable politique à reprendre cette thématique, lui donnant par le fait même un écho officiel. Lors d’une audition devant la commission des affaires étrangères du Sénat, en septembre, il déclara, sur la base d’une « enquête limitée » menée dans les camps de réfugiés au Tchad, comparée avec d’autres informations disponibles, qu’il concluait qu’un génocide était effectivement en cours. (305) Quelques jours plus tard, le 21 septembre, le président George W. Bush lui-même reprenait cette idée et déclarait devant l’Assemblée générale des Nations Unies que « à cette heure, le monde est témoin des terribles souffrances et des horribles crimes dans la région du Darfour au Soudan, crimes que mon gouvernement a conclu être un génocide. » Ultérieurement, Condoleezza Rice, Secrétaire d’Etat à partir de janvier 2005, s’exprimera naturellement en ces mêmes termes à plusieurs reprises lorsqu’elle aura à le faire sur le Soudan.
En d’autres termes, au cours de cette époque charnière se construit avec retard une image partiale du conflit, éloignée de la réalité, biaisée par diverses considérations. Si l’on prend en compte pour l’analyse l’origine et les orientations politiques des principaux animateurs de Save Darfur, la question du thème du génocide comme dérivatif médiatique à la guerre en Irak se pose notamment. (306) Comme on a pu en effet le faire remarquer à juste titre, « la véritable toile de fond sur laquelle se déroulait toute l’affaire soudanaise [c’est] l’enlisement américain en Irak. » (307)
Cela étant, poursuivant sur sa lancée, la campagne médiatique internationale – qui n’est que cela, aucun fonds collecté par Save Darfur n’ayant jamais été destiné à aider les réfugiés et autres victimes du Darfour (308) –, a également débordé sur les périodes électorales, qui ne pouvaient rester à l’écart. A ce titre, ce sont notamment les campagnes présidentielles aux Etats-Unis et en France, en 2007, qui retiennent l’attention, puisque le Darfour est devenu pour l’occasion thème de campagne, les différents candidats ayant à s’engager publiquement, sur les actions qu’ils entendraient mener une fois en charge de la magistrature suprême.
La force du thème est si prégnante qu’aujourd’hui encore, même après que la situation s’est d’une certaine manière heureusement apaisée et éclaircie et que la Commission d’enquête internationale sur le Darfour des Nations Unies a conclu qu’il n’y avait pas eu de crimes de génocide, les responsables politiques semblent avoir du mal à s’en départir. Le Président Barak Obama, au terme de la revue de la politique américaine vis-à-vis du Soudan à laquelle l’administration a procédé dans les derniers mois, continue de considérer la crise du Darfour comme un génocide : « le génocide au Darfour a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes », disait-il entre autres choses le 19 octobre 2009 en présentation ses nouvelles orientations politiques, en compagnie de sa secrétaire d’Etat, Hillary Clinton.
2) « Génocide » ou crimes de guerre et crimes contre l’humanité ?
a) Les définitions du droit international
Avant d’entrer dans le vif de la controverse qui a animé la communauté internationale sur la question de savoir si les autorités soudanaises, dont le président Al-Bachir au premier chef, ont ou non commis lors de la crise du Darfour des crimes de génocide, vos rapporteurs croient opportun de revenir sur quelques notions et concepts clefs.
En premier lieu, les définitions relatives aux crimes de guerre et aux crimes contre l’humanité figurent aujourd’hui dans le Statut de Rome qui a institué la Cour pénale internationale le 17 juillet 1998.
Long de près de cinq pages, l’article 8 du Statut de Rome est extrêmement détaillé dans sa rédaction et traite des crimes de guerre, pour lesquels la Cour pénale internationale a compétence, « en particulier lorsque ces crimes s’inscrivent dans le cadre d’un plan ou d’une politique ou qu’ils font partie d’une série de crimes analogues commis sur une grande échelle. » (309). Il distingue les crimes commis au cours de conflits internationaux des crimes commis « en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international », bien que, dans un cas comme dans l’autre, la base commune soit constituée par des infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949.
S’agissant d’un conflit ne présentant pas de caractère international, comme celui en cours au Darfour, le Statut de Rome distingue particulièrement comme actes constitutifs de crimes de guerre à prendre en considération, ceux « commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités » et « autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ».
Parmi ceux-ci, vos rapporteurs retiennent tout particulièrement à l’article 8-2c :
« i. Les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ;
ii. Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
iii. Les prises d’otages ; (…) »
L’article 8-2e inclut également comme constitutifs de crimes de guerre :
« i) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités ; (…)
v) le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ;
vi) le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l’art. 7, par. 2, al. f), la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une violation grave de l’art. 3 commun aux quatre Conventions de Genève ;
vii) le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités ;
viii) le fait d’ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l’exigent ; (…) »
L’article 7 du Statut ne reprend naturellement pas la distinction faite entre conflit international ou non et définit comme crimes contre l’humanité « l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :
a. Meurtre ;
b. Extermination ;
c. Réduction en esclavage ;
d. Déportation ou transfert forcé de population ;
e. Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
f. Torture ;
g. Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
h. Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du par. 3, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour; disparitions forcées de personnes ;
i. Crime d’apartheid ;
j. Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. » (310).
Enfin, il faut rappeler que la définition du génocide a tout d’abord été posée par l’article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948. Elle a été reprise, sans modification, par l’article 6 du Statut de Rome :
« Le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a. Meurtres de membres du groupe ;
b. Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c. Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
d. Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
e. Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. »
Quant au génocide, l’article 3 de la Convention précise également que « seront punis les actes suivants :
a. Le génocide ;
b. L’entente en vue de commettre le génocide ;
c. L’incitation directe et publique à commettre le génocide ;
d. La tentative de génocide ;
e. La complicité dans le génocide. »
Il faut souligner qu’une certaine ambiguïté juridique a pu pour partie fonder ou alimenter la controverse que vos rapporteurs détailleront plus bas, sur la réalité ou non d’un génocide commis à l’encontre des populations du Darfour.
En premier lieu, vos rapporteurs relèvent la rédaction des articles 6 et 7 du Statut de Rome. En effet, parmi les éléments constitutifs du génocide, l’article 6, alinéa c, considère la « soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle », tandis que l’article 7, dans son alinéa 2b, entend comme constitutif du crime d’extermination, c'est-à-dire de crime contre l’humanité, « notamment le fait d’imposer intentionnellement des conditions de vie (…) calculées pour entraîner la destruction d’une partie de la population ».
A l’évidence, la distinction est des plus tenues et peut entraîner, de l’avis de vos rapporteurs, une certaine confusion et, surtout, des polémiques et batailles juridiques sans doute inopportunes.
Indépendamment de ces éléments communs à deux qualifications juridiques différentes, la notion de génocide, ainsi que la Commission Cassese aura l’occasion de le rappeler dans son rapport en janvier 2005 (311), telle qu’elle résulte de la Convention de 1948, des règles de droit international coutumier et de la jurisprudence, suppose la conjonction d’éléments « objectifs » - essentiellement la réalité des crimes – et d’éléments « subjectifs » - l’intentionnalité.
Consécutivement, l’absence d’intention délibérée d’annihilation de tout ou partie d’un groupe humain donné, ethnique, religieux, tribal, etc., ne peut entraîner la qualification du crime de génocide, quelles qu’aient pu être la nature et l’ampleur des atrocités commises. C’est sur cette base que la Commission d’enquête internationale établira ses conclusions.
b) Les conclusions de la Commission Cassese
Le 18 septembre 2004, la résolution 1564 du Conseil de sécurité a créé la Commission d’enquête internationale sur le Darfour. Cette commission, composée de cinq membres (312) nommés par le Secrétaire général des Nations Unies était présidée par le professeur Antonio Cassese, Italien, ancien juge et premier président du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. Elle avait pour mission de rendre son rapport dans les trois mois. Ayant commencé ses travaux le 25 octobre 2004, elle les acheva le 25 janvier 2005, quelques jours après la signature du CPA à Naivasha.
Les conclusions de la Commission sont accablantes.
Elles le sont en tout premier lieu pour le gouvernement central du Soudan et les milices qu’il arme et envoie sur le terrain : « la Commission a recueilli des éléments d’information substantiels et fiables qui tendent à montrer qu’il y a bien eu meurtre systématique de civils appartenant à certaines tribus, atteintes graves et massives à l’intégrité physique ou mentale de membres de certaines tribus, et soumission massive et délibérée de ces tribus à des conditions d’existence devant entraîner leur destruction physique totale ou partielle (par exemple, destruction systématique de leurs villages et de leurs récoltes, expulsion de leurs foyers et vol de leur bétail) » (313).
Pour autant, les atrocités commises ne relèvent pas, pour la Commission d’enquête, de la qualification juridique de crime de génocide, même s’il « ne fait pas de doute que certains des éléments objectifs du génocide sont présents au Darfour. » (314). En effet, malgré cela, « il apparaît que l’intention génocide fait en l’espèce défaut, du moins pour ce qui concerne les autorités relevant du Gouvernement central. D’une manière générale, la politique consistant à attaquer, tuer ou transférer de force les membres de certaines tribus ne procédait pas de l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe racial, ethnique, national ou religieux, comme tel. Il semblerait plutôt que ceux qui ont planifié et organisé les attaques contre des villages l’aient fait dans l’intention d’en chasser les habitants, principalement aux fins de la répression de la rébellion. » (315)
Pour la Commission, cette appréciation de la situation n’est en aucune manière de nature à rassurer ou à atténuer en quoi que ce soit la gravité des faits et la responsabilité de leurs auteurs. Les commissaires achèvent leur analyse en précisant en effet que « la conclusion que les autorités gouvernementales n’ont pas, directement ou par l’intermédiaire des milices qu’elles contrôlent, agi au Darfour en application ou dans la poursuite d’une politique génocide n’enlève rien à la gravité des crimes commis dans la région. Les crimes au regard du droit international tels que les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre commis à grande échelle peuvent être tout aussi graves, et abominables que le crime de génocide. Tel est, malheureusement, le cas au Darfour, où des atrocités ont été commises à très grande échelle et, jusqu’à présent, en toute impunité. » (316).
En conséquence de quoi, ayant conscience que, parfois, des actes ont été commis individuellement dans une intention génocidaire, la commission d’enquête préfère renvoyer à un tribunal compétent le soin de statuer au cas par cas. Pour ce qui la concerne et en s’agissant des autorités politiques centrales du pays, elle a constaté des faits qui sont constitutifs de crimes contre l’humanité, tels les massacres et transferts forcés de civils, qui « ont revêtu un caractère à la fois systématique et généralisé» ou encore de crimes de guerre : les attaques de civils, la destruction et l’incendie de très nombreux villages, les dévastations, notamment. La Commission fait ainsi état de « crimes de guerre très graves » ou de « crimes de guerre commis à grande échelle » (317).
Enfin, la Commission d’enquête n’exonère pas les forces rebelles de toute responsabilité dans les crimes qui ont été commis au Darfour durant cette période. Son travail a porté sur l’ensemble des faits qui ont constitué autant d’atteintes au droit international humanitaire. En ce sens, elle a indiqué avoir « recueilli des preuves fiables dont il ressort que des membres de l’Armée de libération du Soudan et du Mouvement pour la justice et l’égalité sont responsables de violations graves des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et du droit international humanitaire, qui peuvent constituer des crimes de guerre. Ces violations comprennent en particulier des meurtres de civils et des pillages. » (318) Toutefois, à la différence, - notable selon vos rapporteurs -, de celles commises par les forces armées régulières et les milices janjawids, « la Commission n’a pas établi que les violations commises par les rebelles revêtaient un caractère systématique et généralisé ».
L’argumentation de la Commission internationale apparaît quelque peu sophiste dans ses conclusions, mais le Traité de Rome ou la Convention de 1948, de par l’ambiguïté que vos rapporteurs ont soulevée, n’aident sans doute pas à clarifier les choses. Comme on le verra plus loin, le procureur de la Cour pénale internationale fonde précisément sa démarche en argumentant au contraire qu’il y a bien eu génocide dans la mesure où l’intentionnalité du crime, que ne prend pas en compte la Commission Cassese, est évidente dans les conditions de vie imposées aux déplacés et réfugiés dans les camps, qui sont telles qu’elles ont précisément pour but d’entraîner la mort, ne serait-ce que par les restrictions imposées au ONG humanitaires, longtemps empêchées de fournir leur assistance aux populations des camps. (319)
c) Les incidences de la controverse
Cette controverse apparaîtrait bien dérisoire si elle n’avait contribué à alimenter le débat et à compliquer la recherche de solutions proprement politiques.
Qu’on le veuille ou non, le concept de « génocide » est chargé d’une signification supplémentaire que n’ont ni le crime de guerre, ni le crime contre l’humanité ; La notion de génocide est porteuse d’une dimension morale qui touche à l’essence même de la notion d’humanité qui a entraîné une lecture particulière des événements qui se sont produits au Darfour.
Vos rapporteurs souhaitent apporter sur cet aspect de la question du Darfour deux éléments de réflexion, d’un autre ordre, en mettant en perspective l’ensemble des crises soudanaises.
L’analyse historique comparative de la manière dont Khartoum a traité les régions périphériques du Soudan montre que le gouvernement islamo-militariste est incapable de régler une crise autrement que par la brutalité la plus absolue, sans aucun discernement. Ce qu’on a qualifié de génocide au Darfour avait été mis en œuvre précédemment au Sud Soudan, dans les Monts Nouba, voire dans l’Est du pays. Est-il envisageable de considérer dans ces conditions que Khartoum n’a d’autre souci, région après région, que de procéder au génocide de ses populations périphériques les unes après les autres ?
Cette éventualité, terrifiante, ne semble pas résister à l’analyse pour deux raisons. Le fait tout d’abord que les actes que commet le gouvernement du Soudan interviennent le plus souvent en réaction à une rébellion, sans répondre à une planification préalable. Ensuite, et surtout, que si génocide il y a eu au Darfour, le fait que de très nombreux darfouri se soient réfugiés à Khartoum même ou que ceux qui y résidaient depuis longtemps n’aient à aucun moment été inquiétés s’explique assez mal. Comme on a pu judicieusement le faire remarquer (320), on imagine mal les Juifs, pendant la seconde guerre mondiale, trouver refuge auprès de la Wehrmacht… Vos rapporteurs considèrent plutôt, comme ils ont eu l’occasion de le dire antérieurement, qu’il faut y voir la marque d’un gouvernement dont le mode de fonctionnement répond à des schémas qui échappent à la rationalité telle que nous l’entendons. « La contre-insurrection au Darfour ne pouvait que déraper. (…) Il s’agissait d’une réponse armée par un gouvernement racialement marqué qui était décidé à mettre au pas un groupe ethnique qu’il considérait comme inférieur et voué à la soumission. L’espoir qu’une répression puisse être limitée aux seuls combattants relevait de l’optimisme beat. » (321). Tout comme cela avait été très précisément le cas, ajouteront vos rapporteurs, et avec exactement les mêmes effets, s’agissant des populations des Monts Nouba ou du Sud Soudan.
Cela étant, sans doute la qualification de génocide a-t-elle aussi été malencontreusement porteuse d’« effets pervers » au plan de la recherche de solutions politiques à une crise essentiellement politique à l’origine. En focalisant l’attention sur une approche « victimaire », la gestion de la crise par la communauté internationale s’est essentiellement centrée sur l’aspect humanitaire plus que politique. Les organisations internationales, telle l’Union africaine et bien sûr les Nations Unies ont surtout consacré leurs efforts à la constitution de zones de sécurité pour les populations pourchassées, qu’il a fallu installer, équiper. Les aspects logistiques considérables, au plan militaire ou civil, qu’on imagine sans peine lorsqu’on sait qu’il s’est agi de la plus grosse opération mise en œuvre par les Nations Unies, dans une région au demeurant très isolée, ont finalement pris le pas sur un travail plus diplomatique qui n’a finalement été lancé que trop tardivement.
IV – COMMENT RÉUSSIR LA PAIX AU DARFOUR ?
La situation a donc considérablement évolué sur le terrain depuis le déclenchement de la rébellion au Darfour en 2003. Aujourd’hui, les massacres à grande échelle ont cessé, les déplacements forcés aussi. La population du Darfour vit désormais dans un état de violence latente mais néanmoins sérieuse, de « ni guerre ni paix » (322), dans lequel l’insécurité est devenue la règle, essentiellement due au banditisme et au fractionnement des forces rebelles.
Si la gravité de la situation est sans commune mesure avec ce qu’elle a naguère été, puisque le conflit est entré, en termes de confrontation militaire directe, dans une phase de « basse intensité » selon l’opinion commune, elle reste cependant suffisamment aiguë, à en juger par la teneur des dernières résolutions que le Conseil de sécurité a prises sur ce conflit. Il s’est ainsi récemment déclaré « préoccupé, deux ans après l’adoption de la résolution 1769 (2007), par la gravité persistante de l’état de sécurité et la détérioration de la situation humanitaire au Darfour, ainsi que par les attaques répétées contre la population civile » (323), avant de noter, « avec une profonde préoccupation la violence et l’impunité qui continuent de régner, ainsi que la détérioration de la situation de l’aide humanitaire et des conditions d’acheminement de l’aide humanitaire aux populations sinistrées qui en résulte (…) » (324). Que le conflit soit considéré comme terminé, comme certains l’on dit, sur le plan militaire, entre les rebelles et Khartoum et ses milices, ne s’est donc pas encore traduit par une réelle amélioration des conditions de vie des plus précaires des populations, toujours à la merci des exactions de bandes armées incontrôlées.
Inévitablement, ce contexte influe sur les voies de sortie de la crise. Le Darfour n’est heureusement plus soumis à la barbarie dans laquelle le gouvernement soudanais l’a brutalement plongé il y a maintenant sept ans, le temps n’est plus à l’urgence humanitaire absolue, mais les besoins des populations affectées par le conflit restent incommensurables, auxquels la communauté internationale doit continuer de répondre.
Le jeu des médiations internationales a atteint son rythme de croisière, c’est-à-dire lent. Les Nations Unies, l'Union africaine, mais aussi les grands parrains bilatéraux revenus sur les rives du Nil, ou du Golfe persique, au premier rang desquels, naturellement, les Etats-Unis, s’impatientent, mais peut-on forcer un âne à boire s’il n’a pas soif ?…
Parallèlement aux négociations de paix, presque aussi anciennes que le conflit, la Cour pénale internationale est saisie par le Conseil de sécurité sur les faits commis au Darfour, ce qui l’a conduit à prononcer contre le Président
Al-Bachir un mandat d’arrêt international. Il est important de présenter en détail les tenants et aboutissants de ce volet du dossier et d’analyser ses impacts, nombreux et forts, sur le règlement de la question globale et notamment sur le processus de paix politique.
En d’autres termes, à situation complexe, procédures complexes et multiples, mais aussi tâtonnantes et incertaines. Néanmoins, les développements diplomatiques de ces derniers mois laissent entendre que certains changements sont peut-être en train de s’esquisser. S’y ajoutent quelques évolutions au niveau national et régional qui paraissent aussi montrer qu’une solution du conflit au Darfour serait enfin envisageable. Il y a en tout cas longtemps qu’un ensemble de développements a priori positifs ne s’était pas ainsi produit, qui pourrait raviver les espoirs.
Ainsi que vos rapporteurs se sont attachés à le montrer, la crise qui a surgi au Darfour au début de 2003 est ancienne. Elle trouve ses racines profondes dans une situation enkystée, aux multiples aspects, mais le conflit est aussi en grande partie opportuniste. Il éclate lorsque l’opposition politique locale se rend compte des progrès de la négociation en cours au Kenya entre le Nord et le Sud ; lorsque les perspectives d’un accord de paix définitif, sur la base du Protocole de Machakos, signé en juillet 2002 entre les belligérants, risquent d’éclipser à tout jamais leurs propres revendications, qui ne sont au fond pas fondamentalement éloignées de celles pour lesquelles les troupes sudistes de John Garang se sont battues vingt ans durant.
Il est important de garder présent à l’esprit que les diverses négociations qui seront conduites auront comme référence le CPA signé en janvier 2005. Il y a un parallélisme fort, qui se retrouve notamment dans l’architecture des deux textes.
Un second aspect porte sur la dimension régionale. C’était déjà le cas en ce qui concerne le conflit entre le Nord et le Sud, tant dans la guerre que dans la paix. C’est également le cas pour ce qui est du conflit du Darfour où les voisins les plus intéressés par cette région du Soudan restent présents et acteurs. Certains ont un rôle majeur dans ce qui s’est joué et continuent d’avoir une telle importance dans le scénario régional qu’il serait illusoire d’envisager une paix durable au Darfour sans qu’ils soient à un titre ou un autre impliqués. En ce sens, le Tchad est tout particulièrement au centre des préoccupations.
La distinction de ces séquences, complexes et enchevêtrées, entre négociations sur les questions de fond et cessez-le-feu, n’est pas aisée et l’analyse oblige à des allers et retour au cours des mêmes phases.
Dès les premiers mois du conflit, les pourparlers n’ont cessé de s’enliser interminablement les uns après les autres avant d’échouer, faute de réelle volonté des uns et des autres, ou en raison de manœuvres d’obstruction.
1) La cessation des hostilités : un processus lent et cahotant
Plusieurs tentatives auront lieu dès les premières semaines de conflit pour tenter d’y mettre fin et apporter une aide humanitaire aux populations qui ne seront finalement qu’une succession d’échecs.
a) Des cessez-le-feu aux missions de paix
C’est le Tchad qui le premier se mettra sur la longue liste des médiateurs de la crise du Darfour. Dès le mois de septembre 2003, il organise une rencontre à Abéché, entre le gouvernement soudanais et les forces rebelles qui débouchera sur un premier accord de cessez-le-feu d’un mois et demi, connu sous le nom d’« Abéché I », suivi rapidement d’« Abéché II ». Ces deux accords ne réussirent en rien à calmer le jeu, à tel point que le général Al-Bachir pouvait rapidement déclarer, après quelques succès ultérieurs sur le terrain que les opérations militaires étaient terminées.
Cette orientation des premières négociations sous égide internationale en faveur de la recherche de cessez-le-feu sera encore celle privilégiée lorsque l'Union africaine entrera à son tour en scène en mars 2004. A l’instar des discussions menées à Abéché, celles-ci, qui se tiendront à N’Djamena, mettront en avant la question de l’aide humanitaire à apporter aux populations, sans que celle de leur protection soit toutefois prévue. Un nouveau cessez-le-feu était conclu début avril et pour la première fois aussi, une mission internationale d’observation militaire était constituée pour veiller à son application : la Mission de l’Union africaine au Soudan, MUAS.
L’extrême modestie des moyens de la mission et surtout des équipes d’observation sur le terrain – 60 observateurs et 300 militaires, dans un premier temps, à pied d’œuvre à partir du mois de juin –, ne pouvait permettre à la Mission de tenter quelque action que ce soit à l’encontre de ceux qui violeraient l’accord sur un territoire de la surface de celui de l’Espagne. Cet accord ne pouvait qu’être piétiné et le fut effectivement, par toutes les parties.
Très vite, il apparaît aussi qu’augmenter les effectifs de quelques dizaines de personnels ne servirait non plus à rien : ce qui se passe au Darfour est d’une telle échelle que c’est à une opération d’une autre nature qu’il convient de réfléchir si la communauté internationale entend avoir un rôle positif dans cette crise. A la faiblesse du dispositif s’ajoutait aussi l’ampleur des problèmes logistiques, sur ce territoire la fois gigantesque, éloigné et désolé, qui rendaient le mandat de la mission définitivement impossible à remplir : comment espérer neutraliser les janjawids, et assurer la protection des populations civiles victimes de leurs exactions, en mobilisant en tout et pour tout quelque 300 hommes sur 500 000 km2 ?…
La prise en compte de ces réalités ouvrit rapidement la porte à la transformation de cette mission de l'Union africaine irréaliste et irréalisable en une opération de maintien de la paix des Nations Unies. Si La MUAS avait déjà fait l’objet d’une collaboration avec l’UE et les Nations Unies, une étape devait être franchie rapidement. Un nouveau formatage de la MUAS fut d’abord proposé à l’été 2004 et, en octobre, les effectifs totaux étaient portés à 3320 membres, à raison de 2341 personnels militaires dont 450 observateurs, et d’un maximum de 815 policiers, le reste étant composé de personnels civils nécessaires. Un mécanisme de coordination était également prévu avec les parties en présence, de manière à garantir la bonne marche du processus. D’autres suivraient.
b) Les omissions des pourparlers d’Abuja
A la différence de ce qui s’est passé dans le cadre du conflit du Sud Soudan, où l’IGAD s’était fortement impliquée dans la conduite des négociations, c’est ici l'Union africaine qui prend l’initiative pour aider les Soudanais à entrer dans un processus de paix. Elle le fait sans tarder, dès la conclusion des cessez-le-feu de N’Djamena, afin de profiter de la synergie possible avec le CPA, parallèlement en voie de conclusion. Les pourparlers entre les forces rebelles, JEM et SLM, et le gouvernement soudanais, commencèrent ainsi à Addis Abeba, siège de l’UA, en juillet 2004, pour se poursuivre ensuite sous le parrainage du président Obasanjo, à Abuja, au Nigeria, dès le mois d’août.
Sur un mode comparable à ce qui s’était passé dans la négociation entre le Nord et le Sud, une déclaration de principes fut signée après un an de négociations, le 5 juillet 2005, avant que la discussion n’entre dans le détail de la résolution des causes directes de la guerre : le partage des ressources et du pouvoir, auquel était jointe la question des arrangements de sécurité. En d’autres termes, on tentait de répliquer un scénario qui avait fait ses preuves ailleurs.
Cela étant, à la différence notable de la négociation conclue par l’accord obtenu en juillet, à l’entrée dans ce second volet de négociations, les forces rebelles se présentent séparées, une scission intervenant notamment au sein du SLM, comme vos rapporteurs ont eu l’occasion de l’indiquer, entre ses deux leaders, AbdelWahid al-Nour d’un côté et Mini Arkoi Minawi de l’autre. Cette rupture conditionnera non seulement l’échec de la négociation mais aura aussi un impact profond et durable sur le déroulement du conflit du Darfour.
Indépendamment des questions de fond, sur lesquelles vos rapporteurs reviendront le moment venu, on aurait pu croire que lors des négociations d’Abuja, compte tenu de ce qui s’était débattu antérieurement autour de la nécessité du renforcement de la MUAS, les négociateurs s’attacheraient à traiter ce sujet. Il n’en fut rien. Des divergences importantes rendaient inconciliables les positions du gouvernement de Khartoum et les exigences des rebelles du Darfour, et il fallut attendre mars 2006 pour que soit finalement accepté le principe d’une force conjointe entre l'Union africaine et les Nations Unies.
Entre temps, Khartoum n’avait cessé d’affirmer sa préférence pour la MUAS, force uniquement africaine, renforcée en octobre 2004. En avril 2005, les effectifs furent de nouveau augmentés et portés à près de 8000 hommes, dont 6200 militaires. Les rebelles, pour leur part, affirmaient indéfectiblement leur préférence pour l’ONU et l’OTAN.
c) De la MUAS à la MINUAD, le bras de fer diplomatique entre le Soudan et la communauté internationale
Toujours dotée de moyens très insuffisants, malgré les renforts qui venaient de lui être attribués, la MUAS continua néanmoins d’occuper seule le terrain pendant les deux années suivantes, qui fort heureusement connurent une relative baisse de tension sur le plan militaire, à laquelle la signature du DPA entre le gouvernement et la branche « Minawi » du SLM, et le ralliement de celui-ci à Khartoum, mirent brutalement fin.
Ce sont précisément la reprise des combats, - à la fois entre forces rebelles et de la part du gouvernement qui accentue alors sa contre-insurrection sur la région -, les difficultés matérielles et logistiques de la MUAS, ainsi que les attaques contre les travailleurs humanitaires et les forces de la Mission, qui pousseront à la fois l'Union africaine et les Nations Unies à tenter de forcer les oppositions du gouvernement de Khartoum. L’UA ne pouvait plus faire face seule à cette mission dont l’ampleur dépassait de loin les moyens qu’elle pouvait y consacrer eu égard à la détérioration de la situation sur le terrain ; elle avait un besoin criant de soutien de la part de la communauté internationale.
L'Union africaine poussa donc, contre la ferme opposition du gouvernement de Khartoum, l’idée que la MUAS devait être remplacée par une force des Nations Unies. Des résolutions du Conseil de sécurité furent prises en ce sens, puis atténuées, devant la virulence des réactions de Khartoum. Alors même que la résolution 1679 du 16 mai 2006 prenait « note des communiqués des 12 janvier, 10 mars et 15 mai 2006 du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine relatifs au passage de la MUAS à une opération des Nations Unies » et soulignait « que, dans toute la mesure possible, l’opération des Nations Unies envisagée aurait un caractère africain marqué et compterait une forte participation africaine », le gouvernement soudanais s’y opposa et proposa de nouveau un simple renforcement des moyens de la MUAS.
Pour contrer l’obstruction de Khartoum, une alternative fut envisagée un temps par le Conseil de sécurité : le renforcement de la MINUS, positionnée au Sud Soudan, à la fois en augmentant ses effectifs et en redéployant son mandat vers le Darfour. Le 31 août 2006, le Conseil de sécurité « décide, sans préjudice de son mandat et de ses opérations actuels prévus par la résolution 1590 (2005) et en appui à la mise en oeuvre rapide et effective de l’Accord de paix au Darfour, que le mandat de la Mission des Nations Unies au Soudan (MINUS) sera élargi comme il est indiqué aux paragraphes 8, 9 et 12 ci-après et qu’elle sera déployée au Darfour, invite en conséquence le Gouvernement d’unité nationale à consentir à ce déploiement (…) ».
Rétrospectivement, cette résolution apparaît à vos rapporteurs singulièrement maladroite, voire incompréhensible et il est à se demander comment le Conseil de sécurité a pu croire, et espérer, que le gouvernement soudanais, partie prenante d’un conflit civil sur son territoire, pourrait accepter qu’une force d’interposition internationale soit déployée alors même qu’il avait toujours manifesté son opposition la plus déterminée à toute option de cette nature et que son accord et sa participation à ce type d’opération sont indispensables sauf à envisager que le Soudan n’est plus indépendant et souverain. D’une certaine manière, le ver des difficultés que la MINUAD rencontrera plus tard est déjà dans le fruit, avec la crispation nationaliste du gouvernement soudanais que cette résolution ne pouvait que susciter. Sans doute faut-il voir aussi pour partie dans cette maladresse la manifestation de la tendance que la communauté internationale a eue au long de cette crise, poussée en cela par les campagnes d’opinion qu’on a vues précédemment, de privilégier les aspects humanitaires sur les aspects plus strictement politiques pour tenter d’y mettre fin.
Quoi qu’il en soit, cette résolution 1706, approuvée sans le consentement du principal pays intéressé, aura naturellement le même sort que la précédente : le Soudan, soutenu par la Russie et la Chine, menaça en retour l’UA si ce redéploiement était mis à exécution, et réussit à obtenir un renforcement des forces de la MUAS, jusqu’à ce qu’une solution intermédiaire soit trouvée et péniblement acceptée : la substitution à la MUAS d’une force hybride, la Mission des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour, MINUAD.
Après plusieurs mois de tractations, le Conseil de Sécurité de l’ONU vote le 31 juillet 2007 à l’unanimité la résolution 1769 autorisant pour une durée d’un an le déploiement de la Force hybride Nations Unies/Union africaine au Darfour, dont le déploiement doit être effectif au plus tard au 31 décembre. Mise en place pour une durée initiale de 12 mois, absorbant les personnels de la MUAS et disposant de près de 20 000 personnels militaires et de près de 3800 policiers, la MINUAD est autorisée « à prendre toutes les mesures requises, dans les secteurs où ses contingents seront déployés et dans la mesure où elle juge que ses capacités le lui permettent : i) Pour protéger son personnel, ses locaux, ses installations et son matériel, et pour assurer la sécurité et la libre circulation de son personnel et des agents humanitaires; ii) Pour faciliter la mise en oeuvre rapide et effective de l’Accord de paix pour le Darfour, en empêcher toute perturbation, prévenir les attaques armées et protéger les civils, sans préjudice de la responsabilité du Gouvernement soudanais. » En d’autres termes, le recours à l’usage des armes en cas de légitime défense est autorisé aux troupes de la MINUAD dont l’essentiel sera africain.
En toile de fond de ce bras de fer diplomatique entre Khartoum et les Nations Unies, apparaissent l'Union africaine, en position inconfortable, et les aspects judiciaires du conflit, à savoir l’enquête que le procureur de la CPI diligentait sur saisine du Conseil de sécurité depuis le mois d’avril 2005. En d’autres termes, les éléments pour alourdir la tension sont présents, non seulement du fait du raidissement du Soudan mais aussi des positions de certains de ses alliés, qui tenteront ultérieurement, sans succès, d’introduire des clauses de suspension de la procédure (325). Pour ne pas parler des questions militaires et des négociations de paix, tout aussi laborieuses.
En résumé, les conditions dans lesquelles la MINUAD a été créée pouvaient-elle laisser augurer que le gouvernement soudanais verrait avec bienveillance son action sur le terrain ?
d) Des opérations complexes et difficiles
Tout comme la MUAS avait fait la preuve de son incapacité à exécuter son mandat compte tenu de l’indigence de ses moyens, la MINUAD, à son tour, fera à la fois les frais de son montage difficile et de l’opposition déterminée du gouvernement soudanais. La résolution 1769 fixait un échéancier rigoureux (326) et précis quant au passage du relais entre la MUAS et la force hybride, mais de fait irréaliste et irréalisable, tenant compte de l’ampleur des questions militaires, administratives et logistiques à mettre en œuvre dans un délai de cinq mois et de la nature même de la mission.
En d’autres termes, tout comme la MUAS, la MINUAD a rencontré de graves problèmes logistiques qui ont considérablement obéré l’exécution de sa tâche. Si la MINUAD n’a pas les restrictions de la MUAS, trop étriquée, mal formatée et aux moyens si faibles qu’elle devait faire appel à la logistique militaire soudanaise, elle a néanmoins dû faire face à des contraintes comparables qui l’ont empêchée de pouvoir faire bien mieux.
De sorte que, un an plus tard, à l’été 2008, un peu moins du tiers des forces autorisées par la résolution se trouvait effectivement déployé. La MINUAD était loin d’avoir eu les moyens d’atteindre les 80 % de ses capacités dans le temps qui lui était imparti. Les problèmes logistiques majeurs ont été innombrables, notamment quant au manque de moyens de transport, terrestre ou aériens, de moyens de reconnaissance, de génie, de transmissions ou de logistique médicale, mais aussi en ce qui concerne les ressources humaines disponibles.
Ainsi, comme on a pu le préciser à vos rapporteurs (327), en avril 2009, 67 % de la force seulement étaient en place, soit un peu plus de 13 000 hommes au total. A la date de la visite de vos rapporteurs au siège de l'Union africaine, en quinze mois d’activité, la MINUAD avait dû faire face à des difficultés dont l’ampleur n’avait vraisemblablement pas été mesurée à sa juste valeur. En ce qui concerne l’aspect logistique, en plus de la situation géographique de la région, la plus éloignée d’un rivage maritime sur le continent, la mission a dû compter avec les aléas saisonniers, les pistes étant passables en été mais impraticables à la saison des pluies. Les besoins logistiques, par nature considérables pour une opération de cette envergure, en ont été d’autant plus criants et se sont aggravés avec les retards dans la fourniture des matériels nécessaires, et promis, au demeurant en nombre et en qualité insuffisants. De fait, en juillet 2009, les moyens de transports aériens, les hélicoptères, notamment, essentiels sur ce type de théâtre, pour permettre la réactivité de la mission face à la mobilité des menaces, faisaient alors encore cruellement défaut sur le terrain (328). Les mois passant, la situation ne semble pas connaître d’amélioration significative puisque, fin octobre 2009, le Rapport du Groupe de haut niveau présidé par Thabo Mbeki signalait encore que seule l’Ethiopie avait fourni les hélicoptères prévus, dont le déploiement a été accepté par le gouvernement du Soudan en avril 2007… (329)
A ce dénuement matériel, s’est ajoutée la question des ressources humaines qui a amplifié les difficultés et aggravé les retards du déploiement, dans la mesure où il a fallu former, pour les mettre à niveau, aux standards « Nations Unies », les contingents africains fournis par les pays contributeurs, qui pour la première fois, participaient à une opération de maintien de la paix de l’ONU. En d’autres termes, en avril 2009, près de deux ans après le vote de la résolution 1769, si 67 % des troupes étaient certes déployées sur le terrain, 67 % de l’efficacité n’était pas encore atteints, de l’aveu même des responsables de l’UA, pour lesquels seuls les contingents du Nigeria et du Rwanda correspondaient réellement aux critères onusiens.
En d’autres termes et très concrètement, s’est posé avec la MINUAD le problème de l’adéquation de la volonté politique de la communauté internationale à la réalité (330) : en l’espèce celui d’une force de maintien de la paix voulue comme essentiellement africaine alors que les capacités des pays concernés sont loin de leur permettre de fournir les personnels et les équipements nécessaires, sinon obsolètes, pour assurer le rôle qu’ils se sont engagés à assumer devant l’UA, sauf à démunir celui de leurs propres forces armées (331).
Dans la mesure où, parallèlement à ces réalités, la MINUAD a eu à affronter une situation politique et militaire tendue sur le terrain, on conçoit la difficulté d’exécuter le mandat fixé, ne serait-ce que pour assurer la sécurité des civils ou même la propre sécurité des troupes internationales. Cette période a été celle au cours de laquelle le gouvernement soudanais, et parfois les forces rebelles, n’ont cessé de mettre les pires obstacles politiques, administratifs et militaires au déploiement de la Mission, saisissant un hélicoptère, refusant la présence des contingents de tel pays occidental, la Norvège par exemple, ou l’accès des camps de déplacés aux troupes de la MINUAD, qui deviendront elles-mêmes des cibles militaires à leur tour. La sécurité de la MINUAD deviendra d’ailleurs une préoccupation majeure après la demande de mandat d’arrêt formulée par le procureur de la CPI, Luis Moreno Ocampo, en juillet 2008.
Néanmoins, si l’intensité du conflit a considérablement diminué, le déploiement de la MUAS puis de la MINUAD y sont malgré tout pour une bonne part : les belligérants ont dû compter avec la présence de la communauté internationale sur le terrain, quels que soient les difficultés que celle-ci a rencontrées dans la mise en œuvre des mécanismes qu’elle a prévus. Malgré ses difficultés, la MINUAD a su faire face aux menaces du gouvernement soudanais et a pu contribuer à la protection des populations civiles du Darfour. Elle a pu d’autant mieux le faire que, la situation au cours de cette période n’a pas exigé, malgré certains pics, le déploiement de l’ensemble des moyens prévus, en ce qu’elle a coïncidé avec une baisse progressive de la tension.
Pour autant, il faut également rappeler que la MINUAD est la première mission conjointe menée entre les Nations Unies et l'Union africaine. Cet aspect doit aussi être salué à sa juste valeur, ne serait-ce que parce que cela contribue – la Mission étant essentiellement africaine – au renforcement de l'Union africaine souhaité par la communauté internationale, tant au plan politique qu’institutionnel ou opérationnel.
2) L’échec du Darfur Peace Agreement, DPA
Après avoir été parmi les premières au début des années 1990 à offrir ses services pour la résolution du conflit entre le Nord et le Sud, la diplomatie nigériane se proposa de nouveau d’abriter les pourparlers inter-soudanais pour résoudre la crise du Darfour. A l’instar de ses médiations antérieures, mais pour d’autres raisons, celles-ci ne rencontrèrent pas non plus le succès qu’elles escomptaient.
Dans la foulée des tentatives de cessez-le-feu, la négociation pour le Darfur Peace Agreement (DPA) a été la première à tenter de régler les problèmes de fond à l’origine du conflit. En ce sens, l'Union africaine, qui a piloté les rencontres d’Abuja entre rebelles et gouvernement soudanais, avait d’une certaine manière pris la mesure du CPA entre le Nord et le Sud Soudan, sans peut-être toutefois en tirer toutes les conséquences.
De fait, l’architecture du DPA reprend en grande partie celle du CPA et le document est articulé en plusieurs accords thématiques.
Un premier aspect a posé les bases d’un arrangement sécuritaire qui portait à la fois sur la question du cessez-le-feu mais aussi sur les étapes ultérieures, notamment l’intégration des troupes rebelles dans les forces armées, la démobilisation, ou encore le désarmement. Les divergences entre le gouvernement et les rebelles sur ce volet des négociations ont été considérables pour de multiples raisons. En premier lieu, parce que d’autres cessez-le-feu avaient été signés préalablement au cours des mois précédents, que Khartoum se refusait à réviser. En second lieu, car la question du désarmement des combattants imposait à Khartoum de reconnaître ses liens avec les janjawids et de s’engager à les démilitariser, alors même que son argumentation considérait encore à l’époque le conflit comme ethnique, intertribal et non politique. Certaines des divergences furent suffisamment aplanies toutefois pour permettre aux revendications de la branche Mini Minawi du SLM de signer l’accord, notamment quant à l’intégration de leurs propres forces dans l’armée soudanaise.
La question du partage des richesses est évidemment cruciale, compte tenu de la part que le déséquilibre régional et la marginalisation du Darfour ont eu dans le déclenchement du conflit et de l’importance qu’y attache entre autres le JEM, dont le Livre noir avait, peu avant le déclenchement des hostilités, mis en avant les déséquilibres et le sous-développement du Darfour. En conséquence, l’ensemble des questions est traité dans le texte de l’accord, qui se présente, à l’instar du CPA, comme un texte global, inclusif, traitant non seulement la résolution du conflit du Darfour mais l’inscrivant plus justement dans la problématique soudanaise d’ensemble. Il propose un rééquilibrage socioéconomique en faveur du développement du Darfour. A cet effet, des institutions, tel un Fonds de développement et de reconstruction du Darfour, sont créées et les moyens économiques et financiers sont prévus, moyennant des transferts financiers annuels de la part du gouvernement de Khartoum, une commission d’évaluation devant suivre l’application des mesures prévues. Une commission de compensation est aussi instaurée, chargée de venir en aide aux victimes du conflit, que le gouvernement s’engage à abonder.
En ce qui concerne la question du partage du pouvoir, la place d’une représentation spécifique darfouri au sein des institutions politiques nationales est centrale dans le schéma qui s’est dessiné à Abuja. C’est peut-être finalement la raison première de l’échec de ce processus. Ici aussi, ce thème est entré en résonance avec le texte du Comprehensive Peace Agreement, que les sudistes et le gouvernement venaient alors de conclure à Naivasha. Cette partie de la négociation fut parmi les plus conflictuelles dans la mesure où, précisément, la répartition des postes au sein de l’exécutif national venait d’être réglée par le CPA, sans qu’il soit fait de place particulière au bénéfice des représentants du Darfour. En d’autres termes, surgissait d’une certaine manière dans cette tension sur ces aspects spécifiques, et essentiels, un effet pervers de la prétention du SPLM/A de John Garang à conduire un projet politique pour l’ensemble du Soudan sans pour autant daigner y associer les premiers intéressés. Le fait aussi que le SPLM appartienne à la fois au gouvernement d’union nationale, tout en étant en opposition, ne facilitait pas non plus sa position sur un autre conflit périphérique (332). Une véritable avancée sur la revendication des rebelles darfouri aurait nécessairement supposé un retour en arrière sur le texte du CPA si péniblement obtenu, pour le réviser. Cette question était d’autant plus vive que le JEM tout comme le SLM d’AbdelWahid al-Nour, se positionnaient tous deux également en faveur d’une transformation nationale du Soudan, et ne prétendaient pas simplement régler une supposée « question » du Darfour. Consécutivement, l’impossibilité pour les négociateurs de dépasser le cadre du CPA et de revenir sur ce que le gouvernement et le SPLM avaient accordé, et notamment le partage politique des sièges dans les différentes instances, entre le PCN, parti dominant du Nord, et le SPLM, conduisait le processus à un échec certain.
En complément de cet aspect, essentiel, d’autres questions institutionnelles étaient à régler, sans doute moins épineuses, mais néanmoins importantes, telles que la place des darfouri dans les administrations et institutions nationales, le statut du Darfour, comme région unique, la détermination de ses limites géographiques et les structures administratives et politiques du Darfour même.
Même si les revendications des rebelles n’ont pas été satisfaites sur plusieurs points, c’est sans doute sur cette question institutionnelle et politique que le DPA a achoppé essentiellement. Quoi qu’il en soit, en fin de négociations, le SLM/A d’AbdelWahid al-Nour refusa de signer l’accord, arguant également du fait que les avancées obtenues tant au plan des arrangements de sécurité que du Fonds de compensation des victimes étaient insuffisants. Le JEM de Khalil Ibrahim, pour sa part, mit l’accent sur le traitement de la marginalisation de la région, tant politique que sociale et économique, insuffisant pour que les racines du conflit disparaissent. Il refusa de signer également (333).
b) Comment rebondir sur un échec ?
Quelques temps auparavant, en février, AbdelWahid al-Nour avait reconnu la divergence de positions entre son mouvement et le JEM et l’impossibilité pour les rebelles de négocier avec le gouvernement sur des bases communes. Son propre mouvement, le SLM, se scinda aussi en deux au cours de la phase finale des négociations, puisque, seul parmi les délégations rebelles, Mini Minawi quitta le SLM pour signer le DPA, avant d’ailleurs peu après de basculer résolument dans le camp de Khartoum jusqu’à retourner les armes contre ses anciens compagnons de lutte.
D’une certaine manière, comme on a pu l’analyser, le DPA aura agi comme un révélateur de tensions au sein des mouvements insurrectionnels dont il aura contribué à accélérer les divisions sur des bases ethniques (334).
Selon diverses analyses, le processus de négociation a pu être mal conduit face à des mouvements rebelles et un gouvernement qui avaient chacun leur agenda à défendre vis-à-vis de la communauté internationale, compte tenu de ce qui se jouait par ailleurs. A aucun moment, semble-t-il, on ne s’est trouvé à Abuja dans le cadre d’une démarche véritablement constructive de la part des belligérants. Les combats, particulièrement, se sont poursuivis sans relâche au long de ce processus, qui ont sans doute contribué à ce que l’attention de la communauté internationale continue de se focaliser essentiellement sur l’aspect humanitaire et sécuritaire plus que sur la résolution politique du conflit.
Enfin, last but not least, pour équilibré et positif qu’il ait pu alors paraître à certains, cet accord, contrairement à ce que les promoteurs du processus avaient cru lors des négociations d’Abuja, n’a pas été validé par les populations des camps consultées, comme prévu par le texte de l’accord. Le processus s’est donc déroulé entre négociateurs, sans que les victimes du conflit aient été associées, ni même informées de ce qui allait leur être proposé. Comme le dira ultérieurement le Rapport du groupe de travail présidé par Thabo Mbeki, « en l’absence de compréhension de la part de la population, ni même d’un soutien, le DPA fut tout de suite largement condamné au Darfour. » (335)
Uniquement signé entre le gouvernement et Mini Arkoi Minawi, le DPA, comme on pouvait s’y attendre, n’a pas été appliqué, ou si peu. Mini Minawi, au titre de ses fonctions de président de l’autorité intérimaire du Darfour (TDRA), reproche encore à Khartoum de ne pas transférer les fonds prévus, mais on imagine mal le gouvernement central, toujours en guerre contre les rébellions, appliquer de son propre chef les dispositions d’un accord non accepté par l’ensemble des parties.
Dans un premier temps, les Nations Unies et l’Union africaine ont multiplié les initiatives pour tenter de sauver cet accord. Des ultimatums ont été posés aux mouvements qui avaient refusé de signer le texte pour qu’ils y souscrivent. La position de la France, qui avait joué un rôle important dans les négociations d’Abuja, à la différence de ce qui s’était passé à Naivasha, a également œuvré en ce sens. Elle a par exemple poursuivi ses médiations bilatérales avec les mouvements rebelles, obtenant du président Denis Sassou Nguésso, alors président en exercice de l’Union africaine, et du président Obasanjo, d’étendre les délais de signature initialement prévus, sans que cela aboutisse (336). Aujourd’hui, Mini Arkoi Minawi, de plus en plus isolé, reste le seul à considérer le DPA comme valable et à demander d’appliquer ce qui a été signé. Tout au plus considère-t-il que la question de la sécurité des populations, que la MINUAD a été incapable d’assurer, faute d’avoir rien compris à la nature du conflit (337), reste à traiter.
Il a fallu plusieurs mois, sur fond de tensions entre mouvements rebelles, pour que l’Union africaine et les Nations Unies revoient leurs stratégies. Elles nommèrent chacune un médiateur, Salim Ahmed Salim, d’un côté et Jan Eliasson de l’autre, dont les initiatives ne furent cependant pas couronnées de succès. Au rejet proprement dit du DPA par les non signataires, qui ne voyaient pas au nom de quoi, sans modifications substantielles, ils reviendraient sur leur refus d’autant que la position négative des populations étaient également connue, s’ajouta une tension croissante sur le terrain, pas exclusivement militaire : Scission des mouvements, en tout cas du côté du SLM, qui gardait néanmoins un soutien populaire important ; montée en puissance militaire du JEM sans qu’elle s’accompagne cependant d’une adhésion des populations ; et revendications émergentes des populations arabes frustrées du Darfour désireuses de ne pas être laissées pour compte même si elles n’étaient pas parties prenantes au conflit.
Au final, les médiateurs, malgré leurs efforts pour associer aussi les gouvernements de la région et donner une dimension plus large au traitement de la crise du Darfour, que ce soit à Arusha, en Tanzanie ou lors de la phase de Syrte, en Libye, ne réussirent pas mieux à faire progresser les pourparlers. A tel point que lorsque Djibril Bassolé, les remplaça en août 2008 comme médiateur conjoint Nations Unies/Union africaine, il privilégiait au début de son mandat la négociation d’un cessez-le-feu sur la reprise d’un processus de paix, qu’il considérait alors comme encore prématuré.
L’extrême complexité de la crise du Darfour, comme celle des autres conflits soudanais, impose d’avoir nécessairement une approche globale des problèmes. A considérer les développements ultérieurs, il apparaît que, sans doute, les négociations d’Abuja n’avaient pas pris suffisamment en compte certains des aspects qui, s’agissant d’un conflit civil, sont essentiels. Ainsi, la question de la réconciliation de la société darfouri était certes abordée, mais dans le cadre des compétences de l’autorité régionale de transition du Darfour, moyennant la création d’un modeste « Conseil de paix et de réconciliation du Darfour ». Celle de la justice et de la lutte contre l’impunité des auteurs des massacres et exactions dont avaient souffert, et continuaient de souffrir les populations, n’était pas non plus traitée à sa juste valeur. Certes, en parallèle, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait déféré au procureur de la CPI la situation au Darfour quelques semaines après avoir reçu le rapport de la Commission internationale d’enquête, et cela peut éventuellement expliquer cette omission.
Il est temps de s’intéresser à ce volet essentiel de la crise du Darfour, dont le retentissement a eu un écho international et dont les développements ont été par certains côtés historiques.
B – La justice ou la paix ? La justice et la paix
C’est la résolution 1593 du 31 mars 2005 qui, deux mois après la remise du rapport de la Commission Cassese, a déféré au procureur de la CPI « la situation au Darfour depuis le 1er juillet 2002 ». C’était la première fois que le Conseil de sécurité prenait une telle mesure. La résolution a été adoptée à l’unanimité moins les quatre abstentions de l’Algérie, du Brésil, de la Chine et des Etats-Unis.
S’il est heureux de voir qu’aucune représentation n’a voté contre la résolution ni n’a, a fortiori, opposé son veto, cette absence d’opposition peine à masquer les divergences quant au fond et les préoccupations qui animent les uns et les autres. A l’évidence, l’idée de justice internationale n’est, au moment du vote de cette résolution, pas la chose la mieux partagée.
1) La procédure devant la Cour pénale internationale : un impératif de justice
Plusieurs éléments doivent être distingués dans le cadre de cette procédure.
La personnalité du président Al-Bachir a donné, en mars 2009, à la procédure de délivrance du mandat d’arrêt international l’écho médiatique que l’on sait et cette décision a eu des répercussions importantes sur l’ensemble du processus de paix. Néanmoins, deux autres responsables politiques avant lui avaient également fait l’objet de mandats d’arrêt lancés par la Cour sur le cas desquels il importe de s’arrêter.
a) L’enquête du procureur Luis Moreno Ocampo
La Commission d’enquête internationale sur le Darfour avait indiqué avoir « identifié 10 agents de haut rang du Gouvernement central, 17 agents des autorités locales du Darfour, 14 membres des Janjaouid, 7 membres de différents groupes de rebelles et 3 officiers d’une armée étrangère (qui ont participé à titre individuel au conflit), qui sont soupçonnés de porter une responsabilité pénale individuelle pour les crimes commis au Darfour. » (338) Elle précisait que cette liste, qui serait remise sous scellés, n’était pas exhaustive et que les noms « d’autres auteurs possibles parmi les Janjaouid qui ont été identifiés » figureraient également. Elle recommandait que les nombreuses informations qu’elle avait recueillies « sur des personnes influentes, des institutions, des groupes de personnes ou des comités qui ont joué un rôle important dans le conflit au Darfour, notamment en planifiant, ordonnant, autorisant et encourageant les attaques », en charge à un titre ou un autre des opérations militaires, de la sécurité nationale et du renseignement, soient transmises à l’instance judiciaire saisie pour qu’une enquête approfondie soit menée sur ces institutions afin de déterminer la responsabilité pénale éventuelle des individus qui ont pris part à leurs activités.
Saisi aux termes de la résolution 1793, et après avoir reçu « 9 caisses de documents et 11 Cdroms », soit plus de 2500 éléments réunis par la Commission, le bureau du procureur Luis Moreno Ocampo a effectué à partir de juin 2005 une enquête de 20 mois, qui l’a conduit à effectuer 105 missions dans 18 pays, jusqu’en février 2007. Sa requête a été déposée devant la CPI le 14 juillet 2008.
Au terme de cette enquête, le procureur est arrivé à la conclusion que, « au Darfour, 35 000 personnes (339) ont été tuées directement lors de telles attaques, l’immense majorité d’entre elles étant originaire des trois groupes ciblés », Four, Masalit et Zaghawa. Etayée d’éléments de preuve permettant de conclure à l’implication de plusieurs hauts responsables soudanais pour des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre commis entre 2003 et 2004, perpétrés lors d’attaques menées conjointement par les forces armées soudanaises et les milices janjawids, la requête a été présentée aux juges de la Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale.
Ahmad Muhammad Harun, en premier lieu, après avoir servi au Sud Soudan à mobiliser les milices tribales dans les années 1990, était à partir d’avril 2003 ministre délégué chargé de l’Intérieur et responsable du « bureau de sécurité du Darfour ». Selon l’enquête du procureur, sa fonction la plus importante à ce titre était la gestion des milices janjawids afin de compléter les effectifs des forces armées soudanaises : « Il a recruté des Milices/Janjaouid en ayant pleinement conscience du fait qu’ils commettraient des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre contre la population civile du Darfour, souvent dans le cadre d’attaques conjointes avec les forces de l’Armée soudanaise. » (340).
Selon la requête du procureur, Ahmad Harun, « à diverses occasions (…) a publiquement reconnu que sa mission était de détruire les groupes ciblés, déclarant que M. Al Bashir lui avait donné le pouvoir de tuer qui il voulait et que « " pour le bien du Darfour, ils étaient prêts à tuer les trois quarts de la population au Darfour, pour qu’un quart puisse vivre. " »
Il est poursuivi au titre de la commission de multiples crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Il est actuellement en fuite. En effet, à la suite de la décision d’inculpation prise par la Cour en avril 2007, le général
Al-Bachir a non seulement proclamé qu’il ne le remettrait jamais à la CPI, mais l’a promu ministre délégué chargé des affaires humanitaires. Au cynisme de la mesure s’ajoute le fait qu’au titre de cette nouvelle fonction Ahmad Harun exerce son autorité sur les populations déplacées des camps et se pose comme l’interlocuteur des forces de la MINUAD et du déploiement des Casques bleus, ou au sein d’un « Comité sur les violations des droits de l’homme au sud et au nord ».
Le deuxième individu poursuivi, Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, alias Ali Kushayb, colonel, commandait au Darfour Ouest des « milliers de Milices/Janjaouid ». A ce titre, aux termes de la requête, il « a dirigé les attaques contre les villages de Kodoom, de Bindisi, de Mukjar et d’Arawala et également mobilisé, recruté, armé et approvisionné en fournitures les Milices/Janjaouid placées sous son commandement ».
Lui est également reprochée la commission de multiples crimes de guerre et crimes contre l’humanité et la CPI a lancé un mandat d’arrêt à son encontre au titre de 51 chefs d’accusation. Il est actuellement en fuite.
Une troisième personne fait l’objet d’une enquête de la part de la CPI, qui n’appartient pas à l’appareil répressif du gouvernement soudanais mais au mouvement rebelle : Bahr Idriss Abu Garda, « président et coordonnateur général des opérations militaires du Front uni de résistance », mouvement dissident du JEM, est en effet accusé d’avoir conduit en septembre 2007 une violente attaque contre une base militaire de la Mission de l'Union africaine au Soudan. Il est à ce titre poursuivi de crime de guerre contre des forces de maintien de la paix. A la différence des deux précédents inculpés, il s’est spontanément présenté à La Haye pour comparaître librement pour une première audience en octobre 2009 (341).
Le dernier responsable soudanais pour lequel l’enquête du procureur Luis Moreno Ocampo a conduit au lancement de poursuite est le président de la république, le général Omar Al-Bachir.
b) L’affaire « Le procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir »
Le « cas » Al-Bachir a évidemment une importance particulière dans la phase judiciaire de la résolution du conflit, eu égard aux fonctions occupées par l’intéressé. Comme le précise la requête du procureur, « un conflit armé existe au Darfour depuis 2003. Le Gouvernement a le droit d’user de la force pour se défendre contre des insurgés. Cependant, les crimes visés par la présente requête ne constituent pas les dégâts collatéraux d’une campagne militaire. Tout au long de la période visée par la présente requête, M. Al Bashir a, de façon spécifique et à dessein, pris pour cible des civils qui ne prenaient part à aucun conflit dans l’intention de les détruire, en tant que groupe. »
S’il n’est pas reproché au président Al-Bachir, à la différence des précédents inculpés, d’avoir « commis physiquement ou directement l’un ou l’autre de ces crimes », sa responsabilité est mise en cause en raison des fonctions qu’il exerce : « Tout au long de la période visée par la présente requête, M. Al Bashir a été le Président de la République du Soudan, exerçant une autorité souveraine à la fois en droit et en fait, Chef du Parti du Congrès national et commandant en chef des forces armées. Il est au sommet de la structure hiérarchique de l’État, qu’il dirige personnellement, et assure l’intégration des milices/Janjaouid au sein de cette structure. C’est lui qui a planifié les crimes allégués. Il exerce un contrôle absolu. »
C’est pour cette raison que sa responsabilité individuelle doit être retenue. Selon la requête du procureur Luis Moreno Ocampo, le président Al-Bachir a mené une politique tant civile que militaire, pour lutter, « depuis qu’il a pris le pouvoir en juin 1989 (…) tant à Khartoum quʹaux confins du Soudan contre des groupes qu’il considère comme des menaces pour son autorité » (342) Cette politique, généralisée, s’est étendue à partir de 2003 au Darfour où le général Al-Bachir « a estimé que les Four, les Masalit et les Zaghawa, en tant que groupes dominants sur la scène sociale et politique de cette province, constituaient une telle menace : ils remettaient en cause la mise à l’écart économique et politique de leur région et des membres de ces trois groupes se sont engagés dans des rébellions armées. »
En conséquence de quoi, selon l’argumentation du procureur, « M. Al Bashir a entrepris de réprimer ces mouvements par la force des armes et, au fil des années, il a également eu recours à une politique consistant à exploiter les griefs réels ou perçus comme tels entre les différentes tribus luttant pour prospérer malgré les difficultés ambiantes au Darfour. Il a encouragé l’idée d’une polarisation entre les tribus favorables au Gouvernement, qu’il a qualifiées " d’arabes ", et les trois groupes qu’il estimait être les principales menaces, qu’il a qualifiés de " zourgas " ou " africains ". (…) En mars 2003, après l’échec des négociations et des actions armées menées pour mettre fin au Darfour à une rébellion dont les membres appartenaient pour la plupart aux trois groupes ciblés, M. Al Bashir a décidé de détruire en partie les groupes Four, Masalit et Zaghawa sur la base de leur appartenance ethnique et a entrepris de le faire. Ses motivations étaient, avant tout, politiques. Il prenait le prétexte de la " lutte contre l’insurrection ". En fait, il visait le génocide. » (343)
En d’autres termes, à la différence notable des conclusions de la Commission d’enquête internationale sur le Darfour, pour le bureau du procureur, le président Al-Bachir, et son gouvernement, ont mené sciemment une politique génocidaire au Darfour. L’intentionnalité était précisément l’élément que la Commission Cassese n’avait pas cru devoir déceler au cours de son enquête, et qui faisait à son avis défaut pour que le crime de génocide soit retenu à l’encontre des responsables soudanais. En revanche, Luis Moreno Ocampo fonde son argumentation sur le fait qu’il y a bien un plan à la base de la répression au Darfour, élaboré par Al-Bachir qui en contrôle et dirige les auteurs et l’exécution : « La commission de ces crimes à cette échelle, et pour une si longue période, le ciblage des civils et particulièrement des Four, des Masalit et des Zaghawa, l’impunité dont jouissent les auteurs, et la couverture systématique des crimes au travers de déclarations publiques officielles, constituent la preuve qu’il s’agit d’un plan fondé sur la mobilisation de l’appareil d’État, y compris les forces armées, les services de renseignements, les services d’information publique et démocratique et le système judiciaire. »
Outre les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, le procureur Moreno Ocampo retient également l’accusation de crime de génocide à l’encontre du président soudanais. Il la retient au titre de différents aspects de ce crime, à savoir : le meurtre intentionnel des membres des groupes ciblés ; le sort réservé aux personnes déplacées ; l’atteinte grave à l’intégrité mentale des membres des groupes ciblés ; et enfin, la soumission intentionnelle à des conditions d’existence devant entraîner la destruction physique totale ou partielle d’un groupe.
Les crimes contre l’humanité sont également à retenir contre
Al-Bachir, selon le procureur, s’agissant « des meurtres, des viols, des déplacements forcés et l’extermination des membres des groupes ciblés et autres groupes ethniques moins nombreux comme les Tunjur, les Erenga, les Birgid, les Misseriya Jebel, les Meidob, Dajo et les Birgo. » Si les attaques lancées contre ces groupes ont été menées pour des motifs discriminatoires, en revanche, les éléments de preuve sont insuffisants au moment du dépôt de la requête pour étayer l’accusation de génocide à leur encontre. L’accusation de crimes de guerre se fonde essentiellement sur le fait que le gouvernement a pris part à une campagne militaire menée au Darfour contre les forces armées rebelles, à l’aide des milices janjawids et que de nombreux pillages et destructions de villes et villages ont eu lieu dans ce cadre, ce qui, au regard du droit international, est constitutif de crimes de guerre.
En résumé, « le comportement de M. Al Bashir constitue à la fois un génocide à l’encontre des ethnies Four, Masalit et Zaghawa, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre contre une population civile dans la région, y compris les membres des groupes ciblés. »
c) La décision de la chambre préliminaire I et ses suites
Le 4 mars 2009, la Chambre préliminaire I de la CPI a rendu deux décisions, la décision proprement dite sur la requête du procureur aux fins de poursuite et le mandat d’arrêt international.
La Chambre préliminaire I a émis un mandat d’arrêt à l’encontre du général Al-Bachir fondé sur sept chefs d’inculpation : deux pour crimes de guerre et cinq pour crimes contre l’humanité. La Chambre a recommandé l’arrestation pour garantir que l’intéressé comparaîtra devant la Cour, ne fera pas obstacle à l’enquête en cours concernant les crimes dont il serait responsable au sens du Statut, ni n’en compromettra le déroulement et ne poursuivra pas l’exécution des crimes susmentionnés.
En revanche, la chambre n’a pas retenu le chef de génocide, alors même que, dans les attendus de son mandat d’arrêt, elle estimait qu’« il y a des motifs raisonnables de croire : i) qu’Omar Al Bashir tenait un rôle qui dépassait la coordination de l’élaboration et de la mise en oeuvre du plan commun ; ii) qu’il avait le contrôle total de toutes les branches de " l’appareil d’État " du Soudan, notamment des Forces armées soudanaises et de leurs alliés des milices janjaouid, des forces de police soudanaises, du Service du renseignement et de la sécurité nationale et de la Commission d’aide humanitaire ; et iii) qu’il a utilisé ce contrôle pour assurer la mise en oeuvre du plan commun » (344).
En d’autres termes, les juges de la Chambre préliminaire partagent les conclusions du procureur Moreno Ocampo quant à réalité de l’intentionnalité des crimes commis par Al-Bachir, indispensable selon la Commission d’enquête pour qu’il y ait génocide, mais elles refusent néanmoins de le suivre dans sa requête sur ce point. Il ne faut pas y voir, selon vos rapporteurs de divergence d’interprétation ni d’analyse : leur décision se fonde sur le fait que, s’il y a des preuves indéniables, directes, y compris dans la politique menée par le gouvernement soudanais bien avant 2003, d’une politique de discrimination à l’encontre des populations du Darfour, notamment vis-à-vis des Four, les éléments fournis par le procureur à l’appui du crime de génocide ne sont en revanche que des indices, insuffisants pour pouvoir étayer l’intention de génocide de manière indiscutable devant la Cour (345).
Cette position a fait l’objet d’une opinion dissidente de la part de l’une de trois juges de la Chambre préliminaire, Anita Ušacka, qui a produit un mémoire dans lequel elle argumente au contraire que les preuves lui semblent suffisantes pour que le crime de génocide puisse être retenu. Le procureur Luis Moreno Ocampo a fait appel de la décision de la Chambre préliminaire, pour que le génocide soit retenu. Le 3 février 2010, la Chambre d’appel a annulé, à l’unanimité, la décision rendue le 4 mars 2009 par la Chambre préliminaire I, « en ce que celle-ci avait décidé de ne pas délivrer de mandat d’arrêt à raison de la charge de génocide. La Chambre d’appel a demandé à la Chambre préliminaire de statuer à nouveau sur la question de savoir si le mandat d’arrêt devrait être élargi de façon à couvrir cette charge. » (346). C’est sur ces considérations de procédure que la Chambre d’appel s’est prononcée, estimant que les modalités d’administration de la preuve qui étaient exigées du procureur étaient trop strictes. La décision de la chambre d’appel ne se prononce donc pas sur le fond et la question de la réalité d’un génocide au Darfour reste pendante. Il appartiendra à la Chambre préliminaire, lors du nouvel examen de l’affaire auquel elle procèdera de se déterminer au vu des éléments de preuves que lui apportera le procureur.
De sont côté, interrogé par ailleurs (347) sur la question du manque de preuves concrètes et intangibles apportées pour appuyer juridiquement son accusation, Luis Moreno Ocampo avait précisé que les intentions se prouvent par des faits et rappelé que, à cet égard, l’enchaînement mécanique des événements tragiques du Darfour, qui a débuté peu après que Al-Bachir eut demandé publiquement à ne voir que « de la terre brûlée » et qu’aucun prisonnier ne soit fait, ainsi que l’utilisation des moyens de l'Etat au long de cette crise, confirmait amplement l’intention génocidaire.
2) Le mandat d’arrêt contre Al-Bachir : un risque pour la paix ?
On le sait, la procédure engagée devant la CPI n’a pas été sans provoquer de fortes réactions internationales, d’ordre très divers. Les plus spectaculaires l’ont été du fait du Soudan même et du président Al-Bachir lui-même qui l’an dernier a nargué pendant plusieurs semaines la communauté internationale.
Cela étant, le travail de la CPI et de son procureur a pu susciter quelques interrogations, qui, aux yeux de vos rapporteurs, sont légitimes et méritent d’être discutées.
Il n’est évidemment pas question ici de remettre un seul instant en cause la légitimité de la justice internationale et le fait que la lutte contre l’impunité des dictateurs soit une avancée majeure du droit international. Vos rapporteurs plaident tout au contraire pour un renforcement, si faire se peut, de cette juridiction. En revanche, le lancement d’un mandat d’arrêt international à l’encontre du président Al-Bachir au cours du processus de paix soulève la question de l’opportunité de ce type de décision et de la conciliation entre processus de paix et lutte contre l’impunité.
a) Les réactions : provocations et défis
Dans les premières semaines qui ont suivi l’émission du mandat d’arrêt international, les réactions soudanaises ont été très dures, tant au plan interne que sur la scène internationale.
Elles n’étaient pas pour surprendre, dans la mesure où, pendant les mois précédents cette décision, à partir du moment où Luis Moreno Ocampo avait annoncé son intention de demander l’inculpation du président soudanais pour génocide, le gouvernement avait multiplié les invectives à la communauté internationale, promoteurs de la CPI comme travailleurs humanitaires ou forces de maintien de la paix. Avant même que la décision de la CPI ne soit connue, la rhétorique soudanaise avait aussi porté sur la réactivation de certains des thèmes les plus sensibles que le Soudan avait voulu faire oublier, notamment celle du terrorisme islamiste. C’est ainsi que Saleh Abdallah Gosh, alors puissant chef du service national d’intelligence et de sécurité, avait menacé les soutiens de la Cour d’une résurgence du fondamentalisme islamique au Soudan.
Au plan interne et, par conséquent, au Darfour même, le gouvernement soudanais a mis ses menaces à exécution en prenant la décision d’expulser immédiatement treize ONG étrangères qui opéraient sur le terrain humanitaire en appui aux populations déplacées vivant dans les camps. Cette décision, entre autres fondée sur l’argument selon lequel ces ONG collaboreraient avec la CPI et lui fourniraient des informations au lieu de se consacrer exclusivement à leur mandat, s’est accompagné d’une « volonté » de « soudanisation » de l’aide humanitaire. Argumentée sur le thème de la capacité suffisante des ONG et des services sociaux nationaux, elle a tenté de substituer des associations nationales aux ONG au personnel expatrié.
Médecins sans Frontières (Pays-Bas et France), Action contre la faim, Oxfam, CHF international, CARE international, Solidarities, Mercy Corps, Save the Children (Etats-Unis et Royaume uni), The Norweigan Refugee Council, the International Rescue Committee, ont notamment été concernées et se sont vues octroyer un délai de 24 heures à partir du 4 mars pour que leur personnel international quitte le pays. L’inquiétude a notamment surgi du fait que, si quelque 85 ONG internationales opéraient alors au Darfour, plus de la moitié de l'assistance délivrée l’était par ces 13 ONG, qui représentaient par ailleurs aussi 40% des travailleurs humanitaires, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA. La crainte d’une catastrophe humanitaire supplémentaire a par conséquent été vive, dans la mesure où, dans nombre de cas, seule l’aide internationale apporte l’assistance nécessaire et assure la couverture des besoins sanitaires, notamment médicaux à la population réfugiée dans les camps. La crainte d’une crise alimentaire a également été ravivée, la survie de quelque 1,1 million de personnes dépendant de la distribution de l’aide alimentaire. Plusieurs milliers d’enfants, 7000 environ, étaient alors en effet considérés comme modérément ou sévèrement mal nourris et les risques qu’ils encouraient étaient évidemment accrus du fait de la décision du gouvernement.
Au plan international, le président Al-Bachir pouvait être arrêté à tout moment dès sa sortie du territoire soudanais, dans la mesure où, aux termes de l’article 86 du Statut de Rome, les Etats partie ont une obligation de coopération avec la CPI, que le Conseil de sécurité des Nations Unies avait renforcée dans sa résolution 1593 en demandant « instamment à tous les États et à toutes les organisations régionales et internationales concernées de coopérer pleinement ».
La décision de la CPI a été l’occasion pour le président soudanais de plusieurs provocations. Après avoir tout d’abord été au Darfour danser sur la plateforme d’un 4 x 4 devant les caméras de télévision, le lendemain même de son inculpation, le général Al-Bachir a multiplié les voyages dans les premières semaines, se faisant recevoir avec tous les honneurs par plusieurs chefs d’Etat arabes amis du Soudan. Sa participation au 21e sommet de la Ligue arabe au Qatar, à Doha, à la fin du mois de mars, en a été l’événement le plus spectaculaire, puisque l’organisation, à l’unanimité des participants, lui a apporté son soutien. Ce dernier déplacement concluait un mois de mars intense : auparavant, le président Al-Bachir s’était empressé de se rendre en Erythrée, en Egypte, qui avait tenu à manifester sa solidarité avec le Soudan à ce moment, puis finalement en Libye, à Syrte, où le président en exercice de l'Union africaine, le colonel Kadhafi, l’avait invité le 26 mars au motif de discuter des initiatives de paix.
Sans surprise, de manière systématique, l’illégalité de la décision de la CPI a été notamment réaffirmée par les hôtes du général Al-Bachir, qui ont insisté les uns après les autres sur le fait qu’ils n’arrêteraient pas le président soudanais.
Ces diverses réactions, quelque peu matamore, ne sauraient étonner. On peut y voir un réflexe nationaliste, de solidarité autour du chef assiégé. Des manifestations de soutien au président ont bien sûr été organisées par le pouvoir à Khartoum. Des personnalités pourtant peu proches du président Al-Bachir, tel Lam Akol, même si par le passé il avait déjà eu l’occasion de se rapprocher du Nord, avaient même pris les devants : dès 2007, alors ministre des affaires étrangères, il avait affirmé que la décision de la CPI serait nulle et non avenue (348).
Il est plus intéressant, selon vos rapporteurs, de s’intéresser à la réaction internationale à la décision de la CPI, en ce qu’elle révèle de divisions.
b) Une justice internationale à deux vitesses ?
Schématiquement, les réactions des pays du Sud tournent autour de deux thèmes. La CPI serait l’instrument d’une justice à deux vitesses, celle de l’Occident contre l’Afrique, dont les dirigeants ne subissent pas le même traitement, dans la mesure où, seuls, des dirigeants africains sont mis en cause. C’est la critique du colonel Kadhafi notamment, qui accuse la CPI de mener une politique de « deux poids deux mesures » en ciblant les Etats africains et le Tiers Monde. D’une manière générale, c’est aussi celle qu’émettent les pays de la Ligue arabe, de l’Union africaine, qui déclarent n’être certes pas opposés à un système judiciaire international, encore moins à la lutte contre l’impunité, mais à tout prendre, préférer une juridiction africaine.
Plusieurs présidents se positionnent sur cette argumentation, au premier rang desquels Paul Kagamé. Le président du Rwanda eu l’occasion de dire qu’il n’exécuterait pas le mandat d’arrêt contre Al-Bachir, en précisant qu’il n’était pas « opposé par principe à la justice internationale, ni parce que les chefs d’État sont au-dessus des lois, encore moins parce qu’Al-Bachir serait a priori innocent des crimes qu’on lui reproche, mais parce (…) ce n’est pas avec elle [la CPI] qu’une justice mondiale impartiale et équitable pourra être rendue. Le problème n’est pas que seuls des Africains aient été jusqu’à présent traduits devant cette cour. C’est un épiphénomène. Le problème est que, dès le début, on a pu voir, sentir, détecter derrière sa façon de fonctionner un mélange d’agenda et de manipulation politiques des riches contre les pauvres. Je suis pour les tribunaux pénaux internationaux spécifiques sous la houlette de l’ONU, comme celui d’Arusha sur le Rwanda, celui sur la Sierra Leone, sur l’ex-Yougoslavie et pourquoi pas, demain, celui sur le Darfour. Eux au moins ont des mandats clairs et savent de quoi ils parlent. Mais je suis contre les magistrats omniscients et omnipotents de la CPI » (349).
Jean Ping, président de la commission africaine, aura des propos d’une tonalité semblable : « Nous constatons que la justice internationale ne semble appliquer les règles de la lutte contre l’impunité qu’en Afrique comme si rien ne se passait ailleurs, en Irak, à Gaza, en Colombie ou dans le Caucase. » (350) .
En revanche, Mgr Desmond Tutu, autorité morale incontestée sur le continent s’il en est, fera alors remarquer, désabusé, (351) que « au lieu de condamner le génocide au Darfour, l’organisation choisit de souligner sa préoccupation quant au fait que les dirigeants africains étaient injustement montrés du doigt et de soutenir les efforts du président Al-Bachir pour retarder le processus de la Cour ».
Chacun sait que cette perception du travail de la CPI est biaisée, pas forcément partagée par tous les pays du Sud. La Tanzanie et le Bénin, tout d’abord, membres du Conseil de sécurité en mars 2005, ont par exemple voté la résolution. Cela étant, il faut toutefois convenir à cet égard, que la formulation de la résolution 1593 du Conseil de sécurité des Nations Unies a sans doute inutilement conforté les opposants à la CPI. Il n’est que de lire les débats du Conseil de sécurité du 31 mars 2005 pour voir que l’ensemble des arguments des pays du Sud développés à partir de mars 2009 y sont déjà développés et que les précautions prises pour garantir que les ressortissants de certains pays contributeurs ne pourront en aucune manière être déférés à la CPI n’avaient laissés personne dupe.
Cela étant, force est aussi de constater que si plusieurs Etats africains ou membres de la Ligue arabe avaient menacé dans les semaines qui ont suivi la décision du 4 mars 2009, de se retirer de la Cour, à ce jour, aucun n’a encore mis sa menace à exécution. l'Union africaine a certes adopté une résolution en juillet 2009 aux termes de laquelle les Etats membres ne collaboreraient pas avec la CPI pour arrêter Al-Bachir, mais certains, tel le Botswana ou l’Afrique du sud indiquaient immédiatement qu’ils maintenaient leur coopération avec La Haye et arrêteraient le président soudanais s’il venaient sur leur territoire.
Le procureur Luis Moreno Ocampo est par conséquent peut-être en passe de réussir son pari, qui espérait que l’émission du mandat d’arrêt produirait un effet mécanique d’isolement international du général Al-Bachir. Certains des interlocuteurs de vos rapporteurs – tel Salih M. Osman (352), prix Sakharov pour la liberté de penser 2007, député communiste à l’Assemblée nationale du Soudan –, partagent ce sentiment, estimant par exemple fort probable un lâchage du général Al-Bachir par la Chine, soucieuse de protéger ses intérêts. De fait, après une phase de fanfaronnades, les déplacements internationaux de Al-Bachir se sont considérablement ralentis. Il est notamment significatif qu’il ait renoncé ces derniers mois à se rendre en Ouganda et surtout au Nigeria, alors même que fin octobre s’y déroulait une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à propos du Darfour. Il ne s’est pas non plus rendu à la réunion de la Conférence islamique qui s’est tenue à Istanbul en novembre dernier et l’on sait enfin que la question de sa présence au sommet franco-africain, prévu pour se tenir en février 2010 à Charm el-Cheikh, en Égypte, a récemment entraîné le report de la rencontre au mois de mai à Paris. Il n’y a qu’en Mauritanie que Al-Bachir s’est finalement rendu à la fin décembre 2009, seul déplacement à l’étranger qu’il ait effectué depuis le mois de mars 2009.
Il n’est inutile d’avancer ici que peut éventuellement s’ajouter à cet effet d’isolement international un isolement interne, au sein même des cercles restreints du pouvoir de l’Inqaz, qui n’est pas forcément très uni malgré les apparences et au sein duquel, semble-t-il, diverses tendances coexistent et s’affrontent.
Pour autant, l’essentiel du débat autour de la décision de la CPI n’est sans doute pas là. Il porte plus profondément sur l’avenir et la pérennité du processus de paix et, plus immédiatement, sur l’incidence que la procédure judiciaire peut ou non avoir sur lui.
c) La justice contre la paix ?...
Plusieurs types de critiques ont surgi, des horizons les plus variés, y compris de personnalités les moins soupçonnables de partialité ou de vouloir ruiner en quelque manière que ce soit la construction d’un système de justice pénale internationale.
La première catégorie de critiques a notamment porté sur la stratégie choisie par le procureur de demander à la cour d’émettre un mandat d’arrêt international public. Le professeur Antonio Cassese, notamment, l’a regretté, dans la mesure où cette décision risquait d’affaiblir la Cour elle-même, incapable de faire appliquer ce mandat. Dans des articles et interventions dans la presse quelques jours après, il regrettait qu’une stratégie plus discrète mais plus efficace n’ait pas été privilégiée, à l’instar de celle que les tribunaux antérieurs avaient mise en œuvre contre d’autres chefs d’Etat, Milosevic et Taylor. Il y voyait aussi un risque pour la crédibilité de l’institution, « un coup d’épée dans l’eau », argumentant que « lorsqu’on n’a pas les moyens de faire respecter ses propres ordres, il serait sage d’agir avec prudence » (353). En d’autres termes, pour l’ancien président du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, au-delà de l’effet médiatique et psychologique, notamment quant à la délégitimation de Al-Bachir, aucun effet pratique n’était malheureusement à en attendre, eu égard au manque de moyen de la Cour. « L’impossibilité d’obtenir l’extradition d’accusés au Soudan constitue un défi considérable pour la crédibilité de la CPI », renchérissait pour sa part Michael Johnson (354).
A cette question de l’inefficacité de la mesure, se sont ajoutées d’autres critiques tenant plus à ses éventuels inconvénients. Inconvénients quant au clivage entre l’Occident et le reste du monde, et en cela, Aryeh Neier, l’un des fondateurs de Human Rights Watch rejoint Hubert Védrine, par exemple, qui a pu estimer que, pour être légale, la décision de la CPI n’était pas forcément légitime, voire même inopportune, en ce qu’« il peut y avoir contradiction entre la lutte contre l’impunité et la résolution d’un conflit. » (355).
De fait l’inculpation de Al-Bachir pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité ou, a fortiori, pour génocide, introduit un élément supplémentaire dans le processus de paix, nécessairement rendu plus complexe, puisque, de facto, l’intéressé se trouve marginalisé et l’ensemble des parties prenantes prises dans un engrenage dont la maîtrise leur échappe. Dans une situation où, en l’espèce, les négociations ont toujours été difficiles, le risque est par conséquent perçu qu’une politique du pire pourrait être conduite par des dirigeants n’ayant plus rien à perdre, voire même tout à gagner en renforçant les opérations militaires et les exactions sur le terrain dont seraient victimes les populations civiles qu’on a prétendu protéger. Cette crainte s’est pour partie révélée fondée avec l’expulsion des ONG.
Toutes choses égales par ailleurs, les propos recueillis par vos rapporteurs, de la part de l’ambassadeur d’Egypte en France par exemple (356), confirment en ce sens ceux que les représentants de l’Algérie ou de la Chine au Conseil de sécurité tenaient lors de l’adoption par le Conseil de sécurité de la résolution 1593 sur ce thème : il importe de ne pas occulter la dimension politique pour sortir de la crise, consécutivement de « satisfaire à l’impératif de paix sans sacrifier l’exigence de justice que nous devons tous aux victimes. » « La paix et la justice ne doivent pas s’affronter », avait immédiatement déclaré Jean Ping mais « les impératifs de justice ne peuvent ignorer les impératifs de paix » (357) Auparavant, l'Union africaine s’était inquiétée à plusieurs reprises des possibles effets pervers de la mise en accusation du président soudanais. Le président de l’UA s’était exprimé devant l’Assemblée générale des Nations Unies dès le 23 septembre 2008 en considérant que le report des poursuites serait la chose la plus opportune à envisager pour éviter de compliquer le déploiement de la MINUAD et la gestion de la crise humanitaire au Darfour, idée reprise quelques mois plus tard par les ministres africains des affaires étrangères, unanimes, ou encore par le Conseil exécutif de l’UA. C’est précisément pour cette raison que l'Union africaine décidait à la fin janvier 2009 de prendre les devants, en confiant une mission à un panel de la paix pour le Darfour, qui serait présidé par Thabo Mbeki, ancien président sud-africain, pour proposer des recommandations sur la question de l’impunité et de la réconciliation.
En d’autres termes, est reprochée à la CPI une focalisation excessive sur quelques personnalités, responsables de la commission des pires crimes, sans voir que son action risque de perturber un processus long et difficile, ainsi qu’une stratégie qui ne prend pas suffisamment en compte les différentes dimensions de la crise et de sa résolution. Djibril Bassolé (358), notamment, s’exprimera en ces termes devant vos rapporteurs, soulignant que l’inculpation risquait d’avoir des conséquences négatives sur les négociations de paix.
C’est contre ce genre d’assertion que Mgr Desmond Tutu s’est précisément élevé défendant l’idée qu’il ne saurait y avoir de paix sans justice et que, quelles que soient les difficultés induites par le processus, ne rien faire serait pire. Il ajoutait (359) que l’émission d’un mandat d’arrêt serait un moment extraordinaire pour le peuple du Soudan et, avec d’autres personnalités africaines, telle Wangari Maathai, prix Nobel de la paix 2004, appelait l'Union africaine et la communauté internationale à soutenir la quête de justice et le travail de la CPI.
Cela étant, quand bien même la procédure engagée par la CPI n’entraverait pas les négociations de paix, il paraît cependant clair aux yeux de vos rapporteurs qu’elle ne saurait être considérée comme suffisante. En d’autres termes, pour essentiel qu’il soit de renforcer la Cour pénale internationale, dans ses moyens ou dans son mandat, - ce qui ne se peut envisager que pour le long terme sans par conséquent avoir d’influence positive sur le traitement de la question du Darfour -, d’autres mécanismes complémentaires sont à envisager.
3) Jeter un pont entre justice et paix : Le Rapport Mbeki
Comme on l’a indiqué, c’est précisément soucieuse de l’articulation essentielle entre paix et justice que l'Union africaine a constitué le panel d’experts de haut niveau à la fin du mois de janvier 2009. Outre Thabo Mbeki, président, le groupe de travail, a été composé des personnalité suivantes : Abdulsalami Abubakar, ancien président de la république du Nigeria ; Pierre Buyoya, ancien président de la république du Burundi, Ahmed El Sayed, ancien ministre des affaires étrangères d’Egypte, Florence Mumba, ancienne juge de la Cour suprême de Zambie, ancienne vice-présidente du TPIY, Kabir Mohamed, ancien conseiller juridique au cabinet du président Obasanjo, Nigeria, et Rakiya Omaar, avocate, fondatrice d’African Rights. Il a rendu son rapport au mois d’octobre 2009.
a) L’insuffisance de la procédure devant la CPI
La Commission d’enquête des Nations Unies sur les crimes du Darfour, on l’a vu, avait remis à la CPI sous pli scellé une liste d’une cinquantaine de noms de responsables civils et militaires soudanais des deux parties, auteurs supposés de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. Cette liste n’était pas exhaustive mais constituait la base sur laquelle la CPI devait enquêter, au vu des preuves rassemblées.
Après 20 mois d’enquête, le procureur Luis Moreno Ocampo a formulé ses requêtes de poursuites pour un nombre infiniment plus réduit de personnes : trois actuellement, qui appartiennent à la sphère gouvernementale, et un, membre de l’un des mouvements rebelles (360). En d’autres termes, trois affaires seulement sont actuellement en cours, cinq ans après que la Cour a été saisie par le Conseil de sécurité. Compte tenu de l’ampleur des effectifs des troupes militaires et surtout janjawids, qui ont participé aux crimes qui ont été commis, comment supposer que les victimes pourraient jamais se contenter de quelques noms, fussent-ils ceux des responsables les plus élevés, pour admettre que justice leur a été rendue ? Comment croire qu’elles n’exigeront pas de sanction contre les exécutants directs de ce qu’elles ont souffert ? Et par, conséquent, comment ne pas convenir que, pour essentiel qu’il soit, ce processus devant la CPI reste dramatiquement insuffisant, à lui seul, pour traiter de la question du Darfour et rendre justice aux victimes ?
Comme l’a justement souligné à cet égard le rapport présenté par Thabo Mbeki, « la question de la justice pour le Darfour est devenue une source de divisions après que la Cour pénale internationale a émis un mandat d’arrêt contre le président Omar Al-Bachir en mars 2009. L’attention portée à la CPI ne doit pas détourner de la réalité car, même à pleine capacité, la CPI ne peut s’occuper que d’une poignée d’individus, abandonnant ainsi le fardeau de la justice au système national. » (361)
Si la lutte contre l’impunité est un volet crucial du retour à une situation apaisée au Darfour, inévitablement la lenteur de la justice internationale ne peut que représenter un problème insurmontable, du point de vue des populations déplacées, des victimes en tout genre des exactions innombrables qui ont été commises lors de ce conflit, compte tenu du très grand nombre de coupables. Consécutivement, des mécanismes complémentaires ou alternatifs doivent impérativement être mis en place.
On sait qu’un génocide ou des crimes contre l’humanité provoquent des traumatismes collectifs dans les sociétés qui en sont victimes qui ne peuvent se refermer qu’après de très longs et difficiles processus de réconciliation. Cette question n’est pas une idée neuve au Soudan : la résolution 1593 l’évoquait déjà il y a cinq ans. En déférant l’affaire du Darfour au procureur de la CPI, elle soulignait qu’il importait aussi de « promouvoir l’apaisement et la réconciliation » et elle encourageait par conséquent « la création d’institutions auxquelles soient associées toutes les composantes de la société soudanaise, par exemple des commissions vérité et/ou réconciliation, qui serviraient de complément à l’action de la justice, et renforceraient ainsi les efforts visant à rétablir une paix durable, avec le concours de l’Union africaine et de la communauté internationale si nécessaire. » Cette suggestion était cependant restée lettre morte. C’est tout l’intérêt des travaux du Groupe de travail de haut niveau d’avoir mis fortement l’accent sur cet aspect essentiel de la résolution du conflit.
b) La nécessité d’articuler justice, paix et réconciliation
L’élément central du Rapport Mbeki peut se résumer en une tentative de synthétiser les différents aspects de la problématique soudanaise, tant du point de vue de la recherche de solutions pérennes qui aient l’agrément des différentes parties prenantes au conflit et de la population que de la méthodologie.
En ce sens, en premier lieu, au-delà de la question du cessez-le-feu, le rapport suggère l’inclusion de toutes les composantes de la société darfouri dans le processus de paix, auquel participeraient par conséquent non seulement le gouvernement et les mouvements rebelles, mais aussi les partis politiques, les déplacés et réfugiés, les organisations de la société civile, les nomades du Darfour et les autorités traditionnelles. Ici, vos rapporteurs ne peuvent omettre de mentionner la différence profonde que cette nouvelle approche présente avec les processus jusqu’à ce jour essentiellement « diplomatiques », tel celui de Doha, dans le cadre duquel les négociations se déroulent entre délégations des rebelles et gouvernement, sous l’égide du médiateur conjoint Djibril Bassolé, appuyé par les partenaires internationaux du processus. Ce processus, qui depuis des mois peine à amener à la table des négociations le SLM de AbdelWahid al Nour et, de ce fait, se réduit à un dialogue difficile entre le JEM et Khartoum, n’a, à l’inverse de la démarche proposée par le Groupe de haut niveau, jamais prétendu associer d’autres parties prenantes, alors même qu’elles ont eu le rôle qu’on a vu dans l’échec d’Abuja. Sans nier l’importance d’un travail de réconciliation, tout au contraire, il se limite aux combattants.
La question cruciale autour de laquelle les propositions du rapport Mbeki sont articulées est celle de la justice et de la réconciliation de la société darfouri. Si le processus enclenché au niveau de la CPI est clairement insuffisant pour permettre que, réellement, la question de la lutte contre l’impunité et la justice envers les victimes soit réglée, des mécanismes complémentaires doivent être envisagés. Il s’agit d’une urgence, selon les conclusions du rapport, qui suggère d’étoffer le système judiciaire national soudanais par la création notamment d’une cour pénale hybride, intégrée par des juges soudanais assistés de juges d’autres nationalités, désignés par l’UA. A cela, s’ajouterait notamment la réactivation des mécanismes de justice traditionnelle et l’instauration d’une « Commission vérité, justice et réconciliation », à l’instar de ce qui a pu être expérimenté tant en Afrique du Sud, après la chute de l’apartheid, qu’au Rwanda, au lendemain du génocide de 1994.
Dans le schéma proposé par le Groupe Mbeki, la priorité est très nettement donnée au système judiciaire soudanais et la justice pénale internationale apparaît en retrait. C’est une démarche qui permet aussi de tenir compte des forces qui s’expriment dans la majorité des pays africains vis-à-vis de la CPI.
Vos rapporteurs sont convaincus qu’une approche holistique est effectivement indispensable, qui puisse prendre en compte les préoccupations de l’ensemble des acteurs et satisfaire au mieux la recherche de solutions et la réparation des dommages et souffrances faits aux victimes. Pour autant, il ne faut cependant pas omettre que les mécanismes soudanais traditionnels de résolution des conflits n’ont cessé d’être mis à mal depuis des décennies par les autorités de Khartoum occupées à diminuer leur rôle et à ruiner leur efficacité. C’est même très probablement pour cette raison que les tensions qui ont surgi les unes après les autres n’ont pu être résolues et n’ont cessé de dégénérer. En parallèle, le système judiciaire soudanais non traditionnel n’a, jusqu’à aujourd’hui, pas apporté la preuve de son efficacité et de sa volonté à régler les différends et, à l’inverse de ce que les autorités n’ont cessé d’affirmer, à traiter la question de l’impunité. En conséquence de quoi, si l’intention est bonne, si l’approche et l’analyse sont parfaitement fondées, la réalité et l’histoire appellent à une certaine prudence. Le gouvernement de Khartoum, au-delà d’éventuelles déclarations d’intentions devrait être jugé sur pièces et sur résultats. A tout le moins, la mise en œuvre de ces propositions requerra de la part de la communauté internationale une assistance considérable au système judiciaire soudanais.
Thabo Mbeki et Jean Ping, lors d’une séance du Conseil de sécurité ont présenté les conclusions des travaux du Groupe de haut niveau. Il est encore prématuré de connaître le détail des positions des membres du Conseil de sécurité sur les propositions du Groupe de haut niveau, le débat qui a suivi leur présentation ayant été tenu à huis clos. Toutefois, la tonalité du communiqué de presse publié à l’issue de la réunion du Conseil ne pêche pas par excès d’enthousiasme : « Les membres du Conseil de sécurité ont accueilli avec satisfaction le rapport et se sont félicités du caractère équilibré et complet des recommandations tendant à promouvoir la paix, la justice et la réconciliation au Darfour et dans l’ensemble du Soudan. Ils ont exprimé l’espoir de voir adopter une approche intégrée des problèmes auxquels se heurtait le Soudan et ont exprimé leur appui aux efforts visant à aboutir à une transformation pacifique et démocratique de ce pays conformément aux dispositions de l’Accord de paix global. Les membres du Conseil de sécurité ont affirmé partager le point de vue exprimé dans le rapport, selon lequel les causes et conséquences du conflit du Darfour n’avaient pas encore été traitées. Ils ont réitéré leur appui… (etc.) » (362)
Indépendamment des réserves que vos rapporteurs ont exprimées quant à la position de ce Groupe sur la justice pénale internationale, sans doute aurait-on pu espérer un soutien immédiatement plus affirmé à des propositions qui traduisent une démarche de dialogue, de recherche de consensus, soucieuse aussi d’appropriation constante de la part des parties soudanaises.
A l’occasion du conflit du Darfour, des questions aussi essentielles que celles de la terre ou du rapport entre communautés, comme entre Arabes et non Arabes, se sont imposées et se sont aggravées au long de ces dernières années. A cet égard, il est important de rappeler qu’une part importante de la communauté arabe du Darfour ne se reconnaît pas dans le régime soudanais, qu’elle considère n’être en fait que celui de trois tribus du Nord, les « Jallaba »,
– Ja’liyya et Chayqiyya –, sans que les autres tribus arabes du reste du pays y soient en aucune manière associées. A fortiori, elles ne se sentent pas complices de la politique menée par Khartoum depuis des décennies. Bien qu’elles n’aient pas pris les armes, ces tribus arabes, notamment celles du Darfour, se considèrent tout autant ostracisées que les communautés Four ou Zaghawa et la prise en compte de leurs revendications devra nécessairement être à l’ordre du jour dans la perspective d’un règlement global et inclusif du conflit. Comment envisager d’apaiser les tensions et, au-delà, réussir à instaurer une pacification durable sans mener à son terme un processus qui associe et prenne en compte les préoccupations des différentes composantes de la société darfouri ? Dans le même ordre d’idées, la composante ethnique est évidemment cruciale. Les équilibres entre Four, Zaghawa, Massalit, pour ne prendre que ceux-ci, doivent être respectés, à tout le moins pris en compte, dans les processus de paix, de dialogue et de réconciliation. On a ainsi pu faire remarquer à vos rapporteurs (363) que la question de la réalité de la représentation de chacun était une donnée essentielle : ainsi, à titre d’exemple, on peut rappeler que la population Zaghawa ne représente que 8% de celle du Darfour, quelques centaines de milliers de personnes sur 7 à 8 millions d’habitants au total. Or, le JEM est cependant à 85 % composé de combattants Zaghawa. Cette réalité n’est donc pas sans poser de problème de représentativité et, au-delà, sans risquer d’hypothéquer les négociations de paix, dans la mesure, où l’opposition entre les deux mouvements rebelles, JEM et SLM, est vive. Dès lors que seul le JEM participe aux négociations de paix de Doha, AbdelWahid al Nour s’y refusant depuis toujours pour des raisons sur lesquelles on reviendra plus loin, l’acceptation des éventuels compromis de paix obtenus sous égide internationale entre rebelles et gouvernement court le risque de n’être considérée que comme partielle, au pire, partiale. Elle est également tout sauf garantie si les Four, entre autres, retirent l’impression que ce qui se négocie se fait sans eux voire même contre eux.
Réussir la paix au Darfour, éviter de répéter l’échec d’Abuja pour des raisons identiques, suppose à la fois de cesser les hostilités et de pacifier les relations communautaires et sociales. Cela suppose nécessairement d’être à l’écoute de toutes les parties prenantes. Comme un interlocuteur de vos rapporteurs le soulignait opportunément : la solution aux problèmes du Soudan sera soudanaise ou ne sera pas. (364) Cette approche n’est sans doute pas partagée par tous : si certains groupes rebelles ont tendance à rechercher l’hégémonie dans le débat, le gouvernement soudanais se charge pour sa part de ruiner les initiatives qui pourraient contribuer à renforcer la société civile darfouri. Un projet de la Fondation Mo Ibrahim a par exemple dû être annulé à quelques jours de sa tenue, en mai 2009, après que le gouvernement eut exercé toutes sortes de menaces sur les délégués darfouri les privant de la possibilité de se rendre à Addis Abeba pour y participer, alors même qu’il était lui-même invité.
C’est la raison pour laquelle vos rapporteurs croient utile que la Commission des affaires étrangères appelle le ministère des affaires étrangères à exprimer son soutien résolu à la démarche du Groupe de haut niveau. Compte tenu de l’importance des moyens qui seront nécessaires à la mise en œuvre de cette politique, il serait opportun également qu’elle prenne l’initiative d’une démarche pour appuyer les besoins importants auxquels le Soudan devra faire face pour que cette réconciliation nationale et la justice soient assurées de la meilleure manière.
C – La communauté internationale en mal de stratégie
On l’aura compris, la communauté internationale, soucieuse de ne pas voir la crise du Darfour s’enfoncer dans une guerre interminable comme celle qu’a connue le Sud Soudan, de voir se répéter un génocide semblable à celui du Rwanda, a sans tarder décidé de prendre les choses en mains pour ne pas se laisser déborder. La rapidité et la vivacité des réactions du Conseil de sécurité sont là pour le confirmer. Celles de l'Union africaine également, qui a même été la première à se saisir du dossier et à prendre des initiatives. En cela, le contraste avec l’inertie qui avait prévalu durant les vingt ans du conflit Nord-Sud est saisissant.
Pour autant, au-delà des difficultés qu’elle a rencontrées, et rencontre toujours, dans la mise en œuvre des opérations de paix, son action diplomatique bute aussi sur un certain nombre de circonstances particulières, qui tiennent à la nature de ce conflit et à ses belligérants, ainsi qu’au contexte régional.
Sans faire l’historique fastidieux du processus de paix concernant le Darfour qui, de rebondissements en enlisements, a connu maints aléas depuis qu’il a été lancé, vos rapporteurs mettront plus particulièrement en avant deux aspects de ce processus qui en rendent l’issue délicate et incertaine.
1) Les rebelles veulent-ils la paix ?
Parmi les principaux obstacles à la négociation et à la recherche de la paix, la désunion des rebelles darfouri est l’un de ceux qui ont les impacts les plus déterminants. D’autres traits caractérisent les forces rebelles, qui ne contribuent pas à rendre le chemin vers la paix aisé.
a) La division des forces rebelles : état des lieux
Depuis quasiment les débuts du conflit, la rébellion darfouri est profondément divisée. C’est l’une de ses caractéristiques principales. Que le SLM et le JEM aient affronté un ennemi commun et participé ensemble aux premières négociations de N’Djamena et d’Abuja, qu’ils aient refusé ensemble de signer le Darfur Peace Agreement, n’a pas suffi à leur faire surmonter leur opposition fondamentale. Cette situation est aggravée par le fait que ce ne sont pas seulement le JEM et le SLM qui sont divisés, mais que des tendances centrifuges sont à l’œuvre au sein de chacun d’eux, sans doute de façon plus nette et avec plus de conséquences en ce qui concerne le SLM.
Le SLM, dès les négociations d’Abuja, soit au tout début de la crise du Darfour, a éclaté en deux tendances rivales, chacun conduite par l’un des deux chefs « historiques » du mouvement : AbdelWahid al-Nour, Four, d’un côté, et Minni Arkoi Minawi, Zaghawa, de l’autre. Si leur opposition a pu pour partie tenir à des conceptions différentes quant à la conduite politique du mouvement et aux options militaires stratégiques à adopter, cette lutte pour le leadership a également des racines ethniques et géographiques que Khartoum a savamment su exploiter. (365) On a vu l’acuité de cette rivalité lorsque Minni Minawi, signataire du DPA, devenu conseiller du président Al-Bachir, s’est rangé aux côtés des forces gouvernementales pour prendre les armes contre la rébellion. Tous les efforts qui ont pu alors être tentés par leurs soutiens respectifs dans la région ont échoué à réunifier les tendances, depuis longtemps irréconciliables.
Le JEM, pour n’avoir pas subi de scission aussi importante, n’en a pas moins été l’objet de quelques ruptures, dès les débuts de son existence, conduites par certains commandants militaires, récusant les liens de Khalil Ibrahim avec Hassan Al-Tourabi et refusant que le mouvement coure le risque de dériver vers le fondamentalisme et le terrorisme international (366).
Ces dissidences au sein de chacun des deux principaux mouvements n’ont cessé de se produire au fil du conflit. Récemment encore, d’autres défections intervenaient au sein du SLM, certains de ses responsables importants, tel Suleyman Jamous, figure historique du mouvement de AbdelWahid al-Nour, rejoignant à son tour le JEM pour essayer de contribuer à la réunification de la rébellion.
Quoiqu’il en soit, aujourd’hui, ce sont près d’une quarantaine de mouvements qui coexistent dans ce conflit, toutes tendances confondues, certains groupusculaires, dont la seule raison d’être est dans doute d’exister, dans une stratégie d’autonomisation et de positionnement permettant d’espérer certains dividendes, financiers ou militaires, de la part des différents promoteurs des processus de paix appartenant à la communauté internationale.
Un rapide survol des quelques années de conflit du Darfour permet ainsi de noter un véritable foisonnement des groupes rebelles, qui n’ont cessé, dans un mouvement de balancier ininterrompu de se séparer pour mieux ensuite fusionner. Ainsi, en 2006, un Front national du Salut regroupa un court temps une vingtaine de mouvements, dont le SLM de AbdelWahid al Nour et le JEM de Khalil Ibrahim. Un Front unifié pour la libération et le développement fut créé en 2007, qui réunit cinq factions dont deux du SLM ; le SPLM sudiste s’essaya aussi à fédérer quelques uns des groupuscules issus du SLM et du JEM à la fin de 2007. Sous l’égide de la Libye, en mars 2009, un « Groupe de Tripoli » a été constitué, rassemblant des dissidents du SLM et du JEM pour rejoindre le processus de négociation à Doha, sur lequel le médiateur conjoint fonda un temps ses espoirs. L’échec de cette tentative n’a pas dissuadé le colonel Kadhafi qui continue de pousser diverses factions dissidentes du SLM de se coaliser sous sa houlette : le « Mouvement de l'armée de libération du Soudan-Force révolutionnaire » qui réunit six mouvements, majoritairement issus du SLM, et près de 120 commandements, s’est ainsi constitué à Tripoli au début de l’année 2010 (367).
On constate depuis l’origine plusieurs phénomènes concomitants et contradictoires : en premier lieu, des dissidences, issues des mouvements initiaux d’origine, qui tentent, - seules ou, plus fréquemment, en y étant incitées, de se fédérer pour espérer accéder au processus de négociation internationale ; dans le même temps, l’échec de ces tentatives d’unification et un fractionnement accru, souvent sur des bases ethniques, aspect particulièrement flagrant en ce qui concerne le SLM/A, dont de nombreux commandants Zaghawa par exemple ont fait défection en 2009 pour rejoindre le JEM ; enfin, dans cet ordre d’idées, un phénomène de transfuges, d’instabilité et de ralliements ou de sécessions, répondant plus à des considérations tactiques ou opportunistes qu’idéologiques (368).
A ce premier aspect qui influe de manière directe et négative sur la tenue des négociations de paix, s’ajoute celui des stratégies des rebelles qui ne contribuent pas non plus à les faire progresser.
b) D’intransigeance en surenchères
Le premier des leaders rebelles unanimement critiqué pour sa stratégie politique est incontestablement AbdelWahid al Nour, chef du SLM : Depuis l’échec d’Abuja et du DPA qu’il n’a pas signé, AbdelWahid al Nour s’est toujours refusé de revenir à la table des négociations.
Ce qu’il a lui-même communiqué (369) à vos rapporteurs se résume en peu de mots et traduit bien l’opposition résolue, qu’on peut sans mal trouver peu constructive, mais qu’il manifeste de manière intangible depuis son exil parisien : d’une part le refus de négocier avec un gouvernement génocidaire tant que la communauté internationale ne garantira pas la sécurité de son peuple ; onze cessez-le-feu ont été signés, tous violés par Khartoum qui continue de bombarder les villages et populations civiles du Darfour sans que rien ne soit fait pour y remédier. A cet égard, la MINUAD, inefficace, est devenue plus un problème qu’une solution, à laquelle devrait être substituée une véritable force d’interposition internationale pour arrêter les massacres. D’autre part, l’impossibilité de se rapprocher du JEM de Khalil Ibrahim, islamiste autrefois ministre de Al-Bachir, ancien combattant contre le Sud Soudan, aujourd’hui bras armé de Hassan Al-Tourabi au Darfour, dont il prépare en fait le retour au pouvoir.
Réfugié sur son Aventin dans une attitude « gaullienne » de refus de tout compromis que plus personne, parmi les très nombreux interlocuteurs que vos rapporteurs ont rencontrés – fussent-ils parmi ses soutiens les plus affirmés, Français en tout premier lieu, ne comprend –, AbdelWahid al-Nour s’est enfermé dans une stratégie qui le conduit à l’isolement, y compris vis-à-vis de sa propre communauté : s’il est encore le leader politique à la légitimité historique incontestée et la voix des Four, il semble que monte une lassitude sur le terrain – qu’au demeurant il n’a pas revu depuis longtemps – et que la communauté Four pourrait rechercher un autre représentant pour lui succéder à la tête de la tribu, pour définir une stratégie et une vision d’avenir plus claires et porteuses d’un véritable projet qu’elle attend toujours de sa part.
Cette intransigeance jusqu’au-boutiste est à l’évidence problématique dans la mesure où elle conduit AbdelWahid al-Nour à tarder à réagir aux initiatives des médiateurs des Nations Unies et de l'Union africaine, parfois même à ne pas accepter de les rencontrer lors de leur passage en France. Elle semble aussi ne pas correspondre tout à fait à la réalité de terrain telle qu’elle est aujourd’hui communément analysée et observée, et par conséquent, aux réels besoins des populations. Son irréalisme, enfin, ne peut manquer d’étonner : que la communauté internationale peine déjà à rendre opérationnelle la MINUAD pour des raisons surtout logistiques illustre suffisamment le fait qu’aucune autre action, telle que la mise en place d’une force d’interposition plus importante, ne pourra jamais être montée au Darfour, serait-elle encore aujourd’hui indispensable.
En contrepoint de cette attitude, le JEM n’est pas non plus de son côté exempt de tout reproche et une analyse précise de ses revendications, au fil des négociations, montre une évidente tendance à la surenchère permanente qui ne peut que crisper les relations et consécutivement, retarder l’approche vers un règlement politique de la crise du Darfour. D’une certaine manière, tout se passe comme si le moindre prétexte, situation des déplacés dans les camps ou sort des prisonniers de guerre, était mis à profit par les négociateurs du JEM pour introduire de nouvelles revendications qui contribuent d’autant à l’enlisement du processus.
A titre d’exemple, sans même tenir compte de la décision du JEM l’an dernier de suspendre sa participation sine die aux négociations en réaction à l’expulsion des ONG internationales, alors même que moins de trois semaines plus tôt, le 19 février 2009, il avait signé une Déclaration d’intention avec le gouvernement, un épisode récent appelle surtout l’attention : le projet d’accord-cadre soumis par le JEM à la mi-août 2009, répondant à une sollicitation de la médiation commune Nations Unies/Union africaine, ne répondait en rien à une démarche permettant à la négociation d’avancer. Tout au contraire, ce document semblait destiné à crisper Khartoum, dans la mesure où il développait des positions maximalistes, bousculait les accords obtenus dans le cadre du CPA, que ce soit au plan des institutions ou du partage des richesses. Le mouvement de Khalil Ibrahim semblait alors jeter de l’huile sur le feu pour attiser la tension, alors que deux ans plus tôt, d’autres propositions, sa « road map » de juin 2007, notamment, apparaissaient à l’inverse comme de véritables éléments d’une méthodologie constructive d’un processus de paix.
Chacun des deux mouvements rebelles du Darfour essayant de compenser qui sa faiblesse militaire, qui son manque de représentativité, apparaît finalement comme peu désireux d’avancer véritablement sur la voix de la paix. A l’évidence, comme en témoigne son projet d’accord cadre, le JEM a en tête un tout autre agenda que la pacification de la région darfouri et la résolution de la crise qui s’inscrit bien davantage dans une perspective de prise du pouvoir à Khartoum. Les nordistes ne peuvent évidemment que refuser d’engager une discussion sur une telle base. Au-delà, on peut aussi raisonnablement s’interroger sur la perception que peut en avoir le SPLM sudiste, dans la mesure où cette éventualité ruinerait les accords obtenus dans le cadre du CPA et le partage du pouvoir au sein du GUN qui en est résulté entre les deux partis dominants.
Mais au-delà même de ces divisions, la question qui se pose est celle de la question de la capacité (370), si ce n’est de la volonté des rebelles de faire la paix. Celle de savoir si les uns et les autres ont même réellement intérêt à signer une paix avec Khartoum : le JEM, notamment, fort militairement mais inexistant politiquement et en termes de représentativité dans la population, a-t-il, objectivement, un quelconque intérêt à signer un accord de paix avec Khartoum à Doha ? La question mérite assurément d’être posée aux yeux de vos rapporteurs, dans la mesure où, par le fait même, le JEM se saborderait.
D’où il suit que le pourrissement des négociations peut effectivement apparaître comme une stratégie consciente et qu’il y aurait décidément un très réel intérêt à ce que les autres mouvement rebelles, et tout particulièrement le SLM, rejoignent le processus engagé sur les rivages du Golfe, pour sortir du tête-à-tête stérile entre gouvernement et JEM.
2) Comment surmonter la division des rebelles ?
Comme le rapport Mbeki en octobre 2009, après de nombreux autres, l’a conclu, « la division des forces rebelles a atteint un tel degré que le processus de paix s’en trouve régulièrement paralysé », et c’est précisément la raison pour laquelle l’essentiel des efforts, s’agissant de la résolution du conflit du Darfour tourne autour de la possibilité de réunir à la même table l’ensemble des forces rebelles sans laquelle rien ne pourra se faire. La Libye, qu’on a vue fort active, n’est pas seule sur ce créneau diplomatique et ses efforts, comme ceux de ses pairs, sont suivis avec attention et mesurés à leur juste valeur. L’Ethiopie s’y est aussi essayée, de même que l’Erythrée. Les pays de la région, dont certains, telle l’Egypte, ont tenté comme autrefois sur cette crise un travail de sape, semblent avoir remisé leurs réticences.
Face à la réalité de la rébellion, les parrains internationaux du processus de paix n’ont d’autre choix que de tenter, chacun à sa manière, de provoquer la réunification tant attendue.
A ces tentatives bilatérales de pays de la région, s’en ajoutent d’autres, de plus longue haleine, fruits des efforts des Nations Unies et de l’Union africaine en la personne du médiateur conjoint, appuyé en cela par la facilitation de la diplomatie qatarie. L’un comme l’autre n’ont cessé depuis leur entrée dans le jeu, de plaider pour un processus inclusif qui associe à la négociation l’ensemble des parties prenantes, qu’ils ont incitées à faire le déplacement à Doha. Intéressés aussi, les Etats-Unis, avec d’autres, dont la France et le Royaume Uni. Après avoir révisé leur stratégie vis-à-vis du Soudan, les Etats-Unis essaient aujourd’hui de travailler le sujet du Darfour de manière à le neutraliser et mieux se consacrer aux échéances de 2011. Tous butent de manière inéluctable sur les mêmes obstacles, sans réussir à les aplanir.
a) Les Nations Unies et l'Union africaine main dans la main, mais jusqu’où ?
A l’été 2008, Djibril Bassolé, alors ministre burkinabè des affaires étrangères était nommé médiateur conjoint des Nations Unies et de l’Union africaine pour le processus de paix au Darfour. Il prenait ainsi la relève de Jan Eliasson et de Salim Ahmed Salim, médiateurs à mi-temps dont les efforts n’avaient pas été couronnés des succès escomptés. L’émirat du Qatar, sollicité pour abriter cette phase du processus, compte tenu de son expérience en matière de facilitation, a accepté et les négociations se tiennent à Doha depuis lors.
Involontairement, la CPI n’a pas aidé les efforts de la communauté internationale et de Djibril Bassolé tout particulièrement, à rencontrer le succès. Alors que ce dernier était en passe de réussir à réunir les rebelles du JEM et le gouvernement de Khartoum à la table des négociations, la chambre préliminaire I de la Cour rendait sa décision d’inculpation et délivrait son mandat d’arrêt international contre Al-Bachir.
Au total, la médiation conjointe a eu jusqu’à aujourd’hui à naviguer entre les écueils semés par un JEM profitant de l’opportunité que lui offrait la réaction soudanaise à la décision de la CPI pour se retirer du processus et faire monter les enchères, et un SLM dont le chef se refuse obstinément à se rendre à la table des négociations. On a pu rêver avoir meilleures cartes en mains pour négocier sous le regard attentif de la communauté internationale.
Après avoir un temps privilégié l’optique militaire, et, en accord avec ses partenaires, centré son attention sur le gouvernement et le JEM, Djibril Bassolé a tenté d’engager un processus de pourparlers politiques cherchant à rassembler autour de la table le plus de belligérants possibles.
Pour autant, lorsque vos interlocuteurs l’ont rencontré(371), il semblait finalement ne pas voir un obstacle dirimant à l’absence de d’AbdelWahid al-Nour, comme si son cas était d’ores et déjà passé par pertes et profits. Djibril Bassolé était alors en train d’essayer une sorte de « stratégie de contournement », ses priorités se tournant vers d’autres objectifs : d’une part, une tentative d’inclure d’autres tribus dans la négociation, jusqu’alors exclues, en s’appuyant sur « le groupe de Tripoli », à savoir la réunion de cinq mouvements rebelles sur une base commune. Le fait que les mouvements rebelles se soient dans les deux années antérieures tribalisés pouvaient permettre, en les associant à la discussion, de leur garantir la prise en compte de leurs intérêts et spécificités. En d’autres termes, un « grignotage » de la position encore hégémonique de AbdelWahid al Nour, de manière à pouvoir inclure un nombre croissant d’acteurs.
Comme Ahmad bin Abdallah al Mahmoud, ministre qatari des affaires étrangères, le remarque (372), le problème rencontré par la médiation de Djibril Bassolé comme par leur propre travail de facilitation, tient au fait que chacun joue sa partition : le JEM, d’une part, arguant de son hégémonie militaire parmi les groupes rebelles, qui prétend à l’exclusivité et ne souhaite aucunement associer au processus d’autres forces qui dilueraient son poids par leurs revendications. En contrepoint, le SLM, qui mène, toutes choses égales par ailleurs, une politique aux objectifs similaires, mais de manière différente : celle de la chaise vide.
Las, la situation marque désespérément le pas. Comme pouvait le titrer le journal Le Monde il y a peu (373), « les négociations directes entre rebelles du Darfour et le gouvernement soudanais n’ont pas repris. ». Alors même que « Djibril Bassolé avait affirmé que les discussions directes entre le gouvernement soudanais et les rebelles reprendraient le 24 janvier (…) [et] avait dit espérer la présence d’AbdelWahid al-Nour, (…) ».
A ces efforts à la fois communs et pour l’heure encore vains des Nations Unies et de l'Union africaine pour réunir les rebelles, s’ajoutent les initiatives de l’UA pour jouer sa propre partition sur la scène darfouri. La nomination de Thabo Mbeki à la tête du Groupe de haut niveau sur le Darfour s’inscrit certes dans la recherche d’une solution qui réconcilie paix et justice. Elle est à l’évidence aussi un élément d’une stratégie, d’une démarche politique de la part de l’organisation africaine de ne pas perdre la main dans un dossier dont on se souvient qu’elle avait entendu le piloter dès le début. En témoigne sa médiation à Abuja en 2005, le fait que le Groupe Mbeki ait été réuni au lendemain de la décision de la CPI dont on sait l’impact qu’elle a eue parmi la grande majorité des membres de l'Union africaine.
En témoigne aussi aujourd’hui le fait que, après avoir remis son rapport en octobre 2009, le groupe de Thabo Mbeki continue d’œuvrer en parallèle à la médiation conjointe Nations Unies/UA. Tout semble donc se passer comme si l'Union africaine tentait de développer une stratégie clairement concurrente sur les lignées de celle de la médiation conjointe. Pour intéressante que soient les propositions du rapport Mbeki, il n’est pas certain que cette initiative vienne véritablement faciliter la négociation.
b) L’impatience des grands acteurs
C’est peu dire que dans ces circonstances complexes et répétitives, les grands parrains du processus manifestent une certaine désillusion ; quelque impatience qui peut laisser redouter des voix discordantes à tout instant.
Les Etats-Unis, en premier lieu, qui sont revenus sur le théâtre soudanais. L’administration Bush avait déjà apporté son soutien au processus de Doha après la nomination du rapporteur conjoint. Dès la prise de fonctions du président Barack Obama, il a été clair que cette attention particulière pour le Darfour serait maintenue.
La nomination le 18 mars 2009 du général Scott Gration, proche du président américain, comme envoyé spécial pour le dossier du Darfour, a été perçue comme une initiative marquant l’intérêt renouvelé des Etats-Unis pour ce dossier sensible et l’aube d’une nouvelle politique envers le Soudan. Tout en soutenant le processus conjoint des Nations Unies et de l'Union africaine, la diplomatie américaine a tenté de travailler simultanément sur les deux volets du dossier soudanais, c’est-à-dire sans omettre la perspective de 2011, du référendum prévu dans le cadre du CPA dont elle considère, à juste titre comme on le verra plus loin, la mise en œuvre trop lente. Concernant le dossier darfouri, une approche inclusive a été adoptée, proche en cela de celle défendue par tous les observateurs, qui a tenté de bousculer le rythme jugé trop lent de Djibril Bassolé.
De fait, le travail de l’envoyé spécial américain a été à la base de la révision de la politique soudanaise des Etats-Unis, qui ne s’est toutefois pas traduite par de grands bouleversements, à en croire la communication du Département d’Etat en octobre 2009. Il est notamment intéressant de remarquer que tant Barack Obama que Hillary Clinton, dans leurs allocutions respectives sur le Soudan, continuent de présenter le conflit du Darfour comme un génocide, fortement incités qu’ils sont toujours en cela par le Congrès.
Cela étant, actionnant ses propres réseaux, la politique américaine tente de développer des actions parallèles et par conséquent concurrentes, à celles des médiateurs de Doha, telle la constitution d’un « groupe d’Addis Abeba », réunissant quelques factions dissidentes du SLM d’AbdelWahid al-Nour. En somme, les Etats-Unis mettent en œuvre une stratégie identique, avec d’autres acteurs, ce qui n’est pas sans susciter certaines confusions sans doute préjudiciables au déroulement du processus et au leadership des Nations Unies et de l'Union africaine.
Indépendamment des Etats-Unis, les grandes puissances ne cessent de dialoguer sur la question du Soudan et plus spécialement du Darfour. Au-delà du Conseil de sécurité, les contacts sont tout particulièrement étroits et la coordination exemplaire entre les diplomaties américaines, britannique et française, et on ne saurait véritablement voir de différence d’appréciation ou de proposition sur les solutions à apporter (374).
Si l’Union européenne n’est pas absente de ce processus, elle ne donne pas le la pour autant. Elle participe également à la réflexion et à l’effort communs pour la recherche de solutions pérennes au Soudan et tout particulièrement au Darfour. Un représentant spécial de l’UE pour le Soudan a été nommé par Javier Solana, Torben Brylle, ambassadeur danois, que malheureusement vos rapporteurs n’ont pu rencontrer malgré plusieurs tentatives. S’il participe en compagnie des envoyés spéciaux bilatéraux des différents pays aux discussions, à Doha notamment, force est de constater, cela étant, que les propositions diplomatiques de l’Union brillent par leur absence. Ici comme ailleurs vis-à-vis de l’Afrique, le regard de l’Europe est encore essentiellement « développementaliste » et une approche politique européenne fait défaut. Consécutivement, la voix de l’Europe des 27 est loin d’être celle qui domine dans les cercles internationaux dans lesquels les questions soudanaises sont débattues.
Pour autant, l’Union intervient comme acteur majeur en soutenant très fortement les processus conduits par l'Union africaine. Elle contribue ainsi, et elle est seule à le faire, à hauteur de 600 millions d’euros en appui aux opérations de paix et de sécurité conduites par l'Union africaine (375), renforçant ainsi les capacités institutionnelles de l’UA en la mettant au centre du débat. L’Union européenne mène en d’autres termes une action plus foncièrement régionale, tournée vers le renforcement de la Commission africaine dans une perspective de long terme.
Néanmoins il faut regretter que le discours politique qui accompagnerait ce soutien reste encore à écrire. Pour autant que vos rapporteurs aient pu en juger, ce n’est que lorsque la France a occupé la présidence de l’UE au second semestre de 2008 que l’Union européenne a pris position et communiqué sur le Soudan et sur le Darfour (376). Il ne faut bien sûr y voir aucun hasard de calendrier, mais bien plutôt la traduction du rôle particulier de notre pays sur ces dossiers, notamment dû à son influence régionale.
La France est de ce fait un acteur incontournable du dossier « Darfour » et, consécutivement, de la question soudanaise d’une manière général. Ensuite, au cours de la présidence suédoise, un conseil européen sur le Soudan s’est tenu qui a doté l’Union d’une feuille de route (377) qui, pour être « globale », n’en met pas moins principalement l’accent sur la question du Sud Soudan et des perspectives dues aux échéances à venir dans le cadre de la mise en application du CPA, à l’instar des orientations de l’administration américaine. Pour autant, avant que cette stratégie ait atteint son rythme de croisière, et consécutivement, que la visibilité de la stratégie de l’Union s’améliore, sans doute faudra-t-il attendre que la réforme du service extérieur, entrée en vigueur avec le Traité de Lisbonne, ait porté tous ses fruits.
3) Le conflit du Darfour, un rôle pour la France sur le théâtre soudanais
Vos rapporteurs ont eu l’occasion de rappeler les difficultés que la France avait rencontrées lorsqu’elle avait souhaité entrer dans le processus de paix de Naivasha entre le Nord et le Sud Soudan. La place qu’elle espérait jouer lui avait alors été contestée par John Garang, qui l’accusait de partialité, eu égard au rôle qu’elle avait joué au cours des années précédentes et à la relation particulière qu’entretenaient Paris et Khartoum, jusques et y compris sur les aspects les plus sensibles.
La question du Darfour qui permet à la France d’être désormais présente sans que sa place lui soit contestée par quiconque, tout au contraire, tient évidemment à son positionnement dans cette partie du continent. Le Tchad et la république centrafricaine sont des pièces clefs du puzzle régional, comme cela a été à plusieurs reprises évoqué ici. Le Tchad, en tout premier lieu, par sa relation avec les rebelles du Darfour est l’acteur sans lequel la paix ne sera pas assurée, que ce soit au Darfour ou au plan régional. La France est de ce fait clairement devenue un partenaire incontournable sur ce dossier.
a) La toile de fond tchadienne
Si les relations entre les gouvernements soudanais et tchadien étaient bonnes, sinon excellentes, jusqu’au début du conflit du Darfour, elles se sont envenimées à partir de 2005, sur fond de tentatives de déstabilisations réciproques par soutien aux rebellions interposé. La situation n’a pas fondamentalement changé depuis lors.
Consécutivement, en parallèle aux médiations menées par Djibril Bassolé à Doha entre le gouvernement et les rebelles, de très importants efforts internationaux ont eu lieu depuis longtemps sur cet aspect particulier pour rapprocher les gouvernements soudanais et tchadiens. Cette approche diplomatique est même désormais celle qui fait l’objet des attentions les plus soutenues et la communauté internationale unanime, y prend part, tant il est clair que sans soutien étatique, les diverses forces rebelles en présence ne pourraient continuer leur combat.
A titre d’exemples, plusieurs médiations sont à relever. Vos rapporteurs remarquent en particulier celle conduite à Dakar, sous l’égide du président Abdoulaye Wade, qui s’est conclue par la signature d’un accord entre Idriss Deby et Omar Al-Bachir le 13 mars 2008. La médiation était l’œuvre du Gabon et de l'Union africaine et les parrainages ceux de l’Union Européenne, des Etats-Unis, de la France, des Nations Unies et de l’Organisation de la Conférence islamique. Au termes de cet accord, les présidents soudanais et tchadiens décidaient « solennellement devant nos pairs et les représentants de la communauté internationale de [se] réconcilier et de normaliser les relations entre [leurs] deux pays » et réitéraient notamment « le respect de [leurs] engagements pris antérieurement, notamment l'accord de Tripoli du 8 février 2006, l'accord cadre de Khartoum et ses protocoles additionnels du 28 août 2006, la déclaration de Cannes du 15 février 2007 et l'accord de Riyad du 3 mai 2007. » Surtout, Déby et Al-Bachir déclaraient : « nous nous engageons solennellement à interdire toute activité de groupes armés et à empêcher l'utilisation de nos territoires respectifs pour la déstabilisation de l'un ou l'autre de nos Etats. »
Cet accord, qui n’était ni le premier ni le dernier, sera si vite oublié que moins de deux mois plus tard les deux capitales rompaient leurs relations diplomatiques après une succession de graves incidents frontaliers mettant en cause rebelles et forces gouvernementales des deux côtés. L’histoire se répétant décidément, au début de mai 2009, un nouvel accord de normalisation des relations entre le Tchad et le Soudan était signé à Doha. Comme les précédents, cet accord intervenait après des pics de tension inquiétants et, comme les précédents, il fut suivi, le lendemain même, de nouveaux combats meurtriers opposant les mêmes acteurs.
Cet abcès nourrit le conflit du Darfour. Le percer en réussissant la réconciliation des frères ennemis assèchera les ressources des forces rebelles. Il est désormais indiscutable que la condition préalable d’une paix au Darfour est un accord global entre les deux pays, tout comme l’apaisement de la tension entre le Soudan et le Tchad ne se fera pas sans solution au Darfour. Comme le faisait remarquer entre autres le Rapport Mbeki, après avoir posé un diagnostic identique, « ce qu'il faut, c'est une véritable volonté politique des deux bords pour mettre de côté leurs différences et travailler pour la paix en mettant en œuvre ces Accords. »
Les derniers développements de cet épisode sans fin se sont concrétisés le 15 janvier 2010 et pourraient être plus prometteurs que les précédents. Un accord de normalisation a en effet été signé à Doha complété par un protocole de sécurisation des frontières aux termes duquel une force mixte sera constituée pour s’interposer entre les mouvements transfrontaliers des rebellions respectives des deux pays.
Cela étant, dans la mesure où tant le Soudan que le Tchad entrent l’un comme l’autre en période électorale, chacun pour des échéances majeures, peut-être cette fois-ci le respect des engagements durera-t-il un peu plus longtemps. Sans qu’on puisse toutefois s’aventurer à prédire le futur plus lointain : les priorités immédiates se modifient sans doute pour des raisons de calendrier mais, une fois les élections passées, l’éventualité qu’un régime qui en serait sorti renforcé ne reprenne l’initiative est-elle à exclure ?
Compte tenu de sa présence militaire en terre tchadienne, la France est évidemment appelée à remplir un rôle à la fois important et délicat, dans ce qui ce joue en ce moment.
La France, présente au Tchad depuis le milieu des années 1980 avec le détachement Epervier, est exactement sur la zone conflictuelle, aux portes du Soudan, Forchana se situant précisément à l’est d’Abéché, à quelque dizaines de Kms de la frontière. C’est ce qui lui a permis, lorsqu’elle a promu aux Nations Unies en 2007 le déploiement de la Mission des Nations Unies en République centrafricaine et au Tchad, MINURCAT, adoptée par le vote de la résolution 1778 le 25 septembre, de contribuer au soutien logistique nécessaire. Le soutien militaire confié ensuite à l’UE dans le cadre de l’EUFOR en a également fortement bénéficié tout comme, depuis, le fonctionnement de la MINURCAT II, second volet, actif jusqu’en mars 2010. En d’autres termes, que ce soit par sa présence militaire sur le terrain comme par ses initiatives diplomatiques au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, la France est un acteur clef de la stabilisation de la région qui, concernant tout spécialement la question du Darfour, a contribué à la sécurisation des camps de réfugiés darfouri en territoire tchadien.
Au-delà de ce premier aspect, essentiel, s’ajoute le fait que la relation qu’elle entretient avec le gouvernement de N’Djamena lui ouvre un canal de communication unique, ce qui lui permet d’être sollicitée pour intercéder et favoriser la poursuite du dialogue entre les deux pays. Les autorités soudanaises notamment, alors même qu’elles ont les griefs que l’on sait contre la France depuis le début des années 2000, que ce soit autour de la présence d’AbdelWahid al-Nour en France ou de la saisine de la CPI, en sont conscientes qui attendent ce rôle pour aider à la normalisation des relations. Les partenaires de la France aussi, dans le cadre des différentes instances où se joue actuellement l’avenir du Darfour, du Soudan et celui de cette région.
Cela étant, comme vos rapporteurs l’ont laissé entendre au long de ces développements, le véritable enjeu ne porte sans doute pas dans l’immédiat sur le théâtre darfouri et sur les accords qui pourraient être trouvés à Doha mais bien plutôt sur les perspectives qui se dessinent au Sud Soudan. Les échéances les plus risquées se profilent pour 2011 ; ce sont celles prévues dans le cadre du CPA.
Les élections générales d’avril prochain seront certes essentielles dans la mesure où ce seront les premières organisées au Soudan depuis 1986 et, de leur résultat, si elles peuvent se tenir comme prévu, dépendra l’évolution de la situation et une bonne part de ce qui se décidera ensuite. La résolution du conflit du Darfour en sera finalement conditionnée car on ne voit pas comment les exigences des rebelles pourraient être satisfaites sans que le CPA ne soit remis en cause.
Pour autant, on ne peut nier que l’enjeu majeur porte évidemment sur la perspective d’une sécession du Sud Soudan. En ce sens, pour le Soudan, 2010 est d’ores et déjà l’année de tous les dangers.
V – L’AVENIR DU SOUDAN SE JOUE AU SUD
Un certain regain d’optimisme prévaut depuis quelques mois dans les chancelleries dû au fait que l’application du CPA semble enfin marquer quelques avancées significatives. De fait, un certain nombre d’accords indispensables à la tenue des prochaines échéances sont intervenus ces dernières semaines, qui avaient longtemps été différés. Pour autant, le retard pris pour l’application du CPA est considérable et il n’est pas sûr que les onze mois qui restent avant le référendum d’autodétermination soient suffisants pour rendre l’unité du Soudan assez attractive et renverser la tendance en faveur de la sécession qui s’est dessinée depuis longtemps.
A cela s’ajoute le fait que quelques incertitudes majeures subsistent, qui conduisent à regarder l’avenir du Sud Soudan et du Soudan avec pessimisme. Vos rapporteurs voudraient-ils s’en défaire que l’actualité, d’une part, et l’analyse des conséquences de la partition du pays, d’autre part, tendraient à les retenir.
A – Peut-on encore éviter la partition du Soudan ?
Exactement cinq ans ont maintenant passé depuis la signature du CPA, fruit de longues et difficiles négociations, porteur de toutes les promesses de paix pour le Soudan. Un regard rétrospectif laisse une impression d’inachevé, que l’effervescence de la communauté internationale à pousser aujourd’hui à l’adoption de réformes jusqu’alors sans cesse reportées, conforte. Il n’est pas certain cependant qu’un autre scénario aurait pu être écrit, compte tenu des prémices.
1) Le Comprehensive Peace Agreement, Janus juridique
Le CPA a ceci de paradoxal qu’il s’agit sans doute du seul texte que les négociateurs pouvaient signer en 2005 compte tenu de leur histoire commune, de celle des forces sudistes et de l’évolution qu’avaient connues leurs revendications au long du conflit. Dans le même temps, il s’agit aussi d’un texte qui met le ver de l’éclatement du Soudan dans le fruit.
a) La paix « globale » : une première illusion
Le CPA a été présenté comme l’accord permettant de dessiner un futur harmonieux pour l’ensemble du Soudan, le texte qui réglerait enfin l’ensemble des différends entre Khartoum et ses périphéries. Il n’est pourtant que de lire le protocole de Machakos de 2002, qui est le socle sur lequel il est bâti, pour s’apercevoir que le CPA n’a en fait de global – « comprehensive » - que le nom et qu’une lecture attentive du texte aurait dû inciter à plus de mesure. On peut difficilement se défaire de l’idée que la communauté internationale a, d’une certaine manière, joué ici aux apprentis sorciers, sans apprécier à leur juste valeur les conséquences de ses décisions.
Le texte adopté à Machakos ne mentionne en effet pas les autres provinces soudanaises. Il est même fait référence à la guerre Nord-Sud comme le « Conflit du Soudan », au singulier, sans qu’il soit fait mention des autres qui ont eu lieu. Les autres régions, lorsqu’elles sont évoquées, le sont d’une manière générale, sous l’angle des injustices et des inégalités de développement qu’il faut résoudre, sans plus.
Les seules véritables références régionales auxquelles il est fait concrètement allusion sont celles relatives aux Monts Nouba et à la zone d’Abyei, dans le cadre des protocoles spécifiques qui les concernent. Les Monts Nouba sont traités dans le CPA, car c’est la branche locale du SPLM/A sudiste qui a mené le combat dans cette région contre Khartoum et a négocié la paix avec le gouvernement central. La région d’Abyei est également incluse car cette zone tampon entre le Nord et le Sud était au cours du conflit, et reste aujourd’hui, l’objet de toutes les convoitises pour sa richesse pétrolière.
En revanche, on sait que le conflit du Darfour a précisément éclaté parce que les revendications régionales se trouvaient absentes de la négociation Nord-Sud et que les opposants darfouri craignaient d’être laissés pour compte dans l’accord en train de s’ébaucher. En parallèle aussi, le conflit de l’Est s’est réglé moyennant la signature entre Khartoum et les rebelles Beja d’un Eastern Sudan Peace Agreement, ESPN, en juin 2006, un an et demi après la signature définitive du CPA et plusieurs années après que les différents protocoles négociés à Naivasha l’aient été les uns après les autres. Le fait que le CPA n’ait pas abordé non plus ce conflit sera aussi l’une des raisons pour lesquelles certains foyers de violence, soutenus par le JEM, persisteront dans l’Est du Soudan de manière sporadique après la signature de l’ESPN. La globalité et le caractère inclusif du CPA ont montré ici leurs limites.
Plus précisément, et inversement, il est intéressant de souligner que, à chaque fois que le CPA, que ce soit dans le protocole de Machakos ou dans ceux de Naivasha, aborde des points relatifs au conflit entre le Nord et le Sud, ce qui revient à chacune des deux parties est soigneusement traité. Ainsi, le protocole concernant le partage des richesses ou celui concernant le partage du pouvoir, indiquent-ils précisément ce qui revient à Khartoum et ce qui revient à Juba, ce qui est attribué au SPLM sudiste ou au Parti du Congrès national, PCN, nordiste.
Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne la répartition des sièges entre les deux partis majoritaires de la scène politique soudanaise que l’on a vue précédemment où un équilibre est instauré qui respecte le poids de chacun dans sa région d’origine : au PCN la majorité au Nord, le SPLM se voyant réserver une minorité importante. Le schéma inverse est défini en ce qui concerne le Sud où le SPLM a logiquement la majorité, tandis que le Parti du Congrès national, minoritaire, bénéficie néanmoins d’une forte représentation. En revanche, les autres forces politiques se voient simplement attribuer une minorité, faible, de représentation : 14 % des sièges de l’Assemblée nationale pour l’ensemble des autres partis du nord et 6 % pour l’ensemble de ceux du Sud. En d’autres termes, s’il y a effectivement un aspect global dans cet accord, force de constater qu’il est mineur et, surtout, singulièrement déséquilibré en faveur des deux principaux belligérants, qui sont les grands bénéficiaires politiques des négociations de Machakos/Naivasha. Cela est si vrai que les principaux partis nordistes, Umma de Sadeq al-Mahdi et Congrès national populaire de Hassan al-Turabi, refusèrent de faire leur entrée dans la nouvelle assemblée, dans la mesure où la place qui leur est réservée dans le schéma du CPA ne tient pas compte de la réalité de leur représentativité, telle qu’elle résulte des dernières élections, organisées en 1986. Ils dénoncèrent un dialogue exclusif entre le Parti du Congrès national et le SPLM (378) et, en parallèle, une coalition de partis sudistes prit les mêmes positions vis-à-vis du SPLM.
C’est le même phénomène qui se retrouve logiquement en ce qui concerne le partage des postes au sein de l’administration centrale et du gouvernement : deux vice présidents flanquent le Président de la République, dont l’un est John Garang. De vice-présidences attribuées à d’autres représentants régionaux, il n’est pas question et ce sera par exemple l’un des éléments de la revendication des rebelles du Darfour, le JEM réclamant un poste de vice-président que lui refuse Khartoum au motif que le CPA s’en trouverait aujourd’hui déséquilibré (379).
En ce qui concerne le partage des richesses, le constat est quelque peu différent mais amène néanmoins à une conclusion proche de la précédente. Un mécanisme de péréquation entre régions est certes instauré aux termes duquel la répartition des bénéfices tirés de l’exploitation pétrolière est assurée entre Nord et Sud ; un Fonds de reconstruction national est prévu, de même que des mécanismes de répartition des recettes, mais ce sont surtout les revenus du pétrole extrait des terres sudistes que l’on partage et l’axe principal en filigrane du protocole est bien plus Nord-Sud que transversal. A l’évidence, les autres provinces périphériques du Soudan restent ici encore marginalisées, comme mentionnées pour mémoire plus que comme participant d’un véritable projet politique de développement national.
Il est significatif de remarquer que c’est essentiellement en ce qui concerne les aspects « non matériels » ni politiques, à savoir la religion comme source d’inspiration du peuple soudanais, la culture, les langues, que le CPA est ouvertement national et global : s’agissant des coutumes, des traditions, ce sont les peuples du Soudan qui ont effectivement un héritage commun.
b) L’attractivité de l’unité : une seconde illusion
Ainsi que vos rapporteurs ont eu l’occasion de le souligner plus haut, paradoxalement, le CPA peut être considéré en lui-même comme porteur de graves dangers pour l’intégrité du Soudan.
En effet, si l’unité du pays est affirmée comme étant la priorité des Parties, le fait que le droit à l’autodétermination des sudistes soit immédiatement mis en balance avec elle en atténue nécessairement la portée. Comme on l’a dit, les belligérants n’auraient vraisemblablement pas pu s’accorder sur aucun autre texte, mais le schéma qui a été défini revient à mettre en présence, ou en opposition, un contenu politique face à la reconnaissance d’un droit.
L’unité du Soudan est considérée comme une option, certes perçue comme préférable, mais une option que la volonté politique commune des deux parties va devoir défendre en apportant la preuve de son attractivité aux sudistes. Il y avait peut-être en 2002 une volonté politique, – un intérêt, plus certainement -, à mettre fin au conflit, mais supposer qu’une même volonté existait aussi pour rendre attractive l’unité du pays, n’était-ce pas faire preuve d’un certain angélisme ? Les deux décennies de guerre qui s’achèvent alors tendraient plutôt à prouver le contraire, tout comme la reprise des combats juste après juillet 2002 et leur poursuite jusqu’à la fin du processus. A l’évidence, si les conditions d’une cessation du conflit commençaient d’être réunies, celles qui ouvriraient le chemin vers l’unité maintenue du pays ne l’étaient pas encore. Elles l’étaient si peu que, aujourd’hui, à la fin de la transition, la perspective de la sécession n’a jamais été aussi forte.
Rétrospectivement, vos rapporteurs considèrent que le fait d’inscrire le référendum d’autodétermination dans le texte de l’accord, a sans doute contrarié la mise en œuvre du CPA et le travail commun qui aurait dû être réalisé pour chercher à préserver l’unité. A cet égard, peut-être en aurait-il été autrement si l’organisation du référendum avait été présentée comme une simple éventualité, ou un souhait qu’auraient pu formuler les sudistes au terme de la période de transition. Inversement, le fait que le protocole de Machakos indique que la consultation du peuple du Sud Soudan sera (380) organisée, quoi qu’il ait pu se passer au long de ces six années, a évidemment constitué un facteur de nature à tempérer les velléités politiques en faveur de l’unité.
Cette lecture plus politique de l’accord est d’autant plus nécessaire que les forces et mouvements sudistes ne partageaient pas tous les mêmes positions sur cet aspect du dossier. On rappelle en effet que c’est, entre autres, sur la question d’une stratégie sécessionniste ou non que John Garang avait dû faire face à une dissidence politique et militaire interne et violente au SPLM/A au début des années 1990. Qu’il ait ensuite réussi à réunifier le mouvement ne signifie pas que la tendance séparatiste ait disparu, loin de là.
Il ne s’agit pas de nier l’importance du CPA qui a été un moment unique de l’histoire contemporaine du Soudan : pour la première fois, le Sud s’est vu officiellement reconnaître une place majeure dans l’architecture politique et institutionnelle du pays. Pour la première fois, le Sud a pu disposer d’un gouvernement autonome et pour la première fois aussi, le gouvernement central a fait l’objet d’une restructuration afin d’inclure les sudistes à la gestion des affaires nationales. C’est à l’évidence un bouleversement majeur et indiscutable au sortir de vingt années de guerre civile et au regard de l’histoire soudanaise qui a été introduit dans ce pays avec la signature du CPA.
Toutefois, cet accord n’est, on l’a vu, pas aussi global qu’on a bien voulu le laisser entendre et il serait faux de soutenir que les autres périphéries ont tiré un réel profit de sa signature. Le CPA est le résultat d’une négociation bilatérale entre deux belligérants, aux termes duquel Khartoum a dû consentir à d’importantes concessions et entrer, contraint, dans un mode de partage du pouvoir et des richesses. Ses défauts portent clairement la marque de cette origine. Comme le remarquait de son côté Jan Pronk, alors envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies au Soudan, devant le Conseil de sécurité le 10 janvier 2005 en présentant le bilan des négociations et le chemin pavé de difficultés qui s’ouvrait, « les autres groupes militants du Sud qui n’ont pas pris part aux pourparlers de paix devront être insérés dans les nouvelles structures qui ont été créées sans eux. » Ce qui était le cas des forces sudistes l’était a fortiori bien plus pour les forces des autres régions.
Ce n’est par conséquent pas un hasard si le CPA est considéré comme la cause de la situation conflictuelle qui a perduré dans le reste du Soudan. Comme le chef de la délégation du JEM à Doha a pu le dire à vos rapporteurs, le CPA n’a traité que la question du Sud mais a laissé de côté les autres marginalisés qui n’ont toujours aucun droit ; ce n’est qu’une solution partielle et partant inefficace. D’où la double approche, aujourd’hui encore, du JEM : d’une part, rechercher une solution qui soit véritablement inclusive ; d’autre part, demander que le mandat de Djibril Bassolé soit étendu à tout le Soudan et ne soit pas limité au seul Darfour. (381) Le rapport Mbeki jugera pour sa part ultérieurement que « l'absence d'un forum permettant aux Darfouriens et aux autres Soudanais de définir ensemble leurs demandes et aspirations à la démocratie, au développement et à l'unité n'a fait qu'aggraver cette erreur d'appréciation aux effets néfastes. » (382).
Erreur d’appréciation ou pas, d’une manière générale, comme le Darfour le montre, comme l’exemple précité du conflit de l’Est le confirme aussi, le CPA, eu égard aux bénéfices qu’il a donnés à la guérilla sudiste du SPLM/A, a finalement été vu par les autres périphéries marginalisées comme une « prime » donnée à la violence armée, voire à l’impunité, sur la négociation politique qu’elles tentaient de leur côté de mener en vain depuis des décennies avec le centre. A tout le moins, la perception qui en est faite est celle d’un accord non pas inclusif, qui aurait pu servir de base à la négociation, moyennant d’inévitables révisions, mais tout au contraire exclusif. C’est aussi celle d’un accord qui, pour ne pas traiter la nature profonde des différends, contribue à faire perdurer des tensions et des frustrations, comme en témoigne les incertitudes qui semblent resurgir aujourd’hui dans les Monts Nouba. (383)
Comme Kofi Annan l’avait déclaré le 9 janvier 2005, cette date de la signature du CPA marquait « un commencement et non une fin » : elle était vue à juste titre comme l’ouverture d’un formidable défi pour les Parties signataires et pour la communauté internationale. Les différents sujets qu’il fallait traiter pour réussir à rendre l’unité du Soudan attractive et éviter que la partition six ans et demi plus tard ne soit le choix opéré par les populations sudistes représentaient un ensemble de chantiers considérables.
Cela étant, au long des cinq années écoulées depuis la signature du CPA, divers facteurs sont venus gêner et retarder sa mise en application. Certains d’ordre politique ou institutionnel, d’autres tenant à la communauté internationale qui n’a peut-être pas été à la hauteur de ses propres engagements.
a) L’inapplication du CPA durant la période transitoire
Certains des aspects du CPA exigeaient de la part des Parties prenantes de s’accorder sur des questions des plus épineuses, dont le caractère sensible explique les réticences de Khartoum à les mettre en œuvre. Des circonstances plus factuelles aussi, sans doute : La mort de John Garang le 31 juillet 2005, accidentelle ou non, a sans doute eu plusieurs effets directs sur le processus de paix et notamment la mise en œuvre du CPA. S’il avait vécu, compte tenu de ses propres ambitions et de sa vision du Soudan, le leader sudiste ne se serait-il pas attaché à travailler à l’inclusion des périphéries marginalisées au processus et au partage des ressources et des richesses dans le sens d’un véritable développement du pays ? Sans faire de politique fiction à rebours, on peut raisonnablement penser que le combat de John Garang en faveur de l’unité du Soudan aurait pesé dans la balance. De même, la constitution et le fonctionnement du gouvernement d’union nationale, GUN, en ont-ils directement pâti.
C’est Salva Kiir, son successeur à la présidence du Sud Soudan et à la première vice-présidence du Soudan, dont chacun souligne la différence de stature avec le leader historique, tant au plan de l’expérience politique que du charisme personnel, qui sera chargé de l’ensemble de la négociation avec le gouvernement central.
Dès le début, il apparaît ainsi que Khartoum est pour le moins réticent à respecter les dispositions du CPA quant au partage du pouvoir. Tout au plus applique-t-il à la lettre la répartition des sièges au sein du GUN, dans la mesure où le GoSS se voit attribuer un seul ministère régalien, celui des affaires étrangères, ceux des finances ainsi que de l’énergie et des mines qu’il visait lui étant refusés. Encore faut-il remarquer que le poste est confié à une personnalité qu’on peut aisément considérer comme à la marge du mouvement sudiste : Lam Akol est alors déjà un dissident du SPLM, rallié par le passé à Al-Bachir dont il a déjà été ministre dans les années 1990. Le partage des postes au sein de l’administration publique est lui aussi très lent : fin 2007, la décision de recruter 30 % de la fonction publique au sud n’avait toujours pas été mise en application.
D’autres thèmes importants des accords de Naivasha font également l’objet de retard. Indépendamment de la question d’Abyei, le partage des richesses pétrolières, ainsi que les accords sécuritaires sont notamment concernés, à tel point que le Secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, alertera le Conseil de sécurité, dont certaines résolutions reprendront les préoccupations (384). Deux ans après la signature du CPA, Salva Kiir fera de même pour s’en alarmer aussi et déclarer qu’il est « grand temps d’agir pour faire du maintien et de l’unité du Soudan une option attractive. » (385)
Le transfert de revenus pétroliers, crucial, compte tenu de l’extrême pauvreté et du sous-développement du Sud Soudan ainsi que de la répartition prévue dans le CPA, a été l’objet de la part de Khartoum de manœuvres dilatoires incessantes qui ont ému jusqu’aux négociateurs de l’IGAD : il a fallu près d’un an pour le GoSS reçoive la part qui lui était due des revenus de l’exportation pétrolière, après que des incidents sur la délivrance des permis d’exploitation eurent aussi alourdi le climat entre les deux partenaires. En cela, Khartoum n’a d’ailleurs fait que réitérer ses pratiques antérieures : après la signature des accords de paix d’Addis Abeba de 1972, le Nord n’avait finalement versé que 20 % des sommes qu’il s’était engagé à transférer au Sud pour son développement économique et la plupart des projets industriels ne furent alors pas achevés. (386) Aujourd’hui par exemple, le versement à certains Etats, Bahr el Ghazal, Sud Kordofan, et aux ethnies Ngok Dinka et Misseriya d’Abyei de la part, 2 %, qui leur est due aux termes du CPA, se fait toujours attendre.
La question du redéploiement des forces militaires a enfin été un autre sujet de discorde. Elle a porté à la fois sur le retrait des forces régulières de leurs positions respectives, sur la démobilisation des milices de chaque camp et sur la constitution de forces mixtes.
Deux ans après la signature, d’autres aspects essentiels n’avaient toujours pas connu le moindre début de mise en œuvre comme le découpage des circonscriptions ou le recensement de la population, de telle sorte que l’attitude de Khartoum entraîna un temps, pendant deux mois, d’octobre à fin décembre 2007, le retrait du SPLM du gouvernement d’union nationale. Au total, une étude récente d’International Crisis Group signale en particulier 17 points, sans que la liste soit exhaustive, sur lesquels la mise en œuvre du CPA a connu des retards, et n’est toujours pas achevée à la mi-décembre 2009 (387).
A ces manœuvres dilatoires de Khartoum, qui entraînèrent en octobre 2009 encore le retrait de la délégation du SPLM de l’Assemblée nationale, s’ajoutent les retards dus à l’inexpérience politique et institutionnelle du SPLM, à l’incapacité du Sud Soudan en manque de ressources humaines qualifiées, dont la diaspora parfois émigrée depuis longtemps, ne se montre pas, en ces premières années de paix, soucieuse de rentrer rapidement eu égard aux conditions de vie difficiles, au plan matériel ou de la sécurité. La reconstruction du Sud Soudan pâtit ainsi cruellement du manque d’attractivité de la région, encore fortement troublée.
Au total, pour reprendre une formulation du rapport Mbeki, tout semble s’être passé comme si « les deux parties prenantes au conflit du Darfour n'avaient pas compris que le CPA était la dernière chance pour le Soudan de préserver son unité nationale, et que tout retard dans sa mise en œuvre pourrait compromettre le projet du CPA consistant à rendre l'unité attrayante. » (388).
b) Les données objectives : le rapport de la Commission d’évaluation et de contrôle
Les accords de paix ont institué une commission d’évaluation et de contrôle de l’application du CPA – « Assessment and Evaluation Commission ». Présidée par Sir Derek Plumbly, ancien ambassadeur du Royaume Uni en Egypte, et composée de représentants des parrains internationaux du processus, la commission a assuré le suivi de la mise en œuvre du CPA ; Elle a été installée à la fin octobre 2005 et a véritablement commencé ses travaux en février 2006, soit plus d’un an après la signature du CPA et le début de la période de transition ; son dernier rapport a été publié en janvier 2010 (389).
Si l’on se penche sur les données fournies, il apparaît tout d’abord que les Parties ont engagé un dialogue soutenu sur nombre de points mais que les avancées concrètes restent modestes. Et que, en second lieu, les torts ne sont pas exclusivement à porter au débit de Khartoum.
Vos rapporteurs présenteront plus loin quelques une des avancées législatives qui sont récemment intervenues. En revanche, et de manière significative, le rapport souligne qu’aucun progrès n’a été fait quant au programme national de réconciliation, non plus que sur la désignation de la commission des droits de l’homme, alors même qu’un précédent rapport d’étape avait insisté sur l’urgence de traiter ces thèmes. La commission met également en avant la gravité des risques que comporte le fait de n’avoir pas encore délimité les frontières précises de la zone d’Abyei, dont il reste 20 % à tracer.
En ce qui concerne le partage des richesses, la Commission estime que les progrès sont intéressants, même si toutes les recommandations formulées dans son rapport d’étape n’ont pas été mises en œuvre. La question de la transparence du secteur pétrolier continue de faire problème. La décision de la cour permanente d’arbitrage sur Abyei a été un pas important mais beaucoup reste à faire pour créer, dans le peu de temps qu’il reste de la période intérimaire, les conditions d’une paix durable dans la région, selon les termes du rapport. La question de la sécurité globale dans les Etats du Sud Kordofan et du Blue Nile reste tout autant un sujet d’inquiétude pour la Commission.
Au plan des arrangements de sécurité, il est enfin intéressant de remarquer que le Sud Soudan, à la différence du Nord, est loin d’avoir redéployé ses troupes comme il l’aurait dû. Selon le rapport de la commission, les forces de l’armée soudanaise se sont désormais intégralement repliées au nord de la frontière du 1er janvier 1956, alors que le Sud Soudan n’a procédé qu’au quart, selon le rapport, du redéploiement auquel il devait procéder (390).
c) La communauté internationale et ses engagements
Indépendamment de ces aspects politiques essentiels et de la manière dont les un et les autres au Nord et au Sud ont appliqué ce à quoi ils s’étaient engagés, il est intéressant de se pencher sur l’attitude de la communauté internationale vis-à-vis du Soudan, dès après la signature du CPA. Mobilisée, on l’a vu, dans les négociations de Naivasha, la communauté internationale s’est aussi fortement engagée sur l’avenir du Soudan, pour la mise en œuvre du CPA.
Une très importante réunion des donateurs s’est ainsi tenue à Oslo, en avril 2005, au cours de laquelle environ 400 délégués de plus de 60 pays et organisations internationales se sont accordés sur le financement des besoins de la construction de la paix au Soudan, dans une perspective de développement. Cette conférence, hôte du gouvernement norvégien, répondait à l’appel du Secrétaire général des Nations Unies quelques semaines plus tôt.
Des programmes considérables ont alors été l’objet de promesses de financements, pour un montant total de quelque 4,5 Mds de US$, pour des besoins évalués dans un premier temps à 4,1 Mds. 2,6 Mds représentaient la contribution de la communauté internationale au programme de développement et 1,5 Md était destiné à couvrir les besoins humanitaires et les réparations des dommages de guerre. Des engagements complémentaires sont ensuite intervenus. Lors d’une nouvelle conférence, en mai 2008, le commissaire européen Louis Michel, chargé de l’aide au développement, annoncera ainsi que l’Union européenne apporterait 300 M€ supplémentaires sur les cinq années suivantes pour soutenir la mise en œuvre du CPA, en complément de l’aide de 100 M€ versée annuellement au titre de l’aide humanitaire d’urgence. Ces nouveaux engagements s’ajoutaient au 1,2 Md€ que la Commission européenne avait finalement accordé au Soudan, tous secteurs confondus, y compris le soutien à la MUAS, bien au-delà des 500 M€ qu’elle s’était initialement engagée à fournir en 2005.
Il est important de souligner que la conférence d’Oslo a voulu marquer le lien entre la responsabilité des donateurs à aider le Soudan à se relever du conflit moyennant un soutien financier et celles des parties prenantes au processus de paix, auxquelles il était demandé de respecter les droits de l’homme et notamment de faire des progrès significatifs dans la résolution de la crise du Darfour.
Cela étant, l’enveloppe initiale s’est révélée rapidement insuffisante, compte tenu notamment du nombre de rapatriés qui, par dizaines de milliers, ont eu recours aux programmes d’assistance. En outre, les décaissements ont été plus lents que prévus. Du moins faut-il sans doute ainsi entendre les propos du Conseil de sécurité, dans sa résolution 1784, notamment, « rappelant que la communauté internationale s’est engagée à apporter son soutien à l’Accord de paix global, y compris par l’aide au développement, et appelant les donateurs à soutenir l’application de l’Accord, notamment en honorant les promesses de dons faites à la Conférence d’Oslo de 2005 » (391). En 2008, selon Christian Delmet (392), les donateurs n’avaient ainsi versé concrètement que 430 MUS$ sur les 2 Mds promis au titre de l’aide au développement. Ce sont des chiffres d’un même ordre de grandeur qui seront donnés à vos rapporteurs par le président de l’Assemblée législative du Sud Soudan, James Wani Igga (393). Marc Lavergne porte un jugement similaire en précisant en outre que « la réunion des donateurs qui à Oslo avait promis 4 milliards de dollars pour le développement du Sud éludait le cœur du problème, politique et psychologique plus qu’économique. Même si l’argent avait été versé, il n’existait aucun projet de développement global ni aucune structure et aucune compétence pour le canaliser de manière efficace. » (394).
Le dernier rapport de la Commission d’évaluation et de contrôle confirme ces perceptions et précise que la troisième réunion des donateurs à Oslo en 2008 avait prévu quelque 4,8 Mds de US$ pour le Soudan, cette somme incluant aussi l’assistance humanitaire au Darfour. La commission note que les délais dans les décaissements ont affecté la mise en œuvre des programmes prévus dans le cadre du CPA et qu’au final, la MINUS restait l’expression la plus visible de l’aide de la communauté internationale au CPA.
A cela s’ajoute le fait que la nature ou la lourdeur des procédures internationales ont en partie affecté la gestion de l’aide et par conséquent la mise en œuvre du CPA. Le fait par exemple de confier à la Banque mondiale la gestion de deux Fonds de dépôt multi-donateurs, l’un pour le GUN, l’autre pour le GoSS, a entraîné des retards dans la mesure où le partenariat avec les deux gouvernements a souffert de l’insuffisante capacité des institutions soudanaises, au Sud Soudan surtout, pour traiter les dossiers avec la célérité requise pour répondre à des situations d’urgence. Plus adaptées à la mise en place d’une aide sur le long terme, ces procédures ont suscité des critiques dans la mesure où les résultats ont tardé à répondre aux attentes (395). En d’autres termes, une série de facteurs « exogènes » divers ont contribué à faire en sorte que le soutien que la communauté internationale s’était engagée à apporter aux parties prenantes au CPA soit finalement moins efficace que ce que l’on aurait été en droit d’attendre, eu égard à la brièveté de la période de transition qui exigeait une grande rapidité de réaction.
A cela s’ajoute le fait que, malheureusement, la crise du Darfour est nécessairement venue faire écran et sans doute détourner quelque peu l’attention de la communauté internationale.
Il est important de noter en premier lieu que la communauté internationale s’est mobilisée non seulement financièrement pour aider à la réussite de la paix au Soudan, mais aussi politiquement et sur le terrain. Parmi les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité au début de 2005, à côté de celle déférant la situation du Darfour au procureur de la CPI, la résolution 1593 du 31 mars, d’autres se concentrent sur la question du CPA et sur le Sud Soudan.
En tout premier lieu, la résolution 1590, adoptée le 24 mars 2005 a créé la Mission des Nations Unies au Soudan, MINUS. Cette mission, composée d’un maximum de 10 000 militaires et de personnels civils, dont au plus 715 policiers, a pour premier mandat « d’apporter un soutien à la mise en œuvre de l’Accord de paix global ». Créée initialement pour une durée de six mois, la MINUS, dont le principe était souhaité par le CPA, ne cessera par la suite d’être constamment renouvelée (396).
Dans ce cadre, plusieurs missions lui sont confiées qui portent en premier lieu sur des volets militaires : appui à la formation des unités communes intégrées, observation et surveillance des mouvements de groupes armés, appui à la mise en place du programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des combattants, en portant une attention spéciale aux femmes et aux enfants. Une composante civile est aussi prévue : campagne d’information « vigoureuse » dans tous les secteurs de la société, promotion de l'Etat de droit, réforme de la justice et de la police soudanaises, promotion des droits de l’homme, préparation des élections et référendums prévus par le CPA.
D’autres aspects complémentaires figurent également au mandat de la MINUS : faciliter et coordonner le retour des réfugiés et déplacés et l’assistance humanitaire ; contribuer à la lutte antimines ; contribuer à l’action en faveur des droits de l’homme et à la protection des civils au Soudan.
Près de cinq ans après son déploiement, la situation au Sud Soudan, sur plusieurs des aspects essentiels du mandat de la Mission, n’est pas excellente. Elle est même désastreuse sur le strict plan de la sécurité des populations civiles et sur la tension armée qui prévaut, notamment au plan interethnique. A cet égard, un récent rapport peut affirmer que « l'année 2009 s'est révélée particulièrement violente pour les populations du Sud Soudan : plus de 2 500 personnes ont été tuées et 350 000 ont dû fuir leur foyer. Ce bilan est encore plus catastrophique que celui signalé au Darfour, cette région de l'Ouest du Soudan frappée par un autre conflit plus médiatisé où la situation humanitaire est également très préoccupante. La violence s'exprime principalement dans les zones rurales reculées où les communautés sont souvent les plus pauvres et les plus difficiles à atteindre. La plupart des victimes sont des femmes et des enfants. Lors d'une attaque dans un village de l'état du Jonglei en août 2009, 161 personnes ont été tuées, principalement des femmes et des enfants. » (397)Dans le même esprit, on sait que le désarmement des milices est un échec, que les échéances électorales fixées dans le CPA pour 2009 ont déjà dû être reportées.
Est-ce à dire que la MINUS a failli à sa mission ?
A sa décharge, il faut relever qu’elle a souffert des mêmes aléas que ceux que la MINUAD rencontrerait un peu plus tard, quant au déploiement de ses forces qui a été plus lent que prévu. La mission des Nations Unies ne sera pas non plus aisée, sur le terrain, compte tenu de la tension forte entre Khartoum et Juba au long de cette période transitoire, qui traduit d’ailleurs bien le manque de confiance et de volonté politique qui animent les Parties prenantes : de violents affrontements ont par exemple eu lieu en novembre 2006 entre le SPLA et les forces militaires gouvernementales, qui se sont soldés par plus de 300 tués et ont contraint la MINUS à retirer une partie de son personnel de la zone et ultérieurement à se redéployer sur la région.
Enfin, les rapports de la MINUS avec le SPLA n’ont pas été aisés, concernant tout particulièrement le volet désarmement et démobilisation des forces : à ce jour, il est encore des zones, contrôlées par le SPLA, dans lesquelles les soldats de la MINUS, regardée avec la plus grande méfiance, sont purement et simplement interdits d’accès. De même, ses relations avec le gouvernement soudanais n’ont pas non plus été des plus fluides, comme on l’a vu, notamment lorsque Khartoum s’est opposé très fermement à l’extension de son mandat vers le Darfour, pour renforcer la MUAS, comme cela avait été fort inopportunément souhaité par le Conseil de sécurité pour aider à éteindre ce nouveau foyer de crise.
La MINUS aura pâti du bras de fer entre la communauté internationale et Khartoum, puisque cet épisode se traduira notamment par l’expulsion du représentant spécial de Kofi Annan, Jan Pronk. D’une certaine manière aussi, cela traduit pour partie le glissement de la priorité de la communauté internationale, pendant un temps tout du moins, du Sud Soudan vers le Darfour où le conflit, inattendu et brutal, est venu faire écran et s’interposer, jusqu’à ce qu’on se rende compte que la mise en œuvre du CPA était cruciale pour la résolution de l’ensemble des crises soudanaises et le maintien de la stabilité régionale. De la même manière, ce désengagement se traduira au plan financier : comme le faisait remarquer à titre d’exemple une étude d’International Crisis Group (398), l’USAID, premier donateur bilatéral au Soudan, a fourni en 2005 une aide globale de 855 MUS$, dont 55 % sont allés au Darfour. Plus de la moitié des fonds restants ont été consacrés à de l’assistance humanitaire et à une aide alimentaire. En d’autres termes, les sommes destinées au long terme, à la reconstruction et à la consolidation du processus de paix, à l’application du CPA proprement dit, apparaissent finalement résiduelles.
On peut remarquer aussi que la plupart des résolutions adoptées portent bien davantage sur le Darfour que sur le Sud Soudan. Les efforts que les Nations Unies auront consacrés en urgence à la résolution de la crise du Darfour, à l’apaisement de la situation sur le terrain et à la protection des populations civiles darfouri, auront été autant de moyens et d’attention, politique ou autres, en moins, qu’elles auraient pu et dû porter à la mise en œuvre du CPA, comme on en n’a d’ailleurs jamais douté : « Bien entendu, l’Accord ne met pas fin à tout. Un accord à la table de négociation marque le début d’un long et difficile parcours devant mener à l’édification de la paix au sein même de la société concernée. Il y aura beaucoup d’obstacles sur le chemin. Les anciens combattants devront être désarmés et démobilisés. Les personnes déplacées et les réfugiés devront retourner chez eux et participer à l’économie et à la société en revendiquant leur part des ressources, y compris les terres. Les terrains où se sont déroulés les combats devront être déminés pour qu’il n’y ait plus de zones interdites en temps de paix. Les attentes de la population en matière de bien-être, de croissance, d’éducation et d’autres besoins économiques et sociaux devront être satisfaites. Toutes ces tâches représentent à la fois un risque et une difficulté. Mais, si l’on échoue, la stabilité pourrait être remise en cause et de nouveaux conflits ainsi alimentés. » (399).
Parmi les points de tension entre le Nord et le Sud, celui d’Abyei est probablement le plus sérieux. Le CPA a tenté d’ouvrir la voie d’un règlement provisoire mais s’il est un aspect du CPA qui s’est révélé difficile, voire impossible à appliquer, c’est précisément celui-ci. D’autres étapes sont en conséquence intervenues, qui n’étaient pas prévues initialement et qui n’ont à l’évidence sans doute pas réussi à trancher définitivement la question, dans la mesure où des situations, des revendications n’ont pas été prises en compte, qui provoquent aujourd’hui la persistance d ’incidents inquiétants.
a) Abyei, un point névralgique
C’est depuis que l’on a découvert du pétrole dans ce pays que la région d’Abyei est devenue le point crucial du différend entre le Nord et le Sud. Un seul chiffre suffit à résumer l’importance de la zone d’Abyei : aujourd’hui, 250 000 barils de pétrole par jour en sont extraits, soit la moitié de la production soudanaise. Cette zone est donc d’un intérêt unique, tant pour le Nord que pour le Sud, et son rattachement à l’un ou l’autre change évidemment la donne, notamment dans la perspective d’une sécession du Sud en 2011.
Car Abyei est géographiquement située à la charnière du Nord et du Sud, au sud du Kordofan. Ainsi que le CPA le dit, il est traditionnellement considéré comme un pont entre le Nord et le Sud, qui relie les peuples du Soudan (400), dans la mesure où, depuis un passé ancien, une part importante de sa population, d’origine sudiste, avait adopté une culture arabe. C’est néanmoins une zone dans laquelle les tensions ethniques sont permanentes, notamment entre tribus sédentaires, en majorité, les Ngok Dinka, et tribus nomades et arabes, les Misseriya. Différends traditionnels et séculiers, auxquels le pétrole est venu ajouter sa part : De très violents combats se sont déroulés au long de la guerre et même ultérieurement : en mai 2008, les forces de l’armée soudanaise se sont très durement opposées à celles du SPLA, dans un épisode qui a notamment provoqué l’exode de quelque 50 000 habitants.
Dans cet ordre d’idées, la délimitation du tracé de la frontière de la zone est essentielle et a constitué l’un des thèmes des négociations du CPA. Un protocole spécifique, signé le 26 mai 2004 à Naivasha, a précisément porté sur « la résolution du conflit d’Abyei ». Préparé par le sénateur Danforth, il a été proposé au vice-président Taha et à John Garang, qui l’ont accepté comme base de la résolution du conflit.
Il prétend figer la situation pour la période transitoire. Le CPA reconnaît comme principe de base que le territoire d’Abyei est défini comme celui des neuf chefferies Ngok Dinka transférées au Kordofan en 1905, sur lequel les Misseriya et autres tribus nomades gardent leurs droits coutumiers de passages et de pâture.
Le protocole prévoit que, au cours de la période intérimaire, Abyei bénéficiera d’un statut administratif spécial, qui organisera notamment la distribution des revenus pétroliers tirés du sous-sol de la région et définira un exécutif local, élu par les habitants. A la fin de l’intérim, simultanément au référendum concernant le Sud Soudan, une consultation sera organisée qui offrira le choix aux habitants d’opter pour que la région garde un statut particulier en étant rattachée au Nord ou soit désormais partie du Bahr el Ghazal, en d’autres termes, rattachée au Sud (401).
Indépendamment de la question du partage des ressources, c’est surtout celle relative à la future délimitation exacte des frontières qui était en débat et d’autant plus nécessaire dans la perspective du référendum, dans la mesure où la démarcation précise du territoire des neuf chefferies Ngok Dinka restait à définir et faisait l’objet d’une dispute. Une commission des frontières d’Abyei, ABC, a ainsi été constituée dans le cadre du CPA, qui devait remettre ses conclusions dans un délai de deux ans.
Le gouvernement et le SPLM s’étaient entendus sur le fait que les décisions de la Commission seraient définitives et sans contestation ni recours, ainsi que le prévoyait le CPA lui-même. Néanmoins, Khartoum n’a pas reconnu les conclusions présentées, ce qui n’a pas été contesté par la communauté internationale pourtant garante de l’application du CPA. Après des moments de très vives tensions, le gouvernement soudanais a réussi à obtenir l’accord du SPLM qu’une cour d’arbitrage soit saisie pour déterminer si les experts de la Commission avaient ou non excédé leur mandat. Si tel était le cas, le tribunal arbitral devrait définir les nouvelles délimitations ; dans le cas contraire, les décisions de la Commission seraient d’application immédiate. Dans ce nouveau différend, le SPLM demandera le respect des positions de la commission.
Au-delà du strict point concernant la délimitation des frontières, la protocole sur Abyei n’a par la suite pas non plus été appliqué, notamment dans ses dispositions relatives à l’exécutif local, qui n’a pas été installé.
Il n’est pas inutile enfin de souligner que les populations locales ont fortement souffert des combats de la région, autour des puits de pétrole. Abyei est l’une des zones du conflit Nord-Sud desquelles les plus grands déplacements de populations se sont produits. Inversement, rapidement après la signature du CPA, des retours ont commencé de se faire, malgré l’incertitude quant au devenir de la région, malgré la tension militaire due à la position de Khartoum sur la question, qui s’est traduite à plusieurs reprises par des accrochages violents entre armée gouvernementale et SPLA.
b) La résolution du différend par la Cour permanente d’arbitrage et ses conséquences
La Cour permanente d’arbitrage de La Haye, saisie en juillet 2008 par les deux Parties, a rendu sa décision le 22 juillet 2009.
Au termes de son analyse, quatre des cinq arbitres du collège ont estimé que l’argumentation de la Commission sur certains des points était insuffisante et qu’il convenait de réviser le tracé des frontières proposé, dans la mesure où il était sujet à caution, en ce qu’il reposait sur des prémisses erronées. Si la frontière Sud d’Abyei n’est pas contestable, en revanche les tracés proposés par les experts de la Commission à l’Est, l’Ouest et au Nord de la région ne correspondent pas exactement, selon le collège d’arbitres, au territoire occupé par les Ngok Dinka au long des décennies passées, tel que le démontrent les témoignages et autres analyses anthropologiques.
Le cinquième arbitre, en revanche, par ailleurs membre de la Cour internationale de justice, produisit une opinion dissidente argumentant que la cour arbitrale rendait une décision contradictoire, sans fondement valable voire erroné, qui tentait de ménager les intérêts des Ngok Dinka sans prendre en compte les droits fondamentaux des Misseriya, ce en quoi elle était porteuse de risques pour la paix.
Comme le montre la carte ci-dessous, par rapport à la décision initiale contestée, la sentence de la Cour permanente d’arbitrage favorise le Nord Soudan, dans la mesure où plus de 40 000 Kms2 de la zone litigieuse resteront au Nord, quoi qu’il arrive lors de la consultation référendaire de janvier 2011, et ne seront pas rattachés au Sud Soudan. La zone d’Abyei se trouve ainsi réduite à 10 460 Kms2 sur près de 55 000 antérieurement.
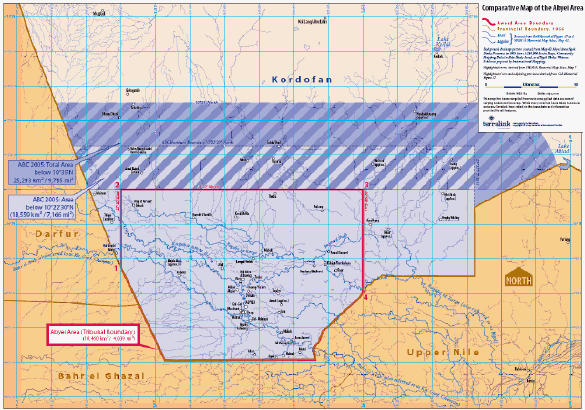
Tracé des limites territoriales de la région d’Abyei (402)
Quoi qu’il en soit de la controverse interne à la Cour d’arbitrage, les deux Parties déclarèrent immédiatement accepter la décision. Pour autant, à en croire le dernier rapport du Secrétaire général des Nations Unies au Conseil de sécurité, « les parties n’ont fait que peu de progrès dans l’application de la décision de la Cour permanente d’arbitrage sur la délimitation de la région de l’Abyei depuis la fin de la dernière période considérée. »
Cela n’est en tout cas pas sans incidence sur les futures ressources financières tirées du pétrole dont les uns et les autres disposeront. D’ores et déjà, le Nord applique la décision de la Cour permanente d’arbitrage pour le calcul de ses transferts de recettes pétrolières au Sud. Il décompte ainsi les recettes tirées des sites d’Higlig et considère qu’il a des droits exclusifs qui excluent tout partage, alors même que la commission de délimitation du tracé frontalier est loin d’avoir achevé ses travaux. (403)
Il n’est pas non plus indifférent de remarquer qu’aujourd’hui, les Misseriya s’estiment effectivement lésés par la décision et revendiquent une meilleure prise en compte de leurs droits : la situation est en ce moment même tendue sur le terrain, et leurs menaces d’attaques sur les puits sont prises au sérieux par Khartoum. Le travail de délimitation des frontières sur le terrain, dont il reste 20% à tracer, est bloqué. La question de leur propre statut et de leur droit de vote lors du référendum spécifique sur Abyei est au cœur de l’enjeu actuel et l’arbitrage rendu à La Haye, en cela, n’a pas résolu la question. Les décisions prises par la suite entre le SPLM et le gouvernement soudanais non plus, comme le montrent notamment la loi adoptée à la fin du mois de décembre 2009 pour l’organisation du référendum, sur laquelle vos rapporteurs reviendront plus loin.
B – Le Sud Soudan indépendant sera-t-il viable ?
On doit pouvoir postuler aujourd’hui, sans crainte de trop d’erreur, que le Sud Soudan sera indépendant au lendemain du référendum de janvier 2011. Consécutivement, se pose une première question quant à la viabilité de ce nouvel Etat africain, dont on voit d’ores et déjà les faiblesses, institutionnelles, économiques, financières. Ces inquiétudes reposent sur l’analyse des capacités institutionnelles du GoSS, sur la situation économique et financière et enfin, last but not least, sur les vives tensions interethniques qui agitent aujourd’hui la société sud-soudanaise. La capacité du Sud Soudan à exister dans un environnement complexe amène à s’interroger sur les moyens que devrait mettre en œuvre la communauté internationale pour l’y aider tout en maintenant la région stable.
1) Le plaidoyer pro domo du GoSS
Les interlocuteurs sudistes que vos rapporteurs ont rencontrés ont la plupart du temps fait montre d’une relative assurance quant à la capacité des autorités à gouverner un Sud Soudan indépendant. Leurs arguments méritent d’être avancés ; ils n’emportent toutefois pas l’adhésion totale de vos rapporteurs.
En premier lieu, les hautes personnalités de l’appareil du SPLM et des institutions du Sud Soudan se montrent aujourd’hui unanimement confiantes dans les capacités de l’appareil d’Etat à assumer ses attributions, sans pour autant se masquer l’immensité de la tâche et des difficultés qui les attendent : comme le disait à vos rapporteurs Luka Tombekan Monoja (404), ministre des affaires du cabinet du GoSS, « il n’y a pas de raison d’être optimiste, mais on ne peut pas être pessimiste ».
Aux arguments opposés quant aux difficultés futures, ils allèguent que la situation des autres pays africains est similaire : la question de l’enclavement du futur pays tout d’abord, serait un faux problème, en témoigne la situation de la République centrafricaine, dont on jamais contesté l’indépendance pour ce motif ; mieux, celle du Kosovo, non plus, que la communauté internationale a pourtant soutenue. En d’autres termes, la nécessaire cohérence de la communauté internationale est rappelée, dans la mesure où il y a cinq ans, elle a très officiellement appuyé la perspective de la séparation du Sud Soudan : Neuf pays ont été partenaires du CPA, les Nations Unies, la Ligue arabe, l’Union africaine et l’UE ont également parrainé le processus, il serait donc opportun qu’ensemble ils poursuivent leur démarche et appuient aujourd’hui la mise en place de ce nouvel Etat qu’ils ont alors promu (405).
De même en est-il des tensions interethniques, qu’on a présentées à vos rapporteurs comme étant fomentées par Khartoum, et plus intraethniques qu’interethniques, en ajoutant que, malgré les apparences, le Sud Soudan n’avait en fait jamais été aussi paisible depuis cinquante ans (406). En outre, les ethnies sont moins nombreuses au Sud qu’au Nord ; le problème, si problème il y a, n’est donc pas uniquement pour le Sud et l’interrogation devrait porter aussi sur le futur Etat du Nord. De plus, les questions ethniques se posent de manière générale dans tous les pays africains, du Nigeria à l’Ethiopie ou au Kenya, et il n’y a là rien qui doive diminuer la confiance dans la capacité des sudistes à surmonter des difficultés que d’autres rencontrent par ailleurs. Dans le même ordre d’idées, les représentants des églises sud-soudanaises que vos rapporteurs ont rencontrés partagent le sentiment des responsables politiques et considèrent, eux aussi, les rivalités entre sudistes sont moins fortes que celles qui opposent le Nord et le Sud, et qu’elles sont instrumentalisées par Khartoum (407).
Selon les responsables du SPLM rencontrés, les problèmes de sécurité interne actuels que rencontre le Sud Soudan seraient fomentés par Khartoum, qui provoque des accrochages violents, par l’intermédiaire de ses milices ou de la LRA, laquelle, avant la signature du CPA, a de tout temps été soutenue par les forces armées soudanaises ; aujourd’hui essentiellement repliée dans l’Etat d’Equatoria, la LRA continue de harceler les populations sudistes. Par ailleurs, la violence due aux civils armés est surtout le fait d’anciens miliciens qui n’ont pas pu être intégrés dans l’armée ; le problème existe certes, mais en proportion moindre que ce que Khartoum veut bien dire pour faire croire à l’ingouvernabilité du Sud Soudan et à l’incapacité de son gouvernement, et par conséquent, à l’impossibilité de le laisser prendre son indépendance. Le GoSS fait de gros efforts pour améliorer l’appareil de sécurité et les bénéfices s’en feront sentir à court terme.
Cela étant, la situation économique est désastreuse, de l’avis même des responsables sudistes rencontrés par vos rapporteurs qui ne cachent pas les difficultés. En premier lieu, la chute des cours du pétrole faisait encore sentir ses effets au moment de la visite de vos rapporteurs ; en second lieu, le Sud Soudan ne recevait que 20% de son dû, car Khartoum ne respectait pas le partage prévu dans le CPA (408). Le Sud Soudan allait devoir développer des sources de revenus autres que celles du pétrole et il faisait face à des difficultés de paiement, à un manque criant de liquidités. Parmi les raisons de la faiblesse de l’économie, le fait que les fonds promis par la communauté internationale aient fait grandement défaut : 400 MUS$ avaient été versés aux fonds multidonateurs gérés par la Banque mondiale sur les quelque 5 Mds prévus, et cela représentait autant d’espoirs déçus (409).
2) La perspective d’une économie exsangue
Malgré des propos qui se veulent rassurants ou confiants, les interlocuteurs de vos rapporteurs ne réussissent pas à ôter toute inquiétude. Plusieurs facteurs en effet montrent que la situation économique du Sud Soudan est à l’heure actuelle extrêmement critique et qu’il est peu probable qu’elle puisse être redressée dans un délai raisonnable, dans l’hypothèse où l’indépendance serait acquise, compte tenu de la faiblesse des capacités institutionnelles.
a) Les assises fragiles du développement du Sud Soudan
Les impressions que vos rapporteurs on pu recueillir de leurs entretiens avec d’autres acteurs que les plus hauts responsables politiques les incitent à la prudence.
En effet, la situation du Sud Soudan, aujourd’hui, après cinq ans de période transitoire n’a pas changé et elle reste toujours aussi désastreuse. A titre d’illustration, en témoigne la situation d’une institution comme la Commission en charge de la promotion de la paix auprès des populations (410), installée dans le cadre du CPA, dont les responsables ont par exemple exprimé l’impossibilité d’assurer leur mandat, faute de moyens matériels dans une zone géographique difficile d’accès, faute d’infrastructures et d’équipements : le manque de véhicules rend les déplacements entre Etats du Sud Soudan impossibles et l’absence d’électricité empêche les communications entre les différents bureaux de la commission. Tout est à reconstruire au Sud, voire à construire, et les ressources de toute nature manquent pour conduire de front les multiples chantiers. Cet état de fait, en soi problématique, est aggravé par les menées de ceux qui, sur le terrain, tentent de torpiller le processus et entretiennent la violence dans certaines zones, telle la LRA en Equatoria, contre laquelle les autorités, eu égard à la faiblesse de leurs moyens ont le plus grand mal à lutter. De même en est-il avec les troubles tribaux en Ethiopie ou au Kenya qui ont des incidences au Sud Soudan, compte tenu du caractère transfrontalier des populations intéressées. De telle manière qu’un volet entier du CPA, essentiel en ce qu’il porte sur les processus de réconciliation entre populations, se voit fortement handicapé faute de pouvoir compter sur l’appui matériel qu’il était en droit d’espérer pour pouvoir être exécuté.
La viabilité économique du Sud Soudan dépend en premier lieu des ressources qui seront les siennes au lendemain de la proclamation de son indépendance. A cet égard, les prévisions sont inquiétantes. Si l’on s’en réfère à des études réalisées pour 2009 par les experts des pays donateurs de l’aide internationale, la crise de l’économie sud-soudanaise, entre autres due à la faiblesse des transferts financiers du Nord, au demeurant lui-même en crise, et à la chute des cours pétroliers, devait être considérée comme la première des priorités du GoSS.
Pour les experts du Join Donor Team, la gravité de la situation se résume à deux chiffres : Les recettes prévisibles avoisinaient alors les 2,2 Mds de Livres soudanaises, pour un budget bâti sur des prévisions de dépenses de 3,7 Mds… S’y ajoutaient des tensions sur la situation alimentaire, dues à la faiblesse des récoltes en Ouganda et au Kenya. Le GoSS devait en conséquence faire face à d’énormes problèmes et parmi les scénarios esquissés, les solutions envisagées s’orientaient vers la réduction drastique des dépenses publiques,
– alors même que les services publics sont toujours quasi inexistants –, une politique d’austérité, de diminution des salaires et pensions de la fonction publique. Entre autres facteurs, le problème est dû au fait que le GoSS ne peut à l’heure actuelle, et pour longtemps, compter sur d’autres ressources que celles tirées de l’exploitation pétrolière et sur l’aide internationale. Le passé récent, entre retards dans la concrétisation des promesses et baisse des cours, prouve que cette situation est loin d’être optimale. Pour le futur, l’incertitude aujourd’hui encore sur la frontière, et par conséquent sur les champs pétroliers que le Sud Soudan sera assuré de détenir, complique encore les perspectives de recettes.
Or, comme le remarquaient en parallèle les experts du Join Donor Team, l’expérience montre qu’une situation de crise économique est un facteur aggravant de conflit dans les pays pauvres, auquel s’ajoute, dans le cas particulier du Sud Soudan, la tension croissante avec le Nord, l’insécurité latente et les troubles urbains, ainsi que la question du SPLA. Cette urgence a conduit le GoSS à solliciter son voisin éthiopien pour qu’il alerte la communauté internationale lors du G-20 de Londres en mars 2009, où il allait représenter l'Union africaine, afin que des aides soient apportées au Sud Soudan. Pour le ministre sud-soudanais Luka Biong Deng, cette crise fiscale et économique est un obstacle au processus de paix au Sud Soudan. (411)
Ainsi, avant même que l’indépendance ne soit proclamée, la situation du Sud Soudan est d’ores et déjà économiquement et financièrement intenable. Elle l’est d’autant plus que la structure budgétaire du Sud Soudan montre que les priorités ne portent pas sur le développement à long terme de la province. En premier lieu, à l’identique de ce que fait le gouvernement central à Khartoum, l’essentiel de la dépense budgétaire est consacrée à la capitale, Juba : 90 % des dépenses de salaires et plus de deux tiers des dépenses de développement sont le fait du gouvernement central du Sud Soudan. Les autres Etats du Sud Soudan sont donc à leur tour des périphéries marginalisées par rapport au centre, à l’instar de celles de Khartoum au niveau national. De plus, selon les données du budget de 2008, le tiers des dépenses est affecté à la sécurité et à la défense, complété en cours d’année par des crédits supplémentaires à destination du SPLA. (412) On estime ainsi que les deux tiers des budgets sont consacrés à la défense et bénéficient d’une manière ou d’une autre aux Dinka. Le fait que le SPLA ait fonctionné la plupart du temps au long de ces deux décennies de guerre comme une armée de conscrits ou de volontaires non rémunérés est sans doute à la base de cet état de fait qui, aujourd’hui, grève considérablement les finances publiques du Sud Soudan et hypothèque par là même toute possibilité d’une politique de développement.
Tout cela avant même, devrait-on ajouter, que la question, cruciale entre toutes, des voies d’exportation de son pétrole par une autre route que l’oléoduc du Nord vers Port-Soudan ne soit réglée. Des études sont actuellement en cours, pour une exportation de la production vers l’océan indien via le Kenya, mais rien n’est encore concrétisé, sachant que la construction d’un nouvel oléoduc vers Mombasa représenterait des travaux longs et d’un coût estimé à quelque 4 MdsUS$, selon les informations communiquées à vos rapporteurs. (413)
S’il est de l’intérêt bien compris des deux parties, ainsi que de celui de leurs clients asiatiques, de s’entendre pour continuer à exporter le pétrole soudanais par Port-Soudan, reste que l’on peut légitimement voir dans cette question un futur point de crispation aiguë, que le CPA n’a cependant pas cru devoir aborder de manière anticipée, alors même qu’il a envisagé la partition du pays.
b) La conjonction de la faible institutionnalisation et de la corruption
Pour autant, bien que le Sud Soudan n’ait pas reçu la totalité des recettes que le Nord aurait dû lui verser, que les donateurs internationaux n’aient pas non plus tenu tous leurs engagements, ses ressources financières n’ont pas été nulles, loin de là. On estime qu’il a reçu quelque 6 Mds de US$, dont cependant les populations locales n’ont ni vu ni senti les effets concrets en termes de développement des infrastructures ou des services publics. Le problème de la corruption du Sud est donc posé avec acuité, par tous les observateurs et nombre d’interlocuteurs de vos rapporteurs, au point que ce thème est considéré comme l’un des plus critiques auxquels doivent faire face les jeunes institutions sud-soudanaises. Loin d’être un sujet agité par les contempteurs du Sud Soudan, il s’agit d’une réalité, objet des discussions des forums d’investissements internationaux consacrés à la région. De même est-il utile de rappeler à ce sujet l’arrestation du ministre des finances du GoSS en mars 2007 sur ordre du président Salva Kiir, sous ce chef d’inculpation.
Au-delà du cas d’une seule personnalité, la corruption a été érigée en véritable système et les informations faisant état de scandales sont nombreuses et fréquentes. Pour Marc Lavergne (414), le Sud Soudan a « sombré dans la corruption, le népotisme et le tribalisme » et « le détournement de fonds est l’unique moyen d’accumulation primitive de capital ». La manne des aides internationales est bien évidemment le moyen le plus immédiat pour l’enrichissement des anciens combattants, impatients de retirer quelques bénéfices concrets de leur engagement. De même en est-il de la richesse pétrolière. La lutte contre le phénomène est d’autant plus difficile que les lignages familiaux et claniques, tribaux ou ethniques, jouent un grand rôle dans les mécanismes de solidarité locale et de répartition des richesses.
Le Sud Soudan est confronté à une situation économique et sociale extrêmement difficile, héritée d’un profond sous-développement que plus de vingt ans de guerre ont conforté. La situation politique et l’impréparation de ses élites administratives contribuent à la détérioration des conditions de vie des populations qui, selon les représentants des églises que vos rapporteurs ont rencontrés, étaient meilleures du temps de la guerre qu’aujourd’hui, le GoSS laissant à l’abandon sa propre population. (415)
3) Le Sud Soudan est-il au bord de la guerre civile ?
Sur cette toile de fond socioéconomique délicate, d’autres éléments viennent se greffer dont la prise en compte permet de mieux mesurer l’inquiétude que la perspective de l’indépendance du Sud Soudan suscite actuellement.
a) L’impossible désarmement des milices
Ainsi que vos rapporteurs l’ont indiqué, la question militaire est un des aspects important des accords de paix. Les accords de Naivasha ont traité plusieurs thèmes complémentaires : la démobilisation des milices, la création de forces mixtes, dont on a vu le retard considérable dans la mise en œuvre et le redéploiement, sur lequel le SPLA a fait preuve de mauvaise volonté.
De chaque côté, durant le conflit, des milices ont soutenu les armées, SPLA et forces armées soudanaises. La démobilisation des milices du Sud est un des sujets que lesquels il apparaît que les autorités n’ont pas eu la capacité, si tant est qu’elles en aient eu la volonté, de désarmer comme elles l’auraient dû les populations. Cette impossibilité tient à la nature tribale ou ethnique des différentes milices et au positionnement de leurs chefs durant le conflit et spécialement par rapport à John Garang. Les premières milices ont ainsi été constituées d’éléments Nuer, au cours des années 1980, par le général Nimeyri, pour sécuriser les puits de pétrole de la région de Bentiu, dont certains des chefs, issus de la mouvance séparatiste Anyanya s’opposèrent ensuite à John Garang. Les alliances, les retournements d’alliances, des uns et des autres, n’ont cessé au fil des années 1990 et 2000, les chefs, au demeurant, étant ou non suivis ou trahis par leurs lieutenants.
L’histoire de cette période du mouvement sudiste est des plus complexes (416). Elle montre en tout cas la très grande difficulté qu’il y a pour une région comme le Sud Soudan, au sortir d’un aussi long conflit civil, à entrer dans la voie de la paix.
Elle montre, en l’espèce, concrètement l’impossibilité de désarmer : compte tenu de leur histoire, de rivalités ethniques et tribales ancestrales entretenues et consolidées par des années, voire des décennies de lutte, un désarmement piloté par une élite issue d’une seule et même ethnie, les Dinka, occupant aujourd’hui le pouvoir politique ne peut avoir une quelconque légitimité. Le gouvernement n’a aucune chance d’obtenir le désarmement volontaire de la part de troupes qui se considèrent comme son ennemi, peut-être autant que Khartoum.
En conséquence, le GoSS s’est trouvé dans l’incapacité d’intégrer dans son armée régulière des forces supplétives qui l’ont aidé dans son combat. Celles-ci sont donc restées armées et libres de toute tutelle, incontrôlables, à la différence de ce qui était prévu dans le CPA. L’armement de ces milices est tel que toute tentative de désarmement de force par le SPLA entraînerait des risques élevés de conflits interethniques violents, ainsi que le soulignaient devant vos rapporteurs les représentants du CICR (417). Cette crainte est loin de n’être qu’une hypothèse : De tels heurts se sont déjà produits dans le passé, comme dans l’Etat de Jonglei, notamment, dans lequel une campagne de désarmement forcé a provoqué la mort de 1600 éleveurs armés et de soldats du SPLA entre décembre 2005 et mai 2006 (418).
En complément de cette situation préoccupante, d’autres milices locales existent, autoconstituées plus récemment et essentiellement chargées de la protection des populations civiles, contre les incursions des belligérants, contre les tribus voisines ou les raids de la LRA. Ces milices sont également peu enclines au désarmement, eu égard à leur rôle vis-à-vis des populations qu’elles protègent. Des heurts violents se sont d’ailleurs produits au cours des dernières années, notamment avec des détachements du SPLA, dont certains ont fait jusqu’à 300 morts. Il va de soi que la multiplication des milices, fort bien armées, sur tout le territoire sudiste, est en soi un facteur de déstabilisation supplémentaire et de violences inter et intra ethniques (419).
Enfin, les difficultés financières du GoSS ne sont pas non plus sans effet sur ses propres troupes du SPLA, dans la mesure où son manque de trésorerie lui rend problématique le paiement régulier des soldes. Des mois de retard, au cours des dernières années ont ainsi provoqué à leur tour une tension avec le GoSS.
b) Incidences des tensions interethniques
Sur une toile de fond très fortement militarisée, non seulement les tensions interethniques traditionnelles sont restées vivaces, mais elles semblent aussi plus fortes que jamais au sein du Sud Soudan. Les affrontements entre communautés sont depuis longtemps et désormais de manière systématique, à la fois violents et fréquents.
Le scénario est classique et bien connu : celui de conflits tribaux traditionnels, héréditaires, mais exacerbés par la raréfaction des ressources et l’armement des acteurs. Le fait qu’une ethnie, les Dinka, domine au Sud Soudan considérablement les autres, et accapare le pouvoir rend la situation explosive : en témoigne aujourd’hui, le nombre de morts qui est désormais au Sud Soudan infiniment plus élevé qu’au Darfour. Comme on l’a dit, ce sont quelque 2500 personnes qui ont été tuées en 2009, tandis que 350 000 autres fuyaient leurs foyers.
Le changement qu’il semble important de souligner, aux yeux de vos rapporteurs, réside dans le fait que les causes qui ont généré les conflits entre le Nord et ses périphéries, se retrouvent aujourd’hui à l’identique au coeur des tensions interethniques au Sud Soudan. Ainsi, la question foncière joue-t-elle aujourd’hui notamment entre Bari et Dinka, les élites et officiels de cette dernière ethnie tendant à s’approprier les terres des Bari. (420) Pour ne pas parler de la tension entre Dinka et Nuer, sur fond de richesse pétrolière.
Consécutivement, ces éléments permettent de prédire que les échéances électorales à venir, et tout particulièrement les élections générales d’avril 2010, quelle que soit l’attention que pourra y porter la communauté internationale pour assurer la sincérité des scrutins, ne suffiront sans doute pas à garantir la légitimité du futur gouvernement du Sud Soudan. Il est clair que le SPLM n’a pas encore réussi à apparaître comme un parti politique, national ni même à l’échelle du Sud-Soudan, incontesté, et que les élections se joueront sur des clivages ethniques avant que d’être programmatiques. Les rivalités tribales détermineront les positionnements politiques. Dans une société sud-soudanaise surarmée où, comme on l’a vu, les modes de résolution traditionnels des conflits ont disparu ou ne fonctionnent plus, où les jeux incessants et basculements d’alliances au cours de la guerre ont bouleversé ou exacerbé les tensions ancestrales que la paix n’a pas réussi depuis à apaiser, qu’est-on réellement en droit d’espérer des prochaines consultations électorales dans lesquelles chacun votera selon son lignage ?
La domination numérique des Dinka laisse prévoir, dans ces conditions, leur victoire électorale, si tant est que les élections puissent être effectivement organisées compte tenu des retards et difficultés logistiques dans un pays encore au sortir de la guerre, en manque de toute infrastructure. Consécutivement, la perpétuation, sanctionnée par les urnes, de la monopolisation du pouvoir par les Dinka, à l’instar de nombre de scénarios que beaucoup d’autres pays africains connaissent, risque d’aviver les tensions actuelles. Cette inquiétude est partagée par nombre d’observateurs, tels le CICR ou les églises sud-soudanaises, qui appellent la communauté internationale à un sursaut pour aider le Soudan à surmonter ce cap et à rester en paix. (421)
c) Le risque d’une guerre entre sudistes ?
En d’autres termes, un ensemble d’éléments est en train de se mettre lentement en place au Sud Soudan. L’inquiétude des observateurs et des ONG porte notamment sur le fait que les derniers mois ont été une période de tension croissante, que rien n’est venu apaiser.
Comme on l’a souligné, 2500 personnes ont été tuées en 2009, malgré les efforts du GoSS, malgré surtout la présence sur place depuis plusieurs années maintenant de près de 10 000 hommes de la MINUS, assistés de 3000 personnels civils, dont le mandat est, entre autres, précisément de « contribuer à l’action menée à l’échelon international pour défendre et promouvoir les droits de l’homme au Soudan, et coordonner l’action internationale visant la protection des civils, en s’intéressant en particulier au sort des groupes vulnérables, y compris les personnes déplacées, les réfugiés de retour et les femmes et les enfants, dans la limite de ses moyens et en étroite coopération avec les autres organismes des Nations Unies, les organisations apparentées et les organisations non gouvernementales ».
Comme toujours au Soudan, ce sont les civils qui constituent l’essentiel des victimes : en effet, selon les informations communiquées à vos rapporteurs (422), le rapport entre tués et blessés lors de ces affrontements est de 10/1, ce qui montre clairement le fait que ce sont les populations civiles et non des combattants qui sont les cibles privilégiées ; le nombre de blessés serait infiniment supérieur dans le cas contraire.
Ces données montrent que l’année 2009 aura été particulièrement violente : ce sont plus du double de victimes qui ont péri par rapport à 2008. Il est à noter que c’est surtout l’Etat de Jonglei qui est touché par cette flambée de violence, sans que les autres soient pour autant épargnés. Si le fond est toujours le même, des conflits traditionnels, vols de bétail et représailles entre pasteurs, entretenus par l’armement des populations, il semble que la nature et l’échelle de la violence aient changé (423) : les affrontements entre Nuer et Dinka prendraient un tour plus politique ; ceux entre Nuer et Murle se sont à ce point exacerbés que la PNUD et la MINUS notamment, ont appuyé une conférence de la paix entre ces ethnies ; d’autres éclatent entre sous-clans Nuer. Selon le Secrétaire général des Nations Unies (424) : « De nombreux affrontements et attaques ont eu lieu dans le Sud, essentiellement dans les États du Haut-Nil, d’Unity et de Jonglei, ainsi que dans le triangle entre les États de Jonglei, d’Équatoria central et des Lacs. Le 17 octobre, apparemment en représailles à des attaques perpétrées en septembre, les Dinka ont attaqué les Lou Nuer dans le comté d’Uror, (État de Jonglei), et auraient tué sept personnes et incendié 120 maisons. Le 16 novembre, un différend entre les Mundari et les Dinka Aliap dans le comté d’Awerial (État des lacs) aurait causé la mort de 49 personnes. Des accrochages entre Shilluk et Dinka dans l’État du Haut- Nil du 7 au 13 novembre auraient fait 11 morts. La situation est restée tendue à Bentiu à la suite des combats opposant des forces commandées par le Gouverneur Taban Deng Gai et le commandant en second de l’Armée populaire de libération du Soudan (SPLA), le général Paulino Matiep, le 2 octobre. » La citation de vos rapporteurs pourrait continuer ainsi.
L’inquiétude ne cesse de croître chez l’ensemble des observateurs, comme au sein de la communauté internationale et si l’on ne parle pas encore de risque de guerre civile interne au Sud Soudan, la situation est suffisamment critique pour que le Secrétaire général des Nations Unies se soit récemment déclaré très préoccupé par la poursuite des violences. Il a appelé le GoSS à tout faire pour assurer la protection des populations civiles, à briser le cycle de la violence, ainsi que la communauté internationale « à redoubler d’efforts pour contribuer à la solution de ces problèmes à court terme et pour donner au gouvernement du Sud Soudan les moyens d’y faire face à long terme. » (425) Cette préoccupation est d’autant plus vive que s’ajoute désormais à la violence un contenu politique nouveau que la crainte de voir le SPLM, à l’approche des échéances électorales d’avril 2010, s’ériger en parti monopoliste a conforté, le GoSS ayant semblé ces derniers temps vouloir étouffer l’opposition au SPLM.
Le Sud Soudan semble aujourd’hui à la croisée de chemins l’un comme l’autre périlleux. Son avenir apparaît en premier lieu conditionné par sa situation interne, tout à la fois difficile et tendue, qui ne laisse pas augurer d’un avenir paisible. Il l’est aussi par la mise en application du CPA, lui-même porteur d’un risque d’implosion du Soudan. La proximité des échéances, essentiellement le référendum de janvier 2011, et le degré actuel d’impréparation dans lequel se trouvent les partenaires en ce qui concerne la période suivante, appellent à un sursaut immédiat pour que la sécession, dont on ne voit pas qu’elle puisse être aujourd’hui évitée, ne soit pas dramatique.
C – Une course contre la montre
Une dynamique est donc inexorablement engagée vers la séparation en janvier 2011 du Sud Soudan de son partenaire nordiste. A ce stade, désormais la question est celle du rôle de la communauté internationale pour permettre à cette partition de s’effectuer de façon non violente. Il y a cinq ans, elle a envisagé cette éventualité, sans peut-être en mesurer toutes les conséquences, sans apporter ensuite toute l’attention nécessaire au long de la période intérimaire à l’accompagnement de cette difficile transition. Aujourd’hui au pied du mur, la communauté internationale ne peut faire autrement que de prévenir l’éclatement d’une nouvelle crise, voire l’embrasement de la région.
1) Le temps perdu se rattrape-t-il jamais ?
A moins d’un an aujourd’hui du référendum au Sud Soudan, il est essentiel de s’interroger sur la question de savoir s’il est possible de rattraper le temps perdu dans la mise en œuvre du CPA pour essayer de rendre l’unité effectivement attractive pour les sudistes.
Les derniers mois ont vu les partenaires soudanais réussir enfin à s’entendre, non sans mal et sous la pression internationale, sur un certain nombre de textes législatifs, indispensables à la réalisation des échéances électorales prévues. Plusieurs lois ont été adoptées au dernier trimestre 2009, sur la presse et les media, ou sur les élections nationales. La commission des élections nationales et le conseil des partis politiques ont ainsi été institués.
Trois lois, notamment, ont été adoptées à la fin du mois de décembre 2009 : la loi pour le référendum du Sud Soudan ; la loi pour l’organisation de la consultation populaire dans les deux Etats du Sud Kordofan et du Nil bleu ; la loi pour le référendum d’Abyei.
Celle sur le référendum du Sud Soudan a fait l’objet de très intenses tractations entre le PCN majoritaire du Nord, parti gouvernemental, et le SPLM, portant notamment sur la composition du corps électoral et les étapes qui devront être franchies après la consultation. Ces tractations ont été âpres non seulement entre les deux parties, mais également au sein du PCN et ont révélé de nouveau des lignes de fractures fortes entre des tendances plutôt partisanes de l’ouverture, tel le vice-président Taha, négociateur historique du Nord avec la rébellion sudiste, chargé de ce dossier, et d’autres plus enclins à la fermeté, tel Ghazi Salaheddine al-Atabani, qui a reproché les concessions trop importantes faites au SPLM. Il faut par exemple rappeler que le PCN avait entamé la négociation en proposant un seuil de 75 % de suffrages exprimés en faveur de l'indépendance pour entraîner la sécession, alors que le Sud exigeait la majorité simple de 50 % plus une voix, qui sera finalement adoptée. De même, le taux de participation pour rendre la consultation valable a-t-il été réduit à 58 % du corps électoral.
Si la loi sur le référendum d’Abyei, adoptée quelques jours plus tard, montre aussi un point d’entente atteint entre SPLM et PCN après de difficiles négociations, force est de constater qu’elle risque de ne pas satisfaire totalement l’ensemble des intéressés. Indépendamment du fait que le territoire d’Abyei n’étant pas encore définitivement déterminé, une incertitude subsiste quant au corps électoral qui sera appelé à se prononcer, il est fait peu de cas de certaines ethnies. L’article 24 (426) de la loi donne en effet le droit de vote aux Ngok Dinka, mais laisse à la commission du référendum, créée à cette occasion, le soin de déterminer les critères de résidence à Abyei pour les autres citoyens qui seront électeurs. C’est l’adoption de cet article qui a entraîné le départ des députés Misseriya de l’Assemblée nationale, estimant les droits de leur communauté insuffisamment garantis.
Une troisième loi a enfin été adoptée, portant sur l’organisation de la consultation des populations des Etats du Sud Kordofan et du Nil bleu, afin de savoir si ces dernières acceptent ou non le CPA comme mode de règlement du conflit en ce qui concerne leur Etat. En cas de refus, une négociation spécifique serait organisée par le gouvernement pour inclure lesdites attentes dans le CPA révisé à cette fin, par décret présidentiel devant les y inclure.
b) La situation sur le terrain et l’état d’esprit de l’opinion sudiste
Pour positives et indispensables qu’elles soient, ces avancées restent relativement modestes, comparativement à l’ampleur de la tâche qui aurait dû être accomplie depuis janvier 2005, et qui reste à terminer dans le cours délai avant le référendum.
Or, d’autres aspects essentiels, qui permettent de mesurer le degré de confiance atteint entre les deux partenaires du processus, incitent au pessimisme. C’est notamment le cas en ce qui concerne les volets militaires du CPA. Les unités conjointes, particulièrement, par lesquelles il était prévu de fusionner troupes sudistes et forces armées nationales dans une armée unique, sont encore aujourd’hui inexistantes ou plus précisément, selon les informations qui ont été communiquées à vos rapporteurs, doivent être considérées comme une pure fiction : bien qu’elles aient été officiellement constituées, concrètement, rien n’a encore été intégré, et les commandements, les entraînements, les opérations, voire même l’hébergement des soldats, restent distincts. Le coût des différentes unités qui les composent reste également assumé par leurs armées d’origine. Il arrive même que ces unités supposément intégrées soient sources de sérieuse instabilité : des cas d’affrontements armés entre soldats issus de l’armée nationale et du SPLA ont été rapportés qui ont tué plusieurs dizaines de civils, 150 dans un cas, par exemple à Malakal en novembre 2006 et en février 2009. (427)
De la même manière, au plan institutionnel ou administratif, aujourd’hui encore, au niveau des Etats du Sud, la gestion conjointe prévue dans le CPA est plus de façade que réelle. Gouverneurs et gouverneurs adjoints se partagent certes les tâches, mais chacun de son côté, voire dans des édifices ici aussi séparés. Chacun satisfait les besoins de sa clientèle à savoir les localités proches qui, du SPLM, qui du PCN.
Selon les avis de nombreux observateurs, tout se passe aujourd’hui encore comme si SPLM et PCN étaient en situation d’attente de l’échéance de janvier 2011, sans rien faire qui puisse essayer de renverser la tendance dominante en faveur de la sécession du Sud Soudan.
Vos rapporteurs ont retiré l’impression des nombreuses rencontres qu’ils ont effectuées, qu’au Sud, il y a depuis longtemps une forte volonté en faveur de l’indépendance. Certains des interlocuteurs rencontrés, tel Luka Tombekan Monoja (428), ministre des affaires du cabinet du gouvernement du Sud Soudan, (GoSS), y voit même la clef de la paix, argumentant que tant que le Sud et le Nord n’auront pas de territoires séparés, il ne pourra pas y avoir de pacification au Soudan. La partition est d’ailleurs un état de fait, dans la mesure où il y a déjà deux constitutions en vigueur, et deux armées. Pour ce ministre clef du GoSS, seul le PCN veut maintenir l’unité du Soudan, mais personne au Sud ne partage cet avis. Sans être aussi affirmatif, James Wani Igga, président de l’Assemblée législative du Sud Soudan, estimait pour sa part que la population sudiste devrait voter l’indépendance, qu’il croyait probable. Pour leur part, plusieurs représentants d’églises et mouvements religieux du Sud Soudan confirmèrent que les habitants du Sud, malgré les très grandes difficultés qui se présenteraient inévitablement à l’issue du référendum, préfèreraient bien plus être « citoyens de première classe » chez eux, que de seconde classe dans un Soudan uni et qu’il n’y avait aucune illusion à se faire à ce sujet. (429) Le président du GoSS, Salva Kiir, est aujourd’hui exactement sur la même ligne, si l’on en croit les propos qu’il a tenus en octobre 2009, tels qu’ils ont été rapportés par la presse (430). Les exemples pourraient être multipliés sur cette perception des acteurs sudistes et de la plupart des analystes qui aujourd’hui partagent tous la même conclusion.
Certains observateurs restent toutefois prudents dans leurs commentaires et notent que, au sein de la population sudiste, ce sont surtout les Dinka qui sont en faveur de l’indépendance, que les autres ethnies craindraient plutôt de ce fait, compte tenu de l’hégémonie d’ores et déjà exercée par les Dinka (431). Compte tenu de la dimension tribale forte, qui prime la dimension nationale, il ne serait finalement pas aussi certain que la majorité de la population soit en faveur de l’indépendance.
Quoi qu’il en soit, au-delà de ces divergences d’appréciation, force est de constater, et c’est là un point essentiel, que personne ne croit plus aujourd’hui que l’unité du Soudan soit un projet politique suffisamment attractif pour inverser la tendance en faveur de l’indépendance du Sud d’ici à janvier 2011.
Au désenchantement initial des régions périphériques qui n’avaient pas été incluses dans le processus de négociations du CPA, s’est peu à peu ajouté celui des partenaires mêmes de cet accord, des sudistes, plus précisément, tel qu’on peut le percevoir à l’écoute des acteurs.
Sans surprise, les nordistes en rejettent la responsabilité sur les sudistes qui soutiennent pour leur part que Khartoum n’a rien fait que de verser de l’huile sur le feu. Ghazi Salaheddine al-Atabani, proche conseiller du Président soudanais, se plaisait (432) à énumérer l’ampleur des concessions que le Nord avait été contraint de faire au profit du Sud Soudan dans le cadre du CPA et reprochait au SPLM de ne cesser de parler de sécession, sans rien faire de sa part de chemin vers l’attractivité de l’unité, au plan législatif notamment. Inversement, Luka Biong Deng soutenait (433) que Khartoum avait « tué » les mécanismes qui permettaient de garantir la mise en place du CPA et rejetait la responsabilité du temps perdu dans les manœuvres du Nord, plaidant que la bonne foi du SPLM ne cessait de se heurter à la mauvaise volonté du PCN.
Quoi qu’il en soit, sans qu’il s’agisse ici de jeter la pierre aux uns ou aux autres, une analyse « simple » inciterait à conclure que c’est plutôt, en bonne logique, aux nordistes qu’aux sudistes qu’il appartenait de faire la preuve de l’attractivité de l’unité : les sudistes en rébellion depuis aussi longtemps, sensibles mêmes pour nombre d’entre eux, aux sirènes de la séparation depuis le début des années 1990, - voire même plus encore si l’on se remémore les claires ambitions du mouvement Anyanya dans les années 1960 avant la paix d’Addis Abeba de 1972 -, ne risquaient pas d’avoir spontanément pour Khartoum les yeux de Rodrigue pour Chimène. Il fallait à l’évidence que le Nord convainque le Sud que son intérêt bien compris résidait dans l’unité du Soudan. Or, le constat que font aujourd’hui certains dirigeants sudistes (434) est qu’il n’y a pas de différence, en ce qui les concerne, entre l’avant et l’après CPA. Par conséquent, les dirigeants n’ont rien qu’ils puissent présenter à leurs électeurs pour les convaincre que l’unité du Soudan est effectivement attractive. En ce sens, la mort de John Garang n’a certes pas facilité la tâche des responsables sudistes, même si dans les premiers temps, Salva Kiir restait sur la ligne d’un Soudan uni : En 2008 encore, l’évolution du SPLM vers un parti politique aux ambitions nationales ne semblait pas chose gagnée et les tendances unionistes et séparatistes en son sein s’y affrontaient encore durement (435).
Depuis 2005, rien n’a été fait ou insuffisamment par Khartoum puisque aujourd’hui la position majoritaire des sudistes, autorités politiques comme populations, est semble-t-il en faveur de la séparation.
Cette situation, et cette attitude de la part de Khartoum, ne laissent pas d’intriguer, dans la mesure où, comme on le verra ultérieurement, vos rapporteurs ne croient pas que la séparation du Sud soit dans l’intérêt du Nord. Or, on a laissé s’enliser voire pourrir une situation sans rien faire pour éviter de risquer le pire dont les effets ne se feront à l’évidence pas sentir uniquement pour Juba. D’une certaine manière, ne faut-il pas voir ici une autre facette de l’attitude récurrente de Khartoum vis-à-vis de ses périphéries, celle d’un jeu on ne peut plus dangereux, dans lequel chacun risque de perdre beaucoup, voire même trop, - le pétrole, en l’occurrence pour le Nord et une part conséquente du territoire national -, si l’on porte un regard « rationnel » sur les enjeux. Tout se passe en tout cas comme si Khartoum avait joué la carte de la sécession du Sud, au risque de sacrifier sa principale source de devises étrangères, qui représente aujourd’hui les deux tiers de son budget national, lequel est consacré à 85 %, selon les estimations les plus couramment admises, aux dépenses militaires…
En d’autres termes, se retrouvent ici les conséquences de la gestation du CPA qui n’a pu être signé que sous la pression de la communauté internationale sans laquelle aucun accord n’aurait sans doute jamais été signé (436). Tout a été misé sur le projet politique d’un nouveau Soudan de John Garang et sa capacité réelle à mobiliser au-delà de son camp et, consécutivement, d’offrir une alternative nationale à Al-Bachir en maintenant l’unité du pays. John Garang disparu, cette perspective s’est nécessairement évanouie, diluée, tout du moins. Le Sud n’a plus été en mesure d’opposer quoi que ce soit face au gouvernement et à la puissance de son parti bien mieux organisé que le SPLM.
d) Et si le CPA n’intéressait personne ?
Cela a souvent été dit mais il est néanmoins nécessaire de rappeler le contexte politique soudanais qui, en janvier 2005, a présidé à la signature du CPA.
John Garang, à l’époque, jouissait d’une immense popularité dans le pays, qui dépassait de loin son fief sudiste. A preuve le fait que lorsqu’il est revenu pour la première fois à Khartoum, au début du mois de juillet 2005, pour prêter serment comme Premier vice-président de la république, c’est une foule de plusieurs centaines de milliers de personnes, sans doute plus d’un million, qui l’a ovationné sur son parcours. Cet accueil confirmait sans doute la justesse de la cause politique de l’unité du Soudan défendue par John Garang et le fait que l’ancien chef rebelle aurait sans doute pu concrétiser son ambition d’être un jour Président de la république. L’exclusion de facto du jeu politique des partis d’opposition traditionnels du Nord en application des dispositions du CPA, servait précisément les intérêts politiques du leader sudiste en lui permettant d’élargir ses possibilités de représentation et, consécutivement, ses perspectives électorales contre le PCN.
Trois semaines plus tard, l’annonce de son décès accidentel provoqua de violentes émeutes et surtout, bouleversa la donne politique qui était en train de s’installer.
John Garang mort, sans leader alternatif de sa stature pour poursuivre son combat, il devenait impossible de maintenir sa ligne politique, combattue par une frange non négligeable de son mouvement de son vivant, et de contenir la vague séparatiste. Sceptiques de toujours sur les possibilités d’un Soudan uni, ce ne sont certes pas les chausse-trappes et les manœuvres de Khartoum au long de ces cinq années qui auront pu convaincre les tenants de cette ligne de leur erreur et les faire changer d’avis, revenir à de meilleures intentions quant à l’application du CPA.
Cette impression est renforcée par le fait que chez certains des hauts dirigeants sudistes, l’indépendance du Sud Soudan sera véritablement l’aboutissement d’un projet de long terme. Luka Tombekan Monoja (437) disait ainsi à vos rapporteurs qu’il y avait une unité du Sud Soudan, depuis toujours au plan culturel, et qui s’était construite en cinquante ans d’indépendance au plan politique, l’unité du Soudan n’étant souhaitée que par le PCN.
Une sociologie du SPLM ou de l’électorat sudiste serait sans doute à faire autour des clivages internes entre partisans de l’unité et partisans de l’indépendance du Sud Soudan. Les centaines de milliers de sudistes vivants au Nord, à Khartoum, notamment, se révèleraient vraisemblablement opposés à la partition, probablement s’y opposeront-ils en janvier 2011, sans doute peu enthousiastes à l’idée de devoir émigrer au Sud et reconstruire leurs vies dans un dénuement à peu près total. Sans doute en serait-il de même de ceux de la diaspora.
Au-delà de ce premier aspect, la question des motivations de Khartoum à signer le CPA doit être encore une fois soupesée. Vos rapporteurs ont estimé plus tôt que l’on pouvait voir dans la signature de l’accord de Machakos par le régime en 2002 la manifestation d’un pragmatisme retors, à mettre plus au compte d’une gestion bien comprise de ses intérêts à long terme ; que les concessions d’Al-Bachir, et surtout la perspective de la perte, en cas de référendum positif des ressources pétrolières qui constituent pourtant l’essentiel de ses recettes, ne pouvaient s’expliquer que par l’intérêt qu’il y a trouvé, à un moment donné. Khartoum a cédé à la pression américaine parce que le rapprochement avec les Etats-Unis et la question de sa dette extérieure étaient alors prédominants et ont joué un rôle non négligeable, tout comme la perspective de contrecarrer l’alliance du SPLM avec les autres partis d’opposition. C’est aussi l’opinion qu’a exprimée devant vos rapporteurs James Wani Igga (438), selon lequel le CPA n’a été signé que parce que Khartoum a été soumis à la pression intense du « marteau américain » ; le Sud ayant signé pour sa part pour mettre fin à cette interminable guerre et à la fatigue de la population qui n’a jamais rien connu d’autre que la violence et vécu toujours dans les pires difficultés. En d’autres termes, vos rapporteurs s’interrogent sur le fait de savoir si ces circonstances n’auraient pas dû inciter à la plus grande perplexité quant aux chances de succès du CPA.
Rétrospectivement, les retards qu’a connus le CPA confirment ce sentiment, dans la mesure où il n’est pas exagéré de dire que ni les uns ni les autres, qui y auraient pourtant, a priori, eu intérêt, n’ont fait les efforts nécessaires pour que le référendum soit au bout du compte négatif et que le Soudan reste uni. Cela vaut surtout pour Khartoum qui, encore une fois, eu égard à l’enjeu pétrolier, aurait dû être particulièrement attentif à la réalisation étapes successives de l’accord global.
Or, il n’en a rien été, ou presque. Marc Lavergne (439) propose à cet égard une analyse à la fois cohérente et inquiétante que vos rapporteurs font leur, aux termes de laquelle Khartoum jouerait aujourd’hui sur le fait que, après cinq ans de gestion semi autonome, le GoSS est discrédité. Le gouvernement, qui a bénéficié des ressources pétrolières en abondance qu’il n’a pas partagé avec le Sud Soudan comme il l’aurait dû au termes du CPA, s’est en cinq ans doté d’armements modernes qui lui permettront de faire pièce aux velléités du SPLA, désormais incapable de s’engager dans un conflit comme celui qui les a opposés vingt ans durant. Que le Sud Soudan devienne indépendant en janvier 2011 importerait finalement peu, et n’empêchera pas Khartoum de garder un contrôle sur les ressources pétrolières dans la mesure où le gouvernement sudiste « fantoche », - et exsangue, pourrait-on ajouter -, ne sera pas en mesure de contrer les milices tribales ou les mercenaires que Khartoum utilisera pour cela.
Selon les propos de Marc Lavergne à vos rapporteurs (440), Khartoum a « digéré » à son rythme le CPA, misant sur l’impréparation et l’incapacité du GoSS à faire face au pouvoir extrêmement cohérent du Nord, à l’agenda concret et de long terme sur les plans politique, militaire, agricole ou pétrolier. Or, la logique du CPA était précisément d’être un accord portant engagement politique des uns et des autres, Nord et Sud, « sur le Soudan que l’on veut et la manière de le gouverner pour les années à venir. » (441) Il porte sur un ensemble de thèmes, pendants depuis l’indépendance, qui ont suscité des années de conflit. Ne pas appliquer le CPA revient en quelque sorte directement à remettre sur le devant le scénario de la résolution violente des différends ; en ce sens, ne pas avoir donné la priorité, autant qu’il aurait été nécessaire, à son application est sans doute une erreur de la communauté internationale. Comme on a pu le faire remarquer (442), le CPA n’a pu être signé que grâce à l’engagement, à la pression, au travail diplomatique infatigable des promoteurs du processus. Mais « ce niveau d’engagement et d’intérêt a complètement disparu depuis la signature du CPA. Il est pourtant une nécessité cruciale, compte tenu de l’équation actuelle autour du CPA : un PCN fort, avec des capacités mais sans volonté politique et un SPLM faible, avec la volonté mais sans capacité. »
2) La dynamique enclenchée d’une crise majeure
a) Un sentiment soudain d’urgence
Le soutien insuffisant à la mise en œuvre du CPA depuis cinq ans n’est pas le seul reproche que l’on peut adresser à la communauté internationale. Il est par exemple frappant de relever que l’on prend conscience aujourd’hui seulement de la nécessité de travailler sur l’après-référendum.
En effet, à ce jour, aucune décision n’a encore été prise entre les deux Parties concernant les conséquences d’un référendum positif, qui proclamerait la séparation du Sud et du Nord. Absolument rien, mesures d’accompagnement temporaires, modalités de partage des biens communs, etc., n’a été prévu pour régler les clauses du divorce. Rien n’est même encore en discussion ni à l’état d’ébauche, a fortiori, en passe d’être approuvé par les deux Parties.
Le CPA n’a rien prévu de concret à ce sujet, et cela sans doute pourrait confirmer que le scénario s’était écrit autour de l’option non dite d’un John Garang un jour élu président de la république du Soudan, qu’il aurait bien évidemment maintenu uni.
Concrètement, les différents protocoles nécessaires, relatifs au partage des ressources, notamment pétrolières, ou à la nationalité des centaines de milliers de sudistes résidant au Nord, pour ne citer que ceux-ci, évidemment essentiels dans la perspective d’une sécession pacifique du Sud, ne sont pas encore rédigés ni même n’ont encore fait l’objet de discussion entre les Parties. Le rapport du Secrétaire général des Nations Unies du 19 janvier 2010 au Conseil de sécurité est à cet égard édifiant : « Les parties à l’Accord de paix global sont de plus en plus conscientes de la nécessité de se préparer pour la période post référendaire. Lors d’un symposium organisé par la MINUS le 3 novembre, Deng Alor, le Ministre des Affaires étrangères du SPLM et Ghazi Salah-ud-Deen le conseiller présidentiel du Parti du Congrès national, ont publiquement abordé la nécessité de jeter les bases d’une séparation pacifique tout en continuant de s’employer à renforcer l’intérêt pour l’unité. Le 5 décembre, le Gouvernement du Sud Soudan a organisé une réunion publique à Djouba sur le thème « Sud Soudan : 2011 et au-delà » qui était axée sur plusieurs questions post référendaires, y compris les ressources naturelles, la citoyenneté, la sécurité, la dette et les ressources nationales. Toutefois, jusqu’à présent, ces mesures n’ont suscité aucun débat de fond entre les parties. » (443).
Les seules dispositions que le CPA a expressément prévues concernant l’après-référendum portent sur les aspects militaires et de sécurité : « Dans le contexte d’un Soudan uni, et dans l’hypothèse où le référendum d’autodétermination confirmerait l’unité, les Parties, (le gouvernement du Soudan et le SPLM) déclarent que la future armée du Soudan sera composée des forces armées soudanaises et du SPLA. » Les « unités intégrées », JIU, dont on a vu le faible degré de fusion dans la réalité des faits, devaient servir de noyaux préfigurant cette armée unique au sortir du référendum. Le texte prévoyait encore que les Parties développeraient une doctrine militaire commune dans la perspective de l’unité post-référendaire.
En revanche, aucun autre chapitre du CPA n’a abordé la question de la période post-référendaire et des arrangements à trouver entre les Parties pour atténuer les inévitables tensions. Or, il est clair qu’elles seront nombreuses et fortes et qu’il aurait été prudent d’anticiper les réactions. Car de deux choses l’une : Soit une négociation du partage des recettes pétrolières est engagée suffisamment tôt et réussie et la résurgence du conflit entre le Nord et le Sud a une chance d’être évitée, soit les pourparlers n’ont pas lieu ou échouent, et la guerre éclate inévitablement. Il est en tout cas certain que le Nord n’acceptera en aucune manière de se laisser déposséder sans réagir de l’essentiel du pétrole pour lequel il a montré une telle voracité et que des arrangements devront être trouvés pour un partage, au moins temporaire, qui ne soit pas exclusivement fondé sur des critères géographiques et frontaliers. Les informations obtenues à ce sujet par vos rapporteurs et les commentaires formulés par certains hauts responsables nord soudanais sont à cet égard sans aucune ambiguïté et la menace de la reprise de la guerre doit être considérée avec la plus vive attention.
Comme le précise de son côté fort justement Ban Ki-moon dans le rapport précité, « si les deux parties ne s’accordent pas sur les mesures qu’elles doivent prendre l’une et l’autre dans les jours, les semaines et les mois suivants le scrutin, le risque serait grand de voir le conflit se rallumer et prendre des proportions telles qu’il serait difficile voire impossible de l’éteindre. (444) La loi relative au référendum ayant été adoptée, je demande instamment aux parties de lancer sans perte de temps les négociations sur les accords post référendaires. L’ONU demeure prête à les aider dans cette entreprise. »
Compte tenu des raisons qui ont de tout temps présidé à l’apparition ou à la résurgence des conflits au Soudan, vos rapporteurs ne peuvent que partager l’inquiétude du Secrétaire général de l’ONU.
Ils regrettent et dénoncent l’inconséquence de la communauté internationale qui a engagé il y a cinq ans un processus majeur pour l’avenir du Soudan et de la région, sans en prévoir longtemps à l’avance tous les tenants et aboutissants ni organiser de la manière la plus rigoureuse les différentes étapes. Ce préalable indispensable aurait évité d’avoir à se saisir aujourd’hui dans l’urgence de problèmes dont on sait pertinemment, connaissant les acteurs et tirant les leçons de l’histoire du Soudan, que la résolution sera extrêmement délicate et conflictuelle, si tant est qu’elle soit encore réalisable en moins de onze mois. Sachant la lenteur avec laquelle au long de ces années l’application du CPA a progressé, et si mal, connaissant le peu de volonté politique qu’ont montrée les Parties à négocier, ce défi est une gageure qui apparaît aujourd’hui évidemment impossible à tenir, sauf à se complaire dans une illusion stérile.
En d’autres termes, si rien n’est fait immédiatement, le scénario de la prochaine guerre entre le Nord Soudan et le Sud Soudan peut être d’ores et déjà considéré comme écrit.
Une politique active de prévention du conflit doit par conséquent être engagée sans retard.
b) La perspective d’un face à face tendu entre deux Etats faillis
Cela étant, quant bien même ce conflit serait évité, le ciel soudanais n’en serait pas pour autant éclairci. Il n’est pas certain que la meilleure volonté du monde, si tant est qu’elle animerait aujourd’hui les Parties en présence, soit suffisante pour régler aussi aisément des années de crispation ou d’incurie et pour que l’avenir et le voisinage des deux Etats soient sereins.
L’état de délabrement économique du Sud Soudan, le sous-développement de ses infrastructures, de son administration, son niveau de corruption et de violence, la faiblesse de ses ressources, financières ou humaines, la débilité de son système politique, les tentations hégémoniques de son principal parti, les rivalités et tensions ethniques, sont autant de dangers immédiats, sans que cette énumération prétende à l’exhaustivité, qui menaceront le jeune Etat indépendant. Fut-il immédiatement reconnu par la communauté internationale, ce dont il ne faut pas douter, son enclavement géographique et commercial, quoiqu’en disent les ministres du GoSS que vos rapporteurs ont rencontrés, devraient entraver longtemps les pas du Sud Soudan.
En face, Khartoum restera la capitale d’un Etat blessé : l’humiliation de l’amputation du quart de sa surface, réduite de plusieurs centaines de milliers de kms2 ; une puissance régionale réduite, recentrée sur son pré carré arabe ; une économie terriblement affaiblie par la perte de l’essentiel de ses ressources pétrolières qui lui permettaient jusqu’alors de consacrer des budgets considérables à son armement ; des périphéries toujours, et d’autant plus, agitées. Mais aussi, si ce n’est surtout, l’ambition frustrée d’un parti islamiste au pouvoir depuis plus de vingt ans qui n’a jamais rien épargné à ses contestations et dont le projet international radical n’attend peut-être que d’être ravivé…
Il est aisé de voir dans ces ingrédients ceux de la reprise d’un conflit majeur entre les deux Parties. A tout le moins, les germes d’une tension renouvelée. On ne peut imaginer que Khartoum laisserait Juba exporter son pétrole vers Port-Soudan sans manifester une quelconque exigence ; Sans exercer quelques manigances propres à saboter le développement de son voisin sudiste. Ainsi que le faisait remarquer Ban Ki-moon, « au cours des dernières semaines, les parties à l’Accord de paix global ont considérablement débloqué la situation en surmontant des obstacles importants qui les empêchaient de progresser depuis longtemps. Il n’en demeure pas moins que les dangers de voir le conflit se rallumer sont réels. »
La question pétrolière est d’autant plus essentielle à traiter que les deux acteurs ont fait la preuve de leur total manque de confiance respective et de transparence dans la question du partage des ressources. Le différend sera consécutivement très délicat à régler, même si l’on peut convenir que, dans cette perspective, la décision de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye de réduire la zone d’Abyei, est, objectivement, de nature à apaiser les revendications nordistes.
Ce n’est pour autant pas le seul aspect qui doive être objet de l’attention et être pris en compte dans les négociations : le fait que les industries sucrières, notamment, soient géographiquement situées dans la partie Nord du Soudan n’exclue pas qu’elles devront faire l’objet de mesures de partage, s’agissant d’entreprises étatiques. La question douanière, la réforme agraire, la question pastorale, autour d’Abyei, notamment, et agricole, sont autant de thèmes majeurs qui conditionneront aussi l’après-2011.
De même en est-il du secteur bancaire public. Il y a semble-t-il une quarantaine de compagnies publiques et d’entités qui devraient en toute logique faire l’objet d’une division de leurs actifs et consécutivement d’une négociation entre le gouvernement du Soudan et le GoSS. (445) Au plan financier, la question du contrôle des réserves de devises de la Banque du Sud Soudan est ainsi cruciale. Or, on sait qu’elle est d’ores et déjà l’objet d’une vive contestation entre les deux Parties, le PCN insistant pur qu’elles soient intégrées aux réserves de change nationales, quand le SPLM en revendique un contrôle exclusif. A lui seul, ce point illustre l’ampleur du défi, dans la mesure où « le facteur le plus important qui détermine le succès ou l’échec du processus de paix soudanais demeure la nature des relations entre le Mouvement populaire de libération du Soudan (SPLM) et le Parti du Congrès national. À moins d’un an des référendums, il faudra que les deux parties fassent preuve d’une très grande volonté politique pour achever avec succès la mise en oeuvre de l’Accord de paix global. L’atmosphère actuelle de méfiance générale, dans laquelle toute avancée d’une partie est considérée comme un recul par l’autre, compromet gravement l’émergence d’une telle volonté politique, ébranle les efforts déployés par la communauté internationale et ouvre la voie à la résurgence du conflit. » (446)
D’une manière ou d’une autre, il est essentiel qu’en bonne intelligence Nord et Sud s’accordent pour que le Nord ait accès à une part des ressources pétrolières du Sud pour éviter d’avoir la tentation de le déstabiliser, ce qui ne lui serait au demeurant pas difficile, compte tenu de son expérience et de la faiblesse du Sud. La garantie de la paix est à ce prix. Il est à espérer que Juba saura se positionner sur cette ligne, alors que le dernier trimestre a été marqué de tensions croissantes, malgré le fait que quelques accords aient pu cependant être trouvés.
c) Les possibles dommages collatéraux
Les inquiétudes que manifestent ainsi vos rapporteurs sont partagées par nombre d’observateurs. Pour les résumer, on peut rappeler les propos que tenait Takeda Alemu (447), selon lequel l’inapplication du CPA était porteuse d’un risque d’implosion du Soudan. Pour le ministre délégué aux affaires étrangères de la République éthiopienne, la situation était imprévisible, le pire à craindre, au point que ce qui s’était passé jusqu’à présent n’était rien en comparaison de ce qui pourrait arriver, d’autant qu’une conflagration régionale était désormais à redouter : l’Ethiopie en subirait les conséquences, mais le Kenya, l’Ouganda, la République centrafricaine ou le Tchad également qui étaient concernés par ce qui se passait au Soudan et risquaient d’en être très durement affectés.
De fait, et pour ne prendre que ce seul exemple, il faut rappeler qu’un contexte ethnique transfrontalier se greffe sur la question de la LRA dont la barbarie contre les populations civiles n’est pas la seule caractéristique. Les liens entre populations Acholi, ougandaises, et Shilluk, au Sud Soudan, peuvent ainsi laisser craindre des tentations séparatistes chez ceux-ci. Un risque de somalisation est ainsi envisagé par certains analystes, dans une région où les séparatismes sont toujours actifs. De déstabilisation, à tout le moins.
Ce n’est d’ailleurs pas seulement sur cet aspect que les voisins du Soudan sont concernés. Leurs intérêts immédiats sont aussi en jeu. La question du partage des eaux du Nil est en tout premier lieu en arrière plan et non encore résolue. L’Egypte ne regardera pas d’un bon œil la perspective d’une sécession, qu’elle soit brutale ou pacifique, sans avoir la garantie de pouvoir continuer à bénéficier des ressources hydrauliques du fleuve, sur lesquelles l’Ethiopie a aussi des vues, tout aussi légitimes et de tout temps et jusqu’à ce jour frustrées.
Indépendamment de cette question traditionnelle et récurrente, les voisins du Sud Soudan sont aujourd’hui impliqués et intéressés par son pétrole et par les opportunités d’investissements et les possibilités de développement économique qu’il induit. Ethiopie et Ouganda, notamment, y ont fortement investi depuis la signature du CPA. Les explorations encourageantes menées ces dernières années dans l’extrême ouest de l’Ethiopie, dans la région de Gambela, notamment, laissent espérer des perspectives de production qui pourraient justifier des possibilités de coopération intéressante, qu’une déstabilisation du Sud Soudan compromettrait fâcheusement. (448)
Il existe de toute évidence un très fort intérêt régional à la stabilité du Soudan pour de multiples raisons, qu’elles soient économiques ou politiques. La crainte d’une implosion du pays, ou d’une dérive incontrôlable est partagée par nombre de partenaires et voisins.
D’une manière générale, le conflit avait jusqu’alors été essentiellement perçu durant des décennies comme un enjeu national soudanais, même s’il n’a pas été sans répercussion sur les régions voisines. La réactivation du conflit est aujourd’hui surtout considérée comme pouvant avoir des conséquences catastrophiques pour l’ensemble de la région, voire au-delà, en termes humanitaires, militaires, politiques ou économiques. C’est le sens de l’alerte donnée récemment par le Secrétaire général des Nations Unies devant le Conseil de sécurité (449). Jean Ping estime quant à lui que « pour l’Afrique ce qui se joue au Soudan est d’une importance existentielle (…) Il est évident que le choix qui sera effectué aura des conséquences considérables pour le Soudan et pour le reste de l’Afrique, tout comme il est évident que les conditions et circonstances prévalant avant, pendant et après ces consultations électorales auront le plus grand impact sur le cours et la cohérence des événements. » (450).
Il est en conséquence de la plus haute importance que la communauté internationale se saisisse de nouveau du dossier soudanais pour recentrer son attention sur les risques auxquels ce pays est confronté et sur ceux que la dégradation de sa situation impliqueraient mécaniquement sur la région.
« (…) le conflit au Darfour est le symptôme d’une crise soudanaise générale, comme l’étaient les conflits du Sud-Soudan et du Soudan oriental. Nous avons expliqué que cette crise soudanaise était une crise de longue date, qui s’étend de l’époque coloniale à l’époque postcoloniale. Une fois encore, comme l’a dit le Président de la Commission de l’Union africaine, elle a son origine dans la concentration du pouvoir et de la richesse entre les mains d’une élite basée à Khartoum, ce qui a entraîné la marginalisation, l’appauvrissement et le sous-développement de la zone soi-disant périphérique, y compris le Darfour. » (451)
Ainsi que vos rapporteurs l’ont souligné à plusieurs reprises, au-delà de la question du Darfour, c’est précisément sur cette même réalité que s’articule l’ensemble des crises soudanaises depuis l’indépendance. Toute la politique incendiaire du pouvoir central se résume à sa volonté de captation des richesses et de marginalisation des périphéries du pays. Aucune des guerres soudanaises, dans les Monts Nouba, l’Est et le Sud Soudan, demain peut-être au Kordofan (452), n’a d’autres racines que la prétention à la domination totale de l’élite arabe des environs de Khartoum.
Cela étant, la situation au Darfour pourrait être enfin entrée dans un processus de stabilisation durable et vos rapporteurs y voient une opportunité pour que la communauté internationale recentre véritablement son attention sur la situation au Sud Soudan qui leur paraît, tout au contraire, plus préoccupante et porteuse de dangers que jamais.
En effet, une nouvelle fois, le Tchad et le Soudan sont en phase de réconciliation. Les dernières semaines ont montré des signes de rapprochements, a priori plus prometteurs que les précédents. L’accord qui a été conclu le 15 janvier 2010 sur « la normalisation des relations entre le Tchad et le Soudan » (453), aux termes duquel chacune des parties s’engage à poursuivre et à achever avant le 21 février 2010 « la mise en œuvre des mesures prises mettant un terme à toute présence, à tout soutien et à toute action hostile des groupes » rebelles armés contre le gouvernement de l’autre, est positif et doit être suivi avec attention. Un protocole additionnel porte sécurisation de frontières et prévoit dans les mêmes délais le déploiement complet d’une force mixte, qui sera notamment chargée d’interdire de part et d’autre des frontières communes, toute forme d’incursion hostile et de contrebande, de veiller à ce qu’aucune activité hostile ne soit menée contre l’un ou l’autre des deux Etats à partir de leur territoire respectif. Les groupes armés sont invités à accepter les appels à la paix de leur gouvernement respectif, faute de quoi, ils seront désarmés et neutralisés et devront, soit rentrer dans leur pays d’origine, soit résider dans le pays d’accueil en qualité de réfugiés. Des patrouilles communes, aériennes et terrestres, sont également prévues pour assurer la surveillance des frontières, le ramassage des armes de guerre détenues illégalement par la population civile aux frontières, la lutte contre l’enlèvement des personnes, des véhicules et la restitution des biens volés à leurs propriétaires.
Sans préjuger de la sincérité des deux partenaires dans ce nouvel apaisement, ni s’aventurer à prédire la durée de cette entente, sachant d’expérience que les accords soudano-tchadiens peuvent se révéler caducs en peu de temps, force est de constater que les agendas respectifs des deux présidents, Idris Déby et Omar Al-Bachir, peuvent aider à consolider, cette fois-ci, une réelle période de paix. En effet, le fait que le Tchad et le Soudan soient l’un comme l’autre entrés dans de longs processus électoraux – élections présidentielles et législatives dans les deux pays entre avril 2010 et avril 2011 – est une opportunité unique : l’un comme l’autre ont besoin d’une période de stabilité d’un an et demi sur leurs fronts respectifs.
Depuis longtemps, observateurs et chancelleries savent que le cadre régional est un élément clef de ce conflit et de sa résolution, et que la condition préalable d’une paix au Darfour est un accord global entre les deux pays. Les termes de l’accord du 15 janvier, s’ils sont respectés, peuvent le permettre. Ils auront pour effet de couper les vivres des groupes rebelles. Le JEM ne pourra plus compter sur le soutien tchadien pour continuer de mener sa guérilla. Vos rapporteurs estimaient plus haut que l’intérêt du JEM n’était sans doute pas de signer la paix, dans la mesure où la réalité de son combat réside en fait dans la prise du pouvoir à Khartoum et que conclure une paix serait pour lui une manière de se saborder compte tenu de sa faible représentativité. On peut considérer qu’il devrait en toute logique y être désormais contraint. Consécutivement, les pourparlers de Doha devraient marquer de nets progrès à brève échéance.
La France, de par sa présence dans la région, et les liens qu’elle a tissés avec nombre de voisins du Soudan, au premier rang desquels le Tchad, a une responsabilité particulière aux côtés de ses partenaires. Il est important qu’elle s’implique fortement dans la réussite durable de l’accord qui vient d’être conclu.
Pour autant, la paix au Darfour ne sera cependant ni complète ni pérenne sans qu’un véritable processus de réconciliation nationale soit conduit en parallèle aux discussions de paix. En ce sens, pour essentiel qu’il soit, le processus en cours devant la Cour pénale internationale ne peut être suffisant pour rendre justice aux victimes de la barbarie et en finir avec l’impunité dont bénéficient les responsables. Le jugement à La Haye du général Omar Al-Bachir pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité, pour génocide éventuellement, ne suffira pas à apaiser les tensions et à réconcilier les populations. Il est urgent que la communauté internationale s’engage davantage et soutienne les propositions qui sont émises, pour compléter les procédures judiciaires par des actions destinées aux populations civiles. La France devrait jouer un rôle dans ce processus long et essentiel.
Cette période d’apaisement au Darfour pourrait aussi utilement être mise à profit par la communauté internationale pour concentrer ses efforts sur le règlement du conflit Nord/Sud et la mise en application du CPA pour éviter tout risque d’embrasement. Probablement est-il trop tard pour rattraper tout le temps perdu et l’ensemble des dispositions du CPA ne seront-elles pas mises en œuvre avant les échéances de janvier 2011. Néanmoins, il est possible d’organiser une conférence internationale pour préparer l’après-référendum, qui semble à vos rapporteurs déterminant et éviter une nouvelle guerre.
Ecartée de la gestion du dossier du Sud Soudan au tournant des années 2000, la France a su revenir dans le jeu régional à la faveur du dossier du Darfour. La diplomatie française doit poursuivre les efforts qu’elle mène actuellement pour aider à la résolution des crises que connaît ce pays, dans les différentes instances auxquelles elle participe.
La France devrait prendre l’initiative d’une telle rencontre qui, à Paris et dans les plus brefs délais, réunirait l’ensemble des parties prenantes à la résolution du conflit sud-soudanais. Il ne s’agit pas de modifier le calendrier qui a été accordé, ni d’envisager de remettre en question les résultats du référendum, qui devront naturellement être acceptés par la communauté internationale. En revanche, il est indispensable et urgent de déterminer les modalités de partage des richesses soudanaises et, sans doute, de prévoir une extension de la transition afin d’aider les futurs Etats du Nord Soudan et du Sud Soudan à surmonter ensemble et surtout pacifiquement les difficultés auxquelles ils devront faire face.
La gravité de la situation au Soudan justifie aussi que la commission des affaires étrangères reste saisie des différents dossiers soudanais. A cet égard, la Mission d’information pourrait notamment maintenir son activité et continuer d’assurer le suivi attentif de la situation et des prochaines échéances : processus de paix de Doha ; élections du mois d’avril 2010 ; référendum au Sud Soudan de janvier 2011 ; période post-référendum.
D’une manière plus générale, les nouveaux pouvoirs de contrôle dont dispose désormais le parlement peuvent être l’occasion d’une meilleure information de la représentation nationale sur les dossiers soudanais et de la position de notre pays.
A cet effet, il paraît opportun qu’un débat parlementaire soit organisé dans le cadre d’une prochaine semaine de contrôle qui donnerait notamment l’occasion au gouvernement de s’exprimer devant la représentation nationale pour l’informer sur :
- son analyse et sa position en ce qui concerne les processus et initiatives en cours ;
- l’évolution des dossiers, les échéances de l’année et les risques de déstabilisation régionale ;
- la politique qu’il mène et les initiatives qu’il compte prendre à ce sujet, de manière bilatérale ou avec ses partenaires, notamment de l’Union européenne.
Enfin, vos rapporteurs recommandent la constitution d’un groupe d’étude à vocation internationale sur le Sud Soudan, à l’instar de ceux que l’Assemblée nationale a déjà créés sur d’autres situations complexes.
La communauté internationale se doit d’apporter une extrême attention au futur immédiat du Soudan. Elle doit continuer à travailler de pair les deux aspects de la problématique soudanaise, sachant que ce qui se réglera au Darfour ne sera pas sans incidence sur la situation globale. Elle doit redoubler d’efforts compte tenu de la proximité des échéances et de l’urgence de prévenir l’explosion. Si certains signes semblent encourageants, rien n’est encore cependant assuré et les probables manœuvres de Khartoum pour déstabiliser encore le Sud Soudan ne laissent pas d’inquiéter.
La volonté politique des deux Parties a souvent besoin d’être stimulée et celles-ci doivent être accompagnées et aidées. Il est essentiel que la communauté internationale s’engage à cette fin. La stabilité de la région et le futur de l’Afrique en dépendent au plus haut point.
La commission examine le présent rapport d’information au cours de sa réunion du mercredi 3 février 2010.
Après l’exposé des rapporteurs, un débat a lieu.
M. le Président Axel Poniatowski. Sur la question clé de la partition, sur laquelle vous avez concentré une partie de votre propos, vous dîtes qu’elle est probable voire inévitable mais vous ne portez pas d’appréciation. La partition du Soudan vous paraît-elle souhaitable ? Je trouve que l’objet même des rapports de notre commission est précisément de manifester une opinion sur ce genre de questions, comme cela avait été le cas lors du rapport d’information de nos collègues Jean-Michel Ferrand et Jean-Pierre Dufau sur le Kosovo.
M. Michel Terrot. Ma question principale concerne l’opinion qu’ont les rapporteurs sur la décision de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye au sujet de la délimitation de la frontière entre le Nord et le Sud Soudan. Ma seconde question, subsidiaire, concerne Total. Cette entreprise possède une concession dans la zone Sud, mais ne l’exploite pas actuellement. Est-ce dû à l’insécurité régnant dans la région, ou bien la compagnie Total attend-elle l’indépendance du Sud pour négocier avec les nouvelles autorités ?
M. Lionnel Luca. Je voudrais insister sur certains points qui m’ont paru insuffisamment développés. Sur l’islamisme, vous semblez défendre l’idée que le fondamentalisme est un paravent utilisé pour habiller une politique nationaliste et centralisatrice classique. Pourtant, certains signes de l’influence islamiste au Soudan me paraissent très clairs : Al Qaida y est présent depuis longtemps et tout récemment, une journaliste a été condamnée pour tenue vestimentaire immorale. En un mot, l’islamisme au Soudan est-il seulement un affichage ?
Par ailleurs, quel rôle la Chine a-t-elle décidé de jouer au Soudan ? Elle apparaît, dans ses prises de position, très proche du gouvernement de Khartoum…
M. Renaud Muselier. J’ai pu effectuer, dans le cadre de mes fonctions ministérielles, un déplacement d’une semaine au Soudan en hiver 2003, au lendemain des accords de sécurité entre le Nord et le Sud et à la veille du vote par le Conseil de sécurité des Nations unies de sa résolution 1564. J’ai eu la chance de rencontrer John Garang, puis je suis allé au Darfour où j’ai pu constater l’usage des doubles discours, du double langage, qui laissaient présager de la suite des événements.
Le rapprochement entre MM. Al-Bachir et Garang doit être replacé dans le contexte de l’affrontement Nord – Sud, qui a causé 2,5 millions de morts. Il est clair qu’il y a eu une volonté de réconciliation, mais entre deux personnes qui ne pouvaient pas s’entendre. Il était évident que l’un des deux devait disparaître, et j’avais pronostiqué celle de John Garang dès mon retour.
L’apaisement entre le Nord et le Sud a provoqué le désastre du Darfour. Quand j’y suis allé, j’ai constaté que la totalité des villages avait été rasée, que tous les hommes avaient été assassinés, ne laissant que les femmes, les enfants et les vieillards, cantonnés dans les camps de peur de devoir affronter la répression féroce des miliciens janjawid envoyés par Khartoum. La question se posait dès lors de savoir si nous étions en présence d’un génocide.
Diplomatiquement, les Etats-Unis étaient présents au Sud par l’intermédiaire d’USAID auprès de M. Garang, la Chine était omniprésente pour récupérer un pétrole principalement situé au centre du pays, d’où il est difficile à exporter car se pose la question logistique de l’emplacement des oléoducs, et une pression islamique très forte était exercée sur les populations du Darfour afin de déstabiliser notre influence au Tchad en renversant le rapport de forces tchadien de l’Ouest vers l’Est.
En réalité, le Soudan est un pays éminemment stratégique, divisé à l’intérieur, soumis à des pressions politiques énormes liées à des intérêts stratégiques et religieux, où les institutions multilatérales, qui pourraient pourtant y défendre une vision propre, ne pèsent plus assez. Je ne puis donc accepter, comme le rapport semble l’indiquer, que l’on tolère que des puissances extérieures se livrent à un dépeçage du Soudan.
Le multilatéral doit reprendre la main et faire respecter les conventions internationales, eu égard aux millions de morts que cette situation a déjà causé. Le président Al-Bachir a un comportement inacceptable au regard des principes démocratiques et des droits de l’homme.
M. Robert Lecou. Si la diplomatie des Etats doit rechercher l’efficacité, la diplomatie parlementaire peut apporter un autre éclairage, ce que permet le rapport. Pouvons-nous rester en-dehors de la situation au Soudan ? Non, de toute évidence : l’ampleur des massacres, et les risques de contagion notamment par l’influence d’Al Qaida dans les zones proches comme au Mali, sont deux raisons largement suffisantes pour intervenir. Quels pays peuvent intervenir avec le plus d’efficacité ? Quel rôle les Nations Unies peuvent-elles jouer dans la zone ? Faut-il privilégier le multilatéralisme pour encadrer une intervention qui s’avèrera nécessaire ?
Mme Martine Aurillac. Je veux plaider vigoureusement pour un suivi de cette mission car, si la France n’a pas été absente, compte tenu des échéances politiques et judiciaires à venir, une intervention internationale à laquelle elle participerait me paraît nécessaire.
Mme Chantal Bourragué. Combien de populations déplacées reste-t-il ? Combien de réfugiés vivent encore dans les camps ? Combien de réfugiés se trouvent encore au Tchad ou dans d’autres pays ?
M. Jean-Claude Guibal. Je voudrais poser plusieurs questions. La première est d’ordre général. Quelle est votre appréciation sur l’intervention de la justice internationale et son éventuelle instrumentalisation par la politique ? Comment jugez-vous l’intervention de la Cour pénale internationale et l’influence politique de ses décisions ?
Mes autres questions seront plus précises. Quel est le rôle de la Chine dans la crise soudanaise ? Quel est le rôle de l’Arabie Saoudite ? On parle beaucoup d’islamisme, voire de wahhabisme au Soudan, pourtant le royaume saoudien semble complètement absent du dialogue politique régional. Enfin, quelle part les conflits autour de l’accès à l’eau représentent-ils parmi les causes de l’instabilité régionale ?
M. Dino Cinieri. Quelle est la situation sociale, et économique, au Sud Soudan ? De plus, le président du Sud Soudan, Salva Kiir, a-t-il une réelle autorité sur la région ? Enfin, peut-on espérer enrayer le risque de famine, croissant au Soudan ?
M. Jean-Michel Ferrand. Je souhaiterais connaître l’état des relations entre l’Ethiopie chrétienne et le Soudan. De plus, je voudrais faire remarquer, concernant la décision de la Cour pénale internationale, que vous avez cité beaucoup de témoignages incitant à ne pas poursuivre les actions engagées, afin de ne pas réveiller la menace Al Qaida, et laisser les acteurs locaux régler leurs conflits entre eux, cette solution dût-elle provoquer un nouveau bain de sang.
Toutefois, vous semblez opposés à la partition, ce qui rejoint ma position sur le Kosovo, à la différence près qu’au Soudan, nous sommes intervenus précisément pour préparer cette partition. Cette différence se retrouve dans votre jugement sur le traitement du président Al-Bachir par la CPI, si on le compare à celui appliqué à Slobodan Milosevic.
M. Jacques Myard. Les Anglais sont coupables, au Soudan comme ailleurs, de n’avoir jamais su créer un Etat viable avant de quitter le territoire. J’estime que c’est sur ce problème, qui se pose dans toute l’Afrique, que la France devrait intervenir, par exemple en envoyant nos officiers auprès des Etats africains au lieu de peupler les bureaux de l’OTAN. Il faut élever le débat dans cette commission des affaires étrangères. La France doit retrouver une politique africaine, et se doter des outils pour recréer et stabiliser des Etats dans ce continent. La menace pour notre sécurité est liée à l’influence d’Al Qaida en Afrique, et pas en Afghanistan.
Après cette introduction, je souhaite poser une question. Quel est le lien entre la Somalie, dont on connaît la faiblesse des structures étatiques, et les conflits au Soudan ?
M. Serge Janquin, Rapporteur. Beaucoup de réponses aux questions posées figurent dans le rapport écrit. Sur le thème de l’unité politique du Soudan, nous sommes convaincus que son maintien aurait été préférable mais d’ores et déjà nous pouvons affirmer que la partition se fera. Ce sera le regrettable échec d’une coexistence noire et blanche dans un même pays, qui aurait représenté un symbole important pour l’Union africaine. Cependant cette unité doit demeurer l’objectif de long terme. Une administration transitoire sous contrôle international serait susceptible d’y œuvrer mais cela aurait nécessité une réelle implication de la communauté internationale au cours des six dernières années ; il faut déplorer cette défaillance – même si la responsabilité de Khartoum est immense.
Que peut faire la France ? Son implication la plus utile devrait consister à pacifier les frontières avec le Tchad et avec la République centrafricaine. C’est notre intérêt comme celui de ces deux pays et du Soudan lui-même. Tchad et Soudan sont devenus des frères ennemis qui lancent régulièrement des offensives l’un contre l’autre. Il faut sécuriser une frontière qui est aujourd’hui une passoire. De même, la République centrafricaine est victime de l’instabilité que provoque la présence de rebelles dans ses régions frontalières, ce qui compromet tout progrès démocratique dans le pays, alors que les élections approchent.
La question du Darfour est venue « faire écran » aux yeux de la communauté internationale quand la mise en œuvre du CPA aurait dû constituer la première des priorités.
Dans la relation avec l’Égypte, la répartition des eaux du Nil est un sujet essentiel. Si ce pays a hâté à ce point la conclusion d’un accord avec le Soudan, c’était avant tout pour éviter qu’un État tiers ne revendique sa part de la ressource.
À l’évidence, la partition du Soudan entre Nord et Sud donnera naissance à deux États faillis, non viables : au Sud du fait de l’insécurité constante et de la dramatique pénurie alimentaire ; au Nord par défaut de recettes pétrolières. C’est donc bien l’unité qu’il faudrait préserver ; elle est malheureusement tout près de disparaître.
M. Patrick Labaune, Rapporteur. La décision rendue à La Haye fin juillet 2009 a représenté un habile arbitrage entre Nord et Sud : le Nord y gagnait la majorité des ressources tandis que le Sud, lésé économiquement, voyait son organisation ethnique mieux prise en compte.
Total dispose d’une zone de prospection immense dans la partie orientale du Sud Soudan, aujourd’hui inexploitée car, comme nous l’a indiqué le représentant de la compagnie sur place, il n’est pas envisageable de prospecter dans un tel climat d’instabilité – le Sud est encore plus instable que le Darfour – et d’autre part, chacun attend le référendum de 2011 et la sécession qui s’ensuivra inéluctablement.
La grande majorité des habitants du Nord Soudan sont des musulmans pratiquants. Pourtant nous avons pu observer à Khartoum – contrairement à l’abaissement manifeste des femmes dont nous avons été les témoins à Doha – une relative décontraction vestimentaire féminine. Personnellement, j’estime que l’islam est largement utilisé au Soudan comme prétexte, dans un but politique, pour conforter ou reconquérir le pouvoir. Maints exemples montrent que les élites du pouvoir central instrumentalisent l’islam en ce sens. Ainsi, M. Hassan Al-Tourabi a beau être l’idéologue du conflit de 1989, même lui utilise l’islam comme un prétexte.
M. Serge Janquin, Rapporteur. C’est une posture tactique destinée pour lui à se venger de ses fils spirituels actuellement au pouvoir.
M. Patrick Labaune, Rapporteur. L’implication de la Chine est réelle au Soudan, mais exclusivement commerciale et non politique. Il est d’ailleurs frappant de voir à quel point le commerce tient lieu d’idéologie en Chine désormais.
M. Serge Janquin, Rapporteur. Khartoum refuse catégoriquement toute implication du Conseil de sécurité des Nations unies dans les affaires du Soudan mais n’est pas hostile à l’implication de ses membres permanents, s’ils agissent hors du cadre onusien. Il y a là une piste à explorer pour apaiser les tensions locales.
M. Patrick Labaune, Rapporteur. Les relations franco-soudanaises sont exécrables. M. Hubert Védrine a eu l’occasion de nous le confirmer. Dans ce contexte, c’est l’effet de levier de son influence au Tchad que la France aurait intérêt à faire jouer.
M. Serge Janquin, Rapporteur. J’ajoute que Khartoum craint beaucoup l’implication directe des troupes françaises présentes au Tchad et à Djibouti.
M. Patrick Labaune, Rapporteur. En réponse à l’intervention de Mme Martine Aurillac, je suggérerais la création d’un groupe d’études à vocation internationale sur le Sud Soudan, pour anticiper la sécession et le suivi de cette question.
Les camps de réfugiés – nous en avons visité un aux portes du Darfour – regroupent 300 000 personnes au Tchad et plusieurs centaines de milliers au Soudan. Il faut reconnaître que la situation s’y améliore, même si un responsable de l’ONU a qualifié devant nous la situation de « calme mais imprévisible ». Les réfugiés trouvent dans ces camps protection, nourriture, soins et éducation ; partir, ce serait pour eux perdre tout cela. Le principal problème rencontré est l’oisiveté de ceux qui vivent dans les camps.
M. Serge Janquin, Rapporteur. On assiste ainsi à un phénomène d’enkystement urbain : des bidonvilles se forment car la situation est pire encore hors des camps. Pourtant, lorsque nous visitons ces camps, on nous interpelle : que font les grandes puissances pour permettre le retour des réfugiés à leurs terres et à leurs troupeaux ?
M. Patrick Labaune, Rapporteur. À la question posée sur le rôle joué par l’Arabie saoudite, je répondrai qu’il est inexistant, en dépit de la proximité géographique de ce pays. L’Éthiopie a certes joué un rôle important pendant la guerre civile mais aujourd’hui elle n’est plus impliquée au Soudan. Quant à la Somalie, elle n’a aucun lien avec le Soudan.
M. Serge Janquin, Rapporteur. Je voudrais insister sur la question emblématique du Nil. Historiquement, il a été un trait d’union au sein de la région, mais aussi un vecteur de domination venue des îles britanniques ou incarnée par Bonaparte. Ce couloir a toujours été très disputé, comme l’a illustré le désastre de Fachoda. Avant leur départ, les Britanniques ont proposé un accord de partage des eaux du Nil ; la question était toutefois plus complexe car s’y mêlait une problématique religieuse impliquant également l’Érythrée et l’Éthiopie. Chacun a ses raisons pour contester le partage qui a été fait. Il reste que la donnée majeure aujourd’hui est le refus de l’Égypte de voir une autre Partie que le Soudan revendiquer une implication dans le partage. Quant à l’autre ressource qu’est le pétrole, son exploitation est en train de dégrader fortement l’environnement au Sud Soudan.
M. Patrick Labaune, Rapporteur. Le Sud se caractérise par ses vastes dimensions et la multiplicité des tribus qui le peuplent. L’instabilité qui y règne est due, premièrement, aux menées du pouvoir de Juba, deuxièmement, aux rivalités traditionnelles entre tribus sur la propriété foncière, et enfin à la politique du « diviser pour mieux régner » utilisée par Khartoum.
Le pouvoir de tel ou tel des anciens résistants du Sud Soudan contre le pouvoir du Nord existe mais il est toujours fluctuant. Ces hommes ne jouissent pas d’une grande popularité. À cela s’ajoutent les multiples divisions entre pouvoir politique et « pouvoir pétrolier », le tout privant le futur État du Sud de viabilité.
Notre collègue Jacques Myard a raison de dire qu’il n’y a pas d’État nation au Soudan, et raison de plaider pour que nous portions un intérêt renouvelé à l’Afrique. D’une façon générale, nous n’écoutons pas assez les intellectuels qui allient une réflexion de qualité sur telle ou telle région du monde et une profonde connaissance des réalités de terrain, indispensable complément de l’analyse géopolitique.
La commission émet un avis favorable à la publication du présent rapport d’information.
– Liste des personnes rencontrées par la Mission 267
– Chronologie générale du Soudan 273
– Conclusion du Conseil européen du 15 septembre 2009 277
– Accord de N’Djamena sur la normalisation des relations entre le Tchad et le Soudan 279
Liste des personnes rencontrées par la Mission
(par ordre chronologique)
___
1) A Paris
– M. Salih M. Osman, avocat, député à l’Assemblée nationale du Soudan, Prix Sakharov pour la liberté de pensée 2007 (12 février 2009)
– Mme Caroline Baudot, Directrice de Crisis Action France (12 février 2009)
– Mme Christine Robichon, ancienne ambassadrice de France au Soudan (12 mars 2009)
– M. Philippe Hugon, directeur de recherche à l’IRIS (18 mars 2009)
– M. Jean-Pierre Favennec, professeur à l’Institut français du pétrole (25 mars 2009)
– M. Bruno Joubert, conseiller diplomatique du président de la République (1er avril 2009)
– M. Roland Marchal, chargé de recherches au CERI/Sciences Po (2 avril 2009)
– Son Exc. M. Sulieman M. Mustafa, Ambassadeur du Soudan en France (2 avril 2009)
– M. Rony Brauman, ancien président de Médecins sans frontières (13 mai 2005)
– M. Marc Lavergne, directeur de recherches au CNRS (20 mai 2009)
– Son Exc. M. Patrick Nicoloso, ambassadeur de France au Soudan (27 mai 2009)
– M. Hubert Védrine, ancien ministre des affaires étrangères (27 mai 2009)
– M. Gregory S. d'Elia, premier secrétaire, ambassade des Etats-Unis, chargé des affaires africaines (3 juin 2009)
– Mme Marie-Claude Dumay, analyste politique, Ambassade des Etats-Unis (3 juin 2009)
– M. Eric Chevallier, conseiller spécial de M. Bernard Kouchner, ministre des affaires étrangères et européennes (16 juin 2009)
– M. AbdulWahid al Nur, président du SLM, Darfour, Soudan (16 juin 2009)
– M. Jean-Michel Salvadori, Directeur Afrique subsaharienne, Groupe Total (18 juin 2009)
– M. Romaric Roignan, chargé des relations internationales, Groupe Total (18 juin 2009)
– M. François Tribot Laspiere, direction des relations institutionnelles, Groupe Total (18 juin 2009)
– M. Michel Roy, Directeur, « Plaidoyer international, Secours catholique (19 juin 2009)
– Mgr. Micah Laila Dawidi, Eglise épiscopalienne du Soudan (19 juin 2009)
– Rvd. Both Reth Luang, Eglise Presbytérienne du Soudan, (19 juin 2009)
– Révérend Peter Tibi, Secrétaire Général du Conseil des Eglises du Soudan (19 juin 2009)
– Isaac Kenyi Kungur, Eglise Catholique (19 juin 2009)
– M. Jacques Chirac, ancien président de la République (24 juin 2009)
– M. Michel de Bonnecorse, ancien conseiller pour les affaires africaines du Président Jacques Chirac (24 juin 2009)
– M. Bernard Diguet, conseiller adjoint pour les affaires africaines du Président Jacques Chirac (24 juin 2009)
– M. Charles Josselin, ancien ministre de la coopération (25 juin 2009)
– M. François Zimeray, ambassadeur des droits de l'homme, président de SOS Darfour (1er juillet 2009)
– Son Exc. M. Tarald Brautaset, ambassadeur de Norvège (1er juillet 2009)
– Mme Therese Løken Gheziel, premier secrétaire à l'Ambassade (1er juillet 2009)
– Son Exc. M. Nasser Kamel, ambassadeur d'Egypte (2 juillet 2009)
– M. Tarek Tayel, conseiller de l’ambassade d’Egypte (2 juillet 2009)
– M. Abdou Diouf, secrétaire général de l’Organisation internationale de la francophonie, ancien président de la République du Sénégal (15 juillet 2009)
– M. Hugo Sada, délégué à la paix, aux droits de l’homme et à la démocratie de l’OIF, chercheur à l’IRIS (15 juillet 2009)
– M. Christian Delmet, chargé de recherche au CNRS (22 juillet 2009)
– M. Bernard Kouchner, ministre des affaires étrangères et européennes (22 juillet 2009)
– Melle Charlotte Montel, conseiller pour les affaires africaines au cabinet de M. Bernard Kouchner (22 juillet2009)
– M. Daniel Duvillard, chef des opérations Corne de l'Afrique, Comité international de la Croix rouge (30 septembre 2009)
– M. Michel Katz, conseiller diplomatique, Comité international de la Croix rouge (30 septembre 2009)
– M. Laurent Corbaz, chef de délégation en France, Comité international de la Croix rouge (30 septembre 2009)
– M. Henri de Coignac, ancien envoyé spécial du président de la République aux processus de paix pour le Sud Soudan et le Darfour (30 septembre 2009)
– M. Luka Biong Deng, ministre des affaires présidentielles dans le gouvernement autonome du Sud Soudan (GoSS) (20 novembre 2009)
– Gen. Oyay Deng Ajak, ministre de la coopération régionale, GoSS (20 novembre 2009)
– M. Francis Nazario, secrétaire personnel du premier vice-président du GoSS (20 novembre 2009)
– M. Stéphane Gompertz, directeur Afrique et Océan indien du ministère des affaires étrangères et européennes (2 décembre 2009)
– Thierry Caboche, rédacteur Soudan au ministère des affaires étrangères et européennes (2 décembre 2009)
– Table ronde avec les ONG - Participation de M. Jean Marie Fardeau, Human Rights Watch, M. Christian Wagner, Human Rights Watch, M. Jérôme Larché, Médecins du monde, Mme Marie Claude Gendron, Amnesty International, M. Jacques André Pill, Amnesty International, Mme Catherine Lalonde, Action contre la faim, Mme Catherine Hiltzer, Enfants du monde – Droits de l’homme, M. Emmanuel Dray, Enfants du monde – Droits de l’homme, Mme Armelle Guillembet, Secours Catholique, Mme Tchérina Jerolon, Fédération internationale des ligues des droits de l’homme, Mme Claire Constant, Fédération internationale des ligues des droits de l’homme, M. Pierre Gallien, Solidarités, Mme Mariame Camara, Crisis Action, Mme Aldine Furio, Crisis Action (20 janvier 2009)
2) A Addis Abeba, Ethiopie (du 7 au 9 avril 2009)
– Son Exc. M. Jean-Christophe Belliard, ambassadeur de France, représentant permanent de la France auprès de l’Union africaine
– M. Romain Vuillaume, premier conseiller, ambassade de France
– M. Gérard Prunier, chargé de recherches au CNRS
– M. El Ghassim Wane, chef de la division « gestion des conflits », Département Paix et sécurité, Commission de l’Union africaine
– M. Tekeda Alemu, ministre délégué aux affaires étrangère de la République éthiopienne
– M. Stanislas Nakaha, chef du « Darfur Desk », Commission africaine
– Lieutenant-colonel Alfred Mvondo, gestion de l’administration et du personnel, « Darfur Desk », Commission africaine
– M. Koen Vervaeke, ambassadeur, chef de la délégation de la Commission européenne auprès de l’Union africaine
– M. Umberto Tavolato, conseiller politique, délégation de la Commission européenne auprès de l'Union africaine
– M. Osman Khalid Mudawi, Président de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale du Soudan
– M. Lam Ajawin Akol, député à l’Assemblée nationale du Soudan, ancien ministre des affaires étrangères du GUN
– M. Mudawi al Turabi, député à l’Assemblée nationale du Soudan
– Mme Sahlework Zewdie, directrice Afrique du ministère éthiopien des affaires étrangères
3) A La Haye, Pays-Bas (14 avril 2009)
– Son Exc. M. Jean-François Blarel, ambassadeur de France
– Mme Michèle Dubrocard, conseillère juridique, ambassade de France
– M. Patrick Comoy, Premier secrétaire, ambassade de France
– M. Koen Davidse, directeur pour les États fragiles et la reconstruction de la paix au ministère néerlandais des affaires étrangères
– Mme Irma van Dueren, coordinatrice de l’équipe Soudan au MAE néerlandais
– Mme Karel, sous-direction des Etats fragiles, mission « Soudan », ministère des affaires étrangères des Pays-Bas
– M. Wesseling, sous-direction des Etats fragiles, mission « Soudan », ministère des affaires étrangères des Pays-Bas
– M. Wilke, Chef de la « task force » pour la Cour pénale internationale, ministère des affaires étrangères des Pays-Bas
– M. Sang-Hyun Song, Président de la Cour pénale internationale
– M. Luis Moreno Ocampo, Procureur de la Cour pénale internationale
– M. Emeric Rogier, analyste chargé des situations, bureau du procureur de la Cour pénéle internationale
– M. Henk Jan Ormel, député, président (CDA) de la commission des affaires étrangères
– Mme Kathleen G. Ferrier, députée, membre de la commission des affaires étrangères, porte-parole du CDA pour les questions de développement
– M. Marteen Havercamp, député, membre de la commission des affaires étrangères, porte-parole du CDA pour les affaires étrangères
– M. Harm Evert Waalkens, député, membre de la commission des affaires étrangères (PVDA), président de la commission des affaires européennes
– M. Ewout Irrgang, député, membre de la commission des affaires étrangères, porte-parole du SP pour les questions de développement.
4) A Bruxelles, Belgique (6 mai 2009)
– M. Donald Steinberg, Président adjoint d'International Crisis Group (ICG)
– M Thomas Bertin conseiller, Représentation de la France auprès du comité politique et de sécurité de l’Union européenne
– Colonel Cyril Claver, conseiller, chef de la section militaire des crises, auprès du comité politique et de sécurité de l’Union européenne
– Général Pierre-Michel Joana, conseiller spécial auprès de Javier Solana pour le développement des capacités africaines de maintien de la paix
5) A Genève, Suisse (19 mai 2009)
– Son Exc. M. Jean-Baptiste Mattéi, ambassadeur, représentant permanent de la France auprès des Nations unies et des organisations internationales en Suisse
– Mme Caroline Grandjean, Conseiller humanitaire, Mission permanente de la France auprès de l'ONU à Genève
– M. Antonio Guterres, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, ancien Premier ministre du Portugal
– M. David Gervais Koutangni, administrateur principal de secteur Soudan/Tchad & Afrique de l’Est et Corne de l’Afrique, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
– Mme Mengesha Kebede, directeur-adjoint, Bureau Afrique, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
– M. Hawa Sylla-Kane, administrateur-principal de secteur géographique pour le Tchad, Unité spéciale pour le Soudan et le Tchad, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
– M. Ala Almoman, directeur, chef de cabinet
– M. Pasquale Lupoli, directeur du département de support des opérations, Organisation internationale pour les migrations
– M. Randa Hassan, conseiller au Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU, (OCHA)
6) A Doha, Qatar (du 8 au 10 juin 2009)
– Son Exc. M. Gilles Bonnaud, ambassadeur de France
– M. Issa Maraut, envoyé spécial pour le processus de paix au Darfour
– M. Djibril Bassole, médiateur conjoint Nations Unies/Union africaine pour le Darfour, ancien ministre des affaires étrangères du Burkina Faso
– M. George Zachariah, assistant spécial du médiateur conjoint pour le Darfour
– M. Amin Hassan Omar, ministre de la culture, chef de la délégation du gouvernement d’unité nationale du Soudan au processus de paix
– M. Ahmad Lissan Tugod, chef de la délégation du «Mouvement Justice et Egalité», JEM, au processus de paix.
– M. Ahmad bin Abdallah Al Mahmoud, ministre d’Etat aux affaires étrangères du Qatar
– M. Mohsen Marzouk, Secrétaire général exécutif de la Fondation arabe pour la démocratie
7) Au Soudan (du 4 au 10 juillet 2009)
– Son Exc. M. Patrick Nicoloso, Ambassadeur de France
– M. Denis Douveneau, premier conseiller, ambassade de France
– M. Othman El Kachtoul, deuxième conseiller, ambassade de France
– M. Othman Khaled Moudawi, Président de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale soudanaise
– M. Ahmad Ibrahim al-Taher, Président de l’Assemblée nationale soudanaise.
– M. Ali Yahia Abdallah, Président du Conseil des Etats (chambre haute)
– M. Hassan al Tourabi, ancien président de l’Assemblée législative, ancien ministre, président du Parti du Congrès populaire
– Dr. Nafi’ Ali Nafi’, Assistant du Président soudanais
– Responsables de « l’Union des Patrons soudanais » et de la « Chambre du Commerce et des Investissements »
– M. Ali Karti, secrétaire d’Etat aux affaires étrangères
– Dr. Ghazi Salaheddine al-Atabani, conseiller du Président soudanais, en charge du dossier du Darfour
– Table ronde avec les responsables des groupes politiques progouvernementaux et d’opposition de l’Assemblée nationale
– M. Mohamed Youssef Kibir, gouverneur de la Wilaya du Nord Darfour
– Général Martin Luther Agwaï, commandant de la MINUAD
– M. Rodolphe Adada, chef de la MINUAD
– M. Gérard Larôme, Chef du bureau de l’ambassade de France à Juba, Sud Soudan
– M Pierre Jaubert, chargé de mission pour la société civile, bureau de l’ambassade
– M. James Wani Igga, président de l’Assemblée législative du Sud Soudan
– M. Minni Arkoi Minnawi, chef du SLM/Minni, président de l’autorité intérimaire du Darfour
– M. Luka Tombekan Monoja, ministre des affaires du cabinet, gouvernement du Sud Soudan, GoSS
– M. Martin Elia Lomuro, ministre des relations avec l’assemblée législative, GoSS
– M. Jesus Orus Baguena, Chef du bureau de Juba, Délégation de la Commission européenne au Soudan
– Table ronde avec les représentants d’ONG humanitaires et d’entreprises françaises opérant au Sud Soudan. Participation de : Mme Sabrine Laffont, Solidarité, M. Marc Ducrey, chef délégation sud-Soudan du CICR, M. Yannick Georis, Pharmaciens sans frontières, M. Benoit Clément-Bollée, PSF, Mme Charlène Lemercier, Médecins sans Frontières, M. François Hennepin, SDV (groupe Bolloré), M. Jean Patarin, TOTAL Soudan.
– M. Al Sadeq el Mahdi, ancien premier ministre, président du Parti de l’Umma
– M. Einas Ahmed, bureau des affaires électorales, MINUAD
– Mme Samia Hassan Sid ahamed, députée, présidente du groupe des femmes parlementaires
8) A Londres, Royaume Uni (16 juillet 2009)
– M. Nicolas Croizer, premier secrétaire, ambassade de France au Royaume Uni.
– M. David Drew, député, président du groupe parlementaire pour le Soudan
– M. Michael O’Neill, Représentant spécial du Royaume Uni pour le Soudan
Chronologie générale du Soudan
1820 : Début de la conquête du Soudan par l’Egypte.
1874 : Conquête du Darfour.
1881 : Muhammad Ahmad Abdallah se proclame Mahdi.
1896-1898 : Reconquête anglo-égyptienne. Affrontement anglo-français à Fachoda (septembre-novembre 1898).
1899 : Signature du traité anglo-égyptien établissant le condominium sur le Soudan.
1922 : Début de la politique officielle de Closed District dans le Sud.
1953 : Signature de l’accord anglo-égyptien sur le Soudan.
1955 : Début du conflit entre le gouvernement de Khartoum et la rébellion sudiste Anyanya.
1er janvier 1956 : Indépendance du Soudan.
Novembre 1958 : Coup d’Etat militaire du général Abboud. Interdiction des partis politiques.
Octobre 1964 : Soulèvement populaire ; renversement du général Abboud.
Juillet 1966-mai 1967 : Premier gouvernement Sadeq el-Mahdi.
Mai 1969 : Coup d’État du général Nimeyri.
Avril 1971 : Le Soudan se retire du projet de fédération arabe.
Juillet 1971 : Echec d’une tentative de coup d’État procommuniste.
Mars 1972 : Accords d’Addis-Abeba avec les sudistes : autonomie des trois provinces, réunies en une seule.
Mai 1973 : Approbation de la nouvelle Constitution : les accords d’Addis-Abeba en font partie.
Juillet 1976 : Échec d’une tentative de coup d’État islamiste.
Juillet 1977 : Politique de Réconciliation nationale envers les islamistes ; amnistie générale ; islamisation de la législation.
Août 1979 : Hassan al-Turabi ministre de la Justice (Attorney General).
1981-1982 : Le projet de division du Sud accentue les divergences entre sudistes. En 1982, reprise de la guérilla (maquis Anyanya II).
Octobre 1982 : Signature avec l’Égypte de la « charte de complémentarité ».
Mai-Juin 1983 : Répression de la sédition de la garnison de Bor ; reprise de la guerre civile Nord-Sud.
Juin 1983 : Division du Sud en trois provinces.
Juillet 1983 : Manifeste du Mouvement de libération des peuples du Soudan, SPLM, de John Garang.
Septembre 1983 : Promulgation du nouveau code pénal « islamique ».
1984 : Proclamation de l’état d’urgence.
Mars-Avril 1985 : Manifestations et émeutes à Khartoum et Omdourman, puis dans l’Ouest. Renversement de Nimeyri.
Avril 1986 : Élections législatives ; Sadeq el-Mahdi, premier ministre.
Mai 1988 : Gouvernement de coalition de Sadeq el-Mahdi, entrée des islamistes du FNI ; Hassan al-Turabi, ministre de la Justice. Violents affrontements entre populations arabes et Four dans le Darfour.
30 juin 1989 : Coup d’État militaire du général Omar Al-Bachir.
Juillet 1989 : Gouvernement islamiste.
Novembre 1997 : Embargo américain contre le Soudan.
Décembre 2000 : Le général Al-Bachir est élu président de la république
19 juin 2002 : Cessez-le-feu dans les Monts Nouba.
20 juillet 2002 : Signature du protocole de Machakos.
Février-mars 2003 : Violents combats dans le Darfour entre troupes gouvernementales et rebelles.
25 septembre 2003 : Accords de sécurité Nord-Sud.
7 janvier 2004 : Signature du protocole sur le partage des richesses.
26 mai 2004 : Signature des protocoles sur les partage du pouvoir, sur les Monts Nouba, et la région d’Abyei.
Septembre 2004 : Adoption de la résolution 1564 ; création d’une commission d’enquête internationale pour déterminer si un génocide a été commis au Darfour.
9 janvier 2005 : Signature d’un accord de paix entre le SPLA et le gouvernement soudanais.
25 janvier 2005 : Remise du rapport de la commission internationale d’enquête sur le Darfour.
31 mars 2005 : Adoption de la résolution 1593 : le Conseil de sécurité défère « la situation au Darfour » au procureur de la CPI.
9 Juillet 2005 : John Garang devient vice-président de la république, président du gouvernement du Sud Soudan.
31 juillet 2005 : Mort de John Garang, dans un accident d’hélicoptère.
Septembre 2005 : Constitution du gouvernement d’union nationale, GUN, aux termes du CPA.
5 mai 2006 : Echecs des négociations du DPA. Poursuite des combats au Darfour.
Avril 2006 : Rupture des relations diplomatiques avec le Tchad.
19 juin 2006 : Fin de la guerre de l’Est ; signature de l’Eastern Sudan Peace Agreement.
31 août 2006 : Adoption de la résolution 1706 par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Crispation des relations ONU-Soudan.
Décembre 2006 : Le Soudan accepte, du bout des lèvres, le déploiement d’une force d’interposition ONU – Union africaine au Darfour.
14 février 2007 : Opposition du Soudan au déploiement de Casques bleus.
Février 2007 : Inculpation d'Ahmed Haroun et d'Ali Kosheib par la CPI pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre au Darfour.
Avril 2007 : Accord entre le Soudan, l'ONU et l'UA sur le déploiement des Casques bleus.
Mai 2007 : Réconciliation avec le Tchad ; Sanctions économiques de la part des Etats-Unis ; Mandats d'arrêt internationaux de la CPI contre Ahmed Haroun et Ali Kosheib.
31 juillet 2007 : Résolution 1769 du Conseil de sécurité, déploiement de la force conjointe ONU-UA, MINUAD, au Darfour.
Octobre 2007 : le SPLM suspend sa participation au gouvernement d'unité nationale.
31 décembre 2007 : La MINUAD prend le relais de la MUAS.
13 mars 2008 : A Dakar, accord de réconciliation et non-agression par rebelles interposés entre le Tchad et le Soudan.
Mai 2008 : Attaque des rebelles du JEM sur Omdurman.
14 juillet 2008 : Requête du procureur Luis Moreno Ocampo pour un mandat d'arrêt international contre le président Omar Al-Bachir.
Septembre 2008 : Offensive contre les rebelles au nord du Darfour.
Novembre 2008 : Le président Al-Bachir annonce un cessez-le-feu au Darfour ; Appel au désarmement des milices. Rétablissement des relations diplomatiques avec le Tchad.
17 février 2009 : Signature à Doha d'un accord cadre entre le gouvernement et le JEM.
4 mars 2009 : Inculpation du général Al-Bachir de crimes de guerre et crimes contre l’humanité ; mandat d’arrêt international ; Expulsion de 13 ONG humanitaires internationales en représailles. Retrait du JEM des négociations de paix de Doha.
3 mai 2009 : Nouvel accord de réconciliation entre le Tchad et le Soudan signé à Doha.
22 juillet 2009 : Décision de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye sur le différend frontalier de la région d'Abyei.
Septembre 2009 : Procès de la journaliste Loubna Hussein pour tenue vestimentaire « indécente ».
Janvier 2010 : Reprise des négociations de Doha entre le JEM et le gouvernement.
Avril 2010 : élections générales au Soudan.
Janvier 2011 : Référendum d’autodétermination au Sud Soudan.
Conclusion du Conseil européen du 15 septembre 2009
Le Conseil a adopté les conclusions suivantes:
“1. Le Conseil réitère son soutien à l’évolution pacifique et démocratique du Soudan dans son ensemble et réaffirme l’importance que revêtent l’accord de paix global et la constitution nationale provisoire. Il souligne que l’évolution de la situation au Soudan a des répercussions sur la région tout entière.
2. Le Conseil se félicite des progrès accomplis récemment, mais s’inquiète de voir que la mise en œuvre de l’accord de paix global est retardée et inégale, que la situation se dégrade au SudSoudan, qu’un accord de cessez-le-feu n’a toujours pas été conclu et que les négociations politiques au Darfour progressent lentement. Il se déclare préoccupé par la situation dans l’est du Soudan, où les problèmes sous-jacents de pauvreté et de marginalisation doivent encore être résolus. En outre, le Conseil regrette que le gouvernement du Soudan ait décidé de ne pas ratifier l’accord de Cotonou révisé et s’inquiète des effets préjudiciables que cela aura sur ceux qui, au Soudan, sont dans le besoin.
3. Le Conseil se félicite des points d’accord conclus, le 19 août, par les parties à l’accord de paix global en ce qui concerne la mise en œuvre de ce dernier et salue le rôle actif joué par les États-Unis. Il engage vivement les parties à respecter les délais fixés dans cet accord. L’UE continuera de coordonner ses activités et le soutien apporté à l’accord de paix global avec la communauté internationale.
4. Le Conseil invite les parties à mettre en œuvre sans plus attendre les engagements pris dans le cadre de l’accord de paix global qui n’ont pas encore été honorés, notamment la délimitation des frontières Nord-Sud, la feuille de route d’Abyei et la décision de la Cour permanente d’arbitrage concernant la délimitation des frontières de la région d’Abyei. Les parties devraient mettre pleinement à profit l’action menée par la Commission de bilan et d’évaluation (CBE) et la mission des Nations unies au Soudan (MINUS) et coopérer avec celles-ci.
5. Le Conseil demande instamment au gouvernement d’unité nationale d’accélérer les travaux préparatoires en ce qui concerne les élections au niveau national qui auront lieu en avril 2010, et notamment de résoudre la question du recensement bien avant la phase essentielle d’enregistrement des électeurs en novembre 2009. Il importe au plus haut point que le gouvernement du Soudan et le gouvernement du Sud-Soudan instaurent de toute urgence un climat propice au processus électoral et garantissent le plein respect des droits de l’homme et des principes démocratiques. L’UE apportera son soutien au processus électoral et prévoit d’envoyer au cours des prochaines semaines une mission d’exploration au Soudan afin d’évaluer dans quelles conditions une mission d’observation électorale de l’UE pourrait être mise en place.
6. Le Conseil invite les parties à entreprendre tous les préparatifs nécessaires à la tenue du référendum de 2011 comme le prévoit l’accord de paix global. Il encourage toutes les parties prenantes soudanaises à engager un dialogue sur les dispositions à prendre pour la période qui suivra le référendum. Il y a lieu d’encourager la participation active des femmes. L’UE est déterminée à contribuer à ces efforts, notamment en fournissant une aide et des conseils techniques.
7. Le Conseil se déclare préoccupé par les fréquentes flambées de violence dans le Sud-Soudan. Il demande au gouvernement du Sud-Soudan de s’employer à faire respecter l’État de droit et à lutter contre l’insécurité. Le Conseil souligne qu’il est indispensable de mener à bien le processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Il invite le gouvernement du Sud-Soudan à mettre en œuvre les engagements pris dans le cadre de l’accord de Juba conclu avec l’UE et d’autres partenaires de développement. En outre, il invite les parties à l’accord de paix global à renforcer la capacité et l’intégrité des unités communes intégrées dans les trois régions visées par les protocoles.
8. Il engage le gouvernement du Soudan et les mouvements rebelles du Darfour à prendre part de toute urgence aux négociations de paix sur le Darfour menées sous l’égide du médiateur en chef conjoint UA-ONU, Monsieur Djibril Bassolé. Le Conseil salue les efforts déployés par le médiateur pour favoriser la cohérence entre les mouvements. Le Conseil souligne qu’il importe d’offrir à la société civile au Darfour la possibilité de contribuer au règlement du conflit et à la réconciliation. Il souligne qu’il incombe au gouvernement du Soudan de protéger la population civile et de contribuer au déploiement complet et effectif de la mission UA-ONU au Darfour (MINUAD).
9. Le Conseil demande au gouvernement du Soudan, aux autorités locales et aux mouvements rebelles au Darfour de faciliter l’accès de l’aide humanitaire et de respecter le droit international humanitaire et ses principes. Il condamne fermement la poursuite des violences commises contre les civils et le personnel humanitaire, notamment l’enlèvement de travailleurs humanitaires au Darfour.
Accord de N’Djamena
sur la normalisation des relations entre le Tchad et le Soudan
Suite à la décision des Gouvernements de la République du Tchad et de la République du Soudan de normaliser leurs relations et de consolider leurs rapports de bon voisinage ;
Considérant la volonté et la détermination politiques des présidents Idriss Deby Itno du Tchad et Omar Hassan Al-Bachir du Soudan de mettre un terme aux hostilités entre leurs deux pays, de rétablir la confiance réciproque en vue de restaurer une paix durable ;
Conformément à l’esprit de collaboration et la sincérité qui ont prévalu tout au long des rencontres bilatérales du 10 octobre 2009 à N’Djamena, du 24 décembre à Khartoum et celle du 08 janvier 2010 à N’Djamena,
Les deux parties conviennent de ce qui suit :
1. Le Tchad poursuivra la mise en œuvre des mesures prises mettant un terme à toute présence, à tout soutien et à toute action hostile des groupes rebelles soudanais contre le Soudan à partir du territoire tchadien. Ce processus doit s’achever au plus tard le 21 février 2010 ;
2. Le Soudan poursuivra la mise en œuvre des mesures prises mettant un terme à toute présence, tout soutien et à toute action hostile des groupes armés tchadiens contre le Gouvernement de la République du Tchad à partir du Soudan. Ce processus doit s’achever au plus tard le 21 février 2010 ;
3. L’application du Protocole additionnel tchado-soudanais dans le domaine de la sécurisation des frontières signé par les experts des deux pays à N’Djamena le 15 janvier 2010. Le processus de cette application interviendra concomitamment aux dispositions 1 et 2 du présent accord et le déploiement complet des forces s’achèvera le 21 février 2010, après la mise en œuvre effective des points 1 et 2 dudit accord ;
4. Jusqu’à l’application complète du Protocole de sécurisation des frontières et le déploiement complet des Forces, les deux parties doivent, à travers la coordination au sein de la Commission bilatérale conjointe militaro-sécuritaire, veiller à ce qu’aucune activité hostile ne soit menée contre l’un ou l’autre des deux Etats à partir de leur territoire respectif d’ici le 21 février 2010 ;
5. En cas de nécessité, les délais prévus dans l’article 1, 2,3 et 4 peuvent être prorogés de commun accord. Dans tous les cas, cette prorogation ne peut excéder la date du 21 mars 2010 ;
6. Dans le respect des dispositions des Articles 1 et 2 du présent Accord, les deux parties encourage les groupes armés hostiles à accepter les appels à la paix de leur Gouvernement respectif ; à défaut, ils feront l’objet de désarmement et de neutralisation. Les Groupes neutralisés et désarmés ont le choix, soit de rentrer dans leur pays d’origine, soit de résider dans le pays d’accueil en qualité de réfugié, sur la base d’une liste nominative agrée par les Gouvernements respectifs des deux pays. Les demandeurs de statuts de réfugié non admis sur ladite liste doivent être acheminés v ers un pays tiers.
7. Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature
Faite à N’Djamena, le 15 janvier 2010
Pour la République du Tchad La République du Soudan
Moussa Faki Mahamat Ghazi Salah dine Al-Atabani
1 () Selon les résultats, controversés pour les raisons qui seront détaillées ultérieurement, du recensement effectué entre le 22 avril et le 6 mai 2008, publiés le 21 mai 2009.
2 () Données PNUD, Indice de développement humain, 2008.
3 () Paul W. Gore, Centre d’études et de recherches sur le développement, CERD, « Note sur l’ethnicité et les relations ethniques au Soudan », Egypte/Monde arabe, 1993.
4 () Seuls une quinzaine d’idiomes sont parlés par plus de 100 000 personnes. L’arabe est la langue maternelle de plus de 50 % de la population, le dinka de plus de 10 % ; les autres le sont de 5 à 10 % des soudanais. Catherine Miller, CNRS, « langues et identité » in Marc Lavergne, « le Soudan contemporain », Editions Karthala, 1989, page 94.
5 () Christian Delmet, CNRS, « Société rurales et structures sociales au Soudan central », in Marc Lavergne, « le Soudan contemporain », op. cit., page 57.
6 () Nicole Grandin, EHESS, « Le Soudan nilotique et l’administration britannique, 1898 - 1956 », Etudes sociales, économiques et politiques du Moyen-Orient, Vol. XXIX, 1982. Chapitre 2 : Le peuplement, pages 40 et suiv.
7 () Entretien du 6 juillet 2009, à Khartoum.
8 () Entretien du 8 juillet 2009 à Juba.
9 () Catherine Miller, ibid.
10 () Salah al-Din al-Shazali, Université de Khartoum, « Famine, vulnérabilité et politique étatique », Égypte/Monde arabe, Première série, 15-16, 1993.
11 () Roland Marchal, CERI, Science Po, « Le Soudan d’un conflit à l’autre », Les études du CERI, n° 107-108, septembre 2004, page 41.
12 () Christian Delmet, « Les relations nord-sud au Soudan (1983-1993) », Egypte/Monde arabe, Première série, n° 17, 1994, page 13.
13 () Rapport intérimaire sur la sil’UAtion des droits de l’homme au Soudan établi par M. Gáspár Bíró, Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme ; Assemblée générale, doc. A/48/601, page 9.
14 () Rapport sur le développement humain, 2007-2008, PNUD, page 320.
15 () Gérard Prunier, CNRS, « Le Darfour, un génocide ambigu », Ed. La table ronde, chapitre 1er, pages 29-30.
16 () Roland Marchal, « Le Soudan, terre d’asile », in Marc Lavergne, « le Soudan contemporain », op. cit., pages 575-598.
17 () Salah al-Din al-Shazali, « Les réfugiés étrangers au Soudan », Égypte/Monde arabe, Première série, 15-16, 1993
18 () Gérard Prunier, « Le Sud Soudan depuis l’indépendance (1956-1989) », in Marc Lavergne, « Le Soudan contemporain », op. cit., pages 381-433.
19 () A la suite de l’épisode de Fachoda, une « convention franco-anglaise relative au Soudan » fut signée le 21 mars 1899, qui consacra l’éviction de la France du Bahr el Ghazal et le fait que la Grande Bretagne disposait du Djebel Marrah. Annales de géographie, 1899.
20 () Source : http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/soudan.htm
21 () Roland Marchal op. cit., page 33.
22 () Nicole Grandin, op.cit.
23 () Christian Delmet, « Construction de l’Etat et conflits de nationalismes au Soudan », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 1993, volume 68, n° 1, pages 87-98.
24 () Gérard Prunier, ibid., page 27.
25 () Gérard Prunier, ibid., pages 54 et 55.
26 () Carte du Darfour, Site du Monde diplomatique
27 () Jérôme Tubiana, INALCO, « Le Darfour, un conflit pour la terre ? », in Politique africaine, n° 101, mars - avril 2006, pages 111s.
28 () Gérard Prunier, op. cit., page 56.
29 () Marc Lavergne, CNRS, Directeur du Centre d’Etudes et de Documentation Economiques, Juridiques et Sociales (Le Caire/Khartoum) ; entretien du 20 mai 2009.
30 () Christian Delmet, op. cit., page 88.
31 () Christian Delmet, op. cit., page 89.
32 () Le nom du président soudanais est également orthographié Omar al-Bashir, Omer Hassan Ahmed El Bashire, Omar al-Bashir, Omar al-Beshir, Omar el-Bashir, Omer Albasheer, Omar Elbashir et Omar Hassan Ahmad el-Béshir. L’orthographe retenue par le rapport est celle retenue par le ministère des affaires étrangères.
33 () Christian Delmet, op. cit., pages 93-94.
34 () Voir plus loin « La plus longue guerre civile africaine : le conflit Nord-Sud », pages 74 et suiv.
35 () UN-OHRLLS (Bureau du Haut représentant des Nations Unies pour les pays les moins avancés), données 2009.
36 () Voir plus loin, « Les préoccupations de l’Assemblée générale », pages 143 et suiv.
37 () Dernièrement encore, le 26 août 2009, des pluies torrentielles durant quelques heures sur l’Etat de Khartoum ont ainsi provoqué la mort de 27 personnes et fait près de 15 000 sans abri. « Soudan : la nuit où Khartoum s’est transformée en lac » ; CICR ; http://www.icrc.org
38 () Programme des Nations Unies pour l’Environnement, PNUE, « Sudan Post-conflict Environmental Assessment », juin 2007.
39 () Marc Lavergne, « Le Soudan contemporain », op. cit., page 29.
40 () Ibid, page 60 et suiv.
41 () Moshe Terdiman, université de Tel Aviv, « Sécurité environnementale, changements climatiques et conflits : le cas du Darfour. », in Outre Terre, n°20, « Pourquoi on meurt au Darfour », pages 147 et suiv.
42 () Rapport sur le développement humain, 2007-2008, PNUD, op. cit.
43 () Le site Web de Total, non actualisé à la date de rédaction de ce rapport, indique pour sa part que les prévisions pour 2008 étaient de 600 000 barils. « Quel est le potentiel pétrolier du Soudan ? » ; http://www.total.com/fr. Selon le site www.sudantribune.fr, (25 octobre 2009), citant Al-Zubeir Ahmed
al-Hassan, ministre de l’énergie soudanais, pour un objectif de production pour 2009 fixé à 600 000 barils, la production n’a en moyenne été que de 470 000 barils ; elle devrait pouvoir atteindre les 500 000 barils en 2010.
44 () Energy Information Administration, Country Analysis Briefs, Sudan, September 2009, 8 pages.
45 () Energy Information Administration, Country Analysis Briefs, Sudan, April 2007, 8 pages.
46 () Martin Prével, « L’agriculture soudanaise (1989 – 1993) », revue Egypte/Monde arabe, Première série, n° 17, 1994, page 1.
47 () Voir plus loin, « Un conflit qui s’abreuve au pétrole », pages 86 et suiv.
48 () Source : http://www.rightsmaps.com/html/sudmap2.html
49 () Martin Prével, op. cit, page 3.
50 () Sur ces questions : Eric Denis, CNRS, université Paris VII, « Inégalités régionales et rébellions au Soudan », in Outre-Terre, n° 20 « Pourquoi on meurt au Darfour », pages 164 et suiv. ; voir aussi Medani M. Ahmed, université de Khartoum, « La crise de l’économie soudanaise dans les années 80 », Égypte/Monde arabe, Première série, 15-16, 1993.
51 () Eric Denis, ibid., page 163.
52 () Eric Denis, ibid.
53 () Jérôme Tubiana, op. cit., page 122.
54 () Eric Denis, ibid., page 161.
55 () Ce rapport, infra Partie II : « Khartoum et ses périphéries : une histoire de conflits récurrents », pages 73.
56 () Voir par exemple Christian Delmet, « Les relations nord-sud au Soudan (1983-1993) », op. cit., pages 12 et suiv., ainsi que International Crisis Group, « God, Oil and Country, Changing the Logic of War in Sudan”, 2002, pages 147 et suiv : “Use of Food as a Weapon”.
57 () Les gouvernements britanniques et égyptiens parviendront à un accord sur l’autonomie et l’autodétermination du Soudan en 1953 ; l’indépendance sera prononcée le 1er janvier 1956.
58 () Entre temps, seule l’élection présidentielle de 1971, remportée par le général Nimeyri, avait eu lieu.
59 () Christian Delmet, « Chronique soudanaise 1985-1989 », in Marc Lavergne, « le Soudan contemporain », op. cit., page 289-306.
60 () Voir Roland Marchal, « Soudan : vers une recomposition du champ politique ? », Revue du monde musulman et de la Méditerranée, année 1996, volume 81, numéro 1, pages 93-117.
61 () Entretien du 22 juillet 2009.
62 () Mohammed Beshir Hamid, université de Khartoum, « Traditionnalisme et modernisation : une perspective politique », Egypte/Monde arabe, Première série, n° 15-16, « Les crises soudanaises des années 1980 », 1993, pages 207-226.
63 () Roland Marchal, op. cit.
64 () Nicole Grandin, op. cit. « Traditions religieuses et politiques au Soudan contemporain », in Marc Lavergne, « Le Soudan contemporain », op. cit., pages 227 et suiv.
65 () Voir International Crisis Group, « Oil, God and Country, Changing the Logic of War in Sudan », 2002, pages 7 et suiv., “Sudan before 1989” ainsi que Christian Delmet, « Un Soudan, des Soudan », Outre-Terre, n° 20, « Pourquoi on meurt au Darfour », pages 193-212.
66 () Curtis F. J. Doebbler, « Cinq ans après la constitution soudanaise de 1998, vérités et conséquences d’un anniversaire », Egypte/Monde arabe, Troisième série, n° 2, 2005, Les architectures constitutionnelles des régimes politiques arabes, pages 244-270.
67 () Ismail bin Matt, université de Brunei, “Toward an Islamic constitutional government in Sudan”, AMSS 35th Annual Conference, Harford Seminary, octobre 2006.
68 () Constitution soudanaise, article 65: “The Islamic Sharia and the national consent through voting, the Constitution and custom are the source of law and no law shall be enacted contrary to these sources, or without taking into account the nation's public opinion, the efforts of the nation's scientists, intellecl’UAls and leaders.”
69 () International Crisis Group, op. cit. : « In early October 2001, Vice President Taha reiterated the government's commitment to jihad. He told a brigade of mujahedeen fighters heading for the front that "the jihad is our way and we will not abandon it and will keep its banner high". »
70 () Marc Lavergne et Roland Marchal, « Introduction au thème », Politique africaine, n° 66, juin 1997, « Le Soudan : l’échec d’une expérience islamiste ? », page 4.
71 () Propos tenus dans Al-Qirds al-arabi, 9 janvier 1992, cités par Hayder Ibrahim Ali, « Le Front national islamique », op.cit., page 18.
72 () Roland Marchal, « Soudan : vers une recomposition du champ politique ? », op. cit., page 94
73 () Roland Marchal, ibid.
74 () Voir Curtis F. J. Doebbler, op.cit.
75 () Hervé Bleuchot, CNRS, « le Soudan anglo-égyptien », in Marc Lavergne, « le Soudan contemporain, op. cit., pages 210 et suiv.
76 () Roland Marchal, op. cit.
77 () Sur ces questions, voir Mohammed Beshir Hamid, op. cit., et Nicole Grandin, op. cit.
78 () Nicole Grandin, ibid.
79 () Gérard Prunier, avec la collaboration de Marc Lavergne, « Les Frères musulmans au Soudan : un islamisme tacticien », in Marc Lavergne, « Le Soudan contemporain », pages 359-380.
80 () Roland Marchal, op. cit.
81 () Voir Hayder Ibrahim Ali, Centre d’études soudanaises, Le Caire, « Le Front national islamique », in Politique africaine, n° 66, 1997, page 19.
82 () Idris Salim, université de Khartoum, « Le Front national islamique » : idéologie et pratique », in Egypte/Monde arabe, première série, n° 15-16, 1993, pages 227-248.
83 () Marc Lavergne et Roland Marchal, op. cit., page 7.
84 () Sur les questions qui suivent, voir Roland Marchal, « Soudan : vers une recomposition du champ politique ? », op. cit.
85 () Didar Fawzy, université de Lille III, « le Parti communiste soudanais », in Marc Lavergne, « Le Soudan contemporain, op. cit., pages 307-358.
86 () Didar Fawzy, ibid., page 347.
87 () « With Friends Like These… », International Crisis Group, op. cit., page 53.
88 () Charte d’intégration liant la République arabe d’Egypte et la République démocratique du Soudan, Partie I, article 1er, II. Source : http://untreaty.un.org/unts/60001_120000/11/20/00020987.pdf
89 () Entretien du 2 juillet 2009.
90 () Ibid., Partie I, article 1er, IV, « économie et finances ».
91 () Audition par la commission des affaires étrangères de Jean Felix-Paganon, ambassadeur de France en Egypte, 1er avril 2009.
92 () Créée en 1996, l’IGAD est une organisation régionale qui réunit aujourd’hui Djibouti, l’Ethiopie, l’Erythrée, le Kenya, l’Ouganda, la Somalie et le Soudan. Elle a pris la suite de l’IGADD (Intergovernmental Authority on Drought and Development) et a notamment joué un rôle important dans le processus de paix soudanais.
93 () International Crisis Group, op. cit., pages 160 et suiv.
94 () Le Soudan, avec Oman, sera le seul pays arabe à prendre cette position.
95 () Gérard Prunier, « le Darfour, un génocide ambigu », op. cit., page 119-120.
96 () La lettre de l’Océan indien, 15 avril 1989, citée par Gérard Prunier, op. cit., page 124.
97 () Claude Wauthier, « Quatre présidents et l’Afrique », Coll. L’histoire immédiate, pages 216 et suiv.
98 () Roland Marchal, « Le Soudan d’un conflit à l’autre », op. cit., page 44 et suiv.
99 () Marielle Debos, CERI/Science Po, « Darfour, Tchad, RCA, le développement d’une crise régionale », RAMSES 2008, IFRI, pages 269-273.
100 () Roland Marchal, « L’après-Mengistu dans la Corne de l’Afrique : une stabilisation impossible ? » Cultures & conflits n° 8 (1993) pp. 40-63.
101 () Alain Gascon, Centre d'études Africaines (CNRS/EHESS), « Le partage des eaux du Nil et les politiques éthiopiennes : le Nil est un don de l’Ethiopie, un mythe hydropolitique », http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2003/gascon/article.htm
102 () Entretien du 9 avril 2009 à Addis Abeba, avec Mme Sahlework Zewdie, directrice générale des affaires africaines, ministère éthiopien des affaires étrangères.
103 () Entretien du 8 avril 2009, à Addis Abeba.
104 () Sudan Tribune, 30 novembre 2009.
105 () Gérard Prunier, « le Sud Soudan depuis l’indépendance, (1956-1989) », in Marc Lavergne, « le Soudan contemporain », op. cit., page 396.
106 () Entretien avec MM. Jean-Michel Salvadori, Romaric Roignan et François Tribot Laspière, Total, le 16 juin 2009.
107 () Ronan Morin-Allory, université de Paris IV, « Chine – Soudan, une amitié à l’ombre des derricks », in Outre-Terre, op. cit., pages 226-243.
108 () Wu Lei, université du Yunnan, « Le pétrole, la question du Darfour et le dilemme chinois », in Outre-terre, op. cit., page 215-226.
109 () François Lafargue, Centrale, « Etats-Unis, Inde, Chine : rivalités pétrolières en Afrique », in Afrique contemporaine, n° 216, 2005-4, dossier « Le pétrole en Afrique », pages 43-56.
110 () Luke A. Patey, Danish Institute for International Studies, « States Rules : Oil Companies and Armed Conflict in Sudan »
111 () François Lafargue, « Kriegspiel pétrolier en Afrique », Politique internationale, n° 112, Eté 2006.
112 () Luke A. Patey, ibid.
113 () Roland Marchal, « L’après-Mengistu dans la Corne de l’Afrique : une stabilisation impossible ? », in « Cultures et conflits », n°8, 1993, pages 40-63.
114 () En mars 1973, à Khartoum, le groupe Septembre noir avait enlevé et assassiné Cleo A. Noel, ambassadeur des Etats-Unis au Soudan, son adjoint et le chargé d’affaires belge.
115 () Roland Marchal, « Le facteur soudanais, avant et après », in « Critique internationale », n° 17, octobre 2002.
116 () Roland Marchal et Oussama Osman, « Les ambitions internationales du Soudan islamiste », in Politique africaine, n° 66, op. cit., page 81.
117 () Michel Bole-Richard, « Israël a détruit au Soudan un convoi d'armes destiné, selon lui, au Hamas », Le Monde, 27 mars 2009.
118 () Gérard Prunier, « Le Sud Soudan depuis l’indépendance, 1956-1989 ») op. cit., pages 395 et suiv. : « Joseph Lagu, l’aide israélienne et l’unification du mouvement Anyanya (1970-1971).
119 () Osman Mirghani, « Le Soudan de tous les maux », Politique internationale, n° 64, été 1994.
120 () Roland Marchal et Oussama Osman, op. cit., page 81.
121 () Amal Madibbo, université de Toronto, « L’introduction du français en Afrique non-francophone : l’expérience soudanaise », Sud Langues, n° 2, juin 2003. http://www.sudlangues.sn
122 () Entretien avec MM. Abdou Diouf, Président de l’Organisation internationale de la francophonie, et Hugo Sada, Délégué à la paix, aux droits de l’homme et à la démocratie de l’OIF, le 15 juillet 2009.
123 () Jean-David Levitte, représentant permanent de la France auprès de l’Organisation des Nations Unies, lettre du 10 octobre 2001 au Secrétaire général, compte rendu des travaux menés par le Conseil de sécurité sous la présidence de la France en septembre 2001. Voir aussi : Résolution n° 1372 du 28 septembre 2001, Conseil de sécurité, Nations Unies.
124 () Stephen Smith, Libération, jeudi 12 janvier 1995.
125 () Géraldine Faes, Jeune Afrique, n° 1755, 25-31 août 1994.
126 () Jacques Julliard, Le Nouvel observateur, 1er-7 septembre 1994.
127 () « La France n’a rien fait pour aider le Soudan s’agissant des provinces du Sud. Elle n’a fourni ni information, ni armes, ni aucune aide via d’autres Etats de la région. La France n’est présente ni en Ouganda, ni au Kenya, ni au Zaïre. (…) Aucun soldat soudanais n’est passé en territoire centrafricain. », Hassan al-Turabi, « Notre islam pour toute la terre », entretien au Nouvel observateur, 25-31 août 1994.
128 () Jeune Afrique, ibid., indique que la Lettre de l’Océan indien a révélé cette information en février 1993.
129 () Naïm Mouna, « Non-dits franco-soudanais », Le Monde, 18 août 1994.
130 () Entretien avec Henri de Coignac, 30 septembre 2009, Paris.
131 () Entretien avec Lam Akol Ajawin, du 9 avril 2009, Addis Abeba.
132 () René Backmann, « Affaire Carlos : l’info et l’intox », Le Nouvel observateur, 25-31 août 1994 ; Stephen Smith, « Quand Pasqua prend la voie soudanaise », Libération, 16 août 1994.
133 () Jean Guisnel, Patricia Tourancheau et Gilles Millet, « Carlos, la chute d’un terroriste sans abri » ; Libération, lundi 5 septembre 1994.
134 () Entretien du 25 juin 2009 avec Charles Josselin.
135 () Entretien du 30 septembre 2009 avec Henri de Coignac.
136 () Jean-Marc Rochereau de la Sablière, Conseil de sécurité, séance du jeudi 31 mars 2005.
137 () Rapport de la Commission internationale d’enquête sur le Darfour au Secrétaire général, 25 janvier 2005, doct. N° S/2005/60, « Mesures que devrait prendre le Conseil de sécurité », page 187.
138 () Entretien du 6 juillet 2009 à Khartoum avec Nafi’ Ali Nafi’, Assistant du président Al-Bachir.
139 () Audition du 27 mai 2009.
140 () Entretien du 6 juillet 2009 à Khartoum, avec Hassan al-Turabi.
141 () Cité par Gérard Prunier, « le sud Soudan depuis l’indépendance », op. cit., page 388.
142 () Due aussi au fait que, résultat concret des politiques de marginalisation antérieures, les personnels qualifiés au Sud faisaient cruellement défaut.
143 () Sans lien avec John Garang de Mabior, qui n’interviendra dans l’histoire soudanaise qu’à compter des années 1980.
144 () Christian Delmet, « Construction de l'Etat et conflits de nationalismes au Soudan », op. cit.
145 () Christian Delmet, « Les relations nord-sud au Soudan (1983-1993) », Egypte/Monde arabe, Première série, N° 17, 1994, page 48.
146 () Christian Delmet, ibid., page 47., ainsi que « Construction de l'Etat et conflits de nationalismes au Soudan », page 92.
147 () Christian Delmet, ibid.
148 () Roland Marchal, « Le facteur soudanais, avant et après », op. cit.
149 () Les informations divergent quant à l’origine des bombardements : rebelles sudistes ou aviation éthiopienne.
150 () Christian Delmet, « Les relations nord-sud au Soudan (1983-1993) », op.cit., page 40.
151 () International Crisis Group, “God, Oil and Country; changing the logic of war in Sudan”, op. cit., page 102.
152 () Gérard Prunier, « le Sud Soudan depuis l’indépendance », in Marc Lavergne, « le Soudan contemporain », op. cit., page 400.
153 () Christian Delmet, « Les relations nord-sud au Soudan (1983-1993) », Egypte/Monde arabe, Première série, N° 17, 1994, pages 39-77.
154 () Christian Delmet, « Construction de l'Etat et conflits de nationalismes au Soudan », op. cit., page 96. Voir aussi : Luke A. Patey, The Danish Institute for International Studies, « State Rules : Oil Companies and Armed Conflict in Sudan ».
155 () Christian Delmet, « Les relations nord-sud au Soudan (1983-1993) », op. cit.
156 () John Garang, discours du 27 mai 1985, cité par Christian Delmet, op. cit.
157 () Pages 93 et suiv.
158 () Christian Delmet, « Construction de l'Etat et conflits de nationalismes au Soudan », op. cit., page 89.
159 () Cité par Christian Delmet, op. cit., page 91.
160 () http://www.splmtoday.com
161 () « The SPLM aims at the complete destruction of the minority, oppressive clique regime of the Old Sudan in all its forms; and its replacement by the New Sudan, that shall be built on a free, just, democratic and secular system of governance based on the free will and popular participation of all the people of the New Sudan. » SPLM, Vision et Programme, section 3, http://www.splmtoday.com
162 () Marc Lavergne, « Sud-Soudan : guerre tribale, Jihad islamique ou genèse de la nation ? », in « La Nation et le territoire. Le territoire, lien ou frontière ? », Joël Bonnemaison, Luc Cambrézy et Laurence Quinty-Bourgeois (dir.), L’Harmattan, Coll. Géographie et culture, t. 2, pages 51 à 60.
163 () Cité par Christian Delmet, in « Les relations Nord-Sud au Soudan (1983-1993) », op. cit.
164 () Human Rights Watch, ibid., pages 129 et suiv.
165 () La dimension ethnique ou tribale de cette opposition n’est pas à négliger : John Garang était Dinka ; Riek Machar ou Gordon Kong, autre opposant à Garang, sont Nuer ; Lam Akol est shilluk. Leur rivalité ne peut être lue uniquement sous l’angle politique ou de stratégie militaire.
166 () Christian Delmet, « Un Soudan, des Soudan », op.cit., page 194 et suiv.
167 () « Sudan, Oil, and Human Rights », Human Rights Watch, 2003, 567 pages ; page 114.
168 () Human Rights Watch, ibid., pages 125 et suiv.
169 () Voir supra, carte page 33.
170 () International Crisis Group, « God, oil, and Country », op ; cit., pages 115 et suiv.
171 () International Crisis Group, ibid., page 120.
172 () John Prendergast, Colin Thomas-Jensen, “Blowing the Horn”, Foreign Affairs, volume 86, n° 2, mars-avril 2007, pages 59-74.
173 () John Young, « The Eastern Front and the Struggle against Marginalization », The Small Arms Survey, HSBA Working Paper n° 3, mai 2007, page 17.
174 () International Crisis Group, « Sudan’s other Wars », juin 2003, page 17.
175 () John Young, ibid., page 20.
176 () Jérôme Larché, Médecins du Monde, « Le conflit oublié des Beja : l’Est Soudan au cœur de la Corne de l’Afrique ? », Humanitaire, juillet 2009.
177 () Jérôme Larché, ibid.
178 () Mohamed Suliman, Institute For African Alternatives, Londres, « Les Monts Nuba du Soudan : accès aux ressources, conflit violent et identité » ; www.crdi.ca (CRDI : Centre de recherche pour le développement international).
179 () Christian Delmet, « Le conflit dans les Monts Nouba/Sud Kordofan (1985-2005) », Outre-Terre, op. cit., pages 181-191.
180 () International Crisis Group, « Sudan’s Other Wars », juin 2003.
181 () Gáspár Bíró, Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme, « Rapport intérimaire sur la situation des droits de l’homme au Soudan », ONU, Document A/48/601, 18 novembre 1993.
182 () Marc Lavergne, « Sud-Soudan : guerre tribale, Jihad islamique ou genèse de la nation ? », op. cit.
183 () Jean Hélène, « Au Soudan, la tragédie cachée des Noubas. », Le Monde, 13 août 1996.
184 () Gáspár Bíró, ibid.
185 () Ibid. Lesquelles milices sont destinées à appuyer les forces armées dans leur guerre contre les sudistes ; les déportations, à fournir notamment des esclaves sexuelles et des prostituées.
186 () Gáspár Bíró, ibid.
187 () Christian Delmet, ibid., page 187.
188 () Roland Marchal, « Le conflit au Darfour, point aveugle des négociations Nord-Sud au Soudan », Politique africaine n° 95, octobre 2004, page 129.
189 () http://www.sudanjem.com/2004/en/books_php/books.htm
190 () Entretien avec Ahmad Lissan Tugod, chef de la délégation du JEM aux négociations de paix, Doha, 9 juin 2009.
191 () Entretien avec Amin Hassan Oman, ministre de la culture, chef de la délégation soudanaise aux négociations de paix, Doha, 9 juin 2009.
192 () Entretien avec Nafi’ Ali Nafi’, assistant du président Al-Bachir, Khartoum, le 6 juillet 2009.
193 () Gérard Prunier, « Le Darfour, un génocide ambigu », op. cit., pages 134 et suiv.
194 () Victor Tanner, John Hopkins University, Washington, « Darfour : racines anciennes, nouvelles virulence », Politique étrangère, 2004, volume 69, n° 4, pages 715-728.
195 () Roland Marchal, ibid., pages 126 et suiv.
196 () Victor Tanner, ibid.
197 () Jérôme Tubiana, « Le Darfour, un conflit pour la terre ? », op.cit., pages 111 et suiv.
198 () Victor Tanner, ibid.
199 () Gérard Prunier, « le Darfour, un génocide ambigu », op.cit. pages 100 et suiv.
200 () Roland Marchal, ibid., page 132.
201 () Gérard Prunier, op. cit., page 111
202 () Roland Marchal, ibid., page 13.
203 () Jérôme Tubiana, « Le Darfour, un conflit identitaire ? », Afrique contemporaine, n° 214, 2005/2, pages 184 et suiv.
204 () International Crisis Group, “Darfur Rising: Sudan’s New Crisis”, mars 2004.
205 () Marc Lavergne, « Darfour : un Munich tropical », Politique internationale, n° 117, automne 2007, « Le pétrole au second plan », page 390.
206 () Gérard Prunier, Roland Marchal, notamment.
207 () Jérôme Tubiana, ibid.
208 () Gérard Prunier, Paix fragile et partielle au Soudan », Le Monde diplomatique, février 2005.
209 () Entretien avec Issa Maraut, 9 juin 2009, Doha, Qatar.
210 () Gérard Prunier, « Le Darfour, un génocide ambigu », op. cit., pages 143 et suiv.
211 () International Crisis Group, ibid.
212 () Jérôme Tubiana, « Le Darfour, un conflit pour la terre ? » op. cit., page 114.
213 () AbdelWahid al-Nour, « Soudan : l’âme de la résistance », entretien conduit par Alexandre Del Valle, Politique internationale, n° 117, automne 2007, page 402.
214 () AbdelWahid al-Nour, ibid.
215 () « Rapport de la Commission internationale d’enquête sur le Darfour au Secrétaire général », page 44.
216 () Selon une étude, plusieurs indices laissent penser que les liens entre le JEM et le mouvement de Hassan al-Turabi, notamment financiers, sont encore actifs. International Crisis Group, « Unifying Darfur’s Rebels : A Perequisite for Peace », octobre 2005.
217 () AbdelWahid al-Nour, ibid., page 411.
218 () Gérard Prunier, op. cit., pages 167 et suiv.
219 () Rapport de la Commission des Nations Unies, op. cit., page 37 et suiv.
220 () Gérard Prunier, ibid., page 168.
221 () Marc Lavergne, « Darfour : un Munich tropical », op. cit., page 381.
222 () Cité in Rapport de la Commission des Nations Unies, op. cit. page 40, et in International Crisis Group, « Darfour Rising… », op. cit., page 16.
223 () Gérard Prunier, « Le Darfour, un génocide ambigu », op. cit., pages 160 et suiv.
224 () Gérard Prunier, ibid., page 170.
225 () Gérard Prunier, ibid., page 171.
226 () Rapport de la Commission d’enquête des Nations Unies, pages 70-122. ; rapports des rapporteurs spéciaux de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies ; Amnesty International ; Human Rights Watch ; International Crisis Group ; Gérard Prunier, ibid., pages 170-175, notamment.
227 () Marc Lavergne, ibid., pages 381 et suiv. ainsi que Jérôme Tubiana, « Au Darfour après Abuja : quand l’insécurité devient la règle », Outre-Terre n° 20, « Pourquoi on meurt au Darfour », pages 55-79.
228 () Pierre Salignon, « Darfour : l’action humanitaire en sursis ? Nos représentations de la crise en question », Humanitaire, n° 15 ; http://www.msf.fr/
229 () Source : Marc Lavergne, « L’analyse géographique d’une guerre civile en milieu sahélien », Afrique contemporaine, n° 214, 2005/2, page 140.
230 () Entretien avec Rodolphe Adada, chef de la MINUAD, 7 juillet 2009.
231 () Jérôme Tubiana, ibid., page 77.
232 () Conseil de sécurité des Nations Unies, Réunion du 27 avril 2009, audition de Rodolphe Adada.
233 () Entretien avec le Général Martin Luther Agwai, commandant de la force de maintien de la paix dans le Darfour, 7 juillet 2009 .
234 () Roland Marchal, entretien du 2 avril 2009.
235 () International Crisis Group, « Tchad : la poudrière de l’Est », avril 2009.
236 () Ibid.
237 () Roland Marchal, « Le Soudan, d’un conflit à l’autre », op. cit. ; Jennifer Giroux, David Lanz et Damiano Sguaitamatti, “The Tormented Triangle: The Regionalisation Of Conflict In Sudan, Chad And The Central African Republic”, Crisis States Research Center, Working paper n° 47, avril 2009.
238 () Jérôme Tubiana, « Le Darfour, un conflit pour la terre ? », op. cit.
239 () Gérard Prunier, « Le Darfour, un génocide ambigu », op. cit., page 178-179 ; (souligné par l’auteur).
240 () Ibid., page 257.
241 () International Crisis Group, ibid., « The Terrorist Connection », page 71 et suiv.
242 () International Crisis Group, ibid., page 74-78.
243 () Ben Laden n’en avait pas moins alors quitté le Soudan pour l’Afghanistan
244 () Alex de Waal, « Une perspective de paix pour le Soudan en 2002 ? », Politique africaine, n° 85, mars 2002, pages 93-107.
245 () International Crisis Group, « Capturing the Moment: Sudan’s Peace Process in the Balance », avril 2002, page 6.
246 () Alex de Waal, ibid., page 93.
247 () Alex de Waal, ibid., page 100.
248 () Alex de Waal, ibid., page 105.
249 () International Crisis Group, « God, Oil, and Country », ibid., pages160 et suiv.
250 () Selon International Crisis Group, ibid., page 122, certaines ONG ont estimé à 200 000 le nombre de personnes réduites à l’esclavage.
251 () Alex de Waal, ibid., page 98.
252 () Alex de Waal, ibid.
253 () Gérard Prunier, « Négociations sous tensions régionales, paix introuvable au Soudan », Le Monde diplomatique, décembre 2002.
254 () International Crisis Group, « God, Oil and Country », op. cit., page 187.
255 () International Crisis Group, ibid., page 182-186.
256 () International Crisis Group, « Capturing the Moment : Sudan’s Peace Process in the Balance », op. cit.
257 () Roland Marchal, « Le facteur soudanais, avant et après », Critique internationale n° 17, octobre 2002, page 50.
258 () Entretien avec Henri de Coignac, 30 septembre 2009.
259 () International Crisis Group, « Capturing the Moment : Sudan’s Peace Process in the Balance », op. cit.
260 () International Crisis Group, ibid.
261 () International Crisis Group, ibid.
262 () Protocole de Machakos, Partie B, Processus transitoire, point 2.5.
263 () Accord sur le partage des richesses, Navaisha, 7 janvier 2004, Points 5.5 et 5.6.
264 () Roland Marchal, « le Soudan d’un conflit à l’autre », op. cit., page 27.
265 () Protocole du 26 mai 2004, principe général, 1.1.1.
266 () « Abyei Boundaries Commission ».
267 () Gérard Prunier, « Le Sud Soudan depuis l’indépendance », op. cit., « la paix difficile (1972-1983), pages 400 et suiv.
268 () International Crisis Group, « Sudan’s Best Chance for Peace : How not to Loose it »”, septembre 2002.
269 () International Crisis Group, ibid.
270 () Gérard Prunier, « Paix fragile et partielle au Soudan », Le Monde diplomatique, février 2005.
271 () Gérard Prunier, « Le Darfour, un génocide ambigu », op. cit., page 186 et suiv.
272 () Source : Chatham House, « Lost Opportunitiesin the Horn of Africa », op. cit. page 30.
273 () Résolutions 43/8 du 18 octobre 1988 et 43/52 du 6 décembre 1988.
274 () Adoptée le 18 décembre 1992.
275 () Résolutions 48/200, décembre 1993 ; 49/21K, décembre 1994 ; 50/58J, décembre 1995 ; 51/30, décembre 1996 ; 52/169F, décembre 1997 ; 53/1, décembre 1998 ; 54/96, décembre 2000 ; 52/112, décembre 2001. Les résolutions ultérieures de l’Assemblée générale ne porteront que sur le financement de l’opération MINUS.
276 () Résolution 51/112, 12 décembre 1996.
277 () Résolution 50/197, 22 décembre 1995.
278 () Résolution 52/140, 12 décembre 1997.
279 () Résolution 1993/60, du 10 mars 1993.
280 () Résolutions 1054, du 26 avril 1996, et 1070, du 16 août 1996, adoptées à l’unanimité moins les abstentions de la Fédération de Russie et de la Chine.
281 () Résolution 1372, du 28 septembre 2001.
282 () Résolution 1547.
283 () Déclaration du président du Conseil de sécurité, 10 octobre 2003.
284 () Rapport du Secrétaire général sur le Soudan, 3 juin 2004.
285 () Rapport du secrétaire général, S/2004/453, 3 juin 2004, § 22.
286 () Déclaration du président du Conseil de sécurité, 25 mai 2004.
287 () Adoptée le 30 juillet 2004.
288 () Résolution 1556 du 30 juillet 2004, paragraphe 11.
289 () Par le passé, depuis la création de l’organisation, le Conseil de sécurité ne s’était ainsi délocalisé qu’à trois reprises.
290 () 21 en 2005 ; 31 en 2006 ; 15 en 2007 ; 24 en 2008 et 16 en 2009.
291 () Résolution 1593, du 31 mars 2005.
292 () Luke A. Patey, « State Rules: Oil Companies and Armed Conflict in Sudan », The Danish Institute for International Studies, 2007.
293 () Maria M. Gabrielsen, « Mobilisations pour le Sud Soudan et le Darfour : émergence d’un mouvement transnational », in Outre-Terre n° 20, « Pourquoi on meurt au Darfour », 2008, pages 396-397.
294 () Gérard Prunier, op. cit., page 179.
295 () International Crisis Group, « God, Oil and Country,… », op. cit., pages 120 et suiv.
296 () Gérard Prunier, « Le Darfour, un génocide ambigu », op. cit., pages 207 et suiv., chapitre V: « La crise du Darfour et le monde ».
297 () Abdel Wahid al Nour, « Soudan, l’âme de la résistance », Politique internationale, n°117, automne 2007.
298 () Entretien du 16 juin 2009.
299 () Gérard Prunier, ibid., pages 249-250.
300 () United States Government Accountability Office, « Darfur Crisis, Death Estimates Demonstrate Severity of Crisis, but Their Accuracy and Credibility Could Be Enhanced”, Report to Congressional Requesters, novembre 2006, 77 pages.
301 () Debarati Guha-Sapir, et Olivier Degomme, Université catholique de Louvain, « Darfur : Counting the Deaths. What are the Trends ? », décembre 2005
302 () Entretien téléphonique du 14 mai 2009 avec le docteur Olivier Degomme, médecin, spécialiste de santé publique, CRED.
303 () Darfour CE-DAT “complex emergency database”, Juillet 2009
304 () 108th Congress, 2nd session, Résolution n° 133, du 22 juillet 2004 : “Resolved by the Senate (the House of Representatives concurring), That Congress (1) declares that the atrocities unfolding in Darfur, Sudan, are genocide; (2) reminds the Contracting Parties to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (signed at Paris on December 1948), particularly the Government of Sudan, of their legal obligations under the Convention; (3) declares that the Government of Sudan, as a Contracting Party, has violated the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide; (4) deplores the failure of the United Nations Human Rights Commission to take appropriate action with respect to the crisis in Darfur, Sudan, particularly the failure by the Commission to support United States–sponsored efforts to strongly condemn gross human rights violations committed in Darfur, and calls upon the United Nations and the United Nations Secretary General to assert leadership by calling the atrocities being committed in Darfur by their rightful name: genocide; (5) calls on the member states of the United Nations, particularly member states from the African Union, the Arab League, and the Organization of the Islamic Conference, to undertake measures to prevent the genocide in Darfur, Sudan, from escalating further, including the imposition of targeted means against those responsible for the atrocities; (6) commends the Administration’s leadership in seeking a peaceful resolution to the conflict in Darfur, Sudan, and in addressing the ensuing humanitarian crisis, including the visit of Secretary of State Colin Powell to Darfur in June 2004 to engage directly in efforts to end the genocide, and the provision of nearly $140,000,000 to date in bilateral calls on the Administration to continue to lead an international effort to stop genocide in Darfur, Sudan; (9) calls on the Administration to impose targeted means, including visa bans and the freezing of assets, against officials and other individuals of the Government of Sudan, as well as Janjaweed militia commanders, who are responsible for war crimes and crimes against humanity in Darfur, Sudan; (…)”
305 () Colin Powell, 9 septembre 2004, témoignage devant la Commission des affaires étrangères, du Sénat : « I concluded that genocide has been committed in Darfur and that the Government of Sudan and the Jingaweit bear responsibility -- and that genocide may still be occurring.”
306 () Rony Brauman, entretien du 13 mai 2009 ; Roland Marchal, entretien du 2 avril 2009.
307 () Gérard Prunier, op. cit., page 195.
308 () Mahmood Mamdani, Université de Columbia, « Qui veut sauver le Darfour ? », Le monde diplomatique, août 2009.
309 () Article 8, alinéa 1.
310 () En complément de cette définition générique, diverses précisions sont apportées dans les alinéas suivants de l’article, sur ce qui doit être entendu par esclavage, déportation, ou encore extermination.
311 () Rapport de la Commission internationale d’enquête sur le Darfour au Secrétaire général, S/2005/60, pages 141s.
312 () Outre M. Antonio Cassese, la Commission était composée de M. Mohammed Fayek, Egyptien, Secrétaire général de l’Organisation arabe des droits de l’homme; Mme Hina Jilani, Pakistanaise, avocate à la Cour suprême du Pakistan, Secrétaire générale de la Commission des droits de l’homme du Pakistan et Représentante spéciale du Secrétaire général pour la question des défenseurs des droits de l’homme; M. Dumisa Ntsebeza, Sud-Africain, ancien membre de la Commission Vérité et réconciliation en Afrique du Sud; Mme Therese Striggner-Scott, Ghanéenne, ancienne juge à la Haute Cour du Ghana et à celle du Zimbabwe, avocate au Ghana.
313 () Commission d’enquête internationale sur le Darfour, op. cit., page 141.
314 () Ibid., page 141.
315 () Ibid., page 185.
316 () Ibid., page 185.
317 () Ibid., pages 183-184.
318 () Ibid., page 184.
319 () Entretien avec Luis Moreno Ocampo, du 14 avril 2009.
320 () Rony Brauman, « Darfour : La Morale contre les peuples », http://www.causeur.fr
321 () Gérard Prunier, ibid., page 253.
322 () Jérôme Tubiana, « Au Darfour après Abuja : quand l’insécurité devient la règle. », Outre-Terre, n° 20, « Pourquoi on meurt au Darfour », op. cit., pages 55 et suiv.
323 () Résolution 1881, du 30 juillet 2009
324 () Résolution 1891, du 13 octobre 2009
325 () La résolution 1828, adoptée le 31 juillet 2008, résoudra la question par une formule de compromis en faisant état des « préoccupations exprimées par certains de ses membres au sujet de l’évolution potentielle de la situation suite à la demande formulée par le Procureur de la Cour pénale internationale le 14 juillet 2008 ».
326 () Résolution 1769, annexe X, page N.
327 () Entretien avec Stalislas Nakaha, ambassadeur, chef du « Darfur Desk », Commission de l’Union africaine, et Alfred Mvondo, Lt-colonel, chargé de l’administration et du personnel du « Darfur Desk », Addis Abeba, 2 avril 2009.
328 () Entretien avec le général Martin Agwaï, 7 juillet 2009.
329 () « La quête de la paix, de la justice et de la réconciliation », Rapport du Groupe de travail de haut niveau de l’Union africaine sur le Darfour, page 103.
330 () Entretien avec Rodolphe Adada, 7 juillet 2009.
331 () Entretien avec le général Martin Luther Agwaï, 7 juillet 2009.
332 () Entretien avec Henri de Coignac, du 30 septembre 2009.
333 () International Crisis Group, « Darfur’s Fragile Peace Agreement », juin 2006.
334 () International Crisis Group, ibid.
335 () « La quête de la paix, de la justice et de la réconciliation », rapport du Groupe de haut niveau sur le Darfour, octobre 2009, page 42.
336 () Entretien avec Henri de Coignac, 30 septembre 2009.
337 () Entretien du 6 juillet 2009, Khartoum.
338 () Rapport de la Commission, ibid., page 154.
339 () Après les polémiques des dernières années, le chiffre de 35 000 tués de mort violente au cours de la période comprise entre avril 2003 et janvier 2005 est celui sur lequel on s’accorde désormais. C’est par exemple celui que retiendra aussi en octobre 2009 le Groupe de haut niveau présidé par Thabo Mbeki, se fiant aux enquêtes internationales.
340 () Cour pénale internationale, bureau du procureur, fiche de synthèse, situation au Darfour.
341 () A l’heure de la mise sous presse de ce rapport, la Chambre préliminaire a finalement refusé, le 8 février 2010, de confirmer les charges à l’encontre de Abu Garda, faute de preuves suffisantes pour établir qu’il était pénalement responsable des crimes qui lui étaient imputés.
342 () Cour pénale internationale, situation au Darfour, Soudan, « requête du procureur aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt en vertu de l’article 58 contre Omar Hassan Ahmad AL BASHIR ».
343 () Cour pénale internationale, ibid.
344 () Cour pénale internationale, La chambre préliminaire I, « Mandat d’arrêt à l’encontre d’Omar Hassan Hamad al Bashir », document n° ICC-02/05-01/09, 4 mars 2009.
345 () Cour pénale internationale, Pre-trial Chamber I, Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir document n° ICC-02/05-01/09, 4 mars 2009.
346 () Communiqué de presse de la Cour pénale internationale, 3 février 2010.
347 () Foreign Policy, février 2009.
348 () Lam Akol, entretien à l’Express, 29 mars 2007.
349 () Cité par François Soudan, Courrier Sud, les blogs de Jeune Afrique, “Tutu, Kagamé et le cas Al-Bachir », 17 mars 2009.
350 () Jean Ping, déclaration à l’AFP, 4 mars 2009.
351 () Mgr Desmond Tutu, ancien archevêque du Cap, prix Nobel de la paix 1984, «Will Africa let Sudan off the Hook? », The new York Times, 2 mars 2009.
352 () Entretien du 12 février 2009.
353 () Antonio Cassese, « Giustizia impossibile », La Repubblica, 5 mars 2009.
354 () Michael Th. Johnson , notamment ancien procureur en chef adjoint du TPI pour le Rwanda, ancien chef de la division des poursuites du TPIY, « Justice mondiale, tribunaux locaux ».
355 () Entretien du 27 mai 2009 ; entretien à l’Express, « Pas de puissance supérieure aux Etats », 12 mars 2009.
356 () Entretien avec Nasser Kamel, ambassadeur d’Egypte en France, 2 juillet 2009.
357 () Ibid.
358 () Djibril Bassolé, médiateur conjoint des Nations Unies et de l’Union africaine pour le processus de paix du Darfour, entretien du 9 juin 2009, Doha, Qatar.
359 () Ibid.
360 () Pour lequel, comme indiqué, les preuves viennent d’être considérées par la cour comme insuffisantes pour justifier le maintien des charges.
361 () « Darfour, la quête de la paix, de la justice et de la réconciliation », Rapport du Groupe de haut niveau de l'Union africaine sur le Darfour, octobre 2009, page xv.
362 () http://www.un.org/News/fr-press/docs//2009/SC9831.doc.htm
363 () Entretien avec Mohsen Marzouk, Secrétaire général de la Fondation arabe pour la démocratie, le 10 juin 2009, Doha. La Fondation arabe pour la démocratie mène des actions sur le terrain, au Darfour notamment, impliquant la société civile.
364 () El Ghassim Wane, chef de la division « Gestion des conflits », département Paix et Sécurité, Commission de l’Union africaine, entretien du 8 avril 2009, Addis Abeba.
365 () International Crisis Group, « Unifying Darfur’s Rebels : A Prerequisite for Peace », octobre 2005.
366 () International Crisis Group, ibid.
367 () Dépêche de l’Agence Panafricaine de presse, Panapress, 17 janvier 2010.
368 () Entretien avec Issa Maraut, envoyé spécial de la France pour le processus de pais au Darfour, Doha, 9 juin 2009.
369 () Entretien du 16 juin 2009.
370 () Jérôme Tubiana, « Au Darfour après Abuja… », Outre-Terre, op.cit.
371 () Entretien du 9 juin 2009, Doha.
372 () Entretien du 10 juin 2009, Doha
373 () Le Monde, 24 janvier 2010.
374 () Entretiens avec Michael O’Neill, représentant spécial pour le Soudan, et avec David Drew, député à la Chambre des Communes, président du groupe d’études sur le Soudan, 16 juillet 2009, Londres.
375 () Entretien avec Koen Verkaeke, ambassadeur, chef de la délégation de la Commission européenne auprès de l'Union africaine, Addis Abeba, 9 avril 2009.
376 () « Déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne sur la situation au Darfour », 19 novembre 2008.
377 () Conclusions du Conseil sur le Soudan, 15 septembre 2009, annexe 4 page 281.
378 () Christian Delmet, « un Soudan, des Soudan », Outre-Terre, op. cit.
379 () Entretiens du 9 juin 2009 avec les délégations du gouvernement soudanais et du JEM aux négociations de paix de Doha.
380 () “At the end of the six (6) year Interim Period there shall be an internationally monitored referendum, organized jointly by the GOS and the SPLM/A, for the people of South Sudan to: confirm the unity of the Sudan by voting to adopt the system of government established under the Peace Agreement; or to vote for secession.”, Protocole de Machakos, 20 juillet 2002, article 2.5.
381 () Entretien du 9 juin 2009 avec Ahmad Lissan Tugod, chef de la délégation du JEM, à Doha, Qatar.
382 () Op. cit., page 39.
383 () International Crisis Group, “Sudan’s Southern Kordofan Problem: The Next Darfur?” Africa Report n° 145, 21 octobre 2008.
384 () En autres, la résolution 1784 du 31 octobre 2007 : « Invitant instamment les parties à honorer les engagements qu'elles ont pris dans l'Accord de paix global et dont elles ne se sont pas encore acquittées, notant en particulier le retard pris dans le redéploiement complet et vérifié des forces au plus tard le 9 juillet 2007 et recommandant vivement que celui-ci soit achevé et que de nouveaux progrès soient accomplis dans la délimitation de la frontière Nord-Sud et dans l'application de la résolution sur le conflit d'Abyei ».
La même résolution demandait aussi « instamment au Gouvernement d'unité nationale de prendre toutes les mesures voulues pour préparer la tenue d'élections libres et régulières, notamment en mobilisant sa part des ressources nécessaires à la conduite d'un recensement national, et exhortant en outre la communauté internationale à apporter une assistance technique et matérielle à la préparation des élections, y compris au recensement national. » Ces élections, qui devaient se tenir avant la fin de la troisième année de la transition développement devraient finalement avoir lieu en avril 2010.
385 () Christian Delmet, « Un Soudan, des Soudan », Outre-Terre, op.cit..
386 () Gérard Prunier, « Le Sud Soudan depuis l’indépendance », in Marc Lavergne, « Le Soudan contemporain », op. cit., page 415.
387 () « International Crisis Group, « Sudan : Preventing Implosion », Policy Briefing, Africa Briefing n° 68, 17 décembre 2009.
388 () Ibid., page 39.
389 () “AEC January 2010 report”, http://www.aec-sudan.org ; (AEC : Assessment and Evaluation Commission).
390 () Depuis ce rapport de la Commission, la situation s’est légèrement améliorée du fait du SPLM/A, puisque ce sont 33,7 % de l’effectif qui ont été redéployés, selon les données du rapport du Secrétaire général des Nations Unies au Conseil de sécurité sur le Soudan du 10 janvier 2010 ; Document n° S/2010/31.
391 () Conseil de sécurité, résolution n° 1784, du 31 octobre 2007.
392 () Christian Delmet, « Un Soudan, des Soudan », Outre-Terre, op.cit.
393 () Entretien du 8 juillet 2009.
394 () http://www.marc-lavergne.com
395 () Banque mondiale, Report n° 43036-SD, « Interim Strategy Note for the Republic of Sudan », mars 2008.
396 () Aujourd’hui, 68 pays participent à cet effort et près de 9 600 militaires et 700 policiers sont présents.
397 () « Sauver la paix au Soudan », rapport conjoint d’ONG, janvier 2010. Rapport au nom d'Oxfam International, Christian Aid, Cordaid, Handicap International, Save the Children, ICCO & Kerk in Actie, International Rescue Committee (IRC), Secours Catholique/Caritas France, Tearfund et World Vision
398 () International Crisis Group, « Sudan’s Comprehensive Peace Agreement : The Long Road Ahead”, Africa Report n° 106, 31 mars 2006.
399 () Jan Pronk, représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies, Réunion du Conseil de sécurité, 10 janvier 2005.
400 () CPA, Protocole d’Abyei, 1.1.1. : « Abyei is a bridge between the north and the south, linking the people of Sudan ».
401 () Si elle a été fortement réactivée par la présence de pétrole dans la zone, la question de l’appartenance d’Abyei au Nord ou au Sud est néanmoins ancienne : le traité de paix d’Addis Abeba de 1972 prévoyait déjà un référendum des populations locales à ce sujet, qui n’a cependant jamais été organisé.
402 () Source : Cour permanente d’arbitrage, http://www.pca-cpa.org
403 () Rapport du Secrétaire général sur le Soudan au Conseil de sécurité, document n° S/2010/31, 19 janvier 2010.
404 () Entretien du 8 juillet 2009, à Juba.
405 () Entretien avec Martin Elia Lomuro, ministre des relations avec l’assemblée législative du GoSS, le 8 juillet à Juba.
406 () Ibid.
407 () Entretien du 19 juin 2009, à Paris, avec Mgr. Micah Laila Dawidi, Eglise épiscopalienne du Soudan, Rvd. Both Reth Luang, Eglise Presbytérienne du Soudan, Révérend Peter Tibi, Secrétaire Général du Conseil des Eglises du Soudan et Isaac Kenyi Kungur, Eglise Catholique.
408 () Entretien avec Luka Biong Deng, ministre de la présidence du GoSS, 20 novembre, à Paris.
409 () Entretien avec James Wani Igga, du 8 juillet 2009, à Juba.
410 () Entretien du 8 juillet 2009, à Juba.
411 () Sudan Tribune, 1er avril 2009, « South Sudan asks Ethiopia’s Zenawi to address fiscal crisis »
412 () Chatham House, « Against the Gathering Storm, Securing Sudan’s Comprehensive Peace Agreement », 2009, page 27.
413 () Entretien avec MM. Jean-Michel Salvadori, Directeur Afrique subsaharienne, Romaric Roignan, chargé des relations internationales et François Tribot Laspiere, direction des relations institutionnelles, Groupe Total, le 18 juin 2009.
414 () http://www.marc-lavergne.com, note du 22 octobre 2009, ibid.
415 () Entretien du 19 juin 2009, à Paris.
416 () Christian Delmet, « Un Soudan, des Soudan », Outre-Terre, op.cit., pages 202 et suiv. Voir aussi : Christian Delmet, « Les relations Nord-Sud au Soudan, 1983- 1993 », op. cit.
417 () Entretien du 30 septembre 2009 avec MM. Daniel Duvillard, chef des opérations Corne de l'Afrique, Michel Katz, conseiller diplomatique et Laurent Corbaz, chef de délégation en France, Comité international de la Croix rouge.
418 () « Sauver la paix au Sud Soudan », rapport conjoint d’ONG, janvier 2010.
419 () Christian Delmet, ibid.
420 () Entretien avec Christian Delmet, du 22 juillet 2009.
421 () Entretien du 19 juin 2009
422 () Entretien du 30 septembre 2009 avec MM. Daniel Duvillard, chef des opérations Corne de l'Afrique, Michel Katz, conseiller diplomatique et Laurent Corbaz, chef de délégation en France, Comité international de la Croix rouge.
423 () International Crisis Group, “Jonglei’s Tribal Conflicts :Countering Insecurity in South Sudan”, Africa Report n° 154, 23 décembre 2009.
424 () Conseil de sécurité, Rapport du Secrétaire général sur le Soudan, 19 janvier 2010, document n° S/2010/31. La période concernée par ce rapport est le dernier trimestre de 2009.
425 () Ibid.
426 () Article 24, Critères pour le droit de vote : Un votant doit être habitant d’Abyei conformément à l’Article 6, alinéa 1 du Protocole du règlement du conflit. Sont considérés comme habitants d’Abyei : 1. Les membres de la communauté des Dinka Ngok ; 2. Les autres Soudanais résident à Abyei selon les critères de résidence à arrêter par la Commission, conformément à l’Article 14, alinéa 1, de la présente loi ; 3. Agé d’au moins 18 ans ; 4. En possession de toutes ses facultés mentales ; 5. Inscrit sur le Registre du Référendum.
427 () « Sauver la paix au Sud Soudan », rapport conjoint d’ONG, janvier 2010.
428 () Entretien du 8 juillet 2009 à Juba.
429 () Entretien du 19 juin 2009.
430 () “When you reach your ballot boxes the choice is yours: you want to vote for unity so that you become a second class in your own country, that is your choice”. Propos rapportés par l’agence Reuters, cité par International Crisis Group, “Sudan: Preventing Implosion”, Africa Briefing n° 68, 17 décembre 2009.
431 () Entretien du 30 septembre 2009 à Paris avec Daniel Duvillard, chef des opérations Corne de l'Afrique, Michel Katz, conseiller diplomatique, et Laurent Corbaz, chef de délégation en France, Comité international de la Croix rouge.
432 () Entretien du 6 juillet 2009, à Khartoum.
433 () Entretien du 20 novembre 2009, à Paris.
434 () Entretien avec Martin Elia Lomuro, ministre des relations avec l’assemblée législative, GoSS, du 8 juillet 2009, à Juba.
435 () Christian Delmet, « un Soudan, des Soudan », ibid., page 212.
436 () Entretien avec Marc Lavergne, 20 mai 2009.
437 () Entretien du 8 juillet 2009, à Juba.
438 () Entretien du 8 juillet 2009, à Juba.
439 () http://www.marc-lavergne.com, note du 22 octobre 2009 : « Washington Forum, la voix de l’Amérique ».
440 () Entretien du 20 mai 2009.
441 () Entretien du 19 juin 2009, à Paris, avec Mgr. Micah Laila Dawidi, Eglise épiscopalienne du Soudan, Rvd. Both Reth Luang, Eglise Presbytérienne du Soudan, Révérend Peter Tibi, Secrétaire Général du Conseil des Eglises du Soudan et Isaac Kenyi Kungur, Eglise Catholique, représentants des églises du Sud Soudan.
442 () International Crisis Group, « Sudan’s Comprehensive Peace Agreement : The Long Road Ahead”, Africa Report n° 106, 31 mars 2006, page 27.
443 () Souligné par vos rapporteurs.
444 () Souligné par vos rapporteurs.
445 () European Union Institute for Security Studies, « Post-2011 scenarios in Sudan : What role for the EU ? », ISS Report, n° 06, novembre 2009.
446 () Rapport au Conseil de sécurité du Secrétaire général sur le Soudan, précité. Souligné par vos rapporteurs.
447 () Entretien du 8 avril 2009, à Addis Abeba.
448 () Chatham House, « Lost Opportunities in the Horn of Africa », op. cit.
449 () Rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité du 19 janvier 2010 précité.
450 () Intervention devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, 21 décembre 2009.
451 () Thabo Mbeki, ancien président de la république d’Afrique du sud, président du groupe de haut niveau de l’Union africaine sur le Darfour, intervention devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, 21 décembre 2009.
452 () International Crisis Group, « Sudan’s Southern Kordofan Problem : The Next Darfur ?”, Africa report n° 155, octobre 2008.
453 () Annexe 4, page 279.
© Assemblée nationale
