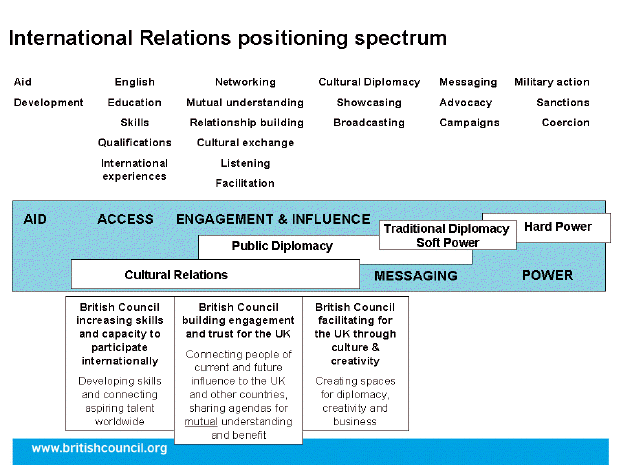______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mai 2010.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
en conclusion des travaux d’une mission d’information constituée le 28 janvier 2009 (1),
sur « le rayonnement de la France par l’enseignement et la culture »
Président
M. François ROCHEBLOINE
Rapporteure
Mme Geneviève COLOT
Députés
__________________________________________________________________
(1) La composition de cette mission figure au verso de la présente page.
La mission d’information sur le « Rayonnement de la France par l’enseignement et la culture » est composée de : M. François Rochebloine, président, Mme Geneviève Colot, rapporteure, Mme Martine Aurillac, MM. Jean-Louis Bianco, Philippe Cochet, Jean-Pierre Dufau, Jean-Michel Ferrand, Jean-Claude Guibal, Jean-Pierre Kucheida, Robert Lecou, Didier Mathus, Jacques Remiller, André Schneider.
INTRODUCTION 5
I – LES SUITES DU RAPPORT D’ÉTAPE : POUR CHACUN DES DEUX RÉSEAUX, DES CONSTATS CONFIRMÉS, UNE TYPOLOGIE AFFINÉE 9
A – UNE CONFIRMATION DES PREMIERS CONSTATS ET DES PREMIÈRES PRÉCONISATIONS DE LA MISSION 9
1) Faire fructifier le trésor qu’est le réseau d’enseignement 9
2) Retisser la toile du réseau culturel 16
B – DE NOUVEAUX CONSTATS EN RÉPONSE AUX QUESTIONS LAISSÉES EN SUSPENS 20
1) Une typologie révélatrice de la cartographie de l’influence française 20
2) Pour le réseau d’enseignement : plus de « dialogue social » à propos des lycées, le défi du supérieur à relever 23
3) Pour le réseau culturel : mieux mettre en relation les différents intervenants et réfléchir aux contenus 25
II – LE TERME D’UN AN DE TRAVAUX : DU RAYONNEMENT À L’INFLUENCE, COMMENT RÉUSSIR UNE TRANSITION DOULOUREUSE 27
A – QUESTIONS DE MÉTHODE : RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES 27
1) Une stratégie avant toute chose 27
2) Les mérites du jardin à la française, l’attrait du jardin anglais… Vive le jardin zen ! 31
3) Des interrogations sur la méthode 32
B – QUESTIONS D’INTENDANCE : RECOMMANDATIONS PORTANT SUR LES MOYENS ET L’ORGANISATION 33
1) Enseignement : un « retour sur investissement » garanti en termes d’influence 33
2) Culture : un rayonnement qui ne doit pas s’étioler pour répondre à une forte « demande de France » de par le monde 34
CONCLUSION 35
EXAMEN EN COMMISSION 37
ANNEXE 1 : Liste des auditions de la mission 45
ANNEXE 2 : Comptes rendus des auditions de la mission à Paris 49
ANNEXE 3 : Programmes des déplacements de la mission 207
Mesdames, Messieurs,
Une année après les avoir entamés, la mission d’information sur le rayonnement de la France par l’enseignement et la culture a achevé ses travaux. Une année au cours de laquelle ses sujets d’étude auront connu bien des effets d’annonce et quelques interrogations quasi existentielles.
Entre-temps, le 12 janvier dernier, la mission a présenté un rapport d’étape (1) dont les échos reçus au cours de la suite de ses travaux ont permis d’aboutir au présent document.
Rappelons-nous : il y a un peu plus d’un an, le ministre des Affaires étrangères et européennes présentait un nouvel élan pour l’action culturelle extérieure, en même temps que la réforme de l’administration centrale de son ministère avec, notamment, la création d’une direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats. Il annonçait notamment dans ce cadre :
– une mission de préfiguration d’une nouvelle agence culturelle devant conclure ses travaux pour juillet 2009 ;
– la rénovation du réseau culturel, structuré autour du regroupement des services de coopération et d’action culturelle des ambassades d’une part, et des divers centres et instituts culturels d’autre part, pour former dans chaque pays un unique établissement à autonomie financière dénommé « Institut français » ;
– le lancement d’une « plate-forme numérique » appelée « LatitudeFrance.org », destinée à servir de vitrine à l’ensemble du réseau culturel français à l’étranger ;
– un « plan de développement pour les lycées français à l’étranger », l’expression étant d’ailleurs littéralement reprise de la lettre de mission adressée au ministre en juillet 2007 par le Président de la République et le Premier ministre ;
– enfin, des crédits supplémentaires pour cette politique de rayonnement et d’influence.
Il faut se réjouir de la décision prise par le président et le bureau de la commission des affaires étrangères de maintenir cette mission d’information au printemps dernier, alors que tout semblait déjà décidé, calé, acté. Car en vérité, comme la mission s’en est rendue compte au fil de ses auditions et de ses déplacements à l’étranger, beaucoup reste à faire.
En effet, en reprenant point par point :
– l’agence culturelle n’a été mise en place et ses contours n’ont été déterminés ni avant l’été dernier, ni à l’occasion du débat budgétaire, ni au 1er janvier 2010. Elle fait encore l’objet de débats dans le cadre du projet de loi relatif à l’action extérieure de l’État, déposé le 22 juillet 2009 au Sénat et adopté par celui-ci en première lecture le 22 février dernier. La mission veut aider le Gouvernement à adopter une démarche autrement plus ambitieuse sur ce sujet ;
– la restructuration du réseau culturel, indépendamment de ses liens avec l’agence, est entravée par un désaccord interministériel sur l’existence même des établissements à autonomie financière ;
– la plate-forme numérique « LatitudeFrance » n’a pas semblé aux yeux de la mission avoir, à ce stade, acquis une grande visibilité ;
– le plan de développement du réseau des lycées français ? Nous l’attendons toujours et il est en effet très nécessaire, surtout dans le contexte de la mesure de gratuité de la scolarité pour les enfants de nos compatriotes expatriés ;
– enfin, s’agissant des moyens d’intervention du réseau culturel, les crédits supplémentaires ont en effet été obtenus, à hauteur de 20 millions d’euros en 2009 et de 20 millions d’euros en 2010, mais ce faisant la réduction drastique de ces moyens d’intervention a été seulement enrayée, comme les développements qui suivent le rappelleront une fois encore. Du reste, c’est uniquement à l’occasion du débat budgétaire de cet automne que l’on pourra « solder les comptes » et constater si, oui ou non, la régulation budgétaire étant passée par là, le ministère a bien obtenu 40 millions d’euros supplémentaires pour l’action culturelle. Il faudra voir également si cette « rallonge » perdurera l’an prochain.
Par conséquent, redisons-le, cette mission d’information tombait à point nommé pour éclairer la commission des affaires étrangères et l’Assemblée sur la réalité des choses et pour tracer des perspectives à moyen terme, en dessinant le souhaitable, là où le Gouvernement doit se contenter du possible compte tenu des contingences budgétaires et administratives. C’est en cela qu’elle entend faire œuvre utile, sans lamentations ni incantations.
Partout où la mission s’est rendue – dans les lycées français, dans les centres et instituts culturels, dans les alliances françaises, dans les ambassades –, elle a rencontré des personnels dévoués, parfois même passionnés ; dans presque tous ses déplacements, elle a constaté une réelle « demande de France », qui ne rencontre pas toujours l’offre adéquate.
C’est donc aussi pour ces militants de la France, de son enseignement et de sa culture, auxquels la mission veut exprimer sa gratitude pour le temps qu’ils lui ont consacré, que ce rapport existe. C’est aussi pour eux que sont formulées, dans les pages qui suivent, des recommandations que la mission n’a pas voulues pléthoriques, mais ciblées et opérationnelles. C’est aussi pour eux que la mission doit dire si la France a les moyens de ses ambitions en matière d’influence dans la mondialisation actuelle, et si elle parvient à mettre sa diplomatie au service de sa culture ou sa culture au service de sa diplomatie.
Pour se forger son opinion, la mission a veillé à garder sur son double objet d’étude un regard pluraliste. C’est ainsi que les treize membres de la mission représentaient un large éventail de sensibilités politiques et que les déplacements organisés ont associé l’opposition et la majorité. Une quarantaine d’auditions se sont tenues à l’Assemblée, et ses déplacements dans deux pays d’Europe (Allemagne et Grande-Bretagne), ainsi qu’en Amérique du Sud (Chili et Argentine) ont été complétés, depuis le rapport d’étape de janvier dernier, lorsque des membres de la mission se sont rendus aux Émirats arabes unis, en Inde et enfin au Liban.
D’aucuns s’étonneront que la mission ne soit pas allée en Afrique. D’autres regretteront que tel centre culturel en Indonésie ou tel lycée aux États-Unis n’aient pu être visités… Mais dans le cadre des moyens qui lui étaient alloués, la mission a privilégié, dans l’organisation de ses déplacements, ceux qui lui permettaient tout à la fois :
– de mener des comparaisons avec des pays aussi divers que possible (des voisins européens, deux visages d’un même continent éloigné – l’Amérique du sud –, un « marché de niche » comme le Golfe, un grand émergent, une terre de présence historique) ;
– de « sortir des sentiers battus » en écartant des destinations plus « classiques », ces dernières pouvant néanmoins être évoquées grâce aux témoignages reçus par les membres de la mission ou grâce à leurs propres déplacements dans d’autres cadres – comme l’a fait la Rapporteure au Canada.
*
Les quelque quarante auditions conduites par la mission n’ont pas toujours réuni, tant s’en faut, la totalité de ses membres, ce que le président regrette et voulait signaler noir sur blanc dans le présent rapport, dans le compte rendu de chaque audition. Loin d’être une opération de stigmatisation de tel ou tel, il s’agit surtout de donner aux travaux de la mission la crédibilité qu’ils méritent et de lancer une forme de « signal pédagogique ».
Ce gage de sérieux et de responsabilité rejaillira aussi, espérons-le, sur le contenu des préconisations du présent rapport, dont la mission n’a pas voulu faire un catalogue mais les présenter au contraire en nombre limité, et aussi opérationnelles que possible.
I – LES SUITES DU RAPPORT D’ÉTAPE : POUR CHACUN DES DEUX RÉSEAUX, DES CONSTATS CONFIRMÉS, UNE TYPOLOGIE AFFINÉE
A – Une confirmation des premiers constats et des premières préconisations de la mission
1) Faire fructifier le trésor qu’est le réseau d’enseignement
Le rapport d’étape avait déjà été l’occasion de souligner l’excellence du réseau d’enseignement français à l’étranger et d’en décrire l’architecture, reprise dans l’encadré ci-dessous. C’est avec justesse que certains des interlocuteurs les plus qualifiés de la mission ont pu qualifier de « trésor » cet outil exceptionnel de rayonnement de la France sur tous les continents.
LE RÉSEAU D’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L’ÉTRANGER
Le réseau d’enseignement français à l’étranger compte 461 établissements scolaires répartis dans plus de 130 pays et appartenant à trois catégories distinctes (homologués, conventionnés et en gestion directe). L’an dernier, le réseau comptait 452 établissements.
Les 77 établissements en gestion directe sont des services déconcentrés de l’AEFE. Les 166 établissements conventionnés sont des établissements gérés par des associations de droit privé français ou étranger qui ont passé avec l’AEFE un accord portant notamment sur les conditions d’affectation et de rémunération des agents titulaires, sur l’attribution de subventions et sur les relations avec l’agence. Ces deux catégories d’établissements perçoivent des subventions versées par l’agence qui assure également la rémunération des personnels titulaires grâce, d’une part, à la subvention qui lui est allouée par l’État français, et d’autre part aux remontées que les établissements effectuent d’une partie des droits de scolarité acquittés par les familles.
Les 212 établissements simplement homologués n’ayant pas passé de convention avec l’agence ne bénéficient pas d’aide directe. Ils sont néanmoins, lorsqu’ils le souhaitent, associés aux actions de formation continue organisées par l’agence et bénéficient du conseil pédagogique des inspecteurs de l’Éducation nationale détachés à l’étranger.
L’Agence accompagne également le développement du réseau en signant des accords de partenariat qui permettent un pilotage souple, diversifié et au plus proche de la situation particulière des établissements. Ce statut intermédiaire entre l’homologation et le conventionnement concerne 6 établissements : le lycée franco-israélien de Tel-Aviv, le lycée Théodore Monod d’Abou Dabi, la section française de l’école européenne de Taipei, l’école internationale française de Bali, l’école française de Tachkent et l’Interkulturelle Schule de Brême.
La tutelle qu’exercent les ambassades est elle aussi fonction de la nature de l’établissement. Les postes sont étroitement associés par l’agence aux décisions concernant les établissements en gestion directe. S’agissant des établissements conventionnés, l’ambassadeur ou son conseiller de coopération et d’action culturelle sont souvent membres de droit des conseils de gestion.
Le nombre total d’enfants français dans le réseau des établissements en gestion directe ou conventionnés évolue comme suit : 78 640 élèves en 2007-2008 et 82 221 élèves en 2008-2009. Quant au nombre d’élèves étrangers, il était de 89 332 en 2007-2008 et de 91 371 en 2008-2009. Le réseau continue donc à s’étendre, en nombre d’établissements comme de par le nombre d’élèves accueillis.
Le réseau « respire » également, puisque chaque année interviennent des ouvertures, des fermetures et des changements de statut. Au titre des entrées récentes dans le réseau, citons notamment le Centre d’appui à la réouverture des établissements d’enseignement français en Côte d’Ivoire, mis en place le 1er septembre 2008 afin d’accompagner notamment la réouverture du lycée français Blaise Pascal d’Abidjan à la rentrée 2008, avec un statut d’établissement homologué. Ce dernier a accueilli 950 élèves à la rentrée 2008 et 1 200 élèves à la rentrée 2009.
Les déplacements supplémentaires de la mission – au lycée Louis Massignon d’Abou Dhabi, à l’École Théodore Monod d’Abou Dhabi, au lycée Georges Pompidou de Dubaï, au lycée français international de Dubaï, en Inde au lycée de Delhi et à travers une rencontre avec les chefs d’établissements de Pondichéry et Bombay, enfin au Liban avec les visites du Grand Lycée et du Lycée Verdun, une réunion avec les représentants des établissements homologués puis une rencontre avec les six proviseurs des établissements conventionnés – ont confirmé à la fois l’excellence du réseau et les tensions auxquelles il est soumis, qui compromettent son développement et nuisent par là même au rayonnement de la France.
À la lumière de ces enseignements nouveaux, la mission a pu réexaminer, en les confirmant, les préconisations qu’elle avait formulées dans son rapport d’étape.
– Plafonner la prise en charge des écolages des élèves français inscrits dans le réseau d’enseignement français à l’étranger, en fonction du revenu des familles, de façon différenciée selon un barème établi par pays de résidence : telle était la préconisation la plus urgente.
Elle avait déjà fait l’objet, en dernier lieu à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2010, d’un amendement déposé par le président de la mission en sa qualité de Rapporteur pour avis des crédits du programme budgétaire 185 Rayonnement culturel et scientifique de la mission Action extérieure de l’État.
Cet amendement, reproduit page suivante, avait été adopté à l’unanimité en commission des affaires étrangères, avant d’être adopté à l’unanimité moins une voix en séance publique par l’Assemblée nationale, contre l’avis du Gouvernement.
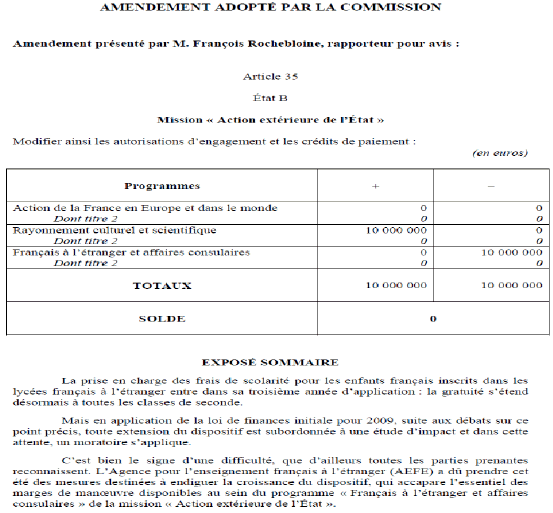
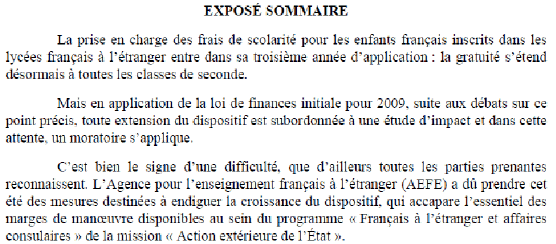
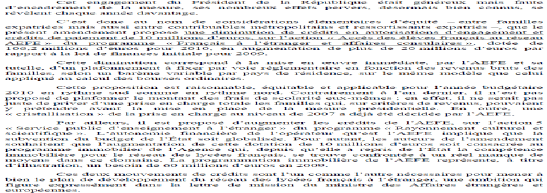
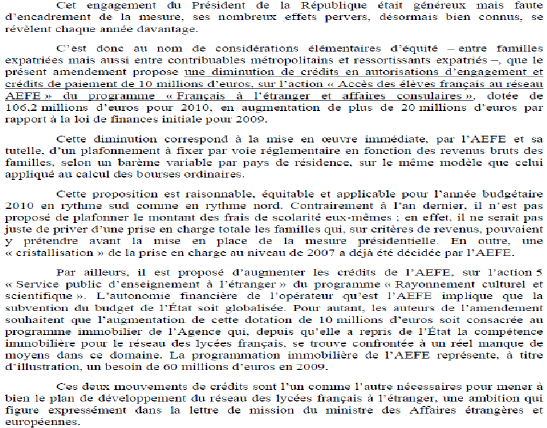
*
Partout où elle s’est rendue, la mission a été confortée dans sa conviction de la nécessité d’encadrer la mesure de prise en charge. Toutes les auditions qu’elle a menées à Paris sont allées dans le même sens, à l’exclusion notable de certaines prises de position parmi les membres de l’Assemblée des Français de l’étranger élus des circonscriptions d’Amérique du Nord (États-Unis et Canada).
Dès lors, la mission n’a pas de raison de modifier sa position de principe. Elle le dira dans ses conclusions finales.
Toutefois, l’unanimité n’étant pas totale au sein de l’exécutif sur cette question qui soulève des questions d’équité et des questions techniques tout à la fois, la mission prend acte de la décision de la Présidence de la République de confier à un membre de l’Assemblée nationale – Mme Geneviève Colot, Rapporteur de la mission – et à une sénatrice, Mme Sophie Joissains, une étude sur les suites qu’il convient de donner à cette mesure de gratuité, aujourd’hui en application pour les classes de lycée mais dont l’extension au collège fait l’objet d’un moratoire depuis la rentrée de septembre 2009.
La mission reviendra sur ce point dans ses conclusions.
– Conforter le réseau « historique » des lycées français à l’étranger par la mise à niveau de leurs moyens, notamment immobiliers, mais également en personnel, afin de conserver à ce réseau son unité pédagogique et son lien étroit avec l’Éducation nationale, tout en préservant son attractivité à l’égard des élèves français et étrangers. Telle était la deuxième préconisation du rapport d’étape.
Confirmée également, cette orientation semble toujours à la mission devoir être mise en œuvre via une augmentation de la subvention à l’AEFE, mais à une quadruple fin (elle était triple dans le rapport d’étape) :
o financer les conséquences de la prise en charge des écolages pour nos compatriotes expatriés ;
o mettre aux normes de sécurité et de confort le patrimoine immobilier remis en dotation à l’Agence ;
o conserver un minimum de personnel d’encadrement et d’enseignement expatrié ;
o maintenir le fonds de roulement de l’Agence à 30 jours au moins pour les services centraux.
Sur ce dernier point en effet, il faut rappeler le caractère critique de la situation présente :
DÉCOMPOSITION DU FONDS DE ROULEMENT DE L’AEFE EN 2009 (en millions d’euros) | |||
|
Services centraux |
Établissements |
Total |
Montant du fonds de roulement |
18,99 |
78,85 |
97,84 |
soit, en nombre de jours : |
11 jours |
110 jours |
40 jours |
Source : ministère des Affaires étrangères et européennes. | |||
Sans méconnaître les autres voies de scolarisation possibles ou les autres moyens de rattacher un établissement aux cursus français, la pierre angulaire du réseau doit demeurer cet ensemble historique de lycées dirigés par des proviseurs, principaux et directeurs expatriés, dotés d’un minimum d’enseignants eux-mêmes expatriés, tous garants du lien étroit à conserver entre la communauté scolaire française disséminée de par le monde et l’Éducation nationale.
Or en lui-même, ce réseau réclame des moyens pour son maintien à niveau face à la concurrence d’autres réseaux − anglophones par exemple −, et face aux charges croissantes qui lui incombent. Il réclame aussi des moyens pour son développement, si les conditions locales s’y prêtent et que cette solution est plus efficiente que l’ouverture d’un autre établissement ou le recours à d’autres solutions, intermédiaires.
– Précisément, « Mettre en place la “quatrième catégorie” d’établissements sous forme de sections bilingues dans des établissements existants des pays d’accueil » figurait au nombre des recommandations du rapport d’étape.
La mission a certes entendu quelques critiques contre cette modalité « alternative » de développement du réseau, émanant en particulier de la Fédération des associations de parents d’élèves des établissements de l’enseignement français à l’étranger (FAPEE). Sans faire tout à fait siennes ces critiques, la mission reconnaît qu’il s’agit là d’une solution de « second rang » et que, lorsque cela est possible, l’ouverture – et parfois la construction – d’un établissement est préférable. Mais il est des cas où la demande de scolarisation, existante et avérée, est manifestement insuffisante pour que soit raisonnablement envisagée l’ouverture d’un établissement ; la question financière occupe aussi une place cruciale.
C’est cet ensemble de considérations qui conduit la mission à maintenir inchangée sa préconisation relative aux sections bilingues.
D’autre part, en complément de la préconisation précédente et du renforcement ainsi opéré du « socle » des lycées français, il est nécessaire de développer, pour répondre à une demande croissante, mais aussi inévitablement fluctuante à raison de la démographie ou de la situation politique ou économique de tel ou tel pays dans le monde, des solutions alternatives à la construction neuve de lycées français. Tel était le sens de la recommandation de la mission sur ce point :
– Donner leur chance aux solutions alternatives à la construction ex nihilo d’établissements, par exemple selon la formule d’un trust ou d’une charter school dans les pays anglo-saxons, sous réserve de la compatibilité de tels modèles avec l’homologation de ces établissements par l’AEFE.
Ce type de dispositif étant peu connu en France, la mission a jugé utile d’en donner un exemple d’application : le projet d’« école à charte » franco-américaine de New York (encadré ci-dessous).
Il faudrait toutefois aménager ce modèle afin de le rendre compatible avec l’homologation, en particulier pour rapprocher les cursus du système français en préparant les élèves au baccalauréat – et non au « baccalauréat international ».
L’ÉCOLE À CHARTE FRANCO-AMÉRICAINE :
NEW YORK FRENCH-AMERICAN CHARTER SCHOOL “NYFACS”
I – Qu’est-ce qu’une « école à charte » ?
Une école à charte est une école publique gérée de manière privée par un conseil d’administration (Board of Trustees). Cette indépendance permet une flexibilité du curriculum (i.e. de la pédagogie) et une gestion financière autonome.
L’État alloue une enveloppe budgétaire en fonction du nombre d’élèves : 12 443 dollars par enfant. Des sommes supplémentaires sont octroyées en fonction du nombre d’élèves dits « désavantagés » ou d’enfants nécessitant des soins particuliers que l’école accueille. La contrepartie de cette autonomie financière est une obligation de résultats : les écoles à charte sont tenues d’obtenir des résultats académiques supérieurs aux écoles publiques classiques.
A. Le système des écoles publiques à New York
À New York, il existe deux types d’écoles publiques : l’école de quartier (traditional public school) et l’école à charte. Les fonds du gouvernement ne sont pas suffisants pour faire fonctionner une école avec tous les programmes. Toutes les écoles publiques ont recours à des financements extérieurs pour faire fonctionner l’école de manière normale ou offrir des programmes supplémentaires.
Les écoles à charte reçoivent moins de financement que les écoles publiques classiques (aucune subvention pour le bâtiment, par exemple). Elles ont donc recours à des financements extérieurs : fondations, philanthropes, institutionnels et particuliers.
B. La réforme de l’éducation aux États-Unis
Les écoles à charte bénéficient d’un mouvement de réforme de l’éducation aux États-Unis visant à améliorer le système public d’enseignement dans le primaire et le secondaire. Le président Obama est très en faveur de ces écoles à charte, écoles « pilotes », qui fonctionnement mieux, et il en a augmenté le niveau d’aide fédérale afin de pouvoir en développer de nouvelles.
II – L’école à charte franco-américaine de New York
A. La mission
La mission de l’école à charte Franco-américaine bilingue est de former des « citoyens du monde » ayant une maturité qui leur permette d’accéder à des fonctions de leadership dans une société multiculturelle. En préparant les étudiants au baccalauréat international et au Regents High School Diploma, l’école allie une forme de rigueur propre au système éducatif français, à l’approche américaine qui prône l’individualité et l’esprit critique. Il s’agit de permettre aux élèves d’être d’excellents candidats à l’entrée dans des universités de langues anglaise et française à travers le monde.
[Toutefois, l’inclusion complète dans le système d’enseignement français à l’étranger supposerait la préparation du baccalauréat français, ou d’un double diplôme ad hoc à concevoir ; car en l’état actuel, le « baccalauréat international » n’est pas reconnu en équivalence du baccalauréat français.]
B. L’historique
Ce projet est né d’une série de tables rondes organisées autour du thème : « Quelle école publique bilingue idéale faut-il à la ville de New York ? ». C’est à l’été 2008 que ce projet d’école a pris corps. Depuis, un important travail a été accompli par des bénévoles de tous horizons : éducateurs, financiers, juristes, experts en communication, leaders communautaires et de nombreux parents. Ce travail a été récompensé lorsque, le 15 septembre 2009, l’approbation des autorités (le Board of Regents) pour ouvrir en septembre 2010 a été donnée.
C. La concrétisation
La subvention allouée par la ville (cf. supra) couvre 70 à 80 % du budget de fonctionnement. Le reste devra être obtenu par le recrutement d’élèves en nombre suffisant, et le paramètre des locaux d’implantation – prêtés ou loués – est évidemment essentiel dans le budget. En amont déjà, des frais importants sont engagés dès avant la mise en place effective de l’école : frais juridiques et comptables liés à la constitution de l’entité de l’école à charte, financement de consultants (pour trouver un bâtiment, pour les demandes de subventions auprès du gouvernement et des fondations, pour la levée de fonds et les stratégies de communication), frais de communication, matériel scolaire et meubles pour les classes, recrutement et formation d’enseignants.
Plus de 500 familles ont signé les lettres de pétition. Ont également été reçues plus de trente lettres de soutien d’organismes institutionnels, académiques, communautaires et du secteur privé.
Tout en les étoffant, les nouveaux déplacements et les auditions supplémentaires de la mission ont confirmé les constats initiaux dressés dans le rapport d’étape en faveur du développement du réseau d’enseignement français à l’étranger, par la levée des contraintes qui le menacent de saturation.
S’agissant du réseau culturel, c’est également dans une large mesure la continuité qui prévaut entre le rapport de janvier et le présent travail de synthèse finale.
2) Retisser la toile du réseau culturel
La mission l’a dit et elle le répétera : c’est d’abord et avant tout une stratégie d’ensemble, une vision, qui manque aujourd’hui à l’action culturelle extérieure. Pourtant, dans son rapport d’étape elle avait mentionné un préalable nettement plus technique :
– lever sans délai les obstacles juridiques à la généralisation du modèle de l’unique établissement à autonomie financière par pays, destiné à regrouper en une seule structure l’ensemble des centres et instituts culturels qui y sont installés.
En effet, les décisions du Conseil de modernisation des politiques publiques (CMPP) d’avril puis de juin 2008 avaient conduit à la généralisation du modèle de l’établissement à autonomie financière, issu d’un décret de 1976 (2), pour rationaliser l’ensemble du réseau culturel de la France à l’étranger.
Ces structures originales sont tout à fait adaptées au fonctionnement de petites entités administratives disséminées dans l’ensemble des pays du monde et encaissant les recettes issues de leurs prestations pour financer leur propre fonctionnement. Ce modèle, unique en son genre dans le paysage administratif français, fonctionnait à la satisfaction générale, non pas de façon cachée mais à bas bruit, jusqu’à ce que le CMPP lui donne une grande publicité en voulant élargir son succès.
Le ministère des finances a alors découvert un motif d’illégalité du décret de 1976, lié aux amples modifications du fonctionnement juridique et comptable engendrées par la mise en place de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Alors que la décision du CMPP était déjà en voie de généralisation, comme la mission a pu s’en rendre compte à Berlin et comme les réponses aux questionnaires budgétaires du président et de la rapporteure de la mission l’indiquaient, cette rationalisation administrative bienvenue a été stoppée net, le temps de trouver le moyen juridique de consolider le régime des EAF qui demeure, de l’avis général, un modèle efficace, et à promouvoir.
POSSIBILITÉS D’ACTION D’UN ÉTABLISSEMENT à AUTONOMIE FINANCIÈRE
1°) Ce que peut faire un EAF (régi par le décret de 1976)
● Percevoir des recettes (notamment tout type de subvention accordée par les autorités locales ou des organismes privés).
● Avoir un fonds de réserves propres (principe de l’autonomie) qui le dispense de renvoyer les fonds libres à Paris en fin d’exercice.
● Placer les recettes locales (recettes de cours de langue par exemple) avec l’autorisation du Trésorier et après avis de la mission économique.
● Contracter en « leasing » sur des biens immobiliers.
● Entretenir les immeubles sur ses propres fonds, à condition de respecter les règles contractuelles.
● S’il est établissement pluridisciplinaire, recevoir tous les crédits de la direction générale de la mondialisation « audio », « linguistique », « coopération scientifique », etc.
● Devenir le prestataire de l’ambassade pour mener des opérations.
● Recruter avec l’accord du Département.
● N’être pas redevable de la TVA pour ses propres prestations de services (cours de langue), n’étant pas considéré en droit local comme un établissement commercial. La mission des EAF précisée par instruction comptable est la « diffusion de la culture française », et la « vente des cours de français », qui, pour l’instant, n’est pas assimilée par les autorités locales (allemandes en l’espèce) à une activité commerciale.
2°) Ce que ne peut pas faire un EAF
● Se dispenser de l’autorisation du Département, tutelle des EAF, pour recruter ou licencier et pour ouvrir des crédits.
● Faire des dons.
● Verser des subventions à partir de l’EAF (convention de partenariat à établir retraçant les obligations des uns et des autres).
● Ester en justice (l’EAF n’a pas la personnalité morale) : il le fait au nom du ministère des Affaires étrangères dont il engage ainsi la responsabilité.
● Gérer le personnel expatrié du réseau culturel (au sens des nominations et du suivi des carrières) ; c’est le SCAC qui en a la charge (pouvoir régalien).
● Devenir propriétaire ni percevoir de recettes pour la location de surfaces immobilières appartenant au domaine de l’État.
● En l’état de la pratique, délivrer un certificat libératoire au titre du mécénat (point à clarifier dans le cadre de l’expérimentation). Pour l’instant, lorsqu’un partenaire local (allemand en l’espèce) fait un don, l’EAF ne peut délivrer de certificat libératoire exigé par les autorités fiscales allemandes et doit recourir à un organisme tiers (exemple : fondation existant à l’appui d’un institut) ou s’adresser à l’administration centrale.
● S’exempter du paiement de la TVA à ses fournisseurs, l’EAF n’étant pas assimilé par les autorités allemandes à un service de l’ambassade bénéficiant des privilèges fiscaux réservés aux diplomates.
Source : d’après une note de l’ambassade de France en Allemagne.
Aux yeux de la mission, il est urgent de lever l’hypothèque juridique qui pèse aujourd’hui sur les EAF. D’aucuns pourraient même voir un « mal français » dans cette propension à remettre en cause, pour le principe, voire « pour la beauté des procédures », un mode de gestion qui a fait la preuve de son efficacité. Où est passé l’esprit de la LOLF si l’on peut ainsi aller à contre-courant, non seulement de la modernisation de l’État insufflée par cette loi organique, mais encore de décisions prises au plus haut sommet de l’État par le Conseil de modernisation des politiques publiques ?
À la différence de travaux prospectifs, il s’agissait bien de « décisions » de mise en œuvre de la RGPP, prises qui plus est au plus haut sommet de l’État, par le secrétaire général de la Présidence de la République et le directeur du cabinet du Premier ministre, en accord avec le ministre responsable. Il va sans dire que l’application effective de ces décisions du CMPP devait faire l’objet d’un suivi attentif.
La mission avait aussi, comme d’autres rapports parlementaires avaient eu l’occasion de le souligner avec bon sens, déploré l’absence de stratégie clairement définie pour orienter l’action du réseau culturel :
– De façon préalable à toute réforme supplémentaire, définir une stratégie pour l’action culturelle précisant à la fois les buts à atteindre, les moyens humains et matériels pour le faire et les responsabilités de chacun dans le pilotage et la mise en œuvre.
Ce sera, espérons-le, le rôle que jouera le conseil d’orientation stratégique de la future agence culturelle une fois votée la loi relative à l’action extérieure de l’État. Mais c’est par la volonté du Parlement que cette mention particulière a été inscrite dans le projet de loi ; il faudra donc veiller à ce que la définition d’une stratégie ne reste pas un vœu pieux ou un slogan. Le présent rapport y reviendra également.
– Une fois établie la stratégie de l’action culturelle extérieure, engager pour la mettre en œuvre à l’échelon local une fusion des réseaux des centres et instituts culturels (regroupés en un seul EAF) d’une part, et des Alliances françaises d’autre part, sous le label des Alliances. C’était là une proposition-phare de la mission et elle n’est d’ailleurs pas passée inaperçue dans le réseau, ni parmi les syndicats du MAEE.
Depuis la publication du rapport d’étape, la mission a également noté que le ministre des Affaires étrangères et le président de la Fondation Alliance française n’avaient jamais plaidé aussi ostensiblement pour un rapprochement entre les deux réseaux. La mission ne voit pas ici le solde de tout compte, mais bien plutôt un encouragement à aller plus loin. C’est pourquoi il importe de préciser les choses afin que cette proposition ne soit pas mal comprise.
Il ne s’agit pas de licencier du personnel et de rechercher d’abord et avant tout des économies budgétaires. Il ne s’agit pas de supprimer tout un réseau pour le faire absorber « en bloc » par un autre.
Il s’agit de reconnaître la valeur inestimable des Alliances françaises, de leur marque et de leur modèle de fonctionnement associatif local, en partenariat étroit avec les pouvoirs publics français. Il s’agit de chercher à généraliser, partout où cela est pertinent, la constitution d’un relais d’influence de la France, de sa langue et de sa culture, qui fonctionnerait sous la marque inégalable d’« Alliance française », avec un conseil d’administration présidé par une personnalité locale, et avec l’appui de personnels français, y compris en position de détachement ou de mise à disposition. Cet établissement financièrement autonome donnerait des cours de langue et organiserait des manifestations culturelles tout à la fois.
À vrai dire, si l’on devait fournir un exemple, c’est celui, très brillant, de l’Alliance française de Buenos Aires dont la mission souhaiterait que l’on s’inspirât partout où cela est possible. La suite des travaux de la mission (cf. infra) lui a permis d’affiner encore cette proposition, qui fera également l’objet d’amendements au projet de loi relatif à l’action extérieure de l’État lors de sa discussion en première lecture à l’Assemblée nationale.
– Former les agents du réseau culturel − en formation initiale et en formation continue − en cohérence avec ce qui est attendu d’eux en fonction de la stratégie élaborée en amont. Symétriquement, valoriser les expériences de terrain réussies et encourager la diffusion de bonnes pratiques.
Sur ce point, la mission a conforté sa conviction et noté avec grand intérêt l’accent mis par le ministre lui-même avec beaucoup de force, accompagné d’un déploiement de moyens qu’il faut saluer en espérant qu’ils perdurent.
– Ne pas diminuer les moyens d’intervention du réseau culturel en deçà de l’étiage qu’ils ont atteint en 2009 et les augmenter autant que le permettra la situation du budget de l’État, afin d’accompagner la réforme ; mais avant tout, donner aux gestionnaires un minimum de vision prospective fiable quant aux moyens qui leur seront alloués.
La suite et la fin des travaux de la mission ont corroboré cette analyse, mais elle forme un élément indétectable du reste des propositions : réclamer « des moyens pour des moyens » n’a jamais fait une politique.
B – De nouveaux constats en réponse aux questions laissées en suspens
1) Une typologie révélatrice de la cartographie de l’influence française
La diversité géographique rencontrée et étudiée par la mission au fil de ses auditions et de ses déplacements lui a permis de dresser une intéressante typologie :
– l’Europe, l’étranger tout proche, aurait pu n’être vue que comme une zone à délaisser sur le plan culturel, précisément à cause de sa trop grande proximité, et une zone à densifier en matière scolaire pour faire face à la demande. Cette analyse est juste pour la matière scolaire mais dans le champ culturel, Berlin est un poste pilote de la RGPP qui a su très vite expérimenter le regroupement juridique des SCAC et des centres ou instituts culturels en un seul établissement. Quant à Londres, c’est, entre autres, un laboratoire des partenariats public-privé ;
– l’Amérique latine est bien, comme se plaisent à le dire leurs responsables, le « navire amiral » des alliances françaises. Mais la mission a trouvé aussi, au Chili, des structures fort modestes et aux prises avec un réel manque de moyens. Quant au réseau scolaire, il est, toujours au Chili, très intéressant à étudier en raison de la variété des statuts qui s’y rencontrent. En outre le pôle régional de l’AEFE est là-bas au complet, ce qui faisait partie du champ d’investigation de la mission et qui se retrouve dans les préconisations qui suivent ;
– les Émirats arabes unis sont à maints égards une sorte de « niche », un État où l’autofinancement apparaît garanti presque sans limite. Un endroit du monde où la « marque France » fait recette, à travers des partenariats avec la Sorbonne ou le Louvre. Or la mission a pu réaliser sur place que, s’il n’y a pas un minimum de mise de fonds de la part de la France, son engagement dans le partenariat n’est pas crédible ;
– en Inde, qui est l’exemple de grand pays émergent que la mission avait choisi, elle n’a pas été surprise de constater le très faible poids relatif de la France, de sa langue et de sa culture, ainsi que le petit nombre de ses relais pour la faire vivre. Pourtant, la délégation présente sur place a pris conscience du fait que l’anglais lui-même n’était parlé que par 5 % de la population – ce qui représente tout de même 60 millions de personnes. Et c’est dans cet immense sous-continent, en s’appuyant sur une poignée d’alliances françaises disséminées dans quelques grands centres urbains, que l’ambassade a pu monter le festival « Bonjour India » et susciter son miroir dans notre pays, le festival « Namaste France » ;
– au Liban, la mission a observé, comme elle s’y attendait, la place éminente occupée par l’enseignement francophone, mais elle a bien senti le caractère réversible de cette domination sans partage et la vive compétition qui se déroulait dans le champ de l’enseignement supérieur. À côté des « piliers » que représentent les lycées historiques, c’est aussi dans de petites structures comme l’École supérieure des affaires que se joue la perpétuation de l’influence française ;
− la rapporteure s’est également rendue, en marge des travaux de la mission, au Canada, complément tout à fait intéressant au déjeuner de travail de la mission avec les représentants élus de l’Assemblée des Français de l’étranger pour l’Amérique du Nord. L’encadré suivant rend compte des principaux constats de ce déplacement en lien avec le contenu du présent rapport.
DÉPLACEMENT DE MME GENEVIÈVE COLOT, RAPPORTEUR, AU CANADA
Compte rendu d’entretien avec l’Ambassadeur Delattre et M. Boasson
Quel état des lieux pour la francophonie au Canada ?
Selon M. Delattre, la francophonie progresse au Canada, mais avec deux phénomènes marquants :
− le cœur de la Francophonie (Québec) est en déclin régulier, du fait de la diminution de son poids démographique (aujourd’hui 20 % de la population ; 14 % en 2040) ;
− le français progresse comme seconde langue, soit dans les autres provinces (1 million de personnes dans les autres communautés francophones, dont 600 000 en Ontario), soit dans le cadre du bilinguisme.
► La francophonie repose sur deux piliers très différents : l’un, au Québec, fort mais dont le poids diminue ; l’autre, la francophonie hors Québec, fragile mais qui progresse.
La carte de la francophilie recoupe en partie la carte de la francophonie : il existe un certain ressentiment chez certains Québécois (sentiment d’abandon) ; maintien d’une francophobie minoritaire mais virulente : les belles manifestations francophones françaises entraînent des réactions d’internautes ; et l’on trouve une francophilie importante dans les milieux anglophones.
La France est très présente au canada, peu par l’export (2 %), mais surtout par les investissements, très créateurs d’emplois (80 000), ce qui est vu comme un atout dans cette période de crise.
Quelles sont les motivations qui poussent à choisir l’apprentissage du français ?
Il n’y a pas d’obligation de suivre un cursus incluant le français, mais on constate aujourd’hui une prise de conscience dans les familles canadiennes de la valeur ajoutée que représente la maîtrise du français : c’est particulièrement vrai chez les « new Canadians » immigrés. C’est aussi, de façon plus anecdotique mais cependant importante, un signe / baromètre de la volonté /ambition d’un homme politique.
La maîtrise du français est un élément d’identification / différenciation par rapport aux États-Unis.
Le gouvernement canadien promeut un plan visant à ce que la moitié de la population soit fonctionnellement bilingue d’ici 2013–2014. Cet objectif paraît ambitieux, compte tenu de l’origine des immigrés récents (sous-continent indien, Caraïbes, Extrême-Orient). Les langues chinoises viennent ainsi en troisième position dans la liste des langues parlées.
Il convient de saluer la dynamique canadienne : à l’origine le bilinguisme signifiait simplement que les deux langues devaient pouvoir être utilisées dans les services publics. Par extension, le concept est devenu la possibilité de s’exprimer partout dans sa langue au Canada, même dans la partie anglophone. Rappel : au début du 20e siècle, en Ontario ou au Manitoba, une loi interdisait l’usage du français à l’école.
L’éducation est du ressort des provinces : organisation très éclatée, avec une très grande marge de manœuvre laissée aux niveaux locaux voire infra-locaux (conseils scolaires).
Le réseau scolaire et culturel
Réseau français : coopération et harmonisation mise en œuvre entre les deux réseaux (Québec / hors Québec). Compromis à la fois choisi et nécessaire : si cela n’était pas le cas, la France serait non seulement en porte-à-faux politique mais également moins efficace.
Tous les établissements scolaires français ont vu croître les demandes d’inscription mais le contexte canadien est particulier : il existe une offre (privée et publique) en français. Le réseau français (c’est également le cas des Alliances françaises) opère sur un marché marqué par la concurrence, y compris sur le « cœur de métier » linguistique.
Réseau scolaire :
Québec : Collèges Stanislas et Marie de France à Montréal : 4 000 élèves pour les deux. Hors Québec : Claudel (Ottawa) : 20 % d’élèves français et 80 % de Canadiens / élèves tiers. Conventionné AEFE. Toronto : lycée français (conventionné). 350 élèves. Locaux en location dans une école publique. Toronto French School : quelques classes (section homologuée). Calgary : 350 élèves. Fin d’un projet immobilier (inauguration prévue au printemps). Vancouver : école française internationale (homologuée). Projet en cours de déménagement vers le centre ville (100 élèves). Préconisation : section homologuée au sein d’une école publique canadienne (moins coûteux que l’acquisition d’un bâtiment en propre).
► Pas de problème de financement ni de parc immobilier. Facteur positif : le nombre de Canadiens anglophones francophiles.
Gratuité : une certaine incompréhension de la part des Canadiens et des élèves tiers. 317 prises en charge par l’État en 2009-2010 pour un coût d’1 million d’euros. Montréal est la plus grosse communauté française hors de France avec Londres et Genève. Pas de constat général de désengagement des entreprises pour l’instant.
Réseau culturel : le Canada est en avance sur le concept de la réforme : réseau d’Alliances + services culturels de l’ambassade et des consulats qui travaillent hors les murs et interagissent avec les acteurs canadiens.
Les projets soutenus par les services culturels doivent l’être au moins à hauteur de 10 % du budget du projet (+ conseils, appuis politiques, etc.) : à 1 euro investi par la France correspondent 3 euros apportés par les partenaires. Alliances : 1 euro apporté par la France correspond à 8-9 euros de ressources extérieures (recettes des écoles de langues).
Vrai problème : 20 ETP sur cinq fuseaux horaires. Or ces questions au Canada sont gérées par des professionnels expérimentés. Il faut donc être en mesure de répondre au même niveau, d’où une tension sur les ressources humaines. Pas de difficulté insurmontable pour les ressources budgétaires (cantonnement du budget Canada à un niveau modeste et forte volonté politique de maintenir le lien et la présence).
Attention : spécificité nord américaine qui fait que ce modèle fonctionne : USA : partenariat public–privé ; Canada : partenariat public France–public Canada–privé Canada.
D’autres déplacements auraient probablement permis d’enrichir encore cette typologie ; la mission ne l’en estime pas moins utile à la compréhension de la complexe cartographie de notre diplomatie d’influence. Une diplomatie qui, la mission tient à le souligner, doit énormément − trop, peut-être, car c’est un risque de manque de continuité dans l’action − à l’engagement des personnels en poste dans les services de coopération et d’action culturelle, dans les centres et instituts ou dans les Alliances françaises, sans oublier ceux qui animent le réseau d’enseignement.
2) Pour le réseau d’enseignement : plus de « dialogue social » à propos des lycées, le défi du supérieur à relever
– Le statut différencié des personnels travaillant dans les établissements du réseau d’enseignement français à l’étranger (expatriés, résidents et recrutés locaux) : un besoin de dialogue pour éviter tout malaise généralisé.
La mission l’a ressenti là où elle s’est rendue. Alors qu’au départ elle analysait le problème comme étant de nature plutôt administrative, elle a progressivement pris conscience de son caractère plus profond. Un besoin de dialogue accru s’impose donc, pourquoi pas sous la forme d’un groupe de travail, y compris avec des représentants de l’Éducation nationale, afin d’apporter un remède avant que la situation n’empire.
– Le rôle, le fonctionnement et l’efficacité des pôles régionaux de l’AEFE, y compris dans les relations qu’ils entretiennent avec les ambassades.
La mission préconise la généralisation de véritables antennes régionales au plus près de l’ambassadeur du pays où elles sont implantées. Elle plaide également pour que les instructions de chaque ambassadeur de France soulignent son devoir de veiller à la bonne marche du réseau. L’implication personnelle de l’ambassadeur est un facteur-clef de son fonctionnement harmonieux et de son rayonnement.
– Le recours au « mécénat d’entreprise » ou à d’autres formes de levée de fonds auprès de partenaires privés pour accompagner le développement du réseau des lycées français à l’étranger : le miroir aux alouettes ?
En tout cas, la mission ne peut se permettre de désigner cette source de financement comme fiable, pérenne et suffisante dans le cadre du futur « plan de développement du réseau ».
C’est le cas y compris pour les collectivités territoriales, comme l’ont très bien fait comprendre les auditions complémentaires menées par la mission avec les représentants d’associations de collectivités ou avec le Délégué à l’action extérieure de collectivités territoriales au quai d’Orsay, M. Antoine Joly.
Par conséquent, la mission souhaite que soient encouragés toutes les coopérations existantes et poursuivis ou développés tous les cofinancements mis en place − tel celui qu’illustre l’encadré suivant −, mais elle se veut lucide en excluant de faire de ces financements d’appoint « la » solution au manque de moyens d’intervention du ministère des Affaires étrangères et européennes.
LE DISPOSITIF « QUAI D’ORSAY / ENTREPRISES »
Le dispositif « Quai d’Orsay / Entreprises » a été mis en place en 2006 par le ministère des Affaires étrangères et européennes. Il concourt au développement de l’attractivité de la France sur le plan international, en portant quatre objectifs principaux :
− accompagner l’action des entreprises françaises en direction des jeunes élites étrangères ;
− soutenir l’ambition internationale des établissements d’enseignement supérieur français ;
− encourager les meilleurs étudiants étrangers dans leur volonté de partage de savoirs et de compétences au meilleur niveau ;
− accroître les moyens d’action de la France dans le cadre de la mondialisation.
Grâce au dispositif « Quai d’Orsay / Entreprises », le ministère des Affaires étrangères et européennes co-finance des bourses avec des entreprises françaises auxquels leurs succès industriels et économiques, notamment dans les technologies de pointe, assurent une présence reconnue sur la scène internationale, comme avec d’autres, dont le développement au-delà de nos frontières est plus récent : partenaires pour l’excellence, ils favorisent et développent ensemble l’accueil en France d’étudiant(e)s étrangers issus des meilleurs établissements d’études de leur pays d’origine.
Pour ouvrir à ces étudiant(e)s l’accès, dans les meilleures conditions possibles, à un cursus d’études supérieures dans un établissement d’enseignement supérieur français de renom, en lien direct avec le monde professionnel, le dispositif « Quai d’Orsay / Entreprises » propose aux entreprises des conventions de partenariat permettant d’associer les moyens du ministère des Affaires étrangères et européennes à ceux du secteur privé, de grandes écoles et universités françaises renommées.
Cinq entreprises ont déjà rejoint ce dispositif : Thalès, en 2006, puis Orange, DCNS et Alten en 2008, et enfin le Crédit Agricole S.A. en 2009, répondant à cet esprit de collaboration et de partage de compétences de haut niveau.
Depuis 2006, 99 étudiants ont été accueillis en France, dont 51 pour l’année 2008/2009, d’abord originaires de l’Inde, mais également de Chine et de Russie dès 2007/2008, puis du Brésil en 2008/2009.
Le ministère des Affaires étrangères et européennes assure la coordination de ces partenariats, s’engage à l’étranger dans l’information en direction des meilleurs étudiants des établissements locaux sur chacun des programmes de bourses, apporte l’expertise de son réseau de coopération culturelle et scientifique, et attribue aux lauréat(e)s le statut de boursier du Gouvernement français à travers la couverture sociale et les avantages qui s’y attachent. Il propose également aux boursiers des cours de français intensifs avant leur départ, dispensés dans leur pays d’origine au sein des Alliances françaises.
Les entreprises allouent à chaque étudiant(e) une bourse de vie, un tutorat au sein de l’entreprise et un accompagnement en fin de cursus pour l’orientation de sa carrière, pouvant aller jusqu’au recrutement.
Le programme « Quai d’Orsay / Entreprises » est amené à se développer. Pour l’année 2009/2010, il est prévu de doubler le nombre total de bénéficiaires de ces programmes de bourses cofinancées, et d’étendre ces partenariats à de nouveaux pays.
L’accueil au sein de nos meilleurs établissements d’enseignement supérieur d’étudiants étrangers qui formeront demain les élites de leurs pays est un atout majeur, que le ministère entend garantir et amplifier : il renforce l’attractivité de la France et la qualité des échanges internationaux avec le concours actif d’entreprises françaises pleinement engagées dans cette dynamique.
Source : ministère des Affaires étrangères et européennes.
Un autre aspect de la poursuite des travaux de la mission, laissé en suspens à l’issue du rapport d’étape, a concerné l’articulation entre l’enseignement secondaire français et l’enseignement supérieur français ou francophone :
– Les débouchés de l’enseignement secondaire français à l’étranger après le baccalauréat, leurs déterminants et l’impact de cette situation sur le rayonnement de l’enseignement secondaire et supérieur français : un enjeu crucial qui doit être mieux pris en compte.
Les derniers déplacements et auditions de la mission, tout particulièrement au Liban, ont été l’occasion d’analyser cette question sous des angles complémentaires, convergents… et assez sombres en réalité.
Les débats sur le projet de loi relatif à l’action extérieure de l’État seront l’occasion de remettre ce sujet sur la table. On peut au moins saluer le fait que la prise de conscience d’une réelle faiblesse française dans ce domaine ait gagné du terrain.
3) Pour le réseau culturel : mieux mettre en relation les différents intervenants et réfléchir aux contenus
– Le devenir de l’agence culturelle dont la création est contenue dans le projet de loi relatif à l’action extérieure de l’État : la mission a ressenti à cet égard une certaine perplexité parmi les agents du réseau.
Sans grande surprise à vrai dire, la mission a recueilli un certain nombre de critiques à propos de la conduite de cette réforme certes délicate et de grande ampleur. Or on voit mal comment elle pourrait être menée sans l’adhésion et un minimum d’implication des personnels censés la mettre en œuvre.
Sur ce point, c’est sans doute, par souci de compromis autant que d’efficacité, le principe de l’expérimentation qu’il convient de retenir afin de fixer un cap et de progresser sur le chemin du rattachement à l’agence culturelle de l’ensemble du réseau culturel français à l’étranger, tout en préservant les occasions de dialogue dans la résolution des difficultés qui seront rencontrées.
– L’éventuelle recomposition des tutelles ministérielles dans le champ de l’action culturelle extérieure : une polémique très française… et inutile.
Ce point qui avait fait l’objet de fermes prises de position au Sénat n’a pas paru à la mission d’une importance telle qu’il doive figurer au nombre de ses préconisations. Tout au plus a-t-il été jugé opportun de mentionner le besoin d’une coopération étroite entre les deux ministères, dans le domaine des contenus comme dans celui de la formation. C’est bien sûr dans la pratique que se règlent ce type de questions ; si l’existence d’une tutelle administrative n’est pas anodine, la mission estime que c’est à tort que l’on se livre à des excès de juridisme en cette matière.
– Le rôle des collectivités territoriales dans le rayonnement de la France à l’étranger par sa culture : de multiples initiatives à connaître et à faire connaître.
En dépit de l’existence, précitée, d’une Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales au ministère des Affaires étrangères et européennes, jouant un rôle de « tour de contrôle », ses moyens demeurent limités. Il conviendrait de la transformer en véritable centre de ressources capable de faire de ce type d’action extérieure, tout en respectant l’autonomie de ces collectivités, un véritable relais d’influence de la France.
– L’inclusion dans la réflexion de l’outil audiovisuel : un sujet majeur dans le monde d’aujourd’hui, qui nécessiterait des travaux distincts.
Ces travaux pourraient, par exemple, prendre la forme d’un suivi de la mission d’information de la commission des affaires étrangères menée à la fin de la précédente législature. Même si elle a abordé ce sujet dans tous ses déplacements, la présente mission ne l’a fait en réalité qu’à la marge de ses entretiens, ce qui ne permet pas de formuler une analyse suffisamment étayée.
*
Entre constats réitérés et nouvelles analyses corroborant les premières réflexions de la mission, l’heure est venue de conclure : c’est bien une transition douloureuse qui est à l’œuvre, car elle suppose, dans une certaine mesure, une forme de remise en question ; mais cette transition est aussi un défi et une chance à relever pour l’ensemble de notre diplomatie. À condition de se fixer une stratégie et d’adopter une méthode appropriée… sans oublier la mobilisation de moyens suffisants.
II – LE TERME D’UN AN DE TRAVAUX : DU RAYONNEMENT À L’INFLUENCE, COMMENT RÉUSSIR UNE TRANSITION DOULOUREUSE
A – Questions de méthode : recommandations stratégiques
1) Une stratégie avant toute chose
a) C’est aisé pour le réseau d’enseignement…
Le « cœur de métier » des lycées français à l’étranger est clairement identifié et nul n’est besoin de formuler de nouvelles orientations stratégiques du réseau pour les bouleverser. Les préconisations mentionnées dans la première partie du présent rapport sont pour l’essentiel des ajustements, des perfectionnements, des adaptations locales à un modèle qui fonctionne bien.
Le vrai défi est plutôt à rechercher dans l’après-lycée, l’enseignement supérieur manquant d’attractivité dans la compétition mondiale actuelle (cf. infra).
b) … mais nettement plus compliqué pour le réseau culturel.
Le principe a été rappelé plus haut, en écho au rapport d’étape : une impression de flottement domine et le besoin de stratégie est urgent. C’est donc aux contenus qu’il s’agit de réfléchir, en répondant aux questions suivantes :
o qu’est-ce que la présence culturelle française dans la mondialisation ? S’agit-il d’abord d’implantations ou de contenus, de messages, d’idées, de valeurs ? Faut-il repérer, attirer, former des individus ? Faut-il préférer toucher les masses ?
o a-t-on tranché le débat sur la définition et le sens de l’action culturelle de la France à l’étranger, que l’on pourrait résumer ainsi de façon un peu caricaturale : s’agit-il de mettre la culture au service de la diplomatie – mais avec quels objectifs ? – ou la diplomatie au service de la culture (via le soutien aux artistes français à l’international) ?
o la langue française est-elle la base de tout ? L’action culturelle en est-elle dissociable et si oui, faut-il néanmoins mener de front les deux missions ?
o à qui revient-il, selon quelles modalités et avec quel degré de permanence, de définir les priorités de notre diplomatie d’influence ? Dans quelle mesure cette notion dépasse-t-elle la « classique » action culturelle ?
o où, dans le monde, s’agit-il de faire porter l’effort en priorité ? L’universalité est-elle une donnée incontournable ? Faut-il privilégier les grands pays émergents au sein desquels la voix de la France porte peu ? Quel traitement réserver aux zones d’influence française historique ?
o quels moyens sont les plus appropriés pour diffuser l’influence française ? Quels personnels, quels relais, quels supports ?
o faut-il plutôt mettre en avant l’avant-garde et la création (mais gare au « parisianisme ») ? ou privilégier les valeurs sûres et la tradition (mais gare aux clichés) ?
L’ampleur de ces questions est redoutable. La mission se veut modeste en la matière mais quelques réponses peuvent être tentées :
– le rayonnement de la France est indissociable de la diffusion de ses valeurs, et de sa langue. L’allusion à la Francophonie est ici évidente. Cela doit faire partie de notre stratégie d’influence, qui est dans la mondialisation le nouveau nom de l’action culturelle extérieure ;
– nous sommes certes à l’ère numérique ; la France ne doit pas pour autant singer les États-Unis. Ils inondent le marché des contenus ; la France ne manque pas de savoir-faire en ce domaine, mais si ses plus grands succès commerciaux sont ceux remportés par des films d’animation comme Arthur et les Minimoys, peut-on considérer qu’il y a là un modèle à dupliquer à l’infini ? Il semble plutôt que la France doive cultiver sa différence… Le réseau des centres et instituts culturels et des alliances françaises en est sans doute l’illustration la plus marquante. Il ne faut pas, bien sûr, renoncer à la bataille des contenus, mais il faut se garder de sacrifier les moyens institutionnels d’intervention au nom de leur prétendue obsolescence. Au contraire, il faut rénover ces réseaux pour les mettre aussi – mais pas exclusivement – au service des industries culturelles françaises et francophones ;
– c’est pour cette raison que le morcellement n’est plus possible, et qu’une agence culturelle sous forme d’EPIC doit devenir la tête de réseau d’entités locales fonctionnant sur le modèle des Alliances françaises et avec leur marque. Ces entités locales seraient des points d’appui aussi bien pour la direction générale de la Mondialisation du Quai d’Orsay que pour le Bureau international de l’édition française, le Bureau export musique, ou Unifrance dans le domaine du cinéma ;
– mais la rationalisation et la fin du morcellement ne sont pas synonymes d’uniformisation. S’agissant des structures, de petites alliances françaises implantées loin des métropoles culturelles et essentiellement tournées vers la préparation aux diplômes de français langue étrangère, autofinancées en quasi-totalité, pourront fort bien demeurer en place, tant que durera leur « labellisation » par la Fondation Alliance française. Sur le plan des contenus, c’est là aussi un compromis original qu’il faut trouver, selon un schéma simple que rend bien l’image du menu et de la carte : un menu pensé et composé par la tête de réseau, comme l’illustration de priorités stratégiques de notre diplomatie d’influence périodiquement évaluées et révisées (à la manière du British Council, mais avec le rôle de tutelle stratégique de la DGM), et un volant – concrétisé par une enveloppe de moyens – propre à chaque pays, pour la mise en œuvre de priorités locales dont il serait rendu compte périodiquement.
SCHÉMA PROPOSÉ DU RÉSEAU CULTUREL
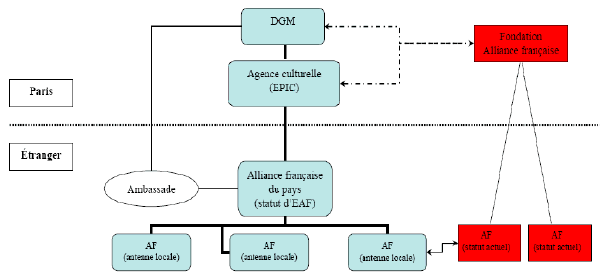
Ce schéma permet de conserver l’universalité de la présence française et l’universalité de ses messages culturels les plus importants, tout en donnant aux acteurs de terrain une marge d’action dont ils ne disposent aujourd’hui qu’en assouplissant plus ou moins légalement des règles trop rigides.
À l’occasion du débat suscité sur cette question par les travaux de la mission, le ministre des Affaires étrangères et européennes, M. Bernard Kouchner, et M. Jean-Pierre de Launoit, président de la Fondation Alliance française, ont signé conjointement une tribune dans le journal La Croix daté du 8 avril 2010, soit deux jours après l’entretien accordé par le ministre aux membres de la mission.
L’idée sous-jacente était, avait-il été indiqué à la mission, d’illustrer un rapprochement qui n’aille pas jusqu’à la fusion des réseaux − présentée comme juridiquement, sinon « politiquement », impossible. Or le propos va manifestement plus loin :
« […] nous avons décidé, ministère et Fondation Alliance française, d’unir nos efforts et de mettre en place une stratégie commune visant un seul et même but : répondre ensemble à la compétition culturelle mondiale en portant la voix, l’attractivité et les valeurs de la France au plus près des peuples.
Plus précisément encore, on peut lire dans cette tribune conjointe :
« Sur la carte du monde, les Instituts français et les Alliances françaises devront constituer un réseau unique. En rapprochant leur label, en multipliant les opérations communes, en renforçant ensemble leur professionnalisation, ils seront mieux armés pour travailler plus efficacement dans le cadre d’une seule et même stratégie. »
Et le ministre, tout comme le Secrétaire général du Quai d’Orsay que la mission a également entendu, d’évoquer des logos communs qui seraient l’illustration la plus marquante du rapprochement opéré.
La mission se plaît à vouloir prendre le ministre des Affaires étrangères et le président de la Fondation alliance française au mot : s’il s’agit bel et bien de « constituer un réseau unique », elle préconise d’adopter, au moins de façon expérimentale, sur trois ans, dans un nombre significatif de « pays à Alliances » − par exemple les Émirats arabes unis, l’Inde, l’Argentine, le Chili et la Russie −, le schéma de fusion des réseaux qu’elle propose (cf. schéma page précédente).
Un tel schéma pourrait être le premier pas vers la constitution, à terme, d’une grande agence de la diplomatie française d’influence, qui constituait d’ailleurs l’un des axes de réflexion de la réforme en cours, l’axe le plus ambitieux, et celui dont les travaux préparatoires de la réforme n’ont cessé de s’éloigner au fur et à mesure de leur avancement.
Sans le citer en modèle mais simplement à titre d’illustration, la mission veut reproduire ici le schéma possible d’une telle organisation. Ce schéma (en anglais) lui a été fourni par la directrice adjointe du British Council de Paris au cours de son audition (3).
Le schéma reproduit page suivante part du principe selon lequel, dans le spectre des relations internationales, les deux extrêmes sont constitués respectivement par l’aide publique au développement lise en œuvre par l’État et par la puissance militaire. Au milieu de ces deux extrêmes se déploient les relations culturelles, qui concernent le développement des connaissances, l’établissement de relations d’influence et de compréhension mutuelle, ainsi que l’échange des idées.
Les outils mis en œuvre dans ce cadre incluent la « diplomatie culturelle » classique, les expositions, foires et autres salons, et bien sûr l’audiovisuel extérieur.
Sans appeler à « plaquer » un quelconque modèle préétabli sur une réalité française dont le présent rapport n’a cessé de souligner les singularités, un tel schéma présente toutefois l’avantage de rendre concrète l’existence d’une stratégie globale d’influence, dont la France aurait tout intérêt à s’inspirer.
En définitive, il s’agit de rendre lisible notre modèle original qui combine « jardin à la française » et « jardin anglais »… vers une sorte de « jardin zen » ?
2) Les mérites du jardin à la française, l’attrait du jardin anglais… Vive le jardin zen !
a) Pour l’enseignement, des aménagements marginaux
– Le jardin à la française, ce sont les mêmes programmes de base partout, un cursus garanti dans le monde entier.
– Le jardin anglais, ce sont différents statuts pour les établissements (gestion directe / conventionné / homologué, coexistence de l’AEFE et de la Mission laïque française), ainsi qu’une fraction de l’enseignement imprégnée par la culture locale du pays d’implantation.
– Le jardin zen, ce seraient d’autres statuts, ponctuellement, en fonction des besoins locaux mais à l’intérieur du cadre général (la « quatrième catégorie » d’établissements sous forme de filières bilingues dans les établissements du pays d’accueil, des charter schools là où cela est pertinent et juridiquement accessible).
b) Pour le réseau culturel, une profonde rénovation
– Au jardin à la française correspond la fusion généralisée, par pays, des services de coopération et d’action culturelle des ambassades, et des établissements à autonomie financière que sont les centres et instituts culturels. Telle est la mesure-phare de la « RGPP 1 », décidée en avril 2008.
En termes de contenus, le jardin à la française, ce sont les mêmes tournées des mêmes artistes, organisées depuis Paris et fournies « clefs en main » aux postes, notamment par CulturesFrance.
– Au jardin anglais correspond le fait que continuent à coexister de par le monde des « pays à centres et instituts culturels » et des « pays à Alliances françaises ».
En termes de contenus, ce sont des événements typiquement locaux, ponctuels ou réguliers, non transposables dans un autre pays ou sur un autre continent.
– Le jardin zen, cela consisterait à aller vers un mariage harmonieux des deux réseaux. Dans le cadre de la « RGPP 2 », à venir en 2010 ? Si tel est le cas, mieux vaut l’organiser aujourd’hui de façon réfléchie plutôt que de voir s’imposer un schéma-type trop orienté vers les seules économies budgétaires.
En termes de contenus, on peut imaginer que la future agence culturelle propose « le menu et la carte », ou encore une « part fixe » et une « part variable », ce qui aurait pour corollaire une enveloppe de crédits laissée localement entre les mains et sous la responsabilité du conseiller culturel de l’ambassade, directeur de l’antenne locale de l’agence culturelle, disposant de l’autonomie financière et d’un conseil d’administration local.
3) Des interrogations sur la méthode
– Dans le domaine de l’enseignement, il faut se demander si le problème des effets pervers de la gratuité pourra être résolu par la mission mise en place au début du mois de mai sur l’initiative de la Présidence de la République.
Ce débat aura lieu de nouveau à l’occasion de l’examen du prochain projet de loi de finances ; mais il faut que d’ici là tout soit en ordre pour une prise de décision définitive.
– S’agissant du réseau culturel, le « feuilleton » de la grande agence, largement évoqué dans le rapport d’étape de la mission, illustre la difficile conduite de la réforme. Le projet de loi relatif à l’action extérieure de l’État est une occasion rare de débattre de ces sujets en traduisant dans la loi les résultats de ces débats. Par conséquent, après de trop longs atermoiements, c’est cette fois-ci un excès de précipitation qui est à craindre. Il aurait fallu demander au Gouvernement de faire en sorte que la navette se poursuive sur ce texte et obtenir qu’il soit disposé à y intégrer les dispositions qui ne peuvent être introduites par les parlementaires eux-mêmes, à cause de l’obstacle de la recevabilité financière (l’article 40 de la Constitution).
– Enfin, l’oubli volontaire de la dimension audiovisuelle dans la réforme en cours pose une question de cohérence de l’action culturelle extérieure. Entendons-nous bien : la dimension de l’audiovisuel extérieur existe mais elle est traitée ailleurs au sein de l’organigramme gouvernemental, donc de façon déconnectée de la réflexion actuelle sur notre diplomatie d’influence ; c’est cette déconnection que la mission déplore.
B – Questions d’intendance : recommandations portant sur les moyens et l’organisation
1) Enseignement : un « retour sur investissement » garanti en termes d’influence
– Pour absorber la mesure de gratuité, « il faut deux fois les moyens », a-t-il été confirmé à la mission au cours de ses dernières auditions : le coût de la mesure elle-même, et le coût des répercussions de la mesure, c’est-à-dire l’inscription d’élèves français plus nombreux, le besoin corrélatif de locaux et d’installations annexes, et le surcroît de demandes de bourses à caractère social.
La promesse du « plan de développement du réseau » des lycées français doit elle aussi être tenue. Cela concerne tout particulièrement l’aspect immobilier.
– L’enseignement français à l’étranger est un investissement essentiel ; il faut le poursuivre dans la sphère de l’enseignement supérieur. En cette matière, les établissements eux-mêmes, qu’il s’agisse des universités dans le cadre rénové posé par la « LRU » (4), des grandes écoles ou des autres établissements d’enseignement supérieur, mènent aussi leur propre politique de rayonnement − dans le Golfe par exemple. Les auditions menées par la mission en hiver et au printemps ont permis de vérifier amplement cet état de fait.
L’agence créée sous forme d’EPIC par le projet de loi relatif à l’action extérieure de l’État, par transformation du GIP CampusFrance, gagnerait à être mieux calibrée pour relever le défi, en étant davantage centrée sur la mobilité universitaire et plus étroitement reliée aux autres intervenants de cette « chaîne de la mobilité », y compris le Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS), y compris également les collectivités territoriales qui participent à l’accueil des étudiants étrangers.
2) Culture : un rayonnement qui ne doit pas s’étioler pour répondre à une forte « demande de France » de par le monde
– La situation budgétaire du réseau culturel à l’étranger a été trop fragilisée. Même dans les pays du Golfe où les moyens abondent, un minimum de crédibilité exige une mise initiale de fonds publics français. Dans les grands émergents comme en Inde, il est satisfaisant de pouvoir compter sur de petits exploits comme le festival « Bonjour India » mais on ne peut pas systématiquement condamner à l’exploit les services culturels et les Alliances françaises !
– Attendre trois ans avant de retravailler la question des liens entre l’EPIC opérateur et le réseau risque d’être une nouvelle perte de temps. Voilà qui, de nouveau, plaide pour une meilleure utilisation du « véhicule législatif » que constitue le projet de loi relatif à l’action extérieure de l’État, afin que le texte soit enrichi par la réflexion de la mission – et s’il le faut par le Gouvernement lui-même lorsque la procédure l’exige.
Ne créons pas d’autre occasion manquée, ce serait celle de trop.
*
* *
Au terme de plus d’un an d’analyse et de réflexion, la mission dresse un bilan mitigé d’une diplomatie d’influence française en pleine mutation. Elle ne renie rien des préconisations de son rapport d’étape, paru alors que les deux tiers de ses travaux étaient achevés ; elle a affiné sa vision de la cartographie du réseau culturel et d’enseignement de la France à l’étranger, et peaufiné, ce faisant, la gamme de ses recommandations.
L’encadré suivant en dresse un inventaire réduit à l’essentiel, car la mission n’a cessé de dire à ses interlocuteurs qu’elle se refusait à établir un catalogue de propositions, préférant un nombre limité de propositions structurantes. Telle est aussi la raison pour laquelle la mission a choisi − hormis la publication des comptes rendus des auditions − un format synthétique pour rendre compte de ses travaux. Le détail des préconisations est développé dans le corps du rapport.
PRINCIPALES RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELLES
choisies par la mission parmi les recommandations du rapport d’étape et du rapport final
Faire fructifier le « trésor » du réseau d’enseignement
• Encadrer la mesure de gratuité en plafonnant la prise en charge des écolages des élèves français, en fonction du revenu des familles, selon un barème différencié par pays.
• Utiliser et étoffer toute la palette des statuts des établissements (en créant notamment la « 4e catégorie ») ; pour les personnels en revanche, réduire les disparités et maintenir un nombre suffisant d’expatriés.
• Mieux utiliser l’excellence de l’enseignement secondaire français à l’étranger pour favoriser l’attractivité de l’enseignement supérieur français et francophone.
• Remettre à niveau l’immobilier du réseau et maintenir à 30 jours au moins le fonds de roulement des services centraux de l’AEFE.
Retisser la toile du réseau culturel
• Bâtir une stratégie ambitieuse pour l’action culturelle extérieure, pilotée par la DGM, incluant la langue, le débat d’idées, la création artistique, les industries culturelles, l’audiovisuel extérieur et les nouvelles technologies.
• Mettre en œuvre cette stratégie au moyen de la nouvelle agence culturelle, en la déclinant dans tout le réseau, rattaché à l’agence, sous la marque « Alliance française ».
• Organiser le réseau culturel sous cette marque et selon le schéma proposé par la mission (voir page 29).
• Maintenir des crédits d’action culturelle en volume suffisant, d’une part, pour former – en formation initiale et continue –, des personnels spécialisés et d’autre part, pour exercer un minimum d’effet de levier en nouant des partenariats locaux.
Au-delà de cette liste succincte, et à l’image de la conclusion des auditions menées par la mission, qui se concluaient « rituellement » par une préconisation finale demandée aux intervenants, quatre prolongements peuvent utilement compléter la réflexion sur les thèmes, très riches, étudiés dans le présent rapport :
– « retisser la toile réseau culturel », comme le préconise la mission, renvoie aussi, par une sorte de clin d’œil, à l’acception la plus contemporaine du mot « toile », c’est-à-dire, en anglais, le web. L’utilisation de l’Internet et des nouvelles technologies de l’information et de la communication ne va cesser d’imprégner davantage l’action culturelle extérieure et il est crucial de penser en ces termes la stratégie de notre diplomatie d’influence ;
– « cultiver le jardin zen » évoqué dans le rapport. Il s’agit d’une invitation à ne pas accorder une importance excessive aux questions de structures et d’organisation institutionnelle, que le débat franco-français, y compris au Parlement, a souvent tendance à exacerber ;
– défendre la francophonie – la langue mais aussi les idées, les valeurs – doit être, aux yeux de la mission, une préoccupation quotidienne. Celle-ci irrigue nécessairement le réseau culturel et d’enseignement mais bien d’autres domaines sont concernés ;
– de façon plus immédiate et opérationnelle, utiliser l’occasion de la loi relative à l’action extérieure de l’État et de son application – qui sera suivie de près par la commission des Affaires étrangères – est non seulement un devoir mais aussi une chance à saisir pour faire rayonner dans le monde l’enseignement et la culture de notre pays.
La Commission examine le présent rapport d’information au cours de sa réunion du mardi 11 mai à 11 heures 30.
Après l’introduction du Président Axel Poniatowski, l’intervention du Président de la mission et l’exposé de la Rapporteure, un débat a lieu.
Mme Martine Aurillac. Je tiens à saluer l’excellent travail, très dense, de la mission à laquelle j’ai participé. La discussion d’aujourd’hui me paraît devoir porter surtout sur l’enseignement français à l’étranger, puisque les questions culturelles seront abordées lors de la réunion de demain sur l’examen du projet de loi relatif à l’action extérieure de l’État.
Concernant l’enseignement, je partage l’essentiel des conclusions du rapport. Nous disposons d’un outil unique au monde, doté de structures, d’équipements importants, et de personnels de très grande qualité. Toutefois, nous devons le conforter, car il ne peut pas tout faire tout seul. Il faut notamment améliorer le statut des coopérants, qui font un travail remarquable.
S’agissant de notre rayonnement culturel, la discussion sur le rapport d’Hervé Gaymard relatif au projet de loi de réforme de notre action extérieure sera l’occasion d’obtenir des éclaircissements sur des propositions qui ont suscité, pour dire le moins, un certain étonnement de la part des observateurs de cette matière. Quoi qu’il en soit, j’estime que notre action culturelle internationale manque cruellement de vision stratégique, celle-ci devant s’accompagner des moyens nécessaires à sa mise en œuvre.
M. Jean-Louis Bianco. Je tiens également à remercier le Président et le Rapporteur pour la qualité de leur travail, et m’inscris également en accord avec la majorité des conclusions de la mission.
La France, et donc le Gouvernement actuel, doit clarifier ce qu’il entend par l’expression « stratégie d’influence ». Cela ne saurait revenir à mettre la culture au service de la diplomatie, mais cela ne peut pour autant impliquer de mettre notre diplomatie au service de la culture. La France ne peut soumettre la culture à des impératifs stratégiques, mais il ne faudrait pas pour autant céder aux lobbies culturels qui poussent à la diffusion des artistes français à l’étranger. La France doit défendre la diversité culturelle, et lutter contre toute forme d’hégémonie dans ce domaine. Je partage le constat d’une absence de stratégie, et d’un manque de moyens.
Je veux également souligner que je m’oppose à la mesure de gratuité de l’enseignement français à l’étranger. Personne ne soutient cette mesure. Sur ce point, la réaction de l’exécutif n’est pas acceptable. Il n’y a pas besoin d’une nouvelle évaluation ; la mission l’a déjà faite, et elle est de toute façon relativement simple à établir et ne nécessite pas une nouvelle analyse d’un an.
Sur l’audiovisuel, nous avons l’impression d’une grande incohérence, d’une dispersion des moyens et d’une efficacité plus que douteuse des dispositifs existants.
M. Robert Lecou. Les conclusions de la mission correspondent à ce que tout le monde ressent. La difficulté des membres de la mission à assister à toutes les réunions s’explique aussi par l’inflation législative, qui devient préoccupante.
Cette mission d’information était nécessaire. Trop souvent, les discours entendus évoquent une France qui perdrait pied, un constat qui ne correspond pas toujours à la réalité. Aux Émirats arabes unis, la présence du Louvre et de la Sorbonne montre que l’envie de France existe. Dans le monde, la « marque France » est plébiscitée. Il reste des marges de progression pour l’influence de notre pays. Je rappellerai à cet égard qu’en Inde, seulement 5 % de la population parle anglais.
Je veux aussi souligner la qualité de l’activité des Alliances françaises, dont le travail, remarquable, relève parfois de la vocation. Il est important de noter combien les personnels locaux sont dévoués dans les Alliances. Il faut que nos postes diplomatiques soient impliqués dans le rayonnement de la France à l’étranger.
Il existe une difficulté spécifique, en matière d’audiovisuel. Les chaînes françaises, et francophones, ne sont pas assez facilement accessibles à l’étranger.
La France doit également prendre en considération le travail effectué par les collectivités locales, dans le cadre de la coopération décentralisée, qui sert au rayonnement du pays. Une autre dimension à prendre en compte, et qui n’est pas assez mise en avant aujourd’hui, c’est la dimension européenne. Trop souvent, l’Europe est invisible à l’étranger, alors qu’elle pourrait représenter beaucoup.
Enfin, je veux rappeler que l’absence de déplacement de la mission en Afrique n’est en rien révélatrice d’un manque d’intérêt, au contraire. Nous sommes conscients que, souvent, ce sont les Africains qui défendent la langue française dans le monde.
M. André Schneider. Je n’ai pas pu m’investir comme je le souhaitais dans la mission car j’ai été désigné corapporteur de la mission d’évaluation et de contrôle constituée à la commission des finances portant précisément sur la place du français et l’enseignement dans notre langue de par le monde.
Dans ces travaux, nous avons mangé la « tarte à la crème » évoquée par la Rapporteure ! Nous avons pu constater combien les différentes compétences, les règles d’affectation et toutes ces complications nuisaient considérablement à la lisibilité de l’ensemble. Les questions de gestion, de propriété, de matériels, sont bien sûr quelque chose qui compte mais en termes stratégiques, nous devons réfléchir à la place du français dans le monde, à l’enseignement du français dans le monde, et au rayonnement du français.
Sur la question de la gratuité de l’enseignement français à l’étranger, nous avons beaucoup étudié le problème, et nous avons constaté qu’en réalité, les gens qui bénéficient de ce système ne demandaient rien… On aurait pu donner à ceux qui demandent au lieu d’accorder un avantage à ceux qui ne le demandaient pas. Mais le vrai problème dans ce domaine, c’est l’inégalité qu’une telle mesure va générer entre les Français et les étrangers, qui n’ont pas droit à la gratuité et seront ceux sur qui le financement de cette mesure va reposer in fine.
Par ailleurs, dans l’enseignement français à l’étranger, il y a effectivement un problème de moyens. Toutefois, il faut veiller à maintenir une évaluation correcte, et systématique, de tous ces personnels. Il faut aussi faire en sorte qu’une rotation suffisante soit observée ; la sédentarisation à l’étranger des personnels du réseau n’est pas de bonne politique.
Enfin, il ne faut pas oublier le rôle important de la francophonie, et de la diplomatie parlementaire.
M. Serge Janquin. Si les thèmes de cette mission d’information semblent bien connus, ils cachent en fait une grande complexité tant les statuts des personnels et la nature des institutions qui participent au rayonnement de la France sont divers. Le rapport de la mission d’information a su dépasser cette complexité pour aboutir à une vision politique dont l’objectif est de mettre un terme au fatalisme et au sentiment de renonciation qui a longtemps prévalu dans ce domaine. Pour ce faire, l’accent est mis sur la nécessité de définir une stratégie et de structurer les moyens pour accroître leur efficacité. Tout cela me semble aller dans la bonne direction. Le président et la rapporteure ont évoqué certains éléments de faiblesse du dispositif actuel destiné à assurer le rayonnement culturel et je voudrais revenir sur deux points. Je m’interroge d’abord sur le projet de création d’une agence chargée de conduire l’action culturelle extérieure : ce terme signifie pour moi un affaiblissement de la volonté de l’Etat, une prise de distance de celui-ci par rapport aux missions dont l’agence sera chargée et il me semble que ce n’est pas ce dont le rayonnement de la France a aujourd’hui besoin. Je m’inquiète ensuite des moyens et des financements dont disposera à l’avenir le rayonnement culturel de la France. Ni le président, ni la rapporteure, qui ont aussi exprimé leurs préoccupations dans ce domaine, n’y peuvent à l’évidence rien mais il me semble que sans renforcement de ces moyens, les autres préconisations risquent de demeurer des vœux pieux.
Sur la forme, je souhaiterais que, dans le document de synthèse du rapport, l’expression « dose d’enseignement couleur locale » soit remplacée par une formule plus neutre comme par exemple « option d’enseignement liée à l’histoire et à la culture locales ».
Mme Geneviève Colot, Rapporteure. Bien évidemment.
M. Didier Mathus. Sans remettre en cause un instant la qualité du travail conduit par le président et la rapporteure, je regrette, tout comme M. François Loncle, que la commission n’ait pas choisi de nommer un tandem pluraliste à la tête de cette mission d’information. Ayant participé aux travaux de la mission, je peux témoigner de la volonté permanente du président et de la rapporteure de redonner du « punch » à la présence de la langue et de la culture françaises à l’étranger. Toute réflexion doit partir du constat du recul marqué de la langue française partout dans le monde.
Il est vrai que les lycées français fonctionnent bien mais leur attrait est plus lié à l’outil de sélection qu’ils constituent qu’au fait que l’enseignement y est dispensé en français. Je déplore l’absence de volonté politique en faveur de l’attractivité de notre enseignement supérieur. Il me semble que ce sujet aurait dû être davantage traité dans le projet de loi relatif à l’action extérieure de l’Etat. Alors que la demande de culture française est immense, les institutions ne sont pas à la hauteur de ce potentiel exceptionnel.
J’insisterai enfin sur la question de l’audiovisuel extérieur qui n’était pas un thème central des travaux de la mission d’information bien que l’on ne puisse pas traiter du rayonnement d’une langue et d’une culture sans prendre en compte le fait que les principaux vecteurs de leur diffusion sont la télévision et l’Internet. Si la culture anglo-saxonne est devenue aussi dominante, c’est qu’elle a parfaitement su s’adapter à ces vecteurs. Le retard pris par le français est largement imputable au retard pris dans l’utilisation de ces outils de diffusion.
Mme Henriette Martinez. Dans le cadre de mes fonctions de présidente par délégation de la section française de l’Assemblée parlementaire de la francophonie (APF) je constate régulièrement que l’enseignement de la langue française ne régresse pas. J’ai pu mesurer la semaine dernière, à l’occasion d’un déplacement en Arménie, à quel point les établissements scolaires assurant un enseignement en français et l’université française d’Erevan étaient prisés. Il me semble que la France n’a pas à rougir des efforts qu’elle consent en faveur de la francophonie car elle est le seul état francophone à mener des actions en ce sens. Je juge primordial que notre pays mette en place des partenariats de terrain avec d’autres grands pays francophones comme la Belgique ou le Québec, car elle ne doit pas être seule à défendre concrètement la francophonie. La mission a-t-elle eu l’occasion d’avoir connaissance de l’existence de partenariats de ce type ?
Je suis également inquiète des débouchés offerts aux étudiants ayant étudié le français. Je prépare actuellement un rapport pour l’APF sur la francophonie économique. Toujours à l’occasion du même voyage, j’ai appris que des étudiants arméniens parfaitement francophones qui étaient candidats à des emplois dans de grandes entreprises françaises avaient dû passer des entretiens en anglais. Je trouve cela absolument scandaleux ! Il n’y a aucune raison que l’anglais soit la seule langue de l’économie. C’est pourquoi je juge indispensable de renforcer le lien entre francophonie culturelle et francophonie économique.
M. Michel Vauzelle. J’adresse mes compliments à la mission d’information. Je considère que le titre II de la synthèse de son rapport « du rayonnement à l’influence, comment réussir une transition douloureuse » est effectivement douloureux. Il me semble que la France est une grande puissance culturelle qui peut encore prétendre au rayonnement et pas à une vague politique d’influence.
Quand un pays ne dispose plus des moyens économiques de sa politique culturelle – qui doit être porteuse d’esthétique et d’éthique –, il lui reste les moyens audiovisuels. Or dès qu’on franchit nos frontières, on ne peut que s’interroger sur l’absence des chaînes de télévision françaises à l’étranger. Il est préoccupant que cette question pourtant récurrente ne parvienne pas à trouver une solution.
Le recul de la langue française est également douloureux. On le constate chez nos voisins, en Espagne, en Italie ou à Bruxelles, mais aussi sur des continents plus éloignés alors que les peuples manifestent une soif de langue et de culture françaises. Pervertie par l’esprit de la révision générale des politiques publiques (RGPP), notre action n’est pas à la hauteur de ces attentes. Je considère que cette action devrait être préservée de la RGPP afin de permettre à la France de demeurer la grande puissance qu’elle est encore.
Sur le cas de l’Inde, je rappellerai que dans toutes les anciennes colonies ayant dépendu des Britanniques la France peine à redresser l’image que ces derniers avaient présentée d’elle.
Je salue le patriotisme culturel du président et de la rapporteure. Ce sentiment que je partage impose à l’État de sanctuariser les moyens de notre rayonnement culturel.
En conclusion, il ne faut pas négliger que la disparition des régions au profit des métropoles, prévue par la réforme des collectivités territoriales à venir, risque de fragiliser encore plus notre dispositif en faveur de l’influence française dans le monde.
M. Hervé Gaymard. J’adresse également mes félicitations à la mission pour son travail remarquable et utile. Sans anticiper sur le débat de demain matin, je tiens à souligner que le projet de loi que nous examinerons n’est pas un texte définitif mais évolutif. Cette caractéristique justifie la présentation de ce rapport aujourd’hui mais aussi, pour l’avenir, le fait que la Commission continue à suivre méticuleusement ce dossier.
M. Jean-Michel Boucheron. Je m’étonne que dans la bataille engagée pour notre influence dans le monde le Gouvernement semble ignorer les nouvelles technologies qui sont pourtant appelées à jouer un rôle déterminant. Quelle est l’analyse du Gouvernement sur ce point ? Soutient-il des projets novateurs dans ce domaine ? Je sais par exemple qu’existe un logiciel expérimental de traduction automatique – qui permet une conversation téléphonique entre deux personnes qui ne parlent pas la même langue. Toutes les langues, à l’exception de l’anglais et du chinois, sont aujourd’hui menacées. L’enseignement du français ne passera à l’avenir que par les nouvelles technologies. Je souhaiterais donc savoir quel est l’état de la réflexion du Gouvernement sur cette question. On ne peut malheureusement pas s’en tenir à un combat d’arrière-garde en dépit du talent et de la conviction avec lesquels on le mène.
M. François Rochebloine, Président. Je remercie tous les intervenants, dont plusieurs d’entre eux étaient membres de la mission, qui ont formulé plus de remarques que de questions. Je les partage en grande partie. Je partage également l’avis d’Henriette Martinez sur l’Arménie que je connais bien. Ce qu’elle dénonce est tout à fait regrettable.
Il est important de montrer les effets pervers de la politique de gratuité dans les lycées français. Nous avons eu l’exemple au Chili d’une famille de trois enfants que la gratuité a mis en difficulté : en effet, les deux aînés étant pris en charge, la base de ressources prise en compte pour le calcul de la bourse du troisième avait mécaniquement augmenté, de sorte que la famille devait payer là où auparavant elle ne déboursait rien. De même, il faut savoir que cette politique a conduit à attirer des enfants français vers certains lycées du réseau de l’AEFE alors qu’ils étaient auparavant scolarisés dans d’autres établissements, et à marginaliser des enfants étrangers qui ne peuvent plus assumer les frais.
Jean-Michel Boucheron souligne un véritable problème. Ces logiciels sont remarquables et l’on échappera effectivement aux nouvelles technologies.
Mme Geneviève Colot, Rapporteure. En réponse au commentaire de M. Robert Lecou, je précise que la mission a choisi de se déplacer dans des régions où l’on ne se rend pas fréquemment, tels que les Émirats ou l’Argentine, de manière à élargir notre étude à d’autres pays que ceux, plus classiques, et mieux connus de l’Afrique francophone.
Quant aux partenariats que Mme Henriette Martinez appelle de ses vœux avec d’autres pays francophones, nous n’en avons jamais vu ! La France est seule à déployer un tel réseau d’enseignement en français à l’étranger et personne ne lui apporte son aide. Peut-être l’OIF pourrait-elle prendre l’initiative d’une démarche en ce sens. Je suis également très favorable à l’articulation entre francophonie culturelle et francophonie économique et je souhaite que le rapport de Mme Henriette Martinez soit effectivement insistant sur ce point.
M. le Président Axel Poniatowski. Je remercie la mission pour la qualité de son travail, même si la question de la télévision n’a pas été abordée. À ce sujet, il faut rappeler qu’il y a des divergences fortes, de fond, au sein de la commission des affaires étrangères, sur la nature de la télévision que l’on entend promouvoir : s’agit-il d’une télévision en français ou en langue étrangère ? Ce point est fondamental. Je fais partie de ceux qui sont partisans d’une télévision en français, et qui considèrent que sinon, CNN ou la BBC, plus que France 24, sont aptes à diffuser des messages en anglais ! Il faudra en tout cas trancher avant d’aller plus loin sur cette question.
M. Didier Mathus. Il faut savoir de quelle télévision l’on parle !
M. le Président Axel Poniatowski. Je mets aux voix la publication du rapport.
Puis la commission autorise la publication du rapport d’information.
*
* *
ANNEXE 1 :
LISTE DES AUDITIONS DE LA MISSION
(par ordre chronologique)
Date |
Personnalités entendues |
Jeudi 26 mars 2009 |
M. Berthold Franke, directeur général du Goethe Institut de Paris |
Instituto Cervantes de Paris M. Jorge Jimenez Mme Asuncio Pastor | |
British Council Mme Dawn Long, directrice adjointe, Mme Sylvie Gelis, directrice finances et ressources humaines | |
Mardi 30 juin 2009 |
M. Christian Masset, directeur général de la mondialisation, du développement et des partenariats M. Yves Carmona, directeur adjoint de la politique culturelle et du français |
M. Jean-Pierre de Launoit, président de la Fondation Alliance française M. Gérald Candelle, responsable des zones Asie/Océanie/États-Unis et du recrutement. | |
M. Yves Aubin de la Messuzière, président de la Commission pour l’avenir de l’enseignement français à l’étranger | |
Jeudi 2 juillet 2009 |
Mme Anne-Marie Descôtes, directrice de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) |
M. Alain Catta, directeur des Français à l’étranger et de l’administration consulaire M. Éric Lamouroux, sous-directeur de l’expatriation, de la scolarisation et de l’action sociale | |
Mardi 7 juillet 2009 |
M. Jean-Pierre Bayle, président de la Mission laïque française M. Jean-Pierre Villain, directeur général |
Mercredi 8 juillet 2009 |
Mme Anne Gazeau-Secret, ancienne directrice générale de la coopération internationale et du développement (DGCID) |
M. Stéphane Romatet, directeur général de l’administration et de la modernisation du ministère des Affaires étrangères et européennes | |
Mercredi 9 septembre 2009 |
Déjeuner avec des conseillers de l’Assemblée des Français de l’étranger |
Mardi 6 octobre 2009 |
M. Alain Gründ, président du Bureau international de l’édition française et M. Jean-Guy Boin, directeur général |
Mme Sophie Mercier, directrice du Bureau Export Musique et M. Jean-François Michel, fondateur et aujourd’hui conseiller du Bureau Export. | |
M. Olivier Poivre d’Arvor, directeur de CulturesFrance | |
Mardi 13 octobre 2009 |
M. Antoine de Clermont-Tonnerre, président d’Unifrance et Mme Régine Hatchondo, directrice générale |
Mardi 20 octobre 2009 |
M. François Denis, président de la Fédération des associations de parents d’élèves des établissements d’enseignement français à l’étranger (FAPÉE) |
Jeudi 22 octobre 2009 |
M. Clément Duhaime, administrateur de l’Organisation internationale de la francophonie |
M. Henri Loyrette, Président-directeur du Musée du Louvre , M. Bruno Maquart, directeur général de l’Agence France muséums, Mme Laurence des Cars, directrice scientifique de l’agence France muséums et M. Ugo Bertoni, chargé de mission auprès du directeur général | |
Mardi 17 novembre 2009 |
M. Jean-François Cervel, directeur du CNOUS et M. Jean-Paul Roumegas, sous-directeur des affaires internationales |
Mercredi 18 novembre 2009 |
Agence Europe-Education-Formation France (A 2e2f, maître d’œuvre des programmes européens d’éducation et de formation) : Pr Pierre Grégory, vice-chancelier des universités de Paris, président, et Pr Jean Bertsch, directeur national (à Bordeaux). |
M. Gérard Binder, président du conseil d’administration de CampusFrance, et Mme Béatrice Khaiat, directrice déléguée | |
Mardi 24 novembre 2009 |
M. Laurent Batsch, président de l’Université Paris-Dauphine et M. Arnaud Raynouard, vice-président chargé des affaires internationales. |
Mercredi 25 novembre 2009 |
M. Pierre Tapie, directeur général du groupe Essec, président de la Conférence des grandes écoles, et M. Pierre Aliphat, délégué général de la conférence. |
Mardi 15 décembre 2009 |
M. Jean-Claude Colliard, président de l’Université Paris I Panthéon,-Sorbonne, Mme Christine Mengin, Vice-présidente chargée des relations internationales, et Mme Catherine Germain, directrice du cabinet de M. Colliard. |
Mercredi 16 décembre 2009 |
M. Pierre Buhler, directeur général de France Coopération Internationale |
M. Dominique Hénault, directeur général de l’association Egide et M. Bertrand Sulpice, directeur général adjoint | |
Mardi 2 février 2010 |
M. Richard Descoings, directeur de l’Institut d’études politiques de Paris |
M. Dominique de Combles de Nayves, conseiller maître à la Cour des comptes | |
Mercredi 3 février 2010 |
Mme Nathalie Delapalme, inspectrice générale des finances |
M. Benoît Paumier, inspecteur général des affaires culturelles. | |
Mercredi 31 mars 2010 (*) |
Mme Sonia Dubourg-Lavroff, directrice des relations européennes et internationales et de la coopération au ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche et au ministère de l’Éducation nationale M. Marc Rolland, sous-directeur des relations internationales M. Gilles Vial, chargé de mission |
Mardi 6 avril 2010 |
M. Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères et européennes |
M. Bernard Latarjet, directeur général du projet « Marseille Provence 2013, capitale européenne de la culture » | |
M. Bertrand Gallet, directeur général de Cités unies France | |
Mercredi 7 avril 2010 |
M. Antoine Joly, délégué pour l’action extérieure des collectivités territoriales au ministère des Affaires étrangères et européennes |
Lundi 26 avril 2010 |
M. Jean-David Levitte, conseiller diplomatique et sherpa du Président de la République |
M. Pierre Sellal, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et européennes |
(*) Le même jour, la commission des affaires étrangères entendait, dans le cadre de ses travaux sur le projet de loi relatif à l’action extérieure de l’État (n° 2339) : Mme Julia Kristeva, M. Antoine Compagnon et M. Bernard Faivre d’Arcier. Le compte rendu de cette audition est reproduit dans le rapport de M. Hervé Gaymard sur ce projet de loi (n° 2513).
ANNEXE 2 :
COMPTES RENDUS DES AUDITIONS DE LA MISSION À PARIS
Compte rendu de l’audition de M. Berthold Franke,
directeur général du Goethe Institut de Paris
(Jeudi 26 mars 2009 − 33, rue Saint-Dominique – salle 4223)
La réunion est ouverte à 10 heures.
• Présents
M. François Rochebloine, Président
Mme Geneviève Colot, Rapporteur
Mme Martine Aurillac
M. Robert Lecou
M. André Schneider
• Excusés
MM. Jean-Louis Bianco, Philippe Cochet, Jean-Pierre Dufau, Jean-Michel Ferrand, Jean-Claude Guibal, Jean-Pierre Kucheida, Didier Mathus et Jacques Remiller.
*
M. François Rochebloine, Président, accueille M. Berthold Franke en évoquant le souvenir de sa visite de l’institut culturel franco-allemand de Ramallah.
M. Berthold Franke, directeur général du Goethe Institut de Paris, déroule un bref historique de l’institution à laquelle il appartient :
– dans les années 1950, sa création était une tentative pour regagner une aura perdue après la catastrophe nazie. Il s’agissait de mettre en place une organisation qui soit totalement différente du « système Goebbels », lequel était centralisé au plus haut point, et constituait de ce fait une rupture par rapport au modèle traditionnel.
Le Goethe Institut a donc été créé en tant que structure nationale mais non étatique. Son statut est associatif et son siège est à Münich ; l’Institut possède un lien juridique avec le ministère allemand des Affaires étrangères mais pas avec un ministère fédéral de la Culture car celui-ci n’existe pas : il y a en tout et pour tout 16 ministères de la Culture à l’échelle de chaque Land ;
– pendant la Guerre froide, il s’est agi de surmonter la propagande. Avec deux « missions accomplies » : l’apparition d’une nouvelle culture allemande et la victoire dans la Guerre froide ;
– aujourd’hui, le panorama est renouvelé.
S’agissant de l’autonomie à l’égard du ministère des Affaires étrangères, elle ne doit pas masquer le fait qu’une grande proximité existe et que la plupart des crédits centraux sont issus de ce ministère.
Cependant, M. Franke précise qu’il n’est pas diplomate et que l’ambassadeur d’Allemagne à Paris n’est pas son supérieur hiérarchique. En cas de difficulté, le directeur général du Goethe Institut de Paris en réfère à Münich quand l’ambassadeur en réfère à Berlin.
Le modèle suivi est celui du British Council. Le Goethe Institut dispose de 134 relais implantés dans 83 pays. Le monde est découpé en 12 régions, la plus grande étant l’Europe du Sud-ouest, gérée depuis Paris. C’est au niveau régional que se prennent les décisions relatives au budget, au personnel et à la stratégie.
Les activités du Goethe Institut sont de trois ordres : la langue, la coopération culturelle et l’information sur la culture et la société allemandes.
Enfin, il faut souligner que cette institution est encore d’envergure nationale mais que les Allemands ont « dans leurs gènes » une aspiration au multilatéralisme, au moins à l’échelle européenne.
C’est pourquoi les colocalisations se développent : à Stockholm avec l’Institut Cervantès, et avec la France à Ramallah, Glasgow et peut-être enfin Moscou, où une implantation est recherchée pour concrétiser un projet désormais vieux de 20 ans !
M. André Schneider demande quelles sont les différences entre le Goethe Institut et la Konrad Adenauer Stiftung.
M. Berthold Franke répond que cette fondation émane d’un parti politique, la CDU en l’occurrence – son « pendant » politique étant la Fondation Friedrich Ebert, liée au SPD. Ces fondations sont en général très engagées dans l’aide au développement.
Interrogé par le Président François Rochebloine, M. Berthold Franke précise que la stratégie mondiale du Goethe Institut fait l’objet d’un dialogue permanent entre le siège et le ministère des Affaires étrangères, lequel verse 95 % des quelque 260 M€ de subventions dont dispose l’Institut. S’y ajoutent les recettes tirées des cours de langue, aboutissant à un taux d’autofinancement de 18 à 20 %.
À la question de Mme Geneviève Colot, Rapporteur, sur les liens entretenus avec d’autres organismes comparables en Europe, M. Berthold Franke répond que beaucoup de liens ont été noués à cette fin en Europe mais que, là comme ailleurs dans le monde, l’apprentissage d’une deuxième langue vivante est en baisse.
Parler anglais et connaître Windows suffit à peu près n’importe où et les systèmes éducatifs du monde entier semblent, hélas, s’en contenter.
Le Président François Rochebloine demande quel rôle jouent les Parlementaires allemands à l’égard du Goethe Institut.
M. Berthold Franke répond qu’ils exercent leur droit de vote et de contrôle dans le cadre du rôle budgétaire du Parlement. Il existe par exemple des enveloppes consacrées exclusivement à tel ou tel projet – par exemple le développement du réseau des écoles allemandes à l’étranger – que le Parlement peut confier en gestion au Goethe Institut.
Interrogé par le Président François Rochebloine sur le réseau scolaire allemand à l’étranger, M. Berthold Franke indique qu’il s’agit d’un bon réseau, comparable à celui de la France quoique moins étendu. Les partenaires privés n’y ont jamais participé à plus de 3 % environ et aujourd’hui leur apport est à peu près nul.
Mme Geneviève Colot, Rapporteur, demande quels liens sont entretenus avec les établissements scolaires du pays d’implantation. M. Berthold Franke les qualifie d’intenses.
Puis la Rapporteure demande pourquoi le modèle actuellement suivi est celui du British Council alors qu’il s’agissait plutôt de celui de la France à l’origine.
M. Berthold Franke répond que le British Council suscite l’admiration par sa capacité à se réinventer tous les trois ans, et par le pragmatisme anglo-saxon. L’idée de régionalisation est également essentielle.
Les centres et instituts culturels français ou certaines alliances françaises ont un lien direct avec la France via les ambassades ; il n’y a aucune organisation à l’échelon régional. Ainsi, pour le Goethe Institut, une comparaison (benchmarking) est possible avec les implantations du British Council, mais pas avec le réseau français, trop morcelé, en attendant la création d’une agence culturelle unique.
Puis la mission a échangé avec M. Berthold Franke sur le degré d’immixtion du politique dans la culture, que les Allemands trouvent très fort en France alors qu’eux sont jaloux de leur organisation décentralisée. À tel point que le drapeau national pose parfois problème.
Interrogé par Mme Geneviève Colot, Rapporteur, sur l’état du budget de l’Institut, M. Berthold Franke répond que le budget global de l’institution augmente, notamment pour les projets scolaires en Afrique, mais qu’ils stagnent en Europe. La situation est très difficile en raison du contexte de crise économique et des échéances électorales à venir. La Chine ou l’Inde restent des pays à prospecter…
À la question de M. Robert Lecou sur le rayonnement de la France en Allemagne, M. Berthold Franke répond que la place de la langue française se réduit – symétriquement à celle de l’allemand en France – et que le réseau des instituts culturels est menacé mais que le centralisme politique français aide au volontarisme et que l’ambassade elle-me^me est très dynamique.
Au demeurant, le premier contact avec la culture française se fait via les médias, le tourisme, les événements sportifs ou l’Internet ; la politique culturelle proprement dite intervient en deuxième intention, pour l’approfondissement : tel film moins grand public, de la poésie, l’étude approfondie de la langue…
Répondant à M. Robert Lecou sur le thème de l’adéquation de l’organisation du Goethe Institut à ses missions, M. Berthold Franke souligne que l’Institut vit une période décisive durant laquelle il tente de retrouver sa place centrale, alors qu’il a perdu le monopole de l’accès à la culture allemande dont il jouissait dans les années 60-70.
En effet, il existe aujourd’hui des initiatives concurrentes et commerciales, il existe d’autres organismes, y compris à Paris, et beaucoup de manifestations culturelles auxquelles le Goethe ne participe pas. Or cette reconquête ne va pas de soi ; l’Institut a besoin d’être davantage culturel et moins institutionnel, il n’a pas encore trouvé sa nouvelle identité.
Et l’Allemagne n’est pas facile à « vendre » à l’étranger, elle n’a pas de mode de vie particulier à promouvoir, sa taille et son histoire peuvent être des handicaps… En revanche, Berlin est une « marque » extraordinaire, riche de son histoire particulière et de sa culture si diverse, y compris russe ou juive.
En définitive, il n’y a pas à proprement parler de concurrence entre États européens à propos de leurs implantations culturelles hors d’Europe, mais bien plutôt une complémentarité.
La réunion est levée à 11 heures.
Compte rendu de l’audition de M. Jorge Jiménez et de Mme Asuncio Pastor,
représentant l’Institut Cervantès de Paris
(Jeudi 26 mars 2009 − 33, rue Saint-Dominique – salle 4223)
La réunion est ouverte à 11 heures.
• Présents
M. François Rochebloine, Président
Mme Geneviève Colot, Rapporteur
Mme Martine Aurillac
M. Robert Lecou
M. André Schneider
• Excusés
MM. Jean-Louis Bianco, Philippe Cochet, Jean-Pierre Dufau, Jean-Michel Ferrand, Jean-Claude Guibal, Jean-Pierre Kucheida, Didier Mathus et Jacques Remiller.
*
Mme Geneviève Colot, Rapporteur, accueille les deux représentants de l’équipe dirigeante de l’Institut Cervantès de Paris.
Mme Pastor présente l’institut en rappelant sa création en 1991 et son statut d’organisme officiel. Les actions qu’il mène sont décidées par son Conseil d’administration, où siègent le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l’Éducation et le ministère des Finances : le président de ce conseil est le secrétaire d’État à la coopération internationale, qui dépend du MAE, et chacun des trois ministères précités dispose d’un siège de vice-président, occupé par un sous-secrétaire d’État.
Le président d’honneur de cet organisme est Sa Majesté le roi d’Espagne et le président de son instance exécutive, le chef du gouvernement espagnol. Il existe également un conseil culturel où siègent notamment des personnalités du monde de la culture – des écrivains célèbres en particulier.
L’Institut Cervantès n’est donc pas une association mais bien un organisme public de l’État espagnol, indépendant et doté d’un budget propre sous forme d’une enveloppe spécifique au sein des crédits du ministère des Affaires étrangères. En 2009, ce budget s’élève à 102 M€ pour 70 centres de par le monde (dont 4 en France, à Paris, Lyon, Toulouse et Bordeaux, 6 au Maroc et 4 en Italie). Les instituts sont implantés dans près d’une soixantaine de pays du monde, majoritairement situés en Europe. Le budget est abondé à 89 % par des subventions et à 11 % par des ressources propres.
À la question de Mme Geneviève Colot, Rapporteur, sur l’existence de partenaires privés, M. Jorge Jiménez répond qu’il y est recouru ponctuellement mais qu’aucun n’est un partenaire permanent, bien que la direction actuelle recherche de tels soutiens pérennes. Cela dit, l’État espagnol est réticent à l’égard de l’intervention d’un tiers dans des proportions trop importantes.
M. Robert Lecou demande les raisons de la création récente de l’Institut Cervantès.
M. Jiménez explique qu’auparavant il existait des « maisons de l’Espagne » à l’étranger, destinées aux citoyens espagnols ; le changement de régime politique et de modèle économique ont conduit à rénover et à transformer ce réseau.
Mme Pastor précise qu’il existait déjà un réseau de centres culturels à côté de celui des Casa de España – 5 centres au Maroc, par exemple – qui tous sont devenus des Instituts Cervantès à la faveur de la vaste réorganisation mise en œuvre par le Gouvernement. Quant aux « Maisons d’Espagne », certaines sont demeurées en place, pour les ressortissants espagnols expatriés de longue date, comme lieux de rencontre conviviaux.
À la demande de Mme Geneviève Colot, Rapporteur, portant sur la stratégie guidant l’action des Instituts Cervantès, M. Jiménez répond qu’il s’agit de consolider la présence espagnole dans le monde, à travers la culture et la langue. L’heure est à l’expansion de ce réseau.
Mme Pastor ajoute qu’aucune implantation n’existe en Amérique du Sud, hormis au Brésil, bien qu’une collaboration soit entretenue avec chacun des pays de la zone pour promouvoir la langue et la littérature espagnoles en particulier.
Répondant ensuite à Mme Geneviève Colot, Rapporteur, sur le statut des personnels des Instituts Cervantès, M. Jiménez indique que le directeur en est un diplomate (titulaire d’un passeport diplomatique), tandis que les directeurs des études, de la bibliothèque, des activités culturelles et l’administrateur possèdent un passeport de service (intermédiaire entre le passeport diplomatique et le passeport ordinaire). Les personnels ne passent pas plus de cinq ans dans un même pays. L’ambassadeur n’est pas leur supérieur hiérarchique, sauf exception, i.e. dans les pays où l’ambassade héberge l’institut.
Le Président François Rochebloine demande quels liens sont entretenus avec les lycées espagnols à l’étranger. Mme Pastor répond que ces établissements dépendent uniquement du ministère de l’Éducation, par le truchement de l’ambassade. Ils scolarisent surtout les enfants des personnels expatriés.
En réponse au Président François Rochebloine à propos des supports audiovisuels pour les cours de langue, Mme Pastor décline « l’offre de produits » existante : les cours de langue à l’Institut, conformes au cadre commun d’enseignement défini par le Conseil de l’Europe, les cours par Internet et, depuis tout récemment, les cours accessibles via la télévision. Ceux-ci ne sont pas encore commercialisés et ne sont pour l’heure disponibles que sur la chaîne espagnole internationale mais seront à terme diffusés sur des chaînes nationales.
Puis les échanges entre les membres de la mission et les intervenants permettent de préciser que le réseau des Instituts Cervantès emploie quelque 1 000 personnes, expatriés ou recrutés locaux, sous de nombreux statuts différents, variables aussi selon les pays d’implantation − ils sont par exemple, au Maroc, quasiment assimilés à des personnels diplomatiques, et en Égypte ils sont également très proches de l’ambassade, ce qui offre une garantie contre tout type de censure.
Les raisons du développement croissant de la langue espagnole dans le monde sont, selon M. Jiménez, le développement de l’Espagne elle-même et l’attrait de l’Amérique latine ; un « double moteur » culturel et économique pousse dans le même sens.
M. Jiménez précise également que les Instituts Cervantès coopèrent avec d’autres centres culturels étrangers, surtout en Europe.
Répondant ensuite au Président François Rochebloine, il indique que l’Académie d’Espagne à Rome, bien que collaborant étroitement avec l’Institut Cervantès, en est distincte.
Puis des questions de M. Robert Lecou et de Mme Martine Aurillac lui permettent de dire que Madrid a donné pour 2009 des instructions rigoureuses en matière budgétaire, avec une hausse des crédits de 2 % seulement par rapport à 2008, et l’imposition d’un plafond de dépenses de personnels en pourcentage du budget global. À Paris, la part des frais de personnel − ils sont dix − représente 50 % du budget.
En réponse aux questions du Président François Rochebloine et de M. Robert Lecou, M. Jiménez indique que, s’il n’y a pas de concurrence avec les organismes homologues d’autres pays européens comparables (hormis pour mesurer les différences de nombre d’heures de cours ou leur coût unitaire, par exemple), il n’y a pas pour autant de coopération, ni d’établissements communs.
À M. Robert Lecou qui souhaite connaître les axes de développement stratégique de l’Institut Cervantès, M. Jiménez répond que les États-Unis sont la première priorité − à l’inverse, le développement en Extrême-Orient est perçu comme « plus compliqué ».
Mme Pastor insiste pour sa part sur la mission de certification de la compétence linguistique en espagnol langue étrangère. Un réseau de centres organise deux sessions d’examens par an. Un axe de développement dans ce cadre serait la certification de la compétence en espagnol au sein même des systèmes éducatifs nationaux, en France par exemple (appel d’offres lancé la veille pour les sections européennes en classe de seconde). C’est ce que font les homologues britanniques et allemands de l’Institut Cervantès.
M. Jiménez précise enfin que l’Institut travaille « tous azimuts », y compris pour promouvoir le flamenco, l’activité principale demeurant cependant la mise en valeur de la littérature, et à un degré moindre, du cinéma.
La réunion est levée à 11 heures 55.
Compte rendu de l’audition de Mme Dawn Long,
directrice adjointe du British Council de Paris
accompagnée de Mme Sylvie Gelish, directrice des finances et des ressources humaines
(Jeudi 26 mars 2009 − 33, rue Saint-Dominique – salle 4223)
La réunion est ouverte à 12 heures.
• Présents
M. François Rochebloine, Président
Mme Geneviève Colot, Rapporteur
M. André Schneider
• Excusés
Mme Martine Aurillac, MM. Jean-Louis Bianco, Philippe Cochet, Jean-Pierre Dufau, Jean-Michel Ferrand, Jean-Claude Guibal, Jean-Pierre Kucheida, Robert Lecou, Didier Mathus et Jacques Remiller.
*
M. François Rochebloine, Président, accueille les intervenantes.
Mme Dawn Long, directrice adjointe du British Council de Paris, prie la mission d’excuser le directeur retenu à Londres, et indique que, en poste à Paris depuis 4 ans, elle est, en tant que directrice adjointe, attachée culturelle à l’ambassade du Royaume-Uni.
Le British Council a été fondé en 1934 comme organisation à but non lucratif. Il est aujourd’hui présent dans 110 pays et 240 villes. Organisé en 11 régions administratives, il emploie 8 000 personnes de par le monde. Son implantation en France remonte à 1944, et la première convention franco-britannique ad hoc date de 1948. En France sont employés 70 salariés, dont 32 permanents et 38 professeurs d’anglais à temps partiel.
Les missions du British Council concernent en premier lieu les relations culturelles, c’est-à-dire l’échange de connaissances et d’idées avec tous les pays du monde, dans un climat « de confiance, d’engagement et de respect ». Sont englobés, outre la langue bien sûr − avec l’organisation d’examens notamment −, les arts, les sciences, l’économie de la création, l’économie de la connaissance…
Une phase de changement profond a été engagée depuis 2005, notamment en Europe où l’accent est mis sur le fonctionnement en partenariat et en réseau pour construire l’Europe de demain, dans un cadre plus multilatéral que bilatéral.
Le budget du British Council s’élevait en 2008 à 565 millions de livres, dont 198 millions (soit 35 %) de subvention du Foreign and Commowealth Office. Le reste des recettes provient des cours de langue, des droits d’examens et des contrats de prestataires (pour les programmes européens d’éducation, par exemple).
À Mme Geneviève Colot, Rapporteur, l’interrogeant sur les partenariats avec le secteur privé, Mme Dawn Long répond qu’environ 10 000 projets sont sponsorisés chaque année, par exemple la Coupe du monde de rugby recevant le soutien de la banque HSBC. Mme Sylvie Gelish précise que ces partenariats sont toujours locaux et temporaires.
Mme Dawn Long poursuit en présentant les activités du British Council en France : l’enseignement de l’anglais à quelque 4 000 étudiants par an, âgés de 5 à 18 ans, y compris dans le cadre de stages extrascolaires le soir, le mercredi, le week-end et pendant les vacances. Certains élèves prennent des cours pendant dix ou quinze ans !
Ce même modèle est reproduit partout, sauf en Espagne où le British Council gère une école.
Les examens de langue sont passés par plus de 15 000 personnes chaque année ; il s’agit des examens « de Cambridge », de plus en plus populaires dans les cursus français. S’y ajoutent les examens IELS (Institute of English Language Studies), nécessaires pour poursuivre des études au Royaume-Uni, en Australie ou aux États-Unis.
Les ressources disponibles en ligne rencontrent un grand succès : le site Internet Education UK reçoit 30 à 40 000 « visiteurs » par an.
Enfin, les projets en cours sont les suivants : un programme de coopération entre chercheurs dans le domaine des sciences, un programme pour jeunes artistes et un programme de développement des liens entre les structures de l’Éducation nationale que sont les académies en France et leurs homologues au Royaume-Uni.
Il existe, de chaque côté de la Manche, beaucoup de demandes pour l’apprentissage à un âge plus précoce de la langue du voisin. Le français est ainsi la première langue vivante demandée au Royaume-Uni, où elle est enseignée dans 98 écoles primaires. Répondant à Mme Geneviève Colot, Rapporteur, Mme Dawn Long précise que cet enseignement de langue vivante étrangère devient obligatoire en 2010 et que le français est la première choisie.
M. André Schneider déclare militer pour l’apprentissage d’une deuxième langue vivante étrangère également.
S’agissant des liens entre le British Council et le Foreign and Commonwealth Office, Mme Dawn Long indique que les relations sont bonnes, que le FCO finance le British Council à hauteur de 35 % et qu’il est représenté à son conseil d’administration. Un contact annuel est noué en particulier pour définir des priorités géographiques ; l’accord s’établit, en principe, spontanément…
En France, le directeur du British Council est le conseiller culturel de l’ambassade du Royaume-Uni, son adjointe étant également diplomate. Toutefois, le British Council demeure indépendant par rapport au FCO, surtout dans les pays où cela se révèle politiquement indispensable – en Iran par exemple.
Mme Sylvie Gelish précise que le British Council est apolitique.
À la question du Président François Rochebloine demandant « qui est le patron », Mmes Long et Gelish répondent qu’il s’agit du siège du British Council mais que la coopération avec l’ambassade est toujours étroite et qu’il n’y a pas de conflit entre les deux fonctions. Mme Sylvie Gelish souligne que l’autonomie du conseiller culturel britannique est plus grande que celle d’un conseiller de coopération et d’action culturelle (COCAC) français. Le travail, côté britannique, est un travail d’équipe et il n’existe pas de lien de subordination.
Répondant à une question du Président François Rochebloine, Mme Dawn Long indique que le budget du British Council est réparti à l’échelon des grandes régions administratives, qui est aussi le niveau de déclinaison locale de la stratégie d’ensemble.
Cette dernière, depuis 2005 et sous la pression d’une rationalisation budgétaire, est globalement définie par le siège. Elle comprend actuellement trois volets : le dialogue interculturel, la créativité et le changement climatique. À charge pour chaque région d’adapter ces axes localement, pour mise en œuvre par chaque implantation du British Council.
Le Président François Rochebloine demande comment s’effectue le contrôle et l’évaluation des centres.
Mme Sylvie Gelish répond qu’un système d’évaluation parfaitement homogène fonctionne avec le logiciel SAP et permet un efficace benchmarking, d’ailleurs reproduit dans le rapport annuel sous forme de diagramme avec code de couleur.
Mme Dawn Long présente un schéma des outils de la diplomatie culturelle britannique (5) puis, répondant au Président François Rochebloine, elle indique que les centres du British Council travaillent en principe avec les instituts culturels d’autres pays, comme en témoigne l’existence de colocalisations avec le Goethe Institut.
À la question du Président François Rochebloine sur la perception du réseau culturel français du point de vue britannique, Mme Dawn Long répond qu’il apparaît comme un regroupement de nombreuses entités diverses et Mme Sylvie Gelish ajoute que, bien qu’étant elle-même de nationalité française et ayant vécu à l’étranger, elle peine, comme tous les observateurs extérieurs, à comprendre les liens entre institut culturels, alliances françaises et autres lycées français… Ces derniers, en tout cas, jouissent d’une excellente réputation.
La réunion est levée à 12 heures 50.
Compte rendu de l’audition de M. Christian Masset,
directeur général de la mondialisation, du développement et des partenariats
au ministère des Affaires étrangères et européennes
accompagné de M. Yves Carmona,
directeur adjoint de la politique culturelle et du français
(Mardi 30 juin 2009 − 33, rue Saint-Dominique – salle 4211)
La réunion est ouverte à 15 heures 15.
• Présents
M. François Rochebloine, Président
Mme Geneviève Colot, Rapporteur
• Excusés
Mme Martine Aurillac, MM. Jean-Louis Bianco, Philippe Cochet, Jean-Pierre Dufau, Jean-Michel Ferrand, Jean-Claude Guibal, Jean-Pierre Kucheida, Robert Lecou, Didier Mathus, Jacques Remiller et André Schneider.
*
M. François Rochebloine, Président, accueille le directeur général en rappelant le contexte de la mission et la nomination récente de M. Masset à ce poste de directeur général de la mondialisation, du développement et des partenariats créé à l’occasion de la refonte de l’administration centrale du Quai d’Orsay opérée par le décret du 19 mars 2009, qui supprime en particulier la DGCID. Il lui demande de faire le point sur la réforme du réseau de l’action culturelle extérieure d’une part, et sur l’avenir de l’enseignement français à l’étranger d’autre part.
M. Christian Masset, directeur général de la mondialisation, du développement et des partenariats, présente sa direction comme l’une des trois grandes directions générales du ministère des Affaires étrangères et européennes, en charge des « sujets globaux », qui sont aussi des sujets de société : la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, la crise économique et financière, les négociations globales dans le cadre du G8 et du G20, la Convention UNESCO… sont autant de questions globales qui touchent directement le citoyen − à la différence des sujets diplomatiques « classiques » comme le traitement de crises régionales.
Or le Parlement se trouve précisément à la charnière entre sujets politiques et sujets de société. Le contact avec le Parlement, pour cette nouvelle direction générale, est donc très important, à la fois pour informer les parlementaires et pour recevoir les messages qu’ils ont à faire passer.
S’agissant du thème de la culture lato sensu, jamais il n’a été aussi fondamental qu’aujourd’hui. Il existe des liens entre crise alimentaire, énergétique, économique et financière etc., qui conduisent tout un chacun à s’interroger sur son identité, ses racines. Il est symptomatique à cet égard qu’en France, la culture soit le seul secteur qui échappe à la crise ! Les entrées au cinéma ou dans les musées progressent.
La fonction de directeur général de la mondialisation, à travers le rôle de sous-sherpa pour le G8 et le G20, est un poste d’observation privilégié pour réaliser que les cartes sont actuellement rebattues entre pays « du Nord » et pays émergents : les premiers sont à l’origine de la crise, de sorte que les seconds proclament qu’ils ne veulent pas forcément reproduire les mêmes valeurs mais bien plutôt réaffirmer leur propre modèle.
L’histoire a vu passer le monde d’un système bipolaire à un système unipolaire − dominé par les seuls États-Unis − puis à un système multipolaire. Mais cette multipolarité sera-t-elle harmonieuse ou conflictuelle ? La culture fait partie de la solution. Et la création de la direction générale de la mondialisation est née de cette réflexion.
À la question de M. François Rochebloine, Président, sur ce que cette direction générale va changer par rapport à l’organisation précédente, M. Christian Masset répond que, sans changer le monde, cette direction générale va y apporter sa petite pierre.
Il existe un lien entre culture, patrimoine et développement, identité (cf. l’Irak) et économie (cf. l’existence d’une industrie culturelle) ; il existe un lien entre l’aspiration à un monde multipolaire mieux régulé, plus solidaire, et notre action de développement. Ainsi, dans certains pays africains, le centre culturel français ou la médiathèque est le seul lieu de savoir disponible. Autre exemple : les saisons culturelles qui sont organisées régulièrement − la saison de la Turquie étant lancée ce 30 juin.
M. François Rochebloine, Président, demande des précisions sur cette saison, à la lumière de l’expérience récente de l’année de l’Arménie.
M. Christian Masset indique que, ouverte cet après-midi même, la saison de la Turquie en France courra jusqu’en mars 2010. Elle verra se conjuguer manifestations culturelles, débats d’idées ou encore actions de coopération universitaire et éducative. À titre d’illustration, une initiative comme l’année du Brésil en France en 2005 a représenté un total de 450 manifestations : théâtre, colloques de chefs d’entreprise, rencontre sur la prévention routière, échanges scientifiques, échanges entre étudiants. Ce fut un grand succès, avec 15 millions de participants à l’ensemble de ces manifestations.
L’année de la France au Brésil qui a commencé ce printemps s’annonce également comme un grand succès. La dimension économique n’est pas absente, comme en témoigne l’implication du Président du directoire d’Axa en tant que président, côté français, de la saison turque. Une société est mise en contact avec une autre ; c’est aussi l’occasion de diffuser dans une société étrangère des références françaises.
Il s’agit, à travers ce type d’événements, de créer un « appétit pour la culture française », en Russie (années croisées en 2010), en Chine ou au Brésil, mais ce mouvement s’élargit aussi aux étudiants ou aux chercheurs.
M. François Rochebloine, Président, salue cette vision idyllique mais s’interroge sur les moyens disponibles pour la concrétiser.
M. Christian Masset répond que deux éléments sont indissociables. Il faut tout d’abord de vrais objectifs dans la démarche : il ne s’agit pas de proclamer, par exemple, le génie de Voltaire mais bien davantage de donner une vision de notre pays comme susceptible d’apporter des solutions alternatives à celles qu’offrent les États-Unis ou le Japon, grâce à ses entreprises, notamment de technologies propres, sa politique de formation, sa culture…
Deuxièmement, il faut des moyens, à l’instar de ceux que le Royaume-Uni donne au British Council.
M. François Rochebloine, Président, demande si cette vision est « seulement » française ou élargie à l’échelle de l’Union européenne.
M. Christian Masset précise que la culture est aujourd’hui et va demeurer une compétence nationale, même s’il existe des programmes communautaires dans ce domaine, à l’exemple de Media − la France étant d’ailleurs motrice dans ce cadre. On ne peut donc pas mettre sur le même plan la coordination entre États membres de l’UE face à la crise financière et le domaine de la culture.
Cependant toute coordination n’est pas absente, à l’exemple de celle qui s’est fait jour à l’échelle mondiale pour préserver le particularisme des échanges commerciaux de type culturel.
M. François Rochebloine, Président, prend l’exemple du centre culturel de Ramallah pour illustrer l’idée de coopération européenne en matière culturelle.
M. Christian Masset approuve et prolonge cette idée avec les actions projetées au titre du volet culturel de l’Union pour la Méditerranée ou encore avec les centres culturels communs à plusieurs États membres, comme la France et l’Allemagne à Moscou.
L’important est de s’appuyer sur une vision politique, fût-elle un peu « stratosphérique », pour décliner ensuite cette vision avec des instruments − de trois types dans le cas français : services de coopération et d’action culturelle (SCAC) de nos ambassades, centres et instituts culturels, et enfin dispositifs de coopération et de développement.
S’agissant de la réforme en cours au Quai d’Orsay dans ce domaine, on peut la décrire en trois actes. L’acte I a été la création de la direction générale de la mondialisation il y a cent jours.
L’acte II consiste à bâtir ou à réformer des opérateurs forts sur le terrain : l’Agence française de développement avec sa double tutelle − Bercy et le Quai d’Orsay −, CulturesFrance qui doit être transformée en EPIC, CampusFrance qui doit obtenir le même statut en fusionnant avec l’association Egide et le GIP France coopération internationale, et enfin l’AEFE, à statut inchangé.
L’acte III, c’est la réforme du réseau, qui regroupe acteurs étatiques et Alliances françaises. Nous les concevons comme un réseau unique bien qu’il faille absolument préserver la distinction entre ces deux catégories et donc maintenir l’originalité du statut des Alliances.
« L’acte III, scène 1 » recouvre la création, pour mutualiser les moyens disponibles, d’un seul établissement à autonomie financière par pays, structure juridique de regroupement des SCAC et des instituts culturels, même si, physiquement, les murs demeurent en l’état. L’autonomie financière permet de nouer des partenariats, de trouver des recettes nouvelles, de bénéficier d’une souplesse de gestion.
« L’acte III, scène 2 » concerne la gestion des ressources humaines : amélioration de la formation, amélioration de la sélection, meilleurs profils de carrière. La richesse actuelle du réseau étant la diversité des profils professionnels qui le composent (enseignants, diplomates, etc.), il faut désormais offrir à ces personnes de réelles perspectives.
Par ailleurs, dans chaque pays, il convient de se demander quelle est la meilleure configuration du réseau, à traduire ensuite dans un plan de reconfiguration comme en Italie ou en Allemagne. Enfin, l’ensemble est sous-tendu par des moyens financiers nouveaux : 20 millions d’euros ont été obtenus sur la gestion 2009 et 20 millions d’euros supplémentaires sont demandés pour 2010. M. Bernard Kouchner a inversé la tendance en matière de crédits ; l’aide des parlementaires sera précieuse pour le vote du budget.
M. François Rochebloine, Président, observe que la marge de manœuvre des parlementaires, surtout en matière budgétaire, est réduite. En matière d’audiovisuel extérieur, quel avenir pour TV5 Monde et France 24 ? Que cette dernière chaîne ne soit, bien souvent, pas disponible en français à l’étranger pose un réel problème.
M. Christian Masset fait valoir que la tutelle de l’audiovisuel extérieur a été transférée à la direction du développement des médias du ministère de la Culture et de la communication. France 24 est un très bon produit, qui pâtit certes d’un problème de couverture.
La réflexion est en cours sur le redéploiement des moyens disponibles, par exemple à Radio France internationale (RFI) : certaines langues de diffusion disparaissent, d’autres sont introduites. Il faut évoluer. Il en va de même pour le réseau des centres culturels : des ouvertures ont lieu presque chaque mois en Chine, tandis que l’on en ferme ailleurs.
M. Yvan Carmona précise que la nouvelle direction en charge de l’audiovisuel extérieur a procédé à des études dont les résultats sont très clairs à propos de RFI, qui soulignent les besoins de redéploiements entre langues et zones géographiques, ainsi que la nécessité de renouveler des programmes parfois inchangés depuis de très longues années.
Même dans les pays peu développés, nous sommes à l’ère de l’Internet et non plus de la radio à ondes courtes. L’État consacre tout de même quelque 300 millions d’euros chaque année à cette politique.
M. François Rochebloine, Président, reconnaît que la problématique des moyens se pose pour n’importe quel État mais observe que les syndicats concernés n’ont pas le même discours sur RFI.
Mme Geneviève Colot, Rapporteur, souhaite savoir si la fusion du réseau culturel avec celui des Alliances françaises est envisageable dans certains pays.
M. Christian Masset répond que c’est juridiquement impossible en l’état, du fait du statut des Alliances françaises. Et politiquement, ce n’est pas souhaitable. Il convient toutefois d’éviter autant que possible les doublons. Un accord avec la Fondation Alliance française existe sur ce point et l’on ne compte que trois cas dans le monde de double implantation.
De plus en plus d’instituts culturels sont transformés en Alliances, en Europe en particulier. Le double réseau n’est pas un handicap ; l’harmonisation progresse, par exemple lorsqu’un directeur d’Alliance est aussi directeur adjoint du centre culturel. Sur les quelque 1 000 Alliances de par le monde, 300 environ sont conventionnées mais demeurent indépendantes.
Un exemple de la force de cette complémentarité : l’ambassadeur du Royaume-Uni en Birmanie a reconnu que dans ce pays c’est l’influence française qui était la plus forte, grâce à la présence de l’Alliance.
D’une façon générale, il faut rappeler que le réseau culturel de la France à l’étranger représente, crédits de personnel inclus, un coût de 140 millions d’euros par an, dont 40 millions d’euros pour le réseau des Alliances françaises ; ce total équivaut au budget annuel de l’Opéra de Paris.
De surcroît, l’effet de levier de cette somme est de 10 pour 1, grâce aux divers cofinancements levés. Enfin, la récente création d’une mission du réseau au sein de la direction générale de la mondialisation témoigne de la ferme volonté de conclure avec chaque institut français, sous trois ans, un contrat d’objectifs et de moyens.
M. François Rochebloine, Président, interroge le directeur général sur l’avenir de la Villa Médicis.
M. Christian Masset rappelle que la Villa a deux missions : l’accueil des pensionnaires et le rayonnement culturel de la France. La première mission ne se justifie plus − M. François Rochebloine, Président, objecte que ce jugement est sévère −, en tout cas à Rome bien moins qu’à New York ou à Berlin. Si Rome était le entre des arts lors de la création de la Villa Médicis en 1630, tel n’est plus le cas aujourd’hui.
M. Christian Masset tombe d’accord avec le Président François Rochebloine pour estimer que le possibilités de « délocalisation » de la Villa existent. Quant à la seconde mission, utilisant Rome comme lieu de rayonnement, de vitrine du monde, à l’évidence elle demeure, comme l’avait parfaitement compris M. Frédéric Mitterrand… sur une idée initiale de son prédécesseur, M. Richard Peduzzi, précise le Président François Rochebloine.
Abordant enfin le thème de l’avenir des lycées français, M. Christian Masset estime qu’il s’agit du plus grand atout de la France : à travers ce réseau, on investit à un horizon de trente ans sur des élites qui toute leur vie garderont un lien avec notre pays. Ce réseau doit être préservé et dans le même temps, faire face à une demande croissante.
Il est aujourd’hui confronté à trois chocs : tout d’abord l’augmentation des élèves accueillis, au rythme de 5 000 par an, du fait de l’attrait exercé par un système d’enseignement à l’étranger unifié, unique au monde, jouissant d’un vrai label de qualité. Le deuxième choc est celui de la prise en charge progressive de la scolarité des élèves français à l’étranger, élément de déstabilisation considérable qu’il est très pertinent de vouloir limiter aux seules classes de lycée.
M. François Rochebloine, Président, rappelle l’adoption à l’unanimité de la commission des Affaires étrangères et le rejet en séance publique − sur demande du Gouvernement − d’un amendement au projet de loi de finances pour 2009 déposé conjointement avec Mme Colot, qui instaurait un double plafonnement de la prise en charge : en fonction des revenus des parents et en fonction du montant des écolages. Un déplacement à Dakar à l’automne 2008 a également permis de recueillir des témoignages de parents d’élèves attestant la réalité des effets d’aubaine et d’éviction de la mesure, dénoncés dans maints rapports parlementaires.
M. Christian Masset reconnaît qu’il s’agit d’un vrai sujet de préoccupation : on se prive en effet de l’accueil des élites du pays d’accueil ou des étrangers tiers, alors que les efforts devraient plutôt aller dans le sens d’une amélioration de leur accueil, depuis la délivrance des visas jusqu’à leur accueil en France pour la suite de leurs études.
Le troisième choc pour le réseau des lycées français est celui des moyens financiers, c’est-à-dire celui de l’absence de moyens supplémentaires au moment même où la demande croît très fortement et où les locaux et équipements sont trop vétustes.
L’AEFE doit fait face à ce triple choc ; les États généraux sur l’avenir de l’enseignement français à l’étranger ont permis d’en prendre la mesure. Dans les six mois à venir, cette réflexion doit aboutir à un plan d’orientation stratégique 2010-2012 pour l’Agence, destiné à se transformer en contrat d’objectifs et de moyens (qui couvre aussi le nombre et l’évolution des emplois d’expatriés et de recrutés locaux, à côté des moyens de fonctionnement). La clôture des États généraux cet automne sera l’occasion d’une grande opération de communication qui sera mise à profit pour présenter le plan d’orientation stratégique.
À la remarque du Président François Rochebloine sur la faiblesse alarmante du fonds de roulement de l’AEFE, M. Christian Masset acquiesce et indique travailler à l’obtention de 8 millions d’euros d’augmentation du fonds de roulement pour 2010.
Par ailleurs, est envisagée la création d’une quatrième catégorie d’établissements au sein du réseau des lycées français (à côté des établissements en gestion directe, conventionnés et homologués), sous forme de sections bilingues intégrées à l’enseignement local − du type des classes européennes en France −, qui bénéficieraient du « label » de l’enseignement français à l’étranger.
La réunion est levée à 16 heures 30.
Compte rendu de l’audition de M. Jean-Pierre de Launoit,
Président de la Fondation Alliance française
accompagné de M. Gérald Candelle,
responsable des zones Asie/Océanie/États-Unis et du recrutement
(Mardi 30 juin 2009 − 33, rue Saint-Dominique – salle 4211)
La réunion est ouverte à 16 heures 30.
• Présents
M. François Rochebloine, Président
Mme Geneviève Colot, Rapporteur
Mme Martine Aurillac, MM. Jean-Louis Bianco et Didier Mathus.
• Excusés
MM. Philippe Cochet, Jean-Pierre Dufau, Jean-Michel Ferrand, Jean-Claude Guibal, Jean-Pierre Kucheida, Robert Lecou, Jacques Remiller et André Schneider.
*
M. François Rochebloine, Président, accueille le Président de Launoit et lui donne la parole pour une intervention liminaire.
M. Jean-Pierre de Launoit, Président de la Fondation Alliance française, rappelle qu’en 2008 a été célébré le 125e anniversaire de l’Alliance française, créée en 1883 au 215, bd Saint-Germain à Paris, sur l’initiative de personnalités telles que Ferdinand de Lesseps, Hippolyte Taine ou Ernest Renan, tous peinés de la perte d’influence de la France dans la foulée de la défaite de Sedan. Dès 1893, des Alliances étaient implantées sur tous les continents ; elles sont aujourd’hui au nombre de 1 040, de toutes tailles, réparties dans 133 pays.
Elles accueillent un peu plus de 492 000 « apprenants », c’est-à-dire non seulement des étudiants mais aussi des adultes. Le cap des 500 000 sera atteint en 2009, le rythme de croissance de ce « public » étant de l’ordre de 3 % par an. Au total, ce sont quelque 6 millions de personnes dans le monde qui sont concernées par les activités culturelles proposées par les Alliances. On peut noter que l’Europe, où le public tendait à diminuer ces dernières années, connaît un regain d’intérêt pour les Alliances, notamment en Italie, aux Pays-Bas et en Belgique.
À la question du Président François Rochebloine sur la raison de ce nouvel engouement, M. Gérald Candelle, responsable du recrutement à la Fondation Alliance française, répond que d’importants progrès ont été accomplis dans la formation des personnels, dans le contenu et la qualité des enseignements et activités proposés, ainsi qu’en termes de « marketing » (sic) pour rendre « l’offre » plus visible.
M. Jean-Pierre de Launoit poursuit en indiquant que des ouvertures d’Alliances sont projetées à Stockholm, Luxembourg et Edimbourg, pour répondre en fait à des sollicitations du quai d’Orsay afin de parfaire l’harmonie entre réseau des Alliances et réseau culturel français à l’étranger. L’Amérique latine conserve quant à elle son statut de « vaisseau amiral » du réseau, et a même enregistré récemment une demande émanant… de Mme le maire de l’Île de Pâques. Mentionnons également l’Alliance de Cuba ou encore les superbes bâtiments des Alliances établies en Amérique du Nord.
En Asie, le réseau continue à se développer : l’Alliance de Pékin fête son dixième anniversaire et la Chine compte à ce jour 14 Alliances, dont deux sont récentes. L’Afrique représente un enjeu considérable. Comme l’a souligné M. Jacques Attali, sa population va doubler en l’espace de 30 ans. On y recense 76 000 étudiants répartis dans 39 pays (une Alliance par pays) et des États généraux des Alliances en Afrique sont d’ailleurs prévus pour la deuxième quinzaine de novembre.
Le réseau des Alliances promeut des valeurs. L’enseignement des langues comprend aussi des cours dans la ou les langue(s) du pays d’implantation, par exemple le berbère à Essaouira. La diffusion d’une culture, le souci de l’excellence et le développement d’un réel savoir-faire font aussi partie des valeurs du réseau. Enfin, il existe une solidarité entre Alliances : typiquement, New York aide Ushuaïa.
M. François Rochebloine, Président, souhaite connaître la part, dans le budget des Alliances, des subventions reçues du gouvernement français.
M. Jean-Pierre de Launoit indique que le chiffre d’affaires de l’ensemble des Alliances représente 160 millions d’euros, le chiffre d’affaires de la Fondation s’élevant à 2,5 millions d’euros. La Fondation perçoit une subvention de 41 millions d’euros.
M. Gérald Candelle précise que 281 Alliances sur 1 040 sont conventionnées avec le ministère des Affaires étrangères et européennes, la masse salariale des personnels détachés dans ce cadre se montant à 30 millions d’euros. À ce chiffre s’ajoutent, en toute rigueur, des moyens qui sont, dans les faits, fondus dans le budget des services de coopération et d’action culturelle (SCAC) des ambassades.
M. Jean-Pierre de Launoit conclut en soulignant que la convention précitée entre le Quai d’Orsay et la Fondation prévoit, s’agissant des 234 personnels détachés, une désignation d’un commun accord par les deux parties.
Mme Martine Aurillac demande comment se financent les Alliances non conventionnées.
Prolongeant le propos de Mme Geneviève Colot, Rapporteur, qui évoque l’autofinancement via les cours de langue, les manifestations culturelles, le mécénat etc., M. Jean-Pierre de Launoit précise que la Cour des comptes a récemment calculé un taux global d’autofinancement de 76 % – l’objectif étant de 100 %.
M. Jean-Pierre de Launoit poursuit en dressant un premier bilan du fonctionnement de la Fondation Alliance française, créée en 2007 dans le but de décharger l’Alliance française de Paris de la fonction de coordination du réseau qui passait régulièrement au second plan dans les conseils d’administration, accaparés par les difficultés financières chroniques de l’école de langue créée 35 ans après l’Alliance de Paris.
Aujourd’hui l’école est nettement séparée et connaît des résultats financiers bénéficiaires tout en se développant, par exemple via la création de cours d’alphabétisation pour des manœuvres étrangers. La Fondation, reconnue d’utilité publique, joue un rôle de « plaque tournante » et apporte son soutien au réseau – elle n’exerce pas de pilotage. Jouissant d’un parrainage brillant – le Conseil d’administration comprend des personnalités comme Mme Hélène Carrère d’Encausse ou M. Abdou Diouf –, la Fondation organise un colloque annuel qui réunit plus de 600 participants. En 2009, ceux-ci provenaient de 88 pays, et parmi les intervenants on a remarqué M. Valéry Giscard d’Estaing, M. Hubert Védrine et M. Bertrand Delanoë.
Les partenariats noués par la Fondation impliquent 8 500 bénévoles de par le monde et des entreprises dans tous les pays d’implantation, pour un résultat tangible : la multiplication de la subvention versée par le ministère des Affaires étrangères et européennes par un facteur 4 ou 5. D’autres partenariats existent avec TV5 Monde (une nouvelle série d’émissions est en préparation), avec l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) pour un montant annuel d’1 million d’euros (l’Alliance française de Bruxelles-Europe est ici pilote), avec la mairie de Paris enfin (une nouvelle convention sera signée début septembre).
En ces temps de crise, la culture fait figure de valeur refuge. Le Sommet de l’OIF tenu à Québec en octobre 2008, qui réunissait 55 chefs d’État – et auquel participait le Président de la Fondation Alliance française – a démontré que la culture échappait à une crise économique et financière déjà bien présente alors.
Par ailleurs, les jeunes refusent l’uniformisation que la mondialisation voudrait leur imposer. « La fraternité d’esprit et le pas vers l’autre », telle pourrait être la devise des Alliances françaises. La culture ne saurait devenir une marchandise. À cet égard, on ne peut que se réjouir de la signature en 2005 de la convention de l’UNESCO sur la diversité culturelle. Nous avons besoin d’un monde unifié dans la diversité.
M. François Rochebloine, Président, demande quelle part la Fondation a prise à la réflexion sur la réforme de l’action culturelle extérieure.
M. Jean-Pierre de Launoit indique que trois invitations à participer à des réunions de travail ont été reçues, et honorées à deux reprises par M. Jean-Claude Jacq, secrétaire général de la Fondation. Une note a par ailleurs été transmise au ministère des Affaires étrangères et européennes. La Fondation est tout à fait disposée à prêter son concours au développement du réseau d’action culturelle.
En réponse à une intervention du Président de la Fondation au Conseil économique, social et environnemental il y a quelques mois, M. Luc Ferry avait déploré l’insuffisante unité de l’action culturelle extérieure de la France, regrettant aussi que nous n’ayons plus d’André Malraux… Les 8 500 bénévoles des Alliances œuvrent de leur mieux partout où ils se trouvent.
Mais une chose est claire : la Fondation tient absolument à éviter toute confusion entre le réseau des Alliances françaises et celui des nouveaux Instituts français, y compris toute éventuelle confusion dans la dénomination des entités du réseau.
Quoi qu’il en soit, les contours exacts des nouvelles entités à mettre en place demeurent flous et beaucoup de questions restent sans réponse, y compris après un entretien avec M. Christian Masset, directeur général de la mondialisation, du développement et des partenariats.
À la question du Président François Rochebloine quant au souhait des Alliances de participer activement au rayonnement de la culture française dans le monde, M. Jean-Pierre de Launoit répond par l’affirmative.
Mme Martine Aurillac demande, d’une part, dans quelle région du monde la culture française est la plus vivante et la plus dynamique, et d’autre part, quels sont les moyens dont disposent les Alliances, le cas échéant, pour promouvoir l’audiovisuel extérieur de la France.
M. Jean-Pierre de Launoit indique que des liens existent avec TV5 Monde, avec Radio France internationale (RFI) et avec Canal Académie, émanation de l’Institut de France.
S’agissant des Alliances les plus « performantes », M. Gérald Candelle cite celle de Lima, qui comprend sept implantations et accueille 12 000 apprenants, celle de Bogota avec 11 000 apprenants, celle de Paris avec 10 300 apprenants, celle de New York avec 9 000 apprenants et celle de Hong Kong avec 7 000 apprenants. Se vérifie une nouvelle fois la « francophilie héréditaire » de l’Amérique latine. L’Argentine est toutefois absente du palmarès, ayant beaucoup souffert de la crise de la fin des années 1990. Le nombre d’apprenants y est tombé à 5 800 aujourd’hui.
En Afrique, la première place est détenue par Madagascar avec près de 7 000 apprenants ; sur le continent lui-même, on trouve Nairobi et Lagos mais qui ne figurent pas parmi les « grandes » Alliances. Par ailleurs, au-delà de leurs propres cours, les Alliances développent la promotion des études en France.
Mme Geneviève Colot, Rapporteur, demande quelles relations le réseau des Alliances entretient avec le réseau culturel français à l’étranger et quelle est l’évolution de ces relations. Par ailleurs, quels enseignements peut-on tirer de l’action du British Council ou du Goethe Institut ?
M. Jean-Pierre de Launoit souligne que la philosophie de l’Alliance française consiste à faire appel à des étrangers, résidents du lieu d’implantation, pour présider les associations que sont les Alliances. C’est une caractéristique unique au monde. Les relations avec les autres réseaux sont excellentes ; par exemple, des colocalisations avec le Goethe Institut existent à Glasgow, à Lahore ou à Santa Cruz. En octobre 2005 à Oviedo, l’Alliance française a reçu le prestigieux Prix Prince des Asturies dans la catégorie Communication et humanités, conjointement avec cinq autres institutions (British Council, Goethe Institut, Instituto Cervantes, Società Dante Alighieri et Instituto Camões).
Tous ces organismes ne sont toutefois pas directement comparables. Ainsi, le British Council est une association qui reçoit ses moyens de financement du ministère du Budget, ce qui est très différent du cas de la plupart des Alliances françaises.
Les relations avec le réseau culturel français sont très bonnes ; en particulier, d’excellentes relations personnelles ont été nouées. Dans l’ensemble, le réseau des Alliances se sent soutenu et compris. M. Gérald Candelle souscrit à cette appréciation générale très positive mais souligne qu’il existe parfois une mauvaise compréhension du statut associatif des Alliances, qui se traduit par une attention insuffisante portée au Président du Conseil d’administration et une trop grande place faite au directeur de l’Alliance, personnel détaché.
M. Jean-Pierre de Launoit évoque également l’Alliance française de Belgique qu’il préside et les mouvements de personnel qu’elle doit subir de la part du gouvernement français : les trois postes pourvus par des détachés changent de titulaire en même temps, il se pourrait que seul l’un des trois soit remplacé et de surcroît, l’ambassadeur, le conseiller culturel et l’attaché culturel quittent concomitamment leur poste…
M. Didier Mathus demande si l’on constate au fil du temps une évolution de la « clientèle » des Alliances.
M. Jean-Pierre de Launoit fait valoir que les Alliances tentent de répondre à une demande mouvante en apprenant à penser, ce qui va au-delà de l’apprentissage des règles de grammaire, et ce qui est une originalité par rapport à d’autres écoles de langue. M. Gérald Candelle note que les besoins exprimés aujourd’hui sont de plus en plus « opérationnels », ce qui marque une prise de distance avec la « transmission héréditaire » de la langue.
À titre d’exemple, à Bogota, 40 % des étudiants sont des candidats à l’émigration vers le Québec, dont les autorités conseillent de suivre les cours de l’Alliance en raison de leur qualité. Citons encore les cours aux employés de Carrefour ou du groupe Accor de par le monde, ou enfin le souhait de pouvoir commercer avec l’Afrique francophone lorsque l’on est entrepreneur en Afrique du Sud ou en Chine. Le directeur d’une Alliance est presque désormais un chef de PME, qui doit prêter attention au « marketing », à ses coûts, à sa gestion des ressources humaines etc.
M. François Rochebloine, Président, souhaite savoir comment se crée une Alliance française, ce à quoi M. Jean-Pierre de Launoit répond que les trois étapes sont les suivantes : initiative locale, validation par la Fondation et accord donné par le ministère des Affaires étrangères et européennes.
La réunion est levée à 17 heures 15.
Compte rendu de l’audition de M. Yves Aubin de la Messuzière,
ancien président de la Commission pour l’avenir de l’enseignement français à l’étranger
(Mardi 30 juin 2009 − 33, rue Saint-Dominique – salle 4211)
La réunion est ouverte à 17 heures 15.
• Présents
M. François Rochebloine, Président
Mme Geneviève Colot, Rapporteur
Mme Martine Aurillac, MM. Jean-Claude Guibal et André Schneider
• Excusés
MM. Jean-Louis Bianco, Philippe Cochet, Jean-Pierre Dufau, Jean-Michel Ferrand, Jean-Pierre Kucheida, Robert Lecou, Didier Mathus et Jacques Remiller.
*
M. François Rochebloine, Président, accueille M. Aubin de la Messuzière et lui donne la parole en tant qu’ancien président de la Commission pour l’avenir de l’enseignement français à l’étranger, non sans rappeler que les fonctions qu’il a précédemment exercées lui permettront également de livrer son point de vue sur la réforme du réseau culturel et l’audiovisuel extérieur de la France.
M. Yves Aubin de la Messuzière rappelle que, comme président de la Commission pour l’avenir de l’enseignement français à l’étranger, sa lettre de mission reçue de M. Bernard Kouchner, s’appuyant sur celle que le ministre avait lui-même reçue du Président de la République et du Premier ministre, prévoyait un renforcement du réseau d’enseignement français à l’étranger. La Commission s’est réunie dans le contexte d’une demande en très forte croissance, avec chaque année plus de 5 000 inscriptions nouvelles souhaitées par des ressortissants français (7 000 en 2008), une forte attractivité de ce réseau pour les ressortissants étrangers et enfin la situation créée par l’annonce et le début de mise en œuvre de la prise en charge des frais de scolarité pour les élèves français.
Réunis en septembre 2008, les « États généraux de l’enseignement français à l’étranger » ont abouti à la validation des 30 recommandations formulées par la Commission en juillet, et à l’organisation d’une consultation des postes diplomatiques. D’après les récentes annonces ministérielles, un nouveau forum se tiendrait à l’automne prochain pour faire le point sur ce dossier.
À la demande du Président François Rochebloine portant sur le nombre de recommandations appliquées, M. Yves Aubin de la Messuzière répond que la suite de son propos va permettre d’en juger. Certaines recommandations sont en cours d’application et une fois n’est pas coutume, le rapport n’a pas fini au fond d’un tiroir. M. Bernard Kouchner a lui-même annoncé lors d’une récente audition à l’Assemblée nationale un moratoire sur la prise en charge des frais de scolarité des enfants français, une annonce reprise dans la presse.
Mais à propos de moratoire, le report d’application du décret de décembre 2007 mettant à la charge de l’AEFE les cotisations sociales des personnels qui lui sont détachés n’a pas duré plus d’un an, ce qui est regrettable.
Le Président François Rochebloine indique que les parlementaires sont vainement intervenus pour obtenir un report plus long, voire pérenne.
Pour M. Yves Aubin de la Messuzière, il y a un paradoxe à évoquer si souvent le réseau des lycées français à l’étranger mais si peu sous l’angle du rayonnement de la France. Or le contexte est également celui de la concurrence avec le réseau scolaire britannique ou celui des États-Unis.
Enfin, la RGPP « frappe de nouveau », et comme le montrent des témoignages reçus en Tunisie il y a une dizaine de jours, le nombre d’enseignants expatriés baisse du fait de cette contrainte budgétaire et la qualité de l’enseignement s’en ressent.
La mesure de gratuité de la scolarité pour les élèves français à l’étranger est généreuse dans son principe, égalitaire ; mais elle pose des problèmes d’équité. On a ainsi constaté, à l’occasion des demandes de remboursement d’écolages, que des familles londoniennes déclaraient 500 000 voire 1 million d’euros de revenu annuel, souvent non soumis à l’impôt français.
Se pose également le problème, à l’égard des ressortissants étrangers, de leur éviction tout d’abord, mais aussi de la charge croissante que représentent pour eux les écolages alors même que les élèves jouissant de la double nationalité ne paient plus. Une telle situation sur le territoire de l’Union européenne comporte en germe un fort risque contentieux devant la Cour de justice des Communautés européennes, sur le fondement de la non-discrimination.
S’ajoute à cela le désengagement financier des entreprises qui naguère prenaient en charge les frais de scolarité ; le Cercle Magellan, dont les représentants ont été entendus par la Commission pour l’avenir de l’enseignement français à l’étranger, n’était pourtant pas demandeur d’une réforme. Cela étant, il faut se réjouir de l’afflux de demandes d’inscription, y compris de la part des binationaux. Mais cela nécessitera d’augmenter la capacité physique d’accueil des établissements.
En outre, des moyens budgétaires nouveaux sont nécessaires pour augmenter le volume des bourses, toujours sur le terrain de l’équité. En effet, comment ne pas voir que la gratuité octroyée à un ménage aisé accroît mécaniquement la demande de bourse de la part de leur employé de maison qui, ayant ses enfants inscrits dans le même établissement, devrait acquitter les écolages ?
Le Livre blanc sur l’avenir de la politique étrangère et européenne de la France demandait à ce que l’on revienne sur la mesure de gratuité ; le rapport de la Commission pour l’avenir de l’enseignement français à l’étranger n’a pas demandé de suppression mais plaidé pour un accompagnement de la mesure, un plafonnement, pour éviter par exemple l’envolée des droits de scolarité à New York.
M. François Rochebloine, Président, déclare partager entièrement cette analyse. Il rappelle l’adoption à l’unanimité de la commission des Affaires étrangères et le rejet en séance publique − sur demande du Gouvernement − d’un amendement au projet de loi de finances pour 2009 déposé conjointement avec Mme Colot, qui instaurait un double plafonnement de la prise en charge : en fonction des revenus des parents et en fonction du montant des écolages.
Un déplacement à Dakar à l’automne 2008 a également permis de recueillir des témoignages de parents d’élèves attestant la réalité des effets d’aubaine et d’éviction de la mesure, dénoncés dans maints rapports parlementaires. La mesure est généreuse mais n’a pas été réfléchie. Le nombre de demandes d’inscription augmente fortement alors même que le fonds de roulement de l’AEFE est historiquement bas − 13 jours, contre deux mois il y a quelques années seulement.
S’y ajoute le problème de la vétusté du parc immobilier scolaire, comme par exemple au lycée français de Vienne. Cette situation est grave pour le rayonnement de la France. Quelles préconisations peut-on formuler aujourd’hui ?
Revenant sur l’annonce d’un moratoire de la prise en charge complète, M. Yves Aubin de la Messuzière estime qu’une telle réponse n’a pas de sens. En effet, le Président de la République a d’ores et déjà annoncé que la prise en charge se poursuivrait jusqu’à la maternelle. En outre, il serait aberrant de cantonner la gratuité à la scolarité non obligatoire (au-delà de 16 ans) et à maintenir une scolarité obligatoire payante.
La solution consiste sans doute à étendre la prise en charge jusqu’à la maternelle mais en l’encadrant pour que son application soit à peu près équivalente au système des bourses. Le chiffrage fourni à la Commission de la mesure appliquée jusqu’à son terme représentait initialement 350 millions d’euros ; il semble que le coût actualisé avoisine 600 millions d’euros. À l’évidence, il faut un double plafonnement (revenus et écolages). Il faut également que les parlementaires réaffirment que ce réseau est pour la France un outil d’influence. L’attribution en 2008 du Prix Goncourt à M. Atiq Rahimi l’a démontré une fois encore.
À l’observation du Président François Rochebloine sur le peu de soutien reçu du Quai d’Orsay dans la lutte pour l’encadrement de la mesure, M. Yves Aubin de la Messuzière répond que le ministre est personnellement convaincu et s’efforce de convaincre le Président de la République. Hélas, ce dernier réaffirme son engagement auprès de la communauté française expatriée à chacun de ses déplacements. On ne lui a sans doute pas suffisamment expliqué le rôle du réseau des lycées comme outil d’influence. En effet, dans ses discours le Président insiste toujours sur la qualité de l’enseignement due à nos compatriotes de l’étranger, alors même que seul un tiers des élèves français, en moyenne, fréquente le réseau.
Sollicité par le Président François Rochebloine quant au montant d’un éventuel plafonnement, M. Yves Aubin de la Messuzière indique le chiffre de 150 000 euros de revenus annuels et, pour les frais de scolarité, un plafond variable selon les établissements, compte tenu de la grande disparité des écolages.
Selon M. Jean-Claude Guibal, c’est le principe même de la mesure qui est pervers : plus elle fonctionne et plus elle coûte cher. C’est devenu un tabou à briser, mais pourquoi ne pas contourner la difficulté en demandant par exemple aux entreprises de prendre en charge les écolages, ce qui permettrait de respecter en apparence la parole présidentielle ?
M. André Schneider estime que l’enseignement français à l’étranger recouvre trois réalités distinctes. Tout d’abord un enseignement « obligatoire » dû aux enfants des fonctionnaires expatriés − la gratuité ne pose alors aucun problème de principe. Ensuite le cas des expatriés par choix − la question se pose alors de la même façon que pour le financement de l’enseignement privé en France métropolitaine : que le système soit payant va de soi. Enfin l’enseignement français à l’étranger est aussi une vitrine pour notre pays − pour les élèves concernés, une prise en charge partielle, modulée selon les pays, est la solution.
Le contexte est celui du déclin relatif de la francophonie dans le monde. Dans le même temps, l’enseignement français à l’étranger est aussi un nouveau levier d’influence française là où cette influence est menacée, comme par exemple en Chine aujourd’hui. Dans le cadre des débats à l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, on constate que souvent les demandes d’implantations scolaires adressées aux États-Unis sont rapidement satisfaites, tandis que la France semble avoir plus de mal à aider la francophonie.
M. Yves Aubin de la Messuzière évoque à cet égard son expérience au cabinet de M. Alain Decaux ou comme sherpa du Président François Mitterrand pour les Sommets de la Francophonie, par exemple le Sommet de Dakar. Le débat sur ce thème au sein des familles binationales est également bien connu.
Ainsi, au Maroc, on est parvenu à une véritable logique de substitution à l’enseignement local − cas particulier que l’on ne retrouve pas chez le voisin tunisien. La Mission laïque française, qui possède une longue tradition d’implantation au Moyen-Orient, est également très présente au Maroc, en appui au réseau de l’AEFE. Le rôle de l’ambassadeur est aussi très important : il doit s’intéresser au réseau, ce n’est pas seulement le rôle de l’AEFE. Cette dernière souffre par ailleurs de l’absence de toute stratégie de développement : aucun document stratégique ne lui assigne, par exemple, la moindre priorité géographique.
La Commission pour l’avenir de l’enseignement français à l’étranger a formulé des recommandations sur ce point, à côté des préconisations consistant à s’appuyer davantage sur la Mission laïque et à développer les filières francophones renforcées au sein d’établissements locaux, comme en Espagne. En effet, les parents d’élèves français eux-mêmes tiennent beaucoup à la mixité ; on peut donc imaginer des filières de ce type en lieu et place du « classique » lycée français qui représente un investissement très lourd.
Le rapport de la Commission n’a donc pas été enterré : des États généraux ont suivi, relayés dans les postes diplomatiques, un forum des anciens élèves des lycées français a été organisé, une nouvelle session des États généraux est prévue pour l’automne…
Un point crucial pour le réseau sera sa bonne « alimentation » en enseignants expatriés. Le défaut de la RGPP est de porter l’effort sur la diminution du nombre d’expatriés dans le réseau. Il y a certes des économies à réaliser mais le résultat d’une telle politique est que les lycées de Tunisie n’ont plus de professeur de philosophie.
M. André Schneider ajoute qu’une autre donnée du problème est l’absence de volonté au sommet. Un inspecteur d’académie envoyé à l’étranger ne doit pas concevoir sa mission comme une période de vacances… Trop de nominations à l’étranger ont nui à la crédibilité de la France. Dans le cadre d’une mission d’information sur ce thème confiée par le Président Édouard Balladur, en 2005 à Taipei on pouvait constater que les enseignants recrutés localement étaient de bien meilleur niveau que les expatriés, pourtant incomparablement mieux traités. Il ne faut pas laisser les expatriés séjourner trop longtemps dans un même pays.
M. François Rochebloine, Président, observe que de plus en plus, le seul expatrié est le chef d’établissement. Au Liban, pays francophile s’il en est, la présence française s’étiole. En Roumanie, le français a été supplanté par l’anglais ; on néglige trop le phénomène, avant de s’alarmer lorsqu’il est devenu irréversible. Le président Axel Poniatowski a souhaité que la mission d’information mette le doigt sur ces questions.
M. Jean-Claude Guibal résume ainsi la situation : une stratégie est nécessaire mais les moyens budgétaires sont limités. Dès lors, que faire : renforcer la présence française là où elle est historique ou bien aller à la rencontre des pays émergents ?
M. Yves Aubin de la Messuzière reprend l’exemple du Maroc où l’enseignement français est en situation de quasi-substitution, à la différence du cas tunisien qui démontre qu’au prix d’une profonde réforme des structures et des contenus de l’enseignement on peut obtenir des résultats remarquables − il y a chaque année des polytechniciens tunisiens qui ne viennent pas d’établissements français. Au Maroc, en Tunisie, au Sénégal, il faut prendre garde à l’effet d’éviction de l’enseignement français à l’égard des classes moyennes supérieures, même hors mesure de gratuité (laquelle n’arrange rien).
La solution pourrait résider dans l’octroi de bourses par une fondation, qui solliciterait les entreprises par exemple. Il existe des expériences originales de ce point de vue, comme à Pékin où l’an dernier on a demandé à des entreprises françaises de contribuer à des investissements au profit des établissements français. Il y a en Asie, ainsi qu’en Amérique du Sud, des enjeux commerciaux, politiques et culturels importants : c’est là qu’il faut porter l’effort, même si l’enjeu n’est pas alors celui de la francophonie.
M. Jean-Claude Guibal évoque la crainte d’un grave recul de la francophonie sur la rive Sud de la Méditerranée, sphère d’influence historique.
M. Yves Aubin de la Messuzière répond que la francophonie n’est pour l’instant pas en danger au Maghreb, où l’on rencontre beaucoup d’écrivains francophones. La Mission laïque fortement implantée au Maroc ne bénéficie d’aucune subvention française ; les familles pourvoient aux besoins, même dans les régions où les élèves ne sont pas majoritairement français.
Interrogé par le Président François Rochebloine sur le thème de l’action culturelle et de l’audiovisuel extérieur, M. Yves Aubin de la Messuzière exprime une inquiétude plus grande encore. En effet, au moins existe-t-il un intérêt politique pour le réseau des lycées français, dont chacun s’accorde à dire qu’il doit au moins être préservé.
Tout autre est la situation des centres et instituts culturels, qui subissent une baisse considérable de leurs moyens et pâtissent d’une image injustement négative. La responsabilité incombe en partie aux rapports parlementaires stigmatisant la prétendue « ringardise » de ces établissements ou pointant des doublons. Or la spécificité française d’un réseau diversifié devrait bien plutôt être valorisée. Certes, il est des Alliances françaises « ringardes » qui doivent être fermées, il existe çà ou là une excessive propension au « wine and cheese » qui néglige trop l’Airbus ou la Pyramide du Louvre, il faut parfois fermer un centre culturel car l’Alliance française locale suffit. Mais notre réseau est une chance immense. Le French May à Hongkong remporte un vif succès et attire des milliers de jeunes sans que cela ait quoi que ce soit à voir avec la francophonie.
Le nœud du problème est que l’on parle aujourd’hui de réforme de ce réseau comme d’une fin en soi. Un ambassadeur sera jugé sur le nombre de centres fermés ou d’emplois supprimés, quand bien même cela ne répond à aucune stratégie. De même, il faudrait de toute urgence transformer CulturesFrance en EPIC et accroître son champ de compétence… mais ne faut-il pas plutôt se demander quelle stratégie elle doit poursuivre ? Ce qui ne veut pas dire qu’une agence ne soit pas nécessaire pour professionnaliser les actions menées. Il y a un manque de cohérence générale ; conserver telle implantation et supprimer telle autre sans logique d’ensemble n’a pas de sens et le Livre blanc l’a clairement dit.
Sollicité par le Président François Rochebloine sur la question de l’avenir de la Villa Médicis, M. Yves Aubin de la Messuzière rappelle que la France en est propriétaire − ce qui n’est pas le cas du Palais Farnèse. C’est une vitrine magnifique dont le coût n’est pas excessif et qui s’ouvre de plus en plus aux Romains. M. Yves Aubin de la Messuzière rappelle aussi avoir fermé, comme ambassadeur, l’institut culturel de Rome, « ranci ». M. Richard Peduzzi a ouvert la Villa, organisé de grandes expositions, M. Frédéric Mitterrand avait de beaux projets d’ouverture du lieu aux pays du Sud. Le défi réside surtout dans le choix des pensionnaires, à diversifier.
S’agissant de l’audiovisuel extérieur, il faut rendre hommage au remarquable travail accompli par M. Serge Adda à la tête de TV 5, augmentant l’audience de la chaîne. Il fallait renforcer TV 5 ; car sans TV 5, y aurait-il encore une place pour la francophonie ? L’audience de France 24 en revanche suscite des doutes ; il faut en effet distinguer le succès d’un site Internet ou la notoriété d’une chaîne de son audience réelle. En langue arabe, cette audience n’est pas significative.
D’une façon générale, la qualité de la rédaction tend à se dégrader : elle n’est pas assez rigoureuse. Le cas de Radio France internationale est différent. RFI s’était beaucoup améliorée ; cela dit, certaines langues rares ne suscitent plus toujours le même intérêt que par le passé. Quoi qu’il en soit, il est incompréhensible − le Livre blanc ne dit pas autre chose − que l’audiovisuel extérieur soit sorti du giron du quai d’Orsay.
S’adosser davantage au ministère de la Culture est une nécessité. L’enjeu n’est pas celui d’une co-tutelle − un tel système ne fonctionne jamais − mais celui de la qualité de la formation et du recrutement, car en la matière le ministère de la Culture a beaucoup à offrir.
La réunion est levée à 18 heures 30.
Compte rendu de l’audition de Mme Anne-Marie Descôtes,
directrice de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger
(Jeudi 2 juillet 2009 − 33, rue Saint-Dominique – salle 4223)
La réunion est ouverte à 11 heures.
• Présents
M. François Rochebloine, Président
Mme Geneviève Colot, Rapporteur
• Excusés
Mme Martine Aurillac, MM. Jean-Louis Bianco, Philippe Cochet, Jean-Pierre Dufau, Jean-Michel Ferrand, Jean-Claude Guibal, Jean-Pierre Kucheida, Robert Lecou, Didier Mathus, Jacques Remiller et André Schneider.
*
M. François Rochebloine, Président, accueille Mme Descôtes en rappelant le contexte de son audition et notamment le Conseil d’administration de l’AEFE tenu la veille et consacré en grande partie au problème du financement de la scolarité des élèves français à l’étranger.
Mme Anne-Marie Descôtes replace cette réunion en perspective : l’un des objectifs de sa lettre de mission lors de sa nomination en septembre 2008 consistait à définir un nouveau plan d’orientation stratégique prenant le relais du précédent, achevé en 2007, et tenant compte du contexte nouveau créé en 2008 par la mise en place de la prise en charge de la scolarité des élèves français à l’étranger.
Le 2 octobre 2008 se sont tenus les premiers États généraux de l’enseignement français à l’étranger, au cours desquels le Ministre a officiellement pris acte du rapport Aubin de la Messuzière. Les débats se sont poursuivis, y compris dans tous les postes.
En parallèle, le ministère s’est réformé, en particulier avec la suppression de la DGCID et la création de la direction générale de la Mondialisation, du développement et des partenariats. La synthèse de l’ensemble de ces évolutions doit être faite et l’ensemble des membres du Conseil d’administration de l’AEFE pourrait être réuni en séminaire avant adoption de cette synthèse en novembre prochain, débouchant sur la conclusion du contrat d’objectifs et de moyens (COM) à la fin de l’année.
Par ailleurs, est annoncé un audit de l’AEFE par l’Inspection générale des finances, dans le cadre de la RGPP. Sans doute un renforcement des contraintes en découlera-t-il pour l’Agence mais mieux vaut que cela intervienne maintenant plutôt qu’après la conclusion du COM.
M. François Rochebloine, Président, estime qu’une nouvelle baisse des moyens de l’AEFE serait inappropriée, à moins que l’on ne réduise les missions de l’Agence.
Pour Mme Anne-Marie Descôtes, la question des moyens dont dispose l’Agence doit être clarifiée afin de lui permettre de gérer le réseau des 263 établissements accueillant 675 000 élèves. Les enseignants expatriés sont au nombre de 1 250 : 650 personnels d’encadrement (chefs d’établissement, inspecteurs, conseillers principaux d’éducation) et 600 enseignants, sur un total de plus de 5 000.
M. François Rochebloine, Président, insiste sur le besoin d’apprécier ces chiffres en tendance, sur la décennie écoulée. Il y avait davantage d’enseignants expatriés il y a quelques années seulement. Cela ne va pas sans poser la question de la qualité de l’enseignement dispensé dans certaines matières.
Mme Anne-Marie Descôtes précise que les enseignants titulaires se partagent entre expatriés et résidents, ces derniers étant des fonctionnaires sous contrat avec l’AEFE. L’Agence rémunère tous les titulaires mais prend en charge les expatriés en totalité. Chaque établissement recrute les enseignants résidents ainsi que la catégorie des recrutés locaux. Les expatriés bénéficient d’une indemnité d’expatriation. Ce n’est pas le cas des résidents qui perçoivent une « indemnité supplémentaire de vie locale » (ISVL), avantage dont ne disposent pas les recrutés locaux.
L’an dernier, la lettre de cadrage budgétaire était triennale et assortie d’un commentaire invitant l’Agence à supprimer sur trois ans la moitié des postes d’expatriés, pour les transformer en postes de résidents. La directrice d’alors, Mme Maryse Bossière, dont le mandat s’achevait, avait fait valoir que cette exigence était nouvelle par rapport aux décisions arrêtées trois mois plus tôt dans le cadre de la RGPP. L’effort maximal consiste à transformer annuellement 50 postes d’expatriés en résidents. C’est d’ailleurs ce qui a été fait pour 2009.
Pour 2010, le ministère du Budget a demandé 100 transformations ; le Premier ministre a arbitré à 80. L’AEFE évalue en tout état de cause le nombre « incompressible » d’enseignants expatriés à 150, correspondant aux postes où « personne ne veut aller ». Les enseignants résidents sont certes des titulaires bien formés mais ce sont les expatriés qui font la force du réseau. Eux ont une obligation de retour et ont besoin d’une formation régulière. Le coût d’un enseignant expatrié et celui d’un résident s’élèvent respectivement à 120 000 et 60 000 euros par an.
Les recrutés locaux sont en principe moins bien traités mais ce n’est pas toujours le cas. Au Caire par exemple, les enseignants recrutés locaux gagnent environ 3 000 euros par mois, ce qui est considérable pour le pays.
À la demande du Président François Rochebloine, Mme Anne-Marie Descôtes indique, s’agissant des corps d’inspection, qu’une vingtaine d’inspecteurs de l’Éducation nationale sont présents au sein du réseau, compétents pour les écoles élémentaires qui sont en quelque sorte une « vitrine ».
Les inspecteurs d’académie inspecteurs pédagogiques régionaux sont au nombre de cinq (anglais, lettres, mathématiques, physique et histoire-géographie), en poste à l’Agence et sillonnant le réseau. Ils ont aussi pour mission d’aider à l’élaboration des outils pédagogiques et de maintenir le lien avec l’Inspection générale de l’Éducation nationale, qui est notamment compétente pour les classes préparatoires (l’AEFE a des projets d’ouverture de telles classes).
Répondant au Président François Rochebloine sur l’équilibre du budget de l’Agence en 2009 et 2010, Mme Anne-Marie Descôtes fait part d’une « bonne surprise » dans le cadre du budget triennal (hors bourses et prise en charge) : alors que l’annuité de 415 M€ en 2009 devait passer à 410 M€ pour 2010 comme pour 2011 (dont 120 M€ par an pour les pensions civiles des fonctionnaires détachés), 10 M€ supplémentaires auraient été obtenus pour 2010, faisant passer la subvention du budget de l’État à 420 M€.
Le fonds de roulement de l’Agence ayant été présenté comme devant tomber à 10 jours en fin d’année, le ministère du Budget a demandé une « révision de la copie ». Mais les seules possibilités d’amélioration consistent à revoir le mécanisme d’aide à la scolarité ou de retarder certains grands projets coûteux, tel celui de Moscou (ce qui est envisageable car même si les autorités locales se décidaient à accorder un terrain, de longues études préalables seraient nécessaires).
Quant à la prise en charge de la scolarité des élèves français, son coût global dans l’hypothèse d’une extension jusqu’à la maternelle est évalué à 700 M€. En 2008, première année complète d’application de la mesure, on a observé un coût brut de 15 M€ (au lieu des 20 M€ prévus).
Mais on a constaté également un effet de report de la mesure sur les bourses à caractère social. En effet, les familles faisaient preuve de beaucoup de retenue dans les demandes de bourses en dépit de généreux critères d’admission. Avec la mise en place de la « mesure de gratuité », le tabou a été levé et les demandes de bourses à caractère social ont quintuplé.
Les 5 M€ restants sur le coût prévisionnel de la gratuité ont été consommés à cette fin et devant l’impact de la variation de change pour 2 M€, l’AEFE a dû demander un dégel de la réserve de précaution sur sa subvention. Le nombre total de prises en charge s’est élevé à 4 000 pour 2008.
Mme Geneviève Colot, Rapporteur, demande si le ratio observé au lycée Charles de Gaulle de Londres, à savoir un taux de demande de la mesure de gratuité de l’ordre d’un tiers par rapport au total théorique, s’observe ailleurs. Mme Anne-Marie Descôtes répond que la situation varie d’un pays à l’autre et que certaines entreprises continuent en effet à prendre en charge les écolages.
Répondant au Président François Rochebloine sur la possible modulation de la prise en charge ou le relèvement éventuel des critères d’admission aux bourses à caractère social, Mme Anne-Marie Descôtes répond que cela est envisageable mais que l’on se heurte toujours au problème des effets de seuil. En déplacement à Mexico, le Président de la République a redit que la décision d’instaurer la gratuité visait précisément à éviter tout effet de seuil.
Mme Geneviève Colot, Rapporteur, demande des précisions sur le paiement des écolages par les fonctionnaires français expatriés. Mme Anne-Marie Descôtes répond que c’est également le cas pour les résidents et que d’une façon générale la mesure de gratuité est réservée à tous ceux dont l’employeur ne prend pas en charge la scolarité des enfants.
Or pour les fonctionnaires expatriés, l’indemnité d’expatriation n’est pas fléchée, de sorte que le ministère du Budget a indiqué qu’il la supprimerait en totalité si la mesure de gratuité devait être étendue à ces familles... qui y perdraient nécessairement.
Interrogée par le Président François Rochebloine sur le plan de développement du réseau, Mme Anne-Marie Descôtes répond que les projets immobiliers en cours concernent l’école Desnos de Tunis, le lycée Mermoz de Dakar (fin en 2011, coût de 20 M€ dont 14 M€ pour l’AEFE), un prochain chantier à Pékin (objectif d’ouverture en 2011), un chantier en cours à Ho Chi Minh Ville, une recherche d’emplacement à Hanoi, le projet à Tokyo de vendre deux établissements pour s’implanter sur un autre site (mais le contexte de la crise a déjà causé le départ d’une centaine d’élèves), de gros travaux prévus à Londres et à Madrid, à Barcelone un nouvel établissement prévu, au Nord de la ville (qui abrite déjà deux lycées), en raison de la montée en charge du projet ITER, de l’implantation du secrétariat général de l’UPM et d’une très forte demande espagnole.
Mme Anne-Marie Descôtes insiste sur les nouvelles règles de gestion immobilière imposées à l’Agence. Jusqu’à présent, il lui était possible de choisir le calendrier lors de la remise en dotation de certains établissements. Désormais, les remises se font d’office, certes sans loyer à acquitter mais avec, d’emblée, d’importantes provisions à passer.
C’est d’ailleurs plutôt l’inverse qui était attendu (pas de provisions mais un loyer). Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un transfert de charge du ministère des Affaires étrangères vers l’AEFE. Les moyens de celle-ci doivent donc être adaptés en conséquence.
À une question de Mme Geneviève Colot, Rapporteur, sur l’appel à des financements privés, comme à Londres, Mme Anne-Marie Descôtes répond que cette voie a été explorée sans succès. Le cas de Londres est très particulier, qui repose sur un trust.
Ailleurs c’est beaucoup plus aléatoire : à Pékin par exemple, pour un projet de 15 M€ on n’a réussi à ne lever que 2 M€ malgré l’implication du Président de la République et de Mme le ministre de l’Économie.
Interrogée par le Président François Rochebloine sur les rapports entretenus par l’AEFE avec la Mission laïque française (MLF), Mme Anne-Marie Descôtes répond qu’ils sont très bons. La taille et les conditions d’intervention des deux entités sont très différentes car la Mission laïque n’a ni les mêmes missions ni les mêmes contraintes que l’AEFE.
Par exemple, l’AEFE a l’obligation d’accueillir les Français en priorité, ce qui n’est pas le cas de la Mission laïque qui peut ainsi, comme au Maroc via l’OSUI, ne scolariser presque que des Marocains. La MLF n’emploie aucun expatrié, ne verse pas de bourses, elle est un acteur privé, plus léger, plus souple et plus réactif (comme le montre sa rapidité d’intervention lorsque Total ouvre une nouvelle implantation dans le monde, par exemple). L’AEFE et la MLF sont liées par une convention de coopération qui sera révisée à la rentrée ; elles ont beaucoup à faire en commun.
M. François Rochebloine, Président, déclare que la mission devra analyser, par pays, l’évolution du nombre d’élèves français et étrangers.
Mme Anne-Marie Descôtes relève à cet égard l’exemple intéressant du Maroc, où l’on observe depuis deux ou trois ans un retour massif d’enfants, souvent binationaux, qui étaient scolarisés en banlieue parisienne. La cause est-elle à rechercher dans la mesure de gratuité ? dans la crise économique ? C’est difficile à dire. Un important phénomène de retour a lieu en Israël également, souvent dans des milieux relativement modestes. Il y a une tendance lourde au reflux des expatriations « traditionnelles ».
En conclusion, le Président François Rochebloine demande à Mme Descôtes son point de vue quant à l’arbitrage entre outil de rayonnement et prestation de service aux expatriés dans les missions de l’AEFE. Mme Geneviève Colot, Rapporteur, s’interroge sur ce que prévoit le statut de l’AEFE à cet égard. Mme Anne-Marie Descôtes répond que le statut prévoit les deux aspects, qui sont évidemment nécessaires l’un comme l’autre et s’inscrivent dans la recherche d’un équilibre économique.
Pour rayonner, il faut accueillir des élèves étrangers. Si l’on demande d’accroître l’autofinancement, il faut mécaniquement augmenter les écolages, ce qui en retour a un impact sur les bourses sociales. Il faut souligner que le réseau n’accueille pas forcément moins d’élèves étrangers dorénavant mais que ce ne sont pas les mêmes étrangers. On le voit bien au Maghreb. Quant à l’Amérique latine, elle possède une intelligentsia qui n’est pas forcément la classe la plus aisée.
La réunion est levée à 12h15.
Compte rendu de l’audition de M. Alain Catta,
directeur des Français à l’étranger et de l’administration consulaire
au ministère des Affaires étrangères et européennes
accompagné de M. Éric Lamouroux,
sous-directeur de l’expatriation, de la scolarisation et de l’action sociale
(Jeudi 2 juillet 2009 − 33, rue Saint-Dominique – salle 4223)
La réunion est ouverte à 12 heures 15.
• Présents
M. François Rochebloine, Président
Mme Geneviève Colot, Rapporteur
• Excusés
Mme Martine Aurillac, MM. Jean-Louis Bianco, Philippe Cochet, Jean-Pierre Dufau, Jean-Michel Ferrand, Jean-Claude Guibal, Jean-Pierre Kucheida, Robert Lecou, Didier Mathus, Jacques Remiller et André Schneider.
*
M. François Rochebloine, Président, présente le cadre de la mission et accueille M. Alain Catta et M. Éric Lamouroux en précisant leur qualité de gestionnaires, en 2009, des crédits destinés à financer la prise en charge de la scolarité des élèves français à l’étranger. Il demande ce qu’il en sera en 2010 et ce qu’il faut penser de la soutenabilité de la mesure.
M. Alain Catta, directeur des Français à l’étranger et de l’administration consulaire, remercie le Président de son accueil et estime qu’après deux ans de gestion de ces crédits au sein du programme budgétaire n° 151 (Français à l’étranger et affaires consulaires), un bilan s’impose en effet.
L’aide aux Français à l’étranger à travers la scolarité est l’une des principales actions du programme, à côté de la gestion du fonds social consacré aux Français en difficulté (peu de crédits mais action très visible), de l’accueil des étrangers dans les services consulaires (mission politiquement partagée avec le ministère en charge de l’immigration), et du fonctionnement de l’Assemblée des Français de l’étranger (179 membres).
Le total de ces crédits est modeste (316 M€ dont 190 M€ de crédits de rémunération des personnels consulaires), mais l’enjeu politique qu’ils représentent est très important. En particulier, ce programme est pour les Parlementaires un outil irremplaçable car il permet d’effectuer la synthèse des concours publics aux Français de l’étranger. Il a cependant fallu se battre pour en asseoir la légitimité politique.
Les répercussions, sur la maquette budgétaire du ministère, du décret du 16 mars 2009 réorganisant le Quai d’Orsay, étaient évidentes et la tentation a été forte de faire disparaître le programme 151. Mais le départ simultané du Secrétaire général du Quai et du directeur du cabinet du ministre a permis de l’empêcher, définitivement, grâce au soutien reçu de l’Élysée, de Matignon et surtout de Bercy. La perspective de voir en 2012 le nombre de parlementaires de l’étranger passer à 23 a dû peser...
Il existe un vrai problème (qui n’est pas propre au ministère des Affaires étrangères et européennes) de gestion de la tutelle exercée sur les opérateurs. L’État en compte environ 300, qui emploient 300 000 personnes et coûtent 30 Mds€. Le plus important est de disposer d’une tutelle unique, seule organisation permettant la conclusion d’un vrai contrat d’objectifs et de moyens et un réel suivi des objectifs à atteindre. Or concernant l’AEFE, la tutelle reste divisée puisque la direction générale de la Mondialisation, du développement et des partenariats (DGM) gère une subvention de 410 M€ sur le programme 185 (Rayonnement culturel et scientifique), tandis que la direction des Français à l’étranger (DFAE) gère 126 M€ sur le programme 151 (annuité prévue pour 2011 par la loi de programmation des finances publiques).
Il y a eu des amendements parlementaires pour demander l’unification de la tutelle. La démarche était louable mais s’effectuait dans le mauvais sens car c’est le responsable du programme 151 qui perdait tout pouvoir ! En effet, la DGCID (gestionnaire du programme 185) n’a jamais véritablement exercé la tutelle de l’AEFE. Et ce n’est pas l’élargissement des missions de la DGCID à la faveur de la création de la DGM qui va faire de l’AEFE une priorité du nouveau directeur général, accaparé qu’il sera par la préparation des G8 et des G20 ou par la recherche de solutions à la crise mondiale...
Les deux grandes missions de l’AEFE sont le rayonnement et le soutien à la communauté française. Elles n’ont rien d’incompatible. Mais laisser sur deux programmes budgétaires différents les crédits nécessaires à l’accomplissement de ces deux missions n’est pas bon et rend le contrôle parlementaire moins efficace. Le responsable du programme 151, gestionnaire de la « mesure de gratuité », n’a pas la main sur la carte scolaire, qui relève de la tutelle exercée dans le cadre du programme 185. Or le choix de l’implantation des établissements a d’évidentes répercussions sur la prise en charge des frais de scolarité. Pour autant, la proximité entre les équipes de la DFAE et de l’AEFE est très grande et l’intérêt de l’État serait de concentrer la tutelle sur le programme 151, tandis que la solution consistant à la confier entièrement au programme 185 serait très mauvaise.
La réforme du ministère n’est pas viable car la DGM est trop vaste et couvre des sujets qui n’ont rien à voir les uns avec les autres. Si la DFAE n’avait pas suivi de très près la gestion des crédits de prise en charge de la scolarité des élèves français, on aurait laissé dériver cette politique au lieu d’en arriver à la prise de conscience actuelle. La DFAE a commencé à reprendre en main la tutelle et veut l’exercer tout entière.
De 47 M€ au début de 2007, le coût des bourses et de la prise en charge devrait passer à 126 M€ en 2011 : le législateur a accepté la directive du Président de la République et les bourses suivent la dynamique créée par la prise en charge (avec 10 M€ de hausse). Mais une impasse de 7 à 12 M€ est devant nous.
C’est la raison pour laquelle s’est tenue le 1er juillet une réunion associant la DFAE, l’AEFE, les parents d’élèves et des parlementaires. Un problème existe dans les grands pays de l’OCDE comme les États-Unis où les coûts de prise en charge atteignent une proportion extravagante, avec des montants records de l’ordre de 20 à 25 000 $ par an (en Europe, la moyenne est seulement de 8 700 € par an environ).
Il faut cristalliser la prise en charge au niveau de septembre 2007, augmenté de l’inflation annuelle et éventuellement de la perte de change. Nous ne sommes pas là pour financer des profits indécents. S’agissant des établissements homologués, la DFAE n’a pas beaucoup de prise. En revanche, pour les conventionnés ou les établissements en gestion directe, la maîtrise des coûts est beaucoup plus aisée.
M. François Rochebloine, Président, se déclare en faveur du plafonnement de la prise en charge et rappelle l’adoption l’an dernier à l’unanimité de la commission des Affaires étrangères d’un amendement prévoyant un double plafonnement (en fonction des revenus et des droits à acquitter). M. Alain Catta y souscrit, étant l’auteur avec Mme Maryse Bossière, alors directrice de l’AEFE, d’une circulaire de 2007 précisant que la prise en charge pourrait faire l’objet de ce double plafonnement. Bien que n’ayant jamais été mise en pratique, elle est un support juridique valide pour plafonner effectivement.
Interrogé par le Président François Rochebloine sur l’opportunité d’un moratoire sur la prise en charge, M. Alain Catta approuve cette perspective. La tendance est bien connue et au prix des mesures d’encadrement évoquées lors de la réunion du 1er juillet, il est possible de continuer à financer l’existant. Mais le passage aux classes de collège de la mesure inchangée est impossible financièrement.
M. François Rochebloine, Président, expose l’attitude réservée de M. Yves Aubin de la Messuzière à l’égard d’un « simple » moratoire et de l’arrêt de l’extension aux autres classes.
M. Alain Catta critique les analyses de M. de la Messuzière tout comme le rapport de la Commission pour l’avenir de l’enseignement français à l’étranger, collation de toutes les demandes existantes confinant à « l’air du catalogue » de Leporello ! C’est M. Éric Lamouroux qui représentait la DFAE aux réunions de cette commission. Quant au nouveau « forum » prévu cet automne, il fait songer à dresser un parallèle entre les États généraux et une symphonie de Bruckner qui ne s’arrêterait pas...
L’objectif de rayonnement et celui de la scolarisation des élèves français n’ont rien d’irréconciliable. Mais dans certains pays, notamment en Europe, il convient de déterminer lequel des deux objectifs doit primer. Or il s’agit d’établissements extraordinairement coûteux qui ne présentent pas de plus-value évidente. En Espagne par exemple, où des établissements sont implantés à Madrid, Séville, Barcelone et Bilbao, nous finançons des écoles d’excellence relativement bon marché pour nos amis espagnols ! Dans le même temps, nous ne sommes pas présents dans l’enseignement espagnol sous forme de filières bilingues.
À l’inverse, en Turquie, la Fondation Galatasaray a remarquablement pénétré l’enseignement turc. Dans les pays les plus développés, notre action doit passer par la coopération technique au sein des systèmes scolaires locaux. Il s’agit certes d’une politique de très longue haleine, pays par pays et région par région. Mais l’assertion selon laquelle nous formerions en Espagne, grâce à nos lycées, des francophones et des francophiles est tout simplement fausse. On établit un lien fallacieux entre francophonie et francophilie. Songeons que les Allemands ne vendent pas leurs produits en allemand... Et pendant la présidence française du Conseil de l’Union européenne, la DFAE n’a pas rencontré plus d’obstacles de la part d’interlocuteurs non francophones que de francophones.
Il y a des années que l’on sait fort bien (surtout dans les pays développés connaissant la scolarité gratuite et obligatoire) que nos intérêts seraient bien mieux défendus par la pénétration des systèmes scolaires locaux que par l’entretien de grands lycées, certes prestigieux.
M. Alain Catta aborde un dernier point, celui des bourses pour les années de maternelle : en France, la scolarité à ce niveau n’est pas juridiquement obligatoire. Cela soulève la question de l’opportunité d’un soutien financier pour ces classes à l’étranger. Or le budget de l’État y consacre actuellement 12 M€ par an.
Si ce financement est acceptable pour les grandes sections de maternelle, quid des années inférieures ? Ne pourrait-on se contenter de bourses partielles ? Car pour le dire crûment, cela revient sinon à financer des nounous... On rétorquera bien sûr qu’une telle modulation des bourses créerait un effet d’éviction à l’égard des jeunes Français... exactement à l’inverse du reproche effectué pour le reste de la scolarité. Il faudrait savoir !
La réunion est levée à 13h10.
Compte rendu de l’audition de M. Jean-Pierre Bayle,
Président de la Mission laïque française
accompagné de M. Jean-Pierre Villain, directeur général
(Mardi 7 juillet 2009 − 33, rue Saint-Dominique – salle 4211)
La réunion est ouverte à 16 heures 30.
• Présents
M. François Rochebloine, Président
Mme Geneviève Colot, Rapporteur
MM. Jean-Louis Bianco et Didier Mathus.
• Excusés
Mme Martine Aurillac, MM. Philippe Cochet, Jean-Pierre Dufau, Jean-Michel Ferrand, Jean-Claude Guibal, Jean-Pierre Kucheida, Robert Lecou, Jacques Remiller et André Schneider.
*
M. François Rochebloine, Président, accueille les intervenants en leur demandant d’exposer l’action de la Mission laïque française dans le cadre de l’enseignement français à l’étranger.
M. Jean-Pierre Bayle, Président de la Mission laïque française, indique en préambule qu’après quatorze ans il quitte pour raisons professionnelles (ayant été nommé président de chambre à la Cour des comptes) ses fonctions de président. De même le directeur général quitte-t-il ses fonctions après six ans d’exercice, pour retourner à l’Inspection générale de l’Éducation nationale.
La Mission laïque française a été créée en 1902. Sa longue histoire est jalonnée de vicissitudes puisqu’elle a été chassée d’Égypte par Nasser, chassée de Syrie, chassée d’Iran où elle possédait un lycée de 3 000 élèves. La Mission laïque n’est pas un opérateur de l’État ; elle est un partenaire de l’AEFE mais a également noué d’autres partenariats, avec l’Éducation nationale ou avec l’ex-DGCID. Alors que l’AEFE bénéficie des moyens de l’État, la Mission laïque n’est pas subventionnée et n’en a pas besoin. Tout au plus l’AEFE finance-t-elle quelques directeurs d’établissements au profit de la Mission laïque. Il n’y a pas de concurrence mais une complémentarité entre la Mission laïque et l’AEFE et les relations entre dirigeants sont excellentes, même si la capacité à négocier n’est pas identique de part et d’autre.
Répondant à une question du Président François Rochebloine sur la nature des relations qu’entretient la Mission laïque avec les ministères concernés par son action, M. Jean-Pierre Bayle indique que d’une façon générale, en cas de difficulté, le ministère des Affaires étrangères et européennes renvoie à l’AEFE. Quelques cas particuliers peuvent être soulignés : en Angola, Total a formulé une demande de création de quatre lycées d’excellence, financés par Total via la Mission laïque, pour le compte du gouvernement angolais et selon le cursus scolaire angolais. En Afghanistan, M. Pierre Lellouche alors Représentant spécial a souhaité que la Mission laïque reprenne l’activité de formation des chefs d’établissement du lycée de Kaboul, et qu’une rénovation des locaux soit effectuée. Au Kurdistan irakien, le Quai d’Orsay a demandé à la Mission laïque l’ouverture de deux écoles. La Mission laïque est convaincue de la nécessité de répondre à chaque sollicitation mais elle étudie le dossier auparavant ; elle a ainsi pris un an avant de répondre pour le lycée de Kaboul.
M. François Rochebloine, Président, demande des précisions sur le choix des professeurs de ce lycée.
MM. Jean-Pierre Bayle et Jean-Pierre Villain répondent qu’aucun enseignant n’a pour l’instant été recruté et que cela se fera par l’intermédiaire de la Mission laïque une fois l’actuelle phase d’organisation achevée.
Mme Geneviève Colot, Rapporteur, s’interroge sur le financement de ce projet.
M. Jean-Pierre Bayle répond qu’une subvention du ministère des Affaires étrangères est prévue. M. Jean-Pierre Villain, directeur général de la Mission laïque française, précise que ce financement couvre trois volets :
– la formation des professeurs (question d’ingénierie et d’organisation) ;
– la rénovation des locaux, souhait exprès du Président de la République, qui devrait représenter 1 M€ (500 000 euros sont prévus pour 2010 via l’Agence française de développement), ainsi que l’aide à l’utilisation de cette subvention ;
– la formation des formateurs.
L’ancien ministre de l’Éducation nationale, M. Xavier Darcos, souhaitait s’impliquer par le financement de postes d’enseignants. Il faudra sonder son successeur, M. Luc Chatel, sur la question. Une mission d’audit complémentaire doit permettre de déterminer si une aide supplémentaire est nécessaire.
Répondant au Président François Rochebloine, M. Jean-Pierre Bayle indique que le réseau de la Mission laïque française scolarise 40 000 élèves, dont 15 à 20 % de Français, dans quatre types d’établissements. Les principaux sont les grands lycées (7 au Liban par exemple, où l’AEFE est absente et où la Mission laïque vient de fêter son centenaire), conventionnés avec l’AEFE. Ce statut pose d’ailleurs le problème du droit de regard de l’Agence sur les choix exercés par ces lycées. Une autre problématique est celle du Maroc où le réseau de la Mission laïque date de 1996 seulement. 5 000 élèves y sont scolarisés par la Mission, appelée en renfort par la France et par le Maroc pour faire face à la demande. La situation présente quelques points d’achoppement avec certaines familles en raison de l’écart de frais de scolarité entre les établissements de l’AEFE et ceux de la Mission laïque, cette dernière étant contrainte à l’autofinancement. Mais les résultats scolaires sont identiques. Il y a donc parfois un peu de ressentiment à l’encontre de la Mission laïque qui démontre qu’avec moins de moyens on peut réussir aussi bien.
M. François Rochebloine, Président, fait observer qu’avec 15 à 20 % d’élèves français et 60 à 70 % d’élèves du pays d’accueil, il reste un « solde ».
M. Jean-Pierre Bayle met en avant la « devise » de la Mission laïque : « deux cultures, trois langues » (français, anglais, langue locale). M. Jean-Pierre Villain précise que la Mission tient le « discours des deux dignités » : en premier lieu, elle est un outil du rayonnement de la France. Il n’y a pas deux enseignements français ; la Mission laïque comprend d’abord et avant tout « des institutionnels français », en phase avec l’Éducation nationale. Ce système fonctionne d’ailleurs très bien puisque si le réseau de la Mission laïque scolarise aujourd’hui 40 000 élèves dans plus de cent établissements, il ne comptait encore que 20 000 inscrits en 2003. La « deuxième dignité » de l’association est d’être une « Mission de la réponse », c’est-à-dire d’apporter une attention particulière à ceux qui sollicitent son intervention. Il s’agit d’accorder une place très importante à la langue et à la culture du pays d’accueil, tout en conservant une loyauté absolue envers l’Éducation nationale. Accueillir 80 % d’élèves étrangers crée une responsabilité particulière. Cette attention à la langue et à la culture du pays d’implantation est en revanche très récente à l’AEFE. Ainsi, à Alexandrie, l’arabe a été mis au programme de l’école reprise de l’AEFE, et le nombre d’élèves a augmenté de 25 %, à tel point qu’un lycée français devrait pouvoir être recréé sur place. Ces « deux dignités » expliquent le succès de la Mission laïque (d’ailleurs, deux accessits en arabe ont été remportés cette année au concours général). Il faut y ajouter, depuis, peu, l’importance de la langue anglaise, systématiquement enseignée pour répondre à la demande des familles. Par exemple, au Liban, la francophilie se conjugue avec une forte demande d’anglais.
M. Jean-Louis Bianco pose trois questions : comment la répartition des enseignements entre les trois langues s’effectue-t-elle ? À propos de la réussite identique pour des coûts moindres au Maroc, s’agit-il d’une généralité dans le réseau ? Quelles en sont les causes ? Enfin, quel est le budget global de la Mission laïque et les ressources provenant d’entreprises comme Total sont-elles un complément fréquent ?
À la première question, M. Jean-Pierre Villain répond que la situation diffère selon le lieu d’implantation : New York, Beyrouth, Shenzhen, Addis Abeba… L’attitude de l’Éducation nationale fluctue également. Enfin, il convient de distinguer entre programmes, examens et choix pédagogiques. Il y a quelques années, l’AEFE avait préconisé un enseignement aux trois quarts en français. Puis la pression des familles a été très forte en faveur du bilinguisme, l’Éducation nationale se montrant plus frileuse. Il faut aussi mentionner l’interventionnisme de certaines ambassades. Ainsi, aux États-Unis, alors que l’AEFE se retirait progressivement puisque de 15 établissements conventionnés en 1995 le total est tombé à deux seulement aujourd’hui, en 2004 l’ambassadeur Jean-David Levitte a fait appel à la Mission laïque et souhaité un enseignement français dans le respect de la culture américaine, conformément au vœu des familles. Celles-ci demandaient un tiers d’enseignements en anglais et l’ont obtenu grâce à l’ambassadeur.
À la deuxième question, M. Jean-Pierre Bayle répond que ce ratio coût-efficacité est surtout vérifié au Maroc mais qu’il est observable partout, en raison des frais de scolarité consentis par les familles et du plus petit nombre d’enseignants rémunérés par l’État.
À la troisième question sur le budget de la Mission laïque, M. Jean-Pierre Bayle répond que l’essentiel des ressources provient des droits de scolarité, le (modeste) siège de l’association vivant grâce au réseau des écoles d’entreprise (Total, Renault, Peugeot, Michelin, Areva…), qui existe depuis une trentaine d’années.
M. Jean-Pierre Villain précise que le budget de l’association s’élève à quelque 100 M€, dont 4 à 5 M€ pour le siège. Les entreprises contribuent davantage que les familles. La Mission laïque est propriétaire de certains établissements ; dans d’autres cas elle n’est que responsable pédagogique, par contrat, moyennant une contribution de l’ordre de 5-6 % à son budget.
M. François Rochebloine, Président, demande quel est l’impact, pour la Mission laïque, de la prise en charge de la scolarité des élèves français à l’étranger pour les élèves français.
M. Jean-Pierre Bayle indique que les établissements de la Mission sont concernés, qu’ils soient conventionnés ou homologués, mais dans une faible proportion puisque le réseau compte peu d’élèves français. Le phénomène est très complexe. L’AEFE, par ce biais, reçoit soudain 20 M€ supplémentaires de la part de l’État ; la Mission laïque a demandé que cela n’obère pas les subventions versées aux établissements. Sur le fond, il y a longtemps qu’une telle mesure était envisagée (elle figurait même au nombre des 110 propositions du candidat François Mitterrand en 1981, mais plutôt via les bourses). C’est une mesure acceptable à la condition qu’elle ne débouche pas sur l’éviction des élèves étrangers. L’AEFE n’a pas été dotée des moyens lui permettant de faire face à la croissance de la demande et de surcroît la crise brouille la donne.
M. Jean-Pierre Villain évoque une mesure qui passe très mal pour son caractère injuste et pervers. Injuste car le réseau de la Mission laïque accueille 80 % d’élèves étrangers, sans qui les établissements n’existeraient pas. Or les Français qui bénéficient de ces établissements sont aussi les bénéficiaires de la gratuité – et eux seuls. Cette situation affecte l’image de la France. La mesure est en outre perverse car les établissements du réseau de la Mission laïque sont gérés par des comités de gestion, donc par des étrangers, qui réagissent à la mesure. Ainsi du board du lycée de Los Angeles qui a augmenté les frais de scolarité de 40 % ! Et au lycée français de New York, c’est désormais 1 à 1,5 M€ qui est payé par l’État français.
M. François Rochebloine, Président, observe que l’AEFE réagit en décidant de cristalliser la prise en charge au niveau des frais de 2006.
M. Jean-Pierre Bayle fait valoir que le problème s’était posé en 1982 avec l’envolée des bourses.
M. François Rochebloine, Président, rappelle l’amendement au PLF 2009 qu’il avait présenté conjointement avec Mme Colot et que la commission des Affaires étrangères avait adopté à l’unanimité, pour appliquer un double plafonnement à la prise en charge.
M. Jean-Pierre Bayle indique que les débats sur ce point à l’Assemblée nationale et au Sénat ont été suivis avec attention. Poursuivant sur les questions budgétaires, il cite l’exemple de l’Espagne où un plan d’économies a été engagé. La Mission laïque y participe (maîtrise des frais de scolarité, contention des coûts de fonctionnement…). L’AEFE est, au quotidien, « prise à la gorge » par les besoins de financement. Elle se voit transférer la compétence immobilière sans en avoir les moyens. Ses crédits sont séparés entre deux programmes budgétaires. Le directeur des Français à l’étranger se démène pour en récupérer la totalité mais ce serait inopportun car les rapports entre l’AEFE et les conseillers de coopération et d’action culturelle sont très bons. L’AEFE a deux missions : la scolarisation des élèves français et celle des « élites locales ». Sans ces dernières, il n’y aurait aucun lycée français.
M. Jean-Pierre Villain rappelle qu’il n’y a que 70 établissements à gestion directe de par le monde mais environ 500 établissements homologués, que l’AEFE a trop tendance à oublier.
M. François Rochebloine, Président, demande quelles sont les relations de la Mission laïque avec les Alliances françaises.
M. Jean-Pierre Bayle répond qu’une convention les lie mais que la tendance à l’autonomisation des Alliances s’accentue, surtout depuis la création de leur Fondation en 2007. La vocation des deux réseaux est toutefois différente ; mais une meilleure synergie serait souhaitable, par exemple pour l’utilisation des locaux scolaires après 18 heures.
À la question de Mme Geneviève Colot, Rapporteur, sur la reconnaissance des examens, M. Jean-Pierre Bayle répond qu’il s’agit des examens français.
M. Jean-Pierre Villain souligne que la convention-cadre signée avec l’Éducation nationale prévoit la publication au Bulletin officiel des postes à pourvoir. La proximité est donc grande. Mais il n’y a malheureusement aucun lieu où l’on discute de la définition de l’enseignement français à l’étranger. Certes, le Conseil d’administration de l’AEFE peut remplir ce rôle mais au prix d’une confusion entre maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage. Or il ne s’agit pas ici que d’enseignement mais aussi d’« ingénierie éducative » ; dès lors, il manque une instance interministérielle de réflexion d’ensemble sur ce sujet, qui permette de définir les grands axes d’une politique, de déterminer l’opportunité d’un déploiement en Irak ou en Afghanistan, etc. Ce n’est pas à l’AEFE d’en décider seule. De ce point de vue, il est très bon que la Représentation nationale se saisisse de la question.
M. François Rochebloine, Président, remercie M. Villain pour cette remarque qui s’inscrit parfaitement dans l’optique des travaux de la mission d’information.
M. Jean-Pierre Villain précise qu’il ne s’agit pas de contester le rôle de l’AEFE avec laquelle la Mission laïque travaille très bien, mais de souligner qu’une même instance ne peut pas à la fois définir la politique et l’appliquer. M. Jean-Pierre Bayle ajoute que l’Agence a mis du temps à trouver sa place après sa création en 1990. En 1993, M. Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères, a eu le courage de faire le choix de son maintien, contre de nombreux élus RPR qui réclamaient un Rectorat des Français de l’étranger. De même, nombreux étaient les chefs d’établissements qui privilégiaient la scolarisation des Français et menaçaient d’organiser des déconventionnements… Aujourd’hui l’AEFE est bien installée dans le paysage et personne ne préconise sa transformation. Demeure toutefois l’épineux problème de sa tutelle, dont l’Éducation nationale réclame une partie. Or derrière la question de principe se cachent des préoccupations toutes matérielles… Le poids de la masse salariale représente 65 % dans le budget de la Mission laïque et 80 % dans celui de l’AEFE. En outre, le traitement de certains chefs d’établissement expatriés atteint des sommets (plus de 20 000 euros par mois) ; le sachant, le ministère du Budget y voit des sources d’économies. En 2000, avec la suppression du ministère de la Coopération, une fenêtre de tir s’était ouverte pour en finir avec l’alignement sur le régime du décret de 1967 fixant l’échelle des rémunérations pour les personnels expatriés. Or on n’a pas remis en cause l’application des mêmes règles aux diplomates et aux personnels de l’Éducation nationale, alors que leurs contraintes n’ont aucune commune mesure. Si la Mission laïque se voyait accorder la possibilité de gérer la totalité de sa masse salariale, notamment au Liban, elle ne s’en porterait que mieux.
À l’objection du Président François Rochebloine selon laquelle l’AEFE ne fait qu’appliquer les règles existantes, M. Jean-Pierre Bayle répond que l’on pourrait tout remettre à plat. M. Rochebloine estime que cela suppose une volonté politique très forte.
M. Jean-Pierre Villain dénonce des tabous et des lourdeurs. Par exemple le mythe du lien entre présence d’enseignants expatriés et meilleurs résultats. Chacun sait que des enseignants expatriés n’apportent aucune plus-value et que tout dépend de la façon dont les enseignants sont suivis et évalués. Quant à la lourdeur administrative qu’entraîne la coexistence de trois statuts pour les enseignants français à l’étranger (expatriés, résidents et détachés quand l’établissement n’est pas conventionné), elle est bien connue également.
M. Jean-Pierre Bayle ajoute que la présence de chefs d’établissements expatriés ne se justifie que dans les établissements en gestion directe ; dans les établissements conventionnés, elle n’a d’autre intérêt que de permettre à l’AEFE de garder une forme de contrôle local. Au Conseil d’administration de l’AEFE à l’heure actuelle, sur 25 points à l’ordre du jour, 5 sont d’intérêt général et au bout d’une heure, le Conseil ressemble fortement à une commission paritaire où les questions de personnel évincent tout le reste ! L’Agence est quasiment co-gérée comme un établissement dépendant de l’Éducation nationale. Il est insupportable de voir sa directrice et le Président du Conseil d’administration se faire presque insulter à propos du niveau de l’indemnité supplémentaire de vie locale, ou de voir agitée la menace de la grève alors qu’il est des pays où la question du droit de grève est particulièrement sensible.
Rappelant sa présence au dernier Conseil d’administration de l’AEFE, M. François Rochebloine, Président, demande comment les États généraux de l’enseignement français à l’étranger du 2 octobre 2008 ont été perçus à la Mission laïque.
M. Jean-Pierre Bayle répond qu’ils ont été vus comme une « grand-messe » au cours de laquelle a été souligné le risque majeur lié à la question de la gratuité. Il n’est pas choquant que le Président de la République tienne une promesse électorale, mais si cette mesure doit aboutir à l’éviction des élèves étrangers, elle n’est pas bonne. Il eût été préférable de consacrer la moitié des crédits ainsi mobilisés aux bourses à caractère social : la mesure eût contenté davantage de monde, pour un « profit politique » au moins équivalent. Alors que selon les modalités retenues, la mesure va s’arrêter en deçà de la seconde.
M. François Rochebloine, Président, demande un avis sur les trente recommandations du rapport Aubin de la Messuzière. S’agit-il d’un « catalogue » qui à trop demander n’est ciblé sur rien ?
M. Jean-Pierre Bayle répond que, contrairement à l’ancienne directrice de l’AEFE, Mme Maryse Bossière, qui estimait la demande d’enseignement français tellement robuste et croissante que l’on ne courait aucun risque à exiger beaucoup, il existe bel et bien un risque de dégradation de l’image de l’enseignement français.
M. Jean-Pierre Villain ajoute que la crise est passée par là, comme le montre le cas espagnol.
À la demande du Président François Rochebloine sur l’état des contraintes immobilières comparées de la Mission laïque et de l’AEFE, M. Jean-Pierre Bayle répond qu’elles diffèrent car le réseau de la Mission laïque a été construit par elle-même. La demande reçue n’est pas du même ordre : ce sont les familles qui sollicitent la Mission laïque, décident de l’aménagement d’un stade, d’un gymnase, etc. À titre d’exemple, la reprise du lycée de Florence s’est traduite par une hausse du coût de l’immobilier de 200 000 euros en un exercice.
M. Jean-Pierre Villain précise que les établissements de la Mission laïque française, tous homologués, sont de trois types : établissements en pleine responsabilité (que la Mission possède en majorité), établissements sous contrat d’adhésion (avec conseil de gestion, la Mission laïque assurant l’autorité pédagogique), et établissements sous contrat d’adhésion (la Mission intervenant comme prestataire). À Jeddah, donc à 30 km de La Mecque – terrain difficile s’il en est pour un établissement laïque –, fonctionnait un établissement de l’AEFE pour 1,6 M€ par an avec 37 expatriés. L’AEFE annonce soudain son retrait complet. Repris par la Mission laïque, cet établissement aurait dû voir les écolages augmenter de 39 % pour assurer sa viabilité financière ; dans les faits, l’augmentation n’a été que de 26 % et l’État a économisé 1,6 M€ annuels.
À la question « volontairement provocatrice » du Président François Rochebloine sur le poids de la rémunération des enseignants dans les surcoûts constatés, M. Jean-Pierre Villain répond que lorsque les coûts reposent sur la collectivité, la gestion n’est souvent pas optimale : on tolère par exemple des classes à 21 élèves. Les « gains de productivité » enregistrés à Jeddah proviennent notamment du passage d’un ratio de 24 élèves par classe à 28.
Mme Geneviève Colot, Rapporteur, rappelle qu’à Londres, seules 30 % des familles demandent à bénéficier de la gratuité de la scolarité et souhaite savoir ce qu’il en est dans les établissements de la Mission laïque française.
M. Jean-Pierre Villain répond que le taux de demande y est peut-être même inférieur. À Londres comme à New York, un fort développement est à prévoir car environ 85 % des enfants français qui y vivent ne sont pas scolarisés dans des établissements français. Il faudrait 10 collèges de 500 élèves supplémentaires pendant 10 ans !
M. Jean-Pierre Bayle observe que dans ce contexte la souplesse de gestion de la Mission laïque, qui est une association, est bien supérieure à celle de l’AEFE, qui est un établissement public.
La réunion est levée à 17 h 45.
Compte rendu de l’audition de M. Stéphane Romatet,
directeur général de l’Administration et de la modernisation
au ministère des Affaires étrangères et européennes
(Mercredi 8 juillet 2009 − 33, rue Saint-Dominique – salle 4223)
La réunion est ouverte à 16 heures 30.
• Présents
M. François Rochebloine, Président
MM. Jean-Michel Ferrand et Jean-Claude Guibal.
• Excusés
Mme Geneviève Colot, Rapporteur, Mme Martine Aurillac, MM. Jean-Louis Bianco, Philippe Cochet, Jean-Pierre Dufau, Jean-Pierre Kucheida, Robert Lecou, Didier Mathus, Jacques Remiller et André Schneider.
*
M. François Rochebloine, Président, accueille M. Romatet en soulignant le changement de l’intitulé de sa fonction à l’occasion de la refonte récente de l’organigramme du Quai d’Orsay.
M. Stéphane Romatet confirme que le titre et l’organisation de la direction générale de l’administration, également en charge de la « modernisation » depuis le décret et l’arrêté du 16 mars 2009, ont été modifiés par volonté politique de montrer que cette direction générale a vocation à coordonner et à piloter l’ensemble des chantiers de modernisation du ministère, dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP).
À cet égard, il faut noter que le Quai d’Orsay prend plus que sa part du chantier des réformes puisque sur 350 mesures décidées, 35 le concernent (y compris celles relatives à l’aide publique au développement). D’autre part, cette direction générale n’est pas étrangère à la réforme de la diplomatie d’influence, « soft power » qui n’est pas l’action diplomatique proprement dite mais qui en est le complément indispensable. Car la France ne serait pas ce qu’elle est sans l’influence mais sans la diplomatie, l’influence n’a pas de sens.
Ainsi, dans les trois compartiments de la réforme de notre rayonnement culturel (réorganisation des structures, réagencement des opérateurs et réforme des procédures), la direction générale de l’administration et de la modernisation est à l’œuvre.
M. François Rochebloine, Président, trace le cadre des travaux de la mission d’information et demande à M. Romatet, à propos de l’enseignement français à l’étranger, son point de vue sur la diversité des statuts des personnels et des établissements concernés.
M. Stéphane Romatet répond que toute volonté d’homogénéisation serait une erreur tragique. La richesse du réseau provient justement de cette diversité statutaire, à préserver autant que faire se peut. Tout dépend de la situation locale.
M. François Rochebloine, Président, observe que préserver l’existant peut aussi signifier maintenir dans le réseau de l’AEFE des postes de proviseurs expatriés rémunérés 20 000 euros par mois…
M. Stéphane Romatet répond qu’il s’agit probablement de cas très isolés ; si certaines situations sont excessives, il faut les corriger. D’une façon générale, c’est la diversité statutaire des établissements qu’il s’agit de conserver, pas celle des personnels ; pour ces derniers l’homogénéisation est une très bonne démarche.
On dénombre aujourd’hui 1 300 expatriés dans le réseau de l’AEFE ; ils étaient environ cinq fois plus nombreux il y a seulement quelques années. L’harmonisation avec les statuts de résidents et de recrutés locaux est également à rechercher. On n’est d’ailleurs pas encore arrivé au stade où existera un bon équilibre entre ces différentes populations.
Le nombre des expatriés est encore appelé à baisser mais il ne faut pas les supprimer car ils sont indispensables à la tête des quelque 400 établissements du réseau : ce sont des proviseurs expérimentés et ces postes permettent en outre de leur offrir un déroulement de carrière intéressant.
M. François Rochebloine, Président, demande qui détient le pouvoir de nomination à l’égard des chefs d’établissement à l’étranger.
M. Stéphane Romatet répond que, l’AEFE étant un établissement public, il s’agit – et c’est très bien ainsi – d’une prérogative de sa directrice. Toutefois, en réponse à M. Jean-Claude Guibal qui exprime des doutes sur la totale liberté de nomination de la directrice, il reconnaît que cette liberté, bien que juridiquement incontestable, est en pratique très atténuée par le mode de fonctionnement de l’Éducation nationale.
Une fois nommés, ces proviseurs sont détachés sur des contrats d’expatriés, en alternance avec des fonctions identiques en France. Une telle alternance est indispensable : s’il est envisageable d’enchaîner deux postes à l’étranger, toute carrière d’expatrié est à proscrire.
M. Jean-Claude Guibal observe, pour le déplorer, qu’il existe pourtant des formes de spécialisation pour l’exercice à l’étranger, cette situation étant même facilitée par l’existence en métropole de « lycées porte-avions » qui accueillent un expatrié temporairement pour mieux lui permettre de repartir.
M. Stéphane Romatet admet que de telles pratiques sont néfastes ; le remède est à rechercher dans la mise au point de fiches de poste très rigoureuses. Il en va d’ailleurs de même pour le réseau culturel : on a besoin de commissions de sélection, de candidatures formalisées, de fiches de poste et d’une sélection rigoureuse.
À la question du Président François Rochebloine sur les orientations stratégiques de l’AEFE et sur la conclusion avec elle d’un contrat d’objectifs et de moyens, M. Stéphane Romatet répond que ce rôle revient à la direction générale de la Mondialisation, la direction générale de l’Administration et de la modernisation n’intervenant qu’en soutien. Mais elle intervient néanmoins, sous l’angle budgétaire.
Sur ce point, M. François Rochebloine, Président, demande où en sont les discussions sur l’abondement du budget de l’AEFE à hauteur de 8 M€ afin de consolider son fonds de roulement.
M. Stéphane Romatet confirme que cela fait partie des discussions budgétaires en cours. L’état de quasi-rupture du budget de l’AEFE est une réelle préoccupation. Or l’État a le devoir de financer cette politique publique, certes onéreuse (2 Mds€ annuellement, à peu près pour moitié à la charge de l’État et pour moitié à la charge des familles).
Une telle anémie du fonds de roulement n’est pas tenable pour un établissement public administratif dont le budget dépend largement de décisions exogènes (l’évolution du point de la fonction publique, par exemple). Ce fonds de roulement doit être de 30 jours, 20 à la rigueur, mais certainement pas 13.
L’Agence répercute sur les familles le sous-financement de l’État, de sorte que la part des familles dans le budget de l’AEFE, longtemps minoritaire, est désormais en hausse tendancielle.
M. François Rochebloine, Président, rappelle l’adoption, à l’unanimité de la commission des Affaires étrangères, de l’amendement au PLF 2009 qu’il avait cosigné avec Mme Colot pour instaurer un double plafonnement (en fonction des revenus et des frais de scolarité) de la prise en charge de la scolarité des enfants français à l’étranger. Il est aujourd’hui question d’un moratoire, ce qui n’est pas suffisant.
M. Jean-Claude Guibal ajoute que l’application de la « mesure de gratuité » a également pour conséquence de faire progressivement reposer les écolages sur les seules familles étrangères, ce qui ne va pas sans poser problème en termes d’influence.
M. Stéphane Romatet assure que ce constat est partagé par le ministre. L’unanimité du Parlement (Sénat compris) comme des acteurs de terrain va dans le même sens : poursuivie jusqu’à la maternelle, la réforme aura un coût prohibitif. Nous ne ferons pas l’économie du double plafonnement. Un ticket modérateur est tout à fait envisageable.
M. Jean-Claude Guibal, à la faveur de ce consensus sur le caractère pervers de certains effets de la mesure, demande s’il est envisageable de préserver le principe de la gratuité pour les familles en faisant contribuer directement les entreprises au budget de l’AEFE.
M. Stéphane Romatet répond que le ministère et l’AEFE travaillent conjointement sur cette solution, parmi d’autres. Elle est juridiquement très complexe. Les États généraux de l’enseignement français à l’étranger du 2 octobre 2008, auxquels participaient également les représentants des entreprises (M. François Périgot, Président du Medef international), l’ont d’ailleurs montré.
Il faut trouver un mécanisme permettant que les entreprises continuent à intervenir financièrement ; mais il ne peut plus s’agir désormais que de financements volontaires.
M. Jean-Claude Guibal observe qu’à côté des opérations de mécénat d’entreprise, il existe des mécanismes obligatoires, comme le 1 % logement.
M. Stéphane Romatet reconnaît que l’une des pistes envisageables consisterait à créer, à côté de l’AEFE, une fondation reconnue d’utilité publique qui recevrait des dons. Mais pourquoi pas, en effet, une forme de « 1 % éducation » ?
À la question du Président François Rochebloine sur les contours concrets du moratoire annoncé, M. Stéphane Romatet indique ne pas les connaître.
*
Abordant la seconde partie de l’audition, M. François Rochebloine, Président, demande quelle part la direction générale de l’Administration et de la modernisation prend à la réforme du réseau culturel à l’étranger et au projet de loi annoncé sur ce thème.
M. Stéphane Romatet répond qu’elle est particulièrement impliquée, à la fois dans la préparation du projet de loi et dans la réforme concrète du réseau. Le projet de loi est actuellement dans sa phase finale : le texte en a été transmis au Conseil d’État, qui doit l’examiner en assemblée générale le 9 juillet pour adoption par le Conseil des ministres du 22 juillet.
Dans ses grandes lignes, il prévoit la création de deux opérateurs. Le premier se substituera à CulturesFrance avec des responsabilités élargies. L’actuelle association CulturesFrance sera donc mise en liquidation et le nouvel opérateur (qui devrait reprendre le même nom) aura le statut d’EPIC.
À l’observation du Président François Rochebloine sur l’ancienneté de cette idée, M. Stéphane Romatet répond que l’originalité du projet réside dans le périmètre de compétence élargi de l’EPIC, qui couvrira, en plus des missions actuelles de l’association, la coopération culturelle et linguistique ainsi que la promotion du français. Le décret d’application de la future loi est déjà prêt et il faut commencer à travailler au « business plan » du nouvel opérateur, à recruter ses personnels, etc.
Le second opérateur sera créé par fusion de trois organismes existants, dont le métier est voisin (l’accueil des étudiants et des boursiers en France, la promotion des savoirs et de l’expertise français à l’étranger) : le GIP France coopération internationale, le GIP CampusFrance et l’association Egide.
Ce second opérateur, dénommé « Agence française pour l’expertise et la mobilité internationales » (AFEMI), conserverait toutefois le label « CampusFrance ». Il s’agit de la concrétisation d’une décision prise le 11 juin 2008 par le Conseil de modernisation des politiques publiques alors présidé par le Président de la République ; il aura fallu un an pour effectuer la mission de préfiguration, analyser la nécessité juridique d’un projet de loi, mener les consultations avec les autres ministères concernés, etc.
La question du Président François Rochebloine sur le calendrier parlementaire du projet de loi ne reçoit pas de réponse. Sa demande quant à la finalité réelle du projet, essentiellement budgétaire ou non, amène M. Stéphane Romatet à insister sur l’organisation comme priorité : c’est la raison majeure de cette réforme dans des domaines où la compétition internationale oblige à l’excellence (qu’il s’agisse d’enseignement supérieur ou de culture).
M. François Rochebloine, Président, demande comment on peut assimiler la mobilité étudiante à la promotion de l’expertise.
M. Stéphane Romatet répond que ces métiers, bien que distincts, font appel aux mêmes modes de financement : réponse à des appels d’offres internationaux ou communautaires, notamment. Mais le futur organisme devra comprendre des pôles distincts par type d’activité.
M. Jean-Claude Guibal s’interroge sur le statut des agents de la future agence CampusFrance : sera-t-il le même pour tous ? quels seront les profils de poste (formation, spécialisation, etc.) ?
M. Stéphane Romatet explique que ce sujet est très compliqué car il s’agira d’intégrer trois établissements préexistants, dont deux GIP employant à la fois des fonctionnaires et des contractuels de droit public, tandis que l’association à intégrer emploie des personnels de droit privé.
Les personnels du futur EPIC seront tous de droit privé. Il faudra organiser cette « bascule » et ce sera l’une des tâches principales du nouveau directeur général de l’EPIC. 350 personnes sont concernées, provenant pour trois quarts d’entre eux de l’association Egide.
M. Jean-Claude Guibal demande s’il est prévu que CulturesFrance promeuve les études supérieures françaises, et comment cette compétence s’articulerait avec l’autonomie des universités.
M. Stéphane Romatet précise que l’élargissement des compétences de CulturesFrance ne va pas jusque-là mais que sur la compétence de promotion de la langue française, le ministère s’est interrogé. L’idée un temps envisagée de confier cette mission à l’AEFE a été abandonnée car trop éloignée de son « cœur de métier ».
M. Jean-Claude Guibal fait valoir l’exemple du pôle de premier cycle de Sciences Po Paris à Menton : l’un des soutiens les plus actifs de ce pôle est un Saoudien qui a été en son temps le premier étudiant saoudien en France (à Besançon). Il est aujourd’hui devenu un inlassable promoteur de la promotion des études supérieures françaises et de la langue française : vu sous cet angle, un cloisonnement semble difficile.
M. Stéphane Romatet indique que le ministère des Affaires étrangères et européennes exercera sa tutelle sur l’ensemble de ces sujets et devra dans ce cadre s’interroger sur la bonne répartition géographique de son effort, etc.
La direction générale de la Mondialisation devra pour ce faire s’appuyer sur les compétences adéquates au bon exercice de sa tutelle, afin de conclure des contrats d’objectifs et de moyens pertinents et d’en bien suivre l’exécution.
À M. Jean-Claude Guibal observant que la tutelle s’exerce mieux lorsque l’on participe au financement de l’opérateur, et au Président François Rochebloine désireux de connaître l’origine des 20 M€ supplémentaires en 2009 (auxquels s’ajouteraient 20 autres M€ en 2010), M. Stéphane Romatet confirme que le ministre a obtenu du Président de la République et du Premier ministre qu’ils prennent conscience de l’intenable écart entre discours et réalité à propos des crédits d’action culturelle.
Un décret d’avance a ainsi permis de dégager 20 M€ supplémentaires en gestion 2009 et pour 2010, l’annuité prévue par la loi triennale de programmation des finances publiques serait abondée de 20 M€ supplémentaires.
M. François Rochebloine, Président, interroge enfin M. Romatet sur l’avenir de la Villa Médicis. Ce dernier répond que la Villa dépend de la tutelle exclusive du ministère de la Culture.
Notre ambassadeur à Rome se plaint suffisamment de ne pas disposer de toute l’autorité voulue à ce sujet. On peut rapprocher ce cas de celui de la Casa Vélasquez à Madrid : de tels organismes doivent-ils échapper à toute réflexion sur leur avenir et leur gestion ? La Casa Vélasquez occupe 4 hectares au cœur de Madrid et emploie 77 ETP. Qu’au moment où nous réfléchissons à la refonte complète de notre réseau culturel en Espagne, il ne soit pas possible d’y inclure la Casa Vélasquez est inacceptable.
La réunion est levée à 17 h 30.
Compte rendu de l’audition de M. Alain Gründ,
président du Bureau international de l’édition française
accompagné de M. Jean-Guy Boin, directeur général
(Mardi 6 octobre 2009 − 33, rue Saint-Dominique – salle 4223)
La réunion est ouverte à 16 heures 30.
• Présents
M. François Rochebloine, Président
Mme Geneviève Colot, Rapporteur
M. Jean-Michel Ferrand
• Excusés
Mme Martine Aurillac, MM. Jean-Louis Bianco, Philippe Cochet, Jean-Pierre Dufau, Jean-Claude Guibal, Jean-Pierre Kucheida, Robert Lecou, Didier Mathus, Jacques Remiller et André Schneider.
*
M. François Rochebloine, Président, accueille le président et le directeur général du Bureau international de l’édition française (BIEF) en rappelant le cadre des travaux de la mission d’information et invite M. Gründ à présenter le Bureau et son action dans un propos liminaire.
M. Alain Gründ, Président du BIEF, rappelle que l’industrie du livre est la première industrie culturelle en Europe, très loin devant le cinéma, le théâtre etc., et la moins subventionnée. Alors que les théâtres et autres musées ne pourraient exister sans subventions, l’industrie du livre « se tient toute seule » pour l’essentiel ; elle représente annuellement 2,8 Mds€ en « prix producteur », soit 5,6 Mds€ en prix public. 50 à 60 000 titres supplémentaires sont recensés chaque année par la bibliothèque nationale ou la base de données professionnelle Électre. Les Allemands et les Britanniques publient davantage encore. Une caractéristique essentielle du livre est sa variété ; chacun a sa bibliothèque personnelle. Il existe actuellement quelque 300 000 titres disponibles en langue française. Le livre, c’est aussi un objet qui dure et se transporte n’importe où, sans tomber en panne ni s’abîmer, à la différence du disque, par exemple.
L’influence du livre français à l’étranger s’exerce de deux façons : les exportations et la cession de droits de traduction. Les exportations, aux deux tiers à destination de pays francophones, représentent un quart du chiffre d’affaires des éditeurs. Mais l’érosion de la langue française partout dans le monde fait ici peser un risque réel ; l’allemand décline de la même façon. Quant aux droits de traduction cédés chaque année, ils correspondent à 9 000 titres ; l’influence ainsi exercée est importante, même auprès d’un public non francophone. Incidemment, l’achat de droits sur les livres en langue étrangère concerne 9 000 titres par an également. Les Britanniques n’achètent rien à l’extérieur mais vendent beaucoup ; cependant, après l’anglais, le français est la première langue traduite. Notons au passage que le système anglo-saxon du copyright est très différent du droit d’auteur.
Le BIEF s’appelle « bureau international » et non « bureau d’export », ce qui signifie qu’il mise sur l’échange. Alors que sa politique a été infléchie depuis trois ans, le BIEF se satisfait d’avoir évolué jusqu’à prendre un nom qui évoque le bief… c’est-à-dire un petit lac qui apporte de l’eau au moulin…
M. Jean-Guy Boin, directeur général du Bureau international de l’édition française, précise que le BIEF est une association loi de 1901. Sur ses 3,7 M€ de budget en 2009, 70 % proviennent de subventions. Celles-ci émanent du ministère de la Culture et de la communication via le Centre national du livre (avant 2009 c’était directement la compétence de la direction du Livre et de la lecture). Elles émanent également de l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), de l’Organisation internationale de la Francophonie ou du ministère des Affaires étrangères et européennes (à hauteur de moins de 1 % pour ce dernier). Le BIEF entretient d’ailleurs avec les postes diplomatiques des relations d’« industriel » mais a donc très peu de liens financiers avec le ministère lui-même.
Le BIEF compte 270 adhérents, c’est-à-dire 270 marques éditoriales différentes − il existe par exemple de multiples adhérents au sein d’un seul groupe éditorial comme Hachette. Leurs cotisations annuelles représentent environ 3 % des ressources du BIEF.
Mais, précise M. Alain Gründ, environ un quart du budget du BIEF provient des participations versées par les adhérents à l’occasion d’opérations de promotion, essentiellement des salons (une trentaine chaque année de par le monde) : le BIEF y crée, construit et anime des stands, et facture ces services à ses adhérents.
À la question de M. Jean-Michel Ferrand sur la langue utilisée dans ces promotions, M. Jean-Guy Boin répond qu’il s’agit du français à 99 %. À une question de Mme Geneviève Colot, il répond que tous les domaines sont couverts, du plus littéraire au plus technique.
M. Jean-Michel Ferrand demande si, dans les pays de langue latine comme la Roumanie ou le Mexique, le français occupe une place particulière.
M. Alain Gründ, rappelant le déclin de la langue française, indique que la cession de droits de traduction prédomine. M. Jean-Guy Boin précise que les Roumains, par exemple, acquièrent très volontiers de tels de droits pour leur propre langue. Il faut savoir qu’un livre coûtant communément 16 ou 18 euros en France a un prix prohibitif en Roumanie. Il est beaucoup moins cher de traduire puis de produire le livre sur place.
M. Jean-Michel Ferrand observe qu’on trouve en Roumanie des ouvrages de Céline interdits ailleurs.
M. Alain Gründ note que la « piraterie » qu’est le viol du droit d’auteur, endémique en Inde à l’égard des auteurs Anglo-saxons, existe aussi à l’égard des auteurs français, notamment au Liban, surtout pour les manuels scolaires. Le contre-feu consiste alors à monter des opérations de production sur place, afin de supprimer la différence de prix.
Pour justifier l’importance des contributions des éditeurs au budget du BIEF, M. Jean-Guy Boin prend l’exemple du récent salon de l’édition tenu à Pékin, qui réunissait une bonne quarantaine de participants ; pour la France, le seul stand était celui monté par le BIEF. À l’inverse, à Francfort, ce sont 150 éditeurs qui se partagent 570 m² et le BIEF côtoie les stands d’Hachette, de Gallimard etc.
Répondant à M. François Rochebloine, Président, M. Boin indique qu’aucune autre institution ne remplit le même rôle que le BIEF. CulturesFrance est bien présente mais sur un créneau différent, plutôt celui des échanges internationaux d’auteurs.
Le directeur général du BIEF décline ensuite les quatre missions du BIEF : être une « vitrine », faire vivre un catalogue, assurer une veille sectorielle, promouvoir la formation et les rencontres professionnelles. Sur ce dernier point, le BIEF a récemment lancé un partenariat avec l’Organisation internationale de la Francophonie pour aider à la professionnalisation des libraires en Afrique subsaharienne.
En réponse à la question du Président François Rochebloine sur les liens entretenus entre le BIEF et les Alliances françaises, M. Boin explique qu’ils sont très ténus et passent plutôt, lorsqu’ils existent, par le service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade. Le Président François Rochebloine évoque l’exemple de l’Alliance française de Buenos Aires, que M. Boin estime plus proche d’un centre culturel que d’une Alliance française type. Il s’agit vraiment d’un établissement exceptionnel, qui anime notamment un excellent programme d’aide à la traduction, en même temps qu’il fournit un remarquable travail de promotion culturelle. La foire du livre de Buenos Aires est chaque année, en avril, un grand rendez-vous.
M. Alain Gründ ajoute que ce travail de fond et cette manifestation en particulier sont l’occasion de faire diffuser la culture française par les éditeurs argentins.
A la question du Président François Rochebloine sur la faible présence de bibliothèques à Buenos Aires, M. Jean-Guy Boin répond que telle n’est pas la mission première du BIEF – même si les invendus des salons peuvent aller abonder le fonds des universités ou garnir les étagères des bibliothèques.
Le Président François Rochebloine demande si le BIEF intervient dans les salons français.
M. Jean-Guy Boin répond par la négative et M. Alain Gründ précise qu’en marge des salons organisés en France le BIEF reçoit à Paris des interlocuteurs étrangers. Les rencontres professionnelles sont distinctes des salons destinés au grand public. Elles se déroulent généralement sur deux jours : exposés croisés le premier jour et entretiens individuels le lendemain. Il s’agit à la fois d’aider à la vente de droits pour tous les éditeurs – grands ou petits – et de promouvoir le système français en général – à propos de la législation sur le prix unique du livre par exemple.
M. Jean-Guy Boin rappelle la mission sur le prix unique menée par M. Hervé Gaymard à la demande de Mme Christine Albanel alors ministre chargée de la culture, mission qui par exemple avait conduit le Mexique à adopter une telle législation. Autre exemple de promotion du « système » français : une mission de MM. Paul Otchekowski-Laurens et de M. Boin en Israël sur le thème du droit d’auteur et de la politique du livre.
Au Président François Rochebloine demandant quels sont les atouts et les handicaps pour le BIEF de son statut associatif, M. Jean-Guy Boin répond qu’il ne voit aucun inconvénient mais que les avantages sont multiples, en premier lieu celui de la souplesse. Le principal atout du BIEF est sa gestion actuelle, avec 18 permanents à Paris et des bénévoles – dont M. Alain Gründ – surtout présents en province, pour 70 manifestations par an. 4 permanents sont installés à New York. C’est un cas unique d’une agence littéraire vendant des droits français sur place, avec quelques succès retentissants comme celui des droits de traduction sur l’œuvre d’Irène Nemirovski.
M. Alain Gründ souligne qu’avec peu de moyens le BIEF accomplit beaucoup de choses. Il indique également que la crise atteint peu le secteur du livre, qui en tant qu’industrie mature est habituellement en croissance presque nulle.
Le Président François Rochebloine demande qui sollicite qui, entre les éditeurs et le BIEF.
M. Jean-Guy Boin répond que les échanges s’effectuent dans les deux sens. Le BIEF envoie au début de chaque mois de juillet des sollicitations à ses adhérents qui y répondent et sollicitent eux-mêmes le Bureau pour demander un soutien sur tel ou tel marché. Il existe également des invitations spontanées de la part d’Etats étrangers, comme la Corée du Sud en 2010.
M. Boin souligne également le besoin d’un interlocuteur à l’administration centrale. Le MAEE est concerné au premier chef ; à cet égard, il faut se féliciter de ce que le démantèlement complet de la DGCID n’ait pas eu lieu. Faute de quoi un certain désordre risquerait de s’instaurer car chaque ambassadeur serait ravi de voir un événement se dérouler « chez lui ».
Au Président François Rochebloine s’enquérant des relations entretenues entre le BIEF et les SCAC, MM. Boin et Gründ répondent qu’elles sont indispensables, citant les exemples réussis de Téhéran et de Berlin.
Quant aux préconisations finales formulées à l’endroit de la mission, elles consistent en deux points, selon M. Gründ : œuvrer au maintien – actuellement compromis – des salons littéraires et des rencontres professionnelles dans le monde, d’une part, et conserver le soutien ministériel existant, financier de la part du ministère de la Culture et de la communication, et « industriel » de la part du MAEE. Si le contact est excellent avec le directeur général de la mondialisation au Quai d’Orsay, il faut qu’il se concrétise avec la formation de personnels du réseau culturel de la France à l’étranger dans le domaine de la promotion du livre, par exemple à raison de trois sessions de 20 auditeurs par an, qui seraient autant de précieux relais dans les postes. Les 5 à 6 000 comptes ouverts chez des éditeurs français de par le monde ont besoin de ce soutien professionnel.
La réunion est levée à 17 heures 30.
Compte rendu de l’audition de Mme Sophie Mercier,
directrice du Bureau export musique
accompagnée de M. Jean-François Michel, conseiller et fondateur du Bureau export
(Mardi 6 octobre 2009 − 33, rue Saint-Dominique – salle 4223)
La réunion est ouverte à 17 heures 30.
• Présents
M. François Rochebloine, Président
Mme Geneviève Colot, Rapporteur
Mme Martine Aurillac
M. Didier Mathus
• Excusés
MM. Jean-Louis Bianco, Philippe Cochet, Jean-Pierre Dufau, Jean-Michel Ferrand, Jean-Claude Guibal, Jean-Pierre Kucheida, Robert Lecou, Jacques Remiller et André Schneider.
*
M. François Rochebloine, Président, accueille Mme Sophie Mercier et M. Jean-François Michel.
Mme Sophie Mercier rappelle en préambule que le Bureau export musique a été fondé en 1993 par M. Jean-François Michel, aujourd’hui conseiller en son sein et secrétaire général du European Music Office à Bruxelles.
Elle indique que le Bureau export est une association financée par les pouvoirs publics et les professionnels, en vue d’aider les artistes sur la scène internationale. À la création de l’association en 1993, il se vendait annuellement environ 4 millions de disques français à l’étranger. En 2001, ce chiffre était passé à 40 millions.
Le secteur connaît depuis 2002 une crise structurelle du fait de l’évolution vers le numérique. Le marché français s’effondre ; il a perdu 60 % en valeur depuis 2004. Les exportations ont chuté également mais dans de moindres proportions. Ces exportations sont devenues vitales.
En 2007, dernière année connue, le chiffre d’affaires du secteur réalisé à l’export était de 290 M€, ce montant incluant les producteurs, la SACEM (société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) et les éditeurs mais pas le spectacle vivant (le chiffre n’étant pas encore établi).
Un disque sur dix vendu à l’étranger l’est sous forme physique et un sur deux au format numérique, cette dernière statistique résultant surtout des marchés américain et britannique.
En 2008, les correspondants du Bureau export musique étaient au nombre de 7, implantés dans 15 pays, liés au Bureau par l’intermédiaire des SCAC ou des Instituts français.
7 000 concerts sont organisés chaque année dans ce cadre. Le Bureau export aide à la production de disques et de concerts, sans toutefois se substituer aux professionnels.
L’association est financée à 59 % par le ministère de la Culture, le ministère des Affaires étrangères, Ubifrance et CulturesFrance – ces deux derniers organismes finançant exclusivement des projets précis – et à 41 % par les producteurs, les sociétés civiles la SACEM (i.e. les éditeurs) et le Centre national des variétés, de la chanson et du jazz (CNV, pour le spectacle vivant).
L’aide qu’apporte le Bureau (aux producteurs phonographiques, aux éditeurs, aux managers et aux producteurs de spectacle) est essentiellement financière : 1,3 M€ est distribué directement chaque année aux professionnels français pour l’organisation de tournées, d’interviews, de showcases ou la signature de contrats. Sont aidées aussi bien la musique classique que les musiques actuelles.
M. Jean-François Michel souligne que le Bureau export est très différent d’une autre association, CulturesFrance : comme son nom l’indique, il apporte un soutien aux professionnels en vue d’une exportation ; la décision revient aux producteurs, le Bureau ne faisant que suivre leur idée. Maints exemples existent de succès commerciaux qui, si l’on avait sollicité en amont le Bureau export, auraient reçu un avis négatif…
À Mme Geneviève Colot, Rapporteur, demandant si seuls les artistes français sont soutenus, Mme Sophie Mercier répond qu’aucun critère linguistique n’est posé ; il s’agit d’ailleurs parfois de musique électronique sans paroles. Le Bureau poursuit une logique commerciale. M. Jean-François Michel précise que la francophonie est toutefois très présente.
À M. Didier Mathus demandant quelle est la part du budget de fonctionnement, et celle des aides publiques – émanant du SNEP (syndicat national de l’édition phonographique) ou de la SACEM notamment – dans les dépenses du Bureau export, Mme Sophie Mercier répond que la part du fonctionnement s’établit à 13 %, que les aides publiques directes représentent 53 % des dépenses et que les aides directes correspondent à 33-34 % des dépense. Ces dernières aides recouvrent, par exemple, l’information-conseil – comment aborder tel ou tel marché –, la diffusion de lettres d’information, la présence dans les salons professionnels – en lien avec Ubifrance –, la présence dans les festivals, la publication de guides très complets, par pays, à destination des professionnels, etc.
Le Président François Rochebloine demande si le Bureau sollicite des clients étrangers ou bien s’il répond à leurs demandes. Mme Sophie Mercier répond qu’au départ le Bureau est en position de « démarchage » ; on mesure sa bonne implantation dans son pays d’accueil au fait qu’alors, ce sont les clients étrangers qui le sollicitent.
Mme Martine Aurillac demande quels rapports entretiennent l’association à Paris et ses correspondants à l’étranger.
Mme Sophie Mercier répond que 80 % de l’argent distribué l’est à Paris, et que le « siège » consacre environ 70 % de son temps à répondre aux sollicitations reçues directement des professionnels et 20 à 30 % de son temps à coordonner des opérations avec les conseillers culturels des ambassades.
M. Didier Mathus fait valoir que les labels français sont déjà des marques mondiales, mis à part Naïve qui est le seul label vraiment indépendant. Quelle est, dans ces conditions, la valeur ajoutée du Bureau export musique ?
M. Jean-François Michel répond que bien des labels existent : Wagram, Harmonia mundi et d’autres beaucoup plus petits. Par ailleurs, Universal France n’a aucune prise sur Universal Allemagne ; les multinationales raisonnent presque toujours par marchés nationaux. Le bureau apporte donc son aide à chaque fois qu’un artiste n’est pas considéré comme une priorité mondiale chez son éditeur – ce qui est fréquent –, soit pour améliorer une situation au sein d’une « major », soit pour proposer un label indépendant de substitution. 300 entreprises sont aidées en moyenne chaque année, la moitié étant des producteurs phonographiques.
À Mme Geneviève Colot, Rapporteur, s’enquérant des relations entre le Bureau export et les COCAC, Mme Sophie Mercier répond qu’elles sont très nourries partout où le Bureau dispose d’un correspondant en propre ; dans les autres pays, tout dépend de l’état du marché pour les producteurs français. Par exemple, en Scandinavie, au Canada ou en Asie du Sud-Est, le Bureau export n’est pas implanté mais un marché existe ; des contacts sont donc noués depuis Paris avec les COCAC locaux ; une personne de l’équipe parisienne se consacre à ce type de tâches.
Au Président François Rochebloine demandant quels sont les homologues étrangers du Bureau export, M. Jean-François Michel répond qu’il existe 20 – dont 16 « véritables » – bureaux du même type dans l’UE, que la Commission européenne devrait prendre en compte dans ses prochains travaux sur la culture. La France est toutefois le seul pays à avoir utilisé comme relais dans ce domaine son réseau culturel à l’étranger. Ce modèle d’un organisme cofinancé par les pouvoirs publics et par la filière elle-même est excellent.
Le Président François Rochebloine s’inquiète de la tendance du budget de l’association. Mme Sophie Mercier répond que le ministère de la Culture a, depuis l’origine, augmenté sa subvention, ciblée sur la musique classique et contemporaine, tandis que le ministère des Affaires étrangères et européennes, qui avait alloué 500 000 euros en 2007, n’a accordé en 2009 que 315 000 euros de subvention – à quoi s’ajoute le soutien local, non chiffré, apporté par les ambassades à l’étranger. Cela étant, au moment où la filière est très fragilisée par la crise du secteur, un relais étatique plus solide serait bienvenu.
M. Didier Mathus demande si les plates-formes numériques (comme iTunes) font partie du champ d’activités du Bureau export musique. Mme Sophie Mercier répond que tel a bien été le cas dès leur apparition en 2003 : le Bureau aide les artistes à être présents sur ces plates-formes, soit directement, soit via des distributeurs digitaux. C’est d’ailleurs un succès : tous les éditeurs y ont accès aujourd’hui (sauf s’ils le refusent expressément) ; le problème est de se rendre visible, tant l’offre foisonne, et sur ce point également le Bureau export peut aider.
Quid des réseaux sociaux musicaux ? demande M. Didier Mathus. Mme Sophie Mercier répond que tel est le premier sujet d’actualité du secteur, qui mobilise tous les COCAC concernés : comment utiliser au mieux les « communautés » existantes ? La réflexion est en cours, au Royaume-Uni notamment. M. Jean-François Michel confirme qu’il s’agit du principal problème actuel : pour être visible sur Internet il faut être promu, bâtir sa notoriété au moyens d’événements, de spectacles.
Mme Sophie Mercier indique enfin que le Bureau export musique réalise tous les deux ans, en partenariat avec la direction du ministère des Affaires étrangères en charge du français, des « compilations pédagogiques » de chansons françaises actuelles, destinées aux enseignants de français à l’étranger et gratuites pour eux. Il s’agissait à l’origine de supports de cours à destination de l’Allemagne. Le septième volume vient de paraître.
La réunion est levée à 18 heures 30.
Compte rendu de l’audition de M. Olivier Poivre d’Arvor,
directeur de CulturesFrance
(Mardi 6 octobre 2009 − 33, rue Saint-Dominique – salle 4223)
La réunion est ouverte à 18 heures 30
• Présents
M. François Rochebloine, Président
Mme Geneviève Colot, Rapporteur
Mme Martine Aurillac
M. Didier Mathus
• Excusés
MM. Jean-Louis Bianco, Philippe Cochet, Jean-Pierre Dufau, Jean-Michel Ferrand, Jean-Claude Guibal, Jean-Pierre Kucheida, Robert Lecou, Jacques Remiller et André Schneider.
*
M. François Rochebloine, Président, accueille M. Olivier Poivre d’Arvor et l’interroge sur la transformation de CulturesFrance en « grande agence culturelle ».
M. Olivier Poivre d’Arvor répond que le ministre Bernard Kouchner doit trancher dans les jours suivants la question de l’organisation à retenir. Des éléments de réponse sont sur la table, avec le rapport tout récent de M. Dominique de Combles de Nayves, rapport technique sur les implications, notamment financières et juridiques, des choix qui seront faits.
Lors des « Journées du Réseau » en effet, les 16 et 17 juillet 2009, le ministre n’avait semble-t-il pas tous les éléments en main pour décider, ce qui l’avait conduit à mener une consultation des ambassadeurs et des conseillers de coopération et d’action culturelle sur le thème de l’agence culturelle et de ses liens avec le réseau.
Au stade de la mise en œuvre, un EPIC – ou peut-être un EPA – sera créé,vraisemblablement pas au 1er janvier 2010 cependant : le Quai d’Orsay prévoit un examen du texte au début de 2010, ce qui conduit raisonnablement à envisager une mise en place à l’été 2010.
Le ministre aura à choisir entre une légère augmentation du périmètre de CulturesFrance et la création d’un « grand opérateur ».
Le premier scénario correspond à l’actuelle CulturesFrance augmentée de la compétence en matière d’action linguistique et éducative : un établissement sans réseau à l’étranger, récupérant les derniers aspects opérationnels de l’activité de la direction générale de la mondialisation. Le budget passerait de 30 M€ à 40 M€.
Dans ce premier scénario, serait également créé un opérateur de la mobilité internationale, regroupant France coopération internationale (FCI), CampusFrance et Égide.
Le second scénario est celui du « grand opérateur » rassemblant CulturesFrance, CampusFrance et l’ensemble du réseau culturel à l’étranger, soit une centaine de personnes au « siège » et quelque 6 000 agents de par le monde – recrutés locaux pour l’essentiel. Et parallèlement serait mis sur pied une sorte d’opérateur de moyens, par fusion de FCI et d’Égide.
On arrive donc au terme d’un débat qui court depuis des années : faut-il une agence culturelle parisienne qui gère des programmes ou bien une agence qui pourrait plutôt se comparer au British Council ? Il est regrettable que l’accumulation des rapports et autres études masque l’absence de décisions… et la diminution des moyens d’intervention du réseau, à hauteur de près de 50 % en 5 ans.
Bien plus que le réseau consulaire, le réseau culturel a servi de variable d’ajustement. Tandis que CulturesFrance a réussi – à grand-peine – à préserver ses moyens propres, ceux des SCAC ont été drastiquement réduits. À tel point que l’on peut se demander, dans tel poste important, si tant de personnels sont nécessaires pour gérer si peu de moyens ? Le réseau regroupe 7 000 agents environ, et non pas 2 000 comme on l’a longtemps prétendu.
À la remarque du Président François Rochebloine se référant aux commentateurs qui estiment la situation de l’AEFE plus simple car organisée au tour d’une mission claire, avec un public presque « captif », etc., M. Olivier Poivre d’Arvor répond qu’à l’époque de la création de l’AEFE, personne ne parlait de simplicité. Or la réussite est là aujourd’hui.
Il est indispensable que le Quai d’Orsay conserve l’action culturelle extérieure parmi ses missions et n’en laisse pas la responsabilité au ministère de la Culture. La diplomatie, c’est aussi de l’économie, de la culture ; mais il faut penser une nouvelle organisation.
Le Président François Rochebloine fait référence à un article du Monde daté du 17 juillet 2009, évoquant l’enlisement de la réforme du réseau culturel.
M. Olivier Poivre d’Arvor répond que les administrations ont toujours été un peu rétives face aux réformes. Ce qui compte, c’est que l’établissement public qui sera créé, quel que soit son périmètre, ait le ministère des Affaires étrangères et européennes comme tutelle unique. Demain comme aujourd’hui, le ministère de la Culture sera présent, mais pas en première ligne car il ne veut pas trop s’engager sur le plan budgétaire.
Si le ministre hésite et que des débats se nouent autour de cette question, c’est parce que la réponse ne va pas de soi. Il faut trouver la bonne échelle, le bon nom, la bonne structure.
À M. Didier Mathus demandant son souhait personnel sur ces différents points, M. Olivier Poivre d’Arvor répond qu’il a été parmi les premiers, six mois auparavant, à participer à la réflexion du ministère, à alerter sur la baisse des crédits, etc. Les mauvais souvenirs de la fusion Coopération-Affaires étrangères sont encore là. La DGM, comme la DGCID qui l’a précédée, est une machine assez lourde ; il y a encore six mois, la création c’une grande agence semblait préférable, le projet de loi désormais à discuter tranche différemment. C’est à présent aux politiques de débattre puis de trancher.
Puis la mise en œuvre devra se faire loyalement et efficacement, par une administration totalement convaincue et avec un suivi étroit au plus haut niveau. Bien que le ministère des Affaires étrangères et européennes ne soit pas une entreprise, c’est quelqu’un de l’envergure d’un Carlos Ghosn dont nous aurions besoin !
Au Président François Rochebloine demandant s’il verrait d’un bon œil l’appui financier d’entreprises à l’agence culturelle, M. Olivier Poivre d’Arvor répond par l’affirmative. C’est même indispensable.
M. Didier Mathus revient sur la différence entre l’AEFE, dotée d’un objectif clair – emmener des enfants jusqu’au baccalauréat – et l’agence culturelle à laquelle rien de semblable n’est demandé.
M. Olivier Poivre d’Arvor fait valoir que l’objectif premier de cette agence sera de défendre la cause de la langue française. Il n’est pas absurde qu’une entreprise française très présente à l’étranger, dans le domaine des vacances et du loisir par exemple, investisse dans cette cause… Autre suggestion : un écrivain connu pour son amour et sa défense de la langue pourrait être impliqué dans une campagne promotionnelle en faveur du français en Afrique.
Nul besoin de moyens considérables pour ce faire. Beaucoup de jeunes seraient prêts à entrer au ministère des Affaires étrangères et européennes pour cela, comme contractuels. On pourrait songer à créer une forme de « volontariat pour la langue » à cette fin.
Les bourses pouvant servir de support à une telle politique ayant beaucoup diminué, les entreprises pourraient prendre le relais, à la condition que le projet soit convenablement piloté. On peut aussi imaginer que des collectivités territoriales concluent des conventions avec l’agence.
M. Didier Mathus fait remarquer que tout cela n’est pas facilement évaluable.
M. Olivier Poivre d’Arvor estime que ce n’est pas impossible pour autant. Il est peut-être difficile de faire admettre cela à un directeur d’institut culturel, mais on devrait lui fixer des objectifs, par exemple la progression du nombre ou du niveau des étudiants qu’il accueille, ou en matière de recherche de financements. C’est pour cela que l’Alliance française est un beau modèle : elle se « frotte au privé » et fonctionne avec peu de moyens. Le ministère des Affaires étrangères et européennes peine à faire de même.
Mme Martine Aurillac observe que nombre d’ambassadeurs seraient probablement réticents.
M. Olivier Poivre d’Arvor acquiesce. Il ajoute que la question de la « marque » est importante. Celle de l’Alliance française aurait très bien convenu à l’ensemble du réseau ; à tout le moins faudra-t-il défendre la marque « Institut français » à côté de celle de l’Alliance française.
Le Président François Rochebloine conclut en espérant que « la montagne n’accouche pas d’une souris ».
La réunion est levée à 19 heures 30.
Compte rendu de l’audition de M. Antoine de Clermont-Tonnerre,
président d’Unifrance
accompagné de Mme Régine Hatchondo, directrice générale
(Mardi 13 octobre 2009 − 33, rue Saint-Dominique – salle 4223)
La réunion est ouverte à 16 heures 20.
• Présents
M. François Rochebloine, Président
MM. Jean-Claude Guibal et Robert Lecou
• Excusés
Mme Geneviève Colot, Rapporteur, Mme Martine Aurillac, MM. Jean-Louis Bianco, Philippe Cochet, Jean-Pierre Dufau, Jean-Michel Ferrand, Jean-Pierre Kucheida, Didier Mathus, Jacques Remiller et André Schneider.
*
M. François Rochebloine, Président, accueille les intervenants.
M. Antoine de Clermont-Tonnerre, Président d’Unifrance, indique qu’il forme avec Mme Régine Hatchondo une équipe nouvelle à la tête de cet organisme, lui étant arrivé en février 2009 et elle en avril. Unifrance a 60 ans d’histoire et exerce deux fonctions principales : le soutien commercial à l’exportation de films français d’une part, et la présence culturelle d’autre part.
La gestion est assurée par une petite équipe de 30 personnes, légère et qui doit le rester. Toutes les professions concernées sont associées : producteurs, exportateurs, artistes ; c’est l’un des rares lieux de rencontre de l’ensemble des professionnels ! Même le Centre national du cinéma (CNC) n’y parvient pas au même degré.
Dans les commissions artistiques on croise des gens de talent comme Philippe Lioret, Tonie Marshall ou Régis Wargnier.
Mme Régine Hatchondo, directrice générale, précise que quatre commissions artistiques préparent le Comité exécutif d’Unifrance, dont la gouvernance est très participative.
M. Antoine de Clermont-Tonnerre ajoute que Juliette Binoche a donné cette année plus d’une semaine de son temps pour être présente au Japon, ce que Sophie Marceau avait fait l’an dernier. Elle s’est aussi rendue en Chine tandis que Vincent Cassel allait au Brésil…
Au Président François Rochebloine qui trouve normal ce temps donné, M. Antoine de Clermont-Tonnerre répond que beaucoup d’artistes refusent.
Il poursuit sa présentation en indiquant qu’Unifrance participe à une série de grands rendez-vous du marché cinématographique – Cannes, Toronto, etc. – parfois concomitants avec un festival.
Unifrance organise également, sur le budget du Fonds de soutien du cinéma géré par le CNC – donc hors budget de l’État, sauf une petite subvention du ministère des Affaires étrangères et européennes –, des rendez-vous promotionnels dans de grands hôtels parisiens. Généralement sont présents 500 acheteurs de 47 pays.
Enfin, Unifrance soutient des festivals, soit organisés directement soit organisés par d’autres – New York, Tokyo, Rio, Sao Paulo, Pékin, Bombay, Budapest et Novossibirsk, donc au nombre de huit.
La particularité d’Unifrance est d’associer les artistes à la promotion et de les emmener voir les acheteurs, ce qu ces derniers apprécient beaucoup. Les postes diplomatiques sont alors des relais précieux pour l’organisation des déplacements.
Mme Régine Hatchondo insiste sur l’importance d’une promotion au plus près des distributeurs locaux. Le « retour » est alors parfois immédiat. Le public est un public de francophiles, et de « cinéphiles mondiaux », manifestant une curiosité pour toutes les filmographies.
Selon les pays, le cinéma français se classe troisième ou quatrième, en dépit de l’émergence des cinémas asiatique ou israélien. Enfin, un troisième type de public est constitué des étudiants et des jeunes en général, qui apprécient les courts-métrages (2 à 45 min). Ce format commence à s’exporter ; le chiffre d’affaires annuel est de 500 000 euros.
M. Antoine de Clermont-Tonnerre souligne la difficulté que représente le nombre élevé de festivals de cinéma de par le monde. Ainsi, 81 festivals internationaux ont fait l’objet d’un soutien d’Unifrance l’an dernier.
Mme Régine Hatchondo précise qu’un tel soutien (envoi d’une délégation d’artistes français sélectionnés, accompagnement etc.) s’accompagne généralement de l’organisation par Unifrance, dans une université du pays visité, de « leçons de cinéma » ou master classes de réalisateurs.
Au Président François Rochebloine s’interrogeant sur les modalités de sélection des films soutenus, M. Antoine de Clermont-Tonnerre répond qu’Unifrance s’appuie pour ce faire sur les producteurs, les exportateurs et les festivals. Il existe par ailleurs, pour les courts-métrages, une commission ad hoc.
Mme Régine Hatchondo ajoute qu’Unifrance crée les conditions d’une exportation réussie mais n’exporte pas directement.
M. Antoine de Clermont-Tonnerre indique enfin qu’Unifrance noue beaucoup de contacts avec la presse internationale, et que son site Internet est encore un autre moyen de faire connaître le cinéma français à l’étranger, avec 200 000 visites par mois en 2008 et une fréquentation à la hausse en 2009.
L’année 2008 aura représenté une « année record », avec 86 millions de spectateurs dans le monde pour des films français. Des films en anglais produits par des Français ont remporté de beaux succès, comme Taken de Pierre Morel.
Cinq premiers films ont été soutenus, dont quatre en langue anglaise. Ce « cru exceptionnel » ne devrait pas se reproduire en 2009. Au total, le nombre de films soutenus s’élève à 400 ; beaucoup de petits films contribuent aux résultats. Certains ont été vendus à 4 pays, d’autres à 50…
Mme Régine Hatchondo précise que cinq films ont concentré 40 % des entrées en 2008, dans le champ couvert par Unifrance, dont Taken, Babylon AD, Transformers et Astérix aux Jeux olympiques.
À M. Jean-Claude Guibal demandant quelle image de la France à l’étranger ce cinéma diffuse, elle répond qu’un « micro-trottoir » réalisé à New York a révélé que le public local n’avait pas réalisé que Taken était un film français.
Ce ne serait évidemment pas le cas pour Astérix. Un bon exemple du film français typique est celui de Cédric Klapisch, Paris : un film romantique, une analyse des sentiments des personnages…
Les films français les plus cités dans une étude d’IFOP réalisée à l’étranger en 2004 étaient Taxi 4 et Le fabuleux destin d’Amélie Poulain.
M. Antoine de Clermont-Tonnerre ajoute que cette même étude concluait que 66 % des personnes interrogées répondaient par l’affirmative à la question de savoir si le cinéma français donnait envie de venir en France.
Il indique que 2009 est une année moins brillante que 2008, d’une part en raison d’un manque de productions en langue anglaise du type de celles de Luc Besson, d’autre part à cause de la crise qui frappe également ce secteur.
Pour autant, si l’on se concentre sur les seuls films pour lesquels la présence française est majeure– Le code a changé, La fille de Monaco, L’heure d’été, LOL, etc. –, la baisse est moins importante (de l’ordre de 5 %).
Mme Régine Hatchondo précise toutefois que mesurer l’impact en nombre d’entrées de l’activité d’Unifrance est très difficile.
À la question de M. Jean-Claude Guibal sur la typologie des films français les plus appréciés à l’étranger, Mme Régine Hatchondo répond par de exemples variés :
– que les films en langue anglaise sont très appréciés car ils rappellent le tour de main des États-Unis ;
– qu’à Londres et New York on rencontre de « vrais cinéphiles » capables d’apprécier L’heure d’été d’Olivier Assayas ;
– qu’en Russie le public est friand de comédies.
M. Antoine de Clermont-Tonnerre ajoute qu’à Tokyo le film de Luc Besson a remporté un vif succès mais que les journalistes étaient aussi venus à cette occasion s’enquérir de la pérennité de l’image de marque du cinéma français, en tant que cinéma d’auteur.
Les atouts du cinéma français résident dans la diversité de l’offre, et dansa sa grande qualité. Un diplomate chinois confiait récemment que pour lui, le cinéma européen se réduisait au cinéma français.
Il est vrai d’ailleurs que celui-ci est en moins mauvaise posture que les cinémas allemand ou britannique.
Pourquoi ? demande M. Robert Lecou. M. Antoine de Clermont-Tonnerre répond que ce secteur est chez eux moins organisé, que son financement est moins protecteur, même si le soutien au cinéma local est de plus en plus répandu (jusques et y compris au Japon, en Chine et en Corée du Sud).
Le système du fonds de soutien au cinéma demeure une originalité française ; mais le principe du financement du cinéma par la télévision se développe dans plusieurs pays, en Europe orientale par exemple. Ce système français fait beaucoup d’envieux…
Le principal enjeu pour le cinéma français à l’exportation consiste à demeurer « le troisième cinéma » – après le cinéma américain et le cinéma local – dans le plus grand nombre possible de pays. Or les concurrents progressent !
Un autre enjeu consiste à développer des actions nouvelles, comme par exemple avec Ubifrance (depuis le début de l’année 2009). Il s’agit de compenser, par ce partenariat nouveau, la diminution des subventions directes du ministère des Affaires étrangères et européennes.
Le Président François Rochebloine demande si le Quai d’Orsay exerce une quelconque tutelle sur Unifrance.
M. Antoine de Clermont-Tonnerre répond par la négative… et s’en réjouit beaucoup. La variété des intervenants interagissant avec Unifrance rend inopportune son inclusion dans la sphère diplomatique.
Le Président d’Unifrance évoque deux enjeux supplémentaires : les nouvelles possibilités offertes à l’exportation par le développement des supports numériques, et le développement de la VOD (vidéo à la demande), qui permet de toucher un public intéressé sans passer par les circuits des salles.
En conclusion, le cinéma est vraiment un « point fort » du rayonnement de la France, plus que le livre ou le théâtre.
Le Président François Rochebloine s’enquiert de la place de CulturesFrance dans le champ d’intervention d’Unifrance à l’heure actuelle.
M. Antoine de Clermont-Tonnerre répond que les ambassades (leurs services culturels) ont toujours eu un rôle de diffusion d’un portefeuille de films au profit des centres culturels, s’acquittant très bien de cette tâche.
Quand CulturesFrance deviendra une agence, apparaîtra un risque de concurrence avec Unifrance dans son secteur, pour ce qui est de la présence culturelle française à l’étranger. En revanche, une mission demeurera indiscutablement le monopole d’Unifrance : le soutien à l’exportation.
Des entretiens sur ce points avec le ministre Bernard Kouchner et le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et européennes Pierre Sellal ont permis de conclure qu’il faudrait trouver un modus vivendi une fois l’agence en place, à l’instar cde ce qui se produit déjà avec CulturesFrance en Inde, par exemple.
La réunion est levée à 17 heures 30.
Compte rendu de l’audition de M. François Denis,
président de la Fédération des associations de parents d’élèves
des établissements d’enseignement français à l’étranger (FAPEE)
(Mardi 20 octobre 2009 − 33, rue Saint-Dominique – salle 4223)
La réunion est ouverte à 17 heures 30.
• Présents
M. François Rochebloine, Président
Mme Geneviève Colot, Rapporteur
MM. Didier Mathus et Robert Lecou
• Excusés
Mme Martine Aurillac, MM. Jean-Louis Bianco, Philippe Cochet, Jean-Pierre Dufau, Jean-Michel Ferrand, Jean-Claude Guibal, Jean-Pierre Kucheida, Jacques Remiller et André Schneider.
*
M. François Rochebloine, Président, accueille M. François Denis en soulignant combien la mission a apprécié de rencontrer, lors de chacun de ses déplacements, les équipes dirigeantes, enseignantes et les parents d’élèves.
M. François Denis, Président de la FAPEE, présente la fédération, née il y a 30 ans du souhait des Français de l’étranger de disposer d’une représentation adaptée. En effet, par rapport à l’enseignement en métropole, si les mêmes valeurs sont partagées, le contexte diffère.
La fédération est apolitique ; elle regroupe des associations (et non des individus), au nombre de 120. Si l’on exclut les établissements qui ne sont ni homologués ni écoles d’entreprises, c’est donc une représentativité des deux tiers, ce qui est considérable.
Le rayonnement de la France est un excellent concept. La fédération est également attachée à l’équilibre entre l’accueil d’enfants français (y compris les familles peu aisées) et d’enfants du lieu d’accueil (y compris d’une nationalité tierce). Cet équilibre est enrichissant pour tous.
La fédération s’efforce d’être présente partout où elle y a intérêt : son président est membre du conseil d’administration de la Mission laïque française et de l’AEFE, que la FAPEE a d’ailleurs contribué à créer il y a vingt ans et à conforter depuis lors.
Souvent, la FAPEE est la seule fédération de parents d’élèves présente dans un établissement donné.
À la question du Président François Rochebloine sur les relations entretenues avec les autres fédérations de parents d’élèves existantes, M. François Denis répond qu’elles existent mais que ces fédérations (FCPE, PEEP) sont à l’étranger de taille très modeste. Par ailleurs, la FCPE représente souvent… les professeurs (les élèves sont souvent des enfants de professeurs !). Les adhérents sont pour moitié français, pour moitié étrangers.
À propos de la prise en charge de la scolarité pour les enfants français inscrits dans les établissements du réseau de l’AEFE, un double plafonnement est absolument nécessaire (en fonction des revenus des familles et en fonction du montant des écolages pris en charge). La FAPEE a toujours été favorable à la gratuité de la scolarité à l’étranger ; mais mieux vaut le faire via le système des bourses.
Il ne faut pas avoir peur de dire que les Français de métropole seraient fondés à dénoncer l’octroi d’une aide si généreuse à des ménages expatriés à ce point aisés…
Premièrement, un certain nombre de familles bénéficiaires de la gratuité n’avaient pas besoin de prise en charge. Deuxièmement, les entreprises, qui payaient souvent les écolages de leurs salariés, commencent à les consolider dans les salaires, de sorte que l’on ne pourra plus identifier cette aide. Troisièmement, un moratoire a été annoncé à la rentrée, mais qu’adviendra-t-il ensuite ?
Or dans le même temps, les crédits finançant les bourses se raréfient ! Alors que, pour le calcul de ces dernières, il avait été décidé de ne pas toucher au « coefficient K » (qui mesure le pourcentage maximum que doivent représenter les dépenses d’éducation des enfants par rapport au reste à vivre du foyer), fixé à 20 % ‘et à 30 % aux États-Unis), on le porte désormais à 25 % (respectivement 35 % aux États-Unis) ! On est en train de ne plus aider ceux qui en ont pourtant le plus besoin.
Nous disposons aujourd’hui d’un réseau d’enseignement français à l’étranger très ouvert, qui accueille des enfants étrangers et représente de ce fait un formidable outil d’influence. Or ces ressortissants étrangers vont peu à peu quitter notre réseau.
Il existe deux types d’expatriés : ceux qui recherchent un modèle unique d’enseignement de par le monde et ceux qui, davantage ancrés dans un pays, souvent même binationaux, sont plus sensibles à une forme de « rapport qualité-prix ».
S’agissant des formes diverses de l’enseignement français ou de l’enseignement en français à l’étranger, il convient d’aider avec discernement : par exemple, le programme « français langue maternelle » (FLAM), proposant des filières bilingues à l’intérieur des écoles du pays d’accueil, est un très bon système mais il vaut mieux proposer un enseignement complet.
Les écoles d’entreprise gérées par la MLF fonctionnent très bien. Elles sont payées, comme leur nom l’indique, par les entreprises ; pourquoi leur offrir la gratuité par ailleurs ? Restons décents. M. François Denis rappelle à cette occasion qu’il est « un homme d’entreprise ».
Il n’est pas possible de « pressurer » le réseau comme on cherche à le faire actuellement. De 1 080 expatriés, on voudrait arriver à 500 (voire moins pour le ministère du Budget…). Or une bonne qualité de l’enseignement suppose l’emploi de titulaires de l’Education nationale de bon niveau.
Le Président François Rochebloine insiste sur le paramètre du coût des enseignants.
M. François Denis acquiesce en soulignant que les établissements ne payaient pas les expatriés, et qu’aujourd’hui on leur demande de payer des résidents à leur coût complet. On a déjà fait économiser à l’AEFE le différentiel de coût entre expatriés et résidents ; en outre on contraint les établissements à payer toutes les charges sociales des résidents (soit 120 % du salaire) ; on risque fort de leur faire payer, de surcroît, les pensions civiles ! S’il est nécessaire d’ajuster les pensions, ce coût doit cependant être compensé aux établissements, et l’être complètement. Par ailleurs, il existe des endroits où l’on ne trouve pas de résidents…
Interrogé par le Président François Rochebloine sur les recrutés locaux, M. François Denis indique que la MLF y recourt beaucoup. Ils ne d’ailleurs pas d’un niveau forcément moindres que les enseignants de statut différent. Cependant, fixer un objectif de 50 % de titulaires semble de bonne politique.
Il faut s’efforcer de suivre et de contrôler la qualité de l’enseignement, le respect des programmes etc., quelle que soit la catégorie de recrutement. Les parents ne souhaitent certes pas d’augmentation des écolages… mais ils souhaitent encore moins une dégradation de la qualité de l’enseignement.
Le Président François Rochebloine demande si la « cristallisation » de la prise en charge des écolages pour éviter de financer certaines hausses exorbitantes intervenues, par exemple, aux Etats-Unis, est une réalité.
M. François Denis répond que tout ce qui a été annoncé par M. Alain Catta (directeur des Français de l’étranger au Quai d’Orsay) a été fait. Pour autant il faut faire beaucoup plus. Nous avons été écoutés mais pas entendus. Ou alors il faut dore clairement que l’on informe les parents d’élèves, et non qu’on les consulte. La FAPEE se bat pour susciter chez les parents, à grand-peine, le sens de l’intérêt général, et voilà qu’on lui coupe l’herbe sous le pied.
Interrogé par le Président François Rochebloine sur la notion de « quatrième catégorie » d’établissements d’enseignement français à l’étranger, M. François Denis répond que l’on n’a pas créé l’AEFE pour rien.
On a tort de traiter les établissements en gestion directe (EGD) comme des lycées de métropole. Il faudrait plus de démocratie locale, davantage d’association de ceux qui vivent sur place ; l’AEFE semble prête à avancer sur ce point. En outre, il faut se garder de transformer le statut des établissements sous prétexte d’une absence de reconnaissance juridique locale. On constate ainsi que des établissements conventionnés et « abrités » par l’ambassade sont transformés en EGD au seul motif de conserver cette « sécurité »… Or il existe d’excellents établissements conventionnés (le lycée La Pérouse de San Francisco par exemple). L’homologation est par ailleurs une bonne solution alternative au conventionnement. Cependant le passage du conventionnement à l’homologation ne doit pas s’effectuer sans accompagnement, faute de quoi on s’expose à un brusque ressaut des écolages.
Attention à la « quatrième catégorie », ou « label » : il est bon de dire que ces établissements ne sont pas des établissements français, qu’ils ne présentent pas la même qualité d’enseignement. Sinon ils risquent de « cannibaliser » l’enseignement français à l’étranger. D’ailleurs les professeurs sont plutôt hostiles au concept. Il faudrait donc réserver ce label aux lieux où le réseau français d’enseignement n’est pas déployé.
Le Président François Rochebloine demande à quels niveaux il faudrait fixer le double plafonnement de la prise en charge des écolages des enfants français.
M. François Denis répond que le plafonnement devrait être modulé (à l’instar de ce qui se fait pour les bourses) en fonction du niveau de vie local. Entre 1 000 euros à Madagascar et 16-17 000 euros aux Etats-Unis, l’écart est grand… Une modulation par continent suffit, du reste. Cependant, la notion même de plafonnement n’est pas sans risque car elle peut exclure des personnes qui auraient eu vraiment besoin de la mesure. Le problème est que l’on essaie de redresser un système qui n’aurait jamais dû exister.
Interrogé par le Président François Rochebloine à propos d’éventuels recours contentieux de ressortissants de l’Union européenne contre une mesure ne bénéficiant qu’aux Français, M. François Denis répond qu’il n’en a pas connaissance mais que ce ne serait pas infondé ; en revanche, à partir du moment où le niveau des ressources est pris en compte, le raisonnement n’est plus tout à fait le même.
En guise de préconisations à l’adresse de la mission, M. François Denis mentionne les trois points suivants :
– que l’État s’implique dans l’immobilier du réseau. Les besoins sont de 40 à 50 millions d’euros ;
– que l’on ne promeuve pas l’autofinancement des établissements sans aider les familles plus modestes, y compris étrangères ;
– que l’on soit très soucieux de la qualité de l’enseignement.
La réunion est levée à 18 heures 40.
Compte rendu de l’audition de M. Clément Duhaime,
administrateur de l’Organisation internationale de la Francophonie
(Jeudi 22 octobre 2009 − 33, rue Saint-Dominique – salle 4214)
La réunion est ouverte à 11 heures.
• Présent
M. François Rochebloine, Président
• Excusés
Mme Geneviève Colot, Rapporteur, Mme Martine Aurillac, MM. Jean-Louis Bianco, Philippe Cochet, Jean-Pierre Dufau, Jean-Michel Ferrand, Jean-Claude Guibal, Jean-Pierre Kucheida, Robert Lecou, Didier Mathus, Jacques Remiller et André Schneider.
*
M. François Rochebloine, Président, accueille M. Duhaime en présentant les travaux de la mission et les objectifs qu’elle poursuit.
M. Clément Duhaime, administrateur de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), évoque en préambule le succès des Jeux de la Francophonie ayant au mois de septembre rassemblé au Liban quelque 3 000 jeunes venus de plus de 40 pays.
Au Liban toujours, se déroule au moment de l’audition un salon du livre, le plus grand salon francophone après Paris et, semble-t-il, devant Montréal…
En 2005, M. Abdou Diouf a réussi là où personne avant lui n’avait su le faire, en créant une Organisation internationale de la Francophonie digne de ce nom, fonctionnant sur ses deux jambes politique et administrative. L’OIF s’est réorganisée pour devenir un modèle de gouvernance.
A été mise en place une programmation sur quatre ans, avec des résultats vérifiables et mesurables, sur le modèle de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). Elle doit être entérinée en décembre 2009.
Quatre axes prioritaires ont été définis pour guider l’action de l’OIF :
– la démocratie, les droits de l’homme et la paix ;
– le développement durable et la solidarité, couplés au développement économique ;
– l’éducation ;
– la langue française.
Au service de ces quatre priorités, l’objectif est de faire fonctionner de façon complémentaire et efficace les différentes enceintes de la Francophonie – maires, universités, parlementaires – et d’associer également les professeurs et les Alliances françaises.
La recherche d’efficacité, comme les leçons du passé, ont conduit à choisir des actions ciblées : ainsi, dans un premier temps, une concentration sur l’enseignement primaire, conduisant à laisser temporairement de côté l’alphabétisation, la lutte contre l’exclusion du système scolaire, ou le français dans l’enseignement secondaire.
Il faudrait deux à trois millions d’instituteurs en Afrique pour enseigner le français. C’est crucial pour l’avenir de la langue, qui n’est langue maternelle que dans peu de pays ; ailleurs c’est une langue choisie. Or en 2030, un humain sur quatre sera africain ! En se focalisant sur la Chine ou l’Inde on oublie cette réalité démographique majeure.
Dès lors, si l’on ne forme pas assez d’instituteurs, le français risque de disparaître en Afrique. Le danger guette déjà au Burundi, en Haïti, au Bénin, voire à Madagascar. Il faut également travailler sur les méthodes pédagogiques.
Le Président François Rochebloine demande qui sont les formateurs.
M. Clément Duhaime répond qu’il s’agit d’un partenariat avec l’Agence universitaire de la Francophonie. S’y ajoutent la Fondation Lagardère, ainsi que toutes les coopérations bilatérales que l’Agence française de développement suit de près, et enfin la coopération européenne.
L’OIF précise toujours qu’elle intervient au stade du lancement des actions ; par la suite, n’étant pas elle-même bailleuse de fonds, elle ne reste pas impliquée indéfiniment mais encourage à la coopération bilatérale et multilatérale.
Il existe un centre de formation à Sofia en Bulgarie pour l’Europe centrale et orientale, un autre est en projet à Madagascar et un autre encore dans les Antilles. Longtemps restées indifférentes l’une à l’autre, les différentes organisations de la famille francophone ont à présent compris leur besoin de s’allier.
Cela vaut aussi dans le domaine de la formation professionnelle et technique, dans les domaines du tourisme, de l’hôtellerie ou de l’industrie culturelle (technique cinématographique, technique musicale et arts de la scène, livre).
La Francophonie a développé depuis 40 ans une expertise considérable dans le domaine de l’audiovisuel, avec par exemple plus de mille œuvres soutenues en 15 ans, comme le montre le catalogue numérique actuellement en cours de constitution. Les hôtels du groupe Accor proposent ainsi à la vente, dans leur hall d’entrée, des DVD soutenus (à hauteur de 20-30 %) par l’OIF.
Interrogé par le Président François Rochebloine sur TV5 Monde, M. Clément Duhaime décrit un outil extraordinaire. Avec d’autres, le Président Diouf s’est battu pour qu’elle reste une chaîne multilatérale. Les partenaires ont consenti à la soutenir davantage financièrement, en appui à la France qui était trop esseulée jusqu’alors.
L’OIF travaille beaucoup avec TV5 Monde sur l’apprentissage du français ; c’est un formidable outil pour les enseignants du monde entier.
Pour en revenir à la formation professionnelle dans le domaine culturel : pourquoi avoir retenu ces trois filières (image, musique et arts de la scène, livre) ? Pour développer, par exemple, des projets d’entreprise (PME), comme c’est le cas actuellement grâce à 650 000euros de la BIDC (Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO, Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest), 650 000 euros de l’OIF et sans doute une participation de la branche française de l’AFD. Pourraient être ainsi soutenues des initiatives en Afrique du Nord, en Europe centrale…
Il faut tordre le cou à l’idée selon laquelle la culture est « dévoreuse de crédits » et ne rapporte rien ! Si le Québec ne s’était pas battu pour sa culture, il n’abriterait pas aujourd’hui des multinationales comme le Cirque du soleil ou le Festival « Juste pour rire », il n’aurait pas une télévision qui lui ressemble.
Un dernier aspect à mentionner est celui des lectures publiques dans les centres culturels : au Liban où c’est un point de ralliement pour toutes les communautés, au Burkina Faso et en Haïti où cette pratique améliore beaucoup les résultats scolaires de ceux qui s’y adonnent…
Le Président François Rochebloine demande si cette activité ne concurrence pas celle des Alliances françaises.
M. Clément Duhaime répond que la question s’est posée, mais que ce n’est plus le cas aujourd’hui car il existe une relation de collaboration. En outre, l’OIF soutient certaines Alliances, comme celle de Bruxelles qui a connu un développement important grâce aux élèves que l’OIF a pu drainer.
La collaboration permet aussi la levée de fonds auprès de mécènes. C’est notamment dans cette optique que le Président Abdou Diouf a accepté de participer à la Fondation Alliance française. Il faudrait parler d’« Alliances francophones » !
Sur la question du français comme langue olympique, le Président François Rochebloine fait observer que sa place n’est pas toujours respectée. Que fait l’OIF à cet égard ?
M. Clément Duhaime répond qu’elle agit beaucoup mais ne le dit pas assez. Ainsi, c’est l’OIF, sur l’initiative du Président Abdou Diouf, qui a institué les « grands témoins » de la francophonie dans le cadre des Jeux olympiques : M. Hervé Bourges à Athènes (2004), qui est revenu furieux ; Mme Lise Bissonnette à Turin (2006) qui n’était pas très satisfaite et M. Jean-Pierre Raffarin à Pékin (2008), qui était nettement plus satisfait.
Les Chinois ont consenti de réels efforts, signant même un accord sur ce point. M. Jacques Rogge, Président du Comité international olympique, a été rencontré à plusieurs reprises sur ce thème.
Le travail se poursuit en amont des Jeux de Vancouver ; le grand témoin sera M. Pascal Couchepin, ancien Président de la Confédération suisse. La tâche risque d’être plus difficile même si le CIO comprend que l’OIF est là pour l’aider. La Colombie britannique ne comprend que 5 % de francophones…
Au Président François Rochebloine demandant son point de vue sur la réforme en cours du réseau culturel de la France à l’étranger, M. Clément Duhaime répond que le Secrétaire général (M. Abdou Diouf) a été consulté. Tout ce qui permettra un meilleur rayonnement de la France et une meilleure organisation du réseau sera bienvenu.
Le Président François Rochebloine demande à M. Duhaime de laisser à la mission une préconisation finale. Celui-ci répond que l’on pourra accomplir de grandes choses en préservant la coopération entre tous. Mais cette coopération est encore fragile. L’OIF met en place pour la conforter un « pôle langue française », afin que chacun ne travaille pas isolément en apprenant par la presse les actions du voisin. Le français est une langue d’avenir.
La réunion est levée à midi.
Compte rendu de l’audition de M. Henri Loyrette,
Président-directeur du Musée du Louvre
accompagné de :
– M. Hervé Barbaret, administrateur général du Musée du Louvre
– Mme Dominique de Fontréaulx, conseillère scientifique du Président
– M. Bruno Maquart, directeur général de l’Agence France-Muséums
– Mme Laurence des Cars, directrice scientifique de l’agence
– M. Ugo Bertoni, chargé de mission auprès du directeur général
(Jeudi 22 octobre 2009 − 33, rue Saint-Dominique – salle 4223)
La réunion est ouverte à 12 heures 10.
• Présent
M. François Rochebloine, Président
• Excusés
Mme Geneviève Colot, Rapporteur, Mme Martine Aurillac, MM. Jean-Louis Bianco, Philippe Cochet, Jean-Pierre Dufau, Jean-Michel Ferrand, Jean-Claude Guibal, Jean-Pierre Kucheida, Robert Lecou, Didier Mathus, Jacques Remiller et André Schneider.
*
M. François Rochebloine, Président, accueille l’équipe dirigeante du Musée du Louvre et de l’Agence France-Muséums.
M. Henri Loyrette, Président-directeur du Musée du Louvre, rappelle que, créé en 1793, le Louvre a été « développé » par l’Empire comme musée universel de toutes les civilisations et s’adressant au monde entier, ce qui était très original à l’époque.
Depuis quelques années, le Louvre s’essaie à renouveler cette mission dans le monde d’aujourd’hui. Il exporte son expertise en Égypte ou en Syrie, il explore des terres nouvelles – des fouilles sont en cours au Soudan et de nouvelles fouilles sont envisagées en Asie centrale.
Il organise des expositions dans le monde entier, avec beaucoup de succès.
Le Président François Rochebloine indique que la mission a pu visiter l’une d’elles à Buenos Aires en septembre 2009.
M. Henri Loyrette ajoute que le Louvre est le troisième musée américain dans le monde : il reçoit davantage de visiteurs américains que chacun des musées des États-Unis, hormis le Metropolitan Museum de New York et la National Gallery de Washington.
Les pays étrangers qui font appel à l’expertise du Louvre recherchent de plus en plus des partenariats qui ne sont plus seulement artistiques mais également techniques (restauration, architecture, signalétique etc.).
Le Louvre est le symbole du musée universel dans le monde. Le Met de New York imite ce modèle et le Louvre Abou Dhabi recherche le même rayonnement.
La Syrie est également, du fait du meilleur climat de nos relations diplomatiques avec ce pays, un dossier qui avance en ce moment. Enfin, avec l’appui de l’Aga Khan, le Louvre procède actuellement à une profonde rénovation du musée islamique du Caire.
La concurrence est rude ce pendant, dans ce domaine. Ainsi, en Iran, un musée créé par un Français est en cours de rénovation par une équipe italienne, grâce à un dispositif financier original.
Le projet du Louvre Abou Dhabi est né par accord intergouvernemental le 6 mars 2007. Ce sont tous les musées nationaux français qui y participent, sous le label du Louvre.
Le Président François Rochebloine indique qu’une délégation de la mission se rendra sur place.
M. Henri Loyrette résume les grandes lignes de l’accord intergouvernemental, dont l’approbation a été autorisée le 18 octobre par le Parlement. Pendant trente ans, le nom du Louvre pourra être utilisé et pendant dix ans, des prêts d’œuvres seront réalisés pour des durées limitées. De grandes expositions seront organisées pendant quinze ans. A par ailleurs été instituée une commission des acquisitions du Louvre Abou Dhabi, afin de lui permettre de créer sa propre collection. Il s’agit donc bien d’un musée national en création qui sera autonome, et nullement d’une antenne du Louvre.
Ce projet consiste donc à créer rien de moins que le premier musée universel en dehors du monde occidental. Sa portée éducative est évidente, comme en témoigne l’implantation aux Emirats arabes unis de la Sorbonne (Paris IV) et de la New York University.
Par ailleurs, seront présents à proximité une émanation du musée Guggenheim de New York – pour l’art moderne et l’art contemporain – et un musée du Sheik Zayed dont la conception a été confiée au British Museum.
L’architecture du Louvre Abou Dhabi est l’œuvre, magnifique, de M. Jean Nouvel.
Quant à l’Agence France-Muséums, elle a été créée le 11 juillet 2007 entre le Louvre, actionnaire principal, le Musée d’Orsay, le Centre Georges-Pompidou, la Réunion des musées nationaux, le Domaine national de Chambord, celui de Versailles, le Musée Rodin, le Musée Guimet, le Musée du Quai Branly, la Bibliothèque nationale de France, l’EMOC (Établissement public de maîtrise d’ouvrage des travaux culturels)…
À la question du Président François Rochebloine demandant qui « exporte » aux Émirats dans le cadre du projet du Louvre Abou Dhabi, M. Henri Loyrette répond que le Louvre ne le fait pas seul, d’où la création de l’agence France-Muséums.
Beaucoup reste à faire au Louvre, même après la grande réforme qu’il a connue. Dès lors, les 400 millions d’euros versés par les Émirats arabes unis – dont 150 millions d’euros ont déjà été perçus – serviront à un fonds de dotation (c’est-à-dire que seuls les intérêts, et non le capital, sont dépensés). Celui-ci ne devrait pas accompagner un désengagement de l’État – ce qui se produit pourtant, hélas.
M. Hervé Barbaret ajoute qu’a été négociée une licence de marque, une exploitation du nom du Louvre qui permettra par exemple le développement d’une ligne de produits dérivés, après approbation du Louvre, lequel recevra un pourcentage des recettes.
Mme Dominique de Fontréaulx précise que l’engagement conclu pour trente ans vise en priorité à promouvoir le « rayonnement de l’expertise muséale » de la France.
Le Président François Rochebloine demande si des obstacles ont été ou sont rencontrés dans le développement du projet.
M. Henri Loyrette répond que les Émirats arabes unis se sont d’abord adressés directement au Musée du Louvre seul ; celui-ci n’ayant pas les capacités de porter le projet de façon autonome, tous les musées nationaux ont été impliquées, grâce au rôle excellemment joué par le ministère de la Culture.
Le projet a germé en 2005, à l’initiative des Émiriens. Ceux-ci avaient déjà en tête le ^projet architectural de Jean Nouvel, avant même de réfléchir à son contenu.
Au chapitre des « difficultés », on pourrait évoquer les particularités du pays lui-même, son organisation originale. Ainsi, l’interlocuteur local – avec lequel les relations sont très bonnes au demeurant – s’appelle TDIC (Tourisme Development and Investment Company), une entité présidée par un membre de la famille régnante. Le projet global, dans lequel s’insère le musée, est très vaste, incluant logements, golf, etc. On rencontre parfois un « problème culturel » avec les interlocuteurs locaux.
L’autre élément de préoccupation concerne l’absence d’articulation entre les différents musées qui seront implantés sur l’île artificielle en cours d’aménagement : pour l’instant, on manque d’une vue d’ensemble.
À la question du Président François Rochebloine sur le coût des travaux, M. Bruno Maquart répond par le chiffre de 500 millions de dollars, hors infrastructures spécifiques – par exemple pour la construction de fondations empiétant sur la mer. La superficie totale du projet représente 27 km2, soit le quart de Paris… Il a d’abord fallu construire cette île de toutes pièces.
Le musée lui-même occupera 24 000 m2, dont 2 000 m2 pour les expositions et 6 000 m2 pour les collections, soit une taille moyenne, aisément maîtrisable. Le grand apport de M. Henri Loyrette a été de rendre de le projet viable et raisonnable.
Mme Laurence des Cars ajoute, en tant que directrice scientifique, que s’agissant d’un musée universel, il a été conçu dans un esprit de dialogue, de décloisonnement et non de séparation entre peintures et sculptures par exemple, ou entre civilisations.
Il s’agit de s’adapter au public local, à sa situation géographique particulière, à un certain cosmopolitisme. En somme, sous la bannière du Musée du Louvre, le but recherché est de relire la philosophie du musée universel en en faisant un musée du temps de la mondialisation, par adaptation au monde actuel de l’esprit des Lumières.
Le Sheikh Sultan tient beaucoup à la constitution d’une collection nationale. L’Agence apporte en réponse son savoir-faire, sa connaissance, son expertise. Les acquisitions se font dans un esprit de confiance et de respect mutuel. Une quarantaine d’œuvres ont déjà été rassemblées. Cette collaboration culturelle est d’un type nouveau, très stimulant.
Mme Dominique de Fontréaulx précise qu’il s’agit bien de la constitution d’une collection et non de la juxtaposition d’œuvres singulières.
Le Président François Rochebloine demande si l’inauguration aura bien lieu en 2013 comme prévu.
M. Bruno Maquart répond par l’affirmative ; le projet est « millimétré », conduit au moyen d’appels d’offres publiés dans la presse internationale. Le Louvre Abou Dhabi est une institution à but non lucratif financée par l’État émirien sur ses importants surplus budgétaires. En effet, le budget d’Abou Dhabi est construit sur l’hypothèse d’un cours du baril de pétrole de 35 dollars, tout le surplus étant mis en réserve dans des fonds souverains pour mener des projets comme celui du Louvre. Ce qui permet de dégager quelque 40 millions de dollars par an en moyenne pour ce seul musée…
À la question du Président François Rochebloine sur le fonctionnement futur du musée une fois construit et sur son « patron », M. Bruno Maquart répond que tout reste à prévoir sur ce point.
M. Henri Loyrette ajoute que la France devra nécessairement s’impliquer, ne serait-ce qu’à cause du nom du Louvre pendant trente ans. Le directeur sera choisi d’un commun accord.
Le Président François Rochebloine s’enquiert de l’existence d’autres projets d’implantation à l’étranger.
M. Henri Loyrette répond que les sollicitations syriennes sont aujourd’hui très pressantes, notamment du fait de liens très anciens avec le Louvre. Cependant, dans un contexte de subventions et d’effectifs décroissants, il convient de garder raison. L’État doit s’impliquer davantage. Ainsi, le Louvre a accédé à la demande de l’État consistant à ouvrir un département des arts islamiques, mais sans moyens nouveaux alloués à cette fin… Devra-t-on fermer des salles existantes pour ouvrir ce nouveau département ? Le Louvre ne dispose que de 60 conservateurs ; c’est très peu.
À la question du Président François Rochebloine sur la place de la France dans le phénomène de mondialisation des musées, M. Henri Loyrette répond qu’elle est privilégiée, y compris pour le Musée d’Orsay.
La richesse des œuvres est indéniable mais les compétences humaines parmi les conservateurs, les personnels administratifs, ainsi que tous les métiers de la muséographie, des doreurs aux socleurs en passant par les marbriers, sont tout aussi excellentes. Il faut les valoriser ! C’est une vraie richesse patrimoniale à développer.
Le Président François Rochebloine interroge ensuite M. Henri Loyrette sur l’action culturelle extérieure de la France et les moyens qui lui sont consacrés. Celui-ci répond que la France peut s’enorgueillir d’une grande tradition en ce domaine mais que son influence régresse globalement. Les Italiens, par exemple, sont plus offensifs.
En outre, il y a une incapacité préoccupante à coordonner différentes finalités. Or la culture peut servir d’autres intérêts, économiques ou stratégiques ; il n’y a là rien d’indécent. L’Italie ou l’Allemagne le savent bien ; nous devrions, comme eux, mutualiser nos efforts.
Quant à la langue française, elle recule partout, de l’Italie à l’Égypte ou au Liban.
Au Président François Rochebloine lui demandant de conclure par une préconisation, M. Henri Loyrette répond qu’il souhaite recevoir les moyens qui permettent au Louvre de répondre aux nombreuses sollicitations dont il est l’objet.
La réunion est levée à 13 heures.
Compte rendu de l’audition de M. Jean-François Cervel,
directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)
accompagné de M. Jean-Paul Roumegas, sous-directeur des affaires internationales
(Mardi 17 novembre 2009 − 33, rue Saint-Dominique – salle 4211)
La réunion est ouverte à 16 h 45.
• Présents
M. François Rochebloine, Président
Mme Geneviève Colot, Rapporteur
• Excusés
Mme Martine Aurillac, MM. Jean-Louis Bianco, Philippe Cochet, Jean-Pierre Dufau, Jean-Michel Ferrand, Jean-Claude Guibal, Jean-Pierre Kucheida, Robert Lecou, Didier Mathus, Jacques Remiller et André Schneider.
*
M. François Rochebloine, Président, accueille MM. Cervel et Roumegas et présente la mission et ses travaux. Il sollicite en particulier les intervenants sur la question de l’articulation entre l’enseignement secondaire français à l’étranger et l’enseignement supérieur français ou francophone.
M. Jean-François Cervel, directeur du CNOUS, indique qu’en trois ans et demi de mandat il a pu constater que l’accueil des étudiants étrangers en France et, plus largement, la dimension internationale de l’enseignement supérieur, sont des sujets à propos desquels le besoin de réforme est une constante.
Le CNOUS, établissement public administratif, est à la tête d’un réseau de 28 centres régionaux – soit un par académie –, les CROUS, dotés eux aussi du statut d’EPA. La loi créant le CNOUS, qui date de 1955, a été adoptée au terme de plusieurs années de réflexion.
L’établissement mène une mission assumée par l’État, dans un objectif de promotion sociale : il s’agit de permettre aux enfants d’origine modeste de poursuivre des études supérieures au même titre que ceux issus de familles privilégiées. 525 000 bourses sur critères sociaux ont été allouées en 2008-2009 (sur un total de 2,2 millions d’étudiants, dont 200 000 non-Européens). Cela représente un montant d’1,5 milliard d’euros. Ainsi, le taux d’étudiants boursiers est de l’ordre de 30 %.
Mme Valérie Pécresse, ministre de l’Enseignement supérieur, a annoncé l’augmentation des bourses par la création d’un sixième échelon.
Le Président François Rochebloine demande si des effets de seuil sont constatés.
M. Jean-François Cervel répond par l’affirmative. La ministre elle-même l’a publiquement reconnu, en justifiant cette réforme du sixième échelon qui, à partir d’un montant de 4 060 euros par an, est porté à 4 450 euros si l’on prend en considération l’exonération de droits de scolarité et de cotisations de sécurité sociale.
Le programme budgétaire 231 Vie étudiante de la Mission Recherche et enseignement supérieur est doté de 2 milliards d’euros environ, dont 1,5 milliard pour les bourses et 500 millions d’euros pour le financement du réseau des œuvres universitaires (y compris le logement et la restauration).
Les résidences du réseau sont ouvertes dix mois par an, de septembre à juin, et l’été pour des étudiants étrangers en court séjour.
Le CNOUS peut compter sur 600 millions d’euros de ressources propres, tirées des loyers et de la restauration (même si les tarifs en sont très modiques).
Le Président François Rochebloine s’enquiert de comparaisons étrangères.
M. Jean-François Cervel répond que ce système est très français. Toute la vie étudiante est dans notre pays gérée par un régime d’État, alors que dans les pays anglo-saxons cette gestion est le fait des établissements eux-mêmes, soit sous forme associative, soit par d’autres moyens.
En France, l’essentiel des moyens provient du budget de l’État. Leur répartition est effectuée par le CNOUS. Deuxième particularité française : un fonctionnement très administratif, mis en œuvre par des fonctionnaires et des contractuels de droit public. La tutelle est exercée par la direction générale de l’enseignement supérieur et la direction générale de la mondialisation.
La tutelle administrative du CNOUS est unique, c’est celle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche. Mais d’autres ministères sont représentés au conseil d’administration.
Dès l’origine, le CNOUS a été chargé de l’accueil des étudiants étrangers ; dès l’origine, a été créée à cette fin une sous-direction ad hoc, la sous-direction des affaires internationales (SDAI). Elle est compétente pour la gestion de toutes les conventions avec les boursiers du gouvernement français, financées par le ministère des Affaires étrangères et européennes.
M. Jean-Paul Roumegas précise que la SDAI exerce ses activités dans deux domaines : la mise en place des programmes de bourses pour l’accueil des étudiants étrangers d’une part, et le pilotage et l’animation de la politique internationale des CROUS (donc des universités), d’autre part.
Le Président François Rochebloine demande quels liens le CNOUS entretient avec l’Agence Europe éducation formation France (A 2e 2f) ainsi qu’avec CampusFrance.
M. Jean-Paul Roumegas répond qu’à l’origine les programmes européens d’échange étaient gérés par le CNOUS, avant que ne soit créée l’agence A 2e 2f, sous la forme d’un groupement d’intérêt public dont le CNOUS est membre avec 18 % des voix. Les personnels et les crédits afférents ont été transférés du CNOUS à l’agence.
Par ailleurs, ces deux entités contractualisent l’une avec l’autre pour le logement des étudiants européens accueillis en France dans le cadre des programmes communautaires de mobilité étudiante.
M. Jean-François Cervel ajoute à cet égard qu’il existe plusieurs catégories d’étudiants étrangers accueillis en France. ; les étudiants européens présentent la double particularité d’être citoyens de l’Union et bénéficiaires de programmes de mobilité spécifiques.
Mme Geneviève Colot, Rapporteur, demande si des étudiants étrangers viennent en France en bénéficiant de bourse de leur pays d’origine.
M. Jean-François Cervel répond par l’affirmative. C’est une part importante de l’activité de la SDAI. Il existe d’ailleurs des bourses mixtes, françaises et étrangères.
M. Jean-Paul Roumegas précise que le CNOUS est depuis 1960 opérateur du ministère des Affaires étrangères et européennes pour les pays « hors champ » – de la coopération française. Pour les pays « du champ », c’est aujourd’hui Égide qui est gestionnaire, cette dichotomie ayant perduré en dépit de la fusion, au tournant des années 2000, du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Coopération.
Aujourd’hui, le CNOUS gère 295 programmes avec 145 pays différents. Il est un « opérateur d’aval », qui intervient une fois qu’a été prise la décision d’octroi d’une bourse.
À la question du Président François Rochebloine sur le suivi de l’assiduité des étudiants aidés, M. Jean-Paul Roumegas répond qu’il existe.
Le ministère des Affaires étrangères et européennes verse 25 millions d’euros pour financer les bourses, 32 millions d’euros en incluant l’AEFE. Au total, 37 millions d’euros financent des bourses au profit de 15 000 étudiants ; nombre d’entre elles sont cofinancées. 2 500 de ces étudiants sont des boursiers du gouvernement français, les autres bénéficiant d’autres financements, parfois mixtes entre gouvernements français et étranger.
M. Jean-François Cervel rappelle l’historique de CampusFrance, GIP auquel le CNOUS participe. Alors que la création de l’agence Edufrance, décidée en 1997 et mise en œuvre en 1998, avait débouché en 2006 sur une période d’incertitude, la transformation de cet organisme en GIP, en mars 2007, a été fort bien inspirée.
Certes, le dispositif est très complexe car il associe de nombreux acteurs, notamment les établissements d’enseignement supérieur.
Mais cette organisation est nécessaire pour figurer dans la compétition internationale que représente le marché de l’enseignement supérieur.
CampusFrance regroupe la Conférence des présidents d’université, la Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs, la Conférence des grandes écoles, trois ministères (affaires étrangères et européennes, enseignement supérieur et recherche, immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire) et enfin des opérateurs comme le CNOUS et Égide.
Il s’agit d’une formule très intéressante permettant à chaque entité d’exister au sein du GIP, et qui fait à peu près l’unanimité aujourd’hui.
Le Président François Rochebloine demande si le projet de loi relatif à l’action extérieure de l’État en instance au Sénat ne pose pas le problème de la création d’une agence reprenant les activités de CampusFrance en omettant certaines entités participantes, dont le CNOUS.
M. Jean-François Cervel répond que tel est le choix du Gouvernement. Dans sa configuration envisagée, cet opérateur supplémentaire ne facilitera pas les choses dans la mesure où il se situera à côté des établissements d’enseignement supérieur, alors que ceux-ci participaient jusqu’à présent à l’assemblée générale du GIP.
Un rapport d’audit des inspections générales de l’Éducation nationale et de la recherche d’une part, et des affaires étrangères d’autre part, a mis en évidence un coût de gestion des bourses du gouvernement français deux à quatre fois moindre au CNOUS qu’à Égide.
M. Jean-Paul Roumegas ajoute que l’intention ayant présidé à la création de CampusFrance était de créer un « grand opérateur de la mobilité universitaire » ; en revanche, le projet de loi relatif à l’action extérieure de l’État envisage un « grand opérateur de la mobilité » tout court… On peut regretter une concession excessive à la logique du « guichet unique ».
M. Jean-François Cervel regrette pour sa part que le ministère des Affaires étrangères et européennes poursuive une vision trop orientée vers la rationalisation – c’est-à-dire la baisse – de ses moyens. Par ailleurs, il s’agit de donner un statut plus solide à Égide. Le tout est fortement teinté de la logique de la RGPP.
L’avantage de l’assemblage proposé consiste à mettre tous les acteurs autour de la table… mais le CNOUS reste à l’extérieur. Quel est, dans ces conditions, l’avenir de la SDAI ?
M. Jean-Paul Roumegas indique comprendre que al création d’un EPIC soit nécessaire à la consolidation du statut d’Égide. Mais pourquoi ne pas avoir simplement inclus cet EPIC dans le GIP CampusFrance ?
M. Jean-François Cervel exprime sa crainte qu’à l’avenir on doive recréer un GIP pour intégrer tous les acteurs concernés.
M. Jean-Paul Roumegas précise que le CNOUS et Égide présentent des coûts de gestion unitaires des bourses fort différents, bien plus élevés pour Égide, alors que le CNOUS dégage un bénéfice net de 4 millions d’euros, intégralement réinvesti dans es activités internationales.
S’agissant des publics accueillis, MM. Cervel et Roumegas indiquent qu’il serait souhaitable que davantage d’anciens élèves des lycées du réseau de l’AEFE viennent poursuivre en France des études supérieures.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier l’ensemble des étudiants étrangers arrivant en France sans aide aucune, qu’ils soient issus de familles aisées ou, au contraire, de milieux très modestes et pourtant dépourvus de toute aide. Ces derniers forment une grande partie du public géré par les CROUS ; ils demandent par ailleurs des aides sociales et un montant de 6 millions d’euros leur est consacré chaque année sous forme d’aides ponctuelles.
Le Président François Rochebloine interroge les intervenants sur l’attractivité de l’enseignement supérieur français en général et sur le rééquilibrage géographique souvent évoqué à propos de la provenance des étudiants choisissant de venir en France.
M. Jean-François Cervel répond qu’elle est globalement forte, notamment du fait de la gratuité des études.
M. Jean-Paul Roumegas ajoute que l’attractivité est celle d’un modèle européen d’enseignement supérieur ; il y a en Europe beaucoup plus d’étudiants qu’aux États-Unis. L’aspect social de cette attractivité est essentiel.
Le rééquilibrage géographique des pays d’où proviennent les étudiants ne se fera pas uniquement au moyen d’actions de promotion ; il faut des programmes structurés, incluant notamment des bourses. Or ces moyens sont aujourd’hui utilisés à plus de 50 % au bénéfice de pays de l’ex-champ.
Il convient donc, premièrement, de mieux répartir l’emploi de ces crédits de bourses et, deuxièmement, de créer des partenariats d’excellence, des réseaux universitaires , pour convaincre, par exemple, les étudiants indiens d’apprendre le français et de venir étudier en France. Être présent dans les salons ne suffit pas.
M. Jean-François Cervel souligne que se développe un marché mondial de l’enseignement supérieur, l’attractivité passant alors avant tout par la qualité des établissements.
Revenant à la question du projet de loi relatif à l’Action extérieure de l’État, M. Jean-Paul Roumegas déplore qu’il ait interrompu la dynamique selon laquelle le CNOUS était en passe de créer en région des structures « miroirs » des espaces CampusFrance à l’étranger.
À la question du Président François Rochebloine sur l’opportunité d’inclure la SDAI du CNOUS dans le nouvel opérateur en projet, M. Jean-François Cervel répond qu’il ne croit pas beaucoup à l’opérateur unique, même si le CNOUS y participe. Ce que recherche le CNOUS est l’articulation entre son action en France et son action internationale.
De ce point de vue, poursuit M. Jean-Paul Roumegas, inclure la SDAI dans l’EPIC en projet reviendrait en réalité à faire disparaître le CNOUS du paysage…
Quoi qu’il en soit, le nouvel opérateur devra conventionner avec le CNOUS pour l’accueil des étudiants. Ce sera peut-être l’occasion d’une remise à plat des rôles de chacun.
Par exemple, imagine M. Jean-François Cervel, Égide pourrait recevoir une compétence exclusive pour la mobilité de tous les « adultes », tandis que le CNOUS s’occuperait de l’aide à tous les étudiants.
La réunion est levée à 17 h 30.
Compte rendu de l’audition de M. le professeur Pierre Grégory, vice-chancelier des universités de Paris,
président de l’Agence Europe Éducation Formation France (A 2e 2f)
accompagné de M. le professeur Jean Bertsch, directeur national de l’agence
(Mercredi 18 novembre 2009 − 33, rue Saint-Dominique – salle 4223)
La réunion est ouverte à 16 h 30.
• Présents
M. François Rochebloine, Président
Mme Geneviève Colot, Rapporteur
Mme Martine Aurillac, MM. Robert Lecou et Didier Mathus
• Excusés
MM. Jean-Louis Bianco, Philippe Cochet, Jean-Pierre Dufau, Jean-Michel Ferrand, Jean-Claude Guibal, Jean-Pierre Kucheida, Jacques Remiller et André Schneider.
*
M. François Rochebloine, Président, accueille les professeurs Pierre Grégory et Jean Bertsch et présente la mission ainsi que ses travaux.
M. le professeur Pierre Grégory, président de l’Agence Europe Éducation Formation France (A 2e 2f), présente l’agence comme une très belle institution, au sein de laquelle le président tient un rôle modeste. Il est un administrateur bénévole dont les attributions sont limitées.
Au vu des classements établis par programme communautaire de mobilité, l’A 2e 2f est l’un des organismes les plus actifs. En plus d’être certifiée ISO 9001, l’agence a connu une impressionnante liste de contrôles sur la période récente : un cabinet de consultants et l’inspection générale de l’administration de l’Éducation nationale et de la recherche en 2007, un commissaire aux comptes et l’inspection générale de l’administration en mars 2008, la certification AFNOR en avril 2008, le cabinet Ernst & Young en juin 2008, la Cour des comptes européenne en septembre 2008, un cabinet de commissaires aux comptes en avril 2009, de nouveau l’inspection générale chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche en avril 2009…
Les ministères compétents participent au GIP que constitue l’agence et s’intéressent de très près à son action : ministère des Affaires étrangères et européennes, ministères de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement, de l’Agriculture, de l’Enseignement supérieur et de la recherche. Les Universités sont elles aussi présentes autour de la table : Bordeaux IV et Paris IV, ainsi que la Conférence des présidents d’universités.
C’est la direction des relations européennes et internationales et de la coopération (DREIC) du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche qui exerce la tutelle de l’agence, pour le compte de la Commission européenne.
M. le professeur Jean Bertsch, directeur national de l’agence, souligne le caractère récent de sa nomination deux mois auparavant et présente le double rôle de l’agence : d’une part, opérateur de moyens et signataire de programmes, dont le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie, et d’autre part, relais de formation à l’échelle nationale et européenne.
C’est-à-dire un rôle de promotion et de valorisation de la mobilité internationale des Français partant à l’étranger, dans le but de connaître le système et les réalités d’autres pays, avant de revenir faire fructifier ces connaissances.
Parmi les programmes mis en œuvre, au premier chef apparaît le programme Erasmus, dont l’A 2e 2f est l’opérateur national pour la France.
Incidemment, les échos dans la presse d’un prétendu essoufflement du programme, 4 000 bourses étant supposément non distribuées, sont dénués de fondement. Il s’agit d’un simple décalage calendaire.
Erasmus concerne 27 000 étudiants par an et la progression se poursuit. Ce programme s’est enrichi d’un volet « Erasmus stage », en entreprise, qui a concerné 3 389 étudiants en 2008 et en concerne environ 5 000 cette année. L’agence accompagne ces projets sous la forme d’un tutorat et d’une aide financière.
À la question de Mme Geneviève Colot, Rapporteur, demandant si les étudiants reviennent tous de leur séjour à l’étranger, M. Jean Bertsch répond que tous reviennent avec l’envie de repartir.
Ayant crû de 17 161 étudiants en 2000 à 27 490 en 2009, Erasmus, manifestement, ne s’essouffle pas. Il y a également une certaine émulation avec le programme Leonardo (apprentissage).
Pour autant, il est vrai que la culture internationale demeure peu développée chez les étudiants français.
Le Président François Rochebloine demande si l’agence dispose de relais locaux en propre.
M. Jean Bertsch répond qu’elle ne s’appuie localement que sur les rectorats, les écoles et les universités.
Le budget de l’agence est important : 22,3 millions d’euros en 2009, associant acteurs publics et privés, collectivités territoriales, chambres de commerce et d’industrie, fédérations professionnelles, associations, partenaires sociaux… Très nombreux sont les acteurs impliqués dans les programmes européens.
Le troisième de ces programmes par ordre d’importance est le programme Grundtvig, destiné aux adultes demandeurs d’emploi. Il est certes de taille modeste (1 000 à 1 200 personnes par an) mais il aura probablement des répercussions dans le cadre du futur « service civique ».
Le Président François Rochebloine et Mme Martine Aurillac demandent des détails sur le mode de sélection des bénéficiaires du programme Grundtvig.
M. Jean Bertsch indique que la sélection s’effectue au vu de projets, éventuellement présentés avec l’aide de Pôle emploi. Puis c’est un comité d’évaluation extérieur qui choisit les candidats.
L’agence emploie 87 personnes pour les fonctions de tutorat dans ce cadre et peut se targuer d’apporter une grande valeur ajoutée aux bénéficiaires de Grundtvig. Mais il est un fait que la mobilité professionnelle internationale reste à inventer en France.
On relève notamment une grande « timidité linguistique ». Or une telle mobilité sert évidemment à valoriser la France, les Français, la langue française à l’étranger !
Quant au programme Comenius, il va permettre à des jeunes de partir chez des lycéens étrangers ; la cible projetée est celle de 600 à 1 000 jeunes à partir du 1er janvier 2010.
À M. Robert Lecou demandant à quel niveau d’études s’effectue un séjour Erasmus, M. Jean Bertsch répond qu’il s’agit généralement de la deuxième et plus fréquemment encore de la troisième année après le baccalauréat.
Il existe par ailleurs un programme dénommé « Erasmus Mundus », déconnecté des programmes européens, s’adressant à des étudiants de niveau Master et doctorat.
Le Président François Rochebloine demande quels pays sont plus particulièrement concernés par cette mobilité « sortante ».
M. Jean Bertsch évoque l’Allemagne, l’Espagne, le Royaume-Uni, l’Italie, c’est-à-dire les pays européens dotés d’une riche culture.
Par ailleurs, le programme Tempus est centré sur les pays méditerranéens, l’Asie centrale et les Balkans, en se reposant assez largement sur les ambassades ; les effectifs concernés sont toutefois réduits.
Le Président François Rochebloine demande quelles sont les particularités de la procédure française par rapport à celle adoptée dans d’autres États membres. Quels sont les atouts et les handicaps du statut de GIP ?
M. Pierre Grégory répond que partout on rencontre le même type d’agence, jouissant de relations identiques avec la Commission – ce qui ne fait d’ailleurs que souligner les performances de l’A 2e 2f.
Le statut de GIP est un atout, surtout car il oblige à faire travailler régulièrement en commun des ministères qui autrement resteraient « chacun chez soi ».
Cependant, force est de reconnaître que le rythme de la mobilité sortante en général n’est plus aussi soutenu aujourd’hui qu’il y a quelques années.
Interrogé par le Président François Rochebloine sur les causes de ce phénomène, M. Pierre Grégory explique que les raisons en sont notamment financières. Mais il existe aussi d’autres freins, plus techniques : tant que le processus de Bologne ne sera pas suffisamment mis en œuvre, c’est-à-dire tant que la validation des semestres passés à l’étranger ne sera pas absolument garantie, il restera difficile de faire croître la mobilité.
Un autre aspect du problème est l’insuffisante valorisation de la mobilité dans les cursus des étudiants par les établissements, qui restent trop frileux… tout comme les étudiants eux-mêmes.
À quoi bon en effet aller à l’étranger apprendre une matière dans un manuel traduit du français ?
L’action à mener est de longue haleine. Elle nécessite la montée en puissance des accords de Bologne. La DREIC, ainsi que la direction générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle (DGESIP) doivent y œuvrer.
Il faut dépasser le faible taux actuel de 5 % de mobilité parmi les étudiants. La cible de la ministre, Mme Valérie Pécresse, s’établit à 20 % ! Quoi qu’il en soit, la demande de moyens supplémentaires n’y suffira pas.
Le GIP est la meilleure structure juridique permettant de lever les freins précités.
Mme Martine Aurillac demande quel est le moyen de connaître l’existence de l’agence lorsque l’on cherche à partir en mobilité, compte tenu du peu de notoriété de l’A 2e 2f.
M. Jean Bertsch répond que les conseillers d’orientation des établissements, eux, connaissent l’agence en principe. Les autres outils sont le site Internet de l’A 2e 2f et les manifestations auxquelles participe son directeur.
Mme Martine Aurillac demande si l’agence est l’interlocutrice directe des étudiants et comment s’effectue le tri entre leurs dossiers de candidature.
M. Jean Bertsch répond que les étudiants s’adressent à leur propre établissement, qui transmet la demande, la décision finale revenant à la commission nationale d’évaluation.
Il n’y a aucune hiérarchie de valeur entre les projets. Le taux de satisfaction des demandes est très élevé puisqu’il avoisine 90 %.
M. Pierre Grégory ajoute que c’est aux établissements qu’il appartient d’abord de faire vivre la mobilité étudiante, par l’information de leurs étudiants.
À la remarque du Président François Rochebloine sur la modestie des effectifs concernés par la mobilité sortante, M. Jean Bertsch répond qu’en valeur absolue, la France se situe au-dessus de la moyenne européenne, occupant même la deuxième place.
M. Pierre Grégory précise que c’est la mobilité européenne en général qui reste faible ; les derniers élargissements n’aident pas à la faire progresser rapidement.
Mme Martine Aurillac s’enquiert du montant des bourses allouées.
M. Jean Bertsch indique que le montant versé dépend du statut de l’étudiant, selon qu’il est ou non boursier sur critères sociaux. Le maximum est de l’ordre de 600 euros par mois, soit environ 7 000 euros par an. Le montant complémentaire versé au titre du programme atteint 190 à 200 euros mensuels.
Ce total reste modeste ; mais quelle stratégie vaut-il mieux adopter : augmenter le nombre d’étudiants concernés ou plutôt les montants individuels versés ?
Ne perdons pas de vue la tendance actuelle : la volonté de mieux assurer le rayonnement de la France. Les programmes européens n’ont pas vocation à servir de simple séjour linguistique ou d’échappée hors du cocon familial, mais de tracer des perspectives d’insertion professionnelle.
Le Président François Rochebloine fait observer que la région Rhône-Alpes conclut des accords de mobilité étudiante avec l’Italie ou l’Espagne.
M. Pierre Grégory reconnaît qu’il existe de multiples bourses de mobilité internationale ; si 30 000 sont proposées par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, certaines régions les complètent parfois.
M. Jean Bertsch rajoute que des régions envoient parfois, d’elles-mêmes, des étudiants en mobilité à l’étranger, qui « échappent » alors à l’A 2e 2f. C’est pourquoi des partenariats devraient être noués avec elles, comme c’est le cas à Bordeaux.
Le Président François Rochebloine interroge les intervenants sur leur perception du rayonnement de l’enseignement supérieur français dans le monde, ainsi que sur le projet de loi relatif à l’action extérieure de l’État en tant qu’il concerne le thème de l’attractivité de l’enseignement supérieur de notre pays.
M. Pierre Grégory fait valoir que l’enseignement supérieur en France a connu ces cinq dernières années des soubresauts qui laissent des traces.
Les sciences dures et les humanités sont des domaines dans lesquels les universités françaises sont universellement appréciées : les mathématiques à Paris, les sciences économiques à Toulouse, la littérature et les lettres classiques à Paris IV, l’École normale supérieure, etc.
La question du nouvel opérateur de la mobilité que crée le projet de loi précité est difficile. Il n’y aura développement de la mobilité entrante et sortante dans l’enseignement supérieur que si le monde de l’éducation reste aussi impliqué que possible dans le système institutionnel chargé de cette mission.
Le rôle des établissements d’enseignement est crucial également. Ce serait une erreur que de mettre en place des opérateurs qui seraient extérieurs au monde de l’Éducation nationale.
Le Président François Rochebloine demande quelle devrait être, idéalement, la place des activités internationales du CNOUS à l’égard du nouvel opérateur.
M. Jean Bertsch répond que le CNOUS demeurera, comme membre fondateur, dans le tour de table de l’A 2e 2f. la vraie question qui se pose est celle de savoir si la mobilité est envisagée sous l’angle « touristique » ou dans une perspective de formation universitaire et professionnelle.
Quoi qu’il en soit, l’A 2e 2f n’aura pas le même « fonds de commerce » que l’opérateur créé par le projet de loi, pour trois raisons : l’agence forme, elle forme des Français, et elle les forme tout au long de la vie.
Que CampusFrance et Égide se regroupent et travaillent ensemble, il n’y a là rien que de très logique.
Au Président François Rochebloine demandant une recommandation en conclusion de ces échanges, M. Pierre Grégory répond qu’il ne faut pas compromettre ce qui a réussi jusqu’ici, à l’exemple d’Erasmus qui progresse en dépit d’obstacles, qui sont surmontables.
L’objectif actuel est de multiplier par quatre la mobilité étudiante française sortante, en passant de 5 % aux 20 % précités. Cela favorisera, en retour, la mobilité entrante.
La réunion est levée à 17 h 30.
Compte rendu de l’audition de M. le professeur Gérard Binder,
président du Conseil d’administration de CampusFrance
accompagné de Mme Béatrice Khaiat, directrice déléguée
(Mercredi 18 novembre 2009 − 33, rue Saint-Dominique – salle 4223)
La réunion est ouverte à 17 h 40.
• Présents
M. François Rochebloine, Président
Mme Geneviève Colot, Rapporteur
• Excusés
Mme Martine Aurillac, MM. Jean-Louis Bianco, Philippe Cochet, Jean-Pierre Dufau, Jean-Michel Ferrand, Jean-Claude Guibal, Jean-Pierre Kucheida, Robert Lecou, Didier Mathus, Jacques Remiller et André Schneider.
*
M. François Rochebloine, Président, présente la mission et accueille les intervenants en leur demandant de faire le point de la situation de CampusFrance ainsi que sur les centres pour les études en France et les espaces CampusFrance à l’étranger.
M. le professeur Gérard Binder, président du Conseil d’administration de CampusFrance, rappelle la création en 1998 du GIP Edufrance, qui a évolué depuis lors jusqu’à la création de CampusFrance en mars 2007, déjà dans le but d’intégrer d’autres organismes existants : la sous-direction des affaires internationales (SDAI) du CNOUS et Égide en particulier.
Aujourd’hui, avec le projet de loi relatif à l’action extérieure de l’État, une nouvelle hypothèse est sur la table avec la fusion projetée d’Égide et de France coopération internationale (FCI) dans le même ensemble.
Les adhérents du GIP CampusFrance aujourd’hui sont la quasi-totalité des universités et des écoles, publiques ou privées, d’enseignement supérieur, dont toutes celles de la Conférence des grandes écoles, y compris les écoles de commerce et d’ingénieurs. Soit un total de 227 établissements.
CampusFrance a pour mission de promouvoir à l’étranger l’éducation française publique ou privée, à l’occasion de différentes manifestations publiques et autres salons.
Pour ce faire, l’outil de l’Internet est très puissant. Le site de CampusFrance a enregistré l’an dernier plus de deux millions de visites et 21 millions de pages ont été vues. La fréquentation de ce site Internet double tous les deux ans.
Dans cet ensemble il faut inclure tous les sites Internet « locaux », en 27 langues, y compris le japonais, le coréen et plusieurs formes de la langue chinoise. Cela, même les autres agences concurrentes » n’en disposent pas !
Tout le catalogue des formations proposées par l’Onisep, soit 36 000 formations, est lui aussi disponible en ligne.
Enfin, un moteur de recherche bilingue français-anglais permet de s’y retrouver parmi les nombreux types de bourses existantes, y compris celles que financent les collectivités territoriales.
Mme Béatrice Khaiat, directrice déléguée de CampusFrance, présente le dispositif de CampusFrance à l’étranger. Financé par le ministère des Affaires étrangères et européennes, il compte 127 bureaux dans 88 pays, sur tous les continents, employant environ 250 personnes.
Ces personnels sont jeunes et bien formés mais mal rémunérés… de sorte que leur turnover est important.
À Paris, le siège de CampusFrance emploie 28 ETP et bénéficie de 8 mises à disposition.
M. Gérard Binder précise qu’historiquement, CampusFrance n’opérait qu’en Amérique latine et en Asie. Puis, M. Philippe Etienne ayant constaté, au temps où il exerçait les fonctions de directeur général de la coopération internationale et du développement, le recul de l’influence française dans les pays d’Europe centrale, y compris les pays francophiles comme la Roumanie et la Bulgarie, il a décidé le déploiement de CampusFrance dans cette région.
Enfin, M. Francis Laffont, alors ambassadeur en Chine, a créé le premier centre d’évaluation linguistique et académique (CELA), ouvrant la voie aux centres pour les études en France (CEF) dans les trente pays dits à fort flux, c’est-à-dire au Maghreb et dans le reste de l’Afrique.
Or les bureaux des CEF étant liés aux bureaux de CampusFrance, cette réforme a ipso facto élargi les missions de CampusFrance au continent africain.
Les CEF sont implantés dans les « pays à visa » ; ils opèrent sous la marque CampusFrance et dégagent des recettes car pour chaque dossier est demandée une somme de 150 euros.
Mme Béatrice Khaiat précise que, derrière l’utilisation du nom de CampusFrance dans ce cadre, c’est le ministère des Affaires étrangères et européennes qui gère les procédures et reçoit l’argent versé par les demandeurs.
L’opérateur est donc, en l’espèce, le ministère, même si CampusFrance forme les agents et permet l’utilisation de son site Internet.
Répondant au Président François Rochebloine sur les priorités géographiques de l’action de CampusFrance, Mme Béatrice Khaiat indique qu’il s’agit, dans l’ordre, de l’Amérique du Nord et du Sud, de l’Asie, de l’Europe, de l’Afrique et bientôt du Moyen-Orient – le Qatar, les Émirats arabes unis et le Koweït sont très demandeurs, et ont pour leurs étudiants des programmes de bourses très généreux.
C’est en fonction de cet ordre de priorités que CampusFrance programme ses « tournées » et sa participation à diverses manifestations publiques.
En comparaison avec le budget de 304 millions d’euros du DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst), dont 60 millions d’euros de promotion, ou avec les 627 millions d’euros du British Council (dont 312 millions d’euros consacrés à la promotion), le montant du budget de CampusFrance – 6,2 millions d’euros dont 3 millions d’euros de subventions – donne une idée de la « débrouillardise » que l’agence doit déployer pour honorer ses missions.
Mme Geneviève Colot, Rapporteur, demande quelles autres ressources que les subventions abondent le budget de CampusFrance.
Mme Béatrice Khaiat répond qu’il s’agit des cotisations des membres du GIP, des recettes provenant de salons payants et de programmes conclus avec certains partenaires étrangers, la Malaisie par exemple.
Par ailleurs, si chacun s’accorde à reconnaître l’excellence de l’enseignement supérieur français, notre système pèche par deux aspects : l’accueil des étudiants étrangers et la délivrance de visas à ces étudiants. Sur ce dernier point, la procédure des CEF a permis de réels progrès mais aujourd’hui, des problèmes se posent à l’arrivée en France, avec les services de certaines préfectures. Or les difficultés rencontrées reçoivent très vite nue large publicité sur les forums Internet.
M. Gérard Binder ajoute que, les études en France étant gratuites, le but à poursuivre ne consiste pas à augmenter le nombre d’étudiants accueillis – 2,5 milliards d’euros pour les contribuables français, cela représente déjà un effort important – mais à attirer les meilleurs. Il est certes difficile de mesurer cette qualité…
Le Président François Rochebloine fait observer que les universités américaines démarchent directement les étudiants, comme au Liban par exemple.
Mme Béatrice Khaiat renchérit : le même problème existe au Maroc où le démarchage est le fait des Allemands, et en Afrique en général, où interviennent les Canadiens. Un étudiant étranger « ne coûte pas cher » et représente un excellent investissement d’avenir.
M. Gérard Binder ajoute qu’un étudiant japonais n’aura pas l’idée de venir en France se spécialiser en mécatronique ; nous accueillerons plutôt une étudiante japonaise en lettres…
Gardons-nous des discours simplistes. La quantité ne fait pas le succès d’une politique. Les quotas sont un sujet qui nécessite beaucoup de discernement.
Mme Béatrice Khaiat indique que la France « fait la course » avec l’Allemagne, derrière les universités anglo-saxonnes, et qu’elle progresse dans l’accueil des étudiants en master et en doctorat, ce qui correspond aux but assignés à CampusFrance.
Le Président François Rochebloine interroge les intervenants sur le cas du CNOUS et sur son absence du périmètre de la réforme projetée actuellement.
M. Gérard Binder et Mme Béatrice Khaiat regrettent cette exclusion du périmètre. Si CampusFrance doit devenir un opérateur de moyens, il faut qu’il le soit pour toutes les bourses. En revanche, le CNOUS et son réseau demeurent comme opérateur chargé de l’accueil, du logement etc.
Le problème vient du fait que le Conseil d’État a demandé que les EPIC créés par le projet de loi soient placés sous une tutelle unique ; or il est peu probable que le ministère de l’Enseignement supérieur soit disposer à faire passer une partie des moyens qu’il gère sous tutelle exclusive du Quai d’Orsay.
Mme Béatrice Khaiat ajoute que sa préférence irait à un EPIC qui regrouperait, outre CampusFrance, la SDAI du CNOUS, Égide et FCI qui est un opérateur important en matière d’appels d’offres.
M. Gérard Binder conclut en déplorant que le projet de loi soit inspiré par la seule logique de la RGPP, qui fait que l’on s’intéresse davantage aux structures qu’aux contenus. Il se demande si le GIP n’était pas finalement la meilleure formule juridique.
Cependant, la fragilité du statut de GIP réside dans la précarité qu’il représente pour les personnels. En effet, la durée limitée d’un GIP – quatre ans en l’occurrence – rend les contrats des personnels précaires ; ils sont parfois même à la limite de la légalité puisque de tels contrats sont, pour certains, renouvelés depuis 1998…
Les ministères seront plusieurs à être représentés au conseil d’administration de l’EPIC et pourtant la tutelle sera unique. Ce modèle n’est pas idéal. En tout état de cause, une fusion qui exclurait les établissements d’enseignement supérieur n’aurait aucune pertinence.
La réunion est levée à 18 h 20.
Compte rendu de l’audition de M. le professeur Laurent Batsch,
président de l’Université Paris-Dauphine
accompagné de M. le professeur Arnaud Raynouard, vice-président chargé des affaires internationales
(Mardi 24 novembre 2009 − 33, rue Saint-Dominique – salle 4223)
La réunion est ouverte à 17 h 30.
• Présents
Mme Geneviève Colot, Rapporteur
M. Didier Mathus
• Excusés
M. François Rochebloine, Président, Mme Martine Aurillac, MM. Jean-Louis Bianco, Philippe Cochet, Jean-Pierre Dufau, Jean-Michel Ferrand, Jean-Claude Guibal, Jean-Pierre Kucheida, Robert Lecou, Jacques Remiller et André Schneider.
*
Mme Geneviève Colot, Rapporteur, accueille les deux intervenants et les invite à présenter leur action et leur vision des thèmes de travail de la mission d’information.
M. le professeur Laurent Batsch, président de l’Université Paris-Dauphine, relève que le sujet que la mission traite à l’échelle du pays est plutôt envisagé, chez les universitaires, du point de vue de la stratégie internationale de chaque établissement. De plus en plus, l’influence de la France dans le monde en matière d’enseignement supérieur sera la somme de ces stratégies internationales.
Dans ce cadre, la diplomatie peut apporter un soutien utile. Par exemple, l’ambassadeur de France en Tunisie a littéralement « sauvé », profitant d’une visite sur place du Président de la République, le projet d’université privée dénommée « Institut Tunis Dauphine ».
De même, la diplomatie a beaucoup aidé à l’aboutissement du projet d’université française au Vietnam. Stratégies d’établissement et action diplomatique se complètent donc utilement.
Mais pour parvenir à un tel résultat, nous avons besoin de diplomates convaincus, et d’opérateurs locaux de qualité. L’impulsion diplomatique seule ne suffit pas, l’appui de professionnels du secteur est nécessaire.
La stratégie internationale poursuivie par l’Université Paris-Dauphine est classique. Le contexte actuel de la mobilité internationale et de ses obstacles, notamment à l’égard des universités anglo-saxonnes de plus en plus enclines au contingentement de places, et adeptes du prélèvement de droits que Dauphine s’abstient de prélever, tout cela oblige à être inventif.
Par exemple, Dauphine a créé une année de césure entre le M1 et le M2, ce qui permet de conserver le bénéfice de la sécurité sociale étudiante tout en étant en année de stage, assimilé à un diplôme d’université (DU).
Dauphine s’efforce également d’attirer des étudiants anglophones non francophones. L’établissement délivre par ailleurs des doubles diplômes. Dans le domaine de la recherche et de l’enseignement, il procède à des échanges de professeurs, ce qui équivaut à une extension de la mobilité étudiante aux doctorants et post-doctorants.
Autre exemple : a été lancé un projet « skyteam », véritable pôle de recherche et d’enseignement supérieur avec un petit nombre de partenaires étrangers disposant comme Dauphine de moyens financiers limités. Ce projet permettrait une projection en Asie – Inde, Chine, Corée du sud – non pas de façon isolée mais à deux établissements, l’un français et l’autre autrichien, par exemple.
Mme Geneviève Colot demande si de tels projets de coopération se heurtent à des difficultés tenant par exemple à une trop grande différence entre les formations universitaires susceptibles d’être proposées.
M. Laurent Batsch répond que de telles difficultés se surmontent, sauf peut-être dans les disciplines juridiques. Mais en sciences, « c’est toujours le même globish ».
M. le professeur Arnaud Raynouard, vice-président chargé des affaires internationales, estime que le rayonnement de la France est une notion noyée dans un ensemble plus large. Le but poursuivi, matérialisé par exemple par les places obtenues dans les classements internationaux, dépasse de beaucoup la seule question de la langue ou de la nationalité française.
Bien que le français ne soit pas « porteur », Dauphine n’entend pas abandonner la filière francophone. Le défi en l’espèce est d’arriver à convaincre des partenaires que la langue française n’intéresse pas. Pourtant, notre langue est bien le seul moyen d’exister aujourd’hui dans le monde de l’enseignement supérieur à l’échelle internationale. Nous envisageons même d’utiliser en anglais des manuels dont les auteurs sont français !
Dauphine a l’ambition d’être un établissement résolument « global » ; mais la prééminence de l’anglais est une donnée incontournable. Nous souhaiterions développer des cursus trilingues, incluant l’espagnol, ou l’allemand, voire le russe. En tout état de cause, l’établissement ne se présente pas comme purement et uniquement français.
À la question de savoir si ce caractère non exclusivement français est un frein à l’appui apporté par les ambassades, M. Arnaud Raynouard répond que cette question n’est pas au cœur de la réflexion de l’établissement. S’il ne s’agit pas de « baisser le pavillon » français, il ne s’agit pas non plus de le revendiquer ostensiblement. Pour rester française, Dauphine doit être toujours plus internationale.
Mme Geneviève Colot s’enquiert des priorités géographiques de l’établissement.
M. Arnaud Raynouard cite en premier lieu l’Union européenne, à la fois pour des raisons de coût et de lisibilité des diplômes. Viennent ensuite les États-Unis puis l’Amérique latine − cette zone occupant une place fortement croissante mais déséquilibrée car beaucoup de Latino-américains veulent venir alors qu’en sens inverse, certains pays, comme la Colombie, suscitent des craintes liées à la sécurité des personnes −, et enfin l’Asie, notamment la Chine. Les échanges sont faibles en valeur absolue avec cette dernière mais leur fréquence augmente.
Le problème rencontré avec tous les pays anglophones est le manque de places qu’ils ont à offrir, alors que le principe de l’échange est la réciprocité. L’absence de logement conduit au refus de signature de certaines conventions.
M. Laurent Batsch souligne que l’influence de Dauphine à l’étranger se mesure d’abord en France, à l’aune de son pouvoir d’attraction des étudiants, des enseignants, et de sa capacité à produire une recherche et des publications de qualité. Sachant que cet exercice se déroule dans un contexte de réforme de l’enseignement supérieur et du budget de l’État.
Mme Geneviève Colot demande quel pourcentage représentent, à Dauphine, les étudiants étrangers, quelle est leur provenance, et combien d’entre eux ont été scolarisés dans un lycée français à l’étranger.
M. Arnaud Raynouard répond que de telles statistiques ne sont disponibles que depuis récemment. Les lycées français sont le plus souvent des établissements d’excellence, formant les élites locales. Or Dauphine sélectionne attentivement ses étudiants. Elle a donc toujours recruté ce type de très bons bacheliers. Ce n’est toutefois pas cette source qui fournit l’essentiel des recrutements.
Erasmus et les programmes bilatéraux de mobilité entrante représentent 20 % du total des étudiants de Dauphine. En sens inverse, 20 % des étudiants effectuent une mobilité sortante − et même 100 % si l’on ne considère que ceux des étudiants entrés en première année.
50 % des entrants sont des Européens, 40 % des Américains (du Nord ou du Sud), les Asiatiques tendent vers 10 %. La proportion d’Africains est très faible, essentiellement en raison de la délocalisation en Tunisie et au Maroc de formations sélectives. En outre, souvent les étudiants originaires du Maghreb s’inscrivent après un cursus en France, de sorte qu’ils sont comptabilisés dans les étudiants français.
Mme Geneviève Colot demande quelles sont les matières les plus prisées.
M. Arnaud Raynouard répond que la gestion arrive largement en tête. L’économie est régulièrement choisie également car au niveau M1, les cours de micro- ou de macroéconomie sont assez standardisés.
Mais on enregistre également des demandes éloignées du « cœur » de la formation dispensée à Dauphine : littérature américaine de la fin du XIXe siècle, sociologie du cinéma… Ces enseignements « à l’américaine » sont très populaires auprès des étudiants étrangers. Il est donc prévu de les développer.
Mme Geneviève Colot souhaite savoir s’il est prévu de créer une fondation, comme la loi le permet désormais aux établissements d’enseignement supérieur.
M. Laurent Batsch rappelle que la loi « LRU » permet la création de deux types de fondations : universitaires ou partenariales. Dauphine a créé un fondation partenariale dès octobre 2007. Six grands groupes ont abondé son capital et des chaires ont été créées en lien avec des entreprises.
L’investissement nécessaire au projet Tunis Dauphine a été porté par cette fondation qui, étant dotée de la personnalité morale, est autonome. C’est l’une des retombées positives de la loi « LRU ». Toutefois, créer des établissements à l’étranger n’est pas l’objet principal de la fondation.
Par ailleurs, Dauphine a créé un Master international sous forme de « MBA européen » en partenariat avec le Liban, l’Égypte, la Syrie, l’Algérie, la Tunisie, le Maroc et le Sénégal. A également été créé un executive MBA en commun avec l’Université du Québec à Montréal. Ce dernier cursus présente l’avantage d’un travail conjoint avec des francophones et francophiles qui offre une ouverture vers les États-Unis.
Un sujet important est celui des accréditations internationales. Accréditation des diplômes tout d’abord, réclamée par les étudiants. Accréditation de l’immobilier, accréditation financière… Certains labels sont indispensables, mais il faut aussi « savoir s’arrêter ».
Le label Equis (European QUality Improvement System) est particulièrement exigeant ; il ouvre beaucoup de portes en contrepartie. Il est quasiment indispensable pour exister sur la scène universitaire internationale – à moins de le contourner, comme le fait l’École des Mines de Paris, en inventant un classement international « sur mesure » – ; il sert également de levier de management interne.
Dauphine ne fait ainsi que se conformer au modèle international… qui est purement anglo-saxon. Le modèle français a perdu la bataille des publications (peu d’articles mais des ouvrages fondamentaux, là où les anglo-saxons privilégient les formats courts et efficaces), celle de la langue, celle de l’Europe, celles des « standards », celle des classements…
M. Arnaud Raynouard estime en contrepoint que, pour préserver une part du modèle français d’enseignement supérieur, il faut bien passer par les fourches caudines des standards internationaux.
Faire passer notre culture et nos valeurs ne sera possible que lorsque nous aurons au préalable fait nos preuves sur le terrain des Anglo-saxons.
M. Didier Mathus demande si la crise n’a pas battu en brèche le modèle anglo-saxon.
M. Arnaud Raynouard en doute ; les universités américaines reprennent déjà le chemin de l’expansion ; l’Université de Shanghaï crée pour 50 millions de dollars une école de finance, où la totalité des enseignants sont des Chinois ayant accompli leur cursus aux États-Unis. Il n’y a pas même un Britannique…
M. Laurent Batsch ajoute que la fondation de Harvard a encore pu dégager 3 milliards de dollars pour la Business school, qu’à Chicago on compte 2 000 enseignants-chercheurs pour 14 000 étudiants (soit un pour sept), et à Dauphine 350 enseignants-chercheurs pour 9 000 étudiants, soit un pour trente…
Dauphine sait faire du « travail de masse » mais si l’on veut tirer le système vers le haut, on ne le fera qu’avec de très bons éléments. Et si ces derniers ne se dirigent que vers les grandes écoles, la mission est impossible.
Interrogé sur le statut de « grand établissement » de Dauphine, M. Laurent Batsch indique que le statut de grande école n’est pas souhaité par Dauphine qui se veut nue alternative aux classes préparatoires et se positionne en concurrent de Sciences Po.
M. Arnaud Raynouard ajoute que ces subtilités statutaires sont illisibles à l’étranger, où Sciences Po se présente comme « centre universitaire »… Nous nous concurrençons entre Français !
M. Didier Mathus s’enquiert des effets néfastes de cette concurrence.
MM. Laurent Batsch et Arnaud Raynouard répondent en s’interrogeant sur la correcte allocation des fonds publics, lorsque l’on constate que Sciences Po a les moyens d’employer 25 chargés de mission pour l’international quand Dauphine ne dispose que d’un vice-président aidé par quelques bonnes volontés.
La concurrence se noue aussi autour de la capacité d’accueil des étudiants, par exemple pour l’aide au logement. Afin de surmonter son handicap de moyens, Dauphine a monté un projet de « Maison internationale » avec une filiale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, portant sur 150 logements destinés à des professeurs invités et à des étudiants internationaux.
Mme Geneviève Colot demande si les étudiants étrangers repartent tous à l’issue de leur séjour en France.
M. Arnaud Raynouard répond que la plupart le font, mais que bon nombre d’entre eux garderont un lien avec la France. De ce point de vue, Dauphine participe bien, même « inconsciemment », au rayonnement de la France.
Il existe aussi des associations d’anciens « Dauphinois » à l’étranger. C’est un levier d’une force étonnante qu’il faudrait songer à activer.
À la demande de Mme Geneviève Colot portant sur les préconisations des intervenants en conclusion de leur propos, M. Arnaud Raynouard répond par le souhait que cesse l’éparpillement des structures et leur accumulation ; de ce point de vue, le projet de loi relatif à l’action extérieure de l’État ne prend pas le bon chemin : une accumulation de structures inefficaces, en plus d’être coûteuse, ne fera pas une structure efficace.
M. Laurent Batsch indique pour sa part que l’efficacité française à l’étranger dans le domaine de l’enseignement est possible lorsque se conjuguent les compétences du diplomate et celles de « l’ingénieur pédagogique » ; que la question des moyens est cruciale (pour améliorer le ratio enseignants-chercheurs / étudiants), et que si aujourd’hui la qualité d’un établissement se juge à l’aune du « petit buzz franco-français », demain elle passera par les classements internationaux.
La réunion est levée à 18 h 45.
Compte rendu de l’audition de M. Pierre Tapie,
président de la Conférence des grandes écoles
accompagné de M. Pierre Aliphat, délégué général de la CGE
(Mercredi 25 novembre 2009 − 33, rue Saint-Dominique – salle 4223)
La réunion est ouverte à 17 h 40.
• Présents
M. François Rochebloine, Président
Mme Geneviève Colot, Rapporteur
• Excusés
Mme Martine Aurillac, MM. Jean-Louis Bianco, Philippe Cochet, Jean-Pierre Dufau, Jean-Michel Ferrand, Jean-Claude Guibal, Jean-Pierre Kucheida, Robert Lecou, Didier Mathus, Jacques Remiller et André Schneider.
*
M. François Rochebloine, Président, présente les travaux de la mission et accueille les deux intervenants, en évoquant la « double casquette » de M. Pierre Tapie, directeur général du groupe ESSEC en même temps que président de la Conférence des grandes écoles.
M. Pierre Tapie, président de la Conférence des grandes écoles, souligne le mouvement d’internationalisation fortement croissante de l’ensemble des établissements membres de la CGE.
Quant à l’ESSEC, c’est un établissement de taille importante et hautement sélectif – ce qui n’est pas un modèle universel. L’école accueille 4 250 étudiants répartis dans 19 programmes d’enseignement, du BA au PhD.
Parmi eux, on compte 1 350 étudiants étrangers de 90 nationalités différentes, soit un ratio d’un tiers. 60 % d’entre eux sont originaires d’Asie, 20 % du monde francophone – du Maroc au Liban – et 20 % du reste de la planète – dont 76 d’Amérique du Nord, soit 6 % ; ils étaient 46 il y a deux ans.
On est donc au-delà du seuil d’un quart d’étudiants étrangers, qui marque le moment où les Français de l’établissement modifient leur attitude et leur comportement.
Interrogé par le Président François Rochebloine sur la tendance observée à propos de la fréquentation de l’ESSEC par des étudiants étrangers, M. Pierre Tapie répond qu’il y a six ans, l’école accueillait 3 600 étudiants, dont 600 étrangers.
C’est un véritable mouvement stratégique qui s’est opéré : en six ans, 700 des 750 nouveaux étudiants de l’école sont venus de l’étranger. En effet, l’ESSEC avait « fait le plein » des étudiants français excellents ; quant à l’objectif de promotion sociale, il concerne surtout la formation continue. C’est ainsi qu’a été effectué le choix de recruter des étudiants étrangers.
Un recrutement à tous les niveaux : après le lycée avec un petit programme de BA, après classe préparatoire en France à l’issue d’une scolarité dans le réseau de l’AEFE, après un Master en France ou à l’étranger, enfin au niveau du doctorat (PhD).
Ce dernier contingent est très restreint mais il exerce une grande influence. Sur 550 candidats, 20 ont été acceptés et 16 sont effectivement venus… dont un seul Français ! Selon les programmes, la proportions d’étudiants étrangers varie de 20 à 80 % (93 % en PhD).
Mme Geneviève Colot, Rapporteur, demande si une telle variété de recrutement ne pose pas des problèmes de différence de niveau.
M. Pierre Tapie répond par la négative. Car l’ESSEC est davantage une « université internationale de management » qu’une grande école – cette dernière ne concerne que 30 % des diplômés, soit 560 sur 1 600, annuellement.
Le Président François Rochebloine s’enquiert du coût de la scolarité.
M. Pierre Tapie répond qu’elle varie selon le programme suivi. Deux programmes sont subventionnés – par l’État à 2,5 %, soit 2 millions d’euros, ce qui est peu, par la Chambre de commerce et d’industrie de Versailles et via la taxe d’apprentissage. Pour ces deux programmes, les subventions couvrent 50 % des coûts, le reste provient des droits de scolarité.
L’ESSEC, contrairement aux autres écoles de commerce, n’est pas une émanation d’une CCI mais une association ayant avec une CCI des liens étroits.
M. Pierre Aliphat précise que la scolarité coûte 7 500 à 8 000 euros par an sur quatre ans, et pour le programme grande école, 8 000 euros la première année puis 10 000 euros les deux années suivantes, soit 28 000 euros au total.
Il y a cinq ans a été prise la décision courageuse de faire payer aux étudiants étrangers le coût complet de leur scolarité, y compris en effectuant une certaine redistribution au moyen de bourses.
Coexistent ainsi deux tarifications pour une même formation : 10 000 euros par an pour un Français de milieu aisé et 18 000 euros par an pour un Indien de la classe moyenne… dont les parents auront dû hypothéquer leur maison pour lui donner l’équivalent de 2 à 300 000 euros.
Au Président François Rochebloine relevant ce coût très élevé, M. Pierre Tapie répond que cela reste beaucoup plus abordable qu’une scolarité aux États-Unis à 40 000 dollars par an.
Il est vrai que cette décision a suscité un vif débat en interne. Un élément a été crucial : vu de l’étranger, une formation qui coûte peu n’a pas de valeur… L’ESSEC tient à rester abordable mais à pratiquer un « juste prix ».
Le MBA spécialisé dans le luxe, pour lequel l’ESSEC est le référence mondiale, coûte 30 000 euros par an aux étudiants, mais l’INSEAD coûte 50 000 euros pour dix mois et en tout état de cause, une scolarité moins chère pour ce programme « enverrait un mauvais signal au marché ».
Mme Geneviève Colot demande quelle est la langue d’enseignement.
M. Pierre Tapie répond qu’elle varie en fonction des programmes. L’enseignement en PhD est dispensé entièrement en anglais. La décision de changer la langue d’enseignement a été prise il y a quatre ans. Mais malgré cela, au bout de leur scolarité de quatre ans, tous ces étudiants parlent français et sont très francophiles.
Le corps professoral est lui aussi internationalisé : il compte une petite majorité d’Européens (souvent titulaires d’un doctorat aux États-Unis).
Le Président François Rochebloine demande quelle proportion des étudiants étrangers de l’ESSEC restent en France à l’issue de leur scolarité.
M. Pierre Tapie répond que cette proportion est variable selon les programmes. Une loi de 2006 a autorisé la prolongation des visas 6 mois après la fin des études pour la recherche d’un emploi. La France a été ainsi heureusement rendue plus accueillante, à l’instar d’autres pays ; c’était nécessaire lorsque l’on sait que certains ingénieurs polytechniciens faisaient l’objet d’une reconduite à la frontière sur demande de l’inspection du travail…
La conférence des grandes écoles a organisé sur le thème de l’attractivité internationale un séminaire au début du mois d’octobre 2009. Les grandes écoles délivrent chaque année 04 % du total des masters en France et ce taux atteint même 56 % dans les matières scientifiques, techniques et du management. Ce système particulier est attractif vis-à-vis de l’étranger.
Certains chiffres mériteraient d’être mieux connus. Entre 2000 et 2015, le nombre des étudiants dans le monde doit passer de 100 à 200 millions. Sur cette progression de 100 millions, 70 concernent l’Asie, dont 55 pour les seules Chine et Inde.
Cela signifie, pour ces deux pays, construire chaque année pendant 15 ans une capacité d’accueil supplémentaire de 2 millions de places… soit la totalité du « stock » d’étudiants français ! Autrement dit, la Chine et l’Inde devraient, chacune, construire une université de 20 000 étudiants chaque semaine pendant 15 ans !
Dans les faits, l’absorption de cette masse d’étudiants nouveaux s’effectue pour partie par un énorme effort de construction d’universités sur place et pour l’autre partie, par l’envoi d’étudiants à l’étranger. Pour la France, c’est un marché illimité.
Les grandes écoles comptent 300 000 étudiants. Même un triplement en dix ans ne ferait qu’absorber 1 % du nombre d’étudiants supplémentaires à former en Asie.
N’est-ce pas inquiétant ? se demande le Président François Rochebloine.
C’est une chance à saisir ! répond M. Pierre Tapie, qui évoque sa rencontre la veille, à Singapour, avec le dirigeant d’un cabinet de 550 architectes à qui l’on avait confié l’invention d’une ville de 10 millions d’habitants…
L’enseignement supérieur à l’échelle mondiale est un défi pour le rayonnement de la France. Le marché est potentiellement infini ; il s’agit d’un marché solvable en Chine et en Inde, y compris pour les étudiants issus de la classe moyenne, du fait de la politique de l’enfant unique en Chine et parce qu’en Inde les familles sont prêtes à investir énormément pour la réussite d’un ou deux enfants.
400 millions de Chinois, 3 à 400 millions d’Indiens, c’est déjà davantage que l’ensemble des étudiants solvables de toute l’Europe. Et de surcroît, dans ces deux pays ce qui est gratuit est dépourvu de toute valeur.
Par conséquent, pour peu qu’elles soient suffisamment entreprenantes, les grandes écoles françaises ont un bel avenir devant elles.
Elles bénéficient de cinq avantages comparatifs :
– elles sont davantage pluridisciplinaires que d’autres formations (incluant par exemple de la philosophie ou de l’histoire, ce que ne font pas les business schools d’autres pays) ;
– même à coût complet, elles restent peu onéreuses au regard de la moyenne mondiale ;
– les règles du concours républicain imprègnent notre modèle, la sélection est donc surtout intellectuelle ;
– la pédagogie n’est pas guidée par la seule recherche, c’est-à-dire l’accumulation de savoir sur un sujet très pointu, mais par la volonté de donner les moyens de décortiquer et de résoudre par soi-même un problème complexe. C’est pourquoi les ingénieurs français et allemands sont les meilleurs du monde, et les patrons chinois ou japonais le savent bien ;
– beaucoup d’allers-retours avec l’étranger sont obligatoires durant la scolarité. Le programme de BA impose de pratiquer quatre langues et de passer au moins un an à l’étranger, des standards impossibles à appliquer aux États-Unis.
Par ailleurs, cinq préconisations peuvent être formulées :
– multiplier par dix le nombre de bourses Eiffel, bourses d’excellence au nombre de 400 chaque année, pour des montants individuels de 8 à 10 000 euros. En comparaison avec les 2 à 3 milliards d’euros que représente l’accueil de 2 à 300 000 étudiants étrangers en France, l’investissement est modique et il est ciblé sur les étudiants les plus talentueux. Ce sont les élites mondiales qu’il faut « capter » ;
– aller vers une demande du financement à coût complet de leur scolarité par les étudiants étrangers (proposition sous signature commune de la Conférence des présidents d’universités et de la CGE). C’est indispensable pour donner des moyens aux établissements, c’est un bon signal à envoyer à l’extérieur et c’est tout à fait compatible avec u régime de bourse d’excellence et de bourses sociales (l’ESSEC redistribue en bourses sociales 30 % de ce qu’elle reçoit en frais de scolarité d’étudiants étrangers) ;
– préserver dans les ambassades les postes consacrés à la promotion de l’enseignement supérieur français, au lieu de poursuivre assidûment l’objectif d’une baisse des effectifs pour raisons budgétaires ;
– donner instruction aux CEF d’aller jusqu’au bout des procédures de vérification d’identité, y compris en recourant aux outils biométriques. Il y va aussi de la protection des intérêts français ;
– faire prendre conscience, en France, de l’enjeu de long terme attaché à la formation de docteurs, qui de retour dans leur pays seront des professeurs d’université. Car avec l’explosion du nombre d’étudiants, une pénurie d’enseignants se profile.
Le Président François Rochebloine interroge les intervenants sur les contours de « l’opérateur de la mobilité » contenu dans le projet de loi relatif à l’action extérieure de l’État.
M. Pierre Tapie répond que la CGE est représentée au conseil d’administration de CampusFrance, qui accomplit un bon travail dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles, notamment à cause de la pluralité des ministères concernés. Égide a un rôle différent, celui de la gestion de bourses de façon très ciblée ; elle s’acquitte convenablement de sa tâche.
La constitution d’un grand opérateur n’emporte pas vraiment la conviction : on chercherait vainement des économies d’échelle car les métiers réunis sont trop différents.
M. Pierre Aliphat ajoute que l’impression est celle de la création d’un opérateur avant d’avoir réfléchi au projet à mettre en œuvre. Par ailleurs, il est curieux qu’en matière de promotion de l’enseignement supérieur on n’associe pas davantage le ministère compétent, alors que c’est en l’espèce le ministère des Affaires étrangères et européennes à qui l’on donne l’essentiel des prérogatives.
Le Président François Rochebloine demande si la CGE a été consultée sur cette fusion.
M. Pierre Tapie répond que tel n’a pas été le cas à propos de la fusion des opérateurs elle-même, mais qu’en revanche la CGE a eu son mot à dire en tant qu’« utilisatrice » d’Égide et administratrice de CampusFrance. Cela étant, il est regrettable d’observer autant d’agitation autour de la composition d’un conseil d’administration qui ne se réunira que deux fois par an…
Un GIP est théoriquement faible car il souffre souvent d’une paralysie de la prise de décision mais tel n’était pas le cas à CampusFrance car tous les participants avaient un réel intérêt à faire fonctionner la structure efficacement et que le directeur général en était le vrai « patron ».
Pourquoi pas une transformation en EPIC ? mais seulement si c’est le moyen de lui donner une plus grande autonomie et non de mener des querelles administratives stériles.
La réunion est levée à 18 h 30.
Compte rendu de l’audition de M. le professeur Jean-Claude Colliard,
président de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne
accompagné de Mme Christine Mengin, vice-présidente chargée des relations internationales
et de Mme Catherine Germain, directrice du cabinet du président
(Mardi 15 décembre 2009 − 33, rue Saint-Dominique – salle 4223)
La réunion est ouverte à 18 h 15.
• Présents
M. François Rochebloine, Président
Mme Geneviève Colot, Rapporteur
Mme Martine Aurillac et M. Didier Mathus
• Excusés
MM. Jean-Louis Bianco, Philippe Cochet, Jean-Pierre Dufau, Jean-Michel Ferrand, Jean-Claude Guibal, Jean-Pierre Kucheida, Robert Lecou, Jacques Remiller et André Schneider.
*
M. François Rochebloine, Président, accueille le président Jean-Claude Colliard et présente les travaux de la mission en invitant les intervenants à exposer leur vision du thème du rayonnement de la France dans le monde par son enseignement supérieur.
M. Jean-Claude Colliard, président de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, présente l’établissement qu’il préside comme une grande université, naguère la plus grande de France avec 40 000 étudiants dont 8 000 étrangers – soit 20%. Cette présence des étudiants étrangers est précieuse pour Paris I, et d’ailleurs les étudiants eux-mêmes en sont heureux ; il n’y a aucun problème de coexistence.
Le programme Erasmus se concrétise par la venue de 500 étudiants, principalement en L3 et en M1, ainsi que quelques-uns en L1.
Le Président François Rochebloine s’enquiert de la provenance géographique des étudiants étrangers inscrits à Paris 1.
Mme Christine Mengin répond que 600 viennent du Maroc, 350 de Chine, 200 de chacun des pays que sont la Tunisie, l’Algérie, la Grèce et les États-Unis, le reste étant plus « émietté ».
160 pays d’origine ont été recensés pour les trois dernières années. Par continent, la répartition est approximativement la suivante : un tiers d’Européens, un tiers d’Africains et un tiers pour le reste du monde.
M. Jean-Claude Colliard observe que la part de l’Afrique est en baisse tendancielle.
Mme Christine Mengin indique que se pose notamment pour ce continent le problème d’obtention de visas.
M. Jean-Claude Colliard précise que, sauf exception, l’université n’a pas à s’assurer de la détention d’un visa en règle par les étudiants qui sont censés en disposer.
D’un échange entre le Président François Rochebloine, Mme Martine Aurillac et Mme Christine Mengin, il ressort que la compétence appartient en amont aux consulats et aux SCAC des ambassades.
En aval, une fois en France et en cas de problème, l’Université prête main-forte, notamment pour l’accomplissement des démarches en préfecture.
M. Jean-Claude Colliard souligne les problèmes que rencontrent les étudiants en thèse, car dans beaucoup de disciplines trois ans se transforment en cinq ans…
Outre les 500 « entrants » du programme Erasmus, ce même programme bénéficie à 300 étudiants « sortants ». Pour ceux-ci, les bourses financées sont passées de 300 à 236 cette année, alors même que la presse évoquait des bourses Erasmus non consommées… il faudrait vérifier ce point et si des bourses ont été « gaspillées », y remédier.
Il semble par ailleurs que le programme Erasmus s’essouffle quelque peu. La curiosité des étudiants se serait-elle émoussée ? Il faut mentionner également le problème de la mobilité étudiante non valorisée dans les faits – y compris pour des questions de calendrier…
La France présente souvent des cursus plus riches que ses voisins ; nous n’avons pas à en rougir même si cela complique un peu la mobilité.
Dès lors, au moins pourrait-on, même si cela paraît anodin, harmoniser les calendriers universitaires pour encourager la mobilité. Il faudrait notamment recentrer la mobilité sur la période la plus utile, c’est-à-dire la première semaine du M1 ou, si l’échange poursuit un but de recherche, le deuxième semestre du M2.
Répondant au Président François Rochebloine sur les conséquences du statut de Paris I, M. Jean-Claude Colliard n’y voit ni un atout ni un handicap.
Quant à savoir si Paris I a les moyens de ses ambitions, son président estime qu’un point noir doit être évoqué : l’hébergement des étudiants étrangers. Paris I a fait un effort cette année en ce domaine, financier notamment, en réservant des chambres à la Cité universitaire ; elles sont peu nombreuses mais le système fonctionne très bien. Les réservations effectuées dans une résidence de Villeneuve Saint Georges, en revanche, ont eu beaucoup moins de succès…
Le nombre de chambres réservées a été porté cette année de 130 à 160 ; 12 d’entre elles sont demeurées inoccupées, ce qui pèse sur le budget de l’Université.
Une suggestion : lorsque l’on construit des logements étudiants, pourquoi ne pas en réserver une partie à des étudiants étrangers ?
S’agissant de la promotion des études françaises à l’étranger, elle passe par des bourses, d’un montant maximum de 700 euros, si le plafond des ressources prises en compte pour leur calcul ne dépasse pas 18 à 19 000 euros.
Mme Christine Mengin observe que ce système représente un frein à la mobilité pour les étudiants dont les parents disposent de ressources supérieures à ce seuil, qui doivent débourser 150 euros par mois pour un séjour à Londres ou à Barcelone.
M. Jean-Claude Colliard cite les pays les plus prisés par les étudiants français en Europe : le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne par ordre décroissant ; les autres sont plus loin. Le critère de la discipline joue également.
L’existence de quatre doubles diplômes (avec les quatre pays précités : King’s College, université de Cologne, Florence, Université Complutense à Madrid) contribue à promouvoir l’enseignement supérieur français en Europe.
Il ne s’agit cependant, à Paris I, que de promotions de deux fois 20 étudiants… Ayant connaissance de 1 800 dossiers d’excellents bacheliers, Paris I aimerait développer ces doubles cursus !
Sur le thème de la continuité entre enseignement secondaire et enseignement supérieur, M. Jean-Claude Colliard évoque les filières délocalisées de Paris I à Bucarest, au Caire, à Istanbul (Galatasaray) et à Buenos Aires, destinées à des étudiants pour lesquels un séjour à Paris serait trop coûteux. Pour ces programmes, les droits d’inscription étaient faibles, sinon inexistants ; or la baisse des crédits d’intervention du MAEE a conduit à exiger des droits de scolarité.
Concernant les liens entretenus par Paris I avec le Quai d’Orsay et les ambassades, ils sont très bienveillants à propos des filières délocalisées. Par ailleurs, Paris I est à la tête de consortiums d’appui à certaines universités étrangères, comme par exemple Galatasaray, Bir Zeit ou le collège d’économie de Moscou.
Pour autant, tous ces liens ne fonctionnent que directement, grâce à des individualités. À cet égard, il est sans doute regrettable que le réflexe n’existe pas de prendre contact avec les attachés de coopération universitaire des ambassades concernées.
Toutefois, ces attachés ont trop souvent tendance à privilégier les sciences dures, quand les ministres de demain sont plutôt les étudiants en sciences politiques.
Abordant le thème de l’implantation de la « Sorbonne » à Abou Dhabi, M. Jean-Claude Colliard déplore l’existence d’un accord secret conclu par Paris IV et contenant une clause d’exclusivité de l’emploi du nom de la Sorbonne. Cela est d’autant plus regrettable que Paris I a reçu des demandes de la part du Koweït, du Qatar, de Bahreïn, de l’Arabie saoudite…
La cellule diplomatique de la Présidence de la République a été saisie, le ministère de l’Enseignement supérieur ne s’estimant pas en mesure de trancher la question à son niveau. Sans vouloir soulever de polémique inutile, Paris I serait désireuse d’un règlement approprié de cette question qui préserve ses intérêts.
La « marque » Sorbonne n’a pas à faire l’objet d’un commerce en soi, même si tout apport de fonds dans le cadre d’une coopération n’est pas à négliger.
La réforme de la loi LRU n’a pas fondamentalement renouvelé la question du rayonnement à l’étranger de l’enseignement supérieur français, même si les pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) qu’elle crée peuvent être utiles en l’espèce : par exemple avec l’EHESS qui dispose de quelques implantations à l’étranger, ou avec l’ESCP qui a quatre campus à l’étranger.
Les grands équipements du type « Plan campus » sont en revanche évidemment bénéfiques, de même que le grand emprunt qui permettrait de dégager 11 milliards d’euros pour les universités.
Un gain possible d’attractivité pourrait être obtenu en s’attachant à faire venir des étudiants plus avancés, de jeunes chercheurs par exemple. Ceux-ci viendraient d’autant plus facilement qu’ils auraient des centres d’hébergement à leur disposition.
Or Paris I ne dispose que de 2 m2 par étudiant, un chercheur n’y dispose généralement d’aucun bureau et seul un enseignant sur cinq en possède un…
Sur la question des liens entretenus avec les autres opérateurs, Mme Christine Mengin cite CampusFrance et l’« A 2e 2f » à titre principal, et Égide dans une moindre mesure.
Les données statistiques produites par CampusFrance sont très intéressantes et utiles. Le GIP a bien rempli sa mission de ce point de vue, même s’il a, hélas, reçu des instructions qui le conduisaient à servir davantage les intérêts des grandes écoles d’ingénieurs ou de commerce que ceux des universités.
Par exemple, l’accent mis sur les salons étudiants, qui ne pèsent pas beaucoup sur les finances des grandes écoles mais coûtent cher aux universités moins bien dotées, a quelque peu détourné ces dernières de CampusFrance.
Le nouvel opérateur dont la création est contenue dans le projet de loi relatif à l’action extérieure de l’État pose problème : alors que les universités étaient représentées au conseil d’administration de CampusFrance, ce ne serait plus le cas dans le nouvel EPIC !
Enfin, si l’A 2e 2f est une agence très professionnelle, les relations qu’entretient Paris I avec elle ne sont pas excellentes.
Interrogée par le Président François Rochebloine sur le statut du nouvel opérateur projeté, Mme Christine Mengin répond que le statut d’EPIC n’est pas très souple.
L’enjeu est bien celui du développement des doubles diplômes. Or Erasmus n’organise à l’heure actuelle qu’une simple mobilité, pas un double cursus. Qui possède l’expertise de cette question, sinon les universités ?
M. Jean-Claude Colliard en conclut que l’on pourrait, sans créer d’« usine à gaz » pour autant, associer les universités à un conseil d’administration ou au moins d’orientation.
Mme Christine Mengin ajoute que la « sanctuarisation » des CEF ou des espaces CampusFrance dans leur monopole de recrutement pose également problème car les universités ont une compétence indéniable.
Répondant au Président François Rochebloine sur la place du CNOUS dans le nouvel ensemble, M. Jean-Claude Colliard estime qu’il doit être associé d’une manière ou d’une autre, puisqu’il a via le réseau des œuvres la main sur la question du logement étudiant.
Le Président François Rochebloine demande aux intervenants une préconisation de conclusion.
M. Jean-Claude Colliard et Mme Christine Mengin évoquent la question des moyens, en particulier ceux provenant du ministère des Affaires étrangères et européennes. S’ils devaient faire défaut, Paris I ne pourrait pas poursuivre dans sa politique de filières délocalisées.
La réunion est levée à 19 h 20.
Compte rendu de l’audition de M. Pierre Buhler,
directeur général de France coopération internationale
(Mercredi 16 décembre 2009 − 33, rue Saint-Dominique – salle 4211)
La réunion est ouverte à 18 h.
• Présents
M. François Rochebloine, Président
Mme Geneviève Colot, Rapporteur
• Excusés
Mme Martine Aurillac, MM. Jean-Louis Bianco, Philippe Cochet, Jean-Pierre Dufau, Jean-Michel Ferrand, Jean-Claude Guibal, Jean-Pierre Kucheida, Robert Lecou, Didier Mathus, Jacques Remiller et André Schneider.
*
M. François Rochebloine, Président, accueille le directeur général de France coopération internationale (FCI), présente les travaux de la mission d’information et demande à M. Buhler sa position quant à ces thèmes de travail, à la lumière du projet de loi relatif à l’action extérieure de l’État qui concerne très directement FCI.
M. Pierre Buhler, directeur général de FCI, rappelant son expérience de conseiller culturel à New York, d’ambassadeur à Singapour et de professeur associé à Sciences Po, souligne la pertinence du lien entre rayonnement et culture.
Sur le plan culturel, la France jouit d’un capital de sympathie considérable dans le monde ; elle dispose d’un bel outil pour répondre à cette attente, à travers ses centres et instituts culturels.
Comment juger de l’adéquation de l’offre à la demande ? C’est un ensemble dense ; il y a toujours des indices pour étayer la thèse du déclin. Cette vision n’est qu’en partie fondée.
Le dispositif destiné à projeter l’image de la France dans le monde repose sur trois éléments :
– une organisation, déjà assez ancienne, avec un échelon central – le ministère des Affaires étrangères et européennes, en particulier la direction générale de la mondialisation, ainsi que CulturesFrance – et un échelon décentralisé – l’ambassade et les centres et instituts culturels ;
– une démarche, résolument politique, consistant à voir la culture comme un outil politique au service de la France, un élément de soft power, visant à rendre la France attractive. De façon connexe, il s’agit de promouvoir l’industrie culturelle (cinéma, arts de la scène etc.) en direction de marchés prescripteurs ;
– une méthode, selon laquelle, en s’appuyant sur un petit nombre d’institutions et de partenaires locaux (des musées par exemple), avec un peu de savoir-faire, il est possible de faire en sorte que ces musées accueillent des expositions françaises. Cela suppose de l’entregent, des contacts… Une nouvelle dimension de cette méthode est celle de la levée de fonds – ce que l’on appelle les « financements innovants ». La culture s’y prête bien.
Ce dispositif peut être amélioré. Les gains d’efficience ont déjà été largement exploités : avec al décroissance des crédits observée depuis presque 25 ans, on arrive « à l’os ». L’effet démultiplicateur à partir d’une mise de fonds publics est réel mais il faut tout de même une mise de fonds !
Une amélioration profonde est possible dans le domaine du recrutement et plus encore de la formation. Cependant cela nécessite également quelques crédits.
Le Président François Rochebloine et Mme Geneviève Colot, Rapporteur, soulignent qu’il s’agit d’une grave lacune et demandent quel est l’état de cette question.
M. Pierre Buhler répond que les attachés culturels reçoivent une formation de cinq jours, ce qui est évidemment très insuffisant même s’ils possèdent un bagage du fait de leur parcours professionnel. Beaucoup, en effet, sont enseignants, ils ont parfois connu une expérience en Alliance française ou au ministère de la Culture.
Il a été un temps envisagé de verser l’ensemble des agents du réseau culturel dans la « grande agence » ; il est sage de ne pas l’avoir fait.
En conclusion, nous n’avons pas à rougir de notre dispositif. Avec de modestes moyens nous faisons beaucoup ; mieux par exemple que le Goethe Institut pourtant plus largement doté.
Le Président François Rochebloine interroge ensuite M. Pierre Buhler à propos de France coopération internationale.
Son directeur général depuis septembre 2009 décrit le GIP France coopération internationale, qui à partir du ministère des Affaires étrangères et européennes associe le ministère chargé de la Fonction publique et l’ENA, comme une réponse à un besoin qui avait été constaté par M. Hubert Védrine au Quai d’Orsay : le besoin d’expertise publique à court et moyen termes pour des missions de coopération au sens large – « Comment bâtit-on un État ? ». FCI peut aussi agir en consortium – c’est le cas le plus fréquent – en assurant la maîtrise d’œuvre de projets complexes.
Ses missions sont vastes, qu’il s’agisse de l’évaluation pour le compte de la Commission européenne des dégâts causés par la guerre de 2008 en Géorgie, de l’aide au développement de médias indépendants dans certains pays ou de la réponse à des appels d’offres relatifs à des projets dans le domaine de la santé…
FCI emploie 50 personnes. Mais ce n’est que l’un des trente opérateurs publics de l’expertise technique internationale en France, alors qu’il y en a un seul en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas ou en Espagne ! La GTZ allemande fait figure de référence à cet égard.
Répondant aux questions du Président François Rochebloine, M. Pierre Buhler indique que ministère des Affaires étrangères et européennes exerce sur FCI une tutelle active ; la tutelle du ministère chargé de l’immigration et du développement solidaire l’est moins. Les seuls relais locaux de FCI sont les ambassades ; le GIP ne dispose pas de bureaux à l’étranger.
M. Buhler indique en outre que FCI est entièrement autofinancé ; non seulement il ne reçoit aucune subvention mais le nombre de mises à disposition d’agents dont il bénéficie est en baisse : quatre cette année et probablement deux l’an prochain.
Avec 25 millions d’euros, FCI se maintient difficilement à flot. Il faut souhaiter que les mises à dispositions gratuites demeurent possibles dans le cadre du futur opérateur.
Interrogé par le Président François Rochebloine sur les remèdes au préoccupant émiettement des opérateurs français, M. Pierre Buhler estime qu’il faudrait bâtir un opérateur interministériel unique. À l’heure actuelle, FCI entretient peu de relations avec les autres opérateurs publics de l’expertise ; il n’existe aucun lien structurel entre eux.
Quant aux étudiants, ils ne font pas vraiment partie des sujets de préoccupation de FCI ; ce sera le cas avec la fusion des trois opérateurs CampusFrance, Égide et FCI prévue par le projet de loi relatif à l’action extérieure de l’État.
Le Président François Rochebloine demande s’il est normal de laisser le CNOUS à l’extérieur du nouvel opérateur.
M. Pierre Buhler indique que si le CNOUS gère les bourses d’étudiants étrangers, il ne le fait pas pour la totalité d’entre eux. Par ailleurs, il convient de distinguer Paris du reste du territoire.
Le Président François Rochebloine interroge M. Buhler sur sa perception du rayonnement de la France dans son domaine d’activité.
Celui-ci répond qu’il faut l’améliorer. Dans le champ de l’expertise internationale, FCI est un petit opérateur, même par rapport aux Pays-Bas, car il est un opérateur sectoriel. En s’organisant mieux, il est possible de gagner davantage de marchés mais c’est le nouvel opérateur qui aura la masse critique pour ce faire. Il n’est pas opportun de fusionner tous les opérateurs en un seul mais ont peut tout de même progresser en ce sens.
Le Président François Rochebloine relève que FCI a fait l’objet d’un référé très sévère de la Cour des comptes.
M. Pierre Buhler tempère en rappelant que le ministère des Affaires étrangères et européennes a produit une réponse, point par point.
Le constat sévère de la Cour portait essentiellement sur la gestion antérieure à 2006 ; il a ensuite été remédié à certains des dysfonctionnements identifiés. Le nouveau dispositif sera plus satisfaisant. Par ailleurs, aucune irrégularité comptable n’a été décelée.
FCI travaille dans un cadre concurrentiel qui oblige à une constante remise en cause. S’il existe un « marché captif » des anciens coopérants, cette source se tarit. Il faut aujourd’hui des recrutements pour répondre à des appels d’offres internationaux portant sur des sujets très variés.
Le nouvel opérateur prévu par le projet de loi apporte la bonne réponse. Une fois la décision prise, il s’agira de ne plus revenir en arrière afin de créer un minimum de stabilité. L’opération n’est pas simple car elle concerne 300 personnes au total, dont les cultures différentes devront être mariées.
Par conséquent, un certain temps sera nécessaire à l’opérateur pour s’établir correctement. Si une incertitude pèse sur son avenir, la greffe ne prendra pas. Il convient donc de laisser l’opérateur trouver sa place et d’en juger, au bout de trois ans, le bilan.
En effet, Égide est déjà le produit d’une fusion, CampusFrance est issu de la transformation d’un ancien GIP et FCI n’a que sept ans… Dans al mesure où on mêle mobilité étudiante et expertise, ce qui n’est pas absolument évident, il faudra bien laisser au nouvel opérateur le temps de trouver sa place.
La réunion est levée à 19 h.
Compte rendu de l’audition de M. Dominique Hénault,
directeur général d’Égide
accompagné de M. Bertrand Sulpice, directeur général adjoint
(Mercredi 16 décembre 2009 − 33, rue Saint-Dominique – salle 4211)
La réunion est ouverte à 19 h.
• Présents
M. François Rochebloine, Président
Mme Geneviève Colot, Rapporteur
• Excusés
Mme Martine Aurillac, MM. Jean-Louis Bianco, Philippe Cochet, Jean-Pierre Dufau, Jean-Michel Ferrand, Jean-Claude Guibal, Jean-Pierre Kucheida, Robert Lecou, Didier Mathus, Jacques Remiller et André Schneider.
*
M. François Rochebloine, Président, accueille les deux intervenants en leur demandant de présenter Égide et son action.
M. Dominique Hénault, directeur général d’Égide, indique qu’il a pris son poste 18 mois auparavant. Égide aura 50 ans d’existence en 2010 ; son activité concerne à près de 90 % la mobilité entrante, la mobilité sortante représentant donc une faible part de son action.
Les « entrants » dont s’occupe Égide sont des étudiants mais aussi de jeunes chercheurs ou des personnalités invitées par le gouvernement français, tandis que les « sortants » sont des experts français compétents dans un domaine précis. Les étudiants, au nombre de 3 000 par an, représentent la moitié du « public » d’Égide.
Égide gère l’ensemble de la chaîne de l’accueil sur tout le territoire : le transport, l’accueil à l’aéroport, l’interprétariat, les formalités administratives de séjour, la protection sociale, les découvertes culturelles…
Forte de 50 ans d’expérience, l’association compte 210 personnes, réparties entre son siège parisien et huit villes de France. Elle gère 135 millions d’euros par an.
Mme Geneviève Colot, Rapporteur, demande quels sont les relais de l’association à l’étranger.
M. Dominique Hénault répond qu’il s’agit d’abord et avant tout des ambassades, dans 135 pays.
À la question du Président François Rochebloine sur la place d’Égide au sein du « paysage » des opérateurs, M. Dominique Hénault répond qu’elle est l’opérateur principal du ministère des Affaires étrangères et européennes pour la mobilité internationale – même s’il y a d’autres acteurs, CampusFrance et FCI.
Des collaborations entre opérateurs existent, par exemple avec CampusFrance, qui « démarche » les étudiants étrangers en amont, avant qu’Égide ne les accueille en France.
Le Président François Rochebloine demande comment s’effectue la répartition des rôles avec le CNOUS (s’agissant des activités internationales de celui-ci).
M. Bertrand Sulpice répond que le métier exercé par le CNOUS et par Égide est le même s’agissant de la répartition des bourses du gouvernement français. Selon une règle ancienne, les étudiants étrangers qui en bénéficient et sont inscrits dans une université française relèvent du CNOUS, tandis que pour les autres établissements (grandes écoles par exemple), ou bien pour les formations non diplômantes de longue durée, c’est Égide qui officie.
La sous-direction des affaires internationales du CNOUS gère une « mono-activité » avec l’hébergement résidence, tandis qu’Égide propose des prestations beaucoup plus variées. Par ailleurs, le CNOUS s’occupe d’étudiants âgés de 25 ans en moyenne ; Égide gère aussi des personnes nettement plus âgées, dont les besoins sont différents.
Cela étant, les similitudes entre le CNOUS et Égide ne sont pas absentes. Lorsqu’il s’agit de partager la gestion des bourses du gouvernement français, les règles sont les mêmes, le ministère donneur d’ordre est le même, le travail est le même. De ce point de vue, la coexistence à terme de deux établissements publics dans un même champ d’activité pose certes un problème.
M. Dominique Hénault ajoute que cette situation mérite en effet une clarification. Les étudiants sont les premiers à être désorientés. De surcroît, cela nuit à l’image de la France sur le marché concurrentiel de l’enseignement supérieur.
À la question du Président François Rochebloine sur les liens entre Égide et sa tutelle, M. Dominique Hénault répond qu’elle est entretenue de manière étroite et confiante, ce qui permet à chacun de se concentrer sur son métier : la stratégie pour la tutelle et l’opérationnel pour l’association.
La comparaison avec les équivalents d’Égide en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, montre que nous aurions besoin de nous regrouper davantage pour offrir un guichet unique en lieu et place de la multiplicité actuelle.
Répondant au Président François Rochebloine, M. Dominique Hénault qualifie de très bons les rapports avec les ambassades de France à l’étranger. Les personnels d’Égide se déplacent d’ailleurs pour aller les voir afin de mieux les connaître ; la relation est proche de celle de client à fournisseur de services.
Mais Égide travaille aussi, à hauteur de 10 % de son activité environ, pour de grands groupes privés, comme Areva ou Total, pour lesquels elle gère des programmes de bourses.
M. Bertrand Sulpice précise que l’association n’est toutefois pas subventionnée mais rémunérée à la tâche, en fonction de son activité. La relation avec la tutelle n’est donc pas structurée autour de la négociation d’une subvention mais de celle d’un tarif de prestation.
Interrogé par le Président François Rochebloine sur les liens entre Égide et CampusFrance ou l’A 2e 2f, M. Bertrand Sulpice répond que les relations sont inexistantes avec la seconde amis qu’avec le premier il y a une relation de continuité.
Le Président François Rochebloine demande aux intervenants leur jugement sur le rayonnement de la France dans leur domaine d’activité.
M. Dominique Hénault répond que la France fait beaucoup mais avec insuffisamment de cohérence et de visibilité. L’impression est celle de l’éparpillement et du saupoudrage.
Dire que nous travaillons à notre rayonnement ne suffit pas ; il faut fixer trois ou quatre grandes priorités. Les autres pays, nos concurrents, se présentent plus clairement et mettent mieux en valeur leurs atouts. Il s’agit aussi d’une question de marketing !
Nous donnons aujourd’hui une image brouillée, par exemple avec l’agitation régnant autour de l’autonomie des universités. Quels atouts la France peut-elle mettre en avant, sur ce sujet par exemple ? Ils sont de deux ordres : la qualité de l’enseignement français tout d’abord ; un coût des études universitaires dérisoire par rapport à ce qu’il est dans d’autres universités de par le monde.
M. Bertrand Sulpice ajoute qu’il y a dix ans à peine, les écoles et universités françaises étaient absentes des salons de l’éducation dans le monde. Depuis lors, Edufrance puis CampusFrance ont permis de donner à la France une représentation professionnelle dans ces grands rendez-vous. Que de chemin parcouru !
Demeure toutefois un important handicap par rapport aux Anglo-saxons, du fait d’une inégalité de préparation et d’organisation. Les grandes écoles sont les mieux à même de répondre aux attentes du marché, quand les universités sont encore en retrait, du fait d’une autonomie acquise il y a seulement peu de temps et du fait d’un manque de moyens qui s’explique par la modicité des droits d’inscription.
Répondant au Président François Rochebloine sur l’éventuel rééquilibrage géographique des zones de prospection françaises, M. Dominique Hénault estime que le bon sens doit servir de guide : il est normal de continuer à être présents dans les pays d’influence historique, dans une logique de « fidélisation ».
Mais il y a un intérêt évident pour la France à être très présente dans les pays émergents. Des moyens sont nécessaires. Il faut donc faire des choix, même s’il est des pays d’où nous ne pouvons être absents, au risque sinon de perdre des « marchés ».
M. Bertrand Sulpice précise que la France consacre aux pays émergents davantage de moyens qu’il y a dix ou quinze ans. En particulier, le programme de bourses Eiffel – 4 000 bourses depuis l’origine – privilégie l’Amérique latine et l’Asie, comme l’a récemment souligné le ministre Bernard Kouchner à l’occasion de la célébration du dixième anniversaire de ce programme.
Un tel programme de bourses d’excellence rivalise tout à fait avec ceux des autres pays comparables. Les succès remportés sont importants au Pakistan, en Chine, au Brésil, en Indonésie, etc. Autant de pays désireux d’envoyer des étudiants en France.
Au Président François Rochebloine demandant aux intervenants une préconisation finale à l’adresse de la mission, M. Dominique Hénault répond que l’offre française dans son domaine d’activité est touffue, dense. Or nous devons faire comprendre de façon simple ce que nous avons à mettre en valeur.
Mieux vaut donc être plus succinct, plus elliptique pour être mieux compris. La France doit « clarifier son offre ».
La réunion est levée à 19 h 45.
Compte rendu de l’audition de M. Richard Descoings,
directeur de l’Institut d’études politiques de Paris
accompagné de M. Vincent Tenière, chargé de mission
(Mardi 2 février 2010 − 33, rue Saint-Dominique – salle 4223)
La réunion est ouverte à 16 h 40.
• Présents
M. François Rochebloine, Président
Mme Geneviève Colot, Rapporteur
Mme Martine Aurillac, MM. Jean-Claude Guibal, Robert Lecou et Didier Mathus
• Excusés
MM. Jean-Louis Bianco, Philippe Cochet, Jean-Pierre Dufau, Jean-Michel Ferrand, Jean-Pierre Kucheida, Jacques Remiller et André Schneider.
*
M. François Rochebloine, Président, accueille le directeur de Sciences Po et présente la mission et ses travaux.
M. Richard Descoings, directeur de l’Institut d’études politiques de Paris, présente son établissement en soulignant que sur les 9 000 étudiants qu’il accueille, 40 % de ceux qui suivent le cycle du diplôme ne sont pas de nationalité française. Parmi eux, une petite moitié est originaire de pays de l’Union européenne.
Les groupes nationaux les plus nombreux viennent des États-Unis et d’Allemagne, puis par ordre décroissant, d’Asie, du Moyen-Orient et des pays de la Méditerranée – notamment dans le premier cycle délocalisé à Menton.
En outre, Sciences Po envoie chaque année hors de France 1 200 étudiants. La polarisation américaine n’est pas ici aussi forte qu’on aurait pu s’y attendre : 150 étudiants sur le total des 1 200. L’Amérique du Sud et l’Asie sont en progression. C’est u vrai apprentissage de ce que cela signifie de vivre en Chine, en Inde, au Japon…
Quant aux enseignements, ils sont dispensés pour un volume d’un tiers dans une autre langue que le français : l’anglais surtout, l’espagnol et l’allemand. Mais aussi le russe, l’arabe, le coréen, etc.
Deuxièmement, Sciences Po emploie 250 professeurs et chercheurs à temps plein. Mais au total ce sont 3 300 personnes qui y enseignent, dont un quart constitué d’universitaires d’autres établissements et un tiers de non-Français.
À cet égard, Sciences Po a un effort soutenu à conduire – un retard à rattraper ! – pour que le corps enseignant ne soit pas exclusivement français. La stratégie a changé : en 2010 seront créés douze emplois d’enseignants chercheurs, ce qui est beaucoup à l’échelle de Sciences Po. Des recrutements opérés via la presse internationale.
Inversement, c’est d’un certain point de vue une bonne nouvelle que les enseignants de Sciences Po soient « débauchés » par des universités étrangères. Ainsi, un chercheur en sciences politiques a été recruté par une université de Hongkong et travaille aujourd’hui à Pékin. Au-delà de la perte causée à Sciences Po, c’est aussi une marque de reconnaissance pour l’établissement.
En troisième lieu, aussi bien les professeurs que les chercheurs doivent pouvoir passer un an ou deux à l’étranger. Or il n’y a pas à l’étranger que les universités très grandes, très célèbres et très internationales : par exemple, les universités anglo-saxonnes, dans leur immense majorité, sont très nationales.
Interrogé par le Président François Rochebloine sur une éventuelle réciprocité en ce domaine, M. Richard Descoings répond qu’elle est possible mais très coûteuse. Car il faut prendre en charge un conjoint, des enfants, des cotisations en vue de la retraite…
Quatrième élément : la question de la maîtrise de la langue française. Il faut cesser de ne recruter que des francophones. Il vaut bien mieux les faire devenir francophones après les avoir recrutés sur des critères de compétence. C’est certes plus difficile mais très efficace en termes d’influence.
Ainsi, le premier cycle délocalisé de Menton recrute des étudiants originaires du Soudan ou du Qatar, qui deviennent francophones et francophiles au cours de leur scolarité. C’est un véritable investissement pour notre pays.
Interrogé par le Président François Rochebloine sur le pouvoir d’attraction des universités américaines, M. Richard Descoings répond que l’extraordinaire force des universités anglo-saxonnes repose sur la prise en charge financière offerte via les bourses.
En France nous disposons d’un système ancien et efficace avec les bourses du gouvernement français et les bourses d’excellence du programme Eiffel. Une grande différence avec les programmes anglo-saxons est que ces bourses sont gérées, non par les établissements, mais par les ambassades – et bien gérées d’ailleurs.
Les incidents regrettables du type de celui récemment découvert à Toulon sont graves car ils font du tort à tous les établissements français d’enseignement supérieur. Ils permettent de justifier le fait de ne pas confier directement aux établissements la gestion des bourses.
Le Président François Rochebloine demande dans quelle mesure le pont de vue de Sciences Po sur la mobilité internationale diffère de celui des universités ou de la conférence des grandes écoles.
M. Richard Descoings répond que nous souffrons aujourd’hui d’une séparation qui dure depuis des décennies entre l’université et la recherche d’une part, et les classes préparatoires et grandes écoles d’autre part.
Imagine-t-on Oxford sans ses colleges ou Cambridge sans sa recherche ? Pourtant l’université française, c’est à la fois Oxford sans ses colleges et Cambridge sans sa recherche !
Certes des progrès ont eu lieu en 2006 et 2007. On songe notamment à la création des pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) créés par la loi LRU ; la semaine prochaine, Mme Valérie Pécresse, ministre de la Recherche et de l’enseignement supérieur, doit annoncer la mise en place du PRES dont Sciences Po sera un membre fondateur. Le but est clairement de permettre aux établissements français de se battre dans la compétition internationale à armes égales avec leurs homologues étrangers.
Quelles faiblesses demeurent ? Tout d’abord, l’Agence nationale de la recherche n’est pas l’agence de moyens que d’aucuns espéraient. Elle se cherche, même si elle n’est plus le CNRS de l’après-guerre.
En second lieu, les deux premières années d’université sont souvent passées à trier ou à sélectionner les étudiants. Pendant ce temps-là, on ne fait pas de recherche. Et du côté des classes préparatoires, là où la sélection a été effectuée en amont, il n’est pas certain que l’on passe beaucoup de temps à cultiver le doute inhérent à toute recherche ; la plupart des grandes écoles sont moins irriguées par le doute qu’orientées vers la restitution élégante de savoirs constitués.
Mme Martine Aurillac se déclare admirative de l’internationalisation de Sciences Po, qui montre peu de retard en réalité. S’agissant de l’expatriation, le plus difficile est de la réaliser concrètement, compte tenu du suivi des conjoints et des enfants. Quid du financement de Sciences Po ?
Par ailleurs, concernant le rayonnement de la France, que manque-t-il, au-delà de l’autonomie des universités, pour progresser plus vite ?
M. Richard Descoings répond que la République paie mal ses chercheurs car elle les rémunère tous de la même façon. Sciences Po en revanche négocie les salaires qu’elle offre, au même titre que les autres éléments du contrat de recrutement.
Il faut doubler le niveau de la rémunération statutaire pour faire venir un chercheur de bon niveau. Pour parvenir à ce résultat il faut que la Fondation nationale des sciences politiques – et non l’IEP lui-même – soit l’organe de recrutement.
En France, un professeur des universités proche de la retraite perçoit 5 à 6 000 euros par mois et un professeur de 30-40 ans, 3 à 4 000 euros par mois… On est très loin des standards internationaux ! Même si une lente évolution est en cours, par exemple au moyen de primes d’encadrement doctoral.
L’État, depuis quinze ans, augmente sa subvention à Sciences Po de l’ordre de 4 % par an. C’est mieux que l’inflation et cela témoigne d’un soutien sûr et constant. Au milieu des années 1980, la part du financement de l’État dans le budget de Sciences Po représentait 80 %. Cette part était encore de 70 % dans les années 1990 et de 60 % dans les années 2000. Aujourd’hui, elle est tombée à 50 %.
Parallèlement, le nombre d’étudiants à Sciences Po est passé de 4 000 dans les années 1990 à 9 000 aujourd’hui. Hormis la subvention de l’État, les ressources de Sciences Po proviennent pour un quart des droits de scolarité et pour le dernier quart des recettes du mécénat ou des subventions de collectivités territoriales – communes et départements.
Enfin, chaque année, Sciences Po consacre 5 millions d’euros à sa politique d’aide sociale.
Sur le second point, l’accélération des changements relatifs à la mobilité internationale : plus on aura d’enseignants et de chercheurs immergés à l’étranger, mieux l’internationalisation se portera. C’est prosaïque mais vrai.
Pourquoi, par exemple, les principales réticences à la mobilité internationale s’observent-elles dans les facultés de sciences sociales ? Surtout parce que la communauté universitaire, dans ces matières, est peu internationalisée.
M. Jean-Claude Guibal demande si les financements d’entreprises ne pèsent pas sur l’objectivité des enseignements dispensés. Il s’interroge également sur la stratégie qui sous-tend les délocalisations d’établissements du type de celui opéré par la Sorbonne à Abou Dhabi.
Il souhaite enfin savoir si les anciens élèves de Sciences Po sont constitués en association et si leur réseau contribue au rayonnement de l’institut.
M. Richard Descoings répond à la première question que l’indépendance de l’enseignement n’est pas menacée par des financements d’entreprises qui sont très modestes : 150 millions d’euros, à comparer au 15 milliards prévus dans le cadre du plan de relance… En outre, en sciences sociales on ne dépose pas de brevet, hélas !
S’agissant de la délocalisation d’universités hors de France, le frein essentiel est le manque de moyens, même s’il n’est pas le seul. Ainsi une tentative d’implantation de Sciences Po au Maroc a-t-elle reçu l’agrément des autorités marocaines mais pas celui des autorités françaises…
Par ailleurs, en pareil cas la question du financement et de sa traduction en termes d’indépendance de l’établissement a toute sa pertinence. Un projet a ainsi existé au Qatar, où l’on trouve même un établissement sans étudiants… Mais comment convaincre un étudiant chinois d’aller faire ses études à Sciences Po… au Qatar ? Un autre problème rencontré dans cet émirat est l’organisation séparée des amphithéâtres entre ceux réservés aux filles et ceux réservés aux garçons.
Alors peut-être peut-on prospecter à Singapour ? L’INSEAD y est implanté. Mais une université australienne en est repartie au bout de six mois.
À M. Jean-Claude Guibal demandant si le savoir-faire d’un établissement peut s’exporter, M. Richard Descoings répond que la stratégie des universités anglo-saxonnes sur ce point est très claire : c’est non, à aucun prix. Si « exportation » il y a, c’est sous forme de licence pour l’utilisation d’un nom.
Le rôle des anciens élèves est un aspect qui a été négligé, à tort. Un redressement s’opère depuis deux ans. À cet égard, il faut remercier le Parlement d’avoir voté la loi « TEPA » à l’été 2007 qui encourage les financements supplémentaires.
Le Président François Rochebloine observe que la question n’est pas seulement financière ; il s’agit aussi d’entretenir des réseaux d’anciens.
M. Richard Descoings répond que si les réseaux sont une bonne chose, les anciens ont une tendance systématique au conservatisme, à la préservation de l’établissement tel qu’ils l’ont connu. Les soutiens individuels sont donc bienvenus mais pas le soutien institutionnel d’une association d’anciens trop conservatrice.
M. Didier Mathus demande si Sciences Po a rejoint les grandes universités d’envergure mondiale – c’est aussi la problématique des classements internationaux. Par ailleurs, le modèle d’enseignement de Sciences Po, très imprégné de la culture française des affaires publiques, est-il exportable ?
Plus généralement, peut-on exporter autre chose que l’enseignement des sciences dures ?
Sur le premier point, M. Richard Descoings fait valoir que, lorsque Sciences Po signe des accords de double diplôme avec des universités étrangères très prestigieuses, oui, le niveau est le même ; la reconnaissance par les pairs existe.
Quelles sont les faiblesses identifiées ? Essentiellement la spécialisation en sciences humaines et en sciences sociales, qui ne se retrouve pratiquement à la London School of Economics et à l’Université Bocconi de Milan.
Dans le classement de l’université de Shanghaï, en effet, on ne trouve que les sciences dures. Mais il existe d’autres types de classement, par discipline. En sciences économiques et en gestion par exemple, la LES est classée 5e, Sciences Po 105e…
Cependant toutes les grandes universités possèdent, à côté de leurs départements de sciences dures, de très bons départements d’humanités et de sciences sociales (le MIT, Cambridge…). D’où l’intérêt du PRES auquel appartient Sciences Po.
En second lieu, Sciences Po est-il exportable ?
L’établissement est né de deux défaites : celle de 1870 qui a suscité la création en 1872 de l’École libre des sciences politiques, par la haute société protestante et par la banque juive, au temps de la IIIe République naissante, avant les associations, sous forme de société par actions.
Deuxième défaite, celle de 1945 ; deuxième transformation, avec la naissance de l’IEP, une transformation souhaitée par le général De Gaulle.
Oui, ce modèle est exportable. Les grands progrès exigent que les sciences sociales se les approprient. Si l’on a aujourd’hui besoin de traders, on a aussi besoin de les contrôler, de comprendre les mécanismes de la financiarisation de l’économie pour analyser la crise.
Sciences Po est né de deux défaites militaires, donc du besoin de comprendre le monde et ses guerres. Cela s’exporte car les Américains, les Chinois ne voient pas le monde comme nous.
Si nous n’exportons pas notre modèle, c’est la porte ouverte à tous les relativismes ; ce sont les droits de l’homme à géométrie variable. Idem pour les droits des femmes ou la procédure pénale. Ce combat pour les valeurs est très important en termes d’influence.
Répondant au Président François Rochebloine qui lui demande une dernière préconisation à l’adresse de la mission, M. Richard Descoings insiste sur l’instrument inégalé dont dispose la France avec ses lycées à l’étranger. Sciences Po y recrute beaucoup.
Pour un jeune Américain, ce n’est pas la même chose d’avoir été formé au lycée Rochambeau de Washington DC que dans la meilleure high school. Le système français n’est pas meilleur mais il est différent.
Ce système est certes coûteux ; il est pourtant de grande valeur. M. Richard Descoings souligne qu’il a fait part au Président de la République de son opposition au mécanisme de prise en charge.
C’est folie que de supprimer les écolages pour les enfants français ; les bourses sur critères sociaux suffisent. Quant aux enfants d’autres nationalités, pour leur famille le paiement de droits de scolarité élevés est synonyme de qualité.
La réunion est levée à 17 h 45.
Compte rendu de l’audition de M. Benoît Paumier,
inspecteur général des affaires culturelles
(Mercredi 3 février 2010 − 33, rue Saint-Dominique – salle 4211)
La réunion est ouverte à 17 h 45.
• Présents
M. François Rochebloine, Président
Mme Geneviève Colot, Rapporteur
M. Robert Lecou
• Excusés
Mme Martine Aurillac, MM. Jean-Louis Bianco, Philippe Cochet, Jean-Pierre Dufau, Jean-Michel Ferrand, Jean-Claude Guibal, Jean-Pierre Kucheida, Didier Mathus, Jacques Remiller et André Schneider.
*
M. François Rochebloine, Président, accueille M. Paumier en présentant la mission et ses travaux. Il souligne que la mission a souhaité entendre M. Paumier à titre personnel, à raison de ses travaux passés qui concernent les thèmes de travail de la mission.
Toutefois, sans s’exprimer officiellement au nom du ministère de la Culture et de la communication, M. Paumier pourra en esquisser l’action internationale dans ses grandes lignes.
M. Benoît Paumier, inspecteur général des affaires culturelles, indique cibler son propos sur les opérateurs, ce qui représente environ 85 % de l’action internationale du ministère de la Culture et de la communication.
Il s’agit des opérateurs dont le ministère exerce la tutelle ou la co-tutelle, ainsi que des sociétés comme le Bureau international de l’édition française, le Bureau export musique ou l’opérateur compétent pour les architectes… tous organismes que finance le ministère de la Culture et de la communication.
Il existe trois vecteurs de l’action culturelle de la France à l’étranger. Le premier est le réseau culturel – ou plutôt le réseau de coopération, en fait – à l’étranger. Le deuxième est l’audiovisuel extérieur, à quoi s’ajoute l’Internet. Le troisième, ce sont les opérateurs.
Ce dernier domaine, traditionnellement moins exploré, est en pleine progression. Il s’agit d’un mouvement de fond. De ce point de vue, le Louvre Abou Dhabi est un peu « l’arbre qui cache la forêt ».
Ainsi, malgré un contexte de diminution des moyens budgétaires d’intervention, il convient de nuancer le déclin de la culture française dans le monde.
La présence des opérateurs à l’étranger s’est accrue très fortement ces dernières années, notamment du fait d’un mouvement d’européanisation. C’est le cas dans les domaines de la propriété intellectuelle, de la lutte contre le piratage, de la protection des œuvres et de leur circulation, etc.
Le ministère de la Culture et de la communication a donc de plus en plus besoin d’experts, et pas seulement de généralistes de l’action culturelle. Il s’agit de dépasser l’activité que l’on pourrait trivialement désigner comme celle de « gentils organisateurs de manifestations culturelles ».
Le rapport d’étape de la mission d’information a souligné à juste titre l’importance des industries culturelles. Cela vaut aussi dans le domaine des négociations commerciales internationales.
Le but n’est plus seulement de cibler tel ou tel pays du monde mais de permettre une diffusion maximale, y compris dans les zones les plus solvables. Si l’audiovisuel s’est bien adapté à cette nouvelle donne via les attachés audiovisuels dans certaines ambassades, il serait souhaitable que ce modèle se généralise.
Le développement de l’activité internationale des établissements publics culturels n’est pas tant né d’un désir soudain de s’investir dans le sujet que de la prise de conscience d’une réalité extérieure, qui s’est imposée d’elle-même.
Cela a été le cas pour les musées, à l’image du Louvre ou du Musée du Quai Branly qui a dû nouer des liens avec les pays d’origine des œuvres détenues dans ses collections afin de prévenir les demandes de retour desdites œuvres…
Pour la Réunion des musées nationaux ou pour l’Institut national de l’audiovisuel, il s’est agi de développer la valorisation du patrimoine, notamment audiovisuel. Pour les écoles d’art, l’engagement international est apparu nécessaire à leur attractivité.
Il faut noter qu’aucune stratégie uniforme n’a été imposée à ces opérateurs ; ils représentent une somme d’expériences individuelles à valoriser.
La géographie de cette projection internationale est différenciée : elle se concentre sur les pays très développés comme ceux d’Amérique du Nord ou sur les grands émergents comme l’Inde. Il existe donc des « zones blanches » d’où les opérateurs sont absents : l’Asie centrale, l’Asie du Sud-est, l’Océanie, l’Afrique subsaharienne, y compris francophone, même s’il existe quelques exceptions.
Le paramètre de la capacité financière de nos partenaires est important ; ainsi le Moyen-Orient « rapporte » aux établissements publics qui y sont implantés.
En définitive, une « carte implicite » s’impose d’elle-même. Comment la faire coïncider avec les priorités de notre diplomatie ? Comment être plus volontariste ?
Une difficulté à cet égard est celle du grand cloisonnement qui caractérise l’action de nos établissements publics – sauf exception comme la Réunion des musées nationaux ou l’agence France Muséums. Il s’agit même d’un double cloisonnement : entre l’administration centrale et les établissements d’une part, et entre les établissements et le réseau culturel, d’autre part.
S’ajoute à cela le « contournement » des voies normales de conclusion de partenariats par des États étrangers qui s’adressent directement aux établissements publics.
Le constat général est donc celui d’une faible performance d’ensemble. Pourtant, trois tempéraments de nature géographique doivent être apportés :
– il est des lieux où les postes ont encore les moyens de financer des bourses et autres instruments d’influence, comme en Afrique du nord ;
– il y a des pays à risque, comme au Moyen-Orient ;
– il y a l’Afrique francophone, où le réseau culturel français est le seul lieu de la vie culturelle et du débat d’idées.
Hors ces zones, et dans les pays développés en particulier, la coopération s’effectue directement entre l’opérateur et les autorités locales – à New York par exemple, on s’adresse directement à tel musée ou à telle école d’architecture, sans passer par le SCAC.
Le Président François Rochebloine demande si les postes sont néanmoins tenus informés.
M. Benoît Paumier répond qu’ils le sont en règle générale, très souvent a posteriori, au moment de la signature solennelle de l’accord.
Le rôle des postes est très important dans deux cas : les pays à risque et les pays avec lesquels la France entretient une relation historique de coopération. Pour le reste, il faudrait reproduire le modèle des attachés audiovisuels, c’est-à-dire être plus réactifs et davantage en lien avec le terrain local.
M. Robert Lecou observe que les collectivités territoriales agissent elles aussi et regrette une certaine forme de condescendance à l’égard des acteurs qui n’auraient pas reçu le « label » du ministère de la Culture et de la communication. Des expositions ont pu voyager sans pour autant recevoir un soutien de la part du ministère.
M. Benoît Paumier souligne qu’il ne méconnaît pas du tout l’action des collectivités territoriales mais qu’il a choisi de centrer son propos sur les quelque 80 opérateurs liés au ministère de la Culture et de la communication.
M. Robert Lecou demande dans quelle mesure existe un travail en commun entre les collectivités territoriales et le ministère de la Culture et de la communication. Ne faudrait-il pas réfléchir à une pus grande synergie ?
M. Benoît Paumier répond qu’il n’existe pas à l’échelon de l’administration centrale mais qu’il se rencontre à l’échelon local, via les directions régionales de l’action culturelle (DRAC). Des conventions tripartites ont par ailleurs déjà été conclues entre des collectivités, des DRAC et CulturesFrance.
Des coopérations transfrontalières sont menées dans les cinq euro-régions. Enfin, il faut citer les opérations exceptionnelles que sont les désignations de capitales européennes de la culture.
Le Président François Rochebloine demande quelle place occupent les saisons culturelles dans ce panorama.
M. Benoît Paumier répond qu’il s’agit probablement de la seule manifestation existante d’une politique culturelle internationale volontariste. Un « effet saison » est très notable avec chacun des pays concernés.
Ce dispositif fonctionne bien à la condition que soient respectées quatre conditions :
– une orientation politique interministérielle claire ;
– une décision suffisamment anticipée (deux à quatre ans à l’avance) ;
– une bonne visibilité médiatique ;
– et une implication financière de l’État, même ponctuelle.
Répondant à Mme Geneviève Colot, Rapporteur, qui souhaite savoir si des entreprises participent au financement de ces saisons, M. Benoît Paumier indique qu’elles le font si tel est leur intérêt. À cet égard, la Chine ou la Russie ont un autre pouvoir d’attraction que la francophonie…
L’étude de la manière dont « fonctionnent » ces saisons est très instructive. Même quand le financement étatique est très limité, il encourage les autres acteurs à s’impliquer.
Le Président François Rochebloine s’enquiert d’une éventuelle menace qui pèserait sur les saisons culturelles.
M. Benoît Paumier répond par quatre remarques :
– le choix du pays concerné joue beaucoup. Autant le Brésil était un succès garanti, autant avec la Pologne l’engouement est limité ;
– les saisons ne doivent pas être trop rapprochées. Encore une fois, la Pologne en pâtit, « coincée » qu’elle est entre la Chine et la Russie ;
– le « retour médiatique » est crucial. En témoigne le succès de la quinzaine islandaise ;
– faire « tenir » une saison un an relève de la gageure.
Un deuxième paramètre de l’action des postes à l’étranger est le profil des interlocuteurs qui y travaillent. Ainsi, certaines coopérations aux États-Unis – à Miami notamment – ont pu prospérer grâce au parcours qui était celui de l’attaché culturel.
Le besoin de formation d’un futur attaché ou conseiller culturel avant sa prise de poste est absolument crucial.
Il faut également savoir que certains acteurs ignorent les circuits nationaux, et que certains conseillers de coopération et d’action culturelle ou certains ambassadeurs poursuivent leurs propres priorités.
Dans beaucoup de pays on constate la juxtaposition d’initiatives isolées. Pour autant on ne déplore pas d’impairs, ou alors de très rares dysfonctionnements. Cependant il ne faut pas se cacher le manque de synergie ni les occasions perdues.
À la décharge des intéressés toutefois, le développement des activités international est récent dans le domaine culturel ; nous sommes encore en phase de transition entre l’action traditionnelle et cette nouveauté.
Le Président François Rochebloine demande à l’intervenant son sentiment personnel sur la future agence culturelle et ses liens avec le réseau culturel de la France à l’étranger, ainsi que sur al création de deux EPIC distincts dans le projet de loi relatif à l’action extérieure de l’État.
M. Benoît Paumier souligne le rôle d’intermédiation à jouer entre les « offreurs de culture » en France et le réseau culturel à l’étranger chargé d’en assurer la diffusion. Deux modèles sont possibles : une coopération s’appuyant sur l’amont (l’apprentissage, la formation) ou plutôt sur l’aval.
La crainte actuelle est celle d’une agence qui, privée de réseau, resterait comme « en lévitation ».
Quant à la création de deux EPIC distincts, elle est a priori satisfaisante du point de vue du ministère de la Culture et de la communication, en ce qu’elle évite que l’action culturelle soit « phagocytée » par l’action éducative. Il n’est pas évident que des liens très forts existent, d’ailleurs, entre ces deux volets.
Le Président François Rochebloine interroge M. Paumier sur la place de l’audiovisuel extérieur dans la diplomatie d’influence française. Il est heureux que TV5 Monde soit présente comme elle l’est car France 24, agréable à regarder à Paris et de bonne qualité, n’est souvent pas vue à l’étranger en dépit de son coût élevé !
M. Benoît Paumier répond qu’une étape majeure a été franchie avec la création de France 24. Sa faible diffusion est due à l’absence de choix entre cette chaîne et TV5 Monde, qui a des conséquences budgétaires car les deux sont liées de ce point de vue.
En tout état de cause, il serait erroné de concentrer tous les moyens de production à France 24 et tous les moyens de diffusion à TV5 Monde.
Au Président François Rochebloine l’interrogeant sur la chaîne Euronews, M. Benoît Paumier répond qu’elle fonctionne bien.
M. Robert Lecou observe que l’on a donc réussi à faire fonctionner une chaîne européenne. Qu’en est-il des mutualisations d’implantations culturelles entre États membres de l’Union ? Cela serait-il profitable au rayonnement de la France ?
M. Benoît Paumier répond que le ministre de la Culture et de la communication lui a confié la coordination de la présidence française du Conseil de l’Union européenne sur les questions culturelles. Le problème est que la culture n’est arrivée que tardivement dans la construction européenne.
Par conséquent, l’idée de postes culturels communs à l’étranger (hors Union européenne) n’est pas mûre. Il faut pourtant y travailler car cela servira à construire une identité européenne. Pour autant le chemin est encore long : un échec a été enregistré à Moscou entre les Français et les Allemands…
Le Président François Rochebloine observe qu’une implantation culturelle franco-allemande fonctionne à Ramallah.
La réunion est levée à 18 h 50.
Compte rendu de l’audition de Mme Nathalie Delapalme,
inspectrice générale des finances
(Mercredi 3 février 2010 − 33, rue Saint-Dominique – salle 4211)
La réunion est ouverte à 16 heures 45.
o Présents
M. François Rochebloine, Président
Mme Geneviève Colot, Rapporteur
Mme Martine Aurillac, MM. Jean-Claude Guibal et Robert Lecou.
o Excusés
MM. Jean-Louis Bianco, Philippe Cochet, Jean-Pierre Dufau, Jean-Michel Ferrand, Jean-Pierre Kucheida, Didier Mathus, Jacques Remiller et André Schneider.
*
M. François Rochebloine, Président, accueille Mme Delapalme en lui présentant les travaux de la mission et il lui demande de rappeler son action dans le cadre de la mise en œuvre de la révision générale des politiques publiques (RGPP) au Quai d’Orsay.
Mme Nathalie Delapalme, inspectrice générale des finances, indique que son travail a porté sur deux volets de la RGPP, deux politiques publiques distinctes : l’action extérieure de l’État et l’aide publique au développement. Cette dernière étant notamment mise en œuvre par les services de coopération et d’action culturelle (SCAC) des ambassades, elle est aussi en lien avec les réflexions de la mission d’information.
Dans le domaine de l’action extérieure de l’État, quatre chantiers ont été identifiés : l’action diplomatique proprement dite, l’action consulaire, l’action économique et la « diplomatie d’influence », qui va au-delà de la culture et de la langue pour englober la coopération scientifique et universitaire.
Outre le ministère des Affaires étrangères et européennes, plusieurs ministères concourent à l’action extérieure de l’État. Ainsi, en matière de « diplomatie d’influence », il est important de tenir compte aussi par exemple des ministères en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche, ou de la culture.
L’exercice RGPP a été mené en parallèle avec la rédaction du Livre blanc sur la politique étrangère et européenne de la France, Mme Delapalme indiquant qu’elle appartenait aussi au secrétariat de la commission du Livre blanc.
Observations générales sur la RGPP : le fil conducteur général de l’exercice RGPP, qui le distingue des audits plus traditionnels, a consisté à définir au préalable la mission mise en œuvre – quel public? quelle demande? quels objectifs ? –, avant d’examiner les moyens nécessaires ou disponibles pour accomplir cette mission, et de s’interroger sur le rôle spécifique de l’État en la matière.
L’intérêt de faire prévaloir une double logique de métiers et de partenariat, en confortant le rôle d’ensemblier et de « catalyseur » de l’État a été souligné.
L’examen particulier de l’action extérieure de l’État a conduit à relever plusieurs particularités fortes. Régalienne par essence, cette politique publique est aussi celle qui s’exerce dans un contexte particulièrement concurrentiel, puisque nos « partenaires étrangers » sont aussi, souvent, nos concurrents Il est donc essentiel de chercher à faire prévaloir l’« avantage comparatif » de la France.
En second lieu, presque toutes les politiques publiques – sécurité, santé, culture, environnement, agriculture… – ont aujourd’hui une dimension internationale. De sorte que le rôle du Quai d’Orsay doit passer d’une logique de « monopole de l’action diplomatique » à une logique de « coordination de l’action extérieure ». En l’occurrence, s’agissant de l’action culturelle, entre ministères, mais aussi avec les grandes écoles et les universités, avec les collectivités territoriales, avec les partenaires privés…
Enfin, pour exercer une mission aussi vaste, le budget du Quai d’Orsay, hors audiovisuel extérieur et hors aide publique au développement, est extraordinairement limité : 0,7 % du budget de l’État, soit moins que le budget consacré aux Anciens combattants. De fait, l’insistance sur ce lancinant problème de moyens bloque très régulièrement toute discussion sur les missions.
À la question de M. François Rochebloine, Président, demandant si la LOLF a apporté des solutions sur ce point, Mme Nathalie Delapalme répond qu’elle a parfois compliqué les sujets, citant à titre d’exemple la difficulté relative aux établissements à autonomie financière, que la mission d’information a d’ailleurs abordée dans son rapport d’étape.
L’« action culturelle extérieure » au sens large s’inscrit aujourd’hui dans un paysage profondément remanié, à la fois par l’émergence de grands partenaires désireux de développer cet outil essentiel d’influence – Chine, Japon, Brésil par exemple –, par l’apparition de vecteurs d’influence de portée inédite – sur la forme avec l’Internet, sur le fond avec le poids du facteur religieux – et par le poids croissant des acteurs infra ou supra nationaux – grandes universités, think tanks, collectivités territoriales, grands établissements culturels, grands instituts de recherche.
L’apparition d’une forme de « communautarisme planétaire » se traduit à la fois par la banalisation du modèle anglo-saxon et la montée des revendications à la « souveraineté culturelle » émanant de sous-groupes culturels.
Dans ce cadre, les principales conclusions de la RGPP ont d’abord conduit à souligner que l’« action culturelle extérieure » constituait désormais une dimension croissante de l’action extérieure de l’État.
Dans le cadre d’un enjeu géo-stratégique croissant, renforcé par les évolutions démographiques contrastées des pays du Nord et du Sud, la défense et surtout la promotion des valeurs culturelles au sens large revêt une importance essentielle, et doit être élargie à la dimension particulière de la recherche, face à l’apparition de nouveaux enjeux : santé, dépendance énergétique, biodiversité, protection du patrimoine, changement climatique, sécurité alimentaire…
Deux questions importantes également : le lien à faire avec la notion d’« immigration choisie » – vaut-il mieux privilégier l’apprentissage du français dans les pays francophones dont nous souhaitons maîtriser les flux d’immigration ou bien faut-il plutôt privilégier l’apprentissage du français dans des pays non francophones en provenance desquels nous souhaitons voir l’immigration se développer ? D’autre part, quel lien, quelle articulation, ou quel ordre de priorité, entre culture française et culture européenne ?
Dans ce contexte, la politique publique mise en œuvre doit être confortée. Certes, la culture française demeure une valeur reconnue dans le monde. Mais la langue française demeure un vecteur plus culturel qu’économique, et la France souffre d’un désavantage comparatif dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Par ailleurs, la juxtaposition des organismes et des institutions sur le terrain nuit à la lisibilité du dispositif, qui doit être améliorée. Enfin, il apparaît souhaitable de mieux adapter l’offre française à la demande des différents partenaires, en tenant compte de la concurrence qui s’exerce de façon croissante.
Les recommandations formulées dans le cadre de la RGPP ont été plus ou moins approfondies en fonction de l’implication, sur ces sujets, de la commission du Livre blanc sur les Affaires étrangères et européennes, de la mission spécifique sur l’audiovisuel extérieur conduite par M. Georges-Marc Benhamou, et de plusieurs missions sur l’AEFE (un audit RGPP spécifique de l’agence vient de se conclure), ou sur l’opérateur culturel.
Les principales recommandations peuvent être synthétisées comme suit :
– regroupement des dispositifs sur le terrain sous un label unique, sous forme d’établissements dotés de l’autonomie administrative et financière leur permettant notamment de renforcer le recours aux partenariats public/privé et aux cofinancements, le directeur de l’établissement ayant vocation à être le conseiller culturel de l’ambassade ;
– mise en place d’un grand opérateur culturel, symétrique en quelque sorte de l’opérateur de développement qu’est l’AFD et de l’opérateur de l’enseignement qu’est l’AEFE, doté de ses « filiales » sur le terrain, elles-mêmes symétriques des agences de l’AFD et des lycées de l’AEFE. Le MAEE au niveau de l’administration centrale, et l’ambassadeur sur le terrain, ayant vocation à coordonner et mettre en synergie les actions ainsi mises en œuvre par différents opérateurs.
Ce dernier point, consistant à doter l’opérateur culturel d’un réseau propre sur le terrain, dans le cadre d’un contrat d’objectifs et de moyens passé avec l’État, a fait l’objet de très nombreuses discussions, qui ont perduré après la réunion du Conseil de modernisation de politiques publiques (CMPP, instance décisionnaire de la RGPP). Ce choix n’a finalement pas été retenu, les ambassadeurs préférant conserver une autorité hiérarchique sur le réseau culturel.
M. François Rochebloine, Président, faisant observer que l’enseignement n’est pas le culturel, Mme Nathalie Delapalme indique que la coordination sous l’égide de l’ambassadeur peut être la règle dans tous les domaines, en particulier grâce au contrat d’objectifs et de moyens signé par l’opérateur tête de réseau avec l’État – et non avec tel ou tel ministère.
Le CMPP a par ailleurs décidé de mettre en place un opérateur de l’attractivité et de la mobilité. Aujourd’hui près de 300 000, les étudiants étrangers en France ne représentent qu’environ 12 % de l’ensemble des inscrits dans l’enseignement supérieur. La France dispose du meilleur réseau de lycées de par le monde mais peine à assurer le maintien des meilleurs éléments dans le réseau français d’enseignement supérieur.
L’AEFE vient de faire l’objet d’un audit spécifique dans le cadre de la « RGPP-opérateurs ». La gratuité de la scolarité pour les élèves français scolarisés dans le réseau de l’AEFE comporte un triple effet pervers :
– effet d’aubaine pour les familles expatriées dont les écolages étaient acquittés par l’employeur ;
– effet d’éviction à l’égard des ressortissants étrangers ;
– et pour certaines familles, perte nette par rapport au système préexistant des bourses scolaires.
Le réseau français se heurte aujourd’hui à de réels problèmes de capacité d’accueil et de sécurité.
M. François Rochebloine, Président, rappelle l’amendement de plafonnement qu’il a déposé puis fait adopter par la commission des affaires étrangères unanime et par l’Assemblée nationale à la quasi-unanimité, avant qu’au Sénat la disposition ne soit supprimée. Il demande quelle est aujourd’hui la marge de manœuvre sur ce sujet.
Mme Nathalie Delapalme répond qu’elle devient sans doute étroite à l’approche des grandes échéances électorales.
M. Jean-Claude Guibal se demande si la solution ne pourrait être trouvée via un système de gestion de marque, inspiré du modèle de la franchise.
M. François Rochebloine, Président, souhaite savoir si le thème de l’audiovisuel extérieur de la France a été traité dans le cadre de la RGPP.
Mme Nathalie Delapalme confirme que le sujet audiovisuel, comme d’ailleurs celui de la recherche, étaient hors périmètre de la RGPP « action extérieure ».
À Mme Martine Aurillac demandant si l’audiovisuel extérieur a vocation à être traité dans le cadre de la RGPP, Mme Nathalie Delapalme répond qu’il l’a été dans le cadre de la mission conduite par M. Georges-Marc Benhamou.
M. François Rochebloine, Président, souhaite creuser la question de la mutualisation de moyens entre États membres de l’Union européenne. Les regroupements d’implantations sont-ils une solution ?
Mme Nathalie Delapalme répond que sans en faire un principe général d’action, il est toujours possible de trouver des synergies entre opérateurs européens.
On pourrait par exemple songer à des « bouquets universitaires » qui seraient proposés aux étudiants des grandes universités européennes. Les regroupements d’implantations ont au moins le mérite de permettre des économies.
Un des travers du système français consiste sans doute à trop raisonner en termes d’offre, et de ne pas assez analyser la demande, moins encore la concurrence.
M. Robert Lecou insiste sur le fait que la mutualisation ne doit pas aboutir à gommer les singularités nationales.
M. François Rochebloine, Président, demande quelles sont les prochaines étapes du processus de RGPP. Mme Nathalie Delapalme répond que ce processus continue d’être suivi régulièrement au plus haut niveau par le Conseil de modernisation des politiques publiques co-présidé par MM. Claude Guéant et Jean-Paul Faugère et qu’il est assisté en permanence par la Direction générale de la modernisation de l’État à Bercy
La réunion est levée à 17 h 40.
Compte rendu de l’audition de Mme Sonia Dubourg-Lavroff,
directrice des relations européennes et internationales et de la coopération
au ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche
et au ministère de l’Éducation nationale
accompagnée de M. Marc Rolland, sous-directeur des relations internationales
et de M. Gilles Vial, chargé de mission
(Mercredi 31 mars 2010 − 33, rue Saint-Dominique – salle 4223)
La réunion est ouverte à 16 h 45.
• Présents
M. François Rochebloine, Président
M. Robert Lecou
• Excusés
Mme Geneviève Colot, Rapporteur, Mme Martine Aurillac, MM. Jean-Louis Bianco, Philippe Cochet, Jean-Pierre Dufau, Jean-Michel Ferrand, Jean-Claude Guibal, Jean-Pierre Kucheida, Didier Mathus, Jacques Remiller et André Schneider.
*
M. François Rochebloine, Président, accueille les intervenants en présentant la mission et ses travaux. La mission revient du Liban où elle a pu rencontrer les représentants de grandes universités francophones et le directeur de l’École supérieure des affaires.
Mme Sonia Dubourg-Lavroff, directrice des relations européennes et internationales et de la coopération au ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche et au ministère de l’Éducation nationale, présente sa direction (la DREIC) comme transversale aux deux ministères dont elle relève, ce qui lui donne une vision large.
Comptant 65 personnes, elle joue un rôle d’interface à l’égard du ministère des Affaires étrangères et européennes et des acteurs étrangers dans son domaine de compétence.
Ce rôle se décline de deux façons :
– une mission de représentation officielle des deux ministères, consistant à porter et à défendre les positions françaises. Cela suppose un important travail de veille ;
– une mission d’élaboration de la politique internationale des deux ministères, en lien avec les autres directions qui le composent. Il s’agit d’articuler nos priorités avec les enjeux rencontrés dans les différents pays du monde.
La DREIC mène une action de coordination, notamment en exerçant la tutelle sur l’A 2e 2f, sur l’École supérieure de l’Éducation nationale (ESEN), sur le Centre international d’éducation pédagogique (CIEP) et sur le Centre national d’enseignement à distance (CNED).
L’activité de la DREIC a une dimension à la fois bi- et multilatérale. Sur le plan bilatéral, des centaines d’actions sont menées, par exemple la mise en place de l’université des sciences e technologies de Hanoï ou des programmes de formation professionnelle avec des pays d’Amérique latine.
Les 65 personnes qui composent la DREIC sont souvent plurilingues, ils ont pour la plupart une bonne expérience des questions internationales ; leurs compétences ne sont pas en cause. Mais dans le nouveau paysage de l’action extérieure de la France, il y a une légitime inquiétude à propos de la place qu’occupera la coopération en matière d’enseignement supérieur. Car il ne s’agit pas d’un champ proprement « culturel » mais bien distinct.
La contribution apportée par les deux ministères au réseau éducatif et culturel de la France à l’étranger comprend deux volets : l’enseignement scolaire français – Mme Dubourg-Lavroff est membre du conseil d’administration de l’AEFE) – et l’enseignement du français.
S’agissant du premier volet, le ministère de l’Éducation nationale n’exerce pas la tutelle sur l’AEFE mais il joue un rôle majeur à son égard : à travers la participation au conseil d’administration de l’agence, à travers l’association à toutes les réflexions menées au sein de l’agence ou du ministère des Affaires étrangères et européennes concernant, par exemple, l’attribution d’un label « France éducation » à des établissements à l’étranger, etc.
Le Président François Rochebloine exprime ses doutes à propos de la pertinence d’un « label » qui viendrait compenser l’absence d’homologation : ne cherche-t-on pas seulement à « se faire plaisir » ?
Mme Sonia Dubourg-Lavroff répond que ce type de « labellisation » permettrait de « donner un goût de France » à certains établissements. Il s’agit par ailleurs d’un souhait du ministère des Affaires étrangères et européennes et la décision lui appartient, seul.
L’inspection générale du ministère défend elle aussi cette idée d’un label « France éducation » mais le ministre lui-même est plus dubitatif. Le risque serait de laisser entendre que la France s’implique dans le fonctionnement de l’établissement et dans l’enseignement dispensé alors que ce n’est pas le cas en réalité.
M. Gilles Vial précise que si l’inspection générale est favorable à un tel label, c’est pour renforcer les critères d’homologation des lycées à l’étranger, la catégorie des lycées homologués souffrant parfois de contours trop flous.
Interrogé par le Président François Rochebloine sur les effectifs de l’Éducation nationale détachés dans le réseau d’enseignement français à l’étranger, Mme Sonia Dubourg-Lavroff souligne le contexte de baisse du nombre d’enseignants titulaires expatriés. Par ailleurs, quatre inspecteurs généraux se déplacent de par le monde, et sont détachés auprès de l’AEFE sept inspecteurs pédagogiques régionaux ainsi qu’une quinzaine d’inspecteurs de l’Éducation nationale.
M. Gilles Vial, en réponse à une question du Président François Rochebloine, indique que l’on sait de longue date que l’AEFE et la MLF ne sont pas de bons promoteurs de l’enseignement supérieur français.
Interrogée sur le nouvel EPIC dont la création est contenue dans le projet de loi relatif à l’action extérieure de l’État voté en première lecture au Sénat, Mme Sonia Dubourg-Lavroff réaffirme la tutelle de la DREIC sur le CNED et le CIEP.
En particulier, les diplômes d’études en et langue française et les diplômes approfondis de langue française (DELF et DALF) relèvent de l’Éducation nationale. Le CIEP joue un grand rôle dans l’enseignement du français car il labellise tous les établissements dispensant un enseignement de français langue étrangère.
Questionnée sur la place des Alliances françaises dans le dispositif, Mme Sonia Dubourg-Lavroff souligne que l’on est toujours frappé par l’enthousiasme que manifestent les Alliances dans la promotion du français ; dès lors, attention à ne pas les froisser en envisageant un rapprochement trop étroit avec le réseau ou u passage sous l’autorité de l’ambassadeur.
Il faut reconnaître que la rechercher de financements nouveaux par le ministère des Affaires étrangères et européennes conduit ce dernier à s’intéresser de très près à l’enseignement du français langue étrangère.
S’agissant du futur Institut français dont la création est contenue dans le projet de loi relatif à l’action extérieure de l’État, la volonté de porter plus haut la voix de la France à l’étranger doit être saluée et soutenue. Mais il ne faudrait pas que soient mélangées les compétences en matière d’éducation et celles du champ culturel.
Une préconisation fondamentale à propos de cet institut concerne le recrutement, la formation et le suivi de tous les personnels des établissements du réseau. Le ministère de l’Éducation nationale devrait y être associé.
M. Marc Rolland précise que lorsque ces personnels expatriés reviendront au sein de l’Éducation nationale, le risque est grand qu’une séparation trop nette entre la politique de recrutement et de formation de l’EPIC et celle de la DREIC cause des difficultés.
M. Gilles Vial ajoute qu’initialement, l’article 6 du projet de loi ne consistait qu’à transformer CulturesFrance en EPIC. Mais à l’issue de la première lecture au Sénat, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche est directement concerné par le nouvel EPIC.
Par exemple, il n’est pas impossible que ce futur Institut français veuille recruter de son propre chef un attaché de coopération universitaire. C’est inacceptable !
Le Président François Rochebloine fait observer que les amendements introduits au Sénat l’ont été avec l’assentiment du Gouvernement.
Mme Sonia Dubourg-Lavroff répond que l’influence du ministère des Affaires étrangères et européennes a été forte en l’espèce. Mais le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche entend bien participer à la gouvernance de l’Institut français s’il apparaît que l’étendue définitive de ses missions continue à empiéter sur les siennes.
Le Président François Rochebloine interroge les intervenants sur leur perception du rayonnement européen et mondial de l’enseignement supérieur français.
Mme Sonia Dubourg-Lavroff répond que la France est présente, y compris dans les instances communautaires, notamment dans le cadre du nouveau programme relatif à l’éducation et à la formation à l’horizon 2020, qui débutera en 2013.
Pour al mobilité entrante comme pour la mobilité sortante, la France se place dans les deux ou trois meilleurs Européens. Elle est très en pointe pour la mise en œuvre du programme Erasmus Mundus.
Le Président François Rochebloine demande si le programme d’origine, Erasmus, s’essouffle quant à lui.
Mme Sonia Dubourg-Lavroff rappelle qu’à sa création, ce programme fonctionnait de façon quasi automatique au sein de chaque établissement, en fonction du nombre de places disponibles. Aujourd’hui il doit être mis au cœur du projet international de chaque université et non laissé en « pilotage automatique » sans mise sous tension.
Le Président François Rochebloine demande quelles conséquences emporte la différence de statut entre les universités et les grandes écoles dans le domaine de l’action internationale.
Mme Sonia Dubourg-Lavroff répond qu’aucun établissement ne peut ignorer aujourd’hui la dimension internationale de son activité. Pour une école, c’est un élément de qualité indispensable. Pour une université, davantage d’incitation est nécessaire. Les étudiants des universités n’ont souvent pas les mêmes « prédispositions internationales » que les élèves des grandes écoles.
M. Gilles Vial ajoute que les écoles rendent souvent la mobilité internationale obligatoire. Depuis très longtemps, la proportion d’élèves étrangers est bien supérieure dans les écoles à ce qu’elle est dans les universités.
Le Président François Rochebloine s’enquiert des effets de la LRU du point de vue de la DREIC.
Mme Sonia Dubourg-Lavroff souligne l’aspect stratégique. Les nouveaux campus d’excellence favorisent la dimension internationale.
M. Marc Rolland ajoute que cette loi ouvre beaucoup d’horizons en matière de partenariats avec des entreprises via des fondations. L’exemple du projet d’école scientifique de Hanoï est très encourageant, du fait de la réactivité des entreprises et de l’implication de l’ambassadeur de France.
Le Président François Rochebloine interroge les intervenants sur les liens entre la DREIC et les autres opérateurs.
Mme Sonia Dubourg-Lavroff répond que la relation est celle d’une simple tutelle à l’égard de l’A 2e 2f, opérateur qui fonctionne très bien, comme en témoigne sa bonne notation par la Commission européenne.
À l’égard de CampusFrance en revanche, la préoccupation est grande. Cette agence a en effet acquis une réelle légitimité auprès des intervenants de l’enseignement supérieur, une légitimité qui risque d’être écornée si le nouvel opérateur reprenant ses activités est rattaché exclusivement au ministère des Affaires étrangères et européennes.
S’il est légitime que le Quai d’Orsay soit chef de file à l’étranger, la présence des autres ministères compétents doit néanmoins être assurée. C’est utile pour l’opérateur lui-même : en particulier, les universités doivent demeurer convaincues de l’utilité de l’opérateur, sans l’identifier exclusivement au ministère des Affaires étrangères et européennes.
M. Gilles Vial ajoute que le statut d’EPIC instille un doute supplémentaire à cet égard.
Répondant au Président François Rochebloine qui lui demande une préconisation finale à l’adresse de la mission, Mme Sonia Dubourg-Lavroff répond que l’expertise de la DREIC doit être prise en compte par une place qui lui soit réservée au sein du nouvel opérateur.
La réunion est levée à 18 h.
Compte rendu de l’audition de M. Bertrand Gallet,
directeur général de Cités unies de France
(Mardi 6 avril 2010 − 33, rue Saint-Dominique – salle 42113)
La réunion est ouverte à 17 h 40.
• Présents
M. François Rochebloine, Président
Mme Martine Aurillac
• Excusés
Mme Geneviève Colot, Rapporteur, MM. Jean-Louis Bianco, Philippe Cochet, Jean-Pierre Dufau, Jean-Michel Ferrand, Jean-Claude Guibal, Jean-Pierre Kucheida, Robert Lecou, Didier Mathus, Jacques Remiller et André Schneider.
*
M. François Rochebloine, Président, accueille M. Gallet en présentant la mission et ses travaux.
M. Bertrand Gallet, directeur général de Cités unies de France, excuse le Président Charles Josselin.
Il rappelle la définition de la coopération décentralisée, posée en particulier par la loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République et souligne l’originalité des collectivités territoriales dans ce champ d’action, où elles diffèrent des États et des ONG.
Les fonds de concours mis en place par Cités unies de France pour la Croix rouge, le Secours populaire, le Secours catholique et le centre de crise du ministère des Affaires étrangères et européennes ont beaucoup reçu suite à la catastrophe intervenue en Haïti. Ils avaient reçu plus encore à l’occasion du tsunami de 2006.
Les collectivités territoriales sont donc d’importants donateurs en cas d’urgence. Elles s’engagent aussi sur la longue durée ; parfois même sur 40 ans ! Ces coopérations sont mises en place entre pairs.
Cités unies de France promeut des jumelages de coopération hors d’Europe. Ces jumelages trouvent très souvent leur source dans la ruralité, le syndicalisme agricole chrétien, etc. Les deux grands éléments déclencheurs en ont été la décolonisation – à l’origine de l’idée d’une « dette » du Nord en vers le Sud – et la grande sécheresse ayant frappé le Sahel.
C’est alors qu’a vu le jour cette invention pragmatique dénommée coopération de développement. Il n’a pas été simple de faire admettre que des budgets locaux soient dépensés à plusieurs milliers de kilomètres de distance…
Puis est venue la loi précitée de 1992, complétée par la proposition de loi de Michel Thiollière, définitivement adoptée en janvier 2007.
Il existe trois types de coopération décentralisée :
– l’humanitaire / caritatif, fonctionnant grâce aux dons, qui constitue une sorte de « premier réflexe » ;
– le développement de solidarité, articulé autour de projets, noués de maire à maire ou de président à président de tel conseil territorial ;
– et enfin la construction d’objectifs en commun, organisée par programmes, à un horizon de deux ou trois ans, portant par exemple sur le transport ou l’urbanisme, avec recherche en commun de bailleurs de fonds (y compris européens). C’est le travail en commun qui crée une culture commune.
Ces trois types sont, grosso modo, les trois étapes historiques du développement de la coopération décentralisée.
Avec, en toile de fond, le mouvement de décentralisation dans les pays du Sud, qui devrait être regardé comme aussi important que la mondialisation. Ce mouvement correspond à la situation suivante :
– des États « cassés » par les programmes de la Banque mondiale etc. ;
– des maires très présents aux yeux de la population, beaucoup moins éloignés que les ministres ;
– une classe politique locale jeune et volontariste, très bien formée dans les universités du monde entier.
La loi du 6 février 1992 a donné à l’État une mission de suivi statistique et créé un lieu de rencontre pluraliste, la Commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD). Cette commission se réunit une fois par an. Il existe aussi un répertoire des différents projets de coopération.
Les chiffres disponibles sont très vagues : 80 à 250 millions d’euros par an sont consacrés à des actions de coopération décentralisée. Le flou provient notamment de la réticence de certaines collectivités à afficher leurs actions ou le coût de celles-ci.
Une autre loi, dite « Oudin-Santini », après modification en décembre 2006 (6), permet aujourd’hui aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, aux syndicats mixtes chargés de l’eau et de l’assainissement et aux services publics de distribution d’électricité et gaz de prélever jusqu’à 1 % du budget de ces services pour mener des actions de coopération avec les collectivités étrangères dans le cadre de la loi Thiollière dans les domaines de l’eau, de l’assainissement et de la distribution d’électricité et de gaz. C’est une sorte de taxe Tobin à la française…
Il faut noter que pour la première fois cette année, les collectivités territoriales ont davantage donné – les dons ne sont pas des prêts – que l’Agence française de développement pour le financement de l’assainissement en Afrique : 18 millions d’euros contre 17 millions d’euros.
La « masse critique » des collectivités territoriales est devenue telle qu’elles ne peuvent plus être ignorées.
Le Président François Rochebloine demande quel est le degré de proximité de Cités unies de France avec le ministère des Affaires étrangères et européennes.
M. Bertrand Gallet répond qu’il est très grand, notamment car Antoine Joly, le délégué à l’action extérieure des collectivités territoriales au Quai d’Orsay, est un très bon interlocuteur pour les quelque vingt collaborateurs de Cités unies de France.
L’action internationale des collectivités territoriales est devenue incontournable. Le Front national a bien tenté quelques recours ; aucun n’a abouti. Il existe une clause de non-contradiction avec la politique étrangère française. Cela n’a jamais posé de difficulté, sauf une fois, en Casamance. Et parfois les choses ne sont pas simples entre Tel Aviv et Jérusalem…
Il existe à l’heure actuelle 12 000 liens de coopération dans 139 pays, c’est-à-dire 12 000 conventions entre collectivités de pays différents. L’État cofinance ces projets, même si les sommes en question sont modiques. L’important est bien le « label » du ministère des Affaires étrangères et européennes, qui vaut reconnaissance.
Le Président François Rochebloine demande quels sont les conseils généraux impliqués dans des actions de coopération décentralisée, et avec quels pays.
M. Bertrand Gallet répond que tous sont impliqués, tous ayant – comme les régions d’ailleurs – un département des affaires internationales en leur sein.
Les pays cibles sont en particulier ceux d’Afrique saharienne (Burkina, Mali, Niger, Sénégal), ceux du Proche et du Moyen-Orient, le Maroc (moins l’Algérie, qui ne pose pas de difficulté du point de vue des collectivités mais nettement plus du point de vue étatique), la Tunisie (même si la coopération y devient très compliquée), le Liban, les territoires palestiniens et Israël.
Une deuxième catégorie prend son essor : les pays émergents. Enfin, même les États-Unis sont concernés – la coopération n’y est bien sûr pas du même type.
Il faut par ailleurs noter que al coopération décentralisée est dans les collectivités un sujet assez consensuel. Les budgets correspondants sont généralement votés à l’unanimité.
Six thèmes de réflexion peuvent être dégagés pour tenter d’expliquer ce succès rencontré par l’action internationale des collectivités :
– c’est tout d’abord un facteur de consensus, comme on vient de le dire ;
– c’est aussi un facteur d’animation locale ;
– c’est également un facteur d’intégration des populations migrantes ;
– c’est un facteur de rayonnement de la collectivité. Lyon est à cet égard un modèle du genre ;
– c’est un facteur d’éducation à la citoyenneté, surtout du point de vue des municipalités de gauche ou écologistes.
Sur ce point, le Président François Rochebloine se montre dubitatif mais M. Bertrand Gallet y insiste.
– de façon plus marginale, la coopération décentralisée permet de s’inspirer des expériences participatives étrangères pour les adapter en France.
Le Président François Rochebloine demande si les relais nécessaires à la mise en œuvre de la coopération décentralisée sont bien identifiés dans les ambassades de France à l’étranger, et réciproquement dans les ambassades étrangères en France.
M. Bertrand Gallet répond que tel est précisément le métier de Cités unies de France, qui n’est toutefois pas un opérateur en tant que tel mais s’est formé historiquement à partir du rôle d’opérateur dans les grandes collectivités (avec des personnalités comme MM. Jacques Chaban-Delmas, Bernard Stasi, Charles Josselin notamment).
Aujourd’hui, en période budgétaire difficile, les ambassadeurs ne sont pas mécontents de pouvoir compter sur Cités unies comme une sorte de relais. Cependant, si le contact est très étroit, en aucun cas il ne’ saurait s’agir d’une relation de donneur d’ordre à exécutant.
Les coopérations les plus fructueuses sont celles qui reposent sur un véritable partenariat solidement enraciné, qui bénéficient d’une longue durée d’existence (parfois plusieurs dizaines d’années), et qui mettent en œuvre une coopération de projet. Angers-Bamako est l’un de ces exemples.
Le Président François Rochebloine demande si la participation de collectivités territoriales à la construction d’un lycée français à l’étranger est envisageable.
M. Bertrand Gallet répond qu’il s’agit d’une compétence régionale. Une promesse a été faite pour Haïti suite à la catastrophe qui s’y est déroulée ; elle a ensuite été revue à la baisse. Le Kosovo a été concerné par un cas de ce type. Il s’agit d’une demande très fréquente, mais la vision d’ensemble fait défaut sur ce point.
Au Président François Rochebloine demandant une préconisation de conclusion à l’adresse de la mission, M. Bertrand Gallet répond qu’il faut se garder de faire des collectivités territoriales les bailleurs du réseau culturel et de coopération de la France à l’étranger. Or des cas de ce type existent (au profit d’Alliances françaises notamment).
Des groupes de travail moins formels que la CNCD seraient utiles pour réfléchir avec le ministère des Affaires étrangères et européennes à une meilleure utilisation des compétences de Cités unies de France, qui est au carrefour de toutes les collectivités territoriales.
La réunion est levée à 18 h 40.
Compte rendu de l’audition de M. Jean-Philippe Mochon,
chef du service des affaires juridiques et internationales
au ministère de la Culture et de la communication
accompagné de Mme Brigitte Favarel,
sous-directrice des affaires européennes et internationales
(Mercredi 7 avril 2010 − 33, rue Saint-Dominique – salle 4223)
La réunion est ouverte à 16 h 35.
• Présents
M. François Rochebloine, Président
Mme Martine Aurillac
M. Robert Lecou
• Excusés
Mme Geneviève Colot, Rapporteur, MM. Jean-Louis Bianco, Philippe Cochet, Jean-Pierre Dufau, Jean-Michel Ferrand, Jean-Claude Guibal, Jean-Pierre Kucheida, Didier Mathus, Jacques Remiller et André Schneider.
*
M. François Rochebloine, Président, accueille les intervenants en présentant la mission et ses travaux.
M. Jean-Philippe Mochon, chef du service des affaires juridiques et internationales au ministère de la Culture et de la communication, présente son service en soulignant sa création récente.
L’action internationale du ministère de la Culture et de la communication est encore aujourd’hui tributaire d’une séparation remontant à l’époque d’André Malraux, entre la culture à l’étranger – domaine de compétence du Quai d’Orsay – et la culture en France – domaine de compétence du ministère de la Culture.
Ce partage a vieilli car à la fois la politique culturelle et les relations internationales ont évolué depuis lors. Par exemple, le Festival d’Avignon a changé d’échelle. Tous les acteurs culturels un tant soit peu importants ont de facto une dimension internationale, intégrée en leur sein, qu’il s’agisse de l’Opéra, des grands musées, etc.
Par ailleurs, les industries culturelles – livre, cinéma… – sont désormais soutenues en tant que telles à l’exportation. Enfin, l’accueil des cultures étrangères demeure une réalité, via des manifestations ponctuelles ou l’accueil de formations.
Interrogé par le Président François Rochebloine sur les saisons culturelles, M. Jean-Philippe Mochon répond que le coût en est partagé entre le ministère de la Culture et de la communication et le ministère des Affaires étrangères et européennes, avec l’apport du mécénat. L’opérateur en est CulturesFrance, et un commissaire responsable est désigné pour chaque saison.
Mme Brigitte Favarel, sous-directrice des affaires européennes et internationales, précise que les saisons de la France à l’étranger – au Brésil par exemple, récemment – sont de la responsabilité exclusive du ministère des Affaires étrangères et européennes. L’année du Mexique en France se prépare pour 2011. Ce concept remporte un vif succès.
M. Jean-Philippe Mochon poursuit en indiquant qu’une autre dimension de l’action culturelle extérieure est l’exportation d l’expertise technique et culturelle. Deux exemples parmi d’autres : le développement d’une politique de protection du patrimoine au Maroc et le développement d’une politique culturelle en Colombie.
Sur les crédits du ministère de la Culture et de la communication, environ 20 millions d’euros sont consacrés annuellement à l’action internationale. Ce montant est actuellement stabilisé. Cela représente peu, évidemment, au regard des 230 millions d’euros de l’audiovisuel extérieur.
Deux sujets d’actualité, enfin, méritent d’être mentionnés :
– le développement ces dernières années, méconnu et pourtant très réussi, de l’action internationale propre de grands opérateurs comme le Louvre (cf. Abou Dhabi) ou le Musée d’Orsay, en tant qu’établissements publics autonomes ;
– la question de la formation des agents du réseau culturel de la France à l’étranger, en plein renouveau.
Mme Brigitte Favarel précise qu’avant l’obtention de la « rallonge » de 20 millions d’euros à cette fin par le ministère des Affaires étrangères et européennes, on formait seulement une vingtaine d’agents recrutés locaux par an. La « rallonge » permet de porter ce nombre à une centaine.
Ils s’ajoutent aux 150 agents étrangers venant de trente à quarante pays, formés depuis plusieurs années par le ministère de la Culture et de la communication pendant trois semaines. Cette initiative vise aussi à créer un réseau, initialement circonscrit aux pays d’Europe centrale et orientale.
Le Président François Rochebloine souhaite obtenir des précisions sur la formation qui débute aujourd’hui même à La Courneuve.
Mme Brigitte Favarel répond qu’elle s’adresse aux agents du réseau, qui ne sont pas des recrutés locaux mais des diplomates, des enseignants etc. Cette formation n’est donc pas concurrente de celle décrite à l’instant.
Mme Martine Aurillac et M. Robert Lecou expriment leur soutien à la formation de recrutés locaux, qui semble encore plus intéressante pour le bon fonctionnement du réseau que la mise à niveau des fonctionnaires.
M. Jean-Philippe Mochon aborde la question de l’agence culturelle, question d’autant plus importante que dans de nombreux pays, l’image de la France est d’abord celle de sa culture.
À l’heure actuelle, le ministère de la Culture et de la communication verse à CulturesFrance 2 millions d’euros par an, soit 8 % de ses ressources. Cette somme est essentiellement consacrée au financement des saisons culturelles.
Dans la réforme en cours, il convient de poursuivre ce qui fonctionne bien aujourd’hui – les saisons par exemple. Il faut par ailleurs impliquer davantage le ministère de la Culture et de la communication dans la nouvelle organisation et le ministère cherche le meilleur moyen pour ce faire.
La question de la cotutelle sur le futur EPIC ayant, hélas, été tranchée, ce débat ne sera pas rouvert ici. Au moins le ministère de la Culture et de la communication siège-t-il au conseil d’administration de l’Institut français, c’est évident.
Le projet de loi évoque par ailleurs des « orientations définies conjointement » par les deux ministères à propos de l’Institut français.
Le Président François Rochebloine souligne que la mission a senti chez M. Bernard Kouchner la volonté de travailler en commun avec M. Frédéric Mitterrand. Qu’en est-il des administrations et des ambassades ?
M. Jean-Philippe Mochon répond que cette volonté commune existe tant chez les ministres que dans leurs administrations et dans les ambassades. La prétendue division entre ministère de la Culture et de la communication et ministère des Affaires étrangères et européennes n’a donc pas lieu d’être.
Mme Brigitte Favarel précise qu’un séminaire commun a été organisé récemment en Corée du Sud ; les conseillers culturels des ambassades font régulièrement appel au ministère de la Culture et de la communication car ils ont besoin de son expertise.
M. Jean-Philippe Mochon se réjouit que la future agence soit pilotée par les deux ministères même si la tutelle unique est celle du Quai d’Orsay. Il est important de faire travailler tous les acteurs en commun, y compris, comme le dit la mission, les Alliances françaises.
Pour autant, ce serait une erreur de créer un établissement unique dont le champ d’intervention serait trop vaste. Le ministère de la Culture et de la communication plaide pour que l’agence culturelle se concentre sur la diffusion non commerciale de la culture et laisse par conséquent agir, dans le champ commercial, les opérateurs comme le Bureau international de l’édition française, le Bureau export musique ou Unifrance.
Le Président François Rochebloine et M. Robert Lecou demandent si l’image de la culture française dans le monde progresse ou décline, notamment à l’égard des grands pays émergents.
M. Jean-Philippe Mochon répond que la France n’est plus seule dans ce domaine mais qu’elle reste une référence.
Rappelant son expérience professionnelle d’agent en poste en Inde pendant trois ans, il juge très intéressante la manière dont les Indiens investissent dans le soft power afin de susciter la sympathie du reste du monde, avec l’exportation des films de « Bollywood » par exemple. Or la France fait de même depuis si longtemps que nous ne nous en rendons plus compte.
Le Président François Rochebloine demande aux intervenants leur avis personnel sur la question des liens entre la « grande agence » et le réseau culturel de la France à l’étranger.
M. Jean-Philippe Mochon répond que les ambassadeurs tiennent manifestement à garder la possibilité d’actionner ce « levier » culturel et de coopération.
Par ailleurs, il convient d’analyser précisément les coûts et les conséquences d’une telle réforme, en termes de salaire, de statut, etc.
Par exemple, lors de la réforme des services économiques et de la scission entre les missions économiques et les filiales d’Ubifrance compétentes pour le commerce extérieur, certains agents des missions économiques ont soudain dû faire face à la fiscalisation qui était celle des résidents alors qu’ils jouissaient jusque-là d’un statut d’expatrié… Une telle réforme doit donc être anticipée dans ses moindres détails.
Mme Brigitte Favarel ajoute que l’on entend régulièrement à l’égard de l’agence parisienne – CulturesFrance aujourd’hui – la plainte selon laquelle Paris envoie ses programmes sans concertation et ne répond pas aux demandes des postes. De ce point de vue, un rattachement du réseau à l’agence permettrait sans doute de mieux articuler les deux niveaux.
Dans le même temps, il est évident que ce levier est important pour les ambassadeurs. Il faudra donc mettre à profit le délai annoncé de trois ans pour expérimenter le rattachement du réseau à l’agence.
Le rapport d’étape de la mission évoque une « saga », un feuilleton à cet égard ; il est temps de l’achever, de sortir de l’incertitude.
On répète volontiers que CulturesFrance bénéficie de 20 millions d’euros de crédits de la part du ministère des Affaires étrangères et européennes et de 2 millions d’euros de la part du ministère de la Culture et de la communication.
Mais qui soutient les artistes français sur la scène internationale, en tournée à l’étranger, sinon le ministère de la Culture ? C’est par exemple le cas de la Comédie-Française en tournée en Russie ou de l’exposition Picasso qui voyage.
Nous travaillons en commun avec le Quai d’Orsay et poursuivons même certaines priorités communes, comme dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée ou s’agissant d’un certain tropisme asiatique. Il est important que personne ne s’isole ; il faut éviter que l’agence culturelle soit l’opérateur du seul ministère des Affaires étrangères et européennes.
À M. Robert Lecou demandant si des inquiétudes doivent être nourries sur ce sujet, Mme Brigitte Favarel répond que tel n’est pas le cas tant que les deux ministres actuels seront à leur poste.
Le Président François Rochebloine demande une dernière préconisation à l’adresse de la mission.
M. Jean-Philippe Mochon répond que la dimension internationale n’est plus « la cerise sur le gâteau » pour le ministère de la Culture et de la communication puisque tous les acteurs relevant de ce ministère y participent, y compris dans le domaine du spectacle vivant. Le rayonnement culturel international fait partie des attributions du ministre de la Culture, il ne faut pas l’oublier.
La réunion est levée à 17 h 30.
Compte rendu de l’audition de M. Antoine Joly,
Délégué pour l’action extérieure des collectivités territoriales
au ministère des Affaires étrangères et européennes
(Mercredi 7 avril 2010 − 33, rue Saint-Dominique – salle 4223)
La réunion est ouverte à 17 h 35.
• Présents
M. François Rochebloine, Président
Mme Martine Aurillac
• Excusés
Mme Geneviève Colot, Rapporteur, MM. Jean-Louis Bianco, Philippe Cochet, Jean-Pierre Dufau, Jean-Michel Ferrand, Jean-Claude Guibal, Jean-Pierre Kucheida, Robert Lecou, Didier Mathus, Jacques Remiller et André Schneider.
*
M. François Rochebloine, Président, accueille M. Joly et présente la mission et ses travaux.
M. Antoine Joly, délégué pour l’action extérieure des collectivités territoriales au ministère des Affaires étrangères et européennes, indique que la première mission de la délégation consiste à informer sur ce que font les collectivités territoriales en matière internationale et à contrôler cette action.
L’information est concrétisée par un atlas de la coopération décentralisée (il existait auparavant une base de données). Cette mission est confiée par la loi à la Commission nationale de la coopération décentralisée, dont la Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales (DAECT) assure le secrétariat.
Le contrôle s’exerce auprès des préfets, responsables du contrôle de légalité des actes des collectivités. Le consensus existant dans cette matière explique que peu de problèmes se posent, hormis dans le cas de relations transfrontalières qui peuvent soulever des questions de droit.
La deuxième mission de la DAECT est une mission de dialogue. La Commission nationale se réunit une fois par an sous la présidence de M. Alain Joyandet, secrétaire d’État chargé de la coopération. Un Premier ministre l’a présidée une fois, M. Jean-Pierre Raffarin. Tous les ministères y sont représentés, y compris le ministère de la Culture et de la communication.
Par ailleurs, M. Joly réunit tous les deux mois les associations de collectivités territoriales − Association des maires de France, Association des départements de France, Association des régions de France −, ainsi que Cités unies de France et l’Association française des communes et régions d’Europe.
C’est la délégation qui donne les impulsions et réunit les groupes de travail sur divers thèmes. Elle est informée des actions menées par les collectivités, elle les conseille, les oriente le cas échéant vers l’ambassade. La DAECT joue ainsi le rôle de porte d’entrée du ministère des Affaires étrangères et européennes pour les collectivités territoriales.
La DAECT a à cœur de faire en sorte que la gestion de la coopération décentralisée soit apolitique. À titre d’exemple, lorsque la délégation demande à Cités unies de France, moyennant une subvention qui représente la moitié du budget de cette association, de constituer des « groupes pays », elle demande à ce que soient incluses dans les groupes les collectivités territoriales qui ne sont pas membres de Cités unies.
Les cinq principaux acteurs de la coopération décentralisée en France sont les régions Rhône-Alpes, Provence Alpes Côte d’Azur et l’Île-de-France, ainsi que la ville de Paris et le conseil général des Hauts-de-Seine.
Mme Martine Aurillac demande quels sont les destinataires des actions menées par la ville de Paris.
M. Antoine Joly répond que l’essentiel passe par l’Association internationale des maires francophones, surtout en direction de l’Afrique et particulièrement de l’Égypte. Cette association dépense à ce titre 3 millions d’euros par an, dont 1,9 million d’euros versés par la ville de Paris.
Paris a également noué des accords avec Saint-Pétersbourg, Rio, Le Caire, Phnom Penh, etc. mais un seul jumelage existe, avec Rome.
Troisième mission de la DAECT : le soutien financier. Dans le cadre de la RGPP, rares sont les services du MAEE à avoir pu préserver leurs crédits ; c’est le cas de la DAECT.
Ce soutien fonctionne selon le mode de l’appel à projets. Le parti pris dans ce cadre consiste à favoriser systématiquement l’expertise technique : projets liés à l’eau, à l’assainissement et aux déchets, ainsi qu’à l’état civil.
Ainsi, la DAECT n’aidera pas directement à la construction d’une école mais fournira un appui institutionnel : le financement d’une politique scolaire, par exemple. De même, pas de soutien à la construction de latrines au Niger (projet de la mairie de Conflans Sainte-Honorine), mais une aide à l apolitique de traitement des déchets et des eaux usées.
Enfin, pour un exemple tiré du domaine culturel : non au don d’un livre mais oui à la formation d’un bibliothécaire ou à la mise en place d’une politique de diffusion de la lecture, etc.
Mme Martine Aurillac demande si ce principe n’est pas trop contraignant lorsque la demande est très concrète – construction d’un puits ou de latrines ?
M. Antoine Joly répond que des cas de conscience se posent parfois. Mais les moyens des collectivités sont limités. Il existe de multiples donateurs possibles pour un puits ; en revanche, peu d’organismes ont une expertise aussi développée que les collectivités territoriales ne matière de gestion de l’eau.
N’est-ce pas trop ambitieux ? demande Mme Martine Aurillac.
M. Antoine Joly répond que cette démarche produit des résultats concrets, et à moindre coût. Cependant l’aide publique au développement financée par les collectivités territoriales demeure modeste : de l’ordre de 100 millions d’euros par an, soit 1 % de l’APD française. Ce sont moins des crédits que de l’expertise et des moyens humains qui sont ainsi mobilisés par les collectivités territoriales.
Le Président François Rochebloine demande, en matière de gestion de l’eau et d’assainissement, quel est l’apport de compagnies comme Veolia ou la Saur.
M. Antoine Joly répond que le principe de base de la coopération décentralisée consiste à mettre en relation deux collectivités et elles seules. Il existe même des contentieux sur ce point. Attention : les collectivités territoriales n’ont pas à être directement maîtres d’ouvrage, mais au moins doivent-elles être à l’origine de la coopération. Et le financement doit venir de façon prépondérante des collectivités.
Mais des levées de fonds externes sont possibles. Ainsi, la DAECT, en partenariat avec l’ADF, l’ARF et l’Association des villes d’art et d’histoire, va faire paraître un guide sur le patrimoine. La DAECT finance aussi des Rencontres de la coopération décentralisée.
Par ailleurs, il est fait appel aux fondations d’entreprise, aux fonds européens, voire à certaines collectivités de pays en développement partenaires, comme Saint-Louis du Sénégal.
Le total de ces actions de la DAECT représente 30 millions d’euros par an.
Au Président François Rochebloine demandant quels autres ministères que le MAEE sont concernés par la coopération décentralisée, M. Antoine Joly répond en citant le ministère de la Culture, Bercy, l’Éducation nationale, l’Enseignement supérieur, l’Intérieur, l’Agriculture, le Commerce extérieur…
Par ailleurs, la DAECT bénéficie de personnels mis à disposition, par le ministère de l’Agriculture par exemple.
Alors que le Président François Rochebloine s’étonne que la Santé ne soit pas présente, M. Antoine Joly rappelle que ce sujet n’est pas au cœur des compétences des collectivités.
Cependant, c’est dans ce domaine qu’une action très intéressante a pu être menée au Niger, où Cités unies de France est parvenue à mettre en place une coopération entre collectivités territoriales nigériennes pour la formation d’infirmières.
Au demeurant, l’Afrique subsaharienne prédomine dans les projets mis en œuvre : 170 sur 250. Les Pays les plus aidés sont Madagascar et Haïti. La coopération est évidemment très marquée par la présence de fortes communautés françaises dans les collectivités qui lancent les projets : Mali, Haïti, Comores etc.
La francophonie est aussi un thème porteur pour la coopération décentralisée ; les projets de développement économique également (avec la Chine ou le Brésil par exemple). Presque toutes les collectivités françaises ont des liens avec la Chine ; témoin ce déplacement d’une délégation d’une centaine de personnes depuis la région Pays de la Loire jusqu’au Guangdong.
Le Président François Rochebloine demande si les relations avec les ambassades sont continues.
M. Antoine Joly le confirme et précise que dans les pays les plus « ciblés » par la coopération décentralisée, la DAECT dispose d’un correspondant à l’ambassade. Les ambassadeurs eux-mêmes sont parfois très impliqués. À Madagascar, le Président de la République reçoit les présidents de régions françaises !
Le Président François Rochebloine demande dans quelle mesure des collectivités territoriales françaises seraient prêtes à aider à la construction d’un lycée ou à la conduite d’une action culturelle.
M. Antoine Joly répond qu’elles n’aideront pas à la construction d’un lycée français car leur action s’inscrit dans le cadre de l’aide au développement. Elles aideront donc plutôt, typiquement, un lycée africain local, sénégalais ou malien.
Ou alors leur aide pourra concerner un lycée qui servirait d’outil de développement de la collectivité territoriale où il est implanté. Une aide très indirecte, donc.
Des lycées professionnels pourraient-ils entrer dans ce cadre ? demande Le Président François Rochebloine.
M. Antoine Joly acquiesce. Il poursuit à propos des actions culturelles pour indiquer que les collectivités françaises s’investissent déjà dans ce genre d’actions de coopération. C’est par exemple le cas de la région Rhône-Alpes qui aide l’Institut culturel implanté au Sénégal car cet institut est très présent là où cette région intervient dans le cadre de ses programmes de coopération.
À la demande du Président François Rochebloine, M. Antoine Joly fournit un tableau de données chiffrées sur les montants d’aide publique au développement mises en œuvre par les collectivités territoriales françaises.
Le Président François Rochebloine interroge M. Joly sur son sentiment personnel à l’égard de l’agence culturelle créée par le projet de loi relatif à l’action extérieure de l’État.
M. Antoine Joly répond que les collectivités territoriales seront peu ou pas concernées par la réforme. Il est néanmoins très positif que ces collectivités soient, comme c’est actuellement prévu, associées à l’action de l’agence via son conseil d’administration et son comité stratégique.
Par ailleurs, que les différentes entités du réseau présentes dans un même pays soient regroupées est de bonne logique.
Le débat portant sur la nature et la portée de « l’autorité » des ambassadeurs dans leur pays d’établissement est un faux débat. La crispation sur ce sujet n’a pas lieu d’être.
Au Président François Rochebloine demandant quelle préconisation finale il souhaite laisser à la mission, M. Antoine Joly répond qu’il serait de mauvaise politique que de s’adresser aux collectivités territoriales pour leur demander de pallier le manque de financement de l’État.
Il faut bien plutôt jouer sur la notion de partenariat avec les collectivités… ce qui en aval pourra permettre des levées de fonds complémentaires. Mais en aucun cas un rapport ne devrait proposer de but en blanc aux collectivités territoriales de « faire un chèque »…
La réunion est levée à 18 h 35.
Compte rendu de l’audition de M. Pierre Sellal,
Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et européennes
(Lundi 26 avril 2010 − 33, rue Saint-Dominique – salle 4211)
La réunion est ouverte à 14 h 30.
• Présents
M. François Rochebloine, Président
Mme Martine Aurillac
MM. Jean-Louis Bianco et Robert Lecou
• Excusés
Mme Geneviève Colot, Rapporteur, MM. Philippe Cochet, Jean-Pierre Dufau, Jean-Michel Ferrand, Jean-Claude Guibal, Jean-Pierre Kucheida, Didier Mathus, Jacques Remiller et André Schneider.
*
M. François Rochebloine, Président, accueille M. Pierre Sellal en le remerciant de sa venue devant les membres de la mission d’information. Après avoir présenté la mission et ses travaux, il interroge le Secrétaire général sur la question des moyens consacrés à l’action culturelle extérieure et sur la stratégie qui sous-tend notre « diplomatie d’influence ».
M. Pierre Sellal, Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et européennes, rappelle que la question des moyens du Quai d’Orsay a fait l’objet, directement ou indirectement, de nombreux rapports, dont le rapport d’étape de la mission d’information.
Il est exact que le ministère des Affaires étrangères et européennes a vu ses moyens diminuer depuis bien des années. Il a ainsi perdu 15 % de ses effectifs depuis 1995, surtout dans le domaine de la coopération et de l’action culturelle.
Répondant à une demande de précision du Président François Rochebloine, M. Pierre Sellal indique que le Quai d’Orsay regroupe seulement 0,7 % des effectifs civils de l’État et même 0,4 % de ses effectifs civils titulaires. Dans ces conditions, il est difficile de réduire encore le nombre d’équivalents temps plein ! Non seulement du fait de la moindre masse globale susceptible d’être réduite, mais aussi du fait de l’organisation du ministère des Affaires étrangères et européennes en un réseau mondial.
Quant à dire, comme le fait la mission, que le point de départ de la réflexion doit être une réflexion stratégique et non la Révision générale des politiques publiques ou un présupposé de réduction des effectifs, rien n’est plus vrai.
Cette réflexion stratégique a été bien conduite dans le cadre du Livre blanc de 2008 sur la politique étrangère et européenne de la France, notamment avec l’accent légitimement mis sur l’action culturelle et éducative.
Il n’y a plus aujourd’hui de rente d’influence pour la France ; cette influence se conquiert désormais. Or l’État peut s’organiser de façon plus efficace, par exemple en séparant la fonction de stratège de celle d’opérateur.
C’est ainsi que l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) est efficace, comme la mission le souligne dans son rapport. Il en va de même pour l’Agence française de développement. Ce modèle est à dupliquer en matière d’attractivité, d’expertise, de mobilité…
En résumé, le premier élément de contexte est celui de la baisse des moyens du ministère et celui de la RGPP. Deuxièmement, le choix a été fait de ne pas remettre en cause le réseau universel du Quai d’Orsay, ce qui implique des frais de structure. En troisième lieu, des « lignes dynamiques » accaparent une bonne part des moyens disponibles, à savoir les contributions internationales obligatoires. Conclusion : il ne faut pas diminuer les crédits d’intervention !
S’agissant de la coordination entre le ministère des Affaires étrangères et européennes et le ministère de la Culture et de la communication, il est faux de prétendre qu’un partage − un « Yalta » − entre ces deux ministères soit intervenu dans les années 1960 à propos de l’action culturelle.
Le lien est très fort entre action culturelle extérieure et diplomatie. Dans le domaine commercial, à propos d’Ubifrance, Bercy a fait le choix de distinguer entre le régalien et le commercial. Le cas de l’action culturelle est différent : dans le monde, l’image de la France est largement celle de sa culture !
C’est dans ce contexte que s’est déroulée la mission de préfiguration de la réforme de la diplomatie d’influence de la France en mai-juin 2009, présidée par le Secrétaire général.
Six points sont à relever :
− l’attente est immense dans ce domaine ;
− l’appréciation portée sur le réseau culturel est, à rebours des idées préconçues, très positive ;
− l’inquiétude à l’égard de l’évolution des moyens disponibles est vive ;
− le sentiment d’une moindre efficacité et d’une moindre professionnalisation est réel. Ainsi, l’action menée localement manque de continuité car elle tient trop à l’engagement de telle ou telle personne en poste. De même il se révèle difficile d’offrir des carrières aux personnels en poste dans le réseau culturel. Enfin, la conception de la culture mise en mouvement dans le réseau doit être large, c’est-à-dire par exemple englober le débat d’idées ;
− l’attente est très grande à l’égard des opérateurs professionnels que sont Unifrance ou le Bureau export musique − avec lequel M. Sellal a signé, en tant que directeur du cabinet de M. Hubert Védrine, la première convention le liant au Quai d’Orsay ;
− le besoin d’un rôle actif des ambassadeurs est manifeste.
La mission de préfiguration a conclu que l’action culturelle devait faire partie du champ d’action de l’ambassadeur et que, dans ce cadre, toute levée de fonds recherchée localement nécessitait l’implication personnelle de l’ambassadeur.
Le Président François Rochebloine et Mme Martine Aurillac font remarquer que la question du rôle de l’ambassadeur est apparue comme étant le « nœud du problème ». Que signifie, dès lors, le report à trois ans de l’éventuel rattachement du réseau culturel à l’EPIC appelé à prendre la succession de CulturesFrance ? Le décalage ainsi observé avec les annonces ayant précédé la mission de préfiguration ne justifie-t-il pas la critique sur le mode de la montagne accouchant d’une souris ? Quelle est par ailleurs la logique de fond d’une réforme consistant à poser les cadres avant de se préoccuper du contenu ?
M. Pierre Sellal répond qu’il serait en effet illusoire de prétendre régler la question par un simple changement de statut de CulturesFrance.
Cinq éléments doivent être mis en perspective :
− il y a un réel besoin de stratégie comme point de départ ;
− il y a également besoin d’un ministère des Affaires étrangères et européennes fort et bien organisé dans le domaine de la diplomatie d’influence ; c’est tout le sens de la mise en place de la direction générale de la Mondialisation ;
− il y a besoin, concomitamment, d’un opérateur fort lui aussi ;
− il y a un profond besoin de pérenniser les moyens dits exceptionnels de deux fois 20 millions d’euros obtenus en 2009 et en 2010 ;
− il y a besoin de poursuivre la réforme consistant à fusionner les services de coopération et d’action culturelle et les établissements à autonomie financière.
La question du rattachement du réseau culturel à l’agence n’est que l’un des aspects du problème. Il présente des avantages : sur le plan de la préservation des moyens d’intervention et pour la gestion des carrières des personnels du réseau.
Le rattachement présente aussi des inconvénients : en particulier le surcroît de réformes pour l’opérateur. Il n’est pas envisageable de passer au 1er janvier 2011 d’une association, CulturesFrance, employant 100 personnes à Paris, à une EPIC disposant d’un réseau mondial de 4 à 5 000 personnels !
Il convient de prendre le temps de la réforme, d’apporter une réponse aux questions posées pays par pays − ne serait-ce que partout où existe un doute quant à la possibilité de continuer à exonérer fiscalement les personnels du réseau s’ils devaient passer de l’ambassade à l’agence.
D’ici trois ans, nous saurons si le ministère des Affaires étrangères et européennes a su définir correctement son rôle de stratège, si la transformation de CulturesFrance est réussie, si la cartographie du réseau convient, si les liens avec les Alliances françaises sont pertinents ; enfin, nous aurons expérimenté, dans quelques cas précis, le rattachement du réseau à l’agence.
Le Président François Rochebloine interroge le Secrétaire général sur l’opportunité de disposer d’une seule « marque » : celles des Alliances françaises.
M. Pierre Sellal répond qu’une meilleure complémentarité entre les centres culturels et les alliances est certainement nécessaire. Il existe aujourd’hui moins d’une demi-douzaine de doublons entre les deux réseaux ; cette source d’inefficacité est à résorber.
Mais dans le même temps, la Fondation Alliance française est très jalouse de sa « marque ». Il doit exister un moyen de concevoir un logo qui soit quasi identique pour les alliances et les établissements du réseau culturel.
Interrogé par le Président François Rochebloine sur le rôle de l’audiovisuel extérieur dans notre diplomatie d’influence, M. Pierre Sellal le qualifie d’indispensable. À la fois pour la diffusion de nos valeurs, de nos idées, de notre langue.
Et au-delà du strict champ de l’action culturelle, cet outil est essentiel pour toutes les actions françaises dans le domaine de l’économie numérique. C’est pourquoi les attachés audiovisuels présents dans certaines ambassades sont très précieux ; tous les professionnels des médias le reconnaissent et le disent.
Le Président François Rochebloine, MM. Jean-Louis Bianco et Robert Lecou font part de leur perplexité à l’égard de l’existence conjointe de TV5 Monde et de France 24 et des performances toutes relatives de l’audiovisuel extérieur.
M. Pierre Sellal répond que TV5 Monde fait partie de l’offre de programmes standard à l’échelle de la planète, ce qui en fait un outil très important mais qui ne répond pas vraiment à l’attente du public qui penche plutôt pour les formats du type de celui qu’a adopté France 24.
M. Robert Lecou souligne que dans la mise en place de la réforme selon la séquence stratégie / structure juridique / réseau organisé / moyens de mise en œuvre, c’est évidemment le dernier maillon qui va manquer. Comment les collectivités territoriales pourraient-elles être associées à cet égard ?
M. Jean-Louis Bianco précise que certaines d’entre elles interviennent déjà dans ce domaine.
M. Pierre Sellal répond qu’en effet la diminution des moyens alloués à notre diplomatie est partiellement compensée par des mouvements inverses, notamment de la part des collectivités territoriales.
*
Abordant dans un second temps la question du rayonnement de la France par son enseignement, le Président François Rochebloine interroge le Secrétaire général sur :
− la diversité des statuts que connaissent les différents établissements du réseau, à la fois pour les personnels qui y travaillent et pour les lycées eux-mêmes ;
− l’articulation problématique entre l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur ;
− la prise en charge des écolages pour les enfants français scolarisés dans le réseau à l’étranger, réforme partie d’un bon sentiment mais comportant d’innombrables effets pervers, qui rendent ses défenseurs quasi inexistants.
M. Pierre Sellal répond que l’extraordinaire outil du réseau d’enseignement français à l’étranger peut à juste titre être qualifié de « trésor ».
Deuxièmement, ce réseau est soumis à une demande croissante, en raison du changement observé dans la démographie de nos compatriotes expatriés ainsi que dans celle des pays étrangers.
En troisième lieu, la diversité des statuts des établissements est un atout et non une faiblesse. Elle est le produit de l’histoire, de l’origine des lycées, de leur sociologie variable, des différences de taille entre les établissements… Faut-il envisager une palette de statuts plus riche encore, comme l’esquisse le rapport d’étape de la mission ? Oui, sans doute : cela permettrait d’augmenter la capacité d’accueil du réseau.
Quatrièmement, le développement du réseau n’est pas envisageable sans que soit maintenue la qualité de l’enseignement. Cela suppose des moyens suffisants et l’emploi de personnels expatriés en nombre certes limité mais pas en deçà de l’étiage nécessaire.
En cinquième lieu, la coexistence des différents statuts d’enseignants dans un même réseau est indiscutablement source de tensions.
Enfin, la prise en charge des écolages pour les enfants français scolarisés dans le réseau français d’enseignement à l’étranger répond à un engagement du Président de la République. Cette réforme se heurte toutefois à un problème de financement. En outre on constate qu’elle produit des effets non désirés. Le rapport d’étape de la mission l’a notamment souligné.
Or le réseau d’enseignement français à l’étranger doit être soutenu, y compris pour faire face à ses dépenses immobilières. Il doit, en parallèle, conserver sa double mission de service rendu aux Français expatriés et d’outil de rayonnement grâce à l’accueil d’élèves étrangers.
Si l’on ajoute que la « prise en charge » a des répercussions, attestées, sur les bourses scolaires, dont le coût s’accroît, alors il est urgent de définir un nouveau modèle soutenable de financement. À cet égard, il faut souligner qu’un plafonnement de la prise en charge via le plafonnement du montant des frais de scolarité eux-mêmes est très différent d’un plafonnement en fonction du revenu des familles du point de vue du respect de l’engagement présidentiel).
Répondant au Président François Rochebloine qui lui demande une ultime préconisation à l’adresse de la mission, M. Pierre Sellal souligne le besoin de moyens en volume suffisant.
La réunion est levée à 15 h 30.
ANNEXE 3 : PROGRAMMES DES DÉPLACEMENTS DE LA MISSION
1) Londres, le 1er juillet 2009
Mission parlementaire - Commission des Affaires étrangères - mercredi 1er juillet 2009 |
||||||||||
Heure |
|
Coop. Éducative |
Lycée |
Gestion |
CDL |
Mediathèque |
Cinéma |
Marketing |
Echanges artistiques |
Musique |
08h59 |
St Pancras - Accueil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09h30 |
|
M. Monsauret, cons. Cult. adjoint + |
|
|
|
|
|
|
|
|
10h15 |
|
|
Bernard Vasseur proviseur |
|
|
|
|
|
|
|
11h00 |
|
|
|
|
J-Philippe Bottin, dir. du centre de langue |
|
|
|
|
|
12h00 |
Résidence – |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13h30 |
Déjeuner - IFRU |
|
|
Mme Auer + P. Hajaali, sec. |
|
|
|
|
|
|
15h00 |
|
|
|
|
|
|
Guillaume Silvy-Leligois, |
|
|
|
15h30 |
|
|
|
|
|
Anne-Elizabeth Buxtorf, dir. de la médiathèque |
|
|
|
|
16h00 |
|
|
|
|
|
|
|
Natacha Antolini, responsable |
|
|
16h30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Patrice Hourbette, chef du bureau des musiques actuelles | |
17h00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Caroline Ferreira, attachée culturelle |
|
17h30 |
Départ du SCAC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18h30 |
St Pancras - Départ Eurostar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 a) Chili, du 13 au 16 septembre 2009
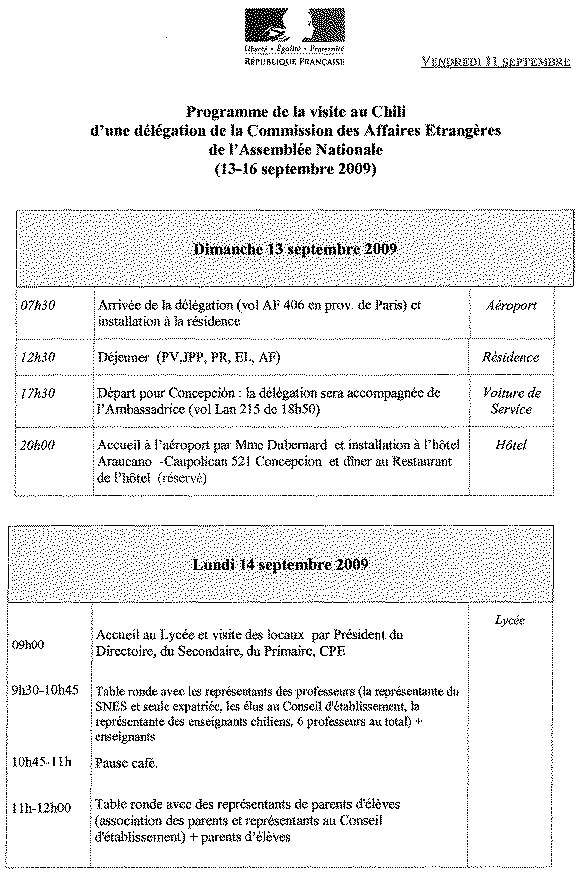

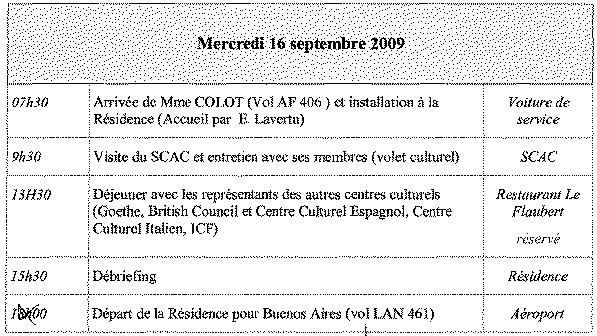
2 b) Buenos Aires, du 16 au 19 septembre 2009
MISSION D’INFORMATION DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
(Buenos Aires, 16-19 SEPTEMBRE 2009)
_________
PROGRAMME
Mercredi 16 septembre
- 21h 05 : arrivée à Buenos Aires-Ezeiza (vol LA 461, en provenance de Santiago). Accueil par le Conseiller de coopération et d’action culturelle, M Jack Batho
- Installation à l’hôtel
Jeudi 17 septembre
- 9h 30 – 11h : réunion de cadrage au Service de coopération et d’action culturelle, avec le Conseiller et les attachés ;
- 11h – 13h : visite de l’Alliance française ;
- 13h – 15h : déjeuner offert par le Président de l’Alliance française de Buenos Aires, M Maximo Bomchil ;
- 15h 30 – 17h : visite du Lycée franco-argentin Jean Mermoz - rencontre avec le personnel d’encadrement.
- 17h – 18h : rencontre avec les enseignants.
- Fin d’après-midi : visite de deux importantes expositions « françaises » à Buenos Aires, au Musée national des Arts Décoratifs : « Houdon – Trésors du Louvre » et « Le Corbusier ».
- Soirée libre
Vendredi 18 septembre
- 9h : départ pour le Collège franco-argentin de Martinez (proche banlieue de Buenos Aires) ;
- 9h 30 – 10h 15 : visite du Collège franco-argentin de Martinez et rencontre avec le personnel d’encadrement.
- 10h 15 – 11h : rencontre avec une partie des personnels enseignants et des parents d’élèves.
- 11h - 12h : rencontre avec le Président (M Jacques Gilotaux) et les membres du conseil d’administration du Collège franco-argentin de Martinez.
- Déjeuner offert par le Consul général, M Gilles Montagnier, en présence des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ;
- 15h : visite d’un des projets de coopération culturelle réalisés au cours des derniers mois, le Polo Circo, dans le quartier populaire de « Parque Patricio ». Rencontre avec la responsable du projet, Gabriela Ricardes, et avec le Ministre de la culture de la ville autonome de Buenos aires, M Hernan Lombardi.
- 17h - 18h : réunion de travail avec l’Ambassadeur.
- Soirée : libre
Samedi 19 septembre
- matinée : programme libre
- à confirmer, si la mission de l’Assemblée nationale le souhaite : déjeuner offert par l’Ambassadeur, en l’honneur des deux délégations parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat.
- 14h 45 : départ pour l’aéroport
- 17h 05 : départ pour Paris (vol AF 417)
3) Berlin, les 7 et 8 octobre 2009
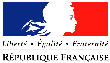
|
AMBASSADE DE FRANCE EN REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE _______ SERVICE CULTUREL |
Pariser Platz 5 D-10117 Berlin Tél. : + 49 30 590 03 92 00 Fax : + 49 30 590 03 92 30
|
9h00-10h30 |
Entretien avec Charles MALINAS et Sylvain THOLLON, Thème : mise en place de l’EAF unique (Bureau du Conseiller culturel, 4e étage, 401) |
10h30-12h00 |
Entretien avec Charles MALINAS, Christian RABAULT et Robert VALENTIN, Thème : le réseau AEFE (Bureau du Conseiller culturel, 4e étage, 401) |
12h00-14h00 |
Déjeuner chez TUCHER Participants : - 4 membres de la délégation - C. Malinas, Conseiller culturel - C. Blosen, Bureau I du Plénipotentiaire – Auswärtiges Amt - R. Seider, Bureau II du Plénipotentiaire - Senatskanzlei |
13h40 |
Départ de la Pariser Platz (devant le Tucher) pour le Lycée Français de Berlin puis pour le Collège Voltaire |
14h00 -15h15 |
Visite du Lycée Français de Berlin, rencontre avec le chef d’établissement |
15h15 |
Départ du Lycée Français de Berlin pour le Collège Voltaire |
15h45- 17h00 |
Visite du Collège Voltaire, rencontre avec le chef d’établissement |
17h00 |
Départ du Collège Voltaire pour l’aéroport de Tegel |
17h15 |
Rendez-vous avec M. Bernard de Montferrand, Ambassadeur de France en Allemagne (Aéroport de Tegel. Salon Air France) |
18h35 |
Départ du Vol AF 2335 à destination de Paris |
4 a) Abou Dhabi et Dubaï, du 7 au 10 février 2010
19h35 |
Arrivée par le vol AF8401 en provenance d’Amsterdam à l’aéroport d’Abou Dhabi Accueil par M. l’Ambassadeur, M. Didier Gazagnadou, Conseiller culturel et M. Etienne Cazin, son adjoint. |
08h30 – 09h45 |
Petit-déjeuner de travail à la Résidence de France M. l’Ambassadeur, M. Didier Gazagnadou, Conseiller culturel et M. Etienne Cazin, son adjoint. |
10h00 – 11h15 |
Entretiens au Lycée Louis Massignon : - Proviseur (env. 30min) - Représentants des Parents d’élèves et des professeurs (env. 45min) |
12h00 – 14h00 |
Entretiens à l’Université Paris-Sorbonne Abou Dhabi, Visite du campus de la Sorbonne déjeuner avec M. de Cara et des responsables de l’ADEC (Abu Dhabi Education Council) sujets : Sorbonne, Lycée Louis Le Grand, envoi d’Emiriens dans des lycées internationaux |
14h45 – 16h00 |
Entretiens à l’ecole Théodore Monod - Proviseur (env. 30min) - Représentants des Parents d’élèves et des professeurs (env. 45min) |
16h15 – 17h00 |
Entretien à l’Ambassade : Représentants des Français Mme Laurenti, Mme Rayer et M. Makki |
17h00 – 17h30 |
Entretien à l’Ambassade : Ingrid Jouette-Nagati, Attaché pour la coopération linguistique |
18h00 – 18h45 |
Visite de l’exposition sur l’île des musées à l’Emirates Palace |
20h00 |
Dîner |
08h00 |
Départ pour Dubaï |
09h45 – 11h00 |
Entretiens au Consulat Général Entretien avec la Consule Générale et l’attaché audiovisuel : 45 min Entretien avec le Directeur de Vatel (école de tourisme et d’hôtellerie à Ras al Khaimah) : 30min |
12h00 – 14h15 |
Entretiens au Lycée Georges Pompidou - Déjeuner avec le Proviseur, les Directeurs des annexes et le Responsable du Conseil de Gestion 1h30 - Représentants des Parents d’élèves et des professeurs : 45min |
15h00 – 15h45 |
Alliance Française de Dubaï Directrice de l’Alliance Française : 45min |
16h30 – 18h00 |
Entretiens au Lycée Français International - Proviseur : 30min - Représentants des Parents d’élèves et des professeurs : 45min |
19h30 – 21h00 |
Dîner à la Résidence de la Consule Générale Didier Gazagnadou, Etienne Cazin, Hussein Jaziri, Laurent Rigaud, Henri Zolein |
22h30 |
Arrivée à Abou Dhabi |
09h00 |
Entretiens à Alliance Française d’Abou Dhabi Directrices de l’Alliance Française Abou Dhabi et Al Ain |
10h00 – 10h30 |
Entretien à l’Ambassade avec le Président du FBG (French Business Group) Sujet : contributions des entreprises au réseau culturel |
Matin ou Après-midi |
Entretien avec Zaki Nusseibeh, Président du Comité de l’Alliance Française d’Abou Dhabi |
Matin ou Après-midi |
Entretien avec Rita Aoun, Directrice du Département Culture à TDIC (Tourism Development and Investment Company) Sujet : Louvre Abou Dhabi et projets menées par TDIC |
Matin ou Après-midi |
Entretiens à l’Emirates Foundation Sujet : envoi d’artistes en résidence en France |
Matin ou Après-midi |
Entretiens au Goethe Institute |
Matin ou Après-midi |
Visite de Saadiyat (île des musées) |
19h30 |
Debriefing avec M. l’Ambassadeur et Dîner |
00h55 |
Départ pour New Delhi |
4 b) New Delhi, du 11 au 14 février 2010
JEUDI 11 FEVRIER | |||||
Horaire |
Lieu |
Thématique |
Avec | ||
|
5.50 |
Arrivée Delhi vol EY 032 en provenance d’Abou Dhabi |
Accueil | |||
Transfert hôtel |
|||||
9.30 |
Départ pour le SCAC |
||||
10.00 |
Service culturel et de coopération |
Présentation de la coopération |
P. Martinet, Cocac A. Rechner, Cocac Adjoint | ||
10.30 – 12.30 |
Lycée français |
L’enseignement français en Inde, service rendu aux expatriés et outil d’influence du réseau Passerelles avec enseignent supérieur français |
Rencontre avec les chefs d’établissements de Delhi, Pondichéry, Bombay | ||
13.00 |
Ambassade |
Déjeuner offert par l’Ambassadeur |
Avec Cocac, Cocac Adjoint, Proviseurs, Attaché Universitaire | ||
15.00 -17.00 |
SCAC |
Les passerelles entre l’enseignement supérieur en Inde et l’enseignement supérieur français Rôle de Campus France et de son successeur, des établissements d’enseignement supérieur français en Inde. Comment faire face à l’attractivité des universités anglo-américaines ? |
Olivier Duchatelle, Attaché de coopération universitaire + Campus France, Coopération universitaire, Ifan Chefs d’établissements disponibles | ||
17.00 |
Lycée français de Delhi |
Les enseignants, leur point de vue |
Rencontre avec les représentants des enseignants | ||
18.00 |
Lycée français de Delhi |
Les parents d’élèves, leur point de vue sur les établissements |
Rencontre avec les représentants élus des parents | ||
19.30 |
Dîner libre ou à déterminer |
||||
VENDREDI 12 FEVRIER | |||||
9.30 |
Scac |
L’impact de la réforme à venir sur les personnels, les structures, les ressources Autofinancement, réseautage |
P. Martinet, Cocac et les attachés de coopération, CEDUST | ||
10.30 |
Scac |
Les alliances françaises, Leur rôle dans la diffusion de la langue et de la culture françaises |
A. Rechner Coopération éducative Coopération artistique | ||
11.45 |
Alliance Française de Delhi |
Visite de l’Alliance, rencontre avec des professeurs et étudiants |
Myriam Kryger, Directrice Jacques Cretin, Directeur des cours | ||
13.00 |
A déterminer |
Déjeuner |
Président de l’Alliance, Direction, membres du Comité, attachés concernés | ||
15.00 |
Institut Allemand Max Mueller |
La politique allemande |
Directeur du Max Mueller (à confirmer) | ||
16.30 |
RV Institut Cervantès |
La politique espagnole |
Directeur de l’Institut Cervantès (à confirmer) | ||
À partir de 18.30 |
SCAC, Bonjour India |
inauguration JM Othoniel |
Rencontre avec des artistes | ||
20.00 |
À déterminer |
Dîner libre |
|||
SAMEDI 13 FEVRIER | |||||
Matinée |
créneaux disponibles pour ajuster / compléter les entretiens | ||||
Après-midi |
Visites à New Delhi, dont celle de l’Alliance française | ||||
23.00 |
Arrivée à l’aéroport pour embarquement |
||||
DIMANCHE 14 FEVRIER | |||||
1.25 |
Départ vol AF 225 |
||||
5.55 |
Arrivée Roissy CDG |
||||
5) Liban, du 22 au 25 mars 2010
AMBASSADE DE FRANCE AU LIBAN |
Beyrouth, le 17 mars 2010 |
MISSION PARLEMENTAIRE
DU LUNDI 22 AU JEUDI 25 MARS 2010
Lundi 22 mars
14h00 Arrivée à l’aéroport international Rafic El Hariri de Mme Martine AURILLAC, députée, de M. Didier MATHUS, député, et de M. Olivier GARIAZZO, administrateur
Accueil par M. Denis GAILLARD, Conseiller de coopération
Transfert et installation à la Résidence des Pins
16h00 Réunion de cadrage au SCAC avec les chefs de secteur :
Participants :
M. Denis GAILLARD, Conseiller de coopération
M. Joseph VALLANO, Conseiller adjoint en charge des établissements scolaires
Mme Martine HERLEM, Attachée de coopération
M. Jany BOURDAIS, Attaché culturel et audiovisuel
M. Christophe CHAILLOT, Attaché de coopération éducative
17h30 Réunion au SCAC avec les directeurs de CCF :
Participants :
Mme Delphine GAYRARD (Deir El Qamar)
M. Robert HORN (Tripoli)
M. Olivier LANGE (Saïda, Nabatieh, Tyr)
Mme Alicia THOUY (Zahlé, Baalbeck)
Mme Marie-Pascale BERRO (Jounieh)
M. Jany BOURDAIS, Attaché culturel et audiovisuel
M. Christophe CHAILLOT, Attaché de coopération éducative
Mme Nicole FOUCHET, Agent comptable
M. Antoine HELOU, Secrétaire général
19h00 Arrivée à l’aéroport de M. François ROCHEBLOINE, Vice-président de la Commission des Affaires étrangères.
Accueil par Mme Martine HERLEM, Attachée de coopération
20h30 Dîner à la Résidence des Pins à l’invitation de M. Denis PIETTON, Ambassadeur
Mardi 23 mars
08h10 Départ de la Résidence des Pins
08h30 Visite du Lycée Verdun (problématique sécurité/immobilier) avec :
- M. Denis GAILLARD, Conseiller de coopération
- M. Joseph VALLANO, Conseiller adjoint en charge des établissements scolaires
- M. Éric SEEBOLD, Inspecteur de l’Éducation nationale
10h15 Visite du Grand Lycée (rencontre avec les parents d’élèves)
12h00 Rencontre au SCAC avec les 6 proviseurs des établissements conventionnés
13h00 Déjeuner avec les Proviseurs à l’Atelier
15h00 Rencontre avec les représentants du personnel enseignant (au SCAC)
16h00 Réunion au Consulat général : bourses et prise en charge
17h30 Réunion avec les représentants des établissements homologués (thème : prélèvement de 2 % souhaité par l’AEFE)
20h30 Dîner coopération universitaire à l’École supérieure des affaires (directeur : M. Stéphane Attali)
Mercredi 24 mars
09h00 Petit déjeuner avec les Directeurs des centres culturels étrangers (Café des lettres)
10h00 Visite de la Mission culturelle à Beyrouth
10h30 Départ de Beyrouth
11h30 Visite du CCF de Deir El Qamar dans le Chouf
13h00 Déjeuner à Saïda
14h30 Visite du CCF de Saïda
16h00 Visite en ville (souks, musée du savon…)
17h30 Départ pour Beyrouth. Soirée libre
Jeudi 25 mars
10h00 Réunion de synthèse
12h30 Déjeuner en ville
14h00 Départ pour l’aéroport
15h55 Décollage
1 () Doc. AN n° 2215.
2 () Décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l’organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération.
3 () Voir le compte rendu de cette audition page 57.
4 () Loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités.
5 () Ce schéma est reproduit dans le présent rapport, page 31.
6 () Loi nº 2005-95 du 9 février 2005 relative à la coopération internationale des collectivités territoriales et des agences de l’eau dans les domaines de l’alimentation en eau et de l’assainissement, modifiée par la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie.
© Assemblée nationale