______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 juin 2010.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
en conclusion des travaux d’une mission d’information constituée le 20 mai 2009 (1),
sur la place de la Syrie dans la communauté internationale
Présidente
Mme Elisabeth GUIGOU
Rapporteur
M. Renaud MUSELIER
Députés
__________________________________________________________________
(1) La composition de cette mission figure au verso de la présente page.
La mission d’information sur la place de la Syrie dans la communauté internationale est composée de : Mme Elisabeth Guigou, présidente, M. Renaud Muselier, rapporteur, MM. Jean-Michel Boucheron, Jean-Jacques Guillet, Robert Lecou, François Loncle, Jacques Myard, Jean-Marc Nesme, Eric Raoult, Dominique Souchet, Michel Vauzelle.
INTRODUCTION 7
I – DES SIGNES D’OUVERTURE INCONTESTABLES 13
A – LA CONVERSION D’UNE ÉCONOMIE D’ETAT À UNE ÉCONOMIE DE MARCHÉ 13
1) La situation avant 2004 : une économie encore largement étatisée 13
2) Les réformes essentielles réalisées au cours des dernières années 16
3) D’importants défis encore à relever 19
B – LE PROCESSUS DE RAPPROCHEMENT AVEC L’OCCIDENT 22
1) La France, premier pays à franchir le pas 22
a) Un pari réussi 23
b) Des relations bilatérales désormais très intenses 26
2) Le rapprochement, à confirmer, avec l’Union européenne 31
a) La question de la signature de l’accord d’association 32
b) Une participation prometteuse à l’Union pour la Méditerranée 37
3) L’amélioration souhaitée des relations avec les Etats-Unis 41
a) La montée des tensions syro-américaines sous les deux mandats de George W. Bush 41
b) Le difficile chemin vers un rapprochement, souhaité par les deux parties 43
C – UN JEU RÉGIONAL PLUS ÉQUILIBRÉ 47
1) La Turquie, nouvel allié 47
a) Un changement radical dans l’atmosphère des relations politiques 47
b) Une nette intensification des relations économiques 51
2) Des relations compliquées avec l’Irak mais une volonté d’ouverture 53
a) Deux pays longtemps rivaux 54
b) Les conséquences de la guerre en Irak sur la Syrie : la question des réfugiés 54
c) Des liens difficiles à renouer 57
3) Des progrès plus ou moins marqués dans les relations avec les Etats arabes modérés de la région 59
a) Une réconciliation surprise avec l’Arabie saoudite 59
b) Des relations qui restent froides avec l’Egypte 62
c) Un rapprochement sensible de la Jordanie 63
II – LES HÉSITATIONS SYRIENNES 67
A – LES RELATIONS SYRO-LIBANAISES PEUVENT-ELLES SE NORMALISER ? 67
1) Un partage en deux Etats jamais accepté par la Syrie ? 67
a) Des peuples et des économies étroitement liés 68
b) Des décennies d’influence et d’ingérences syriennes dans la vie politique libanaise 70
2) Les signes d’une forme de normalisation en cours 73
3) Des limites évidentes : vers le maintien de « liens privilégiés » ? 77
B – L’ALLIANCE SYRO-IRANIENNE EST-ELLE AFFECTÉE PAR L’OUVERTURE DIPLOMATIQUE SYRIENNE ? 81
1) Une alliance stratégique ancienne, aujourd’hui déséquilibrée 81
a) Les fondements d’une alliance qui dure depuis trente ans 81
b) Une alliance déséquilibrée en faveur de l’Iran 82
2) La Syrie, l’Iran et les « forces de la résistance » 83
a) Le soutien des deux alliés aux « forces de la résistance » 83
b) Un soutien ouvertement affiché 85
3) Des liens qu’il serait vain de vouloir briser 87
a) Une alliance qui a fait la preuve de sa solidité 87
b) La Syrie, possible intermédiaire entre l’Iran et ceux qui se défient de lui ? 88
C – LA PAIX AVEC ISRAËL EST-ELLE ENVISAGEABLE ? 90
1) Un soutien affiché à la cause palestinienne malgré des relations difficiles avec les responsables palestiniens 90
a) Un soutien conditionnel et en partie instrumentalisé 90
b) Une hostilité constante à l’égard d’Israël 93
2) Des échecs passés qui pèsent lourd 95
a) L’échec des années 1990 95
b) Les récents pourparlers via la Turquie 96
3) Un règlement improbable à court terme 97
a) Une paix séparée « israélo-syrienne » acceptable pour la Syrie ? 98
b) Un retrait du Golan envisageable côté israélien ? 99
D – OÙ EN SONT LES DROITS DE L’HOMME ? 101
1) Un régime toujours autoritaire 102
a) Un « printemps de Damas » qui a tourné court 103
b) Un jeune président qui parvient finalement à établir son autorité 104
2) Des libertés publiques encore à conquérir 105
a) Quelques signes encourageants 106
b) Un bilan qui reste négatif 107
3) Les droits des Kurdes en question 108
a) Une minorité nombreuse, victime de discriminations 109
b) Un peuple dont les aspirations sont violemment réprimées 110
E – COMMENT LA SOCIÉTÉ ÉVOLUE-T-ELLE ? 114
1) La tradition laïque syrienne face à la montée de l’islamisme 114
a) La laïcité à la syrienne 114
b) Une montée de l’islamisme difficile à contrer 116
2) La place des femmes : des inégalités persistantes 117
3) Les difficultés rencontrées par la jeune génération 120
CONCLUSION 123
RÉCAPITULATIF DES PROPOSITIONS 127
EXAMEN EN COMMISSION 129
ANNEXES 135
Mesdames, Messieurs,
Le 20 mai 2009, la commission des affaires étrangères a décidé la création d’une mission d’information sur la place de la Syrie dans la communauté internationale, composée de douze membres (1).
Cette mission était chargée d’étudier l’évolution de la position internationale de la Syrie au cours des dernières années, période pendant laquelle elle est passée d’une situation d’isolement particulièrement marqué entre 2004 et 2006 à un processus de réintégration dans la communauté internationale qui, bien que non encore achevé, a été relativement rapide. Au cours de l’année pendant laquelle les travaux de la Mission se sont déroulés, la réorientation diplomatique syrienne s’est globalement confirmée.
Cette ouverture de la Syrie, qui s’observe aussi en matière économique, contraste avec la fermeture persistante, si ce n’est croissante, de l’Iran, allié indéfectible de la Syrie depuis plus de trente ans, auquel la commission avait consacré une mission d’information qui a rendu ses conclusions en décembre 2008 (2).
La Syrie a incontestablement adopté une stratégie différente de celle de l’Iran : au lieu de multiplier les discours provocateurs et violents et de braver ouvertement la communauté internationale, elle apparaît disposée à dialoguer, y compris, sous certaines conditions, avec son pire ennemi, Israël, et à acquérir une nouvelle respectabilité. Mais cela ne signifie pour autant ni qu’elle accepte toutes les concessions qui lui sont demandées, ni qu’elle est prête à renoncer aux fondamentaux de sa politique étrangère (proximité de l’Iran, soutien aux forces de la « résistance » à Israël, influence sur le Liban).
Pour traiter ce sujet aussi complexe que passionnant, la Mission a procédé à une vingtaine d’auditions à Paris et s’est rendue à deux reprises au Proche-Orient (3) : du 1er au 6 novembre 2009, cinq de ses membres ont séjourné en Syrie, à Damas et à Alep ; du 27 février au 5 mars 2010, deux d’entre eux ont effectué une tournée au Proche-Orient, qui les a conduits en Israël et dans les Territoires palestiniens, en Jordanie, à nouveau en Syrie, puis au Liban. La Mission tient à remercier très chaleureusement les ambassadeurs et consuls de France, ainsi que leurs collaborateurs, qui ont remarquablement bien reçu ses membres et ont organisé à leur attention des rencontres très intéressantes et de haut niveau. Tous ces entretiens ont considérablement enrichi les informations et analyses fournies par les auditions parisiennes.
Le premier déplacement a permis à la Mission de mieux connaître la situation intérieure, économique, politique et sociale, de la Syrie et d’appréhender la vision qu’elle avait de sa place dans le monde. La tournée régionale visait à replacer sa politique étrangère dans son environnement proche et à comprendre la perception qu’en avaient ses voisins.
La situation géographique de la Syrie (4), vaste territoire de plus de 185 000 km2, joue un rôle déterminant dans sa diplomatie. Le pays, qui, depuis la création du Liban, ne compte plus qu’environ 150 km de côtes, a une très longue frontière avec la Turquie, au nord, et avec l’Irak, à l’Est. La Jordanie est son voisin au sud, tandis que le Golan le sépare actuellement d’Israël. L’Iran et l’Arabie saoudite font aussi partie de son voisinage proche. L’absence de relations diplomatiques entre la plupart des Etats de la région et Israël renforce le rôle de la Syrie comme pays de transit entre ces pays et la Méditerranée, puis l’Occident. Il est traversé par un gazoduc et deux oléoducs destinés à assurer le passage des hydrocarbures irakiens vers la Méditerranée. Les infrastructures de transport terrestre sont encore peu développées dans la région, mais les nombreux projets qui existent dans ce domaine intègrent fort logiquement la Syrie.
Son poids démographique doit aussi être souligné : ses 21,3 millions d’habitants sont à comparer aux faibles populations d’Israël (7 millions d’habitants), de la Jordanie (6,1 millions d’habitants) et du Liban (3,8 millions d’habitants).
Les relations franco-syriennes ne constituaient qu’un volet du sujet à traiter par la Mission, mais un volet particulièrement important. En effet, avant d’être le pays qui, à partir de l’automne 2007, a mis un terme à l’ostracisme syrien dont il était en grande partie à l’origine, la France a joué un rôle non négligeable dans la constitution de la Syrie.
M. Christian Velud, directeur des relations internationales à l’Institut d’études politiques de Lyon (5), est allé jusqu’à affirmer que la France avait « façonné » la Syrie d’aujourd’hui. Il est vrai qu’après avoir soutenu le projet d’un royaume arabe de « Grande Syrie », incluant le Liban et la Palestine, sur lequel aurait régné l’émir Faysal, fils du chérif de La Mecque, la France a empêché sa réalisation en envoyant des troupes qui ont défait l’armée syrienne et les volontaires arabes près de Damas, en juillet 1920. Forte du mandat obtenu à la conférence de San Remo en avril 1920, elle a occupé la Syrie intérieure, tandis que les Britanniques exerçaient leur mandat sur la Palestine et l’Irak. La façade maritime syrienne, les territoires de la Bekaa et les districts de Tyr et de Tripoli se sont unis pour former le « Grand Liban » au détriment de la Syrie. Il est évident que ce dépeçage de la Syrie historique pèse lourdement dans l’histoire du pays et dans ses relations avec son voisin libanais.
Les héritages de la période du mandat français sur la Syrie contemporaine ne se limitent pas à ce « péché originel ». La mise en place d’une administration très pesante, l’établissement d’une partition communautarisée du territoire et la cession d’Alexandrette à la Turquie lui sont aussi imputables. Tel est également le cas de la promotion des minorités, notamment alaouite, au sein de l’armée, qui a conduit au coup d’Etat du 8 mars 1963, portant au pouvoir des militaires du parti Baas, et parmi eux de nombreux officiers alaouites. Comme il l’a fait avec les colons européens en Afrique du Nord et les chrétiens au Liban, le pouvoir colonial s’est en effet appuyé en Syrie sur les minorités druze, alaouite, kurde et chrétienne.
Cela n’a pas empêché les phases de violence : en 1925 éclate la révolte druze, qualifiée de « Grande révolution syrienne », qui est rejointe par les nationalistes arabes et contribue à l’ancrage de cette idéologie dans les villes syriennes intérieures.
Une fois l’indépendance acquise dans les frontières du mandat français, en 1943, le pays connaît encore plusieurs soulèvements de groupes minoritaires refusant la politique d’assimilation du gouvernement central. La déconfessionalisation imposée dès la fin des années 1940 s’accompagne d’une politique d’arabisation dans tous les domaines de la vie publique et la constitution de 1953 impose que le chef de l’Etat soit musulman.
Les années 1950 ont laissé le souvenir d’un âge d’or car, en dépit d’une instabilité politique chronique, le pays connaissait une période de modernisation et la population bénéficiait de toutes les libertés publiques et de celle d’entreprendre. Victime des rivalités des acteurs régionaux et des intrigues des grandes puissances, la Syrie unit son destin à celui de l’Egypte dans le cadre de la République arabe unie, entre 1958 et 1961, avant que des militaires baasistes n’organisent le coup d’Etat de 1963.
La Syrie s’efforce alors de se libérer de l’héritage mandataire : les nouveaux dirigeants, dont le projet allie nationalisme et socialisme, prennent en main la politique extérieure, libèrent l’économie de l’emprise étrangère et construisent un nouvel Etat, mais ils le font au prix d’un autoritarisme que l’arrivée au pouvoir d’Hafez el-Assad, en 1970, ne fait qu’accentuer. Celui qui était ministre de la défense au moment de la déroute militaire syrienne de 1967 veut en effet mettre un terme à l’instabilité politique du pays afin de pouvoir se consacrer à la lutte contre Israël. Pour cela, il établit des réseaux clientélistes au cœur desquels se trouve la communauté alaouite mais dont la base inclut des membres de différentes communautés. Ce système repose ainsi plus sur des hommes que sur des institutions, ce qui le rend relativement vulnérable mais ne l’a pas empêché de survivre à la disparition de son créateur et de subsister jusqu’à aujourd’hui.
Pour gagner son combat contre Israël et récupérer le Golan, le Président Hafez el-Assad veut maîtriser le jeu régional afin qu’aucun acteur arabe n’entraîne la Syrie ni dans une escalade avec l’Etat hébreu, ni dans un règlement de paix contraire aux intérêts de celle-ci. C’est ce qui le conduit notamment à tenter, en vain, d’imposer son autorité aux Palestiniens et à intervenir durablement au Liban. Sa politique étrangère s’avère particulièrement habile : si elle ne lui permet pas d’obtenir la restitution du Golan, elle lui assure des relations cordiales aussi bien avec l’URSS, sa grande pourvoyeuse d’armes, qu’avec les pays occidentaux et la République islamique d’Iran. Tous acceptent de facto son influence directe sur le Liban jusqu’au début des années 2000, lorsque les troupes israéliennes auront quitté le pays du Cèdre et que M. Bachar el-Assad aura succédé à son père.
La situation se complique pour la Syrie à partir de 2003. Dans le contexte de la guerre en Irak et de la lutte contre le terrorisme lancée après les attentats du 11 septembre 2001, elle est accusée par les Etats-Unis de soutenir des groupes terroristes, notamment en Irak, et de chercher à se doter d’armes interdites par le droit international. Le renouvellement du mandat du président libanais pro-syrien Emile Lahoud à l’été 2004 puis l’assassinat de l’ancien premier ministre Rafic Hariri en février 2005, dont elle est immédiatement considérée comme responsable, conduisent à son isolement international. Sous l’injonction des Nations unies, les troupes syriennes doivent se retirer du Liban. Le régime donne l’impression qu’il chancelle.
Pourtant, depuis la fin 2007, les ministres, les chefs d’Etat et les responsables de haut niveau de tous les pays du monde se succèdent à Damas. Le dialogue se renoue progressivement, les autres pays ayant suivi la voie ouverte par le Président Sarkozy. La date qui symbolise ce processus est en effet celle du 13 juillet 2008, lorsque le Président el-Assad participe, aux côtés des représentants de quarante-deux autres Etats, au Sommet de Paris pour la Méditerranée. Depuis lors, la Syrie cherche à se réconcilier avec l’Occident comme avec les Etats arabes modérés auxquels elle reprochait pourtant leur trahison il y a peu.
Le présent rapport s’efforce de dresser un bilan du processus de retour de la Syrie au sein de la communauté internationale, et donne le sentiment de la Mission sur les perspectives de son évolution. Il comporte deux grandes parties : la première présente les domaines dans lesquels la Mission considère que les progrès réalisés sont suffisamment avancés et soutenus par une volonté politique assez forte pour constituer des acquis durables ; dans la seconde, sont abordés les thèmes sur lesquels la volonté syrienne n’apparaît pas aussi nette et où les enjeux apparaissent trop essentiels à la survie du régime pour qu’il accepte à court terme toutes les concessions que la communauté internationale attend de lui.
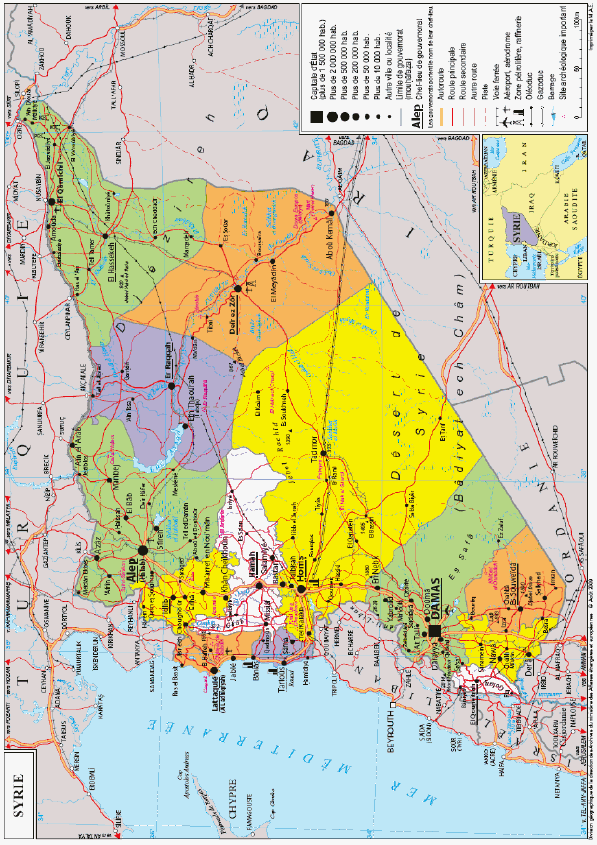
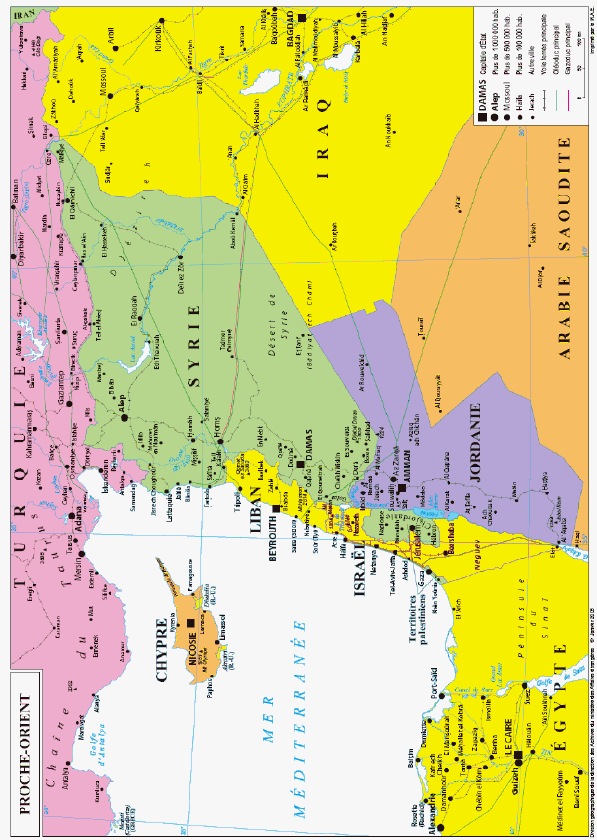
I – DES SIGNES D’OUVERTURE INCONTESTABLES
La Syrie d’aujourd’hui est, sur bien des points, très différente de ce qu’elle était en juillet 2000, lorsque le Président Bachar el-Assad a succédé à son père, Hafez el-Assad. Les premières années de sa présidence ont pourtant été très difficiles d’un point de vue diplomatique, le pays se retrouvant isolé au point que le régime lui-même est apparu en danger. Malgré cette fragilisation, ces années ont été mises à profit pour lancer une série de réformes qui ont conduit à une certaine libéralisation de l’économie et qui, bien qu’encore inachevées, ont déjà fait la preuve de leur pertinence.
Elles ont aussi contribué à changer le regard que le reste du monde portait sur la Syrie, ce qui a facilité le retour du pays sur la scène internationale. En effet, dès que le régime a consenti des concessions sur le dossier libanais – en contribuant au retour à la paix civile, à l’élection d’un président de la République, puis à celle d’un nouveau Parlement –, qui était la cause principale de sa mise à l’écart, les Occidentaux, suivant la France, puis les pays arabes modérés ont progressivement renoué le dialogue avec la Syrie, qui a accueilli favorablement ces gestes d’ouverture.
A – La conversion d’une économie d’Etat à une économie de marché
Plus de dix ans après la chute de l’Union soviétique et alors que la Russie elle-même et les pays européens qui avaient été sous sa coupe s’étaient depuis longtemps convertis à l’économie de marché, l’économie syrienne était toujours très fermée et largement tenue par l’Etat.
Bien que d’importants retards soient encore à combler et que des pesanteurs subsistent, les règles qui la régissent ont été profondément modifiées, ce qui a stimulé les investissements étrangers et la croissance.
1) La situation avant 2004 : une économie encore largement étatisée
Le système économique dominant en Syrie au moment où M. Bachar
el-Assad arrive au pouvoir est encore largement celui mis en place à partir de 1963 en application des Fondements théoriques rédigés par des idéologues marxisants soucieux d’articuler le nationalisme arabe à un étatisme économique inspiré du modèle de l’Union soviétique. Le parti Baas, qui venait alors de prendre les rênes du pays et dont le slogan était « Unité, liberté, socialisme », voulait en effet tourner définitivement la page de la période postmandataire en mettant en œuvre des transformations radicales, notamment en matière économique. La priorité était la réalisation d’une révolution intérieure qui passait par l’approfondissement de la réforme agraire, la nationalisation des entreprises commerciales et industrielles, le développement de la planification économique générale et la création d’une banque d’Etat. La mise en œuvre de ces orientations conduisit à la fuite des entrepreneurs privés, des grands commerçants, des propriétaires terriens et des banquiers, qui quittèrent le pays avec leurs capitaux, avant que les vagues de nationalisations de 1964 à 1966 ne déclenchent de violentes émeutes des classes moyennes et des petits commerçants à Hama et Alep.
Conséquence de l’étatisation de l’économie, aux effets de laquelle s’ajoutent les conséquences de la guerre de 1967, l’économie syrienne se trouve au bord de l’asphyxie dès 1970. C’est pourquoi Hafez el-Assad lance le processus des Infitah, les politiques d’ouverture économique. Dans la première moitié des années 1970, la première vise à attirer les investisseurs privés syriens, locaux et expatriés, et les investisseurs étrangers. Elle profite à la bourgeoisie commerçante, majoritairement sunnite et chrétienne, dont le régime attend en contrepartie le soutien politique, ainsi qu’à une nouvelle classe de capitalistes issus de la haute fonction publique. Cette politique consiste principalement en la levée de restrictions touchant le commerce extérieur, l’adoption de mesures encourageant le rapatriement des capitaux, le relâchement du contrôle des changes, la restitution des avoirs séquestrés dans les années 1960, l’accord de nouvelles facilités de crédit aux entreprises privées et l’ouverture aux investissements étrangers, y compris non arabes.
Mais la portée de cette politique demeure limitée, comme en atteste la situation de banqueroute que connaît à nouveau l’économie syrienne en 1985, laquelle pousse le régime à engager une seconde Infitah, procédant d’une logique identique. Le régime ouvre alors au privé les secteurs que l’Etat ne peut plus gérer seul financièrement, ce qui se traduit par la constitution d’un secteur mixte dans le transport et le tourisme, puis dans l’agriculture et l’agroalimentaire. La loi n° 10 sur les investissements, votée en 1991, est le point fort de cette deuxième phase de libéralisation. Mais les résultats de cette nouvelle politique restent de faible ampleur : les incitations à investir dans les secteurs productifs ont peu d’impact car elles ne modifient pas fondamentalement l’environnement des affaires, la possession de devises étrangères est réprimée depuis 1986 et, faute d’infrastructures bancaires satisfaisantes, les investisseurs se replient sur les banques libanaises, vidant de sa substance la loi n° 10 sur les investissements. Cette fois encore, la libéralisation profite surtout aux membres du régime.
Comme le souligne Caroline Donati, « les mesures libérales consenties par Hafez el-Assad ne servaient, chaque fois, qu’à répondre à des contextes de crise : la quête d’un soutien et de capitaux en 1970-1972, la crise financière et les bouleversements induits par la perestroïka soviétique en 1985-1986. Et elles visaient au mieux à assurer la pérennisation de la rente et les ressources nécessaires à la redistribution sociale. » (6) Aussi, en dépit de la hausse de la rente pétrolière, d’investissements importants dans le secteur agricole et d’un début d’industrialisation, le pays connaît une nouvelle récession en 1996. La maladie d’Hafez el-Assad plonge alors la Syrie dans l’immobilisme pendant plusieurs années.
C’est ainsi que, au début des années 2000, la Syrie se place au quinzième rang sur les dix-huit pays de la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord pour ses performances économiques, et occupe la 102ème place sur 185 au niveau mondial, juste derrière le Bangladesh, l’Ukraine et le Honduras (7). Le pays ne parvient pas à se développer, comme en atteste la baisse du revenu moyen par habitant de 1 250 dollars à 1 120 dollars entre 1980 et 2000, en dépit d’un léger recul de la croissance démographique, passée de 3 % par an en 1995 à 2,5 % par an en 2001. Plus la moitié des 17 millions d’habitants a alors moins de vingt ans et 250 000 nouveaux demandeurs d’emploi arrivent chaque année sur le marché du travail. Le taux de chômage est officiellement de 9 % mais les experts l’évaluent à 20 %.
Pour expliquer ce « mal développement », il faut ajouter à l’absence des réformes structurelles nécessaires le poids de la manne pétrolière, qui dépend du prix du baril et est amenée à se tarir à court terme (de l’ordre d’une dizaine d’années pour les réserves susceptibles d’être exploitées sans investissements lourds supplémentaires). Les ressources pétrolières représentent encore au début des années 2000 les deux tiers des exportations syriennes et la moitié des revenus de l’Etat. Mais le pays n’est pas dépourvu d’atouts : l’agriculture, qui assure 27 % du PIB et emploie 30 % de la population active, couvre les besoins du pays – même si elle est très sensible à la sécheresse –, l’industrie privée est dynamique et les équilibres financiers du pays sont remarquables.
Dès son discours d’investiture, prononcé le 17 juillet 2000, M. Bachar el-Assad exprime la volonté de rattraper le retard pris par l’économie syrienne, en s’inspirant des travaux du comité économique qu’il a constitué avant même d’accéder à la tête de l’Etat. Des tenants de la modernisation et de l’ouverture économiques sont nommés au gouvernement. Entre la fin 2000 et le début 2001, deux monopoles d’Etat sont supprimés : l’établissement de banques privées et d’une bourse de valeur est approuvé, ainsi que la création d’universités privées. Malgré les obstacles rencontrés, un processus est enclenché, qui a conduit à des réformes de grande portée, véritablement mises en œuvre à partir de 2004.
2) Les réformes essentielles réalisées au cours des dernières années
Les réformes structurelles visent à faire passer le pays d’un modèle d’économie dirigée à une économie plus ouverte sur le monde.
La législation a été progressivement adaptée afin de permettre la libéralisation des importations, le développement des banques et des assurances privées, la réforme des systèmes fiscal et douanier et celle du code de commerce, la modernisation du droit des sociétés et des règles relatives aux investissements, la suppression de l’essentiel des monopoles. Certaines subventions, notamment celles relatives aux carburants et aux produits alimentaires de base (riz et sucre en particulier), ont été supprimées et remplacées par des aides limitées aux foyers les plus modestes.
Il a été décidé de réduire la pression fiscale afin de tenter de réconcilier le contribuable et l’Etat et de restaurer un esprit civique qui faisait défaut en Syrie. Ainsi, les taux d’imposition sur le revenu des personnes physiques et des sociétés sont passés d’un niveau supérieur à 50 % à un taux de 28 %, susceptible d’être réduit à 14 % dans certains cas. La pression fiscale sur les revenus de l’immobilier a aussi été abaissée. Plusieurs taxes indirectes (dont les droits de succession) ont été supprimées au profit d’une taxe à la consommation sur certains produits de luxe, qui préfigure la mise en place d’une taxe sur la valeur ajoutée. Cette dernière, dont l’introduction a été repoussée à plusieurs reprises et n’est toujours pas réalisée, devrait être à un taux unique avoisinant les 10 % et se substituer à douze taxes actuellement appliquées. Des produits et services « de base » en seront exemptés.
Au début des années 2000, la Syrie ne comptait que six banques publiques, dont les services de piètre qualité inspiraient si peu confiance à la population qu’on ne comptait en moyenne qu’un compte bancaire pour vingt-six habitants et que le total des dépôts privés équivalait à moins du quart du PIB
– contre 46 % en moyenne dans les pays arabes. En quelques années, douze banques privées, dont deux islamiques, ont été créées ; elles représentent le quart du secteur. Ces banques privées sont d’origine libanaise, mais de nombreux interlocuteurs de la Mission ont souligné que les banques libanaises avaient elles-mêmes bien souvent été fondées par des Syriens installés au Liban dans les années 1950 et 1960. Les Syriens leur font confiance : les dépôts ont été multipliés par 2,5 entre 2005 et 2010 et les dépôts en devises par 8 (ils atteignent 4 milliards de dollars). Ont été mis en place de véritables bureaux de change et une supervision bancaire assurée par la Banque de Syrie, la banque centrale.
Plusieurs membres de la Mission ont eu l’occasion de s’entretenir avec son gouverneur, M. Adib Mayaleh, qui est franco-syrien. Ils ont été impressionnés par sa volonté de vaincre les conservatismes pour moderniser en profondeur les finances publiques syriennes. Il leur a présenté la véritable révolution que connaît la banque centrale depuis quelques années, après des décennies pendant lesquelles l’Etat décidait tout lui-même.
Il a expliqué que la banque centrale avait comme horizon l’adoption des normes internationales. Jusqu’en 2004, les taux d’intérêt étaient identiques depuis 20 ans ; au cours de la seule année 2005, ils ont été modifiés à quatre reprises – la livre syrienne a en effet perdu 25 % de sa valeur à la suite de l’assassinat de Rafic Hariri. Le lien entre la livre syrienne et le dollar a été coupé : elle est, depuis juillet 2007, liée aux droits de tirage spéciaux, c’est-à-dire à un panier de devises, même si 80 % du commerce extérieur se font encore en dollars. Les réserves, jadis entièrement en dollars, sont aujourd’hui composées de 50 % de dollars et 50 % d’euros. La banque centrale peut désormais vendre et acheter des devises pour défendre le taux de change, jour après jour. Mais elle ne dispose pas encore d’instruments lui permettant d’assurer le contrôle des réserves de change et des taux d’intérêt, qui demeurent fixés par le gouvernement.
Une réforme est en cours pour permettre à la Banque de Syrie d’émettre des bons du Trésor au profit du ministère des finances afin de disposer de liquidités et d’offrir des instruments de refinancement au secteur bancaire. Elle prévoit d’émettre 20 milliards de livres syriennes en bons au cours des prochains mois. La bourse de Damas a réouvert début 2009, après quarante années de fermeture.
Sur le plan commercial, la Syrie, qui est membre du GAFTA (Greater Arab Free Trade Area, ou Grand marché arabe de libre-échange (8)) depuis le 1er janvier 2005, a réitéré sa demande d’adhésion à l’Organisation mondiale du commerce, demande rejetée depuis 2004, notamment à cause du blocage américain. A l’appui de cette demande, les autorités syriennes peuvent mettre l’accent sur les effets positifs que le processus ne manquera d’avoir sur la poursuite des réformes en faveur de l’ouverture et sur la mise à niveau international des entreprises.
Globalement, l’amélioration de l’environnement des affaires commence à porter ses fruits et à restaurer progressivement la confiance des investisseurs, qui ont amorcé leur retour en Syrie depuis 2005. Selon l’Agence syrienne d’investissement, les flux entrants d’investissements directs étrangers auraient ainsi dépassé 2 milliards de dollars américains en 2008 et atteint 3,2 milliards de dollars en 2009, soit une croissance de 52 % en valeur et de 31 % en nombre de projets. La part des projets industriels serait en progression, de 45,5 % en 2008 à 56 % des nouveaux projets en 2009.
L’INTÉRÊT CROISSANT DES INVESTISSEURS FRANÇAIS POUR LA SYRIE Le premier investissement français en Syrie remonte à 1998 avec l’implantation de Total. Il faudra ensuite attendre 2003 pour voir arriver des capitaux français importants, en lien avec l’ouverture de la Syrie aux investissements privés. Bel est le premier groupe français à avoir implanté une unité de production, inaugurée en 2005, pour un coût de 13 millions d’euros, entièrement financé sur des fonds français, et Lafarge réalise depuis 2008 l’investissement étranger le plus important dans son secteur en construisant près d’Alep, en partenariat avec un investisseur syrien, la première cimenterie privée du pays, pour un montant de 480 millions d’euros. Air Liquide, pour sa part, inaugurera en 2010 une usine de production de gaz industriels (30 millions d’euros). Altadis y est aussi présente depuis 2004 et IMP Pharma est en train de s’y implanter. Danone, qui distribue ses produits en Syrie depuis janvier dernier, envisage d’y construire une première ferme et une usine laitière. Les investissements français en Syrie sont concentrés sur les secteurs des hydrocarbures et ressources minières, qui représentaient 89 % des stocks d’investissements directs étrangers français en Syrie en 2008. Cet investissement avoisine 1,6 milliard de dollars. Début 2010, la Syrie comptait seize implantations françaises et plus d’une vingtaine de sociétés présentes au travers de filiales ou de bureaux de représentation, employant 850 personnes. Si les entreprises françaises portent un intérêt croissant à la Syrie, les destinataires privilégiés des investissements français dans cette région restent, en termes de stock, l’Egypte, suivie de loin par le Liban et la Jordanie. Afin notamment de stimuler l’implantation des PME françaises en Syrie, a été lancé en mai 2009 un Club des entrepreneurs franco-syriens. Source : Fiche de synthèse du service économique de l’ambassade de France en Syrie, mai 2010. |
Ce mouvement de réformes s’est traduit par le retour à une croissance dynamique depuis 2004, après un début de décennie difficile. La Syrie a retrouvé des taux de croissance proches de ceux des années 1990 (+ 5,6 % entre 1990 et 1999), renforcés en 2006 par l’afflux des réfugiés irakiens et l’abondance de liquidités en provenance du Moyen-Orient. Après un léger ralentissement en 2007 (+ 4,2 %), dû notamment à de mauvaises récoltes agricoles et à la baisse régulière de la production de brut (380 000 barils par jour en 2008, contre 462 000 barils par jour en 2004), la croissance syrienne s’est rétablie à 5,2 % en 2008, chiffre portée entre 6 et 7 % par la Banque de Syrie en tenant compte du poids de l’économie parallèle. Mais cette croissance reste insuffisante pour faire face à la pression démographique qui serait d’environ 3,3 % par an en moyenne sur la période 2005-2010 – alors que le chiffre officiel est de 2,5 % – et de 4 % pour la population urbaine. L’inflation a atteint un pic en 2008, à plus de 15 %, avant de s’établir à 2,5 % en 2009 sous l’effet de la baisse des prix des matières premières et des produits alimentaires – l’inflation constatée étant due pour 60 % à des effets externes – et d’une pause dans le démantèlement des subventions. La réalité de cette baisse de l’inflation en 2009 est d’ailleurs contestée par le FMI, qui estime que les prix ont encore progressé de 14 % au cours de l’année. Ce sont les 30 % de pauvres qui subissent le plus fortement les conséquences de cette inflation, et paient le prix de la transition vers l’économie de marché.
Si les autorités syriennes ont tendance à se féliciter du caractère très limité de l’impact de la crise économique mondiale sur leur pays, conséquence de sa faible intégration dans l’économie globalisée et des règles prudentes appliquées dans le secteur financier, la Syrie en ressent néanmoins des effets indirects. La croissance a ainsi ralenti en 2009, à 4 %, mais pourrait se redresser dès 2010 pour atteindre les 5 %. Le tassement de la croissance observé en 2009 résulte principalement d’une baisse des exportations (hydrocarbures, textiles, industrie légère) de 15,2 milliards de dollars en 2008 à 12,7 milliards de dollars en 2009 et d’un tassement des flux d’investissements directs étrangers (de 1,6 à 1,5 milliard de dollars de flux entrants), alors que les recettes touristiques auraient très légèrement progressé (de 3,1 à 3,2 milliards de dollars) et que les transferts provenant des travailleurs expatriés, qui sont pourtant revenus en grand nombre (plus de 30 000 sur 500 000 Syriens travaillant à l’étranger seraient rentrés en 2009), auraient stagné à 1,2 milliard de dollars. La position financière de la Syrie n’en a pas pour autant souffert et son endettement reste limité.
Les avancées réalisées dans la modernisation et l’ouverture de l’économie sont donc incontestables et les personnes rencontrées par la Mission sont unanimes à les considérer comme irréversibles. Il ne faut pas pour autant croire que les réformes ont été faciles à obtenir et, a fortiori, qu’elles sont mises en œuvre sans réticences. Le processus est en outre loin d’être achevé.
3) D’importants défis encore à relever
Les nombreux interlocuteurs de la Mission ont souligné l’existence d’une volonté politique forte, au sommet de l’Etat, en faveur des réformes économiques. Le président, son vice-premier ministre chargé des affaires économique, qu’une délégation de la Mission a rencontré à deux reprises, font preuve d’une volonté sans faille. Mais ils sont confrontés aux réticences de certains – le Premier ministre semble ainsi plus réservé dans ce domaine.
Globalement, les réformes sont menées à un rythme relativement lent, avec prudence. Plusieurs personnes rencontrées par la Mission ont mis en avant le caractère limité des capacités d’absorption et d’acceptation de ces réformes par l’administration et la population syriennes. Elles ont aussi établi un lien entre cette prudence et l’expérience de la Russie post-soviétique. Traditionnellement proche de l’Union soviétique, le régime syrien a été marqué par l’effondrement qui a suivi la rapide libéralisation économique en Russie et par le développement des mafias auquel elle a conduit. Il veut absolument éviter que les mêmes effets pervers n’apparaissent en Syrie.
Le gouverneur de la Banque de Syrie a souligné que la réalité avait du mal à suivre la volonté politique du président de la République, notamment à cause des « nombreux handicaps » du pays, parmi lesquels il a cité la tradition bureaucratique et « beaucoup d’autres enjeux qui s’opposent à la mise en œuvres des réformes », et « d’un héritage qui pèse lourd sur les mentalités ». Il en a conclu que le premier objectif devait être de faire changer ces dernières.
On observe aussi des mouvements de recul après des avancées importantes. Devant la Mission, l’économiste Samir Aïta (9) a ainsi déploré que, alors que, depuis 2004, le développement des banques privées avait constitué une grande réussite des nouvelles politiques économiques, deux décisions qu’il a qualifiées d’incompréhensibles aient été prises à l’été 2009 : le capital minimal des banques a été multiplié par dix (soit désormais 200 millions de dollars américains), ce qui n’est pas justifié du point de vue des règles prudentielles – et donne l’impression de vouloir créer une barrière d’entrée à de nouveaux entrants, et même que certains acteurs du pouvoir souhaitent rentrer dans le capital de ces banques – ; les banques n’ont plus le droit d’employer plus de 3 % d’étrangers, décision populiste qui vise essentiellement les Libanais, alors que les banques elles-mêmes n’ont pas intérêt à employer beaucoup d’expatriés. Les autorités sont revenues partiellement sur ces décisions et la part étrangère autorisée dans le capital d’une banque est passée de 49 % à 60 % depuis le 1er janvier 2010, mais ces hésitations témoignent de luttes d’influence au sein du pouvoir.
L’un des plus hauts responsables des activités internationales d’un grand groupe français fortement implanté au Proche et au Moyen-Orient a témoigné devant la Mission des difficultés auxquelles continuaient de se heurter les investisseurs étrangers en Syrie – ce qui fait selon lui de ce pays l’un des plus difficiles de la région pour les affaires, même l’Irak ne posant pas autant de problèmes : la réglementation n’a encore été modifiée que partiellement, certaines normes sont contradictoires, de nombreux actes quotidiens (comme les importations) exigent des autorisations, et le seul moyen d’obtenir la résolution de ces difficultés consiste à faire intervenir telle ou telle personnalité proche du pouvoir, ce qui revient à lier l’aboutissement d’un projet à des relations personnelles ou claniques dont les subtilités échappent totalement à l’observateur extérieur.
Le Fonds monétaire international – aux conseils duquel la Syrie a fait appel en 2004, ce qui constituait un signe d’ouverture – félicite régulièrement la Syrie pour les progrès accomplis, ce que rappelle volontiers M. Abdallah Dardari, le vice-premier ministre chargé des affaires économiques. Mais il assortit aussi ses rapports de préconisations qui donnent une idée de l’ampleur des réformes que le pays doit encore conduire.
Dans son rapport de décembre 2009, il appelle à la poursuite de la préparation de l’entrée en vigueur de la TVA, prévue en 2011, pour laquelle la France apporte une assistance importante à la Syrie, et, plus généralement, celle de la réforme du système fiscal. Il préconise l’intégration dans le budget de l’Etat des dépenses quasi fiscales qui n’y figurent pas et continuent d’être assurées directement par des entreprises ou des banques publiques. Suivant en cela les vœux formulés par le gouverneur de la Banque de Syrie devant la Mission, le FMI souhaite que la banque centrale obtienne son indépendance opérationnelle et que soient introduits des bons du Trésor et créé un marché financier d’obligations et bons d’Etat. Il soutient la réforme des banques publiques mais met en garde contre le projet visant à différencier les niveaux de réserve exigés de celles-ci pour encourager les prêts en faveur des investissements. Il attire l’attention des autorités sur la nécessité d’améliorer la fiabilité des statistiques économiques. Le FMI juge aussi essentiel de rationaliser la hausse des investissements publics envisagés pour 2010.
La Syrie doit en effet non seulement continuer à adapter les règles applicables et obtenir leur mise en œuvre effective, mais aussi moderniser les infrastructures du pays, dont le mauvais état a de lourdes conséquences sur le développement économique. Les secteurs du bâtiment, de l’eau, de l’assainissement et de l’irrigation, des transports routiers, aériens, maritimes et urbains ont besoin d’investissements considérables.
Le Premier ministre, M. Naje Otri, a beaucoup insisté sur ces investissements au cours de son entretien avec plusieurs membres de la Mission. Il a indiqué que les 40 milliards de dollars d’investissement prévus par le dixième plan quinquennal 2005-2010 avaient été dépassés dès la fin 2009. La Mission économique française de Damas n’en arrive pas à la même conclusion : elle estime qu’une partie des investissements prévus a été différée et que le pays manque encore de moyens pour accélérer leur réalisation. Les priorités du onzième plan seront l’eau, l’énergie et l’habitat social, afin de combattre l’habitat illégal extrêmement répandu. Pour financer les investissements dans ces domaines, les autorités syriennes ont l’intention de chercher des modes de financement externes : recours à l’emprunt, émission de bons du Trésor et recours à des partenariats public-privé, récemment autorisés par une loi élaborée en coopération avec la France.
A l’issue de ses travaux, la Mission a la conviction que l’ouverture économique de la Syrie est irréversible et se poursuivra, même si c’est à un rythme moins rapide que celui souhaité par ses plus fervents partisans. Des hésitations se feront peut-être encore sentir, comme c’est le cas pour la signature de l’accord d’association et de partenariat avec l’Union européenne, mais le mouvement n’en sera pas pour autant stoppé. Il appartient donc à ceux qui le peuvent de favoriser cette évolution.
La Mission ne peut qu’encourager la poursuite des actions menées par le ministère français de l’économie notamment en faveur de la modernisation du système fiscal et des modes de financement public.
Elle souhaite aussi que la France appuie le processus devant conduire la Syrie à devenir membre de l’Organisation mondiale du commerce, d’autant que les Etats-Unis semblent désormais décidés à ne plus s’y opposer, et aide concrètement le pays à s’y préparer.
B – Le processus de rapprochement avec l’Occident
Lorsque les autorités syriennes prennent les premières décisions importantes pour libéraliser l’économie du pays, en 2004, la situation diplomatique de celui-ci n’est guère confortable. La rapide victoire militaire des Etats-Unis en Irak a fait craindre à la Syrie d’être la prochaine cible de la politique américaine. Surtout, le 2 septembre 2004 est adoptée la résolution 1559 du Conseil de sécurité des Nations unies, à l’initiative de la France et des Etats-Unis : elle demande notamment le retrait de toutes les troupes étrangères déployées au Liban, exigence qui vise directement les troupes syriennes. La mort de Rafic Hariri dans un attentat à la voiture piégée, le 14 février 2005, dont la responsabilité est immédiatement imputée à la Syrie, achève de fragiliser la position internationale de cette dernière, ce dont témoigne le retrait effectif de l’armée syrienne du Liban entre le début du mois de mars et la fin avril. La publication, le 20 octobre, d’un rapport de la commission d’enquête des Nations unies mettant en cause la Syrie dans la mort de l’ancien de Premier ministre la met de facto au ban de la communauté internationale.
Pourtant, après seulement quelques années de « purgatoire », la Syrie a largement engagé un processus de rapprochement de l’Occident, qui a déjà porté ses fruits. Il témoigne de l’habilité du président syrien et du rôle de pivot que ce pays continue à jouer dans la région. C’est à la France que la Syrie doit l’enclenchement de ce processus : après avoir directement contribué à sa mise à l’écart, notre pays a en effet été le premier à refaire un pas dans sa direction, entraînant les autres pays occidentaux à sa suite.
1) La France, premier pays à franchir le pas
La France avait joué un rôle important dans l’adoption de la résolution 1559. M. Jean-Claude Cousseran y voit l’aboutissement de « désaccords croissants sur la question libanaise » (10) entre Paris et Damas. Certains considèrent que cette résolution était un moyen pour la France de se rapprocher des Etats-Unis après la phase de tension provoquée par l’opposition française à la guerre en Irak. D’autres établissent un lien entre la dégradation des relations franco-syriennes, dont cette résolution est la traduction, et l’échec subi par Total en Syrie en 2003, lorsque le Président el-Assad lui avait préféré Pétrocanada pour l’attribution d’un champ gazier. Selon l’analyse de la mission économique à Damas, cet échec résultait surtout de la trop grande confiance de Total qui, comptant sur la qualité des relations politiques entre les deux pays pour gagner l’appel d’offres, avait fait la proposition la moins intéressante pour la Syrie (11).
Les relations bilatérales, tendues depuis le printemps 2004, se sont véritablement « glacées » au lendemain de l’assassinat de Rafic Hariri, dont les liens d’amitié avec le Président Chirac étaient bien connus. Mais, comme l’a souligné M. Patrice Paoli, le directeur de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient au ministère des affaires étrangères et européennes (12), il n’y avait jamais eu de vraie rupture bilatérale dans la mesure où les ambassadeurs étaient restés en poste, où des contacts avaient été maintenus et des émissaires envoyés, mais que les relations étaient en effet très tendues à certains moments. Les relations politiques étaient donc minimales – les parlementaires étaient par exemple invités par le ministère à avoir le moins de rapports possible avec des Syriens, y compris si ceux-ci n’étaient pas très proches du régime, et à éviter de se rendre dans le pays en mission officielle ; aucun ministre des affaires étrangères ou chef d’Etat français n’a effectué de déplacement en Syrie entre mai 2003 et août 2008 – mais la coopération culturelle n’a pas été pour autant interrompue.
M. Jean-Claude Cousseran, qui a été l’un de ces émissaires, a expliqué à la Mission, en octobre 2009, que « il y a deux ans, le Président Sarkozy a bien perçu qu’il y avait un moment politique à saisir si on voulait aboutir à quelque chose avec la Syrie » (13). C’est en effet à l’automne 2007, quelques mois après le début de son mandat, que le Président Sarkozy a souhaité que s’amorce un réchauffement des relations bilatérales.
M. Christophe Bigot, qui était alors le conseiller du ministre des affaires étrangères et européennes chargé notamment du Proche et du Moyen-Orient, a rappelé à la Mission que le ministre Bernard Kouchner avait été le premier à rencontrer son homologue syrien en octobre 2007. Il a ajouté que cette nouvelle orientation avait été facilitée par la création du Tribunal spécial pour le Liban (décidée par la résolution 1757 du Conseil de sécurité, adoptée le 30 mai 2007) : aucun retour en arrière sur ce sujet, qui « n’était pas négociable », n’était plus possible, ce qui garantissait que l’ouverture envers la Syrie ne se ferait pas au détriment de la constitution de ce tribunal (14). Il faut rappeler que cette première tentative a tourné court, fin 2007, avant d’être renouvelée avec plus de succès en 2008.
Les choses se sont accélérées à partir de juillet 2008. M. Patrice Paoli en a fait le récit suivant devant la Mission :
« Le 12 juillet 2008, la veille du premier sommet de l’Union pour la Méditerranée, s’est tenue à Paris une rencontre franco-syro-libanaise qui a permis de renouer les contacts au plus haut niveau entre les trois pays après une phase de refroidissement. Elle avait été rendue possible par les gages donnés par les autorités syriennes à Doha, en faveur du retour au calme au Liban après les vives tensions du printemps, et à travers les négociations sur le Golan avec Israël par l’intermédiaire de la Turquie. Le Président Bachar el-Assad était donc à Paris le 12 et le 13 juillet 2008. Son vice-premier ministre chargé des affaires économiques a aussi fait une visite à Paris afin de stimuler le développement des relations économiques bilatérales. En août 2008, M. Bernard Kouchner s’est rendu à Beyrouth et à Damas, avant que le Président Sarkozy n’effectue une visite à Damas les 3 et 4 septembre. Il y est ensuite retourné pendant la crise à Gaza. Le dialogue bilatéral est donc continu depuis juillet [2008]. » (15)
On voit donc que le climat avait changé au cours des mois qui ont précédé cette rencontre franco-syro-libanaise : en contribuant au retour au calme au Liban, en facilitant l’élection du Président Sleiman, après six mois de vacance à ce poste, et en reconnaissant la tenue de négociations indirectes sur le Golan avec Israël – le 21 mai 2008, sont annoncées simultanément la signature de l’accord interlibanais de Doha et l’existence de ces négociations –, la Syrie a montré qu’elle avait modifié sa posture et a créé les conditions nécessaires au début d’un rapprochement avec l’Occident. La France, alors fortement engagée dans le lancement de l’Union pour la Méditerranée, dans laquelle la Syrie avait toute sa place, lui a tendu la main.
M. Jean-Claude Cousseran a développé devant la Mission le raisonnement qui avait conduit la France à faire ce choix de l’ouverture : « Aujourd’hui, dans un contexte difficile, la Syrie semble sur la défensive, elle sait qu’elle ne peut affronter à la fois Israël, les Etats-Unis, la France et les Arabes modérés. Elle pourrait, si elle y trouve les moyens de préserver le régime, opter pour une attitude plus constructive. Si la Syrie a pu être dans le passé un acteur de la décomposition régionale, il faut peut-être la voir aujourd’hui comme un possible acteur d’un début de recomposition. Elle peut aider à une meilleure appréhension du difficile problème irakien, elle peut contribuer à une stabilisation au Liban. C’est en tout cas le pari que fait la diplomatie française en normalisant ses relations avec Damas et en invitant le président syrien à participer aux cérémonies du 14 juillet à Paris et au lancement de l’Union pour la Méditerranée. »
Cette main tendue n’était d’ailleurs pas inconditionnelle, puisqu’elle s’est accompagnée de l’établissement d’une feuille de route qui demandait à la Syrie d’avancer dans trois domaines :
– l’établissement de relations diplomatiques syro-libanaises ;
– un réengagement sur le dossier de la délimitation et de la sécurisation de la frontière syro-libanaise et sur celui des prisonniers et des disparus libanais en Syrie ;
– l’amélioration du contrôle de la frontière syro-irakienne.
Sans faire de triomphalisme ni entrer dans le détail de ces sujets, on peut souligner que des progrès – certes d’inégale importance – ont été enregistrés sur ces trois volets de la feuille de route :
– à l’issue d’un sommet bilatéral qui s’est tenu à la mi-août 2008, des relations diplomatiques ont été établies entre la Syrie et le Liban et les deux pays ont échangé des ambassadeurs, qui sont désormais en poste ;
– les commissions chargées des deux dossiers bilatéraux les plus épineux ont été relancées, même si aucune avancée concrète n’a encore été enregistrée ;
– les Etats-Unis eux-mêmes estiment que la surveillance de la frontière syro-irakienne s’est relativement améliorée.
M. Antoine Sfeir (16) a estimé que l’ouverture française en direction de la Syrie avait un autre objectif, la fin de la vague d’attentats qui frappait le Liban depuis des mois : cet objectif a été atteint, ce qui, d’ailleurs, selon lui, apporte la preuve de l’implication de la Syrie dans l’organisation de ces attentats. Il semble pourtant que, au moins en ce qui concerne les assassinats qui sont l’objet du Tribunal spécial pour le Liban – au premier rang desquels figure celui de Rafic Hariri –, l’enquête, qui se poursuit et reste couverte par le secret de l’instruction, s’oriente vers des responsabilités libanaises, ce qui n’exclut pas une influence occulte syrienne mais écarterait toute mise en cause directe du régime. La perspective de l’émission d’actes d’accusation à l’automne prochain ne semble pas inquiéter directement les autorités syriennes, alors que les responsables politiques libanais sont très préoccupés par les conséquences qu’elle pourrait avoir sur la stabilité du pays dans le cas où les accusations viseraient des personnalités ou des groupes libanais influents.
La Mission partage donc l’appréciation de M. Christophe Bigot qui parle d’un « pari réussi », tout en soulignant que les choix des Syriens sont encore tactiques et que la situation au Liban est loin d’être totalement normalisée (17).
b) Des relations bilatérales désormais très intenses
Depuis la seconde visite du Président Sarkozy à Damas, le 6 janvier 2009, dans le contexte de l’opération israélienne à Gaza, le ministre des affaires étrangères et européennes s’est à nouveau rendu en Syrie les 11 et 12 juillet 2009, puis fin mai 2010 ; le Premier ministre a fait de même les 19 et 20 février dernier. Entre-temps, M. Walid al-Mouallem, le ministre syrien des affaires étrangères, et le Président Bachar el-Assad étaient venus en France, respectivement en septembre et novembre.
Ces relations politiques denses se sont naturellement traduites par l’intensification de la coopération bilatérale et de nos relations économiques.
La Syrie reste un partenaire modeste pour la France : en 2008, elle était notre 73eme client (289 millions d’euros d’exportations) et notre 57eme fournisseur (696 millions d’euros d’importations). La France ne figure qu’en quinzième position parmi les fournisseurs de la Syrie, qui favorise les achats de Russie, Chine et Ukraine, ainsi que d’Italie et Malte pour ses approvisionnements en provenance d’Europe.
Nos échanges commerciaux sont largement conditionnés par les produits pétroliers, avec une forte élasticité liée aux cours mondiaux du brut. Le poste « combustibles et carburants » représente entre 93 et 96 % (94 % en 2009) de nos importations en provenance de Syrie.
Les chiffres pour l’année 2009 font apparaître une augmentation de nos exportations vers la Syrie de 5 % par rapport à 2008 (303 millions d’euros contre 289 millions d’euros) et une chute de 50 % du montant de nos importations en provenance de la Syrie (348 millions d’euros en 2009 contre 696 millions d’euros). Ce sont principalement aux produits agricoles et agroalimentaires, qui assurent le tiers du total, que nous devons la hausse de nos exportations, mais les ventes de nos équipements et de nos produits industriels, à l’exception des produits pétroliers raffinés et des matériels de transport, ont aussi progressé. Nos importations d’hydrocarbures syriens ont chuté de 55 %, tandis que nos achats de produits pétroliers raffinés ont augmenté de 35 %. Hors produits pétroliers, la France n’a importé des produits syriens qu’à hauteur de 16 millions d’euros. Le déficit de notre balance commerciale est ainsi ramené de 406 millions d’euros en 2008 à 45 millions d’euros en 2009.
Malgré les aléas de notre relation, en termes politiques, la coopération franco-syrienne a connu une activité soutenue en Syrie pendant ces dernières années. Elle compte parmi les plus actives du pays et s’articule autour d’une action forte en faveur de la formation des élites (bourses co-financées avec l’Etat syrien, réforme de l’administration), de l’enseignement du français et d’une action importante en matière de valorisation du patrimoine dans le domaine de l’archéologie.
La coopération universitaire constitue l’axe principal de notre coopération, la France étant le premier partenaire de la Syrie dans ce domaine avec un accent mis sur les disciplines scientifiques et professionnalisantes. A terme, 20 % des enseignants des universités syriennes auront été formés en France. Depuis 2003, à la demande des universités syriennes, des partenariats avec des universités françaises se développent, débouchant sur des masters conjoints. Notre pays est le deuxième pays d’accueil pour les étudiants syriens : ils sont plus de trois mille en France, majoritairement en masters et dans des disciplines scientifiques.
La France a une relation privilégiée en archéologie (premier partenaire de la Syrie) et en sciences humaines et sociales. La création, en 2003, de l’Institut Français du Proche-Orient (IFPO) a donné une dimension régionale à la recherche française. Elle procède de la fusion en un seul établissement de l’Institut français d’études arabes de Damas, créé en 1922, du Centre d’études et de recherches sur le Moyen-Orient contemporain, créé à Beyrouth en 1977, et de l’Institut français d’archéologie du Proche-Orient, lui aussi créé en 1977 à partir de l’Institut français d’archéologie de Beyrouth, fondé en 1946. L’IFPO, actuellement implanté dans trois pays (Jordanie, Liban, Syrie), est dirigé depuis Damas. En Syrie, il dispose aussi d’une antenne à Alep. Une délégation de la Mission s’est entretenue avec son directeur, M. François Burgat, et plusieurs de ses chercheurs spécialisés dans différents aspects de la société syrienne contemporaine.
Une dimension plus récente, mais qui prend de l’ampleur, de la coopération culturelle concerne les musées et implique notamment le Musée de Louvre. Mme Asma el-Assad s’occupe directement de ce projet, dont elle s’est entretenue avec la Présidente de la Mission, et qui lui tient tout particulièrement à cœur. Les demandes syriennes se sont progressivement élargies, comme le met en évidence l’encadré suivant.
LA COOPÉRATION ENTRE LE MUSÉE DU LOUVRE ET LA SYRIE Auditionné par la Mission le 20 janvier 2010, M. Henri Loyrette, président-directeur du musée du Louvre, a présenté cette coopération dans les termes suivants : « La coopération entre le département des Antiquités orientales du Louvre et la Syrie est ancienne : le premier effectue des fouilles de sites syriens depuis le XIXème siècle ; il assure aussi un partenariat scientifique. L’accord-cadre de coopération a été conclu en décembre 2006 entre le Louvre et la direction générale des antiquités et des musées syrienne. Il comporte trois volets : l’ouverture d’un nouveau chantier de fouille, la restauration à Paris de certaines pièces exposées en Syrie (comme des ivoires d’Alep) et un travail d’expertise sur le musée national de Damas. L’embellie des relations bilatérales s’est traduite par la visite à Paris de Mme el-Assad en juillet 2008. A cette occasion, elle a demandé l’aide et les conseils du Louvre en vue d’une rénovation globale du musée de Damas. Mais, en janvier 2009, elle a élargi sa requête : le Louvre est appelé à apporter ses conseils pour la rénovation du musée dans son ensemble et pour la réorganisation de tout le paysage des musées et des sites syriens (il y a beaucoup de musées de sites). Elle a en effet été très impressionnée par la capacité du Louvre à répondre à toute sorte de demandes, y compris en matière d’administration des musées. Depuis lors, les missions sur place se sont multipliées et une équipe de conservateurs et de documentalistes a été constituée, sous l’autorité de MM. Hervé Barbaret, administrateur général du musée, et Benoît de Saint-Chamas, conseiller diplomatique du président-directeur. Côté syrien, Mme el-Assad a aussi constitué une équipe à la tête de laquelle se trouve son directeur de cabinet. » Le travail sur la réorganisation du paysage muséal syrien comportait trois phases : la première a consisté à dresser un état des lieux du système syrien actuel ; la deuxième, finie en décembre 2009, a permis de définir des concepts-clés pour la recomposition de ce paysage ; la troisième portait sur l’élaboration d’une vision commune sur la rénovation du musée national de Damas et la place des autres musées et sites. Elle s’est achevée début mars 2010 par la remise à Mme el-Assad d’un rapport intitulé Une vision pour l’avenir des musées syriens. Parallèlement, le 20 février 2010, M. François Fillon a signé à Damas, avec le Premier ministre syrien, un accord bilatéral relatif à la coopération culturelle qui place la coopération conduite par le Louvre au centre de son dispositif. Il inclut un programme indicatif pluriannuel d’actions (2010-2015) dont l’un des trois volets est consacré à la coopération dans le domaine des musées et des patrimoines. Le Louvre sera amené à participer aux cinq actions qu’il regroupe : – définition d’une stratégie globale de rénovation du paysage muséal syrien ; – expertise pour la rénovation du musée national de Damas ; – présentation aux publics français et syriens des collections retraçant l’art et l’histoire des deux pays ; – gouvernance ; – sauvegarde et mise en valeur des sites archéologiques. |
Notre coopération culturelle en Syrie a pour objectif d’atteindre de nouveaux publics et de pérenniser la transmission de la francophonie. Elle s’inscrit également dans une logique d’influence en direction des élites et futures élites en promouvant le débat d’idées. Mme el-Assad, bien qu’elle s’exprime peu en français et ait été pensionnaire dans une école privée britannique, a confié à la Présidente de la Mission qu’elle souhaitait que l’enseignement en français s’élargisse. Elle a inscrit ses enfants au centre culturel français de Damas.
Notre coopération administrative repose essentiellement sur l’Institut d’administration publique (INA), créé en 2002, et fait l’objet d’un partenariat avec l’ENA. L’INA a ouvert ses portes en janvier 2004 avec une première promotion de cinquante étudiants. Le ministère des finances mène aussi plusieurs programmes visant à partager son expertise avec les autorités syriennes.
Un nouveau domaine a été ouvert à la coopération bilatérale avec la signature, à l’occasion de la récente visite officielle de M. François Fillon, d’une « déclaration d’intention » visant à promouvoir les échanges et la coopération agricoles entre les deux pays. La Syrie pourra ainsi bénéficier de l’expertise française dans les projets agricoles et agro-alimentaires qu’elle a décidé de lancer, et particulièrement en matière de formation, laquelle sera dispensée en France comme en Syrie.
Enfin, depuis l’automne dernier, l’Agence française de développement (AFD) a ouvert un bureau à Damas. M. Etienne Viard, directeur du département Méditerranée-Moyen-Orient de l’AFD (18), a expliqué à la Mission que l’effectif de ce bureau comprenait un expatrié, un volontaire international et un employé local, encore en cours de recrutement en décembre dernier. On trouve le même format en Jordanie, alors qu’il y a quatre agents en Egypte. La révision générale des politiques publiques recommande en effet à l’AFD de s’interroger sur son dispositif local en agence lorsque celui-ci comporte plus de trois expatriés. C’est pourquoi l’essentiel du travail d’évaluation des projets est effectué par des missionnaires venus de Paris. A titre de comparaison, une cinquantaine de personnes travaillent en Syrie pour l’équivalent allemand de l’AFD. Les priorités de l’action de l’Agence en Syrie et les premiers projets auxquels elle va participer sont présentés dans l’encadré de la page suivante.
Les responsables de l’AFD entendus par la Mission ont souligné la modestie des moyens non seulement humains mais aussi financiers qu’ils peuvent mettre en œuvre en Syrie. Par exemple, pour l’ensemble du bassin méditerranéen, l’Agence ne peut accorder que 35 millions d’euros de subventions dont 25 millions d’euros sont destinés aux Territoires palestiniens. Par ailleurs, pour la même zone, elle ne dispose que de 130 millions d’euros pour financer la bonification de prêts en faveur d’un nombre croissant d’Etats – la Syrie et l’Irak étant de nouveaux bénéficiaires. Cette somme lui permet d’accorder environ 850 millions d’euros de prêts par an : pour que ce volume de prêt puisse augmenter, l’AFD est contrainte de diminuer le taux de bonification qu’elle accorde à chacun, aussi les taux qu’elle propose sont-ils actuellement voisins de 3,5 %. L’agence allemande est pour sa part autorisée à prêter en Syrie à des taux très bas (de l’ordre de 0,5 %), sur de longues durées, pour des projets relatifs à l’eau et à l’assainissement. Devant la modestie de ces moyens, l’AFD est donc amenée à travailler en collaboration avec d’autres bailleurs de fonds, notamment allemands ou communautaires, ce qui n’est pas du tout une mauvaise chose en soi, mais donne moins de visibilité à ses actions.
Au cours de l’entretien que lui a accordé Mme Asma el-Assad, la Présidente de la Mission a eu le sentiment que celle-ci tenait l’AFD en haute estime et attendait beaucoup de son action. Conscient de ces attentes, l’Ambassadeur de France a fait part à la Mission de sa préoccupation devant la faiblesse des moyens de l’AFD en Syrie, craignant que les autorités syriennes soient déçues. M. Etienne Viard n’a pas écarté ce risque et a reconnu que les Syriens attendaient beaucoup de l’expertise française. Mais il a précisé que ces derniers espéraient surtout que l’intervention de l’AFD favoriserait la venue d’entreprises françaises, qui se sentiraient plus en sécurité du fait de sa présence sur place, même si elles ne recevaient pas de financements. La COFACE vient d’ailleurs de relever la notation de la Syrie.
L’ACTION DE L’AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT EN SYRIE Les priorités identifiées pour l’action de l’AFD en Syrie sont : – le développement des PME, destinées à contribuer à la croissance économique, à la création de valeur ajoutée locale et d’emplois, notamment en zone rurale, tant pour les marchés intérieurs que régionaux et internationaux, – le développement urbain avec une priorité accordée aux infrastructures de transport et aux problèmes environnementaux, tels que l’assainissement et le traitement des déchets, dans une approche intégrée incluant l’habitat social et l’adduction d’eau, – le financement de projets d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique destinés à pallier la réduction prévue à terme de la production nationale de pétrole et à promouvoir la production et la consommation d’énergie propre, dans le cadre notamment des initiatives relevant de l’UpM. Plusieurs missions programmées au cours de l’année 2009, avec l’appui de la mission économique de Damas, ont déjà permis de progresser sur certaines thématiques : – l’AFD a participé, aux côtés du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, à la mission transport qui s’est déroulée du 17 au 22 octobre 2009, avec une attention particulière accordée aux transports urbains. Un premier projet pour l’AFD dans le domaine des transports urbains devait être un cofinancement avec la Banque européenne d’investissements (BEI) du projet de métro de Damas pour lequel une demande de financement avait été adressée à la France : l’AFD se proposait de financer à hauteur de 50 millions d’euros ce projet dont la première phase était évaluée à 700 millions d’euros et auquel la Réserve pays émergents (RPE) (19) devait contribuer pour 200 millions d’euros ; à la suite de changements dans les priorités des autorités syriennes, ce projet a depuis été remis en cause ; – une mission de l’AFD dans le domaine de l’eau et de l’assainissement s’est déroulée du 25 au 29 octobre 2009 avec pour objectif d’identifier un premier projet potentiel dans ce secteur d’excellence pour le savoir-faire français, en coordination si possible avec les grands bailleurs européens (Banque Européenne d’Investissement ou KfW (20) allemande). Un premier projet dans le domaine de la modernisation des réseaux de distribution est envisageable dans la banlieue de Damas. L’AFD souhaite plus largement s’investir sur la thématique des collectivités locales, à la croisée de nombreuses initiatives. Le ministre syrien de l’administration locale a été reçu à l’AFD le 20 novembre dernier. Dans ce projet, l’AFD pourrait cofinancer avec la BEI des investissements prioritaires s’intégrant dans un projet subventionné par l’Union européenne. Les priorités sont l’assainissement, le traitement des déchets et la signalisation urbaine. Sur un investissement de 100 millions d’euros, l’AFD pourrait intervenir à hauteur de 20 millions d’euros et la BEI pour 50 millions d’euros ; – une mission d’identification dans le domaine du développement rural a eu lieu en juin 2009, dont l’une des premières retombées sera l’instruction d’un projet d’appui aux filières d’exportation (huile d’olive, arboriculture). L’idée est d’intervenir dans un secteur touché par les réformes en cours, en faveur d’une plus grande efficacité de l’irrigation et du financement d’une banque publique agricole syrienne. Pour l’heure, le projet n’est pas encore bouclé et son montant n’est pas évalué. Source : audition du 2 décembre 2009. |
La France a ainsi aujourd’hui des relations denses et diversifiées avec la Syrie. La cordialité retrouvée des relations politiques suscite beaucoup d’attentes du côté syrien en termes d’investissements et d’actions de coopération. Si les premiers dépendent surtout de décisions que les entreprises prennent en fonction de leur appréciation du marché syrien, les secondes sont subordonnées aux moyens que l’Etat décide de leur consacrer, même si des cofinancements privés, notamment en provenance des entreprises françaises implantées en Syrie, peuvent venir abonder ces moyens dans une certaine mesure.
Or, la Mission constate que ces crédits publics restent très contraints. La situation difficile que connaissent actuellement nos finances publiques y est évidemment pour beaucoup. Mais la Syrie n’apparaît pas comme un pays prioritaire pour le financement des actions de coopération françaises. Ceux qui ont la charge de les mener se trouvent ainsi confrontés au gouffre qui sépare les engagements politiques et les moyens censés permettre de les mettre en œuvre. Par exemple, comment le Musée du Louvre pourra-t-il satisfaire aux demandes syriennes d’aide pour la réorganisation en profondeur du musée national de Damas sans moyens supplémentaires ? Devra-t-il renoncer aux actions, bien plus modestes, qu’il mène en direction d’autres pays ? Sera-t-il contraint de détourner une partie de son personnel de ses fonctions parisiennes ? Aucune de ces solutions n’est évidemment satisfaisante.
2) Le rapprochement, à confirmer, avec l’Union européenne
La Syrie est, aujourd’hui encore, le seul pays du bassin méditerranéen, à n’être pas lié à l’Union européenne par un accord d’association et de partenariat. Les relations entre elles restent donc régies par l’accord de coopération de 1977, lequel a conduit à l’ouverture d’une délégation de la Commission à Damas en 1979. La Syrie bénéficie d’actions de coopération dans le cadre de l’Instrument de la politique européenne de voisinage, même si l’absence d’accord d’association en vigueur l’empêche d’en profiter pleinement, et participe depuis l’origine, en 1995, au processus de Barcelone.
Les relations entre l’Union européenne et la Syrie ont suivi, quoique de manière moins passionnelle, les fluctuations des relations franco-syriennes. En effet, la France a joué un rôle important aussi bien dans le « gel » de l’accord d’association à partir de fin 2004 que dans le lancement de l’Union pour la Méditerranée, auquel la Syrie a pleinement participé.
a) La question de la signature de l’accord d’association
L’accord d’association entre l’Union européenne et la Syrie a été paraphé le 19 octobre 2004, après une accélération des négociations souhaitée par la Syrie. Comme plusieurs personnes l’ont fait observer à la Mission, la Syrie était alors très favorable à la conclusion de cette discussion car elle s’efforçait de battre en brèche l’ostracisme américain, après l’adoption de sanctions par le Congrès en novembre 2003 et l’adoption de la résolution 1559. Après avoir d’abord été réticente, elle a accepté de parapher l’accord négocié. Celui-ci est le plus abouti de tous ceux qui ont été conclus avec les Etats du processus de Barcelone. Il comporte notamment des stipulations relatives à la non-prolifération, aux droits de l’Homme, à la lutte contre le terrorisme, au démantèlement complet des barrières tarifaires sur les produits agricoles, à la propriété intellectuelle, à la promotion des investissements européens selon la clause de la nation la plus favorisée ou le traitement national.
Mais la poursuite de ce processus a été entravée par l’hostilité de certains pays européens, dont la France, qui ont obtenu en avril 2005 sa suspension aussi longtemps que la situation politique n’aurait pas évolué au Liban.
On remarquera que cette situation de blocage au niveau communautaire n’a pas empêché la Syrie de maintenir ses rapports avec certains Etats européens avec lesquels elle entretenait d’importants échanges commerciaux, comme l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne. Elle est même parvenue à développer avec eux une coopération économique et sociale bilatérale qui n’exigeait aucune contrepartie politique. L’Allemagne a consolidé sa place sur le marché syrien pendant que les entreprises françaises renonçaient à y entrer ou voyaient leurs contrats annulés. Les ministres des affaires étrangères des trois pays européens précités se sont rendus à Damas dès l’été 2006.
Mais il a fallu attendre la participation du Président el-Assad au sommet de l’UpM, pour qu’une relance du processus de négociation de l’accord d’association soit envisagée. Le document paraphé en 2004 a été révisé afin de prendre en compte l’entrée de nouveaux Etats membres dans l’Union européenne et l’évolution des tarifs douaniers syriens. Cette nouvelle version de l’accord a été paraphée le 14 décembre 2008. Les Etats membres ont ensuite donné leur accord pour que la signature de l’accord se déroule le 27 octobre 2009. C’est alors que, à la surprise générale, les autorités syriennes ont demandé le report de sa signature.
Lorsque plusieurs membres de la Mission se sont rendus en Syrie, du 1er au 6 novembre dernier, le refus syrien de signer était encore tout récent et il a logiquement été l’un des principaux thèmes abordés pendant les entretiens. Plusieurs séries de raisons peuvent être distinguées.
La première, qui semble futile mais ne l’est pas, concerne la forme prise par « l’invitation » à la cérémonie de signature formulée par l’Union européenne en direction de la Syrie. Le représentant de la Commission à Damas, M. Vassilis Bontossoglou, a lui-même reconnu qu’une « maladresse » avait été commise par l’Union. Il s’agissait pour cette dernière de régler le dossier avant les mois de novembre et de décembre qui s’annonçaient très chargés à cause de l’achèvement de la préparation de l’entrée en vigueur de l’accord de Lisbonne.
Mais la Commission n’a informé les autorités syriennes de cette date qu’environ un mois avant, ce qui est apparu trop court et a donné l’impression qu’il s’agissait d’une convocation plus que d’une invitation. Cet aspect a été souligné par le Premier ministre syrien qui a insisté sur la nécessité de veiller à l’égalité entre partenaires dans un tel accord. Il a résumé la situation dans les termes suivants : « Entre 2004 et 2009, l’Union n’accordait aucun intérêt à la Syrie puis, il y a un mois, elle la convoque soudainement pour signer l’accord : ce n’est pas acceptable. Les Syriens, comme les Français, sont attachés au respect de leur dignité. » Le président de l’Assemblée du peuple a pour sa part parlé d’une « mise en demeure qui a heurté la fierté syrienne ». Il a en outre évoqué des obstacles « technocratiques », la commission des affaires juridiques de l’Assemblée du peuple demandant du temps – il parlait en novembre de deux ou trois mois – pour examiner le projet d’accord et proposer quelques changements.
Au-delà de cette question de fierté nationale blessée, les diplomates européens en poste à Damas voient la signature de l’accord comme l’enjeu d’un rapport de force interne entre conservateurs et progressistes. Ils estiment que les progressistes l’emporteront s’ils parviennent à obtenir davantage de contreparties financières à l’issue des discussions qui ont été relancées après le refus syrien de signer.
La question des contreparties financières est en effet l’un des points de l’accord dont les autorités syriennes disent qu’ils posent problème. Le Premier ministre insiste sur l’importance des réformes économiques intervenues entre 2004 et aujourd’hui, dont l’accord doit tenir compte. Il estime ainsi que la suppression des droits de douane sur les marchandises entrant en Syrie privera le budget syrien de 14 milliards de dollars de recettes chaque année, perte qui doit être compensée dans la mesure où les dépenses ne peuvent être réduites du même montant et où les autres recettes du budget – notamment les recettes pétrolières et les profits des entreprises publiques – sont aussi orientées à la baisse.
Une étude est en cours pour déterminer quels sont les secteurs qui subiront le plus les effets de la concurrence, afin d’envisager une forme de compensation.
Le traitement des produits agricoles gêne aussi les autorités syriennes car l’accord introduit des quotas pour certains produits syriens, mais pas pour les produits européens, ce qui fait craindre que ces derniers soient utilisés pour faire du dumping, comme cela a été observé en Algérie et en Jordanie après l’entrée en vigueur de leur accord d’association. Le vice-premier ministre chargé des affaires économiques a ainsi indiqué aux membres de la Mission qui l’on rencontré en mars dernier qu’il souhaitait l’augmentation de certains de ces quotas, notamment ceux concernant l’huile d’olives et les agrumes.
Même si on peut rappeler à juste titre que le même vice-premier ministre a paraphé l’accord révisé a minima en décembre 2008, sans trouver alors rien à y redire, les arguments économiques mis en avant par les autorités sont considérés comme au moins partiellement fondés par les diplomates européens et les observateurs. Il faut en effet reconnaître que les ajustements techniques opérés en 2008 ont été menés rapidement afin d’obtenir le nouveau paraphe sous présidence française et que l’accord comporte de nombreux avantages asymétriques au profit de l’Union européenne. Il est donc légitime que les autorités syriennes expriment des inquiétudes, d’autant que, si le délai de ratification par les Vingt-sept laisse le temps de la réflexion, l’accord de commerce et d’accompagnement entrera en vigueur dès la signature, après le seul avis conforme du Parlement européen.
Le représentant de la Commission a indiqué que les Syriens avaient tendance à surévaluer le coût de l’accord pour les finances publiques en y intégrant les conséquences des réformes économiques, qui ont aussi un impact sur les recettes douanières. La Commission estime ainsi les pertes de recettes dues à l’accord entre 500 et 600 millions d’euros sur cinq ans, quand les Syriens les évaluent à 2 milliards de dollars, c’est-à-dire à nettement plus du double. L’ambassadeur du Royaume-Uni a souligné quant à lui que l’accord d’association aurait des conséquences beaucoup moins fortes que celle de l’accord économique conclu avec la Turquie, lesquelles ne donnaient pourtant pas lieu à polémique. Surtout, les autorités syriennes s’inquiètent des pertes de recettes sans tenir compte des gains que l’économie syrienne retirera de l’application de l’accord. D’abord, l’effet volume devrait largement compenser la baisse des taux de douane ; ensuite, l’intérêt de l’accord pour l’économie syrienne à moyen et à long termes est incontestable. Mais l’ambassadeur de France a reconnu que les mesures d’accompagnement prévues par l’accord ne s’élevaient qu’à 150 millions d’euros quand la Jordanie, trois fois moins peuplée que la Syrie, s’était vu accorder 250 millions d’euros.
Selon l’analyse effectuée par le service économique de l’ambassade de France à Damas, en première approche, la substitution de produits européens bon marché, notamment agricoles, à des produits syriens aura un impact négatif sur la balance commerciale syrienne et sur les secteurs les plus fragiles de l’économie locale, étant donné les écarts considérables de productivité entre l’Union européenne et la Syrie, et profitera plus aux consommateurs qu’aux producteurs. En revanche, les craintes relatives à la baisse des recettes douanières sont à relativiser, surtout à moyen terme : d’une part car les recettes douanières n’ont jusqu’à présent représenté qu’une part relativement peu importante des recettes du budget de l’Etat (entre 6 % en 2007 et 7,5 % en 2009) ; d’autre part, car la balance commerciale syrienne a déjà très largement bénéficié des baisses des droits de douane et de la limitation des interdictions d’importation, avec 22 % de croissance en 2007 et 42 % en 2008. Enfin, à plus long terme, la Syrie tirera profit des économies d’échelle liées à la taille des marchés, de l’amélioration de l’efficience liée à la concurrence et de l’augmentation des investissements étrangers – et notamment européens – grâce à la sécurisation du climat des affaires.
Un chercheur de l’Institut de relations internationales et stratégiques entendu par la Mission, M. Barah Mikaïl, a évoqué une autre raison susceptible d’expliquer les réticences syriennes, qui peut apparaître paradoxale mais mérite néanmoins attention, eu égard au souci d’indépendance qui anime le régime syrien. Selon son analyse, « les Syriens craignent qu’en allant trop loin dans la réalisation de projets avec l’Union européenne, ils deviennent dépendants de celle-ci sur le plan politique. Ils préfèrent se priver d’une partie de l’aide européenne pour éviter cela. Ces réticences s’expliquent par les exemples jordanien et égyptien : devenus dépendants de la manne financière américaine, ces deux pays se voient parfois contraints d’adopter des positions politiques qui permettent de la maintenir, même si elles déplaisent à leur opinion publique. » (21)
Il faut enfin en venir à la dimension plus politique de l’accord, celle qui se rapporte aux droits de l’Homme. La question des droits de l’Homme en Syrie sera traitée au fond plus loin. Ici sera seulement analysé comment la prise en compte de cette question dans la négociation de l’accord d’association a contribué à justifier la demande syrienne de reporter sa signature.
Il faut d’abord rappeler que l’insistance de certains Etats européens, en particulier les Pays-Bas, sur ce point a failli compromettre la décision communautaire en faveur de sa signature. Sur proposition française, il a finalement été décidé de lui consacrer une déclaration à part, dont il n’aurait pas dû être fait publicité, en plus des stipulations présentes dans tous les accords de ce type – mais qui n’ont jamais été mises en œuvre avec quelque pays que ce soit : les Etats membres y réaffirment leur intention de rester attentifs aux évolutions de la Syrie dans ce domaine et de suspendre l’application de l’accord en cas de problème. Cette déclaration politique n’a pas de valeur juridique, mais elle est interprétée comme l’expression d’une plus grande sévérité de l’Union vis-à-vis de la Syrie qu’à l’égard de ses autres partenaires.
Deux autres éléments de contexte, très prégnants à l’automne dernier, sont aussi à prendre en compte : l’attitude très prudente des Etats européens vis-à-vis des suites à donner au rapport Goldstone, qui entretient l’idée qu’il y a un « double standard » des Européens en matière de droits de l’Homme, qu’Israël pourrait bafouer en toute impunité mais dont on ferait une condition pour l’approfondissement des relations avec la Syrie ; la multiplication des atteintes aux droits de l’Homme en Syrie au cours des semaines précédant la date à laquelle la signature de l’accord aurait dû intervenir : par exemple, le 14 octobre 2009, M. Haitham al-Maleh, avocat et célèbre défenseur des droits de l’Homme bien connu des ambassades occidentales, a été arrêté pour des charges liées à la sécurité nationale à la suite d’un entretien accordé plusieurs semaines auparavant à une chaîne de télévision étrangère. Les diplomates européens rencontrés en novembre à Damas par la Mission ont estimé que ces arrestations n’avaient par de lien direct avec le report de la signature de l’accord d’association car elles sont décidées par les seuls services de renseignement. Elles n’en sont pas moins du plus mauvais effet vis-à-vis des Etats européens.
Cela n’empêche nullement les autorités syriennes de demander la révision des stipulations de l’accord relatives aux droits de l’Homme. Le Premier ministre les a déclarées inacceptables, mettant en avant le traitement selon « deux poids, deux mesures » appliqué à son pays, évoquant l’existence de violations de ces droits en Europe même et insistant sur le refus de toute ingérence dans les affaires intérieures syriennes, par respect de sa souveraineté. D’autres interlocuteurs de la Mission ont été moins radicaux : pour le président de l’Assemblée du peuple, ce sujet n’est pas problématique ; quant au vice-premier ministre chargé des affaires économiques, il estime que la Syrie ne s’oppose pas à ce que ce sujet soit pris en compte dans l’accord, dès lors que les stipulations de celui-ci n’entraînent pas d’interférence dans les affaires intérieures syriennes. La question du traitement des droits de l’Homme dans l’accord reste l’un des thèmes des discussions actuellement en cours entre la Syrie et l’Union européenne.
Quelles sont, dans ces conditions, les perspectives de signature de l’accord d’association ? En novembre dernier, le président de l’Assemblée du peuple souhaitait devant la Mission que la signature intervienne en janvier. Ce vœu n’était guère réaliste puisque les études menées par les autorités syriennes sur les conséquences économiques et financières de l’accord devaient prendre plusieurs mois. Prudents, les diplomates européens ne faisaient aucune prévision. Ils avaient tendance à annoncer un marchandage sur les contreparties qui prendrait un certain temps. Seul le représentant de l’ambassade d’Allemagne était plutôt pessimiste sur l’issue finale, mettant en avant la préférence syrienne pour les accords bilatéraux avec les Etats européens pris séparément et la montée d’un discours sur la défense de l’intérêt national. Les autres voulaient croire à une issue positive, grâce à la ferme volonté des défenseurs de l’ouverture de la Syrie et parce que la signature de l’accord améliorerait l’image internationale du pays. Aucun d’entre eux ne s’avançait sur la date possible de la signature, ce qui était prudent puisqu’elle n’est toujours pas intervenue plus de sept mois après.
Le directeur général adjoint des relations extérieures à la Commission, avec lequel la Présidente s’est entretenue par téléphone au début du mois de juin, regrettait que les autorités syriennes n’aient pas encore fait parvenir les résultats de leurs études. Le Président el-Assad et le ministre des affaires étrangères syrien ont annoncé que, une fois ce travail achevé, ils inviteraient les représentants de la Commission à venir en discuter à Damas. Si les autorités syriennes décident finalement de rouvrir les négociations, la Commission devra obtenir un nouveau mandat des Etats membres pour négocier et les réticences de certains d’entre eux risquent alors de resurgir. Même dans le meilleur des cas, la signature de l’accord ne pourrait pas intervenir avant un long délai supplémentaire.
En dépit de ces retards, la Mission reste optimiste en ce qui concerne la signature de l’accord d’association. Dans la mesure où certaines stipulations sont incontestablement déséquilibrées au détriment de la Syrie, des ajustements apparaissent nécessaires. Elle souhaite que l’Union fasse des concessions, notamment en matière agricole et de compensations financières. La signature de l’accord est dans son intérêt, à la fois d’un point de vue économique et d’un point de vue politique, car elle constituerait un succès pour les progressistes syriens.
b) Une participation prometteuse à l’Union pour la Méditerranée
Parallèlement à la relance du processus devant déboucher sur la signature de l’accord d’association, a été conduit le projet d’Union pour la Méditerranée, auquel participent quarante-trois Etats, dont la Syrie. Le Président Bachar el-Assad faisait ainsi partie des nombreux chefs d’Etat et de gouvernement réunis au Sommet de Paris du 13 juillet 2008, à l’invitation du Président Sarkozy.
Lors de son audition devant la Mission, Mme Lamia Chakkour, ambassadrice de Syrie en France (22), a souligné la communauté de vue entre la France et la Syrie sur l’Union pour la Méditerranée. Elle estime que « la Syrie a contribué à la dynamique et à la valorisation du concept ». Selon elle, la Syrie est en effet persuadée que les liens forts qui unissent les pays de la Méditerranée constitueront un facteur de stabilité et de succès pour les projets lancés dans la région en concertation avec l’Union européenne. Elle estimait néanmoins, en septembre 2009, que des questions restaient à régler sur le cadre institutionnel de la présidence et du secrétariat de l’UpM.
Cette réserve est loin d’être anodine. En effet, comme M. Serge Telle, notre ambassadeur chargé de l’initiative sur l’Union pour la Méditerranée, l’a exposé devant la Mission, « si le Sommet de Paris a symbolisé la réintégration de la Syrie dans la communauté internationale, et donc une forme de renouveau, une question demeure : jusqu’où la Syrie peut-elle accepter la normalisation rampante de ses relations avec Israël, qu’implique leur participation à l’UpM, sans progrès dans le processus de paix ? Cette extrême sensibilité explique que la Syrie se raidit dès que la règle de l’unanimité apparaît mise en cause. »
Il a reconnu que « la Syrie, toujours à la recherche d’un équilibre entre son désir d’influence et sa capacité de nuisance, n’avait pas utilisé cette dernière dans le cadre de l’UpM : elle n’a pas bloqué l’octroi à Israël d’un poste de secrétaire général adjoint ; elle a créé un certain nombre de problèmes de procédure, mais a finalement accepté le nom d’Union pour la Méditerranée, auquel elle s’était d’abord opposée. En fait, la Syrie avance avec l’ensemble des membres car elle a conscience des bénéfices qu’elle peut en tirer, du point de vue politique – normalisation de ses relations avec l’Union européenne, relance de l’accord d’association et de partenariat, même s’il n’a pas encore été signé – que du point de vue économique grâce à la réalisation de projets à même de stimuler le développement économique. En résumé, sur ce dossier, la Syrie cherche plus à acquérir de l’influence qu’à user de sa capacité de nuisance. » (23)
En dépit de l’intérêt soutenu que les membres de la Mission, et en particulier sa Présidente et son Rapporteur, portent à l’UpM, force leur est de constater qu’elle n’a été que très rarement abordée spontanément par ses interlocuteurs syriens, sauf par l’ambassadrice de Syrie en France. M. Christophe de Margerie, directeur général de Total (24), a avoué que le Président el-Assad n’avait jamais évoqué ce sujet en sa présence. Le président de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée du peuple a estimé que l’UpM ne pourrait pas continuer si les Européens persistaient à avoir une position aussi favorable à Israël qu’à propos du rapport Goldstone. Il a rappelé que, même si l’un des secrétaires généraux adjoints était israélien, il ne pourrait se rendre ni en Syrie ni au Liban et ne pourrait donc pas remplir son rôle. Les chercheurs du centre Al Charq, un think tank très proche des autorités syriennes, ont aussi une analyse politique des objectifs poursuivis par l’UpM, qu’ils ont exposés à plusieurs membres de la Mission : selon eux, le but des Européens est de contrer le rapprochement en cours entre la Syrie, la Turquie et l’Iran, qui est défavorable aux intérêts d’Israël.
On mesure ainsi à quel point les relations syro-israéliennes – ou plutôt l’absence de telles relations – pèsent sur la participation de la Syrie à l’UpM au niveau politique. Le pays a néanmoins fait part de son intérêt pour la réalisation d’un certain nombre de projets qui pourraient bénéficier de financements dans ce cadre.
Le Sommet de Paris a permis de définir les grands projets régionaux : la dépollution de la Méditerranée, les autoroutes maritimes et terrestres, la protection civile, les énergies de substitution, le plan solaire méditerranéen, l’initiative européenne de développement des entreprises, l’enseignement supérieur et la recherche. Ainsi, de multiples projets en matière économique sont en cours : tout d’abord, la création d’un mécanisme d’échange souple, efficace et favorable au développement des affaires pour plus de transparence sur les opportunités commerciales et d’investissement ; ensuite, la création d’une initiative méditerranéenne pour le développement des entreprises ; enfin, la négociation d’une charte de promotion et de protection des investissements. Les impacts de cette union se traduisent par de nombreux aspects et des projets d’investissement à long terme en Syrie.
La Syrie est surtout concernée par les volets relatifs aux énergies renouvelables, à la question de l’eau et aux transports. Elle souhaiterait aussi le développement d’un volet agricole.
Sur l’ensemble des pays du sud de la Méditerranée, l’UpM s’est fixé pour objectif d’installer d’ici 2020, 20 GW de capacité de production d’électricité d’origine renouvelable pour faire face à une demande qui croîtra de 20 %, pour un montant estimé entre 38 et 46 milliards d’euros. Le développement de la production énergétique constitue un enjeu essentiel car le manque d’énergie constitue un frein évident à la réalisation d’investissements industriels. En Syrie, le Plan directeur des énergies renouvelables syrien (2001-2011) retient comme objectif que les ressources renouvelables contribuent à hauteur de 3 % de la demande totale énergétique. Par conséquent, plusieurs projets phares sont actuellement l’objet d’études de faisabilité dans le cadre du plan solaire méditerranéen. Ils visent à construire une centrale thermodynamique à concentration solaire à Palmyre, pour 350 millions d’euros, une centrale solaire de 10 MW, pour un coût estimé de l’ordre de 430 millions d’euros, et une centrale éolienne pilote de 6 MW dans la région de Homs, à 10 millions d’euros ; s’y ajoute le projet d’extension de la centrale électrique de Deir Ez Zor, qui atteindrait ainsi 750 MW, et pour laquelle la BEI prêterait 200 millions d’euros sur un coût total de 600 millions d’euros. D’autres projets visent à établir des liaisons énergétiques entre plusieurs pays de la région, dont la Syrie : ils portent d’une part sur l’interconnexion des réseaux d’électricité entre la Syrie, la Jordanie, l’Irak, les Territoires palestiniens et l’Egypte, d’autre part sur le prolongement du gazoduc existant entre l’Egypte et la Jordanie en direction de la Syrie, du Liban et de la Turquie.
Dans le secteur de l’eau, de multiples projets ont été proposés dans le bassin méditerranéen, pour plus de 3,5 milliards d’euros au total. Pour la Syrie, particulièrement confrontée au problème de la sécheresse, le programme SustainableMed a été adopté et porte sur la gestion des ressources des bassins côtiers et de l’Oronte pour un coût de 3,3 millions de dollars. De plus, a été adopté le 23 novembre 2009 lors de la conférence de Lyon, le schéma directeur urbain de la gestion de l’eau à Lattaquié et Hama.
Suite à la conférence ministérielle qui s’est tenue fin 2008 en Jordanie, une nouvelle stratégie a été élaborée afin de préserver les ressources hydriques, et de les diversifier. Pour le traitement des eaux usées, le Xème plan (2006-2010) ambitionnait d’équiper l’ensemble du territoire d’un réseau de stations d’épuration (actuellement insuffisant) pour pouvoir faire face à la demande croissante en eau, et le ministère de l’irrigation alloue un budget de 89 milliards de livres syriennes pour financer les différents projets dans le secteur de l’irrigation.
En ce qui concerne la dépollution, il existe certains obstacles : par exemple, l’exploration sous-marine nécessite l’autorisation du préfet maritime. De plus, les égouts et les déchets industriels se déversent directement dans la mer, particulièrement en Syrie. Ainsi, plusieurs mesures ont été adoptées pour remédier à ce problème d’envergure, comme le Waste Water Treatment Plan (WWTP), qui devrait notamment s’appliquer à Tartous, Lattaquié et Banias. L’UpM doit aussi contribuer au financement de l’extension du réseau de distribution des eaux à Jableh, Tartous et Banias et à celui de la réhabilitation de la raffinerie et la construction d’un centre de collecte des déchets dangereux à Banias.
Les projets relevant du volet « transports » de l’UpM sont aussi nombreux en Syrie. Le forum EuromedTransport a permis de trouver un accord de principe sur l’établissement d’une liste de dix-sept infrastructures de transport (un à deux projets par pays méditerranéen) et la liste définitive sera adoptée par les ministres méditerranéens des transports lors de la prochaine conférence. Les projets en Syrie sont multiples, comme par exemple le projet de plateforme logistique à Homs, pour faciliter le fret international entre l’Europe et le Moyen-Orient, y compris l’Irak et le Golfe (l’étude de faisabilité est achevée), ou la ligne de chemin de fer de Damas à la frontière jordanienne pour connecter l’Europe à la Jordanie et au Golfe (pour un coût de 167 millions d’euros, la conception est achevée). La CMA-CGM a proposé aux autorités syriennes de faire une étude stratégique de développement d’un réseau terre/mer grâce à un partenariat avec la SNCF et les Chemins de Fer Syriens pour que la Syrie devienne le chemin naturel vers l’Irak. Ces investissements ont pour but principal de faire de ce pays un espace de transit incontournable au Proche-Orient, que ce soit par les transports terrestres, maritimes, ferroviaires ou pour l’acheminement du pétrole et du gaz vers la Méditerranée.
Les interlocuteurs de la Mission ont aussi exprimé leur intérêt pour le développement de projets dans le secteur agricole. Ce dernier représente en effet 22 % du PIB et 15 % des exportations syriennes et emploie 23 % de la population active, mais les moyens de production sont souvent assez archaïques et les investissements publics diminuent. Le pays s’efforce néanmoins d’exporter ses excédents agricoles, en particulier de céréales et de fruits et légumes. Il est dans l’intérêt de la Syrie, mais aussi de sa région et de l’Europe de soutenir ces exportations. Entre la fin des années 1980 et le milieu des années 1990, la Syrie est parvenue à passer d’un stade de totale dépendance aux importations de blé au statut de pays exportateur. Si ses problèmes de sécheresse étaient traités efficacement, elle pourrait augmenter encore sa production et contribuer à la sécurité alimentaire du Moyen-Orient : pour ce faire, elle aurait besoin d’améliorer aussi ses capacités de stockage en créant de grands silos. Pour ce qui est par exemple des olives, des amandes, des pistaches ou des abricots, pour lesquels la Syrie figure parmi les premiers producteurs au monde, l’Europe pourrait favoriser l’importation de produits syriens de préférence à celle de productions géographiquement plus éloignées. M. Serge Telle a estimé que des projets de ce type devaient être conduits par des organismes comme les chambres d’agriculture, mais il a estimé que l’UpM devait pouvoir trouver les moyens de les soutenir.
On voit donc que les projets non seulement existent mais avancent, et ont commencé à être mis en œuvre sans même attendre que soient nommés le secrétaire général, lequel est installé à Barcelone depuis début mars dernier, et les secrétaires généraux adjoints de l’UpM. Si l’impatience exprimée par l’ambassadrice de Syrie en France lors de son audition par la Mission est compréhensible – elle regrettait le retard pris dans l’instruction de projets, qu’elle imputait à l’absence de position claire de l’Union européenne après les événements de Gaza fin 2008, et appelait à l’accélération des visites de délégations techniques en Syrie (25)–, il faut reconnaître les progrès accomplis et souligner les formidables opportunités que l’UpM offre aux pays du sud de la Méditerranée, et notamment à la Syrie.
3) L’amélioration souhaitée des relations avec les Etats-Unis
Le rapprochement entre la Syrie et la France d’une part, l’Union européenne d’autre part, a pu être rapide dans la mesure où le différend principal était relatif à la situation au Liban : l’absence de dialogue avait conduit à l’aggravation de la crise libanaise avant que la Syrie ne fasse pression sur ses alliés pour mettre un terme à celle-ci, suscitant ainsi des gestes de reconnaissance.
Bien que la Syrie comme les Etats-Unis souhaitent que leurs relations s’améliorent, leurs désaccords ne se limitent pas au Liban. La proximité syro-iranienne, le soutien syrien au Hamas et au Hezbollah, la reprise des discussions avec Israël sur le Golan et la question de la surveillance de la frontière syro-irakienne sont autant de dossiers de fond que les Etats-Unis voudraient voir évoluer en échange de concessions accordées à la Syrie. Il ne faut pourtant pas s’attendre à ce que cette dernière abandonne facilement des cartes aussi essentielles pour sa position stratégique.
a) La montée des tensions syro-américaines sous les deux mandats de George W. Bush
Les relations entre les Etats-Unis et la Syrie n’ont jamais été simples, mais elles n’ont pas non plus été aussi mauvaises qu’elles auraient pu l’être, en particulier pendant la guerre froide. En effet, bien que la Syrie ait alors eu des liens très cordiaux avec l’Union soviétique, elle ne pouvait se permettre de laisser de côté Washington étant donné le poids des Etats-Unis dans la région. Hafez el-Assad a fait preuve d’une grande subtilité en parvenant à favoriser l’approvisionnement de son pays en armement soviétique tout en se rendant respectable et même indispensable aux yeux des Américains. Bien qu’il n’ait pas été respecté, l’accord sur les lignes rouges qui a fait suite à l’intervention syrienne au Liban en 1975 traduisait la permission accordée par les Etats-Unis à la Syrie de rester sur le territoire libanais tant qu’elle ne dépassait pas un certain périmètre de manière à ce qu’Israël ne se sentît pas menacé. Surtout, les Etats-Unis ont pu compter sur l’appui de Damas lorsqu’ils ont constitué une coalition internationale pour chasser les Irakiens du Koweït, en 1990-1991. En contrepartie, ils ont validé le maintien par la Syrie de sa présence au Liban en reconnaissant les accords de Taëf, signés en 1989, qui la consacrent.
Mais les relations syro-américaines se tendent avant même le début du refroidissement franco-syrien et européano-syrien, dès que commencent les préparatifs de l’intervention américaine en Irak, qui se déroule en 2003. Cette fois, non seulement la Syrie ne se range pas du côté américain, mais elle est immédiatement mise en garde par les Etats-Unis contre toute forme de soutien qu’elle pourrait accorder à des éléments irakiens anti-américains. La défiance des Etats-Unis vis-à-vis de la Syrie était déjà très forte, comme en atteste l’anecdote rapportée à la Mission par M. Philippe de Fontaine Vive Curtaz, vice-président de la Banque européenne d’investissement (26) : en février 2003, les Etats-Unis ont fait pression sur lui afin qu’il renonce à se rendre en Syrie pour y signer un prêt de 50 millions d’euros destiné au financement du port de Tartous, ce qui a constitué l’unique cas de ce type au cours des sept années qu’il a déjà passées à son poste.
Une étape supplémentaire est franchie lorsque le Congrès adopte, le 11 novembre 2003, la loi pour la responsabilité de la Syrie et sur la souveraineté du Liban, qui établit des sanctions économiques contre la Syrie et demande à celle-ci de mettre fin à l’occupation du Liban. Cette loi se veut une réaction au soutien apporté par la Syrie aux terroristes agissant en Irak, au Hamas, au Hezbollah et au Djihad islamique, ainsi qu’à ses tentatives supposées d’acquisition d’armes biologiques, chimiques et nucléaires. Ces sanctions seront prorogées le 5 mai 2005, en dépit du retrait syrien du Liban, et ont été renouvelées chaque année depuis lors. Elles sont particulièrement pénalisantes pour le secteur du transport aérien syrien, qui ne parvient pas à importer la moindre pièce de rechange pour ses avions : les Européens eux-mêmes déplorent l’extrême fermeté américaine dans ce domaine, qui gêne considérablement les activités commerciales en Syrie de certaines entreprises comme Airbus ou Dassault. Enfin, les Etats-Unis sont à l’origine, avec la France, de l’adoption, en septembre 2004, par le Conseil de sécurité des Nations unies de la résolution 1559, perçue comme une humiliation par la Syrie.
L’occupation de l’Irak par les forces britanniques et américaines fournit de nombreuses occasions de tension entre les Etats-Unis et la Syrie, les premiers sommant la seconde de ne pas s’ingérer dans les affaires irakiennes et de surveiller davantage sa frontière pour éviter l’infiltration de djihadistes.
C’est pourquoi, à l’automne 2004, le Président Bachar el-Assad se dit prêt à reprendre les négociations avec Israël sur le Golan sans conditions, ce qui apparaît comme un recul par rapport à la position traditionnelle syrienne demandant de les reprendre là où elles se sont arrêtées. Cette annonce n’a guère de contenu dans la mesure où il revendique toujours le « dépôt Rabin », c’est-à-dire la promesse israélienne d’un retrait total du Golan, mais elle visait à desserrer l’étau des pressions internationales. Elle reste à ce jour sans effet sur les autorités américaines qui veulent maintenir la Syrie dans son isolement.
Washington est néanmoins obligé d’envoyer une représentation officielle à Damas, en janvier 2007, pour dissuader la Syrie de mettre en œuvre sa décision visant à renvoyer chez eux une grande partie des réfugiés irakiens présents sur son territoire. Depuis la publication du rapport Baker-Hamilton (27), remis le 6 décembre 2006 au Président Bush, qui proposait de réinsérer Damas dans la communauté internationale en contrepartie de son implication positive sur le dossier irakien, la Syrie participe aussi, aux côtés des Américains, aux conférences des Etats voisins de l’Irak.
Progressivement, la Syrie améliore la surveillance de sa frontière avec l’Irak, ce que les Etats-Unis eux-mêmes reconnaissent. Ceux-ci n’hésitent pas pour autant à activer des sanctions supplémentaires contre elle en réaction aux premiers gestes d’ouverture français, puis à mener, le 26 octobre 2008, un raid meurtrier contre un village syrien censé abriter une filière de combattants anti-américains. Huit civils sont tués dans cette opération commando.
La grande proximité entre Israël et les Etats-Unis de George W. Bush et l’intransigeance de celui-ci vis-à-vis de la Syrie ne laissaient pas espérer d’amélioration des relations bilatérales avant la fin de son mandat. Les autorités syriennes attendaient donc avec beaucoup d’impatience l’issue de l’élection présidentielle américaine de novembre 2008, puis l’entrée en fonction du Président Obama.
b) Le difficile chemin vers un rapprochement, souhaité par les deux parties
La Mission a effectué son premier déplacement en Syrie en novembre 2009, soit un an après l’élection du Président Obama et plus de neuf mois après sa prise de fonction. La déception de ses interlocuteurs syriens était alors palpable ; elle était encore plus forte quatre mois plus tard, lorsque deux membres de la Mission se sont à nouveau rendus à Damas. Au cours de leur visite dans les pays arabes voisins, ils ont d’ailleurs pu constater qu’elle y était largement partagée, y compris parmi les modérés.
Alors que George W. Bush avait une profonde défiance vis-à-vis du régime syrien, Barack Obama avait exprimé la volonté de tendre la main aux adversaires des Etats-Unis. Il voulait aussi s’occuper sans tarder du règlement du dossier israélo-palestinien. Les autorités syriennes s’attendaient donc à des gestes dans leur direction, lesquels ont eu lieu, du moins dans une certaine mesure, mais aussi à une plus grande fermeté vis-à-vis d’Israël, laquelle ne leur semble pas se traduire dans les faits.
Le ministre syrien des affaires étrangères a reconnu que l’administration Obama avait de bonnes intentions dans le dossier israélo-palestinien mais estimé que, après une dizaine de mois, elle avait fait la preuve de son impuissance, à la fois à cause du poids des dossiers internes aux Etats-Unis sur l’agenda international et de l’absence de volonté de paix israélienne.
Cette déception, unanimement partagée, sur le processus de paix israélo-palestinien, est doublée d’une déception sur le rythme jugé trop lent du rapprochement syro-américain, perçu, côté syrien, comme imputable aux Américains. Pourtant, si tous les interlocuteurs de la Mission ont estimé que la Syrie cherchait effectivement à se rapprocher des Etats-Unis, la plupart a jugé que la principale question portait sur les concessions qu’elle était susceptible d’accepter pour y parvenir. Car les Etats-Unis, certes ouverts à un rapprochement, entendent le subordonner à des conditions très exigeantes.
En juillet 2008, M. Christophe Bigot rappelait à la Mission l’intensification des visites d’émissaires américains de haut niveau à Damas et la rencontre entre la secrétaire d’Etat américaine, Mme Hillary Clinton, et son homologue syrien. Il estimait que, en dépit du maintien des sanctions américaines, depuis le rapport Baker-Hamilton, l’approche américaine était graduelle mais éclairement orientée vers une normalisation (28).
En novembre dernier, M. Peter Harling, le représentant de l’International Crisis Group à Damas, observait que, en dépit de gestes de bonne volonté consentis de part et d’autre, chacun reprochait à l’autre de ne pas faire assez. Selon lui, pour sortir du blocage actuel, il faudrait un accord sur la sécurité de la frontière irakienne, de manière à réduire l’hostilité du Congrès à l’encontre de la Syrie, et une rencontre entre les deux présidents, en l’absence des conseillers américains méfiants vis-à-vis des Syriens.
La Syrie a effectivement une mauvaise image à Washington, à cause notamment de son rôle en Irak, et il est évident que, même s’il le souhaitait, le Président Obama aurait bien du mal à obtenir du Congrès la levée des sanctions économiques ou le retrait de la Syrie de la liste des Etats soutenant le terrorisme, qui constitue l’objectif ultime des autorités syriennes. Le président de l’Assemblée du peuple a reconnu cette difficulté, qu’il attribue à la puissance du lobby juif américain.
L’administration Obama pose les mêmes préalables que l’administration Bush à la normalisation, c’est-à-dire au moins l’arrêt du soutien au Hezbollah, au Hamas et à l’insurrection irakienne, voire le relâchement des liens avec l’Iran. Elle attend des gestes concrets de la Syrie avant toute avancée.
Le 17 février 2010, Williams Burns, le sous-secrétaire d’Etat aux affaires politiques, et le Président el-Assad ont jeté les bases d’un nouveau dialogue présenté comme progressif mais concret, qui prend la forme d’une feuille de route comportant trois étapes.
La première correspond aux sujets sur lesquels un accord a déjà été trouvé : la nomination de M. Robert Ford comme ambassadeur américain à Damas, dont la candidature a été acceptée par la Syrie, mais qui doit être approuvée par le Sénat, ce qui s’annonce long et difficile (29) – les Etats-Unis n’ont plus d’ambassadeur en Syrie depuis l’assassinat de Rafic Hariri, ce qui les prive d’un canal de communication permanent avec les autorités syriennes aussi ont-ils annoncé en juin 2009 qu’ils allaient en nommer un ; le prochain dépôt par les Syriens d’une demande auprès de l’administration américaine sur le dossier des avions Falcon, que les Américains ont promis d’étudier avec la plus grande bienveillance ; la construction d’une nouvelle ambassade américaine sur un site faisant consensus, dans la banlieue sud de Damas ; la réouverture de l’école américaine, fermée depuis l’incursion militaire américaine en territoire syrien en octobre 2008, selon des modalités à préciser. En novembre 2009, les diplomates français avaient déploré que les autorités syriennes ne donnent pas satisfaction aux Etats-Unis sur ces deux derniers points, qui ne posaient pas de problèmes de fond. Des progrès ont donc été accomplis depuis.
La deuxième étape de la feuille de route comporte les initiatives américaines destinées à améliorer la relation bilatérale : la levée des restrictions sécuritaires pour les voyageurs américains désireux de se rendre en Syrie, les bonnes dispositions américaines à l’égard de la candidature de la Syrie à l’OMC, la venue prochaine d’une délégation de chefs d’entreprise américains spécialisés dans les technologies de l’information et de l’informatique, la fourniture de matériel médical (non visé par les sanctions) au ministère syrien de la santé.
Enfin, la troisième étape a trait aux sujets sur lesquels « les deux pays doivent encore faire des efforts », c’est-à-dire les questions politiques régionales (situation en Irak et au Liban, dossier nucléaire iranien, soutien aux Hezbollah et au Hamas, processus de paix) et la levée complète des sanctions commerciales américaines – qui ont été renouvelées pour un an début mai 2010.
On voit donc que, sans aborder le fond des véritables enjeux, cette feuille de route témoignait de la volonté américaine d’aller de l’avant. La médiatisation, huit jours plus tard, d’une rencontre à Damas entre le Président el-Assad, le Président Ahmadinejad et M. Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, n’en a que plus surpris les observateurs internationaux, et surtout occidentaux. Elle s’est accompagnée de commentaires ironiques du président syrien en réponse à un appel de Mme Hilary Clinton à la Syrie pour qu’elle prenne ses distances avec l’Iran. Lors d’une conférence de presse commune avec le président iranien, M. Bachar el-Assad a ainsi déclaré : « Nous nous sommes rencontrés aujourd’hui pour signer un " accord de séparation " entre la Syrie et l’Iran, mais en raison d’une mauvaise traduction nous avons signé un accord sur la suppression des visas. […] Je suis étonné qu’ils [les Etats-Unis] demandent aux pays de s’éloigner les uns des autres (…) alors qu’ils évoquent la stabilité et la paix au Proche-Orient et tous les autres beaux principes. Nous avons besoin de renforcer davantage les relations si l’objectif est vraiment la stabilité. »
M. Abdallah Dardari, le vice-premier ministre chargé des affaires économiques, a cherché à banaliser cette rencontre devant les membres de la Mission, mais a clairement expliqué que la publication de la photo des trois hommes était une réponse aux exigences présentées par Mme Clinton. En effet, personne ne peut dire à la Syrie ce qu’elle doit faire ou non ! Ces exigences lui semblaient d’autant plus déplacées que la feuille de route sur les relations bilatérales, qu’il a qualifiée de positive, venait d’être adoptée. Il a en outre signalé que les Etats-Unis avaient offert la nomination d’un ambassadeur, la levée du veto américain à l’accession de la Syrie à l’OMC et la possibilité d’acheter des pièces de rechange pour les avions contre la fin des relations de la Syrie avec l’Iran et le Hezbollah et des négociations sans condition avec Israël sur le Golan, ce qu’il a jugé très déséquilibré. Même si la déclaration de Mme Clinton était surtout un message adressé au Congrès, il a jugé qu’elle n’était pas acceptable.
Cette réaction de M. Dardari illustre la longueur du chemin qu’il reste à parcourir à la Syrie et aux Etats-Unis pour trouver un véritable terrain d’entente. On voit bien que les deux parties sont ouvertes à des concessions, mais que celles acceptées par l’une sont systématiquement jugées insuffisantes par l’autre, et que ni l’une ni l’autre n’apparaît encore décidée à franchir une étape décisive dans le rapprochement bilatéral, faute de confiance mutuelle.
Tout en étant sensible aux préoccupations américaines sur les différents dossiers régionaux, la Mission comprend que la Syrie ne soit pas prête à renoncer à tous ses atouts stratégiques. Seule la poursuite d’une démarche progressive du type de celle amorcée par la feuille de route pourrait faire avancer les choses, car, à trop vouloir obtenir de la Syrie, on risque de ne rien en obtenir du tout. Mais, deux mois après le déplacement de M. William Burns à Damas, les diplomates américains déploraient auprès de leurs collègues français l’attentisme syrien et l’absence de suites données aux promesses faites dans le cadre de la feuille de route. Le 20 avril 2010, le Département d’Etat a fait une déclaration très dure contre les transferts d’armements syriens au Hezbollah, qui traduisait à la fois ses inquiétudes face à des suspicions sérieuses relatives à la livraison de missiles Scud au Hezbollah et sa frustration devant l’absence de résultats du dialogue qu’il mène depuis l’été 2009.
C – Un jeu régional plus équilibré
Hafez el-Assad était réputé pour son habileté diplomatique, qui lui permettait d’entretenir des relations cordiales avec des pays que la guerre froide opposait, et d’avoir toujours plusieurs cartes dans son jeu. Après quelques années de tâtonnements, M. Bachar el-Assad semble engagé sur la même voie. Sans renier aucunement ses anciens amis – au premier rang desquels l’Iran, cf. infra –, la Syrie fait des gestes en direction des pays occidentaux, mais se réconcilie aussi avec la plupart des pays de la région. Le rapprochement syro-turc est particulièrement remarquable dans la mesure où les deux pays sont passés en peu de temps d’une situation proche de la guerre à une alliance étroite et multiforme.
De nombreuses personnes entendues par la Mission ont insisté sur l’extrême tension qui régnait encore en 1998 entre la Syrie et la Turquie, la seconde accusant la première de soutenir le PKK et de donner asile à certains de ses activistes et en particulier à leur chef, Abdoulah Öcelan. Aujourd’hui, il n’est pas excessif de parler, comme M. Peter Harling, le représentant de l’International Crisis Group à Damas, d’une « lune de miel » entre les deux pays. Cette nouvelle situation se traduit à la fois au niveau politique et en matière économique.
a) Un changement radical dans l’atmosphère des relations politiques
Avant même que la question kurde ne mène les deux pays au bord de la confrontation militaire, les relations syro-turques étaient marquées par deux sources de tensions principales : la question d’Alexandrette et le dossier de l’eau. Rattaché à la Syrie sous mandat français, le sandjak d’Alexandrette a été cédé à la Turquie en juin 1939 ; la Syrie a longtemps revendiqué sa restitution. La gestion de la ressource en eau pèse aussi sur les relations bilatérales depuis plusieurs dizaines d’années. La Syrie prélève en effet une grande partie de l’eau qu’elle consomme dans le Tigre et dans l’Euphrate, deux fleuves dont les sources sont situées sur le territoire turc, et accuse régulièrement la Turquie de la priver d’une partie de l’eau à laquelle elle a droit, notamment du fait de la construction de trop nombreux barrages.
Les membres de la Mission ont observé que ces deux sujets de tensions n’étaient plus abordés par les autorités syriennes et que l’ambassadeur de Turquie à Damas n’a évoqué la seconde qu’en réponse à une question posée par un député français. Les spécialistes entendus par la Mission ont confirmé leur quasi-disparition dans le discours des représentants des deux pays.
Pourtant, si on peut concevoir que le Président el-Assad ait renoncé à ses revendications sur Alexandrette, la question de l’eau est loin d’être résolue et trouve même une actualité renouvelée avec la sécheresse qui touche très fortement le nord-est syrien depuis plusieurs années, provoquant notamment un fort exode rural et la paupérisation des populations touchées.
M. Barah Mikaïl, chercheur à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) (30), a expliqué à la Mission que le problème de répartition de l’eau entre la Syrie et la Turquie était apparu dans le courant des années 1960 lorsque la Turquie a décidé d’utiliser pour son développement économique l’eau dont elle pouvait disposer et a lancé le « Grand projet anatolien » (GPA), qui a eu des conséquences sur la quantité d’eau disponible en aval du fleuve, en Syrie et en Irak. Devant les inquiétudes suscitées par cette nouvelle situation, la Turquie et la Syrie ont conclu en 1988 le protocole de Damas qui reconnaît à la Syrie le droit de prélever une partie des eaux du Tigre et de l’Euphrate. La Turquie n’a pas souhaité alors que l’Irak soit associé à ce protocole et elle n’a toujours pas conclu d’accord avec lui sur ce dossier. Mais ce protocole n’offrait pas de véritable garantie à la fourniture par la Turquie des volumes d’eau en question. Ainsi, dans les années 1990, lorsque la Turquie et la Syrie ont eu des différends sur d’autres sujets, la Turquie n’a pas hésité à priver la Syrie de l’eau à laquelle elle avait droit. Cela s’est notamment produit en mars 1990 : quand la Syrie s’en est plainte, les Turcs ont prétendu être victimes de problèmes techniques. La Syrie est donc très attachée au respect du protocole de 1988.
Le réchauffement des relations bilatérales s’est ainsi opéré malgré la persistance de ce différend et M. Barah Mikaïl estime qu’il ne signifie nullement que les Turcs céderont sur la question de l’eau. En atteste par exemple la déclaration conjointe de la Turquie, la Syrie et l’Irak en faveur d’un renforcement de leur coopération sur l’eau, faite à l’issue du Forum mondial de l’eau qui s’est tenu à Istanbul en mars 2009 : les Turcs ont effectivement annoncé la mise en place d’un centre régional prévu notamment pour opérer le recensement et le suivi des ressources hydrologiques régionales et promouvoir le lancement de nouveaux projets. Mais aucune avancée n’a été observée dans la réalisation de ces annonces. Le ministre irakien de l’eau a récemment exprimé à la Turquie son mécontentement devant l’absence d’évolution sur le terrain.
On peut mettre en avant trois raisons à cette situation : la Turquie est située en amont des fleuves et dispose ainsi de gros volumes d’eau, ce qui la place en position de force pour défendre ses intérêts ; le rapport de force politique et militaire est aussi incontestablement en sa faveur ; enfin, elle reste attachée à l’aboutissement du GPA, qui n’est encore que très partiellement réalisé : seules 15 % des terres qui devaient être irriguées grâce à ce projet le sont effectivement, une partie seulement des vingt-deux barrages prévus a été construite et le pays veut poursuivre le développement de son potentiel hydroélectrique, ce qui implique qu’il continue à disposer de volumes d’eau importants. L’ambassadeur de Turquie à Damas n’en a pas moins expliqué à la Mission que la Turquie, qui n’est elle-même pas riche en eau et souffre aussi de la sécheresse, a toujours respecté ses engagements de fourniture d’eau à la Syrie et déploré les polémiques politiques dont son pays a été victime sur ce sujet.
Le changement dans la qualité des relations bilatérales est présenté par tous comme la conséquence du retournement syrien vis-à-vis du PKK. Les autorités syriennes ont finalement accepté d’expulser Abdoulah Öcelan vers la Turquie et ont cessé de soutenir son mouvement. Les deux pays se retrouvent aujourd’hui sur la même ligne pour s’opposer aux revendications des Kurdes d’Irak vers encore davantage d’autonomie, par peur que ces demandes soient reprises par les populations kurdes de Syrie et de Turquie.
Même si l’ambassadeur de Turquie à Damas s’en défend, il est difficile de ne pas établir un lien entre le rapprochement syro-turc et le relâchement des liens entre la Turquie et Israël, ennemi de la Syrie. M. Peter Harling analyse la fin des relations pacifiées entre Israël et la Turquie comme la conséquence de la disparition de trois éléments : la position stratégique turque vis-à-vis de l’Occident, l’existence du lobby juif américain qui, en échange de ces bonnes relations, s’opposait à la demande de la reconnaissance du génocide arménien, le fait que cette alliance constituait un moyen de pression sur la Syrie contre les PKK. Aujourd’hui, la Turquie a des relations décomplexées avec l’Occident, ses relations avec l’Arménie sont en cours de transformation et le PKK n’utilise plus la Syrie comme base arrière. On peut ajouter à ces évolutions l’arrivée au pouvoir en Turquie de l’AKP, qui est un parti islamiste, moins bien disposé envers l’Etat hébreu que ne l’étaient les partis laïcs. Devenue l’alliée de la Syrie sans être pour autant l’ennemie d’Israël, la Turquie était particulièrement bien placée pour servir d’intermédiaire dans les négociations entre les deux pays sur le Golan (voir infra). M. Denis Bauchard, consultant au centre Maghreb-Moyen-Orient de l’Institut français des relations internationales (IFRI), voit d’ailleurs dans le rapprochement entre la Syrie et la Turquie la volonté syrienne d’éloigner la seconde d’Israël : dans tous les cas, on voit bien que la relation à Israël occupe une place importante dans le rapprochement syro-turc.
Le contexte régional était donc favorable à l’amélioration des relations syro-turques, mais les liens d’amitié entre MM. Bachar el-Assad et Recep Tayyip Erdogan ont joué un rôle moteur. M. Peter Harling voit aussi la rapidité et l’intensité du processus de rapprochement comme un succès pour les institutions turques, qui l’ont conduit. Pour la Syrie – dont le régime est tenu par des alaouites mais où la majorité de la population est sunnite –, il s’agit de se rapprocher d’une puissance sunnite émergente pour contrebalancer le poids de l’Iran chiite. La Turquie a une véritable capacité de médiation envers Israël et l’Irak, alors que l’Iran n’est capable que d’attiser les tensions. M. Samir Aïta, économiste (31), estime aussi que la Turquie souhaite œuvrer à la stabilité de la Syrie. Aujourd’hui, la Turquie est en train de devenir un ancrage régional stabilisant, réalisant des partenariats politiques et économiques importants avec la Syrie et l’Irak, voire la Russie à terme. M. Saad Hariri, le président du conseil des ministres libanais, considère également que l’ouverture de la Syrie envers la Turquie est positive car l’influence de cette dernière s’exerce en faveur de la paix et de la stabilité, ce qui la distingue de l’influence iranienne, dont il juge que les objectifs ne sont pas clairs.
La Syrie et Turquie ont donc développé des relations nourries tant sur le plan politique (et militaire) que culturel et économique, qui placent aujourd’hui la Turquie parmi les premiers partenaires du pays. L’encadré suivant récapitule les principales visites croisées des dirigeants des deux pays au cours des dernières années. Mme Lamia Chakkour (32) a mentionné comme des événements importants la création d’un Haut conseil de coopération stratégique et la suppression de l’obligation de visa entre les deux pays, intervenue quelques jours avant le premier déplacement de la Mission en Syrie, qui a, selon l’ambassadrice, satisfait les populations – ce qu’a confirmé à la Mission le gouverneur d’Alep.
LES RÉCENTES VISITES BILATÉRALES SYRO-TURQUES – 2007 : visite en Turquie du président syrien, accompagné du vice-premier ministre pour les affaires économiques et du ministre des affaires étrangères ; visite en Syrie du ministre turc des affaires étrangères, reçu par le président syrien ; – 2008 : Visite en Turquie du Vice-premier ministre chargé des affaires économiques, accompagné des ministres du transport, du pétrole, du vice-ministre de l’industrie, des adjoints des ministres des affaires étrangères et de l’agriculture, ainsi que du président de la bourse de Damas et du président du côté syrien au Conseil des hommes d’affaires syro-turc ; – 2009 : visite à Damas du ministre turc du commerce extérieur ; première session du Haut conseil de coopération stratégique à Damas en octobre 2009 ; visite du Premier ministre turc et de nombreux ministres des deux pays (affaires étrangères, économie, transport, agriculture, santé, environnement, tourisme, défense, éducation...) ; – début 2010 : visite à Damas d’une délégation parlementaire menée par le président du Parlement turc. |
On observe en particulier l’importance de la dimension économique dans ces échanges de visites. Elle est en effet centrale dans le rapprochement entre les deux pays.
b) Une nette intensification des relations économiques
Toutes les personnes entendues par la Mission ont insisté sur l’aspect économique des relations bilatérales. M. Barah Mikaïl a mis l’accent sur le nombre de représentants du commerce et de l’industrie turcs dans les délégations qui accompagnent chaque visite ministérielle ou présidentielle en Syrie (33).
Le nombre des accords bilatéraux conclus dans le domaine économique et les données chiffrées des relations économiques entre les deux pays donnent une bonne idée de l’ampleur de l’évolution en cours.
Plusieurs accords récents favorisent en effet la relation économique bilatérale et l’investissement. Il s’agit principalement de l’accord de libre échange, signé en 2005 et entré en vigueur le 1er janvier 2007 : côté turc, tous les produits industriels syriens bénéficient de droits de douane nuls, côté syrien, les droits de douanes appliqués aux produits turcs sont dégressifs sur douze ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, des restrictions demeurent appliquées aux produits agroalimentaires, les deux pays cherchant à protéger ce secteur ; de l’accord de non double-imposition de 2006 et de l’accord de protection réciproque des investissements de 2007.
Le développement des échanges économiques bilatéraux est très substantiel. Il faut y ajouter une série de projets structurants visant l’interconnexion des principaux réseaux de transport d’énergie et de marchandises, énumérés dans l’encadré suivant.
PROJETS SYRO-TURCS VISANT L’INTERCONNEXION DES PRINCIPAUX RÉSEAUX DE TRANSPORT D’ÉNERGIE ET DE MARCHANDISES |
– Gaz : la connexion des réseaux arabe (Arab Gas Pipeline) et turc via un tronçon (dont la construction vient d’être attribuée à la compagnie tchèque Plynostav), qui permettra l’exportation de gaz arabe et l’importation de gaz de Turquie, d’Azerbaïdjan et d’Iran dès 2011. La Turquie devrait ainsi livrer entre 500 000 et 1 million de m3 de gaz par an pendant cinq ans ; – Eau : la mise en place d’un système d’alarme contre les inondations dans le bassin de l’Oronte, la recherche d’opportunités de projets d’irrigation mixtes sur l’Euphrate, le projet de construction d’une station de pompage sur le Tigre et, tout dernièrement annoncé, le projet de construction d’un barrage sur l’Oronte, « le barrage de l’amitié » ; – Electricité : le degré d’interconnexion actuelle des réseaux permet la livraison régulière à la Syrie d’électricité produite en Turquie ; – Transports : la réouverture de la liaison ferroviaire Alep-Gaziantep en décembre 2009 qui devrait accueillir 3 millions de passagers et 900 000 tonnes de marchandises en 2010, ainsi que la connexion des réseaux routiers turcs et syriens. |
Selon le Bureau syrien des statistiques, les importations de la Syrie en provenance de Turquie ont progressé au cours des dernières années (336 millions de dollars en 2005, 461 millions de dollars en 2006, 571 millions de dollars en 2007) avant de retomber à 343 millions de dollars en 2008. En 2007, les produits pétroliers représentaient 38 % des montants importés, suivis de produits issus majoritairement de l’industrie : ciment, équipements mécaniques, plastiques, huiles et matières grasses, fibres synthétiques, véhicules, équipements électriques, produits de l’industrie des métaux, ainsi que fer et acier, papiers, aluminium, bois, produits chimiques, caoutchouc, portés par des coûts de production souvent plus bas qu’en Syrie.
Les exportations syriennes vers la Turquie ont connu à partir de 2006 un net redémarrage après plusieurs années de déclin, avec un temps de retard cependant par rapport à la progression des exportations syriennes globales qui redécollent dès 2005. Après un bond spectaculaire de + 72 % à 604 millions de dollars en 2007, elles atteignent 635 millions de dollars (+ 5 %) en 2008. Hors pétrole, qui comptait pour plus d’un quart du total, les ventes 2007 concernent essentiellement des produits des secteurs textile/habillement/chaussures, agro-alimentaire et agricole et phosphates. La Turquie est le premier client de la Syrie pour plusieurs productions, dont le phosphate.
Le solde de la balance commerciale syro-turque est ainsi excédentaire de 33 millions de dollars en 2007 en faveur de la Syrie et de 143 millions de dollars en 2008. En 2007, la Turquie est le cinquième pays client de la Syrie après l’Italie, la France, l’Arabie Saoudite et l’Irak et son dixième fournisseur. Les données statistiques turques sont très sensiblement différentes avec des exportations vers la Syrie de 1,1 milliard de dollars en 2008, et 638 millions de dollars d’importations, ce qui place l’excédent de la balance commerciale syro-turque largement en faveur de la Turquie.
Le stock d’investissement direct étranger turc en Syrie s’élèverait à 200 millions de dollars en 2007 – l’essentiel étant réalisé par l’investissement du cimentier Guris, le reste relevant de diverses petites implantations textiles dans le nord du pays. En matière de services, aucune banque ni compagnie d’assurance turque n’est enregistrée en Syrie à ce jour.
Plus de 560 000 touristes turcs ont visité la Syrie en 2008, auxquels s’ajoutent les visiteurs frontaliers estimés à près d’un million par an et dont la fréquence des visites s’est probablement encore accrue depuis la suppression des visas pour les ressortissants des deux pays en visite dans le pays voisin, en septembre 2009.
Le développement des relations économiques entre les deux pays profite à l’ensemble de la Syrie, mais ses effets sont évidemment plus sensibles dans le nord du pays. Le gouverneur d’Alep, ville située à 40 km de la frontière avec la Turquie, s’en est particulièrement réjoui en présence des membres de la Mission qui l’ont rencontré. Il a évoqué le travail des chambres de commerce d’Alep et de Gaziantep, la grande ville turque la plus proche d’Alep, avec laquelle cette dernière est jumelée, et qui est seulement distante de 120 km. Elles multiplient les échanges pour stimuler le développement des relations économiques et un accord de coopération a été signé entre leurs deux commissions de planification. Des projets communs de recherche sont en cours dans les domaines agricole, historique, environnemental et de protection du patrimoine ottoman. On voit ainsi que le rapprochement syro-turc n’est pas limité aux dirigeants des deux pays mais commence à se diffuser dans la société et prend des formes de plus en plus diverses.
La Mission a le sentiment que l’intensification des relations entre la Turquie et la Syrie, les deux pays laïcs de la région, est positive. L’ouverture économique l’est incontestablement dans la mesure où elle est de nature à renforcer le développement des deux partenaires, notamment dans les régions frontalières qui ne sont pas les plus riches, et de créer des solidarités de fait. Le renforcement de leurs liens politiques ne semble pas devoir inquiéter l’Occident : il est certes concomitant d’un rafraîchissement des liens turco-israéliens, mais n’en est pas pour autant la cause ; s’il ne signifie pas que la Syrie distend ses liens avec l’Iran – voir infra –, il donne à la Turquie, qui reste un Etat modéré et membre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, une capacité d’influence sur la Syrie, ce qui se révéler précieux, surtout étant donné l’excellence des relations entre leurs chefs d’Etat.
La Mission n’a pas à se prononcer ici sur les évolutions de la diplomatie turque, qui font actuellement l’objet d’une autre mission d’information de la commission des affaires étrangères. Elle n’a pas effectué de déplacement en Turquie du fait de l’existence de cette autre mission. Elle a néanmoins l’impression que la Turquie a choisi de s’impliquer davantage dans la diplomatie proche-orientale afin de compenser le blocage actuel du processus de son adhésion à l’Union européenne. Ce rééquilibrage de sa diplomatie devra être observé avec attention car certaines des récentes prises de position turques laissent entrevoir une volonté de se rapprocher des Etats les plus radicaux de la région, ce qui confère à la Turquie une popularité nouvelle auprès de la « rue arabe » mais risque de remettre en cause le rôle de stabilisateur qu’elle s’est jusqu’ici efforcée de remplir.
2) Des relations compliquées avec l’Irak mais une volonté d’ouverture
La Syrie et l’Irak présentent un certain nombre de points communs qui les ont plus éloignés que rapprochés au cours des dernières décennies, principalement à cause de la rivalité qui opposait leurs chefs d’Etat dans la défense de l’idéologie du parti Baas. En décidant d’ouvrir ses frontières aux personnes fuyant l’Irak à partir de mars 2003, la Syrie a témoigné sa solidarité vis-à-vis de ses voisins arabes, mais a aussi, d’une certaine manière, lié son avenir à celui d’un Irak instable. Elle n’en est pas pour autant, jusqu’ici, parvenue à nouer des liens de confiance avec les nouvelles autorités irakiennes.
La rivalité entre la Syrie et l’Irak trouve son origine dans les relations difficiles qu’entretenaient leurs chefs d’Etats : arrivés au pouvoir dans les années 1960, tous les deux à l’issue d’un coup de force, Saddam Hussein et Hafez el-Assad appartenaient certes au même moule idéologique, celui du parti Baas, mais ils étaient en mauvais termes car chacun revendiquait pour lui-même une légitimité qu’il refusait à l’autre. Chacun défendait aussi sa conception du pouvoir et de l’intérêt national.
Ces tensions ont atteint une intensité extrême au cours de la guerre entre l’Iran et l’Irak, la Syrie prenant le parti du premier quand l’ensemble du monde arabe soutenait plutôt le second. Une fois la guerre finie, la situation ne s’est pas améliorée, comme en a attesté le ralliement de la Syrie à la coalition occidentale contre l’Irak après que ce dernier eut envahi le Koweït. Hafez el-Assad a néanmoins refusé d’offrir une aide autre que logistique aux forces de la coalition, signifiant ainsi qu’il s’opposait à ce que son armée participât au bombardement de ressortissants d’un pays arabe voisin.
Les relations syro-irakiennes restèrent froides pendant les années 1990. Le seul motif de rapprochement était le besoin qu’avait l’Irak d’écouler une partie de son pétrole via le territoire syrien, de façon à contourner l’embargo international contre lui. La Syrie acceptait de se prêter au jeu car cela lui permettait d’opérer des prélèvements sur le pipe-line qui aboutissait au port de Banias, tout en percevant des droits de transit.
Lorsque la guerre en Irak éclate, la Syrie se retrouve avec un voisin sous occupation américaine, rapidement doté d’un gouvernement pro-américain. Dans les années 1970, le régime syrien avait accueilli un grand nombre d’opposants à Saddam Hussein ; après la chute de celui-ci, tandis que les premiers rentrent en Irak, ce sont d’anciens membres du parti Baas, d’anciens militaires et membres des forces de sécurité, menacés de mort ou d’arrestation dans leur pays, qui trouvent refuge en Syrie.
b) Les conséquences de la guerre en Irak sur la Syrie : la question des réfugiés
C’est en effet en application de l’idéologie pan-arabe défendue par le régime, qui veut que tout citoyen arabe soit considéré comme un hôte, que la Syrie a laissé sa frontière avec l’Irak ouverte, permettant aux Irakiens fuyant leur pays de trouver refuge sur son territoire alors que d’autres pays voisins ont rapidement cherché à fermer leur frontière. Cette politique a été maintenue jusqu’en septembre 2007 : depuis, tout Irakien désirant se rendre en Syrie doit demander un visa à l’ambassade de Syrie à Bagdad, le visa n’étant accordé qu’à certaines catégories de personnes. Mais dans les faits, la majorité des réfugiés irakiens ne renouvelle pas son visa et vit dans une situation irrégulière tolérée par l’Etat syrien. Les expulsions relèvent de cas isolés, ce qui témoigne de la volonté du régime syrien de maintenir une dynamique d’accueil vis-à-vis de la population irakienne (34).
Les autorités syriennes ne perdent jamais une occasion de rappeler le poids que représente pour le pays l’accueil de ces réfugiés. Elles ont d’abord tendance à faire une estimation haute de leur nombre : Mme Lamia Chakkour a indiqué à la Mission qu’un million trois cent mille réfugiés irakiens vivaient sur le sol syrien d’après les statistiques officielles, auxquels il fallait ajouter trois cent mille autres ressortissants irakiens qui sont des réfugiés mais qui n’apparaissent pas comme tels dans les statistiques (35). M. Philippe Leclerc, le représentant-adjoint en Syrie du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), a expliqué à la Mission que 1,6 million serait le nombre de réfugiés le plus élevé atteint en Syrie, et qu’il était, selon les autorités syriennes, actuellement de 1,1 million de personne. Comme les frontières sont restées ouvertes, il y a eu des flux permanents dans les deux sens. Le décompte est aussi rendu difficile par le fait que les réfugiés n’ont pas été conduits dans des camps, mais se sont installés au cœur des villes, majoritairement autour de Damas, ainsi qu’à Alep et Homs. Mais un chiffre aussi élevé est jugé surestimé par de nombreuses organisations et de nombreux experts indépendants. Par exemple, si on extrapole à partir du nombre d’enfants irakiens inscrits à l’école, une estimation basse aboutit au chiffre de 300 000 personnes. Quant au chercheur de l’Institut français du Proche-Orient spécialiste de ce sujet, il en reste au nombre de réfugiés enregistrés par le HCR, qui est de 220 000. Il considère d’ailleurs que c’est déjà beaucoup.
Il est naturellement dans l’intérêt des autorités syriennes de retenir une estimation haute qui leur permet de valoriser le rôle de havre rempli par leur pays pour les Irakiens en fuite et de demander un soutien plus fort à la communauté internationale. Il n’en demeure pas moins vrai qu’elles ont fait leur possible pour accueillir ces réfugiés dans des conditions décentes, en leur ouvrant le système de soins, pourtant déjà inférieur aux besoins de ses citoyens, et le système scolaire.
La majorité des réfugiés sont des citadins originaires de Bagdad, issus des classes moyennes, les chrétiens étant surreprésentés puisqu’ils constitueraient 18,5 % des réfugiés contre seulement 2 % de la population totale en Irak. Les réfugiés ont donc, dans un premier temps, vécu sur leurs économies ; celles-ci sont aujourd’hui bien souvent épuisées et, comme il leur est interdit de travailler, ils connaissent un phénomène de paupérisation, que Mme Lamia Chakkour a reconnu.
Leur présence a entraîné une pression importante sur les infrastructures de santé et d’éducation, ainsi que sur le marché de l’immobilier. Les autorités syriennes ont dû mettre un terme à l’accès total et gratuit aux soins médicaux initialement accordé en 2005, devant la saturation des services. Elles n’assurent plus que la prise en charge des cas les plus urgents, les autres étant à la charge des réfugiés. Seuls ceux qui sont enregistrés auprès du HCR bénéficient encore d’un accès complet aux services de santé. Près de 50 000 enfants irakiens ont en outre été accueillis dans les écoles publiques et gratuites pendant l’année scolaire 2007-2008, mais certains ont été refusés en raison de classes surchargées. L’année suivante, leur nombre avait chuté d’un tiers, à cause de difficultés à s’adapter au cursus syrien ou pour des raisons économiques. Chaque élève coûte de l’ordre de 300 dollars par an au gouvernement syrien, soit plus de 10 millions de dollars pour l’année 2008-2009, sans tenir compte de la nécessité de construire de nouvelles écoles. L’arrivée de nombreux réfugiés irakiens souvent aisés a enfin provoqué une hausse des loyers et des prix de vente des appartements. Au total, le gouvernement syrien estime que les réfugiés irakiens entraînent un coût de 1,5 milliard de dollars par an pour l’économie nationale.
Plusieurs éléments tendent néanmoins à démontrer que l’économie syrienne est parvenue à absorber ce choc et a finalement réussi à en tirer profit. En effet, les riches irakiens ont investi une partie de leur capital en Syrie et ceux appartenant aux classes moyennes ont contribué à la croissance en dynamisant la consommation, l’industrie et le marché immobilier. Ils ont aussi participé à la baisse du chômage. L’inflation en a certes été accentuée pendant un temps, mais elle est désormais orientée à la baisse.
En revanche, les plus pauvres des Syriens ont souvent souffert de la hausse des loyers et mal vécus que des hôpitaux financés par la communauté internationale soignent gratuitement les réfugiés irakiens quand ils devaient, pour leur part, payer les soins. Les autorités syriennes ont néanmoins fait en sorte que les retombées des actions menées par les organisations humanitaires profitent aussi aux Syriens. Les sommes en jeu sont loin d’être négligeables : les Etats-Unis affirment par exemple avoir dépensé 500 millions d’euros pour les réfugiés irakiens entre 2006 et le printemps 2008. Le président de l’Assemblée du peuple a pourtant souligné les difficultés rencontrées par les Syriens à la suite de l’augmentation du coût de la vie provoquée par les flux de réfugiés et déploré la faiblesse de l’aide internationale. Globalement, les interlocuteurs de la Mission ont reconnu les efforts faits par le régime et estimé que la population syrienne avait été globalement accueillante vis-à-vis des réfugiés.
On observera que la présence de centaines de milliers d’Irakiens en Syrie n’a pas facilité les relations de cette dernière avec les nouvelles autorités irakiennes, dans la mesure où figurent parmi eux des membres du parti Baas que le régime pro-américain voit comme un danger.
c) Des liens difficiles à renouer
L’occupation américaine de l’Irak a fait craindre à la Syrie d’être l’objectif suivant des Etats-Unis. Cette peur est aujourd’hui dissipée. En revanche, la Syrie s’inquiète toujours des risques d’implosion de l’Irak et des revendications kurdes. Elle a pourtant amorcé, depuis la fin 2006, un mouvement de rapprochement en direction de Bagdad, qui n’a pas encore beaucoup avancé.
Après avoir rétabli des relations diplomatiques avec l’Irak, en novembre 2006, reconnaissant par là le gouvernement de Nouri al-Maliki, la Syrie a envoyé un ambassadeur à Bagdad au printemps 2008, ce qui était une première depuis trente ans. Cette volonté de renouer le dialogue visait principalement, côté syrien, à obtenir une intensification des relations économiques. Un pas important semblait avoir été franchi le 18 août 2009, avec la visite du Premier ministre irakien à Damas. Elle avait été l’occasion de créer un Haut conseil de coopération stratégique devant se réunir tous les six mois, alternativement dans chaque capitale, pour discuter de la coopération politique, économique, militaire, énergétique, financière, culturelle, éducative et scientifique. Avait aussi été prise la décision de créer des zones franches pour encourager les échanges et les investissements et plusieurs projets énergétiques avaient été évoqués. Le Premier ministre irakien avait refusé la coopération sécuritaire tripartite proposée par les Américains et demandé aux Syriens de remettre à l’Irak certains membres du parti Baas réfugiés en Syrie. Les autorités syriennes ne s’en félicitaient pas moins des progrès accomplis.
Mais cette satisfaction fut de courte durée puisque, quelques jours après, le Premier ministre irakien mettait en cause la responsabilité des autorités syriennes dans l’attentat qui avait fait plus de cent victimes à Bagdad le 19 août. Ces accusations ont été qualifiées d’immorales par Mme Lamia Chakkour, qui a considéré qu’elles reflétaient un déséquilibre des forces sur l’échiquier politique irakien et déploré une « crise artificielle » mettant en danger les projets économiques encore embryonnaires entre les deux pays.
Les diplomates français en poste à Damas estiment eux aussi que ces accusations n’étaient pas fondées, comme l’ont montré le refus américain de les relayer et le fait qu’elles n’aient pas été renouvelées après les attentats qui ont suivi celui du 19 août. Ils les replacent également dans le contexte des élections législatives irakiennes – qui se sont tenues en mars dernier.
M. Peter Harling considère de même que les accusations ne reposaient sur aucun élément précis mais qu’elles témoignaient d’une préoccupation plus générale : de temps en temps, des baasistes irakiens ou des réseaux salafistes installés en Syrie prennent des initiatives hostiles aux intérêts de Bagdad sans que la Syrie réagisse immédiatement. Le chercheur a signalé que les deux pays étaient, à la mi-août, sur le point de conclure un accord prévoyant une sécurisation des frontières en échange de contreparties économiques et il a estimé que la Syrie ne ferait pas d’efforts supplémentaires en termes de sécurité tant qu’elle n’aura pas obtenu ces contreparties. Selon lui, aucun accord de ce type ne sera viable sans une réconciliation nationale en Irak, qui permettrait le retour des réfugiés.
Il est incontestablement dans l’intérêt de la Syrie de renforcer ses relations économiques avec l’Irak, afin de retrouver le rôle de pays de transit que lui confère logiquement la géographie. Ces relations ont existé par le passé, mais elles ont souffert des problèmes politiques bilatéraux, comme l’a rappelé M. Patrice Paoli (36) : par exemple, la Syrie interrompait l’oléoduc qui traversait son territoire quand une difficulté politique surgissait. M. Christophe de Margerie, directeur général de Total (37), n’a pas caché qu’un élément essentiel dans la présence en Syrie du groupe qu’il dirige était sa situation géographique, au croisement des routes vers le Moyen-Orient, qui est d’autant plus importante que nous abordons une période où les hydrocarbures deviennent plus rares. Il a expliqué que l’enjeu principal était celui du transit des hydrocarbures depuis l’Irak. Le pipe-line passant par la Syrie a continué de fonctionner en dépit de l’embargo, sans que les Etats-Unis s’y attaquent. Mais il est aujourd’hui en très mauvais état et aurait besoin d’être refait. La Syrie pourrait devenir un hub gazier et une importante voie de passage pour le pétrole vers la Méditerranée. Sur ce plan, elle n’est pas véritablement en concurrence avec la Turquie : il est logique que le gaz de Kirkouk soit évacué par la Turquie et que celui provenant du sud de l’Irak passe par la Syrie. L’idée, développée dans le passé, de faire transiter le gaz iranien par l’Irak et la Syrie relevait pour sa part surtout d’une logique politique entre Etats anti-occidentaux.
Il ne semble pas en revanche que les entreprises syriennes puissent placer beaucoup d’espoirs dans la reconstruction de l’Irak car elles ne sont pas de taille à concurrencer les groupes internationaux qui y participent.
La volonté d’une réconciliation avec l’Irak semble sincère côté syrien : la longueur de leur frontière commune, les flux de populations de part et d’autre et les liens que celles-ci ont noués entre elles, les gains économiques potentiels justifient pleinement la normalisation des relations entre les deux pays, alors que, dans le même temps, la concurrence entre les chefs de l’Etat a disparu et que l’Irak s’est rapproché de l’Iran, allié fidèle de Damas. A cet égard, les autorités syriennes rappellent volontiers qu’elles défendent l’unité territoriale de l’Irak et le développement d’un sentiment d’appartenance nationale, relayant ainsi les espoirs que les Occidentaux fondent aujourd’hui pour l’avenir de l’Irak, alors que l’Iran attise plutôt les tensions communautaires. L’Occident, et la Mission, ont donc plutôt lieu de plaider en faveur d’un véritable rapprochement syro-irakien, qui aurait notamment un effet positif sur la sécurisation de leur frontière et sur la stabilité régionale. On peut supposer que l’arrivée au pouvoir d’une majorité moins marquée que la précédente du point de vue de l’appartenance communautaire pourra favoriser cette évolution.
3) Des progrès plus ou moins marqués dans les relations avec les Etats arabes modérés de la région
Les relations syro-irakiennes occupent une place à part dans la diplomatie syrienne à cause de la dimension intérieure du problème des réfugiés. Mais le nouveau cours de la politique régionale syrienne a aussi des traductions très visibles dans le climat des relations que la Syrie entretient avec les autres principaux Etats arabes de la région. A cause de leur modération, qui traduit leur proximité de l’Occident, la Syrie n’était, ces derniers temps, en bons termes ni avec l’Arabie saoudite, ni avec l’Egypte, ni avec la Jordanie. Mais, là encore, les choses sont en train de changer, même si c’est pour l’heure avec des résultats différents selon le pays concerné.
Le Rapport n’aborde pas ici la question du Liban, qui fera l’objet d’un traitement spécifique dans la partie suivante. Les relations que la Syrie entretient avec lui n’ont en effet rien à voir avec celles qu’il a avec les autres Etats arabes de la région.
a) Une réconciliation surprise avec l’Arabie saoudite
Si l’assassinat de Rafic Hariri a été un élément important dans la rupture, déjà amorcée, entre l’Occident et la Syrie, il a directement provoqué la rupture syro-saoudienne dans la mesure où l’ancien premier ministre était l’homme de confiance de la famille royale saoudienne et le relais de son influence au Liban. Les relations entre les deux pays avaient certes été tumultueuses au cours des années 1970, mais l’axe Riyad-Le Caire-Damas avait globalement fonctionné jusqu’à la « trahison » égyptienne des accords de Camp David, et Damas avait largement profité de la générosité saoudienne. Les deux pays étaient ensuite devenus les co-parrains du Liban.
L’assassinat de Rafic Hariri est perçu par le roi Abdallah comme une trahison, alors que son pays avait contribué à sécuriser la transition du pouvoir en Syrie en 2000 et s’était rallié aux positions syriennes sur le conflit israélo-arabe. Les médiations de l’Arabie saoudite afin de résoudre la crise libanaise dès janvier 2006 n’aboutissent pas, échec en partie imputé aux positions syriennes, tandis que la dégradation de la situation sécuritaire au Liban entraîne une forte détérioration de la relation entre les deux Etats. Le Royaume est alors partagé entre la volonté de faire pression sur les Syriens pour qu’ils coopèrent avec le Tribunal spécial pour le Liban et l’impératif de sécuriser ses investissements au Liban en les ménageant.
La situation interpalestinienne n’arrange rien dans la mesure où, tout en soutenant en principe, en 2006-2007, les efforts en vue de la formation d’un gouvernement d’union nationale réunissant les factions rivales, la Syrie est suspectée par Riyad et Le Caire – qui prennent de plus en plus le parti du Président Abbas – de pousser le Hamas à la surenchère.
Enfin, l’Arabie saoudite voit d’un mauvais œil la proximité entre la Syrie et l’Iran, car elle se méfie de ce dernier et considère cette alliance comme dirigée contre les Etats du Golfe, l’Egypte et les autres Etats arabes.
Le dossier irakien est en revanche un sujet de rapprochement car tous les deux redoutent autant la partition du pays qu’un Irak dominé par des chiites sous influence iranienne, la peur saoudienne étant liée au risque de propagation dans sa province orientale, où vivent la plupart des chiites du royaume et où se trouve l’essentiel de ses ressources pétrolières.
M. Jean-Claude Cousseran (38) affirmait en outre que le régime syrien ne pouvait pas se couper de tous les Arabes modérés : « l’Arabie joue un rôle majeur dans le monde sunnite et Damas doit en tenir compte. Pour des raisons symétriques, l’Arabie ne souhaite pas envenimer ses relations avec la Syrie qui pourraient déboucher sur un drame chiite-sunnite au Liban. »
Selon l’analyse de M. Patrice Paoli (39), le roi d’Arabie saoudite a accepté de renouer le dialogue avec la Syrie après l’opération israélienne à Gaza, fin 2008-début 2009, à l’occasion de laquelle les conférences concurrentes au Qatar et au Koweït avaient montré un monde arabe divisé, dont les fractures ne profitaient qu’à l’Iran.
Plusieurs raisons expliquent donc ce rapprochement, amorcé au sommet de la Ligue arabe de Riyad, en 2007, et devenu réellement visible en 2009. Le deuxième semestre a été marqué par la visite du Président el-Assad à Djeddah, en septembre, suivie par le déplacement du roi Abdallah à Damas en octobre. Depuis, le principe Saoud est revenu à Damas début janvier 2010 et le président syrien a passé trois jours dans le royaume au milieu du même mois. C’est naturellement la visite du roi qui a été la plus marquante, d’autant qu’elle a eu des conséquences positives immédiates sur la situation au Liban.
Quelques jours après cette visite, M. Salam Kawakibi, chercheur en sciences politiques et relations internationales et coordinateur de projets à l’Initiative arabe de réforme (40), expliquait à la Mission qu’elle « avait été permise par la position de retrait dans laquelle s’était tenue la Syrie au moment des élections au Liban, tout en contrôlant ses alliés. Elle témoignait aussi du fait que Riyad a tourné la page depuis l’assassinat de Rafic Hariri. Depuis la visite du roi à Damas, l’atmosphère a changé au Liban : MM. Aoun et Hariri ont renoué des discussions, M. Joumblatt amorce un rapprochement vis-à-vis de Damas… » Il concluait que la composition du gouvernement libanais serait certainement annoncée dans un bref délai, ce qui a bien été le cas, le gouvernement d’union nationale ayant été formé le 9 novembre suivant.
L’ambassadrice de Syrie (41) en France n’a d’ailleurs pas caché ce rôle de co-parrains de la Syrie et de l’Arabie saoudite sur le Liban. Elle a indiqué que « la réconciliation entre la Syrie et l’Arabie saoudite avait permis des progrès dans la situation au Liban, les deux pays étant conscients du fait que la stabilité au Liban est un facteur de paix pour toute la région. »
L’analyse de M. Jean-Claude Cousseran n’est pas très différente : « Une fraction du régime saoudien était tentée par la confrontation avec l’Iran et ses alliés et notamment le régime alaouite. En dépit de ces dispositions d’esprit, il semble que les deux leaderships soient finalement arrivés à un arrangement, au moins tactique, et à des compromis sur plusieurs sujets, et notamment sur la question libanaise. On l’a vu à Doha, on le voit dans la reprise graduelle de rencontres au sommet entre Syriens et Saoudiens, on commence à le voir sur le terrain depuis les récentes élections législatives libanaises. Le rapprochement des deux parrains régionaux syrien et saoudien du Liban peut servir la stabilité de ce pays. »
Un nouveau sujet de convergence de vues entre la Syrie et l’Arabie saoudite est apparu depuis l’automne dernier : il s’agit de la situation au Yémen. Les deux pays défendent la stabilité et l’unité du pays. La Syrie accepte le principe de la protection de la souveraineté saoudienne et reconnaît la légitimité d’une action militaire contre les rebelles houthistes en cas de violation de la frontière. Elle se dit même prête à discuter avec Téhéran des « ingérences iraniennes indirectes » au Yémen, dénoncées par le roi Abdallah.
Enfin, l’Arabie saoudite a repris ses investissements en Syrie et a promis de les augmenter dans des proportions considérables à l’occasion de la 13ème conférence des hommes d’affaires et des investisseurs arabes qui s’est tenue début mars dernier à Damas.
La réconciliation syro-saoudienne traduit donc un certain nombre d’intérêts communs incontestables. Elle est néanmoins apparue très rapide, après une période de vives tensions. M. Ludovic Pouille, sous-directeur de l’Egypte et du Levant (42), a avoué que les spécialistes pensaient que la Syrie se rapprocherait d’abord de l’Egypte avant de se réconcilier avec l’Arabie saoudite. C’est l’inverse qui s’est produit. Selon lui, un rapprochement avec l’Egypte pourrait suivre si la réconciliation interpalestinienne enregistrait des progrès dans les prochains mois. Force est de constater que cela n’a pas encore été véritablement le cas.
b) Des relations qui restent froides avec l’Egypte
Si c’est le Liban qui a été le principal sujet des tensions syro-saoudiennes au cours des dernières années, c’est le dossier palestinien qui envenime directement les relations entre l’Egypte et la Syrie. Dans les deux cas, l’alliance syro-iranienne pose aussi problème, comme cela a déjà été évoqué pour l’Arabie saoudite.
La Syrie et l’Egypte ont pourtant été les deux seuls pays arabes à se réunir au sein d’un même Etat, la République arabe unie, mais l’expérience n’a duré que trois ans, entre 1958 et 1961, les Syriens n’acceptant pas l’hégémonie que Nasser voulait leur imposer. La guerre de 1973, dans laquelle l’Egypte entraîna la Syrie avant de la « trahir » et de négocier une paix séparée avec Israël, à Camp David, en 1979, a ensuite durablement empêché une trop grande proximité. La situation ne s’est pourtant envenimée qu’au cours des dernières années, alors que le Président Moubarak s’était d’abord montré ouvert envers le jeune Président el-Assad, qu’il espérait plus souple que son père.
La crise bilatérale a commencé en 2005, à cause du dossier libanais. Elle a atteint un point de non-retour lorsque le Président el-Assad, mécontent du refus des Etats arabes modérés de soutenir le Hezbollah pendant la guerre contre Israël de l’été 2006, a qualifié leurs leaders de « demi-hommes » à l’occasion d’un discours très agressif. Comme le président égyptien ne faisait pas mystère de sa profonde méfiance vis-à-vis de l’Iran et de ses alliés, il avait de bonnes raisons de se sentir visé.
Les deux chefs d’Etat se sont certes serré la main au sommet tenu à Paris en juillet 2008 pour le lancement de l’UpM, mais la tension n’est pas retombée. L’Egypte voit la Syrie comme un instrument de l’Iran et la Syrie perçoit l’Egypte comme entièrement soumise aux exigences américaines et israéliennes.
Des journalistes syriens rencontrés à Damas par la Mission ont présenté la situation dans les termes suivants : « La Syrie n’a rien à gagner à avoir de bonnes relations avec l’Egypte : l’opinion publique n’y est pas favorable. En outre, pour que la succession du Président Moubarak soit assurée, l’Egypte a besoin du soutien américain, même si cela rend le régime impopulaire dans le monde arabe. Elle refuse les critiques contre les accords de Camp David et fait tout pour les justifier et montrer qu’ils n’ont pas affaibli sa position dans le monde arabe, alors que c’est l’inverse qui s’est produit. Le Président Moubarak veut persuader le Président Sarkozy qu’il ne peut pas faire confiance aux Syriens ! Les populations syriennes et égyptiennes sont très liées, il n’y a pas d’obligation de visa pour aller d’un pays à l’autre, mais les relations politiques sont peu développées. »
Cette opposition se cristallise sur le dossier palestinien.
Selon M. Peter Harling, « pour les Egyptiens, la priorité est d’avancer sur la situation à Gaza et sur la réconciliation interpalestinienne. Les Syriens pensent que les Egyptiens leur en veulent car eux seuls sont restés fidèles à leurs principes et car les deux pays ont une vision contraire de la relation avec Israël. Il y a peu de relations de haut niveau, mais des hommes d’affaires égyptiens sont actifs à Alep et les muftis syriens visitent volontiers la grande mosquée el-Azhar. Le triangle Le Caire, Damas, Riyad a existé pendant la première guerre du Golfe, malgré ces divergences, mais il n’a pas résisté à l’absence d’avancée du processus de paix. »
L’Egypte et la Syrie se trouvent en fait en compétition sur la question de la réconciliation interpalestinienne, alors que, sous couvert de neutralité, la première soutient de facto le Président Abbas quand la Syrie prend le parti du Hamas, étant donné ses relations houleuses avec le Fatah. C’est l’Egypte qui a été chargée par la Ligue arabe de conduire les négociations et c’est elle qui a préparé un document qu’elle souhaite voir parapher par le Fatah et le Hamas. Mais la Syrie juge ce document déséquilibré en faveur du premier et voudrait qu’il soit amendé. Forte de son influence sur le Hamas, elle voudrait être le pays qui a permis la conclusion d’un accord. Damas reproche aussi au Caire de contribuer au bouclage de la Bande de Gaza.
Les désaccords de fond entre les deux pays sont donc profonds et aucun progrès concret n’a encore été réalisé dans le sens d’un rapprochement. Il est évident que la conclusion d’un accord interpalestinien facilitera une telle évolution, que s’efforcent de promouvoir depuis quelque temps les Saoudiens, les Turcs et même les Libyens, conscients de la gêne que le litige syro-égyptien constitue pour la réémergence d’une forme d’unité arabe. Des occasions de renouer le dialogue ont été perdues en 2009, mais de nouvelles pourraient se présenter prochainement. Le 29 mars dernier, au sommet de la Ligue arabe de Syrte, le Premier ministre égyptien a lu une allocution du Président Moubarak réclamant la restitution de tous les territoires arabes occupés, notamment les territoires syriens et libanais, et le Président el-Assad aurait fait part de sa volonté d’aller au Caire, s’entretenir avec son homologue.
Si les relations syro-égyptiennes sont encore tendues et n’ont pas retrouvé la cordialité des relations syro-saoudiennes, une évolution positive pourrait se dessiner. Comme sur de nombreux autres dossiers de cette région, un accord interpalestinien ou une véritable relance du processus de paix contribuerait à accélérer le rétablissement du dialogue. En dépit de ce blocage, ou, d’une certaine manière, en réaction à ce blocage, la Jordanie s’est pour sa part déjà nettement rapprochée de son voisin syrien.
c) Un rapprochement sensible de la Jordanie
Deux membres de la Mission d’information ont effectué un déplacement en Jordanie, qui, bien que très bref, leur a permis de mesurer la déception des Jordaniens vis-à-vis de l’absence d’avancée du processus de paix, malgré un discours officiel lénifiant, et d’observer les signes d’un glissement de l’opinion publique de ce pays vers une certaine radicalisation. Tendre la main vers la Syrie, même si c’est surtout dans une perspective de développement économique, apparaît logique dans ce contexte, même de la part d’un pays très proche des Etats-Unis.
Petit Etat sans passé glorieux, la Jordanie n’apparaît pas comme un concurrent pour la Syrie. Elle défend néanmoins l’initiative arabe de paix, que la Syrie n’approuve pas. Près de la moitié de sa population étant d’origine palestinienne, elle fait de la résolution du conflit israélo-arabe sa priorité et s’efforce de jouer un rôle modérateur dans la région.
M. Antoine Sfeir (43) a rappelé que les difficultés dans les relations syro-jordaniennes dataient du règne du roi Hussein : les Syriens ont tenté de s’ingérer dans les affaires du royaume, notamment en empêchant le passage de produits libanais vers la Jordanie. La Jordanie fait en effet partie de l’axe opposé à l’Iran, tout comme l’Arabie saoudite et le Liban : elle s’oppose ainsi à la Syrie.
Si la Jordanie cherche de nouveaux partenaires régionaux, et accepte de se tourner désormais vers la Syrie, c’est par déception vis-à-vis d’Israël : en effet, la paix qu’elle a signée avec lui en 1994 ne lui a pas apporté le développement économique qu’elle en espérait, la plupart des projets n’ayant pas enregistré le moindre progrès vers leur mise en œuvre. Elle n’attend plus grand-chose de cette « paix froide » et s’ouvre désormais davantage vers ses voisins du nord, à la recherche de partenariats économiques et de projets à plus long terme, notamment dans les domaines des transports et de l’énergie. Le roi se fait l’avocat d’un rapprochement entre la Syrie, l’Arabie saoudite, la Turquie et l’Europe et considère que les négociations entre Israël et la Syrie et les négociations isréalo-palestiniennes ne sont pas contradictoires.
Le rapprochement de la Syrie a été illustré par un échange de visites entre les chefs d’Etat, en 2009 : le Président el-Assad s’est rendu en Jordanie en mars et le roi Abdallah II est allé à Damas en septembre, suivi par son Premier ministre, en octobre.
Début janvier 2010, ont été supprimées les taxes frontalières de sorties pour les voyageurs des deux pays, ce qui a entraîné une forte hausse du tourisme jordanien en Syrie (de l’ordre de 45 % au cours du premier trimestre, soit 800 000 Jordaniens au total), notamment liée au fait que la vie est nettement moins chère en Syrie qu’en Jordanie (d’environ 30 %).
La question de la délimitation de leur frontière est sur le point d’être réglée : après s’être heurtée à des résistances côté syrien, la Haute commission syro-jordanienne de démarcation de la frontière créée en février 2005 a terminé ses travaux fin mars 2010 ; elle doit désormais fixer la date de signature d’un accord final. Un accord de bon voisinage serait aussi en discussion. Le différend sur le partage des eaux du Yarmouk persiste en revanche, la Jordanie estimant que la Syrie ne respecte pas les accords passés, tandis que cette dernière refuse fermement toute coopération dans le bassin frontalier du Yarmouk à cause de la sécheresse structurelle qui frappe l’Est de son territoire.
Parallèlement, les projets économiques impliquant les deux pays se multiplient. Dans le domaine de l’énergie, la Jordanie souhaite accroître les capacités de son réseau électrique et développer les interconnexions avec l’Egypte, les Territoires palestiniens, l’Irak et la Syrie. Elle aura d’autant plus de surplus d’électricité à exporter qu’elle aura réalisé son grand projet de développement du nucléaire civil, consistant à construire des centrales dans le port d’Aqaba. Un autre projet, présentant des difficultés techniques, porte sur l’implantation d’une centrale dans le nord du pays. La Jordanie voudrait aussi que le gazoduc qui la relie à l’Egypte soit prolongé vers la Syrie, le Liban et la Turquie. Pour ce qui est des transports, elle a présenté un projet de transport ferroviaire reliant la frontière syrienne à Aqaba, et qui serait relié aux réseaux irakien et saoudien.
La Jordanie souhaite ainsi devenir un carrefour entre la péninsule arabique et l’Europe, via la Turquie et la Syrie, ce qui la conduit à plaider en faveur de l’insertion de la Syrie dans ces programmes régionaux, mettant en avant le fait que tous les projets qui rapprochent cette dernière de l’Ouest l’éloignent aussi de l’Iran.
Sans avoir d’illusions sur un éventuel ralliement de la Syrie à l’Occident au détriment de l’Iran, la Mission estime, comme les autorités jordaniennes, qu’il faut convaincre la Syrie que son intérêt est davantage du côté de l’Europe et du Proche-Orient qu’à l’Est. Toutes les initiatives visant à la faire participer à des programmes régionaux sont donc à favoriser. Dans la mesure où la Syrie et la Jordanie font partie de l’Union pour la Méditerranée, la Mission souhaite que les moyens dont celle-ci dispose contribuent autant que possible à la concrétisation de ces projets.
*
La première partie de ce rapport met en évidence les domaines dans lesquels la politique syrienne a connu des évolutions importantes au cours des toute dernières années, en rupture avec la période précédente. Leur bilan apparaît incontestablement positif : l’économie syrienne se défait progressivement des oripeaux de l’étatisme qui l’a caractérisée pour s’ouvrir à l’économie de marché et aux investissements étrangers ; même si tous les processus ne sont pas également avancés, la Syrie a renoué des liens plus cordiaux avec l’Occident, et amélioré ses relations avec la plupart des pays de la région. On pourrait souhaiter qu’ils soient plus rapides, mais des progrès sont enregistrés. Les autorités syriennes sont toujours prudentes, mais elles acceptent d’évoluer.
Dans la deuxième partie de ce rapport, seront abordés les sujets sur lesquels le diagnostic de la Mission est plus incertain : sur la plupart d’entre eux, les positions syriennes ne sont pas non plus figées, mais elles évoluent peu ou leurs frémissements restent de surface. Alors que, sur les dossiers que le rapport vient d’aborder, les plus hautes autorités syriennes considèrent que leur intérêt est dans le mouvement, elles hésitent davantage sur le traitement à accorder aux thèmes qui seront l’objet de cette deuxième partie, comme s’ils constituaient des lignes rouges que le régime ne se sent pas en mesure de franchir sans risquer de se fragiliser.
La tâche prioritaire des diplomaties occidentales et modérées doit consister à encourager la Syrie à traiter ces dossiers avec plus de pragmatisme, ce qui implique de mettre en avant les avantages qu’elle en tirerait et de limiter les inconvénients qu’elle redoute.
II – LES HÉSITATIONS SYRIENNES
Trois pays très importants, pour des raisons différentes, ne sont pas inclus dans le processus de rééquilibrage de la diplomatie syrienne : le Liban, l’Iran, Israël. Les rapports que la Syrie entretient avec chacun d’eux ont une dimension quasi passionnelle, ce qui rend leur réorientation difficile, et qui touche aux fondements du régime. On peut donc, sinon approuver, du moins comprendre ses hésitations.
Celles-ci sont aussi perceptibles à l’intérieur même du pays, qu’il s’agisse de la question des droits de l’Homme ou, plus généralement, des évolutions de la société, deux thèmes qui sont influencés par le positionnement international du pays mais qui ont aussi une influence sur lui.
A – Les relations syro-libanaises peuvent-elles se normaliser ?
Ce rapport ne va pas retracer ici en détail l’histoire des relations entre la Syrie et le Liban au cours du siècle dernier. Il évoquera essentiellement ses principaux jalons et la manière dont ces événements pèsent encore sur les liens entre les deux pays, au point que l’on puisse légitimement s’interroger sur la possibilité que ceux-ci deviennent « normaux », c’est-à-dire débarrassés de toute volonté d’influence d’un Etat sur l’autre.
1) Un partage en deux Etats jamais accepté par la Syrie ?
A l’issue de la conférence de San Remo, en avril 1920, la Grande-Bretagne se voit confier un mandat sur la « Syrie du Sud » (Palestine, Israël et Jordanie actuels) et l’Irak, tandis que la « Syrie du Nord » (Syrie et Liban actuels) revient à la France. Celle-ci redécoupe ces territoires, fractionnant les anciennes provinces syriennes ottomanes. Ainsi, dès 1920, l’ancien « Mont Liban », refuge des minorités chrétiennes, et autonome juridiquement depuis les heurts confessionnels de 1860 entre maronites et druzes, se voit attribuer de nouveaux territoires pris sur la « Syrie naturelle » : les villes portuaires de Beyrouth, Saïda et son arrière-pays chiite, Tripoli et son hinterland à dominante sunnite, ainsi que la riche pleine de la Bekaa, majoritairement chiite, le tout constituant le « Grand Liban ». La France veut en effet faire de ce territoire une entité économiquement viable et politiquement sûre, car c’est le point d’ancrage de son influence dans la région.
Le rattachement à la Turquie de la Cilicie (44), d’une partie de la province d’Alep puis d’Alexandrette, accentue encore l’humiliation ressentie par les Syriens et le sentiment d’avoir été trahis par les Français. Ce démembrement a surtout rompu une unité géographique et historique, même si la « Syrie naturelle » n’a jamais constitué une entité politique unifiée : ses habitants ont toujours éprouvé le sentiment d’appartenir à un espace propre, uni par une même culture et soudé par des liens économiques, correspondant à l’ancienne province ottomane du Bilad ach-Cham.
Plusieurs des personnes entendues par la Mission ont souligné le refus de la Syrie d’accepter l’existence du Liban comme un Etat distinct. M. Christophe Bigot (45) a ainsi indiqué que, jusqu’au récent échange d’ambassadeurs, « la Syrie était dans une rhétorique de non-reconnaissance, le Liban étant perçu comme une création de facto de la France de l’époque du mandat. » M. Denis Bauchard (46) fait la même analyse, évoquant le thème de « deux Etats, une nation », longtemps défendu par la Syrie et cher au Président Hafez el-Assad. Les deux diplomates considèrent qu’un changement est intervenu au cours des toute dernières années, et que les Syriens auraient tourné la page.
Mais plusieurs interlocuteurs régionaux de la Mission sont apparus moins optimistes. M. Abderrahmane Bseisso, directeur de la stratégie au ministère palestinien des affaires étrangères, a ainsi affirmé que le Liban est toujours considéré par les Syriens comme faisant partie de la Syrie. Surtout, M. Amine Gemayel, ancien président libanais et chef de Kataëb, a estimé pour sa part que le principal problème était psychologique : « les Syriens sont ataviquement malades de leur conception de la géographie, selon laquelle le Liban doit faire partie de la Syrie, conception qui perdure même depuis son indépendance. Il y a deux Etats à l’ONU, à la Ligue arabe, donc la Syrie a toujours reconnu de fait l’indépendance libanaise, mais elle garde – ainsi que son peuple, auquel elle a été inculquée – la nostalgie de l’unité des deux Etats. Pourtant, pendant l’Empire ottoman, le Mont Liban avait préservé son identité, son gouvernorat et son prince libanais, élu par ses pairs, ce qui était un cas unique dans l’Empire ! »
a) Des peuples et des économies étroitement liés
Les difficultés des Syriens à accepter l’indépendance des Libanais ont été entretenues par la persistance de liens étroits résultant de leur histoire partagée pendant l’Empire ottoman.
M. Salam Kawakibi a ainsi indiqué à la Mission : « Les grands banquiers et un certain nombre des riches commerçants du Liban sont des catholiques originaires d’Alep qui ont quitté la Syrie à la fin des années 1950. Les liens familiaux et sociaux entre les deux peuples sont très étroits. Une chercheuse française a estimé que 60 % des familles libanaises avaient des parents en Syrie, et inversement. Il n’en reste pas moins qu’une partie des Libanais se montre condescendante à l’égard des Syriens.
Depuis les années 1940, la main-d’œuvre ouvrière syrienne est considérable au Liban. Ces personnes sont à la fois victimes de la piètre image que les Libanais ont d’eux et du régime syrien qui les maintient dans la pauvreté et les contraint à se faire exploiter au Liban. Dans le même temps, la réorganisation urbaine de Damas a été confiée à un cabinet d’études libanais et 80 % des banques privées en Syrie sont des banques libanaises. Les deux pays partagent ainsi des intérêts économiques communs. De même, les intellectuels syriens publient dans la presse libanaise, malgré les efforts du régime syrien pour l’empêcher. » (47)
Les jeunes acteurs socio-économiques que la Mission a rencontrés à Damas ont aussi témoigné directement des liens entre les deux peuples et les deux économies. Un grand nombre d’entre eux a d’ailleurs la double nationalité et fait des affaires dans les deux pays.
Le service économique régional pour le Proche-Orient, placé auprès de notre ambassade au Liban, estime que, jusqu’en 2005, le Liban a été le poumon économique de la Syrie et un refuge pour les intérêts financiers du régime. Le « traité de fraternité » de 1991 fixe pour objectif, au plan économique, une « intégration » entre les deux pays. Une série d’instances bilatérales a été mise en place pour y contribuer et dix-sept conventions d’application du traité ont été conclues entre 1991 et 1997, couvrant la plupart des secteurs d’activité.
Signée en 1993 et entrée en vigueur le 1er janvier 1999, la convention de coopération économique et sociale repose sur les principes de liberté de déplacement, de résidence, de travail, de création d’emplois et d’exercice d’une activité économique, d’échange de produits nationaux, de transfert de capitaux, de transport et de transit, d’acquisition de biens immobiliers, dans le respect des législations nationales. Afin de réaliser un marché commun entre les deux pays, ont aussi été conclus un accord de libéralisation des produits industriels et un accord de libre-échange des produits agricoles et d’élevage, ces accords s’insérant désormais dans le GAFTA. Vingt-quatre projets libano-syriens ont reçu, depuis 1991, l’autorisation légale de démarrer en Syrie : il s’agit de partenariats portant sur l’industrie alimentaire, la production de phosphate brut, la fabrication de bouteilles en verre ou de barres d’acier, pour ne citer que quelques exemples.
Les accords bilatéraux, destinés à promouvoir les échanges, n’ont pourtant pas eu les résultats escomptés. Les hommes d’affaires libanais déploraient les nombreuses barrières syriennes qui gênaient leur application, à cause du caractère encore largement étatique de son économie. En outre, la Syrie était soucieuse de protéger se productions industrielles et agricoles, d’une part en interdisant l’entrée de certains produits libanais directement concurrents, et d’autre part en en retardant les formalités d’entrée pour d’autres produits. Les échanges commerciaux bilatéraux étaient ainsi traditionnellement déséquilibrés en faveur de la Syrie.
Par ailleurs, 200 à 300 000 Syriens travailleraient au Liban, où ils sont exclus de l’application de la législation libanaise du travail, ce dont profitent très volontiers les entreprises privées libanaises, l’Etat libanais se montrant extrêmement tolérant dans ce domaine.
Le système financier libanais héberge aussi une part significative
– estimée au tiers – des avoirs syriens à l’étranger et a été très utilisé comme plate-forme pour les transactions commerciales des milieux économiques syriens. Le secret bancaire libanais a également favorisé l’émergence d’une véritable zone grise dans les relations financières entre les deux pays. Les hommes d’affaires d’origine syrienne sont enfin très présents au Liban, dans le secteur financier mais aussi dans d’autres secteurs clés comme la promotion immobilière.
On voit bien que ces liens étroits ont laissé des traces très fortes, particulièrement marquées côté libanais, et dont l’aspect le plus gênant pour l’indépendance du Liban est l’influence exercée par la Syrie sur la vie politique du pays du Cèdre.
b) Des décennies d’influence et d’ingérences syriennes dans la vie politique libanaise
Au cours des dernières décennies, la Syrie a su tirer profit des faiblesses inhérentes au Liban, pour exercer une véritable main mise sur sa vie politique. Depuis qu’il a proclamé son indépendance en 1943, le Liban n’a jamais été durablement stable : une première crise a éclaté en 1958 entre pro-occidentaux et nassériens, puis des violences ont secoué le pays à partir de la fin des années 1960, opposant partis de gauche et formations palestiniennes aux miliciens de Kataëb, la principale force chrétienne. Elles dégénèrent en guerre civile, qui semble tourner à l’avantage des plus radicaux et risque d’entraîner une attaque israélienne préventive (48), susceptible de toucher aussi le territoire syrien. Damas décide alors d’intervenir pour imposer sa solution : le 1er juin 1976, l’armée syrienne pénètre au Liban ; en septembre, elle domine Beyrouth ; en novembre, elle s’installe dans l’ensemble du pays à l’exception du sud, après l’acceptation d’un cessez-le-feu par les différentes parties. La communauté internationale finit par entériner ce fait accompli.
Ce coup de force est encore dans toutes les mémoires, à Damas comme à Beyrouth. M. Richard Labevière, le rédacteur en chef de la revue Défense(49), a rappelé que l’intervention syrienne de juin 1976 répondait à une demande des chrétiens libanais. M. Sleiman Frangié, chef de Al Marada, un parti chrétien pourtant pro-syrien, a en revanche indiqué que les Syriens étaient entrés au Liban sous couverture internationale, sans que les Libanais le leur demandent – tout comme d’ailleurs, ils en étaient partis en 2005.
Une fois dans la place, l’armée syrienne est en effet restée sur le territoire libanais pendant près de trente ans. Hafez el-Assad considère que la défense de la Syrie contre Israël passe par celle du territoire libanais, dans la mesure où, pour une armée israélienne installée au sud-Liban, la vallée de la Bekaa est un couloir d’accès naturel vers les villes du centre de la Syrie. Ainsi, profitant de la faiblesse de l’Etat libanais et des conflits communautaires, la Syrie trouve constamment des parades juridiques ou politiques justifiant le maintien de l’armée syrienne au Liban, au nom de la résistance à l’Israël ou du maintien de l’équilibre du pays. Elle prend directement part à la guerre « civile » qui dévaste le pays jusqu’en 1989, lorsque les accords de Taëf consacrent le maintien de sa présence au Liban.
Au-delà de la présence militaire, la Syrie entend imposer sa tutelle en vassalisant les acteurs de la vie politique libanaise. Elle défend la constitution de gouvernements d’union nationale car, étant faibles, ils dépendant toujours de son appui. Pour que le Liban soit stable, pluricommunautaire et économiquement prospère, Hafez el-Assad prône un équilibre communautaire que les accords de Taëf institutionnalisent. Ils conditionnent le retrait de l’armée syrienne à la réalisation d’improbables réformes politiques, y compris la déconfessionnalisation, et mentionnent l’établissement de « liens privilégiés » entre la Syrie et le Liban, sur lesquels se fondent la coopération et la coordination entre les deux pays et qui permettent l’intervention permanente de la Syrie dans les affaires libanaises.
Hafez el-Assad met un terme par la force à la résistance du général Michel Aoun, le Premier ministre, qui refuse le processus, avant d’obtenir une véritable vassalisation du Liban à travers la signature de l’accord de fraternité et de coopération entre les deux pays, en mai 1991, puis la conclusion d’un accord de défense, la tenue de sommets bilatéraux, la mise en place d’un Conseil supérieur mixte et la signature de nombreux accords culturels et économiques. Les institutions libanaises sont alors restaurées sous le contrôle de la Syrie, qui coopte la nouvelle classe politique libanaise après avoir fait condamner sévèrement ses principaux adversaires.
Bien que, le 25 mai 2000, Israël ait retiré unilatéralement ses forces du Liban-Sud, qu’elles occupaient depuis 1978, Hafez el-Assad meurt quelques jours après sans avoir pris de décision relative à la présence militaire syrienne au Liban. Un an plus tard, M. Bachar el-Assad ordonne un retrait partiel de ces troupes : près de 7 000 soldats, sur les 10 000 postés à Beyrouth, évacuent la capitale et sa banlieue – ce qu’ils auraient dû faire dès 1992, en application des accords de Taëf.
Avant même l’assassinat de Rafic Hariri, un vent de révolte contre la tutelle syrienne a commencé à souffler parmi les partis qui étaient dans l’opposition après l’annonce, le 28 août 2004, par le gouvernement libanais, alors présidé par Rafic Hariri, d’un projet d’amendement à la constitution destiné à prolonger le mandat du Président Emile Lahoud, suite à la demande expresse qui en avait été faite par le Président el-Assad. Quatre ministres opposés à cet amendement démissionnent puis le député druze Wallid Joumblatt lance une pétition remettant en cause cette décision. Le Premier ministre démissionne le 20 octobre et, le 13 décembre, pour la première fois, tous les partis de l’opposition lancent un programme commun dénonçant la tutelle syrienne.
Le mouvement prend une ampleur considérable aux lendemains de l’assassinat de Rafic Hariri : les manifestations quotidiennes contre la présence syrienne commencent dès le 16 février 2005, deux jours après l’attentat. Si, le 8 mars, 400 000 personnes manifestent à Beyrouth en faveur de la Syrie et contre l’ingérence de Washington et Paris, à l’appel des partis chiites Hezbollah et Amal, elles sont près d’un million, le 14 mars, à réclamer, dans un rassemblement sans précédent, à la fois la vérité sur l’assassinat de l’ancien premier ministre et le départ du chef de l’Etat.
C’est donc sous la pression de l’opposition libanaise et de la communauté internationale, qui exige l’application de la résolution 1559 du Conseil de sécurité, que s’achève, le 26 avril 2005, le retrait précipité des 14 000 soldats syriens encore présents dans la plaine de la Bekaa, dont le départ avait débuté le 8 mars 2005. Les 29 mai et 19 juin, se tiennent des élections législatives remportées par la coalition anti-syrienne menée par Saad Hariri, le fils de l’ancien premier ministre assassiné. Le nouveau gouvernement, formé par M. Fouad Siniora, inclut néanmoins des membres du Hezbollah. Pendant plusieurs mois, les attentats meurtriers se multiplient, contre des hommes politiques et des journalistes, notamment. Faisant écho aux demandes libanaises exprimées dans le cadre du « dialogue national » lancé en mars 2006, le Conseil de sécurité a adopté en mai 2006 la résolution 1680 qui demande à Damas de délimiter sa frontière avec le Liban et d’établir des relations diplomatiques complètes avec lui.
Le Président Emile Lahoud achève quant à lui son second mandat normalement, fin 2007, ce qui ouvre une nouvelle crise, le Parlement ne parvenant pas, pendant plusieurs mois, à élire son successeur.
Cette crise ne se dénoue qu’à la fin du mois de mai 2008, après que le pays soit à nouveau passé tout près de la guerre civile. Début mai, le limogeage du chef des services de sécurité de l’aéroport, un officier chiite pro-syrien, et la mise hors la loi du réseau de télécommunication du Hezbollah ont en effet conduit à des affrontements meurtriers entre la majorité et l’opposition, qui font une soixantaine de victimes. Bien que, le 14 mai, le gouvernement ait annulé les deux décisions contestées, il faut attendre la conclusion de l’accord de Doha, une semaine plus tard, pour que l’on s’achemine vers une sortie de crise : obtenu grâce à la médiation de la Ligue arabe et du Qatar, l’accord prévoit l’élection immédiate du président de la République, la formation d’un gouvernement d’union nationale – demandée par le Hezbollah depuis fin 2006 – et le départ des manifestants de l’opposition installés au centre de Beyrouth depuis fin 2006. Le 25 mai, M. Michel Sleiman, commandant en chef de l’armée – donc un militaire, ce qui, en application de la constitution, n’est pas compatible avec la fonction présidentielle –, est élu président du Liban et, le 11 juillet, M. Fouad Siniora forme un gouvernement d’union nationale composé de seize ministres de la majorité, de onze appartenant à l’opposition menée par le Hezbollah, et de trois membres nommés par le président de la République et celui du Parlement, M. Nabib Berri.
La résolution de cette crise, à laquelle la communauté internationale sait gré à la Syrie d’avoir contribué, marque à la fois le début du processus d’amélioration des relations de celle-ci avec l’Occident et celui d’une certaine normalisation de ses rapports avec le Liban.
2) Les signes d’une forme de normalisation en cours
Les premiers signes de la volonté syrienne de faire évoluer les relations entre les deux pays ont été observés à compter de la rencontre des deux chefs de l’Etat à la veille du sommet de l’UpM de Paris, le 12 juillet 2008. Depuis, un certain nombre de progrès ont été enregistrés.
M. Denis Bauchard les résume en quelques mots : « l’établissement des relations diplomatiques, l’échange d’ambassadeurs, le déroulement des élections législatives de juin 2009 sans interférences massives, la formation d’un gouvernement d’union nationale – après la visite du roi d’Arabie saoudite à Damas –, la constitution de groupes de travail sur les dossiers à traiter, comme celui des frontières ou des disparus » (50).
Le 14 août 2008, à l’issue d’entretiens entre les présidents syrien et libanais, ce dernier étant reçu officiellement en Syrie, les deux pays décident notamment d’ouvrir, pour la première fois depuis leur indépendance, des ambassades dans leurs capitales respectives, de réévaluer les accords bilatéraux conclus pendant la présence militaire syrienne au Liban et de lutter contre les activités illégales et la contrebande à leurs frontières. Les relations diplomatiques entre les deux pays deviennent officielles à partir du 15 octobre. Des ambassadeurs ont, depuis, été nommés et sont entrés en fonction. Tous les interlocuteurs de la Mission ont souligné la dimension symbolique de cette reconnaissance. Lors de sa visite à Damas, les 19 et 20 décembre 2010, le Premier ministre libanais a ainsi pu tenir une conférence de presse dans les locaux temporaires de l’ambassade de son pays.
Le déroulement des élections législatives du printemps 2009 et la victoire remportée par les anti-syriens sont aussi mis au crédit de la Syrie, même si beaucoup s’interrogent sur les raisons profondes de la non-interférence syrienne.
Tel est le cas de M. Christophe Bigot qui a dit à la Mission : « Les Syriens sont apparus comme de bons élèves dans le déroulement de ces élections. Peut-être ne souhaitaient-ils pas une victoire du Hezbollah qui aurait déséquilibré sa relation avec la Syrie ? Peut-être ne souhaitent-ils pas non plus que leurs alliés deviennent trop puissants ? » (51)
M. Jean-Claude Cousseran a nourri des interrogations du même type : « Le résultat des récentes législatives libanaises a été une surprise. Contre la plupart des pronostics, les amis de la Syrie et de l’Iran ont subi une défaite. Certains y ont vu la main de l’Arabie saoudite, qui aurait indirectement subventionné le retour au pays de nombre d’électeurs sunnites venus voter au Liban. Certains observateurs ont exprimé le sentiment que les élections aient pu avoir été " concertées ". Il n’est pas impossible que la Syrie et l’Iran aient pu se persuader qu’une victoire de leurs alliés libanais aurait été plus embarrassante qu’utile dans un contexte marqué par la puissance des Etats-Unis, par les menaces israéliennes sur l’Iran, par l’hypothèse d’une grave crise régionale. » (52)
Même si ces questions sont parfaitement pertinentes, il est évident que, quelles que soient les motivations de la Syrie, cette dernière a laissé les élections législatives libanaises se dérouler dans des conditions normales, ce qui ne peut qu’être salué.
En ce qui concerne la constitution du gouvernement d’union nationale, en novembre dernier, sous la présidence de M. Saad Hariri, Mme Lamia Chakkour a volontiers reconnu la contribution de son pays : « La Syrie est parvenue à faire accepter à l’opposition libanaise l’idée d’un gouvernement de consensus national, formé de quinze membres de la majorité, de dix membres de l’opposition et de cinq personnalités choisies par le président de la République. Son rôle est désormais fini : elle n’interviendra pas dans le choix des ministres. » (53)
La mise en place des deux groupes de travail, mentionnée par M. Denis Bauchard, renvoie à deux des questions les plus délicates que les deux pays ont à régler : celle de la délimitation de leur frontière et celle des Libanais détenus ou disparus en Syrie.
Afin de garantir le respect de la souveraineté des deux Etats et leur sécurité, il est nécessaire de fixer les frontières et d’organiser leur contrôle, pour empêcher, notamment, les transferts d’armes. Une commission chargée de ce travail a existé entre 1964 et 1974, puis une nouvelle a été mise en place en 2005. Mais le blocus syrien de la frontière syro-libanaise à l’été 2005 a montré que c’était la Syrie qui en avait la maîtrise et qu’elle était prête à utiliser cette capacité à des fins de déstabilisation. Parmi les zones litigieuses dans la délimitation de la frontière figure celle de Chebaa, qui constitue un abcès de fixation. Syriens et Libanais estiment que ce petit territoire est libanais tandis qu’Israël considère qu’il fait partie du Golan syrien et l’occupe à ce titre depuis 1967. C’est officiellement l’occupation israélienne de cette minuscule portion de territoire qui justifie la résistance conduite par le Hezbollah. Aussi, si Damas reconnaissait officiellement sa « libanité », il se priverait dans ses discussions avec Israël à la fois du levier que constitue l’action du Hezbollah et d’un outil de pression en vue de récupérer son propre territoire occupé, le plateau du Golan (voir infra). C’est pourquoi la Syrie a affirmé que l’occupation de Chebaa empêchait toute délimitation de la partie sud de la frontière. Le comité mixte chargé de délimiter les frontières ne s’est pas encore réuni, seuls ses membres libanais ayant été désignés.
La résolution des litiges frontaliers est pourtant essentielle pour permettre d’améliorer la sécurité régionale grâce à une lutte efficace contre la contrebande d’armes, laquelle constitue un problème extrêmement sensible puisqu’elle assure l’essentiel de l’ascendant de Damas sur le Hezbollah et est nécessaire au maintien du statut milicien de celui-ci, lequel est l’objet d’un débat tendu au Liban mais a été reconnu dans le discours d’investiture du Président Sleiman et dans la déclaration de politique générale du gouvernement. Il est aussi au centre du dialogue national sur la stratégie de défense récemment lancé par la présidence libanaise. Une commission mixte chargée de coordonner l’action des deux ministères de l’intérieur dans la lutte contre le terrorisme et d’établir un mécanisme de contrôle aux frontières a été mise sur pied le 10 novembre 2008, mais les difficultés semblent bien moins liées à un manque de capacités qu’à un manque de volonté politique.
Une commission a aussi été créée pour traiter le dossier, également très délicat, des Libanais disparus dans les prisons syriennes. Il s’agit de la quatrième chargée de cette question depuis 2000. Le nombre de ces disparitions non élucidées est un premier objet de polémique. Environ 2 000 auraient été recensées au Liban ; nombre de ces disparus ont été tués ; certains auraient été enlevés par des miliciens, d’autres par l’armée syrienne. Plusieurs centaines seraient encore tenues au secret dans les prisons syriennes (54). M. Nasri Khoury, secrétaire général du Haut conseil syro-libanais, que deux membres de la Mission ont rencontré, a expliqué que la commission mixte créée en 2005 avait établi une liste, que le gouvernement libanais doit réviser, ce qu’il ne semble pas prêt à faire. Il a affirmé que les Syriens avaient répondu à 90 % des questions qui leur étaient posées et déploré que les milices aient fait inscrire de nombreux noms de disparus, alors qu’il est possible que ces personnes aient été exécutées au Liban. Même M. Samir Geagea, chef des Forces libanaises, qui, contrairement à M. Khoury, n’est pas suspect de proximité avec les intérêts syriens, estime seulement entre 300 et 600 les personnes détenues par l’armée syrienne qui n’ont plus donné de nouvelles depuis des années. Sans citer de chiffre, le Président Sleiman a souligné le caractère délicat de ce dossier, en particulier à cause des familles des disparus, et déploré que les Syriens refusent de nommer des défenseurs des droits de l’Homme au sein de la commission, qui ne devrait, selon eux, n’avoir pour membres que des fonctionnaires et des magistrats. On signalera néanmoins qu’une vingtaine de détenus libanais ont été libérés au printemps 2009.
Au cours de l’entretien qu’il a accordé à la Mission, M. Saad Hariri a estimé que la stabilisation des relations bilatérales progressait lentement et que, à l’occasion de sa visite à Damas, il avait abordé tous les sujets avec le Président
el-Assad. Parmi les dossiers à traiter, il a mentionné la délimitation des frontières, mais aussi la question des armes des Palestiniens hors des camps de réfugiés et la révision des accords bilatéraux. Dans ces deux dernières matières, il s’agit aussi de mettre un terme à l’héritage de la période d’immixtion directe de la Syrie dans les affaires libanaises.
Un grand nombre des responsables politiques libanais a abordé la question des armes des Palestiniens hors des camps devant les membres de la Mission, en lien avec le dialogue national sur la stratégie de défense. Ces armes constituent en effet un relais de l’influence syrienne : non seulement elles ont été fournies par la Syrie, mais ce sont aussi des officiers syriens qui forment et encadrent les hommes qui les détiennent. Il semble qu’un consensus existe au sein des forces politiques libanaises pour désarmer ces groupes, mais rien n’a encore été fait. Même ceux qui défendent le maintien des armes du Hezbollah, considérées comme les armes de la « résistance » (voir infra), à l’exemple du général Michel Aoun, contestent la légitimité de celles détenues par les Palestiniens : le général estime qu’elles posent même un problème bien plus grave que celles du Hezbollah.
Enfin, le principe d’une révision des accords bilatéraux conclus à partir de 1991 au profit des intérêts syriens et qui ont contribué à la vassalisation du Liban a été accepté au sommet syro-libanais de l’été 2008, sans avoir encore été traduit dans les faits. M. Nasri Khoury a, une fois encore, attribué la responsabilité de ce blocage au gouvernement libanais, qui n’aurait, contrairement à la Syrie, pas encore formulé ses propositions. Le secrétaire général du Haut conseil syro-libanais n’a pas pour autant indiqué qu’elles étaient les propositions syriennes. Il a seulement précisé que les Syriens souhaitent discuter de tous les accords en même temps, voire même traiter l’ensemble des sujets bilatéraux sous la forme d’un « paquet », ce qui, étant donné la complexité de certains d’entre eux, rend très improbables des avancées rapides. Le Président Sleiman a d’ailleurs estimé que, si des études étaient en cours en vue d’une éventuelle renégociation des accords, celle-ci n’est pas le point le plus important, et a conclu que l’on « pouvait s’arranger avec les accords actuellement en vigueur ».
On voit donc bien que, si la Syrie a effectivement consenti des gestes en direction d’un rééquilibrage de ses relations avec le Liban, ceux-ci n’ont pas encore reçu une véritable traduction sur le terrain. Tout ne peut évidemment pas être résolu en quelques mois et les premiers gestes ne datent que de l’été 2008. Mais les observateurs et certains acteurs de la vie politique libanaise ont néanmoins des raisons de douter de la volonté syrienne de parvenir à une véritable banalisation des relations bilatérales.
3) Des limites évidentes : vers le maintien de « liens privilégiés » ?
Les plus sceptiques mettent en avant l’absence d’avancées concrètes sur les dossiers de la délimitation de la frontière et des disparus, mais minorent aussi l’impact de l’échange d’ambassadeurs. Si l’ambassadeur du Liban en Syrie est présenté comme un diplomate de qualité, son homologue semble un homme de peu de poids, qui ne remplit pas son rôle. Il est reproché au Haut conseil syro-libanais et à son secrétaire général de continuer à « tirer les ficelles » de la relation bilatérale. Ce dernier s’est d’ailleurs défendu de ce reproche en indiquant avoir déjà transmis à l’ambassadeur de Syrie au Liban la responsabilité des tâches consulaires qu’il assurait en l’absence de représentation diplomatique et en assurant qu’il ferait de même des autres missions qui ne relevaient pas strictement de sa compétence. Son rôle devrait ainsi être redéfini. On observera qu’il n’a nullement évoqué une éventuelle suppression de son poste et du Haut conseil, laquelle avait pourtant, un temps, été envisagée.
Un autre signe incontestablement négatif réside dans l’émission par la justice syrienne, à la veille de la visite à Damas de M. Rafic Hariri, de commissions rogatoires à l’encontre de plusieurs de ses proches, accusés de faux témoignage, de subornation de témoin ou, en ce qui concerne les magistrats, de déni de justice, par le général syrien Jamil Sayyed, ancien directeur général de la sûreté générale, détenu provisoirement pendant quatre ans, avant d’être libéré en avril 2009, dans le cadre de l’enquête sur l’assassinat de Rafic Hariri. La validité juridique de ces commissions rogatoires est incertaine, mais le message politique qu’elle porte est négatif. M. Samir Geagea, chef des Forces libanaises, a ironisé sur ce réveil soudain de la justice syrienne, d’habitude si discrète. Cet acte d’hostilité n’a pourtant pas fait obstacle à la visite du Premier ministre libanais au Président el-Assad, perçue par certains comme un geste d’allégeance. Pour les diplomates français, elle était le prix à payer pour l’intervention de l’Arabie saoudite en faveur de la constitution du gouvernement et un moyen, pour M. Saad Hariri, de se poser comme l’interlocuteur de Damas.
M. Samir Geagea a aussi mentionné devant la Mission d’autres indices significatifs : « la réapparition de Haou Moussa, qui était chef d’un groupe dissident du Fatah il y a trente ans, qui vit à Damas, et qui déclare aujourd’hui qu’il ne faut pas accepter de compromis sur les armes détenues par les Palestiniens hors des camps, alors que l’on sait que ces bases, situées près de la frontière libano-syrienne, sont financées par la Syrie qui en assure la logistique » ; les critiques vis-à-vis du régime politique libanais exprimées par le Président el-Assad à l’occasion d’une interview donnée au New Yorker ; le fait que les médias syriens s’en prennent au mouvement du 14 mars et au Premier ministre libanais.
Pour les anti-syriens, Damas n’a nullement renoncé à exercer une influence importante sur les affaires libanaises, même après le retrait de son armée.
Les déclarations de M. Amine Gemayel, chef de Kataëb, sont sans concession : « La Syrie considère toujours qu’elle a des droits sur le Liban. (…) Le retrait militaire syrien a été vécu comme une humiliation car il a été imposé à la Syrie. Aussi, cette dernière s’efforce d’en compenser les effets : elle possède toujours des armées auxiliaires au Liban, sous une étiquette palestinienne mais encadrées par l’armée syrienne et avec des cadres syriens, ce qui lui permet de contrôler des enclaves en territoire libanais ; les services de renseignement constituent une cinquième colonne au Liban ; la Syrie appuie le Hezbollah et des groupuscules islamistes pilotés par ses services de renseignement ; elle a des liens privilégiés avec Nabih Berri, le président du Parlement libanais, et avec de nombreux leaders politiques pro-syriens. Infiltrée dans les institutions (armée, sûreté générale, services de renseignement, organismes caritatifs), la Syrie fait toujours directement pression sur le pouvoir libanais. »
L’analyse de M. Denis Bauchard (55), plus nuancée, arrive néanmoins à la même conclusion : « En fait, si elle n’est plus militaire, la présence syrienne au Liban reste forte, par l’intermédiaire des services de renseignement et des nombreux obligés libanais du régime. » Il observe aussi qu’une partie importante de la population libanaise – de l’ordre de la moitié – fait allégeance à la Syrie, ce qui se reflète dans la composition du Parlement libanais : il s’agit d’abord des chiites, mais aussi de la majorité des sunnites – du moins jusqu’à l’assassinat de Rafic Hariri – et des chrétiens de la Bekaa et de Tripoli. C’est au sein du mouvement du 8 mars que l’influence syrienne est la plus importante, mais le mouvement du 14 mars compte aussi des éléments qui ont été autrefois pro-syriens. Plusieurs des responsables politiques libanais qui ont discuté avec les membres de la Mission ont rappelé les relations amicales qu’ils entretenaient avec le Président el-Assad et sa famille.
Le Président Sleiman, pourtant proche de la Syrie, déplore très légitimement que son homologue syrien persiste à rencontrer officiellement et régulièrement non seulement les responsables du Hezbollah mais aussi les chefs de certains autres partis libanais, alors que les relations bilatérales devraient être établies entre les deux Etats et leurs représentants officiels. Récemment, les Libanais ont suivi avec attention la rencontre à Damas entre le président syrien et M. Wallid Joumblatt, qui avait, un temps, pris ses distances avec la Syrie avant d’amorcer un nouveau rapprochement. Ce type d’événement témoigne de manière évidente de la persistance des immixtions syriennes dans la vie politique libanaise, que le chef de l’Etat libanais ne peut que regretter.
L’influence économique de la Syrie demeure aussi très forte au Liban, par l’intermédiaire de ses alliés directs (Hezbollah, alaouites du nord du pays, certains partis politiques) et grâce à ses contacts d’intérêt économique (hommes d’affaires, banquiers, hommes politiques) : ces relais sont toujours actifs et présents dans tout le pays. La Syrie reste l’arbitre des grandes décisions économico-politiques au Liban, ce dont atteste le nombre de « voyages à Damas » de personnalités influentes du monde économique libanais. Son influence s’exerce en faveur du ralentissement des grandes évolutions de l’économie libanaise d’une part pour éviter que celle-ci se développe trop vite par rapport à l’économie syrienne, d’autre part dans le but de montrer que, en l’absence de la Syrie au Liban, les Libanais sont incapables de s’entendre pour réaliser les réformes économiques nécessaires. Les services économiques de l’ambassade de France au Liban estiment néanmoins que l’ouverture et la modernisation de l’économie syrienne commencent à changer la donne, de grands projets étant désormais réalisés en Syrie par des entreprises libanaises, ce qui a pour conséquence que les relations économiques évoluent progressivement de la domination vers la coopération.
M. Abbas Zaki, membre du comité central du Fatah, estime que, paradoxalement, la présence syrienne est aujourd’hui plus forte qu’avant le retrait des troupes syriennes : en effet, selon lui, « quand l’armée syrienne était présente au Liban, elle a commis des erreurs qui ont conduit les Libanais à la détester. Ce n’est plus le cas aujourd’hui : si des erreurs sont commises, elles le sont par les Libanais eux-mêmes. Le Liban est entouré d’un côté par la mer, de l’autre par Israël et enfin par la Syrie ; il ne peut donc se tourner que vers cette dernière. Les Syriens le savent parfaitement : si ce que fait le régime libanais leur déplaît, ils soutiennent la résistance ; si celle-ci va trop loin, ils se rallient aux autorités. »
Son collègue M. Nabil Shaath, responsable des relations internationales du Fatah, estime lui aussi que la priorité de la Syrie est de maintenir son influence sur le Liban. Ce sentiment est d’ailleurs partagé par les responsables israéliens rencontrés par la Mission, y compris par M. Dan Meridor, ministre de l’Etat d’Israël, chargé des services de renseignement et de la commission à l’énergie nucléaire, pourtant l’un des plus fervents défenseurs d’un accord syro-israélien sur le Golan.
Même les observateurs les plus impartiaux reconnaissent que la Syrie veut empêcher que ne s’installe au Liban un pouvoir qui serait hostile à ses intérêts, qu’il soit pro-israélien (comme le fut celui de M. Amine Gemayel), pro-américain ou pro-français, et qu’elle a encore les moyens d’y parvenir. Le Président Sleiman a conclu son analyse sur les relations syro-libanaises dans les termes suivants : « La Syrie est plus forte que le Liban et elle a une influence politique historique sur une partie importante du peuple libanais : il faut obtenir qu’elle ne s’exerce pas contre les intérêts libanais. Quand la Syrie sentira que le Liban n’est pas contre elle, ça ira mieux. »
M. Sleiman Frangié juge indispensable le maintien de relations étroites entre son pays et la Syrie. Il se réjouit de la fin de la présence militaire syrienne car cette présence a causé bien des problèmes, et son retrait permet une amélioration de la relation bilatérale, de nombreuses sources de tension (comme les centaines de barrages) ayant été levées. Il reconnaît que les Syriens s’ingèrent dans la politique libanaise, mais, relativise ce phénomène en affirmant que tous les pays profitent des politiques menées chez leurs voisins et se réjouissent du fait qu’elles soient proches de la leur ! Pour lui, il ne s’agit pas d’immixtions directes mais une présence de trente ans a pour conséquence des intérêts très mêlés et de nombreuses amitiés. Aussi, conclut-il, géographiquement, historiquement et politiquement, le Liban ne peut être l’ennemi de la Syrie, ce qui ne signifie pas pour autant qu’il en soit dépendant.
Côté syrien, persiste clairement l’idée que les relations bilatérales doivent rester particulières, ce qui renvoie directement aux « liens privilégiés » inscrits dans le traité de fraternité de 1991. M. Wallid el-Mouallem a ainsi expliqué que la Syrie étant le seul voisin du Liban – ce qui revient à oublier l’existence d’Israël – « ou ils ont des relations privilégiées, ou ils n’ont pas de relations. La Syrie a choisi la première solution, tout en se félicitant du retrait de 2005 et en n’envisageant pas de retour ». Lorsque M. Mahmoud al-Abrache, président de l’Assemblée du peuple, qualifie de « familiales » les relations bilatérales, on ne peut que constater que la banalisation des relations entre la Syrie et le Liban est loin d’être acquise.
La Mission estime que les progrès enregistrés dans les relations syro-libanaises doivent absolument être consolidés et que les gestes symboliques, pour importants qu’ils soient, ne sauraient suffire. Si la France ne doit pas apparaître comme prenant systématiquement la défense du Liban contre la Syrie, elle doit rester ferme lorsque la souveraineté de celui-ci est en cause. La proximité de deux peuples ne saurait justifier l’ingérence d’un Etat dans les affaires de son voisin.
Il est donc essentiel que notre pays contribue d’une part à renforcer l’Etat libanais, d’autre part à veiller au respect par la Syrie de l’indépendance de celui-ci. Le retour à la normale des relations franco-syriennes était conditionné à une feuille de route (voir supra) : sa mise en œuvre a connu des avancées mais beaucoup reste encore à faire. La France doit donc rester attentive à ce que les travaux des commissions relatives à la question des disparus libanais et surtout à la délimitation de la frontière – laquelle est essentielle pour l’avenir des relations syro-libanaises – aboutissent. Il en va de la crédibilité de notre diplomatie. Les autorités syriennes attendent beaucoup de notre pays ; celui-ci doit savoir accorder ce qui lui est demandé en fonction des résultats obtenus sur les dossiers auxquels il a donné sa priorité, ce qui est le cas de la démarcation de la frontière syro-libanaise et de la résolution des disparitions de Libanais en Syrie.
Il est d’autant plus important de faire pression en faveur du règlement de ces différends que celui-ci apparaît certes délicat, mais pas irréaliste, et en tout cas plus facile à atteindre que la disparition de tous les relais officieux de l’influence syrienne au Liban ou le relâchement des liens entre la Syrie et l’Iran, un autre Etat dont l’Occident la juge, pour des raisons différentes, trop proche.
B – L’alliance syro-iranienne est-elle affectée par l’ouverture diplomatique syrienne ?
Les relations syro-iraniennes ne sont absolument pas comparables aux relations syro-libanaises, même si elles peuvent aussi être qualifiées d’étroites. La Syrie et l’Iran sont deux Etats solides, aux mains de régimes autoritaires. Si l’idéologie les sépare, leurs intérêts stratégiques les rapprochent depuis plus de trente ans.
1) Une alliance stratégique ancienne, aujourd’hui déséquilibrée
Abordant dans son rapport la question de l’alliance entre la Syrie et l’Iran, la mission d’information sur « Iran et équilibre géopolitique au Moyen-Orient » citait M. Jubin Goodarzi, le spécialiste des relations syro-iraniennes qu’elle avait auditionné, lequel soulignait le caractère « extraordinaire » de la durée de cette alliance, « si l’on tient compte de la volatilité de la région et des changements politiques qu’elle a connus » (56).
a) Les fondements d’une alliance qui dure depuis trente ans
Elle apparaît a priori d’autant plus surprenante que ni les deux peuples ni les deux régimes ne sont des amis « naturels » : le clivage entre Perses et Arabes a des racines très anciennes et reste d’actualité ; les Iraniens sont chiites alors que la majorité des Syriens est sunnite ; la République islamique d’Iran se veut une synthèse entre démocratie et islam, quand la République arabe syrienne se présente comme un Etat laïc. M. Salam Kawakibi explique ainsi : « Les relations syro-iraniennes ne reposent ni sur l’idéologie, ni sur la religion. Les deux régimes sont fondamentalement différents, mais ils sont liés par une alliance d’intérêts. » (57)
Si les régimes des deux pays se réfèrent à des idéologies différentes, ils sont tous les deux autoritaires et ont une conception restrictive des droits de l’Homme. Ils n’ont donc pas à craindre que l’un exerce sur l’autre la moindre pression dans ce domaine. La dimension religieuse intervient aussi dans la mesure où le régime syrien est tenu par la minorité alaouite, considérée comme hérétique par les sunnites mais reconnue comme une branche du chiisme. Mais c’est surtout leur anti-impérialisme et leur hostilité à Israël qui a rapproché les deux pays depuis la révolution islamique iranienne.
Aux membres de la Mission qu’il a reçus, M. Wallid el-Mouallem, le ministre syrien des affaires étrangères, a expliqué cette alliance dans les termes suivants : « Les relations privilégiées entre la Syrie et l’Iran depuis la révolution islamique s’expliquent, côté syrien, par la position de l’Iran sur le conflit israélo-arabe. Alors que le Shah soutenait Israël, le régime actuel défend les droits des Arabes. La Syrie s’est toujours opposée à la guerre entre l’Iran et l’Irak et a joué un rôle pour éviter qu’elle ne s’étende aux pays du Golfe. Aussi, lorsque Saddam Hussein a envahi le Koweït, en 1990, les Etats du Golfe se sont rangés du côté de la position syrienne et ont soutenu la guerre de libération du Koweït. C’est encore la Syrie qui est intervenue auprès de l’Iran, à la demande du Président Bush, pour qu’il reste neutre dans cette guerre, ce qu’il a fait. Les relations syro-iraniennes ont toujours été bonnes ; la concertation politique est permanente entre les deux pays. Même si, aujourd’hui, l’isolement syrien est rompu, le pays garde logiquement de bonnes relations avec l’Iran. »
Mme Lamia Chakkour présente une vision tout à fait en phase avec celle de son ministre de tutelle : « Pour qu’une paix globale au Moyen-Orient soit possible, il faut des pays alliés sûrs qui soutiennent la paix. La Syrie n’a jamais rien eu à craindre de l’Iran : ni menaces politiques, ni menaces militaires. Il y a des accords de défense en cas d’agression, des échanges économiques entre les deux puissances ainsi que des liens confessionnels étroits. » (58)
La communauté de vue entre les deux pays ne se limite pas à l’opposition à Israël qui fonde leur alliance : elle porte aussi sur l’ensemble de la région, et particulièrement sur le Liban, ce qui fait dire à M. Amine Gemayel qu’ils ont conclu « une alliance pragmatique contre le Liban ».
b) Une alliance déséquilibrée en faveur de l’Iran
L’ancienneté de cette alliance n’empêche pas qu’elle ait évolué au gré des soubresauts de l’histoire. Plusieurs interlocuteurs de la Mission ont ainsi mis l’accent sur son déséquilibre croissant au profit de l’Iran, sous l’effet de la montée en puissance de ce dernier et de l’affaiblissement de la Syrie au cours des dernières années.
Sans aller jusqu’à parler de la Syrie comme d’un « satellite » de l’Iran, ce que fait M. Antoine Sfeir (59), M. Peter Harling estime que l’alliance est déséquilibrée « depuis que le Président Bush a affaibli la Syrie et renforcé l’Iran en supprimant ses ennemis irakiens et talibans et en lui conférant le rôle de défenseur des musulmans au Proche-Orient. Le rapport de force tourne ainsi à l’avantage de l’Iran. » M. Christophe Bigot arrive à la même conclusion : la relation entre la Syrie et l’Iran lui semble être devenue trop exclusive, si bien que la première devenait dépendante du second. Un élément révélateur était l’attitude prosélyte de l’Iran, qui avait entrepris de financer la minorité chiite de Syrie. L’ambassadeur estime que cette proximité était devenue trop visible et risquait de conduire à une opposition de la majorité sunnite syrienne. L’ouverture de la Syrie à d’autres partenaires avait notamment pour objectif de rééquilibrer cette relation. Cet aspect religieux de la relation irano-syrienne entretient d’ailleurs l’idée, défendue par certains, d’un « croissant chiite », dont ferait partie le régime syrien.
La dimension économique de cette relation doit aussi être mentionnée car elle prend une importance croissante et contribue à son déséquilibre : les investissements iraniens en Syrie seraient passés de 500 millions d’euros en 2003 à 3 milliards d’euros fin 2007 et concernent désormais de nombreux secteurs de l’économie syrienne (hydrocarbures, agriculture, industries diverses) (60).
M. Alon Liel, ancien directeur général du ministère des Affaires étrangères israélien et président de Israel-Syria Peace Society, estime ainsi que la Syrie dépend de l’Iran économiquement, militairement et politiquement.
C’est certainement pour contrer l’image déséquilibrée que cette relation bilatérale a désormais que les responsables syriens affirment volontiers son caractère égalitaire et non exclusif devant les Occidentaux. Le ministre syrien des affaires étrangères a cité les discussions secrètes avec Israël sur le Golan comme un témoignage de l’indépendance syrienne vis-à-vis de Téhéran.
2) La Syrie, l’Iran et les « forces de la résistance »
A la tête du « front du refus », la Syrie et l’Iran apportent soutien politique et aide matérielle aux groupes d’activistes qui partagent leur hostilité à Israël, dans les Territoires palestiniens comme au Liban. La Syrie, qui est directement au contact de ces régions, est principalement un pays de transit pour les armes qui leur sont envoyées depuis l’Iran.
a) Le soutien des deux alliés aux « forces de la résistance »
Les autorités israéliennes sont naturellement les plus sévères dans leur dénonciation de ces trafics d’armes, dont les citoyens de leur pays sont les victimes potentielles. Ils alimentent principalement le Hezbollah, le Hamas et le Djihad islamique.
M. Ygal Palmor, porte-parole du ministère des affaires étrangères israélien, a été très clair : « Il existe un trafic permanent d’armements entre l’Iran et le Liban, souvent via la Syrie, qui emprunte les voies aérienne, terrestre et maritime. On ne sait pas tout sur cette contrebande, interdite par les résolutions des Nations unies, mais elle se poursuit. Le Hezbollah communique parfois sur les armes qu’il détient, que ce soit pour faire peur ou parce qu’il les détient vraiment. Il est probablement vrai qu’il a les moyens d’atteindre Tel Aviv. Ces armes ne sont pas forcément de fabrication iranienne (mais plutôt russe, chinoise ou sud-américaine) mais elles sont fournies par l’Iran. »
La réalité de ce trafic est attestée par un certain nombre de saisies réalisées par l’armée israélienne, à l’exemple de l’arraisonnement, le 4 novembre 2009, d’un navire sous pavillon chypriote, le Francop, qui faisait route vers le port de Lattaquié avec dans ses soutes un grand nombre de roquettes de différents modèles comparables à celles utilisées par le Hezbollah contre Israël en 2006. Les autorités françaises estiment que le stock des armes détenues par le Hezbollah serait de l’ordre de 20 000 missiles à courte et moyenne portée. Les sources israéliennes évoquent 40 000 roquettes, dont certaines d’assez longue portée pour atteindre les grandes villes israéliennes, et affirment que le Hezbollah a aussi acquis clandestinement des missiles Scud, ce qui n’est pas confirmé par les services de renseignement français. Le risque d’un incident de frontière qui dégénèrerait en guerre, comme ce fut le cas en juillet 2006, n’en est pas pour autant à sous-estimer.
La Syrie est un pays de transit et de stockage des armes, mais elle assure aussi l’entraînement des membres de ces groupes. L’importance du rôle qu’elle joue se traduit par la présence sur son territoire de certains de leurs responsables : M. Khaled Mechaal, l’un des principaux chefs du Hamas, ainsi que M. Hassan Nasrallah, qui est à la tête du Hezbollah, sont installés en Syrie.
Il est évidemment difficile de mesurer l’influence que l’Iran et la Syrie exercent sur les « forces de la résistance » qu’elles soutiennent. Le poids du premier, qui est à l’origine des flux financiers et d’armements, est probablement plus fort que celui de la Syrie. M. Sayyed Ammar Moussaoui, responsable des relations internationales du Hezbollah, que deux membres de la Mission ont rencontré à Beyrouth, a affirmé que ce groupe avait certes de bonnes relations avec l’Iran et la Syrie, mais qu’il n’était pas leur instrument. Selon lui, il a une fonction « libanaise », tout en étant reconnaissant aux pays qui l’aident.
A travers l’aide multiforme qu’elle apporte au Hezbollah, la Syrie s’assure une forme de présence militaire au Liban en dépit du retrait de son armée. Certes, son contrôle sur l’utilisation de ces armes n’est pas aussi direct que celui qu’elle exerce sur les armes détenues par les Palestiniens hors des camps (voir supra), mais personne ne doute de son influence. Aussi, dans le cadre du dialogue national sur la stratégie de défense, les prises de position des différentes forces politiques libanaises sur la question du devenir de ces armes reflètent leurs sentiments vis-à-vis de Damas. M. Sleiman Frangié va jusqu’à s’opposer à la tenue même du dialogue national, tandis que le général Aoun insiste sur le fait que les décisions doivent s’y prendre par consensus. Le responsable du Hezbollah a déclaré que son parti n’était évidemment pas en faveur de l’élimination de ses armes et que l’objectif du dialogue national devait être de réfléchir non pas à leur élimination mais à la manière de coordonner l’armée et la « résistance ». Il a expliqué que les armes du Hezbollah avaient pour unique fonction de protéger le Liban et qu’elles étaient d’autant plus nécessaires qu’aucun pays ne voulait fournir à l’armée libanaise les armes défensives dont elle avait besoin. Interrogé sur une éventuelle intégration du Hezbollah à l’armée, il ne s’y est pas montré favorable tout en affirmant que le parti s’y conformerait dans le cas où le dialogue national conduirait à une telle décision. M. Walid Joumblatt a jugé que, les armes du Hezbollah étant supposées éliminer les risques de « guerres sectaires » au Liban, il serait difficile de les supprimer tant que, d’une part, l’Etat et l’armée seraient faibles et que, d’autre part, la Syrie ne reconnaîtrait pas la souveraineté pleine et entière du Liban. Les représentants des partis chrétiens de la majorité parlementaire étaient tout aussi sceptiques sur l’issue du dialogue national, tant il leur semblait improbable que l’Iran et le Hezbollah acceptent un jour l’intégration des armes de la « résistance » aux forces armées libanaises.
Le soutien de la Syrie au Hamas peut apparaître paradoxal dans la mesure où ce mouvement est une émanation des Frères musulmans que le régime syrien a combattu avec violence sur son territoire au début des années 1980. Sa méfiance vis-à-vis du prosélytisme chiite en Syrie ne l’empêche pas non plus d’avoir le Hezbollah comme allié au Liban.
Ni la Syrie ni l’Iran ne cachent leur soutien à ces mouvements. Il semble même qu’ils en fassent état plus ouvertement encore que par le passé.
b) Un soutien ouvertement affiché
Sur le dossier palestinien, tout en soutenant officiellement le processus de réconciliation entre partis rivaux, la Syrie défend les revendications du Hamas contre les exigences du Fatah ; de même, les responsables syriens reconnaissent la légitimité du Hezbollah en tant que force armée de résistance contre Israël, comme le font ses alliés libanais.
Dans le contexte actuel d’ouverture de la Syrie vers l’Occident et de rétablissement de relations plus cordiales avec les Etats arabes modérés, on pouvait s’attendre à une certaine discrétion syrienne vis-à-vis de son allié iranien, lui-même accusé de vouloir se doter de l’arme nucléaire, et surtout vis-à-vis des « forces de la résistance ». C’est pourtant l’inverse qui se produit, comme en atteste le très médiatisé dîner partagé par les présidents syrien et iranien et M. Hassan Nasrallah, le 25 février dernier, à l’occasion d’une visite officielle du M. Mahmoud Ahmadinejad à Damas. Il s’est déroulé quelques heures après que le Président el-Assad ait ironisé sur la demande de Mme Clinton en faveur d’un relâchement des liens entre la Syrie et l’Iran (voir supra).
Une délégation de la Mission s’étant rendue au Proche-Orient deux jours seulement après la publication dans la presse de la région de photos de ce dîner, elles étaient dans toutes les conversations. Elles ont fort logiquement été perçues de manières différentes selon les pays.
Il semble que les rencontres entre ces trois personnalités sont régulières et que le dîner n’était pas une surprise en soi ; il n’a d’ailleurs été l’occasion d’aucune annonce particulière. C’est la publicité faite autour qui a étonné, voire choqué, les opinions publiques et les observateurs, d’autant que, comme mentionné supra, elle est intervenue peu de temps après la visite réussie de M. William Burns à Damas.
Trois explications principales peuvent être dégagées : la volonté syrienne de faire preuve de fermeté dans la négociation avec les Etats-Unis, le souci de rassurer l’Iran dans un contexte d’ouverture diplomatique vers l’Occident et les autres pays de la région, la volonté de mettre en garde Israël contre toute tentation d’intervention armée contre l’un des participants.
M. Rafael Barak, le directeur politique du ministère des affaires étrangères israélien, qui y voit, comme les diplomates français, le résultat d’une initiative iranienne, est partisan de la seconde explication. Ceux des Israéliens qui défendent la relance du volet syrien du processus de paix (voir infra) ont vivement déploré la médiatisation de cette réunion, qui a eu un impact très négatif dans l’opinion publique israélienne, particulièrement sensible à la menace iranienne et aux risques de tirs du Hezbollah sur le nord d’Israël.
M. Sleiman Frangié, qui veut pour sa part dédramatiser cet épisode, explique aussi que, bien qu’il n’y ait ni complot ni volonté syrienne de s’éloigner de l’Iran et du Hezbollah, le président syrien, suspecté de les avoir trahis pour se rapprocher de l’Arabie saoudite, s’affiche avec leurs dirigeants pour les rassurer.
Côté palestinien, c’est la troisième explication qui est retenue. M. Abderrahmane Bseisso a estimé que cette médiatisation changeait le jeu dans la région : « Auparavant, en cas de guerre israélienne contre Gaza ou contre le Hezbollah, la Syrie et l’Iran intervenaient seulement de manière souterraine. Par cette médiatisation ils affirment que désormais ils ne resteront plus sans réaction face à une attaque israélienne : si Israël bombarde Beyrouth, Tel Aviv subira le même sort ; en cas d’attaque contre Gaza, un conflit régional est à craindre. Dans l’avenir, tout conflit sera général. » M. Nimr Hamad y voit « un acte de provocation contre l’arrogance et l’impunité israéliennes » de nature à satisfaire « un peuple de plus en plus désespéré, qui, même s’il ne partage pas les valeurs du Hamas et du Hezbollah, se rallie à eux ». La popularité de M. Hassan Nasrallah dans le monde arabe depuis la guerre entre son parti et Israël pendant l’été 2006 est en effet incontestable. Le conseiller politique du Président Abbas observe en outre que M. Khaled Mechaal, le responsable du Hamas qui vit à Damas, n’a pas participé à ce dîner.
Quant au vice-premier ministre syrien chargé des affaires économiques, il parle d’abord d’une réponse aux exigences inacceptables de Mme Clinton, puis d’un message pour les Israéliens : s’ils agressent un Etat, y compris le Liban, la guerre sera générale et touchera les populations civiles. Il a d’ailleurs souligné que cette mise en garde allait dans le sens de la paix.
Les diplomates français en poste à Damas ajoutent deux éléments à ces explications : face à l’autonomisation relative du Hezbollah par rapport à ses parrains, en particulier par rapport à la Syrie, compte tenu de ses objectifs libanais, il est important pour Damas de rappeler ses liens avec lui ; pour remplir le rôle d’intermédiaire entre l’Occident et l’Iran que le Président el-Assad voudrait se voir reconnaître, il doit évidemment parler avec les Iraniens et le Hezbollah : il aurait ainsi profité de cette rencontre pour dissuader ses partenaires d’entreprendre une action contre Israël.
Quelle que soit l’explication que l’on retient, cet épisode montre en tout cas que la Syrie assume face au reste du monde son alliance avec l’Iran et les « forces de la résistance », et ne semble pas prête à y renoncer. On observera d’ailleurs que le Président el-Assad n’hésite pas à parler au nom du Hezbollah : lors de la visite du ministre Bernard Kouchner à Damas, fin mai 2010, il a ainsi promis que ni la Syrie, ni le Hezbollah ne déclencherait de guerre contre Israël
– tout en dénonçant les fréquentes violations de l’espace aérien libanais par les avions de reconnaissance israéliens.
3) Des liens qu’il serait vain de vouloir briser
Rares sont les interlocuteurs de la Mission qui jugent possible que la Syrie renonce à son alliance avec l’Iran. Plusieurs d’entre eux ont au contraire souligné que cette alliance avait déjà prouvé sa capacité à durer en dépit de désaccords ponctuels entre les deux pays.
a) Une alliance qui a fait la preuve de sa solidité
Si, sur la plupart des sujets régionaux, les Syriens et les Iraniens partagent les mêmes analyses et les mêmes objectifs, ils peuvent se trouver en désaccord sur certains points, sans que cela remette en question leur alliance.
C’est le désaccord sur l’Irak qui a le plus souvent été évoqué devant la Mission. S’il est dans l’intérêt de l’Iran et la Syrie que l’Irak reste uni mais ne soit ni trop fort ni trop faible, comme l’a expliqué M. Denis Bauchard (61), le premier voudrait en faire son satellite en jouant sur les appartenances communautaires des Irakiens tandis que la Syrie souhaite un renforcement de leur nationalisme arabe. Il semble néanmoins que les deux alliés soient parvenus à un compromis à la veille des élections législatives : la Syrie espérait que M. Nouri al-Maliki, auquel elle reprochait notamment des accusations injustifiées contre elle (voir supra), ne soit pas reconduit au poste de premier ministre, tandis que l’Iran tenait à ce que le premier ministre soit à nouveau chiite ; le succès du Bloc irakien de M. Iyad Allaoui était donc la solution qui permettait de satisfaire les deux pays. Force est de constater que c’est le parti de ce dernier qui a remporté le scrutin du 7 mars.
L’autre sujet de désaccord mentionné devant la Mission porte sur le rapprochement en cours entre la Syrie et l’Arabie saoudite, adversaire notoire de l’Iran (62). Mais, selon l’analyse de M. Amine Gemayel, il ne pose pas problème : « le ménage syro-iranien est assez solide pour supporter cette infidélité mineure, d’autant qu’elle est dans l’intérêt de l’Iran puisqu’elle calme le jeu avec les Etats-Unis ».
M. Denis Bauchard a aussi cité comme exemple de phases de crispation, les pressions que l’Iran aurait exercées sur le Hezbollah pendant la crise de Gaza fin 2008 pour qu’il intervienne dans le conflit, sans concertation préalable avec la Syrie, qui n’aurait pas apprécié d’être ainsi contournée.
Ces difficultés, inévitables, semblent finalement toujours avoir été surmontées sans crise ouverte. Elles témoignent ainsi in fine de la solidité de l’alliance syro-iranienne.
b) La Syrie, possible intermédiaire entre l’Iran et ceux qui se défient de lui ?
Dans ces conditions, l’objectif affiché par les Etats-Unis et Israël d’obtenir de la Syrie un relâchement de ses liens avec l’Iran en échange de différentes contreparties apparaît à la Mission bien difficile à atteindre, si ce n’est irréaliste au moins à court et moyen termes.
Même le porte-parole du ministère des affaires étrangères israélien exprime des doutes sur la possibilité d’un tel relâchement, « tant la relation actuelle est profonde ». En effet, l’Iran est un allié sûr, qui donne à la Syrie une ampleur stratégique sans exiger d’elle qu’elle modifie sa perception du monde.
Les diplomates français considèrent eux aussi que, si la Syrie veut desserrer sa relation avec l’Iran, elle n’a pas pour autant l’intention de rompre.
M. Itamar Rabinovitch, ancien ambassadeur d’Israël aux Etats-Unis, estime que l’accord entre Israël et la Syrie doit conduire cette dernière à se détacher de l’Iran, du Hamas et du Hezbollah, mais que, étant donné « la mentalité de bazar » qui règne en Orient, cela suppose des contreparties, la fixation d’un calendrier clair et l’établissement d’un lien étroit entre concessions et résultats obtenus. Il pense que l’Occident doit obliger la Syrie à choisir son camp, mais n’est pas sûr qu’il y parviendra dans la mesure où les el-Assad ont toujours cherché à jouer sur les deux tableaux : tirer profit de bonnes relations avec l’Occident et garder des liens avec l’Iran. Selon lui, ce que la Syrie veut, c’est rester un pont entre les Etats-Unis et l’Iran.
M. Sleiman Frangié confirme la conclusion de cette analyse lorsqu’il explique que M. Bachar el-Assad veut avoir plusieurs cartes en main. Il va plus loin en soulignant qu’il est dans l’intérêt de l’Occident qu’il garde plusieurs cartes, et surtout celle du Hamas, car, remarque-t-il, l’influence de M. Bachar el-Assad est préférable à celle de Ben Laden ! Il est difficile de lui donner tort sur ce point !
M. Samir Aïta (63) estime de même que l’Occident devrait voir la Syrie (ainsi, d’ailleurs, que la Turquie) comme une courroie de transmission positive pour obtenir une évolution des positions iraniennes. Si M. Salam Kawakibi (64) rappelle que la Syrie sert d’intermédiaire entre l’Iran et les Etats du Golfe depuis les années 1980 et confirme que les Syriens pensent pouvoir être le relais entre les Occidentaux et les Iraniens, comme les Turcs le sont entre les Syriens et les Israéliens, il ne se fait guère d’illusions sur l’efficacité d’une médiation syrienne : il juge que, étant donné l’habileté de la diplomatie iranienne, le plus probable est pourtant que l’Iran traite directement les sujets les plus cruciaux.
Force est de constater que, jusqu’ici, la Syrie n’est pas parvenue à faire bouger son allié iranien sur un sujet aussi important pour la diplomatie occidentale que celui du nucléaire. Les journalistes syriens que la Mission a rencontrés à Damas ont rapporté que le Président Sarkozy aurait demandé au Président el-Assad, dès la fin 2007, d’assurer un rôle de médiation entre l’Occident et Téhéran, mais que, bien que flatté, il aurait refusé, ne jugeant pas que cela était nécessaire. M. Wallid el-Mouallem a expliqué que la Syrie était favorable à ce que l’Iran négocie sur ce dossier, car elle s’est toujours opposée à la course aux armements nucléaires dans la région – bien que certains indices conduisent à douter de sa sincérité en la matière, voir infra. Mais il a aussi justifié les réticences iraniennes vis-à-vis de la proposition de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) consistant à faire enrichir son uranium en Russie ou en France. Ce dossier semble bien trop délicat et trop important pour la diplomatie iranienne pour que la Syrie puisse réellement espérer jouer un rôle de médiation dans sa résolution, même si elle le souhaitait vraiment.
En revanche, la diplomatie syrienne aurait apporté une aide réelle à la France dans le cas de l’arrestation en Iran de notre compatriote Clotilde Reiss, le 1er juillet 2009. Accusée d’espionnage et emprisonnée pendant un mois et demi à l’été 2009, elle aurait été libérée sous contrôle judiciaire (mais contrainte ensuite à demeurer en permanence à la résidence de France) à la suite de l’intervention de la Syrie. Lors de son audition, l’ambassadrice de Syrie a expliqué que, sans entrer dans le volet pénal de l’affaire, la Syrie avait fait une intervention politique visant à créer les modalités d’un dialogue entre la France. Une fois Mlle Reiss libérée et rentrée en France, le 16 mai denier, le président de la République a d’ailleurs remercié les présidents syrien, brésilien et sénégalais pour le rôle que chacun d’eux avait joué dans sa libération.
Etant donné l’absence de toute avancée sur le dossier nucléaire iranien, en dépit des gestes d’ouverture consentis par les Etats-Unis, et le durcissement du régime de la République islamique depuis les manifestations qui ont suivi la réélection contestée du Président Ahmadinejad en juin 2009, la Mission estime que l’Occident ne peut se priver d’aucune voie de dialogue avec l’Iran, aussi indirecte et incertaine soit-elle.
De son point de vue, le positionnement international actuel de la Syrie fait de celle-ci un intermédiaire possible, alors qu’elle juge très improbable la rupture de l’alliance syro-iranienne, quelles que soient les contreparties que l’Occident pourrait consentir. En diversifiant sa diplomatie, Damas rééquilibre progressivement ses relations avec Téhéran : elle en devient moins dépendante, alors que l’Iran reste très isolé ; sa capacité à peser sur lui en est renforcée d’autant. Reste à l’Occident à faire en sorte que cette influence s’exerce dans un sens conforme à ses intérêts, ce qui suppose de parvenir à persuader la Syrie que ces intérêts sont aussi les siens.
C – La paix avec Israël est-elle envisageable ?
L’hostilité à Israël est l’un des fondements de l’alliance syro-iranienne, mais la situation objective de ces deux pays vis-à-vis de l’Etat hébreu est très différente. Alors que cette hostilité est avant tout idéologique au sein des dirigeants de la République islamique et se traduit par des menaces directes contre l’existence d’Israël (65), le régime syrien affirme vouloir seulement récupérer la partie du Golan qui est occupée depuis juin 1967 – ce qui permettrait de mettre fin à l’état de guerre entre les deux Etats qui dure depuis plus de quarante ans –, tout en soutenant la revendication d’un Etat palestinien. La Syrie est donc à la fois plus directement concernée que l’Iran par les conséquences du conflit israélo-arabe et plus pragmatique quant aux moyens de le résoudre.
1) Un soutien affiché à la cause palestinienne malgré des relations difficiles avec les responsables palestiniens
Comme le Liban et la Jordanie, la Syrie accueille sur son territoire depuis plusieurs décennies un grand nombre de réfugiés palestiniens : ils seraient actuellement de l’ordre de 600 000. Elle est d’ailleurs plus généreuse avec eux que la plupart des autres pays d’accueil. Ainsi, alors qu’au Liban l’accès à un grand nombre de professions leur est fermé, en Syrie, les réfugiés palestiniens ont quasiment les mêmes droits sociaux que les Syriens ; leurs camps sont devenus des villes ou des quartiers semblables aux autres. De même que pour l’accueil récent des réfugiés irakiens (voir supra), le sentiment pan-arabe a facilité leur acceptation par la société syrienne.
Les relations entre Syriens et Palestiniens sont pourtant marquées par l’ambiguïté et ont plus souvent été conflictuelles qu’amicales au cours des dernières décennies et encore aujourd’hui. Cela n’empêche pas les autorités syriennes de se présenter comme soutenant la revendication d’un Etat palestinien.
a) Un soutien conditionnel et en partie instrumentalisé
Afin d’être reconnu comme un leader arabe, le Président Hafez el-Assad se voulait le défenseur des droits des Palestiniens, présentés comme indissociables de ceux des Arabes. Dans son esprit, cela signifiait que les Palestiniens devaient respecter la « solidarité arabe », c’est-à-dire ne jamais s’écarter de la politique syrienne en menant une politique autonome.
C’est pourquoi il a refusé de soutenir les fedayin palestiniens en Jordanie en 1970, pendant « septembre noir », puis que, ceux-ci s’étant repliés au Liban, il y a envoyé les troupes syriennes, en 1976, pour empêcher les hommes de Yasser Arafat alliés aux progressistes libanais de l’emporter sur le camp chrétien. Dans les deux cas, il fallait éviter que les Palestiniens ne déclenchent une réaction israélienne qui aurait pu mettre en danger la Syrie.
Afin de garder son influence, Hafez el-Assad a ensuite exploité les divisions palestiniennes en soutenant les factions radicales en dissidence par rapport à la direction de l’OLP et utilisé tous les moyens pour limiter le poids et même la présence des partisans de Yasser Arafat au Liban. Il n’est pourtant pas parvenu à éliminer celui-ci du jeu. La signature des accords intérimaires d’Oslo, en 1993, est vue comme un nouveau revers pour le président syrien : il considère que les signataires de ces accords sont des « collaborateurs d’Israël » et un front anti-Oslo est formé à Damas et Beyrouth.
La constitution d’une Autorité palestinienne en Cisjordanie et à Gaza à partir de 1994 et la territorialisation du nationalisme palestinien ont pour effet de marginaliser la diaspora et le leadership palestinien de Damas au profit de celui des Territoires. M. Bachar el-Assad tente certes de se rapprocher de Yasser Arafat, qui a assisté aux funérailles de son père et se trouve isolé à cause de la seconde Intifada, mais Damas continue de patronner les factions palestiniennes hostiles aux accords d’Oslo, en premier lieu le Hamas, le Jihad islamique et le Front populaire de libération de la Palestine-Commandement général (FPLP-CG). Elle laisse le premier s’implanter dans les camps palestiniens du Liban, tandis que le second renoue avec l’action armée. Peu après le retrait israélien du Liban, des factions palestiniennes mènent des opérations contre l’Etat hébreu.
Damas refusant de cesser son soutien à ces mouvements comme Israël le lui demande, celui-ci procède au bombardement d’une base du FPLP-CG située au nord de Damas, le 5 octobre 2003. C’est la première intervention israélienne contre le territoire syrien depuis 1973. Moins d’un an plus tard, le chef de la branche militaire du Hamas hors des Territoires palestiniens est assassiné à Damas, sans que les Israéliens démentent leur responsabilité. Ces opérations israéliennes témoignent du fait que la Syrie a perdu la protection tacite américaine qui lui avait permis d’entrer au Liban et d’y asseoir sa tutelle. Aussi lorsque, dans la nuit du 5 au 6 septembre 2007, des chasseurs israéliens bombardent un site près de Deir ez-Zor, qu’Israël affirme être un site nucléaire, la Syrie se contente de dénoncer la violation de son espace aérien.
L’attitude des autorités syriennes vis-à-vis des Palestiniens démontre ainsi plus une instrumentalisation de leur cause qu’un soutien sincère de leurs intérêts. M. Denis Bauchard a ainsi déclaré que « la Syrie reste présente sur le dossier palestinien dans le but d’éviter que la paix entre Israël et les Palestiniens se fasse sans un accord israélo-syrien. C’est pour cette raison qu’elle s’est opposée à Yasser Arafat et qu’elle a accueilli des organisations de résistance contre Israël, au premier rang desquelles le Hamas. Elle défend en fait ses intérêts propres, et ne fait pas de sensiblerie vis-à-vis des Palestiniens. » (66)
M. Nabil Shaath, le responsable des relations internationales du Fatah, a qualifié de « relation d’amour-haine » les liens entre la Syrie et les Palestiniens : « L’amour vient de l’histoire, d’une tradition de résistance arabe contre Israël et les Etats-Unis et du recours à des moyens de négociations durs. La haine s’est développée parce que la Syrie manipule la situation régionale : les Palestiniens ne sont qu’une carte dans ses négociations avec les Etats-Unis et Israël. » Il cite avec une certaine amertume les nombreux différends bilatéraux toujours en suspend : il n’y a pas d’ambassade de l’Autorité palestinienne en Syrie, les documents d’identité palestiniens ne sont pas reconnus, il n’y a pas de liaison téléphonique, il existe toujours un problème de biens séquestrés en Syrie appartenant à l’Autorité palestinienne, un grand nombre de Palestiniens sont encore emprisonnés en Syrie à cause de la confrontation au Liban, et la Syrie accueille toujours sur son sol les groupes rebelles de la gauche palestinienne qu’elle avait créés contre le Fatah. Malgré les efforts du Président Abbas pour améliorer ces relations – il a ainsi assisté à l’ensemble du sommet de la Ligue arabe qui s’est tenu à Damas en mars 2008 et que certains pays ont boycotté –, il n’a obtenu aucun progrès et « les relations restent froides et empreintes de calculs ».
M. Abbas Zaki, responsable des affaires arabes au Fatah, parle aussi de relations froides mais estime que, idéologiquement, la Syrie devrait être plus proche du Fatah laïc que du Hamas, dont elle déplorerait l’ambiance religieuse qu’il fait peser sur la Bande de Gaza. Même s’il est perçu comme responsable du coup d’Etat du Hamas à Gaza en 2007, le Président el-Assad serait néanmoins favorable à une réconciliation interpalestinienne sans laquelle l’idée d’un Etat palestinien disparaîtrait, mais n’apprécierait pas que le processus soit conduit par l’Egypte (voir supra). C’est pourquoi il tient beaucoup à se que M. Mahmoud Abbas se rende à Damas pour y rencontrer M. Khaled Mechaal, ce que le président de l’Autorité palestinienne refuse. Il a ainsi reporté à plusieurs reprises une visite dans la capitale syrienne.
M. Abdallah Dardari n’a pas manqué de déplorer ce blocage devant les membres de la Mission qu’il a reçus, tout en soulignant que « la Syrie n’utilise pas ce sujet comme une carte » : dans la mesure où le Hamas a été élu régulièrement et démocratiquement – ce qui est un cas unique dans le monde arabe, a-t-il souligné ! –, il n’y a pas d’autre solution que de discuter avec lui et on ne peut pas lui demander de renoncer à la résistance armée contre Israël alors qu’il a été élu pour conduire cette résistance.
On mesure donc bien le caractère fluctuant et souvent tendu des relations entre la Syrie et les Palestiniens. Les accords d’Oslo ont été perçus comme une trahison par la Syrie, qui en tient rancune à l’Autorité palestinienne dont ils ont permis la constitution. Le soutien syrien aux factions palestiniennes les plus radicales n’est pas non plus surprenant eu égard à la profondeur de l’hostilité des Syriens vis-à-vis d’Israël : quand l’Autorité palestinienne collabore incontestablement avec lui, le Hamas est, comme la Syrie, toujours en guerre contre l’Etat hébreu, même si cette guerre syro-israélienne se fait sans aucune effusion de sang.
b) Une hostilité constante à l’égard d’Israël
La persistance de l’état de guerre entre les deux pays se traduit notamment par le refus de laisser entrer sur le territoire syrien toute personne s’étant rendue en « Palestine occupée » mais aussi par l’interdiction, fixée par la loi syrienne, des relations directes entre les Syriens et l’Etat d’Israël ou des Israéliens. M. Salam Kawakibi (67) a précisé que les chercheurs, par exemple, peuvent participer à des conférences en présences de leurs homologues israéliens, sans pour autant avoir le droit de s’entretenir directement avec eux.
Cette situation a des conséquences sur le fonctionnement de l’Union pour la Méditerranée (cf. supra).
L’animosité des autorités syriennes à l’égard d’Israël est très sensible, notamment depuis le bombardement israélien du site de Deir ez-Zor, évoqué supra.
Les Israéliens affirment qu’un réacteur plutinogène y était en cours de construction avec l’aide de la Corée du Nord. L’AIEA a été saisie et a pu constater à l’occasion d’une visite que le site était militaire, ce que la Syrie a reconnu, qu’il avait été nettoyé après l’attaque israélienne, que les débris avaient été enlevés et que des échantillons présentaient des traces de radiation. L’Agence a jugé troublant de ne pouvoir obtenir d’images satellitaires commerciales montrant le site immédiatement après le bombardement. Depuis, la Syrie refuse de poursuivre sa coopération, ce qui empêche de trouver d’autres preuves, bien que l’affaire reste officiellement ouverte devant l’AIEA.
Pour se défendre, les autorités syriennes ont beau jeu de voir dans cette affaire une manipulation israélienne et de se plaindre du « deux poids, deux mesures » dont elle est victime, tout comme l’Iran.
M. Mahmoud al-Abrache, le président de l’Assemblée du peuple, a ainsi affirmé que c’était Israël qui avait « inventé » le site de Deir-ez-Zor et l’avait bombardé avec des munitions comportant des traces radioactives afin de compromettre la Syrie.
Devant la Mission, Mme Lamia Chakkour (68), a réaffirmé que la Syrie n’avait pas d’ambition nucléaire et que, de son point de vue, le vrai danger nucléaire ne se trouvait pas en Iran mais en Israël, le seul pays de la région doté d’armes de destruction massive. Elle a rappelé que, quelques jours avant son audition, une résolution de l’AIEA demandant à Israël de se soumettre à ses contrôles avait été rejetée par 49 voix contre 46 et déploré que l’on fasse « deux poids, deux mesures ». Concernant le site inspecté par l’AIEA après le bombardement, elle a déclaré : « Jusqu’alors le rapport sur les capacités nucléaires de la Syrie est resté très évasif, comme si les preuves étaient insuffisantes pour l’accuser. La Syrie a toujours coopéré et a accepté une visite, si celle-ci était unique, des lieux suspects, tels que le site de Deir-ez-Zor. Israël a bombardé ce site, détruisant toute possibilité pour la Syrie de prouver sa bonne foi. Un pays a ainsi violé le territoire syrien pour anéantir toute possibilité de vérification. »
Malgré cette hostilité et les accusations réciproques, aucun accrochage n’a eu lieu sur le plateau du Golan depuis plus de trente-cinq ans et, à l’exception des deux bombardements israéliens mentionnés plus haut, aucun d’entre eux n’a fait directement usage de la force contre l’autre. M. Jean-Claude Cousseran a formulé ainsi ce paradoxe : « Sur le fond, les relations entre Israël et la Syrie sont complexes et difficiles à déchiffrer. La Syrie proclame jour après jour une hostilité catégorique à l’égard Israël et soutient contre l’Etat hébreu le Hezbollah et le Hamas. Elle s’affirme comme une alliée stratégique de l’Iran. Pour autant, les deux pays ne s’affrontent directement que très rarement et Damas veille à ne pas prendre de risque vis-à-vis d’Israël. Il n’y a pas eu d’incident sur le Golan depuis des années. Les Israéliens n’ont évidemment pas la moindre sympathie pour le régime syrien mais ils savent que l’alternative que serait un régime proche des Frères musulmans sunnites serait plus dangereuse encore que le régime alaouite actuel. » (69)
M. Christophe Bigot partage cette analyse. La Syrie lui apparaît en fait le meilleur allié d’Israël dans la région, parce qu’elle est à la fois un Etat stable et faible. En effet, il est dans l’intérêt d’Israël d’avoir un voisin qui n’est pas islamiste et qui est un Etat stable du point de vue de la Realpolitik : la Syrie présente ses deux caractéristiques.
Dans ces conditions, il n’est pas si surprenant que les deux pays aient passé plusieurs années à tenir des négociations en vue de la restitution du Golan.
2) Des échecs passés qui pèsent lourd
D’une certaine manière, les négociations passées gênent plus qu’elles ne facilitent de nouvelles discussions car leur échec a été durement ressenti par les Syriens, qui exigent que les discussions reprennent au point où elles en étaient lorsqu’elles ont été interrompues.
Le ministre syrien des affaires étrangères, qui a directement participé aux négociations syro-israéliennes des années 1990, en a fait un récit détaillé aux membres de la Mission qu’il a reçus en novembre dernier. Il est restitué dans l’encadré suivant.
LES NÉGOCIATIONS SYRO-ISRAÉLIENNES DES ANNÉES 1990 RACONTÉES PAR « Fin 1990, le Président Hafez el-Assad avait rencontré le Président Bush à propos de la libération du Koweït alors occupé par l’Irak. Ils s’étaient mis d’accord sur le lancement d’une initiative de paix une fois réglée la situation du Koweït. Cette initiative a été lancée en mars 1991. Après six mois de discussion, la conférence de Madrid a pu se tenir, sur la base des résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité qui reposent sur le principe de l’échange de la terre contre la paix. James Baker avait présenté aux parties des lettres de garantie. Après la conférence, en décembre 1991, la négociation a comporté trois volets : un israélo-palestinien, un israélo-libanais et un israélo-syrien. Sur ce dernier, la Syrie a exigé la participation des Américains et des Russes à la négociation. Les négociations se sont tenues sous parrainage américain de 1991 à 2000. En septembre 1993, Rabin s’est engagé au retrait israélien du Golan jusqu’à la ligne du 4 juin 1967, mais cet engagement a été tenu secret à cause de la situation intérieure israélienne. Shimon Pérès a ensuite renouvelé cet engament et les militaires se sont joints aux discussions. Après l’assassinat de Rabin, des négociations intensives ont encore eu lieu dans la banlieue de Washington, à Wye River Plantation, fin 1995. Shimon Pérès a voulu profiter de sa popularité pour avancer les élections israéliennes, qui ont entravé les négociations de paix. Le cadre d’un accord de paix avait été élaboré, qui prévoyait un retrait en deux étapes. Mais la durée de ces étapes était source de divergence, les Syriens demandant qu’elle se limite à 12 mois, les Israéliens voulant qu’elle soit de 36 mois. A l’exception de la question de l’observatoire israélien du mont Hermon, les arrangements de sécurité étaient aussi trouvés. Il était prévu que les deux Etats nouent des relations diplomatiques et signent un accord de coopération une fois le retrait achevé. Les Nations unies auraient surveillé les zones tampons démilitarisées des deux côtés de la ligne de retrait. Mais, en 1996, les élections israéliennes ont conduit à l’opération « raisins de la colère » au Liban, puis à un accord, en avril, visant à remettre de l’ordre au Liban. Après la victoire du Likoud, le nouveau Premier ministre, M. Nétanyahou a chargé un milliardaire juif américain de parrainer les discussions en lieu et place des Etats-Unis. L’accord était conclu à 95 % ; les deux pays avaient échangé des cartes de la ligne du 4 juin 1967. Mais Ariel Sharon, alors ministre des affaires étrangères, a fait publier des informations sur l’accord dans le New Yorker, provoquant la démission de l’intermédiaire et l’interruption des négociations. Lorsque de nouvelles élections ont donné le pouvoir à Ehoud Barak, la Syrie a donné son accord pour reprendre les discussions, à condition que ce soit au point où elles avaient été interrompues. Le Premier ministre israélien l’a accepté et a proposé que les négociations soient conduites au niveau ministériel. Il a été décidé de former quatre commissions, chargées respectivement de la fixation de la ligne du 4 juin 1967, de l’examen des relations bilatérales normalisées, de l’accord de sécurité et du partage des ressources en eau. Ehoud Barak refusé que la commission dite « des frontières » se réunisse, alors que les autres pouvaient le faire. Il craignait en effet que la coalition qu’il dirigeait ne résiste pas à la réunion de cette première commission. Ce refus a signifié la fin de dix années de négociations. » |
En tant qu’ambassadeur de France à Tel Aviv, M. Christophe Bigot a confirmé à la Mission, en mars dernier, que c’était bien à cause de l’opposition de l’opinion publique israélienne que l’accord sur le Golan obtenu à l’issue des négociations n’avait pas été signé, en 1999.
Ce que les Syriens en ont retenu c’est l’engagement pris par Yitzhak Rabin, en 1993, sur le retrait israélien du Golan. Ils désignent cette promesse sous le terme de « legs» ou de « dépôt Rabin ».
M. Denis Bauchard (70) a précisé à la Mission qu’il n’y avait pas de trace écrite officielle de son contenu, mais seulement des comptes rendus de réunion. Les Syriens en retiennent l’accord sur le retrait israélien du Golan jusqu’à la ligne du 4 juin 1967. Les conditions étaient négociables et portaient notamment sur la création de stations d’alerte sur le Golan, confiées à des troupes neutres des Nations unies, sur le démantèlement des colonies de peuplement du Golan selon un calendrier à fixer et sur le retour progressif des 500 000 anciens habitants du Golan réfugiés en Syrie.
Ces négociations de plusieurs années ont ainsi échoué tout près du but, alors que la quasi-totalité des questions avait trouvé une solution acceptable par les deux parties.
b) Les récents pourparlers via la Turquie
A l’automne 2004, le jeune Président el-Assad s’était dit prêt à reprendre des discussions sans condition avec Israël, tout en revendiquant toujours le « dépôt Rabin », dans l’espoir d’obtenir un relâchement des pressions internationales contre son pays.
De fait, il a laissé des membres de la société civile mener des discussions secrètes sur des arrangements de paix entre septembre 2004 et juillet 2006. Ces pourparlers se sont déroulés en Europe, sous médiation suisse, et ont conduit à l’adoption d’un texte qui ressemble à un modèle d’arrangement
– prévoyant notamment le retrait israélien jusqu’à la ligne du 4 juin 1967, une démilitarisation asymétrique selon un rapport de 1 à 4, une normalisation et l’ouverture très large du plateau du Golan aux civils israéliens. Révélée par la presse israélienne en janvier 2007, cette initiative a été désavouée par les deux gouvernements, mais elle a ouvert la voie aux négociations annoncées en mai 2008, par l’intermédiaire de la Turquie.
Mme Lamia Chakkour a décrit ces pourparlers dans les termes suivants : « la Syrie a tenu quatre sessions de pourparlers bilatéraux avec Israël par l’intermédiaire de la Turquie, qui s’est avérée un excellent intermédiaire, parfaitement honnête. Une cinquième, prévue le 18 septembre 2008, a été repoussée à la demande des Israéliens. L’attaque israélienne contre Gaza a ensuite interrompu ces discussions, qui n’ont pas repris depuis. »
M. Alon Liel, ancien directeur général du ministère des Affaires étrangères israélien, président de Israel-Syria Peace Society, évoque pour sa part huit réunions sous médiation turque entre 2007 et 2008, la dernière ayant eu lieu le 23 décembre 2008, soit quatre jours avant le début de l’intervention à Gaza. Il précise que le Premier ministre israélien et le président syrien étaient directement impliqués dans la dernière.
Ainsi, même si, comme M. Jean-Claude Cousseran l’a souligné, la négociation nouée à Istanbul portait essentiellement sur les conditions auxquelles Israël et la Syrie pourraient passer d’une négociation indirecte à une négociation directe, il semble bien que, en décembre 2008, les pourparlers étaient très avancés. M. Denis Bauchard précise qu’ils étaient prêts à déboucher sur une phase de négociation directe. M. Patrice Paoli confirme que la négociation avec Israël avait beaucoup progressé, et que l’offensive à Gaza était apparue aux Syriens comme une « trahison ».
Depuis l’intervention israélienne à Gaza, les pourparlers n’ont pas repris, bien que les deux parties se disent disposées à les relancer.
3) Un règlement improbable à court terme
Les deux Etats ne sont en effet pas d’accord sur le cadre d’éventuels nouveaux pourparlers. En juillet dernier, M. Christophe Bigot résumait leur désaccord de la manière suivante : « M. Nétanyahou se dit, à nouveau, prêt à négocier directement avec les Syriens. Le Président Bachar el-Assad, lui, est prêt à négocier avec les Israéliens mais via le facilitateur turc. Cependant, les Israéliens n’acceptent pas, que d’entrée de jeu, les négociations portent sur le Golan. Mais sur quoi d’autre la négociation pourrait-elle porter ? A l’inverse, les Syriens considèrent que les Israéliens doivent respecter les acquis antérieurs, à savoir ceux découlant des pourparlers avec M. Olmert. Le nouveau gouvernement israélien n’y est pas prêt. »
La situation n’a pas évolué depuis l’été 2009. La relance des discussions ne serait pourtant qu’un tout premier pas, car il semble que, sur le fonds, le problème apparaisse encore plus complexe qu’il ne l’était dans les années 1990, Israël attendant aussi de la Syrie qu’elle relâche ses liens avec l’Iran et ses alliés. On peut ainsi se demander s’il est réaliste d’espérer un accord isréalo-syrien en l’absence d’avancée sur le dossier israélo-palestinien ; on peut légitimement douter de la réelle volonté des Etats de voir ces discussions déboucher sur un accord.
a) Une paix séparée « israélo-syrienne » acceptable pour la Syrie ?
Conclure une paix séparée isréalo-syrienne signifierait pour le régime syrien à la fois mettre un terme à une opposition qui est l’un des fondements de sa légitimité, et abandonner la cause palestinienne en acceptant de normaliser ses relations avec Israël. On comprend qu’une telle décision ne serait pas facile à prendre pour le Président el-Assad, même s’il obtenait un accord très favorable à la Syrie.
M. Christophe Bigot estime que l’approche de la Syrie envers Israël a changé. La conception idéologique qui prévalait jusqu’à présent n’existe plus, selon lui, alors qu’elle subsiste encore dans certains pays arabes. Cependant la Syrie entend vendre ses cartes chèrement, même si l’approche actuelle est essentiellement pragmatique.
Mais la position officielle syrienne, qui a été présentée à plusieurs reprises aux membres de la Mission qui se sont rendus en Syrie en novembre dernier, reste en faveur d’une paix globale, alors que les exemples égyptien et jordanien ont montré que des paix séparées n’étaient pas de véritables paix. Mme Lamia Chakkour a affirmé qu’il n’y aurait pas de résolution de la question du Golan au détriment du règlement du dossier palestinien. Il faut une négociation globale pour aboutir à une paix globale. Selon elle, la Syrie accepte l’idée de pourparlers indirects avec Israël, via la Turquie, médiateur islamique, la France étant invitée à participer comme médiateur international et le Qatar comme médiateur arabe, le tout sous parrainage américain. Mais Israël franchissant toutes les lignes rouges à Jérusalem-Est, il n’est pas actuellement, pour elle, un partenaire ni de paix ni de négociations, qu’elles soient directes ou indirectes.
Le président de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée du peuple a exposé la même conception. Il a notamment souligné que, si Hafez
el-Assad avait voulu simplement récupérer le Golan, il aurait pu le faire ; mais il a toujours mis la récupération de Jérusalem au premier rang, car il ne peut y avoir de solution que globale.
On peut alors s’interroger sur la logique qu’il y a à accepter de relancer des discussions indirectes avec Israël sur le Golan si c’est pour, in fine, refuser de signer une paix séparée. Ces pourparlers n’auraient de raison d’être que si les discussions sur le volet palestinien du processus de paix reprenaient elles aussi, laissant espérer des progrès parallèles sur les deux volets, puis la conclusion d’un accord les englobant tous les deux.
Les interlocuteurs israéliens de la Mission n’ont pour leur part pas plus d’illusions sur la volonté de paix syrienne que les Syriens croient à une volonté de paix israélienne. M. Itamar Rabinovich, ancien ambassadeur d’Israël aux Etats-Unis, estime qu’un accord avec Israël serait un « suicide politique » pour le président syrien, idée reprise par M. Ygal Palmor, qui considère que si la Syrie récupérait le Golan, elle devrait ouvrir sa frontière avec l’Etat hébreu, ce qui déclencherait un vent de liberté à Damas et une mise en danger du régime. Selon lui, la Syrie voudrait un arrangement territorial et un accord de non-belligérance, mais pas accorder la liberté de mouvements aux populations.
b) Un retrait du Golan envisageable côté israélien ?
Force est de constater que, côté israélien, un retrait du Golan a certes des partisans, mais est très loin de faire l’unanimité.
C’est l’armée israélienne – et le ministre travailliste de la défense, l’ancien premier ministre Ehoud Barak – qui défend depuis plusieurs années la conclusion d’un accord avec la Syrie sur le Golan, soutenue sur ce point par les services secrets intérieurs israéliens (le Shin Beth). La Présidente de la Mission s’est entretenue avec M. Dan Méridor, ministre chargé des services de renseignement et de la commission à l’énergie nucléaire, qui, bien que membre du Likoud, est aussi un partisan de cette solution, et avec M. Alon Liel, lui aussi fervent défenseur d’une paix entre Israël et la Syrie.
Pour eux, le Golan a perdu de son intérêt stratégique d’un point de vue militaire : il n’est plus nécessaire d’avoir un plateau avec une position dominante pour pouvoir surveiller son environnement proche, les progrès technologiques permettant de s’en passer facilement, tandis que la menace vient davantage des fusées de moyenne ou longue portée que de tirs depuis le Golan. La paix aurait, de plus, l’avantage de permettre une distanciation des liens entre la Syrie et le Hezbollah et le Hamas.
Selon M. Denis Bauchard, depuis 2006, le ministère israélien de la défense est en faveur de la reprise des négociations car il voit trois avantages principaux au règlement de ce dossier : la sécurisation de la frontière nord contre le Hezbollah, un affaiblissement des liens entre l’Iran et la Syrie, d’une part, des Palestiniens, d’autre part.
M. Liel insiste sur le fait que, en l’absence de tout processus de paix, les risques de guerre augmentent. Il faut absolument cesser de favoriser la conjonction des ennemis d’Israël. Comme il lui semble plus facile de conclure la paix avec les Syriens qu’avec les Palestiniens, il faut accepter les concessions nécessaires à la signature d’un accord avec les premiers.
Pour lui, l’essentiel est de convaincre le Premier ministre de la pertinence de cette option, car celui-ci pourrait imposer des négociations, même en cas d’opposition de son parti. Les discussions pourraient en outre être tenues secrètes pour ne pas heurter l’opinion publique israélienne, qui n’y est pas prête.
La position du peuple peut pourtant difficilement être négligée dans une démocratie comme Israël. C’est pourquoi M. Christophe Bigot parle d’une difficulté d’ordre démocratique. A l’heure actuelle 75 à 80 % des Israéliens sont contre un retrait du Golan car ils perçoivent cette région comme une zone skiable, un immense parc naturel, sécurisé, où l’on ne tire jamais un coup de feu, etc… En outre, nombre d’entre eux a toujours connu le Golan comme une partie intégrante de l’Etat d’Israël.
Des parlementaires ont même pris une initiative pour rendre juridiquement plus difficile la restitution du Golan. En application de la loi sur l’annulation du droit, de l’autorité et de l’administration de l’Etat de 1999, la restitution du Golan nécessiterait actuellement un simple vote à la majorité qualifiée à la Knesset dans la mesure où le référendum prévu par la loi ne peut être tenu à défaut de loi fondamentale sur son organisation. Mais la Knesset a commencé à discuter d’un amendement visant à durcir ces conditions : il faudrait soit la tenue d’un référendum – même en l’absence de loi organique –, soit un vote à la majorité des deux tiers à la Knesset, soit l’organisation d’élections générales dans les six mois suivant la décision.
M. Itamar Rabinovich estime néanmoins qu’un accord de paix sur le Golan peut être finalement accepté par l’opinion israélienne : pour cela, il faut d’abord trouver un accord, puis faire un effort de diplomatie publique, c’est-à-dire expliquer les avantages de l’accord. Il a rappelé que le Président Sadate était jadis parvenu à faire comprendre aux Israéliens l’intérêt de la paix séparée israélo-égyptienne en se rendant à Jérusalem. M. Bachar el-Assad devrait accepter des gestes d’ouverture, recevoir des journalistes israéliens à Damas, par exemple.
La Mission d’information ne croit pas qu’un accord sur le Golan puisse être conclu à court terme entre Syriens et Israéliens – même s’il serait dans l’intérêt des deux peuples –, surtout en l’absence de progrès dans le processus de paix israélo-palestinien. Or, celui-ci est actuellement quasiment au point mort. Même les modestes « proximity talks », pourparlers indirects proposés par les Etats-Unis, n’ont commencé qu’avec retard et après bien des difficultés. Début mars, alors que l’OLP venait d’accepter d’y prendre part et que le Vice-président américain Joe Biden était venu en Israël pour les lancer, le gouvernement israélien annonçait qu’il venait d’autoriser la construction de 16 000 logements à Jérusalem-Est. Devant son refus de revenir sur une décision qui constituait une provocation pour la communauté internationale, le début des pourparlers indirects a été reporté. Prévus pour durer quatre mois, ils n’ont finalement pu commencer qu’au début du mois de mai.
Cela ne signifie pas pour autant qu’il ne serait pas utile de rétablir un canal de discussion entre Israéliens et Syriens, ne serait-ce que parce que cela constituerait un signe de bonne volonté de la part de leurs gouvernements et contribuerait à apaiser les tensions régionales ; avancer dans les discussions permettrait aussi de mieux connaître la réalité des intentions des deux parties. Plusieurs interlocuteurs de la Mission, israéliens et syriens, ont estimé que la France pouvait jouer un rôle en la matière, étant donné qu’elle avait de bonnes relations avec les deux pays. Ce rôle d’intermédiaire pourrait être assuré en coopération avec la Turquie, qui a prouvé sa valeur dans cet exercice en 2007 et 2008. La Mission pense que ce serait ainsi non seulement un moyen d’aider la Syrie et Israël à renouer le contact, mais aussi un geste positif envers la Turquie, dont l’image en France est souvent injustement négative.
La Mission souhaite aussi relayer ici l’appel des responsables palestiniens et libanais à une implication plus forte de l’Union européenne dans les efforts en faveur du règlement du conflit israélo-arabe. La fermeté des conclusions du Conseil du 8 décembre 2009, qui appelaient notamment à la fin de toutes les activités d’implantation et à la recherche d’une réponse négociée à la question du statut de Jérusalem « comme future capitale de deux Etats » a été largement saluée. Le Conseil a aussi renouvelé son soutien aux efforts déployés par les Etats-Unis pour relancer les négociations entre Palestiniens et Israéliens. La Mission a conscience du fait que seuls les Etats-Unis sont en mesure d’exercer une pression décisive sur le gouvernement israélien pour qu’il prenne les décisions courageuses nécessaires à la conclusion de la paix. Mais l’Union européenne a aussi un rôle à jouer : la densité de ses relations politiques et économiques avec l’Etat hébreu lui confère incontestablement les moyens de peser en faveur de la paix.
D – Où en sont les droits de l’Homme ?
Les grandes réticences des autorités syriennes face à l’inclusion, dans l’accord d’association avec l’Union européenne, de stipulations relatives au respect des droits de l’Homme en Syrie ont déjà été évoquées. Bien que la Syrie soit partie à la quasi-totalité des normes internationales dans le domaine des droits de l’Homme (cf. tableau suivant) – ce que n’a pas manqué de souligner le président du groupe d’amitié Syrie-France de l’Assemblée du peuple lorsqu’il a reçu des membres de la Mission –, leur mise en œuvre est loin d’être parfaite. Pour certains observateurs, quelques progrès seraient actuellement enregistrés, tandis que d’autres estiment au contraire que la situation a tendance à se dégrader.
LA SYRIE ET LES NORMES INTERNATIONALES EN MATIÈRE DE DROITS DE L’HOMME | |
Normes internationales |
Date d’adhésion ou de ratification par la Syrie |
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, du 9 décembre 1948 |
25 juin 1955 |
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, du 7 mars 1966 |
21 avril 1969 |
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du 16 décembre 1966 |
21 avril 1969 |
Pacte international relatif aux droits civiques et politiques, du 16 décembre 1966 |
21 avril 1969 |
Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, du 30 novembre 1973 |
18 juin 1976 |
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, du 18 décembre 1979 |
28 mars 2003 (1) |
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984 |
19 août 2004 (2) |
Convention relative aux droits de l’enfant, du 20 novembre 1989 |
15 juillet 1993 |
Convention relative aux droits des personnes handicapées, du 13 décembre 2006 |
20 juillet 2009 |
Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, du 26 décembre 2006 |
La Syrie n’y est pas partie |
(1) dépôt de nombreuses réserves privant la convention de sa substance sur de nombreux points (notamment sur l’égalité des droits et des responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution). (2) dépôt d’une réserve qui empêche le Comité contre la torture de mener une enquête à la suite de la réception de « renseignements crédibles qui lui semblent contenir des indications bien fondées que la torture est pratiquée systématiquement sur le territoire d’un Etat partie » (art. 20). Source : Collection des traités des Nations unies (http://treaties.un.org). | |
1) Un régime toujours autoritaire
L’accession au pouvoir de M. Bachar el-Assad n’a absolument pas été démocratique. Avant même l’annonce officielle du décès de son père, le 10 juin 2000, l’Assemblée du peuple a abaissé l’âge légal des candidats à la présidence de quarante ans à trente-quatre ans, l’âge qu’avait alors M. Bachar el-Assad. Dès le 17 juin, le Congrès du parti Baas lui accorde le poste de vice-président ; il est nommé commandant en chef des armées le lendemain, puis secrétaire régional (c’est-à-dire national, suivant la terminologie du parti) du parti. Candidat unique, il est plébiscité à l’occasion d’un référendum organisé le 10 juillet : il recueille 97,30 % de votes positifs. La Syrie devient ainsi une « République héréditaire ».
Pourtant, le changement de ton de l’héritier et l’annonce de réformes lors de son discours d’investiture laissent espérer l’ouverture d’une ère nouvelle, qui ne durera en fait que quelques mois, avant que le régime se referme.
a) Un « printemps de Damas » qui a tourné court
Le nouveau président apparaît désireux d’élargir sa base sociale et le quotidien officiel Al-Thaoura ouvre ses pages à des intellectuels critiques, constituant « un espace de dialogue entre l’Etat et la société ». Plus de 250 forums de discussion voient le jour à travers de pays : on y débat de questions relatives aux réformes politiques et économiques, à la société civile et à la réconciliation nationale.
Les activistes interpellent le pouvoir en publiant des pétitions dans la presse libanaise : la « Déclaration des 99 », en septembre 2000, puis le « Manifeste des mille », en janvier 2001, appellent à la levée de l’état d’urgence, la libération des prisonniers politiques, le pluralisme politique et intellectuel et le respect des libertés publiques.
Le mouvement commence à s’organiser et appelle à former des partis politiques, ce qui alerte le régime, qui donne un coup d’arrêt à ce « printemps de Damas » en invoquant l’exigence de l’unité nationale face aux menaces extérieures. Lorsqu’il a reçu des membres de la Mission, le ministre syrien des affaires étrangères a encore mis en avant l’état de guerre avec Israël pour justifier le maintien en vigueur de l’état d’urgence, qui, selon lui, empêche d’appliquer les stipulations de l’accord d’association relatives aux droits politiques.
Les cercles de débat ont commencé à être interdits à partir de février 2001 et les principales figures du mouvement ont été arrêtées à l’automne suivant. Elles ont été condamnées par un tribunal militaire à des peines allant de deux à dix ans d’emprisonnement pour atteinte à la constitution. Seul le « Salon Atassi », du nom de Jamal Atassi, le père de l’Union socialiste arabe, est resté toléré, donnant une certaine image de pluralisme, mais sa direction devait rendre compte de ses activités aux services de renseignement, qui les surveillaient et les utilisaient pour repérer d’éventuelles dissidences.
Comme le souligne Caroline Donati (71), « la mobilisation du " printemps de Damas " a mis en exergue la faiblesse d’une opposition laïque laminée par des années de répression et par l’émigration, minée par des rivalités personnelles instrumentalisées par le pouvoir. » Elle observe aussi que les revendications politiques de ces formations sont éloignées des préoccupations dominantes de la société, qui aspire à un mieux-être économique et qui a pris ses distances avec la scène publique.
Selon M. Samir Aïta (72), cette situation ne s’est pas améliorée depuis le début des années 2000. Lui aussi juge inefficace le positionnement politique de l’opposition : elle mène de grandes batailles, contre l’état d’urgence, pour plus de démocratie, batailles qu’elle n’est pas en mesure de gagner à court terme, mais oublie de conduire les petites batailles qui intéressent le peuple, sur des thèmes sociaux, contre le nouveau projet de code civil par exemple, etc. Il déplore d’autant plus cet état de fait qu’il estime que le pouvoir est lui aussi faible, comme en atteste le recours systématique à des décrets présidentiels pour éviter de soumettre les projets du gouvernement au Parlement, qui lui est pourtant acquis.
La répression systématique des oppositions, même de celles qui se veulent constructives, est également un signe de faiblesse. M. Salam Kawakibi (73) a insisté sur le paradoxe que constituait la très forte répression subie par les personnes ayant participé à la « Déclaration de Damas pour un changement démocratique en Syrie », alors même que le changement prôné était compatible avec le maintien du régime en place et que ces personnes tendaient la main au pouvoir.
b) Un jeune président qui parvient finalement à établir son autorité
Cette faiblesse relative du pouvoir ne doit cacher ni le fort attachement des Syriens à l’Etat – alors que cet attachement est étranger aux Irakiens comme aux Libanais –, lequel les a conduits à faire bloc avec les autorités en 2005, quand le régime chancelait sous la pression extérieure, ni l’autorité que M. Bachar el-Assad a aujourd’hui acquise, après des débuts difficiles.
Il faut d’abord rappeler que ce n’était pas Bachar mais son frère aîné Bassel qui avait été préparé pour prendre la succession de leur père. Ce n’est qu’après la mort du jeune homme dans un accident de voiture, en janvier 1994, que Bachar interrompt les études d’ophtalmologie qu’il suivait à Londres et prend le relais de son frère. Comme les institutions militaire et sécuritaire sont le centre du pouvoir réel, il entre dans l’armée où il suit une formation accélérée à l’issue de laquelle il est nommé colonel début 1999. Il prend la direction de la Société syrienne de l’informatique, créée par Bassel, et promeut l’informatisation du pays et sa connexion au réseau Internet. Nombre de ses collaborateurs dans cette société accèderont à des postes de conseillers ou de hauts fonctionnaires après son élection à la présidence.
Après avoir neutralisé toute opposition au sein du clan Assad, le futur président écarte les officiers alaouites, puis sunnites, susceptibles de faire obstacle à son ascension. L’appareil militaro-sécuritaire a ainsi été verrouillé avant la disparition de Hafez el-Assad et son fils s’est constitué une puissante garde rapprochée. Dès son élection, Bachar nomme des hommes de confiance à tous les postes importants, mais des résistances se font jour dans le parti et dans l’armée. Pendant les premières années, les lois et décrets présidentiels ne sont pas systématiquement appliqués et son arbitrage est contesté.
En effet, la modernité et la jeunesse de l’héritier, sa tendance à se mêler à la population, quand son père était inaccessible et redouté, ne sont pas gage d’autorité, si bien que les anciens collaborateurs du défunt président restés au pouvoir veillent à la continuation du système et à la poursuite de leur hégémonie. L’exercice du pouvoir redevient collégial, comme il l’avait été avant que Hafez el-Assad ne s’impose, et les rivalités personnelles et claniques pèsent énormément. Elles continuent d’ailleurs à aller bon train aujourd’hui, alors même que, depuis l’automne 2006 et surtout l’hiver 2007, le jeune président est parvenu à dominer son entourage et à imposer son arbitrage, grâce à la victoire qu’il a remportée dans l’épreuve de force avec la communauté internationale.
De nombreux observateurs entendus par la Mission ont évoqué le changement de comportement du président au cours des dernières années. Le témoignage de M. Christophe de Margerie, qui l’a rencontré à plusieurs reprises, est à cet égard très précieux : le Président Bachar el-Assad « a d’abord traversé une période marquée par un volontarisme peu efficace ; il apparaît désormais partagé entre continuité et ouverture. En fait, depuis longtemps, il a la volonté d’ouvrir son pays mais, pour ce faire, il avait besoin d’une puissance qu’il ne détenait pas au début de son mandat. Son pouvoir personnel et celui du système qu’il dirige se sont renforcés et son autorité est devenue réelle. Il a notamment repris en main le système sécuritaire et les renseignements généraux, qu’il a réformés. » M. de Margerie estime que c’est le départ de certains de ses proches qui a permis au président de reprendre le contrôle.
En dépit de cette reprise en main du pouvoir par le chef de l’Etat et de la réorganisation de l’appareil sécuritaire, les services de renseignement continuent d’être omniprésents. L’armée, qui a beaucoup souffert du retrait du Liban, voit en revanche son image se détériorer : elle a perdu son rôle d’ascenseur social au profit de la fonction publique tandis que les « héritiers » préfèrent désormais bien souvent le monde des affaires. Aussi, le poids des alaouites dans les postes militaires clés recule au profit des sunnites, ce qui est parfois perçu comme une brèche dans le verrouillage communautaire du pouvoir, même si le partage du pouvoir avec les sunnites a largement commencé sous la présidence de Hafez el-Assad.
Si le renforcement de l’autorité du président a permis une accélération de l’ouverture économique et diplomatique du pays, il ne s’est pas traduit, une fois passé le bref « printemps de Damas », par un changement radical d’attitude en matière de libertés publiques.
2) Des libertés publiques encore à conquérir
Il est évident que la Syrie n’est ni une démocratie ni un Etat de droit. C’est donc plutôt en termes de progrès ou d’absence de progrès que la question des libertés publiques peut être posée. Les avis sont assez partagés en la matière, mais la Mission a le sentiment que, si quelques avancées peuvent être constatées, elles sont trop rares et trop lentes pour que le bilan ne reste pas largement négatif.
a) Quelques signes encourageants
De manière classique, les meilleurs avocats de la Syrie relativisent le problème des droits de l’Homme en replaçant la situation syrienne dans le contexte régional. M. Richard Labevière (74) a ainsi fait remarquer qu’il y avait davantage de prisonniers politiques en Egypte, en Arabie saoudite, voire en Jordanie, mais que personne n’en parlait. Nous ne sommes pas loin de la critique des « deux poids, deux mesures » si souvent utilisée pour leur défense par les autorités syriennes elles-mêmes.
Mais plusieurs interlocuteurs de la Mission ont aussi mentionné des signes concrets témoignant de certains progrès dans le domaine des libertés publiques.
M. Barah Mikaïl (75) a évoqué la fermeture de la prison de Palmyre qui avait une réputation épouvantable en matière de torture, ainsi que le discours présidentiel en faveur de plus de démocratie, même si les candidats d’opposition ne sont toujours pas autorisés à se présenter aux élections. En effet, le président souhaite que cette évolution se fasse « au rythme syrien, et dans le respect de l’intérêt national syrien… ».
A l’occasion d’un dîner organisé par l’Ambassadeur de France en Syrie, deux membres de la Mission ont pu s’entretenir avec les représentants à Damas des agences des Nations unies. Ceux-ci ont mentionné des évolutions positives s’agissant des droits de l’Homme en Syrie, ce que les diplomates français ont jugé à la fois paradoxal et inattendu. Mme Renata Dubini, représentante du HCR, a certes rappelé que la conception syrienne des droits de l’Homme était différente de leur conception occidentale dans la mesure où l’approche, inspirée de la tradition musulmane de l’accueil, était surtout caritative, mais elle a jugé que la Syrie évoluait dans la bonne direction, même s’il fallait être patient.
Surtout, M. Ismaïl Ould Cheick Ahmed, représentant du Programme des Nations unies pour le développement, a salué le fait que, désormais, les Nations unies parvenaient à aborder, dans une certaine mesure, ce sujet avec la Syrie, alors que c’était totalement impossible il y a peu. Il a indiqué que, pour la première fois, le bureau des droits de l’Homme de Beyrouth avait été autorisé à organiser une mission à Damas, laquelle avait été l’occasion de tenir une réunion où toutes les questions avaient pu être posées aux autorités syriennes. Ces dernières préparent sérieusement leur premier rapport pour la revue périodique devant le Conseil des droits de l’Homme ; ce dernier a prévu de l’examiner pendant sa session de l’automne 2011. Le représentant du PNUD a cité d’autres exemples, comme la création d’un Institut des droits de l’Homme, la participation du Programme à la formation des policiers, son soutien à la réforme pénitentiaire et un programme visant à réformer le Syrian Times, journal très « officiel » devenu illisible. S’il était très nuancé en ce qui concerne l’attitude du régime vis-à-vis des organisations non gouvernementales (ONG), il a conclu que le mouvement allait dans la bonne direction.
M. Christophe de Margerie estime lui aussi que la situation des droits de l’Homme évolue positivement, même si c’est très lentement. Optimiste, il juge que l’important est que le mouvement se poursuive de manière cohérente et pérenne, plutôt que par à-coups.
Il semble pourtant que, à bien des égards, l’évolution ne soit pas linéaire et que les sujets de préoccupation restent nombreux.
M. Salam Kawakibi n’a pas caché aux membres de la Mission les difficultés rencontrées en Syrie par tous ceux qui désiraient exprimer une opinion libre. Il a insisté sur le contrôle sévère imposé aux libertés d’expression et d’association : « Si, depuis le début des années 2000, des médias privés sont apparus dans le paysage audiovisuel, ils ne traduisent pas une véritable liberté politique. Ils peuvent s’exprimer sur l’ensemble des sujets relatifs à la vie quotidienne des Syriens tels que les questions sociales et économiques, l’administration locale ou le sport, à l’exception des sujets relatifs à la vie politique. Récemment les nouveaux journaux privés qui sont apparus dans le paysage médiatique ainsi que les chaînes privées répondent à une logique similaire : ils n’offrent pas un véritable espace d’expression politique notamment du fait de leurs liens avec des personnes proches du pouvoir en place, tant d’un point de vue administratif que de l’origine de leurs capitaux, même s’ils traitent occasionnellement de questions politiques. Il n’existe pas de possibilité pour un intellectuel indépendant de s’exprimer librement dans ces medias. La seule possibilité d’expression réside dans l’Internet malgré le contrôle du pouvoir sur les sites : plus de 250 sites sont interdits en Syrie, cependant il est possible, par une bonne connaissance des systèmes informatiques, de détourner la censure, et d’accéder aux écrits de fonds et critiques des intellectuels libres. » Finalement, c’est surtout dans la presse libanaise que les intellectuels syriens publient leurs travaux, malgré les efforts du régime pour les en empêcher.
Sans nier les quelques avancées précitées, l’ambassade de France juge la situation des droits de l’Homme toujours très insatisfaisante. Elle considère même que la situation s’est dégradée ces deux dernières années sur le front des libertés publiques et des droits de l’Homme entendus dans leur acception politique et civique. En juillet dernier, elle constatait que, sur les seize personnalités figurant sur la liste élaborée pour la visite du Président Sarkozy à Damas à l’automne 2008, seules deux avaient été libérées, après avoir purgé la totalité de leur peine, tandis que les signataires de la Déclaration de Damas restaient détenus, y compris les deux qui étaient gravement malades.
L’ONG SHRIL (Syrian Human Rights Information Link) a identifié pour 2008 974 détenus d’opinion dans les prisons syriennes, contre 800 en 2007. Parmi eux, seuls 283 ont été jugés. Ce recensement ne prétend pas être exhaustif : le nombre total de détenus d’opinion ou politiques serait de quelques milliers. Lorsqu’ils ont lieu, les procès se déroulent dans des conditions douteuses. Les mauvais traitements et la torture demeurent d’usage courant. L’ONG juge la situation pire qu’à la fin de la présidence d’Hafez el-Assad, qui avait été marquée par des vagues de libérations. Les autorités s’en prennent à la fois aux militants politiques stricto sensu et aux défenseurs des droits de l’Homme n’ayant pas ou plus d’engagement partisan.
Afin de dissuader les oppositions, le régime recourt de plus en plus systématiquement aux interdictions de voyager, qui toucheraient au total 15 000 Syriens, à la répression des activités sur Internet (censure, fermeture de sites et arrestation de cyberdissidents) et à des sanctions contre les familles des détenus (freins à l’emploi des conjoints, aux études des enfants).
Human Rights Watch parle aussi d’une détérioration de la situation en 2009, déplorant de même les arrestations de militants politiques et des défenseurs des droits de l’Homme, la censure des sites Internet et l’arrestation de blogueurs, les interdictions de voyager et la réouverture en mars 2009, après huit mois de suspension, des procès devant la Cour suprême de sûreté de l’Etat, tribunal d’exception dépourvu de presque toutes les garanties de procédure.
Même l’annonce par la Première dame, en janvier 2010, d’une prochaine loi-cadre sur les ONG inquiète, la question étant de savoir si l’encadrement de la société civile naissante ne contribue pas davantage à son contrôle qu’à son épanouissement. Cette préoccupation apparaît légitime dans un pays où le président et son épouse affichent certes leur soutien aux projets associatifs visant à encourager les initiatives de la société civile, mais ont tendance à ne concevoir cette dernière que modelée sur mesure, et où le nouveau projet de société présidentiel est incarné par une « government-operated non-gouvernmental organization » (GO-NGO) fondée par la Première dame (76).
Outre la question des droits des femmes, qui restent inférieurs à ceux des hommes, l’autre grand sujet de préoccupation en matière de droits de l’Homme est le traitement réservé à l’importante minorité kurde.
3) Les droits des Kurdes en question
Alors que la situation des minorités kurdes de Turquie et d’Irak s’est notablement améliorée au cours des dernières années, les Kurdes de Syrie continuent à souffrir à la fois de discriminations et de la répression des autorités contre toute forme de revendications. Ils constituent pourtant une partie non négligeable, quoique difficile à chiffrer précisément, de la population du pays.
a) Une minorité nombreuse, victime de discriminations
Le nombre de Kurdes vivant en Syrie est objet de polémiques. M. Salam Kawakibi a estimé qu’ils étaient environ 1,5 million, soit de l’ordre de 7 % des 21,3 millions de Syriens. Le ministère des affaires étrangères et européennes considère que les Kurdes constituent 10 % de la population syrienne. Selon les représentants kurdes rencontrés à Damas par la Mission, cette part atteindrait 15 %. Si leur nombre exact reste incertain, on voit néanmoins que cette communauté ethno-culturelle est importante ; tous les autres Syriens sont qualifiés d’arabes.
Mais il ne faut pas voir les populations kurdes comme formant un groupe homogène. Leur grande diversité est le résultat de plusieurs facteurs : la date de leur établissement en Syrie d’abord (des Kurdes sont installés à Damas depuis l’époque de Saladin, d’autres sont arrivés progressivement au cours des siècles suivants, certains ont immigré en Syrie dans les décennies 1970 et 1980, les derniers sont arrivés plus récemment), qui a d’importantes conséquences sur leurs niveaux d’assimilation culturelle, d’intégration économique et de maintien de liens avec les lieux d’origine ; leur religion (il y a surtout des musulmans, mais aussi des yézidis, membres d’une secte considérée comme hérétique par les premiers) ; leur identité locale (ils vivent principalement dans quatre zones : Damas, le Kurd dagh, le Jérablous et la Haute Jézireh) (77).
Le fait que tous ne se sentent pas kurdes au même degré – les plus anciennement implantés en Syrie ne parlent plus la langue kurde et ne respectent pas les traditions – contribue à rendre difficile l’évaluation de leur nombre, mais celui-ci constitue aussi un enjeu politique, à l’origine de la situation d’apatrides que connaissent en Syrie des dizaines voire des centaines de milliers d’entre eux.
En effet, lors du recensement de la population syrienne de 1962, n’ont été recensés que les Kurdes qui se trouvaient à leur domicile le jour où les agents recenseurs y sont passés : ceux qui étaient absents ont ensuite été privés de la nationalité syrienne. Selon M. Salam Kawakibi, les personnes devenues apatrides et leurs descendants seraient aujourd’hui entre 60 000 – chiffre avancé par le régime syrien – et 150 000 – de source kurde. M. François Burgat, le directeur de l’IFPO, que la Mission a rencontré à Damas, retient pour sa part une fourchette de 200 à 300 000 personnes. C’est ce dernier chiffre qu’ont cité M. Philippe Leclerc, représentant adjoint du HCR à Damas, et M. Barah Mikaïl. M. Leclerc a précisé que ces personnes sont non seulement privées de droits civiques, mais sont aussi contraintes de demander des autorisations pour se déplacer ou se marier, et ne peuvent devenir propriétaires. Comme elles vivent souvent dans les zones touchées par la sécheresse, elles sont fortement tentées par l’émigration. Les contrôles étant moins nombreux qu’auparavant, certaines parviennent à obtenir un titre de voyage pour quitter la Syrie ; elles tentent leur chance en Europe, où elles demandent souvent l’asile, à l’exemple d’une partie de la centaine de Kurdes qui sont arrivés en janvier 2010 sur une plage corse. En cas de rejet de leur demande, la Syrie refuse leur réadmission puisqu’elles n’ont pas la nationalité syrienne.
Le Président Bachar el-Assad avait annoncé peu après son accession à la présidence que la situation des Kurdes apatrides serait prochainement réglée, mais rien n’a encore été fait en ce sens. M. Philippe Leclerc a indiqué qu’il existait des précédents de solutions à des problèmes de ce type dans d’autres pays et que tous les apatrides kurdes n’avaient pas vocation à être confirmés dans la nationalité syrienne – une petite partie d’entre eux était turque : il s’agit notamment des familles des combattants du PKK qui se sont installées sans papier dans des camps d’entraînement et y sont restés après la fuite des combattants en 1999.
M. Barah Mikaïl attribue l’absence d’avancées sur ce dossier à deux raisons principales : malgré l’opacité du pouvoir syrien, on peut supposer qu’une partie des membres de l’appareil d’Etat craint que l’octroi de la citoyenneté syrienne à 300 000 Kurdes supplémentaires entraîne une forte progression de l’influence des Kurdes dans le pays et que cela affaiblisse le régime ; d’autre part, les soulèvements de Kurdes qui ont eu lieu en Syrie en avril 2004 et en mai 2005 (voir infra) ont été perçus comme le résultat d’une manipulation des Etats-Unis. Ces derniers auraient menacé le pouvoir syrien de favoriser le soutien des Kurdes d’Irak à leurs cousins de Syrie.
La situation des Kurdes apatrides est la plus difficile, mais l’ensemble des Kurdes est victime de discriminations, moins graves, mais bien réelles. Selon les représentants kurdes rencontrés par la Mission, les mesures discriminatoires contre eux n’ont fait qu’empirer depuis l’indépendance syrienne. Ils ont d’abord évoqué la politique, conduite à partir de 1962, consistant à installer des populations arabes dans les zones majoritairement kurdes. Ils ont ensuite présenté la situation dans les termes suivants : « Dans les zones kurdes, aucun projet d’infrastructure n’est réalisé. Les emplois dans les usines leur sont interdits sous prétexte qu’elles sont situées dans des zones frontalières. Les Kurdes n’obtiennent jamais de hautes responsabilités, même dans les régions où ils sont nombreux ; il n’y a jamais eu de ministre kurde depuis que le parti Baas est au pouvoir. »
Même lorsqu’ils sont des citoyens syriens, les Kurdes ne sont donc pas traités par l’Etat comme leurs compatriotes arabes. Ils sont aussi victimes d’une répression très sévère dès qu’ils se plaignent de leur sort ou expriment leurs différences culturelles.
b) Un peuple dont les aspirations sont violemment réprimées
M. François Burgat a expliqué que l’attitude du régime alaouite vis-à-vis des Kurdes avait évolué : il s’est d’abord opposé à leurs revendications au nom de la défense du pan-arabisme ; il a ensuite perçu les Kurdes comme formant une minorité susceptible de s’allier avec d’autres minorités ; il les a enfin vus comme une menace lorsque le Kurdistan irakien a gagné en autonomie et que les Kurdes de Syrie se sont présentés comme des opposants au régime. C’est la situation actuelle, qui est vivement critiquée par les ONG de défense des droits de l’Homme comme par les diplomaties occidentales.
La question kurde a retrouvé une visibilité en Syrie depuis le printemps 2004. En mars, des affrontements entre supporters arabes et kurdes lors d’un match de football à Qamichli, dans l’extrême nord-est du pays, ont conduit à un mouvement de répression à l’encontre des Kurdes, provoquant des émeutes et des échauffourées dans l’ensemble des enclaves kurdes du pays. Pour la première fois, on a vu émerger un mouvement de contestation qui donnait un semblant d’unité à une forme de « groupe kurde », lié par un sentiment de solidarité dépassant tout clivage partisan, local, tribal ou religieux.
Début 2008, M. Jordi Tejel Gorgas pensait qu’un nouvel équilibre était en train de se dessiner entre le mouvement kurde et le régime syrien, dans la mesure où les partis kurdes avaient largement contribué à la pacification de la rue après les flambées de violence du printemps 2004. Il avait le sentiment que le Président el-Assad s’apprêtait à permettre, au moins de manière officieuse, la consolidation d’un espace culturel et symbolique kurde, les revendications des Kurdes de Syrie étant essentiellement culturelles et identitaires. Les choses ont changé depuis, conduisant à ce qu’il qualifie de « retour du bâton », une phase de répression succédant à une période de timide ouverture, comme ce fut déjà le cas à plusieurs reprises depuis les années 1960.
Le contexte régional attise incontestablement les tensions. Ainsi, en novembre 2007, les menaces du gouvernement turc d’une intervention militaire en Irak pour y déloger la guérilla du PKK avaient provoqué de nouvelles mobilisations en Syrie, qui se sont soldées par un mort à Qamichli et des dizaines d’arrestations à Kobane.
Depuis lors, le régime a multiplié les décisions dirigées contre les revendications des Kurdes. En avril 2008, il a été décrété que toute réunion, manifestation ou célébration n’ayant pas obtenu la permission du ministère de l’intérieur étaient interdites. En septembre de la même année, le gouvernement de Damas vote un décret limitant de manière significative le droit des personnes à vendre ou à acheter des terres situées dans les zones frontière, toute transaction devant désormais être autorisée par l’Etat. Bien que ce décret affecte tout le territoire syrien les principales villes à majorité kurde du nord syrien sont toutes situées à proximité de la frontière turco-syrienne, aussi ce décret a été interprété par les partis kurdes comme une agression dirigée contre la population kurde et ils ont organisé des actes de protestation à Damas, à l’occasion desquels plus de deux cents personnes ont été interpellées.
La répression a également concerné les manifestations culturelles. Le 21 mars 2008, lors du nouvel an kurde, la police a dispersé trois cents personnes avec des balles réelles faisant trois morts et six blessés. Un an après, la police a réprimé violement la fête de Norouz à Alep. Dans d’autres villes du nord syrien, entre le 27 et le 31 mars, sept jeunes kurdes furent arrêtés pour avoir participé à des actes « incitant au conflit sectaire ». Des mariages où l’on jouait de la musique kurde ont été également interrompus de manière violente par des forces de sécurité à Qamichli en 2008 et, à nouveau en octobre 2009 à Derik.
Les membres des partis politiques kurdes ont été cependant les principales victimes de la coercition étatique. Le régime syrien a décapité la direction des partis qui s’étaient montrés les plus actifs depuis 2004. Ces vagues d’arrestations ont touché finalement tous les partis et ont obtenu, en partie, l’objectif poursuivi : faire régner la terreur. En février 2009, huit des treize partis kurdes existants se sont réunis clandestinement au Caire. M. Jordi Tejel Gorgas a assisté à cette rencontre en tant qu’observateur extérieur et a pu constater que les partis kurdes n’envisageaient, pour l’instant, ni de défier ouvertement le régime ni de travailler avec l’opposition syrienne pour le renverser. Les arrestations de responsables de partis kurdes n’en continuent pas moins : la dernière en date signalée par l’Observatoire syrien pour les droits de l’Homme est intervenue le 20 mai 2010 ; les raisons de cette arrestation et le lieu de détention de l’opposant kurde concerné restent inconus.
Les cas de tortures et de mauvais traitements sur des prisonniers kurdes ont également augmenté. Les pressions sont aussi de plus en plus fortes contre les activistes kurdes et même contre les jeunes Kurdes faisant leur service militaire. Depuis les émeutes de mars 2004, vingt-deux jeunes Kurdes (dont sept en 2009) se sont « suicidés » dans les casernes de l’armée syrienne. Aucune instance officielle n’a enquêté sur la mort mystérieuse de ces jeunes gens bien que certaines familles signalent ouvertement la piste de meurtres dus aux activités politiques et culturelles des victimes.
Sur le terrain linguistique, les autorités syriennes ont pris des initiatives visant à limiter les droits linguistiques des citoyens kurdes. En novembre 2008, le gouverneur de la province de Hassaka (dans la Haute Jézireh) a interdit d’imprimer sur n’importe quel support (livres, cartes postales, posters) dans une autre langue que l’arabe.
Les faits ainsi présentés par M. Jordi Tejel Gorgas se retrouvent dans le rapport que Human Rights Watch a consacré aux Kurdes en Syrie en novembre 2009. Il précise notamment qu’au moins quatorze rassemblements politiques et culturels kurdes, pacifiques dans la plupart des cas, ont été réprimés depuis 2005 par les forces de sécurité syriennes, qui recourent souvent à la violence pour disperser les foules.
M. Christophe Bigot (78) a jugé que la politique répressive des autorités syriennes contre le fait national kurde, que le régime veut ignorer, est plus développée encore que celle visant les autres opposants.
Les autorités syriennes ont évidemment des difficultés à défendre cette politique d’une manière convaincante pour les Occidentaux. Interrogée très directement sur cette question, l’ambassadrice de Syrie (79) a souligné que le gouvernement syrien tenait au maintien de la paix dans le nord du pays et de l’équilibre entre les communautés et que les autorités locales contribuaient aussi au maintien de leur diversité. Mais, selon elle, cette région connaît des « invasions » permanentes des Kurdes venus de Turquie et d’Irak car ils ont des liens familiaux avec des Kurdes de Syrie. Ils formeraient ensuite des vagues de migration vers l’Europe, en recourant au service de passeurs appartenant à des réseaux mafieux.
Il est certain qu’il existe des liens familiaux entre les Kurdes habitant dans les différents pays de la région, de part et d’autre des frontières ; on ne peut pas non plus nier que certains d’entre eux entrent illégalement en Europe. Mais cela ne justifie ni le refus de régler la question des apatrides, ni la situation de sous-développement dans laquelle sont laissées les zones où les Kurdes sont les plus nombreux, ni la répression qui s’abat contre la moindre manifestation de l’identité kurde.
Comme c’est aussi le cas dans d’autres pays, notamment méditerranéens, les autorités syriennes font preuve d’une mauvaise foi incontestable en matière de respect des droits de l’Homme. Les arguments régulièrement invoqués de l’ingérence dans les affaires intérieures, du « deux poids, deux mesures » ou du « péril islamiste », que seul un régime fort serait en mesure de prévenir, ne sont pas recevables.
Les moyens dont les diplomaties occidentales disposent pour soutenir les défenseurs des droits de l’Homme sont limités et à manier avec précaution : il ne s’agit pas de les exposer à encore davantage de mesures répressives. L’ambassade de France à Damas insiste sur l’attachement des groupes de défenseurs des droits de l’Homme à la présence de diplomates occidentaux aux procès de leurs membres. Elle soutient l’idée d’élaborer une stratégie commune aux Etats membres de l’Union européenne sur les droits de l’Homme en Syrie et suggère, pour y parvenir, d’harmoniser les messages des Vingt-sept dans leurs contacts avec les autorités syriennes, notamment en établissant une liste actualisée de détenus symboliques dont ils demanderaient la libération. Elle juge aussi qu’il serait pertinent de choisir les droits de l’enfant comme thème de dialogue avec Damas.
La Mission soutient ces propositions. Elle considère plus généralement que l’accomplissement de progrès en matière de droits de l’Homme doit être exigé des autorités syriennes au même titre que le règlement des dossiers prioritaires dans les relations syro-libanaises (voir supra). A court et moyen termes, elle ne croit pas plus à la transformation de la Syrie en une véritable démocratie qu’à la banalisation de ses relations avec le Liban, mais elle estime que la France se doit de conditionner à des avancées dans ces domaines la poursuite de ses relations politiques de haut niveau avec Damas et de ses actions de coopération.
E – Comment la société évolue-t-elle ?
En dépit de ses retards persistants en matière de libertés publiques, la société syrienne change et présente des signes de modernité, favorisés par l’ouverture économique du pays. Après des décennies de « glaciation », l’arrivée au pouvoir d’un président jeune, au mode de vie occidentalisé, a beaucoup contribué à cette évolution.
Le général Wolfgang Jilke, ancien commandant de la FNUOD (80), a confié aux membres de la Mission qu’il a rencontrés que, entre son premier séjour en Syrie, en 1974, et le deuxième, en 1999, le pays avait peu changé ; en revanche, en 2006, lorsqu’il est arrivé pour son troisième séjour, il a constaté de nombreux changements : d’un côté, le nombre de femmes voilées avait beaucoup augmenté ; de l’autre, les gens avaient l’esprit plus ouvert car étaient en contact avec plus d’informations, notamment grâce au téléphone mobile et aux chaînes de télévision par satellite – jusqu’à sept cents sont accessibles en Syrie !
Cette évolution contrastée s’observe également dans d’autres pays de la région, mais elle surprend davantage en Syrie car celle-ci est marquée par une tradition laïque à laquelle les autorités restent officiellement très attachées et dont elles font un modèle pour la région, voire pour le monde.
1) La tradition laïque syrienne face à la montée de l’islamisme
La Syrie est considérée, non sans raison, comme un Etat laïc, mais cette laïcité est très éloignée de la conception que nous en avons en France. Elle consiste en une tentative de dépasser le communautarisme, sans y parvenir tout à fait.
C’est surtout lorsque l’on compare la situation syrienne à celle des autres pays de la région, que l’on mesure la qualité de la cohabitation entre les communautés religieuses – environ 10 % des Syriens sont chrétiens. M. Antoine Sfeir (81) voit dans la Syrie le seul rempart au communautarisme dans la région, alors que celui-ci progresse de manière inquiétante en Irak et au Liban. En effet, depuis que l’Etat irakien a perdu le caractère laïc qu’il avait sous le régime de Saddam Hussein, la Syrie reste le seul Etat arabe à se réclamer de ce principe, qui régresse aussi nettement dans le Territoires palestiniens, en dépit des efforts du Fatah, sous l’effet de l’influence croissante du Hamas.
M. Samir Aïta a remarqué que, en Syrie, les oppositions majeures s’observent plus entre villes (les habitants d’Alep s’opposant à ceux de Damas, par exemple) qu’entre confessions religieuses. Il estime que les identités confessionnelles existent mais occupent moins de place qu’au Liban par exemple.
Elles n’en jouent pas moins un rôle important dans certains domaines. La constitution syrienne dispose que le président de la République doit être de confession musulmane. Surtout, c’est la charia qui s’impose dans la gestion des affaires civiles. Comme celle-ci interdit par exemple à une musulmane d’épouser un chrétien, un tel mariage n’aura pas d’existence au regard du droit syrien et les enfants nés de cette union seront considérés comme illégitimes et privés de tout droit civique.
La communauté alaouite occupe une place particulière en Syrie dans la mesure où le président et de nombreux hauts responsables du pays, en particulier dans l’armée, en sont issus bien qu’elle ne représente que 12 % de la population, qui est sunnite à 74 %. Mais M. Samir Aïta a insisté sur le fait qu’il n’était pas pertinent de qualifier le régime d’alaouite. Le président est certes alaouite, mais il est surtout damascène, quand son épouse est une sunnite d’Homs. Si beaucoup d’officiers supérieurs sont alaouites, c’est aussi le cas de nombreux opposants. L’Etat syrien s’est en effet construit à partir d’une alliance entre la montagne alaouite, les autres régions et les grandes villes syriennes. Aussi les réseaux d’alliances sont-ils très complexes et ne se résument-ils pas à l’appartenance confessionnelle.
M. Salam Kawakibi partage cet avis. Il a rappelé qu’Hafez el-Assad avait pris soin de diluer la spécificité alaouite du pouvoir, notamment par une « politique » de mariages mixtes avec les classes de commerçants sunnites. Il n’existe pas, en Syrie, de risque de guerre entre les communautés, comme en Irak, car la culture intercommunautaire est très développée. Les communautés sont très liées les une aux autres et les idéologies des partis politiques ont toujours été laïques et partagées par des membres des différentes communautés. Les communautés chrétiennes soutiennent le régime par peur de ce qui s’est passé en Irak : le régime s’est toujours montré attentif à combattre les dangers qui pesaient contre elles.
Le mufti général de la République, avec lequel plusieurs membres de la Mission se sont entretenus, a mis l’accent de manière très appuyée sur la diversité religieuse de la société syrienne : « il existe vingt-trois communautés religieuses en Syrie et leur coexistence ne pose plus de problèmes depuis qu’a été abolie la notion de minorité qui suppose l’existence d’une majorité. Il n’existe pas non plus de minorité " ethnique " mais uniquement des citoyens syriens dont l’appartenance culturelle, ethnique, religieuse et confessionnelle est respectée dans le cadre de la loi. » Ainsi, le Président el-Assad est le président de tout le pays et les différents responsables religieux veillent aussi sur tous les citoyens, quelle que soit leur confession. Le mufti général est le mufti de la République et pas celui des seuls musulmans : il fête Noël avec les chrétiens et les chrétiens fêtent avec lui la naissance du Prophète. Cette laïcité syrienne est mise en regard du caractère juif revendiqué par l’Etat d’Israël et présentée comme le seul moyen d’éviter la multiplication des conflits religieux.
A l’occasion d’un déjeuner réunissant autour du mufti général le patriarche d’Antioche et de tout l’Orient de l’Eglise grecque-orthodoxe et un représentant du patriarche d’Antioche et de tout l’Orient de l’Eglise grecque-catholique, les membres de la Mission ont pu constater que les relations étaient cordiales entre les responsables des différentes religions en Syrie. Il ne faut pas pour autant oublier que nombre de chrétiens de Syrie a émigré ou aspire à le faire, non pas à cause de l’attitude des autorités, qui reste bienveillante, mais en réaction au processus d’islamisation de l’ensemble de la société syrienne. La communauté juive de Syrie a en outre quasiment disparu. Aussi, bien que le chef de l’Eglise grecque orthodoxe ait déclaré que vivre parmi 90 % de musulmans ne posait pas de problèmes particuliers aux chrétiens syriens, il n’a pas manqué d’appeler au respect des différences.
b) Une montée de l’islamisme difficile à contrer
Si les chrétiens syriens sont tentés par l’émigration, ce n’est pas à cause de discriminations qu’ils subiraient de la part de l’Etat, mais plutôt du phénomène d’islamisation ou de réislamisation que connaît depuis quelque temps la société, à l’instar de ce qui passe dans la plupart des pays de la région.
Tous les interlocuteurs de la mission qui ont évoqué les évolutions de la société syrienne ont souligné ce phénomène, qui se traduit notamment par un nombre croissant de femmes voilées.
M. Antoine Sfeir en a donné l’explication suivante : « Dans les années 1950, l’Egypte de Nasser étant diabolisée, la Syrie a noué une alliance stratégique avec l’Arabie saoudite. Au moment où les dictatures militaires se multipliaient dans le monde arabe, les mosquées, qui bénéficiaient d’argent saoudien, restaient les seuls lieux où la parole était libre. La réislamisation trouve là son origine. »
Au début des années 1980, le régime syrien avait pourtant mis un terme brutal à la « vague d’agitation confessionnelle » à laquelle il était confronté depuis l’été 1979. Ce mouvement était conduit par les Frères musulmans, mais il s’opposait surtout à un régime qui avait supprimé les libertés démocratiques et promu une nouvelle bourgeoisie au détriment des élites traditionnelles des grandes villes. Les partis étant interdits, la contestation s’était naturellement déplacée vers le champ religieux. L’armée fut envoyée pour mettre au pas Alep en 1980, puis Hama en 1982. L’écrasement du soulèvement d’Hama avait été suivi par une violente répression contre les mosquées et les associations religieuses.
Aussi, afin de canaliser le renouveau de la demande d’islam de la part de la majorité sunnite, le régime a-t-il favorisé l’affirmation d’un islam quiétiste déconnecté du politique et ayant en principe de bonnes relations avec les minorités. Cet « islam officiel » est promu par les institutions publiques et des acteurs privés. L’essentiel de la formation religieuse supérieure est délivré à Damas conformément à cette ligne et seuls ceux qui la respectent montent dans la hiérarchie. Le mufti général de la République n’a pas caché aux membres de la Mission l’extrême vigilance des autorités à l’égard des prêches extrémistes.
M. Salam Kawakibi n’en redoute pas moins que la partie la plus extrémiste de l’islam officiel n’échappe au contrôle de l’Etat. Il observe à quel point la religiosité croissante pèse socialement, en particulier sur les personnes laïques mais aussi sur ceux qui défendent une religion éclairée. Mais il a aussi mis en garde la Mission contre l’instrumentalisation par le régime de la peur des Occidentaux vis-à-vis de l’intégrisme musulman : les autorités prennent volontiers prétexte du risque de voir les plus radicaux accéder au pouvoir pour justifier le refus de toute concession démocratique.
Les membres de la Mission ont été impressionnés par le discours du mufti général de la République, prônant un islam modéré, qui s’adapte à la société dans laquelle les fidèles vivent. Ils y ont vu un modèle qu’ils apprécieraient de voir mis en œuvre par tous les musulmans français. Mais ils ont aussi constaté que ce discours officiel ne suffisait pas à encadrer le phénomène d’islamisation que connaît la société syrienne, et dont les femmes subissent tout particulièrement les conséquences.
2) La place des femmes : des inégalités persistantes
Le fait que le droit civil soit régi par la loi religieuse de chaque communauté conduit à maintenir les femmes dans une position d’infériorité juridique ; la réislamisation de la société ajoute à cette situation une pression sociale peu favorable à leur liberté, même si, jusqu’ici, elle ne s’est pas traduite par un recul dans les droits qui leur sont reconnus. Cela n’empêche pas certains progrès de fait, variables il est vrai selon les classes sociales, les appartenances communautaires et les régions, mais il est difficile de se prononcer sur l’évolution future de la place des femmes en Syrie.
En Syrie, la constitution garantit aux femmes les mêmes droits politiques que les hommes, ce qui a été souligné par le président du groupe d’amitié Syrie-France. Leur situation est sur ce point plus favorable que dans d’autres pays de la région, c’est indéniable. Il a signalé qu’elles pouvaient être candidates à toutes les élections et qu’il y avait des femmes députées depuis 1954. Certaines occupent des postes importants dans la fonction publique, une femme est vice-présidente, une est conseillère du président, deux sont ministres, cinq ambassadrices et un grand nombre est magistrat, y compris, il y a peu, procureur général. Elles bénéficient des mêmes salaires que les hommes, à poste équivalent, et peuvent travailler voilées ou dévoilées. Cette liberté de choix leur est accordée, conformément au principe du respect à la vie privée, garanti par la Cour européenne des droits de l’Homme. Néanmoins, le voile intégral est interdit dans certaines situations : pour passer un examen, par exemple, il faut montrer son visage. On voit bien que ce discours tenu par le président du groupe d’amitié visait au moins autant à décrire la situation des femmes en Syrie qu’à critiquer des dispositions françaises encadrant le port du voile dans les services publics.
Il n’évoque en revanche ni le taux élevé d’analphabétisme féminin (près de 42 %, contre moins de 13 % pour les hommes), ni les inégalités juridiques que subissent les femmes du fait de l’application du statut personnel en matière civile. Ce sont elles qui ont justifié les réserves formulées par la Syrie au moment de la signature de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979, entrée en vigueur pour la Syrie en mars 2003 seulement. Ces réserves portent sur des points essentiels : l’octroi de la nationalité de la mère à l’enfant, le droit de circuler librement et de choisir sa résidence, l’égalité des droits et des responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution en ce qui concerne la tutelle, la curatelle, la garde et l’adoption, l’absence d’effets juridiques des fiançailles et des mariages d’enfants. Même l’article 2 de la convention qui pose l’objectif de la suppression de toutes les discriminations à l’égard des femmes est l’objet d’une réserve. On signalera en particulier que les musulmanes sont victimes de discriminations très marquées en matière d’héritage (leur part correspond à la moitié de celle perçue par un homme se situant au même degré de parenté). Le code pénal comporte aussi des mesures discriminatoires au détriment des femmes.
En 2007, une commission a été chargée de préparer une réforme du statut personnel censée prendre en compte les nombreuses demandes d’évolution vers plus de modernité. Pourtant, au printemps 2009, c’est un autre projet, élaboré sous l’autorité du Premier ministre par des musulmans radicaux, qui a été rendu public. Non seulement ce projet n’apportait pas de progrès sur les points les plus critiquables du droit actuel, mais il comportait même de nombreuses dispositions régressives. M. Hassan Abbas, l’un des chercheurs de l’IFPO qui a discuté avec certains membres de la Mission, a énuméré plusieurs dispositions qu’il a qualifiées d’aberrantes : le mot de citoyenne était supprimé ; la question du mariage mixte, qui aurait dû être libéralisé, était au contraire traitée de manière réactionnaire ; en cas de divorce, l’asymétrie en faveur du père pour la garde des enfants était accentuée (et étendue à la famille paternelle) ; la question de la nationalité des enfants, actuellement transmise par le seul père, n’était pas traitée… La société civile a réagi vivement à ce projet, que même une partie des musulmans conservateurs a désapprouvé. C’est finalement le Président el-Assad qui est intervenu pour qu’il soit retiré.
Même si elle n’a pas abouti, une initiative de ce type ne peut qu’inspirer de l’inquiétude à tous ceux qui sont attachés aux droits des femmes. Dans ce domaine comme dans d’autres, conservateurs et progressistes s’affrontent, le président et son épouse se plaçant dans le second camp.
M. Aref Sheikh, coordinateur de programme du Fonds de développement des Nations unies pour la femme (UNIFEM), a jugé que la Syrie avait changé de position dans le traitement de la question. Selon lui, le fait qu’elle soit finalement devenue partie à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en atteste. Même s’il y a une grande différence entre le droit, national et international, et sa mise en œuvre, la question des femmes a été intégrée dans le nouveau plan quinquennal. L’UNIFEM s’efforce de sensibiliser les autorités à la lutte contre les discriminations à l’égard des femmes ; il finance par exemple un programme régional qui associe les femmes députées afin qu’elles fassent du lobbying auprès de chaque parlement. Mais le coordinateur de programme n’a pas caché les difficultés : un projet, soutenu par l’ambassade des Etats-Unis et portant sur les questions du mariage et de la polygamie, a dû être arrêté sous la pression des imams qui contestaient la mise en avant de la notion d’égalité homme-femme.
Seule une évolution des mentalités permettrait de réaliser des progrès importants dans ce domaine. Celle-ci devrait être favorisée par l’exemple que donne l’épouse du président de la République, Mme Asma el-Assad, avec laquelle la Présidente de la Mission a eu l’honneur de s’entretenir. Née en 1976 en Grande-Bretagne, où elle a été élevée, Mme el-Assad a un master en économie du King’s College et a travaillé dans la finance aux Etats-Unis avant d’épouser le président, en janvier 2001. Elégamment vêtue à l’occidentale, non voilée, elle a fondé une GO-NGO très active dans l’action sociale et suit très attentivement la politique culturelle du pays. Elle donne une image de modernité à la fois vis-à-vis de l’extérieur, mais aussi à l’attention de ses concitoyennes. Elle a notamment soutenu les associations féministes qui ont conduit la mobilisation contre le projet de réforme du statut personnel. Elle fait preuve d’une grande lucidité sur la situation de son pays, ainsi que sur la portée et les limites de ses actions.
Toutes les femmes proches du pouvoir ne sont pas progressistes. M. Hassan Abbas a signalé l’existence d’un mouvement de femmes musulmanes, constitué en 1984 mais resté discret jusqu’en 2007, qui a désormais pignon sur rue : il se présente comme un mouvement soufi apolitique de soutien aux démunis, mais il cherche à toucher les épouses des hommes les plus influents, qu’il s’efforce d’influencer dans un sens radical.
Si la Mission craint que le régime syrien ne se montre guère ouvert à un plus grand respect des droits politiques sans une pression extérieure forte, elle a l’impression que, comme dans le domaine de l’ouverture économique, les progressistes peuvent l’emporter sur les conservateurs en ce qui concerne les droits des femmes. En effet, des progrès en ces matières ne menacent pas la survie du régime ; ils pourraient au contraire le conforter en lui conférant l’un plus de ressources à partager, l’autre le soutien de celles dont le statut sera moins inégalitaire. Le rythme des réformes à conduire doit rester adapté à la capacité d’absorption de la société. Reste à savoir si la jeunesse de la population est susceptible de faciliter ces évolutions.
3) Les difficultés rencontrées par la jeune génération
Bien qu’il soit légèrement en baisse, le taux de croissance de la population syrienne reste élevé (2,4 % par an officiellement, 3,3 % en réalité). 40 % de la population a aujourd’hui moins de quinze ans, et plus de la moitié moins de vingt ans.
Les jeunes Syriens sont ouverts sur le monde et ressemblent de plus en plus aux jeunes Libanais. Depuis que l’uniforme scolaire a été supprimé, en 2003, ils s’habillent comme eux et la société militarisée de l’époque d’Hafez el-Assad a cédé la place à la société de consommation. En ville comme à la campagne, la jeunesse vit à l’heure des clips arabes ou occidentaux, écoute de la musique sur les ondes des nouvelles radios privées syriennes et admire les mêmes stars de cinémas que la jeunesse occidentale.
Bien sûr, tous les jeunes Syriens ne sont pas tels que ceux qui ont été décrits aux membres de la Mission par les jeunes acteurs socio-économiques avec lesquels ils ont partagé un petit-déjeuner : ayant beaucoup voyagé et souvent vécu à l’étranger, entretenant des liens avec l’Asie et les Etats du Golfe et dotés de l’esprit d’entreprise, mais la plupart a accès aux nouvelles technologies de l’information. Tous sont séduits par les modèles étrangers, en particulier celui des Etats-Unis, pays associé à la liberté de mouvement et de comportement, à la technologie et à un foisonnement d’opportunités, mais ils tiennent à leur identité, musulmane, arabe, orientale ou syrienne.
Dans la mesure où l’ouverture économique profite encore principalement à quelques privilégiés, les nombreux jeunes Syriens qui arrivent chaque année sur le marché du travail ont beaucoup de difficultés à trouver un poste. Plusieurs interlocuteurs de la Mission ont observé que la Syrie manquait de personnes bien formées, mais même les jeunes diplômés ont du mal à accéder à un emploi.
Ces difficultés, conjuguées au renchérissement du coût de la vie, limitent les possibilités d’autonomie des jeunes. La difficulté à trouver un logement, rare et coûteux, et l’importance toujours attachée à la situation économique du futur marié contribuent au recul de l’âge du mariage, dans un pays où la vie en couple ne s’envisage pas hors de ses liens.
Les préoccupations économiques l’emportent largement sur les considérations idéologiques ou politiques. Beaucoup ont été déçus par les promesses non tenues du président, dont le discours modernisateur avait été apprécié par les jeunes. Aussi une part importante de la jeune génération, supérieure au tiers si l’on en croit un rapport du Comité syrien pour les affaires de la famille (82), serait tentée par l’émigration, les Etats-Unis ou la Canada, où vit déjà une importante communauté syrienne, étant les destinations rêvées. Dans les faits, les possibilités sont de plus en plus limitées : rares sont les jeunes Syriens qui maîtrisent une langue étrangère, l’isolement du régime a compliqué l’obtention de visas pour se rendre dans les pays occidentaux, la crise économique a réduit les opportunités d’emplois dans le Golfe, duquel nombre de Syriens sont revenus, tandis que le Liban n’est plus aussi ouvert aux travailleurs syriens que par le passé.
La jeunesse syrienne connaît ainsi un certain désarroi. Seule une partie limitée, surtout issue des milieux populaires, refuse la modernité et se tourne vers la religion. A l’exception de ceux appartenant aux familles les plus favorisées, les autres se battent pour avoir un emploi et accumuler de l’argent, sans contester réellement le régime.
La Mission n’a pas l’impression que la jeunesse syrienne soit portée par une volonté de s’opposer au régime. Mais elle subit les conséquences immédiates du processus en cours de libéralisation de l’économie. La France accueille d’ores et déjà 3 000 étudiants syriens chaque année dans l’enseignement supérieur : elle doit à la fois maintenir cette politique d’accueil – ce qui suppose d’accorder des visas aux jeunes gens qui les demandent – et poursuivre sa coopération avec les établissements syriens d’enseignement afin d’améliorer le niveau de formation et de l’adapter aux besoins importants d’une économie syrienne en plein développement. L’Union européenne serait également bien avisée de faire de ce champ une priorité de son aide à la Syrie. L’enjeu n’est pas mince : la population syrienne en général, et la jeune génération en particulier, n’accepteront véritablement l’ouverture économique du pays que si elles en tirent bénéfice et y sont associées, ce qui n’est pas encore suffisamment le cas aujourd’hui.
*
La Syrie apparaît ainsi réticente à renoncer à certains des fondamentaux de la politique étrangère et intérieure menée par le régime depuis trois décennies au moins, car ceux-ci sont perçus comme indispensables à la préservation du système : l’influence syrienne sur le Liban, quelques formes qu’elle prenne, l’opposition à Israël, l’alliance avec l’Iran et les « forces de la résistance » donnent à la Syrie une profondeur stratégique et une capacité de nuisance qui dépassent de beaucoup celles qu’elle pourrait tirer de son armée, de sa population ou de son économie. Au niveau intérieur, le maintien d’une forte pression contre toute velléité de contestation reste aussi d’actualité. Tout au plus le régime a-t-il pour objectif affiché d’améliorer les conditions de vie des populations afin de prévenir le mécontentement, mais les fruits de l’ouverture économique profitent jusqu’ici exclusivement à certains privilégiés.
Ce rapport a exprimé le sentiment de la Mission sur les différents thèmes abordés ; lorsque le sujet s’y prêtait, elle a esquissé des propositions à l’attention des autorités françaises ou européennes. Le moment est venu d’en faire une synthèse.
La Mission se félicite d’abord vivement du choix fait au printemps 2007 par le Président Sarkozy de renouer le dialogue avec la Syrie. Maintenir l’isolement de celle-ci ne faisait que contribuer à la radicalisation de ses positions et à accentuer sa dépendance vis-à-vis de l’Iran. Depuis le changement de cap français, l’Europe, les Etats-Unis ainsi que la quasi-totalité des Etats arabes modérés ont suivi la même voie. Mais il reste beaucoup à faire pour conforter l’ouverture de la Syrie vers le reste du monde, l’objectif de plus long terme restant d’obtenir son ralliement aux positions des Etats modérés de la région.
Ceux qui critiquent la politique de la main tendue en direction de la Syrie estiment qu’elle est unilatérale : les pays occidentaux, les Etats arabes modérés acceptent de rétablir des relations denses avec Damas, donc mettent un terme à son isolement diplomatique, mais la Syrie ne donnerait rien en contrepartie. On peut leur objecter le rôle constructif qu’elle a joué pour assurer le retour au calme au Liban en mai 2008, puis à l’occasion des élections législatives et de la constitution d’un gouvernement d’union nationale, en 2009. Les négociations avec Israël sur le Golan par l’intermédiaire de la Turquie, bien qu’interrompues en décembre 2008, sont aussi à porter au crédit de Damas, tout comme l’amélioration relative du contrôle de la frontière syro-irakienne.
On ne peut donc pas dire que la Syrie a refusé de donner suite à toutes les demandes formulées par les Occidentaux, mais il est vrai qu’elle n’a pas non plus consenti l’ensemble des efforts qui lui étaient demandés : elle est loin d’avoir renoncé à exercer toute influence sur le Liban, elle continue à soutenir les organisations qu’elle considère comme des « forces de la résistance », elle ne s’est pas nettement distancée de l’Iran, dont elle défend les prises de position, notamment sur le dossier nucléaire. Mais fallait-il réellement s’attendre à ce que la Syrie abandonne ainsi toutes ces cartes ? Qu’est-ce que l’Occident et ses alliés lui offrent pour espérer des concessions aussi fondamentales ? Car il est évident, et même légitime, que la Syrie soit avant tout soucieuse de défendre ses intérêts.
Les préconisations ébauchées par la Mission s’efforcent de parvenir à un équilibre entre le souci d’aider la Syrie à se développer et à s’ouvrir sur le monde et la nécessité pour la France et l’Europe de rester fermes sur leurs principes. L’accroissement des actions de coopération, vivement souhaité par Damas, doit rester conditionné à la réalisation de progrès du côté syrien.
La Mission estime que la France doit continuer à soutenir les efforts de modernisation de l’économie, des infrastructures, de l’administration et des institutions culturelles et d’enseignement syriennes. Pour ce faire, les structures françaises qui en sont chargées doivent bénéficier de moyens financiers à la hauteur des engagements politiques pris à l’égard des autorités syriennes.
Mais la conduite de ces actions, dont le coût est d’autant plus lourd que la situation de nos finances publiques est tendue, suppose l’attention de Damas à nos préoccupations. La feuille de route élaborée au moment du rétablissement de nos relations politiques bilatérales incluait des engagements sur les dossiers de la délimitation des frontières syro-libanaises et des prisonniers et détenus libanais en Syrie : les progrès sont jusqu’ici restés limités, ce que la France ne doit pas accepter. Nos sollicitations en faveur de la libération de certains prisonniers politiques et, plus largement, d’une amélioration de la situation des droits de l’Homme ne peuvent pas non plus rester sans réponse.
Cette approche donnant-donnant devrait aussi prévaloir au niveau européen. La Mission juge en partie fondées les demandes syriennes en faveur d’un rééquilibrage de l’accord d’association entre la Syrie et l’Union européenne. Il ne s’agit pas de revenir sur les stipulations relatives aux droits de l’Homme, mais d’accroître les quotas d’importation de produits agricoles syriens et d’adapter le niveau des compensations financières aux effets négatifs réellement attendus sur les secteurs les plus fragiles de l’économie syrienne. Les projets proposés dans le cadre de l’UpM qui viseraient à développer les interactions entre la Syrie et ses voisins devraient aussi être considérés comme prioritaires. La Mission est en effet d’avis qu’il faut absolument associer le plus possible la Syrie aux échanges économiques avec l’Europe et avec son voisinage. Il convient aussi de soutenir les plus progressistes des responsables syriens en étant ouvert à leurs demandes, lorsqu’elles sont légitimes. Cela n’est pas incompatible avec une action visant à les pousser à aller plus loin dans le respect des droits de l’Homme : une coordination entre les Vingt-sept apparaît à cet égard nécessaire.
L’accent mis sur les réalisations concrètes de l’UpM ne doit pas faire oublier que cette union doit également avoir une dimension politique, aujourd’hui gelée à cause de l’absence d’avancée dans le règlement du conflit israélo-palestinien. Alors que l’administration Obama a commencé à rééquilibrer sa position sur ce dossier, une initiative européenne en faveur de ce règlement est indispensable et urgente ; elle est vivement souhaitée par les Palestiniens et pourrait aussi avoir un effet positif sur la Syrie.
La Mission estime que la mise en œuvre de ses préconisations serait de nature à rapprocher la Syrie du camp des modérés, mais elle ne se fait pas d’illusion : cette approche ne saurait suffire à détacher véritablement Damas de ses alliés traditionnels. En effet, aussi longtemps que le conflit israélo-palestinien n’aura pas trouvé une solution fondée sur le respect du droit des Israéliens et des Palestiniens à vivre dans un Etat national sûr et viable, c’est-à-dire aussi longtemps que les modérés n’auront pas démontré que la voie qu’ils ont choisie conduit à la paix, la Syrie ne renoncera pas à soutenir les « forces de la résistance ». Car ce soutien lui assure une légitimité internationale et la sympathie de la rue arabe, une sympathie que l’absence d’avancées dans le processus de paix ne fait que stimuler. Si un Etat palestinien voyait enfin le jour, si un accord sur la restitution du Golan était trouvé – ce qui est parfaitement concevable –, la Syrie ne pourrait plus justifier ni le maintien de l’état d’urgence, ni son appui à des « forces de la résistance » devenues inutiles. Le fondement anti-israélien de son alliance avec l’Iran disparaîtrait, tandis que le Hezbollah, l’un des relais de son influence au Liban, n’aurait plus qu’à devenir une force politique parmi d’autres et pourrait s’éloigner de ceux dont son armement dépend aujourd’hui.
Sous la houlette d’un président qui a su consolider son pouvoir et l’utiliser en faveur des réformes, tout en maintenant les équilibres complexes du régime et de la société, le positionnement de la Syrie a évolué lentement, mais globalement dans une direction positive. Son rapprochement avec les Etats arabes modérés a pris un caractère plus visible et, bien qu’elle reste à confirmer, une attitude plus ouverte s’observe de part et d’autre dans les relations syro-américaines. La Mission ne peut qu’appeler de ses vœux la signature rapide de l’accord d’association avec l’Union européenne et l’accession de la Syrie à l’OMC, qui confirmeraient une évolution irréversible des autorités de Damas.
En retissant des liens avec les Etats qui pèsent sur la scène internationale, la Syrie a retrouvé son poids diplomatique et un rôle incontournable dans la région. Elle n’a pas fondamentalement changé, mais sa posture a commencé à changer. Des résistances internes existent, qui menacent toujours de bloquer le processus, c’est pourquoi la France et l’Union européenne ne doivent pas ménager leurs efforts pour encourager la poursuite de cette évolution, tout en restant attentives à des sujets aussi fondamentaux que le respect des droits de l’Homme et de la souveraineté du Liban.
Si la période du mandat français n’a pas laissé que de bons souvenirs en Syrie, elle a permis de nouer des relations particulières entre le peuple syrien et notre pays, lesquelles ont perduré depuis, notamment grâce à la coopération culturelle et à la francophonie. Elles ne demandent qu’à être revivifiées pour faire de la France et de la Syrie des partenaires œuvrant ensemble en faveur d’une paix équilibrée et durable au Proche-Orient.
La commission examine le présent rapport d’information au cours de sa séance du mercredi 16 juin 2010.
Après les exposés du rapporteur et de la présidente, un débat a lieu.
M. le président Axel Poniatowski. J’aurais deux questions. Vous avez abordé la question du Hezbollah. Avez-vous pu mesurer le degré de soutien actuel que lui accorde la Syrie, comme c’est le cas depuis ces 10 dernières années ? En second lieu, en ce qui concerne le nucléaire syrien, une opération israélienne a eu lieu il y a deux ans en territoire syrien pour détruire un site sur lequel un réacteur nucléaire aurait été en construction. A votre connaissance, y a-t-il une volonté d’acquisition d’une technologie nucléaire militaire par la Syrie ?
M. Jean-Marc Roubaud. Le président de la République a eu raison d’ouvrir la porte au retour de la Syrie sur la scène internationale car il y a un besoin d’apaisement dans la région. Je suis heureux de voir votre accord sur ce point. Je me joins au Président Poniatowski pour vous poser la même question sur le Hezbollah. Quel est par ailleurs le rôle de la Syrie vis-à-vis du Hamas dans le processus israélo-palestinien et qu’en est-il de la relation entre la Syrie et la Turquie ?
M. Jacques Myard. J’ai participé à cette mission et ne reviendrai pas sur le fond. Il y a un problème géostratégique et diplomatique. On se rend compte qu’à partir du moment où l’on sort un pays du cordon sanitaire ou du ghetto, on peut faire bouger les lignes. Cela doit nous inspirer pour une politique future vis-à-vis de l’Iran. Chaque acteur est toujours le terroriste de l’autre. Il faut briser cet enchaînement. Le « chemin de Damas » est parfois tortueux mais une ouverture est possible. C’est une méthode positive à faire valoir vis-à-vis de l’Iran.
Mme Martine Aurillac. J’approuve les conclusions de ce rapport très intéressant et je voudrais des précisions sur la place des communautés chrétiennes et juives. J’estime moi aussi que la France et l’Union européenne doivent être davantage présentes.
M. Philippe Cochet. Rien ne sert de se lamenter sur les faiblesses de l’Union européenne. La France est à l’avant-garde sur ces dossiers. D’autres acteurs mènent-ils une politique bilatérale semblable ? Le nucléaire est un sujet important, et je ne suis pas d’accord avec Jacques Myard : il y a certes une ouverture de la Syrie sur le plan diplomatique mais il y a aussi, me semble-t-il, un double, voire un triple, langage sur le nucléaire. Quel est votre avis ?
M. Daniel Garrigue. Le rapport est excellent sur l’évolution de la Syrie et je partage ses conclusions quant à l’Union européenne. J’évoquerai les relations Syrie – Irak. On aurait pu penser que la chute de Saddam Hussein conduirait à une relation plus étroite entre les deux frères ennemis des années 1980. Or, c’est le contraire qui s’est produit et les dirigeants irakiens sont véhéments contre les Syriens qu’ils accusent d’attentats, sans aucune nuance. Il y a une part d’irrationnel dans cette relation. La France et l’Union européenne pourraient aider à rapprocher des positions fondées sur des malentendus car il y a un risque. Quant au fameux dîner, il faut considérer que les Syriens peuvent être des interlocuteurs privilégiés dans le dialogue avec le Hamas ou le Hezbollah.
M. Jean-Michel Ferrand. Je voudrais revenir sur le rôle de la Turquie et sur le fait qu’on ne doit pas lui donner le sentiment qu’on la repousse. J’aimerai également savoir comment est appréciée la position diplomatique syrienne. La Syrie a-t-elle apporté effectivement une aide logistique ou matérielle aux responsables d’attentats en Irak ? Cela étant, comme le dit Daniel Garrigue, il faut garder un contact très étroit avec la Syrie qui a une diplomatie très habile.
M. Jean-Paul Dupré. Vous avez évoqué des aspects économiques et sociaux. La présence des entreprises françaises est-elle importante et quel est son impact ? Au plan éducatif, quels sont les taux de scolarisation dans le primaire et le supérieur ?
Mme Marie-Louise Fort. Sur la question de la laïcité, les Syriens ont l’avantage, par rapport aux Turcs, d’avoir une première dame très impliquée ! On a vu que les Syriens ont toujours dit que la Turquie devait adhérer à l’Union européenne. Qu’en est-il précisément et quelles en sont les raisons ? S’agit-il de pousser la Turquie vers l’Europe pour rester entre soi dans le monde arabe ou bien de conférer à la Turquie un rôle d’interface ?
M. Robert Lecou. Je souligne la pertinence du rapport et l’intérêt des exposés. Comment est vue du côté syrien la candidature de la Turquie à l’Union européenne et quels sont les souhaits syriens ? Dans cet Etat laïc, quelle est la perception du débat sur le voile intégral ?
M. Jean-Claude Guibal. Ce rapport est passionnant, subtil et complet et les deux missions d’information décidées par le Bureau de notre commission sur la Turquie et sur la Syrie me semblent particulièrement pertinentes. Il y a de telles analogies et évolutions, de tels rapprochements qu’on se demande si l’Union européenne dans le cadre de l'UPM et via la France n’a pas un rôle à jouer en s’appuyant sur ces deux pôles, Syrie et Turquie. Un scénario dans lequel l’une et l’autre seraient des éléments de structuration du Moyen-Orient et une voie d’influence de l’Union européenne est-il envisageable ?
M. François Loncle. Le mérite de ce rapport est aussi qu’il tord le cou à nombre de lieux communs et d'inepties relayés dans la presse depuis dix ans sur la Syrie. Il est en ce sens extrêmement salutaire. Cela étant, comment voyez-vous la suite et quelles seront les conclusions des travaux du tribunal sur l’assassinat de Rafic Hariri. La question principale est évidemment : à qui profite le crime ? Des surprises sont possibles. C’est une affaire très délicate.
M. Patrick Labaune. Vous avez souligné que la politique extérieure de la Syrie était encourageante. Quelle est l’explication de cette évolution ? L’arc chiite ne joue-t-il plus ? La personnalité du président ou la pression internationale sont-ils des facteurs explicatifs ?
M. Jean-Michel Boucheron. Je n’hésite pas à dire que le président de la République a eu un rôle extrêmement positif dans l’évolution de la Syrie et dans ses relations avec les autres Etats de la région. J’espère que le même processus pourra s’enclencher vis-à-vis de l’Iran où tout n’est qu’affaire de posture, de la part des Etats-Unis, de l’Iran et d’Israël. Sur la question kurde, la Syrie est-elle observateur, acteur ou médiateur ? Concernant l’eau, est-ce un enjeu important, sachant que la Syrie a toujours manqué de ressources hydrauliques ?
M. Rudy Salles. En tant que président de l’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée, je note la participation de la Syrie avec une réelle volonté de prendre part à ce débat méditerranéen. Sur la relation avec Israël, le discours public très ferme est évidemment un ciment interne mais il faut garder présent à l’esprit que les Syriens sont un peuple de marchands, qui a une réelle volonté d’ouverture. Je suis étonné de voir que le sentiment et le discours de l’homme de la rue à Damas sont très différents du discours officiel.
M. François Rochebloine. En ce qui concerne l’évolution des relations entre la Syrie et le Liban, suite au départ des forces armées, quel a été le rôle de la Syrie dans la composition du gouvernement libanais qui a été difficile ? Qu’en est-il de la situation des prisonniers libanais et personnes disparues ? J’avais interrogé le Président Bachar el-Assad lorsqu’il était venu devant la commission des affaires étrangères et il avait alors nié qu’il y en ait.
M. Gérard Menuel. Tout le monde s’accorde à souligner l’amélioration de la situation, notamment au plan politique interne, même si le parti Baas est privilégié de par la constitution. Qu’en est-il de l’environnement politique interne, l’avez-vous senti évoluer ?
M. Hervé de Charrette. Je ferais deux observations. Il semble qu’il faille aller loin dans l’intensité des relations entre la France et la Syrie. C’est un pays clef de la région et il nous faut développer des partenariats forts, dans notre intérêt politique. Ensuite, il ne faut pas faire dépendre la relation avec la Syrie des problèmes libanais ou de la question du Golan. Il y a certes la question des frontières, mais pour le reste, ils ont fait beaucoup de concessions et ne pourront à l’évidence pas aller bien plus loin. Quant au Golan, ni du côté syrien, ni du côté israélien, ce n’est une question d’une grande intensité. Ce qui est en revanche central, c’est la question du développement économique : la Syrie a beaucoup de retard par rapport à ses voisins. Elle a peu de moyens, et a besoin de partenaires. Les Etats-Unis sont toujours très négatifs, il faut en profiter avant qu’il ne soit trop tard et qu’ils révisent leur politique. C’est le moment de maintenir notre place.
Mme Elisabeth Guigou, présidente de la mission d’information. Je remercie tous les intervenants pour leurs remarques, dont nous allons tenir compte au moment de mettre la dernière main à l’écriture du rapport.
Le Hezbollah et le Hamas sont pour les Syriens des « forces de la résistance », un rempart contre les velléités militaires d’Israël à l’encontre du Liban. Pour autant, lorsque nous avons rencontré à Beyrouth un dirigeant du Hezbollah, il a insisté sur le fait qu’il n’était pas sous tutelle syrienne et représentait une résistance proprement libanaise. Ces mouvements sont donc, au minimum, une force de dissuasion à l’égard d’Israël à propos du Liban ; à telle enseigne que beaucoup de Libanais, peu suspects de sympathies pro-syriennes, disent que le Hezbollah joue un rôle dans leur protection. Demeure néanmoins le réel problème des armes du Hezbollah, dont on se demande si un jour l’armée libanaise pourra les absorber. Ce sujet reste très difficile.
Avec la Turquie, des frictions bilatérales subsistent. C’est notamment le cas à propos de l’eau et des barrages que la Turquie a construits. La question est très prégnante à Alep, où nous nous sommes rendus ; en effet, c’est là que le manque d’eau est le plus criant car la Syrie souhaiterait y développer l’agriculture. Cela étant, les deux pays ont clairement décidé de faire passer ces frictions à l’arrière-plan. J’ajoute que les relations entre les familles du Premier ministre Erdogan et du Président el-Assad sont très intimes.
Sur le plan économique se dessine un arc Turquie-Syrie-Liban-Jordanie, bientôt étendu à l’Irak, qui présente pour nos entreprises un potentiel très important. Certes, Total, présent depuis longtemps, a essuyé des revers sur place. Lafarge y est implanté, ainsi qu’Air Liquide. La France est localement un partenaire commercial mineur mais sa place doit absolument croître, et cela vaut en particulier pour nos PME.
M. Hervé de Charette. Nous avons justement créé il y a moins d’un an un club d’affaires franco-syrien destiné aux PME, dirigé pour la partie française par le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris.
Mme Elisabeth Guigou, présidente de la mission d’information. Je salue cette initiative. Pour terminer sur le volet économique, n’oublions pas de nous appuyer sur la coopération décentralisée, y compris dans sa dimension très personnelle : par exemple, il n’est pas insignifiant que le maire d’Alep soit diplômé de l’Institut d’urbanisme de Créteil. À l’instar des Anglo-saxons, nous devrions mieux faire fructifier ces liens humains.
Entre Syriens et Palestiniens, des liens privilégiés existent avec les forces qui s’opposent à l’Autorité palestinienne. En parlant avec M. Nabil Shaath, le responsable des relations internationales du Fatah, au cours de l’un de nos déplacements, nous avons perçu une profonde méfiance à l’égard de la Syrie. Un accord avec l’Autorité palestinienne n’en sera évidemment pas facilité, à moins que le Hamas ne conclue lui-même, en amont, un tel accord. De même que la France a encouragé la reprise du dialogue avec la Syrie, de même elle devrait faciliter la conclusion d’un accord entre le Hamas et l’Autorité palestinienne.
Les relations culturelles que nous entretenons avec la Syrie sont très importantes et la mission propose de les intensifier. Au cours de maints entretiens a été évoqué le rôle du Musée du Louvre et les formidables attentes suscitées par son projet de coopération mais malheureusement, d’une manière générale, il y a un gouffre entre ces attentes et les moyens réellement déployés par la France, tandis que les Italiens et les Allemands sont beaucoup plus impliqués.
Vis-à-vis de l’Irak, l’impression de la mission d’information est celle d’une normalisation sincèrement souhaitée par la Syrie, qui se défend de toute implication dans les attentats récents sur place.
Quant à l’enquête concernant l’assassinat de M. Rafic Hariri, je dois admettre que les informations font défaut.
M. Renaud Muselier, rapporteur. Je réponds tout d’abord aux questions concernant l’arme nucléaire. Il est un fait que les Israéliens sont intervenus, au motif que la Syrie poursuivait un programme nucléaire avec l’aide de la Corée du Nord. La Syrie a toujours démenti. Les inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) ont constaté sur place que les sites suspects avaient été soigneusement nettoyés, mais ils ont noté des traces de radioactivité. Et aujourd’hui l’AIEA n’est plus autorisée à mener des inspections en Syrie.
La Syrie a bien noué des relations bilatérales avec d’autres pays européens : l’Italie, l’Allemagne et l’Espagne sont très présentes, via leurs PME notamment. Leurs ministres des affaires étrangères se sont d’ailleurs rendus sur place dès avant le dégel des relations diplomatiques.
Les relations syro-irakiennes s’étaient nettement améliorées jusqu’à la survenue de l’attentat d’août 2009 à Bagdad, qui a causé la mort d’une centaine de personnes. Le gouvernement irakien a mis en cause la Syrie, qui s’est défendue de toute implication. Il semble en effet que le régime ne soit pour rien dans cet attentat, que certaines factions irakiennes auraient pu perpétrer en en accusant les Syriens. Bien que dégradées depuis lors, les relations bilatérales reprennent néanmoins.
Le taux d’alphabétisation en Syrie est de 87 % pour les hommes et de 58 % pour les femmes.
Quant à l’intensité des relations économiques franco-syriennes, elle est encore faible puisque l’on ne compte sur place que 16 implantations et 20 sociétés françaises présentes à travers des filiales ou des bureaux de représentation, employant 850 personnes. La marge de progression est substantielle.
La question de l’eau et du partage de cette ressource avec la Turquie est de fait très importante mais n’est pas évoquée directement en Syrie.
S’agissant des disparus, 2 000 auraient été recensés au Liban, tandis que d’autres sources libanaises évoquent le chiffre de 3 000 à 600 personnes. Une vingtaine de détenus a été relâchée au printemps 2009 ; une quatrième commission depuis 2000 est en cours de création pour traiter ce sujet.
M. François Rochebloine. Quid des ONG ?
Mme Elisabeth Guigou, présidente de la mission d’information. Le secrétaire général du Haut conseil syro-libanais nous a dit attendre que des listes révisées lui soient fournies.
M. François Rochebloine. Ils les ont depuis longtemps !
M. le président Axel Poniatowski. Je remercie de nouveau la présidente, le rapporteur et les membres de la mission d’information.
Puis la commission autorise la publication du rapport d’information.
Liste des personnalités rencontrées
(par ordre chronologique)
1) À Paris
a) par la Mission
– M. Patrice Paoli, directeur d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient au ministère des affaires étrangères et européennes, et M. Ludovic Pouille, sous-directeur de l’Egypte et du Levant (1er juillet 2009)
– M. Christophe Bigot, conseiller Afrique du Nord, Proche et Moyen-Orient, Méditerranée, au cabinet du ministre des affaires étrangères et européennes (8 juillet 2009)
– Son Exc. Mme Lamia Chakkour, ambassadeur de Syrie en France (23 septembre 2010)
– M. Jean-Claude Cousseran, ministre plénipotentiaire, secrétaire général de l’Académie diplomatique internationale (7 octobre 2009)
– M. Salam Kawakibi, chercheur en sciences politiques et relations internationales et coordinateur de projets à l’Initiative arabe de réforme (14 octobre 2009)
– M. Samir Aïta, rédacteur en chef des éditions arabes du Monde diplomatique, éditeur du portail www.mafhoum.com sur le monde arabe (28 octobre 2009)
– M. Etienne Viard, directeur du département Méditerranée-Moyen-Orient de l’Agence française de développement, accompagné de Hubert Dognin, coordinateur régional pour le Liban et la Syrie, M. Quentin Berinchy, consultant Relations Extérieures, et de Mme Mady Paoli, chargée de mission sur les partenariats au sein de la division des relations extérieures (2 décembre 2009)
– M. Antoine Sfeir, directeur des Cahiers de l’Orient, président du Centre d’études et de réflexions sur le Proche-Orient (16 décembre 2009)
– M. Serge Telle, ambassadeur chargé du processus euroméditerranéen initié à Barcelone, en charge de l’initiative sur l’Union pour la Méditerranée (13 janvier 2010)
– M. Henri Loyrette, président-directeur du musée du Louvre (20 janvier 2010)
– M. Barah Mikaïl, chercheur à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), spécialiste du Moyen-Orient. (27 janvier 2010)
– M. Christophe de Margerie, directeur général de Total (3 février 2010)
– M. Denis Bauchard, consultant au centre Maghreb-Moyen-Orient de l’Institut français des relations internationales (IFRI) (10 février 2010)
– MM. Philippe de Fontaine Vive Curtaz, vice-président de la Banque européenne d’investissement, Christian Velud, directeur des relations internationales à l’Institut d’études politiques de Lyon, Gérard Bapt, président du groupe d’amitié France-Syrie, Lucien Bitterlin, écrivain et journaliste, Richard Labeviere, rédacteur en chef de la revue Défense, Chérif Khaznadar, directeur d’institutions culturelles, metteur en scène de théâtre, écrivain et critique, et Abed Azrie, compositeur et chanteur (à l’occasion d’un déjeuner à l’invitation de Son Exc. Mme Lamia Chakkour, 18 mars 2010)
– M. Patrice Paoli, directeur d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient au ministère des affaires étrangères et européennes, et M. Ludovic Pouille, sous-directeur de l’Egypte et du Levant (2 juin 2010)
b) par la Présidente et/ou le Rapporteur
– M. Jean Desazars de Montgailhard, directeur général adjoint chargé de la stratégie, du développement et des affaires publiques du Groupe Lafarge (20 avril 2010)
– M. Frederic Hof, coordinateur spécial pour les affaires régionales au Département d’Etat américain (19 mai 2010)
– M. Hughes Mingarelli, directeur général adjoint des relations extérieures de la Commission européenne (conférence téléphonique du 3 juin 2010)
2) À l’occasion du déplacement en Syrie de la Présidente et de MM. François Loncle, Jacques Myard, Jean-Marc Nesme et Eric Raoult (du 1er au 6 novembre 2009)
– Son Exc. M. Eric Chevallier, ambassadeur de France en Syrie, et ses collaborateurs
– M. Wallid el-Mouallem, ministre syrien des affaires étrangères
– M. Mahmoud al-Abrache, président de l’Assemblée du peuple
– M. Sleiman Haddad, président de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée du peuple et plusieurs de ses collègues
– M. Hassan Abdecaziz, président du groupe d’amitié Syrie-France et plusieurs membres de ce groupe
– M. Abdallah Dardari, vice-premier ministre chargé des affaires économiques
– M. Peter Harling, le représentant de l’International Crisis Group à Damas
– M. Ahmed Ali Mansoura, gouverneur d’Alep
– M. Maen Chibli, maire d’Alep
– Son Exc. M. Badreddine Hassoun, mufti général de la République
– Sa Béatitude Ignace IV, Patriarche d’Antioche et de tout l’Orient de l’Eglise grecque-orthodoxe, accompagné de l’Archimandrite Père Ibrahim Daoud
– Monseigneur Absi, représentant sa Béatitude Grégoire III, Patriarche d’Antioche et de tout l’Orient de l’Eglise grecque-catholique
– Mme Asma el-Assad, épouse du président de la République (rencontrée par la Présidente de la Mission)
– Son Exc. M. Omer Ohon, ambassadeur de Turquie en Syrie
– M. François Burgat, son directeur, et MM. Kamel Dorai, Hassan Abbas et Maher Charif, chercheurs de l’Institut français du Proche-Orient
– Mmes Joëlle Chami et Nada Assaad, MM. Omar Challah, Abdul Ghani Attar, Michel Arcouche et Iyad Betinjaneh, jeunes acteurs socio-économiques
– M. Naje Otri, Premier ministre de la République arabe syrienne
– M. Samir al-Taqi et des chercheurs du centre Al Charq
– Son Exc. M. Niklas Kebbon, ambassadeur de Suède en Syrie
– M. Nicolas Diaz Patche, diplomate espagnol
– Son Exc. M. Vassilis Bontossoglou, représentant de la Commission européenne
– Son Exc. M. Simon Collis, ambassadeur du Royaume-Uni en Syrie
– M. Jens Jokisch, chargé d’affaires allemand
– M. Waddah Abed, rédacteur en chef du journal El Watan et M. Ziyad Haydar, journaliste
3) À l’occasion de la tournée au Proche-Orient de la Présidente et de M. Jean-Jacques Guillet (du 27 février au 5 mars 2010)
a) dans les Territoires palestiniens (27 février et 1er mars 2010)
– M. Frédéric Desagneaux, consul général à Jérusalem, et ses collaborateurs
– M. Nabil Shaath, membre du comité central du Fatah, responsable des relations internationales
– MM. Khaled Yazji, directeur de cabinet du ministre des affaires étrangères, et Abderrahmane Bseisso, directeur de la stratégie
– M. Abbas Zaki, membre du comité central du Fatah, responsable des affaires arabes, ancien ambassadeur de l’OLP au Liban
– M. Nimr Hamad, conseiller politique du président de l’Autorité palestinienne
b) en Israël (28 février 2010)
– Son Exc. M. Christophe Bigot, ambassadeur de France en Israël, et ses collaborateurs
– M. Dan Meridor, ministre chargé des services de renseignement et de la commission à l’énergie nucléaire
– M. Ygal Palmor, porte-parole du ministère des affaires étrangères israélien
– M. Alon Liel, ancien directeur général du ministère des affaires étrangères israélien, président de Israel-Syria Peace Society
– M. Rafael Barak, directeur politique du ministère des affaires étrangères israélien
– M. Itamar Rabinovich, ancien ambassadeur d’Israël aux Etats-Unis
– M. Gilead Sher, ancien conseiller du Premier ministre Ehud Barak
– M. Daniel Ben Simon, député travailliste
c) en Jordanie (1er et 2 mars 2010)
– Son Exc. Mme Corinne Breuzé, ambassadrice de France en Jordanie, et ses collaborateurs
– M. Said Darwazeh, chief executive officer de Hikma Pharmaceuticals, M. Abdel Hamid Shoman, directeur général de l’Arab Bank, M. Hamdi Tabba’a, président de Al Tewfik Automobile & Equipment, M. Michel Marto, président de la Housing Bank, et M. Hazim Al Naser, ancien ministre de l’eau, ancien député
– M. Nasser Judeh, ministre des affaires étrangères
– M. Taher Masri, président du Sénat
d) en Syrie (3 mars 2010)
– Son Exc. M. Eric Chevallier, ambassadeur de France en Syrie, et ses collaborateurs
– Mme Suzanne Zahredine, de la Croix-Rouge française
– Général Wolfgang Jilke, ancien commandant de la FNUOD (la Force des Nations Unies chargée d’observer le désengagement)
– deux représentants de la communauté kurde
– M. Abdallah Dardari, vice-premier ministre chargé des affaires économiques
– M. Adib Mayaleh, gouverneur de la Banque de Syrie
– M. Roger Hern, représentant de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, Mme Renata Dubini, représentante du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, et M. Philippe Leclerc, représentant-adjoint, M. Ismaïl Ould Cheick Ahmed, représentant du Programme des Nations unies pour le développement, et Mme Zena Ali Ahmad, représentante-adjointe, Mme Silvana Giuffrida, adjointe au représentant du Programme alimentaire mondial, Dr Ibrahim Betelmal, représentant de l’Organisation mondiale de la santé, et M. Aref Sheikh, coordinateur de programme du Fonds de développement des Nations unies pour la femme
e) au Liban (4 et 5 mars 2010)
– Son Exc. M. Denis Pietton, ambassadeur de France au Liban, et ses collaborateurs
– M. Samir Geagea, chef des Forces libanaises
– MM. Sayyed Ammar Moussaoui, responsable des relations internationales du Hezbollah, et Nawwar Sahili, député Hezbollah
– Mme Cécile Perraud, directrice générale d’Air Liquide, et MM. Riad Salame, gouverneur de la Banque du Liban, Habib Rahal, directeur général de Blom Bank, Jacques Sarraf, président-directeur général du Malia Group, Selim Ghorayeb, président-directeur général de Algorithm, Francis Hartmann, directeur général de l’Emirates Bank, Mohammed Choucair, président-directeur général de Patchi, Gaby Tamer, président-directeur général du groupe Tamer, Nabil Fawaz, président-directeur général de Fawaz Holding, François Bassil, président-directeur général de la Byblos Bank, Chadi Karam, conseiller à la Présidence de la République, et Antoine Abou Samra, directeur général de Bader
– M. Wallid Joumblatt, chef du Parti socialiste progressiste
– M. Nasri Khoury, secrétaire général du Haut conseil syro-libanais
– M. Michel Sleiman, président de la République libanaise
– M. Amine Gemayel, chef de Kataëb
– Mme Sahar Al-Atrache, analyste à l’International Crisis Group, M. Kamal Hamdane, chef du département d’économie au Consultation & Research Institute, Mmes Fadia Kiwan, professeur, directrice du département de Sciences politiques de l’université Saint Joseph, Leila El-Sohl, présidente de la Fondation Walid Ben Tallal, et Elisabeth Longuenesse, directrice des études contemporaines à l’Institut français du Proche-Orient
– M. Sleiman Frangié, chef de Al Marada
– Général Michel Aoun, chef du Courant patriotique libre
– M. Saad Hariri, président du conseil des ministres
– MM. Farid El Khazen, du Courant patriotique libre, rapporteur de la commission des affaires étrangères de la Chambre des députés, et Mohamad Kabb Ani, député du Courant du futur
Données géographiques et générales
Nom officiel : République arabe syrienne
Nature du régime : République (constitution du 31 janvier 1973)
Chef de l’Etat : Président de la République, M. Bachar el-Assad (élu le 17 juillet 2000, reconduit le 27 mai 2007)
Vice-président : M. Farouq al-Charaa (11 février 2006)
Vice-présidente chargée des affaires culturelles : Mme Najah al-Attar (23 mars 2006)
Superficie : 185 181 km2
Capitale : Damas
Villes principales : Alep, Homs, Hama, Lattaquié
Langue officielle : arabe
Langues courantes : arabe, kurde
Monnaie : Livre syrienne
Fête nationale : 17 avril (commémore l’évacuation des troupes françaises le 17 avril 1946)
Données démographiques
Population : 21,3 millions
Croissance démographique : + 2,4% par an officiellement (+ 3,3 % sur la période 2005-2010 selon d’autres sources)
Espérance de vie : 74 ans
Indice de développement humain : 0,716 ; 105ème rang sur 182 (11 % de la population vivrait avec moins de 2 dollars par jour)
Taux d’alphabétisation : 87,2 % pour les hommes, 58,1 % pour les femmes
Communautés religieuses et confessionnelles : 90 % de musulmans (soit 74 % de sunnites, 12 % d’alaouites, 3 % de druzes, 2 % de chiites), 10 % de chrétiens
Communautés ethno-culturelles : 90 % d’Arabes, 10 % de Kurdes
Le pays compte aussi :
– 400 000 réfugiés palestiniens (issus de la vague de 1948)
– de l’ordre de 1,5 million de réfugiés irakiens arrivés principalement depuis la guerre de 2003
– 300 000 personnes déplacées, essentiellement des habitants du Golan, occupé par Israël depuis 1967 et annexé en 1981. Environ 20 000 Syriens (18 000 druzes et 2 000 alaouites) et autant de colons israéliens vivent sur les hauteurs du Golan.
Données économiques (pour 2009, sauf indication différente)
PIB : 52,5 milliards de dollars américains ; PIB/hab : 2 437 dollars américain
Taux de croissance : 4 % (5,2 % en 2008)
Inflation : 2,5 % (mais 15 % en 2008)
Principales productions : pétrole (la production est tombée à 382 000 barils par jour, contre 462 000 en 2004), phosphate, coton, blé
Secteurs de l’économie : agriculture : 20 % du PIB, industrie : 30 % (hydrocarbures : 20 %), services : 50 %
Solde commercial : – 4 milliards de dollars (– 3 milliards de dollars en 2008)
Taux de chômage au sens du BIT : 11 % (mais estimé à au moins 20 % ; un tiers des chômeurs sont des jeunes)
Relations avec la France
2 500 Français résidant en Syrie (60 % de binationaux)
plus de 5 500 Syriens titulaires d’un titre de séjour en France
Exportations françaises : 303 millions d’euros (286 millions d’euros en 2008)
Importations françaises : 348 millions d’euros (696 millions d’euros en 2008)
La France est le 15ème fournisseur de la Syrie
Crédits de coopération culturelle, scientifique et technique : 2,8 millions d’euros
Accords de coopération technique du 2 juillet 1970 ; accord de coopération culturelle du 16 septembre 1971, complété par l’accord du 20 février 2010 ; convention d’établissement de l’AFD de mai 2009.
Source : ministère des affaires étrangères et européennes.
1 () La mission ne compte plus que onze membres depuis que M. Jean Roatta a quitté la commission des affaires étrangères en avril 2010 ; M. Dominique Souchet avait en outre remplacé en septembre 2009 M. Marc Vampa, qui a aussi changé de commission.
2 () MM. Jean-Louis Bianco, président, et Jean-Marc Roubaud, rapporteur, L’Iran à la croisée des chemins, rapport d’information de la commission des affaires étrangères sur « Iran et équilibre géopolitique au Moyen-Orient », XIIIème législature, n° 1324, 16 décembre 2008, 179 pages.
3 () La liste des personnes rencontrées figure en annexe.
4 () Cf. la carte du Proche-Orient.
5 () Déjeuner du 18 mars 2010.
6 () Caroline Donati, L’exception syrienne. Entre modernisation et résistance, Paris, La Découverte, 2009, 355 pages, p. 214.
7 () Etude réalisée par Euromoney, publiée le 30 mai 2002, citée par Caroline Donati, ibid., p. 212.
8 () Il regroupe l’Algérie, l’Arabie saoudite, l’Autorité palestinienne, Bahreïn, l’Egypte, les Emirats arabes unis, l’Irak, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, le Maroc, Oman, le Qatar, le Soudan, la Syrie, la Tunisie et le Yémen.
9 () Audition du 28 octobre 2009.
10 () Audition du 7 octobre 2009.
11 () Le Congrès ayant adopté des sanctions américaines contre la Syrie en novembre 2003, Pétrocanada n’a jamais réalisé le projet pour lequel elle avait été choisie. Le champ gazier en question a finalement été intégré dans l’accord-cadre récemment conclu entre Total et la Syrie.
12 () Audition du 1er juillet 2009.
13 () Audition du 7 octobre 2009.
14 () Audition du 8 juillet 2009.
15 () Audition du 1er juillet 2009.
16 () Audition du 16 décembre 2009.
17 () Audition du 8 juillet 2009.
18 () Audition du 2 décembre 2009.
19 () Il s’agit d’un instrument de prêt intergouvernemental avec garantie souveraine, en vue de financer des projets (principalement d’infrastructures) répondant aux objectifs de développement du pays bénéficiaire ; ces prêts, destinés aux pays émergents à fort potentiel, financent essentiellement des biens et services français.
20 () La KfW (Kredit Anstalt für Wiederaufbau) est la banque qui est l’équivalent allemand de l’AFD et de la Caisse des dépôts et consignations.
21 () Audition du 27 janvier 2010.
22 () Audition du 23 septembre 2009.
23 () Audition du 13 janvier 2010.
24 () Audition du 3 février 2010.
25 () Audition du 23 septembre 2009.
26 () Déjeuner offert aux membres de la Mission par Mme Lamia Chakkour, le 18 mars 2010.
27 () The Iraq Study Group Report, rédigé sous la co-présidence de MM. James Baker et Lee Hamilton, décembre 2006.
28 () Audition du 8 juillet 2009.
29 () A la mi-avril, la commission des affaires étrangères du Sénat n’a pas donné un avis favorable à la confirmation de sa nomination car quatre sénateurs s’y sont opposés ; elle doit désormais être soumise à un vote en séance plénière du Sénat, processus qui peut être bloqué par un seul sénateur.
30 () Audition du 27 janvier 2010.
31 () Audition du 28 octobre 2009.
32 () Audition du 23 septembre 2009.
33 () Audition du 27 janvier 2010.
34 () Léa Conti Fabra, « Les réfugiés irakiens en Syrie », La revue internationale et stratégique, automne 2009, pp. 27 à 35 : l’essentiel du contenu de cette partie est tiré de cet article.
35 () Audition du 23 septembre 2009.
36 () Audition du 1er juillet 2009.
37 () Audition du 3 février 2010.
38 () Audition du 7 octobre 2009.
39 () Audition du 1er juillet 2009.
40 () Audition du 14 octobre 2009.
41 () Audition du 29 septembre 2009.
42 () Audition du 1er juillet 2009.
43 () Audition du 16 décembre 2009.
44 () Cette ancienne province romaine située dans la moitié orientale du sud de l’Asie mineure correspond aujourd’hui approximativement à la province d’Adana (cf. la carte du Proche-Orient).
45 () Audition du 8 juillet 2009.
46 () Audition du 10 février 2010.
47 () Audition du 14 octobre 2010.
48 () Les chrétiens menacent en effet de faire sécession en se tournant vers une alliance avec Israël.
49 () Déjeuner du 18 mars 2010. Défense est la revue de l’Institut des hautes études de défense nationale.
50 () Audition du 10 février 2010.
51 () Audition du 8 juillet 2009.
52 () Audition du 7 octobre 2009.
53 () Audition du 23 septembre 2010.
54 () Cf. Elisabeth Meur, « Rapprochement libano-syrien : une normalisation contrariée », Revue internationale et stratégique, printemps 2010, pp. 44-53.
55 () Audition du 10 février 2010.
56 () MM. Jean-Louis Bianco, président, et M. Jean-Marc Roubaud, rapporteur, L’Iran à la croisée des chemins, rap. cit., pp. 30-31.
57 () Audition du 14 octobre 2009.
58 () Audition du 23 septembre 2009.
59 () Audition du 16 décembre 2009.
60 () M. Barah Mikaïl, La Syrie en cinquante mots clés, collection Comprendre le Moyen-Orient, L’Harmattan, Paris, 2009, 184 pages, p. 113.
61 () Audition du 10 février 2010.
62 () Cf. le rapport de MM. Jean-Louis Bianco et Jean-Marc Roubaud précité, pp. 26-27.
63 () Audition du 28 octobre 2009.
64 () Audition du 14 octobre 2009.
65 () Cf. le rapport de MM. Jean-Louis Bianco et Jean-Marc Roubaud précité, pp. 24-25.
66 () Audition du 10 février 2010.
67 () Audition du 14 octobre 2009.
68 () Audition du 23 septembre 2009.
69 () Audition du 7 octobre 2009.
70 () Audition du 10 février 2010.
71 () Caroline Donati, L’exception syrienne, op. cit., p. 314.
72 () Audition du 28 octobre 2009.
73 () Audition du 14 octobre 2009.
74 () Déjeuner du 18 mars 2010.
75 () Audition du 27 janvier 2010.
76 () Cf. Laura Ruiz de Elvira, « L’Etat syrien à l’épreuve des organisations non gouvernementales depuis l’arrivée au pouvoir de Bachar al-Assad », Maghreb-Machrek, printemps 2010.
77 () M. Jordi Tejel Gorgas, Actualisation de l’intervention réalisée lors de la conférence internationale sur « la question kurde au XXIème siècle » qui s’est tenue à l’Assemblée nationale le 25 février 2008. M. Gorgas a procédé à cette actualisation en février 2010, à la demande de la Mission, qui le remercie chaleureusement de cette contribution à ses travaux.
78 () Audition du 8 juillet 2009.
79 () Déjeuner du 18 mars 2010.
80 () Il s’agit de la Force des Nations unies chargée d’observer le désengagement, en place sur le Golan depuis 1974.
81 () Audition du 16 décembre 2009.
82 () Cité par Caroline Donati, L’exception syrienne, op. cit., p. 343.
© Assemblée nationale