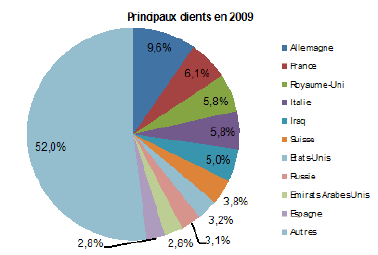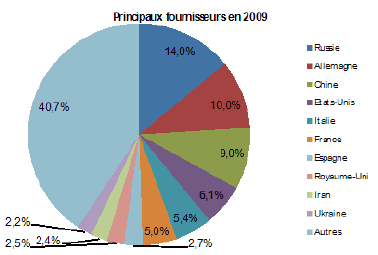______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 juillet 2010.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
en conclusion des travaux d’une mission d’information constituée le 6 mai 2009 (1),
sur « le rôle de la Turquie sur la scène internationale »
Président
M. Jean-Marc ROUBAUD
Rapporteure
Mme Marie-Louise FORT
Députés
__________________________________________________________________
(1) La composition de cette mission figure au verso de la présente page.
La mission d’information sur le rôle de la Turquie sur la scène internationale est composée de : M. Jean-Marc Roubaud, président, Mme Marie-Louise Fort, rapporteure, Mme Martine Aurillac, MM. Michel Delebarre, Tony Dreyfus, Jean-Michel Ferrand, Jean-Claude Guibal, Jean-Pierre Kucheida, Didier Mathus, Jean-Claude Mignon, Rudy Salles, Gérard Voisin.
INTRODUCTION 5
I – LA TURQUIE, PUISSANCE EMERGENTE 7
A – ECONOMIE ET ÉNERGIE : LES CARTES MAÎTRESSES DE LA DIPLOMATIE TURQUE 7
B - DIPLOMATIE TOUS AZIMUTS OU « PROFONDEUR STRATÉGIQUE » ? 15
1. Les moyens encore limités de la diplomatie 16
2. L’Afrique et l’Amérique latine, nouvelles terres de mission 16
a) L’Afrique 16
b) L’Amérique latine 17
3. Les Balkans, le Caucase et l’Asie centrale, retour discret dans les zones d’influence traditionnelle 18
a) Les Balkans 18
b) Le Caucase du Sud 19
c) L’Asie centrale 20
4. Vers un triangle Kaboul, Islamabad, Ankara ? 21
II – LA TURQUIE TOURNE T-ELLE LE DOS À L’OCCIDENT ? 23
A – LA SOCIÉTÉ TURQUE, ENTRE ISLAMISATION ET MODERNITÉ 23
B – LES ALLIANCES STRATÉGIQUES 29
1. Les Etats-Unis 29
a) Une alliance solide 29
b) Les interrogations américaines 30
2. Israël 32
a) Une relation stratégique chaotique 33
b) Rupture ou réévaluation après l’arraisonnement de « la flottille » ? 35
C – L’UNION EUROPÉENNE, ENTRE DÉPIT ET INCOMPRÉHENSION 37
1. Les promesses de la négociation 38
2. Dépit ou renoncement turc ? 41
3. Les hésitations européennes 43
4. Quelle Europe pour quelle Turquie ? 45
III – QUEL RÔLE RÉGIONAL POUR LA TURQUIE ? 47
A – « ZÉRO PROBLÈME AVEC LE VOISINAGE » : SLOGAN OU SOUCI D’EXEMPLARITÉ RÉGIONALE ? 47
1. Les voisins chrétiens 48
a) L’impasse chypriote 48
b) L’échec arménien 51
c) L’ouverture grecque 54
2. Les voisins musulmans 56
a) L’incertitude iranienne 56
b) L’embellie syrienne 60
c) Le succès irakien 64
B – LES AMBIGUÏTÉS DU DESSEIN MOYEN-ORIENTAL DE LA TURQUIE 65
a) Une politique guidée par le pragmatisme 66
b) La tentation néo-ottomane 67
c) Le danger de la radicalité 69
CONCLUSION 71
EXAMEN EN COMMISSION 73
ANNEXE - Liste des personnalités rencontrées 81
Mesdames, Messieurs,
La réaction turque aux récents événements au large de Gaza pose une nouvelle fois la question du sens et de la portée qu’il convient d’attribuer aux développements actuels de la politique étrangère turque.
Si la prudence commande de ne pas en tirer des conclusions hâtives, cette réaction ne manque pas de nourrir les inquiétudes et de relancer des questions qui ne sont pas nouvelles quant à l’évolution de la Turquie. En effet, la politique étrangère de la Turquie, parce qu’elle a connu dans ces dernières années des évolutions marquantes, inattendues voire spectaculaires, est l’objet de toutes les attentions, diplomatiques comme universitaires.
Ce constat d’une Turquie à la recherche d’une nouvelle place sur la scène internationale a convaincu, il y a un an, la commission des affaires étrangères de créer une mission d’information, pluraliste et composée de douze membres, sur cette question. Pour mener à bien cette tâche ardue, la Mission a réalisé une vingtaine d’auditions et s’est rendue en Turquie, en Syrie, en Israël et à Bruxelles. Ces rencontres, par leur variété, par la qualité et la richesse des discussions, ont considérablement nourri la réflexion de la Mission. Elle tient donc à remercier l’ensemble de ses interlocuteurs, français et étrangers, ainsi que le personnel diplomatique pour leurs contributions à ses travaux.
La Mission a d’abord pu constater que le rôle de la Turquie sur la scène internationale avait longtemps reposé sur trois piliers : l’appartenance à l’OTAN, l’alliance avec les Etats-Unis et la candidature à l’Union européenne, auxquels venaient s’ajouter des conflits de voisinage historiques, hérités pour une large part du démembrement de l’Empire ottoman.
Aujourd’hui la Turquie semble ne plus se contenter de ce rôle. La fin de la guerre froide, les attentats du 11 septembre 2001, l’arrivée de l’AKP au pouvoir, l’ouverture des négociations d’adhésion à l’Union européenne sont autant d’éléments qui ont contribué à la révision de la politique étrangère turque.
Sa puissance économique, récemment acquise, ainsi que l’arme énergétique lui donnent en outre quelques arguments pour réclamer une considération nouvelle de la part de ses interlocuteurs traditionnels mais aussi pour élargir sa sphère d’influence. Parallèlement, l’essoufflement du processus européen l’oblige à s’interroger sur ses priorités stratégiques.
Dans le même temps, la Turquie a mis en œuvre une politique de bon voisinage qui n’a pas toujours été couronnée de succès mais qui lui permet d’essayer de mettre fin à des conflits historiques, d’une part, et de se rapprocher du Moyen-Orient, d’autre part. Cette amélioration dans son environnement régional contraste avec la dégradation de ses relations avec ses alliés stratégiques traditionnels, notamment avec Israël.
La mission d’information s’est donc interrogée sur les trois orientations qui semblent aujourd’hui guider la diplomatie turque en essayant de mettre en évidence les liens entre celles-ci : la volonté de s’affirmer comme une puissance émergente mais aussi comme une puissance régionale ainsi que l’infléchissement de son ancrage occidental.
Comme l’a fait remarquer une personne entendue par la Mission, « un pont n’appartient à aucune rive ». La Turquie revendique depuis longtemps le rôle de pont entre l’Occident et l’Orient. Est-ce à dire qu’elle croit à cette définition ?
I – LA TURQUIE, PUISSANCE EMERGENTE
La Turquie a durant les dix dernières années étoffé son jeu diplomatique afin de s’imposer comme une puissance émergente. Pour ce faire, elle dispose avec l’économie et l’énergie de deux cartes maîtresses. Elle a par ailleurs déployé d’intenses efforts diplomatiques pour asseoir sa présence dans presque toutes les régions du monde.
A – Economie et énergie : les cartes maîtresses de la diplomatie turque
L’économie et l’énergie sont à des degrés différents des cartes maîtresses dans le jeu diplomatique de la Turquie. Sa puissance économique comme sa stratégie de « hub » énergétique en font un acteur incontournable de la scène internationale. Parallèlement, la dépendance énergétique turque ainsi que les contraintes de la conquête de nouveaux marchés pèsent fortement sur la politique étrangère turque.
La Turquie n’est devenue que récemment une puissance économique pouvant revendiquer fièrement le 16ème rang de l’économie mondiale, le 8ème parmi les économies européennes. Cinquième économie émergente dans le monde, elle est aussi le 15ème exportateur et le 22ème importateur mondial.
Grâce à une période ininterrompue de forte croissance entre 2005 et 2008, la Turquie est passée, en l’espace de dix ans, de la 28ème à la 16ème place du classement des économies mondiales, lui permettant ainsi de faire partie du G20. Son PIB par habitant a progressé entre 2005 et 2008 de 50 %, passant de 7 000 à 10 500 dollars. Le PIB turc représentait 0,9 % du PIB mondial dans les années 50 contre 1,5 % en 2007. Ses échanges ont également fait un bond spectaculaire, passant de 105 milliards de dollars au début des années 2000 à 470 milliards en 2008.
Cette progression exceptionnelle doit beaucoup à une politique volontariste d’ouverture qui s’est notamment appuyée sur les échanges avec l’Union européenne. Elle a ensuite été complétée par une série de réformes structurelles qui ont permis à la Turquie de traverser la crise financière sans trop de dommages, crise qui l’a d’ailleurs poussée vers de nouveaux marchés.
La politique économique turque a connu une rupture au début des années 80 lorsque la stratégie de développement a été repensée au bénéfice d’une ouverture vers les marchés extérieurs. Avant cette date, la dimension extérieure de la politique économique consistait à lever des fonds pour financer le déficit dû au manque de compétitivité des entreprises. La Turquie mettait alors en avant son poids géostratégique dans le contexte de la guerre froide pour convaincre les grandes puissances bailleurs de fonds. Depuis 1980, une logique de recherche de marchés s’est substituée à la recherche de financements. C’est à cette époque que des hommes d’affaires commencent à accompagner les voyages présidentiels, pratique que la Turquie continue de mettre en œuvre avec force.
Ce tournant s’est traduit, d’une part sur le plan intérieur par la mise en place d’institutions pour soutenir les exportations et d’autre part par la définition de priorités géographiques : l’Union européenne et le Moyen-Orient sont les deux cibles principales.
Un Conseil aux relations économiques extérieures, réunissant les 82 chambres de commerce et d’industrie, a été créé en 1988 pour favoriser la coopération entre milieux d’affaires. Le montant du soutien aux exportations s’élève en 2008 à 4 milliards de dollars, soit 7 % des exportations turques la même année. 61 % des crédits à court terme sont consacrés aux exportateurs qui exportent vers l’Union européenne (UE).
A partir de 1980, les Turcs reprennent le processus d’intégration à l’Union européenne, gelé au nom du protectionnisme depuis 1976 et la suspension de la réduction des tarifs douaniers en vue de l’Union douanière. De nombreux responsables considéraient alors que l’économie turque n’était pas en mesure d’affronter la concurrence des économies plus avancées. Rappelons que l’accord d’Ankara du 12 septembre 1963 (cf. infra) prévoyait trois phases : une phase préparatoire (1965-1972), une phase transitoire (1973-1985) et une phase définitive (1986-1995) avec pour objectif la constitution d’un marché commun avec la libre circulation des biens et services, des personnes et des capitaux. A l’exception de la libre circulation des personnes, tous ces objectifs ont été réalisés, notamment l’Union douanière, conclue en 1995. La Turquie est ainsi le seul pays qui a réalisé l’union douanière sans devenir membre à part entière de l’Union européenne. La part de la Turquie dans les exportations extracommunautaires de l’UE est passée de 0,7 % à 5,5 % entre 1965 et 2005. On observe les mêmes tendances dans les importations extra-communautaires. Les échanges commerciaux de la Turquie avec l’Union européenne correspondent aujourd’hui au quart du PNB turc.
« Dans les années 80, on constate le retour de la question de l’intégration européenne, la diversification des partenaires étant envisagée comme des relations complémentaires et non alternatives. Motifs de cette diversification : il s’agit pour la Turquie de mettre à profit les opportunités qui se présentent et d’amortir les inconvénients d’une éventuelle exclusion de l’UE sur laquelle la Turquie a commencé à réfléchir. C’est aussi la suite d’une stratégie politique décrétée à la fin des années 60 : la Turquie avait trop délaissé le Moyen Orient, ce qui l’avait défavorisée dans la défense de ses intérêts. Il fallait donc renforcer sa position par rapport à l’Occident, ce qui passait par des relations avec le Moyen-Orient afin de proposer des ponts qui allaient renforcer la position de la Turquie au sein de l’Occident. La diversification est aussi une conséquence de l’évolution économique mondiale, caractérisée par le déclin relatif de l’UE » selon M. Deniz Agakul, maître de conférence à l’université de Lille I (1).
Les marchés du Moyen-Orient qui bénéficiaient de la manne pétrolière ont constitué la première zone d’expérience des exportateurs turcs. Les industriels turcs ont commencé à « faire leurs dents » sur ces marchés, moins exigeants initialement en terme de qualité que les marchés occidentaux. Ensuite, dans les années 90, l’effondrement du bloc soviétique a offert de nouvelles perspectives en Asie centrale où se trouvent tous les pays turcophones, à l’exception du Tadjikistan.
En 2001, la Turquie a connu la crise économique et financière la plus violente de son histoire : la livre turque a été dépréciée de 50 %, le PIB a chuté de 7,5 %, le système bancaire s’est effondré. Cette crise a été salvatrice puisqu’elle a contraint la Turquie à réagir dans plusieurs directions : assainissement du secteur financier et bancaire, indépendance de la banque centrale, régime de change flottant, réformes structurelles, discipline budgétaire, processus de privatisation. Elle a également poussé les acteurs économiques à se tourner davantage vers l’extérieur et a singulièrement amélioré l’attractivité de la Turquie pour les investissements directs étrangers (IDE). Ces réformes ont enfin permis à la Turquie de traverser la dernière crise financière mondiale avec moins de difficultés que l’Union européenne par exemple.
Entre 2002 et 2006, la Turquie a ainsi bénéficié d’une croissance du PIB de 7,5 % en moyenne par an puis 4,7 % en 2007 et 1,1 % en 2008. En 2009, le PIB a reculé de 6 %. Les prévisions de croissance pour 2010 varient entre 4 et 6 %.
La crise financière turque s’est traduite par le renforcement de l’attractivité du pays pour les IDE et par la poursuite de la réorientation des échanges. La crise mondiale à partir de 2008 a conforté cette dernière tendance. Cependant, pour M. Pekin Baran, Vice-président du Comité consultatif de TUSIAD (2) « ce n’est pas le marasme européen mais la politique étrangère diversifiée de la Turquie qui est à l’origine de l’évolution géographique des échanges. »
Si quinze années d’Union douanière ont conduit à une véritable intégration économique, le volume des échanges avec l’Union européenne est néanmoins passé de 56 % du commerce extérieur turc en 2005 à 46 % en 2008. Le partenaire européen privilégié demeure l’Allemagne.
L’Europe représente, en 2009, 40,4 % des importations et 46 % des exportations turques, s’établissant respectivement à 56,4 et 47 milliards de dollars. Les trois autres pays fournisseurs de la Turquie sont la Russie (14 %), la Chine (9 %) et les Etats-Unis (6,1 %).
Pour la première fois, en 2009, les pays du Moyen-Orient apparaissent parmi les vingt premiers marchés d’exportation pour la Turquie. Le commerce avec le Moyen-Orient a doublé depuis 2006 pour atteindre 43,05 milliards de dollars en 2008. Cette évolution a été facilitée par la levée de l’obligation de visas avec la Syrie, l’Albanie, la Libye, le Pakistan, la Jordanie et le Liban. La facilitation de la libre circulation des personnes pourrait être la première pierre du projet de zone de libre-échange au Moyen-Orient. La Turquie a également signé des accords de coopération économique avec les monarchies du Golfe. Les Emirats arabes unis étaient ainsi le 3ème client de la Turquie en 2008, le 9eme en 2009. La Russie et l’Iran occupent également une place privilégiée dans le commerce extérieur turc, notamment pour des raisons énergétiques.
La Turquie se classe au 20eme rang mondial des sites d’accueil pour les investissements étrangers. Avec 18,2 milliards de dollars en 2008 contre 1 milliard en 2002, elle occupe la 6eme place parmi les pays émergents. La France est toujours le troisième investisseur en Turquie. Les trois quarts des IDE réalisés en Turquie viennent des pays de l’UE.
La Turquie, en raison de sa stabilité économique, est aussi devenue un intermédiaire pour les pays qui veulent faire du commerce avec ses voisins. Elle offre aussi à ces derniers des perspectives de désenclavement économique.
En revanche, la Turquie est un faible investisseur en dehors de ses frontières. 60% des IDE turcs ont pour destination l’UE. La compétition accrue sur le marché intérieur et l’ouverture de la Turquie pourraient favoriser une évolution sur ce point.
La Turquie n’est plus aujourd’hui l’atelier de l’Europe mais un pays producteur de haute technologie. Elle est le 6ème producteur automobile ainsi que le 2ème exportateur mondial dans le domaine de l’habillement.
Alors que le déficit de la balance des transactions courantes et la résurgence de tensions inflationnistes sont préoccupants, les réformes structurelles semblent marquer le pas et le processus de privatisation s’achève. Par ailleurs, le FMI, fin mai, pointait deux sujets de préoccupation : l’importance de l’économie souterraine et la politique énergétique. Il faut également mentionner l’augmentation importante du chômage qui touchait fin avril près de 14,5 % de la population active.
En dépit de ces motifs d’inquiétude, la crise économique qui a frappé principalement les Etats-Unis et l’Europe a renforcé la Turquie dans sa conviction qu’elle peut jouer sur le plan économique, mais pas seulement, dans la cour des grands. La Turquie n’a pas hésité à faire part au sein du G20 de ses conseils, tirés de son expérience du début des années 2000, quant aux réponses à apporter à la crise financière mondiale. Son évolution économique est un motif de fierté pour la Turquie. Elle s’enorgueillit ainsi d’être le seul pays à avoir vu sa notation relevée pendant la crise.
La Turquie ambitionne d’être dans les vingt prochaines années la dixième économie mondiale. Dans cette perspective, le Premier ministre turc s’investit particulièrement dans la diplomatie économique. Au cours des 234 visites qu’il a effectuées dans 80 pays, il a toujours veillé à être largement entouré d’hommes d’affaires turcs et a signé quantité d’accords de coopération économique.
Le Vice-premier ministre syrien chargé des affaires économiques, M. Al Dardari, cite en exemple la « success story » turque d’un pays islamiste dans une économie de marché, exemple susceptible d’encourager l’ouverture économique des autres pays du Moyen-Orient.
Cette réussite fait aussi grincer des dents dans certains pays arabes qui reprochent à la Turquie d’avoir toujours des arrière-pensées économiques dans ses relations diplomatiques.
M. Peter Harling, représentant de l’International crisis group à Damas, met aussi en garde contre le risque de voir les relations économiques prises en otage des questions politiques de la région. Il souligne qu’intégration économique et politique doivent aller de pair. Or aujourd’hui, la Turquie a les moyens d’avancer sur le plan économique tandis que ses résultats en termes politiques sont discutables.
La situation géographique de la Turquie lui permet d’aspirer à devenir un « hub » énergétique puisqu’elle se situe au carrefour de nombreux réseaux existants ou en projet.
La Turquie se positionne donc comme un acteur incontournable de l’approvisionnement énergétique européen, pivot de l’acheminement des ressources de l’Est à l’Ouest. Elle n’hésite d’ailleurs pas à le rappeler aux responsables de l’Union européenne.
Mais sa propre dépendance énergétique pèse sur son ambition en même tant qu’elle la nourrit. Elle l’oblige en effet à être accommodante avec de nombreux fournisseurs tout en recherchant à diversifier ces derniers. En 2007, l’approvisionnement turc était réparti principalement entre la Russie (63 %), l’Iran (17 %), l’Algérie (12 %) et l’Azerbaïdjan (4 %).
La Turquie est intéressée ou partenaire direct de tous les projets énergétiques en cours dans la région ce qui entraîne des répercussions importantes sur sa diplomatie :
– le gazoduc BTC (Bakou, Tbilissi, Ceyhan) et l’oléoduc BTE (Bakou, Tbilissi et Erzurum) permettent à Ankara de disposer d’un accès aux hydrocarbures de la Caspienne. Cet accès dépend néanmoins de la qualité de ses relations avec l’Azerbaïdjan.
Depuis le printemps 2008, l’Azerbaïdjan et la Turquie ont tenu plus de 15 rounds de négociations portant sur le prix du gaz azerbaïdjanais acheminé vers la Turquie depuis le gisement Shah Deniz dans la mer Caspienne, sur le volume de ces livraisons et les conditions de leur transit vers l’Europe via le territoire turc.
La signature des protocoles de Zürich entre la Turquie et l’Arménie a sérieusement handicapé ces négociations. Ce n’est qu’au prix de fortes tensions et d’un refus turc de ratifier ces protocoles – cf. infra – que Bakou et Ankara sont parvenus à signer le 7 juin une série d’accords sur l’acheminement du gaz provenant du gisement de Shah Deniz.
Les questions politiques déterminent également à bien des égards l’efficacité des projets de gazoducs Nabucco, ITGI (Interconnexion Turquie-Grèce-Italie) et TAP (Trans Adriatic Pipeline) destinés à transporter le gaz caspien vers l’Union européenne.
– la Turquie est partenaire à hauteur d’un sixième du projet de gazoduc Nabucco, dont l’accord a été signé à Ankara le 13 juillet 2009. Selon une spécialiste de l’énergie rencontrée par la Mission, la Turquie détient les clés de l’ouverture du corridor Sud alors que son soutien à Nabucco n’est pas à ce jour très coûteux.
Long de 3 300 km et d’une capacité de 31 milliards de m3 de gaz par an, ce gazoduc a vocation à relier la mer Caspienne et l’Autriche via la Turquie, la Grèce, la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie. La date de mise en œuvre initiale était 2014, aujourd’hui celle de 2018 semble plus réaliste.
Ce projet doit en effet surmonter plusieurs difficultés d’ici là : la question du financement et surtout celle de l’approvisionnement.
L’Azerbaïdjan ne dispose en effet pas de réserves suffisantes pour fournir entièrement le gazoduc ; il peut fournir un quart des ressources nécessaires. L’Europe courtise donc le Turkménistan très doté mais a été prise de vitesse par les Chinois qui ont ouvert un débouché à l’Est pour le gaz turkmène. En outre, l’acheminement du gaz turkmène suppose la traversée de la mer Caspienne sur laquelle Russie et Iran prétendent détenir des droits de transit. Or, la Russie s’oppose à l’ouverture d’un corridor Sud qui menacerait sa suprématie énergétique.
Les autres sources d’alimentation sont l’Iran et l’Irak. L’Iran est en effet le seul pays à détenir les ressources suffisantes pour approvisionner seul Nabucco. Il existe techniquement un bras d’entrée en Iran du gazoduc qui aboutit en Turquie. La position actuelle de l’Iran vis-à-vis de la communauté internationale ne permet pour l’instant pas d’envisager cette solution. Quant aux ressources irakiennes, elles ne sont pas suffisamment exploitées actuellement pour répondre à la demande de Nabucco. Mais là encore, la Turquie a un rôle à jouer dans l’évacuation de ces futures ressources, situées notamment au Kurdistan.
– Afin de ne négliger aucune option stratégique pour assurer son approvisionnement, la Turquie a également accepté de se rapprocher du projet concurrent South Stream, porté par les Italiens et les Russes.
La Turquie veille à ne pas fâcher les Russes car elle doit sécuriser ses approvisionnements en prévision de l’éclatement de la bulle de gaz actuelle. Elle n’en est pas moins incontournable sur le projet South Stream puisque celui-ci doit traverser ses eaux.
Long de 900 km et d’une capacité de 30 milliards de m3, le projet South Stream doit relier la Russie et la Bulgarie. En échange de son accord pour la traversée de sa zone économique exclusive en Mer Noire, Ankara a exigé le renouvellement d’un contrat de fourniture de gaz russe ainsi que l’approvisionnement en pétrole russe de l’oléoduc Sumsun-Ceyhan (projet turco-italien), resté au point mort jusqu’à présent.
En raison des incertitudes qui pèsent sur la viabilité de Nabucco, d’autres projets paraissent plus réalistes à court terme :
– Long d’environ 800 km, le gazoduc ITGI est conçu pour transporter le gaz caspien entre la Turquie, la Grèce et l’Italie. Son débit se situera autour de 8 à 10 milliards de m3.
– D’une longueur de 520 km, le gazoduc TAP acheminera du gaz vers l’Italie du sud-est à travers la Grèce et l’Albanie. Une partie du pipeline (115 km) passera au fond de la mer Adriatique entre l’Albanie et l’Italie. Fixée au départ à 10 milliards de m3 de gaz par an, sa capacité sera par la suite portée à 20 milliards.
La Turquie se trouve donc en position de force à l’égard de l’Union européenne contrairement à sa position vis-à-vis de la Russie. « Même si la Turquie, officiellement, n’en faisait pas argument par rapport à son adhésion à l’UE, on a bien vu cependant que les questions étaient liées et que les Turcs soulignaient les liens existants entre leur candidature et la signature de Nabucco. N’oublions pas que le chapitre sur l’énergie a été gelé dans le cadre du différend chypriote » rappelle M. Jean Marcou, professeur à l’Institut d’études politiques de Grenoble (3).
Les relations entre l’UE et la Russie sont une donnée majeure de l’évolution de la problématique énergétique pour l’Europe et pour la Turquie. Si ces relations venaient à s’améliorer, la Turquie perdrait de son attrait en tant que « nœud unique des voies de contournement de l’influence russe » (4).
Les relations Russie-Turquie
Bien avant la guerre froide, Russie et Turquie ont été ennemis : à partir du XVIIème siècle, la Russie fait figure de principale menace pour les Ottomans. M. Cengiz Aktar, directeur du Centre d’études européennes de l’Université privée Bahçeshir d’Istanbul, rappelle ainsi que l’armée russe est la seule armée contre laquelle l’armée ottomane n’a jamais gagné de guerre.
Pourtant, les deux pays sont aujourd’hui entrés dans une ère de coopération économique et commerciale, qui illustre une nouvelle fois le poids de l’économie dans la diplomatie turque. Cependant, la relation bilatérale paraît déséquilibrée tant la Turquie est dépendante pour son approvisionnement énergétique de la Russie. Celle-ci est en ce domaine le premier fournisseur de la Turquie à hauteur de 63 %. Le marché russe est par ailleurs primordial pour les entreprises turques. La Russie est en effet le premier partenaire commercial de la Turquie, le volume des échanges s’établissant à 38 milliards d’euros, soit 11,3 % du volume total turc en 2008, mais déficitaire à hauteur de 24 milliards.
Point d’orgue d’un cycle de rencontres à très haut niveau, la visite du Président russe, M. Dimitri Medvedev, en Turquie les 11 et 12 mai, a confirmé la place des questions économiques dans les relations turco-russes. Elle a permis la signature de 17 accords, les deux principaux portant sur la construction et l’exploitation d’une centrale nucléaire à Akkuyu (ce marché a été attribué par la Turquie de manière unilatérale) ainsi que sur une exemption de visas de court séjour pour les ressortissants des deux pays. La création d’un Haut conseil de coopération de haut niveau a également été décidée. Enfin, l’objectif de porter le volume du commerce bilatéral à 100 milliards d’euros en cinq ans a été réaffirmé.
Pour autant, les interlocuteurs que la Mission a rencontrés ne croient pas à une alliance entre les deux pays, parfois avancée comme alternative à l’adhésion à l’Union européenne. M. Gilles Veinstein, professeur au Collège de France, parle ainsi d’une « réaction d’amour-propre vis-à-vis des Européens » (5). Pour M. Aktar, un tel rapprochement n’a aucun sens car la Russie reste un empire qui n’a pas fini de disloquer. D’autres considèrent que la peur d’une Russie qui veut descendre vers les mers chaudes est toujours présente dans les mémoires turques. Cela n’empêche pas les autorités turques de veiller à ménager leur partenaire russe dans leurs initiatives diplomatiques.
B - Diplomatie tous azimuts ou « profondeur stratégique » ?
Forte de sa puissance économique et de son atout énergétique, la politique étrangère turque, théorisée par son ministre actuel, M. Ahmet Davutoglu, se doit de revêtir une « profondeur stratégique » conforme aux ambitions de puissance émergente affichées. La Turquie cherche à acquérir cette profondeur notamment en déployant ses efforts diplomatiques sur tout le globe, aussi bien sur des continents méconnus pour elle que dans des régions avec lesquelles elle entretient des relations historiques. Il est en effet frappant de constater qu’il n’existe aujourd’hui que peu de pays dans lesquelles la Turquie n’est pas présente. Cependant, la lisibilité comme les moyens consacrés à cette diplomatie tous azimuts posent question. Les résultats ne semblent pas à ce jour à la hauteur des attentes.
1. Les moyens encore limités de la diplomatie
Face aux ambitions affichées, plusieurs interlocuteurs ont souligné l’insuffisance actuelle des moyens diplomatiques turcs. Il semble cependant que le ministre actuel cherche à obtenir les moyens correspondant aux nouvelles aspirations turques.
L’ancien ministre des affaires étrangères aujourd’hui député, M. Yasar Yakis, a fait part à la Mission d’une remarque que lui avait faite un diplomate américain selon laquelle la diplomatie turque semblait presque fière de n’avoir jamais produit d’expert des questions arabes. En écho, M. Cengiz Aktar a estimé que la Turquie n’avait pas les moyens de ses ambitions ; à l’appui de son propos, il a fait valoir que le ministère des affaires étrangères ne compte que cinq arabophones et personne parlant le persan, illustrant ainsi le fait que la Turquie avait longtemps tourné le dos au monde arabe et à l’Asie centrale.
Le ministère des affaires étrangères compte environ 5 000 agents dont un peu moins de 1 000 diplomates. Il dispose en 2010 d’un budget de 920 millions de livres turques (470 millions d’euros), soit 0,22 % du budget turc. Le réseau diplomatique en 2009 s’appuie sur 177 missions : 99 ambassades, 67 postes consulaires et 11 missions multilatérales. Le réseau pourrait atteindre 203 postes d’ici la fin de l’année, contre 136 en 1991 et 160 en 1999. Cette croissance bénéficie principalement à l’Afrique et dans une moindre mesure à l’Amérique latine.
2. L’Afrique et l’Amérique latine, nouvelles terres de mission
La diplomatie turque se déploie vers des continents qu’elle ignorait jusqu’alors, l’Afrique et l’Amérique latine. En Afrique, la Turquie semble s’inspirer de l’expansionnisme chinois. Ainsi, l’offensive est-elle politique mais aussi fortement économique. En Amérique latine, il s’agit de mettre un pied sur un continent en devenir mais aussi de nouer des relations politiques fortes avec d’autres puissances émergentes, au premier rang desquels le Brésil.
La stratégie turque se traduit d’abord par le renforcement de ses moyens diplomatiques.
La Turquie dispose déjà de douze ambassades sur le continent africain : cinq en Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye et Egypte) et sept en Afrique subsaharienne (Afrique du Sud, Ethiopie, Kenya, Nigeria, République démocratique du Congo, Sénégal, Soudan).
Sur les quinze nouvelles ambassades annoncées en Afrique, huit ont été ouvertes depuis 2009 (Tanzanie, Côte d’Ivoire, Cameroun, Ghana, Mali, Ouganda, Angola, Madagascar). Les prochaines devraient l’être dans les pays suivants : Burkina-Faso, Guinée, Mauritanie, Mozambique, Niger, Tchad et Zambie.
La Turquie a accueilli les 19 et 20 août 2008 les représentants de 50 pays africains pour le premier sommet entre la Turquie et l’Union africaine, auprès de laquelle elle bénéficie d’un siège d’observateur. Ce sommet a permis de jeter les bases d’un partenariat entre l’Afrique et la Turquie. Un deuxième sommet devrait avoir lieu en Afrique en 2013. Les pays africains ont d’ailleurs apporté un soutien précieux à la candidature turque au Conseil de sécurité des Nations unies.
Le président turc s’est rendu au Cameroun les 16 et 17 mars, accompagné d’une importante délégation composée principalement d’hommes d’affaires. A cette occasion, il a précisé sa conception de la politique turque en direction de l’Afrique insistant sur la nécessité d’une approche globale, équitable et dépourvue d’intentions unilatérales, en référence à la colonisation.
Les efforts déployés sur le plan politique s’accompagnent d’une implication forte du monde des affaires. Ainsi, la confédération des hommes d’affaires et des industriels de Turquie (TUSKON) soutient-elle de fréquents échanges entre les mondes des affaires turc et africain. Elle invite ainsi de nombreux pays africains à son forum annuel.
En dépit de la crise, la Turquie est parvenue à développer ses échanges commerciaux avec l’Afrique. Alors que début 2009, ses exportations chutaient de 30 %, celles vers le continent africain ont augmenté de 40 %. Le volume des échanges est passé de 6 à 18 milliards de dollars entre 2005 et 2008 tandis que les exportations ont crû de 2,5 à 9 milliards.
Enfin, une importante coopération en matière d’éducation a été mise en place grâce à l’ouverture de plusieurs dizaines d’écoles turques en Afrique par le réseau éducatif Fethullah Gülen (6).
Plusieurs interlocuteurs ont mis en garde contre une surestimation des ambitions turques en Afrique. La Turquie doit en effet faire face à deux difficultés : elle est, d’une part, confrontée à la concurrence des autres pays émergents. D’autre part, sa faible connaissance du continent africain constitue jusqu’à présent un handicap.
La Turquie entretient des relations sereines mais peu substantielles avec plusieurs pays d’Amérique latine (Brésil, Argentine, Chili et Mexique).
Elle cherche donc, d’une part, à accroître sa présence sur le sous-continent – deux nouvelles ambassades devraient être installées au Pérou et en Colombie – et d’autre part, à densifier ses liens avec les pays émergents. Le Brésil en constitue l’exemple le plus significatif.
Les deux pays s’accordent pour renforcer leur coopération économique mais partagent également des vues en matière de gouvernance mondiale. Ces deux puissances émergentes estiment que sur les grands enjeux mondiaux la parole ne peut plus aujourd’hui être le monopole des grandes puissances traditionnelles. Elles souhaitent donc notamment renforcer la concertation préalable entre elles dans les instances multilatérales comme le G20 ou le Conseil de sécurité. On notera que le ministre brésilien des affaires étrangères est intervenu devant la conférence des ambassadeurs turcs en janvier dernier.
Le rapprochement avec le Brésil a connu récemment une traduction spectaculaire avec la signature d’un accord entre les deux pays et l’Iran sur la question nucléaire (cf. infra).
Se pose cependant une nouvelle fois la question des moyens consacrés à l’approfondissement des liens avec l’Amérique latine. « La publicité faite par la Turquie sur l’ouverture d’ambassades en Amérique latine et en Afrique ne correspond pas à la mise en œuvre d’une politique à l’égard de ces continents. Cela s’inscrit plutôt dans la recherche d’une visibilité et d’un statut international » considère ainsi Mme Dorothée Schmid, responsable du programme « Turquie contemporaine » à l’Institut français des relations internationales (IFRI) (7).
3. Les Balkans, le Caucase et l’Asie centrale, retour discret dans les zones d’influence traditionnelle
L’histoire lie la Turquie aux Balkans, au Caucase ainsi qu’à l’Asie centrale. A l’indifférence observée pendant la guerre froide a succédé aujourd’hui une attention marquée qui peine cependant à se traduire par des réalisations concrètes.
Selon M. Jean-Christophe Filori, chef de l’unité Turquie à la direction Elargissement de la Commission européenne, la Turquie est très demandeuse d’un dialogue structuré avec l’Union européenne sur les Balkans en raison de l’héritage ottoman et d’une forte population d’origine balkanique ; la Commission explore les possibilités de mise en œuvre d’un tel dialogue. Parallèlement, au sein de l’OTAN, les Turcs sont des soutiens actifs de l’adhésion notamment de la Bosnie-Herzégovine.
Ces indications confirment l’intérêt que la Turquie porte aux Balkans. Cela s’est jusqu’à présent traduit principalement par la mise en œuvre d’une médiation entre la Serbie et la Bosnie-Herzégovine. Celle-ci a donné lieu à cinq rencontres trilatérales depuis octobre 2009. La dernière en date, à Istanbul, le 24 avril avec les trois présidents, a confirmé l’objectif de réconciliation et d’intensification des relations entre les deux pays. Un premier résultat a été obtenu en matière de normalisation des relations diplomatiques avec l’accréditation d’un ambassadeur bosnien en Serbie.
Parallèlement, le Premier ministre turc s’est rendu à Sarajevo en avril dernier tandis que le Président Gül était en Serbie en octobre 2009.
Dans le cadre de sa politique de « zéro problème avec le voisinage », la Turquie n’est pas indifférente au sort du Caucase du Sud. Sa stratégie de « hub » énergétique nécessite également la stabilité de la région et le maintien de bonnes relations avec l’Azerbaïdjan, incontournable voie d’acheminement. Cependant, son rôle dans cette région est largement hypothéqué par ses relations avec l’Arménie – cf. infra. En outre, la diplomatie y est phagocytée par les Etats-Unis et la Russie, laissant une faible marge de manœuvre aux initiatives turques.
Dès la fin de la guerre entre la Russie et la Géorgie, la Turquie a proposé la mise en place d’une « plateforme de stabilité et de coopération pour le Caucase », réunissant les trois républiques caucasiennes et la Russie. Cette initiative peine aujourd’hui à voir le jour, empêtrée elle aussi dans les querelles entre l’Arménie et la Turquie.
Les relations entre la Turquie et l’Azerbaïdjan
L’appartenance des deux pays au même ensemble turcophone a créé au début du XXème siècle un sentiment de solidarité entre les deux peuples résumé par la formule « deux Etats, une Nation ».
Les Azerbaïdjanais sont reconnaissants envers la Turquie de les avoir soutenus en 1918 alors que leur jeune indépendance était menacée. La Turquie a par ailleurs été le premier pays à reconnaître le 9 novembre 1991 la nouvelle République d’Azerbaïdjan et à établir avec elle des relations diplomatiques à partir du 14 janvier 1992.
La proximité entre les deux Etats s’exprime sur tous les plans (politique, économique, culturel, éducatif, etc…). Deux questions dominent cependant cette relation : l’énergie et le Haut-Karabakh, l’un n’étant pas toujours sans lien avec l’autre.
Sur le premier point, l’Azerbaïdjan est un important fournisseur de gaz pour la Turquie. Il est par ailleurs un point de passage obligé pour de nombreux réseaux dont la Turquie souhaite être le carrefour, notamment en direction de l’Europe – cf. supra. Les autorités azerbaïdjanaises ne se privent pas d’utiliser cette arme énergétique pour faire entendre leurs vues diplomatiques à la Turquie.
Ainsi, la signature le 7 juin d’un accord gazier entre les deux pays vient-elle clore un chapitre difficile des relations entre les deux pays, ouvert par le rapprochement turc avec l’Arménie.
Le conflit du Haut-Karabakh entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie se trouve aujourd’hui au cœur des relations de ces deux pays avec la Turquie. En effet, la Turquie a fermé sa frontière avec l’Arménie en 1993 en réaction à son intervention militaire au Haut-Karabakh.
Depuis la signature des protocoles de Zurich sur la normalisation des relations turco-arméniennes, un pas en arrière a été fait puisque la Turquie exige désormais la solution de ce conflit avant de ratifier ces accords. Les Arméniens voient derrière cette exigence nouvelle la main de l’Azerbaïdjan qui dispose avec l’énergie d’un moyen de pression très efficace.
Selon l’analyse de nos collègues MM. Blum et Bataille (8), « partagée entre ses objectifs diplomatiques, économiques, sa place dans le monde euro-atlantique – occupée et recherchée notamment par sa candidature à l’Union européenne – et sa volonté de maintenir de bonnes relations avec la Russie, partenaire obligé dans le domaine énergétique dont elle fait une de ses priorités, la Turquie ne semble pas en mesure d’imposer une orientation claire dans le Caucase ».
« Après l’effondrement de l’empire soviétique et les processus d’indépendance des pays d’Asie centrale, il y a eu pendant deux ans l’illusion en Turquie que le processus allait tout à fait dans le sens de leurs intérêts et qu’ils allaient être absolument irremplaçables en retrouvant leurs « cousins » turcophones. En effet, les Turcs pensaient assez naïvement que la parenté linguistique avec leurs voisins turcophones se traduirait par un jeu d’influence immédiat. Il faut néanmoins rappeler que cette parenté linguistique est toute relative car si les racines linguistiques sont les mêmes, le temps a aussi fait son œuvre, et la compréhension entre locuteurs turcophones n’est pas immédiate entre par exemple un Turc d’Istanbul et un habitant du Kirghizistan. Lorsqu’ils ont compris que leur rôle de grand frère ne serait jamais véritablement reconnu, les Turcs ont abandonné l’idée d’un système globalisant l’Asie centrale et repris un jeu de relations bilatérales. Celles-ci sont d’ailleurs plus commerciales et industrielles que politiques ; de nombreux hommes d’affaires sont présents dans le secteur du BTP, la construction d’infrastructures routières, etc. C’est autant de réseaux d’influence pour la Turquie mais sans illusions excessives. Les Turcs sont ainsi revenus, et c’est tant mieux, à une conception plus réaliste de leurs relations avec l’Asie centrale » résume M. Didier Billion, directeur adjoint de l’Institut de relations internationales et stratégiques (9).
Alors que les années 90 ont été marquées par un enthousiasme pour l’Asie centrale qui recouvrait alors son indépendance – la Turquie a été l’un des premiers pays à reconnaître l’indépendance des républiques d’Asie centrale –, les ambitions turques ont depuis été revues à la baisse. L’intérêt pour le monde turcophone s’est heurté à la faible unité culturelle des Etats turciques ainsi qu’à l’absence de cohérence politique. En outre, le nationalisme revendiqué des dirigeants ainsi que l’ombre russe handicapent toute reconnaissance d’un rôle prééminent à la Turquie. Enfin, le modèle turc, laïque et démocratique, ne correspond guère à l’évolution autoritaire et islamiste des régimes en place.
Les seules avancées significatives, en dehors de l’économie, ont été réalisées dans les domaines culturel et linguistique avec notamment la diffusion des programmes turcs via le satellite Türksat. Les entreprises turques quant à elles ont su largement profiter de ces marchés turcophones.
« Le bilan de l’ouverture à l’Asie centrale est donc décevant par rapport aux projets initiaux – un espace politique turcique homogène est un rêve » conclut M. Gilles Dorronsoro (10).
Face aux obstacles rencontrés dans sa reconquête du monde turcophone, la Turquie a préféré orienter son offensive diplomatique vers d’autres régions dans lesquelles elle pouvait disposer d’un espace politique. Elle a néanmoins trouvé en Asie centrale un espace économique et énergétique au sein duquel elle occupe une position forte.
4. Vers un triangle Kaboul, Islamabad, Ankara ?
Le Pakistan et l’Afghanistan sont deux autres pays cibles de la politique étrangère turque dans lesquels la religion musulmane et l’histoire donnent à la Turquie un avantage certain par rapport aux autres puissances impliquées dans la recherche de solutions aux défis régionaux.
La Turquie entretient des relations anciennes avec l’Afghanistan : le roi d’Afghanistan a été le premier dignitaire étranger à se rendre en Turquie après la fondation de la République. La visite du Président Karzai en Turquie en janvier 2006, première visite d’un chef d’Etat afghan depuis 1957, a permis de relancer les relations turco-afghanes avec la signature d’un accord général de coopération.
La Turquie considère qu’elle a des responsabilités particulières à assumer à l’égard de ce pays et que la parenthèse afghane ouverte par la communauté internationale ne se refermera pas pour ce qui la concerne.
Elle a notamment exercé des responsabilités au sein de la coalition militaire à deux reprises, en dirigeant notamment une PRT (Provincial Reconstruction Team) dans la province de Wardak. Elle gère depuis le 1er novembre 2009 le commandement régional de Kaboul. 1795 soldats turcs sont aujourd’hui présents en Afghanistan. Les responsables politiques ont néanmoins refusé l’envoi de troupes supplémentaires demandé par les Américains dans le cadre du surge.
La Turquie participe aux efforts de reconstruction en Afghanistan au travers de son agence de coopération TIKA (Turkish international cooperation and development agency) et de plusieurs ministères (éducation, santé, etc.).
Les relations avec le Pakistan sont également de grande qualité pour des raisons historiques et culturelles : l’appui du sous-continent au mouvement des Jeunes turcs et la religion musulmane constituent le socle de cette proximité. L’évolution de la Turquie suscite d’ailleurs une certaine admiration de la part du Pakistan qui voit en elle un modèle de réussite ayant surmonté ses contradictions.
La Turquie est membre du Groupe des amis démocratiques du Pakistan dont elle a accueilli la seconde réunion en août 2009. Créé à New York en septembre 2008, ce groupe compte 26 membres parmi lesquels le Pakistan, l’Australie, le Canada, la Chine, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Turquie, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni, les États-Unis, les Nations unies et l’Union européenne.
Aux termes de la déclaration conjointe faite à l’occasion de la visite du Premier ministre M. Erdogan en octobre 2009, les deux pays ont créé un haut conseil de la coopération sur le modèle de ceux qui existent avec la Syrie et l’Irak. Ce conseil doit se réunir annuellement sous l’autorité des Premiers ministres et dans l’intervalle avec les ministres des affaires étrangères. La visite du Président Gül, en avril 2010, qui était accompagné de 70 chefs d’entreprise, a été l’occasion de réaffirmer l’objectif de faire passer les échanges commerciaux entre les deux pays de 700 millions d’euros à deux milliards en 2012 notamment dans les domaines du BTP, de l’énergie et du textile. Par ailleurs, les deux pays collaborent dans la lutte contre le terrorisme et mettent en œuvre une étroite coopération militaire.
Partageant les vues occidentales sur la dimension régionale du conflit afghan, la Turquie s’est engagée en faveur du renforcement de la solidarité entre Afghanistan et Pakistan. A cette fin, elle a organisé à quatre reprises des sommets trilatéraux, dénommés « processus d’Ankara », depuis 2007 (avril 2007, décembre 2008, avril 2009, janvier 2010). Elle a par ailleurs accueilli en janvier dernier le sommet régional des voisins immédiats de l’Afghanistan. Ces actions s’inscrivent dans la démarche turque en faveur d’une prise de conscience par les acteurs régionaux de leur responsabilité dans le règlement de cette crise. Elles répondent à la volonté de créer une dynamique régionale autour de coopérations à géométrie variable. Pour autant, la coopération trilatérale avec ces pays relève pour le moment davantage de l’effet d’affichage que de la réalisation concrète selon l’analyse d’un diplomate français.
Cette question se pose d’ailleurs plus généralement pour la politique étrangère turque : « cette diplomatie, très active, tous azimuts, est-elle soutenable à long terme ? Quels sont ses résultats ? Est-elle déterminante ? Il convient de ne pas se laisser aveugler par l’hyper activisme mais de déterminer le poids réel de cette nouvelle politique » souligne Mme Dorothée Schmid.
De nombreuses voix s’élèvent par ailleurs pour s’interroger sur la lisibilité des ambitions turques sur la scène internationale. Celles-ci sont-elles la simple transposition sur le plan politique des succès économiques turcs ou signifient-elles une révision profonde de la politique étrangère turque ?
II – LA TURQUIE TOURNE T-ELLE LE DOS À L’OCCIDENT ?
« Si le statut international de la Turquie se trouve rehaussé par ces avancées diplomatiques, l’incertitude pèse sur son positionnement par rapport aux grandes lignes de clivage géopolitique. Se pose de manière récurrente la question : dans quel camp sont les Turcs ? L’évolution de l’attitude turque à l’égard d’Israël nourrit cette inquiétude des Occidentaux : les Turcs travaillent-ils pour eux-mêmes ou pour " le camp islamique " ? » interroge Mme Dorothée Schmid, responsable du programme « Turquie contemporaine » à l’IFRI (11).
Cette question provocante est sur les lèvres de tous ceux qui s’intéressent à la géopolitique. L’évolution de la société turque, les vicissitudes des relations stratégiques avec Israël et les Etats-Unis ainsi que l’enlisement des négociations d’adhésion à l’Union européenne seraient à l’origine d’une rupture dans la politique étrangère turque qui aurait pour conséquence une réorientation de celle-ci au détriment de l’Occident.
A – La société turque, entre islamisation et modernité
Les membres de la Mission qui se sont rendus en Turquie ont tous été impressionnés par la modernité et le dynamisme du pays. Alors que sa modernité économique ne fait pas de doute, comme nous l’avons vu précédemment, la maturité politique et sociale paraît encore un objectif éloigné.
L’arrivée au pouvoir en 2002 du parti de la justice et du développement, l’AKP, et la nomination de M. Erdogan au poste de Premier ministre ont jeté le trouble sur la fermeté de l’attachement turc au principe de laïcité. L’intérêt turc pour le Moyen-Orient a donné un nouveau coup de projecteur sur cette question puisque cet intérêt serait selon certains commentateurs motivé par une dimension religieuse.
Si les négociations d’adhésion à l’Union européenne ont encouragé de nombreuses réformes, l’évolution de la démocratie en Turquie demeure également un sujet de préoccupation : le respect des droits de l’homme est loin d’être assuré, la réforme constitutionnelle ne semble pas dénuée d’objectifs propres à l’AKP et à son chef et la perte d’influence de l’armée n’est pas nécessairement un signe positif en raison des conditions dans lesquelles elle se produit.
1. Islamisme ou conservatisme religieux ?
L’AKP a toujours été qualifié de parti islamiste puisqu’il était l’héritier de partis islamistes précédemment dissous, le parti lui-même n’ayant jamais revendiqué cette appellation. Dès l’origine, l’ascension de l’AKP a nourri les craintes d’une dérive religieuse du seul Etat avec la France dont la laïcité est inscrite dans la Constitution. L’adoption de la législation sur le port du voile à l’université – avant qu’elle ne soit finalement déclarée inconstitutionnelle – ou le projet de pénalisation de l’adultère ont semblé donner raison à cette analyse. D’après les interlocuteurs rencontrés par la Mission, la réalité est plus nuancée.
Mme Dorothée Schmid souligne qu’il « faut se garder de comparer laïcité française et turque : la société turque est beaucoup plus imprégnée de religion ; le voile y est une réalité sociale. » M. Leguil-Bayard, directeur de recherche au CNRS (12), rappelle ainsi que « la laïcité turque est organisée selon un modèle césaropapiste, hérité de Byzance et de l’Empire ottoman, c’est-à-dire la soumission du religieux au pouvoir politique et à l’Etat. L’islam en Turquie est soumis au Premier ministre par l’intermédiaire d’une direction des affaires religieuses. Par ailleurs, il n’y a pas eu un jeu à somme nulle entre le kémalisme et l’islam. La république turque est une république ethnoconfessionnelle, cela dès 1920 sur toile de fond de purification ethnique contractuelle avec la Grèce. Très souvent l’armée turque et le kémalisme ont joué la carte de l’islam. En 1980, c’est l’armée qui introduit l’enseignement religieux dans le secondaire. La religion a pu être utilisée pour lutter contre le marxisme. »
« La société turque est culturellement conservatrice ; le conservatisme ne progresse pas mais devient plus visible avec une dimension religieuse mais aussi patriarcale qui fait du statut des femmes une question difficile y compris dans les familles laïques. Le conservatisme s’exprime nécessairement par l’islam en Turquie » nous a confié M. Ahmet Insel, doyen de la faculté d’économie de l’Université francophone de Galatasaray.
Selon M. Can Paker, président de la Fondation turque pour les études sociales et économiques (TESEV), 85 à 90 % du peuple turc est satisfait de la séparation entre l’Etat et la religion. Seulement 9 % revendique l’application de la charia et 1 % l’application stricte des règles qui en découlent.
Mme Füsun Türkmen, directrice adjointe du département des relations internationales de l’Université francophone de Galatasaray, a par ailleurs expliqué que, depuis le milieu du XIXème siècle, deux camps s’affrontaient en Turquie sur le plan politique : une élite laïque et jacobine qui souhaitait imposer la modernisation par le haut et un front commun entre conservateurs religieux et libéraux pour résister à la pression de l’Etat. Ce phénomène persiste et l’AKP est issu de la deuxième tendance. Il y a toujours eu en Turquie une perméabilité entre le mouvement religieux et les libéraux.
Il faut en effet comprendre que « l’AKP, parti de coalition, est très hétéroclite et compte en son sein au moins trois tendances qui coexistent dans la société turque : la première qui est le moteur des transformations, la seconde qui accompagne les évolutions, la dernière qui y résiste. » selon M. Hamit Bozarslan, directeur d’études à l’EHESS (13). Il existe donc des tendances extrémistes au sein de l’AKP.
Pour M. Didier Billion, « le terme d’islamisation, souvent employé dans la presse, à propos du parti au pouvoir, l’AKP, est erroné. L’AKP est un parti conservateur en termes de valeurs sociales et sociétales. C’est un parti libéral sur le plan économique. Même si ses racines sont religieuses, il n’est en rien un parti islamiste. Si l’on prend un référent occidental, il faudrait le considérer comme un parti de centre-droit » (14).
« Avec les kémalistes, le conflit est en réalité plus social que religieux. Il y a aujourd’hui une élite anatolienne plus conservatrice donc plus religieuse. C’est un petit patronat très innovant économiquement. C’est du libéralisme économique conservateur. L’AKP a une élite qui a toujours été snobée par l’establishment kémaliste, c’est donc plus un conflit de classe. Pour dire les choses de façon familière, les kémalistes voient dans les dirigeants de l’AKP des " ploucs" auxquels ils ne donneraient pas leur fille en mariage. Le vote AKP religieux ne dépasse pas 5 à 10 % des votes. Tous les autres ont voté pour ne plus voir ces coalitions corrompues, incapables de gouverner et de mener l’agenda européen. C’est un vote d’opposition à l’armée, de démocratisation. D’autre part, la victoire de l’AKP est une victoire réversible. On est dans une démocratie. Le vote AKP est aussi un vote d’intégration au corps national de l’Anatolie et des Kurdes. Les Kurdes ont le choix entre le PKK (15), qui n’est pas vraiment le parti légal puisqu’il est persécuté et interdit, les partis traditionnels de la droite, toujours incapables de régler politiquement la question kurde puisqu’ils étaient aux ordres de l’armée, ou l’AKP » rapporte M. Leguil-Bayart.
D’après les intellectuels turcs avec lesquels la Mission a dialogué à Istanbul, M. Erdogan, issu de l’islamisme politique, a évolué en démocrate musulman ce qui ne l’empêche pas de commettre des impairs au regard de la laïcité : en vertu de cette dernière, le Premier ministre ne peut pas se faire le porte-parole de l’islam comme il l’a fait au sommet de l’OTAN (16).
Pour les diplomates français à Ankara, la Turquie est aujourd’hui à la recherche d’un équilibre entre démocratie et laïcité. M. Pekin Baran veut croire que « la population turque n’acceptera jamais de délaisser la démocratie ni, d’ailleurs, de renoncer à l’adhésion à l’UE pour des raisons purement identitaires ou religieuses. »
Si l’AKP connaît aujourd’hui un phénomène d’érosion, c’est parce qu’il a déçu un électorat aux aspirations composites, voire contradictoires. D’un côté, les conservateurs islamistes qui attendaient un desserrement de l’étau laïc, de l’autre les libéraux qui souhaitaient le changement du régime constitutionnel hérité du coup d’Etat militaire de 1980. Les lacunes démocratiques du Gouvernement AKP sont l’objet de nombreuses critiques en Turquie comme en dehors.
Sous l’influence positive de l’Union européenne, le Gouvernement a certes réalisé des progrès en matière de respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales : abolition de la peine de mort en 2002, suppression des tribunaux de sûreté nationale, réformes en matière de liberté d’association et de presse, adoption d’un nouveau code pénal. De même, le rôle de l’armée dans la société turque tend à s’aligner sur les normes européennes. Enfin, des avancées ont été réalisées en faveur des droits culturels, en particulier à l’égard des citoyens turcs d’origine kurde. Pour M. Leguil-Bayart, « être kurde aujourd’hui en Turquie n’a plus rien à voir avec [ce qu’était] être kurde il y a quelques années. »
Ces avancées se sont notamment traduites par la création d’une chaîne de télévision publique émettant en continu en langue kurde et l’ouverture d’un département de langues orientales (dont le kurde) dans une université publique. Longtemps demeurée taboue, la question kurde est devenue à l’été 2009 une priorité du gouvernement. Les autorités turques – y compris l’armée, du propre aveu de son chef d’État-major – ont pris conscience des limites de la stratégie du « tout militaire » pour résoudre la question kurde, pendant trop longtemps réduite à la seule violence du PKK. Elles ont donc lancé en août 2009 « l’ouverture démocratique ». Alors qu’il visait à favoriser le « vouloir vivre ensemble » turc, ce projet a abouti à l’effet inverse : la population a eu le sentiment d’une ouverture kurde mais non démocratique puisque celle-ci ne visait qu’une partie des habitants. L’interdiction par la Cour constitutionnelle du parti pour une société démocratique (DTP) en décembre 2009 a également porté un coup sévère à ce processus. L’expression politique des Kurdes continue de poser problème puisque le parti de la paix et de la démocratie (BDP), successeur du DTP, entretient le flou quant à son attitude à l’égard du PKK. Parallèlement, la situation sécuritaire demeure tendue : après l’attentat à Istanbul le 22 juin (17) et la reprise des affrontements entre l’armée turque et le PKK dans le sud-est de la Turquie depuis plusieurs semaines (18), les autorités turques s’interrogent sur les moyens d’enrayer ce nouveau cycle de violence. Le Premier ministre semble convaincu de la nécessité de relancer l’ouverture démocratique.
Si l’influence déclinante de l’armée rapproche la Turquie des standards européens, elle est aussi le fruit d’un affrontement très dur avec le Gouvernement. Ce « rempart de la laïcité » a perdu de son prestige auprès de l’opinion publique et de son pouvoir en raison notamment des nombreuses affaires dans lesquelles elle a été impliquée récemment. Certains observateurs voient dans cette perte d’influence le signe que la démocratie progresse en Turquie et que la laïcité se normalise, « sa défense n’appartenant plus seulement à une élite qui trouve là sa raison d’exister ». Pour d’autres, l’affaiblissement de l’armée est un indice supplémentaire de l’islamisation de la société.
En dehors des avancées réelles précitées, des progrès tangibles restent cependant à réaliser dans les domaines des droits des minorités religieuses et de la liberté d’expression notamment. L’un des principaux défis du gouvernement sera enfin de réformer en profondeur la constitution actuelle, instaurée par les militaires en 1982, ce qui augure d’un nouveau bras de fer avec l’armée et le bastion fort de l’establishment kémaliste, la justice.
Les députés de l’opposition que la Mission a rencontrés ont déploré les reculs sur les droits de l’homme :
– en matière de liberté d’expression : le harcèlement fiscal du groupe de presse Dogan qui menace sa survie économique (une amende record de 2,52 milliards de dollars pourrait lui être infligée) est l’exemple le plus frappant des atteintes à la liberté d’expression. 44 journalistes ont par ailleurs signé récemment une tribune pour protester contre les propos du Premier ministre demandant aux patrons de presse de « mieux contrôler leurs chroniqueurs ». La Turquie a été récemment placée « sous surveillance » par Reporters sans frontières. Une forme d’autocensure inquiétante chez les journalistes a été rapportée à la Mission lors de son déplacement en Turquie ;
– pour ce qui est des droits des minorités religieuses : les minorités en Turquie (60 000 Arméniens, 20 000 Juifs, 10 000 Syriaques et 4 000 Grecs orthodoxes) souffrent de discrimination de droit et de fait. Par ailleurs, les autorités turques refusent toujours de reconnaître la personnalité juridique aux communautés religieuses non musulmanes compliquant l’acquisition ou l’administration de propriétés par ces dernières.
Enfin l’indépendance de la justice a aussi été mise en question par les interlocuteurs de la Mission. L’opposition accuse ainsi le gouvernement d’instrumentaliser l’emblématique procès sur l’affaire Ergenekon (réseau mafio-militaire accusé d’avoir voulu fomenter un complot contre le gouvernement) pour marginaliser laïcs et kémalistes. Le Premier ministre se serait, selon elle, posé en procureur de ce procès. A l’inverse, une procédure judiciaire visant à interdire l’AKP a pu aller à son terme avant d’être remise en cause par la Cour constitutionnelle.
Sans se prononcer sur le fond, on peut dire que cette affaire est révélatrice de l’extrême tension qui règne dans la vie politique turque. Pour M. Jean-Christophe Filori (19), cette extrême polarisation entre une classe émergente conservatrice et les ultra-laïques et ultra-nationalistes rend la mise en œuvre des réformes difficile. Mme Schmid ajoute que « si la Turquie renvoie une image d’unité sur la scène internationale, il n’existe pas sur la scène intérieure de culture de la négociation ; les débats donnent lieu à des affrontements très rudes. »
Cette tension risque d’être exacerbée par la discussion du projet de réforme de la Constitution de 1982, héritage du coup d’Etat militaire de 1980. Cette réforme, réclamée par l’Union européenne comme par les libéraux, a été abandonnée une première fois fin 2007 faute de consensus.
Le Gouvernement a présenté début avril un nouveau projet très controversé. Il fait l’objet d’une double lecture : ce projet est interprété par les uns comme un règlement de compte visant à soumettre les dernières institutions (armée et justice) qui résistent à l’hégémonie de l’AKP. Pour ses détracteurs, ce projet serait une parade constitutionnelle aux obstacles qu’a rencontrés l’AKP : durcissement des conditions d’interdiction des partis politiques, réforme de la composition et des pouvoirs de la Cour constitutionnelle avec laquelle l’AKP est en conflit depuis de longs mois sur la désignation de nouveaux magistrats, possibilité pour les tribunaux civils de juger les militaires en cas d’atteinte à la sécurité de l’Etat. Pour ses défenseurs, cette réforme constitue une avancée démocratique puisqu’elle ferait définitivement triompher le civil sur le militaire.
En outre, le Gouvernement a annoncé son intention de soumettre très rapidement ce projet à référendum s’il échouait à obtenir la majorité requise, renforçant les accusations de populisme et d’un abus de la démocratie directe au détriment de la représentation nationale.
Les prochaines élections en Turquie seront déterminantes pour son avenir. A ce jour, la plupart des observateurs parient sur une victoire de l’AKP, moins large cependant que les précédentes. « L’avenir de l’AKP n’est pas menacé, faute de challenger. La crédibilité de l’opposition est minée par l’absence de programme alternatif tandis que l’AKP a intelligemment manœuvré pour élargir sa base électorale » selon Mme Dorothée Schmid. Cette affirmation mérite aujourd’hui d’être nuancée : M. Kemal Kilicdaroglu, nouveau président du principal parti d’opposition, le parti républicain du peuple (CHP), semble un adversaire plus sérieux que son prédécesseur M. Deniz Baykal, sa réputation d’intégrité pouvant constituer un atout face aux soupçons de corruption qui pèsent sur l’AKP.
B – Les alliances stratégiques
Les deux piliers de la politique extérieure turque que sont depuis longtemps les Etats-Unis et Israël s’interrogent sur le devenir de leurs relations avec la Turquie. Alors que celles-ci n’ont pas toujours été sans nuages, les deux pays expriment aujourd’hui des inquiétudes sur la distance que la Turquie semble prendre par rapport à eux et sur les conclusions qui peuvent en être tirées quant aux orientations de la diplomatie turque.
Plusieurs observateurs s’alarment des divergences actuelles entre les Etats-Unis et la Turquie alors que leur alliance stratégique faisait figure de constante de la géopolitique mondiale depuis la fin de la Seconde guerre mondiale. Si l’élection de M. Barack Obama à la présidence a permis le réchauffement d’une relation dégradée depuis l’intervention américaine en Irak, l’évolution de la Turquie suscite actuellement des interrogations aux Etats-Unis.
Il faut rappeler que l’histoire des relations américano-turques est jalonnée d’épisodes de crise.
Après la Seconde guerre mondiale, la Turquie choisit de se ranger sous la protection des Etats-Unis face à la menace soviétique. Il s’ensuit son adhésion à l’OTAN qui intervient en 1952. « Il n’y a pas eu, de la part de la Turquie, un réflexe de suivisme ou une volonté de s’aligner sur la politique américaine, mais un choix fait à l’issue de la Seconde guerre mondiale. Il s’agissait alors pour les Turcs de faire face à la menace soviétique, menace perçue comme redoutable et dont on sait aujourd’hui qu’elle a sans doute été surévaluée. Cela a amené Ankara à rompre avec une sorte de neutralisme kémaliste qui consistait à éviter de s’engager dans des alliances internationales et, au contraire, à mener une politique prônant l’indépendance nationale. C’est sans doute pour cela qu’il a pu y avoir des heurts dans le temps avec les Etats-Unis car les Turcs, même s’ils ont été contraints d’entrer dans une alliance internationale, ont toujours été particulièrement soucieux de la sauvegarde de leur indépendance » estime M. Jean Marcou (20).
Les premiers soubresauts dans la relation apparaissent avec la guerre de 1958 au Liban. En 1963, les Etats-Unis décident de démanteler les fusées Jupiter installées sur le sol turc, provoquant chez les Turcs un sentiment de trahison. En 1964, le Président Johnson menace, dans une lettre restée célèbre, de mettre fin à la protection de l’OTAN en cas d’intervention turque à Chypre. Puis, en 1979, la Turquie s’oppose à une intervention militaire pour la libération des otages américains en Iran. Le dernier épisode en date, et probablement le plus significatif, est le vote de la Grande Assemblée nationale de Turquie (GANT), le 1er mars 2003, refusant l’autorisation aux troupes américaines de passer par le sol turc pour entrer en Irak.
Cette décision parlementaire ouvre une ère de refroidissement de la relation bilatérale pendant la présidence Bush. La guerre en Irak nourrit un antiaméricanisme latent depuis les années 60. L’aide américaine dans la lutte contre le PKK, qualifié d’« ennemi commun » a néanmoins permis un rapprochement, le Président Bush s’étant engagé en ce sens lors des visites du Premier ministre turc puis du Président.
L’arrivée au pouvoir de M. Barack Obama semble refermer cette parenthèse même si les Turcs affirment être l’un des seuls pays à ne pas avoir cédé à l’« Obamania ».
En réservant sa première visite officielle à l’étranger à la Turquie, le Président américain entend marquer l’importance qu’il accorde à ce « partenaire stratégique ».
Dans son discours prononcé devant la GANT le 6 avril 2009, il a séduit son auditoire en renouvelant le soutien américain à l’adhésion à l’Union européenne, en soulignant les défis communs dans la région (Chypre, Moyen-Orient, lutte contre les armes de destruction massive, Irak, lutte contre le terrorisme) et en adressant un message d’ouverture au monde musulman. Il a salué le rôle de la Turquie dans le dialogue avec le monde musulman en vantant sa capacité à être le lieu non pas « où Orient et Occident se séparaient mais où ils se rejoignaient ». Cependant, l’évocation du dossier arménien, sans que le mot de génocide ne soit d’ailleurs prononcé, n’a pas apaisé les inquiétudes nées de l’engagement de M. Barack Obama durant la campagne électorale en faveur d’une reconnaissance du génocide par les Etats-Unis.
Alors que cette visite semblait avoir permis de retisser des liens distendus, l’administration américaine, au vu des nouvelles orientations de la politique étrangère turque, s’interroge aujourd’hui sur le bien-fondé de son « pari sur la Turquie » selon l’expression d’un diplomate français à Washington.
b) Les interrogations américaines
L’Ambassadeur de France à Washington résumait en ces termes en février dernier l’appréciation portée par les Etats-Unis sur la politique étrangère turque : « Le président américain continue de penser qu’il faut soutenir la Turquie, même si Washington est préoccupé par les obstacles que la ratification de l’accord entre l’Arménie et la Turquie, auquel les Américains ont poussé, rencontre au sein du Parlement turc. De plus les déclarations du Premier ministre Recep Erdogan sur l’Iran les inquiètent au plus haut point, de même que les allers-retours du ministre des affaires étrangères turc à Téhéran. Enfin, les relations entre Ankara et Tel-Aviv ne sont pas au beau fixe. Les Américains ont donc conscience que la Turquie donne parfois l’impression d’évoluer de manière préoccupante. C’est la raison pour laquelle il faut, à leurs yeux, plus que jamais rester proche des Turcs pour éviter toute dérive. » (21)
L’ambassadeur des Etats-Unis en Turquie a confirmé à la Mission, en mars dernier, que la Turquie était l’un des alliés les plus importants du Gouvernement Obama, en mettant en avant la croissance économique, l’enracinement de la démocratie, la puissance diplomatique et militaire ainsi que les liens avec l’Union européenne qui caractérisent la Turquie aujourd’hui.
Si la Turquie est un interlocuteur incontestable sur de nombreuses questions stratégiques au premier rang desquelles l’Afghanistan et l’Irak, l’Ambassadeur a néanmoins relevé plusieurs sujets de préoccupation pour les Etats-Unis :
– l’Arménie : les Américains souhaiteraient que l’aboutissement du processus de normalisation – cf. infra – permette une modification de la situation stratégique dans le Caucase dont ils pourraient tirer profit. L’intense investissement de la secrétaire d’Etat Hillary Clinton n’a pas suffi à convaincre les parties de parachever ce processus ;
– l’équilibre entre les forces laïques et la tendance islamique du gouvernement Erdogan ;
– la diplomatie que la Turquie déploie dans les Balkans, la Mer noire et le Moyen-Orient. D’après Mme Dorothée Schmid, « les Américains s’interrogent sur le néo-ottomanisme qui pourrait inspirer la diplomatie turque. »
– l’Iran : les Américains ont regretté l’abstention turque lors du vote par le conseil des gouverneurs de l’AIEA le 27 novembre 2009 condamnant le programme nucléaire iranien. Par ailleurs, ils s’interrogent sur le rôle de facilitateur entre l’Iran et l’Occident que revendique la Turquie et qui ne semble pas avoir produit des résultats sérieux ;
– Israël : les Etats-Unis s’inquiètent de la dégradation des relations avec cet autre allié stratégique dans la région.
Les Etats-Unis constatent à contrecœur que sur plusieurs dossiers, la Turquie est décidée à jouer sa propre partition et que celle-ci met à l’épreuve la communauté d’intérêts stratégiques qui liaient jusqu’alors les deux pays. Le cas de l’OTAN est à cet égard révélateur.
« Le temps de l’alignement sur les Etats-Unis est révolu », comme nous l’a indiqué un responsable français au sein de l’OTAN. L’exemple le plus marquant est l’opposition turque à la nomination de M. Anders Fogh Rasmussen comme secrétaire général de l’Organisation (22). Il semble que les Américains ont dû déployer des trésors de diplomatie pour convaincre les Turcs de lever leur veto. Depuis cet incident, le secrétaire général est d’ailleurs très attentif aux positions turques.
D’autres divergences ont été observées : les Turcs ont milité très activement pour accorder rapidement à la Bosnie-Herzégovine le plan d’action pour l’adhésion (MAP) alors que les Etats-Unis n’y étaient pas favorables. Sur la question des armes nucléaires tactiques, les Turcs plaident pour le statu quo, à rebours du discours d’Obama sur leur réduction. Cela confirme leur volonté d’apparaître comme une puissance régionale y compris au sein de l’OTAN, selon l’interlocuteur de la Mission.
Plus récemment, l’adoption, le 4 mars dernier, par la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants d’une résolution sur la reconnaissance du génocide arménien a provoqué de nouvelles tensions entre les deux pays : l’ambassadeur turc à Washington a été ainsi rappelé début mars dans son pays, pour revenir aux Etats-Unis un mois plus tard. La participation du Premier ministre Erdogan au sommet sur la sécurité nucléaire les 12 et 13 avril derniers n’a été confirmée que tardivement.
Si la politique étrangère turque laisse perplexe l’administration américaine, celle-ci en tire jusqu’à présent la conclusion qu’il convient de consolider l’arrimage de la Turquie à l’Union européenne afin de ne pas précipiter une dérive éventuelle vers la radicalité. La dégradation des relations avec Israël ne peut que renforcer cette conviction.
La Mission considère qu’il appartient aux Européens de décider de l’avenir de l’Union qu’ils ont construite. Il est souhaitable que la France et l’Union européenne continuent à travailler avec les Etats-Unis en partageant leurs analyses, qui semblent convergentes, sur les aspects positifs mais également sur les dangers de la politique étrangère turque actuelle. Compte tenu des reproches entendus par la Mission sur l’absence de l’Europe au Moyen-Orient, celle-ci doit néanmoins faire entendre sa propre voix.
« Même s’il existe des désaccords médiatiques, aucun des deux pays ne souhaite que la nature des relations change ». Cette affirmation de l’ambassadeur turc en Syrie, M. Omer Ohon, en mars dernier, est-elle toujours d’actualité après les événements de Gaza ?
L’arraisonnement meurtrier de la flottille par l’armée israélienne le 31 mai dernier a porté un nouveau coup à une relation bilatérale dégradée. S’il convient de ne pas tirer de conclusions hâtives des déclarations qui ont suivi cet incident, ces dernières témoignent cependant d’une escalade entre les deux pays.
L’arraisonnement de la flottille et les déclarations qui l’ont suivi
Dans la nuit du 31 mai, l’arraisonnement par l’armée israélienne de la « flottille de la liberté », composée de six navires qui entendaient forcer le blocus de Gaza en dépit des avertissements israéliens a causé la mort de neuf passagers, dont 8 étaient des ressortissants turcs. La Turquie a violemment réagi : les déclarations virulentes des responsables politiques ont accompagné une vive émotion populaire. Le Premier ministre, M. Erdogan, a estimé qu’avec ce « massacre sanglant », « rien ne serait plus pareil ». Il a mis en garde Israël contre la tentation de tester la patience turque. Le ministre des affaires étrangères, M. Davutoglu, a qualifié l’intervention israélienne de « 11 septembre » sur le plan psychologique pour la Turquie. Le président de la commission des affaires étrangères a comparé l’attaque israélienne à celle de pirates somaliens. Cet incident a par ailleurs été l’occasion pour le Premier turc de réitérer ses propos indulgents à l’égard du Hamas.
Outre un activisme diplomatique pour convaincre la communauté internationale de condamner l’opération israélienne, la réprobation turque s’est traduite par le rappel de son ambassadeur, l’exigence d’une enquête internationale et la demande d’excuses de la part d’Israël. Elle a par ailleurs fermé son espace aérien à un vol militaire israélien le 28 juin. Les accords militaires n’ont à ce jour pas été remis en question.
Lors de son audition par la commission des Affaires étrangères le 17 juin, le vice-ministre israélien des affaires étrangères, M. Danny Ayalon a déclaré : « Israël ne veut pas perdre l’amitié de la Turquie et utilise la voie diplomatique pour maintenir de bonnes relations. Si les autorités turques ont décidé de changer leur orientation, c’est le résultat du choix de l’AKP. Soit le gouvernement décide d’être raisonnable, soit il préfère tenir un discours afin de plaire à la rue arabe. J’ai beaucoup de mal à comprendre le lien qui existe entre l’AKP et le Hamas alors que celui-ci s’oppose aux intérêts de l’Autorité palestinienne, de l’Egypte et de l’ensemble des Etats du Golfe. Il est évident qu’Israël ne peut pas à lui seul infléchir les choix diplomatiques turcs. Il serait intéressant de comprendre ce que veut le Premier ministre Erdogan ! Qu’est-ce que la Turquie fera si l’IHH (Fondation pour les droits de l’homme et pour l’aide humanitaire) décide d’affréter une nouvelle flottille pour Gaza ? Acceptera-t-elle de faire pression sur le Hamas, de concéder des gestes en direction de l’Autorité palestinienne et d’Israël ? Que penser du vote de la Turquie contre le nouveau train de sanctions décidées par le Conseil de sécurité ? Le Liban lui-même s’est abstenu car son vote reflète la position de la Ligue arabe pour laquelle l’Iran constitue une véritable menace. Pourquoi la Turquie a-t-elle fait un choix différent ? Il est bien difficile d’apporter des réponses à toutes ces questions. » Il a également souhaité que l’ONG turque IHH soit officiellement reconnue comme une organisation terroriste.
Avant de répondre aux questions que pose cette évolution, il est nécessaire de revenir sur l’historique d’une relation stratégique, ainsi que sur les épisodes récents qui ont provoqué ou symbolisé son altération.
a) Une relation stratégique chaotique
Pendant longtemps, Israël a fait figure de partenaire stratégique de la Turquie, à côté des Etats-Unis.
La Turquie est, en 1948, le premier Etat musulman à reconnaître l’Etat d’Israël ce qui lui vaudra la réprobation, encore perceptible chez certains, de nombreux pays arabes.
Pendant la guerre froide, la Turquie observe une relative neutralité à l’égard du conflit israélo-palestinien. David Ben Gourion et Golda Meir se rendent néanmoins en Turquie en août 1958 pour conclure un accord secret par lequel les deux pays s’engagent à échanger des informations et à ne pas porter atteinte aux intérêts de l’autre. Après le froid consécutif à la guerre des Six jours, un nouveau rapprochement s’opère à la suite du coup d’Etat de 1980, l’armée turque étant perçue par les Israéliens comme un rempart contre le risque d’islamisation de la région.
La fin de la guerre froide précipite la consolidation des relations entre les deux pays. Alors que les relations diplomatiques furent longtemps établies à un faible niveau – Israël disposant d’un consulat à Istanbul et d’une mission à Ankara mais pas d’ambassade – suite notamment à la conférence de Madrid, les missions diplomatiques des deux pays ont été élevées au rang d’ambassades en décembre 1991.
Le 31 mars 1994, le Premier ministre turc signe un accord garantissant la confidentialité des échanges de renseignements. Le 23 février 1996, un accord de coopération militaire est conclu. Un second accord est consacré aux questions d’armement. En 1998, Israël fait pression sur la Syrie au moment où la Turquie mobilise son armée à la frontière syrienne pour obtenir l’expulsion du leader kurde, Abdullah Öcalan.
De nombreux partenariats économiques sont également noués. « Les catalyseurs économiques – au premier rang desquels le tourisme – ne sont pas négligeables : la Turquie est la première destination pour les touristes israéliens mais leur nombre est passé de 500 000 à 200 000 entre 2005 et aujourd’hui » a fait observer l’ambassadeur d’Israël en France (23).
Deux importants projets sont aussi mis à l’étude : la construction d’un oléoduc reliant le terminal pétrolier de Ceyhan à celui d’Ashkelon pour acheminer en Israël du pétrole en provenance de la mer Caspienne ; un projet d’importation d’eau, incluant la Palestine et la Jordanie, depuis le fleuve Manavgat en Anatolie.
La seconde Intifada, à l’automne 2000, place la Turquie dans une position délicate, tiraillée qu’elle est entre son attachement au peuple palestinien et sa relation privilégiée avec Israël. Cet événement provoque donc les premiers accrocs dans la relation bilatérale.
Après l’arrivée au pouvoir de l’AKP, l’intervention américaine en Irak en 2003 et la guerre du Liban en 2006 sont autant de sujets de tensions. En dépit d’un tangage consécutif à l’élection d’Abdullah Gül à la présidence de la République, la relation demeure bonne permettant même à la Turquie de tenir le rôle de médiateur dans les négociations entre Israël et la Syrie. Cette relation harmonieuse est d’abord entamée par la guerre de janvier 2009 à Gaza.
Quelques jours avant le déclenchement de l’opération militaire israélienne à Gaza fin décembre 2008, le Premier ministre Ehud Olmert se trouve à Ankara pour les négociations avec la Syrie dont la Turquie assure la médiation. Il n’évoque pas l’imminence de l’attaque lorsqu’il doit retourner précipitamment en Israël. Cet épisode a été vécu par les autorités turques comme une trahison et un manque de confiance manifeste de la part des Israéliens. Par ailleurs, la population turque, comme de nombreuses opinions publiques de par le monde, a été choquée par la violence et la disproportion de l’intervention israélienne.
Le 28 janvier 2009, le Premier ministre Erdogan quitte avec fracas un débat au forum de Davos avec M. Shimon Peres afin de protester contre la répartition inéquitable du temps de parole, non sans lui avoir auparavant lancé « je pense que vous devez vous sentir un peu coupable. (...) Vous avez tué des gens. Je me souviens des enfants qui sont morts sur des plages ». Ce coup d’éclat, certainement calculé, quelques jours après la fin de la guerre à Gaza, lui vaut la sympathie de ses concitoyens et en fait également le héros de la « rue arabe ».
Quelques semaines plus tard, l’arrivée au pouvoir de Benyamin Netanyahou et la nomination au poste de ministre des affaires étrangères de M. Avigdor Lieberman ne contribuent pas à l’apaisement.
Depuis cette date, en dépit de quelques signes de détente, de nombreux incidents ont émaillé les relations turco-israéliennes : annulation de contrats et des manœuvres militaires conjointes « Aigle anatolien » le 12 octobre 2009, refus de livraison de drones, etc.
L’année 2010 est marquée par un regain de tension : la convocation de l’ambassadeur turc en Israël, M. Oguz Celikkol, par le vice-ministre des affaires étrangères, M. Danny Ayalon en est l’exemple le plus frappant : cette entrevue, qui visait à protester contre la diffusion en Turquie d’une série télévisée considérée comme antisémite, vire à l’humiliation pour l’ambassadeur turc. Israël présentera des excuses.
b) Rupture ou réévaluation après l’arraisonnement de « la flottille » ?
Après avoir entendu de nombreux observateurs et acteurs de la relation turco-israélienne, la Mission estime que trois questions se posent : quelle est l’ampleur de la détérioration de la relation ? Celle-ci est-elle structurelle ou conjoncturelle ? Est-elle le symptôme d’une radicalisation de la Turquie ?
Avant les événements au large de Gaza, on pouvait considérer, à l’instar de l’ambassadeur israélien en France, que la relation israélo-turque « a connu des hauts et des bas ; récemment, les bas ont été plus nombreux mais il est nécessaire de prendre du recul et de ne pas accorder trop de poids aux turbulences du moment. Selon l’analyse israélienne, en dépit de ces aléas, la centralité de la relation n’est pas remise en question. Il est vrai que l’atmosphère évolue parce que la Turquie et la région changent mais les fondations demeurent solides. »
De nombreuses voix s’élèvent aujourd’hui pour demander, comme M. Pierre Razoux, « si la Turquie n’est pas en train de changer de camp » (24).
Rien ne permet d’affirmer à ce jour que la flottille a provoqué des dégâts irréversibles entre les deux pays. En dépit des déclarations, on peut penser qu’il reste dans l’intérêt de la Turquie de maintenir des relations désormais cordiales avec Israël si elle veut confirmer son statut d’interlocuteur capable de parler à tout le monde.
On peut par ailleurs constater, comme M. Peter Harling (25), que la relation avec Israël était déjà affaiblie avant même la guerre de Gaza. Il rappelle aussi que les relations israélo-turques ont toujours été indexées sur le conflit israélo-palestinien. Les relations exceptionnelles dans les années 90 se sont approfondies à la faveur du processus de paix et de l’implication américaine. Pour Israël, la Turquie était une porte d’entrée à l’OTAN ainsi que le seul allié lui permettant de rompre son isolement dans la région.
Pendant longtemps, les intérêts respectifs des deux parties convergeaient pour entretenir des relations stables. Pour la Turquie, l’alliance avec Israël visait trois objectifs : le soutien d’Israël pour se rapprocher d’une part, de l’Union européenne et d’autre part des Etats-Unis notamment afin de contrebalancer l’influence des groupes de pression arméniens ; l’aide israélienne pour lutter contre le PKK et intimider la Syrie sur cette question.
Or aujourd’hui, la perspective européenne s’éloigne, la Turquie a les moyens de gérer la question arménienne, les relations avec les Etats-Unis sont en voie d’amélioration, la Syrie est l’amie de la Turquie… autant d’éléments qui atténuent le caractère essentiel pour la Turquie d’une alliance avec Israël. Le président de la Commission des affaires étrangères de la Knesset, M. Tzachi Hanegbi, admet ainsi que la Turquie a aujourd’hui moins à perdre d’une détérioration de ses relations avec Israël, notamment parce que l’empathie américaine à l’égard d’Israël faiblit. Il faut ajouter que l’influence déclinante de l’armée sape les fondements de la coopération militaire tandis que la puissance économique offre de nombreux autres débouchés aux entreprises turques et que celles-ci ont en partie comblé leur retard technologique.
En outre, l’escalade à laquelle nous assistons est d’abord imputée au Premier ministre Erdogan, coutumier des déclarations outrancières et populistes. Le président de la commission des affaires étrangères de la Knesset souligne ainsi que les mots employés par M. Erdogan ne sont même pas ceux que prononcent les ennemis traditionnels d’Israël.
Enfin, un consensus parmi les interlocuteurs de la Mission se dégage pour souligner l’influence des déboires européens de la Turquie dans son attitude actuelle au Moyen-Orient. A rebours de cette idée, le vice-ministre israélien des affaires étrangères, M. Danny Ayalon, estime qu’il s’agit là d’une fausse excuse et que ce sont les changements de la société turque ainsi que les aspirations idéologiques du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères turcs qui expliquent ce changement. Le député M. Robert Tiviaev observe également que, pour conquérir le monde musulman, Israël est le sacrifice le moins douloureux.
Il est vrai que la proximité affichée par la Turquie avec le Hamas ainsi que son attitude conciliante à l’égard de l’Iran ne peuvent que susciter la désapprobation israélienne et nourrir les craintes d’une radicalisation turque. Cela renforce paradoxalement leur position dans la recherche d’une solution au conflit israélo-palestinien.
Parallèlement, Israël occupe désormais une position d’Etat partenaire privilégié au sein du Dialogue méditerranéen de l’OTAN. Par ailleurs, la coalition au pouvoir actuellement est obligée de composer avec les deux seuls partis – russophones et ultrareligieux – qui étaient opposés de longue date à la relation stratégique avec la Turquie. Cependant, une rupture avec la Turquie renforcerait son isolement diplomatique sur la scène régionale.
Israël semble donc aujourd’hui plus en position de demandeur. Sur l’évolution future de la relation, le président de la commission des affaires étrangères de la Knesset confiait à la Mission que « l’équation comporte trop d’inconnues ». Le vice-ministre des affaires étrangères estime pour sa part qu’il appartient à l’Union européenne de tendre un miroir à la Turquie et de lui demander de choisir.
Sur cette question, la Mission considère qu’Israël comme la Turquie ont intérêt à rétablir des relations normales, à défaut d’être privilégiées, le premier pour rompre son isolement régional, la seconde pour consolider son statut de pacificateur de la région. Afin de parvenir à ce rétablissement souhaitable, la Turquie doit en finir avec ses déclarations qui mettent en cause la légitimité de l’Etat d’Israël.
C – L’Union européenne, entre dépit et incompréhension
Après l’euphorie qui a suivi l’ouverture des négociations d’adhésion à l’Union européenne, la Turquie comme l’Union européenne semblent victimes de désenchantement. Le processus est enlisé faute de progrès suffisants de la part de la Turquie dans les réformes et de soutien de la population. Les opinions publiques européennes, relayées par certains gouvernements, doutent du bien-fondé d’une adhésion turque. Chaque partie se renvoie la responsabilité de l’impasse actuelle. La Mission souhaite réfléchir aux conditions d’une évolution constructive de cette situation.
1. Les promesses de la négociation
La Turquie a manifesté dès 1959 son désir d’adhérer à l’Union européenne. En réponse, l’Union européenne a proposé la conclusion d’un accord d’association, « l’accord d’Ankara », signé le 12 septembre 1963 (26), qui prévoit un renforcement des relations économiques et commerciales permettant d’aboutir à une union douanière.
Son préambule indique que « l’appui apporté par la Communauté économique européenne aux efforts du peuple turc pour améliorer son niveau de vie facilitera ultérieurement l’adhésion de la Turquie à la Communauté ». L’article 28 précise également que : « lorsque le fonctionnement de l’accord aura permis d’envisager l’acceptation intégrale de la part de la Turquie des obligations découlant du traité instituant la Communauté, les parties contractantes examineront la possibilité d’une adhésion de la Turquie à la Communauté. » S’appuyant sur ces stipulations, les autorités turques ne manquent pas de rappeler qu’un engagement a ainsi été pris de longue date.
La Turquie dépose, pour la première fois, en avril 1987, sa demande d’adhésion.
Si la Commission et le Conseil refusent l’ouverture des négociations d’adhésion en 1990, le processus d’intégration économique est relancé. L’Union douanière, prévue par l’accord de 1959, entre en vigueur le 1er juillet 1996. Elle comprend : la libre circulation des marchandises ; la politique commerciale et une politique de préférences tarifaires communes ; des dispositions douanières et le rapprochement des législations, y compris dans les domaines de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, de la concurrence et de la fiscalité. La Turquie est depuis lors le seul pays non-membre bénéficiant d’une union douanière avec l’Union européenne.
C’est lors du Conseil européen de décembre 1999 à Helsinki que la Turquie obtient le statut de candidat. La déclaration faite à l’issue de ce Conseil européen indique que « la Turquie est un pays candidat, qui a vocation à rejoindre l’Union sur la base des mêmes critères que ceux qui s’appliquent aux autres candidats ». Le Conseil européen précise aussi « qu’une condition préalable à l’ouverture de négociations d’adhésion est le respect des critères politiques de Copenhague ». Il décide le lancement d’une stratégie de préadhésion pour la Turquie.
Le 17 décembre 2004, le Conseil européen décide que la Turquie remplit suffisamment les critères politiques de Copenhague pour que soient ouvertes des négociations d’adhésion. Il pose cependant, comme condition préalable, l’adoption par la Turquie de six lois et la signature d’un protocole additionnel à l’accord d’Ankara visant à étendre cet accord aux nouveaux Etats membres, invite la Commission à présenter au Conseil une proposition relative à un cadre de négociation avec la Turquie et demande au Conseil de l’Union de parvenir à un accord sur ce cadre en vue de l’ouverture de négociations le 3 octobre 2005.
Les conclusions du Conseil rappellent que « l’objectif commun des négociations est l’adhésion. Ces négociations sont un processus ouvert dont l’issue ne peut pas être garantie à l’avance. Tout en tenant compte de l’ensemble des critères de Copenhague, si l’État candidat n’est pas en mesure d’assumer intégralement toutes les obligations liées à la qualité de membre, il convient de veiller à ce que l’État candidat concerné soit pleinement ancré dans les structures européennes par le lien le plus fort possible. »
Le 29 juillet 2005, la Turquie et l’Union européenne signent le protocole additionnel à l’accord d’Ankara (27) mais la Turquie l’assortit d’une déclaration unilatérale dans laquelle elle affirme qu’elle ne reconnaît pas l’un des Etats membres, la République de Chypre. Cette réserve est à l’origine de nombreuses difficultés que rencontre la Turquie dans les négociations.
Le cadre des négociations, proposé par la Commission en juin, est adopté par le Conseil à la date prévue, le 3 octobre 2005. Il comprend 35 chapitres.
Les 35 chapitres de négociation
1. Libre circulation des marchandises
2. Libre circulation des travailleurs
3. Droit d’établissement et de libre prestation de services
4. Libre circulation des capitaux
5. Marchés publics
6. Droit des sociétés
7. Droit de la propriété intellectuelle
8. Politique de la concurrence
9. Services financiers
10. Société de l’information et médias
11. Agriculture et développement rural
12. Sécurité sanitaire des aliments, politique vétérinaire et phytosanitaire
13. Pêche
14. Politique des transports
15. Énergie
16. Fiscalité
17. Politique économique et monétaire
18. Statistiques
19. Politique sociale et emploi
20. Politique d’entreprise et politique industrielle
21. Réseaux transeuropéens
22. Politique régionale et coordination des instruments structurels
23. Pouvoir judiciaire et droits fondamentaux
24. Justice, liberté et sécurité
25. Science et recherche
26. Éducation et culture
27. Environnement
28. Protection des consommateurs et de la santé
29. Union douanière
30. Relations extérieures
31. Politique extérieure de sécurité et de défense
32. Contrôle financier
33. Dispositions financières et budgétaires
34. Institutions
35. Questions diverses
Près de cinq ans après le début du processus, 12 chapitres sont ouverts : science et recherche, entreprise et politique industrielle, statistiques, contrôle financier, réseaux transeuropéens, protection du consommateur et santé, droit des sociétés, propriété intellectuelle, libre circulation des capitaux, société de l’information, fiscalité, environnement. Un chapitre (science et recherche) a été clos provisoirement. Depuis le Conseil européen de décembre 2006, aucun chapitre ouvert ne peut être clos, en raison du refus de la Turquie d’appliquer le protocole additionnel à l’accord d’Ankara étendant l’union douanière UE-Turquie à Chypre, tant qu’elle maintient des restrictions à l’encontre des navires et aéronefs chypriotes.
La France, durant sa présidence, a réussi à ouvrir deux chapitres alors qu’elle était soupçonnée de freiner la poursuite des négociations.
Par ailleurs, 18 chapitres sont bloqués à des titres divers :
– la France est opposée à l’ouverture de cinq chapitres qui peuvent préjuger de l’adhésion pleine et entière : agriculture, politique économique et monétaire, politique régionale, budget, et institutions ;
– l’ouverture de huit chapitres liés à l’union douanière UE-Turquie est gelée depuis le Conseil européen de décembre 2006, en raison de la non-application du protocole d’Ankara ;
– cinq chapitres pour lesquels la Turquie est techniquement prête sont bloqués par un ou plusieurs autres Etats membres : celui de l’énergie par Chypre depuis début 2007 en raison de la contestation par la Turquie de la légitimité de l’exploration pétrolière de sa zone économique exclusive (ZEE) et de nombreux incidents impliquant la marine turque dans cette zone, celui de l’éducation et la culture, par Chypre et la Grèce pour la prise en compte du droit à l’éducation de la minorité grecque en Turquie et la protection du patrimoine culturel chypriote grec dans la partie nord de l’île de Chypre et celui de la libre circulation des travailleurs, par l’Allemagne et l’Autriche ;
L’ouverture des négociations fut un incontestable succès de la politique de l’AKP qui en avait fait un objectif prioritaire pendant la campagne électorale de 2002. Cet engagement lui avait notamment permis d’élargir sa base électorale, le projet européen séduisant à la fois l’électorat populaire, les intellectuels proches de la gauche et les élites kémalistes. « Le parti était très attendu sur la scène internationale : la volonté de mettre l’Europe au cœur des programmes répondait à un objectif de crédibilisation. Dans les premières années, le programme de réforme fut donc très européen. L’Union européenne a permis à la Turquie de revendiquer son rôle de frontière de l’Europe » raconte Mme Dorothée Schmid.
Sous l’impulsion du Premier ministre, M. Erdogan, le gouvernement turc a adossé l’ensemble de sa politique à la perspective européenne et a fait de l’adhésion un objectif stratégique.
Cette politique a été jusqu’à présent largement couronnée de succès et elle a permis au Gouvernement turc de procéder à une modernisation en profondeur de son pays par l’adoption de plusieurs paquets législatifs. Parallèlement, le Gouvernement a réalisé d’importants progrès en matière de respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales (cf. supra).
En dépit de ces débuts prometteurs, un constat s’impose : le processus de négociation s’essouffle. Aujourd’hui, la « réserve » de chapitres « ouvrables » est donc réduite à quatre chapitres (« politique sociale et emploi », « marchés publics », « concurrence » et « sécurité alimentaire »), le dernier chapitre, celui des questions diverses étant traditionnellement réservé à la fin des négociations. Les quatre chapitres ouvrables sont tous très difficiles à mettre en œuvre. L’Espagne, pourtant favorable à l’adhésion, n’est parvenue durant sa présidence à ouvrir que le seul chapitre sur la sécurité alimentaire.
Union européenne et Turquie se renvoient actuellement la responsabilité de l’enlisement du processus de négociations.
2. Dépit ou renoncement turc ?
Depuis plusieurs années déjà, l’élan européen du Gouvernement turc semble fléchir. Les insuffisances tant en termes d’ampleur que de rythme des réformes sont régulièrement soulignées par la Commission et le Parlement européens. Afin de démentir l’inquiétude européenne, début 2009, un nouveau négociateur en chef, M. Egemen Bagis, élevé au rang de ministre d’Etat, a été nommé et un programme national de reprise de l’acquis communautaire présenté. Mme Ayse Sezgin, sous-secrétaire d’Etat adjoint en charge de l’Europe, a ainsi assuré à la Mission que le groupe de monitoring des réformes, qui est la force motrice depuis 2003, se réunit de nouveau tous les deux mois. La Commission européenne, dans son dernier rapport de progrès, ne paraît pourtant pas convaincue. Les conclusions du Conseil faisant suite à ce rapport en témoignent, tout en pointant les progrès accomplis :
Conclusions du Conseil de l’Union européenne du 7 décembre 2009 (extraits)
Le Conseil invite la Turquie à intensifier le rythme des réformes et à mettre en œuvre les mesures engagées. Des efforts supplémentaires en vue d’assurer le plein respect par la Turquie des critères de Copenhague sont nécessaires dans plusieurs domaines, notamment la liberté d’expression, la liberté de la presse, la liberté de culte en droit et en pratique pour toutes les communautés religieuses, le respect des droits en matière de propriété, les droits des syndicats, les droits des personnes appartenant à des minorités, le contrôle civil des forces militaires, les droits des femmes et des enfants, la lutte contre la discrimination et l’égalité entre les hommes et les femmes. Le Conseil salue la volonté exprimée par le gouvernement d’intensifier ses efforts en matière de lutte contre la torture et les mauvais traitements, ainsi qu’en matière de lutte contre l’impunité.
Le Conseil note que les négociations d’adhésion ont atteint un stade plus difficile, exigeant de la Turquie qu’elle redouble d’efforts pour satisfaire aux conditions définies. En progressant dans la satisfaction des critères d’ouverture et de clôture ainsi que des exigences définies dans le cadre de négociation, qui couvrent notamment la mise en œuvre du partenariat pour l’adhésion et le respect des obligations découlant de l’accord d’association, la Turquie sera à même d’accélérer le rythme des négociations.
M. Marc Pierini, chef de la délégation de la Commission européenne en Turquie, estime qu’après avoir traité des sujets anodins, le processus de négociation est parvenu aux chapitres qui coûtent le plus sur le plan intérieur.
Au-delà de l’hypothèque chypriote, sur laquelle aucun mouvement de la part des Turcs n’est perceptible, la Mission, au diapason de nombreux observateurs, s’est donc interrogée sur la place qu’occupe aujourd’hui l’Union européenne dans l’agenda politique turc.
L’opinion publique turque semble remettre en cause son soutien à l’adhésion. « Jusqu’en 2005, cette perspective a donné lieu à un grand élan fédérateur et réformateur. Cet enthousiasme est aujourd’hui douché par l’adhésion chypriote et les déclarations de certains Etats membres. Les responsables turcs s’étonnent qu’on leur demande des efforts politiquement risqués et économiquement coûteux alors que la porte est fermée. L’opinion publique affiche un désenchantement spectaculaire mais qui n’est pas irréversible » selon l’analyse d’un responsable de la Commission européenne. Il convient néanmoins de noter que les députés de la Grande Assemblée nationale de Turquie (GANT) que la Mission a rencontrés ont confirmé le consensus entre les partis sur la question européenne.
La Turquie s’interroge sur les bénéfices réels de l’adhésion. La crise financière a ainsi mis en lumière l’incertitude des retombées économiques de l’intégration qui ont toujours constitué l’une des motivations principales de la démarche turque.
En outre, une nouvelle question essentielle se fait jour : en dépit de l’affichage, on ne peut affirmer que la Turquie souhaitera in fine adhérer. Le choix de transférer sa souveraineté n’est en effet pas une évidence pour la Turquie ; le débat sur le partage de souveraineté qu’implique l’adhésion n’a pas encore eu lieu et son issue est incertaine tant la fierté nationale pèse.
Enfin, le reproche a été fait à maintes reprises lors du déplacement de la Mission en Turquie d’une présentation erronée de la réalité turque. Mme Ayse Sezgin a ainsi plaidé pour un examen de la candidature turque fondé sur les réalités actuelles. Elle a passé en revue les inquiétudes européennes à l’égard de la Turquie pour les réfuter : la diversité culturelle est déjà présente au sein de l’Union européenne ; l’UE repose sur le partage de valeurs et d’un destin communs auxquels la Turquie aspire également. Le risque d’épuiser les ressources financières de l’UE n’est pas avéré dès lors que la Turquie a prouvé sa capacité à se développer par elle-même. L’afflux de travailleurs turcs ne se produira pas si le niveau de vie en Turquie s’améliore.
Si l’incertitude plane sur la volonté et la capacité turques à mettre en œuvre les réformes nécessaires, les interlocuteurs de la mission ont tous réaffirmé que l’adhésion demeure une priorité pour la Turquie.
« L’adhésion à l’Union européenne est perçue en Turquie comme une opportunité de modernisation, comme la possibilité d’être invité « à la table des grands » et enfin comme « une source de dynamisme économique grâce aux investissements étrangers » d’après les responsables de la Commission européenne.
Afin de souligner l’intérêt pour la Turquie de conserver une perspective européenne, l’un des interlocuteurs turcs de la Mission a qualifié l’Union européenne de « deus ex machina provoquant la démocratisation et aidant la Turquie à combattre ses propres démons ».
Les personnes rencontrées ont également attiré l’attention de la Mission sur les conséquences désastreuses pour la détermination turque de nombreuses prises de position refusant la perspective de l’adhésion.
3. Les hésitations européennes
Les déclarations du Président de la République française ainsi que la campagne pour les élections européennes ont laissé des traces en Turquie, plus semble t-il que les déclarations allemandes qui étaient plus attendues.
Les relations franco-turques
La loi du 29 janvier 2001 reconnaissant le génocide arménien et plus encore l’adoption par l’Assemblée nationale le 12 octobre 2006 de la proposition de loi tendant à pénaliser la négation du génocide arménien ont été à l’origine des premiers remous sérieux dans les relations franco-turques alors que la France entretient depuis 1484 avec l’Empire ottoman puis la Turquie, l’une de ses plus longues relations diplomatiques.
Le second épisode de tension a été la position du candidat à l’élection présidentielle M. Nicolas Sarkozy. Contrairement au Président Chirac qui soutenait l’adhésion turque à l’Union européenne, celui-ci considère que la « Turquie n’a pas vocation à devenir membre de l’Europe ».
« La France ne s’opposera pas à ce que de nouveaux chapitres de la négociation entre l’Union et la Turquie soient ouverts dans les mois et les années qui viennent, à condition que ces chapitres soient compatibles avec les deux visions possibles de l’avenir de leurs relations : soit l’adhésion, soit une association aussi étroite que possible sans aller jusqu’à l’adhésion. Chacun sait que je ne suis favorable qu’à l’association. Je pense que cette idée d’association sera un jour reconnue par tous comme la plus raisonnable. En attendant, comme le Premier ministre Erdogan, je souhaite que la Turquie et la France renouent les liens privilégiés qu’elles ont tissés au fil d’une longue histoire partagée. Sur les trente-cinq chapitres qu’il reste à ouvrir, trente sont compatibles avec l’association. Cinq ne sont compatibles qu’avec l’adhésion. J’ai dit au Premier ministre turc : occupons-nous des trente compatibles avec l’association, on verra pour la suite » (28). Ainsi, M. Nicolas Sarkozy justifiait-il le blocage à la demande de la France de cinq chapitres de la négociation.
La présidence française de l’Union européenne avait ensuite suscité de nombreuses craintes quant à la poursuite des négociations qui ont cependant été apaisées par l’ouverture de deux nouveaux chapitres.
La réforme constitutionnelle – avec la proposition d’un référendum sur les futurs élargissements de l’Union européenne qui visait très clairement la Turquie – et la campagne des élections européennes ont de nouveau été l’occasion de déclarations très mal reçues en Turquie.
La Mission regrette que des préoccupations de politique intérieure soient venues plusieurs fois perturber les relations entre nos deux pays.
Plusieurs signes sont aujourd’hui encourageants : la saison de la Turquie en France a été un véritable succès ; les relations politiques bilatérales s’intensifient comme en témoignent les nombreuses visites de membres du Gouvernement ou de parlementaires des deux pays ; enfin, le Président français a fait part à au Premier ministre turc, lors de sa visite à Paris en avril dernier, de son intention de se rendre en Turquie à l’automne. Cette annonce est heureuse tant les relations franco-turques ont besoin de marques de confiance réciproques pour développer un potentiel largement sous-exploité.
Le refus de l’adhésion que symbolise le blocage de certains chapitres par la France ainsi que les propos déniant à la Turquie sa vocation européenne ont été vécus comme une humiliation en Turquie. Par ailleurs, les Turcs jugent anormal que « les règles du jeu soient modifiées en cours de match » selon l’expression d’un diplomate français.
La proposition d’un partenariat privilégié a également été particulièrement mal reçue : non seulement elle est contraire à la promesse européenne, mais elle confirme le sentiment turc de « double standard » en comparaison par exemple du sort réservé à la Croatie (30 chapitres ouverts, 17 fermés). En outre, elle apparaît comme un slogan dépourvu de contenu. Cette proposition semble avoir disparu des discours actuels.
L’opposition des opinions publiques européennes, au premier rang desquelles l’opinion française, n’est pas étrangère aux réserves émises par plusieurs gouvernements quant à la perspective de l’adhésion.
Pour le représentant permanent de la Turquie auprès de l’Union européenne, la Turquie est consciente que l’adhésion n’est pas pour demain ; il importe néanmoins de maintenir le processus dans son intégralité et son intégrité ; au nom d’engagements très anciens, le processus doit se dérouler honnêtement et comme prévu, sans interférences politiques.
« Fermer la porte aujourd’hui n’est pas raisonnable : l’adhésion doit être appréciée au moment où la question se pose vraiment » : M. Yasar Yakis, député et ancien ministre des affaires étrangères, résume ici un discours très répandu chez les responsables politiques turcs.
4. Quelle Europe pour quelle Turquie ?
Il apparaît clairement que l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne soulève des questions fondamentales pour l’une comme pour l’autre.
Dans l’état actuel, l’Union européenne n’est pas prête pour un élargissement à la Turquie. Elle doit d’abord « digérer » le traité de Lisbonne, réfléchir à son devenir et répondre à cette question : le futur projet européen est-il compatible avec l’adhésion de la Turquie ? L’Europe ne sera en mesure d’absorber la Turquie que lorsqu’elle aura retrouvé pleine confiance en elle et que la situation économique sera rétablie.
Outre les inconvénients qui sont d’ores et déjà largement soulignés, elle devra également, le moment venu, considérer les atouts d’une adhésion turque. L’adhésion turque renforcerait les capacités d’action de l’UE tant sur le plan militaire que diplomatique, donnant ainsi un sens à l’Europe puissance. Elle serait aussi l’occasion de construire enfin ce pont entre l’Orient et l’Occident. Elle apporterait en outre beaucoup en termes économiques, en raison du potentiel de croissance turc.
M. Murat Mercan, président de la commission des affaires étrangères de la GANT, estime que l’Union européenne sera à long terme placé devant un choix : soit elle choisit de devenir une force globale mondiale et son intérêt est d’accueillir la Turquie, soit elle choisit de rester une union économique qui s’affaiblira de plus en plus. Partageant cette idée, M. Engin Soysal, sous-secrétaire d’Etat adjoint en charge du Moyen-Orient, considère que la perception future de l’Europe dépendra de sa capacité à prendre en compte les changements de la géopolitique mondiale et à leur apporter des réponses.
Selon M. Yasar Yakis, la Turquie doit de son côté utiliser le processus pour mettre de l’ordre à l’intérieur et faire de la Turquie une meilleure démocratie et une économie plus transparente. Pour le courant moderniste en Turquie, le processus exerce une pression bienvenue en faveur de l’ouverture et de la modernisation du pays ; il constitue par ailleurs un multiplicateur d’influence.
Il paraît clair aujourd’hui aux nombreux connaisseurs et acteurs de la Turquie que la Mission a rencontrés que les déboires européens de la Turquie sont pour une part à l’origine de son virage en faveur du Moyen-Orient.
La Mission est sensible à cette analyse qui place en quelque sorte les dirigeants de l’Union européenne devant leurs responsabilités. Il est en effet difficile de déplorer un basculement de la Turquie vers le monde arabe et dans le même temps de ne rien faire pour le contrebalancer.
La Mission considère que si l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne est un audacieux pari sur l’avenir qu’il appartiendra aux futurs élus de la Nation de prendre ou pas, il est important aujourd’hui de ne pas insulter l’avenir. Cela signifie ne pas décourager les forces progressistes et démocratiques en Turquie, ne pas donner des arguments à la Turquie pour se détourner d’un Occident qui la rejetterait. Pour ces raisons, la Mission souhaite que le processus d’adhésion se poursuive dans les meilleures conditions – sans que la politique intérieure ne vienne interférer de manière déraisonnable – et que chaque partie fasse les efforts nécessaires en ce sens car la valeur vertueuse du processus de négociations est indéniable.
III – QUEL RÔLE RÉGIONAL POUR LA TURQUIE ?
Alors que la Turquie connaît des déboires sur la scène européenne et qu’elle peine à s’affirmer sur d’autres continents, elle se tourne naturellement vers son environnement régional, qu’elle a longtemps délaissé.
De nombreux commentateurs refusent d’attribuer le tournant, si tournant il y a, de la politique étrangère turque à l’arrivée au pouvoir de l’AKP. Pour eux, ce sont le Premier ministre Bülent Ecevit et le ministre des affaires étrangères Ismaïl Cem à la fin des années 90 qui ont commencé à infléchir la diplomatie turque. A cette époque, la Syrie expulse Abdullah Öcalan, le chef du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), un rapprochement s’opère avec la Grèce à la suite des séismes dont ont été victimes les deux pays et l’Union européenne reconnaît à la Turquie le statut de candidat. Tous les observateurs s’accordent néanmoins pour considérer que la priorité de la politique étrangère turque a toujours été et demeure la sécurité.
L’ambassadeur turc en Syrie fait ainsi valoir pour expliquer l’intérêt de son pays pour le Moyen-Orient que la position géographique de la Turquie rend l’exercice moins théorique pour elle. Si la diplomatie turque met en avant son slogan « zéro problème avec le voisinage » pour preuve de son engagement en faveur de la stabilité régionale, certains lui prêtent d’autres ambitions. Son incontestable volonté de s’imposer comme une puissance régionale ne cache t-elle pas un désir de leadership ? Est-elle compatible avec la constance de son ancrage occidental ? Est-elle le signe d’une radicalisation islamique du pays ?
A – « Zéro problème avec le voisinage » : slogan ou souci d’exemplarité régionale ?
M. Murat Mercan, président de la commission des affaires étrangères de la GANT, a rappelé à la Mission que les conflits ou difficultés géopolitiques qui agitent la scène internationale se trouvent principalement à proximité de la Turquie. La Turquie ne peut pas être insensible aux réalités qui l’entourent.
Pour le ministère des affaires étrangères syrien, les efforts de la Turquie pour résoudre ses problèmes de voisinage visent à tirer profit de sa situation stratégique et à résoudre son problème énergétique. Il est évident que ces deux points occupent une place de choix dans les motivations turques. Les aspirations de puissance régionale de la Turquie l’obligent également à montrer l’exemple ce qu’elle ne parvient pas toujours à faire. Enfin, la pacification des relations avec le voisinage est aussi une condition posée par l’Union européenne à l’adhésion turque.
Les querelles avec les trois voisins chrétiens de la Turquie qui trouvent leur origine dans le traumatisme territorial ottoman et se sont perpétuées sous la République, font figure de fondamentaux de sa politique étrangère. Si la perspective de normalisation avec l’Arménie que laissait entrevoir la signature des protocoles de Zürich s’éloigne, des signes d’ouverture sont perceptibles dans les relations avec la Grèce, tandis que la question chypriote demeure dans l’impasse.
La question chypriote empoisonne non seulement les relations entre la Turquie et l’Union européenne mais aussi celles entre l’UE et l’OTAN et entrave la mise en place de l’Union pour la Méditerranée. Le différend vieux de près de quarante ans ne semble pourtant pas sur le point de trouver une solution.
Depuis l’indépendance de Chypre en 1960, le système constitutionnel pondère la représentation des Chypriotes turcs et des Chypriotes grecs. Dès 1963-64, le président Makarios veut modifier la constitution au profit de la majorité des ressortissants chypriotes, c’est-à-dire les Chypriotes grecs. Inquiète pour les Chypriotes turcs, la Turquie envisage alors d’intervenir. Une lettre du président américain Johnson vient mettre un terme aux velléités militaires turques : Johnson menace la Turquie de ne pas intervenir en tant qu’allié si une hypothétique intervention militaire turque sur Chypre avait pour conséquence une riposte soviétique. Une force d’interposition des Nations unies est envoyée en 1964 à la suite d’affrontements entre les deux communautés.
En réponse au coup d’Etat du 15 juillet 1974 à Nicosie, fomenté par Athènes et l’extrême droite chypriote en vue d’un rattachement de l’île à la Grèce, la Turquie envoie son armée occuper 37 % du territoire chypriote et cesse de reconnaître la République de Chypre. Les affrontements meurtriers et les transferts de population aboutissent à une séparation géographique des deux communautés, et à une proclamation par Ankara de la « République turque de Chypre du Nord (RTCN) ».
La Turquie est aujourd’hui le seul pays à reconnaître la RTCN. Ankara maintient au Nord de l’île environ 40 000 hommes et finance, à hauteur de 400 millions de dollars par an, le fonctionnement de la RTCN.
Pendant vingt ans, l’ONU encourage les négociations, directes ou indirectes, entre les deux communautés. Dans la perspective de l’adhésion chypriote à l’Union européenne, l’ONU est pressée de parvenir à une solution. Le plan Annan de réunification de l’île fait l’objet d’un référendum le 24 avril 2004. Le oui l’emporte chez les Chypriotes turcs (65 %) tandis que le non est majoritaire chez les Chypriotes grecs (76 %). Ankara soutenait le projet de plan de paix. Les responsables politiques de la République de Chypre expliquent alors que les Chypriotes grecs n’ont pas rejeté la réunification de l’île mais un plan trop déséquilibré à leur détriment.
Le rejet du plan Annan par la communauté chypriote grecque mène à la définition d’une nouvelle approche des négociations, proposée par le Secrétaire général adjoint des Nations unies, M. Ibrahim Gambari, et approuvée par le Président de la République de Chypre, M. Tassos Papadopoulos, et le représentant de la communauté chypriote turque, M. Mehmet Ali Talat, lors de leur rencontre du 8 juillet 2006. Cette approche est formalisée dans un accord qui comporte des engagements sur les principes de réunification de l’île, du règlement global, du refus du statu quo et du lancement de discussions bi-communautaires. Plusieurs événements sont venus contrarier ces négociations jusqu’à l’élection à la présidence de la République de Chypre de M. Dimitris Christophias le 24 février 2008.
Les négociations directes ont été relancées en septembre 2008 entre M. Talat pour la RTCN et M. Christophias pour la République de Chypre. Elles ont donné lieu à de nombreuses rencontres jusqu’au début 2010. La perspective de l’élection présidentielle en RCTN a interrompu un processus largement soutenu par la communauté internationale. L’échéance de l’élection avait été utilisée comme un moyen de pression par les Britanniques, les Américains, l’ONU ainsi que les Chypriotes turcs pour accélérer le règlement du conflit.
L’objectif constant de ces négociations reste de parvenir à un règlement global de la question chypriote par la mise en place d’une fédération bi-zonale et bi-communautaire fondée sur l’égalité politique, prévue par plusieurs résolutions du Conseil de sécurité et conforme au droit de l’Union européenne.
Les négociations ont été suspendues le temps de l’élection présidentielle. Plusieurs questions importantes restaient alors en suspens : la question des colons turcs et de leur devenir en cas de réunification, la question des propriétés et des rétrocessions de territoires, l’abrogation ou le maintien du traité de garantie, en vertu duquel le Royaume-Uni, la Turquie et la Grèce sont les garants de l’équilibre constitutionnel chypriote.
La candidature à l’élection présidentielle en RTCN de M. Dervish Eroglu, alors Premier ministre, a suscité des craintes quant à l’avenir du processus. Son élection le 18 avril dernier ouvre une période d’incertitude malgré ses déclarations rassurantes quant à la poursuite les négociations. Ce résultat marque en tout cas l’autonomie des Chypriotes turcs à l’égard d’Ankara dont le candidat était M. Talat.
Alors que certains membres de la Mission exprimaient leur incompréhension face au blocage de la situation à Chypre, M. Jean Marcou a fait valoir que « comme dans tous les conflits fossilisés, l’une des résistances résulte du fait que les protagonistes se sont installés dans le conflit » (29).
L’attitude turque sur la question chypriote n’est pas toujours lisible. Ankara paraît favorable à une rapide solution chypriote sous l’auspice des Nations unies mais refuse elle-même de faire un geste encourageant à l’égard de la République de Chypre. La Turquie paie pourtant chèrement son intransigeance.
Comme pour la mer Egée, le facteur historique (attachement à cette île en raison des pertes territoriales de l’empire), le rôle de l’armée (présence d’environ 40 000 soldats obtenant des récompenses foncières en RTCN), les ressources off shore potentielles et le sentiment de rejet de la part de l’Europe pèsent dans l’immobilisme turc sur ce dossier.
Le différend chypriote est considéré en Turquie comme un problème de politique intérieure sur lequel l’armée exerce encore une influence, par ailleurs déclinante. L’adhésion de Chypre à l’Union européenne a été vécue comme une gifle par Ankara. Plusieurs responsables turcs rencontrés voient d’ailleurs dans cet événement l’origine du désenchantement européen pour la Turquie. En outre, les Turcs considèrent qu’ils n’ont pas été récompensés pour leurs efforts en faveur de l’adoption du plan Annan.
Le statu quo sur la question chypriote se traduit notamment par la non-application du protocole d’Ankara de 2005 qui étend l’Union douanière aux Etats membres de l’Union européenne depuis 2004. En effet, la Turquie bloque l’accès de la République de Chypre à ses ports et aéroports tant que celle-ci bloque le règlement « commerce-direct » qui permettrait à la partie Nord de l’île d’avoir des échanges commerciaux avec les autres Etats de l’Union.
En réponse, l’Union européenne a gelé huit chapitres de négociation liés à ce protocole. Par ailleurs, le Conseil européen examine régulièrement la mise en œuvre du protocole d’Ankara. Le dernier rapport de la Commission déplore l’absence de progrès réalisés par la Turquie sur ce sujet. Toutefois, malgré ce constat, la présidence suédoise n’a pas fait adopter par le Conseil de sanctions contre la Turquie. La Présidence suédoise, la Commission et la Turquie ont alors plaidé pour la clémence afin de ne pas fragiliser le processus de négociation en cours à Chypre en vue de la réunification de l’île. Le processus étant actuellement au point mort, la question des sanctions est de nouveau à l’ordre du jour.
Si l’absence de solution de la question chypriote pénalise la Turquie dans sa quête européenne, elle emporte également des conséquences au sein de l’OTAN et de l’Union pour la Méditerranée.
A l’OTAN, la Turquie est à l’origine de blocages politiques et institutionnels importants. Elle n’hésite pas à prendre en otage l’ensemble de la relation entre l’UE et l’OTAN, exigeant notamment que la coopération entre les deux institutions s’inscrive exclusivement dans le cadre des accords de « Berlin plus » (30), pourtant dépassés aujourd’hui, ou refusant les réunions avec les 27 Etats membres. Cette paralysie des relations entre les deux institutions nuit à l’efficacité des interventions communes sur les théâtres d’opérations.
De même, les faibles avancées sur le fonctionnement de l’Union pour la Méditerranée (UpM) sont en partie dues aux différends turco-chypriotes. M. Serge Telle, a ainsi relevé que l’UpM devait faire face à deux difficultés persistantes : le conflit israélo-palestinien et le conflit turco-chypriote. « Chypre s’est opposée à la nomination d’un secrétaire général adjoint turc au motif que les Turcs bloquent les nominations de Chypriotes dans les institutions internationales. Il s’en est suivi deux mois de blocage. Chypre n’a pas d’autre préoccupation de politique étrangère que la Turquie. L’attribution de postes a donné lieu à une rivalité infantile dans laquelle les Grecs soutiennent les Chypriotes » a-t-il indiqué à la Mission (31).
La capacité des responsables turcs à œuvrer pour la réconciliation, avec une interrogation sur leur influence sur le nouveau président, constituera un signe de leur volonté réelle d’apaiser leurs relations avec leurs voisins.
Le signe le plus spectaculaire de la politique « zéro problème avec le voisinage » est sans conteste le rapprochement avec l’Arménie. Pour de nombreux observateurs, le succès de ce dernier a valeur de test pour la sincérité de cette politique.
Histoire des relations entre l’Arménie et la Turquie
Placée sous domination turque à partir du 14ème siècle, l’Arménie commence à échapper à l’emprise de l’empire ottoman au début du 19ème siècle, suite aux premières incursions russes dans la région. Alors que le culte chrétien arménien est toléré par les Turcs, et que de nombreux Arméniens occupent d’ailleurs des postes de responsabilité au sein de l’empire ottoman, les relations entre les communautés se tendent au fur et à mesure de l’accroissement de l’influence russe dans la région.
Les relations entre la Turquie et l’Arménie ont toujours évolué en fonction des avancées russes sur le territoire arménien. Les soupçons turcs d’une alliance de chrétiens contre l’intégrité de l’empire ottoman prennent de l’ampleur après l’intégration d’une grande partie du territoire correspondant alors à l’Arménie dans l’empire russe, en 1827. Les historiens font d’ailleurs remonter les premiers massacres d’Arméniens par des Turcs à la fin du 19ème siècle.
L’entrée en guerre de l’Empire ottoman en 1914 contre la Russie précipite les événements. Les dirigeants de la Sublime Porte, notamment Enver Pacha, soupçonnant les Arméniens de collusion avec l’ennemi du Nord, décident de mener des actions de répression contre la population, avec des conséquences effroyables. Des villages entiers peuplés d’Arméniens sont déportés, et les convois sont victimes d’attaques par des hommes armés destinés à tuer le plus grand nombre de civils. Ce génocide commis contre les Arméniens par les Turcs à partir de 1915 ouvre une période d’affrontement radical entre les deux Nations.
A la suite du traité de Brest-Litovsk du 3 mars 1918, plusieurs territoires sont cédés par la Russie à l’empire ottoman, dont le district de Kars, autrefois arménien. La Turquie s’efforce parallèlement de reprendre pied sur le reste du territoire arménien, mais elle est obligée de reconnaître son indépendance en juin 1918. La fin de la première guerre mondiale met un terme provisoire aux affrontements, et le traité de Sèvres du 10 août 1920 donne à l’Arménie les districts de Van et Bitlis.
Toutefois, l’intégration à l’Union soviétique se solde pour l’Arménie par une perte de plusieurs territoires. En effet, le traité de Kars, signé le 13 octobre 1921 entre la Turquie et les Républiques soviétiques de Transcaucasie, prévoit, en plus d’une délimitation des frontières correspondant à l’actuel territoire arménien, la reconnaissance par chacune des parties de la caducité des traités imposés par la force. Dès lors, la Turquie ne s’estime plus tenue par le traité de Sèvres, qui l’amputait de fait d’une partie de son territoire.
L’indépendance de l’Arménie survient dans un contexte d’intenses agitations. La déclaration d’indépendance de la province azerbaïdjanaise du Haut Karabakh, auquel le gouvernement d’Azerbaïdjan répond par la force, entraîne l’Arménie dans une guerre avec son voisin oriental, dont elle occupe une partie du territoire.
Bien que la Turquie ait été un des premiers Etats à reconnaître l’Arménie indépendante, sa proximité avec l’Azerbaïdjan l’incite à répondre à ce qu’elle considère comme une agression injustifiée de son allié, et décide de fermer sa frontière avec l’Arménie en juillet 1993. Dès lors, l’Arménie reproche à la Turquie de tout mettre en œuvre pour la tenir à l’écart des grands projets économiques régionaux, comme l’oléoduc BTE et le gazoduc BTC.
Par ailleurs, la pression internationale s’accroît pour que la Turquie accepte de reconnaître le génocide des Arméniens par les Turcs. Un article cosigné par 126 intellectuels dont Elie Wiesel est publié le 9 juin 2000 dans le New York Times, demandant à ce que la dénomination de génocide soit appliquée aux événements de 1915. Des lois sont adoptées par plusieurs parlements, dont le parlement français, qui reconnaissent également le génocide arménien.
La situation, au début des années 2000, semble donc bloquée. L’arrivée au pouvoir du parti AKP, en Turquie, se révèle favorable au rapprochement entre les deux pays.
« La diplomatie du football » a été le premier acte du processus de normalisation des relations turco-arméniennes : le Président Gül se rend à Erevan le 6 septembre 2008 pour assister à un match de qualification pour la coupe du monde de football opposant l’Arménie et la Turquie ; le match retour le 14 octobre 2008 permet au président Sarkissian de venir à Istanbul.
Après un premier communiqué tripartite (Turquie, Arménie, Suisse) en avril 2009, qui annonce la mise en place d’une feuille de route pour la normalisation des relations turco-arméniennes, un deuxième communiqué est publié le 31 août 2009 faisant état de l’intention des parties de signer deux protocoles, l’un sur le rétablissement des relations diplomatiques, l’autre sur le développement des relations bilatérales.
La cérémonie de signature des deux protocoles a lieu le 10 octobre à Zurich, en présence des ministres des affaires étrangères suisse, français, américain et russe et de M. Javier Solana.
Si cette signature fait figure d’événement historique, les obstacles à la ratification des protocoles surgissent rapidement et conduisent aujourd’hui le processus dans une impasse. Chaque partie, s’appuyant sur la dénaturation supposée des accords signés, en rejette la responsabilité sur l’autre : cette attitude ne laisse pas augurer d’une évolution prochaine favorable.
La Turquie conditionne désormais sa ratification à la solution du conflit du Haut-Karabakh, l’Arménie lui reprochant de ne pas avoir fait de cette question une condition préalable à la signature des protocoles. La Turquie fait valoir cet argument par solidarité avec son « pays frère », l’Azerbaïdjan. Les analyses convergent sur ce point pour considérer d’une part que la Turquie a accédé à la demande de l’Azerbaïdjan et d’autre part que le lien établi entre les deux dossiers ne peut qu’entraîner un blocage des deux.
Sur le premier point, la signature récente –cf. supra – d’un accord avec l’Azerbaïdjan sur le prix du gaz permettra probablement de lever un obstacle en privant l’Azerbaïdjan d’un moyen de pression important.
Cependant, la proximité des élections législatives en Turquie ne constitue pas un élément encourageant. En effet, la sensibilité de la population turque sur la question arménienne, relayée par l’opposition, ne peut que freiner le Gouvernement dans sa politique de bon voisinage avec l’Arménie.
Deux points cristallisent les inquiétudes de cette dernière :
– la reconnaissance du génocide arménien : la position officielle turque reste inchangée puisque seuls les « événements » de 1915 sont évoqués, en dépit d’une pétition d’intellectuels turcs publiée le 15 décembre 2008. La Turquie a néanmoins accepté par le biais des protocoles la création d’une commission d’historiens. A l’approche de la commémoration de son 95ème anniversaire, le 24 avril, les initiatives de parlements étrangers sur la reconnaissance du génocide arménien (Suède, Etats-Unis) ont contribué à exacerber la susceptibilité de l’opinion publique sur cette question.
– la question de la délimitation des frontières entre l’Arménie et la Turquie. Certains groupes arméniens contestent les frontières dessinées par le traité de Kars et souhaitent en revenir à celles du traité de Sèvres. L’opposition turque exige donc la reconnaissance par l’Arménie de la frontière orientale turque.
Les Arméniens quant à eux mettent en avant la décision de la Cour constitutionnelle arménienne qui a validé le 12 janvier dernier, avec un mois d’avance, insistent-ils, les protocoles tout en émettant une « réserve d’interprétation » : le respect de la constitution arménienne nécessite l’emploi du terme de génocide que les Turcs refusent avec force.
Les Arméniens soulignent par ailleurs le courage du Président Sarkissian qui a pris l’initiative de la normalisation en dépit de l’hostilité de la population arménienne et notamment de la diaspora.
La nouvelle condition posée selon eux sur la solution du conflit du Haut-Karabakh peut légitimement faire douter de la détermination turque à poursuivre le processus.
L’ambassadeur d’Arménie en France a fait part à la mission de ses conclusions à ce stade : « en conditionnant la normalisation de ses relations avec l’Arménie par le règlement du conflit du Haut-Karabakh, la Turquie met en danger à la fois les deux processus. A l’heure actuelle, la Turquie semble donner la priorité à ses relations avec l’Azerbaïdjan, au détriment de sa crédibilité internationale. L’initiative de l’Arménie de la normalisation des relations avec la Turquie, sans conditions préalables, est à l’heure actuelle au bord d’échouer à cause des pré-conditions avancées par la Turquie après la signature des Protocoles. La normalisation des relations avec l’Arménie est un test pour la Turquie, pour le rôle qu’elle souhaite jouer sur la scène internationale, pour sa nouvelle politique extérieure avec le slogan zéro problèmes avec les voisins. » (32)
Afin de manifester l’impatience américaine à l’égard de l’inertie turque sur ce dossier, le Congrès a voté une résolution reconnaissant le génocide arménien (cf. supra). La menace de ce vote ainsi que l’activisme diplomatique américain n’ont pas suffi à ce jour à faire évoluer la position turque.
Selon la formule d’un diplomate français, le processus de ratification est aujourd’hui juridiquement gelé côté arménien et politiquement gelé du côté turc. En l’absence de progrès sur le dossier du Haut-Karabakh, aucune avancée significative sur le dossier turco-arménien n’est donc attendue avant les élections législatives prévues en Turquie en 2011.
Les espoirs suscités par la signature des protocoles sont aujourd’hui à tout le moins déçus. Les deux parties campent sur leur position. La Mission ne peut que le regretter et encourager les deux parties sur la voie de la réconciliation. Celle-ci offrirait notamment à l’Arménie un oxygène économique dont elle manque cruellement tandis qu’elle donnerait corps à l’image de puissance pacificatrice que la Turquie revendique.
Les tensions gréco-turques remontent à la guerre d’indépendance turque de 1919-1922 qui éclate suite à la décision des Alliés d’octroyer des territoires de l’Empire ottoman à la Grèce. La victoire des nationalistes turcs dirigés par Atatürk leur permet de contraindre la Grèce à abandonner ses territoires en Anatolie et en Thrace orientale, et provoque l’exode de plus d’un million de Grecs d’Anatolie et d’Izmir. Certes, les relations gréco-turques se sont pacifiées depuis les violents affrontements en 1954-55, 1964 et 1974.
Le tremblement de terre d’Izmit en 1999, dont le bilan s’élève à environ 17 000 morts, a été l’occasion pour la Grèce de faire la preuve de sa solidarité. « La diplomatie des tremblements de terre », comme on a appelé cette politique mise en œuvre par les ministres des affaires étrangères de l’époque, MM. Georges Papandrou et Ismaïl Cem, a alors permis de rapprocher la Turquie et la Grèce. De nombreux accords bilatéraux ont été conclus dans des domaines variés (énergie, immigration, tourisme, environnement, réseau de routes aériennes en mer Egée), tandis que l’ancien Premier ministre grec, Costas Caramanlis, a effectué en janvier 2008 la première visite d’un chef d’Etat grec à Ankara depuis 50 ans.
L’arrivée au pouvoir de Georges Papandreou a relancé le réchauffement des relations diplomatiques dont il avait été l’artisan en tant que ministre des affaires étrangères. Faisant suite à la visite du Premier ministre grec en octobre 2009, le Premier ministre turc a adressé le 30 du même mois une lettre à son homologue dans laquelle il faisait part de son intention de mener une politique de bon voisinage. M. Papandreou lui a répondu dans une lettre du 25 janvier 2010 qui précisait le cadre de la coopération ainsi que les sujets de discorde.
En effet, plusieurs sujets de tensions fragilisent encore cette relation bilatérale :
– les différends territoriaux en mer Egée : Ankara et Athènes ont des interprétations juridiques opposées sur la délimitation des espaces maritimes et aériens, ce qui a conduit à un accroissement depuis le début 2009 des plaintes grecques quant aux violations de son espace aérien et maritime par les forces turques ;
– la minorité grecque orthodoxe en Turquie (entre 3 et 4 000 personnes) ; la fermeture en 1971 du séminaire de Halki, seul lieu d’expression des Grecs orthodoxes, et la décision judiciaire en 2007 de ne pas reconnaître le caractère œcuménique du Patriarcat de Constantinople nuisent au dialogue greco-turc. L’entretien du Premier ministre Erdogan avec Bartholomée Ier, le patriarche œcuménique, le 15 août sur l’île des Princes, a permis d’aborder ces questions, sans toutefois apporter de réponse précise ;
– le problème de l’immigration clandestine. Athènes reproche à Ankara de ne pas surveiller ses frontières et de ne pas appliquer l’accord de réadmission signé en 2002. En contrepartie, la Turquie réclame un allégement des obligations en matière de visas pour certains ressortissants turcs.
L’élan turc en direction de la Grèce doit autant à la recherche de crédibilité à l’égard de l’Union européenne qu’à la perte d’influence de l’armée qui octroie une marge de manœuvre nouvelle au Gouvernement pour promouvoir la coopération et en finir avec les conflits « historiques ». La mer Egée devenant « mer de paix » selon les mots du Premier ministre Erdogan serait une démonstration de la capacité de la Turquie à résoudre les conflits et un atout incontestable pour ses ambitions régionales.
Cependant, les autorités grecques affichent une certaine prudence quant aux résultats escomptés estimant ne pas avoir été jusqu’à présent payées en retour de leurs efforts de normalisation. Les expériences passées permettent aux Grecs d’exprimer des doutes sur l’effectivité de la politique « zéro problème avec le voisinage ». Ils rappellent par ailleurs volontiers qu’ils peuvent être un soutien appréciable pour la candidature turque à l’Union européenne. Il est vrai que les échanges économiques entre les deux pays plaident du point de vue grec en faveur de l’intégration européenne de la Turquie.
La récente visite du Premier ministre turc (14 et 15 mai) semble avoir été l’occasion pour les deux pays de franchir un nouveau cap dans leur coopération. Un partenariat stratégique incluant 21 accords bilatéraux a été conclu. Le premier Haut conseil de coopération qui en est l’un des éléments s’est tenu à cette même date. La Turquie a signé un accord visant une application efficace du protocole de réadmission donnant ainsi de précieux gages à la Grèce. M. Erdogan a également eu des paroles apaisantes sur la question du patriarcat œcuménique. Enfin, la Turquie a réaffirmé sa solidarité à l’égard de la Grèce dans l’épreuve qu’elle traverse sur les plans économique et financier.
Si le bon voisinage avec la Grèce semble aujourd’hui un objectif raisonnable à la différence des autres voisins chrétiens, les relations de la Turquie avec ses voisins musulmans ont connu des améliorations spectaculaires.
La question kurde fut longtemps le principal déterminant de la qualité des relations de la Turquie avec ses voisins musulmans. Aujourd’hui, tous ces pays partagent la préoccupation turque à l’égard des revendications autonomistes des Kurdes présents sur leurs territoires. L’interdépendance économique régionale constitue également une puissante incitation au bon voisinage.
La nature et l’évolution des liens de la Turquie avec la Syrie, l’Irak et l’Iran ne peuvent cependant pas être mis sur le même plan. Ces différences trouvent une traduction dans les résultats de la politique « zéro problème avec le voisinage » menée par la Turquie à l’égard de ces pays.
« Les relations turco-iraniennes sont plutôt bonnes, mais comme disent les diplomates turcs, les Iraniens ne sont ni des amis ni des ennemis » explique M. Jean Marcou. Il semble que les intérêts de ces deux Etats convergent en faveur d’une relation de bon voisinage historique. M. Didier Billion qualifie ainsi cette relation de « coopération mesurée ».
Aucun conflit territorial n’a jamais opposé la Turquie et l’Iran qui sont séparés par la même frontière depuis le XVIème siècle.
Selon M. Deniz Agakul, « il y a un principe de non-ingérence. C’est une attitude qui date des années 60 dans la politique extérieure de la Turquie. » Mme Dorothée Schmid confirme que « les Turcs ont conscience que la proximité commande d’entretenir des relations de bon voisinage. »
Les préoccupations sécuritaires comme économiques expliquent en grande partie la stabilité de la relation turco-iranienne.
M. Didier Billion souligne ainsi « la hantise des Turcs d’avoir un Iran totalement déstabilisé à leur frontière immédiate ». M. Can Buharali, chercheur à l’EDAM (33) à Istanbul, fait également observer que les deux pays ont pu au travers de leur histoire commune mesurer la puissance de l’autre et ont décidé de ne pas s’affronter. Il précise qu’actuellement la Turquie cherche à éviter un affrontement qui aurait des conséquences (ethniques et économiques) sévères en Turquie.
La question kurde joue également un rôle prééminent. « Il n’y a pas une réunion de haut niveau entre les deux pays sans un chapitre, dans la déclaration finale, concernant les Kurdes et un rappel de la volonté commune d’éradiquer les groupes séparatistes, terroristes, kurdes. Le PKK, qualifié de groupe terroriste par la Turquie et par l’Union européenne a constitué le Pejak, organisation qui lui est inféodée et qui agit militairement sur le territoire iranien. C’est là un élément de coopération supplémentaire entre les services iraniens et turcs » rappelle M. Didier Billion.
Enfin, l’énergie comme l’économie occupent une place importante dans la relation bilatérale. A la recherche d’une diversification de ses sources d’approvisionnement, la Turquie a besoin des hydrocarbures iraniens, surtout du gaz, que l’Iran a économiquement intérêt à leur vendre. L’Iran est aujourd’hui le deuxième fournisseur de gaz de la Turquie. L’Iran doit en outre utiliser les routes terrestres turques pour exporter ses produits.
Dans les cinq dernières années, le volume des échanges a augmenté de 96 %. Le montant des exportations est passé entre 2002 et 2009 de 300 millions de dollars à deux milliards. Par ailleurs, les Iraniens forment le premier contingent de touristes en Turquie avec 1,38 million de personnes en 2009.
Contrairement aux relations de la Turquie avec ses autres voisins du Moyen-Orient, celle avec l’Iran ne semble pas avoir gagné en intensité et en proximité sur les plans économique et politique ces dernières années. Les visites officielles ont lieu mais leurs résultats paraissent minces, notamment parce qu’elles sont dominées par la question nucléaire.
On observe ainsi que les relations cordiales qu’entretiennent les deux pays ne permettent pas à la Turquie d’exercer une influence auprès de l’Iran sur la question du nucléaire, contrairement aux espérances turques.
Lors d’une rencontre avec la Mission, M. Engin Soysal, sous-secrétaire d’Etat adjoint en charge du Moyen-Orient, de l’Irak et de l’Asie du Sud a estimé que la Turquie avait sur cette question une responsabilité particulière en tant que voisin. Il a confirmé la position du Gouvernement turc en faveur d’une solution diplomatique considérant que la « fenêtre d’opportunité reste ouverte ». Il a indiqué que toute négociation dans la région, et surtout avec l’Iran, se compose de 60 % de psychologie, 20 % de méthodologie et 20 % de contenu.
Les Turcs ont voté les trois premiers jeux de sanctions contre l’Iran aux Nations unies, mais n’ont jamais cessé, notamment M. Davutoglu, d’appeler au dialogue. Ils se proposent d’être les facilitateurs de ce dialogue entre l’Iran et l’Occident.
Mais le pouvoir d’influence de la Turquie sur l’Iran est limité, d’après M. Can Buharali. Il considère que l’Iran n’a pas d’intérêt à écouter la Turquie mais que Téhéran essaiera, en revanche, de maintenir la Turquie dans le jeu pour se protéger.
A contrario, Peter Harling (34) estime que la Turquie dispose vis-à-vis de l’Iran de trois atouts : elle a une bonne connaissance des acteurs et des mécanismes de prise de décision ; elle a une influence notamment depuis 2003, date à laquelle elle a gagné ses lettres de noblesse en démontrant qu’elle était capable de ne pas s’aligner sur les Etats-Unis ; enfin, elle offre une porte de sortie.
La Mission constate que la position turque s’est durcie récemment : elle s’est d’abord abstenue sur la résolution de l’AIEA en novembre 2009. Elle a ensuite voté le 9 juin dernier contre la résolution 1929 relative à l’application d’une nouvelle série de sanctions à l’égard de l’Iran alors que la Russie et la Chine l’avaient approuvée. La Turquie a justifié son opposition par l’existence de la déclaration de Téhéran du 17 mai qui a provoqué un fort scepticisme dans les chancelleries occidentales.
Accord Iran-Turquie-Brésil du 17 mai 2010
Déclaration de Téhéran
L’accord signé en présence des trois présidents prévoit l’échange de 1 200 kg d’uranium iranien enrichi à 3,5 % conte 120 kg de combustible enrichi en Turquie à 20 % afin d’approvisionner le réacteur de recherche de Téhéran (TRR). Le ministère français des affaires étrangères considère qu’une « solution à la question du TRR, le cas échéant, ne réglerait en rein le problème posé par le programme nucléaire iranien. L’échange d’uranium envisagé n’est qu’une mesure de confiance, un accompagnement. »
Ce dernier avatar des relations turco-iraniennes renforce les craintes occidentales d’un dangereux rapprochement entre ces deux puissances en devenir du Moyen-Orient.
Pour les diplomates français à Tel-Aviv, l’attitude turque sur les sanctions s’explique par la mentalité de pays émergent, viscéralement opposé aux sanctions, ainsi que par le spectre irakien, les sanctions y ayant précédé la guerre.
Les analyses les plus optimistes font observer que l’activisme diplomatique turc contrebalance l’influence iranienne au Moyen-Orient, en offrant par exemple à la Syrie une alternative à sa relation privilégiée avec l’Iran.
De nombreux interlocuteurs rencontrés par la Mission partagent le constat que l’Iran et la Turquie, deux pays non arabes de la région, se disputent aujourd’hui le leadership sur le Moyen-Orient. Certains observateurs y voient une rivalité religieuse, entre sunnites et chiites et entre régime théocratique et régime laïc.
Pour M. Didier Billion, cette idée est erronée : « la bonne grille de lecture est que ce sont deux États déterminants pour les évolutions moyen-orientales des quinze prochaines années. Même si l’Iran connaît actuellement une période trouble, c’est incontestablement un pays qui va compter dans la région et il en est de même pour la Turquie. Ce sont deux Etats qui sont conscients de leur potentiel, qui sont nationalistes au sens patriotique, pour des raisons liées à l’histoire et qui sont en concurrence non pour des raisons idéologiques ou religieuses mais pour des raisons d’influence politique et de puissance économique. Le terrain de l’Asie centrale permet d’illustrer cela puisqu’en effet, sur ce terrain, Turcs comme Iraniens essaient de s’y implanter toujours plus, de façon concurrentielle. Au-delà des turbulences politiques, ce sont deux grands Etats qui ont une très longue histoire, qui ont un Etat très structuré depuis des siècles, ayant une politique extérieure ancrée dans leur histoire et qui ont de ce fait des diplomates de qualité. »
M. Robert Malley, directeur du programme pour le Moyen-Orient de l’International crisis group, considère que les deux pays défendent une vision opposée de l’avenir du Moyen-Orient : « la vision iranienne serait nourrie de la résistance aux projets occidentaux et à Israël. Elle répond à une demande, à une soif un peu tiers-mondiste, de dignité et d’autodétermination du monde arabe et du monde musulman et elle se conjugue principalement sur le mode militant. A l’opposé, la vision turque met l’accent sur la diplomatie tous azimuts. Elle récuse les boycotts ou les interdits de dialogue et elle privilégie l’intégration économique et l’interdépendance régionale » (35).
Un rapport de l’International Crisis group (36) pose la question de savoir à qui profite le plus l’engagement turc à l’égard de Téhéran : à la stabilité globale, à l’image turque d’acteur régional ou à l’agenda du régime iranien.
La Mission estime que la position turque sur le dossier iranien manque de clarté. S’il est souhaitable que des canaux de communication restent ouverts en complément de la fermeté que traduisent les sanctions, la Mission s’interroge sur l’instrumentalisation – assumée ou non – dont la Turquie comme le Brésil pourraient être victimes de la part de l’Iran.
Trois dossiers ont longtemps miné les relations turco-syriennes :
– la question d’Alexandrette : rattaché à la Syrie sous mandat français, le sandjak d’Alexandrette a été cédé à la Turquie en juin 1939 ; la Syrie a longtemps revendiqué sa restitution.
– le parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) : la Turquie accusait la Syrie de soutenir le PKK et de donner asile à certains de ses militants et en particulier à leur chef, Abdullah Öcalan. En 1998, la Turquie masse des troupes à la frontière syrienne et menace d’intervenir reprochant à la Syrie de ne pas respecter les engagements formalisés dans un accord du 17 juillet 1997 de mettre fin à son soutien au PKK.
– les eaux du Tigre et de l’Euphrate : dans les années 1960, lorsque la Turquie décide de réaliser le « Grand projet anatolien » (GAP) en utilisant ses ressources en eau pour développer le sud-est du pays, la Syrie comme l’Irak voient la quantité d’eau disponible en aval diminuer. Devant les inquiétudes suscitées par cette nouvelle situation, la Turquie et la Syrie ont conclu en 1988 le protocole de Damas qui reconnaît à la Syrie le droit de prélever une partie des eaux du Tigre et de l’Euphrate. Mais ce protocole n’offre pas de véritable garantie pour la fourniture par la Turquie des volumes d’eau en question. Ainsi, dans les années 1990, la Turquie, prétextant des problèmes techniques, n’a pas hésité à priver la Syrie de l’eau à laquelle elle avait droit lorsque les deux pays connaissaient des différends sur d’autres sujets.
Aujourd’hui ces trois dossiers ont presque disparu des agendas politiques syriens et turcs pour laisser la place à une relation qualifiée de « lune de miel » par certains. L’expulsion du leader kurde, Abdullah Öcalan, a probablement été le déclencheur d’un rapprochement dont les retombées économiques sont importantes.
D’après les diplomates français à Damas, les Syriens ont le sentiment d’un intérêt économique absolu à des relations avec la Turquie même si celles-ci comportent un risque de fragilisation. Le Vice-premier ministre, M. Al-Dardari, a indiqué à la Mission que le voisinage turc avait influencé la pensée économique syrienne. La Syrie, à l’instar de l’Irak, est une route commerciale vers le Proche-Orient, a confirmé par ailleurs l’ambassadeur turc à Damas.
Plusieurs accords récents favorisent en effet la relation économique bilatérale et l’investissement. Il s’agit principalement de l’accord de libre-échange, signé en 2005 et entré en vigueur le 1er janvier 2007 , de l’accord de non double-imposition de 2006 et de l’accord de protection réciproque des investissements de 2007.
Les échanges économiques bilatéraux
Selon le Bureau syrien des statistiques, les importations de la Syrie en provenance de Turquie ont progressé au cours des dernières années (336 millions de dollars en 2005, 461 millions de dollars en 2006, 571 millions de dollars en 2007) avant de retomber à 343 millions de dollars en 2008. En 2007, les produits pétroliers représentaient 38 % des montants importés, suivis de produits issus majoritairement de l’industrie : ciment, équipements mécaniques, plastiques, huiles et matières grasses, fibres synthétiques, véhicules, équipements électriques, produits de l’industrie des métaux, ainsi que fer et acier, papiers, aluminium, bois, produits chimiques, caoutchouc, portés par des coûts de production souvent plus bas qu’en Syrie.
Les exportations syriennes vers la Turquie ont connu à partir de 2006 un net redémarrage après plusieurs années de déclin, avec un temps de retard cependant par rapport à la progression des exportations syriennes globales qui redécollent dès 2005. Après un bond spectaculaire de + 72 % à 604 millions de dollars en 2007, elles atteignent 635 millions de dollars (+ 5 %) en 2008. Hors pétrole, qui comptait pour plus d’un quart du total, les ventes 2007 concernent essentiellement des produits des secteurs textile/habillement/chaussures, agro-alimentaire et agricole et phosphates. La Turquie est le premier client de la Syrie pour plusieurs productions, dont le phosphate.
Le solde de la balance commerciale syro-turque est ainsi excédentaire de 33 millions de dollars en 2007 en faveur de la Syrie et de 143 millions de dollars en 2008. En 2007, la Turquie est le cinquième pays client de la Syrie après l’Italie, la France, l’Arabie Saoudite et l’Irak et son dixième fournisseur. Les données statistiques turques sont très sensiblement différentes avec des exportations vers la Syrie de 1,1 milliard de dollars en 2008, et 638 millions de dollars d’importations, ce qui place l’excédent de la balance commerciale syro-turque largement en faveur de la Turquie.
Le stock d’investissement direct étranger turc en Syrie s’élèverait à 200 millions de dollars en 2007 – l’essentiel étant réalisé par l’investissement du cimentier Guris, le reste relevant de diverses petites implantations textiles dans le nord du pays. En matière de services, aucune banque ni compagnie d’assurance turque n’est enregistrée en Syrie à ce jour.
Plus de 560 000 touristes turcs ont visité la Syrie en 2008, auxquels s’ajoutent les visiteurs frontaliers estimés à près d’un million par an et dont la fréquence des visites s’est probablement encore accrue depuis la suppression des visas pour les ressortissants des deux pays en visite dans le pays voisin, en septembre 2009.
Le développement des relations économiques se traduit également par la mise en œuvre de projets structurants visant l’interconnexion des principaux réseaux dans les domaines suivants :
– Gaz : la connexion des réseaux arabe (Arab Gas Pipeline) et turc via un tronçon (dont la construction vient d’être attribuée à la compagnie tchèque Plynostav), qui permettra l’exportation de gaz arabe et l’importation de gaz de Turquie, d’Azerbaïdjan et d’Iran dès 2011. La Turquie devrait ainsi livrer entre 500 000 et 1 million de m3 de gaz par an pendant cinq ans ;
– Eau : la mise en place d’un système d’alarme contre les inondations dans le bassin de l’Oronte, la recherche d’opportunités de projets d’irrigation mixtes sur l’Euphrate, le projet de construction d’une station de pompage sur le Tigre et, tout dernièrement annoncé, le projet de construction d’un barrage sur l’Oronte, « le barrage de l’amitié » ;
– Electricité : le degré d’interconnexion actuelle des réseaux permet la livraison régulière à la Syrie d’électricité produite en Turquie ;
– Transports : la réouverture de la liaison ferroviaire Alep-Gaziantep en décembre 2009 qui devrait accueillir 3 millions de passagers et 900 000 tonnes de marchandises en 2010, ainsi que la connexion des réseaux routiers turcs et syriens.
Une inquiétude se fait néanmoins jour en Syrie sur les bénéfices non partagés du renforcement des liens économiques, notamment dans le nord de la Syrie dont certains craignent qu’il ne devienne une sphère d’influence turque. Par ailleurs, les Syriens sont gênés par l’idée que la Turquie soit le passage obligé de leurs produits vers l’Europe. Les PME syriennes craignent enfin la concurrence des entreprises turques. Du côté turc, les entraves à la libre circulation constituent un frein mal compris au développement des affaires.
L’intensification des relations économiques va de pair avec une embellie sur le plan politique.
Après avoir rappelé que la Syrie partage avec la Turquie sa plus longue frontière, le vice-ministre des affaires étrangères syrien, M. Abdelfatah Ammourah, soulignait ainsi lors du déplacement de la Mission en mars dernier les préoccupations communes, outre le développement économique, des deux seuls Etats laïcs de la région : la stabilité de la région et l’intégrité territoriale de l’Irak (les deux pays craignent que la satisfaction des revendications kurdes en Irak ne provoque une contagion parmi les minorités kurdes sur leurs territoires). Il a estimé que la relation turco-syrienne pourrait servir de « modèle pour la région ».
La visite de Bachar-el-Assad en Turquie en septembre 2009 a donné lieu à la mise en place d’un conseil de coopération stratégique – sur le modèle de celui existant avec l’Irak – dont la première réunion s’est tenue le 13 octobre 2009 à Alep (côté syrien) et à Gazantiep (côté turc). A cette occasion, un accord d’exemption de visas a été signé ce qui a provoqué l’inquiétude de l’opposition en Turquie au moment où l’Union européenne reproche à la Turquie son inaction sur l’immigration clandestine.
La visite du Premier ministre Erdogan à Damas les 23 et 24 décembre 2009 a permis la signature de 51 accords bilatéraux et la confirmation de l’objectif de porter le volume du commerce bilatéral à 5 milliards de dollars dans les prochaines années contre 2 milliards actuellement.
A l’encontre de cette présentation idyllique, certains diplomates français ont nuancé le caractère privilégié des relations turco-syriennes : « la Syrie veut avoir des cartes dans son jeu. La Turquie en fait partie mais cela n’empêche pas les autorités syriennes de recevoir le Président arménien. ». Par ailleurs, on ne peut s’empêcher de lire la qualité des relations entre la Syrie et la Turquie au miroir de la récente dégradation des relations de cette dernière avec Israël.
L’amélioration de ses relations avec la Syrie avait précédemment permis à la Turquie de jouer le rôle de médiateur entre celle-ci et Israël. Cinq rounds de négociations se sont ainsi déroulés à partir de mars 2008 avant que l’opération israélienne à Gaza ne vienne les interrompre. Ces négociations indirectes, à la demande d’Israël, portaient principalement sur la délimitation des frontières dans le Golan. Lors du cinquième round, le Premier ministre israélien s’est rendu en Turquie ; d’après les interlocuteurs de la Mission en Syrie, le ministre des affaires étrangères syrien était prêt à faire de même le lendemain. Le Premier ministre israélien s’est alors excusé pour rentrer en Israël : l’intervention israélienne commençait à Gaza.
Le rapport récemment publié de la mission d’information sur la place de la Syrie dans la communauté internationale fait état du sentiment de celle-ci « que l’intensification des relations entre la Turquie et la Syrie, les deux pays laïcs de la région, est positive. L’ouverture économique l’est incontestablement dans la mesure où elle est de nature à renforcer le développement des deux partenaires, notamment dans les régions frontalières qui ne sont pas les plus riches, et de créer des solidarités de fait. Le renforcement de leurs liens politiques ne semble pas devoir inquiéter l’Occident : il est certes concomitant d’un rafraîchissement des liens turco-israéliens, mais n’en est pas pour autant la cause ; s’il ne signifie pas que la Syrie distend ses liens avec l’Iran, il donne à la Turquie, qui reste un Etat modéré et membre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, une capacité d’influence sur la Syrie, ce qui se révéler précieux, surtout étant donné l’excellence des relations entre leurs chefs d’Etat. » (37)
A l’instar de ses collègues, la Mission considère que la Turquie a œuvré à bon escient, en parallèle des efforts diplomatiques français, à la réhabilitation de la Syrie sur la scène internationale. La Mission espère, au vu des derniers développements, que l’éclaircie dans les relations avec la Syrie ne signifie pas l’éclipse dans celles avec Israël puisque la Turquie est la première à revendiquer sa capacité à dialoguer avec tous les acteurs régionaux.
Comme avec ses deux autres voisins musulmans, les relations entre la Turquie et l’Irak sont dictées à la fois par des considérations économiques et sécuritaires. La lutte contre le PKK qui fait partie des fondamentaux de la politique étrangère turque justifie l’attention particulière portée au devenir de l’Irak et au maintien de son intégrité territoriale. A l’instar de la Syrie, la Turquie a décidé de renouer des liens avec l’Irak dès lors que les autorités avaient donné des gages quant à la distance prise avec les militants kurdes.
La guerre du Golfe a laissé des traces en Turquie : elle a provoqué en avril 1991 l’afflux de 500 000 réfugiés irakiens à la frontière turque ; par ailleurs les sanctions infligées à l’Irak lui font perdre son second partenaire commercial. Après la guerre, le nord de l’Irak a été négligé par les responsables irakiens et américains laissant entrevoir la création d’un Kurdistan indépendant que la Turquie redoute depuis longtemps.
L’invasion américaine en 2003 relance cette perspective. La crainte d’une nouvelle déstabilisation de la région ainsi que l’opposition de la population à la guerre expliquent le coup de tonnerre que constitue le refus de la GANT, déjà évoqué, d’autoriser les troupes américaines à transiter par le sol turc.
Entre 2004 et 2007, les Turcs sollicitent les États-Unis pour éradiquer les bases du PKK au nord de l’Irak. Les États-Unis n’ont pas fait droit à ces demandes réitérées de la Turquie jusqu’en 2008, date à laquelle le président Bush permet aux Turcs de localiser ces bases grâce aux renseignements américains et aux observations satellitaires.
Parallèlement, les Turcs constatent que l’option du tout militaire a échoué dans la lutte contre le PKK. Il fallait donc, selon un diplomate français, nouer un dialogue sur la question de la sécurité avec l’ensemble des acteurs, le gouvernement central irakien bien sûr mais aussi les autorités de la région autonome kurde.
Un comité tripartite est donc mis en place en novembre 2008, comprenant la Turquie, les États-Unis et l’Irak, qui a pour objet de juguler les activités du PKK. « C’est un changement dans la politique du président irakien Talabani et cela explique que le Président turc se soit rendu en Irak en mars 2009 » analyse M. Didier Billion.
La visite du Président Gül en Irak est la première à ce niveau depuis 34 ans. Elle est suivie d’une visite du ministre turc des affaires étrangères en août 2009.
L’Irak est le premier pays avec lequel la Turquie a décidé la création d’un conseil supérieur de coopération stratégique dont la première réunion s’est tenue en septembre 2009.
La visite de M. Erdogan le 15 octobre 2009 qu’il a lui-même qualifié de « jour historique » a permis la signature de 48 accords bilatéraux. Enfin, un consulat a été ouvert en mars 2010 à Erbil, capitale du Kurdistan irakien.
Sur le plan économique, les échanges ont progressé de 60 % en 2008 pour atteindre 7 milliards de dollars en 2009. L’objectif est de parvenir dans les prochaines années à un volume de 20 milliards. La Turquie est aujourd’hui le premier investisseur au Kurdistan irakien. Un projet de zone de libre-échange est actuellement à l’étude.
Plusieurs contentieux persistent cependant :
– le partage des ressources en eaux du tigre et de l’Euphrate : l’Irak reproche à la Turquie de ne pas respecter ses engagements en matière d’approvisionnement et de ne recevoir que la moitié des 500 m3 auxquels il a droit. Le Parlement irakien a ainsi adopté le 12 mai 2009 une résolution interdisant la négociation de tout accord commercial ou stratégique sans garantie d’une part plus juste des eaux de l’Euphrate ;
– les opérations militaires contre le PKK dans le nord de l’Irak qui sont perçues comme une atteinte à la souveraineté irakienne. La GANT a renouvelé pour un an, en octobre 2009, l’autorisation de mener ces opérations. Il sera intéressant de voir quelle sera l’attitude turque en octobre 2010.
– le refus de la médiation dans la crise syro-irakienne : les relations entre les deux pays sont dégradées depuis que le Premier ministre irakien a mis en cause la responsabilité des autorités syriennes dans l’attentat qui avait fait plus de cent victimes à Bagdad le 19 août 2009.
La politique à l’égard du Kurdistan irakien est souvent reconnue comme un succès indéniable, parfois le seul, de la politique étrangère turque. M. Peter Harling explique ainsi la démarche turque : les Turcs au lieu de chercher la confrontation avec les Kurdes, ont compris qu’ils pouvaient créer une interdépendance économique ; la Turquie est aujourd’hui le premier investisseur au Kurdistan, pris plus au sérieux que Bagdad ; on est passé d’une stratégie militaire à une politique plus subtile ; la Turquie recueille aujourd’hui les dividendes politiques de sa politique économique.
B – Les ambiguïtés du dessein moyen-oriental de la Turquie
L’activisme diplomatique turc, comme le montrent les précédents chapitres de ce rapport, n’a pas toujours été payant jusqu’à présent. Les ambitions de la Turquie se sont heurtées dans de nombreuses régions du monde aux prétentions des puissances traditionnelles et des autres puissances émergentes. Le Moyen-Orient apparaît aujourd’hui comme le seul véritable terrain d’expression pour la politique étrangère turque. Le rapprochement avec la Syrie et l’Irak ainsi que liens cordiaux avec l’Iran constituent la première pierre de la construction d’une puissance régionale qui s’enorgueillit de pouvoir dialoguer avec tous les interlocuteurs. Cette position, pour autant qu’elle soit tenable, suscite des questions voire des craintes parmi les Etats occidentaux mais aussi parmi les acteurs du Moyen-Orient. Opportunisme, non-alignement, modèle, leadership, néo-ottomanisme, radicalisation sont autant de mots entendus par la Mission pour qualifier la politique turque dans la région.
a) Une politique guidée par le pragmatisme
Deux arguments principaux viennent soutenir la thèse que la Turquie, en s’investissant au Moyen-Orient, cherche à tirer parti de la nouvelle donne géopolitique.
D’une part, la Turquie comble le vide laissé par les échecs américains, la passivité européenne et les grands frères arabes.
L’intervention militaire en Irak ainsi que l’échec du projet de « Grand Moyen-Orient » ont abouti au retrait diplomatique – provisoire – des Etats-Unis de la région. La présidence de Barack Obama devait marquer leur retour. Si l’administration américaine semble aujourd’hui impliquée dans plusieurs dossiers, les résultats se font attendre.
Combien d’interlocuteurs rencontrés par la Mission ont regretté l’inertie européenne sur le conflit israélo-palestinien notamment. « L’Europe parle mais ne fait rien » a ainsi asséné un responsable palestinien.
Enfin, l’Egypte n’est pas en mesure aujourd’hui, en raison de ses problèmes intérieurs notamment, de jouer le rôle de grand frère, pas plus que la Jordanie.
Cette situation permet à la Turquie d’offrir ses services et de déployer ses talents diplomatiques. Mme Irit Lilian, directrice du département Europe au ministère des affaires étrangères israélien rappelle en souriant que, dans les négociations syro-israéliennes, la Turquie a joué la baby-sitter car les parents américains étaient absents.
D’autre part, la Turquie compense l’absence de perspective européenne en se tournant vers d’autres terrains d’action. La plupart des personnes auditionnées par la Mission établissent en effet un lien entre les difficultés rencontrées avec l’Union européenne et l’intérêt manifesté pour le Moyen-Orient.
M. Hamit Bozarslan voit dans l’attitude turque de l’opportunisme : selon lui, la Turquie ne peut que s’appuyer sur les ambiguïtés de la situation régionale actuelle de « ni guerre, ni paix ». Tant que celle-ci perdure, elle peut continuer à « flotter ».
L’ambassadeur turc en Syrie a souligné les deux grandes erreurs commises par le passé dans la région : d’une part, une perception erronée par l’Occident de la réalité des pays de la région sur laquelle il cherchait à plaquer sa vision ; d’autre part, l’habitude prise par de nombreux pays de la région de voir leurs problèmes régler par d’autres. Aujourd’hui les pays de la région doivent assumer leur responsabilité et chercher des solutions par eux-mêmes. Les autres pays peuvent les aider mais ne pas s’y substituer. Ils peuvent « aider à apporter la paix mais pas apporter la paix ». Cette affirmation laisse à penser que la Turquie a tiré les leçons de ces erreurs pour définir sa politique à l’égard du Moyen-Orient mais qu’elle a aussi l’ambition d’y être un acteur de premier plan.
De nombreux observateurs prêtent à la Turquie l’intention de s’imposer comme le leader de la région et de faire revivre l’empire ottoman. Le Premier ministre Erdogan se verrait, selon cette analyse, comme le nouveau Nasser.
Cette volonté, réelle ou supposée, se heurte néanmoins à la réticence voire à l’opposition de nombreux pays du Moyen-Orient. La Turquie présente notamment le défaut de n’appartenir ni au monde arabe ni au monde perse. Mme Schmid estime notamment que « la Turquie n’est pas un pays du Moyen-Orient : la culture politique, le sens des équilibres et les ambitions internationales diffèrent. En raison de son héritage impérial, la Turquie aspire à être une puissance à l’égal des autres. » M. Gilles Veinstein souligne également que « ce n’est pas parce que l’on a une politique active au Moyen-Orient qu’on est réduit à n’être qu’une puissance moyen-orientale et que l’on a une identité moyen-orientale. »
M. Jean Marcou estime qu’il faut « rester prudent sur les nouvelles relations de la Turquie avec le monde arabe. C’est vrai qu’il y a de très bonnes relations avec les Syriens mais la Syrie est elle-même un pays à part, marginal dans le monde arabe. Les relations turco-syriennes ne sont pas les relations turco-arabes. Par ailleurs, concernant ce rôle de puissance régionale tenant aux multiples cartes que joue la Turquie, elle est en concurrence directe avec l’Arabie saoudite ou l’Égypte. Si la Turquie est très populaire auprès des Egyptiens, elle l’est moins auprès du gouvernement égyptien qui s’inquiète d’une rivalité éventuelle. »
Il est en effet nécessaire de distinguer la perception de la « rue arabe » et des dirigeants.
Le Premier ministre turc fait preuve d’un talent certain pour s’adresser aux masses musulmanes. Celles-ci lui savent gré de parler un langage de vérité et n’hésitant pas à « dire les choses qui fâchent » notamment à Israël, selon l’expression du sous-secrétaire d’Etat adjoint turc en charge du Moyen-Orient, M. Engin Soysal. Cette posture est parfois mise en scène avec brio, à défaut de sincérité : l’épisode très médiatisé de Davos a eu un retentissement indéniable auprès de la « rue arabe ».
La position turque sur l’intervention américaine en Irak, la réaction à la guerre de Gaza ou encore le rapprochement avec la Syrie ont donc permis de donner des gages au monde arabe.
Néanmoins, le Président de l’Assemblée du peuple syrienne a fait valoir que de nombreux pays arabes étaient réticents à l’égard de la Turquie en raison de l’héritage ottoman.
Sur le conflit israélo-palestinien, les responsables palestiniens ne semblent pas convaincus par la pertinence des interventions turques. M. Ziad Abu Amr, député de Gaza, juge que le rôle de la Turquie dans le conflit n’est pas meilleur qu’un autre et que celui-ci ne peut qu’être secondaire, comme pour l’Europe. M. Nabil Shaath, ancien ministre des affaires étrangères, déplore pour sa part que les Turcs s’occupent des Palestiniens plus qu’il n’en faut.
Plus qu’entre sunnites et chiites ou entre perses et arabes, le Moyen-Orient semble aujourd’hui divisé entre islam modéré et islam radical. La Turquie pourrait s’imposer comme le porte-drapeau de l’islam modéré. Certains pays arabes voient en la Turquie le seul pays de la région aujourd’hui capable de contrebalancer l’influence iranienne.
De nombreuses personnes rencontrées par la Mission considèrent que la Turquie peut plutôt être un modèle pour le Moyen-Orient, modèle économique et démocratique.
Il ressort d’une étude de la fondation TESEV (Turkish economic and social studies foundation) (38) que 61 % des personnes interrogées voient en la Turquie un modèle pour le monde arabe. 63% d’entre elles plébiscitent l’exemple réussi d’équilibre entre démocratie et islam qui caractérise à leurs yeux le régime turc. L’implication turque dans la région est en outre accueillie favorablement. Par ailleurs, 57 % considèrent que l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne serait une « très bonne chose » pour le Moyen-Orient et 64 % pensent que l’influence de la Turquie dans la région s’en trouverait fortifiée. Enfin, l’étude montre que l’économie est la première préoccupation de la population de la région, loin devant le conflit israélo-palestinien.
Le Vice-premier ministre syrien, M. Al Dardari, considère que le monde arabe doit s’assurer du succès de l’expérience turque. La Turquie démontre, selon lui, que la démocratie peut survivre à la victoire d’un parti islamiste aux élections et qu’un équilibre est possible entre islam et laïcité. Il ajoute qu’il est utile d’avoir à ses côtés un pays qui comprend les préoccupations du monde arabe en même temps que les inquiétudes de l’Occident. Cette faculté place d’après lui la Turquie dans une position unique au monde.
Les liens avec le Hamas sont présentés par les Turcs comme la preuve de leur objectivité, de leur capacité à ne prendre parti ni pour l’un ni pour l’autre. L’attitude actuelle de la Turquie à l’égard d’Israël semble pourtant contredire cette affirmation. Pour M. Nabil Shaath, la Turquie ne peut cependant rompre ces liens avec le Hamas si elle veut peser dans le processus de réconciliation nationale même si cette attitude suscite des craintes, y compris chez les Palestiniens.
« Il ne faut pas sous-estimer la dimension religieuse dans cette région. Mais si on utilise la religion comme seule grille d’analyse, on risque de passer à côté des vrais enjeux. On ne peut pas comprendre les clivages ou les points de résolution de ces clivages par la religion et cela, que ce soit au Moyen-Orient ou ailleurs. En Turquie, le défi n’est pas la religion en tant que telle mais le conservatisme social et sociétal. Il faut néanmoins avoir confiance dans le dynamisme de la société turque. La religion ne peut pas servir comme instrument de politique extérieure turque dans la région, même s’il faut rester attentif. Cette politique extérieure reste fondamentalement menée par le seul objectif de la défense des intérêts nationaux. La réarticulation de la Turquie à son environnement régional n’est pas motivée par le facteur religieux » selon M. Didier Billion.
Mme Irit Lilian pointe quant à elle le fait que la Turquie est un pays musulman dépourvu de pensée islamique. Ce vide philosophique comporte un risque d’importation d’une pensée religieuse venue d’autres pays. L’Iran pourrait s’inscrire dans ce schéma en cherchant à radicaliser la Turquie.
La Mission souhaite saluer l’implication bienvenue de la Turquie dans la solution des conflits du Moyen-Orient. Elle considère qu’en dépit de quelques dérapages condamnables, la Turquie est parvenue au nom de sa capacité de médiation à maintenir un équilibre subtil entre la modération et la radicalité, entre les déclarations de son Premier ministre et celles de son Président. Cependant, cet équilibre est précaire. La Mission estime donc que les relations de la Turquie avec les Etats ou les organisations extrémistes doivent être observées avec une vigilance particulière et que toute atteinte aux principes démocratiques doit être condamnée.
Alors que la Turquie a longtemps semblé vouloir assumer le rôle de passerelle entre l’Orient et l’Occident, elle semble aujourd’hui vouloir le dépasser pour être reconnue comme une puissance régionale.
Si la Turquie a incontestablement su saisir les opportunités offertes par la mondialisation sur le plan économique, elle cherche à en faire de même sur le plan diplomatique. La redistribution des cartes géopolitiques lui donne en effet l’occasion de confirmer son statut de puissance émergente.
Ce positionnement oblige les puissances traditionnelles à regarder d’un œil neuf, dépourvu de préjugés mais lucide, les évolutions de la Turquie. C’est précisément ce que la Mission a tenté de faire au cours de ses travaux.
Le premier constat que peut dresser la Mission est celui de la forte dominante économique de la diplomatie turque. La réussite économique dont témoigne la présence de la Turquie au G20 l’incite à développer une véritable stratégie d’entreprise, orientée vers la conquête de nouveaux marchés. Parallèlement, la Turquie sait rappeler à ses interlocuteurs sa position géographique qui en fait un acteur incontournable de l’approvisionnement énergétique, en dépit de sa propre dépendance en la matière.
Le second aspect remarquable concerne sa diplomatie tous azimuts qui conduit la Turquie à s’implanter sur des continents qu’elle ignorait jusque-là. Cette politique, si elle a notamment pour objet de la rapprocher d’autres puissances émergentes, peine pour le moment à produire des résultats concrets. Elle pose également la question des moyens dont dispose à ce jour la Turquie pour satisfaire ses ambitions.
En troisième lieu, si la détermination turque à adhérer à l’Union européenne semble entière, elle doit plus que jamais se traduire par des actes tant il reste de chemin à parcourir en matière de droits de l’homme et de démocratie. Pour cette raison, il est important que le processus de négociation, « deus ex machina » de la modernisation de la Turquie, selon l’expression d’une interlocutrice de la Mission, se poursuive, ce qui suppose la relance des réformes aujourd’hui enlisées en Turquie.
La Mission a relevé d’autres contradictions de la politique étrangère turque actuelle : la volonté d’apaisement dans la région brandie par la Turquie comme son nouvel étendard semble aujourd’hui démentie par la dégradation, toujours plus marquée, de ses relations avec Israël. En outre, le rapprochement avec ses voisins, dont la motivation économique est évidente, n’est pas encore une réalité : en dépit de réels progrès qui méritent d’être salués, les questions de Chypre et de l’Arménie demeurent dans l’impasse.
Enfin, sa volonté de s’imposer comme une puissance régionale ne doit pas inciter la Turquie à des compromissions avec des Etats ou des organisations qui refusent la démocratie. Cette volonté se heurte par ailleurs à la résistance de certains pays arabes, tandis que d’autres voient en la Turquie un modèle pour leur développement.
De nombreuses questions restent donc en suspens. Il est peu probable que des réponses y seront apportées avant les prochaines élections législatives. Le devenir du Premier ministre, dont les déclarations ont parfois des effets diplomatiques destructeurs, sera ainsi l’une des clés de l’évolution de la diplomatie turque dans les prochaines années. La Mission estime que les paradoxes qu’elle a soulignés devront être résolus pour clarifier le dessein encore incertain de la Turquie sur la scène internationale.
La commission examine le présent rapport d’information au cours de sa séance du mercredi 7 juillet 2010.
Après les exposés de la rapporteure et du président, M. Jean-Marc Roubaud, président de la mission, souhaite faire part de quelques réflexions personnelles au sujet de l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne qui divise tant l’opinion publique française. Il me semble essentiel que la Turquie poursuive le processus d’adhésion, ce qu’a permis la France en ouvrant deux nouveaux chapitres de négociation sous sa présidence. Je suis en outre persuadé qu’il ne faut pas laisser la Turquie s’ancrer du côté de l’Iran et de certains Etats arabes peu sûrs. La France doit adopter une position d’apaisement et s’efforcer de développer ses partenariats, notamment économiques, avec la Turquie, car les deux parties ont beaucoup à y gagner. Le positionnement de la France contre l’adhésion turque à l’Union européenne lui a déjà coûté un certain nombre de marchés, parfois au profit d’entreprises russes. En tout état de cause, personne n’aura à prendre de décision sur la question de l’adhésion avant quinze à vingt ans et c’est alors la situation en Turquie qui devra être prise en considération.
Actuellement, ce sujet cristallise des préoccupations internes de part et d’autre. En France, la sensibilité, légitime, aux problèmes des Arméniens, l’image négative qui entoure souvent les musulmans, tous perçus comme arabes, pèsent dans l’opinion publique. En Turquie, les difficultés rencontrées dans le traitement de certains chapitres de négociation trouvent aussi des causes dans la politique intérieure.
M. le président Axel Poniatowski. Nombreux sont nos collègues qui souhaitent poser une question ou exprimer une opinion. Je vous annonce que, à partir du mois de septembre, le bureau décidera du temps de parole qui sera accordé à chaque membre de la commission, en fonction du nombre de demandes d’intervention. Je veillerai à ce que ce temps soit respecté en utilisant un sablier électronique.
Mme Martine Aurillac. Je tiens à féliciter le Président et la Rapporteure pour leur rapport, qui montre bien la complexité du sujet.
Il met notamment en évidence les ambiguïtés et paradoxes de la position turque sur le Moyen-Orient. Les Palestiniens que nous avons rencontrés ont souhaité que la Turquie entre dans l’Union européenne, ce qui aurait pour effet de l’éloigner du conflit proche-oriental !
Je partage les conclusions du président de la Mission : il faut en effet poursuivre le processus d’adhésion. Je m’interroge sur les limites de la montée en puissance de la Turquie : la concurrence de l’Egypte, celle des pays émergents, le poids du problème arménien, qui sera encore accru si le Congrès des Etats-Unis reconnaît le génocide arménien, ne risquent-ils pas de limiter ses possibilités d’actions ?
M. Dominique Souchet. La diplomatie turque connaît de nouveaux développements dans le Sud Caucase. L’accord qu’elle avait conclu avec l’Arménie a été remis en cause dès le lendemain de sa signature. Ankara endosse désormais la politique de nouveau agressive de l’Azerbaïdjan, qui s’est traduite par de récents incidents dans la région du Haut-Karabakh, lesquels ont fait plusieurs morts de part et d’autre. La Turquie joue avec le feu alors que les moyens militaires azerbaïdjanais ont été décuplés au cours des dernières années grâce à la rente pétrolière. Le Haut-Karabakh est redevenu une véritable poudrière. Pourriez-vous nous expliquer ce revirement de la diplomatique turque ?
M. Jean-Michel Ferrand. On critique régulièrement le fonctionnement de la démocratie en Turquie mais je tiens à souligner que le parti au pouvoir perd régulièrement les élections et que la place des femmes y est sur certains points plus avancée qu’en France : les Turques ont obtenu le droit de vote bien avant les Françaises et l’une d’entre elle, Mme Ciller, a occupé le poste de premier ministre pendant trois ans.
Pour ce qui est de la position de la Turquie vis-à-vis d’Israël, il ne faut pas oublier qu’elle a très longtemps été son seul allié dans la région et que les deux pays ont réalisé de nombreuses manœuvres militaires communes. En ce qui concerne Chypre, l’origine de la séparation de l’île en deux entités est imputable aux colonels grecs qui voulaient l’annexer, et non à un quelconque expansionnisme turc.
N’est-il pas dangereux de se prononcer en faveur de la poursuite des négociations tout en affirmant que la Turquie n’a pas sa place en Europe ?
M. Philippe Cochet. Je souhaiterais aborder l’aspect militaire de la puissance turque. L’armée turque est la troisième d’Europe derrière les armées française et britannique. Le processus de rapprochement entre la Turquie et l’Union européenne aura-t-il des conséquences sur les forces militaires turques et, le cas échéant, dans quel sens ?
L’accord signé dans le domaine du nucléaire avec l’Iran a été obtenu par un travail conjoint des diplomaties turque et brésilienne. Faut-il attendre de nouveaux développements de cette coopération ? Les travaux de la Mission vous ont-ils conduit à être plutôt favorables ou plutôt défavorables à l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne ?
M. Jean-Louis Bianco. Je suis moi aussi d’accord avec les conclusions du président. La question de l’adhésion est très complexe et il est vrai que la crise économique risque encore de renforcer la position de ceux qui y sont hostiles. Il me semble néanmoins indispensable de réaffirmer que cette question reste ouverte. On verra bien, le moment venu, quelle réponse lui sera apportée. Jusqu’ici, même si deux nouveaux chapitres ont été ouverts sous sa présidence, la France continue à donner le sentiment qu’elle est défavorable à l’entrée de la Turquie.
Il me semble que, la question de Chypre mise à part, les relations entre la Turquie et la Grèce s’étaient réchauffées. L’avez-vous également constaté ? Un certain nombre de progrès ont été enregistrés dans le rapport entre les autorités turques et la communauté kurde mais des blocages subsistent. Pourriez-vous revenir sur ce sujet ? La diplomatie turque est-elle influencée par d’autres pays que les Etats-Unis et la Russie ?
M. Michel Terrot. Je voulais interroger le président et la rapporteure sur les relations entre la Turquie et l’Azerbaïdjan, thème qui a déjà été abordé par M. Dominique Souchet.
M. Lionnel Luca. Je retiens de la présentation de ce rapport le grand nombre d’ambiguïtés de la diplomatie turque. Il est difficile de se faire une opinion claire sur ses positions, dans quelque domaine que ce soit. Peut-être n’est-ce que de l’habileté politique… Il me semble néanmoins qu’il ne faut pas mésestimer le poids de l’histoire et de la géographie. J’ai le sentiment que la Turquie aspire à retrouver une puissance « ottomane » sous de nouvelles formes. Ce n’est pas une aspiration méprisable, mais une traduction de la fierté nationale turque.
Pourriez-vous préciser les relations que la Turquie entretient avec la Bosnie-Herzégovine, avec le Kosovo et avec l’Allemagne ? Par ailleurs, j’estime que la commission devrait s’intéresser au problème kurde en tant que tel. Il est regrettable que la situation de ce peuple, partagé entre plusieurs Etats, suscite aussi peu l’attention des médias.
M. Jean-Michel Boucheron. La Turquie est le seul espace de respiration stratégique de l’Europe, tout ce qui peut amener à adopter des positions plus visionnaires sur l’avenir des relations entre la Turquie et l’Europe est positif. Actuellement, l’évolution des mentalités est trop lente, et la position de l’exécutif français n’est pas la bonne. J’aimerais que les responsables politiques de notre pays gouvernent avec le sens du long terme, et pas le nez dans les sondages.
L’Europe comprend mal la nouvelle politique extérieure de la Turquie, qui est, en réalité, le résultat de l’histoire et surtout de la géographie de ce pays, et de l’émergence d’un monde multipolaire.
J’aurais deux questions. Vers quel pays le leader kurde Ocalan a-t-il été expulsé ? Percevez-vous des évolutions sur le dossier chypriote ?
M. Christian Bataille. Je n’ai pas ressenti les mêmes évolutions des relations entre la Turquie et la France. La Turquie éprouve un ressentiment assez fort sur les mécomptes de son adhésion à l’Union européenne à l’égard de deux pays : l’Allemagne, du fait de l’importante communauté turque allemande, et la France, avec laquelle la relation ressemble à du dépit amoureux.
La Turquie estime que la France a surdimensionné la question de son adhésion à l’Union européenne. Les Turcs gardent en tête la campagne de 2007, au cours de laquelle il fut beaucoup question de ce point, et leur dépit amoureux est d’autant plus fort que beaucoup d’éléments rapprochent la Turquie de la France.
La laïcité d’abord. Peu de pays musulmans sont aussi laïcs que la Turquie, à part peut-être la Tunisie. L’héritage kémaliste reste vivace, malgré un retour relatif de l’Islam dans la vie quotidienne. La langue, en deuxième lieu. Malheureusement limité à la précédente génération de l’élite turque, le français reste toutefois très pratiqué en Turquie. Enfin, l’Histoire. La France a des relations plus qu’anciennes avec la Turquie.
En dehors de la question de l’adhésion à l’Union européenne, qui ne sera pas résolue avant longtemps, la France doit développer considérablement ses relations avec la Turquie, sur tous les points. La Turquie est notre meilleure porte d’entrée vers l’Asie, et la France ne doit pas ramener l’évolution de ses relations avec cette grande puissance à une simple question binaire. Après les dérapages passés, est-il raisonnable d’espérer un rattrapage de nos relations avec la Turquie ?
Enfin, la Turquie est un pays de transit pour l’énergie. Vous avez cité Nabucco, mais de nombreux autres réseaux existent. Toutefois, concernant Nabucco, celui-ci ne peut être rentabilisé qu’avec l’apport de gaz et de pétrole iranien. Pensez-vous que cela puisse devenir réalité ?
M. Jean-Paul Dupré. L’attitude ambiguë de la France et de l’Europe vis-à-vis d’une République laïque comme la Turquie est très préjudiciable, compte tenu du rôle de ce pays dans l’Histoire, de son poids géographique, et des évolutions à venir. Il est urgent d’être responsable.
Vous avez évoqué des difficultés nouvelles concernant le respect de la laïcité. Pourriez-vous être plus précis ?
M. Jean-Claude Guibal. La Turquie est une puissance émergente qui s’appuie sur une histoire ancienne et glorieuse, et peut suivre désormais plusieurs stratégies de développement géopolitique. Dans les discours, et les rêves, des dirigeants turcs, avez-vous perçu des références à l’empire ottoman ? Est-ce une référence pour les futurs développements géopolitiques turcs ?
Concernant l’Union pour la Méditerranée, quel rôle celle-ci peut-elle jouer dans les relations entre la Turquie et l’Europe ? L’entrée de la Turquie en Europe pourrait-elle modifier l’organisation de l’Union européenne ?
M. Jean-Luc Reitzer. J’ai toujours été convaincu de la nécessité d’ancrer la Turquie en Europe, la question des modalités venant nécessairement après cette affirmation. Personnellement, j’ai été frappé par la qualité du personnel politique turc. En tant que membre de l’assemblée parlementaire de l’OTAN, j’estime que la Turquie est un élément essentiel de notre dispositif de sécurité.
Pourriez-vous nous donner des éléments chiffrés concernant l’émigration turque ? Une importante communauté turque réside en Allemagne, mais aussi en Alsace, et notamment dans ma commune. Quelles conséquences la croissance économique très rapide de la Turquie a-t-elle eu sur l’émigration ?
M. Jacques Myard. La Turquie est turque, comme elle l’a rappelé en refusant l’autorisation de survol de son territoire aux avions américains lors de la guerre d’Irak de 2003. La Turquie défend ses intérêts stratégiques qui lui sont dictés par sa géographie, ce qui est parfaitement normal. La Turquie appartient à l’espace euro-méditerranéen, c’est une évidence. Je suis étonné des propos tenus sur la relation entre la Turquie et Israël. De nombreux Juifs ne se sont-ils pas réfugiés en Turquie dans le passé ? Il y avait également de nombreuses loges maçonniques dans le pays.
Ne pourrait-on pas donner un mandat à la Turquie pour stabiliser le Moyen-Orient ?
M. Jean-Paul Lecoq. Il est évident que la Turquie est appelée à jouer un grand rôle à l’avenir. Concernant le problème kurde, l’accession de la Turquie à la présidence de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe modifie-t-elle la donne ?
M. Jean-Pierre Kucheida. La Turquie a un patrimoine commun avec la France. Atatürk souhaitait absolument l’arrimage de son pays à l’Europe et historiquement l’empire ottoman a toujours eu un tropisme vers l’Europe. Mais la Turquie, ce sont des Turcs.
Le problème est que, si l’Europe refuse de se rapprocher de la Turquie, celle-ci se tournera vers l’Est et l’Asie centrale en raison de facteurs géostratégiques – présence d’hydrocarbures – et culturel – une religion commune. Notre intérêt majeur est de ne pas laisser ce glissement s’opérer. Nous avons, nous Français, une responsabilité très lourde.
M. Didier Mathus. La question turque est devenue, en France, une question de politique intérieure. Comment peut-on la dégager de cette ornière pour en faire, à nouveau, un sujet de politique étrangère ?
M. Jean-Marc Roubaud, président de la mission. Pour répondre à Martine Aurillac, il est évident que le développement de la puissance économique turque sera progressif et devra faire face à la concurrence d’autres pays.
En réponse à Dominique Souchet, sur le sud Caucase, les résultats de la politique turque sont minces. Je partage les opinions exprimées par Jean-Michel Ferrand et Jean-Louis Bianco. Pour répondre à Philippe Cochet, l’effort militaire continuera, il est nécessaire. L’ancrage de la Turquie à l’OTAN reste fort : celui-ci pourrait avoir une influence sur les relations avec Israël. Il faut cependant avoir conscience que l’axe traditionnel Turquie-Israël-Etats-Unis est fêlé en ce moment.
La Russie a une influence très forte sur la région, qui relègue parfois la Turquie au second plan notamment dans le Caucase.
Je suis d’accord avec Lionnel Luca quant au poids de l’histoire. L’empire ottoman est une fierté pour ce grand peuple.
Quant à la remarque de Jean-Michel Boucheron sur les sondages, on fait tous de la politique. Les positionnements de la campagne de 2007 étaient à usage interne, et c’est la même chose en Turquie où les problèmes de politique intérieure pèsent sur le processus de réformes demandées par l’Europe.
Je partage aussi l’avis de Christian Bataille. La Turquie est un hub énergétique. Il y a là un entrelacement de réseaux impressionnant, dont Nabucco n’est qu’un des éléments. La question de la relation avec l’Iran est d’autant plus importante mais il ne faut pas laisser la Turquie bouleverser les alliances et les équilibres au Moyen-Orient, tout en espérant que l’Iran se démocratise.
Sur la question de Jean-Claude Guibal, la Turquie a été très réticente sur l’UpM au début, croyant qu’on lui présentait un hochet de substitution à l’Union européenne mais elle a désormais conscience de son importance, et joue pleinement son rôle.
Comme le dit Jean-Luc Reitzer, la Turquie au sein de l’OTAN demeure un allié majeur de notre sécurité collective. Donner un mandat à la Turquie sur le Proche-Orient, comme le suggérait Jacques Myard, est sans doute difficile mais elle peut tenir le rôle de stabilisateur. Enfin, comme le disait Didier Mathus, sur la position de la France, nous avons effectivement une carte d’apaisement à jouer aujourd’hui pour construire quelque chose pour le futur.
Mme Marie-Louise Fort, rapporteure. Je crois que, en ce qui concerne la Turquie et le parti actuellement au pouvoir, on n’a pas encore pris la mesure du changement par rapport aux vieilles élites kémalistes. Il s’agit d’un parti qui représente la grande bourgeoisie anatolienne, conservatrice, bigote, si l’on peut employer ici ce terme, et très industrieuse. Les questions d’Islam, de radicalisme sont à examiner dans ce contexte. Il y a aussi une nette évolution en ce qui concerne les femmes. Il y a deux ans, la Cour suprême devait faire échec au dépôt d’un projet de loi sur l’adultère féminin. En deux ans, au cours de nos deux visites successives, nous avons vu une nette évolution, depuis un point de départ proche de la caricature.
Sur la question kurde dont le gouvernement a fait une de ses priorités depuis 2009, on constate également des évolutions : il y a désormais une télévision publique en langue kurde, qui est par ailleurs enseignée dans un département de langue orientale de l’université. Le projet d’« ouverture démocratique » est certes loin d’avoir abouti mais il y a une volonté réelle de progresser sur ce thème. J’invite d’ailleurs à faire le parallèle avec la Syrie où la situation des Kurdes est moins favorable. Pour M. Boucheron, je précise qu’un Ocalan a été condamné à mort et qu’il est en prison. Face au regain de violence actuel, les responsables turcs souhaitent relancer le processus démocratique en direction des Kurdes. Sur le respect des minorités, les choses doivent être nuancées. Les minorités religieuses en Turquie ne sont pas aidées et l’absence de reconnaissance de leur personnalité juridique leur pose problème. Lors d’un déplacement il y a deux ans, on a ainsi pu voir ce qu’il en était des minorités chrétiennes, qui ne peuvent pas avoir les moyens d’entretenir leurs monuments, qu’on empêche de former de jeunes générations capables de prendre la relève. Les minorités musulmanes ne sont guère mieux traitées malgré les discours d’ouverture et de tolérance. Elles sont ainsi fortement incitées à adopter des pratiques proches de celles de la majorité. Il y a donc encore beaucoup de progrès à faire, sans parler de la question chypriote.
Sur la question de l’adhésion à l’Union européenne, il y a deux ans, je vous aurais répondu non. Aujourd’hui, je dirais qu’il ne faut pas insulter l’avenir. Le monde va vite. La planète traverse une crise financière et morale. Il faut continuer le processus de négociation et lorsque le problème se posera, on s’apercevra qu’ils sont fortement tournés vers nous. Cela étant, pourquoi tout le monde pousse-t-il à cette adhésion ? Les Palestiniens que nous avons rencontrés comme l’a rappelé Mme Aurillac considèrent que si la Turquie était membre de l’Union européenne, elle se mêlerait moins des affaires du Proche-Orient tandis que l’Union européenne pourrait s’y impliquer davantage. Il faut souligner en même temps le poids de l’Egypte dans la région.
Enfin, concernant l’Arménie et l’Azerbaïdjan, j’ai une sensation d’enlisement. Cependant, la Turquie est assez pragmatique : quand le moment sera venu, ils seront capables d’avancer.
Puis la commission autorise la publication du rapport d’information.
Liste des personnalités rencontrées
(par ordre chronologique)
1) à Paris
– M. Joël Meyer, sous-directeur de l’Europe méridionale à la direction de l’Union européenne du ministère des affaires étrangères et européennes, et Mlle Vanessa Selk, pôle Turquie/Chypre de la sous direction Europe méridionale (9 juin 2009)
– M. Gilles Veinstein, professeur au Collège de France, chaire Histoire turque et ottomane (10 juin 2009)
– M. Didier Billion, directeur adjoint de l’Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS) (30 juin 2009)
– M. Jean Marcou, chercheur à l’Institut français d’études anatoliennes d’Istanbul, directeur de l’Observatoire de la vie politique turque (21 juillet 2009)
– Son Exc. M. Osman Koruturk, ambassadeur de Turquie en France (22 septembre 2009)
– M. Jean-François Leguil-Bayart, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) (21 octobre 2009)
– Mme Dorothée Schmid, responsable du programme « Turquie contemporaine » à l’Institut français des relations internationales (IFRI) (1er décembre 2009)
– M. Pekin Baran, vice-président du Comité consultatif de l’association des industriels et des entrepreneurs de Turquie (TUSIAD) (20 janvier 2010)
– Son Exc. M. Daniel Shek, ambassadeur d’Israël en France (26 janvier 2010)
– M. Serge Telle, ambassadeur chargé du processus euroméditerranéen initié à Barcelone, en charge de l’initiative sur l’Union pour la Méditerranée (2 février 2010)
– M. Hamit Bozarslan, directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) (9 février 2010)
– Son Exc. M. Viguen Tchitetchian, ambassadeur d’Arménie en France (23 février 2010)
– Mme Catherine Verdier, directrice expertise marchés, direction gaz-énergies nouvelles – Groupe Total (11 mai 2010)
– Son Exc. M. Elchin Amirbayov, ambassadeur d’Azerbaïdjan en France (18 mai 2010)
– M. François Bernard, représentant permanent en France de l’Agence nationale turque pour le soutien et la promotion des investissements (Invest in Turkey) (23 juin 2010)
2) en Turquie (du 21 au 24 mars 2010)
a) à Ankara
– Son Exc. M.Bernard Emié, ambassadeur de France en Turquie, et ses collaborateurs
– M. Marc Pierini, chef de la délégation de la Commission européenne en Turquie
– M. Yasar Yakis, député AKP et ancien ministre des affaires étrangères
– M. Murat Mercan, président de la commission des affaires étrangères de la Grande Assemblée de Turquie (GANT)
– M. Mustafa Sukru Elekdag, député
– Mme Ayse Sezgin, sous-secrétaire d’Etat adjoint en charge de l’Europe
– M. James Jeffrey, ambassadeur des Etats-Unis en Turquie
– M. Engin Soysal, sous-secrétaire d’Etat adjoint en charge du Moyen-Orient, Irak et Asie du Sud
– MM. Onur Öymen (député CHP), Hüseyin Pazarci (député indépendant), Yahya Dogan (député AKP), Kürsat Atilgan (député MHP)
– M. Metin Heper, doyen de l’Université de Bilkent
– M. Sinan Ülgen, directeur de l’EDAM (Center for economic and foreign policy studies)
– M. Hakan Celik, représentant à Ankara du quotidien Posta
– M. Denis Zeyrek, directeur de l’information du quotidien Radikal
– M. Hervé Magro, consul général à Istanbul, et ses collaborateurs
– M. Hugh Pope (International Crisis Group)
– M. Can Buharali (Center for Economics and Foreign Policy Studies)
– M. Cengiz Aktar, directeur du Centre d’études européennes, de l’Université privée Bahçeshir d’Istanbul
– M. Ahmet İnsel, doyen de la faculté d’économie de l’Université francophone de Galatasaray
– Mme Füsun Türkmen, directrice adjointe du Département des relations internationales de l’Université francophone de Galatasaray
– M. Can Paker président de TESEV (Fondation turque pour les études sociales et économiques)
– M. Mensur Akgün, Mme Sabiha Şenyücel Gündoğar et Mlle Gökçe Perçinoğlu - (TESEV)
3) en Syrie (du 24 au 26 mars 2010)
– Son Exc. M. Eric Chevallier, ambassadeur de France en Syrie, et ses collaborateurs
– M. Didier Guilbert, consul de France à Alep
– M. Abdallah al Dardari, vice-premier ministre chargé des affaires économiques
– M. Abdelfatah Ammourah, vice-ministre des affaires étrangères
– M. Mahmoud al Abarche, président de l’Assemblée du Peuple
– M. Peter Harling, responsable du bureau régional de l’International Crisis Group (ICG)
– Son Exc. M. Omer Ohon, ambassadeur de Turquie en Syrie
4) à Bruxelles (6 mai 2010)
– Son Exc. M. Philippe Etienne, ambassadeur, représentant permanent de la France auprès de l’Union européenne et Mme Mathilde Grammont, conseillère en charge du dossier élargissement pour la Turquie
– Son Exc. Mme Pascale Andréani, ambassadeur, représentant permanent de la France auprès de l’OTAN
– M. Jean-Christophe Filori, responsable de l’unité Turquie, direction générale de l’élargissement de la Commission européenne
– Mme Alexandra Cas Granje, directrice, direction générale de l’élargissement de la Commission européenne
– M. Selim Kuneralp, ambassadeur de la Turquie auprès de l’Union européenne
– Mme Ria Oomen-Ruijten, eurodéputée
5) en Israël et dans les territoires palestiniens (du 24 au 26 mai 2010)
a) à Jérusalem et Tel Aviv
– Son Exc. M. Christophe Bigot, ambassadeur de France en Israël, et ses collaborateurs
– M. Tzachi Hanegbi, président de la commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset et M. Shmuel Latko, directeur de la commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset
– M. Gérard Benhamou, journaliste Radio J
– M. Dan Catarivas, directeur des relations internationales de l’Association des industriels israéliens
– Mme Tsilla Hershco, Begin-Sadate Center for Strategic Studies (BESA)
– M. François Lafon, directeur du Centre de recherche français de Jérusalem (CRFJ)
– Mme Renée Poznanski, professeur de sciences politiques à l’Université Ben Gourion
– M. Majadli Wahbee, député, ancien vice-ministre des affaires étrangères
– M. Danny Ayalon, vice-ministre des affaires étrangères
– Mme Irit Lilian, directrice du Département Europe (division Turquie) au ministère des affaires étrangères
– M. Robert Tiviaev, député, président du groupe d’amitié Israël-Turquie
b) à Jérusalem et Ramallah
– M. François-Xavier Léger, consul général adjoint à Jérusalem, et ses collaborateurs
– M. Ziad Abu Amr, ancien ministre des affaires étrangères, député indépendant de Gaza
– M. Bernard Sabella, député
– M. Mahdi Abdel Hadi, directeur de la Palestinian Academic Society for the Studies of International Affairs (PASSIA)
– M. Hanna Siniora, directeur de l’Israel-Palestine Center for Research and Information (IPCRI)
– M. Issa Kassassiyeh, chef de l’unité de soutien aux négociations (Negotiating Support Unit) de l’OLP
– M. Nabil Shaath, ancien ministre des affaires étrangères, député, chef du département des affaires internationales du Fatah
1 () Audition du 6 octobre 2009.
2 () Association des industriels et des entrepreneurs de Turquie. Audition du 20 janvier 2010.
3 () Audition du 21 juillet 2009.
4 () « Energies : trait d’union entre l’Europe et la Turquie », M. Richard Yilmaz, Défense nationale et sécurité collective.
5 () Audition du 10 juin 2009.
6 () Ce réseau créé par l’imam Fethullah Gülen, aujourd’hui exilé aux Etats-Unis, compterait plus de 2 000 écoles dans plus de 110 pays.
7 () Audition du 1er décembre 2009.
8 () Rapport d’information n° 2553 sur « la situation dans le Caucase du Sud ».
9 () Audition du 30 juin 2009.
10 () « Que veut la Turquie ? », M. Gilles Dorronsoro, Editions Autrement.
11 () Audition précitée du 1er décembre 2009.
12 () Audition du 21 octobre 2009.
13 () Audition du 9 février 2010.
14 () Audition précitée du 30 juin 2009.
15 () Parti des travailleurs du Kurdistan.
16 () Sommet de Strasbourg-Kelh, 3 et 4 avril 2009.
17 () Attentat contre un bus transportant du personnel militaire qui a causé la mort de cinq personnes.
18 () Outre de nombreux bombardements, l’armée turque a réalisé le 16 juin une incursion en territoire irakien pour poursuivre un groupe de terroristes du PKK.
19 () Responsable de l’unité Turquie de la direction générale Elargissement de la Commission européenne.
20 () Audition précitée du 21 juillet 2009.
21 () Audition par la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale le 2 février 2010.
22 () Alors Premier ministre du Danemark, M. Rasmussen avait défendu la liberté d’expression dans l’affaire des « caricatures de Mahomet » qui avaient été publiées dans la presse danoise en 2005.
23 () Audition du 26 janvier 2010.
24 () « Quel avenir pour le couple Turquie-Israël ? », M. Pierre Razoux, Politique étrangère, n° 1/2010.
25 () Représentant de l’International crisis group à Damas.
26 () Entré en vigueur le 1er décembre 1964.
27 () Protocole qui prévoit l’extension de l’union douanière aux nouveaux Etats membres de l’Union européenne.
28 () Discours du Président de la République devant la Conférence des Ambassadeurs, 27 août 2007, Paris.
29 () Audition précitée du 21 juillet 2009.
30 () Les accords dits « Berlin plus » adoptés lors du sommet de Washington en 1999, régissent la mise à disposition de l’Union européenne des moyens et des capacités de l’OTAN pour des opérations dans lesquelles l’Alliance ne serait pas engagée militairement en tant que telle, les modalités de coopération entre l’OTAN et l’Union européenne ayant été confirmées lors du Conseil européen de Nice, en décembre 2000.
31 () Audition du 2 février 2010.
32 () Audition du 23 février 2010.
33 () Center for economics and foreign policy studies.
34 () Représentant à Damas de l’International crisis group.
35 () « La Turquie, pivot incontournable au Moyen-Orient », Diplomatie, n°44.
36 () « Turkey and the middle East : ambitions and constraints », avril 2010.
37 () Rapport d’information n° 2628 publié le 16 juin 2010.
38 () « The perception of Turkey in the middle east », étude réalisée en juillet 2009 auprès de 2006 personnes en Egypte, Syrie, Palestine, Jordanie, Liban, Irak et Arabie saoudite.
© Assemblée nationale