![]()
N° 3334
——
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 avril 2011.
RAPPORT D’INFORMATION
déposé
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, en conclusion des travaux d’une mission d’information (1) sur la prostitution en France,
ET PRÉSENTÉ
PAR M. Guy Geoffroy,
Député,
——
La mission d’information sur la prostitution en France est composée de Mme Danielle Bousquet, présidente, M. Guy Geoffroy, rapporteur, M. Philippe Goujon, M. Alain Vidalies et Mme Marie-Jo Zimmermann pour la commission des Lois ; M. Élie Aboud et Mme Marie-Françoise Clergeau pour la commission des Affaires sociales.
INTRODUCTION 15
PREMIÈRE PARTIE : LA PROSTITUTION AUJOURD’HUI EN FRANCE : MUTATIONS ET PERMANENCES D’UNE RÉALITÉ MÉCONNUE 19
I. – COMBIEN Y A-T-IL DE PERSONNES PROSTITUÉES AUJOURD’HUI EN FRANCE ? 19
A. LA PROSTITUTION DE RUE : DES CHIFFRES À MANIER AVEC PRÉCAUTION 20
1. La prostitution de rue en région parisienne, une réalité difficile à quantifier avec précision 20
2. La prostitution de rue en province, des ordres de grandeurs cohérents 22
3. La prostitution des mineurs, emblématique des divergences de chiffres entre les services de police et les associations 23
B. UNE PROSTITUTION « DISCRÈTE » DIFFICILE À QUANTIFIER 25
1. La prostitution dans les bars à hôtesse et les salons de massage 25
2. La prostitution par Internet 26
C. LA PROSTITUTION ÉTUDIANTE : FANTASME OU RÉALITÉ ? 27
D. LA PROSTITUTION MASCULINE ET TRANSGENRE 29
1. La prostitution masculine en général 29
2. La prostitution transgenre en particulier 30
II. – LA PROSTITUTION DITE « TRADITIONNELLE » CÈDE PROGRESSIVEMENT LA PLACE À L’EXPLOITATION SEXUELLE ET À LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS 31
A. LA FORTE AUGMENTATION DE LA PROSTITUTION ÉTRANGÈRE DEPUIS LES ANNÉES 1990 EST LIÉE À L’ÉMERGENCE DE RÉSEAUX DE PROSTITUTION 32
1. Les années 1990 constituent un tournant en matière de prostitution 32
a) La part des personnes prostituées de nationalité étrangère a doublé depuis les années 1990 32
b) Plus de 90 % des personnes prostituées sur la voie publique sont aujourd’hui de nationalité étrangère 34
2. Cette augmentation s’explique par les bouleversements géopolitiques des années 1990 associés au développement de réseaux internationaux de traite 37
a) Plusieurs facteurs ont rendu possible le développement de réseaux de traite et d’exploitation sexuelle 37
b) La prostitution étrangère a connu plusieurs vagues successives en France 38
c) Les personnes prostituées étrangères sont aujourd’hui majoritairement sous l’emprise de réseaux étrangers de traite et d’exploitation sexuelle 39
B. LE FONCTIONNEMENT DES RÉSEAUX DE TRAITE ET D’EXPLOITATION SEXUELLE ASSURE LA PERSISTANCE DU SYSTÈME PROSTITUTIONNEL 41
1. La contraction d’une dette de passage est généralement à l’origine de la situation de prostitution et d’exploitation sexuelle 41
2. Une contrainte, physique ou morale, est toujours exercée sur les personnes prostituées victimes de la traite 43
a) Les réseaux africains : envoûtement et piété filiale 43
b) Les réseaux de l’Est : violences physiques et psychologiques 44
c) L’équilibre du système prostitutionnel assuré par les réseaux 44
3. La prostitution chinoise à Paris, la fin d’une exception ? 45
C. LA GÉOGRAPHIE DE LA PROSTITUTION ÉTRANGÈRE EN FRANCE ET À PARIS 46
1. Les personnes originaires d’Europe de l’Est et des Balkans constituent la majeure partie des personnes prostituées dans les villes de province 47
2. Paris comporte certaines spécificités par rapport à la province 48
III. – L’APPARITION D’INTERNET A PERMIS L’ÉMERGENCE D’UNE NOUVELLE FORME DE PROSTITUTION 49
A. INTERNET, UN MÉDIA PRIVILÉGIÉ POUR LA PROSTITUTION 49
a) L’avantage financier : la faiblesse des coûts d’accès et de fonctionnement 50
b) La discrétion et l’anonymat : la facilitation du passage à l’acte pour le client comme pour la personne prostituée 51
c) L’impunité : les difficultés de la répression du racolage et du proxénétisme sur Internet 52
B. L’ESCORTING, LA PROSTITUTION PAR INTERNET 53
1. L’escorting, un mot nouveau pour décrire une même réalité ? 53
a) L’escorting se définit essentiellement en opposition à la prostitution de rue 53
b) Le client dans l’escorting 54
c) L’escorting semble en réalité être aussi divers que la prostitution elle-même 55
2. Les motivations des escortes indépendantes 56
a) La motivation première de la prostitution par Internet reste financière 56
b) L’aspect « glamour » de cette forme de prostitution en favorise l’acceptabilité 57
c) Une façon différente de vivre sa sexualité 58
C. LES « SEX TOURS », NOUVELLE FORME D’EXPLOITATION DE LA PROSTITUTION 58
IV. – LA PRÉCARITÉ ET LA VULNÉRABILITÉ DEMEURENT DES FACTEURS DÉTERMINANTS D’ENTRÉE ET DE MAINTIEN DANS LA PROSTITUTION 60
A. LES RUPTURES FAMILIALES ET L’EXCLUSION SOCIALE 61
1. Les mineurs en errance 61
2. Un rejet lié à l’orientation sexuelle 62
3. L’exclusion sociale accrue des personnes transgenres 62
B. LA PRÉCARITÉ ÉCONOMIQUE 64
1. La prostitution étrangère comme aboutissement d’un processus migratoire 64
2. La prostitution résultant d’une vulnérabilité accrue de certaines catégories sociales 67
a) La prostitution des étudiants : concilier études et conditions de vie décentes 67
b) La prostitution de personnes âgées : le cumul d’une vulnérabilité financière et sociale 68
3. Toxicomanie et prostitution : un cercle vicieux 70
C. LA VULNÉRABILITÉ PSYCHOLOGIQUE 71
1. Les violences subies durant l’enfance comme facteur fragilisant 71
2. L’emprise psychologique d’un proche comme facteur déclenchant 72
V. – DES CONDITIONS DE VIE ET D’EXERCICE QUI PORTENT LE PLUS SOUVENT ATTEINTE À LA SANTÉ DES PERSONNES PROSTITUÉES 74
A. UNE ACTIVITÉ QUI FAIT COURIR DES RISQUES MAJEURS POUR LA SANTÉ DES PERSONNES QUI LA PRATIQUENT 74
1. Le risque de contamination par les infections sexuellement transmissibles 74
2. Un état de santé globalement détérioré 78
B. UN UNIVERS MARQUÉ PAR DES VIOLENCES D’UNE PARTICULIÈRE GRAVITÉ 79
1. La stigmatisation et l’isolement des personnes prostituées 79
a) Une stigmatisation particulièrement forte 79
b) Un isolement familial fréquent 81
2. Une violence inhérente au milieu prostitutionnel 82
a) Des violences très fréquentes et d’une extrême gravité 82
b) La violence émane, à titre principal, des clients des personnes prostituées 83
c) Elle est également le fait des proxénètes, des personnes prostituées et des passants 84
C. DES SÉQUELLES PSYCHOLOGIQUES ET PHYSIOLOGIQUES SOUVENT MAJEURES 86
1. Une souffrance psychologique notamment liée à la répétition de rapports sexuels non désirés 86
2. Des conséquences physiologiques souvent importantes 88
3. Un usage fréquent des drogues 88
DEUXIÈME PARTIE : DES POLITIQUES PUBLIQUES SOUVENT INCOHÉRENTES, PARFOIS INEFFICACES, VOIRE INEXISTANTES 91
I. – REFUSER TOUTE RECONNAISSANCE JURIDIQUE DE LA PROSTITUTION : UNE POSITION ABOLITIONNISTE DE PRINCIPE QUI SOUFFRE DE QUELQUES INCOHÉRENCES 91
A. LA FRANCE A EXPÉRIMENTÉ, EN MATIÈRE DE PROSTITUTION, LE PROHIBITIONNISME ET LE RÉGLEMENTARISME AVANT D’ADOPTER UNE POSITION ABOLITIONNISTE EN 1946 92
1. Du Moyen Âge à l’Ancien Régime : l’hésitation des pouvoirs publics entre prohibitionnisme et réglementarisme 92
2. La mise en place du « système français » réglementariste à partir du Consulat 93
3. L’avènement de l’abolitionnisme à partir de la seconde moitié du XXe siècle 94
B. L’ABOLITIONNISME POURSUIT PLUSIEURS OBJECTIFS : PROTÉGER LES PERSONNES PROSTITUÉES ET DÉCOURAGER L’ACTIVITÉ PROSTITUTIONNELLE 95
1. L’absence de reconnaissance juridique donnée à la prostitution et son corollaire, la tolérance de la prostitution privée 96
2. La répression du proxénétisme et de l’exploitation sexuelle 96
3. La disparition du phénomène prostitutionnel comme horizon 97
C. LA MULTIPLICITÉ DES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR L’ABOLITIONNISME EST SUSCEPTIBLE DE CONDUIRE À CERTAINES CONTRADICTIONS, QUI N’ENTAMENT TOUTEFOIS PAS SA COHÉRENCE 98
1. La prostitution serait juridiquement reconnue par le droit fiscal et social 98
2. La prostitution serait tolérée, mais empêchée en pratique 100
3. La personne prostituée ne serait pas considérée comme une victime, mais comme une délinquante 102
4. Les personnes prostituées seraient stigmatisées, non pas réinsérées 102
II. – PRÉVENIR LES TROUBLES À L’ORDRE PUBLIC : LES EFFETS CONTRADICTOIRES DE LA RÉPRESSION DU RACOLAGE 104
A. L’ACTIVITÉ PROSTITUTIONNELLE, LORSQU’ELLE CRÉE UN TROUBLE À L’ORDRE PUBLIC, EST RÉPRIMÉE 104
1. L’incrimination des atteintes aux bonnes mœurs et la police administrative sont depuis longtemps utilisées pour limiter la visibilité de la prostitution 105
a) L’incrimination de l’exhibition sexuelle permet de réprimer l’acte prostitutionnel effectué en public 105
b) La police administrative est utilisée depuis longtemps pour limiter les troubles à la tranquillité et à la sécurité publiques 106
2. L’incrimination de racolage est une constante depuis 1939 107
B. L’INCRIMINATION ÉLARGIE DU RACOLAGE DEPUIS LA LOI DU 18 MARS 2003 POUR LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE 109
1. Genèse et principes du délit de racolage tel qu’issu de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure 109
2. Les éléments constitutifs du délit de racolage 110
a) Des moyens caractérisant l’attitude 110
b) Le caractère public de l’acte de racolage 111
c) Le but du racolage 111
3. Une jurisprudence restrictive et une application impressionniste 111
C. LE BILAN NUANCÉ DE L’INCRIMINATION DU RACOLAGE 112
1. Une mesure d’une efficacité relative 112
2. Les effets indésirables de l’incrimination du racolage passif 115
a) Le simple déplacement de la prostitution et la fragilisation des personnes prostituées 115
b) La dégradation des relations avec les forces de l’ordre 117
c) Une difficulté croissante d’accès aux soins 117
III. – LUTTER CONTRE LA TRAITE ET LE PROXÉNÉTISME : DES PROGRÈS RESTENT À ACCOMPLIR 118
A. UN DISPOSITIF JURIDIQUE COMPLET DE LUTTE CONTRE LA TRAITE ET LE PROXÉNÉTISME 119
1. L’incrimination de proxénétisme, dont le champ est particulièrement large, permet une prise en compte de toutes les situations 119
a) Une incrimination particulièrement large, qui permet d’appréhender l’ensemble des situations d’exploitation de la prostitution d’autrui 119
b) Un ensemble complet de peines 123
2. L’infraction de traite des êtres humains vise à assurer une répression efficace des réseaux internationaux de prostitution 125
3. Des moyens et des structures dédiés pour assurer l’effectivité de la répression 128
a) Des procédures dérogatoires en matière de proxénétisme et de traite des êtres humains 128
b) Des droits spécifiques accordés aux victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme 129
c) Des structures d’enquête et de jugement dédiées à la lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains 130
B. LA MISE EN œUVRE DU DISPOSITIF RÉPRESSIF PAR L’APPAREIL JUDICIAIRE CONNAÎT CEPENDANT UN BILAN NUANCÉ 131
1. La mise en œuvre de l’infraction de proxénétisme semble plutôt satisfaisante 131
a) L’infraction de proxénétisme, largement utilisée par les tribunaux, apparaît aujourd’hui comme un outil juridique satisfaisant 132
b) Toutefois, cette incrimination fait l’objet de critiques 133
c) Cette qualification est appliquée de façon variable par les juridictions 134
2. La qualification pénale de traite des êtres humains est insuffisamment utilisée 135
a) Une infraction qui semble peu utilisée en dépit des avantages qu’elle présente 135
b) Les causes de la faible utilisation de l’infraction de traite sont diverses 137
C. LES DROITS OUVERTS AUX VICTIMES DE TRAITE ET DE PROXÉNÉTISME SONT INSUFFISAMMENT MIS EN œUVRE 138
1. Le droit au séjour, corollaire insuffisamment utilisé de l’aide apportée à la justice 138
a) Une possibilité aujourd’hui peu utilisée 139
b) Des services de police et des préfectures parfois réticents à mettre en œuvre l’article L. 316-1 du CESEDA 139
c) Des considérations tant juridiques que pratiques font obstacle à la délivrance d’un titre de séjour 141
2. Les insuffisances du dispositif de protection et d’indemnisation des victimes de la traite et du proxénétisme 141
a) Les failles du système de protection des victimes 142
b) Des dispositifs d’indemnisation jugés inégalitaires et lacunaires 142
IV. – LE VOLET SOCIAL DE L’ABOLITIONNISME, OUBLIÉ PAR LES POLITIQUES PUBLIQUES 144
A. LES POLITIQUES SOCIALES, SOUVENT GÉNÉRALISTES, NE PRENNENT PAS EN COMPTE LES SPÉCIFICITÉS DES PERSONNES PROSTITUÉES 144
1. Les personnes prostituées bénéficient, au plan théorique, des mêmes droits sociaux que le reste de la population 144
a) Le bénéfice théorique des prestations sociales universelles pour les personnes prostituées 145
b) L’affiliation à une caisse de sécurité sociale est possible mais difficile pour les personnes prostituées 146
2. Dans les faits, les personnes prostituées connaissent des difficultés particulières d’accès aux droits et aux soins 147
a) Des conditions trop restrictives et peu adaptées au parcours des personnes prostituées 148
b) Des difficultés notables d’accès aux droits 149
c) Les lacunes de l’accès aux soins 149
B. LES DISPOSITIFS SPÉCIALEMENT DESTINÉS AUX PERSONNES PROSTITUÉES DEMEURENT INSUFFISANTS 151
1. L’échec des services de prévention et de réinsertion sociale 151
2. Le dispositif actuel demeure largement insuffisant au regard des objectifs de prévention et de réinsertion 152
C. LA MAJEURE PARTIE DES POLITIQUES SOCIALES EST AUJOURD’HUI LE FAIT DU SECTEUR ASSOCIATIF 154
1. Des associations diverses qui poursuivent des objectifs parfois opposés 154
2. L’action sanitaire et sociale en faveur des personnes prostituées est aujourd’hui principalement mise en œuvre par le secteur associatif 156
a) L’action des associations dans le domaine sanitaire 157
b) L’action des associations dans le domaine social 158
3. Un financement public variable et non pérenne qui fragilise l’action des associations 159
a) Des financements illisibles 159
b) Des financements en diminution 161
TROISIÈME PARTIE : CONSIDÉRER LA PROSTITUTION AU REGARD DES PRINCIPES RÉPUBLICAINS ET DÉMOCRATIQUES 163
I. – UNE QUESTION À L’ORDRE DU JOUR DANS DE NOMBREUX ÉTATS MAIS MARGINALISÉE SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE 164
A. DES PRÉOCCUPATIONS INTERNATIONALES ESSENTIELLEMENT CENTRÉES SUR LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS 164
1. Une prise de conscience internationale 164
2. Une action déterminée au niveau européen 165
3. Une implication inégale des pays dont sont issues les victimes de la traite 167
B. DES POLITIQUES DIVERGENTES EN MATIÈRE DE PROSTITUTION, QUI RENDENT DIFFICILE TOUT ACCORD INTERNATIONAL 168
1. Des politiques publiques divergentes en matière de prostitution 168
a) Prohibitionnisme, abolitionnisme et réglementarisme : trois grands modèles… 168
b) … qui ne rendent qu’imparfaitement compte de la diversité des politiques publiques 169
2. La marginalisation progressive de la prostitution au sein des accords internationaux et des discussions européennes 170
a) Un sujet polémique, qui semble être de moins en moins abordé 170
b) Une préoccupation qui serait même en voie de régression 171
II. – « LE PLUS VIEUX MÉTIER DU MONDE » : UN SYSTÈME REPOSANT SUR DES PRÉSUPPOSÉS NON QUESTIONNÉS 173
A. LA PROSTITUTION, UN FAIT SOCIAL À RÉGULER : LE MODÈLE NÉERLANDAIS 173
1. La prostitution, une donnée à réguler 173
a) La prostitution est une donnée sociale 173
b) Lutter contre la traite et l’exploitation en réglementant la prostitution 174
c) Améliorer la condition des personnes prostituées en faisant de la prostitution un travail comme un autre 175
2. Des objectifs imparfaitement atteints 176
a) Des effets non mesurés sur le nombre de personnes prostituées 176
b) La réglementation n’a pas mis fin à la traite et à l’exploitation sexuelle 176
3. Vers un renforcement de la réglementation, qui passe par la pénalisation des clients 179
a) Un projet de loi visant à renforcer l’encadrement de la prostitution et la lutte contre la traite 179
b) Un débat public qui ne porte plus sur la prostitution mais sur ses conditions d’exercice 179
B. « L’UTILITÉ SOCIALE » DE LA PROSTITUTION 180
1. « La prostitution fait diminuer le nombre de viols » 180
a) Une « évidence » démentie par les faits 181
b) Au contraire, la reconnaissance de la prostitution peut accroître les pressions sexuelles 182
2. « La prostitution est une réponse à la misère sexuelle » 183
a) La « misère affective et sexuelle » des clients 183
b) Les clients, des « hommes ordinaires » 184
3. Des conceptions largement fondées sur les « besoins irrépressibles » de la sexualité masculine 186
C. LA PROSTITUTION « LIBRE » 188
1. La capacité de consentir 189
2. L’entrée dans la prostitution et les vices du consentement 190
a) Le consentement « extorqué par violence » 190
b) Le consentement « surpris par dol » 191
c) Le consentement « donné par erreur » 191
3. L’existence d’alternatives 192
4. La réversibilité du choix 194
a) L’engrenage de la prostitution 194
b) « Ce n’est pas un métier que l’on quitte un soir en claquant la porte » 195
5. Et celles qui affirment leur liberté ? 196
a) D’autres logiques d’entrée dans la prostitution ? 196
b) Ce que disent les personnes prostituées et ce qu’elles pensent 197
c) La part de liberté 198
III. – UNE PRATIQUE À INTERROGER AU REGARD DES PRINCIPES D’UNE RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ET SOLIDAIRE, FONDÉE SUR LE RESPECT INTANGIBLE DE LA DIGNITÉ DE L’ÊTRE HUMAIN 199
A. LA NON-PATRIMONIALITÉ DU CORPS HUMAIN 200
1. La distinction du corps humain et des biens marchands est au fondement de notre droit 200
2. Se prostituer, est-ce travailler ou est-ce louer son corps ? 201
B. L’INTÉGRITÉ DU CORPS HUMAIN 204
1. La violence est inhérente au monde de la prostitution 204
2. La prostitution est-elle constitutive d’une violence ? 205
a) Des conséquences physiques et psychologiques majeures 205
b) Une activité qui est fréquemment perçue comme étant constitutive d’une violence par les clients et les personnes prostituées 207
c) Le consentement à la violence supprime-t-il la violence ? 208
C. L’ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES 209
1. La prostitution, un monde fortement sexué 209
2. La prostitution perpétue-t-elle les inégalités de genre ? 211
QUATRIÈME PARTIE : REFONDER LES POLITIQUES PUBLIQUES POUR VOIR RÉGRESSER LA TRAITE, LE PROXÉNÉTISME ET LA PROSTITUTION 213
I. – COUPLER LA PÉNALISATION DES CLIENTS À UNE POLITIQUE AMBITIEUSE EN MATIÈRE D’ÉDUCATION ET DE PRÉVENTION 214
A. LA DEMANDE, UNE QUESTION DE PLUS EN PLUS SOULEVÉE 214
1. Le client, acteur central mais longtemps occulté du système prostitutionnel 214
a) « Le client est la personne qui contribue le plus à la traite » 214
b) La demande, une dimension occultée de la prostitution 216
2. Une prise de conscience croissante du rôle de la demande aux plans international et européen 217
a) Une prise de conscience progressive au plan international 217
b) Un mouvement de fond en Europe en direction de la pénalisation des clients 219
c) Un pas vers une pénalisation des clients des victimes de la traite au niveau communautaire 221
B. DIX ANNÉES D’EXPÉRIENCE EN SUÈDE SUR LA PÉNALISATION DES CLIENTS 222
1. Une interdiction symbolique à visée pédagogique 222
a) Une infraction pleinement applicable 222
b) Une vocation essentiellement dissuasive et pédagogique 224
2. De réels effets sur la prostitution et sur la traite 224
a) Une diminution globale de la prostitution 224
b) Des effets dissuasifs sur la traite des êtres humains 228
3. Une loi bénéficiant d’un large soutien politique et populaire 229
a) Un consensus politique s’est établi sur le fondement du bilan de l’application de la loi, jugé très positif 229
b) L’opinion publique soutient massivement la pénalisation du client 230
C. COUPLER LA PÉNALISATION DES CLIENTS À UNE POLITIQUE AMBITIEUSE EN MATIÈRE D’ÉDUCATION ET DE PRÉVENTION 231
1. Créer une infraction pénale pour sanctionner le recours à la prostitution 231
a) Les grands objectifs de la pénalisation des clients 231
b) Poser l’interdit dans notre droit pénal en créant un délit 232
b) Prévoir une information des clients de la prostitution 234
2. Prévoir une entrée en vigueur différée de cette infraction afin de mener un travail de sensibilisation et d’information 234
a) Prévoir une entrée en vigueur différée de l’interdiction 234
b) Durant cette période, mener des actions de communication, notamment en direction des clients 235
3. Poursuivre ce travail dans la durée, en éradiquant à terme les racines du système prostitutionnel, par la prévention et l’éducation 237
a) Mettre enfin en œuvre une politique d’éducation aux inégalités de genre 237
b) Engager une réflexion sur la pornographie 239
II. – METTRE EN œUVRE UN ACCOMPAGNEMENT INTÉGRAL DES PERSONNES PROSTITUÉES 240
A. GARANTIR LES DROITS FONDAMENTAUX DES PERSONNES PROSTITUÉES 240
1. Le droit d’accéder à la justice : une révolution culturelle est nécessaire 241
a) Le droit de déposer plainte 241
b) Le droit à une juste indemnisation 243
2. La question de l’incrimination du racolage passif 244
3. La question de la reconnaissance d’un statut 245
B. OFFRIR DES ALTERNATIVES CRÉDIBLES À LA PROSTITUTION PAR LA MISE EN œUVRE D’UN ACCOMPAGNEMENT INTÉGRAL 248
1. Offrir des alternatives crédibles à la prostitution 248
2. Mettre à la disposition des personnes prostituées les cinq grands éléments nécessaires à la sortie de la prostitution 249
a) La délivrance d’un titre de séjour 250
b) La garantie de revenus 255
c) L’accès à un logement 258
d) La possibilité d’une formation professionnelle et de l’apprentissage du français 261
e) L’accompagnement et la reconstruction, notamment psychologiques 262
3. Accroître les budgets consacrés à l’insertion des personnes prostituées 263
III. – SYSTÉMATISER LA LUTTE CONTRE LA TRAITE ET LE PROXÉNÉTISME 264
A. MIEUX UTILISER LES OUTILS EXISTANTS DANS LE DOMAINE DE LA LUTTE CONTRE LA TRAITE ET LE PROXÉNÉTISME 264
1. Une priorité : poursuivre davantage sur le fondement de la traite 264
a) La politique pénale de la Chancellerie 264
b) L’identification des victimes de la traite 266
2. Mieux appliquer la législation aux nouvelles formes de proxénétisme 268
a) Le proxénétisme hôtelier, un partenariat à renforcer 268
b) La mise en relation par Internet et par la presse, des lacunes surprenantes 270
3. Mieux utiliser les outils de la procédure pénale 272
a) Avoir davantage recours à la coopération internationale 272
b) Mieux protéger les victimes de la traite 276
c) Saisir et confisquer les avoirs criminels 278
B. CONSERVER LA LÉGISLATION EXISTANTE EN MATIÈRE DE PROXÉNÉTISME 279
1. La question de la dépénalisation du « proxénétisme de soutien » 279
a) Le proxénétisme hôtelier et la réouverture des maisons closes 279
b) Le proxénétisme par aide et assistance 281
2. La question de l’assistance sexuelle pour les personnes en situation de handicap 282
a) Une revendication portée par plusieurs associations 282
b) Des difficultés juridiques et éthiques considérables 285
c) Des possibilités importantes sont ouvertes en l’état du droit 286
IV. – DONNER UN CAP CLAIR ET COHÉRENT AUX POLITIQUES PUBLIQUES, DU PLAN NATIONAL À L’ÉCHELLE LOCALE 287
A. RÉAFFIRMER AVEC FORCE LA POSITION ABOLITIONNISTE DE LA FRANCE À L’ÉCHELLE NATIONALE ET INTERNATIONALE 287
1. Y a-t-il encore une position française en matière de prostitution ? 287
2. Donner un cap aux politiques publiques en définissant la position française par le vote d’une résolution 289
B. FAIRE DE LA PROSTITUTION UN OBJET DE POLITIQUES PUBLIQUES 291
1. Un manque de coordination préjudiciable à l’efficacité des politiques publiques, tant en matière d’aide aux personnes prostituées que de lutte contre la traite 291
a) Un désengagement progressif de l’État 291
b) Une pluralité d’acteurs compétents 292
c) Un manque flagrant de coordination 294
2. Faire travailler ensemble les acteurs locaux au service de la réinsertion des personnes prostituées 294
a) Créer un lieu de pilotage des politiques publiques locales 295
b) Définir un parcours fléché pour les personnes qui souhaitent sortir de la prostitution en désignant des référents 297
c) Coordonner les acteurs pour la protection des victimes de la traite 299
3. Créer une véritable coordination nationale pour piloter la politique de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution 300
a) Créer une coordination nationale interministérielle sur la traite des êtres humains… 300
b) …qui serait également compétente en matière de prostitution 301
C. ÉVALUER LES RÉSULTATS DES POLITIQUES PUBLIQUES 303
1. Nommer un rapporteur national sur la traite des êtres humains et la prostitution 303
2. Mener une grande enquête scientifique sur la prostitution en France 305
EXAMEN DU RAPPORT EN COMMISSION 309
LISTE DES PROPOSITIONS 321
AUDITION DE MME ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN, MINISTRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE 327
AUDITION DE M. CLAUDE GUÉANT, MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L’IMMIGRATION 335
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 339
ANNEXES 351
MESDAMES, MESSIEURS,
« Le système prostitutionnel est fait pour verrouiller le silence : il est très difficile de faire sortir cette parole, et que cette parole soit entendue par la société qui ne souhaite absolument pas l’entendre » (2). La parole des personnes prostituées est inaudible dans l’espace public, dans lequel elles se trouvent pourtant visibles de tous. Stigmatisées, marginalisées, elles apparaissent parfois dans la presse, mais généralement dans la rubrique des faits divers, lorsque l’une d’entre elles a été agressée voire assassinée, comme ce fut récemment le cas dans la région lyonnaise. Pour remédier à cette absence de visibilité, sont apparus, au cours des dernières années, des collectifs et des associations composés de personnes prostituées. Ces associations, la mission a tout fait pour les rencontrer, recevant certaines d’entre elles à l’Assemblée nationale et auditionnant les autres au cours de ses déplacements, notamment à Lyon et Marseille. Lorsqu’elles n’entretenaient pas de très bons rapports avec les pouvoirs publics locaux, la mission s’est employée à convaincre ces derniers de la nécessité de les rencontrer.
Mais la mission a également été attentive à une autre parole, plus difficile à entendre encore, parce qu’emprisonnée dans la honte et la culpabilité. Cette parole, c’est celle des anciennes personnes prostituées, les « pleureuses », comme les appelle l’anthropologue Catherine Deschamps, celles qui, un jour, veulent sortir de la prostitution et raconter ce qu’elles y ont vécu. Leur parole est emprisonnée sous la chape de plomb que constitue le mythe de la « putain », la femme coupable, qui se prostitue parce que, nécessairement, c’est une mauvaise femme. D’où une intense culpabilité, qui fait obstacle au besoin éperdu de s’exprimer. C’est également cette parole que la mission a souhaité entendre. Parfois à la surprise de ceux qui les accompagnent au quotidien, ces personnes ont été nombreuses à vouloir témoigner de leur parcours devant des parlementaires, soulignant combien cette prise de parole était importante pour elles.
Il revenait au Parlement d’être ce lieu d’écoute et de débat. Pour libérer la parole, la mission a tenu ses auditions à huis clos, à l’exception de celle des ministres. Elle s’est efforcée d’auditionner l’ensemble des acteurs qui interviennent dans le domaine de la prostitution, rencontrant plus de 200 personnes, dont quinze personnes prostituées ou s’étant prostituées. L’expérience des associations et des travailleurs sociaux, qui mettent en œuvre l’essentiel des politiques publiques, a été primordiale, dans un domaine où l’État est largement absent. Des représentants des services publics qui sont quotidiennement au contact des personnes prostituées, qu’ils soient policiers, gendarmes, magistrats, infirmiers ou médecins, de même que des sociologues, ont fourni un éclairage précieux quant aux conditions de vie et d’activité de ces dernières. Enfin, les responsables nationaux et locaux des principales politiques publiques ont permis de dresser le constat du désintérêt croissant de l’État pour le sujet de la prostitution.
Ces auditions et ces rencontres ont donné à la mission les informations nécessaires pour mener à bien ses deux premiers objectifs : établir un état des lieux objectif et aussi partagé que possible, d’une part, de la réalité de la prostitution aujourd’hui en France, et, d’autre part, de l’ensemble des politiques publiques menées en la matière. Les données ainsi collectées forment les deux premières parties de ce rapport.
Ce travail d’information à proprement parler a permis de mettre en lumière les permanences et les évolutions de l’activité prostitutionnelle. De grands constats se dégagent ainsi. En premier lieu, la prostitution est exercée à plus de 80 % par des personnes étrangères dans nos villes, alors qu’au début des années 1990, elles n’étaient que 20 %. Ce constat ne manque pas de susciter des interrogations quant aux circonstances qui poussent ces personnes, originaires du Nigeria, d’Europe de l’Est ou de Chine, à venir se prostituer sur nos trottoirs. En deuxième lieu, l’apparition d’Internet facilite incontestablement la rencontre entre la personne prostituée et son client, sans que cette réalité puisse être numériquement quantifiée. Enfin, le constat ne serait pas complet si l’on ne faisait pas état des circonstances qui poussent certaines personnes, essentiellement des femmes, à se prostituer. La traite des êtres humains est la première pourvoyeuse de personnes prostituées, associée à la vulnérabilité et à la précarité financière.
Du côté des politiques publiques, le bilan qui se dégage est en demi-teinte. Plutôt positif en matière de lutte contre le proxénétisme, il est plus nuancé dans celui de l’accès aux soins et de la lutte contre le racolage et désastreux pour ce qui est des politiques sociales. La France semble avoir tiré un trait sur le versant social de sa politique abolitionniste, se concentrant de manière pratiquement exclusive sur la lutte contre l’exploitation sexuelle et le maintien de l’ordre public. Ce sont les personnes prostituées qui en sont les premières victimes.
Ce double bilan constituait l’objectif premier de la mission. Une fois ce constat dressé, encore fallait-il analyser la prostitution en tant que telle et sa légitimité dans une société comme la nôtre.
En règle générale, cette question est reléguée au second plan comme relevant de l’opinion personnelle de chacun. Ce rejet de tout débat est fréquemment appuyé sur des jugements qui se veulent définitifs : la prostitution serait « le plus vieux métier du monde », invariant de nos sociétés depuis la nuit des temps, elle permettrait de réduire le nombre de viols, répondrait à la « misère sexuelle » de certains hommes et aurait ainsi une certaine « utilité sociale », notamment lorsqu’elle est pratiquée de manière « libre ». Ces lieux communs, si souvent utilisés pour couper court à tout débat, n’ont jamais fait l’objet d’une investigation approfondie. La mission a donc choisi de les confronter aux faits en tentant de répondre aux questions suivantes : y a-t-il moins de viols dans les sociétés où la prostitution est tolérée ou encadrée ? Les clients de la prostitution connaissent-ils réellement une misère sexuelle et affective ? La prostitution est-elle choisie et exercée en toute connaissance de cause ?
Peu à peu, toutes ces évidences se sont estompées, invitant à pousser l’enquête plus avant et à discuter de la nature même de la prostitution. Là encore, le Parlement a joué son rôle de lieu de débat lorsque la mission a décidé de réunir des philosophes de toutes sensibilités pour aborder ce sujet. Elle s’est rendue dans quatre pays étrangers qui ont tous adopté une approche différente de la question, sous-tendue par des conceptions éthiques et juridiques parmi les plus fondamentales de nos sociétés. Deux ont particulièrement retenu l’attention de la mission : les Pays-Bas et la Suède, qui ont choisi deux voies opposées mais qui se rejoignent parfois. Ces expériences étrangères fournissent des éléments d’analyse essentiels du phénomène prostitutionnel, qui sont largement mobilisés dans ce rapport.
Face à ce pluralisme tant idéologique que géographique, la mission a choisi la seule boussole possible afin de dresser la liste de ses préconisations : les principes juridiques qui sont au fondement de notre société démocratique et républicaine, au premier rang desquels la non-patrimonialité du corps humain, son intégrité et l’égalité entre les sexes. La prostitution a été analysée à l’aune de ces grands principes ; il en ressort qu’elle doit être considérée comme une violence, en majorité subie par des femmes et aux conséquences souvent considérables.
Dès lors, la perspective des politiques publiques ne peut être que celle d’un monde sans prostitution. Les arguments à l’appui de cette position, nombreux, sont détaillés dans la troisième partie de ce rapport. Cet objectif ambitieux ne doit cependant pas avoir pour conséquence de causer un tort aux personnes prostituées qui sont des sujets de droits et doivent être considérées comme tels. La mission a donc estimé qu’il fallait s’intéresser au client, longtemps passé sous silence mais acteur central de la prostitution, afin de lui faire prendre conscience des implications de ces actes. À n’en pas douter, cette préconisation sera largement débattue. Si elle devait être mise en œuvre prochainement, ainsi que l’espère la mission, tout devra également être fait pour accompagner les personnes prostituées qui le demandent dans l’exercice de leurs droits, et, si elles le souhaitent, vers la sortie de la prostitution. Des alternatives crédibles doivent leur être proposées, grâce à des politiques sociales ambitieuses, afin de les mettre en situation de véritable choix. La responsabilisation du client ne constitue que l’un des aspects d’une politique d’ensemble qui vise à garantir les droits de chacun et à les accorder avec ceux d’autrui. Telle est la philosophie générale qui anime les préconisations de la mission d’information.
PREMIÈRE PARTIE : LA PROSTITUTION AUJOURD’HUI EN FRANCE : MUTATIONS ET PERMANENCES D’UNE RÉALITÉ MÉCONNUE
La réalité de la prostitution ne se laisse pas facilement appréhender. L’impression qui se dégage des auditions de la mission d’information est celle d’une connaissance en pointillé de cet univers, en l’absence d’étude d’ensemble. Chaque intervenant (associations, forces de l’ordre, sociologues…) adopte une approche qui lui est propre et qui conditionne la fiabilité et la pertinence des données qu’il collecte. En conséquence, ces dernières ne sont que rarement comparables.
Ce constat est d’autant plus vrai que la prostitution évolue. Les personnes prostituées sont désormais dans leur très grande majorité étrangères et l’apparition d’Internet a permis l’émergence de nouvelles formes de prostitution. Or, ces deux champs sont parmi les plus difficiles à connaître : Internet assure une certaine discrétion, voire un plein anonymat, quand la traite des êtres humains, par essence criminelle, ne se laisse approcher que par l’action de la justice.
Dès lors, si les acteurs associatifs s’accordent généralement sur une typologie des grandes formes de prostitution, c’est au sujet de leur importance relative qu’ils divergent. En conséquence, la question des chiffres est particulièrement discutée.
I. – COMBIEN Y A-T-IL DE PERSONNES PROSTITUÉES AUJOURD’HUI EN FRANCE ?
Fournir une évaluation quantitative précise du phénomène prostitutionnel aujourd’hui en France est un exercice périlleux. En effet, il n’existe pas une forme unique de prostitution, mais des pratiques prostitutionnelles diverses, allant de la prostitution de rue à la prostitution par Internet, exercée de façon continue ou au contraire occasionnelle.
Les contours de la prostitution sont donc relativement flous, étant donné qu’il n’existe pas de définition précise de la prostitution. Un certain nombre de pratiques, notamment la prostitution occasionnelle ou les « attitudes prostitutionnelles » (3), sont à la marge de cette notion, ce qui les rend difficiles à appréhender de façon chiffrée.
Par ailleurs, les données quantitatives font, dans ce domaine, grandement défaut. L’Office central pour la répression de la traite des êtres humains (OCRTEH) est ainsi le seul organisme public à évaluer quantitativement la prostitution en France. Il y aurait ainsi, d’après cet office entre 18 000 et 20 000 personnes prostituées en France aujourd’hui. Ce chiffre est issu, selon le ministre de l’Intérieur, du croisement de diverses données : le nombre de personnes mises en cause pour racolage par la police nationale, le nombre de victimes de traite des êtres humains (4) ou de proxénétisme identifiées dans des procédures judiciaires et les évaluations issues du monde associatif (5).
Cette estimation a été contestée par le Syndicat du travail sexuel (STRASS), sur un double fondement (6). D’une part, cette évaluation prendrait essentiellement en compte la prostitution de rue, qui, dans des pays comme le Royaume-Uni ou la Suisse ne représenterait que de 13 à 15 % de la prostitution totale. D’autre part, le chiffre de la prostitution en France semble très inférieur à celui des autres pays européens, notamment l’Allemagne, où l’on compterait 400 000 personnes prostituées.
En l’absence d’étude d’ensemble, on peut distinguer la prostitution de rue de la prostitution discrète (salons de massage, bars, Internet…). Par ailleurs, il faut chercher à quantifier la prostitution étudiante, qui passe généralement par Internet, ainsi que la prostitution masculine et transgenre.
A. LA PROSTITUTION DE RUE : DES CHIFFRES À MANIER AVEC PRÉCAUTION
Nous disposons aujourd’hui de sources d’information éparses en matière de prostitution de rue. L’OCRTEH en particulier évalue la prostitution de rue à partir des données fournies par les procédures judiciaires pour racolage sur la voie publique. En 2010, 1 367 personnes ont été mises en cause pour racolage par la police nationale (7), dont l’essentiel exerçait sur la voie publique.
1. La prostitution de rue en région parisienne, une réalité difficile à quantifier avec précision
Le rapport de l’OCRTEH de 2009 fournit des éléments d’information concernant les procédures pour racolage sur la voie publique. La brigade de répression du proxénétisme de la direction régionale de la police judiciaire de Paris (8) indique avoir recensé 551 personnes prostituées, en 2009, au travers de procédures. Ce chiffre englobe la prostitution de rue comme la prostitution par Internet, mais les affaires de proxénétisme via Internet ne représentant que 20 % de l’activité de la brigade de répression du proxénétisme, on peut penser que les personnes recensées se prostituent essentiellement sur la voie publique.
Les recensements ponctuels effectués, dans la rue, par la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) de la préfecture de police de Paris ne portent, par construction, que sur la prostitution de rue. Il ressort du recensement du 1er octobre 2010 qu’il y aurait eu, ce jour précis, 837 personnes prostituées dans les rues de Paris. Toutefois, la prostitution étant par nature une activité masquée, ce chiffre est nécessairement inférieur à la réalité. En effet, ce recensement ne fait que dénombrer les personnes prostituées présentes, dans les rues, à un instant donné. Il ne saurait tenir compte des personnes prostituées qui évitent sciemment la police, de celles qui n’exercent pas ce jour-là ou bien encore de celles qui ne se trouvent pas dans l’espace public au moment du dénombrement.
Par ailleurs, en ce qui concerne la région parisienne, il importe de tenir compte de la périphérie de Paris, qui abrite, depuis la création de l’incrimination du racolage en 2003, des personnes prostituées qui exerçaient auparavant à Paris intra muros. En effet, la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a repoussé la prostitution parisienne en périphérie de la capitale, comme l’a indiqué Mme Johanne Vernier (9), juriste, auteur d’une étude sur la traite des êtres humains pour la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) (10). Aussi ces éléments d’information comportent-ils un biais méthodologique lié à leur délimitation géographique.
Enfin, les associations d’aide aux personnes prostituées permettent d’appréhender l’activité prostitutionnelle de rue via leurs rapports d’activité. Mais là encore, ces chiffres ne sauraient fournir une évaluation exacte de la prostitution de rue. En effet, les personnes prostituées ne se tournent pas toutes vers les associations, si bien que le nombre de personnes rencontrées ne peut être qu’inférieur à la réalité.
Par exemple, les Amis du bus des femmes (11), association de santé communautaire, évalue à 500 le nombre de personnes prostituées dites « traditionnelles » à Paris. Or, la prostitution dite « traditionnelle », exercée par des femmes françaises ou maghrébines, est aujourd’hui une activité déclinante (12), qui ne semble représenter qu’une faible part de la prostitution de rue prise dans son ensemble. Si l’on se fonde sur ce chiffre pour évaluer la prostitution de rue à Paris, on obtient un ordre de grandeur fort différent de celui délivré par les services de l’État, qui ne comptent que 165 femmes françaises se prostituant dans les rues de Paris (13).
Par ailleurs, l’enquête du Lotus Bus, initiée par Médecins du monde en 2009, a été réalisée auprès de 450 à 550 prostituées chinoises à Paris (14), chiffre bien supérieur au nombre de personnes chinoises recensées par les services de police parisiens (15). Cet écart pourrait s’expliquer par le fait que certaines personnes chinoises se prostituant dans les rues de Paris ont la particularité de se déplacer en permanence, contrairement à d’autres personnes prostituées, qui stationnent à un endroit précis. Ces « marcheuses » seraient donc plus difficiles à comptabiliser. Il n’en reste pas moins que l’écart demeure important.
Il ressort de ces éléments que la prostitution de rue en région parisienne est très difficile à quantifier avec certitude. Il est toutefois loisible de penser que celle-ci est supérieure au chiffre issu du dénombrement ponctuel organisé par les services de police parisiens, qui n’offre, en tout état de cause, qu’une vision partielle de la prostitution de rue.
2. La prostitution de rue en province, des ordres de grandeurs cohérents
Concernant la ville de Lyon, les chiffres fournis par les services de police sont légèrement inférieurs à ceux établis par les associations. Si l’on se réfère au rapport de l’OCRTEH pour l’année 2009 (16), il y aurait 424 personnes prostituées de rue à Lyon (17), ce qui est cohérent avec les chiffres qui ressortent des auditions organisées par la mission d’information. En effet, M. Franck Courson (18), commissaire, chef de la division criminelle de la direction interrégionale de police criminelle de Lyon, fait état de 450 à 500 personnes prostituées à Lyon. De même, M. Marc Désert, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon, souligne que près de 600 personnes sont répertoriées comme prostituées de rue à Lyon. C’est également ce qu’a indiqué l’association Cabiria (19) lors d’un déplacement de la mission d’information, dont la file active (20) sur l’agglomération lyonnaise est de 650 personnes.
La région lyonnaise semble cependant avoir connu une évolution notable au cours de l’année passée. En effet, le rapport de l’OCRTEH pour l’année 2010 montre que la prostitution de rue serait passée à 424 personnes en 2009 à 802 personnes en 2010. Cette augmentation serait essentiellement due à l’arrivée de personnes prostituées bulgares, roumaines, nigérianes et camerounaises en provenance d’Espagne, du fait de la crise économique (21).
L’écart est plus important concernant les autres villes de province. Ainsi, d’après les rapports de l’OCRTEH pour 2009 et 2010, il y aurait 252 personnes prostituées de rue à Bordeaux (22), 413 à Nice et Cannes (23), 127 à Toulouse (24) et 301 à Marseille (25). Les associations, qui travaillent principalement avec les personnes prostituées de rue, fournissent des chiffres supérieurs. Ainsi, l’association Information - Prévention - Proximité – Intervention (IPPO), basée à Bordeaux, a accompagné, en 2009, environ 600 personnes prostituées (26). Par ailleurs, M. Patrick Hauvuy (27), représentant de l’association niçoise Accompagnement lieu d’accueil (ALC), a estimé à 700 le nombre de personnes prostituées rencontrées chaque année. L’association de santé communautaire Grisélidis (28) suit annuellement 500 à 600 personnes prostituées à Toulouse. Enfin, l’association marseillaise Autres Regards rencontre près de 600 personnes prostituées par an (29).
COMPARAISON DES CHIFFRES DE LA PROSTITUTION DE RUE EN PROVINCE
Ville |
Chiffres de l’OCRTEH |
Chiffres des associations |
Lyon |
802 |
650 |
Bordeaux |
252 |
600 |
Nice et Cannes |
413 |
700 (Nice seulement) |
Toulouse |
127 |
500 à 600 |
Marseille |
301 |
600 |
Source : Rapports de l’OCRTEH pour 2009 et 2010 ; auditions des associations.
Les chiffres avancés par les associations s’écartent donc quelque peu de ceux établis par l’OCRTEH, surtout pour certaines villes comme Toulouse, Marseille et Bordeaux.
3. La prostitution des mineurs, emblématique des divergences de chiffres entre les services de police et les associations
La prostitution des mineurs, envisagée comme un cas particulier de prostitution de rue, est représentative des divergences de chiffres qui existent entre les services de police et les associations.
En effet, les chiffres de l’OCRTEH font état de seulement six mises en cause de personnes mineures pour racolage (30), soit 0,44 % du total des mis en cause pour racolage en 2010 en France. À Paris, les enquêtes menées par la brigade de répression du proxénétisme comme par la brigade des mineurs établissent que la prostitution de mineurs « reste un phénomène limité et de faible ampleur ». En tout, 16 cas de minorité ont été détectés au cours d’enquêtes pour des faits de racolage et de proxénétisme (31).
De même, lors de leur déplacement à Lyon (32), il a été indiqué aux membres de la mission, que sur quatre des cinq dernières années, en moyenne une à cinq procédures avaient été engagées chaque année dans des affaires de prostitution de mineurs. En 2010, un seul cas a été découvert, impliquant deux mineurs. Il en va de même à Nice, où l’association niçoise Accompagnement lieu d’accueil (33) a indiqué n’avoir eu connaissance que de très peu de cas de prostitués mineurs. Enfin, lors du déplacement dans les Bouches-du-Rhône (34), la brigade départementale de protection de la jeunesse a indiqué à la mission n’avoir eu à traiter que deux cas par an, en moyenne.
Plusieurs éléments peuvent concourir à expliquer la faiblesse de ce chiffre.
En premier lieu, l’incrimination qui pèse sur les clients, particulièrement forte, tendrait à dissuader cette forme de prostitution sur le territoire français, les clients se déplaçant éventuellement au-delà des frontières pour recourir à la prostitution de mineurs.
Ensuite, la vigilance dont font preuve les personnes prostituées majeures à l’égard de la prostitution des mineurs aurait pour effet de favoriser l’alerte immédiate des forces de police et serait donc largement dissuasive. Il a ainsi été porté à la connaissance de la mission d’information que les personnes prostituées signalaient spontanément les cas de prostitution de mineurs aux services de police.
En outre, les difficultés tenant à la détermination de l’âge des personnes prostituées constituent un obstacle technique à la reconnaissance légale de leur minorité (35). Les incertitudes entourant la détermination scientifique de l’âge osseux ne permettent en effet pas de remédier aux fausses déclarations des personnes prostituées mineures. Il semble, comme l’a indiqué Mme Nathalie Caron, avocate entendue à Lyon, que les mineurs se présentent souvent comme majeurs (36). Baina (37), ancienne prostituée nigériane rencontrée par la mission, a confirmé que des faux papiers lui avaient été fabriqués par son réseau, afin de porter son âge officiel de 17 à 18 ans lors de son arrivée en France (38).
Toutefois, les chiffres issus des associations de lutte contre la prostitution de mineurs contrastent avec les éléments précédents. Ainsi, selon l’association Hors la rue (39), il y aurait 4 000 à 8 000 mineurs en situation de prostitution en France aujourd’hui. De façon générale, la prostitution des mineurs serait en forte progression, ce que confirme l’Amicale du Nid (40). La banalisation de la pratique prostitutionnelle chez les mineurs expliquerait dès lors l’« explosion » des chiffres dont fait état l’association Hors la rue en 2010. De même, l’Association contre la prostitution des enfants fait part de chiffres pour le moins inquiétants : près de 10 000 mineurs se livreraient à la prostitution en France aujourd’hui. Ce chiffre peut être corroboré par le fait que les personnes prostituées commencent généralement à se prostituer alors qu’elles sont mineures (41). Quatre des cinq anciennes personnes prostituées rencontrées par la mission à l’Amicale du Nid de Paris ont ainsi commencé à se prostituer étant mineures, respectivement à l’âge de 16 ans pour deux d’entre elles et de 17 ans pour les deux autres.
La différence est donc abyssale entre les quelques cas que connaissent annuellement les services de police et de gendarmerie et le chiffre de plusieurs milliers d’enfants prostitués brandi par des associations dont l’objet est la lutte contre la prostitution de mineurs.
B. UNE PROSTITUTION « DISCRÈTE » DIFFICILE À QUANTIFIER
Si les chiffres de la prostitution de voie publique font débat, alors même qu’il s’agit de la forme la plus visible de prostitution, la prostitution « discrète » est encore plus ardue à quantifier.
Depuis quelques années, la prostitution dite « discrète » en raison des lieux d’activité (salons de massage, bars à hôtesse, appartements) ou des modes de communication avec le client (prostitution par Internet, utilisation de SMS) s’est largement développée (42).
1. La prostitution dans les bars à hôtesse et les salons de massage
Il y aurait, d’après le rapport de l’OCRTEH de 2009, 611 établissements présentant un risque de prostitution en France (43). Ces établissements peuvent être des bars à hôtesse, où les serveurs et serveuses doivent jouer de leurs charmes pour pousser le client à consommer plus d’alcool. Cependant, dans de nombreux cas, ces bars, aussi appelés « bars américains » dans le sud de la France et en Corse, abritent bel et bien des activités prostitutionnelles, comme le montre ce témoignage d’une ancienne hôtesse recueilli par la mission d’information : « Très vite, on se rend compte que les clients ne sont pas habitués à payer une bouteille à 150 euros pour ne rien faire avec les serveuses. Il fallait donc les recevoir dans les loges. La règle c’était donc : « à la première bouteille, tu fais un strip-tease, à la deuxième bouteille, tu branles, à la troisième bouteille, tu suces » […] En Corse, les bars américains sont de véritables bordels, les filles montent à l’étage pour faire de vraies passes. Un client qui prend une bouteille a droit immédiatement à une relation sexuelle » (44).
Outre les bars à hôtesse, les salons de massage et les clubs à vocation sexuelle (strip-tease, échangisme…) sont susceptibles d’abriter des activités prostitutionnelles. Ainsi, la brigade de répression du proxénétisme de la direction régionale de la police judiciaire de Paris (45) recense près de 130 salons de massage à Paris. Le rapport de l’OCRTEH de 2009 comptabilise 481 bars, cabarets, salons de massage ou clubs, en France métropolitaine (hors Paris), susceptibles d’abriter une activité prostitutionnelle. M. Marc Désert, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon, établit à 25 le nombre d’établissements de massage présentant un risque prostitutionnel à Lyon, employant une centaine de personnes. Ce chiffre est cohérent avec ceux fournis par la direction interrégionale de la police judiciaire (46) de Lyon, qui y recense 21 salons de massage.
Cependant, la preuve de l’activité prostitutionnelle est difficile à apporter, étant donnée l’apparence de légalité de ces établissements. Les services de police doivent ainsi recueillir le témoignage de clients reconnaissant l’existence d’une relation sexuelle tarifée, ou d’une proposition allant dans ce sens. Or, il est évident que ces derniers ne seront guère enclins à faire de telles déclarations.
2. La prostitution par Internet
La prostitution par Internet fait, elle aussi, l’objet d’évaluations chiffrées, même si celles-ci sont délicates à réaliser. En effet, une même annonce, déposée sur Internet, peut correspondre à plusieurs personnes prostituées. C’est par exemple le cas des annonces gérées par les réseaux de prostitution, qui ne correspondent pas à une seule et même personne. À l’inverse, une personne prostituée peut déposer son annonce sur plusieurs sites de rencontres.
Des estimations ont cependant pu être réalisées. Ainsi, d’après M. Laurent Mélito (47), sociologue, qui réalise actuellement des recherches sur l’escorting, il existerait près de 10 000 annonces distinctes sur Internet, à destination de la France, qui apparaissent sur cinq à six sites dédiés. Parmi ces annonces, seules 4 000 seraient le fait de personnes prostituées indépendantes, n’exerçant pas par le biais d’« agences ».
Ces ordres de grandeurs sont corroborés par M. Jean Yannick Pons, directeur du site de petites annonces Vivastreet (48), qui comporte une section « Erotica » dédiée aux annonces à caractère sexuelle. Sans que toutes ces annonces puissent être assimilées à des offres prostitutionnelles, il est néanmoins révélateur de l’importance du phénomène de la prostitution sur Internet que près de 5 000 annonces distinctes, en France, aient été recensées en 2010.
Concernant la prostitution masculine sur Internet, il existe très peu de données chiffrées. Néanmoins, il semblerait que le principal site de prostitution masculine, domicilié aux Pays-Bas, compte aujourd’hui près de 2 500 annonces d’escort boy français (49), sans que l’on puisse en induire, pour les raisons précédemment évoquées, le nombre d’hommes qui se prostituent effectivement sur Internet.
C. LA PROSTITUTION ÉTUDIANTE : FANTASME OU RÉALITÉ ?
La prostitution étudiante fait aujourd’hui l’objet d’une attention particulière de la part des medias, car ce thème porteur mêle jeunesse, sexualité et argent. Il est cependant difficile de démêler le faux du vrai, le fantasme de la réalité, dans ce domaine.
Les chiffres font en effet, là encore, largement défaut. Ainsi, le chiffre de 40 000 personnes prostituées étudiantes, avancé par le syndicat Sud-Étudiant, il y a quelques années, était, au dire même de ses représentants (50), non fondé. Il a d’ailleurs été démenti très rapidement par l’organisation elle-même, dont les membres avaient extrapolé ce chiffre à partir des données relatives à la précarité étudiante fournies par l’Observatoire de la vie étudiante.
Les acteurs de la vie étudiante que la mission a auditionnés sont unanimes : la prostitution étudiante existe, dans des proportions toutefois non identifiées.
Plusieurs syndicats (51), notamment Sud-Etudiant et la Fédération des associations générales étudiantes (Fage), disent avoir reçu des témoignages de plusieurs étudiants se livrant à la prostitution. À l’inverse, l’Union nationale interuniversitaire (Uni) et l’Association de promotion et de défense des étudiants (Pde) ne font état d’aucun cas avéré. De la même façon, l’Union nationale des étudiants de France (Unef) n’a pas souhaité participer à la table ronde organisée par la mission d’information, afin de ne pas accroître la portée médiatique d’un phénomène que ce syndicat juge marginal.
En ce qui concerne les services universitaires de médecine préventive, seuls 3 services sur 59 font état de cas avérés (52). Ainsi, le service universitaire de médecine préventive de l’université Paris V – Descartes (53), qui draine près de 4 000 étudiants par an, n’a connu que deux cas avérés de prostitution étudiante ces dernières années. Mme Laure Boisjoly (54), psychologue au service universitaire de médecine préventive de l’université Paris VII – Diderot, n’a eu connaissance de cas de prostitution étudiante que de façon indirecte, via un collègue médecin qui officie également dans un centre de dépistage anonyme et gratuit, où il a été en contact avec des étudiants prostitués.
La mission d’information a également tenu à interroger les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (Crous) de France. M. François Bonacorsi (55), directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (Cnous), a indiqué à la mission d’information l’existence d’environ dix-sept cas de prostitution ou de conduite à risques au cours de ces trois dernières années, à Montpellier, Toulouse, Lille et Dijon. Le Crous de Lyon, entendu au cours d’un déplacement (56) dans le Rhône, fait quant à lui état d’une dizaine de cas par an, sur 7 000 étudiants.
Toutefois, la faiblesse des chiffres avancés par ces organismes ne saurait être comprise comme le reflet d’une réalité finalement très marginale. En effet, il est difficilement concevable que les étudiants se confient spontanément aux personnels de santé et aux assistants sociaux sur ce sujet, qui relève de leur vie privée et qui est vraisemblablement porteur de tabous importants. Il est d’ailleurs révélateur que seul un médecin du service universitaire de médecine préventive de l’université Paris Diderot, officiant alors dans un centre de dépistage anonyme, ait eu connaissance de cas avérés, l’anonymat libérant probablement la parole.
Face à la pénurie de chiffres globaux, les enquêtes ponctuelles menées par différents acteurs (associations, sociologues, services universitaires de médecine préventive…) s’avèrent éclairantes.
Par exemple, l’Amicale du Nid de Montpellier a mené une enquête (57) en lien avec l’Université Paul Valéry – Montpellier III, qui fait apparaître que sur 651 étudiants interrogés, 13 ont déjà accepté de l’argent ou autre chose en contrepartie d’un acte sexuel (soit 2 % des répondants). Ce chiffre, rapporté à la population étudiante totale, soit près de 2,3 millions de personnes d’après l’INSEE, pourrait faire apparaître une pratique prostitutionnelle étudiante relativement importante en termes absolus, de l’ordre de plusieurs dizaines de milliers d’étudiants.
De même, Mme Éva Clouet, dans le cadre d’un mémoire de sociologie publié en 2008, a mené une étude auprès des étudiants de médecine et de psychologie de deuxième année de l’université de Nantes. Il apparaît que sur 138 personnes ayant répondu au questionnaire, 4 étudiants affirment connaître, dans leur entourage, un ou une étudiante qui se prostitue (58). Ce chiffre doit toutefois être interprété avec précaution. En effet, le champ de l’étude étant restreint, il n’est pas impossible que ces quatre étudiants évoquent la ou les mêmes personnes prostituées.
Enfin, le service universitaire de médecine préventive de Poitiers a pu recueillir des données grâce à un questionnaire distribué à l’occasion d’une action de sensibilisation. Il ressort de ce questionnaire que près de 3 % des 2 622 étudiants interrogés ont déjà été confrontés, eux-mêmes ou leur entourage proche, à une situation de prostitution étudiante.
Là encore, la réalité est difficile à cerner. La prostitution étudiante existe bel et bien. Il est en outre possible que ce soit dans des proportions non négligeables en valeur absolue. Reste toutefois à en mesurer l’importance.
D. LA PROSTITUTION MASCULINE ET TRANSGENRE
La prostitution masculine représente une part significative de la prostitution. Elle a ceci de commun avec la prostitution féminine que les clients sont pour l’immense majorité, des hommes.
1. La prostitution masculine en général
La prostitution masculine représente aujourd’hui une part relativement faible de la prostitution totale. Ainsi, d’après le rapport annuel de l’OCRTEH, les personnes prostituées de sexe masculin ne représentent que 13 % des personnes mises en cause pour racolage en 2010 (59). Ces chiffres ne portent toutefois que sur la prostitution de rue et celle exercée dans certains établissements. Ils sont cohérents avec ceux des associations. L’Amicale du Nid (60) héberge ainsi 20 % d’individus de sexe masculin. En tout état de cause, il ressort de ces chiffres que la prostitution masculine représenterait entre 10 % et 20 % de la prostitution de rue.
Mais la prostitution masculine est également présente sur Internet. En effet, des sites Internet sont dédiés à la prostitution masculine et près de 2 500 annonces d’escort boys en France sont recensées sur l’un d’eux (61). Là encore, cela ne nous permet pas de savoir combien de personnes se cachent effectivement derrière ce chiffre, une même personne étant susceptible de déposer plusieurs annonces et, inversement, une même annonce pouvant renvoyer à plusieurs personnes distinctes.
2. La prostitution transgenre en particulier
Au sein de la prostitution masculine, il convient de faire une place spécifique à la prostitution des personnes transgenres. Ce terme relativement récent englobe toutes les personnes qui considèrent que le genre qui leur a été attribué à la naissance ne fournit qu’une description incomplète, voire fausse, de leur identité réelle. Ce terme recouvre donc une réalité variée, allant des travestis (62) aux personnes transsexuelles (63). Cet écart entre genre et identité n’est pas, dans la société, l’apanage des hommes. Toutefois, dans l’univers prostitutionnel, il apparaît que les travestis et transsexuels sont, presque dans la totalité des cas, des individus de sexe masculin.
L’étude des chiffres locaux tirés du rapport de l’OCRTEH de 2009 ne permet pas de connaître avec certitude la part de la prostitution transgenre au sein de la prostitution masculine. Si certains services de police font la distinction entre prostitution masculine et prostitution transgenre, il n’est pas certain que ce soit le cas de tous. La brigade de répression du proxénétisme de Paris fait ainsi état, en 2009, de 103 « hommes ou travestis » parmi les 551 personnes mises en cause pour racolage, sans fournir plus de précisions. Il semble également que le vocable de « travesti » soit utilisé à la place du terme « transgenre » par les services de police, ce qui ne permet pas d’appréhender la réalité de la pratique prostitutionnelle des personnes transsexuelles par exemple. En tout état de cause, ces chiffres sont à manier avec une extrême précaution, les acteurs n’utilisant pas les mêmes références.
En tenant compte des réserves émises ci-dessus, il ressort de l’analyse générale des chiffres du rapport de l’OCRTEH que la prostitution masculine de rue semble majoritairement transgenre. Par exemple, sur les 393 personnes prostituées recensées à Marseille (64), les services de police ont dénombré 59 travestis. De même, à Toulouse (65), les services de police ont dénombré 113 prostituées et 14 travestis, tandis qu’à Bordeaux (66), la prostitution de rue compterait 245 femmes et 15 travestis. À Lyon (67), sur les 424 personnes prostituées dénombrées, 34 travestis ont été recensés. Dans toutes ces villes, qui représentent une part importante de la prostitution, aucun homme non travesti n’a été recensé.
Ces données quantitatives et qualitatives ne sont toutefois pas tout à fait cohérentes avec celles avancées par certaines associations qui distinguent la prostitution masculine de la prostitution transgenre. Ainsi, parmi la file active de l’association bordelaise IPPO (68), 16,3 % sont des hommes et 3,7 % sont des personnes transgenres, travesties ou transsexuelles. Ce chiffre laisse au contraire à penser que la prostitution transgenre constituerait une part faible de la prostitution masculine. À l’inverse, une étude de MM. Laurindo Da Silva et Luizmar Evangelista (69) montre que les hommes et les transgenres se prostituant dans la rue constituent deux parts numériquement égales des 252 personnes interrogées. Cependant, ils indiquent également que les transgenres ont été plus nombreux à ne pas répondre au questionnaire. On peut donc en déduire que les transgenres seraient plus nombreux que les « garçons » (70). Aucune conclusion fiable ne peut donc être retirée de ces chiffres. Par ailleurs, aucune donnée n’a pu être recueillie concernant la part des personnes transgenres se prostituant par Internet.
*
* *
La prostitution est un phénomène multiforme et partant, difficile à appréhender. Les chiffres que la mission a pu réunir fournissent une première appréciation de la pratique prostitutionnelle en France. Toutefois, les champs sur lesquels portent ces chiffres tendent à se recouper. Par exemple, la prostitution étudiante peut être comprise comme faisant partie de la prostitution par Internet. De même, la prostitution des mineurs fait partie de la prostitution de rue. La prostitution masculine s’exerce, quant à elle, à la fois sur Internet et sur la voie publique. Ces données ne permettent donc pas de dresser un état des lieux quantitatif exhaustif de la prostitution en France. Il serait donc hasardeux, sur ce fondement, d’avancer un chiffre du nombre de personnes prostituées exerçant aujourd’hui en France.
II. – LA PROSTITUTION DITE « TRADITIONNELLE » CÈDE PROGRESSIVEMENT LA PLACE À L’EXPLOITATION SEXUELLE ET À LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS
Un des faits marquants des dernières décennies tient à la place prise par les réseaux de traite étrangers dans le domaine prostitutionnel. En effet, la prostitution « traditionnelle » semble avoir progressivement cédé la place aux réseaux d’exploitation sexuelle. En parallèle, l’activité des personnes prostituées de nationalité française a décliné par rapport à celle des personnes de nationalité étrangère. Or, il apparaît que ces deux évolutions sont intimement liées : la forte augmentation de la prostitution étrangère a été rendue possible par l’émergence de réseaux de prostitution en France.
A. LA FORTE AUGMENTATION DE LA PROSTITUTION ÉTRANGÈRE DEPUIS LES ANNÉES 1990 EST LIÉE À L’ÉMERGENCE DE RÉSEAUX DE PROSTITUTION
Les années 1990 constituent un véritable tournant en matière de prostitution. En effet, la chute du mur de Berlin et l’effondrement politique des pays de l’Est et des Balkans, ont provoqué une arrivée massive de personnes prostituées originaires de ces pays. Mais la nationalité des personnes prostituées étrangères s’est ensuite diversifiée, avec l’afflux de femmes africaines puis chinoises.
Il est significatif que les personnes prostituées étrangères ne viennent que de quelques pays clairement identifiés. Aujourd’hui, la Roumanie, la Bulgarie, le Nigeria et la Chine sont les principaux pays d’origine des personnes prostituées étrangères en France, démontrant par là l’existence de filières et de réseaux de prostitution.
1. Les années 1990 constituent un tournant en matière de prostitution
Les années 1990 marquent le déclin de la prostitution dite « traditionnelle », exercée par des femmes françaises, parfois d’origine maghrébine, le plus souvent indépendantes ou sous la coupe d’un souteneur de faible envergure, qui tient plus du « julot casse-croûte » que du chef de réseau de prostitution. De fait, alors que cette forme de prostitution était majoritaire dans les années 1990, elle ne représente aujourd’hui qu’une part faible de la prostitution de rue dans son ensemble.
a) La part des personnes prostituées de nationalité étrangère a doublé depuis les années 1990
En matière de prostitution étrangère, il semble que les années 1990 constituent un tournant relativement net. En effet, les chiffres de l’OCRTEH montrent que la prostitution de rue est aujourd’hui essentiellement le fait de personnes étrangères.
Du début des années 1990 à 1995, la prostitution étrangère représente une part faible de la prostitution de rue dans son ensemble. Ainsi, à Paris, elle s’établissait à environ 30 % du total des personnes prostituées (71), tandis qu’en province, elle était d’environ 15 %.
PART DE LA PROSTITUTION ÉTRANGÈRE DANS LA PROSTITUTION DE RUE TOTALE
À PARIS ET EN PROVINCE AU DÉBUT DES ANNÉES 1990
1992 |
1993 |
1994 |
1995 | |
Paris |
32,2 % |
32,4 % |
29,3 % |
31,1 % |
Province |
NC |
14,8 % |
14 % |
16,6 % |
Source : Rapport de l’OCRTEH de 1995
En 1999, l’évolution est déjà enclenchée. Ainsi, d’après le rapport de l’OCRTEH de 1999, sur 5 186 personnes prostituées contrôlées sur la voie publique en 1999, 2 111 sont étrangères, soit plus de 40 %. En 2001, les femmes de nationalité étrangère représentent 56 % des femmes prostituées sur la voie publique. En 2002, ce chiffre s’élevait à 63 %. En 2003, l’OCRTEH indiquait que 85 % des femmes mises en cause pour racolage et 70,5 % des hommes étaient de nationalité étrangère. En 2009, l’OCRTEH estime que 88 % des personnes mises en cause en 2008 pour racolage sont étrangères. En 2010, la part des personnes étrangères est estimée par l’OCRTEH à 91 %. Parmi les femmes mises en cause pour racolage, 91,5 % sont de nationalité étrangère.
PART DES FEMMES DE NATIONALITÉ ÉTRANGERE PARMI LES FEMMES PROSTITUÉES
DE RUE ENTRE 1994 ET 2009
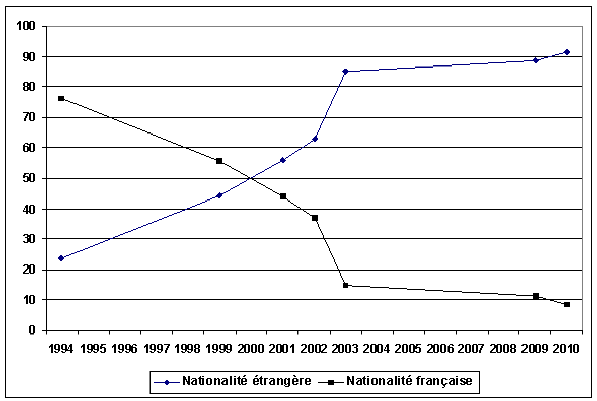
Source : Rapports de l’OCRTEH, 1995, 1999, 2001 à 2003, 2009 et 2010.
Certes, la comparaison ne porte pas tout à fait sur les mêmes éléments. En effet, avant 2003, les chiffres de l’OCRTEH étaient issus des contrôles d’identité effectués sur la voie publique. Toutefois, l’entrée en vigueur de la loi sur la sécurité intérieure du 18 mars 2003 a changé la donne, en faisant du racolage un délit. Les chiffres concernent donc désormais le nombre de personnes mises en cause pour racolage et ce, sur tout le territoire national.
Toutefois, les chiffres du proxénétisme, pour lesquels la méthodologie n’a pas changé, semblent confirmer cette évolution. En effet, les personnes de nationalité étrangère ne représentaient que 19 % des proxénètes en 1980 (72). En 2000, 48 % des proxénètes sont étrangers, contre 58 % en 2003 (73). Ce chiffre s’établit, en 2010, à 64 % (74). Le constat est sans appel : la prostitution étrangère, qui peut également être observée par le prisme des mises en cause pour proxénétisme, a fortement augmenté au cours des années 1990 et au début des années 2000.
Les auditions organisées par la mission d’information vont également dans ce sens et montrent que la prostitution de rue a connu une évolution notable depuis les années 1990, avec l’arrivée massive de personnes étrangères en provenance des pays de l’Est et d’Afrique. Mme Gabrielle Partenza, présidente de l’association Avec Nos Aînées, témoigne : « J’ai assisté, en 1999, à l’émergence des réseaux mafieux et à l’arrivée des Albanaises puis des Africaines. Ce n’était plus de la prostitution, mais bien du crime organisé » (75).
Pour sa part, la prostitution traditionnelle a commencé à diminuer à partir des années 1990. Elle ne concerne plus aujourd’hui que des personnes prostituées françaises ou maghrébines d’âge mûr, entrées il y a longtemps dans la prostitution.
Le rapport de la mission d’information commune sur les diverses formes de l’esclavage moderne de 2001, de nos collègues Christine Lazerges et Alain Vidalies, décrivait déjà cette évolution : « la population prostituée a fortement changé ; il ne s’agit plus seulement d’aider des femmes françaises ou francophones par un suivi matériel, médical, social. Les associations ont aussi maintenant affaire à des femmes, des hommes, majeurs ou mineurs, le plus souvent étrangers, sans aucune connaissance ou presque de notre langue, sans papiers, soumis à des violences extrêmes et démunis de tout » (76).
b) Plus de 90 % des personnes prostituées sur la voie publique sont aujourd’hui de nationalité étrangère
Il ressort du rapport d’activité de l’OCRTEH de 2010 que plus de 90 % des personnes prostituées de rue aujourd’hui en France sont de nationalité étrangère.
Ce chiffre a été critiqué par le STRASS, qui accuse la méthodologie utilisée par cet office central d’être biaisée. Pour le STRASS, « la répression du racolage vise en premier lieu les étrangères. La loi de sécurité intérieure du 18 mars 2003 qui a pour but autant la lutte contre l’immigration que la tranquillité publique des riverains a donc ainsi eu comme effet de gonfler le nombre officiel des étrangères, celles-ci étant arrêtées en priorité par la police » (77). La lutte contre l’immigration illégale prendrait donc pour cible directe les prostituées étrangères et, ce faisant, augmenterait artificiellement les chiffres de la prostitution étrangère. Le pourcentage avancé de 90 % de personnes prostituées étrangères sur la voie publique serait donc, d’après le STRASS, bien supérieur à la réalité.
Il semble toutefois que cet ordre de grandeur soit corroboré par les résultats du dénombrement réalisé par la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) de la préfecture de police de Paris. En effet, sur les 837 personnes prostituées recensées dans les rues de Paris le 1er octobre 2010, 165 personnes seulement étaient de nationalité française (20 %), contre 607 personnes étrangères (72 %) et 65 pour lesquelles il n’est pas possible de déterminer la nationalité (78). Le pourcentage avancé par l’OCRTEH semble donc confirmé par le dénombrement effectué, à Paris, par les services de police.
NOMBRE DE PERSONNES FRANÇAISES ET ETRANGÈRES
PARMI LES PERSONNES PROSTITUÉES SUR LA VOIE PUBLIQUE À PARIS EN 2010
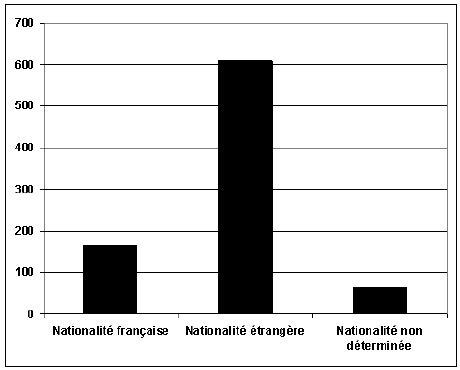
Source : Recensement réalisé par la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne le 1er octobre 2010.
Par ailleurs, ce chiffre est également relayé par les associations qui travaillent, sur le terrain, auprès des personnes prostituées. Ainsi, Grisélidis (79), association de santé communautaire toulousaine, a indiqué que la part des personnes étrangères parmi les personnes prostituées de rue était de 80 %. De même, parmi les personnes rencontrées par l’association IPPO à Bordeaux, 51 % proviennent d’Afrique subsaharienne, anglophone et francophone, 37 % sont originaires d’Europe de l’Est, principalement de Bulgarie et de Roumanie, 9,5 % sont françaises, et 1 % vient d’Afrique du Nord et d’Amérique du Sud.
La provenance géographique des personnes étrangères qui se prostituent sur la voie publique est variable en fonction de leur sexe.
Les femmes étrangères qui se prostituent sur la voie publique viennent principalement d’Europe de l’Est, d’Afrique et de Chine. D’après les chiffres de l’OCRTEH, parmi les femmes étrangères mises en cause pour racolage par la police nationale en 2010, 40 % sont originaires d’Europe de l’Est et des Balkans, 38 % d’Afrique, 12,5 % d’Asie (dont 98 % de Chine) et 3,5 % d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud (80).
NATIONALITÉ DES FEMMES ÉTRANGÈRES SE PROSTITUANT SUR LA VOIE PUBLIQUE
EN FRANCE EN 2010
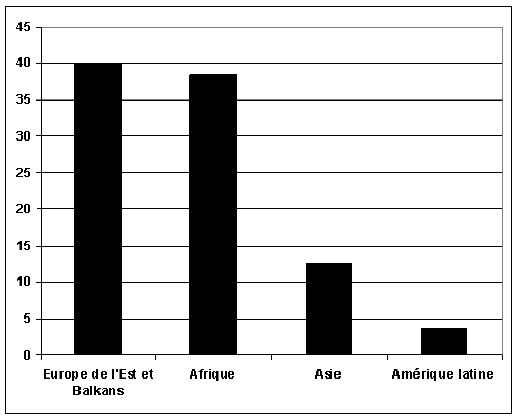
Source : Rapport de l’OCRTEH, 2010.
Les hommes étrangers qui se livrent à la prostitution sur la voie publique viennent essentiellement d’Amérique latine. Parmi les hommes étrangers mis en cause pour racolage par la police nationale en 2010 (81), 72 % étaient originaires d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, et 12,5 % du Maghreb.
NATIONALITÉ DES HOMMES ÉTRANGERS SE PROSTITUANT SUR LA VOIE PUBLIQUE
EN FRANCE EN 2010
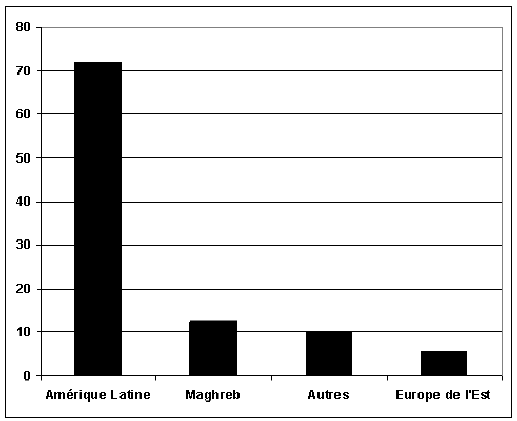
Source : Rapport de l’OCRTEH, 2010.
2. Cette augmentation s’explique par les bouleversements géopolitiques des années 1990 associés au développement de réseaux internationaux de traite
Plusieurs facteurs géopolitiques sont à l’origine du développement de filières migratoires appuyées par des réseaux de prostitution.
a) Plusieurs facteurs ont rendu possible le développement de réseaux de traite et d’exploitation sexuelle
Les bouleversements géopolitiques des années 1990 – effondrement de l’Union soviétique, conflits balkaniques, crises politiques en Afrique – ont engendré la prolifération des réseaux de traite et d’exploitation sexuelle. C’est par exemple le cas de l’Albanie, qui a fait l’objet d’une étude de Mme Maryse Chureau : « Les facteurs expliquant le développement de la traite à partir d’une zone varient selon les contextes socioéconomique, politique mais aussi culturel. Certaines constantes existent néanmoins comme l’accroissement des écarts de richesse et le désir migratoire, la guerre ou la faiblesse de l’État qui jouent un rôle important dans le développement de réseaux criminels et donc dans le développement du trafic de femmes. Si l’on centre l’analyse sur la zone albanophone, le développement de la traite des femmes apparaît étroitement lié à l’apparition des réseaux criminels, elle-même liée à la désintégration économique et politique ayant suivi la fin du régime d’Enver Hoxha » (82).
De plus, l’ouverture des frontières qui a résulté de la chute du mur de Berlin et de la création de l’espace Schengen, en 1995, a facilité les mouvements migratoires et partant, l’activité des réseaux et l’arrivée de personnes prostituées étrangères en France. De même, l’existence d’un marché unique européen, assurant la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux facilite l’entreprise des réseaux criminels, d’après M. Dragos Chilea, ancien procureur roumain : « La traite des êtres humains profite de ces quatre libertés : les victimes sont des marchandises, des personnes qui offrent des services, et tout ceci draine de grosses sommes d’argent qui enrichissent les chefs de réseaux » (83).
La conjonction de l’effondrement politique ou économique des États et de l’ouverture des frontières en Europe fournit une explication plausible aux vagues successives de personnes prostituées étrangères à partir des années 1990.
b) La prostitution étrangère a connu plusieurs vagues successives en France
Le rapport de l’OCRTEH de 1995 montre qu’au début des années 1990, si les principales nationalités représentées sont l’Algérie et le Maroc, la plus forte augmentation est cependant due aux pays de l’ex-Yougoslavie. M. Jean-Marc Souvira (84), commissaire divisionnaire, ancien responsable de l’OCRTEH, a indiqué qu’un mouvement massif de traite avait touché les femmes d’Europe centrale et orientale à partir de 1989, celles-ci étant alors contraintes de venir pratiquer la prostitution en Europe occidentale.
De même, le rapport de Mme Adrienne O’Deye, sociologue, et de M. Vincent Joseph, anthropologue, remis au ministère de la Justice en octobre 2006, qui étudie la prostitution de mineurs à Paris, note l’arrivée massive de personnes prostituées étrangères soumises à des réseaux de prostitution. Selon eux, les filières de l’Europe de l’Est se sont vraisemblablement développées à partir de 1995, à la suite de l’effondrement de l’Union soviétique et de l’éclatement de la Yougoslavie ; sont ensuite apparues les filières africaines, puis chinoises.
Cette évolution est également constatée par les acteurs associatifs. Ainsi, M. Patrick Hauvuy (85), directeur d’un établissement de l’association Accompagnement lieu d’accueil, qui intervient dans les Alpes-Maritimes, a souligné l’existence de deux vagues récentes d’immigration. À la fin des années 1990, les personnes prostituées étrangères étaient originaires d’Europe de l’Est, d’abord d’Ukraine et de Moldavie, puis de Bulgarie et de Roumanie. Ensuite, à partir du milieu des années 2000, sont arrivées à Nice des personnes prostituées africaines. Dans les deux cas, M. Patrick Hauvuy précise que ces arrivées massives sont surtout le fait de réseaux de traite et d’exploitation sexuelle.
c) Les personnes prostituées étrangères sont aujourd’hui majoritairement sous l’emprise de réseaux étrangers de traite et d’exploitation sexuelle
Il est apparu à de nombreuses reprises, au cours des auditions de la mission d’information, que les personnes prostituées étrangères étaient, en grande majorité, soumises à des réseaux de prostitution, qui gèrent toute la filière prostitutionnelle, du recrutement au rapatriement des produits de la prostitution. Ces réseaux se distinguent du simple proxénétisme par leur structure organisée et le nombre de leurs membres. Loin d’être un proxénète isolé, la tête de réseau est entourée de « lieutenants », parfois de sexe féminin, qui assument pour lui toutes les étapes de la traite des êtres humains : recrutement ou embrigadement des personnes prostituées, hébergement, transfert vers la France, mise en état de prostitution et collecte des fonds.
Mme Véronique Degermann (86), chef de section du parquet pour la juridiction interrégionale spécialisée de Paris, a précisé que très peu de personnes prostituées étrangères relevaient en fait de la prostitution « indépendante ». De même, les chiffres tirés des rapports de l’OCRTEH montrent tous que les victimes des réseaux de prostitution sont majoritairement d’origine étrangère. En moyenne, depuis le début des années 2000, les femmes victimes de proxénétisme sont à plus de 70 % de nationalité étrangère.
PART DES FEMMES DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE PARMI LES FEMMES
VICTIMES DE PROXÉNÈTISME DE 2002 À 2009
2003 |
2005 |
2007 |
2010 |
79 % |
75 % |
76 % |
74 % |
Source :Rapports de l’OCRTEH de 2003 et 2010 ; rapport du Gouvernement faisant état de la situation démographique, sanitaire et sociale des personnes prostituées ainsi que des moyens dont disposent les associations et les organismes qui leur viennent en aide, mars 2006.
Les réseaux sont d’ailleurs le plus souvent situés à l’étranger, comme le souligne M. Jean-Marc Souvira (87) et partagent presque toujours la nationalité de leurs victimes. En France, les principaux pays d’origine de la traite sont la Bulgarie et la Roumanie pour l’Europe de l’Est, le Nigeria et le Cameroun pour l’Afrique, et la Chine pour l’Asie. Mme Véronique Degermann (88) souligne qu’un proxénétisme brésilien, principalement hôtelier, sévit également dans la capitale.
D’après le rapport de l’OCRTEH, 39 réseaux internationaux de prostitution ont ainsi été démantelés en 2010. Parmi eux, 25 réseaux agissaient depuis l’Europe de l’Est et les Balkans, 9 depuis l’Afrique, 4 en provenance d’Amérique du Sud, principalement du Brésil, 1 depuis la Chine. Par rapport à 2009, les réseaux originaires d’Europe de l’Est et des Balkans sont en nette progression, puisqu’ils ne représentaient que 47 % des réseaux démantelés, contre 64 % en 2010.
ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES RÉSEAUX DE PROSTITUTION DÉMANTELÉS EN FRANCE
EN 2010
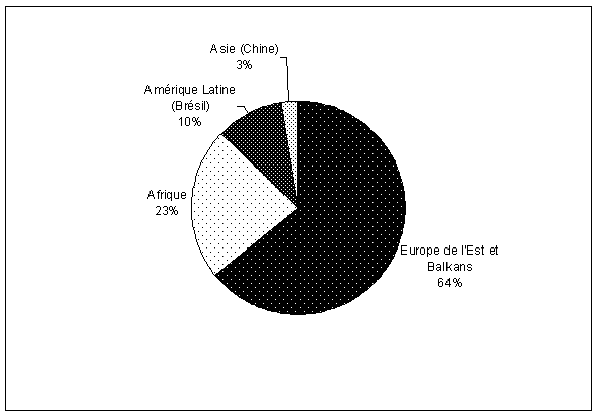
Source : rapport de l’OCRTEH, 2010.
B. LE FONCTIONNEMENT DES RÉSEAUX DE TRAITE ET D’EXPLOITATION SEXUELLE ASSURE LA PERSISTANCE DU SYSTÈME PROSTITUTIONNEL
La mainmise des réseaux de traite et d’exploitation sexuelle sur les personnes étrangères prostituées de rue a essentiellement pour origine la contraction d’une dette de passage par la personne migrante. Elle est ensuite assurée par divers moyens, allant du conditionnement psychologique à la violence physique.
1. La contraction d’une dette de passage est généralement à l’origine de la situation de prostitution et d’exploitation sexuelle
Les personnes prostituées étrangères victimes de la traite sont, dans de nombreux cas, liées au réseau par la contraction d’une dette assurant leur arrivée en France. D’après l’étude menée par Mme Françoise Guillemaut (89), sociologue, près de 80 % des femmes migrantes prostituées a une dette de passage.
M. Christian Kalck (90), chef de la brigade de répression du proxénétisme, a indiqué que la dette de passage pouvait aller de 5 000 euros pour les personnes en provenance des Balkans, à 50 000 euros pour celles qui viennent d’Afrique. Il a ainsi calculé que, pour rembourser ces 50 000 euros, dix années de travail étaient nécessaires dans un atelier de confection clandestin, ou comme nourrice, à raison de 17 heures de travail par jour et ce, tous les jours de la semaine. À l’inverse, la prostitution permet de gagner 3 000 à 5 000 euros par mois et de rembourser bien plus rapidement ses dettes.
Mme Nathalie Simmonot (91), coordonnatrice de Médecins du Monde, a souligné que le coût du passage était aussi fonction de la difficulté à passer les frontières. Le tourisme chinois étant en plein développement, les personnes chinoises ont nettement moins de mal que les personnes de nationalité africaine à passer officiellement les frontières européennes ou françaises. L’enquête du Lotus Bus indique que les femmes chinoises s’endettent à hauteur de 7 000 à 15 000 euros pour obtenir un visa de tourisme ou un visa d’affaire pour venir en France. De fait, le coût du passage pour les personnes d’origine africaine est exorbitant – autour de 60 000 euros (92) – et allonge d’autant la durée du remboursement et donc de la situation d’exploitation sexuelle.
La dette est aussi à l’origine de la prostitution de certains jeunes roumains, d’après M. Alexandre Lecleve, directeur de l’association Hors la rue (93). Ces jeunes garçons, originaires du sud de la Roumanie, se prostituent afin de permettre à leurs familles de rembourser la « kamata », la dette contractée auprès des réseaux mafieux en vue de financer leur émigration clandestine. Ainsi, même si ces jeunes garçons, parfois âgés de douze ans seulement, semblent se prostituer de façon autonome, ils sont en réalité sous la dépendance étroite de réseaux.
Ces réseaux peuvent assurer eux-mêmes le passage en France de personnes étrangères. C’est notamment le cas des réseaux nigérians, très structurés, qui fournissent de faux papiers aux personnes migrantes et organisent leur transfert vers l’Europe (94). Comme l’écrit M. Cédric Amourette, juriste, « les filles d’Afrique noire sont recrutées par d’anciennes prostituées retournées au pays, et qui s’occupent de toute la logistique, voyages, papiers, … » (95). De façon générale, le passage peut s’opérer selon des modes différents. Le plus coûteux consiste à arriver en France par avion, muni de faux papiers. Il est également possible d’entrer dans un autre pays de l’espace Schengen, pour lequel on dispose d’un titre de résident, avant de se rendre en France. Enfin, certains migrants arrivent par voie terrestre, au péril de leur vie. C’est notamment le cas des personnes de nationalité africaine, qui passent par l’Espagne ou par Malte.
Dans d’autres cas, les personnes migrantes sont peu ou prou « récupérées », à leur arrivée, par des membres de leur communauté, la dette initiale, contractée pour le passage, étant alors transférée au proxénète, qui la rachète. M. Christian Kalck (96) a ainsi indiqué que certains réseaux de traite ne se souciaient pas de l’activité future des personnes transportées et que le remboursement de la dette contractée passait par des intermédiaires, d’anciennes personnes prostituées, qui devenaient alors les créancières des personnes migrantes (97).
Par ailleurs, le rapport d’information sur l’esclavage moderne montrait que le recrutement de personnes migrantes s’opérait à l’époque directement dans la zone d’attente de l’aéroport de Roissy et au tribunal de Bobigny : « Le recrutement par les réseaux peut aussi se faire à l’arrivée des immigrés, comme ont pu en témoigner les responsables de l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFÉ). Les exploiteurs agissent au vu et au su de tous à la sortie de la zone d’attente de Roissy ou du tribunal de Bobigny où sont déférés les étrangers arrivés illégalement sur le territoire. Ce sont de véritables « rabatteurs » qui agissent en ces lieux et qui proposent aux étrangers dans un état de vulnérabilité extrême un numéro de téléphone, une adresse où on pourra les aider » (98).
2. Une contrainte, physique ou morale, est toujours exercée sur les personnes prostituées victimes de la traite
Les victimes de la traite sont presque systématiquement contraintes de se prostituer pour payer leurs dettes. Toutefois, le ressort qui conduit les personnes à le rembourser varie selon l’origine des personnes en question.
a) Les réseaux africains : envoûtement et piété filiale
Il n’est pas rare que les personnes prostituées venant d’Afrique aient fait l’objet de ce qu’elles estiment être un ensorcellement avant leur départ. En effet, les « mamas » nigérianes qui les recrutent les font participer à une cérémonie, appelée « juju », visant à les protéger une fois arrivées au pays de destination. Cependant, le charme du rite est rompu si elles évoquent l’activité du réseau ou cessent leur activité de prostitution.
Tel a notamment été le cas de Baina, une jeune femme nigériane rencontrée par la mission d’information (99). Arrivée à l’âge de 17 ans en France, par le biais d’un réseau de traite dont elle ignorait le véritable but, Baina, sous la menace d’un couteau, a été violée puis contrainte de se prostituer. Elle rapporte qu’il lui était alors impossible d’arrêter la prostitution et de s’enfuir, tant ses proxénètes l’avaient endoctrinée. Il lui était même interdit de parler aux associations présentes sur le terrain, car cela risquait de jeter « le mauvais œil » sur la communauté toute entière.
Ainsi, ces personnes éprouvent d’immenses difficultés à rompre le pacte initial. Le conditionnement psychologique qui résulte de l’envoûtement est tel que M. Jean-Marc Souvira (100), ancien directeur de l’OCRTEH, a pu observer, grâce à un dispositif de fixation d’images, des jeunes femmes africaines « ouvrir un colis et s’asperger d’un liquide pour se recharger en pouvoir magique ». M. Jean-Michel Fouchou-Lapeyrade (101), commissaire central du XVIe arrondissement, constate ainsi que leur « ensorcellement » empêche toute collaboration avec les forces de l’ordre.
Dans le cas des filières africaines, et plus particulièrement nigérianes, Mme Nathalie Simmonot (102) rapporte que c’est parfois la famille elle-même qui organise le départ et la prostitution de la fille aînée, en la mettant en contact avec les réseaux de traite et en finançant son passage. Le réseau utilise ainsi la piété filiale pour assurer le remboursement de la dette et la poursuite de l’activité prostitutionnelle.
b) Les réseaux de l’Est : violences physiques et psychologiques
Les réseaux de l’Europe de l’Est répondent à un modus operandi différent. Certains d’entre eux recourent généralement à la contrainte physique et à la violence psychologique pour forcer les personnes migrantes à se prostituer. M. Jean-Marc Souvira (103) fait ainsi état d’un véritable « parcours de dressage » pour les jeunes femmes de l’Europe de l’Est.
Celles-ci sont vendues telles du bétail en Moldavie, en Bulgarie ou en Roumanie à des réseaux, pour quelques centaines d’euros. Elles sont ensuite conduites en Turquie, dans les Balkans ou à Chypre pour subir le « dressage » à proprement parler, qui recourt de façon systématique à des viols collectifs, à la privation de nourriture, à l’enfermement et à la violence physique. Psychologiquement brisées et conditionnées, les victimes sont alors transférées en Europe occidentale, où leurs conditions de vie et d’exercice, comparativement moins dures, assurent leur entière docilité. Leur loyauté au réseau est également acquise par la menace permanente d’être renvoyées dans les précédents établissements. Enfin, la barrière linguistique achève de les isoler.
La contrainte morale exercée par les réseaux peut également prendre d’autres formes, comme le chantage sur la vie des membres de la famille de la personne prostituée. C’est ce dont témoigne l’histoire d’Adriana, qui a quitté l’Albanie à l’âge de 16 ans pour suivre, par amour, un homme plus âgé, qui l’a contrainte à se prostituer une fois en France, menaçant de s’en prendre à sa petite sœur restée au pays : « Là, il a commencé les menaces. Il m’a dit qu’il arriverait quelque chose à ma petite sœur. C’était une idée insupportable » (104).
Les réseaux menacent aussi les personnes prostituées de dévoiler la nature de leur activité à leur entourage ou de les livrer, sans papiers, aux services de police, signifiant ainsi le retour au pays d’origine. La confiscation des papiers d’identité est également employée pour s’assurer que la personne prostituée ne s’échappera pas, comme en témoigne M. Cédric Amourette : « Les réseaux de prostitution dépossèdent systématiquement les victimes de leurs papiers officiels et leur en fournissent d’autres, souvent faux, afin de garder sur elles pouvoir et contrôle » (105). Ainsi, le chantage, la menace, la violence sont les vrais ingrédients d’un consentement vicié (106).
c) L’équilibre du système prostitutionnel assuré par les réseaux
L’équilibre du système prostitutionnel repose sur la hiérarchie interne des réseaux. Ainsi, une certaine forme de promotion professionnelle et sociale assure le maintien du système prostitutionnel. En donnant la possibilité aux personnes prostituées de devenir elles-mêmes proxénètes un jour, le réseau de traite assure sa propre survie. C’est ce que souligne Mme Claudine Legardinier, journaliste spécialiste des questions de prostitution : permettre aux personnes prostituées de devenir proxénète à leur tour, en leur offrant ainsi une forme de promotion sociale, maintient le système prostitutionnel en l’état (107).
C’est notamment le cas des personnes prostituées nigérianes, qui peuvent devenir « mamas » si elles remboursent leurs dettes. Il apparaît également, dans le cas des réseaux africains, que les personnes prostituées peuvent racheter leur liberté en recrutant une autre personne prostituée (108).
La logique de la dette participe également du maintien du réseau de traite. En effet, les réseaux de prostitution entretiennent leur activité en pratiquant un véritable racket sur les personnes prostituées, ainsi que l’a souligné Mme Claudine Legardinier (109). Tout ce que gagnent les personnes prostituées est récupéré d’une façon ou d’une autre et contribue à les maintenir dans cet état de prostitution, seule façon de payer leurs dettes. C’est également ce qu’indique une étude de M. Richard Poulin, sociologue et anthropologue, à propos de personnes prostituées polonaises : « Victimes de violence, elles se retrouvent dans une vitrine, un bordel ou sur le pavé d’une rue, pour rembourser au trafiquant leur prétendue dette : frais de transport, de passeport, d’hébergement. Elles doivent ensuite rembourser le prix payé par le nouveau proxénète qui les a achetées à l’ancien proxénète » (110).
La dette n’est donc pas faite pour être remboursée, mais bien pour maintenir les personnes prostituées dans le système prostitutionnel le plus longtemps possible. La seule façon de racheter sa liberté est bien souvent le passage au proxénétisme et donc la participation au maintien du système.
3. La prostitution chinoise à Paris, la fin d’une exception ?
Les femmes originaires de Chine, qui se prostituent à Paris, semblent à première vue devoir échapper à l’emprise des réseaux. C’est en tout cas ce qui ressort de l’étude (111) de Mme Florence Lévyet et de Mme Marylène Lieber, publiée en 2009 dans la Revue française de sociologie. Ces deux sociologues montrent en effet que les Chinoises du Nord, qui se sont imposées à Paris à partir de la fin des années 1990, « ne dépendent pas de réseaux mafieux et de souteneurs » (112), contrairement à d’autres personnes prostituées migrantes. Les migrantes de Chine du Nord semblent donc constituer une exception notable à la mainmise des réseaux de traite et d’exploitation sexuelle. Elles migreraient par le biais de réseaux de passage, dans le but de financer les études de leur enfant ou payer les soins médicaux d’un proche, mais choisiraient de payer leur dette et de subvenir aux besoins de leur famille élargie en se prostituant.
Cependant, la situation des femmes chinoises à Paris, dans leur ensemble, semble avoir récemment évolué.
En effet, Mme Véronique Degermann (113), vice-procureur près le tribunal de grande instance de Paris, fait état de la constante augmentation du proxénétisme chinois. Notamment, les « marcheuses » du XIe arrondissement de Paris seraient sous la coupe de proxénètes extrêmement violents, qui tirent profit des réseaux d’immigration clandestine chinois, tout comme les tenanciers de salons de massage. C’est également ce que confirme la brigade de répression du proxénétisme de Paris (114). Les diverses enquêtes menées par ce service dans le milieu de la prostitution chinoise ont montré l’existence d’un fait nouveau, la présence d’individus constitués en bande organisée, parfois violents.
De même, la pratique semble avoir quelque peu changé, puisque les personnes prostituées chinoises exercent plutôt dans des appartements, loués par des compatriotes à des fins prostitutionnelles, ou des salons de massage, et non plus dans des lieux publics, comme l’a indiqué le docteur Ai Anh Vo Tran (115), médecin du Lotus Bus. Leur profil sociologique semble également avoir changé, puisque les prostituées chinoises sont aujourd’hui en moyenne sensiblement plus jeunes que celles des années 1990 et 2000. En outre, d’après la brigade de répression du proxénétisme de Paris, les personnes prostituées chinoises travaillent désormais de façon regroupée, dans des tenues plus visibles et de façon statique (116). Si les personnes prostituées chinoises n’arrivent pas toujours en France par le biais de réseaux de traite, il semble toutefois que la mainmise des réseaux d’exploitation sexuelle concerne désormais une part croissante d’entre elles.
C. LA GÉOGRAPHIE DE LA PROSTITUTION ÉTRANGÈRE EN FRANCE ET À PARIS
Ainsi qu’évoqué précédemment, la prostitution étrangère n’est pas exactement de même nature à Paris et en province.
1. Les personnes originaires d’Europe de l’Est et des Balkans constituent la majeure partie des personnes prostituées dans les villes de province
D’après le rapport de l’OCRTEH pour 2009, les femmes étrangères, qui représentent entre 80 % et 100 % des femmes mises en cause pour racolage en 2008, sont, dans toutes les villes françaises, à l’exception de Bordeaux, majoritairement originaires d’Europe de l’Est et des Balkans. De façon générale, la prostitution asiatique semble absente de la prostitution de rue en province.
Ainsi, à Strasbourg, sur 200 femmes étrangères appréhendées dans le cadre du délit de racolage, 158 sont originaires d’Europe de l’Est, principalement de Bulgarie et de République tchèque. Un constat similaire peut être fait pour Nice et Cannes. En effet, sur 354 personnes étrangères mises en cause pour racolage en 2009, les services de police ont dénombré près de 218 personnes originaires de l’Europe de l’Est et des Balkans, dont 161 d’origine bulgare. De même, à Toulouse, les personnes prostituées viennent majoritairement de Bulgarie et de Roumanie. Les personnes prostituées africaines, qui représentent une part presque aussi importante de la prostitution de rue toulousaine, sont en grande partie originaires du Nigeria.
Certaines villes connaissent une situation peu ou prou équilibrée entre personnes originaires d’Europe de l’Est et d’Afrique. C’est notamment le cas de Bordeaux, dont la majorité des personnes prostituées sont d’origine africaine et viennent notamment de Sierra Leone, du Nigeria et du Cameroun. Les personnes prostituées d’Europe de l’Est, également nombreuses, sont principalement originaires de Bulgarie. Enfin, certaines villes de province connaissent une prostitution spécifique en fonction de leur localisation géographique. C’est par exemple le cas de Marseille, qui connaît une prostitution d’origine maghrébine, notamment algérienne, proportionnellement plus importante que d’autres grandes villes de province.
RÉPARTITION DES NATIONALITÉS PARMI LES PERSONNES MISES EN CAUSE
POUR RACOLAGE EN PROVINCE EN 2008
Europe de l’Est |
Afrique subsaharienne |
Maghreb |
Asie |
Amérique du Sud |
Europe occidentale | |
Strasbourg |
79 % |
21 % |
- |
- |
- |
- |
Nice et Cannes |
63 % |
19 % |
2 % |
- |
14 % |
2 % |
Bordeaux |
43 % |
53 % |
1 % |
- |
2 % |
1 % |
Toulouse |
56 % |
40 % |
1 % |
- |
2 % |
1 % |
Marseille |
55 % |
12 % |
24 % |
- |
5 % |
10 % |
Source : Rapport de l’OCRTEH, 2009
2. Paris comporte certaines spécificités par rapport à la province
Plusieurs points semblent séparer Paris du reste de la France en matière de prostitution. En premier lieu, alors que la prostitution issue de l’Europe de l’Est domine ailleurs, sont représentées à Paris, de façon équitable, toutes les origines géographiques. En second lieu, la prostitution asiatique, en particulier chinoise, continue de progresser à Paris, alors même qu’elle semble absente des villes de province.
RÉPARTITION DES NATIONALITÉS PARMI LES PERSONNES MISES EN CAUSE
POUR RACOLAGE À PARIS EN 2010
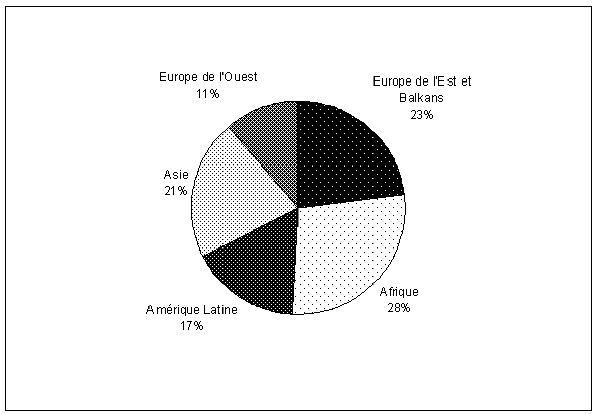
Source : Rapport de l’OCRTEH, 2010.
Les personnes prostituées originaires d’Europe de l’Est et des Balkans exercent en hôtel ou à bord de voitures dans le XIIIe arrondissement, à proximité de l’Arc de triomphe et de Vincennes. Elles sont également nombreuses sur les grands boulevards.
La prostitution africaine s’exerce surtout, d’après la brigade de répression du proxénétisme de Paris (117), dans le secteur de la Goutte d’or, dans les quartiers de Château rouge et Marcadet Poissonniers. Les personnes prostituées officiant dans ces zones géographiques sont essentiellement originaires du Ghana, du Nigeria et du Cameroun. Cependant, le bois de Vincennes demeure historiquement un lieu d’implantation pour la prostitution camerounaise.
La prostitution asiatique s’exerce principalement dans les Xe, XIIe et XXe arrondissements de Paris et se caractérise par sa grande mobilité géographique. Les quartiers de Belleville, Strasbourg-Saint-Denis, République, Porte de Vincennes et Porte Dorée et les boulevards des Maréchaux sont les principaux quartiers d’exercice. Les salons de massage présentant un risque de prostitution sont pour l’essentiel implantés dans le IXe arrondissement.
Les personnes transgenres exercent principalement dans les bois de Boulogne. Elles sont surtout d’origine sud-américaine, africaine et roumaine.
Les personnes prostituées dites « traditionnelles », généralement plus âgées (entre 40 et 70 ans), sont peu nombreuses et exercent, en appartements, dans les IIe, IXe et XVIe arrondissements.
Les mineurs exercent dans différents quartiers parisiens (118) : à proximité de la Porte Dauphine et Gare du Nord pour les jeunes garçons de toutes nationalités ; les jeunes filles de l’Est exercent plutôt boulevard des Maréchaux et dans le bois de Vincennes ; celles originaires d’Afrique sont localisées dans le quartier de la Goutte d’Or.
III. – L’APPARITION D’INTERNET A PERMIS L’ÉMERGENCE D’UNE NOUVELLE FORME DE PROSTITUTION
La prostitution par Internet semble aujourd’hui connaître une forte croissance, comme en témoigne Mme Myriam Quémener, magistrate au service criminel de la cour d’appel de Versailles, pour qui l’on est passé de « la prostitution de rue à la prostitution du Web » (119).
Internet constitue en effet pour la prostitution un média privilégié, dont les faibles coûts d’accès et la discrétion sont les principaux avantages. La prostitution par Internet semble au premier abord constituer une nouvelle forme de prostitution, répondant à des motivations parfois différentes et s’exerçant dans un contexte distinct de la prostitution de rue, tant pour les personnes prostituées que pour les clients. Toutefois, aussi complexe et diverse que la prostitution elle-même, la prostitution par Internet peut être soumise aux mêmes réseaux et se trouver entre les mains des mêmes proxénètes, dénotant ainsi une simple évolution de la prostitution, davantage qu’une révolution.
A. INTERNET, UN MÉDIA PRIVILÉGIÉ POUR LA PROSTITUTION
Internet présente des avantages considérables pour une activité aussi clandestine que la prostitution. En premier lieu, la faiblesse des coûts d’accès et de fonctionnement assure une rentabilité maximale aux activités de prostitution. La discrétion et l’anonymat que garantit ce média aux clients facilitent grandement le passage à l’acte de ces derniers, mais également de certaines personnes prostituées, qui n’auraient jamais envisagé d’exercer sur la voie publique. Enfin, la possibilité de brouiller les pistes derrière des petites annonces anodines ou des sites de rencontre favorise les entreprises criminelles.
a) L’avantage financier : la faiblesse des coûts d’accès et de fonctionnement
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication, en matière de prostitution, ont pour effet de faciliter la mise en relation avec le client. Ainsi, comparée à la prostitution de rue, la prostitution par Internet démultiplie la clientèle.
Par ailleurs, comme pour les autres activités économiques, l’essor d’Internet a engendré une baisse des coûts. Ceci profite en premier lieu aux réseaux de traite et d’exploitation sexuelle, qui peuvent, à peu de frais, créer un site Internet, hébergé dans des cyberparadis connus pour leur législation laxiste, et l’alimenter en annonces et photographies diverses. Les réseaux peuvent également utiliser des sites Internet déjà existants pour y déposer des annonces multiples. Ainsi, la rentabilité de leurs activités est maximale.
Les personnes prostituées indépendantes peuvent également en tirer profit, notamment du fait de la publicité qu’offre la toile. M. Laurent Mélito (120), sociologue, affirme ainsi qu’une inscription de trois mois peut coûter entre 300 et 1 000 euros, selon le site, la présence sur la première page coûte plus cher. Ces tarifs sont confirmés par le témoignage d’une escorte qui payait 200 euros par trimestre à un site dont le siège était en France, mais certains sites pratiquent, selon elle, des tarifs plus élevés, allant jusqu’à 300 euros par mois (121).
Les personnes qui se prostituent par le biais d’Internet peuvent en outre voir leurs prestations notées et commentées par les clients, ce qui leur donne une visibilité que la voie publique n’offre pas. En effet, sur certains sites, les clients « peuvent voter, opérer un classement (par popularité, ancienneté, tarif), poster des commentaires (certains font dans l’esthétisme, d’autres sont très crus) et évaluer la prestation » (122). Si cela ne saurait constituer un quelconque progrès, notamment en termes de dignité humaine, cette possibilité peut être considérée comme un « avantage » dans un secteur aussi concurrentiel que celui de la prostitution. Cette analyse est à rapprocher de celle de Mme Sylvie Bigot (123), sociologue, sur la marchandisation de la relation prostitutionnelle par Internet. Elle décrit en effet certains escort boys ou escort girl comme de véritables « entrepreneurs », qui « se posent très clairement en prestataires de services » et ont « une vision commerciale, mercantile des choses » (124). Dès lors, la possibilité d’être évalué, à l’instar d’un bien marchand, présente un intérêt substantiel.
Certaines escortes tiennent des blogs et des sites Internet personnels (125), qui leur assurent une publicité plus grande encore. Elles peuvent alors y indiquer leurs prestations, leurs tarifs et leur profil, et opérer ainsi un tri des clients.
b) La discrétion et l’anonymat : la facilitation du passage à l’acte pour le client comme pour la personne prostituée
Toutefois l’immense avantage qu’offrent les nouvelles technologies de l’information et de la communication aux acteurs de la prostitution réside dans la discrétion qu’elles permettent. En effet, l’utilisation de pseudonymes, l’usage des téléphones portables et de SMS, assurent l’anonymat des clients comme des personnes prostituées.
Il semble que cette prostitution ait généré l’apparition de nouveaux clients, qui répugnaient à recourir à la prostitution de rue. Le sentiment de s’adresser à une professionnelle indépendante, tout à fait consentante, en même temps que la facilité de la démarche via Internet, notamment dans la fixation du rendez-vous, a pu encourager le passage à l’acte de certains clients, selon M. Jean-Marc Souvira (126). La discrétion est un facteur déterminant pour certains clients de la prostitution. Il a ainsi été rapporté à la mission d’information, lors d’un déplacement en Espagne, que certains clients prenaient rendez-vous par Internet et allaient ensuite directement, avec leur voiture, dans un box de parking donnant accès à un immeuble où se déroulait la passe (127).
La possibilité offerte par Internet de cloisonner et de compartimenter les différents pans de son existence est à l’origine d’une nouvelle forme de prostitution dite occasionnelle. Les femmes se livrant à la prostitution sur Internet ont en réalité une « double vie », les proches n’étant pas au courant de leur activité. C’est notamment le cas d’une femme auditionnée par la mission d’information, qui exerce sur Internet depuis cinq ans, ce qui lui permet de dissimuler plus aisément cette activité à son entourage. De fait, les personnes prostituées exerçant sur Internet n’ont, pour la plupart, jamais travaillé sur la voie publique et ne le souhaitent nullement, selon Mme Véronique Boyer, animatrice de prévention sur l’action Internet au sein de l’association Grisélidis (128).
Ceci est particulièrement vrai pour deux populations spécifiques. Il s’agit, en premier lieu, des étudiants, comme l’indique le syndicat Sud-Étudiant (129). Si la prostitution étudiante existe sans doute depuis longtemps, elle a été rendue plus facile par l’utilisation d’Internet. La possibilité de racoler depuis son domicile, en toute discrétion, a également pu contribuer à la prostitution de mères de famille en situation précaire (130). Ces femmes, célibataires avec enfants à charge, travaillant à temps partiel ou touchant un revenu minimum, se prostituent de façon occasionnelle afin de subvenir à leurs besoins.
c) L’impunité : les difficultés de la répression du racolage et du proxénétisme sur Internet
Internet offre aux acteurs de la prostitution une certaine forme d’impunité. En premier lieu, d’un point de vue juridique, les sites étant le plus souvent hébergés à l’étranger, il est difficile d’inquiéter leurs webmestres et leurs hébergeurs. Pour échapper au mandat d’arrêt européen, les sites sont hébergés aux frontières de l’Europe et opèrent depuis la Moldavie, l’Ukraine ou la Biélorussie (131). Ils peuvent également être hébergés en dehors de l’espace européen, dans des pays à la législation moins répressive. Tel est le cas des États-Unis qui, en vertu du premier amendement, permettent à de tels sites d’exister en toute légalité (132), la répression ne s’exerçant que si les personnes prostituées sont mineures. Les enquêtes policières requièrent dès lors une importante coopération internationale, qui n’est pas toujours acquise (133). Enfin, la possibilité de fermer très rapidement un site Internet dont l’hébergeur aurait été inquiété par les services de police, et d’en ouvrir aussitôt un autre, est très souvent exploitée par les proxénètes. Le caractère éphémère des sites Internet constitue donc un réel obstacle à la répression.
Par ailleurs, les personnes prostituées profitent du flou juridique entourant le racolage sur Internet. Bien que la réponse du ministre de l’Intérieur à notre collègue Alain Bocquet (134), en 2007, souligne que le démarchage sur Internet n’est pas assimilé à du racolage par la jurisprudence, il semble que les services de police, comme certains parquets, aient retenu une interprétation différente du délit de racolage. En effet, plusieurs personnes ont déjà été mises en cause pour racolage sur Internet. Cependant, comme l’a indiqué Mme Myriam Quémener (135), il n’y a pas eu de directive de politique pénale en ce sens. Une décision de relaxe est d’ailleurs intervenue récemment, des preuves plus circonstanciées étant nécessaires pour caractériser le racolage sur Internet.
Enfin, l’activité prostitutionnelle se réfugie le plus souvent derrière des petites annonces anodines, sur des sites de rencontre ou d’emploi, dont il est difficile de prouver qu’il s’agit bien de prostitution. La personne prostituée peut dès lors se présenter comme une simple masseuse, ou encore une secrétaire ou une femme de ménage. En outre, la preuve de la relation sexuelle tarifée est extrêmement difficile à obtenir, sauf à ce que le client reconnaisse les faits. La répression du proxénétisme sur Internet suppose donc la surveillance active de la toile et la mobilisation de nombreux fonctionnaires de police, pour des résultats aléatoires.
B. L’ESCORTING, LA PROSTITUTION PAR INTERNET
Pour certains observateurs, Internet a donné naissance à une nouvelle forme de prostitution, dont les motivations, le contexte et la démarche même seraient distincts de la prostitution de rue. L’escorte, loin d’être une simple prostituée, proposerait des services sexuels tarifés de luxe. Toutefois, la réalité ne résiste pas longtemps à cette analyse réductrice. En effet, il apparaît que la prostitution par Internet est aussi diverse que la prostitution elle-même.
1. L’escorting, un mot nouveau pour décrire une même réalité ?
L’escorting, nouvelle forme de prostitution, s’est d’abord défini par opposition avec la prostitution de rue. Le changement de dénomination est d’ailleurs révélateur de cette volonté de différencier les deux activités. Toutefois, l’escorting ne saurait résumer, aujourd’hui, l’ensemble de la prostitution par Internet, qui est aussi diverse que la prostitution en général.
a) L’escorting se définit essentiellement en opposition à la prostitution de rue
L’escorting vise, à l’origine, à fournir un accompagnement de qualité dans le cadre d’événements mondains. Des femmes, en règle générale, tiennent compagnie à des hommes dans le cadre d’événements sociaux et doivent dès lors posséder certains attraits spécifiques, comme le charme et l’esprit, en plus d’une plastique agréable. Mme Éva Clouet, doctorante en sociologie, note que « dans ce cadre, la relation sexuelle ne fait pas partie du contrat (donc n’est pas obligatoire), mais reste une intention implicite, considérée comme un acte privé entre l’escorte et son client » (136). C’est la raison pour laquelle l’escorting a été très tôt associé à la prostitution de luxe.
L’escorting constitue, au premier abord, une forme de prostitution de luxe, qui se distingue nettement de la prostitution de rue. Pour M. Laurent Mélito, « la majorité des femmes interrogées acceptent la référence à la prostitution mais se situent sur le registre de l’euphémisation. Du point de vue du marketing, il s’agit de dire : ceci n’est pas une passe. Elles font référence à différents types de compétences : la qualité d’engagement et la qualité de la prestation ; l’accueil, l’écoute, le conseil, la prestance, la culture, l’allure, la distinction, l’habileté sexuelle, mais aussi des compétences plus secrètes : art de la simulation, endurance, distanciation » (137).
De fait, la relation ne semble pas, comme dans la prostitution de rue, réductible à un rapport sexuel tarifé. « Dans l’escorting, les rendez-vous durent au minimum une heure et peuvent se prolonger pour une soirée, un week-end ou même plusieurs jours […] L’acte sexuel est par conséquent moins « mécanique » et il semble beaucoup plus proche du « faire l’amour » que du simple échange de bons procédés exercés dans la pratique « traditionnelle » » (138), indique Mme Éva Clouet.
La dissociation entre le moment où le contrat est passé et sa réalisation permet à la personne prostituée comme au client de se projeter dans la rencontre (139). Parfois même, il s’agit de la scénariser à la façon d’un jeu de rôle. Pour M. Laurent Mélito, l’escorting est différent en ce sens que l’implication de la personne prostituée est plus forte : « Par exemple, à pratique identique […] la plus-value doit intervenir tant sur le plan de l’implication de la personne que d’un supposé savoir-faire ou d’une attention de la personne » (140). En dehors de l’acte sexuel lui-même, la conversation, l’accueil, l’attitude de la personne prostituée sont différents.
C’est également le sens du témoignage de cette escorte : « La différence entre l’escorte et la prostituée, c’est que la première passe sa soirée avec un seul client. C’est une différence de classe. On n’invite pas au resto une prostituée de rue. Moi, si » (141). L’escorting est donc une forme de prostitution « haut de gamme », ce dont attestent les différences de tarifs entre la prostitution de rue et l’escorting. Ainsi, l’escorte précitée dit avoir gagné environ 15 000 euros par mois pendant sa période d’activité. À l’inverse, les personnes prostituées de rue peuvent ne gagner que 5 à 40 euros par passe (142), et 1 500 euros par mois (143). De même, d’après M. Jean-Marc Souvira, les tarifs horaires des escortes vont de 300 à 400 euros, quand les personnes prostituées de rue ne toucheraient que 30 à 50 euros en moyenne (144).
L’escorting permet aux clients d’entretenir une relation extraconjugale sans s’embarrasser des liens affectifs qu’elle pourrait impliquer. Pour Mme Sylvie Bigot, l’escorting est « l’archétype de la relation sexuelle désengagée : plus encore qu’une relation sans lendemain, elle n’engage pas les partenaires les uns envers les autres ni ne suscite d’attentes au-delà du temps imparti et déterminé au préalable » (145). L’argent assure le cadrage de la relation et la légitimité du désengagement relationnel.
L’escorting permet également à certains clients d’avoir accès à un public particulier, celui des étudiants. En effet, les étudiants se livrant à la prostitution racolent presque exclusivement par Internet. Mme Éva Clouet montre que les clients des étudiantes sont des hommes mariés, d’âge mûr, issus de classes sociales aisées, qui viennent assouvir leur fantasme de la « Lolita » auprès de cette catégorie particulière de personnes prostituées (146).
c) L’escorting semble en réalité être aussi divers que la prostitution elle-même
L’escorting semble cependant revêtir plusieurs visages, selon que les personnes qui l’exercent sont indépendantes ou non. Bien que le terme même d’« escorting » soit utilisé aujourd’hui par la majorité des personnes se prostituant par Internet, « quel que soit leur niveau de prestation » (147), il semble qu’il faille distinguer l’escorting « indépendant » de l’escorting organisé par les « agences ».
Concernant l’escorting indépendant, il faut également opérer une distinction entre les escortes occasionnelles et les escortes professionnelles. Les premières sont souvent des femmes françaises, de plus de trente ans, qui occupent parfois un emploi à temps partiel, souvent mères célibataires (148). De façon générale, les escortes français, hommes ou femmes, ne sont pas socialement déclassées, d’après l’étude menée par M. Laurent Mélito (149).
Dans le cas des escortes étrangères, ces dernières peuvent être soumises à différents types de contrainte. En premier lieu, ces dernières doivent payer des frais d’inscription sur le site Internet où elles figurent ; une part importante de leurs gains est parfois prélevée ; des menaces et des violences physiques peuvent être exercées à l’encontre des escortes qui souhaiteraient se désinscrire du site Internet, ainsi que l’a indiqué M. Jean-Philippe Lenormand (150), adjoint au chef de la brigade de répression du proxénétisme à la préfecture de police de Paris.
La pression du réseau est évidemment poussée à son paroxysme lorsque son action dépasse la simple mise à disposition de l’outil informatique permettant d’entrer en contact avec des clients. Le réseau peut ainsi organiser plus largement la pratique prostitutionnelle. Ce fut notamment le cas d’un réseau libanais, démantelé à Cannes en 2007, qui organisait, à Beyrouth, de faux concours de beauté, dont il tirait ensuite un recueil de photographies de jeunes femmes en maillot de bain, expédié à de riches clients européens. Ceux-ci réservaient une jeune femme via Internet et payaient alors près de 30 000 euros à la tête de réseau. Les personnes prostituées étaient emmenées en tournée, dans le sud de la France et à Ibiza, où elles devaient défiler. Puis, le soir venu, elles étaient contraintes, par surprise, de se prostituer (151).
2. Les motivations des escortes indépendantes
Les motivations des escortes indépendantes sont généralement financières. Toutefois, plusieurs facteurs, affectifs ou psychologiques, favorisent le passage à l’acte et la continuation de l’activité prostitutionnelle.
a) La motivation première de la prostitution par Internet reste financière
Le besoin d’argent semble tenir une place cruciale parmi les motivations des personnes se prostituant par Internet. M. Laurent Mélito (152), montre ainsi que les dettes sont souvent à l’origine du passage à l’acte. « Il fallait que je sauve ma boîte. Le pire, c’est que j’ai fait ça pour l’État ; pour payer la TVA et les URSSAF », témoigne une escorte (153). L’escorting peut également constituer une activité annexe à un emploi officiel, souvent à mi-temps, qui ne permet pas aux personnes d’atteindre le confort financier qu’elles souhaitent.
Mais l’escorting, bien plus rémunérateur que la prostitution de rue, crée aussi un engrenage financier d’autant plus important : les nouvelles entrées d’argent créent de nouveaux besoins, qui eux-mêmes appellent une augmentation de la rémunération, créant ainsi une forme d’accoutumance à cette forme de prostitution. C’est ce qui ressort du témoignage de l’escorte évoquée plus haut : « L’argent, c’est super dangereux. Avec 500 euros par jour, on en garde moins qu’avec 2 000 par mois. Avec tout ce que j’ai gagné, pourquoi est-ce que je n’en ai pas mis de côté ? On a toutes le même problème ; on est tellement mal qu’on a besoin de compenser. On achète des trucs incroyables, on ne regarde plus les prix. (…) Ce monde-là est trop dangereux » (154). L’engrenage est financier, mais également psychologique. M. Laurent Mélito (155) avance ainsi que cette manne financière est valorisante sur le plan narcissique et qu’elle devient dès lors rapidement indispensable.
L’enjeu financier est en particulier présent dans le cadre de la prostitution étudiante. Mme Éva Clouet, montre ainsi que le besoin d’argent constitue une motivation importante de l’activité prostitutionnelle des étudiants (156). Ainsi, l’association toulousaine Grisélidis, qui mène une action à destination des personnes prostituées sur Internet depuis trois ans, constate que les personnes prostituées occasionnelles de moins de trente ans sont généralement des étudiantes qui préparent une thèse, et qui se prostituent afin de financer leurs études (157).
Le passage à l’acte peut résulter d’une rupture affective ou professionnelle. Pour M. Laurent Mélito, c’est généralement « un événement fort, un réaménagement complet de leur vie » qui est à l’origine de l’activité prostitutionnelle des escortes indépendantes. Divorce, décès du conjoint, licenciement peuvent ainsi pousser certaines personnes à recourir à l’escorting. C’est également ce que note Mme Éva Clouet (158) à propos des étudiantes qu’elle appelle les « désillusionnées de l’amour ». Ces jeunes femmes ont vécu des échecs amoureux avant de se lancer dans des aventures d’un soir, puis dans la prostitution, l’argent permettant alors de faire face à l’échec sentimental et de se valoriser.
C’est aussi le cas de Lucie, dont le témoignage est rapporté par Mme Sylvie Bigot : « Fonctionnaire, elle s’est mise en disponibilité pour reprendre des études universitaires et s’est lancée dans l’escorting parallèlement pour répondre, selon ses propres termes, à une détresse matérielle et une détresse amoureuse. En effet, elle a essuyé une grosse déception amoureuse, puis a essayé sans grande satisfaction les relations sans lendemain avant de s’orienter vers les relations tarifées » (159).
b) L’aspect « glamour » de cette forme de prostitution en favorise l’acceptabilité
L’escorting se veut ainsi la face luxueuse et « glamour » de la prostitution. Cet aspect des choses est bien souvent le déclencheur de l’activité prostitutionnelle des escortes. Ainsi, la banalisation de cette activité par le cinéma et les médias, des séries télévisées comme Maison close (2010) ou Journal intime d’une call-girl (2008), des films comme Pretty Woman ou encore des œuvres littéraires, a pu renvoyer une image valorisée de cette forme de prostitution. C’est ce que note Mme Claudine Legardinier, journaliste : « Tout ce bain médiatique fait de la prostitution quelque chose de banalisé, voire de chic et branché. » (160)
Les émissions télévisées semblent également avoir un impact non négligeable sur le développement de l’escorting. Mme Claudine Legardinier dénonce ces « émissions sur les « escort girls », qui ne parlent que d’argent facile et de glamour […] qui ont une véritable influence sur les jeunes femmes » (161). C’est notamment le cas d’une escort girl, qui témoigne dans la revue Prostitution et société : « Un soir, sur Zone Interdite, sur M6, est passé un reportage sur les escorts. J’ai été sidérée. Les tarifs étaient complètement fous. Je me suis dit que c’était la solution. Je ne savais pas que c’était possible » (162).
c) Une façon différente de vivre sa sexualité
Certaines escortes avancent également que cette activité est un moyen de vivre leur sexualité de façon différente. Elles ne conçoivent alors pas leur activité comme un travail, mais comme « un moyen de vivre en toute discrétion une sexualité active, d’autant plus que l’argent permet de lever les inhibitions » (163). C’est paradoxalement pour ne pas répondre au stigmate de la « putain » que certaines femmes, d’après l’analyse de Mme Sylvie Bigot (164), deviennent escortes. C’est également le cas d’Alain, escort boy à Paris : « Alain a d’abord découvert la prostitution en tant que client. Ses fantasmes l’ont toutefois orienté vers les couples, qu’il cherche dans un premier temps à rencontrer pour son propre plaisir » (165), avant de se prostituer par Internet.
Parmi les étudiants qui se prostituent, la volonté de s’inscrire en rupture par rapport aux valeurs morales transmises par la famille peut motiver l’entrée dans la prostitution, comme le montre Mme Éva Clouet : « Anne-Sophie a commencé à se prostituer occasionnellement à la fin du mois de novembre 2006. Cette pratique, à l’opposé de l’éducation inculquée par ses parents, marque sa volonté de rompre avec « une éducation stricte et étouffante » […] En se prostituant, Anne-Sophie se heurte frontalement à la morale familiale » (166).
C’est également ce que note M. Laurent Mélito à propos des escortes les plus jeunes : « Il y a aussi celles qui désirent un changement, qui découvrent un univers sexuel et relationnel différent et disent vouloir joindre l’utile à l’agréable (…) Très sollicitées par les hommes qu’elles désirent souvent, elles ont pris la décision de solliciter plus ou moins directement ces partenaires sur le registre financier » (167). Il note cependant qu’une minorité seulement tient ce discours.
C. LES « SEX TOURS », NOUVELLE FORME D’EXPLOITATION DE LA PROSTITUTION
Internet est également le lieu de l’activité des réseaux de prostitution, qui, sous le nom d’« agences d’escortes », exploitent des personnes prostituées. De fait, dans ce cadre, le client a le sentiment de traiter avec une escorte indépendante, une professionnelle libre de ses choix (168). Le caractère invisible de l’emprise du réseau rend cette forme de prostitution particulièrement attrayante pour le client, qui est dès lors déculpabilisé.
Le rapport du Gouvernement relatif à l’évolution de la situation des personnes prostituées de 2010 souligne que la pratique des « sex tours » tend aujourd’hui à se développer (169). Elle consiste à programmer le séjour des personnes prostituées étrangères dans différentes villes européennes, à raison de quelques jours à une semaine par ville. Cette tournée assure la mobilité, et donc la quasi-invulnérabilité, des réseaux qui l’organisent. Les personnes prostituées, le plus souvent de jeunes femmes, sont recrutées de façon trompeuse par des petites annonces pour un emploi ou de simples rencontres sur des forums.
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication sont ainsi utilisées par les réseaux de traite pour faciliter leur entreprise criminelle. Le recrutement est facilité par Internet. Les victimes, qui entrent en contact avec des réseaux depuis leur domicile, à leur insu, en répondant à des petites annonces ou par le biais de réseaux sociaux, ne se sentent pas en danger et sont dès lors moins vigilantes (170). M. Jean-Marc Souvira a ainsi indiqué que les réseaux d’escortes constituaient une forme de traite, dans la mesure où les victimes sont trompées sur la nature des prestations qu’elles auront à fournir. Par ailleurs, la violence exercée contre elles semble être du même ordre que dans le cas de réseaux classiques (171).
Par la suite, les jeunes femmes sont référencées, de même que leurs mensurations et leurs prestations, sur un site Internet. Les clients passent commande par un message écrit, envoyé depuis un téléphone portable, en Roumanie ou en Bulgarie (172). Tel était le cas d’un réseau slovène récemment démantelé. Un site hébergé à l’étranger proposait un catalogue de photographies de jeunes femmes, choisies par le client. Celui-ci recevait la confirmation du rendez-vous, la date, l’heure l’adresse de l’hôtel et le numéro de chambre, par un message envoyé sur son téléphone portable (173).
Ces tournées sont généralement organisées dans des hôtels de moyenne et de haute gamme qui, par leur fréquentation et leur taille, permettent à l’activité prostitutionnelle de passer inaperçue. Par sa nature, cette forme de prostitution est particulièrement difficile à quantifier. M. René-Georges Querry, directeur de la sécurité du groupe Accor, a toutefois estimé que « dans les grands hôtels de type Ibis à proximité de la Tour Eiffel, qui comptent de 300 à 600 chambres, il a pu déjà être constaté la présence d’une douzaine de prostituées en même temps dans l’hôtel. » (174) La prostitution semble peu présente dans l’hôtellerie de luxe, dans la mesure où la fréquence des passages d’employés dans les chambres est beaucoup plus importante.
Les personnes se livrant à la prostitution réservent une chambre pour une durée d’une semaine et reçoivent ensuite les clients, au cours de rendez-vous successifs, dans leur chambre. Il s’agit essentiellement de femmes en provenance d’Europe de l’Est. La réservation de la chambre d’hôtel est toujours effectuée par des personnes seules, car un groupe attirerait l'attention. De faux noms sont alors utilisés (175).
Ces personnes travaillent, sauf exception, pour des réseaux, ainsi que l’a indiqué M. Jean-Marc Souvira : « les profits de ce trafic [sont] récupérés par une femme, souvent ex-prostituée, qui dirige cinq ou six prostituées et qui est seule en lien avec le réseau mafieux » (176). Il arrive ainsi fréquemment que ce soit une ancienne personne prostituée qui soit en charge de veiller au bon déroulement du « sex tour » et de surveiller les jeunes femmes. C’est notamment ce qu’indique le rapport de l’OCRTEH à propos du démantèlement d’un réseau d’Europe de l’Est sévissant dans des hôtels parisiens : « Deux prostituées russes étaient chargées de former leurs compatriotes et de transférer en Russie 50 % du produit de leur prostitution » (177). Les profits ainsi réalisés sont envoyés dans le pays d’origine via des systèmes internationaux de transfert de fonds. Du fait de ce mode d’organisation, la preuve du proxénétisme est particulièrement difficile à apporter. Ces tournées sont très organisées, le réseau assurant une surveillance étroite des personnes prostituées (178).
IV. – LA PRÉCARITÉ ET LA VULNÉRABILITÉ DEMEURENT DES FACTEURS DÉTERMINANTS D’ENTRÉE ET DE MAINTIEN DANS LA PROSTITUTION
En dehors des cas de traite des êtres humains, on peut distinguer plusieurs grandes logiques d’entrée dans la prostitution, qui constituent, généralement, autant de facteurs fragilisants pour les personnes qui les subissent.
Il s’agit tout d’abord des ruptures familiales et de l’exclusion sociale dont sont victimes certains jeunes, notamment homosexuels ou transgenres. La prostitution peut alors apparaître comme une stratégie de survie, étant souvent la seule activité permettant de se nourrir et de se loger. Plus largement, la précarité économique, qu’elle soit subie à l’étranger ou en France, constitue également un facteur majeur d’entrée dans la prostitution, débutant souvent sous une forme occasionnelle. Enfin, il n’est pas rare que les personnes prostituées soient victimes de tiers peu scrupuleux, qui n’hésitent pas à abuser de leur crédulité ou de leur vulnérabilité pour les faire entrer dans cette activité.
Ainsi, en dehors de la traite des êtres humains, c’est la vulnérabilité sous toutes ses formes, sociale, financière et psychologique, qui constitue l’autre grand ressort de l’entrée dans la prostitution.
A. LES RUPTURES FAMILIALES ET L’EXCLUSION SOCIALE
Les jeunes isolés, notamment en raison d’un rejet lié à leur orientation sexuelle, sont particulièrement vulnérables et peuvent trouver dans la prostitution un moyen de survie.
La question de la prostitution des mineurs, qui a émergé au début des années 2000 sur la scène publique, est liée à l’arrivée visible de jeunes prostitués roumains à la Porte Dauphine, en 1999 (179). La réponse législative ne se fait pas attendre : dès 2002, la prostitution des mineurs est interdite et leurs clients se rendent coupables d’un délit (180).
Les mineurs prostitués, lorsqu’ils sont français, sont généralement isolés. Filles ou garçons, leur activité prostitutionnelle est souvent occasionnelle, transitoire et peu organisée (181). La prostitution est pour eux une stratégie de survie face à leur précarité sociale et financière.
Bien souvent, ces jeunes sont en rupture familiale et leur passé institutionnel instable, au sein de foyers, témoigne de leur isolement. Comme le note une étude sur la prostitution masculine, « souvent ces garçons ont perdu un de leurs parents, ont des conflits avec la belle-mère ou avec le beau-père ce qui les amène à quitter la maison des parents »(182). Sans logement, sans couverture sociale, coupés de leur famille, ascolaires, ces mineurs sont plongés dans un profond isolement social et affectif (183).
Un jeune homme français, prostitué, témoigne : « Je me suis trouvé dans la rue à l’âge de 16 ans, donc, il fallait que je me débrouille pour trouver un logement. Eh bien, j’ai essayé des foyers et ils me fermaient toujours la porte au nez. Pour des questions d’hébergements ils disaient toujours : « il n’y a pas de place », à force, pendant trois mois, j’ai réellement galéré et donc, j’ai trouvé la prostitution. J’ai connu ça à la gare du Nord. Je suis arrivé… Cela s’est passé un peu dans les deux sens : quelqu’un qui m’a présenté là-bas, il m’a montré un tel, un tel et puis moi je suis allé voir directement, j’ai dragué » (184).
De même, les comportements pré-prostitutionnels, comme le fait d’avoir des relations sexuelles en contrepartie de biens non monétaires, touchent en premier lieu, d’après le docteur Dinah Vernant, « les adolescentes les plus fragiles, livrées à elles-mêmes, dont les familles sont souvent défaillantes » (185). Ces pratiques, non assimilées à de la prostitution par les mineurs, sont plutôt de l’ordre de la « débrouille » : le troc sexuel constitue un moyen rapide d’acquérir certains biens.
2. Un rejet lié à l’orientation sexuelle
La prostitution masculine des mineurs et des jeunes majeurs a ceci de particulier qu’elle est essentiellement homosexuelle (186). Aussi, l’entrée dans la prostitution de jeunes hommes est-elle fréquemment liée à la non-acceptation de leur orientation sexuelle par leur famille, qu’ils soient homosexuels ou transgenres.
Ce cas de figure est celui de Kevin (187), jeune homme rencontré à l’Amicale du Nid de Paris, qui a commencé à se prostituer à 16 ans, après le rejet dont il a été victime de la part de sa famille, à la suite de la révélation de son homosexualité (188). C’est aussi ce qui ressort du témoignage de Martin, jeune homme mis à la porte par ses parents du fait de son homosexualité : « Je devais payer un loyer de 300 euros tous les mois, à peine ce que me rapportait n'importe quel petit boulot […] Dans le milieu gay, on me disait que j'étais mignon, que je pourrais gagner jusqu'à 500 euros par jour. Entre ça et la galère, ma décision a été vite prise » (189).
En parallèle, la prostitution peut constituer, pour certains jeunes hommes, le moyen de vivre leur homosexualité. C’est ce qui transparaît dans le témoignage de Paolo : « Longtemps, je ne me suis pas assumé en tant qu’homosexuel. Je sortais avec des filles, je me racontais qu’un jour je me marierais […] J’ai commencé à rencontrer des garçons par réseau téléphonique pour […] des rencontres homosexuelles en direct. J’utilisais beaucoup ces réseaux depuis des cabines. Ça me coûtait très cher. De 18 à 20 ans, j’appelais, j’écoutais les messages et je raccrochais. Les garçons ne cherchaient pas à rencontrer quelqu’un pour une relation ; c’était seulement sexuel. Un jour, il y en a un qui m’a proposé de l’argent. […] Au début j’ai refusé. Le type était âgé et l’effet de surprise a fait que j’ai décliné. Et puis un jour j’ai accepté ; la personne devait me convenir. De l’argent, j’en avais pourtant. En plus, j’habitais chez mes parents. Tout s’est passé très vite. Je n’en ai que de vagues souvenirs. J’avais 21 ans » (190).
3. L’exclusion sociale accrue des personnes transgenres
Compte tenu de l’exclusion sociale et de la stigmatisation dont elles font l’objet, la prostitution constitue, pour les personnes transgenres, travesties ou transsexuelles, l’un des principaux moyens de se procurer une source de revenus. L’entrée dans la prostitution des personnes transgenres semble ainsi répondre à plusieurs préoccupations.
La première est d’ordre sociale : rencontrer des pairs, partager son expérience et parfois, amorcer sa transformation. La solitude des personnes transgenres peut en effet être extrêmement lourde. Pour Dominique, transsexuel, « on s’habitue par la force des choses : au silence total de la famille qui vous traite de malade et, plus douloureux encore, à l’inextricable situation de la rencontre. Dire la vérité à quelqu’un qui vous plaît, c’est horrible. Dans le meilleur des cas, la personne disparaît. Encore heureux quand on ne se fait pas casser la figure » (191).
C’est aussi ce dont témoigne l’histoire de Myriam, jeune transsexuel, rejeté par sa famille à 14 ans et pour qui la prostitution a été un moyen de rompre son isolement affectif : « Si je suis entrée dans la prostitution, c’est parce que je suis transsexuelle. On m’avait dit que c’était le seul endroit où je pourrais rencontrer des trans. Je n’avais pas de famille, personne. […] À 14 ans, j’ai été rejetée par ma famille » (192). Le milieu de la prostitution transgenre apparaît alors comme un lieu de sociabilité : « Mais ce que je voulais surtout, c’était avoir un lien avec les autres filles. La prostitution, c’était un cocon, une famille. Mais une famille qui me détruisait. Ce que je voulais, c’était être entourée, rencontrer des jeunes, rigoler, boire un coup. On a sa souffrance et on est seul. À qui en parler ? » (193)
Les motivations sont également d’ordre économique et financier. Hassen (194), jeune homme algérien rencontré à l’Amicale du Nid de Paris, s’est régulièrement prostitué, à partir de 16 ans, afin de disposer des moyens de subsistance, ayant été rejeté par sa famille (195). Mais la prostitution semble aussi être un moyen rapide, pour les personnes transsexuelles, de gagner suffisamment d’argent pour achever leur transformation. C’est ce qui ressort du témoignage de Myriam : « Quand on est trans, on va dans la prostitution pour pouvoir s’offrir la chirurgie et puis après on s’habitue et on y reste » (196).
La prostitution est enfin l’une des principales activités rémunérées que les personnes transgenres peuvent exercer en accord avec leur apparence physique. L’étude de M. Laurindo Da Silva sur la prostitution masculine indique ainsi que « la majorité a pratiqué des petits boulots avant la prostitution, mais ceux-ci peuvent devenir incompatibles avec le mode de vie choisi » (197). La discrimination à l’égard des personnes transsexuelles est en effet telle qu’il n’est parfois pas possible pour ces personnes d’exercer un métier classique en conservant l’apparence physique qui correspond à leur genre. La prostitution est, pour les personnes transgenres « une façon de se faire une profession » (198). C’est ce qui ressort du témoignage de Mira, transsexuel français : « J’ai commencé à faire la prostitution c’est parce que j’avais besoin d’argent… Et parce que franchement, chaque fois que je me présente pour travailler quand on me voit comme ça on me dit toujours Madame, et quand je présente ma pièce d’identité c’est toujours un mec, et c’est d’avantage pour ça qu’on trouve jamais du travail… » (199)
Il faut préciser que seule une minorité de personnes transgenres recoure à la prostitution. Mais les motifs de l’entrée dans la prostitution sont liés à l’exclusion sociale et à la stigmatisation profonde dont ces personnes font l’objet dans notre société.
Sans revenir sur les situations de contrainte qui sont de loin les plus nombreuses, la nécessité de gagner, souvent rapidement, de fortes sommes d’argent est l’un des autres grands facteurs d’entrée dans la prostitution, qui peut alors prendre une forme occasionnelle, notamment au début.
1. La prostitution étrangère comme aboutissement d’un processus migratoire
Ce cas de figure peut être celui de certaines personnes étrangères, qui décident de migrer afin de procurer de l’argent à leur famille ou de se constituer un capital, sans toujours savoir quelle activité elles exerceront et dans quelles conditions. La décision de migrer vers la France est souvent le résultat du manque de perspectives économiques dans le pays d’origine.
C’est par exemple le cas des femmes chinoises qui se prostituent à Paris. D’après l’enquête menée par le Lotus Bus de Médecins du Monde (200), celles-ci viennent principalement du nord-est de la Chine, région connue pour sa production industrielle et son exploitation minière mais qui est fortement touchée, depuis quelques années, par le chômage. Ces femmes, qui avaient jusqu’alors un travail correctement rémunéré, se trouvent tout à coup socialement déclassées et peinent à retrouver un emploi. Selon l’étude de Mmes Florence Lévyet et de Marylène Lieber, ces femmes, « qui appartiennent à une génération marquée par la transition économique entamée en Chine depuis 1978 […] ont été pendant une vingtaine d’années employées d’entreprise d’État, jouissant d’un statut relativement favorisé, avant d’être pour la plupart mises à pied et de vivoter grâce à des emplois temporaires, ou, pour d’autres, de se lancer dans les affaires en ouvrant généralement un commerce au succès éphémère » (201).
Cette situation n’est en rien spécifique aux femmes chinoises. Certaines femmes originaires du Nigeria (202) ou d’Europe de l’Est migrent vers la France dans les mêmes conditions. L’une des caractéristiques communes de ces migrations est la précarité dans laquelle elles se déroulent. En effet, fréquemment, ces personnes qui souhaitent migrer en France font appel à des réseaux clandestins et se trouvent donc en situation irrégulière. Or, cette situation administrative leur ouvre très peu de liberté de choix. Une fois sur place, les personnes migrantes, ne parlant pas le français, peuvent difficilement trouver d’autres sources de revenus que la prostitution (203).
Par exemple, l’entrée dans la prostitution des femmes chinoises est la plupart du temps postérieure à la migration, mais également liée à l’absence d’alternative rémunératrice. En effet, M. Lilian Mathieu, sociologue, indique que les prostituées chinoises peuvent préférer cette activité à une place de domestique ou un travail dans un atelier clandestin (204). Mme Nathalie Simmonot, coordinatrice de Médecins du monde à Paris, souligne que les femmes originaires de Chine du Nord, après avoir fait l’expérience de l’esclavage domestique auprès d’autres membres de leur communauté, se tournent vers la prostitution, qui leur assure une certaine forme de liberté (205). En effet, les employeurs qui se trouvent face à des personnes sans papier ou en situation administrative très précaire, les font travailler à temps plein sans les rémunérer et parfois en abusant sexuellement d’elles. De fait, dans ces conditions, l’activité prostitutionnelle peut devenir un choix « acceptable ».
C’est également ce qui ressort du témoignage de Perle, recueilli par Mmes Nasima Moujoud et Dolorès Pourette : « Perle a 45 ans, elle est originaire de la Chine du Nord. Elle est en France depuis trois ans et demi au moment de notre rencontre. Divorcée depuis treize ans, elle a un fils de 18 ans qui vit avec elle. Elle a été licenciée il y a huit ans, alors qu’elle travaillait dans une fabrique d’instruments chirurgicaux. […] Perle est venue avec quatre autres personnes, en versant la somme de 50 000 francs (7 600 €) à des passeurs pour le voyage et le visa touristique. Elle a emprunté cette somme à sa famille, qu’elle a remboursée en deux ans. Arrivée en France, elle a été embauchée chez des Wenzhou (Chinois originaires de la région du même nom, située dans la province du Zhejiang) comme « nourrice ». Payée 3 000 francs (450 €) par mois, elle travaillait, tous les jours, toute la journée, avec seulement deux jours de repos par mois. Elle n’était en outre ni nourrie, ni logée - elle mangeait aux Restos du coeur et payait 700 francs (environ 100 €) par mois pour un lit dans un logement appartenant à une famille de Chine du Sud, dans lequel elle dort avec cinq autres personnes, dont deux hommes. Ayant remboursé sa dette au bout de deux ans, elle a arrêté de travailler en tant que nourrice. Misant tout sur l’avenir de son fils, elle se prostitue pour ne plus être exploitée par un employeur, et pour gagner de quoi financer ses études » (206).
La grande vulnérabilité de ces personnes en fait des cibles idéales pour les proxénètes, ainsi que le montre le témoignage de Raïssa, jeune albanaise, qui, mariée de force à un homme violent, décide de quitter son pays : « Un jour, je n’en pouvais plus, je me suis enfuie. […] Là, j’ai rencontré un homme, la trentaine, qui était avec une copine. Un homme normal. Enfin, je le pensais. Il m’a dit qu’à l’Ouest, je pourrais avoir une vie meilleure et un bon travail... À l’arrivée [à Paris], j’ai appelé. J’ai eu une fille qui m’a donné un rendez-vous à la Porte d’Orléans. […] Elle m’a donné des vêtements, des préservatifs et l’après-midi, elle m’a emmenée avec elle à la Porte d’Auteuil. Je n’avais pas un euro, je ne parlais pas un mot de français et je ne connaissais pas Paris. Je ne savais rien. Quand elle m’a dit de l’accompagner, au début, je n’ai pas compris. C’est en arrivant à la Porte d’Auteuil que j’ai compris ce qu’elle faisait. Il y avait une Albanaise et une Russe. Je suis restée sur le trottoir jusqu’à 9 h du soir. Le soir, elle a pris tout mon argent » (207).
M. Lilian Mathieu, sociologue, souligne que certaines migrantes qui se prostitueront sont relativement conscientes de la nature de l’activité qui les attend (208). Elles ne sont pas toutes abusées par de fausses promesses ou contraintes physiquement à se prostituer. Il arrive qu’elles choisissent sciemment cette activité afin de gagner d’importantes sommes d’argent en peu de temps, afin de nourrir un autre projet dans leur pays d’origine, sous-estimant généralement la violence générée par le réseau ou l’activité de prostitution elle-même et la part de revenus qu’elles pourront conserver.
C’est notamment le cas de certaines femmes chinoises qui se prostituent à Paris. Elles migrent puis recourent parfois à la prostitution pour payer les soins médicaux d’un proche ou les études de leur enfant unique (209). L’enquête du Lotus Bus rapporte ainsi l’histoire de Mme Z. : « Âgée de 47 ans, elle vient du Liaoning (Nord Est) et a un fils qui fait des études d’informatique. Il est dans sa dernière année d’université et ses études, en Chine, coûtent 10 000 euros par an. Madame Z. est venue en France et a fait de multiples petits boulots comme la garde d’enfants ou de personnes âgées à domicile. Elle a également une mère malade en Chine qui a besoin de se faire opérer des yeux mais l’opération coûte très cher. […] Tout le peu d’argent qu’elle peut économiser est envoyé à sa famille » (210).
D’après l’étude menée par Mme Suzanne Cagliero et M. Hugues Lagrange sur les femmes prostituées, « les femmes d’Europe de l’Est, dont la moitié n’accepte pas sa condition, ont souvent des projets très précis : acheter une boutique ou un établissement ou plus simplement faire de l’argent pour s’acheter une maison, retourner chez elles et reprendre leur vie « normale ». La prostitution serait juste un passage pour réaliser ce projet. » (211) C’est également ce que montre l’étude de M. Richard Poulin, sociologue et anthropologue : « Les Polonaises, qui quittent leur pays pour l’Eldorado occidental en sachant qu’elles auront à se prostituer, croient pouvoir gagner le maximum d’argent en quelques mois, puis rentrer à la maison » (212).
Les personnes migrantes idéalisent bien souvent la prostitution telle qu’elle a lieu en Europe occidentale. La découverte des véritables conditions d’exercice en France peut alors constituer un choc considérable comme l’explique Mme Vanessa Simoni, dans le cas des personnes prostituées nigérianes exerçant à Paris (213).
2. La prostitution résultant d’une vulnérabilité accrue de certaines catégories sociales
La précarité dans laquelle se trouvent certaines catégories sociales, notamment du fait des lacunes des politiques sociales, constitue la seconde forme de vulnérabilité économique pouvant conduire à la prostitution. Il apparaît que les étudiants et les personnes âgées sont plus particulièrement concernés, même si la précarité économique est la racine commune à de nombreuses formes de prostitution.
a) La prostitution des étudiants : concilier études et conditions de vie décentes
Le manque de moyens financiers est la principale motivation de la prostitution des étudiants. C’est ce que montre Mme Éva Clouet (214) à travers le témoignage de Sandrine, étudiante en situation de prostitution. Cette jeune femme a choisi d’étudier l’architecture dans une grande école. Ses parents n’ayant que peu de moyens financiers du fait d’une situation de chômage prolongée, elle ne souhaite pas dépendre financièrement d’eux, et ce d’autant plus qu’un autre membre de sa famille les sollicite déjà sur le plan financier. Les bourses dont elles bénéficient ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins. Bénéficiaire d’une bourse d’échelon 1, elle touchait 1 200 euros par an seulement. Ainsi, pour assumer ses choix en matière d’éducation – elle aurait pu se contenter d’aller dans une université près de la ville de ses parents – elle se prostitue pour ne pas peser financièrement sur ses parents.
C’est également ce que montre le témoignage anonyme de ce jeune homme : « Aucun étudiant sain d’esprit ne se prostitue par plaisir ; quand on le fait, c’est qu’on est financièrement au pied du mur. On veut de l’argent pour payer le loyer et poursuivre ses études » (215).
Un second facteur intervient cependant pour motiver l’entrée dans la prostitution des étudiants, comme les syndicats étudiants représentés devant la mission (216) en ont fait part à la mission : le temps. Les étudiants financièrement autonomes, qui ne dépendent pas ou peu de leurs parents, doivent étudier tout en gagnant de quoi vivre décemment. Or, les étudiants qui s’y adonnent perçoivent l’activité prostitutionnelle, notamment l’escorting, comme un moyen de consacrer plus de temps à leurs études, ce qu’un emploi étudiant classique, mal rémunéré, ne leur permettrait pas, pensent-ils. La réussite universitaire, qui demeure l’objectif premier, les conduit donc à préférer l’activité de prostitution, qu’ils considèrent moins chronophage, à un emploi de garde d’enfant ou de caissier. Le sentiment d’une flexibilité accrue et d’une plus grande compatibilité de cette activité avec un emploi du temps étudiant est un des éléments du choix fait par certains.
Ainsi, comme le résume Mme Éva Clouet, « la prostitution permet aux étudiantes escortes qui ressemblent à Sandrine de poursuivre leurs études dans des conditions matérielles favorables – les besoins quotidiens tels que le loyer ou la nourriture sont assurés – tout en leur laissant suffisamment de temps pour travailler leurs cours et espérer réussir leur année universitaire » (217).
b) La prostitution de personnes âgées : le cumul d’une vulnérabilité financière et sociale
« Peut-on imaginer sa grand-mère dans de telles conditions ? Est-ce humain ? Est-ce normal dans un pays comme la France ? », s’est indignée Mme Gabrielle Partenza (218), présidente de l’association Avec Nos Aînées, lors de son audition.
De fait, la prostitution des personnes âgées, au sujet de laquelle nous ne disposons que de peu d’éléments, semble signer l’échec des politiques sociales à l’égard de cette catégorie de la population. Il a en effet été rapporté à la mission d’information que certaines personnes prostituées seraient âgées de plus de 80 ans. Mme Gabrielle Partenza (219) en a d’ores et en a déjà dénombré environ deux cents, âgées de 65 ans à 80 ans, au cours d’une étude menée sur le sujet, mais elle estime qu’elles sont bien plus nombreuses encore.
La majorité d’entre elles ne sont pas entrées dans la prostitution à cet âge. Cependant, certains facteurs peuvent les pousser à s’y maintenir ou à y revenir après une période d’interruption.
La cause principale de l’entrée dans la prostitution de femmes d’un certain âge ou de continuation et de reprise de cette activité, est à rechercher dans la faiblesse des pensions de retraite dont elles bénéficient. Mme Gabrielle Partenza a ainsi indiqué que beaucoup d’entre elles touchaient une retraite d’un peu plus de 60 euros par mois. Mal informées de leurs droits à la retraite, ces femmes cumulent en réalité plusieurs handicaps. Abandonnées par leurs proches et leurs conjoints, elles recourent à la prostitution de rue pour survivre.
Parmi ces femmes, certaines sont entrées dans la prostitution à un âge mûr ; pour d’autres, elles ont été contraintes de reprendre cette activité après un échec financier. Certaines personnes prostituées avaient en effet cessé cette activité pour monter une petite entreprise commerciale. Mais un redressement fiscal ou social les a conduites à retourner dans la rue. Dans d’autres cas, le conjoint, parfois tout juste sorti de prison, leur a volé leurs économies (220). Les situations d’endettement sont également nombreuses parmi les personnes prostituées âgées et le marché de l’emploi, fermé aux seniors, ne leur permet pas d’y faire face (221).
Enfin, certaines personnes prostituées, n’étant pas parvenues à réaliser des économies substantielles au cours de leur activité, ne parviennent pas à financer leur retraite et doivent donc continuer leur activité. Comme le dit cette femme âgée de 68 ans, « tu sais, à un moment, faut savoir arrêter. Mais ce n’est pas facile, il faut pouvoir le faire. Il faut avoir des sous de côté sinon comment tu veux faire, on a droit à rien alors qu’on a bossé toute notre vie, qu’on a payé des impôts, et des amendes par centaines… Regarde-moi, j’ai 68 ans et je suis toujours là. » (222)
L’âge de ces femmes n’est pas sans conséquence sur leur santé et sur la façon dont elles exercent leur activité prostitutionnelle. Ayant déjà « un pied dans la tombe » (223), comme le dit l’une d’entre elles, elles acceptent sans peine des rapports non protégés. De fait, Mme Gabrielle Partenza souligne qu’il est difficile de leur faire utiliser des préservatifs (224). Les personnes prostituées de plus de 60 ans sont aussi plus sensibles aux rudes conditions d’exercice de la prostitution de rue : trois cas de tuberculose ont été détectés en 2010 (225). Comme le relève le compte rendu d’une recherche-action récemment conduite par l’association des Amis du bus des femmes : « Certaines d’entre elles se voient contraintes de maintenir leur activité malgré un état de santé défavorable. Les problèmes de santé dus au vieillissement du corps (douleurs articulaires, problèmes cardiovasculaires, tension…) mais également à des conditions difficiles d’exercice d’une activité pendant plusieurs années (froid, position debout, travail de nuit, stress…) se font ressentir sur leurs corps. » (226)
3. Toxicomanie et prostitution : un cercle vicieux
D’après l’enquête menée par l’Amicale du Nid de Paris en 2010 auprès des 508 personnes qu’elle accompagne, il est apparu que 88 d’entre elles consommaient des drogues dures, soit 17 % (227).
Drogue et prostitution entretiennent des « relations complexes », comme le soulignait une étude parue en 2000 (228). Un certain nombre de personnes prostituées deviennent en effet consommatrices de drogues pour « tenir » dans un univers particulièrement violent (229). D’autres, au contraire, entrent dans la prostitution du fait de leur toxicomanie, cette activité étant le moyen le plus rapide de gagner suffisamment d’argent pour se procurer de la drogue. Il s’agit en général de personnes jeunes voire de mineurs (230). Leur proxénète est alors fréquemment leur fournisseur de produits stupéfiants, ce qui les maintient dans le système prostitutionnel.
Les toxicomanes qui se prostituent connaissent des conditions de vie et d’activité encore plus dures que les autres personnes prostituées, dans la mesure où il leur est absolument nécessaire de se procurer l’argent pour acheter leur dose quotidienne de drogue. En conséquence, elles sont accusées de faire baisser les tarifs, de « casser le marché », d’accepter des relations non protégées et de ne pas respecter les us et coutumes de la prostitution. Elles sont « très critiquées par les personnes prostituées dites traditionnelles, notamment pour leur manque d’éthique « professionnelle » (tentative de vol sur les clients par exemple) », a expliqué Mme Françoise Gil, sociologue (231).
Les personnes prostituées usagères de drogues servent alors de « repoussoir » pour les autres personnes prostituées. C’est ce que montre Mme Stéphanie Pryen, chercheuse à l’Institut fédératif de recherche sur les économies et sociétés industrielles : « les anciennes prostituées tentent, en fait, de revaloriser une pratique illégitime et déviante, mais participent au maintien de l’ordre social ; pour cela, elles mobilisent un autre stigmate, la toxicomanie, encore moins légitime. Ainsi tentent-elles d’améliorer leur position sociale au détriment des usagères de drogues » (232).
C. LA VULNÉRABILITÉ PSYCHOLOGIQUE
La vulnérabilité psychologique apparaît tout à la fois comme un facteur fragilisant, lorsqu’elle favorise le passage à l’acte de personnes prostituées ayant subi des violences, notamment sexuelles, durant l’enfance, mais également comme un facteur déclenchant, quand l’entrée dans la prostitution est directement liée à l’emprise psychologique d’un proche.
1. Les violences subies durant l’enfance comme facteur fragilisant
Les violences subies par les personnes prostituées durant leur enfance peuvent constituer un facteur fragilisant, expliquant pour partie leur entrée ultérieure dans la prostitution. Les seules études disponibles à ce sujet sont internationales. L’étude de Mme Melissa Farley (233) montre qu’une part importante des personnes prostituées interrogées ont été soumises, durant l’enfance, à des violences physiques et sexuelles. Ainsi, en Allemagne, 48 % des personnes prostituées interrogées ont été battues par des parents ou abusées sexuellement étant enfant.
C’est également le constat que fait M. Laurent Mélito, sociologue, à propos des escortes indépendantes : « S’il y a des références communes dans les propos de certaines escortes […] elles concernent le registre des violences vécues en amont : viols, inceste, maltraitance physique et psychologique » (234).
C’est ce dont témoigne aussi une escorte : « On ne tombe pas par hasard dans le monde à part des escortes. Nous partageons toutes une histoire presque semblable. Notre parcours révèle un ratage, une défaillance dans notre passé de petites filles dont on n’a pas respecté le corps. On saute le pas parce qu’on a souffert dans son enfance. Je suis suivie par un psy depuis l’âge de 13 ans. Battue par mon père, écartelée entre des parents qui se déchirent, victime d’inceste, j’ai été mise dehors par ma mère le jour de mes 18 ans. J’ai trouvé mes affaires dans deux sacs poubelles. Je n’avais ni logement ni argent ; juste un petit copain violent. » (235)
Si le fait d’avoir vécu des violences sexuelles durant l’enfance ne conduit pas nécessairement à la prostitution, il est clair que ces violences, conditionnant l’image que peuvent avoir les victimes d’elles-mêmes, facilitent le passage à l’acte prostitutionnel. Mme Muriel Salmona (236), psychiatre traumatologue, souligne que les personnes qui ont été sexuellement abusées pendant l’enfance sont de fait davantage susceptibles de subir de nouveau des violences sexuelles.
En particulier, la dégradation de l’image de soi provoquée par ces violences sexuelles peut laisser penser aux personnes prostituées que la prostitution est la seule activité qu’elles soient susceptibles d’exercer. Mme Muriel Salmona a ainsi fait part à la mission d’information du témoignage d’une jeune femme, qui entendait entrer dans la prostitution : « De toute façon, aussitôt qu’un homme me regarde, je ne suis qu’une pute » (237). C’est en effet le discours qu’elle avait entendu durant toute son enfance et son adolescence, et c’est de cette façon qu’elle avait été utilisée par des personnes de son entourage. Mme Muriel Salmona note par ailleurs que l’argument selon lequel « je ne suis bonne qu’à ça » est le leitmotiv des personnes en situation prostitutionnelle qu’elle reçoit en entretien à l’antenne des Hauts-de-Seine de l’Institut de victimologie.
Il s’agit donc d’une corrélation forte mais qui n’implique nullement que toutes les personnes prostituées aient été victimes de violences, notamment sexuelles, avant d’exercer cette activité.
2. L’emprise psychologique d’un proche comme facteur déclenchant
La dernière grande source de vulnérabilité pouvant conduire à la prostitution est d’ordre psychologique et sentimentale. Elle résulte de l’emprise psychologique prise par un proche, le plus souvent l’ami ou le conjoint, sur une personne d’autant plus vulnérable qu’elle est attachée à celui qui deviendra son proxénète.
La mise en situation de prostitution par un conjoint sans scrupule et manipulateur, jadis connu sous la figure du « julot casse-croûte », est plus fréquente qu’il n’y paraît. Pour Mme Claudine Legardinier, cette situation s’intègre parfaitement dans la catégorie des violences faites aux femmes (238). Ces femmes pensent avoir choisi leur activité et n’identifient pas leur compagnon à un proxénète, du fait de la manipulation subie.
Anaïs est devenue « masseuse » sous l’influence directe de son compagnon : « Il a commencé à me dire qu’il n’avait plus d’argent et à me parler de son ex, qui était masseuse. Il m’a mis dans le cerveau l’idée que notre fils allait manquer de tout ; que je n’aurais rien pour l’habiller, que nous n’aurions pas de belle voiture. Petit à petit, la prostitution, j’ai trouvé ça presque normal. Pour mon fils. Maintenant je comprends comment il a fait. Je comprends les femmes battues. Et je vois comment notre fils a été pour lui une monnaie d’échange. En fait, j’étais encerclée » (239).
C’est ce qui ressort également de l’étude de Mme Suzanne Cagliero et de M. Hugues Lagrange sur l’usage de drogues dans le milieu prostitutionnel féminin. Ils rapportent le parcours d’une jeune femme belge : « Elle a quitté l’école et est arrivée en Belgique à dix-sept ans, il y a environ quatre ans, avec son fiancé. Ce garçon lui a demandé de se prostituer et cette situation a duré tant qu’ils sont restés en Belgique et ensuite en France où elle a été expulsée. Il s’est arrangé pour la faire retourner à Paris et à la prostitution jusqu’au jour où elle a réussi à se séparer de lui. Elle raconte cette histoire avec beaucoup de force émotive et de rage contre son ex-fiancé » (240).
Par ailleurs, la mission de Médecins du Monde en Bulgarie (241) constate que c’est souvent le conjoint masculin qui pousse la jeune femme à se prostituer en Europe occidentale, afin que le ménage puisse récolter suffisamment d’argent pour se marier, à son retour.
Mme Claudine Legardinier et M. Saïd Bouamama décrivent ainsi ces conjoints manipulateurs et les armes psychologiques dont ils usent : « Des hommes souvent, mais aussi des femmes, passé(e)s maîtres dans l’art de jouer sur les cordes sensibles : demande affective, besoin de reconnaissance et valorisation […] Les gestes « amoureux », la générosité (temporaire), la banalisation savante de la prostitution, l’introduction dans un milieu présenté comme « glamour » sont, de la part de ces compagnons empressés, des armes efficaces. Quand ce n’est pas la violence physique » (242). Le cas de Lisina, jeune femme albanaise rencontrée par la mission, qui avait décidé de migrer en Italie avec son ex-fiancé et qui y a été contrainte de se prostituer, est emblématique de ce mélange de suggestion, d’emprise psychologique et de contrainte physique (243).
Les proxénètes semblent également tirer profit des failles psychologiques de certaines personnes, principalement des femmes, pour assurer la prospérité de leur activité criminelle. Les jeunes filles de l’Est en particulier, quand elles ne font pas l’objet de rapts purs et simples, sont parfois manipulées par un proxénète, dont elles sont tombées amoureuses, qui les met ensuite en situation de prostitution (244). C’est ce que raconte Adriana, jeune albanaise : « Je l’avais rencontré dans les jardins de l’école, il disait qu’il avait 25 ans, qu’il vivait grâce à ses parents qui avaient un magasin. Il m’a donné un nom mais je ne sais pas s’il était vrai. Il m’a fait faire un passeport. Comme je n’avais que 16 ans, il a fait mettre comme date de naissance 1977 au lieu de 1981. Je le connaissais depuis quatre mois quand nous avons pris le bateau. […] Avec lui, j’étais bien parce que j’étais amoureuse, mais je n’étais pas tranquille d’avoir quitté mes parents. À Paris, on a pris une chambre d’hôtel. Il avait toujours été gentil, je lui faisais confiance. Et puis, alors qu’on se baladait dans Paris, il m’a montré une fille sur un boulevard, près du Parc Monceau ; une jeune Africaine. Il m’a dit : « tu vas faire comme elle ». Je n’ai pas compris […] Il m’a raconté qu’on achèterait une belle maison, qu’on aurait des enfants » (245).
Un phénomène de même nature s’est récemment développé aux Pays-Bas (246). De jeunes souteneurs, appelés « lover boys », séduisent des jeunes femmes fragiles, par le biais de cadeaux onéreux et de marques d’affection, dans le but de les pousser à se prostituer, ce qu’elles accepteront de faire par amour. Ils agissent le plus souvent par le biais d’Internet et peuvent pousser plusieurs jeunes filles à se prostituer simultanément.
V. – DES CONDITIONS DE VIE ET D’EXERCICE QUI PORTENT LE PLUS SOUVENT ATTEINTE À LA SANTÉ DES PERSONNES PROSTITUÉES
Des cinq personnes prostituées que la mission a rencontrées lors de son déplacement à l’Amicale du Nid de Paris, seule une a pu exposer son récit de vie sans fondre en larmes. Toutes consultent régulièrement un psychologue ou un psychiatre et souffrent d’insomnie chronique. L’une d’entre elles, Kevin, voit fréquemment en rêve la figure de ses anciens clients. Pourtant, deux seulement ont été, à proprement parler, victimes de traite ou d’exploitation sexuelle.
La violence de l’univers prostitutionnel, sur laquelle toutes les associations s’accordent, laisse donc des empreintes durables sur le corps et l’esprit de ceux et celles qui ont été confrontés à cette réalité.
A. UNE ACTIVITÉ QUI FAIT COURIR DES RISQUES MAJEURS POUR LA SANTÉ DES PERSONNES QUI LA PRATIQUENT
Si le risque de contamination par des infections sexuelles transmissibles retient particulièrement l’attention des personnes prostituées, leur corps est exposé à de multiples autres formes d’agressions.
1. Le risque de contamination par les infections sexuellement transmissibles
L’activité prostitutionnelle expose les personnes qui l’exercent à de multiples infections sexuellement transmissibles (IST), comme l’a indiqué M. Pierre Micheletti, délégué régional de Médecins du monde : blennorragie gonococcique, herpès, chlamydiose, hépatites B et C, papillomavirus, syphilis et virus de l’immunodéficience humaine (VIH) pour les plus fréquentes (247).
Toutefois, l’évaluation, dans ce domaine, fait cruellement défaut depuis les années 1990. En ce qui concerne la prévalence du VIH et des hépatites B et C chez les personnes prostituées en France, il n’existe aucune donnée récente. À la fin des années 1990, les personnes prostituées toxicomanes et homosexuelles présentaient d’importants taux de prévalence en matière de VIH, de l’ordre de 25 % à 30 % (248). Concernant les personnes prostituées non homosexuelles et non toxicomanes, il était admis que seules 2 % étaient atteintes par le VIH.
Toutefois, depuis cette époque, la prostitution a changé de visage, avec l’augmentation du nombre de personnes prostituées étrangères. Certains pays d’origine, comme la Chine, le Nigeria ou le Ghana, sont très touchés par l’épidémie de VIH. On peut dès lors penser que les personnes prostituées originaires de ces pays connaissent le même taux de prévalence que le reste de leur population d’origine. De fait, pour les femmes chinoises se livrant à la prostitution, le Lotus Bus indique que les taux de prévalence sont équivalents à ceux de la population chinoise dans son ensemble, ce qui pourrait donc avoir un impact sur le taux de prévalence général (249).
Les risques de contamination augmentent avec le nombre de partenaires sexuels, si les rapports ne sont pas protégés. Or, l’utilisation du préservatif par les personnes prostituées semble difficilement quantifiable. Pour la prostitution masculine, 68,5 % des hommes et 80 % des personnes transgenres déclarent utiliser un préservatif de façon systématique (250). Pour les femmes, ce taux atteindrait 100 % pour les rapports pénétratifs. Toutefois, il est possible qu’un biais existe dans les déclarations faites par les personnes prostituées, le fait de ne pas utiliser de préservatif ne correspondant pas au schéma social et moral dominant : « des taux d’usages des préservatifs de 100 % concernant la pénétration sont évidemment une forme de présentation de soi guidée par la désirabilité sociale » (251).
Il semble en effet, d’après les auditions effectuées par la mission, que de nombreux clients exigent, et obtiennent des rapports sexuels non protégés. D’après le rapport du Conseil national du sida (252), entre 10 % et 50 % des clients demanderaient des rapports non protégés. Certains clients tenteraient même d’enlever le préservatif au cours de l’acte sexuel (253).
Ces demandes se seraient par ailleurs accrues depuis le début des années 2000, et elles seraient aujourd’hui régulièrement acceptées par les personnes prostituées. Plusieurs facteurs, d’après le Conseil national du sida, expliquent cette prise de risque : « la dépendance financière des personnes prostituées, [les] habitudes prises avec des clients réguliers, [le] regain de concurrence consécutif à l’accroissement de l’offre prostitutionnelle, [le] relâchement global des pratiques de prévention en particulier chez les clients et [l’] accroissement des pratiques à risque, particulièrement sur Internet » (254).
En effet, il apparaît que l’absence de préservatif est un argument mis en avant par certaines personnes prostituées, pour obtenir davantage de clients ou d’argent. Par ailleurs, les personnes prostituées en situation précaire, étrangères ou exerçant dans la rue, seraient davantage susceptibles de ne pas faire usage du préservatif sur demande de leur client. En outre, certains actes sexuels, comme la fellation, sont souvent réalisés sans protection, alors même qu’ils sont susceptibles de conduire à une contamination par le VIH et les hépatites B et C.
Les tests de dépistage sont utilisés de façon variable par les personnes prostituées. Entre 60 % et 70 % des femmes prostituées étrangères, hors pays du Maghreb, déclarent avoir effectué un test de dépistage du VIH dans les trois derniers mois (255). Les femmes plus expérimentées déclarent ne faire le test de dépistage du VIH qu’une fois par an. Les campagnes de prévention menées dans les années 1990 et l’ouverture de centres de dépistage anonyme et gratuit semblent toutefois avoir fortement encouragé la pratique du dépistage.
Il est à noter que 10 % des femmes ne connaissent pas leur statut sérologique, contre 18 % chez les hommes non transgenres (256). Concernant les hépatites, les taux sont plus importants, notamment chez les hommes, où il atteint 27 %. En outre, pour certaines populations, le dépistage n’est pas suffisamment fréquent. Ainsi, seules 54 % des femmes chinoises qui se prostituent ont fait un test de dépistage du VIH (257).
En dépit de ces observations, aucune étude ne fait état de résultats alarmants. La campagne de dépistage du Lotus Bus, menée en décembre 2008, ne fait apparaître aucun cas de VIH, ni d’hépatite C, parmi les 46 femmes chinoises testées. Seulement, trois femmes chinoises sont porteuses de l’hépatite B. Par ailleurs, les études menées en 2003 par l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (258) révèlent qu’au sein de l’échantillon, seules 3 femmes sur 173 sont séropositives, contre 7 hommes sur les 252 interrogés. En outre, les taux d’infection par les hépatites B et C sont d’environ 1 % chez les hommes prostitués. Seules 6 femmes sur les 173 interrogées sont infectées par l’hépatite B ou C. La plus forte occurrence des infections hépatiques s’explique en partie par la sous-estimation de la gravité de ces pathologies par les personnes prostituées (259).
Toutefois, les personnes prostituées constituent une population particulièrement vulnérable à la contamination par le VIH, puisqu’elles cumulent certains facteurs de risque déterminés par l’ONUSIDA en 2003 (260) : stigmatisation sociale, faibles perspectives économiques, pouvoir de négociation limité, manque d’accès aux services sanitaires, sociaux et juridiques, fréquences des violences subies. Ces facteurs sont également applicables à la contamination par les hépatites B et C. En outre, la banalisation notable et déplorable du problème du VIH, du fait du développement de la trithérapie, pourrait conduire les personnes prostituées, ainsi que les clients, à limiter le recours au préservatif.
Les facteurs de risque sont en outre largement accrus pour les personnes prostituées de nationalité étrangère, qui ne maîtrisent généralement pas le français et connaissent les conditions de vie les plus dures. C’est ce qui ressort du rapport du Conseil national du sida. Les personnes prostituées étrangères, disposent en général d’un « niveau de connaissances préalables sur les VIH et les IST limité » (261). Certaines croyances circulent ainsi parmi les personnes prostituées étrangères : les baisers, le partage de couverts, les piqûres de moustique ou encore l’usage du préservatif seraient responsables de la propagation du virus du sida (262). En outre, les femmes originaires d’Afrique utilisent certaines techniques intra-vaginales, comme les douches vaginales ou l’usage de produits détergents ou de tissus, qui accroissent considérablement l’exposition aux risques d’infection (263).
Les personnes prostituées sont également exposées aux autres infections sexuellement transmissibles. Lors du dépistage organisé par le Lotus Bus en 2008, un cas de syphilis et un cas de chlamydia ont été repérés parmi les femmes qui s’y sont prêtées (264). Par ailleurs, une étude menée par une association française, en 2004, auprès de 80 femmes prostituées, aurait mis en évidence douze cas d’infections par papillomavirus humain (HPV) et trois cas de cancers du col de l’utérus. L’âge moyen des personnes atteintes de lésions cancéreuses serait de 21 ans (265). Ces infections sont d’autant plus problématiques qu’elles fragilisent les muqueuses et augmentent ainsi considérablement le risque de contamination par le VIH.
L’étude Prosanté 2010, lancée par l’Institut de veille sanitaire et consacrée à l’état de santé des personnes prostituées, dont les résultats sont prévus pour le courant de l’année 2011, devrait remédier au manque d’informations concernant la santé des personnes prostituées et poser les bases d’une politique de santé plus ambitieuse.
2. Un état de santé globalement détérioré
L’activité prostitutionnelle peut exposer les personnes prostituées à des problèmes gynécologiques divers. Les études internationales confirment ce diagnostic. D’après l’étude de Mme Melissa Farley (266), les femmes en situation de prostitution connaissent fréquemment des infections urinaires, des problèmes de fertilité, des troubles de leur cycle menstruel, des douleurs ovariennes. Les problèmes gynécologiques des femmes prostituées, directement liés à leur activité, sont ainsi courants. « À l’époque, des hommes me tripotaient continuellement, j’avais beaucoup de problèmes gynécologiques, c’était vraiment horrible. On ne parle pas du tout de cet aspect des choses », confie une ancienne hôtesse de bar américain (267).
Pourtant, le suivi gynécologique des personnes prostituées fait défaut, en particulier pour celles qui sont de nationalité étrangère. Par exemple, 46 % des femmes chinoises (268) qui se prostituent à Paris ne sont pas suivies sur le plan gynécologique. Les difficultés d’accès aux soins, liées à leur statut administratif précaire et à la barrière de la langue, expliquent en partie cette absence de suivi.
Les conditions de vie et d’exercice des personnes prostituées peuvent également être à l’origine d’une santé fragile. Dans le cas de la prostitution de rue, les infections pulmonaires sont fréquentes en hiver, les personnes demeurant sur la voie publique. C’est ainsi que trois cas de tuberculoses ont été diagnostiqués sur des femmes âgées qui se prostituaient à Paris l’an dernier (269). L’hygiène permise par la pratique prostitutionnelle en camionnette est, par ailleurs, loin d’être satisfaisante.
Les conditions de logement, souvent précaires, accentuent également la propagation des infections et affectent les capacités de guérison. Le rapport du Gouvernement sur la situation des personnes prostituées montre que dans un département de l’Est, 50 % des personnes prostituées ne disposent pas d’un hébergement personnel et que 20 % d’entre elles résident à l’hôtel ou dans la rue (270). Ainsi, lorsqu’elles partagent une chambre avec d’autres personnes prostituées, non seulement la transmission des maladies contagieuses est favorisée, mais il leur est plus difficile de se reposer et de guérir parfaitement.
Enfin, l’activité prostitutionnelle engendre, chez de nombreuses personnes prostituées, des plaintes somatiques récurrentes (271) : maux de tête, problèmes dermatologiques, douleurs abdominales… Ainsi, à propos des femmes chinoises se prostituant à Paris, le Lotus Bus note qu’« il n’est pas rare qu’elles montrent des signes de lassitude ou d’angoisse liés à des conditions de vie difficile dans un climat d’insécurité » (272). En outre, Mme Claudine Legardinier et M. Saïd Bouamama livrent, dans leur enquête, le témoignage de Muriel, ancienne prostituée : « Je me souviens qu’en voyant approcher l’heure, j’avais mal au ventre, mal à la tête » (273).
De la même façon, les problèmes dermatologiques, souvent liés à des situations d’angoisse ou de stress, peuvent apparaître, comme dans le cas d’une jeune femme entendue par la mission d’information : « Un jour, un client n’a pas arrêté de m’insulter et la caissière m’a demandé de m’en occuper, car la fille qui devait le faire ne voulait plus. Sur le coup, je n’étais pas d’accord, dans la mesure où il m’avait insultée pendant toute la soirée, mais la caissière m’a convaincue et j’y suis allée. Le lendemain ou le surlendemain, mon corps a commencé à se couvrir d’eczéma » (274).
L’activité prostitutionnelle engendre donc certaines pathologies spécifiques qui contribuent à détériorer la santé physique des personnes qui l’exercent, celles-ci recourant insuffisamment aux services médicaux et de dépistage, eu égard à la stigmatisation sociale ou à la répression qui pèsent sur elles.
B. UN UNIVERS MARQUÉ PAR DES VIOLENCES D’UNE PARTICULIÈRE GRAVITÉ
La détérioration parfois rapide de l’état de santé des personnes prostituées n’est pas uniquement le fruit de leurs conditions de vie et de travail. Elle est également le résultat de l’isolement dans lequel elles se trouvent et des violences particulièrement graves qui sont leur lot quotidien.
1. La stigmatisation et l’isolement des personnes prostituées
L’isolement constitue un facteur de vulnérabilité particulièrement important, qui se double d’une forte stigmatisation sociale.
a) Une stigmatisation particulièrement forte
Mépris, agressivité, manque de respect, insultes, humiliations sont le lot quotidien des personnes prostituées de rue, dont l’activité est la plus visible. C’est ce qui ressort du journal des répressions et des violences tenu par l’association de santé communautaire Cabiria (275), qui énumère les actes de violence subis par les personnes prostituées lyonnaises : « Une femme bulgare travaillant dans le quartier de Perrache nous fait part des insultes, jets de cannette, crachats qu’elle subit quotidiennement de la part des passants » ou encore « deux femmes travaillant en camionnette dans le quartier de la Halle Tony Garnier se font filmer, contre leur volonté, par des jeunes venus voir un concert ».
On peut également y lire que « d’autres femmes nous signalent qu’elles sont également la cible de projectiles, parfois lancés par des femmes, depuis leur fenêtre ou leur balcon. Parmi les projectiles, il arrive fréquemment qu’il y ait des sandwichs ». Le jet de détritus sur les personnes prostituées est particulièrement révélateur de la position sociale que les passants et riverains leur assignent.
L’enquête Droits et Violences de la mission de Médecins du Monde auprès des personnes se prostituant à Nantes, réalisée en 2009 et 2010, montre également que les personnes prostituées sont parfois agressées physiquement par les passants. Si ces manifestations d’hostilité sont vécues douloureusement par les personnes prostituées, la commisération dont certains font preuve à leur égard, en leur donnant quelques billets pour qu’elles cessent leur activité, l’est tout autant.
Les personnes prostituées feraient également l’objet d’humiliations de la part des forces de l’ordre. L’enquête Droits et violence de Médecins du Monde (276) souligne que plusieurs des personnes interrogées rapportent des moqueries, des insultes voire du voyeurisme de la part de certains policiers. C’est également le sens du témoignage d’Alicia, « masseuse » qui a été escroquée par un client : « Pour mon histoire d’escroc, je suis allée à la police. J’ai dit que je faisais des massages. Ils m’ont humiliée, ils n’ont fait aucune différence avec une prostituée. Pour la chambre de commerce, on est masseuse indépendante et pour la police on est une pute. J’ai horreur de ce mot, pute. C’est terrible, ce qu’il est lourd à porter… » (277)
C’est aussi ce que semble indiquer le journal des répressions et des violences (278) de l’association Cabiria. La fréquence des enlèvements de camionnettes et des contrôles policiers est comprise comme une forme de harcèlement par les personnes prostituées : « Une femme travaillant à pied dans le quartier de Perrache est contrôlée par la police sept fois dans la même journée ». Ce journal montre également les abus de pouvoir dont certains policiers peu scrupuleux se rendraient coupables : « au matin, une femme est interpellée par la police en quittant sa place de travail. Elle est conduite en garde à vue, fouillée, interrogée. Un défaut de clignotant et un délit de fuite lui sont reprochés. Elle sort de garde à vue vers 14 heures, sans amende, sans poursuite et sans aucun document établissant les raisons de son interpellation ». Le journal fait également état des fausses alertes d’enlèvement de véhicule envoyées par la police aux personnes prostituées : « La police prévient les femmes du quartier de Gerland que la fourrière arrive. Quelques femmes choisissent de rester et constatent que la fourrière n’arrive pas. Selon elles, ce genre d’alertes policières est fréquent ».
La stigmatisation sociale qui pèse sur les personnes prostituées est ainsi à l’origine d’une grande souffrance morale. Mme Muriel Salmona, psychiatre traumatologue, décrit ainsi leur état psychologique : « Elles crèvent, littéralement, d’être enfermées dans un no man’s land, de devoir se taire à cause de la honte et de la culpabilité » (279).
b) Un isolement familial fréquent
Le stigmate social que les personnes prostituées portent, du fait de leur activité, tend également à les isoler fortement de leur entourage familial. Elles cachent leur activité à leurs enfants et leur conjoint. Elles ont fréquemment une « double vie », leurs proches n’étant pas au courant de leur activité. Un témoignage recueilli par la mission d’information va dans ce sens : « Moi, ça fait cinq ans que je le fais, mes enfants ne sont pas au courant, personne n’est au courant ».
Pour Judith Trinquart, médecin, plus de 50 % des personnes prostituées sont isolées sur le plan familial. Elles ont rompu tout contact avec leurs proches pour cacher leur activité prostitutionnelle (280). Certaines ont dû confier leurs enfants à leur mère ou à leur grand-mère, afin qu’ils n’apprennent pas la nature réelle de leur activité et surtout, par peur qu’ils ne leur soient enlevés par les services sociaux. La séparation d’avec l’enfant, notamment pour les personnes de nationalité étrangère, est particulièrement dure à supporter, le retour au pays étant impossible du fait des représailles auxquelles elles s’exposeraient.
Les personnes prostituées étrangères, éloignées de leurs familles, sont particulièrement isolées. C’est notamment le cas des femmes chinoises (281), qui taisent leur activité, perçue comme particulièrement honteuse en Chine. C’est également ce que rapporte Adriana, Albanaise prostituée de force en France : « J’appelais mes parents, je leur mentais ; je m’étais inventé une vie normale à leur raconter, je disais que je vivais avec une copine. Ils étaient très inquiets et me demandaient de rentrer. Pour moi, c’était dur, d’autant que ma mère a été hospitalisée. En tout cas je n’ai jamais dit que j’étais avec cet homme. J’avais trop honte. » (282)
Les personnes prostituées peuvent également être abandonnées par leur entourage, dès lors qu’elles ne sont plus à même de rapporter suffisamment d’argent, comme le montre Mme Gabrielle Partenza, présidente de l’association Avec nos Aînées, qui vient en aide aux personnes prostituées âgées : « la pire des maladies pour ces femmes est la solitude […] Ces femmes ont des enfants qu’elles ne voient plus. Quand elles n’ont plus été capables de ramener de l’argent, on les a laissées tomber » (283).
Il est également difficile pour les personnes prostituées d’entretenir une relation amoureuse réelle ou une vie de couple. L’enquête Droits et Violences de Médecins du monde relève que « la plupart des hommes qu’elles rencontrent refusent de poursuivre la relation lorsqu’ils connaissent la nature de leur travail » (284). Lorsqu’elles ont effectivement une vie amoureuse, les personnes prostituées vivent dans la peur perpétuelle que leur activité soit découverte, angoisse que certaines conservent après l’arrêt de cette activité. Lisina, jeune Albanaise contrainte de se prostituer, a ainsi tout fait, sans succès, pour que sa famille restée en Albanie ne découvre pas qu’elle s’était prostituée, sous la contrainte (285).
2. Une violence inhérente au milieu prostitutionnel
Les personnes prostituées sont victimes de violences considérables, émanant notamment des clients, des proxénètes, des autres personnes prostituées et des passants.
a) Des violences très fréquentes et d’une extrême gravité
Une étude internationale menée dans neuf pays par Mme Melissa Farley (286), chercheuse américaine en psychologie clinique, montre que les personnes prostituées subissent d’importantes violences dans l’exercice de leur activité : viols récurrents, vols, menaces d’une arme, agressions physiques…
Si l’on peut déplorer qu’une telle étude n’ait pas été conduite en France, les chiffres du Canada, des États-Unis et de l’Allemagne fournissent un éclairage intéressant sur la prostitution dans les pays occidentaux. D’après cette étude, entre 52 % et 78 % des personnes prostituées interrogées ont déjà été menacées avec une arme. 61 % à 91% d’entre elles ont été physiquement agressées. De 63 % à 76 % ont déjà été violées dans l’exercice de leur activité, et ceci plus de cinq fois pour la plupart d’entre elles.
VIOLENCES SUBIES DANS LE CADRE DE L’ACTIVITÉ PROSTITUTIONNELLE
Canada |
États-Unis |
Allemagne | |
Menace d’une arme |
67 % |
78 % |
52 % |
Agression physique |
91 % |
82 % |
61 % |
Viols |
76 % |
73 % |
63 % |
dont plus de 5 viols |
67 % |
59 % |
50 % |
Source: Melissa Farley et al., “Prostitution and trafficking in nine countries: an update on violence and post traumatic stress disorder”, 2003.
C’est également ce qui ressort de l’enquête Droits et Violences (287) menée par Médecins du Monde à Nantes. Toutes les personnes prostituées interrogées déclarent avoir été insultées ou menacées. Les vols d’argent ou de biens de la part des clients sont également courants. Des agressions sérieuses sont aussi rapportées : coups, tentatives d’étranglement, violences avec armes. Quelques-unes disent avoir été violées au cours de l’exercice de leur activité. Mme Gabrielle Partenza (288) souligne ainsi les attaques et les viols subis par les personnes prostituées âgées au bord des routes où elles racolent.
De fait, les personnes prostituées ont plus de risques d’être agressées et assassinées que le reste de la population. Mme Maria Carlshamre, rapporteure d’un projet de rapport sur la prostitution et ses conséquences sur la santé des femmes dans les États membres de l’Union européenne (289), fait ainsi référence à une étude canadienne qui établit que les personnes prostituées ont entre 60 et 120 fois plus de risques d'être battues ou assassinées que le reste de la population. Une étude américaine (290), publiée par l’American Journal of Epidemiology, identifie d’ailleurs la violence et la toxicomanie comme étant les deux principales causes de la mort des personnes prostituées.
b) La violence émane, à titre principal, des clients des personnes prostituées
Le journal des répressions et des violences (291) tenu par l’association Cabiria pointe, à diverses reprises, la violence émanant des clients : vols, parfois avec armes (arme blanche, pistolet à billes, arme à feu), enlèvement et séquestration, viols apparaissent relativement fréquents. En témoignent ces extraits : « Une femme choisit de stopper une passe qu’elle considère trop longue. L’homme s’énerve et exige la totalité de la recette de la soirée » ; « un client habituel d’une femme bulgare lui tire dans la jambe avec un pistolet à billes en prétextant qu’elle l’a trompé » ; « une femme se fait séquestrer dans son camion par un client » ; « une femme bulgare travaillant à Perrache monte dans le véhicule d’un client. Il l’emmène dans un endroit non convenu et la viole, la frappe, la vole ».
AGRESSIONS RECENSÉES PAR LE JOURNAL DES RÉPRESSIONS ET DES VIOLENCES DE L’ASSOCIATION CABIRIA EN 2009
Clients |
Passants |
Compagnon ou conjoint |
Forces de l’ordre | |
Remarques humiliantes, insultes |
2 |
6 |
– |
2 |
Menaces diverses |
6 |
2 |
– |
4 |
Détériorations volontaires des camionnettes |
1 |
10 |
– |
– |
Agressions physiques |
22 |
15 |
– | |
Agressions physiques avec usage d’une arme |
3 |
1 |
– |
– |
Agressions physiques ayant entraîné la mort |
– |
– |
1 |
– |
Vols simples |
11 |
8 |
– |
– |
Vols à mains armées |
1 |
5 |
– |
– |
Viols |
6 |
4 |
– |
– |
Séquestrations |
2 |
– |
– |
– |
Source : Rapport de synthèse de Cabiria, 2009, p. 163-188.
Comme le note M. Lilian Mathieu, sociologue, les personnes prostituées élaborent des stratégies afin de réduire les risques qu’elles encourent : elles exercent à plusieurs, retiennent les numéros des voitures des clients violents ou adoptent des positions corporelles spécifiques pendant les passes (292).
Les clients peuvent également devenir violents durant le rapport sexuel et exiger des prestations non prévues par le contrat initial, qu’ils obtiennent alors en recourant à la force physique. D’autres recourent également à la force pour récupérer leur argent après la passe. Les personnes prostituées interrogées soulignent le sentiment d’impunité qui anime le client et l’autorise à toutes sortes d’actes sur la personne prostituée. Celle-ci, considérée comme une délinquante, peut dès lors faire l’objet d’agressions, a priori sans conséquences pénales. Si la personne prostituée est étrangère, alors la menace de la dénoncer aux services de police suffit à la faire taire (293).
La violence des clients est également symbolique. Mme Claudine Legardinier raconte ainsi l’histoire d’une jeune femme escorte qui a, un jour, repris un client qui la tutoyait en lui demandant de la vouvoyer. Le client lui a répondu : « Quand on se permet de faire la pute, on ne demande pas aux gens d’être polis » (294). Les marques d’irrespect sont ainsi très répandues.
c) Elle est également le fait des proxénètes, des personnes prostituées et des passants
La violence du milieu prostitutionnel est aussi le fait des proxénètes, qui utilisent la violence physique pour s’assurer de la docilité des personnes prostituées. Le paroxysme de la violence est évidemment atteint dans le cadre des « parcours de dressage », évoqués plus haut, dont certaines jeunes femmes originaires d’Europe de l’Est font l’objet. Outre cette violence initiale, les proxénètes contrôlent les personnes prostituées par des agressions physiques et sexuelles répétées.
Mme Judith Trinquart, médecin, explique ainsi que « les violences physiques, coups, blessures par armes, tortures physiques et psychologiques en tout genre sont fréquentes et régulières, souvent extrêmement violentes […] Les violences peuvent aller jusqu’au meurtre quand la personne n’est pas suffisamment coopérante, dans le cas de victimes de la traite à fins d’exploitation sexuelle, mais également dans le cas de proxénétismes plus isolés » (295).
Une victime nigériane de la traite, Baina, rencontrée à l’Amicale du Nid de Paris a témoigné de la gravité des violences subies : alors qu’elle n’avait jamais eu de rapports sexuels, elle a été ligotée et violée à 17 ans. À huit reprises, Baina est tombée enceinte à la suite de rapports avec des clients qui refusaient de mettre un préservatif. Ses proxénètes l’ont, à chaque fois, obligée à avorter en lui donnant des coups de pied dans le ventre. Surveillée en permanence, elle n’a pas eu une minute à elle entre 2000 et 2007 (296).
Mais le milieu prostitutionnel génère également des violences entre personnes prostituées. La prostitution est en effet un milieu extrêmement concurrentiel, ce qui provoque des conflits, parfois violents, entre personnes prostituées. Des menaces, du chantage, des violences physiques sont ainsi rapportées par l’enquête Droits et Violences (297) de Médecins du monde. Les nouvelles venues sont généralement chassées par les anciennes personnes prostituées, qui leur imposent en outre leurs prix et leurs pratiques.
Des conflits de territoires surviennent également pour les emplacements dédiés au racolage, comme en témoigne l’agression d’un travesti équatorien en forêt de Sénart, en mai 2010, par des personnes prostituées d’origine roumaine et leurs proxénètes (298). Certaines personnes interrogées rapportent également des dénonciations abusives de proxénétisme visant à éliminer la concurrence d’une rivale (299).
En particulier, les personnes étrangères sans papier sont souvent malmenées par les autres personnes prostituées, qui peuvent les dénoncer aux services de police. Les femmes chinoises en particulier, moins expérimentées et pratiquant des tarifs plus bas, sont accusées de « casser le marché » et font l’objet d’une violence particulière de la part des autres personnes prostituées (300).
C. DES SÉQUELLES PSYCHOLOGIQUES ET PHYSIOLOGIQUES SOUVENT MAJEURES
La prostitution, même après son arrêt, ne laisse généralement pas indemnes les personnes qui l’ont pratiquée.
1. Une souffrance psychologique notamment liée à la répétition de rapports sexuels non désirés
L’activité prostitutionnelle elle-même peut engendrer une grande souffrance morale, comme en témoigne Leïla : « Les agressions physiques, ce n’est rien à côté de la douleur intérieure, celle qui vous déchire, celle qui vous empêche de respirer » (301). Les personnes prostituées, soumises en permanence à des rapports sexuels non désirés, peuvent présenter des troubles psychologiques importants.
Mme Muriel Salmona, psychiatre, (302) a montré que 60 % à 80 % des personnes prostituées souffraient de troubles psychotraumatiques sévères, chiffre semblable aux personnes ayant subi des actes de tortures et aux prisonniers politiques (303). L’étude réalisée par Mme Melissa Farley (304) montre également que 68 % des personnes prostituées interrogées répondent aux critères du syndrome de stress post-traumatique. Ce syndrome, qui résulte d’une exposition à une violence de grande intensité, liée à une guerre ou une agression, est l’expression psychique d’un traumatisme.
Selon Mme Muriel Salmona (305), les troubles psychotraumatiques ont des conséquences visibles au niveau du cerveau. L’exposition récurrente à une situation de stress répétée conduit en effet le corps à produire des substances semblables à la morphine et à la kétamine, qui assurent alors une forme de disjonction et d’anesthésie physique et émotionnelle. Le cerveau, confronté à une situation violente, produit donc des drogues dures qui conduisent à un état dissociatif.
C’est d’ailleurs ce qui ressort du témoignage de nombreuses personnes prostituées : « Comment on le supporte ? On ne le supporte pas, on le vit. On fait le vide […] On ne ressent plus rien », rapporte Monika, ancienne hôtesse (306). Une jeune femme, qui a été quelque temps hôtesse dans un bar américain, a témoigné en ces termes devant la mission d’information : « J’étais tellement anesthésiée, tellement dans la violence moi-même, envers mon propre corps, que je ne m’étais pas aperçue des agressions constantes dont on est l’objet » (307). C’est également la « descente aux enfers » que décrit Laurence, « survivante de la prostitution » : « J’ai fait la morte comme j’avais toujours su le faire durant mon vécu de l’inceste avec mon beau-père, Jacques. Je me disais intérieurement : « Tu peux y aller, mon con, je ne ressens rien, je suis morte » (308).
L’état de dissociation se traduit par un sentiment d’irréalité, d’étrangeté à soi-même, d’indifférence et d’insensibilité, un sentiment de « corps mort ».
Cet état de dissociation perpétuel s’exprime aussi à travers le clivage entre la sphère prostitutionnelle et la sphère privée, qui permet de se protéger. L’utilisation de nom d’emprunt, l’accoutrement spécifique, le maquillage, le langage et l’attitude permettent d’éviter la « contamination » du monde privé par le monde prostitutionnel, d’après Mme Judith Trinquart (309). « Bizarrement, dans la prostitution, ce n’était pas moi. J’ai commencé à avoir vraiment l’impression d’être deux personnes […] J’ai fini par croire plus en Tara, mon nom de prostituée, qu’en Leïla. Tara, je la connais bien. En tant que Leïla, je ne sais pas qui je suis » (310), raconte une jeune femme prostituée pendant deux ans dans des bars à hôtesse.
Ce syndrome post-traumatique se traduit également, outre l’état dissociatif, par divers maux : attaques de panique, crises d’angoisse, états dépressifs, conduites à risques. Le projet de rapport de Mme Maria Carlshamre établit ainsi que « les problèmes courants de santé psychologique des prostituées comprennent la dépression, les tentatives de suicide, les crises de panique, le stress traumatique, les troubles du sommeil, les flash-back et les migraines » (311).
Les conditions d’exercice, particulièrement difficiles, peuvent conduire à des symptômes psychosomatiques sévères. Les conditions d’exercice de l’activité prostitutionnelle sont particulièrement stressantes pour les personnes prostituées. La peur est omniprésente : peur des clients, peur des proxénètes, peur des forces de l’ordre. Le Lotus Bus, qui travaille auprès de femmes chinoises, a rapporté ce témoignage à la mission d’information : « je n’ose pas aller travailler. Non seulement il faut faire attention aux délinquants, qui sont de plus en plus nombreux ces derniers temps, mais il faut faire très attention à la police » (312). Les médecins du Lotus Bus soulignent à quel point les personnes prostituées sont en situation de stress intense et omniprésent.
2. Des conséquences physiologiques souvent importantes
Le stress post-traumatique peut avoir de graves répercussions sur la santé des personnes prostituées. En effet, les substances générées par le corps en état de stress intense peuvent induire des problèmes cardiovasculaires se traduisant par des infarctus, des problèmes pulmonaires et, plus largement, des problèmes immunitaires, selon Mme Muriel Salmona (313).
La dissociation mentale entraîne aussi ce que le Dr Judith Trinquart (314) a appelé une « décorporalisation », qui existe aussi bien dans le cadre de la prostitution de rue que dans celui de la prostitution de luxe. Ce phénomène conduit notamment à un dérèglement du schéma corporel, de la représentation de son propre corps.
Les personnes prostituées peuvent ainsi connaître des seuils très élevés de tolérance à la douleur, pour se protéger de la violence physique ressentie durant l’acte prostitutionnel. De même, elles peuvent être peu à peu gagnées par des troubles cutanés sensitifs, d’abord localisés au niveau génital, puis sur tout le corps. Cette anesthésie corporelle peut ainsi conduire les personnes victimes de violence ou atteintes par une maladie, à ne pas reconnaître les signaux d’alerte que sont les douleurs physiques. Le corps des personnes prostituées devient alors, pour certaines d’entre elles, « un simple objet que l’on fait réparer lorsqu’il est cassé et ne rapporte plus suffisamment d’argent », d’après Mme Judith Trinquart (315).
3. Un usage fréquent des drogues
Mais l’activité prostitutionnelle peut également conduire à l’alcoolisme et à la toxicomanie. L’usage de drogues et d’alcool est souvent le seul moyen, pour les personnes prostituées, de rendre leur activité supportable, ainsi que le confirme une étude canadienne (316). C’est aussi ce que montrent les divers témoignages recueillis par Mme Claudine Legardinier et M. Saïd Bouamama : « Sans Valium, je n’aurais pas pu » ; « Avec la colle, on plane, on se fait des films. Avec les clients, c’est comme si on dormait » (317). Le témoignage d’une jeune femme reçue par la mission d’information va également dans ce sens : « Je prenais des médicaments et je buvais beaucoup, j’étais par conséquent continuellement dans un état second. On me faisait donc faire n’importe quoi » (318).
L’alcool, les médicaments, les drogues permettent aux personnes prostituées de faire face à la violence de leur activité, à la stigmatisation sociale, de se dissocier de leur corps, de se donner du courage pour « tenir le coup ». L’accès à ces substances licites et illicites est bien évidemment facilité et entretenu, le cas échéant, par le proxénète, qui est généralement aussi le dealer, leur dépendance lui assurant un contrôle total sur les personnes prostituées.
L’alcool est la principale substance consommée par les personnes prostituées. Deux rapports de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (319) montrent qu’en 2003, 42 % des femmes prostituées et 79 % des hommes prostituées en consomment de façon régulière, l’alcoolisme étant toutefois plus rare, notamment chez les femmes. Toutefois, 17 % des hommes et 5 % des personnes transgenres se déclarent dépendants à l’alcool.
Certains consomment par plaisir, pour se détendre, tandis que d’autres personnes prostituées associent alcool et prostitution (320). L’alcool permet alors de se donner du courage et d’apaiser son anxiété : « Il n’y a que ce moyen-là d’y aller vers la prostitution, d’aller vers le client, d’accepter une passe quoi. Non, on ne peut pas dire que ça vient sur une étoile. C’est une violence qu’on se fait, quoi, tout au début, après il y a une autre routine qui s’installe, mais au début on y va vraiment en reculant on a tous plus ou moins des a priori sur la prostitution » (321).
L’alcoolisme est particulièrement répandu chez les personnes prostituées âgées, d’après Mme Gabrielle Partenza (322), présidente de l’association Avec nos Aînées. Elle montre par ailleurs que la consommation d’alcool est en lien direct avec l’activité prostitutionnelle, ces femmes n’en consommant pas auparavant. C’est également ce qui ressort du rapport de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (323) : 70 % des personnes prostituées de plus 45 ans interrogées déclarent consommer de l’alcool.
Le cannabis est essentiellement consommé par les personnes prostituées de sexe masculin : d’après les deux études précitées, 56 % des hommes prostitués consomment du cannabis, et 30 % se déclarent dépendants. Chez les femmes, ce chiffre n’est que de 16 %, avec peu de dépendances déclarées.
Concernant les médicaments psychotropes, les taux de consommation sont assez semblables pour les hommes et les femmes se livrant à la prostitution, autour de 20 %, taux voisin de celui de la population féminine générale, si bien que la prise de médicaments psychotropes ne peut être corrélée à l’activité prostitutionnelle en elle-même. Toutefois, la consommation de somnifères chez les personnes transgenres, plus importante, est vraisemblablement liée à leur mode de vie nocturne.
Enfin, la consommation de drogues dures (324) serait relativement minoritaire, chez les hommes comme chez les femmes en situation de prostitution. Seules 5 % des femmes en situation de prostitution prendraient de l’héroïne et des produits de substitution correspondants, comme la méthadone et le sulfate de morphine. Elles consomment également des produits stimulants, comme l’ecstasy et la cocaïne.
Le recours à des drogues dures peut débuter dans le milieu prostitutionnel, via une autre personne prostituée, un client ou un proxénète, dans le but de faciliter l’exercice de cette activité : « Je trouvais que ça m’allait, puis je ne sais pas, je me trouvais encore plus forte, voilà ! Pour moi ça veut dire que je suis capable de tout, que je suis la plus forte : j’ai pris de l’héro, maintenant je suis la championne de la rue » (325).
DEUXIÈME PARTIE : DES POLITIQUES PUBLIQUES SOUVENT INCOHÉRENTES, PARFOIS INEFFICACES, VOIRE INEXISTANTES
Les politiques publiques, en matière de prostitution, découlent de la position abolitionniste de la France, esquissée en 1946 et officiellement adoptée en 1960. Cette doctrine repose sur une conception particulière de la personne prostituée, analysée comme la victime d’un système.
En pratique, il s’agit d’abolir toute réglementation de la prostitution, qui revient à lui conférer un statut juridique, sans pour autant interdire son exercice en tant que tel. Le rôle de l’État et des politiques qu’il met en œuvre est donc de prévenir l’entrée dans la prostitution et d’aider les personnes prostituées qui le souhaitent à se réinsérer. La personne prostituée étant considérée comme une victime, il convient de réprimer l’exploitation sexuelle sous toutes ses formes, du proxénétisme à la traite des êtres humains.
La position abolitionniste de la France comporte donc deux facettes : d’une part un volet pénal, qui vise à réprimer l’exploitation sexuelle dont la personne prostituée est victime ; d’autre part un volet social, qui doit encourager la sortie de la prostitution. Force est de constater que l’aspect pénal de l’abolitionnisme semble prédominer à l’heure actuelle, qu’il s’agisse de prévenir les troubles à l’ordre public ou de réprimer l’exploitation de la prostitution d’autrui et son organisation. En revanche, une politique sociale ambitieuse fait toujours défaut aujourd’hui.
I. – REFUSER TOUTE RECONNAISSANCE JURIDIQUE DE LA PROSTITUTION : UNE POSITION ABOLITIONNISTE DE PRINCIPE QUI SOUFFRE DE QUELQUES INCOHÉRENCES
La position abolitionniste de la France, qui apparaît, au regard de l’histoire, comme l’aboutissement naturel d’une doctrine qui s’est longtemps cherchée, semble aujourd’hui souffrir de quelques incohérences. Notamment, ses détracteurs avancent tantôt que les personnes prostituées sont considérées comme des délinquantes, tantôt que le droit fiscal et social les reconnaît implicitement comme des travailleurs ordinaires. La doctrine abolitionniste serait donc à géométrie variable. La réalité apparaît toutefois plus nuancée, si l’on considère les multiples objectifs poursuivis par l’abolitionnisme.
A. LA FRANCE A EXPÉRIMENTÉ, EN MATIÈRE DE PROSTITUTION, LE PROHIBITIONNISME ET LE RÉGLEMENTARISME AVANT D’ADOPTER UNE POSITION ABOLITIONNISTE EN 1946
La position abolitionniste que la France a esquissée en 1946 avant de l’adopter officiellement en 1960, repose sur le constat d’échec tiré de l’expérience de systèmes différents. La France a effet pu, au cours de son histoire, mettre en œuvre plusieurs doctrines en matière de prostitution, notamment le prohibitionnisme et le réglementarisme, entre lesquels elle a oscillé entre le Moyen Âge et le XIXe siècle.
1. Du Moyen Âge à l’Ancien Régime : l’hésitation des pouvoirs publics entre prohibitionnisme et réglementarisme
Au début du Moyen Âge, le prohibitionnisme est la règle. Le bréviaire d’Alaric, recueil de droit romain publié en 506, interdit en effet la prostitution et sanctionne aussi bien les personnes prostituées que les proxénètes. L’Empereur Justinien perpétue le système prohibitionniste, par une loi promulguée en 535. En réprimant sévèrement le proxénétisme, il visait essentiellement à supprimer la prostitution. Une action de reclassement fut d’ailleurs entreprise, par l’impératrice Théodora, à destination des prostituées fraîchement libérées du joug des souteneurs (326). Plus tard, Charlemagne condamnera les femmes prostituées à être flagellées nues en place publique (327).
S’instaure ensuite une phase de tolérance plus ou moins grande à l’égard de l’activité prostitutionnelle : « on peut donc se représenter, pour la plus grande partie du Moyen Âge, des femmes échangeant des rapports charnels contre de l’argent sans que l’autorité publique ne s’en émeuve » (328), à l’exception des cas où l’activité prostitutionnelle trouble l’ordre public. À partir du XIVe siècle et jusqu’au milieu du XVIe siècle, les autorités publiques tentent d’encadrer l’activité prostitutionnelle. Vers 1350, les municipalités, « plus soucieuses de l’ordre public que du relèvement des âmes de leurs administrés » (329) favorisent la création de maisons closes, aidées en cela par l’Église, qui considère en effet que la prostitution est de loin préférable à la « fornication libre » (330). Les cités du sud de la France, principalement, ouvrent alors des maisons municipales de prostitution. Ailleurs, comme à Paris, les municipalités désignent des quartiers susceptibles d’accueillir cette activité, généralement les faubourgs.
Mais, à partir du milieu du XVIe siècle, le réglementarisme cède à nouveau la place à la prohibition de la prostitution. Les notables et les princes se désintéressent de la question prostitutionnelle. Le déclin économique, la mort de François Ier de la syphilis, une évolution des mentalités moins favorable à la prostitution, expliquent également ce changement politique. Ainsi, en 1560, un arrêt des États d’Orléans interdit ce qu’on appelle alors les « bordeaux » (331) et met en place une politique antivénérienne. Louis XIV, par trois ordonnances royales du 20 avril 1684, tente également d’enrayer le phénomène prostitutionnel, en décidant de l’enfermement des femmes prostituées à la Salpêtrière (332).
2. La mise en place du « système français » réglementariste à partir du Consulat
C’est sous le Consulat que naît le système réglementariste, également appelé « système français », qui servira de modèle en Europe. C’est un médecin hygiéniste, Alexandre Parent-Duchâtelet, qui a fondé cette doctrine en 1836. Son ouvrage intitulé De la Prostitution dans la ville de Paris, considérée sous le rapport de l’hygiène publique, de la morale et de l’administration pose en effet les bases du réglementarisme. Il considère la prostitution comme un mal nécessaire, comme le montre l’historien Alain Corbin : « Parent-Duchâtelet considère que la prostitution est un phénomène excrémentiel indispensable qui protège le corps social de la maladie » (333).
Parent-Duchâtelet s’inscrit ainsi dans la droite ligne de la pensée de Saint Augustin, qui écrit, à propos des personnes prostituées : « Elles sont dans la Cité ce qu’un cloaque est dans le palais. Supprimons le cloaque et le palais deviendra un lieu infect. Supprime les prostituées, les passions bouleverseront le monde ; donne leur rang de femmes honnêtes et le déshonneur flétrira l’univers… » (334). La peur de la propagation des mœurs légères des femmes publiques au reste de la société n’est pas absente de la pensée de l’auteur. La prostitution doit être tolérée mais étroitement surveillée. Les femmes publiques doivent être isolées du reste de la société, « contenues », en quelque sorte, dans des lieux clos et rendues invisibles à la société. Il s’agit donc de « protéger la moralité publique du spectacle de la débauche » (335).
M. Cédric Amourette donne la définition suivante du système mis en place par Napoléon sous l’impulsion du Directoire : « Le régime réglementariste consiste à organiser l’exercice de la prostitution », à « la contrôler et l’encadrer afin d’éviter les troubles à l’ordre public et de canaliser les risques liés à la santé publique » (336). Dans cette optique, les personnes prostituées font l’objet d’une surveillance particulière, par le biais notamment du fichage. Les femmes publiques, dès 1796, sont ainsi mises en carte, qu’elles exercent dans des maisons de tolérance – elles sont alors appelées des « filles à numéro » – ou de façon autonome. À l’inverse, les « insoumises », non enregistrées, qui exercent clandestinement la prostitution, seront traquées par la police des mœurs. La mise en carte entraîne certaines obligations administratives, comme celle de se soumettre à des visites sanitaires récurrentes, à partir de 1802, dans le but d’endiguer les maladies vénériennes, en particulier la syphilis.
Cependant, le système réglementariste ne porte pas ses fruits. En effet, il ne permet pas de contenir la prostitution visible, les prostituées clandestines ne travaillant pas dans les maisons de tolérance. De surcroît, le contrôle sanitaire voulu par le système réglementariste est défaillant, les clients en étant exclus. Par ailleurs, ce système a assuré le développement d’un véritable trafic d’êtres humains, destiné à alimenter les maisons de tolérance en nouvelles recrues (337). Enfin, les maisons de tolérance disparaissent progressivement, ne correspondant plus aux mœurs des clients, qui leur préfèrent des garnis ou des hôtels, également moins coûteux et moins contraignants pour les tenanciers. De fait, leur nombre passe d’environ 200 au milieu du XIXe siècle à 59 en 1892 (338).
3. L’avènement de l’abolitionnisme à partir de la seconde moitié du XXe siècle
Dès la fin du XIXe, le système réglementariste fait l’objet d’importantes contestations. Notamment, Joséphine Butler, épouse d’un principal de collège anglais de Liverpool, mène une véritable croisade contre les tentatives visant à instaurer le réglementarisme en Angleterre (339). Victor Hugo apporte d’ailleurs son soutien à ce combat (340). Plus largement, les milieux protestants anglais contestent le système français et remettent en cause l’idée sous-jacente selon laquelle les besoins sexuels de l’homme doivent être assouvis. La prostitution doit être abolie et ne peut dès lors pas être tolérée et reconnue par les autorités publiques.
Le courant abolitionniste qui naît en France, mené par le journaliste Yves Guyot, poursuit les mêmes objectifs, à savoir l’abolition de la réglementation, mais se situe dans une optique bien différente. Il s’agit avant tout de combattre l’arbitraire policier de l’administration des mœurs, qui édicte elle-même les règles auxquelles sont astreintes les femmes publiques et les fait appliquer (341). Ce courant « libéral et radical » (342) de l’abolitionnisme l’emporte finalement en 1880, lors du second congrès de la Fédération britannique et continentale pour l’abolition de la prostitution : « l’essentiel y apparaît de limiter les fonctions de l’État et de garantir plus nettement les droits de la personne humaine » (343).
Toutefois, les propositions abolitionnistes ne seront retenues en France qu’au lendemain de la Seconde guerre mondiale, en 1946. La loi n° 46-685 du 13 avril 1946, dite loi « Marthe Richard » (344), provoque la fermeture des maisons de tolérance et réprime plus sévèrement encore le proxénétisme. La fermeture des maisons closes n’est toutefois pas révolutionnaire ; le mouvement a d’ailleurs été anticipé par de nombreuses municipalités à la Libération, les tenanciers ayant, pour beaucoup, collaboré avec l’armée d’occupation (345). C’est donc sans débat passionné que cette loi sera votée.
Mais la loi dite « Marthe Richard » n’est qu’une victoire partielle des abolitionnistes. En effet, les mesures de contrôle sanitaires sont maintenues par le vote de la loi du 24 avril 1946 sur la prophylaxie des maladies vénériennes. Un fichier sanitaire et social est même instauré. En outre, le système réglementariste continue à s’appliquer dans les colonies et les départements non métropolitains (346). Ce n’est qu’en 1960 (347), par la ratification de la Convention internationale des Nations unies pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui du 2 décembre 1949 (348), que la France devient un pays abolitionniste. Deux ordonnances (349) sont alors publiées qui suppriment le fichier relatif aux personnes prostituées et mettent en place des mesures sociales à leur destination.
B. L’ABOLITIONNISME POURSUIT PLUSIEURS OBJECTIFS : PROTÉGER LES PERSONNES PROSTITUÉES ET DÉCOURAGER L’ACTIVITÉ PROSTITUTIONNELLE
L’abolitionnisme peut être défini comme une doctrine visant à abolir toute forme de réglementation de la prostitution, dans le but de ne pas encourager celle-ci par une quelconque reconnaissance juridique. Outre l’objectif de protection des personnes prostituées par la répression de l’exploitation sexuelle d’autrui et du proxénétisme, la doctrine abolitionniste, qui considère les personnes prostituées comme des victimes, entend prévenir l’entrée dans la prostitution et favoriser la réinsertion des personnes prostituées.
1. L’absence de reconnaissance juridique donnée à la prostitution et son corollaire, la tolérance de la prostitution privée
L’abolitionnisme s’est historiquement construit en opposition au réglementarisme. Comme on peut le lire dans la Charte de la Fédération abolitionniste internationale rédigée en 1912, le réglementarisme est accusé de « [procurer] à l’homme sécurité et irresponsabilité dans le vice » (350) et d’encourager ainsi le recours à la prostitution. En outre, il contrevient aux libertés, notamment des femmes, par la mise en place du système quasi-carcéral des maisons. Toute réglementation de la prostitution doit donc être abolie, de la même façon que l’esclavage a été aboli avec l’abrogation des mesures l’encadrant. C’est aussi un préalable indispensable à la répression de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle.
Le fichier sanitaire et social des personnes prostituées, qui recensait près de 30 000 personnes prostituées, est ainsi supprimé en 1960, conformément à la Convention des Nations unies de 1949. Son article 6 dispose en effet que « chacune des Parties à la présente convention convient de prendre toutes les mesures nécessaires pour abroger ou abolir toute loi, tout règlement et toute pratique administrative selon lesquels les personnes qui se livrent ou sont soupçonnées de se livrer à la prostitution doivent se faire inscrire sur des registres spéciaux, posséder des papiers spéciaux, ou se conformer à des conditions exceptionnelles de surveillance ou de déclaration ». Les obligations de contrôle pesant sur les personnes prostituées sont également supprimées par les ordonnances du 25 novembre 1960.
Cependant, l’objectif final de l’abolitionnisme est bien de décourager la prostitution autant que possible, comme en témoigne le préambule de la convention des Nations unies de 1949 : « la prostitution et le mal qui l'accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et mettent en danger le bien-être de l'individu, de la famille et de la communauté ». Le respect des libertés individuelles impose toutefois de ne pas réprimer l’exercice de cette activité. En effet, selon la doctrine abolitionniste, « la prostitution personnelle et privée ne relève que de la conscience et n’est pas un délit » (351). La prostitution, loin d’être reconnue, est simplement tolérée par l’État, lorsqu’elle n’est pas exercée sur la voie publique. Non réprimée, la prostitution est donc licite dans le cadre abolitionniste.
2. La répression du proxénétisme et de l’exploitation sexuelle
Le réglementarisme est jugé responsable de la « traite des blanches » à la fin du XIXe siècle, puis du trafic d’êtres humains qui sévit au XXe siècle. En effet, comme le montre M. Cédric Amourette, ce trafic « était inhérent au système des établissements de prostitution, les exploitants cherchant à renouveler sans cesse leur personnel » (352). La fermeture des maisons closes a été conçue comme devant remédier aux racines du problème, tandis que la répression du proxénétisme, de l’exploitation sexuelle d’autrui et de la traite des êtres humains devait combattre le mal lui-même.
Ainsi, la convention des Nations unies de 1949 prévoit plusieurs dispositions allant dans ce sens. Il s’agit en effet de « punir toute personne qui, pour satisfaire les passions d'autrui : 1) Embauche, entraîne ou détourne en vue de la prostitution une autre personne, même consentante ; 2) Exploite la prostitution d'une autre personne, même consentante » (353) mais aussi « toute personne qui : 1) Tient, dirige ou, sciemment, finance ou contribue à financer une maison de prostitution; 2) Donne ou prend sciemment en location, en tout ou en partie, un immeuble ou un autre lieu aux fins de la prostitution d'autrui » (354).
L’incrimination est ici particulièrement large et vise toutes les formes de proxénétisme : l’article premier en particulier est un article à portée générale qui peut viser aussi bien le « « julot casse-croûte » (i.e. l’amant ou le mari qui demande à sa femme de se prostituer), l’intermédiaire, femme ou homme, qui recrute de jeunes provinciales dans les gares, le tenancier de bordel et l’investisseur dans l’économie prostitutionnelle » (355). L’article 2 vise lui plus clairement à la destruction de l’économie prostitutionnelle, qui bénéficiait jusqu’alors de la tolérance des États. La traite ne peut en effet être combattue que si le proxénétisme et l’exploitation sexuelle sont réprimés ; or, la fermeture des maisons closes en est le préalable nécessaire.
3. La disparition du phénomène prostitutionnel comme horizon
L’horizon ultime de l’abolitionnisme est la disparition de la prostitution. Il s’agit donc de décourager, autant que possible, l’entrée dans la prostitution et d’aider les personnes prostituées, qui sont vues comme des victimes, à cesser cette activité. C’est ce qui ressort explicitement de l’article 16 de la convention de 1949, dans des termes, il est vrai, quelque peu datés : « les Parties à la présente Convention conviennent de prendre ou d'encourager, par l'intermédiaire de leurs services sociaux, économiques, d'enseignement, d'hygiène et autres services connexes, qu'ils soient publics ou privés, les mesures propres à prévenir la prostitution et à assurer la rééducation et le reclassement des victimes de la prostitution et des infractions visées par la présente Convention ».
C. LA MULTIPLICITÉ DES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR L’ABOLITIONNISME EST SUSCEPTIBLE DE CONDUIRE À CERTAINES CONTRADICTIONS, QUI N’ENTAMENT TOUTEFOIS PAS SA COHÉRENCE
Le système abolitionniste est, comme tous les régimes relatifs à la prostitution, sujet à critiques. En particulier, les tenants du réglementarisme, comme du prohibitionnisme, fondent leurs critiques sur ce qu’ils conçoivent comme des incohérences profondes et des contradictions hypocrites. En réalité, les incohérences supposées de l’abolitionnisme français renvoient plutôt à la multiplicité des objectifs poursuivis. Toutefois, on doit constater que le volet social de l’abolitionnisme, bien qu’affirmé, fait aujourd’hui défaut dans les faits.
1. La prostitution serait juridiquement reconnue par le droit fiscal et social
Les personnes prostituées sont assujetties à l’impôt et doivent s’acquitter de cotisations sociales auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF). Les revenus perçus sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu, les sommes rétrocédées aux proxénètes étant, le cas échéant, admises en déduction. En outre, la prostitution, lorsqu’elle est exercée de façon indépendante, donne lieu au versement de la taxe sur la valeur ajoutée. Par ailleurs, les personnes prostituées sont exonérées de la contribution économique territoriale, en vertu de solutions doctrinales anciennes (356). Enfin, le droit social contraint les personnes prostituées à payer des cotisations sociales (357).
Le régime fiscal applicable aux personnes prostituées (358) Les personnes prostituées sont tout d’abord redevables de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux, sur le fondement de l’article 92-1 du code général des impôts (CGI) qui prévoit l’imposition dans cette catégorie des bénéfices retirés de toute occupation, exploitations lucratives ou sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus. Ce principe a d’ailleurs été affirmé à plusieurs reprises par le Conseil d’État (359). D’après la jurisprudence, l’article 92-1 du CGI s’applique à toutes les formes de prostitution, habituelle (360), occasionnelle ou annexe (361). Les personnes prostituées sont également redevables de la taxe sur la valeur ajoutée. En effet, en application des articles 256 et 256 A du CGI, sont assujetties à cette taxe toutes les personnes qui exercent de façon indépendante une activité économique consistant dans la réalisation de prestations de services à titre onéreux. Toutefois, les personnes prostituées peuvent être exonérées du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée si elles agissent pour le compte d’un proxénète. En effet, dans ce cas précis, elles n’exercent plus de façon indépendante au regard du droit fiscal. Enfin, en matière de contribution économique territoriale, les personnes prostituées bénéficient d’une exonération générale de la part des services fiscaux. |
Pour certains, l’assujettissement à l’impôt des personnes prostituées constituerait une reconnaissance légale de la prostitution, allant à l’encontre de la neutralité de la position abolitionniste, qui tolère la prostitution sans lui donner un quelconque statut juridique (362). Comme l’écrit le professeur Christophe Geslot, « la logique de la solidarité nationale et de l’égalité devant l’impôt postule la reconnaissance de l’activité qui y contribue. La contribution aux charges communes vaut en effet de ce point de vue inclusion parmi les activités économiques de la nation » (363). De fait, en présence d’un proxénète, les revenus de la personne prostituée peuvent être déclarés comme « traitements et salaires ». Les services fiscaux reconnaissent cette possibilité (364), bien que la jurisprudence le refuse catégoriquement (365). De même, les personnes prostituées sont assimilées aux travailleurs indépendants au regard du droit social. La prétendue hypocrisie fiscale de l’État est donc largement critiquée par les anti-abolitionnistes.
Ces prélèvements feraient même de l’État un proxénète au regard du droit pénal, d’après certains, puisqu’il tirerait ainsi profit des fruits de la prostitution. C’est notamment ce qu’a considéré le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un jugement du 17 décembre 1998, en évoquant cette « compromission étatique ». C’est aussi la comparaison que fait la juge Elisabet Fura-Sandström auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, dans une opinion dissidente jointe à l’arrêt Tremblay (366), pour qui l’État français agit « un peu comme un proxénète ».
Toutefois, l’imposition des personnes prostituées répond à certains principes qui la rendent compatible avec la doctrine abolitionniste.
En premier lieu, les personnes prostituées sont normalement imposées au titre des bénéfices non commerciaux, au même titre que toute occupation ou sources de profits. L’imposition au titre de l’impôt sur le revenu n’entraîne donc pas la reconnaissance de la prostitution comme travail, mais comme activité lucrative.
Ensuite, la neutralité du droit fiscal impose de taxer tous les revenus, légaux et illégaux. Les trafiquants de stupéfiants sont ainsi assujettis à l’impôt, alors même que leur activité est parfaitement illégale au regard du droit pénal. Cela ne fait pas pour autant de l’État un complice. En effet l’imposition n’a pas de rapport avec la légalité ou l’illégalité de l’activité exercée. « Il n’y a donc là aucune surprise pour un juriste, puisque, en vertu du réalisme du droit fiscal, tout revenu est imposable, le fait générateur de l’imposition étant indépendant de la légalité de l’activité » (367). Cette solution correspond donc à l’absence de statut juridique qui entoure la prostitution dans la logique abolitionniste.
Concernant les cotisations sociales, là encore, le droit social ne reconnaît pas l’activité prostitutionnelle. Dans les faits, certaines personnes prostituées s’affilient au régime social des indépendants sous les catégories de conseil, de services d’hôtesse, de relations publiques, d’activités de massage ou de relaxation. Aucune affiliation n’est toutefois possible lorsque les personnes prostituées déclaraient leur véritable activité. Cependant, la prostitution n’étant pas réprimée en tant que telle, aucune sanction ne peut être prise contre les personnes qui se déclarent sous une profession autre (368).
Par ailleurs, si les personnes prostituées venaient à être exonérées d’impôts et de cotisations sociales, cela entraînerait une rupture de l’égalité devant les charges publiques et tendrait donc à exclure les personnes prostituées de la citoyenneté, dont la soumission à l’impôt est l’un des éléments. En outre, l’exonération de cette activité reviendrait à créer une « trappe à prostitution » (369), en rendant l’exercice de celle-ci plus attractive. L’imposition des personnes prostituées est donc parfaitement justifiée au regard du système abolitionniste, qui vise à décourager l’activité prostitutionnelle.
2. La prostitution serait tolérée, mais empêchée en pratique
Certains avancent que la prostitution, dans le système actuel, serait tolérée mais empêchée en pratique, contrairement à ce que proclame la doctrine abolitionniste. Ce hiatus apparent entre les principes de l’abolitionnisme et la réalité repose sur le constat que, dans les faits, la prostitution est rendue juridiquement difficile par le droit pénal.
La prostitution ne peut s’exercer que dans peu de lieux, du fait de la répression élargie du proxénétisme. Les personnes prostituées ne peuvent pas exercer leur activité à l’hôtel, dans un bar ou dans un appartement loué, du fait de la répression qui pèse alors sur le propriétaire des lieux, proxénète hôtelier ; elles ne peuvent, pour les mêmes raisons, louer une camionnette, dont le propriétaire sera assimilé au proxénète de soutien ; les personnes prostituées ne peuvent pas devenir propriétaire de leur appartement et y exercer, l’ancien propriétaire étant alors un proxénète immobilier d’après la jurisprudence. Si l’acte prostitutionnel était pratiqué dans un lieu public, comme c’est parfois le cas aujourd’hui (halls d’immeubles, voitures, terrains vagues), la personne prostituée serait coupable d’exhibition sexuelle.
Enfin, l’offre publique de services sexuels est juridiquement empêchée par l’incrimination du racolage. De même, les arrêtés « anti-prostitution » pris par les municipalités, qui visent tant les personnes prostituées que leurs clients, cherchent à entraver l’exercice de la prostitution dans les lieux publics (370). Certains y voient d’ailleurs une forme de réglementation, par la négative, des lieux d’implantation de la prostitution (371), ce qui serait en contradiction avec l’abolitionnisme. Au final, la prostitution ne pourrait s’exercer légalement que dans des circonstances très restreintes.
Cette contradiction n’est cependant qu’apparente. En effet, si l’abolitionnisme tolère la prostitution au titre de la liberté individuelle, il ne cherche aucunement à l’encourager. Bien au contraire, il s’agit d’empêcher toute forme d’exploitation sexuelle d’autrui. Dans ce contexte, l’incrimination élargie du proxénétisme vise à limiter les possibilités d’exploitation sexuelle et, plus largement, à décourager l’activité prostitutionnelle.
Par ailleurs, l’abolitionnisme, s’il tolère la prostitution, ne l’accepte que si elle est exercée dans un cadre privé. Cela vaut donc également pour la phase amont de l’activité prostitutionnelle, qui consiste à proposer des services de nature sexuelle en échange d’une rémunération. Si le racolage est public, l’abolitionnisme ne fait pas obstacle à sa condamnation. Dès lors, l’incrimination du racolage comme du proxénétisme n’est pas en réelle contradiction avec la doctrine abolitionnisme et le principe de tolérance de l’activité prostitutionnelle.
Certains avancent par ailleurs que la tolérance étatique n’est pas réelle compte tenu de l’inexistence juridique du contrat de prostitution au regard du droit, les personnes prostituées n’étant pas soumises au droit commun des contrats. Comme le montre M. Cédric Amourette, la jurisprudence a toujours refusé de reconnaître la validité du contrat de prostitution, en se fondant sur la notion de bonnes mœurs (372). Toutefois, il semble que cette notion soit en passe d’être abandonnée (373). Elle n’a notamment plus cours dans le domaine des libéralités consenties dans le cadre d’une relation adultère (374). Le contrat de prostitution pourrait dès lors être annihilé sur un autre terrain, celui de la dignité de la personne humaine et de la non-patrimonialité du corps humain (375).
En tout état de cause, l’inexistence du contrat de prostitution n’est pas contraire à la logique abolitionniste. Si le système abolitionniste tolère la prostitution, il n’entend lui donner aucune base juridique, encore moins contractuelle. En effet, comme on l’a vu plus haut, la Convention de 1949 tend à remettre en cause le présupposé contractualiste des États réglementaristes. La prostitution, comme l’esclavage, ne peut conduire à des contrats quelconques, quand bien même les personnes y consentiraient.
3. La personne prostituée ne serait pas considérée comme une victime, mais comme une délinquante
La doctrine abolitionniste considère la personne prostituée comme une victime de l’exploitation sexuelle. Or, pour certains, il existe en France « tout un arsenal juridique qui prend directement ou indirectement les prostituées pour cible et entrave leurs droits individuels » (376). La personne prostituée, loin d’être considérée dans les faits comme une victime, est à la fois une délinquante et une personne privée de nombre de ses droits.
L’incrimination du racolage fait de la personne prostituée une délinquante. Interpellations, fouilles, gardes à vue peuvent ainsi être pratiquées par les services de police. Des peines d’emprisonnement et d’amende peuvent être prononcées par les juridictions correctionnelles. De nombreuses associations, qu’elles visent l’abolition de la prostitution, comme le Mouvement du Nid, ou sa professionnalisation, comme le STRASS, critiquent la pénalisation des personnes prostituées, contraire à l’optique initiale de l’abolitionnisme.
Il est vrai que l’incrimination du racolage répond à d’autres objectifs, d’ordre public principalement, et se trouve dès lors en contradiction avec certains aspects de la doctrine abolitionniste. En effet, si la personne prostituée est considérée comme victime d’une forme d’esclavage, il est difficilement compréhensible qu’elle soit inquiétée pour une activité qu’elle n’a pas choisi librement d’exercer. Cette vision est cependant réductrice et ne tient pas compte de l’ensemble de la problématique prostitutionnelle (377).
4. Les personnes prostituées seraient stigmatisées, non pas réinsérées
De nombreuses critiques portent sur la faiblesse de l’aspect social dans l’abolitionnisme aujourd’hui. La personne prostituée, à la fois délinquante et victime, serait de toutes parts stigmatisée par les politiques publiques. Pour certains, « en rabaissant la personne prostituée au rang d’esclave, on la « rabaisse au statut de victime absolue, de peuple de l’abîme », et plus insultant encore, au rang de viande » (378).
La stigmatisation dont les personnes prostituées font l’objet limiterait de facto leurs possibilités de reconversion, contrairement à l’objet poursuivi par l’abolitionnisme. Ainsi, d’après Act Up, association de lutte contre le sida, « l’abolitionnisme condamne les personnes prostituées à la précarité, mais en plus, il leur permet difficilement d’entreprendre une reconversion de leur plein gré » (379). Ainsi, comme l’indique M. Cédric Amourette, « sans généraliser, on constate souvent que suite à l’arrêt d’une activité de prostitution, habituelle voire exclusive, les personnes éprouvent les plus grandes difficultés à trouver ou retrouver un emploi » (380).
Par ailleurs, le droit fiscal et social, loin de soutenir les personnes prostituées qui décident de quitter l’activité prostitutionnelle, favoriserait leur maintien dans la prostitution. Le paiement des impôts entrave ainsi l’arrêt de l’activité prostitutionnelle. Comme l’écrit le professeur Christophe Geslot, « le décalage d’un an quant au paiement, les rappels et les majorations qui supposent de disposer de revenus immédiats et conséquents peuvent contraindre à continuer l’activité » (381). Les redressements fiscaux obligeraient également les personnes prostituées à continuer leur activité prostitutionnelle pour s’acquitter de leurs impôts. C’est ce que note M. Cédric Amourette : « La question pécuniaire peut, en cas d’imposition d’office ou de redressement, faire obstacle à l’arrêt de l’activité de prostitution […]. Les sommes demandées sont souvent extrêmement importantes et la personne prostituée, se sentant prisonnière de ces dettes, pensera que la seule possibilité pour elle de rassembler ces sommes est la poursuite de l’activité de prostitution » (382). Il y a là, en quelque sorte, un cercle vicieux.
Les redressements fiscaux et sociaux peuvent également mettre un terme à une reconversion réussie. En effet, les sommes demandées sont très importantes, puisqu’elles tiennent compte des sommes reçues par les personnes prostituées, et non pas des revenus finaux, après prélèvement par le proxénète. Ainsi, la base sur laquelle repose le redressement fiscal est très largement surévaluée (383). Certains interlocuteurs ont fait part des difficultés que pouvaient rencontrer les personnes anciennement prostituées confrontées à un redressement fiscal. Alors même qu’elles avaient cessé leur activité prostitutionnelle et étaient parvenues à ouvrir un commerce, le redressement fiscal les a contraintes à le fermer et à reprendre leur activité de prostitution (384).
Cependant, en matière de cotisations sociales, la situation est plus nuancée. En effet, en 1999, par une lettre adressée au directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), « la ministre de l’Emploi et de la Solidarité [avait] invité les URSSAF à ne plus engager de procédures de mise en recouvrement à l’encontre des personnes se livrant à la prostitution en voie de réinsertion » (385). M. Éric Le Bont, directeur de la réglementation, du recouvrement et du service de l’ACOSS, a d’ailleurs confirmé à la mission d’information que cette politique était toujours en vigueur (386).
Mais il est vrai que le système abolitionniste, tel qu’il est appliqué aujourd’hui en France, pèche par l’absence de volet social convaincant en matière d’aide à la réinsertion des personnes prostituées, mais aussi de prévention, comme nous le verrons plus loin (387).
II. – PRÉVENIR LES TROUBLES À L’ORDRE PUBLIC : LES EFFETS CONTRADICTOIRES DE LA RÉPRESSION DU RACOLAGE
L’ordre public comprend traditionnellement, en droit français, trois éléments distincts : la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques. Or, l’exercice de l’activité prostitutionnelle peut engendrer un certain nombre de troubles si tout ou partie de la prostitution est exercé publiquement. C’est pourquoi le droit confère depuis longtemps divers moyens aux autorités locales et nationales afin de limiter les effets de la prostitution dans l’espace public.
L’infraction d’exhibition sexuelle est parfois utilisée pour incriminer des faits liés à l’activité prostitutionnelle. Au plan local, les maires et les préfets disposent de la police administrative et peuvent dès lors interdire, pendant une période de temps limitée et dans des lieux précis, le stationnement ou la circulation de véhicules ou de personnes. Ces deux moyens juridiques ont en commun d’être des outils généraux, visant à protéger l’ordre public, appliqués à la prostitution.
L’incrimination du racolage, sous une forme active ou passive, cible directement l’activité prostitutionnelle et plus précisément, l’offre prostitutionnelle. Son efficacité a eu des conséquences importantes sur les conditions d’exercice des personnes prostituées, sans que ses effets sur les mises en cause pour proxénétisme puissent être démontrés.
A. L’ACTIVITÉ PROSTITUTIONNELLE, LORSQU’ELLE CRÉE UN TROUBLE À L’ORDRE PUBLIC, EST RÉPRIMÉE
Trois moyens principaux sont offerts aux autorités publiques pour sanctionner d’éventuels troubles à l’ordre public : l’incrimination de l’exhibition sexuelle, l’usage de la police administrative et l’incrimination du racolage, actif ou passif.
1. L’incrimination des atteintes aux bonnes mœurs et la police administrative sont depuis longtemps utilisées pour limiter la visibilité de la prostitution
Deux moyens non spécifiques à la prostitution sont utilisés depuis longtemps pour limiter les troubles à l’ordre public susceptibles de résulter de l’activité prostitutionnelle : l’incrimination de l’exhibition sexuelle et les interdictions de stationner ou de circuler édictées par les autorités détentrices de la police administrative.
a) L’incrimination de l’exhibition sexuelle permet de réprimer l’acte prostitutionnel effectué en public
L’outrage à la pudeur de l’article 330 de l’ancien code pénal est désormais réprimé à l’article 222-32 du nouveau code pénal qui dispose que « l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ». Si cette infraction ne vise pas directement la prostitution, l’activité prostitutionnelle, si elle est exercée en public, peut se voir appliquer cette qualification pénale. C’était déjà le cas sous l’empire de l’ancien code pénal, comme en témoigne le professeur Émile Garçon, grand pénaliste du siècle dernier : « si une prostituée accomplit publiquement un acte obscène, si elle fait d’actes immoraux ou se livre à des attouchements impudiques pour exciter les passants à la débauche, l’article 330 sera certainement applicable » (388).
L’infraction d’exhibition sexuelle suppose la réunion de plusieurs éléments. L’exhibition est un acte impudique, qui peut consister en des actes suggestifs ou bien directement sexuels. Cet acte doit être susceptible de porter atteinte à la sensibilité du public, qu’il y ait des témoins ou non. La simple possibilité que cet acte soit vu par le public suffit à caractériser l’infraction. Enfin, l’intention coupable est caractérisée par la volonté de l’auteur d’imposer cet acte à la vue d’autrui.
Ainsi, les personnes prostituées peuvent, dans l’exercice de leur activité, se rendre coupables d’exhibition sexuelle. C’est par exemple le cas, lorsqu’elles exercent dans des véhicules motorisés ou bien dans des lieux publics (bois, halls d’immeuble, terrains vagues …) et que cet acte peut être vu par un tiers. Cette infraction est également applicable lorsqu’elles exercent dans des lieux privés accessibles physiquement, visuellement ou auditivement au public. L’exhibition sexuelle peut aussi permettre l’incrimination d’actes de racolage, si ceux-ci présentent un caractère impudique. Des personnes prostituées ont ainsi été condamnées pour exhibition sexuelle en 2000, les juges répressifs ayant considéré que « les prostitués travestis très court vêtus sous un long manteau ouvert qui laissent apparaître leurs organes génitaux au passage des automobilistes alors qu’ils se trouvent dans un lieu public, en l’espèce un bois, se rendent coupables d’exhibition sexuelle » (389).
b) La police administrative est utilisée depuis longtemps pour limiter les troubles à la tranquillité et à la sécurité publiques
Outre le droit pénal, le droit administratif confère également certains pouvoirs aux autorités locales, qui peuvent, en cas de besoin, les exercer en matière de prostitution. Ainsi, en vertu des pouvoirs de police municipale que l’article 2212-1 du code général des collectivités territoriales (390) lui confère, le maire peut prendre des arrêtés interdisant la circulation et le stationnement des personnes prostituées. Le préfet, en tant qu’autorité de police administrative générale au niveau départemental, a également ce pouvoir. Cette possibilité, ouverte par la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale (391), a ainsi permis aux maires et aux préfets de limiter, dans les faits, les lieux où le racolage peut être pratiqué.
Ce pouvoir n’est cependant pas illimité, le juge administratif étant peu clément à l’égard des interdictions générales et absolues. Ainsi, comme le montre M. Cédric Amourette (392), un arrêté général d’interdiction de la circulation des personnes prostituées aux abords de divers lieux publics – écoles, églises, casernes, gares – dans tout le département du Rhône, pris par le préfet de ce département, a été jugé illégal par la Cour de cassation, « à raison de la prohibition générale qu’il comporte au double point de vue du temps et du lieu, et qui aboutit à l’interdiction quasi absolue de la circulation sur la voie publique d’une catégorie de personnes déterminée » (393). Pour être légaux, les arrêtés « anti-prostitution », dont l’utilisation a connu un nouvel essor à partir des années 2000 dans de nombreuses villes, doivent donc être circonscrits dans le temps et dans l’espace.
Par ailleurs, les arrêtés de police administrative ne visent pas uniquement les personnes prostituées, comme le montre M. Cédric Amourette : « les moyens utilisés par les municipalités ainsi que par les préfectures pour limiter ou gêner l’exercice de la prostitution ou du racolage sur la voie publique, ne se limitent pas aux arrêtés visant nommément les personnes prostituées. Ils peuvent concerner aussi la circulation des voitures ou le stationnement des véhicules des clients ou des personnes prostituées dans lesquels se déroulent les actes de prostitution » (394). Ainsi, comme dans le cas de l’infraction d’exhibition sexuelle, il est possible de réprimer par un même biais le racolage et l’acte prostitutionnel lui-même, dès lors qu’ils sont exercés en public.
2. L’incrimination de racolage est une constante depuis 1939
Le racolage, infraction autonome depuis 1939 (395), peut être défini, de façon générale, comme le fait d’offrir publiquement des services sexuels rémunérés. Son incrimination a donc pour but de limiter l’offre prostitutionnelle susceptible, par sa publicité, d’engendrer des troubles à l’ordre public. De simple contravention, le racolage devient un délit en 1946, par la loi Marthe Richard (396), passible de 6 mois à 5 ans d’emprisonnement et de 5 000 à 50 000 francs d’amende. Cette soudaine sévérité s’explique par l’anticipation des conséquences de la fermeture des maisons closes : on craignait alors « la multiplication des atteintes à l’ordre public et à la décence dans les rues » (397). Seul le racolage actif, qui nécessite des actes positifs, est alors réprimé.
La sévérité des peines encourues est à la hauteur des craintes ressenties. Mais elle est incohérente au regard de la répression du proxénétisme. En effet, alors que les personnes prostituées peuvent être emprisonnées jusqu’à cinq ans, les proxénètes, à cette époque, ne sont passibles que de deux ans de prison. Cette distorsion dans la répression n’échappera pas à certains observateurs, qui demanderont la contraventionnalisation de cette infraction. L’ordonnance du 23 décembre 1958 (398) abroge ainsi les dispositions de la loi du 13 avril 1946 et un décret (399) du même jour instaure deux contraventions, l’une réprimant le racolage actif, l’autre l’attitude indécente sur la voie publique de nature à provoquer la débauche.
La répression est accrue par un décret du 25 novembre 1960 (400), qui conserve toutefois la qualification de contravention à ces deux infractions. Le racolage actif est désormais passible d’une contravention de la 5e classe, alors que « ceux dont l’attitude sur la voie publique est de nature à provoquer la débauche » encourent une contravention de la 3e classe. Ces textes ne semblent pas viser directement les personnes prostituées, la débauche n’étant pas réductible à la prostitution. Toutefois, dans les faits, ces infractions ne sont appliquées qu’à des personnes prostituées.
La Cour de cassation fera cependant une application très restrictive de ces textes, n’hésitant pas à censurer les jugements qui ne caractérisent pas assez « l’attitude » dont il est question pour réprimer le racolage passif. Cette nouvelle incrimination est en effet analysée comme « une manière hypocrite de sanctionner la prostitution » (401). De fait, les services de police utilisaient cette infraction afin de réprimer la simple présence des personnes prostituées dans les rues (402). Face à la contestation des personnes prostituées, débitrices d’un nombre très élevé d’amendes, et aux recommandations du rapport de la mission d'information sur la prostitution du ministère des Droits de la femme, rédigé par M. Guy Pinot en 1975, « le nombre des contraventions dressées pour racolage passif ira en diminuant après 1975 » (403). Ainsi, seules 18 contraventions pour racolage passif furent dressées durant le premier semestre de l’année 1994 (404).
C’est donc fort logiquement que l’incrimination du racolage passif est supprimée en 1994, avec l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, « en raison de l’imprécision de l’élément constitutif de cette infraction qui aboutissait à une application aléatoire par les services de constatation » (405). Le racolage, défini comme « le fait, par tout moyen, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles », est alors puni d’une contravention de la 5e classe, prévue par l’article R. 625-8 du code pénal, et de 10 000 francs d’amende.
L’INCRIMINATION DU RACOLAGE DE 1939 À 2003
Racolage actif |
Racolage passif | |
Décret-loi du 29 novembre 1939 |
Contravention |
— |
Loi n° 46-685 du 13 avril 1946 |
Délit puni de 6 mois à 5 ans d’emprisonnement et de 5 000 à 50 000 francs d’amende |
— |
Décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 |
Contravention |
Contravention de la 1ère classe visant à condamner l’attitude indécente sur la voie publique |
Décret n° 60-1248 du 25 novembre 1960 |
Contravention de la 5e classe réprimant « ceux qui, par gestes, paroles ou écrits ou par tout autre moyen, procéderaient publiquement au racolage de personne de l’un ou de l’autre sexe, en vue de les provoquer à la débauche » |
Contravention de la 3e classe réprimant « ceux dont l’attitude sur la voie publique est de nature à provoquer la débauche ». |
Loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 |
Contravention de la 5e classe prévue par l’article R. 625-8 du code pénal. Le racolage est “le fait, par tout moyen, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles”. Il est puni d’une amende de 10 000 francs. |
— |
Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 |
Délit défini par l’article 225-10-1 du code pénal comme « le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération » puni de deux mois d’emprisonnement et 3750 euros d’amende. | |
B. L’INCRIMINATION ÉLARGIE DU RACOLAGE DEPUIS LA LOI DU 18 MARS 2003 POUR LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
L’incrimination du racolage passif est réapparue dans le droit pénal français par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure, cette fois sous forme de délit. Face à la montée en puissance des réseaux de prostitution étrangers, il s’agissait de priver momentanément les proxénètes de leurs sources de profits et de soustraire plus facilement les personnes prostituées à leur emprise.
1. Genèse et principes du délit de racolage tel qu’issu de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure
La dépénalisation du racolage passif s’est heurtée à l’arrivée massive de personnes prostituées de nationalité étrangère sur la voie publique, à la fin des années 1990. Face au mécontentement croissant des riverains, dont certains érigèrent des barrières et recrutèrent des agents de sécurité afin de limiter l’exercice de la prostitution à proximité de leurs habitations (406), une réponse pénale fut apportée au niveau national.
L’article 50 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a créé un délit de racolage public destiné spécifiquement à réprimer l’offre prostitutionnelle publique. En effet, le nouvel article 225-10-1 du code pénal incrimine « le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération ». Outre sa qualification délictuelle, le racolage est aujourd’hui passible d’une amende plus élevée que sous l’empire de l’article R. 625-8 du code pénal, abrogé en 2004 (407).
Les sanctions sont sensiblement alourdies, puisque le racolage est passible de deux mois d’emprisonnement, de 3 750 euros d’amende et de diverses peines complémentaires (interdiction de quitter le territoire, interdiction de droits civiques, interdiction de séjour…). En outre, sa qualification délictuelle confère de nouveaux pouvoirs aux services de police, notamment celui de placer en garde à vue les personnes prostituées prises en flagrant délit de racolage. C’est notamment ce qu’indique la circulaire précitée : « le fait de passer de la contravention au délit permet d’utiliser la contrainte : conduite au poste, placement en garde à vue, voire peine d’emprisonnement » (408).
Mais la nouveauté de cette infraction réside également dans l’incrimination du racolage passif. Le but affiché de la pénalisation du racolage passif est double : d’une part, limiter les troubles à l’ordre public ; d’autre part, combattre le proxénétisme. En effet, outre l’aspect relatif à l’ordre public, les débats parlementaires qui ont présidé à la création de cette infraction ont mis en avant la volonté de pénaliser les proxénètes à travers leurs victimes.
Le caractère délictuel et général de l’infraction de racolage devait donner de nouveaux moyens aux services de police pour extraire les personnes prostituées de leur milieu. En garde à vue, il est notamment possible de faire connaître ses droits à la victime de proxénétisme, de la mettre en contact avec un médecin, un interprète, voire une association de défense des victimes de la traite, comme en témoigne M. Jean-Marc Souvira (409). En outre, la personne prostituée, en garde à vue, ne rapporte pas d’argent à son proxénète, dont le trafic est dès lors gêné.
Cette nouvelle infraction a été jugée conforme à la Constitution par le juge constitutionnel (410). Il a en effet considéré que les troubles à l’ordre public engendrés par l’activité prostitutionnelle, de même que l’intention du législateur de faire ainsi obstacle à la traite des êtres humains en privant le proxénétisme de ses sources de profit, justifiaient la création de cette infraction. Le législateur a ainsi respecté l’équilibre constitutionnel entre les libertés publiques et la préservation de l’ordre public.
2. Les éléments constitutifs du délit de racolage
L’infraction de racolage exige la réunion de trois éléments constitutifs : un moyen, une publicité et une incitation à la prostitution.
a) Des moyens caractérisant l’attitude
En premier lieu, le racolage est constitué s’il s’exerce par le biais d’un « moyen ». Celui-ci est largement défini par la loi, qui vise « tout moyen », ce qui comprend le racolage passif. Une circulaire du ministre de l’Intérieur précise ainsi que « le délit intègre toutes les formes du racolage, active ou passive. Une « attitude même passive » pourra constituer le délit, dès lors qu’il y aura incitation à des relations sexuelles en contrepartie d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération » (411).
Ces moyens sont divers : gestes obscènes, postures suggestives, dénudement partiel, propos, tenue vestimentaire, attitude vis-à-vis des automobilistes... Cependant, l’incrimination du racolage passif fait que certaines attitudes, comme « le simple fait de déambuler ou de stationner sur le trottoir, d’être assise à la terrasse d’un café ou d’attendre l’autobus » (412) peuvent également être réprimées. Il appartient ensuite au juge de caractériser ces moyens utilisés pour racoler le client ; le simple fait d’être une personne prostituée ne suffit pas à caractériser l’infraction.
b) Le caractère public de l’acte de racolage
Le racolage doit ensuite être public. La publicité est acquise lorsque le racolage est exercé dans les lieux publics, mais aussi, plus largement, dans les lieux accessibles au public, comme les bars ou les halls d’hôtels. En outre, le racolage effectué dans des lieux privés (413) ou depuis celui-ci (à la fenêtre d’un appartement par exemple) est réprimé, si des tiers sont susceptibles d’être la cible de ce racolage. La publication d’une annonce dans un journal constitue un mode de publicité punissable, d’après la jurisprudence (414), de même que l’utilisation d’un service de messagerie rose du Minitel, qui est bien un « mode de communication audiovisuelle accessible au public et non une communication privée » (415).
Internet semble également constituer un espace accessible au public dans le cadre de l’infraction de racolage. C’est ainsi qu’en a jugé la cour d’appel de Reims (416) le 14 janvier 2010, en condamnant Mme H., qui diffusait des messages à finalité prostitutionnelle sur son propre site, à 500 euros d’amende. De même, les services de police semblent de plus en plus enclins à interpeller les personnes prostituées racolant sur Internet, même si les poursuites sont rarement engagées (417). En effet, il apparaît que les juges répressifs exigent une attitude plus caractérisée qu’en cas de racolage sur la voie publique (418).
Enfin, l’élément intentionnel de l’infraction réside dans le but poursuivi par le racolage : inciter à des relations sexuelles moyennant rémunération ou promesse de rémunération. Cette précision par rapport aux incriminations précédentes vise clairement à exclure du champ du délit les simples incitations à la débauche. C’est l’offre prostitutionnelle qui est explicitement visée ici.
3. Une jurisprudence restrictive et une application impressionniste
La réception de cette nouvelle incrimination par les juges répressifs n’a cependant pas été à la hauteur de l’espérance des instigateurs de cette loi. En effet, il semble que les juges répressifs analysent de façon restrictive le délit de racolage dans sa composante passive. Tout d’abord, la Cour de cassation a pu considérer que « le fait, au mois de juillet, vers minuit, de se trouver même dans un endroit connu pour la prostitution, légèrement vêtue et en stationnement au bord du trottoir et [alors] que c’était le client qui avait pris l’initiative d’aborder la prévenue en vue d’avoir des relations sexuelles avec elle » (419) ne constituait pas un comportement suffisamment précis pour caractériser le délit de racolage passif. Elle maintient ainsi un haut degré d’exigence en matière de motivation des décisions de condamnations.
Par ailleurs, l’imprécision des termes utilisés et leur généralité ont pu conduire à des différences notables d’appréciation, parfois au sein d’une même juridiction. Par exemple, a été considéré comme du racolage par le tribunal correctionnel de Toulouse (420), le fait de se tenir sur un parking et de s’approcher des voitures qui ralentissent pour discuter avec les conducteurs, alors que ne constitue pas un délit de racolage le fait de se tenir sous un abribus et de se pencher pour discuter avec un automobiliste qui s’arrête, avant de monter dans sa voiture (421).
En matière de racolage passif, la jurisprudence semble encore plus impressionniste : ont été reconnus comme étant du racolage passif le fait de porter une ombrelle multicolore dans le but d’être facilement repérable au bord d’une route connue pour la prostitution (422), ou encore le fait d’être vêtue d’une nuisette rose, ouverte et transparente à l’arrière d’une fourgonnette (423), mais également le fait de stationner, dans son propre véhicule, dans un lieu connu pour la prostitution, en attendant la sollicitation d’un client (424).
C. LE BILAN NUANCÉ DE L’INCRIMINATION DU RACOLAGE
En dépit des intentions louables du législateur, le bilan que l’on peut aujourd’hui tirer de l’incrimination du racolage passif est plutôt nuancé. En effet, son efficacité, au regard des mises en cause et des condamnations de proxénètes, dont l’augmentation était l’objectif affiché de cette infraction, est quelque peu décevante. Par ailleurs, ses effets indésirables sur les conditions d’exercice des personnes prostituées doivent conduire à une réflexion pragmatique quant à son opportunité.
1. Une mesure d’une efficacité relative
Le bilan de l’incrimination du racolage passif est aujourd’hui plutôt mitigé au regard des deux objectifs initialement poursuivis, « mettre un terme au trouble causé à l’ordre public par la prostitution visible et priver le proxénétisme de sa source de profit pour faire ainsi échec à la traite des êtres humains » (425).
Concernant la répression des troubles à l’ordre public, des effets positifs ont été enregistrés pendant les deux premières années d’application du nouveau dispositif pénal. Comme le note Mme Véronique Degermann, chef de section du parquet pour la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Paris en charge du proxénétisme (426), les résultats ont été, les premières années, spectaculaires : une très forte diminution de la prostitution de voie publique a pu être constatée. Cela était lié à la définition d’une politique pénale claire et progressive : les personnes interpellées pour racolage recevaient d’abord un rappel à la loi, avant d’être convoquées devant un juge, puis déférées et condamnées en cas de nouvelle récidive.
Mais, comme il a été indiqué par des policiers à la mission, cette politique s’est ensuite grippée. Le taux de déferrement, satisfaisant au début, a continuellement baissé, pour devenir finalement quasi-nul.
TAUX DE DÉFERREMENT AU PARQUET DES PERSONNES INTERPELLÉES
POUR RACOLAGE À PARIS
Année |
Taux de déferrement |
2005 |
38 % |
2006 |
14 % |
2007 |
8 % |
2008 |
0 % |
2009 |
0 % |
Source : Informations recueillies lors du déplacement à la préfecture de police de Paris.
D’après l’analyse de policiers entendus par la mission, c’est à la fois par idéologie et par manque de moyens que les parquets ont peu à peu rechigné à déférer les personnes mises en cause pour racolage. Cela a provoqué le découragement des services de police officiant sur le terrain, et donc la diminution des interpellations sur ce fondement. La prostitution de voie publique a dès lors repris sa place dans le paysage urbain de nombreuses agglomérations.
Mais le découragement policier tient aussi au fait que cette infraction, aux contours flous, est difficile à établir, comme l’a indiqué M. Jacques Dallest (427), procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. Ainsi, la tenue vestimentaire ne suffit pas à caractériser le délit. De fait, la majeure partie des procédures en matière de racolage est aujourd’hui déclenchée par des plaintes émanant des riverains, ce qu’a confirmé M. Olivier Messens, commissaire divisionnaire, directeur de la sûreté départementale des Bouches-du-Rhône (428). Ainsi, le nombre de personnes mises en cause pour racolage par la police nationale n’a cessé de baisser depuis 2003. En effet, alors qu’en 2004, 3 290 personnes prostituées étaient mises en cause pour racolage (429), ce chiffre est passé à 1802 en 2008 et 1341 en 2009 (430).
Tant la diminution des mises en cause que celle du taux de déferrement expliquent la réduction du nombre de condamnations en matière de racolage. En effet, si plus de 1 000 condamnations ont été prononcées sur ce fondement en 2005, soit 4 à 5 fois plus que les années antérieures, ce chiffre a régulièrement décru par la suite, comme le montre le tableau ci-dessous. La grande majorité des peines a consisté en des amendes, d’un quantum moyen de 324 euros, d’après la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice (431). Seules trente affaires sur 206 ont donné lieu à une peine d’emprisonnement en 2009, dont 27 avec sursis.
CONDAMNATIONS POUR RACOLAGE PRONONCÉES DEPUIS 2004
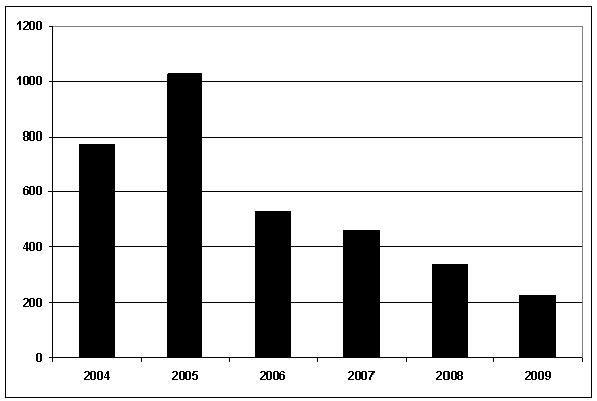
Source : direction des affaires criminelles et des grâces, octobre 2010
Il semblerait en effet que les alternatives aux poursuites soient utilisées de manière croissante par les parquets, en matière de racolage. Ainsi, ce sont près de 94,5 % des affaires poursuivables qui font l’objet d’une alternative aux poursuites. Le rappel à la loi, en particulier, est massivement utilisé (432).
Ainsi, en raison de services de police peu encouragés à enquêter et de magistrats du parquet peu enclins à déférer ces affaires, cette infraction est aujourd’hui peu poursuivie.
2. Les effets indésirables de l’incrimination du racolage passif
Certains ont pu voir, dans l’incrimination du racolage passif, un dévoiement inopportun des principes de notre droit pénal (433). En effet, le raisonnement est quelque peu tortueux qui conclut que la pénalisation des personnes prostituées a en réalité pour but de les protéger. Toutefois, plusieurs autres critiques sont adressées, sur un plan pratique cette fois, à l’incrimination du racolage passif.
a) Le simple déplacement de la prostitution et la fragilisation des personnes prostituées
La prostitution, loin d’avoir disparu, se serait seulement déplacée géographiquement après l’entrée en vigueur de la loi du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure. Ainsi, selon la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) (434), cette infraction a entraîné un déplacement des personnes prostituées, sans pour autant engendrer de baisse substantielle de la prostitution. Pour Mme Malika Amouache (435), coordinatrice du collectif Droit et prostitution, l’incrimination du racolage a conduit les personnes prostituées à déserter les centres villes et les lieux traditionnels de prostitution et à se disperser en zones périurbaines. Par exemple, certaines personnes prostituées exerçant auparavant à Paris même se trouvent désormais aux alentours de Dreux (436), en Seine-et-Marne ou dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye (437).
Les personnes prostituées, isolées en périphérie des zones urbaines, sont exposées à des risques plus élevés de violences et d’agressions. C’est notamment le cas à Lyon, comme le note M. Lilian Mathieu (438), sociologue : les personnes prostituées sont contraintes de pratiquer leur activité dans des zones isolées, ce qui les met à la merci de clients violents. De façon générale, pour l’association Grisélidis (439), les situations de violence et d’exploitation ont été exacerbées par l’incrimination du racolage passif. Mme Gabrielle Partenza (440) constate également une augmentation du nombre d’agressions dont les personnes prostituées sont victimes, notamment aux abords des routes de Seine-et-Marne, où certaines racolent depuis l’entrée en vigueur du nouveau délit.
Les personnes prostituées prennent plus de risques, comme l’expliquent les médecins du Lotus Bus (441). La peur d’être arrêtées par la police les conduit à réduire considérablement le temps de négociation avec le client. En effet, certaines d’entre elles montent directement en voiture avec le client et ne discutent plus à l’extérieur du véhicule du tarif et de la prestation, comme auparavant, car elles ne veulent pas être prises en flagrant délit de racolage (442). De fait, elles peuvent ainsi être confrontées plus souvent à des clients malveillants, dont le tri n’est plus assuré par une discussion préalable.
Pour le docteur Ai Ahn Vo Tran (443), médecin au Lotus Bus, l’inconvénient majeur de cette loi réside dans le sentiment d’impunité généré chez les clients, qui se sentent dès lors autorisés, pour certains, à maltraiter les femmes, à les séquestrer, à enlever le préservatif au dernier moment… Plus généralement, l’incrimination du racolage passif place les personnes prostituées dans une position précaire face aux clients et aux logeurs, qui tirent profit de leur statut légal de délinquantes.
Certaines personnes auditionnées ont même jugé que l’incrimination du racolage passif aurait contribué à l’augmentation du proxénétisme. Mme Françoise Gil (444) a ainsi estimé que plus les personnes prostituées sont fragilisées, plus elles représentent des proies faciles pour les proxénètes. Par ailleurs, comme l’a indiqué Mme Johanne Vernier (445), les personnes prostituées, pour faire face à ces risques nouveaux, auraient préféré se placer sous la coupe de proxénètes et de réseaux, en vue d’assurer leur protection. C’est ce qu’a confirmé Mme Claude Boucher, présidente de l’association des Amis du bus des femmes (446). Isolées, les personnes prostituées ont dû recourir à des proxénètes afin de guetter l’arrivée des forces de police.
b) La dégradation des relations avec les forces de l’ordre
Les relations avec la police sont souvent devenues plus difficiles, l’incrimination de racolage passif donnant parfois l’impression d’un arbitraire policier. D’après la CNCDH (447), les forces de l’ordre peuvent désormais interpeller et placer en garde à vue toute personne se trouvant dans l’espace public, ce qui est porteur d’arbitraire. Ainsi, Mme Françoise Gil , sociologue, a indiqué à la mission d’information avoir été elle-même arrêtée alors qu’elle discutait, sur la voie publique, avec des personnes prostituées (448).
C’est également ce qui ressort du rapport de 2006 de la commission nationale Citoyens-Justice-Police, qui associe représentants de magistrats, syndicats d’avocats et associations de défense des droits de l’homme. Il note en particulier qu’une « justice policière s’est mise en place : les preuves sont appréciées par la seule police, la garde à vue joue le rôle d’une courte peine d’emprisonnement, la confiscation de l’argent tient lieu d’amende, le rappel à la loi de jugement, les conditions dont il est assorti de mise à l’épreuve, le STIC (449) de casier judicaire » (450). De fait, de nombreux acteurs associatifs signalent une relation détériorée avec les forces de l’ordre. Plus méfiantes, les personnes prostituées n’oseraient plus porter plainte en cas d’agression.
c) Une difficulté croissante d’accès aux soins
L’action des associations est rendue difficile en raison de la désertion des lieux traditionnels de prostitution. Plus éloignées, plus mobiles, les personnes prostituées sont plus difficiles à atteindre pour les associations. Mme Malika Amouache (451) a fait état des tournées de bus rendues compliquées par l’incrimination du racolage passif et du déplacement des personnes prostituées en périphérie des zones urbaines. Les actions de prévention comme l’accès aux soins sont donc rendues plus complexes. De même, pour M. Willy Rozenbaum (452), président du Conseil national du sida, l’incrimination de racolage passif constitue un obstacle aux campagnes de prévention contre le sida.
Par ailleurs, comme l’a indiqué l’association de santé communautaire Cabiria (453), le délit de racolage, qui permet aux services de police de confisquer les camionnettes utilisées par les personnes prostituées, contraint celles-ci à exercer dans des conditions d’hygiène nettement moins favorables. Par ailleurs, Mme Nathalie Simmonot de Médecins du Monde, (454) a rapporté à la mission d’information que les préservatifs utilisés par les personnes prostituées pouvaient constituer des éléments de preuve du racolage pour les services de police, ce qui est susceptible d’avoir un impact sur le niveau de protection des personnes prostituées.
Il semble également, au vu de la baisse de la demande que l’isolement géographique a induite, que les personnes prostituées soient plus enclines à consentir à des rapports sexuels non protégés, souvent mieux rémunérés. L’incrimination du racolage donnerait en effet plus de pouvoirs aux clients dans le cadre de la négociation des tarifs et de la prestation elle-même, d’après les médecins du Lotus Bus (455). C’est aussi ce qui ressort de l’audition de Mme Françoise Gil (456), pour qui les rapports non protégés seraient plus fréquents du fait du caractère moins accessible de l’offre prostitutionnelle.
De façon générale, il semble que la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ait constitué une source supplémentaire de stress pour les personnes prostituées. De nombreux acteurs de terrain ont ainsi fait part à la mission d’information de la dégradation des conditions d’exercice de la prostitution imputable à l’incrimination du racolage passif, et ses conséquences psychologiques. Soumises à une pression constante, notamment lorsqu’elles sont en situation irrégulière, les personnes prostituées se plaindraient plus fréquemment de troubles somatiques (457). Ce stress concerne tout particulièrement les mères de famille, qui vivent depuis lors dans la crainte perpétuelle d’être arrêtées, que leur activité soit portée à la connaissance de leur entourage ou des services sociaux (458).
*
Ainsi, tandis que les services de police critiquent la faible réponse pénale donnée au délit de racolage public, l’ensemble des acteurs de terrain constate que cette incrimination a considérablement dégradé les conditions de vie des personnes prostituées. Seuls les services spécialisés dans la lutte contre la traite et le proxénétisme semblent être pleinement satisfaits de l’existence de cette infraction.
III. – LUTTER CONTRE LA TRAITE ET LE PROXÉNÉTISME :
DES PROGRÈS RESTENT À ACCOMPLIR
La lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme sont aujourd’hui au cœur de la politique pénale relative à la prostitution. Mieux comprises que l’incrimination du racolage, ces infractions font l’objet d’une collaboration poussée entre forces de l’ordre et magistrats.
D’un point de vue juridique, elles semblent couvrir l’ensemble des situations où une personne tire profit de la prostitution d’autrui. Il est ainsi possible d’affirmer qu’en la matière, aucun vide juridique n’existe aujourd’hui.
D’un point de vue pratique, les forces de l’ordre, de police ou de gendarmerie, apparaissent parfaitement armées pour faire aboutir des enquêtes sur ces fondements, la procédure pénale spécifique à ces infractions devant leur permettre de confondre les auteurs de traite et de proxénétisme par divers moyens dérogatoires autorisés par le législateur.
Si le bilan est globalement satisfaisant, d’importantes marges de progrès existent encore, notamment dans le domaine de la répression de la traite et de la protection des victimes, corollaire indispensable mais quelque peu négligé de la lutte contre la traite.
A. UN DISPOSITIF JURIDIQUE COMPLET DE LUTTE CONTRE LA TRAITE ET LE PROXÉNÉTISME
Le dispositif répressif semble, au premier abord, tout à fait adapté à la poursuite d’un objectif de répression des auteurs de traite et de proxénétisme. Au plan juridique, le champ des infractions, relativement large, comme le caractère cumulatif de l’infraction de traite et de proxénétisme, assure la poursuite d’individus agissant tout au long de la chaîne conduisant à l’exploitation sexuelle.
1. L’incrimination de proxénétisme, dont le champ est particulièrement large, permet une prise en compte de toutes les situations
Le proxénétisme fait aujourd’hui l’objet d’une répression sévère. D’une part, parce que le champ de l’incrimination permet de réprimer tous les comportements favorisant la prostitution d’autrui ; d’autre part parce que les peines applicables au proxénétisme sont variées et empreintes d’une grande sévérité.
a) Une incrimination particulièrement large, qui permet d’appréhender l’ensemble des situations d’exploitation de la prostitution d’autrui
Le proxénétisme fait l’objet d’une multiplicité d’incriminations différentes dans le code pénal, qui vont de l’aide et l’assistance à une personne prostituée à l’exploitation sexuelle en bande organisée. De fait, on peut distinguer, pour des raisons de clarté, le proxénétisme de soutien du proxénétisme de contrainte.
– Le proxénétisme de soutien rassemble toutes les infractions où l’auteur apporte son aide à une personne prostituée, protège, favorise ou tire profit de la prostitution d’autrui, sans qu’aucune contrainte ne soit nécessaire pour caractériser l’infraction.
Ainsi, « le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit, d’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui » est puni par l’article 225-5, 1° du code pénal. Cette formulation, particulièrement large, vise à réprimer aussi bien le souteneur que toute personne qui favoriserait ainsi l’exercice de la prostitution. Ont ainsi été jugés comme tels le fait de conduire une personne prostituée sur son lieu d’exercice ou le fait d’accompagner le client jusqu’à la chambre (459). De fait, le champ de cette infraction est si large que les personnes prostituées elles-mêmes, lorsqu’elles s’entraident, peuvent être passibles de cette incrimination. Il a ainsi été jugé que le prêt d’une camionnette ou la tenue d’un bar à tour de rôle relevait du proxénétisme (460). Toutefois, la jurisprudence exige, pour qualifier les faits, des actes positifs d’aide et d’assistance.
Le caractère extrêmement large des termes employés est particulièrement utile pour réprimer de nouvelles formes de proxénétisme, notamment sur Internet. Ainsi, la personne qui crée un site Internet proposant les services de personnes prostituées se rend coupable de proxénétisme par aide ou assistance. Plusieurs webmestres ont ainsi été condamnés par la justice française pour faits de proxénétisme (461). Cette incrimination présente ainsi « l’avantage de n’exiger ni habitude, ni vénalité, et de pouvoir s’adapter à toutes les formes de soutien de la prostitution » (462).
Le proxénète est aussi celui qui sert d’intermédiaire entre les clients et les personnes prostituées. Ainsi, l’article 225-6, 1° réprime « le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit, de faire office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’une se livre à la prostitution et l’autre exploite ou rémunère la prostitution d’autrui ». La jurisprudence n’exige, là encore, ni vénalité, ni habitude (463). La simple mise en relation avec une personne prostituée suffit. Ainsi, le directeur de journal qui tolère la publication d’annonces suggestives ou le dirigeant d’un serveur de « Minitel rose » se rendent coupables de proxénétisme (464).
Cette infraction est, pour MM. Jean Pradel et Michel Danti-Juan, l’une des plus utiles aujourd’hui. En effet, « cet alinéa a vocation à s’appliquer lorsque l’on souhaite atteindre et réprimer certaines activités de façade […] qui dissimulent parfois de véritables entreprises de proxénétisme » (465), comme les salons de massages ou les bars à hôtesse.
Par ailleurs, le fait de tirer profit de la prostitution d’autrui constitue une forme de proxénétisme à part entière. Cette incrimination peut s’appliquer à celui qui cohabite avec une personne prostituée sans pouvoir justifier de son train de vie par ses seuls revenus. Plus largement, toute personne qui tire profit de la prostitution d’autrui, en partage les fruits ou reçoit des subsides de la part d’une personne prostituée, est coupable de proxénétisme, en vertu de l’article 225-5, 2°, du code pénal. Outre les proxénètes exerçant sur les personnes prostituées un véritable racket, l’entourage d’une personne prostituée pourrait se voir appliquer cette incrimination. Il a ainsi été jugé en 1946 (466) que les enfants majeurs qui recevaient des subsides de la part de leur mère prostituée étaient coupables de proxénétisme. Il faut toutefois noter que ce jugement est ancien et semble unique. Enfin, l’aide à la justification de ressources fictives apportée à un proxénète est également réprimée à l’article 225-6, 2°, du code pénal.
Le proxénétisme hôtelier et immobilier constitue un pan important du proxénétisme de soutien. Si les tenanciers de maisons closes ont fait l’objet d’une certaine tolérance jusqu’en 1946, ils sont l’objet d’une répression sévère depuis. Aujourd’hui, la fourniture de locaux à une personne pour qu’elle y exerce la prostitution est sévèrement réprimée, sous toutes ses formes. L’exploitation directe ou indirecte d’un établissement de prostitution, la tolérance habituelle de la prostitution à l’intérieur d’un établissement, le fait de vendre, louer ou prêter des locaux, véhicules ou emplacements à des personnes en sachant qu’elles s’y livreront à la prostitution, sont réprimés à l’article 225-10 du code pénal.
La jurisprudence est relativement sévère. En effet, il suffit d’une seule personne prostituée pour faire d’un local accessible au public un établissement de prostitution (467). Par ailleurs, toutes les personnes qui participent de près ou de loin à la tenue d’un établissement de prostitution, quel que soit leur statut juridique ou le montage financier derrière lequel elles se cachent, sont appréhendées par le code pénal, dès lors qu’ils ont connaissance des activités de prostitution, le proxénétisme étant un délit intentionnel. Une ancienne jurisprudence va jusqu’à punir ceux qui ont toléré la recherche de clients par des personnes prostituées, dans leurs établissements (468). De même, le propriétaire qui a connaissance de l’activité prostitutionnelle de la personne à qui il a loué un logement après signature du bail se rend coupable de proxénétisme immobilier s’il ne résilie pas le bail (469).
– Le proxénétisme de contrainte vise quant à lui l’ensemble des infractions consistant à exercer une pression quelconque sur une personne en vue de l’amener à se prostituer. Il est aujourd’hui réprimé par le biais d’infractions spéciales comme par celui de circonstances aggravantes.
L’article 225-5, 3°, du code pénal réprime en premier lieu l’incitation à la prostitution par « le fait par quiconque, de quelque manière que ce soit, d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer une pression sur elle pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire ». La qualification d’entraînement est souvent utilisée contre les réseaux de prostitution. Il consiste, selon la jurisprudence, à emmener physiquement quelqu’un dans un lieu déterminé ou à le détourner de son milieu familial dans le but de permettre sa prostitution. Enfin, les pressions mentionnées par le code pénal visent toutes les formes de contrainte, y compris psychologique, tendant à inciter quelqu’un à se prostituer.
Le code pénal incrimine également de façon aggravée le fait d’inciter quelqu’un à se prostituer en dehors du territoire de la République ou à son arrivée sur le territoire. Le quatrième alinéa de l’article 225-7 vise ainsi à réprimer le proxénétisme international et la récupération des personnes fraîchement immigrées, en situation précaire, par les réseaux de prostitution. De la même façon, l’article 225-6, 4°, du code pénal réprime le fait d’entraver l’action des associations et des services de l’État en faveur de la prévention de la prostitution et de la réinsertion des personnes prostituées. Cette disposition a vocation à punir les proxénètes qui tenteraient d’exercer des pressions sur des personnes quittant la prostitution et soutenues par des associations. Le champ couvert par cette incrimination est particulièrement large, puisqu’il va des pressions psychologiques comme les menaces, à la contrainte physique.
Plusieurs autres circonstances aggravantes participent de la notion de proxénétisme de contrainte. En effet, le législateur a alourdi les peines encourues dans de nombreux cas : lorsque la victime est mineure ou vulnérable ; lorsque l’incitation est exercée par un ascendant, une personne abusant de son autorité ou une personne appelée à lutter contre la prostitution ou à participer au maintien de l’ordre ou à la protection de la santé ; lorsqu’une arme, une contrainte, une menace ou une manœuvre dolosive est employée. Ainsi, dans tous les cas où le consentement de la victime a été altéré, le proxénétisme est aggravé. Par ailleurs, le fait d’agir à plusieurs ou en bande organisée, via un réseau de télécommunication, comme le fait de recourir à des actes de torture et de barbarie sont également des circonstances aggravantes.
LES DIFFÉRENTES INFRACTIONS DE PROXÉNÉTISME
Proxénétisme et assimilé (art. 225-5 et 225-6 CP) |
Aider, assister ou protéger la prostitution d’autrui |
Tirer profit de la prostitution d'autrui, en partager les produits ou recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution |
Embaucher, entraîner ou détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire |
Faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui |
Faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives |
Ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution |
Entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution |
Proxénétisme hôtelier (art. 225-10 CP) |
Détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution |
Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, accepter ou tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution |
Vendre ou tenir à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution |
Vendre, louer ou tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d'une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution |
Proxénétisme aggravé (art. 225-7 CP) |
À l’égard d’un mineur |
À l’égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur |
À l’égard de plusieurs personnes |
À l’égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République |
Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions |
Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public |
Par une personne porteuse d'une arme |
Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives |
Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée |
Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications |
Proxénétisme aggravé (art. 225-7-1 CP) |
À l’égard d’un mineur de 15 ans |
Proxénétisme aggravé (art. 225-8 CP) |
Commis en bande organisée |
Proxénétisme aggravé (art. 225-9 CP) |
Commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie |
b) Un ensemble complet de peines
Les peines encourues sont sévères, certains cas de proxénétisme aggravés recevant une qualification criminelle. De façon générale, le proxénétisme simple et les actes assimilables au proxénétisme sont passibles de 7 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Les faits de proxénétisme hôtelier et immobilier sont passibles de 10 ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende. Les formes de proxénétisme aggravé sont punies de 10 ans d’emprisonnement et de 1 500 000 euros d’amende. Ce quantum est porté 15 ans de réclusion criminelle lorsque les faits sont commis à l’égard d’un mineur de moins de 15 ans, à 20 ans lorsqu’ils sont commis en bande organisée et à la réclusion criminelle à perpétuité en cas d’actes de torture et de barbarie.
Outre les peines d’emprisonnement, de réclusion et d’amende, de nombreuses peines complémentaires sont susceptibles d’être prononcées par les juridictions répressives. En effet, en matière de proxénétisme simple, l’article 225-50 du code pénal prévoit six interdictions et privations de droit différentes. Le juge pénal peut prononcer à titre complémentaire l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale qui a permis la réalisation de l’infraction. Ce sera le cas, par exemple, de l’activité de gérant d’un institut de massage, si cette activité est à l’origine de l’infraction. Le juge peut aussi interdire au condamné d’exploiter, de participer ou d’exercer dans un certain nombre d’établissements énumérés dans la décision de condamnation. Cette peine peut être prononcée à perpétuité.
L’interdiction de paraître dans certains lieux est la peine complémentaire la plus fréquemment prononcée à l’encontre des proxénètes (470). En outre, celui qui s’est rendu coupable de proxénétisme peut se voir interdire, pendant cinq ans, le port d’une arme soumise à autorisation. Enfin, le juge répressif peut contraindre le proxénète à demeurer sur le territoire français, ou au contraire, s’il est étranger, à le quitter. Concernant cette dernière peine, il convient de noter que « la jurisprudence n’hésite […] pas à prononcer des interdictions définitives de territoire français contre les étrangers qui exploitent la prostitution des « femmes en détresse » ou de jeunes filles d’origine étrangère » (471). Des peines de confiscation peuvent également être prononcées.
En matière de proxénétisme hôtelier, c’est fort logiquement que le juge pénal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ayant permis la commission de l’infraction. Il peut en outre ordonner un retrait de licence ou la confiscation du fonds de commerce. L’arsenal répressif semble donc particulièrement complet.
PEINES PRINCIPALES ET COMPLÉMENTAIRES ENCOURUES PAR LES AUTEURS
DE PROXÉNÉTISME
Infraction |
Peine principale |
Peines complémentaires |
Proxénétisme simple (art. 225-5 CP) et assimilé (art. 225-6 CP) |
7 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende |
Pour les personnes physiques uniquement Art. 225-20 CP - Interdiction des droits civiques, civils et de famille ; - Interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle commerciale ou industrielle ; - Interdiction de séjour ; - Interdiction d’exploiter, d’être employé ou d’avoir des participations financières dans des établissements publics ou ouverts au public ; - Interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation ; - Interdiction de quitter le territoire français ; - Interdiction d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ; - Obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale. Art. 225-21 CP Interdiction de territoire pour les personnes condamnées de nationalité étrangère. Pour les personnes physiques ou morales Art. 225-24 CP - Confiscation des biens mobiliers ayant servi à la commission de l’infraction ainsi que des produits de l’infraction ; - Remboursement des frais de rapatriements de la ou les victimes. Art. 225-25 CP - Confiscation de tout ou partie des biens. |
Proxénétisme aggravé (art. 225-7 CP) |
10 ans d’emprisonnement et 1 500 000 euros d’amende | |
Proxénétisme aggravé (art. 225-7-1CP) : à l’égard d’un mineur de 15 ans |
15 ans de réclusion criminelle et 3 000 000 euros d’amende | |
Proxénétisme aggravé (art. 225-8 CP) : commis en bande organisée |
20 ans de réclusion criminelle et 3 000 000 euros d’amende | |
Proxénétisme aggravé (art. 225-9 CP) : acte de tortures et de barbarie |
Réclusion criminelle à perpétuité et 4 500 000 euros d’amende | |
Proxénétisme hôtelier (art. 225-10 CP) |
10 ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende |
En plus des peines complémentaires communes aux autres formes de proxénétisme, les personnes physiques ou morales coupables de proxénétisme hôtelier encourent les peines complémentaires suivantes (art. 225-22 CP) : - Retrait définitif de licence de débit de boissons ou de restaurant ; - Fermeture définitive ou temporaire de tout ou partie de l’établissement ; - Confiscation du fonds de commerce. |
2. L’infraction de traite des êtres humains vise à assurer une répression efficace des réseaux internationaux de prostitution
L’incrimination de la traite des êtres humains trouve son origine dans le droit international. En effet, diverses conventions (472) ratifiées par la France, comme la Convention de 1949 pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui ou le Protocole de Palerme de 2000 (473), ont conduit le législateur français à créer, en 2003, une infraction de traite des êtres humains.
La traite des êtres humains fait l’objet, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, d’un titre spécial dans le code pénal. L’article 225-4-1 du code pénal définit la traite des êtres humains comme « le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit ».
La définition de la traite des êtres humains est particulièrement large. Les actes incriminés couvrent l’ensemble de l’activité de la filière à l’origine de la traite, du recrutement à l’hébergement, en passant par le transport. Cette incrimination a l’avantage, par rapport à l’infraction de proxénétisme, de rechercher la culpabilité d’auteurs qui officient en amont (474).
Dans un premier temps, cette infraction ne visait que la mise à disposition de personnes à un tiers en vue de la commission de certains faits. Le traitant qui organisait la traite pour son propre compte échappait alors à la répression, lacune qui a été corrigée en 2007 (475). En outre, les moyens employés par l’auteur et l’absence de consentement de la victime ne sont pas des éléments constitutifs de l’infraction. Le législateur français a donc été plus loin que ce que les traités internationaux prévoyaient (476). Il a ainsi étendu les dispositions relatives aux enfants du Protocole de Palerme et de la décision-cadre de 2002, à toutes les personnes majeures.
Le champ de l’infraction est particulièrement vaste car « l’incrimination de traite des êtres humains est parfaitement susceptible de s’appliquer à des faits commis en France par une seule personne » (477), le franchissement d’une frontière et la pluralité d’auteurs étant inutiles à la caractérisation de l’infraction. Par ailleurs, comme l’a indiqué M. Frédéric Maury (478), magistrat au bureau de la lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme et le blanchiment, la commission des faits par les victimes n’est pas indispensable à la caractérisation de l’infraction, l’intention seule de l’auteur suffisant à constituer l’infraction.
En outre, la répression de la complicité et de la tentative de l’infraction de traite des êtres humains permet de remonter plus encore dans la chaîne de la traite. Ainsi, le seul fait de fournir « en connaissance de cause les coordonnées d’une personne à un tiers qui contacte cette dernière afin de la recruter en vue de l’exploiter » (479), même si l’exploitation sexuelle n’a pas lieu, constitue une complicité de tentative de traite. Enfin, il est possible de recourir à la notion d’association de malfaiteurs en vue de la traite des êtres humains dès que plusieurs personnes forment une entente en vue de commettre l’infraction de traite. Dès lors, celle-ci apparaît bien comme une « infraction obstacle censée permettre d’intervenir le plus en amont possible de l’exploitation d’une personne afin d’en empêcher la réalisation » (480).
L’infraction de traite des êtres humains connaît peu ou prou les mêmes circonstances aggravantes que le proxénétisme. Ainsi, certaines caractéristiques de la victime ou de l’auteur peuvent conduire à aggraver la répression.
LES PEINES ENCOURUES PAR LES AUTEURS DE TRAITE DES ÊTRES HUMAINS
Traite des êtres humains (art. 225-4-1 CP) 7 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende |
Le fait en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin […] de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme […]. |
Traite aggravée (art. 225-4-2 CP) 10 ans d’emprisonnement et 1 500 000 euros d’amende |
À l’égard d’un mineur |
À l’égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur |
À l’égard de plusieurs personnes |
À l’égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République |
Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications |
Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente |
Avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manœuvres dolosives visant l'intéressé, sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec lui |
Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime de l'infraction prévue à l'article 225-4-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions |
Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public |
Traite aggravée (art. 225-4-3 CP) 20 ans d’emprisonnement et 3 000 000 euros d’amende |
Commise en bande organisée |
Traite aggravée (art. 225-4-4 CP) Réclusion criminelle à perpétuité et 4 500 000 euros d’amende |
Commise en recourant à des tortures ou des actes de barbarie |
3. Des moyens et des structures dédiés pour assurer l’effectivité de la répression
La répression des faits de proxénétisme et de traites des êtres humains s’appuie sur des moyens spécifiques, notamment procéduraux, et des structures dédiés à l’enquête et au jugement de ces infractions particulières.
a) Des procédures dérogatoires en matière de proxénétisme et de traite des êtres humains
Le proxénétisme et la traite connaissent des dispositions procédurales particulières, qui visent notamment à faciliter les poursuites en matière de proxénétisme hôtelier et de proxénétisme sur Internet.
Le code de procédure pénale prévoit en effet, depuis 1994, un titre spécifique pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs. En particulier, son article 706-35 renforce les pouvoirs d’enquête des forces de police, puisque celles-ci peuvent procéder de façon dérogatoire à des visites, des perquisitions et des saisies « à toute heure du jour et de la nuit » dans les établissements susceptibles d’abriter la prostitution d’autrui. Aucune flagrance ni aucune commission rogatoire ne sont alors requises, ce qui en fait une arme particulièrement efficace en matière de proxénétisme hôtelier (481). Enfin, l’article 706-36 du même code autorise le juge d’instruction à fermer provisoirement ces établissements.
En matière de proxénétisme et de traite sur Internet, les services de police disposent également de moyens spécifiques, adaptés à cette nouvelle forme de criminalité. En effet, depuis la loi du 5 mars 2007 (482), les officiers de police judiciaire de certains services spécialisés peuvent, sur commission rogatoire, entrer en contact sous une fausse identité avec les auteurs des infractions de proxénétisme et de traite, dans le but de faciliter la constatation de l’infraction.
Enfin, en matière de proxénétisme et de traite des êtres humains aggravés, le code de procédure pénale prévoit un ensemble important de mesures dérogatoires au droit commun. La loi du 9 mars 2004 (483) a en effet introduit, au titre XXV du code de procédure pénale, la possibilité de recourir à de nouveaux moyens d’investigation. À ce titre, la garde à vue peut être prolongée jusqu’à quatre jours, les perquisitions peuvent avoir lieu en dehors des heures légales, des écoutes téléphoniques ainsi que la sonorisation de certains lieux ou véhicules peuvent être organisées. En outre, l’infiltration des réseaux de prostitution est également possible. Enfin, des mesures conservatoires peuvent être prises à l’encontre des auteurs de l’infraction, afin que soient assurés le paiement des amendes et l’indemnisation de la victime.
b) Des droits spécifiques accordés aux victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme
Les victimes se voient reconnaître des droits particuliers en matière de traite et de proxénétisme, dans le but de faciliter le déclenchement des poursuites.
Les victimes étrangères peuvent bénéficier d’un droit au séjour en échange de leur coopération. L’article 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit en effet, depuis 2003, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » peut être délivrée à la personne de nationalité étrangère qui porte plainte ou témoigne contre l’auteur d’une infraction de traite ou de proxénétisme. Les services de police et de gendarmerie doivent également leur notifier, dans une langue qu’elles comprennent, le fait qu’elles disposent d’un délai de réflexion de trente jours avant de porter plainte ou de témoigner. La délivrance de ce titre de séjour d’une durée maximale de six mois n’est pas conditionnée à une condamnation pénale ou au démantèlement du réseau. Cependant, en cas de condamnation définitive de l’auteur, une carte de résident peut leur être accordée.
Par ailleurs, afin de faciliter le démantèlement des réseaux, l’allocation temporaire d’attente (ATA) peut être accordée à la personne étrangère qui porte plainte ou témoigne contre l’auteur de faits de traite ou de proxénétisme. Attribuée par les services de la préfecture et administrée par Pôle Emploi, cette allocation est versée durant toute la durée de validité de la carte de séjour.
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organise également la protection des victimes. Ainsi, en cas de nécessité, son article L. 316-6 prévoit que la personne qui a porté plainte ou accepte de témoigner peut bénéficier d’une protection policière pendant toute la durée de la procédure pénale. Dans certains départements, un policier référent est attribué à la victime et l’aide dans ses démarches (484).
Les victimes peuvent aussi bénéficier du dispositif de protection des témoins prévu par le code pénal. Leur domiciliation au commissariat ou auprès de leur avocat est alors possible. Elles peuvent, en application de l’article 706-58 du code de procédure pénale, témoigner de manière anonyme si l’audition est susceptible de les mettre, elles ou leurs proches, en danger. Enfin, l’article 706-71 du même code permet aux victimes d’être auditionnées à distance, sans être confrontées aux prévenus, par le biais de moyens de télécommunications.
Par ailleurs, des infractions pénales protègent les victimes. Il s’agit notamment de l’article 434-5 du code pénal qui punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende l’auteur de menaces ou d’actes d’intimidation commis en vue de déterminer la victime d’un crime ou d’un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter.
De même, lorsque sa protection rend nécessaire un changement de résidence, la victime peut bénéficier du dispositif d’accueil sécurisant des victimes de traite, Ac.Sé, géré par l’association Accompagnement lieu d’accueil (ALC), sur le fondement de l’article 42 de la loi pour la sécurité intérieure, qui énonce que « toute personne victime de l'exploitation de la prostitution doit bénéficier d'un système de protection et d'assistance, assuré et coordonné par l'administration en collaboration active avec les divers services d'interventions sociales. » Dans ce cadre, des places dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) sont ouvertes aux victimes de la traite des êtres humains dans des conditions sécurisantes.
LE DISPOSITIF D’ACCUEIL SÉCURISANT AC.SÉ Le dispositif national d’accueil et de protection des victimes de la traite des êtres humains, initié en octobre 2001, est géré par l’association Accompagnement Lieu d’Accueil (ALC), suivant une convention conclue avec le ministère chargé des affaires sociales. Le dispositif Ac.Sé repose aujourd’hui sur un réseau de 40 centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) partenaires répartis sur l’ensemble du territoire national, qui accueillent les victimes de la traite des êtres humains, françaises ou étrangères, dans des conditions sécurisantes, notamment lorsqu’un éloignement géographique est nécessaire. Un comité de pilotage permet de suivre l’activité du dispositif et sa conformité aux objectifs fixés. Le renouvellement de la convention pluriannuelle d’objectifs donne lieu à une évaluation des comptes et de la gestion par ALC. Il est financé par la direction générale de la cohésion sociale, à hauteur de 180 000 euros, et par la Ville de Paris. |
Enfin, les associations de lutte contre le proxénétisme ou d’aide aux personnes prostituées se sont vues reconnaître, depuis la loi du 9 avril 1975 (485), le droit de se constituer partie civile. Cette possibilité est toutefois soumise à la reconnaissance d’utilité publique de la dite association. La présence des associations aux procès est souvent d’une aide précieuse pour les victimes de proxénétisme et de traite des êtres humains (486), qui ne souhaitent pas toujours endurer un procès pénal relativement long et risquer des représailles.
c) Des structures d’enquête et de jugement dédiées à la lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains
En matière d’exploitation de la prostitution d’autrui, outre les brigades de répression du proxénétisme, rattachées à la police nationale, un office spécialisé a été mis en place, en 1958 (487), pour lutter contre la traite des êtres humains. L’office central de lutte contre la traite des êtres humains (OCRTEH) a deux missions principales. D’une part, il rassemble les informations et coordonne l’action des services de police et de gendarmerie en matière de proxénétisme et de traite des êtres humains. D’autre part, il est saisi des affaires les plus importantes, d’envergure nationale et internationale. Dans ce cadre, l’OCRTEH collabore avec les forces de police françaises et étrangères, en matière de lutte contre les réseaux de prostitution.
Les affaires de proxénétisme et de traite peuvent être confiées à des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS), mises en place en octobre 2004 en application de la loi du 9 mars 2004 (488). Huit juridictions, implantées à Paris, Lyon, Marseille, Lille, Rennes, Bordeaux, Nancy et Fort-de-France, sont ainsi saisies, par les parquets, des affaires mettant en jeu des réseaux structurés avec une dimension internationale importante, nécessitant généralement des investigations à l’étranger (489).
Ces juridictions de droit commun ont la particularité d’être composées de magistrats spécialisés dans des enquêtes longues et complexes. Ces magistrats sont également mieux à même de travailler dans un cadre international. Ils disposent en effet d’un nombre important de correspondants et peuvent partager des informations avec les magistrats étrangers via des procédures bien maîtrisées (490). Les JIRS permettent ainsi de mener à bien des investigations qui requièrent une grande technicité, sans risquer le vice de procédure, et de les mener rapidement, du fait notamment des liens forts qui s’établissent entre les magistrats des JIRS et les services de police.
B. LA MISE EN œUVRE DU DISPOSITIF RÉPRESSIF PAR L’APPAREIL JUDICIAIRE CONNAÎT CEPENDANT UN BILAN NUANCÉ
Si l’application de l’infraction de proxénétisme semble plutôt satisfaisante, le bilan est plus nuancé en ce qui concerne l’utilisation de l’infraction relative à la traite des êtres humains et la mise en œuvre des dispositions tendant à protéger les victimes de la traite.
1. La mise en œuvre de l’infraction de proxénétisme semble plutôt satisfaisante
Il apparaît que l’infraction de proxénétisme est relativement satisfaisante, tant du point de vue des services de police et de gendarmerie que des magistrats. Toutefois, son utilisation n’est pas exempte de critiques tant juridiques que pratiques.
a) L’infraction de proxénétisme, largement utilisée par les tribunaux, apparaît aujourd’hui comme un outil juridique satisfaisant
De façon générale, l’infraction de proxénétisme semble satisfaire les services de police et de gendarmerie comme les magistrats.
C’est notamment ce dont a fait part M. Alain Philibeaux, premier vice-président au tribunal de grande instance de Paris, magistrat instructeur à la JIRS (491), pour qui tant les infractions que les procédures sont particulièrement adaptées. Dans le domaine policier, l’existence d’un office et de services spécialisés est également un avantage considérable. En effet, l’OCRTEH, dans la mesure où il n’est pas contraint par la nécessité de recueillir des témoignages pour agir, adopte fréquemment une démarche proactive dans le domaine de la traite des êtres humains (492). Il démantèle ainsi chaque année de nombreux réseaux de prostitution.
De même, la coopération européenne et internationale constitue une arme très efficace en matière de proxénétisme international, notamment avec la création d’équipes communes d’enquête, visant à éviter les problèmes de limite de compétences dues aux frontières nationales, et le mandat d’arrêt européen qui facilite la répression (493).
De fait, le seuil de tolérance légal étant plus bas en France qu’ailleurs, il semble que la répression ait un effet sur l’activité des réseaux de prostitution comme des personnes prostituées. Ainsi, selon M. Jean-Marc Souvira (494), les peines exemplaires prononcées par les juridictions ont pour effet de limiter fortement le développement de la prostitution de rue par rapport à nos voisins européens. Par ailleurs, d’après Mme Véronique Escolano, substitut générale à la cour d’appel de Lyon déléguée à la politique associative (495), l’infraction de proxénétisme correspond bien à la tradition juridique française et repose sur une jurisprudence bien établie, ce qui explique qu’elle soit bien utilisée par l’ensemble des acteurs.
Les chiffres fournis par le ministère de la Justice témoignent de la rigueur continue de la répression depuis quelques années (496). Ainsi, en 2009, ce sont près de 932 condamnations qui ont été prononcées pour proxénétisme et proxénétisme aggravé.
NOMBRE DE CONDAMNATIONS ANNUELLES PRONONCÉES POUR PROXÉNÉTISME ET PROXÉNÉTISME AGGRAVÉ DE 2000 A 2009
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | |||
Total proxénétisme simple |
501 |
436 |
370 |
373 |
388 |
371 |
395 |
423 |
457 |
434 | ||
Total proxénétisme aggravé |
319 |
225 |
305 |
711 |
592 |
627 |
705 |
669 |
512 |
498 | ||
TOTAL |
820 |
661 |
675 |
1084 |
980 |
998 |
1100 |
1092 |
969 |
932 | ||
Source : direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice (les données 2009 sont provisoires).
b) Toutefois, cette incrimination fait l’objet de critiques
Au plan juridique, les diverses infractions relatives au proxénétisme sont parfois redondantes. Ainsi, l’infraction d’incitation à la prostitution porte sur le fait d’embaucher, d’entraîner ou de détourner quelqu’un en vue de la prostitution. Or, pour certains (497), le détournement fait double emploi avec l’entraînement. En effet, l’entraînement suppose, par définition, un détournement du milieu initial.
Le champ relativement large de l’infraction de proxénétisme peut avoir des conséquences néfastes sur les personnes prostituées elles-mêmes et certains de leurs droits. Ainsi, de nombreuses associations (498) dénoncent le caractère injuste du proxénétisme de soutien lorsqu’il réprime l’entraide entre personnes prostituées. Mme Florence Garcia, directrice de l’association Cabiria, a indiqué que les personnes prostituées pouvaient être coupables de proxénétisme par aide et assistance dans le cadre du prêt d’un appartement (499). Il en va de même dans le cadre de prêt de camionnettes ou de tout autre véhicule utilisé à des fins prostitutionnelles. « Ceci aboutit à pénaliser la solidarité entre personnes prostituées », a estimé Mme Florence Garcia.
De même, la vie privée des personnes prostituées subit les conséquences de l’incrimination large du proxénétisme (500). En effet, le conjoint, le compagnon ou les enfants majeurs de personnes prostituées pourraient également se voir incriminés pour proxénétisme sur le fondement du 2° de l’article 225-5 du code pénal, qui prohibe le fait de « recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution » et du 3° de l’article 225-6, qui sanctionne le fait de « ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution. » Dans ce domaine, des conjoints de personnes prostituées ne parvenant pas à justifier seuls de leur train de vie ont déjà été condamnés. Cette qualification est de fait également applicable aux enfants des personnes prostituées, même si la dernière condamnation sur ce fondement semble remonter à 1946.
Enfin, la pénalisation du proxénétisme hôtelier, qui interdit notamment « de vendre ou de tenir à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution » (501), induirait l’existence d’un « système locatif souterrain », selon l’expression de Mme Julie Sarrazin, co-directrice de l’association Grisélidis (502). Ce marché parallèle se caractériserait par des loyers exorbitants et des menaces de révéler l’activité de prostitution. Cette situation a également été soulignée par Maîtresse Gilda, porte-parole nationale du STRASS (503).
c) Cette qualification est appliquée de façon variable par les juridictions
La pratique fait également l’objet de critiques, la qualification de proxénétisme paraissant insuffisamment ou mal appliquée.
Ainsi, il apparaît, dans la pratique de la police comme de la justice, que la circonstance aggravante de contrainte est insuffisamment recherchée (504). Par exemple, dans le cas où une personne est contrainte de se prostituer dans un local donné, il suffira de se fonder sur la fourniture d’un local en vue de la prostitution, punie de sept ans d’emprisonnement, au lieu de qualifier l’infraction de proxénétisme aggravé, puni de dix ans d’emprisonnement. De même, la correctionnalisation des infractions de proxénétisme par omission d’une circonstance aggravante, dans le but d’éviter les cours d’assises, semble relativement courante (505).
Enfin, le faible nombre de mises en cause comme de condamnations en matière de prostitution de mineurs ne semble pas correspondre à la réalité prostitutionnelle. En effet, d’après les chiffres fournis par le ministère de la Justice, seules 6 condamnations ont été prononcées en 2009 pour proxénétisme sur des mineurs de quinze ans, et seulement 25 pour des mineurs de quinze à dix huit ans. Si la faiblesse de ce dernier chiffre peut s’expliquer par la difficulté de la détermination de l’âge des victimes, il n’en reste pas moins que le nombre de condamnations impliquant des mineurs de moins de quinze ans paraît faible au regard des données avancées par les associations (506).
De la même façon, les condamnations avec circonstance aggravante de vulnérabilité de la victime, au nombre de 7 en 2009, semblent dérisoires lorsque l’on considère la définition européenne de la situation de vulnérabilité, livrée par la décision-cadre de lutte contre et prévention de la traite des êtres humains et protection des victimes, devant abroger celle de 2002, et dont l’article 2 dispose qu’« il y a abus d’une situation de vulnérabilité lorsque la personne n’a pas d’autre choix véritable ou acceptable que de se soumettre à cet abus ». Dans une telle perspective, la circonstance aggravante de particulière vulnérabilité pourrait s’appliquer à un nombre important de victimes du proxénétisme.
CONDAMNATION POUR PROXÉNÉTISME SUR MINEUR OU PERSONNE VULNÉRABLE
ENTRE 2005 ET 2009
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total | |
Proxénétisme aggravé : victime mineure de quinze ans |
8 |
2 |
1 |
0 |
6 |
17 |
Proxénétisme aggravé : victime mineure de 15 à 18 ans |
31 |
40 |
38 |
21 |
25 |
158 |
Proxénétisme aggravé : victime particulièrement vulnérable |
5 |
5 |
6 |
1 |
7 |
24 |
Source : direction des affaires criminelles et des grâces, ministère de la Justice.
Il est également des domaines où la qualification de proxénétisme semble insuffisamment employée. L’infraction de proxénétisme mériterait ainsi d’être plus utilisée lorsque l’infraction est commise par le biais de petites annonces dont la finalité ne peut échapper à personne. Au vu du nombre important de petites annonces non équivoques publiées dans de nombreux quotidiens régionaux, il semble que la qualification de proxénétisme soit, dans ce domaine, insuffisamment recherchée.
Enfin, le rôle des juridictions interrégionales spécialisées est critiqué. En effet, le proxénétisme et la traite des êtres humains ne concernent que 4,2 % des affaires traitées par les JIRS (507). Pour Mme Myriam Quémener (508), cela témoigne de la faible spécialisation des JIRS dans le domaine de la prostitution, la grande majorité de leurs affaires portant sur le trafic de stupéfiants. De fait, la compétence des JIRS en matière de proxénétisme aggravé et de traite des êtres humains n’est pas obligatoire. De même, les procédures dérogatoires au droit commun comme les techniques spéciales d’enquête peuvent être utilisées aussi bien par les JIRS que par les juridictions ordinaires.
2. La qualification pénale de traite des êtres humains est insuffisamment utilisée
La nouvelle infraction de traite des êtres humains semble avoir du mal à trouver sa place dans le droit pénal français, alors même qu’elle présente des avantages considérables en termes de procédure pénale.
a) Une infraction qui semble peu utilisée en dépit des avantages qu’elle présente
La qualification de traite des êtres humains semble aujourd’hui sous-utilisée par la justice. En effet, en 2009, seules trois condamnations pour traite des êtres humains ont été prononcées par les juridictions répressives, d’après les éléments d’information transmis par le ministère de la Justice. Parmi celles-ci, il n’est pas possible de déterminer la part des condamnations dues à la traite ayant pour finalité la prostitution d’autrui. Ce chiffre semble particulièrement faible au regard de la proximité de cette infraction avec certaines formes de proxénétisme. Néanmoins, les peines prononcées sur son fondement apparaissent relativement lourdes, ce qui laisse à penser que les juridictions réservent cette infraction aux formes les plus graves d’exploitation (509).
Cependant, plus d’une vingtaine de procédures (510) sont en cours pour lesquelles l’incrimination de traite a été retenue et au moins trois jugements ayant donné lieu à dix condamnations (511) ont été prononcées sur ce fondement en 2010. De fait, les mises en cause, les informations judiciaires et les condamnations se font de plus en plus nombreuses chaque année, laissant ainsi présager la multiplication prochaine des condamnations prononcées sur le fondement de la traite des êtres humains (512).
NOMBRE DE JUGEMENTS AYANT DONNÉ LIEU À UNE CONDAMNATION EN MATIÈRE DE TRAITE DES ÊTRES HUMAINS DE 2006 À 2010
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2 |
4 |
2 |
3 |
3 |
Source : direction des affaires criminelles et des grâces, ministère de la Justice (les données 2010 sont provisoires).
Par ailleurs, la circulaire de politique pénale de 2009 (513) a demandé aux services que soit portée une attention particulière à l’infraction de traite des êtres humains, considérant que cette infraction n’est pas exclusive de celle de proxénétisme. La circulaire insiste par ailleurs sur le fait qu’en plus des droits reconnus aux victimes dans la procédure engagée contre la traite des êtres humains, la poursuite de cette infraction a pour effet de faciliter la coopération internationale en matière de démantèlement de réseaux de prostitution.
En effet, d’après M. Alain Philibeaux (514), en l’absence d’incriminations de proxénétisme équivalentes en droit étranger, la coopération internationale n’aboutit que rarement sur ce seul fondement. Ainsi, les magistrats suisses, par exemple, ne répondent pas favorablement aux commissions rogatoires internationales pour proxénétisme. Pour pallier cette différence qui peut être source de difficultés en matière de coopération internationale, les magistrats français poursuivent sur le double fondement du proxénétisme et de la traite, ce qui a grandement amélioré la coopération judiciaire internationale. L’infraction de traite, issue des traités internationaux, permet à de nombreux pays de parler le même langage (515). De même, au plan européen, l’infraction de traite rend plus facile l’utilisation du mandat d’arrêt européen, puisqu’elle fait partie des 32 infractions ne nécessitant pas de double incrimination.
b) Les causes de la faible utilisation de l’infraction de traite sont diverses
La faiblesse de l’utilisation de la qualification juridique de traite des êtres humains s’explique notamment par le fait qu’elle est difficile à caractériser. En effet, dans le cas de la traite des êtres humains, il convient de prouver les faits de recrutement, de transport ou d’hébergement et le but, l’exploitation sexuelle d’autrui. Par ailleurs, la preuve d’une rémunération, d’une promesse de rémunération ou d’un avantage, est particulièrement difficile à apporter, en dépit des termes relativement larges employés par le législateur (516). En effet, l’avantage en question peut être moral, affectif ou psychologique, et non pas seulement financier. De même, il suffit d’un simple « échange » pour que l’infraction soit caractérisée : le bénéficiaire de la rémunération ou de l’avantage peut donc être l’auteur comme la victime.
La principale difficulté semble résider, pour les juridictions, dans le fait que certains éléments de l’infraction, notamment le recrutement, la rémunération ou l’avantage, sont souvent réalisés en dehors du territoire français, ce qui suppose le déploiement d’une coopération internationale relativement importante. Si cette dernière est facilitée par la qualification de traite des êtres humains, elle peut cependant rencontrer des obstacles en pratique.
Par ailleurs, il semble qu’un élément d’ordre culturel participe également de la sous-utilisation de cette infraction. Certains reprochent en effet à cette infraction sa « rédaction lourde, complexe et très anglo-saxonne » (517), qui ne correspond pas à la tradition juridique française. Alors que l’infraction de proxénétisme, pratiquée depuis fort longtemps par les services de police, fait l’objet d’une jurisprudence fournie, l’infraction de traite des êtres humains, issue du droit international et européen, est tout à fait récente. Il est donc probable qu’un temps d’adaptation à cette nouvelle infraction soit nécessaire.
Enfin, le pragmatisme de l’appareil judiciaire fait qu’à peines équivalentes, les juridictions préféreront poursuivre une infraction plus facile à caractériser, alors même que la qualification de traite offre des droits aux victimes que l’infraction de proxénétisme ne permet pas de leur accorder. De fait, l’infraction d’incitation à la prostitution, héritée du XIXe siècle, semble aujourd’hui redondante avec l’incrimination de la traite. Comme le note Mme Johanne Vernier (518), juriste, l’infraction d’incitation au proxénétisme vise d’ores et déjà la traite. De même, pour M. Francis Caballero, « ses éléments constitutifs (recrutement, transport, hébergement et accueil) [sont] les mêmes que ceux du proxénétisme simple (embauchage, entraînement, détournement) » (519).
De plus, les deux infractions sont punies des mêmes peines et sont passibles des mêmes circonstances aggravantes. Plus encore, dans le cas de la traite de mineurs de moins de quinze ans, la répression est mieux assurée par le biais de l’infraction de proxénétisme aggravée sur mineur de quinze ans (520), passible de quinze ans de réclusion, et non plus de dix ans d’emprisonnement. Ainsi, la superposition de deux infractions proches peut expliquer la préférence accordée à celle de proxénétisme, mieux connue, bénéficiant d’une jurisprudence établie, par rapport à la traite.
Toutefois, comme le rappelle la Chancellerie (521), l’infraction de traite des êtres humains n’est pas exclusive de l’infraction de proxénétisme, mais complémentaire. De même, les actions visées par ces deux articles ne sont pas tout à fait équivalentes. L’infraction de traite permet de réprimer des auteurs qui agissent en amont de la réalisation de l’infraction de proxénétisme. Les deux infractions semblent avoir leur logique propre et assurer une répression efficace de faits proches mais néanmoins différents. Le dispositif juridique dans son ensemble semble donc satisfaisant.
C. LES DROITS OUVERTS AUX VICTIMES DE TRAITE ET DE PROXÉNÉTISME SONT INSUFFISAMMENT MIS EN œUVRE
Les victimes de traite et de proxénétisme bénéficient aujourd’hui de droits particuliers. Notamment, lorsqu’elles sont de nationalité étrangère, les victimes peuvent se voir accorder un titre de séjour, sous réserve de leur coopération avec la justice. Elles peuvent également être protégées par les forces de l’ordre et hébergées par le biais du dispositif Ac.Sé. Enfin, les victimes de la traite et du proxénétisme peuvent être indemnisées par l’État. Toutefois, ces droits semblent aujourd’hui peu mis en œuvre, ce qui limite la portée de la répression pénale du point de vue des victimes.
1. Le droit au séjour, corollaire insuffisamment utilisé de l’aide apportée à la justice
Le droit au séjour est probablement le plus important des droits ouverts aux victimes étrangères de la traite et du proxénétisme, puisqu’il conditionne l’obtention de nombreux autres droits, comme la protection des forces de l’ordre ou le versement d’allocations. Plus encore, le droit au séjour est un élément fondamental de la reconstruction psychologique des victimes de traite et de proxénétisme (522).
a) Une possibilité aujourd’hui peu utilisée
Très peu de victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme bénéficient aujourd’hui du droit au séjour prévu par l’article L. 316-1 du CESEDA, qui dispose que « sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions ».
Cependant, d’après M. François Lucas (523), directeur de l’immigration au ministère de l’Intérieur, seules 23 cartes « vie privée et familiale » ont été délivrées en 2008. Même si des progrès sont palpables, puisqu’en 2010, environ 120 titres de séjours ont été accordés au titre de l’article L. 316-1, il apparaît que sur une centaine de nouvelles personnes victimes de traite identifiées, 10 à 15 % seulement bénéficient d’une protection dans le cadre de l’article L. 316-1 du CESEDA (524). Certaines procédures ont, par conséquent, été engagées devant la Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement de l’absence de protection apportée par l’État à des victimes de traite qui allaient être expulsées alors que leur sécurité était menacée dans leur pays d’origine.
De fait, il semble parfois plus aisé pour les victimes d’obtenir une protection par le biais d’une demande d’asile. Alors même que les cas de traite n’ouvrent pas droit au statut de réfugié (525), il apparaît plus facile aux victimes de la traite et du proxénétisme d’obtenir une protection subsidiaire de la part de l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), d’après M. Nicolas Jeune, chef de service à la maison des réfugiés de Lyon (526). Il suffit que les personnes prouvent qu’elles ne peuvent pas retourner dans leur pays en toute sécurité pour bénéficier d’une protection subsidiaire.
b) Des services de police et des préfectures parfois réticents à mettre en œuvre l’article L. 316-1 du CESEDA
Plusieurs facteurs concourent à expliquer la faible délivrance de ces titres de séjours, en amont, au niveau des services de police, comme en aval, au niveau préfectoral.
D’une part, les services de police, qui considéreraient la délivrance du titre de séjour comme une récompense accordée à la victime en échange de sa coopération, ne proposeraient pas cette possibilité aux victimes de proxénétisme ou de traite lorsque les coupables sont d’ores et déjà identifiés. En outre, Mme Violaine Husson, membre de la Cimade, a indiqué que les nécessités de l’enquête priment souvent sur les droits des victimes. Ainsi le renouvellement du titre de séjour peut ne plus être accordé si l’enquête n’avance pas ou si les principaux responsables du réseau sont démasqués (527).
Il apparaît aussi que l’incrimination de racolage, qui fait des personnes prostituées des délinquantes aux yeux de la loi, constitue un frein à la reconnaissance du statut de victime, et donc à l’ouverture de cette possibilité par la police. De fait, de nombreux dossiers sont en réalité présentés à la préfecture par des associations d’aide aux personnes prostituées, et non pas par les services de police et de gendarmerie (528).
Les personnes auditionnées par la mission d’information font également état de divers blocages au niveau préfectoral. Tout d’abord, il apparaît que certains services préfectoraux exigent, alors que cela n’est pas prévu par le texte de loi, que les victimes cessent leur activité prostitutionnelle pour leur accorder la carte « vie privée et familiale », comme l’a indiqué la Commission nationale consultative des droits de l’homme (529). Or, malgré l’octroi de l’allocation temporaire d’attente (ATA), l’arrêt de l’activité n’est pas toujours possible pour les personnes prostituées. De surcroît, l’activité prostitutionnelle, licite, ne peut en elle-même constituer un trouble à l’ordre public au sens de l’article L. 316-1. Il n’en reste pas moins que la délivrance du titre de séjour est un pouvoir discrétionnaire du préfet, qu’il peut dès lors ne pas exercer.
Il semble qu’il existe également une différence de traitement sur l’ensemble du territoire en matière de délivrance des titres, certains services préfectoraux les délivrant facilement et de façon rapide, tandis que d’autres préfectures connaissent des procédures plus longues de traitement des demandes (530). La préfecture de Paris, par exemple, ne délivre en général de titre de séjour que lorsqu’une instruction judiciaire est ouverte, ce qui allonge encore les délais pour les victimes, comme l’a indiqué Mme Vanessa Simoni, chef de projet à l’association des Amis du bus des femmes (531). D’autres préfectures ont mis en place des cellules spécialisées, ce qui permet de traiter les demandes plus rapidement. C’est notamment le cas de la préfecture du Rhône, qui assure un traitement rapide et confidentiel des demandes de titres de séjour au titre de l’article L. 316-1 (532).
Il est également apparu que les services de police et des préfectures respectaient de façon variable les obligations liées à ce dispositif. En particulier, le délai de réflexion de trente jours qui doit être laissé aux victimes n’est pas toujours proposé, comme l’a indiqué Mme Pascale Marcellin (533) de l’Amicale du Nid. De même, le récépissé de demande de titre de séjour, qui permet aux victimes de ne pas être expulsées du territoire français et ouvre droit à l’allocation temporaire d’attente, est délivré de façon variable par les services préfectoraux. Ainsi, sur 41 victimes aidées par l’Amicale du Nid à Lyon, seules 23 personnes ont effectivement reçu un récépissé (534).
c) Des considérations tant juridiques que pratiques font obstacle à la délivrance d’un titre de séjour
Les services préfectoraux connaissent plusieurs difficultés juridiques dans l’application de l’article L. 316-1. En premier lieu, il est fréquent que les victimes se présentent sans passeport et sans demande de passeport consulaire, ou encore avec de faux papiers. Dans ce cas, les services préfectoraux doivent le signaler au procureur de la République. De même, les victimes de la traite sont généralement domiciliées administrativement auprès d’une association. Or, dans ce cas, seules des autorisations temporaires de séjour peuvent être délivrées. Enfin, les conditions prévues à l’article L. 316-1 sont parfois difficiles à réunir, si bien que les services préfectoraux préfèrent délivrer des cartes de séjour à titre humanitaire (535).
Par ailleurs, plusieurs considérations pratiques font obstacle à la coopération des victimes et à l’application de l’article L. 316-1. Outre le délai de délivrance du titre de séjour, parfois long, les victimes peuvent avoir pour objectif d’obtenir une carte de résident. Dans la mesure où il existe un nombre important de dossiers ne donnant pas lieu à condamnation du proxénète, les victimes renoncent parfois à entamer les démarches.
De plus, le paiement des frais d’établissement de la carte de séjour à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui s’élèvent à environ 360 euros, peut limiter les possibilités, pour les victimes, d’accéder à leurs droits (536). Par ailleurs, la peur des services de police et de préfecture, perçus comme uniquement répressifs, constitue un obstacle au témoignage ou à la plainte de la victime (537).
2. Les insuffisances du dispositif de protection et d’indemnisation des victimes de la traite et du proxénétisme
Si les victimes de la traite et du proxénétisme peuvent accéder au réseau Ac.Sé comme à une indemnisation au titre du préjudice subi, ces dispositifs ne sont pas encore entièrement satisfaisants.
a) Les failles du système de protection des victimes
La protection des victimes est actuellement assurée par le réseau Ac.Sé, précédemment évoqué, qui ouvre des places en centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) pour les victimes de la traite. Toutefois, ces places sont rares et ne donnent lieu à aucune dotation budgétaire supplémentaire pour les hébergeurs (538), qui doivent alors prendre à leur charge d’autres frais, comme la nourriture. Ainsi, il n’existe pas, en France, de budget dédié à l’éloignement des victimes, cette tâche incombant dès lors aux associations (539). Par ailleurs, la protection permise par ces centres collectifs n’est pas toujours efficace, certaines personnes étant rattrapées par les réseaux (540).
En outre, l’absence de protection effective des familles ne met pas les personnes prostituées à l’abri de représailles indirectes. De fait, lorsqu’une personne prostituée décide de porter plainte, ce n’est pas toujours sans conséquences pour ses proches (541). Ainsi, une victime nigériane de la traite, accompagnée par Les Amis du bus des femmes, a perdu son père et sa sœur du fait de l’engagement d’une procédure judiciaire. C’est également ce qui ressort du témoignage de Baina (542), jeune femme nigériane entendue par la mission d’information : elle n’a pu entamer les démarches que parce que sa mère était déjà décédée et qu’elle avait coupé tout lien avec son père.
Le dispositif financier supposé permettre à la victime d’attendre l’issue du procès, l’allocation temporaire d’attente, est loin d’être suffisant. Tout d’abord, la méconnaissance de ce dispositif par les services préfectoraux retarde voire empêche l’ouverture des droits (543). Par ailleurs, cette allocation, d’un montant de 300 euros par mois, n’est versée que pendant le temps de validité de la carte de séjour. Ainsi, l’allocation, versée uniquement le temps de la procédure, ne permet pas aux personnes prostituées de se reconstruire et d’entamer des démarches de réinsertion. Son versement n’est en outre accompagné d’aucun dispositif de soutien à la réinsertion (544). De fait, le faible montant de l’ATA ne permet pas toujours aux personnes prostituées d’arrêter cette activité. Cette allocation n’est pas en mesure de pallier l’existence d’une dette, les difficultés à trouver une autre activité ou la nécessité de faire parvenir de l’argent à sa famille.
b) Des dispositifs d’indemnisation jugés inégalitaires et lacunaires
L’indemnisation des personnes victimes de traite paraît limitée à bien des égards. Peu de personnes ont pu bénéficier, à ce jour, de l’indemnisation prévue par l’article 706-3 du code de procédure pénale, du fait, notamment, des conditions jugées trop restrictives d’octroi de l’indemnisation. En effet, les conditions pour obtenir une indemnisation intégrale du préjudice de la part de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) sont les suivantes :
– avoir été victime de traite, sans besoin de justifier d’une incapacité totale de travail (ITT), ou avoir été victime de proxénétisme et présenter une ITT égale ou supérieure à un mois. La preuve du dépôt d’une plainte est nécessaire ;
– être français ou, pour des faits commis sur le territoire français, être ressortissant d’un État de l’Union européenne ou être en situation régulière.
Ainsi, il apparaît que l’indemnisation des victimes de proxénétisme est également possible dès lors qu’un préjudice grave est rapporté. Toutefois, les textes mettent en œuvre un traitement différencié des victimes de traite et de proxénétisme, les premières étant dispensées d’apporter la preuve d’un dommage important, contrairement aux victimes de proxénétisme, qui doivent montrer que les faits ont entraîné une incapacité totale de travail égale ou supérieure à un mois. Cependant, les victimes de proxénétisme bénéficient de la même présomption quant à la preuve lorsque l’infraction de proxénétisme s’est accompagnée de viols ou d’agressions sexuelles, sur le fondement du second alinéa de l’article 706-3 du même code.
Par ailleurs, l’accès à CIVI n’est ouvert qu’aux personnes en situation régulière. Or, de nombreuses victimes de la traite sont en situation irrégulière. Cette condition est cependant appréciée de manière souple dans la mesure où le séjour de la personne doit être régulier soit au moment des faits, soit au moment de la demande à la CIVI. Or, le dispositif de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a vocation à fournir un titre de séjour aux victimes de la traite et du proxénétisme qui coopèrent. Cependant, ce dispositif est très peu appliqué. Ainsi, les personnes qui n’auraient pas obtenu de titre de séjour ou ayant un titre de séjour dont la validité aurait expiré à la fin de la procédure judiciaire, sans qu’une carte de résident ne leur ait été délivrée, ne peuvent pas bénéficier de l’indemnisation de leur préjudice. Cet accès à la CIVI est pourtant essentiel dans la mesure où les auteurs d’infraction sont souvent insolvables.
En outre, si cette démarche peut être accomplie y compris en l’absence de poursuites pénales, du moment qu’il existe « un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction » (545), la CIVI demeure liée à la qualification donnée par le juge pénal lorsqu’il y a eu condamnation. Elle n’est en effet pas compétente pour se fonder sur une autre qualification juridique des faits (546). Ainsi, la préférence accordée à la qualification de proxénétisme par les juges répressifs engendre un moindre accès à l’indemnisation pour les victimes de la traite.
En dernier lieu, l’indemnisation ne couvre pas forcément le préjudice subi du fait des sommes extorquées durant l’activité de prostitution. En effet, alors que la CIVI de Nantes avait accordé à une personne forcée de se prostituer la restitution des sommes extorquées (80 000 €) (547), le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a obtenu gain de cause en appel (548), en considérant que « la communauté nationale n’a pas à prendre en charge les sommes issues du produit de la prostitution » (549).
IV. – LE VOLET SOCIAL DE L’ABOLITIONNISME, OUBLIÉ PAR LES POLITIQUES PUBLIQUES
Le volet social de l’abolitionnisme semble être aujourd’hui le grand oublié des politiques publiques, qui sont centrées sur la répression du racolage, du proxénétisme et de la traite des êtres humains. Pourtant, la composante sociale de la doctrine française, qui vise à prévenir l’entrée dans la prostitution et à aider les personnes qui le souhaitent à en sortir, est, en théorie, au moins aussi importante que l’aspect pénal de l’abolitionnisme. Face au désengagement de l’État, le secteur associatif, divers et divisé, semble avoir pris le relais d’une politique sociale minimale.
A. LES POLITIQUES SOCIALES, SOUVENT GÉNÉRALISTES, NE PRENNENT PAS EN COMPTE LES SPÉCIFICITÉS DES PERSONNES PROSTITUÉES
Les personnes prostituées bénéficient théoriquement des mêmes droits sociaux que les autres citoyens. Il leur est même possible de s’affilier à un régime de sécurité sociale et d’accéder ainsi à l’assurance maladie et à l’assurance vieillesse. Toutefois, dans la réalité, ces possibilités leur sont difficiles d’accès. En effet, les personnes prostituées connaissent des situations particulières, que les politiques sociales peinent à prendre en compte.
1. Les personnes prostituées bénéficient, au plan théorique, des mêmes droits sociaux que le reste de la population
Les personnes prostituées peuvent accéder à la protection sociale, soit qu’elles bénéficient du dispositif de droit commun ouvert à tout citoyen, soit qu’elles parviennent à s’affilier à un régime de sécurité sociale, en contrepartie du paiement de cotisations sociales.
a) Le bénéfice théorique des prestations sociales universelles pour les personnes prostituées
Les personnes prostituées bénéficient théoriquement des prestations sociales garanties à tous les citoyens.
Avant 1978, seuls les travailleurs et leurs ayants droit pouvaient bénéficier d’une protection sociale. Les personnes prostituées, considérées comme inactives, n’avaient dès lors aucune couverture sociale. Leur accorder des droits sociaux identiques aux autres bénéficiaires de la sécurité sociale aurait conduit à conférer le statut d’activité professionnelle à la prostitution. Or, cette démarche aurait été contraire à la position abolitionniste de la France. Cependant, l’instauration progressive de prestations universelles a permis de garantir des droits sociaux minimaux pour les personnes prostituées.
En particulier, les personnes prostituées peuvent bénéficier de la couverture maladie universelle (CMU), sans condition de ressources. Ce dispositif, qui existe depuis la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, permet le rattachement au régime général d’assurance maladie de toutes les personnes non affiliées à un autre régime à titre personnel ou d’ayant droit et résidant légalement et régulièrement en France. Au-delà d’un certain revenu, le bénéficiaire doit s’acquitter d’une cotisation équivalente à 8 % des revenus fiscaux déclarés. Par ailleurs, en dessous d’un certain plafond de ressources, les personnes prostituées peuvent également bénéficier de la CMU complémentaire (CMUc) et de l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS).
Les personnes prostituées de nationalité étrangère en situation irrégulière bénéficient, sous conditions de ressources, de l’aide médicale d’État (AME), dès lors qu’elles résident régulièrement depuis au moins trois mois en France. Elles ont également accès, comme toutes les personnes en situation précaire, aux permanences d’accès aux soins de santé (PASS) (550) mises en place de façon obligatoire par les établissements participant au service public hospitalier. Les personnes en situation irrégulière qui ne seraient pas éligibles à l’AME peuvent cependant bénéficier de la prise en charge financière, par l’État, « des soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne », selon les dispositions de l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles.
Concernant l’assurance vieillesse, les personnes prostituées peuvent bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), destinée à assurer un minimum de revenus aux personnes de plus de 65 ans. Versée sous conditions de ressources, cette allocation est soumise à une condition de résidence régulière en France. De même, le revenu de solidarité active (RSA), l’allocation adulte handicapé (AAH) et l’allocation parent isolé (API) leur sont ouverts.
b) L’affiliation à une caisse de sécurité sociale est possible mais difficile pour les personnes prostituées
En France, la reconnaissance de droits sociaux est historiquement liée à l’existence d’un statut professionnel. Or, la prostitution ne constituant pas une activité professionnelle au sens du droit français, les personnes prostituées ne peuvent, en théorie, être affiliées à aucun régime de sécurité sociale. Ainsi, le régime général ne leur est pas ouvert, dans la mesure où les personnes prostituées n’exercent pas une activité salariée reconnue par le droit. De même, les personnes prostituées ne répondent pas aux conditions requises pour s’affilier volontairement à la caisse nationale d’assurance vieillesse. En effet, la procédure d’affiliation volontaire s’adresse principalement aux personnes retraitées ou expatriées.
Une affiliation au régime social des indépendants, qui regroupe les commerçants, les artisans et les professions libérales, semble difficile, en théorie. En effet, la prostitution ne constitue ni une activité commerciale, qui suppose l’enregistrement auprès d’une chambre de commerce et d’industrie, ni une activité artisanale, qui nécessite d’être immatriculé au répertoire des métiers. D’après M. Jean Philippe Naudon, directeur du recouvrement au régime social des indépendants (551), la prostitution est une prestation de services que l’on ne peut pas considérer comme une profession libérale, dans la mesure où elle ne renvoie pas à une activité intellectuelle, ce qui constitue l’un des critères de cette dernière catégorie.
Toutefois, certaines personnes prostituées, afin de bénéficier de prestations d’assurance maladie, parviennent à s’affilier au régime social des indépendants sous couvert d’activités de massage ou de relaxation, dans les catégories « Autres services personnels » ou « Entretien corporel ». Dans le premier cas, les personnes prostituées sont assimilées à des commerçants ; dans le second cas, à des artisans. Les cotisations sont calculées sur la base des revenus déclarés à l’administration fiscale. Les personnes prostituées bénéficient alors des prestations d’assurance maladie de droit commun. L’inscription au régime social des indépendants étant déclarative, les personnes prostituées n’encourent aucune sanction pour s’être déclarées sous une fausse profession (552).
Les personnes prostituées doivent, afin d’accéder aux prestations sociales familiales, payer des cotisations sociales auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSAFF), obligation rappelée par un arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 1995 (553). La Cour de cassation a ainsi conclu, en 1996, que « l’intéressée exerçant une activité de prostitution au titre de laquelle elle est affiliée à un régime de protection sociale des travailleurs indépendants […] la cotisation litigieuse est due pour toute activité non salariée, quelle qu’elle soit » (554). L'URSSAF assure également le recouvrement de la CSG, de la CRDS et de la contribution à la formation professionnelle (CFP). Dès lors que les personnes en situation de prostitution paient des cotisations sociales familiales, elles ont accès à l’ensemble des prestations sociales servies par les caisses d’allocations familiales.
Enfin, les personnes prostituées peuvent, depuis 2004, cotiser auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), qui accueille l’ensemble des professions non classées, notamment les professions libérales non affiliées au régime social des indépendants. En effet, le décret n° 2004-460 du 27 mai 2004 permet l’affiliation de « toute profession libérale non rattachée à une autre section professionnelle » (555) à cette caisse d’assurance vieillesse, qui joue aujourd’hui le rôle de « caisse balais » pour les professions non réglementées. Toutefois, les demandes d’affiliation des personnes prostituées n’ont jamais abouti lorsqu’elles déclarent leur activité réelle (556). En pratique, elles doivent donc s’affilier en tant qu’activité de conseil. Cet intitulé ne faisant l’objet d’aucune restriction, le risque contentieux auquel s’exposent alors les personnes prostituées est inexistant.
L’affiliation, si elle est possible, demeure faible dans les faits. D’une part parce qu’elle nécessite de révéler une activité lucrative aux services de l’État, ce qui implique le paiement d’impôts et de cotisations sociales ; d’autre part parce que certaines personnes prostituées souhaitent cacher leur activité pour des raisons personnelles ou n’envisagent la prostitution que comme une activité temporaire (557) et n’entament dès lors pas les démarches administratives nécessaires.
Enfin, les assurances privées, si elles sont théoriquement envisageables, sont peu accessibles aux personnes en situation de prostitution, du fait de primes de risques trop élevées (558).
2. Dans les faits, les personnes prostituées connaissent des difficultés particulières d’accès aux droits et aux soins
En pratique, ces dispositifs sociaux ne sont pas adaptés aux situations particulières vécues par les personnes prostituées. Leurs conditions d’ouverture trop restrictives, associées à des difficultés particulières aux personnes prostituées, limitent bien souvent l’accès aux droits et aux soins.
a) Des conditions trop restrictives et peu adaptées au parcours des personnes prostituées
Les conditions relativement restrictives entourant le RSA le rendent, dans les faits, peu accessible aux personnes qui tentent de sortir de la prostitution. En effet, les conditions de ressources sont calculées sur les trois derniers mois, si bien que les personnes qui souhaitent arrêter leur activité de prostitution doivent vivre trois mois sans revenus déclarés avant de pouvoir en bénéficier. En cas de dissimulation de revenus, elles sont passibles d’une amende administrative et du recouvrement forcé des prestations indûment versées. Par ailleurs, la condition d’âge comme de résidence constitue un obstacle considérable, les personnes prostituées, notamment de nationalité étrangère et soumises à des réseaux, étant souvent jeunes, très mobiles et en situation irrégulière. Enfin, si les personnes étrangères ont droit au RSA, ce n’est qu’à la condition de disposer d’un titre de séjour depuis plus de cinq ans les autorisant à travailler, d’une protection subsidiaire ou d’une carte de résident.
Le RSA ne permet donc pas la réinsertion des personnes prostituées. De fait, en l’absence de revenu minimum accessible, l’expérimentation menée au Pôle Emploi de Lyon fait apparaître que certaines personnes prostituées en formation professionnelle étaient obligées de continuer leur activité afin de subvenir à leurs besoins, avant que la formation ne porte ses fruits (559).
Les personnes étrangères, notamment celles qui sont en situation irrégulière, rencontrent des difficultés particulières. En effet, la plupart des prestations sociales ne sont pas ouvertes aux personnes en situation irrégulière. C’est notamment le cas des allocations familiales, de l’ASPA, de l’ACS, de la CMU et de la CMU complémentaire. Or, les personnes prostituées de nationalité étrangère ont souvent une situation administrative précaire. En outre, elles ne sont pas toujours en mesure de présenter des papiers d’identité, ce qui peut leur valoir un refus d’obtention de l’AME (560).
Par ailleurs, la durée de validité du titre de séjour ne suffit pas toujours. Par exemple, pour accéder à la CMU, elles doivent justifier, en plus d’un titre de séjour, d’une résidence stable d’au moins trois mois. Or, comme le note la CNCDH, les personnes victimes de traite ne disposent généralement que d’une autorisation provisoire de séjour de trois mois, qui est en réalité un peu inférieure à cette période de temps, si bien qu’elles se voient refuser l’accès à la CMU (561).
b) Des difficultés notables d’accès aux droits
Si les dispositifs généraux sont ouverts aux personnes prostituées qui correspondent à leurs critères, elles sont, dans les faits, assez peu nombreuses à y avoir accès. De façon générale, les personnes prostituées, notamment étrangères, ont une faible connaissance de droits auxquels elles peuvent prétendre.
Par ailleurs, la plupart des dispositifs évoqués, notamment l’AME, la CMU, la CMU complémentaire et l’ACS, nécessitent l’établissement d’une domiciliation. Pour les personnes en situation de prostitution n’ayant pas de logement stable, il est toutefois possible de se faire domicilier au centre communal d’action social ou auprès d’une association agréée. Cependant, beaucoup ignorent cette possibilité.
Ainsi, la couverture sociale des personnes prostituées est très variable. Pour les femmes prostituées, une étude menée, en 2003, par Mme Suzanne Cagliero et M. Hugues Lagrange (562) montre que certaines personnes prostituées, qui exercent un emploi à côté de leur activité de prostitution, sont rattachées au régime général de sécurité sociale ; d’autres bénéficient de la CMU, tandis que certaines cotisent à l’URSSAF et disposent donc d’une couverture sociale partielle. Enfin, la majorité des personnes étrangères n’a pas de couverture sociale du tout. Ainsi, 78 % des femmes d’Europe de l’Est interrogées sont sans couverture sociale, contre 52 % des femmes originaires d’Afrique.
Par ailleurs, en matière de droits à la retraite, la possibilité de cotisations auprès de la CIPAV ne permet pas de remédier à la situation des personnes prostituées d’ores et déjà en âge de prendre leur retraite. En effet, celles-ci sont dans l’impossibilité matérielle et financière d’effectuer un rachat de points susceptible de leur ouvrir des droits à la retraite, comme l’a indiqué Mme Sarah-Marie Maffesoli (563), conseillère juridique auprès du STRASS.
Dans le cas des personnes étrangères, la faiblesse des compétences linguistiques en français est un frein considérable à l’accès aux droits sociaux. Ensuite, la forte mobilité des personnes prostituées de rue, accentuée par la crainte d’une arrestation par les services de police, rend ce public peu accessible à l’action des services publics. Par ailleurs, cette mobilité parfois contrainte ne leur permet pas de remplir les conditions de résidence stable exigée par les textes relatifs aux droits sociaux exposés ci-dessus.
c) Les lacunes de l’accès aux soins
L’accès aux soins est, dans les faits, entravé tant par des facteurs juridiques que par des éléments matériels ou psychologiques. La barrière de la langue joue ainsi un rôle important dans l’accès aux soins. En dépit des crédits alloués à l’interprétariat en milieu hospitalier, il n’y est pas suffisamment fait recours aujourd’hui, comme le note le Conseil national du sida (564), si bien que les personnes étrangères ne s’y rendent pas aisément.
L’éloignement et l’isolement géographique des personnes prostituées sont également problématiques, comme le montre le dernier plan national de lutte contre le VIH et les infections sexuellement transmissibles : « la concentration de plus de 50 % des prostituées à Paris y avait entraîné la concentration des dispositifs sociaux sanitaires et des associations spécialisées. Cette configuration est actuellement dépassée : la prostitution est beaucoup plus diffuse et répartie dans tous les départements d’Île-de-France » (565). Les associations de santé communautaire, principaux vecteurs de l’accès aux soins, connaissent aujourd’hui d’importantes difficultés pour mener à bien leur action de prévention et d’aide aux personnes prostituées.
En outre, la crainte d’être signalées aux services de police, pour les personnes en situation irrégulière, les rend relativement méfiantes vis-à-vis de tout représentant de l’État ou service public. Mme Lisa Tichane, directrice du planning familial des Bouches-du-Rhône (566), a ainsi indiqué à la mission d’information que les personnes prostituées étaient naturellement réticentes à consulter un médecin. Sans l’intervention des acteurs associatifs, qui gagnent leur confiance, aucune personne prostituée n’accepterait de consultation médicale.
Par ailleurs, l’effectivité de l’accès aux soins est remise en cause pour les personnes étrangères en situation irrégulière. En effet, l’aide médicale d’État doit, depuis 2008, être accompagnée d’un justificatif de besoin de soins évalué par un médecin. De fait, « les associations constatent que les personnes doivent être accompagnées d’un intervenant pour bénéficier d’une ouverture des droits effective et assurée » (567). Cet état de fait a notamment été signalé par l’association de santé communautaire Grisélidis (568), dont les représentants ont déclaré connaître des difficultés croissantes dans l’accompagnement vers les dispositifs de CMU et d’AME. De façon générale, les bénéficiaires de l’AME, comme ceux de la CMU, connaissent de façon récurrente des refus de soins de la part des praticiens, du fait de la gestion administrative que ces prestations sociales impliqueraient pour les médecins.
Par ailleurs, des cas de discrimination par le personnel médical sont rapportés par le Conseil national du sida (569), notamment en ce qui concerne les personnes transgenres. Plus largement, les personnes prostituées tendent à taire leur activité afin de ne pas risquer d’être stigmatisées par les praticiens. Ainsi, l’accès aux soins est loin d’être garanti dans la réalité.
Toutefois, en matière d’accès aux soins, le plan national de lutte contre le VIH/sida et les infections sexuellement transmissibles (2010-2014) prévoit la mise en place d’actions spécifiques en direction des personnes prostituées. Notamment, le développement du dépistage hors les murs et de la protection vaccinale contre l’hépatite B, comme la conception et la diversification des supports d’information et de prévention, devrait améliorer l’accès aux soins des personnes en situation de prostitution.
B. LES DISPOSITIFS SPÉCIALEMENT DESTINÉS AUX PERSONNES PROSTITUÉES DEMEURENT INSUFFISANTS
Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, les personnes prostituées, plutôt considérées comme des menaces potentielles à l’ordre public, ne faisaient pas l’objet d’une politique sociale spécifique, en dépit du fichier sanitaire et social qui a alors été créé. Ce n’est qu’en 1960 qu’une ambition sociale réelle, mais limitée dans les faits, a vu le jour.
1. L’échec des services de prévention et de réinsertion sociale
L’ordonnance du 25 novembre 1960 (570) prévoyait la création, dans chaque département, de services de prévention de réinsertion sociale (SPRS). Ces centres devaient « chercher et accueillir les personnes en danger de prostitution » et « exercer toute action médico-sociale en faveur des personnes qui se livrent à la prostitution », aux termes de l’ancien article 185-1 du code de la famille et de l’action sociale créé par l’ordonnance du 25 novembre 1960. L’accent était mis tant sur la prévention que sur l’aide aux personnes prostituées. Par ailleurs, les personnes en danger de prostitution comme les personnes sortant de la prostitution pouvaient être hébergées par des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS).
Ce dispositif, pourtant relativement complet, ne fut que peu appliqué. Une dizaine de SPRS seulement furent mis en place, comme l’a rappelé M. Grégoire Théry, secrétaire général du Mouvement du Nid (571). Le manque de moyens matériels et humains entrava également leur bon fonctionnement, de même que le peu d’intérêt qu’y portèrent les autorités (572). Leur caractère décentralisé apparut également peu opportun, alors qu’une politique nationale semblait nécessaire. Enfin, la confusion des missions entre les SPRS et les CHRS limita également les initiatives départementales, les autorités locales ne souhaitant pas voir apparaître de doublon (573).
Aussi, la volonté de ne pas stigmatiser les personnes prostituées par un dispositif spécifique encouragea le report des missions des SPRS sur les CHRS, à vocation généraliste. Ainsi, le rapport de M. Guy Pinot de 1975, magistrat qui fut chargé par le Président de la République de recueillir le témoignage des personnes prostituées, reprocha à ce dispositif « l’étiquetage des inadaptés » et l’accentuation du « processus d’exclusion du corps social » (574). Les quelques SPRS créés furent ainsi peu à peu dissous, les crédits qui leur étaient consacrés étant, dans le meilleur des cas, reversés aux associations d’aide aux personnes prostituées (575). Les SPRS ne sont plus aujourd’hui qu’au nombre de quatre (576) et dépendent, pour leur financement, des CHRS.
De la même façon, la volonté de créer des commissions réunissant tous les acteurs institutionnels de la prostitution est restée lettre morte. La directive du 25 août 1970 du ministère de la Santé publique et de la sécurité sociale tendant à la mise en place, dans chaque département et sous l’autorité du préfet, de commissions réunissant les services sociaux, des médecins responsables de services anti-vénériens, un juge des enfants, les représentants des services de police et de gendarmerie, comme les URSSAF, les offices HLM ou encore le fisc, ne fut pas appliquée (577).
En l’absence d’une ligne claire, les départements mènent de façon non concertée des politiques à destination des personnes prostituées (578). Certains départements font ainsi preuve de plus d’initiative que d’autres, d’où un traitement inégalitaire du problème prostitutionnel sur le territoire. Ainsi, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) de la Gironde a pris l’initiative, en 2003, de créer un réseau d’intervention sociale auprès des personnes prostituées (RISPP) (579). Ce réseau est constitué d’institutions publiques dont le conseil général de la Gironde, la délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité, la mairie de Bordeaux, et de plusieurs associations comme le Mouvement du Nid, le Mouvement national le Cri, AIDES, IPPO et une association de lutte contre les addictions.
2. Le dispositif actuel demeure largement insuffisant au regard des objectifs de prévention et de réinsertion
En matière de logement, les personnes prostituées qui souhaiteraient cesser cette activité ne bénéficient d’aucune aide spécifique de l’État. En particulier, elles ne constituent pas, en tant que tel, un public prioritaire dans le cadre du logement social. Si les personnes victimes de violence sont devenues des demandeurs prioritaires depuis la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, seules les victimes de violences conjugales semblent concernées par le nouveau dispositif. En outre, comme l’a souligné l’Amicale du Nid (580), il faudrait veiller à ce que les besoins des personnes prostituées en voie de réinsertion soient intégrés à la programmation pluriannuelle et territorialisée de l’offre d’hébergement et de logement mise en place par la loi précitée.
À l’heure actuelle, seuls les CHRS semblent susceptibles d’accueillir les personnes prostituées qui souhaiteraient sortir de la prostitution. Mais cette solution ne semble guère satisfaisante au regard des besoins des personnes qui ont été en situation de prostitution.
D’une part, les places sont limitées (581) au regard des besoins, notamment des victimes de la traite des êtres humains. Ainsi, « les rares places disponibles en CHRS peuvent n’être libérées qu’après plusieurs mois d’attente » (582). Le rapport de la Commission nationale consultative des droits de l’homme sur la traite souligne également que l’accès aux CHRS est parfois refusé aux personnes en situation irrégulière, au motif que leur réinsertion est impossible en l’absence de titre de séjour (583).
D’autre part, le caractère collectif de cet hébergement ne répond pas au besoin d’anonymat des personnes prostituées, et notamment des victimes de traite, d’après Mme Vanessa Simoni, chef de projet pour l’association des Amis du bus des femmes (584). Enfin, seuls une dizaine de CHRS sur 224 accueillent spécifiquement des personnes en situation de prostitution, en leur proposant un hébergement ou une structure de jour visant à leur réinsertion (585).
Quant à la réinsertion professionnelle des personnes prostituées, il n’existe aujourd’hui aucun dispositif défini au niveau national qui tiendrait compte des spécificités de ce public (586). La place est donc laissée aux initiatives locales, qui se révèlent parfois fructueuses. C’est notamment le cas de l’action d’un Pôle Emploi de Lyon qui a engagé une action spécifique à destination des personnes prostituées. L’accompagnement réside principalement dans l’apprentissage du français et la mise en relation avec des entreprises, notamment dans les secteurs de l’aide à la personne, de la restauration, de la grande distribution et des emplois saisonniers (587). Sur les 44 personnes accompagnées, dix accompagnements ont débouché sur un emploi stable.
Ce public a en effet des besoins particuliers en matière de réinsertion professionnelle. Le plus souvent de nationalité étrangère et en situation administrative précaire, les personnes prostituées ont généralement de faibles compétences linguistiques en français, mais sont souvent polyglottes par ailleurs (588). En outre, si la volonté de réinsertion des personnes prostituées est forte, elle est souvent entravée par leurs souteneurs qui, d’après M. Patrick Lescure, directeur régional de Pôle emploi (589), cherchent par tous moyens à les récupérer. La principale difficulté de l’insertion professionnelle réside dans la précarité administrative de ces personnes, qui ne disposent souvent que d’un titre de séjour de trois mois, délai insuffisant pour faire aboutir l’accompagnement professionnel.
L’article 43 de la loi pour la sécurité intérieure prévoyait que « toute personne victime de la prostitution [bénéficie] d’un service de protection et d’assistance assuré et coordonné par l’administration ». On doit constater que cet article ne connaît aujourd’hui qu’une application limitée, l’assistance et la protection apportées aux personnes victimes de la prostitution étant largement insuffisantes. L’essentiel de l’action de prévention et de réinsertion est aujourd’hui exercé par les associations, financées en partie par l’État.
C. LA MAJEURE PARTIE DES POLITIQUES SOCIALES EST AUJOURD’HUI LE FAIT DU SECTEUR ASSOCIATIF
Les associations jouent aujourd’hui un rôle primordial en matière de protection sociale et sanitaire des personnes prostituées. Toutefois, la diversité des buts poursuivis par ces nombreuses associations, comme la difficulté de trouver des financements pérennes, nuit à l’action associative dans son ensemble.
1. Des associations diverses qui poursuivent des objectifs parfois opposés
Ayant connu plusieurs évolutions successives, le monde associatif est aujourd’hui très diversifié, tant au niveau des missions et que des buts poursuivis. Le Conseil national du sida (590) dénombre ainsi 66 associations professionnalisées et 26 associations militantes, qui poursuivent des missions de prévention, de réinsertion sociale, de santé, de lutte contre l’exclusion ou en faveur des droits des femmes.
Historiquement, les premières associations relatives à la prostitution ont une vocation purement sociale et ont pour objectif la disparition de la prostitution. Tel est le cas de l’association du Nid, né en 1937, créée par le père André-Marie Talvas, lié au catholicisme social et ouvrier (591). Devenu le Mouvement du Nid en 1971, à la suite d’une scission, cette association abolitionniste mène principalement deux actions (592) : la prévention, notamment auprès des jeunes, et l’accompagnement des personnes prostituées dans leur démarche de réinsertion. Elle dispose d’un réseau de 31 délégations départementales et est reconnue d’utilité publique.
D’autres associations abolitionnistes mènent uniquement des actions de sensibilisation et de prévention. Ainsi, la Fondation Scelles, créée en 1993, qui réunit l’ensemble de la documentation disponible sur la prostitution, a pour principale mission l’information du grand public et la prévention de la prostitution. De même, Le Mouvement Le Cri a principalement pour vocation de sensibiliser l’opinion publique, notamment les jeunes, à la réalité du monde prostitutionnel.
À l’inverse, l’Amicale du Nid, fondée en 1970, est une association laïque, composée majoritairement de travailleurs sociaux, non de bénévoles. Elle se distingue du Mouvement du Nid par ses actions de réinsertion des personnes prostituées, grâce à la quinzaine d’établissements qu’elle gère aujourd’hui (foyers, ateliers, centres de formation…) (593) et à ses 200 salariés. En tout, le Conseil national du sida dénombre 29 associations de réinsertion sociale et d’hébergement.
Le paysage associatif est resté relativement stable jusqu’à la fin des années 1980 et à l’apparition du VIH. Des associations dites « de santé communautaire », paritaires ou associant des personnes prostituées à leur organe de décision et aux équipes de terrain, apparaissent alors, soutenues par les pouvoirs publics. Ainsi, l’association des Amis du Bus des femmes, première association de santé communautaire, a été créée en 1989. D’autres suivront, comme Cabiria à Lyon, Grisélidis à Toulouse ou encore Autres Regards à Marseille.
L’objectif initial est ici sanitaire, ces associations menant principalement des actions de prévention et de soins (information ambulatoire sur les lieux de prostitution, distribution de matériel préventif, dépistages, accompagnements au sein des structures médicales…). Toutefois, ces associations ont quelque peu évolué et militent aujourd’hui pour la plupart en faveur de l’amélioration des conditions d’exercice de la prostitution. Ces associations, si elles ne cherchent pas à décourager l’exercice de la prostitution, n’ont pas pour vocation d’y inciter. Leur positionnement, plus pragmatique, vise à assurer aux personnes prostituées les meilleures conditions d’exercice possible aux plans sanitaire et social. Elles ont également intégré la nécessité de mener une action globale à destination des personnes prostituées, en leur fournissant un soutien sur le plan juridique et administratif, mais aussi social pour certaines. Des programmes de santé non communautaire ont également vu le jour, notamment sous l’impulsion de Médecins du Monde.
Enfin, à partir du début des années 2000 et du durcissement de la répression du racolage, un mouvement revendicatif, émanant des personnes prostituées elles-mêmes, est apparu. Ces associations de défense des droits des personnes prostituées, dont la plus emblématique est probablement le STRASS, créé en 2009, militent en faveur de la reconnaissance d’un statut social et professionnel pour les personnes prostituées, la prostitution étant alors considérée comme un véritable métier.
Ces associations d’aide aux personnes prostituées, anciennes ou nouvelles, poursuivent des objectifs différents, parfois antagonistes. Cela a pour effet de limiter les possibilités de partenariats entre associations et d’entraver le maillage territorial fin de l’action associative, sociale ou sanitaire. Le Conseil national du sida déplore ainsi que « certaines associations de réinsertion déclarent préférer des partenariats avec des associations de santé communautaire étrangères en raison de la persistance de clivages avec les associations françaises » (594).
2. L’action sanitaire et sociale en faveur des personnes prostituées est aujourd’hui principalement mise en œuvre par le secteur associatif
De nombreux acteurs institutionnels et associatifs font aujourd’hui le constat d’un désengagement notable de l’État dans l’action sociale à destination des personnes prostituées. C’est ce que notaient, au tournant des années 2000, deux rapports parlementaires. Ainsi, d’après le rapport de Mme Dinah Deryck (595), « l’approche française de la prostitution pêche par son très maigre bilan social », tandis que le rapport d’information de l’Assemblée nationale sur l’esclavage moderne (596) jugeait que « les carences de l’État [étaient] manifestes » dans le domaine de la prostitution.
L’analyse du Conseil national du sida est cependant plus nuancée : « depuis l’ordonnance et le décret du 25 novembre 1960, l’État s’est largement désengagé de l’action directe en faveur des personnes prostituées et, en contrepartie, il apporte son concours financier au secteur privé non lucratif » (597). En effet, aujourd’hui, la majeure partie de l’action sociale à destination des personnes prostituées est le fait du secteur associatif.
Les centres d’hébergements de réinsertion sociale sont ainsi gérés par des associations. Les établissements de l’Amicale du Nid sont, pour la plupart, des CHRS (598). Le réseau Ac.Sé, qui réunit 40 CHRS sur l’ensemble du territoire, est géré par l’association ALC. Ce sont ainsi près de deux millions d’euros qui sont versés par l’État à une vingtaine d’associations gérant une dizaine de CHRS accueillant spécifiquement des personnes prostituées, d’après Mme Élisabeth Tomé-Gertheinrichs (599).
Dans le domaine de la prévention du risque prostitutionnel, les associations fournissent un travail considérable. Par exemple, le Mouvement du Nid (600) organise une prévention du risque prostitutionnel auprès des jeunes et a ainsi rencontré 15 000 adolescents au cours de 265 interventions en établissements scolaires en 2009. Auprès du reste de la population, des campagnes d’affichage, notamment à destination des clients, et des plaquettes thématiques ont été diffusées. La revue Prostitution et société apporte également des éléments de débats au grand public. Cette association organise également des formations pour les professionnels de la justice et de la police. Ainsi, ce sont près de 1 700 professionnels qui ont été formés au cours de 70 journées de formation en 2009.
a) L’action des associations dans le domaine sanitaire
Dans le domaine de la prévention des risques sanitaires liés à la prostitution, les associations de santé communautaire sont les principaux acteurs de terrain. Ces associations organisent la distribution de matériel de prévention : « préservatifs masculins et féminins, gel lubrifiant, digues dentaires, lingettes antiseptiques, matériel de réduction des risques pour les usagères et usagers de drogues » (601). Elles se déplacent en général sur les lieux de prostitution, effectuent une ou plusieurs tournées hebdomadaires, en voiture ou en unité mobile, de jour comme de nuit, et proposent aux personnes prostituées des boissons chaudes et des préservatifs, ce qui permet de nouer le dialogue et de faire passer le message de prévention.
Mais les associations de santé communautaire ne sont plus les seules à agir dans le domaine de la prévention des risques sanitaires. Ainsi, d’autres associations distribuent également du matériel de prévention, comme Médecins du Monde ou l’Amicale du Nid (602). De même, l’association ALC a distribué près de 60 000 préservatifs en 2008 (603). Au total, dans le Rhône, environ 200 000 préservatifs ont été distribués par les associations en 2009, d’après M. Raphaël Glabi (604), directeur délégué « Protection et promotion de la santé » à l’Agence régionale de santé Rhône-Alpes.
En matière de soins, les associations sont également très présentes, puisqu’elles facilitent bien souvent l’accès aux soins des personnes prostituées. Le Lotus Bus (605) par exemple, créé à l’initiative de Médecins de Monde, met à disposition des personnes prostituées chinoises, sur leurs lieux d’exercice, une équipe médicale sinophone, auprès de laquelle elles peuvent évoquer leurs problèmes de santé. De nombreuses associations assurent également l’accompagnement des personnes prostituées vers les services publics de santé, afin de faire tomber leurs réticences. L’Amicale du Nid accompagne ainsi en particulier les femmes enceintes (606), tandis que l’association Autres Regards (607), par exemple, accompagne les personnes prostituées pour des dépistages ou des soins.
b) L’action des associations dans le domaine social
En matière d’accompagnement social et de réinsertion, les associations ont également pris la place qui revenait à l’État au regard des ordonnances de 1960. Les associations traditionnelles comme les associations de santé communautaire agissent aujourd’hui dans le domaine social, avec une optique quelque peu différente. Les premières cherchent principalement à favoriser la réinsertion des personnes prostituées, en leur donnant accès à des hébergements ou des formations professionnels et en les aidant dans leurs démarches administratives.
L’Amicale du Nid a ainsi fourni un accompagnement social à 2 300 personnes en 2009 (608). L’association a mis en place divers ateliers de réinsertion professionnelle, à Lyon, Colombes et Marseille. Le Mouvement du Nid (609) propose également un accompagnement social, notamment pour les démarches administratives auprès des préfectures, des services de santé ou des organismes de sécurité sociale, qui a bénéficié à 1700 personnes en 2009.
Mais les associations de santé communautaire, dont l’objectif est d’améliorer les conditions de vie des personnes prostituées, ne sont pas en reste dans ce domaine. Comme le montre le Conseil national du sida, « l’accompagnement des personnes […] chez un avocat, dans les structures de police ou de justice est également courant […] les associations doivent répondre à la forte précarité des personnes prostituées en proposant des services extrêmement variés, voir dans certains cas une domiciliation administrative, un hébergement d’urgence, la fourniture d’un repas, le règlement d’un dossier de surendettement, la traduction d’un document administratif » (610). La médiation culturelle et linguistique est alors essentielle, comme l’a indiqué l’association Grisélidis (611), qui dispose d’une médiatrice culturelle bulgare. Un soutien psychologique est également souvent proposé par les associations communautaires, comme celle gérée par Mme Gabrielle Partenza, Avec nos Aînées (612).
Si l’action des associations tient aujourd’hui une place primordiale dans le dispositif social à destination des personnes prostituées, celle-ci est toutefois fragilisée par le désinvestissement financier croissant de l’État.
3. Un financement public variable et non pérenne qui fragilise l’action des associations
La structure actuelle des financements destinés aux associations est très peu lisible. En outre, sa tendance à la baisse fragilise l’action de ces dernières.
a) Des financements illisibles
L’action sociale des pouvoirs publics en matière de prostitution se limite aujourd’hui à une intervention financière. Les associations bénéficient ainsi de subventions de l’État, au niveau national comme déconcentré, et des collectivités territoriales pour mener à bien leurs actions de prévention et de réinsertion.
Certains crédits sont spécifiquement consacrés par l’État aux associations de prévention et de réinsertion. Ils sont actuellement regroupés au sein du programme n° 177 « Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables ». Au niveau national, ils atteignent 351 000 euros en 2009 et se répartissent comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
SOMMES ALLOUÉES AU NIVEAU NATIONAL EN 2009 AUX ASSOCIATIONS D’AIDE AUX PERSONNES PROSTITUÉES AU TITRE DU PROGRAMME 177
Association |
Montant de la dotation |
ALC |
180 000 euros |
Amicale du Nid |
32 000 euros |
Mouvement du Nid |
79 274 euros |
Comité contre l’esclavage moderne |
40 000 euros |
Mouvement le Cri |
20 000 euros |
Total |
351 274 euros |
Source : Note du ministère des Solidarités et de la cohésion sociale du 15 février 2010
En 2010 et 2011, le montant total de la dotation nationale aux associations est de 331 274 euros, la subvention versée au Mouvement le Cri n’ayant pas été reconduite.
Au niveau local, près de deux millions d’euros sont versés aux associations par les services déconcentrés de l’État, notamment les directions départementales de la cohésion sociale. Toutefois, cette somme est en diminution depuis quelques années. Ils n’étaient que de 2,5 millions en 2007, avant de se stabiliser à 2,2 millions aujourd’hui, comme l’a indiqué M. Fabrice Heyries (613).
Ces crédits seront imputés, dès 2012, au programme n° 137 relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes. Ce changement devrait permettre, d’après M. Fabrice Heyries, directeur général de la cohésion sociale (614), de sanctuariser les crédits. En effet, ceux-ci étaient auparavant fongibles dans le programme n° 177, ce qui aboutissait parfois à des réaffectations de crédits en faveur de l’hébergement d’autres publics défavorisés.
Toutefois, pour Mme Sandrine Arnaud, responsable de l’Amicale du Nid de Montpellier (615), ce changement conduit à couper les subventions versées jusqu’ici à plusieurs associations d’aides aux personnes prostituées non habilitées à gérer des CHRS. De surcroît, une part des versements des financements aux associations ne sera plus allouée sous la forme de subventions de fonctionnement ou de soutien à projet sur proposition des associations, mais sera affectée par l’intermédiaire d’appels à projet afin d’avoir une meilleure visibilité sur les actions engagées et un meilleur retour sur l’usage des fonds.
L’État verse également des crédits aux associations, par le biais des agences régionales de santé. Les crédits alloués aux associations œuvrant dans le domaine de la santé des personnes prostituées dépendent du programme n° 204 de la mission « Santé », relatif à la prévention et à la sécurité sanitaire. Ainsi, à Marseille, près de 412 000 euros ont été accordés, en 2010, aux associations comme ALC, Autres Regards ou Aides (616) par l’ARS. Ces crédits, d’après le Conseil national du Sida, représentaient environ 1,5 million d’euros en 2004 (617).
D’autres programmes budgétaires et plusieurs ministères sont à l’origine de subventions aux associations, mais leur part est aujourd’hui marginale dans le budget des associations (618). Le ministère de la Jeunesse et des sports, de même que le fonds interministériel de prévention de la délinquance, qui dépend du ministère de l’Intérieur, ont pu être à l’origine de subventions aux associations d’aide aux personnes prostituées.
Il faut enfin mentionner la dotation générale dont bénéficient les CHRS spécialisés dans l’accueil des personnes prostituées. Les derniers chiffres disponibles datent de 2004. La dotation s’élevait alors à 3,55 millions d’euros (619).
Au total, le budget consacré par l’État à l’action sociale en faveur des personnes prostituées manque de lisibilité, aucun ministère ne semblant en mesure de fournir une vue d’ensemble des financements qui y sont consacrés.
Les collectivités locales participent également au financement des associations. L’Amicale du Nid a reçu près de 37 000 euros de subventions de la part de la Mairie de Paris en 2008. En 2009, l’association Hors la rue a reçu une subvention de 42 000 euros de la part du conseil général de Seine-Saint-Denis. De même, l’association IPPO a reçu, en 2011, une subvention de 18 156 euros accordée par la mairie de Bordeaux (620).
b) Des financements en diminution
De façon générale, la tendance est à la diminution des crédits alloués aux associations. Ainsi, trois délégations de l’Amicale du Nid (621) ont perdu, en 2010, l’intégralité des subventions qui leur étaient versées par les DDASS, à l’occasion de leur transformation en direction départementale de la cohésion sociale. Le Conseil national du sida note ainsi que « plusieurs DDCS ne souhaitent pas entamer ou poursuivre de partenariats avec les associations de santé ou de santé communautaire » (622). L’Amicale du Nid est confrontée à une baisse des crédits publics très problématique. Or, la stabilité des budgets des associations est nécessaire pour mener à bien une action de réinsertion efficace, qui peut prendre plusieurs années. De même, l’association IPPO (623) fait actuellement face à un grave problème de réduction de son financement. En effet, l’association a subi en 2010 une baisse de ses crédits publics de 110 000 euros sur un budget d’environ 260 000 euros.
La diminution des crédits est d’autant plus problématique que les associations connaissent, depuis quelques années, un accroissement certain de leurs coûts de fonctionnement. En effet, la dispersion et l’éloignement géographique des personnes prostituées ont contraint les associations à mettre en place des dispositifs mobiles plus coûteux qu’auparavant. De même, la présence majoritaire de personnes étrangères a rendu nécessaire le recours à des traducteurs et à des médiateurs culturels rémunérés. Par ailleurs, les associations sont contraintes de consacrer plus de temps au démarchage des bailleurs de fonds institutionnels ou privés. En moyenne, les associations consacrent ainsi un équivalent temps plein à la préparation et au suivi des demandes de financement (624).
Le financement public variable et non pérenne nuit aux actions entreprises par les associations, qui assument pourtant une mission qu’il revient, en principe, aux pouvoirs publics d’assurer.
TROISIÈME PARTIE : CONSIDÉRER LA PROSTITUTION AU REGARD DES PRINCIPES RÉPUBLICAINS ET DÉMOCRATIQUES
Toute réflexion sur la prostitution doit éviter deux écueils. Le premier consisterait à réfléchir, d’une manière exclusivement philosophique ou juridique, sur ce qu’est la nature de la prostitution sans prendre en considération la manière dont cette activité est aujourd’hui pratiquée. C’est pourquoi la mission a souhaité présenter un double état des lieux de la prostitution aujourd’hui en France et des politiques publiques qui sont menées dans ce domaine. Le second écueil serait de s’en tenir à ce bilan en considérant que la prostitution ne soulève aucune question éthique ou juridique. La démarche serait alors incomplète et inévitablement fondée sur des idées préconçues.
C’est pourquoi la mission d’information n’a écarté aucun questionnement. Suivant l’avis de Mme Élisabeth Tomé-Gertheinrichs, chef du service des droits des femmes et de l’égalité (SDFE), elle a entendu prendre en considération l’ensemble des possibles qui lui ont été exposés, sans privilégier aucun d’entre eux a priori : « Poser la question de la réouverture des maisons closes est important aujourd’hui en France si rien d’autre n’évolue, car cette question est posée sous l’angle de la dignité humaine. […] En revanche, si un débat d’ensemble sur la prostitution s’ouvre, comme c’est le cas avec la mission d’information, cette question devient pratiquement secondaire. Il faut donc poser la question de la prostitution et non celle de ses conditions. » (625)
Ce questionnement fondamental, la France n’est pas la seule à l’avoir. De nombreux autres pays réfléchissent à ces sujets, en y apportant parfois des réponses opposées. La mission s’est intéressée à chacune des grandes conceptions de la prostitution existant aujourd’hui en Europe. Elle en a retiré la conviction qu’il était nécessaire de questionner l’ensemble des idées préconçues que l’on peut avoir sur la prostitution et qui permettent parfois d’écarter tout débat d’un revers de main, la plus commune étant qu’il s’agit du « plus vieux métier du monde ».
Pour prendre position au sein de ces expériences et de ces opinions contradictoires, la morale, et encore moins le moralisme, ne sauraient avoir leur place : les personnes prostituées n’ont pas besoin qu’on les infantilise ou pire encore, qu’on les montre du doigt. La seule boussole disponible réside dans les principes cardinaux de notre droit. C’est uniquement en se fondant sur ces derniers que pourra être élaborée une approche démocratique et républicaine de ce phénomène complexe qu’est la prostitution.
I. – UNE QUESTION À L’ORDRE DU JOUR DANS DE NOMBREUX ÉTATS MAIS MARGINALISÉE SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE
Les législations portant sur la prostitution ont récemment évolué dans de nombreux États, européens comme extra-européens. Cependant, loin de converger vers une conception commune de la prostitution, ces évolutions partent dans des directions différentes, les unes contribuant à encadrer la prostitution pour mieux la contrôler, les autres tenant à la combattre en tant que violence et atteinte à la dignité de la personne humaine.
En conséquence, compte tenu de l’existence de conceptions divergentes de la prostitution, celle-ci est rarement évoquée au niveau international. En revanche, un consensus se fait jour pour mener une action déterminée contre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle.
A. DES PRÉOCCUPATIONS INTERNATIONALES ESSENTIELLEMENT CENTRÉES SUR LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS
Si l’appréhension du phénomène prostitutionnel ne fait pas consensus au plan international, tel n’est pas le cas de la traite des êtres humains, qui a fait récemment l’objet de nombreux accords internationaux.
1. Une prise de conscience internationale
La définition de normes communes au plan international est une condition sine qua non de toute coopération satisfaisante dans le domaine de la lutte contre la traite. Il est donc particulièrement satisfaisant de constater que cette préoccupation a engendré de nombreux accords internationaux depuis plus de cent ans. Cette préoccupation s’est matérialisée à trois grands moments historiques.
En premier lieu, des conventions internationales ont été conclues au début du XXe siècle pour lutter contre la « traite des blanches ». Ont notamment été adoptés un arrangement international pour la répression de la traite des blanches, le 18 mai 1904, une convention internationale relative à la répression de la traite des blanches, le 4 mai 1910, une convention internationale pour la répression de la traite des femmes et des enfants, le 30 septembre 1921 et une convention internationale pour la répression de la traite des femmes majeures, le 11 octobre 1933.
En deuxième lieu, a été conclue, le 2 décembre 1949, la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, qui est entrée en vigueur le 25 juillet 1951 (626). Elle unifie les conventions précédemment citées en un instrument de référence unique, qui a été, à ce jour, ratifié par plus de quatre-vingts États dans le monde. Elle est applicable en France depuis 1960.
Cette convention demande aux États parties d’incriminer le fait d’embaucher, d’entraîner ou de détourner autrui en vue de la prostitution ou d’exploiter la prostitution d’autrui même si cette personne est consentante (article 1er) et de sanctionner le proxénétisme hôtelier (article 2). La convention comprend également des dispositions visant à faciliter la coopération judiciaire internationale (articles 8 à 13) et à apporter une aide aux victimes qui le désirent (articles 16 à 20).
Enfin, le dernier texte de référence au plan international est le protocole de Palerme, signé en 2000 et entré en vigueur en 2003 (627). La France l’a ratifié en octobre 2002.
Il donne la définition contemporaine de la traite des êtres humains dans son article 3.a : « L’expression “traite des personnes” désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes. » Il prévoit également des mesures de protection des victimes (chapitre II) et de prévention et de coopération (chapitre III) (628).
À travers ces trois moments historiques se dessine une évolution des relations entre la traite des êtres humains et la prostitution. Alors que la traite était vue, tant au début du XXe siècle qu’en 1949, comme l’une des causes de la prostitution, la traite est désormais conçue comme pouvant déboucher sur une multitude de formes d’exploitation. Cette évolution est très positive dans la mesure où elle permet la prise en compte de nouvelles formes d’exploitation. Elle a cependant pour conséquence de marginaliser la prostitution dans le débat international, au profit de la seule traite des êtres humains.
2. Une action déterminée au niveau européen
Cet effort en direction de la pénalisation de la traite des êtres humains et de l’exploitation sous toutes ses formes a été approfondi au niveau européen comme au plan communautaire.
La Convention de Varsovie (629), signée en mai 2005, a été élaborée dans le cadre du Conseil de l’Europe. Elle renforce les obligations des États parties, notamment en matière de garantie des droits des victimes de la traite (articles 11 à 17).
Cette politique a été relayée et confortée au plan communautaire, avec la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains, puis par la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes. Ces deux textes ont le mérite de concerner tous les États membres, mais il faisait partie du troisième pilier pour le premier et ne portait que sur les conditions de séjour pour le deuxième, ce qui en limitait la portée, du fait de l’absence de cadre commun contraignant.
C’est pourquoi, dans le cadre du traité de Lisbonne, la décision a été prise d’élaborer une nouvelle directive qui aurait vocation à s’appliquer dans tous les États membres et qui définirait une politique globale de prévention, de protection et de répression. S’inspirant du contenu de la Convention de Varsovie, tout en en approfondissant certains aspects, cette directive (630) vient de faire l’objet d’un accord entre le Conseil et le Parlement européen, en janvier 2011. Les objectifs de la directive, qui constituent autant de progrès, étaient les suivants :
– prendre en compte toutes les formes de traite (dont l’exploitation de la mendicité, par exemple) ;
– renforcer les droits des victimes en établissant le principe de la protection inconditionnelle des victimes, même en l’absence de coopération de leur part ;
– fixer un niveau minimal de peine pour la traite, de 5 ans en droit commun et de 10 ans s’il s’agit d’une infraction aggravée et améliorer les mécanismes de confiscation des avoirs criminels ;
– former les fonctionnaires susceptibles d’entrer en contact avec des victimes de la traite (les personnels médicaux, sociaux, consulaires…) à leur identification ;
– introduire dans le droit des États membres un principe de compétence extraterritoriale, selon lequel ses tribunaux sont compétents pour juger une affaire de traite, y compris si les faits ont eu lieu à l’étranger ;
– créer un poste de coordinateur européen de la lutte contre la traite, dont le premier titulaire sera issu, en mars prochain, du Lobby européen des femmes.
L’élaboration de textes n’est pas la seule manifestation de la lutte contre la traite au plan communautaire. Une stratégie de lutte contre la traite a été élaborée en 2005, qui prévoit la gestion des fonds dédiés pour financer un certain nombre de projets. Il s’agit par exemple des équipes communes d’enquête, qui peuvent bénéficier du soutien financier de la Commission et du soutien technique d’Europol. De même, la Commission souhaite protéger les victimes dans les pays tiers, notamment en Moldavie. Enfin, dans le cadre des partenariats conclus avec les pays tiers, sont prévues certaines dispositions destinées à lutter contre la traite (631). Enfin, le programme de Stockholm, qui fixe les grandes priorités de l’Union dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité pour la période 2010-2014, place la lutte contre la traite en tête des objectifs poursuivis.
3. Une implication inégale des pays dont sont issues les victimes de la traite
Les pays d’origine des victimes de la traite des êtres humains qui se prostituent en France sont en nombre relativement restreint (632) et inégalement actifs en la matière.
Les pays membres de l’Union Européenne semblent être les plus impliqués dans la lutte contre la traite. Ainsi, la Bulgarie, dont 10 000 à 20 000 ressortissants seraient contraints de se prostituer à l’étranger, a créé une commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains chargée de coordonner la lutte contre la traite. De l’avis des autorités françaises, la coopération est très bonne, tant dans le domaine policier que judiciaire, donnant lieu à près de cent remises par an dans le cadre du mandat d’arrêt européen. Il faut en effet noter que l’appartenance à l’Union européenne permet la mise en œuvre d’instruments communautaires qui facilitent la coopération, la Bulgarie ayant d’ailleurs été favorable à l’adoption de la dernière directive sur la traite (633).
Ce souci de lutter contre la traite des êtres humains est bien moins important dans certains pays voisins de l’Union européenne. Le cas de l’Ukraine est le plus flagrant. Si la traite et le proxénétisme sont punis de peines d’emprisonnement, ces dernières ne sont presque jamais prononcées. De plus, la justice n’a affaire qu’à des rabatteurs (souvent des femmes) et non pas aux organisateurs, situés hors d’Ukraine et bénéficiant de soutiens importants. Le nombre de victimes de la traite est donc important, évalué à environ 5 000 par an, dont la moitié à des fins de prostitution, avec une très forte augmentation du nombre de victimes mineures. La perspective d’une adhésion à l’Union européenne ainsi que la ratification récente du protocole de Palerme et de la Convention de Varsovie (634) pourraient induire une meilleure coopération judiciaire et une plus grande implication dans la lutte contre la traite. La Russie semble se trouver dans une situation voisine, aucune collaboration effective n’ayant eu lieu avec les autorités judiciaires françaises dans ce domaine.
Les grands pays émergents ont en revanche mis en œuvre une politique volontariste de lutte contre la traite des êtres humains. On peut citer à ce titre le Brésil et la Chine. Au Brésil, on estime à environ 60 000 le nombre de personnes victimes de la traite chaque année, en majeure partie à des fins de prostitution. De nombreux partenariats internationaux ont été développés et un plan de lutte contre le trafic des personnes a été créé. Par ailleurs, des campagnes publicitaires sont organisées pour attirer l’attention de la population sur les propositions de travail fantaisistes à l’étranger. En Chine, un plan de lutte contre les enlèvements et la traite a également été élaboré. Il est coordonné, au niveau central, par une structure réunissant 26 institutions publiques.
B. DES POLITIQUES DIVERGENTES EN MATIÈRE DE PROSTITUTION, QUI RENDENT DIFFICILE TOUT ACCORD INTERNATIONAL
Du fait des politiques divergentes menées par les différents États, le sujet de la prostitution est de moins en moins abordé en tant que tel au niveau international et européen.
1. Des politiques publiques divergentes en matière de prostitution
En matière de prostitution, chaque État mène ses propres politiques publiques. Il n’existe pas deux États ayant strictement les mêmes règles dans ce domaine et il faut tenir compte de l’écart qui sépare fréquemment les textes de leur application. De surcroît, l’édiction de la réglementation applicable à la prostitution est, la plupart du temps, dans les États fédéraux, une compétence des États fédérés.
a) Prohibitionnisme, abolitionnisme et réglementarisme : trois grands modèles…
En règle générale, l’on distingue trois grands de modèles, sans que leurs critères ne soient précisément définis (635).
Dans les pays dits « prohibitionnistes », la prostitution est interdite. Le support de cette interdiction est l’incrimination de la prostitution. Tel est le cas, notamment, en Bulgarie, en Chine et dans la quasi-totalité des États-Unis. Cette interdiction est parfois couplée avec des sanctions pénales visant les clients de la prostitution, comme en Californie. En effet, le droit pénal californien sanctionne toute personne qui sollicite, accepte ou prend part à un acte de prostitution.
Les pays « abolitionnistes », comme la France (636), ne rendent pas la prostitution illégale. Ils visent cependant à sa disparition en abolissant toutes les règles juridiques spécifiques à la prostitution, notamment celles qui pourraient la favoriser. Par ailleurs, si la prostitution privée est licite, le racolage dans l’espace public est en général interdit, de même que toutes les formes de proxénétisme, allant de la simple assistance apportée à une personne prostituée à l’exercice d’une contrainte. Le statut du proxénétisme hôtelier est variable. Il est interdit en France et en Italie, où la prostitution est licite mais où toute forme de proxénétisme, y compris hôtelier, est prohibée. Il est en revanche autorisé en Espagne, où les établissements qui disposent d’une licence de bar ou d’hôtel peuvent abriter une activité prostitutionnelle (637).
Enfin, dans les pays « réglementaristes », la prostitution fait l’objet d’un encadrement sanitaire et social de la part des autorités. Les personnes prostituées, ainsi que les maisons closes, doivent faire l’objet d’un enregistrement et leur activité peut être reconnue comme un métier. Tel est le modèle mis en œuvre aux Pays-Bas (638) ou en Suisse. Ne sont généralement passibles de sanctions pénales que la traite des êtres humains, la contrainte exercée en vue de la prostitution et l’exploitation de la prostitution d’autrui.
b) … qui ne rendent qu’imparfaitement compte de la diversité des politiques publiques
Ces trois grandes catégories ne rendent qu’imparfaitement compte de la diversité des politiques publiques menées en matière de prostitution pour plusieurs raisons.
En premier lieu, il peut exister un écart important entre les textes et leur application. La mission d’information a pu en faire l’expérience en Belgique (639). La législation pénale belge est en effet très proche de celle de la France tant en matière de proxénétisme que de racolage. Cependant, son application dépend fortement de l’application qui en est faite par les autorités locales. Ainsi, en dépit d’une incrimination figurant dans le code pénal belge, les locaux dédiés à la prostitution (maisons closes, vitrines…) peuvent être autorisés. Dans les faits, la France et la Belgique mènent donc des politiques pénales très différentes à partir d’un arsenal juridique comparable.
En second lieu, au sein d’un même État, les pratiques peuvent diverger entre entités infra-étatiques. Ainsi, la législation néerlandaise accorde-t-elle de fortes compétences aux maires en matière de prostitution. Ces derniers devraient même pouvoir prochainement interdire toute forme de prostitution, à l’exception de la prostitution privée, sur le territoire de leur commune (640). Aux États-Unis, quelques comtés du Nevada sont réglementaristes, alors que la prohibition est la règle partout ailleurs. De même, en Australie, les règles applicables relèvent des compétences des États et peuvent donc varier fortement de l’un à l’autre.
En troisième lieu, cette typologie ne prend pas en compte les règles qui concernent le client, alors que cet acteur tend à prendre une place croissante dans la législation de nombreux pays (641). Plus largement, elle n’est fondée que sur les règles pénales portant sur la prostitution, alors que de nombreuses autres politiques publiques peuvent être menées dans ce domaine, notamment en matière sanitaire, sociale ou fiscale.
Enfin, ces trois modèles ne permettent pas de rendre compte des évolutions récentes des législations portant sur la prostitution. Ils apparaissent en effet comme des modèles figés, alors que la plupart des pays européens ont modifié récemment leur législation dans des directions innovantes, que sont, notamment, la pénalisation des clients, en Suède, en Norvège ou en Islande, ou la reconnaissance d’un statut, accompagné de droits sociaux, aux Pays-Bas ou en Allemagne. Toutes ces évolutions se sont déroulées en une décennie et s’inscrivent mal dans le cadre de ces trois grands modèles.
2. La marginalisation progressive de la prostitution au sein des accords internationaux et des discussions européennes
Alors que la traite des êtres humains fait figure de sujet croissant de préoccupation tant au niveau international qu’au plan européen, la prostitution est, semble-t-il, de moins en moins évoquée dans les enceintes internationales, du fait, notamment, des politiques divergentes qui sont conduites en la matière.
a) Un sujet polémique, qui semble être de moins en moins abordé
Cette évolution est particulièrement marquée au plan international, où l’attention tend à se détourner de la prostitution. La Convention de 1949 portait ainsi spécifiquement sur la « répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui ». Elle est fondée sur le présupposé que traite des êtres humains et prostitution sont intimement liées, débutant par : « Considérant que la prostitution et le mal qui l'accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de la prostitution, […] ». Elle comporte d’ailleurs des articles spécifiquement consacrés à la prostitution, tel que l’article 6 qui prévoit l’abolition de tous les textes qui disposent que les personnes prostituées « doivent se faire inscrire sur des registres spéciaux, posséder des papiers spéciaux, ou se conformer à des conditions exceptionnelles de surveillance ou de déclaration. »
À l’inverse, la traite et l’exploitation sexuelle apparaissent être aujourd’hui le plus petit dénominateur commun des négociations internationales et européennes. Le terme de « prostitution » n’apparaît que dans les définitions de la traite et de l’exploitation qui figurent à l’article 3 du Protocole de Palerme, à l’article 4 de la Convention de Varsovie et à l’article 2 de la nouvelle directive, à l’exclusion de toute autre mention dans ces textes internationaux et communautaires (642). Ceci ne signifie pas que leurs autres dispositions ne concernent pas la prostitution. Néanmoins, elles ne portent que sur la prostitution en tant qu’elle est le fruit de la traite des êtres humains et/ou d’une exploitation sexuelle et en aucun cas sur la prostitution en elle-même. « La prostitution constitue un sujet très polémique dans les institutions européennes, dans la mesure où chaque pays a une législation particulière en la matière, seule la traite faisant consensus », a estimé Mme Eva-Britt Svensson, présidente de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres au Parlement européen (643).
Cet état de fait résulte pour une large part des divergences des politiques menées en matière de prostitution. De fait, lors des débats sur la nouvelle directive, les opinions exprimées par les parlementaires européens étaient fortement corrélées à leur pays d’origine et non à leur appartenance politique, ce qui est, aux dires des interlocuteurs rencontrés par la mission, inhabituel : « les parlementaires qui viennent d’Europe du Nord (Suède mais aussi Finlande et Danemark où un débat vient d’avoir lieu à la suite de la publication du rapport d’application de la loi suédoise) sont favorables à la pénalisation du client, à l’inverse de l’Allemagne et des Pays-Bas notamment », a indiqué Mme Eva-Britt Svensson (644). Mme Élisabeth Tomé-Gertheinrichs a confirmé que la prostitution ne constituait pas un thème d’échange lors des rencontres européennes consacrées au droit des femmes, du fait des écarts importants séparant les législations nationales (645).
b) Une préoccupation qui serait même en voie de régression
À divers égards, le souci d’aborder la prostitution dans les discussions internationales ne semble pas seulement être occulté par la traite des êtres humains. Il est également en voie de disparition, ce qui ne manque pas d’inquiéter. Les changements sémantiques à l’œuvre sont, à ce titre, riches d’enseignements.
Divers États tentent ainsi de faire reconnaître, sur la scène internationale, l’existence d’une « prostitution libre », en faisant inscrire dans les textes internationaux l’expression de « prostitution forcée ». Cette revendication est portée, dans les instances internationales, par une coalition hétéroclite où figurent notamment les pays qui réglementent la prostitution, mais également un certain nombre de pays musulmans. En effet, ainsi que l’a souligné Mme Malka Marcovich, certains de ces pays tentent de séparer la prostitution forcée de la prostitution libre, afin de pouvoir sanctionner pénalement les femmes qui entretiennent des relations sexuelles en dehors de leur mariage sous l’incrimination de prostitution (646). Lors des négociations portant sur le protocole de Palerme, la volonté de reconnaître une « prostitution libre » était notamment portée par les Pays-Bas, l’Allemagne et l’Iran. De la même façon, en mai 2009, l’expression de « prostitution forcée » a dû être retirée in extremis d’une déclaration qui était initialement soutenue par la France aux Nations Unies (647).
D’autre part, les expressions de « travail du sexe » et de « travailleur du sexe » tendent à entrer dans le langage des organisations internationales. Le Bureau international du travail (BIT), par exemple, qui voudrait avoir une approche pragmatique sur le « métier » de la prostitution, a adopté cette terminologie, de même que l’Organisation mondiale de la santé (OMS). L’adoption de ces expressions, qui contribuent à la banalisation de la prostitution, est le fait de la pression des États réglementaristes (648) ou, tout simplement, d’un manque de consciences des enjeux de cette problématique de la part des organisations internationales (649).
De manière analogue, la Convention du 2 décembre 1949 est de plus en plus contestée. Certains États font pression pour qu’elle soit considérée comme obsolète en dépit du grand nombre de ratifications dont elle a fait l’objet et qu’elle soit retirée de la liste des conventions universelles. De plus, cette convention, contrairement aux traités plus récents, ne prévoit pas de mécanisme contraignant les États à dresser un bilan périodique de son application. Le groupe de travail sur les formes contemporaines d’esclavage, qui existait jusqu’en 2006, était chargé d’analyser la manière dont les pays appliquaient la convention. Or, dans le cadre de la transformation de la commission des droits de l’homme des Nations unies en conseil des droits de l’homme, ce groupe de travail a été supprimé et un poste de rapporteur spécial a été créé sur la traite (650). La résolution qui a procédé à cette modification a également introduit la notion de « prostitution forcée », à l’initiative de l’Égypte, et supprimé la référence à la Convention de 1949, d’après ce qu’a indiqué Mme Malka Marcovich (651). Ainsi, même le Haut conseil aux droits de l’homme ne mentionne plus cette convention parmi les conventions de référence.
Au niveau international comme au plan communautaire, la prostitution, dont l’analyse est moins univoque que celle de la traite des êtres humains et de l’exploitation sexuelle, universellement condamnées, passe donc au second plan. Ce faisant, le risque existe que soit légitimée l’idée selon laquelle il existerait, à côté de la « prostitution forcée », une « prostitution libre », présupposé souvent invoqué mais rarement questionné.
II. – « LE PLUS VIEUX MÉTIER DU MONDE » : UN SYSTÈME REPOSANT SUR DES PRÉSUPPOSÉS NON QUESTIONNÉS
La prostitution est souvent présentée comme une donnée inhérente à toute vie sociale. C’est ce qu’entend démontrer l’expression de « plus vieux métier du monde ». Dès lors, la prostitution ne peut plus être envisagée que comme un trouble à l’ordre public qu’il s’agirait de réguler pour en éliminer toute forme d’exploitation sexuelle et pour en réduire les éventuelles nuisances. C’est ce raisonnement qui fonde la politique engagée aux Pays-Bas.
Ce constat est souvent posé mais presque jamais discuté. Peu de personnes s’interrogent sur ce qui fonderait la nécessité sociale de la prostitution. Souvent, de fausses évidences sont avancées pour couper court à tout débat : « la prostitution réduirait le nombre de viols » ou « la prostitution est nécessaire pour satisfaire les besoins sexuels des hommes isolés ». Ce sont ces préjugés qu’il faut examiner.
Cette argumentation est généralement couplée à une condamnation ferme de l’exploitation sexuelle. La prostitution, inhérente à toute société, aurait une utilité sociale et devrait être admise pourvu que les personnes qui exercent cette activité soient libres de le faire. Le droit de se prostituer est, dans cette logique, corrélatif du devoir de lutter contre toutes les formes d’exploitation.
A. LA PROSTITUTION, UN FAIT SOCIAL À RÉGULER : LE MODÈLE NÉERLANDAIS
Les Pays-Bas sont emblématiques de cette conception de la prostitution, qui y est perçue comme une donnée de la vie sociale. Dès lors, il incombe aux autorités de réguler ce secteur d’activité pour que n’y exercent que des personnes prostituées libres de leurs actes. Le bilan de cette politique est cependant mitigé.
1. La prostitution, une donnée à réguler
La prostitution étant considérée comme un fait de société, inéluctable, la seule politique pouvant être menée en la matière consiste à l’encadrer.
a) La prostitution est une donnée sociale
Tous les interlocuteurs de la mission d’information rencontrés aux Pays-Bas ont fait état de leur conviction que la prostitution est un fait de société qui n’est pas voué à disparaître (652). Ce constat était toujours la première chose qu’ils indiquaient à la mission d’information, écartant de la sorte tout questionnement éthique.
M. Marnix Norder, adjoint au maire de La Haye en charge de l’urbanisme, a ainsi estimé que la prostitution était le plus vieux métier du monde et qu’il était celui qui durerait le plus longtemps, arguant du fait que la prostitution avait existé en tous temps, en tous lieux et dans toutes les religions (653). Dès lors, il incombe au pouvoir politique de réguler ce phénomène davantage que de chercher à en interroger la légitimité. « Nous avons renoncé au débat éthique sur la prostitution », a expliqué M. Paul Peters, sénateur (654).
Dès lors, la politique néerlandaise dans le domaine de la prostitution a consisté à réguler et à encadrer toujours davantage la prostitution. Les principaux objectifs de cette politique sont :
– de lutter contre la traite et l’exploitation de la prostitution, en exerçant un contrôle accru sur ce secteur d’activité ;
– d’améliorer les conditions de vie et de travail des personnes prostituées, notamment dans le domaine de la sécurité, de la santé et des droits sociaux.
Afin de parvenir à remplir ces deux objectifs, la décision a été prise de décriminaliser le secteur de la prostitution afin de le faire sortir de la clandestinité.
b) Lutter contre la traite et l’exploitation en réglementant la prostitution
L’interdiction des maisons closes a été levée le 1er octobre 2000, afin de renforcer les contrôles pouvant y être exercés. Cette levée a fait suite à une longue période de tolérance durant laquelle les maisons closes étaient toujours interdites mais où aucune action pénale n’était engagée à l’encontre de leurs exploitants (655).
Depuis lors, il revient aux communes de réglementer la prostitution sur leur territoire. Elles peuvent, par exemple, soumettre la tenue d’une maison close à une autorisation communale. Cette autorisation peut être accompagnée de prescriptions en matière « de dimensions minimales des chambres, de prévention des incendies, de mesures de sécurité (dispositif d’alarme) et d’hygiène (présence de lavabos et de préservatifs) » (656). Chaque commune est donc libre de réglementer la prostitution comme elle l’entend et de déterminer les zones où elle est autorisée. De nombreuses communes ont ainsi interdit la prostitution de rue afin de limiter les plaintes des riverains. Cette situation a cependant créé de fortes divergences entre communes, certaines réglementant plus ou moins strictement l’ouverture de maisons closes, d’autres l’interdisant (657).
La prostitution des mineurs et des personnes sans titre de séjour est interdite et fait encourir des sanctions pénales et administratives au propriétaire de la maison close (notamment la fermeture de son établissement). De plus, l’exploitation sexuelle est interdite. Elle se définit par l’absence d’une juste rémunération de la personne prostituée (658).
Les clients sont également invités par le biais de campagnes d’information à dénoncer les cas d’exploitation sexuelle dont ils pourraient avoir connaissance. Le constat a été fait qu’à l’occasion de chacune de ces campagnes, le nombre de dénonciations reçues par la police augmentait (659).
De plus, en pouvant contrôler librement et à tous moments ces établissements, la police municipale est mieux à même de repérer les signes de violence et donc les cas d’exploitation, d’autant plus qu’elle n’est pas perçue par les personnes prostituées comme ayant une action répressive (660). Peuvent également opérer des contrôles les services fiscaux, les services de santé ou du logement.
c) Améliorer la condition des personnes prostituées en faisant de la prostitution un travail comme un autre
Aux Pays-Bas, la prostitution est considérée comme un travail, ouvrant les mêmes droits et les mêmes obligations que tout autre travail. Les personnes prostituées comme les exploitants d’établissement sont tenus de payer des cotisations sociales et sont imposés. Les personnes prostituées indépendantes doivent se faire enregistrer auprès des services fiscaux et de la chambre de commerce.
Les personnes prostituées peuvent être soit indépendantes, soit salariées. Beaucoup d’exploitants cherchent à les faire reconnaître comme indépendantes pour éviter de payer des taxes et des cotisations sociales, mais dans de nombreux cas, la relation entre exploitant et personnes prostituées comporte des marques de subordination qui en font, d’un point de vue juridique, des salariées (661).
En matière de droit du travail, ces personnes ont droit à une allocation chômage si elles exerçaient en tant que salariées et sont éligibles, le cas échéant, à l’allocation d’incapacité de travail. Cependant, personne ne peut se voir proposer un emploi dans le secteur de la prostitution par les agences publiques pour l’emploi, ces emplois n’étant « pas considérés comme appropriés. » (662) De surcroît, il n’existe pas de formation professionnelle en matière de prostitution.
2. Des objectifs imparfaitement atteints
Cependant, les objectifs que s’étaient fixés les autorités néerlandaises ne sont pas entièrement atteints, le nombre de délits constatés en matière de traite des êtres humains étant en augmentation.
a) Des effets non mesurés sur le nombre de personnes prostituées
Le nombre de personnes était estimé à environ 25 000 par les pouvoirs publics au moment de la levée de l’interdiction des maisons closes, en 2000. Environ les deux tiers étaient étrangères. Les prostitutions masculine et transgenre représentaient chacune environ 5 % de ce chiffre global (663).
Selon M. Marnix Norder, la légalisation des maisons closes n’a pas entraîné d’augmentation de la prostitution à La Haye (664). Cependant, aucune évaluation n’a été réalisée depuis pour mesurer l’impact de la levée de l’interdiction sur le nombre de personnes prostituées (665).
b) La réglementation n’a pas mis fin à la traite et à l’exploitation sexuelle
La réglementation de la prostitution a été accompagnée d’une politique volontariste en matière de lutte contre la traite des êtres humains, avec la désignation d’un procureur spécialisé, la constitution d’une coordination nationale et la nomination d’un rapporteur national. Cette politique a notamment pris appui sur les contrôles rendus possibles par la légalisation des maisons closes (de la police, de l’inspection du travail…).
Cependant, « les évaluations menées en 2002 et 2007 ont révélé que si la situation s’est améliorée après 2000, de graves abus existent encore, telle la traite des femmes ou la prostitution forcée de mineurs » (666), indique le ministère néerlandais des Affaires étrangères. Les chiffres fournis par la rapporteure nationale en sont une illustration. Pour leur interprétation, deux précautions doivent cependant être prises. En premier lieu, l’augmentation du nombre de victimes peut traduire une hausse du taux de révélation de la traite des êtres humains et non uniquement une hausse de la criminalité en la matière. En second lieu, il faut noter que la traite des êtres humains peut avoir d’autres finalités que l’exploitation sexuelle (esclavage domestique,…), même si la plupart des victimes sont exploitées à des fins de prostitution (667).
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE VICTIMES SIGNALÉES DE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS AUX PAYS-BAS ENTRE 2000 ET 2009
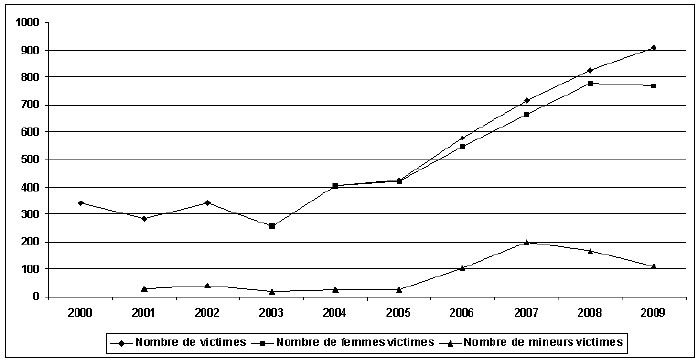
Source : 8e rapport de la rapporteure nationale sur la traite des êtres humains, Trafficking in Human Beings. Ten years of indépendante monitoring, 2010, p. 157-159
Mme Corinne Dettmeijer-Vermeulen, rapporteure nationale sur la traite des êtres humains, a dressé le constat qu’il existait encore un fort lien entre prostitution et traite des êtres humains, notamment en ce qui concerne les pays d’origine des personnes prostituées (668). Il y aurait d’ailleurs eu une augmentation, au moins pendant un temps, du nombre de personnes prostituées en situation irrégulière dans les quartiers rouges, probablement victimes de la traite (669). Afin de lutter contre ces phénomènes, certaines zones de prostitution ont ainsi été réduites, voire fermées, notamment à Amsterdam.
Ainsi que le rapporte le document du ministère néerlandais des Affaires étrangères, il existe « un déplacement de la prostitution vers les hôtels, les bars, les agences d’escort et les salons de massage, qui opèrent dans l’illégalité s’ils ne disposent pas des licences nécessaires. » (670) De plus, la prostitution via Internet, plus difficile à contrôler, semble se développer (671).
Enfin, un nouveau type de proxénétisme préoccupe les autorités néerlandaises : de plus en plus d’adolescentes néerlandaises, généralement vulnérables, se laissent séduire par un jeune proxénète (appelé loverboy) qui les contraint ensuite à se prostituer, souvent dans une maison close (672).
L’impression qui se dégage est donc celle de la difficulté à résorber la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle, même avec la transparence accrue qui serait obtenue par la légalisation de certaines formes de proxénétisme et la reconnaissance de la prostitution. Selon un rapport du gouvernement norvégien de 2004, comparant la politique menée en Suède et celle engagée aux Pays-Bas, il existerait, dans ce dernier pays, un secteur illégal. Par ailleurs, l’exploitation n’aurait pas disparu du secteur légal (673).
Le dernier rapport de la rapporteure nationale dresse le bilan suivant de la levée de l’interdiction des maisons closes : « Le fait d’exiger une licence et les mesures prises pour assainir le secteur de la prostitution à la suite de la levée de l’interdiction des maisons closes ont été évalués à deux reprises. La seconde évaluation a montré qu’en plus des établissements disposant d’une licence et des formes de prostitution qui ne requièrent pas de licence, il existait une prostitution (illégale) en dehors du système des licences. Cependant, cette évaluation a conclu que le secteur légal était plus important que le secteur illégal. Une autre de ses conclusions a été que (en 2006) le système des licences fonctionnait presque partout correctement et que partout des contrôles étaient menés à différentes échelles, de telle sorte qu’il n’y avait plus de « sanctuaires ». Ceci semble démontrer que le secteur de la prostitution était efficacement contrôlé. Cette conclusion ne reflète cependant pas bien la réalité, comme l’a montré, par exemple, l’affaire Sneep (674), dans laquelle plus de cent femmes travaillant dans le secteur légal avaient en fait été contraintes de se prostituer et comme l’a confirmé le rapport administratif qui a suivi cette affaire. Le contrôle du secteur légal doit donc demeurer l’objet d’attentions » (675).
3. Vers un renforcement de la réglementation, qui passe par la pénalisation des clients
Afin de combattre ces lacunes, tant dans le secteur légal que dans le secteur illégal, le gouvernement néerlandais a présenté un projet de loi en novembre 2009.
a) Un projet de loi visant à renforcer l’encadrement de la prostitution et la lutte contre la traite
Un projet de loi sur la régulation de la prostitution et la lutte contre les abus dans le commerce du sexe a été déposé par le gouvernement néerlandais le 10 novembre 2009. Il vise à renforcer les contrôles portant sur la prostitution pour mieux combattre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle.
Le projet de loi prévoit de rendre obligatoire l’enregistrement de toutes les personnes prostituées sur un registre national automatisé. Les agences d’escortes et les établissements de prostitution devront également s’enregistrer sur un fichier pour se voir délivrer une licence. Cet enregistrement devrait être l’occasion de prendre contact avec les personnes prostituées et de leur délivrer des informations sur leurs droits et sur les alternatives qui s’offrent à elles, ainsi que de leur transmettre le numéro de téléphone des associations et de la police.
Afin de contrer la prostitution clandestine, le projet de loi prévoit de créer deux nouvelles infractions. En premier lieu, les personnes prostituées qui pratiqueront cette activité sans être enregistrées préalablement seront passibles d’une contravention. En second lieu, les clients qui auront recours à une personne prostituée non enregistrée se rendront coupables d’un délit (676). La preuve de l’enregistrement devra être apportée par la personne prostituée et sera matérialisée par un certificat qui sera exposé sur la vitrine ou présenté au client.
De surcroît, il est question de faire passer l’âge minimal pour exercer la prostitution de 18 à 21 ans et de donner aux communes la possibilité de choisir l’option « zéro prostitution », ce qui leur permettrait de ne pas avoir d’établissements spécialisés sur leur territoire mais n’interdirait pas aux personnes qui le désirent de se prostituer chez elles.
b) Un débat public qui ne porte plus sur la prostitution mais sur ses conditions d’exercice
Ainsi, les Pays-Bas entendent renforcer leur politique de régulation d’une activité perçue comme devant, en tout état de cause, perdurer. Le projet de loi déposé par le gouvernement vise à séparer encore plus distinctement la prostitution de l’exploitation sexuelle.
En conséquence, le débat ne se focalise pas sur la nature de la prostitution mais sur ses conditions d’exercice, qui doivent permettre la lutte contre la traite et le maintien de l’ordre public. Ainsi, selon Mme Marlies Van Amerongen, de l’association Article 273f, les débats portant sur le projet de loi se concentrent sur la prostitution des personnes en situation irrégulière et sur l’élévation de l’âge minimal requis pour exercer la prostitution à 21 ans (677).
Cette conviction de l’inéluctabilité de la prostitution est si fortement ancrée dans les esprits que Mme Corinne Dettmeijer-Vermeulen, rapporteure nationale sur la traite des êtres humains, a vanté les mérites du modèle néerlandais en matière de lutte contre la traite en indiquant qu’il y avait eu près de 900 affaires de traite depuis 2000, contre environ 50 constatées en Suède (678), attribuant cette différence à l’efficacité de la politique néerlandaise en la matière. Jamais n’a été évoquée l’idée que la réglementation de la prostitution pouvait constituer un encouragement à la prostitution et à la traite des êtres humains, dans un pays qui compterait pourtant dix fois plus de personnes prostituées que la Suède, pour une population deux fois supérieure (679).
B. « L’UTILITÉ SOCIALE » DE LA PROSTITUTION
La position consistant à considérer la prostitution comme le « plus vieux métier du monde » et, partant, à juger qu’elle est inhérente à toute vie sociale, s’appuie généralement sur un certain nombre d’arguments affirmés comme autant d’évidences issues du bon sens le plus élémentaire. On entend ainsi fréquemment que la prostitution fait diminuer le nombre de viols ou qu’elle permet à certains hommes d’accéder à une forme de sexualité dont ils seraient, dans le cas contraire, exclus. Ce sont ces évidences qu’il faut à présent soumettre à un regard critique.
1. « La prostitution fait diminuer le nombre de viols »
La prostitution est souvent vue comme un moindre mal : il serait préférable que les hommes fréquentent des personnes prostituées plutôt qu’ils violent pour assouvir leurs besoins sexuels. Certains clients font d’ailleurs part de cette conviction : « On ne peut pas à la fois vouloir juguler ce genre de travail, d’activité, et penser que, d’un autre côté, les hommes vont assouvir leurs besoins naturels d’une façon bucolique » (680), indique l’un d’entre eux. Un autre, allant au bout de cette logique, explicite ce raisonnement : « Après tout, c’est peut-être une fonction régalienne de l’État que d’organiser la prostitution pour qu’il y ait moins de serial killers. » (681)
a) Une « évidence » démentie par les faits
Ce raisonnement, qui se veut fondé sur le bon sens, est démenti par les études existantes. On peut citer, par exemple, le cas du Nevada. En effet, il s’agit du seul État des États-Unis dont certains comtés ont adopté une position réglementariste en matière de prostitution, les autres étant prohibitionnistes. Il est dès lors possible de comparer le taux de viol existant dans les comtés de cet État en fonction de la politique adoptée en matière de prostitution. Le département de droit pénal de l’université du Nevada a mené une étude en la matière qui donne les résultats suivants.
TAUX DE VIOLS DANS LES COMTÉS DU NEVADA
SELON LE STATUT LÉGAL DE LA PROSTITUTION
2000 |
2007 | |
Taux de viols dans les comtés ruraux qui ont légalisé la prostitution |
35,8 |
45,7 |
Taux de viols dans les comtés ruraux qui n’ont pas légalisé la prostitution |
16,9 |
8,8 |
Taux de viols dans les comtés urbains (aucun n’ayant légalisé la prostitution) |
43,7 |
41,5 |
Source : Note du département de droit pénal de l’université du Nevada (682). Les taux sont exprimés en nombre de viols pour 100 000 habitants.
Ces chiffres édifiants renversent complètement la vision que l’on peut avoir des relations entre prostitution et taux de viols. En effet, il apparaît que le taux de viol est de deux à cinq fois supérieur dans les comtés qui ont légalisé la prostitution que dans ceux où elle est interdite. De plus, la différence entre les taux de viol semble s’accroître avec le temps. Ces chiffres devraient être affinés par une étude moins globale, dans la mesure où les taux de viol varient également entre les comtés qui ont légalisé la prostitution et où d’autres variables sont susceptibles d’expliquer une part de cet écart. Il n’en demeure pas moins que le lien entre prostitution et viols est inexistant voire inverse de celui que l’on pourrait imaginer : la légalisation de la prostitution n’a pas pour conséquence de faire baisser le taux de viols.
Le même constat peut être dressé à la suite de l’expérience suédoise, qui a vu la pénalisation des clients de la prostitution à partir du 1er janvier 1999. Or, cette pénalisation, qui aurait fait diminuer la prostitution (683), ne s’est pas traduite par une rupture de pente dans la courbe des taux de viols et d’agressions sexuelles dénoncés, qui augmentent régulièrement depuis le début des années 1980 en raison notamment de l’augmentation du taux de plainte dans ces affaires.
TAUX DE VIOLS ET D’AGRESSIONS SEXUELLES POUR 100 000 HABITANTS EN SUÈDE
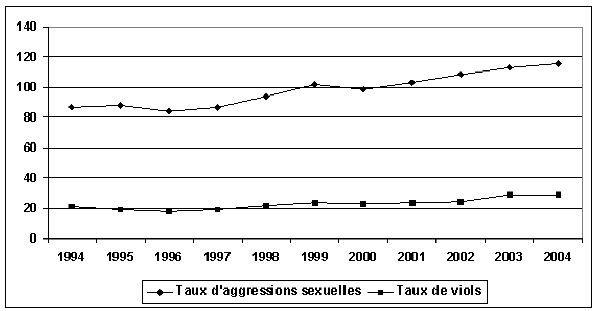 Source : Ministère suédois de la Justice. NB : Les définitions légales du viol et de l’agression sexuelle ont été étendues en 2005, ce qui rend les chiffres ultérieurs, en forte augmentation, incomparables avec ceux qui figurent sur ce graphique.
Source : Ministère suédois de la Justice. NB : Les définitions légales du viol et de l’agression sexuelle ont été étendues en 2005, ce qui rend les chiffres ultérieurs, en forte augmentation, incomparables avec ceux qui figurent sur ce graphique.
Enfin, il faut mentionner le fait que, du point de vue des personnes prostituées qui sont contraintes de se prostituer, la succession de rapports sexuels non désirés s’assimile à des viols, mais qui sont jugés légitimes et qui ne sont pas déclarés.
b) Au contraire, la reconnaissance de la prostitution peut accroître les pressions sexuelles
Le client n’a pas du tout le même profil psychologique que le violeur qui ne peut vivre sa sexualité que dans la violence et la contrainte, a estimé M. Jean-Marc Souvira, commissaire divisionnaire, ancien responsable de l’office central pour la répression de la traite des êtres humains (OCRTEH) (684). Ainsi, prostitution et viol relèveraient de deux logiques différentes, la seconde ne pouvant être fondée que sur la contrainte. D’ailleurs, ainsi que le montrent les statistiques du Nevada, la légalisation de la prostitution n’implique pas un taux inférieur de viols.
À l’inverse, plusieurs personnes auditionnées ont estimé que la prostitution entraînait une dégradation de l’image des femmes dans les quartiers où elle avait cours. Ainsi Mme Claire Quidet, porte-parole du Mouvement du Nid, a fait état de témoignages de femmes habitant dans des quartiers de prostitution qui relatent un fort harcèlement sexuel, « toutes les femmes étant potentiellement des personnes prostituées et donc achetables. » (685) D’ailleurs, en Allemagne, certaines rues consacrées à la prostitution sont interdites aux femmes (686). De même, les établissements spécialisés espagnols où la mission s’est rendue ne tolèrent pas l’entrée de femmes (687).
On peut donc penser, avec Mme Claudine Legardinier et M. Saïd Bouamama, que « loin d’empêcher les viols, la prostitution constitue au contraire une ouverture de droits, non seulement sur le corps des personnes prostituées, mais aussi sur le corps d’autrui, notamment féminin, en entérinant dans les esprits l’idée qu’il s’agit d’un produit disponible que tout homme peut légitimement s’approprier. » (688)
Enfin, il ne faut pas oublier que les personnes qui sont le plus victimes de viols sont les personnes prostituées elles-mêmes. Au Canada, aux États-Unis et en Allemagne, le pourcentage de personnes prostituées déclarant avoir été violées plus de cinq fois au cours de leur activité est respectivement de 67 %, 59 % et de 50 % (689). Aucune étude comparable n’a été menée pour la France mais le journal des répressions et des violences de Cabiria illustre également la fréquence des viols subis par les personnes prostituées (690). Or, la plupart de ces viols ne sont pas comptabilisés dans les chiffres officiels du fait de l’absence de dépôt de plainte ou du refus des forces de l’ordre d’enregistrer ces plaintes (691).
2. « La prostitution est une réponse à la misère sexuelle »
Autre moyen d’établir l’utilité sociale de la prostitution, cette dernière constituerait le seul accès possible à la sexualité pour un certain nombre d’hommes.
a) La « misère affective et sexuelle » des clients
La conception consistant à juger de l’utilité sociale de la prostitution au regard de l’accès à la sexualité qu’elle fournirait à des personnes isolées a pris une forme contemporaine sous la figure de l’assistance sexuelle dont devraient bénéficier les personnes handicapées.
L’argument principal avancé par M. Marcel Nuss, qui a lancé le débat en France sur l’assistanat sexuel, pour la reconnaissance de cette pratique est que certaines personnes handicapées vivent « une misère affective et sexuelle » liée à la « souffrance d’un corps et d’une libido bridés » (692). Il écrit également, s’adressant à Mme Roselyne Bachelot : « J’aurais essayé de vous expliquer quelles souffrances représente le fait de réprimer sa libido, de refouler ses pulsions et d’être privé de vie sexuelle. » (693) Notre collègue Jean-François Chossy, qui réfléchit actuellement à la question de l’assistance sexuelle, partage ce même point de vue en évoquant le fait que les pulsions sexuelles inassouvies de la personne handicapée peuvent devenir insoutenables, justifiant ainsi le recours à l’assistance sexuelle (694).
De manière plus générale, on reconnaît parfois une utilité sociale à la prostitution sur le fondement qu’elle serait la seule réponse possible à la misère sexuelle et affective de certains hommes, qui ne pourraient pas avoir accès à la sexualité sans cela.
Pour d’autres, la prostitution permettrait également de préserver les couples. Plutôt que de quitter leur femme, certains hommes préfèreraient recourir à la prostitution. Mme Gabrielle Partenza estime même que « sans les prostituées, il y aurait certainement plus de massacres au sein des couples […] on a réussi à ressouder des couples » (695).
Enfin, certaines personnes prostituées revendiquent un rôle d’assistante sociale. Mme Gabrielle Partenza a fait part à la mission d’une anecdote selon laquelle il lui aura fallu deux heures pour désarmer l’un de ses clients qui voulait se suicider devant elle (696). Nombreux sont également les témoignages selon lesquels les clients ne seraient pas uniquement à la recherche d’une prestation sexuelle mais aussi d’une relation affective : « en fait, c’est comme un thérapeute. On a un mal de dent, on va voir le dentiste. On a un problème cardiaque, on va voir un cardiologue. On a un problème de sentiment, il y a des femmes qui en font leur métier et on va les voir » (697), explique un client.
b) Les clients, des « hommes ordinaires »
La vision commune voudrait que les clients de la prostitution soient des personnes qui ne puissent pas avoir de relations sexuelles en dehors de cette circonstance. Pourtant, il apparaît que les clients de la prostitution sont « des hommes ordinaires » (698), dont la sociologie ne diffère pas fondamentalement de celle de la population française en général.
Ainsi, au sein de l’échantillon qui a servi de base à l’enquête menée en 2004 par le Mouvement du Nid, environ 37 % des clients interrogés vivaient en couple et 71 % avaient vécu en couple (699). Par ailleurs, plus de 50 % des clients sont pères de famille. Enfin, toutes les catégories sociales sont représentées dans l’échantillon, les couches les plus aisées l’étant davantage du fait du coût du recours à la prostitution. « Il n’existe pas de profil type d’homme recourant à la prostitution. Ces hommes sont divers, ont des trajectoires hétérogènes, mentionnent des motivations également diverses. Ils ressemblent en quelque sorte aux hommes de nos sociétés contemporaines » (700), affirment ainsi Mme Claudine Legardinier et M. Saïd Bouamama.
D’ailleurs, ces hommes se considèrent eux-mêmes comme étant ordinaires. Être client de la prostitution est alors pensé comme allant de soi puisque l’un d’entre eux dit par exemple : « je serais curieux de rencontrer quelqu’un qui ne l’a pas fait, et chez les rarissimes qui ne l’ont pas fait, je serais curieux de voir ceux qui n’ont pas eu ce fantasme. » (701)
La même impression générale a été donnée par le propriétaire de l’établissement spécialisé de La Haye rencontré par la mission d’information, qui a estimé, sur la base de son expérience, que les clients étaient « M. tout le monde » (702). Mme Claude Boucher, présidente de l’association Les Amis du bus des femmes, a également indiqué que la plupart des clients étaient des hommes ordinaires (703).
L’étude sur le « devenir-client » a permis de mettre au jour les principales raisons invoquées par les clients pour justifier leur recours à la prostitution. Sur ce fondement, ils peuvent être répartis en cinq groupes principaux :
– les hommes isolés affectivement et sexuellement. Cet isolement est fréquemment expliqué par les clients, par leur timidité et leur peur des femmes. « C’est facile d’aller voir une prostituée. La relation est vite engagée. Il n’y a pas de comptes à rendre. On n’a pas besoin d’être bien, d’être à la hauteur, d’être intelligent » (704), évoque l’un d’eux. Ces clients ont souvent une faible estime d’eux-mêmes et peuvent être désaffiliés. C’est alors davantage la relation qui est recherchée, l’aspect marchand n’étant qu’un moyen. Peuvent également être rangées dans cette catégorie les personnes vivant une déception et un échec amoureux. Certains clients ont par exemple recours à la prostitution lors de chaque séparation ;
– les hommes qui éprouvent une certaine forme de méfiance à l’égard des femmes. Ces clients décrivent les femmes comme « méchantes » ou « compliquées ». Certains contestent les évolutions sociales qui attribuent davantage de place aux femmes, d’autres éprouvent une véritable haine des femmes. Un client parle ainsi d’« êtres démoniaques » (705) et indique ne jamais faire attention à ce qu’elles peuvent ressentir. Ces clients cherchent notamment dans la prostitution un besoin de domination, qui exprimerait pour partie le décalage entre leur socialisation centrée sur le masculin et les évolutions sociales contemporaines (706) ;
– les hommes qui sont déçus par leur sexualité de couple. Ces hommes distinguent la sphère affective (l’épouse) et la sphère sexuelle (les prostituées). Ils peuvent également mettre en avant leurs « besoins naturels » qui ne seraient pas satisfaits au sein de leur couple, et la « compétence professionnelle » (707) des personnes prostituées ;
– les hommes qui ne désirent pas s’engager. Cette motivation se retrouve chez les hommes célibataires mais aussi chez les hommes mariés qui souhaitent préserver leur couple et évitent donc d’avoir une maîtresse, « pour ne pas tromper leur femme » (708) ;
– les hommes dépendants à la prostitution. Certains clients ne parviennent pas à se passer de la prostitution. « Je me dis des fois que j’ai envie d’arrêter mais je ne sais pas si je pourrais […]. J’ai envie d’arrêter parce qu’il y a des occasions où je ne me sens pas libre. Je le fais parce que j’en ai besoin, j’en ai besoin, j’ai un besoin physique. Mais je me sens forcé. Alors c’est comme la cigarette, il n’y a que ça » (709), évoque un client.
Ainsi, le fait de devenir client de la prostitution est bien davantage lié, de manière générale, à des représentations archaïques des relations entre l’homme et la femme qu’à une extrême solitude affective et sexuelle. Attirer le regard sur la prostitution comme réponse à une forme de misère sexuelle et affective, c’est donc le détourner de la majorité des clients de la prostitution, qui sont des hommes ordinaires.
3. Des conceptions largement fondées sur les « besoins irrépressibles » de la sexualité masculine
La vision de la prostitution comme alternative au viol ou comme réponse à la misère sexuelle repose en fait sur le présupposé que les hommes auraient des besoins sexuels irrépressibles qu’il serait nécessaire de satisfaire. Les clients interrogés adoptent souvent cette conception de la sexualité masculine. L’un d’eux dit par exemple : « C’est un besoin naturel de l’homme. Moi, je le ressens comme ça. Ce n’est pas faire l’amour, c’est décharger quelque chose qui nous pèse. Je suis cru mais tant pis. Pour moi c’est ça, on vient se soulager un truc et puis c’est tout. C’est comme une bête, même pas comme une bête parce qu’une bête c’est pour procréer alors que nous c’est juste pour décharger. » (710) Un autre indique : « Quand je réfléchis à ça, je me dis : « Dans une basse-cour, on met un coq pour sept poules. » » (711)
Dans cette optique, certains considèrent qu’il reviendrait à la puissance publique d’organiser la prostitution pour prendre en charge ce besoin collectif, ainsi que le préconisait Alexandre Parent-Duchâtelet, médecin hygiéniste du début du XIXe siècle et fondateur du réglementarisme, qui concevait les personnes prostituées comme un « réseau d’égouts » et l’éjaculation comme une « vidange organique » (712). Un client estime par exemple : « Moi je serais pour un remboursement des femmes de joie, des passes ; que ce soit pris en charge par la Sécu parce qu’elles aident vraiment. » (713) Il serait donc nécessaire, dans tous les cas, que certaines personnes, essentiellement des femmes, se consacrent, pour le bien-être collectif, à l’exercice de la prostitution.
Cependant, ce discours justificateur de la prostitution doit être fortement relativisé au regard des circonstances qui poussent les clients à avoir recours à la prostitution :
De nombreux clients témoignent du fait que le recours à la prostitution est corrélé à l’argent disponible : « Si j’ai de la chance et qu’il me reste un peu d’argent, j’irai faire un tour. Sinon je m’en passerai. » (714) On est donc bien loin d’un besoin sexuel irrépressible qui devrait être satisfait immédiatement. En témoigne également le fait que plus de 30 % des clients interrogés insistent sur le rituel qui consiste à « tourner » avant d’aborder une personne prostituée. Certains décrivent une méthode de choix, mais d’autres, plus nombreux, évoquent l’excitation ainsi provoquée. Les derniers y voient un signe d’hésitation (715).
De plus, le recours à la prostitution se fait fréquemment en groupe ainsi que sous l’effet d’une alcoolisation. Ainsi, 63 % des hommes qui recourent à la prostitution le font après avoir consommé de l’alcool (716). Le « besoin sexuel » en question est donc produit par un environnement social (le groupe, l’alcool, l’ambiance…) davantage qu’il n’est subi.
Par ailleurs, ce « besoin sexuel » qui est satisfait par le recours à la prostitution pourrait fort bien l’être d’une autre manière. Un client indique ainsi : « Dans la mesure où il n’y en aurait pas, bon, je me débrouillerais autrement, quoi. Parce que là on sait qu’il y a des femmes à disposition, donc c’est la solution de facilité. » (717)
Finalement, il faut bien conclure qu’il n’existe pas de besoin sexuel masculin irrépressible auquel les personnes prostituées viendraient répondre. L’Unicef le dit avec une forme d’humour : « Aucun impératif biologique n’impose un nombre fixe d’orgasmes par jour, par semaine ou par an. Les individus peuvent occasionnellement trouver déplaisant de ne pas éprouver le paroxysme du plaisir sexuel, mais le fait qu’il n’y a personne pour les amener à l’orgasme ne constitue pas exactement une menace pour leur survie. » (718) De surcroît, on ne parle jamais de misère sexuelle pour les femmes. Justifier la prostitution par la solitude revient donc à rendre légitime une socialisation différenciée entre les hommes et les femmes, les premiers ne pouvant pas supporter la frustration, alors que cette question ne se pose pas pour ces dernières.
L’utilité sociale voire la nécessité de l’existence de la prostitution rencontre, en écho, l’affirmation que la prostitution est, au moins pour partie, pratiquée de façon libre et éclairée. Ces deux conceptions font système, l’une justifiant la légitimité de la demande et l’autre, le caractère éthique de l’offre. Pourtant, cette seconde affirmation, tout comme la première, n’est pas aussi simple à vérifier qu’il ne le paraît.
En dehors des cas d’exploitation sexuelle, nombreux sont ceux qui voient, à l’origine de la prostitution, une décision libre et éclairée. Les personnes prostituées, en quelque sorte, mettraient en application le principe philosophique de libre disposition de son corps. Ainsi Mme Claude Boucher, présidente de l’association des Amis du bus des femmes, a-t-elle indiqué qu’il fallait tirer toutes les conséquences du principe selon lequel les femmes disposent librement de leur corps (719). Ce n’est cependant pas ce principe qui, à lui seul, peut expliquer la prostitution. S’il est utilisé comme fondement juridique et philosophique, il ne saurait fournir systématiquement l’explication individuelle de l’exercice dans la prostitution.
Pour s’en convaincre, il faut établir ce en quoi pourrait constituer un choix libre et éclairé. Il semble possible de rassembler un large consensus quant aux critères suivants, qui proviennent notamment du droit civil :
– il ne peut être produit que par une personne capable de consentir ;
– un choix libre est éclairé ne doit être entaché d’aucun vice du consentement, le droit civil retenant traditionnellement l’erreur, la violence et le dol ;
– il doit être réalisé en présence d’alternatives envisageables ;
– il doit pouvoir être retiré à tout moment.
Il convient donc d’analyser la prostitution au regard de ces quatre critères cumulatifs afin de déterminer si cette activité peut effectivement être « libre ».
L’on ne saurait parler de choix libre et éclairé pour une personne n’ayant pas la capacité de consentir. Ainsi, ne peuvent pas contracter, au regard des règles du droit des contrats, les personnes incapables que sont les mineurs et les majeurs protégés. La loi a d’ailleurs tiré toutes les conséquences de l’absence de capacité à contracter dans le cas de la prostitution en interdisant la prostitution des mineurs (720) et en pénalisant les clients des mineurs prostitués ou des personnes prostituées qui présentent une particulière vulnérabilité (721).
Il apparaît cependant que la prostitution débute fréquemment alors que les personnes qui la pratiquent ne sont pas encore majeures. Pour M. Bernard Rouverand, de l’Association contre la prostitution des enfants (ACPE), il est avéré que la très grande majorité des personnes prostituées ont commencé à s’y livrer lorsqu’elles étaient mineures, souvent d’abord de manière occasionnelle (722).
Cette réalité a été contestée par Mme Claude Boucher, présidente de l’association des Amis du bus des femmes. Pour elle, ce constat est faussé par le fait que, au moment où il a été fait, l’âge de la majorité était fixé à 21 ans. On ne pourrait donc pas en inférer que la prostitution débute généralement avant 18 ans, mais avant 21 ans. Par ailleurs, beaucoup de femmes auraient prétendu, dans les années 1980 et 1990, avoir commencé à se prostituer étant mineures car tel était ce que voulaient entendre le Mouvement du Nid et l’Amicale du Nid qui étaient alors les seules associations à les aider (723).
Il n’existe à l’heure actuelle aucune donnée incontestable portant sur l’âge moyen à l’entrée dans la prostitution. Il n’en demeure pas moins que les acteurs associatifs impliqués sur le terrain constatent un nombre relativement élevé de jeunes. L’association Hors la rue dit être en contact avec une soixantaine de jeunes filles mineures prostituées à Paris et indique qu’une quarantaine de jeunes garçons mineurs arriverait chaque année aux alentours de la gare du Nord pour y pratiquer la prostitution. Au total, le nombre de mineurs prostitués s’élèverait à 300 à Paris et dans ses environs (724). Pour sa part, l’Amicale du Nid a réalisé une étude sur les 106 jeunes rencontrés à Paris entre le 1er janvier et le 30 septembre 2009. Il est apparu que beaucoup ont commencé à se prostituer avant 18 ans.
Les constats empiriques réalisés par la mission la portent à accréditer la thèse d’un âge souvent très peu élevé lors de l’entrée dans la prostitution. Sur les cinq personnes s’étant prostituées rencontrées à l’Amicale du Nid de Paris, quatre avaient commencé alors qu’elles étaient mineures : deux avaient 16 ans et deux, 17 ans. La dernière s’est prostituée à partir de 24 ans (725). Il faut préciser que ces personnes n’avaient aucunement été sélectionnées : il s’agissait simplement de celles qui s’étaient portées volontaires pour rencontrer la mission.
2. L’entrée dans la prostitution et les vices du consentement
En deuxième lieu, il faut interroger ce « choix » au regard de la théorie des vices du consentement. Le code civil distingue classiquement trois vices principaux, dans la formule classique de son article 1109 : « Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. »
a) Le consentement « extorqué par violence »
En droit civil, la violence est une cause de nullité du consentement. Cette violence peut prendre différentes formes (physique, psychologique voire économique) et s’exercer à l’encontre de la personne en question ou de sa famille.
La violence physique est fréquemment utilisée par les réseaux de traite et de prostitution pour contraindre leurs victimes à se prostituer. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle leur consentement à la traite est sans valeur juridique et ne justifie absolument pas les faits dont elles sont victimes (726). Dans leur cas, la prostitution ne peut jamais être considérée comme étant librement consentie. Or, elles forment une part essentielle et croissante de la prostitution en France (727).
La contrainte peut également résulter d’une emprise psychologique, le cas échéant accompagnée de violences physiques. Or, une telle emprise est très fréquente chez les personnes qui se prostituent, même si ces dernières ne l’identifient pas comme telle. Le cas de « l’ensorcellement » subi par les prostituées nigérianes en est l’exemple le plus flagrant. Il ne doit pas occulter l’emprise, moins spectaculaire mais tout aussi contraignante, qui est fréquemment exercée par l’entourage des personnes prostituées. Le cas le plus fréquent est celui du mari incitant fortement sa femme à se prostituer (728), mais il peut également s’agir des parents à l’égard de leurs enfants (729).
La violence poussant à se prostituer ne se laisse donc pas circonscrire à la simple contrainte physique. Il faut également prendre en compte les pressions psychologiques insidieuses d’un mari qui laisse entendre à sa femme que la prostitution pourrait être le moyen d’avoir une vie meilleure ou, tout simplement le fait de vivre dans une situation économique très précaire. Dans aucun de ces cas on ne saurait considérer que la prostitution constitue un choix libre, le consentement étant vicié par une forme ou une autre de violence.
b) Le consentement « surpris par dol »
Le deuxième vice du consentement est le dol. On désigne sous ce terme la tromperie organisée par un tiers en vue de provoquer le consentement.
Il est fréquent que les personnes qui arrivent en France ne sachent pas qu’il est prévu qu’elles s’y prostituent. De nombreux exemples ont été portés à la connaissance de la mission des faux espoirs qui peuvent leur être donnés. Deux jeunes femmes victimes d’exploitation rencontrées par la mission en Espagne ont témoigné du fait qu’on leur avait fait croire qu’elles exerceraient un emploi dans la restauration ou dans le travail à domicile (730). Les mêmes promesses avaient été faites à Baina, jeune femme nigériane arrivée en France à 17 ans, et qui a été contrainte de se prostituer pendant sept ans (731).
c) Le consentement « donné par erreur »
Le dernier grand cas de vice du consentement est l’erreur. On ne peut pas consentir à quelque chose que l’on ignore ou que l’on connaît mal. Or, nombreux sont les témoignages de personnes qui, quelle que soit la raison de leur entrée dans la prostitution, se rendent compte que cette activité ne correspond aucunement aux représentations qu’elles en avaient. Ainsi, quand bien même cette entrée aurait été la conséquence d’un « choix », tout laisse penser que, si elles avaient été pleinement conscientes des circonstances dans lesquelles cette activité est exercée, certaines personnes prostituées n’auraient pas fait ce « choix ».
Dans le cas des femmes migrantes qui prennent la décision de venir en Europe de l’Ouest en sachant que la prostitution pourrait être un moyen d’y rembourser leur dette de passage tout en envoyant de l’argent à leur famille, la découverte de la réalité de la prostitution peut constituer un moment de remise en cause de leur projet. « Si certaines femmes sont trompées sur le fait qu’elles devront se prostituer à Paris, d’autres, au contraire, savent très bien qu’elles se prostitueront, mais se trouvent trompées sur les conditions d’exercice de cette activité (la saisie automatique de tous les revenus, la rue, la nuit, l’hiver, le nombre d’heures de travail, l’impossibilité d’envoyer de l’argent à sa famille…) ou la somme d’argent à rembourser (beaucoup de jeunes femmes expliquent avoir accepté de rembourser une somme d’argent sans se rendre compte de l’importance de son montant) » (732), explique ainsi Mme Vanessa Simoni, dans le cas des personnes prostituées nigérianes exerçant à Paris, rejointe par M. Lilian Mathieu pour ce qui est, plus généralement, des personnes prostituées migrantes (733).
Les formes plus récentes de prostitution que sont la prostitution des étudiants et la prostitution via Internet ne font pas exception à cette méconnaissance profonde et parfois à cette idéalisation du monde de la prostitution, au contraire. T., qui s’est prostitué alors qu’il était étudiant évoque sa « grande naïveté » : « je voyais un peu la prostitution comme un tableau de Toulouse Lautrec. Seulement, la réalité est tout autre ... » (734) Pour M. Jean-Marc Souvira, certaines personnes qui participent à des tournées organisées en Europe par Internet « savent ce qui les attend mais elles pensent gagner beaucoup d’argent en peu de temps, ce qui n’est jamais le cas. » (735)
Nombreuses sont également les personnes prostituées qui se rendent compte progressivement des conséquences que cette activité a sur leur santé physique et mentale (736). Une ancienne prostituée rencontrée par la mission, a indiqué que l’élément déclencheur dans sa première prise de distance avec le milieu de la prostitution avait été l’importance de ses problèmes physiques (737).
Sans être victimes de contrainte, certaines personnes prostituées ne sont pas non plus totalement libres de leurs choix, dans la mesure où elles ne connaissent pas les conditions dans lesquelles se déroule la prostitution. Ce n’est qu’en commençant à se prostituer qu’elles découvrent ce qu’implique l’exercice de cette activité. Si certaines décident d’arrêter à la suite d’une première expérience qui s’est mal passée, d’autres se trouvent prises dans l’engrenage de la prostitution.
Sans alternatives, il n’existe pas à proprement parler de choix et encore moins de choix libre et éclairé. Or, de nombreuses situations, l’entrée dans la prostitution résulte, en fait d’une absence d’alternatives envisageables.
On peut en effet analyser certaines formes de prostitution comme constituant des « stratégies de survie » (738), les alternatives disponibles étant très réduites, voire inexistantes. Il en va ainsi, par exemple, pour les mineurs et les jeunes adultes en errance (739). Par ailleurs, certaines personnes vivent dans des conditions de précarité telles qu’elles sont contraintes de pratiquer une « prostitution de la misère », qui a notamment été décrite à Marseille et qui est le fait de « personnes qui vendent une passe environ cinq euros, afin de mettre de l’argent de côté pour leurs enfants. Certaines femmes se prostituent pour un repas. » (740) Nombre de personnes toxicomanes et transgenres, si elles ne sont pas « contraintes » de se prostituer sous la pression d’un tiers, le sont cependant par la nécessité de survivre. C’est sur ce fondement que M. Lilian Mathieu, sociologue, compare la prostitution à la mendicité : « On peut dresser un parallèle entre prostitution et mendicité. Cette dernière est une activité de dernier recours, qui exige également des savoir-faire spécifiques (interpeller la compassion des passants…), prise dans une logique concurrentielle et qui expose à des formes d’exploitation. Si l’on accepte cette comparaison, on en arrive à la conclusion que de même que la mendicité ne saurait être reconnue comme un métier comme un autre, la prostitution ne le peut pas davantage » (741).
Dans d’autres cas, l’entrée dans la prostitution peut s’exercer sous la modalité du « choix contraint ». « Des prostituées de soixante ans qui ont exercé au Bois de Vincennes pendant trente ans, ont indiqué au collectif que l’exercice de la prostitution résultait d’un « choix contraint » » (742). C’est en ces termes que s’est exprimée Mme Malika Amaouche, coordinatrice du collectif Droits et prostitution, association communautaire de défense des droits des personnes prostituées. Cette expression de « choix contraint », qui a été reprise par de nombreux interlocuteurs de la mission (743), reflète bien le fait que ce n’est pas parce que la prostitution n’est pas exercée sous la contrainte directe d’un tiers qu’elle résulte d’un choix libre et éclairé.
Pourraient entrer dans cette catégorie toutes les personnes qui se prostituent par nécessité économique. On peut penser, par exemple, aux étudiant(e)s, qui, sans être dans un dénuement matériel tel que la prostitution constituerait leur seule source de revenus, dépendent néanmoins d’une prostitution occasionnelle pour pouvoir mener à bien leurs études (744) ou aux personnes étrangères qui arrivent en France de manière irrégulière avec une dette à rembourser (qui a servi à payer leur passage) et qui ne subissent pas de contrainte physique directe en dehors de l’obligation de rembourser cette dette. Elles ont un nombre de possibilités extrêmement réduites pour y parvenir. Le « choix » se résume alors au fait de travailler comme domestique, dans un atelier de confection, généralement dans de dures conditions d’exploitation, ou dans la prostitution, toute autre activité étant impossible du fait de l’absence de titre de séjour et de pratique du français. Que cette prostitution soit envisagée comme durable, dans le cadre d’un projet migratoire, ou comme passagère, elle constitue « une forme de sacrifice à durée déterminée (vécu ou non comme de l’esclavage) » (745).
Ainsi, qu’elle pèse sur des personnes françaises ou étrangères, une contrainte économique plus ou moins prégnante, couplée à l’absence d’autres solutions envisageables, constitue toujours un facteur déterminant de l’entrée dans la prostitution. Elle est d’autant plus forte pour les femmes, ainsi que l’a indiqué Mme Claude Boucher, présidente de l’association des Amis du bus des femmes : « Il faut replacer la prostitution dans le cadre d’ensemble de l’exploitation des femmes dans nos sociétés. Compte tenu de l’état du marché du travail et de la place qui y est réservée aux femmes, certaines d’entre elles n’ont pas d’autre choix économique que de se prostituer pour payer leur loyer. » (746) « Ce sont des femmes qui ont choisi une activité parmi un champ de possibles extrêmement limité » (747), explique aussi Mme Véronique Boyer, animatrice de prévention sur l’action Internet au sein de l’association Grisélidis.
Si les raisons de l’entrée dans la prostitution focalisent les débats, chacun s’efforçant de montrer qu’elle résulte d’une contrainte extérieure ou d’un choix libre et éclairé, peu nombreux sont ceux qui s’intéressent à la sortie de l’activité prostitutionnelle. Or, pour que l’on puisse affirmer que la prostitution résulte d’un réel choix, encore faut-il que ce dernier soit à tout moment réversible. Ce n’est que si la personne prostituée peut cesser son activité que l’on peut réellement parler de choix.
a) L’engrenage de la prostitution
De nombreuses personnes entendues par la mission d’information ont fait état de l’existence d’un engrenage lié à l’exercice de la prostitution. Si cette activité est généralement pensée initialement comme devant être transitoire ou demeurer occasionnelle, plusieurs facteurs font que la personne s’installe durablement dans la prostitution.
Le premier peut être l’addiction à un argent rapidement gagné. Cette accoutumance à un niveau de vie élevé, qui ne peut être retrouvé dans aucune autre activité, est susceptible de constituer un facteur décisif de l’établissement dans la prostitution. Mme Claude Boucher, présidente de l’association des Amis du bus des femmes, a souligné que ce risque devait être combattu. Son association rencontre des occasionnelles pour leur expliquer les dangers de la prostitution et notamment « le risque de ne plus exercer que l’activité de prostitution car celle-ci est beaucoup plus rémunératrice et crée des dépendances à l’égard de l’argent. » (748) Cette accoutumance peut se coupler à une perte d’intérêt pour les études suivies. « On veut de l’argent pour payer le loyer et poursuivre ses études. Mais cela stresse tellement qu’on perd son énergie pour suivre ses cours. […] C’est comme une sorte de drogue » (749), explique par exemple un ancien étudiant prostitué.
En deuxième lieu, un engrenage peut s’instaurer entre l’exercice de la prostitution et la consommation d’alcool et de stupéfiants rendue nécessaire par l’exercice de cette activité (750).
Enfin, la prostitution peut devenir une forme d’identité sociale et une sorte de refuge pour des personnes qui sont par ailleurs largement dépourvues de liens sociaux. Mme Gabrielle Partenza, présidente de l’association Avec nos Aînées, a expliqué s’être prostituée à la suite d’une rupture familiale avant d’ajouter : « si j’y suis restée trente ans sans proxénète, c’est que, quelque part, je m’y suis trouvée bien. […] J’y suis rentrée en 1969 et j’y ai trouvé une famille, une vraie famille » (751). Cette communauté peut parfois être la seule dont dispose les personnes prostituées.
Ces phénomènes d’engrenage rendent difficile toute sortie de la prostitution. Même si cette dernière faisait initialement l’objet d’un choix libre et éclairé, son exercice crée des addictions et des habitudes dont il est difficile de se défaire, rendant toute réinsertion particulièrement longue et complexe.
b) « Ce n’est pas un métier que l’on quitte un soir en claquant la porte »
Comme en témoigne cette phrase d’une jeune femme reçue par la mission, la sortie de la prostitution, pour des personnes qui ne souhaitent plus exercer cette activité, s’avère particulièrement complexe pour plusieurs raisons.
En premier lieu, les politiques sociales échouent largement à fournir des alternatives à la prostitution (752). Elles doivent donc être renforcées, ainsi que le préconise la mission d’information (753). De même, des facilités et des remises doivent être accordées aux personnes prostituées qui souhaitent arrêter leur activité par les services fiscaux et les URSSAF, afin de ne pas rendre ces dernières prisonnières de leur activité.
En deuxième lieu, la prostitution est vécue par les personnes qui souhaitent en sortir comme une activité honteuse. En conséquence, elles ne parviennent pas toujours à demander de l’aide pour y parvenir. Ceci est particulièrement vrai pour les personnes qui n’ont pas été contraintes de se prostituer. Mme Claudine Legardinier a ainsi cité le cas d’une jeune femme qui avait choisi de se prostituer en Allemagne sans savoir dans quel milieu elle s’apprêtait à entrer et qui ne pensait pas avoir le droit de parler et de demander de l’aide car elle n’avait pas eu de « revolver sur la tempe » (754).
Enfin, la prostitution semble « coller à la peau » des personnes qui l’ont exercée. Outre les traumatismes physiques et psychologiques que cette activité peut provoquer (755), les personnes qui se sont prostituées vivent très souvent dans l’angoisse de rencontrer certains de leurs anciens clients (756). Pour d’autres, leur vie s’est trouvée anéantie lorsque leur activité de prostitution est devenue publique. Lisina, jeune femme albanaise rencontrée par la mission, n’arrive pas à se reconstruire dans la mesure où, à la suite de son procès dont les médias se sont fait l’écho, toute son histoire apparaît sur Internet. Elle est donc sans cesse contrainte de dissimuler son identité et se demande si elle pourra construire une famille, malgré son passé (757).
Dans la même optique, le témoignage d’un jeune homme s’étant prostitué est particulièrement éloquent, et témoigne du fait qu’il est souvent très difficile de sortir de la prostitution, du moins dans le regard des autres : « Une nuit, alors que j’avais cessé de me prostituer, quelqu’un a frappé. C’était un ancien client. J’ai dit gentiment que j’avais cessé la prostitution et il m’a regardé d’un air très mauvais, comme si je le refusais LUI. Alors... s’est produit un acte sexuel forcé. Étrangement, je ne me suis pas rebellé. Par peur. Je me suis mis en mode « prostitué » et je n’ai rien dit. Seulement après ça, j’ai connu la pire dégringolade psychologique que j’aie jamais connue. J’ai recommencé à me vendre car je n’arrivais plus à me respecter. » (758)
5. Et celles qui affirment leur liberté ?
Malgré tous ces éléments qui rendent difficile le fait de considérer la prostitution comme une activité choisie de manière entièrement libre et éclairée, il faut prendre en compte le témoignage des personnes qui affirment se prostituer de manière pleinement libre.
a) D’autres logiques d’entrée dans la prostitution ?
Il faut dans un premier temps s’interroger sur les raisons qui consistent à choisir la prostitution, en dehors de tout vice du consentement. Les témoignages recueillis par M. Jean-Michel Carré, dans son livre Travailleu(r)ses du sexe et fières de l’être, peuvent en fournir des illustrations.
Peu de raisons sont invoquées pour expliquer le « choix » de la prostitution. Certaines des personnes interrogées évoquent la volonté de ne pas mener une vie « rangée » : « je n’allais pas rentrer dans un boulot, me montrer gentille avec un patron avec un petit salaire à la fin du mois, la maison, le chien, la caravane et les deux enfants » (759), indique l’une des personnes interrogées. Un autre estime : « C’est peut-être, à condition de le faire bien, un moyen de subsister sans pour autant faire l’expérience de l’entreprise ou du fonctionnariat. » (760)
De la même manière, certains étudiants disent également se prostituer occasionnellement non pour disposer d’argent mais afin de « s’émanciper des valeurs et des normes familiales » (761), cette activité restant alors très limitée, à quelques rendez-vous par mois. La même perception de la prostitution peut exister pour certains jeunes, notamment homosexuels ou transsexuels, pour qui la prostitution est vue comme un moyen de s’approprier leur vie sexuelle.
D’autres insistent sur le fait que la prostitution leur permet d’atteindre un niveau de vie qu’elles n’auraient jamais pu atteindre sinon. Ceci rejoint la situation de certains jeunes qui échangent un acte sexuel contre une petite somme d’argent ou contre un objet à la mode (762), alors même qu’ils ne se trouvent pas dans une situation financière difficile.
Mais ce qui ressort, de manière générale, du livre de M. Jean-Michel Carré, est que les personnes qui ont « choisi » la prostitution y sont bien souvent entrées par manque d’argent. Cette motivation est évoquée dans plus de la moitié des cas cités. « Je pense que ce sont toujours des problèmes financiers qui amènent la fille à aller dans la rue » (763), indique l’une d’entre elles.
b) Ce que disent les personnes prostituées et ce qu’elles pensent
Dans cette recherche d’une prostitution authentiquement libre, il convient de prendre en compte le fait que ce qui est perçu à un moment donné comme une liberté peut, après coup, être analysé comme une contrainte, voire comme une violence.
L’expérience faite par la mission en Espagne est à ce titre très instructive. Lorsque le mercredi soir de son arrivée, une délégation de la mission s’est rendue dans un bar plutôt haut de gamme de Madrid, ayant une activité de « puticlub », c'est-à-dire de prostitution, et qu’elle a rencontré les « hôtesses », tout sourire, pleines de confiance en elles et à l’anglais courant, elle aurait presque pu oublier que leur origine roumaine, bulgare ou brésilienne laissait planer quelques doutes quant à la réalité de leur choix d’exercer cette activité. La délégation de la mission en a été pleinement convaincue le jeudi matin, quand, dans les locaux de l’association APRAMP, elle a rencontré trois anciennes personnes prostituées, qui avaient été victimes de traite et d’exploitation sexuelle. Elle a alors pu voir des jeunes filles du même âge mais paraissant dix ans de moins du fait de leur absence de maquillage. Les larmes avaient remplacé les sourires et le récit émouvant de l’exploitation, celui d’une prostitution désirée et revendiquée (764).
Il ne faut donc pas se laisser abuser par les apparences. Aucune personne prostituée ne dit être contrainte ou malheureuse, sauf quand elles cessent leur activité. Les clients ne payent pas pour écouter les complaintes d’une personne prostituée, mais pour passer un moment agréable. « Beaucoup me demandaient pourquoi je faisais ça. Je disais que c’était un choix de vie. Ça les arrangeait » (765), raconte l’une d’entre elles. « Je le revendiquais » (766), dit une autre qui souhaite depuis pénaliser les clients. « Si les clients savaient à quel point on les déteste, on les méprise de nous acheter, pendant qu’on les appelle chéri et qu’on les flatte ! » (767), raconte une troisième. Et que dire de Baina, qui durant sept ans affirmait quotidiennement aux forces de l’ordre, aux clients et aux associations être pleinement libre de se prostituer alors qu’elle était constamment sous la surveillance d’un tiers (768) ?
Ce discours, qui est tenu par toutes les personnes prostituées, ne reflète donc pas toujours la réalité de leur situation. Il n’est en tout cas pas synonyme d’une prostitution librement choisie. Il donne cependant bonne conscience à tous ceux qui bénéficient du système prostitutionnel et les dispensent de questionner ce qui leur est présenté comme une évidence : « Même elle, elle prenait beaucoup de plaisir. Elle me l’a dit et puis ça se voit quand même quelqu’un qui est bloqué ou quelqu’un qui se détend et qui se lâche, hein ! » (769)
Ceci ne signifie cependant pas que toutes les personnes qui disent avoir pleinement choisi la prostitution tiennent un double langage. Mais le champ des « personnes qui ont choisi de se prostituer » se restreint encore d’autant. Finalement, à quelle réalité quantitative ce dernier correspond-il ? Deux tendances se dégagent.
Certaines personnes auditionnées, qui sont parmi les mieux informées sur le monde de la prostitution, estiment que « l’entrée dans la prostitution n’est jamais libre » (770), ainsi que l’a expliqué M. Lilian Mathieu, sociologue. Mme Malika Amaouche, coordonnatrice du collectif Droits et prostitution, a également indiqué que, pour elle, « [La prostitution] ne saurait être analysé[e] en termes de libre choix. » (771) Mme Gabrielle Partenza, présidente de l’association Avec Nos Aînées, estime pour sa part que la prostitution, bien qu’exercée librement et de façon indépendante, ne constitue jamais un choix parfaitement éclairé. (772) Les représentants des associations de santé communautaire, s’ils ont expliqué que toutes les personnes prostituées n’étaient pas sous la coupe d’un réseau ou d’un proxénète, n’ont cependant jamais affirmé que l’entrée dans la prostitution pouvait résulter d’un choix réellement libre et éclairé.
Pour d’autres, ces explications ne permettraient de comprendre la démarche que de la quasi-totalité des personnes prostituées dans la mesure où certaines d’entre elles auraient effectué un choix de vie assumé et revendiqué, qui pourrait réellement s’analyser en termes de libre choix. M. Patrick Hauvuy, directeur d’un établissement de l’association Accompagnement lieu d’accueil (ALC) à Nice, a indiqué que sur les 2 000 à 2 500 personnes prostituées rencontrées au cours de sa carrière professionnelle, quasiment aucune n’a affirmé avoir « choisi cette activité de gaîté de cœur » (773).
Seule Maîtresse Gilda, porte-parole du STRASS, a indiqué, au cours de son audition, que la prostitution faisait fréquemment l’objet d’un choix libre et éclairé, ce qui justifie le fait d’en faire un métier comme un autre (774), les représentants des associations de santé communautaire se montrant cependant beaucoup plus prudents quant à la notion de « métier » (775).
En montrant que l’entrée puis l’installation dans la prostitution peuvent résulter d’une diversité de facteurs, allant de violences extrêmement fortes à des choix contraints, il est possible de sortir de l’opposition entre prostitution libre et prostitution forcée qui tend à placer symboliquement ces deux notions sur un pied d’égalité, alors que les réalités quantitatives qu’elles recouvrent varient du tout au tout. C’est uniquement en égrenant les formes de limitations de la liberté qui sont à l’œuvre dans l’entrée puis l’installation dans la prostitution que l’on peut se rendre compte de l’importance numérique des personnes qui les subissent et du fait que la prostitution choisie en toute connaissance de cause, si elle n’est pas une simple possibilité conceptuelle, demeure une singularité sociologique.
III. – UNE PRATIQUE À INTERROGER AU REGARD DES PRINCIPES D’UNE RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ET SOLIDAIRE, FONDÉE SUR LE RESPECT INTANGIBLE DE LA DIGNITÉ DE L’ÊTRE HUMAIN
Si l’on dépasse ces préjugés qui servent parfois de fondement à la politique menée en matière de prostitution, reste à analyser cette pratique au regard des principes de notre droit, afin de déterminer la politique qui serait la mieux à même de leur correspondre. Ce faisant, la mission d’information n’est animée par aucun présupposé moralisateur quant à la sexualité et à la diversité des pratiques sexuelles qui existent aujourd’hui, chacun ayant par ailleurs un jugement personnel sur la prostitution. Il s’agit de rester sur un terrain juridique pour tenter de répondre à trois questions fondamentales que soulève la prostitution : se prostituer, est-ce travailler ou est-ce louer son corps ? La prostitution est-elle constitutive d’une violence ? La prostitution est-elle viscéralement porteuse d’inégalités entre les sexes ?
Trois grands principes gouvernent les réponses que l’on peut apporter, en droit, à ces questions : la non-patrimonialité du corps humain, son inviolabilité et l’égalité entre les sexes. De ces réponses découle le choix d’une politique en matière de prostitution.
A. LA NON-PATRIMONIALITÉ DU CORPS HUMAIN
En premier lieu, la prostitution se heurte à la protection juridique particulière dont bénéficie le corps humain.
1. La distinction du corps humain et des biens marchands est au fondement de notre droit
S’inscrivant ainsi dans une tradition plus que millénaire, le code civil distingue les personnes et les biens. Le corps humain devant s’inscrire dans l’une de ces deux catégories fondamentales, le parti a été pris, dès les premières lois de bioéthique, en 1994 (776), de le faire figurer en tête du chapitre sur les personnes et d’y inscrire les grands principes protecteurs du corps humain. Ce choix n’a jamais été démenti depuis, puisque la révision de 2004 n’a pas modifié ces grands principes (777).
Ce faisant, le corps humain ne peut pas être considéré comme un bien ou comme une chose, un « respect » particulier lui étant dû, selon l’intitulé du chapitre en question du code civil. Ce respect, qui distingue le corps humain, en tant qu’élément constitutif de l’être humain, a été reconnu par le Conseil constitutionnel, qui a consacré au rang de principe constitutionnel, en 1994, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation (778).
En distinguant le corps humain, qui est pourtant matériel, de l’ensemble des biens, le législateur a entendu l’exclure du domaine marchand, dont relèvent l’ensemble des biens. En conséquence, aucun droit de propriété ne peut être reconnu sur le corps humain, ses éléments et ses produits, sur le fondement du dernier alinéa de l’article 16-1 du code civil. Ceci signifie que la personne humaine n’est pas propriétaire de son propre corps, ce qui fait obstacle à ce qu’elle en dispose librement, quand cette disposition aurait pour conséquence de le réduire à l’état de bien (779).
Cette spécificité du corps humain n’est pas anecdotique. Elle est au fondement, par exemple, de l’interdiction de l’esclavage et de l’impossibilité juridique qu’il y aurait, pour une personne, à y consentir : la libre disposition de son corps ne saurait justifier son aliénation, en tout ou en partie. Sur le même fondement, le fait de consentir à la vente de l’un de ses organes ne peut pas emporter de conséquences juridiques, puisque les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits doivent nécessairement être nulles (780), le corps humain ne pouvant être juridiquement assimilé à un bien.
Enfin, cette protection particulière au corps humain empêche d’en faire une source d’enrichissement lorsque c’est sa matérialité même qui serait la cause de l’enrichissement. Ainsi, par opposition au contrat de travail, où seule la force de travail d’un corps est louée, et non pas le corps lui-même, le code civil interdit toute rémunération pour le fait de se prêter à une expérimentation sur sa personne et frappe de nullité les conventions de gestation pour autrui (781).
Dans tous ces cas, ces règles, qui ont été déclarées conformes à la Constitution (782), sont d’ordre public (783), c’est-à-dire que les sujets de droit ne peuvent pas y déroger, quand bien même ils y consentiraient. La raison en est simple : il est des règles qui protègent les plus faibles et fondent en conséquence un projet de vie en société. Ces grands principes du code civil en font partie. En plaçant le corps humain du côté des personnes et non dans la catégorie des biens, ils posent une limite éthique à l’extension de la sphère marchande, garantissant ainsi que personne ne puisse se dire que l’aliénation d’une partie de son corps ou sa mise à disposition d’autrui à des fins d’expérimentation ou de gestation pourrait constituer une solution envisageable aux difficultés économiques qu’il rencontre. Ils préservent aussi les plus fragiles des pressions susceptibles de les pousser à faire commerce de leur corps, en leur fournissant le point d’appui de la loi. Si la rémunération des donneurs d’organes était possible, le trafic s’en trouverait, à n’en pas douter, facilité.
Pour déterminer si la prostitution est davantage assimilable à un contrat de travail, comme le soutiennent certains, ou à la location de son corps, comme l’estiment d’autres, il est donc nécessaire de déterminer si le corps de la personne prostituée est considéré, dans le cadre de cette activité, davantage comme un bien ou comme un élément de leur force de travail.
2. Se prostituer, est-ce travailler ou est-ce louer son corps ?
Au regard de cette distinction fondamentale, qui sépare le corps humain des biens marchands, la classification de la prostitution nécessite d’analyser quel statut cette pratique confère au corps.
Les conditions dans lesquelles cette activité se déroule ne laissent aucune place à l’hésitation : ce sont bien des corps que les clients viennent louer. Certains des témoignages recueillis à l’occasion de l’enquête menée par le Mouvement du Nid auprès des clients sont à ce titre édifiants. Les métaphores de l’objet et du bien y sont omniprésentes pour désigner les personnes prostituées. « Une prostituée, on peut la prendre comme un objet […]. C’est comme quand on va acheter quelque chose pour se faire plaisir. » (784) Allant au bout de cette logique, un autre client en vient même les à identifier complètement à des machines : « L’idéal serait qu’elles n’aient pas d’âme […] que ce soit des poupées avec une mécanique extrêmement sophistiquée. » (785) Les personnes prostituées peuvent alors être envisagées comme des cadeaux d’anniversaire : « Avec les potes, on s’est déjà arrêté deux fois pour l’anniversaire d’un copain. » (786) Elles-mêmes décrivent parfois en des termes purement organiques cette activité : « Le plus lourd, c’est d’avoir été achetée. Tu n’es rien du tout, je paie. On en prend plein la gueule. Je me sers de toi comme d’une bassine. Pour me vider », explique l’une d’entre elles (787).
Cette réduction d’une personne à son corps est décuplée, pour certains clients, par la présence de l’argent. Ce dernier donne aux clients un sentiment de toute puissance : l’objet de leurs désirs ayant été loué, ils doivent en avoir l’usage plein et entier. En témoignent notamment les clients qui retirent le préservatif au cours de l’acte sexuel (788), en violation de ce qui avait été convenu. « Ça veut dire que tout ce qu’il voudra faire de tordu ou de trucs, il va profiter de la prostituée pour le faire parce qu’il sait qu’avec elle il pourra, du moment où il balance l’argent, il a le pouvoir de l’argent » (789), témoigne un client. Un autre, encore plus cru, explique précisément qu’il recherche la soumission de la personne prostituée par son argent : « Je crois que c’est le pouvoir de la soumission, c'est-à-dire de posséder quelqu’un par la valeur de l’argent […] non pas l’avilir parce que je ne faisais rien qui pouvait avilir la jeune femme, c’était simplement ce pouvoir-là qui me plaisait […]. » (790) C’est comme si l’argent réifiait la personne, la dépouillant, aux yeux du client, de ses attributs humains. Cette réalité a également été exprimée par Sonia, ancienne prostituée brésilienne rencontrée en Espagne, qui a indiqué à la mission que « certains clients maltraitent les femmes, crachent dessus, les insultent parce qu’ils les paient » (791).
Face à ces arguments, certains partisans de la reconnaissance d’un statut pour les personnes prostituées, font valoir qu’il existe des clients qui ont besoin de parler davantage qu’ils ne désirent bénéficier d’une prestation sexuelle. De la sorte, elles exerceraient, en quelque sorte, les fonctions d’une assistante sociale. Une ancienne personne prostituée reçue par la mission a dénoncé cet amalgame qui vise, selon elle, à revaloriser la prostitution : « on ne fait pas que les faire parler ou les écouter. Nous aussi nous sommes en situation de détresse, mais il n’y a personne pour nous écouter. On doit tout faire pour le client mais nous, personne ne nous écoute. […] Il ne faut donc pas confondre aider quelqu’un, l’écouter, et avoir une relation sexuelle avec cette personne. S’il y a des assistantes sociales, ce n’est pas pour rien. Notre corps était engagé, on ne se contentait pas d’écouter ! » (792).
Ceci correspond à ce que les deux psychiatres auditionnées par la mission d’information ont décrit comme des processus de dissociation des personnes prostituées avec leur propre corps et de « décorporalisation » (793). Ce désinvestissement de leur corps est lié à la répétition d’actes sexuels non désirés et témoigne du fait que l’usage qu’elles font de leur corps va bien au-delà d’une simple mise à disposition de leur force de travail, mais se rapproche bien davantage d’une forme d’aliénation. Dans aucun métier, les conséquences directes sur la santé des personnes qui l’exercent ne sont comparables ni ne se manifestent à si grande échelle. Si tel était le cas, ce travail serait immédiatement dénoncé comme inacceptable.
D’ailleurs, dans tous les pays qui acceptent voire organisent la prostitution où la mission s’est rendue, l’impression visuelle a été celle de se trouver face à un étal de corps humains à louer. Les vitrines hollandaises en constituent l’exemple le plus connu (794). Le même sentiment d’incongruité, causé par l’assimilation visuelle de jeunes filles à des marchandises, émane des « puticlubs » espagnols, où plusieurs dizaines de jeunes filles aux tenues généralement sans équivoque, sont alignées face au comptoir de l’établissement, le client étant invité à faire son choix (795). Un client confirme d’ailleurs cette impression, dans le cas français : « Pour l’homme, c’est le besoin de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux corps féminins. C’est comme si on rentrait dans un supermarché et qu’on choisissait sa marchandise. On lit l’étiquette, ça plaît, ça ne plaît pas, on prend ou on ne prend pas. » (796) Un jeune homme qui se prostitue sur Internet emploie la même formule : « Je suis un produit parmi d'autres, avec des caractéristiques qui attirent une certaine clientèle, dans mon cas les hommes mariés, dans la quarantaine. » (797)
Internet ne déroge pas à la règle : un marché de la prostitution s’y est constitué. Le client peut y parcourir des centaines de petites annonces et y faire son choix, comme il achèterait tout autre type de produits en ligne. Les bonnes adresses sont échangées sur des forums (798), accompagnées de notes et de commentaires. Selon M. Frédéric Boisard, chef de projet à la Fondation Scelles, certains compteraient plus de 60 000 abonnés en France (799).
Au regard de ces considérations, il apparaît très clairement que la prostitution se distingue de tout travail communément admis. Elle ne saurait être assimilée à la mise à disposition d’autrui d’une force de travail. La personne prostituée n’est pas un masseur, parce que le client ne choisit pas son masseur en fonction de son sexe ou de son corps. Ainsi que le souligne Mme Marka Marcovich, dans la prostitution, « la satisfaction des désirs [des hommes] suppose qu’une catégorie de personnes soit ravalée à l’état d’objets. » (800) Ce constat, devrait conduire à refuser toute assimilation de la prostitution à un travail et à considérer cette activité comme ne pouvant être admise au regard de la protection fondamentale dont bénéficie le corps humain, qui interdit de l’assimiler à un objet marchand.
Ceci empêche de considérer la prostitution comme un secteur d’activité commercial comme un autre. Lors de son déplacement en Belgique, il a été fait état, devant la mission d’information, d’un projet soumis par un promoteur immobilier à la commune de Schaerbeek, visant à rénover un quartier, pour y construire un complexe immobilier qui intégrerait des résidences permanentes, des commerces de proximité et des vitrines pour la prostitution (801). Ce document mentionne d’ailleurs les impôts locaux importants que pourraient rapporter les vitrines à la commune. Il est à ce titre édifiant que l’un des quatre arguments employés par un adjoint au maire de La Haye pour justifier la reconnaissance de la prostitution dans sa ville ait été que cette activité lui rapportait de nombreuses taxes (802). Ces raisonnements sont proprement incompatibles avec notre principe de non-patrimonalité du corps humain.
B. L’INTÉGRITÉ DU CORPS HUMAIN
Le principe de dignité de la personne humaine vise notamment à garantir son intégrité physique et psychologique contre toute atteinte extérieure. En conséquence, le code civil a reconnu l’inviolabilité du corps humain, dans son article 16-1.
1. La violence est inhérente au monde de la prostitution
Selon M. Lilian Mathieu, sociologue, « affirmer que la prostitution constitue, en tant que telle, une forme de violence revient à prendre une position philosophique. Il faut plutôt analyser les violences réelles que subissent les personnes qui exercent cette activité. » (803) Un bref rappel des conditions dans lesquelles s’exerce la prostitution s’impose donc (804).
La violence passe d’abord par la contrainte qui pèse sur toutes les personnes prostituées qui sont victimes d’exploitation sexuelle ou de la traite des êtres humains. Cette contrainte, qu’elle passe par des violences physiques ou des pressions psychologiques, est d’autant plus forte qu’elle ne porte pas sur une activité banale mais sur la mise en exploitation de son propre corps. C’est donc à juste titre que la traite et le proxénétisme sont sévèrement punis comme constituant des formes inacceptables d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de la personne.
Les violences sont ensuite liées à l’activité prostitutionnelle. Elles proviennent des proxénètes, des clients, voire de tiers ou des forces de l’ordre. Le journal des répressions et des violences tenu pas l’association Cabiria porte le témoignage de la gravité et de la fréquence de ces atteintes (805). Pour y faire face, les personnes prostituées « élaborent des stratégies afin de réduire les risques qu’elles encourent : elles retiennent les numéros des voitures des clients violents, elles adoptent des positions corporelles spécifiques pendant les passes… » (806)
Elles sont enfin l’objet d’une stigmatisation générale de la part de la société, qui leur renvoie l’image d’être déchus, en marge de la normalité. En conséquence, elles tentent fréquemment de dissimuler leur activité et vivent dans l’angoisse d’être reconnues.
« En tout état de cause, la violence est extrêmement présente dans le monde de la prostitution » (807), conclut M. Lilian Mathieu.
2. La prostitution est-elle constitutive d’une violence ?
La prostitution comporte tous les signes objectifs de la violence : elle engendre le plus souvent des séquelles importantes, accentuées par le caractère sexuel de cette pratique, et elle est souvent perçue en tant que telle par ses acteurs.
a) Des conséquences physiques et psychologiques majeures
Les séquelles engendrées par la prostitution justifieraient, dans n’importe quel autre contexte, leur désignation sous le concept de violences. Les deux psychiatres auditionnées par la mission, qui ont eu à connaître depuis de nombreuses années des troubles psychologiques d’anciennes personnes prostituées, ont témoigné de la gravité des psychotraumatismes qu’elles présentent et qu’elles peuvent mettre plusieurs années à surmonter.
Une ancienne personne prostituée reçue par la mission qui n’a pas subi de contrainte extérieure pour entrer dans le monde de la prostitution, a témoigné de la gravité de ces séquelles : « De cette expérience, j’ai tiré la conclusion que la prostitution abîme. Peut-être y a-t-il des filles qui se prostituent de leur plein gré, qui sont psychologiquement fortes et professionnelles, mais je ne pense pas qu’on puisse s’en sortir indemne ou vivre normalement et avoir des rapports sains avec les autres lorsque l’on se prostitue. » (808) Alors qu’elle a arrêté cette activité depuis plus de cinq ans, elle en ressent toujours les conséquences aujourd’hui : « Aujourd’hui, je vais mieux, mais cela m’a demandé beaucoup de travail, deux ans de thérapie avec une psychologue sophrologue. J’ai déjà failli rebasculer. » (809)
Ce témoignage n’est pas unique et n’a pas été sélectionné pour les besoins de la cause (810). Il reflète la réalité de la prostitution. Mme Claire Quidet, porte-parole du Mouvement du Nid, a indiqué que la longue expérience de son mouvement avait permis de recueillir de nombreux témoignages et récits de vie permettant d’affirmer que la prostitution constitue toujours une violence, même si elle est parfois revendiquée (811).
Un jeune homme qui s’est prostitué par manque d’argent à l’âge de dix-huit ans, par exemple, évoque les conséquences tout aussi graves de son activité sur sa santé : « C’est un peu comme un deuil : ça prend du temps. Et surtout, c’est un vécu traumatisant. Cela a quand même changé ma vie. Pas en bien, évidemment. J’ai fait plusieurs tentatives de suicide et une crise d’épilepsie à cause de ça... Maintenant, je suis avec mon copain depuis trois ans et demi. On est sorti ensemble à un moment où j’avais cessé de me prostituer. C’est en grande partie lui qui m’a sauvé du suicide. » (812)
Ces deux témoignages sont pourtant le fait de personnes qui n’étaient pas contraintes par autrui de se prostituer. C’est dire le traumatisme subi par les victimes de la traite ou de l’exploitation sexuelle. La mission d’information a rencontré trois d’entre elles à Madrid, dont la plus jeune paraissait extrêmement marquée par les séquelles de son ancienne activité, tenant la main, pour se rassurer de la personne qui lui avait permis de sortir de la prostitution (813).
Toutes les personnes rencontrées à l’Amicale du Nid de Paris, qui s’étaient prostituées, ont fait état de problèmes physiques les empêchant parfois de travailler et de troubles psychologiques considérables. Presque toutes ont fondu en larmes en racontant leur histoire, alors que seules deux sur cinq avaient été forcées de se prostituer, et toutes ont dit avoir de grosses difficultés à parler de cette expérience et à trouver le sommeil. « Comment vivre avec ? », s’est demandée Baina (814).
Ces conséquences traumatiques de la prostitution sont renforcées par la dimension sexuelle de cette activité, qui est à ce point particulière qu’elle justifie que le code pénal punisse le viol de quinze ans de réclusion criminelle. On ne peut ignorer le traumatisme subi par les victimes de violences sexuelles et leurs difficultés à se reconstruire psychologiquement, qui justifient une répression de même niveau que celle qui est prévue pour la torture et les actes de barbarie.
b) Une activité qui est fréquemment perçue comme étant constitutive d’une violence par les clients et les personnes prostituées
Si les clients occultent généralement la dimension violente de la prostitution (815), certains d’entre eux n’hésitent pas à l’expliciter, voire à la revendiquer : « Sans faire de mal à la femme […] je me venge un peu sur elle quoi, je sens la sexualité, je la pénètre un peu violemment. Enfin, elle, elle aime ça, ça va […] Je ne ressens pas l’amour, je ressens la bestialité, pas l’amour. Je n’ai pas envie de faire mal, attention,… Tiens, je la domine. » (816) Les évolutions contemporaines de la pornographie ne sont d’ailleurs pas innocentes dans cette assimilation de la sexualité à la violence (817). Bien entendu, la réduction d’une personne à l’état d’objet, précédemment évoquée, est également l’expression d’une violence considérable.
Julien, un ancien client de la prostitution, présente également la violence comme un élément inhérent à la prostitution : « Personne ne nous avait expliqué que notre désir, sans réciprocité, pouvait faire du mal. Aujourd’hui, je considère que j’ai été un homme violent car je pense sincèrement que des rapports sexuels non désirés sont une violence. Même si j’ai été un client qui considérait la personne prostituée comme une femme à part entière, j’ai ignoré son propre désir, j’ai nié la part intime de sa personne. Maintenant je pense que le plus doux des clients reste tout de même le plus doux des bourreaux. » (818)
Il est remarquable que beaucoup de personnes prostituées qui ont revendiqué leur activité perçoivent après coup la violence extrême qu’elles ont subie. Une jeune femme reçue par la mission a dû retourner sur les lieux où elle s’était prostituée pour remarquer, en tant qu’observatrice extérieure, la violence liée à la prostitution : « En 2008, je suis retournée en Corse voir des amies africaines qui travaillaient dans des bars américains, et j’ai vraiment été choquée par la violence de ce milieu. Je ne m’étais pas rendu compte à quel point c’était violent. J’étais tellement anesthésiée, tellement dans la violence moi-même, envers mon propre corps, que je ne m’étais pas aperçue des agressions constantes dont on est l’objet. Pour moi, il était normal qu’on me fasse du mal, qu’on me maltraite. » (819)
Cette capacité à élever son seuil de tolérance à la douleur et à la violence a également été mise en lumière par Mme Judith Trinquart, psychiatre (820). De la sorte, les violences subies ne sont pas perçues comme telles au cours de l’activité prostitutionnelle, le corps s’y habituant. Ce n’est qu’a posteriori que la personne se rend compte de la violence des agressions subies.
c) Le consentement à la violence supprime-t-il la violence ?
La prostitution se présente donc, dans ses conséquences, comme une forme de violence d’autant plus extrême qu’elle est sexuelle. Elle est nommée comme telle par certains clients et, au moins a posteriori, par les personnes prostituées. Le seul élément susceptible de la différencier d’une violence ordinaire est le consentement de la personne prostituée à la réalisation de l’acte sexuel. Cet élément a été analysé par la Cour européenne des droits de l’homme, dans une affaire de sadomasochisme, comme faisant le partage entre la liberté sexuelle, d’une part, et la torture, d’autre part (821).
Cependant, la comparaison avec le sadomasochisme n’est pas pleinement satisfaisante, dans la mesure où les personnes qui se livrent à cette pratique le font sans contrepartie, pour leur plaisir personnel. Ayant le choix de le pratiquer ou pas sans que cela n’altère en rien leur situation personnelle, elles décident de s’y livrer. Mais la prostitution n’est pas le sadomasochisme. Les personnes prostituées ne pratiquent pas cette activité sans contrepartie, par amour du sexe associé à la violence. L’élément fondamental de la prostitution, le point fixe de cette notion, c’est l’échange d’un acte sexuel contre une rémunération.
Dès lors, c’est davantage la notion de contrepartie ou de compensation qui trouve à s’appliquer que celle de consentement. La personne prostituée ne désire pas les actes sexuels auxquels elle se livre, elle ne consent pas dans l’absolu à une relation sexuelle, mais elle l’effectue en contrepartie de l’argent qui lui est remis. Sa situation pourrait plus justement être comparée à celle d’une victime de violences conjugales. On sait maintenant avec certitude que la plupart des personnes qui en sont victimes ne déposent pas plainte. Dirait-on d’elles qu’elles consentent aux violences qu’elles subissent ? Ou faut-il davantage insister sur la dépendance qui les lie à leur conjoint violent et sur les raisons qui les font supporter ces violences (par exemple, assurer la sécurité matérielle de leurs enfants), qui, in fine, leur rendent tolérables des actes qui sont parfois d’une barbarie extrême (822) ? Devrait-on, en conséquence, décriminaliser ces violences, puisque, si elles restent au foyer, c’est bien qu’elles y consentent ? « C’est leur choix d’être battues », terrible formule que l’on a trop souvent entendue.
En comparant ces deux réalités, on se rend compte du chemin qu’il reste à parcourir pour faire reconnaître la relation entre une prostituée et son client comme une violence, quel que soit le consentement. Cette reconnaissance ne mettra pas plus un terme à la prostitution que l’incrimination des violences au sein du couple n’y a mis fin, mais elle montrera que la société sait nommer cette violence, qu’elle ne tolèrera plus que les clients s’abritent derrière le consentement de la personne prostituée, pas plus qu’elle ne tolère aujourd’hui que le mari violent argue du fait que sa femme consentirait aux violences puisqu’elle ne porte pas plainte.
Toutes les formes de domination ont progressivement été incriminées par notre droit pénal, afin de garantir l’intégrité du corps humain, et notamment celui des femmes contre toute forme d’abus d’autorité. Depuis le viol jusqu’aux violences psychologiques au sein du couple, le droit pénal a toujours été conçu comme un facteur de rétablissement d’une égalité rompue, quand bien même toutes les parties prenantes « consentaient » à la situation (823). Dans la prostitution, c’est l’argent qui engendre ce déséquilibre fondamental, condition sine qua non du consentement.
Reconnaître la prostitution comme une violence ne signifie pas pour autant affirmer que les personnes prostituées sont uniquement des victimes. De même que pour les victimes de violences conjugales, c’est uniquement en leur proposant des alternatives crédibles et en leur donnant une réelle capacité d’autodétermination qu’elles seront en position d’effectuer un choix libre et éclairé.
En dernier lieu, la prostitution pose question au regard de l’égalité entre les sexes, principe constitutionnel figurant notamment dans le préambule de la Constitution de 1946.
1. La prostitution, un monde fortement sexué
La prostitution, dans sa réalité même, n’est pas neutre du point de vue du genre.
Les personnes prostituées seraient composées, selon la totalité des auditions, de plus de 80 % de femmes (824). Si l’on y ajoute les personnes transgenres, dont la très grande majorité, dans le monde de la prostitution, exerce en tant que femmes, la proportion se rapproche de 90 %. Sur Internet, ce pourcentage est plus difficile à mesurer. Les recherches qui y sont effectuées montrent, qu’en moyenne, depuis 2004, pour sept recherches portant sur « escort boy », quatre-vingt-treize portent sur « escort girl » (825). Les victimes de la traite et du proxénétisme, telles qu’elles ressortent des condamnations pénales, sont dans leur immense majorité des femmes (826).
De l’autre côté, les clients sont presque totalement masculins. La prostitution masculine de rue est exclusivement destinée à une clientèle masculine. Cela semble être également le cas de la grande majorité de la prostitution masculine sur Internet (827). Si les clientes ne sont pas totalement inexistantes, il n’en a jamais été fait mention au cours des auditions de la mission d’information et très peu ont répondu à l’enquête du Mouvement du Nid portant sur les clients (828).
Mais la prostitution ne fait pas qu’exprimer une vision inégalitaire des sexes, elle la perpétue également. L’entrée dans le clientélisme se fait souvent sous l’impulsion de tiers, qui, sans exercer de contrainte explicite, font peser une sorte de pression morale sur leurs pairs les plus jeunes.
Le recours à la prostitution peut constituer une étape initiatique pour les jeunes hommes, à qui l’on veut prouver qu’ils sont vraiment des hommes. Normalité masculine et prostitution sont alors liées. Certains jeunes hommes sont poussés par leur famille à avoir un rapport sexuel tarifé avec une prostituée, dans le cadre d’une « initiation » à la sexualité : « Quand je me souviens de ce que j’ai pu louper au niveau sexuel, parce que j’étais trop timide, trop coincé, parce que j’avais peur que mes parents, éventuellement, sachent que j’ai essayé de draguer. […] Tout était tabou… C’est pour ça que je dis souvent à des amis : moi mon gamin, quand il aura 15-16 ans, s’il faut je lui paierai une prostituée pour qu’il apprenne, qu’il ne soit pas aussi coincé que je l’ai été moi, j’ai été coincé jusqu’à l’âge de 19-20 ans et encore » (829) a indiqué un client.
20 % des clients auraient eu recours à la prostitution, pour la première fois, à l’armée, à l’incitation du groupe. L’un d’entre eux explique ainsi : « Ah, bien sûr que je m’en rappelle parce que ça a été contre mon gré […] Dans la marine, les anciens vous prennent, ils vous saoulent, ils vous tatouent, ils vous font fumer […] et bien sûr, à un moment, ils vous amènent voir une prostituée et, bien sûr, j’avais 16 ans, il fallait passer sur cette femme-là qui en avait 50 ou 60 à l’époque. J’étais tellement jeune, tout jeune, ma première prostituée, c’était une veille femme et il fallait le faire sinon on passait pour un moins que rien, quoi, pas un homme, quoi. C’est le bizutage. » (830) Beaucoup de clients ont connu leur première expérience de la prostitution en groupe. Enfin, le milieu professionnel constitue le troisième groupe d’appartenance qui peut pousser à devenir client (831).
Il n’est d’ailleurs pas rare que les clients fréquentent des personnes prostituées en groupe, comme moment de sociabilité masculine. Le maire de La Jonquera a attesté du fait que les clients venaient en général à plusieurs depuis le sud de la France (832). Le recours à la prostitution se perpétue donc sur le fondement de rites sociaux sexuellement très différenciés entre les hommes et les femmes, apparaissant comme une forme de sociabilité typiquement masculine.
2. La prostitution perpétue-t-elle les inégalités de genre ?
La justification de la prostitution, comme nous l’avons montré, repose sur un univers mental archaïque (833), qui voit les besoins sexuels des hommes comme irrépressibles et leur satisfaction comme une nécessité sociale.
Les représentations qui y sont liées sont elles-mêmes fortement sexuées. Là encore, plusieurs clients en témoignent. « Comme beaucoup d’hommes vous répondront, à part sa mère, les femmes c’est des objets de plaisir » (834), estime l’un d’entre eux. Les mêmes remarques pourraient être faites en ce qui concerne la pornographie. Le rôle de l’homme et de la femme y sont tout à fait différents et l’appréciation portée sur cette pratique varie fortement en fonction du sexe (835).
Ces représentations s’inscrivent dans une vision profondément inégalitaire des relations entre les femmes et les hommes, où une pratique est justifiée sur le fondement de la différence de nature qui existerait entre les sexes. Dans cette conception, les hommes auraient besoin d’une femme et de prostituées, la première leur apportant de l’affection et les secondes satisfaisant ses besoins sexuels irrépressibles. C’est un tel imaginaire qu’expriment certains clients : « avoir une femme qui ne vous apporte rien au lit mais qui vous apporte tellement de choses à côté, un sourire, un repas, un vêtement repassé et qu’on n’a pas envie de s’en séparer. Et on va voir une autre fille à côté parce qu’au lit on n’a rien » (836), raconte un client. La prostitution, dans sa conception commune de moyen de satisfaire un besoin physiologique masculin, constitue donc pleinement une expression des inégalités de genre, en fondant la justification de cette pratique dans une différence de nature.
Cette vision s’inscrit dans l’espace même des lieux de prostitution, qui deviennent fortement sexués. Certains lieux sont interdits aux femmes. La mission a pu en faire l’expérience lors de ses déplacements à La Jonquera et à Madrid : l’entrée des députées dans les établissements de prostitution a été refusée par leur propriétaire (837). Selon Mme Malka Marcovich, des rues dédiées à la prostitution de certains quartiers rouges allemands sont interdites aux femmes, ce qui constitue un cas flagrant de discrimination dans l’espace public (838).
La reconnaissance ou la simple tolérance de la prostitution comme une nécessité sociale emportent donc des conséquences fondamentales sur la conception que l’on se fait de la place des femmes dans la société. Elles perpétuent des représentations traditionnelles du masculin et du féminin qui vont profondément à l’encontre de notre conception de l’égalité de genre, en laissant à penser que le corps des femmes pourrait être loué et que, la prostitution n’étant pas illégale, la société reconnaîtrait la légitimité de cette pratique.
QUATRIÈME PARTIE : REFONDER LES POLITIQUES PUBLIQUES POUR VOIR RÉGRESSER LA TRAITE, LE PROXÉNÉTISME ET LA PROSTITUTION
De l’analyse de ce qu’est la prostitution au regard des grands principes démocratiques et républicains doit découler une orientation donnée aux politiques publiques. Dans la mesure où la prostitution ne saurait être considérée comme un travail et où elle constitue le plus souvent une violence, qui frappe généralement des femmes, ces politiques ne peuvent viser qu’à lutter contre l’exploitation sexuelle et à voir régresser la prostitution.
La prostitution pouvant être assimilée à une forme de violence faite aux femmes (839), il est nécessaire, en premier lieu, de responsabiliser les clients et, par-delà, de sensibiliser la société dans son ensemble à la réalité vécue par les personnes prostituées. Ce n’est pas parce que la prostitution serait condamnable d’un point de vue moral ou religieux que cette politique doit être mise en œuvre, mais bien parce que la prostitution réduit une personne à un corps, qu’elle est porteuse de violences et qu’elle perpétue les inégalités de genre. Chacun doit en être conscient, à commencer par les clients.
Corrélativement, il faut restaurer la liberté de choix des personnes prostituées en garantissant leur accès au droit et en leur proposant des alternatives crédibles. Pour les victimes de la traite, cela signifie les accompagner et les protéger quand elles font le choix de se soustraire à l’emprise du réseau. Pour les autres, il est nécessaire de leur proposer d’autres voies, sur lesquelles elles pourront s’engager si elles le souhaitent.
Souvent, il existe un troisième personnage, le proxénète. La législation pénale en la matière n’a cessé de se renforcer, tant du point de vue des incriminations que de celui des outils procéduraux. Cependant, cette législation demande à être davantage appliquée, notamment par une meilleure coopération internationale.
Enfin, l’ensemble de ces politiques publiques doit être mieux piloté. Parce que la prostitution est une réalité complexe, il est nécessaire que l’ensemble des services publics coopèrent, tant dans la lutte contre le proxénétisme et contre la traite que pour la protection et l’accompagnement des personnes prostituées. Pour ce faire, la prostitution doit enfin devenir un objet de politiques publiques, du niveau local à l’échelle nationale, et non plus une réalité appréhendée par des acteurs qui ont chacun leurs propres préoccupations.
I. – COUPLER LA PÉNALISATION DES CLIENTS À UNE POLITIQUE AMBITIEUSE EN MATIÈRE D’ÉDUCATION ET DE PRÉVENTION
« Quand on aura appris aux hommes et aux femmes à s’entendre, à se respecter et à ne pas avoir honte du sexe, on n’aura plus besoin de prostituées » (840) a estimé Mme Gabrielle Partenza, présidente de l’association Avec nos Aînées. Cette conviction témoigne du fait que la prostitution est d’abord le fruit de lacunes dans l’éducation à l’égalité de genre. Or, pour rendre cette éducation possible, il ne suffit pas de mener des campagnes de communication ou d’enfin introduire l’éducation à l’égalité dans les missions de l’école. Il faut également poser des interdits, sur le fondement desquels peut être réalisé un travail de pédagogie.
A. LA DEMANDE, UNE QUESTION DE PLUS EN PLUS SOULEVÉE
Longtemps occulté, le client apparaît aujourd’hui sur le devant de la scène, aussi bien dans les pays qui ont dépénalisé certaines formes de proxénétisme que dans ceux qui ont entrepris de lutter contre la prostitution. Il ne se passe plus désormais une seule discussion internationale sur la traite des êtres humains sans que la question de la demande ne soit soulevée.
1. Le client, acteur central mais longtemps occulté du système prostitutionnel
Malgré le pourcentage souvent élevé d’hommes qui déclarent avoir eu recours à la prostitution au moins une fois dans leur vie, les politiques publiques se sont, jusqu’à une période récente, peu intéressées à cette figure pourtant centrale de la prostitution.
a) « Le client est la personne qui contribue le plus à la traite »
Cette courte phrase n’est pas issue d’un ouvrage scientifique sur la traite des êtres humains. Elle a été prononcée, devant la mission d’information, par une jeune roumaine victime de la traite rencontrée en Espagne, contrainte de se prostituer dans différents « clubs » espagnols (841).
Le constat est simple : sans clients, la prostitution n’existerait pas et, en conséquence, la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle non plus. Ce lien entre l’offre et la demande de services sexuels a notamment été fait en Suède où Mme Kajsa Wahlberg, rapporteure nationale sur la traite, a estimé que « les clients apportent, par leurs actes, leur soutien à la criminalité organisée. » (842) Cette assertion a largement pu être démontrée dans le cas suédois puisque les autorités estiment que la pénalisation de la demande y a fait chuter de manière importante la traite à des fins d’exploitation sexuelle et, plus largement, l’ensemble de la criminalité organisée (843).
Or, la demande est massive. D’après l’enquête du Mouvement du Nid, environ un homme sur huit (12,6 %) a déjà eu recours à une prestation sexuelle tarifée (844) en France. Ce pourcentage, comparable à celui qui existait en Suède avant la pénalisation des clients, se situe dans la moyenne des autres pays européens. Il faut préciser que les méthodologies adoptées ne permettent pas une comparaison rigoureuse des données internationales. Ces chiffres ne fournissent donc que des estimations du pourcentage de clients dans chaque pays européen.
ESTIMATIONS DU POURCENTAGE D’HOMMES AYANT DÉJÀ EU RECOURS À LA PROSTITUTION DANS QUELQUES PAYS EUROPÉENS
Italie |
16,7 à 45 % |
Espagne |
27 à 39 % |
Pays-Bas |
13,5 à 21,6 % |
Suisse |
19 % |
France |
12,6 à 16 % |
Finlande |
10 à 13 % |
Norvège |
12,9 % |
Suède |
7,9 % |
Royaume-Uni |
7 à 8,8 % |
Sources : enquête du Mouvement du Nid, déplacements en Suède et en Espagne et études disponibles à l’adresse suivante : http://prostitution.procon.org/view.resource.php?resourceID=004119
Le recours à la prostitution est donc un phénomène social de masse. Un récent rapport sur la prostitution en Allemagne estime à environ un million d’hommes le nombre de clients quotidiens de la prostitution dans ce pays (845).
L’existence de cette demande crée, en raison de son importance, un immense appel d’air. Les réseaux de traite sont donc fortement incités à faire venir sur les marchés des grands pays européens de nombreuses jeunes filles dont ils savent qu’elles trouveront facilement des clients, d’autant plus que le nombre de personnes prostituées originaires des pays où elles exercent tend à décroître (846). Ainsi, moins de 10 % des personnes prostituées exerçant dans la rue en France seraient françaises, selon l’OCRTEH. Ce chiffre serait d’environ 37 % en Allemagne (847). Les autorités espagnoles évaluent, quant à elles, ce chiffre à environ 3 % (848).
Le recours à la traite des êtres humains est donc fortement stimulé par la demande en personnes prostituées des clients des pays riches.
b) La demande, une dimension occultée de la prostitution
En dépit du caractère massif du recours à la prostitution dans nos pays, l’analyse de la prostitution ne portait, jusqu’à très récemment, que sur la personne prostituée et, éventuellement, sur son proxénète. En revanche, le client est longtemps resté dans l’ombre, échappant à tout questionnement et, corrélativement, ne faisant l’objet d’aucune politique publique.
En conséquence, il existe très peu de données disponibles sur les clients de la prostitution. Cependant, une enquête d’ampleur, déjà largement citée, a été menée par le Mouvement du Nid en 2004, qui a notamment donné lieu à la publication d’un rapport (849) et de deux livres (850).
Par ailleurs, ce n’est qu’en 2002 que les clients ont été pris en compte dans la législation pénale française, par le biais de la répression du recours à la prostitution de mineurs puis, en 2003, de personnes présentant une particulière vulnérabilité. Ces infractions n’ont cependant donné lieu qu’à un nombre de condamnations très peu élevé depuis leur création.
CONDAMNATIONS PÉNALES POUR RECOURS À LA PROSTITUTION DE MINEURS OU DE PERSONNES VULNÉRABLES DEPUIS 2002
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | |||
Recours à la prostitution de mineur |
9 |
11 |
20 |
27 |
25 |
11 |
14 |
10 | ||
Recours à la prostitution de mineur de 15 à 18 ans par une personne abusant de son autorité |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
Recours à la prostitution de mineur de 15 ans par réseau de télécommunication |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
2 | ||
Recours à la prostitution de mineur de 15 ans par une personne abusant de son autorité |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 | ||
Recours à la prostitution de plusieurs mineurs de 15 ans |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
2 | ||
Recours habituel à la prostitution de mineur de 15 à 18 ans |
0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
Recours habituel à la prostitution de mineur de 15 ans |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
3 |
5 |
3 | ||
Total recours à la prostitution de mineur |
10 |
24 |
22 |
28 |
26 |
21 |
23 |
17 | ||
Recours à la prostitution de personne vulnérable |
– |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 | ||
Recours à la prostitution de plusieurs personnes vulnérables |
– |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 | ||
Recours habituel à la prostitution de personne vulnérable |
– |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 | ||
Total recours à la prostitution de personne vulnérable |
0 |
2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 | ||
TOTAL général |
10 |
26 |
22 |
29 |
27 |
22 |
24 |
20 | ||
Source : ministère de la Justice.
Ainsi, le nombre de condamnations sur ce fondement est faible. On compte environ une vingtaine de condamnations par an pour recours à la prostitution de mineurs et uniquement une condamnation par an, en moyenne, pour recours à la prostitution d’une personne présentant une particulière vulnérabilité. Les policiers rencontrés par la mission d’information ont fait état des difficultés à appliquer ces infractions, dans la mesure où il est nécessaire de prouver que le client avait connaissance du fait que la personne prostituée était mineure ou particulièrement vulnérable.
Les clients restent donc largement absents du champ judiciaire comme du débat public en matière de prostitution. Le client est « tranquille dans sa tête, ça n’est pas lui qui va en garde à vue » (851), a témoigné Kevin, qui s’est prostitué de 16 à 23 ans. Alors que les personnes prostituées sont placées en garde à vue pour racolage, les clients ne sont pas inquiétés. Pourtant, une prise de conscience s’est fait jour, au sein des organisations internationales et dans un nombre croissant de pays européens, visant à mieux mettre en lumière le rôle de cet acteur indispensable du système prostitutionnel qu’est le client.
2. Une prise de conscience croissante du rôle de la demande aux plans international et européen
La demande est de plus en plus prise en compte dans les politiques publiques concernant la prostitution.
a) Une prise de conscience progressive au plan international
Avec l’entrée en vigueur de la loi suédoise pénalisant les clients, une vaste réflexion s’est engagée, à l’échelle internationale sur la responsabilité des clients dans la perpétuation et le développement de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et de la prostitution.
Le protocole de Palerme, signé en 2000 sous l’égide des Nations unies (852), est le premier instrument international à pointer clairement la nécessité, pour lutter contre la traite des êtres humains, de dissuader la demande. Le cinquième alinéa de son article 10 prévoit en effet que « les États Parties adoptent ou renforcent des mesures législatives ou autres, telles que des mesures d’ordre éducatif, social ou culturel, notamment par le biais d’une coopération bilatérale et multilatérale, pour décourager la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation des personnes, en particulier des femmes et des enfants, aboutissant à la traite. » Le lien y est donc clairement établi entre demande, exploitation et traite.
La Convention de Varsovie, signée en 2005 dans le cadre du Conseil de l’Europe (853), se veut un peu plus précise et contraignante. Outre le fait qu’elle encourage les États signataires à incriminer les clients, son article 6 porte spécifiquement sur les mesures à prendre pour décourager la demande. Il reprend la formule du protocole de Palerme concernant le lien entre demande, exploitation et traite et préconise que soient menées des recherches, des campagnes d’information ciblées et des actions d’éducation à l’égalité de genre.
Enfin, en 2007, un rapport a été établi par la rapporteure spéciale de l’ONU sur les droits fondamentaux des victimes de la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, Mme Sigma Huda, sur la place de la demande dans la traite des êtres humains mais qui n’a pas pu être publié, en raison du départ de la rapporteure pour des raisons politiques dans son pays d’origine, le Bangladesh. Il mentionnait notamment le fait qu’« il est clair que la responsabilité du marché du proxénétisme est imputable aux consommateurs de services sexuels, aux trafiquants et aux conditions économiques, sociales, juridiques, politiques, institutionnelles et culturelles qui oppriment les femmes et les enfants dans le monde entier. » (854)
Cette prise de conscience s’est notamment traduite dans le domaine militaire par l’édiction de règles de bonne conduite, ainsi que l’a rappelé Mme Malka Marcovich, directrice pour l’Europe de la Coalition contre la traite des femmes (CATW) (855). Le code de bonne conduite de l’ONU à l’attention de son personnel mentionne la nécessité de lutter contre l’exploitation sexuelle. Il s’appliquait d’abord aux théâtres de conflits armés puis a été généralisé aux personnels humanitaires, considérant que les clients de la prostitution favorisent la traite. Un code semblable a été édicté en 2005 par l’OTAN et par les armées norvégienne, suédoise et américaine, notamment.
La doctrine gouvernant la conduite des militaires français en matière de lutte contre la demande de prostitution a été exposée à la mission par une lettre du ministre de la Défense accompagnée d’une note (856) qui précise que cette lutte « constitue pour les armées non seulement un impératif éthique mais surtout un impératif opérationnel car ce phénomène fragilise toujours l’action d’une force déployée dans des conflits où la ‘‘conquête des cœurs’’ représente un objectif majeur. » La lutte contre le recours à la prostitution passe par plusieurs vecteurs, dont le code du soldat, ainsi que les directives spécifiques données par chaque commandant d’opération. La mise en œuvre de ces préconisations serait satisfaisante, dans la mesure où aucun des dix cas « d’exposition sexuelle à risque » déclarés par les forces françaises au Sénégal n’impliquait de personne prostituée, alors que plus de 5 000 militaires français passent chaque année au Sénégal. Les sanctions encourues sont en effet fortes (du rapatriement en France à la perte d’emploi) (857).
En écho à cette prise de conscience du rôle de la demande dans la traite des êtres humains, l’exploitation sexuelle et la prostitution, un mouvement de fond s’est récemment engagé dans de nombreux pays européens en direction de la pénalisation des clients.
b) Un mouvement de fond en Europe en direction de la pénalisation des clients
La Suède a été le premier État, en 1999, à sanctionner, dans son code pénal, l’achat de services sexuels. Les dix ans d’application de cette loi permettent d’en tirer un bilan précis (858). Cependant, la Suède n’est pas un pays isolé en la matière. Un nombre croissant d’États, prenant conscience de la place centrale du client dans la perpétuation de la prostitution et de la traite des êtres humains, a entrepris de les pénaliser.
– Un premier ensemble d’États a adopté un modèle proche de celui de la Suède, en pénalisant l’achat de services sexuels de manière générale, tout en abrogeant toute sanction visant les personnes prostituées.
En novembre 2008, la Norvège a adopté une législation identique à celle qui est en vigueur en Suède. L’incrimination des clients est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. En avril 2009, l’Islande a adopté une législation visant à pénaliser le client. Toute personne qui achète des services sexuels est passible d’amende et d’une peine d’un an d’emprisonnement. Cette peine est portée à deux ans d’emprisonnement si l’achat de services sexuels est effectué auprès d’un mineur de moins de 18 ans.
Enfin, l’Irlande envisage d’adopter une telle législation pénalisant les clients. Une étude est actuellement en cours sur la faisabilité juridique d’une telle interdiction et un débat est engagé.
– Dans d’autres pays, l’achat de services sexuels n’est incriminé que si la personne prostituée est en situation de vulnérabilité ou si le client a connaissance de son statut de victime d’exploitation sexuelle.
La France a progressivement adopté, entre 2002 et 2003, une légalisation de ce type en pénalisant certains clients. Est actuellement incriminé le recours à la prostitution d’un mineur ou d’une personne qui « présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse », sur le fondement de l’article 225-12-1 du code pénal. Ce délit, qui peut être aggravé, est puni « de trois ans d'emprisonnement et 45000 euros d'amende ». Sur ce modèle, la Belgique incrimine également les clients des personnes prostituées mineures.
La Finlande pénalise depuis 2006 les clients qui achètent des services sexuels auprès de personnes prostituées victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme. Dans la même logique, le Royaume-Uni a décidé, dans le Policing and crime Act 2009 d’introduire dans sa loi sur la délinquance sexuelle une nouvelle infraction visant à punir le fait d’acheter des services sexuels à une personne prostituée contrainte d’exercer cette activité par la force, la menace, la tromperie ou toute autre forme de coercition, d’une amende maximale de 1 000 £ (859). La législation anglaise n’exige pas, pour que l’infraction soit constituée, la preuve de l’élément moral. Autrement dit, il n’est pas nécessaire que le client connaisse le statut de victime de la personne prostituée.
Enfin, les Pays-Bas, allant au bout de leur logique de légalisation et d’encadrement de la prostitution, examinent actuellement un projet de loi visant à la pénalisation des clients des personnes prostituées qui n’exercent pas dans le cadre légal (860), c'est-à-dire qui n’auront pas procédé à l’enregistrement individuel qui devrait être rendu obligatoire.
Ces différents exemples constituent la preuve que, quelle que soit la situation légale de la prostitution, la demande apparaît partout comme l’un des canaux privilégiés de lutte contre la prostitution, de manière générale, et contre l’exploitation à des fins de prostitution, en particulier. Que des pays menant des politiques aussi différentes en matière de prostitution que la Suède et les Pays-Bas soient sur le point de créer ou de renforcer leur législation en matière de pénalisation des clients est fort éclairant à ce propos.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES CLIENTS DANS QUELQUES PAYS EUROPÉENS
Pays pénalisant les clients de manière générale | ||
Suède |
1999 |
Délit puni d’une amende et de 6 mois d’emprisonnement |
Norvège |
2009 |
Délit puni d’une amende et de 6 mois d’emprisonnement |
Islande |
2009 |
Délit puni d’une amende et d’un an d’emprisonnement |
Irlande |
Réflexion en cours | |
Pays pénalisant les clients des personnes prostituées victimes d’exploitation | ||
Finlande |
2006 |
Clients d’une personne prostituée victime de la traite ou d’exploitation |
Royaume-Uni |
2009 |
Clients d’une personne prostituée exerçant cette activité sous la contrainte |
Pays-Bas |
Réflexion en cours sur l’opportunité de sanctionner les clients des personnes prostituées qui ne seront pas enregistrées auprès des autorités | |
Pays pénalisant les clients des personnes prostituées vulnérables | ||
France |
2002 et 2003 |
Clients d’une personne prostituée mineure ou présentant une particulière vulnérabilité |
c) Un pas vers une pénalisation des clients des victimes de la traite au niveau communautaire
En lien avec ce mouvement de fond au sein des pays européens, l’adoption, à la fin de l’année 2010, d’une nouvelle directive relative à la traite des êtres humains au sein des institutions communautaires a été l’occasion de poser la problématique de la demande au niveau européen.
L’article 18 de la future directive (861) porte sur la prévention de la traite des êtres humains. Il préconise notamment que les États membres prennent « les mesures appropriées, notamment en matière d'éducation et de formation, pour décourager et réduire la demande qui favorise toutes les formes d'exploitation liées à la traite des êtres humains. » Par ailleurs, il prévoit que les « États membres envisagent d'adopter les mesures nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale au fait d'utiliser les services qui font l'objet de l'exploitation visée à l'article 2 en sachant que la personne concernée est victime d'une infraction visée audit article », reprenant en cela l’article 19 de la Convention de Varsovie (862).
Sans aller jusqu’à la création, au niveau européen, d’une infraction visant les clients des victimes de la traite, la directive préconise d’adopter une telle infraction au plan national. Afin d’en évaluer les effets, au plus tard trois ans à compter du délai de transposition, un rapport, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives, devra être élaboré par la Commission européenne.
Cette position a été fortement débattue au Parlement européen, qui souhaitait rendre obligatoire la création par les États membres de cette nouvelle infraction. Une position de compromis a été trouvée à l’initiative de la rapporteure, Mme Anna Hedh : le texte initial de la Commission a été maintenu mais cette dernière s’est engagée à remettre un rapport sur la question (863).
B. DIX ANNÉES D’EXPÉRIENCE EN SUÈDE SUR LA PÉNALISATION DES CLIENTS
Le 1er janvier 1999, la Suède a été le premier pays au monde à avoir incriminé l’achat de services sexuels. Elle constitue donc un laboratoire en la matière, qui est observé, voire imité, par de nombreux autres pays. À l’occasion des dix ans de l’entrée en vigueur de la loi, le Gouvernement suédois a chargé la Chancelière de Justice d’en dresser un bilan (864). Afin de se faire une idée précise des effets de la loi suédoise, la mission d’information a rencontré, lors d’un déplacement en Suède, tous les acteurs, politiques, administratifs, associatifs et universitaires qui œuvrent à son application et à son analyse (865).
1. Une interdiction symbolique à visée pédagogique
Si le délit visant les clients a d’abord une portée pédagogique, il n’en est pas moins pleinement applicable.
a) Une infraction pleinement applicable
Depuis le 1er janvier 1999, la section 11 du chapitre 6 du code pénal suédois interdit l’achat de tout type de services sexuels. Le mode de paiement (argent liquide, alcool, drogue,…) ainsi que le lieu (domicile, rue…) où se déroule l’achat sont indifférents. La promesse de paiement suffit également à caractériser le délit, la tentative étant punissable.
La sanction encourue est une amende et une peine de 6 mois d’emprisonnement. Selon un principe classique du droit pénal suédois, les amendes étant proportionnées aux revenus de la personne, la Cour suprême suédoise a indiqué que la peine « normale » était de 50 jours-amende (866).
Jusqu’à présent, seules des peines d’amende ont été prononcées. Selon la Chancelière de Justice, Mme Anna Skarhed, 650 personnes ont été sanctionnées pour un achat de services sexuels depuis 1999 (867).
NOMBRE DE DÉLITS CONSTATÉS, DE POURSUITES PÉNALES ET DE CONDAMNATIONS JUDICIAIRES POUR ACHAT DE SERVICES SEXUELS EN SUÈDE ENTRE 1999 ET 2008
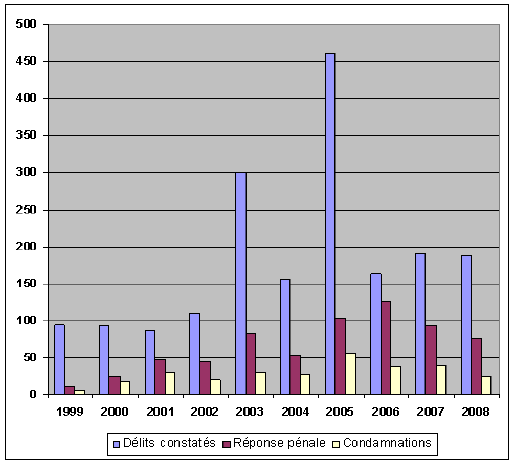
Source : Rapport d’évaluation de la loi, p. 176 et suivantes.
Ce chiffre, relativement faible, s’explique par le fait que le nombre poursuites engagées dépend essentiellement des moyens consacrés à la recherche des auteurs de l’infraction. Il n’en demeure pas moins que la procédure est pleinement applicable, puisqu’elle a entraîné de nombreuses condamnations. De manière générale, la police n’affecte pas beaucoup de moyens au repérage des clients, ces moyens étant plutôt consacrés à la lutte contre la traite. Or, c’est dans les affaires de traite que des clients sont repérés, la plupart d’entre eux reconnaissant immédiatement les faits. De ce fait, la loi est aisée à appliquer, a souligné Mme Kajsa Wahlberg, rapporteure nationale sur les questions de traite (868).
b) Une vocation essentiellement dissuasive et pédagogique
Dans l’esprit des autorités suédoises, l’important n’était pas tant la sanction des clients que leur dissuasion. Il s’agissait de poser clairement un interdit symbolique qui marque durablement la société suédoise. Cet objectif semble avoir été atteint. En effet, l’évaluation de la loi de 1999, en juillet 2010, a montré qu’elle avait eu un effet dissuasif sur les clients. Selon les chiffres disponibles, leur nombre aurait diminué de 50 % depuis 1999, même s’il est difficile d’avoir des chiffres précis. Avant la loi, 13 % des hommes sondés se disaient clients de personnes prostituées, contre 7 % aujourd’hui. Mais ces données sont à prendre avec précaution car elles reposent sur de simples enquêtes d’opinion. Il est toutefois incontestable, pour les autorités suédoises, que ce chiffre a diminué (869).
2. De réels effets sur la prostitution et sur la traite
L’incrimination des clients a fait régresser tant la prostitution que la traite des êtres humains.
a) Une diminution globale de la prostitution
L’évaluation de la loi menée en 2010 établit avec certitude que la prostitution de rue a été divisée par deux en dix ans, passant de 800 à 400 personnes environ. D’ailleurs, le décrochage a été rapide lors de l’entrée en vigueur de la loi, ainsi que le montrent les graphiques ci-dessous.
Dans le même temps, la prostitution de rue, tant en valeur absolue que relative, a fortement augmenté aussi bien au Danemark qu’en Norvège, deux pays comparables à la Suède. Elle a ainsi été multipliée par plus de trois en Norvège entre 1999 et 2008 et par plus de deux au Danemark entre 2003 et 2008. En conséquence, ces deux pays connaissent des taux de prostitution de rue par habitant qui sont cinq à six fois supérieurs à ceux de la Suède.
NOMBRE DE PERSONNES IMPLIQUÉES DANS LA PROSTITUTION DE RUE PAR HABITANT EN SUÈDE, EN NORVÈGE ET AU DANEMARK ENTRE 1998 ET 2008
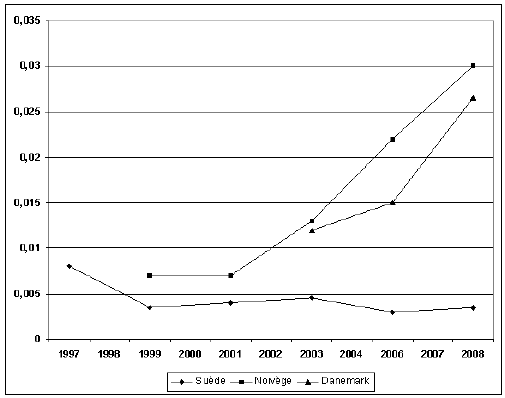
Source : Rapport d’évaluation de la loi, p. 148.
NOMBRE DE PERSONNES IMPLIQUÉES DANS LA PROSTITUTION DE RUE À STOCKHOLM, OSLO ET COPENHAGUE ENTRE 1998 ET 2008
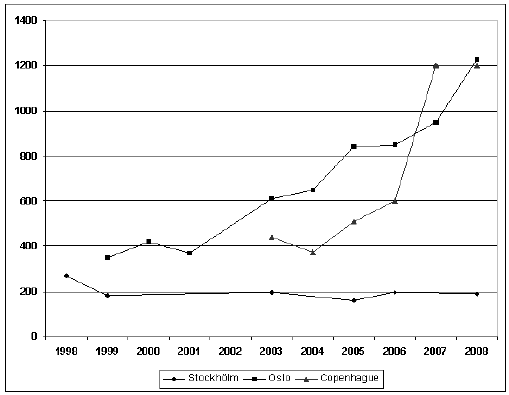
Source : Rapport d’évaluation de la loi, p. 149.
Cependant, afin de pouvoir conclure à une baisse globale de la prostitution en Suède, il est nécessaire de vérifier que la prostitution ne s’est pas déplacée de la rue à des endroits moins visibles, notamment sur Internet.
Mme Pye Jakobson, porte-parole de l’association Rose Alliance, qui regroupe des personnes prostituées, a ainsi estimé qu’il était difficile de faire la part des choses entre les effets de la loi et le boom d’Internet, qui a été concomitant, dans l’augmentation de la prostitution sur Internet (870). Cependant, les données disponibles montrent que la prostitution sur Internet n’a que peu augmenté en Suède, notamment au regard des pays comparables que sont la Norvège et le Danemark. En effet, l’agence nationale des affaires sociales a étudié en 2007 pendant 6 semaines les annonces publiées sur Internet et a recensé seulement 400 personnes y proposant des services sexuels, montrant ainsi qu’il n’y avait pas de forte augmentation de la prostitution en ligne ou de transition de la rue vers Internet (871). Ces données ont été confirmées par Mme Anna Skarhed, chancelière de Justice, qui a indiqué que la prostitution sur Internet avait augmenté mais lentement, invalidant l’hypothèse d’une migration massive vers Internet (872). En conséquence, le nombre de personnes prostituées racolant sur Internet demeure bien moindre en Suède qu’en Norvège et au Danemark.
NOMBRE DE PERSONNES PROPOSANT DE FAÇON « INDÉPENDANTE » DES SERVICES SEXUELS PAR SUR INTERNET, EN SUÈDE, EN NORVÈGE ET AU DANEMARK 2003-2008
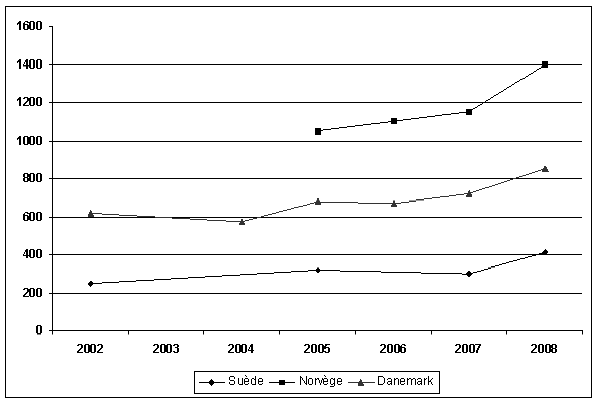
Source : Rapport d’évaluation de la loi, p. 152.
Si l’on rapporte les données de 2008 à la population de chacun des trois pays, on trouve un nombre d’annonces pour un million d’habitants de 43 en Suède, de 149 au Danemark et de 290 en Norvège.
Un élément supplémentaire confirme cette absence de report sur Internet. Lorsque la Norvège a interdit, à son tour, l’achat de prestations sexuelles, le 1er janvier 2009, les recherches sur Internet portant sur les termes « escort » et « eskorte » ont diminué et continuent à décroître depuis, signe que l’interdit a été compris et accepté.
L’ÉVOLUTION DES RECHERCHES SUR INTERNET EN MATIÈRE DE PROSTITUTION EN NORVÈGE
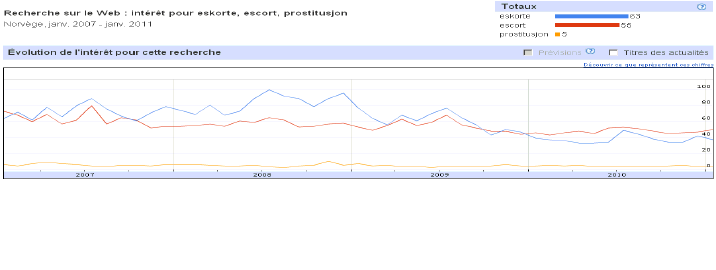
Source : Google Insight, recherches effectuées en Norvège pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 janvier 2011 sur les termes escortes (en anglais, « escort » et en norvégien, « eskorte ») et prostitution (« prostitusjon » en norvégien).
De manière générale, selon les données disponibles, il n’y a pas eu d’accroissement de la prostitution en Suède depuis 10 ans, mais certainement une diminution, ce qui fait de ce pays un cas particulier dans l’espace européen, où la plupart des pays ont connu une augmentation sensible voire une explosion de la prostitution. Corrélativement, le nombre de personnes prostituées étrangères qui ailleurs a également beaucoup augmenté, est resté stable en Suède (873).
Certaines personnes auditionnées ont souligné le possible report de la prostitution suédoise dans les pays voisins ou à bord de ferrys sur la mer Baltique (874). Cependant, aucun des interlocuteurs suédois de la mission d’information, y compris les opposants à la loi, n’a évoqué cet argument. Par ailleurs, quand elle a été questionnée sur ce point, Mme Elisabeth White, de l’unité de la parité entre hommes et femmes du ministère de l’Éducation, a indiqué que la problématique d’un éventuel report de la prostitution aux marges de la Suède n’était pas du tout présente dans le débat public suédois, ce qui, compte tenu de la sensibilité de la population suédoise sur ces questions, tend à attester qu’il ne s’agit pas là d’un phénomène massif.
À ce titre, il faut noter que, s’il était attesté, ce report ne serait en rien spécifique à la situation suédoise, puisqu’un tel phénomène de tourisme sexuel est également attesté entre l’Allemagne et la République tchèque, alors même que la prostitution est légale en Allemagne. Les clients souhaitent en effet préserver leur anonymat ou bénéficier de prestations moins coûteuses (875).
b) Des effets dissuasifs sur la traite des êtres humains
L’une des craintes de certains observateurs de la situation suédoise était que la pénalisation du client ne rende la prostitution davantage clandestine et que, corrélativement, l’emprise des réseaux sur cette activité ne progresse, entraînant une augmentation de la traite des êtres humains et une difficulté accrue à lutter contre ces derniers.
Selon l’évaluation de la loi suédoise, il n’en est rien. La pénalisation des clients a rendu la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle bien moins « sécurisée » en Suède, entraînant sa diminution. Mme Kajsa Wahlberg, inspecteur-détective à l’Office national de la police suédoise et rapporteure nationale sur la traite, a ainsi évoqué des écoutes téléphoniques, menées dans le cadre d’enquêtes judiciaires portant sur des réseaux de traite, dans lesquelles les trafiquants estiment qu’il est trop difficile d’exploiter des femmes à des fins sexuelles en Suède. Mme Pye Jakobson, porte-parole de l’association Rose Alliance, a également estimé que la pénalisation des clients avait rendu plus difficile cette forme de traite en Suède (876).
En effet, pour exploiter la prostitution d’autrui en Suède, il faudrait disposer d’un appartement, être très mobile, faire de la publicité, ce qui rend l’activité moins rentable par rapport aux pays où les femmes peuvent exercer librement dans la rue ou en maison close. Les trafiquants ne peuvent dès lors s’occuper que de quelques personnes prostituées chacun (877). Le ministère de l’Intérieur suédois ayant fait le constat que les différentes formes de criminalité organisée (trafics d’armes, de drogue…) étaient liées, c’est cette dernière qui a diminué dans son ensemble en Suède (878).
Par ailleurs, était également apparue la crainte que les clients ne dénoncent plus à la police les violences subies par les personnes prostituées, dont ils sont témoins. Là encore, ces craintes se sont révélées largement infondées, selon la police suédoise. En effet, dans les faits, très peu de faits de traite ou d’exploitation sont spontanément signalés aux forces de l’ordre : c’est grâce au travail de la police, notamment par ses activités de renseignement, que les réseaux sont démantelés (879).
3. Une loi bénéficiant d’un large soutien politique et populaire
Alors que l’opinion publique suédoise était initialement réticente à la pénalisation des clients, elle lui est désormais acquise, de même que l’ensemble des formations politiques.
a) Un consensus politique s’est établi sur le fondement du bilan de l’application de la loi, jugé très positif
La loi suédoise est issue d’une réflexion et d’un débat au sein de la société ayant duré plus de vingt ans. En 1977, une étude réalisée sur la prostitution avait conclu que cette activité était contraire à l’égalité entre les sexes, qu’elle portait atteinte à l’intégrité de la personne et qu’il fallait s’attaquer au client davantage qu’aux personnes prostituées. En 1993, une autre enquête a été menée, qui proposait de pénaliser à la fois l’achat et la vente de services sexuels pour éliminer la prostitution de la société. Mais ce rapport a été fortement critiqué, car il préconisait de sanctionner aussi bien les clients que les personnes prostituées. Le rapport n’a donc pas été entièrement suivi par le législateur qui a choisi de ne sanctionner que la demande.
Un projet de loi a été présenté au Parlement en 1998 par le gouvernement social-démocrate suédois. Il portait, de manière globale, sur les violences faites aux femmes, avec, en matière de prostitution, la pénalisation de la demande. Lors du débat au Parlement, la droite était opposée à cette pénalisation, à l’exception des chrétiens démocrates, qui souhaitaient également pénaliser la vente de services sexuels.
Cependant, ainsi qu’en a attesté M. Morgan Johansson, président social-démocrate de la commission de la Justice du Parlement suédois, à l’heure actuelle, compte tenu des effets de la loi depuis 10 ans, il existe un soutien politique unanime en sa faveur. M. Johan Linander, vice-président de la commission, membre du parti démocrate-chrétien, a estimé que l’évolution des partis politiques de droite au sujet de la loi était due au fait que le bilan de la loi avait été positif, la police ayant indiqué que la loi lui avait été utile dans son travail de lutte contre la traite. De l’avis de ces deux parlementaires suédois rencontrés par la mission, il semble difficile à un parti politique de se prononcer aujourd’hui contre cette pénalisation, étant donné le bilan qui en est issu (880).
b) L’opinion publique soutient massivement la pénalisation du client
Afin de mesurer l’adhésion de la population suédoise à la loi, différentes enquêtes d’opinion ont été menées avant comme après l’entrée en vigueur de la loi, le 1er janvier 1999. Il apparaît que, dès son entrée en vigueur, la loi a connu une adhésion massive de la population suédoise, puisque, depuis 1999, plus de 70 % des Suédois soutiennent la loi, alors que moins de 20 % disent y être opposés, ainsi que l’indique le tableau ci-dessous.
ENQUÊTES D’OPINION CONCERNANT LA PÉNALISATION DES CLIENTS EN SUÈDE
Personnes favorables à l’interdiction |
Personnes défavorables à l’interdiction |
Sans opinion | |
1996 |
33 % |
67 % |
– |
1999 |
76 % |
15 % |
9 % |
2002 |
76 % |
14 % |
10 % |
2008 |
71 % |
18 % |
11 % |
Source : Rapport d’évaluation de la loi, p. 124.
Signe convergent de la fierté des Suédois à l’égard de leur loi, certains d’entre eux, lors de la coupe du monde de football en Allemagne, en 2006, en ont fait la promotion auprès du pays organisateur, en distribuant des affichettes invitant à ne pas recourir à la prostitution en Allemagne, ainsi que l’a indiqué Mme Eva-Britt Svensson, présidente de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres au Parlement européen (881).
Lors de son déplacement en Suède, la mission a tenu à rencontrer des opposants à la pénalisation du client. Or, il s’est avéré que les critiques formulées par Mme Pye Jakobson, porte-parole de l’association Rose Alliance, qui regroupe des personnes prostituées, ne portent pas, pour l’essentiel, sur la loi en tant que telle mais sur la façon dont elle a été élaborée et dont elle est appliquée. Ainsi, elle a souligné que pour mieux mesurer les effets de la loi, il aurait fallu mener une évaluation statistique de la prostitution en amont, qu’il aurait été nécessaire de mettre en œuvre, parallèlement à la pénalisation des clients, des moyens financiers supplémentaires en direction des personnes prostituées et qu’il aurait fallu davantage faire attention au risque de stigmatisation des personnes prostituées. Au total, elle ne rejette pas l’idée de pénaliser les clients mais estime que cette pénalisation ne devrait concerner, comme en Finlande, que les clients de victimes de la traite ou de personnes vulnérables (882). Ces mêmes critiques dans la mise en œuvre de la loi ont été formulées par la sociologue Petra Östergren qui a également insisté sur la nécessité de mieux associer les personnes prostituées au processus normatif et à l’évaluation de la loi (883).
Le seul reproche de fond qui est formulé à l’encontre de la loi est que cette dernière aurait entraîné une dégradation des conditions d’activité des personnes prostituées qui exercent dans la rue. En effet, les clients étant moins nombreux, le pouvoir de négociation des personnes prostituées aurait diminué, les empêchant, par exemple d’exiger le port du préservatif ou de négocier le tarif de la passe avant de monter dans la voiture du client. Par ailleurs, les « bons clients » fréquenteraient désormais des prostituées exerçant sur Internet, seuls les « mauvais clients » (violents….) restant dans la rue. Enfin, la prostitution étant désormais davantage dissimulée, les personnes prostituées seraient plus isolées et donc plus vulnérables.
Selon le rapport d’évaluation de la loi, ces craintes ne se sont pas réalisées, ce que confirment les analyses de la police et des services sociaux. De surcroît, beaucoup de femmes qui ont quitté la prostitution ou qui voudraient le faire affirment que la loi, en pointant la responsabilité du client, leur a donné une force morale supplémentaire pour ce faire (884).
C. COUPLER LA PÉNALISATION DES CLIENTS À UNE POLITIQUE AMBITIEUSE EN MATIÈRE D’ÉDUCATION ET DE PRÉVENTION
Ainsi que cela a été évoqué précédemment et dans la continuité de l’engagement abolitionniste de la France, l’ambition d’une démocratie avancée ne peut être que d’envisager, à terme, la disparition de la prostitution. Sans qu’il soit besoin de revenir sur les contradictions avec nos principes juridiques les plus fondamentaux que constituerait l’institutionnalisation ou simplement la reconnaissance de la prostitution, il s’agit donc de trouver quelle est la politique qui soit respectueuse des droits reconnus à tout être humain tout en permettant de s’approcher de cet objectif qu’est la disparition de la prostitution. Or, à la lumière tant de nos principes fondamentaux que de l’expérience suédoise, qui est suivie par un nombre croissant de pays dans le monde, il apparaît que la responsabilisation des clients est essentielle à cette conciliation.
1. Créer une infraction pénale pour sanctionner le recours à la prostitution
Cette responsabilisation doit être multiforme et débuter par un travail d’information et de sensibilisation du grand public à la réalité de ce qu’est la prostitution aujourd’hui en France. Mais afin de pouvoir mener ce travail à bien, il est nécessaire, dans un premier temps, de poser l’interdit dans notre loi pénale : l’argent ne peut pas tout acheter, et en particulier le corps humain.
a) Les grands objectifs de la pénalisation des clients
À ce stade, il n’est pas inutile de rappeler quels sont les grands objectifs poursuivis par la volonté de pénaliser les clients de personnes prostituées.
Il s’agit, en premier lieu, de voir régresser la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle. L’exemple comparé de la Suède, de la Norvège et du Danemark est à ce titre instructif, seule la Suède ayant évité une explosion de ces formes de prostitution depuis dix ans. Pénaliser les clients permettrait donc d’écarter une grande partie des réseaux de la France.
En second lieu, il importe de prendre en compte le fait que la prostitution est le plus souvent porteuse de violences, en tant que répétition de rapports sexuels non désirés. Les effets sur la santé des personnes prostituées peuvent être mesurés et sont généralement particulièrement graves et durables. Pénaliser les clients, c’est leur faire comprendre qu’ils participent à une forme d’exploitation de la vulnérabilité d’autrui et c’est donc rendre possible un travail pédagogique sur ce point. « Les proxénètes sont des criminels mercantiles, mais les clients sont des voleurs d’âme, des violeurs d’âme » (885) disait une personne prostituée. Contrairement à ce qu’a affirmé Maîtresse Gilda, porte-parole nationale du STRASS, pénaliser l’achat de services sexuels n’est pas identique au fait d’en pénaliser la vente (886). Au contraire, il faut protéger et accompagner les personnes qui sont en situation de vulnérabilité, quelle qu’en soit la cause, et punir ceux qui profitent de cette vulnérabilité. L’inverse n’aurait pas de sens.
Pénaliser les clients, c’est également donner une application concrète aux grands principes qui sont les nôtres. C’est réaffirmer le principe de non-patrimonialité du corps humain et lutter contre les inégalités et les violences dont sont victimes les femmes.
Enfin, la pénalisation du client constitue, à terme, la meilleure piste pour voir diminuer la prostitution en France, là où tous les pays qui ont réglementé cette activité l’ont vu augmenter. Contrairement à l’opinion du STRASS (887), les données disponibles sur la Suède ne laissent pas augurer que la prostitution de rue se soit reportée ailleurs.
b) Poser l’interdit dans notre droit pénal en créant un délit
Sur le modèle suédois, un délit devrait être créé dans notre code pénal qui sanctionne le recours à la prostitution d’une peine d’amende et d’une peine d’emprisonnement, par exemple de six mois. La rédaction envisagée pourrait être fondée sur la définition de la prostitution proposée par la Cour de cassation : « la prostitution consiste à se prêter, moyennant rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu’ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui. » (888) Il faudrait bien évidemment l’adapter, en remplaçant l’expression de « besoins sexuels d’autrui » (889).
Le but d’un tel délit ne serait pas, bien entendu, d’emprisonner tous les clients. Il convient à ce titre de rappeler que la justice suédoise n’a prononcé aucune peine de prison ferme à l’égard des clients (890) pour plus de 600 clients punis depuis 1999. Il serait d’indiquer aux clients quelles sont les conséquences potentielles de leur acte et quelle est la responsabilité qui est la leur dans la perpétuation de la prostitution et le développement de la traite des êtres humains. À cet égard, la politique pénale devrait consister à répondre à une première infraction par un simple rappel à la loi.
Un tel délit serait proportionné avec les infractions qui existent d’ores et déjà, dans la mesure où le recours à la prostitution de mineurs ou d’une personne particulièrement vulnérable est puni par le premier alinéa de l’article 225-12-1 du code pénal d’une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Ces peines peuvent être portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende en cas de circonstances aggravantes, sur le fondement de l’article L. 225-12-2 du code pénal. Enfin, la peine encourue est de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.
ÉCHELLE DES PEINES EN CAS DE CRÉATION D’UNE INFRACTION SANCTIONNANT LE RECOURS À LA PROSTITUTION
Infraction |
Article du code pénal |
Sanction |
Recours à la prostitution |
Article à créer |
6 mois d’emprisonnement et 3 000 euros d’amende |
Recours à la prostitution d’un mineur ou d’une personne particulièrement vulnérable |
225-12-1 |
3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende |
Recours aggravé à la prostitution d’un mineur ou d’une personne particulièrement vulnérable |
225-12-2, cinq premiers alinéas |
5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende |
Recours à la prostitution d’un mineur de quinze ans |
225-12-2, dernier alinéa |
10 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende |
NB : figurent en grisé les infractions déjà existantes.
Les infractions existantes en matière de recours à la prostitution d’autrui ont une portée extraterritoriale, afin de lutter contre le tourisme sexuel. Elles sont donc applicables aux faits commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français. Pour ce qui est de l’incrimination générale du recours à la prostitution, il paraît préférable, dans un premier temps, de ne pas prévoir une telle application extraterritoriale, qui pourrait se révéler être difficilement applicable. Tel a été le choix de la Suède, la Norvège ayant récemment suivi une voie différente. Le cas échéant, une telle application pourrait être prévue dans un second temps, à l’occasion de la première évaluation des effets de la loi.
Ce délit serait pleinement applicable. Une majorité des commissaires de police rencontrés par la mission à Paris ou à Lyon se sont d’ailleurs dits favorables à la création d’une telle infraction, certains se prononçant pour la création d’une infraction, accompagnée d’une verbalisation systématique des véhicules des clients (891).
b) Prévoir une information des clients de la prostitution
De la même manière que, dans le cadre des violences conjugales (892), il serait nécessaire de prévoir que le juge puisse prescrire au client, en complément de la peine principale, de fréquenter une structure, par exemple associative, l’informant sur la réalité de la prostitution. Cette pratique pourrait prendre place, d’un point de vue juridique, dans le cadre d’une obligation de soin. La nécessité de créer une telle obligation à destination des clients a notamment été soulignée par Mme Élisabeth Tomé-Gertheinrichs, chef du service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes (893).
De telles structures, si elles ne semblent pas exister en France, ont été développées notamment aux États-Unis et au Canada, où elles sont dénommées « John’s schools » ou écoles des clients. L’expérience pionnière en la matière a été menée à San Francisco par Mme Norma Hotaling, ancienne prostituée, et connaîtrait des résultats intéressants, notamment en matière de prévention de la récidive (894). Les intervenants sont notamment composés d’anciennes personnes prostituées. De telles structures permettent de mieux connaître les clients, de leur rappeler la loi, de les éduquer à la santé et aux relations de genre et de leur délivrer une information sur la traite des êtres humains et les conditions d’exercice de la prostitution.
proposition n° 1
Créer un délit sanctionnant le recours à la prostitution (loi).
2. Prévoir une entrée en vigueur différée de cette infraction afin de mener un travail de sensibilisation et d’information
La pénalisation des clients nécessitant un travail d’explicitation et d’information préalable à son entrée en vigueur, il serait souhaitable que cette dernière soit différée.
a) Prévoir une entrée en vigueur différée de l’interdiction
Comme cela a été rappelé précédemment, le vote de la loi suédoise a été précédé de plus de vingt années de débats au sein de la société sur la politique à adopter en matière de prostitution. Or, en France, le débat public et politique en la matière a eu récemment tendance à se concentrer sur l’opportunité de la réouverture des maisons closes, ce qui élude totalement les questions de fond que soulève la prostitution dans une société comme la nôtre.
Afin de permettre à ce débat de s’instaurer, il semble indispensable de prévoir un délai avant l’entrée en vigueur de la pénalisation des clients. C’est d’ailleurs la solution qu’a retenue le législateur à une autre occasion. Lorsqu’a été votée la loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, il a été prévu de différer son entrée en vigueur de six mois afin que puisse avoir lieu une phase initiale de pédagogie et de médiation (895). De la même manière, la pénalisation des clients ne peut pas ne pas être accompagnée d’une période de sensibilisation et d’information sur la réalité de la prostitution, notamment en direction des clients. Un délai de six mois devrait ainsi être prévu entre la promulgation de la loi et l’entrée en vigueur de l’infraction.
b) Durant cette période, mener des actions de communication, notamment en direction des clients
Durant cette période intermédiaire, une politique de communication devrait être engagée par les pouvoirs publics, notamment à destination des clients de la prostitution. M. Fabrice Heyries, directeur général de la cohésion sociale, a rappelé qu’une telle action avait été engagée, en matière de violences conjugales, dans le cadre du deuxième plan interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes (896).
Selon Mme Élisabeth Tomé-Gertheinrichs, chef du service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes, des campagnes de sensibilisation à l’école et dans les médias n’ont jamais eu lieu (897). M. Yves Charpenel, président de la Fondation Scelles, a souligné que les seules initiatives en matière de prévention et de sensibilisation émanaient du secteur associatif (898).
Pourtant, une telle politique, visant notamment à décourager la demande qui favorise l’exploitation et donc la traite, est préconisée par l’article 6 de la Convention de Varsovie, qui prévoit que les États signataires prennent « des mesures visant à faire prendre conscience de la responsabilité et du rôle important des médias et de la société civile pour identifier la demande comme une des causes profondes de la traite des êtres humains » et mènent « des campagnes d’information ciblées, impliquant, lorsque cela est approprié, entre autres, les autorités publiques et les décideurs politiques » (899).
Cette campagne de communication pourrait porter sur trois aspects :
– sensibilisation du grand public à la réalité de la prostitution. Une telle campagne contribuerait à éradiquer les idées fausses concernant la prostitution. Ainsi, selon une enquête de l’Amicale du Nid menée à l’université de Montpellier en 2009-2010, 70 % des étudiants interrogés pensaient que la prostitution était illégale en France et 37 % que le client était puni (900). Elle aurait également pour but de mieux faire connaître la réalité de la prostitution pour faire contrepoint aux représentations « glamours » qui peuvent en être véhiculées par les médias ;
– explicitation de la responsabilité des clients dans la perpétuation de la prostitution et des raisons qui ont conduit à leur pénalisation ;
– information sur l’exploitation sexuelle et la traite des êtres humains, en donnant les principaux critères de reconnaissance des victimes de la traite, ainsi que le préconise le plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2011-2013) (901).
Le lancement d’une telle campagne a été jugé « tout à fait envisageable » par M. Fabrice Heyries au cours de son audition (902). D’ailleurs, celle-ci ne serait pas sans précédent. Mme Malka Marcovich a ainsi évoqué la campagne qui avait été réalisée par son association, la coalition contre la traite des femmes (CATW), en 2006, lors de la coupe du monde de football en Allemagne, sur le thème : « Acheter du sexe n’est pas un sport » (903). Par ailleurs, des associations telles que le Mouvement du Nid ont également lancé des campagnes d’information en la matière. Étant prise en charge par les pouvoirs publics, cette campagne pourrait cependant être d’ampleur bien supérieure.
Elle pourrait prendre comme point d’appui des supports originaux, qui permettent de toucher une grande part des clients potentiels de la prostitution. En Espagne, une grande campagne en direction des clients a été lancée par le ministère de l’Égalité et la Fédération espagnole de l’hôtellerie dont le thème était « Non à l’exploitation sexuelle ». Un million de dessous-de-verre illustrés sur le thème des clients ont ainsi été distribués dans plus de 20 000 hôtels, bars et discothèques, pour un coût de fabrication de seulement quelques milliers d’euros (904).
La coordination, par la puissance publique, des moyens associatifs engagés en la matière serait susceptible d’en augmenter grandement l’efficacité et la portée, a estimé M. Jean-Christophe Tête, directeur de l'établissement de Paris de l’Amicale du Nid (905).
Au cours de son audition, Mme Roselyne Bachelot, ministre des Solidarités et de la cohésion sociale a indiqué qu’il était prévu de mener une campagne d’information en 2012 « visant à dissuader les hommes d’être clients et dénonçant la prostitution comme une violence intolérable. » (906) Cette campagne aurait comme support le troisième plan de lutte contre les violences faites aux femmes.
proposition n° 2
Prévoir pendant les six mois précédant l’entrée en vigueur de la pénalisation des clients, une campagne nationale de communication sur la prostitution, notamment en direction des clients (ministère chargé des droits des femmes).
3. Poursuivre ce travail dans la durée, en éradiquant à terme les racines du système prostitutionnel, par la prévention et l’éducation
De l’avis unanime des partisans d’une pénalisation des clients, cette mesure n’est en aucun cas suffisante pour éradiquer, à terme, les racines du système prostitutionnel. Ce dernier repose en effet sur des présupposés solidement ancrés dans les mentalités que seule une éducation sur le long terme est en mesure de combattre, ainsi qu’en conviennent tant les associations abolitionnistes que les partisans de la reconnaissance d’un statut (907).
a) Mettre enfin en œuvre une politique d’éducation aux inégalités de genre
« Le recours à la prostitution n’est que le haut de l’iceberg, la base en restant le modèle de relation entre les genres que véhicule notre société. », écrivent Mme Claudine Legardinier et M. Saïd Bouamama (908).
Cette constatation est largement partagée par les personnes auditionnées par la mission. C’est précisément l’une des utilités de la pénalisation des clients que d’établir une règle et donc une transgression, susceptible de servir de base à l’éducation à l’égalité de genre. Ainsi que l’a rappelé Mme Malka Marcovich, « ce n’est pas parce qu’il y a une loi sur le viol qu’il n’y a pas de viol. » (909) De la même façon, ce n’est pas parce qu’en dépit de la criminalisation du viol, il y a encore des viols que cette qualification serait inutile et que la société n’aurait rien à dire sur le viol. Au contraire, marquer la transgression rend possible la pédagogie et la sensibilisation.
Il est donc nécessaire, ainsi que l’avaient préconisé la mission d’évaluation des politiques de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes (910) et la mission d’information sur la pratique du port du voile intégral en France (911), d’inscrire dans le projet des établissements d’enseignement les actions à mener pour promouvoir l’égalité entre les filles et les garçons et l’éducation au respect, de systématiser ces actions en les inscrivant dans les programmes validés par les académies et permettant de toucher les différentes classes d’âge, enfin d’inscrire dans la formation des professeurs l’égalité entre les filles et les garçons comme une compétence devant être évaluée et validée.
Ces préconisations rejoignent les engagements internationaux de la France. L’article 6.d de la Convention de Varsovie fait obligation aux États parties d’adopter ou de renforcer les « mesures préventives comprenant des programmes éducatifs à destination des filles et des garçons au cours de leur scolarité, qui soulignent le caractère inacceptable de la discrimination fondée sur le sexe, et ses conséquences néfastes, l’importance de l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que la dignité et l’intégrité de chaque être humain. » (912) Il est significatif que le but de cet article soit le découragement de la demande.
En effet, il ressort de l’étude menée sur les clients de la prostitution que « l’ignorance en matière de sexualité et l’absence d’éducation sexuelle est la règle générale. » (913) D’ailleurs, beaucoup d’entre eux expliquent le recours à la prostitution par une éducation manquant de mixité et par la peur des femmes (914).
Lors de son déplacement en Suède, la mission d’information a pu constater le lien étroit existant entre la pénalisation des clients et l’importance de la politique d’éducation sexuelle dispensée de longue date au sein du système éducatif suédois. L’une de ces deux actions ne saurait aller sans l’autre.
proposition n° 3
Dispenser obligatoirement un enseignement en matière d’éducation à l’égalité de genre dès l’école primaire et à tous les niveaux de formation (ministère de l’Éducation nationale).
b) Engager une réflexion sur la pornographie
Si la mission d’information n’a pas abordé frontalement la question de la pornographie en tant que telle, le lien a été fait, au cours de plusieurs auditions, entre prostitution et pornographie (915).
En effet, la prostitution et la pornographie véhiculent des représentations de la sexualité qui sont fortement corrélées. L’une comme l’autre réduisent l’acte sexuel à sa seule dimension physique et masculine. Elles présentent les femmes comme soumises au désir masculin et comme objet de commerce.
L’enquête menée sur les clients de la prostitution a marqué la fréquence de la consommation de produits pornographiques par ces derniers. Ainsi, 65 % d’entre eux auraient eu recours à la pornographie avant d’acheter des services sexuels. Mise en relation avec la faiblesse de l’éducation sexuelle dans notre système éducatif, la pornographie constitue très souvent la première approche de la sexualité, notamment pour les clients. La pornographie peut donc être vue comme « une étape fréquente du processus de devenir-client » (916). Les demandes des clients en matière de pratiques sexuelles seraient également liées à l’évolution de la pornographie (917).
Ce constat est d’autant plus préoccupant que la pornographie est de plus en plus accessible, notamment sur Internet. En conséquence, les jeunes y sont beaucoup plus exposés que les générations antérieures. M. Bertrand Rouverand, membre de l’Association contre la prostitution des enfants (ACPE), rappelait ainsi que 80 % des garçons de 14 à 18 ans ont vu un film pornographique dans l’année (918). Ceci rend d’autant plus urgent la généralisation de l’éducation sexuelle et à l’égalité de genre à l’école.
Cette homologie entre prostitution et pornographie se retrouve également dans les politiques publiques. Les pays nordiques, qui ont été les premiers à voir l’importance de la demande dans le phénomène prostitutionnel, sont aussi ceux qui ont d’ores et déjà engagé une réflexion au sujet de la pornographie. Mme Eva-Britt Svensson, présidente de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres au Parlement européen a ainsi fait valoir que les pays du Conseil nordique menaient actuellement une réflexion sur la présence de programmes pornographiques dans les hôtels et que certains partis politiques choisissaient leurs hôtels, lors de l’organisation de congrès ou de déplacements, en fonction de la présence ou pas de programmes pornographiques dans ces derniers (919).
Il est donc nécessaire, ainsi que le préconisait l’étude sur les clients (920), de mener une réflexion d’ensemble concernant l’impact de la pornographie sur l’égalité de genre et la sexualité des Français, notamment les plus jeunes. Celle-ci pourrait être fondée sur une enquête réalisée par des universitaires, qui serait commandée par le ministère chargé de la Jeunesse.
En souhaitant qu’une réflexion s’engage en matière de pornographie, la mission n’est à l’évidence pas animée par la volonté d’imposer un nouvel ordre moral sexuel. Elle estime cependant que notre société gagnerait à s’interroger sur le modèle dominant de sexualité qu’elle véhicule et sur ses effets sur l’égalité de genre. Il ne s’agit aucunement de refouler la sexualité mais, au contraire, de lutter contre les préjugés qui l’entourent en promouvant et en diffusant l’information, notamment à l’école. D’ailleurs, on ne saurait accuser la Suède, et plus largement les pays nordiques de promouvoir un nouvel ordre moral, notamment en matière sexuelle, alors qu’ils ont été à la pointe de la libération en ce domaine dans les années 1970.
proposition n° 4
Mesurer l’impact de la pornographie sur les représentations de la femme et l’égalité de genre, notamment chez les jeunes, sur la base d’une enquête universitaire commandée par le ministère chargé de la Jeunesse (ministère chargé de la Jeunesse).
II. – METTRE EN œUVRE UN ACCOMPAGNEMENT INTÉGRAL
DES PERSONNES PROSTITUÉES
La garantie des droits fondamentaux des personnes prostituées nécessite de prendre en compte une double préoccupation. Il est nécessaire, d’une part, de les garantir dans le cadre de l’exercice de la prostitution. Les personnes prostituées doivent être reconnues comme des sujets de droit à part entière, sans que leur activité puisse être considérée, en quoi que ce soit, comme un obstacle à l’exercice de leurs droits. D’autre part, il faut garantir, par la mise en œuvre d’un accompagnement intégral, l’existence d’alternatives crédibles à la prostitution.
A. GARANTIR LES DROITS FONDAMENTAUX DES PERSONNES PROSTITUÉES
Les personnes prostituées, en tant que sujets de droit, doivent disposer des mêmes droits fondamentaux que chacun. D’ailleurs, la convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, du 2 décembre 1949, prohibe, dans son article 6, tout traitement spécial des personnes prostituées. Ce constat nécessite d’examiner les questions de l’accès au droit, de l’incrimination du racolage et de la situation des personnes prostituées au regard de la protection sociale.
1. Le droit d’accéder à la justice : une révolution culturelle est nécessaire
L’accès à la justice est un droit d’autant plus fondamental qu’il conditionne l’effectivité des autres droits. Or, force est de constater que ce droit élémentaire est souvent dénié, dans les faits, aux personnes prostituées.
a) Le droit de déposer plainte
Les personnes prostituées sont victimes de très nombreuses violences, qui sont parfois d’une particulière gravité (921). Pourtant, ce sont elles qui peinent le plus à accéder à la justice. En effet, le dépôt de plainte peut s’avérer être pour elles un obstacle infranchissable.
Le dépôt de plainte est souvent rendu difficile par l’irrégularité de leur séjour : elles craignent d’être arrêtées à l’occasion du dépôt de plainte, ce qui se produit parfois (922). Les contraintes exercées, le cas échéant, par le proxénète constituent également une dissuasion majeure. Enfin, le fait que ces personnes soient généralement considérées comme des délinquantes par les forces de l’ordre, notamment en raison de l’incrimination du racolage, explique les réticences de ces dernières à déposer plainte, quand ce ne sont pas les forces de l’ordre elles-mêmes qui sont à l’origine des violences (923). Dans le Journal des répressions et des violences dressé par l’association Cabiria, figure notamment la phrase suivante, attribuée à un procureur, dans une affaire d’outrage, de dégradation de voitures et de rebellions mettant en cause trois femmes prostituées nigérianes : « La police n’a donc rien de mieux à faire que de harceler ces pauvres jeunes femmes, qui de surcroît se sont retrouvées embarquées après avoir appelé le 17 ? Mais qui, dans ces conditions, ne se serait pas rebellé ? » (924)
Il est donc indispensable que, plutôt que d’être parfois écartées, ces plaintes soient au contraire considérées avec la plus grande attention, afin de permettre un accès effectif au droit pour les personnes prostituées.
Ainsi que l’estime la CNCDH, « la gravité des faits commis à l’encontre des victimes étrangères de traite ou d’exploitation et leur droit de déposer plainte de manière effective devraient, en principe, l’emporter sur la sanction de l’irrégularité de leur situation administrative. » (925) Le ministre de la Justice a d’ailleurs acté ce principe, par ailleurs confirmé par la jurisprudence (926), en 2008, indiquant que toute personne victime d’une infraction pénale, même si elle se trouve en situation irrégulière, doit pouvoir porter plainte « sans risquer de se voir inquiéter ou de faire l’objet de poursuites pénales en raison de sa situation administrative. » (927)
Pour que leurs plaintes soient prises en compte, il est nécessaire d’opérer une révolution culturelle dans la manière dont ces dernières sont parfois considérées par les forces de l’ordre. Par exemple, un responsable de la sécurité rencontré dans les Bouches-du-Rhône a souligné que la police ne connaissant la prostitution qu’à travers la répression du proxénétisme, la protection de la personne prostituée n’était pas l’essentiel dans leur optique (928). Nombreux sont encore ceux qui considèrent qu’un viol subi par une personne prostituée constitue en réalité un simple vol (929). Les associations de santé communautaire ont confirmé les difficultés importantes rencontrées par les personnes prostituées pour faire reconnaître les agressions dont elles sont victimes, qu’elles soient physiques ou sexuelles (930), et qui sont souvent considérées comme faisant partie des « risques du métier », selon l’expression de Mme Julie Sarrazin, co-directrice de l’association Grisélidis (931).
Mme Florence Garcia, directrice de l’association Cabiria, a, à juste titre, estimé nécessaire de former les forces de l’ordre à la réception des plaintes des personnes prostituées et des victimes de la traite des êtres humains (932). Cette formation devrait être délivrée à des personnels référents au sein des commissariats et des brigades de gendarmerie, qui seraient ensuite chargés de la répercuter auprès de leurs collègues.
proposition n° 5
Améliorer l’accès au droit des personnes prostituées en :
– sensibilisant les forces de l’ordre et les personnels de justice à la vision des personnes prostituées comme des victimes plutôt que comme des auteurs d’infraction, disposant de l’intégralité des droits fondamentaux et notamment du droit de porter plainte (ministères de l’Intérieur et de la Justice) ;
– formant les forces de l’ordre à la réception des plaintes des victimes de la traite (ministère de l’Intérieur) ;
– rappelant, par voie de circulaire, que la plainte d’une personne étrangère en situation irrégulière doit être enregistrée (ministère de l’Intérieur).
b) Le droit à une juste indemnisation
Le droit des victimes à une juste indemnisation repose notamment sur les engagements internationaux et communautaires de la France (933). Cela est d’autant plus important que le préjudice causé peut être considérable et que les auteurs de traite et de proxénétisme organisent fréquemment leur insolvabilité, notamment en faisant parvenir à l’étranger les produits de leurs crimes (934).
Or, cette indemnisation dans le cadre des commissions d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) se heurte à certains obstacles, notamment pour les victimes de proxénétisme (935), ce qui appelle plusieurs modifications législatives.
En premier lieu, il est nécessaire d’ouvrir plus largement le droit au séjour pour les victimes de la traite, du fait que les victimes en situation irrégulière au moment de la saisine de la CIVI ou de la décision de cette dernière, ne peuvent pas bénéficier de l’indemnisation totale du préjudice subi.
De surcroît, la différence de traitement entre les victimes de proxénétisme et celles de la traite paraît peu justifiée. Il serait donc nécessaire d’aligner le régime juridique applicable à l’indemnisation des victimes de proxénétisme sur celui des victimes de la traite, pour lesquelles la preuve d’aucune incapacité totale de travail (ITT) n’est demandée, à l’inverse des victimes de proxénétisme.
Enfin, ainsi que le suggère le FGTI, il serait indispensable, pour éviter les écarts trop importants dans l’évaluation des préjudices, de réfléchir à l’élaboration d’un barème national qui serait mis à la disposition des CIVI (936), et de disposer de statistiques plus fines sur les indemnisations allouées aux victimes de traite et de proxénétisme. L’inspection générale des services judiciaires pourrait se voir confier cette mission d’élaboration d’un référentiel national.
proposition n° 6
Améliorer l’indemnisation intégrale du préjudice subi par les victimes de la traite et du proxénétisme en :
– n’exigeant plus d’ITT pour les victimes de proxénétisme dans l’accès à la CIVI (loi) ;
– réfléchissant à l’élaboration d’un barème national pour évaluer les préjudices subis (ministère de la Justice) ;
– disposant de statistiques sur les indemnisations allouées aux victimes (ministère de la Justice).
2. La question de l’incrimination du racolage passif
L’abrogation du délit de racolage passif a été demandée par tous les acteurs associatifs rencontrés par la mission d’information, depuis les associations communautaires (937) jusqu’aux mouvements abolitionnistes (938), en passant par les travailleurs sociaux (939). La CNCDH (940) et le Conseil national du sida (941) ont formulé la même préconisation. Certaines de ces organisations recommandent même une abrogation de toute forme de pénalisation du racolage, l’ordre public pouvant être préservé sur le fondement d’autres infractions telles que l’exhibitionnisme ou le tapage nocturne (942). Ces préconisations sont fondées sur le bilan en demi-teinte du délit de racolage passif (943).
Dans la perspective qui est celle de la mission d’information, il est incontestable qu’il soit nécessaire de ne plus faire porter la sanction sur les personnes prostituées mais sur les clients de la prostitution afin de ne pas pénaliser davantage les personnes prostituées tout en pointant clairement la place du client dans le système prostitutionnel. À ce titre, nous entrons incontestablement dans une période de transition liée à plusieurs facteurs.
En premier lieu, le recours au délit de racolage est de moins en moins fréquent, les juridictions ayant tendance à très peu condamner sur ce fondement. D’ailleurs, les parquets privilégient la voie du rappel à la loi (944).
En deuxième lieu, la directive communautaire qui vient d’être adoptée en matière de lutte contre la traite, oblige, dans son article 8, les États membres à prendre « dans le respect des principes fondamentaux de leur système juridique, les mesures nécessaires pour veiller à ce que les autorités nationales compétentes aient le pouvoir de ne pas poursuivre les victimes de la traite des êtres humains et de ne pas leur infliger de sanctions pour avoir pris part à des activités criminelles auxquelles elles ont été contraintes en conséquence directe du fait d'avoir fait l'objet de l'un des actes visés à l'article 2. » (945) En conséquence, sur ce fondement, le racolage effectué par des victimes de la traite devrait ne plus pouvoir être sanctionné. Ceci constituerait incontestablement une brèche importante dans l’incrimination du racolage, dans la mesure où une grande part des personnes prostituées sont victimes de la traite des êtres humains. Il s’agit donc d’un changement d’angle d’attaque de la question qui a pour but de « de garantir aux victimes le bénéfice des droits de l'homme, de leur éviter une nouvelle victimisation et de les inciter à intervenir comme témoins dans le cadre des procédures pénales engagées contre les auteurs des infractions » (946), selon l’exposé des motifs de la directive. Or, cette directive devra être transposée par les États membres au plus tard deux ans après son adoption (947).
En dernier lieu, la mission préconise que soit mise en œuvre une pénalisation des clients de la prostitution. Or, partout où elle a été mise en œuvre, cette pénalisation a entraîné une diminution importante et souvent immédiate de la prostitution de rue (948). M. Patrick Hauvuy, directeur de l’association ALC, a ainsi indiqué que lorsque le procureur de la République de Nice avait demandé à ce qu’une action beaucoup plus forte soit menée à l’encontre des clients, l’effet avait été très dissuasif et immédiat, la clientèle et donc la prostitution de rue diminuant de manière importante (949).
En considération de ces trois réalités, il apparaît que le délit de racolage est destiné à une lente extinction, du fait, notamment, du fait des dispositions à venir de la directive européenne et de la réticence constatée des magistrats à prononcer des condamnations sur ce fondement. Cependant, afin de ne pas priver les autorités de police des moyens actuellement disponibles pour maintenir l’ordre public dans le domaine de la prostitution et de ne pas envoyer ainsi un mauvais signal aux réseaux, la mission préconise que l’efficacité et l’utilité de ce délit au regard de ses deux objectifs initiaux (maintien de l’ordre public et démantèlement des réseaux) soient évaluées un an après l’entrée en vigueur du dispositif sanctionnant pénalement les clients. En effet, au regard de l’expérience suédoise, il y a fort à parier que la prostitution de rue aura alors fortement diminué et que l’abrogation de ce délit, devenu inutile, ne rencontrera plus aucune réticence, notamment de la part des forces de l’ordre.
proposition n° 7
Évaluer, un an après l’entrée en vigueur du dispositif sanctionnant pénalement les clients, la pertinence et l’utilité du maintien du délit de racolage.
3. La question de la reconnaissance d’un statut
La volonté de voir reconnaître un statut pour les personnes prostituées a été exprimée par de nombreuses associations de santé communautaire. Ainsi, Mme Claude Boucher, présidente de l’association des Amis du bus des femmes, a demandé à ce que des droits sociaux (assurance maladie, retraite…) soient reconnus aux personnes prostituées, sur le fondement d’un statut de profession libérale (950). Le STRASS et le collectif Droits et prostitution ont été créés pour qu’un tel statut soit reconnu. Mme Malika Amaouche, coordinatrice de ce collectif, a estimé qu’un tel statut constituerait une avancée qui permettrait aux personnes prostituées de sortir de la marginalité et de l’illégalité tout en renforçant leur autonomie, ce qui faciliterait leur réinsertion (951). Sans aller jusqu’à ce point, le Conseil national du sida recommande, de manière générale, « que l’ensemble des droits soient garantis aux personnes prostituées en matière de soins, de protection sociale, de séjour et de logement. » (952)
Une telle protection sociale, sur le fondement de l’activité de prostitution, a été reconnue en Allemagne par la loi sur la prostitution du 19 octobre 2001. Or, le rapport d’évaluation du gouvernement allemand dresse un bilan pour le moins mitigé des effets de cette protection sociale destinée aux personnes prostituées, sur le fondement de leur activité : « En fin de compte, il est clair que la loi sur la prostitution a, en théorie, amélioré la situation légale [des personnes prostituées] en ce qui concerne la protection sociale. Cependant, [elle] n’a apparemment, pour l’instant, pas eu de réel impact sur les formes et l’ampleur de leur protection sociale. » (953)
Sur le fondement des grands principes juridiques français, il est apparu à la mission d’information que la prostitution ne pouvait en aucun cas être assimilée à une profession ou à un métier comme un autre (954). D’ailleurs, cette réalité apparaît très aisément quand l’on tente d’appliquer les grandes règles du droit du travail à la prostitution. Il serait par exemple inconcevable que Pôle Emploi puisse proposer à des demandeurs d’emploi de travailler dans le domaine de la prostitution. Pourtant, ses missions sont notamment de mettre en relation l’offre et la demande de travail (955). Si la prostitution devait donc être reconnue comme un travail comme un autre, il reviendrait à Pôle Emploi de proposer des formations et des emplois dans ce secteur. De même, comment appliquer la législation sur le harcèlement sexuel au travail ?
Or, la protection sociale, en France, est traditionnellement liée à l’exercice d’un travail. Cependant, celui ne signifie pas qu’en l’état actuel du droit les personnes prostituées ne puissent pas accéder à une protection sociale (956) :
– elles ont accès, en droit, aux protections universelles, que sont notamment le bénéfice de la couverture maladie universelle (CMU), voire de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUc), de l’aide médicale d’État (AME), de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (APSA), du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation adulte handicapé (AAH) et de l’allocation parent isolé (API). Si le bénéfice de nombre de ces dispositifs est conditionné à la régularité et à une certaine durée de séjour, pour les étrangers, ceci ne diffère pas du droit commun et n’est en rien spécifique aux personnes prostituées ;
– par ailleurs, nombre d’entre elles bénéficient d’une protection sociale, en tant que travailleurs indépendants, sur le fondement de la déclaration d’une fausse activité (massage, relaxation…). Aucun contrôle ne porte sur la réalité de cette activité et aucune sanction n’est encourue, l’enregistrement se faisant sur une base déclarative (957). Cette protection sociale est d’ailleurs la contrepartie de l’obligation qu’elles ont de payer des cotisations sociales.
Davantage que la reconnaissance de droits sociaux sur le fondement de la prostitution, qui impliquerait de reconnaître cette dernière comme un travail, il importe de faire en sorte que les personnes prostituées puissent avoir accès aux protections sociales dont elles sont en droit de bénéficier. Il existe en effet un manque d’information important qui empêche un grand nombre d’entre elles de connaître les prestations auxquelles elles peuvent avoir droit et d’en bénéficier effectivement. C’est ce que met en évidence, entre autres, le Conseil national du sida dans son rapport : « la plupart des personnes rencontrées par les associations ignorent pouvoir prétendre aux prestations sociales et à leur cumul. » (958) Il est donc essentiel de mieux informer les personnes prostituées des dispositifs dont elles sont susceptibles de bénéficier. Cette information pourrait prendre place dans le cadre d’un partenariat renforcé entre les associations, notamment de santé communautaire, et les services de la sécurité sociale, qui a déjà été mis en œuvre par certaines d’entre elles.
D’ailleurs, l’expérience allemande montre que la simple reconnaissance de droits sociaux aux personnes prostituées ne suffit pas à garantir l’amélioration de leur protection sociale. C’est en effet méconnaître la nature de cette activité que de penser que toutes les personnes prostituées, qui sont en général jeunes, souhaitent cotiser pour leur retraite. Mme Gabrielle Partenza a clairement souligné le fait que lorsque cette préoccupation se faisait sentir, il était souvent trop tard (959). C’est donc réellement un travail global d’information et d’orientation qui doit être fait auprès d’elles (960).
B. OFFRIR DES ALTERNATIVES CRÉDIBLES À LA PROSTITUTION PAR LA MISE EN œUVRE D’UN ACCOMPAGNEMENT INTÉGRAL
Comme on a pu le voir précédemment (961), les lacunes des politiques sociales menées dans le domaine de la prostitution constituent l’une des faiblesses majeures du modèle abolitionniste français. Si la France entend, à terme, voir disparaître la prostitution, encore faut-il qu’elle s’en donne les moyens en offrant aux personnes prostituées des alternatives crédibles.
1. Offrir des alternatives crédibles à la prostitution
Il n’est pas possible de se contenter de pénaliser les clients des personnes prostituées, dans l’espoir de voir régresser cette activité sans risquer d’en faire porter le coût sur les personnes prostituées. Un effort concomitant d’aide aux personnes prostituées est également nécessaire afin de « mettre en œuvre une véritable politique alternative à la prostitution » (962), selon les mots de M. Grégoire Théry, secrétaire général du Mouvement du Nid.
En effet, parmi les principales réserves exprimées par les associations de santé communautaire à la pénalisation des clients, figurait la peur d’une perte importante de revenus, qui les mettrait en situation de précarité et de vulnérabilité accrues. « Comment peut-on rendre du jour au lendemain un métier illégal et que vont faire les personnes qui l’exercent ? » (963), s’est par exemple interrogée Maîtresse Gilda, porte-parole du STRASS. Mme Julie Sarazin, co-directrice de l’association de santé communautaire Grisélidis, a également considéré que pénaliser le client reviendrait à priver les personnes prostituées de leur « gagne-pain », alors que peu de solutions s’offrent à elles (964).
Il semble que ce volet social ait fait défaut en Suède lors de l’adoption, en 1998, de la législation pénalisant les clients. Mme Kjerstin Bergman, fonctionnaire à l’Agence nationale pour les affaires sociales, a indiqué à la mission qu’il était nécessaire de renforcer le volet social qui doit être aussi important que la pénalisation des clients, par exemple en donnant davantage de moyens aux municipalités dans ce domaine, qui n’ont jusqu’à présent reçu aucun financement spécifique (965). En conséquence, la première préconisation du rapport d’évaluation de la loi de 1998 est de renforcer l’accompagnement social, qui doit devenir « la première priorité des pouvoirs publics » (966), aux yeux de Mme Anna Skarhed, Chancelière de Justice et auteure de cette évaluation.
Il est enfin l’heure de traduire dans les effets les ambitions sans cesse réaffirmées de la France en matière de politiques sociales, mais qui sont restées pratiquement lettre morte jusqu’à présent. La fermeture progressive des services de prévention et de réinsertion sociale (SPRS) en est l’illustration la plus flagrante (967). Le but de ces politiques sociales ne doit pas être de stigmatiser les personnes prostituées en dénigrant leur activité ou de décider pour elles, comme si elles étaient des mineurs, mais de les mettre en situation de réel choix.
M. Lilian Mathieu a notamment évoqué la notion d’« alternatives crédibles » (968) pour décrire l’ensemble des protections à mettre en œuvre afin de faciliter la sortie de la prostitution. Ces alternatives doivent prendre en compte la spécificité du parcours des personnes prostituées, qui peuvent avoir « plusieurs années de vide dans leur CV » (969) et dont la réinsertion peut entraîner une baisse considérable de leurs revenus. « Il convient de tenir compte du fait que la prostitution est une activité lucrative génératrice de profits. Dès lors, il est impossible d’envisager un arrêt net de cette activité en contrepartie des seules aides sociales » (970), a notamment souligné Mme Malika Amaouche, coordinatrice du collectif Droits et prostitution.
2. Mettre à la disposition des personnes prostituées les cinq grands éléments nécessaires à la sortie de la prostitution
Cinq grands obstacles au changement d’activité des personnes prostituées ont été mis en évidence au cours des travaux de la mission, qui portent sur cinq grands besoins des personnes prostituées : un titre de séjour, des revenus, un logement, une formation, et un accompagnement.
À titre liminaire, il faut souligner que la directive sur la traite, dans son article 11 (971), dresse le cadre minimal de la protection des victimes de la traite qui doit être mis en œuvre par l’ensemble des États membres :
– la protection s’inscrit dans la durée puisque les États membres doivent apporter « une assistance et une aide » aux victimes de la traite « avant, pendant et – durant une période suffisante après la clôture de la procédure pénale » ;
– elle concerne l’ensemble des victimes de la traite puisqu’elle vise les personnes dont on a des « motifs raisonnables de penser » qu’elles ont été victimes de traite ;
– elle ne peut pas être conditionnée au comportement de la victime, dans la mesure où la directive interdit que « l’octroi d’une assistance et d’une aide à une victime [soit] subordonné à sa volonté de coopérer » dans le cadre d’une procédure pénale.
Cette assistance et cette aide « assurent au moins un niveau de vie leur permettant de subvenir à leurs besoins en leur fournissant notamment un hébergement adapté et sûr, une assistance matérielle, les soins médicaux nécessaires, y compris une assistance psychologique, des conseils et des informations, ainsi que des services de traduction et d’interprétation, le cas échéant. » La directive fournit donc un cadre minimal aux mesures d’assistance que les États doivent mettre en œuvre pour les victimes de la traite ainsi que pour les personnes pour lesquelles des motifs raisonnables laissent penser qu’elles le sont. Les besoins des personnes prostituées qui souhaitent sortir de la prostitution sont pour partie similaires, même si elles n’ont pas été victimes de la traite.
a) La délivrance d’un titre de séjour
Toutes les personnes prostituées ne sont pas étrangères et toutes les personnes prostituées étrangères ne sont pas en situation irrégulière (972). Cependant, la majorité des personnes prostituées est étrangère et la plupart d’entre elles disposent, au mieux, d’un titre de séjour de courte durée et donc précaire, la majorité ayant un visa expiré ou ne disposant d’aucun titre de séjour (973). Or, la détention d’un titre de séjour de durée suffisamment longue et permettant l’exercice d’une activité professionnelle est une condition indispensable à l’engagement d’une formation professionnelle ou d’un apprentissage linguistique. Ainsi, pour M. Patrick Lescure, directeur régional de Pôle Emploi dans la région Rhône-Alpes, le principal problème réside dans le défaut de délivrance d’un titre de séjour pérenne, une insertion professionnelle ne pouvant pas être effectuée en trois mois (974).
L’accès à un titre de séjour est donc nécessaire tant pour permettre une insertion professionnelle des personnes prostituées que pour rendre possible une émancipation des victimes de la traite. Or, il apparaît que les dispositifs existants fonctionnent de manière lacunaire (975). Il existe actuellement deux possibilités, pour les personnes prostituées en situation irrégulière, de se voir délivrer un titre de séjour :
– sur le fondement de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui rend possible la délivrance d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » à l’étranger qui a déposé plainte pour traite des êtres humains ou proxénétisme ou témoigne dans une procédure pénale portant sur ces mêmes chefs d’accusation. En cas de condamnation définitive des proxénètes, une carte de résident peut lui être délivrée ;
– sur le fondement de l’article L. 313-14 du même code, à la discrétion du préfet, pour motifs humanitaires.
Cependant, ces deux dispositifs ne permettent pas une bonne prise en compte de la situation de victime de la traite ou d’exploitation sexuelle. En effet, les conditions de la délivrance de la carte de séjour (article L. 316-1) sont trop strictes pour couvrir tous les cas, puisque nombre de victimes ont peur de porter plainte ou de témoigner et laissent, de surcroît, un pouvoir d’appréciation discrétionnaire au préfet. Pour ce qui est du second fondement, malgré la circulaire adressée aux préfectures les invitant à tenir compte de la situation de victime de traite ou d’exploitation (976), les pratiques semblent disparates et le nombre de délivrances peu important.
Pourtant, l’article 10.2 de la Convention de Varsovie prévoit que « chaque Partie s’assure que, si les autorités compétentes estiment qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a été victime de la traite des êtres humains, elle ne soit pas éloignée de son territoire jusqu’à la fin du processus d’identification en tant que victime de [la traite] » (977). Or, le paragraphe 134 du rapport explicatif précise que « le processus d’identification prévu à l’article 10 est indépendant de la procédure pénale éventuelle à l’encontre des auteurs de la traite. » La protection qui est due aux victimes de la traite sur ce fondement est donc distincte de celle qui résulte de la collaboration avec les services de police et se traduit notamment par l’instauration d’un délai de trente jours au minimum afin que la victime puisse prendre la décision de collaborer (978). Cependant, ce délai de rétablissement et de réflexion peut s’avérer trop court au regard de la situation psychologique de la victime. Il serait donc souhaitable, comme le préconise la mesure n° 12 du plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains 2011-2013, de porter ce délai à trois mois (979).
Il faudrait également prévoir que la carte de séjour délivrée en application du premier alinéa de l’article L. 316-1 du CESEDA soit renouvelée de plein droit et sans interruption tant que la procédure judiciaire n’est pas terminée. En effet, Mme Violaine Husson, membre de la Cimade, a indiqué que les nécessités de l’enquête priment souvent sur les droits des victimes. Ainsi le renouvellement peut ne plus être accordé si l’enquête n’avance pas ou si les principaux responsables du réseau sont démasqués (980).
De plus, il ne semble pas adéquat de conserver au préfet un pouvoir discrétionnaire quant à l’attribution d’une carte de résident à une personne qui aura été définitivement reconnue comme une victime de la traite ou d’exploitation. En effet, une décision juridictionnelle sera alors intervenue attestant de la matérialité des faits subis. Dès lors, il est nécessaire de prévoir que cette carte puisse être obtenue de droit par la victime. Il paraît également peu souhaitable d’attendre une « condamnation définitive » ainsi que le prévoit l’article L. 316-1 du CESEDA, dans la mesure où la durée des procédures pénales est susceptible d’être extrêmement longue. Une simple condamnation devrait donc suffire, ainsi que le préconise la mesure n° 17 du plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains 2011-2013.
Par ailleurs, afin d’assurer une protection adéquate des victimes d’exploitation sexuelle qui ne souhaitent pas déposer plainte ou témoigner par peur de représailles, et de leur permettre d’échapper à leur exploiteur, il serait souhaitable d’institutionnaliser la procédure visant à leur accorder un titre de séjour au vu d’indices concordants laissant raisonnablement penser qu’elles sont victimes de traite ou d’exploitation. M. Michael Carlin, chef du secteur « cybercriminalité et traites des êtres humains » à la direction générale des affaires intérieures de la Commission européenne, a d’ailleurs indiqué à la mission d’information que la nouvelle directive établissait « le principe d’une protection inconditionnelle des victimes, même en l’absence de coopération de leur part » (981), pendant une certaine période de temps. Les dossiers concernés pourraient être transmis à la sous-commission départementale qui serait créée en matière de traite des êtres humains et de prostitution et qui serait composée à la fois de représentants des services de l’État, des collectivités territoriales et d’acteurs associatifs (982) et qui rendrait un avis au préfet. Cette nouvelle procédure, qui pourrait s’inscrire à l’article L. 316-1 du CESEDA, aurait vocation à stabiliser la situation juridique des victimes de la traite, ce qui leur permettrait éventuellement, dans un second temps, de porter plainte, ainsi que l’a évoqué Mme Violaine Husson (983). Cette délivrance, qui conditionne l’accès à une assistance et à une aide plus globales (984), pourrait par exemple se matérialiser, comme en Belgique, par la signature d’un contrat avec la victime d’exploitation sexuelle.
D’autre part, il faut noter que pour solliciter un titre de séjour, les victimes de la traite doivent disposer d’une adresse personnelle (985). Tel n’est cependant pas le cas pour les demandeurs d’asile qui peuvent se domicilier auprès d’une association agréée (986). Il serait souhaitable d’autoriser également les demandeurs de titre de séjour sur le fondement de la traite et de l’exploitation à choisir une domiciliation auprès d’une association agréée, voire de leur avocat, comme le préconise le plan d’action national contre la traite 2011-2013 (987).
Enfin, il serait nécessaire de rappeler, par voie de circulaire, un certain nombre de bonnes pratiques liées à la délivrance de la carte de séjour sur le fondement de l’article L. 316-1 du CESEDA :
– le titre de séjour qui doit être délivré sur ce fondement est une carte de séjour temporaire, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle et permettant donc une insertion professionnelle, et non pas une simple autorisation provisoire de séjour. Pourtant, cette substitution semble être fréquente, selon le rapport de la CNCDH (988). En revanche, un récépissé doit être délivré en attendant l’octroi d’une carte de séjour ;
– les démarches, au sein des préfectures, doivent se faire dans un espace particulier, qui permette de garantir l’intimité de la victime de traite ou d’exploitation.
proposition n° 8
Permettre la protection effective des victimes étrangères de traite et d’exploitation sexuelle en améliorant les conditions dans lesquelles elles peuvent avoir accès à un titre de séjour :
– porter d’un à trois mois le délai de réflexion et de rétablissement (décret) ;
– prévoir une délivrance de plein droit d’une carte de résident en cas de condamnation de l’auteur de traite ou d’exploitation sexuelle (loi) ;
– créer une procédure subsidiaire d’obtention d’une carte de séjour s’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne est une victime, avec avis d’une commission départementale (loi) ;
– renouveler automatiquement le titre de séjour obtenu sur le fondement de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tant que des poursuites pénales sont en cours (loi) ;
– permettre aux victimes de la traite, de se domicilier auprès d’une association ou de leur avocat pour leurs démarches administratives (loi) ;
– rappeler par voie de circulaire l’ensemble des bonnes pratiques à mettre en œuvre (circulaire du ministère chargé de l’Immigration).
Dans le domaine de l’asile, des améliorations pourraient également être apportées au dispositif existant. En effet, ainsi que l’a souligné Mme Odile Schwertz-Favrat, représentant l’association Fasti, ni l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ni la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) n’estiment que les cas de traite ouvrent droit au statut de réfugié (989). Pourtant, le Haut commissariat aux réfugiés a indiqué que « les anciennes victimes de la traite peuvent être considérées comme constituant un groupe social du fait de la caractéristique immuable, commune et historique consistant à avoir fait l’objet d’une traite. » (990) Une reconnaissance du statut de réfugié sur ce fondement pourrait donc être envisagée. Cependant, ce n’est pas seulement ce statut qui est refusé aux victimes de la traite, mais parfois aussi, la protection subsidiaire, alors que les conditions pour pouvoir en bénéficier sont remplies (991). Il est donc nécessaire de former les agents de l’OFPRA et de la CNDA à cette problématique.
Par ailleurs, il existe plusieurs difficultés particulières aux victimes de la traite :
– en premier lieu, elles sont généralement contraintes par leur réseau à déposer une première demande d’asile sous une fausse identité, afin de bénéficier provisoirement d’un séjour régulier, le temps que leur demande soit examinée. Une fois sortie de l’emprise du réseau, elles souhaitent parfois déposer une deuxième demande. Mais dans ce cadre, elles bénéficient de garanties bien moins importantes (procédure prioritaire, pas d’effet suspensif du recours…). La spécificité de leur situation n’est donc pas prise en compte ;
– en deuxième lieu, le fait qu’elles aient été condamnées, notamment pour racolage, est parfois considéré, sur le fondement de l’article L. 712-2, d) du CESEDA, comme un motif de refus de la protection subsidiaire ;
– en troisième lieu, dans certaines préfectures, la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 316-1 du CESEDA est conçu comme faisant obstacle à une demande au titre de l’asile.
Là encore, les agents de l’OFPRA et de la CNDA devraient mieux être formés aux spécificités des victimes de la traite.
Enfin, en application du règlement Dublin II, ces victimes peuvent être remises à un autre État membre de l’Union européenne. Ceci peut cependant les exposer à des représailles dans ce nouvel État, les victimes perdant de surcroît tout lien avec les associations qui les assistent en France. Il faudrait que, pour les victimes de traite, la clause humanitaire de ce règlement, qui fait obstacle à la remise, soit activée.
proposition n° 9
Afin d’améliorer la situation des victimes de la traite au regard du droit d’asile :
– former les agents de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour national du droit d’asile aux spécificités de la situation des victimes de la traite (ministère chargé de l’Immigration) ;
– examiner les demandes formées par ces dernières, comme le permet le règlement Dublin II (ministère chargé de l’Immigration).
Le deuxième élément nécessaire à la sortie de la prostitution est l’existence de revenus de substitution. Cet enjeu prend un tour particulier, dans le cadre de la prostitution, puisque cette activité est elle-même génératrice de gains parfois importants et que son arrêt entraîne souvent une diminution drastique des revenus de la personne prostituée.
En premier lieu, se pose la problématique fiscale, dans la mesure où, l’impôt sur le revenu étant payé avec une année de décalage, la fiscalisation des personnes prostituées peut constituer un obstacle important à la cessation de leur activité. Il a d’ailleurs été fait état, devant la mission d’information, du fait que certaines d’entre elles devaient reprendre leur activité alors qu’elles avaient entamé une formation, en raison de la pression fiscale s’exerçant sur elles (992). Le rapport de la délégation aux droits des femmes du Sénat, préconisait, en 2001, d’ouvrir un débat sur cette problématique pour savoir s’il était opportun de maintenir ce réalisme fiscal qui peut aboutir à un enfermement dans la prostitution ou s’il convenait d’exclure la prostitution du champ fiscal, avec le risque de rendre cette activité plus attractive (993).
Si le principe du réalisme fiscal doit être maintenu, pour ne pas mettre à mal le principe de l’égalité devant l’impôt, des modalités concrètes doivent être envisagées pour les personnes qui souhaitent débuter une insertion professionnelle et qui ne peuvent donc plus verser les sommes qui leur sont demandées par les services fiscaux sans reprendre la prostitution. À ce titre, des remises gracieuses peuvent actuellement leur être accordées à la triple condition qu’elles aient abandonné la prostitution, qu'elles aient retrouvé une activité professionnelle et qu’elles n’aient pas conservé le produit de la prostitution (994).
Cependant, selon les associations, ces remises sont parfois difficiles à obtenir, contraignant les personnes prostituées à poursuivre leur activité. Il serait donc utile d’institutionnaliser un dialogue renforcé entre les services fiscaux et les autres acteurs publics et associatifs pour apprécier la réalité des efforts et de la détermination de la personne prostituée. La sous-commission départementale ad hoc devrait constituer un tel lieu de dialogue (995).
Par ailleurs, l’insertion professionnelle des personnes prostituées pouvant nécessiter du temps (accomplissement d’une formation, apprentissage du français…), il serait également nécessaire que les services fiscaux accordent ces remises, ou au moins suspendent la réclamation de l’impôt, lorsqu’elles entament une formation, dès lors qu’elles ont abandonné la prostitution. Ne devrait donc subsister que deux conditions pour l’octroi des remises gracieuses : l’engagement d’une formation ou l’obtention d’un emploi et l’arrêt de la prostitution.
proposition n° 10
Prendre en compte l’engagement d’une formation professionnelle pour accorder les remises fiscales gracieuses, sous réserve de l’arrêt de la prostitution, et mieux coordonner les décisions de remise avec les autres acteurs publics et les acteurs associatifs (ministère du Budget).
En second lieu, il est nécessaire que les personnes prostituées puissent bénéficier d’un revenu de transition, leur permettant de faire la jonction entre la prostitution et leur nouvelle activité.
Les engagements internationaux de la France prévoient qu’une « assistance matérielle » soit apportée aux victimes de la traite dès lors que des « motifs raisonnables » laissent penser qu’elles en sont effectivement victimes (996). Selon leur nationalité ainsi que la régularité et la durée de leur séjour, les personnes prostituées peuvent avoir accès soit au revenu de solidarité active (RSA), soit à l’allocation temporaire d’attente (ATA) (997). Néanmoins, deux catégories de personnes prostituées peuvent ne pas bénéficier d’un revenu de transition :
– celles qui n’ont pas été victimes de la traite et qui ont moins de 25 ans. En effet, le RSA n’est accessible qu’à partir de 25 ans sauf conditions strictes qui ne sont pas remplies par les personnes prostituées (avoir travaillé deux ans pendant les trois dernières années). Ainsi, les jeunes majeurs en errance ne peuvent avoir accès à aucune source de revenus ;
– les personnes dont on peut raisonnablement penser qu’elles sont victimes de la traite ou d’exploitation mais qui ne souhaitent pas porter plainte. En règle générale, ces personnes ne peuvent pas bénéficier de l’ATA ou du RSA, sauf si elles sont demandeuses d’asile. Pourtant, une aide matérielle doit leur être accordée sur le fondement de la nouvelle directive.
Par ailleurs, les personnes qui ont pris le risque de collaborer avec les forces de l’ordre ne peuvent avoir accès qu’à l’ATA et non au RSA.
Pour ce qui est des victimes de la traite, il serait nécessaire d’élever d’un cran le niveau de garantie dont elles peuvent bénéficier afin de répondre aux engagements internationaux de la France et de les placer dans des conditions permettant leur rétablissement. Ainsi, il serait souhaitable :
– de faire bénéficier du RSA les personnes qui collaborent avec les forces de l’ordre et qui obtiennent sur ce fondement une carte de séjour, ainsi que le recommande la CNCDH (998). Il faudrait, pour ce faire, les ajouter aux dérogations prévues à l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles qui regroupe les catégories d’étrangers n’ayant pas besoin de disposer d’un titre de séjour les autorisant à travailler depuis cinq ans. Cette extension est d’autant plus intéressante que le RSA prévoit également des aides à l’insertion ;
– d’accorder le bénéfice de l’ATA aux personnes pour lesquelles il existe des « motifs raisonnables » de penser qu’elles pourraient avoir été victimes de traite ou d’exploitation sexuelle mais qui ne souhaitent pas (encore) collaborer dans le cadre d’une procédure pénale. Ce bénéfice serait lié à la nouvelle procédure de délivrance d’une carte de séjour.
Reste cependant le cas des jeunes majeurs qui ne sont pas victimes de traite ou d’exploitation et qui ne disposent d’aucun revenu. Dans leur cas, la sortie de la prostitution signifie par conséquent une absence totale de revenus en attendant une éventuelle insertion professionnelle. Dans la mesure où les jeunes de moins de 25 ans ne peuvent bénéficier d’aucune allocation, il semble difficile de déroger à cette règle pour les personnes prostituées de moins de 25 ans sans créer de facto une situation d’inégalité voire une incitation à la prostitution. Dès lors, il semble nécessaire de renforcer, dans ce type de cas, une approche intégrée (accès gratuit à une formation, à un logement…) complétée par un appui financier des associations spécialisées, plutôt que de leur ouvrir le droit au RSA.
proposition n° 11
Garantir un meilleur revenu de substitution pour les victimes de la traite et d’exploitation en :
– donnant accès au RSA aux victimes qui obtiennent un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (loi) ;
– donnant accès à l’allocation temporaire d’attente aux personnes dont on peut raisonnablement penser qu’elles sont victimes de la traite ou d’exploitation, le versement de cette allocation devant être prévu jusqu’à ce que la réinsertion soit effective (loi).
Le troisième élément indispensable à la sortie de la prostitution est l’accès à un logement. Les personnes prostituées peuvent se trouver dans plusieurs situations à cet égard, qui rendent en général compliqué l’arrêt de la prostitution :
– absence de logement. C’est le cas, par exemple, pour les jeunes en errance ;
– logement à l’hôtel ou dans un appartement loué ;
– logement par le proxénète, notamment pour les victimes de la traite. Ces dernières peuvent être logées dans des appartements collectifs. En tout état de cause, la sortie de la prostitution implique fréquemment un départ du logement ;
– propriété d’un logement. C’est la situation la plus confortable bien que le changement d’activité puisse compromettre le remboursement d’un éventuel crédit immobilier.
De surcroît, les personnes prostituées ne peuvent parfois pas avoir accès à un logement dans la mesure où elles ne disposent pas de revenus déclarés. « Les difficultés rencontrées pour trouver à être hébergées sont telles qu’aucune solution n’est parfois trouvée », constate la CNCDH (999).
Pour faire face à ces difficultés, les associations spécialisées disposent de moyens d’hébergement et de logement (1000). Cependant, ceux-ci ne sont pas toujours en nombre suffisant ou adaptés à la nature de la demande. Deux types de public rencontrent en effet des difficultés particulières.
Il s’agit, en premier lieu, des jeunes et notamment des mineurs. À l’heure actuelle, il n’existe pas d’établissements spécifiquement dédiés à l’accueil des mineurs en situation de prostitution. Or, ainsi que l’ont souligné de nombreux interlocuteurs de la mission d’information, les structures traditionnelles de l’aide sociale à l’enfance sont mal adaptées à leur prise en charge, ce qui induit un taux élevé de fugues. « Lorsqu’une ordonnance de placement provisoire est prise, les jeunes sont placés dans l’unique foyer de Paris qui accueille les jeunes en urgence, rue de la Croix-Nivert, en attendant que le juge des enfants ne se prononce, au bout de huit jours. Ce lieu est très connu même des réseaux qui parviennent à dissuader les jeunes de se rendre à la convocation du juge des enfants. Beaucoup fuguent ainsi avant d’avoir pu bénéficier d’un véritable suivi. » (1001), a observé M. Alexandre Lecleve, directeur de l’association Hors la rue, soulignant que le dispositif de protection présentait une « énorme carence ». Le même constat a été fait par Mme Isabelle Oudot, vice-présidente chargée des fonctions de juge des enfants au tribunal de grande instance de Lyon : « Face à ces situations, il existe peu d’outils adaptés. L’ultime solution consiste à financer des chambres d’hôtel où ces mineurs pourront être en sécurité, en échange de l’engagement de ne pas y pratiquer la prostitution. » (1002)
Dès lors, afin d’éviter leur « chronicisation dans la prostitution » (1003), il est indispensable de consacrer des moyens importants à ces jeunes dont la santé peut être considérablement dégradée par l’exercice de la prostitution. Une double action offrirait une meilleure prise en charge de leur situation (1004) :
– créer, dans les plus grands centres urbains, des structures spécifiquement dédiées à la prise en charge des mineurs et des jeunes adultes en situation de prostitution. L’Amicale du Nid projette de créer un centre de ce type à Paris, initiative qui doit être encouragée et dupliquée ;
– mettre en réseau certaines structures susceptibles d’accueillir ce type de mineurs afin, le cas échéant, de permettre un accueil sécurisant dans une autre ville (notamment dans les cas de traite), et de développer une expertise en la matière qui passerait par la formation des personnels de ces structures. En effet, le réseau Ac.Sé n’est ouvert qu’aux majeurs. Pourraient participer à ce réseau des établissements de l’Amicale du Nid, qui vient de modifier ses statuts afin de pouvoir accompagner des mineurs, ainsi que des foyers destinés aux mineurs de l’aide sociale à l’enfance.
proposition n° 12
Améliorer la prise en charge des mineurs et des jeunes adultes en situation de prostitution en :
– créant, dans les plus grands centres urbains, des structures spécifiquement dédiées à leur prise en charge (ministère de la Cohésion sociale) ;
– mettant en réseau certaines structures susceptibles d’accueillir ce type de personnes (ministère de la Cohésion sociale).
En second lieu, il faut porter une attention particulière aux victimes de traite et d’exploitation sexuelle, qui représentent une part croissante de la prostitution. Le dispositif Ac.Sé a été mis en œuvre afin de prendre en compte leur spécificité, en leur fournissant un accueil sécurisant dans une ville autre que celle dans laquelle elles ont été exploitées (1005). Ces initiatives doivent être encouragées mais elles ne sont pas suffisantes. En effet, l’accueil en foyer d’hébergement ou à l’hôtel ne convient pas forcément, notamment sur la durée, à toutes les victimes de la traite, pas plus qu’à l’ensemble des personnes prostituées. L’accès à d’autres formes d’hébergement et de logement doit être envisagé (1006).
L’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation fixe la liste des publics prioritaires pour l’accès au logement social et mentionne notamment les « personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence ». Cet alinéa doit être interprété comme conférant aux personnes prostituées et aux victimes de la traite le caractère de public prioritaire dans l’accès au logement social (1007). Il faudra donc veiller à ce que ce public soit pris en considération dans le cadre de la programmation pluriannuelle et territorialisée de l’offre en matière d’hébergement et de logement mise en place à la suite de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion. Une circulaire devrait être adressée en ce sens.
D’autre part, les associations devraient se voir allouer les fonds nécessaires au développement d’un parc de logements privés qui contribuerait à la protection des victimes de la traite et à leur hébergement temporaire. L’association APRAMP, qui accompagne les victimes de la traite en Espagne, dispose ainsi, à Madrid, d’appartements qui peuvent abriter plusieurs victimes simultanément (1008).
proposition n° 13
Améliorer le dispositif d’hébergement et de logement des personnes prostituées et des victimes de la traite en :
– indiquant par voie de circulaire que ces personnes font partie des publics prioritaires pour l’accession au logement social (ministère chargé du Logement) ;
– finançant l’achat d’appartements par les associations spécialisées (ministère de la Cohésion sociale et Collectivités territoriales).
d) La possibilité d’une formation professionnelle et de l’apprentissage du français
Les personnes prostituées qui souhaitent changer d’activité doivent pouvoir bénéficier d’une formation professionnelle, le cas échéant accompagnée d’un apprentissage du français.
Pour ce qui est des victimes de la traite, l’article 12.4 de la Convention de Varsovie prévoit que « chaque Partie adopte les règles par lesquelles les victimes résidant légalement sur son territoire sont autorisées à accéder au marché du travail, à la formation professionnelle et à l’enseignement. » (1009) Cet article vise notamment les personnes qui se sont vues délivrer un titre de séjour sur le fondement de la traite (1010).
La première condition pour accéder au marché du travail est de maîtriser le français et les grandes lignes de l’environnement institutionnel français. Les associations ont un rôle essentiel à jouer à ce double titre, dans la mesure où nombre d’entre elles proposent des cours de français et conseillent les victimes qui souhaitent entreprendre une formation professionnelle. Pôle Emploi peut également financer des cours d’apprentissage du français (1011).
Dans le domaine de l’insertion professionnelle des personnes prostituées et des victimes de la traite, seules des initiatives locales semblent exister (1012). À Lyon, un dispositif spécifique a été mis en œuvre, une agence de Pôle Emploi recevant toutes les personnes prostituées qui désirent engager une formation professionnelle. Il est apparu qu’un partenariat avec les associations spécialisées (Cabiria, Amicale du Nid et Mouvement du Nid) était indispensable pour que sa mise en œuvre réponde réellement aux besoins de ces personnes (1013) et que l’accompagnement ne pouvait pas être celui du droit commun.
Sur le fondement de cette expérience, il ressort deux difficultés principales pour ce qui est de l’accès à la formation des personnes prostituées et notamment des victimes de la traite :
– elles ne disposent souvent d’aucun revenu ;
– elles ne bénéficient que de titres de séjour très temporaires, notamment des autorisations provisoires de séjour de trois mois. Ceci se révèle extrêmement problématique dans la mesure où une formation et une insertion professionnelle ne peuvent être envisagées que sur la durée. Ainsi, d’après le conseiller responsable de l’action, « une personne a dû quitter sa formation en français langue étrangère car ses papiers étaient périmés et il a eu un moment d’interruption avant que la préfecture ne lui en délivre d’autres ; cette personne étant sans ressources a dû retourner dans la prostitution. » (1014)
Ces remarques rendent d’autant plus essentielle la mise en œuvre de propositions portant sur les titres de séjour et les revenus de substitution. Elles montrent également que la spécialisation, dans chaque grande aire urbaine, de conseillers de Pôle Emploi dans l’insertion professionnelle des personnes prostituées et le travail en collaboration avec les associations sont indispensables (1015).
e) L’accompagnement et la reconstruction, notamment psychologiques
Enfin, les personnes prostituées, et notamment celles qui ont été victimes d’exploitation, doivent bénéficier, si elles le désirent, d’un accompagnement, notamment psychologique.
En effet, la violence subie dans le monde de la prostitution est souvent telle qu’elle a des répercussions sur la santé et sur le psychisme des personnes prostituées (1016). Les cinq personnes anciennement prostituées rencontrées lors du déplacement à l’Amicale du Nid bénéficient toutes d’un suivi psychologique ou psychiatrique dont elles affirment la nécessité (1017).
Dès lors, de nombreuses associations ont mis en œuvre des actions originales visant à accompagner psychologiquement les personnes prostituées. Des ateliers danse et musique existent par exemple à l’Amicale du Nid de Paris (1018). D’autres associations proposent des rencontres avec une socio-esthéticienne (1019).
Au-delà, des soins psychologiques (1020) devraient être garantis aux personnes prostituées qui le désirent. Mme Judith Trinquart a souligné que, en théorie, des thérapies adaptées pouvaient être menées, mais que, dans la pratique, ces dernières sont quasiment inexistantes en France car très couteuses (1021). Par ailleurs, les délais d’attente pour une prise en charge psychologique sont trop longs (1022). Il serait donc nécessaire d’accroître l’offre de soins en la matière.
proposition n° 14
Accroître l’offre de soins psychologiques et psychiatriques au bénéfice des personnes prostituées qui souhaitent en bénéficier dans le cadre d’un processus de reconstruction (ministère de la Santé).
3. Accroître les budgets consacrés à l’insertion des personnes prostituées
En complément de la politique de pénalisation des clients, l’accent doit donc être mis sur les politiques sociales destinées aux personnes qui souhaitent quitter la prostitution.
L’expérience suédoise montre que la pénalisation des clients ne remplace en rien l’accompagnement des personnes qui désirent sortir de la prostitution. En effet, de l’avis des autorités suédoises, la lacune de la politique ainsi engagée réside dans l’absence d’effort financier substantiel mis en œuvre pour accompagner cette pénalisation (1023). La pénalisation des clients ne peut pas être une politique menée de façon isolée, elle doit être accompagnée d’un volet social.
Cependant, la tendance actuelle est plutôt celle de la diminution des financements dont bénéficient les associations spécialisées et du désengagement de l’État des politiques sociales à destination des personnes prostituées (1024). À n’en pas douter, ainsi que nous le verrons, une meilleure coordination, notamment entre les acteurs publics et avec les associations, permettrait de réaliser de forts gains d’échelle. Ils ne peuvent pourtant pas, à eux seuls, compenser la baisse des crédits publics, qui met en danger la survie de certaines associations et accompagner la pénalisation des clients.
À ce titre, il faut noter que l’accompagnement des personnes prostituées qui souhaitent changer d’activité est un travail de longue haleine, qui nécessite par conséquent un financement sur la durée. Il est regrettable que les subventions publiques soient souvent accordées de manière épisodique, d’autant plus que cette pratique pousse les associations à consacrer une part importante de leurs moyens humains à la recherche de financements.
Il est également indispensable que l’État prenne en charge lui-même l’accompagnement des personnes prostituées qui désirent changer d’activité dans les territoires où il n’existe pas d’association compétente.
proposition n° 15
Accompagner la pénalisation des clients de l’accroissement des moyens destinés à offrir des alternatives à la prostitution aux personnes qui exercent cette activité, dont la pérennité serait assurée par la conclusion de conventions pluriannuelles avec les associations spécialisées (ministères de la Cohésion sociale et de la Santé).
III. – SYSTÉMATISER LA LUTTE CONTRE LA TRAITE ET LE PROXÉNÉTISME
S’il est un domaine dans lequel chacun s’accorde à agir, c’est bien celui de la lutte contre la traite et le proxénétisme, notamment en mobilisant mieux les outils juridiques existant dans ces domaines. Cependant, là encore, des divergences se font jour sur ce que recouvrent ces notions. Les expressions de « proxénétisme de soutien » et d’« assistance sexuelle », par la polémique qu’elles déclenchent, en témoignent.
A. MIEUX UTILISER LES OUTILS EXISTANTS DANS LE DOMAINE DE LA LUTTE CONTRE LA TRAITE ET LE PROXÉNÉTISME
De l’avis général, le dispositif répressif en matière de proxénétisme et de traite des êtres humains est très complet (1025). Pourtant son usage semble être perfectible.
1. Une priorité : poursuivre davantage sur le fondement de la traite
Comme indiqué précédemment, la qualification de traite des êtres humains n’est pas sans conséquence sur les droits qui sont reconnus à ses victimes. Elle permet également de mieux utiliser les outils de coopération européens en vue du démantèlement des réseaux. Pourtant, les juridictions semblent réticentes à l’utiliser, parce qu’elles sont plus familières des infractions de proxénétisme dont elles ont une meilleure connaissance et pour lesquelles la jurisprudence est bien établie, ou parce qu’elles éprouvent une difficulté plus grande à réunir l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction (1026).
a) La politique pénale de la Chancellerie
La direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice a pourtant pris l’initiative, à plusieurs reprises, de rappeler les outils juridiques existant en matière de lutte contre la traite et le proxénétisme. Ainsi, une circulaire du 18 décembre 2001 dresse un panorama des procédures et des bonnes pratiques dans ce domaine (1027). Elle indique qu’il est nécessaire d’associer les victimes à la lutte contre le proxénétisme et de travailler en collaboration avec le secteur associatif, notamment par le biais de conventions de partenariat. Cette circulaire engageait aussi ses services à lutter contre la prostitution des mineurs, au moyen des infractions d’agression sexuelle et de violences sur mineur, à recourir aux témoignages anonymes, à la vidéoconférence, aux techniques d’enquête spéciales et à la confiscation des avoirs. En deuxième lieu, la circulaire d’accompagnement de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure explicite l’infraction de traite des êtres humains, nouvellement introduite, et celle de racolage, qui devait être utilisée pour permettre aux personnes prostituées de dénoncer leur exploitant (1028). Enfin, une circulaire conjointe du 9 mars 2005 (1029) revient sur la nécessité de lutter contre les réseaux de prostitution et le proxénétisme, prévoyant la création de cellules spécialisées dans les sûretés départementales et explicitant les dispositifs de la loi du 9 mars 2004 portant sur l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité dite « loi Perben II ».
Le ministère de la Justice semble également avoir fait de la lutte contre la traite l’une des priorités de sa politique pénale. La circulaire de politique pénale générale du 1er novembre 2009 rappelle que le nombre de poursuites sur ce fondement demeure très faible et que cette qualification n’est pas exclusive d’autres qualifications, telle que celle de proxénétisme (1030). Plus récemment, Mme Maryvonne Caillibotte, directrice des affaires criminelles et des grâces, a rappelé que l’instruction de politique pénale pour 2010 demandait à ce que soit portée une attention particulière à l’ouverture d’informations sur la traite des êtres humains (1031).
Cette politique pénale a entraîné une augmentation progressive du nombre de procédures ouvertes pour traite. Cependant, il serait nécessaire de mieux faire connaître ces infractions, notamment auprès des élèves de l’École nationale de la magistrature et des magistrats en poste. Par ailleurs, une nouvelle circulaire ad hoc devrait être adressée aux parquets généraux récapitulant l’ensemble des outils disponibles en matière de lutte contre la traite des êtres humains et incitant, lorsque cela est possible, à poursuivre sur le double fondement du proxénétisme et de la traite.
proposition n° 16
Inciter les magistrats à engager, chaque fois que possible, des procédures sur le double fondement de la traite des êtres humains et du proxénétisme, en leur adressant une circulaire de politique pénale (ministère de la Justice).
b) L’identification des victimes de la traite
Pour pouvoir davantage poursuivre sur le fondement de la traite des êtres humains, encore faut-il pouvoir identifier les personnes qui en sont victimes. En effet, ces dernières sollicitent rarement de manière spontanée les forces de l’ordre ou les services sociaux et ne se considèrent parfois pas comme des victimes (1032). De surcroît, l’absence d’identification a non seulement pour conséquence de ne pas reconnaître à ces personnes les droits afférents au statut de victime, mais elle peut également entraîner des mesures d’éloignement du territoire ou des procédures pénales à leur encontre, notamment sur le fondement du délit de racolage.
Dès lors, il importe de disposer de critères permettant de reconnaître avec suffisamment de certitude les victimes de la traite. Le groupe de travail interministériel sur la traite des êtres humains a réalisé un document de référence, en collaboration avec les principales associations concernées, qui regroupe les éléments laissant présager une situation de traite (1033). Le but de ces indicateurs est de pouvoir considérer, en amont de toute enquête, que la personne en cause est susceptible d’être victime, qu’il existe des « motifs raisonnables » de le penser, selon l’expression retenue par la Convention de Varsovie (1034).
Pour avoir une effectivité, ces critères doivent être connus des personnes qui sont susceptibles d’entrer en contact avec les victimes de la traite et qui doivent donc être formées à cet effet.
Cette nécessaire formation des professionnels résulte d’ailleurs des engagements internationaux de la France. La Convention de Varsovie, dans son article 10.2, oblige les États parties à adopter « les mesures législatives ou autres nécessaires pour identifier les victimes, le cas échéant, en collaboration avec d’autres Parties et avec des organisations ayant un rôle de soutien. » (1035) Cette obligation est précisée dans son article 10.1 qui prévoit que chaque Partie doit s’assurer que « ses autorités compétentes disposent de personnes formées et qualifiées […] dans l’identification des victimes […] et que les différentes autorités concernées collaborent entre elles ainsi qu’avec les organisations ayant un rôle de soutien, afin de permettre d’identifier les victimes. » Le rapport explicatif précise que cette formation à l’identification des victimes s’adresse à toutes les « autorités publiques qui peuvent être amenées à entrer en contact avec les victimes de la traite, par exemple, les services de police, de l’inspection du travail, des douanes, de l’immigration ou les ambassades et les consulats. » (1036) La directive européenne (1037) reprend ces deux obligations d’identification et de formation, dans ses articles 11.4 (1038) et 18.3 (1039).
Une formation est d’autant plus nécessaire que même des professionnels de terrain, qui peuvent être au contact régulier de victimes de la traite, ne parviennent pas toujours à les identifier. M. Ludovic Levasseur, responsable du service médical de la zone d’attente de Roissy, a récemment indiqué qu’il était particulièrement compliqué d’identifier les victimes de la traite parmi les mineurs qui arrivent à Roissy et que certains médecins n’étaient pas formés à cette problématique (1040). Pour sa part, Mme Claudine Legardinier a dressé un parallèle entre cette situation et l’identification des femmes victimes de violences au sein de leur couple, citant l’exemple du professeur Roger Henrion : « Avant d’écrire son rapport à ce sujet, il pensait n’avoir jamais rencontré de victimes de violences conjugales ; après s’être intéressé à ce sujet, il en voyait souvent. » (1041)
Des formations sont d’ores et déjà organisées, notamment par l’association Accompagnement Lieu d’Accueil (ALC) depuis plus de quatre ans (1042). Elles devraient cependant prendre une ampleur plus importante. Le plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2011-2013) préconise, dans sa mesure n° 10, de généraliser les formations destinées aux agents publics, sous l’impulsion de la coordination nationale (1043). Seraient ainsi formés des référents au sein de chaque administration concernée, qui seraient ensuite chargés de diffuser l’information reçue. Ce modèle est particulièrement pertinent pour diffuser à grande échelle une formation et des bonnes pratiques. Il a d’ailleurs été mis en œuvre avec succès dans le domaine des violences intrafamiliales (1044). Devraient être formés, sur le fondement de ce plan, des référents au sein des services suivants : les unités de gendarmerie et les services de police, les magistrats, les services chargés de l’immigration et du droit d’asile, les services sociaux, l’aide sociale à l’enfance et la protection judiciaire de la jeunesse, l’éducation nationale, les services de santé, les représentations diplomatiques et consulaires, les associations, les inspecteurs du travail, les douaniers, les agents des impôts, les syndicats et les avocats.
Cette formation doit être accompagnée de la diffusion de supports pédagogiques, comme le propose la mesure n° 9 du plan. Un DVD a ainsi été diffusé à hauteur de 10 000 copies, à l’initiative du groupe de travail interministériel, qui s’adresse aussi bien aux agents publics qu’aux victimes de la traite, dans la mesure où il explicite également leurs droits en différentes langues étrangères (1045).
Ces efforts doivent être encouragés et systématisés. Ils conditionnent en effet l’accès au droit des victimes de la traite.
Au-delà, il serait également souhaitable d’informer le grand public sur la réalité de la traite des êtres humains, notamment à des fins d’exploitation sexuelle. Une campagne de communication devrait être envisagée à cet effet, qui pourrait s’inscrire, pour ce qui est de la traite à des fins d’exploitation sexuelle, dans le cadre de la campagne de sensibilisation précédemment évoquée portant sur la prostitution (1046). La proposition n° 5 du plan préconise de mener une telle campagne auprès du grand public, notamment au moyen d’affichages dans les lieux publics, de spots télévisés et de la création d’un site Internet.
proposition n° 17
Former à l’identification des victimes de la traite l’ensemble des agents publics susceptibles d’entrer en contact avec elles.
2. Mieux appliquer la législation aux nouvelles formes de proxénétisme
Le dispositif pénal en matière de proxénétisme est complet et apte à sanctionner toutes les formes de cette criminalité. Cependant, il gagnerait à être mieux appliqué aux nouvelles formes de proxénétisme que sont en particulier l’organisation de « sex tour » et l’exploitation de la prostitution réalisée par Internet ainsi qu’aux réseaux internationaux.
a) Le proxénétisme hôtelier, un partenariat à renforcer
Plusieurs personnes auditionnées se sont fait l’écho du nombre apparemment de plus en plus important de « tournées » de personnes prostituées étrangères dans les pays d’Europe occidentale. Les chaînes hôtelières sont de plus en plus attentives à ces phénomènes, ainsi que l’a indiqué M. Jacques Barré, président du groupement national des chaînes hôtelières (1047). Outre la fermeture de l’établissement pour proxénétisme, qui est encourue, la présence de prostitution peut également être nuisible à l’image de l’hôtel, voire de la chaîne dans son ensemble. De surcroît, elle peut poser des problèmes de sécurité, puisque des agressions subies par des personnes prostituées ont déjà été signalées dans des hôtels.
En conséquence, des actions sont menées pour éviter que des personnes prostituées n’exercent en hôtel. Au sein du groupe Accor, des formations sont organisées en collaboration avec des policiers spécialisés afin de rendre le personnel attentif à la présence d’indices : « la fréquence des réservations, la répétition des noms utilisés pour réserver, les modes de paiement employés, le comportement des clients, la consonance étrangère des noms. » (1048) Le profil des femmes seules qui réservent une chambre pour une semaine attire particulièrement l’attention. Par ailleurs, les hôtels signalent systématiquement à la police les présomptions de prostitution et, si cette dernière est avérée, oblige la personne qui se prostitue à quitter l’hôtel. Enfin, des échanges de bonnes pratiques sont organisés entre les hôtels. Cette politique, selon M. Franck Courson, chef de la division criminelle de la direction interrégionale de police criminelle de Lyon, a donné de bons résultats, notamment dans la région lyonnaise, où, à la suite d’une affaire médiatisée, le groupe Accor avait désigné des référents dans chacun de ses hôtels (1049).
Cependant, des difficultés importantes persistent. Ainsi, le fait que les réservations passent de plus en plus souvent par Internet et qu’elles soient effectuées par l’intermédiaire d’agences de voyage en ligne compliquent la tâche des hôteliers. Ces problématiques seront encore accrues par la mise œuvre, dans un futur proche, de procédures d’arrivée et de départ automatisées. De plus, les hôteliers ne peuvent pas, sur de simples soupçons, pratiquer des refus de vente, la prostitution étant de surcroît une activité légale.
Des progrès pourraient encore être accomplis, notamment par la désignation systématique de référents du côté des hôteliers et des forces de l’ordre. Des formations plus régulières pourraient également être organisées, non seulement pour repérer les personnes qui se prostituent, mais surtout pour identifier les victimes de la traite des êtres humains. À titre d’exemple, en Suède, une assistance téléphonique a été créée, permettant aux hôteliers de signaler facilement toute présomption de prostitution et de traite (1050). Il convient de s’inspirer de ces bonnes pratiques pour renforcer la politique partenariale entre chaînes hôtelières et pouvoirs publics, par exemple par l’intermédiaire de la signature d’une convention entre la police nationale et les chaînes hôtelières, qui prévoirait d’organiser des formations sur la traite des êtres humains et de désigner des personnes référentes.
proposition n° 18
Renforcer la politique partenariale entre les pouvoirs publics et les chaînes hôtelières en matière de lutte contre la traite et le proxénétisme (ministère de l’Intérieur).
b) La mise en relation par Internet et par la presse, des lacunes surprenantes
Au cours de ses auditions et de ses déplacements, il a été porté à la connaissance de la mission d’information que divers quotidiens, notamment de la presse régionale, contenaient des petites annonces de prostitution tout à fait explicites. Ainsi, un exemplaire de La Provence du 31 janvier 2011 contient plusieurs annonces sans ambiguïté.
EXEMPLES D’ANNONCES FIGURANT DANS LA PROVENCE DU 31 JANVIER 2011
Sublime Call-girl blonde, 23 ans, mannequin, [numéro de téléphone] |
Toulon, Jeune femme, 30 ans, brune, reçoit hommes [numéro de téléphone] |
Travestie super excitante, 29 ans [numéro de téléphone] |
Aix, laissez vous envahir par la tentation d’une jeune femme brune, 24 ans, beauté 100 % [numéro de téléphone] |
Le sexe des personnes qui figurent dans cette rubrique « Rencontres » (exclusivement des femmes ou des personnes transgenres), ainsi que le coût de telles annonces et leur contenu ne laissent pas de doute quant à la nature des prestations proposées. À la préfecture de police de Paris, a également été cité le cas de « revues spécialisées », qui, sous couvert de rencontres, contiennent en fait des annonces de personnes prostituées indépendantes ou travaillant pour des réseaux, ces derniers étant identifiables dès lors que plusieurs annonces contiennent le même numéro de téléphone (1051).
Le 1° de l’article 225-6 du code pénal incrimine pourtant le fait de « faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ». Sur ce fondement, des condamnations ont été prononcées, notamment à l’encontre de directeurs de publications qui comportaient des « annonces contenant des offres de rencontres manifestement prostitutionnelles » (1052). L’absence de prix sur des annonces de massage n’a pas fait obstacle, pour la Cour de cassation, à la qualification de la prostitution (1053) : « si le prix des prestations ainsi offertes ne figure que dans les annonces les plus anodines, le coût élevé de publication de ces messages, dont certains paraissent sous forme d’encarts publicitaires, laisse présumer chez l’annonceur l’exercice d’une activité lucrative, de type professionnelle. » (1054)
Il existe donc un fondement juridique solide pour intenter des poursuites sur le fondement du proxénétisme à l’encontre de ces publications et pour les inciter à refuser ce genre d’annonces. La volonté de poursuivre ce qui constitue de toute évidence une forme de proxénétisme semble cependant faire défaut. Ayant soulevé ce point auprès de M. Michel Mercier, ministre de la Justice, le garde des Sceaux a proposé qu’une circulaire soit adressée aux parquets généraux pour que ces derniers soient plus vigilants et puissent informer les directeurs de publication de la responsabilité pénale qu’ils encourent, afin de les dissuader de publier des annonces de ce type.
proposition n° 19
Adresser une circulaire aux parquets généraux afin qu’ils informent les directeurs de publication que leur responsabilité pénale est susceptible d’être engagée en cas de publication d’annonces à caractère prostitutionnel et que des poursuites soient, le cas échéant, engagées (ministère de la Justice).
En matière de prostitution effectuée via Internet, les outils juridiques existent également, dans la mesure où l’utilisation d’un réseau de télécommunications constitue une cause d’aggravation du proxénétisme, rendant l’infraction passible de 10 ans d’emprisonnement et de 1 500 000 euros d’amende (1055). Plusieurs condamnations ont été prononcées sur ce fondement. Pourtant, les sites d’escortes semblent se développer et les sites de rencontres ou de petites annonces électroniques abritent très certainement des offres prostitutionnelles.
L’éditeur du site est responsable du contenu de son site et peut donc être poursuivi pour proxénétisme. Les hébergeurs des sites disposent d’une responsabilité atténuée, depuis la loi n° 2004-575 pour la confiance en l’économie numérique du 21 juin 2004. En effet, leur responsabilité ne peut être engagée sur le plan civil et pénal qu’après notification du contenu illicite, ce qui constitue une procédure relativement lourde, selon Mme Myriam Quémener, magistrate (1056). De surcroît, les poursuites sont rendues difficiles par la localisation des hébergeurs à l’étranger et la disparition brutale des sites qui sont aussitôt recréés sous une adresse différente.
Pour passer outre ces difficultés, une démarche de partenariat a été engagée entre l’OCRTEH et Vivastreet, site de petites annonces en ligne. Lorsque des suspicions de traite des êtres humains existent, une réquisition peut être envoyée par les services de police, qui aboutit à la communication, sous 48 heures, de l’adresse électronique, de l’adresse IP (1057) et du numéro de téléphone de la personne ayant posté l’annonce. Dès lors, des croisements peuvent être effectués par les forces de l’ordre, afin de vérifier, par exemple, qu’un numéro de téléphone ne correspond pas à plusieurs annonces différentes (1058). De surcroît, la décision a été prise de faire payer les annonces de la section « Érotica », afin de pouvoir disposer d’un numéro de carte bleue, de filtrer les annonces et de modérer leur contenu.
Il semble impossible d’empêcher la création de sites Internet mettant en relation l’offre et la demande en matière de prostitution, dans la mesure où ces derniers peuvent être hébergés partout dans le monde. Dès lors, une réflexion doit être engagée avec les principaux hébergeurs concernés (notamment les sites de petites annonces) quant aux moyens à mettre en œuvre pour limiter ce phénomène.
proposition n° 20
Informer les hébergeurs de sites Internet de leur responsabilité pénale au regard des annonces à caractère prostitutionnel qu’ils publient et développer un partenariat avec ces derniers afin de limiter cette pratique (ministères de la Justice et de l’Intérieur).
3. Mieux utiliser les outils de la procédure pénale
La procédure pénale doit être mieux utilisée dans les affaires de traite des êtres humains et de proxénétisme, notamment en ce qui concerne la coopération internationale, la protection des victimes et la saisie des avoirs criminels.
a) Avoir davantage recours à la coopération internationale
Les réseaux de traite des êtres humains et d’exploitation sexuelle se déploient de plus en plus fréquemment à une échelle européenne voire internationale (1059). Même si la législation française, relativement stricte en matière de proxénétisme, détourne de notre pays une part de cette criminalité, les réseaux de traite s’y implantent néanmoins. La preuve de l’infraction nécessite alors une coopération policière et judiciaire, dans la mesure où le réseau est présent dans des pays différents. La création des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) (1060) constitue indéniablement un progrès dans la lutte contre ce phénomène, dans la mesure où ces dernières sont habituées à mener des procédures internationales. L’existence de mécanismes de coopération est également primordiale. Ils ont progressivement été mis en œuvre dans le cadre européen.
Le mandat d’arrêt européen en constitue l’une des formes privilégiées. Plus de 10 000 ont été exécutés entre 2005 et 2009, avec un délai moyen d’exécution de deux semaines, alors qu’il était d’un an avec la procédure de l’extradition (1061). Or, dans ce cadre, la traite des êtres humains fait partie des infractions pouvant donner lieu à la remise de la personne recherchée sans contrôle de la double incrimination (1062). Cependant, les réseaux se sont adaptés et leurs organisateurs se sont souvent déplacés aux marges de l’Union européenne, notamment en Moldavie, en Ukraine et en Biélorussie (1063).
Des équipes communes d’enquête peuvent être constituées et bénéficier d’un financement communautaire. Il s’agit de structures temporaires, rassemblant les magistrats et les enquêteurs de plusieurs États membres de l’Union européenne (1064) et permettant notamment d’échanger des renseignements, de mener des investigations conjointes et de coordonner les poursuites pénales. Elles sont créées par la conclusion d’un protocole entre magistrats. Dans ce cadre, des magistrats et des policiers français peuvent se rendre dans les pays sources de la traite des êtres humains afin de procéder à l’identification de la tête du réseau et à son démantèlement.
Les structures d’Europol et d’Eurojust sont enfin des mécanismes majeurs de la coopération pénale européenne, notamment en matière de lutte contre la traite des êtres humains.
Europol est une agence européenne de coopération policière, qui a pour buts le partage rapide d’informations et l’analyse criminelle. Cette dernière repose sur des fichiers d’analyse, qui permettent de collecter de stocker et d’analyser, pendant trois ans, des données nominatives émanant d’enquêtes en cours. Ainsi, Mme Angelika Molnar, analyste au groupe « Prostitution et traite des êtres humains » d’Europol, a indiqué que ces fichiers permettaient de mettre en évidence l’existence de réseaux dans des affaires qui sembleraient à première vue locales et de faible ampleur. L’analyse des photographies, des déplacements, des plaques d’immatriculation ou des flux financiers permet une telle caractérisation (1065). Un bureau de liaison français sert d’interface entre la plateforme de coopération internationale de Nanterre et Europol (1066). Il est composé de sept personnes (policiers, gendarmes et douaniers).
EXEMPLE DE RÉSEAU DÉMANTELÉ AVEC L’APPUI D’EUROPOL
Récemment, trois jeunes femmes ont été retrouvées dans une maison en Hongrie. Elles étaient contraintes, depuis douze ans, de se prostituer en Autriche, mais aucune n’avait dénoncé cette situation. Finalement, l’une d’entre elles a parlé, ce qui a permis de mener des arrestations simultanées en Autriche et en Hongrie.
Ces jeunes filles étaient d’abord employées dans la maison du proxénète, subissaient un processus de dressage (coups, viols…) et devaient se prostituer dans un studio à Vienne. Elles recevaient entre 15 et 20 clients par jour, pour un gain quotidien d’environ 1 000 euros. Dans la maison du suspect, en Hongrie, ont été retrouvés de nombreux objets de valeur, dont une collection de 35 motos et d’animaux exotiques, malgré l’absence de revenus légaux.
L’analyse menée par Europol a permis de déterminer que les transferts étaient réalisés par l’intermédiaire de la femme du suspect. Cette enquête financière a été d’une grande utilité dans la mesure où aucune des victimes ne souhaitait collaborer à l’enquête. Grâce à l’analyse des données des deux États membres, il a été possible de repérer trois victimes en Hongrie et six en Autriche. Depuis la fin de l’enquête, cinq autres victimes ont été identifiées.
Eurojust a été créé en 2002 et a notamment pour mission d’encourager la coordination dans les enquêtes et les poursuites, d’améliorer la coopération judiciaire, de soutenir les autorités nationales et de renforcer la coopération judiciaire avec les pays tiers. Eurojust peut par exemple être un lieu d’élaboration d’une stratégie d’enquête ou de coordination d’arrestations entre plusieurs États membres. Il s’agit d’un organe de coopération entre autorités judiciaires nationales fondé sur la confiance, ce qui en fait une structure beaucoup moins intégrée qu’Europol (1067). Eurojust a eu à traiter, en 2009, 74 dossiers relatifs à la traite des êtres humains, dont 52 concernaient des affaires d’exploitation sexuelle (1068). Ce dernier chiffre s’est élevé à 67 en 2010. Sur ces 67 cas, la France a été initiatrice dans 8 et a été requise dans 4 (1069).
EXEMPLE DE PROCÉDURE FACILITÉE PAR EUROJUST
En 2004, quatre personnes prostituées bulgares portent plainte à Nîmes pour un vol commis dans leur appartement. Les policiers décident de mener une enquête pour proxénétisme et traite des êtres humains et parviennent à identifier le réseau auquel elles appartiennent, qui compte 113 personnes prostituées dans toutes les grandes villes françaises, provenant d’un même village bulgare. Des mandats d’arrêt européens sont délivrés pour que les têtes de réseau (douze Bulgares) soient arrêtées.
Eurojust est saisie en 2007 par le juge d’instruction français qui s’inquiète que trois des douze personnes visées par ses mandats, dont le patriarche, ne lui soient pas remis, pour insuffisance de charges. En effet, cela traduisait une mauvaise volonté des autorités bulgares. Grâce à l’intervention du bureau français d’Eurojust auprès de son homologue bulgare, deux des trois mandats d’arrêt sont exécutés.
Pour ce qui est de la troisième personne, le mandat d’arrêt se heurtait à la règle non bis in idem, dans la mesure où elle était poursuivie pour les mêmes faits en Bulgarie. Il a alors été proposé d’émettre un nouveau mandat d’arrêt qui ne mentionne pas les victimes communes aux dossiers français et bulgare. Malgré un refus initial, une remise temporaire est accordée grâce à l’intervention en urgence d’Eurojust, pour que ce suspect puisse être présent à l’audience.
En août 2010, Eurojust est saisi pour faciliter le transfert en Bulgarie de l’un des individus remis, après une condamnation définitive à huit ans d’emprisonnement.
Source : Déplacement à La Haye, rencontre avec M. Mahrez Abassi, adjoint du membre national représentant à la France à Eurojust, le 13 janvier 2011.
Eurojust constitue donc un outil précieux en matière de coopération judiciaire. Des moyens importants y sont d’ailleurs affectés par le gouvernement français puisque le bureau français comprend quatre magistrats, ce qui représente l’effectif le plus important et permet la tenue d’une permanence 24 heures sur 24. Or, au vu des témoignages recueillis par la mission, on a le sentiment qu’Eurojust est sous-utilisé. Ce constat est d’autant plus vrai en matière de traite des êtres humains, dans la mesure où de nombreuses affaires sont menées en France sous le chef de proxénétisme, domaine dans lequel la coopération est plus délicate. Il importe donc de qualifier ces affaires de traite des êtres humains et de mieux faire connaître le dispositif Eurojust ainsi que l’aide qu’il peut apporter aux magistrats français.
proposition n° 21
Mieux former et informer les forces de l’ordre et les magistrats qui travaillent sur la traite des êtres humains et le proxénétisme au recours à Eurojust et Europol (ministères de la Justice et de l’Intérieur).
Une coopération est également nécessaire en matière internationale, tous les faits de traite ne se déroulant pas dans le cadre de l’Union européenne. À ce titre, la mission s’associe aux recommandations du plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2011-2013), qui prévoit notamment :
– d’encourager la ratification par tous les États du protocole de Palerme (1070), dans la mesure où il constitue le seul instrument universel de lutte contre la traite (mesure n° 27) ;
– de développer les actions de coopération et renforcer l’assistance technique auprès des pays d’origine (mesure n° 28). M. Jean-Marc Souvira a donné l’exemple d’accords de jumelage passés avec la Roumanie et la Bulgarie pour améliorer la formation des policiers. Certains agents français sont allés travailler pendant plusieurs mois en Europe orientale pour améliorer les procédures de poursuite et inversement des policiers roumains et bulgares sont venus se former en France (1071). De telles actions devraient être étendues aux autres pays sources de la traite ;
– de coordonner les différentes actions de coopération (mesure n° 29). Pour ce faire, il est proposé de créer une base de données regroupant l’ensemble de projets de coopérations, qu’ils soient menés par des acteurs publics ou associatifs. Cette base de données serait gérée par le ministère des Affaires étrangères et la coordination interministérielle ;
– de développer et renforcer l’entraide judiciaire et policière, que ce soit dans le cadre international ou européen (mesure n° 30) ;
– de promouvoir et pérenniser l’expertise française au sein des organisations internationales (mesure n° 31) ;
– et d’assurer la cohérence des travaux entrepris dans le cadre des différentes organisations internationales (mesure n° 32), afin d’éviter que certains États choisissent les normes les moins contraignantes.
Par ailleurs, la coopération en matière de lutte contre la traite des êtres humains devrait être intégrée dans tous les accords de partenariat conclus par l’Union européenne avec des pays tiers.
proposition n° 22
Renforcer l’action diplomatique de la France en matière de lutte contre la traite des êtres humains, sur le fondement des mesures 27 à 32 du plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2011-2013) (ministère des Affaires étrangères).
b) Mieux protéger les victimes de la traite
La protection des victimes de la traite devrait être renforcée. L’exemple de Baina, victime d’exploitation sexuelle d’origine nigériane rencontrée par la mission d’information, est édifiant : alors qu’une demande de protection avait été faite, elle n’a pas pu être accompagnée pour se rendre au procès de ses proxénètes à Bordeaux, alors même que les mis en cause voyageaient à bord du même train (1072).
Certaines dispositions législatives permettent, en théorie, d’assurer cette protection. Tel est le cas notamment du dispositif d’accueil sécurisant (Ac.Sé), sur le fondement de l’article 42 de la loi pour la sécurité intérieure, qui énonce que « toute personne victime de l'exploitation de la prostitution doit bénéficier d'un système de protection et d'assistance, assuré et coordonné par l'administration en collaboration active avec les divers services d'interventions sociales. » Par ailleurs, des infractions pénales précédemment évoquées protègent les victimes (1073). En outre, en fonction des circonstances, la mise en place d’un dispositif de protection de l’intégrité physique de la personne peut être décidée par les forces de l’ordre, le cas échéant sollicitées par le parquet ou le juge, au bénéfice de témoins, de victimes ou de leurs proches, à l’instar des personnes faisant l’objet de menaces.
Cependant, ce dispositif est perfectible dans trois domaines.
En premier lieu, il n’existe pas en France de réel programme de protection des victimes de la traite, contrairement à plusieurs pays européens. Ce programme pourrait notamment comprendre l’octroi d’une identité d’emprunt et le déplacement vers un État étranger pour relogement (1074). Le rapport explicatif de la Convention de Varsovie mentionne différents moyens d’assurer cette protection, de la mise en place d’une procédure d’alarme au changement d’identité (1075). L’article 12.3 de la nouvelle directive oblige les États membres à veiller « à ce que les victimes de la traite des êtres humains bénéficient d'une protection adaptée sur la base d'une appréciation individuelle des risques, en leur donnant notamment accès aux programmes de protection des témoins ou à d'autres mesures similaires, dans le respect des critères définis dans leur législation ou leurs procédures nationales » (1076).
En deuxième lieu, il faudrait envisager la protection des membres de la famille des victimes de la traite, et notamment de leurs enfants. En effet, la coopération internationale en la matière n’est pas toujours satisfaisante. On peut rappeler à ce titre le cas cité par la CNCDH de la disparition de la sœur et de la mort du père d’une victime nigériane de la traite qui venait de porter plainte (1077). Afin de faciliter la coopération et la protection de ces victimes, il est indispensable de faciliter la procédure de regroupement familial, notamment en n’exigeant pas les conditions de ressources et de logement, exclusion dont bénéficient déjà les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire (1078).
En troisième lieu, il peut être essentiel, pour les victimes, de voir leur anonymat garanti, notamment pendant la procédure judiciaire. Le cas particulièrement dramatique de Lisina, dont la situation d’ancienne prostituée est désormais visible sur Internet du fait de la médiatisation de son procès, ce qui l’incite aujourd’hui à vouloir changer de nom, a attiré l’attention de la mission sur ce point (1079). Poursuivant le même objectif, l’article 12.4 de la nouvelle directive communautaire préconise d’éviter « toute déposition en audience publique » (1080). Or, en l’état actuel du droit, le huis clos n’est de droit, en matière criminelle, qu’à la demande des victimes de viols ou de torture et d’actes de barbarie accompagnées d’agressions sexuelles mais peut être également ordonné si la publicité est « dangereuse pour l’ordre ou les mœurs » (1081). En matière correctionnelle, le huis clos peut être ordonné si le tribunal constate « que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers » (1082). Cependant, le huis clos est rarement imposé dans les affaires de traite et de proxénétisme (1083). Il est donc nécessaire de le rendre de droit à la demande des victimes de traite et de proxénétisme aggravés, compte tenu de la « victimisation secondaire » (1084) qui peut résulter, pour elles, de la publicité des débats.
proposition n° 23
Renforcer la protection des victimes de la traite en :
– envisageant l’instauration d’un programme de protection des victimes et des témoins (ministères de la Justice et de l’Intérieur) ;
– facilitant l’arrivée en France des membres de leur famille restés dans leur pays d’origine (loi) ;
– rendant de droit le huis clos au procès, sur la demande des victimes de traite et de proxénétisme aggravés (loi).
c) Saisir et confisquer les avoirs criminels
Les peines privatives de liberté ne sont pas toujours les plus dissuasives pour les auteurs de traite ou de proxénétisme. Les sommes amassées sont telles que le fait d’être emprisonné pendant quelques années ne contrebalance que modérément le profit escompté. Pour donner un ordre d’idée, on peut citer le chiffre avancé par Mme Angelika Molnar, analyste au groupe « Prostitution et traite des êtres humains » d’Europol, qui a indiqué que dans une affaire impliquant une dizaine de personnes prostituées pendant dix ans, un profit de près de 100 millions d’euros avait été réalisé (1085). M. Franck Courson a cité le cas d’une prostituée lyonnaise qui avait envoyé à l’étranger près d’un million d’euros en deux ans, ne conservant pour elle que 30 000 euros (1086). Cette manne financière permet parfois aux têtes de réseau d’échapper à toute poursuite, grâce à la corruption pratiquée dans leur pays de résidence.
Il est donc nécessaire de coupler systématiquement les sanctions privatives de liberté avec la saisie et la confiscation des avoirs criminels, afin de parvenir à un « étranglement financier des criminels » (1087). À ce titre, il faut mentionner la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, qui a modernisé les procédures dans ce domaine. Sur le fondement de l’article 225-24 du code pénal, les personnes physiques ou morales coupables de proxénétisme encourent également :
« 1° La confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ainsi que les produits de l'infraction détenus par une personne autre que la personne se livrant à la prostitution elle-même ;
« 2° Le remboursement des frais de rapatriement de la ou des victimes. »
Enfin, l’article 225-25 prévoit la confiscation, pour les auteurs de traite et de proxénétisme, « de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ».
Dans le domaine européen, deux décisions-cadres assurent la mise en œuvre de procédures de gel de biens et de confiscation (1088), qui, selon la Chancellerie, permettent de mener des procédures très efficaces (1089). En revanche, en matière internationale, la confiscation dépend de l’existence d’une volonté de coopération judiciaire.
Si les instruments existent, il est cependant nécessaire de mieux les utiliser, en rappelant aux magistrats, par le biais d’une circulaire, la nécessité de saisir et de confisquer les avoirs criminels des auteurs de traite et de proxénétisme.
proposition n° 24
Rappeler aux magistrats, par voie de circulaire, la nécessité de saisir et de confisquer les avoirs criminels des auteurs de traite et de proxénétisme (ministère de la Justice).
B. CONSERVER LA LÉGISLATION EXISTANTE EN MATIÈRE DE PROXÉNÉTISME
À la lumière des grands principes républicains qui ont conduit la mission à proposer d’instaurer une pénalisation des clients de la prostitution, il ne saurait être concevable de dépénaliser le proxénétisme de soutien ou de prévoir une exception à la législation sur le proxénétisme pour ce qui est de l’assistance sexuelle.
1. La question de la dépénalisation du « proxénétisme de soutien »
La répression du proxénétisme de soutien, comme le proxénétisme hôtelier (1090), le fait de recevoir de l’argent d’une personne prostituée (1091) ou d’aider et d’assister la prostitution d’autrui (1092) est parfois dénoncée comme entraînant des effets pervers importants pour les personnes prostituées (1093).
a) Le proxénétisme hôtelier et la réouverture des maisons closes
La question du proxénétisme hôtelier nécessite une attention particulière. En effet, une suppression de ce délit entraînerait la dépénalisation des maisons closes. Or, de l’avis quasi unanime des personnes auditionnées par la mission, il ne serait pas souhaitable d’autoriser la réouverture d’établissements de prostitution. Mme Claude Boucher, présidente de l’association des Amis du bus des femmes, a ainsi estimé que toute initiative dans ce sens provoquerait une réaction rapide et virulente de la part des personnes prostituées car il ne saurait être question de recréer des proxénètes (1094). Le STRASS défend la même position (1095). Cette conception est partagée par la mission d’information. Mais en dépénalisant toute forme de proxénétisme de soutien, la conséquence serait inévitablement d’autoriser la réouverture de ces établissements.
Il faut également noter que l’incrimination actuelle ne concerne que les propriétaires qui savent que la personne loue ou achète un logement pour s’y prostituer. Dès lors, ceci ne complique pas l’accès au logement des personnes prostituées si elles ne pratiquent pas leur activité sur leur lieu d’habitation (1096). De plus, le caractère intentionnel de l’infraction doit être dûment établi pour que l’action pénale puisse prospérer. En conséquence, le nombre de condamnations sur le fondement de cette infraction est relativement faible, puisqu’il s’élève à environ 30 par an, chiffre qui comprend les condamnations sanctionnant les établissements qui s’apparentent à des maisons closes ou à des hôtels de passe.
CONDAMNATIONS ANNUELLES POUR CERTAINES INFRACTIONS DE PROXÉNÉTISME HÔTELIER
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | |
Mise à disposition de local privé à une personne s'y livrant à la prostitution |
24 |
17 |
10 |
22 |
13 |
15 |
34 |
35 |
23 |
31 |
Mise à disposition de véhicule à une personne s'y livrant à la prostitution |
--- |
--- |
--- |
5 |
0 |
7 |
1 |
0 |
7 |
0 |
Vente d'un local privé à une personne s’y livrant à la prostitution |
1 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
0 |
1 |
0 |
3 |
Vente d'un véhicule à une personne s’y livrant à la prostitution |
--- |
--- |
--- |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Source : ministère de la Justice. NB : les données pour 2009 sont provisoires.
Enfin, une dépénalisation de cette forme de proxénétisme nécessiterait une dénonciation de la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui du 2 décembre 1949 (1097), dont l’article 2 prévoit que les Parties punissent toute personne qui « donne ou prend sciemment en location, en tout ou partie, un immeuble ou un autre lieu aux fins de la prostitution d’autrui. »
b) Le proxénétisme par aide et assistance
Pour ce qui est du délit d’aide et d’assistance et de celui de partage des produits de la prostitution, le Conseil national du sida recommande qu’une évaluation spécifique soit mise en œuvre afin de « connaître l’impact de la disposition au regard du proxénétisme et de la stabilité du logement des personnes prostituées. » (1098)
Les condamnations pour non-justification de ressources par une personne en relation avec une personne prostituée ou vivant avec une personne prostituée (1099) ont été au nombre de 5 en 2009 et de 10 en 2008 (1100). Les condamnations en matière d’aide, d’assistance et de protection de la prostitution d’autrui (1101) et pour avoir tiré profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution (1102) sont en nombre plus important (environ 140 pour chacun de ces deux délits en 2009).
Cependant, ces condamnations visent, en très grande majorité, de véritables proxénètes. D’ailleurs, les juridictions sont pleinement conscientes du caractère large et objectif de ces infractions et ne sanctionnent pas de la même manière toutes les formes de proxénétisme. Ainsi Mme Florence Garcia, directrice de l’association Cabiria, a souligné qu’aucun enfant majeur d’une personne prostituée n’avait jamais été condamné pour proxénétisme sur le fondement des subsides qu’elle lui aurait versés (1103). Par ailleurs, un grand nombre de condamnations précitées sanctionnent, en fait, des formes de proxénétisme « de contrainte », dans la mesure où il y a concours d’infractions (1104).
À l’inverse, il ne faudrait pas exempter de toute sanction pénale le conjoint qui incite sa femme à se prostituer et qui en retire un profit, sous prétexte qu’ils sont conjoints. Ces situations sont fréquentes et ne font pas forcément appel à une forme de contrainte pénalement objectivable. Lisina, jeune femme rencontrée à l’Amicale du Nid de Paris, a ainsi été poussée à la prostitution par son ex-fiancé, d’abord en Italie puis en France (1105). Kevin, a, quant à lui, mentionné le fait que, pendant qu’il se prostituait, plusieurs de ses petits amis avaient largement profité de cette situation, sans pour autant en être à l’origine (1106). Mme Claudine Legardinier a indiqué que cette situation de « mise en prostitution » (1107) par un conjoint était très fréquente. Ces dernières pensent alors avoir choisi leur prostitution et ne portent pas plainte.
Il ne semble pas anormal à la mission d’information que ce genre de comportements soit incriminé, à un niveau de peine moindre que le proxénétisme aggravé. Les juges demeurent maîtres du quantum de peine infligé et font parfaitement la différence entre le fait de donner de l’argent à ses enfants majeurs et de remettre systématiquement tous ses revenus à son conjoint. D’ailleurs, les décisions en la matière sont rares, la plupart étant antérieures aux années 1990 (1108). Une affaire récente citée par le quotidien La Montagne met en scène deux couples effectuant des « tournées » en France. Pendant que les femmes se prostituaient, les hommes les surveillaient depuis la chambre voisine. Les gains étaient partagés en quatre parts égales. Arrêtés, les deux maris ont été condamnés à seulement trois mois de prison avec sursis (1109).
Inversement, l’existence d’infractions objectives de proxénétisme, qui ne nécessitent pas la preuve de la contrainte, laquelle est le plus souvent invisible dans ce genre de situations, permet une répression efficace, notamment pour les cas de proxénétisme en dehors du couple. Il est alors possible de se fonder sur la simple remise régulière d’argent par une personne prostituée à une personne tierce pour qualifier juridiquement l’infraction.
2. La question de l’assistance sexuelle pour les personnes en situation de handicap
L’assistance sexuelle constitue un service sexuel rendu, par des personnes spécifiquement formées, à des personnes handicapées, contre rémunération. Cette possibilité existe notamment aux Pays-Bas, en Allemagne et en Suisse (1110). Le réglementarisme de ces pays, et leur définition restreinte du proxénétisme, ont permis aux associations de recruter et de former des assistants sexuels en toute légalité, chose qui n’est pas possible en l’état actuel de la législation française.
a) Une revendication portée par plusieurs associations
Si l’assistance sexuelle n’a pas d’existence légale en France, de nombreuses associations, comme le collectif Sexualités et Handicaps, militent activement en faveur de la création de services de ce genre. Elles demandent à ce qu’une exception juridique au proxénétisme soit instaurée afin de permettre la légalisation de l’assistance sexuelle en France. Notre collègue Jean-François Chossy (1111), a ainsi été chargé par ce collectif de trouver une solution juridique pour légaliser l’assistance sexuelle. Parallèlement, le Comité national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) a créé, en janvier 2010, un groupe de travail « Sexualités, vie affective et parentalité ».
L’ASSISTANCE SEXUELLE EN SUISSE
En Suisse, il existerait une vingtaine d’assistants sexuels, la moitié d’entre eux étant des hommes. Leurs services vont du massage et des caresses jusqu’au rapport sexuel pénétratif, pour une minorité d’entre eux. Les assistants sexuels accompagnent également des couples en situation de handicap moteur, qui peuvent avoir besoin d’une aide physique pour avoir des relations sexuelles. De la même façon, ils enseignent la masturbation à des personnes en situation de handicap mental afin que celles-ci ne se blessent pas. Des prestations de type homosexuel existent également en Suisse alémanique.
La loi suisse considère les assistants sexuels comme des personnes prostituées, à l’exception du canton de Genève, qui a récemment modifié sa loi sur la prostitution afin d’en exclure les assistants sexuels.
Une condition a été posée au recrutement des assistants sexuels en Suisse. Ils doivent tous exercer une autre activité professionnelle afin de ne pas dépendre financièrement de l’assistance sexuelle. De fait, la majorité d’entre eux exerce une profession en relation avec le corps (masseurs, kinésithérapeutes, infirmiers…), tandis que les autres sont musicien, traducteur, psychothérapeute ou secrétaire. Un quart des assistants sexuels recrutés exerçaient la prostitution.
Les tarifs varient de 115 euros à 150 euros, pour une prestation d’environ deux heures. Toutefois, certains assistants sexuels ont mis en place un système de péréquation, qui consiste à demander aux clients valides, ou aux personnes handicapées physiques qui ont parfois un travail correctement rémunéré, un tarif plus élevé que celui applicable aux clients handicapés mentaux, afin de ne pas pénaliser financièrement ces derniers pour des prestations souvent plus longues.
Les assistants sexuels attachent une grande importance au fait que cette prestation soit payante, l’argent assurant une « mise à distance » entre l’assistant sexuel et son bénéficiaire, limitant ainsi les risques d’attachement sentimental. Le coût élevé de la prestation permet de limiter les rencontres et donc les possibilités d’attachement. L’assistance sexuelle n’est pas prise en charge par la sécurité sociale suisse, contrairement à ce qui se pratique aux Pays-Bas.
Source : Audition de Mme Lucie Nayak, doctorante en sociologie, du 14 décembre 2010.
Les principaux arguments développés en faveur de la légalisation de l’assistance sexuelle sont la difficulté, voire l’impossibilité, pour certaines personnes handicapées, de pouvoir satisfaire leurs « besoins sexuels » (1112). Ce raisonnement repose sur la reconnaissance de la sexualité comme un « droit humain fondamental », selon les termes de la note d’intention du collectif Sexualités et Handicaps (1113), qui aurait vocation à s’inscrire dans la tradition des droits de l’homme.
Les associations distinguent clairement cette pratique de la prostitution. Dans la note d’intention précitée, le collectif écrit notamment : « le [collectif] ne nie en aucun cas le caractère sordide et indigne de la prostitution, par plus que l’usage qui en est fait, majoritairement par défaut, par des personnes en situation de handicap » (1114) reproduisant le discours traditionnel de condamnation de la prostitution et d’amnistie des clients. De fait, certaines personnes prostituées interviennent d’ores et déjà auprès de personnes handicapées, ainsi que l’ont confirmé notamment Maîtresse Gilda (1115), porte-parole nationale du STRASS, et Mme Malika Amaouche, coordinatrice du collectif Droits et prostitution (1116). Les différences invoquées par les associations tiennent à l’encadrement dont bénéficierait l’assistance sexuelle et à la formation des assistants sexuels. Par ailleurs, l’assistance sexuelle s’inscrirait dans le cadre d’une démarche volontaire et jamais dans un réseau d’exploitation.
Cependant, la prostitution est définie par la Cour de cassation de la manière suivante : « la prostitution consiste à se prêter, moyennant rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu’ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui » (1117). À la lumière de cette définition, il apparaît que si l’assistance sexuelle devait dépasser le stade du massage pour donner lieu, à proprement parler, à un acte sexuel, elle serait qualifiée de prostitution. Les salons de massage où étaient pratiquées des « finitions manuelles » ont ainsi été condamnés pour proxénétisme : « en l'espèce, il était constant que, dans les trois salons de relaxation, de prétendues masseuses, plus ou moins déshabillées, se livraient à des attouchements, des caresses ou des "effleurements" sur des hommes, allant jusqu'à provoquer l'éjaculation, moyennant le versement de sommes tarifées selon la nature et le degré de la prestation » (1118). En conséquence, les personnes qui mettraient en relation des personnes handicapées et des assistants sexuels seraient sanctionnables du chef de proxénétisme (1119), de même que les associations d’assistants sexuels (1120).
Dès lors, comme l’a suggéré notre collègue Jean-François Chossy, il serait nécessaire de ménager une exception à la législation sur le proxénétisme, notamment pour les personnes lourdement handicapées qui ne sont pas en mesure de toucher leur propre corps. Cette exception législative pourrait être couplée avec la modification des contours de la prestation de compensation du handicap, qui comprendrait également les actes de la vie intime, cette modification étant cependant susceptible de concerner un nombre beaucoup plus important de personnes handicapées (1121).
b) Des difficultés juridiques et éthiques considérables
La mission soutient en totalité les revendications des associations de personnes handicapées dans leur combat pour que soit reconnu et favorisé l’accès de ces dernières à une vie affective et sexuelle qui corresponde à leurs désirs. Cependant, on ne saurait, sous couvert de cette intention, porter atteinte aux principes fondamentaux exposés ci-dessus, tel que le principe de non patrimonialité du corps humain (1122).
Sur un plan juridique, il ne saurait être reconnu de droit à une vie sexuelle. En effet, pour qu’il soit effectif, le titulaire d’un droit doit pouvoir le faire valoir par le biais d’une procédure auprès d’une personne qui est débiteur de ce droit. Ainsi, la reconnaissance d’un droit à une vie sexuelle impliquerait la création d’une procédure pour faire respecter ce droit et la désignation d’un débiteur de ce droit, qui serait certainement l’État. De la sorte, il reviendrait à la puissance publique d’organiser et d’encourager le développement de l’assistance sexuelle à destination de toutes les personnes qui revendiquent ce droit. En cas de défaut de l’initiative privée, si l’on poussait le raisonnement jusqu’à son terme, devrait être créé un service public en la matière.
De surcroît, on voit mal pourquoi ce droit serait limité aux seules personnes en situation de handicap et à certaines d’entre elles en particulier. Mme Maudy Piot, présidente de l’association Femmes pour le dire, femmes pour agir, a souligné le risque de discrimination qu’il y aurait à réserver ce droit à certaines catégories de personnes handicapées ou aux seules personnes handicapées. Il faudrait en effet déterminer à quels types de personnes en situation de handicap cette assistance est destinée. Peut-elle bénéficier aux personnes souffrant d’un handicap mental, comme en Suisse ? Doit-elle être réservée aux handicaps physiques qui empêchent un contact avec son propre corps ? D’autre part, d’autres personnes pourraient faire valoir ce droit à une vie sexuelle, comme les personnes incarcérées et les personnes âgées ou célibataires (1123). On voit mal, s’il devait être reconnu, pourquoi ce droit ne concernerait que les personnes en situation de handicap ou certaines d’entre elles.
Le ménagement d’une exception à la législation en matière de proxénétisme constituerait également une stigmatisation des personnes handicapées, dont la situation serait considérée comme tellement problématique qu’elle justifierait l’instauration d’une exception juridique. L’exemple a été cité de la femme d’un assistant sexuel, qui accepte volontiers que son mari exerce cette activité à l’égard d’une personne handicapée, mais qui ne le tolèrerait pas vis-à-vis d’une personne valide. Ce discours qu’on peut juger empreint de pitié ne tend pas à reconnaître l’humanité de la personne en situation de handicap. La création d’une exception au proxénétisme pour l’assistance sexuelle reviendrait donc à dénier symboliquement aux personnes en situation de handicap la possibilité de mener une vie sexuelle en dehors de cette circonstance.
Enfin, la volonté de distinguer parfaitement l’assistance sexuelle de la prostitution est largement démentie par les faits, dans la mesure où les pays qui ont reconnu cette première pratique sont ceux qui réglementent la seconde.
Pour toutes ces raisons, il ne saurait être envisageable, pour la mission d’information, de reconnaître une exception législative au proxénétisme au profit de l’assistance sexuelle.
c) Des possibilités importantes sont ouvertes en l’état du droit
Cette position de principe n’empêche pas les personnes en situation de handicap d’accéder à une vie affective et sexuelle qui leur convienne.
En premier lieu, la législation actuelle n’empêche pas que soit pratiquée une assistance sexuelle qui serait réalisée à titre bénévole. De fait, la mise en relation d’un assistant sexuel bénévole et d’une personne handicapée ne pose aucun problème au regard de la législation pénale sur le proxénétisme. La philosophie humaniste et altruiste qui sous-tend l’assistance sexuelle trouverait d’ailleurs mieux à s’appliquer dans le cadre d’une relation non marchande.
En deuxième lieu, les pratiques qui sont fréquemment décrites comme étant demandées par les personnes handicapées ne relèvent pas de la législation sur la prostitution et le proxénétisme, mais plutôt d’une certaine forme de tendresse et de contact humain. Maîtresse Gilda évoque, par exemple, « une présence physique bienveillante (parler, tenir la main, caresser…) qui peut apporter un réconfort » (1124). Mme Lucie Nayak a souligné que les demandes de rapports pénétratifs étaient rares (1125). Dès lors que tout acte sexuel est exclu, il faut noter que rien ne s’oppose à ce que la personne qui réalise un accompagnement sensuel et affectif soit rémunérée.
En dernier lieu, des actions liées à l’éducation sexuelle des jeunes femmes et des jeunes hommes en situation de handicap, à la sensibilisation des parents et des familles et à la formation de l’ensemble des intervenants et des professionnels des secteurs sanitaire, social et médicosocial peuvent être entreprises dans le cadre législatif actuel et doivent être encouragées, conformément à ce que demandait l’Association des paralysés de France en janvier 2009 (1126). Par exemple, l’enseignement de la masturbation, qui est pratiqué notamment auprès de personnes en situation de handicap mental en Suisse (1127), pourrait trouver sa place dans ce cadre. De même, des professionnels spécifiquement formés devraient être en mesure de conseiller, voire d’assister, deux personnes qui souhaitent avoir des relations sexuelles ensemble mais qui ne le peuvent pas sans aide extérieure.
Il existe donc un certain nombre de possibilités, dans le cadre législatif actuel, pour permettre aux personnes en situation de handicap de mener une vie affective et sexuelle qui leur convienne. Il apparaît d’autant plus souhaitable de maintenir intacts les grands principes qui fondent notre condamnation du proxénétisme, sous toutes ses formes.
IV. – DONNER UN CAP CLAIR ET COHÉRENT AUX POLITIQUES PUBLIQUES, DU PLAN NATIONAL À L’ÉCHELLE LOCALE
Parmi les idées-forces qui ressortent des sept colloques organisés par le Mouvement du Nid au sujet des politiques publiques menées en matière de prostitution, figure un constat exposé à la mission par M. Grégoire Théry : « la prostitution est appréhendée par les politiques publiques sous de multiples angles (social, fiscal, policier, migratoire…) mais ces politiques sont profondément incohérentes, malgré la position abolitionniste formelle de la France. » (1128)
Cette incohérence ne pourra être surmontée que si un cap clair et cohérent est fixé en la matière. La France doit réaffirmer sa position abolitionniste tant à l’échelle nationale qu’internationale. Par ailleurs, les pouvoirs publics auront pour mission de mettre en œuvre cette position, en assurant une meilleure coordination. Enfin, il est nécessaire d’évaluer régulièrement les résultats de la politique menée.
A. RÉAFFIRMER AVEC FORCE LA POSITION ABOLITIONNISTE DE LA FRANCE À L’ÉCHELLE NATIONALE ET INTERNATIONALE
« La France, qui était le pays le plus attaché à la Convention de 1949, n’a plus de position force sur ce dossier. » (1129) C’est par ces termes forts que Mme Malka Marcovich, directrice pour l’Europe de la Coalition contre la traite des femmes (CATW), a interpellé la mission d’information sur ce qu’elle considère être une perte de vigueur de la position française en matière de prostitution.
1. Y a-t-il encore une position française en matière de prostitution ?
La voix de la France semble être moins audible que par le passé, en matière de prostitution. Plusieurs personnes auditionnées ont fait état de cette perte de visibilité de la position française tant au plan national qu’international.
Lors de son déplacement à Lyon, la mission a été particulièrement sensible à l’appel lancé par M. Jean-François Carenco, préfet de la région Rhône-Alpes (1130), qui a estimé ne pas disposer d’une doctrine claire à appliquer en matière de prostitution. Il est significatif que le préfet de l’une des plus grandes régions de France signale avec force la nécessité de définir une nouvelle ligne nationale qui pourrait servir de fil directeur à l’ensemble des politiques publiques à l’échelle nationale comme au niveau local. M. Fabrice Heyries, directeur général de la cohésion sociale, a également pointé le différentiel important entre une position historique officielle de la France (l’abolitionnisme) et le pragmatisme contemporain de l’action de l’État au niveau local, qui finance les acteurs les mieux placés pour l’aider à remplir ses objectifs, quand bien même ces derniers ne partageraient pas sa vision de la prostitution (associations militant, par exemple, pour la reconnaissance d’un statut) (1131).
La même impression se dégage de l’analyse des prises de positions internationales de la France. Mme Malka Marcovich a souligné une tendance de fond de la diplomatie française : « la France est passée d’une position abolitionniste très ferme, notamment lors des négociations pour le protocole de Palerme en 2000, à une position beaucoup plus fluctuante, ces dernières années. » (1132)
Un événement est particulièrement significatif de ce sentiment d’affaiblissement de la doctrine française en matière de prostitution. Dans la version initiale d’une déclaration ministérielle sur les violences faites aux femmes par les pays membres de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), qui devait ensuite être présentée aux Nations unies, figurait l’expression de « prostitution forcée ». Initialement, les autorités diplomatiques françaises soutenaient cette déclaration, qui, a contrario, revenait à reconnaître l’existence d’une prostitution libre, ce qui est absolument contraire à la position internationale historique de la France. L’ambassadeur de France devait la présenter devant les instances de l’ONU (1133). C’est, semble-t-il, grâce à un intense travail de lobbying des organisations féministes françaises que cette expression « prostitution forcée » a pu être retirée in extremis de la déclaration (1134).
Pourtant, lors de la négociation du protocole de Palerme, à la fin des années 1990, les autorités françaises avaient montré une opposition sans faille à la notion de « prostitution forcée », qui était notamment portée par l’Allemagne et les Pays-Bas, menaçant de quitter la table des négociations si cette expression devait être retenue.
Ces prises de position internationales ne sont pas seulement symboliques, dans la mesure où c’est au sein des organisations internationales et européennes que se négocie un nombre croissant de règles juridiques, qui pèsent ensuite sur notre droit interne. D’ailleurs, Mme Michèle Vianès, vice-présidente de la Coordination française pour le lobby européen des femmes (CLEF), a souligné que les États réglementaristes menaient un lobbying très intense auprès des instances européennes et internationales. Par exemple, le Bureau international du travail (BIT) souhaiterait avoir une approche « pragmatique » de la prostitution et reconnaître cette activité comme un métier (1135).
Sur une scène internationale et européenne où les positions sont très tranchées, voire antagonistes, il est donc essentiel que la France défende sa conception abolitionniste de la prostitution et de la traite des êtres humains avec conviction.
2. Donner un cap aux politiques publiques en définissant la position française par le vote d’une résolution
À cette fin, un cap clair doit être réaffirmé et donné à l’ensemble des autorités françaises qui participent à l’élaboration et à l’application des politiques publiques portant sur la prostitution ainsi qu’aux représentations diplomatiques de la France.
Or, sur un sujet de société tel que celui-ci, c’est à la représentation nationale qu’il revient de fixer le cap. Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, les assemblées disposent de la possibilité, sur le fondement de l’article 34-1 de la Constitution, de voter des résolutions, tant qu’elles ne mettent pas en cause la responsabilité du Gouvernement ni ne contiennent d’injonctions à son égard. Une telle procédure a déjà été utilisée à plusieurs reprises afin que l’Assemblée nationale puisse exprimer publiquement sa position dans un domaine donné.
De manière particulièrement significative, on peut citer la résolution parlementaire qui a explicité la réflexion menée par notre Assemblée sur la question de la dissimulation du visage dans l’espace public (1136). Le parallèle est éclairant dans la mesure où cette résolution avait vocation à accompagner un travail législatif en cours. Une résolution a également été adoptée visant à promouvoir l’harmonisation des législations européennes applicables aux droits des femmes (1137).
De la même manière, afin de réaffirmer la position de la France en matière de prostitution, une résolution parlementaire devrait être adoptée. Elle prendrait appui sur l’ensemble des textes internationaux pertinents et ratifiés par la France, que sont, notamment :
– la Convention du 2 décembre 1949 pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, qui fonde la position abolitionniste de la France ;
– le protocole de Palerme ou protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, signé le 15 novembre 2000 et la Convention de Varsovie ou Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005, qui sont les instruments internationaux les plus performants et les plus récents dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains ;
– la Convention CEDAW du 18 décembre 1979, de l’Organisation des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, afin de marquer le fait que la prostitution constitue un obstacle majeur à l’instauration d’une égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Cette résolution devrait rappeler les grands principes juridiques et les valeurs qui guident l’action internationale de la France non seulement en matière de prostitution mais, plus largement, en ce qui concerne le statut du corps humain :
– le principe fondamental du respect de la dignité de la personne humaine, d’où découle l’ensemble des autres grands principes protecteurs de la personne humaine et de son corps ;
– les principes de la non patrimonialité, de l’indisponibilité et de l’inviolabilité du corps humain, qui font obstacle, selon nos conceptions les plus fondamentales, à considérer le corps humain comme un bien marchand ;
– le principe de l’égalité entre hommes et femmes, que la prostitution et la traite des êtres humains mettent à mal.
Enfin, la résolution devrait énoncer clairement les grandes lignes de sa politique en matière de prostitution, à savoir que :
– la meilleure façon de lutter contre l’exploitation sexuelle et la traite des êtres humains à cette fin est de voir diminuer la prostitution ;
– la prostitution est le plus souvent ressentie comme une violence par les personnes qui l’exercent et s’accompagne de nombreuses violences tant physiques que psychologiques ;
– les politiques publiques doivent offrir des alternatives crédibles à la prostitution pour les personnes qui s’y livrent et garantir leurs droits fondamentaux, en mettant en œuvre des politiques sociales ambitieuses et spécifiques ;
– la lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme doivent constituer des priorités politiques ;
– à terme, la France vise l’horizon de la disparition de la prostitution, de l’exploitation sexuelle et de la traite des êtres humains. Cet objectif ne pourra être atteint que par un changement progressif des mentalités et un patient travail de prévention, d’éducation et de responsabilisation des clients ;
– des actions de coopération doivent être menées avec les pays sources de la traite et dans le cadre des institutions internationales et européennes.
proposition n° 25
Voter une résolution parlementaire rappelant les engagements internationaux de la France, les grands principes qui animent son action ainsi que les grands objectifs qu’elle poursuit à travers ses politiques publiques dans le domaine de la prostitution.
B. FAIRE DE LA PROSTITUTION UN OBJET DE POLITIQUES PUBLIQUES
Corrélativement au sentiment d’une perte de force de la position française en matière de prostitution, de nombreux interlocuteurs de la mission ont fait état du sentiment selon lequel la prostitution ne constituerait plus un objet de politiques publiques. « L’impression qui se dégage est l’absence de politique nationale claire en matière de prostitution, chaque direction départementale menant les actions qu’elle souhaite. » (1138), a ainsi estimé Mme Geneviève Duché, vice-présidente de l’Amicale du Nid. Cette situation a déjà été dénoncée à de nombreuses reprises, notamment par le rapport de la sénatrice Dinah Derycke, qui évoquait « l’urgence d’une politique globale » (1139), sans que rien n’ait réellement évolué depuis lors.
1. Un manque de coordination préjudiciable à l’efficacité des politiques publiques, tant en matière d’aide aux personnes prostituées que de lutte contre la traite
Le désengagement de l’État n’a pas seulement été financier. Se dégage en effet le sentiment que ce dernier n’assure plus de pilotage en matière de prostitution, laissant chacun de ses services agir selon sa propre logique, sans coordination d’ensemble.
a) Un désengagement progressif de l’État
En dehors des aspects judiciaires et policiers, la mise en œuvre des politiques publiques, en matière de prostitution, a progressivement été déléguée au secteur associatif. Le désengagement de l’État est particulièrement visible dans le domaine de l’aide sociale aux personnes prostituées, avec la fermeture progressive des services de prévention et de réadaptation sociale (SPRS). Le relais a été pris par les acteurs associatifs, sans pour autant qu’une coordination ne soit toujours effectuée avec les services de l’État (1140). De la même façon, les actions menées en matière de santé publique s’appuient, dans leur très grande majorité, sur les associations de santé communautaire. Enfin, la prévention, notamment auprès des jeunes, relève exclusivement du secteur associatif (1141).
De surcroît, la prostitution ne faisant plus l’objet de politiques publiques spécifiques (1142), les administrations centrales ne disposent pas toujours des compétences nécessaires à la coordination des différentes actions en la matière. À titre d’exemple, le comité de pilotage du réseau Ac.Sé, impliquant tous les services de l’État concernés par la problématique de la traite des êtres humains, la ville de Paris, la Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS), les directions départementales de la cohésion sociale et la coordination du dispositif Ac.Sé, n’a pas pu se réunir depuis plus d’un an faute de désignation d’un référent par la direction générale de la cohésion sociale (DGCS), la personne compétente en matière de prostitution étant partie à la retraite (1143). M. Fabrice Heyries, directeur général de la cohésion sociale, a indiqué avoir découvert ce problème dans le cadre de la préparation de son audition par la mission d’information (1144). Un nouveau référent devrait être choisi, non plus au sein de l’équipe chargée de la lutte contre l’exclusion, mais dans le service des droits des femmes et de l’égalité.
b) Une pluralité d’acteurs compétents
Une pluralité d’acteurs publics et privés détiennent des compétences et agissent dans le domaine de la prostitution. Il s’agit, bien entendu, de la justice, mais également de la police et de la gendarmerie, dans le domaine de la répression de la traite, du proxénétisme et du racolage. Les maires et les préfectures sont compétents en matière de maintien de l’ordre public. Dans le domaine de la santé, les agences régionales de santé collaborent avec les services municipaux et surtout avec les associations de santé communautaire. Enfin, dans le domaine social, les directions départementales et régionales de la cohésion sociale partagent leurs compétences avec les conseils généraux, les actions de terrain relevant en général des associations qui prennent la forme de centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS).
PRINCIPAUX ACTEURS PUBLICS ET PRIVÉS INTERVENANT DANS LE DOMAINE
DE LA PROSTITUTION AU NIVEAU LOCAL
Compétence générale |
Préfet Déléguées régionales et chargées de mission départementales aux droits des femmes Maires |
Forces de l’ordre |
Office central pour la répression de la traite des êtres humains (compétence nationale) Police judiciaire Sûreté publique Brigade des mineurs |
Justice |
Juridictions interrégionales spécialisées Parquet Juges des enfants Associations d’accès au droit |
Droit au séjour |
Bureau des étrangers de la préfecture Associations spécialisées |
Champ social et insertion professionnelle |
Conseil général Directions départementales de la cohésion sociale Associations d’aide sociale (CHRS) et de santé communautaires Pôle Emploi Services fiscaux URSSAF |
Santé |
Agences régionales de santé Associations de santé communautaires Services de santé, notamment de dépistage et d’urgences |
C’est dire le nombre d’acteurs compétents à un titre ou à un autre, sur un territoire donné, en matière de prostitution. Par ailleurs, les compétences de chacun ne sont pas forcément bien définies. M. Fabrice Heyries a ainsi indiqué qu’il existait parfois des recoupements de compétences, notamment entre les assistantes sociales de secteurs, qui relèvent des départements, et les travailleurs sociaux des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) qui sont financés par l’État (1145).
c) Un manque flagrant de coordination
« Il existe ainsi une réelle complexité dans le pilotage des politiques sociales en direction des personnes prostituées » (1146), a-t-il estimé, indiquant ne pas être en mesure de fournir le montant total des crédits consacrés aux politiques sociales en direction des personnes prostituées par les départements. Ce constat est généralisable à l’absence de coordination entre services publics et initiatives privées. Toutes les politiques visant à une meilleure coordination entre acteurs sont restées lettre morte, ainsi que le pointait déjà le rapport consacré par le Sénat à la prostitution en 2000 (1147).
Plusieurs circulaires prévoyaient la réunion, sous la responsabilité des préfets, d’une commission comprenant les représentants des différents services publics dans le département et des organismes privés œuvrant dans le domaine de la prostitution. Malgré plusieurs rappels, ces commissions n’ont jamais vu le jour (1148) et l’État semble avoir abandonné cette ambition faute de volonté politique réelle.
D’ailleurs, à plusieurs reprises lors de ses déplacements en France, la mission a pu constater que sa venue constituait pour certains acteurs publics, la première occasion de dialoguer ensemble, alors qu’ils agissent sur le même territoire et devraient mener une politique concertée. Ainsi, M. Francis Vuibert, préfet délégué à l’égalité des chances dans le Rhône, a indiqué à la mission qu’il n’existait pas de réunion régulière entre les services de l’État sur la thématique de la prostitution, qu’aucune action particulière n’était menée en la matière par les services déconcentrés des droits des femmes et qu’aucune rencontre n’avait lieu entre les services de l’État et les associations sur ce sujet (1149).
2. Faire travailler ensemble les acteurs locaux au service de la réinsertion des personnes prostituées
Une plus grande coordination entre acteurs publics et avec le secteur associatif devrait être envisagée au plan local afin que les personnes prostituées puissent bénéficier de l’accompagnement intégral précédemment évoqué. Il s’agit de créer un véritable parcours fléché.
a) Créer un lieu de pilotage des politiques publiques locales
Toute coordination, pour être efficace, nécessite un lieu de rencontre et de dialogue. En l’absence de commissions départementales ad hoc, qui n’ont jamais vu le jour malgré les circulaires précitées, certains départements ont mis en œuvre des structures originales permettant cette coordination.
Le cas de Nice a été cité à de nombreuses reprises durant les auditions. Au milieu des années 2000, une organisation informelle réunissant, autour d’un membre du corps préfectoral, des associations et des représentants des forces de l’ordre a permis de mieux prendre en compte la situation des victimes de la traite. Durant une période de trois ans, grâce au sous-préfet en poste à l’époque, ont été développés par l’association ALC des pôles d’activité (apprentissage du français, métiers du tourisme et de l’hôtellerie…). Un titre de séjour était délivré aux personnes désirant entreprendre un parcours de formation, à l’issue duquel celui-ci pouvait être renouvelé. Entre 43 et 45 personnes ayant bénéficié de ce programme, sur 50, ont mené à bien leur formation et obtenu un emploi. Certaines d’entre elles occupent aujourd’hui des postes à responsabilité dans les structures hôtelières de Nice. Cette réussite a été rendue possible par la coordination informelle (avec des réunions de coordination et de synthèse) qui s’était créée entre la préfecture, la police, la justice et l’association ALC. Par ailleurs, un groupe informel d’enquêteurs de la police judiciaire, de la sûreté urbaine, des douanes et de la police municipale, qui a produit des résultats très intéressants, avait été créé (1150). Mais, avec le départ du préfet de département cette dynamique s’est brisée (1151).
De façon générale, cette coordination pourrait être effectuée au sein des conseils départementaux de prévention de la délinquance (CDPD), d’aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes (1152), ainsi que l’a suggéré M. Francis Vuibert, préfet délégué à l’égalité des chances dans le Rhône (1153). Ces conseils, présidés par le préfet de département, ont notamment pour mission d’élaborer « des programmes de lutte contre les violences faites aux femmes. » (1154) Au sein de certains de ces comités, des sous-commissions portant spécifiquement sur les violences faites aux femmes ont pu être créées. Tel est notamment le cas en Île-de-France, à l’initiative de la déléguée régionale aux droits des femmes, ainsi que dans de nombreux autres départements, comme l’a confirmé le ministère de la Cohésion sociale (1155).
Les CDPD peuvent constituer des lieux de coordination adaptés à la problématique de la prostitution. En effet, ils réunissent, outre le préfet, le procureur de la République et le président du conseil général, ainsi que des magistrats, des représentants des services de la police, de la gendarmerie, des droits des femmes et de l’égalité, des affaires sanitaires et sociales, de l’éducation nationale, de la protection judiciaire de la jeunesse, de l’emploi et des finances. En sont également membres des représentants des collectivités territoriales et des associations œuvrant dans ses domaines de compétence (1156).
Pour en faire un lieu de coordination, il serait nécessaire d’ajouter à la liste de ses missions celle d’élaborer et de piloter la mise en œuvre, au plan départemental, de l’accompagnement intégral des personnes prostituées. De cette façon, les associations spécialisées seraient de droit membres du CDPD, qui deviendrait, de facto, une structure de coordination des politiques publiques menées en direction des personnes prostituées. À cette fin, il serait indispensable que tous les CDPD se dotent d’une sous-commission « traite des êtres humains et prostitution », sur le modèle des sous-commissions portant sur les violences faites aux femmes. C’est d’ailleurs ce que préconise le plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2011-2013) (1157).
À un niveau plus local, il serait souhaitable que les états-majors de sécurité abordent la thématique de la prostitution au moins une fois par an, notamment afin de dresser un état des lieux actualisé de la prostitution. Si la prostitution est présente sur une commune, cette thématique pourrait également être abordée en conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD).
proposition n° 26
Créer un organe local de pilotage des politiques publiques en direction des personnes prostituées :
– en ajoutant aux missions des comités départementaux de prévention de la délinquance (CDPD) l’élaboration et le pilotage de l’accompagnement intégral des personnes prostituées et la lutte contre la traite (décret) ;
– en créant au sein de chaque comité départemental de prévention de la délinquance (CDPD) une sous-commission chargée de la prostitution et de la traite des êtres humains (décret) ;
– en donnant instruction aux conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance de consacrer au moins une réunion par an à un état des lieux de la prostitution si cette dernière existe dans la zone concernée (circulaire du ministère de l’Intérieur).
b) Définir un parcours fléché pour les personnes qui souhaitent sortir de la prostitution en désignant des référents
Au cours de ses déplacements en région, la mission d’information a pu constater que bien souvent, outre l’absence de coordination entre acteurs, les services publics compétents en matière d’accompagnement des personnes prostituées n’avaient pas désigné de personne référente pour suivre ce dossier, voire ne menaient aucune politique spécifique en leur direction. Pour mettre en œuvre un véritable accompagnement des personnes prostituées, il est pourtant essentiel qu’elles puissent trouver au sein de chaque service public un interlocuteur compétent qui connaisse l’ensemble de ses homologues dans les différentes structures susceptibles de les accompagner.
Divers services publics ont ainsi désigné un référent qui connaît particulièrement les problématiques spécifiques à l’accompagnement des personnes prostituées qui désirent changer d’activité.
Par exemple, à Lyon, une petite équipe est chargée de l’insertion professionnelle des personnes prostituées au sein d’une agence de Pôle Emploi désignée à cet effet (1158). Pour mener à bien cette mission, Pôle emploi a noué des contacts étroits avec l’Amicale du Nid, le Mouvement du Nid, Cabiria et la brigade de lutte contre le proxénétisme qui proposent l’accompagnement d’insertion professionnelle puis dirigent les personnes volontaires vers l’agence de Pôle Emploi. Un partenariat a également été conclu avec la direction départementale du travail et de l’emploi et avec la préfecture, afin de faciliter la régularisation administrative de ces personnes, condition première de toute insertion professionnelle.
À Paris, une personne de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) intervient directement au sein de l’association des Amis du bus des femmes, servant d’interlocuteur de proximité et de porte d’entrée à la CPAM.
Néanmoins, dans un cas comme dans l’autre, ce partenariat repose avant tout sur la présence d’individualités et serait susceptible d’être remis en cause si ses animateurs venaient à quitter leur poste. Ainsi, le partenariat entre Pôle emploi et la police judiciaire a-t-il été interrompu dans le Rhône en raison du changement de poste du capitaine de police qui s’en chargeait. M. Patrick Lescure, directeur régional de Pôle Emploi dans le Rhône, a pourtant souligné que seuls des partenariats avec les associations, la police et la préfecture permettaient la réussite de ces dispositifs mais que ces derniers étaient fragilisés par l’absence d’organisation institutionnelle (1159). Ainsi, il a été établi que l’orientation vers Pôle Emploi nécessitait que les victimes soient accompagnées par l’association au premier rendez-vous, faute de quoi le taux d’absentéisme était élevé. L’absence de coordination avec la préfecture a pu être désignée comme étant l’un des facteurs majeur de l’échec de l’insertion professionnelle, dans la mesure où les victimes étrangères de la traite se voient délivrer uniquement des autorisations provisoires de séjour de trois mois, ce qui ne permet pas la réalisation d’une formation.
Dans d’autres régions, aucune prise de conscience de la spécificité de la situation des personnes prostituées ne semble avoir eu lieu. Ainsi, à Marseille, il a été souligné qu’aucune action d’accompagnement, de suivi ou d’accueil n’était actuellement menée et qu’aucun référent n’avait été désigné par Pôle Emploi en la matière (1160). De la même manière, les directions régionales des finances publiques de Rhône-Alpes et de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, ainsi que les URSSAF de Lyon et de Marseille (1161) ne portent aucune attention particulière à la situation des personnes prostituées, alors que plusieurs associations de santé communautaire ont signalé que les projets de réinsertion des personnes prostituées étaient parfois remis en cause par des rappels importants de cotisations sociales ou d’impôts (1162).
Il paraît essentiel de systématiser, à l’échelle nationale, les bonnes pratiques qui ont pu être mises en place au niveau local, souvent à la suite d’initiatives individuelles et donc précaires. Devrait ainsi être désigné, dans chaque service public appelé à participer à l’accompagnement intégral des personnes prostituées, un ou plusieurs référents. De cette manière, pourra être constitué un réseau informel capable d’orienter les personnes prostituées vers le bon interlocuteur et susceptible de servir de porte d’entrée au sein d’un organisme public. L’ensemble de ces référents devraient appartenir à la sous-commission portant sur les violences faites aux femmes au sein du CDPD, ce qui renforcerait son rôle de pilotage des politiques publiques à l’échelle départementale.
Le cas échéant, ces personnes référentes pourraient intervenir directement au sein des structures associatives, lorsque le besoin est tel qu’une présence directe se justifie. Dans tous les cas, les associations, qui sont en première ligne dans l’accompagnement des personnes prostituées, devraient faire partie intégrante de ce réseau partenarial.
A minima, une personne référente devrait être désignée, notamment dans les grandes agglomérations, dans les services des préfectures (bureau des étrangers), des grandes mairies, des conseils généraux, de Pôle Emploi, des URSSAF, de l’assurance maladie, de l’assurance vieillesse et des finances publiques. Il est évident que les services de police compétents ainsi que le parquet devraient également faire partie de ce réseau local.
Le cas échéant, cette coopération locale pourrait être formalisée, dans un second temps, par la conclusion d’une convention de partenariat entre ces différentes institutions afin de conforter le travail en réseau.
proposition n° 27
Créer, dans chaque grande agglomération urbaine, un réseau de personnes référentes qui puisse orienter et accompagner les personnes prostituées dans leurs démarches et qui connaisse la spécificité de leur situation.
Devraient notamment désigner des référents : les préfectures, les mairies, les conseils généraux, Pôle Emploi, les URSSAF, l’assurance maladie, l’assurance vieillesse et l’administration des finances publiques.
c) Coordonner les acteurs pour la protection des victimes de la traite
Une meilleure coordination devrait également voir le jour dans le domaine de la traite des êtres humains.
Une expérience pilote a été menée à Lyon, qui a récemment donné lieu au renouvellement de la convention de partenariat conclue entre l’ensemble des acteurs.
L’expérience de la convention-cadre contre la traite des êtres humains, signée à Lyon
Une première collaboration entre acteurs est née dans le cadre du projet ACTES, de 2005 à 2007, qui avait pour ambition une meilleure coordination dans la prise en charge des victimes de la traite en provenance d’Europe de l’Est.
À l’issue de ce projet, une convention-cadre a été signée, en 2008, entre l’État (préfecture), la justice (siège et parquet), les associations et l’ordre des avocats. Cette convention avait un champ plus large que celui du projet ACTES puisqu’elle concernait toutes les formes contemporaines d’esclavage et qu’elle prenait également en compte le cas des personnes originaires d’Afrique. Elle avait pour but : la prévention de la traite, l’identification des victimes, la reconnaissance, par ces dernières, de leur statut de victime, une meilleure information et un meilleur accès au droit, l’incitation au dépôt de plainte et la coordination des mesures de protection.
Un comité de pilotage a été créé, réunissant tous les acteurs, pour fixer les orientations générales, suivre la mise en œuvre de la convention-cadre et en évaluer les résultats.
Dans ce cadre, il revenait à la préfecture de gérer la délivrance des titres de séjour et l’attribution de l’allocation temporaire d’attente ainsi que de faire l’interface avec l’ensemble des services de la préfecture, en cas d’urgence particulière.
Le barreau de Lyon a participé à la coordination avec le souci de former les professionnels et d’informer les victimes. Une vingtaine d’avocats spécialisés ont ainsi fourni des consultations juridiques dans les locaux de l’Amicale du Nid.
L’Amicale du Nid devait assurer l’accompagnement social des victimes, la Croix-Rouge, leur assistance psychologique et l’association VIFF, un soutien psychosocial durant toute la durée de la procédure pénale.
Cette convention a été renouvelée en 2010.
Source : Déplacement à Lyon du 16 décembre 2011.
L’expérience lyonnaise sert de modèle à d’autres parquets, qui tentent de mettre en œuvre des coordinations comparables. Mme Véronique Degermann, chef de section du parquet pour la juridiction interrégionale spécialisée de Paris en charge du proxénétisme, souhaite mettre en place d’ici peu un protocole de prise en charge des victimes, en coordination avec les services de police et les associations (1163).
Il faut noter que cette expérience n’est pas transposable telle quelle à l’ensemble des grandes villes françaises. Elle n’a été rendue possible que par le travail qui avait été réalisé antérieurement, dans le cadre du projet ACTES (1164). Il est cependant envisageable, à moyen terme, de généraliser ce type de partenariat, sur la base de la coopération qui aura pu s’instituer au sein des sous-commissions départementales dédiées à la traite des êtres humains et à la prostitution. C’est ce que préconise le plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2011-2013) (1165).
3. Créer une véritable coordination nationale pour piloter la politique de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution
Le constat de l’absence de « feuille de route nationale » (1166) en matière de prostitution est également valable pour ce qui est de la traite des êtres humains ; il doit inciter les pouvoirs publics à créer une véritable coordination nationale dans ces deux domaines.
a) Créer une coordination nationale interministérielle sur la traite des êtres humains…
Le groupe de travail interministériel pour la protection et la prise en charge des victimes de la traite des êtres humains, créé en décembre 2008 et copiloté par le ministère de la Justice et le ministère de l’Intérieur, qui a rendu ses conclusions en 2010, fait le constat de l’insuffisante coordination des politiques publiques menées en matière de traite des êtres humains au niveau national.
La création d’une coordination nationale interministérielle constitue la première mesure du plan d’action national élaboré par ce groupe de travail. Les acteurs compétents dans ce domaine sont nombreux et la lutte contre cette infraction nécessite une action dans de nombreux secteurs des politiques publiques (action sociale, police, justice, santé, affaires étrangères et immigration notamment) et en partenariat avec les acteurs associatifs (1167).
La mission d’information a pu constater l’utilité d’une telle structure lors de son déplacement en Suède, où elle a rencontré M. Patrik Cederlöf, coordinateur national contre la prostitution et le trafic d’êtres humains (1168). En Suède, la coordination comprend des représentants de la police (police judiciaire, renseignement, pédopornographie et unités opérationnelles de lutte contre la prostitution), du parquet, de l’agence nationale des migrations et des services sociaux spécialisés dans l’accompagnement des personnes prostituées.
La coordination a notamment pour mission de produire des manuels, des supports pédagogiques et d’assurer des formations. 5 000 personnes ont ainsi été formées entre 2009 et 2010. Des procédures types ont été élaborées dans le domaine judiciaire et dans celui du repérage des victimes notamment. La coordination fournit également un soutien opérationnel pour faire entrer différentes autorités en contact les unes avec les autres. Par exemple, un policier du nord de la Suède qui n’est pas un expert en matière de traite des êtres humains peut contacter la coordination, qui le mettra en relation avec l’institution compétente.
La mise en œuvre de cette coordination revêt une valeur obligatoire, sur le fondement des articles 5 et 29 de la Convention de Varsovie (1169). Le premier paragraphe de l’article 5 prévoit que « chaque Partie prend des mesures pour établir ou renforcer la coordination au plan national entre les différentes instances chargées de la prévention et de la lutte contre la traite des êtres humains. » Le deuxième paragraphe de l’article 29 précise que « chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour assurer la coordination de la politique et de l’action des services de son administration et des autres organismes publics luttant contre la traite des êtres humains, le cas échéant en mettant sur pied des instances de coordination. »
Sur le fondement de ces deux articles, 27 des 30 États parties au traité ont d’ores et déjà créé une structure nationale de coordination, mais tel n’est pas le cas de la France. Pour remédier à ce retard, un projet de décret instituant une coordination nationale semble être en cours de signature depuis l’été 2010, sans avoir abouti à l’heure actuelle. Aucun obstacle ne faisant barrage à la création de cette coordination, celle-ci doit être mise en œuvre le plus rapidement possible.
b) …qui serait également compétente en matière de prostitution
Dans le domaine de la prostitution, la coordination est également balbutiante au niveau interministériel, faute de ligne politique claire. Cependant, plusieurs évolutions récentes tendent à montrer le retour d’une volonté politique plus affirmée en la matière, qui s’est traduite par une meilleure collaboration entre ministères. Trois exemples en sont emblématiques.
En premier lieu, la prostitution constitue, pour la première fois, un axe d’action du plan triennal de lutte contre les violences faites aux femmes. Cette inclusion est particulièrement intéressante, dans la mesure où ce plan est interministériel et fournit donc un cadre global dans lequel s’inscrivent les politiques publiques.
En deuxième lieu, l’élaboration du plan national de lutte contre le VIH/sida et les autres infections sexuellement transmissibles 2010-2014 a donné lieu à un travail interministériel, associant notamment le service des droits des femmes et de l’égalité (SDFE). Ce plan constitue le principal outil de programmation dans la lutte que mènent les pouvoirs publics et leurs partenaires (professionnels de santé, acteurs économiques et milieu associatif) contre ces infections. Or, ainsi que cela a été évoqué, ce plan comprend également un axe en direction des personnes prostituées. Ainsi, son élaboration a été le lieu d’un travail interministériel sur l’accès aux soins des personnes prostituées. Il est également prévu que le SDFE assure l’articulation de ce plan avec le plan triennal de lutte contre les violences faites aux femmes.
En troisième lieu, la décision a été prise d’identifier clairement et de sanctuariser les moyens consacrés à l’accompagnement des personnes prostituées. Ces derniers seront désormais, tant au niveau national que local, sous la responsabilité des services des droits des femmes et non plus sous celle, plus générale et moins interministérielle, de la cohésion sociale. Ainsi, les crédits dédiés à l’accompagnement social des personnes prostituées doivent être transférés, en 2012, du programme « Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables » (n° 177) au programme « Égalité entre les hommes et les femmes » (n° 137), afin de les sanctuariser et d’empêcher leur fongibilité. De cette façon, les crédits ne pourront plus être consacrés à d’autres publics et seront gérés directement pour les services des droits des femmes.
Cette meilleure coordination et ce pilotage plus satisfaisant au plan national, pour indispensables qu’ils soient, restent cependant insuffisamment systématiques au regard de l’importance des partenariats à nouer. Se pose dès lors la question de la structure adéquate pour assurer ce pilotage. Il apparaît à la mission d’information que la création d’une coordination interministérielle en matière de traite des êtres humains devrait être l’occasion d’engager un effort comparable pour ce qui est de la prostitution.
Ces deux thématiques ne se recouvrent pas totalement, dans la mesure où la traite des êtres humains peut être effectuée à d’autres fins que l’exploitation sexuelle (exploitation domestique par exemple) et où toutes les personnes prostituées n’ont pas été victimes de la traite. Cependant, à n’en pas douter, la majorité des victimes de traite est utilisée à des fins d’exploitation sexuelle. De surcroît, le pourcentage de personnes étrangères dans les chiffres de la prostitution est considérable et en constante augmentation, laissant présager un taux de victimes de traite très élevé. Il y aurait donc une forte cohérence thématique à rendre la coordination compétente à la fois en matière de traite des êtres humains et de prostitution afin de pouvoir prendre en compte la totalité du processus.
D’ailleurs, les acteurs publics et associatifs sont en grande partie identiques. Les associations qui ont fait partie du groupe de travail interministériel sur la traite œuvrent, pour beaucoup d’entre elles, au contact direct des personnes prostituées ou sur la thématique de la prostitution. C’est le cas de l’Amicale du Nid, de la fondation Scelles, des Amis du bus des femmes, de l’association ALC dont la prostitution est le champ d’activité principal, voire pratiquement exclusif. En ce qui concerne les ministères, tous les acteurs compétents en matière de prostitution étaient représentés (Justice, Intérieur, Cohésion sociale et Immigration), à la seule exception du ministère de la santé.
Afin de disposer d’une coordination interministérielle nationale dans le domaine de la prostitution, la meilleure solution est ainsi de prévoir que la coordination nationale qui doit prochainement être créée sur la traite des êtres humains soit également compétente en matière de prostitution. La création d’une structure unique par les autorités suédoises peut servir d’exemple : elle donne pleine satisfaction à chacun des acteurs engagés (1170).
proposition n° 28
Créer une coordination nationale interministérielle de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution (décret).
C. ÉVALUER LES RÉSULTATS DES POLITIQUES PUBLIQUES
Afin de créer un cercle vertueux dans la mise en œuvre des politiques publiques, ces dernières doivent être évaluées de manière régulière et, si possible, indépendante, cette évaluation ne pouvant être effectuée de manière satisfaisante que si l’on dispose d’un état des lieux de la prostitution en France.
1. Nommer un rapporteur national sur la traite des êtres humains et la prostitution
À plusieurs reprises, la mission d’information a pu constater le manque de données chiffrées sur la traite des êtres humains et la prostitution et de caractère comparable des données issues de chacune des administrations (condamnations judiciaires, nombre de gardes à vue, nombre de titres de séjour délivrés, nombre de victimes accompagnées…) ou acteurs associatifs (1171).
C’est cette mission première de collecte d’informations qui a animé les nombreuses instances qui, depuis 1997, ont recommandé la création d’un réseau européen de rapporteurs nationaux sur la traite. La préconisation de créer un rapporteur national sur la traite figure dans une déclaration ministérielle de 1997, dans une résolution du Parlement européen de 2000 et dans des recommandations du Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme de 2002 et du groupe d’experts de la Commission européenne sur la traite des êtres humains de 2004 (1172).
La Convention de Varsovie, dans le quatrième alinéa de son article 29, reprenait cette préconisation sans en faire pour autant une obligation pour les États parties : « Chaque Partie envisage de nommer des rapporteurs nationaux ou d'autres mécanismes chargés du suivi des activités de lutte contre la traite menées par les institutions de l’État et de la mise en œuvre des obligations prévues par la législation nationale. » (1173)
Depuis lors, la directive sur la traite des êtres humains fait de la création d’un rapporteur national une obligation pour la France. Son article 19 oblige les États membres à mettre en place « des rapporteurs nationaux ou des mécanismes équivalents ». La mission de cette structure consisterait « notamment à déterminer les tendances en matière de traite des êtres humains, à évaluer les résultats des actions engagées pour lutter contre ce phénomène, y compris la collecte de statistiques en étroite collaboration avec les organisations pertinentes de la société civile qui sont actives dans ce domaine, et à établir des rapports. » Il est à noter que la directive, dans son article 20, évoque la « coordination de la stratégie de l'Union en matière de lutte contre la traite des êtres humains », et crée, en niveau communautaire, un « coordinateur européen de la lutte contre la traite des êtres humains ».
Or, une telle structure est inexistante en France. À l’heure actuelle, une partie de ces missions incombe à l’OCRTEH. Cependant, le rapport annuel de cet office ne porte que sur la dimension policière de la lutte contre la traite et n’évalue aucunement les politiques publiques en la matière ni ne collecte de statistiques auprès des associations. De plus, sa mission ne porte que sur la lutte contre la traite à des fins d’exploitation sexuelle et non pas contre toutes les formes de traite. Pour pallier cette absence, le groupe de travail interministériel a rédigé un avant-projet de loi visant à créer un rapporteur national indépendant en charge de promouvoir les règles relatives à la prévention et à la répression de la traite ainsi qu’à la protection des victimes, dont la création prochaine a été annoncée par M. Brice Hortefeux, ministre de l’Intérieur, lors d’une séance de questions au Sénat (1174). Cependant, cet avant-projet de loi n’a, pour l’heure, pas été déposé au Parlement.
D’après M. Brice Hortefeux, ce rapporteur devrait prendre la forme d’une « sorte d’autorité administrative indépendante » (1175). Cette solution semble être la plus conforme avec le rapport explicatif sur la Convention de Varsovie, qui préconise de prendre exemple sur le rapporteur national des Pays-Bas, « doté de son propre personnel, qui a pour mission d’assurer le suivi des activités de lutte contre la traite. Il a le pouvoir d’enquêter et de faire des recommandations aux personnes et institutions concernées et rend un rapport annuel au Parlement contenant ses constatations et recommandations. » (1176)
Au cours de son déplacement aux Pays-Bas, la mission d’information a eu l’occasion de rencontrer la rapporteure nationale sur la traite des êtres humains, Mme Corinne Dettmeijer-Vermeulen, qui a fait état des avantages indéniables que lui conférait son indépendance pleine et entière, notamment dans ses relations avec la société civile. Elle dispose en effet de son propre personnel, qui est pris en charge par cinq ministères différents, et est elle-même magistrate de formation. Son principal travail consiste à collecter les données disponibles en matière de traite et à formuler des préconisations pour améliorer les politiques publiques (1177). Ces éléments sont rendus publics par l’intermédiaire d’un rapport annuel tout à fait substantiel (1178). Il apparaît qu’un tel modèle doive être privilégié par rapport à celui qui a été adopté par la Suède, où la fonction de rapporteur national sur la traite a été confiée à un officier de police du ministère de l’Intérieur, Mme Kajsa Wahlberg, depuis 1998, date de sa création (1179).
La compétence de ce rapporteur ne porterait pas uniquement sur la traite des êtres humains. De même que pour la coordination interministérielle, le rapporteur devrait également être compétent dans le domaine de la prostitution. Cette extension permettrait de disposer de données fiables et neutres, qui seraient particulièrement utiles, notamment pour évaluer l’impact de la pénalisation des clients.
proposition n° 29
Conformément à l’article 19 de la directive sur la traite, créer un rapporteur national sur la traite des êtres humains et la prostitution, chargé de collecter les données disponibles, d’évaluer les politiques publiques, d’échanger des informations avec ses homologues étrangers et de publier un rapport annuel (loi).
2. Mener une grande enquête scientifique sur la prostitution en France
Face au manque de données concernant la prostitution, la création d’un rapporteur national n’est pas suffisante. Il est également nécessaire de disposer dans un futur proche d’un état des lieux de la prostitution en France afin de pouvoir mesurer l’impact des évolutions des politiques publiques. Un tel tableau initial d’ensemble paraît avoir fait défaut en Suède (1180), rendant plus difficiles les comparaisons ultérieures. En revanche, un bilan sur la prostitution en Norvège a été fait en amont de la loi. Cette cartographie sera probablement un élément central dans une future évaluation des effets de la législation, selon les informations fournies par l’ambassade de Norvège en France (1181).
De fait, comme l’a indiqué M. Lilian Mathieu, sociologue, toute évaluation quantitative est difficile dans le domaine de la prostitution, cette activité étant souvent cachée, notamment depuis l’adoption de la loi sur la sécurité intérieure en 2003 (1182). Dès lors, toute méthodologie d’enquête doit prendre en compte ce facteur. Certaines méthodes d’enquête devraient cependant pouvoir être envisagées, dans la mesure où elles ont déjà partiellement fait leur preuve.
En premier lieu, une étude universitaire devrait être conduite au plan national pour dresser un état des lieux aussi bien quantitatif que qualitatif de la prostitution en France. L’enquête nationale sur les violences faites aux femmes (ENVEFF), réalisée en 2000, avait permis de mettre en lumière l’importance des violences au sein du couple au moyen d’une enquête sur un échantillon représentatif, avec un questionnaire administré par téléphone à près de 7 000 femmes. Une telle méthodologie pourrait être reproduite en matière de prostitution, afin d’approcher un premier chiffre, global, de la prostitution en France et de quantifier, au moins partiellement, les grandes causes de ce phénomène ainsi que sa diversité. Mme Roselyne Bachelot, ministre des Solidarités et de la cohésion sociale, s’était dite prête à contribuer au financement d’une telle étude, qui serait menée par des statisticiens et des universitaires (1183). Cette étude, commandée, par exemple, par le service des droits des femmes et de l’égalité (comme l’avait été l’ENVEFF), serait pilotée par un comité composé d’universitaires, chargé, dans un premier temps, de définir une méthodologie.
En deuxième lieu, une attention particulière devrait être portée à la prostitution étudiante, pour laquelle l’absence de données alimente tous les fantasmes. Là encore, quelques études existantes ont permis de baliser la méthodologie qui pourrait être employée. Ainsi, trois études ont été menées, dont deux par l’Amicale du Nid à Nantes et à Montpellier et une par le service universitaire de médecine préventive de Poitiers (1184). Cette dernière enquête repose sur l’analyse de plus de 2 600 questionnaires remplis par les étudiants. De telles études, qui pourraient être élargies à un niveau national, et dont la méthodologie devrait être élargie pour accroître sa scientificité, sont donc possibles. Là encore, il reviendrait au pouvoir politique de donner l’impulsion nécessaire en passant commande d’une telle enquête auprès d’universitaires. Son pilotage pourrait être effectué par l’Observatoire national de la vie étudiante, ainsi que l’ont suggéré les représentants de plusieurs syndicats étudiants (1185).
En dernier lieu, une enquête sur les besoins des personnes prostituées devrait être réalisée, visant notamment à adapter en conséquence l’accompagnement proposé par les pouvoirs publics. Ce type d’enquêtes, plus qualitatives, pourrait être réalisé par entretiens. Dans le domaine de la santé, la Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS) a mis au point, en partenariat avec le ministère de la Santé et l’Institut national de veille sanitaire, une grande étude dite « Prosanté » qui a débuté en juin 2010 et qui devrait se terminer en 2011. Il s’agit de mener une enquête sur les personnes prostituées qui fréquentent des centres associatifs avec l’objectif de recueillir entre 350 et 500 témoignages. Cette enquête comporte un volet social qui sera établi avec l’aide d’un travailleur social et un volet médical qui sera complété par un médecin. Dans ce cadre, il sera possible de dresser des comparaisons entre le groupe des personnes prostituées et l’ensemble de la population (1186).
Une enquête de ce type devrait permettre de croiser les informations dont tous les acteurs disposent et porter, en conséquence, sur le panel le plus large possible de personnes prostituées.
proposition n° 30
Pour améliorer notre connaissance de la prostitution :
– commander une enquête universitaire visant à dresser un état des lieux de la prostitution dans sa globalité (service du droit des femmes et de l’égalité) ;
– demander à l’Observatoire national de la vie étudiante de mener une enquête sur la prostitution étudiante (ministère de l’Enseignement supérieur) ;
– mener une enquête visant à évaluer les besoins des personnes prostituées en matière d’accompagnement (ministère de la Cohésion sociale).
EXAMEN DU RAPPORT EN COMMISSION
Au cours de sa réunion du mercredi 13 avril 2011, la Commission procède à l’examen du rapport de la mission d’information présenté par M. Guy Geoffroy, rapporteur.
M. le président Jean-Luc Warsmann. Je laisse à présent la parole à Mme Danielle Bousquet et M. Guy Geoffroy, respectivement présidente et rapporteur de la mission d’information sur la prostitution en France, pour la présentation du rapport d’information adopté par celle-ci.
Mme Danielle Bousquet, présidente de la mission d’information. La mission d’information dont l’objet portait sur la prostitution en France a entamé ses auditions en septembre 2010. Elle a mené un travail exhaustif, sans idées préconçues.
Nous nous sommes en effet attachés à entendre des intervenants divers et à examiner, de manière ouverte, leurs propositions, qu’elles émanent d’associations de personnes prostituées, de chercheurs, de philosophes, de juristes ou de médecins.
La mission d’information a auditionné plus de 200 personnes et effectué sept déplacements, dont quatre hors de France, afin d’inscrire sa réflexion dans une démarche comparative vis-à-vis des législations étrangères, notamment européennes.
Le résultat de ce travail est un rapport remarquable de Guy Geoffroy. Il a été adopté, ce matin, à l’unanimité par la mission d’information.
Cette unanimité souligne combien ce rapport montre de manière objective la réalité du système prostitutionnel français et transcende les faux débats, tels que celui sur l’opportunité d’une réouverture des maisons closes ou celui sur la liberté individuelle des personnes prostituées. Les enjeux dépassent de loin ces faux débats. Mais je laisse à présent au rapporteur, dont je salue le travail, le soin de vous faire part de nos constats et propositions.
M. Guy Geoffroy, rapporteur. Je tiens à dire en premier lieu la fierté que j’ai à présenter aujourd’hui ce rapport après son adoption par la mission d’information.
Nous avons su travailler, avec l’ensemble des membres de la mission, dans un esprit positif et réfléchi. Nous avons atteint, me semble-t-il, nos objectifs. Nous avons étudié ce sujet complexe, délicat et bien souvent douloureux, sans a priori, afin de faire non pas œuvre de moralisateurs mais œuvre d’acteurs publics éclairés, œuvre de juristes, puisque cette mission a trouvé sa place au sein de la commission des Lois, et œuvre de responsables politiques. Toutes les familles politiques représentées au sein de la mission ont travaillé dans une belle harmonie républicaine.
Je salue notre présidente, ainsi que tous les membres de la mission dont les réflexions ont été autant de contributions décisives.
Nous avons pu clore ce long travail d’entretiens et de déplacements par trois rencontres décisives avec les ministres concernés par la question de la prostitution : Mme Roselyne Bachelot, M. Michel Mercier et M. Claude Guéant. Nous avons reçu d’entre eux un accueil extrêmement intéressé et positif, chacun nous faisant savoir son intérêt pour la globalité de notre réflexion.
Nous avons souhaité travailler en partant des principes qui fondent notre République : l’égalité entre les hommes et les femmes, le respect de la dignité, la lutte contre les violences quelles qu’elles soient, notamment les violences de genre. Beaucoup des réflexions que nous avons menées trouvent des points de convergence non surprenants avec le travail fourni dans le cadre de la mission sur les violences faites aux femmes.
Notre travail s’est déroulé à plusieurs niveaux. D’une part, nous avons tenté de réaliser un état des lieux de la prostitution, ce qui n’a pas été une mince affaire. D’autre part, nous avons mené une réflexion sur la prétendue nécessité sociale de la prostitution, et plus largement sur tous les préjugés et idées reçues qui l’entourent. Enfin, nous avons formulé trente préconisations qui portent sur les trois acteurs de la prostitution que sont les personnes prostituées, les proxénètes et les clients.
Nous en sommes parvenus à la conclusion que la personne prostituée doit être protégée et aidée lorsqu’elle souhaite quitter la prostitution ; la lutte contre le proxénétisme et la traite doit être accentuée ; enfin, le client, qui fait aujourd’hui l’objet de l’attention des médias, doit prendre conscience qu’il est à l’origine de situations contraires à la dignité humaine.
L’état des lieux de la prostitution aujourd’hui en France n’a pas été aisé à établir. Nous proposons d’ailleurs qu’une enquête nationale soit menée à ce sujet. Par ailleurs, la prostitution des mineurs comme la prostitution en milieu étudiant doivent faire l’objet d’une attention particulière. Aujourd’hui, le nombre de personnes prostituées est évalué, par l’office central de lutte contre la traite des êtres humains, à 20 000, dont 85 % de femmes.
Il y a vingt ans, seules 20 % de personnes étrangères exerçaient la prostitution en France. Aujourd’hui, la proportion est plus qu’inversée, puisque 90 % des personnes prostituées exerçant sur la voie publique sont de nationalité étrangère et le plus souvent en situation irrégulière. Elles viennent principalement de Roumanie, de Bulgarie et des pays voisins, mais aussi, pour l’Afrique, du Nigeria et du Ghana. La prostitution chinoise se développe également.
Nous avons également constaté que la prostitution, y compris chez celles qui déclarent l’avoir choisie, a des conséquences non négligeables et irréversibles. Plus de la moitié des personnes prostituées ont été violées plus de cinq fois. Elles ont par ailleurs cent fois plus de risques de mourir assassinées que le reste de la population. Ce n’est pas là une activité banale ! Au contraire, elle a de lourdes conséquences.
La prostitution n’est jamais exercée de gaîté de cœur. Elle est bien souvent liée à un événement traumatique, parfois dans l’enfance de ces personnes. On pourrait penser que tel n’est pas le cas dans la prostitution dite « de luxe ». Et pourtant, près de la moitié des escortes ont vécu antérieurement un événement qui a permis le passage à l’acte et l’entrée dans la prostitution.
En matière de politiques publiques, le bilan est contrasté. Lorsque la France a signé, en 1960, la Convention des Nations unies de 1949 sur la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle d’autrui, elle a adopté une position abolitionniste dont le postulat fondamental est que les personnes prostituées sont des victimes et qu’il convient de punir ceux qui les exploitent. Ce qui était valable en 1949 l’est encore plus aujourd’hui, puisque les réseaux de traite ont pris une place considérable dans le système prostitutionnel actuel.
La politique de lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains a donné des résultats satisfaisants. Nous avons également eu des échanges instructifs sur l’infraction de racolage, dont le but premier était le maintien de l’ordre public et le démantèlement des réseaux. La police a indiqué son utilité ; les associations ont, quant à elles, constaté qu’elle avait contribué à fragiliser les personnes prostituées, désormais isolées en périphérie des zones urbaines.
Nous n’avons cependant pas souhaité centrer nos réflexions sur l’opportunité de maintenir ou non le délit de racolage et ce, d’autant plus qu’une directive européenne va nous conduire à lever les sanctions pesant sur les personnes prostituées victimes de la traite. Nous n’ignorons pas qu’un repositionnement sera nécessaire à terme et nous proposons d’ailleurs que soit évalué l’ensemble de la « boîte à outil » législative sur la prostitution un an après l’entrée en vigueur des dispositions de pénalisation du client.
La déserrance est totale en matière d’accompagnement social des personnes prostituées. Les pouvoirs publics se donnent bonne conscience en finançant les associations d’aide aux personnes prostituées, qui font d’ailleurs toutes un travail admirable. Mais cela ne suffit pas. En réalité, les personnes prostituées souffrent de leur situation avant, pendant et après la prostitution. Quand elles veulent sortir de la prostitution, c’est à nouveau le parcours du combattant ! Les personnes que nous avons rencontrées nourrissent ainsi de fortes inquiétudes sur leur reconstruction psychique et quant à leur identité même.
Nous nous sommes ensuite interrogés sur ce qu’est fondamentalement la prostitution. Pourquoi la prostitution est-elle considérée comme un invariant social, une activité utile à la société, vouée à ne jamais disparaître ? Nous avons entendu, en Espagne, que la prostitution protégeait l’institution du mariage, les maris volages n’entretenant pas de réelles relations adultères grâce à la prostitution. Plus encore, la prostitution limiterait le nombre de viols ! Bien au contraire, des études menées en Suède et au Nevada montrent qu’il n’y a aucune corrélation entre la légalisation de la prostitution et la diminution du taux de viol, bien au contraire.
La prostitution permettrait également de répondre à la misère sexuelle dans laquelle sont plongés certains hommes. Mais, plus de deux tiers des clients de la prostitution sont ou ont été en couple, et près de la moitié sont des pères de famille. Ce n’est pas là l’idée que l’on se fait de la misère sexuelle ! Par ailleurs, on entend souvent que la prostitution soulagerait les maux psychologiques de certains. Là encore, comme nous l’a dit une jeune femme anciennement prostituée, « notre corps est engagé ». Ce n’est pas un réconfort moral que les personnes prostituées amènent au client. Enfin, la prostitution libre n’existe pas. Une contrainte préside toujours au choix de la personne.
Nous ne sommes pas des moralistes, ni des puritains, mais bien des citoyens. C’est à l’aune des valeurs de la République, telles qu’elles sont traduites dans notre droit, que nous avons analysé la prostitution. En premier lieu, la non patrimonialité du corps humain, qui figure à l’article 16-1 de notre code civil, fait obstacle à la marchandisation du corps humain.
Ensuite, la violence subie au quotidien par les personnes prostituées est incompatible avec le principe d’intégrité du corps humain. Les divers témoignages recueillis par la mission d’information font état des sévices terribles vécus par les personnes prostituées victimes de la traite : violées, privées de sommeil, battues, elles se sentent presque libérées lorsqu’elles arrivent sur les trottoirs français.
« La prostitution abîme », nous a confié l’une d’entre elles. Nous garderons longtemps en mémoire les larmes des personnes que nous avons pu rencontrer. Les psychiatres font ainsi un rapprochement entre les violences subies par les personnes prostituées et les traumatismes résultant des violences les plus graves.
Enfin, l’égalité entre les hommes et les femmes constitue le dernier repère. La même réflexion sur l’égalité de genre a conduit les Suédois à libéraliser les mœurs dans les années 1970 et à pénaliser les clients en 1999. De fait, les clients sont presque exclusivement des hommes. Est-il normal que des corps de femmes soient en permanence à leur disposition ? On nous a indiqué que des rues dédiées à la prostitution étaient interdites en Allemagne aux femmes non prostituées. Lorsque la mission s’est rendue à La Jonquera, en Espagne, l’entrée des maisons closes a été refusée aux membres féminins de la délégation. Les personnes prostituées qui y travaillaient étaient d’ailleurs conduites sur les lieux par des hommes. C’est dire si cette question est sexuellement clivée.
L’analyse politique, juridique et républicaine de la prostitution nous a conduit à formuler 30 propositions, visant les clients, les proxénètes et les personnes prostituées.
Nous avons été sensibles à l’exemple suédois et à ses résultats spectaculaires et incontestés. En dix ans, la prostitution de rue a diminué de moitié et elle ne s’est pas réfugiée ailleurs, sur Internet ou sur des bateaux en mer Baltique. Des écoutes téléphoniques réalisées par la police suédoise ont montré que désormais les réseaux se désintéressaient de la Suède, ce qui a également eu un impact sur la criminalité de manière générale.
Le corps social comme le corps politique se sont d’ailleurs rendus à l’évidence. Alors que seul un tiers de la population soutenait la loi pénalisant le client en 1999, ce sont aujourd’hui les trois quarts qui s’expriment en sa faveur. Il en va de même au sein des partis politiques : ceux qui n’avaient pas voté la loi en 1999 ont affirmé qu’ils agiraient tout autrement aujourd’hui, tant la loi a fait la preuve de son efficacité.
À tout le moins, nous devons essayer d’aller dans cette direction en créant un délit de recours à la prostitution, mais surtout en sensibilisant les clients par le biais de rappels à la loi. D’ailleurs, en Suède, ce délit n’a donné lieu qu’à 700 peines d’amende en 10 ans, et à aucune peine d’emprisonnement. La répression a donc posé une sorte de frein mental à la prostitution, ce qui a permis la diminution de celle-ci.
Les personnes prostituées doivent être mieux accompagnées qu’elles ne le sont aujourd’hui. Elles doivent bénéficier d’un accompagnement intégral. Les associations fournissent aujourd’hui un travail admirable. Mais, comme le tonneau des Danaïdes, ce travail se perd dans les sables. C’est pourquoi nous proposons que des référents soient instaurés dans chaque service de l’État concerné, afin de faciliter le parcours administratif des personnes prostituées. Ensuite, nous devons prendre des dispositions intelligentes et responsables en matière de délivrance de titres de séjour. De même, l’accès au logement, aux soins, à la formation et à l’emploi doit être assuré.
Le proxénétisme fait d’ores et déjà l’objet d’une lutte efficace, qui doit être amplifiée et systématisée. Nous devons tirer parti des dispositifs communautaires que sont Europol et Eurojust. Il est aujourd’hui nécessaire de s’appuyer sur ces institutions. De même, des partenariats doivent être noués avec les chaînes hôtelières qui abritent malgré elles des « sex tours ». En outre, la presse quotidienne régionale, qui publie des petites annonces à caractère prostitutionnel dans l’impunité la plus totale, doit être sensibilisée à la question.
Enfin, il faut davantage confisquer les avoirs criminels. L’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que le président Jean-Luc Warsmann et moi-même avons d’ailleurs contribué à créer, devra prendre la place qui lui revient sur cette question qui génère des flux financiers considérables.
La traite et la prostitution, loin d’être deux phénomènes distincts, se confondent de plus en plus. C’est pourquoi nous avons présenté ces conclusions, dont nous pensons qu’elles sont cohérentes et respectueuses de l’ensemble des valeurs fondatrices de notre République.
M. Philippe Goujon. Les conclusions de ce rapport étaient attendues par beaucoup d’entre nous. Étant moi-même membre de la mission d’information, je tiens à féliciter sa présidente et son rapporteur pour le travail considérable qui a été accompli et l’audace des propositions soumises à la commission des Lois.
Après une longue réflexion et plusieurs mois d’écoute et d’étude, nous entrons dans une nouvelle phase dans la prévention des phénomènes prostitutionnels, dont on peut attendre beaucoup. Jusqu’à présent, les dispositifs existants n’ont pas suffisamment permis de contrer ce phénomène qui se développe et évolue profondément.
La sanction pénale des clients constitue, à cet égard, une mesure plus qu’intéressante car elle a bien fonctionné dans les pays qui l’ont appliquée, à l’instar de la Suède. En France, l’exemple des mesures volontaristes mises en œuvre à l’encontre des clients, il y a quelques années, dans le bois de Boulogne, qui était devenu le centre mondial de la prostitution de travestis, montre que de telles initiatives peuvent permettre d’assainir une situation et diminuer la « prostitution de la misère ».
Cette sanction va d’autant plus dans le bon sens que la prostitution s’apparente à une violence exercée à l’encontre de personnes humaines – parfois extrêmement fragiles dans la mesure où il s’agit souvent de mineurs isolés ou d’individus en rupture familiale, violence qui bafoue leur dignité et leur intégrité physique voire psychique, ce qui est particulièrement grave.
Ces personnes sont en outre les victimes de réseaux criminels très organisés, du stade de leur immigration jusqu’à l’exploitation de leur prostitution. Le visage de la prostitution a beaucoup évolué depuis l’image de la prostitution de trottoir des années 1920, popularisée à travers certains films : aujourd’hui, 80 % des personnes prostituées sont d’origine étrangère, ce qui illustre bien qu’il s’agit d’une « prostitution de la misère » – il nous a même été fait état de passes à 5 euros dans certaines villes… Originaires principalement d’Afrique et d’Europe de l’Est, les personnes prostituées d’aujourd’hui sont totalement tributaires de réseaux. La Chine apparaît aujourd’hui comme un nouveau lieu de provenance.
Parallèlement, Internet a aboli les frontières et permis à ces réseaux de prospérer à travers de nouvelles formes de prostitution, telles que l’organisation de tournées sexuelles d’escortes dans certains hôtels, de sorte que le législateur devra se pencher sur cette évolution et mieux la prendre en compte.
Je souhaite enfin souligner que l’instauration d’une sanction pénale pour les clients nécessitera de pérenniser le délit de racolage passif, complémentaire à bien des égards, même s’il faudra sans doute l’articuler avec le droit communautaire en gestation. L’instauration de ce délit en 2003 s’est accompagnée d’effets positifs, puisque les troubles à l’ordre public ont notablement diminué dans les deux années qui ont suivi. Il est vrai, cependant, que le taux de déferrement au parquet des personnes interpellées a diminué et que la prostitution sur la voie publique réapparaît, notamment à Paris, du fait de la propension de l’autorité judiciaire à se contenter de rappels à la loi, bien peu dissuasifs. Pour ma part, je souhaite me faire le relais des services spécialisés de la préfecture de police de Paris pour insister sur la nécessité d’appliquer de manière plus effective les sanctions prévues.
Il me semble, mais ce sera là mon seul regret, que le rapport de la mission d’information ne met pas suffisamment en avant les apports positifs du délit de racolage passif. Pour le reste, l’exemple suédois, qui révèle une diminution de la prostitution et un détournement sensible des réseaux mafieux vers d’autres pays, nous invite à introduire rapidement dans notre droit la pénalisation des clients, dont j’approuve le principe.
Mme Pascale Crozon. Je souhaite remercier les membres de la mission d’information pour le travail qu’ils ont accompli. Il s’agit d’un sujet difficile, qui donne lieu à des remarques et des sourires convenus car il est ancré dans l’inconscient – ou le conscient d’ailleurs – de notre société.
S’agissant de la troisième proposition de la mission d’information, consistant à dispenser obligatoirement un enseignement en matière d’éducation à l’égalité de genre dès l’école primaire et à tous les niveaux de formation, je m’interroge sur l’applicabilité d’une telle préconisation. Depuis 2001, l’éducation sexuelle est obligatoire dans les établissements scolaires mais cet impératif n’est mis en œuvre que de manière aléatoire, ce qui nourrit mes interrogations. Ce point me semble important car la proposition de la mission d’information - qui rejoint d’ailleurs un certain nombre d’autres problématiques liées à la prévention des violences faites aux femmes ou à l’interruption volontaire de grossesse - est intéressante et doit, à mon sens, trouver à se concrétiser. En effet, plus la sensibilisation des esprits intervient tôt, plus les mentalités changent réellement.
Pour ce qui concerne les réseaux de traite internationaux, je souhaiterais avoir votre sentiment sur les actions qui vous semblent envisageables pour les démanteler plus efficacement.
Je conclurai mon intervention par un regret. Même si j’ai entendu les arguments avancés par le rapporteur, j’aurais souhaité la suppression du délit de racolage passif, qui me semble constituer une mesure injuste à l’encontre des personnes prostituées. En Suède d’ailleurs, cette suppression est intervenue concomitamment à la pénalisation des clients et il me serait apparu opportun que nous n’attendions pas les évolutions communautaires à venir pour nous pencher sur ce point.
M. Jean-Pierre Schosteck. Je félicite également les auteurs de ce rapport, qui paraît très complet et approfondi. Je souhaite toutefois exprimer une crainte, celle que la proposition n° 1 consistant à pénaliser le client n’occulte le reste des propositions. J’avais été rapporteur au Sénat du projet de loi reconnaissant la traite et l’esclavage comme crimes contre l’humanité, et j’avais à l’époque regretté que les dispositions ne s’appliquent qu’au passé et ne puissent pas s’appliquer aux réseaux actuels.
Or, la lutte contre la traite me paraît être l’élément le plus important. Le problème vient du fait que les réseaux, bien qu’ils soient connus et visibles, ne sont pas suffisamment attaqués, notamment par les juridictions interrégionales spécialisées en matière de criminalité organisée qui ne font pas tout le travail qui serait nécessaire. Il me semble donc indispensable de porter l’effort sur la lutte contre la traite, que la pénalisation du client ne doit pas conduire à occulter.
Par ailleurs, j’ajouterai, au sujet de la proposition n° 13 consistant à classer les personnes prostituées comme prioritaires pour l’accès au logement social, que l’ajout, une fois de plus, d’une nouvelle catégorie de populations prioritaires n’est pas de nature à placer les élus locaux dans une situation facile, faute de pouvoir créer de tels logements en proportion.
M. Alain Vidalies. Ayant été rapporteur en 2001 de la mission d’information sur l’esclavage moderne, j’avais accompli le même parcours et réalisé les mêmes constats que ceux exposés aujourd’hui par le rapporteur de la mission d’information sur la prostitution. Je trouve affligeant que, dix ans après, l’on retrouve des témoignages identiques sur les réseaux et leur violence.
Le rapport et les propositions qu’il contient prennent pour point de départ que la prostitution est forcément liée à la traite des êtres humains. Or, historiquement, ce n’est pas vrai, et ce n’est pas aujourd’hui vrai pour la totalité des personnes prostituées. En réalité, la proposition consistant à pénaliser le client de la prostitution peut s’entendre comme un constat d’échec de la lutte contre les réseaux. En effet, la véritable réponse réside dans la lutte contre les réseaux, dont la violence est insupportable. Mais, alors que la lutte contre le proxénétisme au niveau national a été couronnée de succès dans les années 1970, en permettant presque de l’éradiquer, le constat d’aujourd’hui est celui de l’échec et de l’impuissance face aux réseaux internationaux de prostitution.
Ces réseaux sont complexes et atomisés, avec des ramifications dans plusieurs pays. Il faut néanmoins souligner que leur action est facilitée par les circuits financiers, et par certaines banques spécialisées dans les transferts de fonds telles que Western Union.
Mon sentiment est que c’est ce constat d’échec qui conduit aujourd’hui à formuler une proposition tendant à éradiquer la demande, par la pénalisation du client. Mais la formulation de cette proposition soulève des problèmes de cohérence, tout d’abord sur le plan fiscal, au regard de la prise en compte de la prostitution au titre de l’impôt sur le revenu. Le rapport reproduit une note adressée par le ministre du Budget, dont le paragraphe sur la déduction des sommes versées aux proxénètes est absolument stupéfiant : « L’imposition est établie sur la totalité des revenus perçus. Les sommes rétrocédées le cas échéant aux proxénètes sont admises en déduction ». Il y a également une incohérence dans le fait de maintenir le délit de racolage si l’on considère que les personnes prostituées sont des victimes de la traite : le délit de racolage, appliqué à des victimes, n’a alors pas de sens.
Je considère donc qu’il serait plutôt nécessaire d’apporter une réponse au phénomène de la traite, en adoptant au niveau européen une organisation policière et judiciaire qui soit adaptée à l’importance des réseaux à combattre.
À ce stade, je m’interroge sur l’efficacité que pourra avoir la pénalisation du client. Le risque, si la France choisit cette voie, est que se développe un tourisme prostitutionnel vers la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne ou l’Espagne.
Une autre solution aurait pu consister à légaliser la prostitution, afin de la contrôler, comme c’est le cas aux Pays-Bas, tout en étant conscient que cela n’élimine pas nécessairement les réseaux.
Je partage donc l’orientation principale du rapport : celle consistant à dire que l’on ne peut pas rester inactif face au constat d’impuissance à lutter contre les réseaux. Mais je pense que le pénalisation du client aura beaucoup d’inconvénients, notamment celui d’accroître les risques pour la sécurité des personnes prostituées, qui seront contraintes de se cacher davantage. Un suivi de l’application de la réforme sera nécessaire et, si mes craintes sont fondées, il faudra alors envisager de rechercher d’autres solutions.
M. Patrice Verchère. En écoutant le rapporteur, je mesure combien certaines situations rencontrées lors de cette mission ont dû être douloureuses et combien il a dû être difficile de faire des propositions sur un tel sujet. À ce titre, j’adresse mes félicitations aux membres de la mission pour l’ensemble du travail qui a été réalisé.
Je rejoins M. Alain Vidalies sur le caractère édifiant de la circulaire que le ministre du Budget vous a transmise dans sa réponse : il est désormais avéré que le plus grand proxénète est bien l’État lui-même. Aussi aurai-je une question : combien la prostitution déclarée rapporte-t-elle chaque année au fisc ?
Enfin, la mission a formulé des propositions destinées à aider les personnes souhaitant en finir avec la prostitution, comme les aides au logement ou à la réinsertion. Ne peut-on pas, dans cette perspective, envisager que ces aides soient financées à partir des impôts que l’État prélève sur la prostitution ?
M. Émile Blessig. Je m’associe à tout ce qui vient d’être dit sur le caractère complet et quasi-exhaustif des travaux réalisés par la mission.
J’observe ensuite que la notion de non patrimonialité du corps humain, sur laquelle le rapport met l’accent, est une notion que l’on retrouve aujourd’hui dans de nombreuses problématiques, comme les dons d’organes et les rapports sexuels.
Je m’interroge enfin sur les conséquences qu’induirait la pénalisation du client. En effet, une mesure aussi emblématique ne risque-t-elle pas de conduire à un transfert de la prostitution de la voie publique – forme la plus visible et la plus miséreuse de la prostitution – vers Internet qui ne connaît pas les frontières et qui repose sur l’anonymat le plus complet ? La question doit être posée afin de lutter contre ce « cancer » de la société.
M. Guy Geoffroy, rapporteur. Je souhaiterais répondre à certaines des points évoqués par les différents intervenants.
En ce qui concerne la lutte contre les réseaux internationaux de traite, une meilleure coopération entre États est nécessaire. C’est pourquoi nous proposons de promouvoir, au niveau international, la ratification du protocole de Palerme.
Mme Danielle Bousquet. À ce titre, il faut préciser que la position que prendra la France en matière de prostitution jouera un rôle très important au niveau européen. Nous sommes aujourd’hui sur la ligne de crête. Les choses peuvent basculer soit du côté de la légalisation de la prostitution, soit du côté d’une conception de la prostitution comme constitutive d’une violence, ainsi que le propose la mission. La France joue dans ce domaine un rôle essentiel, comme cela nous a été dit dans plusieurs pays étrangers.
M. Guy Geoffroy, rapporteur. L’attente est en effet grande en Europe quant à la position que prendra la France. La Suède, la Norvège et l’Islande pénalisent d’ores et déjà les clients. L’Irlande et le Royaume-Uni l’envisagent. À l’inverse, des pays comme l’Espagne et les Pays-Bas ne considèrent pas la prostitution comme une forme de violence.
Bien évidemment, toutes les personnes prostituées ne sont pas des victimes de la traite des êtres humains. Pour autant, ceci ne signifie pas que la prostitution soit librement exercée. Dans certains cas, il peut exister un proxénète, par exemple le mari ou un membre de la famille. Dans d’autres, la prostitution s’apparente à une stratégie de survie. C’est le cas notamment pour les travestis prostitués que nous avons rencontrés et qui ont témoigné du rejet social dont ils faisaient l’objet. Enfin, il faut prendre en compte le fait que de nombreuses personnes prostituées ont débuté cette activité alors qu’elles étaient mineures, ce qui n’est pas sans soulever de question au regard de la liberté du consentement. Le client exploite donc dans tous les cas la vulnérabilité des personnes prostituées.
Par ailleurs, il faut souligner que les Pays-Bas s’apprêtent à encadrer encore davantage la prostitution en instaurant une obligation d’enregistrement pour les établissements de prostitution et pour les personnes prostituées. Or il est parallèlement envisagé de pénaliser les clients des personnes prostituées qui ne se situeraient pas dans le cadre légal.
En ce qui concerne la problématique fiscale, il faut préciser que la déduction des sommes versées aux proxénètes pour le calcul de l’impôt sur le revenu est illégale, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État. Par ailleurs, le ministère des Finances n’a pas été en mesure de nous indiquer quelle était la recette fiscale procurée par l’imposition de la prostitution.
L’éducation à l’égalité entre les sexes est essentielle. Pour nous assurer que la proposition que nous formulons en la matière soit bel et bien mise en œuvre, le rapport sera adressé au ministre de l’Éducation nationale et nous lui demanderons quelles sont les suites qu’il compte lui donner.
Enfin, je souhaite souligner que la prostitution, même lorsqu’elle n’est pas la conséquence de la traite des êtres humains, est constitutive d’une inégalité entre les sexes.
La Commission autorise à l’unanimité le dépôt du rapport de la mission d’information en vue de sa publication.
I. Coupler la pénalisation des clients à une politique ambitieuse
en matière d’éducation et de prévention
Proposition n° 1 : Créer un délit sanctionnant le recours à la prostitution (loi).
Proposition n° 2 : Prévoir pendant les six mois précédant l’entrée en vigueur de la pénalisation des clients, une campagne nationale de communication sur la prostitution, notamment en direction des clients (ministère chargé des droits des femmes).
Proposition n° 3 : Dispenser obligatoirement un enseignement en matière d’éducation à l’égalité de genre dès l’école primaire et à tous les niveaux de formation (ministère de l’Éducation nationale).
Proposition n° 4 : Mesurer l’impact de la pornographie sur les représentations de la femme et l’égalité de genre, notamment chez les jeunes, sur la base d’une enquête universitaire commandée par le ministère chargé de la Jeunesse (ministère chargé de la Jeunesse).
II. Mettre en œuvre un accompagnement intégral
des personnes prostituées
Proposition n° 5 : Améliorer l’accès au droit des personnes prostituées en :
– sensibilisant les forces de l’ordre et les personnels de justice à la vision des personnes prostituées comme des victimes plutôt que comme des auteurs d’infraction, disposant de l’intégralité des droits fondamentaux et notamment du droit de porter plainte (ministères de l’Intérieur et de la Justice) ;
– formant les forces de l’ordre à la réception des plaintes des victimes de la traite (ministère de l’Intérieur) ;
– rappelant, par voie de circulaire, que la plainte d’une personne étrangère en situation irrégulière doit être enregistrée (ministère de l’Intérieur).
Proposition n° 6 : Améliorer l’indemnisation intégrale du préjudice subi par les victimes de la traite et du proxénétisme en :
– n’exigeant plus d’incapacité totale de travail pour les victimes de proxénétisme dans l’accès à la CIVI (loi) ;
– réfléchissant à l’élaboration d’un barème national pour évaluer les préjudices subis (ministère de la Justice) ;
– disposant de statistiques sur les indemnisations allouées aux victimes (ministère de la Justice).
Proposition n° 7 : Évaluer, un an après l’entrée en vigueur du dispositif sanctionnant pénalement les clients, la pertinence et l’utilité du maintien du délit de racolage.
Proposition n° 8 : Permettre la protection effective des victimes étrangères de traite et d’exploitation sexuelle en améliorant les conditions dans lesquelles elles peuvent avoir accès à un titre de séjour :
– porter d’un à trois mois le délai de réflexion et de rétablissement (décret) ;
– prévoir une délivrance de plein droit d’une carte de résident en cas de condamnation de l’auteur de traite ou d’exploitation sexuelle (loi) ;
– créer une procédure subsidiaire d’obtention d’une carte de séjour s’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne est une victime, avec avis d’une commission départementale (loi) ;
– renouveler automatiquement le titre de séjour obtenu sur le fondement de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tant que des poursuites pénales sont en cours (loi) ;
– permettre aux victimes de la traite, de se domicilier auprès d’une association ou de leur avocat pour leurs démarches administratives (loi) ;
– rappeler par voie de circulaire l’ensemble des bonnes pratiques à mettre en œuvre (circulaire du ministère chargé de l’immigration).
Proposition n° 9 : Afin d’améliorer la situation des victimes de la traite au regard du droit d’asile :
– former les agents de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour national du droit d’asile aux spécificités de la situation des victimes de la traite (ministère chargé de l’Immigration) ;
– examiner les demandes formées par ces dernières, comme le permet le règlement Dublin II (ministère chargé de l’Immigration) ;
Proposition n° 10 : Prendre en compte l’engagement d’une formation professionnelle pour accorder les remises fiscales gracieuses, sous réserve de l’arrêt de la prostitution, et mieux coordonner les décisions de remise avec les autres acteurs publics et les acteurs associatifs (ministère du Budget).
Proposition n° 11 : Garantir un meilleur revenu de substitution pour les victimes de la traite et d’exploitation en :
– donnant accès au RSA aux victimes qui obtiennent un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (loi) ;
– donnant accès à l’allocation temporaire d’attente aux personnes dont on peut raisonnablement penser qu’elles sont victimes de la traite ou d’exploitation, le versement de cette allocation devant être prévu jusqu’à ce que la réinsertion soit effective (loi).
Proposition n° 12 : Améliorer la prise en charge des mineurs et des jeunes adultes en situation de prostitution en :
– créant, dans les plus grands centres urbains, des structures spécifiquement dédiées à leur prise en charge (ministère de la Cohésion sociale) ;
– mettant en réseau certaines structures susceptibles d’accueillir ce type de personnes (ministère de la Cohésion sociale).
Proposition n° 13 : Améliorer le dispositif d’hébergement et de logement des personnes prostituées et des victimes de la traite en :
– indiquant par voie de circulaire que ces personnes font partie des publics prioritaires pour l’accession au logement social (ministère chargé du Logement) ;
– finançant l’achat d’appartements par les associations spécialisées (ministère de la Cohésion sociale et Collectivités territoriales).
Proposition n° 14 : Accroître l’offre de soins psychologiques et psychiatriques au bénéfice des personnes prostituées qui souhaitent en bénéficier dans le cadre d’un processus de reconstruction (ministère de la Santé).
Proposition n° 15 : Accompagner la pénalisation des clients de l’accroissement des moyens destinés à offrir des alternatives à la prostitution aux personnes qui exercent cette activité, dont la pérennité serait assurée par la conclusion de conventions pluriannuelles avec les associations spécialisées (ministères de la Cohésion sociale et de la Santé).
III. Systématiser la lutte contre la traite et le proxénétisme
Proposition n° 16 : Inciter les magistrats à engager, chaque fois que possible, des procédures sur le double fondement de la traite des êtres humains et du proxénétisme, en leur adressant une circulaire de politique pénale (ministère de la Justice).
Proposition n° 17 : Former à l’identification des victimes de la traite l’ensemble des agents publics susceptibles d’entrer en contact avec elles.
Proposition n° 18 : Renforcer la politique partenariale entre les pouvoirs publics et les chaînes hôtelières en matière de lutte contre la traite et le proxénétisme (ministère de l’Intérieur).
Proposition n° 19 : Adresser une circulaire aux parquets généraux afin qu’ils informent les directeurs de publication que leur responsabilité pénale est susceptible d’être engagée en cas de publication d’annonces à caractère prostitutionnel et que des poursuites soient, le cas échéant, engagées (ministère de la Justice).
Proposition n° 20 : Informer les hébergeurs de sites Internet de leur responsabilité pénale au regard des annonces à caractère prostitutionnel qu’ils publient et développer un partenariat avec ces derniers afin de limiter cette pratique (ministères de la Justice et de l’Intérieur).
Proposition n° 21 : Mieux former et informer les forces de l’ordre et les magistrats qui travaillent sur la traite des êtres humains et le proxénétisme au recours à Eurojust et Europol (ministères de la Justice et de l’Intérieur).
Proposition n° 22 : Renforcer l’action diplomatique de la France en matière de lutte contre la traite des êtres humains, sur le fondement des mesures 27 à 32 du plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2011-2013) (ministère des Affaires étrangères).
Proposition n° 23 : Renforcer la protection des victimes de la traite en :
– envisageant l’instauration d’un programme de protection des victimes et des témoins (ministères de la Justice et de l’Intérieur) ;
– facilitant l’arrivée en France des membres de leur famille restés dans leur pays d’origine (loi) ;
– rendant de droit le huis clos au procès, sur la demande des victimes de traite et de proxénétisme aggravés (loi).
Proposition n° 24 : Rappeler aux magistrats, par voie de circulaire, la nécessité de saisir et de confisquer les avoirs criminels des auteurs de traite et de proxénétisme (ministère de la Justice).
IV. Donner un cap clair et cohérent aux politiques publiques, du plan national à l’échelle locale
Proposition n° 25 : Voter une résolution parlementaire rappelant les engagements internationaux de la France, les grands principes qui animent son action ainsi que les grands objectifs qu’elle poursuit à travers ses politiques publiques dans le domaine de la prostitution.
Proposition n° 26 : Créer un organe local de pilotage des politiques publiques en direction des personnes prostituées :
– en ajoutant aux missions des comités départementaux de prévention de la délinquance (CDPD) l’élaboration et le pilotage de l’accompagnement intégral des personnes prostituées et la lutte contre la traite (décret) ;
– en créant au sein de chaque comité départemental de prévention de la délinquance une sous-commission chargée de la prostitution et de la traite des êtres humains (décret) ;
– en donnant instruction aux conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance de consacrer au moins une réunion par an à un état des lieux de la prostitution si cette dernière existe dans la zone concernée (circulaire du ministère de l’Intérieur).
Proposition n° 27 : Créer, dans chaque grande agglomération urbaine, un réseau de personnes référentes qui puisse orienter et accompagner les personnes prostituées dans leurs démarches et qui connaisse la spécificité de leur situation.
Devraient notamment désigner des référents : les préfectures, les mairies, les conseils généraux, Pôle Emploi, les URSSAF, l’assurance maladie, l’assurance vieillesse et l’administration des finances publiques.
Proposition n° 28 : Créer une coordination nationale interministérielle de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution (décret).
Proposition n° 29 : Conformément à l’article 19 de la directive sur la traite, créer un rapporteur national sur la traite des êtres humains et la prostitution, chargé de collecter les données disponibles, d’évaluer les politiques publiques, d’échanger des informations avec ses homologues étrangers et de publier un rapport annuel (loi).
Proposition n° 30 : Pour améliorer notre connaissance de la prostitution :
– commander une enquête universitaire visant à dresser un état des lieux de la prostitution dans sa globalité (service du droit des femmes et de l’égalité) ;
– demander à l’Observatoire national de la vie étudiante de mener une enquête sur la prostitution étudiante (ministère de l’Enseignement supérieur) ;
– mener une enquête visant à évaluer les besoins des personnes prostituées en matière d’accompagnement (ministère des Solidarités et de la cohésion sociale).
AUDITION DE MME ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN, MINISTRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
(Séance du 30 mars 2011)
Mme Danielle Bousquet, présidente – Nous entrons aujourd’hui dans la dernière phase de nos travaux, consacrée aux auditions des ministres. Nous venons à l’instant de rencontrer M. Michel Mercier, ministre de la Justice, et nous recevrons, la semaine prochaine, M. Claude Guéant, ministre de l’Intérieur.
Je saisis l’occasion de cette audition, qui est la première à être ouverte à la presse, pour dresser un rapide bilan de nos travaux.
Notre ambition était de dresser un état des lieux de la prostitution, aujourd’hui, en France, et des politiques publiques conduites dans ce domaine. Pour ce faire, nous avons rencontré près de 175 personnes lors de nos auditions à Paris ou dans le cadre de nos déplacements en province et à l’étranger. En France, nous nous sommes rendus à la préfecture de police de Paris, à Lyon et à Marseille. Au cours de nos déplacements à l’étranger, nous sommes allés en Belgique, aux Pays-Bas, en Suède et en Espagne afin de regarder attentivement la politique conduite dans chacun de ces pays ainsi que les résultats obtenus dans la lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains.
Notre premier souci a été d’écouter les personnes prostituées ou celles qui l’avaient été. Nous avons entendu, en tout, quinze de ces personnes, qui nous ont fait part de ce qu’elles avaient vécu dans le monde de la prostitution. Nous avons également rencontré des associations – communautaires ou abolitionnistes –, la police, la justice, des travailleurs sociaux, des médecins, des infirmiers. Nous avons enfin reçu l’ensemble des responsables de l’administration chargés d’élaborer et de mettre en œuvre les politiques publiques dans les domaines de la lutte contre la prostitution. À ce titre, nous avons auditionné M. Fabrice Heyries, ancien directeur général de la cohésion sociale, et Mme Élisabeth Tomé-Gertheinrichs, chef du service des droits des femmes. Nous avons enfin organisé une table ronde sur les implications éthiques et philosophiques de la prostitution.
Dans chacune de ces démarches, nous avons souhaité entendre toutes les sensibilités et libérer la parole des personnes entendues en les auditionnant à huis clos. Les auditions des ministres font bien entendu exception à la règle puisque c’est une parole publique que nous attendons de vous.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre des Solidarités et de la cohésion sociale – Que penser d’une société qui, pour satisfaire les désirs des uns, autorise l’aliénation des autres ? Dans un monde où l’on profite de tout, de la misère et des faux espoirs, il revient au politique, et c’est là son rôle le plus noble, de lutter sans relâche contre la traite des êtres humains et leur asservissement. Car la prostitution est une profonde atteinte à la dignité et à la liberté des êtres humains - des femmes, presque toujours dont l’intégrité physique et morale, principe pourtant irréfragable, n’est pas respectée.
Je le dis sans ambiguïté : contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire, il n’existe pas de prostitution libre, choisie ou consentie. Par définition, la prostitution est une violence faite aux femmes, en premier lieu à celles qui se trouvent dans des situations de grande précarité et sont, pour cette raison, les plus vulnérables.
En tant que ministre en charge des droits des femmes, j’entends combattre cette réalité avec la plus grande détermination et fermeté.
Sur la scène internationale, la politique de la France en matière de prostitution repose sur un système abolitionniste qui condamne le proxénétisme, même dans le cas où la victime est consentante, et autorise les poursuites judiciaires en cas de manifestation publique telle que le racolage. En 1960, la France a ratifié la convention, adoptée, onze ans plus tôt, par l’Assemblée générale des Nations unies, relative à la répression de la traite des êtres humains et l’exploitation de la prostitution. En 1983, la France a signé la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Je salue, à cette occasion, les actions de Françoise Gaspard et, aujourd’hui, de Nicole Ameline, députée et ancienne ministre chargée des droits des femmes, pour leur engagement en tant que membres expertes du prestigieux comité d’évaluation de cette convention. Sur ce sujet, l’engagement militant a largement transcendé les frontières politiques.
En France, l’action menée pour lutter contre la prostitution prend d’abord la forme de plans de lutte contre les violences faites aux femmes. Plusieurs plans ont été mis en œuvre. Je vais dans quelques jours en proposer un troisième qui s’appuiera sur les grandes orientations développées dans les deux précédents : formation professionnelle, protection des victimes, accompagnement dans la défense de leurs droits, lutte contre la récidive et la banalisation des violences. En plus des violences au sein du couple, des mariages forcés et des mutilations sexuelles féminines, le troisième plan abordera des questions nouvelles : la dénonciation des viols et des agressions sexuelles, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes au travail. Une large place y est aussi réservée à la prostitution : les crédits destinés à la lutte conte la prostitution sont transférés sur le programme 137 ce qui permettra de consacrer deux millions d’euros supplémentaires à l’accompagnement des personnes prostituées. Enfin, ce troisième plan prévoit une campagne de sensibilisation du grand public, analogue aux grandes campagnes d’information sur la lutte contre les violences au sein du couple, la lutte contre la violence routière ou la toxicomanie. Nous devons réfléchir à des moyens pouvant amener, dans une démarche de responsabilisation, les « clients » des personnes prostituées à prendre conscience de la gravité de leur acte. Le plan prévoit l’élaboration d’une campagne d’information en 2012 visant à dissuader les hommes à être des « clients » et dénonçant la prostitution comme une violence intolérable.
J’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer sans détours sur la question des aidants sexuels : je suis résolument opposée à la mise en place de services tarifés de ce genre. Il s’agit d’une pratique contraire aux droits des femmes comme à celle de la dignité des personnes en situation de handicap.
Notre action vise, en second lieu, à renforcer la lutte contre le proxénétisme et à mieux protéger les personnes prostituées. Je vais agir en lien étroit avec les ministères de l’Intérieur et de la Justice ; de nouvelles missions pourraient être confiées à l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales pour produire des statistiques sexuées sur les violences faites aux femmes et éclairer ainsi la décision publique. En ce sens, je me réjouis que mon ministère soit bientôt représenté au sein du conseil d’administration et d’orientation de cet organisme.
Troisièmement, je veux faciliter l’accueil et la prise en charge des personnes prostituées ; celles-ci sont, en effet, des victimes. L’État consacre des crédits importants à des politiques sociales portant sur l’accompagnement ; nous pourrions réfléchir à un élargissement de la mission du numéro d’urgence 39-19 à d’autres violences qu’à celles commises au sein du couple, les conditions de mise en œuvre d’un numéro unique devant être précisées.
Quatrième point : je souhaite voir évoluer le cadre juridique. Je me réjouis que votre mission ait engagé une réflexion sur l’évolution du régime pénal de la prostitution. Je le dis avec solennité : je suis favorable à la pénalisation du « client ». Il s’agit de mettre en cohérence notre régime juridique : l’achat d’un acte sexuel correspond à la mise à disposition du corps des femmes pour les hommes, indépendamment du désir de celles-ci. Ce n’est donc pas une transaction entre deux individus, un consentement donné par l’une pour se plier aux exigences de l’autre, mais un rapport inégalitaire inscrit dans une domination sexiste. Un rapport sexuel non désiré constitue en soi une violence et entraîne des conséquences psychologiques extrêmement destructrices.
Dans ce contexte marqué par une volonté résolue de lutter contre la prostitution, je me réjouis de l’initiative que vous avez prise de créer une mission parlementaire sur ce sujet. J’exprime ma profonde gratitude à son rapporteur, Guy Geoffroy ainsi qu’à sa présidente, Danielle Bousquet. Vous avez mené ses travaux d’une manière remarquable en plaçant la question du droit des femmes au-dessus des querelles partisanes et en ouvrant des chemins pour que la loi accompagne les changements de mentalité sur la question de l’égalité entre les femmes et les hommes. Votre rapport va permettre de sensibiliser le grand public et de développer une approche globale en conjuguant la prise en charge sanitaire et l’accompagnement social pour répondre aux besoins spécifiques des personnes prostituées. Mon engagement sera entier sur ces sujets et je serai très attentive à vos propositions.
Si la prostitution est si difficile à combattre, c’est parce qu’elle fait partie de notre quotidien. J’avais pu constater, quand j’étais ministre des Sports, que des manifestations sportives, telles que la Coupe du monde de football s’accompagnaient, par le biais de puissants réseaux de proxénétisme, d’une hausse de l’offre de prostitution dans le pays organisateur. Ces pratiques de tourisme ou de consommation sexuelle de loisir touchent toutes les catégories sociales. Il arrive même qu’elles participent de la culture commerciale de certaines entreprises. Ainsi des séminaires de travail ou des signatures de contrats sont parfois organisés dans des lieux où s’exercent des activités de prostitution. Ces comportements renvoient aux femmes travaillant dans ces entreprises une image particulièrement dégradante des relations entre les hommes et les femmes dans le monde du travail. De telles pratiques sont à proscrire comme contraires aux valeurs sociales que nos entreprises doivent porter ; elles sont à l’opposé de ma conception de l’égalité entre les femmes et les hommes. J’entends donc combattre sans relâche la prostitution, qui est une violence de genre. En tant que ministre de la Santé, je m’étais opposée, à l’occasion des débats sur la révision des lois de bioéthique, à la pratique des mères porteuses en France et à toute forme de marchandisation du corps humain. Un droit qui fait le lit de l’exploitation du corps humain n’est pas un droit mais un leurre dont les plus vulnérables risquent, les premiers, de payer le prix fort. Avec la même cohérence, je veux construire avec vous un référentiel éthique garant des droits fondamentaux et de l’incessibilité du corps humain.
Mme Danielle Bousquet, présidente – Votre position concernant les aidants sexuels rejoint celle de notre mission, de même que ce que vous avez dit concernant la conception de la dignité des personnes handicapées, la dignité des femmes et le principe de non marchandisation du corps humain.
Quel bilan dressez-vous de l’application de la loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 qui pénalise le racolage passif, sachant que le racolage actif fait l’objet d’une incrimination depuis longtemps ? L’objectif de cette mesure était de lutter contre les filières de traite mais on constate qu’avec le temps le nombre d’affaires relatives au racolage passif a diminué.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre des Solidarités et de la cohésion sociale – La loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 avait pour objectif le maintien de l’ordre public et la lutte contre les réseaux de proxénétisme. Il s’agit aujourd’hui de compléter le dispositif en prenant en compte ce qui génère la demande, à savoir les « clients ». Votre mission a suivi cette démarche. Le problème se pose d’autant plus que nous constatons l’émergence de nouvelles formes de prostitution touchant les jeunes et l’apparition de nouveaux vecteurs comme Internet. Face à cela, les seules mesures liées au racolage sont rendues inopérantes. Le ministre de l’Intérieur est en train de dresser un bilan de cette loi ; il sera intéressant d’en analyser les résultats. Il faudra veiller à ce que le délit de racolage passif ne constitue pas une double peine pour les personnes prostituées et à ce que notre législation reste conforme à la directive européenne sur la traite des êtres humains qui sera transposée en 2012.
M. Guy Geoffroy, rapporteur – Nous proposons de mieux prendre en compte tous les paramètres de la prostitution. Les pouvoirs publics se sont attachés jusqu’à présent à lutter contre le proxénétisme et contre la prostitution en tant qu’elle constitue un trouble à l’ordre public. Nous proposerons que l’auteur de la demande de prostitution soit également interpellé car il constitue un élément important qui permet le développement des réseaux. Il est probable que l’application de cette mesure fera diminuer la demande, comme on l’a constaté en Suède, mais qu’elle aura aussi pour effet une précarité plus importante des personnes prostituées. Après avoir supprimé les flux, il restera à traiter les stocks, si on peut s’exprimer ainsi. L’action publique menée en faveur des personnes prostituées sera alors d’autant plus nécessaire pour les sortir de la prostitution. Se pose, notamment, la question de la formation de ces personnes qui ont eu un accès rapide à des sources de revenus parfois très importants. On est aujourd’hui incapable de leur proposer un cadre professionnel qui leur permette un retour à la dignité tout en leur offrant un niveau de rémunération qui les aide à passer le cap de la réinsertion.
Quelles mesures pensez-vous prendre pour coordonner les politiques publiques au niveau national et au niveau des territoires ? Quelle est votre position sur l’idée de créer une autorité qui se consacrerait à la lutte contre la traite des êtres humains et en particulier contre la prostitution ? Êtes-vous favorable, notamment, à la création d’un rapporteur indépendant qui aurait en charge ces questions, ce que diverses dispositions internationales nous obligent d’ailleurs à mettre en place ? Au niveau territorial, ne serait-il pas opportun de créer des commissions départementales qui auraient compétence pour lutter contre la traite et la prostitution ?
L’évaluation du phénomène de la prostitution nous a, par ailleurs, posé beaucoup de difficultés, tant pour la quantifier que pour en suivre l’évolution qualitative. Qu’en est-il, par exemple, de la prostitution par le biais d’Internet ? Certains supports d’information sont également utilisés dans la presse locale pour faire du racolage – très peu étant fait, semble-t-il, pour lutter de manière organisée contre cette pratique. Ne vous semblerait-il pas nécessaire de mener une enquête nationale sur la prostitution, au financement de laquelle votre ministère contribuerait, comme cela a été fait sur la question des violences faites aux femmes ? Nous manquons d’éléments d’analyse. Par exemple, ni les syndicats étudiants ni les professionnels des milieux universitaires n’ont été en mesure de nous fournir des données quantitatives approchées sur la réalité du phénomène de la prostitution dans le monde estudiantin, alors que tout le monde est persuadé qu’il existe.
M. Philippe Goujon – Je partage les positions présentées par Madame la ministre et soutiens les propositions de la mission d’information sur la pénalisation des clients, sa position sur l’assistance sexuelle, son opposition à l’autorisation d’ouvrir des établissements de prostitution en France et son analyse sur la politique menée en matière de prévention et de répression des filières de proxénétisme. Les formes nouvelles de prostitution, particulièrement évolutives, sont aussi un motif de préoccupation.
Cependant, plusieurs d’entre nous sommes favorables à maintenir les dispositions luttant contre le racolage passif. Je peux témoigner qu’elles ont eu une très grande efficacité à Paris. Tant qu’elles étaient appliquées – mais la situation a depuis changé – elles ont été à même d’assurer la tranquillité des riverains des lieux de prostitution et, surtout, de lutter contre des pratiques qui suscitent l’effroi et s’avèrent désastreuses en matière de santé – prostitution entre deux portes d’immeubles, parfois des immeubles sociaux, voire derrière des poubelles. Il ne faut donc pas affaiblir ces dispositions, même s’il conviendrait certainement de les préciser pour les juges car c’est au niveau des tribunaux que les problèmes d’application se posent.
Il y a quelques années, un accord entre le Premier ministre, Mme Edith Cresson, et le maire de Paris, M. Jacques Chirac, avait permis de prendre des mesures pour lutter contre la prostitution dans le Bois de Boulogne. Les clients étaient en particulier visés, dans le respect de la loi de l’époque. Le préfet de police et le procureur de la République s’étaient concertés pour débloquer des moyens policiers et judiciaires qui avaient conduit à assainir cet espace. Ce résultat avait conforté ma conviction que des actions devaient être dirigées contre les clients de la prostitution.
Mme Marie-Françoise Clergeau – Vos positions, madame la ministre, rejoignent celles de notre mission, en particulier sur la question des aidants sexuels. Les associations qui nous ont sollicités sur ce dernier sujet seront d’ailleurs satisfaites par votre annonce.
Votre accord pour pénaliser les clients renforcera la lutte contre les réseaux mafieux, comme on l’a vu au cours de notre voyage en Suède.
Le rôle que peut avoir Internet dans le développement de la prostitution doit être mieux évalué.
Dans le cadre du troisième plan que vous avez mentionné, il conviendra de ne pas négliger le volet portant sur la prévention et l’éducation dans les écoles. Puisqu’on évoque les « clients », il convient en effet de sensibiliser les jeunes hommes. Comment, à leur âge, leur faire prendre conscience de tous les problèmes posés par la prostitution ?
Mme Danielle Bousquet, présidente – Je voudrais insister sur le volet relatif à la prévention. La politique que nous appelons de nos vœux ne prend en effet tout son sens que si on accepte de penser que les êtres humains peuvent évoluer ; mais pour cela, ils ont besoin d’être éduqués. Le débat qu’il faut lancer dans la société française pour expliquer que la prostitution et la traite des êtres humains sont les deux volets d’une même réalité doit aussi permettre d’éduquer les jeunes en leur expliquant que le corps d’un autre ne s’achète pas. Cette vertu éducative doit faire l’objet d’un engagement plus fort de la part des politiques publiques.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre des Solidarités et de la cohésion sociale – Mon ministère est actuellement assiégé d’appels téléphoniques de personnes estimant que notre politique va rejeter la prostitution dans la clandestinité et même l’augmenter. L’exemple de la Suède est pourtant parfaitement éclairant. La pénalisation des clients n’a pas renforcé la prostitution mais a affaibli les réseaux de proxénétisme et les pratiques de traites d’êtres humains.
Je rappelle que le système français est abolitionniste. En 2008, le ministre de l’Intérieur a confié à la délégation de l’aide aux victimes, conjointement avec le service de l’accès au droit, à la justice et de l’aide aux victimes, une mission dont sont issus trois projets. Il s’agit, pour le premier, d’un plan d’action contre la traite des êtres humains ; en cours d’élaboration, il repose sur une approche des victimes. Le deuxième est la création d’une mission interministérielle de coordination pour la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains. Le troisième est un projet de texte visant à créer un rapporteur national indépendant. Ces dispositions sont à compléter par le troisième plan de lutte contre les violences faites aux femmes, dont je présenterai le contenu dans quelques jours.
La coordination des actions ministérielles au niveau local mériterait certainement d’être améliorée. Elle est indispensable pour traiter de la prostitution dans toutes ses dimensions : la protection des victimes, les difficultés sociales et les risques d’exclusion des personnes prostituées, les atteintes à la santé publique, les aides à l’insertion professionnelle et sociale, l’accès au droit, les ressources, l’hébergement et le logement. Les commissions départementales d’action contre les violences faites aux femmes existent depuis 1989. Depuis la réforme de 2006, elles poursuivent, pour la plupart, leurs activités au sein d’une sous-commission thématique relevant du conseil départemental de prévention de la délinquance, d’aide aux victimes, de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes ; elles constituent une instance dont le rôle est essentiel et qui peut être mobilisée sur la question de la prostitution. Par exemple, la déléguée régionale aux droits des femmes et à l’égalité de la région Île-de-France a créé un sous-groupe consacré à la prostitution. Les délégués régionaux aux droits des femmes et à l’égalité auprès des secrétariats généraux pour les affaires régionales et les chargés de mission auprès des directions départementales de la cohésion sociale, auprès des directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations ou encore auprès des directions départementales interministérielles peuvent être amenés à intervenir dans le cadre des sous-commissions relatives aux violences faites aux femmes.
Le service des droits des femmes et de l’égalité a participé à l’élaboration du cinquième plan national, 2010-2014, de lutte contre le VIH/sida et les autres infections sexuellement transmissibles. Il s’agit d’un outil très important de programmation dans la lutte que mènent les pouvoirs publics contre ces infections. Il intègre une approche populationnelle consistant en des actions dirigées vers les populations les plus exposées, notamment les personnes prostituées. Le service des droits des femmes veillera à surveiller l’articulation de ce programme avec le prochain plan de lutte contre les violences faites aux femmes.
La création d’un rapporteur indépendant sur la traite et la prostitution répond à des obligations internationales et, plus récemment, à une directive européenne. Mon ministère a participé à une mission co-pilotée par la délégation d’aide aux victimes, le ministère de l’Intérieur, et le service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes du ministère de la Justice. Le projet de texte issu de ces travaux suggère le rattachement de cette fonction de rapporteur à une autorité administrative indépendante qui formulerait des recommandations au Gouvernement sous la forme d’un rapport annuel public. Ce rapporteur pourrait avoir toute sa place au sein de la future structure du Défenseur des droits. Votre mission nous éclairera très certainement sur sa nature et ses prérogatives. En tout état de cause, je suis, bien évidemment, favorable à la création d’une telle fonction.
J’apporte également mon complet soutien à l’idée de lancer une grande enquête nationale sur la prostitution, sur le modèle de l’enquête nationale sur les violences envers les femmes en France. On ne combat bien que ce qu’on connaît bien. Même le nombre de personnes prostituées en France est mal connu : certaines études disent qu’il y en aurait 10 000, d’autres 50 000 ; l’Office central de répression de la traite des êtres humains estime que le chiffre se situe entre 18 000 et 20 000, tout en reconnaissant une marge d’erreur très importante. Je suis donc favorable, dans le cadre d’un financement interministériel, au lancement d’une étude plus qualitative entreprise à l’occasion du troisième plan de lutte contre les violences faites aux femmes. Le ministère de la Cohésion sociale et de la solidarité apportera sa part de financement. Ce qui se passe, par exemple, sur Internet ou dans le milieu scolaire et universitaire demeure une terra incognita.
Mme Danielle Bousquet, présidente – Madame la ministre, je vous remercie.
AUDITION DE M. CLAUDE GUÉANT, MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L’IMMIGRATION
(Séance du 7 avril 2011)
M. Guy Geoffroy, rapporteur – L’audition d’aujourd’hui sera la dernière d’une longue série. En six mois, notre mission a rencontré plus deux cents personnes et s’est déplacée à sept reprises, en France et à l’étranger. Nous avons auditionné, la semaine dernière, M. Michel Mercier, garde des Sceaux, et Mme Roselyne Bachelot, ministre des Solidarités et de la cohésion sociale. Votre intervention, aujourd’hui, montre la nature interministérielle de la thématique sur laquelle notre mission travaille depuis plusieurs mois.
M. Claude Guéant, ministre de l’Intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration – Permettez-moi d’abord de vous remettre un exemplaire du rapport annuel, pour l’année 2010, de l’Office central pour la répression de la traite des êtres humains.
Le ministère de l’Intérieur mobilise l’ensemble des services concernés pour lutter contre la prostitution. Ce phénomène doit s’analyser comme une conséquence de la traite des êtres humains dont sont victimes, à 90 %, des personnes d’origine étrangère exploitées par des réseaux criminels.
Notre action repose sur la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. En faisant du racolage passif un délit, l’objectif de cette loi était de lutter contre des pratiques qui avaient lieu sur la voie publique et portaient atteinte à l’ordre public. À Paris, notamment, de nombreuses protestations s’étaient élevées pour dénoncer ce phénomène qui s’était développé jusqu’au voisinage des écoles et dans des halls d’immeubles.
Mais cette loi visait aussi à protéger les droits de la personne humaine. Elle prévoit, par exemple, l’attribution d’un titre de séjour pour les personnes apportant des informations permettant de remonter une filière de proxénétisme. Pendant sa garde à vue, la personne arrêtée pour racolage est informée sur ses droits et mise en rapport avec une association qui vient en aide aux personnes prostituées.
Ce texte est par ailleurs cohérent avec la directive européenne qui rendra plus efficace la lutte contre les réseaux transnationaux de prostitution.
M. Guy Geoffroy, rapporteur – Nous nous interrogeons sur notre capacité à cerner les diverses formes de prostitution et à en proposer une évaluation quantitative. Les informations que nous avons rassemblées nous conduisent à avancer le nombre de 20 000 personnes prostituées en France. Disposez-vous de sources qui permettraient de valider ce chiffre ?
Responsabiliser le client a constitué un axe de notre réflexion. La Suède a choisi un modèle allant dans ce sens ; c’est également le cas de la Norvège et de l’Islande, et bientôt de l’Irlande. Que pensez-vous de l’idée de créer un délit visant les clients de la prostitution ?
La lutte contre la traite des êtres humains va faire l’objet d’un plan national pour les années 2011-2013. Pouvez-vous nous indiquer dans quel délai ce plan sera effectif ?
Une approche interministérielle est nécessaire. Êtes-vous favorable à la création d’un rapporteur indépendant sur la traite et la prostitution, comme le prévoient, d’ailleurs, des textes internationaux et européens ?
M. Philippe Goujon – En tant qu’élu de Paris, j’insisterai sur la question du racolage passif. Il est sanctionné par la loi de 2003 pour la sécurité intérieure. Je suis favorable au maintien de cette sanction qui a donné, dans un premier temps, d’excellents résultats, notamment à Paris, tant sur le plan préventif qu’humanitaire. On constate, cependant, une dégradation de la situation. Comment revenir à une application plus rigoureuse de la loi ? Quelle conséquence aura la directive européenne sur cette question ?
On assiste, par ailleurs, au développement de nouvelles formes de prostitution. De quelle manière la police peut-elle lutter contre la prostitution qui s’exerce par le biais d’Internet ou dans des lieux tels que les salons de massage ?
M. Claude Guéant, ministre de l’Intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration – Le chiffre de 20 000 personnes prostituées est une évaluation de nos services faite sur la base, d’une part, des informations fournies par les associations et, d’autre part, des données de police relatives aux procédures ouvertes pour racolage et pour proxénétisme.
Peut-on envisager, selon le modèle suédois, un délit visant les clients de la prostitution ? Cette proposition mérite la plus grande attention. D’après ce que nous savons de ce qui s’est fait en Suède, une telle mesure conduit à des résultats évidents. Cela dit, cela supposerait une révision juridique profonde de l’ensemble du régime pénal de la prostitution. Car la prostitution n’est pas, aujourd’hui, un délit ; il paraît donc difficile de faire de la pratique du client un délit. Une remise en cause globale pourrait être envisagée, mais cela mérite, vraiment, attention. L’extension du modèle suédois dans d’autres pays offrira un spectre d’analyse de cette mesure et de ses effets qui pourra être très intéressant.
Concernant le plan de lutte contre la traite des êtres humains, un ensemble de trente-trois mesures a été défini conjointement par les ministères de la Justice et de l’Intérieur. La création d’une instance d’animation est prévue auprès du garde des Sceaux. Dans quelques jours, se tiendra une réunion au cabinet du Premier ministre pour déterminer la nature de la participation des différents ministères concernés. Mon ministère sera représenté au comité de pilotage par un officier qui a été choisi parmi le personnel de la police aux frontières car le problème de la traite touche beaucoup de personnes venant de l’étranger.
Pour répondre à nos obligations internationales, il nous faut procéder à la création d’un rapporteur indépendant qui, extérieur à l’administration, suivra les questions de la traite et de la prostitution. Il me semble que cette fonction pourrait relever de la compétence du Défenseur des droits ; ce sont en effet les droits de l’homme qui sont en jeu. Cette proposition figure dans le plan d’action.
Les mesures de lutte contre le racolage introduites par la loi de 2003 pour la sécurité intérieure ont eu des effets visibles. L’espace public n’est plus envahi comme il avait pu l’être dans certains quartiers. Mais il est vrai que le nombre de procédures pour racolage a baissé, passant de plus de 3 000 en 2004 à 1 300 en 2009. Trois raisons expliquent cette évolution. Elle traduit d’abord l’efficacité même du dispositif. On constate aussi que le juge choisit, le plus souvent, de prononcer un simple rappel à la loi, ce qui n’est pas un encouragement à la mise en œuvre des dispositions qu’offre la loi. Enfin, de nouvelles formes de prostitution sont apparues : se développe un marché de la prostitution sur la voie publique qui se fait sans racolage manifeste ; des nouveaux lieux apparaissent, comme les appartements privés et les salons de massage. Quant au racolage par le biais d’Internet, celui-ci ne tombe pas sous le coup de la loi. Il reviendra au législateur de prendre en compte cette nouvelle pratique.
M. Guy Geoffroy, rapporteur – Parmi les modes de racolage, notre mission d’information a appris, avec étonnement, que des journaux, parmi lesquels, par exemple, La Provence ou Le Midi Libre, faisaient paraître des petites annonces qui sont clairement des offres de prostitution. Ces pratiques ne suscitent aucune réaction des autorités. Comment l’expliquer et comment combattre cette forme de racolage ?
Par ailleurs, de quelle formation les forces de l’ordre bénéficient-elles pour identifier parmi les personnes prostituées celles qui sont victimes de réseaux de traites d’êtres humains ?
M. Claude Guéant, ministre de l’Intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration – Les petites annonces qui pullulent dans la presse et sur Internet sont en effet choquantes. L’Office central pour la répression de la traite des êtres humains est très attentif à ce phénomène.
Ces pratiques sont difficiles à sanctionner. Le contenu souvent sibyllin des messages est un problème sur le plan juridique. De plus, les tribunaux font une application stricte de l’article 225-10-1 du code pénal relatif aux conditions permettant de caractériser un acte de racolage ; le texte ne fait mention ni des annonces dans les journaux ni d’Internet. Pour le sanctionner, de nouvelles dispositions devraient être prévues par le législateur.
La formation des personnels concernés est une préoccupation très importante pour mon ministère et pour celui de la justice. L’École nationale de la magistrature a ouvert une session de formation destinée à sensibiliser les policiers et les gendarmes aux questions juridiques relatives à la traite des êtres humains. L’Office central chargé de cette question a établi un canevas pour mener les auditions des personnes prostituées. Des fiches techniques et un DVD ont été diffusés aux services au mois de juillet 2010 pour mieux mettre en évidence les actes criminels liés à la prostitution.
M. Philippe Goujon – Il est dommage qu’on n’ait pas procédé aux modifications législatives nécessaires à l’occasion de la discussion de la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure dans laquelle figuraient des dispositions sur Internet. Pour que le racolage passif ne soit pas sanctionné seulement par un rappel à la loi, pensez-vous qu’il soit nécessaire de modifier la loi de 2003 pour la sécurité intérieure ?
M. Claude Guéant, ministre de l’Intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration – La prostitution est toujours une exploitation de la misère humaine. Le législateur, en 2003, avait voulu lutter contre celle-ci avec le maximum d’efficacité. Comme il l’a fait à l’occasion d’initiatives législatives récentes, ce serait une bonne chose qu’il fasse peser des obligations plus fortes sur le juge afin que la loi du 2003 pour la sécurité intérieure soit appliquée dans un esprit plus conforme à ses objectifs.
M. Guy Geoffroy, rapporteur – Les dispositifs juridiques actuels ne sont pas suffisants pour caractériser un délit de racolage par le biais de petites annonces. Cependant, de même qu’il existe un proxénétisme hôtelier qui a conduit à prononcer la fermeture d’hôtels, ne pourrait-on pas caractériser, de façon similaire, ce qu’on pourrait appeler un « proxénétisme médiatique » ?
M. Claude Guéant, ministre de l’Intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration – Deux approches sont possibles. La première consisterait à qualifier le contenu de ces annonces comme constituant des faits de racolage au sens de la loi de 2003. La seconde viserait à dissuader les journaux de se prêter à de telles pratiques. Je ne sais pas s’il faut considérer qu’il s’agit de proxénétisme mais des mesures de dissuasion sont très certainement envisageables.
M. Philippe Goujon – Sur la question du racolage passif, quelles sont les évolutions législatives qui seront rendues nécessaires par la directive européenne ?
M. Claude Guéant, ministre de l’Intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration – La directive vient en complément de notre droit interne et confirme les choix faits par la loi de 2003. Elle rendra, en outre, plus efficace la coopération entre les États.
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
Mardi 7 septembre 2010
— Mme Johanne VERNIER, juriste, auteur d’une étude sur la traite des êtres humains pour la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH)
— Mme Noémie BIENVENU, chargée de mission
Mardi 14 septembre 2010
• Groupe de travail interministériel sur la traite
— Mme Elisabeth MOIRON-BRAUD, chef de bureau de l’aide aux victimes et de la politique associative au ministère de la Justice et des libertés
— M. Éric PANLOUP, lieutenant-colonel de gendarmerie et Mme Cendrine LÉGER, commandant de police
— M. Jean-Marc SOUVIRA, commissaire divisionnaire, ancien responsable de l’Office central pour la répression de la traite des êtres humains (OCRTEH)
Mardi 5 octobre 2010
— Mme Maryvonne CAILLIBOTTE, directrice des affaires criminelles et des grâces
— Mme Élisabeth TOMÉ-GERTHEINRICHS, chef du service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes
Mardi 12 octobre 2010
• Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Paris
— M. Alain PHILIBEAUX, magistrat instructeur, premier vice-président du tribunal de grande instance de Paris
— Mme Véronique DEGERMANN, chef de section du parquet chargé du proxénétisme
• Coalition contre la traite des femmes (CATW)
— Mme Malka MARCOVICH, directrice pour l’Europe
• Mouvement du Nid
— M. Jacques HAMON, président
— M. Grégoire THÉRY, secrétaire général
— Mme Claire QUIDET, membre du conseil d’administration
Mardi 26 octobre 2010
• Coordination française pour le lobby européen des femmes
— Mme Olga TROSTIANSKY, présidente
— Mme Michèle VIANÈS, vice-présidente
— M. Lilian MATHIEU, sociologue
— M. Patrick HAUVUY, directeur de l’association Accompagnement lieu d’accueil (ALC)
Mardi 2 novembre 2010
— M. Jean-Philippe NAUDON, directeur du recouvrement au Régime social des indépendants (RSI)
• Amicale du Nid
— Mme Geneviève DUCHÉ, vice-présidente
— M. Jean-Christophe TÊTE, directeur de l’établissement de Paris
— M. Fabrice HEYRIES, directeur général de la cohésion sociale
Mercredi 3 novembre 2010
• Déplacement à la Préfecture de police de Paris
— M. Jean-Jacques HERLEM, directeur adjoint de la police judiciaire
— M. Christian KALCK, chef de la brigade de répression du proxénétisme (BRP) et M. Jean-Philippe LENORMAND, adjoint au chef de la BRP
— M. Philippe CARON, directeur territorial de Paris à la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP)
— Commandant BERTRAND, chef adjoint du service d’investigations transversales
— M. Laurent MERCIER, commissaire central adjoint du XIIe arrondissement
— M. Jean-Michel FOUCHOU-LAPEYRADE, commissaire central du XVIe arrondissement
Mardi 9 novembre 2010
• Association contre la prostitution des enfants (ACPE)
— M. Bernard ROUVERAND
— Mme Christine BEGHAGEL
• Association des Amis du Bus des femmes
— Mme Claude BOUCHER, présidente
— Mme Vanessa SIMONI, chef de projet
Mardi 16 novembre 2010
— M. François LUCAS, préfet, directeur de l’immigration
• Services des étrangers des préfectures de la petite couronne
Préfecture de police de Paris
— Mme Katia BOUDRAA, chef de la section des affaires générale à la direction de la police générale
— Mme Florise CAO, adjointe
Préfecture de police de Seine-Saint-Denis
— M. Olivier NOLLEN, chef du bureau des examens spécialisés
— M. Aurélien GAUCHERAND, chef du bureau des étrangers de la sous-préfecture du Raincy
Préfecture de police des Hauts-de-Seine
— Mme Cécile OURAULT, adjointe au chef du bureau du séjour des étrangers
Préfecture de police du Val-de-Marne
— M. Olivier HUISMAN, sous- préfet à la ville
• Action et droits des femmes exilées et migrantes (ADFEM)
— Mme Claudie LESSELIER (Rajfire)
— Violaine HUSSON (Cimade)
— Mme Cynthia MARTIN (Femmes de la Terre)
— Mme Odile SCHWERTZ-FAVRAT (Fasti)
Mardi 23 novembre 2010
• Fondation Selles
— M. Yves CHARPENEL, président
— M. Yves SCELLES, vice-président
— M. Frédéric BOISARD, chef de projets
— Mme Sandra AYAD, responsable du centre de recherches
• Syndicat du travail sexuel (STRASS)
— « Maîtresse Gilda », porte-parole nationale
— Mme Sarah-Marie MAFFESOLI, conseillère juridique
• Association Hors la rue
— M. Alexandre LECLEVE, directeur
— M. Olivier PEYROUX, responsable des projets européens
Mardi 30 novembre 2010
• Collectif Droits et Prostitution
— Mme Malika AMAOUCHE, coordinatrice du collectif
• Table ronde
— Mme Sylviane AGACINSKY, philosophe
— M. Norbert CAMPAGNA, philosophe, professeur associé à l’université du Luxembourg
— Mme Geneviève FRAISSE, philosophe et historienne
Mardi 7 décembre 2010
— Mme Janice RAYMOND
• Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS)
— Mme Sandrine ARNAUD, responsable de l’établissement de l’Amicale du Nid La Babotte à Montpellier et responsable du groupe de travail de la FNARS
— Mme Sophie ALARY, responsable du service des missions à la FNARS
— Mme Elsa HAJMAN, chargée de mission prostitution à la FNARS
Mardi 14 décembre 2010
— M. Cédric AMOURETE, avocat
— Mme Sidonie AMIOT, avocate au barreau de Montpellier, membre du Comité territorial Hérault de l’Amicale du Nid
— Mme Lucie NAYAK, doctorante en sociologie
Jeudi 16 décembre 2011
Déplacement à Lyon
— M. Francis VUIBERT, préfet délégué à l’égalité des chances
— Mme Véronique ESCOLANO, substitut générale à la cour d’appel de Lyon déléguée à la politique associative
— M. Marc DÉSERT, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon
— M. Pierre-Pascal ANTONINI, délégué du préfet
— Mme Nathalie CARON, avocate, membre du conseil de l’ordre
— Mme Nadine CAMP, de l’association Agir ensemble pour les droits de l’homme
— Commandant GIROUD, chef de la brigade de prévention sociale de la sûreté départementale
— Mme Isabelle OUDOT, vice-présidente chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal de grande instance de Lyon
— Mme Chantal DAMGE, responsable de la coordination des informations préoccupantes à l’aide sociale à l’enfance du Rhône
— M. Franck COURSON, commissaire, chef de la division criminelle de la direction interrégionale de police criminelle de Lyon
— M. Cédric SÉRANDIO, chef du service de l’immigration et de l’intégration à la préfecture du Rhône
— M. Nicolas JEUNE, chef de service à la maison des réfugiés
— Mme Pascale MARCELLIN, membre de l’Amicale du Nid
— M. Patrick LESCURE, directeur régional de Pôle emploi
— M. Pierre MICHELETTI, délégué régional de Médecins du monde
— M. Raphaël GLABI, directeur délégué « protection et promotion de la santé » à l’Agence régionale de santé Rhône-Alpes
— Mme Catherine ESPINASSE, chef de service « veille sociale, hébergement et habitat transitoire » à la direction départementale de la cohésion sociale du Rhône
— Mme Laetitia VERNIAU, assistante sociale au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires
— M. Daniel MELLIER, délégué régional du Mouvement du Nid
— Mme Florence GARCIA, directrice de l’association Cabiria
Mardi 21 décembre 2010
• Association Information Prévention Proximité Orientation (IPPO)
— Mme Anne-Marie PICHON, directrice
— Mme Maryse TOURNE, trésorière
• Conseil national du sida
— Professeur Willy ROZENBAUM, président
— M. Laurent GEFFROY, rapporteur
— Mme Françoise GIL, sociologue
Mardi 11 janvier 2011
— M. Jacques BARRÉ, président du Groupement national des chaînes hôtelières (GNC)
— M. René-Georges QUERRY, directeur de la sécurité du groupe Accor
• Femmes pour le dire, femmes pour agir
— Mme Maudy PIOT, présidente
— Mme Claire DESAINT, secrétaire adjointe
Mercredi 12 et jeudi 13 janvier 2011
Déplacement en Belgique
— M. Michael CARLIN, chef du secteur « cybercriminalité et traites des êtres humains » de la direction générale des affaires intérieures de la Commission européenne
— M. Olivier TELL, chef de l'unité de coopération judiciaire pénale de la Direction générale Justice de la Commission européenne
— Mme Eva-Britt SVENSSON, présidente de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres du Parlement européen
— M. Paul VAN THIELEN, directeur général de la police judiciaire, Police fédérale
— M. Wim BONTINCK, commissaire divisionnaire, chef de service de la cellule « traite des êtres humains » et de la lutte contre le proxénétisme, Police judiciaire fédérale
— M. Marcel BENATS, police fédérale de Liège, chef de division en matière de traite des êtres humains
— Mme Christine WILWERTH, procureur du Roi de Verviers, expert magistrat spécialisée dans les questions relatives à la prostitution
— Mme Renée RAYMAEKERS, chef de service, Office des étrangers, Service public fédéral de l'Intérieur
— Mme Sophie WIRTZ-JEKELER, Samilia Foundation
— Mme Patricia LECOQ, du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme
— Mme Anne VERCAUTEREN, coordinatrice
— Mme Caroline DESIR, membre de la commission intérieure du Sénat.
— M. Paolo DE FRANCESCO, membre de la commission des Affaires sociales du Sénat.
— Mme Céline VAN NEYVERSEEL, attachée Action sociale & Famille, Cabinet de M. Émir KIR, ministre bruxellois chargé de l'action sociale
Déplacement aux Pays-Bas
— Mme Martine BIEDNARCZYK, chef du bureau France auprès d’EUROPOL
— Mme Angelika MOLNAR, analyste au groupe « prostitution et traite des êtres humains » d’EUROPOL
— M. Mahrez ABASSI, représentant adjoint de la France à EUROJUST
— M. Paul PETERS, sénateur
— Mme Corinne DETTMEIJER-VERMEULEN, rapporteure nationale sur la traite des êtres humains
— Mme Marlies VAN AMERONGEN, association Article 273f
— Mme Esther VAN FESSEM–VAN DER WALK, conseillère politique au ministère de la Sécurité et de la Justice
— M. Marnix NORDER, échevin à la mairie de La Haye
— Mme Carin HOFMAS, chargée de mission « traite des êtres humains et prostitution »
— M. Henri VAN DER HEIJDEN, Mme Roos DEN HENGST, Mmes Monique VAN DER BRUGGE
— Mme Anita BAKKER, brigade des mœurs commerciales de la police de La Haye
— Mme Ingrid VAN DEN BOSCH, clinique des maladies sexuellement transmissibles
Mercredi 19 janvier 2011 – Vendredi 21 janvier 2011
Déplacement en Suède
— Mme Helén LUNDKVIST, directrice générale adjointe au ministère de l’Éducation
— Mme Elisabeth WHITE
— M. Morgan JOHANSSON, (député social-démocrate), président de la Commission « Justice »
— M. Johan LINANDER (député parti du centre), vice-président
— Mme Pye JAKOBSSON, représentante de l’association Rose Alliance
— Mme Kajsa WAHLBERG, inspecteur-détective au Département des affaires de la police, Office national de police suédois, rapporteur sur les questions de traite des êtres humains
— M. Patrik CEDERLÖF, coordinateur national contre la prostitution et la traite des êtres humains
— Mme Kjerstin BERGMAN, agence nationale pour les affaires sociales
— Mme Anna SKARHED, chancelière de Justice
— Mme Petra ÖSTERGREN, sociologue
Mardi 25 janvier 2011
• Grisélidis
— Mme Julie SARRAZIN, co-directrice
— Mme Véronique BOYER, animatrice de prévention sur l’action Internet
— Mme Annie IVANOVA, médiatrice culturelle
Mardi 1er février 2011
• Table ronde Services de médecine préventive
— Mme Annie PERUFEL, infirmière (Université Paris Descartes)
— Mme Martine LEGRAND, infirmière (Université Paris I)
— Mme Laure BOISJOLY, psychologue (Université Paris Diderot)
• Table ronde Syndicat étudiants
— M. Philippe LOUP, président de la Fédération des associations générales étudiantes (FAGE)
— M. Pascal ELLUL, président de section de l’Union nationale inter-universitaire (UNI)
— Mme Cerise VINCENT, secrétaire générale de Promotion et défense des étudiants (PDE)
— Mme Marie PRIEUR, porte parole de SUD Étudiants
Jeudi 3 février 2011
Déplacement à Marseille
— M. Jean-Louis DELTEIL, avocat général à la cour d’appel d’Aix-en-Provence
— M. Jacques DALLEST, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille
— M. Olivier MESSENS, commissaire divisionnaire à la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône, chef de la sûreté départemental
— Commandant Michel MARTINEZ, chef de la brigade de répression du proxénétisme de Marseille
— Lieutenant-colonel Alain ESPINOSA, section de recherche de la gendarmerie
— Mme Michèle ZOLLER, délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité
— Mme Hélène de RUGY, déléguée générale de l’Amicale du Nid à Marseille
— Mme Valérie SECCO
— M. Jean-Régis PLOTON, directeur de l’association Autres Regards
— Mme Roxana BOLDOR, assistante sociale au Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) Les lucioles à Nice
— M. SUR, juge des enfants au tribunal de grande instance de Marseille
— M. Luc CHARPENTIER, direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse
— M. Jean BLANC, chef du service prévention au conseil général des Bouches-du-Rhône
— Major Claude PEILLON, brigade départementale de protection de la jeunesse
— Mme Marie-Cécile MARCELLESI, chargée de mission à l’agence régionale de santé (ARS)
— Mme Claude ARAGON, brigade de contrôle et de recherche de la direction régionale des finances publiques
— Mme Jacqueline HATCHILIGUIAN, chargée de mission droit des femmes à la préfecture des Bouches-du-Rhône
— M. Daniel BABOLAT, capitaine de gendarmerie
— Mme Virginie BAUDOUIN, direction régionale de Pôle emploi
— M. Vincent GIRARD, psychiatre à l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille (APHM)
— Mme Chantal VERNAY-VAISSE, chef du service de prévention des infections sexuellement transmissibles au conseil général des Bouches-du-Rhône
— Mme Lisa TICHANE, directrice du planning familial des Bouches-du-Rhône
Mardi 8 février 2011
— Mme Claudine LEGARDINIER, journaliste, accompagnée d’une ancienne personne prostituée
Mardi 15 février 2011
• Table ronde sur les conséquences physiques et psychologiques de la prostitution
— Docteur Muriel SALMONA, psychiatre
— Docteur Judith TRINQUART
— Mme Nathalie SIMONNOT (Lotus Bleu)
— Docteur Françoise GUILLEMETTE (Lotus Bleu)
— Docteur Ai Anh VO TRAN
Mercredi 16 – Vendredi 18 février 2011
Déplacement en Espagne
— M. Eugenio PEREIRO BLANCO, sous-directeur général de la coopération policière internationale
— Mme Maria MARCOS, directrice du Centre contre le crime organisé (CICO)
— Mme Rocio MORA, coordinatrice de l’APRAMP et trois victimes de la traite
— Mme Ana GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, directrice de cabinet de la Secrétaire d’État à l’Égalité
— Mme Maria JOSÉ PÉREZ, directrice de la direction générale de la femme de la Communauté de Madrid
— Mme ROCÍO DE LA HOZ GÓMEZ, directrice générale à l’Egalité des Chances, service « Famille et services sociaux » de la Mairie de Madrid
— Mme Rosario SEGURA GRAIÑO, chef du service des Études de l’Institut de la Femme
— M. Emilio GALLENO, secrétaire général de la Fédération espagnole de l’hôtellerie (FEHR)
— Mme Elsa BLASCO, conseillère municipale à la mairie de Barcelone
— Mme Malika ZEDJAOUI, mairie de Barcelone
— Mme Núria SERRA, responsable de l’agence pour une approche intégrale du travail sexuel de la mairie de Barcelone
— Mme Marta PUCHAL, directrice des relations internationales
— Mme Rosa Maria CEDON
— Mme Carmen CANYELLES, de l’association SICAR (Traite des Femmes et Environnements des Prostituées)
— Mme Lourdes PERRAMÓN
— Teresa BALAGUÉ, du Lloc de la Dona, Centre d’aide sociale dirigé aux femmes autochtones et immigrantes
— M. Juan FORTUNY, commissaire et responsable de l'UCRIF (Unité contre les Réseaux d’Immigration et de Falsification), police nationale espagnole
— M. Joan DELORT, secrétaire d'État à la Sécurité intérieure de la Catalogne
— M. Ferran LOPEZ, commissaire, coordinateur des opérations de la police
— M. Toni PERMANYER, commissaire, responsable du commissariat général des enquêtes criminelles de la Catalogne
— M. Jordi CABEZAS, maire de la Jonquera
— M. Joaquim BELENGUER, commissaire, responsable de la région policière de Gérone
— M. Alfons SÁNCHEZ GARCIA, inspecteur, chef de police du Haut-Ampurdan
Mardi 1er mars 2011
— Mme Myriam QUÉMENER, magistrate
Mardi 15 mars 2011
— M. Vincent MONTRIEUX, conseiller pénal au cabinet de M. Michel MERCIER, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des libertés
Déplacement à l’Amicale du Nid de Paris
— Rencontre avec cinq anciennes personnes prostituées.
Mercredi 30 mars 2011
— M. Michel MERCIER, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des libertés
— Mme Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre des Solidarités et de la cohésion sociale.
Jeudi 7 avril 2011
— M. Claude GUÉANT, ministre de l’Intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration
Annexe 1 : Recensement des bars à hôtesses et salons de massage en France métropolitaine 352
Annexe 2 : Violences subies dans le cadre de l’activité prostitutionnelle 354
Annexe 3 : Les personnes prostituées face aux infections sexuellement transmissibles 355
Annexe 4 : Consommation de drogues et activité prostitutionnelle 357
Annexe 5 : Statistiques judiciaires en matière de proxénétisme 359
Annexe 6 : La situation fiscale des personnes prostituées 361
Annexe 7 : L’armée française et la prostitution 365
Annexe 8 : Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de prostitution d’autrui 368
Annexe 9 : Convention cadre sur la traite des êtres humains conclue à Lyon le 22 avril 2010 375
Annexe 10 : Document des ministères de l’Intérieur et de la Justice sur l’identification des victimes de la traite des êtres humains 382
RECENSEMENT DES BARS À HÔTESSES ET SALONS DE MASSAGE
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE
Ville |
Bars à hôtesse/ Bars/Cabarets |
Établissement de massage |
Autres (clubs de rencontres, clubs de striptease…) |
Paris |
130 |
||
Maisons-Laffitte |
1 |
||
Saint-Germain-lès-Arpajon |
1 |
||
Enghien-les-bains |
1 |
||
Marseille |
14 |
4 |
14 |
Toulon |
5 |
||
Nice et Cannes |
6 |
3 |
|
Montpellier |
5 |
25 |
|
Béziers |
3 |
3 |
|
Sète |
3 |
||
Agde |
5 |
||
Nîmes |
3 |
||
Orange |
2 |
||
Carpentras |
1 | ||
Perpignan |
15 |
||
Narbonne |
5 |
||
Ajaccio |
3 |
||
Bastia |
6 |
||
Grenoble |
13 |
6 |
|
Saint-Etienne |
10 |
||
Lyon |
26 |
21 |
|
Anemasse |
2 |
10 |
|
Gaillard |
2 |
1 |
|
Clermont-Ferrand |
2 |
||
Vichy |
5 |
||
Montluçon |
4 |
||
Châteauroux |
4 |
||
Bordeaux |
30 |
15 |
|
Périgueux |
3 |
||
Bergerac |
2 |
||
Tarbes |
2 |
||
Toulouse |
9 |
16 |
|
Strasbourg |
12 |
2 |
|
Metz |
5 |
1 |
|
Reims |
4 |
||
Troyes |
1 |
1 | |
Nancy |
15 |
4 |
|
Charleville-Mézières |
3 |
||
Dijon et Chenove |
4 |
1 |
|
Besançon |
2 |
||
Belfort |
5 |
||
Brest |
4 |
||
Quimper |
1 |
||
Rennes |
6 |
3 |
|
Nantes |
29 |
20 |
|
Saint-Nazaire |
4 |
||
Lorient |
9 |
||
Rouen |
13 |
||
Le Havre |
12 |
||
Lille |
5 |
1 |
|
Boulogne |
1 |
||
Lens |
1 |
1 |
Source : Rapport de l’OCRTEH, 2009.
ANNEXE 2 : VIOLENCES SUBIES DANS LE CADRE DE L’ACTIVITÉ PROSTITUTIONNELLE (MÉLISSA FARLEY ET AL., 2003)
Moyenne des 9 pays étudiés |
Canada |
Colombie |
Allemagne |
Mexique |
Afrique du Sud |
Thaïlande |
Turquie |
États-Unis |
Zambie | |
Prostituées menacées par une arme à feu |
64% |
67% |
59% |
52% |
48% |
68% |
39% |
68% |
78% |
86% |
Prostituées agressées physiquement |
73% |
91% |
70% |
61% |
59% |
66% |
56% |
80% |
82% |
82% |
Prostituées violées dans l’exercice de leur activité |
57% |
76% |
47% |
63% |
46% |
56% |
38% |
50% |
73% |
79% |
Prostituées violées plus de cinq fois |
59% |
67% |
64% |
50% |
44% |
58% |
56% |
36% |
59% |
52% |
Prostituées sans domicile fixe actuellement ou par le passé |
75% |
86% |
76% |
74% |
55% |
73% |
57% |
58% |
84% |
89% |
Prostituées violemment battues dans leur enfance par leur tuteur légal |
59% |
73% |
66% |
48% |
57% |
56% |
39% |
56% |
49% |
71% |
Prostituées abusées sexuellement dans leur enfance |
63% |
84% |
67% |
48% |
54% |
66% |
47% |
34% |
57% |
84% |
Nombre moyen d’abus sexuels sur mineurs |
4 |
5 |
2 |
17 |
2 |
2 |
1 |
Inconnu |
2 |
6 |
Nombre médian d’abus sexuels sur mineurs |
1 |
3 |
1 |
4 |
1 |
1 |
0 |
Inconnu |
1 |
3 |
LES PERSONNES PROSTITUÉES FACE AUX INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES
STATUT SÉROLOGIQUE DES FEMMES PROSTITUÉES SELON LEUR LIEU DE NAISSANCE
(d’après une étude de 2003)
VIH |
VHC |
VHB | |||||||
Inconnu |
Négatif |
Positif |
Inconnu |
Négatif |
Positif |
Inconnu |
Négatif |
Positif | |
Europe de l’Ouest |
2 % (2) |
94 % (76) |
4 % (3) |
4 % (3) |
90 % (73) |
6 % (5) |
5 % (4) |
94 % (76) |
1 % (1) |
Europe de l’Est |
17 % (7) |
83 % (33) |
- (0) |
27 % (11) |
73 % (29) |
- (0) |
27 % (11) |
73 % (29) |
- (0) |
Afrique sub-saharienne* |
15 % (5) |
85 % (28) |
- (0) |
21 % (7) |
79 % (26) |
- (0) |
21 % (7) |
79 % (26) |
- (0) |
Maghreb |
19 % (3) |
81 % (13) |
- (0) |
13 % (2) |
81 % (13) |
6 % (1) |
12 % (2) |
88 % (14) |
- (0) |
Amériques |
- (0) |
100 % (3) |
- (0) |
33 % (1) |
67 % (2) |
- (0) |
- (0) |
100 % (3) |
- (0) |
Total |
10 % (17) |
88 % (153) |
2 % (3) |
14 % (24) |
83 % (143) |
3 % (6) |
14 % (24) |
85 % (148) |
1 % (1) |
* pour les sept personnes originaires du Nigeria, seulement quatre connaissent leur statut sérologique.
TAUX D’INFECTION PAR L’HÉPATITE C DES HOMMES EN SITUATION DE PROSTITUTION
(d’après une étude de 2003)
Catégorie |
Taux d’infection d’hépatite B | |||
Inconnu |
Négatif |
Positif |
TOTAL = N | |
Garçon |
40 % |
59 % |
1 % |
126 |
Transgenre |
12 % |
86 % |
2 % |
122 |
TOTAL |
27 % |
72 % |
1 % |
248 |
Source : Laurindo Da Silva et Luizmar Evangelista, « La consommation de drogues et d’alcool dans le milieu masculin », 2003.
TAUX D’INFECTION PAR L’HÉPATITE B DES HOMMES EN SITUATION DE PROSTITUTION
(d’après une étude de 2003)
Catégorie |
Taux d’infection d’hépatite C | |||
Inconnu |
Négatif |
Positif |
TOTAL = N | |
Garçon |
41 % |
59 % |
0 % |
126 |
Transgenre |
9% |
89 % |
2 % |
121 |
TOTAL |
25 % |
74 % |
1 % |
249 |
Source : Laurindo Da Silva et Luizmar Evangelista, « La consommation de drogues et d’alcool dans le milieu masculin », 2003.
TAUX D’INFECTION PAR LE VIH DES HOMMES EN SITUATION DE PROSTITUTION
(d’après une étude de 2003)
Catégorie |
Taux d’infection par le VIH | |||
Inconnu |
Négative |
Positif |
TOTAL = N | |
Garçon |
18 % |
81 % |
1 % |
124 |
Transgenre |
0 % |
95 % |
5 % |
121 |
TOTAL |
9 % |
88 % |
3 % |
245 |
Source : Laurindo Da Silva et Luizmar Evangelista, « La consommation de drogues et d’alcool dans le milieu masculin », 2003.
CONSOMMATION DE DROGUES ET ACTIVITÉ PROSTITUTIONNELLE
PRODUITS CONSOMMÉS DANS LES 30 DERNIERS JOURS PAR LES HOMMES
EN SITUATION DE PROSTITUTION
Produits consommés |
Total par catégorie et pour l’ensemble des prostitués | |||
Garçon |
Transgenre |
Total = N |
Total % | |
Tabac |
75 % |
76 % |
189 |
75 % |
Alcool |
74 % |
84 % |
198 |
78 % |
Cannabis |
51 % |
62 % |
142 |
56 % |
Amphétamine |
1 % |
0 % |
1 |
0,4 % |
Antidépresseur |
3 % |
2 % |
7 |
3 % |
Calmant |
2 % |
7 % |
11 |
4 % |
Cocaïne |
4 % |
12 % |
20 |
8 % |
Crack |
2 % |
0 % |
2 |
0,8 % |
Héroïne |
2 % |
1 % |
4 |
2 % |
Poppers |
12 % |
14 % |
33 |
13% |
Solvant |
0 % |
1 % |
1 |
0,4 % |
Méthadone |
0 % |
1 % |
1 |
0,4 % |
Somnifère |
7 % |
22 % |
36 |
14 % |
Subutex |
1 % |
1 % |
2 |
0,8 % |
Ecstasy |
12 % |
2 % |
18 |
7 % |
* Plusieurs réponses possibles
Source : Laurindo Da Silva et Luizmar Evangelista, « La consommation de drogues et d’alcool dans le milieu masculin », 2003.
MOTIFS DE LA PRISE D’ALCOOL ET DE PRODUITS STUPÉFIANTS CHEZ LES HOMMES EN SITUATION DE PROSTITUTION
Produits |
Motif de la prise des produits | |||||||
Détente hors travail |
Détente au moment du travail |
Courage pour travailler |
Demande du client |
S’exciter |
S’apaiser |
Par plaisir |
autres | |
Alcool |
31 % |
10 % |
5 % |
9 % |
2 % |
9 % |
33 % |
0,2 % |
Cannabis |
37 % |
8 % |
2 % |
0,5 % |
1 % |
13 % |
38 % |
0,5 % |
Hallucinogènes** |
0 % |
3 % |
0 % |
51 % |
28 % |
0 % |
18 % |
0 % |
Médicaments |
41 % |
2,5 % |
0, % |
0, % |
1 % |
53 % |
1 % |
1,5 % |
Opiacs** |
32,5 % |
13% |
0 % |
0 % |
0 % |
46 % |
7,5 % |
1 % |
Stimulants** |
19 % |
11 % |
3 % |
6,5 % |
11,5 % |
12 % |
37 % |
0 % |
Total N = 1 106 |
31 % |
8 % |
31 % |
8 % |
4 % |
14 % |
31 % |
1 % |
*Plusieurs réponses possibles
** Hallucinogènes : LSD, champignon, gamma OH, poppers, Kétamine®
** Opiacs : Héroïne, subutex®, sulfate de morphine (Moscontin® et Skenan®), méthadone, codéine
** Stimulants : Cocaïne, crack (free-base), amphetamines/speeds, Ecstasy
Source : Laurindo Da Silva et Luizmar Evangelista, « La consommation de drogues et d’alcool dans le milieu masculin », 2003.
PRODUITS CONSOMMÉS PAR LES FEMMES EN SITUATION DE PROSTITUTION
Consommation * |
Femmes non dépendantes des opiacés (n = 147) |
Femmes dépendantes des opiacés (n = 22) |
Ensemble des femmes (n = 169) |
Alcool |
(4) 3 % |
(3) 14 % |
(7) 4 % |
Tabac |
(86) 58 % |
(22) 100 % |
(108) 64 % |
Cannabis |
(10) 7 % |
(17) 77 % |
(27) 16 % |
Médicaments (actuelle) |
(24) 16 % |
(10) 45 % |
(34) 20 % |
Hallucinogènes |
(2) 1 % |
(2) 9 % |
(4) 2 % |
Poppers |
(0) - |
(8) 36 % |
(8) 5 % |
Cocaïne |
(10) 7 % |
(20) 91 % |
(30) 18 % |
Autres stimulants |
(3) 2 % |
(2) 9 % |
(5) 3 % |
Opiacés |
(2) 1 % |
(22) 100 % |
(24) 14 % |
* Pour l’alcool, le tabac et le cannabis il s’agit des consommations actuelles ; pour les autres produits, sauf les médicaments, il s’agit de la consommation au cours de la vie.
Source : Suzanne Cagliero et Hugues Lagrange, dans « La consommation de drogues et d’alcool dans le milieu prostitutionnel féminin », 2002.
STATISTIQUES JUDICIAIRES : NOMBRE DE CONDAMNATIONS ANNUELLES EN MATIÈRE DE PROXÉNÈTISME
► Proxénétisme simple :
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009* | |||
Aide apportée à un proxénète dans la justification de ressources fictives |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
4 |
0 |
1 |
0 | ||
Proxénétisme : aide, assistance ou protection de la prostitution d'autrui |
165 |
171 |
145 |
129 |
156 |
133 |
129 |
175 |
163 |
138 | ||
Proxénétisme : embauche, entraînement, détournement ou pression sur autrui |
29 |
30 |
34 |
20 |
24 |
23 |
28 |
25 |
39 |
34 | ||
Proxénétisme : intermédiaire entre un individu prostitué et celui qui l'exploite |
5 |
11 |
3 |
5 |
5 |
11 |
10 |
6 |
18 |
20 | ||
Proxénétisme : manœuvre entravant le contrôle ou l'assistance en faveur d'individu prostitué |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
Proxénétisme : non justification de ressources par une personne en relation avec prostitué |
11 |
10 |
6 |
9 |
13 |
4 |
1 |
3 |
4 |
3 | ||
Proxénétisme : non justification de ressources par une personne vivant avec prostitué |
6 |
5 |
2 |
7 |
3 |
3 |
3 |
5 |
6 |
2 | ||
Proxénétisme : partage des produits de la prostitution d'autrui |
189 |
146 |
101 |
105 |
118 |
114 |
115 |
131 |
134 |
137 | ||
Mise à disposition de local privé à la disposition d'une personne s'y livrant à la prostitution |
24 |
17 |
10 |
22 |
13 |
15 |
34 |
35 |
23 |
31 | ||
Mise à disposition de véhicule à la disposition d'une personne s'y livrant à la prostitution |
SO |
SO |
SO |
5 |
0 |
7 |
1 |
0 |
7 |
0 | ||
Tenue ou financement d'un établissement de prostitution |
38 |
17 |
18 |
31 |
23 |
8 |
20 |
14 |
19 |
19 | ||
Tolérance habituelle de la prostitution dans un lieu ouvert au public |
33 |
27 |
50 |
35 |
29 |
48 |
50 |
28 |
43 |
47 | ||
Vente d'un local prive à une personne devant s'y livrer à la prostitution |
1 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
0 |
1 |
0 |
3 | ||
Vente d'un véhicule à une personne devant s'y livrer à la prostitution |
SO |
SO |
SO |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
Total proxénétisme simple |
501 |
436 |
370 |
373 |
388 |
371 |
395 |
423 |
457 |
434 | ||
► Proxénétisme aggravé :
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009* | |||
Proxénétisme aggravé commis en bande organisée (crime) |
0 |
0 |
6 |
4 |
0 |
21 |
0 |
6 |
1 |
7 | ||
Proxénétisme aggravé : victime mineure de 15 ans (crime) |
SO |
SO |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
6 | ||
Proxénétisme aggravé : auteur chargé lutte contre la prostitution, protection santé ou ordre public |
2 |
2 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 | ||
Proxénétisme aggravé : par une personne abusant de son autorité |
4 |
1 |
0 |
1 |
1 |
6 |
1 |
2 |
3 |
0 | ||
Proxénétisme aggravé : utilisation d'un réseau de télécommunication |
0 |
0 |
3 |
1 |
7 |
3 |
37 |
36 |
24 |
28 | ||
Proxénétisme aggravé : pluralité auteurs ou complices |
88 |
70 |
102 |
218 |
177 |
140 |
160 |
138 |
142 |
125 | ||
Proxénétisme aggravé : pluralité de victimes |
114 |
62 |
106 |
220 |
240 |
253 |
250 |
274 |
203 |
198 | ||
Proxénétisme aggravé : port d'arme |
5 |
1 |
2 |
4 |
2 |
2 |
1 |
4 |
0 |
0 | ||
Proxénétisme aggravé : usage de contrainte, violences ou manœuvres dolosives |
51 |
27 |
22 |
96 |
49 |
62 |
53 |
63 |
34 |
30 | ||
Proxénétisme aggravé : victime hors du territoire national |
0 |
6 |
11 |
7 |
9 |
6 |
18 |
12 |
20 |
1 | ||
Proxénétisme aggravé : victime lors de son arrivée sur le territoire national |
35 |
40 |
24 |
117 |
72 |
88 |
136 |
89 |
63 |
71 | ||
Proxénétisme aggravé : victime mineure |
15 |
14 |
21 |
17 |
11 |
7 |
2 |
0 |
0 |
0 | ||
Proxénétisme aggravé : victime mineure de 15 ans à 18 ans |
0 |
0 |
2 |
13 |
18 |
31 |
40 |
38 |
21 |
25 | ||
Proxénétisme aggravé : victime particulièrement vulnérable |
5 |
2 |
5 |
11 |
5 |
5 |
5 |
6 |
1 |
7 | ||
Total proxénétisme aggravé |
319 |
225 |
305 |
711 |
592 |
627 |
705 |
669 |
512 |
498 | ||
* Données provisoires
SO = sans objet car année antérieure à l’instauration de l’infraction
Tableau récapitulatif :
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009* | |||
Total proxénétisme aggravé |
319 |
225 |
305 |
711 |
592 |
627 |
705 |
669 |
512 |
498 | ||
Total proxénétisme simple |
501 |
436 |
370 |
373 |
388 |
371 |
395 |
423 |
457 |
434 | ||
TOTAL |
820 |
661 |
675 |
1084 |
980 |
998 |
1100 |
1092 |
969 |
932 | ||
LA SITUATION FISCALE DES PERSONNES PROSTITUÉES
NOTE DU MINISTÈRE DES FINANCES
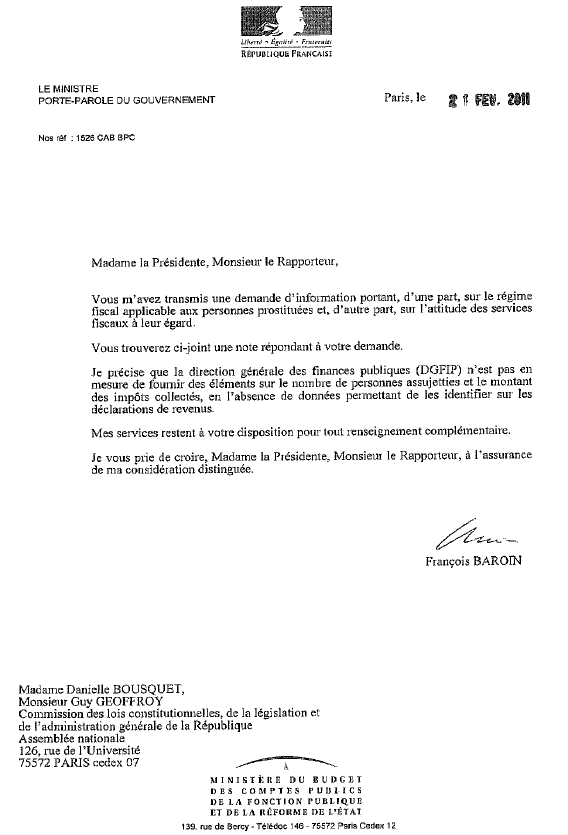
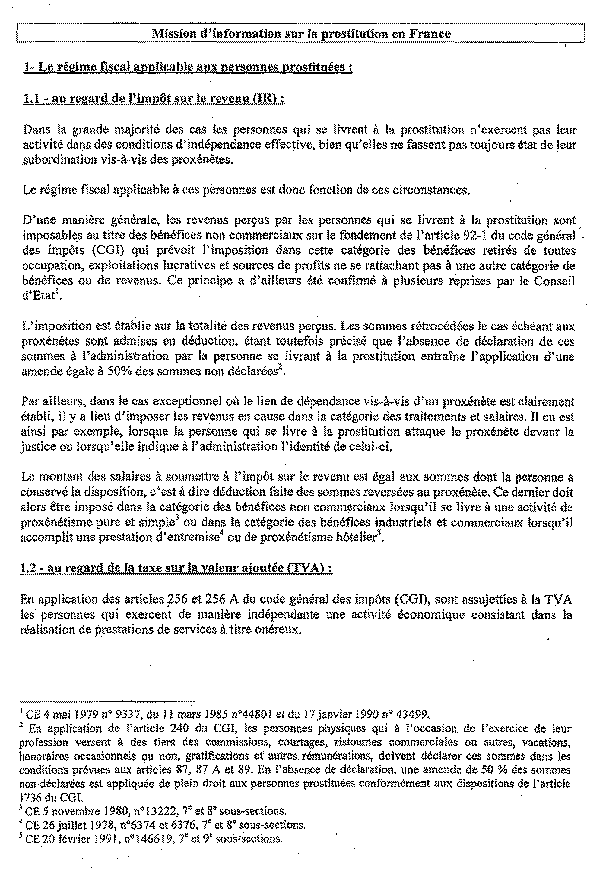
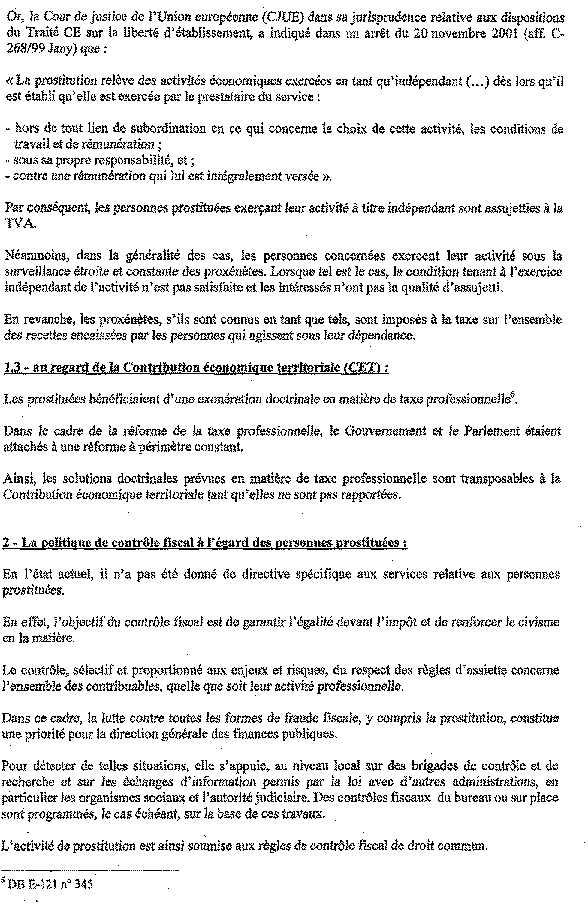
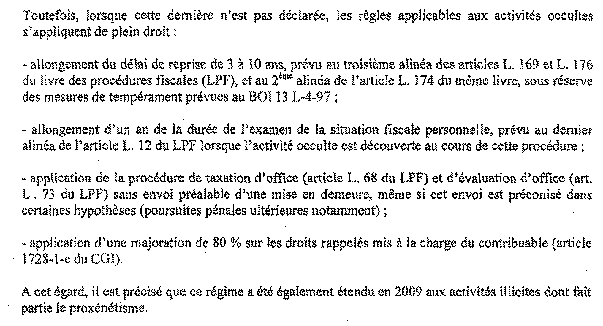
L’ARMÉE FRANÇAISE ET LA PROSTITUTION
NOTE DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
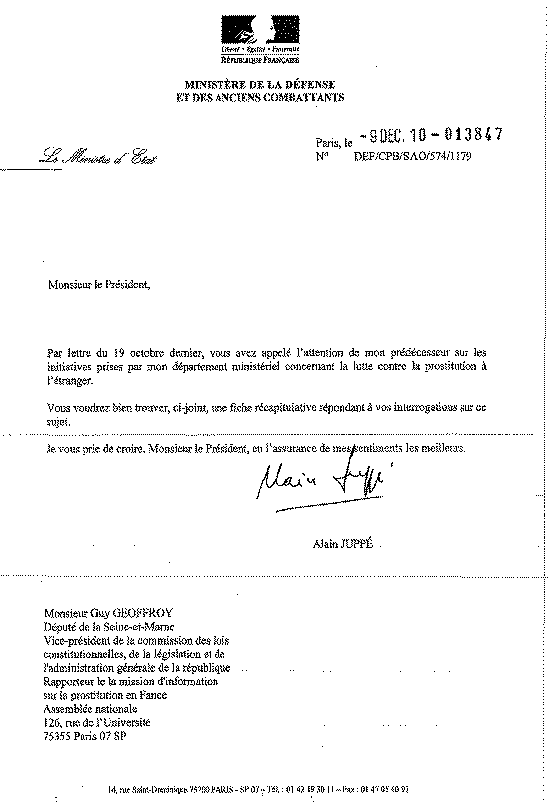
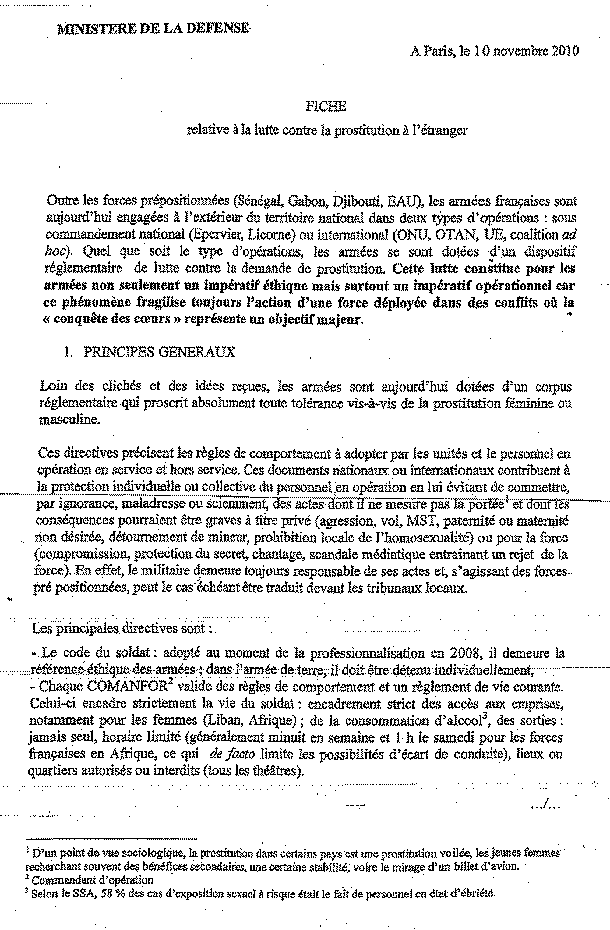
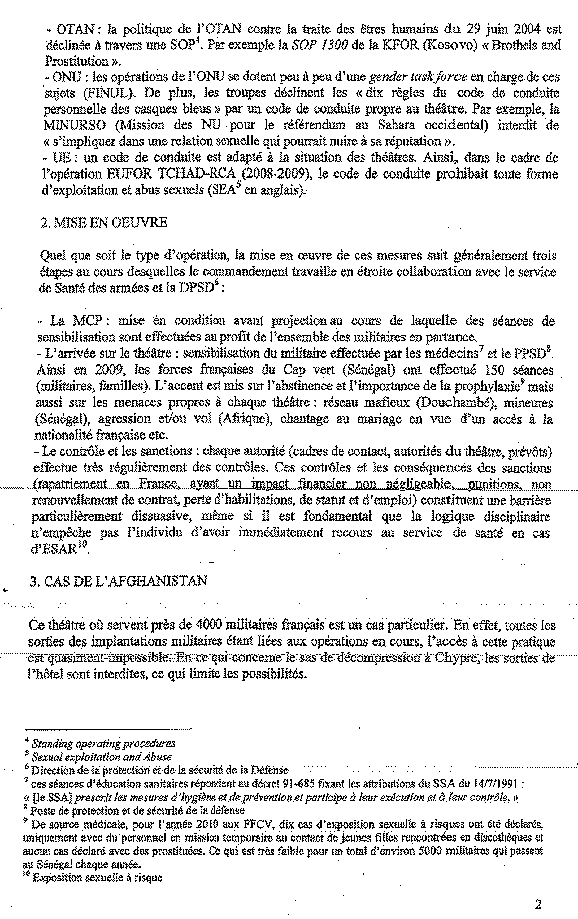
CONVENTION POUR LA RÉPRESSION DE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS ET DE L’EXPLOITATION DE PROSTITUTION D’AUTRUI
Approuvée par l'Assemblée générale dans sa résolution 317 (IV) du 2 décembre 1949
Entrée en vigueur : le 25 juillet 1951, conformément aux dispositions de l'article 24
Préambule
Considérant que la prostitution et le mal qui l'accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et mettent en danger le bien-être de l'individu, de la famille et de la communauté,
Considérant qu'en ce qui concerne la répression de la traite des femmes et des enfants, les instruments internationaux suivants sont en vigueur :
1) Arrangement international du 18 mai 1904 pour la répression de la traite des blanches, amendé par le Protocole approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 3 décembre 1948;
2) Convention internationale du 4 mai 1910 relative à la répression de la traite des blanches, amendée par le Protocole susmentionné;
3) Convention internationale du 30 septembre 1921 pour la répression de la traite des femmes et des enfants, amendée par le Protocole approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 20 octobre 1947;
4) Convention internationale du 11 octobre 1933 pour la répression de la traite des femmes majeures, amendée par le Protocole susmentionné;
Considérant que la Société des Nations avait élaboré en 1937 un projet de convention étendant le champ des instruments susmentionnés,
Considérant que l'évolution depuis 1937 permet de conclure une convention qui unifie les instruments ci-dessus mentionnés et renferme l'essentiel du projet de convention de 1937 avec les amendements que l'on a jugé bon d'y apporter.
En conséquence, les Parties contractantes conviennent de ce qui suit :
Article premier
Les Parties à la présente Convention conviennent de punir toute personne qui, pour satisfaire les passions d'autrui :
1) Embauche, entraîne ou détourne en vue de la prostitution une autre personne, même consentante;
2) Exploite la prostitution d'une autre personne, même consentante.
Article 2
Les Parties à la présente Convention conviennent également de punir toute personne qui :
1) Tient, dirige ou, sciemment, finance ou contribue à financer une maison de prostitution;
2) Donne ou prend sciemment en location, en tout ou en partie, un immeuble ou un autre lieu aux fins de la prostitution d'autrui.
Article 3
Dans la mesure où le permet la législation nationale, toute tentative et tout acte préparatoire accomplis en vue de commettre les infractions visées à l'article premier et à l'article 2 doivent aussi être punis.
Article 4
Dans la mesure où le permet la législation nationale, la participation intentionnelle aux actes visés à l'article premier et à l'article 2 ci-dessus est aussi punissable.
Dans la mesure où le permet la législation nationale, les actes de participation seront considérés comme des infractions distinctes dans tous les cas où il faudra procéder ainsi pour empêcher l'impunité.
Article 5
Dans tous les cas où une personne lésée est autorisée par la législation nationale à se constituer partie civile du chef de l'une quelconque des infractions visées par la présente Convention, les étrangers seront également autorisés à se constituer partie civile dans les mêmes conditions que les nationaux.
Article 6
Chacune des Parties à la présente Convention convient de prendre toutes les mesures nécessaires pour abroger ou abolir toute loi, tout règlement et toute pratique administrative selon lesquels les personnes qui se livrent ou sont soupçonnées de se livrer à la prostitution doivent se faire inscrire sur des registres spéciaux, posséder des papiers spéciaux, ou se conformer à des conditions exceptionnelles de surveillance ou de déclaration.
Article 7
Toute condamnation antérieure prononcée dans un Etat étranger pour un des actes visés dans la présente Convention sera, dans la mesure où le permet la législation nationale, prise en considération :
1) Pour établir la récidive;
2) Pour prononcer des incapacités, la déchéance ou l'interdiction de droit public ou privé.
Article 8
Les actes visés à l'article premier et à l'article 2 de la présente Convention seront considérés comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu ou à conclure entre des Parties à la présente Convention.
Les Parties à la présente Convention qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent dorénavant les actes visés à l'article premier et à l'article 2 de la présente Convention comme cas d'extradition entre elles.
L'extradition sera accordée conformément au droit de l'Etat requis.
Article 9
Les ressortissants d'un Etat dont la législation n'admet pas l'extradition des nationaux et qui sont rentrés dans cet Etat après avoir commis à l'étranger l'un des actes visés par l'article premier et par l'article 2 de la présente Convention doivent être poursuivis devant les tribunaux de leur propre Etat et punis par ceux-ci.
Cette disposition n'est pas obligatoire si, dans un cas semblable intéressant des Parties à la présente Convention, l'extradition d'un étranger ne peut pas être accordée.
Article 10
Les dispositions de l'article 9 ne s'appliquent pas lorsque l'inculpé a été jugé dans un Etat étranger, et, en cas de condamnation, lorsqu'il a purgé la peine ou bénéficié d'une remise d'une réduction de peine prévue par la loi dudit Etat étranger.
Article 11
Aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme portant atteinte à l'attitude d'une Partie à ladite Convention sur la question générale de la compétence de la juridiction pénale comme question de droit international.
Article 12
La présente Convention laisse intact le principe que les actes qu'elle vise doivent dans chaque Etat être qualifiés, poursuivis et jugés conformément à la législation nationale.
Article 13
Les Parties à la présente Convention sont tenues d'exécuter les commissions rogatoires relatives aux infractions visées par la Convention, conformément à leur législation nationale et à leur pratique en cette matière.
La transmission des commissions rogatoires doit être opérée :
1) Soit par voie de communication directe entre les autorités judiciaires;
2) Soit par correspondance directe entre les ministres de la justice des deux Etats, ou, par envoi direct, par une autre autorité compétente de l'Etat requérant, au ministre de la justice de l'Etat requis;
3) Soit par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou consulaire de l'Etat requérant dans l'Etat requis; cet agent enverra directement les commissions rogatoires à l'autorité judiciaire compétente ou à l'autorité indiquée par le gouvernement de l'Etat requis, et recevra directement de cette autorité les pièces constituant l'exécution des commissions rogatoires.
Dans les cas 1 et 3, copie de la commission rogatoire sera toujours adressée en même temps à l'autorité supérieure de l'Etat requis.
A défaut d'entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée dans la langue de l'autorité requérante, sous réserve que l'Etat requis aura le droit d'en demander une traduction faite dans sa propre langue et certifiée conforme par l'autorité requérante.
Chaque Partie à la présente Convention fera connaître, par une communication adressée à chacune des autres Parties à la Convention, celui ou ceux des modes de transmission susvisés qu'elle admet pour les commissions rogatoires de ladite Partie.
Jusqu'au moment où un Etat fera une telle communication, la procédure en vigueur en fait de commissions rogatoires sera maintenue.
L'exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement d'aucun droit ou frais autres que les frais d'expertise.
Rien dans le présent article ne devra être interprété comme constituant de la part des Parties à la présente Convention un engagement d'admettre une dérogation à leurs lois en ce qui concerne la procédure et les méthodes employées pour établir la preuve en matière répressive.
Article 14
Chacune des Parties à la présente Convention doit créer ou maintenir un service chargé de coordonner et de centraliser les résultats des recherches relatives aux infractions visées par la présente Convention.
Ces services devront réunir tous les renseignements qui pourraient aider à prévenir et à réprimer les infractions visées par la présente Convention et devront se tenir en contact étroit avec les services correspondants des autres Etats.
Article 15
Dans la mesure où le permet la législation nationale et où elles le jugeront utile, les autorités chargées des services mentionnés à l'article 14 donneront aux autorités chargées des services correspondants dans les autres Etats les renseignements suivants :
1) Des précisions concernant toute infraction ou tentative d'infraction visée par la présente Convention :
2) Des précisions concernant les recherches, poursuites, arrestations, condamnations, refus d'admission ou expulsions de personnes coupables de l'une quelconque des infractions visées par la présente Convention ainsi que les déplacements de ces personnes et tous autres renseignements utiles à leur sujet.
Les renseignements à fournir comprendront notamment le signalement des délinquants, leurs empreintes digitales et leur photographie, des indications sur leurs procédés habituels, les procès-verbaux de police et les casiers judiciaires.
Article 16
Les Parties à la présente Convention conviennent de prendre ou d'encourager, par l'intermédiaire de leurs services sociaux, économiques, d'enseignement, d'hygiène et autres services connexes, qu'ils soient publics ou privés, les mesures propres à prévenir la prostitution et à assurer la rééducation et le reclassement des victimes de la prostitution et des infractions visées par la présente Convention.
Article 17
Les Parties à la présente Convention conviennent, en ce qui concerne l'immigration et l'émigration, de prendre ou de maintenir en vigueur, dans les limites de leurs obligations définies par la présente Convention, les mesures destinées à combattre la traite des personnes de l'un ou de l'autre sexe aux fins de prostitution.
Elles s'engagent notamment :
1) À promulguer les règlements nécessaires pour la protection des immigrants ou émigrants, en particulier des femmes et des enfants, tant aux lieux d'arrivée et de départ qu'en cours de route;
2) À prendre des dispositions pour organiser une propagande appropriée qui mette le public en garde contre les dangers de cette traite;
3) À prendre les mesures appropriées pour qu'une surveillance soit exercée dans les gares, les aéroports, les ports maritimes, en cours de voyage et dans les lieux publics, en vue d'empêcher la traite internationale des êtres humains aux fins de prostitution;
4) À prendre les mesures appropriées pour que les autorités compétentes soient prévenues de l'arrivée de personnes qui paraissent manifestement coupables, complices ou victimes de cette traite.
Article 18
Les Parties à la présente Convention s'engagent à faire recueillir, conformément aux conditions stipulées par leur législation nationale, les déclarations des personnes de nationalité étrangère qui se livrent à la prostitution, en vue d'établir leur identité et leur état civil et de rechercher qui les a décidées à quitter leur Etat. Ces renseignements seront communiqués aux autorités de l'Etat d'origine desdites personnes en vue de leur rapatriement éventuel.
Article 19
Les Parties à la présente Convention s'engagent, conformément aux conditions stipulées par leur législation nationale et sans préjudice des poursuites ou de toute autre action intentée pour des infractions à ses dispositions et autant que faire se peut :
1) À prendre les mesures appropriées pour pourvoir aux besoins et assurer l'entretien, à titre provisoire, des victimes de la traite internationale aux fins de prostitution, lorsqu'elles sont dépourvues de ressources en attendant que soient prises toutes les dispositions en vue de leur rapatriement;
2) À rapatrier celles des personnes visées à l'article 18 qui le désireraient ou qui seraient réclamées par des personnes ayant autorité sur elles et celles dont l'expulsion est décrétée conformément à la loi. Le rapatriement ne sera effectué qu'après entente sur l'identité et la nationalité avec l'Etat de destination, ainsi que sur le lieu et la date de l'arrivée aux frontières. Chacune des Parties à la présente Convention facilitera le transit des personnes en question sur son territoire.
Au cas où les personnes visées à l'alinéa précédent ne pourraient rembourser elles-mêmes les frais de leur rapatriement et où elles n'auraient ni conjoint, ni parent, ni tuteur qui payerait pour elles, les frais de rapatriement seront à la charge de l'Etat où elles se trouvent jusqu'à la frontière, au port d'embarquement, ou à l'aéroport le plus proche dans la direction de l'Etat d'origine et, au-delà, à la charge de l'Etat d'origine.
Article 20
Les Parties à la présente Convention s'engagent, si elles ne l'ont déjà fait, à prendre les mesures nécessaires pour exercer une surveillance sur les bureaux ou agences de placement, en vue d'éviter que les personnes qui cherchent un emploi, particulièrement les femmes et les enfants, ne soient exposées au danger de la prostitution.
Article 21
Les Parties à la présente Convention communiqueront au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies leurs lois et règlements en vigueur, et annuellement par la suite, tous nouveaux textes de lois ou règlements relatifs à l'objet de la présente Convention, ainsi que toutes mesures qu'elles auront prises pour l'application de la Convention. Les renseignements reçus seront publiés périodiquement par le Secrétaire général et adressés à tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres auxquels la présente Convention aura été officiellement communiquée, conformément aux dispositions de l'article 23.
Article 22
S'il s'élève entre les Parties à la présente Convention un différend quelconque relatif à son interprétation ou à son application, et si ce différend ne peut être réglé par d'autres moyens, il sera, à la demande de l'une quelconque des Parties au différend, soumis à la Cour internationale de Justice.
Article 23
La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et de tout autre Etat auquel le Conseil économique et social aura adressé une invitation à cet effet.
Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Les Etats mentionnés au paragraphe premier qui n'ont pas signé la Convention pourront y adhérer.
L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Aux fins de la présente Convention, le mot "Etat" désignera également toutes les colonies et territoires sous tutelle dépendant de l'Etat qui signe ou ratifie la Convention, ou y adhère, ainsi que tous les territoires que cet Etat représente sur le plan international.
Article 24
La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du deuxième instrument de ratification ou d'adhésion.
Pour chacun des Etats qui ratifieront ou adhéreront après le dépôt du deuxième instrument de ratification ou d'adhésion, elle entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 25
A l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention, toute Partie à la Convention peut la dénoncer par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
La dénonciation prendra effet pour la Partie intéressée un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 26
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres mentionnés à l'article 23 :
a) Les signatures, ratifications et adhésions reçues en application de l'article 23;
b) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, en application de l'article 24;
c) Les dénonciations reçues en application de l'article 25.
Article 27
Chaque Partie à la présente Convention s'engage à prendre, conformément à sa Constitution, les mesures législatives ou autres, nécessaires pour assurer l'application de la Convention.
Article 28
Les dispositions de la présente Convention annulent et remplacent, entre les Parties, les dispositions des instruments internationaux mentionnés aux alinéas 1, 2, 3 et 4 du deuxième paragraphe du préambule : chacun de ces instruments sera considéré comme ayant cessé d'être en vigueur quand toutes les Parties à cet instrument seront devenues Parties à la présente Convention.
Protocole de clôture
Aucune des dispositions de la présente Convention ne devra être considérée comme portant atteinte à toute législation prévoyant, pour l'application des dispositions tendant à la suppression de la traite internationale des êtres humains et de l'exploitation d'autrui aux fins de prostitution, des conditions plus rigoureuses que celles prévues par la présente Convention.
Les dispositions des articles 23 à 26 inclus de la Convention seront applicables au présent Protocole.
CONVENTION CADRE SUR LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS CONCLUE À LYON LE 22 AVRIL 2010
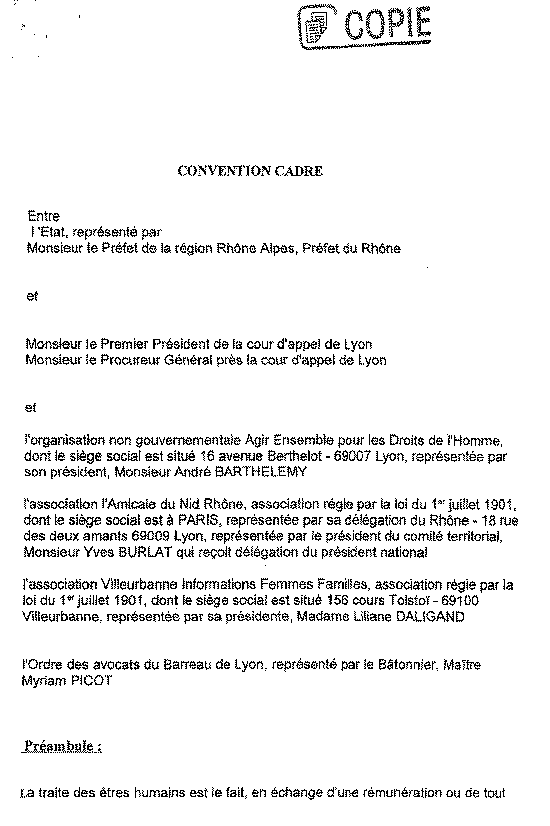
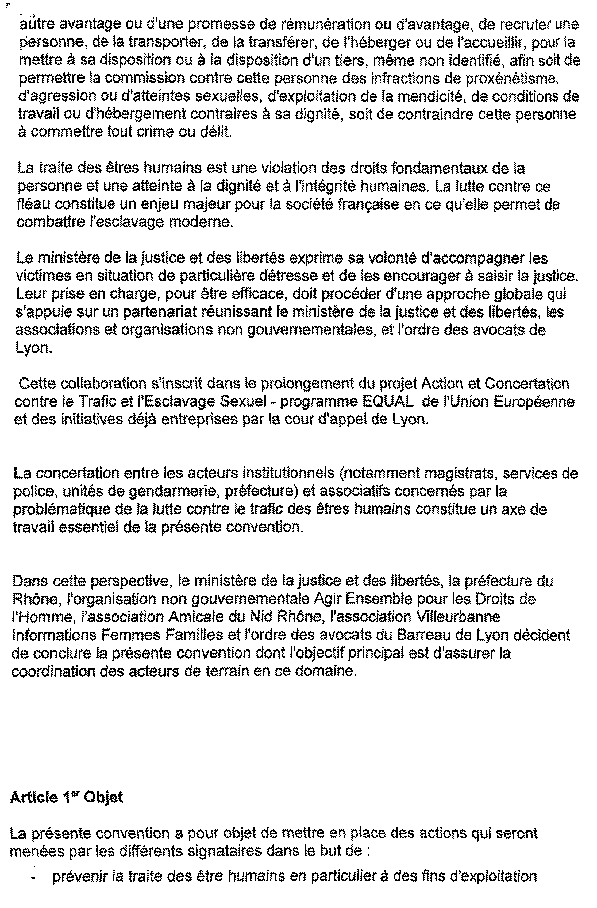
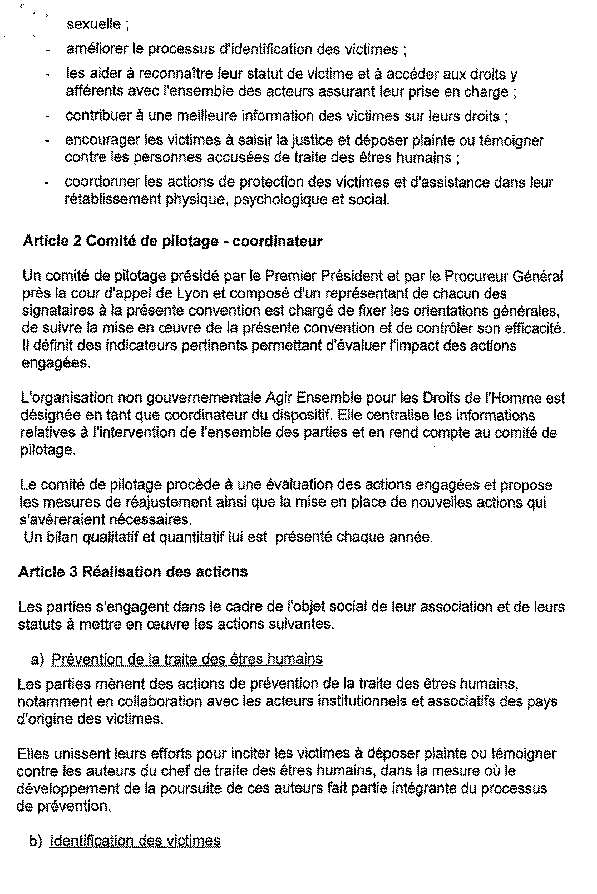
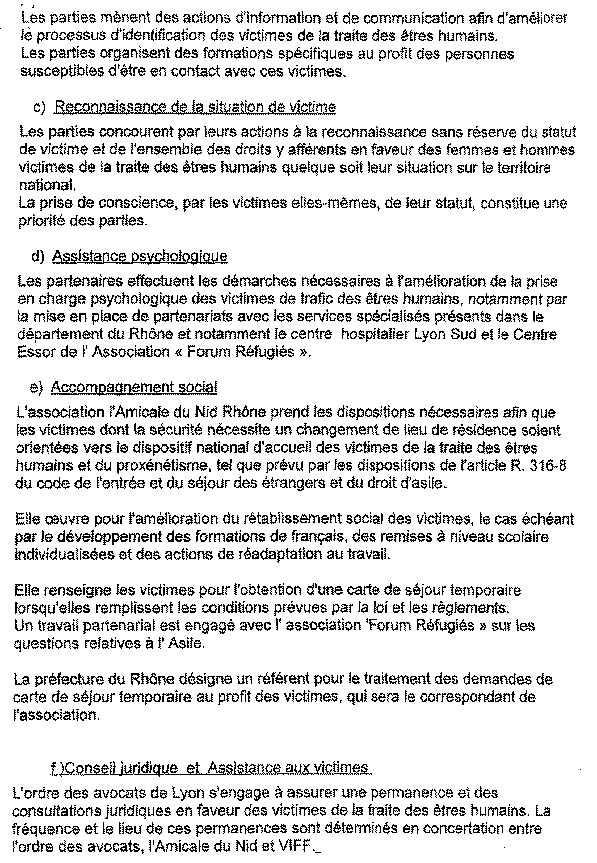
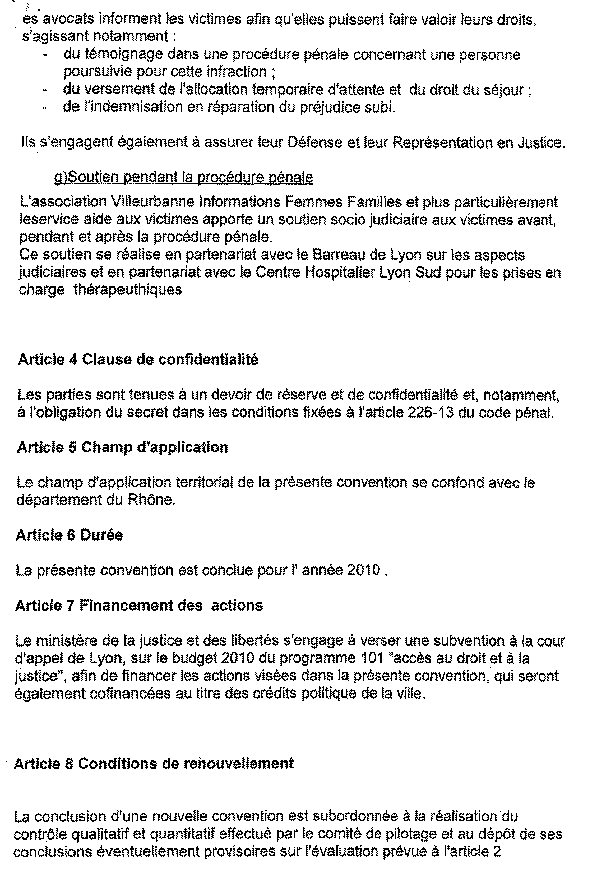
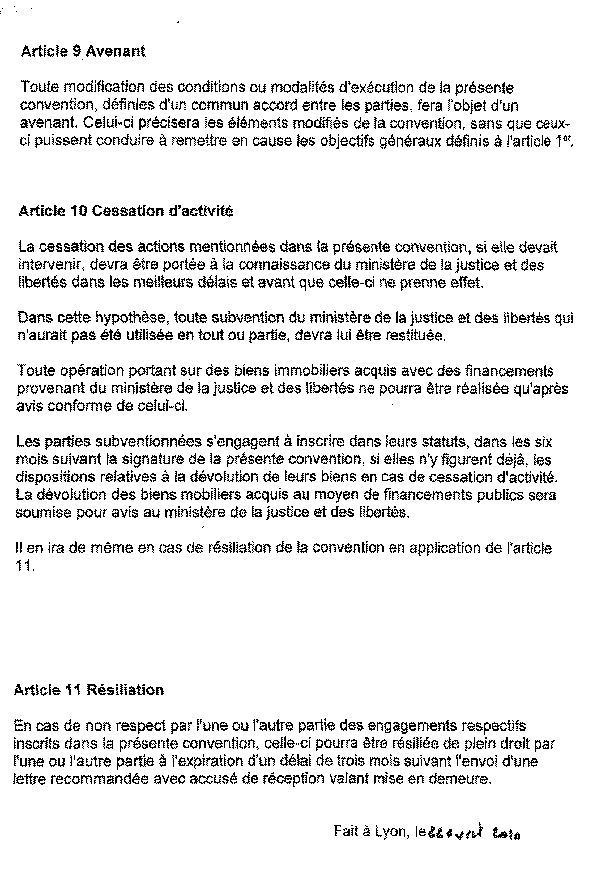
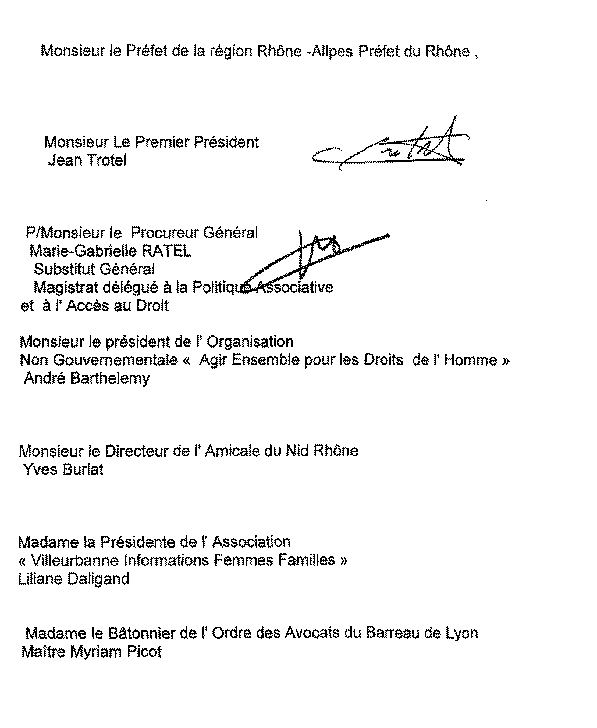
DOCUMENT DES MINISTÈRES DE L’INTÉRIEUR ET DE LA JUSTICE SUR L’IDENTIFICATION DES VICTIMES DE LA TRAITE
DES ÊTRES HUMAINS
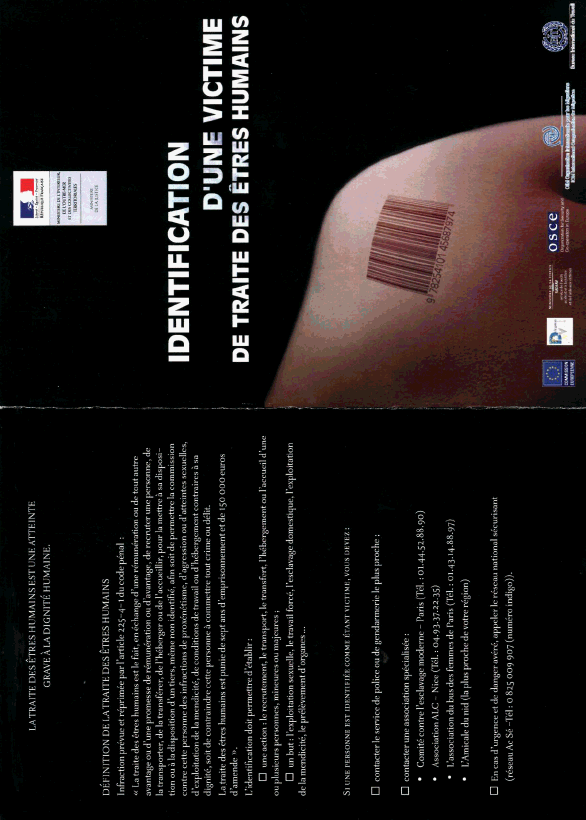
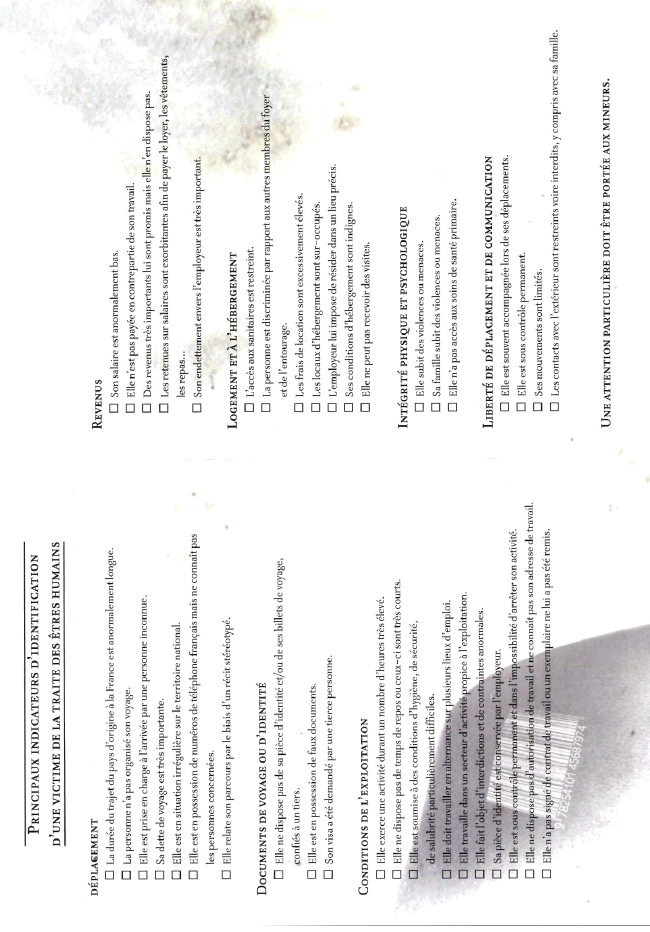
1 () La composition de cette mission figure au verso de la présente page.
2 () Audition de Mme Claudine Legardinier, auteur de nombreux livres sur la prostitution, le 8 février 2011.
3 () On entend par cette expression le fait d’échanger un bien non monétaire ou un service en contrepartie d’un acte de nature sexuelle.
4 () Bien qu’elle puisse donner lieu à de nombreux types d’exploitation, la traite des êtres humains est entendue, dans ce rapport, comme traite à des fins d’exploitation sexuelle.
5 () Audition de M. Claude Guéant, ministre de l’Intérieur, du 7 avril 2011.
6 () Thierry Schaffauser, « Combien de travailleurs du sexe sommes-nous ?», Le Monde du 2 juin 2010.
7 () La compétence territoriale de la gendarmerie nationale limite le nombre de procédures qu’elle engage pour racolage, la prostitution étant un phénomène plutôt urbain.
8 () OCRTEH, Rapport annuel, 2010, p. 2.
9 () Audition du 7 septembre 2010.
10 () Commission nationale consultative des droits de l’homme, La traite et l’exploitation des êtres humains en France, La documentation française, 2010.
11 () Audition du 9 novembre 2010.
12 () Audition de Mme Véronique Degermann, chef de section du parquet pour la juridiction interrégionale spécialisée de Paris, du 12 octobre 2010.
13 () Recensement par la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne, réalisé le 1er octobre 2010.
14 () Médecins du Monde, « Lotus Bus : enquête auprès des femmes chinoises se prostituant à Paris », février 2009.
15 () Le recensement du 1er octobre 2010 fait état de 68 personnes prostituées d’origine chinoise dans les rues de Paris.
16 () Les chiffres cités ne sont pas ceux des procédures pour racolage mais une estimation de la prostitution de rue par les services de police.
17 () OCRTEH, Rapport annuel, 2009, p. 32.
18 () Déplacement du 16 décembre 2010.
19 () Idem.
20 () Ensemble de personnes vues au moins une fois au cours de la période de référence.
21 () OCRTEH, Rapport annuel, 2010, p. 34.
22 () Ibid, p. 37.
23 () Ibid, p. 32.
24 () OCRTEH, Rapport annuel, 2009, p. 36.
25 () OCRTEH, Rapport annuel, 2010, p. 31.
26 () Audition de Mme Anne-Marie Pichon, directrice de l’association IPPO et de Mme Maryse Tourne, trésorière, du 21 décembre 2010.
27 () Audition du 26 octobre 2010.
28 () Audition du 25 janvier 2011.
29 () Déplacement à Marseille du 3 février 2011.
30 () OCRTEH, Rapport annuel, 2010, p. 5.
31 () Ibid, p. 28.
32 () Déplacement du 16 décembre 2010.
33 () Audition du 26 octobre 2010.
34 () Déplacement du 3 février 2011.
35 () Déplacement du 16 décembre 2010.
36 () Idem.
37 () Ce prénom a été modifié pour des raisons d’anonymat.
38 () Déplacement du 15 mars 2011.
39 () Audition du 23 novembre 2010.
40 () Audition du 12 novembre 2010.
41 () Audition du 9 novembre 2010 de M. Bertrand Rouverand, membre de l’Association contre la prostitution des enfants (ACPE).
42 () Rapport du Gouvernement relatif à l’évolution de la situation des personnes prostituées, 2010.
43 () Cf. annexe n° 1.
44 () Audition du 8 février 2011.
45 () OCRTEH, Rapport annuel, 2009, p. 25.
46 () Ibid.
47 () Interview de M. Laurent Mélito par la revue Prostitution et société, octobre 2010.
48 () Rencontre du 29 mars 2011.
49 () Kevin Le Louargant, « Qui sont les escort boy ? », L’Express, 12 janvier 2010.
50 () Audition du 1er février 2011.
51 () Ibid.
52 () Information fournie par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche le 28 octobre 2010.
53 () Audition du 1er février 2011.
54 () Idem.
55 () Courrier en date du 3 février 2011.
56 () Déplacement du 16 décembre 2010.
57 () Amicale du Nid de Montpellier, Les représentations de la prostitution étudiante : résultats du questionnaire, 2009-2010.
58 () Contribution écrite à la mission d’information.
59 () OCRTEH, Rapport annuel, 2010, p. 4.
60 () Déplacement du 16 décembre 2010.
61 () Kevin Le Louargant, « Qui sont les escort boy ? », L’Express, 12 janvier 2010.
62 () Le travestissement désigne le fait de s’habiller avec des vêtements du genre opposé.
63 () Le transsexualisme désigne habituellement les personnes qui ont entamé ou qui envisagent d’entamer une démarche de changement de sexe.
64 () OCRTEH, Rapport annuel, 2009, p. 28 et suivantes.
65 () Ibid.
66 () Ibid.
67 () Ibid.
68 () Audition du 21 décembre 2010.
69 () Laurindo Da Silva et Luizmar Evangelista, La consommation de drogues dans le milieu de la prostitution masculine, octobre 2001, p. 17.
70 () On entend usuellement par ce terme les jeunes hommes non travestis non transsexuels qui se prostituent sur la voie publique.
71 () Rapport de l’OCRTEH de 1995.
72 () Rapport de l’OCRTEH, 1980.
73 () Rapport de l’OCRTEH, 2003.
74 () OCRTEH, Rapport annuel, 2010, p.10.
75 () Audition du 11 janvier 2011.
76 () Christine Lazerges, Alain Vidalies, Rapport d’information n° 3459 sur les diverses formes de l’esclavage moderne, Assemblée nationale, 2001, p. 121.
77 () Thierry Schaffauser, « Combien de travailleurs du sexe sommes-nous ?», Le Monde du 2 juin 2010.
78 () En effet, ce recensement est opéré par groupe des personnes prostituées. Pour certains de ces groupes, la part de personnes françaises et étrangères n’est pas spécifiée.
79 () Audition du 25 janvier 2011 de Mme Julie Sarrazin, co-directrice de l’association Grisélidis.
80 () OCRTEH, Rapport annuel, 2010, p.3.
81 () Ibid, p.4.
82 () Maryse Chureau, « Traite des femmes et analyse géopolitique : focus sur le cas albanophone », Hérodote, n°136, La Découverte, 2010, p. 155.
83 () Actes du colloque « Lutter contre l’exploitation sexuelle : état des lieux, réflexions, propositions » organisé par la fondation Scelles, 22 janvier 2010.
84 () Audition du 14 septembre 2010.
85 () Audition du 26 octobre 2010.
86 () Audition du 12 octobre 2010.
87 () « Une traite mondialisée », Le Nouvel Observateur, 12 novembre 2009.
88 () Audition du 12 octobre 2010.
89 () Françoise Guillemaut, « Victimes de trafic ou actrice d’un processus migratoire ? Saisir la voix des femmes migrantes prostituées par la recherche-action », Terrains et travaux, n° 10, 2006, p. 159.
90 () Déplacement à la préfecture de police du 3 novembre 2010.
91 () Audition du 15 février 2011.
92 () OCRTEH, Rapport annuel, 2010, p. 26.
93 () Audition du 23 novembre 2010.
94 () OCRTEH, Rapport annuel, 2009.
95 () Cédric Amourette, La prostitution et le proxénétisme en France depuis 1946 : étude juridique et systémique, Université de Montpellier I, novembre 2003, p. 62.
96 () Déplacement à la préfecture de police du 3 novembre 2010.
97 () Dans le cas des victimes nigérianes de la traite, voir Vanessa Simoni, « Territoires et enjeux de pouvoir de la traite à des fins d’exploitation sexuelle : le cas de Paris », Hérodote, n° 136, 2010/1.
98 () Christine Lazerges, Alain Vidalies, Rapport d’information n° 3459 sur les diverses formes de l’esclavage moderne, Assemblée nationale, 2001, p. 32.
99 () Déplacement à l’Amicale du Nid du 15 mars 2011.
100 () « Une traite mondialisée », Le Nouvel Observateur, 12 novembre 2009.
101 () Déplacement à la préfecture de police de Paris du 3 novembre 2010.
102 () Audition du 15 février 2010.
103 () Audition du 14 septembre 2010.
104 () Témoignage publié dans la revue du Mouvement du Nid, Prostitution et société, n° 143, disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.prostitutionetsociete.fr/temoignages/adriana-je-suis-contente-parce-que.
105 () Cédric Amourette, La prostitution et le proxénétisme en France depuis 1946 : étude juridique et systémique, Université de Montpellier I, novembre 2003, p. 62.
106 () Audition du 30 novembre 2010.
107 () Audition du 8 février 2011.
108 () Adrienne O’Deye et Vincent Joseph, La prostitution des mineurs à Paris : données, acteurs et dispositifs existants, Cabinet Anthropos, octobre 2006.
109 () Audition du 8 février 2011.
110 () Richard Poulin, « Mondialisation des industries du sexe, crime organisé et prostitution », in L’agression sexuelle : coopérer au-delà des frontières, CIFAS 2005.
111 () Florence Lévyet et de Marylène Lieber, « La sexualité comme ressource migratoire. Les chinoises du Nord à Paris », in Revue française de sociologie, 2009/4.
112 () Ibid, p. 719.
113 () Actes du colloque « Lutter contre l’exploitation sexuelle : état des lieux, réflexions, propositions », 22 janvier 2010.
114 () Rapport de l’OCRTEH pour 2009, p. 25.
115 () Audition du 15 février 2011.
116 () OCRTEH, Rapport annuel, 2010, p. 26.
117 () Déplacement à la préfecture de police de Paris du 3 novembre 2010.
118 () Adrienne O’Deye et Vincent Joseph, La prostitution des mineurs à Paris : données, acteurs et dispositifs existants, Cabinet Anthropos, octobre 2006, p. 85 et suivantes.
119 () Audition du 1er mars 2011.
120 () Interview de Laurent Mélito, Prostitution et société, octobre 2010.
121 () « Une escort témoigne : on est pas des femmes, on est des objets », Prostitution et Société, juin 2006.
122 () Interview de Laurent Mélito, Prostitution et société, octobre 2010.
123 () Sylvie Bigot, « La prostitution sur Internet : entre marchandisation de la sexualité et contractualisation de relations affectives », Genre, sexualité et société, n° 2, automne 2009.
124 () Ibid, p. 5.
125 () Éva Clouet, La prostitution étudiante à l’heure des nouvelles technologies de communication, 2007, p. 47.
126 () Audition du 14 septembre 2010.
127 () Déplacement en Espagne du 18 février 2011.
128 () Audition du 25 janvier 2011.
129 () Audition du 2 février 2011.
130 () Audition de l’association Grisélidis du 25 janvier 2011.
131 () Audition de M. Jean-Marc Souvira du 14 septembre 2010.
132 () Audition de Mme Myriam Quémener du 1er mars 2011.
133 () Audition de M. Vincent Montrieux du 15 mars 2011.
134 () Question n° 117964, réponse publiée au Journal officiel le 4 avril 2007.
135 () Audition du 1er mars 2011.
136 () Éva Clouet, La prostitution étudiante à l’heure des nouvelles technologies de communication, 2007, p. 46.
137 () Interview de Laurent Mélito, Prostitution et société, octobre 2010.
138 () Éva Clouet, La prostitution étudiante à l’heure des nouvelles technologies de communication, 2007, p. 107.
139 () Audition du 15 février 2011.
140 () Interview de Laurent Mélito, Prostitution et société, octobre 2010.
141 () « Une escort témoigne : on est pas des femmes, on est des objets », Prostitution et Société, juin 2006.
142 () Déplacement à Marseille du 3 février 2011.
143 () Audition de l’association des Amis du bus des femmes du 9 novembre 2011.
144 () « Une traite mondialisée », Interview de Jean-Marc Souvira, Le Nouvel Observateur, 12 novembre 2009.
145 () Sylvie Bigot, « La prostitution sur Internet : entre marchandisation de la sexualité et contractualisation de relations affectives », Genre, sexualité et société, n° 2, automne 2009, p. 7.
146 () Éva Clouet, La prostitution étudiante à l’heure des nouvelles technologies de communication, 2007.
147 () Ibid.
148 () Audition de l’association Grisélidis du 25 janvier 2011.
149 () Interview pour la revue Prostitution et société, octobre 2010.
150 () Déplacement à la préfecture de police de Paris du 3 novembre 2010.
151 () « Une traite mondialisée », Interview de Jean-Marc Souvira, Le Nouvel Observateur, 12 novembre 2009.
152 () Interview pour la revue Prostitution et société, octobre 2010.
153 () « Une escort témoigne : on est pas des femmes, on est des objets », Prostitution et Société, juin 2006.
154 () Ibid.
155 () Interview pour la revue Prostitution et société, octobre 2010.
156 () Éva Clouet, La prostitution étudiante à l’heure des nouvelles technologies de communication, 2007.
157 () Audition du 25 janvier 2011.
158 () Éva Clouet, La prostitution étudiante à l’heure des nouvelles technologies de communication, 2007.
159 () Sylvie Bigot, « La prostitution sur Internet : entre marchandisation de la sexualité et contractualisation de relations affectives », Genre, sexualité et société, n° 2, automne 2009, p. 7.
160 () Audition du 8 février 2011.
161 () Idem.
162 () « Une escort témoigne : on est pas des femmes, on est des objets », Prostitution et Société, juin 2006.
163 () Sylvie Bigot, « La prostitution sur Internet : entre marchandisation de la sexualité et contractualisation de relations affectives », Genre, sexualité et société, n° 2, automne 2009.
164 () Ibid.
165 () Jean-Michel Carré, Travailleu(r)ses du sexe et fières de l’être, 2010, p. 57.
166 () Sylvie Bigot, « La prostitution sur Internet : entre marchandisation de la sexualité et contractualisation de relations affectives », Genre, sexualité et société, n° 2, automne 2009.
167 () Interview pour la revue Prostitution et société, octobre 2010.
168 () Audition du 14 septembre 2010.
169 () Rapport du Gouvernement relatif à l’évolution de la situation des personnes prostituées, 2010, p. 2.
170 () Audition de Mme Myriam Quémener du 1er mars 2011.
171 () Audition du 14 septembre 2010.
172 () Idem.
173 () Intervention de Mme Myriam Quémener au colloque « Lutter contre l’exploitation sexuelle : état des lieux, réflexions, propositions », 22 janvier 2010.
174 () Audition du 11 janvier 2011.
175 () Audition du 11 janvier 2011 réunissant M. Jacques Barré, président du groupement national des chaînes hôtelières, et M. René-Georges Querry, directeur de la sécurité du groupe Accor.
176 () Audition du 14 septembre 2010.
177 () OCRTEH, Rapport annuel, 2010, p. 23.
178 () Audition de Jean-Marc Souvira du 14 septembre 2010.
179 () Adrienne O’Deye et Vincent Joseph, « La prostitution des mineurs à Paris : données, acteurs et dispositifs existants », Cabinet Anthropos, octobre 2006.
180 () Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale.
181 () Adrienne O’Deye et Vincent Joseph, « La prostitution des mineurs à Paris : données, acteurs et dispositifs existants », Cabinet Anthropos, octobre 2006.
182 () Laurindo Da Silva et Luizmar Evangelista, « La consommation de drogues dans le milieu de la prostitution masculine », Observatoire français des drogues et des toxicomanies, octobre 2004.
183 () Bilan des accueils de jeunes lors des permanences du Xe arrondissement de Paris, Amicale du Nid, 2009.
184 () Laurindo Da Silva et Luizmar Evangelista, « La consommation de drogues dans le milieu de la prostitution masculine », Observatoire français des drogues et des toxicomanies, octobre 2004.
185 () Fondation Scelles Infos, « Ados à vendre… », n° 4, février 2011.
186 () Adrienne O’Deye et Vincent Joseph, « La prostitution des mineurs à Paris : données, acteurs et dispositifs existants », Cabinet Anthropos, octobre 2006.
187 () Ce prénom a été modifié pour des raisons d’anonymat.
188 () Rencontre du 15 mars 2011.
189 () Kévin Le Louargant, « Qui sont les escorts boys ? », L’Express, 12 janvier 2011.
190 () Prostitution et société, n° 152.
191 () Prostitution et société, n° 158.
192 () Ibid.
193 () Ibid.
194 () Ce prénom a été modifié pour des raisons d’anonymat.
195 () Rencontre du 15 mars 2011.
196 () Prostitution et société, n° 158.
197 () Laurindo Da Silva et Luizmar Evangelista, « La consommation de drogues dans le milieu de la prostitution masculine », Observatoire français des drogues et des toxicomanies, octobre 2004.
198 () Laurindo Da Silva et Luizmar Evangelista, « La consommation de drogues dans le milieu de la prostitution masculine », Observatoire français des drogues et des toxicomanies, octobre 2004.
199 () Ibid.
200 () Médecins du Monde, « Lotus Bus : enquête auprès des femmes chinoises se prostituant à Paris », février 2009.
201 () Florence Lévyet et de Mme Marylène Lieber, « La sexualité comme ressource migratoire. Les chinoises du Nord à Paris », Revue française de sociologie, 2009/4.
202 () Voir notamment Vanessa Simoni, « Territoires et enjeux de pouvoir de la traite à des fins d’exploitation sexuelle : le cas de Paris », Hérodote, n° 136, 2010/1.
203 () Audition du Lotus Bus du 15 février 2011.
204 () Audition du 26 octobre 2010.
205 () Audition du 15 février 2011.
206 () Nasima Moujoud et Dolorès Pourette, « Traite de femmes migrantes, domesticité et prostitution », Cahier d’études africaines, 2005, p. 1113.
207 () Prostitution et société, n° 143.
208 () Audition du 26 octobre 2010.
209 () Audition du Lotus Bus du 15 février 2011.
210 () Médecins du Monde, Lotus Bus : enquête auprès des femmes chinoises se prostituant à Paris, février 2009.
211 () Suzanne Cagliero et Hugues Lagrange, « La consommation de drogues et d’alcool dans le milieu prostitutionnel féminin », 2004, p.24.
212 () Richard Poulin, « Mondialisation des industries du sexe, crime organisé et prostitution » in L’agression sexuelle : coopérer au-delà des frontières, CIFAS 2005.
213 () Vanessa Simoni, « Territoires et enjeux de pouvoir de la traite à des fins d’exploitation sexuelle : le cas de Paris », Hérodote, n° 136, 2010/1, p. 136-7.
214 () Éva Clouet, La prostitution étudiante à l’heure des nouvelles technologies de communication, 2007, p. 121 et suivantes.
215 () Prostitution et société, n° 159.
216 () Audition du 1er février 2011.
217 () Éva Clouet, La prostitution étudiante à l’heure des nouvelles technologies de communication, 2007, p.127.
218 () Audition du 11 janvier 2011.
219 () Idem.
220 () Idem.
221 () Les Amis du Bus des femmes, « La retraite des personnes prostituées », Compte-rendu d’action, 2010.
222 () Ibid.
223 () Audition du 11 janvier 2011.
224 () Idem.
225 () Idem.
226 () Les Amis du Bus des femmes, « La retraite des personnes prostituées », Compte-rendu d’action, 2010.
227 () « Évaluation des personnes accompagnées en 2010 à l’Amicale du Nid de Paris ».
228 () Stéphanie Pryen, « Drogue et prostitution : une relation complexe », CNRS Info n° 383, avril 2000.
229 () Cf. infra, V de la présente partie.
230 () Déplacement à Marseille du 3 février 2011, rencontre avec le major Claude Peillon, qui dirige la brigade départementale de protection de la jeunesse des Bouches-du-Rhône.
231 () Audition du 21 décembre 2010.
232 () Stéphanie Pryen, « Drogue et prostitution : une relation complexe », CNRS Info n° 383, avril 2000.
233 () Melissa Farley et al., « Prostitution and trafficking in nine countries : an update on violence and post traumatic stress disorder », 2003.
234 () Interview de M. Laurent Mélito par la revue Prostitution et société, octobre 2010.
235 () Prostitution et société, n° 153.
236 () Audition du 15 février 2011.
237 () Idem.
238 () Audition du 8 février 2011.
239 () Prostitution et société, n° 141.
240 () Suzanne Cagliero et Hugues Lagrange, « La consommation de drogues et d’alcool dans le milieu prostitutionnel féminin », Observatoire français des drogues et toxicomanies, 2003.
241 () Audition du Lotus Bus du 15 février 2011.
242 () Claudine Legardinier et Saïd Bouamama, Les clients de la prostitution, l’enquête, 2006, p.226.
243 () Rencontre à l’Amicale du Nid de Paris du 15 mars 2011.
244 () Audition du 15 février 2011.
245 () Prostitution et société, n° 143.
246 () Déplacement à La Haye du 13 janvier 2011.
247 () Déplacement à Lyon du 16 décembre 2010.
248 () Rapport du Gouvernement faisant état de la situation démographique, sanitaire et sociale des personnes prostituées ainsi que des moyens dont disposent les associations et les organismes qui leur viennent en aide, mars 2006.
249 () Audition du 15 février 2011.
250 () Laurindo Da Silva et Luizmar Evangelista, « La consommation de drogues et d’alcool dans le milieu masculin », 2003.
251 () Suzanne Cagliero et Hugues Lagrange, « La consommation de drogues et d’alcool dans le milieu prostitutionnel féminin », 2003, p. 33.
252 () Conseil national du sida, « VIH et commerce du sexe : Garantir l’accès universel à la prévention et aux soins », 16 septembre 2010.
253 () Audition du 15 février 2011 du Lotus Bus.
254 () Ibid, p. 15.
255 () Suzanne Cagliero et Hugues Lagrange, « La consommation de drogues et d’alcool dans le milieu prostitutionnel féminin », 2003.
256 () Laurindo Da Silva et Luizmar Evangelista, « La consommation de drogues et d’alcool dans le milieu masculin », 2003.
257 () Médecins du Monde, Enquête du Lotus Bus auprès des femmes chinoises se prostituant à Paris, 2009.
258 () Cf. annexe n° 3.
259 () Conseil national du sida, « VIH et commerce du sexe : Garantir l’accès universel à la prévention et aux soins », 16 septembre 2010.
260 () Rapport du Gouvernement faisant état de la situation démographique, sanitaire et sociale des personnes prostituées ainsi que des moyens dont disposent les associations et les organismes qui leur viennent en aide, mars 2006.
261 () Conseil national du sida, « VIH et commerce du sexe : Garantir l’accès universel à la prévention et aux soins », 16 septembre 2010, p. 14.
262 () Ibid.
263 () Ibid.
264 () Médecins du Monde, Enquête du Lotus Bus auprès des femmes chinoises se prostituant à Paris, 2009.
265 () Rapport du Gouvernement faisant état de la situation démographique, sanitaire et sociale des personnes prostituées ainsi que des moyens dont disposent les associations et les organismes qui leur viennent en aide, mars 2006.
266 () Melissa Farley et al., « Prostitution and trafficking in nine countries : an update on violence and post traumatic stress disorder », 2003.
267 () Audition du 15 février 2011.
268 () Médecins du Monde, Enquête du Lotus Bus auprès des femmes chinoises se prostituant à Paris, 2009.
269 () Audition de Mme Gabrielle Partenza du 11 janvier 2011.
270 () Rapport du Gouvernement faisant état de la situation démographique, sanitaire et sociale des personnes prostituées ainsi que des moyens dont disposent les associations et les organismes qui leur viennent en aide, mars 2006.
271 () Audition du 15 février 2011.
272 () Médecins du Monde, Enquête du Lotus Bus auprès des femmes chinoises se prostituant à Paris, 2009.
273 () Claudine Legardinier et Saïd Bouamama, Les clients de la prostitution : l’enquête, 2006, p. 221.
274 () Audition du 8 février 2011.
275 () Rapport de synthèse de Cabiria, 2009, p. 163-188.
276 () Enquête Droits et Violences de la mission de Médecins du Monde auprès des personnes se prostituant à Nantes, réalisée en 2009 et 2010.
277 () Prostitution et société, n° 145.
278 () Rapport de synthèse de Cabiria, 2009, p. 163-188.
279 () Prostitution et société, Interview de Muriel Salmona, mai 2010, disponible à l’adresse suivante : http://www.prostitutionetsociete.fr/interviews/muriel-salmona-psychiatre-psycho
280 () Audition du 15 février 2011.
281 () Audition du 15 février 2011 du Lotus Bus.
282 () Prostitution et société, n° 143.
283 () Audition du 11 janvier 2011.
284 () Enquête Droits et Violences de la mission de Médecins du Monde auprès des personnes se prostituant à Nantes, réalisée en 2009 et 2010.
285 () Rencontre à l’Amicale du Nid de Paris du 15 mars 2011.
286 () Melissa Farley et al., « Prostitution and trafficking in nine countries : an update on violence and post traumatic stress disorder », 2003. Cf. annexe n° 2.
287 () Enquête Droits et Violences de la mission de Médecins du Monde auprès des personnes se prostituant à Nantes, réalisée en 2009 et 2010.
288 () Audition du 11 janvier 2011.
289 () Projet de rapport sur la prostitution et ses conséquences sur la santé des femmes dans les États membres (2007/2263(INI)), Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres, Parlement européen, 2008.
290 () Potterat and col., « Mortality in a long-term open cohort of prostitute women », in American Journal of Epidemiology, 2004.
291 () Rapport de synthèse de Cabiria, 2009, p. 163-188.
292 () Audition du 26 octobre 2010.
293 () Audition du 15 février 2011 du Lotus Bus.
294 () Audition du 8 février 2011.
295 () Dr Judith Trinquart, Mémoire pour l’obtention de la capacité de pratiques médico-judiciaires, 2010.
296 () Rencontre à l’Amicale du Nid de Paris, le 15 mars 2011.
297 () Enquête Droits et Violences de la mission de Médecins du Monde auprès des personnes se prostituant à Nantes, réalisée en 2009 et 2010.
298 () « Guerre de territoire entre prostitué(e)s », Le Parisien, 25 mai 2010.
299 () Enquête Droits et Violences de la mission de Médecins du Monde auprès des personnes se prostituant à Nantes, réalisée en 2009 et 2010.
300 () Enquête du Lotus Bus auprès des femmes chinoises se prostituant à Paris, février 2009.
301 () Claudine Legardinier et Saïd Bouamana, Les clients de la prostitution : l’enquête, 2006.
302 () Audition du 15 février 2011.
303 () Projet de rapport sur la prostitution et ses conséquences sur la santé des femmes dans les États membres (2007/2263(INI)), Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres, Parlement européen, 2008.
304 () Melissa Farley et al.,« Prostitution and trafficking in nine countries : an update on violence and post traumatic stress disorder », 2003.
305 () Audition du 15 février 2011.
306 () Claudine Legardinier et Saïd Bouamana, Les clients de la prostitution : l’enquête, 2006.
307 () Audition du 8 février 2011.
308 () Prostitution et société, n° 163.
309 () Audition du 15 février 2011
310 () Claudine Legardinier et Saïd Bouamama, Les clients de la prostitution : l’enquête, 2006, p. 224.
311 () Projet de rapport sur la prostitution et ses conséquences sur la santé des femmes dans les États membres (2007/2263(INI)), Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres, Parlement européen, 2008.
312 () Audition du 15 février 2011.
313 () Audition du 15 février 2011.
314 () Idem.
315 () Idem.
316 () Gilles Bibeau et Marc Perreault, Dérives montréalaises. Itinéraires de toxicomanies dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, 1995.
317 () Claudine Legardinier et Saïd Bouamama, Les clients de la prostitution : l’enquête, 2006, p. 221.
318 () Audition du 8 février 2011.
319 () Suzanne Cagliero et Hugues Lagrange, « La consommation de drogues et d’alcool dans le milieu prostitutionnel féminin », 2004 et Laurindo Da Silva et Luizmar Evangelista, « La consommation de drogues et d’alcool dans le milieu masculin », 2003.
320 () Cf. annexe n° 4.
321 () Laurindo Da Silva et Luizmar Evangelista, « La consommation de drogues et d’alcool dans le milieu prostitutionnel masculin », 2003.
322 () Audition du 11 janvier 2011.
323 () Suzanne Cagliero et Hugues Lagrange, « La consommation de drogues et d’alcool dans le milieu prostitutionnel féminin », 2002.
324 () Cf. annexe n° 4.
325 () Témoignage cité par Suzanne Cagliero et Hugues Lagrange, dans « La consommation de drogues et d’alcool dans le milieu prostitutionnel féminin », 2002.
326 () Cédric Amourette, La prostitution et le proxénétisme en France depuis 1946 : étude juridique et systémique, Université de Montpellier I, novembre 2003, p. 28.
327 () Malika Nor, Thibault Gautier, La prostitution, Le Cavalier bleu, 2001, p. 16.
328 () Amélie Maugère, Les politiques de la prostitution du Moyen Âge au XXIe siècle, Dalloz, 2009, p. 33.
329 () Ibid, p. 45.
330 () Ibid.
331 () Terme probablement employé dès le Moyen Âge pour désigner les maisons closes.
332 () Jean-Pierre Carrez, « La Salpêtrière de Paris sous l’Ancien Régime : lieu d’exclusion et de punition pour femmes », Criminocorpus, 2008.
333 () Alain Corbin, Les filles de noces, misère sexuelle et prostitution au XIXe siècle, Champs Histoire, 2010, p. 16.
334 () Malika Nor, Thibault Gautier, La prostitution, Le Cavalier bleu, 2001, p. 5.
335 () Francis Caballero, Droit du sexe, LGDJ, 2010, p. 481.
336 () Cédric Amourette, La prostitution et le proxénétisme en France depuis 1946 : étude juridique et systémique, Université de Montpellier I, novembre 2003, p. 30.
337 () Cédric Amourette, La prostitution et le proxénétisme en France depuis 1946 : étude juridique et systémique, Université de Montpellier I, novembre 2003, p. 34-35.
338 () Pierre Ansart, Anne-Marie Dourlen-Rollier, La société, le sexe et la loi, Casterman, 1971, p. 98.
339 () À partir de 1866, les Contagious Diseases Acts tentent d’encadrer la prostitution, dès lors officiellement tolérée.
340 () Alain Corbin, Les filles de noces, misère sexuelle et prostitution au XIXe siècle, Champs Histoire, 2010, p. 316.
341 () Cédric Amourette, La prostitution et le proxénétisme en France depuis 1946 : étude juridique et systémique, Université de Montpellier I, novembre 2003, p. 33.
342 () Alain Corbin, Les filles de noces, misère sexuelle et prostitution au XIXe siècle, Champs Histoire, 2010, p. 322.
343 () Ibid.
344 () Il semble que cette conseillère parisienne, ancienne espionne, à l’origine de cette loi, ait également se soit également prostituée par le passé.
345 () Amélie Maugère, Les politiques de la prostitution du Moyen Âge au XXIe siècle, Dalloz, 2009, p. 162.
346 () Cédric Amourette, La prostitution et le proxénétisme en France depuis 1946 : étude juridique et systémique, Université de Montpellier I, novembre 2003, p. 35.
347 () Loi n° 60-754 du 28 juillet 1960.
348 () Cf. annexe n° 8.
349 () Ordonnance n° 60-1245 du 25 novembre 1960 relative à la lutte contre le proxénétisme ; Ordonnance n° 60-1246 du 25 novembre 1960 modifiant et complétant les dispositions du chapitre 1er du titre II du livre III du code de la santé publique.
350 () Henri Minod, Simple exposé du but et des principes de la Fédération abolitionniste internationale, Genève, 1912.
351 () Ibid.
352 () Cédric Amourette, La prostitution et le proxénétisme en France depuis 1946 : étude juridique et systémique, Université de Montpellier I, novembre 2003, p. 44.
353 () Article 1er de la Convention de 1949.
354 () Article 2 de la Convention de 1949.
355 () Amélie Maugère, Les politiques de la prostitution du Moyen Âge au XXIe siècle, Dalloz, 2009, p. 183.
356 () Réponse du ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'État adressée à la mission d’information, cf. annexe n° 6.
357 () Réponse du ministère des Solidarités et de la cohésion sociale adressée à la mission d’information, le 15 février 2011.
358 () Cf. annexe n° 6.
359 () Voir notamment l’arrêt CE, 17 janvier 1990, n° 43499, RJF 3/90 n° 279.
360 () Idem.
361 () CE, 19 décembre 1988, D.F. 1989, n° 19.
362 () Audition du 14 décembre 2010.
363 () Christophe Geslot, « Prostitution, dignité…Par ici la monnaie ! », Recueil Dalloz 2008, p. 1292.
364 () Réponse du ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'État adressée à la mission d’information.
365 () CE, 13 octobre 1993, CAPC, n° 133116, RJF 12/93 n° 1545.
366 () CEDH, 11 septembre 2007, Tremblay c/ France, qui refuse de condamner la France du fait d’un redressement imposé par les URSAFF à une personne ayant cessé de se prostituer.
367 () Sarah Marie Maffesoli, « Le traitement juridique de la prostitution », Sociétés, 2008/1, n° 99.
368 () Réponse du ministère des Solidarités et de la cohésion sociale adressée à la mission d’information du 15 février 2011.
369 () Audition de M. Cédric Amourette du 14 décembre 2010.
370 () Ces arrêtés visent par exemple à empêcher le stationnement des camionnettes dans lesquelles les personnes prostituées exercent leur activité dans des lieux précis.
371 () Act-Up Paris, « L’abolitionnisme condamne les prostituées à la précarité », Mouvements, 2003/4 n° 29, p. 91-97.
372 () Cédric Amourette, La prostitution et le proxénétisme en France depuis 1946 : étude juridique et systémique, Université de Montpellier I, novembre 2003, p. 233
373 () Audition du M. Cédric Amourette du 14 décembre 2010.
374 () Dans un arrêt d’Assemblée plénière n° 03-11238 du 29 octobre 2004, la Cour de cassation affirme que : « n’est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes moeurs la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère ».
375 () Audition de M. Vincent Montrieux, conseiller pénal du ministre de la Justice, du 15 mars 2011.
376 () Act-Up Paris, « L’abolitionnisme condamne les prostituées à la précarité », Mouvements, 2003/4 n° 29, p. 91-97.
377 () Cf. infra, II de la présente partie.
378 () Francis Caballero, Droit du sexe, LGDJ, 2010, p. 480
379 () « L’abolitionnisme condamne les prostituées à la précarité », Mouvements, 2003/4 n° 29, p. 91-97
380 () Cédric Amourette, La prostitution et le proxénétisme en France depuis 1946 : étude juridique et systémique, Université de Montpellier I, novembre 2003, p. 290
381 () Christophe Geslot, « Prostitution, dignité... Par ici la monnaie ! », Recueil Dalloz 2008, p. 1292
382 () Cédric Amourette, La prostitution et le proxénétisme en France depuis 1946 : étude juridique et systémique, Université de Montpellier I, novembre 2003, p. 289.
383 () Ibid, p. 290.
384 () Audition de Mme Gabrielle Partenza du 11 janvier 2011.
385 () Dinah Deryck, Les politiques publiques et la prostitution, Rapport d’information du Sénat sur l’activité de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité entre les hommes et les femmes pour l’année 2000.
386 () Réponse de l’ACOSS du 31 mars 2011.
387 () Cf. IV de la présente partie.
388 () Emile Garçon, Code pénal annoté, 1901-1906, p. 829.
389 () Cour d’appel de Versailles, 3 mai 2000, J.C.P. 2001. IV. 1032 ; Juris-Data, n° 112981.
390 () « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. »
391 () Article 97 : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques […] ».
392 () Cédric Amourette, La prostitution et le proxénétisme en France depuis 1946 : étude juridique et systémique, Université de Montpellier I, novembre 2003, p. 189.
393 () Cass. Crim., 1er février 1956, Bull. Crim. 1956, n° 118, p. 209.
394 () Cédric Amourette, La prostitution et le proxénétisme en France depuis 1946 : étude juridique et systémique, Université de Montpellier I, novembre 2003, p. 190.
395 () Décret-loi du 29 novembre 1939.
396 () Loi n° 46-685 du 13 avril 1946 tendant à la fermeture des maisons de tolérance et au renforcement de la lutte contre le proxénétisme.
397 () Cédric Amourette, La prostitution et le proxénétisme en France depuis 1946 : étude juridique et systémique, Université de Montpellier I, novembre 2003, p. 192.
398 () Ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958 modifiant certaines peines en vue d’élever la compétence des tribunaux de police, J.O. 24 décembre 1958, p. 11758.
399 () Décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 modifiant diverses dispositions d’ordre pénal en vue d’instaurer une seconde classe de contravention de police, J.O 24 décembre 1958, p. 11772.
400 () Décret n° 60-1247 du 25 novembre 1960 modifiant certaines dispositions du code pénal, J.O. 27 novembre 1960, p. 10608.
401 () Jean-Pierre Doucet, La Gazette du Palais, 1984, p. 57.
402 () Cédric Amourette, La prostitution et le proxénétisme en France depuis 1946 : étude juridique et systémique, Université de Montpellier I, novembre 2003.
403 () Ibid, p. 198.
404 () Johanne Vernier, « La répression de la prostitution à la conquête de nouveaux espaces », Archives de politique criminelle, 2010, n° 32.
405 () Réponse du garde des Sceaux, n° 19596, J.O. 9 janvier 1995, p. 212.
406 () Johanne Vernier, « La répression de la prostitution à la conquête de nouveaux espaces », Archives de politique criminelle, 2010, n° 32.
407 () Décret n° 2004-1021 du 27 septembre 2004 portant modification du code pénal et du code de procédure pénale.
408 () Circulaire du 24 mars 2003 relative à la loi pour la sécurité intérieure, BO Intérieur 2003-1 du 20 novembre 2003, p. 227-233.
409 () Audition du 7 septembre 2010.
410 () Conseil constitutionnel, 13 mars 2003, décision n° 2003-467 DC, JO du 19 mars, p. 4789.
411 () Circulaire du 24 mars 2003 relative à la loi pour la sécurité intérieure, BO Intérieur 2003-1 du 20 novembre 2003, p. 227-233.
412 () Francis Caballero, Droit du sexe, LGDJ, 2010, p. 449.
413 () Michèle Laure Rassat, Droit pénal spécial, Infractions des et contre les particuliers, Dalloz, 2006, p. 644.
414 () Crim., 30 octobre 1956, B., n° 690.
415 () Crim., 21 juin 1994, n° 93-82699.
416 () Cour d’appel de Reims, Ministère public contre époux H., 14 janvier 2010, dossier n° 09/01138.
417 () Johanne Vernier, « La répression de la prostitution à la conquête de nouveaux espaces », Archives de politique criminelle, 2010, n° 32.
418 () Audition de M. Vincent Montrieux du 15 mars 2011.
419 () Crim., 25 mai 2005, n° 04-84 769.
420 () Tribunal correctionnel de Toulouse, 4 mars 2005.
421 () Tribunal correctionnel de Toulouse, 28 juin 2006.
422 () Cour d’appel d’Amiens, 30 mars 2005.
423 () Cour d’appel de Paris, 9 février 2005.
424 () Question orale avec débat n° 0054A de Mme Michèle André, publiée au JO du Sénat, 31 décembre 2009, p. 3039.
425 () Johanne Vernier, « La répression de la prostitution à la conquête de nouveaux espaces », Archives de politique criminelle, 2010, n° 32.
426 () Audition du 12 octobre 2010.
427 () Déplacement du 3 février 2011 à Marseille.
428 () Déplacement du 3 février 2011 à Marseille.
429 () Rapport du Gouvernement faisant état de la situation démographique, sanitaire et sociale des personnes prostituées ainsi que des moyens dont disposent les associations et les organismes qui leur viennent en aide, mars 2006.
430 () OCRTEH, rapport annuel, 2009.
431 () Note de la direction des affaires criminelles et des grâces adressée à la mission d’information le 26 octobre 2010.
432 () Idem.
433 () Question orale avec débat n° 0054A de Mme Michèle André, publiée au JO du Sénat, 31 décembre 2009, p. 3039.
434 () Audition du 7 septembre 2010.
435 () Audition du 30 novembre 2010.
436 () Audition du 9 novembre de Mme Claude Boucher et de Mme Vanessa Simoni.
437 () Audition du 23 novembre 2010 du STRASS.
438 () Audition du 26 octobre 2010.
439 () Audition du 25 janvier 2011.
440 () Audition du 11 janvier 2011.
441 () Audition du 15 février 2011.
442 () Idem.
443 () Idem.
444 () Audition du 21 décembre 2010.
445 () Audition du 7 septembre 2010.
446 () Audition du 9 novembre 2010.
447 () Audition du 7 septembre 2010.
448 () Audition du 21 décembre 2010.
449 () Le système de traitement des infractions constatées est un fichier d’antécédents judiciaires utilisé par la police nationale.
450 () Commission nationale Citoyens-Justice-Police, De nouvelles zones de non droit, des prostituées face à l’arbitraire policier, juin 2006, p. 19.
451 () Audition du 30 novembre 2010.
452 () Audition du 21 décembre 2010.
453 () Déplacement du 16 décembre 2010 à Lyon.
454 () Table ronde du 15 février 2011.
455 () Idem.
456 () Audition du 21 décembre 2010.
457 () Ibid.
458 () Ibid.
459 () Francis Caballero, Droit du sexe, LGDJ, 2010, p. 499.
460 () Cédric Amourette, La prostitution et le proxénétisme en France depuis 1946 : étude juridique et systémique, 2003.
461 () TGI Nanterre, 18 mai 2000 ; TGI de Bobigny, 8 mars 2007.
462 () Francis Caballero, Droit du sexe, LGDJ, 2010, p. 500.
463 () Cass. Crim., 4 décembre 1958, Bull. crim. n° 725, p. 1299.
464 () Francis Caballero, Droit du sexe, LGDJ, 2010, p. 501.
465 () Jean Pradel et Michel Danti-Juan, Droit pénal spécial, 1995, p. 501.
466 () Crim., 20 juin 1946, B., n° 146.
467 () Francis Caballero, Droit du sexe, LGDJ, 2010, p. 507.
468 () Crim., 20 octobre 1964, B. n°271, p. 582.
469 () Francis Caballero, Droit du sexe, LGDJ, 2010, p. 511.
470 () Francis Caballero, Droit du sexe, LGDJ, 2010, p. 550.
471 () Francis Caballero, Droit du sexe, LGDJ, 2010, p. 551.
472 () Cf. Troisième partie, I.
473 () Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, 2000.
474 () Audition de Mme Maryvonne Caillibotte du 5 octobre 2010.
475 () Loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile.
476 () Commission nationale consultative des droits de l’homme, La traite et l’exploitation des êtres humains en France, 2010, p. 58.
477 () Francis Caballero, Droit du sexe, LGDJ, 2010, p. 531.
478 () Audition du 5 octobre 2010.
479 () Commission nationale consultative des droits de l’homme, La traite et l’exploitation des êtres humains en France, 2010, p. 58.
480 () Ibid, p. 59.
481 () Francis Caballero, Droit du sexe, LGDJ, 2010, p. 538.
482 () Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
483 () Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
484 () Déplacement du 16 décembre 2010 à Lyon.
485 () Loi n° 75-299 du 9 avril 1975 habilitant les associations constituées pour la lutte contre le proxénétisme à exercer l'action civile.
486 () Déplacement à l’Amicale du Nid le 15 mars 2011.
487 () Décret n° 58-1039 du 31 octobre 1958.
488 () Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
489 () Audition du 12 octobre 2010 de M. Alain Philibeaux, magistrat instructeur à la JIRS de Paris.
490 () Ibid.
491 () Ibid.
492 () Audition du 7 septembre 2010 de Mme Johanne Vernier.
493 () Cf. infra, Quatrième partie, III.
494 () Audition du 14 septembre 2010.
495 () Déplacement du 16 décembre 2010 à Lyon.
496 () Cf. annexe n° 5.
497 () Francis Caballero, Droit du sexe, LGDJ, 2010, p. 515.
498 () Déplacement à Lyon du 16 décembre 2010.
499 () Idem.
500 () Cf. supra, Première partie.
501 () Article 225-10 du code pénal.
502 () Audition du 25 janvier 2011.
503 () Audition du 23 novembre 2010.
504 () Audition de Mme Johanne Vernier du 7 septembre 2010.
505 () Ibid.
506 () Cf. Première partie, I.
507 () Réponse du ministère de la Justice au questionnaire de la mission d’information, janvier 2011.
508 () Audition du 1er mars 2011.
509 () Réponse du ministère de la Justice au questionnaire de la mission d’information, janvier 2011.
510 () Actes de la 4ème journée européenne de lutte contre la traite, intervention de Mme Elisabeth Moiron-Braud.
511 () Chiffre provisoire transmis par la Chancellerie à la mission d’information en décembre 2010.
512 () Réponse du ministère de la Justice au questionnaire de la mission d’information, janvier 2011.
513 () Circulaire du 1er novembre 2009.
514 () Audition du 12 octobre 2010.
515 () Audition de Mme Myriam Quémener du 1er mars 2010.
516 () Francis Caballero, Droit du sexe, LGDJ, 2010, p. 531.
517 () Ibid.
518 () Audition du 7 septembre 2010.
519 () Francis Caballero, Droit du sexe, LGDJ, 2010, p. 505.
520 () Article 225-721 du code pénal.
521 () Réponse du ministère de la Justice au questionnaire de la mission d’information, janvier 2011.
522 () Déplacement du 15 mars 2011.
523 () Audition du 16 novembre 2010.
524 () Audition de Mme Vanessa Simoni, chargée de mission à l’association des Amis du Bus des femmes.
525 () Audition du 16 novembre 2010 de Mme Odile Schwertz-Favrat, représentant l’association Fasti.
526 () Déplacement à Lyon du 16 décembre 2010.
527 () Audition du 16 novembre 2010.
528 () Audition de M. Oliver Nollen du 16 novembre 2010.
529 () Audition de Mme Johanne Vernier du 7 septembre 2010.
530 () Audition de Mme Vanessa Simoni du 9 novembre 2010.
531 () Audition du 9 novembre 2010.
532 () Déplacement du 16 décembre 2010 à Lyon.
533 () Idem.
534 () Idem.
535 () Audition du 16 novembre 2010.
536 () Audition de M. François Lucas du 16 novembre 2010.
537 () Audition du 16 novembre 2010.
538 () Audition de Mme Vanessa Simoni du 9 novembre 2010.
539 () Audition de Mme Véronique Degermann du 12 octobre 2010.
540 () Déplacement à l’Amicale du Nid du 15 mars 2010.
541 () Audition de Mme Vanessa Simoni du 9 novembre 2010.
542 () Déplacement à l’Amicale du Nid du 15 mars 2010.
543 () Audition de Mme Vanessa Simoni du 9 novembre 2010.
544 () Idem.
545 () Article 706-3 du code de procédure pénale.
546 () Note de la CIVI à l’attention de la mission d’information, 13 décembre 2010.
547 () CIVI de Nantes, 13 mars 2009, Mme Y contre FGTI, n° 08/00146.
548 () CA Rennes, 7 avril 2010, FGTI contre Mlle Y, n° 06-73498.
549 () Cité dans Commission nationale consultative des droits de l’homme, La traite et l’exploitation des êtres humains en France, La documentation française, 2010, p. 186.
550 () Article L. 6112-6 du code de la santé publique.
551 () Audition du 2 novembre 2010.
552 () Note du ministère des Solidarités et de la cohésion sociale du 15 février 2010.
553 () Cass. Soc. 18 mai 1995, RJS 7/1995, n° 832.
554 () Cass. Soc., 19 décembre 1996, pourvois nos 95-13.063, 95-13.064 et 95-13.065.
555 () Article R. 641-6 du code de la sécurité sociale.
556 () Note du ministère des Solidarités et de la cohésion sociale du 15 février 2010.
557 () Conseil national du sida, VIH et commerce du sexe : garantir l’accès universel à la prévention et aux soins, 16 septembre 2010.
558 () Audition de M. Jean Philippe Naudon du 2 novembre 2010.
559 () Pôle Emploi Opéra, « Bilan de l’action préfecture sur l’insertion professionnelle des prostitués de Lyon », 2010.
560 () Commission nationale consultative des droits de l’homme, La traite et l’exploitation des êtres humains en France, 2010, p. 259.
561 () Ibid, p. 259.
562 () Suzanne Cagliero et Hugues Lagrange, « La consommation de drogues et d’alcool dans le milieu prostitutionnel féminin », 2003.
563 () Audition du 23 novembre 2010.
564 () Conseil national du sida, VIH et commerce du sexe : garantir l’accès universel à la prévention et aux soins, 16 septembre 2010.
565 () Ministère de la santé et des sports, Plan national de lutte contre le VIH/sida et les IST, 2010-2014.
566 () Déplacement du 3 février 2011 à Marseille.
567 () Conseil national du sida, VIH et commerce du sexe : garantir l’accès universel à la prévention et aux soins, 16 septembre 2010, p. 18.
568 () Audition du 25 janvier 2011.
569 () Conseil national du sida, VIH et commerce du sexe : garantir l’accès universel à la prévention et aux soins, 16 septembre 2010.
570 () Ordonnance n° 60-1246 du 25 novembre 1960, J.O. 27 novembre 1960, p. 10606.
571 () Audition du Mouvement du Nid du 12 octobre 2010.
572 () Cédric Amourette, La prostitution et le proxénétisme en France depuis 1946 : étude juridique et systémique, Université de Montpellier I, novembre 2003.
573 () Ibid.
574 () Guy Pinot, Rapport au Président de la République, 1975, p. 34.
575 () Audition du Mouvement du Nid du 12 octobre 2010.
576 () Déplacement du 3 novembre 2010 à la préfecture de police de Paris.
577 () Audition de l’Amicale du Nid du 2 octobre 2010.
578 () Ibid.
579 () Audition de l’association IPPO du 21 décembre 2010.
580 () Audition de l’Amicale du Nid du 2 octobre 2010.
581 () Audition des responsables du groupe de travail interministériel sur la traite du 14 septembre 2010.
582 () Commission nationale consultative des droits de l’homme, La traite et l’exploitation des êtres humains en France, 2010, p. 254.
583 () Ibid, p. 256.
584 () Audition du 9 novembre 2010.
585 () Note du ministère des Solidarités et de la cohésion sociale du 15 février 2010.
586 () Audition du 5 octobre 2010.
587 () Déplacement à Lyon le 16 décembre 2010.
588 () Pôle Emploi Opéra, « Bilan de l’action préfecture sur l’insertion professionnelle des prostitués de Lyon », 2010.
589 () Déplacement à Lyon le 16 décembre 2010.
590 () Conseil national du sida, VIH et commerce du sexe : garantir l’accès universel à la prévention et aux soins, 16 septembre 2010, p. 31.
591 () Ibid.
592 () Audition du Mouvement du Nid du 12 octobre 2010.
593 () Conseil national du sida, VIH et commerce du sexe : garantir l’accès universel à la prévention et aux soins, 16 septembre 2010.
594 () Ibid, p. 36.
595 () Rapport d’information de l’activité de la délégation aux droits des femmes du Sénat n° 209, Les politiques publiques et la prostitution, 2000, p. 64.
596 () Rapport d’information n° 3459 sur les diverses formes de l’esclavage moderne, Assemblée nationale, 2001, p. 121.
597 () Conseil national du sida, VIH et commerce du sexe : garantir l’accès universel à la prévention et aux soins, 16 septembre 2010, p. 31.
598 () Audition de l’Amicale du Nid du 2 novembre 2010.
599 () Audition du 5 octobre 2010.
600 () Audition du Mouvement du Nid le 12 octobre 2010.
601 () Conseil national du sida, VIH et commerce du sexe : garantir l’accès universel à la prévention et aux soins, 16 septembre 2010, p. 34.
602 () Ibid.
603 () ALC, Rapport d’activité, 2008.
604 () Déplacement du 16 décembre 2010.
605 () Audition du 15 février 2011.
606 () Déplacement du 3 février 2011 à Marseille.
607 () Idem.
608 () Audition de l’Amicale du Nid du 2 novembre 2010.
609 () Audition du Mouvement du Nid du 12 octobre 2010.
610 () Conseil national du sida, VIH et commerce du sexe : garantir l’accès universel à la prévention et aux soins, 16 septembre 2010, p. 34-35.
611 () Audition du 25 janvier 2011.
612 () Audition du 11 janvier 2011.
613 () Audition du 2 novembre 2010.
614 () Idem.
615 () Audition du 7 décembre 2010.
616 () Déplacement du 3 février 2011 à Marseille.
617 () Conseil national du sida, VIH et commerce du sexe : garantir l’accès universel à la prévention et aux soins, 16 septembre 2010.
618 () Conseil national du sida, VIH et commerce du sexe : garantir l’accès universel à la prévention et aux soins, 16 septembre 2010.
619 () Ibid, p. 38.
620 () Extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Bordeaux, séance du lundi 20 décembre 2010.
621 () Audition de l’Amicale du Nid du 2 novembre 2010.
622 () Conseil national du sida, VIH et commerce du sexe : garantir l’accès universel à la prévention et aux soins, 16 septembre 2010, p. 37.
623 () Audition du 21 décembre 2010.
624 () Conseil national du sida, VIH et commerce du sexe : garantir l’accès universel à la prévention et aux soins, 16 septembre 2010.
625 () Audition du 5 octobre 2010.
626 () Cf. annexe n° 8.
627 () Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.
628 () Pour une présentation plus détaillée du contenu de ces mesures, cf. Partie IV.
629 () Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, signée à Varsovie le 16 mai 2005.
630 () Directive 2010/.../UE du Parlement européen et du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes, remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI.
631 () Rencontre avec M. Michael Carlin, chef du secteur « cybercriminalité et traites des êtres humains » à la direction générale des affaires intérieures de la Commission européenne, le 12 janvier 2011.
632 () La mission d’information a adressé un questionnaire à neuf ambassades françaises auquel ont répondu les ambassades de France en Russie, en Ukraine, en Bulgarie, en Chine, au Cameroun et au Brésil. Un contact a également été pris, sans succès, auprès de l’ambassade du Nigeria en France.
633 () Directive 2010/.../UE du Parlement européen et du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes, remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI.
634 () Respectivement en 2004 et en 2010.
635 () Pour ce qui est des pays de l’Union européenne, une étude comparative a été financée par le Parlement européen en 2005 : Andrea Di Nicola, Isabella Orfano, Andrea Cauduro et Nicoletta Conci, Étude des législations nationales en matière de prostitution et de traite des femmes et des enfants, 2005. Par ailleurs, la mission d’information a interrogé les ambassades de France situées en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse, en Italie, en Espagne, en Suède, en Norvège, aux États-Unis, au Canada et en Australie.
636 () Cf. supra, Deuxième partie, I.
637 () Déplacement en Espagne des 16, 17 et 18 février 2011.
638 () Déplacement aux Pays-Bas des 11 et 12 janvier 2011.
639 () Déplacement du 11 janvier 2011.
640 () Déplacement aux Pays-Bas des 11 et 12 janvier 2011.
641 () Cf. infra, Quatrième partie, I.
642 () La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), adoptée le 18 décembre 1978 par l’Assemblée générale des Nations unies a cependant maintenu une référence spécifique à la prostitution dans on article 6 : « Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour réprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l’exploitation de la prostitution des femmes. »
643 () Rencontre à Bruxelles le 12 janvier 2011.
644 () Ibid.
645 () Audition du 5 octobre 2010.
646 () Audition du 12 octobre 2010.
647 () Ibid.
648 () Audition de Mme Michèle Vianès, du 26 octobre 2010.
649 () Audition de Mme Malka Marcovich du 12 octobre 2010.
650 () Rapporteur spécial sur les droits fondamentaux des victimes de la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants.
651 () Audition du 12 octobre 2010.
652 () Ce sentiment a notamment été exprimé par Mme Corinne Dettmeijer-Vermeulen, rapporteure nationale sur la traite des êtres humains, et par Mme Esther Van Fressem-van der Walk, cadre fonctionnelle au ministère de la Sécurité et de la Justice le 13 janvier 2011.
653 () Rencontre du 13 janvier 2011.
654 () Idem.
655 () Cette situation était comparable à celle qui prévaut aujourd’hui en Belgique.
656 () Ministère néerlandais des Affaires étrangères, FAQ prostitution 2010.
657 () L’interdiction doit être fondée sur des motifs d’urbanisme, d’ordre public, de qualité du cadre de vie ou de sécurité des personnes prostituées et de leurs clients.
658 () Rencontre avec Mme Esther Van Fressem-van der Walk, cadre fonctionnelle au ministère de la Sécurité et de la Justice, le 13 janvier 2011.
659 () Idem.
660 () Rencontre avec Mme Monique Van der Brugge et Mme Anita Bakker, de la brigade des mœurs commerciales de La Haye le 13 janvier 2011.
661 () Ministère néerlandais des Affaires étrangères, FAQ prostitution 2010, p. 11.
662 () Ministère néerlandais des Affaires étrangères, FAQ prostitution 2010, p. 12.
663 () Ibid.
664 () Rencontre du 13 janvier 2011. Selon la police, il y a environ 1 500 personnes prostituées et 83 établissements de prostitution à La Haye
665 () Ministère néerlandais des Affaires étrangères, FAQ prostitution 2010, p. 11.
666 () Ibid, p. 6.
667 () Le 8e rapport de la rapporteure nationale sur la traite donne les chiffres suivants pour la période 2007-2009 : « Industrie du sexe » : 50 % ; « autre secteur » : 7 % ; « autres » : 4 % ; inconnu ou non disponible : 39 %.
668 () Rencontre du 13 janvier 2011.
669 () Ministère norvégien de la Justice et de l’Intérieur, Purchasing Sexual Services in Sweden and the Netherlands. Legal Regulation and Experiences, 2004, p. 54.
670 () Ministère néerlandais des Affaires étrangères, FAQ prostitution 2010, p. 10.
671 () Ibid.
672 () Déplacement à La Haye du 13 janvier 2011.
673 () Ministère norvégien de la Justice et de l’Intérieur, Purchasing Sexual Services in Sweden and the Netherlands. Legal Regulation and Experiences, 2004.
674 () Cette affaire concernait des réseaux de prostitutions qui exerçaient aux Pays-Bas depuis la fin des années 1990 et qui ont été démantelés en 2007. Ils ont exploité la prostitution de plus de cent jeunes femmes qui exerçaient en vitrines.
675 () “The licensing requirement and the measures to clean up the prostitution sector following the abolition of the ban on brothels have been evaluated twice. The second evaluation indicated that – in addition to licensed establishments and forms of prostitution that did not require a license – there was non-licensed (illegal) prostitution. However, the evaluation concluded that the legal prostitution sector was larger than the illegal sector. Another conclusion was that (in 2006) the licensing system was working properly almost everywhere and that everywhere controls were carried out to one extent or another, so that there were scarcely any so-called sanctuaries any longer. That seemed to indicate that the licence prostitution sector was being properly controlled. This conclusion did not accurately reflect the true situation, as was shown by the Sneep case, for example, in which more than 100 women working in the licensed sector were found to have been forced into prostitution, and also became apparent from the administrative report following that case.”, 8e rapport annuel de la rapporteure nationale sur la traite des êtres humains, 2010, p. 57.
676 () En l’état du texte, passible de 6 mois d’emprisonnement et de 7 400 euros d’amende.
677 () Rencontre du 13 janvier 2011.
678 () Idem.
679 () Ministère norvégien de la Justice et de l’Intérieur, Purchasing Sexual Services in Sweden and the Netherlands. Legal Regulation and Experiences, 2004, p. 24.
680 () Claudine Legardinier et Saïd Bouamama, Les clients de la prostitution. L’enquête, Paris, 2006, p. 143.
681 () Ibid, p. 208.
682 () http://www.unlv.edu/centers/crimestats/SDBs/Rape/Rape%20in%20Nevada%20v4.pdf
683 () Cf. infra, Quatrième partie, I.
684 () Audition du 14 septembre 2010.
685 () Audition du 12 octobre 2010.
686 () Audition de Mme Malka Marcovich du 12 octobre 2010.
687 () Déplacement à Madrid et à La Jonquera des 16 et 18 février 2011.
688 () Claudine Legardinier et Saïd Bouamama, Les clients de la prostitution. L’enquête, Paris, 2006, p. 235.
689 () Melissa Farley et al., « Prostitution and trafficking in nine countries: an update on violence and post traumatic stress disorder », 2003.
690 () Rapport de synthèse de Cabiria, 2009.
691 () Cf. infra, Quatrième partie, II.
692 () Marcel Nuss, « Lettre ouverte à Roselyne Bachelot de la part d’un citoyen (presque) ordinaire », http://nussmarcel.fr/blog/?p=560
693 () Ibid.
694 () Audition du 14 décembre 2010.
695 () Audition du 11 janvier 2011.
696 () Idem.
697 () Claudine Legardinier, Les clients en question. Étude sociologique et enquête d’opinion publique, 2004, p. 31.
698 () Claudine Legardinier et Saïd Bouamama, Les clients de la prostitution. L’enquête, Paris, 2006, p. 113 et suivantes.
699 () Ibid, p. 114.
700 () Ibid, p. 197-198.
701 () Cité dans Claudine Legardinier et Saïd Bouamama, Les clients de la prostitution. L’enquête, Paris, 2006, p. 117.
702 () Rencontre du 13 janvier 2011.
703 () Audition du 9 novembre 2010.
704 () Cité dans Saïd Bouamama, « L’homme en question. Le processus du devenir-client de la prostitution », 2004, p. 107.
705 () Ibid, p. 113.
706 () Ibid, p. 113.
707 () Ibid, p. 122.
708 () Ibid, p. 127.
709 () Ibid, p. 128.
710 () Claudine Legardinier et Saïd Bouamama, Les clients de la prostitution. L’enquête, Paris, 2006, p. 139.
711 () Ibid, p. 118.
712 () Alexandre Parent-Duchâtelet, De la prostitution dans la ville de Paris, considérée sous le rapport de l'hygiène publique, de la morale et de l'administration, 1836.
713 () Claudine Legardinier et Saïd Bouamama, Les clients de la prostitution. L’enquête, Paris, 2006, p. 210.
714 () Saïd Bouamama, « L’homme en question. Le processus du devenir-client de la prostitution », 2004, p. 92.
715 () Claudine Legardinier, Les clients en question. Étude sociologique et enquête d’opinion publique, 2004, p. 27.
716 () Ibid, p. 34.
717 () Saïd Bouamama, « L’homme en question. Le processus du devenir-client de la prostitution », 2004, p. 169.
718 () Cité dans Claudine Legardinier, Les clients en question. Étude sociologique et enquête d’opinion publique, 2004, p. 231. Deuxième congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Qui est l’exploiteur sexuel ?, Dossier de presse – Document d’information no 2, Yokohama, 2001, p. 5.
719 () Audition du 9 novembre 2011.
720 () Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale.
721 () Articles 225-12-1 à 225-12-4 du code pénal.
722 () Audition du 9 novembre 2010.
723 () Idem.
724 () Audition du 23 novembre 2010.
725 () Déplacement à l’Amicale du Nid de Paris du 15 mars 2011.
726 () Article 3 du Protocole de Palerme.
727 () Cf. supra, Première partie, II.
728 () Cf. supra, Première partie, IV.
729 () A titre d’exemple, un couple a été condamné le 2 juillet 2010 par le tribunal de Béziers pour avoir poussé sa fille de 15 ans à se prostituer.
730 () Déplacement à Madrid le 18 février 2011.
731 () Rencontre à l’Amicale du Nid du 15 mars 2011.
732 () Vanessa Simoni, « Territoires et enjeux de pouvoir de la traite à des fins d’exploitation sexuelle : le cas de Paris », Hérodote, n° 136, 2010/1, p. 136-7.
733 () Audition du 26 octobre 2010.
734 () http://www.prostitutionetsociete.fr/temoignages/t-etudiant-aucun-etudiant-sain-d
735 () Audition du 14 septembre 2010.
736 () Cf. supra, Première partie, V.
737 () Audition du 8 février 2011.
738 () Expression employée par Mme Lourdes Perramon, du Lloc de la Dona, Centre d’aide sociale dirigé aux femmes autochtones et immigrantes à Barcelone, rencontre du 17 février 2011.
739 () Cf. supra, Première partie, IV.
740 () M. Vincent Girard, psychiatre à l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille (APHM), le 4 février 2011.
741 () Audition du 26 octobre 2010.
742 () Audition du 30 novembre 2010.
743 () Par exemple, par Mme Véronique Boyer, lors de l’audition de l’association Grisélidis, le 25 janvier 2011.
744 () Cf. supra, Première partie, III.
745 () Vanessa Simoni, « Territoires et enjeux de pouvoir de la traite à des fins d’exploitation sexuelle : le cas de Paris », Hérodote, n° 136, 2010/1, p. 137.
746 () Audition du 9 novembre 2010.
747 () Idem.
748 () Idem.
749 () http://www.prostitutionetsociete.fr/temoignages/t-etudiant-aucun-etudiant-sain-d.
750 () Cf. supra, Première partie, V.
751 () Audition du 11 janvier 2011.
752 () Cf. supra, Deuxième partie, IV.
753 () Cf. infra, Quatrième partie, II.
754 () Audition du 8 février 2011.
755 () Cf. supra, Première partie, V.
756 () Déplacement du 15 mars 2011 à l’Amicale du Nid.
757 () Déplacement du 15 mars 2011 à l’Amicale du Nid.
758 () http://www.prostitutionetsociete.fr/temoignages/t-etudiant-aucun-etudiant-sain-d.
759 () Jean-Michel Carré, Travailleu(r)ses du sexe et fières de l’être, Seuil, 2010, p. 20.
760 () Ibid, p. 46.
761 () Éva Clouet, La prostitution étudiante à l’heure des nouvelles technologies de communication, 2008, p. 141.
762 () Audition de l’Amicale du Nid du 2 novembre 2010.
763 () Jean-Michel Carré, Travailleu(r)ses du sexe et fières de l’être, Seuil, 2010, p. 40.
764 () Déplacement à Madrid des 17 et 18 février 2011.
765 () Claudine Legardinier, Les clients en question. Étude sociologique et enquête d’opinion publique, 2004, p. 29.
766 () Audition du 8 février 2011.
767 () Claudine Legardinier, Les clients en question. Étude sociologique et enquête d’opinion publique, 2004, p. 31.
768 () Déplacement à l’Amicale du Nid du 15 mars 2011.
769 () Témoignage d’un client cité dans Claudine Legardinier et Saïd Bouamama, Les clients de la prostitution. L’enquête, 2006, p. 175.
770 () Audition du 26 octobre 2010.
771 () Audition du 30 novembre 2010.
772 () Audition du 11 janvier 2011.
773 () Audition du 26 octobre 2010.
774 () Audition du 23 novembre 2010.
775 () Tel a été le cas notamment de Mme Claude Boucher, présidente de l’association des Amis du bus des femmes, qui a indiqué, lors de l’audition du 9 novembre 2010, éviter d’utiliser le terme de « métier » pour qualifier la prostitution.
776 () Article 1er de la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain.
777 () Loi n°2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique.
778 () Décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994.
779 () A l’exception des cheveux, des ongles, des poils et des dents, en vertu de l’article R.. 1211-49 du code de la santé publique.
780 () Article 16-5 du code civil.
781 () Articles 16-6 et 16-7 du code civil.
782 () Décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994.
783 () Article 16-9 du code civil.
784 () Témoignage cité dans Claudine Legardinier et Saïd Bouamama, Les clients de la prostitution. L’enquête, 2006, p. 154.
785 () Ibid., p. 158.
786 () Ibid., p. 193.
787 () Cité dans Prostitution et société : http://www.prostitutionetsociete.fr/temoignages/mylene-prostituee-de-luxe
788 () Ces pratiques ont été signalées par de nombreuses personnes auditionnées, notamment par l’association Médecins du Monde, le 15 février 2011.
789 () Ibid., p. 184.
790 () Ibid.
791 () Rencontre avec trois anciennes personnes prostituées à l’association pour la prévention, la réinsertion et l’attention à la femme prostituée (APRAMP) à Madrid, le 16 février 2011.
792 () Audition du 8 février 2011.
793 () Audition de Mme Muriel Salmona et de Mme Judith Trinquart, psychiatres, le 15 février 2011. Cf. supra, première partie.
794 () Déplacement de la mission d’information à La Haye du 13 janvier 2011.
795 () Visite de la mission dans un « puticlub » de Madrid, le 16 février 2011 et au Club Paradise, à La Jonquera, le 18 février 2011.
796 () Témoignage cité dans Claudine Legardinier et Saïd Bouamama, Les clients de la prostitution. L’enquête, 2006, p. 205.
797 () Cité dans « Qui sont les "escort boys"? », L’Express.fr, 12 janvier 2011.
798 () Voir par exemple le site http://internationalsexguide.info/forum/forums.php, indiqué par Mme Malka Marcovich au cours de son audition.
799 () Audition du 23 novembre 2010.
800 () Audition du 12 octobre 2010.
801 () Document fourni par Mme Sophie Wirtz-Jekele de la Samilia foundation, à l’occasion du déplacement à Bruxelles du 11 janvier 2011.
802 () Entretien avec M. Marnix Norder, échevin de La Haye du 13 janvier 2011.
803 () Audition du 26 octobre 2010.
804 () Pour une description détaillé de la violence du monde de la prostitution, cf. supra, notamment la première partie, V.
805 () Cabiria, Rapport de synthèse 2009, p. 163-187.
806 () Audition de M. Lilian Mathieu du 26 octobre 2010.
807 () Audition du 26 octobre 2010.
808 () Audition du 8 février 2011.
809 () Idem.
810 () Pour d’autres témoignages analogues, cf. première partie, V.
811 () Audition du 12 octobre 2010.
812 () Cité dans Prostitution et société : http://www.prostitutionetsociete.fr/temoignages/t-etudiant-aucun-etudiant-sain-d
813 () Déplacement à Madrid du 17 février 2011.
814 () Rencontre du 15 mars 2011.
815 () Claudine Legardinier et Saïd Bouamama, Les clients de la prostitution. L’enquête, 2006, p. 186.
816 () Témoignage cité dans Claudine Legardinier et Saïd Bouamama, Les clients de la prostitution. L’enquête, 2006, p. 148.
817 () Saïd Bouamama, « L’homme en question. Le processus du devenir-client de la prostitution », 2004.
818 () http://www.prostitutionetsociete.fr/temoignages/julien-je-voudrais-temoigner-du
819 () Audition du 8 février 2011.
820 () Audition du 15 février 2011.
821 () CEDH, KA et AD c. Belgique, jugée le 15 février 2005.
822 () Voir notamment le rapport de la mission d’évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, Violences faites aux femmes : mettre enfin un terme à l’inacceptable, n° 1799, juillet 2009, p. 92-105.
823 () Il faut noter que, dans le cas de la traite, le consentement de la victime est indifférent. Cf. article 3.b du Protocole de Palerme (Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants).
824 () Cf. supra, Premier partie, I.
825 () Notamment si l’on se réfère aux recherches réalisées sur Google, qui sont bien plus nombreuses à porter sur les termes « escort girl » que « escort boy ».
826 () Il faut cependant noter que récemment, un réseau de traite de personnes transgenres a été démantelé à Marseille.
827 () L’article consacré par L’Express à la prostitution masculine sur Internet n’évoque qu’une prostitution homosexuelle : « Qui sont les "escort boys"? », L’Express.fr, 12 janvier 2011
828 () 0,6 % des femmes seraient clientes contre 12,7 % des hommes selon l’enquête d’opinion publique menée en 2004 par le Mouvement du Nid : Claudine Legardinier, Les clients en question. Étude sociologique et enquête d’opinion publique, 2004.
829 () Saïd Bouamama, « L’homme en question. Le processus du devenir-client de la prostitution », 2004, p. 45.
830 () Ibid, p. 58.
831 () Ibid.
832 () Déplacement à La Jonquera du 18 février 2011.
833 () À l’exception du principe de libre disposition de son corps, dont on a vu les limites qu’il rencontrait.
834 () Témoignage cité dans Claudine Legardinier et Saïd Bouamama, Les clients de la prostitution. L’enquête, 2006, p. 157.
835 () Cité dans Claudine Legardinier, Les clients en question. Étude sociologique et enquête d’opinion publique, 2004, p. 23.
836 () Saïd Bouamama, « L’homme en question. Le processus du devenir-client de la prostitution », 2004, p. 120.
837 () Déplacement à Madrid et à La Jonquera des 16 et 18 février 2011.
838 () Audition du 12 octobre 2011.
839 () Ceci ne signifie pas que seules des femmes se prostituent, de même que des hommes sont victimes de violences conjugales.
840 () Audition du 11 janvier 2011.
841 () Déplacement à Madrid du 17 février 2011.
842 () Rencontre du 20 janvier 2011.
843 () Cf. infra, B du I de la présente partie.
844 () Contre environ 0,6 % des femmes : Mouvement du Nid, Les clients, enquête d’opinion publique, juin 2004, p. 16.
845 () http://www.amnestyforwomen.de/_notes/FInal%20Report%20TAMPEP%208%20BRD%202009.pdf: enquête européenne TAMPEP, volet allemand, 2009.
846 () Cf. supra, Première partie, II.
847 () http://www.amnestyforwomen.de/_notes/FInal%20Report%20TAMPEP%208%20BRD%202009.pdf, enquête européenne TAMPEP, volet allemand, 2009.
848 () Rencontre avec M. Antonio Vega Ramos, commissaire au centre d’information contre le crime organisé (CICO) du ministère de l’Intérieur espagnol, le 17 février 2011.
849 () Saïd Bouamama, « L’homme en question. Le processus du devenir-client de la prostitution », 2004, disponible à l’adresse suivante : http://www.mouvementdunid.org/IMG/pdf/HommeEnQuestion.pdf.
850 () Mouvement du Nid, Prostitution. Les clients en question, Paris, 2004 et Claudine Legardinier et Saïd Bouamama, Les clients de la prostitution. L’enquête, Paris, 2006.
851 () Rencontre à l’Amicale du Nid du 15 mars 2011.
852 () Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, signé le 15 novembre 2000.
853 () Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, signée à Varsovie le 16 mai 2005.
854 () Mme Sigma Huda, Intégration des droits fondamentaux des femmes et de l’approche sexospécifique, 2006, § 74.
855 () Audition du 12 octobre 2010.
856 () Lettre de M. Alain Juppé du 10 novembre 2010, cf. annexe n° 7.
857 () Note transmise à la mission d’information par le ministère de la Défense.
858 () Cf. infra, B du I de la présente partie.
859 () Section 53A du Sexual Offences Act 2003 : “Paying for sexual services of a prostitute subjected to force etc.”
860 () Rencontre avec Mme Evelien Pennings, chargée de mission au ministère néerlandais de la sécurité et de la justice, direction de la lutte contre la criminalité et de l'application du droit, 13 janvier 2011.
861 () Directive 2010/.../UE du Parlement européen et du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes. Le texte de cette future directive a fait l’objet d’un accord politique entre le Parlement et le Conseil. Il est disponible à l’adresse suivante : http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5849482¬iceType=null&language=fr
862 () « Chaque Partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait d’utiliser les services qui font l’objet de l’exploitation visée à l’article 4 paragraphe a de la présente Convention, en sachant que la personne concernée est victime de la traite d’êtres humains. »
863 () Rencontre avec M. Michael Carlin, chef du secteur « cybercriminalité et traites des êtres humains » à la direction générale des affaires intérieures de la Commission européenne, 12 janvier 2011.
864 () Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering 1999-2008, Stockholm, 2010 (disponible à l’adresse suivante : http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/14/91/42/ed1c91ad.pdf). Ce rapport comprend un résumé en anglais.
865 () Déplacement à Stockholm du 19 au 21 janvier 2011.
866 () Mme Elisabeth White, ministère de l’Éducation, Unité de la parité entre hommes et femmes, 20 janvier 2011.
867 () Rencontre du 21 janvier 2011.
868 () Mme Kajsa Wahlberg, inspecteur-détective au département des affaires de la police, Office national de la police suédoise et rapporteure nationale sur les questions de traite, rencontre du 20 janvier 2011.
869 () Mme Elisabeth White, ministère de l’Éducation, Unité de la parité entre hommes et femmes, 20 janvier 2011.
870 () Rencontre du 20 janvier 2011.
871 () Mme Penilla Flanck Zetterström, fonctionnaire du Parlement suédois, 20 janvier 2011.
872 () Rencontre du 21 janvier 2011.
873 () Mme Anna Skarhed, chancelière de Justice, 21 janvier 2011.
874 () Audition de Mme Françoise Gil, du 21 décembre 2010, et de Maîtresse Gilda, porte-parole nationale du Syndicat du travail sexuel, du 23 novembre 2010.
875 () Mme Kajsa Wahlberg, inspecteur-détective à l’Office national de la police suédoise et rapporteure nationale sur la traite, 20 janvier 2011.
876 () Rencontre du 20 janvier 2011.
877 () Mme Kajsa Wahlberg, inspecteur-détective à l’Office national de la police suédoise et rapporteure nationale sur la traite, 20 janvier 2011.
878 () Mme Elisabeth White, ministère de l’Éducation, Unité de la parité entre hommes et femmes, 20 janvier 2011.
879 () Mme Kajsa Wahlberg, inspecteur-détective à l’Office national de la police suédoise et rapporteure nationale sur la traite, 20 janvier 2011.
880 () Rencontre du 20 janvier 2011.
881 () Rencontre du 12 janvier 2011.
882 () Rencontre du 20 janvier 2011.
883 () Rencontre du 21 janvier 2011.
884 () Mme Anna Skarhed, Chancelière de Justice, 21 janvier 2011.
885 () Cité dans Claudine Legardinier et Saïd Bouamama, Les clients de la prostitution. L’enquête, 2006, p. 231.
886 () Audition du 23 novembre 2010.
887 () Audition du 23 novembre 2010.
888 () Crim., 27 mars 1996, B. n° 138, p. 396.
889 () Cf. supra, Troisième partie, II.
890 () Mme Anna Skarhed, Chancelière de Justice, 21 janvier 2011.
891 () Déplacement à Lyon du 16 décembre 2010 et déplacement à la préfecture de police de Paris du 3 novembre 2010.
892 () Voir notamment le rapport de la mission d’évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, Violences faites aux femmes : mettre enfin un terme à l’inacceptable, n° 1799, juillet 2009, p. 92-105.
893 () Audition du 5 octobre 2010.
894 () Voir notamment Claudine Legardinier et Saïd Bouamama, Les clients de la prostitution. L’enquête, 2006, p. 248-249.
895 () L’article 5 de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public prévoyait que l’interdiction entre en vigueur à l’issue d’un délai de cinq mois à compter de la promulgation de la loi.
896 () Audition du 2 novembre 2010.
897 () Audition du 5 octobre 2010.
898 () Audition du 23 novembre 2010.
899 () Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005.
900 () Amicale du Nid, Les représentations de la prostitution étudiante, 2009-2010, p. 7.
901 () Mesure n° 5.
902 () Audition du 2 novembre 2010.
903 () Audition du 12 octobre 2010.
904 () Rencontre avec M. Emilio Galleno, Secrétaire Général de la fédération espagnole de l’hôtellerie du 17 février 2011.
905 () Audition du 2 novembre 2010.
906 () Audition du 30 mars 2011.
907 () Cf. notamment l’audition de Mme Malika Amaouche, coordinatrice du collectif Droits et prostitution, qui indiquait, le 30 novembre 2010 que la lutte contre la prostitution devait être effectuée en amont, à travers la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes, l’accès à l’éducation et la lutte contre la paupérisation.
908 () Claudine Legardinier et Saïd Bouamama, Les clients de la prostitution. L’enquête, 2006, p. 112.
909 () Audition du 12 octobre 2010.
910 () Mission d’évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, Violences faites aux femmes : mettre enfin un terme à l’inacceptable, n° 1799, juillet 2009, proposition n° 18, p. 115.
911 () Mission d’information sur la pratique du port du voile intégral en France, Voile intégral : le refus de la République, n° 2262, janvier 2010, proposition n° 5, p. 135.
912 () Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005.
913 () Saïd Bouamama, « L’homme en question. Le processus du devenir-client de la prostitution », 2004, p. 49.
914 () Claudine Legardinier et Saïd Bouamama, Les clients de la prostitution. L’enquête, 2006, p. 130.
915 () Tel a été le cas notamment de M. Jacques Dallest, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, le 3 février 2011.
916 () Saïd Bouamama, « L’homme en question. Le processus du devenir-client de la prostitution », 2004, p. 17.
917 () Claudine Legardinier et Saïd Bouamama, Les clients de la prostitution. L’enquête, 2006, p. 186.
918 () Audition du 9 novembre 2010.
919 () Rencontre du 11 janvier 2011.
920 () « Il nous semble en conséquence nécessaire d’approfondir notre connaissance des effets des images pornographiques et des modèles qu’elles véhiculent. Sans doute une recherche ambitieuse en la matière est-elle à envisager. », Saïd Bouamama, « L’homme en question. Le processus du devenir-client de la prostitution », 2004, p. 140.
921 () Cf. supra, Première partie, V.
922 () Audition de Mme Violaine Husson, de la Cimade, le 16 novembre 2010.
923 () Rencontre avec Lisina, personne anciennement prostituée, qui a été violée par trois policiers en 2004, à l’Amicale du Nid de Paris, le 15 mars 2011.
924 () Cabiria, Rapport de synthèse 2009, p. 166.
925 () Commission nationale consultative des droits de l’homme, La traite et l’exploitation des êtres humains en France, La documentation française, 2010, p. 170.
926 () Citée dans : Commission nationale consultative des droits de l’homme, La traite et l’exploitation des êtres humains en France, La documentation française, 2010, p. 170.
927 () Commission nationale de déontologie et de sécurité, Rapport annuel, 2008, p. 32.
928 () Déplacement à Marseille du 2 février 2011.
929 () Audition de Mme Judith Trinquart du 15 février 2011.
930 () Audition, notamment de l’association des Amis du bus des femmes, du 9 novembre 2010 et de l’association Grisélidis du 25 janvier 2011.
931 () Audition du 25 janvier 2011.
932 () Déplacement à Lyon du 16 décembre 2010.
933 () Par exemple, l’article 6-6 du Protocole de Palerme prévoit « la possibilité [pour les victimes] d’obtenir réparation du préjudice ».
934 () Commission nationale consultative des droits de l’homme, La traite et l’exploitation des êtres humains en France, La documentation française, 2010, p. 181.
935 () Cf. supra, Deuxième partie, IV.
936 () Note adressée à la mission d’information par le FGTI le 13 décembre 2010.
937 () Audition des Amis du bus des femmes, le 9 novembre 2010, du STRASS, le 23 novembre 2010, du collectif Droits et prostitution, le 30 novembre 2010, de Cabiria, le 16 décembre 2010, de Grisélidis, le 25 janvier 2011 et d’Autres Regards le 4 février 2011.
938 () Audition du Mouvement du Nid, le 12 octobre 2010 et de la fondation Scelles, le 23 novembre 2010.
939 () Audition de l’Amicale du Nid, le 2 novembre 2010, de l’association ALC le 26 octobre 2010 et de l’association IPPO, le 21 décembre 2010.
940 () Commission nationale consultative des droits de l’homme, La traite et l’exploitation des êtres humains en France, La documentation française, 2010, p. 218.
941 () Conseil national du sida, VIH et commerce du sexe. Garantir l’accès universel à la prévention et aux soins, septembre 2010.
942 () Commission nationale consultative des droits de l’homme, La traite et l’exploitation des êtres humains en France, La documentation française, 2010, p. 209-218.
943 () Cf. supra, Deuxième partie, II.
944 () Ibid.
945 () Article 3 de la directive 2010/.../UE du Parlement européen et du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes. Le texte de cette future directive a fait l’objet d’un accord politique entre le Parlement et le Conseil. Il est donc définitif mais n’a pas encore été publié.
946 () § 14 de l’exposé des motifs de la même directive.
947 () Article 22 de la directive.
948 () Cf. supra I. de la présente partie, pour le cas de la Suède où la prostitution de rue aurait été divisée par deux depuis 1999.
949 () Audition du 26 octobre 2010.
950 () Audition du 9 novembre 2010. Cette position a été exprimée par la grande majorité des associations de santé communautaire auditionnées.
951 () Audition du 30 novembre 2010.
952 () Conseil national du sida, VIH et commerce du sexe. Garantir l’accès universel à la prévention et aux soins, septembre 2010, p. 40.
953 () Report by the Federal Government on the impact of the Act regulating the legal situation of prostitutes (Prostitution Act), 2007, p. 29.
954 () Cf. supra, Troisième partie, III.
955 () Article L. 5312-1 du code du travail.
956 () Cf. supra, Deuxième partie, IV.
957 () Note du ministère des Solidarités et de la cohésion sociale du 15 février 2010.
958 () Conseil national du sida, VIH et commerce du sexe. Garantir l’accès universel à la prévention et aux soins, septembre 2010, p. 19.
959 () Audition du 11 janvier 2011.
960 () Cf. infra, IV sur la coordination des politiques publiques.
961 () cf. supra, Deuxième partie, IV.
962 () Audition du 12 octobre 2010.
963 () Audition du 23 novembre 2010.
964 () Audition du 25 janvier 2011.
965 () Rencontre du 21 janvier 2011.
966 () Rencontre du 21 janvier 2011.
967 () Cf. supra, Deuxième partie, IV.
968 () Audition du 26 octobre 2010.
969 () Idem.
970 () Audition du 30 novembre 2010.
971 () « Assistance et aide aux victimes de la traite des êtres humains »
972 () Cf. supra, Première partie, II.
973 () Cf. supra, Troisième partie, III.
974 () Rencontre du 16 décembre 2010.
975 () Cf. supra, Troisième partie, III.
976 () Circulaire n° IMIM0900054C du 5 février 2009 relative aux conditions d'admission au séjour des étrangers victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme coopérant avec les autorités judiciaires : « Vous avez toujours la possibilité d’envisager la délivrance à ces victimes d’un titre de séjour en dérogeant à l’obligation de témoignage ou de dépôt de plainte, en tenant compte des éléments permettant de caractériser leur situation de victime et des efforts de réinsertion consentis (inscription à une formation linguistique, professionnelle, exercice d’une activité professionnelle...). »
977 () Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, signée à Varsovie le 16 mai 2005.
978 () Article 13 de la convention, traduit, en droit interne, à l’article R. 316-1 du CESEDA.
979 () Audition des responsables du groupe de travail interministériel sur la traite des êtres humains du 14 septembre 2010.
980 () Audition du 16 novembre 2010.
981 () Déplacement à Bruxelles du 12 janvier 2011.
982 () Cf. infra, IV.
983 () Audition du 16 novembre 2010.
984 () Cf. infra.
985 () Audition de Mme Katia Boudraa, chef de la section des affaires générales à la direction de la police générale à la préfecture de police de Paris, le 16 novembre 2010.
986 () Article R. 741-2 du CESEDA.
987 () Mesure n° 16.
988 () Commission nationale consultative des droits de l’homme, La traite et l’exploitation des êtres humains en France, La documentation française, 2010, p. 224.
989 () Audition du 16 novembre 2010.
990 () Principes directeurs du Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés sur la protection internationale : application de l’article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou du Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés aux victimes de la traite et aux personnes risquant d’être victimes de la traite, 2006.
991 () La CNCDH en cite plusieurs exemple dans son rapport : Commission nationale consultative des droits de l’homme, La traite et l’exploitation des êtres humains en France, La documentation française, 2010, p. 247.
992 () Cf. supra, Deuxième partie, I.
993 () Rapport d'information n° 209 (2000-2001) de Mme Dinah Derycke, fait au nom de la délégation aux droits des femmes, déposé le 31 janvier 2001, Les politiques publiques et la prostitution. Rapport d'information sur l'activité de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes pour l'année 2000.
994 () Décision ministérielle du 7 septembre 1981, reprise par la note précitée du 7 mai 1982, mentionnées dans le rapport du Sénat précité.
995 () Cf. infra, IV.
996 () Article 11 de la future directive 2010/.../UE du Parlement européen et du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes. Le texte de cette future directive a fait l’objet d’un accord politique entre le Parlement et le Conseil.
997 () Pour une description des conditions de versement, cf. supra, Deuxième partie, III. Pour mémoire, l’ATA représente environ 325 euros par mois, contre 467 euros pour une personne seule pour le RSA.
998 () Commission nationale consultative des droits de l’homme, La traite et l’exploitation des êtres humains en France, La documentation française, 2010, p. 265.
999 () Commission nationale consultative des droits de l’homme, La traite et l’exploitation des êtres humains en France, La documentation française, 2010, p. 255.
1000 () Cf. supra, Deuxième partie, IV.
1001 () Audition du 23 novembre 2010.
1002 () Rencontre du 16 décembre 2010.
1003 () Expression de M. Jean-Christophe Tête, directeur de l'établissement de Paris de l’Amicale du Nid, audition du 2 novembre 2010.
1004 () Ces préconisations rejoignent la mesure n° 20 du Plan d’action national de lutte contre la traite (2011-2013).
1005 () Cf. supra, Deuxième partie, III.
1006 () Le Plan national de lutte contre la traite (2011-2013) préconise d’ailleurs de diversifier les formes d’hébergement pour les adapter aux besoins des victimes de la traite (mesure n° 19).
1007 () Ces personnes peuvent également bénéficier d’une priorité sur le fondement d’un autre critère, qui concerne les « personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ».
1008 () Rencontre avec Mme Rocio Mora, coordinatrice de l’APRAMP, le 17 février 2011.
1009 () Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, signée à Varsovie le 16 mai 2005.
1010 () Rapport explicatif sur la Convention de Varsovie, § 166.
1011 () Rencontre avec M. Patrick Lescure, directeur régional de Pôle Emploi pour la région Rhône-Alpes, à Lyon le 16 décembre 2010.
1012 () Cf. supra, Deuxième partie, IV.
1013 () Cf. infra, IV.
1014 () Note communiquée par M. Patrick Lescure.
1015 () Cf. infra, IV.
1016 () Cf. supra, Première partie, V.
1017 () Déplacement du 15 mars 2011.
1018 () Idem.
1019 () Association IPPO, audition du 21 décembre 2010.
1020 () Pour ce qui est de l’accès aux soins de manière générale, cf. supra, 1.
1021 () Audition du 15 février 2011.
1022 () Commission nationale consultative des droits de l’homme, La traite et l’exploitation des êtres humains en France, La documentation française, 2010, p. 259.
1023 () Déplacement en Suède des 19-21 janvier 2011.
1024 () Cf. supra, Deuxième partie, IV.
1025 () Certaines recommandations en la matière, notamment concernant le périmètre de la traite des êtres humains, figurent cependant dans le rapport de la CNCDH, La traite et l’exploitation des êtres humains en France, La documentation française, 2010, p. 56-66 et dans le plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains 2011-2013.
1026 () Cf. supra, Deuxième partie, II.
1027 () Circulaire CRIM.2001.20/G1 du 18 décembre 2001, relative au proxénétisme aggravé.
1028 () Circulaire CRIM-03-7/E8 du 3 juin 2003 de présentation des dispositions de droit pénal de la loi n° 2003-239 du 18 mars pour la sécurité intérieure et de la loi n° 2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe.
1029 () Circulaire conjointe (Justice/Défense/Intérieur) du 9 mars 2005 relative au renforcement de la lutte contre le proxénétisme et les réseaux organisant la prostitution.
1030 () Circulaire CRIM-9-12/cab du 1er novembre 2009 de politique pénale générale.
1031 () Audition du 5 octobre 2010.
1032 () CNCDH, La traite et l’exploitation des êtres humains en France, La documentation française, 2010, p. 162-167.
1033 () Cf. annexe n° 10.
1034 () Article 10.1 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, signée à Varsovie le 16 mai 2005.
1035 () Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, signée à Varsovie le 16 mai 2005.
1036 () Rapport explicatif sur la Convention de Varsovie, § 129.
1037 () Directive 2010/.../UE du Parlement européen et du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes. Le texte de cette future directive a fait l’objet d’un accord politique entre le Parlement et le Conseil.
1038 () « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour créer des mécanismes appropriés d'identification précoce des victimes et d'assistance et d'aide aux victimes, en coopération avec les organismes d'aide pertinents. »
1039 () « Les États membres favorisent la formation régulière des fonctionnaires susceptibles d'entrer en contact avec des victimes et victimes potentielles de la traite des êtres humains, y compris les policiers de terrain, afin de leur permettre d'identifier les victimes et victimes potentielles de la traite des êtres humains et de les prendre en charge. »
1040 () Ensemble contre la traite des êtres humains, Actes du colloque « Identifier, protéger et prendre en charge les personnes victimes de traite des êtres humains : Comment améliorer la coopération entre les acteurs ? », 21 octobre 2010.
1041 () Audition du 8 février 2011.
1042 () Audition de M. Patrick Hauvuy, du 26 octobre 2010.
1043 () Cf. infra, IV.
1044 () Voir notamment le rapport de la mission d’évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, Violences faites aux femmes : mettre enfin un terme à l’inacceptable, n° 1799, juillet 2009, p. 145 et suivantes.
1045 () Audition de Mme Elisabeth Moiron-Braud, chef de bureau de l’aide aux victimes et de la politique associative au ministère de la Justice, M. Éric Panloup, lieutenant-colonel de gendarmerie, Mme Cendrine Léger, commandant de police à la préfecture de la Gironde, du 14 septembre 2010.
1046 () Cf. supra, I.
1047 () Audition du 11 janvier 2011.
1048 () Audition de M. René-Georges Querry, du 11 janvier 2011.
1049 () Déplacement à Lyon du 16 décembre 2010.
1050 () Déplacement en Suède, rencontre avec Mme Kajsa Wahlberg, inspecteur-détective à l’Office national de la police suédoise et rapporteure nationale sur les questions de traite, du 20 janvier 2011.
1051 () Déplacement à la préfecture de police de Paris du 3 novembre 2010.
1052 () Cass., Crim., 17 octobre 2001, n° 01-81698 ou Cass., Crim., 3 mars 1999, 97-85581.
1053 () Cass., Crim., 9 octobre 1996, n° 95-81232.
1054 () Ibid.
1055 () 10° de l’article 225-7 du code pénal.
1056 () Audition du 1er mars 2011.
1057 () Une adresse IP (avec IP pour Internet Protocol) est le numéro qui identifie chaque ordinateur connecté à Internet.
1058 () Documentation envoyée à la mission d’information par Vivastreet.
1059 () Cf. supra, Première partie, I sur la traite des êtres humains et notamment ses dimensions internationales.
1060 () Cf. supra, Deuxième partie, II.
1061 () Déplacement à Bruxelles le 12 janvier 2011, rencontre avec M. Olivier Tell, chef de l’unité de coopération judiciaire pénale à la direction générale Justice de la Commission européenne.
1062 () Article 2.2 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres.
1063 () Audition de M. Jean-Marc Souvira, du 14 septembre 2011.
1064 () Articles 695-2 et 695-3 du code de procédure pénale.
1065 () Déplacement à La Haye, rencontre avec Mme Mme Angelika Molnar, analyste au groupe « Prostitution et traite des êtres humains » d’Europol, le 13 janvier 2011.
1066 () Déplacement à La Haye, rencontre avec Mme Martine Bednarczyk, chef du bureau France auprès d’Europol, le 13 janvier 2011.
1067 () Déplacement à La Haye, rencontre avec M. Mahrez Abassi, adjoint du membre national représentant à la France à Eurojust, le 13 janvier 2011.
1068 () Eurojust, Rapport annuel 2009, p. 21.
1069 () Déplacement à La Haye, rencontre avec M. Mahrez Abassi, adjoint du membre national représentant à la France à Eurojust, le 13 janvier 2011.
1070 () Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, signé le 15 novembre 2000.
1071 () Audition du 14 septembre 2010.
1072 () Rencontre du 15 mars 2011 à l’Amicale du Nid de Paris.
1073 () Cf. supra, Deuxième partie, III.
1074 () Mesure n° 23 du Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2011-2013).
1075 () Rapport explicatif sur la Convention de Varsovie, § 286.
1076 () Directive 2010/.../UE du Parlement européen et du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes.
1077 () CNCDH, La traite et l’exploitation des êtres humains en France, La documentation française, 2010, p. 232.
1078 () Mesure n° 24 du Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2011-2013).
1079 () Rencontre à l’Amicale du Nid de Paris du 15 mars 2011.
1080 () Directive 2010/.../UE du Parlement européen et du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes.
1081 () Article 306 du code de procédure pénale.
1082 () Article 400 du code de procédure pénale.
1083 () CNCDH, La traite et l’exploitation des êtres humains en France, La documentation française, 2010, p. 237.
1084 () Article 12.4 de la directive 2010/.../UE du Parlement européen et du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes. On entend par ce terme, le fait d’accroître le tort infligé aux victimes à l’occasion de la procédure judiciaire qu’elles initient.
1085 () Déplacement à La Haye du 13 janvier 2011.
1086 () Déplacement à Lyon du 16 décembre 2010.
1087 () Ibid.
1088 () Décision-cadre 2003/577/JHA du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve et décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation.
1089 () Réponse au questionnaire de la mission d’information.
1090 () Article 225-10 du code pénal.
1091 () Article 225-5 du code pénal.
1092 () Ibid.
1093 () Cf. supra, Deuxième partie, III.
1094 () Audition du 9 novembre 2010.
1095 () Audition du 23 novembre 2010.
1096 () Cette situation n’est pourtant pas rare mais peut engendrer des situations problématiques, notamment en cas de présence d’enfants au domicile, ainsi que l’a souligné M. Jean-Régis Ploton, directeur de l’association Autres Regards.
1097 () Article 25 de la convention.
1098 () Conseil national du sida, VIH et commerce du sexe. Garantir l’accès universel à la prévention et aux soins, septembre 2010, p. 40.
1099 () 3° de l’article 225-6 du code pénal : « De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution »
1100 () Cf. annexe n° 5.
1101 () 1° de l’article 225-5 du code pénal.
1102 () 2° de l’article 225-5 du code pénal.
1103 () Déplacement à Lyon du 16 décembre 2010. L’exemple cité par M. Francis Caballero remonte à 1946 : Francis Caballero, Droit du sexe, 2010, p. 504, note n° 97.
1104 () Francis Caballero, Droit du sexe, 2010, p. 503.
1105 () Déplacement à l’Amicale du Nid de Paris du 15 mars 2011.
1106 () Idem.
1107 () Audition du 8 février 2011.
1108 () Les décisions citées par Francis Caballero, Droit du sexe, 2010, sont, à une ou deux exceptions, toutes antérieures.
1109 () Cécile Bergougnoux, « L’argent du sexe éponge leurs dettes », La Montagne, 31 mars 2011, p. 3.
1110 () Audition de Mme Lucie Nayak, doctorante en sociologie, du 14 décembre 2010.
1111 () M. Jean-François Chossy a été invité à participer à l’audition de Mme Lucie Nayak, le 14 décembre 2010.
1112 () Cf. supra, Troisième partie, II.
1113 () Note du 12 décembre 2008 transmise à la mission d’information par l’Association des paralysés de France. L’Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis (Unapei) a indiqué à la mission ne pas disposer de document sur l’assistance sexuelle, sa réflexion s’inscrivant dans le cadre de celle de la Commission nationale consultative des personnes handicapées (CNCPH).
1114 () Ibid, p. 5.
1115 () Audition du 23 novembre 2010.
1116 () Audition du 30 novembre 2010.
1117 () Cass. Crim., 27 mars 1996, B. n° 138, p. 396. La mission renouvelle les remarques exprimées ci-dessus quant à la notion de « besoins sexuels d’autrui », qui ne peut pas être acceptée telle quelle.
1118 () Ibid.
1119 () Article 225-6, 1°, du code pénal qui sanctionne le fait de « faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ».
1120 () Ces dernières seraient également sanctionnables sur le fondement de l’article 225-5, 3° du code pénal, qui punit le fait d’« embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire. »
1121 () Audition du 14 décembre 2010.
1122 () Cf. supra, Troisième partie, III.
1123 () Audition du 11 janvier 2011.
1124 () Audition du 23 novembre 2010.
1125 () Audition du 14 décembre 2010.
1126 () APF, « Pour un droit effectif à une vie affective, sentimentale et sexuelle des personnes en situation de handicap moteur, avec ou sans troubles associés », janvier 2009. Document communiqué à la mission par l’APF.
1127 () Audition de Mme Lucie Nayak du 14 décembre 2010.
1128 () Audition du 12 octobre 2010.
1129 () Audition du 2 novembre 2010.
1130 () Déplacement du 16 décembre 2010.
1131 () Audition du 2 novembre 2010.
1132 () Audition du 12 octobre 2010.
1133 () Audition de Mme Malka Marcovich du 12 octobre 2010.
1134 () Audition de Mme Michèle Vianès du 26 octobre 2010.
1135 () Audition du 26 octobre 2010.
1136 () Résolution sur l'attachement au respect des valeurs républicaines face au développement de pratiques radicales qui y portent atteinte, adoptée le 11 mai 2010.
1137 () Résolution adoptée par l'Assemblée nationale le 23 février 2010.
1138 () Audition du 2 novembre 2010.
1139 () Rapport d'information n° 209 (2000-2001) de Mme Dinah Derycke, fait au nom de la délégation aux droits des femmes, déposé le 31 janvier 2001, Les politiques publiques et la prostitution. Rapport d'information sur l'activité de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes pour l'année 2000.
1140 () Cf. supra, Deuxième partie, IV.
1141 () Audition de M. Yves Charpenel, président de la fondation Scelles, du 23 novembre 2010
1142 () Cf. supra, Deuxième partie, IV.
1143 () Actes du colloque « Identifier, protéger et prendre en charge les personnes victimes de traite des êtres humains : Comment améliorer la coopération entre les acteurs ? », Paris, 21 octobre 2010.
1144 () Audition du 2 novembre 2010.
1145 () Audition du 2 novembre 2010.
1146 () Idem.
1147 () Rapport d'information n° 209 (2000-2001) de Mme Dinah Derycke, fait au nom de la délégation aux droits des femmes, déposé le 31 janvier 2001, Les politiques publiques et la prostitution. Rapport d'information sur l'activité de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes pour l'année 2000.
1148 () Circulaire du 25 août 1970 prise en application de l'article 185-1 du code de la famille et de l'action sociale et relative à la lutte contre la prostitution et le proxénétisme, circulaire n° 14 A.S du 21 mars 1979 relative à la lutte contre la prostitution et circulaire n° 88-08 du 7 mars 1988 relative à la prévention de la prostitution et la réinsertion des personnes prostituées
1149 () Déplacement à Lyon du 16 décembre 2010.
1150 () Déplacement à Marseille du 3 février 2011.
1151 () Audition de M. Patrick Hauvuy, du 26 octobre 2010.
1152 () Créés par le décret n° 2008-297 du 1er avril 2008.
1153 () Déplacement à Lyon du 16 décembre 2010.
1154 () Article 12 du décret n° 2008-297 du 1er avril 2008.
1155 () Réponse écrite du ministère des Solidarités et de la cohésion sociale à la mission d’information.
1156 () Article 12 du décret n° 2008-297 du 1er avril 2008.
1157 () Mesure n° 3.
1158 () Déplacement à Lyon du 16 décembre 2011.
1159 () Idem.
1160 () Déplacement à Marseille du 3 février 2011.
1161 () Déplacements à Lyon du 16 décembre 2010 et à Marseille du 3 février 2011.
1162 () Tel a été notamment le cas lors de l’audition de l’association des Amis du bus des femmes, le 9 novembre 2010.
1163 () Audition du 12 octobre 2010.
1164 () Rencontre avec Mme Véronique Escolano, substitut générale à la cour d’appel de Lyon déléguée à la politique associative, lors du déplacement à Lyon du 16 décembre 2010.
1165 () Mesure n° 2.
1166 () Audition de Mme Elisabeth Tomé-Gertheinrichs, chef du service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes (SDFE) du 5 octobre 2010.
1167 () Audition de Audition des responsables du groupe de travail interministériel sur la traite :
Mme Elisabeth Moiron-Braud, chef de bureau de l’aide aux victimes et de la politique associative au ministère de la Justice, M. Éric Panloup, lieutenant-colonel de gendarmerie et Mme Cendrine Léger, commandant de police à la préfecture de la Gironde.
1168 () Rencontre du 20 janvier 2011.
1169 () Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, signée à Varsovie le 16 mai 2005.
1170 () Rencontre avec M. Patrik Cederlöf, coordinateur national contre la prostitution et le trafic d’êtres humains du 20 janvier 2011.
1171 () Cf. supra première et deuxième parties.
1172 () Pour le détail de ces textes, voir le rapport de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, La traite et l’exploitation des êtres humains en France, La documentation française, 2010.
1173 () Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, signée à Varsovie le 16 mai 2005.
1174 () Séance du mardi 11 mai 2010, JORF Sénat n° 42.
1175 () Ibid.
1176 () Rapport explicatif sur la Convention de Varsovie, § 296.
1177 () Rencontre du 13 janvier 2011.
1178 () Disponibles à l’adresse suivante : http://english.bnrm.nl/.
1179 () Rencontre du 20 janvier 2011.
1180 () Rencontre avec Mme Pye Jakobson, porte-parole de l’association Rose Alliance, le 20 janvier 2011.
1181 () Information fournie le 1er avril 2011.
1182 () Audition du 26 octobre 2010.
1183 () Audition du 30 mars 2011.
1184 () Cf. supra, Première partie, I.
1185 () Table ronde du 2 février 2011.
1186 () Audition de Mme Elsa Hajman, chargée de mission prostitution à la FNARS, le 7 décembre 2010.
© Assemblée nationale