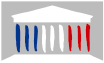
N° 3605
——
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 juin 2011.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE
sur le droit de la nationalité en France
ET PRÉSENTÉ
PAR M. Claude GOASGUEN
Député.
——
en conclusion des travaux d’une mission d’information présidée par
M. Manuel VALLS (1)
Député.
——
La mission d’information est composée de :
M. Manuel Valls, président ; M. Claude Goasguen, rapporteur ; M. Abdoulatifou Aly, M. Claude Bodin, M. Éric Diard, M. Julien Dray, M. Christian Estrosi (2), M. Jean-Paul Garraud, M. Guénhaël Huet, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sandrine Mazetier, Mme George Pau-Langevin, M. Bernard Roman, M. Éric Straumann, M. Christian Vanneste, M. Patrice Verchère.
INTRODUCTION 7
I. UNE NATIONALITÉ VIDÉE DE SA SUBSTANCE DANS UN CONTEXTE MONDIALISÉ 9
A. UN « ROMAN NATIONAL » À BOUT DE SOUFFLE 9
1. La nation : histoire d’un concept 10
a) L’apparition du concept de nation sous l’Ancien Régime 10
b) La définition et l’affirmation du concept de nation avec la Révolution française 11
c) La théorisation du concept de nation 12
d) La crise du concept de nation 17
2. Les vertiges d’une nation sans passé commun et hantée par le spectre d’une sortie de l’Histoire 20
a) Une mémoire absente ou « balkanisée » manifestant une exténuation du modèle républicain de construction nationale 21
b) Un enseignement de l’histoire trop désincarné et peu à même de recréer le tronc commun de l’appartenance nationale 22
B. CITOYENNETÉ DIFFUSE, NATIONALITÉ CONFUSE 27
1. La nationalité n’est pas la citoyenneté 27
a) Une distinction claire en théorie 27
b) Une distinction floue en pratique 31
2. Un sentiment d’appartenance n’allant plus de soi quand mondialisation et crises sociales suscitent la tentation du repli identitaire 36
a) Un instrument à améliorer : le contrat d’accueil et d’intégration 37
b) Une intégration citoyenne tendant à prendre le pas sur l’assimilation dans le contexte des nouveaux flux migratoires 41
c) L’essor d’identités particulières et la tentation de « l’entre-soi » 47
3. Un dépassement problématique du cadre national : le développement inédit de la plurinationalité 52
a) Un phénomène connaissant un accroissement certes imperceptible mais réel 52
b) Une source d’incertitudes nouvelles et problématiques quant à la réalité des liens existant entre un État et des individus 53
c) Le vecteur potentiel de conflits d’allégeance et d’intérêts ? 58
4. Une nouvelle source de confusion : la citoyenneté européenne 60
a) La concurrence entre nationalité et citoyenneté 60
b) La primauté de la nationalité 63
C. UN DROIT FROID SANS RÉELLE PORTÉE POLITIQUE ET SYMBOLIQUE 65
1. La genèse du droit de la nationalité 65
a) Une branche du droit privé de l’Ancien Régime à 1927 66
b) Une branche du droit public de 1927 à 1993 72
c) Le retour au droit privé depuis 1993 73
d) Les grands principes du droit de la nationalité en 2011 75
2. La naturalisation : des procédures tendant parfois à ravaler l’acquisition de la nationalité au rang de formalité administrative 79
3. La déchéance de la nationalité : une attribution régalienne bientôt résiduelle ? 84
II. POUR UNE NATIONALITÉ DOTÉE D’UN SUPPLÉMENT D’ÂME 92
A. FAVORISER UNE ADHÉSION MIEUX ASSUMÉE 92
1. L’automaticité du droit du sol : une règle dont l’application est parfois problématique 92
a) Les problèmes mahorais et guyanais 93
b) Les incertitudes constitutionnelles planant sur la solution d’un régime dérogatoire 97
c) Une réponse possible à travers un droit de la nationalité plus volontariste 102
2. La prestation de serment : un geste peu conforme à la culture nationale 109
3. Exiger de tous les Français une manifestation de volonté à leur majorité 112
a) Le principe 112
b) Les modalités 114
4. Valoriser l’expérience du service civique 119
a) Préserver le caractère volontaire, et non obligatoire, du service civique 120
b) Accroître le nombre des missions financées dans le cadre du service civique 121
c) Prendre en compte le service accompli lors de l’examen d’une demande de naturalisation 124
d) Soutenir le projet de création d’un Institut du service civique 125
e) Intégrer les engagés du service civique au défilé du 14 juillet 125
B. VALORISER L’ENTRÉE DANS LA NATIONALITÉ 126
1. Faire évoluer les règles d’acquisition de la nationalité pour les réfugiés 126
2. Étendre et donner toute la solennité qu’il convient aux cérémonies d’accueil dans la nationalité française 130
3. Instituer un examen de naturalisation en renforçant les exigences de maîtrise de la langue française 132
a) Les actuelles insuffisances de l’évaluation de l’assimilation linguistique et culturelle 132
b) Les modèles étrangers 133
C. CHOISIR OU DÉCLARER UNE ALLÉGEANCE 141
1. Promouvoir la notion de nationalité effective en imposant une obligation de choix 141
a) La « nationalité effective » en droit international 141
b) Le modèle allemand 143
c) La déclinaison possible en France 145
2. Conforter l’obligation de déclarer les appartenances nationales multiples 148
3. Encourager l’adoption d’une convention internationale régissant les appartenances nationales multiples 150
a) Le modèle de la Convention de La Haye du 12 avril 1930 150
b) Les conventions onusiennes de 1954 et de 1961 151
c) Les conventions du Conseil de l’Europe de 1963 et de 1997 154
d) La nécessité d’une convention-cadre onusienne régissant les appartenances nationales multiples 157
CONCLUSION 159
EXAMEN DU RAPPORT EN COMMISSION 161
SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS 165
CONTRIBUTION DU GROUPE SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE 169
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LA MISSION D’INFORMATION 175
ANNEXE N° 1 LA PROCÉDURE DE NATURALISATION DEPUIS LE 1ER JUILLET 2010 179
ANNEXE N° 2 LE DOSSIER DE NATURALISATION 180
On s’étonnera probablement de l’objet de ce rapport. Il est vrai qu’à première vue, le droit de la nationalité en France ne constitue pas en soi un sujet dont le grand public s’empare spontanément.
Ainsi, depuis près de trente ans et le rapport fameux de M. Marceau Long (3), disserter sur les liens juridiques et politiques qui rattachent une personne (physique ou morale) à un État passe pour un exercice académique, un objet de curiosité savante laissée à la réflexion éclairée des juristes.
Il s’agit d’une erreur profonde car par-delà la complexité des procédures, l’enchevêtrement des règles et l’hermétisme des notions, la nationalité touche à des enjeux fondamentaux, tant pour la collectivité que pour ses membres. Il en va en effet du vivre ensemble, de la capacité de notre pays d’honorer une longue tradition d’accueil. La société française s’ouvre au monde. Chaque année, quelque 200 000 étrangers entrent sur le territoire national. Près de 65 000 personnes obtiennent la nationalité française au terme de la procédure de naturalisation.
Or, comme en bien d’autres domaines, la mondialisation renouvelle profondément les termes de cette problématique, et ce même de manière imperceptible pour le plus grand nombre. Dans une matière autrefois apanage exclusif des États, s’imposent en effet des règles nouvelles, établies par les instruments ou les juridictions de droit international ; des conflits de lois éclatent à mesure que les individus multiplient les attaches et que se complexifie la hiérarchie des normes ; des repères tombent ou se brouillent et des malaises identitaires s’expriment dont, en 2001, le match amical de football entre la France et l’Algérie a pu montrer l’acuité.
C’est sur la base de ce constat que des membres de la majorité et de l’opposition ont souhaité prendre date et, par-delà la divergence des convictions et des sensibilités personnelles, engager une nouvelle réflexion sur ce pourquoi, au XXIe siècle, on est et on devient Français.
On l’ignore souvent mais le droit de la nationalité est un droit relativement récent par rapport à notre longue histoire et, en tant que tel, il ne saurait être sacralisé. Il doit, de notre point de vue, refléter ce lien particulier qui doit unir la collectivité incarnée par l’État et l’individu : le sentiment d’appartenance nationale.
Dans cette optique, nous avons examiné l’ensemble des modes d’acquisition de la nationalité française. Cette analyse nous a conduits à un diagnostic partagé quant au relâchement des liens entre la communauté nationale et les individus qui la composent. Il en découle 19 propositions qui, pour n’avoir pas recueilli l’assentiment de tous, n’en montrent pas moins l’ampleur des défis que nous devrons un jour ou l’autre relever s’agissant de l’enseignement de l’histoire, des modalités de naturalisation, et du phénomène de la plurinationalité. Ces propositions constituent des pistes de réflexion pour l’avenir. Mais le rôle d’une mission d’information est de faire réfléchir sur un sujet délaissé. La mondialisation conduira à une modification de l’ensemble des droits nationaux. Il ne s’agit pas d’une simple réflexion politique mais aussi juridique avec l’importante croissance des conflits positifs ou négatifs de nationalité qui se multiplient tant dans le domaine du droit civil que dans celui des affaires.
Certes, les sentiments ne se commandent pas, a fortiori celui de l’appartenance nationale, mais ils s’entretiennent. Que ce soit sous l’Ancien régime ou après la Révolution française – Alexis de Tocqueville l’a montré en des termes définitifs –, avant que d’être enseignée sur le tableau noir des écoles de la IIIe République, l’idée de l’unité française a logé dans la tête de quelques hommes d’État éclairés. Pour que le sentiment d’appartenance nationale naisse et s’exprime, il nous faut aujourd’hui renouer avec un récit national volontariste mais également réaffirmer nos valeurs républicaines, mieux partager notre langue.
Ces problèmes – nous en avons tous conscience – dépassent sans doute le strict cadre du droit de la nationalité et ne trouveront pas de solutions immédiates. Mais nous voulons croire qu’il n’est « point besoin d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer ». À chaque époque de notre histoire nationale, on a vu des hommes jeter les bases d’une nouvelle alliance. C’est pour les temps à venir qu’il nous appartient aujourd’hui de prendre cette responsabilité. La jurisprudence internationale, qui ira en s’accroissant, doit souvent recourir au concept de nationalité effective ou efficiente, et témoigne des difficultés d’analyse que pose une société où les relations entre les hommes sont rapides et multiples.
I. UNE NATIONALITÉ VIDÉE DE SA SUBSTANCE DANS UN CONTEXTE MONDIALISÉ
Le droit de la nationalité tend aujourd’hui à devenir un droit « froid ». La promotion de la citoyenneté a conduit à parer cette dernière de la quasi-totalité des attributs de la nationalité qui, n’étant plus le passage obligé pour la jouissance de nombreux droits, a perdu tout contenu propre. Sans chair, le droit de la nationalité est également sans âme, ayant cessé d’être irrigué par la conception française de la nation qui elle-même s’épuise dans ce qui semble être les dernières pages du « roman national ».
A. UN « ROMAN NATIONAL » À BOUT DE SOUFFLE
Il y a près d’un quart de siècle, M. Marceau Long, président de la Commission de la nationalité, ouvrait ainsi son rapport au Premier ministre :
« État-nation par excellence, la France, héritière de la centralisation politique et culturelle constituée par la monarchie et renforcée par la légitimité révolutionnaire et la tradition jacobine, imposait que l’unité nationale fût doublée de l’unité culturelle, manifestée par l’emploi d’une même langue et la référence à une même histoire. Tout particularisme, breton, occitan, italien ou juif, apparaissait comme une menace pour l’unité nationale. L’école de la IIIe République eut pour charge et pour effet de transformer les petits Bretons, Corses, Provençaux, les fils de mineurs italiens ou polonais, les enfants du prolétariat juif d’Europe centrale, en citoyens de la République, parlant la même langue et partageant les mêmes valeurs culturelles et patriotiques » (4).
Apparu au XVIIIe siècle, construit à la Révolution française, et étoffé sous la IIIe République le concept de nation a connu une longue et riche histoire qui semble aujourd’hui arrivée à sa fin, tant le « pessimisme national » assène l’idée que la nation n’est plus apte à jouer le rôle de « creuset » qui fut le sien.
1. La nation : histoire d’un concept
a) L’apparition du concept de nation sous l’Ancien Régime
Le concept de nation n’est apparu en France que très tardivement, à la fin de l’Ancien Régime. Le mot « nation » semble devenir usuel, dans sa signification actuelle, à partir du début du XVIIIe siècle : ainsi, l’édit de juillet 1717 sur les princes légitimés énonce qu’en cas de rupture de la lignée légitime des rois, ce serait « à la nation même » de désigner le nouveau roi. Le concept de « nation » émerge ainsi à la faveur de l’absolutisme, dans un régime monarchique où la distinction médiévale entre le corps physique et le corps politique du roi tend à s’atténuer pour finalement disparaître complètement (5). En ce début de XVIIIe siècle, la personne du roi se confond totalement avec la fonction royale, et, par là même avec l’État et la nation, au point que Bossuet a pu dire au sujet de Louis XIV que « tout l’État est en lui » et que « la volonté de tout le peuple est renfermée dans la sienne »(6).
Sous l’Ancien Régime, la nation entretient donc une relation fusionnelle avec le roi. Le concept de nation n’a alors que peu en commun avec l’abstraction désincarnée que l’on connaît aujourd’hui : il s’incorpore tout entier dans la personne du monarque. Comme le note le professeur Élisabeth Zoller, « à la différence de la monarchie anglaise qui, dès les origines, travailla à séparer entre le roi, corps charnel, et le « roi en son Parlement », corps politique, la monarchie française est toujours restée fidèle à une relation fusionnelle entre le roi et la nation. Il n’y a jamais eu en France d’un côté le roi, et de l’autre la nation […] Lorsqu’à partir de 1615, les États généraux ne se réuniront plus, la nation n’aura plus d’expression institutionnelle si ce n’est la personne royale. […] Le roi faisait corps avec la nation qui faisait corps avec le roi, les deux étant indissolublement unis dans l’État »(7). C’est ce qui fit dire à Louis XV, lors de la fameuse séance de la Flagellation du 3 mars 1766, que « les droits et les intérêts de la nation, dont on ose faire un corps séparé du monarque, sont nécessairement unis dans mes mains et ne reposent qu’en mes mains ».
Si l’absolutisme a contribué à forger l’unité de la nation en l’incarnant dans une personne et dans une volonté uniques, il n’en reste pas moins que la Révolution française a profondément transformé le concept de nation en rompant avec l’idée qu’il puisse être incarné dans une personne ou dans un groupe de personnes.
b) La définition et l’affirmation du concept de nation avec la Révolution française
La Révolution française a rompu avec l’idée que la nation puisse être incarnée par un corps physique ou social. L’article 3 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 énonce que « le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément ». Autrement dit, on ne conçoit plus que la nation puisse tout entière résider dans une assemblée ou dans la personne d’un chef d’État, qui ne peuvent tout au plus que la « représenter ». Pour reprendre la formule du professeur Élisabeth Zoller, « la nation n’est pas le peuple réel dans toute sa diversité, mais le peuple pensé dans ce qui fait son unité »(8).
La nation devient dès lors une construction intellectuelle, une abstraction portant en elle l’intérêt général qui, à la différence du sens qui lui est donné dans les pays de culture anglo-saxonne, ne se confond pas avec la somme des intérêts particuliers. Non sans lien avec les thèses développées par Jean-Jacques Rousseau dans son ouvrage Du contrat social, l’intérêt général est pensé en France comme étant d’une autre nature que les intérêts particuliers : il n’en est pas le simple agrégat. Alors que le peuple forme l’accumulation et la juxtaposition de ces intérêts particuliers, la nation est le corps presque mystique dans lequel sont investies la définition de l’intérêt général et l’expression de la volonté générale.
C’est du moins ce qui ressort des propos de l’abbé Sieyès, qui, en 1788, dans son fameux ouvrage Qu’est-ce que le Tiers État ?, écrivait que « lorsque l’égoïsme paraît gouverner toutes les âmes, il faut que […] l’assemblée d’une nation soit tellement constituée que les intérêts particuliers y restent isolés »(9). La nation représente donc un intérêt d’une tout autre essence que les intérêts particuliers de chacun des trois ordres (noblesse, clergé et Tiers État) qui forment le peuple. Et c’est bien dans cet esprit que se forma l’Assemblée nationale.
En effet, le 17 juin 1789, des représentants des trois ordres – pour l’essentiel des députés du Tiers État, qui furent rejoints toutefois par quelques membres du clergé et qui invitèrent des nobles à s’associer à eux – refusèrent de siéger séparément comme le leur imposait la configuration des États généraux. Ils se réunirent en une assemblée unique en faisant abstraction de leurs origines sociales, de leurs appartenances locales et de leurs intérêts particuliers. Ils choisirent la dénomination d’Assemblée nationale, soulignant que cette dénomination était la seule qui convenait et que la représentation était « une et indivisible ».
Cette Assemblée était « nationale » parce que, composée de nobles, de prêtres et de députés du Tiers État, elle était investie de la définition et de la défense d’un intérêt qui transcendait les intérêts particuliers des trois ordres. En d’autres termes, la nation avait cessé de se matérialiser dans la personne du roi, pour devenir un concept désincarné correspondant au dénominateur commun des intérêts des Français, et susceptible d’être porté par des représentants qui ne se confondent pas pour autant avec lui.
Devenue une abstraction, la nation n’est plus un corps charnel et elle n’est pas non plus absorbée par le corps social ou politique de ses représentants. La nation n’étant plus une réalité matérielle, la représentation nationale ne résume pas non plus à un groupe de personnes ou à un bâtiment. C’est la raison pour laquelle, lorsque le roi refuse à l’Assemblée nationale l’accès à la salle de séance des États généraux le 20 juin 1789, les membres de cette Assemblée prêtent, dans la salle du Jeu de paume, le célèbre serment du même nom, dans lequel ils jurent « de ne jamais se séparer, et de se rassembler partout où les circonstances l’exigeront », parce que « partout où ses membres sont réunis, là est l’Assemblée nationale ».
Dans la conception française de la nation, de la représentation et de la souveraineté nationales, le député est élu dans une circonscription mais il n’est pas l’élu de sa circonscription. Comme l’écrit le professeur Élisabeth Zoller, « le député français est l’élu de la nation ; il représente non ses électeurs, non sa circonscription, mais la nation tout entière ; […] il représente toujours un intérêt national, et donc général, et non un (ou des) intérêt(s) particulier(s) »(10).
Le concept de nation n’a acquis l’abstraction qu’on lui connaît aujourd’hui que très tardivement, avec la Révolution française. C’est seulement au tournant des XVIIIe et XIXe siècles qu’il devient une construction intellectuelle à laquelle la définition de l’intérêt général et l’expression de la volonté générale donnent un contenu abstrait. La nation étant ainsi conçue, en faire partie suppose qu’on y adhère par un acte manifestant la volonté de reconnaître dans l’intérêt général le dénominateur commun de ses propres intérêts et de ceux des autres, quitte, s’il le faut, à sacrifier certains de ses intérêts propres si l’intérêt général le requiert. Faire partie de la nation exige de vouloir ce que veut la volonté générale indépendamment de ses volontés individuelles. En somme, l’appartenance à la nation devient indissociable d’une manifestation de volonté et de l’adhésion à une idée.
c) La théorisation du concept de nation
Si le concept de nation s’est doté du contenu qu’on lui connaît aujourd’hui pendant la période révolutionnaire, il n’a été théorisé qu’à la fin du XIXe siècle, par l’écrivain, philosophe et philologue Ernest Renan, à l’occasion de son fameux discours en Sorbonne du 11 mars 1882, sur le thème Qu’est-ce qu’une nation ?(11).
Dans cette célèbre conférence, Ernest Renan a défini la nation comme étant « une âme, un principe spirituel », ajoutant que « deux choses constituent cette âme : […] la possession en commun d’un riche legs de souvenirs […et] la volonté de continuer à faire valoir l’héritage qu’on a reçu indivis »(12). On retrouve dans cette définition la dimension volontaire dont s’est teinté le concept de nation en devenant une abstraction avec la Révolution française. La nation est non seulement un héritage mais aussi la volonté d’entretenir et de perpétuer cet héritage. La nation est une idée qui suppose qu’on y adhère et qu’on manifeste cette adhésion au jour le jour par des « rituels ». La nation ne saurait se satisfaire d’un consentement originel, d’une histoire et d’une définition figée de l’intérêt général : elle exige au contraire un consentement renouvelé, une vision partagée de l’avenir et une définition évolutive de l’intérêt général. C’est en ce sens qu’Ernest Renan dit, à l’occasion de cette même conférence, que « l’existence d’une nation est un plébiscite de tous les jours »(13).
Formulée onze ans après l’annexion de l’Alsace et de la Lorraine par l’Empire allemand, la définition de la nation proposée par Renan s’inscrit dans un contexte de tensions avec l’Allemagne, concrétisées entre autres par un débat d’idées opposant deux conceptions de la nation. Dans la conception allemande, la nation est moins une idée à laquelle on adhère, des valeurs que l’on partage, un intérêt général auquel on consent, qu’une communauté de langue. Appartiennent à la nation tous ceux qui sont animés par « l’esprit du peuple » (Volksgeist), sorte de force supérieure, mystique, voire métaphysique, se manifestant dans la langue allemande. Ancrée dans les travaux du poète et philosophe Johann Gottfried von Herder, cette conception organique tend à incarner la nation dans un corps linguistique composé de tous ceux qui parlent la même langue. C’est en contrepoint de cette conception linguistique de la nation que s’est construite la conception française que l’on peut qualifier d’« idéologique » au sens où elle est avant tout un socle d’idées et de valeurs partagées.
Adhérer à la nation ne signifie pas pour autant faire preuve de nationalisme. Le nationalisme a été défini par l’historien Ernest Gellner comme « un principe qui exige que l’unité politique et l’unité nationale se recouvrent »(14). Signalé en 1874 comme un néologisme par le dictionnaire Le Petit Larousse, le nationalisme y est défini comme visant à « exalter la défense et la grandeur de la nation ». Le mot « nationalisme » est ainsi apparu en France à la fin du XIXe siècle, à une époque où la France était soucieuse de redevenir un État-nation en réalisant à nouveau l’adéquation entre la structure étatique et le périmètre de la nation, adéquation qu’avait mise à mal la perte de l’Alsace et de la Lorraine en 1871. Animé d’un esprit de revanche caractéristique du nationalisme d’exclusion, le pays l’était aussi d’un esprit de conquête, propre au nationalisme d’expansion qui a présidé à la constitution de l’empire colonial.
Si Maurice Barrès employa le terme de « nationalisme » dans un article publié dans le journal Le Figaro en 1892, les thèses que le député boulangiste développa dans ses divers ouvrages reposent sur une conception dévoyée de la nation assimilée à la patrie. Alors que la nation est une construction intellectuelle attribuant à un corps mystico-politique la définition de l’intérêt général et l’expression de la volonté générale, la patrie est une notion matérielle désignant l’environnement, et plus précisément le territoire où l’individu naît, vit et meurt et où ses ancêtres ont vécu et sont enterrés (en allemand : Heimat ou Vaterland, pays des pères).
Alors que la nation relève du registre politique, la patrie relève du registre guerrier. Ainsi, lorsqu’en 1792, le territoire français est menacé par les armées autrichiennes et prussiennes, on parle de « patrie » en danger, et non de nation. Hanté par la perte de l’Alsace et de la Lorraine, et habité par l’esprit de revanche sur l’Empire allemand, Maurice Barrès exalta ainsi dans Le système nerveux central, « le culte des morts et de la terre où ils ont vécu et souffert, de la religion et de la patrie »(15). Et c’est bien à la patrie, plus qu’à la nation au sens strict, qu’il pense quand, dans sa trilogie intitulée Le Roman de l’énergie nationale, il célébra l’attachement aux racines (16), et quand, dans le célèbre discours « La Terre et les Morts », prononcé le 10 mars 1889 devant la Ligue de la patrie française, il appela à « restituer à la France une unité morale, [et à] créer ce qui nous manque depuis la Révolution : une conscience nationale ».
Comme en témoignent le développement d’un nationalisme exacerbé au tournant des XIXe et XXe siècles, et la confusion qui, concomitamment, enveloppe progressivement son concept, le concept de nation a connu une évolution dans les premières décennies de la IIIe République. Alors que la nation en tant que concept était dévoyée et assimilée à la patrie, au patriotisme et au nationalisme, et alors que la nation en tant que construction politique fondée sur la représentation était malmenée à travers l’antiparlementarisme galopant, paradoxalement, la nation n’a jamais autant été célébrée à travers le « roman national » inculqué aux jeunes Français pour lesquels, depuis le début des années 1880, l’enseignement primaire était obligatoire, et notamment à travers les manuels de Paul Vidal de La Blache ou d’Ernest Lavisse, qui nourrissaient l’imagination des enfants des légendes de Charlemagne, de Jeanne d’Arc ou d’Henri IV (17). De construction intellectuelle liée à la définition de l’intérêt général, à l’expression de la volonté générale, et au tracé du présent et de l’avenir d’un corps politique qu’elle était depuis 1789, la nation est devenue en cette fin de XIXe siècle synonyme de mémoire, d’histoire et d’héritage dans une optique de légitimation du régime républicain.
Si la nation a été mise en exergue après la défaite de 1870, c’est en effet non seulement dans un souci de revanche militaire, mais aussi d’affirmation d’un régime républicain balbutiant qui, menacé tour à tour par les tentations monarchistes, boulangistes et antiparlementaristes, a eu besoin de renouer avec la conception révolutionnaire de la nation en l’ancrant dans les symboles. C’est en 1879 que la toute jeune IIIe République, née dans la douleur et presque par hasard en 1875, se dote d’un hymne national (La Marseillaise). En 1880 est votée la loi faisant du 14 juillet la fête nationale annuelle commémorant la fête de la Fédération du 14 juillet 1790, où les Français, par-delà les différences liées à leurs origines sociales et géographiques, par-delà les ordres auxquels ils avaient appartenu sous l’Ancien Régime, avaient communié autour d’un roi qui avait alors prêté serment à la « nation » et à la loi. Au début des années 1880, la devise « Liberté, Égalité, Fraternité » est adoptée comme symbole officiel de la République et orne les frontons des institutions publiques. Dans le même temps, les statues et les bustes de Marianne fleurissent sur les places et dans les mairies. Tout était fait pour montrer qu’après près d’un siècle de changements de régimes, « la Révolution entr[ait] au port », pour reprendre l’expression de l’historien François Furet(18). Ce faisant, la dimension prospective qu’avait la nation en 1789 s’effaçait devant l’entreprise rétrospective du régime républicain qui a conduit à rattacher la nation au passé et à en faire un héritage.
Le « roman national », dont l’écriture commença aux débuts de la IIIe République, est indissociable de l’affirmation d’un régime républicain qu’il était nécessaire de relier au concept de nation forgé pendant la Révolution française pour lui donner force et légitimité. Et tout au long de la IIIe République, on n’aura de cesse d’étoffer ce roman et d’en poursuivre l’écriture en intégrant peu à peu le legs de l’Ancien Régime. La nation républicaine s’est progressivement présentée comme la synthèse, le « compromis » entre la nation révolutionnaire et la nation monarchique.
Lors de son audition, l’historienne Anne-Marie Thiesse a montré aux membres de la mission d’information comment la IIIe République s’était efforcée d’intégrer dans le « roman national » les plus farouches opposants à la Révolution : la noblesse, le clergé réfractaire, mais aussi les « pays » de l’Ancien Régime, qui, correspondant en quelque sorte à nos actuelles « régions », étaient riches de cultures, de langues et de coutumes qui avaient renâclé à se fondre dans une République unitaire, jacobine et centralisatrice. Au tournant des XIXe et XXe siècles, le régionalisme fut pourtant toléré voire encouragé avec l’idée que « l’amour de la petite patrie était le fondement de la grande patrie »(19). Il s’agissait de faire émerger un « esprit » ou un « génie » national en adossant la nation à un passé assumé et pacifié pour mieux parvenir à constituer la nation en « communauté politique imaginée » (20) et soudée autour d’un régime républicain accepté de tous.
L’historien Pierre Nora, dans l’ouvrage collectif Les Lieux de mémoire, qu’il a dirigé de 1984 à 1992, retrace la genèse de ce « roman national » en décrivant les monuments, les écrits voire les événements qui ont échappé à l’oubli grâce à l’affect et aux émotions que la collectivité y a investis, que ce soit le Palais Bourbon, L’Histoire de France d’Ernest Lavisse ou les funérailles de Victor Hugo(21). Des monuments aux morts à La Marseillaise, il s’agit d’objets plus ou moins abstraits qui ont jalonné la construction de la nation et du sentiment d’appartenance nationale.
Avec l’écriture du « roman national » apparaît l’idée qu’on puisse « se sentir » Français et en tirer une fierté. À l’inverse, celui qui ne vibre pas à la lecture du « roman national » peut apparaître comme n’appartenant pas à la nation. C’est ainsi que l’historien Marc Bloch écrivit en 1940, dans L’Étrange défaite, qu’il y a « deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l’histoire de France : ceux qui refusent de vibrer au souvenir de Reims, et ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération »(22). À compter de la IIIe République, faire partie de la nation française, c’est non seulement consentir à ce que ses intérêts particuliers soient sacrifiés au nom de l’intérêt général et soumettre sa volonté individuelle à la volonté générale, mais aussi tenir en affection une histoire commune, empruntant à la fois à la Révolution et à l’Ancien Régime.
Selon l’historien Pierre Nora, la nation revêtait sous la IIIe République une triple dimension : juridique, en tant que pouvoir constituant ; sociale, en tant que collectivité d’individus égaux devant la loi ; et historique, en tant que collectivité d’individus réunis par un sentiment d’appartenance reposant sur un patrimoine culturel et sur une forme de solidarité dans le présent et pour l’avenir(23). Selon ce même historien, la IIIe République a construit un modèle de nation caractérisé par sa capacité de synthèse entre l’héritage de la Révolution et celui de l’Ancien Régime. L’école a été le véhicule du concept de nation ainsi entendu. Pour lui, « vous pouviez être aristocrate descendant de nobles guillotinés, fils de Polonais de la première génération, petit-fils de communard fusillé, à partir du moment où vous étiez à l’école, vous étiez un petit Français comme les autres »(24).
Mais ce modèle républicain de la nation a vécu, selon M. Pierre Nora. La grandeur de la nation chantée par le « roman national » a été ébranlée au cours du XXe siècle par trois « défaites masquées ». La victoire de 1918 n’a en effet été que l’aboutissement d’un suicide collectif au niveau européen. La victoire de 1945 n’a été arrachée, in extremis, que par l’action du général de Gaulle. Et la décolonisation s’est soldée par la défaite de la France à Diên Biên Phu en 1954 et par le retrait d’Algérie en 1962. Depuis, la France n’a pas connu de conflit majeur sur son territoire métropolitain, au point que, selon M. Pierre Nora, la nation française, dont l’affirmation s’est nourrie des conflits et des menaces militaires, est, pour ainsi dire, « en péril de paix »(25). À l’aube du XXIe siècle, le concept de nation semble menacé par une « sortie de l’Histoire ».
d) La crise du concept de nation
Le concept de nation, tel qu’apparu pendant la Révolution française et étoffé sous la IIIe République, est aujourd’hui en crise, confronté qu’il est, selon M. Pierre Nora, à des mouvements en sens contraires qui l’exposent à un risque d’éclatement : par le haut, du fait de l’intégration difficile et incertaine au sein de l’Europe, et par le bas, du fait d’une décentralisation valorisant notamment les régions. Tiraillé à la verticale par ces pressions en sens contraires, le concept de nation est miné à l’horizontale par des idéologies transnationales (jadis le communisme, et aujourd’hui l’écologie), par la mondialisation, par l’individualisme et par le communautarisme.
Dans un entretien accordé le 17 mars 2007 au journal Le Monde, M. Pierre Nora identifiait, parmi les facteurs de crise du concept de nation, « la réduction de la puissance de la France depuis la fin de l’empire colonial », « l’altération des paramètres de la souveraineté : territoire, frontières, service militaire, monnaie avec la disparition du franc », la désagrégation des formes d’autorité qu’ont été les familles, les Églises et les partis, l’urbanisation du territoire et de la population, et l’arrivée d’une nouvelle immigration, « plus difficile à soumettre aux normes des lois et coutumes françaises »(26).
Selon lui, tout en prétendant s’affirmer au détriment de la nation, des communautés et minorités – régionales, religieuses, sexuelles – exigent paradoxalement d’elle une forme de reconnaissance. Ainsi en est-il des régionalismes qui sont parvenus à faire inscrire dans la Constitution, à l’article 75-1, que « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France », alors même que l’article 2 de la même Constitution dispose que « la langue de la République est le français ». Remettant en cause l’un des fondements de la nation, à savoir la langue française, les régionalismes ont néanmoins acquis une reconnaissance dans la loi fondamentale que s’est donnée la nation.
C’est le même besoin d’affirmation à la fois contre et à travers la nation qui a présidé aux votes des lois mémorielles non normatives du 29 janvier 2001 (loi n° 2001-70 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915), du 21 mai 2011 (loi n° 2001-434 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité) et du 23 février 2005 (loi n° 2005-158 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés).
Suivant M. Patrick Weil, on peut dire que certaines de ces lois mémorielles sont l’expression d’un phénomène de « désidentification », au sens où la nation s’est morcelée en perpétuant notamment la mémoire de discriminations existant autrefois au détriment de certaines catégories de Français dans le droit de la nationalité. Selon lui, les Juifs, dénaturalisés ou déchus de leur nationalité entre 1940 et 1944, auraient vécu le discours prononcé par le général de Gaulle le 27 novembre 1967 comme l’expression d’un rejet de la part du « père de la nation »(27). Et les musulmans d’Algérie, relégués à l’époque coloniale dans une nationalité mineure leur imposant des démarches administratives pour bénéficier des droits attachés à la nationalité française alors même qu’ils étaient ressortissants français, auraient vécu la réforme du droit de la nationalité de 1993 comme une réactivation douloureuse du statut colonial (28). Disloquée, la mémoire nationale a ainsi laissé le champ libre à des mémoires de groupe qui lui ont fait concurrence au point de l’entamer et de l’oblitérer.
L’attitude ambivalente des communautés et minorités à l’égard de la nation est le signe que si les Français ne sont plus prêts à mourir pour la nation, ils l’adorent néanmoins. Mais il ne s’agit plus tout à fait du même concept de nation ni du même sentiment d’appartenance nationale. Selon M. Pierre Nora, il existe ici un sentiment d’attachement que l’on peut presque qualifier d’amoureux et qui relève plutôt du sentimentalisme. Ce sentiment d’appartenance nationale ainsi métamorphosé s’investit plus dans les joutes sportives ou dans un certain « bonheur français » fait de paysages, de traditions et d’autres richesses du patrimoine culturel, que dans des combats militaires ou dans la définition de l’intérêt général. Pour reprendre la formule de M. Pierre Nora, « il n’y a plus de roman national, mais une romance nationale »(29).
Le concept de nation tel qu’hérité de la Révolution française et le « roman national » tel qu’écrit sous la IIIe République arrivant « à bout de souffle », de deux choses l’une : soit on donne un nouveau souffle au « roman national », soit on rompt avec le projet même d’écrire un « roman national ».
L’historien Pierre Nora s’est montré favorable à la seconde branche de l’alternative(30). Selon lui, la nation telle que définie par Ernest Renan appartient au passé et on ne l’invoque aujourd’hui que parce qu’elle est morte. « Cette nation conçue par Ernest Renan suppose une coalescence du passé et de l’avenir et un sens de la communauté historique qui est mort », a-t-il affirmé devant la mission, avant d’ajouter que si « le contrat tel que conçu par Ernest Renan est mort, il faut réinventer un contrat »(31). L’idée d’une nation « démocratique » est « à l’ordre du jour »(32).
À rebours, M. Pierre Henry, directeur général de l’association « France terre d’asile », a appelé à donner au « roman national » un souffle positif, non pas au sens où ne seraient retenues de l’histoire de la nation française que ses pages glorieuses mais au sens où le concept de nation retrouverait le caractère prospectif et tout entier tourné vers l’avenir qui était le sien initialement(33). Selon M. Pierre Henry, la France a besoin d’un récit national républicain et volontariste, non pas figé dans la nostalgie, mais offensif et positif. Il s’agirait de sortir d’une forme de pessimisme historique.
Dans la même veine, l’historien et essayiste Tzvetan Todorov a dénoncé en 1995 les « abus de la mémoire », fustigeant la « maniaquerie commémorative » et l’obsession du culte de la mémoire dont les Européens, et tout particulièrement les Français, font montre à la faveur du besoin d’identité collective que fait naître la mondialisation. Selon lui, le « devoir de mémoire », la victimisation de certains groupes et les innombrables journées de commémoration ne seraient que des subterfuges pour nous détourner des défis du présent et de l’avenir, tout en nous procurant les bénéfices de la bonne conscience.
On peut aussi estimer, comme certains membres de la mission, que la crise du concept de nation trouverait son origine dans la crise d’un système éducatif qui, parce qu’il s’est massifié, n’a pas été capable de recréer un tronc commun de notre identité nationale. Dès lors, il y aurait encore place en France pour un « roman national », dans la mesure où la France connaît encore de grands moments de ferveur nationale où l’adhésion à la nation peut être redéfinie. Faire partie de la nation supposerait non plus seulement de renoncer à ses intérêts particuliers au bénéfice de l’intérêt général, ni de soumettre sa volonté individuelle à la volonté générale, mais de partager un corpus de valeurs fondant l’ordre démocratique.
Il paraît aujourd’hui nécessaire de donner un nouveau souffle au « roman national » qui, quoique grièvement mis à mal par une forme de désespérance nationale, n’est pas mort pour autant. En effet, de tout temps, au-delà de leurs différences, les hommes ont éprouvé le besoin de partager un dénominateur commun, que la Grèce antique, par exemple, a trouvé dans la mythologie et dans la « koinè »(34). À l’instar de l’historien Max Gallo(35), qui, lors d’un entretien accordé au journal Le Figaro le 25 septembre 2008, a invité à « ressaisir l’esprit du roman national » parce que « la nation n’a jamais été une donnée acquise, [qu’] elle s’est construite par étapes, au fur et à mesure de l’œuvre des rois, puis de la Révolution, de l’Empire et enfin de la République », et qu’« écrire l’histoire de cette construction nationale chaotique était un moyen de mieux la réaliser » (36), votre rapporteur pense que perpétuer le « roman national » est une façon de faire vivre la nation et de la sortir de ce que M. Xavier Lemoine, maire de Montfermeil, a qualifié devant la mission de « coma dépassé »(37).
C’est la raison pour laquelle votre rapporteur entend proposer des pistes susceptibles de mettre fin à la crise du concept de nation et de conjurer le pessimisme national.
2. Les vertiges d’une nation sans passé commun et hantée par le spectre d’une sortie de l’Histoire
Une fois encore, et en des termes ô combien éloquents, Ernest Renan, dans la conférence de 1882, montre combien l’histoire est au cœur du concept de nation : « La nation, comme l'individu, est l'aboutissant d'un long passé d'efforts, de sacrifices et de dévouements. Le culte des ancêtres est de tous le plus légitime ; les ancêtres nous ont faits ce que nous sommes. Un passé héroïque, des grands hommes, de la gloire (j'entends de la véritable), voilà le capital social sur lequel on assied une idée nationale. Avoir des gloires communes dans le passé, une volonté commune dans le présent ; avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore, voilà les conditions essentielles pour être un peuple. On aime en proportion des sacrifices qu'on a consentis, des maux qu'on a soufferts. On aime la maison qu'on a bâtie et qu'on transmet. Le chant spartiate : « Nous sommes ce que vous fûtes ; nous serons ce que vous êtes » est dans sa simplicité l'hymne abrégé de toute patrie ».
On ne saurait mieux exprimer l’importance d’un imaginaire commun parmi les fondements de la communauté nationale. Or, suivant l’analyse développée par Mme Anne-Marie Thiesse, historienne et directrice de recherches au CNRS (38), la nation se présente aujourd’hui comme une communauté séculière, un principe fédérateur fondé sur l’intérêt collectif. Le sentiment national se nourrit ainsi par l’histoire et par différentes formes de commémoration.
Dans cette optique, on peut percevoir l’une des sources essentielles du malaise quasi identitaire qui, à nos yeux, prive le droit de la nationalité d’une partie de sa substance en le dissociant de l’expression du sentiment d’appartenance nationale. Il s’agit du rapport de plus en plus distancié voire même inexistant avec l’histoire de notre pays.
Or, parmi les fondements spécifiques de la communauté nationale, le partage du passé constitue un élément décisif. M. Patrick Weil, historien, directeur de recherche au CNRS – Centre d’histoire sociale du XXe siècle de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, le montre bien lorsqu’il décrit « les quatre piliers de la nationalité » (39). Outre l’attachement à l’égalité devant la loi, notion fondatrice de la nation française, la mémoire positive de la Révolution s’imposerait comme le deuxième principe unificateur de la nation. Cette valeur conditionnerait en effet sinon la propension à des mobilisations de masse, du moins la croyance, présente à gauche mais également à droite, à croire en la capacité de changer le cours de l’Histoire par l’action de ces mouvements.
Dans la problématique qui intéresse notre mission, la perspective ouverte par cette analyse incite en tout cas à prendre la mesure des conséquences qu’entraîne l’effacement d’une mémoire collective et à se demander dans quelle mesure l’enseignement de l’histoire participe, dans sa logique contemporaine, à l’expression d’un sentiment d’appartenance.
a) Une mémoire absente ou « balkanisée » manifestant une exténuation du modèle républicain de construction nationale
Pour M. Pierre Nora, l’émergence de la conscience de soi et des identités particulières signe une rupture en même temps qu’elle marque, à certains égards, la fin d’un imaginaire collectif véhiculé par le modèle républicain.
Sur le plan de l’imaginaire collectif, l’école républicaine plaçait les Français en situation de vivre selon un double registre, à la fois collectif et individuel, qui permettait à tout individu, quelles que soient ses origines et son histoire familiale, de se reconnaître dans l’Histoire de France et de se considérer dans l’espace public comme le maillon d’une continuité, « un descendant des Gaulois ». Aujourd’hui, on est passé d’une conscience de soi politique à une conscience de soi sociale, d’une conscience de soi profondément ancrée dans l’histoire à une conscience mémorielle, d’une conscience intimement nationale à une conscience patrimoniale dont procèdent, selon M. Pierre Nora, les déchirements, les conflits, les négociations caractérisant notre époque. En effet, cette évolution de la conscience collective implique l’existence d’une nation non consensuelle, au sein de laquelle existent des conflits abordés cas par cas.
Du point de vue du modèle républicain, les revendications portées par les identités sociales nouvelles ne facilitent pas l’action des mécanismes d’insertion, d’intégration ou d’assimilation et de conception de valeurs par une conscience historique de la nation. Or, leur impact se révèle d’autant plus grand que le modèle républicain subit, depuis les années 1970, une métamorphose lente, douloureuse et à ce jour inachevée qui tient au passage d’un modèle par essence étatique, centralisateur, paysan, chrétien, providentialiste et impérialiste à un type de nation démocratique. Aux yeux de M. Pierre Nora, l’exténuation du modèle républicain résulte d’abord de l’ébranlement des trois piliers sur lesquels il reposait, à savoir la capacité de synthèse historique entre l’héritage de la Révolution et le legs de l’Ancien régime, le fait que la nation française ait localisé dans la politique la question de son identité et, enfin, un universalisme à la française fondé sur la confiance absolue en la raison et qui imprégnait assez profondément l’impérialisme colonial.
La crise actuelle est d’autant plus aiguë que le sentiment national en France a été étroitement lié à la guerre et à la puissance qui, pour la première – heureusement – et la seconde – hélas – ne peuvent plus fonder un tel sentiment d’appartenance nationale en ce début de XXIe siècle.
Ceci explique aux yeux de M. Pierre Nora que l’on puisse percevoir en France, par-delà les bonheurs individuels, une forme de malheur collectif qui s’explique par un sentiment d’une « sortie de l’histoire ». Ce sentiment ne manque pas, selon lui, de retentir sur le sentiment d’appartenance collective pour les membres d’une nation habituée à compter dans les affaires du monde et à affirmer ainsi sa souveraineté.
Cet état des lieux des relations qu’entretiennent les Français avec l’histoire de leur pays ne peut qu’inciter à recommander l’affirmation d’un projet mobilisant l’ensemble des membres de la nation dans une œuvre commune. Il s’agit là d’un devoir constant et d’un objectif nécessaire pour tous les responsables politiques amenés à exercer des responsabilités dans la conduite de notre pays.
Cela étant, recréer un imaginaire collectif et transmettre le sens de la continuité de l’État et des valeurs républicaines supposent d’abord que les Français s’approprient pleinement leur passé commun. M. Tzvetan Todorov a ainsi souligné qu’il fallait sans doute moins redouter le multiculturalisme que la déculturation, autrement dit un manque de culture même élémentaire que l’on peut observer aujourd’hui dans une frange de la jeunesse française. C’est pourquoi appréhender autrement l’enseignement de l’histoire à l’école est une impérieuse nécessité.
b) Un enseignement de l’histoire trop désincarné et peu à même de recréer le tronc commun de l’appartenance nationale
Par-delà les effets de la massification des effectifs de l’enseignement secondaire et universitaire à l’œuvre depuis les années 1960, ce jugement tient au constat que l’enseignement de l’histoire peine aujourd’hui à ancrer dans l’esprit des élèves le sentiment d’une continuité nationale.
Non que l’histoire occupe une place marginale dans les programmes de l’Éducation nationale. À la suite de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école (40), le décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006 (41) a en effet défini un socle commun de connaissances et de compétences, ciment de la nation, qui accorde beaucoup d’importance aux connaissances historiques. Ainsi, la définition des éléments de culture humaniste que doivent acquérir les élèves implique, suivant ce texte, d’« avoir des repères historiques » portant sur :
– « les différentes périodes de l’histoire de l’humanité, les événements fondateurs caractéristiques permettant de les situer les unes par rapport aux autres en mettant en relation faits politiques, économiques, sociaux, culturels, religieux, scientifiques et techniques, littéraires et artistiques, ainsi que les ruptures ;
– les périodes et les dates principales, les grandes figures, les événements fondateurs de l’histoire de France, en les reliant à l’histoire du continent européen et du monde ».
Le socle commun des connaissances inclut également « des éléments de culture politique : les grandes formes d’organisation politique, économique et sociale (notamment des grands États de l’Union européenne), la place et le rôle de l’État ». On notera que le décret du 11 juillet 2006 prévoit également que les élèves doivent assimiler et maîtriser des notions leur permettant de « se préparer à sa vie de citoyen ». En plus des connaissances essentielles, notamment de l’histoire nationale et européenne, l’élève doit ainsi connaître :
– la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
– les symboles de la République et leur signification (drapeau, devise et hymne national) ;
– les règles fondamentales de la vie démocratique (la loi, le principe de la représentation nationale, le respect du suffrage universel, le secret du vote, la décision majoritaire, etc.) ;
– des notions juridiques de base, notamment la nationalité, les grands traits de l’organisation de la France, les principales institutions de la République (pouvoirs et fonctions de l’État et des collectivités territoriales), le principe de laïcité.
Conformément à cette orientation, les programmes d’histoire et de géographie de l’école primaire, du collège (42) et du lycée contribuent à l’acquisition des grandes compétences du socle commun et visent à un approfondissement progressif de l’histoire nationale, notamment au collège et au lycée. L’école primaire aura permis, quant à elle, aux élèves d’identifier et de caractériser simplement les grandes périodes historiques.
Cependant, il convient de souligner que si l’enseignement de l’histoire de France occupe une place première parmi les programmes d’enseignement, il n’est pas certain que ceux-ci parviennent à réellement mettre en valeur son importance singulière et en fassent un élément de mémoire commune partagée.
Abstraction faite des conditions pédagogiques pratiques de la transmission de ce savoir, on notera d’une part que l’histoire nationale n’est pas nécessairement abordée en tant que récit propre (à l’exception des programmes de 1ère et de terminale). Dans l’arrêté du 15 juillet 2008 fixant les programmes d’histoire au collège, on peut ainsi lire que « si l’histoire nationale reste essentielle, elle ne constitue plus un passage obligé pour une ouverture sur l’histoire de l’Europe et du monde » (43). Les programmes incitent à la replacer dans des contextes européens et mondiaux plus globaux du fait d’une approche thématique de l’histoire et non plus centrée par principe sur un apprentissage chronologique des événements et des grandes figures de la vie du pays.
L’approche thématique ne manque pas de pertinence dans la mesure où elle permet de mettre à jour les grandes logiques structurelles qui transcendent les histoires nationales particulières. Cependant, elle a pour nécessaire contrepartie d’inciter à ne présenter l’histoire de France que comme une illustration et à procéder à des choix inévitablement réducteurs s’agissant des événements et des personnages. On remarquera par exemple que l’histoire de la IVe République ne semble pas constituer aujourd’hui, dans le programme des classes terminales des séries Littéraire et Économique et sociale, un objet d’étude particulier mais se présente d’abord sous l’angle de la reconstruction du pays au lendemain de la Seconde guerre mondiale et se réduit à une phase de transition vers la Ve République (44).
D’autre part, il convient de s’interroger sur la propension des élèves à pouvoir s’identifier et à se reconnaître dans cette histoire dès lors que son enseignement – suivant une démarche qui n’apparaît pas au demeurant illégitime au plan de la connaissance scientifique – privilégie une étude portant davantage sur le mouvement d’ensemble des sociétés que sur l’action de quelques personnages fameux, incarnation de la geste ou de la légende nationale.
Le problème de l’identification se pose également dans la mesure où les programmes n’abordent pas sans doute suffisamment certaines heures sombres du passé ou certains territoires extra-européens avec lesquels nous partageons une histoire commune. Il en va ainsi de l’étude des civilisations africaines dont l’enseignement en 5e présente un caractère relativement récent. Or, ainsi que l’a relevé Mme Anne-Marie Thiesse, historienne et directrice de recherche au CNRS (45), la question de la place accordée aux populations colonisées pose aussi problème et le désir de repentance conduit parfois à des approches historiques contestables.
Dans ces conditions, la mission préconise l’engagement d’une réflexion approfondie tendant à accentuer la dimension nationale de l’enseignement de l’histoire et à faire en sorte que la connaissance de l’histoire de France nourrisse le sentiment d’appartenance nationale. De son point de vue, cette orientation ne signifie pas nécessairement de rompre avec le legs inestimable que constituent, en terme de méthode et de connaissance scientifique, les avancées de l’École des Annales. Il s’agit de rompre avec un enseignement désincarné de l’histoire au profit d’un enseignement donnant toute la place à l’apprentissage plus systématique de la chronologie, des personnages et de leur action. Il importe tout autant de diffuser les valeurs de la République, en premier lieu, la connaissance de son hymne, et de donner à tous la possibilité de savoir et de comprendre toutes les pages, glorieuses ou sombres, du « roman national ».
Ainsi que l’a démontré M. Tzvetan Todorov (46), par-delà la pluralité des cultures, caractéristique des sociétés modernes, il apparaît indispensable de parvenir au partage d’une « culture cadre » (en allemand, Leitkultur, en anglais, mainstream culture), c’est-à-dire une culture de référence permettant la communication entre toutes les cultures présentes au sein d’une société et dont l’un des trois éléments constitutifs renvoie au partage de quelques pans de mémoire commune. Aux yeux de M. Tzvetan Todorov, il ne s’agit pas de faire en sorte que la société se complaise dans une mémoire artificiellement construite et imposée aux citoyens mais que chacun – en particulier les Français d’origine étrangère – dispose d’un bagage minimal lui permettant de vivre pleinement inséré dans la société française.
L’article 2 de notre Constitution l’affirme, « la langue de la République est le français ». Il importe donc que, quel que soit le mode d’acquisition de la nationalité française, chacun de nos concitoyens ait le français en partage et que les enseignements dispensés dans le cadre de l’Éducation nationale fassent de la maîtrise de notre langue le ciment de notre unité.
Proposition n° 1 : Rétablir une place plus large dans notre enseignement pour l’apprentissage plus chronologique de l’histoire nationale, un récit républicain volontariste intégrant les mémoires, redonnant le sens de l’appartenance à la nation et assurant la transmission des valeurs républicaines, notamment par l’enseignement plus systématique de l’hymne national.
Renforcer l’enseignement de la langue française de façon à en faire le vecteur intégrateur de la nation.
*
* *
Ces propositions paraissent susceptibles de sortir le « roman national » du bourbier de pessimisme dans lequel il s’est enlisé. Il s’agit d’éviter à la conception française de la nation d’abdiquer ses ambitions comme a pu le faire la conception allemande de la nation.
La conception allemande de la nation, elle aussi en crise, a fait des concessions de taille, et renoncé notamment à l’assimilation des immigrés. Lors des entretiens que la mission a eu à l’occasion de son déplacement à Berlin, il a été expliqué d’une part, que la conception allemande de la nation, dont l’émergence avait été plus compliquée ne reposait plus comme au XVIIIe siècle sur la langue et sur l’ethnie, et, d’autre part, que les autorités allemandes avaient abandonné toute prétention à réaliser l’assimilation des communautés au sein de la nation pour se replier sur la construction d’une société où elles trouveraient dans l’espace public la place suffisante pour exprimer leurs spécificités culturelles (47).
Si, pour reprendre l’expression du ministre de l’Intérieur du Land de Berlin, M. Ehrhart Körting, l’Allemagne s’efforce de passer d’un « roman d’exilés » à un « roman d’immigrés »(48), c’est au prix de sa conception de la nation et de l’ambition de faire de la nation un creuset intégrateur et fédérateur.
Selon lui, la nation en Allemagne ne se définit plus seulement comme une communauté de langue, mais aussi comme une proximité de résidence sur un même territoire. Les parlementaires allemands rencontrés à Berlin ont assuré qu’ayant renoncé à toute volonté d’être une grande nation, l’Allemagne ne s’interrogeait plus aujourd’hui sur le concept de nation qu’elle avait définie dans la Loi fondamentale de 1949 comme une communauté partageant une langue et des valeurs démocratiques. « Être allemand, c’est avant tout être fier de la Loi fondamentale », a assuré le député socialiste Dieter Wiefelspütz(49).
Selon M. Ehrhart Körting, la nation allemande s’est ouverte, non sans difficultés, à de nouveaux venus n’ayant pas de sang allemand et ne parlant pas l’allemand. À la différence de la France, où bon nombre d’immigrés viennent de pays où l’on parle français (Algérie, Maroc, Tunisie…), l’Allemagne a vu arriver sur son sol des migrants originaires de Turquie, du Proche-Orient ou de pays de l’ex-URSS où l’on ne parle pas l’allemand. Selon M. Ehrart Körting, seuls sont vraiment assimilés les étrangers très minoritaires, comme les Chinois ou les Palestiniens qui, à la différence des Turcs, ne sont pas en nombre suffisant pour former des communautés vivant en autarcie dans des quartiers où l’on n’a plus besoin de parler l’allemand (50).
L’évolution de la conception allemande de la nation s’est donc faite au détriment d’une ambition fédératrice et au profit d’une communion dans un socle de valeurs démocratiques définies par la Loi fondamentale de 1949. L’Allemagne se serait ainsi convertie au « patriotisme constitutionnel » que le philosophe allemand Jürgen Habermas appelait de ses vœux, au prix d’une confusion entre nationalité et citoyenneté(51).
B. CITOYENNETÉ DIFFUSE, NATIONALITÉ CONFUSE
À l’encontre des évolutions qu’elle a pu connaître en Allemagne, la conception de la nation ne doit pas, en France, se résumer à l’intégration par la seule résidence effective et le partage d’un socle, souvent minimal, de valeurs démocratiques. Votre rapporteur soutient qu’il y a encore lieu de distinguer entre la nationalité et la citoyenneté, entre l’adhésion à la nation et le formatage citoyen, même si la mondialisation, le développement des appartenances multiples et la citoyenneté européenne favorisent leur confusion.
1. La nationalité n’est pas la citoyenneté
a) Une distinction claire en théorie
Le mot « nationalité » est apparu à la fin de la période révolutionnaire, à l’époque où le concept de « nation » se dotait d’un contenu politique mais pas encore mémoriel ni historique. Alors que la nation désigne un corps abstrait investi de la définition de l’intérêt général et de l’expression de la volonté générale, et qu’elle est indissociable en France d’une structure étatique fondée sur la représentation, la notion de nationalité a été utilisée pour la première fois par Madame de Staël pour désigner des communautés caractérisées par une unité linguistique mais dépourvues de structure étatique(52). C’est du moins ce qui ressort de la lecture de Corinne ou l’Italie(53), où l’héroïne, Corinne, se réjouit d’avoir au cours de sa vie baigné dans les cultures anglaise, romaine et napolitaine, et d’avoir « deux nationalités différentes »(54). Par la suite, le mot « nationalité » devint usuel en France. Il fallut toutefois attendre le célèbre arrêt Nottebohm rendu le 6 avril 1955 par la Cour internationale de justice (CIJ) pour que le mot « nationalité » soit clairement et durablement défini comme « un lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective d’existence, d’intérêts, de sentiments, joints à une réciprocité de droits et de devoirs », et comme « l’expression juridique du fait que l’individu auquel elle est conférée, soit directement, soit par la loi, soit par un acte d’autorité, est, en fait, plus étroitement attaché à la population de l’État qui la lui confère qu’à celle de tout autre État »(55). Cette définition a été reprise à l’article 2 de la Convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997 qui décrit la nationalité comme un « lien juridique entre une personne et un État ».
Mais il s’agit là d’une définition du droit international, et non du droit interne, qui occulte le caractère également politique de ce lien(56). Votre rapporteur définit donc la nationalité comme un lien juridique et politique entre une personne et un État. C’est du reste la définition retenue par la Commission de la nationalité présidée par M. Marceau Long en 1987-1988. Dans son rapport Être français aujourd’hui et demain, la Commission a en effet choisi délibérément de définir la nationalité comme « un lien politique entre l’État et un individu qui donne à celui-ci la qualité de membre de la population constitutive de l’État »(57).
Quant au citoyen, le doyen Gérard Cornu le définit comme « la personne qui, dans un État démocratique, participe à l’exercice de la souveraineté, soit, dans la démocratie indirecte, par l’élection de représentants, soit, dans la démocratie directe, par l’assistance à l’assemblée du peuple »(58). Autrement dit, le concept de citoyenneté n’est nullement exclusif d’une forme de participation directe à la souveraineté que l’on peut alors qualifier de « populaire » en ce sens que le pouvoir suprême est confié au peuple, aux individus et aux intérêts particuliers qui le composent, sans passer par le prisme de représentants chargés de définir l’intérêt général. Sur ce point, le concept de citoyenneté diffère foncièrement du concept de nation tel qu’élaboré en France. Comme on l’a montré, la démocratie indirecte et la représentation sont consubstantielles de la construction du concept de nation pendant la Révolution française. Il y a une sorte de lien de consanguinité entre la nation et le mécanisme représentatif. Dans la conception française, le pouvoir suprême réside dans la nation, autrement dit dans le peuple pensé dans ce qui fait son unité, et non sa diversité. La souveraineté est donc « nationale », et non « populaire ». Et l’exercice du pouvoir passe par l’élection de représentants qui, au sein de la représentation nationale, expriment la volonté générale. Alors que la citoyenneté se satisfait de l’expression brute des intérêts particuliers, plus ou moins agrégés, la nation exige que ces intérêts particuliers passent par un prisme qui les transfigure pour constituer un intérêt d’une tout autre nature : l’intérêt général (59).
Contrairement à ce qui a pu être soutenu par certains auteurs (60), votre rapporteur est convaincu qu’il existe un lien intime entre cette conception de la nation et la notion de nationalité, et qu’il existe une corrélation entre la vision de la nation et la configuration du droit de la nationalité. C’est du reste le point de vue qu’avait adopté la Commission de la nationalité présidée par Marceau Long. Dans son rapport, la Commission soulignait certes que « nation et droit de la nationalité sont deux notions distinctes, l’une fondamentale et politique, l’autre instrumentale et juridique », et que « l’histoire du droit de la nationalité montre qu’il n’y a pas nécessairement continuité parfaite entre une conception de la nation, sur le plan philosophique et politique, et les règles posées par le législateur pour l’accès à la nationalité française »(61). Mais, elle affirmait néanmoins que « l’intensité des débats récents, d’une part, et le sentiment largement partagé d’un affaiblissement de l’identité nationale, d’autre part, incitent à rechercher la plus grande cohérence possible entre notre idée de la nation et le droit de la nationalité » (62). Il n’y a donc pas lieu de distinguer entre la nationalité comme lien de rattachement et la nationalité comme lien d’appartenance, contrairement à ce que soutient le professeur Hugues Fulchiron(63). Et la distinction proposée par le professeur Patrick Courbe entre une nationalité de proximité, qui serait assimilée à la « participation à la vie du corps social », et une nationalité de souveraineté, qui consisterait dans le partage de valeurs (64), n’apparaît pas plus pertinente, puisqu’elle repose au fond sur une confusion entre la citoyenneté, que recouvre en fait la notion de « nationalité de proximité », et la nationalité proprement dite, qualifiée par l’auteur de « nationalité de souveraineté ».
Si l’on admet que la nationalité est une courroie de transmission d’une certaine conception de la nation, que votre rapporteur pense, avec M. Marceau Long, comme devant être « élective »(65), et si, au-delà de la dimension mémorielle et historique qu’elle a acquise à la fin du XIXe siècle, la conception française de la nation, dans sa dimension purement politique, ne se confond pas avec la notion de citoyenneté, alors force est d’admettre que les notions de nationalité et de citoyenneté ne se recouvrent pas. Alors que la nationalité est un lien juridique et politique entre une personne et un État reflétant une certaine conception de la nation, et que la conception française de la nation repose sur la représentation (nationale) et sur une participation indirecte à l’exercice de la souveraineté (nationale) par le truchement de représentants d’un peuple pensé dans son unité, la citoyenneté est indifférente au mode de participation à l’exercice de la souveraineté, et s’accommode aussi bien de la démocratie indirecte et de la souveraineté nationale que de la démocratie directe et de la souveraineté populaire, pourvu que soient partagées les valeurs démocratiques.
Le philosophe Jürgen Habermas l’a du reste fort bien compris et théorisé, même si votre rapporteur ne partage pas ses conclusions. Dans son ouvrage intitulé L’intégration républicaine(66), il réfléchit sur les défis que constituent, pour un État-nation déstabilisé, l’avènement de sociétés multiculturelles et le développement de la mondialisation économique. Hostile à toute crispation sur l’État-nation, le philosophe allemand avance l’idée d’un État de droit démocratique, d’un socle de valeurs démocratiques qui formeraient un ordre démocratique et seraient communément partagées au sein d’une « constellation post-nationale »(67). Selon Jürgen Habermas, il est possible de parvenir à cimenter des sociétés multinationales et multiculturelles par une intégration démocratique, par une intégration civique, par une forme de citoyenneté diffuse. Des lecteurs avertis du philosophe allemand résument ainsi sa pensée : après avoir démontré qu’était finie l’époque où « l’idée nationale fut capable de se substituer aux religions pour assurer l’unification symbolique des sociétés modernes […] il lance un vibrant plaidoyer pour que l’État de droit démocratique s’étende au-delà des nations […et] appelle de ses vœux la formation d’institutions démocratiques et d’espaces publics transnationaux, en particulier européens, pour permettre une intégration politique élargie »(68). Selon M. Tzvetan Todorov, dans le cadre de l’État de droit démocratique, les rapports de l’État avec les citoyens ne relèvent plus du domaine affectif : l’État de droit démocratique n’exige pas de ses ressortissants qu’ils aiment les institutions mais seulement qu’ils leur soient loyaux (69).
Votre rapporteur désapprouve la conclusion de Jürgen Habermas, mais approuve la distinction conceptuelle qui en constitue les prémisses. Si votre rapporteur, à la différence du philosophe allemand, se montre réticent à l’égard d’un patriotisme constitutionnel, notamment européen, qui résulterait d’un sentiment d’appartenance fondé sur des principes universels contenus dans une constitution, il s’accorde en revanche à distinguer la citoyenneté de la nation et de la nationalité. Cette distinction a également reçu l’assentiment de M. Alain Jakubowicz, président de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA), qui, lors de son audition, a soutenu que la citoyenneté devait être déconnectée de la nationalité(70).
Comme l’écrit Jürgen Habermas, « le lien créé entre ethnos et démos n’était qu’un passage » et « d’un point de vue conceptuel, la citoyenneté était toujours déjà indépendante de l’identité nationale »(71). En d’autres termes, si la nation, la nationalité et la citoyenneté ont souvent été concomitantes, se renforçant mutuellement au sein des États-nations, la participation à l’exercice de la souveraineté qu’est la citoyenneté ne correspond pas nécessairement à la conception politique de la nation qui, en France, repose sur la démocratie indirecte, la représentation et la souveraineté nationales. En outre, elle n’inclut pas la dimension mémorielle et historique dont s’est étoffé le concept de nation à la fin du XIXe siècle. En effet, participer par le vote à l’exercice de la souveraineté ne présuppose pas l’appartenance et le sentiment d’appartenance à une communauté culturelle. Alors que la citoyenneté est effective et se nourrit de principes démocratiques universalistes, la nationalité est la traduction juridique de l’appartenance affective à une nation particulière.
Cette distinction, claire en théorie, apparaît de plus en plus floue en pratique, d’une part parce que les appartenances multiples prolifèrent à la faveur de la mondialisation, et d’autre part parce l’intégration européenne a conduit à l’avènement d’une citoyenneté européenne(72) préfigurant l’État de droit démocratique européen et le patriotisme constitutionnel européen que Jürgen Habermas appelait de ses vœux.
b) Une distinction floue en pratique
Les développements du droit interne et du droit international ont contribué à brouiller la distinction conceptuelle entre nationalité et citoyenneté en relativisant et en affaiblissant le contenu de la nationalité avant même que l’Europe ne promeuve celui de la citoyenneté.
Rappelons en effet que la nationalité est en principe la condition de l’exercice, dans l’État dont on est le national, de droits importants dont les étrangers ne peuvent se prévaloir, et parmi lesquels figurent notamment : le droit d’entrer sur le territoire national et de s’y établir sans pouvoir en être expulsé ; le droit de voter et d’être éligible aux élections locales et nationales pour lesquelles la qualité de Français est exigée – sous réserve de l’exception prévue pour les citoyens de l’Union européenne ; le droit de bénéficier de la protection diplomatique de l’État dont on a la nationalité ; le droit à certains avantages sociaux.
Si l’on n’enregistre pas encore les individus en tant que « citoyens du monde » comme avaient appelé à le faire en 1963 treize personnalités de renommée mondiale, dont plusieurs lauréats du prix Nobel(73), le droit international a contribué à affaiblir la nationalité en reconnaissant les droits qui s’y attachent à d’autres que les nationaux.
C’est ce que montre Mme Amélie Dionisi-Peyrusse dans sa thèse de doctorat intitulée Essai sur une nouvelle conception de la nationalité(74). Selon elle, si le principe de non-discrimination est érigé au rang des droits de l’homme par les textes internationaux (75), si la nationalité est perçue comme un critère illégitime de distinction entre les nationaux et les étrangers pour la reconnaissance d’un certain nombre de droits, et si les nationaux et les étrangers doivent avoir les mêmes droits, « alors la nationalité n’est pas un critère apte à justifier une différence de droit et son existence pourrait être remise en cause » (76).
La Cour européenne des droits de l’homme s’est emparée de bon nombre de matières relevant des droits civils (droit des personnes, de la famille, des biens, des successions) dont la jouissance est traditionnellement subordonnée à la nationalité(77). S’est ainsi construite une jurisprudence qui fait fi de la nationalité et esquisse un statut personnel européen de plus en plus homogène au sein des États parties à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH).
En matière de droit d’entrée sur le territoire national, dont le caractère absolu est traditionnellement réservé aux nationaux, la Cour européenne des droits de l’homme qui, longtemps, a refusé de reconnaître aux étrangers le droit de vivre en famille dans leur pays d’immigration, a nettement infléchi sa position dans un arrêt Sen rendu le 21 décembre 2001(78).
En matière de droit de séjour sur le territoire, dont le caractère absolu est, en principe, un attribut de la nationalité, la Cour européenne des droits de l’Homme a tendu à en reconnaître le bénéfice quasi-absolu à certains étrangers dans ses arrêts Moustaquim(79) et Beldjoudi(80), dès lors qu’aucun lien avec leur pays d’origine ne donnait d’épaisseur à leur nationalité et que la mesure d’éloignement portait une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le comité des droits de l’homme du Pacte international relatif aux droits civils et politiques tend également à renforcer les droits d’entrée et de séjour des étrangers, en se fondant sur l’article 12 dudit Pacte qui prévoit que « nul ne peut être arbitrairement privé du droit d’entrer dans son propre pays ». Dans une observation générale sur la situation des étrangers au regard du Pacte (n° 15), du 11 avril 1986, le comité a considéré que s’« il appartient à l’État de décider qui il admet sur son territoire », il n’en reste pas moins que, « dans certaines situations, un étranger peut bénéficier de la protection du Pacte même en ce qui concerne l’entrée et le séjour […pour] des considérations relatives à la non-discrimination, à l’interdiction des traitements inhumains et au respect de la vie familiale ». Dans une communication Stewart contre Canada, du 16 décembre 1996, le même comité a formulé une interprétation extensive de la notion de « propre pays » figurant à l’article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, notion qui ne s’entend pas seulement du pays dont on a la nationalité. Le comité a fait valoir que toute personne qui a des « liens particuliers » avec un pays donné « ne peut être considérée dans ce même pays comme un simple étranger ».
En matière de droits sociaux, la Cour européenne des droits de l’homme a également émoussé la distinction entre nationaux et étrangers. Dans un arrêt Gaygusuz contre Autriche, du 16 septembre 1996, il a été jugé que la subordination de l’octroi d’une allocation d’urgence aux chômeurs à la condition de nationalité était contraire à l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif au principe de non-discrimination, ainsi qu’à l’article 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention(81). Cette jurisprudence a été réitérée dans une affaire Koua Poirrez contre France, au sujet d’une prestation sociale contributive(82).
Le professeur Yves Lequette a montré comment la nationalité française avait ainsi été « dévaluée »(83) par le rapprochement progressif des droits reconnus aux nationaux et aux étrangers. La nationalité n’étant plus un critère de distinction pour l’obtention d’un certain nombre de droits, son utilité et son principe même semblent remis en cause.
Ainsi les droits d’entrée et de séjour sur le territoire national, qui sont d’ordinaire absolus pour les seuls nationaux, ont peu à peu été reconnus non seulement aux citoyens européens, mais également à certaines catégories d’étrangers ayant la nationalité d’États tiers à l’Union européenne.
Fondé sur le droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit au regroupement familial a abouti à reconnaître un droit d’entrée sur le territoire qui, après avoir été consacré par le Conseil d’État en 1978(84), revêt une valeur constitutionnelle depuis 1993(85). Le droit communautaire reconnaît également un droit au regroupement familial pour les ressortissants d’États tiers à l’Union européenne(86).
Au-delà du droit d’entrée sur le territoire, c’est le droit de séjour qui a été reconnu à certaines catégories d’étrangers, autres que celle des ressortissants communautaires. Dans un arrêt Belgacem en date du 19 avril 1991, le Conseil d’État a accepté de contrôler la conformité d’une mesure d’expulsion au regard du droit au respect à la vie privée et à la vie familiale garantis par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’annuler en cas de violation des dispositions conventionnelles(87). Par ailleurs, l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définit cinq catégories d’étrangers dont le droit de séjour sur le territoire est quasi-absolu dans la mesure où la protection qui leur est accordée à l’encontre des mesures d’éloignement est elle-même quasi-absolue(88). Sauf atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, actes de terrorisme et actes de provocation à la discrimination, à la haine et à la violence, les étrangers visés par ce texte sont aussi inexpulsables que le sont des nationaux. Il n’y a donc pas que la nationalité qui donne un droit absolu de séjourner sur le territoire national.
La nationalité a également cessé d’être la condition d’octroi des droits sociaux. Dans une décision du 22 janvier 1990, le Conseil constitutionnel a considéré que « le législateur peut prendre à l’égard des étrangers des dispositions spécifiques à la condition de respecter les engagements internationaux souscrits par la France et les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République ». Partant, « l’exclusion des étrangers résidant régulièrement en France du bénéfice de l’allocation supplémentaire, dès lors qu’ils ne peuvent se prévaloir d’engagements internationaux ou de règlements pris sur leur fondement, méconnaît le principe constitutionnel d’égalité »(89). Cette décision, rendue dans une affaire où était en cause l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, prestation non-contributive, a été confirmée par une décision du 13 août 1993 où le Conseil constitutionnel a estimé que, certes, « les étrangers se trouvent placés dans une situation différente de celle des nationaux », mais que, néanmoins, ils « jouissent des droits à la protection sociale, dès lors qu’ils résident de manière stable et régulière sur le territoire français »(90). La loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile a tiré les conséquences de la jurisprudence constitutionnelle en évinçant la condition de nationalité pour l’octroi de prestations sociales non-contributives.
En d’autres termes, les prestations sociales ont été incorporées dans un socle de droits fondamentaux qui, reconnus indifféremment aux nationaux et aux étrangers, neutralisent la condition de nationalité et contribuent à retirer à la nationalité sa spécificité.
Le droit communautaire a consacré cette évolution, tout d’abord en abolissant toute distinction entre les nationaux et les ressortissants d’autres États membres ou d’États ayant conclu des accords en ce sens avec l’Union européenne, puis en reconnaissant le bénéfice de « la sécurité sociale, [de] l’aide sociale et [de] la protection sociale telles qu’elles sont définies par la législation nationale » aux résidents de longue durée originaires d’États tiers à l’Union européenne qui n’ont pas conclu d’accords avec elle en matière de droits sociaux (91).
Toutes ces évolutions, tant en droit interne qu’en droit international, ont sapé la légitimité de la notion de nationalité, en la dépouillant de sa spécificité et en dotant la citoyenneté des attributs traditionnels de la nationalité. Devenue une coquille vide, la nationalité n’est aujourd’hui plus qu’un mot désignant le même contenu de droits que la citoyenneté. La confusion est telle que, même dans le code civil, le titre I bis relatif à la nationalité française contient des dispositions faisant référence à la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française (articles 21-28 et 21-29).
Cette confusion entre une nationalité en repli et une citoyenneté diffuse n’a fait que s’accroître avec l’explosion des échanges, des flux migratoires et des appartenances multiples.
2. Un sentiment d’appartenance n’allant plus de soi quand mondialisation et crises sociales suscitent la tentation du repli identitaire
Du point de vue de votre rapporteur, la nationalité doit se distinguer de la citoyenneté en ce qu’elle repose nécessairement sur un authentique sentiment d’appartenance nationale. Ce sentiment d’une même communauté de destin ne saurait se réduire au seul respect de valeurs, de lois, d’us et coutumes, c'est-à-dire au sens de la civilité. Il implique le partage d’un passé et l’enracinement dans un territoire, legs indivis de la communauté.
Forgé et entretenu en France par l’école héritée de la Troisième République, le sentiment d’appartenance s’est longtemps nourri de la capacité des membres de la communauté nationale à inscrire leur existence dans une temporalité, l’Histoire de France et dans un espace, celui de l’Hexagone. Or, ainsi que l’a relevé M. Pierre Nora (92), après avoir longtemps vécu en autarcie, le modèle français se trouve aujourd’hui confronté à des mouvements qui l’exposent à un double éclatement : par le haut, du fait de l’intégration difficile et incertaine au sein de l’Union européenne ; par le bas, du fait d’une décentralisation revêtant les formes diverses qui, sur le fond d’un mouvement général à l’œuvre dans l’ensemble des sociétés démocratiques, a contribué au brouillage de tous les repères.
Ce brouillage des repères affecte au premier chef les liens existant entre les individus et le territoire national. Ce faisant, il fragilise le sentiment d’appartenance car en dépit de l’inflexion décisive mais inaboutie que représente le contrat d’accueil et d’intégration, le renouvellement des flux migratoires et l’impact de la mondialisation mettent à l’épreuve les processus de l’intégration à la société, au demeurant confrontée au réflexe de l’entre-soi.
a) Un instrument à améliorer : le contrat d’accueil et d’intégration
Pour préparer l’intégration républicaine de l’étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement sur le territoire national entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui souhaite s’y maintenir durablement , la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration a rendu obligatoire la signature avec l’État d’un contrat d’accueil et d’intégration (CAI).
En application de l’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ce contrat est conclu pour une durée d’un an et, dans certains cas, peut être prorogé d’une année supplémentaire. Par la signature de cette convention, l’étranger s’engage à :
– respecter les valeurs du pays d’accueil ;
– suivre la formation civique (module de 6 heures) destinée à informer les nouveaux arrivants sur les institutions françaises et les valeurs de la République (notamment l’égalité hommes/femmes, la laïcité, l’accès obligatoire et gratuit à l’éducation), l’organisation et le fonctionnement de l’État et des collectivités territoriales ;
– suivre la formation linguistique, qui lui aura été prescrite (entre 100 et 400 heures) s’il n’a pas le niveau requis pour se présenter au diplôme initial de langue française (DILF), lequel valide une maîtrise des rudiments de la langue (93);
– se soumettre à un bilan de compétences professionnelles visant à déterminer les compétences du migrant et à l’orienter conformément à son projet professionnel ;
– suivre la formation sur les droits et devoirs des parents pour les étrangers et leurs conjoints bénéficiant de la procédure du regroupement familial(94).
Un entretien individuel avec un auditeur social de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), organisme chargé de l’organisation de ces formations en tant qu’auxiliaire des pouvoirs publics pour la mise en œuvre des procédures relatives à l’immigration, vise également à établir un diagnostic personnalisé des besoins du migrant et de l’orienter, le cas échéant, vers l’assistant social présent sur les plateformes d’accueil (95).
Le suivi des formations civiques et linguistiques donne lieu :
– pour la formation civique, à la remise d’un certificat attestant de la participation de l’étranger à la journée de formation ;
– pour la formation linguistique, à la remise d’une attestation ministérielle (AMDLF) validant le niveau de compétences.
Les attestations délivrées à l’occasion de la signature du contrat d’accueil et d’intégration ainsi que le respect des engagements souscrits constituent des éléments d’appréciation entrant dans la décision de renouvellement de la carte de séjour.
D’après les chiffres communiqués par l’OFII à l’occasion de l’audition par la mission de son directeur général, M. Jean Godfroid (96), le nombre des signataires de contrat d’accueil et d’intégration a atteint 97 736 signataires en 2009, soit un taux d’adhésion de 98,3 % des personnes auxquelles la signature du CAI a été proposée.
Il en ressort également que les signataires du CAI forment une population jeune (l’âge moyen s’élevant à 31,8 ans), plutôt féminine (les femmes représentant 52 % des signataires) et issue des pays du Maghreb (les ressortissants de cette région du monde comptant pour 37,2 % des signataires).
Les principales nationalités recensées
parmi les signataires du CAI
On dénombre près de 150 nationalités parmi les signataires du CAI. Les plus représentés sont
- les Algériens (17,4 %) ;
- les Marocains (13,45 %) ;
- les Tunisiens (6,4 %) ;
- les Turcs (5,6 %) ;
- les Maliens (5,2 %) ;
- les Congolais (Congo Brazzaville et République démocratique du Congo) : (4,4 %) ;
- les Camerounais (2,9 %) ;
- les Chinois (2,8 %) ;
- les Ivoiriens (2,7 %) ;
- les Sénégalais (2,7 %).
Source : OFII
On notera également que les membres de familles de Français demeurent toujours largement majoritaires : 48,8 % des signataires appartiennent à cette catégorie (conjoints, parents d’enfants français, ascendants ou enfants) contre 14,5 % pour celle des personnes ayant des liens personnels et familiaux, 9 % pour les travailleurs, 8,5 % pour les bénéficiaires du regroupement familial et 12,6 % pour les réfugiés, les apatrides et les membres de leur famille.
Dans ces conditions, la signature du contrat d’accueil et d’intégration se présente comme une étape essentielle du parcours d’intégration républicaine alors que le nombre de ses signataires représente près de la moitié du nombre des étrangers entrant sur le territoire national chaque année.
Cela étant, il convient de rappeler que la vocation première de cet instrument est de garantir l’intégration des étrangers désireux de s’établir durablement sur notre sol, l’objectif restant que les nouveaux arrivés adoptent des comportements qui ne contreviennent pas aux mœurs et aux coutumes du pays d’accueil. Ainsi que l’a souligné M. Jean Godfroid, cette volonté n’implique pas nécessairement le désir d’acquérir la nationalité française. En droit, sa signature ne figure pas parmi les conditions et critères d’acquisition de la nationalité française.
En cela, le contrat d’accueil constitue un instrument utile de promotion et d’acquisition de la citoyenneté. S’agissant en revanche d’une entrée de plain-pied dans la communauté nationale, le contrat d’intégration ne peut à l’évidence que marquer une première étape dans un processus d’intégration pouvant conduire à l’acquisition de la nationalité française dont au demeurant chacun mesure les incertitudes compte tenu de la durée de ce processus.
En effet, dans la conception exigeante que défend votre rapporteur d’une nationalité fondée sur un réel sentiment d’appartenance, on ne saurait confondre taux d’adhésion au contrat et partage des valeurs que le contrat incite à partager. Après tout, le CAI n’engage l’étranger qu’à participer à la journée de formation civique et il ne s’agit pas de déterminer le degré de compréhension de l’enseignement qu’il reçoit en l’espace d’une journée, voire la sincérité et la profondeur de son adhésion aux valeurs de la République. Sur un plan strictement juridique, les articles L. 311-9 et L. 311-9-1 du CESEDA ne prévoient en effet le non-renouvellement de la carte de séjour qu’en cas de « non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l’étranger, des stipulations du contrat d’accueil et d’intégration ».
Du reste, la formation civique dispensée dans le cadre de la mise en œuvre apparaît comme un dispositif certes essentiel mais finalement modeste et perfectible. Devant les membres de la mission (97), M. Jean Godfroid, directeur général de l’OFII, a ainsi préconisé l’établissement de messages d’information plus individualisés et adaptés au profil des publics reçus, mettant l’accent sur des notions fondamentales que chacun doit nécessairement connaître. Suivant son analyse, la formation civique actuellement dispensée repose sur un programme excessivement volumineux dans la mesure où il aboutit à un empilement de notions et connaissances sans doute trop diverses pour être véritablement assimilées au fil d’une session ne durant qu’une demi-journée. De fait, les participants sont censés couvrir en ce court laps de temps les programmes d’histoire étudiés de la classe de sixième à celle de troisième, un enseignement allant de la Gaule cisalpine à la navette parlementaire sous la Ve République. Or, certains d’entre eux ne parlent guère français et peinent à comprendre des notions telles que la laïcité.
Dans ces conditions, la mission ne peut que se féliciter de ce qu’un groupe de travail ait pu dresser un cahier des charges qui fixe un certain nombre d’objectifs tendant notamment à ce que la formation civique soit dispensée à des groupes homogènes de migrants et permette la diffusion de messages ciblés en fonction des origines géographiques, culturelles et du niveau d’études.
De son point de vue, le recentrage des formations dispensées dans le cadre du CAI constitue l’une des orientations nécessaires pour initier pleinement à la vie citoyenne en France les étrangers désireux de s’établir durablement sur notre sol.
Cela étant, cette initiation ne saurait préjuger de la capacité d’un individu à acquérir la nationalité française. La naturalisation, le souhait authentique de se fondre tout entier dans la communauté nationale ne va pas de soi. Il s’agit d’un véritable processus, de l’aboutissement d’une maturation dont les études montrent qu’elle peut prendre entre dix et quinze ans et qui, parce qu’elle agite les individus en leur for intérieur, relève souvent, ainsi que l’a souligné M. Patrick Weil (98), d’une affaire intime.
On ne saurait mieux dire le caractère essentiel de la volonté et du sentiment d’appartenance dans la démarche qui conduit à demander l’obtention de la nationalité française. Or, c’est précisément la signification de cette demande, sa portée exacte et les implications de cet engagement personnel dans une relation singulière avec le pays d’accueil qui ne paraissent plus aussi évidentes aujourd’hui.
Cette incertitude conduit nécessairement à se demander dans quelle mesure l’acquisition de la nationalité française correspond à l’expression d’un authentique sentiment d’appartenance nationale alors que le renouvellement des flux migratoires concourt à l’évolution des conditions d’accueil et à la position des étrangers au sein de la société française.
b) Une intégration citoyenne tendant à prendre le pas sur l’assimilation dans le contexte des nouveaux flux migratoires
D’après les chiffres fournis par Mme Michèle Tribalat, directrice de recherche à l’Institut national des Études démographiques (INED) et auteur depuis près de trente ans d’études relatives à l’immigration et au destin en France des populations d’origine étrangère, on recensait, en 2008, 12 millions de personnes d’origine étrangère sur deux générations (immigrés ou enfants d’immigrés), effectif qui représente 19 % de la population totale, soit une proportion égale avec celle observée en Allemagne. Parmi les 5,3 millions d’immigrés, on compte environ 2 millions de Français par acquisition (soit 40 % d’entre eux). Sur 6,5 millions de personnes issues d’au moins un parent d’origine immigrée, 4 millions ont déjà acquis la nationalité française en raison de leur âge.
Suivant l’Enquête sur la diversité des populations en France : Trajectoires et Origines dont l’INSEE et l’INED ont publié les premiers résultats de la dernière livraison en octobre 2010 (99), 98 % des enfants d’immigrés se déclarent Français, soit 3,3 millions de personnes âgées de 18 à 50 ans. Parmi les enfants d’immigrés se déclarant Français, on dénombre des doubles nationaux, soit 24 % d’entre eux et 800 000 personnes parmi les 18-50 ans.
Pour autant, on ne saurait occulter l’existence d’éléments statistiques illustrant certaines disparités dans l’acquisition de la nationalité française.
Ainsi, les résultats de cette étude révèlent également que le degré de francisation varie. Mme Michèle Tribalat a ainsi mis en exergue le fait que cette assimilation dépendait beaucoup de l’origine géographique et des courants migratoires, de l’ancienneté de l’implantation en France et de l’âge d’entrée.
Par exemple, 80,7 % des personnes originaires d’Asie du Sud-Est ont acquis la nationalité française. En revanche, cette proportion n’atteint que seulement 45 % parmi les immigrés venus d’Afrique (Sahel excepté), contre respectivement 45 % et 56 % de ceux venus d’Italie et d’Espagne. Le chiffre se révèle plus faible pour les autres immigrés originaires de l’Union européenne et de l’Espace économique européen. Ainsi, seuls 16 % des immigrés venus du Portugal dans les années 1980 ont acquis la nationalité française. Cette dernière donnée s’explique sans doute par le contexte dans lequel sont arrivées ces populations ainsi que par l’adhésion du Portugal à la Communauté européenne, l’acquisition de la nationalité française présentant alors moins d’utilité. Parmi les immigrés arrivés en France dans les années 2000, les personnes originaires du Maroc et de Tunisie sont celles qui ont le plus acquis la nationalité française (autour de 20 % contre 7 % en moyenne des immigrés hors Europe du sud). Ceci explique que la part des immigrés d’origine africaine atteigne près de 50 % parmi les immigrés ayant acquis la nationalité française alors qu’elle ne représente que 44 % des immigrés sur le territoire. Les Européens comptent pour 26 % des immigrés ayant acquis la nationalité française et 36 % parmi les étrangers.
En soi, ces données reflètent la divergence des positionnements vis-à-vis de l’acquisition de la nationalité française observée parmi les populations d’origine immigrée. On perçoit la même réalité lorsque l’on analyse les déclarations recueillies auprès d’un panel représentatif concernant le sentiment d’appartenance nationale que synthétise le tableau ci-dessous, extrait de l’Enquête Trajectoires et Origines publiée en 2008 par l’INSEE et l’INED.
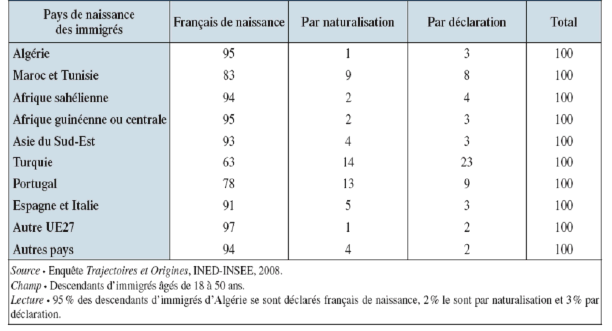
Ces données disent également la diversité des conditions contemporaines d’intégration dans notre société suivant les origines.
Cette intégration dépend pour partie d’éléments matériels objectifs, de facteurs économiques et sociaux, sur lesquels nous ne pouvons ici nous appesantir puisqu’il ne s’agirait ni plus ni moins que de se livrer à une évaluation – forcément réductrice – des résultats et des échecs des politiques sociales de notre pays et, en particulier, de la politique de la ville. Beaucoup reste sans doute à accomplir mais l’intégration ne saurait par ailleurs réussir sans la volonté des intéressés.
Or, l’état des lieux établi par certains observateurs incite sinon à mettre en doute du moins à questionner l’existence même d’un sentiment d’appartenance nationale chez certaines personnes ayant acquis la nationalité française par la naissance, la résidence ou le mariage.
Telle est par exemple l’opinion de Mme Malika Sorel, membre du Haut Conseil à l’intégration et essayiste, qui, devant les membres de la mission (100), a tenu à mettre en exergue l’absolue nécessité de prendre la mesure des changements intervenus entre les différentes vagues d’immigration.
À ses yeux, on assisterait en effet aujourd’hui à une dégradation continue du mouvement d’intégration qui, jusqu’à présent, s’opérait au fil des courants migratoires. Cette dégradation se cristalliserait au travers :
– du refus croissant de respecter les valeurs et principes du peuple français qui s’incarnent au travers des valeurs républicaines inscrites dans la Constitution : chacun de ces principes est contesté et même combattu jusqu’à l’intérieur des classes, à l’école ;
– du refus croissant de pratiquer la langue française ;
– des outrages récurrents aux symboles : drapeau et hymne national ;
– de l’affichage agressif de son appartenance à un autre peuple, attitude qui se manifeste de diverses manières : par l’exhibition du drapeau du pays d’origine en toute occasion, y compris dans les cérémonies de mariage ; par la pratique systématique de sa langue d’origine, y compris en classe ; par l’expression quasi permanente de sa propre sensibilité religieuse, la religion se transformant en une identité à part entière.
De façon générale, on observerait d’après Mme Malika Sorel une bien moindre volonté de mimétisme pour s’inspirer des comportements socioculturels des Français. De son point de vue, les facteurs économiques et sociaux revêtiraient une importance relativement mineure dans les comportements observés, si l’on considère la situation, à certains égards plus difficile, dans laquelle s’est déroulée l’intégration de précédents immigrés, par exemple dans l’entre-deux-guerres.
Par comparaison, la simple insertion dans la société apparaît même faire l’objet de refus croissant alors que, dans l’esprit de Mme Malika Sorel, il s’agit là d’une obligation s’imposant à tous. Cette attitude s’expliquerait par le fait que l’éducation des enfants des dernières vagues d’immigration ne repose plus sur un socle de reconnaissance envers la France construit par les parents. Autrefois, les parents de l’immigration transmettaient à leurs enfants cette reconnaissance qu’ils ressentaient pour la France qui les avait accueillis. Cela aidait leurs enfants à s’inscrire dans le projet français. Ce n’est plus du tout le cas pour les enfants de l’immigration extra-européenne. D’après Mme Malika Sorel, on leur répéterait sans doute trop que la France ne serait pas la France sans l’apport des différentes vagues d’immigration.
De même, afin de faciliter l’adoption ou la cooptation de leurs enfants par la communauté française, les parents s’évertuaient, malgré la souffrance qui était la leur – à ne surtout pas contrarier le travail de l’école. Bien au contraire, ils le facilitaient en imposant à leurs enfants le respect des représentants de la société française que sont les enseignants de la République. D’instinct, ils comprenaient et acceptaient la nécessité de minimiser les différences afin que l’adoption puisse se produire pour leurs enfants. La donne aurait complètement changé avec les dernières vagues d’immigration.
Du reste, suivant l’analyse développée par Mme Malika Sorel, l’école ne se trouverait plus aujourd’hui en mesure de jouer le rôle intégrateur qu’elle a su jouer par le passé. Les parents, pour des raisons de distance culturelle et de valeurs non partagées, ne marcheraient en effet plus dans la même direction que les enseignants. Cela aboutit à ce que pour des élèves de l’immigration de culture non européenne, « l’enfant qu’il est dans sa famille s’oppose à l’élève qu’il doit être à l’école. »101 alors que, suivant la sociologue finlandaise Jouni Välijärvi, « on sait que les performances des élèves ont pour moteur le capital culturel et les centres d’intérêts qu’ils apportent de chez eux à l’école » (102).
Ainsi, aux yeux de Mme Malika Sorel, la seule véritable chance des enfants d’immigrés est de s’investir à l’école, ce que nombre d’entre eux ne feraient pas. Ainsi que tend à le montrer le dernier avis du Haut conseil à l’intégration, les enfants ne font pas leurs devoirs, manquent de concentration faute d’un sommeil suffisant. Or, il faudrait s’occuper de ces enfants très tôt, vers l’âge de deux ou trois ans, afin de leur permettre d’acquérir la maîtrise de la langue française qui fait défaut chez eux. Ceci exige de les inciter à s’exprimer dans le cadre de petits groupes, de leur apprendre les comptines et contes qui constituent des éléments de la culture orale nationale et suscitent l’attachement au pays.
Au contraire, plus la distance culturelle est importante, plus l’appropriation des codes socioculturels sera longue et difficile, voire souvent conflictuelle. Aujourd’hui, on peut être français, musulman et républicain à condition d’accorder le primat aux valeurs qui sous-tendent le corpus des lois françaises.
Selon Mme Malika Sorel, il convient également de prendre en considération l’impact des moyens de télécommunications modernes, des réseaux sociaux, d’Internet de manière générale, de l’évolution des tarifs des transports aériens, de la circulation rendue plus aisée. Tout cela permet le maintien d’un lien étroit avec le pays d’origine et rend l’intégration beaucoup plus difficile.
Suivant ses observations, on assisterait à la reproduction des sociétés culturelles d’origine sur la terre d’accueil. La société française ne serait plus confrontée à un phénomène migratoire classique, mais à des phénomènes de diasporas, de « peuples qui gardent un sentiment de leur unité malgré l’éclatement géographique ». Dans ces conditions, les migrants n’éprouveraient plus le besoin de se plier aux us et coutumes de la société d’accueil.
Par ailleurs, Mme Malika Sorel a jugé que, dans ces conditions, les politiques de diversité, de discrimination positive parfois appelée « égalité réelle » rendent plus attrayante la revendication d’appartenance à une communauté étrangère plutôt qu’à la communauté nationale française. La victimisation des immigrés et de leurs descendants les aurait déresponsabilisés et leur aurait laissé croire que tout viendrait depuis l’extérieur. Cette idéologie de la victimisation prospérerait sur un terreau très fertile dans la mesure où la culture d’origine de très nombreux migrants présenterait un caractère fataliste qui les déposséderait déjà en grande partie de la conduite de leur propre destin.
Dès lors, les migrants et leurs descendants apparaîtraient de moins en moins nombreux à souhaiter l’intégration voire l’assimilation, ce qui représente l’un des freins majeurs à l’intégration. Dans l’ouvrage intitulé Le destin des enfants d’immigrés, Mme Claudine Attias-Donfut et M. François-Charles Wolff montraient que « tiraillés davantage entre la famille et le dehors, leurs enfants risquent d’éprouver plus de difficultés à se faire une place en France et se montrent incapables de s’adapter à l’école ou dans le monde du travail, ce qui aggrave les conflits avec les parents. Quand ils ont, au contraire, pu s’émanciper de leurs parents et se sont bien intégrés en France, c’est au prix d’une rupture avec eux. » (103) Le prix de l’intégration peut donc s’avérer très lourd.
Certes, il convient sans doute de ne pas présenter certains comportements comme une généralité et d’expliquer les échecs de l’intégration comme résultant d’un refus unilatéral de certaines populations arrivées récemment sur le territoire national. Néanmoins, du point de vue de votre rapporteur, la thèse défendue par Mme Malika Sorel ne paraît pas dépourvue de tout fondement dans la mesure où, d’une part, elle rappelle une vérité essentielle : pour pouvoir s’intégrer, il faut le vouloir ; l’intégration ne saurait être imposée.
D’autre part, elle attire l’attention de la mission sur des logiques à l’œuvre dans notre société et que les sciences humaines invitent à prendre en considération.
La sociologue Évelyne Ribert a ainsi montré que, dans l’esprit des jeunes de l’immigration, les papiers d’identité français n’engageaient en rien leur propre identité et qu’il existait une décorrélation complète entre nationalité et identité (104). À certains égards, on peut relever un autre indice de cette dissociation entre acquisition du statut juridique de ressortissant et expression d’un sentiment d’appartenance nationale dans les conclusions d’une étude que M. Mustapha Belbah, sociologue, a évoqué devant la mission (105). Il ressort en effet de ces travaux(106) que les demandes de naturalisation semblent principalement répondre à des préoccupations avant tout pratiques telles que pouvoir se présenter aux concours de la fonction publique, circuler plus librement grâce à l’obtention d’un passeport français, assurer l’avenir de ses enfants. On remarquera toutefois que l’étude démontre également la nécessité de dépasser ce qui s’assimile, au premier abord, à une attitude utilitariste et matérialiste : la recherche de facilité en matière de travail, de liberté de circulation, touche en effet à des questions qui structurent l’identité sociale d’un individu.
Cela étant, on ne saurait donc présumer dans ces conditions de la volonté d’acquérir la nationalité française chez les personnes venues vivre sur le territoire national. Ainsi que l’a souligné Mme Malika Sorel, il importe de rappeler que le processus de l’intégration met en présence deux parties ou contractants : le postulant à l’intégration et la communauté à laquelle il souhaite être intégré ou rattaché. C’est dire également, suivant un point de vue que partage votre rapporteur, que la réussite de l'intégration nécessite tout autant que la communauté nationale reconnaisse sans distinction comme l’un des siens celui de celui qui demande à s’intégrer pleinement.
Or, cette acceptation ne relève pas de l’évidence pour certains membres de la société d’accueil ainsi que l’établissent les travaux de plusieurs sociologues.
Rendant compte du résultat de ses travaux, et notamment d’une étude intitulée Les couleurs du drapeau (107), Mme Catherine Withol de Wenden, directrice de recherches au CNRS, a ainsi souligné devant la mission (108) que le véritable problème venait du regard porté sur les Français issus de l’immigration, lesquels ne sont pas considérés par certains de leurs compatriotes comme français à part entière.
Reposant sur l’examen des réponses d’un échantillon raisonné de 90 personnes précédé d’une enquête exploratoire auprès de gradés et de hauts gradés, l’étude a ainsi mis en évidence le fait qu’au sein de l’institution militaire, les jeunes engagés d’origine immigrée n’étaient pas considérés comme français par une partie de leurs camarades, soit parce qu’ils étaient de culture musulmane – alors que la plupart observaient discrètement les rites de leur religion en public –, soit parce qu’on leur prêtait des attitudes communautaristes – alors que la plupart avaient une approche très individuelle de leur identité – soit encore parce qu’en raison de leurs origines, on présupposait qu’ils venaient de banlieues, qu’ils étaient d’anciens dealers ou délinquants. Par ailleurs, d’après l’enquête exploratoire, si un certain nombre de hauts gradés se déclaraient convaincus de l’intérêt de la diversité pour l’institution militaire afin de montrer que celle-ci était à l’image de la Nation, et conservait avec elle des liens étroits en tant que deuxième employeur de France, l’attitude de l’encadrement plus immédiat des troupes apparaissait en revanche plus contrastée, certains reprochant aux engagés leur culture ou religion musulmane supposée – tout en affichant eux-mêmes une foi catholique au caractère ostentatoire sinon intégriste, peu compatible avec la laïcité républicaine – voire rejetant la diversité. Les camarades des jeunes engagés d’origine immigrée tiennent souvent un discours aux relents xénophobes, hostile aux Arabes.
Or, l’étude menée par Mme Withol de Wenden tend par ailleurs à montrer l’attachement indéfectible des jeunes engagés à la France, par-delà leurs origines et les croyances religieuses qu’ils professent et peuvent retrouver sur les théâtres d’opération où ils sont déployés tels que l’Afghanistan. Cependant, certains d’entre eux se trouvent confrontés à un sentiment de discrimination, thème récurrent parmi les sujets abordés au fil de l’étude tandis que les auteurs de l’étude n’ont pas perçu la présence d’un intégrisme musulman au sein des troupes.
Aux yeux de Mme Withol de Wenden, il s’agit de la manifestation d’une grave fracture qui amène certains Français à dénier la qualité de concitoyen à des personnes qui, au strict plan juridique, peuvent tout autant qu’eux revendiquer la nationalité française.
Du point de vue de votre rapporteur, on ne saurait occulter ces attitudes car celles-ci reflètent en effet un problème plus grave qui mine le sentiment d’appartenance nationale: il s’agit de l’essor des identités particulières et la tentation de l’entre-soi.
c) L’essor d’identités particulières et la tentation de « l’entre-soi »
Dans la mesure où il participe d’une ouverture de la société française au monde et contribue, à bien des égards, au renouvellement des cadres de la pensée individuelle et collective, on peut ne pas percevoir au premier abord en quoi l’essor des identités particulières présente un caractère problématique. Encore faut-il définir et prendre la mesure de ce phénomène et de ses implications pour le savoir-vivre ensemble.
Au cours de son audition, M. Jean-Philippe Thiellay observait ainsi que le lien unissant un individu à la nation subit aujourd’hui les effets contradictoires de la mondialisation et du campanilisme : les individus et, en particulier les jeunes, se sentent soit appartenir à des ensembles plus vastes que la seule France tels que l’Europe ou même le monde, soit revendiquent des attaches plus locales. Les questions religieuses peuvent également contribuer à affaiblir ce lien, du fait parfois des difficultés à trouver sa place dans la société laïque française.
De fait, l’essor des identités particulières concourt à ce que les individus n’inscrivent pas nécessairement leur existence dans le cadre traditionnel que constitue historiquement et juridiquement la nation. En témoignent par exemple les deux grandes enquêtes conduites par l’Institut national d’études démographiques sur les facteurs d’identification à un territoire dont ont fait état devant la mission (109) M. Alain Blum et Mme France Guerin-Pace, respectivement responsable et directrice de recherches à l’unité Identités et territoires des populations de l’INED.
Il ressort de ces études, réalisées aussi bien auprès des Français nés en France qu’auprès des personnes immigrées et de leurs descendants, que le sentiment d’appartenance s’explique davantage par un parcours personnel, qui crée des liens entre une personne et un territoire, que par des données juridiques comme la nationalité.
Ainsi, interrogées sur la manière dont elles caractériseraient leurs origines, les personnes nées en France de parents français citent pour 55 % d’entre eux une commune, 10 % un département, 14 % une région ; 6 % déclarent spontanément être Français ou de France. On remarquera que 14 % des personnes ayant vécu une partie de leur vie à l’étranger choisissent cette dernière affirmation, ce qui tend à démontrer que le fait d’avoir vécu à l’étranger accroît le sentiment d’appartenance nationale.
Parmi les immigrés et leurs descendants, 64 % des immigrés de nationalité étrangère citent leur pays de naissance comme lieu d’où ils se sentent originaires, 18 % une commune, 7 % se déclarant simplement français. Par comparaison, les immigrés devenus Français évoquent à 37 % leur pays d’origine, à 29 % une commune ; 22 % se disent français. S’agissant des descendants d’immigrés, 7 % se rattachent par leur déclaration à l’un des pays d’origine de leurs parents, 61 % à une commune, 3 % à un département, 8 % à une région et 12 % se présentent comme étant français.
D’après ces mêmes enquêtes, lorsque l’on demande si les personnes se sentent avant tout originaires d’une région française, européenne, d’un autre pays ou d’un autre continent, les personnes nées en France de parents français répondent à 63 % se sentir avant tout françaises, 27 % d’une région de France et 9 % se déclarent européennes.
Parmi les immigrés devenus français, 56 % se sentent avant tout français ; 11 % d’une région de France, 13 % de leur pays d’origine et 13 % européens. Parmi les immigrés de nationalité étrangère : 19 % se sentent avant tout français ; 9 % d’une région de France ; 46 % de leur pays d’origine et 18 % européens.
Parmi les descendants d’immigrés (ayant deux parents immigrés) : 54 % se sentent avant tout français ; 18 % d’une région de France ; 10 % du pays d’origine d’un de leurs parents ; 15 % européens.
A tout le moins, on peut conclure de ces résultats que la réalité juridique revêt un caractère bien souvent secondaire, beaucoup des enfants d’immigrés se déclarant spontanément français même s’ils n’acquièrent juridiquement la qualité de national qu’à leur majorité. Au-delà, la faiblesse du pourcentage de personnes invoquant leur nationalité française plutôt que leur appartenance à une commune ou à une région ne manque pas de convaincre qu’une citoyenneté que certains qualifient « de résidence » tend à prévaloir sur le sentiment d’appartenance nationale. En effet, les déclarations recueillies par l’INED accréditent l’analyse suivant laquelle les liens de proximité l’emportent sans doute désormais sur le sentiment d’appartenance nationale dans l’identité de nombre de nos concitoyens.
En cela, l’essor des identités particulières constitue à bien des égards le symptôme de l’affaiblissement du sentiment d’appartenance nationale. Or, cette évolution comporte ceci de préoccupant qu’elle s’accompagne parfois de la revendication d’identités distinctes voire même de comportements de repli ou d’enfermement entre soi.
M. Xavier Lemoine peut en porter le témoignage qui, en tant que maire de Montfermeil (Seine-Saint-Denis), a tenu à alerter la mission(110) sur des logiques territoriales contribuant à miner la cohésion sociale et à compromettre gravement la paix civile.
Il tire notamment des travaux du sociologue Edgar Morin, de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles, et de l’Institut national de la statistique et des études économiques, la conviction que la spécialisation des territoires aboutit au regroupement des populations par affinités culturelles. En conséquence, la mixité est menacée tandis que des logiques démographiques d’organisation du territoire renforcent le phénomène et désamorcent l’effet escompté des politiques publiques. Il existe de son point de vue des tendances lourdes de repli identitaire, une logique d’entre soi, qui risquent d’échapper aux pouvoirs publics et d’aboutir à la création de blocs territoriaux impénétrables.
A ces logiques territoriales, il convient également d’ajouter le véritable problème fondamental que représente le poids des communautés sur les individus, lesquels peuvent difficilement s’en affranchir et font dans certains cas l’objet d’une véritable reprise en main. Son expérience de terrain lui a ainsi permis d’observer deux situations : dans les quartiers populaires, de petits noyaux exerçant une pression sur des individus ne disposant pas d’une éducation suffisante pour s’émanciper de la communauté ; des expressions fondamentalistes émanant parfois de membres des classes moyennes, polyglottes, possédant un bagage intellectuel qui les rend à même de construire des revendications politico-religieuses et de manier la dialectique (comme on peut le vérifier en lisant les commentaires laissés sur certains sites Internet d’associations musulmanes de Seine-Saint-Denis).
S’il convient bien entendu de se garder de toute extrapolation, cette description d’une réalité locale n’en fait pas moins écho aux dynamiques de confinement sinon de repli observées à une échelle plus globale tant au plan sociologique et géographique.
Au plan sociologique, Mme Michèle Tribalat a pu ainsi attirer l’attention des membres de la mission (111) sur certaines spécificités observables dans la trajectoire des populations immigrées en France et les modalités de leur intégration.
Ainsi, les données pouvant être extraites de l’étude précitée Trajectoires et Origines, Enquête sur la diversité des populations en France, d’octobre 2010, donneraient à penser, sous certaines réserves méthodologiques, que dans le cas des premières unions et des premiers mariages d’enfants d’immigrés âgés de 18 ans à 50 ans, la mixité de ces unions est favorisée lorsque les enfants d’immigrés sont originaires de l’Espace économique européen : plus d’une union sur deux aurait été conclue avec un partenaire d’origine française (de deux parents nés en France), avec un taux atteignant les 75 % pour les enfants nés de parents espagnols. L’union avec un conjoint français apparaîtrait moins fréquente pour les enfants ayant des origines algériennes (par leurs deux parents) puisqu’elle ne concerne que 32 % d’entre eux. Ce taux se révélerait également faible chez les Français d’origine tunisienne (autour d’un tiers) ou marocaine et plus encore chez les Français d’origine turque puisque 5 % des femmes originaires de Turquie s’unissent avec un Français d’origine. Concernant les mariages, Mme Michèle Tribalat observe que la mixité est encore plus faible.
Du point de vue de la confession religieuse, on tend à constater la prégnance d’un phénomène d’homogamie religieuse extrêmement forte parmi les enfants d’immigrés, quelle que soit la religion concernée. 72 % des enfants d’immigrés chrétiens sont unis à des conjoints chrétiens, 78 % des musulmans à des musulmans, 70 % des personnes se déclarant sans religion avec des personnes sans religion. On constate également une homogamie très forte parmi les Français d’origine métropolitaine.
De fait, l’homogamie religieuse semble se renforcer en cas de mariage. Les enfants d’immigrés chrétiens sont 79 % à contracter un premier mariage avec un chrétien. De même, 91 % des musulmans se marient avec une personne de même confession.
Par ailleurs, les unions mixtes demeurent vraisemblablement exceptionnelles. Ainsi, suivant l’étude réalisée par Mme Michèle Tribalat (sur un échantillon d’enfants immigrés originaires du Maghreb, du Sahel ou de Turquie), seuls 27 % des Français de culture musulmane vivent avec un conjoint français non-musulman. En matière d’union, le critère déterminant dont dépend la conclusion des unions apparaît être la confession religieuse. Ainsi, les études tendent à montrer que les unions mixtes avec des Français de culture musulmane sont d’autant plus importantes que la confession musulmane est abandonnée.
Les chiffres dont dispose Mme Michèle Tribalat révèlent par ailleurs un mouvement de reconfessionnalisation des jeunes générations d’immigrés. Ainsi, 30 % des enfants d’origine algérienne par leurs deux parents, âgés de 20 ans à 29 ans en 1992, se déclaraient sans religion contre seulement 10 % de la même classe d’âge en 2008. On assisterait à une évolution inverse parmi les Français d’origine métropolitaine : plus on est jeune et moins on croit en général. Par ailleurs, la référence religieuse apparaît plus forte parmi les immigrés de culture musulmane que parmi ceux de culture chrétienne.
Au plan géographique, de nombreuses études rendent compte de phénomènes de concentration des populations d’origine immigrée qui ne peuvent que mettre à mal sinon l’expression d’un sentiment d’appartenance nationale du moins l’intégration à la société française.
Il ressort en effet des données chiffrées fournies par Mme Michèle Tribalat (112) une tendance très prononcée à la concentration des immigrés et enfants d’immigrés dans certaines localités, en particulier en Ile-de-France et en Seine-Saint-Denis. Dans une étude publiée en 2005, les chiffres montraient une évolution assez sensible dans ce dernier département, la proportion de jeunes d’origine étrangère (ayant au moins un parent immigré) passant de 19 % à 57 % chez les moins de 18 ans entre 1968 et 2005. On relève également des pourcentages très élevés dans certaines villes, par exemple près de 75 % à la Courneuve, à Aubervilliers ou Clichy-sous-Bois. On compte un tiers de musulmans en Seine-Saint-Denis, l’islam étant la première religion du département. On doit noter également des phénomènes de concentration similaire dans des villes telles qu’Orléans ou Blois. Or, d’après Mme Michèle Tribalat, on doit prendre en considération la réticence que semblent manifester les Français d’origine métropolitaine à s’établir dans des lieux où existe une telle concentration et sur la nécessité de ne pas nourrir d’illusion sur le degré de mixité existant en France.
Or, du point de vue des membres de la mission, il s’agit là de questions qui ont leur importance si l’on veut établir un droit de la nationalité fondé sur le rapport indissoluble entre l’obtention de la qualité juridique de citoyen français et l’expression d’un sentiment d’appartenance nationale.
Pour ce faire, le droit de la nationalité doit manifestement répondre à de multiples défis : des défis inhérents – on l’a vu – aux transformations mêmes du modèle républicain mais également des défis liés à l’intégration croissante de la France à une société de droit international. Parmi ces derniers, figure au premier rang la question posée par la multiplication des cas de plurinationalité.
3. Un dépassement problématique du cadre national : le développement inédit de la plurinationalité
Pendant longtemps, les situations dans lesquelles des individus pouvaient détenir et acquérir la qualité de ressortissant de plusieurs États ont pu sembler ne devoir constituer qu’un objet d’étude ou de réflexion théorique. Il faut dire que l’hermétisme des frontières et le caractère relativement localisé des déplacements ne prédisposaient guère en général les individus à nouer des attaches diverses à l’échelle du monde.
Mais la révolution des transports et des télécommunications, le renouveau des flux migratoires ont profondément modifié les données de cette problématique en favorisant une très sensible augmentation du nombre des personnes détenant au moins deux nationalités.
a) Un phénomène connaissant un accroissement certes imperceptible mais réel
Quoique l’on ne dispose pas en France de véritables statistiques officielles en la matière, certains indices donnent à penser que le nombre des bi- ou plurinationaux connaît une augmentation assez sensible.
Ainsi, d’après les éléments communiqués par Mme Michèle Tribalat au cours de son audition (113), on peut lire un accroissement du nombre de binationaux par comparaison avec les résultats d’une précédente enquête Mobilité géographique et insertion sociale (MGIS) réalisée en 1990. Ainsi, s’agissant des enfants d’immigrés, la part des individus qui se déclarent binationaux serait passée de 13 % chez ceux qui sont nés avant 1971 à 26 % parmi ceux qui sont nés dans la décennie suivante et à 31 % parmi ceux qui sont nés plus récemment. Il s’avère du reste que c’est parmi les enfants d’immigrés se déclarant de confession musulmane que le nombre des binationaux est le plus élevé : 43,7 % contre 12,1 % chez ceux qui ne confessent aucune religion et 30,8 % chez les chrétiens. On remarquera une forte augmentation de la part des personnes ayant une double nationalité parmi les jeunes chrétiens puisque l’on passe de 9 % parmi ceux qui sont nés avant 1971 à 28 % parmi les plus jeunes, une évolution par ailleurs observable parmi les jeunes se déclarant sans religion.
Il ressort également de ces données que l’importance des chiffres de la bi-ou plurinationalité varie beaucoup en fonction de l’origine géographique, la double nationalité se révélant particulièrement répandue parmi les personnes originaires du Maghreb. On recense en effet dans cette catégorie de la population les deux tiers des binationaux, la part de binationaux atteignant par exemple près de 70 % parmi les Tunisiens devenus Français. En revanche, on dénombre extrêmement peu de cas de double nationalité parmi les personnes issues des anciens courants migratoires européens. Ainsi, les binationaux ne représentent que 11 % à 13 % des immigrés venus d’Espagne et d’Italie alors que cette proportion apparaît plus importante parmi les personnes originaires d’autres pays européens. À cet égard, on peut par ailleurs constater l’extrême faiblesse du phénomène de la double nationalité parmi les immigrés venus de l’Asie du Sud-Est, la proportion de personnes concernées ne s’élevant qu’à 6,6 % de cette population.
Au total, le nombre des personnes possédant plusieurs nationalités et vivant sur le territoire national pourrait approcher le chiffre de 1,35 million de citoyens.
Il convient à ce stade de noter que l’état de bi- ou pluri- national caractérise également les Français établis à l’étranger. Ainsi, suivant les informations dont M. Jean-Philippe Thiellay a pu faire état devant la mission (114), près de 50 % de nos compatriotes vivant en dehors des frontières posséderaient une autre nationalité, la part des binationaux atteignant près de 80 % des expatriés au Moyen-Orient. En revanche, d’après la même source, cette proportion ne s’élèverait qu’à 60 % parmi ceux installés en Suisse et en Italie, 35 % en Allemagne et seulement 23 % en Italie. En Afrique du nord, d’après les données fournies par M. François de Saint-Paul, directeur des Français à l’étranger et de l’administration consulaire au ministère des Affaires étrangères et européennes (115), les binationaux représentent près de 54 % des Français inscrits sur les listes consulaires.
Dans de nombreux cas, la plurinationalité reflète la multiplicité des attaches nouées par une population de plus en plus mobile et ouverte au monde. Mais si le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, ce phénomène ne soulève pas moins d’épineux problèmes : des problèmes en premier lieu juridiques parce que la nationalité met en cause l’application de règles touchant au droit des personnes ; des problèmes en second lieu politiques dans la mesure où, du point de vue de votre rapporteur, la plurinationalité représente une absence pratique de choix qui ne manque pas de soulever des questions tout aussi délicates concernant le sentiment d’appartenance.
b) Une source d’incertitudes nouvelles et problématiques quant à la réalité des liens existant entre un État et des individus
L’accroissement du nombre des binationaux ou plurinationaux soulève en premier lieu des problèmes d’ordre juridique dans la mesure où ce phénomène complique la détermination des droits et des devoirs d’individus se plaçant par leur nationalité sous la juridiction de plusieurs États.
La nationalité produit des effets en droit international et cette question se pose tant pour les individus que pour les États dont ils se réclament. La reconnaissance d’une personne comme ressortissante d’un État conditionne en effet l’application de règles touchant à l’état des personnes (s’agissant par l’exemple du partage des biens ou de la garde des enfants en cas de séparation ou de divorce), à l’exercice du droit de propriété, à la fixation des obligations militaires mais également à d’autres branches du droit (telles que le droit commercial) ou encore à la compétence des tribunaux dans des litiges de droit civil ou pénal dépassant les frontières. On comprend ainsi aisément que les cas de plurinationalité favorisent l’existence de conflits de lois, c'est-à-dire de situations où à un même fait juridique trouvent à s’appliquer deux ou plusieurs règles émanant d’États différents, ce qui pourrait conduire dans un litige à une solution différente.
Du rattachement à un État, dépend par ailleurs l’exercice éventuel de la protection diplomatique, protection qu’un État peut assurer à ses nationaux lorsque ceux-ci ont été lésés par des actes contraires au droit international commis par une puissance étrangère et qu’ils n’ont pu obtenir réparation par les voies de droit interne de cet État. Rappelons que dans cette hypothèse, l’État qui exerce la protection diplomatique endosse la réclamation de son ressortissant et se substitue complètement à lui dans le débat contentieux qui devient alors un débat entre États.
Or, compte tenu du principe traditionnel de la compétence souveraine des États dans l’élaboration des règles relatives à la nationalité, le droit international offre peu instruments susceptibles de dissiper les incertitudes.
Cette branche du droit demeure relativement embryonnaire dans la mesure où en premier lieu, elle procède de quelques conventions de portée assez limitée. Sur ce plan, on remarquera d’abord qu’à l’instar de la Convention signée à La Haye le 12 avril 1930, toutes les conventions multilatérales traitant des questions de nationalité rappellent presque systématiquement qu’ « il appartient à chaque État de déterminer par sa législation quels sont ses nationaux » et que « toute question relative au point de savoir si un individu possède la nationalité d’un État doit être résolue conformément à la législation de cet État ». Il convient ensuite de noter que ces textes n’édictent que des principes généraux dont la force ne tient de surcroît qu’au nombre des États acceptant de s’y conformer.
Il en va ainsi tout particulièrement des conventions adoptées dans le cadre du Conseil de l’Europe. Ainsi, la convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, texte signé à Strasbourg le 6 mai 1963, consacre en son article 1er le principe suivant lequel l’acquisition volontaire d’une nationalité entraîne nécessairement la qualité de ressortissant d’un État dont une personne pouvait se prévaloir jusque-là. L’article 2 établit logiquement le droit, pour tout individu possédant la nationalité de deux ou plusieurs États parties, à renoncer à l’une ou l’autre des nationalités qu’il possède avec toutefois l’autorisation de l’État de la nationalité à laquelle il entend renoncer. Suivant les articles du chapitre II de la convention (116), les individus possédant la nationalité de deux ou plusieurs des États parties ne sont tenus de remplir leurs obligations militaires qu’à l’égard d’un seul de ces États. À défaut d’accord entre les États pour déterminer les modalités d’application de cette règle, la convention prévoit que, par principe, les individus ne seront soumis qu’aux obligations militaires de l’État partie sur le territoire duquel ils résident habituellement. Par exception, le texte ménage la faculté, jusqu’à l’âge de dix-neuf ans, de se soumettre aux obligations militaires dans l’un des États parties dont les individus possèdent également la nationalité sous forme d’un engagement volontaire pour une durée totale et effective au moins égale à celle du service militaire actif dans l’autre État partie. Notons que les individus se voient reconnaître une liberté de choix quant à l’État dont ils possèdent la nationalité et dans lequel ils accomplissent leurs obligations militaires dès lors qu’ils ont leur résidence individuelle sur le territoire d’un État partie dont ils ne sont pas les ressortissants ou sur celui d’un État n’ayant pas signé la convention.
La convention européenne sur la nationalité, également signée dans le cadre du Conseil de l’Europe le 6 novembre 1997, pérennise l’application de ces règles tout en les complétant par l’affirmation expresse de principes généraux concernant la compétence de l’État et de garanties portant sur le droit à une nationalité, la protection contre l’apatridie et l’interdiction des discriminations dans les législations relatives à la nationalité.
Quoique comportant des stipulations essentielles s’agissant des cas de plurinationalité, ces deux conventions ne présentent pas moins une efficacité limitée dans la mesure où d’une part, elles ne s’appliquent que dans une aire géographique relativement circonscrite. Par exemple, dans le cas de la convention européenne sur la nationalité, on recense à ce jour seulement 20 ratifications alors que le Conseil de l’Europe compte plus de 47 États membres. À cet égard, il convient de noter que la France n’est que signataire de cette convention tandis qu’elle a par ailleurs dénoncé le chapitre 1er de la convention du 6 mai 1963 en mars 2008 (avec effet en mars 2009) afin de permettre aux personnes possédant deux nationalités dont une de l’Union européenne de conserver leurs deux nationalités.
Ce dernier exemple montre d’autre part que les conventions internationales énonçant des règles en matière de plurinationalité se révèlent d’une application d’autant plus incertaine que leur exécution repose avant tout sur les accords et les interprétations dont les États conviennent entre eux. En constitue une récente illustration l’accord sous forme d’échange de notes verbales entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant l’interprétation de la convention franco-suisse relative au service militaire des doubles–nationaux du 16 novembre 1995 (117). Tout en affirmant le principe de l’accomplissement des obligations militaires dans l’État de résidence, la convention de 1995 laissait en effet ouverte une option qui autorisait les jeunes gens concernés à choisir l’État dans lesquelles ils souhaitaient s’acquitter de leurs obligations par un acte déclaratif formulé avant l’âge de 19 ans. Or, la réforme du service national français intervenue en 1997 faussait les conditions de ce choix : cette réforme aboutissait, de ce côté-ci de la frontière, au remplacement de l’appel sous les drapeaux par la participation obligatoire à la journée d’appel de préparation à la défense (JAPD) tandis qu’en Suisse, les jeunes demeurent soumis jusqu’à l’âge de 28 ans à un service de 260 jours. En application de l’accord conclu entre les gouvernements français et helvétique, un double national qui optera pour le service en France et qui aura participé à la journée défense et citoyenneté sera libéré de l’obligation de servir dams l’armée suisse et ne sera pas assujetti au paiement de la taxe suisse d’exemption de l’obligation de servir.
En l’espèce, cet accord atteste de la capacité de certains États à dégager des solutions pragmatiques aux problèmes concrets que posent les situations de plurinationalité. Par contraste, il donne en second lieu un aperçu de l’absence en la matière de principes dégagés de manière autonome sur le fondement du droit international. En effet, le seul véritable principe consacré par les juridictions internationales demeure la notion d’effectivité de la nationalité telle qu’elle résulte de l’arrêt Nottebohm rendu le 6 avril 1955 par la Cour internationale de justice (CIJ).
Dans cette espèce, la Cour a décidé que la nationalité attribuée par un État ne pouvait être valablement opposée à un État tiers que si elle revêtait un caractère effectif, c’est-à-dire si elle traduisait un rattachement réel de l’individu à l’État lui ayant octroyé la nationalité. La CIJ a estimé en l’occurrence que M. Nottebohm n’avait aucun attachement réel au Liechtenstein ; que la naturalisation lui avait été conférée dans des conditions exceptionnelles de rapidité et de bienveillance et qu’en définitive, la nationalité manquait de sincérité et se révélait purement fictive. En conséquence, le Liechtenstein ne fut pas admis par la Cour à exercer sa protection diplomatique en faveur de M. Nottebohm.
Sur le plan des principes, on retiendra de cet arrêt la définition déjà évoquée de la nationalité dégagée par la Cour : « un lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement , une solidarité effective d’existence d’intérêts, de sentiments jointe à une réciprocité de droits et de devoirs ». On pourra remarquer avec Mme Amélie Dionisi-Peyrusse, maître de conférences à l’Université de Rouen (118), que cette notion de nationalité effective tient compte partiellement de l’intention de l’une des parties, sous réserve que cette volonté présente quelque réalité pour l’examen des faits du litige.
La solution arrêtée par l’arrêt Nottebohm constitue aujourd’hui un principe solidement établi. Cependant, la notion de nationalité effective consacrée par cette jurisprudence ne paraît pas devoir fournir une réponse suffisante pour dissiper les incertitudes que peuvent susciter certains cas de plurinationalités et les litiges entourant parfois la détermination de la nationalité.
Il en va ainsi aux yeux d’une partie de la doctrine lorsqu’une personne privée, victime de la violation du droit international, possède à la fois la nationalité de l’État présumé responsable et celle de l’État réclamant. La solution traditionnellement retenue dans cette hypothèse était qu’un État ne peut accorder sa protection diplomatique à l’un de ses ressortissants à l’encontre de l’État mis en cause dont celui-ci possède également la nationalité. L’illustrent notamment l’arrêt rendu le 3 mai 1912 par la Cour permanente d’arbitrage dans l’affaire Canavero ou l’avis consultatif rendu le 11 avril 1949 par la Cour internationale de Justice dans l’affaire de la Réparation des dommages subis au service des Nations unies. Cependant, une partie de la doctrine tend à s’interroger sur l’application de ce principe traditionnel d’irrecevabilité de la réclamation et donc de non-exercice de la protection diplomatique depuis l’arrêt Nottebohm. Si l’on suit la logique du principe de la nationalité effective consacrée à cette occasion, deux cas de figure apparaissent concevables suivant que la nationalité effective est celle de l’État réclamant ou bien celle de l’État défendeur. Dans la première situation, la protection diplomatique doit pouvoir être exercée même à l’encontre de l’État qui se prétend aussi mais abusivement État national des réclamants. Une partie de la doctrine considère ainsi que ce pourrait être le cas si la nationalité de l’État défenseur a été imposée de façon autoritaire à des personnes qui la rejettent et revendiquent la nationalité de l’État réclamant.
Le principe de nationalité effective ne semble également d’aucun secours dans des situations aussi problématiques et inédites pour le droit français que celles créées par les conventions de gestation pour autrui conclues à l’étranger.
Ainsi, au cours de son audition (119), M. François Saint-Paul a exprimé la crainte du ministère des Affaires étrangères et européennes face à l’accroissement constant du nombre de naissances résultant de gestations pour autrui à l’étranger. On observerait en effet un phénomène prenant désormais la forme de quasi filières dans des pays comme l’Inde ou l’Ukraine. Si la gestation pour autrui ne pose pas de difficultés en termes d’acquisition de la nationalité lorsque l’enfant qui naît sur le sol étranger ne demande pas la nationalité française, elle pose de graves problèmes dès lors que les parents de l’enfant né d’une gestation pour autrui à l’étranger demandent la transcription de la naissance sur les registres de l’état civil tenus par les consulats français afin que lui soit attribuée la nationalité française.
Suivant trois arrêts rendus, le 6 avril 2011, par la première chambre civile de la Cour de cassation (120), le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, « principe essentiel du droit français » s’oppose à ce qu’une convention de gestation pour autrui produise des effets au regard de la filiation, la Cour de cassation soulignant du reste que cette convention, « fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public ». Par conséquent, les actes de naissance établis sur les registres d’un pays étranger ne sauraient être transcrits sur les registres d’état civil français ; les parents ne peuvent prétendre obtenir un acte de notoriété constatant la possession d’état d’enfant légitime, même si l’enfant est issu des gamètes des deux époux. Or, il en résulte l’impossibilité pratique de transmettre la nationalité française par filiation et rien ne garantit que la législation du pays dans lequel la convention de gestation pour autrui présente un caractère légal permette à l’enfant ainsi conçu d’obtenir la nationalité de la mère porteuse. Il existe ainsi un risque de placer l’enfant dans une situation d’apatridie lorsque la loi du pays, à l’exemple de la loi indienne, ne reconnaît pas la nationalité aux enfants nés sur son sol d’une gestation pour autrui.
Dans ces conditions, comment déterminer la nationalité effective ? La question reste entière à ce jour.
Même si un rapprochement des législations ne parait pas hors de propos, des solutions juridiques n’épuiseront pas des interrogations de nature plus politiques concernant la potentialité d’un conflit d’allégeance ou d’intérêts.
c) Le vecteur potentiel de conflits d’allégeance et d’intérêts ?
Cette préoccupation se justifie au moins sur un plan théorique par la nature des droits auxquels ouvre l’obtention de la nationalité. Qui devient national acquiert en effet le privilège d’exercer, dans leur plénitude, les droits politiques qui s’attachent à l’exercice de la souveraineté. Éligible et électeur, le national participe en effet, directement ou par la voie de ses représentants, à l’élaboration des lois, à la définition et au contrôle des politiques publiques. Il possède ainsi voix au chapitre concernant les affaires les plus quotidiennes comme celles qui engagent le destin de la collectivité. Suivant les mots de Mme Malika Sorel (121), « l’accès à la nationalité confère à celui qui la reçoit le statut d’architecte du projet politique collectif ».
Ceci posé, il apparaît d’autant moins illégitime de s’interroger sur le risque d’un potentiel conflit d’allégeance ou d’intérêts que le vote des binationaux constitue aujourd’hui une réalité incontournable.
D’après les chiffres qu’a pu rassembler et communiquer à la mission Mme Michèle Tribalat (122), 21 % des immigrés binationaux auraient déjà voté au moins une fois à l’étranger, les autres binationaux déclarant pour moitié d’entre eux ne pas avoir souhaité ou pu accomplir cette démarche pour divers motifs. Les immigrés originaires de l’Espace économique européen et, en particulier, ceux venus d’Espagne et d’Italie s’imposent comme ceux ayant le plus volontiers accompli cette démarche. Au total, seuls 18 % des immigrés dans leur ensemble auraient voté à l’étranger, le taux maximal étant atteint parmi les immigrés venus d’Italie avec 60 % de cette catégorie de la population ayant déjà accompli son devoir électoral pour les scrutins concernant les affaires de la Péninsule. D’après les mêmes sources, un peu moins de 20 % des enfants immigrés en âge de voter l’aurait déjà fait au moins une fois, proportion identique à celle observée parmi les étrangers ou les doubles nationaux. Rapporté à l’ensemble des personnes nées en France de parents étrangers, le nombre des personnes ayant voté au moins une fois à l’étranger reste faible, soit 6 % de cette catégorie. On relève néanmoins des variations suivant la nationalité, Mme Michèle Tribalat indiquant que ce sont les Franco-Algériens nés en France qui votent le plus à l’étranger.
De surcroît, le vote à l’étranger ne manque pas de présenter une dimension particulière dès lors que certains droits nationaux maintiennent à ce jour le principe de l’allégeance perpétuelle. En application de ce principe, un ressortissant ne saurait se départir de sa nationalité d’origine même s’il s’agit là d’un acte volontaire ou s’il ne conserve aucun lien avec l’État. À tout le moins, un individu devra solliciter l’autorisation du gouvernement qui, par un acte d’autorité publique, le relèvera de tout lien d’allégeance avec lui. Il en va ainsi dans le cadre du droit de la nationalité réformé en vigueur en Algérie (depuis la réforme de février 2005) ou au Maroc (depuis la révision du code de la nationalité intervenue en mars 2007).
S’il ne s’agit nullement de remettre en doute la loyauté de nos compatriotes possédant une autre nationalité, chacun conviendra que la possible participation à l’exercice de la souveraineté de plusieurs États bouleverse, quant à elle, les schémas que sous-tend la conception traditionnelle du droit de la nationalité. En effet, la protection qu’accorde l’État à des ressortissants suppose, en contrepartie, que ceux-ci lui fassent allégeance, ce qui implique une obligation de fidélité et d’obéissance. Dans cette optique, la jouissance de la nationalité suppose donc une relation de caractère exclusif. Or, on discerne mal comment il pourrait en être ainsi dès lors que les individus se rattachant à plusieurs États peuvent se voir placer dans la situation d’avoir à se prononcer sur des politiques nationales éventuellement antagonistes et conflictuelles.
Il existe – on le voit – le risque d’un véritable écartèlement des individus, risque d’autant plus aigu que certains États peuvent ne pas renoncer à l’exercice d’une influence sur la conduite des individus vivant antérieurement sous leur juridiction de fait et de droit. Chacun peut ainsi se souvenir des déclarations réitérées de feu le roi Hassan II aux yeux duquel l’allégeance perpétuelle liait définitivement les Marocains à son royaume. On remarquera que plus récemment, lors de l’inauguration de la foire allemande des hautes technologies, le 28 février 2011, le Premier ministre turc, M. Recep Tayyip Erdogan, avait proclamé que les travailleurs immigrés turcs appartenaient tout autant à l’Allemagne qu’à la Turquie et demeuraient quoi qu’il arrive des compatriotes. Ce faisant, il entendait manifester explicitement que son gouvernement soutenait l’intégration mais pas l’assimilation.
En somme, la plurinationalité ne favorise pas la détermination des droits et des devoirs réciproques qui existent entre l’État et ses ressortissants. En cela, ce phénomène comporte le risque de conflits de lois et, surtout, de conflits d’allégeance pour lesquels les instruments du droit international n’offrent que des réponses encore imparfaites tant du point de vue du droit que de l’expression du sentiment d’appartenance nationale.
À bien des égards, le développement du nombre des plurinationaux constitue en effet un dépassement problématique du cadre national auquel concourt également, sans doute à un moindre degré, l’émergence en droit d’une citoyenneté européenne.
4. Une nouvelle source de confusion : la citoyenneté européenne
L’institution d’une citoyenneté européenne par le traité de Maastricht du 7 février 1992 a achevé l’œuvre de démembrement de la nationalité entreprise par le droit international et par le droit interne. Rongée par les appartenances multiples qui pullulent avec l’intensification des flux migratoires, la nationalité est désormais également affaiblie par une citoyenneté triomphante et auréolée par le droit communautaire.
Le traité de Maastricht a reconnu la qualité de citoyen européen à tout individu ayant la nationalité d’un État membre de l’Union européenne et a introduit dans la notion de citoyenneté européenne des droits qui sont d’ordinaire les principaux attributs de la nationalité au point que le professeur Mireille Delmas-Marty a pu écrire en 2000 que « le citoyen européen serait un animal encore étrange qui préfigure peut-être le futur citoyen du monde »(123).
a) La concurrence entre nationalité et citoyenneté
La citoyenneté européenne donne à ses bénéficiaires un certain nombre de droits, énoncés aux articles 9 et suivants du Traité sur l’Union européenne (TUE), aux articles 20 et suivants du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et au chapitre V de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Le citoyen européen jouit tout d’abord du « droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres » (articles 18 TUE, 20 § 2 et 21 § 1 TFUE, ainsi que 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne), dans le respect toutefois des limites posées par le droit communautaire. Le citoyen européen a ainsi le droit de séjourner dans un État membre dont il n’est pas le national pour une durée de trois mois, sans aucune autre obligation que celle de détenir des documents d’identité en cours de validité. Pour une période comprise entre trois mois et cinq ans, un État membre peut poser des conditions au séjour sur son sol d’un citoyen européen, parmi lesquelles celle de se faire enregistrer, celle d’être un travailleur (salarié ou non salarié) et celle de disposer de ressources suffisantes et d’une assurance-maladie complète afin de ne pas constituer une charge pour le système de protection sociale. Mais au-delà de cinq ans, le citoyen européen peut prétendre à un titre de séjour permanent sur le territoire de l’État membre d’accueil, conformément à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Or l’on sait que le droit d’entrée et de séjour est l’un des principaux droits traditionnellement attachés à la nationalité.
Le citoyen européen s’est ensuite vu reconnaître le droit de vote et d’éligibilité à certaines élections dans l’État membre où il réside depuis plus de trois mois mais dont il n’a pas pour autant nécessairement la nationalité (articles 10 TUE, 20 § 2 et 22 TFUE, ainsi que 39 et 40 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne). Ainsi, en France, un citoyen européen peut non seulement participer aux élections européennes, qui n’ont pas à proprement parler de caractère national, mais aussi aux élections municipales. Même s’il s’agit d’élections locales et d’une participation motivée par la proximité entre l’organe élu et la résidence du votant, il n’en reste pas moins que l’exercice de ce droit de vote participe indirectement à l’exercice de la souveraineté puisque les conseillers municipaux élisent à leur tour des sénateurs qui font partie de la représentation nationale.
Certes, l’article 88-3 de la Constitution prévoit que les citoyens européens « ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs ». Mais même s’ils ne participent pas aux élections sénatoriales et même s’ils ne sont pas élus conseillers municipaux, il n’en reste pas moins que les citoyens européens votent pour désigner des conseillers municipaux, le cas échéant des nationaux, qui eux-mêmes représentent l’essentiel des électeurs d’une assemblée qui participe à l’exercice de la souveraineté. Le simple fait d’élire des conseillers municipaux, même nationaux, constitue une participation indirecte à l’exercice de la souveraineté nationale.
Alors que le droit de vote est en principe attaché à la nationalité puisque son exercice suppose d’être intégré à une nation appelée à désigner des représentants, il a été reconnu à des étrangers, ressortissants d’autres États membres de l’Union européenne, sur le seul fondement de leur qualité de résidents et de citoyens européens.
Enfin, le citoyen européen bénéficie de la protection diplomatique, non pas de l’Union européenne, mais de tout État membre de l’Union européenne (articles 35 TUE, 20 § 2 et 23 TFUE, ainsi que 46 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne).
À ces trois principaux droits attachés à la citoyenneté européenne s’ajoutent un droit d’accès aux documents administratifs, un droit de saisir le médiateur de l’Union et un droit de pétition (124). Par ailleurs, des droits ont également été reconnus aux « ressortissants en situation communautaire », à savoir aux nationaux des États membres qui sont aussi des travailleurs transfrontaliers au sein de l’Union européenne. L’un d’entre eux est celui de ne pas être discriminé en raison de sa nationalité (articles 18 TFUE et 21 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne). Comme le note Mme Amélie Dionisi-Peyrusse, sauf exceptions prévues par les traités, « la nationalité serait alors privée de tous ses effets puisque la possession de la nationalité française ou de celle d’un autre État serait indifférente »(125).
On le constate donc : les droits attachés à la citoyenneté européenne convergent vers les droits attachés à la nationalité. La nationalité s’en trouve dévaluée, et la citoyenneté valorisée. Ce qui compte, c’est moins d’avoir la nationalité française que d’avoir la nationalité d’un État membre, quel qu’il soit, et d’être ainsi reconnu comme citoyen européen. L’étranger n’est pas tant celui qui n’a pas la nationalité française que celui qui n’a pas la nationalité d’un des vingt-sept États membres de l’Union européenne et n’est donc pas un citoyen européen.
C’est d’autant plus vrai que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne tend à dépouiller la nationalité de ses attributs pour n’en faire plus qu’une notion fantomatique, dépourvue de toute réalité. Dans son arrêt Micheletti, du 7 juillet 1992 (126), la Cour s’est en effet satisfaite d’une nationalité « fictive » pour accorder à une personne le bénéfice du droit communautaire. Dans une affaire mettant en cause un double national possédant la nationalité espagnole et celle d’un État tiers à l’Union européenne, les juges communautaires ont effet reproché au juge espagnol d’avoir exigé du double national en question qu’il ait sa résidence habituelle en Espagne et que sa nationalité espagnole ait un minimum d’effectivité pour lui reconnaître le bénéfice de la liberté d’établissement. Comme le note Amélie Dionisi-Peyrusse, « la Cour rejette la condition d’effectivité de la nationalité d’un État membre pour que la qualité de citoyen européen puisse en découler »(127). Et cette jurisprudence semble constante puisqu’elle a été réitérée dans un arrêt « Chen » du 19 octobre 2004 (128), rendu dans une affaire où étaient cette fois en cause les nationalités de deux États membres de l’Union européenne.
b) La primauté de la nationalité
Si l’article 9 du Traité sur l’Union européenne prévoit qu’« est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre », c’est pour ajouter aussitôt que « la citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas ». En d’autres termes, les traités européens eux-mêmes soulignent d’une part que l’attribution de la citoyenneté européenne dépend de l’acquisition ou de l’attribution de la nationalité d’un État membre, qu’elle en est le prolongement, qu’elle y est subordonnée, et, d’autre part, que la citoyenneté européenne ne saurait absorber la nationalité (ou « citoyenneté nationale ») ni se confondre avec elle.
Si l’on peut interpréter la création d’une citoyenneté européenne comme la promotion d’une forme de patriotisme constitutionnel universaliste, on peut tout aussi bien y voir une forme de valorisation de la notion de nationalité puisque la reconnaissance de la citoyenneté est subordonnée à celle de la nationalité. En théorie, deux personnes placées dans la même situation et ayant des liens aussi étroits avec les États membres où elles résident respectivement, peuvent tout à fait jouir ou non de la qualité de citoyen européen selon la politique de la nationalité menée par chacun des deux États membres. Dans sa thèse, Mme Amélie Dionisi-Peyrusse souligne que, parce qu’il détient encore le droit de déterminer qui est ou non membre de la communauté nationale, par voie de conséquence, « chaque État membre a une entière liberté de déterminer qui doit être considéré par les autres comme citoyen européen »(129).
Il est donc impératif que les États membres de l’Union européenne adoptent des principes communs pour harmoniser les règles de détermination de la nationalité. En son temps, la Commission de la nationalité présidée par M. Marceau Long avait du reste appelé à une concertation au niveau européen pour éviter que certains États ne deviennent des « paradis de la naturalisation »(130).
Comme l’a souligné la politologue Catherine Wihtol de Wenden lors de son audition (131), l’apparition de la citoyenneté européenne peut faire l’objet d’interprétations divergentes. Les uns y verront le fait que la nationalité est dissociée de la citoyenneté, qu’il est désormais possible d’être citoyen et même d’être élu à l’échelon local sans être national, et que cette citoyenneté enrichie et transnationale menace la nationalité classique, fondée sur un sentiment d’appartenance exclusive à la nation. Les autres, dont Mme Catherine Wihtol de Wenden, insisteront au contraire sur le fait que la reconnaissance de cette citoyenneté est subordonnée à l’attribution ou à l’acquisition de la nationalité d’un État membre de l’Union européenne, que la nationalité revêt toujours une grande importance, et qu’elle conservera cette importance aussi longtemps qu’existera l’État-nation.
L’historien et essayiste Tzvetan Todorov a également souligné qu’en dépit de la perte de certains attributs de la souveraineté au profit d’ensembles régionaux tels que l’Union européenne, l’appartenance à un État conservait une certaine prégnance (132).
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique a ouvert la fonction publique française aux ressortissants communautaires en réservant toutefois aux seuls nationaux les « emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'État ou des autres collectivités publiques » (133).
*
* *
Développement des appartenances multiples, nationales et régionales, infra-étatiques et supra-étatiques, concurrence entre nationalité et citoyenneté, patriotisme constitutionnel européen et universaliste nous ont accoutumés à l’idée kelsenienne que l’État pouvait se passer de l’institution de la nationalité.
Hans Kelsen écrit en effet que « si un ordre juridique interne ne contient que des normes qui peuvent s’appliquer aussi aux ressortissants d’États étrangers, l’institution de la nationalité n’est pas nécessaire », et que « pour l’État au sens du droit international, il n’est pas essentiel d’avoir des nationaux mais seulement d’avoir des sujets, c’est-à-dire des individus vivant sur son territoire et auxquels l’ordre étatique impose des obligations et confère des droits »(134).
Votre rapporteur pense au contraire qu’un État a besoin de nationaux, et pas seulement de citoyens(135), que la nationalité, à la différence de la citoyenneté, ne se partage pas, et qu’il est urgent de revaloriser la nationalité en aménageant un droit de la nationalité qui est devenu « froid », étranger à la dimension affective, mémorielle et culturelle qui enveloppe le concept de nation depuis la fin du XIXe siècle.
C. UN DROIT FROID SANS RÉELLE PORTÉE POLITIQUE ET SYMBOLIQUE
Le temps est aujourd’hui passé où l’on pouvait, comme M. Marceau Long, affirmer que « la législation sur la nationalité a constitué un des moyens à la fois d’encourager et de consacrer le processus nécessaire de francisation » (136). Fort d’un riche passé, le droit de la nationalité a perdu depuis la fin du XXe siècle la dimension volontariste qui était la sienne, et la procédure de naturalisation le caractère régalien qui était le sien, tandis que certains de ses éléments, comme la déchéance de la nationalité, ont inutilement concentré l’attention.
1. La genèse du droit de la nationalité
Avant même d’envisager l’histoire du droit de la nationalité, son rattachement aléatoire au droit public ou au droit privé et son ancrage tantôt dans le droit du sang, tantôt dans le droit du sol, et tantôt dans les deux à la fois, il convient de présenter les postulats sur lesquels reposent précisément les notions de droit du sang et de droit du sol.
La distinction entre le droit du sang (jus sanguinis) et le droit du sol (jus soli) ne saurait être comprise avant que ne l’ait été celle entre l’attribution et l’acquisition de la nationalité.
La nationalité attribuée est la nationalité qui est conférée à la naissance par l’effet de la loi. La nationalité acquise est la nationalité qui est obtenue après la naissance, que ce soit à 13 ans, 16 ans, 18 ans, en raison du mariage ou par décision de l’autorité publique.
Les notions de droit du sang et de droit du sol pur se rattachent à l’attribution de la nationalité, et non à son acquisition. Le droit du sang réside dans la règle selon laquelle un enfant naît français parce qu’il a le sang d’un parent de nationalité française (père ou mère). Le droit du sol pur réside dans la règle selon laquelle un enfant naît français parce qu’il est né sur le sol français.
L’idée d’attribuer une nationalité à un enfant dès sa naissance parce qu’il est né d’un(e) national(e) trouve son fondement dans l’acculturation parentale des jeunes années. Parce qu’il est né d’un(e) français(e), l’enfant est présumé être élevé par ce(tte) français(e) dans ses primes années et s’imprégner ainsi de la langue et de la culture françaises. Mais la théorie du droit du sang rencontre deux limites. D’une part, lorsque la famille est établie à l’étranger, la filiation ne suffit plus à garantir la transmission de la langue et de la culture françaises au gré des générations (137). Et d’autre part, comme l’indiquait M. Marceau Long dans son rapport, cette théorie « confond l’appartenance à la nation avec l’appartenance à une ethnie », et « oublie que l’incidence de la filiation sur la nationalité se justifie davantage par l’éducation parentale que par la procréation » (138).
C’est la raison pour laquelle s’est développée la théorie du droit du sol. L’idée d’attribuer une nationalité à un enfant dès sa naissance parce qu’il est né sur le territoire national s’ancre dans le postulat selon lequel l’enfant, parce qu’il est né sur le sol national, va y résider au moins pendant ses premières années, y être scolarisé, et donc assimiler la langue et la culture nationales. La théorie du droit du sol a partie liée avec la résidence et la scolarisation.
En France, le droit du sol ne permet de se voir attribuer la nationalité française dès la naissance que s’il est « double », c’est-à-dire si l’enfant est né en France de parents étrangers dont l’un au moins est lui-même né en France. Si l’enfant est né en France de parents étrangers qui sont tous les deux nés à l’étranger, autrement dit si le droit du sol est simple, le droit du sol permet seulement d’acquérir la nationalité française, à la majorité ou de façon anticipée à 13 ou 16 ans.
Sous l’angle de la gestion de l’immigration et de l’intégration des étrangers, l’intérêt du droit du sol est plus marqué pour les pays d’immigration que pour les pays d’émigration. Un État d’immigration qui a besoin d’accroître sa population a intérêt à instaurer un droit de la nationalité ouvert. Un État d’immigration qui ne souhaite pas augmenter sa démographie a intérêt à restreindre les conditions d’acquisition de sa nationalité. À l’inverse, les États d’émigration, dont le souci est de conserver des liens avec leurs ressortissants par-delà les frontières et les générations, ont intérêt à privilégier le droit du sang, voire même à le renforcer par un principe d’allégeance perpétuelle interdisant à leurs nationaux de renoncer à leur nationalité lorsqu’ils en acquièrent une autre. Les grandes lignes de l’architecture du droit de la nationalité d’un État sont donc susceptibles d’avoir un lien avec ses choix en matière d’immigration, mais leur effet régulateur de l’immigration est beaucoup moins net et immédiat que les règles en matière d’entrée et de séjour des étrangers.
À la faveur de la mondialisation et du développement des flux migratoires, des États, qui jadis étaient des États d’émigration et sont aujourd’hui des États d’immigration, ont introduit dans leur droit de la nationalité, auparavant fondé sur le droit du sang, des éléments de droit du sol. Le cas le plus connu est celui de l’Allemagne (en 2000), mais on pourrait aussi citer l’Autriche, le Portugal ou, récemment, la Grèce (loi du 11 mars 2010).
a) Une branche du droit privé de l’Ancien Régime à 1927
La notion de « nationalité » n’étant apparue en France qu’en 1807, sous la plume de Madame de Staël, on ne peut guère parler d’un droit de la nationalité identifié comme tel sous l’Ancien Régime. Selon un auteur, « ce qui a certainement existé, c’est un ensemble de qualités, de conditions, permettant de séparer les nationaux des étrangers, les régnicoles des aubains »(139). Le régnicole désigne étymologiquement celui qui habite (colere) le royaume (regnum). L’aubain désigne la personne à l’égard de laquelle le roi de France peut exercer le droit d’aubaine, droit qui l’autorise à se saisir des biens d’un défunt étranger ne laissant en France aucun héritier français. En d’autres termes, sous l’Ancien Régime, la détermination de ceux qui ont ou non la qualité de Français (ou plus exactement de « régnicole ») importe essentiellement au regard du droit des successions.
Conçue comme étant un aspect du droit privé, la détermination de la nationalité a longtemps obéi à la règle selon laquelle il fallait être né en France de parents français et résider en France pour avoir la qualité de « régnicole ». Toutefois, dans un arrêt du 23 février 1515, le Parlement de Paris a assoupli cette règle et jugé qu’une personne née et résidant en France pouvait avoir la qualité de « régnicole » quand bien même ses parents étaient étrangers (140). D’une règle d’acquisition de la nationalité par le cumul de la filiation, de la naissance sur le sol et de la résidence sur le sol, mêlant droit du sang et droit du sol, on passait ainsi à une règle fondée sur le seul droit du sol mais exigeant à la fois la naissance et la résidence sur le sol français. La condition de naissance sur le sol français a été écartée par le Parlement de Paris, dans son arrêt Mabille du 7 septembre 1576 où il fut admis qu’une personne née à l’étranger de parents français avait la qualité de « régnicole » dès lors qu’elle résidait en France. La condition de naissance sur le sol français fut donc abandonnée au profit de la seule condition de résidence.
Comme M. Jean-Philippe Thiellay l’a rappelé devant la mission, il faut donc se défaire de l’idée, fausse, selon laquelle le droit du sol serait la marque d’un droit de la nationalité ouvert et progressiste tandis que le droit du sang serait celle d’un droit de la nationalité régressif et reposant sur des bases ethnicisantes. Le droit du sol a largement dominé le droit de l’Ancien Régime, et fut alors l’expression de la notion de « fief » et de l’idée que le souverain avait toute autorité sur les personnes nées sur son territoire (141).
M. Marceau Long soulignait, quant à lui, la dimension volontariste du droit de la nationalité sous l’Ancien Régime : selon lui, la notion de résidence ne correspondait à la notion objective de domicile réel, mais aussi à celle, subjective, d’intention de maintenir son domicile dans le royaume, qualifiée dans l’arrêt Mabille d’« espérance de ne point bouger »(142).
Savant mélange de droit du sang et de droit du sol au sein duquel ce dernier avait une place prépondérante(143), le droit de la nationalité apparaît à la veille de la Révolution française comme une branche du droit privé où la qualité de Français sert surtout à déterminer la reconnaissance de droits civils, patrimoniaux et successoraux.
Pendant la période révolutionnaire, le tumulte général jette le trouble sur les notions. Alors que la citoyenneté s’entend comme la participation, par le vote, à l’exercice de la souveraineté, la Constitution du 3 septembre 1791 présente comme des « citoyens » des personnes dont la qualité de Français ne suffit pas à leur conférer le droit de vote, la participation aux décisions politiques étant alors également soumise à la prestation d’un serment civique. S’ils désignent comme des citoyens ceux qui n’en sont pas, les articles 2 et suivants du titre II de cette Constitution qualifient également de « citoyens » ceux qui sont en fait des « nationaux », au sens où ils ont la qualité de Français. Par ailleurs, la situation était si confuse que la Constitution de 1791 admettait à la citoyenneté française tous les étrangers qui résidaient en France depuis au moins cinq ans, dès lors qu’ils prêtaient le serment civique ; l’Assemblée nationale reconnut même la qualité de citoyen Français à des étrangers qui n’avaient guère résidé en France, tels que George Washington(144). À une époque où la nation s’affranchissait de la personne du roi et de toute corporéité pour se hisser au rang de concept éminemment politique, la qualité de Français s’affranchit elle aussi des conditions de filiation ou de naissance et de résidence sur le sol pour n’être plus subordonnée qu’à l’adhésion partagée à des idées et à des valeurs. Le droit de la nationalité, si on peut le qualifier ainsi, paraît relever davantage de la chose publique et du droit public que du droit privé.
Mais cet intermède publiciste fut de courte durée puisqu’en 1804, la distinction est nettement opérée entre la citoyenneté d’une part, dont le contenu en termes de droits et de devoirs est défini dans la Constitution et paraît relever du droit public, et la nationalité d’autre part, dont les règles de détermination sont introduites dans le code civil et paraissent donc relever du droit privé. La détermination de la nationalité importe pourtant non seulement pour la reconnaissance des droits civils, mais aussi pour l’accomplissement des obligations militaires et l’exercice du droit de vote.
Ce retour du droit de la nationalité dans le champ du droit privé s’accompagne de l’affirmation triomphante du droit du sang comme règle de détermination de la nationalité, conformément aux vœux de Tronchet, mais contre l’avis de Napoléon Ier, dont l’intérêt pour la chose militaire et la taille de ses armées le portait à préférer le droit du sol (145). À l’époque, le droit du sang est perçu comme la marque d’un droit de la nationalité fondé sur le respect de l’individu et de ses libertés. Une personne peut avoir une nationalité même si elle ne naît pas dans le « fief » du souverain. Comme l’a fait remarquer l’historien Patrick Weil lors de son audition, la France « est le premier pays du monde à avoir fait de la transmission de la nationalité par la filiation le principal mode d’attribution de la qualité de « national », et « l’institution en 1804 de ce qu’on appellera plus tard le jus sanguinis (droit du sang) était une rupture avec le droit en vigueur à l’époque dans les pays européens, où prévalait le droit du sol », car « c’était la revendication de l’autonomie de l’individu et de la famille par rapport à l’État : la nationalité ne dépendait pas obligatoirement du lieu de naissance et était ainsi affranchie du pouvoir souverain dirigeant le pays »(146).
Le droit du sang a connu au XIXe siècle un rayonnement mondial proportionné à celui du code civil qui le consacrait : beaucoup de législations en Europe, en Asie et en Afrique l’ont adopté comme règle de détermination de la nationalité.
Mais, comme l’a expliqué le professeur Paul Lagarde lors de son audition, la prééminence du droit du sang, en vertu de laquelle il fallait naître de père français pour devenir français, conduisait à des situations qui étaient ressenties comme des injustices au XIXe siècle : le tirage au sort pour la conscription ne touchait que les Français alors que les personnes nées en France de père étranger y échappaient(147).
C’est la raison pour laquelle la loi du 7 février 1851 renoua avec le droit du sol en affirmant le principe du double droit du sol : naissait désormais français non seulement l’enfant qui était né d’un père français mais aussi celui qui était né en France d’un père étranger si ce dernier était lui-même né en France. Comme l’explique M. Marceau Long, « à l’époque il s’agit de soumettre aux obligations du service militaire les étrangers de la troisième génération […] dont on peut présumer qu’ils sont définitivement installés, sans esprit de retour, mais aussi intégrés » (148).
Toutefois l’enfant pouvait, à sa majorité, répudier la nationalité française qui lui avait été attribuée à raison de sa naissance en France. Cette exception finit par ruiner le principe. La faculté de répudiation fut en effet exercée massivement afin d’échapper à la conscription. La loi du 16 décembre 1874 qui subordonna la répudiation à la justification d’une nationalité étrangère ne suffit pas à endiguer le flot des répudiations, les intéressés recourant abondamment à des pièces de complaisance.
C’est la raison pour laquelle la loi sur la nationalité du 26 juin 1889 supprima la faculté de répudiation pour ne garder que le principe du double droit du sol, outre celui du droit du sang. Naissait ainsi français l’enfant qui était né en France de parents étrangers eux-mêmes nés en France. Toute répudiation de la nationalité française ainsi attribuée étant exclue, il n’y avait plus d’échappatoire possible au service militaire obligatoire.
Selon le professeur Paul Lagarde, le droit de la nationalité a ainsi évolué pour permettre à la France, après la défaite de 1871, de disposer de jeunes gens pouvant accomplir leur service militaire et préparer la revanche (149). Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si cette loi a été adoptée quelques jours avant celle du 15 juillet 1889 sur le service militaire. Le Conseil constitutionnel l’a bien compris, qui signale dans l’une de ses décisions que le législateur « n’a conféré un caractère absolu à cette règle [du double droit du sol] qu’en 1889, pour répondre notamment aux exigences de la conscription » (150).
En revanche, lors de son audition (151), l’historien Patrick Weil a soutenu que la loi du 26 juin 1889 visait bien moins à satisfaire les besoins de la conscription qu’à un souci de rétablir l’égalité de tous devant la loi en général et devant les obligations militaires en particulier. La loi du 26 juin 1889 reposerait donc moins sur des considérations d’ordre militaire que sur le principe d’égalité. Selon cet historien, dans les départements frontaliers et en Algérie (intégrée au territoire français depuis 1848), le privilège d’être enfant d’étrangers nourrissait un sentiment d’injustice car ces enfants échappaient à six ou huit ans de service militaire. Les parlementaires des départements frontaliers auraient revendiqué une modification du droit de la nationalité au nom de l’égalité des devoirs. Les parlementaires d’Algérie auraient également revendiqué une telle modification face aux risques d’irrédentisme que représentait l’accroissement démographique des étrangers nés en Algérie : on craignait alors qu’ils ne revendiquassent un rattachement à l’Espagne ou à l’Italie. La loi du 26 juin 1889 n’aurait donc pas été motivée par les besoins de la conscription : elle n’a tout au plus produit que deux mille nouveaux soldats. Elle aurait bien plutôt été adoptée au nom du principe d’égalité des droits et des devoirs.
Outre l’affermissement du double droit du sol, la loi du 26 juin 1889 a organisé le droit du sol simple qui permet aux enfants nés en France de parents nés à l’étranger d’acquérir la nationalité française à leur majorité. À l’option expresse en faveur de la nationalité française dans l’année suivant la majorité qui existait depuis 1804, la loi de 1889 a substitué une triple faculté d’option. La première option, expresse, pouvait être exercée dès la naissance de l’enfant en France, jusqu’à l’âge de 23 ans (ramené à 21 ans par la loi du 10 août 1927). La deuxième option, tacite, déduisait la manifestation de la volonté d’acquérir la nationalité française de la participation de l’intéressé aux opérations de recrutement. La troisième option, également tacite, présumait qu’avait opté pour la nationalité française la personne qui, née en France de parents étrangers nés à l’étranger, résidait encore en France à l’âge de 21 ans. En d’autres termes, alors que depuis 1804, l’acquisition de la nationalité française au titre de la naissance et de la résidence supposait une manifestation de volonté, elle était, sous l’empire de la loi de 1889, très largement présumée, la simple résidence ou la participation à la conscription étant assimilées à une manifestation de volonté.
En matière d’acquisition de la nationalité française par décision (à l’époque totalement discrétionnaire) de l’autorité publique, la loi créa « l’effet collectif » dans le cadre de la procédure de naturalisation qui, depuis le décret du 17 mars 1809, était régie par un texte distinct du code civil. L’effet collectif désigne le principe selon lequel la naturalisation individuelle d’un père (ou d’une mère) emporte automatiquement celle de ses enfants mineurs (152).
En matière d’acquisition de la nationalité française à raison du mariage, la loi de 1889 instaura l’acquisition automatique de la nationalité française pour l’étrangère qui épousait un Français et l’acquisition facultative de la nationalité française pour l’étranger qui épousait une Française.
Au total, la loi de 1889 a considérablement réduit la faculté de choisir entre la nationalité française et une nationalité étrangère : les enfants nés en France de parents étrangers nés en France étaient Français dès la naissance sans faculté de répudiation ; les enfants nés en France de parents étrangers nés à l’étranger devenaient presque tous tacitement Français à leur majorité, sauf s’ils revendiquent leur extranéité ; les enfants mineurs d’un naturalisé devenaient automatiquement Français, ainsi que l’épouse étrangère d’un Français.
Au tournant des années 1910 et 1920, la Première guerre mondiale et les besoins de la conscription aidant, le droit de la nationalité est de plus en plus regardé comme ayant partie liée aux intérêts fondamentaux et à la souveraineté du pays. En 1919, la Cour de cassation affirme que « les règles concernant l’acquisition de la nationalité française relèvent […] surtout du droit public »(153), et elle réitère sa position en 1921 en soulignant que « les règles relatives à l’acquisition et à la perte de la nationalité, bien qu’elles soient inscrites au code civil, relèvent du droit public »(154).
b) Une branche du droit public de 1927 à 1993
Le divorce entre le droit de la nationalité et le droit civil des personnes est consommé avec la loi du 10 août 1927 qui retire du code civil les dispositions relatives à la nationalité pour les placer dans un texte autonome.
Selon l’historien Patrick Weil(155), la loi du 10 août 1927 s’inscrit dans une politique de naturalisation massive pour les besoins de la démographie et de la conscription. Après l’hécatombe de la Première guerre mondiale, la condition de stage pour prétendre à la naturalisation fut abaissée de dix à trois ans pour « créer » chaque année 100 000 nouveaux Français et faire face à une Allemagne de plus en plus menaçante. Dans certains cas particuliers, la durée de séjour minimale à la date de la demande de naturalisation pouvait même être réduite à un an, voire écartée.
La loi de 1927 remplit si bien ses objectifs qu’entre 1927 et 1939, près d’un million de personnes acquirent la nationalité française dans un pays où, en 1930, près de 7 % de la population étaient étrangères (156).
La défiance succéda à la confiance. Dans un souci de défense des intérêts de l’État, et dans un esprit de méfiance à l’égard d’étrangers ou de « nouveaux » Français perçus comme de potentiels ennemis extérieurs mais aussi intérieurs, un décret-loi fut adopté le 12 novembre 1938 qui restreignit l’accès à la nationalité française, élargissant les cas de perte de la nationalité et créant de nouvelles incapacités pour les naturalisés.
Le régime de Vichy emboîta le pas en organisant la révision des naturalisations accordées depuis 1927 et en prononçant la déchéance de 15 000 personnes de la nationalité française, dont 6 000 Juifs (157).
En 1945, le texte autonome relatif à la nationalité prit le nom de « code de la nationalité ». L’ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité décrivait le droit de la nationalité comme une « véritable institution autonome qui, malgré sa place dans le code civil, appartient au droit public ». C’est d’ailleurs dans cette optique publiciste qui fait du droit de la nationalité un droit régalien que l’ordonnance de 1945 érigea l’existence de certaines condamnations pénales en obstacles à la naturalisation.
Durant la période qui suivit celle de la décolonisation, le droit de la nationalité resta perçu comme touchant aux intérêts fondamentaux d’un pays dont la puissance devenait moyenne et qui était soucieux d’entretenir son rayonnement.
Alors qu’une disposition prévoyait depuis 1804 que l’acquisition volontaire d’une nationalité étrangère entraînait la perte automatique de la nationalité française, la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 a modifié le code de la nationalité pour faire de cette perte une faculté, et non plus une obligation. Depuis, le droit de la nationalité est devenu totalement indifférent aux appartenances nationales multiples. En effet, aucune disposition n’interdit ni ne limite l’attribution de deux ou plusieurs nationalités à la naissance. Aucun texte n’impose de choix aux personnes ayant deux ou plusieurs nationalités, ni à la majorité ni à aucun autre moment de leur vie. L’acquisition d’une nationalité étrangère, qu’elle soit volontaire ou non, n’entraîne plus la perte automatique de la nationalité française. L’acquisition de la nationalité française par des étrangers, qu’elle soit de plein droit ou l’aboutissement d’une procédure de naturalisation, n’est subordonnée à aucune renonciation à la nationalité étrangère.
c) Le retour au droit privé depuis 1993
Dès 1973, le législateur a préparé le retour du droit de la nationalité dans le giron du droit civil. En effet, la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 a mis le droit de la nationalité en harmonie avec le droit civil en tirant toutes les conséquences du principe de l’égalité entre les hommes et les femmes, notamment pour l’exercice de l’autorité parentale, ainsi qu’entre les enfants légitimes et naturels (158).
La loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité a formellement opéré le retour du droit de la nationalité dans le champ du droit privé en insérant les dispositions relatives au droit de la nationalité dans le livre premier du code civil, relatif au droit des personnes, et plus précisément dans un titre I bis enchâssé entre le titre I décrivant les droits civils et le titre II régissant les actes de l’état civil.
Conformément aux recommandations de la Commission de la nationalité présidée par M. Marceau Long, la loi du 22 juillet 1993 a érigé la manifestation de volonté en une condition nécessaire à l’acquisition de la nationalité française au titre de la naissance et la résidence en France. Pour les enfants qui étaient nés en France de parents étrangers nés à l’étranger et ne bénéficiaient donc pas de l’attribution automatique de la nationalité française à la naissance par l’effet du double droit du sol, il fallait, s’ils souhaitaient acquérir la nationalité française, non seulement qu’ils résident en France depuis un certain nombre d’années mais en outre qu’ils en manifestent la volonté entre 16 et 21 ans (159).
La loi du 22 juillet 1993 a également restreint le double droit du sol pour les personnes nées en France dont les parents étaient nés en Algérie avant l’indépendance (160), et même supprimé l’application du double droit du sol pour les personnes nées en France de parents nés dans un ancien territoire d’outre-mer.
La loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité est revenue sur l’application restreinte du double droit du sol pour les personnes nées en France de parents nés en Algérie avant 1962 au profit d’une application pleine et entière, mais a maintenu la suppression du double droit du sol pour les personnes nées en France de parents nés dans un ancien territoire d’outre-mer.
Rompant avec la conception élective de la nation ainsi qu’avec la dimension volontariste du droit de la nationalité qui avait inspiré le code civil, la loi du 16 mars 1998 a supprimé la manifestation de volonté exigée depuis le 1er janvier 1994 des personnes qui étaient nées en France de parents étrangers nés à l’étranger et qui souhaitaient acquérir la nationalité française (161). Depuis le 1er septembre 1998, le droit du sol simple a retrouvé un caractère automatique : l’enfant né en France de parents étrangers nés à l’étranger acquiert automatiquement la nationalité française à sa majorité, sans avoir à en manifester la volonté dès lors qu’il réside en France à cette date et qu’il a eu sa résidence habituelle en France non pas pendant les cinq années qui précèdent sa majorité (de 13 à 18 ans), mais pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq années entre l’âge de 11 ans et de 18 ans.
Allant plus loin encore, la loi du 16 mars 1998 a permis à cet enfant de demander d’acquérir la nationalité française de façon anticipée : soit à 16 ans, de sa propre initiative, soit dès l’âge de 13 ans si ses parents en prennent l’initiative avec son consentement (162).
Les représentants du Haut conseil à l’intégration ont indiqué à la mission qu’en application de ce texte, environ 30 000 jeunes devenaient chaque année « automatiquement » français à leur majorité (163). Ainsi, en 2009, on a enregistré 23 000 demandes anticipées de la nationalité française et 2 300 acquisitions automatiques de la nationalité française, à la majorité.
La loi n° 2011-672 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, promulguée le 16 juin 2011, a amorcé un retour à la conception élective et volontariste du droit de la nationalité, notamment en exigeant des candidats à la naturalisation la connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises ainsi que la signature d’une charte des droits et des devoirs. L’article 21-24 du code civil tel que modifié par cette loi fait désormais expressément référence à l’« adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République », ce qui constitue une orientation extrêmement satisfaisante.
d) Les grands principes du droit de la nationalité en 2011
En 2011, le droit français de la nationalité repose à la fois sur le droit du sang, le double droit du sol et le droit du sol simple.
• En matière d’attribution de la nationalité
La nationalité française peut être attribuée dès la naissance en vertu du droit du sang ou par l’effet du double droit du sol.
Pour ce qui est du droit du sang, l’article 18 du code civil dispose qu’« est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ».
Toutefois, si un seul de ses parents est français et s’il n’est pas né en France, l’enfant peut répudier la nationalité française dans les six mois qui précèdent sa majorité et dans l’année qui la suit, sauf si le parent étranger ou apatride acquiert la nationalité française durant la minorité de l’enfant, auquel cas les deux parents seraient français (164).
Outre cette limite, il existe deux obstacles notoires à la répudiation. Dans le souci de prévenir l’apatridie, l’article 20-3 du code civil prévoit en effet que « nul ne peut répudier la nationalité française s’il ne prouve qu’il a par filiation la nationalité d’un pays étranger ». Dans un souci de préserver la souveraineté nationale, l’article 20-4 du même code dispose que « le Français qui contracte un engagement dans les armées françaises perd la faculté de répudiation ».
Pour ce qui est du double droit du sol, l’article 19-3 du code civil dispose qu’« est français l’enfant né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né ».
Toutefois, comme pour l’enfant né français par l’effet du droit du sang, si un seul de ses parents est né en France, l’enfant né français par l’effet du double droit du sol a la faculté de répudier la nationalité française dans les six mois qui précèdent sa majorité et dans l’année qui la suit, sauf si le parent étranger ou apatride acquiert la nationalité française durant la minorité de l’enfant (165).
Selon M. Marceau Long, la règle du double droit du sol s’explique par le fait qu’« on est en droit de supposer un enracinement réel lorsque deux générations successives naissent dans un même pays » (166).
Le double droit du sol existe aussi en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal et en Espagne.
À côté du double droit du sol, un droit du sol pur permet de se voir attribuer la nationalité française sans autre condition que la naissance sur le sol français dans trois cas exceptionnels : lorsque l’enfant est né en France de parents inconnus, lorsque l’enfant est né en France de parents apatrides et lorsque l’enfant est né en France de parents étrangers dont le statut personnel leur interdit de transmettre leur(s) nationalité(s) à leur enfant (167).
• En matière d’acquisition de la nationalité
Un étranger peut acquérir la nationalité française soit au titre de la naissance et de la résidence en France, soit en raison de son mariage avec un(e) ressortissant(e) français(e), soit en raison d’une décision de l’autorité publique au terme d’une procédure de naturalisation. Depuis 1973, l’acquisition de la nationalité française n’est plus subordonnée à la renonciation à la nationalité étrangère et n’entraîne donc plus automatiquement sa perte (168).
Pour ce qui est de l’acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France, elle correspond au droit du sol simple. L’article 21-7 du code civil prévoit que « tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence, et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans ».
En d’autres termes, alors qu’avant 1998, l’enfant né en France de parents étrangers nés à l’étranger devait manifester sa volonté d’acquérir la nationalité française à sa majorité et que la condition de résidence était appréciée sur la période fixe et continue des cinq années précédant sa demande, depuis 1998, il n’a plus à manifester sa volonté d’acquérir une nationalité qu’il acquiert automatiquement à sa majorité, et la condition de résidence est appréciée sur une période discontinue allant de 11 à 18 ans.
Toutefois, l’intéressé a la faculté de décliner la nationalité française ainsi acquise automatiquement dans les six mois qui précèdent sa majorité ou dans l’année qui la suit (169).
Mais il a aussi la faculté de demander la nationalité française par anticipation. Il peut le faire seul à partir de l’âge de 16 ans, dès lors qu’au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et qu’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans depuis ses 11 ans (170).
Il peut aussi le faire accompagné de ses parents dès l’âge de 13 ans. Dans ce cas, ce sont les parents qui ont l’initiative de la démarche et peuvent réclamer, au nom de leur enfant et avec son consentement, la nationalité française, dès lors que ce dernier a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue depuis l’âge de 8 ans (171).
Pour ce qui est de l’acquisition de la nationalité à raison du mariage, il ne saurait être question ici d’en détailler toutes les règles. Il suffit de retenir que « le mariage n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité » (172), que le conjoint étranger ou apatride d’un(e) ressortissant(e) français(e) doit donc, s’il souhaite acquérir la nationalité française, faire une déclaration après un délai de quatre à cinq ans à compter du mariage (173), et qu’on exige désormais de lui « une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française » (174).
Pour ce qui est de l’acquisition de la nationalité française par déclaration, il n’y a pas lieu non plus d’en décrire tout le régime. Il suffit de savoir qu’elle concerne notamment l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple (175), dépourvue d’effet sur la nationalité (176) ; l’enfant qui a été recueilli et élevé en France par un(e) Français(e) depuis au moins cinq ans (177), l’enfant qui, recueilli et élevé en France par un organisme public ou privé, a reçu une formation française pendant au moins cinq ans (178), et les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français pendant les dix années précédant leur déclaration (179).
Pour ce qui est enfin de l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique, elle fait l’objet d’amples développements relatifs à la procédure de naturalisation auxquels votre rapporteur vous renvoie (180).
Dans les cas d’acquisition de la nationalité française à raison du mariage ou d’une décision administrative, on notera que le gouvernement conserve un pouvoir d’opposition « pour indignité ou défaut d’assimilation, autre que linguistique » (181) ou en cas de fraude (182). C’est la marque du caractère éminemment régalien que doit avoir le droit de la nationalité. La réintégration par décret dans la nationalité française (183) et la déchéance de la nationalité française (184) constituent aujourd’hui les vestiges d’une conception régalienne de la nationalité qui en faisait une faveur à la discrétion de l’État.
*
* *
Contrairement à M. Jean-Philippe Thiellay qui a affirmé devant la mission que l’insertion du droit de la nationalité dans le code civil représentait à certains égards un acquis (185), votre rapporteur soutient que le droit de la nationalité, en tant que branche du droit public intimement liée à la souveraineté nationale et aux fonctions régaliennes de l’État, a toute sa place dans un code de la nationalité, distinct du code civil. Lors de son audition, l’essayiste Malika Sorel a d’ailleurs également préconisé la refonte du code de la nationalité (186).
L’insertion et le maintien des dispositions relatives à la nationalité dans le livre du code civil relatif au droit des personnes incitent en effet à penser que le droit de la nationalité se résume au statut personnel, qu’il se borne à la jouissance des droits civils, et qu’il fait même partie des droits que la personne peut invoquer à l’encontre de l’État. La jurisprudence internationale et, sous l’influence de cette dernière, la jurisprudence interne tendent à élargir progressivement le périmètre des droits fondamentaux, au point d’y inclure des droits civils. Peu à peu, on voit émerger l’idée qu’il puisse y avoir un droit à la nationalité (187), susceptible d’être opposé à un État dont le pouvoir souverain et régalien de désigner et choisir ses nationaux serait ainsi considérablement circonscrit, voire même réduit à néant. La place du droit de la nationalité dans le code civil ne fait qu’entretenir cette idée.
Cet avis est du reste partagé par M. Xavier Lemoine, maire de Montfermeil, qui a affirmé devant la mission que l’idée d’un droit à la nationalité était apparue en raison de la dilution du code de la nationalité dans le code civil (188). Depuis 1993, la nationalité se comprend davantage comme ce que les personnes peuvent en revendiquer, comme un statut dont on peut retirer passivement des avantages, que comme ce à quoi il faut se conformer. Selon le même élu, le droit de la nationalité a été désincarné au point que l’acquisition de la nationalité française ne fait que rajouter un ayant droit supplémentaire à une longue cohorte d’ayants droit.
C’est la raison pour laquelle votre rapporteur considérerait logique d’extraire les dispositions relatives à la nationalité du code civil pour les introduire dans un code de nationalité comme il en a existé un de 1945 à 1993.
Proposition n° 2 : Extraire les dispositions relatives à la nationalité du code civil pour les introduire dans un code de la nationalité.
L’élaboration d’un code distinct contribuerait à rappeler, ne serait-ce que symboliquement, qu’il n’y a pas de droit à la nationalité mais un droit de la nationalité. Ce droit de la nationalité traduit moins l’acquisition d’un statut personnel, de droits civils ou d’un droit fondamental opposable à l’État que l’adhésion à une nation, l’engagement dans un projet politique faisant primer l’intérêt général et la volonté générale, et le sentiment d’avoir une histoire et une mémoire communes.
2. La naturalisation : des procédures tendant parfois à ravaler l’acquisition de la nationalité au rang de formalité administrative
Ce jugement tient en premier lieu au constat, partagé par de nombreux observateurs, suivant lequel même indirectement, le contrôle croissant exercé par les juges concourt à la remise en cause du pouvoir discrétionnaire du Gouvernement, la naturalisation reposant sur des conditions qui présentent un caractère de plus en plus objectif.
Certes, la naturalisation relève toujours en principe du pouvoir discrétionnaire de l’État dans la mesure où le législateur fixe souverainement les conditions devant être remplies par les demandeurs. Ainsi, l’article 21-15 du code civil énonce qu’hormis le cas des étrangers engagés dans les armées françaises, blessés en mission au cours ou à l’occasion d’un engagement opérationnel et qui en font la demande 189, « l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Il appartient de surcroît à l’autorité administrative d’en apprécier le respect par l’examen des dossiers qui lui sont soumis (190). Tel est le principe consacré par la décision Abecassis rendue par le Conseil d’État, le 30 mars 1984. La plus haute juridiction administrative y affirme ainsi que le fait de remplir les différentes conditions de recevabilité « ne donne aucun droit à obtenir la naturalisation, laquelle constitue une faveur accordée par l’État français à un étranger ». Remarquons qu’il s’agit là d’une interprétation littérale des dispositions du code civil. Tout en prévoyant d’éventuelles dérogations à la condition de stage pour des individus justifiant des qualités particulières (au bénéfice par exemple de « l’étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel » (191)), la lettre même du code souligne que leur application ne constitue qu’une possibilité à la discrétion de l’autorité administrative, le plus souvent le ministre de la Défense ou le ministre des Affaires étrangères. En 2010, le nombre des naturalisations s’élevait à 65 364.
En revanche, l’absence d’un « droit à la naturalisation » ne signifie pas que la juridiction administrative s’estime incompétente pour exercer un contrôle des décisions rejetant une demande de naturalisation sur le fondement de l’erreur de droit, de l’erreur de fait, du détournement de pouvoir ou de l’erreur manifeste d’appréciation. Ainsi, dans l’arrêt Cajarville du 27 mai 1983, le Conseil d’État énonce-t-il que la règle dispensant de motivation les décisions de rejet des demandes de naturalisation ou de réintégration « ne fait pas obstacle au pouvoir du juge administratif d’exiger de l’administration qu’elle fasse connaître les raisons de fait et de droit sur lesquelles ont été fondées de telles décisions afin de vérifier si elles ne sont pas entachées d’erreur de droit ou de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir ».
L’obligation de motivation des décisions de rejet des demandes de naturalisation trouve aujourd’hui son fondement dans les dispositions prises par le législateur. Ainsi, la loi du 22 juillet 1993 (192) a posé le principe de la motivation de toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française. La loi du 16 mars 1998 (193) a pour sa part précisé ce que doivent être les motivations de l’administration rendues obligatoires par la loi du 22 juillet 1993 en renvoyant expressément aux obligations contenues dans la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public.
M. Michel Aubouin, directeur de l’accueil, de l’intégration et de la citoyenneté au ministère de l’Intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, a également attiré l’attention de la mission (194) sur le fait que la définition des critères d’opportunité (tels que le degré d’intégration à la communauté française) devait beaucoup à la jurisprudence du Conseil d’État, de la cour administrative d’appel de Nantes et du tribunal administratif de Nantes, seules juridictions spécialisées en ces matières.
Suivant certains auteurs, on assisterait même, à la faveur de l’introduction en droit interne des normes internationales visant à la protection des droits de l’homme, à un nouvel encadrement de la compétence discrétionnaire de l’État du fait de l’application de motifs de contrôle inédits.
Ces contrôles portent ainsi sur le respect des stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme relative au droit au procès équitable (article 6) et au droit au respect de la vie privée et familiale (article 8). Il existe ainsi des interrogations persistantes de la jurisprudence, notamment dans l’ordre juridique interne, quant au caractère applicable de l’article 6 de la CESDH aux procédures concernant les demandes d’acquisition de la nationalité.
Certes dans un arrêt M’ Baye rendu le 7 juillet 1995, le Conseil d’État avait semblé vouloir fermer cette voie en jugeant que l’article 6 de la Convention ne s’appliquait pas aux litiges relatifs à l’acquisition de la nationalité, ceux-ci n’ayant pas trait à des contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil. Mais à l’inverse, dans un arrêt de sa première chambre civile rendu le 22 février 2000, la Cour de cassation a accepté de vérifier le respect du droit au procès équitable dans un litige relatif à la conservation de la nationalité française.
Pour autant que l’on puisse en juger avec le recul nécessaire, la CEDH fait montre pour sa part de moins d’hésitation en la matière. L’atteste un arrêt Karassev contre Finlande du 12 janvier 1999, arrêt dans lequel la Cour affirme que « bien que le droit d’acquérir une nationalité ne soit garanti, comme tel, ni par la Convention ni par ses protocoles (…), elle n’exclut pas qu’un refus arbitraire de nationalité puisse, dans certaines conditions, poser un problème sous l’angle de l’article 8 de la Convention en raison de l’impact d’un tel refus sur la vie privée de l’intéressé ». Dans l’arrêt Koua Poirrez contre France (195), la CEDH ne décèle aucune apparence de violation de l’article 6 de la Convention dans le cadre de la procédure relative à la demande de nationalité.
En second lieu, l’acquisition de la nationalité française par naturalisation s’assimile parfois d’autant mieux à une formalité administrative que la dimension procédurale occulte souvent le fond et l’enjeu même de la requête présentée par le demandeur.
Ici se pose la question du déroulement et de la mise en œuvre pratique des procédures, des délais et demandes de pièces supplémentaires qui peuvent être opposés aux requérants.
Certes, la déconcentration de la procédure d’examen des dossiers de naturalisation depuis le 1er juillet 2010 semble contribuer à une réduction globale des délais sans remise en cause de l’égalité de traitement, d’après les éléments que la mission a pu recueillir auprès des représentants des administrations intervenant dans la procédure de naturalisation (196).
Dans le cadre de cette nouvelle procédure, objet d’une expérimentation de six mois menée dans 21 départements à compter du 1er janvier 2010 et généralisée par le décret du 29 juin 2010 (197), les décisions de naturalisation relèvent d’un décret pris par le Premier ministre, sur rapport du ministre en charge des naturalisations et sur proposition des préfets. Les décisions défavorables sont prises par les préfets mais systématiquement transmises à l’administration centrale afin que le ministre puisse, autant que de besoin, exercer son pouvoir hiérarchique. Les préfets peuvent également prononcer l’ajournement en imposant des délais ou des conditions. En application de l’article 7 du décret précité, les demandeurs doivent former un recours gracieux auprès du ministre dans les deux mois suivant la notification d’une décision négative. Ce recours doit être préalable à tout recours contentieux.
D’après les premiers éléments d’évaluation (198), on observe une réduction significative des délais, le délai moyen de traitement des décisions passant de 11 mois en 2009 à 6,5 mois en 2010. Les chiffres disponibles semblent par ailleurs indiquer un maintien de l’homogénéité de traitement dans la mesure où le taux de réformation moyen des décisions préfectorales ne s’élève qu’à 5 % et que l’équilibre entre les décisions favorables et défavorables apparaît relativement constant puisque l’écart moyen entre 2010 et 2009 se réduit à 7 %. Plus précisément, suivant les chiffres dont a fait état M. Laurent Audinet, sous-directeur de l’accès à la nationalité française au ministère de l’Intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration (199), 65 000 décisions ont été prises en 2010. Sur les quelque 4 000 recours administratifs préalables obligatoires intentés au cours de cet exercice, 65 % ont conduit à une confirmation des décisions préfectorales par l’administration centrale, 14 % à une confirmation avec substitution de motifs, 17 % à une infirmation pure et simple, et les 4 % restants à des rejets pour défaut de motivation ou caractère tardif. Or, avant la réforme, environ 44 % des quelque 35 000 recours gracieux aboutissaient à une réformation de la décision préfectorale favorable ou défavorable par l’administration centrale. On peut supposer que cette évolution reflète une amélioration assez nette de la qualité de la motivation des décisions rendues par les préfectures.
De fait, la sous-direction de l’accès à la nationalité française (SDANF) a reçu près de 4 000 recours pour environ 17 500 décisions défavorables en 2010, soit un taux de recours de 23 % alors que le taux de recours gracieux s’élevait en 2009 à près de 55 % et, dans 50 % des cas, conduisait à une réformation de la décision. S’agissant du contentieux, la SDANF avait reçu, au 31 décembre 2010, 373 recours portant sur les 17 500 décisions défavorables prises en 2010, soit un taux de recours contentieux s’établissant à 2 % du total des décisions, taux à comparer avec la proportion de 10 % relevée au cours des exercices précédents.
Ces résultats, globalement satisfaisants, tiennent sans doute pour beaucoup aux mesures d’accompagnement de la déconcentration.
D’une part, durant toute la phase expérimentale de cette réforme dont l’achèvement est fixé à l’été 2011, l’administration centrale continue de contrôler systématiquement toutes les décisions prises au niveau préfectoral afin de mesurer la capacité des préfectures à appliquer correctement la législation et la jurisprudence en matière d’acquisition de la nationalité française.
D’autre part, la mise en œuvre progressive de la déconcentration donne lieu à un travail de soutien pédagogique et d’assistance des préfectures.
En effet, en cas de divergence entre la décision des préfectures et celle de l’administration centrale, les agents préfectoraux sont contactés afin que soient clarifiés et aplanis les points de désaccord et que leur soient expliquées la législation et la jurisprudence applicables en la matière. En cas de difficultés dans l’examen d’un dossier, les agents préfectoraux consultent de plus en plus souvent la sous-direction de l’accès à la nationalité française par téléphone avant de prendre leur décision. Enfin, le soutien apporté aux préfectures se traduit par une importante séquence de formation destinée à couvrir l’ensemble des départements français. Ces formations doivent apporter à l’ensemble des agents instructeurs des préfectures les outils de connaissance nécessaires à l’application autonome de la procédure. Il a également été institué par la sous-direction de l’accès à la nationalité française un suivi territorial grâce au déploiement d’agents de l’administration centrale désignés comme correspondants dans les préfectures et chargés d’appuyer les agents préfectoraux sur toutes les questions complexes relatives aux demandes de naturalisation. Des séances d’information sur les difficultés rencontrées et les questions nouvelles sont du reste régulièrement organisées, notamment par le biais de la généralisation des visioconférences.
Lorsque les préfectures auront gagné en autonomie, il sera mis en place un système de contrôle de gestion avec des prélèvements de dossiers qui permettront de vérifier que les règles sont correctement appliquées.
Les succès rencontrés par un dispositif connaissant une montée en charge progressive ne sauraient toutefois dissimuler des problèmes persistants observés par les acteurs de terrains.
Des éléments d’expertise rendus publics par la direction de l’accueil, de l’intégration et de la citoyenneté, il ressort en premier lieu qu’un certain nombre de sous-préfectures rencontrent des difficultés, soit dans leurs relations avec leur préfecture (notamment pour obtenir des informations), soit en raison de la faiblesse des moyens affectés au traitement des demandes de naturalisation du fait d’effectifs réduits ou de l’absence d’encadrement intermédiaire. S’y ajoute une demande de formation récurrente, laquelle s’explique par divers facteurs : les agents n’ont pas bénéficié des formations organisées dans le cadre du dispositif expérimental ou dans celui de la généralisation de la procédure déconcentrée (ce serait notamment le cas des agents des sous-préfectures) ; des effectifs ont connu un roulement important au cours de l’exercice 2010 ; des compléments de formation se révélaient nécessaires.
En second lieu, il s’avère que des disparités persistent à l’échelle du territoire du point de vue du déroulement de la procédure et des délais de traitement des dossiers. Il en va tout particulièrement ainsi dans certains départements tels que celui de Seine-Saint-Denis. Celui-ci compte pour près de 10 % du nombre total des naturalisations octroyées en 2010 alors qu’il n’accueille que 2,5 % de la population nationale. D’après les éléments communiqués au cours la visite de la mission par M. Christian Lambert, préfet de la Seine-Saint-Denis (200), le délai moyen de traitement des dossiers oscillait, en 2010, dans une fourchette de 9 à 14 mois à compter de la date de la première convocation. Il ressort également de l’état des lieux dressé par M. Lambert que ce délai moyen peut varier à l’échelle même du département pour des raisons liées aux locaux et aux effectifs. Cette différence s’observe entre les sous-préfectures de Saint-Denis et celle du Raincy, le délai moyen de traitement étant plus court dans la seconde que dans la première.
Or, du point de vue de l’égalité de traitement sur l’ensemble du territoire, la question des délais, donc de l’affectation optimale des ressources humaines et des moyens matériels revêt une importance indéniable. La comparaison établie par le préfet Lambert entre le département dont il assume la responsabilité et Paris apparaît de ce point de vue significative du caractère parfois inégal de leur répartition. Ainsi, alors qu’elle ne traite qu’un nombre de demandes supérieur de 15 % à celui traité en Seine-Saint-Denis, la préfecture de police de Paris compte par ailleurs des effectifs affectés à cette tâche supérieurs de 30 %. Même si cette situation s’explique par des réalités locales liées notamment au statut particulier de la préfecture de police de Paris, le constat ainsi établi sur l’inégalité des moyens entre préfectures ne dément pas d’autres signalements obtenus par les membres de la mission quant à l’amplitude des délais de traitement relevée ailleurs en France.
Aussi, la mission ne peut qu’encourager la poursuite des efforts de soutien apporté aux préfectures en vue de l’achèvement de la procédure de déconcentration. Les difficultés auxquelles il convient bien entendu de remédier ne sauraient toutefois conduire à une remise en cause du principe même de cette réforme dont les premiers résultats apparaissent prometteurs en termes de réduction des délais et de simplification administrative.
3. La déchéance de la nationalité : une attribution régalienne bientôt résiduelle ?
Procédure permettant au Gouvernement de retirer, par un acte de puissance publique, la qualité de national à l’un de ses ressortissants, la déchéance de la nationalité française représente en effet un vestige à bien des égards menacé de la compétence souveraine des États en droit de la nationalité.
Historiquement, la déchéance se présente comme une mesure destinée à sanctionner l’indignité, l’atteinte à l’ordre public ou le manque de loyalisme des étrangers devenus nationaux mais également des nationaux par filiation. Cette conception a de fait inspiré l’ensemble des textes relatifs au droit de la nationalité en France depuis la Révolution de 1789. La Constitution du 3 septembre 1791 en fournit une première illustration en disposant que « la qualité de citoyen français se perd :
1° par la naturalisation en pays étranger ;
2° par la condamnation aux peines qui emportent la dégradation civique, tant que le condamné n’est pas réhabilité ;
3° par un jugement de contumace, tant que le jugement n’est pas anéanti ;
4° par l’affiliation à tout ordre de chevalerie étranger ou à toute corporation étrangère qui supposerait, soit les preuves de noblesse, soit des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux religieux ».
On pourrait également citer les décrets des 27 avril et 3 mai 1848 aux termes desquels pouvait perdre sa nationalité toute personne s’étant vu attribuer ou ayant acquis la qualité de Français dès lors qu’elle se livrait au commerce des esclaves.
De ce point de vue, les lois du 7 avril 1915 et du 18 juin 1917 auront marqué un tournant puisque, depuis lors, la déchéance ne remet potentiellement en cause que la nationalité des seuls naturalisés. Pérennisant les dispositions adoptées au cours du premier conflit mondial, la loi du 10 août 1927 a défini trois motifs généraux de déchéance :
– l’atteinte à la sûreté de l’État ;
– des actes incompatibles avec la qualité de Français commis au profit d’un État étranger ;
– le fait de se soustraire aux obligations militaires.
A ceux-ci a été ajoutée, en application du décret-loi du 12 novembre 1938 (201), la condamnation pour crimes et délits punis par une peine d’au moins un an d’emprisonnement.
C’est sur le fondement de ces règles, reprises par l’ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 et la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, que repose aujourd’hui, dans la quasi-intégralité de leur substance, le dispositif fixé aux articles 25 et 25-1 du code civil.
Ainsi, suivant l’article 25, « l'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'État, être déchu de la nationalité française :
1° s'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ;
2° s'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;
3° s'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ;
4° s'il s'est livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France.
En raison même du caractère limitatif des cas qu’il énumère, l’article 25 du code civil fait nécessairement de la déchéance une mesure d’application très exceptionnelle. De fait, on ne dénombre que sept mesures de déchéances depuis 1998 (202) . On remarquera toutefois que ce chiffre n’apparaît guère plus élevé que celui des déchéances prononcées entre 1927 et 1940, soit 16 déchéances pour plus de 250 000 naturalisations d’après les statistiques dont a fait état devant la mission(203) M. Patrick Weil.
Du point de vue de votre rapporteur, on peut y voir la manifestation la plus tangible d’une évolution majeure du droit de la nationalité : celle qui, depuis 1945 et au fil d’encadrements successifs, tend à restreindre le pouvoir souverain d’appréciation dont l’État a pu disposer et à faire de la déchéance une procédure répondant moins à des considérations d’ordre politique qu’à des motifs objectivés en droit.
En effet, l’exercice du pouvoir régalien se heurte en cette matière à un ensemble de règles qui, tant au plan international que national, contraint sa mise en œuvre.
Au plan international, ces contraintes résultent de l’adoption de conventions qui, quoique de force inégale, imposent aux États des principes limitant la libre définition du droit de la nationalité.
Cet encadrement tient en premier lieu à la consécration de ce qu’une partie de la doctrine qualifie de « droit à la nationalité ».
Ainsi, suivant l’analyse développée dans la thèse de Mme Amélie Dionisi-Peyrusse(204), sans nécessairement créer des obligations explicites et réelles à la charge des États, le droit international tend à considérer la jouissance d’une nationalité comme un droit de l’homme dont les individus pourraient – au moins théoriquement – se prévaloir. Il en va ainsi de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, laquelle affirme en son article 15 : « Tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité ».
Bien davantage, l’exercice du pouvoir de retirer leur nationalité à certains de leurs ressortissants apparaît en second lieu, pour la France comme pour de nombreux États, conditionné au respect des règles visant à réduire les cas d’apatridie.
Tel est notamment le cas, suivant les explications fournies aux membres de la mission par M. Philippe Leclerc, représentant du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (205), dans le cadre de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie conclue aux Nations unies, le 30 août 1961. Les articles 6 et 7-1-a du texte subordonnent en effet la perte de la nationalité (article 6) ou la renonciation à la nationalité (article 7-1-a) à la garantie de l’obtention d’une autre nationalité. La convention affirme également que la seule résidence à l’étranger ou le non-enregistrement auprès des autorités consulaires ne suffit pas à déchoir un individu de sa nationalité, sauf naturalisation. De surcroît, les articles 8 et 9 présentent la privation de nationalité comme devant être une mesure de caractère exceptionnel. L’article 8-4 prévoit pour sa part qu’un État ne fera usage de la faculté de priver un individu de sa nationalité que conformément à la législation de l’État, l’article 9 excluant que la déchéance puisse intervenir à l’égard d’un individu ou d’un groupe d’individus « pour des raisons d’ordre racial, ethnique, religieux ou politique ».
D’autres conventions et accords internationaux ou régionaux ont depuis réaffirmé l’objectif de la réduction voire de l’élimination de toute cause engendrant l’apatridie : la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (21 décembre 1965) ; le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (16 décembre 1966) ; la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (18 décembre 1979) ; la Convention internationale des droits de l’enfant (20 décembre 1989) ; la Convention européenne sur la nationalité du Conseil de l’Europe (6 novembre 1997) ; la recommandation sur la prévention et la réduction des cas d’apatridie du Comité des ministres des États membres du Conseil de l’Europe (15 septembre 1999).
Or, la consécration de l’objectif de la réduction voire de l’élimination des cas d’apatridie ne manque pas en soi de battre en brèche la conception d’une nationalité dont l’obtention relève d’un choix politique et souverain des États.
Ainsi, la Convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997 précitée énumère-t-elle très strictement les motifs de déchéance, posant à l’article 7 une interdiction de principe suivant laquelle « un État partie ne peut prévoir dans son droit interne la perte de la nationalité de plein droit ou à son initiative, sauf dans les cas suivants :
– l’acquisition volontaire d'une autre nationalité ;
– l’acquisition de la nationalité de l'État Partie à la suite d'une conduite frauduleuse, par fausse information ou par dissimulation d'un fait pertinent de la part du requérant ;
– l’engagement volontaire dans des forces militaires étrangères ;
– un comportement portant un préjudice grave aux intérêts essentiels de l'État Partie ;
– l’absence de tout lien effectif entre l'État partie et un ressortissant qui réside habituellement à l'étranger ;
– lorsqu'il est établi, pendant la minorité d'un enfant, que les conditions prévues par le droit interne ayant entraîné l'acquisition de plein droit de la nationalité de l'État Partie ne sont plus remplies ;
– l’adoption d'un enfant lorsque celui-ci acquiert ou possède la nationalité étrangère de l'un ou de ses deux parents adoptifs.
Dans ce contexte, même si la France a signé mais n’a pas ratifié certains de ces textes et notamment la Convention du 30 août 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, la protection contre l’apatridie constitue néanmoins en droit interne un principe dont la primauté conduit à écarter le recours à la déchéance et, par suite, lui ôte beaucoup de sa portée.
Ce constat tient à la lettre même de l’article 25 du code civil. Celui-ci non seulement subordonne la possibilité d’une déchéance à la condamnation pour l’un des actes ou l’une des infractions énumérés par le texte mais encore, depuis la loi n° 98-170 du 16 mars 1998, l’exclut « si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride ».
Au plan strictement national, outre la protection de l’apatridie, il convient de souligner l’importance des règles de droit interne encadrant la privation de la nationalité.
Il s’agit d’une part du dispositif de l’article 25-1 du code civil, lequel limite strictement la période pendant laquelle l’État peut priver un ressortissant de la nationalité française à compter de la date de son acquisition. En effet, « la déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition ; elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits ». En cas de condamnation pour un acte qualifié de « crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation » ou « pour un crime ou délit constituant un acte de terrorisme », la déchéance peut être prononcée dans un délai de quinze ans à compter de l’acquisition de la nationalité ou de la commission des infractions.
Il s’agit d’autre part des principes dégagés par le Conseil constitutionnel dans la décision du 16 juillet 1996 relative à la loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire (206). Même si en l’espèce, le Conseil a jugé conforme aux normes constitutionnelles et, en particulier, à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la déchéance de nationalité pour les auteurs d’actes de terrorisme, il n’en ressort pas moins de cette décision l’énoncé de règles limitant strictement le recours à ce type de procédure. Ainsi que l’a souligné M. Jean-Philippe Thiellay (207), le Conseil a affirmé que par principe, les personnes ayant acquis la nationalité française se trouvaient dans la même situation juridique que celles s’étant vu attribuer à leur naissance cette qualité. Or, le Conseil ne semble tenir une différence de traitement pour admissible que dans la mesure où celle-ci permet d’atteindre des objectifs d’intérêt général très précisément établis tels qu’en l’espèce, la répression des actes terroristes. De fait, cette jurisprudence comporte des incertitudes qui peuvent conduire, à l’exemple de M. le professeur Hugues Fulchiron, président de l’Université Jean Moulin Lyon III, à s’interroger sur les risques d’une éventuelle déclaration d’inconstitutionnalité à l’encontre d’un texte qui étendrait excessivement le nombre des infractions susceptibles de motiver une déchéance de la nationalité française.
Dans ces conditions, il s’avère que le recours à la déchéance de la nationalité constitue une procédure dont l’usage doit être précautionneux. Chacun peut, d’un point de vue général, légitimement considérer – et sans doute se féliciter – de l’existence d’un tel encadrement dans la mesure où cette évolution participe de l’affermissement de l’État de droit. À l’aune du seul droit de la nationalité, on peut en revanche penser que l’objectivisation des motifs de déchéance concourt tout autant à l’affaiblissement d’une certaine conception du rôle de la puissance publique dans la détermination des nationaux.
Or, aux yeux de votre rapporteur, cet affaiblissement porte en lui le risque d’une potentielle altération du lien non seulement juridique mais privilégié et singulier que doivent entretenir un État et ses ressortissants, suivant une logique que l’on peut mesurer dans le cadre des procédures de naturalisation.
*
* *
Dans l’un de ses articles, le professeur Hugues Fulchiron a mis en exergue « l’émergence de nouveaux liens d’appartenance » et mis en garde contre « la montée en puissance de telles appartenances [qui] met en péril le cadre traditionnel de l’État-nation en vidant le concept de nationalité de sa substance » (208). Plus récemment, Mme Amélie Dionisi-Peyrusse, dans son Essai sur une nouvelle conception de la nationalité, a également constaté que « la revendication grandissante du droit au respect de l’identité à travers la reconnaissance d’une appartenance à un groupe ne renforce pas le lien de nationalité », mais qu’« au contraire, elle apparaît comme une source de déstabilisation de la nationalité par la concurrence d’autres appartenances collectives, infra ou supra-étatiques » (209).
Lors de son audition, l’essayiste Malika Sorel a souligné qu’alors que l’intégration des précédents vagues d’immigration s’effectuait progressivement, on observait aujourd’hui une dégradation continue de cette intégration dans le temps (210). Ce refus du mimétisme traduit l’incapacité de la nation à jouer le rôle intégrateur et fédérateur qui était le sien du temps où elle était un creuset. Selon Mme Malika Sorel, les migrants européens avaient jadis une identité qui plongeait ses racines dans le même patrimoine culturel que les Français : antiquité gréco-romaine, christianisme, Renaissance, Siècle des Lumières…
Aujourd’hui, la distance culturelle est plus grande, l’immigration s’apparente de plus en plus à un phénomène de diasporas où les peuples gardent un sentiment de leur unité malgré leur éclatement géographique, et l’appropriation des codes socioculturels est, par la force des choses, plus longue, plus difficile et plus conflictuelle.
La multiplication des cas de plurinationalité est l’expression de la résistance croissante des nouvelles vagues d’immigrés qui ont une propension à faire de leur nationalité initiale le vecteur de leur attachement au pays d’origine alors que ce rôle revient en principe aux pratiques culturelles. Au début des années 2000, un auteur a ainsi fait remarquer qu’« on comptait en 1950 deux millions de binationaux répartis par moitié entre Français d’attribution et d’acquisition », et que « trente ans plus tard, le chiffre a été multiplié par trois » (211).
Face à cette résistance, la nation a vu sa vertu intégratrice s’émousser, et le droit de la nationalité, privé de toute coloration nationale, est aujourd’hui aseptisé. Alors que la nationalité confère en principe à celui qui l’acquiert le statut d’architecte du projet politique collectif, votre rapporteur constate, avec Mme Malika Sorel, que, de nos jours, celle-ci est parfois accordée au début du processus d’intégration alors que son issue n’est pas prédictible (212).
Comme l’a noté Mme France Guérin-Pace, directrice de recherche à l’Institut national d’études démographiques (INED), lors de son audition du 17 novembre 2010, on peut en effet se demander si l’acquisition de la nationalité au début ou en cours de processus d’intégration peut renforcer le sentiment d’appartenance nationale et contribuer à achever le processus d’intégration, ou si, à l’inverse, elle doit intervenir uniquement à l’issue d’un parcours d’intégration qui attesterait de la bonne intégration dans la communauté nationale et dont elle constituerait ainsi l’achèvement et la consécration (213).
Votre rapporteur s’accorde avec Mme Malika Sorel pour dire que la nationalité ne doit désormais être octroyée qu’à l’issue du processus d’intégration, lorsque ce dernier a réussi et s’est conclu par l’assimilation (214). On peut en effet douter que des étrangers qui n’ont pas réussi leur parcours d’intégration ou ne l’ont pas même entamé, puissent nécessairement s’accorder avec les Français sur le contenu des valeurs fondant la nation (liberté individuelle, égalité, notamment entre les hommes et les femmes, laïcité). Selon Mme Malika Sorel, la personne qui acquiert trop tôt la nationalité et reçoit ainsi le sésame des documents d’identité français, risque ne plus jamais s’astreindre à aucun effort pour ne serait-ce que respecter les règles du bien-vivre ensemble.
Après de longs débats, l’Allemagne a d’ailleurs fait le choix de n’octroyer sa nationalité qu’au terme du parcours d’intégration. Lors du déplacement de la mission à Berlin, M. Ole Schröder, secrétaire d’État parlementaire au ministère fédéral de l’Intérieur a en effet indiqué que le gouvernement allemand actuel considérait que la naturalisation devait être le couronnement, et non l’étape préalable, du processus d’intégration (215).
Octroyer la nationalité française à une personne uniquement lorsque son parcours d’intégration est suffisamment avancé pour que l’on soit assuré de sa volonté d’appartenir à la nation suppose, d’une part, que soient réaffirmés la liberté de l’État de choisir ses nationaux et, par là même, le caractère régalien de la procédure de naturalisation, et, d’autre part, que soit mise en œuvre une conception volontariste du droit de la nationalité rendant à la notion de nationalité le corps et l’âme dont la citoyenneté diffuse, la mondialisation et les appartenances multiples l’ont privée.
II. POUR UNE NATIONALITÉ DOTÉE D’UN SUPPLÉMENT D’ÂME
À une époque où, comme l’ont fait remarquer certains orateurs, les expressions « Français de papier » et « Français de souche » sont bien plus que des mots (216), doter la nationalité d’un supplément d’âme témoigne de l’ambition d’abolir la distinction entre ceux qui ont la nationalité française et ceux qui sont français. Poursuivre l’écriture du « roman national » exige que soit mieux assumée l’adhésion à la nation, que soit valorisée l’entrée dans la nationalité et que l’allégeance soit choisie plutôt que subie.
A. FAVORISER UNE ADHÉSION MIEUX ASSUMÉE
Pour les personnes qui se voient attribuer la nationalité française dès la naissance ou qui l’acquièrent à raison de leur naissance et de leur résidence en France, votre rapporteur propose de favoriser une adhésion mieux assumée à la nationalité française qui, sans remettre en cause le droit du sol ni exiger une prestation de serment, passerait par des solutions nationales aux problèmes spécifiques de la Guyane et de Mayotte, par l’institution d’une obligation générale de manifestation de volonté d’appartenir à la nation française pour tous les Français, quel que soit le mode d’attribution ou d’acquisition de la nationalité française, et enfin par la valorisation du service civique.
1. L’automaticité du droit du sol : une règle dont l’application est parfois problématique
Lors de leur audition par la mission (217), les représentants du Haut conseil à l’intégration ont fait part de leurs interrogations sur la pertinence de l’acquisition automatique de la nationalité française par l’effet du droit du sol, dans la mesure où l’école tend à perdre le rôle d’intégration qui était jadis le sien sous la IIIe République.
Toutefois, M. Pierre Mazeaud a d’emblée mis en garde la mission contre toute remise en cause du droit du sol (218). Attaché depuis longtemps à une conception généreuse de la nationalité, M. Pierre Mazeaud a appelé à garder le droit du sol comme fondement de notre droit de la nationalité et à ne pas en limiter l’application par des restrictions et exceptions diverses.
Pourtant on sait aujourd’hui que l’application stricte du droit du sol s’avère problématique dans certains départements d’outre-mer où l’immigration clandestine est particulièrement forte, comme en Guyane ou à Mayotte (219). Si une solution constitutionnelle paraît incertaine, il n’en reste pas moins que des pistes doivent être tracées, allant dans le sens d’une meilleure régulation de l’accès à la nationalité française dans ces départements d’outre-mer.
a) Les problèmes mahorais et guyanais
En 2008, la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation du Sénat a créé une mission d’information sur l’immigration clandestine à Mayotte, dont le sénateur Henri Torre a été rapporteur (220).
D’après le rapport d’information du sénateur Henri Torre, le secrétaire d’État à l’outre-mer estimait alors que la population mahoraise était composée d’environ un tiers d’immigrés clandestins, soit entre 50 000 et 55 000 clandestins, ce qui correspondait approximativement à l’estimation qui lui avait été fournie par le commandant de la gendarmerie de Mayotte (221). Du reste, le recensement effectué par l’Institut national de la statistique et des études économiques en 2002 évaluait le nombre d’étrangers à Mayotte à 55 300, sur une population totale de 160 300 personnes, soit environ 34,5 % de la population de l’île. En 2008, M. Christian Estrosi, secrétaire d’État à l’outre-mer, avait indiqué que 30 % de la population de Mayotte étaient composés de clandestins et que d’ici dix ans, cette population irrégulière pourrait devenir majoritaire par rapport à la population franco-mahoraise (222).
Le sénateur Henri Torre estimait à 16 000 le nombre de clandestins qui, chaque année, arrivaient à Mayotte : ce chiffre était, certes, l’équivalent du nombre annuel de personnes éloignées, mais il indiquait aussi que, chaque année, l’équivalent de 10 % de la population totale de Mayotte tentait de s’installer sur l’île illégalement (223). Le sénateur affirmait que ces clandestins étaient en grande majorité des Comoriens, ayant fait la traversée de nuit depuis Anjouan, à bord d’embarcations de fortune connues sous le nom de kwassa kwassa. Ces derniers représentent d’ailleurs plus de 95 % de la population étrangère présente sur l’île (224). Mais la police aux frontières de Mayotte lui avait également signalé que des migrants clandestins originaires de Madagascar, de Tanzanie, et parfois d’Irak transitaient par les Comores pour gagner Mayotte (225).
Rares étaient néanmoins les clandestins qui séjournaient durablement sur le territoire. Le nombre élevé de mesures d’éloignement (environ 16 000 par an) montrait que la lutte contre l’immigration clandestine n’était pas dénuée d’effets. Mais ces mesures ne suffisaient toutefois pas à réduire le nombre d’étrangers en situation irrégulière sur le territoire mahorais, et notamment à prévenir les récidives : environ 25 % des clandestins étaient des récidivistes (226).
Ce n’est pas pour autant que le nombre de régularisations et de naturalisations était élevé. D’après le sénateur Henri Torre, sur 7 615 demandes de cartes de séjour satisfaites en 2007, 4 800 étaient des cartes de séjour temporaire, délivrées en majorité dans le cadre d’un renouvellement, et seulement 174 étaient des cartes de résident (227). En matière de naturalisations, si la moyenne du nombre annuel de demandes était d’environ 200, les services préfectoraux indiquaient donner un avis défavorable à la naturalisation dans plus de 95 % des cas, et la grande majorité des décisions préfectorales étaient confirmées par l’administration centrale du ministère de l’Intérieur. Dans les réponses faites au questionnaire adressé à la délégation générale à l’outre-mer, il a été précisé qu’en 2010, on avait compté 302 demandes de naturalisation dont 98 % émanaient de Comoriens, et dont seulement 56 % avaient reçu un avis défavorable.
Les avis défavorables à la naturalisation se fondaient soit sur l’absence de maîtrise de la langue française, soit sur la précarité de la situation professionnelle, soit sur l’illégalité de l’aide fournie au passage d’immigrés clandestins, soit sur l’absence d’état-civil fiable, l’ambassade de France aux Comores estimant à 80 % le taux d’actes d’état-civil comoriens falsifiés (228).
Le rapport du sénateur Henri Torre signalait un problème de plus en plus préoccupant : celui des mineurs. Le premier objet d’inquiétude est celui des reconnaissances de complaisance. Le sénateur Henri Torre indiquait dans son rapport que près de 50 % des demandes de titres de séjour émanaient de parents étrangers d’enfants nés à Mayotte, notamment de femmes qui avaient eu un enfant avec un père français et qui avaient donc un enfant français par l’effet du droit du sang. Le chef du bureau des étrangers à Mayotte avait fait remarquer au sénateur Henri Torre que ces demandes pouvaient se fonder sur des « reconnaissances de complaisance », fort difficiles à établir.
Quand ces enfants ne naissent pas français par filiation, ils peuvent réclamer la nationalité française au titre du droit du sol simple. Étant nés sur le territoire français de parents étrangers, ils acquièrent automatiquement la nationalité française à l’âge de 18 ans en application de l’article 21-7 du code civil, dès lors qu’ils ont résidé habituellement en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans depuis l’âge de 11 ans. Ils peuvent même demander la nationalité française de façon anticipée soit seuls à partir de 16 ans soit à partir de 13 ans en cas de démarche engagée par leurs parents avec leur consentement, dès lors qu’ils ont résidé habituellement sur le territoire français respectivement depuis l’âge de 11 ans ou depuis l’âge de 8 ans (229).
Dans la réponse au questionnaire adressé par la mission à la délégation générale à l’outre-mer, il a été signalé qu’à Mayotte, on enregistrait chaque année un peu plus de 7 000 naissances dont 70 % seraient le fait de femmes étrangères en situation irrégulière. Bon nombre des enfants qui ne naissent pas français par l’effet du droit du sang demandent la nationalité française de façon anticipée dès l’âge de 13 ans, au titre de la naissance et de la résidence en France. S’il n’y a pas de chiffres sur le nombre de déclarations souscrites auprès du tribunal, il n’en reste pas moins que, selon les réponses faites par la préfecture de Mamoudzou à la mission, « ce phénomène est très important » d’autant que la condition de régularité du séjour des parents et des enfants n’est pas exigée au moment du dépôt de la demande des enfants. Une fois que leurs enfants nés en France sont devenus français à l’âge de 13 ans ou de 16 ans, de façon anticipée, les parents étrangers sont protégés contre l’éloignement (230) et peuvent se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » (231).
Le second sujet de préoccupation est celui des mineurs comoriens envoyés sans famille à Mayotte, ou abandonnés à Mayotte par leurs parents clandestins expulsés. L’article L. 511-4, 1°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière. Un mineur ne peut être reconduit à la frontière que si un adulte, lui-même reconduit à la frontière, accepte de l’accompagner. La présence sur le sol mahorais de ces nombreux enfants abandonnés à eux-mêmes suscite de sérieux problèmes en termes d’accueil, d’hébergement, et de scolarisation.
Ces phénomènes concourent à concentrer sur le territoire mahorais un nombre important de mineurs étrangers, souvent sans structure familiale ni structure d’accueil, qui ne peuvent être reconduits à la frontière et qui demandent la nationalité française sans qu’on puisse leur opposer l’irrégularité de leur entrée et de leur séjour (232). Un phénomène comparable existe en Guyane.
La Guyane est confrontée à une immigration clandestine massive. Sur une population totale estimée par l’Institut national de la statistique et des études économiques à 221 500 personnes en 2009 (233), le ministère de l’Intérieur estime à environ 38 000 le nombre total de clandestins en Guyane, dont 5 000 à 10 000 travailleraient sur des sites d’orpaillage clandestin. La population immigrée en séjour régulier ou irrégulier en Guyane est estimée à 40 % de la population totale. Les immigrés, et en particulier les clandestins, sont principalement originaires des pays voisins : Brésil, Guyana, Surinam et Haïti.
Dans son rapport (234), la commission d’enquête sur l’immigration clandestine créée le 27 octobre 2005 en vertu d’une résolution adoptée par le Sénat, indiquait que les flux migratoires vers la Guyane s’étaient accentués à mesure que les différences de niveaux de vie se creusaient entre ce département d’outre-mer et les pays voisins. Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques, le produit intérieur brut de la Guyane représentait en 2002 treize fois celui du Surinam, quinze fois celui du Guyana et trente-neuf fois celui d’Haïti. L’attractivité du territoire guyanais tient aussi au développement de la pratique de l’orpaillage clandestin : alors que 900 personnes travaillaient en 2005 sur les sites d’orpaillage légaux, faisant l’objet d’une concession, la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement évaluait entre 5 000 et 10 000 le nombre de personnes présentes sur des sites d’orpaillage clandestins. La guerre civile au Surinam dans les années 1980 a entraîné un afflux de migrants qui sont demeurés sur le sol guyanais et souhaitent aujourd’hui faire venir leurs concitoyens.
L’immigration clandestine est d’autant plus aisée que les frontières de la Guyane sont immenses et difficiles à contrôler. Selon la police aux frontières de Saint-Laurent du Maroni, environ 40 % des personnes faisant l’objet d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière sont des récidivistes.
La Guyane est le département français où le taux de natalité est le plus élevé et le taux de mortalité le plus faible, et c’est le territoire du continent américain où le taux de fécondité est le plus élevé. Dans les réponses faites au questionnaire adressé par la mission à la délégation générale à l’outre-mer, un phénomène a particulièrement été souligné : celui des femmes étrangères entrant illégalement et accouchant en Guyane afin que leur enfant ait la nationalité française. D’après les éléments fournis à la mission, il existe peu d’estimations chiffrées sur ce sujet car les naissances sont déclarées en mairie, et non en préfecture, et aucune étude exhaustive sur la question n’a été menée à ce jour. Toutefois l’ampleur du phénomène est constatée soit lors des demandes anticipées d’acquisition de la nationalité française, à 13 ou 16 ans, au titre de la naissance et de la résidence en France, sur le fondement de l’article 21-11 du code civil, soit lors des demandes de documents d’identité à 18 ans, sur le fondement de l’article 21-7 du code civil.
b) Les incertitudes constitutionnelles planant sur la solution d’un régime dérogatoire
À plusieurs reprises, l’aménagement d’un régime dérogatoire d’acquisition de la nationalité française pour certains départements d’outre-mer, et particulièrement pour Mayotte alors collectivité départementale, a été proposé, afin de prévenir les risques qu’une immigration clandestine massive fait courir aux équilibres économiques et sociaux.
Ainsi, en 2005, M. François Baroin, alors ministre de l’Outre-mer, avait déclaré « envisager de modifier ou de suspendre temporairement certaines règles relatives à l’acquisition de la nationalité française à Mayotte », et « étudier la possibilité de limiter à un délai d’un an après la naissance de l’enfant la période pendant laquelle un Français [pouvait] reconnaître un enfant naturel dont la mère est étrangère » (235). Il avait ajouté qu’il serait concevable de « poser la règle de régularité du séjour des parents comme condition pour l’accès ultérieur des enfants à la nationalité française » (236). M. François Baroin avait alors sollicité le Président de l’Assemblée nationale afin que soit créée une mission d’information parlementaire sur Mayotte. Cette mission, dont le député Didier Quentin a été le rapporteur, a déposé le 8 mars 2006 un rapport sur la situation de l’immigration à Mayotte (237).
En 2005, M. Mansour Kamardine, député de Mayotte, déposait à l’Assemblée nationale une proposition de loi relative au renforcement des dispositions de lutte contre l’immigration clandestine à Mayotte (238). Dans son exposé des motifs, le député affirmait que 80 % des accouchements à la maternité de Mamoudzou étaient le fait de femmes étrangères en situation irrégulière, qu’environ 50 000 naturalisations interviendraient par l’effet mécanique du droit du sol dans les quinze prochaines années (soit un tiers de la population mahoraise en 2005), et que dans près d’une décennie, il y aurait à Mayotte plus d’étrangers en situation irrégulière que de Français. L’élu mahorais proposait d’aménager dans le code civil des règles spécifiques à Mayotte de façon à ce que les mineurs nés à Mayotte de parents étrangers ne puissent demander la nationalité française à 18, 16 ou 13 ans sur le fondement des articles 21-7 et 21-11 du code civil que si l’un de leurs parents au moins était en situation régulière pendant la période quinquennale de résidence habituelle en France.
En 2007, M. François Bayrou avait déclaré lors de la campagne présidentielle qu’il était « favorable à ce que la nationalité française ne soit plus automatique dès l’instant qu’en Guyane ou à Mayotte, on est venu seulement pour accoucher sur le territoire national »(239). En 2008, M. Christian Estrosi, alors secrétaire d’État à l’Outre-mer, avait repris la proposition faite en 2005 par M. François Baroin et suggéré qu’à Mayotte, « tout enfant né de parents en situation irrégulière ne puisse plus réclamer son appartenance à la nationalité française »(240).
En 2010, lors de l’examen de la loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité (241), M. Dominique Tian, député des Bouches-du-Rhône, a déposé un amendement visant à compléter l’article 19-3 du code civil qui pose le principe du double droit du sol et prévoit qu’« est français l’enfant né en France lorsque l’un de ses deux parents au moins y est lui-même né » (242). L’exception que notre collègue Dominique Tian proposait d’introduire pour le seul cas de Mayotte, visait à exiger que les deux parents de l’enfant né à Mayotte soient eux-mêmes nés en France pour que l’enfant naisse français.
La création d’une telle exception au principe du double droit du sol et, plus généralement, l’aménagement d’un régime dérogatoire d’attribution ou d’acquisition de la nationalité française dans certains départements d’outre-mer ou dans certaines collectivités d’outre-mer apparaissent difficilement compatibles avec les principes d’égalité et d’indivisibilité de la République posés par l’article 1er de la Constitution (243).
Certes, l’article 73 de la Constitution, qui régit les départements et régions d’outre-mer soumis au principe d’identité ou d’assimilation législative, prévoit que les lois et règlements peuvent faire l’objet « d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités » et que « ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi ». Mais l’article 73 de la Constitution exclut explicitement que le droit de la nationalité puisse faire l’objet de telles adaptations par les départements ou les régions d’outre-mer eux-mêmes. L’article 73, alinéa 4, de la Constitution dispose en effet que les règles applicables sur leur territoire que les départements et régions d’outre-mer peuvent être habilités par la loi à fixer eux-mêmes « pour tenir compte de leurs spécificités », « ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral ».
En application de l’article73, alinéa 4, de la Constitution, l’État ne peut se départir de sa compétence en matière de nationalité au profit des deux départements d’outre-mer que sont la Guyane et, depuis le 31 mars 2011, Mayotte (244).
Du reste, même lorsque Mayotte était une collectivité d’outre-mer régie par le principe de spécialité législative posé par l’article 74 de la Constitution, la nationalité restait une matière pour laquelle l’État seul avait compétence. Si l’article 74, alinéa 1er, prévoit que « les collectivités d’outre-mer […] ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République », l’alinéa 2 dispose que « ce statut est défini par une loi organique […] qui fixe […] les compétences de cette collectivité [et que] sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert des compétences de l’État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par une loi organique ». Seul l'État peut donc exercer des compétences en matière de nationalité dans les collectivités d’outre-mer : l’article 3, I, 1° de la loi statutaire n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte mentionnait du reste la nationalité parmi les matières pour lesquelles les lois, ordonnances et décrets nationaux étaient applicables de plein droit à Mayotte. En application de l’article 74-1 de la Constitution, seul « le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de l’État […] adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l’organisation particulière de la collectivité concernée », sauf si la loi l’exclut.
C’est en application de ce principe selon lequel, dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, l’État peut adapter la loi pour les matières énoncées par l’article 73, alinéa 4, de la Constitution, et donc y compris en matière de nationalité, que le code civil comporte des dispositions spécifiques à Mayotte (article 30-2, alinéas 2 et 3) (245), à la Nouvelle-Calédonie, et aux collectivités d’outre-mer (articles 33 à 33-2). On notera toutefois que ces dispositions spécifiques en matière de nationalité soit concernaient des règles de preuve (article 30-2, alinéa 2), qui plus est au caractère transitoire (article 30-2, alinéa 3), et non des règles fondamentales d’attribution et d’acquisition de la nationalité française, soit n’avaient trait qu’à des modalités particulières d’organisation institutionnelle (articles 33 à 33-2). Ces aménagements portaient donc sur des points mineurs du droit de la nationalité.
Étant ainsi établi que la nationalité est, en application de l’article 73 de la Constitution, une matière dont les règles relèvent de la compétence exclusive de l’État, il convient d’examiner la question de savoir si le législateur peut, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, en adapter les règles dans les départements d’outre-mer pour y aménager un régime dérogatoire substantiel sans contrevenir à l’article 1er de la Constitution.
La délégation générale à l’outre-mer a fait part à la mission de sa réflexion sur les possibilités d’adaptation de la législation relative à la nationalité en Guyane et à Mayotte.
Dans un premier temps, la délégation générale à l’outre-mer a souligné que la jurisprudence du Conseil Constitutionnel ne plaçait pas l’acquisition de la nationalité par les étrangers au nombre des principes à valeur constitutionnelle : les droits des étrangers ne comprennent aucun droit de caractère général et absolu d’acquérir la nationalité française (246). Si le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce qu’une loi établisse des règles différentes à l’égard de catégories de personnes se trouvant dans des situations différentes dès lors que la différence de traitement qui en résulte est en rapport avec l’objet de la loi, alors le statut juridique des étrangers peut être différent de celui des nationaux en matière de nationalité (247). Ainsi le Conseil constitutionnel a-t-il estimé « qu'au regard des conditions d'acquisition de la nationalité française que le législateur a entendu déterminer, les personnes qui prétendent à cette acquisition ne peuvent être regardées comme étant dans la même situation que celles qui sont françaises » (248).
Mais dans un second temps, la délégation générale à l’outre-mer a expliqué que « le droit de la nationalité [était] considéré comme une loi de souveraineté qui a vocation à régir de façon uniforme l’ensemble du territoire de la République ».
Selon la délégation générale à l’outre-mer, la nationalité est une compétence de l’État qui est insusceptible d’être adaptée par les collectivités concernées au regard du contrôle que le juge constitutionnel exerce sur les « caractéristiques et contraintes particulières » mentionnées à l’alinéa 1er de l’article 73 de la Constitution.
La délégation générale à l’outre-mer a rappelé que dans des situations où le législateur avait souhaité faire valoir ce caractère spécifique, notamment au titre de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, pour différer son entrée en vigueur dans les départements et régions d’outre-mer, le Conseil Constitutionnel avait estimé que les contraintes mises en avant ne constituaient pas, au sens de l'article 73 de la Constitution, des « caractéristiques et contraintes particulières » (249).
Sauf à envisager que le Conseil Constitutionnel soit prêt à accepter de considérer que les conséquences de l’immigration massive en direction de la Guyane et de Mayotte constitueraient des « caractéristiques et contraintes particulières », le succès du recours à ce type d’adaptation législative n’est pas garanti.
Selon la délégation générale à l’outre-mer, la possibilité d’un droit dérogatoire risque de s’opposer à deux principes constitutionnels : l’indivisibilité de la République et l’égalité des citoyens devant la loi, principes posés à l’article 1er de la Constitution qui impliquent que les conditions d’accès à la nationalité française soient les mêmes sur l’ensemble du territoire pour une même catégorie de personnes.
La délégation générale à l’outre-mer en conclut que des dérogations territorialement limitées en matière d’octroi de la nationalité semblent dès lors à écarter (250).
L’instauration dans les départements d’outre-mer d’un régime dérogatoire d’attribution et d’acquisition de la nationalité française nécessiterait une révision constitutionnelle. Il conviendrait d’introduire dans la loi fondamentale une disposition prévoyant expressément que le droit de la nationalité obéit à un régime dérogatoire en Guyane et à Mayotte.
En 2008, le professeur Guy Carcassonne avait déclaré qu’un aménagement du droit du sol n’était pas contraire à la Constitution, rappelant que « le droit du sol a été reconnu par les lois de la République, mais [que] ce n’est pas du tout un principe constitutionnel » (251).
Mais M. Pierre Mazeaud, lors de son audition, a fermement dissuadé les parlementaires d’adopter des dispositions qui, de son point de vue, pourraient encourir la censure du Conseil constitutionnel dès lors qu’elles viseraient à créer un régime dérogatoire d’attribution et d’acquisition de la nationalité pour certains départements de la République et à violer ainsi le principe d’égalité (252). Allant plus loin encore, l’ancien président du Conseil constitutionnel a invité les parlementaires à ne pas prévoir dans la Constitution des dispositifs particuliers qui, sans encourir la censure a priori ou a posteriori du Conseil constitutionnel, pourraient néanmoins à long terme se heurter à des difficultés d’application ou d’interprétation, comme c’est le cas pour les règles relatives à la composition du corps électoral de la Nouvelle-Calédonie, fixées à l’article 77 de la Constitution.
Selon M. Jean-Philippe Thiellay, une éventuelle modification de la Constitution ne suffirait pas de toute façon à limiter les effets, en matière de nationalité, de l’immigration clandestine massive (253).
Il reste néanmoins que cette solution reste probablement d'actualité avec les difficultés croissantes que rencontrent les autorités dans le cas de Mayotte et de la Guyane.
À défaut de réviser la Constitution, il faut donc envisager des solutions qui pourraient passer par des modifications du droit de la nationalité au niveau national, qui présenteraient ainsi une garantie d’uniformité au regard des exigences constitutionnelles, et qui s’inscriraient dans une optique volontariste (254).
c) Une réponse possible à travers un droit de la nationalité plus volontariste
• Prévenir les demandes d’acquisition de la nationalité française en aménageant des dérogations au droit d’entrée et de séjour
Avant même d’envisager des modifications du droit de la nationalité au niveau national, il est possible de concevoir des régimes dérogatoires au droit d’entrée et de séjour des étrangers qui s’appliqueraient spécifiquement en Guyane et à Mayotte. Des dérogations au droit d’entrée et de séjour des étrangers peuvent permettre de réguler les flux migratoires et d’endiguer ainsi indirectement les demandes d’acquisition de la nationalité française émanant des migrants.
Certes, Mayotte est entrée dans le régime d’« identité » ou d’« assimilation » législative depuis le 1er janvier 2008 et devenue un département d’outre-mer le 31 mars 2011, relevant ainsi, comme la Guyane, de l’article 73 de la Constitution. Mais ce régime, qui prévoit que l’ensemble des textes législatifs adoptés par le Parlement est immédiatement applicable à la collectivité territoriale en cause, autorise des « adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités ».
Ainsi, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comporte d’ores et déjà des dispositions dérogatoires pour le département de la Guyane. La préservation de la compétence des autorités de l’État pour l’édiction des règles d’entrée et de séjour ne s’est pas accompagnée d’un alignement total du droit applicable en Guyane sur le droit métropolitain. Le Conseil constitutionnel a admis la constitutionnalité des dérogations au droit d’entrée et de séjour applicables à la Guyane. Dans une décision du 13 mars 2003, le Conseil constitutionnel a considéré que « le législateur a pu, pour prendre en compte la situation particulière et les difficultés durables du département de la Guyane […] en matière de circulation internationale des personnes », prévoir des mesures dérogatoires qui ne violaient pas le principe d’égalité dès lors qu’elles étaient proportionnées à « l’objectif [que le législateur] s’est fixé de renforcer la lutte contre l’immigration clandestine » (255).
À titre d’exemple, l’obligation de quitter sans délai le territoire français peut être exécutée immédiatement, sauf si l’autorité consulaire demande une mise à exécution après l’expiration du délai d’un jour franc à compter de la notification de cette obligation (256), et l’étranger qui défère cet acte au tribunal administratif a la faculté d’assortir son recours d’une demande de suspension car il ne bénéficie pas du sursis automatique qui, en métropole, s’oppose à l’exécution de l’obligation avant 48 heures s’il est notifié par voie administrative ou avant le jugement du tribunal administratif s’il a été saisi (257). Ces dérogations ont été motivées par le nombre élevé d’arrêtés de reconduite à la frontière pris en Guyane, qui, à lui seul, avoisinait celui des arrêtés de reconduite à la frontière enregistrés en métropole.
Autre exemple, en matière d’éloignement d’office, l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’« en Guyane, lorsque l’équipage d’un navire se livrant à des activités de pêche illicite est contraint par l’autorité administrative de se rendre à terre, ses membres peuvent être éloignés d’office, avec leur accord et aux frais de l’État, à destination du Venezuela, du Brésil, du Surinam ou du Guyana, selon qu’ils ont la nationalité de l’un de ces États », et que « l’autorité administrative prend toutes mesures à cette fin dans un délai qui ne peut excéder 48 heures ».
Si la départementalisation de Mayotte entraîne un alignement des règles de droit civil qui y étaient applicables sur le droit commun (258), elle ne remet pas en cause les règles de droit spécifiques à Mayotte en matière d’entrée et de séjour des étrangers. L’article L. 111-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été modifié et il prévoit que les conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte demeurent régies par l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.
La mise en œuvre de mesures dérogatoires en matière d’entrée et de séjour des étrangers en Guyane et à Mayotte est d’autant plus envisageable que les départements et collectivités d’outre-mer sont exclus de l’espace de libre-circulation de Schengen. L’article 138 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 prévoit en effet que « les dispositions de la présente convention ne s'appliqueront, pour la République française, qu'au territoire européen de la République française » (259). Le Conseil constitutionnel a estimé que le champ d’application territoriale d’une convention était déterminé par ses stipulations ou par les règles statutaires de l’organisation internationale sous l’égide de laquelle la convention avait été conclue, et qu’en raison du but poursuivi par la convention de Schengen, qui visait à supprimer les contrôles opérés aux « frontières communes » des États parties, l’exclusion des départements et collectivités d’outre-mer ne portait pas atteinte au principe d’indivisibilité de la République (260). En vertu de cette exclusion, les titulaires d’un visa spécifique aux départements d’outre-mer qui souhaitent se rendre en métropole doivent aujourd’hui solliciter un visa uniforme Schengen. Tous les voyageurs qui arrivent dans un département ou une collectivité d’outre-mer sont soumis à un contrôle d’identité s’ils proviennent directement du territoire métropolitain ou d’un(e) autre département ou collectivité d’outre-mer, et à un contrôle transfrontalier dans les autres cas.
Proposition n° 3 : Renforcer le régime dérogatoire d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte et en Guyane.
Les dispositions constitutionnelles et conventionnelles en offrant la possibilité, il conviendrait de durcir les règles d’entrée et de séjour des étrangers applicables à Mayotte et en Guyane, de façon à éloigner plus rapidement et facilement les étrangers qui, à Mayotte, embarquent de nuit et au péril de leur vie sur les fameuses kwassa kwassa, et, qui, en Guyane, profitent de la géographie pour traverser les frontières illégalement.
Le tarissement des flux migratoires résultant du renforcement des règles d’entrée et de séjour des étrangers aura indirectement pour effet d’endiguer le flot des entrées dans la nationalité française, puisque moins d’étrangers pourront s’installer sur le sol national et y avoir des enfants susceptibles de se voir attribuer la nationalité française grâce à des reconnaissances de paternité frauduleuses ou de demander d’acquérir la nationalité française au titre de la naissance et de la résidence en France.
Mais, outre des règles dérogatoires en matière d’entrée et de séjour des étrangers, on peut imaginer des modifications du droit de la nationalité au niveau national dont l’effet serait particulièrement marqué en Guyane et à Mayotte, particulièrement à l’égard des mineurs qui soit naissent français à la faveur de reconnaissances de paternité de complaisance, soit réclament la nationalité française à 13, 16 ou 18 ans au titre de la naissance et de la résidence en France.
• Lutter contre les reconnaissances de complaisance en aménageant les règles d’attribution de la nationalité française par filiation
La Guyane et Mayotte sont aujourd’hui confrontées à des reconnaissances frauduleuses d’enfants. Des hommes français reconnaissent ainsi des enfants qui, nés sur le sol guyanais ou mahorais de femmes étrangères en situation irrégulière, ne sont pas les leurs. À Mayotte, on estime que plus de 70 % des naissances étaient le fait de femmes en situation irrégulière (261).
Longtemps, l’état civil coranique applicable à Mayotte n’a fait que brouiller encore davantage la preuve de la filiation. L’ordonnance n° 2000-19 du 8 mars 2000 relative à l’état civil à Mayotte a créé un état civil de droit commun dans chaque commune mais n’a pas suffi à mettre fin à la confusion entretenue notamment par l’imperfection des procédures d’enregistrement et par le système de dénomination des personnes. Alors qu’en droit commun l’enfant reçoit un ou plusieurs prénoms, et prend le nom de son père si la filiation est légitime, ou le nom de sa mère si seule la filiation naturelle est établie, il n’y a pas en droit musulman de nom patronymique au sens strict. Jusqu’en 2000, les enfants mahorais se voyaient attribuer un prénom, librement choisi par les parents, et un second prénom ou surnom qui était nécessairement le prénom du père mais qui n’était transmissible qu’à deux générations au plus, c’est-à-dire du grand-père au petit-fils.
Face à ce phénomène, des mesures ont d’ores et déjà été prises. L’article 29-1 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte punit de cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende « le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, ou aux seules fins d’acquérir ou de faire acquérir la nationalité française ».
Par ailleurs, le livre V du code civil, qui regroupe les dispositions applicables à Mayotte, contient un article 2499-2 qui prévoit que « lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que la reconnaissance d'un enfant est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République et en informe l'auteur de la reconnaissance ». Une fois saisi, le procureur de la République a quinze jours pour décider soit d’autoriser l’enregistrement de la reconnaissance de l’enfant, soit d’y surseoir dans l’attente des résultats de l’enquête, soit d’y faire opposition. Le sursis ne peut excéder un mois renouvelable une fois, sauf si l’enquête est menée à l’étranger, auquel cas la durée du sursis est de deux mois, renouvelable une fois.
Pour aller plus loin dans la lutte contre les reconnaissances de complaisance en Guyane et à Mayotte sans encourir le grief d’inconstitutionnalité, et notamment de contrariété aux principes d’égalité et d’indivisibilité de la République, on aurait pu imaginer de modifier la loi, au niveau national, sur l’ensemble du territoire, métropolitain et ultra-marin, de façon à enfermer la reconnaissance de paternité d’un enfant naturel né d’une mère étrangère dans un délai relativement bref, comme le suggérait en 2005 M. François Baroin, alors ministre de l’Outre-mer (262).
Il conviendrait alors d’introduire dans le code civil un article 18-2 ou d’introduire un second alinéa à l’article 18 qui dispose qu’« est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Ce nouveau texte prévoirait que l’enfant qui est né hors mariage et dont la mère est étrangère est français si un Français reconnaît en être le père dans un délai d’un an à compter de la naissance de l’enfant.
Applicable sur l’ensemble du territoire national, une telle disposition ne porterait pas atteinte aux principes d’égalité et d’indivisibilité de la République comme le faisait l’article 7 de la proposition de loi relative au renforcement des dispositions de lutte contre l’immigration clandestine à Mayotte déposée le 28 septembre 2005 par le député Mansour Kamardine. Ce texte proposait de limiter le champ d’application territorial de l’article 335 du code civil, relatif la contestation de la filiation, en prévoyant qu’à Mayotte uniquement, la reconnaissance d’un enfant naturel ne pouvait intervenir que dans l’année de la naissance de l’enfant (263).
La délégation générale à l’outre-mer a expliqué à la mission que si une restriction concernant une partie du territoire français ne semblait pas envisageable, des mesures d’un plus large champ d’application pourraient être soutenues. La mesure envisagée, applicable au niveau national, permettrait de lutter contre les reconnaissances de complaisance.
Toutefois, une telle mesure pourrait prêter le flanc à des griefs d’inconstitutionnalité. Le fait d’enfermer ou non dans un certain délai la possibilité pour un père français de reconnaître son enfant selon que sa mère est étrangère ou non crée en effet une rupture d’égalité entre le Français dont l’enfant a une mère étrangère et le Français dont l’enfant a une mère française. Le fait, pour un père français, de pouvoir reconnaître son enfant avec ou sans condition de délai selon que la mère est étrangère ou française risquerait de constituer une atteinte au principe d’égalité devant la loi de tous les citoyens posé par l’article 1er, alinéa 1er, de la Constitution. Cette atteinte semble d’autant moins motivée et d’autant plus disproportionnée que c’est précisément lorsque la mère est étrangère, et donc susceptible de regagner son pays d’origine, que la logique voudrait que le père français puisse reconnaître son enfant sans condition de délai ou tout au moins dans un délai plus long que le délai ouvert aux pères français d’enfants dont la mère est française, dans la mesure où il est susceptible d’avoir connaissance de son existence plus tardivement.
Au regard de ces risques d’inconstitutionnalité, il semble préférable d’envisager d’autres solutions.
• Limiter les demandes d’acquisition de la nationalité française au titre de la naissance et de la résidence en France en restaurant la condition de régularité du séjour
Outre les reconnaissances de complaisance, la Guyane et Mayotte sont particulièrement confrontées aux acquisitions automatiques et anticipées de la nationalité française par des mineurs qui, nés en France de parents étrangers en situation irrégulière, s’appuient sur les articles 21-7 et 21-11 du code civil pour demander la nationalité française alors même que leur séjour sur le territoire est irrégulier.
L’article 21-27 du code civil prévoit en son alinéa 3 que nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité si son séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France.
Mais l’alinéa 4 du même texte ajoute que les dispositions de cet article ne sont pas applicables à l’enfant mineur susceptible d’acquérir la nationalité française, notamment en application des articles 21-7 et 21-11 du code civil.
Il en résulte qu’en dépit de leur séjour irrégulier sur le territoire, dont ils ne sont pas expulsables, des mineurs étrangers acquièrent la nationalité française, et qu’une fois devenus français, leurs parents, étrangers en situation irrégulière, bénéficient de la protection accordée par la loi aux parents d’enfants français, et notamment de la protection contre l’éloignement (264) ainsi que d’une carte de séjour temporaire (265).
En 2005, M. François Baroin, alors ministre de l’outre-mer, avait suggéré de « poser la règle de régularité du séjour des parents comme condition pour l’accès ultérieur des enfants à la nationalité française » (266). En 2008, M. Christian Estrosi, alors secrétaire d’État à l’Outre-mer, avait proposé qu’à Mayotte, « tout enfant né de parents en situation irrégulière ne puisse plus réclamer son appartenance à la nationalité française » (267).
En 2011, la délégation générale à l’outre-mer a expliqué à la mission que la prise en compte des difficultés posées par l’ampleur des flux migratoires en Guyane et à Mayotte pourrait passer par un renforcement uniforme sur tout le territoire de la République des conditions d’accès des étrangers à la nationalité française, et que ce renforcement pourrait résider, par exemple, dans une condition supplémentaire de régularité du séjour des parents pour les enfants nés sur le sol français qui demandent la nationalité française au titre de la naissance et de la résidence en France, et que la régularité du séjour des parents s’apprécierait au moins pendant la période continue ou discontinue de cinq ans au cours de laquelle les enfants ont eu leur résidence habituelle en France.
Cette proposition ne fait que reprendre l’essentiel des articles 1er et 2e de la proposition de loi déposée le 28 septembre 2005 à l’Assemblée nationale par le député Mansour Kamardine, mais en les étendant à l’ensemble du territoire national, ce qui élimine le risque d’inconstitutionnalité encouru par le texte proposé par le député mahorais, qui limitait les aménagements des règles d’acquisition de la nationalité française au seul territoire de Mayotte (268).
Proposition n° 4 : Limiter les demandes d’acquisition de la nationalité française au titre de la naissance et de la résidence en France en étendant la condition de régularité du séjour aux mineurs étrangers et à leurs parents.
Il conviendrait de modifier la rédaction de l’article 21-27, alinéa 4, du code civil de façon à ce que la condition de régularité du séjour en France pour l’acquisition de la nationalité française soit applicable à l’enfant mineur susceptible d’acquérir la nationalité française en application des articles 21-7 et 21-11 du code civil.
Réaffirmer l’exigence de la régularité du séjour de l’enfant et de ses parents pour l’acquisition de la nationalité française par un enfant mineur qui est né en France et y a résidé au moins cinq ans de façon continue ou discontinue ne serait qu’une façon de renouer avec les règles antérieures à 1993 et 1998. En effet, le décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la situation et à la police des étrangers interdisait toute acquisition de la nationalité française par un étranger qui n’était pas titulaire d’une autorisation de séjour valable de plus d’un an (article 1er). Sous réserve de la durée de l’autorisation de séjour, cette règle avait été conservée dans le code de la nationalité issu de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France et portant création de l’Office national d’immigration. Mais elle fut supprimée par la loi n° 61-1408 du 22 décembre 1961 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française.
Bien des problèmes liés à l’acquisition de la nationalité française en Guyane et à Mayotte pourraient être résolus par la combinaison de la condition de régularité du séjour et du retour à l’exigence d’une manifestation de volonté que votre rapporteur entend proposer pour les personnes qui, nées en France de parents étrangers nés à l’étranger, réclament la nationalité française au titre de la naissance et de la résidence en France.
2. La prestation de serment : un geste peu conforme à la culture nationale
De prime abord, l’idée d’organiser la prestation d’un serment peut apparaître séduisante. En soi, un tel geste marque en effet un engagement, amène l’individu qui s’y soumet à prendre pleinement conscience des droits mais aussi des devoirs qui le lient à la communauté. Il offre le moyen d’exprimer concrètement et simplement un sentiment d’appartenance nationale.
Dans les faits, la prestation de serment constitue d’ailleurs un moment important de communion collective dans des pays dont la culture démocratique n’est plus à démontrer.
L’attachement et la fidélité à la communauté nationale s’expriment ainsi aux États-Unis par l’existence deux serments d’allégeance : le serment au drapeau que les élèves récitent quotidiennement dans les établissements scolaires et dont le texte résulte d’un acte du Congrès daté du 22 juin 1942 ; le serment d’allégeance que prononce au cours d’une cérémonie chaque personne obtenant la qualité de citoyen des États-Unis. Au Royaume-Uni, les personnes qui acquièrent la nationalité britannique prêtent le serment d’allégeance au souverain régnant et à ses héritiers suivant une formule contenue dans le Promisssory Oaths Act promulgué en 1868. Au Canada, par le serment de la citoyenneté, les nouveaux citoyens canadiens jurent non seulement fidélité au souverain mais également aux lois et aux coutumes de leur nouveau pays.
Pour autant que l’on puisse en juger, ces serments revêtent presque la dimension d’un rituel (au moins aux États-Unis) et s’enracinent dans la mentalité propre à ces pays et à leur histoire.
Les serments d’allégeance et de fidélité : l’exemple des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada § Aux États-Unis Serment d’allégeance : « Je déclare, par le présent acte, renoncer et faire abjuration d’obéissance et de fidélité à toute puissance étrangère, prince, potentat, état ou souverain, desquels j’ai été le sujet ou le citoyen ; soutenir et défendre la Constitution et la loi des États-Unis d’Amérique contre tout ennemi, qu’il vienne de l’extérieur ou de l’intérieur ; porter à ces derniers une foi et une obéissance entières ; prendre les armes pour les États-Unis si la loi l’exige ; accomplir mon service militaire pour les États-Unis si la loi l’exige ; exécuter un travail d’intérêt général sous autorité civile si la loi l’exige ; et prendre cet engagement librement sans aucune réserve ou volonté de fuite. Que Dieu me vienne en aide. » Serment d’allégeance au drapeau : « Je jure allégeance au drapeau des États-Unis d’Amérique et à la République qu’il représente, une nation unie sous l’autorité de Dieu, indivisible, avec la liberté et la justice pour tous ». § Au Royaume-Uni « Moi (identité entière) jure que je serai fidèle et porterai fidèle allégeance à sa Majesté, la Reine Élizabeth, à ses héritiers et successeurs selon la loi. Que Dieu me vienne en aide. » § Au Canada « J’affirme solennellement que je serai fidèle et porterai sincère allégeance à sa Majesté la Reine Élizabeth II, Reine du Canada, à ses héritiers et à ses successeurs, que j’observerai fidèlement les lois du Canada et que je remplirai loyalement mes obligations de citoyen(ne) canadien(ne) ». |
C’est précisément pourquoi il s’avère en réalité difficilement concevable d’introduire la prestation de serment en France car ce geste ne reposerait sur aucun soubassement d’ordre culturel et ne revêtirait probablement pas la signification profonde qui s’attache aux serments prononcés à l’étranger. Il pourrait paraître artificiel ou incongru.
D’une part, nonobstant les références à la divinité – trait qui n’est pas nécessairement présent dans les serments étrangers – ou à l’allégeance à un souverain, la prestation de serment ne semble pas en effet convenir à un pays dont les structures mentales portent davantage à l’individualisme pour ce qui est de la relation à la nation. D’autre part, dans la culture politique républicaine, l’allégeance peut d’autant moins se concevoir facilement que la participation à l’élaboration de la loi, fruit de la volonté générale suivant la théorie rousseauiste, amène à présumer de son respect par les individus et de leur adhésion à l’ordre politique. Dans cette optique, on peut se laisser convaincre par l’argumentation de M. Tzvetan Todorov (269), opposé à l’idée d’un serment solennel dans la mesure où l’acquisition de la nationalité implique par elle-même l’acceptation des lois et des institutions du pays. À ses yeux, la prestation de serment tendrait à créer une distinction implicite entre des citoyens jugés fiables car ayant acquis leur nationalité automatiquement et les autres.
Constatons enfin que l’on trouve peu d’exemples de serment d’allégeance hormis dans des périodes historiques troublées dont le souvenir ne renforce pas nécessairement la légitimité d’un tel acte. Que l’on pense aux serments en vigueur pendant la période révolutionnaire tels que le serment républicain du 10 mars 1796 (« Je jure haine à la royauté, attachement et fidélité à la République et à la Constitution de l’an III. ») ou à celui du serment républicain du 12 janvier 1797 (« Je jure haine à la royauté et à l’anarchie, attachement et fidélité à la République et à la Constitution de l’an III.»). Si le souvenir de l’âpreté des luttes intestines de cette époque s’estompe aujourd’hui, demeure celui du serment que devaient prêter à la personne du Maréchal Pétain les secrétaires d’État, hauts dignitaires et hauts fonctionnaires (270), les militaires (271), les magistrats (272) et finalement l’ensemble des fonctionnaires (273).
Du reste, eu égard à l’ampleur de la crise qui secoue le modèle républicain et qui retentit sur l’expression même du sentiment d’appartenance nationale, la mission peut partager avec M. Pierre Nora (274) le sentiment qu’une prestation de serment constituerait une réponse insuffisante. Accessoirement, il s’agirait d’une obligation inopérante dans la mesure où l’on conçoit mal comment sanctionner son non-respect.
Voilà pourquoi, du point de vue de la mission, la prestation d’un serment n’offre pas un réel instrument de réaffirmation du sentiment d’appartenance nationale. Dans cette perspective, l’exigence d’une manifestation de volonté constitue une solution vraisemblablement plus pertinente.
3. Exiger de tous les Français une manifestation de volonté à leur majorité
Si certaines des personnes auditionnées par la mission n’ont pas caché leur scepticisme à l’égard de l’automaticité de l’acquisition de la nationalité française par l’effet du double droit du sol (275), d’autres ont dissuadé les parlementaires de remettre en cause ce principe, d’en restreindre la portée par des exceptions, voire même de légiférer à nouveau en matière de nationalité (276).
Entre une posture radicale susceptible d’ébranler les fondements de notre droit de la nationalité et une posture fixiste susceptible de le rendre vétuste au point qu’il menace ruine, votre rapporteur pense qu’il y a place pour des aménagements, au besoin législatifs, permettant d’adapter le droit de la nationalité au XXIe siècle.
Or, dans le prolongement d’une conception qui lie la nation à l’adhésion à un projet politique, à des valeurs et à une mémoire communes, et qui fait du droit de la nationalité l’expression de cette conception volontariste et affective de la nation, votre rapporteur propose d’exiger une manifestation de volonté de tous les Français, sans exception, qu’ils se soient vus attribuer la nationalité française par l’effet du droit du sang ou du double droit du sol, qu’ils aient acquis la nationalité par l’effet du droit du sol simple, à l’issue d’une procédure de naturalisation ou par mariage.
Ayant montré qu’en France, la nation revêt une forte dimension politique, historique et affective, et que le droit de la nationalité doit être le reflet et la courroie de transmission de cette conception de la nation, votre rapporteur défend l’idée qu’on exige de tous les Français qu’ils manifestent leur volonté d’appartenir à la nation, d’adhérer au projet politique fédérateur et aux valeurs partagées que cela suppose, et d’exprimer le respect pour une mémoire commune que cela requiert également.
Cette manifestation de volonté pourrait concerner tous les Français, aussi bien ceux qui se sont vus attribuer la nationalité française à la naissance par l’effet du droit du sang ou du double droit du sol que ceux qui l’ont acquis par l’effet du droit du sol simple, de la naturalisation ou du mariage.
Il ne s’agit nullement de remettre en cause le droit du sol. Preuve en est qu’une telle manifestation de volonté concernerait aussi bien les personnes qui naissent françaises par l’effet du droit du sang. Du reste, comme l’a indiqué M. Jean-Philippe Thiellay lors de son audition par la mission (277), des travaux de chercheurs (278) ont montré qu’un droit de la nationalité comportant l’obligation de manifester sa volonté pouvait pour autant fort bien reposer sur le droit du sol.
Il s’agit de rompre avec une conception aseptisée de la nationalité qui la réduit à une carte d’identité plastifiée et à un long et difficile parcours administratif semé d’embûches. Lors de son audition, le professeur Hugues Fulchiron a du reste alerté les membres de la mission sur le fait que la nationalité ne semblait pas devoir se résumer à une formalité administrative, mais semblait au contraire devoir susciter aujourd’hui une forme d’engagement (279). Alors qu’auparavant les conditions objectives fixées pour l’accès à la nationalité suffisaient à garantir l’intégration à la communauté nationale, les aspects subjectifs ont aujourd’hui plus d’importance et paraissent mieux à même d’attester cette intégration.
C’est du reste ce que M. Marceau Long soulignait déjà en 1988. Dans son rapport au Premier ministre, la Commission de la nationalité estimait que « notre système juridique [devait] prendre en compte la volonté individuelle de façon plus large et plus cohérente » (280).
Il s’agit de renouer avec l’« esprit » national et avec le « génie » national qu’avait su mettre en valeur la IIIe République. Il s’agit de renouer avec la nation comme principe spirituel fédérateur fondé sur l’intérêt général et la soumission à la volonté générale. Il s’agit de recréer ce que Benedict Anderson appelle la « communauté politique imaginée », à savoir une communauté réunissant des gens qui ne se connaissent pas et qui ne se croiseront jamais mais qui éprouvent néanmoins un fort sentiment d’appartenance à la même communauté (281). Si la poursuite du « roman national » peut contribuer à nourrir l’imaginaire de la communauté, la manifestation de volonté peut, quant à elle, l’aider à retrouver son caractère politique.
L’érection de la manifestation de la volonté d’appartenir à la nation en obligation réduirait voire éliminerait le décalage, souligné lors de son audition par l’historien Patrick Weil, entre le fait d’être juridiquement français et le sentiment d’appartenir à la nation française (282). La manifestation de volonté contribuerait à faire en sorte qu’il y ait moins de personnes qui, quoique françaises sur le papier, ne sentent pas françaises, ou qui, à l’inverse, se sentent françaises bien que n’étant pas françaises du point de vue du droit. Lors de leurs auditions, l’essayiste Malika Sorel et le maire de Montfermeil ont approuvé cette conception volontariste du droit de la nationalité (283).
Après avoir montré que l’acte manifestant la volonté de faire pleinement partie de la nation contribuerait à faire émerger une adhésion collective à travers l’expression d’une adhésion individuelle, votre rapporteur entend préciser les modalités de cette obligation.
• Pour les personnes qui se voient attribuer à la naissance la nationalité française par filiation ou au titre du double droit du sol
Pour ce qui est des Français qui se sont vus attribuer la nationalité française à la naissance par l’effet du droit du sang ou du double droit du sol, votre rapporteur propose d’appeler à manifester en commun leur volonté d’appartenir à la nation française à la majorité. À l’âge de dix-huit ans, les jeunes Français pourraient réitérer solennellement leur attachement à la nation et leur adhésion à ses valeurs, à son passé et à ses principes politiques fondamentaux lors d’une cérémonie qui pourrait être organisée à l’occasion, par exemple, de la remise de la carte d’identité ou de la carte d’électeur en mairie. Si, exceptionnellement, la manifestation de volonté devait être recueillie à l’étranger, elle pourrait l’être par un agent diplomatique ou consulaire français à l’occasion de la remise de la carte d’identité ou d’électeur au consulat de France.
L’historien et essayiste Tzvetan Todorov a ainsi suggéré lors de son audition de marquer l’appartenance à la nation de l’ensemble des jeunes Français à l’occasion de la remise en mairie de la carte d’identité ou de la carte d’électeur (284).
La manifestation de volonté pourrait se traduire par la signature d’une Charte des droits et des devoirs comparable à celle qui est prévue par la loi n° 2011-672 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.
Proposition n° 5 : Organiser pour tous les jeunes Français une manifestation commune de volonté d’appartenir à la nation française à l’occasion d’une cérémonie de remise de la carte d’identité ou d’électeur en mairie.
L’obligation de manifester la volonté d’appartenir à la nation française quand bien même on se serait vu attribuer la nationalité française à la naissance, sans rien demander, redonnerait une âme au droit de la nationalité en lui insufflant l’esprit de la nation telle qu’on la conçoit en France, à savoir comme une démarche individuelle, autonome et volontaire d’adhésion à une communauté politique et historique.
• Pour les personnes qui acquièrent la nationalité française au titre de la naissance et de la résidence en France
Dès 1988, la Commission de la nationalité présidée par M. Marceau Long, inspirée par une conception élective de la nation, estimait que s’agissant des enfants nés en France de parents étrangers nés à l’étranger, il était « nécessaire d’éviter que leur volonté de devenir ou de ne pas devenir Français puisse demeurer inexprimée » (285). Tout en affirmant « solennellement qu’il n’[était] pas souhaitable de remettre aujourd’hui en cause le droit à la nationalité française que détient tout jeune né en France et y ayant vécu pendant une période correspondant, le plus souvent, à sa scolarisation », elle « estim[ait] cependant que la volonté individuelle de ces jeunes ne saurait, sans artifice, demeurer inexprimée si l’on souhaite que ce droit du sol « simple » soit pleinement le puissant instrument d’intégration recherché pour les années à venir » (286).
Cette recommandation de la Commission de la nationalité a été entendue par le législateur qui, en 1993, a subordonné l’acquisition de la nationalité française par les étrangers nés en France de parents étrangers nés à l’étranger, à la manifestation de leur volonté d’être Français (287). Rompant ainsi avec l’acquisition automatique de la nationalité française à la majorité, l’article 21-7 ancien du code civil disposait que « tout étranger né en France de parents étrangers [pouvait], à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifest[ât] la volonté, qu’il résid[ât] en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifi[ât] d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèd[aient] ».
En plus d’imposer une démarche individuelle, l’article 21-7 ancien du code civil faisait de la demande d’acquisition de la nationalité française une démarche autonome, insusceptible d’être confiée à la tutelle parentale. En effet, avant le 1er janvier 1994, l’acquisition de la nationalité française par un mineur étranger né en France de parents étrangers nés à l’étranger pouvait être anticipée à l’initiative de qui exerçait l’autorité parentale si le mineur avait moins de 16 ans. Entre 1994 et 1998, sous l’empire de la loi de 1993, toute possibilité pour le mineur de moins de 16 ans d’acquérir la nationalité française par simple déclaration, à l’initiative du ou des titulaire(s) de l’autorité parentale, disparut. Dans la mesure où l’acquisition de la nationalité française au titre de la naissance et de la résidence était conçue comme une démarche volontaire, il fallait que cette volonté fût autonome pour que l’obligation de la manifester ait un sens.
Applicable du 1er janvier 1994 au 1er janvier 1998, ce texte reflétait pleinement l’esprit de la nation et de la nationalité telles qu’on les conçoit en France depuis la Révolution française et la IIIe République. Il ne faisait que revenir aux principes simples qui figuraient dans le code civil de 1804, et en vertu desquels celui qui était né en France d’un père étranger pouvait réclamer la nationalité française dans l’année suivant sa majorité à condition de déclarer son intention de fixer durablement voire définitivement son domicile en France (288).
Mais l’édifice législatif de 1993 fut ruiné par la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité qui restaura tout à la fois le caractère automatique de l’acquisition de la nationalité française à la majorité pour les personnes nées en France de parents étrangers nés à l’étranger (289), et la possibilité d’anticiper cette acquisition non seulement à partir de 16 ans (290), mais aussi dès l’âge de 13 ans, à l’initiative de qui exerce l’autorité parentale (291). La loi du 16 mars 1998 a également ouvert la voie à une appréciation extensive, pour ne pas dire laxiste, de la condition de résidence habituelle de cinq ans sur le sol français en admettant la possibilité de se contenter d’une résidence discontinue.
Votre rapporteur propose de revenir au dispositif mis en œuvre par les lois de 1993 réformant le droit de la nationalité en restaurant l’obligation pour l’étranger né en France de parents étrangers nés à l’étranger de manifester sa volonté d’acquérir la nationalité française et en supprimant la possibilité de le faire par anticipation dès l’âge de 13 ans.
Là encore, la manifestation de volonté pourrait se traduire par la signature d’une Charte des droits et des devoirs comparable à celle qui est prévue par la loi n° 2011-672 précitée relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.
Concrètement, la démarche de manifestation de volonté pourrait s’effectuer selon le dispositif prévu par la loi du 22 juillet 1993. La manifestation de volonté serait recueillie par le greffier en chef du tribunal d’instance compétent (292), à l’instar de la quasi-totalité des déclarations de nationalité, à l’exception de celle souscrite en raison du mariage (293). À défaut, elle pourrait l’être par le préfet, le maire ou le maire d’arrondissement (à Paris, Lyon, et Marseille). Si, exceptionnellement, la manifestation à l’étranger devait être recueillie à l’étranger, elle pourrait l’être par un agent diplomatique ou consulaire français dans un consulat de France.
Ces autorités, dépourvues de tout pouvoir d’instruction, d’appréciation et de contrôle, ne feraient que consigner la manifestation de volonté dans un document prévu à cet effet et délivrer un justificatif. Elles ne pourraient refuser de recueillir la manifestation de volonté que si un élément objectif, tel que l’âge ou la naissance en France du déclarant, faisait défaut.
Ainsi recueillie, la manifestation de volonté, accompagnée des pièces justificatives requises, serait transmise pour enregistrement au greffier du tribunal d’instance compétent, s’il ne l’avait pas lui-même reçue, ou au ministre de la Justice, si la manifestation était recueillie à l’étranger. Autrement dit, la procédure d’enregistrement serait alignée sur celle qui prévaut aujourd’hui pour la quasi-totalité des déclarations de nationalité (294). Chargés d’apprécier la régularité des pièces fournies, les greffes des tribunaux d’instance compétents et les services du ministre de la Justice pourraient refuser d’enregistrer la manifestation de volonté si elle ne satisfaisait pas aux conditions légales, comme c’est le cas pour les déclarations de nationalité. Comme pour ces dernières (295), ils auraient six mois à compter de la manifestation de volonté pour le faire et devraient bien sûr motiver leur décision. Comme pour les déclarations de nationalité, la décision de refus d’enregistrement pourrait être contestée devant le tribunal de grande instance dans un délai de six mois à compter de sa notification.
Si la manifestation de volonté était jugée recevable, les greffiers des tribunaux d’instance ou les services du ministre de la Justice notifieraient la décision d’enregistrement au déclarant qui serait convoqué en personne à cet effet. À cette occasion, il serait remis au déclarant un exemplaire enregistré de la manifestation de volonté qui constituerait la preuve qu’il aurait acquis la nationalité française à la date de la manifestation de volonté.
Proposition n° 6 : Exiger des personnes nées en France de parents étrangers nés à l’étranger une manifestation de volonté d’acquérir la nationalité française à leur majorité.
Il convient donc :
- de supprimer le caractère automatique de l’acquisition de la nationalité française à la majorité pour les personnes qui sont nées en France de parents étrangers nés à l’étranger, et qui ont résidé sur le territoire national au moins cinq ans depuis l’âge de 11 ans ;
- de restaurer le caractère continu de la résidence habituelle sur le territoire national d’au moins cinq ans qui est exigée pour demander l’acquisition de la nationalité française au titre de la naissance et de la résidence ;
- de supprimer la possibilité de demander l’acquisition de la nationalité française de façon anticipée dès l’âge de 13 ans.
• Pour les personnes qui acquièrent la nationalité française à raison du mariage ou par décision de l’autorité publique
La procédure de naturalisation, souvent longue et difficile, qu’engagent les étrangers qui souhaitent acquérir la nationalité française, vaut en elle-même manifestation de volonté, d’autant que les naturalisés devront désormais signer une Charte des droits et des devoirs, en application de la loi n° 2011-672 précitée relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.
Entourée de la solennité de la cérémonie de naturalisation que votre rapporteur appelle à renforcer, la signature de cette Charte des droits et des devoirs pourrait toutefois également être exigée des personnes qui acquièrent la nationalité française à raison du mariage.
Ces étrangers, conjoints de ressortissant(e)s français(e)s, doivent aujourd’hui souscrire une déclaration passé un délai de quatre ou cinq ans à compter du mariage pour obtenir la nationalité française. La procédure de déclaration, décrite aux articles 26 à 26-5 du code civil, ne comporte en l’état actuel du droit aucune obligation de manifester la volonté d’appartenir à la nation française.
Aussi est-ce la raison pour laquelle votre rapporteur propose d’étendre l’obligation de manifestation de volonté aux personnes qui demandent à acquérir la nationalité française à raison du mariage, en leur demandant par exemple de signer une Charte des droits et des devoirs comparable à celle que devront désormais signer les naturalisés, à l’occasion de la cérémonie d’accueil dans la nationalité française.
Proposition n° 7 : Exiger des personnes qui acquièrent la nationalité française par déclaration à raison du mariage une manifestation de volonté d’appartenir à la nation française.
S’il est aujourd’hui requis du conjoint étranger d’un(e) Français(e) qui souhaite acquérir la nationalité française par déclaration qu’il justifie « d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française » (article 21-2, al. 3, du code civil), il ne lui est pas demandé de faire montre de son adhésion aux valeurs et à la mémoire commune qui font la nation française.
L’obligation de manifester la volonté d’appartenir à la nation pour les personnes qui acquièrent la nationalité française à raison du mariage pourrait résulter de la signature d’une Charte des droits et des devoirs à l’occasion d’une cérémonie d’accueil dans la nationalité française.
*
* *
L’obligation de manifester sa volonté d’être Français à la majorité, lors de la remise de la carte d’électeur, marquerait, dans le contexte de la mondialisation, la spécificité de l’appartenance nationale par rapport à une culture commune de citoyenneté donnant au citoyen l’essentiel des droits du national sans pour autant exiger de lui une démarche d’engagement et d’adhésion.
C’est précisément parce qu’il repose tout entier sur la notion d’engagement que votre rapporteur invite à valoriser le service civique.
4. Valoriser l’expérience du service civique
La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a mis fin au service militaire obligatoire, privant ainsi la nation de l’un de ses ressorts les plus essentiels. Bon nombre d’historiens s’accordent en effet à dire que la conscription était un creuset où tous les Français, quelles que soient leur classe sociale, leur origine géographique, et leur histoire, se trouvaient mêlés et réunis par un seul dénominateur commun : leur appartenance à la nation.
La journée d’appel à la défense, remplacée depuis le début de l’année 2011 par la journée « défense et citoyenneté », n’est qu’un maigre succédané qui concentre en une seule journée, entre autres activités, des modules sur l’engagement citoyen, sur l’effort de défense et sur les métiers de la défense, une initiation au secourisme et un test d’évaluation des acquis fondamentaux de la langue française. La brièveté de cette journée chargée ne laisse que très peu de temps aux participants pour apprendre à se connaître. L’aspect social du service militaire obligatoire cimentait la cohésion nationale. Aujourd’hui cet aspect a presque totalement disparu.
Néanmoins, la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 a entendu ressusciter l’exigence d’engagement qui sous-tendait le service militaire obligatoire en créant le service civique. Aux termes de l’article L. 120-1 du code du service national, « le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général auprès d'une personne morale agréée », et « les missions d'intérêt général susceptibles d'être accomplies dans le cadre d'un service civique revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne ».
Lors de son audition, M. Martin Hirsch, président de l’Agence du service civique, a rappelé que le service civique avait été créé non seulement afin de promouvoir et de valoriser l’engagement des jeunes mais aussi afin de récréer un lien entre la jeunesse et la nation – ce qui explique le choix du Parlement de faire figurer les dispositions qui se rapportent au service civique dans le code du service national alors que l’appel sous les drapeaux avait été supprimé par la loi du 28 octobre 1997 (296).
a) Préserver le caractère volontaire, et non obligatoire, du service civique
Dès 1996, le Président de la République, M. Jacques Chirac, avait promis un « service civil volontaire », dont la mise en œuvre s’est avérée à ce point lente et complexe qu’il ne fut opérationnel qu’à partir de 2006.
Alors que diverses voix s’élevaient pour réclamer la création d’un service civique obligatoire (297), le Conseil d’analyse de la société, présidé par M. Luc Ferry, remit en 2008 un rapport au Président de la République, qui, intitulé « Pour un service civique », soulignait l’importance de recourir au volontariat (298).
De fait, l’article L. 120-1, II, du code du service national tel qu’il résulte de la loi du 10 mars 2010 définit le service civique comme « un engagement volontaire […] en faveur de missions d’intérêt général reconnues prioritaires pour la Nation ».
De manière générale, l’engagement des personnes qui accomplissent le service civique s’explique manifestement par la volonté d’être reconnues et valorisées dans un rôle au bénéfice de la société. À cet égard, M. Martin Hirsch a tenu à souligner l’extrême faiblesse du nombre des abandons parmi les jeunes s’engageant dans le cadre du service civique ainsi que leur engouement pour servir de manière désintéressée dans un cadre républicain(299).
La notion de volontariat se révèle donc d’une importance essentielle dans le succès du service civique. M. Martin Hirsch a témoigné de ce que les jeunes, à l’instar de ceux qu’il a rencontrés dans le cadre d’un projet mené à Grenoble, tiraient fierté du caractère volontaire de l’engagement et faisaient montre d’une certaine hostilité à l’idée d’un service civique obligatoire. De son point de vue, établir un service civique obligatoire se révèle problématique à deux titres. En premier lieu, il semble difficilement concevable d’imposer aux jeunes un engagement dans des missions relativement mal rémunérées dont les autres générations bénéficient alors que la jeunesse se trouve confrontée à un chômage de masse. En second lieu, l’attrait du service civique tient à l’objet des missions qui peuvent être confiées. Or, il serait difficile d’offrir à 750 000 jeunes des missions d’un intérêt égal et qui valorisent le service civique. Les jeunes ont besoin d’accomplir des tâches grâce auxquelles ils se sentent utiles.
Si l’idée de rendre obligatoire le service civique paraît donc devoir être écartée, votre rapporteur entend néanmoins formuler d’autres propositions allant dans le sens de la valorisation de cette institution.
b) Accroître le nombre des missions financées dans le cadre du service civique
Si la décision de conférer au service civique un caractère volontaire n’est pas allée sans débats, notamment au vu de la faiblesse des effectifs du service civil, qui conduisait certains observateurs à s’interroger sur la propension des jeunes à s’engager dans un tel cadre, cette crainte apparaît rétrospectivement sans fondement.
Selon M. Martin Hirsch, l’Agence du service civique a reçu à ce jour 43 000 candidatures alors qu’elle n’est en mesure d’assurer le financement que de 15 000 missions, 9 000 personnes accomplissant une mission actuellement.
Ces missions s’effectuent dans plusieurs cadres. L’engagement de service civique désigne l’engagement volontaire d’une durée continue de 6 à 12 mois ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans. Le volontariat de service civique, d’une durée de 6 à 24 mois, est quant à lui ouvert aux personnes âgées de plus de 25 ans. Enfin, le service civique a vocation à absorber le volontariat international en administration ou en entreprise, le volontariat de solidarité internationale(300) et le service volontaire européen (301).
Le contrat de service civique, qui n’est pas un contrat de travail (302), donne lieu à une indemnité intégralement prise en charge par l’État pour ce qui est de l’engagement de service civique, et par l’organisme d’accueil agréé pour ce qui est du volontariat de service civique (303).
D’après les chiffres fournis par M. Martin Hirsch, un mois de service civique représente une dépense de 950 euros pour le budget de l’État, soit 8 550 euros par jeune pour sa durée complète (en moyenne, 9 mois). Si l’objectif fixé d’un jeune sur dix engagé dans le cadre du service était atteint, il en coûterait 528 millions d’euros par an en rythme de croisière (304).
Par ailleurs, contrairement à certaines anticipations, le recrutement présente une grande diversité et le service civique n’attire pas que des jeunes déjà acquis aux valeurs républicaines, d’un très haut niveau d’étude. La population des engagés compte ainsi des personnes aux profils variés tant au plan scolaire et universitaire (des bacheliers sur le tard, des étudiants très diplômés) que professionnel et social (salariés, demandeurs d’emploi…).
D’après M. Martin Hirsch, le service civique est connu des jeunes soit par le bouche à oreille, soit par l’intermédiaire des réseaux partenaires avec lesquels l’Agence du service civique entretient des relations contractuelles (missions locales, centres d’information jeunesse), ou encore par le site Internet de l’Agence et par les radios dont les programmes sont orientés vers les jeunes (auprès desquelles a été organisée avec succès une campagne d’information).
S’agissant de la mixité, d’après les chiffres fournis par M. Martin Hirsch, les filles représentent 57 % des effectifs, les garçons, 43 %. L’Agence du service civique s’est fixé un objectif de maintien de la mixité dans une fourchette de 60 % - 40 %.
La loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique prévoit par ailleurs que les ressortissants de l’Union européenne ou des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les ressortissants d’États tiers justifiant d’un séjour régulier en France d’au moins un an peuvent s’engager aux mêmes conditions que les Français (305).
Dans ce prolongement, existent des accords de coopération franco-allemands permettant à de jeunes Allemands et à de jeunes Français d’accomplir leur service civique dans les deux pays (par exemple au mémorial de la déportation). Par ailleurs, des dispositions récentes permettent aux jeunes ayant accompli leur service volontaire européen d’être considérés comme ayant accompli un service civique en France.
Aussi, dans sa formule actuelle, le service civique recèle du point de vue de M. Martin Hirsch des potentialités dont il conviendrait de tirer pleinement parti.
La première façon d’exploiter ces potentialités serait d’augmenter le nombre des jeunes pouvant accomplir le service civique, l’objectif fixé fin mars 2011 étant d’ouvrir le service à près de 75 000 jeunes (soit 1 jeune sur 10), de sorte qu’il ait un impact significatif sur la population. À cette fin, il serait nécessaire d’accroître le nombre de missions financées dans le cadre de ce service.
Proposition n° 8 : Augmenter le nombre de missions financées dans le cadre du service civique.
La deuxième façon d’utiliser le service civique comme vecteur de l’intégration nationale serait de mettre en place la formation civique et citoyenne à laquelle l’Agence du service civique travaille actuellement, ayant établi le cahier des charges de cette formation et ayant déjà rendu obligatoire la formation au secourisme, afin non seulement d’augmenter le nombre des personnes aptes à prodiguer les premiers soins dans les situations d’urgence mais également d’assurer la transmission de valeurs.
La création de la formation civique et citoyenne supposerait la modification du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 relatif au service civique, dont la rédaction actuelle empêche le versement de subventions aux associations du fait de l’opposition des contrôleurs financiers.
Cela étant, certaines collectivités territoriales ont pris des initiatives en ce sens et un marché a pu être conclu de sorte que des prestations correspondantes puissent être assurées. De ce fait, selon M. Martin Hirsch, le déploiement de la formation civique et citoyenne pourrait intervenir assez rapidement sous réserve de la modification du décret précité.
Proposition n° 9 : Lever les obstacles juridiques à la mise en œuvre de la formation civique et citoyenne prévue dans le cadre du service civique.
La troisième façon de promouvoir le service civique serait de mener une réflexion sur les débouchés pouvant être ouverts aux jeunes après son accomplissement, de concert avec les armées et d’autres institutions. Une séquence sur le service civique est d’ores et déjà diffusée par les armées à l’occasion de la journée « défense et citoyenneté ». Par ailleurs, l’article L. 120-1, III, du code du service national prévoit que l’accomplissement du service civique donne lieu à la délivrance par l’État d’une attestation de service civique et d’un document décrivant les activités exercées et évaluant les aptitudes, les connaissances et les compétences acquises pendant la durée du service civique. Il est, en outre, prévu que l’accomplissement du service civique est valorisé dans les cursus des établissements secondaires et supérieurs, et qu’il est pris en compte au titre de la validation des acquis de l’expérience.
Proposition n° 10 : Étendre les débouchés offerts aux jeunes ayant accompli le service civique, notamment dans les armées.
c) Prendre en compte le service accompli lors de l’examen d’une demande de naturalisation
En application de la loi du 10 mars 2010, le service civique est également ouvert aux jeunes étrangers justifiant d’une résidence régulière d’un an (306). En outre, des accords internationaux permettent, par une clause de réciprocité (dernièrement par exemple, entre la France et l’Afrique du Sud), d’accomplir le service civique dans d’autres pays et d’accueillir dans ce cadre de jeunes étrangers.
Du point de vue de M. Martin Hirsch, le service civique peut constituer à cet égard un bon outil d’intégration des jeunes étrangers dans la mesure où leur participation traduit la volonté de s’engager dans un projet collectif.
Dans cette optique, il s’avère difficilement concevable de ne pas prévoir un débouché qui vaille reconnaissance de cet engagement par des possibilités de pleine intégration dans la société française.
La question se pose en des termes particuliers pour les demandeurs d’asile. Dans l’attente d’une décision sur leur statut, les demandeurs se trouvent en effet dans une situation paradoxale, disposant d’une allocation sans pour autant pouvoir occuper un emploi, ce qui est source de tension. M. Martin Hirsch a estimé en réponse à une question du rapporteur que l’on pourrait légitimement donner aux demandeurs d’asile la possibilité de réaliser un service civique (307).
Proposition n° 11 : Ouvrir le service civique aux demandeurs d’asile et mieux prendre en compte l’accomplissement du service civique par une personne qui demande la nationalité française, dans le cadre de la procédure de naturalisation.
d) Soutenir le projet de création d’un Institut du service civique
Lors de son audition, M. Martin Hirsch a fait état d’un projet de création d’un Institut du service civique, regroupant les meilleurs engagés dans ce cadre. Cette idée procède du constat suivant lequel certains jeunes révèlent à l’occasion de leur service des aptitudes au commandement, à l’encadrement ainsi qu’un sens certain de l’initiative tandis que des acteurs publics et privés cherchent à diversifier leur encadrement en recrutant en dehors des filières classiques. Ce projet d’établir un cadre de formation, qui n’est pas celui d’une école de la troisième chance à proprement parler, devrait vraisemblablement bénéficier du soutien de l’Union européenne et donnera lieu à un partenariat avec les établissements d’enseignement supérieur en France et avec des entreprises.
Proposition n° 12 : Appuyer le projet de création d’un Institut du service civique.
e) Intégrer les engagés du service civique au défilé du 14 juillet
Sur le plan de la transmission des valeurs, M. Martin Hirsch a tenu à attirer l’attention de la mission sur le travail qu’a été amené à accomplir un groupe d’une cinquantaine de jeunes engagés sur la définition des valeurs s’attachant au service civique et dont il ressort que, pour certains d’entre eux, la liberté, l’égalité et la fraternité ne constituent pas des valeurs qu’ils invoquent spontanément parmi les principes guidant leur engagement. À leurs yeux en effet, les valeurs fondamentales de la République ne trouvent aucune application concrète dans leur expérience quotidienne. En revanche, ce travail a révélé tout autant l’importance pour eux d’une reconnaissance de leur engagement par les autorités publiques et les collectivités territoriales.
Aussi M. Martin Hirsch a-t-il proposé que les jeunes du service civique prennent part au défilé militaire du 14 juillet, éventuellement vêtus d’une tenue spécifique. Dans son esprit, il s’agirait d’un moyen de matérialiser symboliquement le lien maintenu entre les jeunes et la nation malgré l’abandon du service militaire et de montrer qu’il existe diverses possibilités de la servir qui valent sa reconnaissance à l’occasion de la fête nationale. L’Italie a fait ce choix en faisant défiler à côté des membres de ses forces armées ceux qui accomplissent un service national au service de la cohésion nationale, que ce soit par l’intermédiaire des collectivités territoriales ou des associations.
M. Martin Hirsch a souligné que si le sentiment d’appartenance ne motivait pas l’engagement, l’engagement pouvait, lui, susciter le sentiment d’appartenance. De son point de vue, il faut faire en sorte que les jeunes apprennent par eux-mêmes à éprouver ce lien et s’en approprient naturellement les symboles sans que ceux-ci soient imposés pour la seule vertu de ce qu’ils représentent. Il faut savoir concilier une certaine tradition républicaine et la volonté très moderne d’un libre engagement.
De son point de vue, il apparaît souhaitable qu’à l’avenir, la citoyenneté ne se réduise pas à l’exercice du droit de vote et au paiement de l’impôt et des cotisations sociales mais conduise également à vouloir consacrer à tout âge une année de son existence au service de la collectivité, soit dans le cadre du service civique, soit sur une plus longue durée et sous diverses formes (par exemple, des actions ponctuelles de bénévolat accomplies sur une durée de 10 années).
Proposition n° 13 : Faire participer les engagés du service civique au défilé de la fête nationale.
B. VALORISER L’ENTRÉE DANS LA NATIONALITÉ
Pour les personnes qui acquièrent la nationalité française à raison d’une décision de l’autorité publique, dans le cadre d’une procédure de naturalisation, votre rapporteur propose de valoriser leur entrée dans la nationalité française en étendant aux bénéficiaires du statut de réfugié la condition de « stage » de cinq ans dont ils sont aujourd’hui dispensés au détriment de leur assimilation, en étendant et solennisant les cérémonies d’accueil dans la nationalité française, et en créant un examen écrit de naturalisation qui permette de mieux s’assurer notamment de la maîtrise de la langue française.
1. Faire évoluer les règles d’acquisition de la nationalité pour les réfugiés
En matière d’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique, autrement dit par naturalisation, l’article 21-17 du code civil prévoit que, sauf exceptions, « la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ». Outre la condition de résidence en France (308), la loi prévoit donc une condition de durée de séjour minimale sur le territoire, dite « condition de stage ».
Toutefois, cette condition de stage peut être écourtée (article 21-18 du code civil) voire écartée (article 21-19 du code civil) au profit de certaines catégories d’étrangers dont le profil témoigne de leur bonne intégration.
Ainsi, la condition de stage peut être réduite à deux ans pour l’étranger « qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France » (article 21-18, 2°, du code civil). L’étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel (309) ou qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française (310) est, quant à lui, dispensé de la condition de stage.
La loi fait également bénéficier de cette dispense de stage quinquennal « l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d’un Office français de protection des réfugiés et apatrides » (article 21-19, 7°, du code civil).
Or il a été rapporté à la mission, lors de son déplacement à la préfecture de Seine-Saint-Denis, que les exigences à l’égard des bénéficiaires du statut de réfugié qui demandaient à être naturalisés étaient minimales, notamment en matière d’insertion professionnelle et de maîtrise de la langue française (311).
Cette indulgence est du reste encouragée par la loi, puisque l’article 21-24-1 du code civil dispose que « la condition de connaissance de la langue française ne s’applique pas aux réfugiés politiques et apatrides résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze années et âgés de plus de soixante-dix ans ».
Il s’agit moins de remettre en cause cette dernière disposition dont la souplesse ne profite vraisemblablement qu’à un petit nombre de réfugiés, compte tenu de l’âge et de la durée de séjour requis, que de remettre en cause la dispense de stage dont bénéficient les réfugiés qui sollicitent l’octroi de la nationalité française.
La dispense de stage actuellement attachée au statut de réfugié est susceptible de rendre ce statut attractif au point qu’il soit sollicité et utilisé abusivement pour contourner les règles de droit commun de la procédure de naturalisation.
Lors de son déplacement à Bobigny, la mission a d’ailleurs constaté que, dans un souci d’harmonisation du traitement des demandes de naturalisation, les services préfectoraux étaient favorables à l’extension de la condition de séjour de cinq années sur le territoire national, à la date du dépôt de la demande de naturalisation, aux candidats qui bénéficient du statut de réfugié (312).
Selon les services préfectoraux, l’extension de cette condition de stage quinquennal aux bénéficiaires du statut de réfugié leur permettrait de profiter de cette période pour approfondir leur maîtrise de la langue française et réaliser leur insertion sociale et professionnelle.
Votre rapporteur propose donc d’abroger le 7° de l’article 21-19 du code civil de façon à aligner les conditions de naturalisation des bénéficiaires du statut de réfugié sur les conditions de droit commun.
Une telle mesure ne semble pas contrevenir fondamentalement aux engagements internationaux de notre pays. Lors de son audition, M. Philippe Leclerc, représentant du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), a rappelé que le droit de la nationalité en vigueur en France organisait la recherche de solutions durables pour la protection des réfugiés en leur permettant d’acquérir relativement facilement la nationalité française (313).
En cela, la France met en œuvre la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, qu’elle a ratifiée et dont l’article 34 demande aux États contractants de faciliter dans toute la mesure du possible l’assimilation et la naturalisation des réfugiés, notamment en accélérant la procédure de naturalisation, et de réduire, dans la mesure du possible, les taxes et frais de cette procédure (314).
Certes, les États contractants s’engagent à faciliter la naturalisation des réfugiés, notamment en en accélérant la procédure. Mais il convient de souligner d’une part, qu’il leur est également demandé de faciliter l’assimilation de ces mêmes réfugiés, et d’autre part, que ces mesures facilitant l’accès des réfugiés à la nationalité du pays d’accueil doivent être prises dans toute la mesure du possible. En d’autres termes, non seulement l’expression « dans toute la mesure du possible » ménage une marge de manœuvre et d’appréciation aux États signataires de la Convention, mais en outre, il apparaît contraire à l’esprit de la Convention que la législation des États signataires prévoit des aménagements de la procédure de naturalisation dont l’effet serait de faciliter la naturalisation au détriment de l’assimilation, qui, elle aussi, doit être favorisée.
La suppression de la dispense de stage dont bénéficient les réfugiés qui sollicitent la naturalisation est d’autant moins choquante que, lors de son audition, M. Pierre Henry, directeur général de l’association « France terre d’asile », a indiqué que, dans les faits, la durée moyenne de séjour des réfugiés sur le territoire au moment de leur naturalisation équivalait à celle des autres candidats à la naturalisation, à savoir entre quinze et dix-huit ans (315). Il n’y aurait aucun inconvénient à ce que la loi prévienne des détournements abusifs mais minoritaires des dispositions en vigueur, sans pour autant porter préjudice à la grande majorité des réfugiés qui demandent la nationalité française, puisque l’alignement des conditions de leur naturalisation sur celles du droit commun reviendrait à tirer en droit les conséquences d’un état de fait qui conduit à constater qu’au moment où est entamée une procédure de naturalisation, la durée de séjour des réfugiés sur le territoire est, en moyenne, la même que celle des autres candidats à la nationalité française.
La proposition de votre rapporteur apparaît par ailleurs comme un compromis bien moins choquant que les mesures radicales envisagées au Royaume-Uni. Lors de l’entretien que la mission a eu à Londres avec des membres de l’Agence de l’immigration, il avait été indiqué que les autorités britanniques envisageaient de limiter l’octroi du statut de réfugié à 20 000 personnes par an, de façon à éviter que ce statut ne soit utilisé pour contourner les règles de l’immigration légale et de la naturalisation (316). Prévenir le détournement abusif du statut de réfugié par un alignement des conditions de naturalisation de leurs bénéficiaires sur les conditions de droit commun semble bien plus mesuré et circonspect que de fixer un quota annuel de réfugiés, dont l’application stricte et arithmétique pourrait avoir des conséquences humaines désastreuses.
Enfin, la garantie d’une assimilation linguistique et culturelle qui est recherchée par l’alignement des conditions de naturalisation des réfugiés sur les conditions de droit commun s’inscrit tout à fait dans la logique de la loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité récemment votée. Si cette loi a ajouté à l’article 21-18 du code civil un nouveau cas de réduction de la durée de stage de cinq ans à deux ans au profit de « l’étranger qui présente un parcours exceptionnel d’intégration, apprécié au regard des activités menées ou des actions accomplies dans les domaines civique, scientifique, économique, culturel ou sportif », c’est dans un souci de privilégier l’accès à la nationalité française des candidats dont l’assimilation est attestée. Il serait juste et cohérent que cette mesure de faveur trouve sa contrepartie dans la suppression de mesures encore plus favorables qui profitent à des candidats dont l’assimilation n’est pas toujours attestée.
Le droit en vigueur, en plus de manquer de cohérence, recèle une rupture d’égalité potentielle entre les candidats à la naturalisation, au regard du degré d’assimilation qui est exigé d’eux : c’est la raison pour laquelle votre rapporteur vous invite à abroger le 7° de l’article 21-19 du code civil.
Proposition n° 14 : Étendre aux bénéficiaires du statut de réfugié la condition de « stage » de cinq ans pour demander la naturalisation en abrogeant le 7° de l’article 21-19 du code civil.
Alors qu’il exige de l’étranger qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France (article 21-18, 2°, du code civil), et qu’il exigera bientôt de l’étranger qui présente un parcours exceptionnel d’intégration, d’avoir eu sa résidence habituelle en France pendant au moins deux ans avant de pouvoir demander la naturalisation, le droit français de la nationalité dispense de toute condition de stage les bénéficiaires du statut de réfugié dont l’assimilation, tant linguistique que culturelle, n’est pas toujours attestée.
Il convient donc d’aligner les bénéficiaires du statut de réfugié sur le droit commun des candidats à la naturalisation, en exigeant d’eux qu’ils aient leur résidence habituelle sur le territoire au moins pendant les cinq années qui précèdent leur demande de naturalisation, notamment afin que le statut de réfugié ne soit pas abusivement sollicité et utilisé aux fins de contourner les règles d’accès à la nationalité française.
2. Étendre et donner toute la solennité qu’il convient aux cérémonies d’accueil dans la nationalité française
Créée par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, la cérémonie d’accueil dans la nationalité française vise à conférer un caractère symbolique à l’acquisition de la nationalité française à raison du mariage, de la naissance et de la résidence en France pour les enfants mineurs de parents étrangers, par déclaration de nationalité, par naturalisation ou à la réintégration dans la nationalité.
En application de l’article 21-28 du code civil, l’organisation de ces cérémonies doit intervenir dans un délai de six mois à compter de l’acquisition de la nationalité. Elle relève de la responsabilité des préfets ou, à Paris, du préfet de police. L’article 21-29 prévoit toutefois que, s’il en fait la demande auprès du préfet, le maire peut, en sa qualité d’officier d’état civil, se charger d’organiser la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française.
Dans l’optique qui est celle de la mission, on ne peut que se féliciter de la création de ce dispositif dans la mesure où, grâce à lui, l’acquisition de la nationalité française ne se réduit pas à l’aboutissement d’une simple procédure administrative. La remise du décret de naturalisation et l’invitation, prévue par la loi, des députés et des sénateurs élus dans le département concourent également à marquer d’une charge affective cet événement qui constitue un passage pour nombre des personnes obtenant la qualité de Français. Du reste, d’après les éléments dont a fait état M. Michel Aubouin, directeur de l’accueil, de l’intégration et de la citoyenneté du ministère de l’Intérieur (317), il convient de souligner la très forte participation aux cérémonies d’accueil des personnes qui acquièrent la nationalité française, de l’ordre de 90 % des naturalisés.
Cependant, quelques signalements donnent à penser que l’organisation des cérémonies d’accueil dans la citoyenneté revêt un caractère inégal et prend des formes diverses sur le territoire national. Tel est le sentiment que les membres de la mission ont pu retirer de leur visite à la préfecture de Seine-Saint-Denis (318). Responsable d’un département dans lequel ont été organisées, en 2010, 104 cérémonies, M. Christian Lambert a ainsi indiqué que si le principe même des cérémonies ne souffrait pas de contestation, il importait en revanche de clarifier les compétences entre les autorités chargées de leur organisation.
En l’absence de toute évaluation précise des conditions de mise en œuvre de ce dispositif, il n’apparaît pas illégitime de se demander dans quelle mesure les cérémonies sont organisées suivant le lieu d’habitation. Le seul élément dont dispose en tout cas à ce jour la mission est que, selon M. Michel Aubouin (319), les préfets ont reçu des instructions pour organiser ces cérémonies,
Du point de vue de la mission, il importe donc d’envisager d’une part de transférer éventuellement la compétence de principe aux communes pour l’organisation des cérémonies d’accueil dans la citoyenneté française, sous réserve d’une compensation des charges induites par l’exercice de cette nouvelle compétence. Ce transfert pourrait se justifier dans la mesure où, en application du premier alinéa de l’article 21-29 du code civil, les préfets sont tenus de communiquer au maire, en sa qualité de d’officier d’état civil, l’identité et l’adresse des personnes résidant dans la commune susceptibles de bénéficier de la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française. La commune peut apparaître ainsi comme l’échelon le plus à même d’exercer cette compétence compte tenu de sa proximité avec les administrés.
D’autre part, afin que la cérémonie revête une certaine solennité de part et d’autre du territoire national, il peut apparaître souhaitable d’en formaliser le déroulement et d’en faire ainsi partout un véritable cérémonial marquant le plus symboliquement possible l’acquisition de la nationalité française et l’entrée dans une communauté d’appartenance.
Proposition n° 15 : Systématiser les cérémonies d’accueil dans la nationalité française en transférant éventuellement aux communes la responsabilité de leur organisation et en formalisant leur déroulement.
3. Instituer un examen de naturalisation en renforçant les exigences de maîtrise de la langue française
Pour s’assurer que les candidats à la naturalisation sont bien parvenus au terme du processus d’intégration, qu’ils ont assimilé la langue, la mémoire et les valeurs allemandes, et que ces efforts témoignent d’une volonté d’intégrer la nation allemande, les autorités les soumettent outre-Rhin à des tests de naturalisation ainsi qu’à un serment de loyauté à l’égard des institutions et des lois de la République fédérale.
Si votre rapporteur a écarté la prestation de serment, parce que porteuse d’une forte connotation religieuse et en tant que telle étrangère à la conception laïque de la nation en France, il pense néanmoins que l’institution d’un examen de naturalisation sur le modèle allemand présenterait en France un grand intérêt.
a) Les actuelles insuffisances de l’évaluation de l’assimilation linguistique et culturelle
D’ores et déjà, l’article 21-24 du code civil dispose que « nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ».
La loi n° 2011-672 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, promulguée le 16 juin 2011, prévoit d’étoffer le champ de l’évaluation en ajoutant à l’évaluation de la maîtrise de la langue, celle de la connaissance « de l’histoire, de la culture et de la société françaises ». Par ailleurs, à la condition de connaissance de langue, de l’histoire, de la culture, de la société, ainsi que des droits et devoirs du citoyen, le texte déféré au Conseil constitutionnel projette d’ajouter la condition d’« adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ».
Ces connaissances et cette adhésion devront faire l’objet d’une évaluation dont le niveau et les modalités seront fixés par décret en Conseil d’État.
Votre rapporteur, qui a également été rapporteur du projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, ne peut qu’appeler de ses vœux l’organisation d’une évaluation approfondie et sérieuse de la maîtrise de la langue et des connaissances de l’histoire, de la culture et des valeurs de la République.
Cette évaluation est aujourd’hui loin d’être satisfaisante. L’évaluation linguistique se résume à un bref entretien oral que les agents préfectoraux ne sont pas les mieux placés pour mener. Lors de son audition, M. Michel Aubouin, directeur de l’accueil, de l’intégration et de la citoyenneté au ministère de l’Intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, a en effet attiré l’attention des membres de la mission sur le fait que l’appréciation du niveau de langue des candidats à la naturalisation par de simples agents préfectoraux plutôt que par des professionnels n’apparaissait guère satisfaisante(320).
Quant aux actuels entretiens de citoyenneté censés permettre, depuis 2003, de s’assurer de la connaissance, par le candidat à la nationalité française, des droits et des devoirs attachés à la qualité de national, la mission a constaté lors de son déplacement à la préfecture de Seine-Saint-Denis qu’ils n’étaient pas toujours mis en œuvre et que, quand ils l’étaient, ils consistaient, là aussi, en une évaluation extrêmement sommaire, pour ne pas dire minimale. Les services préfectoraux ont souligné la nécessité, pour mettre en œuvre les entretiens individuels de citoyenneté, de guides et de directives ministériels suffisamment précis en la matière. En leur absence, bien des préfectures montrent des réticences à organiser des entretiens de citoyenneté, d’autant qu’il est difficile d’évaluer le degré de partage des valeurs de la République par des candidats dont la demande est souvent motivée par des considérations d’ordre matériel (stabilité administrative, familiale et professionnelle) (321).
• Les tests pour l’obtention d’un titre de séjour
Certains pays soumettent la délivrance de titres de séjour à des tests. Ainsi, l’Allemagne soumet l’obtention d’un permis de séjour temporaire à la certification d’un niveau minimal de maîtrise de l’allemand. Cette certification résulte du passage d’un test écrit dans le pays d’origine, qui, organisé en partenariat avec l’institut Goethe local, coûte environ 65 euros au candidat au séjour.
Les Pays-Bas soumettent, quant à eux, l’autorisation de séjour provisoire à la réussite d’un test oral d’intégration civique qui, organisé dans le pays d’origine en partenariat avec des sociétés privées, coûte environ 230 euros au candidat au séjour, pour qui il est obligatoire, même dans le cadre du regroupement familial. Quant à l’obtention du permis de séjour permanent, elle est soumise à un examen écrit d’intégration civique qui porte à la fois sur les compétences linguistiques et sur la connaissance de la société néerlandaise. Consistant dans des mises en situations de la vie courante, le test de langue comporte 48 questions, dure 15 minutes et présente un niveau d’exigences défini par rapport au cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).
Ces tests sont prévus dans le cadre du droit d’entrée et de séjour sur les territoires allemand et néerlandais et ne doivent pas être confondus avec les tests de naturalisation.
Au Royaume-Uni, des cours d’intégration sont proposés aux personnes qui n’ont pas une connaissance suffisante de l’anglais, du gallois ou du gaélique écossais. Ces cours, dits « d’anglais et de citoyenneté » (English for Speakers of Other Languages - ESOL) ont été mis en place en janvier 2005, comportent des leçons de langue et d’éducation civique, et sont sanctionnés par un examen final.
En Allemagne, depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, de la loi du 30 juillet 2004 sur l’immigration, des cours d’intégration, gratuits ou quasiment gratuits (322), sont offerts aux immigrés afin de les accompagner dans leur parcours d’intégration et, à plus long terme, de les préparer à la procédure de naturalisation, et notamment au test de naturalisation.
Destinés à leur permettre de s’insérer sur le marché du travail et plus généralement dans la société allemande en acquérant la connaissance de ses valeurs et en acquérant une maîtrise suffisante de la langue, ces cours d’intégration (Integrationskurs) s’adressent à tous les ressortissants des pays tiers à l’Union européenne arrivant sur le territoire allemand depuis le 1er janvier 2005. Quel que soit le profil de l’immigrant (parent, travailleur ou réfugié), le suivi de ces cours est obligatoire s’il veut obtenir une autorisation d’établissement, et, a fortiori, la naturalisation, au bout de huit ans de séjour sur le territoire allemand.
Les cours d’intégration sont facultatifs pour les étrangers installés en Allemagne avant le 1er janvier 2005. S’ils le souhaitent, les « anciens immigrés » peuvent en bénéficier pour favoriser le « rattrapage » de l’intégration manquée. Les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne en sont dispensés, étant considérés comme unis par une communauté de valeurs et d’histoire avec les Allemands.
Cette formation comprend 600 heures de cours de langue et 45 heures de cours d’éducation civique, dits « cours d’orientation », portant sur l’histoire, la géographie, la culture et les valeurs allemandes. Ils ont été suivis par 250 000 personnes en 2005, dont la moitié à titre volontaire. Depuis 2005, ils ont été suivis par 700 000 personnes environ, alors que le nombre de participants potentiels est évalué à 1,8 million de personnes. Ils donnent lieu à un examen final (le « certificat d’intégration ») qui consiste, d’une part, en un test de langue et, d’autre part, en un « test d’orientation » sous forme de 25 questions à choix multiples portant sur des aspects culturels.
Toutefois, selon le ministre de l’Intérieur du Land de Berlin, rencontré par la mission lors de son déplacement dans la capitale fédérale, le bilan des cours d’intégration est mitigé (323). Il est donc envisagé d’en accroître l’efficacité en rendant obligatoire le redoublement en cas d’échec aux « tests d’orientation », ce qu’il n’est pas à l’heure actuelle.
Depuis la loi du 15 juillet 2009 portant dispositions en matière de sécurité publique, entrée en vigueur en mai 2010, il existe en Italie un « accord d’intégration » qui préfigure une forme de permis de séjour à points dans le cadre duquel l’assiduité à des cours de culture et d’instruction civique italiennes peut contribuer à la validation des 30 points requis de l’étranger tous les deux ans pour renouveler son titre de séjour.
En France, l’évaluation du niveau de langue et du degré d’assimilation des candidats à la naturalisation à l’occasion d’un entretien avec les agents préfectoraux est minimaliste, à l’image de ce qui se fait aux États-Unis. Dans ce pays, l’évaluation des connaissances civiques et linguistiques se fait au cours d’un entretien avec un agent de l’administration chargée de l’immigration, baptisée United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) (324). Des questions sont posées sur le passé du postulant, sur les raisons de sa demande, sur sa personnalité et sur son attachement à la Constitution américaine.
En Espagne, l’évaluation du degré d’adaptation à la culture et au mode de vie espagnols est également orale, mais c’est le juge du registre civil qui y procède. Muni d’un dossier réunissant tous documents utiles (diplômes…), le juge du registre civil procède à l’audition du candidat à la naturalisation et lui pose des questions de culture générale sur les institutions, l’histoire et les coutumes espagnoles. Au regard de cet entretien, le magistrat adresse au ministre de la Justice un rapport favorable ou défavorable à l’octroi de la nationalité (325).
Au Royaume-Uni, des tests écrits ont été mis en place dès 2001 afin de vérifier les connaissances linguistiques du candidat à la naturalisation, ainsi que ses connaissances des us et coutumes britanniques.
Si la personne parle correctement l’anglais, le gallois ou le gaélique écossais, elle doit passer le test sur « la vie au Royaume-Uni » (Life in the UK Test). Ce test a été mis en place le 1er novembre 2001 afin de vérifier les connaissances de la vie au Royaume-Uni du postulant à l’obtention de la nationalité britannique. La réussite de ce test dispense le candidat d’attester de ses connaissances linguistiques. Ce test de culture générale consiste en 24 questions à choix multiples sur des aspects de la vie courante ainsi que sur les symboles et les traditions du pays. Il coûte environ 41 euros. Le site Internet de l’Agence de l’immigration (UK Border Agency) donne des informations sur la préparation de ce test et sur les 65 centres agréés qui le font passer.
Si la personne n’a pas une connaissance suffisante de l’anglais, du gallois ou du gaélique écossais, elle doit suivre des cours « d’anglais et de citoyenneté » (English for Speakers of Other Languages - ESOL) et réussir l’examen correspondant.
Si la personne a déjà passé et réussi le Life in the UK Test ou un ESOL course, elle n’a pas besoin de justifier à nouveau sa connaissance de la langue et des us et coutumes du Royaume-Uni lors de sa candidature à la naturalisation.
Les personnes âgées de plus de 65 ans ou atteintes de déficiences physiques ou mentales peuvent être dispensées de passer les tests.
Toute autre personne prétendant à la nationalité britannique doit remplir ce critère. Aucune dérogation n’est accordée en fonction de l’origine du demandeur. Ainsi, les citoyens de l’Union européenne, tout comme les étrangers dont la langue maternelle est l’anglais, sont soumis à ce test. Le certificat d’obtention du test continue un élément nécessaire au dossier de naturalisation.
Le Home Office a confié la gestion de cet examen de connaissances à des centres spécialisés, organisations indépendantes spécialisées dans les cours d’anglais et les examens par informatique. Chacune de ces organisations répond à des critères de sélection rigoureux et est approuvée par le Home Office (326).
Au Canada, les tests écrits n’excluent pas l’évaluation orale. Les candidats à la naturalisation doivent y passer des examens de connaissance de la société canadienne, qui se présentent sous forme de questionnaires à choix multiples comprenant 25 questions. Les aptitudes linguistiques sont appréciées au cours d’entretiens réalisés avec des fonctionnaires de « Citoyenneté et Immigration Canada ». Le requérant doit avoir un niveau de français ou d’anglais suffisant. Il doit pouvoir comprendre des énoncés et des questions simples à l’oral et être en mesure de transmettre des renseignements simples (327).
Si le candidat échoue à l’examen écrit et en cas de doutes sur ses compétences linguistiques, il est convoqué à un entretien avec un juge de la citoyenneté, qui dure entre 15 et 30 minutes. Au cours de cette entrevue, le juge posera oralement des questions au candidat pour lui permettre de démontrer qu’il répond à toutes les exigences relatives à la citoyenneté, et notamment celles ayant trait à la maîtrise de la langue et à la culture générale. Ce juge apprécie souverainement les capacités du candidat à la naturalisation (328).
En Allemagne, non sans susciter des débats, un test de naturalisation a été introduit dès 2005 dans certains Länder et au niveau fédéral en 2008. Contrairement à l’évaluation du niveau de langue et du degré d’assimilation qui, en France, est orale, ce test consiste en un examen écrit sous forme de 33 questions à choix multiples auxquelles les candidats doivent répondre dans un délai d’une heure. Pour ce qui est des compétences linguistiques, les exigences sont définies par rapport au cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).
Le taux de réussite s’élève à 98 %. Un tel taux s’explique par le fait qu’il n’y a pas d’intention dissuasive de la part des autorités qui veulent seulement inciter les candidats à la naturalisation à s’informer sur l’histoire, les institutions et les lois de la République fédérale. Des exemples de tests sont même fournis sur le site Internet du ministère fédéral de l’Immigration afin que les candidats puissent s’exercer dans les meilleures conditions.
Ce test, auquel sont soumis des candidats à la naturalisation qui, par définition, ont séjourné au moins 8 ans sur le sol allemand (329), présente un niveau de difficulté un peu plus élevé que le test « d’orientation » qui est réalisé dans le cadre des cours d’intégration. Mais comme l’illustre le taux de réussite (98 %), dès lors que la loyauté du candidat à l’égard des institutions allemandes et son respect pour les lois de la République fédérale sont attestés, la nationalité allemande est accordée sans grandes difficultés. Seule une condamnation pénale dans le passé du candidat pourrait y faire obstacle.
L’idée d’un test de naturalisation a fait des émules en Europe, puisqu’en Italie, où les candidats à la naturalisation devaient déjà se soumettre à une évaluation orale de leur niveau de langue à l’occasion d’un entretien, ils doivent désormais, en application de la loi du 15 juillet 2009 portant dispositions en matière de sécurité publique, se soumettre à des tests écrits. Cette loi, qui a créé l’accord d’intégration, a également prévu qu’en cas d’impossibilité pour les agents du guichet unique d’attester la connaissance par le candidat de la langue et de la culture italienne, ce dernier devra se soumettre à un test portant à la fois sur la maîtrise de la langue et sur la connaissance de la Charte constitutionnelle, des lois et institutions italiennes ou encore des obligations fiscales (330).
Les services préfectoraux se sont, certes, montrés perplexes à l’idée d’une éventuelle transposition en France du dispositif existant en Allemagne (331), au motif qu’un test de langue et de connaissances uniformisé au niveau national présenterait un risque que les candidats à la naturalisation apprennent par cœur les questions et les réponses, faussant ainsi l’évaluation. Mais M. Patrick Gaubert, président du Haut conseil à l’intégration, s’est montré favorable à l’institution d’un examen de naturalisation, dans la mesure où le but de cet examen serait d’aider les gens à s’intégrer (332).
L’institution d’un test de naturalisation, écrit et exigeant, sur le modèle allemand, permettrait de s’assurer de ce que les candidats à la nationalité française se sont bien fondus dans ce que M. Tzvetan Todorov appelle la « culture-cadre », traduction de la notion allemande de « Leitkultur », qu’il définit comme une culture de référence permettant la communication et le dialogue entre toutes les cultures présentes au sein d’une société, par hypothèse multiculturelle (333).
Dans ce test, la question de la maîtrise de la langue française est cardinale. M. Patrick Weil l’a démontré lors de son audition (334) : la langue constitue le troisième pilier de la nationalité française.
Historiquement, elle représente en effet un catalyseur, une source d’unification du territoire à l’exemple de l’ordonnance de Villers-Cotterêt qui, en 1539, imposait le recours au français dans l’établissement des registres paroissiaux et des actes de justice. La création par Richelieu d’une compagnie de gens bien nés recevant pour mission d’œuvrer à l’embellissement du langage – l’Académie Française – s’impose également comme l’un des instruments majeurs de la centralisation monarchique et de l’affirmation d’une culture nationale.
Aujourd’hui, suivant l’analyse développée par M. Tzvetan Todorov, la langue doit être tenue pour le premier fondement d’une culture-cadre, l’élément constitutif primordial en ce qu’il conditionne tous les autres et permet la communication entre les membres de la société et un fonctionnement harmonieux de celle-ci.
Dans cette optique, le renforcement par le législateur des exigences qui doivent être remplies concernant la maîtrise de la langue pour obtenir la nationalité française va dans le bon sens. Par principe, suivant l’article 21-24 du code civil, tel que modifié par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 (335), « nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française (…) ».
La loi n° 2011-672 précitée relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, a, pour sa part, affermi les conditions exigibles des étrangers ou apatrides contractant mariage avec un conjoint de nationalité française. L’article 2 du texte modifie ainsi le dernier alinéa de l’article 21-2 du code civil en prévoyant expressément une évaluation du degré de maîtrise de la langue française suivant des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
Il apparaît en effet nécessaire que le contrôle de ce prérequis essentiel pour l’acquisition de la nationalité française ne varie pas suivant les conditions pratiques d’examen des requêtes dans chaque préfecture. Du point de vue de la mission, il importe que cette évaluation repose sur des critères uniformes, objectifs et exigeant permettant véritablement de juger de la capacité des personnes qui rejoignent la communauté nationale de pouvoir participer pleinement à la vie de la cité par-delà l’accomplissement des démarches quotidiennes.
Dans cette optique, la mission préconise d’une part que l’évaluation de la maîtrise de la langue incombe à un personnel administratif professionnalisé, spécialement formé à l’accomplissement de cette tâche. Il conviendrait aussi de déployer un plan de formation permettant aux agents administratifs concernés d’acquérir les compétences requises et de développer un savoir-faire professionnel.
D’autre part, la mission invite le pouvoir réglementaire à définir le plus précisément possible les éléments d’évaluation de la maîtrise de la langue exigée des personnes demandant à devenir français. Ainsi que l’a indiqué M. Stéphane Fratacci, secrétaire général au ministère de l’Intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration (336), l’évaluation du niveau de langue est facilitée à l’heure actuelle par la mise à disposition d’un guide.
M. Thierry Mariani, alors député et rapporteur, en première lecture, du projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, avait d’ailleurs signalé dans son rapport qu’il serait judicieux de confier au pouvoir réglementaire le soin de définir un référentiel commun en matière d’évaluation des compétences linguistiques des candidats à la naturalisation (337). M. Thierry Mariani avait indiqué que l’on « pourrait avantageusement s’inspirer de tout ou partie de l’échelle des niveaux linguistiques établie par le cadre européen commun de référence sur les langues (CECRL) publié en 2001 par le Conseil de l’Europe » (338).
La certification du niveau de connaissance de la langue française par les candidats à la naturalisation serait ainsi plus objective qu’elle ne l’est aujourd’hui. Il leur faudrait obtenir, auprès d’organismes de certification linguistiques agréés par la voie réglementaire, une attestation que les agents préfectoraux auraient seulement à contrôler, n’ayant plus à évaluer eux-mêmes la maîtrise du français au cours de l’entretien d’assimilation. Le coût d’une telle démarche devrait se situer entre 50 et 100 euros pour les intéressés. Il existe actuellement 70 centres sur le territoire national qui sont capables de procéder à de telles évaluations. L’entretien d’assimilation en préfecture gagnerait ainsi à la fois en objectivité et en facilité, puisqu’il serait plus aisé à conduire pour les agents de l’État.
Il conviendrait que la définition des critères attestant d’une connaissance suffisante de la langue prenne pour exemple les compétences requises pour l’obtention du diplôme d’études en langue française A2 (DELF A2). Correspondant au premier niveau d’utilisateur élémentaire du cadre européen, ce diplôme atteste d’une maîtrise des structures de base de la langue, l’apprenant titulaire du DELF A2 devant être capable de réaliser des tâches simples de la vie quotidienne à l’écrit comme à l’oral (achats, travail, vie personnelle et familiale). Cette proposition tient compte du fait que la naturalisation n’intervient souvent qu’après 10 à 15 années de résidence.
Les diplômes attestant d’une maîtrise de la langue dans le cadre des procédures d’accueil de l’immigration § Le diplôme initial de langue française (DILF) • créé spécifiquement pour le contrat d’accueil et d’intégration, visant les personnes non ou peu scolarisées, ce diplôme valorise les premiers acquis. • les compétences à l’oral sont proches de celles attestées par le DELF A1. • les compétences à l’écrit sont peu prises en compte, les publics visés n’ayant pas souvent la maîtrise de l’écrit de leur langue maternelle. § Le diplôme d’Études en langue française A1 (DELF A1) • ce diplôme correspond au premier niveau d’utilisation de la langue maternelle défini par le cadre européen et concerne les personnes scolarisées dans leur langue maternelle ; • l’apprenant titulaire du DELF A1 doit pouvoir réaliser des interactions simples, parler de lui et de son environnement immédiat, comprendre un écrit rudimentaire (affiches, annonces, catalogue, etc.) et produire un écrit simple de type « carte postale ». § Le diplôme d’études en langue française(DELF A2) : voir supra.
|
En revanche, la mission n’estime pas très pertinent d’établir un test de langue unifié à l’échelle nationale. Un tel examen ne semble pas en effet présenter un intérêt majeur par rapport à l’entretien d’évaluation de la langue réalisé dans les préfectures. Par ailleurs, cette modalité comporte le risque de fausser les résultats de l’évaluation, les candidats pouvant éventuellement apprendre par cœur un certain nombre de questions et de réponses de l’examen.
Proposition n° 16 :
– Instituer un test écrit de naturalisation portant à la fois sur la maîtrise de la langue, définie conformément au cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), et sur la connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises ;
– Établir une procédure d’évaluation plus stricte concernant la maîtrise de la langue par un effort de formation des personnels affectés à cette tâche et la définition de critères d’un niveau égal à celui des compétences exigées pour l’obtention du diplôme DELF A2.
C. CHOISIR OU DÉCLARER UNE ALLÉGEANCE
Manifester la volonté d’appartenir à la nation française et d’en acquérir la nationalité suppose que cette nationalité soit affective et effective. Partant, votre rapporteur propose d'en finir avec l'ignorance des allégeances multiples par une obligation de déclaration et d'entamer une politique visant à limiter les abus de multinationalités. Cette action au niveau national doit être confortée par une action au niveau international, allant dans le sens de la réduction des appartenances nationales multiples au moyen de conventions bilatérales et d’une convention-cadre internationale en la matière. Le rapporteur est parfaitement conscient des difficultés posées par cette question ignorée de notre droit. Il estime néanmoins que la mondialisation poussera les États à des modifications, probablement lentes mais nécessaires.
1. Promouvoir la notion de nationalité effective en imposant une obligation de choix
Plutôt que de reconnaître à certaines personnes une multiplicité de nationalités, il apparaît préférable de les amener à choisir et de ne leur reconnaître qu’une nationalité, correspondant à ce que les jurisprudences interne et internationale désignent par la notion de « nationalité effective ». Il serait souhaitable que cette nationalité « effective » soit également leur nationalité « affective ».
a) La « nationalité effective » en droit international
Dès 1915, la jurisprudence interne a refusé de se conformer aux législations et aux décisions des États étrangers en matière de nationalité, dès lors qu’il apparaissait aux juges que la nationalité qui en résultait était plus fictive qu’effective. Dans un jugement du 13 juillet 1915, le tribunal civil de la Seine a ainsi refusé de reconnaître la nationalité brésilienne d’une personne au motif que celle-ci lui avait été attribuée en application « d’une législation anormale » faite de « dispositions exorbitantes du droit commun international » en matière d’état des personnes (339).
C’est pourtant bien plus tard que s’est forgé le « droit commun international » applicable en la matière. La notion de « nationalité effective » n’a en effet pris corps en droit international qu’avec l’arrêt Nottebohm rendu le 6 avril 1955 par la Cour internationale de justice, évoqué au début du présent rapport (340).
La Cour internationale de justice a amorcé dans cet arrêt le processus de morcellement de la nationalité en en distinguant les effets internes et internationaux. La haute juridiction admit en effet qu’une nationalité pouvait produire des effets en droit interne sans pour autant produire des effets en droit international dès lors que ses règles de détermination n’étaient pas conformes à ce dernier.
Tout en reconnaissant aux États la compétence pour fixer les règles de détermination de la nationalité (341), elle a ainsi restreint leur souveraineté en la matière, ou tout au moins leur marge d’appréciation pour ce qui est des effets internationaux de la nationalité, en posant une exigence d’effectivité.
Si l’on peut interpréter cette décision comme opérant un morcellement de la notion de nationalité, jusqu’ici conçue comme étant unitaire, et comme contribuant en tant que telle à son affaiblissement, on peut tout aussi bien l’interpréter comme une promotion de la notion de nationalité dès lors que celle-ci présente un minimum d’effectivité et de consistance.
La décision Nottebohm propose l’une des premières définitions relativement complètes de la nationalité dont on dispose en droit international. La nationalité y est en effet définie comme « un lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective d’existence, d’intérêts, de sentiments, joints à une réciprocité de droits et de devoirs », et comme « l’expression juridique du fait que l’individu auquel elle est conférée, soit directement, soit par la loi, soit par un acte d’autorité, est, en fait, plus étroitement attaché à la population de l’État qui la lui confère qu’à celle de tout autre État » (342).
Cette définition fait certes de la nationalité un lien juridique mais elle intègre aussi la dimension idéologique (« solidarité effective d’intérêts », « réciprocité de droits et de devoirs »), affective (« solidarité effective de sentiments ») et culturelle (« fait social de rattachement ») qu’ont prise les notions de nation et de nationalité à la Révolution française et à la fin du XIXe siècle. C’est donc une conception enrichie et ambitieuse de la nationalité que la Cour internationale de justice met en avant.
C’est bien davantage valoriser la nationalité que la dévaluer que d’inviter les États à octroyer leur nationalité seulement si elle est effective. Si l’on peut voir dans cette décision une forme d’empiétement de la juridiction internationale sur le domaine de compétence exclusive et souveraine des États, on peut tout aussi bien y voir un appel aux États à abandonner une conception légère de la nationalité, indifférente à son caractère fictif, au profit d’une exigence en la matière qui serait plus respectueuse de la notion de nationalité.
Si, conformément à la jurisprudence internationale, les États se montraient plus exigeants quant à l’effectivité de la nationalité qu’ils octroient ou attribuent, les phénomènes d’appartenances multiples, qui aujourd’hui prolifèrent, se raréfieraient à coup sûr. C’est du reste ce à quoi conclut Amélie Dionisi-Peyrusse dans le commentaire qu’elle fait de l’arrêt Nottebohm : « Une plus grande prise en considération de l’effectivité dans la détermination de la nationalité permettrait donc de ne pas avoir recours à une dissociation entre effets internationaux et effets internes de la nationalité », et de « limiter les cas de pluralité de nationalités aux hypothèses dans lesquelles l’individu a réellement des liens avec plusieurs États […] sans altérer la notion de nationalité »(343).
En matière d’attribution de la nationalité, le code allemand de la nationalité entré en vigueur le 1er janvier 2000 prévoit que les enfants nés en Allemagne de parents étrangers acquièrent automatiquement la nationalité allemande à la naissance. L’attribution de la nationalité allemande conjugue ainsi depuis 2000 le droit du sang et le droit du sol simple. Peu importe que les parents étrangers de l’enfant né en Allemagne soient eux-mêmes nés en Allemagne ou à l’étranger : l’enfant né en Allemagne est allemand dès lors que l’un de ses parents étrangers a sa résidence habituelle et légale en Allemagne depuis au moins huit ans (durée du stage conditionnant la naturalisation) ou qu’il ou elle possède depuis au moins trois ans un permis de séjour à durée indéterminée.
Mais les enfants qui se sont ainsi vus automatiquement attribuer la nationalité allemande à leur naissance, par l’effet du droit du sol, acquièrent aussi bien souvent la nationalité de leur(s) parent(s) étranger(s), de sorte qu’ils ont deux ou plusieurs nationalités. En pareil cas, le droit allemand de la nationalité prévoit donc une obligation de choisir entre la nationalité allemande et la ou les nationalité(s) étrangère(s). Entre 18 et 23 ans, les personnes devenues allemandes par l’effet du droit du sol doivent ainsi opter pour l’une ou l’autre de leurs nationalités. Si elles déclarent vouloir conserver leur nationalité étrangère, alors elles perdent automatiquement la nationalité allemande. Si elles optent pour la nationalité allemande, alors elles doivent prouver avant leur 23e anniversaire qu’elles ont perdu leur(s) nationalité(s) étrangère(s).
Par ailleurs, en matière d’acquisition de la nationalité par décision de l’autorité publique, le droit allemand de la nationalité impose en principe à celui qui acquiert la nationalité allemande au terme d’une procédure de naturalisation de renoncer à sa nationalité d’origine.
Toutefois, la double nationalité est admise dans trois cas de figure (344) :
– premièrement, lorsque la législation de l’État d’origine n’admet pas que ses ressortissants perdent leur nationalité ;
– deuxièmement, lorsque l’abandon de la nationalité de l’État d’origine est possible d’un point de vue juridique mais impossible d’un point de vue pratique, par exemple si le succès de la démarche est lié, comme dans certains pays, au versement de sommes d’argent à des autorités corrompues, ou s’il résulte de l’abandon de la nationalité de l’État d’origine un préjudice patrimonial ou professionnel tel qu’il en devient intolérable, en particulier pour les personnes âgées ;
– troisièmement, lorsque l’État d’origine appartient à l’Union européenne.
Si les personnes qui se sont vues attribuer la nationalité allemande à la naissance par l’effet du droit du sol se trouvent dans l’un de ces trois cas de figure, elles doivent, au plus tard dans le courant de leur 21e année, déposer une demande d’autorisation spéciale leur permettant de conserver leur(s) nationalité(s) étrangère(s).
Pour ce qui est des naturalisés d’origine turque, les autorités allemandes évitent autant que se peut la double nationalité. Toutefois, près de 15 % des naturalisés d’origine turque conservent la nationalité d’origine. Le cumul des nationalités turque et allemande a été favorisé par l’assouplissement du droit de la nationalité turc, et non en raison d’une quelconque indulgence du droit allemand de la nationalité.
Le droit allemand de la naturalisation incite très fortement les naturalisés à abandonner leur nationalité antérieure pour ne garder que la nationalité allemande, qui, au terme de la procédure de naturalisation et après le succès aux tests de naturalisation, est censée être la seule nationalité « effective » (345).
On notera que l’Allemagne n’est pas le seul pays à encadrer la plurinationalité en y posant des conditions et des limites. Ainsi, aux États-Unis, si la Cour suprême a eu l’occasion d’affirmer qu’une personne pouvait bénéficier des droits attachés à la nationalité dans deux pays différents dès lors qu’elle en assumait également les devoirs dans chacun d’eux, il n’en reste pas moins que le serment d’allégeance qui est prêté au drapeau américain ne souffre pas de concurrent et que l’exercice de quelques hautes fonctions au sein de l’administration fédérale nécessite d’être exclusivement américain (346).
Par ailleurs, en Espagne, sauf exceptions pour les ressortissants de pays européens et latino-américains, ainsi que pour les étrangers originaires d’Andorre, des Philippines, de Guinée équatoriale et du Portugal, le candidat à la nationalité espagnole doit expressément renoncer à sa nationalité d’origine avant de prêter serment de fidélité au roi et de jurer obéissance à la constitution et aux lois espagnoles devant le fonctionnaire en charge du registre civil de son domicile (347).
c) La déclinaison possible en France
La notion de « nationalité effective » a été accueillie en droit interne à l’occasion de décisions rendues en matière de conflits de nationalités, qui peuvent être positifs ou négatifs. Survenant dans un litige, les conflits positifs de nationalités désignent les conflits en matière d’application des règles de droit lorsque sont en cause au moins deux nationalités désignant des règles différentes. Le conflit négatif de nationalités survient lorsque la personne en cause dans le litige, étant apatride, n’a aucune nationalité.
Dans un arrêt du 15 mai 1974, la Cour de cassation a fait sienne la règle selon laquelle les conflits de nationalités devaient être tranchés en fonction de la nationalité effective de la personne en cause (348). Cette nationalité effective est déterminée par les juges à l’aune de plusieurs critères, parmi lesquels la culture, la langue, la situation de famille, la résidence, les relations avec les autorités étatiques. Mais ce faisceau d’indices a été complété par la jurisprudence qui voit dans la nationalité effective la nationalité pratiquée, vécue, mais aussi ressentie. En effet, la prise en compte de la volonté de l’individu, concrétisée par des choix et des comportements quotidiens, a commencé de retenir l’attention des juges.
On peut imaginer que ces développements jurisprudentiels inciteront le législateur à s’y intéresser.
La promotion de la notion de « nationalité effective » pourrait s’inscrire dans une logique de valorisation de la nationalité et de défense d’une conception volontariste de la nationalité. Comme le note Mme Amélie Dionisi-Peyrusse, « à travers l’effectivité, on peut faire prévaloir différentes conceptions de la nationalité : une conception élective si l’on retient essentiellement des éléments démontrant la volonté de l’individu, une conception attachée à la souveraineté si l’on retient essentiellement des signes d’allégeance tels que l’accomplissement du service militaire ou encore une conception de la nationalité envisagée comme lien de proximité si l’on retient essentiellement des éléments tels que la résidence » (349). Encourager l’adhésion à la notion de « nationalité effective » au niveau interne et au niveau international ne serait qu’une façon de renouer avec la conception élective de la nation au nom de laquelle la Commission de la nationalité présidée par M. Marceau Long avait mis en exergue l’importance de la manifestation de volonté en matière d’acquisition et d’attribution de la nationalité.
Lors de son audition, Mme Malika Sorel a exprimé un point de vue voisin en affirmant son opposition de principe à ce que des personnes ayant deux ou plusieurs nationalités puissent accéder à quelque fonction élective que ce soit, même au niveau local, ainsi qu’à toute fonction au gouvernement ou dans la haute administration (350). Allant plus loin encore, elle a proposé qu’au-delà d’un certain délai, qui, par exemple, pourrait être de cinq ans à compter de l’acquisition de la nationalité française, les personnes qui ont deux ou plusieurs nationalités devraient faire un choix et renoncer soit à leur nationalité française soit à leur(s) nationalité(s) étrangère(s).
Cette conception de la nationalité effective, qui tend à se généraliser devant les difficultés multiples que pose la pluripatridie, se heurte en France à une tradition beaucoup plus libérale à l’égard des appartenances nationales multiples. Les modalités d’application en seraient complexes et la récente révision constitutionnelle de 2008, qui institue l’élection de députés représentant les Français établis hors de France – parmi lesquels on recense de nombreux binationaux –, n’apparaît pas compatible avec la mise en œuvre d’une conception stricte de la nationalité effective.
Néanmoins, pour ce qui est des personnes qui acquièrent la nationalité française à raison de leur mariage ou au terme d’une procédure de naturalisation, on pourrait imaginer que l’octroi de la nationalité française par les autorités publiques soit, dans ces deux cas, subordonné à la renonciation à leur(s) nationalité(s) étrangère(s).
Tout comme en Allemagne, cette obligation de choix, liée à l’obligation de manifester sa volonté d’appartenir à la nation française, pourrait réserver des exceptions.
La première permettrait de conserver la ou les nationalité(s) étrangère(s) lorsque la législation de l’État d’origine n’admet pas que ses ressortissants perdent leur nationalité.
La seconde autoriserait le cumul de nationalités lorsque l’abandon de la nationalité de l’État d’origine est possible d’un point de vue juridique mais impossible d’un point de vue pratique, par exemple si le succès de la démarche est lié, comme dans certains pays, au versement de sommes d’argent à des autorités corrompues, ou s’il résulte de l’abandon de la nationalité de l’État d’origine un préjudice patrimonial ou professionnel tel qu’il en devient intolérable.
Proposition n° 17 : Subordonner l’acquisition de la nationalité française par déclaration – à raison du mariage – ou par décision de l’autorité publique – dans le cadre de la procédure de naturalisation – à la renonciation expresse du déclarant ou du candidat à sa ou ses nationalité(s) étrangère(s).
Réserver toutefois deux exceptions :
- les cas où la législation du pays d’origine empêche l’abandon de sa nationalité en vertu du principe de l’allégeance perpétuelle ;
- les cas où l’abandon de la nationalité du pays d’origine provoque un préjudice patrimonial ou professionnel disproportionné.
Imposer aux naturalisés le choix d’une nationalité comme en Allemagne paraît plus viable que la solution d’une restriction des droits politiques des plurinationaux que M. Marceau Long appelait de ses vœux en 1988. Face au développement des cas de plurinationalité au sein de l’Union européenne, Marceau Long estimait « souhaitable que les États membres des communautés limitent l’exercice à un seul pays, normalement celui de résidence, des droits politiques de leurs doubles-nationaux », et il suggérait que « des conventions bilatérales à cet effet pourraient être envisagées dans un premier temps » (351). Même si la proposition est séduisante et fondée, car l'exercice du vote national multiplie les conflits d'intérêts dans certains domaines comme celui de la Défense nationale, elle paraît assez peu défendable et difficile à mettre en oeuvre. En toute hypothèse, la Commission de la nationalité préconisait « une harmonisation des législations des États membres sur la double nationalité » (352).
Avant même d’imaginer des dispositifs curatifs, les appartenances nationales multiples pourraient en effet être réduites voire éliminées par l’adoption d’une convention internationale, qui, élaborée au niveau des Nations unies, engagerait le plus grand nombre possible d’États, et dont les dispositions préviendraient la pluripatridie.
2. Conforter l’obligation de déclarer les appartenances nationales multiples
De fait, on ne dispose à l’heure actuelle en France d’aucun outil statistique permettant de prendre la mesure du nombre des personnes détenant plusieurs nationalités.
Cette situation tient notamment au fait que les dispositions du droit français reposent sur le principe d’une certaine indifférence à l’égard des autres nationalités que possèdent les ressortissants français, en particulier depuis la loi précitée du 9 janvier 1973. Jusqu’à cette date, l’article 87 du code de la nationalité prévoyait ainsi que l’acquisition volontaire d’une nationalité étrangère entraînait la perte de la nationalité française. Cette règle ne s’appliquait pas en revanche de manière automatique pour les hommes, afin que ceux-ci ne puissent ainsi échapper à leurs obligations militaires, la perte de la nationalité n’intervenant qu’en vertu d’une autorisation gouvernementale.
Depuis l’abrogation de ce texte, la perte la nationalité ne constitue plus une conséquence nécessaire mais à certains égards un droit dont l’exercice dépend en partie de la volonté des individus dans la logique de certaines dispositions du livre Ier, titre Ierbis, chapitre IV du code civil. Ainsi, l’article 23 de ce code prévoit que « toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément (…) ». Suivant l’article 23-5, « en cas de mariage avec un étranger, le conjoint français peut répudier la nationalité française (…) à la condition qu'il ait acquis la nationalité étrangère de son conjoint et que la résidence habituelle du ménage ait été fixée à l'étranger ».
Les seuls cas où la perte de la nationalité revêt un caractère plus systématique restent ceux liés :
– à l’absence de possession d’état et de toute résidence habituelle en France, si les ascendants n’ont eux-mêmes ni possession d’état de Français, ni résidence en France depuis un demi-siècle (article 23-6 du code civil) ;
– au comportement par lequel un Français se conduit en national d’un pays étranger, s’il a la nationalité de ce pays (article 23-7 du code civil) ;
– à la non-renonciation à un emploi ou au concours apporté dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie, nonobstant l’injonction reçue du Gouvernement français (article 23-8 du code civil).
De surcroît, ainsi que l’a rappelé M. Michel Aubouin (353), la direction de l’accueil, de l’intégration, de la citoyenneté du ministère de l’Intérieur dont il a la charge n’enregistre pas la ou les nationalité(s) des candidats à la nationalité française lorsqu’ils font leur demande de naturalisation. D’ailleurs, suivant la jurisprudence tirée de l’arrêt rendu, le 24 juin 1913, par le tribunal civil de la Rochelle, la nationalité ne figure pas parmi les renseignements devant être portés sur les actes d’état civil en application de l’article 35 du code civil.
En sens inverse, ainsi que l’a indiqué à la mission (354), M. Christian Lambert, préfet de la Seine-Saint-Denis, les décisions d’octroi de la nationalité française ne donnent lieu à aucune notification aux ambassades et services consulaires des pays d’origine. Le plus souvent, les autorités du pays d’origine constatent ainsi la naturalisation d’un de leurs ressortissants lors du renouvellement de ses documents d’identité et, notamment, de son passeport. Plus généralement, il n’existe que peu d’échanges d’information entre les États concernant l’acquisition ou la perte de nationalité du fait de l’absence d’instrument de droit international adéquat. L’illustre la Convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997 qui, dans son article 24, ne confère qu’un caractère facultatif à l’échange d’information, celui-ci relevant de la libre volonté de chaque État et du principe de réciprocité : « Chaque État Partie peut, à tout moment, déclarer qu’il s’engage à informer un autre État Partie qui avait fait la même déclaration, de l’acquisition volontaire de sa nationalité par des ressortissants de l’autre État Partie, sous réserve des lois applicables concernant la protection des données. Une telle déclaration peut indiquer les conditions dans lesquelles l’État Partie fournira de telles informations. La déclaration peut être retirée à tout moment ».
Dans ce contexte, les dispositions adoptées dans le cadre de la loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité constituent une avancée significative. Complétant le livre Ier du code civil en y insérant un nouvel article 21-27-1, l’article 4 du texte fait obligation aux personnes acquérant la nationalité française par décision de l’autorité publique ou par déclaration d’indiquer la ou les nationalités qu’elles possèdent déjà, la ou les nationalités qu’elles conservent en plus de la nationalité française ainsi que la ou les nationalités auxquelles elles entendent renoncer.
Dès lors, reste le cas des seules personnes possédant plusieurs nationalités du fait de leur naissance ou de leur résidence sur le territoire français. Du point de vue de la mission, une réponse pourrait consister à modifier l’article 35 du code civil de sorte que la nationalité figure parmi les mentions des actes d’état civil.
Ajouté aux dispositions nouvelles de l’article 21-27-1 du code civil, ce dispositif permettrait, à défaut d’imposer le choix d’une nationalité, de mieux mesurer le phénomène de la plurinationalité sans pour autant créer une différence de traitement contraire aux normes constitutionnelles. On soulignera à cet égard que dans la décision rendue à propos de la loi relative à l’immigration, l’intégration et à la nationalité (355), le Conseil a jugé conforme à la Constitution la déclaration créée à l’article 4 du texte, estimant que cet article n’instituait pas de différence de traitement entre les personnes ayant la nationalité française.
Proposition n° 18 : Faire figurer la nationalité parmi les mentions obligatoires portées sur les actes d’état civil en réformant l’article 35 du code civil.
3. Encourager l’adoption d’une convention internationale régissant les appartenances nationales multiples
La nationalité étant un lien juridique et politique entre une personne et un État qui déploie ses effets tant dans l’ordre interne (reconnaissance du droit de vote, des droits civils et des droits sociaux) que dans l’ordre international (protection diplomatique, détermination du statut personnel en cas de conflits de lois), on ne peut faire l’économie d’une convention internationale tendant à harmoniser la détermination, le contenu et les effets dans le contexte de la mondialisation.
Plusieurs textes internationaux ont d’ores et déjà été adoptés, qui peuvent servir de modèles pour dessiner les contours d’une convention internationale régissant les appartenances nationales multiples.
L’adoption d’une convention multilatérale, au niveau de l’Organisation des Nations unies, ne serait nullement exclusive de la révision et de la conclusion d’un certain nombre de conventions bilatérales aménageant plus précisément les conditions et les effets de la double nationalité entre la France et tel ou tel État. La négociation ou la révision de conventions bilatérales avec les États qui imposent une allégeance perpétuelle à leurs ressortissants apparaît particulièrement pressante.
a) Le modèle de la Convention de La Haye du 12 avril 1930
Du 13 mars au 12 avril 1930 se tint à La Haye une conférence pour la codification du droit international, dans le cadre de la Société des nations (SDN). Cette conférence déboucha sur l’adoption de la première convention multilatérale relative aux questions de nationalité, la Convention de La Haye du 12 avril 1930, que la France n’a jamais signée. Cette convention visait à apporter une réponse, sur le terrain du droit international, à l’hétérogénéité et à la contrariété des règles étatiques de détermination de la nationalité, qui, dès cette époque, étaient jugées excessives. Elle entendait également répondre aux problèmes posés par l’apatridie et par la pluripatridie, mettant en exergue le fait que « l’idéal vers lequel l’Humanité doit s’orienter dans ce domaine consiste à supprimer tout ensemble les cas d’apatridie et ceux de double nationalité ».
Si l’article premier de ladite convention prévoit qu’« il appartient à chaque État de déterminer, conformément à sa propre législation, quels sont ses nationaux », c’est pour nuancer aussitôt le principe en précisant que les autres États n’ont l’obligation de reconnaître la nationalité ainsi attribuée à des personnes que si elle résulte d’une législation « en accord avec les conventions internationales, la coutume internationale, et les principes de droit généralement reconnus en matière de nationalité ». La marge de manœuvre laissée aux États pour l’exercice d’une compétence souveraine s’en trouvait donc réduite. Comme le note Mme Amélie Dionisi-Peyrusse, « pour qu’une nationalité soit efficace et reconnue au niveau international, sa détermination doit remplir certaines conditions, la liberté de l’État n’est pas absolue »(356).
Allant plus loin encore, un protocole additionnel à cette convention énonçait en son article premier une règle de détermination de la nationalité censée s’imposer aux États signataires. Cette règle prévoyait que « dans un État où la nationalité n’est pas attribuée du seul fait de la naissance sur le territoire, l’individu qui y est né d’une mère ayant la nationalité de cet État et d’un père sans nationalité ou de nationalité inconnue, a la nationalité dudit pays ».
Si dès 1930 on concevait la possibilité d’un accord-cadre international permettant aux États souverains de s’accorder sur les principes fondamentaux censés gouverner la détermination de la nationalité, il n’y a pas de raison pour qu’au début du XXIe siècle, dans un monde bien plus globalisé, les mêmes États ne puissent pas parvenir à conclure un tel accord.
b) Les conventions onusiennes de 1954 et de 1961
L’Organisation des Nations unies s’est elle aussi emparée des questions de nationalité mais de manière très lacunaire.
La Déclaration universelle des droits de l’homme, qui n’a qu’une valeur déclarative, et nullement normative, prévoit en son article 15 § 1 que « tout individu a droit à une nationalité » et que « nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité ». Dans les années qui suivirent la Seconde guerre mondiale et la chute de régimes qui avaient abondamment recouru aux déchéances de nationalité à des fins purement idéologiques, la préoccupation était bien plus l’apatridie que la pluripatridie.
Après la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, c’est une Convention relative au statut des apatrides qui fut adoptée le 28 septembre 1954. Ces deux conventions, qui invitent les États à favoriser l’accès à la nationalité sans prévoir de contraintes ni de sanctions, ont été ratifiées par la France, ainsi que le Pacte des Nations unies du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques dont l’article 24 § 3 prévoit que « tout enfant a le droit d’acquérir une nationalité », et la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant dont l’article 7 § 1 affirme également que l’enfant a le droit, dès sa naissance, d’acquérir une nationalité.
En revanche, notre pays n’a pas ratifié la Convention sur la réduction des cas d’apatridie du 30 août 1961, dont l’article 1er prévoit que « tout État contractant accorde sa nationalité à l’individu né sur son territoire et qui, autrement, serait apatride ». Cette convention est allée relativement loin dans l’édiction de règles de détermination de la nationalité s’imposant aux États parties. Ses articles 1 à 4 font reposer l’octroi de la nationalité sur le lien que l’individu entretient avec l’État soit par son lieu de naissance soit par la filiation (naissance d’un père ou d’une mère ayant la nationalité de l’État en question). Mais l’énoncé de ces règles de détermination reste motivé par le souci d’éliminer les situations d’apatridie, comme la plupart des autres dispositions de cette convention (357).
Le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés, représenté par M. Philippe Leclerc, a souligné devant les membres de la mission l’opportunité de ratifier la Convention des Nations unies de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, y voyant un engagement fort de la France à ne pas provoquer de situations d’apatridie dans le futur (358).
Toutefois, une telle ratification nécessiterait de modifier la rédaction de deux dispositions du code civil relatives à la nationalité, pour les rendre compatibles avec la Convention. L’article 27-2 du code civil dispose en effet que « les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'État dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales » d’obtention de la nationalité française, et que « si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ». Un tel délai crée une situation d’incertitude sur la nationalité qui paraît incompatible avec la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.
En outre, l’article 21-4 du code civil dispose que « le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'État, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans » à compter de la remise du récépissé de la déclaration de nationalité souscrite en raison du mariage, et qu’« en cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française ». Or la Convention onusienne de 1961 ne prévoit que deux exceptions à l’impossibilité de déchoir une personne de sa nationalité : la fraude et la fausse déclaration.
Modifier les articles 27-2 et 21-4 du code civil pour les mettre en conformité avec la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie reviendrait donc à limiter encore davantage la marge de manœuvre et d’appréciation de l’État en matière de nationalité : d’une part, il faudrait réduire le délai ouvert pour rapporter les décrets portant naturalisation, acquisition de la nationalité, ou réintégration dans la nationalité alors même que ces derniers auraient été obtenus au mépris des conditions prévues par la loi ou à la suite d’un mensonge ou d’une fraude ; et, d’autre part, il faudrait supprimer le pouvoir d’opposition du gouvernement, qui est la marque du caractère régalien de l’acte octroyant la nationalité.
De tels aménagements iraient à contre-courant du caractère souverain du droit de la nationalité que prône votre rapporteur, alors même que M. Philippe Leclerc, représentant du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés, a indiqué lors de son audition que 1 500 personnes avaient obtenu le statut d’apatride en France, et que la plupart avaient été naturalisées (359). Par ailleurs, ces modifications iraient également à l’encontre de la loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité récemment adoptée. Ce texte prévoit d’une part d’allonger à deux ans le délai prévu pour rapporter les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration en cas de non-satisfaction du requérant aux conditions légales et d’autre part d’étendre de six mois à deux ans le délai pendant lequel le gouvernement peut s’opposer à l’enregistrement d’une déclaration de nationalité.
La France n’a pas non plus ratifié la Convention de la commission internationale de l’état civil de Berne, tendant à réduire le nombre des cas d’apatridie, du 13 septembre 1973, dont l’article 1er, alinéa 1er, dispose que « l’enfant dont la mère a la nationalité d’un État contractant acquiert à la naissance la nationalité de celle-ci au cas où il eut été apatride ».
On le voit, tous ces textes internationaux visent à garantir le droit à la nationalité et à prévenir l’apatridie, voire à l’éliminer. La lutte contre l’apatridie contribue à valoriser la notion de nationalité dans la mesure où elle répond au souci de voir les personnes s’ancrer dans une nationalité. Si la mondialisation avait totalement relégué le fait national dans l’oubli, tant de conventions sur la réduction de l’apatridie n’auraient pas été adoptées.
Mais il est vrai que l’affirmation du droit à une seule nationalité et la prévention voire l’élimination de la pluripatridie sont restées étrangères aux préoccupations de l’Organisation des Nations unies. Au niveau international, seul le Conseil de l’Europe s’est préoccupé de la réduction des cas de plurinationalité.
c) Les conventions du Conseil de l’Europe de 1963 et de 1997
Dès lors que l’on définit la nationalité comme un lien juridique et politique entre une personne et un État et qu’on y voit l’expression d’une vision de la nation reposant sur l’adhésion à des idées et à des valeurs, il apparaît cohérent de concevoir ce lien comme exclusif, exclusif tout au moins de l’adhésion à des visions de la nation et à des valeurs antithétiques. Pierre Louis-Lucas ne s’y était pas trompé, qui écrivait que « la nationalité est, par définition, un lien absolu et exclusif » (360). Comment croire en la loyauté, en l’engagement et en l’adhésion d’une personne ayant la nationalité d’États exigeant le partage de valeurs ou la réalisation d’actes contradictoires ? À cette question, Pierre Louis-Lucas répondait que « l’État est dans un constant état de doute touchant ses droits envers l’incertain bipatride » (361).
Plus récemment encore, la Cour supérieure d’Australie, dans une décision de juin 1999, a jugé qu’une personne de nationalité australienne possédant également une nationalité étrangère ne pourrait être élue au Parlement fédéral australien en raison de ses liens avec cette puissance étrangère.
C’est du reste dans cette optique que le Conseil de l’Europe a adopté, dès 1963, une convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités. Signée le 6 mai 1963 par la France, cette convention a été ratifiée par notre pays le 26 janvier 1965 et est entrée en vigueur le 28 mars 1968. Deux protocoles additionnels furent adoptés le 24 novembre 1977, et un troisième le 2 novembre 1993. Mais le 4 mars 2008, la France a dénoncé le titre premier de cette convention, relatif à la réduction des cas de pluralité de nationalités, avec effet à compter du 5 mars 2009, de façon à lever les obstacles juridiques à la plurinationalité au sein de l’Union européenne.
L’article premier de la Convention de Strasbourg du 6 mai 1963 disposait que les ressortissants des États parties qui acquéraient volontairement la nationalité d’un autre État partie perdaient leur nationalité antérieure. Le protocole additionnel du 24 novembre 1977 prévoyait à cette fin une procédure de communication entre les États concernés des acquisitions de nationalités, sous forme d’échanges d’informations. La France a signé ce protocole additionnel le 30 juillet 1984 mais ne l’a pas ratifié. Si une telle ratification paraît impossible depuis que notre pays a dénoncé la partie de la Convention de 1963 à laquelle se rattachait ce protocole additionnel, il n’en reste pas moins qu’il serait bon à l’avenir d’envisager la conclusion de conventions du même type, et de s’inspirer de la procédure de collecte et d’échange d’informations entre États en matière d’acquisitions de nationalités.
L’article 2 de la Convention du Conseil de l’Europe de 1963 prévoyait que les ressortissants de plusieurs États signataires pouvaient renoncer à la nationalité de l’un de ces États sous réserve d’une autorisation de ce dernier qui, dans certains cas, ne pouvait être refusée.
Avant même que la France ne dénonçât le titre premier de la Convention du Conseil de l’Europe de 1963 au profit d’un libéralisme total en matière de plurinationalité, le protocole additionnel du 2 novembre 1993, ratifié par la France le 23 février 1995 et entré en vigueur le 24 mars 1995, modifiait l’esprit de la Convention de 1963 de façon non négligeable (362).
L’adoption d’une nouvelle attitude du Conseil de l’Europe à l’égard des problèmes de pluripatridie s’est confirmée dans les années qui ont suivi : c’est en effet un tout autre esprit qui a présidé à l’adoption de la Convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997(363), qui ne contient aucune disposition visant à lutter contre la pluralité de nationalités.
Conscients de l’impact qu’a la détermination de la nationalité sur les droits de la personne, et soucieux d’harmoniser en conséquence les règles de détermination de la nationalité pour homogénéiser les droits reconnus aux personnes placées dans la même situation, les organes du Conseil de l’Europe ont créé un comité d’experts sur la nationalité dont les travaux ont conduit en 1997 à l’adoption d’une convention édictant des règles de détermination de la nationalité communes aux États signataires.
Si l’article 3, § 1, de cette convention rappelle le principe, admis depuis 1923, selon lequel « il appartient à chaque État de déterminer par sa législation quels sont ses ressortissants », il n’en reste pas moins que l’introduction du rapport explicatif de la convention ne cache pas que l’ambition du texte est de « favoriser le développement progressif du droit international en matière de nationalité » en faisant « la synthèse entre des idées nouvelles qu’a fait apparaître l’évolution du droit interne et du droit international ».
Répondant au souci de prévenir l’apatridie plutôt que la pluripatridie, l’article 4 de la Convention énonce tour à tour que « chaque individu a droit à une nationalité », que « l’apatridie doit être évitée » et que « nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ».
L’article 5 pose un principe de non-discrimination et interdit toute discrimination « fondée sur le sexe, la religion, la race, la couleur, ou l’origine nationale ou ethnique ».
Mais le texte va plus loin en édictant des règles communes en matière d’attribution, d’acquisition et de perte de la nationalité. Pour ce qui est de l’attribution de la nationalité, promouvant le droit du sang, la Convention impose aux États parties de reconnaître la transmission de plein droit de la nationalité par la filiation, sous réserve d’exceptions possibles en cas de naissance à l’étranger. Pour ce qui est de l’acquisition de la nationalité, le texte impose aux États signataires de prévoir la possibilité de naturaliser des étrangers, d’exiger une durée maximale de séjour de dix ans sur le territoire pour solliciter la naturalisation, et de prévoir des procédures de naturalisation simplifiées pour les conjoints et enfants de nationaux. Pour ce qui est de la perte de la nationalité, la Convention l’interdit par principe, qu’elle soit de plein droit ou à l’initiative des États. Toutefois, elle ménage la liberté d’appréciation des États en prévoyant de multiples exceptions. Ainsi, il est admis qu’une personne puisse perdre sa nationalité en en acquérant volontairement une autre, ou si elle réside habituellement à l’étranger au point d’avoir perdu tout lien effectif avec son État d’origine, ou encore si elle se rend coupable de fraude ou d’une atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État (364).
Toutes ces dispositions montrent qu’à la fin du XXe siècle, le Conseil de l’Europe a cessé de se soucier de la pluripatridie pour se focaliser sur la lutte contre l’apatridie. Du reste, le retournement est si probant que le chapitre V de la Convention sur la nationalité du 6 novembre 1997 favorise même la double nationalité en la rendant de plein droit. Les dispositions de ce chapitre interdisent en effet la remise en cause de la double nationalité automatiquement attribuée à la naissance ou acquise automatiquement par mariage, et elles imposent l’égalité des droits entre nationaux et doubles nationaux dès lors que ces derniers résident sur le territoire de l’État concerné. La Convention du Conseil de l’Europe de 1997 étant censée s’appliquer sans préjudice des dispositions de celle de 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités, l’impact de ces dispositions peut apparaître limité. Il n’en reste pas moins qu’elles illustrent l’émoussement d’une prise de conscience amorcée dans les années 1960 qu’il faut aujourd’hui raviver.
d) La nécessité d’une convention-cadre onusienne régissant les appartenances nationales multiples
Le principe de la compétence exclusive et souveraine des États pour fixer les règles de détermination de la nationalité, posé par la Cour permanente de justice internationale en 1923, et rappelé par la Cour internationale de justice en 1955, était conçu comme susceptible d’évoluer.
Dans l’avis consultatif rendu le 7 février 1923, la Cour permanente de justice internationale indiquait que « dans l’état actuel du droit international, les questions de nationalité sont, en principe, de l’avis de la Cour, comprises dans ce domaine réservé [des États] » (365).
Dans son arrêt Nottebohm, la Cour internationale de justice admettait que c’était aux États souverains de fixer les règles de détermination de la nationalité, mais ajoutait que « s’il en [était] ainsi, c’[était] que la diversité des conditions démographiques n’a[vait] pas permis jusqu’ici l’établissement d’un accord général sur les règles concernant la nationalité, encore que, par sa nature, celle-ci affect[ait] les rapports internationaux » (366). Depuis longtemps les juridictions internationales appellent donc de leurs vœux l’adoption d’un accord-cadre international fixant les principes fondamentaux appelés à gouverner les règles de détermination de la nationalité.
Dans le contexte de la mondialisation, à l’heure où la pluripatridie se développe et où, dans le même temps, en matière de droit de la nationalité, les écarts se creusent entre les législations d’États qui reposent sur l’allégeance perpétuelle, celles qui admettent la binationalité voire la plurinationalité, et celles qui imposent le choix d’une appartenance nationale unique, l’adoption d’un tel accord apparaît plus que nécessaire. Il satisferait en effet un impérieux besoin d’harmonisation des règles d’attribution et d’acquisition de la nationalité dont la diversité actuelle est propice à une rupture d’égalité entre les personnes.
Dans l’attente de l’adoption d’une telle convention au niveau onusien, il conviendrait à tout le moins que notre pays engage sans délai une révision des conventions bilatérales qu’il a conclues en matière de double nationalité, en commençant par celles qui le lient à des États imposant à leurs ressortissants une allégeance perpétuelle. La renégociation de ces conventions devrait être dominée par le souci de réduire au maximum la possibilité pour les ressortissants des deux États parties de cumuler leurs nationalités.
Proposition n° 19 : Encourager la négociation de conventions bilatérales réduisant les cas de double nationalité, particulièrement avec les États imposant à leurs ressortissants une allégeance perpétuelle, ainsi que l’adoption d’une convention-cadre internationale sur la réduction des appartenances nationales multiples.
Près d’un quart de siècle plus tard, le constat est le même que celui que faisait M. Marceau Long en 1988 dans son rapport au Premier ministre :
« On n’entend plus guère le discours du patriotisme. Les institutions nationales, comme l’école ou l’armée, sont volontiers remises en cause. Les Églises catholiques, française, polonaise et italienne, qui devaient contribuer à aider, contrôler et intégrer les populations étrangères ont perdu une grande part de leur rôle social. Les syndicats ouvriers contribuaient aussi à insérer les ouvriers étrangers dans l’ensemble de la classe ouvrière » (367).
Quant à l’école, elle est en 2011 comme en 1988 « moins autoritaire, moins exigeante, moins sûre de ses valeurs et de sa mission qu’elle ne l’a été pendant la IIIe République » (368).
Le défi du début du XXIe siècle reste le même que celui de la fin du XXe : « il est essentiel pour la société française de réussir au cours des vingt prochaines années l’intégration de la population étrangère régulièrement établie sur son sol » (369). Comme M. Marceau Long, votre rapporteur soutient que cette intégration « sera rendue d’autant plus facile que sera plus forte la conscience d’identité de la nation française » (370).
En d’autres termes, l’intégration des étrangers sera d’autant plus réussie que la nation française aura retrouvé ce qui fait sa quintessence : le respect des valeurs du pacte républicain, la participation à un projet politique tourné vers l’avenir dans lequel l’intérêt général prime les intérêts particuliers, et l’affection partagée pour une histoire et une mémoire communes.
Les propositions de votre rapporteur s’efforcent donc de tracer les contours d’un projet mobilisateur susceptible de donner un nouveau souffle au « roman national » en redonnant une âme au droit de la nationalité.
Il s’agit de redonner à la nation son rôle intégrateur en mettant en œuvre une conception volontariste de la nationalité privilégiant un effort d’engagement de la part de ceux qui la détiennent ou qui la demandent.
C’est en effet en demandant à tous ceux qui se voient attribuer la nationalité française dès la naissance et à tous ceux qui l’acquièrent à raison de la naissance et de la résidence en France, ou du mariage, ou de la naturalisation, de manifester leur volonté d’appartenir à la nation française, que le droit de la nationalité va parvenir à renouer avec ce qui, selon Alain Finkielkraut, est le propre de la France, à savoir d’être « un pays dont les plus hautes valeurs éthiques ou spirituelles sont proposées à l’adhésion consciente de ses membres » (371).
EXAMEN DU RAPPORT EN COMMISSION
Au cours de sa réunion du mercredi 29 juin 2011, la Commission procède à l’examen du rapport de la mission d’information présenté par M. Claude Goasguen, rapporteur.
M. Claude Goasguen, rapporteur. La mission d’information sur le droit de la nationalité en France a adopté la semaine dernière son rapport et je vous demande aujourd’hui de vous prononcer sur sa publication.
Je suis convaincu que, sur un sujet aussi difficile que le droit de la nationalité – matière très technique notamment parce qu’elle soulève des questions relevant du droit international privé qui reste assez peu connu –, ce travail apportera des éléments importants, susceptibles d’ouvrir un champ nouveau de réflexion concernant les relations entre le droit de la nationalité et la mondialisation au plan juridique.
Je regrette qu’un document de travail ait été diffusé dans la presse alors que telle n’était pas sa vocation.
Sur un plan politique, nul ne s’étonnera que persiste le désaccord patent qui pouvait déjà séparer les membres de la mission au lancement de ses travaux. Le rapport en fait état puisqu’il comporte la contribution qu’a souhaité y insérer le groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche. Celui-ci exprime de fait une nette divergence avec la vision très volontariste de l’adhésion à la nationalité que défend le groupe majoritaire et qui sous-tend les propositions que je tiens ici à exposer brièvement.
Ces propositions visent essentiellement à redonner un caractère volontaire à l’acquisition de la nationalité française et participent de la volonté de réduire le nombre des naturalisations car, à nos yeux, ces procédures présentent un caractère trop administratif et ne marquent pas suffisamment la dimension politique de l’adhésion à la nationalité.
En premier lieu, le rapport propose ainsi que les personnes acquérant la nationalité française par l’application du droit du sol manifestent la volonté de devenir français. Ainsi, nous revenons à l’état du droit créé par la loi du 22 juillet 1993 en supprimant l’automaticité prévue par la loi « Guigou » du 16 mars 1998 qui, de mon point de vue, avait affaibli le lien existant entre les individus et la nationalité. De fait, avec la suppression du service national, il n'y a plus de moyen de manifester son adhésion à la nation.
S’agissant en second lieu de la binationalité – situation sur laquelle on peut entendre beaucoup d’affirmations erronées au plan juridique dans la mesure où la double nationalité constitue, en droit français, une situation de fait et non de droit – le rapport propose tout d’abord de modifier l’article 35 du code civil de sorte que chacun déclare les nationalités qu’il possède. Cette disposition permettra de connaître enfin le phénomène de la plurinationalité, la France demeurant probablement à ce jour le seul pays à ne pas posséder d’éléments statistiques à ce sujet. Ensuite, le rapport préconise que toute personne obtenant la nationalité française par décision de l’autorité publique abandonne la nationalité qu’elle possédait antérieurement à sa naturalisation. Je rappelle que ce système correspond à celui en vigueur aux États-Unis : en effet, chaque individu acquérant la nationalité américaine doit abandonner sa nationalité d’origine ; il ne perdra jamais la nationalité américaine et la transmettra à ses descendants – à la différence de ce que prévoit le droit français. Dans le cas d’un mariage avec un conjoint français, le rapport estime également justifié que, sous réserve de certaines exceptions, le conjoint d’origine étrangère renonce à la nationalité qu’il détenait précédemment.
En troisième lieu, le rapport s’attache à préserver le droit du sol en faisant en sorte que ses dispositions ne soient pas détournées et que leur application ne donne pas lieu à des abus à l’exemple de ceux constatés dans certains départements d’outre-mer tels que Mayotte ou la Guyane. En l’espèce, le rapport montre le caractère indispensable d’une révision constitutionnelle, révision que François Baroin avait d’ailleurs prônée, il y a quelques années, avec beaucoup de courage.
Je ne reviendrai pas sur les autres propositions de ce rapport, plus consensuelles. Sa publication est nécessaire. Il permettra d’éclairer pour l’avenir les dirigeants, de gauche comme de droite, dans un contexte de mondialisation croissante. Car les conflits de nationalité – positifs ou négatifs – vont se multiplier dans tous les domaines : le mariage, l’adoption, les successions, le droit politique, les entreprises…
Mme Marietta Karamanli. Je souhaite formuler trois observations. Premièrement, la double nationalité constitue un progrès pour le droit des femmes qui, je le rappelle, représentent la moitié de la population européenne. Dans une recommandation émise en 1995 sur la situation des femmes immigrées en Europe, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe appelle d’ailleurs à réduire les « obstacles à l’acquisition de la nationalité du pays de résidence et à la reconnaissance de la double nationalité permettant aux femmes immigrées de préserver les liens avec leur société d'origine tout en s’intégrant dans la société d'accueil ». Deuxièmement, on constate aujourd’hui, au niveau mondial, une tendance au développement de la reconnaissance de la double nationalité, en dépit des mouvements contraires observés notamment en Iran et en Algérie. Troisièmement, la remise en cause de la double nationalité pour les personnes qui deviennent Françaises conduira aussi à une telle remise en cause pour les Français de naissance résidant à l’étranger qui sont très nombreux à disposer de deux, voire trois nationalités. Il faut l’affirmer clairement : la double nationalité est tout à la fois un facteur d’intégration des personnes et un instrument d’influence de la France dans le monde. Aujourd’hui, la double nationalité n’induit aucune différence de traitement mais bien une égalité de droits. C’est à la France qu’il revient de décider qui est titulaire de la nationalité française, dans le respect de cette égalité des droits. Pour toutes ces raisons, je me prononce contre la publication de ce rapport d’information, qui touche aux fondements des sociétés européennes.
Mme Sylvia Pinel. Ce rapport d’information appelle de nombreuses critiques. La principale, de mon point de vue, réside dans l’inégalité des droits qu’il suggère pour l’acquisition de la nationalité française ainsi que dans les conséquences de cette acquisition. Ce rapport aboutit à créer une gradation contestable des situations, qui vont de la simple manifestation de volonté de devenir français par les jeunes arrivant à leur majorité – mesure dont on peine à voir l’intérêt – à l’impossibilité d’acquérir la nationalité française pour les jeunes nés et résidant en France mais ayant des parents étrangers nés à l’étranger et en situation irrégulière, en passant par l’obligation faite aux jeunes nés en France et y résidant et dont les parents étrangers sont nés à l’étranger, pour lesquels serait supprimée l’acquisition automatique de nationalité française à la majorité, ainsi que la possibilité de l’obtenir par anticipation à treize ans. L’ensemble de ces propositions multiplierait les obstacles à l’acquisition de la nationalité française. Ces propositions seraient génératrices d’inégalités et auraient des conséquences dommageables pour de nombreux jeunes (par exemple pour l’accès à des examens ou à des diplômes). La plurinationalité est une chance pour la France. Pourquoi faudrait-il renoncer à ses origines lorsque l’on veut intégrer la communauté nationale ? Ce rapport d’information contribue à diviser les Français et ce n’est pas en les divisant que la France s’affirmera.
Mme Sandrine Mazetier. Au nom de l’ensemble de mes collègues du groupe SRC membres de cette mission d’information, je regrette que ce rapport soit hors sujet au regard de ce qui aurait dû être la question centrale de nos réflexions : comment « faire France » au XXIe siècle ? En ce sens, l’approche initiale de la mission, au-delà des auditions très juridiques et techniques, avait conduit à entendre, au-delà de la sphère juridique, de grands intellectuels, des témoins. Nous avions approuvé cet élargissement de l’objet de la mission. Mais si le travail de la mission a été passionnant, le rapport auquel il aboutit nous déçoit.
J’ajoute que, contrairement à ce qu’affirment souvent les membres de l’UMP, le groupe SRC ne défend aucunement l’idée d’une acquisition « automatique » de la nationalité. Bien au contraire, lors de la discussion du projet de loi sur l’immigration, l’intégration et la nationalité, devenu la loi du 16 juin 2011, nous avons présenté des amendements proposant que des textes fondamentaux comme la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et le Préambule de la Constitution soient remis à tous les Français au cours des cérémonies de mariage et de naturalisation et lors de la journée d’appel de préparation à la défense. Nous défendons ainsi une vision unitaire de la nationalité française, quel que soit son mode d’acquisition, conformément aux valeurs républicaines et à l’article 1er de notre Constitution.
Cela explique notre désaccord avec de nombreuses recommandations du rapport d’information, qui sont trop « défensives » et, inquiétantes au demeurant quant au moral de nos collègues de la majorité. Elles heurtent les valeurs fondamentales de la République. Cela vaut pour les moyens d’obtenir la nationalité française, comme pour les droits attachés à cette obtention : ceux-ci devraient être les mêmes, que l’on naisse Français, en France ou à l’étranger, ou qu’on le devienne.
Enfin, je me demande au nom de qui s’exprime M. Claude Goasguen lorsqu’il nous présente ses recommandations. Non seulement celles-ci n’ont pas rencontré l’assentiment de tous les membres de la mission, mais des responsables nationaux de l’UMP et des ministres ont publiquement pris leurs distances avec elles.
M. Claude Goasguen, rapporteur. Le droit est une discipline difficile et rigoureuse, très éloignée de la logomachie politique habituelle. Et le droit de la nationalité est complexe. On ne peut reprocher à personne de ne pas connaître le droit : il faut l’apprendre. Un certain nombre de personnalités politiques, même de droite, se sont laissées aller à des annonces, notamment dans le journal Libération, qui ne correspondaient pas au contenu du rapport. Le droit est une matière difficile : ce n’est pas Bibi Fricotin ! Que nous n’ayons pas la même conception de la nationalité, je m’en félicite. De très nombreux pays font ce que nous proposons : non pas seulement l’Iran mais aussi les États-Unis, l’Allemagne, la Finlande, l’Italie, la Grèce…
Mme Sandrine Mazetier. Qui est-ce « nous » ?
M. Claude Goasguen, rapporteur. Ce « nous » désigne les membres de la mission appartenant au groupe UMP qui ont voté l’adoption de ce rapport. Je suis désolé que cela ne vous plaise pas, mais très franchement, je me félicite, encore une fois, que nous n’ayons pas la même conception de la nationalité.
La Commission autorise le dépôt du rapport de la mission d’information en vue de sa publication.
SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS(372)
RENOUER AVEC UN RÉCIT NATIONAL VOLONTARISTE
Proposition n° 1 : Rétablir une place dans l’enseignement pour l’apprentissage plus chronologique de l’histoire nationale, un récit républicain volontariste intégrant les mémoires, redonnant le sens de l’appartenance à la nation et assurant la transmission des valeurs républicaines, notamment par l’enseignement plus systématique de l’hymne national.
Renforcer l’enseignement de la langue française de façon à en faire le vecteur intégrateur de la nation.
Proposition n° 5 : Organiser pour tous les jeunes Français une manifestation commune de volonté d’appartenir à la nation française à l’occasion d’une cérémonie de remise de la carte d’électeur en mairie.
Proposition n° 6 : Exiger des personnes nées en France de parents étrangers nés à l’étranger une manifestation de volonté d’acquérir la nationalité française à leur majorité.
Proposition n° 7 : Exiger des personnes qui acquièrent la nationalité française par déclaration à raison du mariage une manifestation de volonté d’appartenir à la nation française.
CHOISIR OU DÉCLARER SA NATIONALITÉ
Proposition n° 17 : Subordonner l’acquisition de la nationalité française par déclaration – à raison du mariage – ou par décision de l’autorité publique – dans le cadre de la procédure de naturalisation – à la renonciation expresse du déclarant ou du candidat à sa ou ses nationalité(s) étrangère(s).
Réserver toutefois deux exceptions :
- les cas où la législation du pays d’origine empêche l’abandon de sa nationalité en vertu du principe de l’allégeance perpétuelle ;
- les cas où l’abandon de la nationalité du pays d’origine provoque un préjudice patrimonial ou professionnel disproportionné.
Proposition n° 18 : Faire figurer la nationalité parmi les mentions obligatoires portées sur les actes d’état civil en réformant l’article 35 du code civil.
Proposition n° 19 : Encourager la négociation de conventions bilatérales réduisant les cas de double nationalité, particulièrement avec les États imposant à leurs ressortissants une allégeance perpétuelle, ainsi que l’adoption d’une convention-cadre internationale sur la réduction des appartenances nationales multiples.
CONSACRER À LA NATIONALITÉ UN CODE
ET EN MODIFIER CERTAINES RÈGLES
Proposition n° 2 : Extraire les dispositions relatives à la nationalité du code civil pour les réintroduire dans un code de la nationalité.
Proposition n° 3 : Renforcer le régime dérogatoire d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte et en Guyane.
Proposition n° 4 : Limiter les demandes d’acquisition de la nationalité française au titre de la naissance et de la résidence en France en étendant la condition de régularité du séjour aux mineurs étrangers et à leurs parents.
MODIFIER LA PROCÉDURE DE NATURALISATION
Proposition n° 14 : Étendre aux bénéficiaires du statut de réfugié la condition de « stage » de cinq ans pour demander la naturalisation en abrogeant le 7° de l’article 21-19 du code civil.
Proposition n° 15 : Systématiser les cérémonies d’accueil dans la nationalité française en transférant éventuellement aux communes la responsabilité de leur organisation et en formalisant leur déroulement.
Proposition n° 16 : Instituer un test écrit de naturalisation portant à la fois sur la maîtrise de la langue, définie conformément au cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), et sur la connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises.
Établir une procédure d’évaluation plus stricte concernant la maîtrise de la langue par un effort de formation des personnels affectés à cette tâche et la définition de critères d’un niveau égal à celui des compétences exigées pour l’obtention du diplôme DELF A2.
Proposition n° 8 : Augmenter le nombre de missions financées dans le cadre du service civique.
Proposition n° 9 : Lever les obstacles juridiques à la mise en œuvre de la formation civique et citoyenne prévue dans le cadre du service civique.
Proposition n° 10 : Étendre les débouchés offerts aux jeunes ayant accompli le service civique, notamment dans les armées.
Proposition n° 11 : Ouvrir le service civique aux demandeurs d’asile et mieux prendre en compte l’accomplissement du service civique par une personne qui demande la nationalité française, dans le cadre de la procédure de naturalisation.
Proposition n° 12 : Appuyer le projet de création d’un Institut du service civique.
Proposition n° 13 : Faire participer les engagés du service civique au défilé de la fête nationale.
CONTRIBUTION DU GROUPE SOCIALISTE, RADICAL,
CITOYEN ET DIVERS GAUCHE
Il y a assez de discriminations dans notre pays pour que la République n’en crée pas de nouvelles. Alors que toute catégorisation et hiérarchisation des Français, notamment selon leur mode d’acquisition de la nationalité française, devraient être combattues, c’est pourtant une légalisation de celles-ci qui est proposée à la représentation nationale. Au droit inégal à la binationalité, le rapport ajoute des devoirs différents quant à l’obligation de manifester sa volonté d’appartenir à la nation française.
Fatalisme, peur, repli sur soi, division des Français, remise en cause du droit du sol et de la binationalité afin de limiter le nombre de Français, les fondements et les objectifs de ce rapport ne peuvent susciter aucune adhésion. Ce dernier s’inscrit dans un contexte lourd marqué par les débats sur l’identité nationale et sur la déchéance de nationalité. La France de 2011 ici dessinée est repliée sur elle-même et craintive. L’État y est faible et la nation étriquée.
Au contraire, c’est une France sûre d’elle-même et fière de ses citoyens qu’il faut construire et promouvoir. C’est une France ouverte sur l’extérieur, communiquant avec ses ambassadeurs que sont les centaines de milliers de Français, binationaux ou non, résidant à l’étranger. C’est une France, qui permet, surtout, à chacun de ses citoyens de se sentir Français.
Une toute autre vision est défendue dans le présent rapport. Sur la défensive, ce dernier fait fi des préconisations des personnalités auditionnées par la mission, et notamment de la position de Pierre Mazeaud opposé à toute conception restrictive du droit de la nationalité. Ce rapport cherche avant tout à imaginer de nouvelles barrières qui protégeraient la France contre une menace identifiée mais jamais expliquée. Il y est établi une hiérarchisation complexe entre individus, graduant les droits et devoirs de chacun en fonction de critères pour le moins contestables.
Les jeunes Français (par droit du sang ou double droit du sol) seront simplement invités à participer à une « manifestation commune de volonté d’appartenir à la nation française » (proposition n° 5). Tous auront eu leur(s) nationalité(s) déclaré(es) à leur naissance du fait d’une modification de l’article 35 du code civil (proposition n° 18).
La deuxième catégorie regroupe, selon le rapport, les jeunes nés en France et y résidant, de parents étrangers nés à l'étranger. Alors que ces enfants sont aujourd’hui de facto français à leur majorité, ils seront désormais obligés de manifester leur volonté d'acquérir la nationalité française. À défaut, ils deviendront étrangers dans leur propre pays. En outre, ils ne pourront plus obtenir la nationalité française par anticipation à 13 ans (proposition n° 6).
La troisième catégorie concerne les jeunes nés en France, résidant en France, mais ayant des parents étrangers nés à l’étranger, en situation irrégulière. Ceux-ci ne pourront plus acquérir la nationalité française à leur majorité ou de manière anticipée du fait de la situation illégale de leurs parents (proposition n° 4).
Quatrième et dernière catégorie : les personnes devenant françaises par mariage ou par décision de l’autorité publique au terme d’une procédure de naturalisation. Celles-ci devront à la fois répondre à l'obligation de manifester leur volonté d’appartenir à la nation française (proposition n° 7) mais aussi renoncer à leurs autres nationalités (proposition n° 17). C’est donc un système fondé sur une inégalité fondamentale qui est proposé : un Français pourra avoir plusieurs nationalités - ce qui permet, dans un contexte de campagne électorale, de rassurer les centaines de milliers d’électeurs français de l’étranger et/ou binationaux - mais un étranger souhaitant devenir Français devra, quant à lui, renoncer à sa ou ses nationalités.
Cet enchevêtrement complexe, modulant droits et devoirs selon une hiérarchisation dangereuse des individus, ne peut être que condamné. Ce n’est pas en catégorisant et en divisant que la France affirmera sa capacité « à fabriquer des Français ». Quel intérêt a la République à maintenir étrangers sur son territoire des individus qui n’aspirent qu’à rejoindre la communauté nationale ? En quoi celle-ci serait mieux protégée - et d’ailleurs de quoi ?- en limitant le nombre de Français ? Un État fort est celui qui choisit ses nationaux et non, comme le propose le présent rapport, celui qui renvoie la nationalité à une option individuelle.
Les conclusions de ce rapport sont d’autant plus condamnables qu’elles reposent sur des raisonnements tronqués ou erronés.
Ainsi, la situation en Guyane et Mayotte - d’ailleurs non étayée par des données chiffrées fiables - sert de prétexte à un durcissement du droit du sol sur l’ensemble du territoire. Il est vrai que malgré la forte tentation du rapporteur de créer un régime dérogatoire concernant le droit de la nationalité dans ces départements français, l’inconstitutionnalité prévisible d’une telle mesure a servi de garde-fou. La conséquence en est une remise en cause générale du droit du sol des enfants nés et résidant en France en ajoutant la condition de régularité du séjour de leurs parents.
En outre, à aucun moment, la bi ou plurinationalité n’est considérée comme une chance, participant à l’enrichissement de la France et à son rayonnement à l’étranger. Pourquoi intégrer une communauté nationale nécessiterait de renoncer à ses origines ? L’individu n’est pas un monolithe ne tolérant qu’une seule attache. L’obsession du choix unique ne traduit qu’une fermeture d’esprit et une peur du différent. Dans tous les domaines, s’attacher à l’unité ne peut consister à nier la diversité.
Un argument nauséabond doit d’ailleurs être rejeté sans appel, celui selon lequel des binationaux engagés dans l’armée française pourraient être une menace pour nos propres troupes. Le degré d’« allégeance » des Français s’évaluerait ainsi selon leur religion ou culture présupposées, celles-ci les conduisant à se sentir plus ou moins proches d’un ennemi. Ce type d’affirmation est d’autant plus intolérable que par leur engagement au risque de leur vie, ces personnes ont, plus que d’autres, démontré leur attachement à la France.
À cet égard, il serait juste de permettre l’acquisition de la nationalité française à tous les anciens combattants étrangers qui le souhaitent ayant servi dans l’armée française. Le fait d’avoir été blessé au cours de son service, nécessaire actuellement pour déclencher une naturalisation, ne devrait plus être une condition essentielle.
Faire en sorte que la nation se rappelle à ses citoyens aurait pu être un élément de consensus, à l’instar des propositions du groupe SRC par voie d’amendements sur un texte récent. Dépassant le simple caractère solennel et symbolique d’une cérémonie, il était proposé que chaque Français, quel que soit son mode d’acquisition de la nationalité française, reçoive les textes fondateurs que sont la Constitution Française et son Préambule ainsi que la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. La journée « défense et citoyenneté », les cérémonies de mariage ou d’acquisition de la nationalité française, auraient pu constituer ces occasions où la nation se manifeste aux siens.
Le lien national n’est pas une banale vue de l’esprit, c’est une construction de tous les jours. Néanmoins, réaffirmer cette appartenance commune ne peut consister en une simple « manifestation de volonté d’appartenir à la nation française » comme le prévoit le présent rapport, et encore moins si celle-ci est plus ou moins contraignante selon les différentes catégories de Français artificiellement créées. D’une simple cérémonie a priori facultative pour les Français de naissance, celle-ci devient une exigence pour le mineur né en France mais ne bénéficiant que du droit du sol simple (parents étrangers nés à l’étranger). Pour deux enfants nés en France et ayant grandi dans ce pays, en quoi serait-il plus grave de ne pas manifester sa volonté d’appartenir à la nation française pour celui dont les parents sont nés à l’étranger que pour celui dont au moins un des parents est né en France ? Cette catégorisation ne tient pas et sa perversité saute aux yeux. Car c’est le droit du sol qui est une fois de plus attaqué par le refus de reconnaître français, sans condition de manifestation, des enfants qui sont nés en France et qui n’ont connu que ce pays.
D’autres points ou interrogations légitimes ont été soigneusement ignorés par le rapport. Ainsi, qu’en est-il du traitement différencié des demandes de naturalisation sur le territoire du fait de la déconcentration de la procédure ? Quelles perspectives pour les conjoints de Français dont les obstacles pour venir sur le sol français puis, s’ils le souhaitent, bénéficier de la nationalité, ne cessent de s’accroître ? Quels droits politiques ouvrir à des résidents étrangers, notamment au niveau local ?
Enfin, quant à la question essentielle, « se sentir Français », celle-ci est éludée. La réunion d’un État et d’une nation n’a rien d’une évidence. Le concept d’État-nation mêle, en effet, deux réalités distinctes, une juridique et institutionnelle, l’autre plus floue, renvoyant à un groupe humain conscient de son unité (notamment historique, sociale et culturelle) et possédant la volonté de vivre en commun. Peut-on réellement croire que « manifester sa volonté », en une heure un jour dans sa vie, peut créer la conviction d’appartenir à la nation française ?
À aucun moment n’est questionné le cas des milliers de personnes qui sont françaises juridiquement mais qui n’en n’ont pas le sentiment. D’autres Français souffrent de l’image d’étrangers qu’on leur renvoie. C’est le regard des autres sur soi qui peut faire douter de sa propre identité, de sa nationalité. Les contrôles au faciès, l’abandon de certains quartiers et l’indifférence devant la ghettoïsation ou encore la stigmatisation de populations en difficulté sont autant d’éléments qui minent la cohésion nationale.
Le problème est donc moins celui d’une révision des règles d’accès à la nationalité que celui du sentiment d’appartenance à la communauté nationale, de partage d’une même nationalité. Comment « faire France » au XXIe siècle et répondre au « mal-vivre ensemble » ? Comment créer ce « plébiscite de tous les jours » cher à Renan ? À l’exception de quelques propositions relatives au service civique, aucune réponse n’est apportée.
Pourtant, ne faudrait-il pas rappeler l’importance de la maîtrise de la langue, pour tous, et non seulement pour les personnes souhaitant être naturalisées ? Confier à des organismes privés l’évaluation de la maîtrise du français des personnes candidates à la naturalisation, comme le préconise le rapport, est-il souhaitable et à la hauteur des enjeux ? Alors que plus d’un jeune sur 10 échoue au test d’évaluation de la maîtrise de la langue française lors de la journée « défense et citoyenneté », la langue, ce « pilier de la nationalité » selon la formule de Patrick Weil, mérite attention et moyens.
Il en est de même quant à l’enseignement de l’Histoire. Proposer d’un côté la suppression de l’enseignement de l’Histoire en Terminale Scientifique et renoncer à celui-ci dans les filières professionnelles comme l’a fait l’actuel Gouvernement, et souhaiter, d’un autre, valoriser cette matière, semble pour le moins antagonique. L’Éducation nationale doit être au cœur des priorités d’une République qui souhaite donner à chacun la conscience de partager un patrimoine commun, une Histoire et des valeurs fondatrices : la liberté, l’égalité et la fraternité auxquelles il faut ajouter la laïcité. Cela ne peut être accompli en maltraitant les enseignants et en fermant des classes.
Bref, la lecture de ce rapport ne peut que décevoir. Décevoir ceux qui s’attendaient à une approche renouvelée du droit de la nationalité. Décevoir ceux qui pensaient que le législateur serait capable d’intégrer les mutations de la France du XXIe siècle. Décevoir ceux qui souhaitaient des solutions concrètes aux difficultés rencontrées sur le terrain. Décevoir ceux qui pensaient que les thèses basées sur le déclin de la France, la dangerosité de « l’étranger », de « l’ennemi de l’intérieur », avaient désormais moins de prise. Décevoir, enfin et surtout, ceux qui espéraient trouver des réponses à la question fondamentale du lien national, du sentiment d’appartenir à une même nation et de partager une même nationalité.
À la déception s’ajoute l’inquiétude de voir ainsi affirmés des principes contraires à notre idée de la République, égale vis-à-vis des siens et combative envers toute forme de discrimination et de stigmatisation.
C’est pourquoi les membres du groupe socialiste, radical et citoyen ne peuvent que dénoncer les conclusions de ce rapport et appeler à une véritable politique du « vivre ensemble ».
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
PAR LA MISSION D’INFORMATION
Réunion du mercredi 3 novembre 2010
— M. Pierre MAZEAUD, ancien président du Conseil constitutionnel, président de la fondation Charles de Gaulle
— M. Paul LAGARDE, professeur émérite de droit à l’université Paris I, spécialiste en droit international privé
Réunion du mercredi 17 novembre 2010
— M. Jean-Philippe THIELLAY, maître des requêtes au Conseil d’État, auteur de l’ouvrage « Les clefs de la nationalité française »
— M. Alain BLUM, responsable de l’unité de recherche Identités et territoires des populations et Mme France GUÉRIN-PACE, directrice de recherche en charge de l’unité de recherche Identités et territoires des populations à l’Institut national d’études démographiques (INED)
Réunion du mercredi 1er décembre 2010
— M. Hugues FULCHIRON, président de l’université Jean Moulin, professeur de droit privé
Réunion du mercredi 8 décembre 2010
— Mme Anne-Marie THIESSE, historienne et directrice de recherches au CNRS
— M. Jean GODEFROID, directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration
Réunion du mercredi 15 décembre 2010
— M. Philippe LECLERC, représentant du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR)
Réunion du mercredi 12 janvier 2011
— M. Patrick WEIL, historien, directeur de recherche au CNRS Centre histoire sociale au XXe siècle – Université Paris I – Panthéon-Sorbonne
Réunion du mercredi 19 janvier 2011
— Mme Michèle TRIBALAT, démographe, directrice de recherche à l’Institut national des études démographiques (INED)
Réunion du mercredi 26 janvier 2011
— M. Patrick GAUBERT, président du Haut Conseil à l’Intégration et M. Benoît NORMAND, secrétaire général
Réunion du mercredi 9 février 2011
— Mme Malika SOREL, essayiste
— Mme Catherine WITHOL de WENDEN, directrice de recherches au CNRS
Réunion du mercredi 16 février 2011
— M. Mustapha BELBAH, sociologue
— M. Xavier LEMOINE, maire de Montfermeil
Réunion du mercredi 2 mars 2011
— M. Alain JAKUBOWICZ, président de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA)
— M. Pierre HENRY, directeur général de France Terre d’asile
Réunion du mercredi 16 mars 2011
— M. Pierre NORA, historien, membre de l’Académie Française
— M. Tzvetan TODOROV, historien et essayiste
Réunion du 30 mars 2011 : table ronde des représentants des administrations intervenant dans la procédure de naturalisation :
— M. Michel AUBOUIN, directeur de l’accueil, de l’intégration et de la citoyenneté, ministère de l’Intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration
— M. Laurent AUDINET, sous-directeur de l’accès à la nationalité française, ministère de l’Intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration
— M. Stéphane FRATACCI, secrétaire général du ministère de l’Intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration
— M. François SAINT-PAUL, directeur des Français à l’étranger et de l’administration consulaire, ministère des Affaires étrangères et européennes
— M. Laurent TOUVET, directeur des libertés publiques, ministère de l’Intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration
— M. Laurent VALLÉE, directeur des affaires civiles et du Sceau, ministère de la Justice et des libertés
Réunion du mercredi 6 avril 2011
— M. Martin HIRSCH, président de l’Agence du service civique
— Général Robert AUGIER de CRÉMIERS, directeur du service national au ministère de la Défense et des anciens combattants, responsable de l’organisation de la Journée défense et citoyenneté (JDC)
Personnes auditionnées dans le cadre des déplacements de la mission
Londres
(16 décembre 2010)
— M. Dominic Grieve, Attorney general
— M. Keith Vaz, président de la commission des Affaires intérieures à la Chambre des Communes
— M. Matthew Coats, Mme Nicola Smith, M. Jonathan Devereux, et M. Paul Ghent membres de l’Agence de l’immigration UK Border Agency
Berlin
(17 janvier 2011)
— M. Ole Schröder, secrétaire d’État parlementaire au ministère fédéral de l’Intérieur, et M. Franz Wessendorf, responsable des questions de nationalité au sein du même ministère
— M. Ralf Gebel, directeur de cabinet de Mme Maria Böhmer, ministre déléguée à la Chancellerie fédérale en charge de l’intégration et avec Mme Sybille Röseler, sous-directrice auprès de Mme Maria Böhmer
— M. Ehrhart Körting, ministre de l’Intérieur du Land de Berlin
— MM. Dieter Wiefelspütz (porte-parole du groupe SPD), Wolfgang Wieland, (porte-parole du groupe des Verts), Memet Kiliç (député des Verts), membres de la commission des Affaires intérieures du Bundestag
Préfecture de Seine-Saint-Denis (Bobigny)
2 mars 2011
— M. Christian Lambert, préfet de la Seine-Saint-Denis,
— M. Arnaud Cochet, secrétaire général de la préfecture.
LA PROCÉDURE DE NATURALISATION
DEPUIS LE 1ER JUILLET 2010
(DÉCRET N° 2010-725 DU 29 JUIN 2010)
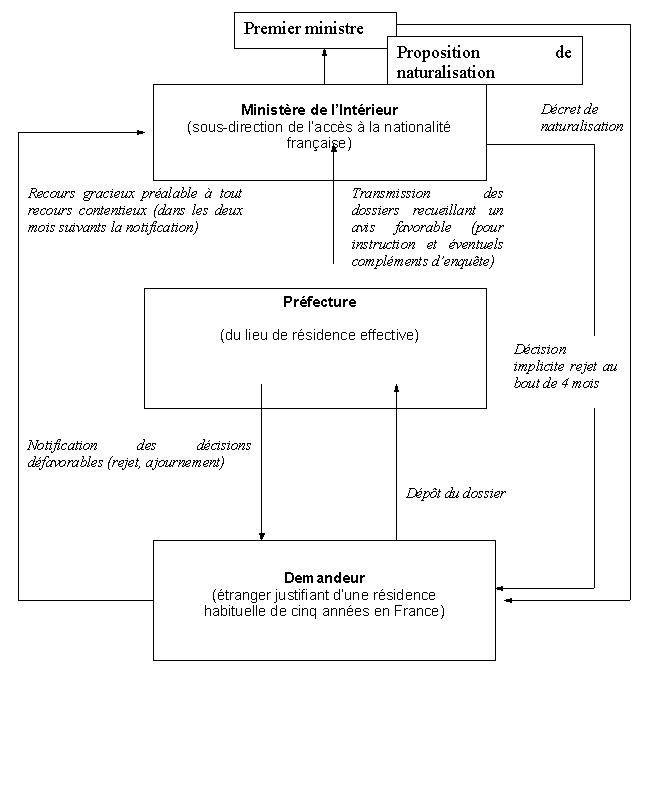
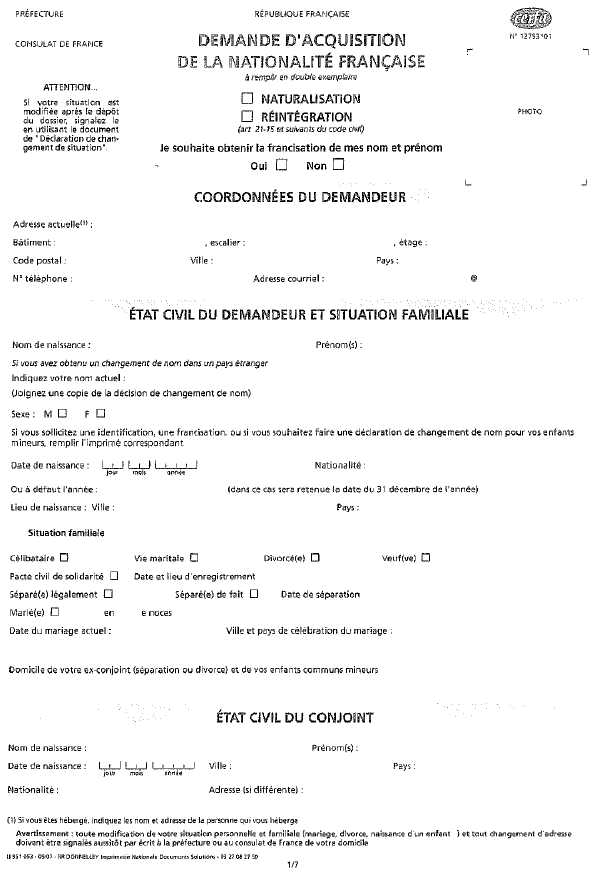
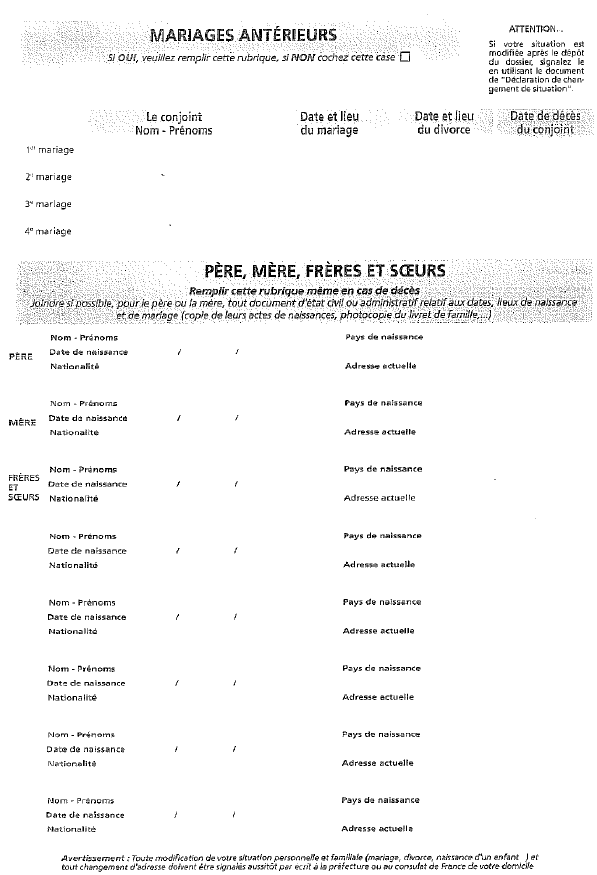
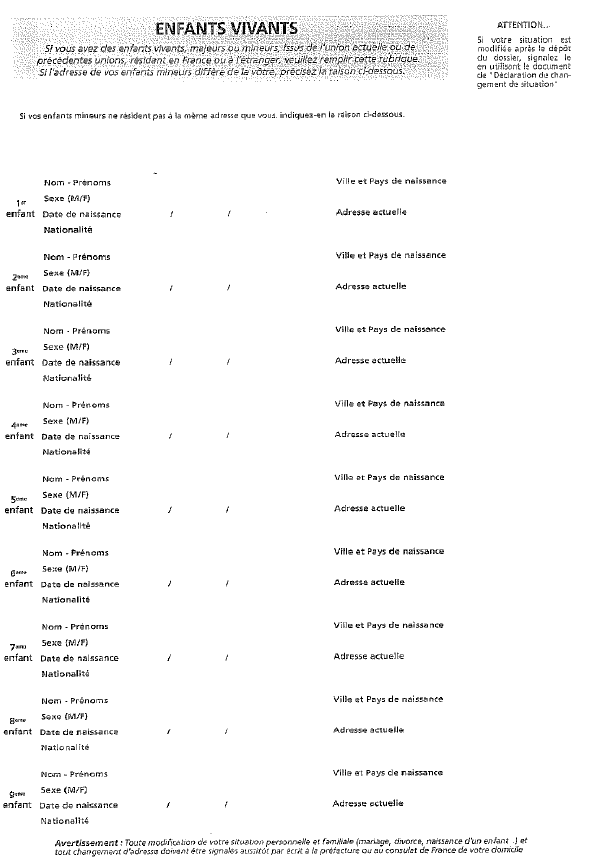
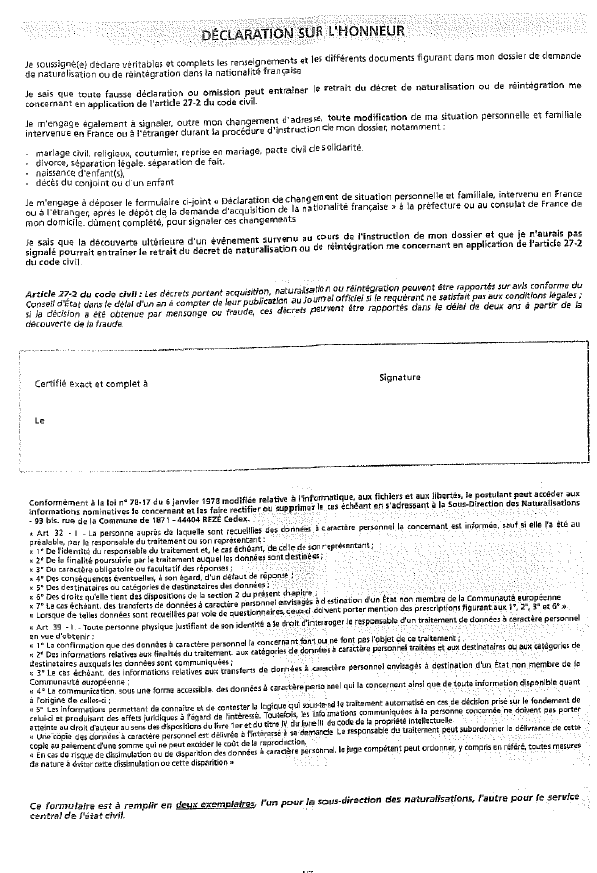
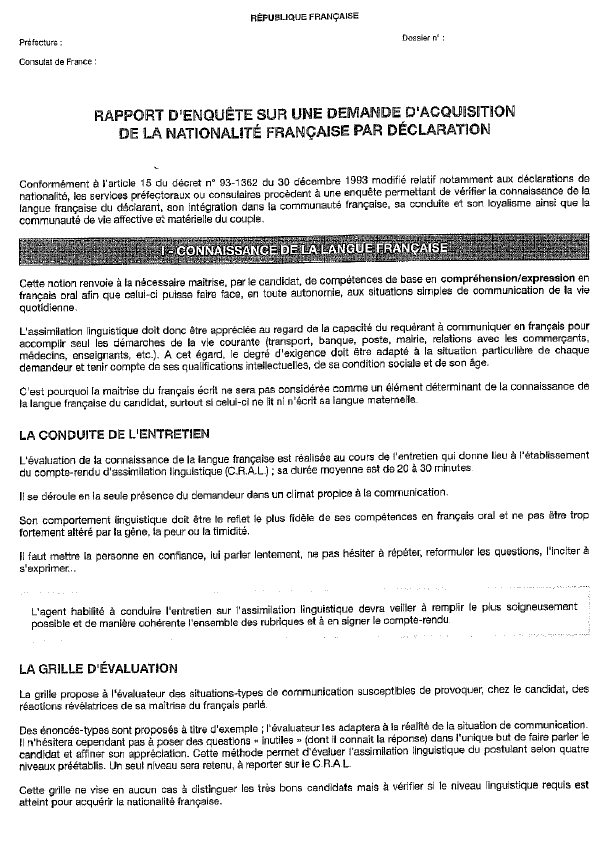
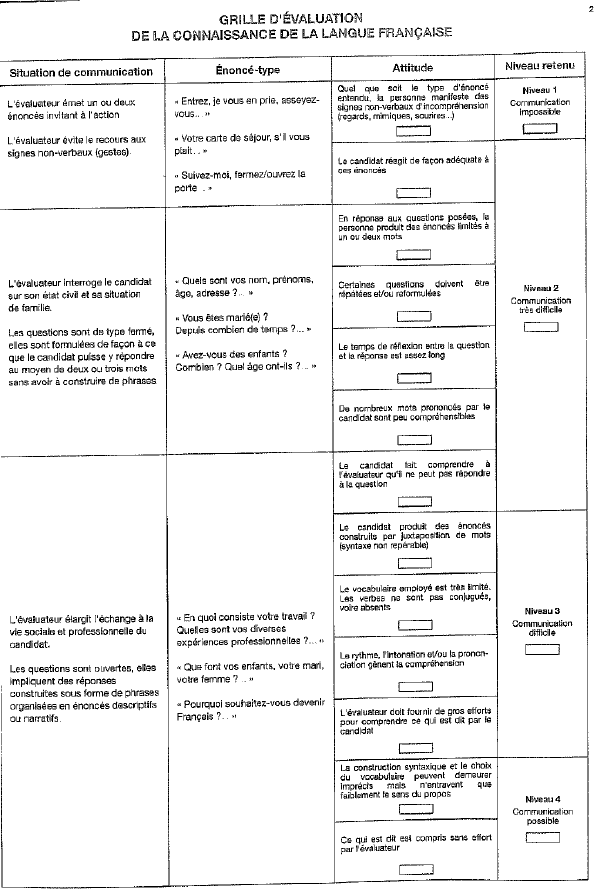
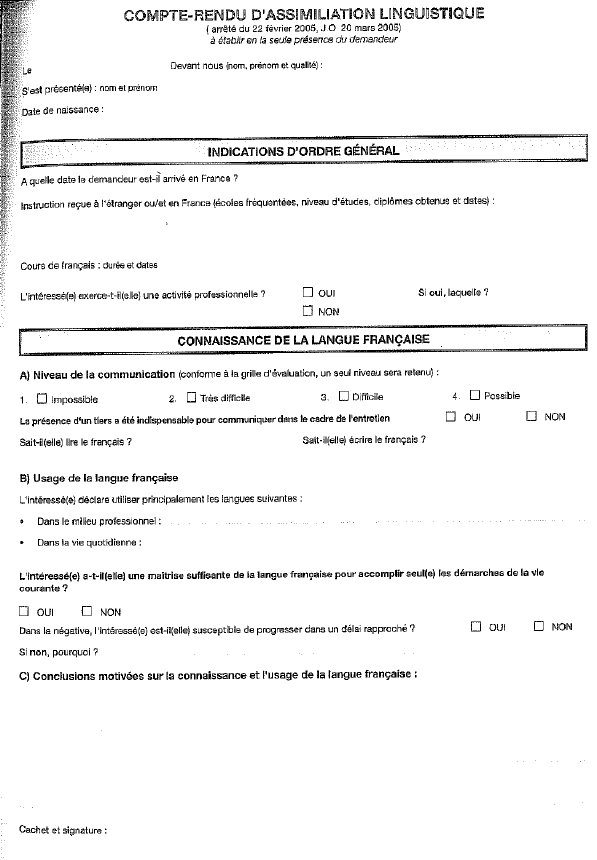
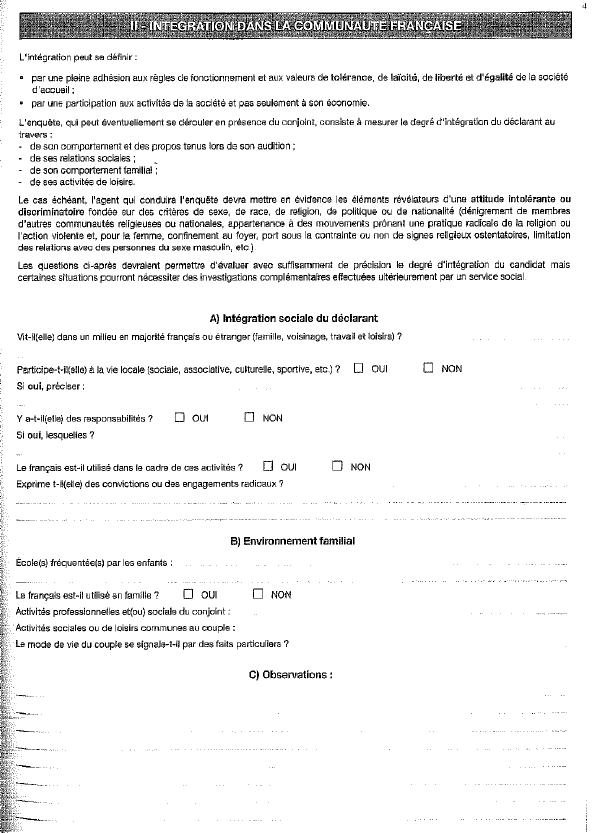
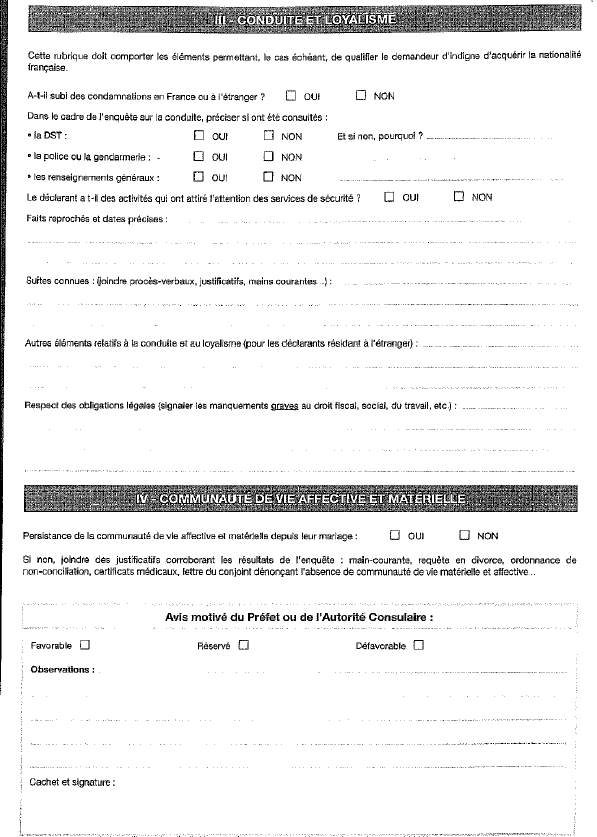
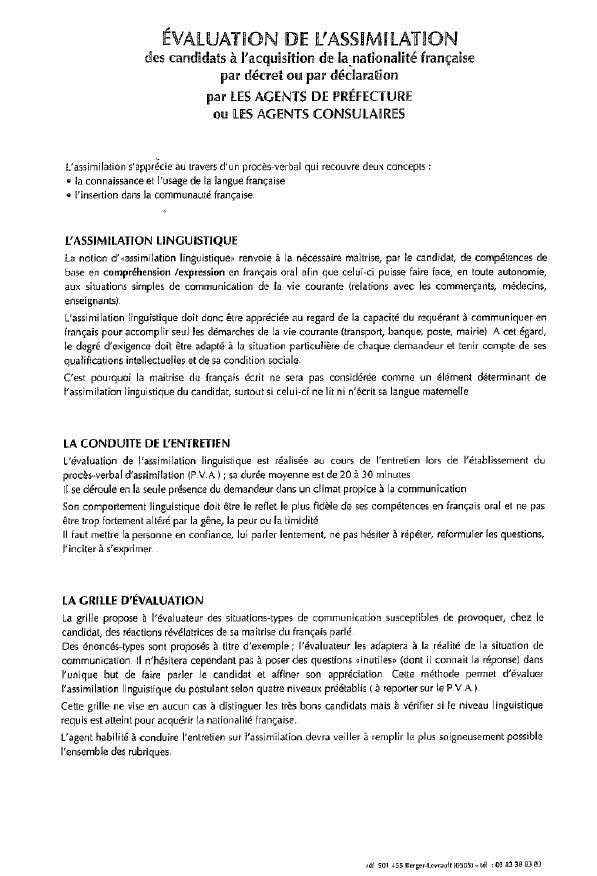
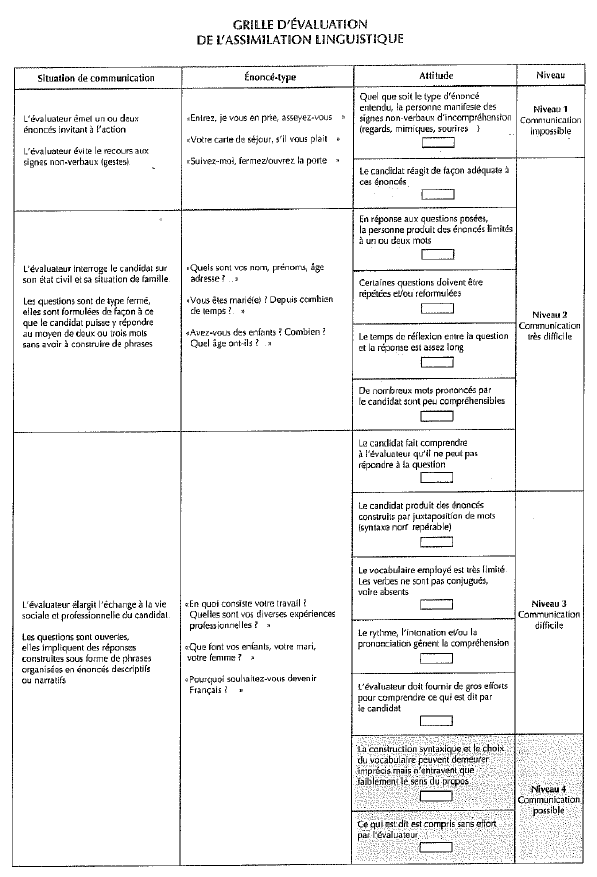
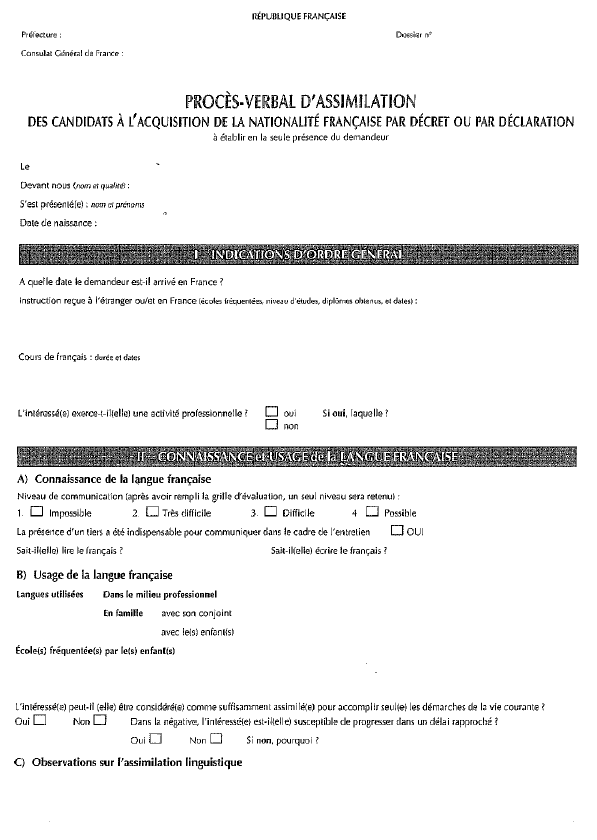
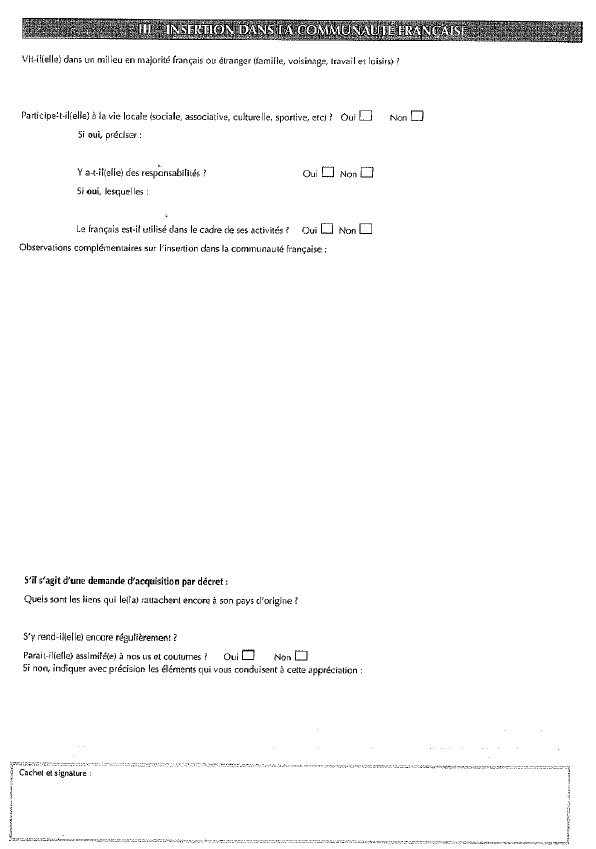
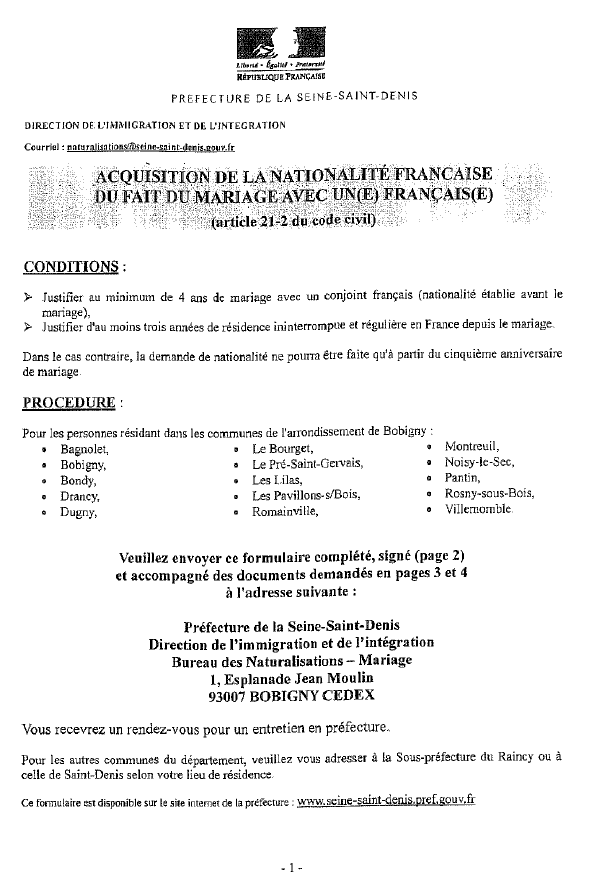
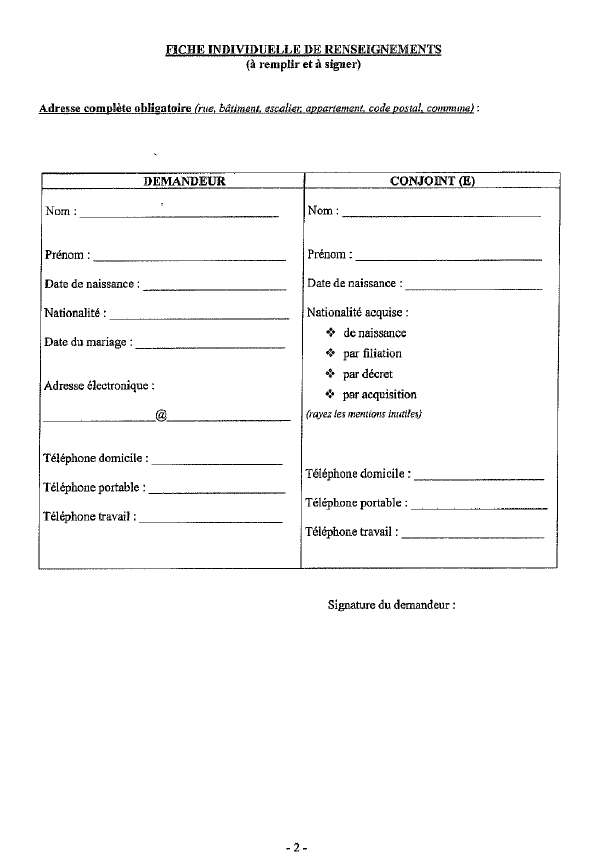
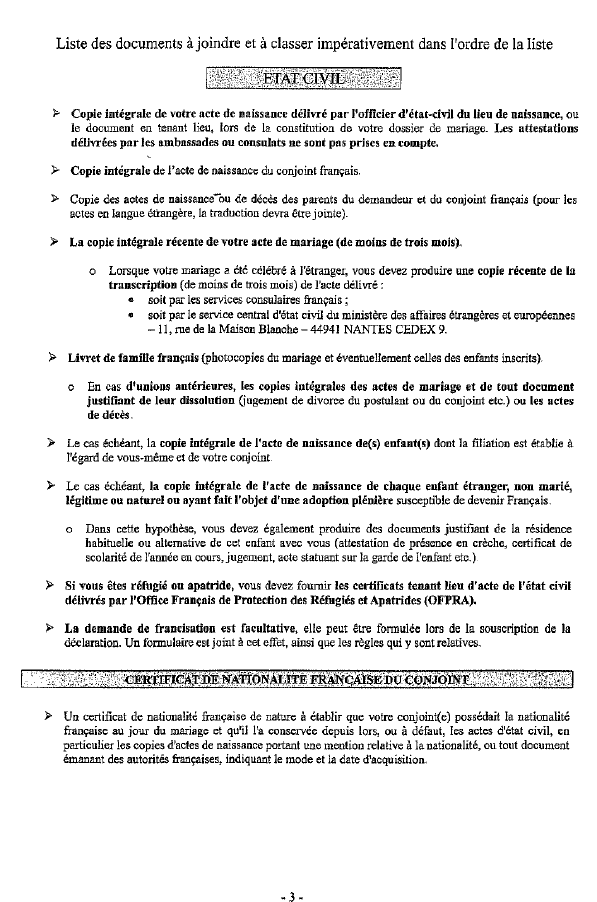
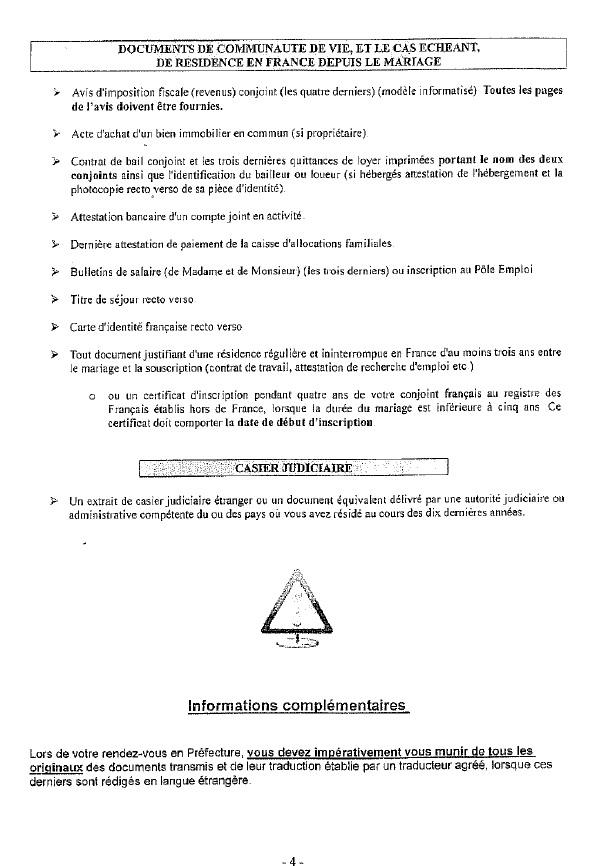
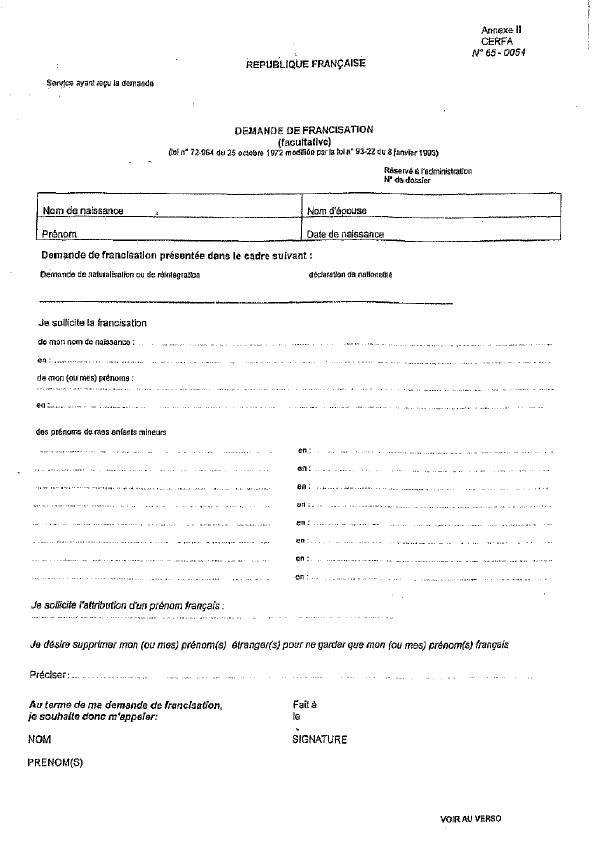
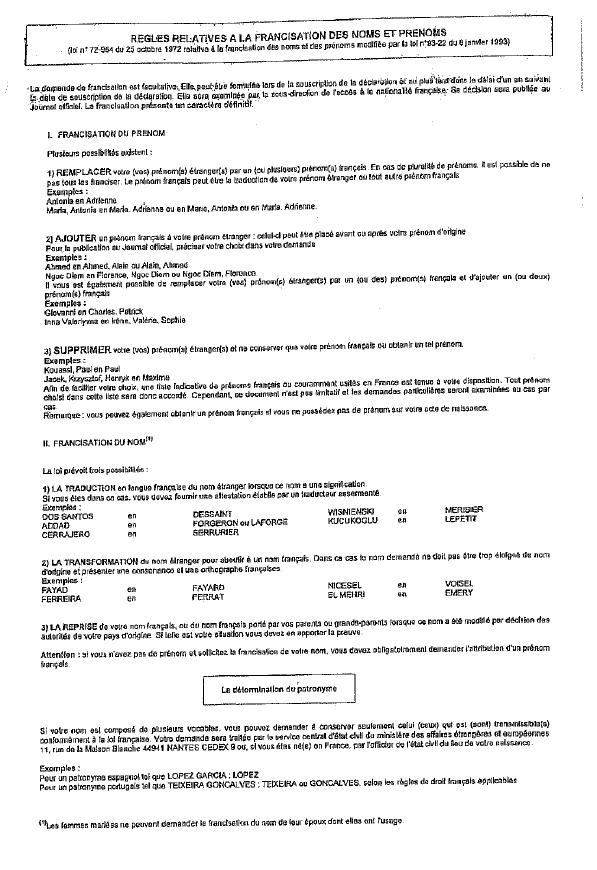
1 () La composition de cette mission figure au verso de la présente page.
2 () Nommé le 9 mars 2011.
3 () Être Français aujourd’hui et demain, Rapport remis au Premier ministre par M. Marceau Long, président de la commission de la nationalité, La Documentation française, 1988.
4 () Être français aujourd’hui et demain, Rapport de la Commission de la nationalité présenté par M. Long au Premier ministre, 1988, Éd.10/18, t. II, p. 24. Une Commission de la nationalité, présidée par M. Marceau Long, fut mise en place en 1987 pour préparer une réforme du droit de la nationalité afin de l’adapter aux préoccupations de son temps. Réunie entre juin 1987 et janvier 1988, et après avoir entendu plus de 120 personnalités, cette commission a produit un rapport dont les conclusions servirent de base à la réforme du droit de la nationalité entreprise en 1993.
5 () E. Kantorowicz, Les deux corps du roi, Gallimard, Quarto, 2000.
6 () F. Olivier-Martin, L’absolutisme français, suivi de Les Parlements contre l’absolutisme traditionnel au XVIIIe siècle, LGDJ, 1997, p. 52.
7 () E. Zoller, Introduction au droit public, Dalloz, 2006, pp. 32-33.
8 () E. Zoller, Introduction au droit public, Dalloz, 2006, p. 173.
9 () E. Sieyès, Qu’est-ce que le Tiers État ?, PUF, Coll. Quadrige, 1982, p. 86.
10 () E. Zoller, Introduction au droit public, Dalloz, 2006, p. 183.
11 () E. Renan, Qu’est-ce qu’une nation ? Discours en Sorbonne du 11 mars 1882, Calmann Lévy, 1882.
12 () Ibidem.
13 () E. Renan, Qu’est-ce qu’une nation ? Discours en Sorbonne du 11 mars 1882, Calmann Lévy, 1882.
14 () E. Gellner, Nations et nationalisme, Payot, 1989.
15 () M. Barrès, Le système nerveux central, 1899.
16 () M. Barrès, Les déracinés, Paris, Fasquelle, 1897.
17 () L’un des manuels d’Ernest Lavisse comportait la formule suivante : « Tu dois aimer la France, parce que la nature l’a faite belle et parce que son histoire l’a faite grande […] Pour tout dire, si l’écolier n’emporte pas avec lui le vivant souvenir de nos gloires nationales, s’il ne sait pas que ses ancêtres ont combattu sur tous les champs de batailles pour de nobles causes, s’il n’a point appris ce qu’il a coûté de sang et d’efforts pour faire l’unité de notre patrie et dégager ensuite du chaos de nos institutions vieillies les lois qui nous ont fait libres, s’il ne devient pas un citoyen pénétré de ses devoirs et un soldat qui aime son fusil, l’instituteur aura perdu son temps ». Cité par P. Nora dans « Lavisse, instituteur national. Le « Petit Lavisse », évangile de la République », Les Lieux de mémoire, Gallimard, 1984-1992.
18 () F. Furet, La Révolution française, Hachette Littératures, Coll. Pluriel, Paris, 1999.
19 () Audition de Mme Anne-Marie Thiesse, historienne et directrice de recherches au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), auteur de La création des identités nationales. Europe XVIIIe – XXe siècles, Éd. du Seuil, 1999, le 8 décembre 2010.
20 () Formule de Benedict Anderson, auteur de Imagined communities : reflections on the origin and spread of nationalism, 1983 (L’imaginaire national : réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, Paris, La Découverte, 1996).
21 () P. Nora, Les Lieux de mémoire, Gallimard, 1984-1992.
22 () M. Bloch, L’Étrange défaite, 1940.
23 () Audition du 16 mars 2011.
24 () http://www.lemonde.fr/politique/article/2007/03/17/pierre-nora-le-nationalisme-nous-a-cache-la-nation_884396_823448.html
25 () Audition du 16 mars 2011.
26 () http://www.lemonde.fr/politique/article/2007/03/17/pierre-nora-le-nationalisme-nous-a-cache-la-nation_884396_823448.html
27 () Il s’agit de la conférence de presse donnée le 27 novembre 1967 par le général de Gaulle, quelques mois après la Guerre des Six Jours et présentant le peuple juif comme un « peuple d’élite, sûr de lui-même et dominateur ».
28 () Audition du 12 janvier 2011. Adde, P. Weil, Liberté, égalité, discriminations, L’« identité nationale » au regard de l’histoire, Grasset, pp. 14-17.
29 () Audition du 16 mars 2011.
30 () Ibidem.
31 () Ibidem.
32 () http://www.lemonde.fr/politique/article/2007/03/17/pierre-nora-le-nationalisme-nous-a-cache-la-nation_884396_823448.html
33 () Audition de M. Pierre Henry, directeur général de l’association « France terre d’asile », le 2 mars 2011.
34 () La koinè ou koinê (en grec ancien « κοινή » signifiant « langue commune ») est, au sens propre, une forme de grec ancien, ayant servi de langue commune au monde hellénistique. Elle s'est imposée comme langue administrative et véhiculaire dans les zones sous influence hellénistique, en concurrence par la suite avec le latin. Par extension, une koinè est une langue véhiculaire dans laquelle se sont fondus différents dialectes et parlers locaux.
35 () Max Gallo s’est essayé à poursuivre l’écriture du « roman national », notamment dans son récent ouvrage L’âme de la France, une histoire de la nation des origines à nos jours, Fayard, 2007.
36 () http://www.lefigaro.fr/livres/2008/09/25/03005-20080925ARTFIG00413-max-gallo-ressaisir-l-esprit-du-roman-national-.php
37 () Audition du 16 février 2011.
38 () Audition du 8 décembre 2010.
39 () Audition du 12 janvier 2011.
40 () Loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école.
41 () Décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006 relatif au socle commun de connaissances et de compétences et modifiant le code de l’éducation.
42 () Arrêté du 15 juillet 2008 fixant le programme d’enseignement d’histoire-géographie – éducation civique pour les classes de sixième, de cinquième, de quatrième et de troisième du collège.
43 () Ibidem, cf. I. des orientations générales communes aux trois programmes, I.1 leur cohérence avec les programmes de l’enseignement primaire.
44 () Cf. Bulletin officiel de l’Éducation nationale, n° 7, annexe 1, Séries économique et sociale et littéraire, pp. 99-100, octobre 2002.
45 () Audition du 8 décembre 2010.
46 () Audition du 16 mars 2011.
47 () Entretien avec M. Ehrhart Körting, ministre de l’Intérieur du Land de Berlin, le 17 janvier 2011.
48 () Idem.
49 () Entretien avec des députés du Bundestag membres de la commission des Affaires intérieures du Bundestag (Dieter Wiefelspütz – SPD -, Wolfgang Wieland - Verts - et Memet Kiliç - Verts), le 17 janvier 2011.
50 () Entretien avec M. Ehrhart Körting, ministre de l’Intérieur du Land de Berlin, le 17 janvier 2011.
51 () J. Habermas, L’intégration républicaine. Essais de théorie politique, traduit de l’allemand par R. Rochlitz, Paris, Fayard, 1998.
52 () On a ainsi pu parler des révoltes de l’année 1848 comme d’un « printemps des nationalités ».
53 () Madame de Staël, Corinne ou l’Italie, 1807.
54 () Selon l’historien Gérard Noiriel, c’est là la première occurrence du mot « nationalité ». Voir G. Noiriel, État, nation et immigration – Vers une histoire du pouvoir, Gallimard, Folio histoire, 2005, p. 223.
55 () CIJ, 6 avril 1955, Recueil p. 23. Adde S. Bastid, « L’affaire Nottebohm devant la Cour internationale de justice », Rev. Crit. DIP 1956.607 ; P. de Visscher, « L’affaire Nottebohm », Rev. gén. Dr. Int. Public 1956.238.
56 () J. – P. Niboyet, dans son Traité de droit international privé français (Recueil Sirey, 1947, t. III, n° 924), qualifie la nationalité de « concept politique au plus haut chef ».
57 () Être français aujourd’hui et demain, op. cit., t. II, p. 28.
58 () G. Cornu, Vocabulaire juridique, « Citoyen », Association Henri Capitant, Quadrige, PUF, 8e éd., 2007.
59 () Voir E. Zoller, Introduction au droit public, Dalloz, 2006.
60 () A. Dionisi-Peyrusse, Essai sur une nouvelle conception de la nationalité, Defrénois, Coll. de thèses, t. 31, préf. P. Courbe, 2008. L’auteur écrit notamment que « la nationalité, contrairement à ce que la racine du mot laisse entendre, ne se définit pas en droit comme un lien entre une personne et une nation. C’est un lien juridique entre une personne et un État. C’est « étatialité » qu’il faut donc comprendre lorsque l’on évoque aujourd’hui la nationalité en droit » (pp. 15-16). .
61 () Être français aujourd’hui et demain, op. cit., t. II, pp. 82 et 89.
62 () Ibidem, p. 89.
63 () H. Fulchiron, « La place de la volonté individuelle dans le droit français de la nationalité », Trav. Du Comité français de dr. int. privé, 1998-2000, Éd. A. Pedone, Paris, 2001, p. 177.
64 () P. Courbe, « Réflexions sur la réforme du droit de la nationalité par la loi du 16 mars 1998 », in Mélanges Raymond Goy, Du droit interne au droit international, Publications de l’Université de Rouen, Mont Saint Aignan, 1998, p. 53.
65 () Être français aujourd’hui et demain, op. cit., t. II, p. 89. La Commission de la nationalité s’est appuyée sur cette conception élective de la nation pour formuler des propositions en faveur d’un rôle accru de la volonté individuelle et de la manifestation de volonté en matière de détermination de la nationalité.
66 () J. Habermas, L’intégration républicaine. Essais de théorie politique, traduit de l’allemand par R. Rochlitz, Paris, Fayard, 1998.
67 () J. Habermas, Die postnationale Konstellation. Politische Essays, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1998.
68 () Y. Sintomer, P. Hassenteufel, « Jürgen Habermas, L’intégration républicaine », Politix, vol. 12, n° 46, 1999, pp. 173-177.
69 () Audition du 16 mars 2011. Selon Tzvetan Todorov, les individus n’éprouvent d’attachement affectif envers la sécurité sociale : ils en attendent seulement fiabilité et efficacité, et semblent prêts à consentir pour cela le sacrifice d’une partie de leurs revenus.
70 () Audition de M. Alain Jakubowicz, président de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme, le 2 mars 2011.
71 () J. Habermas, L’intégration républicaine. Essais de théorie politique, traduit de l’allemand par R. Rochlitz, Paris, Fayard, 1998.
72 () L’article 9 du Traité sur l’Union européenne dispose qu’« est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre ».
73 () Il s’agissait de : Lord Boyd Orr (britannique, directeur de la FAO, Prix Nobel de la paix 1949), J. de Castro (brésilien, président du conseil de la FAO), D. Dolci (italien), S. Hamai (japonais, ancien maire d’Hiroshima), J. – L. Hromadka (tchèque), A Kastler (français, Prix Nobel de physique 1966), R. Nehru (indien), L. Pauling (américain, Prix Nobel de chimie 1954, Prix Nobel de la paix 1962), l’abbé Pierre, J. Rostand (biologiste français), Lord B. Russel (philosophe britannique, Prix Nobel de littérature 1949), I. Supek (yougoslave), et H. Tirring (autrichien).
74 () A. Dionisi-Peyrusse, Essai sur une nouvelle conception de la nationalité, Defrénois, Coll. de thèses, t. 31, préf. P. Courbe, 2008.
75 () Outre la Convention internationale du 21 décembre 1965 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, on peut citer notamment l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, qui prohibe entre autres les discriminations fondées sur la race, la couleur et l’origine nationale. L’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme pose également un principe de non-discrimination et vise expressément l’appartenance à une minorité nationale.
76 () A. Dionisi-Peyrusse, Essai sur une nouvelle conception de la nationalité, Defrénois, Coll. de thèses, t. 31, préf. P. Courbe, 2008, p. 6.
77 () Sauf réciprocité, puisque l’article 11 du code civil dispose que « l’étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra ».
78 () CEDH, Sen contre Pays-Bas, 21 décembre 2001. La Cour de Strasbourg y constata l’impossibilité de reconstituer la vie familiale dans un État autre que celui d’immigration, compte tenu de la faiblesse des liens autres que la nationalité avec le pays d’origine.
79 () CEDH, Moustaquim contre Belgique, 18 février 1991 – au sujet d’un marocain qui avait commis 147 infractions en Belgique et dont la Cour de Strasbourg a considéré que son expulsion violait l’article 8 de la CESDH au motif qu’il n’avait que très peu de liens avec le Maroc, hormis sa nationalité.
80 () CEDH, Beldjoudi contre France, 26 mars 1992 – au sujet d’un algérien, multirécidiviste, condamné à huit ans de réclusion criminelle, dont l’expulsion a été jugée comme contraire à l’article 8 de la CESDH au motif qu’il n’avait que très peu de liens avec l’Algérie, à l’exception de sa nationalité.
81 () CEDH, Gaygusuz contre Autriche, 16 septembre 1996.
82 () CEDH, Koua Poirrez contre France, 30 décembre 2003.
83 () Y. Lequette, « La nationalité française dévaluée », in L’avenir du droit, Mélanges F. Terré, Dalloz, PUF, Paris, 1999, p. 349.
84 () CE, G.I.S.T.I, 8 décembre 1978, Recueil Lebon, p. 493 : « les étrangers résidant régulièrement en France ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale ».
85 () Conseil constitutionnel, 13 août 1993, n° 93-325 DC, Recueil p. 224. Adde B. Genevois, « Un statut constitutionnel pour les étrangers – À propos de la décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993 », RFDA, 1993, p. 871.
86 () Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial.
87 () CE, Belgacem, 19 avril 1991, Recueil Lebon, p. 152. Le même contrôle de conformité au regard de l’article 8 de la CESDH a été appliqué aux reconduites à la frontière (CE, Babas, 19 avril 1991, Recueil Lebon, p. 152), aux délivrances de visa (CE, Aykan, 10 avril 1992) et aux délivrances de titre de séjour (CE, Marzini, 10 avril 1992).
88 () L’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes :
1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ;
4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.
Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables à l'étranger mentionné au 3° ou au 4° ci-dessus lorsque les faits à l'origine de la mesure d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.
Les étrangers mentionnés au présent article bénéficient de ses dispositions même s'ils se trouvent dans la situation prévue au dernier alinéa de l'article L. 521-2 », à savoir lorsqu’ils ont été condamnés définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.
89 () Conseil constitutionnel, 22 janvier 1990, n° 89-269 DC, Recueil p. 33.
90 () Conseil constitutionnel, 13 août 1993, n° 93-325 DC, Recueil p. 224. Adde B. Genevois, « Un statut constitutionnel pour les étrangers – À propos de la décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993 », RFDA, 1993, p. 871.
91 () Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.
92 () Audition du 16 mars 2011.
93 () Pour le migrant conjoint de Français ou bénéficiaire du regroupement familial, l’évaluation des besoins de formation en français est réalisée depuis le pays d’origine, préalablement à son arrivée en France, au moyen d’un test de connaissance de la langue française conçu en référence au DILF. Le test passé avec succès, le migrant reçoit une attestation ministérielle de dispense de formation linguistique (AMDFL) qui le dispense de la formation organisée par l’OFII à l’étranger et en France. Dans le cas contraire, le migrant reçoit une initiation à la langue française de 40 heures au minimum suivie d’une seconde évaluation.
94 () L’article L. 311-9-1 prévoit également la signature d’un CAI pour l’étranger admis au séjour en France et, le cas échéant, son conjoint lorsque un ou plusieurs enfants ont bénéficié de la procédure de regroupement familial. Cette signature vaut engagement à suivre une formation sur les droits et les devoirs des parents en France et à respecter l’obligation scolaire. En cas de non respect du contrat, manifesté par une volonté caractérisée de l’étranger ou de son conjoint, le préfet peut saisir le président du conseil général en vue de la mise en œuvre du contrat de responsabilité parentale prévue à l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles. Il est tenu compte de la manière dont l’étranger s’est acquitté de ses engagements lors du renouvellement de la carte de séjour.
95 () Cette plateforme de l’OFII sert à l’organisation de séance d’accueil des migrants d’une demi-journée au cours de laquelle le contrat d’accueil et d’intégration leur est présenté. Prennent part à ces séances des auditeurs de l’OFII, des assistants de service social de l’OFII, un interprète (en fonction des besoins du public) et éventuellement un médecin et une infirmière.
96 () Audition du 8 décembre 2010.
97 () Audition du 8 décembre 2011.
98 () Audition du 12 janvier 2011.
99 () Institut national des études démographiques et Institut national des statistiques et des études économiques, équipe Trajectoires et Origines, Trajectoires et Origines, Enquête sur la diversité des populations en France, document de travail 168, octobre 2010.
100 () Audition du 9 février 2011.
101 Nicole Mosconi, Jacky Beillerot, Claudine Blanchard-Laville, Formes et formations du rapport au savoir, L’Harmattan, juin 2000.
102 () Jouni Välijärvi et al., in Rapport mondial de suivi sur l'éducation pour tous, UNESCO, 2005.
103 () Claudine Attias-Donfut, François-Charles Wolff, Le destin des enfants d’immigrés, Éditions Stock, octobre 2009.
104 () Évelyne Ribert, Liberté, égalité, carte d'identité. Les jeunes issus de l'immigration et l'appartenance nationale, Paris, éditions La Découverte, mars 2006.
105 () Audition du 16 février 2011.
106 () M. Belbah et Z. Chattou, « Naturalisation, appartenance et identité », Les Cahiers de l’Orient, n° 71, 2003.
107 () Christophe Bertossi et Catherine Withol de Wenden, Les couleurs du drapeau : les militaires français issus de l’immigration, Robert Laffont, mars 2007.
108 () Audition du 9 février 2011.
109 () Audition du 17 novembre 2010.
110 () Audition du 16 février 2011.
111 () Audition du 19 janvier 2011.
112 () Audition du 19 janvier 2011.
113 () Audition du 19 janvier 2011.
114 () Audition du 17 novembre 2010.
115 () Audition du 30 mars 2011.
116 () Articles 5 et 6 de la convention.
117 () Rapport fait au nom de la commission des Affaires étrangères sur le projet de loi n° 2988 autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de notes verbales entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant l’interprétation de la convention relative au service militaire des doubles nationaux du 16 novembre 2005 et mettant fin au dispositif mis en place par l’accord sous forme d’échange de notes des 28-29 décembre 1999.
118 () Amélie Dionisi-Peyrusse, Essai sur une nouvelle conception de la nationalité,op. cit.
119 () Table ronde des représentants des administrations intervenant dans la procédure de naturalisation organisée le 30 mars 2011.
120 () Cass. 1ère civ., 6 avril 2011, n° 09-17130, n° 10-19. 053, n° 09-66.486.
121 () Audition du 9 février 2011.
122 () Audition du 19 janvier 2011.
123 () M. Delmas-Marty, « L’espace judiciaire européen, laboratoire de la mondialisation », Dalloz 2000, chronique, p. 426.
124 () Le droit d’accès aux documents administratifs des institutions, organes et organismes de l’Union européenne est prévu par les articles 15 TFUE et 42 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le droit de pétition et le droit de saisir le Médiateur de l’Union européenne sont prévus par les articles 11 § 4 TUE, 20 § 2, 24, 227 et 228 TFUE, ainsi que par les articles 43 et 44 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
125 () A. Dionisi-Peyrusse, op. cit., p. 115.
126 () CJCE, Micheletti, 7 juillet 1992, Recueil CJCE I. p. 4239.
127 () A. Dionisi-Peyrusse, op. cit., p. 40.
128 () CJCE, Chen, 19 octobre 2004, C-200/02. Il s’agissait d’une femme qui s’était déplacée en Irlande du Nord dans le seul but d’y accoucher et de permettre à son enfant d’acquérir la nationalité de l’État de naissance pour se prévaloir ensuite d’un droit de séjour dans cet État. Face au détournement abusif des règles communautaires invoqué par l’État de naissance, les juges ont considéré qu’« il n’appart[enait] pas à un État membre de restreindre les effets de l’attribution de la nationalité d’un autre État membre en exigeant une condition supplémentaire pour la reconnaissance de cette nationalité en vue de l’exercice des libertés fondamentales prévues par le Traité ».
129 () A. Dionisi-Peyrusse, op. cit., p. 40.
130 () Être français aujourd’hui et demain, op. cit., t. II.
131 () Audition de Mme Catherine Wihtol de Wenden, le 9 février 2011.
132 () Audition du 16 mars 2011.
133 () Article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
134 () H. Kelsen, « Théorie générale du droit international public, problèmes choisis », Recueil de Cours La Haye, 1932, t. IV, p. 244.
135 () D’éminents auteurs se également prononcés en ce sens. Le professeur J. – P. Niboyet écrivit ainsi qu’« avec la nationalité, l’État se délimite, sans nationaux, il n’existerait pas » (Traité de droit international privé français, Recueil Sirey, 1947, t. I, n° 57). Le professeur J. Maury s’est également employé à démontrer l’importance qu’il y avait à établir des différences de degré dans l’appartenance à la communauté étatique (« V° Nationalité (théorie générale et droit français) », Rép. Droit international A. de Lapradelle et J. – P. Niboyet, Paris, 1931, Librairie du Recueil Sirey, n° 14 et s.).
136 () Être français aujourd’hui et demain, op. cit., p. 25.
137 () C’est la raison pour laquelle l’article 23-6 du code civil prévoit que « la perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l'intéressé, français d'origine par filiation, n'en a point la possession d'état et n'a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française, n'ont eux-mêmes ni possession d'état de Français, ni résidence en France depuis un demi-siècle ». Dans ce cas, le jugement « peut décider que cette nationalité avait été perdue par les auteurs de l'intéressé et que ce dernier n'a jamais été français ». Voir aussi l’article 30-3 du code civil.
138 () Être français aujourd’hui et demain, op. cit., p. 93.
139 () M. Vanel, « Le Français d’origine dans l’ancien droit français (XVe- XVIIIe siècles) », Rev. crit. DIP 1946.220
140 () Ibidem, p. 225. Ainsi les enfants des étrangers pouvaient succéder à leur père, même non naturalisé, dès lors qu’ils étaient nés en France et qu’ils y demeuraient.
141 () On notera par ailleurs que, dès l’Ancien Régime, le principe de la « naturalisation » fut admis, le roi ayant la possibilité d’octroyer à une personne la qualité de « régnicole » par une lettre de « naturalité ».
142 () Être français aujourd’hui et demain, op. cit., p. 19 : « Celui qui est né en France de parents étrangers est français s’il manifeste son intention de se fixer définitivement dans le royaume. Celui qui est né à l’étranger de parents français est français s’il revient dans le royaume en déclarant que son intention est d’y demeurer définitivement. À l’inverse, le Français d’origine qui quitte la France « sans esprit de retour » […] soit parce qu’il est parti s’établir à l’étranger avec sa famille, soit parce qu’il a acquis des lettres de naturalité d’un autre souverain, perd sa qualité de Français. Mais il peut toujours revenir dans le royaume et retrouver sa qualité de Français en manifestant son intention de s’y fixer durablement. »
143 () Lors de son audition en date du 3 novembre 2010, le professeur Paul Lagarde a insisté sur la place prépondérante du droit du sol dans le droit français de la nationalité sous l’Ancien Régime. Il a ainsi rapporté que le juriste Pothier, au XVIIIe siècle, estimait qu’étaient français tous ceux qui étaient nés « dans l’étendue de la puissance française », à l’exclusion des Français qui, installés à l’étranger, n’avaient pas l’intention de revenir vivre en France.
144 () P. Weil, Qu’est-ce qu’un Français – Histoire de la nationalité française depuis la Révolution, Gallimard, Folio histoire, 2005, pp. 29-30.
145 () Comme le rappelle M. Marceau Long dans son rapport au Premier ministre, le Premier consul ne voyait « que de l’avantage à étendre l’empire des lois civiles françaises » par une conception généreuse du droit de la nationalité. Napoléon Ier souhaitait combiner l’attribution de la nationalité par filiation paternelle en vertu du droit du sang et l’attribution de la nationalité en vertu d’un droit du sol pur et simple selon lequel « tout individu né en France est français » (Être français aujourd’hui et demain, op. cit., t. II, p. 20).
146 () Audition du 12 janvier 2011.
147 () Audition du 3 novembre 2010.
148 () Être français aujourd’hui et demain, op. cit., t. II, p. 22. M. Marceau Long mentionne les propos tenus devant l’Assemblée par le rapporteur de la loi du 7 février 1851 qui stigmatisait « l’odieux privilège des fils d’étrangers nés en France qui, pour se soustraire aux charges du recrutement militaire, s’abs[tenaient] de faire la déclaration requise par le code civil ».
149 () Audition du 3 novembre 2010.
150 () Décision du Conseil constitutionnel n° 93-321 DC du 20 juillet 1993, Recueil p. 196, n° 18.
151 () Audition du 12 janvier 2011.
152 () Voir l’actuel article 22-1 du code civil.
153 () Cass. civ. 21 juin 1919, Rev. crit. DIP 1919.265.
154 () Cass. ch. réunies 2 février 1921, Rev. crit. DIP 1921.251. Dans le même sens : Cass. civ. 24 mai 1949, Rev. crit. DIP 1949.501, note H. Motulsky ; Cass. 1ère civ. 12 novembre 1952, Rev. crit. DIP 1954.349, note H. Battifol.
155 () Audition du 12 janvier 2011.
156 () Être français aujourd’hui et demain, op. cit., t. II, pp. 27-28
157 () Ibidem, p. 28.
158 () Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française
159 () Sous l’empire de la loi du 22 juillet 1993, l’article 21-7 du code civil était ainsi rédigé : « Tout étranger né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent ».
160 () La communauté algérienne et le gouvernement algérien se sont longtemps montrés hostiles à l’acquisition automatique de la nationalité française par bon nombre d’Algériens du fait du double droit du sol. Les enfants nés en France à compter du 1er janvier 1963 d’un père né en Algérie avant l’indépendance bénéficiaient en effet du double droit du sol, leur père étant né dans ce qui était alors un département français. La communauté algérienne y voyait un déni de la révolte algérienne contre le colonisateur français, et le gouvernement algérien une atteinte à sa souveraineté. Mais paradoxalement, la restriction en 1993 du double droit du sol dont bénéficiaient les descendants des Algériens nés en Algérie avant l’indépendance a été mal vécue à la fois par la communauté algérienne, qui y a vu un retour à la nationalité mineure instaurée par le statut colonial, et par les autorités algériennes, qui y ont vu une menace pour leur stratégie de rayonnement à travers leurs double nationaux.
161 () Selon le professeur Paul Lagarde, auditionné le 3 novembre 2010, le taux de refus d’octroi de la nationalité française sous l’empire de la loi de 1993 correspond au taux de répudiation de la nationalité française sous l’empire de la loi de 1998. L’auteur y voit la démonstration de l’inefficacité d’un système fondé sur la manifestation de volonté dont il souligne qu’il a généré un surcroît de travail administratif en nécessitant le traitement d’environ 25 000 dossiers par an.
162 () Article 21-11 du code civil.
163 () Audition de M. Patrick Gaubert et de M. Benoît Normand, respectivement président et secrétaire général du Haut conseil à l’intégration, le 26 janvier 2011.
164 () Article 18-1 du code civil.
165 () Article 19-4 du code civil.
166 () Être français aujourd’hui et demain, op. cit., t. II, p. 93.
167 () Article 19-1 du code civil.
168 () Article 23 du code civil.
169 () Article 21-8 du code civil.
170 () Article 21-11 al. 1er du code civil.
171 () Article 21-11 al. 2 du code civil.
172 () Article 21-1 du code civil.
173 () Article 21-2 du code civil.
174 () Article 21-2 al. 3 du code civil.
175 () Article 21-12 du code civil.
176 () Article 21 du code civil.
177 () Article 21-12 du code civil.
178 () Article 21-12 du code civil.
179 () Article 21-13 du code civil.
180 () Voir infra la présentation de la procédure de naturalisation.
181 () Article 21-4 du code civil.
182 () Article 27-2 du code civil.
183 () Articles 24 à 24-3 du code civil.
184 () Articles 25 et 25-1 du code civil.
185 () Audition du 17 novembre 2010.
186 () Audition du 9 février 2011.
187 () Voir notamment la thèse d’Amélie Dionisi-Peyrusse, op. cit.
188 () Audition du 16 février 2011.
189 () Article 21-14-1 du code civil.
190 () Cf. exemple de dossier de demande de naturalisation en annexe 2.
191 () Article 21-19,6°, du code civil.
192 () Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité.
193 () Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité.
194 () Table ronde des représentants des administrations intervenant dans la procédure de naturalisation organisée le 30 mars 2011.
195 () CEDH Koua Poirrez contre France, 13 mars 2001.
196 () Table ronde organisée le 30 mars 2011 (voir liste des personnes entendues en annexe).
197 () Décret n° 2010-725 du 29 juin 2010 relatif aux décisions de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française (cf. schéma annexe 1).
198 () Cf. Bilan de la mesure de déconcentration des décisions individuelles relatives aux demandes d’acquisition de la nationalité française, direction de l’accueil, de l’intégration et de la citoyenneté, février 2011.
199 () Table ronde organisée le 30 mars 2011.
200 () Visite de la mission organisée le 2 mars 2011 dans les locaux de la préfecture de Seine-Saint-Denis, à Bobigny.
201 () Décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la situation et à la police des étrangers.
202 () Rapport n° 2814, fait au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de la Législation et de l’Administration générale de la République sur le projet de loi (n° 2400) relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, par M. Thierry Mariani, déposé à la Présidence de l’Assemblée nationale, le 16 septembre 2010.
203 () Audition du 12 janvier 2011.
204 () Mme Amélie Dionisi-Peyrusse, Essai sur une nouvelle conception de la nationalité, op. cit.
205 () Audition du 15 décembre 2011.
206 () Décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996.
207 () Audition du 17 novembre 2010.
208 () H. Fulchiron, « La place de la volonté individuelle dans le droit français de la nationalité », communication, Trav. Com. fr. dr. int. privé, 1998-2000, Éd. A. Pedone, Paris, 2001, p. 175.
209 () A. Dionisi-Peyrusse, op. cit., p. 9.
210 () Audition du 9 février 2011.
211 () S. Pennarun, « La nationalité, droit objectif ou droit subjectif ? », in L’identité de la personne humaine, Étude de droit français et de droit comparé, dir. J. Poussin-Petit, Bruylant, Bruxelles, 2002, pp. 519-520.
212 () Audition du 9 février 2011.
213 () Audition du 17 novembre 2010.
214 () Audition du 9 février 2011.
215 () Entretien avec M. Ole Schröder, secrétaire d’État parlementaire au ministère fédéral de l’Intérieur, le 17 janvier 2011.
216 () Audition de M. Xavier Lemoine, maire de Montfermeil, le 16 février 2011.
217 () Audition de M. Patrick Gaubert et de M. Benoît Normand, respectivement président et secrétaire général du Haut conseil à l’intégration, le 26 janvier 2011.
218 () Audition de M. Pierre Mazeaud, ancien président du Conseil constitutionnel, ancien président de la Commission des Lois de l’Assemblée nationale, président de la fondation Charles de Gaulle, le 3 novembre 2010.
219 () Voir cartes en annexe 3.
220 () Sénat, rapport d’information n° 461 fait au nom de la Commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur l’immigration clandestine à Mayotte, par M. Henri Torre, sénateur, 10 juillet 2008.
221 () Ibidem, p. 27.
222 () « Droit du sol : Mayotte pourrait devenir une exception », Le Point, 22 février 2008.
223 () Sénat, rapport d’information n° 461, op. cit. p. 27.
224 () Ibidem, p. 28. Le rapport n° 300 de la commission d’enquête sénatoriale sur l’immigration clandestine à Mayotte, présidée par le sénateur Georges Othilly (2005), indiquait que, selon les estimations qui avaient été fournies à la commission, le produit national brut par habitant de Mayotte était neuf fois supérieur à celui des Comores.
225 () Sénat, rapport d’information n° 461, op. cit., p. 28.
226 () Ibidem, p. 37.
227 () Ibidem, pp. 40-41.
228 () Ibidem, p. 41.
229 () Article 21-11 du code civil.
230 () Article L. 521-2, 1°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
231 () Article L. 313-11, 6°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
232 () Article 21-27 al. 4 du code civil.
233 () Source Insee, Antiane – projection 2030.
234 () Sénat, rapport n° 300 de la commission d’enquête sur l’immigration clandestine présidée par M. Georges Othilly, sénateur.
235 () Entretien accordé au journal Le Figaro, le 17 septembre 2005.
236 () Ibidem.
237 () Rapport d’information n° 2932 sur la situation de l’immigration à Mayotte, déposé, en application de l'article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, le 8 mars 2006, par M. Didier Quentin. Voir : http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i2932.asp
238 () http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion2534.asp
239 () Entrevue à La Réunion, AFP, 23 mars 2007. Cité dans « Droit du sol : Mayotte pourrait devenir une exception », Le Point, 22 février 2008.
240 () Ibidem.
241 () Loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.
242 () Amendement n° 41 rectifié présenté par M. Dominique Tian, déposé le 24 septembre 2010.
243 () Article 1er, alinéa 1er, de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée ».
244 () Après avoir été dotée du statut provisoire de collectivité territoriale de la République par la loi du 24 décembre 1976, Mayotte est devenue une collectivité départementale relevant de l’article 74 de la Constitution (loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte), puis, depuis le 31 mars 2011, un département d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution, en application de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010. En application de l’article 72-4 de la Constitution, la départementalisation de Mayotte a fait l’objet d’une consultation populaire, et a été approuvée par 95,24 % des suffrages exprimés le 29 mars 2009. Le référendum a été marqué par un fort taux d’abstention (38,63 %).
245 () L’article 30-2 du code civil dispose que « la nationalité française des personnes nées à Mayotte, majeures au 1er janvier 1994, sera subsidiairement tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français » (al. 2) et que « pendant une période de trois ans à compter de la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, pour l'application du deuxième alinéa du présent article, les personnes majeures au 1er janvier 1994 qui établissent qu'elles sont nées à Mayotte sont réputées avoir joui de façon constante de la possession d'état de Français si elles prouvent, en outre, qu'elles ont été inscrites sur une liste électorale à Mayotte au moins dix ans avant la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 précitée et qu'elles font la preuve d'une résidence habituelle à Mayotte » (al. 3).
246 () Conseil constitutionnel, décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 relative à la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure, considérant n° 35.
247 () Conseil constitutionnel, décision n° 1993-321 DC du 20 juillet 1993 relative à la loi n° 1993-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité, considérants n° 3, 4, et 10.
248 () Ibidem. Considérant n° 10.
249 () Conseil constitutionnel, décision n° 2004-503 DC du 12 août 2004 relative à la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
250 () À l’occasion des auditions menées par la mission d’information parlementaire sur la situation de l’immigration à Mayotte en 2005-2006, M. Bruno Genevois, alors président de la section du contentieux du Conseil d’État, avait déclaré que « les conditions d’accession à la nationalité française, dans notre tradition juridique, valent pour l’ensemble du territoire de la République », et qu’elles étaient « assimilables à des lois de souveraineté ». Voir : http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i2932.asp
251 () Le Monde, 22 février 2008.
252 () Audition du 3 novembre 2010. Lors de son audition du 17 novembre 2010, M. Jean-Philippe Thiellay a formulé la même mise en garde.
253 () Audition du 17 novembre 2010.
254 () À l’occasion des auditions menées par la mission d’information parlementaire sur la situation de l’immigration à Mayotte en 2005-2006, le professeur Olivier Gohin, après avoir expliqué que les conditions d’accès à la nationalité française devaient être les mêmes sur l’ensemble du territoire français, a souligné qu’« en tant qu’elles relèvent de l’exercice de la souveraineté nationale, ces conditions d’accès peuvent être revues dans le sens d’un durcissement […qui] devrait être opéré de façon uniforme sur tout le territoire de la République ». Voir : http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i2932.asp
255 () Conseil constitutionnel, décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 relative à la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure, considérants n° 108, 109, et 110.
256 () Article L. 514-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
257 () Article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
258 () La départementalisation de Mayotte emporte conformation du statut local de droit musulman aux principes fondamentaux du droit civil français, et notamment aux principes d’égalité des droits et de dignité de la personne humaine. Depuis la loi de programme pour l’outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003, les discriminations entre enfants fondées sur le sexe ou sur le caractère légitime ou naturel de la naissance sont interdites en matière successorale. La même loi a proscrit la polygamie et la répudiation pour les personnes qui ont accédé à l’âge légal requis pour se marier à compter du 1er janvier 2005. L’âge légal minimum des femmes pour se marier est relevé de 15 à 18 ans. La référence au tuteur matrimonial disparaît. Le mariage religieux doit être précédé d’un mariage civil célébré en mairie par un officier d’état-civil. L’état-civil est refondu et fiabilisé par un recensement organisé dans chaque commune mahoraise. La justice coutumière musulmane, dite « justice cadiale », est supprimée.
259 () Convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990.
260 () Conseil constitutionnel, décision n° 91-294 DC du 25 juillet 1991, relative à la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 autorisant l'approbation de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, considérant n° 54.
261 () V. Tchen, Jurisclasseur « Collectivités territoriales », Police des étrangers, fasc. 715, 2009, n° 96.
262 () Entretien accordé au journal Le Figaro, le 17 septembre 2005.
263 () Proposition de loi n° 2534 relative au renforcement des dispositions de lutte contre l’immigration clandestine à Mayotte, présentée par le député Mansour Kamardine, 28 septembre 2005.
264 () Article L. 521-2, 1°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
265 () Article L. 313-11, 6°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
266 () Ibidem.
267 () Ibidem.
268 () Proposition de loi n° 2534 relative au renforcement des dispositions de lutte contre l’immigration clandestine à Mayotte, présentée par M. Mansour Kamardine, 28 septembre 2005. L’article 1er de cette proposition de loi prévoyait qu’« à Mayotte l'article 21-7 et le premier alinéa de l'article 21-11 du code civil ne sont applicables qu'à la personne dont l'un des parents au moins a été en situation régulière au regard des lois et accords internationaux relatifs au séjour des étrangers en France pendant la période durant laquelle elle a eu sa résidence habituelle en France ». L’article 2 du texte ajoutait qu’« à Mayotte le second alinéa de l'article 21-11 du code civil n'est applicable qu'à la personne dont l'un des parents au moins a été en situation régulière au regard des lois et accords internationaux relatifs au séjour des étrangers en France pendant la période durant laquelle elle a eu sa résidence habituelle en France à partir de l'âge de huit ans, et dont ce parent est en situation régulière au regard des mêmes lois et accords internationaux au jour de la réclamation ».
269 () Audition du 16 mars 2011.
270 () Acte constitutionnel n° 7 du 27 janvier 1941.
271 () Acte constitutionnel n° 8 du 14 août 1941 : « Je jure fidélité à la personne du chef de l’Etat, promettant de lui obéir en tout ce qu’il me commandera pour le bien du service et le succès des armes de la France ».
272 () Acte constitutionnel n° 9 du 14 août 1941 : « Je jure fidélité à la personne du chef de l’Etat. Je jure et promets de bien et honnêtement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ».
273 () Acte constitutionnel n° 10 du 4 octobre 1941.
274 () Audition du 16 mars 2011.
275 () Audition de M. Patrick Gaubert et de M. Benoît Normand, respectivement président et secrétaire général du Haut conseil à l’intégration, le 26 janvier 2011.
276 () Audition de M. Pierre Mazeaud, le 3 novembre 2010. M. Xavier Lemoine, maire de Montfermeil, a déclaré lors de son audition, le 16 février 2011, que la mission d’information parlementaire sur le droit de la nationalité était « au chevet d’un malade en coma dépassé », car il n’y avait selon lui plus rien à changer au droit de la nationalité.
277 () Audition du 17 novembre 2010.
278 () Étude de l’Institut universitaire européen de Florence de juin 2010.
279 () Audition du 1er décembre 2010.
280 () Être français aujourd’hui et demain, op. cit., t. II, p. 95.
281 () B. Anderson, L’imaginaire national : réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, Paris, La Découverte, 1996.
282 () Audition du 12 janvier 2011.
283 () Audition de Mme Malika Sorel, le 9 février 2011. Audition de M. Xavier Lemoine, le 16 février 2011.
284 () Audition du 16 mars 2011.
285 () Être français aujourd’hui et demain, op. cit., t. II, p. 97.
286 () Ibidem, p. 120.
287 () Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité.
288 () Être français aujourd’hui et demain, op. cit., t. II, p. 21.
289 () Article 21-7 du code civil.
290 () Article 21-11 al. 1er du code civil.
291 () Article 21-11 al. 2 du code civil.
292 () Le tribunal d’instance compétent serait celui désigné comme tel par le décret auquel renvoie l’article 26-2 du code civil.
293 () Articles 26 à 26-5 du code civil.
294 () Article 26-1 du code civil.
295 () Article 26-3 du code civil.
296 () Audition du 6 avril 2011.
297 () Max Armanet, « Appel pour un service civique obligatoire », La Vie, 17 novembre 2005.
298 () Conseil d’analyse de la société, Pour un service civique, Rapport au Président de la République, 19 septembre 2008.
299 () Audition du 6 avril 2011. Cette demande et cette volonté de redéfinir le lien avec la nation fait du service civique un cadre propice à la diffusion de certains messages par les autorités.
300 () Créé par la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale.
301 () Défini par la décision n° 1031/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2000.
302 () Article L. 120-7 du code du service national.
303 () Les articles L. 120-18 à L. 120-24 du code du service national définissent le régime de l’indemnité. Les articles L. 120-25 à L. 120-29 du même code définissent le régime de la protection sociale qui, quel que soit l’âge du volontaire, est intégralement prise en charge par l’État.
304 () Audition du 6 avril 2011.
305 () Article L. 120-4 du code du service national.
306 () Article L. 120-4 du code du service national.
307 () Audition du 6 avril 2011.
308 () Article 21-16 du code civil : « nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ».
309 () Article 21-19, 6°, du code civil.
310 () Article 21-19, 4°, du code civil.
311 () Entretiens lors du déplacement de la mission à la préfecture de Seine-Saint-Denis, à Bobigny, le 2 mars 2011.
312 () Ibidem.
313 () Audition du 15 décembre 2010.
314 () Article 34 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « Les États contractants faciliteront, dans toute la mesure possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure possible, les taxes et les frais de cette procédure ».
315 () Audition du 2 mars 2011.
316 () Entretien avec Mme Nicola Smith et MM. Matthew Coats, Jonathan Devereux, et Paul Ghent, membres de l’Agence de l’immigration, lors du déplacement de la mission à Londres le 16 décembre 2010.
317 () Table ronde des représentants des administrations intervenant dans la procédure de naturalisation organisée le 30 mars 2011.
318 () Visite dans les locaux de la Préfecture de Seine-Saint-Denis organisée le 2 mars 2011.
319 () Table ronde des représentants des administrations intervenant dans la procédure de naturalisation organisée le 30 mars 2011
320 () Table ronde des représentants des administrations intervenant dans la procédure de naturalisation, le 30 mars 2011.
321 () Entretiens lors du déplacement de la mission à la préfecture de Seine-Saint-Denis, à Bobigny, le 2 mars 2011.
322 () Coûtant tout au plus un euro de l’heure aux participants, l’essentiel du coût des cours est pris en charge par l’État fédéral.
323 () Entretien avec M. Ehrhart Körting, ministre de l’Intérieur du Land de Berlin, le 17 janvier 2011.
324 () Rapport n° 2814 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi (n° 2400) relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, par M. Thierry Mariani, 16 septembre 2010. Annexe n° 2, pp. 595 et s. Voir : http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2814.asp
325 () Ibidem.
326 () Rapport n° 2814, op. cit., pp. 595 et s.
327 () Ibidem.
328 () Rapport n° 2814, op. cit., pp. 595 et s.
329 () Outre le fait d’avoir réussi au test, les candidats à la naturalisation doivent : avoir séjourné en Allemagne, en situation régulière, pendant au moins huit ans ; être titulaire d’un permis de séjour ou d’une autorisation d’établissement (délivrée au bout de cinq ans de séjour) ; être capable d’assurer sa subsistance sans avoir recours à l’aide sociale ni à l’assurance-chômage ; ne pas exercer d’activités contraires à la Constitution ; ne pas avoir été condamné pour délits, sauf infractions mineures ; manifester son attachement à l’ordre fondamental ancré dans la Constitution.
330 () Rapport n° 2814, op. cit., pp. 595 et s.
331 () Entretiens lors du déplacement de la mission à la préfecture de Seine-Saint-Denis, à Bobigny, le 2 mars 2011.
332 () Audition du 26 janvier 2011.
333 () Audition du 16 mars 2011.
334 () Audition du 12 janvier 2011.
335 () Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.
336 () Table ronde des représentants des administrations intervenant dans la procédure de naturalisation organisée le 30 mars 2011
337 () Rapport n° 2814 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi (n° 2400) relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, par M. Thierry Mariani, 16 septembre 2010, p. 119. Voir : http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2814.asp
338 () Ibidem.
339 () Tribunal civil de la Seine, affaire Mathias Ulman, 13 juillet 1915, Rev. crit. DIP 1915-1916, p. 67.
340 () CIJ, 6 avril 1955, Recueil p. 4. Adde S. Bastid, « L’affaire Nottebohm devant la Cour internationale de justice », Rev. Crit. DIP 1956.607 ; P. de Visscher, « L’affaire Nottebohm », Rev. gén. Dr. Int. Public 1956.238.
341 () Le principe de la compétence exclusive et souveraine des États pour l’énoncé des règles de détermination de la nationalité a été posé par la Cour permanente de justice internationale (CPJI) de La Haye dans un avis consultatif du 7 février 1923 (Recueil des avis consultatifs CPJI, série B, n° 4, p. 7) dans une affaire opposant la France et la Grande-Bretagne au sujet des décrets de nationalité en Tunisie et au Maroc.
342 () CIJ, 6 avril 1955, Recueil p. 4.
343 () A. Dionisi-Peyrusse, op. cit., p. 110.
344 () Lors de l’entretien que la mission a eu au cours de son déplacement à Berlin le 17 janvier 2011 avec M. Ole Schröder, secrétaire d’État parlementaire au ministère fédéral de l’Intérieur, il a été signalé que les exceptions au principe se sont multipliées à tel point que pour ce qui est des naturalisés, dans 50 % des cas, ils demandent et obtiennent de conserver la nationalité de leur État d’origine. 50 % des naturalisés sont donc binationaux.
345 () Lors de l’entretien que la mission a eu au cours de son déplacement à Berlin le 17 janvier 2011 avec des députés du Bundestag membres de la Commission des Affaires intérieures du Bundestag (MM. Dieter Wiefelspütz – SPD –, Wolfgang Wieland – Verts –, et Memet Kiliç – Verts), les parlementaires allemands ont déconseillé le modèle optionnel adopté par l’Allemagne, en vertu duquel, sauf exceptions, les enfants nés en Allemagne de parents étrangers qui voient leur demande de naturalisation acceptée doivent choisir entre leur nationalité d’origine et la nationalité allemande. Les députés allemands seraient partagés entre l’abolition de ce modèle et son assouplissement.
346 () Rapport n° 2814, op. cit., pp. 595 et s.
347 () Ibidem.
348 () Cass. 1ère civ. 15 mai 1974, Rev. crit. DIP 1975.260, note M. Nisard.
349 () A. Dionisi-Peyrusse, op. cit., p. 258.
350 () Audition du 9 février 2011.
351 () Être français aujourd’hui et demain, op. cit., t. II, p. 183.
352 () Ibidem, p. 184.
353 () Table ronde des représentants des administrations intervenant dans la procédure de naturalisation organisée le 30 mars 2011.
354 () Visite dans les locaux de la préfecture de Seine-Saint-Denis à Bobigny organisée le 2 mars 2011.
355 () Décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, considérant n° 18.
356 () A. Dionisi-Peyrusse, op. cit., p. 34.
357 () Les articles 6 et 7-1-a de la Convention des Nations unies sur la réduction des cas d’apatridie subordonnent la perte de la nationalité (article 6) ou la renonciation à la nationalité (7-1-a) à la garantie de l’obtention d’une autre nationalité. Il est également prévu que la seule résidence à l’étranger et le non-enregistrement auprès des autorités consulaires ne suffisent pas à déchoir une personne de sa nationalité, sauf acquisition de la nationalité du pays de résidence. Les articles 8 et 9 envisagent la privation de nationalité comme étant exceptionnelle. L’article 8-4 prévoit qu’un État ne fera usage de la faculté de priver un individu de sa nationalité que conformément à la loi et l’article 9 met des bornes à la privation de nationalité en excluant qu’elle puisse intervenir à l’égard d’un individu ou d’un groupe d’individus « pour des raisons d’ordre racial, ethnique, religieux ou politique ».
358 () Audition du 15 décembre 2010.
359 () Audition du 15 décembre 2010.
360 () P. Louis-Lucas, « Les conflits de nationalités », Recueil de Cours La Haye, 1938, t. II, p. 14. P. Lerebours-Pigeonnière a également souligné qu’un sujet de plusieurs États « pourrait difficilement avoir vis-à-vis de tous ensemble les sentiments et la conduite d’un sujet correct » (Précis de droit international privé, 6e éd., Dalloz, 1954, n° 52). F. de Castro a, quant à lui, relevé « l’incompatibilité entre la conception absolutiste du pouvoir étatique et la double nationalité […], incompatibilité basée à présent sur le fait que la souveraineté est conçue comme un pouvoir total et exclusif sur le sujet » (« La nationalité, la double nationalité et la supranationalité », Recueil de Cours La Haye, 1961, t. I, p. 596).
361 () P. Louis-Lucas, « Les conflits de nationalités », Recueil de Cours La Haye, 1938, t. II, p. 14.
362 () Qui plus est, M. Marceau Long soulignait déjà en 1988 l’insuffisance de la convention du Conseil de l’Europe de 1963 dans le contexte de la construction européenne. Il écrivait ainsi : « La libre circulation a pour conséquence des migrations auxquelles des États membres ne peuvent rester indifférents. Ces migrations peuvent susciter à terme un accroissement du nombre des personnes ayant plusieurs nationalités des pays de la Communauté économique européenne. La convention du Conseil de l’Europe du 6 mai 1963, qui tend à réduire les cas de double ou plurinationalité entre pays européens et qui n’a d’ailleurs été signée que par une partie des pays membres des communautés, ne paraît plus apporter aujourd’hui la réponse appropriée aux problèmes posés par la double ou plurinationalité à l’intérieur de l’Europe » (Être français aujourd’hui et demain, op. cit., t. II, p. 57).
363 () Signataire de la convention depuis le 4 juillet 2000, la France ne l’a pas ratifiée. Toutefois, trois États (Autriche, Moldavie et Slovaquie) ont ratifié cette convention, de sorte qu’elle a pu entrer en vigueur le 1er mars 2000. Depuis 2000, treize autre États l’ont ratifiée : l’Albanie, l’Allemagne, la Bulgarie, le Danemark, la Hongrie, l’Islande, les Pays-Bas, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, la Suède, l’ex-République yougoslave de Macédoine et l’Ukraine.
364 () Le chapitre IV de la Convention prévoit des garanties procédurales : les procédures de naturalisation doivent engendrer des coûts raisonnables et les décisions étatiques en matière d’acquisition de la nationalité doivent intervenir dans un délai raisonnable, être motivées par écrit et être susceptibles de recours administratif ou judiciaire.
365 () Recueil des avis consultatifs CPJI, série B, n° 4, p. 7.
366 () CIJ, 6 avril 1955, Recueil p. 23.
367 () Être français aujourd’hui et demain, op. cit., t. II, p. 27.
368 () Ibidem, p. 27.
369 () Ibidem, p. 85.
370 () Ibidem, p. 87.
371 () Cité dans Être français aujourd’hui et demain, op. cit., t. II, p. 90.
372 () Pour assurer leur lisibilité, les propositions ont été regroupées par thèmes.
© Assemblée nationale