______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 octobre 2011.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
sur « les vecteurs privés d’influence dans les relations internationales »
et présenté par
MM. Jean-Michel BOUCHERON et Jacques MYARD
Députés
___
INTRODUCTION 7
I – LA MONTÉE EN PUISSANCE DES ENTITÉS PRIVÉES DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES 11
A – LE DÉBUT D’UNE CONSCIENCE MONDIALE 11
1. La lutte contre les souffrances humaines 12
2. Le combat en faveur d’un ordre international fondé sur le droit 13
3. La détermination de nouveaux concepts du droit international : placer l’être humain au-dessus des Etats 15
4. Le rôle décisif des ONG dans la mise en place d’une justice pénale internationale 16
5. ONG sincères, ONG paravents 18
B – LES CONSÉQUENCES DE LA LIBÉRALISATION DE L’ÉCONOMIE : LE POIDS CROISSANT DES ENTREPRISES PRIVÉES DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES 21
1. Les sociétés transnationales : du lobbying à la sous-fiscalisation 22
2. Les sociétés transnationales, vecteurs de la mondialisation et du changement du rapport de force entre le Nord et le Sud 24
3. Le problème posé aux Etats par l’autonomie de la sphère financière 26
4. L’évolution de la place des Etats dans les relations internationales 28
a) Recul ou changement des critères définissant le pouvoir des Etats dans les relations internationales ? 29
b) Gouverner un monde globalisé : le retard des Etats 30
C – L’INFLUENCE, ARME DES VECTEURS PRIVÉS SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE 33
1. Essai de définition de l’influence et des méthodes en usage 34
2. Typologie des vecteurs privés d’influence 38
II – L’INFLUENCE DIFFUSE 41
A – LA DIFFUSION DES IDÉES : FONDATIONS ET LABORATOIRES D’IDÉES 41
1. Un concept essentiellement nord américain 41
a) Le rapport entre société et politique sous l’histoire coloniale américaine 42
b) De l’isolationnisme à l’interventionnisme : la confrontation des conceptions américaines en politique étrangère au travers des laboratoires d’idées 43
c) De la philanthropie comme idéologie à l’idéologie de domination, l’évolution des laboratoires d’idées américains en politique étrangère 48
2. La difficulté des laboratoires d’idées non américains à s’imposer sur la scène internationale 54
B – L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, VECTEUR D’INFLUENCE ET DE DÉVELOPPEMENT SUR LE LONG TERME 55
1. Un vecteur d’influence 56
2. Un vecteur de développement 57
3. S’implanter et attirer 57
4. Le classement de Shanghai ou comment une université chinoise est devenue un vecteur d’influence par hasard 58
C – FORUMS INTERNATIONAUX ET RÉSEAUX PROFESSIONNELS : ENTRE DÉBATS D’IDÉES ET NAISSANCES DE PROJETS 60
1. Les grands forums d’idées : Davos, la Conférence de Munich sur la politique de sécurité et la commission trilatérale 60
2. Les réseaux professionnels 62
D – LA DÉMULTIPLICATION DE L’INFLUENCE DIFFUSE : LE CAS PARTICULIER D’INTERNET 63
1. L’ICANN ou les ambiguïtés de la gestion d’un système internet universel 64
2. Les réseaux sociaux : un espace de protestation, peut-être un vecteur d’influence 67
3. Internet au service de la diplomatie douce : l’exemple du Département d’Etat américain 72
a) Le smart power, une idée élaborée par des laboratoires d’idées 72
b) La faculté d’agir en réseau, nouvelle condition de la puissance 73
c) Un outil de promotion des valeurs américaines 73
4. Internet, instrument d’oppression 74
E – LA SOFT DIPLOMACY, OU L’EXPLOITATION INTELLIGENTE DE L’INFLUENCE DIFFUSE 75
1. Les objectifs de la soft diplomacy (diplomatie publique) 76
2. L’utilisation intelligente de vecteurs privés d’influence 78
III – L’INFLUENCE DIRECTE 81
A – L’INFLUENCE DIRECTE SUR LE POUVOIR 82
1- L’influence directe des laboratoires d’idées et autres entités privées 83
2. Etats et entreprises stratégiques ou le jeu des influences mutuelles 85
3. L’influence sur le droit social ou la réponse des syndicats à la globalisation économique 86
B – LE POIDS DU SECTEUR FINANCIER 88
1. 2007 – 2010, ou la dépendance des Etats occidentaux aux marchés financiers 88
2. Les acteurs d’influence 90
a) les acteurs de marché 90
b) L’élaboration du droit financier : le processus de Bâle 91
c) L’élaboration du droit financier : l’IIF 96
3. Le rôle particulier des agences de notation 97
C – LES PROCESSUS DE NORMALISATION 99
a) Du constat technique au choix idéologique ou comment l’IASC s’est pliée aux souhaits de Wall Street 104
b) Derrière la rhétorique de l’indépendance, une entité efficace de lobbying 107
c) Réactivité de l’IASC et lourdeur bureaucratique européenne 108
d) La part des normes comptables dans la crise financière de 2009/2010 110
D – ENVIRONNEMENT, DROITS DE L’HOMME ET AIDE AU DÉVELOPPEMENT : LE RÔLE À GÉOMÉTRIE VARIABLE DES VECTEURS PRIVÉS 111
1. Environnement, de la protection des milieux aux polémiques sur les politiques globales 111
a) Des actions essentiellement multilatérales conduites par les gouvernements et les ONG 112
b) Les vecteurs privés au cœur des polémiques sur l’environnement 113
2. Droits de l’homme et modes de gouvernement : de la différence entre véritables idéaux et idéaux de façade 115
3. Aide au développement : quand l’action est à l’origine de l’influence doctrinale des vecteurs privés 118
a) L’aide au développement ou le nouveau champ d’un dialogue entre sociétés civiles 119
b) Des solutions privées à des problèmes publics : l’influence naissante des hommes les plus riches du monde 120
E – JEUX OLYMPIQUES ET COUPE DU MONDE DE FOOTBALL : QUAND LES ETATS COURTISENT LES INSTANCES SPORTIVES 121
CONCLUSION 123
EXAMEN EN COMMISSION 125
ANNEXES 133
Annexe 1 : Lettre de M. Jean-Michel Boucheron à M. Pascal Husting, directeur général de Greenpeace France 135
Annexe 2 : La fiscalité des fondations américaines 137
Annexe 3 : Les laboratoires d’idées les plus influents sur les questions internationales et de sécurité 139
Annexe 4 : Liste des personnes auditionnées 141
Annexe 5 : Bibliographie 143
Mesdames, Messieurs,
Tout observateur des relations internationales ne peut manquer de noter la part croissante qu’y prennent les entités qui relèvent d’un statut privé, qu’il s’agisse d’entreprises, de fondations, d’associations, de cercles et de clubs plus ou moins discrets, voire de particuliers. Le phénomène est ancien. L’Ordre de Malte, fondé en 1080, fut en Occident et au Proche-Orient le premier exemple d’un acteur privé si puissant qu’il nouait des relations diplomatiques avec les Etats européens. Ultérieurement, une des phases les plus importantes de l’histoire, la colonisation de l’Afrique, de l’Inde et des pays d’Extrême Orient à partir du XVIème siècle, a été initiée par des guildes et des compagnies commerciales, qui ont su convaincre leurs souverains de la valeur stratégique des routes et des comptoirs qu’elles contrôlaient.
A notre époque, des exemples tels que la pression des agences de notation sur les dettes souveraines, l’expertise de laboratoires d’idées sur les questions internationales, les entreprises brassant des chiffres d’affaires supérieurs aux PIB de certains Etats, la résistance systématique du secteur de la haute finance aux tentatives de régulation de ses activités, la bataille des normes comptables ou des normes environnementales sont autant de manifestations de la place de la sphère privée sur la scène internationale… Dans un monde où le libéralisme économique est devenu le cadre dominant de la pensée et de l’action et où règne la concurrence, son rôle est de facto primordial. Il n’est donc pas étonnant de retrouver des entités privées sur des dossiers économiques ou culturels ; le plus surprenant est qu’elles participent parfois à des négociations internationales, dans des domaines qui relèvent traditionnellement de la diplomatie, en tenant un rôle d’expert auprès d’une délégation nationale ou en témoignant de leur expérience dans des instances multilatérales aussi diverses que l’ONU ou les assemblées parlementaires internationales.
Le rôle des acteurs privés dans les relations internationales est un sujet largement étudié, comme le montrent les ouvrages cités dans la bibliographie à la fin du présent rapport. Il nous a paru néanmoins utile de travailler sur cette question, moins pour en dresser un panorama exhaustif – cette tâche est impossible dans un monde multipolaire où interagissent des milliers d’acteurs politiques, économiques, sociaux et culturels – que pour déterminer s’ils exercent une influence qui affecterait à court ou long terme la conduite des politiques étrangères, notamment dans des secteurs stratégiques.
La politique étrangère a de tout temps comporté deux volets : le premier, traditionnel, concerne les rapports entre Etats et porte sur leurs relations politiques et militaires, par le jeu des alliances et des rapports de force. Le deuxième volet réside dans la capacité d’influence d’un pays grâce à son rayonnement intellectuel, à sa langue, à la puissance de ses entreprises ou aux symboles qu’il incarne (par exemple les droits de l’homme pour la France). L’influence ne relève pas uniquement de l’Etat et de son appareil diplomatique. Il s’agit de la capacité de l’ensemble d’une société – sphères publique et privée confondues – à se projeter vers l’extérieur afin de défendre ses intérêts.
Cet aspect des relations internationales a pris une importance nouvelle. Comme les pays développés ne recourent plus à la guerre pour régler leurs différends, les facteurs classiques de la puissance (territoire, population, état des forces militaires) s’estompent au profit d’autres facteurs, économiques et technologiques principalement. Les rivalités se sont déplacées sur un vaste champ comprenant l’ensemble des domaines assurant le fonctionnement de nos sociétés, l’enjeu étant pour un pays de disposer de centres de décision et de production, créateurs de richesses et d’emplois.
La fin de la guerre froide a incontestablement marqué le point de départ d’une nouvelle ère pour les entités privées. Avec la libéralisation des marchés économiques et financiers, avec la circulation des idées, elles ont acquis une autonomie et un poids jamais atteint dans l’histoire et ne limitent plus leurs actions dans leurs cadres nationaux d’origine. Trois éléments ont contribué au renforcement de leur place sur la scène internationale :
– la libéralisation du commerce et des activités financières a abouti à la globalisation de l’économie et a favorisé l’émergence de sociétés multinationales dont la puissance économique se compare à celle de certains Etats. Le chiffre d’affaire d’Exxon, de Mobil ou de Toyota est équivalent au PIB d’Israël ou du Portugal. Pour défendre leurs intérêts auprès des gouvernements, ces sociétés sont devenues des acteurs politiques à part entière, qui créent leurs propres fondations ou recourent à des cabinets spécialisés afin d’influer sur les décisions prises dans de nombreuses instances de négociations, comme les sommets du G 20 consacrés à la régulation financière ;
– avec les vagues successives de privatisations, les Etats ont abandonné des pans entiers de l’économie sur lesquels leur autorité est devenue marginale : télécommunications, finance, assurance, production et distribution d’énergie, réseaux de transports… Ces secteurs, de leur côté, ont des intérêts à l’échelle internationale et cherchent à influencer les Etats, qui demeurent le cadre où s’établit formellement le droit ;
– la multiplicité des échanges de tous ordres (économiques, éducatifs, culturels) accroît la nécessité de mettre au point des procédures communes. La fixation de normes (comptables, environnementales, ratios de liquidités bancaires) découle de cette nécessité, mais ne se résume pas à une harmonisation technique. Elle comporte plusieurs enjeux économiques, qui affectent l’économie d’un pays. Or, plusieurs des instances normatives ont un statut privé, mais les décisions qu’elles prennent sont susceptibles d’affecter les politiques publiques.
Par ailleurs, dès lors qu’il est admis que nous sommes entrés dans un monde de puissances relatives, le pouvoir d’un Etat ne se mesure plus aux seuls moyens qu’il détient (budget, administration, forces militaires) – qui sont de nature coercitive – mais à sa capacité à obtenir des résultats. Les instruments classiques de la politique peuvent ne plus suffire comme en témoignent les difficultés de la politique étrangère américaine. Malgré leur puissance militaire colossale, les Etats-Unis ne parviennent pas à terminer le conflit en Afghanistan ou à stabiliser l’Irak, et cette puissance ne leur est d’aucune utilité auprès d’Israël et de l’Autorité palestinienne, ou encore dans leurs négociations commerciales avec la Chine. D’autres armes sont alors nécessaires, au rang desquelles figure la capacité d’influence. Ainsi s’explique l’intérêt de Washington pour l’ensemble des industries liées à internet, perçu comme un nouveau moyen d’influence.
L’influence des entités privées est enfin accentuée par le fait que les Etats n’ont pas tiré toutes les conséquences de la mondialisation. Alors que plusieurs problèmes – climat, système financier international, parité des monnaies, commerce international ou aide au développement – exigent une réponse collective et ambitieuse, les décisions des sommets multilatéraux se limitent souvent au plus petit commun dénominateur. L’absence de solution publique à ces problèmes – souvent due à l’action de lobbies privés – alors que prévaut un sentiment d’urgence est à l’origine de l’action de groupes ou d’individus qui estiment n’avoir rien à attendre des Etats. De nombreuses ONG transnationales affichent clairement leur intention soit d’influer sur les négociations internationales, soit d’agir sans tenir compte des puissances publiques. Extrêmement nombreuses dans les secteurs de l’environnement et de l’aide au développement, elles acquièrent avec le temps des capacités d’expertise supérieures aux Etats. Des milliardaires adoptent un comportement analogue, parfois avec une grande discrétion, comme Bill Gates ou Warren Buffet via leurs fondations et leurs initiatives (au sens anglais du terme), qui sont en passe d’éradiquer le paludisme en Afrique subsaharienne en quelques années, alors que ce travail était théoriquement de la compétence de l’Organisation mondiale de la santé.
L’influence n’est pas l’action. Sur les questions stratégiques et les grands dossiers de politique étrangère, la place des Etats demeure prédominante. Mais l’influence précède l’action, par un savant travail sur les idées comme sur les personnes. La place croissante que tiennent des vecteurs privés d’influence sur la scène internationale oblige à s’interroger sur leur impact : ont-ils ou non la capacité d’orienter des politiques et/ou de peser directement sur les décisions prises par les pouvoirs publics, dans des domaines stratégiques ? Ont-ils, pour certains, le pouvoir d’agir sans tenir compte des Etats ?
Au vu des auditions que nous avons conduites, il est apparu que les vecteurs privés recouraient à deux formes d’influence :
– l’influence diffuse, dont les canaux sont multiples, qui vise à préparer un environnement favorable à une décision ou à obtenir gain de cause sans conflit. Cette influence résulte le plus souvent d’initiatives privées mais se révèle très utile pour les Etats. Le concept de soft diplomacy, défini par Joseph Nye comme « le moyen d’amener votre adversaire à adopter naturellement votre position » résulte de l’exploitation intelligente par un Etat de l’ensemble des atouts que lui offrent ses acteurs économiques, sociaux et culturels ;
– l’influence directe, qui permet à un acteur d’accéder aux instances décisionnelles (administrations, gouvernements, organisations multilatérales publiques et privées) et de les persuader de prendre une décision conforme à ses vœux.
Ainsi qu’on le constatera à la lecture du présent rapport, la faculté d’influence des vecteurs privés est variable, mais elle est indéniable, au point qu’aucune action diplomatique ne peut et ne doit en ignorer les ressorts.
I – LA MONTÉE EN PUISSANCE DES ENTITÉS PRIVÉES DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES
La montée en puissance des entités privées dans les relations internationales remonte à environ deux siècles. Elle s’est considérablement amplifiée depuis quatre décennies. Deux raisons peuvent expliquer ce dynamisme : d’une part, le sentiment très ancien de la dignité de chaque être humain, qui conduit à des actions de solidarité et à la prise de conscience d’une communauté de destin ; d’autre part, la défense d’intérêts privés dans un monde où les Etats développés ont en règle générale accepté de fonctionner selon les règles du libéralisme.
Il existerait environ 37 000 entités internationales privées agissant à l’échelle internationale. Les pionnières ont souvent été des associations confessionnelles qui couvraient le champ de la défense de la personne humaine (dignité, sécurité de la personne, lutte contre les souffrances, tortures, etc…). Depuis une quarantaine d’années, nous assistons à l’émergence d’ONG dans des domaines précis comme les droits des femmes, les mines anti personnels, la remise de la dette du tiers monde ou l’environnement…
A – Le début d’une conscience mondiale
Des campagnes de lutte contre la faim en Ethiopie jusqu’à la mobilisation en faveur des victimes du tremblement de terre d’Haïti, de la défense des droits de l’Homme à celle de l’environnement en passant par une multitude de causes (abolition de la peine de mort, droits sociaux, protection des enfants, lutte contre la corruption, situations d’urgence, aide au développement…), les fondations et associations embrassent l’ensemble des activités humaines, témoignant ainsi de la volonté de millions de personnes de peser sur la marche du monde, y compris lorsque leur action s’inscrit dans le cadre habituel et habituellement formalisé des relations internationales. Il n’est pas aisé, dans ce fourmillement d’initiatives, de trouver un fil conducteur… Le sentiment d’humanité, mêlant la compassion et la charité constitue sans doute le point commun d’une série d’actions qui ont abouti à faire émerger une conscience mondiale.
Une brève analyse historique démontre par ailleurs que les entités privées ne se sont pas limitées à un rôle caritatif ou protestataire. Elles ont, au cours des deux derniers siècles, joué un rôle actif dans le rapprochement des sociétés, des Etats et dans la défense de concepts devenus partie intégrante du droit international. Elles sont intellectuellement à l’origine de nombreux mécanismes qui fondent l’émergence d’une société civile internationale.
1. La lutte contre les souffrances humaines
L’on peut sans doute considérer l’Ordre de Malte, fondé vers 1080, comme la première entité privée internationale, dont le rôle initial (soigner les déshérités et porter les valeurs chrétiennes) ne risquait guère d’empiéter sur le pouvoir des Etats, mais qui devint une telle puissance, grâce à son réseau et à son trésor, qu’il entretenait des relations de nature diplomatique avec les Etats européens et l’empire byzantin. Cette prise en compte des souffrances humaines dans un Moyen-Âge où guerres, famines sporadiques et maladies rendaient la vie fragile est à l’origine d’engagements analogues par des ordres religieux qui ont ainsi formé des réseaux « internationaux », ce terme ayant peu de sens en un temps où la notion d’Etat était encore en construction.
A l’époque moderne, la première organisation qui a exercé une influence intellectuelle considérable, puis obtenu un résultat diplomatique fut la « Pennsylvania Society for promoting the abolition of slavery », fondée en 1775 par des Quakers alors que les Etats-Unis n’étaient pas encore indépendants. A cette fin, elle prit contact avec des membres des élites intellectuelles des deux grandes nations du commerce triangulaire, la Grande-Bretagne et la France pour conduire les premières campagnes internationales ayant pour objectif l'abolition du commerce des esclaves. Elle fut relayée à Londres par la « Society for effecting the abolition of slave trade » (1787), puis en France par la « Société des Amis des Noirs » (1788). Cette dernière comptait Condorcet, La Fayette et Sieyes parmi ses membres et fut à l’origine de la première abolition de l’esclavage, votée en 1794 par la Convention. Mais preuve que le lobbying n’a pas attendu l’époque contemporaine pour exister, leurs écrits étaient violemment critiqués par les planteurs de Saint-Domingue qui les accusaient d’être à l’origine des troubles aux Antilles et qui utilisèrent un autre parlementaire, Barnave, pour défendre leur cause. Une multitude d’associations similaires apparurent en Europe sur la base de la défense du genre humain et des valeurs chrétiennes. Ces associations déposèrent lors du Congrès de Vienne (1815) auprès des plénipotentiaires des Etats plus de 800 pétitions réclamant l'abolition du commerce des esclaves et de l'esclavage. Ces efforts permirent en 1841 la signature d'un traité international interdisant le commerce des esclaves.
La technique utilisée par la Pennsylvania Society forme un modèle toujours valide pour l’action internationale des entités privées : définir une cause, la porter internationalement, disposer de relais dans d’autres pays et inscrire la cause que l’on défend dans le droit international.
La lutte contre les souffrances humaines est en outre à l’origine de la naissance d’un pan entier du droit international relatif à la protection des victimes de conflits armés, des blessés, puis de l’ensemble des tentatives pour humaniser la guerre autant que faire se peut avec les traités sur l’interdiction de certains types d’armes. Le fait générateur est la bataille de Solferino (1859) d’où vint l’idée de la Croix Rouge. Mobilisant un réseau international de médecins et d’intellectuels, le Suisse Henri Dunant organisa une première conférence internationale en 1863, qui réunit 14 pays et vota des résolutions, puis obtint, avec l'appui de la France, la tenue d’une conférence réunissant 12 Etats. Elle aboutit à la signature, le 22 août 1864, de la convention de Genève pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne. Cinq ans ont suffi pour qu’un noyau de particuliers obtienne la signature d’un traité.
Malgré ce succès, l’initiative d’Henri Dunant suscita de nombreuses réserves et oppositions car il fut accusé de vouloir encadrer juridiquement la guerre et non de vouloir l’abolir. De nombreuses associations et sociétés se créèrent en Europe pour un monde bannissant la guerre. C’est dans ce but que fut créé le prix Nobel de la paix (1901). La première guerre mondiale porta un coup fatal aux mouvements pacifistes, mais les souffrances qu’elle provoqua mobilisèrent autour des diplomates de nombreux juristes et intellectuels pour fonder les premières structures de règlement des conflits.
La période qui précéda la première guerre mondiale marqua également l’intégration croissante des associations internationales à la diplomatie classique : elles obtinrent des sièges d’observateurs à des conférences internationales, comme à celle de la paix en 1907, où leurs représentants pouvaient ainsi côtoyer directement des diplomates et des membres des gouvernements.
2. Le combat en faveur d’un ordre international fondé sur le droit
La première guerre mondiale marqua à la fois le paroxysme du nationalisme et de l’internationalisme. Pendant que se déroulaient les hostilités, des associations, des groupes informels mêlant diplomates, syndicalistes et intellectuels des pays belligérants comme des pays neutres réfléchissaient aux moyens d’y mettre fin et de mettre en place un nouvel ordre international. L’idée que cette guerre était due à l’autoritarisme de l’Allemagne et de l’Autriche fut rapidement le fil conducteur pour l’établissement d’un monde basé sur le respect de la démocratie.
Ce point est crucial pour comprendre l’émergence des entités privées. A partir du moment où la démocratie devenait une exigence dans les rapports internationaux, tout citoyen ou tout groupe représentatif d’une cause ou d’un idéal avait la légitimité d’intervenir dans le domaine traditionnel des Etats. Le Président Woodrow Wilson insista à de nombreuses reprises sur les notions de peuples et de personnes pendant les longs mois de négociations de paix à Versailles.
La conférence de Versailles marqua l’irruption des entités privées dans des négociations diplomatiques. Leur place n’était plus marginale ; elles disposaient de sièges d’observateurs et pouvaient présenter leurs revendications aux délégations nationales. Des associations anti colonialistes, des syndicats (Léon Jouhaux a participé à la négociation qui a établi le Bureau International du Travail), la Croix Rouge, le Comité juif américain (qui contribua aux dispositions sur les minorités) firent partie de ces organisations très actives qui influèrent plusieurs points du traité, comme l’article 25 qui enjoignait aux Etats de favoriser l’établissement des organisations de la Croix Rouge. En outre, des associations de juristes et de pacifistes pesèrent de tout leurs poids pour l’établissement de la future Société des Nations (SDN).
Il n’est donc pas surprenant que le secrétariat général de la SDN ait établi des relations de travail avec de nombreuses ONG (près de 400, semble-t-il) qui lui apportaient leur expertise, notamment pour la protection des minorités ou des personnes vulnérables, comme les enfants. Elles ne bénéficiaient toutefois d’aucun statut officiel. La Charte des Nations unies, à l’élaboration de laquelle participèrent de nombreuses associations de droits de l’Homme, renforça leur position, sous la pression de trois ONG américaines, le Comité juif américain, le Conseil fédéral des Eglises et la Commission d'étude de l'organisation de la paix. Le secrétaire d'Etat américain Edward Stettinius sut convaincre les délégations d'inclure un article faisant référence aux organisations non gouvernementales, et à leur participation aux travaux de l'ONU. L'article 71 de la Charte fut ainsi rédigé : « Le Conseil économique et social peut prendre toutes dispositions utiles pour consulter les organisations non gouvernementales qui s'occupent des questions relevant de sa compétence. Ces dispositions peuvent s'appliquer à des organisations internationales et, s'il y a lieu, à des organisations nationales après consultation du membre intéressé de l'organisation ». Les ONG eurent ainsi une reconnaissance internationale officielle au sein de l’ONU.
Deux dispositions fondent depuis la fin de la deuxième guerre mondiale la légitimité des ONG à participer à l’élaboration du droit international dans le cadre de l’ONU : l’article 71 de la Charte précitée et la résolution 1996/31 du Conseil économique et social qui permet l’accréditation d’ONG dont les objectifs s’accordent avec l’esprit, les buts et les principes de la Charte et dont le fonctionnement est démocratique. Le statut consultatif auprès du Conseil économique et social concerne actuellement 2000 ONG et ce modèle s’est répandu auprès d’autres organisations comme l’Union européenne, l’Organisation internationale de la Francophonie ou encore le Commonwealth, sans base juridique toutefois, à la différence de l’ONU. Seul le Conseil de l’Europe, avec la convention 124, a reconnu la personnalité juridique des ONG internationales, mais le texte n’a été ratifié à ce jour que par 9 Etats.
L’influence des entités privées fut également importante pour l’élaboration de dispositions de la Charte relatives aux droits de l’Homme ainsi que pour la rédaction de la déclaration universelle des droits de l'Homme. On connaît la part prise par René Cassin dans la rédaction de ce texte mais du côté des négociateurs américains, Eleanor Roosevelt était entourée de nombreux représentants d’associations.
La période d’immédiate après-guerre a donc permis aux ONG de bénéficier d’une reconnaissance de jure au sein de l’ONU et du Conseil de l’Europe et de facto dans d’autres enceintes. L’accès permanent aux diplomates et délégations gouvernementales ainsi qu’aux secrétariats généraux des organismes internationaux leur a permis de jouer à plein un rôle d’influence, allant de l’expertise technique à la définition de concepts. La convention sur les droits de l’enfant est un bon exemple des résultats qu’elles ont obtenus. L’idée que les enfants aient des droits revient à l’Anglaise Eglantyne Webb, Quaker fondatrice de l’association Save the Children. Elle porta cette idée pendant des décennies auprès de la SDN puis de l’ONU, avant la signature de cette convention le 20 novembre 1989.
3. La détermination de nouveaux concepts du droit international : placer l’être humain au-dessus des Etats
Du début de la guerre froide à nos jours, s’étend une période au cours de laquelle les entités privées ont considérablement étendu leur rôle international. Elles ont bénéficié des progrès des moyens de communication pour accroître leur visibilité et acquérir une légitimité de facto mais elles ont surtout franchi un nouveau cap : la détermination de nouveaux concepts du droit international.
La guerre froide a toutefois limité le champ d’intervention des ONG aux pays libres. Le camp soviétique ignorait en effet la notion de société civile indépendante en raison du monopole des partis communistes.
La guerre du Biafra, déclenchée en 1967, a marqué le point de départ de l’affranchissement des règles internationales par des ONG. Cette guerre civile frappa durement les populations, mais l’ONU, faute d’accord au sein du Conseil de sécurité, ne put intervenir. Ce sont des religieux africains, venus notamment de Sao Tome et Principe et assistés par la Croix Rouge internationale, qui décidèrent de venir en aide aux populations, pénétrant en territoire nigérian sans autorisation ni visa… Apportant soins et nourriture aux populations, ils témoignèrent des violations des droits de l’Homme dont ils étaient témoins. « De cette combinaison naît un nouvel esprit humanitaire : le « sans frontiérisme ». La philosophie de ce jeune mouvement est simple : le besoin des populations en aide humanitaire prime la souveraineté de l'Etat. Il s'agit d'une relecture des conventions de Genève en plaçant au centre de la réflexion l'homme avant l'Etat » (François Rubio) (1).
Médecins sans frontières, créé en 1971 par des journalistes et des médecins, suit exactement la même philosophie. L’association se donne le rôle de soigner sans discrimination mais ne se cantonne pas aux soins médicaux. Elle s’autorise à témoigner chaque fois qu’elle constate des violations des droits de l’Homme.
Plusieurs résolutions du Conseil de sécurité se sont ensuite appuyées sur le principe d’assistance humanitaire, dégagé pragmatiquement par des ONG, pour intervenir dans des Etats. Des événements en totale contradiction avec les principes de la Charte de l’ONU rendaient insupportable la notion de souveraineté des Etats. Bernard Kouchner et le juriste Mario Bettati ont ainsi établi au début des années 80 la théorie du droit d’ingérence, prolongé par le concept de responsabilité de protéger, consacré par l’Assemblée générale de l’ONU en 2005, qui permet d’intervenir si une population est menacée, y compris par son propre gouvernement. Le droit d’ingérence, puis le droit d’assistance se sont graduellement imposés dans les relations internationales, à l’initiative d’ONG désormais conviées depuis le début des années 2000 aux débats du Conseil de sécurité pour exposer les situations dont elles sont les témoins.
Après la chute du mur de Berlin s’est ouverte l’époque d’un monde multipolaire, où les puissances politiques sont devenues relatives malgré une ultime tentative d’imperium américain et où les problèmes sont devenus globaux. Les ONG sans frontières se sont multipliées dans tous les domaines, accentuant l’émergence d’une société civile internationale qui n’hésite pas à créer des concepts de droit, à négocier avec les Etats, à les combattre ou à s’en servir comme alliés et à utiliser tous les outils du droit et de la communication pour satisfaire ses objectifs. Les grandes conférences de l’ONU sont le point d’orgue de cette croissance d’une société civile internationale dont les Etats doivent désormais s’accommoder. De Rio en 1990 (environnement), Vienne en 1993 (droit humains), Copenhague en 1995 (développement social), Pékin en 1995 (droits des femmes), La Haye en 2000 (réchauffement climatique), Copenhague en 2009 et Cancun en 2010 (climat), chaque conférence a vu la participation des ONG s’accroître. Parallèlement, les sommets du G8 ont été ponctués de réunions altermondialistes où les ONG abordaient tous les thèmes qui leur semblaient négligés par les chefs d’Etat.
Qu’il s’agisse de développement, d’environnement, de droits de l’Homme, de culture, de finance, de la biomasse et de la biodiversité, de la protection de la faune et de la flore, de l’éducation, de lutte contre les pandémies ou de corruption, les associations travaillent sur l’ensemble du champ des activités humaines. La caractéristique de leur action est de placer l’être humain au-dessus des intérêts des Etats. Les ONG partent souvent du principe que les négociations interétatiques sont stériles car les gouvernements sont souvent prisonniers d’intérêts économiques. En conséquence, il faut résoudre les problèmes si possible avec les Etats, mais si nécessaire sans eux.
4. Le rôle décisif des ONG dans la mise en place d’une justice pénale internationale
L’ordre juridique international est fondé sur le principe de souveraineté des Etats, qui seuls peuvent en déléguer une partie. La mise en place d’une justice pénale internationale pouvait difficilement émaner de leur initiative dans un domaine relevant de leur essence. L’on retrouve donc, là encore, de multiples intervenants, individus, associations de juristes, ONG, qui ont fait pression depuis 150 ans environ sur les Etats afin que des principes humanitaires aient une valeur supérieure à celui de souveraineté et permettent de juger sous certaines conditions des chefs d’Etat ou des responsables politiques en fonction.
Le pionnier de ce mouvement semble avoir été Gustave Moynier, co fondateur avec Henri Dunant du Comité international de la Croix Rouge, qui avait proposé sans succès lors de la négociation des conventions de Genève la création d’un tribunal international pour juger les auteurs des infractions les plus graves auxdites conventions. Son idée était à l’avant-garde d’un mouvement d’opinion qui, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, militait pour soutenir l’idée de la paix par le droit. Elle a été suivie de contributions d’associations de juristes et d’organisations généralistes comme Women’s International League for Peace and Freedom (1915) ou World Peace Foundation (1910).
L’acte final du traité de Versailles, dans la négociation duquel les ONG étaient très actives, mentionnait la comparution devant une juridiction internationale, spécialement constituée à cet effet, de l’ancien empereur Guillaume II et des criminels de guerre allemands. L’article ne reçut aucune application mais l’idée fut constamment à l’ordre du jour de nombreux congrès lors des années suivantes, comme à celui de Paris en 1920 lors de la naissance de la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH).
Au milieu des années 30, les exactions du régime hitlérien à l’égard des Juifs allemands et de ses opposants générèrent des mouvements de solidarité internationale. La conférence d’Evian destinée à trouver des pays d’accueil aux réfugiés juifs allemands, du 6 au 15 juillet 1938, en fut le point d’orgue. Les gouvernements demandèrent l’expertise de nombreuses ONG. Ainsi, la délégation américaine fut accompagnée, à la demande de Franklin Roosevelt, par 32 ONG, principalement des organisations juives des Etats-Unis et de pays européens, mais aussi des associations soutenant des migrants et de défense des droits de l’homme. Certaines d’entre elles (comité juif américain, églises évangéliques) poursuivirent naturellement leur action au cours de la seconde guerre mondiale, dont l’achèvement fut l’occasion d’une profonde réflexion sur la notion de souveraineté des Etats. Le conflit n’avait pas seulement été assorti de crimes, il avait marqué un véritable déni de civilisation par plusieurs Etats qui avaient sciemment organisé ou accepté d’utiliser des moyens industriels à grande échelle à des fins d’extermination. Sous l’impulsion des ONG proches du président américain Franklin Roosevelt furent créés les tribunaux internationaux de Nuremberg et de Tokyo. Parallèlement la création dans le cadre de la Charte des Nations unies d’une juridiction permanente : la Cour internationale de justice, et l’introduction d’une juridiction internationale dans la convention sur la répression du crime de génocide en 1948 confirmèrent l’influence des ONG.
La période de la guerre froide ralentit tous les travaux conduisant à la mise en place d’une cour pénale internationale. Après la chute du mur de Berlin, Amnesty International, Human Rights Watch et la Fédération internationale des droits de l’homme furent au nombre des 2000 ONG qui militèrent pour la mise en place d’une telle cour. Leur combat aboutit en 2002. Aujourd’hui, ces ONG contribuent au fonctionnement de la Cour en lui fournissant des éléments à partir de leurs observations de terrain et assistent également les victimes.
Le travail des juristes, des philosophes et des associations humanitaires a donc abouti à un résultat encore inimaginable pour des juristes. Inculper ou juger le général Pinochet ou Radovan Karadzic aurait été inconcevable il y a deux décennies. Il s’agit d’une véritable révolution dans les relations internationales car elle marque la fin d’une forme de protection que conférait le principe de souveraineté.
5. ONG sincères, ONG paravents
Le tableau ci-dessous opère un bref rappel de la montée en puissance des ONG dans les relations internationales :
Les ONG dans les relations internationales
1775 – 1918 : émergence
– Abolition de la traite des esclaves (Société de Pennsylvanie, 1775, Société des amis des Noirs, 1788).
– Maintien de la paix (Société américaine de la paix, 1828).
– Solidarité ouvrière (Association internationale des ouvriers, 1864).
– Libre-échange (Ligue de la loi anti maïs en Grande-Bretagne, association du libre-échange en France, association pour la liberté commerciale en Belgique, 1838-1846).
– Causes humanitaires et droit international (Croix Rouge, association internationale de droit, 1861 – 1873).
– Philanthropie américaine d’avant-guerre (Carnegie, Rockfeller) promouvant l’idéal américain.
1919-1934 : engagement public et premiers résultats
– Création de la Société des Nations.
– Création du Bureau international du travail.
– Constitution des réseaux de la philanthropie américaine.
1934 – 1944 : désengagement
– Affaiblissement et bureaucratisation de la Société des Nations.
– Mais créations de nouvelles ONG : mouvements de solidarité avec les premières victimes du nazisme.
– Préparation de l’ordre mondial d’après-guerre.
1945 – 1949 : formalisation
– L’article 71 de la Charte des Nations Unies encourage le développement des ONG.
– Le même article leur attribue un rôle spécifique auprès du Conseil économique et social de l’ONU.
– De nombreuses ONG ont officiellement un rôle de conseiller de la délégation américaine aux différentes conférences de paix.
1950 – 1971 : limitation
– Guerre froide et faiblesse institutionnelle du Conseil économique et social de l’ONU.
– Les principales actions des ONG concernent les droits de l’homme : conférence sur la convention des réfugiés, conférence sur l’éradication des préjudices et des discriminations, convention supplémentaire pour l’abolition de l’esclavage…
– Signe avant-coureur d’un renouveau des ONG : création de Médecins sans Frontières en 1971.
1972 – 1991 : nouvelle extension
– Création et croissance de très nombreuses ONG dans les domaines des droits de l’homme et de l’environnement.
– L’Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil économique et social de l’ONU invitent les ONG à les assister pour planifier les grandes conférences internationales (Stockholm en 1972 sur l’environnement (225 ONG accréditées), conférence sur l’alimentation en 1974, année internationale de la femme en 1975…).
– Autorisation pour les ONG de s’exprimer lors de la session plénière de 1987 de la conférence sur le protocole de Montréal pour la protection de la couche d’ozone.
– Rôle clé pour la négociation et l’expertise de traités sur l’environnement : protection des ours polaires en 1973, conférence de l’ONU sur le droit de la mer, avec la signature d’une nouvelle convention le 10 décembre 1982, à Montego Bay…
Depuis 1992 : un rôle actif
– Plusieurs facteurs concourent à l’extension du rôle des ONG : la chute du mur de Berlin met fin à la polarisation idéologique de la politique internationale, la globalisation de l’économie et l’apparition de problèmes mondiaux conduisent à accroître le nombre de conférences intergouvernementales qui utilisent des ONG comme experts pour soutenir ou combattre une position, l’émergence de média comme CNN, puis la croissance spectaculaire d’internet, leur permettent de faire connaître leur point de vue à l’ensemble de la planète…
– La mondialisation de l’économie, le désengagement des Etats de l’économie accroissent le pouvoir des entreprises transnationales.
– Extension des mouvements altermondialistes.
– Extension du champ du droit international (droit d’ingérence) et création de la Cour pénale internationale.
L’on relèvera dans ce tableau que si les actions en faveur des causes humanitaires sont prédominantes, elles ne sont pas exclusives. Des entités représentant des intérêts économiques et sociaux, agissant pour leur propre compte, ont fait leur apparition dès le XIXème siècle.
Les ONG sont désormais présentes dans les relations internationales à plusieurs titres :
– leur statut consultatif ou participatif auprès de nombreuses organisations internationales intergouvernementales ;
– leur présence aux grandes conférences internationales ;
– leur capacité à influencer les négociateurs et à mobiliser l'opinion publique : la Cour pénale internationale, la campagne pour l'interdiction des mines ou contre les armes à sous-munitions en sont quelques exemples ;
– leur poids politique, économique et financier dans les domaines des droits de l’homme, de l’aide au développement et dans la défense de l’environnement.
De nombreuses interrogations ont cours quant à leur rôle et certains considèrent que les ONG ne sont que les représentantes d’un type de société qui a cours dans l’hémisphère Nord, où l’humanisme voisine avec un libéralisme économique quelque peu prédateur… Il est vrai que les ONG sont principalement occidentales, en raison de l'ancienneté de la liberté d'association, de leur capacité à mobiliser les ressources financières de leurs concitoyens et de l'importance de la société civile dans leur pays d’origine. Dès lors, même si le phénomène se développe dans l’hémisphère Sud, il n’est pas étonnant que certaines soient considérées comme des éléments de l’interventionnisme occidental et soient prises à partie dans des conflits ou dans des opérations de stabilisation.
Plus délicate est la question de la sincérité des ONG. Plusieurs enquêtes de journalistes ont mis en lumière le rôle de paravent de certaines d’entre elles, comme Transparency, Sherpa ou Global Witness, qui sous couvert de lutte contre la corruption, chercheraient à déstabiliser des Etats amis de la France dans des pays producteurs de pétrole en Afrique occidentale… La suspicion à l’encontre de certaines d’entre elles provient de leurs mécènes, comme le fonds Sigrid Rausing Trust qui finance Sherpa et qui a longtemps dénoncé la politique française au Rwanda. Elle provient également de la curieuse orientation de leur action : Greenpeace se concentrait sur les essais nucléaires français mais se gardait d’intervenir contre les essais américains. Comme le soulignait en 2009 Hubert Védrine, « il faut être bien naïf ou aveugle pour ne pas voir que les ONG américaines ou britanniques sont une part du soft power américain ou anglais… Et qu’elles sont souvent hostiles, de facto, sous divers prétextes, à l’influence, à la politique ou à la langue française ».
Cette question est loin d’être marginale. Dans les sociétés démocratiques, la collaboration entre pouvoirs publics et ONG va croissant. Nombres d’entre elles sont associées à la préparation des politiques (comme l’environnement, le développement ou les droits de l’homme) parce qu’elles disposent d’une expertise réelle. Mais il existe peu de critères pour analyser leur sincérité. Des ONG peuvent constituer, au-delà de leur objet social et de la cause qu’elles défendent, les instruments de promotion d’intérêts d’Etats ou d’entreprises, comme l’a illustré l’action de Global Witness (volontaire ou involontaire, la question reste en suspens) aux côtés de Kensington, un cabinet de relations publiques, filiale d’Elliott, un hedge fund (siégeant à New York et domicilié aux Iles Caïmans) impliqué dans une tentative de déstabilisation financière du Congo Brazzaville.
Certaines ONG revendiquent par ailleurs un magistère moral et s’érigent en juges de l’éthique de l’action des pouvoirs publics… Leur influence ne doit pas être sous-estimée car elles cherchent à concurrencer les Etats et les institutions internationales auprès du public. Il s’agit pour elles de structurer une société civile autour de valeurs qu’elles sont seules à définir, sans pour autant être soumises aux exigences du suffrage universel.
Dans la mesure où l’article 71 de la charte des Nations unies leur reconnaît un rôle en matière économique et sociale, juger les ONG et déterminer si elles s’appliquent à elles-mêmes les règles de transparence et de moralité qu’elles exigent des Etats devient un élément du débat. En France, le baromètre annuel de transparence des ONG, édité par la fondation Prometheus, s’efforce d’apporter des éléments sur ce point, révélant ainsi que de célèbres ONG comme Greenpeace International brillent par leur opacité…
B – Les conséquences de la libéralisation de l’économie : le poids croissant des entreprises privées dans les relations internationales
Lorsqu’en 1990 le fonds spéculatif Quantum, détenu par Georges Soros, a parié massivement sur la baisse de la Livre sterling et a contraint le gouvernement britannique à dévaluer sa monnaie, plusieurs observateurs se sont interrogés sur la raison de son action. Le profit qu’il engrangeait, certes considérable (près d’un milliard de dollars), constituait une explication insuffisante. Le facteur psychologique a semblé déterminant. Homme d’affaire déjà richissime, à la tête d’une fondation (Open Society) qui intervenait dans les pays de l’ex bloc soviétique d’où il avait fui, Soros voulait manifester au monde sa puissance, sa capacité à influer sur le cours des affaires publiques – en l’occurrence la politique monétaire – affirmant une nouvelle fois le poids des empires économiques et financiers face aux Etats.
Cet épisode n’est pas isolé. Des fonds spéculatifs ont à plusieurs reprises joué des monnaies à la baisse et obligé les pouvoirs publics (FMI, Conseil européen) à agir sous leur pression, comme actuellement avec la gestion des crises grecque et portugaise. Il ne constitue que le volet monétaire d’un problème plus général. Les Etats n’ont pas su s’adapter assez rapidement aux conséquences de la mondialisation en construisant un ou plusieurs espaces politiques internationaux tandis que les grandes entreprises transnationales modèlent l’espace économique qui leur est dévolu non seulement par la localisation des moyens de production mais également en produisant des normes, ou encore en s’opposant à celles proposées par les Etats de manière à subir le moins de contraintes fiscales, sociales ou environnementales dans leurs activités.
Il serait artificiel d’opposer les Etats aux entreprises ou aux marchés. Le libéralisme ou la vision contemporaine d’une économie libre sont le fruit d’un long travail intellectuel. Dès le XIXème siècle, des associations d’entrepreneurs ont cherché à convaincre les Parlements et les gouvernements des bienfaits du libre-échange, comme la Ligue anti maïs en Grande-Bretagne ou l’association pour le libre-échange en France. Dans la deuxième partie du XXème siècle, la figure de proue du libéralisme a été l’Ecole de Chicago (exemple probant d’influence diffuse) dont les thèses ont inspiré de nombreux responsables politiques dans les Etats occidentaux. Les mots ont toutefois le sens qu’on leur donne, et il n’est pas sûr que les Européens aient toujours saisi que l’Ecole de Chicago prônait l’autonomie de l’économie (absence de toute régulation étatique et gestion d’un secteur économique par les seuls professionnels) et non la liberté qui suppose souvent l’existence de règles. Lorsque cette autonomie se combine avec la concentration d’actifs financiers, avec la détention de technologies ou avec une position dominante dans un secteur économique, elle donne aux entreprises la capacité d’infléchir les politiques publiques. La puissance des grandes banques les a ainsi protégées de toute taxation alors que certains Etats du G8 avaient émis cette idée lors des réunions consacrées aux réformes à apporter à la suite de la dernière crise financière.
Le poids de certains acteurs financiers et économiques à l’échelle internationale pose un véritable problème de légitimité lorsque leur action contraint les politiques des Etats. Jürgen Habermas rappelle que « des déficits de légitimité démocratique se font sentir chaque fois que le cercle des personnes qui participent aux décisions démocratiques ne recoupe pas le cercle de ceux qui subissent les conséquences de ces décisions ». La situation actuelle correspond exactement à cette citation, dans la mesure où le secteur financier fonctionne selon les règles qu’il s’est donné et qu’il a imposées aux Etats, et qu’il refuse en outre d’assurer les conséquences d’une crise économique qu’il a provoquée par ses excès : d’après les services de la Commission européenne, 957 milliards d’euros de pertes sur les marchés financiers, ayant entraîné 43 millions de chômeurs supplémentaires dans le monde en 2010, le plus souvent pris en charge par les puissances publiques.
1. Les sociétés transnationales : du lobbying à la sous-fiscalisation
Un rapport annuel de l’ONU (conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement / CNUCED) compare la valeur ajoutée des 100 premières entreprises mondiales au regard du PIB des Etats. Si l’on place ensuite sur le même plan Etats et entreprises, l’on constate que se trouvent une trentaine d’entreprises.
« S’il est un changement qui, plus que tout autre, bouleverse la politique au plus haut niveau interétatique aussi bien que, à l’autre extrême, la vie des individus dans le monde entier, c’est le changement dans la structure de production de l’économie mondiale. En d’autres termes… quels biens et services sont produits, où et par qui ? Ce changement n’est pas tant l’émergence des prétendues multinationales… que le passage d’une production conçue et destinée à un marché local ou national à une production d’abord conçue et destinée à un marché mondial. Bref, ce ne sont pas les firmes qui sont multinationales. C’est le marché » (Susan Strand) (2). Cette importance a inévitablement transformé certaines entreprises en actrices politiques, mais à la différence des gouvernements, des Parlements et des partis qui agissent sur l’ensemble des aspects des sociétés humaines, les entreprises ont de la politique une vision limitée à leurs intérêts : elles souhaitent principalement structurer leurs marchés en fonction de règles qu’elles émettent et ne pas subir le poids de réglementations et d’une fiscalité qu’elles qualifient toujours d’excessives.
Il est difficile de quantifier le nombre de ces sociétés. La CNUCED évaluait leur nombre à 82 000 en 2009, auxquelles il fallait ajouter environ 150 000 filiales. Le phénomène n’est donc pas marginal… Les sociétés transnationales assurent environ 35% de la production et des échanges mondiaux. Elles ne se cantonnent plus à l’extraction de matières premières et aux activités industrielles, mais ont massivement investi dans les services : santé, transports, finance, communication, bases de données, réseaux et services informatiques, services juridiques, publicité, tourisme, culture (édition, cinéma…). Elles sont revenues massivement dans le secteur agricole avec l’achat de terres pour des cultures à usage industriel, comme la production d’huile de palme (ce qui commence à poser un problème social considérable à Madagascar, au Guatemala, au Kenya…). Par ailleurs, ces sociétés n’émanent plus des seuls pays d’Europe, d’Amérique du Nord et du Japon. Elles proviennent également de grands pays émergents comme l’Inde, le Brésil, la Chine, la Malaisie.
L’importance de ces sociétés dans les relations internationales tient en deux points : leur rôle dans l’allocation des moyens de production et leur rejet de tout système fiscal international.
L’allocation des moyens de production obéit à une logique simple, qui est que les entreprises s’implantent là où sont leurs marchés. Mais comme les pays sont en concurrence pour être des centres de décision, de production ou de gestion, les entreprises essaient d’infléchir des politiques publiques en invoquant des enjeux d’emplois et d’investissements. Elles utilisent dans chaque pays tous les moyens habituels du lobbying pour que les législations nationales demeurent conformes à leurs intérêts et que n’apparaissent pas de textes internationaux à valeur contraignante comme en témoigne actuellement leur activisme auprès de la Commission européenne autour du projet de règlement REACH, qui doit remplacer 40 directives applicables à l’industrie chimique.
La question de la fiscalité sur les entreprises transnationales remonte au début du XXème siècle, quand les Etats européens ont dû financer les dépenses de la première guerre mondiale et la réparation des dommages causés à leurs économies. Ils avaient en effet constaté une nette augmentation du commerce mondial comme des investissements internationaux, d’où leur souhait de taxer les entreprises pour l’ensemble de leurs activités sur leur sol national comme à l’étranger, tandis que les pays d’accueil aspiraient également à se procurer des revenus. Pour minorer les doubles impositions, les entreprises ont eu tendance à sous-évaluer leurs bénéfices, ce dont les gouvernements ont eu conscience assez tôt… Ces derniers avaient donc intérêt, pour éviter l’évasion fiscale, à signer des conventions de double imposition, qui sont en réalité un pis aller, « qui forment un système lâche et laborieusement construit de coordination des juridictions fiscales » (Picciotto, cf bibliographie). La véritable politique eut été de créer un système universel de taxation des entreprises transnationales, fondé sur des principes communs. Trois grandes tentatives ont échoué, celles de la commission des finances de la SDN en 1923 et 1933, puis celle de l’OCDE, en collaboration avec le Conseil de l’Europe, en 1988, à chaque fois sous la pression du monde des affaires qui a su trouver des relais au sein des gouvernements. Le projet de texte de 1988 est ainsi resté lettre morte en raison de l’opposition du Royaume-Uni, de l’Australie, de la Suisse et de l’Allemagne.
« Le plus grand obstacle à l’affirmation par l’Etat de son droit de taxer provient de la mobilité internationale du capital » (Picciotto précité). Si les juristes rappellent qu’il n’existe en droit aucune limite à la taxation, les Etats ne peuvent la mettre en œuvre que sur leur territoire. Les entreprises peuvent donc profiter des systèmes fiscaux les plus favorables comme l’Irlande au sein de l’Union européenne, voire passer par des paradis éponymes (parfois avec l’accord de leur Etat d’origine au nom du maintien de leurs marges). Alors que l’économie mondiale n’a jamais créé autant de richesses dans l’histoire, certains Etats sont profondément endettés en raison d’une insuffisance de base ou de niveau fiscal. C’est le cas de pays pauvres, qui ne peuvent prélever d’impôts sur les sociétés, puisqu’ils ont promis des clauses fiscales favorables aux entreprises qui s’implantent sur leur territoire. C’est également le cas de pays très riches, l’exemple le plus patent étant les Etats-Unis où l’industrie pétrolière ne paie plus d’impôts à l’Etat fédéral en raison d’une législation qui l’autorise à déduire les royalties versées aux gouvernements du Moyen-Orient. L’on rétorquera que les relations fiscales entre Washington et les industries pétrolières ne sont pas une question internationale et n’entrent pas dans le champ du présent rapport. Elles le sont, bien au contraire, car lorsque le niveau de prélèvement fiscal de la première puissance militaire mondiale est trop bas au regard de ses engagements militaires et lorsque son incapacité à maîtriser sa dette souveraine la rend dépendante de son créancier chinois, son poids sur la scène internationale en est affaibli.
2. Les sociétés transnationales, vecteurs de la mondialisation et du changement du rapport de force entre le Nord et le Sud
En quelques décennies, des pans entiers de l’économie (banques, assurances, télécommunications, énergie, audiovisuel…) sont passées du secteur public au secteur privé. Les sociétés transnationales, qui dominent la plupart de ces secteurs sont devenues de facto des intervenants politiques au sens où elles assurent l’ensemble des fonctions économiques : production de biens et de services, localisation des moyens de production, innovations techniques et où elles entretiennent d’étroit rapports avec les Etats dans une série de domaines : distribution, fiscalité, droit du travail, degré de protection du consommateur…
Si l’on considère que les rapports internationaux sont régis sur le fondement du principe de souveraineté, défini généralement comme le droit d’exercer sur un territoire déterminé les fonctions d’un Etat, l’on constate que l’économie moderne échappe désormais au champ classique de la souveraineté. Mais l’autorité qu’exercent des entreprises privées sur les activités humaines les plus essentielles n’est pas de nature territoriale; elle est de nature fonctionnelle et porte sur la manière dont sont produits et distribués les biens et les services. Les sociétés transnationales sont devenues les principales forces motrices des décisions économiques. L’internationalisation de l’économie mondiale et le passage des lieux de décision économique des Etats vers les marchés posent la question du contenu de la souveraineté et illustrent la dispersion du pouvoir dans l’économie mondiale, qui ne relève pas exclusivement des entreprises, mais qui ne ressort plus principalement des Etats.
Cette réalité est issue d’un choix délibéré de la plupart des Etats de la planète. Il y a certes une part d’idéologie dans la préférence pour des marchés libres, mais il y a également le constat de l’échec de l’économie dirigée. Des pays à l’économie centralisée comme la Turquie, l’Inde, l’Algérie, des pays communistes comme la Chine ou le Vietnam, l’ensemble des pays de l’ex URSS et la Russie elle-même ont opté pour des privatisations massives sans ressentir de menace quelconque pour la survie de leur Etat ou l’exercice de leur souveraineté, y compris lorsque le pouvoir demeurait autoritaire, comme à Pékin, à Moscou ou à Hanoï. L’accès aux marchés mondiaux a été considéré comme la condition sine qua non de leur modernisation.
L’autonomie des marchés et le poids particulier des sociétés transnationales a incontestablement stimulé la croissance économique mondiale, mais elle a emporté des conséquences que les Etats, notamment occidentaux, n’avaient pas forcément anticipé :
– la liberté quasi générale dont jouissent les entreprises pour la répartition de leurs sites de production a abouti à ce qu’elles ont généré une redistribution de richesses largement supérieure à l’ensemble des programmes d’aide publique au développement. Leurs investissements et leurs relations commerciales ont créé des millions d’emplois et élevé le niveau de vie des habitants, notamment en Asie du Sud Est et en Afrique australe et orientale ;
– les délocalisations massives d’industries, de services et de laboratoires de recherche d’Amérique du Nord et d’Europe vers des pays émergents ont entraîné de nombreuses répercussions sur le commerce, l’emploi, la maîtrise de nouvelles technologies et ont renforcé un secteur bancaire extra européen et extra américain grâce à un afflux d’épargne domestique et internationale. Depuis une dizaine d’années, la croissance économique des pays du Sud est supérieure à celle de l’hémisphère Nord et le poids des pays émergents (dont la démographie, autre facteur essentiel de puissance, est plus dynamique qu’en Occident) doit être désormais pris en considération dans l’ensemble des négociations internationales. Ces pays ne se contentent plus de suivre un bloc mais font entendre leurs spécificités, comme l’ont illustré les dernières négociations sur le climat, l’énergie et la gestion de la crise financière. L’existence d’un G 20, parallèlement à un G 8, est bien la preuve que les rapports de force économiques ont été modifiés et que la gestion de l’économie mondiale ne peut plus être du seul apanage de ce dernier.
3. Le problème posé aux Etats par l’autonomie de la sphère financière
L’importance de la sphère financière est une conséquence de la liberté des marchés. Même si elles n’obéissent à aucune intentionnalité autre que le profit, les activités de marché affectent profondément celles des Etats. Il suffit de garder à l’esprit que l’ensemble des économies interagissent par le biais des marchés des biens, des services et des capitaux et que si ce processus a stimulé la croissance, il est parallèlement générateur d’instabilité car les mouvements de capitaux facilitent la propagation des crises financières et leur amplification. Le poids des dettes souveraines, largement refinancées par les marchés, donne en outre à ces derniers un droit de regard sur les politiques économiques des Etats. Dans le domaine monétaire, la recherche d’un équilibre entre stabilité et flexibilité est au cœur du débat sur le système international, dans un contexte où la compétitivité des économies nationales évolue en permanence en fonction de leur spécialisation, de leur niveau technologique, de leur démographie et de leur capacité d’épargne.
Les Etats comme les acteurs privés ont besoin d’un minimum de prévisibilité pour la gestion de leurs investissements ou de leurs dettes. Mais Etats et marchés n’ont pas les mêmes logiques. Les Etats agissent à la fois sur court terme pour faire face à la conjoncture et sur le long terme, avec des politiques d’investissement sur plusieurs décennies (transports, énergie, éducation) quand les acteurs de marché privilégient souvent le profit sur le court terme.
L’autonomie de la sphère financière ne provient pas de l’absence de réglementation, contrairement à une idée par trop répandue. Il s’agit plutôt de professions très réglementées, mais la création permanente de nouveaux produits oblige les pouvoirs publics à de constantes adaptations et induit dans l’intervalle des vides juridiques. (Avant d’être introduite au début des années 90 dans le droit financier, la titrisation était ainsi une idée qui permettait aux banques d’échapper au ratio Cooke). L’autonomie de la finance procède fondamentalement de la volonté des Etats, qui ont considéré que la liberté des investissements était la meilleure manière de développer leur économie nationale. La libéralisation du marché des capitaux a ensuite favorisé l’émergence d’entités puissantes (notamment les fonds d’investissement) aptes non à concurrencer les Etats (là n’est pas leur objectif) mais à agir indépendamment d’eux. L’on peut affirmer, sans galvauder un terme connoté historiquement, que les entreprises de marchés de capitaux forment la seule Internationale des temps modernes. A partir de ce constat naît une série de problèmes :
– les Etats ont besoin des acteurs de marché pour financer leur économie. Dans un monde globalisé, il leur faut établir des politiques d’attractivité des investissements, tant nationaux qu’étrangers. Une part notable des fiscalités de l’épargne est ainsi élaborée dans cet objectif ;
– les investissements étrangers peuvent concerner des secteurs considérés comme stratégiques pour la sécurité nationale ou le niveau technologique des Etats. Il en résulte des stratégies complexes d’intelligence économique pour conquérir ou défendre des secteurs entiers de l’économie. Les Etats n’hésitent d’ailleurs pas à agir comme les acteurs de marché via leurs fonds souverains.
L’enjeu pour les Etats est de disposer de marchés abondants en capitaux mais également « de maintenir leur souveraineté dans une mondialisation où des puissances économiques et financières sont désormais capables de rivaliser avec eux. Il s’agit surtout de maintenir le contrôle sur les technologies de souveraineté, c'est-à-dire les technologies permettant à un Etat de se maintenir dans la compétition entre nations » (Pascal Dupeyrat).(3) .
S’ajoutant aux établissements financiers et aux compagnies d’assurance, la sphère financière a vu l’émergence de nouveaux intervenants depuis une quarantaine d’années. Les capitaux considérables qu’ils gèrent font d’eux des acteurs macro économiques, dont les choix ont des répercussions sur les économies nationales. Il s’agit principalement des fonds d’investissement, des fonds de pension et des hedge funds.
Les fonds d’investissement sont des sociétés de détention collective d’actifs financiers. Leur dimension, leur statut et leur organisation sont très diverses mais ils ont en commun de former des véhicules regroupant des investisseurs en vue de faire ensemble des investissements en capital investissement et d’en partager les résultats selon une clé déterminée. Nés dans les années 70 dans la Silicon Valley, leur puissance provient de leur capacité croissante à lever des capitaux pour des montants équivalents ou supérieurs à des emprunts d’Etat. En 1991, ils levaient 10 milliards de dollars sur les marchés. Cette somme a dépassé 500 milliards de dollars en 2007. Ils travaillent dans cinq catégories d’investissement : capital-amorçage, capital-risque, capital-développement, capital-transmission (LBO, leverage buy out) et capital-retournement. Leur attractivité est due aux rendements qu’ils annoncent et à la transparence de leurs opérations qui s’effectuent théoriquement en accord avec les sociétés qui sont leurs cibles. Mais les fonds enregistrent des changements de propriétaires puisque leurs parts sont cessibles. Ce sont ces changements qui peuvent poser des problèmes aux Etats lorsqu’une personne physique ou morale indésirable entre au capital d’une société considérée comme stratégique pour l’économie ou la sécurité d’un Etat.
Deux fonds d’investissement américains sont considérés comme posant des problèmes d’ordre stratégique, en raison du secret dont ils entourent leurs activités. Carlyle Group, créé en 1987, présent dans la défense, l’aéronautique, l’automobile, l’énergie, les télécommunications et les medias, investit principalement en Amérique du Nord, en Europe et en Asie du Sud-Est. Environ 575 professionnels de l’investissement travailleraient dans 21 bureaux pour gérer son portefeuille de participations. Il emploie ou compte parmi ses investisseurs d’anciens responsables de la politique américaine, comme le Président George Bush. N’étant pas côté en bourse, il n’est tenu à aucune obligation spécifique d’information. Les liens étroits qu’il entretient avec le gouvernement américain nourrissent la méfiance de nombreux Etats. Blackstone Group, fondé en 1985, intervient dans des secteurs moins sensibles (immobilier, assurance) mais il compte parmi ses souscripteurs des fonds souverains.
Les fonds de pension, qui regroupent des caisses de retraite de salariés, figurent parmi les premiers investisseurs institutionnels au monde. Les fonds américains gèrent à eux seuls 6000 milliards de dollars d’actifs, ce qui leur donne une force de frappe économique considérable. Ces fonds se sont aussi considérablement développés en Grande-Bretagne, aux Pays-bas et en Suisse où le taux d’adhésion de la population active à des régimes par capitalisation est supérieur à 50%. Ils gèrent leurs actifs soit directement, soit via des fonds d’investissements ou des hedge funds. Leurs statuts exigent le plus souvent qu’ils opèrent des placements considérés comme sûrs, d’où leur très grande sensibilité aux notations financières des grandes agences.
Les hedge funds (fonds de couverture) sont des fonds spéculatifs détenus par des investisseurs privés. Théoriquement conçus pour couvrir leurs souscripteurs contre les variations de taux de change ou de prix, ils permettent à leurs détenteurs de spéculer grâce au recours à l’endettement. Leur nombre était de 7285 au début de 2011, disposant d’une capacité d’investissement de 2000 milliards de dollars. Ils sont considérés comme étant à l’origine de plusieurs attaques spéculatives ayant déstabilisé les monnaies de nombreux pays : Pesos mexicain (1992 et 1994), monnaies d’Asie du Sud-Est (crise financière asiatique de 1997), Euro actuellement… Le problème qu’ils posent aux Etats diffère de celui des fonds d’investissement : ils ne recherchent pas le contrôle d’entreprises stratégiques, privilégiant le profit à court terme bâti sur des entreprises fragiles, mais leur mode d’action peut provoquer des crises temporaires sur un secteur d’activité ou une devise.
4. L’évolution de la place des Etats dans les relations internationales
L’Etat, en tant que personne morale exerçant une autorité sur un territoire et une population, a théoriquement le monopole des relations internationales… Mais cette affirmation ne vaut que pour les échanges diplomatiques et les rapports de force classiques, l’aspect militaire notamment. Dans un monde où la guerre, phase ultime du rapport de force, a tendance à disparaître, du moins entre pays développés en raison de son coût insupportable en vies humaines et pour l’économie, les relations internationales embrassent le champ de l’ensemble des activités politiques et les facteurs économiques prennent plus d’importance que les alliances traditionnelles. Dans ce contexte, l’Etat joue toujours un rôle dans les relations internationales mais il est clair que son autorité est limitée – pour de nombreux chercheurs, elle perd même du terrain – dans des domaines en nombre croissant : économie, finance, fixation de normes juridiques et techniques.
A ce constat s’ajoute son impuissance croissante à assumer ses fonctions traditionnelles de maintien de l’ordre et de la sécurité. La montée de la pauvreté favorise ou amplifie des phénomènes d’économies parallèles dont les mafias et la piraterie sont les manifestations les plus criantes. Les guerres, expression du monopole de la violence légitime, sont de plus en plus difficiles à mener, sans pour autant déboucher sur des solutions politiques. Depuis le second conflit mondial, les opérations menées par des pays occidentaux, qu’elles aient été de type classique (Vietnam) ou de nature asymétrique (Somalie, Afghanistan) ont été des échecs ou lorsqu’elles se sont achevées sur une victoire militaire, n’ont débouché sur aucune solution politique (Irak, Bosnie, Kivu). Conséquence de problèmes politiques non résolues, la liste des opérations extérieures, sous mandat de l’ONU ou hors de ce mandat, s’allonge en permanence.
a) Recul ou changement des critères définissant le pouvoir des Etats dans les relations internationales ?
Considérer que l’émergence croissante d’entités privées dans les relations internationales marque concomitamment le recul des Etats serait quelque peu réducteur. Ces derniers exercent certes moins de responsabilités dans un monde où l’économie est libéralisée, mais ils conservent d’importantes prérogatives comme le montrent les nombreux sommets multilatéraux qui ponctuent la vie internationale.
La place des Etats est le plus souvent analysée sous l’angle de critères de pouvoir. Au XIXème siècle, était puissante la nation qui disposait d’une marine, d’un empire colonial, d’une population nombreuse et laborieuse et d’une industrie sidérurgique. Sous la guerre froide, les facteurs essentiels étaient la détention d’armes stratégiques et le contrôle de l’énergie et des matières premières. Ce qui concourrait à la construction d’un appareil militaire et à la conduite de la guerre revêtait donc un caractère essentiel. De nos jours, la guerre a disparu des relations entre pays développés. Les éléments classiques de la puissance ont moins lieu d’être que la capacité à agir en réseau, à être au cœur de systèmes d’échanges et d’informations, à maîtriser de hautes technologies, et plus encore à façonner le monde selon une idéologie et des mécanismes qui garantissent pour un Etat le bien-être de sa population et la sécurité sur son territoire. Le « pouvoir relationnel coercitif » a moins d’importance que le « pouvoir structurel indirect », pour reprendre les deux principaux termes de la thèse de Joseph Nye. (4).
Les relations internationales ne se limitent plus au champ classique de la politique étrangère. Elles comportent une multitude de domaines, certains ressortant des Etats quand d’autres leur échappent complètement, comme la production de biens et de services, leur distribution, l’information, l’industrie culturelle de masse... Il y a donc juxtaposition, plus que concurrence, sur la scène internationale entre Etats et entités privées, ce qui signifie que ces dernières ont désormais une autorité sur des pans entiers des activités humaines.
Influer devient dès lors pour les Etats un élément indispensable de leur activité internationale. A défaut d’avoir un poids direct sur certaines décisions, influer sur les entités privées qui en sont maîtresses constitue une stratégie alternative. Ces entités opèrent une démarche similaire quand leurs objectifs exigent d’être approuvés par les Etats, notamment par le vote de lois ou l’acceptation de normes. La scène internationale peut ainsi être décrite comme les jeux simultanés de milliers d’acteurs qui par des moyens divers cherchent mutuellement à s’influencer.
Les critères qui définissent les pouvoirs des Etats dans les relations internationales ont donc été sensiblement modifiés ces dernières années. Les facteurs classiques de la puissance se sont estompés au profit de capacités d’anticipation, de maîtrise de réseaux, d’influence ou d’alliance avec des partenaires privés, l’objectif étant de maintenir un territoire comme un centre d’activités humaines, notamment économiques.
b) Gouverner un monde globalisé : le retard des Etats
La période actuelle se caractérise par une nouvelle répartition du pouvoir. D’une part, aucun Etat ne domine à lui seul la scène internationale : les Etats-Unis demeurent la première puissance militaire, mais leur niveau d’endettement réduit leur capacité d’action politique, notamment face à la Chine. Cette dernière cherche à structurer l’ordre mondial par un jeu économique dont tous les facteurs convergeraient autour d’elle. L’Union européenne refuse quant à elle de payer le prix de la puissance politique. Les grands pays émergents (Brésil, Inde) jouent un rôle croissant dans l’économie mondiale mais leur poids politique demeure volontairement réduit. Le monde n’est pas toutefois aussi multipolaire que la popularité du terme le laisse entendre car à défaut de désormais plier les autres nations à leurs vues, les Etats-Unis conservent une capacité d'influence et d'action suffisamment importante pour rejeter dans les négociations du G20, du G8 ou sur les problèmes multilatéraux comme le climat toute décision qui ne correspond pas à leurs intérêts.
Ce pouvoir relatif s’accompagne d’autre part d’une réalité nouvelle : l’autorité des Etats s’exerce de moins en moins sur l’économie et la société… En d’autres termes, ils ne dirigent qu’une partie des activités humaines se déroulant sur leur territoire. Or la mondialisation ou globalisation n’est rien d’autre que l’exercice de ces activités à une échelle plus large que celle des Etats. Les opérateurs privés se sont assurés la maîtrise de pans entiers de la production et de la répartition des richesses, comme de la finance, de l’information ou de la culture… Ces opérateurs – entreprises, ONG – travaillent déjà dans la logique d’un marché mondial unique qui ne tolère que des règles a minima, qu’ils ont autant que possible eux-mêmes déterminées.
L’on pourrait opposer à ce constat que sans le cadre législatif et la stabilité politique apportée par les Etats, l’économie de marché n’aurait pu se développer. Toute personne familière des processus législatifs sait toutefois que la réglementation des activités est largement proposée par les professionnels eux-mêmes et que dans des sociétés devenues complexes, la notion d’intérêt général est difficile à déterminer. Depuis 20 ans, les grands ensembles économiques ou économico-politiques que sont l’Union européenne, l’ALENA, l’ASEAN ou l’Organisation mondiale du commerce ont toutes contribué à rapprocher leurs différents marchés selon une logique qualifiée de dénationalisation et de déterritorialisation du capitalisme par le sociologue allemand Ulrich Beck, qui poursuit sur le ton de l’allégorie : « Nous n’avons pas besoin de politique, ou alors d’une politique néo-libérale ; nous n’avons pas besoin d’Etat, le marché se charge de tout. Sur la culture de la liberté, notre position est variable : la liberté politique n’est rien pour nous, seule compte la liberté de consommation… » (Ulrich Beck, cf bibliographie). Pour l’économiste Jean Baechler, il s’agit de donner naissance à « un marché transpolitique, incontrôlable par aucun pouvoir politique » et d’établir « un régime politique compatible avec les exigences d’un système capitaliste, exigences que l’on peut ramener à une seule : le respect de la sphère privée » (Jean Baechler, cf bibliographie). Cette logique transnationale, et non internationale, conduit les entreprises à demander et obtenir l’adoption de règles a minima, applicables aussi bien dans les démocraties que dans des régimes autoritaires. La liberté d’entreprendre s’accommode d’ailleurs parfaitement des dictatures alors qu’il a été longtemps considéré qu’elle ne pouvait s’épanouir que dans des pays libres.
La globalisation des activités conduit à la globalisation des problèmes. Il n’est plus possible d’ignorer que les questions économiques, financières, fiscales, climatiques, environnementales sont toutes liées entre elles et que toute activité dans un pays a des répercussions dans d’autres. Or, si les acteurs économiques raisonnent en fonction d’un marché mondial, les responsables politiques ont du mal à admettre que « les problèmes mondiaux exigent une gouvernance mondiale », pour reprendre les termes de Jacques Mistral.
Ce retard, imputable à la difficulté d’abandonner de nouveaux pans de souveraineté, explique pourquoi des entités privées jouent un rôle si important en matière internationale. Si des entreprises agissant sur un même marché ne disposent pas de normes comptables comparables et que les Etats sont incapables de leur en proposer, elles se tournent naturellement vers des organismes privés qui leur fournissent un cadre référentiel. Si des citoyens estiment que les Etats tergiversent sur les négociations climatiques et de biodiversité, ils accordent une oreille plus attentive aux revendications des ONG de défense de l’environnement. S’ils apprennent que des groupes pétroliers comme Shell ou de grandes entreprises agro alimentaires produisent de l’éthanol, de l’huile de palme ou du bois en expulsant des indiens d’Amazonie, des paysans des îles Andaman ou du Botswana alors que grandit l’aspiration à une consommation respectant l’éthique, ils se sentent en phase avec les actions spectaculaires de Survival International, surtout lorsque cette association britannique obtient gain de cause auprès des tribunaux.
En résumé, les entités privées comblent souvent pour le meilleur comme pour le pire le vide laissé par le pouvoir politique. A l’appui de leur démarche provient le fait que les principales réunions internationales consacrées aux problèmes les plus urgents de la planète n’ont guère donné de résultats.
– Environnement et climat : les Etats parties aux conférences de Copenhague et de Cancun devaient certes tenir compte de multiples groupes de pression économiques et souhaitaient protéger leurs industries en ces temps de crise, mais les deux conférences constituent des échecs, non au regard de leurs résultats mais au regard des attentes qu’elles suscitaient. L’Union européenne, qui disposait avec le paquet climat énergie d’une position politique solide, n’a pas su influencer la négociation. Pour les opinions publiques, l’image laissée par les Etats est celle de l’impuissance sur des problèmes qui concernent désormais des millions de personnes.
– Négociations commerciales : l'échec des négociations sous l’égide de l’OMC est presque une bonne nouvelle pour un grand nombre d’Etats. La libéralisation des services, attendue par un grand nombre d’entre eux et ardemment souhaitée par les entreprises, se heurte à la question agricole et à l’enjeu stratégique de la sécurité alimentaire. Peu de pays, en particulier les pays émergents mais aussi des pays européens, peuvent accepter l'idée que l'alimentation de leur population soit dépendante des fluctuations du marché mondial. Si le rôle de l’OMC est reconnu, les difficultés qu’elle rencontre pour parvenir à un résultat illustrent là encore le chemin à parcourir pour aboutir à un accord.
– Crise économique, réforme des marchés financiers et dettes publiques : ces trois points, liés entre eux, sont au cœur des négociations au sein de l’Union européenne comme du G 20. Il ne saurait être question d’apporter dans le présent rapport une quelconque appréciation sur l’état de ces négociations, toujours en cours. Rappelons simplement que la première réponse à la crise de liquidités induite par la faillite de Lehman Brothers a consisté à augmenter le plafond des dettes publiques, déplaçant un problème qui provenait du secteur bancaire vers la sphère publique. La crise financière est désormais un problème de dettes souveraines qui menace de se transformer en une crise politique de grande ampleur. Les Etats et les banques centrales sont désormais en première ligne. La réunion du G 20 de Pittsburgh (septembre 2009) n’a guère apporté de réponse collective, en dehors d'un mécanisme de surveillance macroéconomique collective; celle de Séoul (novembre 2010) a débouché sur deux grandes décisions : d’une part l’adoption des normes Bâle III sur la qualité du capital des banques, mais sans exiger d’augmentation de capital pour les principaux établissements, d’autre part la réforme du FMI pour tenir compte du poids des pays émergents. Aucune mesure sérieuse n’a en revanche été prise pour réformer les marchés financiers, dossier sur lequel Washington et Bruxelles ne parviennent pas à se mettre d’accord en raison du travail de lobbying de nombreux acteurs de marché.
Malgré des appels incessants, de la part de responsables politiques et d’analystes des relations internationales, à des formes de gouvernance mondiale, les Etats ne parviennent que trop lentement à mettre en place une société politique apte à tirer les conséquences de la globalisation… La complexité du monde et l’interaction de multiples opérateurs en sont les principales raisons. Ce retard risque de placer les gouvernements en situation de décalage par rapport au reste de la société qui, de son côté, s’adapte pragmatiquement aux exigences de notre temps.
C – L’influence, arme des vecteurs privés sur la scène internationale
La question de l’influence en politique préoccupe depuis longtemps les observateurs car elle renvoie aux imperfections de nos sociétés. « Si le pouvoir politique se résumait au principe d'autorité - théoriquement émanant du peuple dans nos démocraties - la norme élaborée par le législateur et appliquée par l'exécutif réglerait toutes les affaires relevant de l'ordre public et il n'y aurait pas de place pour les réseaux, les trafics d'influence, les groupes de pression, les campagnes médiatiques, de communication politique, etc…
Si le système économique fonctionnait selon les pures lois du marché et de l'utilité, il n'y aurait pas non plus d'espace pour la négociation, le lobbying, les effets de mode, le formatage du marché par les producteurs (notamment par la publicité et les habitudes de consommation)...
Si le pouvoir culturel au sens large ne reposait que sur la compétence reconnue de ceux qui l'exercent et sur le respect des critères moraux, esthétiques ou intellectuels établis, il n'y aurait pas de minorités actives, de changements, de débats...
Même le pouvoir militaire (au sens clausewitzien d'une violence utilisée pour faire céder la volonté politique d'un adversaire) doit, en ces temps de guerres asymétriques, faire de la place aux opérations d'influence, à la « diplomatie publique » et à divers autres procédés à la fois pour faire diminuer l'hostilité de populations susceptibles de soutenir une rébellion et pour « vendre » la guerre aux opinions publiques » (François-Bernard Huygue) (5).
En politique internationale, domaine d’élection du rapport de force, y compris lorsqu’il s’agit d’élaborer le droit, l’influence constitue un élément de la stratégie des Etats comme des entités privées, mais elle ne revêt pas pour eux la même importance. Elle est pour les Etats un élément parmi d’autres de leur politique étrangère. Pour les personnes privées, elle constitue le levier essentiel de l’action internationale car ces personnes ne disposent pas des moyens des Etats. Le résultat est parfois paradoxal : si les résultats qu’obtiennent les Etats sont en règle générale fonction des facteurs de leur puissance, ceux des entités privées peuvent être largement supérieurs à l’autorité légale dont ils disposent ou à leur puissance matérielle. Là est la différence, qui établit ainsi un surprenant pouvoir des mots, des idées, des concepts, capable selon les circonstance de s’opposer aux Etats – l’influence étant alors un élément de contre-pouvoir – ou de les accompagner dans l’action politique.
1. Essai de définition de l’influence et des méthodes en usage
L’influence peut être définie comme un ensemble de méthodes qui permettent d’atteindre un objectif sans menace ni violence, sans non plus de négociation, qui exigerait une contrepartie. Il s’agit de créer à court ou long terme un climat favorable conduisant votre interlocuteur à adopter naturellement votre position.
Elle est à ce titre une arme de pouvoir, même si elle est rarement perçue comme telle en raison de sa distance par rapport aux méthodes classiques que sont l’obéissance, la soumission, la crainte, la terreur, l’intérêt ou le compromis. Elle peut résulter d’une politique volontariste conduite par une personne publique ou privée, ou être le produit d’une situation. Ses effets sont difficiles à évaluer et se constatent le plus souvent a posteriori. Une expérience dans une université étrangère peut ainsi imprégner profondément un futur responsable politique ou d’entreprise et susciter chez lui une sympathie envers le pays qui l’a accueilli.
L’influence est une action de longue haleine qui se construit le plus souvent à partir d’un faisceau d’instruments: travail d’image, dynamisme que projette une société, valeurs qu’elle porte, présence dans les forums de discussion… Mesurer la capacité d’influence n’est donc pas aisé, mais il est clair que sur la scène internationale, l’absence d’influence ou un déficit d’image pèsent gravement sur certains Etats, comme l’ont démontré deux tragiques évènements au début de 2010 : le tremblement de terre en Haïti et les inondations au Pakistan. Jouissant d’une aura favorable grâce à ses écrivains et ses peintres, Haïti a bénéficié de centaines de millions de dollars de dons en quelques jours, alors que le compte ouvert par le Croissant rouge pour le Pakistan n’a drainé que quelques milliers de dollars à travers le monde. La catastrophe humanitaire a pourtant touché plus de personnes au Pakistan (15 millions), qui ont perdu leurs proches, assisté à la destruction de leurs logements et vu leurs terres noyées.
La plupart des analystes travaillent sur les politiques d’influence des Etats en utilisant les termes de soft power et de smart power, que la langue française transforme en diplomatie publique. Peu d’entre eux définissent en revanche l’action des entités privées à l’échelle internationale, tant les situations sont diverses. Leur influence peut en effet chercher à s’exercer contre le pouvoir politique (campagnes contre la pêche à la baleine ou contre les essais nucléaires) ou ne pas tenir compte de ce pouvoir (actions caritatives, micro crédit ou micro développement, défense d’intérêts économiques) ou encore relayer la politique des Etats (conférences de laboratoires d’idées sur un thème précis, attraction universitaire). Les frontières entre personnes morales publiques et privées ne sont pas forcément étanches.
La difficulté de procéder à une synthèse provient de l’hétérogénéité et du nombre d’entités privées susceptibles d’agir à l’échelle internationale. Les fondations, les laboratoires d’idées, les secteurs industriel et agricole, le bloc des institutions financières (banques, assurances, fonds de pension, hedge funds, cabinets d’audit, organismes de définition des normes comptables), les ONG activistes ne partagent ni les mêmes valeurs, ni les mêmes objectifs… Certains agissent pour leurs seuls intérêts, d’autres pour défendre un idéal ou un objectif précis.
En revanche, les méthodes sont similaires et facilement identifiables. Elles nécessitent toutes le recours à des professionnels de la communication, car influencer est un métier qui fait appel à la palette de l’ensemble des sens et des émotions humaines. Deux d’entre elles relèvent de l’influence diffuse, tandis que trois concernent l’influence directe.
L’influence diffuse procède de la persuasion et du rayonnement. La persuasion est une technique qui est mise en œuvre très en amont dans un processus de décision. Il s’agit d’exprimer une idée, de la transformer en concept puis d’utiliser des vecteurs privés (laboratoires d’idées) ou publics (comme les assemblées parlementaires internationales) pour en faire un sujet de débat politique. L’exemple majeur de la persuasion en matière internationale est le dossier des missiles anti missiles, présenté par les Etats-Unis à leurs alliés de l’OTAN comme la réponse à une menace iranienne sur l’Europe, alors que cette menace est hypothétique. Le rayonnement relève pour sa part plus de l’image que d’une technique. Il émane de la culture, des technologies, des valeurs humaines, de la langue, de la puissance des industries audiovisuelles, de l’art de vivre, du prestige d’une civilisation ancienne, du poids des universités… Il mêle des éléments immatériels à des facteurs très concrets de puissance. Il peut être résumé comme la capacité d’une société entière à se projeter vers le reste du monde. Ainsi s’explique la capacité du Dalaï Lama à incarner le Tibet… Le rayonnement n’est donc pas obligatoirement une stratégie, mais l’exploitation intelligente par un Etat des éléments qui le composent constitue la soft diplomacy ou diplomatie publique.
L’influence directe est en premier lieu la prolongation de l’influence diffuse puisque le travail sur les idées s’accentue. La sémantique y prend une importance particulière car les mots, en politique, ont le sens que les utilisateurs leur donnent. L’un des exemples les plus éclairants d’un travail d’influence se trouve dans le concept d’armes de destruction massive (cf encadré).
L’évolution du concept d’armes de destruction massive
Le concept d’armes de destruction massive (ADM) est apparu à la suite de la guerre civile d’Espagne où se produisirent à plusieurs reprises des bombardements utilisant des quantités jusqu’alors inusitées d’armes conventionnelles, qui firent des milliers de victimes en quelques heures. Vannevar Bush (1890 – 1974) conseiller des présidents Roosevelt et Truman, le reprit au début de la guerre froide pour désigner exclusivement les armes nucléaires.
Après la première guerre du Golfe, des cercles proches du parti Républicain préconisaient une politique plus stricte à l’égard de l’Irak. Ils étaient notamment animés par Richard Perle et Franck Gaffney Jr, tous deux anciens assistants parlementaires du sénateur Henry Jackson. Tandis que Perle avait accédé à diverses fonctions au Département d’Etat, Gaffney était éditorialiste au Washington Times et avait créé en 1988 le Center for Security Policy, un laboratoire d’idées considéré comme d’obédience républicaine. Les attentats du 11 septembre 2001 furent le signal d’un durcissement de la politique américaine. Les concepts d’armes de destruction massive et d’Etats voyous apparurent dans le langage des cercles Républicains. De nombreux colloques sur ces thèmes furent organisés par des laboratoires d’idées fonctionnant en réseau, le Middle East Media Research Institute, l’Hudson Institute, le Washington Institute for Near East Policy, le Jewish Institute for National Security Affairs et le Center for Security Policy.
Dans l’esprit des Républicains, le concept devait désormais s’étendre aux armes chimiques et bactériologiques, mais aussi aux missiles qui pouvaient en démultiplier les effets. La raison en était la protection d’Israël, visée par des missiles à courte portée et à charge conventionnelle sous la première guerre du Golfe.
Cette vision a évidemment été contestée aux Etats-Unis comme en France. Dans notre pays, Georges Le Guelte, spécialiste reconnu des ADM et chercheur à l’IRIS, déclarait ainsi dès 2002 : « C’est un abus inacceptable de mettre toutes les armes non conventionnelles dans une même catégorie. Cela permet de faire croire qu’un groupe terroriste manipulant du chlore peut être aussi dangereux qu’un Etat ayant la bombe nucléaire. Il n’y a aucun rapport dans les moyens de se les procurer, de les fabriquer ou encore de s’en prémunir ». Dans cette guerre des idées, la vision des Républicains l’a rapidement emporté puisque dès 2003, les Etats-Unis déposèrent à l’ONU, avec le soutien de l’Espagne mais aussi de la France, une proposition devenue la résolution n° 1540 sur les ADM, dont la définition et le champ, incluant les vecteurs (missiles) sont entrés dans le droit international.
La rhétorique, les campagnes dans des média, les colloques, le recours aux leaders d’opinion et l’ensemble des techniques mises à jour par la psychologie sociale peuvent être utilisés à des fins d’influence, mais elles ne peuvent fonctionner que sur la base de la sémantique.
L’influence directe résulte également d’un travail encore plus subtil que la sémantique, qui porte sur l’environnement intellectuel ou les références dans lesquels évoluent décideurs et acteurs. Accepter les normes comptables IFRS revient à valider l’idée qu’une entreprise a principalement une valeur de marché et à renoncer à une vision sociale de l’entreprise. Or cette idée entre progressivement en vigueur après un travail de 30 ans conduit par un organisme privé qui fixe les normes comptables (IASC, cf III). L’action sur le droit ou la fixation des normes est l’un des principaux vecteurs d’influence des acteurs privés car il formate littéralement les modes d’action. Le droit n’a en effet rien d’abstrait : il reflète une philosophie de la société à partir de laquelle différentes dispositions sont déclinées.
L’accès direct aux canaux du pouvoir comme à ceux de la communication constituent le degré d’influence le plus élevé. Lorsque la United Fruit (aujourd’hui Chiquita Brands International) avait comme actionnaire John Foster Dulles, secrétaire d’Etat du Président Eisenhower et frère du directeur de la CIA, il lui était facile de persuader la célèbre agence de fomenter un coup d’Etat (1954) contre le Président du Guatemala Jacobo Arbenz, dont la politique foncière lésait ses intérêts. La firme Halliburton a bénéficié dans les années 60 de ses liens avec Lyndon Johnson pour être le premier fournisseur d’infrastructure militaire au Vietnam, récoltant 400 millions de dollars de bénéfices. Elle a renouvelé l’opération en Irak dans les années 2000, puisque le vice-président des Etats-Unis, Richard Cheney, avait été membre de son conseil d’administration.
Les liens entre Etats et entreprises ont des racines très anciennes dans l’histoire. La colonisation des royaumes de l’Inde, puis de l’archipel indonésien relevait ainsi d’initiatives privées. Ces liens se sont intensifiés avec la place prise par l’économie et la finance dans les sociétés contemporaines et ont sans doute atteint une densité rarement observée auparavant. En politique internationale, la question qui est posée est celle de leur capacité à orienter l’action en fonction de leurs intérêts. Le Président Eisenhower avait bien perçu le danger pour les Etats-Unis d’un complexe militaro-industriel trop puissant. Il avait en effet amorcé une réduction des dépenses militaires au moment où les Soviétiques avaient lancé le satellite Spoutnik, le 4 octobre 1957. L’administration avait rapidement réagi en présentant au Président, dès le 7 novembre, le rapport Gaither, qui préconisait un effort de 20 milliards de dollars pour rattraper le retard technologique sur l’URSS. Cette somme était énorme pour l’époque, et Eisenhower fut irrité de constater que les auteurs réels du rapport étaient les entreprises qui allaient bénéficier du programme. Il s’éleva également contre l’influence des magazines Aviation Week et Air Force magazine, généralement hostiles à toute réduction des programmes militaires et pour lesquels la ligne éditoriale se résumait à une équation simple : de plus grandes menaces signifiaient des contrats publicitaires plus nombreux. Prenant la mesure d’une logique commerciale sans lien avec l’intérêt du pays, Eisenhower mit en garde les Américains dans son discours de fin de mandat, le 17 janvier 1961 : « Cette conjonction entre un establishment militaire et une importante industrie privée de l’armement est une nouveauté dans l’histoire américaine. Nous ne pouvons ignorer, ni omettre de comprendre la gravité des conséquences d’un tel développement. Nous devons nous prémunir contre l’influence illégitime que le complexe militaro-industriel tente d’acquérir, ouvertement ou de manière cachée ».
La maîtrise des média est un moyen d’influence directe, mais dans des sociétés de liberté où s’expriment des opinions contradictoires, elle vaut moins pour les idées qui sont diffusées que pour la capacité de lancer des débats, de retenir des thèmes qui feront polémique et de présenter une vision du monde. C’est dans cette optique que sont apparues les chaînes d’information continue, dont les plus influentes sont multilingues. Si plusieurs sont sous statut public (BBC International, France 24, Deutsche Welle) et servent une stratégie gouvernementale, d’autres sont privées (CNN, Fox International, Bloomberg) et procèdent à une véritable mise en scène de l’actualité en fonction de leur public et de leurs annonceurs publicitaires. La différence de traitement par CNN et Al Jazeera de la révolution égyptienne est significative. Soucieuse de satisfaire un public généralement pro israélien, CNN a analysé les manifestations du Caire sous l’angle de la sécurité d’Israël, interrogeant systématiquement experts et invités sur ce thème. Ce dernier était quasiment absent de la couverture des évènements par Al Jazeera, qui s’efforçait de relever l’état des opinions dans les pays arabes.
2. Typologie des vecteurs privés d’influence
L’on peut classer les vecteurs privés d’influence selon deux logiques : selon leur statut juridique ou selon leur objet :
– selon leur statut juridique : les vecteurs privés peuvent être des entreprises voulant façonner le monde au mieux de leurs affaires. Ils peuvent être à but non lucratif, mais cette catégorie, souvent désignée sous le vocable d’ONG regroupe plusieurs réalités, allant de l’association française ressortant de la loi de 1901 aux fondations de droit américain au sein desquelles certaines fonctions sont rémunérées ;
– selon leur objet : les vecteurs d’influence sont le plus souvent des laboratoires d’idées, des ONG activistes, des universités, des groupes de pression (ou lobbies) et des entreprises.
Les laboratoires d’idées ont pour objet de rechercher des idées pouvant trouver une application pratique en politique. Ils se distinguent des universités qui se limitent théoriquement à la recherche académique (la réalité est naturellement plus complexe). Ils tirent leur réputation de l’excellence qu’on leur attribue et de la qualité de leurs publications. Ils sont théoriquement indépendants de toute affiliation politique mais certains n’hésitent pas à affirmer leur attachement à une famille idéologique. Outre leur rôle d’interface entre la politique et le monde intellectuel et universitaire, leur rôle est de promouvoir leurs idées par des colloques et publications, d’où la recherche permanente de financements.
Les ONG activistes défendent des causes. Leur champ embrasse l’ensemble des activités d’une société, des causes humanitaires à la défense de l’environnement. Elles peuvent aussi bien constituer des forces de protestation comme de proposition, ce qui les conduit à travailler contre ou avec des gouvernements, ou ne pas en tenir compte.
Les universités relèvent de statuts publics ou privés selon les pays où elles sont implantées. Elles constituent des vecteurs d’influence par le seul fait des valeurs et des enseignements qu’elles délivrent aux élites du futur, selon l’expression consacrée.
Les lobbies (6) ou groupes de pression peuvent être des fondations, des ONG ou des entreprises qui agissent pour influer sur la marche du monde selon leur vision. Il peut également s’agir de cabinets qui travaillent pour le compte d’autrui, y compris de gouvernements. Leur force provient de leur capacité à identifier les décideurs politiques ainsi que leurs collaborateurs, afin d'orienter les décisions des dirigeants dans le sens souhaité par leurs mandants.
Les entreprises agissent pour leur intérêt propre. Ce dernier, en politique internationale peut coïncider avec l’intérêt des Etats ou s’y opposer. Mais au-delà de ce diptyque classique, la tendance qui se dégage des deux dernières décennies est la propension des grandes entreprises à façonner un environnement sans Etat.
L’influence diffuse procède, comme nous l’avons précédemment écrit, de la persuasion et du rayonnement. Elle suppose d’agir en amont des décisions, sur les idées et les personnes, puis en aval sur les structures qui peuvent relayer les idées. Elle exige un travail sur le long terme.
Elle constitue un élément de politique étrangère pour les Etats qui opèrent le constat qu’à côté des facteurs classiques de la puissance (militaires, financiers) existent d’autres moyens, souvent moins coûteux. Partant du principe que l’action politique a pour objet de mettre en œuvre des idées, agir sur ces dernières et sur les concepts dont elles sont issues, et plus encore sur les personnes qui les portent est le meilleur moyen d’obtenir gain de cause.
En matière internationale, les laboratoires d’idées et les universités sont les vecteurs les plus importants de l’influence diffuse. Mais internet et les réseaux sociaux jouent un rôle croissant, tant pour le secteur privé que pour les Etats qui cherchent à comprendre les enjeux de ce nouvel espace de débat.
A – La diffusion des idées : fondations et laboratoires d’idées
Il existe environ 5000 fondations, laboratoires d’idées ou associations à travers le monde dont l’objet est de nourrir les réflexions politiques. Leur terre d’élection se trouve pour des raisons historiques aux Etats-Unis, mais ces entités ont connu depuis le début des années 90 un développement notable en Europe, où leur nombre avoisine le millier. Le phénomène se développe également en Asie. Largement étudié par les chercheurs en sciences politiques (cf bibliographie en annexe), il met en lumière l’irruption de nouveaux protagonistes sur la scène politique.
Tous n’agissent pas à l’échelle internationale, mais les travaux de certains d’entre eux ont un réel écho et ils constituent souvent le vivier intellectuel de nombreuses personnalités politiques. « Ce que vous faites dans le gouvernement, c’est dépenser le capital intellectuel que vous avez amassé hors du gouvernement » (Henry Kissinger).
1. Un concept essentiellement nord américain
L’idée que la réflexion politique ne relève pas seulement des partis, des personnes au pouvoir et des administrations qui les assistent, ou encore des philosophes est profondément enracinée dans la mentalité américaine. Les laboratoires d’idées font partie intégrante d’une société qui n’établit ni de séparation entre classe politique et société civile, ni de distance entre politique intérieure et affaires étrangères, en raison d’un processus historique qui remonte au XVIIème siècle.
a) Le rapport entre société et politique sous l’histoire coloniale américaine
De novembre 1620, date de l’arrivée du Mayflower, à 1681, année pendant laquelle William Penn reçut de Charles II la Charte établissant la Colonie de Pennsylvanie, les colons anglais d’Amérique ont fondé une société sans Etat. Ils étaient théoriquement soumis aux lois anglaises, mais ces dernières ne résolvaient aucun des problèmes pratiques auxquels ils devaient faire face : défrichage de la terre, relations avec les tribus indiennes, coexistence de sectes religieuses, éducation, mariage, vie sociale, actes de propriété foncière…
Cette période de soixante ans est fondamentale pour comprendre la société américaine. Dans un milieu où l’environnement fut au départ hostile et qui fut marqué par une forte natalité, tout homme devait être capable d’exercer plusieurs métiers : agriculteur, bâtisseur, artisan, mais également homme de loi, s’il savait lire et que la société jugeait qu’il avait des capacités de raisonnement nécessaire à cette fonction. Les lawyers eurent rapidement comme fonction principale de délimiter les propriétés et d’enregistrer les actes civils. A la différence de l’Angleterre où les juristes défendaient bec et ongles leurs monopoles au travers des inns of courts et high courts, les fonctions juridiques dans les treize colonies n’étaient pas réglementées. Plusieurs systèmes coexistèrent. Ainsi, les planteurs de Virginie préférèrent régler eux-mêmes leurs problèmes. A Massachussets Bay, c’est le clergé puritain qui réglementa les procédures. En Pennsylvanie, les Quakers jugèrent qu’il valait mieux recourir à des médiateurs que de passer par des procès.
Les conséquences de ces choix imprègnent toujours la société américaine :
– elle fonctionne en vertu de contrats plutôt qu’en application de lois ; ces dernières ne sont votées que si la société est incapable de s’organiser par elle-même ;
– les citoyens ont pris très tôt l’habitude de s’organiser pour défendre leurs intérêts ; leurs organisations sont devenues les lieux de réflexion sur l’évolution de leur société ; l’on peut à ce titre considérer que la première association qui a eu une influence internationale fut la Pennsylvania society for promoting the abolition of slavery, fondée en 1776, qui militait en faveur de l’abolition de l’esclavage et qui conduisit des campagnes dans tous les pays impliqués dans le commerce triangulaire; elle eut des relais en Grande Bretagne en 1787, ainsi qu’en France, en 1788, quand fut créée la Société des Amis des Noirs (cf I du présent rapport) ;
– pour éviter d’être opprimés comme ils l’avaient été en Angleterre, les colons américains ont rejeté tout monopole des hommes de loi pour mieux s’approprier le droit. Edmond Burke (1729 – 1797), dans son discours de réconciliation avec l’Amérique, avait bien noté que « la commune connaissance des Américains de leurs droits légaux » était liée à leur irrépressible désir de liberté ;
– droit et politique se sont rapidement confondus puisque le pays n’eut pas d’élus dans les premières décennies d’implantation des colons. La physique, la morale, la rhétorique, la médecine, la religion étaient considérées comme des matières qui favorisaient la compréhension du droit coutumier et ce dernier n’avait pas pour objet de former des juges ou des avocats (ces professions n’étaient pratiquées que par un petit nombre) mais à préparer les citoyens « à devenir utiles pour la société » (Ezra Stiles, fondateur de la chaire de droit à Yale, 1778).
Lorsque les treize colonies sont devenues les Etats-Unis, cette conception d’une forte autonomie de la société a perduré. Elle explique pourquoi les partis politiques américains sont essentiellement des plates-formes électorales au service de leurs candidats, renvoyant aux églises, aux universités puis ultérieurement aux diverses organisations sociales (fondations notamment) le soin de conduire les réflexions doctrinales. Ces dernières ont initialement travaillé sur les problèmes intérieurs américains mais lorsque les Etats-Unis ont commencé à jouer un rôle sur la scène internationale, aucun citoyen, aucune fondation n’a ressenti de réserve à s’exprimer sur les questions diplomatiques. Si l’on garde à l’esprit que l’universalisme professé par les Quakers au XVIIIème siècle (pour lesquels la colonisation de l’Amérique était avant tout une quête de perfection spirituelle) a profondément marqué les Etats-Unis, il est aisé de comprendre que des entités privées, sensibles à ce messianisme, aient souhaité utiliser leurs premières associations, puis les fondations pour projeter à l’extérieur les valeurs américaines. Intervenir en politique extérieure est naturel pour les fondations américaines, à la différence des Européens et des Asiatiques qui ont longtemps considéré qu’il s’agissait d’une affaire relevant des souverains, des diplomates et des militaires.
b) De l’isolationnisme à l’interventionnisme : la confrontation des conceptions américaines en politique étrangère au travers des laboratoires d’idées
L’annexe 1 du présent rapport rappelle le régime fiscal dont bénéficient les fondations (les laboratoires d’idées ont en général ce statut) aux Etats-Unis, qui leur donne des moyens d’action et d’expertise considérables.
Il existe plusieurs définitions des laboratoires d’idées. La plus communément admise est celle d’organes se livrant à la recherche sur des questions publiques afin de proposer des solutions. Ils souhaitent donc influencer les décisions politiques en fonction de leurs analyses ou de leur conception du monde. Washington est leur lieu d’élection, puisque 1500 d’entre eux y ont leur siège. Toutes les grandes institutions qui réfléchissent à la politique étrangère y sont établies, de la Brookings au CSIS en passant par Carnegie, à l’exception notable du Council on Foreign Relations (New York) et de la Rand Corporation (Santa Monica / Los Angeles).
Ces laboratoires d’idées sont-ils de réels vecteurs d’influence, et dans l’affirmative, par quels canaux leurs idées deviennent-elles des éléments de la politique étrangère américaine ?
Il peut être répondu par l’affirmative à la première question, pour des raisons sociologiques. A l’inverse de pays comme la France, le Japon, l’Allemagne ou le Royaume-Uni, les Etats-Unis ne disposent pas de corps de hauts fonctionnaires formés dans des écoles spécialisées, et ils pratiquent la relève massive du personnel de l’administration d’Etat en cas d’alternance. Ce sont des milliers de collaborateurs qu’il faut recruter dans la période de transition. Les laboratoires d’idées assument alors, de pair avec les grandes universités, la fonction de réservoirs de spécialistes. Leurs capacités sont en outre enrichies avec le retour en leur sein des personnes des personnes qui quittent le pouvoir et qui apportent à la réflexion théorique leur expérience professionnelle. Ces allers et retours entre les fonctions gouvernementales et expertise dans une fondation sont fréquents.
L’influence des laboratoires d’idées provient également de leur rôle de forum où règne une liberté de parole d’autant plus grande que certains débats sont confidentiels. Membres du gouvernements, chercheurs, protagonistes politiques peuvent s’exprimer sans crainte, fourbir des arguments qu’ils lanceront dans les enceintes internationales. Carnegie a ainsi rassemblé pendant huit ans, à partir de 1980, les partis politiques sud africains pour préparer l’abolition de l’apartheid. Le CSIS a travaillé sur la résolution des conflits ethniques dans l’ex Yougoslavie et pour le rapprochement entre la Grèce et la Turquie. Plus récemment, le Council on Foreign Relations a émis l’idée d’une entrée de la Russie dans l’OTAN…
Le canal par lequel une idée devient une politique est éminemment humain. Si les fondations et laboratoires d’idées organisent des colloques, des journées d’études ou identifient des personnalités d’avenir, c’est dans l’espoir que se trouveront parmi leur public les décideurs politiques.
Le marché des idées : la répartition idéologique des laboratoires d’idées américains
L’annexe 2 du présent rapport livre la liste des laboratoires d’idées américains les plus importants en matière de politique étrangère, selon le classement de l’université de Philadelphie, qui travaille depuis des années sur ce sujet. Les spécialistes de la scène washingtonienne y reconnaîtront des fondations de différentes obédiences. Reflet d’une société de liberté, les laboratoires d’idées se répartissent en libéraux et centristes (proches du parti Démocrate), en conservateurs (proche des Républicains) et en libertariens (adeptes de la liberté économique absolue et hostiles aux interventions militaires à l’étranger). Ils forment un marché des idées où circulent les principales conceptions politiques. En politique étrangère, les plus importants se répartissent ainsi :
Répartition idéologique des laboratoires d’idées de politique étrangère et de défense
Conservateurs |
Centristes |
Libertarien |
Heritage Foundation |
Brookings |
Cato Institute |
Hudson Institute |
Center for strategic and international studies (CSIS) |
|
Project of a New American Century |
Carnegie |
|
Peterson Institute for International Economics |
||
Council on Foreign relations |
Heritage Foundation prône les valeurs traditionnelles que sont la liberté individuelle, la libre entreprise et un Etat réduit. Il est partisan d’une défense nationale forte. Il est l’initiateur du concept de défense antimissile.
Hudson Institute combat en faveur du libre marché et indique avoir aidé les pays baltes à adopter ce type d’économie après la dislocation de l’URSS. Son action se tourne actuellement vers les pays arabes.
Project of a New American Century (PNAC), aujourd’hui disparu, était considéré comme le laboratoire d’idées responsable de la guerre d’Irak et des conceptions de politique étrangère de l’administration de George W. Bush (7).
Créé par les frères Koch, magnats du pétrole, Cato Institute se considère comme un laboratoire d’idées libertarien. Dans le vocabulaire américain, cela signifie qu’il s’oppose à l’intervention de l’Etat, à la législation environnementale et aux impôts. C’est donc en toute logique que Cato milite actuellement pour la diminution drastique des dépenses militaires et pour le retrait des troupes américaines en Afghanistan, ce qui le distingue des autres laboratoires d’idées conservateurs. Ses idées sont appréciées par les Républicains proches du mouvement tea party et pourraient avoir dans un proche avenir une grande portée si le débat budgétaire devait se focaliser sur la réduction des dépenses militaires.
Fondé en 1927, Brookings est un des plus prestigieux laboratoires d’idées. Il se proclame sans attache partisane, même s’il a fourni de nombreux collaborateurs aux administrations des Présidents Clinton et Obama.
Le CSIS, apparu dans les années 60, dispose d’une audience considérable, grâce à des collaborateurs travaillant dans le monde entier. Il organise de nombreuses conférences aux Etats-Unis, en Asie et dans le Golfe persique. Les plus grands noms de la diplomatie américaine y ont publié des études.
Carnegie Endowment for International Peace dispose de moyens considérables grâce à la dotation initiale d’Andrew Carnegie, en 1910, complétée depuis par de nombreux dons. La fondation entretient des bureaux à Beyrouth, Moscou, Bruxelles et Pékin, attirant ainsi un large public non américain. Son principal combat est l’opposition aux armes nucléaires, posture pacifiste qui conforte le leadership américain compte tenu de la force des Etats-Unis dans le domaine conventionnel.
Peterson Institute fait travailler des chercheurs sur les questions économiques internationales. Il indique fournir des études et des idées pour le FMI, l’OMC ou encore l’ALENA. Il compte parmi son conseil d’administration MM. Jean-Claude Trichet, gouverneur de la Banque centrale européenne et Alain Greenspan, ancien Président de la Réserve fédérale.
Le Council on Foreign Relations, fondé en 1921 par des universitaires qui avaient initialement reçu de Woodrow Wilson mission de le conseiller sur sa politique à l’égard de l’Allemagne, s’assigne le rôle de faire connaître au monde la politique et les valeurs américaines. Il compte quasiment l’ensemble du corps diplomatique américain et les plus prestigieux penseurs en politique étrangère parmi ses contributeurs et chercheurs, ce qui en fait un lieu important de conception d’idées. Situé à New York, il organise chaque année dans ses locaux des colloques avec des chefs d’Etat et des ministres lors de l’Assemblée générale des Nations Unies. Il publie la revue Foreign Affairs, diffusée mondialement.
Ce bref panorama montre que les laboratoires d’idées se rattachent à l’ensemble des familles politiques américaines. Les idées qu’ils formulent sont en compétition mais grâce à leur rayonnement, certaines sont susceptibles d’être reprises si leurs membres accèdent à des responsabilités au Congrès ou dans l’administration.
Conquérir les esprits pour préparer les décisions
Le rôle des laboratoires d’idées est celui qu’eux-mêmes s’assignent puisqu’il s’agit d’organismes privés. Les sociologues américains les répartissent généralement en trois catégories :
– les laboratoires d’idées universitaires (même s’ils ne se rattachent à aucune université), qui se définissent comme non inféodés aux partis Démocrate ou Républicain. Cette neutralité politique ne les empêche pas de proposer des solutions à des questions politiques ;
– les laboratoires d’idées partisans (dits advocacies) affichent clairement leur attachement à un parti (Center for American Progress chez les Démocrates, Heritage chez les Républicains) ou à une cause précise. L’exemple le plus marquant en politique étrangère est l’AIPAC, qui œuvre en faveur de liens étroits entre les Etats-Unis et Israël et dont le dîner annuel réunit les plus importantes personnalités américaines ;
– les instituts de recherche, qui instruisent des dossiers ou préparent des décisions pour le compte de gouvernements ou de très grandes entreprises ; le plus important est la Rand Corporation, basée à Santa Monica, qui dispose d’un budget annuel de 250 millions de dollars et de 1 700 collaborateurs. Actuellement dirigée par James Thomson, qui a travaillé au Département de la Défense et à la Présidence des Etats-Unis, la Rand compte entre autre parmi ses membres Condoleeza Rice, Richard Cheney, Donald Rumsfeld, Jean-Louis Bruguière, Francis Fukuyama, Pascal Lamy, Constantin Melnik, Robert Hunter… Le conseil d’administration est en quelque sorte un condensé des mondes économique, diplomatique et militaire. La Rand œuvre sur tous les sujets qui lui sont commandés, comme, par exemple, le mécanisme de mise en place d’un Etat palestinien… Elle a conseillé le gouvernement américain sur la stratégie d’élargissement de l’OTAN dans les années 90 et travaille actuellement, entre autre, sur la lutte contre le terrorisme.
La plupart ont en commun un objectif d’influence que ne cache d’ailleurs aucun de leurs membres. Dans des sociétés modernes marquées par l’abondance des moyens de communication, faire circuler des idées ne suffit pas. Si les laboratoires d’idées se limitaient à cette mission, ils ne se distingueraient pas d’une bibliothèque ou d’une base de donnée. Google joue ce rôle et n’est en aucun cas un vecteur d’influence. Leur but est d’orienter les idées dans un sens précis, d’apporter des solutions à des problèmes publics et de convaincre l’opinion de leur justesse. Leur action de conquête des esprits s’effectue sur le long terme. « Asseoir les fondations qui permettront le changement de politique nécessaire quand les problèmes émergeront et qu’il sera temps d’agir », telle est par exemple la mission de la fondation Carnegie.
La communication est en conséquence au cœur de l’activité des laboratoires d’idées. Faire connaître les idées, les publier, les positionner dans des moteurs de recherche est primordial dès lors qu’est recherché un impact politique à court ou moyen terme. Les méthodes des laboratoires d’idées embrassent la totalité des techniques de communication courantes : revues, lettres électroniques, mais aussi repas thématiques avec des personnalités sélectionnées et avec des journalistes, qui à leur tour solliciteront le laboratoire d’idées qui les a invités… Les colloques et débats sont l’occasion de réunir un public de décideurs soigneusement sélectionné. Le Royal Institute of International Affairs, plus connu sous le nom de Chatham House, a ainsi acquis une position de référence dans ce domaine puisque ses règles de confidentialité (les célèbres Chatham House Rules) permettent une libre expression, lors des 150 réunions qu’il organise annuellement à Londres sur les sujets les plus difficiles de politique étrangère. Le CSIS, Carnegie, le Council on Foreign Relations recourent largement aux colloques car leur prestige et leur budget leur permettent d’attirer les personnalités les plus connues. L’objectif est à chaque fois de créer un environnement favorable à des idées ou à des solutions politiques.
Parallèlement à la communication, les laboratoires d’idées investissent de plus en plus souvent dans la formation de personnalités d’avenir ou de personnels politiques déjà en poste. Ces derniers formeront des relais efficaces en cas d’accession au pouvoir. Les laboratoires d’idées conservateurs américains, comme l’American Enterprise Institute (AEI) ont ainsi été très efficaces pour combattre les idées fiscales des Démocrates, mais aussi, à l’échelle internationale, pour former les nouvelles élites politiques qui ont accédé au pouvoir dans les pays de l’Est de l’Europe, à la chute du rideau de fer. Le travail idéologique effectué pour les convaincre d’adopter l’économie de marché avait pour objectif de préparer l’implantation d’entreprises américaines.
Enfin, dans certains pays, les règles de fonctionnement du gouvernement ou du Parlement autorisent le recours à des études élaborées par d’autres instances que les services administratifs. C’est le cas du Congrès des Etats-Unis, de la Chambre des Communes britannique et du Parlement européen. Dans ces trois cas, les laboratoires d’idées américains et la Chatham House sont en position dominante pour alimenter les parlementaires en idées et propositions.
Il est difficile de mesurer le degré d’influence réel d’un laboratoire d’idées. De l’aveu même de leurs dirigeants, l’impact est parfois sur le long terme, à vingt ans. Il existe néanmoins des cas précis : le déclenchement de la deuxième guerre en Irak doit beaucoup aux travaux du Project for a new american century (PNAC). L’AEI a œuvré pour le renforcement du contingent américain en Irak. Carnegie a travaillé sur le mécanisme de sortie de l’apartheid en recevant discrètement les personnalités au pouvoir et celles de l’opposition. La plupart des laboratoires d’idées sont en réalité très modestes sur leur pouvoir réel, considérant que leurs travaux sont en concurrence avec les études d’autres laboratoires d’idées.
c) De la philanthropie comme idéologie à l’idéologie de domination, l’évolution des laboratoires d’idées américains en politique étrangère
Il n’y a rien de commun entre les fondations Carnegie ou Ford, pour qui le progrès humain était la condition de la paix, et le PNAC, qui a prôné la guerre en Irak au nom d’une menace supposée pour la sécurité des Etats-Unis. Mais leur histoire résume l’évolution des laboratoires d’idées américains en politique étrangère.
L’idéal américain comme projet universaliste
L’intervention de fondations et laboratoires d’idées dans le domaine si particulier de la politique étrangère provient de la foi de la société américaine en elle-même, au début du XXème siècle. Toute une presse, toute une littérature affichaient leur optimisme sur le dynamisme de cette jeune nation, à l’orée de sa puissance.
Cette foi a conduit plusieurs dirigeants de grandes entreprises à considérer que l’extension des valeurs américaines de liberté, de démocratie et de libre entreprise à l’échelle du monde serait la garante d’une paix universelle, gage d’un climat favorable à leurs affaires. L’idéal américain étendu à l’ensemble du monde est ainsi devenu un projet universaliste, dont les motivations idéologiques ou pratiques n’ont guère varié depuis un siècle. L’objectif de George W. Bush de modeler un Moyen-Orient démocratique à partir du domino irakien résultait du même raisonnement. Seul le moyen différait…
C’est en 1910 qu’a été instituée la première grande fondation, Carnegie Endowment for International Peace (dotation Carnegie pour la paix internationale) financée par le magnat de l’acier. Elle a rapidement ouvert une seconde antenne en Europe où les tensions annonçant la première guerre mondiale devenaient de plus en plus fortes. Son objectif initial était de promouvoir l’arbitrage entre les Etats pour éviter qu’ils recourent à la guerre, ce qui l’a conduit à agir en faveur de l’émergence d’un droit international public. Carnegie a ainsi mené des actions de lobbying auprès des gouvernements, des universitaires, de l’opinion publique et a financé la construction du Palais de la Paix à La Haye, devenu le siège de la Cour permanente de justice internationale en 1921. La fondation n’a cessé de se développer depuis 1910, avec cinq bureaux à travers le monde. Elle dispose ainsi d’une impressionnante base de données sur les questions de prolifération, devenues le cœur de son activité.
La fondation Rockfeller, créée en 1913, joue un rôle moindre que Carnegie dans les relations diplomatiques, mais elle a beaucoup œuvré en faveur des sciences exactes et sociales en finançant des universités et des laboratoires de recherche, dans l’espoir que les progrès du savoir humain permettraient de gouverner rationnellement les sociétés.
La fondation Ford, qui date de 1936, a pris son essor en 1950 sur les questions internationales afin de combattre le communisme. Sa méthode a consisté à donner une image positive des Etats-Unis par le financement, à travers le monde, de multiples recherches en sciences sociales, partant du principe qu’il fallait développer des idées concurrentes du marxisme. C’est dans cette logique qu’elle a co-financé avec la fondation Open Society de George Soros la reprise des activités de la Fondation pour l’entraide intellectuelle en Europe (un temps contrôlée par la CIA), qui soutenait sous la guerre froide les écrivains et artistes d’Europe de l’Est. Depuis la chute du mur de Berlin, la fondation a réorienté une part de ses activités sur l’amélioration des conditions de vie des plus déshérités, aux Etats-Unis et en Amérique latine, ainsi que sur l’environnement. Elle a également discrètement soutenu les actions de sortie de l’apartheid en Afrique du Sud.
Le professeur Ludovic Tournès, qui vient de consacrer un ouvrage sur les fondations américaines entre les deux guerres (cf bibliographie) rappelle que « toutes ces fondations possèdent, au-delà de leurs projets spécifiques, des points communs qui permettent de dessiner les contours de la diplomatie philanthropique qui a émergé au début du XXème siècle. Celle-ci n’est pas toujours aisée à définir, les fondations cumulant à des degrés divers au moins trois fonctions : celle de laboratoire d’idées, celle d’agence opérative, celle de groupe de pression. Mais il se dégage de l’examen de leur politique sur le long terme des permanences qui permettent de la qualifier de diplomatie intellectuelle transnationale. Les politiques des grandes fondations partagent en effet quatre points communs majeurs :
– la volonté d’assurer la promotion d’un modèle de société fondée sur la libre entreprise, la paix et la démocratie telle qu’elle s’est constituée aux Etats-Unis depuis la fin du XVIIIème siècle. Les fondations apparaissent comme des lieux d’élaboration intellectuelle d’un triptyque paix-démocratie-marché dont la thésaurisation remonte à Adam Smith, mais qui est devenu un axe structurant de la diplomatie américaine à partir de la fin du XIXème siècle ;
– le deuxième point commun… est leur stratégie opérationnelle, laquelle consiste à s’appuyer sur les élites du savoir, considérées comme le vecteur principal du changement et du progrès ;
– leur volonté d’agir à l’échelle du monde en mettant en place de programmes hors des Etats-Unis, sur tous les continents ;
– enfin, la quatrième constante est d’agir en complémentarité avec la diplomatie officielle de l’Etat américain » , mais elles conservent un degré d’autonomie appréciable grâce à leurs moyens financiers. Disposant de capacités d’expertise souvent supérieures à l’Etat, elles agissent comme bon leur semble, parfois en coordination avec l’Etat, parfois indépendamment, « la ligne rouge qu’elles ne franchissent jamais est celle de l’intérêt national américain, dont elles se font une haute idée ».
Cette proximité entre les fondations ou les laboratoires d’idées apparus après guerre avec l’Etat américain fait souvent douter un esprit européen de l’indépendance desdites fondations, soupçonnées d’être un prolongement du Département d’Etat et de la CIA. Le soupçon est sans doute fondé, il faut juste y apporter des preuves tangibles.... La proximité est en revanche naturelle pour les Américains qui évoluent dans une société où les carrières politiques sont courtes, où l’Etat fédéral a moins de pouvoir qu’en France et où la fonction publique est faible. Que des entités privées cherchent à influencer les élus et les chancelleries, qu’elles décident d’elles-mêmes d’agir internationalement pour porter au monde les valeurs américaines n’a rien de choquant aux Etats-Unis. Le primat du secteur privé, la mystique de la réussite individuelle par le travail confèrent la légitimité d’agir en toute liberté, y compris dans des environnements différents des Etats-Unis. L’un des exemples les plus récents concerne la Fondation Soros for Open Society (1993), dont nous avons rencontré deux collaborateurs. Elle agit, entre autre, contre les discriminations, ce qui l’a conduit à mener diverses actions en France, par exemple en faveur des tsiganes. Cela pourrait porter à sourire aux pays des droits de l’Homme, mais la fondation vient de remporter un succès non négligeable en mobilisant un collectif d’avocats qui viennent de déposer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité sur les contrôles d’identité « au faciès ». Aucune organisation française n’avait songé à une telle action.
Imposer l’idéal américain a exigé un patient travail en réseau. L’influence diffuse dont jouissent les Etats-Unis actuellement dans le monde, mais surtout les exceptionnelles bases de données dont ils disposent sur l’ensemble des pays du monde, est le résultat d’une constante opiniâtreté de leurs laboratoires d’idées à cultiver leurs relations, ouvrir des bureaux et rendre accessibles leurs publications dont le prestige finit par attirer des chercheurs du monde entier. Carnegie finance des équipes à Washington, mais aussi à Moscou, Pékin et Beyrouth tandis que la Rand est présente dans les plus grandes villes américaines ainsi qu’à Bruxelles, Cambridge, Abou Dabi et Doha.
Le travail en réseau a un objectif : mettre les laboratoires d’idées au cœur des activités politiques et sociales américaines. La stratégie a été établie en toute conscience puisqu’elle a visé les deux pôles principaux des élites: l’administration fédérale et les universités. Les conseils d’administration des fondations Carnegie, Ford ou Rockfeller ont compté parmi leurs membres des Présidents des Etats-Unis, comme William Taft et des secrétaires d’Etat à la Défense, comme Dulles, Root ou Mc Namara. Ils ont également accueilli les universitaires les plus brillants (dont certains, comme Woodrow Wilson, ont ensuite fait une carrière politique) en finançant les programmes de recherche des universités les plus prestigieuses (Yale, MIT, Princeton, Harvard, Stanford…).
Cette stratégie a été déclinée à l’échelle internationale dès le début du XXème siècle. Approche des députés pacifistes français, des universitaires, des scientifiques célèbres, financement de la campagne d’éradication de la tuberculose en France en 1917, bourses d’études et développement des laboratoires d’université en Belgique (action conduite par le futur président Herbert Hoover), soutien aux commissions techniques de la Société des Nations (santé, organisation économique et financière) puis à l’ONU et à ses organes comme la FAO ou l’OMS, relations suivies avec des personnalités célèbres ou prometteuses comme Charles Rist, Jean Monnet, Jean-Marcel Jeanneney ou Raymond Aron, dont le centre de sociologie à l’Ecole pratique des Hautes Etudes a été subventionné par la Fondation Ford… Selon les pays, les fondations américaines ont pris l’initiative de projets ou se sont limitées à en être des partenaires, mais dans les deux cas, elles ont ainsi eu accès à des informations sur le fonctionnement des sociétés dans lesquelles elles intervenaient ainsi qu’à de nombreux cercles de pouvoir.
Ce type de stratégie a été repris après la chute du mur de Berlin par de très nombreux laboratoires d’idées américains dans les pays de l’Est pour y consolider la démocratie et assurer la transition vers l’économie de marché. La tâche leur était d’autant plus facile que les Etats-Unis y jouissaient d’un capital de sympathie supérieur à l’ensemble des pays européens. La CIA était pour les pays de l’Est le symbole de la lutte anti soviétique. En outre, ces pays n’avaient guère confiance en la France ou le Royaume-Uni, coupables de n’avoir pas su empêcher l’expansion hitlérienne, avec leur reculade à Munich en 1938. Les principaux vecteurs de l’influence américaine ont été le Program of Atlantic Security Studies (PASS), géré par l’Association pour les affaires internationales où siégeaient Madeleine Albright et Henry Kissinger, ainsi que Vaclav Havel ; l’Université américaine de Prague, le German Marshall Fund et la Fondation Soros Open Society ont également joué un rôle considérable. Avec le recul, les efforts américains n’ont sans doute pas été couronnés de succès dans le domaine économique, l’Europe centrale commerçant principalement avec le reste de l’Union européenne, mais ils ont permis aux Etats-Unis de remporter deux succès diplomatiques majeurs : l’adhésion des pays de l’Est à l’OTAN et la signature en 2003, à l’initiative d’Aleksandr Vondra, Vice-Premier ministre en charge des affaires européennes, de la « lettre des huit », par laquelle huit pays s’opposaient à la décision franco-allemande de ne pas s’engager en Irak. Pour mémoire, M. Vondra fut un dirigeant du PASS…
La compréhension du monde, la garantie de la sécurité américaine et l’idéologie de la domination
Les laboratoires d’idées américains ne se rattachent pas tous, loin s’en faut, à l’histoire de la philanthropie. Leur action épouse en fait les grandes étapes de l’affirmation des Etats-Unis comme puissance mondiale :
– comprendre le monde : à la charnière des XIXème et XXème siècles, rares étaient les dirigeants politiques américains qui avaient voyagé, à l’exception notable de Théodore Roosevelt. Des entités comme l’Institute for Government Research (créé en 1916, ancêtre de Brookings) ou comme The Inquiry (1921, devenu la même année le Council on Foreign Relations) eurent pour objectif de conseiller le Président Wilson pour préparer les conférences de l’après-guerre en Europe ;
– garantir la sécurité américaine : la fin de la seconde guerre mondiale marque le leadership américain en Occident, rapidement aux prises avec l’URSS. Pour faire face à un monde de plus en plus complexe où la stratégie devient la discipline reine, le gouvernement américain a investi dans des organismes de recherche comme la Rand (acronyme de Research and Development) et a financé des centaines d’études auprès de laboratoires d’idées pour élaborer des scenarii de crise, approfondir la théorie des jeux, maîtriser les négociations stratégiques, définir les concepts de dissuasion;
– l’idéologie de domination et ses opposants : la chute de l’URSS a été considérée comme la victoire d’une Amérique libérale économiquement et forte militairement. De nombreux laboratoires d’idées ont poursuivi un important travail doctrinal auprès du Congrès et du grand public pour maintenir ou accentuer cette politique, notamment Heritage, l’AEI et le PNAC, ce dernier étant la source intellectuelle de la seconde guerre d’Irak (cf III du présent rapport sur l’influence directe). En réaction à la politique du Président George W. Bush, Brookings, qui a engagé plusieurs anciens hauts responsables de l’administration Clinton (qui ont intégré en 2009 les équipes du Président Obama) a publié des thèses de politique étrangère évidemment proches des Démocrates tandis que des intellectuels qui refusaient de laisser le champ libre aux seules thèses du parti Républicain ont fondé le Center for American Progress, dont les notes parviennent quotidiennement au Congrès.
Rôle d’influence ou rôle d’auxiliaire ?
Il peut être répondu par l’affirmative à ces deux questions. Les laboratoires d’idées peuvent se limiter à être des vecteurs d’influence comme ils peuvent servir d’auxiliaire à l’administration américaine. Dans les deux cas, c’est volontairement qu’ils adoptent l’une des deux attitudes.
En tant qu’entités privées, ils veillent à leur liberté. A de rares exceptions, ils évitent de travailler sur un seul sujet afin de garder une vocation de généralistes sur l’ensemble des questions politiques et affichent volontiers leur indépendance à l’égard de l’administration, même lorsqu’ils admettent une proximité idéologique avec un parti.
Aucun laboratoire d’idées n’a de financement unique. Ils évitent de dépendre d’un seul bailleur et font le plus souvent reposer leurs ressources sur les dons du secteur privé (legs, fondations, contributions de sociétés commerciales, frais de scolarité, produit des publications et des conférences). Le seul cas où ils acceptent un financement public provient d’études qu’ils accomplissent à la demande et pour le compte du gouvernement. Il est en outre rappelé aux donateurs privés que leur geste ne les autorise pas à orienter les travaux du laboratoire d’idées qu’ils financent.
Avec des budgets annuels allant de 3 à 30 millions de dollars, mais pouvant dépasser 50 millions et culminer à 250 millions (Rand), les laboratoires d’idées disposent indéniablement des moyens de leur indépendance. Ils peuvent se consacrer à identifier les problèmes politiques nationaux et internationaux et proposer des solutions.
Il est néanmoins de nombreux cas où ils agissent de concert avec l’administration, devenant des relais d’influence de l’action diplomatique. Idéologiquement, franchir ce pas est aisé puisqu’il y a communion de vue sur la place de l’Etat dans la société américaine. Les laboratoires d’idées acceptent donc non seulement de réfléchir pour le gouvernement, mais aussi d’agir pour son compte. L’un des domaines privilégiés se trouve dans le soutien qu’ils peuvent apporter aux exportations de biens sensibles, à la demande du Département d’Etat ou de grandes entreprises. Ainsi, le US Atlantic Council, laboratoire d’idées atlantiste vient d’organiser ces derniers mois une série de conférences sur l’énergie en République tchèque pour promouvoir en Europe centrale la technologie nucléaire américaine, pour le compte de Westinghouse. Elles ont été financées par le Département d’Etat et le Département de l’Energie. Cette action a été relayée par Brookings, qui a sensibilisé des décideurs politiques à la sécurité énergétique (la réunion de Brookings a d’ailleurs bénéficié d’une subvention de l’Union européenne !). Le même phénomène a été constaté aux Emirats arabes unis, où la diplomatie américaine a mobilisé de nombreux consultants en faveur de Westinghouse. Le contrat a certes été attribué en 2010 au Coréen Kepco mais l’échec n’est que relatif pour les Etats-Unis car le réacteur de cette société est sous la licence de Westinghouse.
2. La difficulté des laboratoires d’idées non américains à s’imposer sur la scène internationale
Depuis la chute du mur de Berlin, un nombre considérable de laboratoires d’idées se sont créés dans les pays européens, environ 1200, à raison de près de 300 au Royaume-Uni, près de 200 en Allemagne, un peu plus de 150 en France et un peu moins d’une centaine en Italie, auxquels s’ajoute une vingtaine de réseaux d’influence auprès de l’Union européenne. L’apparition de laboratoires d’idées a également été constatée en Russie, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie.
On relèvera d’emblée deux de leurs caractéristiques : ils se concentrent essentiellement sur des problèmes nationaux; en outre, leurs moyens financiers sont largement inférieurs à ceux de leurs homologues américains. Pour la plupart, les budgets annuels oscillent de quelques centaines de milliers d’euros à 3 millions d’euros, soit une dotation inférieure à un petit laboratoire d’idées américain. Les dons du secteur privé sont relativement faibles, aussi ces entités font-elles souvent appel aux subventions publiques.
Les contraintes budgétaires limitent leur rayonnement international. Il leur est impossible de conduire des activités à des rythmes aussi soutenus que leurs homologues américains. Les facilités offertes par internet leur permettent de multiplier les publications électroniques à peu de frais, mais il n’existe aucune revue en Europe dont le prestige égale Foreign Affairs, alors que les talents ne manquent pas. Les seuls laboratoires d’idées européens de renommée internationale sont Chatham House et l’International Institute for Strategic Studies (IISS), tous deux britanniques. Au classement de l’université de Philadelphie, le premier laboratoire d’idées français en matière internationale apparaît en 19ème position : il s’agit de l’Institut français de relations internationales (IFRI).
Autour des institutions européennes gravite un petit nombre de fondations et laboratoires d’idées, qui espèrent y trouver un écho favorable à leurs thèses. La Commission européenne et le Parlement recourent en effet à des études extérieures à leurs services administratifs, à l’instar du Congrès des Etats-Unis. Il ne faut pas les confondre avec les centaines de cabinets de lobbying qui cherchent à influencer quotidiennement le droit européen. Ces fondations rassemblent des chercheurs unis autour d’un idéal européen qui a le plus grand mal à émerger.
Les principaux laboratoires d’idées « bruxellois » sont le Center for European Policy Studies, l’European Policy Center, la Fondation Bruegel, l’European Council on Foreign Relations (ECFR) ou le Center for a new Europe. La plupart fonctionnent grâce à des subventions publiques. Certains bénéficient du soutien de fondations américaines qui trouvent ainsi des relais en Europe, comme la Fondation Soros Open Society avec l’ECFR. Il faut également noter que les grands laboratoires d’idées américains ont des bureaux ou des représentants à Bruxelles. Les thèses véhiculées aux Etats-Unis sont ainsi portées à la connaissance des décideurs européens.
Réticents à tout approfondissement de la construction européenne, les Britanniques disposent des meilleurs laboratoires d’idées pour en analyser les enjeux et les conséquences pour leur pays. Le Center for Economic Policy Research coordonne ainsi plusieurs centaines de chercheurs à travers le monde et assure entre autre la formation des diplomates du Royaume-Uni. Le Center for European Reform, moins connu, est considéré comme un laboratoire d’idées influent auprès des décideurs européens.
La galaxie des laboratoires d’idées est complexe, tant dans ses objectifs que dans ses modes de fonctionnement. Réalité essentiellement américaine, elle est difficilement transposable sur d’autres continents, malgré un essor important. A l’exception de Chatham House et de L’IISS, aucun des laboratoires d’idées et fondations basés hors des Etats-Unis ne peut être qualifié d’influent, même lorsque leurs travaux sont reconnus. Il leur manque en effet la capacité de faire travailler en leur sein les anciens ou les futurs décideurs politiques.
Est-ce à dire, a contrario, que l’influence des laboratoires d’idées est incontournable pour comprendre la politique étrangère américaine ? La réponse est complexe. L’influence n’est en effet pas l’action. La politique étrangère des Etats-Unis obéit comme celle de tout pays à des facteurs parfois invariables dans le temps, dictés entre autre par la géographie. Aucun laboratoire d’idées n’existait à Washington lorsque le Président James Monroe fixa le 2 décembre 1823 devant le Congrès les éléments de sa célèbre doctrine, qui allait orienter la diplomatie de son pays pour au moins cent ans… Le Département d’Etat n’a pas eu non plus besoin d’aide intellectuelle pour agir en faveur de la liberté des mers et du commerce, comme plus récemment de la liberté sur internet… Il n’y a pas de dépendance intellectuelle lorsque sont en jeu les intérêts fondamentaux d’un Etat.
Il existe néanmoins une spécificité américaine de participation très active de la société civile aux affaires internationales, en raison de l’absence de césure entre secteur public et secteur privé, avec comme corollaire une capacité d’influence réelle sur les décideurs politiques. Cette spécificité n’aurait aucune importance si les Etats-Unis étaient une puissance moyenne. Comme ils demeurent la première puissance mondiale, la compréhension de leur politique étrangère ne peut se concevoir sans la prise en compte du rôle des laboratoires d’idées.
B – L’enseignement supérieur, vecteur d’influence et de développement sur le long terme
De 2000 à 2007, le nombre d’étudiants dans le monde est passé de 100 à 140 millions. Ils seront 210 millions en 2015, avec, poussée démographique oblige, la Chine au premier rang. L’Asie devrait abriter à cette période la moitié de la population étudiante.
Les universités du monde entier sont en concurrence pour attirer les étudiants en leur sein. 2,9 millions d’entre eux ont en effet suivi un cursus hors de leur pays d’origine en 2008, ce chiffre devant passer à 7 millions en 2025. Les dix premiers pays d’accueil d’étudiants étrangers sont respectivement les Etats-Unis (31%), le Royaume Uni (17%), la France et l’Australie (chacune 12%), l’Allemagne (10%), le Japon (6%), le Canada, l’Italie, la Russie et l’Afrique du Sud (chacun 3%). Ce classement évoluera sans doute dans la décennie prochaine avec l’apparition d’universités de Chine populaire, de Singapour et des pays du Golfe persique, qui investissent massivement dans l’enseignement supérieur.
Il n’est point besoin de longs développements pour rappeler l’importance des universités pour les capacités d’influence d’un pays. Trois arguments plaident en faveur d’une telle politique :
– l’influence culturelle a des conséquences économiques : connaître les entreprises d’un pays, leur mode de fonctionnement, leurs cadres et dirigeants conduit naturellement à s’adresser à elles pour la conclusion de marchés. Les étudiants sont souvent les ambassadeurs à vie des pays dans lesquels ils ont étudié en raison des amitiés qu’ils ont pu y nouer et du réseau relationnel qu’ils y ont tissé ;
– l’enjeu linguistique est considérable : une langue est en effet le reflet d’une mentalité, d’un mode de pensée et d’une civilisation. Un enseignement supérieur dominé internationalement par la seule langue anglaise sera un vecteur supplémentaire des valeurs anglo saxonnes. Il s’agit, au passage, d’un défi pour la francophonie. Il ne sert à rien de financer un coûteux réseau culturel (alliances françaises), parlementaire (APF et AIPLF) et interétatique si la langue française n’est pas perçue comme utile dans le monde moderne et si la France ne donne pas d’elle-même une image dynamique. Les universités françaises doivent ainsi poursuivre leur ouverture en réservant une part de leur cursus à la langue anglaise, afin d’attirer en leur sein des étudiants qui deviendront francophones parce que francophiles ;
– attirer des étudiants étrangers permet d’augmenter les budgets des universités, notamment lorsqu’ils proviennent de pays développés. Si la France accueillait 400 000 étudiants supplémentaires, l’apport de ces derniers serait d’environ 5,4 milliards d’euros en ressources annuelles nouvelles, soit 25% des budgets publics de l’enseignement supérieur et de la recherche. Cette somme permettrait d’améliorer l’ensemble des prestations universitaires et d’aider les étudiants des pays en voie de développement.
2. Un vecteur de développement
Derrière la compétition universitaire est en jeu la capacité de chaque pays à attirer les futures élites pour y étudier. Les Etats-Unis, qui concentrent 31% du marché des étudiants étrangers, ont compris depuis longtemps le bénéfice précieux qui en résultait pour leur économie et pour leur influence intellectuelle.
Cette compétition autour de la matière grise est primordiale pour la recherche et l’innovation. Comme le rappelle M. Bernard Ramanantsoa, directeur général d’HEC, « il existe deux types de pays : ceux qui créent le savoir et ceux qui le reproduisent. Avec de bons professeurs, vous contribuez à la fabrication du savoir ». Si la Silicon Valley, Cambridge (en Angleterre), le MIT de Boston ou les établissements du plateau de Saclay ont un rayonnement mondial, c’est en raison du développement économique qu’ils ont généré grâce à leurs activités de recherche.
Les sciences exactes ne sont pas les seules à être concernées par cette compétition. Avec la globalisation des questions politiques (développement, environnement, finance…), « tous les problèmes intéressants franchissent les frontières », comme le note David Ellwood, doyen de la Kennedy School of Government de l’université d’Harvard. Apprendre aux étudiants à franchir les frontières, créer des réseaux par lesquels ils s’efforceront de résoudre les questions d’avenir constitue un enjeu mais également une compétition. L’enseignement que reçoit un étudiant en un point du globe façonne durablement son esprit.
Le rayonnement des universités passe par deux canaux : s’implanter à l’étranger et attirer en leur sein des étudiants.
L’implantation prend le plus souvent quatre formes : les accords d’échanges en vue de l’obtention d’un double diplôme, le partenariat qui débouche sur un diplôme commun à deux universités, la délocalisation de formations (HEC à Doha) et enfin la construction de locaux, comme l’INSEAD à Singapour et à Abou Dabi, la Sorbonne à Abou Dabi ou l’Ecole centrale à Pékin.
Attirer les étudiants peut résulter d’une stratégie propre à chaque université ou d’une politique nationale. La France et les Etats-Unis s’opposent nettement sur ce point. Il n’existe pas de politique française en ce domaine. Chaque université est laissée libre d’agir comme elle l’entend... La situation est analogue aux Etats-Unis, mais il s’y ajoute une action volontariste initiée par le Département d’Etat et déléguée pour sa mise en œuvre à la fondation One to World, qui siège à New York. Cette fondation gère les programmes Fulbright, apparus en 1946 pour promouvoir un monde de paix grâce « à une meilleure compréhension entre Américains et non Américains » (Sénateur Fulbright), par le canal des universités. Dans les dix années qui suivirent sa création, lorsque la guerre froide battait son plein, 15 000 étudiants d’une vingtaine de pays étudièrent aux Etats-Unis et 9000 Américains se rendirent dans des universités étrangères. 19 000 Français ont ainsi bénéficié du programme depuis 1946. Chaque bourse est financée pour moitié, en règle générale, par le Département d’Etat qui, au travers de commissions locales, sélectionne les étudiants ou les enseignants (en général des assistants de recherche) qui lui semblent présenter un intérêt.
La vision américaine ne se limite pas à favoriser le rayonnement des universités. Elle en fait un élément d’influence visant à doter les Etats-Unis d’un capital de sympathie mais leur permettant aussi de se servir de la présence d’étudiants étrangers pour comprendre leur culture. La philosophie du programme Fulbright n’a pas changé et de l’aveu même de la fondation One to World, l’effort est actuellement porté sur les étudiants de pays dans lesquels l’image des Etats-Unis est négative comme le Pakistan et de nombreux pays arabes et/ou musulmans.
4. Le classement de Shanghai ou comment une université chinoise est devenue un vecteur d’influence par hasard
Pour attirer les meilleurs étudiants, les universités ont besoin d’être internationalement reconnues. Comme en d’autres domaines, il faut donc établir une norme de qualité à partir de critères précis. Cette norme aurait pu être déterminée par accord international, ou à l’échelle européenne par les Etats de l’Union, mais ils ne s’en sont pas préoccupés. C’est quasiment par hasard que le classement de l’université Jiao Tong de Shanghai est devenu une référence, emblématique de la manière dont s’exerce une influence diffuse. Il mêle en effet plusieurs éléments : primat de la langue anglaise sur internet, critères déterminés par un petit groupe de personnes et surtout large publicité par la presse, conférant in fine à ce travail une légitimité intellectuelle incontournable.
A l’origine, ce premier classement académique des universités du monde, publié en 2003 par le professeur Nian Cai Lu, chimiste, n’avait d’autre but que d’indiquer aux étudiants chinois prêts à l’expatriation quelles étaient les meilleures universités mondiales. Ne disposant que de deux collaborateurs et d’aucun crédit particulier affecté à l’établissement de ce classement, il reconnaît n’avoir retenu que des données accessibles par internet et que lui-même jugeait objectives.
L’équipe de l’Université de Shanghai a donc retenu six critères :
– le nombre de prix Nobel et de médailles Fields obtenus par des anciens élèves des universités (10 % de la note) ;
– le nombre de lauréats de prix Nobel et de médaille Fields au sein des équipes pédagogiques (20 %) ;
– le nombre de chercheurs les plus cités dans leur discipline (20 %) ;
– le nombre de publications parues dans les revues scientifiques Nature et Science (20 %), de langue anglaise ;
– le nombre de chercheurs répertoriés dans deux bases de données d'articles scientifiques, l'une sur les sciences humaines, Arts & Humanities Citation Index, l'autre sur les sciences exactes : Science Citation Index (20 %) ;
– enfin, la performance académique au regard de la taille de l'institution calculée par la somme pondérée des cinq indicateurs est divisée par le nombre de chercheurs (10 %).
La publication de ce classement a connu six mois plus tard un écho considérable. Alors qu’il ne devait servir qu’à des étudiants chinois, sa forte diffusion à travers le monde en a dénaturé la portée. De nombreux articles ont critiqué la méthodologie et l’orientation adoptées par l’équipe de l’université Jiao Tong :
– la comptabilisation des articles parus dans les revues Nature et Science est sujette à caution. Un article publié par plusieurs chercheurs a plus de poids qu’un article émanant d’un seul chercheur. En effet, lorsque l’article est co-signé, l’auteur référent reçoit 100 % de sa valeur, puis une majoration s’applique au co auteurs : 50 % au premier co auteur, 25 % au suivant et 10 % pour les autres. Tandis que lorsque l’article ne relève que d’un seul auteur, seul 100 % de sa valeur lui sont attribués. Par conséquent, les universités ont intérêt pour augmenter la valeur d’un article à le faire co-signer par de nombreux chercheurs ;
– le poids des « humanités » est également difficile à mesurer. Les sciences humaines et sociales ne sont que peu présentes dans les deux revues utilisées comme référence ;
– un prix Nobel obtenu par un professeur d'université français peut peser deux fois moins qu'un prix Nobel obtenu par un professeur d'université américain ou britannique. En effet, la recherche française s'effectuant en général dans des unités mixtes de recherche associant des universitaires du CNRS, le classement de Shanghai attribue 50 % du bénéfice à l'université et 50 % au CNRS. Or, seules les universités sont classées ; dès lors les centres et les autres organismes de recherche français n'apparaissent pas dans le classement. En d’autre terme, une partie du bénéfice de la récompense internationale s'évapore complètement. En ce qui concerne les 60 % de la note dépendant du décompte d'articles et du nombre de citations, le principe général est le même. La pondération d’articles publiés en collaboration avec des organismes de recherches leur ampute une moitié de leur valeur ;
– enfin, le classement considère exclusivement les publications de langue anglaise. Ainsi, s’il est devenu souhaitable, dans certains secteurs scientifiques, de publier dans une revue britannique (notamment Nature) ou américaine (Science), la promotion de travaux se fait également lors de conférences ou dans des revues non anglo-saxonnes, et ce pour des raisons multiples (coût, accessibilité, pertinence, impact, etc...).
Malgré de nombreux arguments critiquant sa méthodologie, le classement de Shanghai est devenu par un curieux concours de circonstances, grâce à la presse notamment, une référence mondiale qui oriente les choix de l’ensemble des étudiants à travers le monde, dans un domaine désormais hautement concurrentiel. Notre pays n’a pu faire autrement qu’en tenir compte avec la loi portant réforme des universités.
C – Forums internationaux et réseaux professionnels : entre débats d’idées et naissances de projets
Le débat d’idées ne peut se limiter à des publications, aussi importantes soient-elles. Les contacts directs sont nécessaires, au cours desquels les décideurs nouent des contacts, échangent des idées et font naître des projets. Telle est la fonction des clubs et réseaux professionnels, ainsi que des grands forums dont les trois plus importants, en politique internationale, Davos, Munich et la commission trilatérale, à Washington, relèvent de statuts privés.
1. Les grands forums d’idées : Davos, la Conférence de Munich sur la politique de sécurité et la commission trilatérale
Le journaliste Jean-Marc Vittori a ironiquement relevé au début de l’année 2011 que le forum économique mondial de Davos, qui est une association privée de droit suisse, ne devrait plus exister. « Cette gigantesque business party aurait dû s’étioler… Car elle a porté toutes les valeurs, toutes les idées balayées par la crise financière, qui a connu son apogée en 2008. Nulle part ailleurs la valeur actionnariale n’aura été prêchée avec autant de foi. A Davos, on a aussi prôné la mondialisation débridée, la finance souveraine et la déréglementation permanente… ».
Mais comme le rappelle le journaliste, le forum économique de Davos a certes amplifié des idées qui se sont révélées erronées (peu, parmi les invités de cette conférence, ont eu la lucidité comme Nouriel Roubini de prévoir la crise de 2008), mais il demeure un lieu de passage « obligé ». Il n’existe en effet aucun autre forum qui réunisse, à la fin de chaque mois de janvier, les dirigeants des plus grandes entreprises du monde et autant de responsables politiques. Davos leur permet de confronter leurs idées et leurs visions du monde et de nouer des relations, certaines sérieuses, d’autres superficielles et trompeuses.
La Conférence de Munich sur la politique de sécurité (anciennement Wehrkunde) a le statut d’entreprise d’utilité publique en droit allemand. Son financement est mixte, en partie public et en grande partie privé, grâce aux dons d’entreprises de haute technologie et d’armement (Thalès a fait partie des contributeurs en 2011). Elle se déroule chaque premier week-end de février à l’hôtel Bayerische Hof et se consacre aux questions de défense et de politique étrangère. Initialement centrée sur la sécurité transatlantique, elle s’est élargie à d’autres thèmes, en incluant notamment ceux qui intéressent l’Asie. La Conférence de Munich comporte deux parties : celle sous les feux de la presse, qui comprend les discours des chefs d’Etats, de gouvernements et des ministres de la défense ou des affaires étrangères ; celle, plus discrète, qui se déroule dans les salons de l’hôtel, où des diplomates se livrent à diverses négociations et où les représentants des grandes entreprises de défense – qui ont un statut d’observateur à la Conférence – en profitent également pour prendre l’attache des décideurs politiques, ministres et parlementaires présents. Aucun contrat d’armement n’est signé à Munich ; mais la conférence permet des prises de contacts ou des appuis discrets à des dossiers en cours.
La commission trilatérale, communément appelée la trilatérale, est née en 1973 à l’initiative de David Rockfeller. Sa charte fondatrice lui assigne la mission suivante : « Centrée sur l’analyse des enjeux majeurs auxquels font face l’Amérique du Nord, l’Europe de l’Ouest et le Japon, la commission s’attache à développer des propositions pratiques pour une action conjointe. Les membres de la commission regroupent plus de 200 distingués citoyens provenant des trois régions et engagés dans différents domaines ». La trilatérale est passée depuis à environ 400 membres, parmi lesquels une quinzaine de Français, parlementaires, anciens ministres, chefs d’entreprises et professeur d’universités. Elle a également intégré en son sein des personnalités d’Europe de l’Est, de Turquie, du Golfe persique et des Caraïbes, reflétant en quelque sorte l’extension de l’espace des économies libérales.
La trilatérale est une entité privée qui affirme clairement une idéologie libérale. Elle souhaite éclairer les dirigeants politiques des enjeux de politique économique internationale et considère que les cadres nationaux sont trop étroits face à des problèmes caractérisés par l’interdépendance et la complexité. Si à la différence des conférences de Davos et de Munich, ses débats se déroulent à huis clos (ce qui provoque inévitablement des controverses), elle édite les rapports thématiques qui traitent des sujets sur lesquels elle travaille : réforme des institutions internationales, mondialisation des marchés, finance internationale, libéralisation des économies, endettement des pays pauvres…
Si la mission de la trilatérale est la défense d’un modèle libéral considéré comme vital pour l’économie, la finance et le progrès technologique, les débats révèlent de sérieuses nuances d’analyse entre participants. Il semble notamment que de nombreux membres aient marqué leur désaccord avec Colin Powell lorsqu’il y prononça un discours, le 6 avril 2002, où il défendait les grands axes de la politique étrangère américaine.
La trilatérale affiche clairement un objectif d’influence : « quelquefois, les idées mises en avant par les rapports de la commission trilatérale sont devenues des politiques officielles. Ses recommandations ont toujours été sérieusement débattues à l’extérieur de notre cercle et elles ont joué un rôle dans les réflexions des gouvernements et dans la formulation de leurs décisions » – (David Rockfeller). Cet objectif est si explicite qu’elle rend publique la liste de ses membres qui exercent des responsabilités gouvernementales. En 2010, ils étaient au nombre de 19, parmi lesquels Timothy Geithner, secrétaire d’Etat américain au Trésor, Stephen Bosworth, représentant spécial pour la politique à l’égard de la Corée du Nord, Diana Farrell, conseillère du Président Obama pour la politique économique, Kurt Campbell, responsable des affaires d’Asie du Sud-Est et de l’Océan pacifique au département d’Etat, Susan Rice, représentante permanente des Etats-Unis à l’ONU, Dennis Ross, conseiller au conseil national de sécurité, Lene Espersen, ministre des affaires étrangères du Danemark, Grete Faremo, ministre de la défense de Norvège, Toomas Ilves, Président d’Estonie et Hisachi Owada, Président de la Cour internationale de justice.
L’appartenance à des réseaux (anciens étudiants, professionnels) ne nécessite pas de commentaire particulier. Toute société a besoin de former une partie de ses élites. Polytechnique, HEC, l’INSEAD, West Point, Annapolis, Sandhurst, Oxford, Harvard, Yale, Princeton, l’Université de Tokyo sont des lieux où naissent les capacités d’influence par le seul fait qu’une part notable des dirigeants politiques et d’entreprises s’y croisent, formant des fraternités. Ces dirigeants se retrouvent ultérieurement dans des réseaux sociaux, des clubs de réflexion, des organes de lobbying.
Pour les responsables d’entités privées, notamment les chefs d’entreprises, appartenir à plusieurs réseaux des secteurs privés et publics est fondamental pour la conduite de leurs affaires. L’on relève ainsi des similitudes dans plusieurs pays :
– l’appartenance à la fonction publique civile ou aux forces armées, puis au secteur privé (dirigeants de BNP Paribas, d’EADS, de la Société générale, de General Dynamics, nombreux cadres dans les industries d’armement). Ce passage permet de faciliter l’instruction de dossiers et de les faire parvenir aux personnes en charge des décisions ;
– l’appartenance à de multiples conseils (universités, instances professionnels, Etat). Le PDG d’ATT siège ainsi au Comité national américain de sécurité des télécommunications, comme son collègue président de Raytheon, qui est également membre d’un des conseils de la CIA. L’utilité de ces conseils réside dans les informations qui s’y échangent et dans les contacts permanents entre personnalités du secteur privé, responsables politiques et cadres de l’administration ;
– les liens que tissent les dirigeants d’entreprise avec les responsables politiques sont de long terme. Lorsqu’ils permettent aux premiers d’accéder à des fonctions gouvernementales, se pose inévitablement la question de la frontière entre intérêt privé et intérêt général. La question est particulièrement sensible aux Etats-Unis où il n’existe pas de limite aux dons effectués à l’occasion de campagnes électorales. Les dirigeants de Goldman Sachs ont ainsi contribué à hauteur de 1 million de dollars à la campagne présidentielle de Barack Obama, avant que plusieurs de leurs cadres accèdent à de hautes fonctions, notamment Mark Patterson, comme chef de cabinet du secrétaire d’Etat au Trésor Timothy Geithner et Gary Gensler comme président de la commodity futures trading commission.
D – La démultiplication de l’influence diffuse : le cas particulier d’internet
Internet est-il un vecteur d’influence ou un simple outil de communication ?
L’importance prise par les différents réseaux sociaux, notamment dans des campagnes électorales ou dans les récentes révolutions arabes, plaide à première vue pour un classement d’internet au sein des vecteurs d’influence. Les objectifs des principaux industriels de ce secteur ne sont toutefois en rien politiques. Ils se limitent à la conquête de marchés, avec des enjeux financiers certes considérables compte tenu de l’ampleur prise par la toile, mais aucun ne recherche réellement à influencer les politiques des Etats. Ces derniers sont en revanche très intéressés par les potentialités des différentes technologies. Internet doit être considéré en conséquence non comme un outil d’influence, mais comme un outil qui démultiplie l’influence.
Internet ne doit presque rien aux Etats. Né aux Etats-Unis, il a failli être conçu en France grâce aux travaux de l’ingénieur Louis Pouzin, mais a été victime de l’aveuglement des pouvoirs publics… Son ancêtre, Arpanet, inventé à la fin des années 60 par des chercheurs pour mettre en réseau l’université de Californie à Los Angeles (UCLA), l’Institut de recherche de Stanford, les universités de Santa Barbara et de l’Utah, avait néanmoins suscité l’intérêt de la défense nationale américaine qui y voyait le moyen de permettre aux réseaux de communication militaire de fonctionner malgré une attaque nucléaire soviétique…
L’uniformisation technique des réseaux date de 1974, avec le transmission control protocol (TCP) et l’internet protocol (IP), toujours en vigueur de nos jours. Le progrès décisif fut accompli au début des années 90, quand des équipes du CERN créèrent un protocole de mise en ligne de pages reliées entre elles par des hyperliens. Les conditions techniques étaient alors réunies pour que le réseau internet connecte les sites du monde entier.
Deux éléments caractérisent internet. D’une part, il est issu d’initiatives privées, principalement d’universitaires et d’entrepreneurs qui ont exploité intelligemment l’environnement dynamique de la Silicon Valley. Les concepteurs comme les utilisateurs le perçoivent en conséquence comme un espace qui leur est propre, au sein duquel l’Etat doit interférer le moins possible. D’autre part, c’est un outil profondément américain. D’Oracle à Google en passant par Microsoft ou Facebook, les leaders mondiaux d’internet sont tous Américains. Ils ont donc la vision d’une société ouverte, où les idées doivent librement circuler, quelle que soit leur valeur. Ayant foi dans la liberté du commerce et de l’industrie, ils veulent étendre leur activité (moteurs de recherche, indexation, réseaux sociaux,) à l’ensemble du monde.
Le marché d’internet est lié au nombre de personnes connectées, qu’elles soient physiques ou morales. A la fin de 2010, ce nombre était de 1,96 milliard, sur une population mondiale de 6,84 milliards d’habitants, soit un taux de pénétration de 28,7%. La croissance est de 444% depuis l’an 2000. Les zones où internet est le plus répandu sont le Japon (90%), l’Amérique du Nord (77%) et l’Europe (58%).
Jamais dans l’histoire de l’humanité une technologie n’a permis de démultiplier autant les canaux de communication, de commercer et de répandre instantanément et à si grande échelle les messages, les idées, les idéologies. Internet est devenu vital pour toute entité qui vise à être connue. Il ne pouvait évidemment demeurer du seul ressort de la sphère privée. Les Etats cherchent à le contrôler et à s’en servir pour leur influence politique. Espace privilégié de diffusion des facteurs intangibles de la puissance (idées, images…), souvent qualifié de monde virtuel, internet transforme profondément et en permanence la politique, y compris dans le domaine international.
Chaque jour, 165 milliards de messages sont échangés à travers le monde… A la fin de 2008, les moteurs de recherche avaient traité 71 milliards de demandes. En 2013, le volume des contenus sur internet atteindra 2,5 zettaoctets (1 zettaoctet équivaut à 1000 milliards de gigaoctets). Contrôler ce système pour qu’il demeure libre – il s’apparente à une route commerciale – est devenu vital. Mais apparaissent alors trois questions majeures : qui a la légitimité pour le gérer, comment protéger l’identité des personnes physiques et morales qui consultent des données, quel usage enfin est-il fait de ce collationnement de données, sans précédent dans l’histoire de l’humanité ? L’on sait en effet que l’une des techniques utilisée par les services de renseignement et les agences privées d’intelligence stratégique et économique est le recueil systématique de données, suivi de leur analyse.
La réponse est à chaque fois liée au comportement d’entités privées.
1. L’ICANN ou les ambiguïtés de la gestion d’un système internet universel
Pour comprendre l’importance de l’ICANN, entité qui définit les principales normes applicables à internet, il convient de rappeler que chaque ordinateur relié au réseau dispose d’une adresse IP, qui est en fait une série de chiffres, impossibles à mémoriser. Le système de nom de domaine (DNS, domain name system pour l’acronyme anglais) permet aux utilisateurs de naviguer aisément. Le DNS transfère le nom de domaine que toute personne recherche dans l’adresse IP correspondante et la connecte au site recherché. Le DNS permet également le bon fonctionnement du courriel.
L’enregistrement, la gestion et les normes techniques applicables aux noms de domaines sont donc cruciaux. Sans eux, il n’y a pas de stabilité opérationnelle du système.
Cette gestion est le fruit de l’histoire. Conçu principalement en Californie, internet est administré par une société privée de droit californien, l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, qui siège à Marina del Rey, à Los Angeles (budget annuel de 60 millions de dollars et une centaine d’employés). Par ses statuts, elle s’assigne la mission d’allouer l’espace des adresses IP, d’attribuer les identificateurs de protocole, de gérer le système de nom de domaine de premier niveau pour les codes génériques (gTLD) et les codes nationaux (ccTLD, par exemple .fr pour les adresses en France). Techniquement, il lui faut assurer la coordination des éléments du DNS pour assurer la résolution universelle permettant aux internautes du monde entier de trouver les adresses qu’ils recherchent.
Derrière ces termes parfois obscurs pour un profane, apparaît une mission simple et fondamentale à la fois : assurer la liberté de circulation sur internet. Sur d’autres espaces, comme les océans, il s’agit d’une fonction régalienne. L’ICANN, pour sa part, a un statut privé, et comme toute entreprise américaine, se trouve placée sous la tutelle du Département du Commerce. Techniquement, elle est en situation de monopole, ce qui pose un véritable problème de souveraineté. Les Etats n’ont qu’un rôle consultatif au sein d’une structure de droit américain.
La logique voudrait que la gestion d’un système aussi important pour l’humanité fasse l’objet d’un traité instituant une organisation internationale, ainsi qu’il en a été dans le passé avec la poste, la navigation sur de grands fleuves ou l’aviation civile. Jusqu’à présent, ce débat a eu peu d’écho et s’est heurté à la politique intelligente de l’ICANN et (sans doute) à la résistance déterminée du gouvernement américain.
Le choix est en effet entre une organisation qui bénéficierait d’une légitimité internationale, mais avec les inconvénients habituels dans ce type d’instance (alliance entre certains Etats, longues négociations, accès aux postes de responsabilités…) et une entité gérée par des praticiens de l’internet (ingénieurs, juristes et financiers, principalement) qui s’est imposée d’elle-même en raison de sa suprématie intellectuelle et technique. Parfaitement consciente des enjeux d’internet pour les Etats, l’ICANN leur a ménagé une place que certains qualifient de réduite, via son comité consultatif gouvernemental, auquel sont présents 50 pays, dont la France. Pour rééquilibrer un personnel qui était à l’origine en presque totalité américain, elle a engagé de nombreux étrangers, parmi lesquels d’anciens diplomates.
L’ICANN considère qu’il vaut mieux qu’internet soit administré par une société privée dont le siège est dans un pays libre plutôt que par une organisation internationale et rappelle que les Etats n’ont marqué aucun intérêt pour cette technologie pendant de longues années avant d’en réaliser les multiples potentialités. Elle considère –tel est le discours officiellement tenu – qu’elle accomplit les efforts nécessaires pour associer les Etats à la gestion d’internet et que ces derniers ne peuvent que gagner à améliorer un système existant plutôt que chercher une autre voie. « A la perfection formelle, mieux vaut la situation imparfaite actuelle » a ainsi déclaré à vos Rapporteurs M. Jean-Jacques Subrenat, ancien ambassadeur de France et membre du conseil d’administration d’ICANN. Les Etats tiennent un langage hétérogène face à cette situation. Les pays libres s’en accommodent assez bien, considérant que cette entreprise est transparente ; La Chine et la Russie aimeraient pour leur part accroître leur influence sur les normes techniques que définit l’ICANN et songent, en cas d’échec, à créer un système parallèle avec ses propres racines.
L’ICANN ne pose guère de problème en elle-même. Elle n’est pas volontairement un vecteur d’influence en matière internationale car les normes qu’elle définit sont avant tout déterminées par l’état de la technologie et sont largement acceptées par les professionnels. S’assurer le contrôle physique des ordinateurs centraux représente en revanche un réel enjeu. Il est symptomatique que les Etats-Unis soient très fermement attachés à la localisation d’ICANN et des ordinateurs précités sur le sol californien. Le fichier mondial des abonnés et des sites internet se trouve ainsi sur leur territoire, avec de larges possibilités d’accès, soit par voie de justice, soit de manière plus discrète (l’ICANN communiquant difficilement sur ce point). Dans le combat que pays et entreprises mènent dans le cadre de l’intelligence économique, qui se définit par le triptyque veille, protection des informations et influence, le fait pour un pays de disposer de telles possibilités constitue un avantage sérieux.
Cette situation ne convient pas à de nombreux pays, notamment ceux attachés au primat de l’Etat (Russie, Chine, Turquie). Derrière leur attitude, apparaît la question de la souveraineté de l’information. La situation quelque peu paradoxale de l’ICANN n’a pas échappé aux responsables des sécurités nationales qui craignent moins le caractère ouvert d’internet que la place dominante des sociétés américaines dans cette industrie. Le rôle d’In-Q-Tel, société chargée de fournir à la CIA les technologies de surveillance les plus sophistiquées est ainsi mis en avant, cette société étant en mesure d’informer son commanditaire de toute activité inhabituelle sur les réseaux sociaux. La crainte étant similaire pour des données vitales, la Turquie et la Russie souhaitent concevoir dans un premier temps leur propre moteur de recherche (la Chine l’a déjà mis en ligne avec Baïdu) mais au-delà, quelques pays envisagent de mettre en place leur système de gestion des adresses IP, des protocoles et des racines.
Créer de nouveaux systèmes parallèles, avec leurs propres racines, est une tentation qui est juridiquement et techniquement possible (des passerelles entre systèmes sont toujours envisageables), mais qui présenterait l’inconvénient de mettre fin à l’universalité d’internet. Il n’est pas certain que les Etats qui conduiraient une telle politique y gagneraient quand on connaît, par exemple, l’apport d’un internet libre pour stimuler l’économie. Mais les considérations de souveraineté peuvent primer sur tout autre élément…
L’ICANN se présente elle-même comme une société neutre politiquement, par son fonctionnement et ses objectifs. Elle est néanmoins perçue comme un instrument d’influence. Conçu aux Etats-Unis, internet véhicule logiquement les valeurs américaines d’une société ouverte où l’information et les données, quelles que soient leur nature, leur contenu ou leur valeur, doivent circuler librement, même si elles sont erronées. Internet est vu comme le reflet d’une société où l’Etat doit se tenir le plus possible en retrait. En assurant son support technique, l’ICANN renforce cette conception, au point que rares sont les personnes qui se soient posées les questions liées à l’universalité d’internet. La sphère privée a en effet créé un outil qui a non seulement modifié fondamentalement de nombreux usages au travail et a révolutionné les modes de communication mais a également ouvert des espaces de discussions politiques. S’exprimer librement – sous son identité ou anonymement – sur internet est perçu comme une action naturelle, inhérente à ce qu’autorise cette technologie. Un espace de débats, un marché des idées dans lequel la société civile prend une place nettement plus importante que l’Etat, dans lequel elle soulève des problèmes et propose des solutions dans tous les domaines, y compris politiques, correspond exactement à la vision américaine des rapports entre la puissance publique et la sphère privée. C’est en ce sens qu’internet pourrait à terme être classé comme vecteur d’influence puisqu’il façonne inconsciemment les mentalités.
2. Les réseaux sociaux : un espace de protestation, peut-être un vecteur d’influence
Les réseaux sociaux Facebook et Twitter, ou encore You Tube n’ont pas été conçus au départ pour être des vecteurs d’influence politique. Leurs créateurs ont eu l’intuition de perfectionner des technologies et des algorithmes à des fins commerciales. Leur succès en a fait involontairement un outil politique. Peut-être sont-ils devenus un vecteur d’influence, encore que ce terme suppose une intention préalable. Facebook ou Twitter n’ont pour l’heure pas d’autre doctrine que la liberté d’entreprendre. Néanmoins, le phénomène est suffisamment emblématique de notre époque pour être brièvement analysé, d’autant qu’il concerne désormais la politique internationale.
L’intérêt des réseaux sociaux en politique peut ainsi être résumé : ces réseaux sont importants, sans que l’on en saisisse complètement la portée. Nul ne les maîtrise. Ils forment un espace idéal pour des protestations, voire pour des extrémistes, mais ne permettent pas encore de construire un espace civique pour bâtir une politique.
Les particuliers comme les organisations de toute sorte (entreprises, fondations, associations, forums informels) se sont emparés des réseaux sociaux car ceux-ci présentent l’avantage de diffuser des informations très rapidement. En politique, leur capacité de diffusion est supérieure à celle des tracts ou des réunions publiques. Le phénomène touche les pays libres, où ces réseaux s’ajoutent à des canaux de communication déjà abondants, mais il est surtout utilisé dans des Etats où règne la censure. Quelques exemples rappellent le rôle des réseaux pendant les révolutions arabes :
– en Tunisie, les réseaux sociaux sont apparus en 2004 et ont pris de l’ampleur en 2009, lorsque les prémices de la crise sociale sont apparues. Les internautes ont profité de l’usage de pseudonymes pour exprimer leurs critiques, souvent violentes, à l’égard du pouvoir. Lorsque les manifestations ont commencé, ils ont systématiquement réagi à chaque discours de l’ancien Président Ben Ali en lançant des mots d’ordre, des slogans et en communiquant les lieux des prochaines manifestations. Le collectif hackers anonymous (4000 personnes environ) a piraté les sites gouvernementaux officiels. Alors que l’Agence tunisienne d’internet le combattait, le collectif a reçu l’aide d’internautes étrangers, qui lui ont permis d’accéder à des serveurs situés hors de Tunisie lorsque les canaux d’accès aux serveurs tunisiens étaient fermés. Les vidéos des répressions policières, filmées depuis des téléphones portables, ont été largement diffusées via Facebook et You Tube, popularisant ainsi la lutte des Tunisiens pour leur liberté. « Il était devenu plus grave de se promener avec un ordinateur portable qu’avec un cocktail Molotov » a ainsi déclaré un étudiant à des journalistes français… ;
– en Egypte, le mouvement de contestation qui a fait chuter le Président Moubarak est né d’un appel lancé sur Facebook par une femme de 30 ans, Esraa Abdel Farrah, qui protestait au printemps 2008 contre l’absence de services publics, de lieux d’éducation et contre la faiblesse des salaires. Arrêtée par la police, elle passa deux semaines en prison et la grève qui faillit être lancée sur la base de son appel ne put être organisée. Son action a été relayée par des milliers d’internautes issus de milieux urbains tout au long de l’année 2009 ;
– en Syrie, la journée de la colère, prévue le 4 février dernier, a été un échec car la police a lu avec attention l’appel sur Facebook, lancé par 7800 internautes. Mais depuis, la contestation n’a cessé d’enfler et les vagues de répression qui s’abattent sur les manifestants depuis mars 2011 sont filmées et circulent sur internet ;
– en Libye, une première journée de la colère a également eu lieu le 17 février 2011 à Benghazi, à la suite d’appels sur des réseaux sociaux ;
– en Arabie saoudite, un appel à une journée de la colère a été lancé le 11 février 2011, après avoir réuni 33 000 internautes, mais n’a pas débouché sur la moindre manifestation en raison de l’attitude très ferme des autorités.
Les exemples sont légion et ne se limitent pas au monde arabe. En Moldavie, Facebook, Twitter et le réseau Live Social ont été les canaux de mobilisation de milliers de jeunes contre la fraude électorale, en avril 2009. En Biélorussie, c’est par des canaux similaires qu’a été organisée la manifestation du 19 décembre 2010 contre le Président Loukatchenko, fortement soupçonné de fraude électorale. En Colombie, des millions de personnes ont manifesté en février 2008 contre les FARC à la suite d’appels sur Facebook. Enfin, en Iran, Twitter et You Tube ont joué un rôle déterminant pour la diffusion en temps quasiment réel des images de la répression, au point que le gouvernement américain aurait demandé en 2009 aux dirigeants de Twitter de reporter une opération de maintenance pour ne pas gêner son utilisation par les opposants iraniens.
Les réseaux sociaux semblent surtout jouer un rôle dans les mouvements de protestation, plus que dans la construction de politiques ou de doctrines, que l’on retrouve dans des sites mis en ligne par des fondations ou des laboratoires d’idées. Plusieurs raisons expliquent cette force :
– l’extension continue des réseaux sociaux assure une vaste capacité de mobilisation. Facebook est souvent qualifié de troisième Etat de la planète, avec 750 millions d’abonnés en octobre 2011. Les appels des internautes iraniens, en 2009, puis égyptiens et tunisiens en 2011 ont ainsi eu un écho dans le monde entier ;
– cette extension a essentiellement bénéficié aux opinions publiques, à la société civile (peu importe le terme choisi) ; en résumé à des personnes qui ne s’expriment habituellement pas dans l’espace politique classique (partis, institutions, presse). Qualifier de virtuel l’espace des réseaux sociaux est sans doute une erreur, car il s’agit d’un forum politique réel qui a ses propres usages, y compris le droit à l’anonymat dans l’expression des idées ou des opinions ;
– la rapidité de diffusion des informations permet à un nombre croissant d’individus et d’organisations (notamment d’ONG) de se faire une opinion sur les évènements internationaux et de réagir, internet étant un lieu d’échange et non un medium devant lequel le spectateur est passif, comme la télévision ;
– les internautes sont unis par delà les frontières par des pratiques communes (transformation de leur langue, dialogues instantanés) qui instaurent des solidarités ;
– face à des situations qui peuvent évoluer rapidement, les réseaux sociaux constituent des outils inédits permettant à des protestataires de coordonner leurs actions, là encore grâce à la rapidité de diffusion de leurs appels ;
– la diffusion d’images, facilitée par les progrès technologiques des ordinateurs comme des téléphones portables, accroît la capacité de réaction des opinions publiques, une image étant plus parlante qu’un article, même s’il est bien écrit. La diffusion via les réseaux sociaux de l’occupation de la place Tahrir au Caire par les manifestants a pris ainsi la forme d’un drame, où alternaient scènes de liesse et épisodes de répression, la place devenant un théâtre dont le monde entier était spectateur ;
– le fait que les images des internautes aient illustré les reportages des grands media comme CNN a accru leur importance. Face aux difficultés d’envoyer des reporters professionnels sur le terrain – certains journalistes étant d’ailleurs pris à partie par des manifestants ou des policiers – les media se sont emparés de toute source envoyée depuis un téléphone portable ou diffusée sur internet alors que la déontologie exigeait que les reportages émanent de journalistes professionnels. On assiste désormais à l’élargissement de la production des informations, tout individu étant potentiellement journaliste s’il dispose au moins d’un téléphone portable. Pour les télévisions, l’avantage est double : les images sont gratuites et elles se forgent une image sympathique, en se montrant proches des personnes victimes de la répression ;
– les réseaux sociaux ont eux-mêmes profité des évènements politiques dans lesquels ils étaient involontairement impliqués pour se forger une nouvelle image. Google et Yahoo notamment avaient terni leur réputation en acceptant des arrangements avec la censure pour s’implanter en Chine (Google a revu sa position en 2010). Ils apparaissaient prêts à toutes les compromissions politiques pour conquérir des parts de marché, comme toute entreprise classique, ce qui détonnait par rapport à leur image de jeunesse et de liberté. Encouragés par les dirigeants américains qui, comme Hillary Clinton, proclamait que la liberté de circulation des informations sur internet était un objectif de la politique étrangère des Etats-Unis, les réseaux ont modifié leur stratégie. Ils favorisent par des actions ponctuelles les mouvements protestataires. L’exemple le plus caractéristique en la matière est la page sur Facebook créée par Whael Ghonim, directeur du marketing de Google pour le Moyen-Orient, qui a servi de plate-forme à de nombreux insurgés du Caire.
Une rapide interprétation des événements du Moyen-Orient montre que les nouvelles technologies sont avant tout le medium privilégié de la protestation plutôt que le lieu où s’élaborent des idées politiques. Elles en sont des outils plus que des vecteurs.
Le recours aux réseaux sociaux dans le monde arabe a suivi les mêmes étapes qu’en Occident, où les individus ont d’abord bénéficié d’une presse écrite et audiovisuelle, puis ont recouru à des blogs pour communiquer sur leur vie ou leurs activités, avant de connaître Facebook et d’autres réseaux sociaux. Ce phénomène s’est déroulé sur une trentaine d’année et a accompagné l’urbanisation croissante d’une population de plus en plus jeune, avide de communiquer. Avec 15 millions d’usagers, les abonnés à Facebook dépassent depuis 2010 le nombre de lecteurs de la presse écrite dans les pays arabes. De nouveaux espaces sociaux ont ainsi été créés par des jeunes, qui partageaient de moins en moins l’idéal de consensus et de compromis propre aux sociétés arabes, lui préférant la confrontation des idées, considérée comme le moteur des sociétés occidentales. Cette différence fondamentale entre générations n’a pas échappé aux dirigeants arabes, qui tout en acceptant la croissance d’internet dans leur pays pour les nombreux services économiques qu’il rendait, avaient mis le réseau sous surveillance policière. Les polices égyptiennes et tunisiennes consacraient d’importants moyens humains et matériels à la traque d’éventuels opposants qui usaient des nouvelles technologies.
Les polices précitées se sont toutefois heurtées à une caractéristique des nouvelles technologies lorsqu’elles ont cherché à aller plus loin dans la répression, en fermant par exemple les canaux d’internet. Les technologies sont en effet convergentes. Si ces canaux sont bloqués, les réseaux sociaux peuvent fonctionner sur téléphone portable. Il existe une telle fluidité des flux d’information qu’aucun pouvoir ne peut espérer les contrôler.
Une lecture économique et sociale conduit à ne pas surestimer le rôle des nouvelles technologies. La concomitance des mouvements populaires dans le monde arabe a semblé les mettre au premier plan, mais Bahreïn, l’Algérie, le Maroc, la Libye, la Tunisie et l’Egypte souffrent avant tout des mêmes problèmes : une population jeune, sous-employée alors qu’elle est de mieux en mieux éduquée, évoluant dans un milieu urbain qui favorise la communication. Internet a été le révélateur comme le diffuseur d’un malaise qui a des racines économiques et sociales. Il se peut qu’à l’avenir, le même phénomène se produise dans d’autres zones du monde, y compris en Occident. Les protestations de la jeunesse espagnole depuis le début du mois de mai 2011 sont coordonnées sur les réseaux sociaux.
Il serait cependant erroné d’ignorer la dimension culturelle d’internet dans le monde arabe. Beaucoup d’observateurs se sont demandés pourquoi les évènements d’Egypte et de Tunisie n’avaient pas été prévus par l’armée des universitaires, experts et spécialistes qui oscultent en permanence le Moyen-Orient… Peut-être est-ce parce qu’internet est rarement un sujet d’étude en politique ou en sociologie. Un chercheur comme Yves Gonzalez-Quijano, qui analyse depuis de longues années à l’institut français de Damas les comportements dans les pays arabes, rappelle que les nouvelles technologies « favorisent en particulier dans la sphère des relations à l’Autre et à l’autorité politique, religieuse, familiale, des attitudes, des représentations, des pratiques toujours plus autonomes et individualisées qui rendent à l’évidence aujourd’hui impossible ou presque le maintien des anciennes formes de légitimité. A l’image d’autres situations historiques marquées elles aussi par d’importantes ruptures sur le plan des pratiques de communication, et ici on pense à la révolution française et à la place toute particulière qu’elle occupe dans l’histoire, on peut faire l’hypothèse qu’il y a bien des origines culturelles numériques aux révolutions ( ?) tunisienne et égyptienne ».
Internet, forum de dialogue direct, a incontestablement favorisé les multiples formes de contestation des pouvoirs en place depuis 2009. En politique internationale, lieu théoriquement réservé aux chefs d’Etat, aux élus et aux diplomates ainsi qu’aux experts en stratégie, cette irruption brutale de l’opinion publique ne peut manquer en apparence d’avoir des répercussions sur l’orientation même des choix… Il manque toutefois aux utilisateurs des nouvelles technologies une dimension essentielle pour atteindre ce but : la capacité d’élaborer des doctrines, qui sont la base de toute politique. Jusqu’ici, internet a prouvé son remarquable pouvoir à mobiliser des millions d’êtres humains dans des mouvements protestataires ou autour de causes précises, électorales, humanitaires, environnementales, culturelles, mais là s’est arrêté son rôle en politique… La construction de politique demeure à ce jour l’apanage d’autres cercles, pour lesquels internet est un outil de diffusion, mais ils ne s’en servent pas pour faire appel à de nouvelles idées. Ce sera peut-être un nouveau stade de la politique dans quelques années, tant le potentiel des nouvelles technologies est impressionnant.
Les valeurs que véhicule internet – liberté, notamment de communication, mais aussi individualisme – forment les bases des sociétés occidentales. L’expansion de cet outil assure à terme leur prééminence dans le monde. Cet aspect n’a pas échappé à la diplomatie américaine qui fait désormais d’internet non pas un simple outil mais un vecteur – cette fois public – de sa politique étrangère.
3. Internet au service de la diplomatie douce : l’exemple du Département d’Etat américain
Les observateurs de la campagne présidentielle de 2008 ont été impressionnés par l’usage qu’a fait Barack Obama des nouvelles technologies pour conquérir les votes des Américains. Arrivé au pouvoir, le Président des Etats-Unis a continué de leur accorder un intérêt soutenu. IBM, Oracle, Apple, Yahoo, Google et Facebook sont toutes des sociétés américaines, la plupart leaders dans leur domaine et même si elles délocalisent largement leurs fabrications, elles sont créatrices d’emploi et de valeur aux Etats-Unis et participent largement de l’effort de recherche du pays. Le déjeuner qu’a offert le Président à leurs dirigeants, en février 2011, a pris valeur de symbole, et plus encore le fait d’avoir placé à sa droite le plus jeune d’entre eux, Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook.
Internet comme outil d’exercice du pouvoir, et non comme simple canal de communication : là se situe la grande différence entre les Etats-Unis et les autres pays du monde. Pour l’équipe du Président, les nouvelles technologies modifient la conduite de la politique, et donc de la diplomatie. Créées par la sphère privée, elles constituent l’instrument idéal pour l’un des axes de la politique étrangère américaine : redresser l’image des Etats-Unis mis à mal par l’unilatéralisme de l’administration de George W. Bush en utilisant tous les atouts de la soft diplomacy.
a) Le smart power, une idée élaborée par des laboratoires d’idées
Internet, enjeu et outil de pouvoir, a constitué un sujet d’étude pour de nombreux laboratoires d’idées, certains proches du parti Républicain, sous le second mandat du Président Bush. La paternité du terme smart power revient à Suzanne Nossel, dans un article publié en 2004 dans Foreign Affairs (n° 83, 2004). Le terme a été repris par le centre d’études stratégiques (Center for strategic and international studies, CSIS) en 2007, dans un rapport rédigé pour le Congrès. On ne s’étonnera pas que le diplomate Joseph Nye, co rédacteur de ce rapport et qui a servi sous deux administrations démocrate (Carter et Clinton), ait trouvé l’idée intéressante et l’ait reprise à son compte, lui qui a consacré un livre au concept de soft diplomacy. Le cheminement du smart power est une illustration particulièrement éclairante du marché aux idées que forment les grands laboratoires d’idées de Washington et de New York. Le concept est devenu une politique systématisée par l’administration démocrate et mise en lumière par Hillary Clinton le 13 janvier 2009, lors de sa première audition par la commission des Affaires étrangères du Sénat.
Le smart power n’est rien d’autre que le constat que les facteurs classiques de la puissance (force militaire et économique) ne suffisent plus à un Etat à assurer sa prééminence dans le monde. Les Etats-Unis ont échoué en Somalie, ont peiné en Irak et ne parviennent pas à sortir du conflit afghan en position de vainqueurs. Il ne s’agit pas de renoncer aux atouts classiques de la puissance, mais il faut les combiner avec la valorisation du modèle américain, de son mode de vie, de l’image de liberté que portent les Etats-Unis et qui constitue un réel pouvoir d’attraction. La différence, toutefois, avec le concept de soft diplomacy, tient à la prise en compte des potentialités des nouvelles technologies. En étant largement décentralisées, en étant utilisées par des milliards d’individus, elles aboliraient en politique étrangère, le cadre du rapport d’Etat à Etat, de diplomates à diplomates, pour lui substituer un rapport « d’Etat à individus et d’individus à Etat » (8).
b) La faculté d’agir en réseau, nouvelle condition de la puissance
Dans un monde où les centres de décision comme de production (intellectuelle, industrielle, culturelle…) sont désormais multiples et non plus centralisés, caractérisé par l’interdépendance des Etats, des entreprises et des individus, agir en réseau devient un critère de puissance. La connectivité, concept dégagé par Anne-Marie Slaughter (9) consiste pour un Etat à disposer d’un maximum de connexions et de canaux de communications pour avoir le plus d’influence possible sur les structures (entreprises, associations) et les individus et être au cœur de la mondialisation. Si l’on voulait opérer une comparaison avec l’industrie aéronautique, les Etats-Unis ambitionnent de se constituer en plaque tournante (hub) par laquelle transiterait l’ensemble des idées. Un tel projet peut avoir un impact réel sur l’économie car le bouillonnement intellectuel est source de créativité technologique. La place des Etats-Unis comme leader des industries liées à internet en serait renforcée.
c) Un outil de promotion des valeurs américaines
Internet comme outil de la diplomatie américaine obéit au même schéma intellectuel que celui promu de tous temps par les laboratoires d’idées : le monde est plus sûr – donc la sécurité des Etats-Unis est mieux assurée – s’il partage les valeurs américaines de liberté et de société ouverte. L’expansion des nouvelles technologies ouvre un champ nouveau d’action pour les promouvoir avec un nombre démultiplié de destinataires, bien plus large que la diffusion des revues de politique internationale.
L’outil est fondé sur une affirmation de principe : la liberté de circulation sur internet, analogue à la liberté des mers, vigoureusement affirmée par Hillary Clinton dans un discours de janvier 2010. Cette liberté autorise tout acteur à agir comme il le souhaite. Les acteurs publics, comme le gouvernement des Etats-Unis, peuvent donc « soutenir les sociétés civiles sur le terrain » (Hillary Clinton, novembre 2009), quel que soit le territoire où elles évoluent. Ce n’est rien d’autre qu’une faculté d’ingérence, que l’on jugera sans doute utile pour combattre des dictatures en s’adressant à leurs populations – les radios destinées aux citoyens des pays de l’Est, lors de la guerre froide, remplissaient une fonction similaire – mais la stratégie américaine vise l’ensemble du monde, y compris des pays libres.
Tout un appareil a été mis au service de cet objectif. Il existe depuis 2003 un bureau de la diplomatie internet (office of eDiplomacy) au Département d’Etat. Il gère America.gov, le portail de la diplomatie américaine, traduit en 35 langues, mais s’attache surtout à assurer la présence du Département sur le réseau social, avec l’animation de 230 comptes sur Facebook, de 80 comptes sur Twitter, de 25 blogs, auxquels s’ajoutent des vidéos visionnées plus d’un million de fois sur You Tube. Deux ambassadeurs ont été nommés pour défendre le principe d’un internet libre, Alec Ross (ancien chargé de la communication sur internet de Barack Obama pendant la campagne électorale de 2008) et Jared Cohen, ancien membre du bureau de planification politique sous l’administration de George W. Bush. Ils sont souvent accompagnés lors de leurs missions par des responsables des principales sociétés américaines opérant sur internet, ce qui souligne la communauté d’intérêts entre le gouvernement et ces sociétés.
La politique de l’administration américaine est encore en voie de construction, mais elle permet déjà la diffusion des messages du Département d’Etat dans des dizaines de langues, auxquels ont répondu, via Facebook, des internautes du monde entier (environ 20 millions, depuis l’Europe, mais aussi le monde arabe, l’Iran, le Pakistan, l’Inde), comme s’il était naturel pour eux de s’adresser aux autorités de Washington. Les grands discours du Président Obama font l’objet d’une stratégie soigneusement établie. Celui du Caire, prononcé en juin 2009 à l’intention des pays arabes, a été transmis à l’ensemble des réseaux sociaux et traduit dans les 13 principales langues du Moyen-Orient.
4. Internet, instrument d’oppression
L’analyse des effets d’internet ne peut être unilatérale, en d’autres termes, considérer que cette technologie est un instrument de libération parce qu’elle a des effets émancipateurs. Les réseaux sociaux ont certes joué un rôle en Tunisie et en Egypte, mais si la politique se limite à des appels et que les diverses forces protestataires ne peuvent se coordonner autour d’un plan d’action, les manifestations seront sans lendemain. En Libye, la journée de la colère du 17 février 2011 n’a ainsi pas constitué l’élément déclencheur de la révolte, qui tirait plutôt ses racines de la tradition frondeuse de Benghazi, ville en opposition constante au pouvoir du colonel Kadhafi.
Les régimes dictatoriaux ont aussi la capacité de tirer parti d’internet, soit par des actions sporadiques, comme au Soudan, où les services secrets ont ainsi lancé de faux appels pour arrêter les protestataires qui descendaient dans la rue, ou en Biélorussie, où le site du journal d’opposition Novaïa Gazeta est régulièrement attaqué. Internet peut aussi être au cœur d’une stratégie plus globale. La Russie et la Chine placent les nouvelles technologies au cœur de leur doctrine de défense et considèrent que l’espace virtuel est un champ de bataille au même titre que l’air, la terre ou les océans. Pékin dispose ainsi officiellement d’un corps de plusieurs milliers d’informaticiens, chargés de tester les défenses de gouvernements étrangers (ont ainsi été attaquées des administrations en France et en Allemagne) mais aussi de discréditer sur internet des personnes qui critiquent le pouvoir. Cette tactique est plus habile qu’une attitude répressive, la Chine pouvant ainsi se targuer d’une attitude libérale à l’égard des nouvelles technologies et afficher parallèlement le soutien de milliers de ses citoyens. En Russie, l’armée dispose de cybertechniciens et le gouvernement reconnaît discrètement être appuyé en ce domaine par des « associations de jeunes patriotes »… Ce sont elles qui auraient lancé l’attaque contre l’ensemble des systèmes informatiques de l’Estonie pendant l’été 2007.
La balance serait ainsi égale entre liberté et oppression via internet. Telle est notamment la thèse du chercheur Evgeny Morozov, originaire de Biélorussie, qui travaille désormais à Stanford et qui, à la lumière de sa propre expérience d’activiste, assimile à des cyberutopistes ceux qui voient dans internet un instrument de démocratie. Sa thèse est souvent combattue par des chercheurs qui lui reprochent de négliger les aspects spécifiques des nouvelles technologies comme l’individualisation des comportements et les possibilités d’accès à de multiples sources d’information, malgré la censure. L’intrusion d’internet dans les politiques nationales et internationales est encore trop récente pour en mesurer l’impact avec précision, mais nul doute qu’il s’agit d’un champ d’analyse passionnant pour les relations internationales.
E – La soft diplomacy, ou l’exploitation intelligente de l’influence diffuse
Le terme de soft diplomacy, ou encore de soft power, ne signifie évidemment pas diplomatie douce ou pouvoir doux, mais renvoie à la capacité d’influence. Diplomatie publique ou diplomatie d’influence sont plus usités dans notre langue… Si des auteurs français comme le général Faupin ou Nicolas Tenzer s’y intéressent depuis la fin des années 90, il revient au diplomate américain Joseph Nye d’en avoir analysé les ressorts. Convaincu des mérites d’une politique « sans carottes ni bâton » (sans être pour autant naïf ou idéaliste, car il fut négociateur sur les armes stratégiques pour le compte du Département d’Etat), il ne souhaitait pas laisser le champ libre aux thèses de son collègue Robert Kagan, qui fonde les relations internationales sur un classique rapport de force.
Le concept est très ancien. Il remonte au VIIème siècle avant J.C. dans une parabole de Lao Tseu, qui vantait les mérites de l’eau, moins solide que le rocher qu’elle devait contourner, mais qui avançait toujours grâce à sa fluidité. Il a été repris dans l’Angleterre victorienne lorsque des diplomates britanniques ont remarqué que le capital de sympathie dont leur pays jouissait ne provenait pas des facteurs classiques de la puissance mais plus prosaïquement de son mode de vie et du rayonnement de ses œuvres littéraires, notamment Alice au pays des merveilles, de Lewis Caroll.
Transposé à notre époque, ce concept confère une capacité d’influence à de nombreux facteurs économiques et culturels qui donnent une image positive d’un pays. Le mode de vie décontracté des Etats-Unis, symbolisé par des marques mondiales comme Apple, Nike ou Mc Donald’s, auquel s’ajoute le prestige de son cinéma, maintiendraient ainsi en permanence un capital de sympathie envers un pays dont les interventions militaires, constantes depuis Théodore Roosevelt, sont souvent critiquées. L’art de vivre à la française, le TGV, la fusée Ariane et certaines associations comme Médecins sans Frontières (connue à l’étranger sous le vocable de French Doctors) joueraient un rôle analogue pour notre pays.
Encore faut-il différencier ce qui relève de l’action consciente et coordonnée dans un but politique de ce qui a trait à l’image d’un pays. Avec le Burj al Arab et le Burj Dubaï, les Emirats arabes unis disposent de symboles architecturaux universellement connus, mais ces derniers sont simplement une vitrine qui ne leur confère aucun avantage spécifique en matière internationale. Quand en revanche le gouvernement américain obtenait en 1946 du gouvernement de Léon Blum qu’une des conditions de l’effacement de la dette bilatérale française à l’égard des Etats-Unis fût la fixation d’un quota de diffusion dans les cinémas français des films produits à Hollywood (accords Byrnes / Blum), il pariait clairement sur l’impact d’un media de masse pour valoriser l’image des Etats-Unis dans notre pays, à une période où une large part de l’opinion publique soutenait l’URSS. Quand Condoleeza Rice prévoyait en 2006 de dégager 85 millions de dollars pour soutenir des média iraniens libres avec le concours de la presse américaine, lorsqu’elle souhaitait la même année augmenter le nombre d’étudiants iraniens dans les universités américaines, elle usait clairement de deux outils d’influence.
1. Les objectifs de la soft diplomacy (diplomatie publique)
La soft diplomacy est le plus souvent définie comme la capacité d’orienter le comportement d'un État par des moyens autres que contraignants. L’on rétorquera que dans les relations internationales, cette définition correspond au cœur du métier de diplomate, par opposition à l’action militaire, mais ce type d’action est plus subtil, puisqu’il vise à obtenir un résultat sans passer par des négociations.
Il existe autant d’objectifs de diplomatie publique qu’il existe d’Etats. Tout dépend de leur capacité à mobiliser les acteurs de leur société. Aux Etats-Unis, suivant les préceptes de Joseph Nye, les stratèges du Département d’Etat désignent aujourd'hui par cette expression une action dont les vecteurs ont été, au début des années 2000 l'aide au développement, l'action humanitaire et les accords commerciaux et auxquels a été rattachée très récemment la liberté d’expression sur internet. L’objectif final est de créer un monde où règnent démocratie et économie de marché, deux valeurs fondamentales de la société américaine. Au Japon, le concept est apparu dans deux documents officiels, le premier rédigé par le Conseil national de sécurité en 2004 et destiné au Premier ministre Junichiro Koizumi, appelant « à faire usage du soft power et du hard power comme moyens de préserver la paix et la sécurité » ; le second, dans le rapport soumis au Premier ministre Naoto Kan, en août 2010 par le Conseil sur la sécurité et les capacités de défense dans l’Ere nouvelle, qui considère que le soft power est un élément de l’identité du Japon, « nation créatrice de paix ». Dans les deux cas, les rapports considèrent la nature multiforme des menaces à la suite des attentats du 11 septembre et plaident pour une stratégie intégrée pour empêcher ces menaces d’atteindre le Japon. Ils accordent également une grande importance à la sécurité des individus (sécurité alimentaire, développement, libertés) comme facteur de prévention des conflits.
Le cas du Japon est intéressant car sa Constitution l’empêche d’user des classiques rapports de force en usage dans les relations internationales. Comme le rappellent constamment ses dirigeants, le Japon n’intéresserait personne s’il n’y avait le poids de ses industries et de sa recherche scientifique. Il n’est en effet placé sur aucune route stratégique et ses ressources naturelles sont quasi inexistantes. Se projeter à l’extérieur est son unique chance d’exister dans le monde contemporain. Le soft power devient dès lors l’un de ses principaux modes d’action diplomatique et comporte des enjeux grandissants, avec la défense des positions de la troisième économie du monde et le maintien de son influence en Asie, grâce à l’aide au développement, face à une Chine dont les velléités impériales inquiètent ses voisins. L’aide au développement est clairement définie dans un document de 2003 comme le meilleur moyen de garantir la paix et la sécurité du Japon et les actions à conduire, notamment la reconstruction post-conflit et l’aide à moyen et long terme doivent profiter aux entreprises japonaises. Tokyo ne lie pas les droits de l’homme et le développement auprès des pays receveurs, en raison de son passé militariste et expansionniste et préfère se limiter aux volets techniques de cette politique, qui garantissent en fin de compte à ses entreprises un accès plus aisé aux marchés.
La rivalité entre la Chine et Taïwan constitue un autre exemple d’usage de la diplomatie d’influence. La Chine s’est servie de l’exposition universelle de 2010 à Shanghai comme d’une manifestation de sa nouvelle puissance économique, mais le contrôle qu’elle exerce sur ses médias et les atteintes récurrentes aux libertés continuent d’altérer son image. Pékin use des facteurs classiques de puissance que sont ses armées, sa dissuasion nucléaire et le produit de ses excédents commerciaux détenus par sa banque centrale. En comparaison, Taïwan, exclue des Nations Unies, et dont la protection est assurée par les Etats-Unis, fait délibérément de la soft diplomacy un outil de politique étrangère. Son ministère des affaires étrangères a financé ainsi la participation d’ONG aux conférences internationales ainsi que les tournées d’artistes. Tout est mis en œuvre pour atteindre deux objectifs fondamentaux : rappeler l’existence de Taïwan sur la scène internationale mais plus encore, montrer aux citoyens de Chine populaire qu’une autre Chine existe, qui garantit les libertés individuelles. Ce volet est primordial pour les dirigeants taïwanais dans le bras de fer qui les oppose périodiquement à Pékin. Ils caressent le rêve qu’une réunification se ferait sur la base du modèle sociétal de Taipeh et non sur celui de Pékin, « Taïwan servant de phare et d’exemple pour la Chine continentale » comme l’a affirmé en mars 2008 le Président Ma Ying-Jeou.
La France ne semble pas avoir de stratégie bien définie pour sa diplomatie d’influence. Elle limiterait ce concept au rayonnement culturel, par le seul biais de l’action publique, avec l’entretien à l'étranger d’un réseau dense de centres culturels, d’alliances françaises et de centres de recherche en sciences sociales, sans que les incidences de ce réseau aient fait l’objet d'une étude d’impact. Plusieurs rapports récents ont pourtant mis l’accent sur la nécessité de revoir notre stratégie d’influence à l’échelle internationale, notamment les rapports de MM. Bernard Carayon (2003) et Henri Martre (2004) sur l’intelligence économique.
Comme le soulignent Nadège Ragaru et Pierre Conesa (10), « le débat autour de la diplomatie d'influence naît dans une certaine mesure, en France, du constat d'un décalage entre l'image de modèle universel que le pays cherche à faire prévaloir depuis le XVIIIe siècle et la réalité vécue. La France subit de plein fouet les transformations contemporaines du système international, mais a-t-elle entamé sa propre mutation ? Rien n'est moins sûr ».
2. L’utilisation intelligente de vecteurs privés d’influence
La soft diplomacy peut s’exprimer par les canaux publics, avec l’entrisme dans les organisations internationales (notamment les secrétariats généraux et administrations internationales, ce que les Anglais savent très bien faire) ou par des manifestations culturelles, mais l’utilisation volontaire de vecteurs privés comme relais d’action ou d’expertise constitue un autre moyen.
La mise en place d’une telle stratégie par un Etat exige qu’il réponde à plusieurs questions : comment définit-il l'influence ? De quels instruments cherche-t-il à se doter pour accroître son poids sur la scène internationale ? Quelle importance accorde-t-il, par exemple, à la formation des futures élites des États partenaires? Quel usage fait-il des diverses sources d'expertise et quelle place accorde-t-il aux acteurs non étatiques dans le déploiement des stratégies d'influence ? Doit-il considérer les acteurs non gouvernementaux comme ses relais éventuels ou comme des rivaux élaborant leur propre politique étrangère, qui empiètent sur le champ d’action habituel des diplomates? Où se créent les affinités personnelles et les solidarités qui contribueront, dans l'univers des enceintes multilatérales et des sommets, à influencer l’inscription à l’ordre du jour des problèmes internationaux ?
Ces questions importent d’autant plus que dans un monde où la guerre a disparu entre pays développés, sont apparus dans le débat public des sujets étrangers au travail diplomatique traditionnel comme l’environnement, la régulation financière ou internet.
Les réponses varient selon les Etats. Il est plus facile pour la diplomatie américaine de solliciter la sphère privée puisqu’il n’existe quasiment pas de corps dans la haute fonction publique qui aurait un monopole professionnel à défendre. Le recours à des laboratoires d’idées pour préparer le terrain de décisions politiques est d’autant plus courant qu’il y a le plus souvent identité de vue entre ces derniers et le gouvernement sur la politique étrangère des Etats-Unis. Tout au plus peut-on relever des nuances, comme le soutien qu’apporte Human Rights Watch à la cause palestinienne, alors que la plupart des acteurs publics et privés affichent leur sympathie envers Israël. Pour le reste, le gouvernement américain n’hésite pas à confier des études à la Rand sur de nombreux sujets, à user de la rhétorique du Nuclear Threat Initiative (NTI, fondée par l’ancien Sénateur Lugard), de Carnegie ou encore du Centre de Monterey pour appuyer son action contre la prolifération nucléaire et balistique, à utiliser au début des années 90 le German Marshall Fund pour préparer l’adhésion à l’OTAN des pays de l’ex-bloc soviétique ou à déléguer la gestion d’échanges universitaires à One to World. Le principe de base est à chaque fois identique : agir aujourd’hui sur les idées pour préparer les décisions de demain, les vecteurs privés constituant les démultiplicateurs de la vision américaine du monde. Les résultats ont été impressionnants dans certains domaines, notamment l’influence américaine sur le personnel politique des pays d’Europe de l’Est. Cette action se poursuit actuellement en faveur de jeunes opposants au régime en place au Belarus, qui bénéficient de bourses d’études et de formation à l’Etat de droit grâce à l’université de Stanford, ainsi qu’en faveur des écoliers et étudiants du Kosovo, dont l’éducation est largement financée par l’école américaine de Pristina.
Lorsque les vecteurs privés ne sont pas des relais, ils peuvent jouer un grand rôle en tant que forum où s’échangent des idées. Cela permet à un gouvernement d’avoir un accès privilégié à l’information quant à de possibles évolutions en matière internationales. En ce domaine, il existe un quasi monopole américain, car rien ne remplace les réunions du Council on foreign relations, chaque année, lors de l’Assemblée générale de l’ONU, les conférences de la fondation Carnegie et du CSIS ainsi que les réunions discrètes de la commission trilatérale à Washington. Hors des Etats-Unis, seuls deux entités rivalisent : Chatham House, au Royaume Uni et la Conférence de Munich sur la politique de sécurité précitée.
Malgré un recours croissant à l’expertise d’organismes privés, comme l’Institut de développement durable et des relations internationales (IDDRI) pour la préparation et le déroulement des négociations climatiques ou sur la biodiversité, la France est loin d’utiliser tous les atouts que lui offre sa société civile. L’analyse de Nicolas Tenzer (ancien chef de service au Commissariat général au Plan et fondateur de Terra Nova – cf bibliographie) demeure actuelle sur « l’étiolement de l'influence de la France telle qu'elle avait été construite dans l'après-guerre et par la doctrine gaullienne ». Il note la dévalorisation relative des instruments traditionnels sur lesquels l'État français s'était appuyé (siège permanent à l'Organisation des Nations unies et puissance nucléaire) et l'insuffisance de l'expertise française dans les domaines plus inédits des relations internationales (internet par exemple). Les cloisonnements entre les milieux de la recherche et de la décision, la négligence des rencontres internationales informelles, l'absence de structures de réflexion conceptuelle sur la politique étrangère et la sous-estimation du rôle des personnels français employés dans les organisations internationales figurent parmi les paramètres expliquant l'échec à influencer la définition des priorités et des principes sur la scène internationale. Il souligne que la France peut « certes vitupérer la prédominance des modes de pensée anglo-saxons, mais ces lamentations sont dérisoires si nous ne sommes pas capables de proposer des schémas alternatifs». Il manque à la France non seulement une législation fiscale qui accroîtrait les dons aux fondations mais surtout la définition au plus haut niveau de l’Etat d’une stratégie d’utilisation de la sphère privée. Cela signifie que ce dernier admettrait que les relations internationales ne sont plus le monopole de l’appareil administratif. L’idée semble cheminer lentement, sans doute trop lentement au regard de la rapidité des évolutions du monde. Du moins faut-il saluer à leur juste valeur les récentes réformes au sein du Quai d’Orsay, qui accorde désormais plus d’importance à la société civile comme aux technologies de la communication.
Cette définition d’une stratégie est d’autant plus nécessaire que l’analyse des politiques d'influence révèle la difficulté, pour les États qui souhaitent les promouvoir, de maîtriser pleinement l'extraordinaire richesse des flux de communication et d'information, ainsi que leur capacité à distinguer la part des intérêts privés et publics que ces flux représentent. La multiplicité des canaux d’influence diffuse exige préalablement un effort de recensement des lieux de pouvoir ou d’influence que n’a sans doute pas effectué le Quai d’Orsay, ou dont il garde le résultat secret. La fondation Prometheus, en France, a accompli ce travail pour déterminer les lieux d’influence qui affectent le secteur privé. Ce n’est que lorsque ces lieux sont définis qu’une action est en effet possible.
L’influence diffuse emprunte des canaux très divers, s’exerce souvent sur le long terme et a pour conséquence d’agir sur les consciences ou sur l’environnement dans lequel évoluent les personnes. L’influence directe est de nature différente. Elle résulte de liens qui s’établissent entre personnes ou entre structures. Elle se constate a posteriori, lorsqu’il apparaît que des particuliers, grâce à leur réseau de relations, ou des structures, en raison de leurs poids, ont pesé sur les choix d’autres décideurs.
Les Etats cherchent en permanence à exercer ce type d’influence dans la conduite de leur politique internationale. Elle constitue un élément parmi d’autres d’un jeu qui mêle rapport de force et persuasion pour obtenir gain de cause dans une négociation. La problématique est quelque peu différente pour des entités privées. Elles peuvent en effet vouloir influer sur des Etats lorsque ces derniers sont un passage obligé pour accomplir leurs objectifs : ainsi en est-il des ONG de défense des droits de l’homme qui souhaitent étendre le concept d’ingérence ou des entreprises d’armement qui recherchent des contrats. Elles peuvent également exercer des activités qui n’ont pas de lien apparent avec des activités publiques mais qui ont des conséquences notables sur celles-ci. L’exemple le plus spectaculaire actuellement est le poids des agences de notation sur la conduite des politiques monétaires et budgétaires des Etats-Unis et des pays de la zone Euro.
L’influence directe des entités privées s’exerce selon des modalités qui dépendent de leur objet et de leur statut. Celles qui ont un but non lucratif (clubs de réflexion, laboratoires d’idées, ONG activistes) recherchent des relais directs au sein du pouvoir politique ou à susciter de vastes débats d’idées sur les questions économiques et sociétales (taxe sur les transactions financières). Il en est de même pour les entreprises, mais celles qui ont un caractère transnational, qui remplissent des fonctions ou maîtrisent des technologies indispensables à la vie de la société visent essentiellement à façonner un environnement favorable à la marche de leurs affaires. Cet objectif peut passer par l’Etat ou être atteint en influençant des secteurs qui échappent à son autorité.
Les sources privées d’influence sont en conséquence très variées et l’appréciation que l’on porte sur elles dépend largement du système de valeurs auquel on adhère. « Figurons-nous une échelle de gradation avec à une extrémité une autorité non étatique qui soutient et renforce l’autorité de l’Etat et à l’autre, une autorité non étatique qui conteste et défie, ou menace de supplanter l’Etat. Leur place sur l’échelle de gradation n’est pas et ne peut être déterminée objectivement. Celle-ci dépend entièrement des perceptions de l’Etat, s’il considère l’autorité non étatique comme une alliée, une partenaire utile dans l’organisation de la société ou la gestion de l’économie, ou s’il voit en elle une ennemie, une rivale en termes de légitimité et de puissance. Un Etat fort, très autoritaire, a des chances d’être plus jaloux de son monopole du pouvoir qu’un Etat faible, décentralisé » (Susan Strange, cf bibliographie). Ce débat sur la place respective de l’Etat et de la sphère privée a son importance en politique internationale car il répond à une question fondamentale : qui gouverne le monde, ou plus modestement, qui dirige certains aspects de la vie internationale ?
Il n’existe pas de réponse unique, mais plutôt plusieurs grilles de lecture. La place de l’Etat demeure prédominante dans les fonctions régaliennes et dans celles qui leur sont liées, comme la gestion des migrations internationales. Elle s’estompe lorsque l’on aborde les rivages de l’économie, mais avec de fortes nuances. Total en Afrique de l’Ouest, BP en Azerbaïdjan et Chevron Texaco en Arabie saoudite jouent pour leur propre compte mais forment des éléments des politiques étrangères des trois pays dont ces compagnies sont issues. Il en est de même pour toutes les sociétés qui exercent des métiers considérés comme stratégiques : télécommunications, armement et finance.
Il est plus facile d’identifier les vecteurs d’influence qui agissent sur des normes juridiques et techniques car celles-ci sont tangibles, que de déterminer les vecteurs qui ont joué sur des politiques. Les vecteurs privés de fixation des normes sont souvent discrets, mais identifiables in fine. Il est en revanche plus difficile d’analyser l’influence directe des fondations (laboratoires d’idées, ONG) en matière internationale sans connaître les liens personnels que leurs membres ont pu nouer avec les détenteurs du pouvoir politique. Là encore apparaît une nette dichotomie entre les laboratoires d’idées américains, dont certains ont défini des éléments de politique étrangère, et les autres laboratoires d’idées, qui n’exercent qu’une influence marginale sur les pouvoirs en place.
A – L’influence directe sur le pouvoir
L’influence directe sur le pouvoir politique relève d’un mode relationnel ou structurel. Une entité privée exerce ce type d’influence si l’un de ses membres a des rapports privilégiés avec les détenteurs du pouvoir politique ou s’il accède directement à des fonctions politiques (mode relationnel). Mais l’influence résulte aussi du poids qu’exerce une entité sur la société, de sa capacité à structurer son fonctionnement et à orienter les choix des décideurs politiques, économiques et sociaux (mode structurel). Les entreprises transnationales des secteurs stratégiques (énergie, finance, télécommunications) mais également les ONG qui ont un rayonnement mondial sont ainsi en mesure de peser sur des orientations politiques. Mais elles peuvent à leur tour être un élément, voire un instrument, de la politique étrangère des Etats.
1- L’influence directe des laboratoires d’idées et autres entités privées
Il est très difficile d’avoir une vision exacte de l’influence directe que peuvent exercer des groupes de réflexion en matière internationale, notamment par le biais des rapports entre personnes. Ce travail nécessiterait de croiser l’histoire de plus de 6 000 entités avec celle des personnalités qui ont travaillé en leur sein. Quelques grandes tendances peuvent néanmoins être dégagées.
La plupart des élus et responsables gouvernementaux des pays démocratiques sont membres de plusieurs clubs et groupes de réflexion. Aucun n’atteint toutefois la dimension des laboratoires d’idées américains, à l’exception des fondations allemandes liées au SPD, à la CDU et aux Verts (fondations Friedrich Ebert, Konrad Adenauer, Heinrich Böll, le budget des deux premières dépassant 100 millions d’euros) mais celles-ci n’entrent pas complètement dans le champ du présent rapport en raison de la part du financement public dans leurs ressources, qui avoisine 80%. Si ces clubs sont des machines à produire des idées, il n’est pas garanti que ces dernières trouvent automatiquement une traduction politique. Il faut en effet que les élus qui les portent puissent ensuite convaincre leur parti politique de les relayer.
Ce mécanisme ne s’applique pas aux Etats-Unis, où les partis politiques sont des plates-formes électorales et où le travail de réflexion est renvoyé aux laboratoires d’idées et aux universités. Leurs thèses peuvent trouver une application politique grâce à l’accès au pouvoir de leurs chercheurs. Au sein de l’actuel gouvernement américain, Timothy Geithner, secrétaire d’Etat au Trésor, a travaillé au Council on foreign relations ; Robert Gates, ancien secrétaire d’Etat à la défense, a été membre du même laboratoire d’idées (études sur les relations entre les Etats-Unis et l’Iran et le programme nucléaire iranien, recommandations sur la politique américaine à l’égard de Téhéran) et a siégé dans plusieurs conseils d’administration d’entreprises ; Leon Panetta, nouveau secrétaire d’Etat à la défense et ancien directeur de la CIA, a créé sa propre fondation, dont le siège est à l’université de Monterey. Le conseiller auprès d’Hillary Clinton pour le Moyen-Orient, Dennis Ross, a parallèlement à sa longue carrière diplomatique collaboré au sein de l’Institut de Washington sur la politique au Moyen-Orient et a surtout été le cofondateur de l’AIPAC, le plus puissant lobby pro israélien auprès des pouvoirs publics (Etat fédéral comme Etats fédérés) aux Etats-Unis.
Gardons-nous toutefois d’imaginer que les thèses d’un laboratoire d’idées seront reprises en bloc une fois qu’un de ses collaborateurs accède au pouvoir. La politique internationale obéit en effet à des constantes liées à l’histoire, la géographie, la démographie… Il faut un concours de circonstance assez rare dans la vie politique pour qu’un laboratoire d’idées puisse influer profondément une politique. Ce cas s’est néanmoins rencontré à quelques reprises. La fondation Heritage a largement inspiré la politique du Président Reagan à l’égard de l’URSS. Mais c’est surtout le laboratoire d’idées néo conservateur Project for a new american century (PNAC), qui a fonctionné de 1997 à 2006 et qui mérite attention pour la part déterminante qu’il a prise dans la doctrine de politique étrangère du Président George W. Bush. L’on peut en fait le considérer comme un faux laboratoire d’idées car il a été fondé par des personnes qui occupaient ou avaient occupé des postes dans l’administration, comme le diplomate et universitaire Robert Kagan et qui cherchaient délibérément à orienter la politique étrangère des Etats-Unis dans le sens de l’imperium. Son siège social a été établi dans les mêmes locaux (face à la Maison Blanche…) que l’American Enterprise Institute, une importante fondation opposée à l’intervention de l’Etat dans l’économie. Plusieurs des membres les plus éminents de l’administration Bush ont œuvré au sein du PNAC : Richard Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Richard Perle, Robert Zoellick, Jeane Kirkpatrick. C’est entre 1997 et 2000 que le PNAC a rédigé une série de documents, comme « Reconstruire la défense de l’Amérique » qui appelaient à maintenir la supériorité nucléaire, augmenter les dépenses de défense, développer et déployer des défenses anti missiles et repositionner les bases américaines dans le monde. Les entreprises d’armement ont contribué à leur rédaction. La doctrine d’attaque préventive contre tout agresseur potentiel a également été débattue en son sein. Globalement, les idées du PNAC en politique étrangère ont presque toutes été appliquées, y compris l’invasion de l’Irak que ce laboratoire d’idées avait réclamée le 26 janvier 1998 dans une lettre ouverte au Président Clinton.
La puissance du PNAC provenait du fait qu’il coordonnait un réseau de laboratoires d’idées partageant les mêmes valeurs (foi dans les institutions américaines et dans le capitalisme, appel à une défense forte). Parmi ses initiateurs se trouvaient entre autre trois fondations (Sarah Scaife, John M. Olin et Bradley), peu connues en Europe car basées hors de Washington, mais toutes disposaient d’importants moyens financiers. La fondation Sarah Scaife distribuait 235 millions de dollars en 2009 pour divers programmes, certains concernant la politique étrangère.
L’AIPAC (American Israël Public Affairs Committee), dont le siège, un bâtiment très discret, se trouve à quelques centaines de mètres du Capitole, constitue un autre exemple significatif d’influence directe, moins en raison de son idéologie que d’une spécificité de la vie politique américaine, à savoir la non limitation des dépenses électorales. L’AIPAC s’affiche clairement comme un soutien d’Israël mais ne marque pas d’hostilité particulière à un règlement du conflit, à la condition qu’Israël accepte les résultats d’une éventuelle négociation. Il dialogue d’ailleurs volontiers avec des représentants palestiniens. Par sa puissance financière et son réseau dans tous les Etats américains, l’AIPAC demande à tout candidat aux élections fédérales et locales d’afficher son accord avec la politique israélienne. En cas de réponse négative, l’AIPAC apporte une aide financière à son adversaire. Cette simple tactique, qui n’est pas propre à l’AIPAC (nombre de lobbies, comme les fabricants d’armes individuelles, agissent ainsi) lui permet d’affirmer que la quasi-totalité de la classe politique américaine soutient Israël. Fruit d’un travail minutieux qui cible chaque élément de l’espace politique américain (Chambre des Représentants, Sénat, Législatures des Etats, maires, juges), Benyamin Netanyahu, Premier ministre d’Israël a reçu une ovation à l’issue du discours qu’il a prononcé devant le Congrès, le 26 mai 2011.
2. Etats et entreprises stratégiques ou le jeu des influences mutuelles
Les milliers d’entreprises transnationales ou oeuvrant dans des secteurs sensibles ne présentent pas toutes le même enjeu. Tout dépend de leur caractère stratégique. L’industrie automobile ou la sidérurgie sont importantes en termes d’emplois et d’aménagement du territoire, mais elles n’exercent pas d’influence majeure au-delà de leur domaine d’activité. En revanche, les secteurs qui confèrent une puissance politique, qui structurent l’espace économique et sans lesquels d’autres activités auraient peine à s’exercer sont considérés comme stratégiques. L’on peut classer dans cette catégorie les métiers de la finance, qui ont acquis une autonomie grâce à leur puissance économique et à leur faculté d’auto régulation (cf B de la présente partie) et les secteurs de l’énergie, des communications et des entreprises travaillant pour les défenses nationales.
Ces entreprises ne peuvent théoriquement opérer que dans des cadres juridiques (droit, fiscalité) et politiques (accords de défense, sécurité) déterminés par les Etats. Elles constituent en conséquence des éléments des politiques étrangères des Etats dont elles ont la nationalité ; mais elles sont également, par leur puissance, en mesure d’orienter les politiques des Etats, voire de façonner un environnement à leur convenance, dans un jeu d’influence mutuelle.
– En tant qu’éléments de politique étrangère : la géopolitique du pétrole et des routes pétrolières (détroits, pipelines) a marqué l’histoire du XXème siècle. Les rapports entre les Etats-Unis et les pays du Golfe persique, entre la France et ceux du Golfe de Guinée, entre la Russie et l’espace de son ancien empire, entre la Chine et l’Afrique ou entre le Venezuela avec le reste de l’Amérique latine (contrats pour diminuer l’influence américaine) sont tous liés à l’accès et à la sécurisation des champs pétroliers. L’industrie nucléaire représente des enjeux similaires. La France (Areva), les Etats-Unis et le Japon (Westinghouse / Mitsubishi), la Russie (Rosatom) et désormais la Corée du Sud (Kepco) se disputent un marché mondial dont les clients seront technologiquement dépendants d’eux.
Dès lors que ces entreprises sont facteurs de puissance, l’on constate des passages à la fois fréquents et temporaires entre collaborateurs des secteurs publics et privés. Des diplomates du Quai d’Orsay ont ainsi exercé des responsabilités chez Total ou Gaz de France, comme Alain Azouaou, ancien ambassadeur au Qatar et actuellement en poste aux Emirats arabes unis. De nombreux dirigeants de l’industrie pétrolière américaine ont accédé à des postes de pouvoir à Washington, comme Richard Cheney, vice-président de 2000 à 2008.
Orientation de la politique des Etats : lorsqu’un secteur revêt un caractère stratégique, sa capacité à orienter la politique des Etats apparaît au premier plan. Déterminer si la politique pétrolière des Etats-Unis est celle de Washington ou de Chevron est une question classique en science politique et peut être reproduite pour chaque entreprise importante (parmi les 20 premières entreprises mondiales se trouvent 12 compagnies pétrolières). Il n’existe pas de réponse uniforme. Une entreprise évoluant dans un système politique autoritaire n’a pas d’autonomie politique. Si le système est libéral, elle dispose d’une latitude plus importante. BP est ainsi considérée comme un élément de la politique britannique en Azerbaïdjan, où elle dispose de vastes champs. Une analyse similaire peut être opérée dans les hautes technologies, notamment celles de l’information et d’internet, où la plupart des leaders sont des entreprises américaines que Washington défend en s’opposant à toute réglementation qui les empêcherait d’opérer librement. Les industries de défense sont également en plein cœur de ce débat. Le lobbying de Raytheon, Boeing et General Electric auprès des élus du Congrès et via de nombreux laboratoires d’idées pour mettre en place une défense anti missile américaine étendue aux pays de l’OTAN est une constante depuis le début des années 2000 et s’est étendu bien au-delà des Etats-Unis, dans les instituts de politique étrangère d’Europe occidentale et centrale et au sein des assemblées parlementaires internationales, comme celle de l’OTAN.
Façonner un espace économique à la convenance des entreprises : l’autonomie croissante des entreprises transnationales, la territorialisation multiple de leurs activités et leur puissance financière les conduit à construire l’espace économique mondial à leur convenance, le plus souvent avec l’accord des Etats quand elles assurent par leurs investissements la satisfaction des besoins des consommateurs. Il s’agit d’un phénomène ancien car les entreprises ont de tout temps établi les règles d’activité de leur secteur et souvent constitué des cartels (pétrole, acier, aluminium, uranium, transport maritime) pour éviter la concurrence excessive. La mondialisation a amplifié cette autonomie des grands secteurs économiques, au point qu’ils sont en mesure d’influencer les politiques publiques ou d’y résister (opposition du secteur de l’énergie aux normes environnementales, pratiques de la sphère financière, normes comptables déterminées par les grands cabinets d’audit…).
3. L’influence sur le droit social ou la réponse des syndicats à la globalisation économique
La globalisation de l’économie a modifié les cadres traditionnels des négociations sociales à travers le monde. Aux traditionnelles discussions dans un cadre national entre syndicats patronaux et de salariés, s’est ajouté un subtil combat entre les mêmes protagonistes, regroupés en confédérations internationales, à l’échelle mondiale. L’enjeu pour chacun des deux camps est de tirer parti de la globalisation. L’Union européenne constitue un bon observatoire en la matière car le droit économique et le droit social s’y construisent à coup de compromis issus de deux logiques opposées :
– les fédérations patronales, regroupées au sein de Business Europe, sont idéologiquement en faveur de bonnes pratiques, de la soft law et du moins de règles possibles. Elles aspirent à un marché global peu ou pas réglementé. A titre d’exemple, sur le dossier de la santé au travail et de l’exposition des employés à des substances dangereuses, elles sont partisanes de valeurs limites d’exposition à des produits, que les entreprises devraient être incitées à respecter, mais sont hostiles à une directive fixant des limites précises ;
– les organisations syndicales, regroupées au sein de la Confédération européenne des syndicats (CES ou ETUC, european trade union confederation) souhaitent compenser les effets de la globalisation en fixant des normes sociales précises mais leur objectif va bien au-delà. Ayant jugé que la globalisation emportait de multiples conséquences sur les relations entre sphère publique et sphère privée et que l’existence de sociétés transnationales rendait obsolète le dialogue social sur la seule échelle nationale, la CES s’est assignée pour mission de conduire des actions de lobbying pour influencer toute instance produisant des normes. Ce type de syndicalisme s’écarte de la solidarité internationale prônée habituellement par les syndicats, mais la CES a estimé qu’il était plus réaliste d’agir sous un angle réformiste plutôt que révolutionnaire. Estimant par ailleurs que la globalisation est une question politique plus large que l’économie, elle se considère en droit de prendre des positions sur tout problème, comme la gouvernance économique de la zone Euro ou le conflit israélo-palestinien.
L’influence sur la norme s’obtient de deux façons : soit par un accord interprofessionnel avec les organisations affiliées à Business Europe, comme sur le télétravail récemment ; soit par une action de lobbying des organisations syndicales affiliées à la CES, de manière classique, auprès des services de la Commission européenne et des membres du Parlement européen. Il peut s’agir d’une action de longue haleine. La directive de 1994 créant les comités d’entreprises européens est issue d’une réflexion datant des années 70 lorsque se développaient les sociétés transnationales. Pour celle de 1996 sur l’égalité salariale des travailleurs détachés dans l’Union européenne, demandée par les syndicats pour éviter les abus liés à la libre circulation des personnes, la CES a obtenu satisfaction après avoir négocié avec les services de la Commission, un accord avec les organisations d’employeurs n’ayant pu être trouvé.
La globalisation allant au-delà de l’Union européenne, les rapports des syndicats européens avec leurs homologues des autres continents constituent un nouvel enjeu. L’écart des normes sociales entre l’Europe d’un côté, l’Asie et l’Amérique latine de l’autre est à la fois une question humaine et de compétitivité. La CES travaille ainsi avec l’Asie et l’Amérique latine sur la base du plus petit dénominateur commun, à savoir l’exercice du droit syndical (souvent très théoriques dans de nombreux secteurs) et le respect des conventions de l’Organisation internationale du travail et demande que les prêts des grands bailleurs internationaux comportent un volet social comme le droit de se syndiquer et des normes de protection sur les chantiers pénibles. Les résultats sont variables selon les pays. Les rapports avec les syndicats indiens, qui sont bien organisés en vertu d’une tradition britannique, sont denses tandis qu’ils sont inexistants avec la Chine, où les syndicats sont en fait l’émanation du parti communiste.
Un dernier point mérite d’être souligné. Alors que les Etats-Unis sont souvent bien représentés au sein des vecteurs privés d’influence, leur action syndicale internationale est relativement réduite. Cette situation provient du fait que l’Union européenne est la principale émettrice de normes sociales et que la CES hésite à nouer des relations trop denses avec AFL-CIO, qui dispose de moyens financiers très larges, par peur que cette dernière prenne la tête du mouvement syndical international. Les relations sont en conséquence limitées à des actions ponctuelles, comme la formation de cadres syndicaux.
B – Le poids du secteur financier
Pour comprendre l’importance prise par le secteur financier dans les relations internationales, il convient de rappeler que les relations entre sociétés comme entre Etats sont essentiellement économiques et que le crédit – crédit à l’économie comme crédit interbancaire – y joue un rôle primordial. Le bon fonctionnement de l’économie mondiale dépend de la confiance que les créanciers accordent aux émetteurs de dettes.
La science économique s’est longtemps efforcée d’apparaître comme une branche rationnelle des sciences sociales. L’affirmation d’un marché obéissant à des règles logiques a longtemps constitué un dogme avant que sous l’effet des crises répétées et d’ampleur croissante, de nombreux travaux révèlent la part d’irrationnel dans les décisions économiques et l’importance de règles de droit – ou d’absence de règles – le plus souvent élaborées par des entités privées avant d’être avalisées par les Etats et leurs autorités de régulation. Il existe en effet des entités privées en mesure d’influencer des marchés et leur comportement explique entre autre comment les Etats occidentaux sont passés entre 2007 et 2010 de la situation de prêteur à une situation de dépendance envers les marchés financiers.
1. 2007 – 2010, ou la dépendance des Etats occidentaux aux marchés financiers
De septembre 2007 à avril 2009, les Etats occidentaux ont joué un rôle de prêteur en dernier ressort pour garantir la survie d’un secteur bancaire victimes de ses excès, notamment les subprimes, les dérivés de crédit et la titrisation (11). La première crise est survenue le 14 septembre 2007 avec la faillite de la banque Northern Rock, à laquelle le gouvernement britannique a rapidement répondu en garantissant une partie des dépôts. Quelques mois plus tard, la banque d’affaires Bear Stearns n’a pu honorer ses engagements. Le Trésor américain a alors accordé un prêt à la banque Morgan pour qu’elle rachète les actifs de Bear Stearns. Dans l’esprit des gouvernements britanniques et américains, il s’agissait d’opérations ponctuelles qui ne remettaient pas en cause le libéralisme prôné par la City comme par Wall Street.
La faillite de Lehman Brothers, le 15 septembre 2008, a modifié l’attitude des Etats. Avec 613 milliards de dollars de passif, la faillite de cette banque mettait en péril l’ensemble du crédit interbancaire. Si le Trésor américain a décidé de ne pas renflouer Lehman Brothers, il a abandonné le dogme de la non intervention dans la finance pour venir en aide à une série d’entreprises financières fragilisées par la crise, comme l’assureur AIG, les banques Citygroup, Bank of America et Merrill Lynch. En Europe, Fortis, Lloyds TBS et Royal Bank of Scotland ont bénéficié des interventions de la puissance publique. Ces interventions équivalaient à des nationalisations partielles ou totales. Moins exposées aux pertes que leurs consoeurs anglo saxonnes et belges mais néanmoins fragilisées, les banques françaises se sont contentées de recevoir 10,5 milliards d’euros de prêt à un taux d’intérêt de 8%, mais il semble que l’influence de BNP Paribas auprès des pouvoirs publics ait été déterminante pour empêcher l’entrée de l’Etat à leur capital.
Au total, les Etats occidentaux ont injecté sur cette courte période 5 000 milliards de dollars pour soutenir les banques et relancer l’activité économique, dépassant ainsi largement les plafonds de leurs dettes publiques. Or c’est sur les marchés qu’ils placent cette dette.
D’avril à octobre 2009, les Etats ont tenté d’imposer de nouvelles règles de fonctionnement aux marchés financiers. Avec un bref recul, cette politique était vouée à l’échec pour la simple raison que les Etats du G8 et du G20 agissaient en ordre dispersé, n’ayant pas la même conception de l’interventionnisme en la matière. Le Canada comme la Chine ne souhaitaient aucune réforme dans la mesure où leurs banques échappaient à la crise et ont ainsi rejeté l’idée d’une taxe mondiale sur les banques pour renflouer les Etats. La City est intervenue avec succès auprès du gouvernement britannique pour que les hedges funds ne soient pas réglementés tandis que les lobbies agissant pour le compte des banques américaines ont dépensé sur la seule année 2009 la somme de 467 millions de dollars auprès du Congrès, d’après le laboratoire d’idées Center for Responsive Politics.
Malgré des déclarations spectaculaires, les Sommets du G8 et du G20 n’ont débouché que sur des mesures marginales : déclaration de la fin du secret bancaire et publication d’une liste de paradis fiscaux (déjà connue depuis de longues années), encadrement mais non plafonnement du bonus des traders, allègement des règles relatives aux capitaux propres. Les nouvelles dispositions législatives n’ont pas fondamentalement réformé le secteur financier. Aux Etats-Unis, la loi Dodd / Frank n’a pas opéré la séparation entre banques de dépôt et banques d’affaire mais s’est limitée à encadrer certaines activités comme l’échange secret de produits spéculatifs ou le placement pour compte propre sur les marchés d’action. Cette impuissance provient du rétablissement très rapide du secteur bancaire et des acteurs des marchés. Grâce aux prêts des Etats, ils ont rapidement reconstitué leurs marges, rétablissant ainsi leur pouvoir. Cette situation n’était pas nouvelle, sauf sur un point fondamental : les dettes publiques atteignant une hauteur historique, les Etats occidentaux se trouvaient désormais contraints de mettre en œuvre des politiques de réduction de celle-ci, ce qui les plaçaient sous la dépendance des marchés (et de certains acteurs particuliers, comme les agences de notation). Ces derniers se trouvaient en position de force pour rejeter toutes les réformes qui les gênaient d’autant que les Etats ont agi en ordre dispersé, comme précédemment indiqué.
La manifestation la plus évidente de ce retournement de situation est l’attitude des marchés à l’égard des pays méditerranéens de la zone Euro depuis l’automne 2009. La mauvaise gestion des finances publiques grecques ne peut être contestée, ni le fait qu’elle s’est accompagnée d’une dissimulation des statistiques sur le taux réel du déficit public. La Grèce s’est trouvée incapable, à partir du 8 avril 2010, de souscrire des emprunts sur les marchés compte tenu du taux (insupportable pour un Etat déjà endetté) de 7,5% qui lui était proposé. Dans la même logique, les agences de notation ont joué un rôle pro cyclique afin de rassurer les créanciers (notamment les assureurs, qui détenaient 9 000 milliards d’euros en obligations souveraines) en dégradant les notes du Portugal et de l’Espagne, qui étaient pourtant dans une situation différente. Le taux d’intérêt sur leurs emprunts est passé à 6%. Après avoir tenté de résister à la pression de traders et de hedge funds qui jouaient l’euro à la baisse, les Etats européens et le Fonds monétaire international ont mis en œuvre un premier plan de sauvetage avec l’injection de 100 milliards d’euros, puis un deuxième plan le 21 juillet 2011. Bien que demeurant des prêteurs en dernier ressort en cas de défaillance du secteur bancaire – rôle qu’ils ne pourraient assumer en cas de nouvelle faillite de ce secteur – les Etats sont désormais obligés de satisfaire les exigences des marchés en conduisant en interne des politiques de réduction de leur dette, non en vertu d’une stratégie bien définie de réforme de l’Etat mais pour s’assurer que leur note ne sera pas dégradée. Du gel des salaires de la fonction publique en Italie ou en Espagne à l’augmentation de la TVA au Portugal en passant par la diminution des effectifs de fonctionnaires en Irlande, les Etats européens recourent à toute la palette des mesures d’austérité.
Banques, établissements financiers, bourses, intermédiaire de marché répondent à une fonction extrêmement précise, qui est le financement à long terme de l’économie. La transformation de l’épargne courte en une épargne répondant aux besoins des entreprises et de l’économie est le cœur de leur métier. Deux modèles se sont dégagés au fil du temps : le modèle européen et japonais, fondé sur des financements bancaires assurant 70% des besoins des entreprises, et le modèle anglo-saxon, où le marché assure 80% desdits besoins.
Toute activité d’intermédiation est un pari sur l’avenir, qui détermine la fixation des taux d’intérêt. Comme les actifs (placements) ont des durées de vie plus longue que les passifs (ressources), les problèmes surviennent lorsque les acteurs financiers ne renouvellent plus leurs passifs à hauteur des besoins de leurs placements longs. Ils sont alors contraints de vendre précipitamment leurs actifs, ce qui déclenche généralement des crises, comme celles survenues en 1980, 1987, 1990, 1998, 2001, 2007-2008 et 2009-2010, avec chaque fois des conséquences sur l’activité économique.
La nouveauté des dernières crises provient de ce qu’elles ont été générées non par des retraits de particuliers sur leurs dépôts mais par l’interruption du marché interbancaire, lieu où les banques échangent à court terme leurs excédents de trésorerie. Ce marché a été fermé dans les jours qui ont suivi la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008 et n’a pu réouvrir qu’avec la garantie apportée par les Etats.
La fréquence des crises ne doit rien au hasard. Elles sont le résultat de l’autonomie de la sphère financière et de processus législatifs qui ont entériné des pratiques dont l’objet était d’alléger les bilans bancaires par la titrisation et de laisser croire, en application des normes comptables, que seule importait la valeur d’échange instantanée des actifs financiers, l’ensemble devant assurer la parfaite liquidité des marchés. Ce n’était qu’une illusion car les actifs n’étaient nullement liquides.
Alors que les Etats occidentaux peinent à redresser leurs finances publiques, les dix plus grandes banques européennes qu’ils ont renflouées au nom du principe « trop gros pour faire faillite » ont publié des résultats portant sur 50 milliards d’euros de bénéfices et Wall Street a renoué avec les profits. Les hedges funds gèrent 1500 milliards de dollars tandis que des banques comme Goldman Sachs sont impliquées à la fois dans le surendettement de la Grèce, puis dans la gestion du rééchelonnement de sa dette.
b) L’élaboration du droit financier : le processus de Bâle
Comme toute norme de droit, les règles applicables aux banques, aux assurances et aux marchés financiers sont édictées par les Etats, soit dans un cadre strictement national, soit dans un cadre international, comme les règlements et directives de l’Union européenne. En pratique, ce droit est si complexe, particulièrement celui des marchés financiers, qu’il excède la capacité de compréhension des personnes qui n’en sont pas les praticiens. L’ensemble des réformes du droit financier ont été demandées par les professionnels et votées ensuite par les Etats, l’apport de ces derniers n’ayant été que marginal, principalement à des fins de protection des épargnants.
L’internationalisation des métiers de la finance conduit par ailleurs à l’élaboration de règles communes qui complètent ou remplacent des dispositions des législations nationales. Ces règles sont le plus souvent réfléchies, discutées et déterminées par des entités privées avant d’être proposées aux Etats. La principale est la banque des règlements internationaux (BRI), qui siège à Bâle, autour de laquelle gravitent plusieurs organismes : le conseil de stabilité financière, le comité de Bâle sur le contrôle bancaire, le comité sur le système financier mondial, le comité sur les systèmes de paiement et de règlement, l’organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) et l’association internationale des assureurs (AICA). S’y ajoutent plusieurs associations professionnelles dont la plus éminente est l’Institute of International Finance (IIF), qui siège à Washington et qui a fourni à plusieurs reprises des travaux d’expertise pour le compte du G20.
C’est à la fois l’internationalisation croissante du système financier et la récurrence des crises qui ont conduit à l’instauration de règles, mais aucune d’elle ne relève du droit international public. Comme le relève le professeur Hervé Ascensio, « en réponse à des crises systémiques, des réunions régulières de régulateurs ont été instituées au niveau international, sans que les gouvernements éprouvent pour autant le besoin de recourir à un traité créateur d’organisation internationale, ou qu’ils modifient un traité existant ou même qu’une organisation internationale adopte un acte créateur d’un organe subsidiaire ». Faute d’une prise de responsabilité des puissances publiques, la régulation est renvoyée à trois organes qui ont tous un statut privé : le comité de Bâle pour le secteur bancaire, l’OICV pour celui des marchés financiers et l’AICA pour celui de l’assurance. Mais pour ajouter au paradoxe, ces entités privées ont pour membres le plus souvent des personnes de droit public, comme les régulateurs nationaux.
Le Comité de Bâle ne peut être analysé qu’au travers de la BRI. Historiquement, elle a été constituée en 1930 pour régler les questions des dettes de guerre de l’Allemagne et des réparations. Cette mission nécessitait la mise en place de mécanismes interbancaires internationaux, confiés en conséquence à la BRI (mécanismes de compensation). « L’idée d’une institution internationale regroupant les banques centrales nationales, qui n’était pas neuve, puisqu’en germination depuis la fin du XIXème siècle, venait d’être concrétisée. Organisme concourant également à la stabilité financière internationale, la BRI n’a ainsi pas été constituée seulement comme un rouage de liquidation de la guerre, mais comme un rouage d’organisation de la paix » (Régis Bismuth, cf bibliographie).
La BRI est une organisation internationale disposant de la personnalité juridique internationale, en vertu de la convention du 20 janvier 1930 signée par la Suisse, l’Allemagne, la Belgique, la France, le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, l’Italie et le Japon. Aux termes de l’article 1er des statuts du 20 janvier 1930, modifiés le 27 juin 2005, elle est une société anonyme par actions, ce qui a soulevé maintes controverses doctrinales. L’article 2 lui assigne comme mission de favoriser la coopération entre banques centrales et d’assurer pour leur compte certaines opérations internationales. Elle est en quelque sorte la banque des banques centrales, avec comme particularité juridique d’être une société anonyme qui gère un bien public. Ses actionnaires (les banques centrales) lui confient en effet une part de leurs réserves. Elle dispose en bilan de 260 milliards de DTS, soit environ 358 milliards d’euros.
L’importance de la BRI provient de ce qu’elle est largement à l’origine de l’édiction des principales normes bancaires et des règles de marché via notamment le comité de Bâle alors qu’aucun texte international ou national ne lui confère la moindre légitimité en ce domaine. Elle ne fait non plus l’objet d’aucun contrôle démocratique. Elle a su acquérir avec le temps une légitimité de fait. Stricto sensu, elle n’a de pouvoir que celui qui lui est conféré par ses statuts : « favoriser la coopération des banques centrales et fournir des facilités additionnelles pour les opérations financières internationales… » … Mais elle exerce incontestablement une influence en raison de ses trois principales fonctions :
– la conduite des opérations de marché pour la part des réserves de changes (4% des réserves mondiales) que lui confient les banques centrales. Elle agit donc comme un acteur et connaît les règles en vigueur, ce qui lui donne matière à en proposer des modifications ;
– ses travaux d’études dans les domaines économiques et financiers, qui sont considérés comme très sérieux. Le premier article qui annonçait l’actuelle crise financière émanait du service d’études de la BRI ;
– le secrétariat des entités privées qui forment le processus de Bâle, à savoir un ensemble d’organismes qui se donnent pour mission de proposer des règles de marché et d’assurer le bon fonctionnement de l’ensemble du système financier international. Le comité de Bâle et le conseil de stabilité financière précités en font partie.
Processus de Bâle
Nom et année de création |
Membres |
Rôle |
Interlocuteurs |
Président |
Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (1974) |
Gouverneurs des banques centrales et superviseurs bancaires |
Définition des normes internationales de régulation bancaire (Bâle I, II et III) |
Gouverneurs des banques centrales et superviseurs bancaires, banques commerciales |
Nout Wellink, président de la banque centrale des Pays-Bas |
Conseil de stabilité financière (2009 – a succédé au Forum de stabilité financière créé en 1999) |
Ministres des finances, gouverneurs des banques centrales et superviseurs bancaires de 24 pays, parmi lesquels les pays du G20 |
Coopération pour la supervision et la surveillance des institutions financières |
Pays membres du G20 |
Remplaçant de M. Mario Draghi, président de la banque centrale d’Italie |
Comité sur le système financier mondial (1971) |
Sous-gouverneurs de banques centrales de 23 pays |
Surveillance des marchés et des risques systémiques |
Gouverneurs des banques centrales qui participent à la réunion de la BRI sur l’économie mondiale |
M. Mark Carney, gouverneur de la banque centrale du Canada |
Comité sur le système de paiement et de règlement (1980) |
Gouverneurs des banques centrales |
Coordonner l’informatisation des systèmes de paiement, créer les normes de contrepartie et de compensation financière internationale en liaison avec l’OICV |
Gouverneurs des banques centrales qui participent à la réunion de la BRI sur l’économie mondiale |
M. William Dudley, président de la banque centrale de New York |
Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV, 1983) |
Autorités de régulation des principales places boursières mondiales |
Créer les normes de contrepartie et de compensation financière internationale |
Gouverneurs des banques centrales qui participent à la réunion de la BRI sur l’économie mondiale |
M. Greg Tanzer |
Association internationale des superviseurs d’assurance (1994) |
Autorités de régulation nationale des compagnies d’assurance |
Propositions en matière de régulation financière |
Autorités de régulation nationale des compagnies d’assurance |
M. Yoshihiro Kawai |
Le comité de Bâle (initialement comité des règles et pratiques de contrôle des opérations bancaires) a été constitué en 1974 à la suite de plusieurs défaillance bancaires. Il n’a aucun statut car il ne devait pas durer. Il résulte d’une simple initiative du gouverneur de la Banque d’Angleterre, Lord Richardson, en direction de ses collègues des principales banques centrales pour disposer d’informations solides sur les établissements bancaires. Jouissant d’une totale autonomie, ses activités sont financées par la BRI qui assure également son secrétariat et son bon fonctionnement. Sa composition a été élargie en mars 2009 et il comprend désormais les représentants des autorités bancaires des pays suivants : Allemagne, Belgique, Canada, France, Italie, Japon, Pays-Bas, Suisse, Royaume-Uni, Suède, Etats-Unis, Luxembourg, Espagne, Australie, Brésil, Corée du Sud, Inde, Mexique, Russie, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Argentine, Hong Kong, Indonésie, Singapour et Turquie… Soit en fait la majeure partie des pays du G 20.
Son fonctionnement peut apparaître curieux à des juristes rigoureux : il travaille de manière informelle, à raison de 3 ou 4 réunions par an. La participation des membres n’y est pas obligatoire mais comme le souligne le professeur Cynthia Lichtenstein, « les réunions de Bâle se tiennent parce qu’elles se tiennent ; ceux qui y viennent ont choisi de le faire et non parce qu’un traité leur impose de coordonner la supervision ou la politique bancaire ». On ne saurait mieux décrire l’auto régulation de la sphère bancaire, même lorsqu’elle est assurée par des autorités représentant des Etats.
L’OICV et l’AICA ont été créées dans un autre contexte que le comité de Bâle. Elles sont le fruit d’une longue réflexion.
OICV et AICA
Nom et année de création |
Membres |
Rôle |
Interlocuteurs |
Président |
Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV, 1983) |
Autorités de régulation des principales places boursières mondiales |
Créer les normes de contrepartie et de compensation financière internationale |
Gouverneurs des banques centrales qui participent à la réunion de la BRI sur l’économie mondiale |
M. Greg Tanzer |
Association internationale des commissions d’assurance (1994) |
Autorités de régulation nationale des compagnies d’assurance |
Propositions en matière de régulation financière |
Autorités de régulation nationale des compagnies d’assurance |
M. Yoshihiro Kawai |
A la suite de travaux d’une agence de la Banque mondiale, la Société financière internationale (SFI) au début des années 70, le président de cette banque, Robert McNamara a créé une division « marchés financiers », dont les activités ont d’abord été orientées vers l’amélioration de l’infrastructure du secteur financier des pays en développement. La nouvelle division a organisé des rencontres sur le continent américain au cours desquelles étaient abordés les problèmes rencontrés par les autorités de contrôle des marchés dans le cadre de leur mission. C’est en 1983 que des participants venus d’autres continents ont participé à la conférence annuelle qui se tenait à Quito. Le forum s’est mué en Organisation internationale des commissions de valeurs, que la Commission des opérations de bourse (COB) française a rejoint en 1984.
L’Association internationale des commissions d’assurance (AICA) a été institué dix ans plus tard, en 1993, à l’initiative de la National Association of Insurance commissioners (NAIC) américaine. Il s’agissait pour les compagnies d’assurance des Etats-Unis de traiter avec leurs homologues étrangères des questions de libéralisation du secteur de l’assurance et de sa supervision, alors que se profilaient les négociations sur le commerce international (GATT) et sur la zone de libre-échange sur le continent américain (ALENA).
L’OICV et l’AICA ont en commun d’être des organes privés qui rassemblent en leur sein des autorités publiques et des représentants d’organisations professionnelles. L’OICV s’est en effet constituée en association internationale, sans que le moindre document constitutif d’une personne morale ait été écrit, et a fonctionné de manière quelque peu étrange jusqu’en 1987, date à laquelle elle est devenue une personne morale sans but lucratif en vertu d’une loi de l’Assemblée nationale du Québec. L’AICA relève du droit de l’Illinois en tant qu’association privée, mais son siège a rapidement été transféré au sein de la BRI.
Les autorités publiques qui siègent au sein de l’OICV et de l’AICA sont les superviseurs nationaux des marchés financiers et des assurances. En pratique, le véritable pouvoir est dévolu aux comités techniques, qui rassemblent les autorités des principaux pays développés et émergents, reflétant quasiment, comme au comité de Bâle, la composition du G 20. Mais la participation des acteurs privés est assurée par les statuts des deux organisations. Participent ainsi à leurs travaux des entreprises de marchés, des compagnies d’assurance et de réassurance, des associations professionnelles nationales ou régionales (pour les Etats fédéraux), les grands cabinets d’audit, les agences de notation et des cabinets d’avocats. Pour l’OICV et l’AICA, ces participations sont indispensables car elles estiment que leurs métiers ne peuvent fonctionner que sur la base du consensus et de l’adhésion préalable aux règles qui seront fixées ultérieurement par la loi.
Le secteur de la finance, tous métiers confondus, a toujours souhaité se gérer avec le moins d’intervention des pouvoirs publics, selon des règles de consensus de place ou solidarité de place. L’internationalisation de ce secteur a amplifié cette tradition et a débouché sur le paradoxe que des organes de droit privé (BRI, OICV et AICA principalement) composé des représentants d’autorités publiques créent des normes en collaboration avec les entreprises privées de leur secteur. Sans doute s’agit-il de bonnes pratiques définies par des professionnels avisés mais elles sont élaborées dans une grande discrétion. Etant de droit privé, ces organes dotés d’un pouvoir normatif occulte ne sont responsables devant aucune autorité publique. Seul le résultat de leur travail fait l’objet de débats lorsque sont discutés des projets de loi ou des directives, mais le législateur national ou européen ne perçoit à cette occasion qu’une infime partie des enjeux ou des risques, n’ayant qu’une connaissance marginale du contenu des négociations initiales. L’exemple le plus flagrant est la titrisation, proposée par les acteurs de place pour alléger le bilan des banques. Elle a été introduite en France et son régime a été adapté à partir de directives européennes grâce à six lois : n° 88-1201 du 23 décembre 1988, n° 93-6 du 4 janvier 1993, n° 96-597 du 2 juillet 1996, n° 98-546 du 2 juillet 1998, n° 99-532 du 25 juin 1999 et n° 2003-706 du 1er août 2003. A aucun moment, le risque que la titrisation induisait en tant que technique potentiellement spéculative n’a été réellement perçu par le gouvernement ou le Parlement. Or, ce sont les pouvoirs publics qui ont ensuite été obligés de gérer les effets économiques et sociaux d’une crise financière qui tire en grande partie son origine de cette technique.
c) L’élaboration du droit financier : l’IIF
Créé à la suite de la crise financière de 1983, l’Institute of International Finance (IIF), dont le siège est à Washington, se veut la plus large association d’institutions financières au monde et vise par ses statuts à répondre aux besoins du secteur de la finance. Ses membres proviennent de l’ensemble de ce secteur. Sont en effet éligibles à ses statuts les banques centrales, les autorités de marché, les banques commerciales (dépôts et affaires), les sociétés d’investissement, les cabinets d’avocats ainsi que des entreprises spécialisées en des domaines précis, comme l’analyse du risque. Ils sont aujourd’hui près de 400 provenant de 70 pays. L’Institut cultive sa réputation en se basant sur la renommée de ses membres, les liens dont ils disposent avec les décideurs politiques et la qualité de ses études. Les dirigeants des plus grandes banques internationales font partie de son bureau (MM. Beaudoin Prot et Frédéric Oudéa, respectivement présidents de BNP Paribas et de la Société générale y siègent). Ce bureau est actuellement dirigé par M. Josef Ackermann, (Deutsche Bank AG), assisté de MM. Francisco González (BBVA), Roberto Setúbal (Itaú Unibanco Banco Multiplo) et Robert Waugh (Scotiabank).
La mission que s’est assignée l’IIF est de soutenir l’industrie de la finance. A cette fin, il produit des analyses sur les métiers des acteurs de marché (risque prudentiel, par exemple) et sur les politiques économiques conduites par les Etats. Son objectif est un système financier stable fonctionnant au bénéfice de ses membres. Il étudie tous les types de marchés, qu’il s’agisse des marchés des pays développés ou des pays émergents, dessine les grandes lignes des mesures politiques et juridiques à prendre aux niveaux internationaux et nationaux et sert de plateforme d’échange entre ses membres. L’IIF souhaite clairement peser dans le débat public sur l’ensemble des questions intéressant la sphère financière. L’Institut participe notamment aux consultations du Comité de Bâle et contribue aux travaux du G20 et du Financial Stability Board de Bâle, successeur en 2009 du Financial Stability Forum. Il a été partie prenante des deux récents plans de sauvetage financier de la Grèce en acceptant notamment la substitution des obligations grecques existantes par de nouvelles obligations reportant à 2020 les remboursements du pays. En résumé, l’IIF, carrefour d’information des dirigeants des principales sociétés financières, déploie une large activité de lobbying et d’expertise auprès des décideurs politiques. Idéologiquement, il est plutôt en faveur de la supervision et de la surveillance des marchés plutôt que de leur réglementation.
3. Le rôle particulier des agences de notation
Les agences de notation financière sont des entreprises privées qui apprécient le risque de solvabilité financière d’une entreprise, d’un État, d’une collectivité publique ou les risques d’une opération financière.
Le rôle de ces agences est d’évaluer le risque de non-remboursement des emprunts que contracte l’emprunteur. À cette fin, elles construisent des scénarii financiers prévisionnels et évaluent la probabilité que chacun de ces scénarii se réalise à partir de l’examen de la structure future des coûts et des revenus de l’emprunteur. Pour une entreprise, elles prennent en compte notamment les perspectives d'activité et de développement. Pour un État les critères sont les perspectives de croissance, ses prévisions de recettes, notamment fiscales, et l’évolution prévisible de ses dépenses compte tenu de sa politique budgétaire.
Leur importance provient de ce que la plupart des règlements financiers des investisseurs institutionnels et fonds de pension exigent une notation sur les entreprises dans lesquelles ils placent leurs capitaux. Leur clientèle est donc constituée des émetteurs de dettes, qui souhaitent offrir des garanties de solvabilité aux acteurs de marché. Bien positionnées pour recevoir de multiples informations financières, le marché de la notation qu’elles forment est extrêmement concentré : trois agences contrôlent plus de 90 % du marché mondial, avec deux groupes américains, Standard and Poor’s et Moody’s, qui, à eux deux, s'adjugent près de 80 % du marché, et une agence à capitaux français, Fitch, qui en représente un peu plus de 10 %.
La crise des subprimes a mis en lumière l'importance de leur rôle et induit des soupçons tant sur les conflits d'intérêts susceptibles d'affecter leurs notations que sur la qualité de notes dont l'influence sur les marchés est considérable. Elles n’entreraient pas dans le champ du présent rapport si leur comportement n’affectait que les entreprises, mais elles jouent un rôle croissant sur la politique budgétaire en raison de leurs appréciations sur les dettes souveraines. Elles ont à cette occasion acquis une célébrité qu’elles n’avaient pas envisagé, car avant 2007, rares étaient ceux qui avaient conscience de leur impact. Aujourd’hui, il ne se passe pas une journée sans qu’un journal économique les mentionne, surtout en cas de dégradation de note, et loin de pouvoir limiter par la voie législative leur influence, les responsables politiques ont les yeux rivés sur ces agences qui jouissent grâce aux média d’une légitimité de fait. Dégradation de la note de l’Espagne en raison des doutes de Moody’s sur le coût de la restructuration des caisses d’épargne (10 mars 2011), classement de la dette grecque comme hautement spéculative par Fitch (14 janvier 2011) puis par Moody’s (7 mars 2011), puis enfin par Standard and Poors le 13 juin 2001 comme extrêmement spéculative, dégradation de la note du Portugal par les trois agences au début du mois d’avril 2011, interrogations publiques de Moody’s et de Standard and Poors sur la qualité de la dette américaine (13 janvier 2011), dégradation de la note de plusieurs pays et de plusieurs banques depuis le début de l’été 2011, doutes de Fitch sur la qualité du système bancaire chinois (8 mars 2011), enfin, mise sous surveillance de la dette de la France par l’agence Moody’s en octobre 2011… La liste de ces annonces est désormais longue et toutes sont susceptibles d’alimenter une spéculation contre une dette souveraine et / ou une monnaie.
Dans la mesure où il n’y a plus de stricte séparation entre économie nationale et internationale, les annonces ou décisions des agences de notation ont des conséquences sur l’ensemble des acteurs d’une chaîne économique ou financière. Les cours de BNP Paribas, de la Société générale et du Crédit agricole ont ainsi perdu plus de 1,4% le 15 juin dernier parce que Moody’s prévoyait de dégrader leur note en raison de leur exposition à la dette grecque. Il s’agissait d’une nouvelle pression pour une restructuration de cette dette. Comme cette décision a été renouvelée en septembre 2011, sa conséquence est que le refinancement de ces banques sur les marchés est plus onéreux, ce qui les conduit à augmenter les taux d’intérêt proposés aux particuliers et aux entreprises, ou même à refuser d’octroyer des crédits pourtant indispensables à la vie des entreprises.
Les reproches soulevés par les analystes concernent leurs méthodes de notation, jugées défaillantes sur certains produits, qui ont en outre alimenté des soupçons de conflits d’intérêts ayant eu des répercussions directes sur la politique financière des Etats. Ainsi, lors de la crise des subprimes, les agences de notation ont réduit la perception par les investisseurs du risque de crédit en donnant les meilleures notes de leur échelle de notation (AAA) aux tranches supérieures des produits financiers structurés tels que les obligations adossées à des actifs (collateralized debt obligation, CDO), soit la même note que celle donnée aux obligations classiques des États et des entreprises alors que le risque sur ces CDO était largement supérieur. Cette sous-estimation des risques s'expliquerait dans une large mesure par des défaillances de méthode, comme le manque de données historiques concernant le marché des subprimes aux Etats-Unis. Les agences ont en outre tardé à corriger ces appréciations surévaluées, ainsi que l’a souligné devant la commission d’enquête parlementaire M. Michel Aglietta, conseiller au Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII) : « Alors que les prix de l’immobilier baissaient depuis l’automne 2006 mais que l’on continuait à titriser abondamment, [les agences de notation] n’ont dégradé massivement les crédits qu’en avril 2007 ». Ces constatations ont conduit les pouvoirs publics à émettre des soupçons sur des conflits d'intérêts.
En effet, depuis les années 1970, les agences de notation ne sont plus rémunérées par les investisseurs qui utilisent la notation dans leur stratégie d’investissement, mais par les émetteurs des produits soumis à notation. D’où le risque de conflit d’intérêt, les agences pouvant être tentées de fournir à leurs clients des notations accommodantes ou complaisantes.
Ce modèle économique semble avoir favorisé à l’excès la titrisation. Dès lors que les produits structurés sont conçus pour tirer profit des différents degrés d'aversion au risque des investisseurs, ils sont agencés de manière à ce que chaque tranche obtienne une note spécifique. Les implications de la notation des différents produits ont souvent été débattues entre les émetteurs et les agences de notation, qui ont ainsi joué un rôle qui était plutôt celui des banques d’affaires.
En ce qui concerne les dettes souveraines de la Grèce et du Portugal, les méthodes de notation ont joué un rôle pro cyclique en mettant en lumière les soubresauts du marché, accentuant la pression des investisseurs sur les coûts de financement de ces dettes et favorisant un cercle vicieux, la dégradations des notes d’Athènes et de Lisbonne ayant entraîné mécaniquement l’augmentation leur taux d’intérêt, suivie d’une nouvelle dégradation de leur note. Au final, les Etats de la zone euro ont été contraints de restructurer les dettes grecque et portugaise sous la pression des marchés.
L’Union européenne s’est efforcée, par le règlement communautaire du 16 septembre 2009 de mieux encadrer les pratiques des agences de notation, mais l’on ne peut guère considérer qu’il ait eu le moindre effet au regard du jeu pro cyclique que les agences ont joué dans le cas de la dette portugaise. Le règlement ne s’applique par ailleurs qu’au territoire européen alors qu’il s’agit d’une activité mondialisée et rien n’interdit aux trois agences qui dominent le marché de la notation d’agir comme bon leur semble hors d’Europe.
Sauf à considérer la question sous un angle radicalement différent, comme l’interdiction de la notation des dettes souveraines par des entités privées pour ne réserver cette activité qu’à des entités publiques, l’on voit mal comment le rôle d’influence de ces agences pourrait diminuer dans l’avenir. Elles demeurent, par la spécificité de leur métier, des vecteurs qui pèsent sur la gestion des dettes privées et souveraines.
C – Les processus de normalisation
La fixation des normes constitue un excellent exemple de l’importance du travail d’influence. Dans un monde où les marchés s’unifient, le besoin d’un langage commun constitue une nécessité croissante, de l’adoption de normes communes (automobile, électronique), à l’usage de l’anglais comme lingua franca des affaires, ou encore de règles juridiques ou de pratiques acceptées par les professionnels.
Les normes confèrent pour ceux qui les émettent une capacité d’agir sur le comportement d’autres acteurs, les obligeant à se conformer à un modèle défini. Elles constituent un instrument de pouvoir. « Au sein des organismes qui les élaborent, le choix des normes (sujet et contenu) constitue donc un enjeu d’influence et de puissance. Les membres des organisations de normalisation cherchent à imposer leur vision du monde et à conforter leur propre stratégie de conquête et de protection des marchés. Une autre voie de « standardisation » résulte également d’accords conclus entre producteurs, en dehors des lieux officiels de négociations internationales. Ces standards, sortes de normes, permettent aux acteurs les plus puissants d’imposer et de valoriser leurs innovations. » (Bernard Carayon).
Lorsque apparaît une nouvelle technologie ou encore un nouveau produit ou service, l’existence de normes acceptées au plan international contribue à sa diffusion et en multiplie les débouchés. La fixation des normes ne se limite donc pas à une question technique. Elle comporte de gigantesques enjeux de compétitivité. Le pays ou l’entreprise qui est obligé d’adopter des normes extérieures à ses pratiques ou traditions se voit contraint de mettre en œuvre un programme d’investissement qui pèse sur sa compétitivité, tandis que celui qui impose les siennes dispose d’un avantage comparatif.
Les Etats ont théoriquement vocation à assurer cette mission de normalisation puisque qu’une norme est une règle juridique. Le travail de l’Union européenne peut ainsi être analysé comme la plus vaste démarche de normalisation jamais mise en œuvre dans l’histoire de l’humanité. Mais pour diverses raisons, le plus souvent liées à l’histoire des professions, la normalisation est l’affaire des régulateurs privés, apparus sur la scène internationale après la seconde guerre mondiale et dont le statut est le plus souvent associatif comme l’AFNOR en France. Disposant des compétences techniques, ils se sont imposés comme acteurs incontournables.
La normalisation concerne peu les domaines classiques de la politique internationale. Les industries d’armement n’entrent ainsi pas dans son champ, sauf pour certains de leurs composants. Mais dans un monde où les rapports économiques sont devenus essentiels, elle constitue un véritable enjeu en termes d’emplois et de progrès technologique. En règle générale, le processus émane d’entreprises ou de fédérations d’entreprises, soit directement, soit par un cabinet de lobbying (leurs terres d’élection sont K street à Washington et la rue de la Loi à Bruxelles) qui entrent ensuite en relation avec l’organe national de normalisation, lui-même affilié à une instance européenne et à une instance mondiale de normalisation. Les rapports de force ne sont évidemment pas absents de ce type de démarche, les normes techniques étant souvent celles des entreprises dominantes d’un secteur, comme le montre l’exemple de l’installation électrique.
L’instruction des dossiers sur les normes est effectuée par des comités techniques. C’est en leur sein que les entreprises doivent savoir user d’influence, car l’assemblée générale suit le plus souvent leur avis.
Ainsi que précédemment indiqué, la normalisation technique est un processus à trois niveaux. Les certificateurs nationaux (AFNOR, Deutsche Industrie Norm ou British Standards Institution…) sont affiliés au Comité européen de normalisation (CEN), au Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) et à l’Institut européen des standards de télécommunications. Les organismes européens, l’organisme japonais (JISC) et le principal organisme américain de normalisation (American national standard institute, qui rassemble 36 000 adhérents de 175 pays, essentiellement des entreprises qui travaillent sur le territoire américain) sont à leur tour adhérents de l’International Organisation for standardization (ISO), de la Commission électrotechnique internationale et de l’Union internationale des télécommunications. Rien n’interdit toutefois à un organisme national d’être membre à la fois d’un organe européen et international, ce qui arrive souvent dans la pratique.
L’ISO (du Grec Isos, égal en Français) et le comité européen de normalisation (CEN) sont les principaux organismes certificateurs internationaux. De statut privé (association de droit suisse pour l’ISO, de droit belge pour le CEN), ils disposent d’un vaste champ de compétence mais sont loin de couvrir l’ensemble des professions.
On ne sera pas étonné que l’ISO tire son origine des premières tentatives de standardisation du premier marché intérieur au monde au début du XXème siècle : les Etats-Unis. L’American Institute of Electrical Engineer proposa en 1912 aux principales organisations professionnelles de la construction et de la métallurgie de se réunir pour établir des normes industrielles communes. En 1918, était créé le Comité américain des standards industriels, devenu en 1928 l’Association américaine des standards. En 1926, le Comité soutint activement l’initiative de l’Anglais Charles Le Maistre de mettre en place un organe international de standardisation, qui rassemblait les instituts de normalisation fondés dans les pays développés. L’Association française de normalisation (AFNOR) y joua dès le départ un rôle actif. C’est en février 1947 que fut institué l’ISO, dont le siège fut établi à Genève.
L’ISO rassemblait 163 organismes nationaux de normalisation à la fin de 2010. Le cœur de son activité se situe dans les 3 274 organes techniques (à raison de 214 comités techniques, 510 sous-comités, 2 478 groupes de travail et 72 groupes d’études ad hoc). L’ensemble de ce système fonctionne avec environ 550 collaborateurs. Depuis 1974, l’ISO a adopté 18 500 normes dans des domaines aussi divers que l’agriculture, la construction, l’habillement, les technologies de l’information ou les dispositifs médicaux.
Le CEN a accompagné la construction européenne. Fondé en 1961 et siégeant à Bruxelles, il rassemble les organismes nationaux de normalisation, qui sont tous également membres de l’ISO. Il produit les normes EN qui s’appliquent à l’ensemble des secteurs économiques, qu’il s’agisse de technique, de règles sociales ou d’environnement, ainsi que les normes harmonisées qui permettent aux entreprises d’appliquer la législation européenne à laquelle sont soumis leurs produits et leurs services.
A l’instar de l’ISO, le CEN ne couvre pas l’ensemble des professions. Les organes professionnels ont toute liberté d’adhérer à un certificateur de leur choix. Pour renforcer son champ d’activité, le CEN s’est ainsi rapproché du comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) avec pour objectif « de répondre aux enjeux des technologies émergentes dans un contexte d’intense mondialisation » (déclaration du CEN et du CENELEC à Chypre, en juin 2007).
Signe de l’importance de la normalisation technique, la mise en place de l’Acte unique européen, qui accentuait l’intégration économique européenne, a accru l’importance du CEN ainsi que sa charge de travail. Les gouvernements comme les fédérations professionnelles avaient saisi l’enjeu des normes pour leur compétitivité. Mais plus encore, les membres non européens de l’ISO ont marqué de vives inquiétudes face à ce qui leur semblait être une politique de protectionnisme déguisé de la forteresse Europe. Cette préoccupation provenait de la difficulté des certificateurs non européens à accéder aux informations du CEN.
La réponse des Européens a été rapide. La plupart des certificateurs ont estimé que le marché unique devait être intégré au marché mondial et que cet objectif serait garanti par un ensemble de mécanismes procéduraux permettant la compatibilité, voire l’identité, des normes ISO et CEN. L’accord de Vienne signé en 1991 par les deux organismes a établi les grandes lignes de leur coopération et a été confirmé en 2001.
La normalisation du secteur de l’installation électrique
La normalisation du secteur de l’installation électrique constitue un bon exemple du mécanisme de fixation des règles au niveau national, européen et international et du poids qu’y prennent de grandes entreprises.
L’Union technique de l’électricité (UTE) est l’organe français de normalisation. Elle est membre de l’AFNOR. Association sous le régime de la loi de 1901, elle réunit des personnes morales de droit public (EDF, SNCF, RATP…), des organisations professionnelles, des entreprises (dont le leader mondial, Schneider Electric) et des correspondants (associations de consommateurs, de défense de l’environnement, etc…). Son rôle principal est d’assister les pouvoirs publics dans l’élaboration de la réglementation technique. Elle a participé à l’élaboration d’environ 5 500 normes.
A l’échelle européenne, l’UTE est membre du Comité européen de la normalisation électrotechnique (CENELEC) et au niveau international, de la Commission électrotechnique internationale (CEI), ces deux organes étant des ONG à but non lucratif. Le CENELEC travaille avec 35 000 experts désignés par les membres nationaux et par des associations (représentants d’entreprises, de consommateurs). Les normes qu’il propose visent à éliminer les barrières sur les marchés et à augmenter l’interopérabilité des productions. La CEI effectue un travail analogue. L’UTE est membre de 170 comités de la CEI et assure le secrétariat de 24 d’entre eux.
Si ces organismes se caractérisent par une grande diversité de représentants, le poids des grandes entreprises y est déterminant. Schneider Electric est ainsi en négociation permanente avec ses grands concurrents pour imposer ses standards à l’ensemble de cette industrie.
2. La fixation des normes comptables
Les normes comptables fournissent l’excellent exemple d’une discipline technique, en apparence neutre, dont la fixation emporte en réalité de considérables enjeux économiques et politiques, à savoir le mode de gouvernance des grandes entreprises et leur accès aux principaux marchés financiers. Or cette fonction est assurée par une personne morale de droit privé, l’IASC/IASB.
Son histoire est emblématique de la place que peuvent prendre des organismes privés dans la sphère internationale. Ne disposant d’aucune légitimité lui conférant un quelconque pouvoir coercitif, elle a acquis en moins de quarante ans une place centrale, grâce à une stratégie d’alliance et un discours fondé sur sa neutralité supposée.
L’IASC : histoire d’un succès planétaire (12)
En 1973, M. Henry Benson, alors associé au cabinet Coopers & Lybrand de Londres (qui deviendra, après plusieurs fusions, Price Waterhouse Coopers), proposa de créer un organisme international d’harmonisation des normes comptables, proposition à laquelle se rallièrent les professions comptables de dix pays (dont la France), pour l’essentiel anglo-saxons. Organisme international d’origine professionnelle, mais également d’origine britannique, l'IASC n'avait donc pas la possibilité d'imposer ses normes aux États dans lesquelles les professions qui en étaient membres exerçaient leurs activités. Il s’est donc attaché, dès l’origine, à renforcer son pouvoir d’influence.
Les premières normes IAS étaient donc suffisamment ouvertes pour ne pas heurter de front les normes comptables nationales, c'est-à-dire qu’elles comportaient de multiples options afin de prendre en compte toutes les règles nationales. De plus, profitant des vides dans les référentiels comptables nationaux, par exemple en matière de comptes consolidés, l’IASC a pu se forger une réputation de compétence et même voir certains groupes utiliser volontairement ses normes. En 1982, l’IFAC (International Federation of Accountants – Fédération internationale des experts-comptables), qui regroupait alors les organisations professionnelles d'audit d'une soixantaine de pays, l’a ainsi reconnu comme normalisateur. L’appui de l’IFAC présentait pour l’IASC un double avantage : d’une part, il étendait considérablement son pouvoir d’influence dans le monde et, d’autre part, il lui permettait de faire participer à ses activités les pays en voie de développement et de ne plus apparaître comme un club de pays riches.
L’IASC s’est ensuite rapproché de l’IOSCO (International Organization of Securities Commissions – organisation internationale des régulateurs de marché), qui fédère au niveau international l'ensemble des régulateurs boursiers nationaux. Ce rapprochement obéissait à une double nécessité : d’une part, si l’IOSCO n’avait, comme l’IASC, qu’un pouvoir d’influence, il était considérable du fait de la présence en son sein de la SEC. D’autre part, l’un de ses objectifs était d’élaborer et de promouvoir des normes destinées à faciliter le développement des opérations internationales sur les instruments financiers via des normes comptables adaptées. Il va sans dire que la réalisation d’un tel objectif aurait annihilé la raison d’être de l’IASC qui s’est donc attachée à satisfaire aux exigences de l’IOSCO en matière de normes comptables, en donnant à ses travaux une orientation définitive vers les besoins d’information financière des investisseurs et, surtout, en réduisant le nombre des options comptables.
La nouvelle orientation de ses travaux a été formalisée en 1989 dans une déclaration d’intention intitulée « Comparabilité des états financiers ». Celle-ci prévoyait que les normes révisées ainsi que celles à venir ne comporteraient plus d'options mais indiquerait pour chaque problème un traitement de référence ou préférentiel et un second traitement simplement toléré. Ce resserrement de ses normes, qui leur donnait un caractère plus coercitif, répondait aux exigences des marchés financiers. Publié la même année, le cadre conceptuel de l’IASC, intitulé « Cadre pour la préparation et la présentation des états financiers » s’inspirait très fortement du cadre conceptuel dont s’était doté au début des années quatre-vingt le FASB américain.
C’est à ce moment, dans les années quatre-vingt-dix, que l’IASC dut faire face à l’émergence d’un concurrent. Le G4 est un groupe de travail créé à l’initiative de membres des normalisateurs nationaux d’Australie, du Canada, des États-Unis et du Royaume-Uni, rejoint par la suite par la Nouvelle-Zélande. En d’autres termes, un club anglo-saxon dont le travail théorique, de grande qualité, a servi de base à plusieurs normes IFRS. C’est pour contenir cette menace que l’IASC s’est réformé au début des années 2000 en séparant formellement l’IASC de l’IASB, ce dernier étant en quelque sorte un G4 étendu à des membres provenant d’Allemagne, de France ou encore du Japon. De plus, afin de faire face à ses nouvelles responsabilités résultant de la reprise par l’Union européenne des normes IFRS, il a distendu ses liens avec les professions comptables, en particulier l’IFAC, renforcé le poids des préparateurs et des utilisateurs de comptes ainsi que les liens avec les normalisateurs nationaux des grands pays.
Enfin, cette orientation s’est poursuivie par une stratégie de convergence entre les normes IFRS et les normes comptables américaines, formalisée par l’accord de Norwalk du 18 septembre 2002, conclu entre l’IASB et le FASB. De plus, en avril 2004, le FASB et l'IASB se sont réunis pour examiner leurs plans d'actions communs et ont décidé, en octobre 2004, d'y ajouter le projet de développer un cadre conceptuel commun construit à partir des deux cadres existants.
Créé dans l’anonymat il y a près de 40 ans par quelques experts-comptables, l’IASC/IASB est devenu le principal normalisateur mondial, tout en conservant son caractère strictement privé et indépendant. Formidable réussite en soi, il la doit à l’habilité des alliances conclues, à l’échec de la normalisation européenne et au refus général de laisser aux États-Unis le monopole de la normalisation comptable internationale.
Son influence est désormais incontournable même si sa position demeure fragile. Elle fait toujours l’objet de contestations par ceux qui s’accrochent à un modèle comptable européen continental qui fait primer l’intérêt social de l’entreprise sur le modèle actionnarial préconisé par les cabinets anglo-saxons. La situation actuelle n’est donc pas figée même si la sphère privée a pris un avantage très net pour la fixation des normes.
Avec la globalisation de l’économie et la connexion de la plupart des marchés financiers, il est devenu nécessaire que les entreprises cotées soient placées sous un régime unique de norme comptable, permettant de comparer leurs résultats, leurs performances et les perspectives qu’elles offrent au moyen de ratios. Ce travail aurait pu être assuré par les Etats, dans la mesure où la fiscalité est mise en œuvre après constat de résultats comptables mais ceux-ci n’ont pas pris conscience assez tôt de l’importance que revêtait la comptabilité dans une économie internationalisée. Lorsqu’ils ont réalisé leur erreur, ils ont été incapables d’arriver à un accord. Or, les entreprises appelaient à l’adoption de normes communes afin de pouvoir trouver les capitaux nécessaires à leur développement. L’IASC, qui a la souplesse de décision inhérente à un organe privé de petite taille, a été en mesure de répondre à leurs attentes alors que les Etats se sont arc-boutés sur la défense de leurs systèmes comptables nationaux. Elle a acquis une légitimité de fait qu’il sera désormais difficile de contester.
a) Du constat technique au choix idéologique ou comment l’IASC s’est pliée aux souhaits de Wall Street
Dans une économie globalisée où les grandes entreprises trouvent leurs ressources sur les marchés financiers, les investisseurs ont besoin de disposer d’une information comptable qui soit fiable, mais qui soit surtout comparable sur toutes les places financières. Il leur faut en effet travailler sur les mêmes indicateurs de gestion. Le développement des marchés financiers est donc à l’origine du mouvement d’harmonisation des normes comptables, voulu essentiellement par les professionnels de la gestion et de l’investissement.
Face aux multiples référentiels comptables nationaux, le choix de l’IASC s’est porté sur les normes américaines en raison du poids des marchés financiers des Etats-Unis. Toute entreprise souhaitant lever des capitaux dans ce pays, à Wall Street notamment, devait présenter ses états financiers selon les normes américaines en application d’une décision de la Securities and Exchange Commission (SEC, organe de contrôle et de régulation des marchés financiers des Etats-Unis). La prépondérance de Wall Street, mais aussi d’autres marchés importants comme Chicago, avait conduit de nombreuses entreprises internationales à adopter d’elles-mêmes le référentiel américain.
Ce choix n’a cependant été ni évident, ni spontané. L’idée originelle d’Henry Benson était de favoriser la convergence des normes comptables en promouvant leur harmonisation, mais il ne semble pas avoir recherché, initialement, leur normalisation, qui se définit comme « l’uniformité des pratiques comptables dans un espace géographique donné » (Bernard Colasse). Certains qualifieront sans peine l’harmonisation d’étape préalable à la normalisation, mais dans le contexte de l’époque où les marchés financiers étaient cloisonnés, elle n’apparaissait pas comme une nécessité.
Il ne lui a donc pas été trop difficile de réunir les représentants des professions comptables des neuf pays les plus riches, qui avaient des traditions comptables différentes. La France, attachée au modèle continental, était représentée au sein du nouvel International Accounting Standards Committee par l’Ordre des experts comptables et par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, qui n’avaient pas dans notre pays de pouvoir normatif, ce rôle étant dévolu au Conseil national de la comptabilité.
L’IASC s’est imposée graduellement dans le monde de la comptabilité en travaillant sur l’ensemble des domaines qui n’étaient pas couverts par les réglementations nationales, comme les comptes consolidés. Elle a su ainsi accompagner l’ouverture progressive des marchés. Ses propositions étaient d’autant plus facilement adoptées par les Etats européens qu’elles ne reprenaient pas systématiquement les normes américaines.
L’essor de l’IASC et son virage idéologique sont dus à deux rapprochements :
– en 1982, l’International Federation of Accountants (IFAC), qui regroupait les organisations professionnelles d’audit d’une soixantaine de pays, l’a reconnue comme organe de fixation des normes. L’audience de l’IASC s’est étendue aux cinq continents et ne concernait plus uniquement les pays riches. Toutefois, à cette période, la Communauté européenne mettait en œuvre une politique comptable commune qui commençait à avoir une traduction législative dans les Etats membres. De nombreux comptables s’interrogeaient alors sur l’utilité de l’IASC ;
– à la fin des années 80, l’IASC a réussi à convaincre l’International Organization of Securities Commissions (IOSCO) d’être son fournisseur de normes. L’IOSCO est l’organisme, également de droit privé, où sont représentées les autorités nationales de contrôle des marchés financiers, parmi lesquelles la SEC américaine dont l’accord est indispensable pour lever des capitaux à Wall Street. Mais pour obtenir cet appui, elle a été obligée de se rapprocher des conceptions de l’IOSCO.
Sans l’appui de l’IOSCO, il est probable que le rôle de l’IASC aurait périclité. Elle ne disposait d’aucun pouvoir, sinon une certaine considération intellectuelle dans le monde de la comptabilité, alors que l’IOSCO jouissait d’un pouvoir d’influence considérable auprès des Etats en raison de la présence de la SEC en son sein. Or l’IOSCO travaillait comme l’IASC à l’édiction de référentiels comptables pour les entreprises voulant lever des capitaux sur le marché américain.
Pour survivre, l’IASC a délibérément pris parti pour un type de comptabilité répondant à une logique actionnariale. Elle s’est ainsi éloignée de l’équilibre qu’elle tentait de conserver entre l’Europe continentale et les pays anglo-saxons. Elle a établi un cadre conceptuel, comparable à celui que mettait en place l’IOSCO, dans lequel elle se ralliait aux méthodes comptables américaines (à toute question comptable correspond un traitement de référence, prioritaire, et un second traitement, simplement toléré) et par lequel elle affirmait le primat des investisseurs sur tous les autres utilisateurs des normes comptables. « Bien que tous les besoins d’information des utilisateurs ne puissent pas être comblés par les états financiers, il y a des besoins qui sont communs à tous. Comme les investisseurs sont les apporteurs de capitaux à risque de l’entreprise, la fourniture d’états financiers qui répondent à leurs besoins répondra également à la plupart des besoins des autres utilisateurs susceptibles d’être satisfaits par des états financiers » (§ 10 du cadre conceptuel). Cette phrase n’est rien d’autre qu’une affirmation idéologique. Elle est cruciale pour comprendre comment les normes comptables ont favorisé les crises des marchés financiers qui ont émaillé l’économie mondiale depuis les années 90. La logique d’une comptabilité actionnariale conduit en effet à apprécier une entreprise selon sa valeur de marché (fair value) et non sur la base objective de ses actifs. Or la valeur est volatile sur les marchés financiers et ce risque est accentué par le fait que contrairement à ce que la science économique a affirmé de tous temps, les comportements sur les marchés ne sont pas forcément rationnels, comme l’ont démontré de nombreuses études, notamment celle de George Akerlof et de Robert Schiller, auteurs des esprits animaux.
L’on peut analyser l’accord de l’IOSCO et de l’IASC, qui a été finalisé en 1995, après 6 ans d’âpres négociations (l’IOSCO ayant dû accepter quelques concessions sous la pression de certains régulateurs européens) comme un échange de service : l’IOSCO peut affirmer qu’elle n’impose aucune norme américaine comme condition préalable à l’implantation à Wall Street, la norme relevant d’un organisme extérieur et indépendant, tandis que l’IASC renforce sa légitimité technique en avançant que ses normes sont celles acceptées par le principal marché financier du monde.
b) Derrière la rhétorique de l’indépendance, une entité efficace de lobbying
Derrière le choix de normes proches des conceptions américaines, s’affirme clairement une idéologie libérale. Créée par des professionnels afin de satisfaire les besoins des investisseurs, l’IASC est contre l’intervention des Etats en matière comptable. Cette idéologie est constamment rappelée par ses dirigeants : « Il est essentiel que l’élaboration de telles règles revienne à un organisme indépendant et ne soit pas inspirée par le corps politique » (Thomas Jones, vice-président, 30 octobre 2003).
L’indépendance de l’IASC devient en conséquence la source de sa légitimité. Elle est supposée provenir de son statut, qui est celui d’une fondation de droit privé, dont le siège est dans le Delaware. Elle est ensuite constamment réaffirmée par un discours par lequel l’IASC avance le caractère impartial et scientifique de ses travaux, dont le principal argument est que toutes les professions comptables sont associées à la détermination des normes. L’argument est en fait très spécieux. Pour participer au travail de l’IASC, pour en être partie prenante, il faut verser une importante contribution financière, dont seuls sont capables les grands cabinets d’audit et de comptabilité ainsi que les grandes institutions financières. L’IASC dispose d’environ 20 millions de dollars par an pour accomplir la mission qu’elle s’assigne, à savoir, aux termes de l’article 6 de son cadre conceptuel, « élaborer, dans l’intérêt général (sic) un jeu unique de normes comptables de haute qualité, compréhensibles et que l’on puisse appliquer dans le monde entier, imposant la fourniture dans les états financiers et autres informations financières, d’informations de haute qualité, transparentes et comparables, de manière à aider les différents intervenants sur les marchés de capitaux du monde ainsi que les autres utilisateurs de ces informations dans leur prise de décision économique ».
Le discours que tient l’IASC est celui de la satisfaction de l’intérêt général. A la condition qu’il corresponde aux idées affirmées dans les paragraphes 6 et 10 précités du cadre conceptuel : celui d’un service rendu aux investisseurs sur les marchés financiers. C’est donc un certain type de comptabilité qui est ainsi promu, compréhensible par un nombre limité d’intervenants qui disposent seuls des ressources intellectuelles, juridiques et financières pour participer au jeu de la normalisation comptable. Ces intervenants, qui sont les principaux cabinets d’audit et les grandes institutions financières, se servent de l’IASC pour leurs actions de lobbying. Derrière la rhétorique de l’indépendance, l’IASC n’est rien d’autre qu’une entité aux mains de certains professionnels. Elle dissimule l’intérêt particulier de ses donateurs derrière un discours de technicité et d’intérêt général, ce qui ne peut que faire sourire lorsque l’on se rappelle que les principaux scandales financiers des années 2000, comme la faillite d’Enron, ont mis en cause pêle-mêle les régulateurs, les cabinets d’audit et les normes comptables, qui n’ont pas apporté les informations que les investisseurs étaient en droit d’attendre.
Le processus d’élaboration des normes comptables s’effectue logiquement en circuit fermé. Les 22 membres (trustees, dont deux doivent provenir de cabinets d’audit selon les statuts) de l’IASC nomment, financent et supervisent un conseil des normes comptables internationales (international accounting standard board, IASB) basé à Londres et composé de 14 membres, majoritairement anglo-saxons, ce qui reflète les rapports de force au sein de l’industrie de la finance. Ils sont familiers du type de modèle comptable sur lequel ils travaillent. Les normes comptables sont ainsi instituées à partir d’un schéma intellectuel en vigueur dans les grands cabinets d’audit, alors que cette profession n’a pas, loin s’en faut, toujours respecté ses propres règles déontologiques.
c) Réactivité de l’IASC et lourdeur bureaucratique européenne
A l’exception du Royaume-Uni, les normes comptables émanent de la puissance publique dans les pays de l’Union européenne. Dès lors, pourquoi l’Union européenne n’a-t-elle pas mis en place sont propre système comptable, conformément à ses intérêts propres ? L’échec de l’harmonisation comptable européenne illustre comment la souplesse d’un organe privé permet de triompher d’Etats dotés du pouvoir normatif.
Deux raisons fondamentales expliquent l’échec d’une normalisation que l’Europe avait tenté d’instaurer au cours des années 90. En premier lieu, la comptabilité est un métier, une technique, qui s’accommode mal du processus d’élaboration des directives. Les délégations des Etats membres ont effectué pendant des années d’incessantes rotations à Bruxelles sans parvenir à s’accorder, cherchant avant tout à défendre leur modèle national. Deux directives ont péniblement été adoptées alors que les marchés financiers voyaient leur mode de fonctionnement profondément réformé. Il aurait sans doute fallu créer un organe composé de professionnels et lui déléguer la mission d’établir un référentiel comptable européen mais la Commission était principalement préoccupée par l’instauration de la monnaie unique. L’unanimité qu’exigeaient les règles européennes en cette matière a débouché sur un paradoxe : obliger l’Union à adopter le référentiel comptable d’une entité privée sur laquelle elle n’exerçait aucune tutelle.
En second lieu, le rapport de force entre marchés financiers contraignait toute entreprise qui recherchait des capitaux à s’implanter à Wall Street, et donc à accepter les normes comptables de l’IASC ou les normes purement américaines. Comme le rappellent nos collègues Dominique Baert et Gaël Yanno dans leur rapport d’information précité, « en droit, rien n’interdisait à l’Union européenne d’adopter les US GAAP (normes américaines). Cependant, une telle décision aurait posé un véritable problème de souveraineté, aux conséquences considérables pour les entreprises européennes. Adopter les US GAAP, c’était accepter une emprise de fait des normes américaines sur la gestion des entreprises européennes, se mettre dans les mains d’un normalisateur comptable susceptible de changer ces normes sans tenir compte de leurs intérêts, d’une autorité de marché seule habilitée à interpréter et à contrôler leur bonne application et enfin de consultants/auditeurs généralement affiliés à un réseau américain, les seuls ayant une compétence reconnue sur ces normes ». C’est l’ensemble d’une filière économique qui risquait être absorbée par la concurrence. Dans ce contexte, les normes de l’IASC, acceptées par la SEC mais qui différaient en quelques points des règles américaines, pouvaient apparaître acceptables par les Européens.
L’IASC a su profiter de l’inertie des Etats membres pour se poser en arbitre et proposer ses services à la Commission, laquelle lui a délégué la mission d’harmoniser la comptabilité des Etats membres. Dès le 13 juin 2000, une communication de la Commission préconisait l’application des règles de l’IASC pour les entreprises européennes cotées en bourse. Le règlement (CE) n° 1606/2002 du 19 juillet 2002, adopté à l’unanimité des Etats membres a donné à l’IASC la légitimité juridique qui lui manquait jusqu’à présent sur notre continent et l’a même renforcé à l’échelle mondiale. Elle pouvait désormais se prévaloir auprès de la SEC de son rôle dans la normalisation comptable internationale.
L’Union européenne est allée très loin en retenant les règles de l’IASC. Dans les Observations sur certains articles du règlement n° 1606/2002 précité, publiées en novembre 2003, elle a indiqué que les Etats membres devaient appliquer en bloc les normes comptables pour les sociétés cotées, sans y apporter une quelconque adaptation.
La comptabilité représente d’ailleurs le seul exemple où l’Union a entièrement délégué l’élaboration de la norme à un organisme privé qui ne relève d’aucun contrôle. Certains observateurs avancent que cet abandon de souveraineté était bien commode et lui évitait d’arbitrer un conflit entre une conception continentale qu’auraient défendu l’Allemagne et la France et une conception britannique de la comptabilité.
L’application des normes de l’IASC aux sociétés cotées ne s’est toutefois pas faite sans difficultés. Le rejet, le 16 juillet 2003, par le comité de réglementation comptable européen (organisme en charge d’homologuer les normes de l’IASC) de deux normes (n°s 32 et 39) applicables aux instruments financiers a connu un retentissement qui a largement dépassé la sphère des métiers de la comptabilité, notamment parce qu’il avait été précédé d’une lettre adressée au Président de la Commission européenne Romano Prodi par le Président Jacques Chirac, qui craignait « une financiarisation accrue de l’économie et des méthodes de direction des entreprises privilégiant trop le court terme ». C’est la première fois qu’une autorité politique majeure mettait en cause le cadre conceptuel anglo saxon d’une comptabilité centrée sur les actionnaires. Ce réveil était toutefois trop tardif et l’IASC a su amender les normes 32 et 39.
L’IASC, en s’appuyant sur l’IOSCO, puis en tirant parti des divisions européennes, a été en mesure en 40 ans d’existence de devenir de facto une instance normative, en fondant la fixation des normes sur une vision actionnariale de la comptabilité. Il lui a fallu louvoyer entre différentes conceptions de cette discipline pour parvenir à ce résultat. L’influence qu’elle a acquise dans les relations économiques internationales est due à sa réactivité. Un conseil d’administration composé de 22 professionnels aguerris dispose d’une faculté d’adaptation bien plus rapide que celle des Etats qui doivent respecter des procédures parfois lourdes. L’IASC a su s’adapter chaque fois que son rôle risquait d’être mis en cause.
d) La part des normes comptables dans la crise financière de 2009/2010
Le présent rapport ne porte pas sur l’analyse de la crise financière internationale et des conséquences économiques qui l’ont suivies. Mais si l’on garde à l’esprit que celle-ci est à l’origine d’un accroissement considérable du chômage et que ce dernier est un problème public, déterminer la part des normes comptables dans la crise financière n’est pas inutile.
Les normes comptables ne sont évidemment pas les principales responsables de la crise. Elles l’ont en revanche accentué en jouant un rôle procyclique. L’évaluation des actifs et des passifs à leur juste valeur, c'est-à-dire à la valeur du marché, permet aux investisseurs d’analyser les plus-values potentielles de leurs placements trimestre par trimestre. Comme la valeur du marché correspond à des attentes, il suffit que les anticipations soient favorables sur les résultats d’une entreprise pour que sa valeur augmente, parfois nettement plus vite que l’indice du marché. Il y a alors déconnection des résultats réels de l’entreprise (compte d’exploitation notamment) et de sa valeur.
Si les marchés financiers baissent, la diminution de la valeur d’une entreprise risque alors d’être amplifiée. Les conséquences sont alors considérables : les dépréciations que les banques sont obligées d’inscrire dans leurs comptes réduisent leurs fonds propres, sur lesquels est basé le financement de l’économie. Lors de la crise financière de 2009/2010, ces dépréciations ont conduit les banques à vendre leurs actifs pour se procurer des liquidités, y compris les actifs qui étaient sains, accentuant ainsi le mouvement de contraction des marchés.
Le recours à la notion de juste valeur dans la comptabilité de type anglo saxon n’était pas une découverte. Elle est contestée par les analystes qui considèrent, comme en France, que la comptabilité constitue une branche du droit qui permet d’asseoir la réglementation fiscale et qu’elle reflète une vision économique et sociale de l’entreprise, plus qu’une vision financière.
Les conceptions comptables de l’IASC, proches, mais pas complètement identiques à celles prévalant aux Etats-Unis, ont pu s’imposer à travers le monde parce que les Etats ont fait preuve de faiblesse. Ils ont négligé d’analyser les conséquences économiques du choix des normes comptables. Avec la crise, ils paient aujourd’hui le prix de cette négligence. Quand une discipline peut avoir des conséquences sur les politiques publiques, elle ne peut être déléguée au seul secteur privé. Aucun des membres du conseil d’administration de l’IASC ne s’est senti obligé de démissionner depuis l’apparition de la crise financière.
D – Environnement, droits de l’homme et aide au développement : le rôle à géométrie variable des vecteurs privés
Dans les trois domaines que sont l’environnement, les droits de l’homme et l’aide au développement, le rôle des vecteurs privés est à géométrie variable. Leur expérience les rend très intéressants pour les gouvernements auprès desquels ils jouent un rôle d’expertise dans les relations internationales. Mais ils peuvent aussi être le paravent d’actions publiques ou d’intérêt privés, ou encore constituer des forces d’opposition souvent efficaces à des politiques qu’ils contestent.
1. Environnement, de la protection des milieux aux polémiques sur les politiques globales
L’environnement est le domaine dans lequel le traditionnel concept de souveraineté des Etats se heurte à une incontournable réalité : la globalité des phénomènes naturels. Les écosystèmes ignorent les Etats et leurs frontières. Cette prise de conscience est ancienne et se trouve à l’origine de la création en 1948 de l’Union internationale pour la conservation de la nature, organe public qui se décline aux niveaux nationaux (UICN France). Pour conduire ses actions, l’UICN recourt à des partenariats publics et privés, et l’on retrouve parmi ses donateurs privés la fondation Warren Buffet, les fondations Ford et Kellogg, Holcim, Shell Petroleum et la société Sakhalin energy investment.
L’action sur l’environnement s’est longtemps limitée à la protection des milieux naturels et des espèces florales et animales, le plus souvent à une échelle régionale, avec une série de conventions spécifiques. Le rôle des ONG a oscillé sur ces dossiers entre expertise et force protestataire.
Le concept de protection de l’environnement s’est élargi à la fin des années 80 à celui de développement durable, qui pose le problème politique fondamental de la compatibilité des modes de vie humains avec les ressources de la terre. Sont ainsi devenues des questions internationales le climat et l’énergie, la biodiversité terrestre et marine, la gestion des zones côtières, l’émission de carbone et l’instauration d’une taxe, les priorités qui devraient être celles de la recherche agronomique et les espoirs comme les interrogations sur les filières de biocarburants.
L’environnement a ainsi élargi le champ traditionnel de la diplomatie. Considérées comme marginales au début des années 80, les questions environnementales ont pris une importance croissante, avec la prise de conscience que des problèmes globaux exigeaient des réponses globales... Les modifications de notre environnement ne se limitent en effet pas à un problème écologique. Elles ont un impact sur nos économies, comme l’a rappelé le désormais célèbre rapport de M. Nicholas Stern, de la London School of Economics, publié en 2006, comme sur nos sociétés, avec des risques de migrations massives depuis des régions qui risquent de manquer d’eau ou qui, au contraire, sont menacées par la montée des eaux. Le terme de globalité, abusivement utilisé en de multiples domaines, caractérise bien ce domaine.
a) Des actions essentiellement multilatérales conduites par les gouvernements et les ONG
La principale spécificité de la diplomatie sur les questions d’environnement réside en ce qu’elle s’exerce dans un cadre essentiellement multilatéral, compte tenu à la fois de la globalité et de la diversité des thèmes sur lesquelles portent les discussions. Du sommet de Rio (1992) en passant par celui de Kyoto (1997) ou de Johannesbourg (2002) – pour n’en évoquer que quelques uns –les négociateurs ont discuté des grands principes du développement durable, de la protection des biotopes, de la diversité biologique, du changement climatique, de la gestion des océans, des ressources en eau, de la santé, du logement, de la condition des femmes, des populations autochtones, du rôle des acteurs politiques et sociaux, de l’agriculture et des forêts, démontrant l’impact réciproque qu’exercent l’un sur l’autre l’environnement et les activités humaines.
Outre le multilatéralisme, l’implication très forte des ONG caractérise la diplomatie sur l’environnement. Le Sommet de Rio réunissait déjà 2400 ONG, tandis que 17 000 personnes participaient à un forum parallèle. Ces chiffres se sont amplifiés à chaque grande conférence. Il ne faut en rien s’en étonner car ce sont ces ONG qui ont alerté l’opinion depuis des décennies sur les dégradations subies par notre environnement et qui ont développé des capacités d’expertises parfois supérieures aux organismes d’Etat. Certains de leurs militants ont payé de leur vie leurs dénonciations, comme au Brésil et au Guatemala, pour les défenseurs de la forêt amazonienne et de l’agriculture familiale.
La puissance de certaines organisations de défense de l’environnement montre que parallèlement aux sociétés transnationales, sont apparus des mouvements sociaux transnationaux. Par ces termes, nous entendons des mouvements qui agissent sur les mêmes problèmes à travers le monde, sans souci de frontières. Leur succès est révélateur d’une prise de conscience générale sur des questions globales. Aussi les principales ONG comme le WWF et Greenpeace ont-elles plusieurs millions d’adhérents à travers le monde et gèrent des budgets annuels de plus de 100 millions de dollars. Leurs actions, même lorsqu’elles sont juridiquement illégales, sont souvent perçues avec sympathie.
b) Les vecteurs privés au cœur des polémiques sur l’environnement
Depuis l’échec de la conférence de Copenhague, en décembre 2009, les Etats et les groupes privés hostiles à tout accord contraignant ont repris de l’allant. Les conférences de Cancun sur le climat (décembre 2010) et celle de Nagoya (novembre 2010) ont débouché sur des accords a minima. Les climatosceptiques, néologisme qui désigne autant les scientifiques que les entreprises qui doutent de la véracité des travaux du GIEC ont financé aux Etats-Unis mais aussi en France (cf déclarations de M. Claude Allègre) des campagnes visant à semer le doute sur l’origine anthropique du changement climatique.
Entre l’intérêt général, de plus en plus difficile à définir, les prises de position militantes et les intérêts agricoles et industriels, les vecteurs privés animent largement l’ensemble des débats environnementaux, avec pour objectif d’influencer les dirigeants internationaux et les élus qui votent les textes nationaux. L’on retrouve ainsi la palette des différents modes d’action :
– ONG activistes : leurs actions spectaculaires visent à sensibiliser les opinions publiques et à faire pression sur les élus. Greenpeace (action contre Total sur l’exploitation des sables bitumineux au Canada, action contre Nike, Adidas, H&M accusés de polluer des rivières chinoises), Sea Shepherd (défense des baleines et autres cétacés) et le WWF dans une moindre mesure (hostilité à l’énergie nucléaire) sont les plus connues. Ces ONG ont remporté des succès notables, avec la protection d’espèces en danger comme le grand rorqual bleu ;
– Laboratoires d’idées : les fondations et associations qui réfléchissent sur l’environnement n’appartiennent pas exclusivement à la sphère des défenseurs de la nature. Le classement des 25 laboratoires d’idées les plus influents en matière d’environnement est révélateur de la bataille d’idées autour de ce secteur. Il s’en dégage en effet trois grandes branches :
* les chercheurs : l’on retrouve dans cette catégorie les grands laboratoires d’idées généralistes comme Brookings, Chatham House ou Copenhagen consensus center. Ils réfléchissent d’eux-mêmes ou reçoivent commandes de travaux sur l’impact des politiques environnementales sur nos sociétés ; l’Economic institute de Berlin a ainsi récemment remis au Parlement européen une étude et des recommandations sur les usages de l’eau dans les pays en développement ;
* les laboratoires d’idées agissant pour compte d’autrui, comme la Rand, qui conduit des études pour le compte de gouvernements ou d’entreprises privées sur les conséquences des politiques environnementales ;
* les fondations hostiles à toute législation contraignante. On ne s’étonnera pas de trouver dans cette catégorie Cato institute et Heritage, auprès desquelles les grandes entreprises établissent leur stratégie.
Laboratoires d’idées les plus influents en matière d’environnement
Nom |
Pays |
World resources institute |
Etats-Unis |
Brookings |
Etats-Unis |
Worldwatch institute |
Etats-Unis |
Pew center on global climate change |
Etats-Unis |
Potsdam institute for climate impact research |
Allemagne |
Ecologic institute |
Allemagne |
Resources for the future |
Etats-Unis |
Rand corporation |
Etats-Unis |
Earthwatch institute |
Etats-Unis |
Stockholm environment institute |
Suède |
Stanford university program on energy and sustainable development |
Etats-Unis |
Chatham House |
Royaume-Uni |
Center for global development |
Etats-Unis |
Copenhagen consensus center |
Danemark |
International institute for environment and development |
Royaume-Uni |
Center for environmental research |
Allemagne |
E3G, third generation environmentalism |
Royaume-Uni |
Center for economic and ecological studies |
Suisse |
Heritage foundation |
Etats-Unis |
Center for development and environment |
Norvège |
Wüppertal institute |
Allemagne |
African wildlife foundation |
Kenya |
Cato institute |
Etats-Unis |
International institute for sustainable development |
Canada |
Source: université de Philadelphie.
– Entreprises : en 2009 et 2010, les dépenses de lobbying auprès du Congrès ont atteint 90 millions de dollars, soit une augmentation de 400% par rapport à 2004. L’approche du sommet de Copenhague explique cette hausse. Les principaux clients des cabinets de lobby ont été Exxon (30 millions sur les deux années 2008 et 2009), BP, ConocoPhillips, Chevron. En réaction au lobby pétrolier, les représentants des industries éoliennes et solaires sont intervenus auprès des élus, mais pour des montants huit fois moindres. Les dépenses ont été effectuées sur la base de réflexions stratégiques sur l’évolution de l’industrie pétrolière qui remontaient à la fin des années 90, établies par des laboratoires d’idées conservateurs (George Marshall institute, Frontiers of freedom, Advancement of sound science coalition) afin de faire comprendre aux citoyens « les incertitudes de la science climatique ». Les fondations (parmi lesquelles figure Cato) de la famille Koch, propriétaire du groupe pétrochimique Koch industries, ont financé une vingtaine de laboratoires d’idées climatosceptiques à hauteur de 24 millions de dollars, au point d’être considérées par Greenpeace comme le principal bailleur de fonds des partisans du statu quo en matière d’environnement.
Le débat scientifique sur les questions d’environnement est désormais clairement instrumentalisé par l’ensemble de la sphère privée. D’un côté, les positions fondées sur des observations statistiques et modélisées, de l’autre la mise en avant de la notion d’incertitude, selon le mécanisme intellectuel analogue à celui utilisé par les fabricants de tabac pour expliquer que le cancer n’avait pas pour origine la consommation de leurs produits. Dans un tel contexte, seule l’action publique est en mesure d’arbitrer… à la condition de n’avoir pas été au préalable influencée. L’échec de la conférence de Copenhague et le résultat en demi teinte de celle de Cancun provient entre autre de ce que les participants savaient que le Congrès américain refuserait tout accord contraignant.
2. Droits de l’homme et modes de gouvernement : de la différence entre véritables idéaux et idéaux de façade
La défense et la promotion des droits de l’homme ne sont pas l’apanage de la sphère privée. Le respect des droits de l’homme est le fondement même des démocraties et des mécanismes juridiques en vertu desquels elles vivent.
Ainsi que décrit dans le I du présent rapport, les luttes en faveur des droits de l’homme sont largement à l’origine de l’apparition des vecteurs privés dans les relations internationales. Leur rôle n’a pas diminué, tant demeurent à travers le monde de multiples injustices, inégalités et qu’apparaissent de nouveaux problèmes comme l’expulsion de leurs terres des Indiens d’Amérique centrale.
La vigilance des individus et des associations est à l’origine de milliers de mouvements à travers le monde. On recense en France plus de 200 grandes associations de défense des droits de l’homme, cette notion comprenant pour la plupart d’entre elles les libertés individuelles et collectives mais également les droits économiques et culturels, l’Etat de droit (ou encore la bonne gouvernance), la lutte contre la précarité (logement), la protection de publics spécifiques (enfants, handicapés) ou encore l’aide au développement.
C’est l’inclusion de dizaines de domaines dans le champ des droits de l’homme qui est à l’origine d’une interrogation, dès lors que l’on analyse l’influence sur la scène internationale d’entités privées qui se définissent elles-mêmes comme défenseurs de ces droits. Nul ne conteste l’importance des droits économiques et sociaux ou la lutte contre la corruption comme éléments permettant à des individus de mener des vies libres et dignes. Mais de la même manière que certaines personnes privées déclarent réfléchir sur les questions environnementales pour dissimuler leurs activités polluantes, existent des organismes qui se servent des droits de l’homme comme un paravent pour masquer d’autres objectifs.
Le tableau de l’université de Philadelphie est lui-même révélateur de cette ambiguïté. A l’échelle internationale, une vingtaine d’entités privées seraient particulièrement influentes. Mais seuls Amnesty et Human rights watch, et dans une moindre mesure Transparency agissent dans le domaine des droits de l’homme. Les autres traitent des questions de gouvernement, au travers du contrôle de la société civile sur le budget et sur la fiscalité notamment.
Entités les plus influentes en matière de droits de l’homme
et d’institutions publiques
Nom |
Pays |
Transparency international |
Royaume-Uni |
Amnesty international |
Royaume-Uni |
Human rights watch |
Etats-Unis |
Freedom house |
Etats-Unis |
Soros open society |
Etats-Unis |
National endowment for democracy |
Etats-Unis |
Center for public integrity |
Etats-Unis |
Oxford council on good governance |
Royaume-Uni |
Revenue watch institute |
Etats-Unis |
Mo Ibrahim foundation |
Royaume-Uni |
Taxpayers alliance |
Royaume Uni |
Common cause |
Etats-Unis |
Global integrity |
Etats-Unis |
Institute for democracy in South Africa |
Afrique du Sud |
Indonesia corruption watch |
Indonésie |
Centro de analisis e investigacion |
Mexique |
International budget partnership |
Inde |
Grupo Faro |
Equateur |
Fundacion Jubileo |
Bolivie |
Source : université de Pennsylvanie.
Notons qu’aucune entité française n’apparaît dans ce classement, même s’il est indéniable qu’Handicap international, la Ligue des droits de l’homme, Médecins du monde, Médecins sans frontières et Reporters sans frontières ont un rayonnement international. Mais le tableau ci-dessus classe les entités en fonction de l’influence qu’elles exercent, ce qui inclut leurs capacités de communication et de publication de leur travaux, apparemment supérieures aux ONG françaises. La même remarque pourrait être opérée pour deux prestigieuses ONG britanniques, Oxfam et Survival, cette dernière accomplissant un travail considérable aux côtés de populations indigènes spoliées de leurs terres.
Revenue watch institute (RWI) est un bon exemple de paravent. Basé à Washington, censé promouvoir la gestion transparente, contrôlable et efficace des ressources naturelles, il concentre son action sur l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan, deux pays dont les ressources pétrolières considérables sont exploitées par des compagnies concurrentes (comme BP) des sociétés américaines… Les partenaires de RWI sont entre autre Carnegie, Soros Open Society et la Rand, trois fondations qui ont pour tradition de défendre les intérêts et les valeurs des Etats-Unis. Global integrity, également basé à Washington, souhaite « traquer la corruption par l’accès des citoyens et des hommes d’affaires aux organes des gouvernements », en d’autres termes promouvoir la société civile selon l’idéal américain. Freedom house, fondé en 1941 pour soutenir l’entrée des Etats-Unis en guerre, combat toute forme de dictature (du marxisme chinois au pouvoir religieux iranien) et promeut explicitement la démocratie à l’américaine. International budget partnership, en Inde, est la filiale de la fondation américaine (d’obédience démocrate) Center on budget and policy priorities et propose pour l’Inde un contrôle des finances publiques à l’américaine, alors que ce pays dispose déjà de ses propres modes de contrôle, souvent issus de la tradition britannique.
L’influence que certaines fondations cherchent à exercer se différencie du mouvement philanthropique des années 30 car elle ne se limite pas à proposer un idéal démocratique. Sous couvert de transparence, ces fondations militent pour une organisation sociale caractérisée par des prélèvements fiscaux les plus bas possibles et par des règles peu contraignantes sur les entreprises, afin de poursuivre la construction d’un cadre juridique favorable à la mondialisation.
La défense des droits de l’homme illustre l’importance du débat d’idées sur la scène internationale et le détournement sémantique dont elle peut faire l’objet. Aux côtés d’organisations sincères comme Amnesty, qui harcèlent les régimes dictatoriaux pour faire libérer des prisonniers politiques et alertent les opinions sur toutes les atteintes aux libertés existent des entités qui servent des intérêts d’entreprises ou d’Etats. La notion même de droits de l’homme, telle que conçue et portée historiquement par les pays occidentaux, est contestée ou adaptée au gré d’intérêts divers. Singapour avait maladroitement tenté, dans les années 90, de promouvoir les valeurs asiatiques, un type de société fondée sur le travail, la discipline et le consensus pour justifier le caractère autoritaire du régime du Premier ministre Lee Kuan Yew. La Chine avance ses propres valeurs et pour mettre en cause le Prix Nobel qui a récompensé un dissident chinois, crée le Prix Confucius, « une farce qui risque de devenir sérieuse » (Barthélémy Courmont) (13), fondé sur d’autres critères. Cet intérêt qu’ont des Etats ou des entreprises à déformer ou à relativiser l’idée des droits de l’homme n’est pas conjoncturel. Il crée dans un but précis une véritable menace sur son caractère universel et intemporel.
3. Aide au développement : quand l’action est à l’origine de l’influence doctrinale des vecteurs privés
L’aide au développement a de tout temps mêlé les politiques publiques nationales (Etat, agences spécialisées comme l’AFD ou US Aid), locales (coopération décentralisée), internationales (PNUD, Union européenne) et les initiatives privées. Ces dernières embrassent des actions d’urgence (lutte contre les famines et les épidémies) et des politiques de développement, le plus souvent conduites à l’échelle locale par des organisations religieuses ou laïques, mais également par des entreprises.
Cette dualité a généré de nombreuses études ainsi que des prises de position doctrinales sur leur efficacité comparée. « Trade not aid » était ainsi le slogan lancé par les représentants de plusieurs pays pauvres lors de la deuxième conférence des Nations Unies sur le développement en 1968, à New Delhi, marquant ainsi leur préférence pour des règles de marché efficaces et justes plutôt que des aides budgétaires assorties de conditions politiques. Le slogan a été ensuite repris et détourné par les économistes libéraux, partisans de l’élimination de l’aide publique au développement au motif que la liberté du commerce et de l’investissement était plus efficace pour créer des richesses.
Parallèlement à ce débat, des milliers d’ONG ont poursuivi une action de développement, parfois de longue date. Terre des Hommes, Action internationale contre la faim, ENDA et l’ensemble des ONG réunies au sein de Coordination Sud sont les plus connues en France. Leurs actions ont pris une telle ampleur qu’il est difficile pour les pouvoirs publics d’en avoir une vision exhaustive. La caractéristique de ces entités privées est de conduire des politiques de développement indépendamment des Etats, avec des références doctrinales plus ou moins affirmées.
A la différence d’autres domaines, les laboratoires d’idées qui réfléchissent aux questions de développement semblent n’avoir qu’une influence marginale. Ils publient énormément d’ouvrages et de brochures mais n’émettent pas d’idées originales qui puissent être mises en pratique. Dans le tableau de l’université de Philadelphie, seuls méritent une attention particulière le Club de Rome, pour ses analyses prémonitoires et l’International food policy research institute, qui rassemble des organismes publics et privés de 64 pays, spécialisés en recherche agronomique, et dont le rôle est de proposer des solutions aux problèmes de famine et malnutrition.
Laboratoires d’idées censés être influents
en matière de développement
Nom |
Pays |
Brookings |
Etats-Unis |
Center for global development |
Etats-Unis |
Overseas development institute |
Royaume-Uni |
Deutsche Institut für Entwicklungspolitik |
Allemagne |
Chatham House |
Royaume-Uni |
Woodrow Wilson international center for scholars |
Etats-Unis |
Council on foreign relations |
Etats-Unis |
Friedrich Ebert Stiftung |
Allemagne |
International food policy research institute |
Etats-Unis |
Konrad Adenauer Stiftung |
Allemagne |
Atlas economis research foundation |
Etats-Unis |
Institute of development studies |
Royaume-Uni |
Danish institute for international studies |
Danemark |
Fundacao Getulio Vargas |
Brésil |
Cato institute |
Etats-Unis |
Club de Rome |
Suisse |
Center for international governance innovation |
Canada |
Center for development and environment |
Norvège |
Institute for policy studies |
Etats-Unis |
International institute for sustainable development |
Canada |
Korea development institute |
Corée du Sud |
Bengladesh institute of development studies |
Bengladesh |
Institute of developing economies |
Japon |
Hudson institute |
Etats-Unis |
Source: université de Philadelphie.
a) L’aide au développement ou le nouveau champ d’un dialogue entre sociétés civiles
Une série d’évènements est à l’origine de l’émergence croissante des entités privées dans l’action comme dans la définition des politiques de développement. Le scandale des éléphants blancs, les détournements financiers en tous genres au profit de dictateurs, le maintien de la pauvreté dans des Etats riches en hydrocarbures ou en minerais, la déforestation, la spoliation de populations rurales ont provoqué partout dans le monde de profondes réflexions sur les politiques de développement. A défaut de pouvoir agir à grande échelle, des particuliers et des ONG ont pris l’initiative de travailler localement et ont développé de sérieuses capacités d’expertise avec le temps. Ainsi s’est noué un dialogue entre sociétés civiles où des ONG, le plus souvent de pays développés, s’efforcent de comprendre le mode de vie des populations qu’elles souhaitent aider.
Mais au-delà des critiques à l’encontre des politiques publiques, ce sont les réalisations concrètes des mouvements associatifs qui assoient leur légitimité doctrinale. Le succès du micro crédit au sein des populations déshéritées (idée portée par le professeur Mohamed Yunus, première expérience en 1976 et création de la Grameen Bank en 1983) a donné une large publicité aux initiatives citoyennes en matière de développement. Il a en effet été démontré que les politiques publiques négligeaient des pans entiers des populations les plus pauvres et surtout que l’aide au développement pouvait émaner de petites structures, disposant d’un capital s’élevant à quelques milliers d’euros. De multiples ONG se sont constituées sur cette base depuis vingt ans.
Il n’existe pas d’organisme mondial fédérant les milliers d’organisations privées qui oeuvrent en faveur du développement, mais des conférences régulières, notamment en Inde et en Europe, leur permettent de comparer leurs expériences. Ces conférences convainquent sans nul doute les larges publics qui y assistent que les politiques de développement sont plus efficaces lorsqu’elles sont conduites en dehors des Etats. Cette analyse est sans doute réductrice (cf en France le travail conjoint des collectivités territoriales et des ONG dans le cadre de la coopération décentralisée, cf également les analyses très pertinentes d’Esther Duflo, professeur au Collège de France et au MIT de Boston) mais en matière d’influence, la communication est essentielle. La conséquence principale de l’émergence d’entités privées est que la politique de développement est prise en charge de manière croissante par des individus et des ONG, nouant ainsi à travers le monde les bases d’un dialogue entre sociétés civiles
b) Des solutions privées à des problèmes publics : l’influence naissante des hommes les plus riches du monde
A la fin de l’année 2009, le nombre de particuliers fortunés et très fortunés (revenus annuels supérieurs à 30 millions de dollars) était évalué à 10,9 millions, disposant d’un patrimoine de 42 700 milliards de dollars. Les études sociologiques montrent une convergence de leur mode de vie ainsi qu’un intérêt croissant envers les problèmes publics. Relativement méfiants à l’égard des Etats, ils ont foi en des solutions privées aux questions politiques.
L’influence des grandes fortunes sur les politiques publiques est une constante de l’histoire. Fugger, Rothschild, Gulbenkian figurent dans une longue liste de noms. A l’époque contemporaine, l’on retrouve plusieurs grands noms de la finance et de l’industrie comme donateurs de causes humanitaires ou culturelles. Leur implication semble plus faible sur les questions internationales (la fortune n’est en rien un atout pour résoudre les problèmes de la Palestine ou du Cachemire). On note toutefois une exception, dans le domaine de la santé publique, avec la fondation Bill et Melinda Gates, et dans un avenir proche, avec la fondation the giving pledge.
Bill Gates est qualifié de « ministre de la santé mondiale » par William Dab, ancien directeur général de la santé en France, allusion faite aux 100 millions de dollars qu’il donne annuellement au fonds mondial de lutte contre le Sida. Le fondateur de Microsoft est également le deuxième contributeur à l’OMS, loin devant certains Etats et sa fondation ouvre des bureaux dans plusieurs capitales, dont Londres, pour se rapprocher des décideurs politiques en matière de santé. Si la plupart des dirigeants des organismes publics qu’il finance rappellent que Bill Gates est un donateur et que les choix effectués relèvent de leur compétence, ce dernier tient des discours de leader, bien plus que de simple bailleur de fonds, jugeant notamment qu’il faut dépenser mieux chaque dollar investi.
Avec the giving pledge, Bill Gates a franchi un cap qui pourrait à terme modifier de nombreuses politiques publiques. Il s’agit d’une initiative prise conjointement avec Warren Buffet, par laquelle les détenteurs des plus grandes fortunes américaines s’engagent à verser de leur vivant ou après leur mort une part notable de leur capital. Les 40 Américains les plus riches y ont souscrit, soit un montant de 303 milliards de dollars de dons en 2009. Les deux principales priorités (déterminées par les donateurs) sont la santé et l’éducation et the giving pledge est en passe de réussir en Afrique ce que l’OMS n’était jamais parvenu à accomplir : l’éradication du paludisme.
L’action philanthropique des très grandes fortunes est un phénomène naissant, circonscrit à l’Amérique du Nord, même si the pledge caresse l’ambition de réunir en son sein des milliardaires chinois et indiens. Avec autant de moyens, la question centrale sera de déterminer quels rapports les détenteurs de grandes fortunes voudront instaurer avec les Etats, mais l’histoire montre souvent qu’ils apprécient d’agir indépendamment des pouvoirs publics. Leur patrimoine précité de 42 700 milliards de dollars leur confère cette liberté.
E – Jeux olympiques et coupe du monde de football : quand les Etats courtisent les instances sportives
La gestion des grandes compétitions sportives internationales relève d’entités qui ont le plus souvent un statut privé. Deux compétitions se distinguent particulièrement par l’impact qu’elles ont sur l’image du pays hôte (l’audience à la télévision oscille entre 20 à 25% de la population mondiale) et les revenus (ou l’endettement) qu’elles génèrent : la coupe du monde de football et les jeux olympiques. L’une et l’autre sont gérés par des organes privés : la FIFA, association inscrite au registre du commerce en application de l’article 60 du code civil suisse, et le comité international olympique (CIO), association de droit suisse, depuis la révision en 1981 des statuts de 1924.
La coupe du monde comme les jeux olympiques (JO) sont porteurs d’une forte charge symbolique. Ils ont donné lieu à plusieurs reprises à d’âpres conflits et à des manifestations de fierté nationale. Les JO de 1936 devaient montrer au monde la force de l’Allemagne hitlérienne ; ceux de 1968 ont été précédés par la révolte des étudiants mexicains et ont donné lieu dans le stade même à des manifestations des athlètes noirs américains ; ceux de 1972 marquaient le retour de l’Allemagne fédérale parmi les grandes nations démocratiques ; ceux de 1980, à Moscou, symbolisaient initialement la grandeur de l’URSS, mais plusieurs Etats occidentaux ont renoncé à y participer en raison de l’invasion de l’Afghanistan par les troupes soviétiques en 1979. Les opposants à l’apartheid se sont également servis des JO, enceinte de fraternité, pour en exclure l’Afrique du Sud dont le type de société était incompatible avec les valeurs de l’olympisme. Les coupes du monde de football n’ont pas échappé à la politisation, notamment celle de 1978 en Argentine où la FIFA a été accusée de soutenir la dictature du général Videla.
Les deux évènements induisent de tels investissements pour leur organisation qu’il est quasiment impossible pour le pays hôte ou la ville d’en être le financeur exclusif, notamment depuis les JO de Montréal (1976) à la suite desquels celle-ci s’est retrouvée profondément endettée. La FIFA et le CIO ont mis en place des partenariats avec de grandes sociétés transnationales qui font des jeux des évènements commerciaux autant que sportifs. Si Montréal a été un échec financier, les JO de Los Angeles (1984) ont permis de substantiels bénéfices. De même, les jeux d’Athènes (2004) ont permis la modernisation de la capitale grecque, comme ceux de Londres en 2012 seront l’occasion de remodeler l’ensemble de l’Est londonien.
Villes et Etats se livrent à une compétition dans laquelle ils s’engagent à consacrer d’importants investissements publics, mais les décideurs, FIFA et CIO, sont des organes privés de plus en plus sensibles aux intérêts des entreprises (les JO d’Atlanta, en 1996, étaient surnommés jeux de Coca-Cola et l’attribution des jeux à Pékin est largement due au souhait de certaines entreprises d’élargir leur visibilité sur la marché chinois). En conséquence, ce sont les Etats et les villes candidates qui doivent se livrer au lobbying auprès des instances sportives, alors qu’ils sont la plupart du temps les principaux bailleurs de fonds ou les garants financiers de ces grands évènements.
Les stratégies d’influence d’entités privées dans le domaine international ont commencé avec les organisations religieuses caritatives, les missionnaires, les sociétés de pensée et les associations défendant un idéal humanitaire. Par la suite, le retrait de l’Etat, principalement dans les pays occidentaux, de pans entiers de la vie économique et sociale a laissé le champ libre aux entreprises, tant à l’échelle nationale qu’internationale. Les groupes de pression qui agissent en faveur d’intérêts économiques ont ainsi pu amplifier leur action. La disparition progressive de l’Etat stratège n’est pas étrangère à ce phénomène.
La globalisation de l’économie et la rapidité des échanges intellectuels ont accentué l’autonomie croissante des sociétés par rapport aux Etats. Les entités privées agissent selon leur propre logique, indépendamment des pouvoirs publics. Cette situation reflète le fonctionnement de nos sociétés, qui se veulent libres. Le jugement que l’on peut porter sur ce constat est fonction de nos convictions, notamment celle sur la place que nous voulons assigner à l’Etat.
Le débat sur l’influence des entités privées dans les relations internationales se résume à une question : sont-elles en mesure d’orienter les politiques publiques, peuvent-elles modifier le cours des relations internationales ? La réponse est sans doute négative quand il s’agit de la diplomatie classique, peu perméable aux influences et pressions de groupes privés (à l’exception – par ailleurs heureuse – des droits de l’homme) car les Etats ont avant tout des intérêts qui tiennent essentiellement à la géographie, à l’histoire et à la démographie. Elle diffère en revanche dès que l’on aborde les champs idéologiques, économiques, sociaux ainsi que l’ensemble des techniques de communication.
Il est indéniable que les critères de la puissance ont considérablement évolué et que dans un monde où la guerre conventionnelle a quasiment disparu (les guerres d’aujourd’hui sont essentiellement asymétriques), l’économie, la finance, la technologie, la capacité d’user au mieux des moyens considérables offerts par la télématique et les réseaux sociaux, le capital de séduction ou de sympathie constituent quelques uns des éléments nécessaires au développement de nos sociétés. Les Etats sont souvent présents dans ces secteurs, mais ils ne jouent plus le rôle de force motrice qui était le leur autrefois. C’est en ces domaines que l’influence des vecteurs privés est la plus forte et qu’elle emporte les conséquences décrites dans le présent rapport sur les politiques publiques.
Les Etats peuvent adopter deux attitudes face à cette nouvelle donne des relations internationales. S’y résigner, considérer qu’ils subissent une concurrence, ou être capables de se servir des entités privées comme des partenaires ou des leviers.
Face à une mondialisation qui les contraint à redéfinir leur place et à des sociétés qui bénéficieront inéluctablement d’une plus grande autonomie, les Etats doivent relever un formidable défi intellectuel : être capables d’analyser le sens politique des milliers d’informations issues chaque jour des activités humaines. Ce travail vaut autant pour les politiques nationales qu’internationales. Rien n’empêche les Etats et leurs diplomates de dégager, au même titre que les entités privées, les idées qui permettent à nos sociétés d’évoluer. Ainsi, le concept de droit d’ingérence est le fruit d’ONG mais celui de développement durable est issu de réflexions auxquelles les femmes et les hommes d’Etat ont pris largement part.
La place des entités privées dans les relations internationales peut-elle s’amplifier à l’avenir ? La rapidité des techniques de communication et l’intensification des échanges de tous ordres plaideraient en ce sens mais le phénomène a des racines historiques précises. Il doit parfois au hasard… Largement répandu aux Etats-Unis, il l’est nettement moins en Europe et marginal en Asie, même si d’importants laboratoires d’idées apparaissent à Shanghaï, à Tokyo ou à Jakarta. Entreprises, fondations, universités, ONG, joueront vraisemblablement un rôle croissant dans le façonnement de notre monde en raison de leur faculté d’adaptation plus rapide que celle des Etats, obligés de respecter des procédures. La complexité de la réponse à cette question provient des jeux multiples entre Etats et entités privés, qui s’allient, se combattent, s’influencent, cherchent à s’instrumentaliser au gré des circonstances. Il est impossible d’être catégorique, à l’image d’un monde en constante évolution.
La commission examine le présent rapport d’information au cours de sa séance du mardi 18 octobre à 17h00.
M. Jacques Myard, rapporteur : Mes chers collègues, il est temps de regarder la réalité en face : les relations internationales ne sont pas le monopole des Etats. Ce n’est d’ailleurs pas nouveau, les racines dans l’histoire sont anciennes et l’on peut citer pêle-mêle le rôle de l’Ordre de Malte au moyen-âge, l’activité des corsaires ou encore les compagnies des Indes qui ont initié les politiques coloniales des Pays-Bas, de la France ou de la Grande-Bretagne. La fin d’un monde bipolaire s’est traduite par une forte poussée des acteurs privés. Je ne pense pas exagérer en estimant qu’il y a une désétatisation des relations internationales, qui s’est accélérée grâce aux moyens modernes de communication.
On estime à environ 37 000 le nombre d’entités agissant à l’échelle internationale, qu’il s’agisse d’organisations non gouvernementales (ONG), de fondations, d’entreprises… Nous en faisons état dans notre rapport, sans ambition d’exhaustivité tant la matière est vaste et complexe.
Les ONG forment une part importante des entités privées agissant internationalement. Ce n’est pas nouveau. Elles étaient largement représentées au sein de la SDN, et plus tard, l’article 71 de la charte des Nations Unies a prévu que le Conseil économique et social pouvait les consulter. Cette présence est également due au concept de jus cojens, qui place les normes relatives à la personne humaine à un rang supérieur aux concepts s’appliquant aux Etats. C’est une idée forte pour les ONG de défense des droits de l’Homme, qui ont enregistré de notables succès dans leurs actions, principalement la mise en place d’une justice pénale internationale.
Les entreprises privées, notamment financières, présentent à notre sens une caractéristique essentielle : celle d’échapper à tout contrôle. La finance est un secteur largement autonome, mais l’actualité est là pour nous rappeler à quel point elle influe sur la politique monétaire et économique des Etats. Quant aux entreprises transnationales, dont le nombre est évalué à 82 000 environ, rappelons qu’elles assurent 35% de la production manufacturière mondiale. Une trentaine d’entre elles ont un chiffre d’affaires supérieur à un Etat de taille moyenne comme le Portugal. Elles conduisent à l’évidence leur propre politique, leur objectif étant d’échapper à l’impôt. Elles luttent jusqu’à présent avec succès contre toute réglementation fiscale internationale. Les fonds d’investissement, comme Carlyle group, présent dans la défense et l’aéronautique et les fonds de couverture (hedge funds) militent également pour éviter toute réglementation trop contraignante pour leurs activités. Les Etats ont ainsi abandonné des pans entiers de leur pouvoir financier, y compris et surtout la politique monétaire.
A la différence des Etats qui agissent selon des rapports de force – ce qu’on appelle parfois la capacité d’imperium - les acteurs privés jouent sur l’influence pour arriver à leurs fins. Les Etats se retrouvent souvent désarmés face à des acteurs qui agissent selon d’autres modes, notamment par des politiques sur le long terme. Or c’est une force de jouer sur le long terme en matière internationale.
La question que nous nous posons est simple : ces entités jouent elles pour elles-mêmes ou pour des puissances étatiques, dont elles seraient les paravents ?
La réponse est complexe et il peut être répondu par l’affirmative dans les deux cas. Les entités privées agissent selon une technique d’influence diffuse. Elles visent la conquête des esprits. Elles ciblent les élites, les décideurs et les futurs dirigeants. Les laboratoires d’idées – think tanks en anglais - sont l’outil idéal à cette fin. Ce concept nord américain est consubstantiel à la nature des Etats-Unis, la société civile ayant préexisté à l’Etat dans ce pays. La vraie ENA américaine, c’est Goldman Sachs… Vous trouverez dans notre rapport l’analyse de nombreux laboratoires d’idées, du PNAC à Cato en passant par Hudson Institute ou le Council on Foreign Relations. Ces laboratoires ont une idéologie commune : défendre la libre entreprise et vendre cette idée à travers le monde, avec des programmes de formation – comme les programmes Fulbright – et agir en osmose avec la diplomatie américaine. Il s’agit d’une vraie stratégie d’influence, mais il est difficile de savoir si l’initiative en revient au gouvernement américain ou aux laboratoires. En tout état de cause, le gouvernement américain sait tirer les bénéfices de cette situation.
Les universités font également partie du champ de notre rapport. Elles constituent un enjeu essentiel de compétitivité grâce à l’influence culturelle et linguistique. Il y a 3 millions d’étudiants dans un pays étranger, à raison de 31 % aux Etats-Unis, 17 % en Grande-Bretagne, 12 % en France et en Australie.
M. Jean-Michel Boucheron, rapporteur : Je vais poursuivre l’analyse de mon collègue en évoquant d’autres vecteurs d’influence, notamment les forums internationaux, qui sont des lieux de contacts directs. C’est là que se situe leur intérêt puisqu’ils mettent en présence des responsables politiques, des chefs d’entreprises et des intellectuels. Il en existe plusieurs dizaines, certains abrités par des fondations. Les principaux nous semblent être Davos, Munich et la Trilatérale.
Davos est le lieu du Forum économique mondial, avec désormais une autre réunion en Asie. La France y est peu présente, le plus souvent par des chefs d’entreprises. Personnellement, je ne suis pas sûr que ce soit dommageable, tant les idées prônées à Davos, par exemple les bienfaits de la déréglementation financière, ont été contredites par la réalité.
A Munich, se déroule chaque année en février la Conférence sur la politique de sécurité. Elle réunit les personnalités les plus importantes en matière de diplomatie et de défense, ainsi que celles des industries d’armement. La conférence a un statut mixte, public et privé. Rien ne se décide formellement à Munich, mais les discours des chefs d’Etat et des ministres s’accompagnent de tractations de toutes sortes en coulisse et de prises de contact. La France y est souvent présente par des représentants d’EADS et de DCNS ainsi que par des fonctionnaires du Quai d’Orsay, mais plus rarement par des personnalités politiques, alors que la conférence est ouverte aux parlementaires comme aux membres des partis.
La Trilatérale siège à Washington. Créée en 1973 par David Rockfeller, elle affiche avec franchise une vision libérale du monde et sa vocation à influencer les décideurs politiques. Actuellement, 19 de ses membres exercent de hautes fonctions gouvernementales aux Etats-Unis et en Europe et parmi ses 400 membres, 20% ont exercé dans le passé de telles responsabilités.
Il nous faut aussi évoquer les sources de financement des laboratoires d’idées. Les industries du pétrole, de l’armement, de la communication et de la finance constituent leurs principaux bailleurs, ce qui explique la conduite de certaines politiques, comme celle du Président George W. Bush. De même, l’absence de réglementation financière sur les campagnes électorales explique la puissance de l’American Israël public affairs committee (AIPAC) et la prudence des Présidents des Etats-Unis lors de leurs premiers mandats.
Notre rapport s’est efforcé d’analyser les domaines dans lesquels les vecteurs privés étaient influents. A notre sens, six tendances se dégagent :
Etats et grandes entreprises stratégiques jouent un rôle d’influence mutuelle, que l’on peut décrypter par les passages de hauts fonctionnaires dans certaines entreprises et par les orientations de politique étrangère conforme aux intérêts d’entreprises, comme les diplomaties pétrolières en Afrique et au Moyen-Orient, ou encore le travail des entreprises américaines de défense pour mettre en place une doctrine de défense anti missile étendue aux pays de l’OTAN.
Deuxième tendance : face à un monde des affaires qui se globalise, les syndicats ne restent pas sans réagir. Ils ont parfaitement intégré la nécessité d’une réponse collective, par le droit social notamment. Ils ont accompli un travail considérable à l’échelle européenne, mais peinent à obtenir les mêmes résultats au niveau mondial, en raison de divergences de conceptions sur leur rôle et sur leur action sur les différents continents.
Troisième tendance : la dépendance des Etats occidentaux envers les marchés financiers est une réalité dont 2011 constitue le point d’orgue. Elle a pour conséquence une sensibilité extrême à la notation des agences spécialisées au point que les efforts de réduction des dettes procèdent moins d’une réflexion sur l’action publique que de l’impératif de ne pas être dégradé.
Quatrième tendance : l’élaboration du droit financier, à savoir les normes bancaires et les règles applicables aux entreprises d’assurances et de marchés financiers sont élaborés en commun par les banquiers centraux, par les organes de surveillance de ces secteurs et par les représentants des principales entreprises de ces secteurs. L’ensemble du processus est coordonné par quelques organes que l’on appelle Comité de Bâle. Il y a donc auto régulation de la sphère financière. Parallèlement, une association de banquiers, l’International Institute of Finance, dont le siège est à Washington, joue un rôle discret auprès des gouvernements. L’IIF a ainsi donné son aval aux plans de sauvetage de la Grèce, ce qui est logique puisque les banques sont impliquées dans le rééchelonnement de la dette de ce pays.
Cinquième tendance : la normalisation technique comme la normalisation comptable jouent un rôle considérable dans nos sociétés. La normalisation technique est un gage de conquête des marchés. Quant à la normalisation comptable, elle constitue le tragique exemple de la faillite du pouvoir politique et de l’administration, puisque les Etats européens et l’Union européenne ont été incapables d’harmoniser leurs systèmes. C’est donc un organe privé, l’IASC / IASB, qui est devenu en près de 40 ans le régulateur de la comptabilité. Or cette discipline n’est pas neutre et la conception de l’IASB est fortement influencée par les grands cabinets d’audit, qui préfèrent donner des entreprises une valeur de marché plutôt qu’une valeur sociale, sur la base objective de leurs actifs, cette vision prévalant en Europe continentale. Or la valeur de marché est à l’origine de dérives du système financier. L’IASB est si solidement installée qu’elle rejette toute intervention des Etats dans les systèmes comptables.
Sixième tendance : les vecteurs privés sont nombreux et parfois puissants dans les domaines de l’environnement, des droits de l’homme et de l’aide au développement, mais il s’agit de domaines dans lesquels, aux côtés d’entités sincères et militantes se trouvent des « ONG paravents », qui poursuivent d’autres buts, souvent au profit d’entreprises privées. Nous n’expliquons pas autrement l’attitude de Greenpeace, qui après avoir accepté le principe de nous rencontrer, a annulé l’entretien que nous avions prévu, sur le prétexte des positions politiques prises par mon collègue Jacques Myard. Greenpeace a proposé de me voir sans mon collègue, ce que j’ai refusé, considérant que nous avions la même part de souveraineté nationale. Vous trouverez en annexe 1 du rapport la lettre que j’ai adressée à Greenpeace. Je souligne ici qu’une fois de plus, il y a impossibilité de connaître les sources de financement de Greenpeace, alors que comme beaucoup d’ONG, cette organisation se targue de transparence.
Je terminerai par deux points : en premier lieu, l’apparition de détenteurs de très grandes fortunes dans le secteur de l’aide au développement, sans doute bénéfique mais qui n’obéit pas toujours à une logique politique. En second lieu, la gestion d’internet mérite toute notre attention. Historiquement, elle est dévolue à une compagnie privée, l’ICANN. Cette situation comporte plusieurs aspects positifs, mais avantage considérablement les Etats-Unis en cas de conflit cybernétique, en raison du contrôle que le département du commerce et sans doute le département de la défense peuvent exercer sur les ordinateurs centraux qui gèrent les flux de trafic.
En conclusion, je soulignerai que la France a toujours un retard en matière d’intelligence économique et que nos entreprises investissent encore trop peu dans des fondations qui pourraient être incubatrices d’idées nouvelles.
M. le président Axel Poniatowski. Merci, messieurs les rapporteurs pour cette présentation extrêmement intéressante. J’ai bien compris qu’il s’agissait d’un rapport sur les vecteurs privés d’influence. Je relève que la plupart d’entre eux sont américains, qu’il s’agisse des ONG, des multinationales, des think tank, des universités, etc. à un moment où les Etats-Unis sont en perte d’influence, tant au niveau économique que politique. Cela pourrait être intéressant de savoir quels sont les grands vecteurs d’influence dans les pays émergents. Je trouve qu’il y a une déconnection entre les acteurs des vecteurs d’influence que vous citez et les tendances que vous exprimez.
En France, il faudrait que l’on ait des think tank plus puissants ou des sociétés de renseignement économique, un peu comme ceux qui existent en Grande-Bretagne.
M. Jean-Michel Boucheron, rapporteur. Nous n’avons pas du tout visé, dans ce rapport, les Etats-Unis. Mais lorsque nous avons fait le bilan des think tank, des instruments privés d’influence, nous nous sommes aperçus que l’on se tourne 99 fois sur 100 vers les Etats-Unis. Nous sommes à une période de l’histoire où les Etats-Unis, par les vecteurs privés d’influence, ont complètement dépassé l’Europe, alors que la Chine n’émerge pas encore. Dans le secteur de l’armement, dans celui du pétrole ou des droits de l’homme, il n’y a aucune ONG française dans les vingt premières mondiales. Nous n’avons pas volontairement recherché les think tank américains, il s’agit simplement de la réalité du terrain.
Hormis dans le domaine financier où les vecteurs d’influence ont une logique d’alignement de toute l’économie mondiale sur les normes américaines, il n’y a pas de cohérence globale. Chaque think tank a un objectif précis, en terme de lobbying,
M. Jacques Myard, rapporteur. La société transnationale qui s’est fortement développée durant ces vingt dernières années après la chute du mur de Berlin et le développement des technologies correspond à une forme de la société américaine. La société américaine, dans beaucoup de domaines, c’est la liberté individuelle et la liberté de ces groupes qui se sont constitués. S’ils sont si forts aujourd’hui c’est qu’ils ont préexisté dans la société américaine.
L’influence culturelle américaine a commencé, en 1946, avec l’accord Blum-Byrnes, qui est la fin du régime d'interdiction des films américains, imposé en 1939 et resté en place après la Libération. Intellectuellement, tout ce qui venait d’Amérique se rapportait à la liberté de circulation. Le socle d’une stratégie d’influence commence par une politique culturelle.
M. Jean-Paul Lecoq. On dit que l’Etat fédéral américain est faible ; il y a au moins un endroit où il est fort c’est quand il maîtrise sa banque centrale ! Ce qui n’est pas le cas pour l’Europe.
Les « indignés » ne représentent-ils pas une nouvelle approche de l’influence dans le monde ?
Vous n’avez pas parlé du rôle des religions.
Je me demande si le rêve du citoyen de 1789, de prendre le pouvoir dans le monde, pourra aboutir un jour.
M. Hervé Gaymard. Je souhaite avant toute chose féliciter les deux rapporteurs pour leur approche extrêmement intéressante et innovante. Je souhaiterais aborder le cas des étudiants étrangers. Il y a quelques années, j’ai rédigé un rapport sur la stratégie que devrait suivre la France dans les pays émergents. J’ai commencé ce travail sans a priori et je me suis rendu compte qu’un des piliers de notre politique devait être l’attractivité des étudiants étrangers. Dans le monde, il y a les pays où les universités sont publiques et ceux où les universités sont privées. Il y a par ailleurs des pays qui ont des stratégies d’attractivité des étudiants étrangers : les Etats-Unis et l’Angleterre depuis toujours, l’Allemagne plus récemment et de manière plus ciblée dans les secteurs qui concernent ses exportations et l’Australie qui, du jour au lendemain, a décidé qu’un des piliers de sa politique extérieure serait une politique d’accueil des étudiants étrangers. Avez-vous abordé le sujet ? Comment analysez-vous la politique française actuelle dans ce domaine ?
M. Dominique Souchet. Je voudrais également m’associer aux félicitations adressées à nos rapporteurs et leur demander si le réseau du Council on foreign relations constitue toujours un vecteur d’influence important. Lorsque j’étais en poste aux Etats-Unis, c’était une tribune extrêmement importante qui servait de relais très efficace pour diffuser les grands thèmes de la diplomatie américaine dans toutes les grandes métropoles, auprès des milieux d’affaires, auprès des associations et des réseaux consulaires. Ce réseau continue-t-il à avoir une influence significative ?
M. Jacques Myard, rapporteur. Nous n’avons pas abordé la question de la religion, qui constitue un thème très vaste. Les évangélistes sont extrêmement actifs et on peut se demander si leur action ne recoupe pas des objectifs politiques des Etats-Unis.
Sur le rôle de la Banque centrale aux Etats-Unis, je suis convaincu qu'en matière monétaire, c'est le milieu financier qui dicte sa politique à la Maison Blanche. Le Secrétaire d’Etat au Trésor est un ancien de Goldman Sachs. Il y a une symbiose et une action commune entre le pouvoir financier et la Maison Blanche.
Quant aux indignés, la question sous-jacente est de savoir s'il existe une opinion publique mondiale émergente. Il y a certainement des mouvements dans le monde occidental mais ce dernier ne représente pas la planète. Cela reste à étudier de près.
Concernant les étudiants étrangers, je suis d'accord avec vous. C'est un domaine stratégique d'influence, qu’il faut organiser. Les Américains l'ont déjà fait. Ils sont par exemple présents dans les banlieues françaises et accueillent des jeunes aux Etats-Unis. C’est une bonne politique. Aux Etats-Unis, les fondations ont des moyens financiers importants grâce à la structure du système fiscal et aux fortunes qui investissent. Il s’agit d’une question centrale en termes d’influence.
M. Jean-Michel Boucheron, rapporteur. Les « Council on foreign relations » sont un outil d'influence important. Concernant les étudiants étrangers, la stratégie aux Etats-Unis est globale alors que nous avons en France une stratégie d’universités, à l’exception du monde militaire où l’on accueille des étudiants de tous les pays que l’on retrouve ensuite dans les états-majors.
M. Jean-Paul Dupré. Vous avez dressé un état des lieux édifiant qui confirme le rôle exorbitant du pouvoir financier, y compris sur les Etats. Vous avez également pointé du doigt le comportement de certaines ONG. J'ai moi-même pu percevoir un côté arrogant chez certaines organisations qui utilisent, selon moi, une trop grande partie de leurs fonds à assumer des coûts de fonctionnements importants.
M. Myard a évoqué le rôle des fonds de pensions et d'investissement : il s'agit de véritables prédateurs d'entreprises et les conséquences sociales de leurs actions sont désastreuses. Ils sont intéressés uniquement par un profit immédiat. Vous avez enfin évoqué les cyber-attaques.
Quelles sont vos préconisations pour répondre à tous les enjeux évoqués ?
M. François Loncle. Je ne suis pas d'accord avec vous sur le déclin américain, M. le Président. Le rapport présente tous les vecteurs d’influence tels que les think tanks, internet, les organisations non gouvernementales. Nous sommes en train d'assister à un rééquilibrage des pouvoirs qui tend à compenser le déclin politique ou économique de telle ou telle nation.
Je souhaiterais faire deux remarques. A propos des ONG de défense des droits de l’Homme, elles sont moins puissantes en France et en Europe mais certaines, comme Amnesty International, ont des bureaux nationaux relativement indépendants du siège.
Deuxièmement, pourquoi n’avons nous pas un fonds de Bill Gates en Europe ou en France ?
M. le président Axel Poniatowski. Je maintiens ce que j'ai dit. Les Etats-Unis restent la plus grande puissance mondiale mais pour citer un chiffre éloquent, ils représentaient 18% du commerce international en 2000 et plus que 12% aujourd'hui.
M. Jacques Myard, rapporteur. Nous sommes dans l'ère des puissances relatives. La France est passée de 5,4% à 3,4% du commerce international. Jean-David Levitte me disait, que des Etats-Unis, la France est perçue comme une hyper puissance culturelle. Il y a divers critères. Les Etats-Unis arrivent à mener des politiques dans certains domaines, qui sont de véritables stratégies d'influence, grâce à des vecteurs privés qui précèdent la puissance d'un Etat par la conquête des esprits et leur manière de penser et de voir le monde. Les Américains ont joué cette carte avec succès avec leurs moyens propres et leur puissance entrepreneuriale.
Concernant les droits de l’Homme, il s’agit d’un thème universel.
M. Jean-Michel Boucheron, rapporteur. Si on utilise certains chiffres d'influence économique, certes, il peut y avoir un déclin américain car il y a de nouveaux pays émergents. Le montant du commerce est en forte augmentation et la part des Etats-Unis diminue.
Les think tanks américains sont très puissants. Ils fournissent des analyses sur de nombreux sujets. La rencontre de ce stock de connaissances avec internet y donne un accès à la planète entière, qui peut alors puiser dans toutes les études et recherches accumulées. Ce n'est pas un déclin de l'Amérique. Nous avons rencontré deux think tank chinois. Il est frappant de constater qu’ils ont les mêmes normes et les mêmes façons de penser que les Américains.
M. Jacques Myard, rapporteur. Si j'ai insisté pour que l’on utilise le terme de « laboratoires d'idées », c'est que l'asservissement culturel commence par l'emploi des concepts de l'autre.
Pour répondre sur la finance, il existait l'internationale des diplomates, l'internationale des militaires et maintenant, il y a l'internationale de la finance. C'est un réel problème.
Puis la commission autorise la publication du rapport d’information.
Annexe 1
Lettre de M. Jean-Michel Boucheron
à M. Pascal Husting, directeur général de Greenpeace France
Ayant souhaité entendre des représentants de Greenpeace France lors de l’élaboration du présent rapport, nous avons pris l’attache de son directeur général, M. Pascal Husting, par téléphone. Le 19 mai 2011, le secrétariat de M. Husting a confirmé par courriel un rendez-vous fixé au 7 juin, à 17 heures. Le 1er juin 2011, nous avons envoyé, toujours par courriel, un questionnaire sur les thèmes que nous souhaitions évoquer.
Le 7 juin 2011, à 15h40, M. Husting a annulé par courriel le rendez-vous, en indiquant que les positions « défendues par M. Jacques Myard sur un certain nombre de questions sociétales… étaient incompatibles avec les valeurs défendues par Greenpeace… ». Il a indiqué qu’il accepterait en revanche de rencontrer M. Jean-Michel Boucheron et de répondre par écrit au questionnaire. Malgré de nombreux échanges par courriels, aucune suite n’a été donnée à cette promesse. M. Jean-Michel Boucheron a donc adressé la lettre ci-après à M. Pascal Husting.
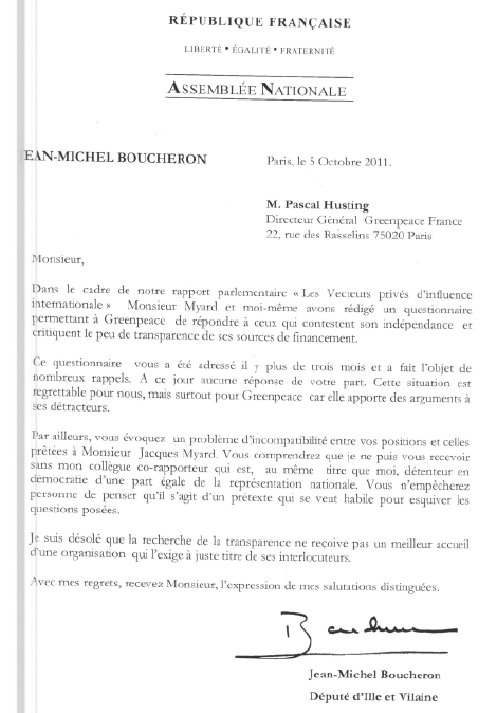
Annexe 2
La fiscalité des fondations américaines
Le nombre de fondations aux Etats-Unis est proche de 60 000. Leurs actifs dépassent 520 milliards de dollars. Elles pallient la carence de services publics de type européen en octroyant près de 40 milliards de subventions dans les secteurs de l’éducation, de la recherche, de la santé, de la culture et des services de proximité.
Contrairement à une idée largement reçue, les donations des particuliers sont largement supérieures à celles des entreprises : en 2010, elles se sont respectivement élevées à 221 milliards et à 16 milliards de dollars.
La plupart des vecteurs américains d’influence en politique étrangère ont le statut de fondation. Leur régime fiscal, particulièrement favorable, leur permet de disposer de moyens financiers qui ne cessent de croître au fil des ans. Dès lors qu’elles sont reconnues à but non lucratif, elles sont placées sous la section 501 du code fédéral des impôts.
Les fondations sont ainsi exonérées de l’impôt sur les sociétés et simplement soumises à une taxe de 2% sur le montant net des revenus provenant de leurs investissements. Cette taxe est réduite à 1% l’année où le montant des dons accordés est supérieur au montant moyen des dons accordés les cinq années précédentes.
Le régime fiscal des donateurs particuliers leur est globalement favorable, en application des sections 170 (impôt sur le revenu), 2055 (droits de succession) et 2522 (donations). La déductibilité des dons oscille de 20 à 50% en fonction du revenu brut déclaré. Les legs et donations à des fondations bénéficient en revanche d’une déductibilité illimitée.
Les fondations bénéficient de ce système à la condition qu’elles ne cherchent pas à influencer la vie politique. Dès lors qu’elles font profession de lobbying, elles sont passibles d’un impôt de 25% sur cette activité.
Annexe 3
Les laboratoires d’idées les plus influents sur les questions internationales et de sécurité
6480 laboratoires d’idées ont été recensés en 2011. Leur implantation se répartit à hauteur de 30% en Amérique du Nord, 27% en Europe, 18% en Asie, 11% en Amérique latine et aux Caraïbes, 8% en Afrique subsaharienne, 5% en Afrique du Nord et au Moyen-Orient et 1% en Océanie. Ils ne se consacrent pas tous à la politique étrangère et à la défense.
L’université de Pennsylvanie réalise chaque année, sous la direction du professeur James Mc Gann, un classement des laboratoires d’idées les plus influents. 250 chercheurs, universitaires et décideurs politiques provenant des cinq continents collaborent à ce travail. Le classement des 25 laboratoires d’idées les plus influents en politique étrangère s’est établi ainsi en 2011 :
1) Brookings (Etats-Unis)
2) Center for strategic and international studies (Etats-Unis)
3) Council on foreign relations (Etats-Unis)
4) Carnegie endowment for international peace (Etats-Unis)
5) Rand corporation (Etats-Unis)
6) International institute for strategic studies (Royaume-Uni)
7) Stockholm international peace research institute (Suède)
8) Chatham House (Royaume-Uni)
9) Hoover institution (Etats-Unis)
10) Heritage foundation (Etats-Unis)
11) International crisis group (Belgique)
12) Human rights watch (Royaume-Uni)
13) Transparency international (Allemagne)
14) German Marshall fund of the United States (Etats-Unis)
15) Cato institute (Etats-Unis)
16) German institute for international and security AKA Stiftung Wissenscahft und Politik (Allemagne)
17) European council on foreign relations (Royaume-Uni)
18) Center for American progress (Etats-Unis)
19) Institut français des relations internationales (France)
20) Peace research institute Oslo (Norvège)
21) Centre d’études et de recherches internationales – CERI Sciences-Po (France)
22) European union institute for security studies (France)
23) Center for strategic and international studies (Indonésie)
24) German council on foreign relations (Allemagne)
25) Institut pour les relations internationales et stratégiques (France)
La place des laboratoires d’idées américains est prépondérante, en raison de la législation fiscale américaine. Les plus anciens ou les plus prestigieux d’entre eux disposent d’un capital considérable (377 millions de dollars pour le Council on foreign relations, 301 millions de dollars pour Carnegie, 153 millions pour l’Aspen institute, 159 millions pour Heritage). Les revenus tirés des capitaux, combinés aux dons des entreprises et des particuliers, leur permettent de financer des chercheurs, d’émettre de nombreuses publications et d’organiser leur rayonnement. Les plus grands laboratoires d’idées dépensent annuellement des sommes considérables (256 millions de dollars pour la Rand corporation en 2009, 82 millions pour Brookings en 2009, 64 millions pour Heritage en 2008). Il existe de nombreux laboratoires d’idées dont le niveau de dépenses avoisine ou dépasse 20 millions de dollars (Cato institute, American enterprise institute). Un petit laboratoire d’idées, à l’échelle américaine, a un budget de 3 à 5 millions de dollars (fondation Century), chiffre néanmoins supérieur à la plupart des budgets des laboratoires d’idées situés hors des Etats-Unis. A titre de comparaison, l’institut Bruegel, qui reçoit des subsides publics et privés et qui est l’un des plus importants laboratoires d’idées en Europe, dispose d’un budget annuel de 2,7 millions d’euros.
Outre les 25 laboratoires d’idées précités, d’autres fondations et instituts sont actifs dans le domaine international par la qualité de leurs publications, les colloques qu’ils organisent et la densité de leurs liens avec les mondes politique, diplomatique et militaire :
Pays |
Nom |
Objet |
Afrique du Sud |
Institute for security studies |
Droits de l’homme, gouvernance, sécurité alimentaire |
Allemagne |
Institut für Weltwirtschaft |
Affaires économiques internationales |
Belgique |
Bruegel |
Questions économiques, questions européennes |
Belgique |
European policy centre |
Intégration européenne |
Chine |
Shangaï institute for international studies |
Relations internationales sous l’angle de la Chine |
Egypte |
Al Ahram center for political and strategic studies |
Moyen-Orient |
Etats-Unis |
American enterprise institute |
Libéralisme économique et politique aux Etats-Unis et dans le monde |
Etats-Unis |
Nixon center |
Relations avec la Russie |
Etats-Unis |
James Baker institute on public policy |
Relations internationales |
Etats-Unis |
United States institute of peace |
Prévention et résolution des conflits internationaux violents |
Etats-Unis |
Peterson institute for international economics |
Questions économiques internationales |
France |
Fondation pour la recherche stratégique |
Affaires internationales et militaires |
France |
EU institute for security studies |
Questions internationales et de sécurité sous l’angle européen |
Hongrie |
Center for policy studies at central european university |
Gouvernance en Europe centrale et dans l’ancienne URSS (en coopération avec la foundation Soros Open Society) |
Inde |
Institute for defense studies and analysis |
Relations internationales et sécurité |
Italie |
Fondazione ENI Enrico Mattei |
Réseau mondial des économistes de l’environnement |
Japon |
Institute for international policy studies |
Sécurité, économie, environnement dans la région Asie-Pacifique |
Pays-Bas |
Netherlands institute for international relations Clingendael |
Conflits contemporains |
Pologne |
Fondation Batory |
Etude sur l’espace post soviétique, stratégie en Europe centrale |
Royaume-Uni |
Centre for european reform |
Pro européen, développement de l’UE sous l’angle britannique |
Annexe 4
Liste des personnes auditionnées
Economie / Finances
M. René Ricol, commissaire général à l’investissement
M. Jeffrey Eubank, vice-président du New York Stock Exchange – Euronext, en charge des affaires stratégiques et des relations avec les pouvoirs publics
M. Evariste Lefeuvre, économiste à Natixis Etats-Unis
M. Alain Méra, président et Mme Françoise Alos, en charge des relations publiques de l’agence de notation Fitch Ratings
MM. Rodolphe Durand et Jean-Philippe Vergne, professeurs à HEC et auteurs de l’ouvrage l’organisation pirate, essai sur l’évolution du capitalisme
M. Régis Bismuth, docteur en droit, professeur des universités
Industrie
M. Michel-Hubert Jamard, président d’AREVA
M. Eric Dutourneau, secrétaire général des laboratoires Pierre Fabre SA
Mmes Florence Vesin-Etterlen, Anne Leherissel et M. Arthur Miller, Sanofi-Aventis
Internet
M. Jean-Jacques Subrenat, ancien ambassadeur de France, membre du conseil d’administration de l’ICANN
M. Jean-Marc Tassetto, directeur général de Google France
Mlle Alice Bonhomme-Biais et M. Jonathan Perleman, équipe de gestion de crise de Google Etats-Unis
Fondations / Laboratoires d’idées
Mmes Samara Hoyer Winfield, Katya Musacchio et Deborah Clifford, Fondation One to World
Professeur Jagdish Bagwati, Mme Janine Hill et M. Charles Landow, Council of foreign relations
M. François Carrel-Billiard, International Peace Institute
Mmes Marta Tellado et Suzanne Siskel, Fondation Ford
Mme Laura Silber et M. Tawanda Mutasah, Institut Soros Open Society
M. Jeffrey Laurenti, Fondation Century
Mme Linda Senat et M. Aaron Jacob, American Jewish Committee
MM. Gary Clyde Hufbauer, Jacob Funk Kirkegaard et Nicolas Véron, Peterson Institute for International Economics
MM. Raad Alkadiri et Jamie Webster, PCF Energy
Mme Sarah Margon et M. Ken Gude, Center for American Progress
Mme Tanja Stumberger, MM. Ian Vasquez et Stanley Kober, Cato Institute
M. Simon Serfaty, Center for Strategic and International Studies
Mme Rosemarie Watkins, American Farm Bureau Federation
American Israël Public Affairs Committee (AIPAC) (les personnes auditionnées souhaitent rester anonymes)
Remerciements
Mlle Alexandra Rettien, secrétaire nationale de la fédération nationale de la construction et du bois de la CFDT.
M. Sébastien Huygues, professeur des universités, auteur de nombreux ouvrages et études sur l’influence.
Isola Agazzi : Les ONG dans le système onusien : vers un partenariat multi-acteurs ? (www.strategicinternational.com), mai 2007.
Tsuneo Akaha : Japon, le difficile équilibre entre soft power et hard power (Politique étrangère, IFRI), 1/2011.
George Akerlof et Robert Schiller : Les esprits animaux (éditions Pearson), 2009.
Laurence Bade : Diplomatie et contrats, l’Etat français et les marchés extérieurs au XXème siècle (publications de la Sorbonne), 2011.
Dominique Baert et Gaël Yanno : Les normes comptables, jeu d’experts ou enjeu politique ? (rapport d’information n° 1508 de la commission des finances de l’Assemblée nationale), mars 2009.
Jean-Philippe Baulon : Les logiques d’une passion stratégique : les Etats-Unis et la défense antimissile (Hérodote, n° 140), 2011.
Jean Baechler : L’économie capitaliste (Gallimard), 1995.
Ulrich Beck : Macht und Gegenmacht im globalen Zeitalter / pouvoirs et contre pouvoirs à l’ère de la mondialisation (éditions Aubier/Flammarion pour la traduction française), 2003.
Gary Becker : La force des marchés (Politique internationale, n° 123), 2009.
Mario Bettati : Le droit d’ingérence (Odile Jacob), 1996.
Daniel Boorstin : Histoire des Américains (éditions Random House), 1958.
Rony Brauman : Humanitaire, diplomatie et droits de l’homme (éditions du cygne), 2009.
Pierre Bro : L’open data, et nous, et nous, et nous ? (regards sur le numérique, Microsoft), 1er trimestre de 2011.
Luc Bronner : Washington à la conquête du « 9-3 » (Les Echos), 7 juin 2010.
Bernard Carayon : A armes égales (Rapport au Premier ministre, la documentation française), 2006.
Elie Cohen : L’ordre économique mondial, essai sur les autorités de régulation (Fayard), 2001.
Bernard Colasse : Harmonisation comptable internationale, de la résistible ascension de l’IASC/IASB (Gérer et comprendre, Annales des Mines), mars 2004.
Barthélémy Courmont : Le soft power chinois (Institut de relations internationales et stratégiques, tribunes 2010 sur www.iris-france.org).
Barthélémy Courmont, Prix Confucius : une farce qui risque de devenir sérieuse (global brief), 8 décembre 2010.
Yann Decorzant : La Société des Nations et l’apparition d’un nouveau réseau d’expertise économique et financière (Critique internationale, Sciences Po / CERI), juillet-septembre 2011.
Pascale-Marie Deschamps : Les maîtres discrets de la finance mondiale (Enjeux – les Echos), novembre 2010.
Cécile Ducourtieux et Laurence Girard : Facebook, « troisième Etat » de la planète (Le Monde), 24 juillet 2010.
Pascal Dupeyrat : Guide des investissements étrangers dans les secteurs stratégiques (éditions Ellipses), 2011.
Arnaud Dupui-Castérès : L’image de la Chine, nouvel enjeu de sa stratégie d’influence (revue internationale et stratégique, n° 81), 2011.
Rodolphe Durand et Jean-Philippe Vergne : L’organisation pirate, essai sur l’évolution du capitalisme (éditions le bord de l’eau), 2010.
Yves Eudes : Facebook, Twitter et la révolution mondiale (Le Monde), 28 mars 2011.
Général Alain Faupin : La pensée au service de l’action : les think tanks américains (revue internationale et stratégique, n° 52), 2003-2004.
Eric Favereau : Deux Bill à l’assaut de la planète (Libération), 20 juillet 2010.
Stéphane Foucart : Qui finance le climato-scepticisme ? (Le Monde), 20 avril 2010.
Chrystia Freeland : The rise of a new global elite (The Atlantic), janvier – février 2011.
Tristan Gaston-Breton : Hommes et maisons d’influence (éditions Arnaud Franel), 2011.
Béatrice Giblin : L’intelligence économique, un enjeu de première importance toujours sous-estimé (Hérodote, n° 140), 2011.
Yves Gonzalez-Quijano : Les « origines culturelles numériques » des révolutions arabes (CERI, Sciences Po), mars 2011.
Richard Haass : Think tanks and US foreign policy, a policy-maker’s perspective (revue électronique du Département d’Etat) novembre 2002.
Robert Kagan : Of paradise and power, America and Europe in the new world order (éditions A. Knopf), 2003.
Sandrine Kott: Une autre approche de la globalisation, socio-histoire des organisations internationales (Critique internationale, Sciences Po / CERI), juillet-septembre 2011.
Henri Lepage : Crise financière, l’autre histoire (Politique internationale, n° 122), 2008-2009.
James McGann : L’influence grandissante des think tanks américains dans le processus d’élaboration des politiques de sécurité contemporaine (revue internationale et stratégique), été 2011.
Barah Mikaïl : Al Hurra ou les raisons d’une atonie américaine (INA global), novembre 2011.
Jacques Mistral : Peut-on gouverner la mondialisation ? (centre des études économiques de l’IFRI) 2011.
Pierre-Emmanuel Moog, en collaboration avec la fondation Prometheus : Les groupes de réflexion et d’influence en Europe (L’Expansion), 2008.
Evgeny Morozov : The net desillusion : the dark side of internet freedom (éditions Penguin), 2011.
Julien Nocetti : La diplomatie d’Obama à l’épreuve du web 2.0 (Politique étrangère, IFRI), 2011.
Joseph Nye : Bound to lead, 1990.
Thierry Pech et Marc-Olivier Padis : Les multinationales du coeur, les ONG, la politique et le marché (éditions du Seuil), 2004.
Alexandre Pham : D’Erasmus à Confucius (revue internationale et stratégique, n° 81), 2011.
Prometheus (fondation) : Baromètre 2010 de transparence des ONG.
Nadège Ragaru et Pierre Conesa : Les stratégies d’influence en affaires étrangères : notion insaisissable ou absence de volonté ? (revue internationale et stratégique, n° 52), 2003-2004.
Hélène Rey : Le fabuleux lobbying de la finance américaine (Les Echos), 10 février 2010.
Martine Royo et Stephen Boucher : Les think tanks, cerveaux de la guerre des idées (éditions Le Félin), 2006.
François Rubio : Les ONG et leur influence dans les relations internationales (www.strategicinternational.com), 2007.
Anne Salmon : Les nouveaux empires, fin de la démocratie ? (CNRS éditions), 2011.
Jean-François Serval et Jean-Pascal Tranié : La monnaie virtuelle qui nous fait vivre (Eyrolles), 2011.
Susan Strange : Le retrait de l’Etat, la dispersion du pouvoir dans l’économie mondiale (Cambridge university press, 1996 et Temps Présent), 2011.
Susan Strange : States and markets (Editions Pinter), 1988.
Nicolas Tenzer : Organiser l’influence : une stratégie intellectuelle pour la France (revue internationale et stratégique, n° 52), 2003-2004.
Alain Touraine : Après la crise (Editions du Seuil), 2010.
Ludovic Tournès : L’argent de l’influence, les fondations américaines et leurs réseaux européens (Editions Autrement), 2010.
Ludovic Tournès : Les fondations philanthropiques américaines en France au XXème siècle (classiques Garnier), 2011.
Louis Turner : Oil companies in the international system (Allen and Unwin), 1978.
Jean-Marc Vittori : L’invraisemblable survie du forum de Davos (Les Echos), 24 janvier 2011.
Robert Walzer : Guerres justes et injustes (Folio), 2006.
1 () Directeur général de Médecins du Monde.
2 () cf bibliographie.
3 () cf bibliographie.
4 () cf bibliographie.
5 () cf bibliographie.
6 () Lobby signifie hall d’accueil dans un hôtel. L’usage de ce mot remonte au XIXème siècle quand les lobbyistes qui agissaient auprès du Congrès et de la Maison Blanche descendaient à l’hôtel Willard, considéré alors comme le meilleur établissement de Washington. Ils avaient pour habitude de rencontrer leurs interlocuteurs dans le hall / lobby de cet hôtel. Le Willard a conservé son luxe et son prestige et ses salons abritent toujours des réunions politiques.
7 () (cf III).
8 () Julien Nocetti, cf bibliographie en annexe.
9 () Universitaire exerçant principalement à Princeton, connue pour ses travaux sur l’éthique en politique internationale, au nom de laquelle elle a jugé « illégale en droit international, mais légitime au plan des principes » l’intervention en Irak. Directrice du bureau de planification politique au Département d’Etat de février 2009 à février 2011. Elle a conservé une fonction de consultante pour ce Département.
10 () cf bibliographie
11 () cf, parmi les multiples études consacrées à la crise financière, le rapport n° 3034 de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale (14 décembre 2010).
12 () Extrait du rapport d’information n° 1508 de MM. Dominique Baert et Gaël Yanno, au nom de la commission des finances : les normes comptables ; jeu d’experts ou enjeu politique ? (mars 2009).
13 () cf. bibliographie.
© Assemblée nationale