______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 novembre 2011.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
en conclusion des travaux d’une mission d’information constituée le 5 octobre 2010 (1),
sur « Les faiblesses et défis du commerce extérieur français »
Président
M. Axel PONIATOWSKI
Rapporteur
M. Philippe COCHET
Députés
__________________________________________________________________
(1) La composition de cette mission figure au verso de la présente page.
La mission d’information « Faiblesses et défis du commerce extérieur français» est composée de : M. Axel Poniatowski, Président, M. Philippe Cochet, Rapporteur, MM. Jean-Paul Bacquet, Christian Bataille, Loïc Bouvard, Jean-Louis Christ, Michel Destot, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Kucheida, Robert Lecou, Rudy Salles, Gérard Voisin.
DES MESURES URGENTES DANS UNE SITUATION DIFFICILE 7
INTRODUCTION 15
I – L’INQUIETANTE SITUATION DES EXPORTATIONS FRANCAISES 17
A – DES COMPARAISONS QUI SOULIGNENT NOS DIFFICULTÉS 17
1) Sur le temps long : l’interruption d’une tendance haussière 17
2) Face à nos concurrents : un décrochage qui se confirme 20
B – LE COMMERCE EXTÉRIEUR, SUJET ÉCONOMIQUE FONDAMENTAL 22
C – DES EXPLICATIONS TRADITIONNELLES INSUFFISANTES 24
II – LES RAISONS D’UNE FAIBLESSE STRUCTURELLE 29
A – LA SPÉCIALISATION GÉOGRAPHIQUE ET SECTORIELLE 29
1) Des secteurs performants aujourd’hui menacés 29
2) Une spécialisation géographique moins porteuse 33
B – LA QUESTION DE LA COMPÉTITIVITÉ 34
1) L’évolution défavorable de la compétitivité prix française 35
2) Le poids du financement de la protection sociale 37
3) La défense de la compétitivité hors prix 38
C – UN CONSTAT MAJEUR : LE FAIBLE NOMBRE D’EXPORTATEURS FRANÇAIS 38
1) Une performance limitée des PME indépendantes 38
2) Trop peu d’entreprises à l’export 40
3) Des explications culturelles fréquemment invoquées 41
a) Héritage du centralisme : grands groupes contre « Mittelstand » 41
b) Un rapport incertain avec l’international 43
4) Les entreprises françaises ont-elles peur de grandir ? 45
a) La fiscalité et ses conséquences sur la taille des PME 45
b) Les effets de seuil du droit du travail et du droit social 46
D) UN PROBLÈME EUROPÉEN : LA FERMETURE DES MARCHÉS EXTÉRIEURS 47
1) Le blocage des négociations multilatérales 48
2) L’Union européenne, seule zone commerciale ouverte ? 49
III – LE SOUTIEN PUBLIC AUX EXPORTATIONS : LA FRANCE COMME MODELE ? 51
A –UN OUTIL DE SOUTIEN PUBLIC FRANÇAIS TRÈS COMPÉTITIF 51
1) La réforme d’Ubifrance et ses effets positifs 51
2) La Coface, acteur majeur du soutien à l’export 53
3) Le développement des activités internationales d’Oséo 55
4) Une organisation locale plus récente 55
B – DES DISPOSITIFS COMPARABLES EN ALLEMAGNE ET EN ITALIE 56
1) Allemagne : un rôle majeur dévolu aux Länder et aux chambres 57
2) Italie : une organisation flexible des regroupements d’entreprises 58
IV – FAIRE DE NOS PME DES ENTREPRISES MONDIALISÉES 61
A – RESTAURER LA COMPÉTITIVITÉ : UNE QUESTION DE FOND 61
B – FAIRE GRANDIR NOS PME 63
C – DE NOUVELLES RESSOURCES FINANCIÈRES POUR LES PME 65
1) Des fonds d’investissements publics-privés régionaux 65
2) Etendre le soutien public et les financements aux grandes PME 65
D – DÉCELER LES EXPORTATEURS POTENTIELS : POUR UN OUTIL PUBLIC INTÉGRÉ 66
1) Une agence régionale pour l’export 67
2) Susciter l’envie d’exporter 67
3) Aider fiscalement au développement à l’international 68
E –DES RESSOURCES POUR L’AVENIR : LE DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES 69
1) Des exemples positifs d’une politique sectorielle efficace 69
2) Des possibilités de développement de ce modèle 69
3) Changer les relations entre les grands groupes et les PME 70
F – AMÉLIORER L’ÉQUILIBRE DES MARCHÉS : LE PRINCIPE DE RÉCIPROCITÉ 71
1) Une nécessaire prise de conscience européenne 71
2) Le principe de réciprocité dans les matières non tarifaires 72
3) La présence française dans les négociations européennes 72
CONCLUSION 75
LES MESURES CLÉS POUR NOTRE COMPETITIVITE 77
EXAMEN EN COMMISSION 81
ANNEXE : LISTE DES PERSONNALITÉS RENCONTRÉES 87
DES MESURES URGENTES DANS UNE SITUATION DIFFICILE
L’évolution négative du solde commercial français depuis dix ans fait l'objet d’une attention médiatique et politique soutenue. Toutefois, ce n'est pas l'observation des fluctuations conjoncturelles qui importe, mais la réflexion sur les faiblesses structurelles de notre économie qui expliquent la situation dramatique de notre commerce extérieur, dont le déficit est chronique.
En 15 ans, la France est passée d'une position d'excédent commercial régulier à celle d'importateur net, alors que l'Allemagne consolidait ses très confortables revenus tirés de l'exportation de biens industriels. Autre preuve de la dégradation de notre statut commercial, notre part du marché mondial est allée en se réduisant, traduisant, certes, la montée en puissance de la Chine, mais également une perte de compétitivité notoire vis-à-vis de nos concurrents européens, au premier rang desquels l'Allemagne.
Notre balance commerciale souffre de trois difficultés majeures : une monnaie surévaluée notamment par rapport au dollar et au yuan chinois, un marché plus ouvert aux importations que ceux que nos entreprises pourraient conquérir, et une compétitivité défaillante. Mais d’autres puissances commerciales européennes souffrent également des deux premiers phénomènes, et bénéficient pourtant de soldes commerciaux bien meilleurs que le nôtre.
Nous devons donc nous comparer avec nos partenaires et concurrents directs les plus performants, notamment l’Italie et surtout l’Allemagne. Ces comparaisons soulignent deux défauts majeurs qu’il est urgent de pallier : les entreprises françaises sont en moyenne trop petites pour réussir à l’international, et la compétitivité de nos produits est rognée par le coût du travail.
De nombreuses mesures ont déjà été adoptées dans les domaines liés de près ou de loin au commerce extérieur français, sur la fiscalité du capital productif, les outils de soutien aux exportations, l’organisation de certaines filières, et seront rappelées ci-après. Les présentes pistes visent à étendre le champ d’action des décisions récentes, à en consolider les résultats, et à proposer de nouvelles pistes d’action pour rendre à nouveau nos produits compétitifs sur le marché mondial.
Pour faire grandir les PME françaises, nous devons assurer leur développement dans la durée. Les fleurons de notre industrie exportatrice, hors groupes de taille mondiale, sont issus de sociétés familiales dont l’expansion a été assurée par chaque génération. Or, jusqu’à récemment, la transmission de la propriété d’entreprise au sein d’une famille était très coûteuse fiscalement ce qui conduisant de nombreuses sociétés performantes à être revendues à des grands groupes, français voire étrangers, réduisant d’autant le nombre d’entreprises françaises à l’export.
Nous nous félicitons des avancées majeures accomplies en 2004 et 2007 en matière de fiscalité des transmissions d’entreprises. La France a évité, grâce à ces dispositifs qu’il faut à tout prix conserver, que nombre de ses entreprises les plus innovantes ne soient vendues à des groupes étrangers.
Des difficultés importantes restent à lever, notamment la situation des héritiers ne travaillant pas dans l’entreprise. Là encore, des solutions ont déjà été apportées, comme le pacte d’actionnaires. Il faut aller au bout de la logique qui fait de nos PME industrielles un élément du patrimoine national et aligner le traitement fiscal des parts de PME familiales sur celui réservé aux œuvres d’art, en exonérant totalement les parts de sociétés attribuées aux héritiers quelle que soit leur situation vis-à-vis de l’entreprise, sous réserve de la conclusion d’un engagement collectif de conservation de dix ans.
Par ailleurs, les entreprises françaises sont soumises à un taux d’imposition sur les bénéfices trop élevé. La rentabilité des sociétés françaises est, contrairement à ce qui est d’usage de dire, très faible, hors grandes entreprises qui réalisent de toutes façons la majeure partie de leurs bénéfices à l’étranger. La baisse de l’impôt sur les sociétés est un impératif, mais doit s’accompagner de conditions strictes.
Ainsi, un taux réduit d’IS, à 20 %, devrait s’appliquer aux bénéfices redistribués à la condition qu’une partie des bénéfices supplémentaires soient redistribués aux salariés. De plus, un taux minimal d’impôt sur les sociétés de 10 % devrait être appliqué aux bénéfices reversés en augmentation du capital de la société.
La croissance des PME ne passe pas que par les dispositions fiscales. En matière réglementaire, et notamment concernant le droit du travail, des obstacles trop nombreux existent encore et poussent les entrepreneurs français à préférer « rester petits ». Notamment, les obligations sociales qui pèsent sur les entreprises à partir de 50 salariés - surcoût généré par la réunion obligatoire d’un comité d’entreprise et la désignation de délégués syndicaux dont les heures d’activité sont payées par l’entreprise, obligation d’organiser un plan de sauvegarde de l’emploi en cas de licenciement économique de plus de 9 salariés, perte d’exonérations de charges sur certaines dépenses comme les cotisations chèques vacances, etc. – poussent trop souvent les entrepreneurs à préférer créer plusieurs petites entreprises plutôt que de faire grandir leur société. Cette situation est très préjudiciable pour nos exportations.
Le passage de 49 à 50 salariés ne doit plus être redouté par les entrepreneurs. Un relèvement de ce seuil permettrait d’aider les entreprises françaises à atteindre la taille critique pour réussir à l’international. Les partenaires sociaux doivent être réunis pour faire avancer ce point. Au-delà, il apparaît indispensable d’organiser la représentation du personnel et les relations.
Enfin, de nombreuses entreprises voient leur croissance contrainte par le manque de ressources financières, particulièrement sensible dans un contexte de grave crise bancaire depuis 2008. La croissance de nos entreprises passe donc par un recours plus aisé aux capitaux, publics comme privés. Il est nécessaire de systématiser les expériences de fonds d’investissements régionaux, à participation publique et privée, et réservés aux PME.
De plus, à l’heure actuelle, les moyens publics sont concentrés sur les très petites entreprises, ce qui peut générer des effets pervers amenant à privilégier une croissance modeste. L’activité d’Oséo doit ainsi être étendu aux entreprises de taille intermédiaire, entre 250 et 5000 salariés. De plus, l’épargne privée doit être plus systématiquement mobilisée en faveur des PME. Le dispositif fiscal, qui prévoit un crédit d’impôt de 25 % du montant de l’investissement dans une PME, dans la limite de 20 000 euros pour une personne et 40 000 pour un couple, doit être étendu.
Mais la croissance des entreprises ne suffit pas. Il est indispensable de restaurer la compétitivité de nos produits. La compétitivité prix française vis-à-vis de l’Allemagne s’est effondrée à cause des lois sur les 35 heures. Pendant que le coût du travail en Allemagne augmentait de 8 % entre 2000 et 2004, en partie du fait de la réunification, le coût du travail en France augmentait de 22 %. Désormais, l’heure de travail en France coûte aussi cher qu’en Allemagne, supprimant du même coup la compétitivité prix dont nos entreprises bénéficiaient, malgré un effort de marge significatif depuis 2000.
La compensation des effets dramatiques des 35 heures sur l’organisation des entreprises industrielles est difficile. La flexibilité offerte par le système dit du forfait jours doit être approfondie, et la possibilité pour les cadres qui en bénéficient de travailler pendant leurs jours de RTT, voire l’extension de ce système aux assimilés cadres, devrait être rétablie.
La perte de compétitivité de nos produits vis-à-vis des produits allemands a deux conséquences graves. D’abord, elle génère un déficit commercial bilatéral croissant : les excédents commerciaux allemands sont largement le reflet des déficits français.
Surtout, dans les marchés en croissance en Asie et en Amérique Latine, la France et l’Allemagne sont concurrentes. Or, traditionnellement, les produits français étaient compétitifs car ils étaient moins chers, compensant une réputation du « made in France » moins établie que le « made in Germany ».
La restauration de la compétitivité de l’industrie française à l’international passe par deux canaux : l’allégement du coût du travail, cause originelle de la moindre attractivité de nos produits, et un renforcement de l’innovation pour améliorer notre compétitivité « hors prix ».
La baisse du coût du travail pourrait s’inspirer des réformes entreprises en Allemagne. D’abord, le transfert d’une partie du financement de la protection sociale sur la TVA, décidé en 2007 par le gouvernement Merkel, a permis de réduire de l’équivalent d’un point de TVA l’ensemble des cotisations pesant sur le travail. Les deux autres points supplémentaires de TVA décidé par le gouvernement (hors produits alimentaires) ont été affectés au financement des caisses de sécurité sociale ce qui revient, in fine, à réduire par anticipation le coût du travail en limitant les déséquilibres des comptes sociaux. De plus, toute augmentation de la TVA augmente le prix des importations, et fait donc peser sur celles-ci les dépenses collectives, contrairement aux autres impôts qui exonèrent en pratique les importations de tout prélèvement.
La flexibilisation du marché du travail en Allemagne est passée par une série de réformes de l’assurance-chômage sous l’impulsion du gouvernement Schröder, notamment la réduction des formalités à l’embauche et une incitation plus forte à la reprise d’emploi (baisse de la durée d’indemnisation du chômage, possibilité d’employer pour une durée limitée des chômeurs à un salaire inférieur au minimum légal). La qualité du dialogue social en Allemagne a permis de mettre en place ses réformes, malgré une forte contestation sociale initiale, et a joué un rôle certain dans la capacité de reprise de l’économie allemande entre 2009 et 2010.
La fiscalisation du financement de la protection sociale renvoie à une problématique plus complexe. Il faut s’assurer que la hausse de la TVA qu’elle engendre ne sera pas répercutée dans les prix, ce qui reviendrait à faire payer par le consommateur le transfert des prélèvements sociaux vers la fiscalité. Si cette décision devait être adoptée en France, comme elle l’a été en Allemagne, des engagements fermes de la part des distributeurs doivent être obtenus.
L’expérimentation de la TVA sociale dans le secteur automobile permet d’éviter ce risque, en se focalisant sur un secteur où les producteurs français sont peu nombreux, ce qui permet de mieux contrôler les prix, et la dépendance aux importations importantes, permettant de faire pleinement jouer à la TVA sociale son rôle de taxe à l’importation.
Le renforcement de notre compétitivité passe également par une amélioration des produits pour s’adapter au plus vite à l’évolution du marché mondial. L’importance du crédit impôt recherche, dispositif envié par tous nos concurrents, est cruciale : c’est en innovant plus que nos entreprises exporteront mieux.
Au-delà de l’innovation, la compétitivité hors prix des produits français passe par une réorganisation de certaines filières. Dans le secteur du bois, des activités importantes du processus de production ont été abandonnées ce qui conduit la France à exporter des produits primaires et importer des produits à haute valeur ajoutée. Une telle situation n’est pas supportable à long terme.
Dans le domaine des industries agroalimentaires, de trop nombreuses organisations professionnelles n’ont pas mis l’exportation au cœur de leurs préoccupations. Il est choquant que l’Allemagne se soit progressivement imposée comme plus performante à l’export pour les produits alimentaires, traditionnel point fort du commerce extérieur français. Une réflexion sur la répartition des aides publiques à l’agriculture doit être entreprise pour sortir de la logique de reproduction de l’existant.
S’agissant des industries stratégiques, la création de conseils nationaux stratégiques regroupant l’Etat et les principaux producteurs, sur le modèle du conseil stratégique des industries de santé, permettrait d’accompagner les réorientations nécessaires de nos secteurs de pointe. Ainsi, pour l’industrie pharmaceutique, une réunion annuelle des principaux acteurs permet à chacun de faire part de ses priorités, et de s’engager sur des objectifs concrets partagés (investissement privé dans une branche particulière, retrait d’un secteur considéré comme moins porteur, en contrepartie de réalisations publiques, par exemple). Une telle démarche pourrait être imitée pour des secteurs essentiels à nos exportations et qui ne comportent pas d’enceintes de discussion comparable (comme c’est le cas pour l’aéronautique, les biens militaires ou l’industrie nucléaire). La question se pose notamment pour l’industrie automobile, l’industrie textile, voire d’autres branches plus spécialisées (industrie du luxe, cosmétique, etc.). Cette nouvelle relation entre la puissance publique et les industriels devrait être accompagné d’une focalisation plus importante des pôles de compétitivité sur la dimension export.
Par ailleurs, la relation entre les grands groupes et les PME doit évoluer. On constate, en Allemagne, que les grandes entreprises traitent les PME comme des cotraitants et pas des sous-traitants. De la même manière, les firmes multinationales françaises doivent aider au développement international des PME au lieu de les considérer comme des concurrents potentiels pour des marchés de niche.
La France n’a pas à rougir de la qualité des agences publiques impliquées dans le soutien aux exportations. Depuis la réforme de 2007, elle dispose avec Ubifrance d’un acteur unique, et très performant si on le compare à ses équivalents dans le monde, qui assure un suivi au plus près des PME dans leur démarche d’exportation.
Certains aspects de notre outil public de soutien aux exportations pourraient toutefois être améliorés, notamment la cohérence entre l’action des très nombreux acteurs impliqués. Les doublons et divergences de stratégies sont très sensibles au niveau local. Il faut rationaliser l’organisation de l’action publique dans ce domaine, en s’attachant à mieux répartir les compétences. Cette question se pose au niveau local. Trop souvent, les chambres de commerce et les agences économiques des conseils régionaux ne coopèrent pas. La création d’agences régionales de l’export, pilotées par Ubifrance et regroupant le conseil régional et la chambre de commerce devraient permettre d’établir une stratégie de développement de l’export et les moyens de la mettre en œuvre au niveau local. Les compétences relatives au développement des exportations seraient réservées à ces agences sans préjudice des autres champs d’action économiques des chambres et des conseils régionaux (emploi, aménagement du territoire, etc.).
De la même manière, la question du maintien d’une activité publique au sein de la Coface doit être posée. A l’heure actuelle, les garanties publiques ne représentent que 5 % de l’activité du groupe Coface. Dans le même temps, Oséo a développé de nombreux instruments d’aide au financement export, ressemblant parfois beaucoup aux outils publics de la Coface. L’intégration des activités publiques de la Coface au sein d’Oséo permettrait de disposer d’un nouvel acteur intégré, parfaitement complémentaire d’Ubifrance, et qui couvrirait l’ensemble des aides publiques à l’investissement et à la croissance des entreprises.
Faire travailler ensemble des acteurs différents permettrait de concentrer les moyens pour mieux déceler les entreprises susceptibles de réussir à l’international mais qui n’ont pas conscience de leur potentiel. Dans le même ordre d’idées, une campagne de communication nationale regroupant tous les acteurs impliqués permettraient de sensibiliser les chefs d’entreprises à l’importance de l’exportation pour le développement de leurs sociétés.
L’envie d’export des entrepreneurs français pourrait également être développée à l’aide d’un dispositif fiscal innovant. Reprenant les principes du crédit impôt recherche, le crédit impôt export permettrait aux entreprises d’appliquer un taux réduit d’impôt sur les sociétés, de 25 % par exemple, sur la part de leur chiffre d’affaires réalisé sur des marchés étrangers. Afin d’éviter les effets d’aubaine, ce crédit d’impôt ne porterait que sur l’augmentation du chiffre d’affaires réalisés à l’export et n’inclurait que les produits fabriqués en France et vendus à l’étranger. Par ailleurs, le dispositif ne serait ouvert que pour les dix premières années de présence sur un marché étranger, afin d’éviter que les entreprises internationalisées n’utilisent ce dispositif qu’en vue de réduire leur impôt payé sur des produits vendus en France.
Enfin, l’application de règles équitables en matière de commerce international doit rester un objectif prioritaire pour la France et l’Europe. L’action de l’Union européenne contre les comportements commerciaux agressifs des puissances émergentes n’est pas assez visible. Le principe de réciprocité doit être réaffirmé et placé comme priorité politique de l’Union.
La France est en pointe dans ces débats, et le gouvernement a fait de l’application de ce principe un élément central de sa stratégie, ce dont il faut se réjouir. Les puissances émergentes, dont la Chine, ne peuvent continuer à s’abriter derrière le statut protecteur qui leur est octroyé au titre des règles de l’OMC pour développer ensuite une politique commerciale agressive sur nos marchés.
De plus, l’application du principe de réciprocité doit aller de pair avec l’application de principes universels connexes, notamment le respect du droit de propriété intellectuelle. Les standards mondiaux ont beaucoup progressé depuis plusieurs années mais leur application reste trop souvent problématique. Les entreprises les plus avancées peinent à faire sanctionner des comportements qui s’apparentent à du vol de savoir-faire de la part d’entreprises étrangères émergentes, voire d’autorités publiques.
Tout aussi problématique pour notre pays, dont les performances en matière de grands contrats restent constantes, la question de l’accès aux marchés publics doit être traitée. Les principes de l’accord général sur les marchés publics doivent être étendus au plus grand nombre de pays afin de favoriser l’accès des entreprises européennes à des contrats aujourd’hui interdits.
Dans le même ordre d’idées, les agences internationales d’aide au développement doivent appliquer des critères de décision plus fins dans l’attribution de marchés aujourd’hui soumis au seul principe du moins-disant, valorisant systématiquement les entreprises de pays émergents qui ne participent pas au financement des actions de développement en cause.
Mesdames, Messieurs,
En choisissant d’aborder spécifiquement les difficultés et les défis du commerce extérieur français, notre mission a suivi une méthode résolument pragmatique. Le constat est, en effet, difficilement contestable : la balance des paiements française s’est fortement dégradée depuis dix à quinze ans, alors que l’évolution amorcée il y a trente ans faisait de notre pays une potentielle puissance exportatrice pour le 21ème siècle.
Les données statistiques du déficit sont discutables à l’envie. Il est notamment indispensable de se focaliser sur la balance commerciale hors produits énergétiques, la dépendance française en matière d’hydrocarbures rendant peu significatifs les chiffres incluant ces biens. Mais même une telle correction laisse apparaître une dégradation significative.
La mission ne partage pas l’opinion de certains économistes qui consiste à ne pas s’inquiéter du commerce extérieur au prétexte que la balance commerciale ne refléterait pas le bien-être d’une économie. En effet, une fois évacuée l’instrumentalisation qui peut être faite des chiffres macroéconomiques, force est de constater que nos exportations évoluent très négativement, en tout cas beaucoup moins vite que nos importations. La principale faiblesse du commerce extérieur français est donc la faible capacité exportatrice de nos entreprises, et ce quel que soit le secteur considéré.
Cette situation est d’autant plus inquiétante qu’elle ne correspond pas aux résultats de nos principaux voisins, Royaume-Uni excepté. L’Allemagne reste l’une des premières puissances exportatrices mondiales, avec l’un des premiers excédents commerciaux au monde. Au-delà de ce modèle très particulier, le cas italien montre qu’une balance commerciale équilibrée est encore un objectif atteignable pour les pays industrialisés d’Europe.
De nombreux facteurs peuvent être avancés pour expliquer la situation française. Toutefois, aucun des facteurs conjoncturels, comme le niveau de l’euro ou le coût des biens énergétiques, n’explique l’écart entre la France et ses concurrents européens. Les questions de spécialisation géographique et sectorielle apportent des éléments plus convaincants, mais ne peuvent suffire à justifier que l’Allemagne s’impose comme la première puissance commerciale mondiale, alors que la France voit son déficit exploser.
L’approche par la compétitivité, et notamment l’impact des lois de réduction du temps de travail de 1998 et 1999 sur le coût du travail en France, permet d’expliquer une bonne partie de l’affaiblissement commercial français depuis le début des années 2000. La France a connu une hausse marquée des coûts de production, notamment dans les industries exportatrices, quand l’Allemagne bénéficiait, sur la même période, d’une baisse sans précédent de ses coûts, faisant progresser rapidement la compétitivité des produits allemands.
Les causes du malaise commercial français tiennent également aux difficultés globales de développement de nos PME. Celles-ci sont incapables d’atteindre la taille critique suffisante pour assurer un positionnement stable et performant à l’international, contrairement à leurs concurrentes allemandes, bien plus grandes en moyenne, ou italiennes, où le regroupement de plusieurs PME locales permet de disposer d’une force de frappe commerciale conséquente.
C’est à cette aune que la mission d’information s’est efforcée de jauger les efforts existants pour soutenir le commerce extérieur français. L’outil public de soutien aux exportations, important et en cours de rénovation depuis 2007, apparaît globalement performant, en tout cas comparable à ceux de nos principaux concurrents.
Il s’agit donc de se focaliser sur la cause première de notre perte de vitesse commerciale, et d’examiner les conditions d’un développement plus rapide de nos PME. Des dispositions fiscales et réglementaires pourraient les aider à devenir des entreprises de taille intermédiaire, qui regroupent les sociétés de 250 à 5000 salariés et dont le chiffre d’affaires reste inférieur à 1,5 milliard d’euros (1).
Des initiatives ont déjà été prises, notamment pour alléger la fiscalité des transmissions de sociétés et l’imposition du patrimoine professionnel. Ces acquis ne doivent pas être remis en cause. D’autres pistes pourraient être suivies, en matière de financement de la protection sociale et de droit du travail notamment.
L’amélioration de notre balance commerciale revêt donc une importance cruciale, au-delà des seuls échanges extérieurs. Il s’agit en effet de modifier radicalement la conception qu’ont nos entreprises de leur développement et de leur croissance. Nos principaux voisins, et concurrents, sont entrés de plein pied dans la mondialisation, car leurs entreprises voient désormais l’exportation comme un élément naturel, et indispensable, de leur croissance en général.
La mission a souvent entendu dire que la faiblesse exportatrice des entreprises françaises était liée à des particularités culturelles. Ce rapport propose quelques pistes pour que ces particularités ne deviennent pas une fatalité.
I – L’INQUIETANTE SITUATION DES EXPORTATIONS FRANCAISES
Au-delà des débats sur le niveau du solde extérieur, il existe un problème français : nos exportations n’ont pas suivi un rythme de progression comparable à celui de nos principaux concurrents européens. Une telle constatation ne saurait être prise à la légère : le commerce extérieur ne devrait plus concerner seulement les grands groupes internationaux, domaine dans lequel la France excelle. C’est parce que l’analyse est restée trop longtemps focalisée sur les difficultés de ces géants que les explications de notre déficit extérieur persistant restent trop souvent à la surface.
A – Des comparaisons qui soulignent nos difficultés
Depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, la France n’a pas de tradition d’excédent commercial fort, mais elle a connu une courte décennie de balance commerciale très positive, entre 1993 et 2001. Cet atout économique a disparu au tournant du siècle, et notre pays affiche désormais un déficit record au sein de la zone euro, qui ne repose pas sur une explosion des importations mais, en dernière analyse, d’une faiblesse inquiétante de nos exportations.
1) Sur le temps long : l’interruption d’une tendance haussière
Le commerce extérieur français s’est constamment développé de 1946 à 2009, à l’instar de l’ensemble des échanges mondiaux. En volume, les exportations de biens sont passées de 82 millions d’euros en 1946 à 340 milliards d’euros en 2009, une multiplication par 4000 qui excède évidemment très largement celle du PIB. Les importations on suivi le même chemin, passant de 350 millions à 384 milliards, une augmentation de facteur mille.
La première baisse des exportations remonte à 1986, et, jusque dans les années 2000, seule 1993, année de crise économique grave, a enregistré une baisse des exportations et des importations. En 1991, les importations avaient également baissé, mais pas les exportations. Le début des années 2000 marque une rupture relative, puisque les exportations comme les importations baissent successivement en 2002 et 2003, phénomène unique.
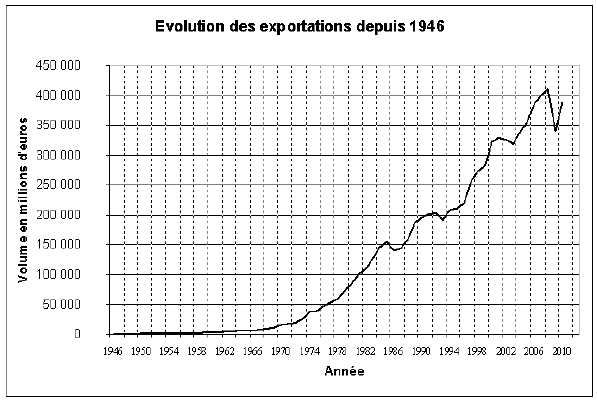
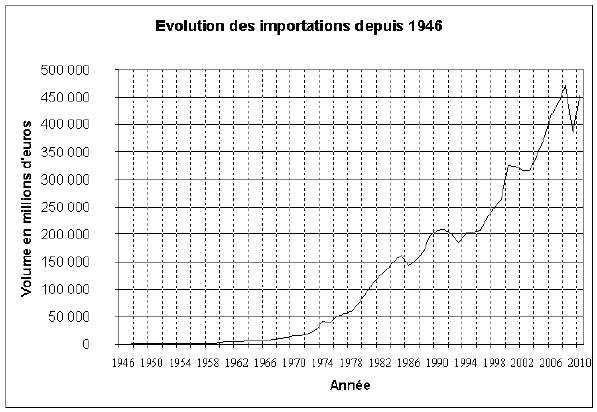
Les chiffres soulignent clairement que la France n’a commencé à avoir un excédent commercial qu’à partir du milieu des années 1990. La rupture dans l’évolution de cet excédent, qui atteint son pic à la fin des années 1990, intervient autour de 2004. La France devient alors déficitaire et le solde se dégrade continuellement.
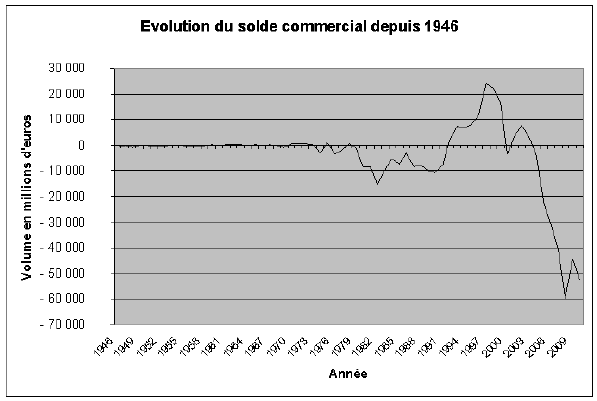
Le solde commercial des marchandises a connu une période d’excédents successifs entre 1992 et 1999, voire 2003 à l’exception de l’année 2000. Avant cela, la tendance était plutôt au déficit, à l’exception de deux périodes : 1959-1963 et 1970-1973, mais les montants restaient anecdotiques.
D’un montant de 1,4 milliards d’euros en 1992, le solde commercial français a atteint un record de 22,5 milliards en 1997, avant de commencer une régression. En 2004, le premier solde négatif de la série actuelle représente (pour les biens) un déficit de 3 milliards d’euros, qui s’aggrave ensuite année après année, à 20 milliards en 2005, 28 en 2006, 39 milliards en 2007, 56 milliards en 2008, 43 milliards en 2009. En 2010, le solde estimé repart à la hausse, avec plus de 52 milliards d’euros de déficit.
Entre 1992 et 1999, les exportations ont augmenté de 55 % environ, contre 46 % pour les importations. Si l’on étend la période jusqu’en 2003, les exportations augmentent de 72 % et les importations de 70 % seulement. Au niveau mondial, selon les chiffres de l’OMC, les exportations ont progressé de 51,6 % et les importations de 52,5 % entre 1992 et 1999, et de 102 % pour les deux indicateurs entre 1992 et 2003. Les excédents commerciaux exceptionnels des années 1992 / 2003 sont donc largement dus à un dynamisme plus faible des importations françaises, et un dynamisme plus proche de la moyenne mondiale de nos exportations.
2) Face à nos concurrents : un décrochage qui se confirme
Si l’on compare l’évolution du solde extérieur français avec des pays de même taille, deux concurrents apparaissent nettement plus performants : l’Italie, qui a réussi à se maintenir à l’équilibre, et surtout l’Allemagne, qui a longtemps occupé la place de premier exportateur au monde, et est passée récemment juste derrière la Chine. Le décrochage français intervient autour de 2004 et se confirme depuis lors.
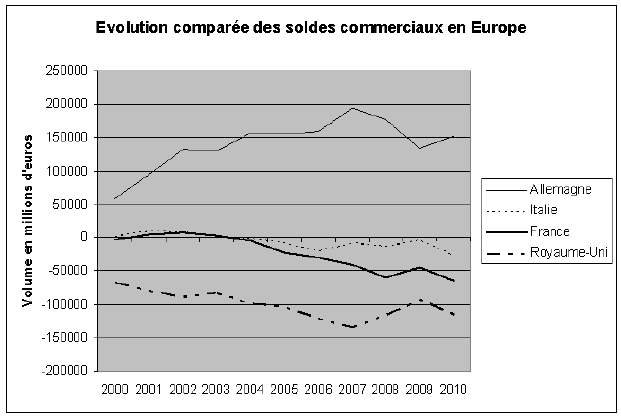
L’examen détaillé de la composition des soldes commerciaux de nos deux concurrents les plus performants, l’Allemagne et l’Italie, souligne que le principal problème français réside dans le faible dynamisme de nos exportations depuis plusieurs années. Ainsi, entre 2000 et 2008, le volume d’exportations italiennes s’est sensiblement rapproché du montant des ventes françaises à l’étranger. L’évolution depuis trois ans est parallèle.
L’Allemagne, quant à elle, a connu une véritable explosion de ses exportations entre 2000 et 2008, avec un volume passant de 600 à plus de 900 milliards d’euros. Si l’Allemagne a connu une baisse plus importante de ses exportations du fait de la crise de 2009, elle a également profité d’un rebond bien plus spectaculaire que la France ou l’Italie depuis deux ans.
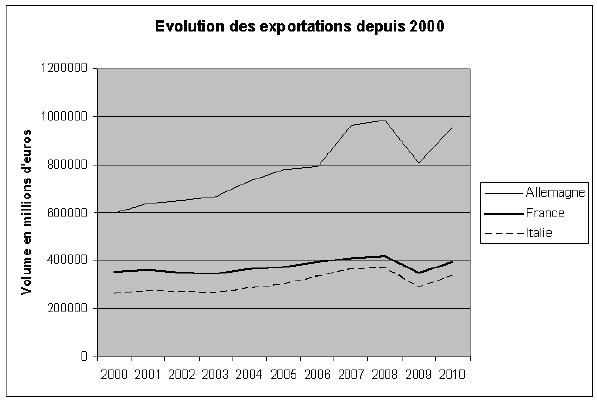
L’évolution des exportations françaises fait preuve d’un rythme plus faible que nos principaux concurrents entre 2000 et 2008. En revanche, la hausse de nos importations sur la même période est pratiquement parallèle.
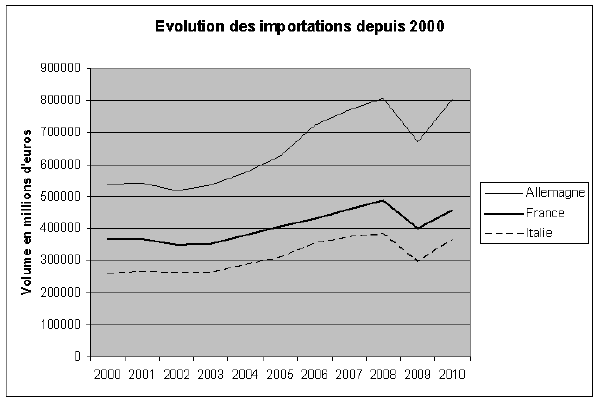
La dégradation des comptes extérieurs français en comparaison de ceux de l’Allemagne et de l’Italie est donc entièrement liée à un dynamisme plus faible de nos exportations. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les chiffres du commerce extérieur français sont inquiétants.
B – Le commerce extérieur, sujet économique fondamental
Les constats d’aggravation du déficit commercial français vis-à-vis de nos principaux partenaires n’épuisent pas la réflexion sur les résultats de notre commerce extérieur. Même si certains éléments de théorie économique soulignent que le niveau de la balance commerciale n’a pas de conséquences directes sur le bien-être de la population, il n’en reste pas moins que le niveau de nos exportations est un signe d’affaiblissement de la position française dans le monde, et doit nous alerter sur les faiblesses structurelles de notre économie.
1) Les limites de la thèse « économiciste »
D’un point de vue strictement théorique, on peut soutenir l’idée que le déficit extérieur n’est pas un problème économique. En effet, le surcroît d’importations révèle une consommation intérieure importante et en accélération, ce qui revient in fine à décrire un pays où l’investissement excède l’épargne, signes d’une économie en bonne santé.
Certains économistes soulignent ainsi l’absence de corrélation entre la contribution allemande aux exportations européennes et sa contribution à la croissance du PIB de l’Union européenne.
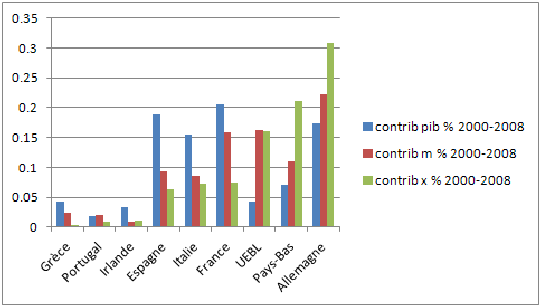
Source : CEPII-CHELEM
Alors même que l’Allemagne représente de loin la plus importante contribution aux exportations européennes entre 2000 et 2008, c’est la France qui, sur la même période, a le plus contribué à la croissance de la zone. La hiérarchie commerciale ne correspond pas à la hiérarchie économique.
Mais une meilleure appréciation de nos performances commerciales passe par une étude de l’évolution de la part de marché des produits français à l’international. Or, les chiffres montrent un recul très net de la France, notamment en comparaison avec l’Allemagne.
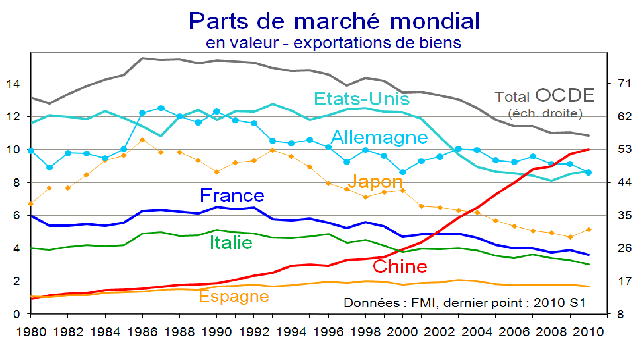
Comme le souligne le graphique ci-dessus, la part de marché mondiale française est celle qui a proportionnellement le plus régressé depuis les années 1980 parmi les pays européens, en passant de 6 à 4 %. Cette baisse de 30 % est seulement comparable à celle subie par les Etats-Unis, qui passent de 12 à 9,5 % de part de marché sur la période (soit une baisse de 20 % environ) alors que l’Italie passait de 4 à 3,5 % (-12,5 %) et l’Allemagne de 10 à 9,5 % (-5 %).
L’évolution du déficit commercial français, si elle est en partie décorrélée de l’évolution de la richesse nationale, révèle donc une régression inquiétante de notre puissance commerciale. Or, cette donnée est un élément fondamental de la croissance future de notre économie dans les prochaines années.
2) Le marché mondial, nouveau marché de référence
L’évolution internationale des échanges a montré, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, une croissance constante qui a résisté à toutes les crises sauf celle de 2009. Selon les statistiques de l’OMC, le commerce mondial a augmenté sans discontinuer entre 1945 et 2009, avec un taux de croissance annuel systématiquement supérieur à la croissance de la production. Le total des exportations dans le monde est ainsi passé de 58 à plus de 16000 milliards de dollars entre 1948 et 2008. Ce montant est repassé en dessous de 13000 milliards (12500 milliards de dollars) entre 2008 et 2009. La seule baisse enregistrée statistiquement remontait à 2001, mais elle était si limitée (de 64 à 62 milliards) qu’elle représente plutôt une année de stagnation, consécutive entre autres aux attentats du 11 septembre. Globalement, entre 1948 et 2008, le volume mondial des exportations a donc été multiplié par 300, avant de connaître une baisse près de 20 % en un an. Même l’impact de la crise financière puis économique de 2008 a été surmonté en un an. Dès 2010, le commerce mondial repartait à la hausse de manière significative : le montant des exportations mondiales en 2010 selon l’OMC était de plus de 15000 milliards de dollars, soit une hausse de 25 % en un an.
Par comparaison, le niveau du PIB mondial a été multiplié par moins de 20 sur la même période, et il a connu également une baisse entre 2008 et 2009. Chercher à développer la part française des échanges mondiaux revient donc à accroître la part des exportations, élément nettement plus dynamique que la croissance intérieure de notre Etat, dans l’ensemble de notre croissance économique. Les exportations sont la clé de notre développement économique futur.
C – Des explications traditionnelles insuffisantes
Regagner des parts de marché est donc un objectif économique essentiel, contrairement à ce que certaines doctrines économiques laissent entendre. Reste à analyser, pour mieux y répondre, les causes de la dégradation de la balance commerciale française depuis quinze ans. A ce titre, il convient de revenir sur les raisons communément avancées pour expliquer les déficits commerciaux français, afin de souligner leur faible pertinence en raison des performances nettement plus positives de nos principaux concurrents pourtant affectés par les mêmes phénomènes que sont l’augmentation tendancielle du cours de l’euro face au dollar et l’explosion de la facture énergétique de notre pays.
1) La question du taux de change
Depuis son introduction parmi les devises internationales, l’euro a fortement progressé face au dollar, passant d’une valeur de 1,1665 (valeur officielle de lancement) à plus de 1,4 dollars pour un euro entre 2009 et 2010 en moyenne.
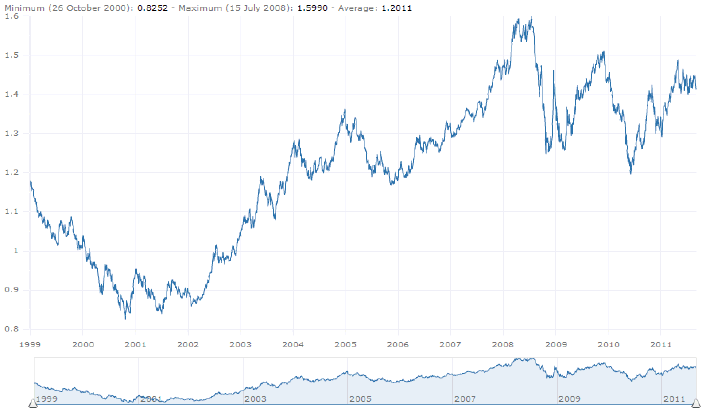
Source : Banque centrale européenne
Face au yuan chinois, l’euro a connu une évolution moins marquée en raison du caractère quasi-fixe du taux de change de cette devise. Bien qu’elles aient légèrement relevé la valeur du yuan, dans le sillage des conclusions successives du G8 depuis plusieurs années, la monnaie chinoise reste sous-évaluée selon de nombreux analystes. Elle s’échangeait à 10,7 yuans pour un euro en 2005 – première cotation du yuan recensée par la Banque de France – et à 9 yuans pour un euro en 2011 après avoir connu un niveau bas à moins de 8,5 yuans pour un euro mi-2010.
L’euro a gagné en valeur par rapport au dollar et au yuan, en raison d’un contrat moral implicite passé entre les Etats-Unis et la Chine, baptisé le « G2 » : la Chine accumule des réserves en dollars en finançant la dette américaine, cette dette servant aux Etats-Unis à financer leurs achats de produits industriels fabriqués en Chine, bien que souvent sous licence ou directement par des entreprises américaines. Cette structure des échanges commerciaux et financiers a conduit naturellement les investisseurs à utiliser l’euro comme monnaie refuge, dans la mesure où le niveau du taux de change du yuan reste fixé par la banque centrale.
Toutefois, si le niveau de l’euro reste élevé, cette explication ne peut emporter la conviction, pour au moins deux raisons majeures. D’abord, la baisse de l’euro n’a pas permis de redresser la balance commerciale française. Plus généralement, l’évolution de l’euro ne correspond pas aux évolutions du solde commercial français : alors que l’excédent record date de 1997, la baisse de l’euro continue de 1999 à 2001 n’a pas permis d’enrayer le recul de notre solde positif. De même, les baisses de l’euro vis-à-vis du dollar entre 2005 et 2006 et 2008 et 2009 n’ont pas empêché nos déficits commerciaux de se creuser.
Surtout, nos principaux concurrents restent l’Allemagne et, dans une moindre mesure, l’Italie. Or, tous deux se trouvent dans la zone euro et ont obtenu des résultats commerciaux significativement meilleurs que ceux de la France.
2) Le problème du coût de l’énergie
L’autre raison pour laquelle la France connaît régulièrement un déficit extérieur est, bien entendu, sa dépendance énergétique envers les fournisseurs extérieurs, notamment en matière d’hydrocarbures. Le niveau des déficits extérieurs est en effet largement dû à la croissance de la facture énergétique.
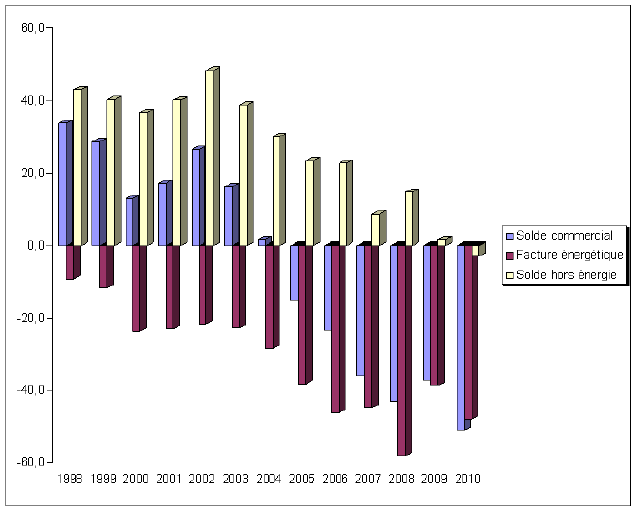
La facture énergétique de la France (solde des importations et des exportations de produits énergétiques, notamment les produits hydrocarbures) s’est considérablement alourdie depuis 12 ans, passant de 10 à 40 milliards d’euros, avec un pic à -60 milliards d’euros en 2008. Cette évolution est indissociable de celle de notre solde commercial général : celui-ci connaît ses pires années parallèlement à l’alourdissement du prix de l’énergie, dont la principale variable reste le prix du pétrole.
Toutefois, là encore, deux contre-arguments limitent la portée explicative de ce phénomène. D’abord, les évolutions du solde hors énergie sont presque systématiquement identiques en proportion avec l’évolution du solde général, les deux se dégradant notamment à partir de 2002/2003, après une baisse entre 1999 et 2001 suivie d’une remontée. Ainsi, la performance commerciale française reste négative même si l’on exclut le poids des produits pétroliers dans nos importations.
Surtout, la situation de l’Allemagne et de l’Italie en matière de dépendance énergétique est comparable, voire plus difficile que la nôtre, en l’absence d’une diversité de fournisseurs sur lesquels la France peut compter, et de choix énergétiques, notamment une part très limitée de l’électronucléaire, les contraignant à utiliser plus de gaz naturel ou de charbon. Ainsi, selon Eurostat, l’Italie se classait au cinquième rang européen en matière de dépendance énergétique, l’Allemagne au 13ème, la France occupant le 19ème rang. La facture énergétique italienne en 2010 était de 52 milliards d’euros, contre 46 pour la France. Les importations allemandes de gaz naturel et de pétrole brut en 2010 avoisinaient, pour leur part, les 63 milliards d’euros.
Les faiblesses du commerce extérieur français ne se résument donc pas au niveau de l’euro ou au montant de la facture énergétique. Il est même intéressant de noter que la Grande-Bretagne, dont la dépendance en hydrocarbures est moindre et qui ne participe pas à la zone euro, est l’une des rares puissances industrielles européennes dont la situation commerciale se soit dégradée dans les mêmes termes que la nôtre. Les raisons de la dégradation continue de nos résultats commerciaux sont à chercher dans des phénomènes plus structurels.
II – LES RAISONS D’UNE FAIBLESSE STRUCTURELLE
Les évolutions des exportations françaises et de notre part de marché internationale, notamment comparées à celles de l’Allemagne, sont les meilleurs indicateurs pour apprécier les difficultés de notre commerce extérieur. Celui-ci ne doit pas être vu comme une simple grandeur comptable : il est le résultat de la compétitivité d’ensemble de notre économie, et procède donc autant de choix stratégiques que de l’héritage historique et de la situation conjoncturelle. C’est donc sur les problèmes de fond qu’il convient de s’attarder afin de proposer des solutions d’ensemble pour notre économie, qui passe, à l’avenir, par un nécessaire développement international.
A – La spécialisation géographique et sectorielle
Bien qu’elle soit assez comparable à celle de nos principaux concurrents, Allemagne et Italie en tête, la structure des exportations françaises, tant en matière de produits exportés que de marchés de destination, souffre d’une trop grande concentration sur certains secteurs et des zones géographiques insuffisamment porteurs. Ainsi, les produits agroalimentaires ne génèrent plus les mêmes excédents qu’auparavant, en raison notamment d’une mauvaise organisation de la filière. De la même manière, la France n’est pas assez présente sur les marchés les plus porteurs, ses exportations restant trop concentrées sur l’Europe.
1) Des secteurs performants aujourd’hui menacés
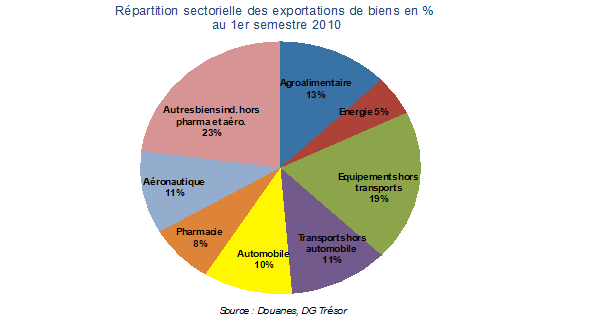
La France offre un profil d’exportations diversifié. Quatre secteurs représentent plus de 40 % des exportations de notre pays : l’agroalimentaire, l’aéronautique, l’automobile et la pharmacie.
L’examen des soldes pour l’ensemble des secteurs de spécialisation français révèle toutefois une autre hiérarchie. En effet, les produits massivement exportés par la France ne sont pas nécessairement ceux qui génèrent l’excédent commercial le plus important.
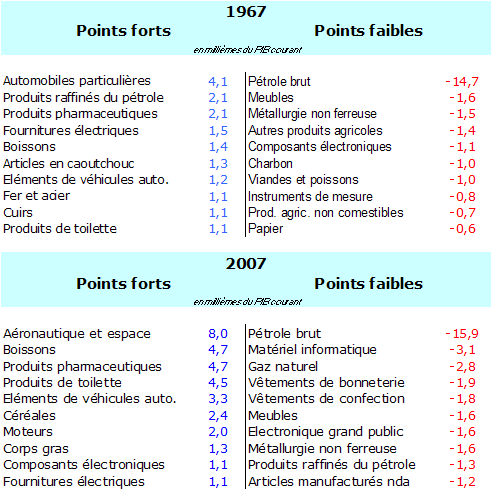
Source : CEPII, bases de données CHELEM-commerce international, CHELEM-PIB et CHELEM-balance des paiements.
Afin d’apprécier l’évolution des spécialisations sectorielles françaises, il est utile de les comparer à celles de l’Allemagne. L’Allemagne connaît une spécialisation industrielle plus marquée de sa balance commerciale, portée principalement par le secteur automobile et les biens d’équipement. Ainsi, l’une des défaillances françaises est liée à la disparition de l’excédent commercial lié au secteur automobile, qui représentait 0,04 % du PIB en 1967, et est légèrement déficitaire aujourd’hui. A l’inverse, l’excédent commercial allemand en matière automobile est passé de 0,09 à 1,9 %.
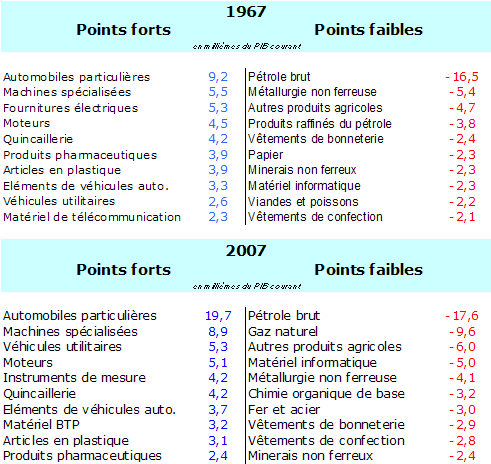
Source : CEPII, bases de données CHELEM-commerce international, CHELEM-PIB et CHELEM-balance des paiements.
Plusieurs raisons peuvent être invoquées pour expliquer cette différence. D’abord, des choix d’implantation d’activités différents entre les deux pays : tous les grands constructeurs automobiles ont délocalisé leur production dans les pays à plus faible coût de main d’œuvre, mais les constructeurs allemands ont choisi de préserver des activités à haute valeur ajoutée, notamment la fabrication de moteurs et l’assemblage final de modèles haut de gamme, sur le territoire national. Cette répartition a été permise notamment par l’évolution favorable du coût du travail en Allemagne, sur laquelle nous reviendrons en détail, qui a diminué depuis vingt ans contrairement au reste des pays européens.
Enfin, l’industrie automobile allemande s’est spécialisée dans les modèles de haut de gamme, soutenue par un marché intérieur supérieur de 50 % environ à notre marché national, selon les industriels français. Or, cette niche cumule deux avantages. En premier lieu, elle est très porteuse dans les marchés en croissance, notamment les grands émergents comme la Chine, l’Inde, le Brésil ou la Russie. En second lieu, les modèles ainsi commercialisés font l’objet d’une compétition moindre de la part des nouveaux constructeurs situés dans ces mêmes pays émergents, dans la mesure où certaines technologies de pointe ne sont pas encore universelles.
L’autre domaine de réussite des exportations allemandes est, historiquement, celui des biens d’équipement. Là encore, l’Allemagne bénéficie d’un secteur en croissance rapide du fait de l’accélération et de l’élévation en qualité de l’équipement des puissances émergentes. Celles-ci sont en effet engagées dans une compétition féroce pour gagner des parts de marché dans le domaine des biens de consommation, et cherchent donc à s’équiper des éléments les plus performants pour améliorer leur productivité.
Ainsi, l’Allemagne bénéficie, dans deux secteurs importants, d’une conjoncture très favorable pour le développement de ses exportations, et enregistre donc des soldes positifs réguliers. Par comparaison, les points forts commerciaux français à l’exportation n’ont pas forcément des perspectives de croissance aussi favorables. L’aéronautique révèle un cas particulier, dans la mesure où le secteur dépend majoritairement d’une entreprise, Airbus. Or, l’enregistrement des exportations d’Airbus dépend largement de l’organisation de la chaîne de production de l’entreprise, éclatée entre plusieurs sites en Europe.
En-dehors du cas particulier d’Airbus, la France est spécialisée dans certains produits chimiques, notamment la pharmacie, et les produits agro-alimentaires. La première catégorie enregistre régulièrement des excédents, et ne semble pas devoir faire face à une régression de sa part de marché, malgré des difficultés d’accès à certains marchés qui seront développées en détail et frappent d’autres produits français et européens.
En revanche, pour les produits alimentaires, l’excédent français connaît une diminution d’autant plus flagrante qu’elle intervient dans le secteur considéré spontanément comme le point le plus fort de nos exportations. Ainsi, en 2010, selon les chiffres des producteurs français, le solde commercial des produits agroalimentaires était déficitaire hors vins et spiritueux. L’Allemagne a ainsi enregistré un excédent agro-alimentaire supérieur à celui de la France en 2010.
Les raisons invoquées pour expliquer cette perte de terrain en matière agroalimentaire sont de deux ordres. D’abord, l’amélioration de la compétitivité coût de nos principaux concurrents, notamment l’Allemagne, qui utilise une dérogation au droit européen permettant de faire travailler des saisonniers au salaire de leur Etat d’origine.
Par ailleurs, la filière agroalimentaire est organisée différemment en France et en Allemagne. Chez nos concurrents, les exploitations sont moins nombreuses, donc plus grandes et bénéficiant d’économies d’échelle. De plus, les autorités allemandes ont fait preuve d’une plus grande réactivité que leurs homologues françaises en matière de répartition des aides agricoles, et ont notamment permis un redressement significatif de la production de fruits et légumes. Enfin, certains produits comme la confiserie ne font pas l’objet d’une organisation adaptée, pour des raisons historiques, ce qui nuit à leur force de frappe commerciale.
Ainsi, les spécialisations sectorielles traditionnelles françaises ont perdu du terrain depuis plusieurs décennies, au premier rang desquelles l’automobile. Par ailleurs, les secteurs dans lesquels les soldes commerciaux français étaient le plus élevés tendent à décroître, à l’exception de la pharmacie. A l’inverse, les entreprises allemandes spécialisées dans les automobiles de luxe et les biens d’équipement profitent de marchés en pleine croissance et enregistrent des excédents réguliers.
La réduction des avantages comparatifs français n’est pas une fatalité. Ainsi, l’une des spécificités de notre commerce extérieur, quoique difficile à retracer statistiquement, concerne les produits de luxe. Dans ce domaine, les marques françaises ont établi une image qui leur permet de se tailler d’importantes parts du marché mondial. Bien que l’on retrouve difficilement ces produits dans les chiffres de notre commerce extérieur, deux sous-secteurs peuvent toutefois donner une idée des performances françaises dans ces domaines : les vins et spiritueux, dont l’excédent commercial en 2010 était de 7 milliards d’euros, et les cosmétiques. Ces secteurs cumulent de nombreux avantages : filières très intégrées, produits de haut de gamme, importante compétitivité hors coût des produits français du fait de l’image très positive dont la marque France bénéfice.
Ces produits peuvent également compter sur le développement de marchés à l’exportation en forte croissance, notamment en Asie et en Amérique Latine. A l’inverse, les spécialisations « lourdes » de notre industrie sont trop souvent concentrées sur des marchés relativement atones, notamment l’Europe de l’Ouest et l’Amérique du Nord.
2) Une spécialisation géographique moins porteuse
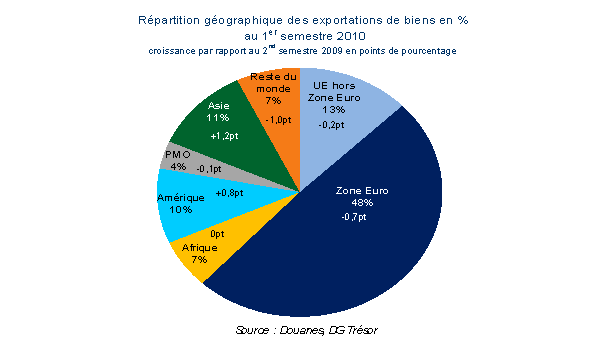
La France connaît, comme l’ensemble de ses compétiteurs européens, une inclinaison particulière envers l’Union européenne et l’Amérique du Nord. Les autres marchés vers lesquels notre commerce extérieur est le plus orienté sont situés en Afrique et au Moyen-Orient, dont la part dans notre commerce est plus importante que la part dans le commerce mondial.
Comparativement, ces orientations souffrent de deux inconvénients. D’abord, la part de nos exportations vendues en Europe est plus importante que l’Italie. Alors que plus de 60 % de nos exportations sont vendues en Europe, l’Italie connaît une répartition plus équilibrée de ses exportations, environ 55 % de ses ventes à l’étranger seulement étant destinées aux pays membres de l’Union européenne.
En second lieu, notre pays reste faiblement implanté dans les zones connaissant le plus de croissance, notamment les puissances émergentes dites BRIC – Brésil, Russie, Inde, Chine. Ainsi, en prenant l’exemple de la seule Chine, celle-ci représentait près de 4,5 % des exportations allemandes en 2009 contre 2,2 % des exportations françaises. Entre 2000 et 2009, le taux moyen d’augmentation des ventes allemandes vers la Chine a été de 16,5 %, contre 13 % pour la France.
S’il n’est pas question d’abandonner l’Afrique, zone d’influence traditionnelle et futur continent de la croissance économique – comme le montrent plusieurs exemples nationaux – il convient de s’interroger sur la difficulté pour nos entreprises d’accéder aux marchés indien, chinois ou brésilien. Nos concurrents, surtout allemands, connaissent les mêmes difficultés, mais leur spécialisation dans des produits qui n’existent pas sur ces marchés leur garantit une position relativement plus dominante que les entreprises françaises.
B – La question de la compétitivité
L’analyse sectorielle révèle à plusieurs reprises – automobile, agroalimentaire – une perte de compétitivité prix des exportations françaises notamment par rapport aux produits allemands. Cette évolution est confirmée par les études portant spécifiquement sur la compétitivité, et contribue pour une grande part à la faiblesse de notre commerce extérieur. Principalement due aux effets de la réduction du temps de travail légal décidée en 1998, la hausse du coût du travail en France a fait disparaître l’avantage traditionnel des produits français, considérés comme fiables et moins chers que les produits allemands. Les entreprises françaises se trouvent désormais contraintes de vendre au même prix que leurs concurrentes allemandes des produits qui ne bénéficient pas de l’image de marque « made in Germany ».
1) L’évolution défavorable de la compétitivité prix française
La compétitivité d’un produit intègre plusieurs éléments, que l’on peut regrouper entre différences de prix et éléments hors prix (qualité, réputation, etc.). Bien qu’elle soit difficile à mesurer, la compétitivité hors prix des produits français ne saurait avoir régressé au point qu’elle expliquerait l’aggravation que connaît notre déficit extérieur depuis dix ans.
En revanche, la compétitivité prix des produits français a subi des chocs importants, notamment liés aux réformes du temps de travail des années 1998 et 2000. La compétitivité prix française connaît ainsi une stagnation puis une baisse à partir de 2000.
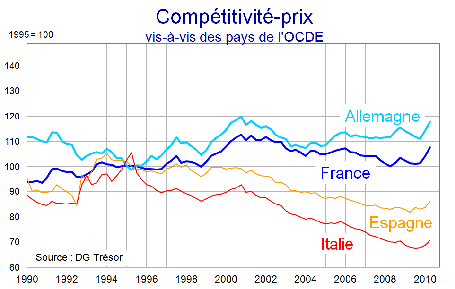
La compétitivité prix elle-même est constituée de deux éléments : le coût de fabrication des produits, et la marge prélevée par les distributeurs. L’évolution de la compétitivité coût française laisse apparaître de manière encore plus éclatante la défaillance française à partir de l’année 2000.
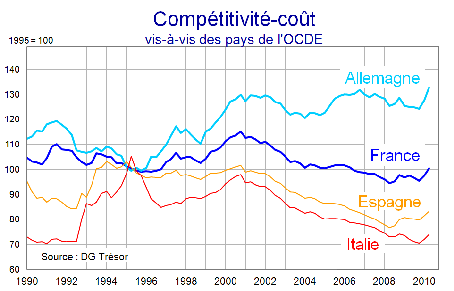
On constate aisément que les produits allemands ont profité d’une évolution favorable de la compétitivité coût pratiquement ininterrompue depuis 1994, alors que la France souffre d’une évolution contraire depuis 2000, malgré une stabilisation depuis 2008.
L’évolution du coût horaire français, comparée à celui des productions allemandes, éclaire l’analyse. Selon l’étude réalisée par le centre d’observation économique et de recherches pour l’expansion de l’économie et le développement des entreprises (COE-REXECODE) pour le ministère des finances en 2010, le coût horaire du travail en France a augmenté de 10 % de plus qu’en Allemagne entre 2000 et 2004. Des incertitudes statistiques planent sur la période 2004-2008, mais celle-ci n’a en tout cas pas permis de compenser cette évolution. Dans l’industrie manufacturière, cœur de l’appareil exportateur, les différences sont encore plus sensibles : le coût horaire du travail a augmenté de 8,1 % en Allemagne entre 2000 et 2004 contre 21,9 % en France.
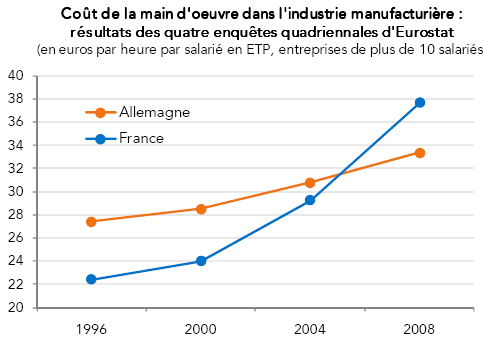
Depuis 2000, la France a perdu ce qui faisait son atout auparavant, à savoir une compétitivité coût supérieure à l’Allemagne, permettant de vendre moins chers des produits comparables mais ne bénéficiant pas de l’effet de réputation du « made in Germany ». Ainsi, alors que le coût horaire moyen en France en 2000 dans l’industrie manufacturière était de 24,01 euros contre 28,48 euros en Allemagne, soit 15,7 % de plus qu’en France, les chiffres en 2008 s’établissaient ainsi : 37,41 euros en France contre 33,37 euros en Allemagne, soit 10,8 % supplémentaires en France.
Une contrainte supplémentaire majeure est ainsi apparue au début des années 2000 pour les entreprises françaises : celles-ci ont perdu l’avantage comparatif que le coût du travail leur conférait par rapport à leurs homologues allemandes, sans pour autant que l’évolution des produits français exportés ne puissent compenser cette différence de compétitivité hors prix. Malgré des efforts de marge importants, retracés dans le graphique ci-dessous, nos entreprises ont vu leurs parts de marché se réduire inexorablement, d’autant plus qu’elles sont très souvent en compétition directe avec des entreprises allemandes (sur 79 % de leurs marchés en 2004, contre un chiffre de 66 % pour les entreprises chinoises et américaines).
2) Le poids du financement de la protection sociale
L’analyse des composantes de l’évolution de la compétitivité coût française fait apparaître clairement le rôle du financement de la protection sociale. Ainsi, comparés aux salariés allemands, les salariés français perçoivent un salaire égal et sont plus productifs par heure ouvrée. Toutefois, le coût du travail, en France, est grevé par des cotisations sociales plus importantes.
Selon l’étude COE Rexecode précitée, le coût horaire du travail dans l’industrie manufacturière était composé, en 2008, à 58,2 % par la rémunération directe et les primes en France, contre 64,9 % en Allemagne. Si l’on applique ces chiffres au coût moyen observé à cette date, le salaire direct perçu par les salariés français était de 21,7 euros par heure, contre 21,65 euros en Allemagne. La différence dans les coûts horaires de travail n’est donc pas à chercher dans la rémunération perçue par les salariés, mais bien dans l’évolution des charges sociales.
Les charges sociales patronales représentent, en 2008, 29,9 % du coût horaire du travail en France contre 22,7 % en Allemagne. Les cotisations salariales représentent une part plus importante en Allemagne (12 % contre 8,8 % en France) mais la différence ne compense pas. En moyenne, dans l’industrie manufacturière française, une heure de travail génère 14,2 euros de charges sociales (dont 11,3 de charges patronales) contre 11,3 euros de charges en Allemagne (dont 7,7 euros de charges patronales).
Cette explication est confirmée par l’évolution de la productivité des salariés français. Traditionnellement supérieure à celle des salariés allemands, malgré un temps de travail annuel plus important des salariés français, la hausse de la productivité française entre 2000 et 2004 est parallèle à celle de la productivité des salariés allemands. Le rapprochement puis le dépassement du coût du travail dans l’industrie française par rapport à ses concurrents allemands ne s’explique donc pas par une augmentation de la productivité individuelle, ni par une augmentation massive du temps de travail par salarié, mais bien par une évolution négative des charges sociales, dont la part dans le coût du travail total est supérieure en France par rapport à l’Allemagne.
Afin de rétablir la compétitivité des produits français, il est urgent de revenir à un niveau de coût du travail inférieur à celui de l’industrie allemande. Cette évolution passe par une réduction des charges sociales, et amène donc à réfléchir sur le mode de financement de la protection sociale en France. Cette piste de réflexion sera abordée en détail plus avant.
3) La défense de la compétitivité hors prix
En plus du coût du travail et de ses conséquences sur la compétitivité prix des exportations françaises, la comparaison avec l’Allemagne permet de soulever la question du positionnement des exportations françaises sur les marchés extérieurs. En effet, même si la reconquête d’une compétitivité coût favorable est un objectif important, la compétitivité de nos produits doit également provenir de leur qualité et de leur niveau technologique.
Or, entre 1993 et 2008, les dépenses en recherche-développement ont eu tendance à décroître en France, de 2,4 % à 2 % du PIB, alors qu’elles augmentaient fortement en Allemagne, passant de 2,3 % à 2,6 % du PIB. Les dépenses publiques de recherche développement françaises sont comparables à celles de l’Allemagne, inférieures de seulement 5,5 milliards d’euros en 2008.
En revanche, les dépenses privées de recherche développement, malgré l’existence de dispositifs fiscaux très favorables et enviés par nos partenaires notamment le crédit impôt recherche, restent inférieures en France, et ont même diminué par rapport à l’Allemagne : alors que les dépenses privées de recherche développement représentaient 1,47 % du PIB en France en 1993, elles ne représentaient plus que 1,27 % du PIB en 2008, contre une hausse de 1,53 % à 1,84 % en Allemagne.
Ainsi, la compétitivité hors coût de nos produits est tendanciellement tirée vers le bas, par rapport aux exportations allemandes qui bénéficient d’un volume plus important d’investissements dans l’innovation et la recherche de la part des entreprises.
C – Un constat majeur : le faible nombre d’exportateurs français
La compétitivité française explique sans doute une large part de la dégradation continue de notre solde commercial depuis 15 ans. Toutefois, des obstacles plus structurels persistent et nuisent encore à notre force de frappe commerciale. D’abord, seules les grands groupes français réussissent à s’implanter durablement hors de nos frontières, et à gagner des parts de marché. Les PME échouent trop souvent, et renoncent rapidement à leur développement à l’international. En conséquence, la France dispose d’un nombre d’exportateurs très limité par rapport à ses concurrents européennes, Allemagne ou Italie. Ce constat soulève nécessairement la question de la croissance des PME françaises, qui sera explorée plus avant.
1) Une performance limitée des PME indépendantes
Les grands groupes français sont, comparativement aux grands groupes allemands ou italiens, tout à fait performants. La France occupe une place très honorable dans le classement des leaders mondiaux, et ses plus grandes entreprises bénéficient d’une avance technologique et d’un savoir-faire commercial qui leur garantissent une position forte sur les marchés extérieurs.
Ainsi, la répartition des exportations en France est très comparable à celle de nos principaux concurrents : la grande majorité des exportations est réalisée par les grands groupes. Que ce soit en France, en Allemagne ou en Italie, les entreprises de moins de 50 salariés représentent environ 2/3 du nombre des exportateurs, et moins du tiers des exportations réalisés.
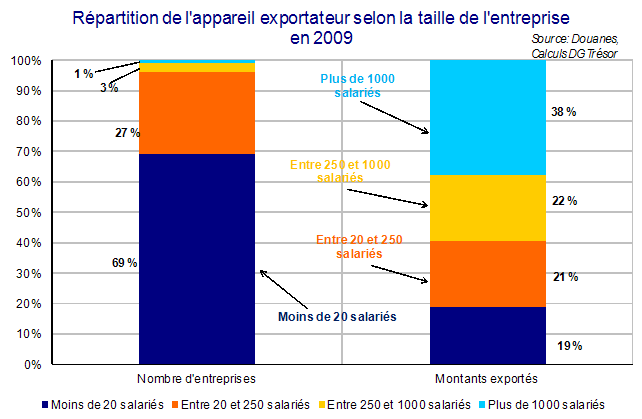
En revanche, la France se distingue par un taux très élevé d’abandon du développement à l’international. Ainsi, sur 100 entreprises qui exportaient pour la première fois en 2000, 70 % avaient abandonné au bout d’un an, et 92 % n’étaient plus présentes à l’export en 2009.
L’analyse plus précise des primo-exportateurs révèle un point majeur : la grande majorité des primo-exportateurs qui abandonnent leur projet de développement à l’international est constituée par des PME indépendantes, soulignant une difficulté structurelle des petites entreprises françaises. L’importance de la proportion d’entreprises ayant renoncé à un projet d’exportation est un phénomène très spécifique à la France.
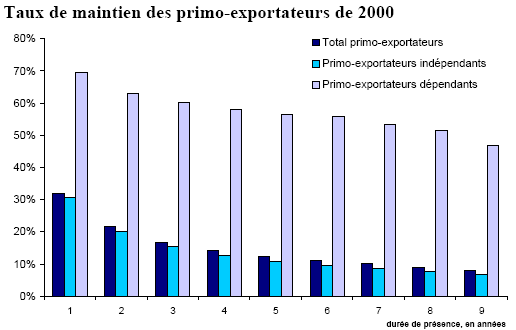
Source : Douanes
La faible propension des PME françaises à exporter, et leur taux d’abandon très important sauf lorsqu’elles sont liées à un grand groupe, a pour conséquence un nombre trop faible d’entreprises françaises tournées vers l’international.
2) Trop peu d’entreprises à l’export
Les chiffres du taux d’abandon par les entreprises françaises de leur stratégie de développement international tendent à montrer que les entreprises françaises considèrent trop souvent l’export comme une opportunité commerciale unique, et pas comme une stratégie de développement. Dès lors, la France souffre considérablement de l’absence de ses PME à l’international. Les chiffres comparés, avec tous nos voisins – Allemagne, Italie, Espagne – font ressortir ce constat : les entreprises françaises ne sont pas assez nombreuses à exporter.
Allemagne* |
Italie |
Espagne |
France | |
Nombre d’exportateurs |
364 000 |
184 000 |
101 000 |
95 300 |
Données 2008 sauf Allemagne (2007) / /* : méthodologie différente de celle des Douanes
La question du nombre d’exportateurs français reste d’actualité : malgré une légère hausse entre 2009 et 2010, leur nombre reste inférieur à 100 000, alors qu’il continue à progresser en Allemagne et en Espagne.
Plus inquiétant, la baisse du nombre d’exportateurs depuis quinze ans est de plus en plus souvent due à la diminution du nombre de primo-exportants, qui représentent désormais moins de 20 % du nombre total d’exportateurs contre près d’un quart en 2000.
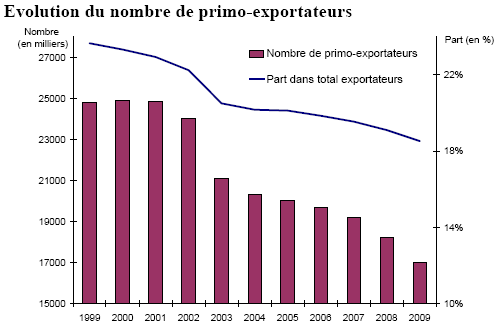
L’appétence des entreprises françaises à exporter est donc comparativement moindre que leurs concurrentes directes, et tend à se réduire depuis 15 ans. Deux séries de raisons sont couramment avancées pour justifier cette évolution : la culture commerciale de nos principaux concurrents, et la difficulté pour les PME françaises d’atteindre la taille critique nécessaire pour exporter.
3) Des explications culturelles fréquemment invoquées
Le déséquilibre entre les faibles performances des PME françaises à l’international et la présence de plusieurs groupes français parmi les leaders mondiaux de certaines branches d’activité est parfois attribué à une culture entrepreneuriale française différente de l’Italie et de l’Allemagne, pays décentralisés et spontanément tournés vers l’export.
a) Héritage du centralisme : grands groupes contre « Mittelstand »
Une certaine tradition française du développement de grandes entreprises nationales centralisées, que certains font remonter au colbertisme, a longtemps orienté les choix industriels de notre pays. Le développement de groupes de taille mondiale, véritables champions nationaux dans leurs branches d’activité, a permis aux technologies françaises de s’imposer comme la référence dans des secteurs variés. Toutefois, nos concurrents directs, Allemagne et Italie notamment, ont connu un développement industriel très différent.
La force industrielle allemande repose, bien que cela soit souvent passé sous silence, dans certains secteurs traditionnels – notamment la chimie, l’automobile, l’industrie lourde – sur des groupes de dimension internationale issus d’une tradition de soutien par les autorités régionales et les banques locales des grandes industries. L’attachement très fort de certaines marques à des villes particulières, comme Stuttgart pour Mercedes ou BMW à Munich, témoigne de cette histoire.
Toutefois, dans les secteurs les plus dynamiques, qu’il s’agisse des machines-outils ou de l’électronique de pointe, ce sont les grandes PME allemandes qui fournissent le plus grand contingent d’exportations et d’investissements innovants. Ces sociétés, qui correspondent plutôt à la catégorie française des entreprises de taille intermédiaire (ETI, entre 250 et 5000 salariés, moins d’1,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires), forment le « Mittelstand », littéralement : le secteur médian, entre les grands groupes internationaux et l’artisanat.
Le Mittelstand se caractérise par plusieurs éléments qui font son succès à l’international : un soutien traditionnel des banques locales et de la banque publique KfW, des liens très étroits avec les organismes de formation régionaux, certaines entreprises disposant pratiquement « d’universités maison », des relations sociales généralement constructives, le recours à la grève étant très peu fréquent par les syndicats allemands, de même que les licenciements pour motif économique, le patronat allemand local privilégiant souvent la mise au chômage technique partiel.
Ce soutien de l’ensemble des acteurs économiques vers les PME leur assure un développement autonome, alors que les entreprises françaises font souvent l’objet de rachat par des groupes, empêchant les plus petites sociétés de développer un réseau commercial propre à l’international.
Ce déséquilibre entre les entreprises françaises est également perceptible, hors cas de rachat ou fusion, s’agissant des relations entre fournisseur ou sous-traitant, et grand groupe. A l’inverse des entreprises allemandes, qui nouent de véritables partenariats avec leurs fournisseurs, les grands groupes français se comportent en acheteur très rationnels au risque, parfois, de porter atteinte au tissu industriel local.
Le modèle italien est un peu différent du modèle allemand, mais permet de développer de véritables consortiums d’exportation, aux contours fluctuants. Fondé sur des entreprises de plus petites tailles, il a conduit à un regroupement sur une base très locale d’industries similaires. Désormais connus sous le terme de « districts industriels », dotés d’une organisation représentative au niveau national, ces réseaux d’entreprises, issus d’un terroir commun, remportent des succès notables à l’extérieur en privilégiant une approche groupée, les succès d’une petite entreprise de Vénétie, par exemple, permettant d’attirer de nombreuses autres sociétés voisines qui vendent ainsi leur savoir-faire.
Les PME françaises souffrent donc d’un double désavantage : plus petites et moins bien financées que leurs concurrentes allemandes, elles ne bénéficient pas d’une tradition de coopération commerciale forte à l’international, contrairement à leurs homologues italiennes. Par ailleurs, les entrepreneurs français semblent culturellement moins enclins que leurs concurrents à aller chercher des marchés à l’extérieur de leurs frontières.
b) Un rapport incertain avec l’international
Dans l’ensemble, les chefs d’entreprises français donnent l’impression de manquer d’appétence pour l’export. La comparaison avec l’Allemagne est révélatrice : alors que 5 % environ (selon la méthodologie retenue) des entreprises enregistrées en France exportaient en 2007, 11 % des entreprises allemandes disposaient de relations commerciales internationales en 2005.
Plusieurs éléments fréquemment invoqués tendent à souligner le caractère culturel de cette faiblesse. Ainsi, le faible niveau linguistique des chefs d’entreprise français est souvent considéré comme un indice de leur absence de volonté de se développer à l’international, où règne l’anglais, langue des affaires.
La réaction de certaines entreprises françaises à la crise de 2009 a ainsi été également diamétralement différente de celle des PME allemandes. Alors que les exportations allemandes, après avoir connu une baisse de -18 %, repartaient à la hausse de manière significative (+20 %), révélant un sursaut global de toutes les entreprises, plusieurs PME françaises ont vu dans la crise un justification pour abandonner leur implantation à l’international. Les chiffres globaux des exportations françaises entre 2008 et 2010 reflètent également une baisse notable (-18 % entre 2008 et 2009), suivie d’une hausse de 9%, mais la reprise est nettement plus lente qu’en Allemagne et, significativement, les comportements d’abandon de projets d’exportation ne sont pas observés outre-Rhin.
L’importance du rôle joué par la volonté des entrepreneurs d’exporter leurs produits dans la décision d’exporter est significative. L’héritage historique joue alors un rôle majeur. En Allemagne ou en Italie, les villes ouvertes au commerce international, notamment hanséatiques, continuent de concentrer une part importante des exportations. Par ailleurs, une part importante des exportations allemandes est destinée aux pays voisins, dans la zone traditionnelle d’influence de l’industrie allemande, notamment les nouveaux Etats membres de l’Union européenne. A cet égard, il est parfois même fait mention du « grand marché intérieur allemand » concernant les pays frontaliers, jusqu’à la Russie.
En Italie, le rôle joué par la diaspora est significatif. L’importance des exportations vers les Etats-Unis en témoignent. De la même manière, les anciennes cités commerçantes restent le pivot de certaines industries exportatrices.
La carte régionale des exportations françaises montre également la concentration des exportations dans les régions frontalières ou maritimes. Le recours à l’exportation comme moyen de développer son entreprise est donc également un héritage de l’histoire. Or, sur ce point, de nombreuses PME françaises apparaissent en retrait par rapport à leurs principales concurrentes.

4) Les entreprises françaises ont-elles peur de grandir ?
Les facteurs culturels jouent un rôle non négligeable, mais il ne faut pas les surestimer. En effet, beaucoup d’entreprises françaises se retirent de l’export car elles n’ont pas la surface financière pour y réussir sur le long terme. La conquête de marchés à l’international est un projet de long terme : les premières années sont fréquemment déficitaires, il faut donc, pour les entreprises, être dotées de ressources suffisantes pour assumer ces pertes initiales.
Cette situation soulève donc d’autres interrogations qui concernent la taille des entreprises françaises. En moyenne, les PME françaises sont plus petites que les allemandes, et financièrement moins solides. L’enquête COE REXECODE précitée souligne ce point, et en fait l’une des principales faiblesses des entreprises françaises par rapport à leurs concurrentes allemandes.
La France manque globalement d’entreprises de taille intermédiaire, entre 250 et 5000 salariés : environ 4700 en 2011, soit deux à trois fois moins qu’en Allemagne ou en Grande-Bretagne.
Les deux obstacles les plus fréquemment invoqués pour expliquer la croissance plus lente et plus limitée des entreprises françaises sont la fiscalité du patrimoine et les effets de seuil de la réglementation sociale. Si la première difficulté est en passe d’être résolue, la deuxième demeure.
a) La fiscalité et ses conséquences sur la taille des PME
L’enquête COE REXECODE, déjà citée, avance, parmi les douze explications de la différence de compétitivité entre les entreprises françaises et allemandes, la plus grande continuité dans la propriété des entreprises familiales outre-Rhin. Diverses dispositions fiscales, notamment l’impôt de solidarité sur la fortune et les droits de succession, ont rendu cette détention par une famille plus difficile en France jusqu’à récemment.
Ainsi, les dispositions traditionnelles exonérant d’ISF les biens professionnels restreignaient la possibilité d’une telle exonération aux seuls personnes exerçant une activité de direction dans l’entreprise, et possédant au moins 25 % des parts et/ou des droits de vote de la société (dans le cas d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés), sauf si les parts représentent plus de 50 % de leur patrimoine. Une telle situation posait deux difficultés majeures.
D’abord, en cas de décès du dirigeant, aucune disposition ne venait protéger les héritiers, sommés alors de régler à la fois les droits de succession sur les parts et l’ISF une fois les parts intégrés à leur patrimoine. De plus, les dirigeants d’entreprises ayant choisi de vendre leurs parts pour prendre leur retraite étaient immédiatement soumis à l’ISF sur l’intégralité du produit de la vente.
Ensuite, les héritiers ne travaillant pas au sein de l’entreprise se voyaient taxés annuellement sur la base des parts détenues, alors même qu’ils ne tiraient pas de revenus de la société hors dividendes. Cette situation a vraisemblablement conduit à de nombreuses ventes de PME françaises à des capitaux étrangers.
Ces dispositions ont changé considérablement en 2003. La loi sur l’initiative économique du 21 juillet 2003 dite « loi Dutreil I » a permis une avancée importante, sur deux points. Ainsi, les plus-values réalisées lors de la cession de parts ont été exonérées d’impôts, sous réserve que l’activité ait été exercée pendant au moins 5 ans, et sans condition en cas de départ à la retraite d’un dirigeant.
Concernant l’héritage, la principale avancée a été l’exonération de droits de mutation des parts de société, portée par la loi en faveur des PME du 2 août 2005 (dite loi « Dutreil II ») à 75 % de la valeur des titres ou parts de capital sous réserve de la conclusion, par les héritiers, d’un pacte d’actionnaires les engageant à conserver collectivement ces titres pendant au moins deux ans.
Ce dispositif, prévu par la loi Dutreil I, peut être utilisé par les héritiers familiaux d’une entreprise n’y exerçant pas d’activité. En effet, n’étant pas bénéficiaire de l’exonération de l’impôt de solidarité sur la fortune concernant les biens professionnels, ces derniers peuvent toutefois bénéficier d’une exonération d’ISF de 75 % de la valeur de leurs titres, sous réserve d’un engagement individuel à conserver ces titres pendant au moins 4 ans à l’issue du pacte initial.
Ainsi, plusieurs obstacles à la croissance liés à la fiscalité individuelle des chefs d’entreprises français semblent aujourd’hui levés. D’autres difficultés restent patentes, notamment en matière d’investissements dans les PME. En effet, la difficulté pour les PME françaises de trouver des capitaux est fréquemment mentionnée parmi les raisons de leur plus faible taille, et donc de leur difficulté à réussir à l’export. Les PME allemandes ont ainsi une taille moyenne et une solidité financière supérieures à celles des PME françaises. Ces avantages sont en partie la conséquence de particularités du système financier allemand, qui repose beaucoup plus qu’en France sur l’existence de banques régionales très attachées au soutien des PME locales.
Pour aider à mieux mobiliser l’épargne en faveur des PME, la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat du 21 août 2007 dite loi « TEPA » avait prévu de réduire l’ISF à hauteur de 75 % des investissements réalisés dans une PME, dans la limite de 50 000 euros. Ce taux a été abaissé à 50 % en 2011. Cependant, quels que soient les mérites de cette mesure, elle ne saurait suffire à résoudre seule le problème du financement des PME françaises.
b) Les effets de seuil du droit du travail et du droit social
Les considérations fiscales ont longtemps été pointées du doigt pour expliquer les difficultés rencontrées par les PME françaises pour atteindre la taille critique nécessaire en vue d’exporter. Des mesures récentes ont permis de lever plusieurs de ces obstacles. Reste toutefois une difficulté majeure : le seuil à partir duquel de nombreuses obligations sociales s’appliquent est, en France, fixé à un niveau très bas, à savoir 50 salariés.
Une fois ce seuil atteint voire dépassé pendant au moins un an, de nombreuses obligations échoient alors à l’entreprise, parmi lesquelles la réunion obligatoire d’un comité d’entreprise, l’obligation de prévoir un plan de sauvegarde de l’emploi en cas de licenciement économique de plus de 9 salariés. En plus de ces contraintes, qui représentent un certain coût (attribution d’une salle pour le comité d’entreprise par exemple), d’autres dispositions du droit français peuvent affecter plus directement encore les finances de l’entreprise.
Ainsi, certaines dépenses, comme les cotisations au dispositif des chèques vacances, ne sont plus exonérées de charges au-delà de 50 salariés. De même, la possibilité de nommer un délégué syndical, dont un quota d’heures est préservé tous les mois pour son activité représentative tout en étant payé par l’entreprise, représente une charge supplémentaire. Globalement, le rapport de la commission pour la libération de la croissance, présidée par Jacques Attali, estimait que le passage de 49 à 50 salariés entraînait « l’application de 34 législations et réglementations supplémentaires, dont le coût représente 4% delà masse salariale » (2).
Ces changements imposés aux entreprises font l’objet d’une véritable anxiété parmi les chefs d’entreprise. Beaucoup de chefs d’entreprises privilégient alors la création de plusieurs sociétés de petite taille, afin de contourner cette difficulté. Il va de soi qu’un tel phénomène contribue encore au retard des PME françaises vis-à-vis des PME allemandes concernant leur taille.
A l’inverse, l’Allemagne dispose d’une tradition de dialogue social et de cogestion des entreprises qui réduit significativement les anticipations négatives des entrepreneurs s’agissant des obligations légales de représentation des salariés.
D) Un problème européen : la fermeture des marchés extérieurs
Bien qu’elle ne puisse expliquer le différentiel de compétitivité entre la France et l’Allemagne, ou avec l’Italie, il n’en reste pas moins que la régulation internationale des échanges commerciaux définie par l’organisation mondiale du commerce n’est pas favorable aux Européens, et participe de la dégradation du solde commercial français. Deux éléments contribuent à rendre plus difficile la position de nos exportateurs : un système de négociations multilatérales bloqué malgré son inadaptation à la situation actuelle et une attitude européenne trop peu protectrice.
1) Le blocage des négociations multilatérales
L’organisation mondiale du commerce (OMC) est engagée depuis dix ans dans un nouveau cycle de négociations visant à prolonger l’abaissement des barrières à l’entrée des marchés en garantissant certaines compensations pour les économies en développement. Après un premier échec en 2006, des discussions ont repris, mais ont échoué une nouvelle fois à faire émerger un accord lors du sommet de Genève de 2008.
Schématiquement, les débats butent sur la difficulté d’obtenir un accord regroupant les produits industriels, pour lesquels les pays en développement refusent d’ouvrir davantage leurs marchés, et les règles d’échange en matière de produits agricoles, qui font l’objet de demandes de la part d’un groupe de pays, dite « groupe de Cairns » (Australie, Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Colombie, Costa Rica, Bolivie, Canada, Chili, Indonésie, Malaisie, Guatemala, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Paraguay, Pérou, Philippines, Thaïlande, Uruguay), en vue d’une reconnaissance large de toutes politiques favorables à l’agriculture comme barrière indirecte aux échanges.
Bien que les Etats membres de l’OMC se soient engagés à ne pas adopter de mesures protectionnistes dans le contexte de crise de 2008, le contexte général reste peu propice à la ratification d’un nouvel accord commercial général. Certains pays non membres, comme la Russie, ont d’ailleurs adopté, des mesures de protection de leurs marchés importantes, certaines lignes tarifaires ayant augmenté de 20 % en 2008.
Plus généralement, l’impasse dans laquelle se trouvent les négociations à l’OMC n’est pas favorable aux pays européens. L’existence de « pays en développement », dont le statut est reconnu à la demande de l’Etat intéressé, peut ouvrir droit à des privilèges : allongement de la durée de transition avant de se voir imposer les règles générales de l’OMC, possibilité de revendiquer une protection particulière pour des industries nationales naissantes dans le cadre des systèmes de préférences généralisées mis en place par les pays industrialisés.
En l’absence de critères précis permettant de définir ce que sont les pays en développement, des pays émergents, voire industrialisés, comme la Chine ou la Corée du Sud, se trouvent dans la même catégorie que des pays en grande difficulté. L’OMC reconnaît en revanche la catégorie des « pays moins avancés » telle que définie par l’organisation des Nations unies, pour lesquels une plus grande flexibilité est autorisée, ainsi qu’une assistance technique et une obligation renforcée d’ouverture des marchés des pays développés.
La principale difficulté concerne plutôt les grands émergents, et les émergents les plus avancés, qui utilisent leur statut de pays en développement au regard du droit de l’OMC pour renforcer leur compétitivité, et demandent une ouverture croissante des marchés européen et américain sans contrepartie.
Ainsi, alors même que leurs industries bénéficient d’une compétitivité prix très forte, dopée par une compétitivité coût extrêmement avantageuse, les BIC (Brésil – Inde – Chine) pratiquent, à l’entrée de certains de leurs marchés (automobile mais aussi produits chimiques voire textile) des taxes d’importation pouvant dépasser les 15 %. A ces obstacles directs s’ajoutent des obstacles techniques indirects (réglementations techniques particulières permettant de retarder l’entrée d’un produit sur un marché par exemple) voire des obstacles cachés (impôts sous-jacents, coûts des formalités administratives). Certains marchés font également l’objet de mesures particulières interdisant l’accès d’entreprises étrangères, comme les grands marchés publics par exemple.
La situation actuelle n’est donc pas favorable à l’Europe, dont la part de marché s’érode et qui doit faire face à une concurrence de la part de pays plus compétitifs sur les prix et aidés par la régulation internationale. Certains préconisent la réouverture de négociations à l’OMC sur de nouvelles bases, en ajoutant une troisième catégorie de pays, qui regrouperait les puissances émergentes et bénéficierait d’avantages moins marqués.
2) L’Union européenne, seule zone commerciale ouverte ?
Désavantagée par le maintien du statu quo commercial, l’Union européenne dispose malgré tout de tous les instruments de défense commerciale autorisés par l’OMC, antidumping, antisubventions et clauses de sauvegarde. Mis en œuvre par la Commission européenne, ils permettent de s’assurer que les cas de distorsion de concurrence les plus graves donnent lieu à sanction, sous la forme, par exemple, de relèvement de droits de douanes pour une entreprise bénéficiant d’un soutien interdit.
La saisine des services européens est prévue par le règlement sur les obstacles au commerce (ROC), en vigueur depuis le 1er janvier 1995. Seulement 25 cas ont été portés à la connaissance de la Commission européenne dans le cadre de ce règlement.
Aux Etats-Unis, deux organismes permettent d’assurer le bon accès des entreprises nationales aux marchés étrangers et le caractère équitable de la compétition internationale : le Trade Compliance Center, qui vérifie l’effectivité de l’application des accords commerciaux américains, et l’US International Trade Commission, qui mène des enquêtes sur les importations lorsque celles-ci sont considérées comme contraires aux règles du commerce international. Depuis 1980, la Commission a mené 75 enquêtes pour s’assurer simplement du respect des règles internationales dans ce domaine.
Enfin, l’Union européenne souffre d’une difficulté à réguler l’intrusion par l’intermédiaire de filiales écran d’entreprises provenant d’Etats tiers cherchant à bénéficier du statut d’entreprise communautaire alors même que l’essentiel de leur activité est situé hors du territoire européen. Certaines acquisitions stratégiques dans des Etats financièrement faibles peuvent ouvrir la voie à une pénétration encore plus importante du marché européen par des produits à très bas coûts, sans aucune contrepartie nécessaire de la part de l’Etat d’origine des produits puisque la société qui les commercialise aura l’apparence d’une entreprise purement communautaire.
III – LE SOUTIEN PUBLIC AUX EXPORTATIONS : LA FRANCE COMME MODELE ?
La compétitivité française s’est érodée depuis 10 ans, en raison d’un coût du travail progressant trop vite et d’une rigidité de certains dispositifs fiscaux et réglementaires empêchant nos entreprises d’atteindre la taille critique, obstacles qui n’ont été qu’en partie levés. Ces difficultés, structurelles et expliquant l’essentiel de la dégradation de notre solde commercial, appellent des réponses spécifiques qui seront développées par la suite.
Toutefois, conscient de la nécessité de redynamiser le commerce extérieur français, l’Etat a décidé de refondre le dispositif de soutien aux exportations, avec le lancement d’une réforme majeure en 2007. La comparaison avec les soutiens publics d’autres pays soulignent la qualité de la majorité des acteurs du soutien public aux exportations en France. Toutefois, des points de blocage subsistent, relevés notamment dans le rapport public annuel de la Cour des comptes de 2011.
A –Un outil de soutien public français très compétitif
En-dehors des réformes structurelles affectant la compétitivité des entreprises, la puissance publique peut agir, principalement, de trois manières différentes pour aider au développement des exportations : en réduisant le risque lié aux dépenses d’investissement des entreprises pour conquérir des parts de marché à l’international, en facilitant les prises de contacts par les entreprises françaises sur des marchés étrangers, en sensibilisant les entrepreneurs aux bénéfices qu’ils peuvent attendre à terme du développement de leurs activités export.
Tous les pays industrialisés disposent de ces outils. Comparativement à nos concurrents directs, le dispositif français paraît aussi efficace, si ce n’est plus avantageux, tant en matière de soutien financier que d’étendue des actions de soutien direct. Reposant sur trois piliers, baptisés « équipe de France de l’export », le dispositif national semble plutôt structuré, même si des simplifications restent possibles. En revanche, l’organisation locale des services de soutien à l’économie pèche trop souvent par absence de coordination entre tous les acteurs concernés.
1) La réforme d’Ubifrance et ses effets positifs
L’organisation traditionnelle du soutien aux exportations reposait sur un double réseau international, diplomatique et issu des services du ministère de l’économie, représenté par les missions économiques. Il était traditionnellement reproché aux personnels en charge de cette mission de se désintéresser du sort des petites entreprises, et de se focaliser sur les activités des grands groupes, susceptibles de recourir au soutien d’une ambassade dans le cadre de grands contrats stratégiques. Cette situation a radicalement changé depuis 2007.
En 2006, le choix a été fait de déléguer à l’établissement public Ubifrance, issue en 2004 de la fusion entre le Centre français du commerce extérieur et l’association Ubifrance, la gestion d’une partie des missions du réseau commercial international français, à savoir l’appui au développement international des entreprises françaises. Le transfert des activités non souveraines des missions économiques à l’agence Ubifrance a ainsi permis de recentrer le soutien public à l’export sur les PME, l’essentiel du soutien aux grands contrats étant le fait des missions économiques et des ambassades.
Ubifrance accompagne les entreprises françaises vers l’export par trois canaux principaux : la facilitation des démarches pour participer à des foires ou des salons à l’étranger, l’aide à la découverte d’un marché en fonction de la demande des entreprises, et l’organisation du système des volontariats internationaux en entreprises (VIE), contrats courts proposés notamment aux jeunes diplômés et pouvant bénéficier d’un cofinancement notamment par les conseils régionaux.
Nombre d’entreprises accompagnées par Ubifrance
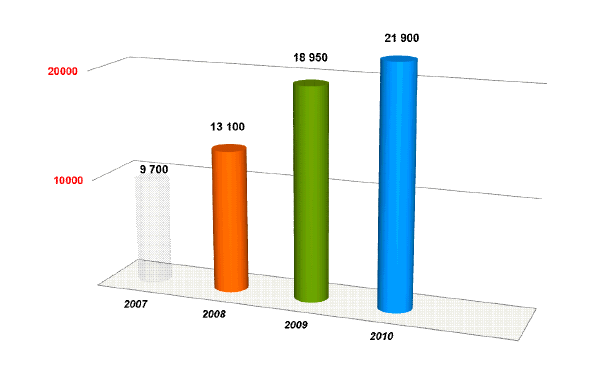
Ubifrance a signé avec l’Etat une convention d’objectifs et de moyens le 1er octobre 2008, qui fixe des objectifs précis concernant le développement de l’activité de l’agence pour la période 2009-2011. L’évolution de l’activité d’Ubifrance montre que l’agence a réussi à s’imposer comme le pivot de l’outil public de soutien à l’export. Ainsi, le nombre d’entreprises ayant eu recours aux services d’Ubifrance a progressé de 40 % par an depuis 2007.
L’accroissement du nombre d’entreprises ayant bénéficié d’une aide d’Ubifrance a permis de remplir dès 2010 l’objectif fixé en 2008 pour 2011. Le nombre de VIE est resté, en revanche, en dessous de l’objectif en 2010, avec 6900 VIE en poste contre 8800 espérés. Toutefois, une importante reprise en 2011 pourrait permettre de réaliser l’objectif de 10 000 VIE en poste à l’étranger.
Ubifrance a également réussi à intégrer 66 missions économiques présentes dans 46 pays dans son réseau international, finalisant ainsi le basculement d’une partie des activités du réseau international du ministère des finances au sein de l’agence.
Le bilan quantitatif de l’action menée par Ubifrance suscite cependant des critiques sur l’aspect qualitatif du travail de l’agence. Le rapport de la Cour des comptes précité revient notamment sur le choix de multiplier les actions d’accompagnement en faveur d’entreprises trop petites pour réussir à l’international, et la concentration de certaines aides en faveur de secteurs particuliers, ou d’entreprises déjà exportatrices.
Afin de compenser les faiblesses ainsi identifiées, Ubifrance s’est engagé, en plus d’une nouvelle augmentation de ses objectifs chiffrés à l’horizon 2014 (notamment la réalisation de 60 000 prestations et l’embauche de 15 000 VIE), à mettre en place des indicateurs d’efficacité renforcés dans le cadre du contrat d’objectifs et de performances 2012-2014.
D’abord, l’agence s’engage à permettre, par son action, le développement de 10 000 nouveaux courants d’affaires, ceci afin de résoudre le problème identifié auparavant, qui voyait l’intervention d’Ubifrance être comptabilisée quelle que soit la conséquence (signature d’un contrat export ou non) de la rencontre commerciale organisée.
Surtout, Ubifrance a annoncé un engagement qu’aucune autre agence de soutien à l’export n’a fait jusqu’à présent : garantir que plus d’une entreprise sur trois accompagnée par l’agence voit son activité à l'international augmenter sur la période.
2) La Coface, acteur majeur du soutien à l’export
En plus du soutien à la participation aux foires et salons et au développement des activités internationales des PME proposées par Ubifrance, les entreprises françaises peuvent compter sur les diverses assurances et garanties proposées par la Coface, société privée délégataire d’une mission de service public.
La Coface gère cinq outils publics de soutien à l’export, matérialisés par un encours de 82 milliards d’euros garantis. La principale aide, en volume, est l’assurance-crédit, qui permet de couvrir le risque de défaut de paiement, quelle que soit la raison, politique ou commerciale. Elle a connu une forte augmentation, passant de 42 à 60 milliards d’euros d’encours garantis entre 2008 et 2010. Elle est principalement utilisée pour les grands contrats stratégiques. Une trentaine de groupes représentait ainsi plus de 80 % du montant des encours.
Trois autres outils plus spécifiques sont proposés par la direction des garanties publiques de la Coface : l’assurance risque exportateur, qui permet de couvrir le risque pris par les banques en cas de défaillance d’un exportateur, l’assurance change et l’assurance investissement, cette dernière étant réservée à la couverture du risque politique.
Enfin, l’assurance prospection est un outil réservé aux sociétés dont le chiffre d’affaires n’excède pas 500 millions d’euros. Bien que de faible montant (200 millions d’euros), elle permet de couvrir l’ensemble des dépenses occasionnées par la recherche de marchés extérieurs, le remboursement n’étant dû qu’en fonction du montant du chiffre d’affaires réalisé sur le marché en question. Cet instrument permet donc d’aider un nombre significatif d’entreprises à faire leurs premiers pas à l’exportation.
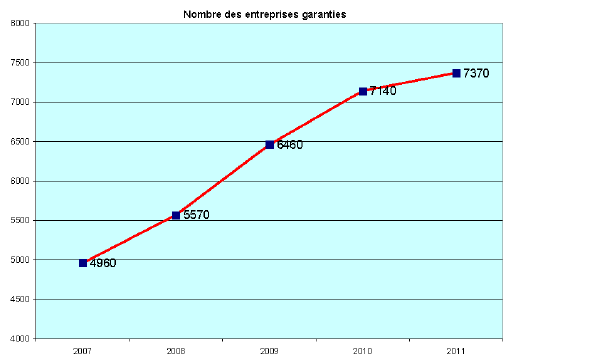
La Coface a subi de nombreuses critiques du fait du déséquilibre apparent de son activité privée. Ainsi, le montant des encours gérés au titre des instruments publics, 80 milliards d’euros, ne représentait que 5 % du volume global d’activité du groupe Coface, supérieur à 1 600 milliards. La Coface soutient néanmoins que l’évolution des encours garantis au titre des instruments publics souligne la réalité de son engagement, et fait valoir que, sur le seul marché français, la proportion des assurances crédit distribuées dans le cadre des procédures publiques est bien supérieure aux 5 % qu’elles représentent par rapport à un chiffre d’affaires mondial.
Toutefois, le développement de l’activité de la Coface est limité par l’absence de réseaux locaux de distribution des produits Coface. La question se pose désormais du maintien des activités publiques de la Coface entre les mains d’un acteur qui apparaît de plus en plus isolé au sein de « l’équipe de France de l’export ». L’agence Oséo, dont l’activité de soutien au développement international des entreprises est plus récente, joue un rôle très proche, à certains égards, de celui de la Coface.
3) Le développement des activités internationales d’Oséo
Société à capitaux publics, Oséo est connue pour son rôle de soutien à l’investissement des PME, notamment le soutien à l’innovation. Toutefois, elle s’est dotée d’une direction nationale pour traiter des questions liées au commerce extérieur. En effet, le développement des PME, mission d’Oséo, passe de plus en plus par la conquête de marchés étrangers.
Les activités de soutien d’Oséo aux exportations des PME sont très proches de celles de la Coface, notamment l’assurance prospection, et reposent principalement sur des prêts, dont le montant varient de 150 000 à 3 millions d’euros, ce dernier type de prêts pouvant également être proposé à des entreprises de taille intermédiaire.
Oséo a réussi à s’imposer comme un acteur important de l’équipe de France de l’export. En effet, ni Ubifrance ni la Coface ne dispose de relais suffisants pour connaître l’ensemble des entreprises françaises. Oséo, qui dispose d’un budget conséquent, est amené à rencontrer beaucoup plus d’entrepreneurs, environ 35 000 en 2010.
Oséo et Ubifrance se sont ainsi progressivement rapprochés, afin de permettre une meilleure complémentarité entre l’agence experte des entreprises de croissance, et celle spécialisée dans le développement international. A terme, l’ambition pourrait être de constituer un pôle unique de soutien au développement des PME, qui passe nécessairement par trois éléments : innovation, financement, exportations.
4) Une organisation locale plus récente
La Cour des comptes relève que la France est, parmi les pays de l’OCDE, l’un de ceux qui soutient le plus ses exportations, avec un total de 3,2 % des entreprises ayant bénéficié d’un appui public en 2007 (derniers chiffres comparatifs disponibles) contre 0,7 % aux Etats-Unis, 1,2 % en Allemagne et 2,2 % en Italie. Seul le Japon, avec 4,5 %, obtient un résultat plus important. L’outil public français au niveau national est donc plus que comparable à ses équivalents étrangers.
En revanche, l’organisation du soutien public au développement international des entreprises au niveau local n’est pas satisfaisante. Les relations entre les conseils régionaux, dont la responsabilité en matière économique, transférée par la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales du 13 août 2004, inclut souvent le développement des exportations, et les chambres de commerce et d’industrie, sont souvent marquées par la conflictualité.
Trop souvent, les conseils régionaux et les chambres de commerce sont en situation de concurrence, au lieu de pousser leurs services à coopérer pour maximiser le résultat de leurs actions de soutien à l’internationalisation des entreprises. Certes, dans certaines régions, comme dans le nord Pas-de-Calais, l’intégration de l’ensemble des services (CCI et agences économiques des soutiens régionaux, mais également la Coface, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et Ubifrance) au sein d’un même immeuble a permis de réduire considérablement les doublons et les pertes d’efficacité.
Mais la grande majorité des régions et des chambres n’ont pas réussi à associer leurs efforts. La création de CCI International en décembre 2010 par l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie devrait améliorer l’action des chambres, en favorisant l’échange de bonnes pratiques et en développant une politique de labellisation des chambres en fonction de leur respect de certains standards. Toutefois, le problème de fond demeure, en l’absence d’une autorité à même de faire aller tous les acteurs dans le même sens.
Le même problème se pose pour les chambres de commerce françaises à l’étranger. Disposant d’un réseau important, celles-ci peinent toutefois à trouver leur place face à l’agence Ubifrance. Celle-ci affirme qu’elle est prête à laisser les chambres organiser les relations entre entrepreneurs français hors de nos frontières là où elles sont plus efficaces, mais, dans ce domaine, l’inégalité des performances suivant les pays demeure la règle.
L’organisation locale et le réseau des chambres à l’étranger sont sans doute les deux points noirs du soutien public aux exportations en France. En effet, la comparaison avec les systèmes allemand et italien souligne, dans l’ensemble, la grande efficacité des acteurs nationaux de notre dispositif.
B – Des dispositifs comparables en Allemagne et en Italie
Dans l’ensemble, nos deux principaux compétiteurs européens, Allemagne et Italie, disposent des mêmes instruments de soutien public à l’export, notamment l’assurance crédit, l’aide à la participation des foires et salons, et la mise à disposition d’informations sur les marchés extérieurs.
Ponctuellement, certains services proposés par les entités publiques de ces deux pays peuvent apparaître plus innovants ou mieux financés, mais, dans l’ensemble, les opérateurs français nationaux apparaissent plus protecteurs que leurs homologues allemands ou italiens. Les principales difficultés françaises sont la moindre organisation régionale des aides, alors que le niveau local est, dans ces deux exemples, le cœur de l’activité de soutien aux exports.
1) Allemagne : un rôle majeur dévolu aux Länder et aux chambres
Trois acteurs fédéraux interviennent en Allemagne en soutien des entreprises : l’agence German Trade and Invest (GTAI), les conseillers commerciaux des ambassades et l’agence fédérale des foires et salons. Deux organismes financiers complètent ce dispositif : les outils publics d’assurance crédit distribués par Euler Hermès, concurrent de la Coface, et la banque KfW, qui dispose de filiales régionales, et assure le financement à long terme des exportations dans les pays en développement.
Hormis certains produits financiers spécifiques de la KfW, les agences allemandes, notamment GTAI, ne disposent pas des outils de soutien aussi approfondis que leurs équivalents en France. Ainsi, les études de marchés spécifiques, parfois gratuites et souvent proposées à des prix largement inférieurs à ceux du marché par Ubifrance, ne sont pas proposées par GTAI. De la même manière, les subventions pour la participation à des foires sont en général inférieures à celles offertes dans le cadre des actions collectives par Ubifrance. Enfin, l’Allemagne ne finance pas de contrats de jeunes diplômés, contrairement aux volontariats internationaux en entreprise français.
Le principal atout de l’outil public allemand de soutien aux entreprises est la forte cohérence des acteurs régionaux. Les départements économiques des Länder participent à l’activité d’agences publiques en charge à la fois du soutien à l’export et à l’innovation, comme c’est le cas en Bavière et dans le Bade-Wurtemberg, dont les excédents commerciaux étaient en 2010 de 14,1 et 25,5 milliards d’euros, soit environ le quart de l’excédent national.
Par ailleurs, les chambres de commerce, souvent parties prenantes de ces agences, agissent de manière coordonnée au niveau fédéral, ce qui démultiplie d’autant leur efficacité. La fédération allemande des chambres de commerce, DIHK, est ainsi présente à Berlin, Bruxelles, et au niveau mondial avec des délégations. Elle s’appuie sur 15 comités spécialisés composés de 1200 entrepreneurs, issus des quelques 3,6 millions d’entreprises membres d’une chambre, à laquelle, comme en France, l’adhésion est obligatoire. La coordination nationale des chambres facilite le lien avec le réseau consulaire allemand à l’étranger, composé de 120 AHK (Auslandshandelskammern) réparties dans 80 pays.
Le soutien public aux exportations en Allemagne, s’il n’est pas plus marqué qu’en France, est caractérisé par une grande cohérence entre les différents acteurs impliqués, quel que soit leurs statut. Ainsi, le réseau des 60 instituts Fraunhofer, qui emploient 18 000 personnes et sont de statut et de financement privé, permet aux PME de développer des liens avec le milieu de la recherche, de valoriser leurs innovations, et même de constituer un réseau commercial. A l’inverse, ces instituts, qui emploient des chercheurs venus de tous les horizons, permettent également à des scientifiques d’appréhender eux-mêmes le processus de valorisation commerciale de leurs inventions. Les instituts Fraunhofer coopèrent avec tous les acteurs économiques et scientifiques, publics et privés, et agissent comme de véritables pépinières d’entreprises, largement tournées vers l’international, grâce au soutien des chambres de commerce et/ou des agences économiques locales ou fédérales, voire même de la propre initiative des instituts, dont le budget global en 2010 s’élevait à 1,66 milliard d’euros.
2) Italie : une organisation flexible des regroupements d’entreprises
Les acteurs publics du soutien à l’export en Italie sont nombreux et forment le « Sistema Paese », système des pays, force de frappe de la promotion de l’Italie à l’étranger. Les deux principaux ministères impliqués sont le ministère des Affaires étrangères, via l’aide liée et sa compétence en matière de coopération au développement, et le ministère du Développement économique (dit MSE) qui est le grand acteur du soutien à l’internationalisation des entreprises.
Ce dernier propose un certain nombre d’instruments qu’il gère soit directement, soit au travers de l’ICE (Instituto nazionale per il Commercio Estero), équivalent d’Ubifrance quoique bien moins doté, ou de la SIMEST pour le soutien aux investissements à l’étranger. L’assurance et le soutien financier aux exportations est assuré par la SACE ; concurrente de la Coface. Enfin, Buonitalia, qui dépend du ministère de l’agriculture, est chargée de la promotion des produits agroalimentaires italiens à l’étranger. D’autres acteurs, notamment les chambres de commerce, la Caisse des Dépôts et des Prêts (CDP) ou des associations de professionnels comme la Confindustria gèrent des instruments spécifiques.
Toutefois, contrairement au système français, l’outil public italien de support aux exportations s’appuie sur une forte action diplomatique et peu sur l’appui financier. Il s’agit du « Sistema Paese », réseau informel de diplomatie économique italien qui prend également la forme de structures souples, issues d’un partenariat public/privé qui a pour objectif de planifier les grandes missions de promotion des entreprises et des territoires à l’étranger. Une réforme du système national italien devrait formaliser cet état de fait, en supprimant l’ICE et en renforçant les compétences du ministère des affaires étrangères en matière de promotion du commerce italien.
Par ailleurs, les Régions se sont vues attribuer à la fin des années 1990 la fonction de soutien au développement économique et industriel. Le commerce extérieur fait ainsi partie des domaines de compétence partagée entre les Régions et l’Etat. Des guichets régionaux pour l’internationalisation des entreprises (dits SPRINT) ont ainsi été constitués pour soutenir plus particulièrement les PME. Ces guichets régionaux visent à regrouper les efforts des différents organismes compétents (ICE, SIMEST, SACE, associations professionnelles).
Cependant l’atout majeur du commerce extérieur italien ne réside pas dans le soutien public à l’export, mais plutôt dans l’existence de multiples regroupements d’entreprises de petite taille, aux activités identiques ou complémentaires, associées sur une base strictement territoriale. Ces groupes spontanés d’entreprises indépendantes sont baptisés « districts industriels » et leurs entreprises représentent une part considérable des exportations italiennes. Il existe également des districts dits technologiques, de création plus récente (2002, quand les districts industriels ont été reconnus par la loi en 1991 alors que certains dataient des années 1970) et en nombre plus limité (34 districts technologiques contre 50 districts pour la seule fédération nationale des districts industriels, association des plus importants d’entre eux).
Il n’existe pas de statut juridique unique pour les districts. Une convention regroupant les entreprises y participant, et un représentant du district, souvent hébergé et financé par la section locale de la Cofindustria, en sont la plupart du temps les seules manifestations formelles. Deux statuts juridiques plus contraignants ont été proposés, les consortiums à l’export en 1983 (mais dont l’objet est plus limité que les districts industriels, dont les regroupements peuvent ne pas avoir de lien direct avec l’export), et les contrats de réseau d’entreprises, dont la diversité des formes et des objectifs est plus proche de l’esprit des districts.
Les regroupements spontanés d’entreprises locales ont permis à l’Italie de préserver une balance commerciale proche de l’équilibre, hors des produits pétroliers. L’absence de cadre juridique précis et d’aide publique identifiée en faveur des districts souligne à quel point la question des exportations et de l’évolution de la balance commerciale engage, en réalité, à une réflexion sur l’économie dans son ensemble. C’est parce qu’il soulève des difficultés globales que l’état de notre commerce extérieur appelle des mesures d’ensemble.
IV – FAIRE DE NOS PME DES ENTREPRISES MONDIALISÉES
L’étude du tissu industriel français et de ses capacités à l’export révèle deux déséquilibres profonds expliquant la dégradation continue de notre balance commerciale : la perte de la compétitivité prix de nos exportations, due à l’augmentation du coût du travail généré par la loi sur les 35 heures, et les difficultés rencontrées par nos PME pour atteindre la taille critique nécessaire pour réussir à l’export. La France dispose ainsi de groupes de taille mondiale, parfaitement organisés dans le monde, et de nombreuses petites entreprises performantes et innovantes. Le maillon manquant est donc celui des entreprises dites de taille intermédiaire, entre 250 et 5000 salariés, qui assurent à l’Allemagne ses performances à l’export.
L’amélioration de la balance commerciale française ne passe donc pas seulement par une réforme des outils publics mis à la disposition des entreprises pour soutenir leur développement international. Elle implique notamment de réfléchir aux meilleurs moyens de retrouver la compétitivité prix pour nos produits phares à l’export, et de lever les obstacles au développement de la taille de nos PME afin de leur conférer le volume d’activités suffisant pour assumer la conquête de marchés extérieurs.
A – Restaurer la compétitivité : une question de fond
La dégradation de la compétitivité prix française face à l’Allemagne est indéniable, et est largement due à la hausse du coût du travail, notamment des charges sociales, consécutives aux deux lois successives sur la réduction du temps de travail. L’observation du seul niveau des salaires dans l’industrie allemande et française est trompeuse : si les salariés allemands continuent de gagner légèrement plus dans l’industrie que les ouvriers français, un tel constat ne tient pas compte, en premier lieu, du fait que l’excédent commercial français coïncidait avec une période où le coût du travail en France était très inférieur à celui de l’Allemagne, en second lieu, du fait que la différence entre les coûts du travail, qui intègre les charges sociales salariales et patronales, fait alors pencher la balance dans l’autre sens : le niveau français est très supérieur à celui du coût allemand.
Le constat laisse donc apparaître deux possibilités de réforme pour alléger le coût du travail : la réduction des charges sociales pesant sur les salaires, et la réforme du temps de travail. Ces deux pistes ont été explorées en Allemagne.
1) Améliorer la rentabilité des entreprises
Selon l’étude COE REXECODE déjà citée, la différence entre les coûts du travail allemand et français était de 4 euros environ en 2008, dont 3 euros dus aux cotisations sociales. Bien que la part des charges sociales dans le coût du travail soit traditionnellement plus forte en France qu’en Allemagne, celle-ci a connu une évolution proche de celle du coût du travail (et du solde commercial extérieur), diminuant jusqu’au début des années 2000, jusqu’à n’atteindre que 2 points de pourcentage, pour remonter ensuite et s’établir, en 2008, à 4 points environ, 38,4 % du coût du travail étant lié aux charges sociales en France contre 34,8 % en Allemagne.
Une telle évolution a été accélérée par la décision du gouvernement d’Angela Merkel, adoptée en juin 2006, d’augmenter la TVA de 3 points de pourcentage (de 16 à 19 %, hors produits alimentaires restant taxés à 5,5 %) et d’affecter le tiers de cette augmentation au financement de la protection sociale, en contrepartie d’une baisse d’un point de TVA des cotisations sociales (principalement les cotisations au régime d’assurance chômage).
Un tel mécanisme pourrait être reproduit en France. Le rapport du secrétariat d’Etat chargé de la prospective et de l’évaluation des politiques publiques sur la « TVA sociale » de 2007 évaluait ainsi à 6 milliards d’euros environ le montant de ressources supplémentaires d’une hausse d’un point de la TVA. En affectant l’intégralité d’une hausse de trois ou quatre points de la TVA, une baisse d’environ 5 points de pourcentage des cotisations sociales en moyenne pourrait être financée, soit la disparition des charges patronales pour le financement de la branche famille. Le coût du travail français retrouverait pratiquement l’équilibre avec le coût du travail allemand.
2) Reconstituer les fonds propres des entreprises
Les entreprises françaises sont moins rentables que leurs concurrentes allemandes, et notamment dans le secteur industriel. Un décrochage très net est intervenu dans l’excédent brut d’exploitations des entreprises industrielles en 2000. Celui-ci a progressé de 67 % en Allemagne entre 2000 et 2007 et baissé de 14 % en France sur la même période. L’estimation courante est que les entreprises françaises affichent un retard de 150 milliards d’EBE annuel par rapport à leurs concurrentes allemandes.
La question de la rentabilité est donc posée, et donc celle de l’imposition des bénéfices de l’entreprise. Le taux d’impôt sur les sociétés est de 25 % en Allemagne contre 33 % en France. Il est nécessaire d’utiliser cet instrument pour redonner à nos entreprises les moyens de leur développement futur.
En prévoyant un taux d’impôt réduit sur les bénéfices de 15 % pour les seuls bénéfices abondés directement au capital de la société, les entreprises seraient incitées fiscalement à accroître leurs ressources propres, dont l’insuffisance par rapport aux PME allemandes est souvent soulignée.
L’amélioration de la rentabilité de nos sociétés est un facteur essentiel de relance des investissements, notamment dans la recherche. Il est aussi un élément, pour les PME, incitant à s’engager à l’international. Investir dans l’exportation est une démarche risquée, l’amélioration de la rentabilité ne peut qu’aider à franchir ce pas.
L’autre difficulté structurelle des entreprises françaises, que reflète le taux record de renoncement aux exportations, est leur taille souvent trop faible. L’exportation reste un investissement risqué pendant les premières années, et rares sont les PME françaises capables de supporter financièrement les pertes occasionnées au début de la démarche d’internationalisation. C’est d’autant plus vrai pour les marchés des BRICS, dont les particularités réglementaires et administratives rendent l’accès particulièrement difficile.
La faible taille des entreprises françaises est la conséquence de trois séries d’éléments : une fiscalité qui a longtemps découragé la transmission d’entreprises au sein d’une famille, alors que les entreprises familiales allemandes constituent le cœur de l’appareil exportateur outre-Rhin ; un seuil fixé par le droit social à 50 salariés, au-delà duquel de nombreuses obligations pèsent sur les sociétés françaises, qui restent donc souvent en deçà de ce niveau pourtant bien trop bas pour garantir un succès à l’export ; enfin, un accès au financement parfois réduit pour les sociétés en croissance.
C’est en agissant dans ces trois domaines que nos PME pourraient retrouver le chemin de la croissance interne, et développer des stratégies export fructueuses. Si beaucoup a été fait en matière de fiscalité des dirigeants d’entreprises et des transmissions, le seuil de 50 salariés continue de brider les initiatives, et certaines facilités de financement continuent d’être réservées à des entreprises de très petite taille.
Deux limites fiscales majeures à la croissance des entreprises ont été identifiées : la fiscalité du patrimoine professionnel des chefs d’entreprise, et la transmission de la propriété des sociétés au sein d’une famille.
Sur le premier point, l’impôt de solidarité sur la fortune prévoit une exonération totale des biens professionnels, parmi lesquels sont classés les parts d’une société sous réserve que leurs détenteurs possèdent 25 % au moins des parts et/ou droits de vote, et exerce une fonction de dirigeant.
Les difficultés posées par ces stipulations ont déjà été évoquées dans ce rapport, de même que les lois dites Dutreil I et Dutreil II qui ont réglé une partie du problème. En autorisant, sous réserve de la signature de pactes d’actionnaires, l’exonération d’ISF de 75 % de la valeur des titres pour les héritiers ne travaillant pas dans l’entreprise, ces dispositifs législatifs ont permis d’éviter la vente de nombreuses sociétés à des groupes ou entités françaises voire étrangères. La situation antérieure à 2004 (loi Dutreil I) a d’ailleurs montré que ce risque était avéré.
Il est temps de pousser cette logique à son terme, en appliquant aux parts dans les sociétés le même statut que les œuvres d’art, totalement exonérées d’ISF. En effet, nos entreprises industrielles sont un élément du patrimoine national. Il convient de reconnaître cette situation, en exonérant totalement les parts de sociétés familiales, quel que soit le statut de l’héritier, sous réserve de pactes d’actionnaires plus contraignants.
Ainsi, seraient exonérées totalement de l’ISF les parts de société détenues par les héritiers d’un chef d’entreprise, quel que soit leur statut vis-à-vis de la société, sous réserve de la conclusion d’un pacte d’actionnaire de dix ans, renouvelable mais à condition de se réengager formellement une nouvelle fois pendant dix ans à ne pas vendre ses parts. Ce dispositif ne devrait pas être vu comme une niche fiscale, mais comme un atout économique majeur pour notre pays, dont il permettrait une protection et, à terme, un développement du patrimoine industriel.
2) Faire du droit social un facteur de croissance
Si les obstacles fiscaux à la croissance des PME ont été levé dans leur grande majorité, la limite de 50 salariés au-delà de laquelle pèsent de nombreuses contraintes nouvelles sur les entreprises persiste. Ces obligations sont coûteuses, comme cela a été indiqué précédemment, qu’il s’agisse de la création d’un comité d’entreprise, la possibilité de nomination de délégués syndicaux, ou des conséquences annexes du passage à 50 salariés pour le bénéfice de certains dispositifs fiscaux et sociaux.
Il n’est plus acceptable que les chefs d’entreprise choisissent de créer plusieurs sociétés de 49 salariés pour éviter les coûts générés par le franchissement du seuil de 50. Il convient donc de fixer un nouveau seuil, suffisant pour permettre aux PME françaises de réussir à l’international, mais tenant compte également de la nécessité d’organiser le dialogue social dans des organisations dépassant une certaine taille.
La catégorie d’entreprises régulièrement citées comme celle regroupant les meilleurs succès à l’exportation est celle des entreprises de taille intermédiaire, qui rassemble des entreprises de plus de 250 salariés. Toutefois, repousser le principal plafond prévu par le droit du travail à ce niveau reviendrait à laisser des entreprises importantes hors du champ de l’organisation des relations collectives de travail. Il semble préférable de proposer un seuil entre celui de 50, trop bas, et 250, trop élevé.
Ainsi, en repoussant l’intégralité des obligations sociales que le franchissement du seuil de 50 salariés déclenche à un plancher de 150 ou 200 salariés, la croissance des PME serait facilitée, sans risquer de désorganiser des entreprises d’une taille importante.
Quel que soit le plancher retenu, cette décision doit faire l’objet d’un dialogue approfondi entre les partenaires sociaux. Ceux-ci doivent définir un nouveau seuil de déclenchement des principales obligations du droit du travail reposant aujourd’hui sur toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Ce nouveau seuil pourrait être de 150 salariés, ou de 100, mais il ne saurait rester inchangé.
C – De nouvelles ressources financières pour les PME
1) Des fonds d’investissements publics-privés régionaux
Les deux régions Haute- et Basse-Normandie ont participé à la création, en en août 1999, d’un fonds, baptisé NCI Gestion, permettant de combler un manque pour les PME. En effet, celles-ci ne trouvent pas nécessairement auprès des investisseurs classiques les fonds nécessaires à leur développement. De plus, la dimension locale de la structure de capital développement NCI Gestion lui permet d’appréhender les logiques de croissance des PME au plus près.
Ce type de dispositif devrait être rendu systématique. Il est parfaitement cohérent avec la responsabilité majeure des conseils régionaux en matière économique. Il présente également l’avantage, en associant des fonds publics (les deux régions détiennent 10 % de NCI Gestion), les banques (30 %) et des entrepreneurs locaux (50 %), d’associer des logiques complémentaires dans la gestion de ses fonds.
En plus de leur apport en ressources, les fonds d’investissement régionaux permettraient aux entrepreneurs associés de jouer un rôle de conseil auprès des PME bénéficiant du soutien de la structure.
2) Etendre le soutien public et les financements aux grandes PME
Dernier moteur de croissance dont les PME françaises manquent trop souvent, le financement des investissements, y compris en matière d’export, est trop souvent concentré sur des catégories d’entreprises limitatives. Ainsi, alors que plusieurs opérateurs publics assurent un soutien au financement des entreprises, notamment Oséo, leurs activités sont restreintes aux seules PME.
De plus, les ETI se voient souvent limitées dans leur accès aux crédits privés : alors que les business angels ont fait de leur métier la détection et le financement d’entreprises de petite taille mais très prometteuses, les marchés financiers, et les fonds d’investissements, se spécialisent dans des entreprises de plus grandes tailles, aux chiffres d’affaires dépassant les 1,5 milliards d’euros en dessous desquels les sociétés ne sont plus considérées comme des ETI.
La possibilité d’élargir les missions des acteurs publics aux ETI a déjà été expérimentée en 2009 puis 2010, pour faire face à la crise, à travers les dispositifs dits CAP et CAP + export, compléments d’assurance publique aux assurances crédits export. De même, les interventions d’Oséo permettant de renforcer temporairement la trésorerie des PME ont été étendues, en mars 2009, aux ETI. Ces dispositifs ont été d’une grande aide pour ces entreprises, notamment en matière de développement d’activités exports.
A terme, la pérennisation des actions de soutien au financement des entreprises de taille intermédiaire doit être envisagée. Elle permettra aux entreprises françaises de poursuivre leur croissance de manière équilibrée, sans craindre un assèchement des financements en raison de leur passage d’une catégorie statistique à une autre. Les dispositifs d’aide d’Oséo doivent pouvoir être proposés plus systématiquement aux ETI, et les instruments de garantie publique type CAP et CAP + pourraient être, avec quelques modifications réduisant le risque pris par l’Etat, maintenus sur la durée.
D – Déceler les exportateurs potentiels : pour un outil public intégré
Le soutien public aux exportations en France est, comparativement à nos principaux concurrents, important et diversifié. La réforme entreprise depuis 2007, avec la création d’Ubifrance, a déjà permis de résoudre certaines des difficultés traditionnelles du modèle français de soutien public à l’export, en focalisant les efforts de l’établissement ainsi créé sur l’aide aux PME.
Deux difficultés doivent pourtant être levées. D’abord, l’organisation au niveau régional des différents acteurs est déficiente. Il faut redonner à l’Etat le contrôle de l’application de la politique nationale de soutien aux exportations, afin de faire travailler ensemble les nombreux acteurs qui interviennent aujourd’hui dans ce domaine. En deuxième lieu, la répartition des instruments financiers à destination des entreprises exportatrices doit être revue. La question de l’attribution de l’assurance prospection à la Coface doit être posée.
1) Une agence régionale pour l’export
Le principal manque identifié dans la galaxie d’acteurs publics concernés par l’exportation est le maillon reliant les grandes agences nationales
– Ubifrance, Oséo, Coface – et les petites entreprises locales. Les services offerts par les chambres de commerce et les conseils régionaux sont très inégaux, certains faisant du développement de l’export un élément essentiel de leur action, quand d’autres se contentent du minimum.
Au-delà de cette inégalité dans la prise en compte de la dimension internationale pour l’appui aux entreprises, c’est surtout le manque de coordination entre les acteurs qui frappe. Malgré la signature de conventions entre tous ces acteurs, au niveau national et, parfois, régional, la concurrence reste la règle, tant la légitimité de chacun est difficile à contester. Pourtant, les rôles respectifs des CRCI, des conseils régionaux et de leurs agences, et des agences nationales, pourraient être clarifiés.
Ainsi, les CRCI doivent se spécialiser dans la détection des entreprises performantes, et les signaler aux agences spécialisées dans les marchés extérieurs, qui étudieraient les pays cibles potentiels. L’action des conseils régionaux, plus structurelle et stratégique, devrait consister à renforcer, chez les chefs d’entreprise, l’envie d’exporter.
La meilleure manière de créer les synergies indispensables entre les acteurs est de les regrouper au sein d’une structure unique, pilotée par un représentant d’Ubifrance, dont la stratégie nationale est déclinée de manière précise par secteurs et par zones géographiques. Seraient ainsi créées des agences régionales de l’exportation, où siégeraient l’ensemble des autres acteurs y compris un représentant de la direction régionale des entreprises (DIRECCTE), de la Coface, d’Oséo, du conseil régional et de la chambre régionale de commerce, et dont le programme d’actions pluriannuelle serait proposé par le représentant d’Ubifrance et agréé par les autres intervenants.
Les agences régionales pour l’exportation (ARE) seraient ainsi le pilier d’un outil public d’appui à l’export entièrement intégré, de la détection des entreprises potentiellement exportatrices à l’accompagnement jusqu’à la signature du premier contrat commercial sur un marché étranger.
2) Susciter l’envie d’exporter
Disposer d’un instrument public à même de déceler les potentiels des entreprises à l’exportation et de les conduire pas à pas serait un atout considérable. Toutefois, les choix des entreprises ne sauraient être systématiquement dictés de l’extérieur. En Allemagne et en Italie, les chefs d’entreprise pensent naturellement aux marchés extérieurs pour développer leur activité, conscients des insuffisances de leurs marchés nationaux.
La progression de l’activité d’Ubifrance et d’Oséo à l’international tendrait à montrer que les entreprises françaises ont progressé dans cette voie. Toutefois, il est sans doute possible d’améliorer encore la situation, en menant différentes actions auprès des entrepreneurs et des futurs responsables d’entreprise.
Les campagnes de communication, actuellement conduites isolément par chaque acteur public du soutien à l’export, pourraient ainsi être regroupées, afin de bénéficier d’un impact plus important. Une large campagne de communication, à l’occasion de la création des agences régionales pour l’exportation par exemple, devrait se concentrer sur un message clair : le développement des entreprises industrielles n’est plus possible sur le seul marché français, et l’exportation est devenue, non pas une possibilité risquée, mais une obligation de croissance.
Par ailleurs, la formation des chefs d’entreprise pourrait inclure plus systématiquement des éléments relatifs à l’exportation, et un enseignement des langues étrangères pourrait être proposé par les institutions au contact des entreprises. Certaines chambres de commerce organisent déjà ce service qui pourrait être systématisé.
3) Aider fiscalement au développement à l’international
Afin de cibler la difficulté principale des PME françaises, qui se révèle lors des premières années de présence à l’export (70 % de taux d’abandon au cours de la première année, 80 % au bout de cinq ans), un dispositif fiscal innovant pourrait être proposé afin de réduire le risque lié à l’exportation.
L’idée centrale consiste à appliquer un taux d’impôt sur les sociétés réduit (15 % au lieu de 33 %) sur la part de chiffre d’affaires réalisée par ces entreprises sur les marchés extérieurs. Une telle disposition réduit mécaniquement le risque de l’investissement à l’export, en augmentant les revenus tirés des ventes par une bonification fiscale.
Ce mécanisme pourrait toutefois donner lieu à des comportements d’optimisation de la part des entreprises, qui pourraient trouver un intérêt à commercialiser depuis la France des produits importés sans effet réel sur l’activité économique nationale. Afin de donner tout son effet à cette réduction d’impôt, il convient de la réserver aux ventes des seuls produits fabriqués en France, et de la limiter dans le temps. Au bout de dix ans, on peut estimer qu’une entreprise a assuré sa présence à l’international. Il conviendra alors de supprimer le bénéfice fiscal prévu (sauf à ce que l’entreprise décide de partir à la conquête d’autres marchés étrangers depuis la France).
Pour limiter les effets d’aubaine, qui récompenseraient majoritairement les grands groupes déjà présents à l’international, ce crédit impôt export serait calculé, sur le modèle de référence du crédit impôt recherche, uniquement sur la part de l’augmentation du chiffre d’affaires annuel réalisée à l’étranger sur des marchés où l’entreprise ne réalisait aucune vente auparavant.
E –Des ressources pour l’avenir : le développement des filières
Les trois priorités absolues pour le rétablissement du commerce extérieur français à moyen terme sont connues : amélioration de la compétitivité prix de nos produits, accroissement de la taille de nos entreprises, meilleure intégration de l’outil public de soutien aux exportations. Toutefois, sur le plus long terme, la France pourrait profitablement développer, ou redévelopper, certaines filières industrielles qui sont devenues, faute d’organisation, des faiblesses commerciales quand elles constituaient une part importante de notre excédent.
1) Des exemples positifs d’une politique sectorielle efficace
Il n’est pas question de développer intégralement une filière sur fonds publics, comme cela a pu être le cas dans le passé. Toutefois, les performances allemandes et italiennes le démontrent, la réussite à l’international dépend souvent de l’existence d’une filière intégrée et organisée, ce qui permet de développer une offre flexible de produits de pointe pour les marchés mondiaux.
En France, certains secteurs, parmi les plus performants à l’export, ont réussi à s’organiser de la sorte. Ainsi, dans le domaine du médicament, les principaux entrepreneurs français sont réuni avec l’Etat au sein d’un conseil national stratégique qui permet aux pouvoirs publics d’organiser au mieux les évolutions du secteur en partenariat avec les industriels.
Les industries de santé et l’Etat ont créé, en 2004, le conseil stratégique des industries de santé, dans le but d’associer étroitement les initiatives publiques et privées dans le domaine. Il est naturel d’associer les acteurs publics, pourvoyeurs de financements importants pour la recherche en France, et les producteurs dans un domaine où l’avance technologique est la clé de la réussite. Les produits pharmaceutiques font partie des principales locomotives de notre commerce extérieur, preuve de la réussite de cette initiative.
2) Des possibilités de développement de ce modèle
En raison de leur caractère stratégique et, souvent, de la présence de l’Etat au sein des entreprises du secteur, plusieurs filières sont déjà organisées de manière à pouvoir garantir un développement harmonieux des initiatives publiques et privées. C’est notamment le cas dans le domaine du nucléaire civil ou des matériels militaires.
Dans le domaine automobile, l’impact à très long terme des décisions des constructeurs sur le type de véhicules produits et le niveau de gamme de la production justifierait sans doute que l’Etat soit associé à ces choix, et puisse apporter son soutien à des initiatives technologiques coûteuses.
Dans le domaine agroalimentaire, la plupart des filières, hormis les vins, sont dans une situation difficile qui rendrait nécessaire une mesure semblable. Là encore, le choix notamment de la répartition des aides agricoles, mais également les orientations des dépenses de recherche et de formation, pourraient faire l’objet de discussions entre les parties prenantes. La création du comité stratégique des filières agroalimentaires le 23 novembre 2010 va donc dans le bon sens et devrait produire des résultats.
Enfin, pour des filières plus spécifiques, des mesures plus opérationnelles permettraient également de reconstruire en France des branches aujourd’hui désorganisées. Ainsi, le rapport remis par Hervé Gaymard au Président de la République le 15 octobre 2010 préconise la transformation de l’office national des forêts en entreprise publique afin d’aider à dynamiser la filière bois, en resserrant les liens entre les acteurs publics et privés.
3) Changer les relations entre les grands groupes et les PME
Les relations entre les PME et les grands groupes restent, en France, marquées par une grande méfiance de ces derniers vis-à-vis d’entreprises plus petites et concurrents potentiels pour certains produits de niche. Les relations de sous-traitance rendent dès lors très difficiles le développement des PME, forcées à réduire leurs marges afin de soutenir une concurrence internationale parfois très rude.
A l’inverse, en Allemagne, de nombreuses grandes entreprises acceptent de payer plus cher, parfois de plus de 20 %, certains biens intermédiaires, et aident leurs sous-traitants à développer leur réseau commercial à l’étranger en leur nom propre.
Les PME françaises ne pourraient que bénéficier d’un passage de la logique de sous-traitance à un tel esprit de « cotraitance ». De nombreuses initiatives nationales ont été adoptées pour inciter les groupes à conduire leurs sous-traitants à l’international, mais celles-ci n’ont pas réussi car c’est un état d’esprit général qu’il convient de changer.
Il est normal que les grands groupes français préservent leur compétitivité, mais il n’est pas acceptable qu’ils privilégient un gain financier minime par rapport au maintien d’activités économiques essentielles sur le territoire. Les services d’achat des grandes entreprises multinationales françaises doivent faire preuve de plus de patriotisme économique à l’avenir.
F – Améliorer l’équilibre des marchés : le principe de réciprocité
Bien qu’il ne soit pas spécifique au commerce extérieur français, l’environnement juridique et réglementaire des échanges commerciaux internationaux est à un tournant. Si l’organisation mondiale du commerce met en avant le fait que le protectionnisme ne s’est pas généralisé pendant la crise, force est de constater que la dynamique d’abaissement des barrières est actuellement interrompue. Il convient dès lors de réfléchir aux moyens d’imposer que les exportations vers les puissances émergentes soient traitées de la même manière que nos importations en provenance de ces Etats.
Le cycle de négociations de l’OMC lancé à Doha il y a dix ans est bloqué, et les difficultés sont d’autant plus vives que plusieurs pays en développement ont connu une croissance économique spectaculaire depuis dix ans, mais refusent d’être considérés désormais comme des pays industrialisés. Les propositions de création d’une troisième catégorie de pays sont, pour le moment, restées lettre morte, et risquent de ne pas aboutir dans la mesure où elles reviendraient à acter l’échec de Doha et rendraient nécessaires la reconstruction de l’ensemble des bases de la négociation.
1) Une nécessaire prise de conscience européenne
L’échec des négociations multilatérales a rendu nécessaire, pour le développement des échanges européens, la signature d’accords de commerce bilatéraux, dans le sillage de la politique américaine. L’Union européenne a réussi, quand des accords de ce type ont été négociés, à obtenir des conditions d’échange plus favorables que le seul droit de l’OMC aurait pu lui laisser espérer.
Une telle stratégie est pertinente, mais ne peut fonctionner qu’avec des partenaires ayant beaucoup plus besoin d’accéder au marché européen que l’inverse. Dans le cas contraire, et notamment avec les BRICS, l’accès à ces marchés en pleine croissance est une facilité en contrepartie de laquelle les émergents exigent de fortes contreparties, notamment agricoles.
La question des rapports entre l’Union européenne et les autres grandes puissances commerciales reste donc entière. Une évolution notable de la stratégie de l’UE dans ce domaine est indispensable pour permettre à nos industries de maintenir leur niveau technologique face à des puissances commercialement agressives. Si le statut des émergents ne peut être reconnu à l’OMC, la surveillance de leurs politiques commerciales nationales, souvent agressives, doit être renforcée, et la possibilité pour l’Union européenne de recourir aux clauses de sauvegarde prévues par les accords de l’OMC doit être étudiée.
2) Le principe de réciprocité dans les matières non tarifaires
Le niveau et l’existence des droits de douanes sont réglementés par les accords de l’OMC. Mais le développement du commerce extérieur soulève bien d’autres difficultés, dans différents domaines : protection de la propriété intellectuelle, accès aux marchés publics. Largement défendu par la France, et notamment le ministère du commerce extérieur depuis quelques années, le principe de réciprocité, s’il était appliqué par l’Union européenne, consisterait à protéger le marché européen des entreprises venant de pays où ces droits connexes au libre échange des marchandises ne sont pas pleinement assurés.
Il est difficile d’accepter que des entreprises européennes se voient refuser des marchés publics, ou voler certaines innovations, sans que l’UE ne prenne de mesures en retour. C’est pourtant le cas, notamment pour les marchés de défense aux Etats-Unis, ou les grands marchés d’équipement dans les grands émergents, mais aussi au Japon. La France demande ainsi à l’Union européenne d’imposer aux Etats membres de ne pas recourir à des entreprises étrangères pour certains marchés publics si celles-ci sont situées dans des pays fermées aux offres européennes. Par ailleurs, la vigilance en matière de propriété intellectuelle et commerciale doit être renforcée.
En dernier lieu, l’Europe ne parvient que très difficilement à empêcher des concurrents étrangers, par le truchement d’entreprises rachetées notamment dans les nouveaux Etats membre, de disposer du statut d’entreprise communautaire, interdisant dès lors toute discrimination entre ces sociétés et des concurrentes réellement européennes. Si la surveillance de ces comportements revient aux Etats membres, l’Union européenne doit se saisir de ce dossier qui risque, si l’on n’y prend garde, d’hypothéquer durablement les chances des économies européennes dans la compétition mondiale.
3) La présence française dans les négociations européennes
Si l’Europe devrait mieux défendre les industries européennes dans les négociations internationales et en utilisant les outils dores et déjà disponibles dans le droit existant, la France doit, pour sa part, mieux faire entendre sa voix lorsqu’il s’agit de négocier notamment les grands textes communautaires relatifs aux activités industrielles.
L’Union européenne joue un rôle essentiel s’agissant de la définition et de l’encadrement des produits industriels. Exemple parmi d’autres, la directive dite REACH – enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques – entrée en vigueur le 1er juin 2007 fixe une procédure unique pour toutes les industries chimiques européennes, chargées de procéder elles-mêmes à l’évaluation de leurs produits avant qu’une décision de mise sur le marché ne soit adoptée.
Trop souvent, ces négociations ne tournent pas à l’avantage des industriels français, l’Allemagne défendant beaucoup plus efficacement ses intérêts industriels dans ce type d’enceintes. La préoccupation allemande pour la défense de son industrie en Europe est visible dans de nombreux débats, mais particulièrement s’agissant des normes techniques et/ou sanitaires imposées depuis Bruxelles.
La France ne doit plus laisser son industrie se voir imposées des normes qui ne correspondent pas à ses pratiques. Les services impliqués dans les négociations doivent mieux prendre en compte les préoccupations de nos entreprises, et prendre le risque d’une discussion avec nos partenaires allemands, plutôt que de laisser la définition des règles aux autres.
Cette question est essentielle pour nos exportations. En effet, les normes européennes sont ensuite utilisées comme base de négociations, multi- ou bilatérales, avec nos partenaires extérieurs. En infléchissant ces règles dans un sens plus favorable à notre industrie, nous parviendrions à mieux positionner nos produits sur les marchés extérieurs et à imposer des normes aux importations que nos entreprises satisfont déjà.
La litanie de l’accroissement du déficit extérieur français n’est pas une fatalité. Alors que l’année 2011 offrira probablement, contrairement aux prévisions faites en 2010, un nouveau déficit record, des pistes pour le redressement de nos comptes extérieurs existent, et certaines, déjà suivies, devraient porter leurs fruits dans les prochaines années.
Il convient, pour proposer des réponses efficaces à la crise de notre commerce extérieur, d’en analyser les causes réelles. Souvent invoqués, le niveau de l’euro et l’augmentation du prix des hydrocarbures ont un effet réel sur les statistiques du déficit. Mais ils ne suffisent pas à expliquer la divergence croissante entre la France et l’Allemagne : alors que la France enregistrait un déficit de 52 milliards d’euros en 2010, l’Allemagne réalisait, avec 154,3 milliards d’euros, le deuxième excédent commercial au monde, après la Chine.
En examinant les raisons du retard français vis-à-vis de l’Allemagne et, dans une moindre mesure, de l’Italie (dont la balance hors pétrole est positive, contrairement à celle de la France), plusieurs points doivent être soulignés qui expliquent les raisons structurelles du déficit commercial français.
D’abord, la France a perdu, depuis 2000, l’intégralité de la compétitivité prix que lui conférait un coût du travail inférieur à celui de l’industrie allemande. En raison du coût généré par les 35 heures, le coût du travail horaire français est devenu supérieur de 4 euros à celui de l’Allemagne. En conséquence, les produits français, réputés autrefois fiables et peu chers, sont devenus aussi chers que les produits allemands, les entreprises françaises ayant réussi, au prix d’un effort de marge considérable, à maintenir leurs prix à l’export ; mais ils ne bénéficient pas de la réputation des produits allemands. Notre position commerciale est donc structurellement fragile.
De plus, les PME françaises ne sont pas incitées à atteindre la taille critique nécessaire pour exporter. Les obstacles fiscaux au développement d’entreprises familiales de grande taille, liés à l’imposition du patrimoine et aux droits de succession, ont été largement levés. Néanmoins, les contraintes liées au seuil fixé à 50 salariés pour l’application de nombreuses dispositions de droit du travail, et la difficulté pour les plus grandes PME d’accéder à des financements d’un montant suffisant, rendent notre industrie particulièrement frileuse à l’export, sauf pour les grands groupes dont l’appareil productif est de toutes façons internationalisé.
La solution aux difficultés de notre commerce extérieur ne réside donc pas dans la multiplication des aides aux entreprises, mais passe par des mesures de fond concernant ces deux points. Les incitations fiscales et la réorganisation de l’appareil public de soutien aux entreprises doivent accompagner ce mouvement, mais ne saurait le remplacer.
En maintenant et simplifiant les dispositifs permettant de transmettre plus facilement les sociétés au sein d’une famille, en basculant une partie du financement de la protection sociale sur la TVA pour alléger les charges sur les salaires, en relevant le seuil d’obligations sociales de 50 à 150 salariés, en développant les financements pour les entreprises de taille intermédiaire, la France pourrait redonner à ses entreprises industrielles la dynamique de croissance indispensable à la réussite à l’export.
Parallèlement, la création d’agences régionales, pilotées par l’établissement public en charge des exportations Ubifrance, et regroupant l’ensemble des acteurs du soutien public à l’export, la sensibilisation des chefs d’entreprise à l’opportunité que représente le développement de marchés extérieurs, la possibilité de pratiquer un taux d’imposition réduit sur la part de chiffre d’affaires réalisé à l’export, permettrait de faire prendre conscience aux PME françaises qu’elles ne pourront pas se développer sans être présentes à l’international.
Enfin, à plus long terme, la reconstruction d’un lien fort entre l’Etat et les industries stratégiques pour l’export, notamment l’automobile et l’agroalimentaire, mais également le développement de filières fortes dans des secteurs aujourd’hui trop désorganisés comme l’industrie du bois, devraient permettre de redonner à notre pays sa place dans le commerce mondial.
Ces solutions, toutefois, ne pourront fonctionner que dans la mesure où le commerce mondial est régi par des règles identiques pour tous les acteurs. Dans ce domaine, c’est à l’Union européenne, seule compétente pour définir la politique commerciale, de prendre en compte les préoccupations de nos entreprises, et de faire appliquer le principe, parfaitement légitime, de réciprocité dans l’accès aux marchés, notamment les appels d’offre publics, pour les entreprises européennes à l’extérieur de nos frontières.
LES MESURES CLÉS POUR NOTRE COMPETITIVITE
A – Pouvoir rester français
Objectif : Eviter la vente aux étrangers de sociétés familiales françaises.
Mesure n°1 : Exonérer totalement d’ISF les parts de sociétés détenues par les membres d’une famille propriétaire, et cela que le détenteur travaille ou non dans la société familiale.
Les PME familiales font partie de notre patrimoine national, et sont la clé de nos succès futurs à l’exportation. Il faut éviter que leurs propriétaires, héritiers des fondateurs, soient conduits à les céder à cause de la pression fiscale.
B – Rendre les entreprises plus profitables
Objectif : Alléger les charges sociales des entreprises produisant en France.
Mesure n°2 : Augmenter de trois ou quatre points la TVA et baisser d’un montant équivalent les charges sociales patronales.
La TVA sociale améliore notre compétitivité en réduisant le coût du travail tout en augmentant le prix des importations. On estime qu’une hausse de trois points de la TVA permettrait de supprimer les 5,4 % de cotisations patronales au régime de la caisse d’allocations familiales.
Objectif : Reconstituer les fonds propres des entreprises.
Mesure n°3 : Appliquer un taux réduit d’impôt sur les sociétés (IS) de 15 % sur la part des bénéfices réinvestie dans le capital de la société.
Les PME françaises affichent un retard de rentabilité sur leurs concurrentes allemandes. Baisser l’impôt sur les sociétés leur permettrait de reconstituer leur assise financière et d’assurer un développement plus rapide, notamment à l’international et dans l’innovation.
Objectif : Encourager la recherche de nouveaux marchés à l’export.
Mesure n°4 : Appliquer un taux d’impôt sur les sociétés (IS) allégé sur la part de chiffre d’affaires réalisée sur un nouveau marché export. Pour éviter l’effet d’aubaine cette mesure doit être limitée à dix ans.
Le crédit d’impôt exportation réduit les coûts liés à la conquête d’un nouveau marché, diminuant le risque d’échec rapide des entreprises à l’export et permettant de rétablir nos parts de marché.
C – Favoriser le développement des entreprises françaises
Objectif : Augmenter le nombre d’entreprises de taille intermédiaire (ETI) en France.
Mesure n°5 : Lancer une négociation entre les partenaires sociaux pour relever le seuil de 50 salariés actuellement en vigueur en droit social et droit du travail, par exemple à 150 ou 200 salariés.
Le seuil de 50 salariés constitue un barrage pour les chefs d’entreprises et les conduit à ne pas se développer. Nos PME doivent au contraire être incitées à atteindre la taille critique pour réussir à l’international.
Objectif : Créer de nouvelles sources de financement pour les PME.
Mesure n°6 : Généraliser la création de fonds d’investissement régionaux.
Sur la base de l’expérience lancée en Normandie, des fonds associant les réseaux bancaires, les conseils régionaux et les entrepreneurs locaux peuvent développer une activité de capital investissement réservée aux PME, et permettre aux chefs d’entreprises de la région de bénéficier de conseils spécifiques.
Objectif : Rationaliser le soutien public régional.
Mesure n°7 : Créer des agences régionales pour l’exportation, sous l’égide de l’agence Ubifrance, regroupant l’ensemble des acteurs du soutien public à l’export : chambres de commerce, conseils régionaux, services déconcentrés, Ubifrance, Coface.
Le soutien public à l’exportation doit être rationalisé au niveau local pour que chaque institution se concentre sur son champ d’expertise et évite les doublons, les acteurs nationaux doivent assurer un rôle de stratège.
Objectif : Rationaliser l’organisation des instruments financiers publics à l’export.
Mesure n°8 : Attribuer la distribution de l’assurance prospection à Oséo.
Cette charge est aujourd’hui assumée par la Coface alors qu’Oséo propose des instruments financiers très complémentaires et dispose de relations plus étroites avec les PME, cœur de cible de l’assurance prospection.
Objectif : Cibler et développer les secteurs porteurs.
Mesure n°9 : Créer des comités stratégiques réunissant l’Etat et les producteurs nationaux en vue de définir dans le cadre d’engagements mutuels contraignants les orientations et investissements à venir.
Sur le modèle du conseil stratégique des industries de santé, les grandes filières exportatrices comme l’agroalimentaire et l’automobile doivent associer leurs efforts à ceux de l’Etat pour répondre à la demande mondiale.
D – Soutien de l’UE aux entreprises européennes
Objectif : Rétablir un commerce équilibré avec les pays émergents.
Mesure n°10 : Inciter l’Union européenne à durcir ses positions face aux stratégies commerciales agressives des grands émergents en examinant la possibilité de nouer des accords commerciaux bilatéraux et appliquer le principe de réciprocité dans les domaines liés au commerce international, notamment l’accès aux marchés publics et la protection de la propriété intellectuelle.
Les grands émergents sont encore considérés, à l’OMC, comme des pays en développement et peuvent dès lors appliquer des taxes fortes sur leurs importations, que des négociations bilatérales pourraient réduire.
L’Europe apparaît trop souvent comme le seul marché réellement ouvert. Elle doit désormais obliger ses partenaires à respecter les mêmes règles sous peine de fermer ses marchés aux entreprises extracommunautaires.
Objectif : Mieux prendre en compte les intérêts des industriels français dans les négociations européennes relatives aux normes techniques.
Mesure n°11 : Renforcer la présence française dans les instances européennes.
Trop souvent, les entreprises françaises se voient imposer des normes européennes qui ne correspondent pas à leurs intérêts. La France doit faire avancer ses exigences dans les négociations les plus techniques afin que nos produits ne soient pas désavantagés dans la compétition internationale.
La commission examine le présent rapport d’information au cours de sa réunion du mercredi 23 novembre 2011.
Après l’exposé du rapporteur et du président, un débat a lieu.
M. François Rochebloine. Pour exporter, il faut produire. Or, nous avons assisté à la disparition de pans entiers de notre industrie : dans certaines régions, comme le Stéphanois, la machine-outil, la verrerie, la fabrication de locomotives, même, ont disparu. Nous nous sommes désindustrialisés et ce n’est donc pas seulement un problème d’exportation.
Je suis d’accord sur le fait que nous ne sommes pas compétitifs. Nous avions un coût de 20 % inférieur à celui de l’Allemagne, nous sommes aujourd’hui à parité. C’est un simple constat économique et il y a aujourd’hui urgence. Je ne vais pas parler des 35 heures, sur lesquelles je suis totalement en désaccord ; je regrette que nous n’ayons pas eu le courage politique de les supprimer, nous en voyons aujourd’hui les résultats.
Quant à vos propositions, sur les PME et les ETI, il y a effectivement des problèmes de seuils. Je partage votre constat, je connais les limites que le seuil de 50 salariés représente pour les chefs d’entreprises.
Le tissu de PME est très riche dans différentes régions, mais exporter est extrêmement difficile ! Il n’est pas certain que les chambres de commerce aient bien rempli leur rôle. Des clubs d’entreprises – par exemple, chez moi, le club GIER pour « gérer, innover, entreprendre et réussir » – se sont créés, mais les entreprises ont de grosses difficultés à l’export. Même avec vos propositions, je ne suis pas certain que cela soit bien efficace. Je vous trouve indulgent avec Ubifrance et surtout avec la Coface et Oséo, dont je ne suis pas sûr qu’elles remplissent bien leur rôle. En résumé, il faut un sursaut, mais je ne suis pas optimiste vis-à-vis de l’Allemagne et de l’Italie.
M. Jean-Michel Boucheron. Je salue ce travail remarquable et ce rapport très intéressant. Je ne suis pas certain que les 35 heures soient véritablement le problème, de nombreuses études ont démontré que ce n’était pas rédhibitoire.
Votre approche est extrêmement financière ; elle est intéressante au demeurant
– celle sur l’ISF par exemple pourrait me séduire –, mais il faut attendre la dixième proposition pour en trouver une qui ne soit pas d’ordre financier.
Le véritable problème, c’est la taille de nos PME. Il faut un système pour les rassembler, pour qu’elles mettent en commun leur innovation, leur recherche, leur marketing, leurs réseaux commerciaux. Une PME ne peut avoir de réseaux commerciaux à l’étranger. Je suis donc d’accord avec votre idée de comités stratégiques.
Il me semble surtout, que d’une manière ou d’une autre, il faudra imposer à l’Union européenne l’idée qu’on peut avoir des politiques industrielles pour l’export, c’est-à-dire des politiques consistant à aider nos PME à fabriquer des produits qui ne se vendraient pas bien en France mais qui s’exporteraient.
Sur les aspects techniques et financiers, il faudrait que les entreprises aient un intérêt majeur à se regrouper, notamment au niveau de leurs services d’export. Je suis d’accord avec la proposition quant à l’argent frais, encore faut-il qu’une politique précise soit définie.
M. Jean-Paul Dupré. C’est un sujet d’importance majeure. Il y a aujourd’hui un comparatif très négatif avec l’Allemagne et un écart qui est désormais de 200 Mds€. Comme il a été dit, si on veut vendre, il faut produire et je ne suis pas sûr que le coût du travail soit essentiel pour expliquer les mauvaises performances.
Se pose aussi la question de la réelle volonté de nos entreprises à aller conquérir les marchés à l’export. L’Afrique est un marché intéressant, mais à l’Est comme à l’Ouest, il y a encore des terrains à explorer. Les entreprises ne sont peut-être pas assez soutenues. Elles manquent peut-être de partenariats avec les chambres de commerce, de métiers, les régions. En Languedoc-Roussillon, nous avons créé le label « Sud de France » avec des « maisons de la région » implantées dans différentes zones du monde. Il faudrait aussi développer des partenariats avec les ambassades, les consulats, les régions.
M. Michel Terrot. Je félicite la mission pour la pertinence de cet excellent rapport. On parle de la TVA sociale depuis une dizaine d’années mais il y a un blocage. C’est pourtant une idée de bon sens : l’Union européenne est notre premier marché, il se protège très peu par rapport à ce que font des pays comme la Chine, l’Inde, ou même le Japon aujourd’hui, où il faut vraiment être très volontaire et tenace pour réussir à exporter ! Alors, on ne voit pas bien ce qui bloque. L’Allemagne, qui veut protéger sa capacité exportatrice ? Le Royaume-Uni ? Pourquoi une taxe peu importante sur les produits en provenance de pays à coûts sociaux très bas n’avance-t-elle pas plus vite ?
M. Alain Cousin. Je suis à un poste d’observation privilégié à Ubifrance et je partage totalement les analyses qui ont été faites ainsi que les propositions. La question de la rationalisation du soutien public est un vrai sujet sur lequel nous travaillons depuis la réforme de l’agence.
Les régions ont leurs propres mécanismes et stratégies, certes louables, mais cela génère aussi des pertes en ligne et des pertes d’argent, aussi. A propos de la réforme d’Ubifrance, je ne suis pas sûr que la loi soit suffisante car c’est aussi un problème culturel. Nous passons des conventions avec les chambres de commerce depuis 18 mois, les régions se mettent à faire du développement économique, comme la loi les y autorise, mais il faut surtout travailler. Avant la réforme, Ubifrance aidait 8 000 entreprises par an ; en 2010, nous en avons aidé 22 000, dont 10 % seulement venaient des chambres de commerce. Il y a donc en amont un problème d’identification par celles-ci des entreprises qui sont susceptibles d’aller à l’export.
En réponse à la remarque de Jean-Michel Boucheron sur les aspects marketing, je dirais oui et non : nous sommes plus ou moins sur les mêmes parts de marché que l’Italie avec beaucoup moins d’entreprises. Heureusement que nous avons les entreprises du CAC40 ! Même en automobile, nous ne sommes pas bons. En Chine, ce sont BMW et Audi qui marchent grâce à leurs modèles haut de gamme, créneau sur lequel nous sommes absents, même si ça change un peu. Ce n’est donc pas seulement un problème de marketing mais aussi de positionnement, et parfois même les grands groupes ne sont pas bien placés.
Globalement, nous travaillons de manière à renforcer « l’équipe de France export ». Il faut reconnaître son rôle au capitaine, c’est-à-dire Ubifrance. Nous avançons, ça balbutie, mais ça se transforme néanmoins, et il faut de l’ambition et de l’espoir.
M. Jacques Myard. Je me félicite qu’on parle de politique industrielle, y compris en politique étrangère. J’ai fait deux rapports pour la Commission des Affaires européennes à ce titre. Il faut prendre conscience que nous sommes l'exception. Quand vous discutez avec M. Alexander Italianer, directeur général de la Concurrence à la Commission européenne, vous vous rendez compte qu’il est à cent lieux des politiques industrielles et des filières économiques. Il ne comprend pas. On est dans deux mondes différents. Ils n’ont pas compris ce qui se passe en Corée et en Chine. C’est un capitalisme d’Etat que vous proposez. Les interventions des Landers ou des régions chez nous sont courantes en Chine et en Corée. Tous les bénéfices sont réinvestis. C’est la réalité du capitalisme d’Etat chinois, qui fonctionne très bien, avec des coups tordus et du protectionnisme. Alstom et Siemens vont être évincés du marché chinois.
On nous dit qu'il faut une TVA anti-délocalisation. Elle peut être décidée au niveau communautaire et porter sur l’entrée des produits dans l’espace européen, mais nous pouvons le faire aussi au niveau national par une baisse des cotisations sociales et une augmentation de la TVA.
Vous connaissez ma position sur la monnaie unique. En dix ans, les exportations sont passées de 5,4% des exportations mondiales à 3,4% et cette monnaie nous a coûté un point de croissance chaque année. Ce n’est pas la taille des entreprises qui est en cause. Nous sommes plus sensibles à la cherté de l'euro que l'Espagne. Quand M. Gallois, président exécutif d’EADS, dit que, quand l’euro augmente de dix centimes par rapport au dollar, son entreprise perd 950 millions d’euros de résultat net, c'est parce que notre structure est plus sensible.
Le système allemand repose sur un concept de patriotisme économique. Là où sont les centres de décision et les centres de recherche et développement, il y a un accord entre le gouvernement, le patronat, les universitaires et les syndicats. On fait fabriquer le boulon de 16 en République Tchèque mais on ne délocalise jamais la recherche et développement comme vient de le faire Peugeot. C’est culturel. Notre hinterland, c’est l’Espagne et l’Italie alors que pour l’Allemagne, ce sont les pays hors zone euro. On fait fabriquer à bas coût, on réintègre et on exporte, avec un monopole dans la métallurgie lourde. Cela dit, l’Allemagne est en négatif avec la Chine et ses positions pourraient très vite être remises en cause.
M. Hervé de Charette. Bravo au président et au rapporteur. Si la situation de l'export français est si grave, c’est parce qu’elle a connu un véritable effondrement. C'est un fait nouveau, propre à ces dix dernières années. Il y a trois batailles clés. La bataille de la compétitivité d’abord, c’est le point central. Si nos prix sont plus chers, nous ne vendons pas. Je regarde la TVA sociale avec un certain scepticisme. Tout d’abord, trois points de TVA, s’appliquant en moyenne à 40 % du prix de revient d’un produit, ne changeront pas grand chose dans la compétition avec les autres pays. Deuxièmement, ceux qui l'ont mis en oeuvre l'ont fait car leurs taux de TVA étaient faibles. Le taux allemand était à 16% alors que nous sommes déjà à un des taux les plus élevés. Quand ça passera à 22%, cela se ressentira sur le pouvoir d'achat de la population française. La bataille de la compétitivité est centrale et je salue vos propositions.
La deuxième bataille est celle de l’export. Il s'agit de transformer le comportement d'un grand nombre d'entreprises pour les conduire sur les terrains de l'exportation, qui ne leur sont pas naturels. Cela dépend de la taille des entreprises mais ce n'est pas le seul facteur. Le principal facteur est l'état d'esprit des dirigeants des PME, d'où l'importance de l'équipe de France de l'export. J'assiste à des réunions conduites par l’actuel Secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur et je trouve que ça fonctionne bien. La réforme d’Ubifrance est excellente. Il y a de bonnes initiatives. Les initiatives de CCI International pour développer un échelon international dans chaque chambre de commerce vont dans le bons sens. Il s’agit d’une bataille fondamentale. L'export ne concerne pas seulement l'Union européenne, il faut aussi aller sur les autres continents car c’est là que les marchés se développent.
Enfin, dernier point, il faut mener la bataille européenne. C'est le marché le plus grand, le plus ouvert, avec le moins de contraintes. Or tous les autres grands ensembles économiques du monde se défendent en prenant des dispositions réglementaires qui ont pour objet de poser des obstacles non tarifaires aux importations. Le libéralisme de la Commission et des états-majors de l'Union européenne a gravement négligé ce point. Nous n'avons pas mené cette bataille.
M. François Loncle. Je trouve ce rapport très intéressant et nous le lirons avec beaucoup d’intérêt. Des remarques pertinentes ont été faites par mes collègues, je n'approuve pas tout ce qui a été dit, notamment sur les maisons de région et les propos de Jacques Myard sur la monnaie, mais il est vrai que quand la part de l'industrie baisse dans le PIB, il y a des conséquences en chaîne, en particulier pour l'exportation. J'approuve ce qui a été dit sur la qualité et l'efficacité d'Ubifrance et sur l'action du Secrétaire d’Etat chargé du commerce extérieur.
Quand vous dites que la difficulté et l'explication de notre effondrement sont dues à des causes structurelles, cela n'explique pas pourquoi, entre 1997 et 2002, le commerce extérieur était si florissant et si positif. Sur le coût du travail, vous disiez que les Allemands étaient plus chers que nous et que c'est la même chose aujourd’hui. Si c'est la même chose, alors cela n'explique pas la différenciation considérable entre l'Allemagne et les difficultés françaises. Vos propositions et les remarques de mes collègues peuvent nourrir une réflexion et une action future intéressantes sur la question.
M. Christian Bataille. Je souhaite faire une remarque sur notre industrie automobile qui mériterait selon moi d’être étudiée pour comprendre ses déboires actuels. Alors que cette industrie était fortement exportatrice et a longtemps occupé une place centrale en Europe – au même niveau que l’Allemagne –, le marché automobile français pourrait être bientôt déficitaire. Aucune marque ne paraît en mesure de redresser la situation, chacune connaissant alternativement des difficultés. Cette industrie semble connaître dans le reste du monde la mésaventure qu’elle a vécue sur le marché des Etats-Unis qu’elle n’est jamais parvenue à pénétrer. Dans le même temps, notre voisin allemand est en pleine réussite. Volkswagen prévoit ainsi d’augmenter sa production de 10 % en 2012 et de créer 20 000 emplois tandis que nous subissons, en France, une baisse de la production avec les licenciements et fermetures d’entreprises qui vont avec. L’explication communément avancée de nos faiblesses sur le marché des voitures haut de gamme ne me semble pas suffisante. En quelques années seulement, peut-être dix, nous sommes devenus mauvais, y compris sur le marché européen où les voitures françaises n’ont plus la cote. Il faut donc creuser cette question à l’avenir. Je m’étonne d’ailleurs que les dirigeants de ces entreprises ne s’interrogent pas davantage sur ce point ce qui laisse penser qu’un changement devrait être opéré là aussi. La réflexion sur l’industrie lourde doit nécessairement porter sur le secteur automobile qui faisait la force de la France.
M. Philippe Cochet, rapporteur. Je suis rassuré par l’ensemble des interventions et je me félicite que nous nous accordions, avec des nuances marginales, sur le constat. Quant aux pistes proposées, je note avec satisfaction que les divergences sont mineures.
Une révolution culturelle de la part des entrepreneurs est nécessaire. L’export est souvent considéré comme un pis aller en temps de crise : la démarche est entreprise faute de demande intérieure puis abandonnée lorsque l’activité reprend. C’est une erreur qui est en partie à l’origine du mal.
M. Rochebloine, vous établissez un lien entre le déclin de la production et le déficit commercial qui ne me semble pas nécessairement avéré. L’exemple des Pays-Bas est à cet égard intéressant puisqu’ils exportent sans être dotés d’atouts industriels. La France a les moyens de retrouver des niveaux d’exportation satisfaisants. Elle doit pour cela développer l’export européen mais surtout conquérir les marchés émergents. Leur part dans nos exportations, de l’ordre de 20 à 25 %, est aujourd’hui insuffisante au regard de leur potentiel. La majorité de nos échanges restent intracommunautaires ce qui n’est pas en adéquation avec les réalités économiques.
Il est important d’insister sur le rôle d’Ubifrance. Les efforts de coordination ont permis d’en faire le vrai pilote de l’avion dont nous avons besoin. Il faut reconnaître que les initiatives à l’échelon territorial sont sympathiques mais contre-productives. La multiplication des acteurs est mal perçue par les interlocuteurs étrangers.
Je partage nombre d’autres remarques qui ont été faites. Je reviens sur le coût du travail qui est une question fondamentale, M. Loncle. Si les consommateurs acceptent de payer cher certains produits, c’est en raison de l’image qui s’y attache. Le label « Made in Germany » permet de facturer plus cher.
Le secteur automobile est une illustration de la nécessité de définir une vision stratégique. L’Allemagne s’appuie sur des entreprises familiales qui acceptent d’acheter à un coût plus élevé mais en conservant leur savoir-faire sur le sol national plutôt que de mener une politique d’achat au plus bas prix. A l’inverse de la France, la stratégie de ces entreprises repose sur une vision à moyen terme. De la même manière, le sous-traitant n’est pas considéré en Allemagne comme un ennemi alors qu’il peut l’être en France. Il faut encourager une évolution dans ce domaine.
Pour conclure, je me félicite que, malgré quelques divergences, le constat et la volonté de se retrousser les manches soient largement partagés. C’est un premier résultat satisfaisant de notre travail.
M. Axel Poniatowski, président. Je retiens que toutes les interventions ont mis en avant le motif culturel du déficit de notre commerce extérieur. Le problème culturel est une évidence. Il est historique : le Français ne s’exporte pas ; les migrations européennes ont été le fait des Italiens, des Espagnols, des Britanniques, des Allemands, etc mais jamais des Français, peut-être est-ce parce qu’il fait trop bon vivre dans notre pays…La France n’a pas de culture d’exportation car ses citoyens n’émigrent pas. La présence de diasporas est un puissant facteur d’aide à l’exportation sur lequel la France ne peut pas compter. Les entreprises françaises ne sont par ailleurs pas orientées vers l’export. A titre d’exemple, j’ai lu récemment que les grandes sociétés françaises n’emploient que 17 % de cadres étrangers contre 27 % pour la moyenne européenne. Or la mondialisation des échanges réclame une diversité dans l’encadrement. Enfin, les Français sont le peuple européen qui maîtrise le plus mal l’anglais, c’est un handicap important.
La mission n’a pas fait de propositions sur la dimension culturelle, pourtant essentielle, car ce n’était pas l’objet de son travail. Nous avons concentré nos propositions sur les aspects financiers qui sont déterminants.
La première difficulté tient à la taille des entreprises. A cet égard, Ubifrance doit encore s’améliorer car son action est trop tournée vers les très petites entreprises. En ne démarchant pas les entreprises plus grosses, Ubifrance risque d’accompagner des sociétés qui ne renouvelleront pas l’expérience de l’exportation ensuite. Il est essentiel de développer des entreprises de taille intermédiaire, c’est-à-dire plus grosses et en meilleure santé.
Ce dernier point a été constamment mis en avant par les entrepreneurs que nous avons interrogés sur leurs besoins. Pour pouvoir exporter, les entreprises doivent être en bonne santé alors qu’aujourd’hui elles ne font pas assez de bénéfices et manquent de fonds propres pour conquérir des marchés. C’est pour cette raison que l’aspect financier nous est apparu primordial.
La TVA sociale, qu’ont évoquée M. Terrot et, avec des réserves, M. de Charette, est un élément important. L’augmentation des taxes sur les produits étrangers renforcera mécaniquement la compétitivité des produits français. Cette TVA rend plus cher les produits étrangers sans affecter les prix de la production nationale.
Je veux dire à M. Bataille que tous les pays européens mais aussi les Etats-Unis, connaissent des problèmes avec leur secteur automobile à l’exception des pays asiatiques pour des raisons de coût et de l’Allemagne. Cette dernière, cela a déjà été mentionné, vend des voitures plus chères mais dispose surtout d’une filière automobile totalement intégrée.
Nous aurions souhaité soumettre des propositions sur les filières. En effet, c’est une force des Allemands et des Italiens que de contrôler les filières de production de A à Z. L’exemple de la filière du bois en France est éclairant : alors que nous disposons du deuxième massif forestier européen, nous sommes incapables d’exporter autre chose que du bois brut. Il est essentiel de mettre en place un comité stratégique dans ce domaine pour parvenir à exporter des produits avec une valeur ajoutée.
Nos deux domaines les plus performants à l’export, ceux pour lesquels nos excédents sont les plus importants, sont l’aéronautique et le vin qui n’ont pourtant rien en commun. En dépit d’une baisse de la production viticole, les exportations progressent grâce à une valeur ajoutée accrue. La filière viticole réussit car les producteurs de vin, sans parler l’anglais pour la plupart, sont très bien organisés. C’est pourquoi nous insistons dans nos propositions sur la nécessité de regrouper les forces.
En conclusion, ce sujet nous a passionnés. J’espère que nos propositions contribueront à enrichir le débat et qu’elles seront d ans un proche avenir mises en œuvre parce qu’elles sont essentielles pour notre économie.
M. François Rochebloine. Beaucoup de PME, pour exporter, doivent exposer dans les salons à l’étranger. Or, cela coûte cher. Dans ce domaine, les entreprises doivent être aidées. Je ne sais pas au travers de quel organisme – Ubifrance peut-être ? – mais elles doivent être aidées.
M. Axel Poniatowski, président. L’assurance prospection est faite pour ça, notamment pour les petites entreprises. Il y a également Ubifrance.
M. Alain Cousin. Ubifrance reçoit environ 25 millions d’euros de crédits d’intervention de l’Etat. Entre 30 et 40 % de subventions sont données aux entreprises qui vont sur les salons.
*
La commission autorise la publication du rapport d’information.
Liste des personnalités rencontrées
(par ordre chronologique)
1) A Paris
– M. Guillaume Gaulier, économiste à la Banque de France et chercheur associé au CEPII et M. Thierry Mayer, professeur à Sciences Po et membre du conseil scientifique du CEPII (1er décembre 2010)
– Mme Catherine Minard, directrice des affaires internationales du Medef (8 décembre 2010)
– M. Benoît Coeuré, économiste en chef de la direction du Trésor du ministère de l’économie et des finances, M. Thomas Courbe, directeur de cabinet du secrétaire d’Etat au commerce extérieur et Mme Corinne Darmaillacq, chef du pôle commerce extérieur (15 décembre 2010)
– M. Jérôme Fournel, direction générale des douanes, M. Jean-Michel Thillier, sous-directeur du commerce international et Mme Claire Lefebvre, chef du département des statistiques et des études économiques (19 janvier 2011)
– M. Patrick Blain, président du Comité des Constructeurs Français d’Automobiles (CCFA), accompagné de Mme Laurence Massenet, directrice des affaires internationales et de M. Pierre-Louis Debar, directeur Economie Statistiques et Transports (9 février 2011)
– M. Roger Fiszelson, délégué général de la commission internationale de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP), accompagné de M. Jean-Christophe Angenault, responsable des relations institutionnelles (16 février 2011)
– M. Christian Lajoux, président de la Fédération Française des Industries de Santé (FEFIS), accompagné de M. Richard Lerat, délégué général et de M. Pascal Favre, secrétaire général (9 mars 2011)
– M. Jean-Lou Blachier, président de l'Union territoriale des PMI à la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME), accompagné de Mme Béatrice Brisson, responsable Europe et international (16 mars 2011)
– M. Michel Nalet, président de la commission développement des exportations de l’ANIA (Association Nationale des Industries Alimentaires), accompagné de Mme Elsa Chantereau, responsable relations institutionnelles et de Mme Diane Dore, responsables échanges extérieurs (23 mars 2011)
– M. Emeric d’Arcimoles, président de la commission internationale du Groupement de l’Industrie Française de l’Aéronautique et du Spatial (GIFAS), accompagné de Mme Agnès Palomeros-Ferragu, responsable des affaires institutionnelles et de M. Vincent Gorry, responsable des affaires internationales (6 avril 2011)
– M. Philippe d’Ornano, directeur général du groupe Sisley cosmétiques (13 avril 2011)
– Son Exc. M Giovanni Caracciolo, ambassadeur d’Italie en France, accompagné de M. Gianluca Greco, conseiller économique (11 mai 2011)
– M. Jean-Bernard Gautier, premier vice-président de l'Union des Chambres de Commerce et d’Industries Françaises à l’étranger (UCCIFE) et M.Vianney de Chalus, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Havre et président de CCI International (18 mai 2011)
– M. Hubert Reynier, co-président de la commission internationale de CroissancePlus, accompagné de Mme Florence Dépret, directrice déléguée (1er juin 2011)
– M. François Drouin, président du groupe Oséo, accompagné de M. Serge Antonini, directeur de la communication (8 juin 2011)
– M. Jean-Marc Pillu, directeur général de la Coface, accompagné de M. Xavier Laurent, directeur à la direction des garanties publiques (15 juin 2011)
– M. Christophe Lecourtier, directeur d’Ubifrance, accompagné de M. Alain Cousin, président du conseil d’administration d’Ubifrance, député, et de M. Aziz Belaouda, chef de cabinet (29 juin 2011)
– Mme Bénédicte Michon, déléguée générale de l’ASMEP-ETI et M. Jean-Michel Henry, directeur des relations extérieures du groupe Soufflet (14 septembre 2011)
– M. Christian Saint-Etienne, professeur des Universités (12 octobre 2011)
2) En Italie (le Président et le Rapporteur)
6 juillet 2011
– Mme Emanuela Lucchini, représentante du district de la thermomécanique « VenetoClima » et administratrice déléguée d’Ici Caldaie
– M. Filippo Maria Carraro, représentant du district
– M. Michele Bauli, président du district
– M. Alberto Zerbinato, président du réseau d’entreprises « Energy for Life »
– M. Alberto Ercole, de la caisse d’épargne de Vérone
3) En Allemagne (le Président et M. Bacquet)
du 19 au 21 juillet 2011
– M. Berend Diekmann, chef du bureau commerce extérieur et mondialisation, appui aux contrats à l’export, Amérique du Nord, sommets internationaux, OCDE, au ministère de l’Economie
– M. Volker Treier, directeur général adjoint et chef du département international de la Fédération des chambres de commerce et d’Industrie
– Mme Ilja Nothnagel, chef de bureau "Economie internationale" à la Fédération allemande des chambres de commerce
– M. Oliver Wieck, chef département commerce extérieur et aide au développement de la Fédération de l’industrie allemande (BDI)
– M. Jan Jost, chargé de mission « Soutien à l’export », à la Fédération de l’industrie allemande (BDI)
– Dr Joachim Gieseke
– M. Humbach, président de la société u2t Photonics.
– M. Julio Neto, adjoint du département commerce extérieur et services, de la Chambre de Commerce de Stuttgart
– Mme Julia Klett, département relations avec les pays de l’Ouest, de la Chambre de Commerce de Stuttgart
– M. Michel Charbonnier, consul général de France à Stuttgart
– M. Jean-Gabriel Recq, président des conseillers du commerce extérieur de la France du Bade Württemberg
– M. Karlheinz Bechtle, ministère de l’économie du Bade-Wurtemberg
– M. Gabriel Hanisch, chef adjoint de la Chambre des métiers internationale
– Mme Heike Pasauer, chargée de mission « Relations internationales », Baden-Württemberg International
– Mme Anna Krywalski, chargée de mission « Relations internationales », Baden-Württemberg International
– M. Jörg Stremme, chef du département Mittelstand et infrastructures à la L-bank
– M. Gernot Kraft, expert associé de l'agence RKW du Bade-Wurtemberg
– M. Uwe Bechinka, chef du département commerce extérieur, Fédération de l’industrie du Land de Bade Württemberg
– M. F. Baudoin, chef du département export de l’entreprise Graupner
1 () Loi de modernisation de l’économie, n°2008-776 du 4 août 2008.
2 () Rapport publié le 23 janvier 2008.
© Assemblée nationale