______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 février 2012.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
sur « La situation intérieure en Belgique »
et présenté par
MM. robert LECOU et Jean-pierre KUCHEIDA
Députés
___
INTRODUCTION 5
I – UN PAYS FRAGILE ET SAISI PAR UNE DYNAMIQUE DE DISSOCIATION 11
A – DES CLIVAGES PROFONDS 11
1. La conviction est fortement ancrée que la Belgique est constituée de deux sociétés différentes 12
2. Le conflit linguistique est aujourd’hui concentré sur des enjeux symboliques 18
a) Un conflit fondateur dans l’histoire de la Belgique contemporaine 18
b) Les enjeux d’aujourd’hui ont une forte portée symbolique 27
3. Le clivage principal est désormais placé sur le terrain économique et social 34
a) Prospère, la Flandre conteste les transferts financiers dirigés vers la Wallonie 35
b) Attachée à sa prospérité, la Flandre veut disposer de leviers plus importants 39
B – DES INSTITUTIONS QUI N’OFFRENT PAS DE CONTREPOIDS SUFFISANT AUX TENDANCES CENTRIFUGES 42
1. Un système institutionnel complexe 42
a) Deux catégories d’entités fédérées 42
b) Des modalités de financement qui procurent déjà un certain degré d’autonomie et de responsabilité 46
2. Un équilibre institutionnel introuvable ? 50
a) Une construction progressive qui ne répond pas à un schéma préétabli 50
b) Un fédéralisme très particulier 55
C – UN SYSTÈME DES PARTIS BOUSCULÉ PAR L’ÉMERGENCE DE LA N-VA 57
1. Un paysage politique fragmenté 58
a) La place des trois familles traditionnelles s’est progressivement érodée 58
b) Les trois familles traditionnelles ont cependant résisté aux premières vagues des partis régionalistes 60
c) Les années 1990 ont vu l’installation durable d’autres acteurs 63
2. La N-VA s’est imposée comme un acteur-clef de la crise de 2010 64
a) La N-VA a tiré profit du sur-place du différend communautaire pendant près d’une décennie 64
b) La N-VA veut s’affirmer le seul vrai défenseur des intérêts des Flamands 68
II – UN ACCORD DE GOUVERNEMENT QUI A MIS FIN À LA CRISE MAIS QUI NE MET PAS LA BELGIQUE À L’ABRI D’UNE NOUVELLE CRISE 75
A – L’ACCORD DE GOUVERNEMENT A SOULAGÉ L’ENSEMBLE DU MONDE POLITIQUE 79
1. Un accord détaillé, à la mesure des difficultés rencontrées 79
a) Le volet institutionnel 79
b) Le volet socio-économique 86
2. Une mise en œuvre sous contraintes 87
a) Des délais très courts 87
b) Les incertitudes résultant de la situation économique et sociale 90
B – L’AVENIR DE LA BELGIQUE RESTE CEPENDANT INCERTAIN 91
1. Le processus d’éloignement n’est probablement pas arrivé à son terme 91
a) Les conséquences de la crise 92
b) La Flandre ne cesse de s’affirmer comme nation 94
2. La (re)construction d’un espace politique national reste pour l’heure hypothétique 95
a) L’introduction de mécanismes de démocratie directe doit être vue comme une piste peu opportune 96
b) Le projet d’une circonscription électorale unique a progressé sans aboutir 98
3. Bruxelles reste un ciment solide 100
CONCLUSION 105
EXAMEN EN COMMISSION 107
LISTE DES PERSONNALITÉS RENCONTRÉES 111
CARTE DES RÉGIONS LINGUISTIQUES ET DES ENTITÉS FÉDÉRÉES 113
Mesdames, Messieurs,
La Belgique aurait-elle renoué avec les vieux démons de l’instabilité gouvernementale qui l’avaient saisie dans les années 1970 et encore, quoique de façon ponctuelle, à l’automne 1987 et l’automne 1991 ? Quatre gouvernements se sont succédés pendant la législature 2007-2010, abrégée par des élections anticipées, alors que les deux législatures précédentes étaient allées à leur terme normal sous la conduite de deux gouvernements successifs seulement, emmenés par Guy Verhofstadt.
Pour autant, ce qui marque la législature 2007-2010 et, plus encore, la législature actuelle est moins une instabilité gouvernementale à proprement parler qu’une « instabilité post-électorale », par où le système politique n’apparaît plus capable de construire en un temps raisonnable un gouvernement qui reflète le résultat des élections au Parlement national et les choix du peuple souverain exprimés par la voie démocratique.
A l’occasion des élections de juin 2007, il avait fallu 194 jours au pays pour retrouver un gouvernement de plein exercice. Celui-ci était au demeurant essentiellement transitoire, puisque sa durée avait été d’emblée fixée à 90 jours et qu’il était dirigé par le chef du gouvernement sortant et non par le dirigeant de la principale formation issue des élections, qui avait cependant vocation à devenir Premier ministre.
Pour l’actuelle législature, 541 jours ont séparé les opérations de vote (13 juin 2010) de la prestation de serment du gouvernement dirigé par Elio di Rupo (6 décembre 2011). Si l’on commence le décompte au jour de l’acceptation par le roi de la démission du gouvernement d’Yves Leterme (26 avril 2010), ce ne sont pas moins de 588 jours que la Belgique aura dû attendre avant de retrouver un gouvernement de plein exercice. Jamais, dans aucun État au monde, la formation d’un gouvernement n’avait duré aussi longtemps.
C’est indiscutablement le révélateur d’une crise du modèle belge de négociation politique, voire du « compromis à la belge » que le politologue Dave Sinardet a pu définir comme « un compromis réfléchi, certes, mais surtout alambiqué, dont seuls les politologues et de fervents amateurs tirent quelque plaisir. Une tentative pour marier l’eau et le feu, prête à répandre le brouillard. » (1) Un certain art, en fait, de trouver une solution qui donne à chaque protagoniste satisfaction et désagrément mêlés, mais qui complique souvent des choses qui n’étaient déjà pas si simples.
C’est aussi le signe d’une divergence essentielle entre les visions des partis en présence, divergence d’autant plus redoutable qu’elle ne concerne pas le contenu des politiques publiques au sens traditionnel du terme, mais qu’elle touche à la conception même de l’État, à la nature des institutions et du pacte primordial qui les fonde.
La crise de 2010-2011, comme avant elle la crise de 2007-2008, a ainsi ranimé les interrogations sur la pérennité de la Belgique. Celles-ci sont aussi anciennes que le pays, puisque l’on prête à Talleyrand ce jugement, censément formulé dès 1832 : « Les Belges ? Ils ne dureront pas. Tenez, ce n’est pas une nation, deux cent protocoles n’en feront jamais une nation. Cette Belgique ne sera jamais un pays, cela ne peut tenir… » (2) Plus récemment, l’hebdomadaire britannique The Economist affirmait que « parfois, il est bon pour un pays de reconnaître que son travail est accompli » (3). Depuis de nombreux mois, les évocations d’une « séparation », d’un « divorce » ou d’un « éclatement » de la Belgique ont à nouveau fleuri, plus ou moins intensément au gré des difficultés rencontrées par les négociateurs.
La Belgique serait donc condamnée, État si faible que toute crise politique serait l’occasion de poser la question de sa survie, État si artificiel qu’il devrait se briser à l’inéluctable envol de la nation flamande. La devise nationale (« L’union fait la force ») n’aura-t-elle donc été qu’une incantation ?
Lorsqu’elle a commencé ses travaux, la mission a, bien entendu, pris conscience que la Belgique est née en 1830 d’une alliance circonstancielle entre des forces normalement antagoniques : forces cléricales, menacées par l’égalité de religion décrétée par Guillaume Ier, prince d’Orange-Nassau, souverain du Royaume uni des Pays-Bas (4) ; forces libérales, irritées par la politique économique de la maison d’Orange et contestant les restrictions apportées par elle aux libertés publiques, notamment la liberté de la presse.
Il est vrai aussi que les grandes puissances de l’époque – Angleterre, Autriche, France, Prusse, Russie – se sont penchées sur son berceau, avec les Pays-Bas, lors de la conférence de Londres (novembre 1830-novembre 1831) et que la Belgique doit sa reconnaissance internationale à la préservation de leurs intérêts bien compris plus qu’à leur adhésion subite au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Il est vrai également que le territoire de ce qui deviendra la Belgique a longtemps vécu sous suzeraineté ou pouvoir « étranger ». Certes, aux environs du Xe siècle, se développent sur ces terres situées aux confins du royaume de France et du Saint-Empire des entités quasi indépendantes, qui conduisent leur propre politique bien qu’elles soient vassales du roi de France (pour le comté de Flandre) ou dépendantes du Saint-Empire (pour les comtés de Hainaut, de Namur et de Luxembourg ainsi que les duchés de Brabant et de Limbourg).
Mais par la suite, c’est sous l’autorité des ducs de Bourgogne que ces entités sont progressivement regroupées – bien que non unifiées sous une même loi – d’abord à partir du comté de Flandre, qui échet par mariage à Philippe le Hardi en 1385, puis avec l’union personnelle réalisée par son petit-fils, Philippe le Bon, lequel devient prince de Hainaut, de Hollande et de Zélande (1428), de Namur (1429), de Brabant (1430) et de Luxembourg (1444). Tout en conservant les institutions locales, les ducs de Bourgogne installent des institutions centrales : créés en 1464 et siégeant à Bruxelles, les « états généraux » accordent les aides nécessaires pour les guerres mais sont aussi consultés sur des questions de politique générale.
Les possessions bourguignonnes du Nord passent ensuite à la maison d’Autriche, Marie de Bourgogne, fille et héritière de Charles le Téméraire, ayant épousé Maximilien Ier de Habsbourg (1477). Il revient alors à Charles Quint (né à Gand, capitale du comté de Flandre) d’unifier sous une seule couronne les « Dix-sept Provinces » (5) en 1549, qui sont dotées de trois conseils. La politique centralisatrice et l’intransigeance religieuse de son fils Philippe II, élevé en Espagne, déclenchent la « Guerre de Quatre-vingts ans » (1568-1648). Elle se conclut, avec le traité de Münster (1648), par la séparation entre la république des Provinces-unies, qui devient indépendante (6), et les Pays-Bas du Sud, qui restent sous l’autorité de la couronne d’Espagne (7). Les guerres avec la France réduisent peu à peu le territoire sur ses frontières méridionales, avec la perte de l’Artois et les amputations subies par la Flandre et le Hainaut. Le traité d’Utrecht (1713), par lequel la couronne d’Espagne passe aux Bourbons, attribue les Pays-Bas du Sud aux Habsbourg d’Autriche.
Ceux-ci sont confrontés à la « révolution brabançonne » (1789) qui, partie de Bruxelles, conteste les réformes religieuses introduites par Joseph II (notamment l’édit de tolérance de 1781) et la remise en cause des droits et privilèges obtenus par les villes et les pouvoirs locaux au fil de l’histoire. Les troupes autrichiennes chassées, les « États » proclament leur indépendance et forment la Confédération des États belgiques unis (1790). Les dissensions internes favorisent cependant le retour des Autrichiens dès 1791.
La France annexe les Pays-Bas du Sud et la principauté de Liège en 1795, à la faveur des guerres révolutionnaires. L’Empire fait de même avec la République batave, née en 1795 à la suite d’un soulèvement contre le stathouder Guillaume V d’Orange-Nassau soupçonné de vouloir faire des Provinces-unies une monarchie. Puis le Congrès de Vienne crée le Royaume uni des Pays-Bas, confié au prince Guillaume VI d’Orange-Nassau (8), et doté de deux capitales : La Haye et Bruxelles. Quinze ans après, cet État-tampon créé pour contenir les ambitions de la France se scinde dans la fièvre révolutionnaire de septembre 1830.
La succession des événements brossée ici à grands traits ne disqualifie pas la Belgique au regard de l’histoire, au contraire. Dire que la Belgique est un pays artificiel revient à faire peu de cas du substrat historique sur lequel elle s’est bâtie – sans cependant méconnaître l’absence d’entité politique unifiée antérieure à 1795, mais était-ce si étonnant en temps d’Ancien régime ? – et à plaquer sur la richesse du passé le schéma simple d’aujourd’hui, fondé sur la différenciation linguistique entre les parties néerlandophone et francophone.
Et quand bien même on accepterait la vision d’un pays artificiel, on n’aurait encore rien expliqué, ni de la naissance de la Belgique, ni de son histoire contemporaine, ni de ses tensions actuelles, ni de ses perspectives. L’Europe elle-même, quoique « naturelle » à l’esprit, peut être vue parfois comme une construction artificielle. Elle n’en perd pas pour autant sa pertinence comme cadre de vie quotidien, comme instance d’identification et comme projet politique.
La mission a cherché à comprendre les ressorts profonds de la crise où s’est trouvée plongée la Belgique, en s’abstenant de toute considération sur les nombreux scénarios qui peuvent être échafaudés dans l’hypothèse où le pays se scinderait. Elle s’est avancée avec prudence, à la fois parce que le cœur de son mandat consistait à étudier la situation purement intérieure d’un partenaire proche, État-membre de l’Union européenne, et parce que le contexte politique interne, très délicat, ne se prêtait guère à une approche sans nuances.
Deux déplacements à Bruxelles ont constitué les temps forts des travaux de la mission. Ils ont été conduits avec le souci de ne pas créer d’interférences dans le processus de négociation politique alors même que le premier, en juillet 2011, est intervenu à une date que l’on peut certainement qualifier de paroxysme de la crise. Le second, en janvier 2012, s’est déroulé dans un contexte différent, plus apaisé, après la formation du gouvernement et l’engagement des premiers travaux législatifs. Les entretiens ont été centrés sur les différends entre néerlandophones et francophones, la petite communauté germanophone de 75.000 personnes située dans les anciens « cantons de l’Est » (9) n’étant pas placée au cœur de ces différends.
Comme en miroir de ses déplacements, la mission analyse d’abord les facteurs centrifuges qui tendent à dissocier le pays ; elle présente ensuite la situation nouvelle qui résulte de l’accord de gouvernement conclu à l’automne.
I – UN PAYS FRAGILE ET SAISI PAR UNE DYNAMIQUE DE DISSOCIATION
La Belgique a vécu plusieurs mois de crise politique, dont elle n’est sortie qu'en décembre dernier. Elle a connu une crise similaire, bien que moins longue, à l’issue des élections législatives de 2007. A chaque fois, la question de sa survie a été posée, avec une acuité toute particulière en 2010-2011. Qu’ils l’aient exprimé explicitement ou de façon plus indirecte, les interlocuteurs de la mission – tout au moins ceux qui ne se revendiquent pas de l’option séparatiste – ont donné le sentiment que cette interrogation existentielle n’était pas une figure rhétorique et que le pays est vraiment passé au bord du gouffre.
En vérité, des forces centrifuges puissantes s’expriment dans l’espace public et orientent l’évolution du système politique. La Belgique est saisie par une dynamique de dissociation dont nul aujourd’hui ne peut discerner le point d’achèvement.
Il est apparu à la mission que trois dimensions permettent d’éclairer cette dynamique et d’expliquer la profondeur de la crise récente. Tout d’abord, la Belgique est traversée par de multiples tensions, de nombreuses lignes de fracture, qui structurent en grande partie le débat politique, quand elles ne l’absorbent pas tout entier. Elles nécessitent de ce fait d’être exposées de façon détaillée. Ensuite, les institutions ne fournissent pas de « point d’ancrage » solide susceptible de contrer les tendances centrifuges évoquées ci-avant ; au contraire, elles peuvent apparaître comme entrant en résonance avec elles. Enfin, le système des partis, marqué par une fragmentation croissante, notamment en Flandre, a été bousculé par l’émergence d’un parti séparatiste, la N-VA, au milieu des années 2000.
Si toutes les sociétés sont traversées par des clivages, rarement peut-être sont-ils aussi structurants qu’en Belgique. Il s’agit tout d’abord du clivage linguistique, qui sépare néerlandophones et francophones et qui prend naissance très peu de temps après la création du pays. S’y ajoute depuis une cinquantaine d’années un clivage socio-économique qui oppose une Flandre plutôt « de droite » et une Wallonie plutôt « de gauche », clivage aujourd’hui prédominant. Mais, surtout, la mission a été particulièrement sensible à ce qui peut être qualifié de « clivage diffus » – diffus mais pas nécessairement moins intense que les deux précédents – à savoir cette conviction si fortement ancrée que la Belgique est composée de deux sociétés différentes.
1. La conviction est fortement ancrée que la Belgique est constituée de deux sociétés différentes
Deux sociétés différentes : c’est peut-être l’image la plus forte qu’ont laissée les premières heures passées en compagnie des interlocuteurs de la mission en juillet dernier. Certains ont mis en valeur des domaines précis où cette différence trouverait à s’exprimer. Ainsi, M. Rik Torfs, sénateur, estimait que l’écart entre les cultures économiques des Flamands et des Wallons était très important, les premiers étant plus enclins à l’esprit d’entreprise et à l’innovation, les seconds penchant plutôt vers le salariat, de préférence dans le secteur public ; de même, les autorités flamandes chercheraient plutôt à favoriser l’entreprise privée et à libérer les initiatives alors que les autorités wallonnes seraient très interventionnistes et chercheraient à conserver un secteur public puissant. Mme Béatrice Delvaux, éditorialiste au Soir, évoquait un rapport différent au besoin d’évolution de la société, avec des Wallons plus « transis » et des Flamands plus « allants » et désireux de changements ; elle affirmait ainsi à la mission que « les francophones ont souvent le bâton dans le dos ; les Flamands sont un révélateur de ce que les Wallons ne veulent pas faire spontanément ».
D’autres interlocuteurs, comme M. Charles Picqué, ministre-président de la région Bruxelles-Capitale, donnaient un caractère plus global aux écarts entre la société flamande et la société francophone ; c’est ainsi que M. Picqué affirmait que les Flamands et les Wallons constituent « deux groupes culturels qui s’affrontent sur les réponses à apporter aux grands problèmes de la société : économie, chômage et emploi, immigration, etc. »
La vision la plus radicale – mais était-ce si étonnant ? – est venue de M. Bart De Wever, président de la N-VA, parti séparatiste, qui a repris devant la mission une thématique affirmée publiquement depuis de nombreux mois, selon laquelle la Belgique n’est que « l’addition de deux démocraties ». Il y a dans cette expression une référence à la démocratie comme système politique, mais aussi comme système de valeurs et comme manifestation d’une volonté de vivre-ensemble. M. De Wever précisait d’ailleurs qu’à ses yeux, la France représente le plus grand succès de l’État-nation, où l’identité nationale se fonde sur la citoyenneté et non sur l’appartenance ethnique, que le Royaume-uni et l’Espagne sont des « demi-succès » et que la Belgique est un « échec complet », ce que traduit le fait qu’il n’y a pas de journal commun à tout le pays, pas de télévision commune, pas de discussions de fond entre les membres des deux groupes linguistiques dans chaque chambre du Parlement, etc. De ce fait, il n’est plus possible d’avoir une approche commune et, a fortiori, des solutions communes aux problèmes de plus en plus complexes qui se posent aux responsables politiques (immigration, justice, questions socio-économiques…).
Le fait est qu’effectivement, les liens se distendent entre les deux parties du pays. S’agissant des médias, la barrière de la langue conduit à ce qu’une très faible partie de la population accède aux médias de l’autre communauté. En conséquence, lorsqu’ils veulent élargir leur horizon médiatique, les Flamands s’orientent vers les médias anglo-saxons et les Wallons vers les médias français. Cette coupure est si franche qu’il a été rapporté à la mission que, lorsque la chaîne publique francophone, la RTBF, a diffusé, en décembre 2006, un pseudo-reportage annonçant l’indépendance de la Flandre et la fin de la Belgique (10), quasiment aucun téléspectateur francophone n’a songé à basculer sur la chaîne publique flamande, la VRT, pour vérifier l’information et voir comment réagissait la partie flamande du pays.
Les médias belges n’accordent qu’une place limitée aux événements survenus de l’autre côté de la frontière linguistique et les analyses sont, en général, plutôt négatives, même si M. Guido Fonteyn, journaliste indépendant, estime que « la presse francophone se montre davantage encline à s’exprimer de façon nuancée sur la Flandre que la presse flamande sur la Wallonie. C’est certainement vrai si on veut bien ne pas tenir compte des épanchements de la presse francophone sur la périphérie de Bruxelles » (11). Celle-ci se répartit entre une presse bruxelloise et une presse wallonne ; selon M. Fonteyn, « la presse francophone bruxelloise polarise l’intérêt, en tout cas en matière de regard sur la Flandre. La presse wallonne n’a tout simplement pas d’opinion au sujet de la Flandre. […] La presse francophone bruxelloise n’est plus homogène. La Libre Belgique est sensiblement plus modérée que Le Soir. « La Libre » demeure fidèle à la Belgique et quiconque souhaite le maintien de la Belgique se doit de montrer de l’attention et du respect pour le partenaire ». M. Christian Laporte, chroniqueur politique à La Libre Belgique, s’est, lui, demandé si la frontière linguistique était devenue un « Mur de Berlin de l’information » (12). Il regrette le désintérêt manifeste des médias pour ce qui se passe chez « l’autre » qui n’est pas nécessairement si lointain (à cet égard, il a évoqué devant la mission la « loi du mort-kilomètre ») ; selon lui, la presse flamande de qualité (De Standaard, De Morgen, etc.) n’investit pas assez dans la présence de journalistes sur le terrain bruxellois et wallon et la presse populaire est trop occupée à « renforcer les clichés au lieu de s’approcher des réalités ». La VRT, chaîne de télévision publique flamande, aurait en revanche une attitude assez ouverte, avec l’envoi fréquent d’équipes sur le terrain, la reprise d’images de la RTBF, l’ouverture de l’antenne à des experts et responsables politiques francophones, etc.
Au demeurant, Mme Béatrice Delvaux a indiqué à la mission que des initiatives ponctuelles sont parfois prises pour retrouver des lieux de communication entre médias. Ainsi, en 2007, Le Soir et De Standaard ont échangé des journalistes pendant plusieurs semaines et ont publié plusieurs séries d’articles en réciprocité. Il y a quelques années, la RTBF et la VRT échangeaient également des reportages sur une base régulière, mais cette pratique semble avoir périclité. La presse écrite, quotidienne ou hebdomadaire, publie parfois des dossiers suivis pendant plusieurs numéros sur des thèmes relatifs à l’autre communauté.
Pour M. Jean Quatremer, correspondant à Bruxelles de Libération, « la presse flamande est enfermée dans son espace et le débat politique est devenu local ». De nombreux interlocuteurs de la mission ont estimé que la nouvelle génération politique se connaît moins que la précédente et a de ce fait plus de difficultés à conclure des compromis inter-communautaires. M. Quentin Dickinson, correspondant à Bruxelles de Radio France International, estime que « les classes politiques se séparent » entre le monde francophone et le monde néerlandophone et que M. Yves Leterme, Premier ministre de 2007 à 2011, « appartient à la première génération de dirigeants qui n’a pas connaissance d’autre chose que de sa propre communauté » avant d’exercer des responsabilités au niveau fédéral (13). M. Jean-Pierre Stroobants, correspondant à Bruxelles du journal Le Monde, y voit l’explication de la position d’Yves Leterme, pour lequel il suffisait de « cinq minutes de courage politique » pour régler le dossier de « BHV » (14), ce qui, selon lui, était « le signe d’une méconnaissance totale du sujet et de sa portée ». On peut relever également que M. Alexander De Croo est devenu président de l’Open-VLD (parti libéral flamand) en 2009, à 34 ans, alors qu’il n’avait pas encore exercé de mandat électif.
Au-delà de l’effet générationnel, la mission doit aussi relever qu’il n’existe plus de parti politique national en Belgique : tous les partis nationaux se sont scindés en un parti francophone et un parti flamand, le parti social-chrétien en 1968, le parti libéral en 1971 et le parti socialiste en 1978. Sans même évoquer les conséquences de la transformation de la Belgique en État fédéral (15), les campagnes électorales pour les élections à la Chambre des représentants et au Sénat sont donc conduites par des partis différents auprès de populations différentes. M. Martin Buxant, chroniqueur politique à La Libre Belgique, indiquait à la mission : « ce n’est pas vraiment une forte incitation à rechercher par la suite des compromis ». Pour M. Charles Picqué, c’est même « un facteur de désunion ».
Même le sport ne semble plus en mesure d’assurer un lien entre les communautés flamande et francophone ; la mission ne fait pas ici référence à la passion des supporteurs, mais à l’organisation institutionnelle des activités sportives. De nombreuses fédérations ont été scindées pour donner naissance à une fédération flamande autonome. S’agissant du football, M. Bert Anciaux, ministre flamand des Sports entre 2004 et 2009, ancien président du parti régionaliste Volksunie de 1991 à 1998, avait lié l’octroi de subventions publiques flamandes à la formation ou aux infrastructures des clubs à une scission administrative de l’Union belge de Football. Une fédération flamande de football a effectivement été créée en novembre 2008, mais ne fédère que les clubs amateurs, les deux premières divisions, professionnelles, restant unifiées.
Plusieurs interlocuteurs de la mission ont attiré son attention sur le fait que la Belgique connaît une multitude de points de friction communautaires, qui conduisent depuis longtemps à cultiver un ressentiment réciproque.
Certains sont nés d’événements ponctuels qui ne s’effacent pas de la mémoire collective. La « grève du siècle », par exemple, a ancré en Flandre l’image d’une Wallonie revendicative et a ancré en Wallonie l’image d’une Flandre dont les syndicats sont frileux et peu attachés à la défense des intérêts des travailleurs.
À l’automne 1960, le gouvernement formé autour d’une coalition entre sociaux-chrétiens et libéraux affronte une situation économique difficile. La perte de la principale colonie – le Congo est devenu indépendant le 30 juin – a brutalement réduit les recettes budgétaires. Le gouvernement décide de prendre des mesures d’économie. Le cabinet dirigé par M. Gaston Eyskens s’accorde sur un paquet de mesures regroupées dans le projet de loi « d’expansion économique, de progrès social et de redressement financier », rapidement dénommé « Loi unique ». Ce texte restreint les pensions de retraite du secteur public, réforme l’assurance-maladie, accroît le contrôle des chômeurs et augmente la fiscalité indirecte, tout en accordant des aides fiscales aux entreprises. Censée neutraliser les diverses oppositions, la Loi unique les concentre et les attise. En décembre éclate la grève générale la plus massive de l’histoire belge, connue sous le nom de « Grève du siècle ».
La grève fut davantage suivie dans les bastions syndicaux de l’industrie lourde wallonne qu’en Flandre ou à Bruxelles, même si les régions de Gand et Anvers furent assez fortement touchées. Au sein même des syndicats, cette différence engendra de fortes tensions. De nombreux militants wallons de la Confédération des syndicats chrétiens – qui réprouvait publiquement la grève bien qu’elle critiquât la Loi unique – participèrent à la grève, en dépit des instructions de leur direction. La Fédération générale du Travail de Belgique, très liée au parti socialiste, se divisa entre ses sections wallonnes, qui s’unirent pour coordonner la grève, et ses sections flamandes, qui refusèrent d’appeler à la grève générale.
La crise dura cinq semaines, mobilisa près de 700.000 grévistes et donna lieu à près de 300 manifestations. Il y eut des signes de tension pré-révolutionnaire en Wallonie. De nombreux maires socialistes se déclarèrent solidaires des grévistes et refusèrent d’obéir aux ordres du gouvernement. A travers la région industrielle du Borinage (Hainaut), des barricades barraient l’accès à maintes localités. Plus de 18.000 gendarmes furent mobilisés pour démanteler les piquets de grève et prendre le contrôle des endroits stratégiques. L’armée vint renforcer la gendarmerie. Il y eut jusqu’à 15.000 soldats pour monter la garde devant les bâtiments industriels, les ponts et les tunnels, les gares et les bureaux de poste. La grève prit peu à peu un tour insurrectionnel. En Wallonie, les militaires durent se frayer un passage à travers les clous à trois têtes semés sur les routes, les arbres renversés, les blocs de béton, les voitures retournées et les grues renversées. Dans plusieurs villes, les rues furent dépavées. Le 6 janvier 1961, Liège connut des combats de rue pendant près de six heures, qui firent 75 blessés et deux morts. Le week-end suivant, des actes de sabotage furent commis dans les provinces de Liège et de Hainaut. On fit dérailler un train et il y eut des attaques contre les ponts et les lignes à haute tension. Quelque 3.000 soldats belges furent retirés d’Allemagne pour protéger les lignes de chemin de fer et les installations électriques importantes. Le 9 janvier, les forces de l’ordre commencèrent à arrêter les grévistes qui tenaient les piquets de grève en vue de prévenir toute tentative de révolte. Quelque 2000 grévistes furent appréhendés, dont près de la moitié furent condamnés à un mois de prison ou plus. (16)
De même, l’expulsion des étudiants francophones de l’université de Louvain, en 1968, aux cris de ‘Walen Buiten !’ (« les Wallons dehors ! ») des étudiants néerlandophones semble avoir causé un traumatisme toujours vivace chez nombre de responsables politiques francophones. L’université catholique de Louvain constituait, en 1968, l’un des derniers bastions francophones en Flandre. En 1963, une première tentative de néerlandisation avait échoué face à la résistance de l’épiscopat et du corps professoral. Au début de 1968, un projet d’extension de l’université présenté par la direction catholique ranima l’opposition flamande. Après une crise gouvernementale, l’université fut dotée des moyens nécessaires pour ouvrir un nouveau campus à Ottignies (ou Louvain-la-Neuve), ville située dans la région de langue française. Par la même occasion, Bruxelles se vit attribuer une université néerlandophone autonome (Vrije Universiteit Brussel) par le biais de la scission de l’Université libre de Bruxelles, et la Katholieke Universiteit Leuven resta à Louvain. L’homogénéité linguistique de la Flandre sortit renforcée de cette crise.
D’autres points de friction relèvent plutôt de processus au long cours qui exacerbent la sensibilité communautaire. Ainsi le regard de la Flandre sur la collaboration est jugé trop complaisant par les francophones, qui dénoncent le dépôt récurrent de propositions de loi d’amnistie au bénéfice des anciens collaborateurs et de leurs descendants. En mai 2011, le vote, par l’ensemble des partis flamands à l’exception du parti écologiste, de la « prise en considération » d’une telle proposition de loi déposée par le parti flamand d’extrême droite, le Vlaams Belang, alors que des propositions similaires n’avaient auparavant jamais franchi cette toute première étape du processus parlementaire, a déclenché une vive émotion, qui était toujours sensible lorsque la mission a réalisé son premier déplacement à Bruxelles au mois de juillet suivant.
Enfin, si les Flamands ont longtemps fait de l’accès aux emplois de la fonction publique, notamment ses emplois supérieurs, une priorité de leur combat communautaire, la situation semble aujourd’hui renversée. Les francophones dénoncent de plus en plus souvent la « flamandisation » de l’administration, qui prendrait la forme, d’une part, de la monopolisation par les néerlandophones des emplois supérieurs au détriment des francophones et, d’autre part, d’une orientation des implantations administratives privilégiant la Flandre. Le cas de l’armée est particulièrement sensible : la répartition linguistique des emplois de commandement serait déséquilibrée et, à la faveur de la réforme de l’armée, certaines infrastructures seraient fermées en Wallonie pour être concentrées en Flandre. Pour M. André Flahaut, président de la Chambre des représentants, ancien ministre de la Défense, « tout l’appareil de l’État est flamandisé, ce qui est le résultat d’une stratégie concertée mise en œuvre sous l’égide d’un parti dominant ».
C’est donc un panorama assez sombre que la mission a retiré de ses entretiens en Belgique, comme si les Flamands et les francophones n’avaient plus grand chose à se dire. Mais, si deux sociétés il y a, sont-elles réellement différentes ou simplement séparées ? Pour M. Paul Buysse, président du conseil d'administration de Bekaert, l’un des problèmes majeurs de la Belgique est la méconnaissance réciproque entre la Flandre et la Wallonie : l’image de l’autre n’est correcte chez aucun des deux partenaires. Certaines enquêtes sociologiques sur les « valeurs » des deux communautés suggèrent, par exemple, qu’il n’y a pas de différences radicales entre Flamands et Wallons et certainement pas plus qu’entre les Belges dans leur ensemble et les ressortissants de pays similaires. Il y a donc un risque à ne lire la société belge qu’à travers le prisme communautaire, comme composée par essence de Flamands et de francophones.
Le risque est grand que la méconnaissance et l’indifférence réciproques ne laissent le champ libre aux clichés réducteurs, voire erronés, et aux discours politiques différenciateurs. Il est vrai que l’on voit souvent fleurir des oppositions entre le Flamand, qui serait laborieux mais xénophobe, et le Wallon, qui serait accueillant, mais paresseux et assisté. Quant à la Wallonie dans son ensemble, elle serait plongée dans un clientélisme politique sclérosant. Cependant, pour M. Dave Sinardet, politologue, « les clichés d’aujourd’hui sont figés sur la base d’une réalité dépassée ». M. Jean Faniel, politologue au CRISP (Centre de recherche et d’information socio-politiques), disait à la mission que l’image du « chômeur à vie » wallon perdure en Flandre mais est largement devenue un « mythe ».
Dans ces conditions, le débat politique peut être largement confisqué par la problématique communautaire, qui se développe également sur le terreau des inquiétudes nées de la mondialisation. C’est ainsi que M. Herman De Croo, député, ancien président du parti libéral flamand Open-VLD, estimait que « plus la fenêtre du monde s’ouvre, plus les gens se mettent dans le coin de la pièce ; et dans le coin prêchent les nationalistes. »
C’est peut-être le paradoxe principal de la Belgique d’aujourd’hui : chacun se vit comme la « périphérie » d’un « centre » menaçant qui est « l’autre » : les Flamands craignent toujours la domination d’un « centre » francophone ; les Wallons se vivent comme une « périphérie » menacée par une Flandre prospère, égoïste et arrogante ; les Bruxellois redoutent un condominium Flandre-Wallonie sur leur ville. Usant pour sa part de la notion de « minorité », M. Herman De Croo disait à la mission : « il y a deux minorités dans le pays : une Flandre riche mais affligée d’un complexe d’infériorité, et une Wallonie pétrie d’un complexe de supériorité mais en voie d’appauvrissement ». Il est difficile de développer des relations sereines et de maintenir un esprit national dans un tel contexte d’inquiétude et de méfiance.
Si la mission a retiré une telle image de ses travaux, c’est parce qu’à l’origine de tout, on trouve bien évidemment le conflit linguistique, ancien et certainement en grande partie privé de fondement rationnel aujourd’hui, mais qui oriente encore les analyses et les réflexions, voire les réflexes. C’est pourquoi les ressorts de ce conflit linguistique doivent être présentés de façon détaillée.
2. Le conflit linguistique est aujourd’hui concentré sur des enjeux symboliques
On ne peut comprendre la Belgique d’aujourd’hui sans prendre la mesure du conflit linguistique qui oppose les néerlandophones et les francophones. Il s’agit d’un conflit fondateur de la Belgique contemporaine, à la fois parce qu’il remonte aux tout premiers temps du pays et parce que, sans épuiser tous les ressorts de son histoire, il traverse et nourrit celle-ci.
a) Un conflit fondateur dans l’histoire de la Belgique contemporaine
Lorsque les révolutionnaires de l’automne 1830 réussissent à chasser les troupes hollandaises, leur première préoccupation consiste à consolider l’unité du pays, tant que les Pays-Bas n’ont pas accepté l’indépendance, et à construire un nouvel État. Dans ce contexte, l’établissement du français comme langue nationale va de soi, tout comme la mise en place d’une politique de francisation de l’appareil de l’État.
Comme dans toute l’Europe occidentale, l’usage du français était déjà répandu au sein des élites (la Cour, l’aristocratie, le haut clergé, la haute bourgeoisie, les acteurs de la vie intellectuelle et artistique), y compris les élites flamandes. Le français, langue reine des Lumières, langue de culture et de prestige, est un ferment d’unification que les nouveaux dirigeants de la Belgique ne peuvent ignorer. Le français est aussi la langue de la modernité révolutionnaire, de la rupture avec l’Ancien régime, de la citoyenneté et de l’égalité. C’est l’un des moyens par lesquels les franges de la bourgeoisie qui doivent leur émancipation à la révolution – notamment avec l’occupation, puis l’annexion des Pays-Bas du Sud par la France – peuvent manifester leur différence de statut avec les classes moins haut placées sur l’échelle sociale. Le français, instrument d’intégration au sein de l’élite, devient un facteur de distinction sociale : il se crée alors une hiérarchie des langues entre, d’une part, le français et, d’autre part, les dialectes flamands et wallons.
Le français est également la langue de la résistance à l’hégémonie hollandaise, la langue de la lutte pour l’indépendance. C’est en fait dans le sillage des troupes françaises victorieuses à Fleurus (juin 1794) que le français est entré en politique en Belgique. La deuxième occupation, puis l’annexion françaises marquent la première tentative de mener une action délibérée pour promouvoir l’unité nationale par l’unité linguistique. C’est ainsi que le français est érigé en langue véhiculaire de l’enseignement secondaire et universitaire (pour ce dernier, en remplacement du latin) et imposé comme langue unique des procédures judiciaires ; en revanche, l’organisation d’un enseignement primaire laïc en français échoue par manque d’instituteurs francophones. La politique de francisation des élites est intensifiée par Napoléon Bonaparte Premier consul, puis empereur ; elle va d’ailleurs dans le même sens que la volonté de la bourgeoisie belge de se rapprocher des cercles du pouvoir. Comme l’indiquent Mme Witte et M. Van Velthoven : « La francisation poussée de l’appareil administratif et judiciaire résultait donc moins d’une politique française sévère que d’un choix manifeste des révolutionnaires locaux pour la nouvelle patrie » (17).
A la suite de l’unification des Pays-Bas du Nord et du Sud par le Congrès de Vienne, au sein du Royaume uni des Pays-Bas, Guillaume Ier souhaite également construire un État national. Comme les Français avant lui, il met l’usage d’une langue, le néerlandais, au service de ce projet. Deux objectifs sont fixés en ce sens : néerlandiser la partie flamande du pays et implanter le néerlandais en Wallonie, à Bruxelles et dans les zones linguistiques mélangées, notamment les communes situées le long de la limite géographique linguistique. Deux leviers vont être actionnés : les conditions d’usage de la langue officielle et l’enseignement.
En premier lieu, le néerlandais devient donc langue de l’administration et de la justice dans les quatre provinces flamandes ainsi que dans les arrondissements de Bruxelles et de Louvain à partir de 1823 (bien qu’à Bruxelles, le français soit toujours la langue véhiculaire) ; le français reste cependant langue officielle de l’administration et de la justice en Wallonie.
Pour qu’à terme sa politique linguistique réussisse, Guillaume Ier compte également sur les bénéfices d’un enseignement néerlandisé dans la partie flamande de la Belgique (à l’exception de l’enseignement supérieur, où le latin est rétabli comme langue universitaire). Le corps enseignant se professionnalise grâce à l’école normale de l’État créée à Lierre (province d’Anvers) en 1818, où tous les cours sont donnés en néerlandais. Le néerlandais devient la langue véhiculaire de l’enseignement primaire d’État, même si le français s’ajoute très rapidement comme cours complémentaire. L’enseignement secondaire est néerlandisé progressivement, par année scolaire, à partir de 1823, et le cours de néerlandais bénéficie d’autant d’heures que celui de français. Ces mesures, applicables à Bruxelles, y sont cependant mises en échec par la résistance des populations concernées, élite et classes moyennes, qui restent francophones de cœur et d’esprit. En Wallonie, l’enseignement secondaire doit également consacrer autant d’heures au néerlandais et au français – mais cette mesure est en fait peu respectée – tandis que, dans l’enseignement primaire, véritable priorité de Guillaume Ier, l’État organise des cours de néerlandais avec financement d’instituteurs flamands. Aucune école normale n’est implantée en Wallonie, l’objectif étant d’attirer les futurs instituteurs dans l’école unilingue de Lierre, donc, à terme, de disposer uniquement d’instituteurs néerlandophones dans toute la Belgique.
Cette politique linguistique, qui apparaît finalement plutôt équilibrée, semble n’avoir suscité qu’un intérêt très limité parmi des élites qui restaient essentiellement francophones. Dans l’opposition naissante à Guillaume Ier, la revendication linguistique ne joue d’ailleurs qu’un rôle minime ; ce n’est qu’à partir de 1829 qu’elle s’impose comme un catalyseur et un principe d’unification des revendications libérales et cléricales contre l’autorité orangiste.
Au lendemain de l’indépendance, les écoles, les administrations du gouvernement et des institutions locales, les tribunaux et les professions juridiques délaissent le « hollandais » au profit du français. Les lois du 19 septembre 1831 et 28 février 1845 établissent le français comme seule langue officielle et prévoient que les textes légaux seront, si nécessaire, accompagnés d’une traduction flamande (18). Dans l’État censitaire qui vient de naître, les 46.000 électeurs (moins de 1 % de la population totale) légitiment le monopole de l’occupation des postes importants par l’élite francophone. Tout patriote digne de ce nom doit accepter la prédominance du français comme langue culturelle et politique ; le principe de liberté linguistique est conçu moins comme une protection pour les citoyens qui ne connaîtraient pas la langue de l’administration à laquelle ils ont affaire que comme une licence permettant aux fonctionnaires de ne pas connaître la langue de la population qu’ils doivent administrer. La connaissance du français devient la condition sine qua non pour occuper des emplois élevés au sein de l’administration et pour y faire carrière.
Et si certains responsables politiques, ouvertement francophiles, voient la francisation de l’État comme la première étape vers une union avec la France (Charles Rogier, Premier ministre, écrit en 1832 à son ministre de la Justice : « Les efforts de notre gouvernement doivent tendre à la destruction de la langue flamande pour préparer la fusion de la Belgique avec notre plus grande patrie, la France »), d’autres y voient d’abord le moyen d’assurer l’unité d’un pays dont l’existence ne sera définitivement acceptée par les Pays-Bas qu’en 1839 (le baron de Stockmar, proche du roi Léopold Ier, affirme que « répandre l’usage du français, c’est consolider la nation belge et renforcer la cohésion interne du pays »).
Dans le même temps, la Flandre connaît un déclin économique profond, qui installe les dialectes flamands dans un statut de langue déclassée. Le chômage, la maladie et la faim poussent à une forte émigration, interne, des campagnes vers les villes, et externe, de la Flandre vers une Wallonie et un Nord de la France tirés par la révolution industrielle. Parler flamand, c’est faire partie d’une communauté pauvre et arriérée, c’est rester à l’écart des progrès intellectuels et sociaux, c’est être irrémédiablement confiné dans la masse inculte du peuple.
Il n’y a pourtant pas de glissement linguistique généralisé en Flandre à cette époque. D’une part parce que l’élite unitaire francophone n’a pas mené de politique systématique de francisation au-delà du cercle étroit des fonctions moyennes et supérieures de l’État et, en tout cas, certainement pas en direction de l’ensemble de la population, qui n’avait pas d’existence politique en raison du cens électoral ; d’autre part parce que, si les cours étaient dispensés en français dans l’enseignement secondaire et supérieur (au demeurant accessibles à une proportion très réduite de la population), les communes et les pouvoirs organisateurs de l’enseignement libre pouvaient décider eux-mêmes à partir de quelle année débutait l’enseignement du français dans l’enseignement primaire ou encore combien d’heures y étaient consacrées.
Dès les premiers temps de l’indépendance, les éléments du conflit linguistique sont donc en place : enjeux culturels, autour de l’opposition entre une langue de prestige et une langue « subordonnée », enjeux économiques, autour des possibilités ou des difficultés d’accès aux fonctions publiques offertes dans les institutions locales et centrales, enjeux sociaux, autour de l’intégration dans la classe dominante ou de l’exclusion de celle-ci. Par ailleurs, la période hollandaise a fait du néerlandais – certes la langue de l’occupant – une langue reconnue, protégée et officielle.
C’est sur ce terreau propice que naît le mouvement flamand, ensemble composite d’associations et d’individualités qui va lutter contre l’intransigeance linguistique des élites francophones (notamment bruxelloises) et œuvrer pour la reconnaissance de la langue flamande.
Le mouvement flamand a ses acteurs obscurs, organisateurs de congrès littéraires, promoteurs de pétitions ou philologues d’Anvers ou de Gand. Il a aussi ses porte-drapeaux, au premier rang desquels Henri (ou Hendrik) Conscience, qui écrit Le Lion des Flandres en 1838. Ce récit épique raconte la bataille des Éperons d’Or (1302) au cours de laquelle les milices communales flamandes, aidées de milices namuroises et zélandaises, défirent l’armée du roi de France commandée par Robert d’Artois. Il participe d’un « flamingantisme culturel » qui cherche à installer le néerlandais comme instrument de culture autonome et exalte la Flandre comme réalité géographique et historique. Ce même flamingantisme veut affirmer l’existence d’un peuple flamand conçu comme une communauté solidaire, dont la fierté peut faire pièce à la misère économique de la « pauvre Flandre ». Cette appropriation du passé, relecture audacieuse, s’inspire d’un nationalisme culturel romantique qui voit des peuples endormis sortir de leur léthargie et pour lequel la langue est l’âme du peuple.
Le flamingantisme culturel, pour limité que soit son objectif affiché, a une influence considérable sur les développements ultérieurs du mouvement flamand : il contribue en effet à créer une Flandre mythique, imaginée, dont les racines sont supposées plonger dans les profondeurs de l’histoire pré-belge, dont les contours sont bien plus larges que ceux de la Flandre historique, et dont l’existence putative heurte de plein fouet l’ambition unitaire des révolutionnaires de 1830. Et si la Flandre est ainsi censée avoir « préexisté » à la Belgique, le combat pour son émancipation n’en devient que plus légitime. C’est dans ce cadre qu’il faut entendre les propos de MM. Karl Vanlouwe, président de la commission des Affaires étrangères du Sénat, et Frank Boogaerts, sénateur, qui indiquaient à la mission que « dès l’origine du pays, la Flandre a dû se battre contre l’État francophone » ; mais comme l’a fait remarquer un autre interlocuteur de la mission, une telle vision relève en fait d’une « reconstruction historique ».
Le mouvement flamand naît donc pour lutter contre la situation d’oppression linguistique imposée par l’élite belge francophone. Mais cette notion d’oppression linguistique peut être lue de plusieurs manières. Il convient d’abord de rappeler qu’elle ne concerne que très peu l’immense masse de la population flamande, qui, enfant, ne termine que rarement la scolarité primaire (lorsqu’elle l’entreprend) et, adulte, n’a que d’infimes possibilités d’accéder aux fonctions publiques. Le mouvement flamand est essentiellement un mouvement de classes moyennes, une émanation de la petite bourgeoisie urbaine.
Dans sa dimension littéraire et culturelle, celle-ci veut établir (ou restaurer) le néerlandais dans un statut de langue reconnue et lutter contre le mépris ou l’indifférence dans laquelle le tient le monde culturel d’obédience francophone. Dans sa dimension sociale, elle veut gravir l’échelle des distinctions, notamment en accédant à l’emploi public, sans être gênée ou empêchée par les francophones issus des classes supérieures ou venus de Wallonie. Dans sa dimension politique – mais celle-ci apparaît plus tard, au tournant des années 1860 – elle veut lutter contre la suprématie des dynasties fransquillonnes qui monopolisent les instruments du pouvoir.
Le mouvement flamand n’est donc pas d’abord un mouvement anti-belge ou anti-wallon mais un mouvement d’émancipation culturelle et sociale essentiellement dirigé contre les élites flamandes francophones. A ses débuts, il manque de la base sociale nécessaire pour faire avancer ses revendications, mais l’élargissement progressif du droit de suffrage et du corps électoral lui donne les leviers dont il a besoin : une proportion croissante de la bourgeoisie est intégrée au corps politique et peut contester les positions acquises des fransquillons ; les aspirations flamingantes trouvent plus d’écho au sein des forces politiques.
• L’action des milieux flamingants donne ainsi naissance aux premières lois linguistiques. Le statut du français comme langue nationale n’est nullement compromis mais l’élite au pouvoir accepte de ne plus priver de leurs droits linguistiques élémentaires les quelque trois millions de personnes qui parlent uniquement le flamand. En 1873, la toute première loi linguistique permet d’user du néerlandais dans tout procès pénal organisé devant les tribunaux sis en Flandre. Suit en 1878 une loi sur l’usage des langues dans l’administration, qui se borne en fait à régler les contacts entre l’administration centrale et les particuliers et administrations néerlandophones après que la proposition de loi initiale – qui visait à faire prévaloir la liberté linguistique du citoyen sur celle du fonctionnaire – a été largement édulcorée au cours du processus parlementaire (19). Le bilinguisme acquiert également ses lettres de noblesse par le biais des emprunts d’État (1885), des pièces de monnaie (1886), des billets de banque (1888), des timbres postaux (1891), du Moniteur (1895), etc…
Mais les lois linguistiques souffrent de limites et de difficultés d’application : dans le domaine judiciaire, aucun progrès n’est consenti en matière de procédure civile ou commerciale ; les pyramides administratives francophones opposent une résistance sérieuse à la mise en œuvre des dispositions votées par le Parlement ; l’armée reste imperméable à toute ébauche de bilinguisme. Très vite, les flamingants comprennent que la lutte contre la prédominance du français dans l’administration et la réduction des résistances internes francophones passent par une rupture avec le fondement unilingue français de l’enseignement en Flandre. En 1883, un premier pas est accompli avec l’adoption d’une proposition de loi qui prévoit que, dans l’enseignement secondaire public, outre les cours de néerlandais et l’utilisation de cette langue pour l’initiation à l’allemand et à l’anglais, le néerlandais devient la langue véhiculaire des cours d’histoire-géographie et de sciences naturelles. Cette loi de 1883, assortie de facilités pour tenir compte de la présence d’importants cercles de fonctionnaires wallons dans de nombreuses villes flamandes – facilités qui furent source de nombreux « détournements » – ouvre la voie à des revendications pour sa généralisation à l’enseignement supérieur et à l’enseignement secondaire catholique (le plus important à l’époque).
L’introduction du suffrage universel plural (20), en 1893, multiplie par dix le nombre total d’électeurs, qui passe de 100.000 à un million environ. En Flandre, des centaines de milliers de personnes ne connaissant pas le français ont pour la première fois le droit de voter. Le flamand devient une langue de propagande politique, un enjeu électoral, et le mouvement flamand acquiert une base sociale massive. La « loi d’égalité » est adoptée en 1898 : elle établit le néerlandais, appelé « flamand », comme seconde langue officielle de la Belgique. En 1899, le passage du scrutin majoritaire au scrutin proportionnel oblige à la constitution de coalitions, affaiblit les gouvernements et ouvre ainsi un espace parlementaire aux revendications flamingantes. En conséquence, le processus d’approfondissement des lois relatives à l’usage de la langue se poursuit au début du XXe siècle : le régime linguistique dans l’armée connaît un lent équilibrage, avec notamment des lois adoptées en 1915, 1917 et 1928 (21) ; la néerlandisation de l’université d’État de Gand est acquise en 1930 (après sa « bilinguisation », votée en 1923) ; le régime linguistique de l’enseignement primaire et secondaire privé et public est réglé par la loi Segers-Franck (1910) et la loi du 14 juillet 1932.
• Les années qui précèdent la Première guerre mondiale voient également le combat engagé par le mouvement flamand changer de dimension : face aux difficultés rencontrées pour faire adopter, mais surtout pour faire appliquer correctement, les lois relatives à l’usage de la langue, une nouvelle revendication, axée sur la recherche d’une plus grande homogénéité linguistique territoriale, commence à se faire jour. Elle va rencontrer les intérêts des Wallons, qui se sentent de plus en plus menacés par l’extension du néerlandais.
Cette nouvelle phase du conflit linguistique peut être vue comme articulée en trois temps. Dans un premier temps, au tout début du XXe siècle, le gouvernement conduit par le parti catholique craint que la « flamandisation de la Flandre » (en fait, l’expansion du bilinguisme en Flandre) ne constitue une menace pour l’unité du pays. Entre 1906 et 1909, il prend alors plusieurs initiatives pour développer une forme de bilinguisme national, ce qui implique de rendre obligatoire la connaissance du néerlandais en Wallonie, ainsi que son usage dans un cadre officiel, notamment pour les relations entre les administrations et les minorités flamandes. Ces projets suscitent une opposition virulente des milieux administratifs wallons ; les flamingants, désireux de s’assurer de l’appui wallon pour pousser leurs propres exigences centrées sur la Flandre, renoncent alors à toute revendication linguistique portant sur la Wallonie, tant dans le domaine de l’administration que de celui de l’enseignement. La logique d’homogénéité linguistique territoriale vient d’apparaître.
Dans un deuxième temps, cette logique trouve à se concrétiser dans les grandes lois linguistiques de 1921 et 1932, qui engagent la marche vers l’unilinguisme régional. La loi du 31 juillet 1921 sur l’emploi des langues en matière administrative est la première qui s’applique dans toute la Belgique en vertu de droits et obligations égaux pour tous. Fondée sur le principe selon lequel la langue de l’administration locale (communale ou provinciale) est la langue de la région, elle donne pour la première fois une substance juridique forte à la notion de « frontière linguistique ». Elle offre cependant aux minorités des mécanismes de protection : l’organe délibérant peut décider d’instaurer l’autre langue nationale comme seconde langue de service ; les avis et communications à l’extérieur doivent être rédigés dans les deux langues si 20 % des électeurs en formulent la demande (ce qui est le cas dans de nombreuses communes flamandes) ; la langue administrative peut être changée si les résultats du recensement montrent que la minorité linguistique est devenue majorité. Pour leur part, les communes du Brabant et de l’agglomération bruxelloise peuvent choisir librement la langue interne et externe de leur administration (22) (ce qui revient à y légitimer l’usage exclusif du français) ; au demeurant, Bruxelles-ville absorbe trois communes flamandes et l’agglomération bruxelloise est élargie à seize communes. Le bilinguisme est introduit dans les administrations centrale et bruxelloise : les candidats fonctionnaires doivent montrer une connaissance de la langue nationale autre que leur langue maternelle, variable selon le niveau de l’emploi postulé ; les agents de l’administration centrale doivent utiliser la langue de la région pour les relations avec le public.
La loi du 28 juin 1932 sur l’emploi des langues en matière administrative renforce l’homogénéité linguistique territoriale : dans les administrations locales, la possibilité d’établir une seconde langue de service est supprimée et le quota nécessaire pour passer au « bilinguisme externe » (dans la communication avec les usagers) passe de 20 % à 30 % ; dans l’administration centrale, le principe devient le bilinguisme du service fondé sur l’unilinguisme des fonctionnaires ; ceux-ci doivent donc être inscrits sur des rôles linguistiques, entre lesquels il convient d’établir un équilibre numérique « équitable » ; au sommet de la hiérarchie administrative, des adjoints bilingues doivent être rattachés aux fonctionnaires dirigeants francophones unilingues.
Il est dit, parfois, que les Wallons portent une responsabilité écrasante dans la séparation progressive des Flamands et des francophones, parce qu’ils auraient refusé, en 1921 puis en 1932, que la Belgique s’engage dans un bilinguisme généralisé et qu’ils l’auraient donc empêchée de réaliser le brassage culturel permettant que la question linguistique devienne secondaire. Une vision nuancée semble plus appropriée : au sortir de la Première guerre mondiale, le mouvement flamand s’est trouvé divisé entre les « minimalistes », qui prônent la néerlandisation de la Flandre et le bilinguisme de l’administration centrale dans le cadre d’un État unitaire, et les « maximalistes », qui prônent le fédéralisme. Les lois de 1921 et 1932 traduisent en fait un compromis entre les cercles francophones bruxellois et wallons et les « minimalistes » flamands, dont les objectifs divergent – les premiers veulent éviter de léser les francophones unilingues et d’officialiser l’existence de minorités linguistiques en Wallonie, les seconds veulent améliorer l’application des lois linguistiques en Flandre – mais dont les intérêts se rencontrent autour de l’implantation souhaitable d’un unilinguisme régional.
Les lois de 1921 et 1932 laissent ouverte une brèche dans le principe de territorialité de l’usage de la langue : le statut linguistique des communes (23) est à la merci des recensements décennaux, dont les résultats peuvent faire apparaître des minorités suffisantes pour exiger la mise en œuvre des mécanismes de protection reconnus par ces lois, voire pour faire basculer totalement le régime linguistique de l’administration communale. Le recensement de 1947 – dont les résultats ne sont connus qu’en 1954 – montre une nouvelle poussée francophone dans les zones limitrophes de la frontière linguistique (24), y compris la périphérie de Bruxelles, et amène le mouvement flamand à revendiquer désormais la fixation définitive de cette frontière. C’est le troisième temps de la lutte pour l’homogénéité linguistique territoriale (25).
L’agenda politique des années 1950 étant essentiellement consacré à la question scolaire, c’est au tournant des années 1960 que la question linguistique revient sur le devant de la scène, le travail législatif ayant été préparé par le centre d’études Harmel, créé au milieu des années 1950 par le catholique francophone Pierre Harmel pour examiner la problématique communautaire de façon dépassionnée, en tenant compte des attentes de l’ensemble des parties prenantes. A la suite de plusieurs actions mobilisatrices (26), le volet linguistique du recensement est supprimé en 1961. La loi du 8 novembre 1962 fixe la limite entre la Wallonie francophone et la Flandre néerlandophone ; elle transfère une cinquantaine de communes entre la Wallonie et la Flandre et fixe définitivement un statut unilingue pour près de 80 communes flamandes et 80 communes wallonnes ; elle crée la région linguistique germanophone. Sur la base du « compromis de Val Duchesse » (juillet 1963), la loi du 2 août 1963 fixe les limites de l’agglomération bruxelloise, élargie à 19 communes, et prévoit l’introduction d’un régime de « facilités linguistiques » pour les habitants francophones de six communes de la zone périphérique du Brabant flamand : Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem ; le même régime est mis en place pour dix communes situées le long de la frontière linguistique (6 communes en Flandre avec facilités en français et 4 communes en Wallonie avec facilités en néerlandais) ainsi que pour la plupart des communes de la région germanophone, avec facilités en français et / ou en néerlandais.
En 1963, la géographie politico-linguistique de la Belgique est donc définitivement arrêtée : le pays compte quatre régions linguistiques (la région de langue néerlandaise, la région de langue française, la région de langue allemande et la région bilingue de Bruxelles) dont les limites sont figées ; hors la région bilingue de Bruxelles, le principe de l’unilinguisme régional (principe de territorialité) est acquis, en totalité pour les relations entre le citoyen et l’administration, en partie pour l’enseignement ; ce principe est cependant limité au profit de certaines minorités, grâce au régime des facilités dont l’étendue géographique est précisément déterminée par la loi.
Avec la scission de l’université de Louvain en 1968 et les nouveaux progrès enregistrés dans le rééquilibrage linguistique de l’administration, on peut considérer que deux objectifs majeurs du mouvement flamand ont été réalisés au tournant des années 1970 ; celui-ci va alors se concentrer sur le développement de l’usage du néerlandais dans la vie quotidienne (enseignement, sciences, médias, etc.). Pour sa part, le conflit linguistique se focalise désormais sur certains enjeux symboliques.
b) Les enjeux d’aujourd’hui ont une forte portée symbolique
M. Christian Laporte a rapporté à la mission qu’à partir de la fin des années 1960, le conflit linguistique se cristallise sur Bruxelles et la périphérie bruxelloise, ainsi que sur le transfert à la Flandre des six communes des Fourons. Ce dernier sujet étant réglé à la fin des années 1980, ne subsiste plus aujourd’hui dans le débat public que la situation dans et autour de Bruxelles : le dossier de la scission de l’arrondissement « BHV » (Bruxelles-Hal-Vilvorde), la situation dans les communes à facilités de la périphérie bruxelloise et le bilinguisme à Bruxelles.
En fixant la frontière linguistique, la loi du 8 novembre 1962 transfère à la province du Limbourg, province flamande, six communes des Fourons dans lesquelles vit une forte proportion de francophones (51,8 % des habitants s’étaient déclarés francophones au recensement de 1947). Ces communes avaient toujours appartenu à la province de Liège, avec laquelle elles entretenaient des liens socio-économiques étroits. Le transfert aurait été décidé en « contrepartie » du glissement vers la Wallonie des communes de Comines et Mouscron, situées dans l’ouest du pays. Fourons comme Comines-Mouscron constituent des enclaves géographiques, respectivement flamande à l’intérieur de la région wallonne et wallonne à l’intérieur de la région flamande. A la suite du transfert, des manifestations à Liège et dans les Fourons exigent leur retour au sein de la province liégeoise.
Durant vingt ans, l’électorat des Fourons reste stable : 60 % pour la liste francophone prônant le « Retour à Liège » et 40 % pour la liste flamande. L’organisation et le financement de l’enseignement francophone servent de terreau à l’émergence d’une conscience politique forte. En 1968, confronté à une crise persistante, le gouvernement imagine la création d’un canton autonome des Fourons sous la tutelle directe du ministre de l’Intérieur ; un projet de loi est déposé en 1972, mais le Conseil d’État s’y oppose car il contrevient au principe de territorialité linguistique dans la région de langue néerlandaise. Le débat se radicalise dans les années 1970, avec notamment des « promenades flamingantes » soutenues par l’extrême droite flamande.
Aux élections communales de 1982, la liste « Retour à Liège » obtient 62 % des suffrages et 10 des 15 sièges du conseil communal. Celui-ci propose à l’autorité de tutelle la candidature de M. José Happart aux fonctions de bourgmestre. En raison de son militantisme francophone, cette candidature apparaît d’emblée compromise et le gouvernement, après avoir envisagé de transférer la commune au Brabant, retient un « compromis à la belge » : J. Happart sera nommé bourgmestre, mais entrera en fonction avec un an de retard, le 1er janvier 1984. Le Conseil d’État est saisi de requêtes visant à faire annuler la nomination du Fouronnais pour non-respect de la loi sur l’usage des langues dans l’administration : J. Happart n’aurait pas prouvé qu’il parle le flamand. L’arrêt est rendu en septembre 1986 : devenu entre-temps député européen, le candidat-bourgmestre ne peut être bourgmestre, ni même échevin. Commence alors ce que l’histoire retiendra sous le nom de « carrousel fouronnais », qui tournera à sept reprises entre octobre 1986 et octobre 1987 : le collège échevinal (francophone) démissionne puis organise sa réélection ; J. Happart est désigné premier échevin ; en vertu de la loi communale, il fait fonction de bourgmestre ; il est suspendu par sa tutelle ; le collège démissionne, puis est réinstallé… Incapable de dégager en son sein un compromis sur les Fourons, la coalition gouvernementale tombe le 14 octobre 1987. Lors des élections communales d’octobre 1988, la liste flamande progresse, mais J. Happart triomphe avec plus de 1.000 voix de préférence. Le parti socialiste convainc alors J. Happart de céder son écharpe en échange de compensations politiques (délibérations du collège échevinal en français, commissaire d’arrondissement adjoint francophone) qui font l’objet d’un accord de gouvernement le 28 décembre. Les crises des Fourons ont perturbé la vie politique de la Belgique pendant plus de vingt ans.
• La mission a été particulièrement impressionnée par les crispations observées autour du dossier « BHV », qui revêt une extraordinaire dimension passionnelle.
Dès l’indépendance, la loi électorale a identifié au sein de la province (alors unique) de Brabant un « district électoral » de Bruxelles correspondant au territoire actuel de BHV. Lors de la négociation des lois de 1962 et 1963, le maintien de la circonscription électorale BHV a été concédé par les Flamands afin d’arracher aux francophones le principe même de la fixation définitive de la frontière linguistique. La province de Brabant, faite d’arrondissements situés dans trois régions linguistiques différentes, subsistait également. La réforme institutionnelle de 1993 l’a cependant scindée et a créé la province de Brabant wallon, située en région francophone, et la province de Brabant flamand, située en région néerlandophone ; BHV a été maintenu. Par un arrêt du 22 décembre 1994, la Cour constitutionnelle a considéré que le maintien de BHV n’était pas contraire à la Constitution, car, d’une part, le dispositif attaqué poursuit un objectif légitime, en procédant « d’un choix dicté par le souci d’un compromis global dans le cadre duquel l’indispensable équilibre a été recherché entre les intérêts des différentes Communautés et Régions au sein de l’État belge », et, d’autre part, il n’emporte pas d’effets manifestement disproportionnés à l’égard des électeurs et des candidats flamands dans la province.
La coalition gouvernementale arrivée au pouvoir en 1999 a inscrit à son programme la provincialisation des circonscriptions électorales pour la Chambre des représentants. Pour ce faire, la circonscription BHV devrait être scindée afin d’agglomérer les arrondissements de Hal-Vilvorde et de Louvain, éléments constitutifs de la province de Brabant flamand. La loi du 13 décembre 2002 consacre en fait un système original, qui évite la scission et repose sur une construction complexe : des listes flamandes identiques seront présentées aux suffrages dans les deux circonscriptions de BHV et de Louvain, les voix obtenues par ces listes étant additionnées pour la dévolution des sièges du côté flamand. Cette solution permet aux électeurs flamands de BHV d’avoir des droits similaires à ceux des autres électeurs de la province de Brabant flamand. Ce dispositif revient à effectuer une « scission » de BHV par le droit de suffrage plutôt que par le territoire.
La loi est contestée devant la Cour constitutionnelle, qui rend un arrêt complexe le 26 mai 2003. Sans expliquer clairement pourquoi sa jurisprudence de 1994 ne serait plus susceptible de justifier le maintien de BHV, la Cour juge, en effet :
– que le système électoral mis en place par la loi du 13 décembre 2002 pour BHV et le Brabant flamand est contraire aux principes d’égalité et de non-discrimination ; la Cour annule donc les dispositions concernées ;
– que la loi du 13 décembre 2002, amputée du dispositif annulé, établit une différence de traitement injustifiée entre les candidats de la province du Brabant flamand et les candidats des autres provinces ; la Cour décide alors que le dessin des circonscriptions électorales, dans le dispositif subsistant de la loi, ne peut être maintenu au-delà de l’échéance légale de la législature en cours (soit juin 2007).
L’interprétation de l’arrêt de la Cour divise les juristes : du côté néerlandophone, il est admis que la Cour entend obliger le législateur à scinder BHV et à conférer au Brabant flamand un statut identique à celui des autres provinces ; du côté francophone, l’avis est plutôt que le législateur doit se saisir à nouveau des motifs pour lesquels les statuts de BHV et du Brabant flamand pourraient rester différents du reste du pays. Consultée, la section de législation du Conseil d’État, statuant en assemblée générale, se rallie à la position flamande. En 2007 puis 2009, les deux co-présidents (flamand et francophone) de la Cour constitutionnelle prennent position publiquement sur la portée de l’arrêt, dans des sens contraires…
Après plusieurs années de débats, il apparaît que l’arrêt de la Cour peut être lu comme :
– obligeant à une scission de la circonscription BHV et au rattachement de l’arrondissement Hal-Vilvorde au Brabant flamand, si le législateur maintient la réforme instaurant la provincialisation des circonscriptions électorales ;
– permettant le maintien de la circonscription BHV si, au contraire, le législateur décide de revenir sur la réforme de 2002 ;
– permettant, en tout état de cause, le maintien de la circonscription BHV pour les élections non concernées par la loi de 2002, à savoir les élections sénatoriales et les élections européennes.
Les conséquences politiques de l’arrêt de la Cour sont majeures : BHV devient un point de fixation des projets de réforme institutionnelle et des accords de gouvernement, ainsi qu’un abcès permanent dans les relations entre Flamands et francophones.
Pour les premiers, l’existence de la circonscription BHV fait perdurer un lien politique entre les francophones de l’arrondissement flamand Hal-Vilvorde (« HV ») et la population francophone bruxelloise, puisque tous peuvent voter pour des listes identiques. Cela est vu par les Flamands comme permettant de conforter les francophones de Flandre dans leur identité francophone et favorisant leur refus de s’intégrer en n’adoptant pas la langue néerlandaise, langue officielle de la partie « HV » de la circonscription. M. Rik Torfs assurait ainsi à la mission que « BHV est l’exemple typique de l’impérialisme francophone ». Scinder BHV est donc indispensable pour écarter tout élargissement de Bruxelles et assurer l’assimilation linguistique des francophones de Flandre.
Pour les seconds, au contraire, le maintien de BHV est essentiel pour garantir la préservation des droits politiques des francophones de « HV », installés en Flandre, et pour maintenir ouverte l’option d’un élargissement de Bruxelles. De plus, l’existence de BHV permet aux candidats francophones bruxellois de « capter » les voix des francophones habitant « HV », soit 100.000 à 150.000 personnes (sur les 530.000 habitants de l’arrondissement Hal-Vilvorde).
• Les communes à facilités de la périphérie bruxelloise sont également une source récurrente de tensions communautaires. Dans les communes à facilités, l’administration locale travaille dans une seule langue mais utilise deux langues dans ses relations avec le public : les avis et communications destinés au public se font dans les deux langues ; les usagers peuvent obtenir les documents administratifs dans la langue de leur choix ; le régime des facilités constitue donc une exception au principe général selon lequel les relations entre les usagers et l’administration se font obligatoirement dans la langue de la région.
Une ambiguïté fondamentale entoure le régime des facilités. Pour les Flamands, les facilités ne sont que des mesures temporaires consenties, lors de la fixation de la frontière linguistique, afin de faciliter l’intégration future des allophones dans des territoires dont la vocation néerlandophone est irréversible. Pour les francophones, au contraire, les facilités sont des mesures tendant à préserver les droits linguistiques de minorités, la liberté linguistique étant au nombre des libertés individuelles garanties par la Constitution.
Dans la même perspective, les Flamands considèrent que les facilités, aménagements dérogatoires au principe de territorialité, doivent recevoir une interprétation restrictive et ne peuvent en aucun cas déboucher sur l’instauration d’un bilinguisme déguisé dans les communes concernées. Les francophones considèrent que le régime des facilités est défini par la loi et ne peut recevoir de restrictions de la part des autorités flamandes.
Les Flamands cherchent en fait à circonscrire le phénomène dit de la « tache d’huile francophone », à savoir l’augmentation des populations francophones en périphérie de Bruxelles, qui résulte de multiples facteurs, comme l’aspiration des classes moyennes et supérieures à quitter l’agglomération centrale bruxelloise au profit d’un habitat plus éloigné mais offrant un cadre de vie plus agréable. Cependant, selon M. Pascal Delwit, professeur de science politique à l’Université libre de Bruxelles, il est faux de dire qu’un flux de francophones envahirait la périphérie bruxelloise ; M. Dave Sinardet estime, pour sa part, qu’il est plus juste de parler de « dé-néerlandisation » que de francisation de la périphérie. Il faut noter que l’expression même de « périphérie de Bruxelles » est contestée par certains flamingants comme établissant un lien indu entre la région bilingue de Bruxelles-Capitale et des territoires indubitablement et définitivement flamands.
Au nom de la lutte contre le détournement des facilités vers un bilinguisme déguisé, M. Leo Peeters, alors ministre régional flamand de l’Intérieur, a publié en 1997 une circulaire prévoyant que l’administration locale doit envoyer ou présenter systématiquement les documents publics en néerlandais et que lorsqu’un francophone entre en relation avec elle, il doit expressément demander que les documents lui soient délivrés en français ; la circulaire Peeters interdit donc aux usagers d’être identifiés une fois pour toutes comme « francophones » auprès des services locaux. Les francophones dénoncent cette circulaire comme instaurant des tracasseries administratives discriminatoires. D’autres circulaires sont également contestées, comme celle qui prévoit que les délais de paiement courent depuis l’envoi du document officiel en néerlandais, et qui réduit donc les délais dont disposent les usagers francophones pour s’acquitter de leurs dettes auprès des services publics locaux, puisqu’il leur faut demander le document en français et attendre de l’avoir reçu.
Les autorités flamandes, qui exercent la tutelle des institutions locales (communes et provinces), considèrent aussi que celles qui enverraient directement des documents en français aux francophones commettraient une faute susceptible de recevoir une sanction. C’est à ce titre que les bourgmestres des communes de Linkebeek, Wezembeek-Oppem et Kraainem, dont la candidature a été proposée par le collège échevinal à la suite des élections communales de 2006, n’ont toujours pas été nommés par le ministre flamand de l’Intérieur. Il leur est reproché d’avoir envoyé aux électeurs de leur commune « réputés francophones » les convocations électorales directement en français. Les bourgmestres auraient également toléré l’usage du français pendant les séances du conseil communal alors que le néerlandais est la seule langue autorisée. Le Congrès des pouvoirs locaux du Conseil de l’Europe a été amené à se pencher sur le sujet en 2008, à travers une « visite d’enquête ». Les deux co-rapporteurs ont estimé, dans leur rapport final, que « cette visite a mis en évidence cinq manquements à la Charte européenne de l’autonomie locale qui sont : le trouble dans la gestion des affaires publiques causé par la non-nomination de trois maires pourtant démocratiquement élus ; une entrave à la participation à la vie politique locale du fait de l’interdiction, en application de la loi, de l’usage du français par le bourgmestre et les échevins, dans des communes dites « à facilités » et composées majoritairement de francophones ; un problème de proportionnalité de la décision de non nomination par rapport aux fautes reprochées aux maires ; une tutelle excessive exercée par les autorités flamandes ; et le non-respect de la recommandation 131 (2003) » sur la démocratie locale en Belgique, qui, notamment, recommandait aux autorités belges de préférer l’élection des bourgmestres par le conseil municipal ou par les citoyens à leur nomination par l’exécutif.
M. André Flahaut indiquait pour sa part à la mission que la non-nomination des trois bourgmestres était constitutive d’un « déni de démocratie » révélateur de la volonté de la Flandre de « faire prévaloir sa supériorité démographique », tout comme l’était, d’ailleurs, le refus de la Flandre de ratifier la convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la protection des minorités nationales.
• Si la situation de Bruxelles n’est pas aussi troublée que celle des trois communes à facilités susnommées, elle n’en est pas moins un sujet important de tensions communautaires. Personne ne conteste que Bruxelles est une agglomération dont la très grande majorité des résidents est francophone. Cependant, des incertitudes subsistent, qui donnent prise à des polémiques dont l’enjeu est, finalement, la place du néerlandais au sein des institutions bruxelloises (27).
C’est, par exemple, M. Philippe Van Parijs, professeur à l’Université catholique de Louvain, qui invitait la mission à considérer avec nuances la notion de « francophone à Bruxelles » dès lors que dans l’agglomération, un tiers de la population serait étrangère, un tiers serait constitué de Belges d’origine étrangère et un tiers seulement de « belgo-Belges ». La proportion des néerlandophones est généralement estimée à 10 % environ (soit un peu plus de 100.000 personnes), mais selon une étude réalisée par deux anciens démographes de l’Université catholique de Louvain et publiée en juillet 2010 (28), les néerlandophones ne représenteraient qu’un peu plus de 5,3 % de la population. Pour sa part, la Communauté flamande a défini un groupe-cible de 300.000 personnes (soit un peu moins de 30 % de la population) pour ses politiques linguistiques et culturelles, cette population-cible regroupant les néerlandophones proprement dits ainsi que les personnes susceptibles d’utiliser les services proposés par la Communauté.
Au-delà de ces incertitudes chiffrées, des problèmes concrets relatifs au bilinguisme des institutions bruxelloises sont mis en avant tant par les Flamands que par les francophones. Les Flamands dénoncent une piètre maîtrise du néerlandais par les services publics ; dans les hôpitaux et les services d’urgence, par exemple, il y aurait trop peu de médecins et d’infirmiers capables de s’adresser en néerlandais aux personnes hospitalisées ; certains services publics ne respecteraient pas, délibérément, les obligations posées par la loi en matière de recrutement équilibré de personnel. La plupart des problèmes rencontrés s’expliquent, en fait, par la difficulté des services publics à trouver du personnel bilingue ; la mission a eu connaissance des efforts entrepris par les services de santé, qui ont mis en place, il y a quelques années, un « plan langues » dont le champ d’application dépasse d’ailleurs le seul face-à-face entre français et néerlandais en raison de la vocation internationale de Bruxelles. L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe s’est saisie du sujet en 2005. Le rapport présenté dans ce cadre propose plusieurs recommandations aux représentants politiques des communautés linguistiques dans la région de Bruxelles-Capitale, comme le développement de l’offre de personnel bilingue dans les hôpitaux publics bruxellois, la mise en place de personnel bilingue dans les services d’accueil ou encore le renforcement des efforts pour mieux accueillir les patients néerlandophones ; surtout, le rapport relativise l’importance des inconvénients susceptibles d’être rencontrés par les néerlandophones en relevant que, sur la période 1996-2003, neuf plaintes seulement ont été déposées devant les organes de contrôle de la législation linguistique ; il met aussi en évidence les efforts réels entrepris par les responsables des établissements de santé pour assurer dans les meilleures conditions possibles la conciliation entre les exigences légales sur l’emploi des langues et la continuité non moins indispensable du service public de la santé.
La situation des tribunaux bruxellois génère, pour sa part, de réels problèmes de qualité du service public de la justice. Ces tribunaux doivent respecter deux obligations : d’une part, les deux tiers de l’ensemble des magistrats doivent justifier de la connaissance des deux langues, indépendamment du rôle linguistique sur lequel ils sont inscrits ; le vivier des magistrats bilingues étant trop étroit, 20 % à 30 % des postes sont vacants ; d’autre part, interdiction est faite aux magistrats de siéger dans une autre langue que celle dans laquelle ils ont obtenu leur diplôme ; or, la très grande majorité des dossiers devant être traitée en langue française, compte tenu de la répartition linguistique de la population bruxelloise, le système judiciaire à Bruxelles génère un immense arriéré de dossiers de langue française. Cette situation donne lieu à de nombreuses prises de position des personnels politiques bruxellois ou nationaux.
• La présentation des tensions linguistiques ne serait pas complète sans évoquer des sujets délicats qui ont été portés à la connaissance de la mission, parce qu’ils touchent très directement à la non-discrimination et à l’usage des langues dans la sphère privée.
Tout d’abord, le gouvernement flamand a adopté, en décembre 2006, un décret modifiant le code du logement et prévoyant, pour l’accès à un logement social, que les candidats-locataires doivent être en mesure de prouver, au moment de leur inscription dans le registre des candidats locataires, au moment de l’octroi d’un logement social et tout au long du contrat de location, leur disposition à apprendre le néerlandais ; le texte n’impose pas la maîtrise d’un certain niveau de langue, mais son exposé des motifs fixe comme cible le niveau A1 du Cadre européen commun de référence du Conseil de l’Europe, le plus modeste ; des leçons de néerlandais peuvent être dispensées gratuitement dans ce but. L’avant-projet de décret prévoyait plusieurs sanctions du non-respect de cette obligation, dont la possibilité de résilier le bail, mais aussi des amendes pénales, des peines de travail ou des peines de prison. A la suite de son examen par le Conseil d’État, les sanctions ont été limitées à des amendes administratives. Plusieurs organisations internationales se sont émues de ce texte ; ainsi, le Comité des droits de l’homme de l’ONU, dans le cadre de l’examen des rapports soumis par les États membres sur le fondement de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a pris la position suivante : « Le Comité juge préoccupant que l’accès à certains droits énoncés dans le Pacte puisse être entravé du fait des décisions prises par les autorités communales de Flandre portant, notamment, sur l’achat de terrains communaux, l’accès aux services et au logement, la jouissance de certaines prestations sociales ainsi que l’exercice du droit d’être élu, et exigeant la connaissance ou l’apprentissage du néerlandais, ce qui crée une discrimination à l’égard d’autres catégories de la population. » (29)
Les autorités flamandes rejettent ces critiques et affirment que les mesures contestées n’ont d’autre but que d’instaurer des discriminations positives propres à assurer une « émancipation sociale supplémentaire », selon les propos tenus au journal Le Soir, en juin 2008, par M. Marino Keulen, alors ministre flamand des Affaires intérieures.
La mission a également eu connaissance de polémiques autour de contraintes que certaines communes flamandes situées en périphérie de Bruxelles ont voulu apporter à l’usage des langues dans la sphère privée. Il s’agissait soit de restrictions à l’affichage en français sur les marchés publics, soit d’invitations adressées aux citoyens pour informer les autorités communales d’infractions supposées à la législation linguistique. Les autorités régionales flamandes se sont désolidarisées de certaines de ces initiatives, contraires au principe constitutionnel de liberté linguistique. Certains des interlocuteurs francophones de la mission ont fait part de leur émotion face à ce qui peut apparaître comme des appels à la délation linguistique.
Et lorsqu’on apprend que certaines communes flamandes (Zaventem, Vilvorde, Zemst) réservent l’acquisition de terrains à bâtir communaux à des néerlandophones ou que telle autre (Hoeilaart) conditionne l’acquisition d’un logement dans un lotissement social à la connaissance – et non plus seulement la démonstration de la volonté d’apprentissage – du néerlandais, on ne peut s’empêcher de se demander si ces mesures ont pour seul objectif de favoriser la bonne intégration des postulants au sein de la société ou s’il ne s’agit pas aussi de lutter contre la « dé-néerlandisation » de la Flandre, notamment dans la périphérie de Bruxelles.
3. Le clivage principal est désormais placé sur le terrain économique et social
Si la question linguistique génère encore un important ressentiment, le cœur des tensions communautaires actuelles est la situation économique et sociale comparée des grandes régions composant la Belgique et les divergences sur les politiques à conduire.
a) Prospère, la Flandre conteste les transferts financiers dirigés vers la Wallonie
La région wallonne a été, pendant plusieurs décennies, le poumon économique de la Belgique, lui assurant une place enviable au sein des plus grandes puissances industrielles. Cependant, elle a connu au lendemain de la Seconde guerre mondiale un décrochage patent, qui a installé la Wallonie dans une crise profonde et durable, même si les positions respectives de la Wallonie et de la Flandre se sont globalement stabilisées depuis une dizaine d’années.
Alors que la population wallonne compte pour environ 32,3 % de la population belge totale, le produit intérieur brut wallon ne représente que 23,7 % du PIB national (chiffres 2010), la Flandre comptant pour 57,2 % et la Région Bruxelles-Capitale pour 19,1 % du PIB (30).
La population wallonne porte le poids de la crise. Si, comme dans le reste du pays, l’espérance de vie ne cesse d’augmenter – les gains ont atteint 5 à 6 ans pendant les trois dernières décennies – les Wallons vivent cependant, en moyenne, deux ans de moins que les habitants des autres régions belges ; l’écart d’espérance de vie est de un an pour les Wallonnes (31).
S’agissant de l’emploi, les statistiques de la Banque nationale de Belgique montrent qu’en 2010, la Flandre avait un taux d’emploi global d’environ 66 % et la Wallonie d’environ 56,5 %, ce qui représente un décalage considérable ; les taux de chômage respectifs estimés étaient de 5,5 % pour la Flandre et 11,4 % pour la Wallonie. Ces chiffres régionaux masquent cependant de fortes disparités intra-régionales : la Wallonie connaît de véritables poches de sous-emploi, avec des taux de chômage dépassant 15 %, par exemple dans les alentours de Mons, La Louvière et Charleroi, ainsi que Liège.
La Wallonie est également en retard en matière de revenu des ménages. Sur l’exercice d’imposition 2009, le revenu moyen par habitant déclaré à l’IRPP s’est élevé à 14.377 euros en région wallonne, 15.266 euros dans la région de Bruxelles et 16.199 euros en Flandre, soit des écarts respectifs de 6,2 % et 12,7 %. Là encore, les provinces wallonnes présentent des situations contrastées. Selon les statistiques fiscales, si globalement la région wallonne se situe à 94 sur une base nationale de 100, la province du Brabant wallon se situe à 115, la province de Namur à 96, la province de Liège à 93, la province de Luxembourg à 95 et la province de Hainaut à 88, sans compter qu’il existe encore de nombreuses disparités entre arrondissements d’une même province (32).
Enfin, la population wallonne est très exposée au risque de pauvreté. Selon la dernière enquête européenne sur les revenus et les conditions de vie (EU‐SILC 2009 – revenus 2008), le taux de risque de pauvreté s’élève en Wallonie à 18,4 %, ce qui signifie que près d’une personne sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. En comparaison, le même taux est de 10,1 % seulement en Flandre (33).
Les explications à ce « déclin wallon » sont multiples. Il résulte en premier lieu de la crise des charbonnages qui a frappé toutes les régions extractives dans les années 1950-1960, avec un renchérissement des coûts dont l’effet est démultiplié par la concurrence des hydrocarbures importés. S’y est ajoutée, en Belgique, la comparaison défavorable entre les gisements traditionnels et anciens, situés en Wallonie, dans le sillon Sambre-et-Meuse, et des gisements plus récents et de meilleure qualité, situés en Campine, province flamande, dont l’exploitation a commencé au tournant des années 1930 ; lorsqu’en 1952 la production belge de houille atteint son record historique, la Wallonie n’y contribue déjà plus que pour deux tiers. De même, en termes de résultats financiers, 31 entreprises wallonnes sont en perte contre 25 en bénéfice en 1957, alors qu’en Campine, une seule mine est en perte contre six en situation bénéficiaire ; c’est clairement le signe d’un secteur en déclin dans la région wallonne.
La crise du milieu des années 1970 est ressentie avec une violence particulière en Wallonie, dont la structure productive reste encore, à l’époque, marquée par une part importante des industries sidérurgiques et métallurgiques. La région est obligée de s’engager dans de lourdes restructurations, génératrices de chômage, et grevant les possibilités d’une reconversion rapide.
Au-delà de ces facteurs proprement économiques, nombre de responsables wallons estiment que les déboires de la Wallonie résultent en partie d’un « abandon » de la région par l’État belge, contrôlé par les Flamands. M. André Flahaut a ainsi affirmé à la mission que « les mécanismes nationaux ont été biaisés en faveur de la Flandre » : pendant des décennies, la construction des compromis entre la Wallonie et la Flandre est passée par le financement d’infrastructures ou le soutien à l’implantation d’industries en Flandre, grâce à la richesse wallonne ; pendant que l’État subventionnait chichement les derniers bassins houillers wallons, il soutenait massivement l’extraction en Campine.
M. Philippe Van Parijs estime que l’on ne peut pas nier une certaine « préférence » des gouvernements, dans la seconde moitié du XXe siècle, pour diriger les investissements publics vers la Flandre, mais « l’on ne peut pas dire que la Flandre ait été outrageusement avantagée ». Mme Mia Doornaert, conseillère de M. Yves Leterme, alors Premier ministre, indiquait que la politique des investissements publics a été, en fait, assez équilibrée, les décisions prises au profit de la Flandre étant, en général, accompagnées de décisions en faveur de la Wallonie, selon un processus connu en Belgique sous le nom de « politique du moule à gaufres », marqué par une symétrie des « creux » et des « bosses ».
Surtout, ces orientations aujourd’hui contestées données aux investissements publics ont été accompagnées par des modifications dans les flux d’investissements privés. Après des travaux fondateurs comme ceux de M. Michel Quévit, professeur d’économie politique à l’Université catholique de Louvain, dans son ouvrage Les causes du déclin wallon (1978), un consensus semble s’être dégagé pour dire que la Wallonie a souffert d’un désinvestissement des décideurs économiques belges, à savoir la haute bourgeoisie bruxelloise placée à la tête des sociétés holdings qui contrôlaient une grande partie du capital des entreprises belges (34). D’autre part, la Flandre s’est bien intégrée dans le système moderne de production fordiste qui s’est développé en Europe au sortir de la Seconde guerre mondiale, en attirant notamment de nombreux capitaux américains. Ceux-ci, rappelait M. Jean Faniel à la mission, y trouvaient des terrains vastes et peu chers ainsi qu’une main d’œuvre de qualité et peu coûteuse. « A partir de 1965, les investissements en Wallonie sont en perte de vitesse et leur caractère défensif se renforce. L’investissement industriel est moins rentable en Wallonie que dans le nord du pays. On assiste progressivement à un glissement des investissements vers le nord. C’est l’époque (1960) où Cockerill, sous la férule de la Société Générale, s’associe à l’Arbed pour fonder Sidmar, créant le premier grand centre sidérurgique de Flandre en se lançant dans la maritimisation du secteur qui deviendra bientôt le standard international. Dans un même temps, les capitaux américains, qui profitent de la nouvelle loi sur l’expansion économique (1959), se déversent littéralement sur la Belgique, se concentrent sur la Flandre et bien peu franchissent la frontière linguistique. Ainsi, sur la période 1961-1967, seuls 20 % des investissements privés étrangers en Belgique étaient réalisés en Wallonie. Parallèlement à cela, sur la même période, 64 % des emplois nouveaux dus à ces investissements étaient créés dans le nord du pays. » (35)
Mais les explications rationnelles à la situation dans laquelle se trouve plongée la Wallonie depuis de nombreuses années ne satisfont plus l’opinion publique flamande. Celle-ci conteste de plus en plus les transferts interrégionaux dont bénéficie la Wallonie, et nombreux sont les interlocuteurs francophones de la mission qui ont relevé que cette contestation s’est fait entendre dans le débat public très peu de temps après que le « rapport de forces économique » entre la Wallonie et la Flandre a basculé, au milieu des années 1960.
Ainsi, dès le début de la crise des années 1970, le patronat flamand représenté au sein de l’organisation régionale VEV revendiquait qu’il soit mis un terme aux subventions publiques à la sidérurgie wallonne. En 1983, M. Luc Van den Brande, député social-chrétien, lançait : « plus un franc flamand pour l’acier wallon ! »
Ce qui insupporte la Flandre, semble-t-il, est moins le fait que la Wallonie ait été frappée par des chocs économiques dont la plupart ont été également ressentis en Flandre (celle-ci, avait, comme la Wallonie, une industrie charbonnière et une industrie sidérurgique), que le fait qu’elle mette si longtemps à se redresser. La longue crise wallonne a donné – et donne toujours l’image – d’une Wallonie et d’une population wallonne qui ne font pas réellement d’efforts et qui se complaisent dans un état d’assistance aux crochets du système de protection sociale national. Mme Mia Doornaert indiquait à la mission que malgré 25 ans de transferts, le chômage ne baisse pas en Wallonie et regrettait que les chômeurs du Hainaut ne franchissent pas la frontière linguistique pour occuper les emplois vacants dans les provinces de Flandre occidentale et orientale, alors que des travailleurs français passent la frontière d’État. M. Philippe Van Parijs estimait, pour sa part, que la sécurité sociale a effectivement changé la donne : lorsque la Flandre était pauvre, dans la deuxième moitié du XIXe siècle et encore dans la première moitié du XXe siècle, les Flamands en âge de travailler allaient chercher de l’emploi en Wallonie ; en revanche, aujourd’hui, grâce aux transferts de sécurité sociale, les chômeurs wallons ne sont pas incités à aller en Flandre. Dans le même temps, selon M. Karl Vanlouwe, « on demande un effort toujours plus important à la Flandre pour le redressement des finances publiques ».
C’est donc le sentiment que les efforts face aux difficultés de la vie économique sont inégalement répartis qui nourrit le discours revendicatif des dirigeants flamands. « Ce qui tue la Belgique aujourd’hui, disait à la mission M. Charles Picqué, c’est le différentiel socio-économique entre les deux régions et la croyance que la Flandre paie pour la Wallonie ». Des phrases-choc, justement, sont répétées à travers les médias flamands, comme celle qui voudrait que « tous les quatre ans, chaque ménage flamand a payé une voiture neuve à chaque ménage wallon ». Quelques initiatives médiatiques marquent les esprits : en 2005, M. Bart De Wever fait déposer 10 milliards d’euros en faux billets au pied de l'ascenseur à bateaux de Strépy-Thieu (Hainaut) pour dénoncer la gabegie wallonne permise par les subsides flamands. Des personnalités s’unissent pour dénoncer les insuffisances de la stratégie économique mise en œuvre en Wallonie : cela donne le Manifeste pour une Flandre indépendante en Europe, publié en 2005 par des décideurs flamands regroupés au sein du club « In de Warande », qui manifeste la crainte de voir disparaître, à cause des Wallons, des francophones et de l’État belge, la richesse qu’au cours des dernières décennies la Flandre a pu accumuler dans une proportion largement supérieure à la moyenne belge ou européenne. Parmi les raisons qui expliquent la faible création de bien-être en Wallonie, le groupe insiste sur l’effet « freinant » que les transferts financiers exercent sur sa capacité à se prendre en charge et sur le goût de l’initiative. Il chiffre ces transferts à plus de 10 milliards d’euros, ce qui paraît nettement surévalué à de nombreux économistes.
« La solidarité n’aide pas beaucoup les Wallons et la Flandre donne des chèques en blanc », disait M. De Wever à la mission.
b) Attachée à sa prospérité, la Flandre veut disposer de leviers plus importants
Puisque les transferts feraient de la Wallonie un poids mort empêchant la Flandre de valoriser pleinement ses atouts, celle-ci se trouve légitime à réclamer un affaiblissement des liens qui unissent les régions belges, donc à revendiquer une plus grande autonomie en matière de décision publique, notamment dans le domaine socio-économique.
La Flandre, il est vrai, est consciente tout à la fois de sa richesse, acquise depuis à peine plus d’un demi-siècle, et de sa fragilité. Ses élites savent que l’insertion de leur région dans le système mondial de production exige de maintenir au plus haut sa position concurrentielle. En particulier, la forte présence d’entreprises multinationales est source de vulnérabilité : en 1997, la fermeture de l’usine Renault implantée à Vilvorde avait causé un choc, tant chez les salariés que dans les cercles dirigeants. Il en a été de même en février 2010, lorsque le constructeur automobile Opel a annoncé sa décision de fermer son usine d’Anvers, touchant directement près de 2600 travailleurs, auxquels s’ajoutent les effectifs des sous-traitants.
La crise de 2008-2009 a touché le cœur de l’économie flamande : l’automobile, le transport, la chimie, etc. Si celle-ci a bien rebondi depuis 2010, il n’en reste pas moins qu’un doute a pu s’installer : les pertes d’emplois sont-elles dues seulement à la crise, ou bien le modèle flamand est-il en train de s’épuiser ? La Flandre a pris conscience d’un risque réel de voir sa prospérité s’étioler : elle a vu que sa population est vieillissante au sein de l’espace belge ; elle a vu que son espace est de plus en plus saturé ; elle a réalisé que l’efficacité de son gouvernement peut être sujette à caution, quand il a fallu, par exemple, douze ans pour décider quelle infrastructure, d’un pont ou d’un tunnel, sera réalisée pour améliorer les conditions de circulation autour d’Anvers. En février 2010, la presse flamande s’est même mise à évoquer une « wallonisation » de la Flandre…
Pour autant, la revendication d’autonomie n’est pas une conséquence directe des évolutions économiques récentes. Elle s’inscrit, plus largement, dans une démarche identitaire fondée sur l’affirmation de l’existence d’intérêts économiques spécifiquement flamands.
Cette démarche identitaire est ancienne ; dès la fin du XIXe siècle, au moment où le prolétariat se développe en Wallonie dans le sillage de la révolution industrielle et où s’y crée un parti socialiste, les élites flamandes, essentiellement catholiques, veulent éviter les menaces associées à l’essor des masses prolétaires. Elles s’attachent à promouvoir un modèle social fondé sur la conciliation et la collaboration entre classes, dont la réussite sera favorisée par une industrialisation plus limitée et plus progressive que celle de la Wallonie. Le « consensus interclassiste » est vu comme un atout flamand, un facteur de prospérité à protéger ; cette idée va irriguer la pensée économique des cercles dirigeants flamands pendant tout le XXe siècle. Dans un contexte où, au sortir de la Seconde guerre mondiale, la Flandre a misé sur un processus de développement régional fondé sur l’économie de marché dans une perspective keynésienne, il convient de s’écarter de la tradition wallonne du conflit social pour rechercher, grâce à un consensus entre patrons et ouvriers, la maîtrise des coûts salariaux qui offrira à la Flandre la compétitivité dont elle a besoin.
De cette recherche naîtront, à la fin des années 1980, la doctrine de « l’ancrage flamand » des entreprises, selon laquelle la Flandre doit tendre à ce que les leviers du pouvoir au sein de l’entreprise restent localisés dans la région, la contestation des transferts financiers vers la Wallonie qui a été évoquée précédemment, ainsi qu’à partir de 1983, la tentation d’institutionnaliser un processus de concertation sociale au niveau régional. Celle-ci ne rencontre pas le succès espéré en raison de la réticence du patronat qui y voit le support possible de revendications salariales plus vigoureuses.
La demande d’autonomie économique et sociale est présentée comme bénéfique tant à la Flandre qu’à la Wallonie : les deux régions ayant des structures économiques différentes, les politiques adaptées à l’une ne le sont pas nécessairement à l’autre ; une plus grande autonomie relève donc d’une logique « gagnant – gagnant ». Pour la dynamisation du marché de l’emploi, par exemple, la situation de chaque région au regard de l’emploi est différente : la Flandre pâtit plutôt d’une pénurie de main d’œuvre, notamment dans un contexte de vieillissement de la population, et aurait donc besoin d’agir pour retenir dans l’emploi les travailleurs âgés ; la Wallonie souffre d’une pénurie d’emplois et devrait donc faire porter ses efforts sur le développement du volume de l’emploi ; Bruxelles est confrontée à un afflux de travailleurs peu qualifiés et devrait donc privilégier la mise en place de politiques d’insertion.
La revendication porte tout à la fois sur les instruments de politique économique, sur les leviers de la sécurité sociale (notion qui inclut, en Belgique, la gestion du chômage) et sur la fiscalité. Une expression particulièrement aboutie peut être trouvée dans la « note Octopus du Gouvernement flamand », dont le contenu a été intégralement repris en annexe de l’accord de gouvernement flamand pour la législature régionale 2009-2014 (36). La Flandre y demande en premier lieu plus d’instruments pour mener une politique active de l’emploi, notamment obtenir toutes les possibilités pour mettre les demandeurs d’emploi au travail, élaborer une politique de groupes-cibles et statuer sur la disponibilité des chômeurs pour le marché de l’emploi (37). La demande porte également sur certains dispositifs de la formation professionnelle ainsi que sur le contrôle et la surveillance du travail intérimaire.
La note demande aussi le transfert de certains instruments de politique économique, comme des fonds pour le développement de l’économie sociale ou pour le soutien à l’entreprenariat, le transfert de la politique scientifique et technologique. En ce qui concerne le commerce extérieur, la Flandre revendique à l’égard de diverses institutions belges un pouvoir de décision autonome pour les dossiers d’entreprises situées dans la région flamande. Dans le secteur de la santé et de l’aide sociale, la note rappelle que le Parlement flamand a demandé en 1999 la compétence de normalisation, d’exécution et de financement relative à l’ensemble de la politique en matière de santé et de famille, y compris l’assurance soins de santé et les allocations familiales. La note présente également une liste de domaines où des transferts de compétences doivent être opérés ; on y trouve des sujets aussi divers que la politique des taxes sur l’énergie, l’organisation et la politique en matière de protection civile et de services de lutte contre l’incendie, la politique des statistiques ou l’organisation, le fonctionnement et la structure de la police et de la justice.
Enfin, la note Octopus prône un renforcement de l’autonomie financière, non seulement en termes de dépenses, mais aussi en termes de ressources, ce qui passe par l’acquisition d’un pouvoir fiscal plus important : « Une plus grande autonomie fiscale sur le plan de l’impôt sur les revenus est également considérée par la Flandre comme un élément essentiel de la réforme de l’État, comme le stipulent les cinq résolutions du Parlement flamand de 1999. »
Toutes ces revendications, qui forment le cœur de ce que les dirigeants flamands souhaitent intégrer dans la « réforme de l’État », fût-ce avec des nuances selon les partis ou des variations au fil du temps, obéissent à une triple motivation : il s’agit de préserver le bien-être de la population et la position concurrentielle de la Flandre (sachant que la Wallonie est présentée comme devant elle aussi tirer des bénéfices d’une autonomie accrue), d’améliorer l’efficacité des politiques publiques et d’améliorer la responsabilité des mandataires vis-à-vis des électeurs.
Sur les deux objets principaux de la réforme de l’État appelée de ses vœux par la Flandre, les propositions flamandes sont, par nature, extrêmement « clivantes » vis-à-vis de leurs partenaires francophones. D’une part, en matière de fiscalité, la dimension symbolique associée au pouvoir de lever l’impôt conférerait à l’entité qui disposerait d’une fraction significative de ce pouvoir une légitimité démocratique accrue, susceptible de mettre à mal la légitimité de l’État belge. Les francophones sont également très vigilants quant au risque de concurrence fiscale entre une Flandre dont le tissu économique est bien plus solide et dynamique que celui de la Wallonie et qui pourrait tirer profit d’une autonomie fiscale accrue pour réduire la pression fiscale, soit sur les entreprises (impôt sur les sociétés), soit sur les entrepreneurs (impôt sur le revenu). D’autre part, en matière de sécurité sociale, les francophones sont attentifs au risque d’atteinte à la solidarité interpersonnelle, qui constitue l’un des éléments essentiels du « pacte social » dans les États modernes. Le sujet de la sécurité sociale – en clair, son éventuelle scission – est posé depuis une trentaine d’années, mais sa véritable insertion dans la problématique communautaire est acquise depuis le milieu des années 1990, au moment où la perspective néo-libérale donnée à l’évolution de la protection sociale n’est plus apparue comme un repoussoir pour la gauche flamande.
B – Des institutions qui n’offrent pas de contrepoids suffisant aux tendances centrifuges
Dans toute société, il revient au système politique, notamment dans sa dimension institutionnelle, d’organiser la façon dont les intérêts divergents et concurrents qui la traversent peuvent s’exprimer et contribuer à la formation de l’intérêt général. L’intensité du clivage communautaire et des tensions au sein de la société belge a conduit les milieux politiques à accepter l’idée que l’État unitaire créé en 1830 ne pouvait plus fournir un cadre adéquat pour gérer ces tensions. Il en est résulté, par réformes successives, la transformation de l’État unitaire en un État fédéral et la création d’un système institutionnel complexe, sans pour autant que l’équilibre entre État fédéral et entités fédérées apparaisse définitivement établi. L’ajustement de cet équilibre est d’ailleurs l’enjeu principal des négociations intercommunautaires ces dernières années.
1. Un système institutionnel complexe
Depuis 1993, la Belgique est officiellement un État fédéral. C’est plus une étape qu’un aboutissement, dans un processus de réforme institutionnelle qui a commencé en 1970 et s’est poursuivi ensuite au rythme d’une réforme tous les dix ans en moyenne.
La réforme institutionnelle en Belgique peut comporter un ou plusieurs des trois volets suivants : révision de la Constitution, transfert de compétences, modification des mécanismes de financement des entités fédérées. Si, aux premiers temps de la réforme, l’accent était surtout mis sur la révision de la Constitution, les efforts des négociateurs se sont ensuite axés sur la recherche d’une « meilleure » répartition des compétences entre État fédéral et entités fédérées. Avec la réforme de 1988-1989, il est cependant apparu que l’ajustement des mécanismes de financement conditionnait pour une large part l’atteinte des objectifs poursuivis par les forces politiques.
a) Deux catégories d’entités fédérées
La configuration de l’État fédéral belge est unique au monde en ce qu’elle repose sur la juxtaposition de deux catégories d’entités fédérées, les Régions et les Communautés, alors que les autres États fédéraux ne sont organisés qu’autour d’une seule catégorie, Länder en Allemagne, provinces en Argentine, États au Mexique, en Malaisie ou au Brésil, etc. Chaque Région ou Communauté dispose d’un Parlement, d’un gouvernement et d’une administration.
La base territoriale des Régions et des Communautés est constituée des quatre régions linguistiques, définies à l’origine par les lois de 1962 et 1963 et dont l’existence a été constitutionnalisée dans l’article 4 de la Constitution. Les régions linguistiques constituent les « briques de base » à partir desquelles sont définies les aires respectives des Régions et des Communautés. Ainsi :
– la Région wallonne a pour territoire la région de langue française et la région de langue allemande ;
– la Région flamande a pour territoire la région de langue néerlandaise ;
– la Région de Bruxelles-Capitale a pour territoire la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
– la Communauté française est compétente dans la région de langue française et la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
– la Communauté flamande est compétente dans la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
– la Communauté germanophone est compétente dans la région de langue allemande.
Les compétences des Communautés s’étendent à six domaines : les matières culturelles, l’enseignement, l’emploi des langues, les matières dites « personnalisables », la coopération internationale et la recherche scientifique se rapportant aux matières communautaires ainsi définies. Les matières dites « personnalisables » sont censées passer par un rapport direct et personnel entre les institutions et les citoyens ; elles recouvrent (hors la sécurité sociale, qui reste dans le champ fédéral) la politique des soins de santé et l’aide aux personnes (aide aux familles, aide sociale, accueil et intégration des immigrés, personnes handicapées, troisième âge, protection de la jeunesse).
Les compétences des Régions s’étendent à des domaines que l’on dit « territorialisables » : aménagement du territoire, urbanisme, rénovation urbaine et rurale, politique foncière, monuments et sites, protection de l’environnement, politique des déchets, gestion de l’eau, agriculture, forêt, chasse et pêche, logement, travaux publics (routes, voies hydrauliques, ports et dépendances), transports et aéroports, richesses naturelles. Les Régions sont également compétentes pour les aspects régionaux de la politique économique, la politique de l’emploi (dont le placement des travailleurs et les programmes d’activation du chômage), les aspects régionaux de la politique de l’énergie, l’organisation et la tutelle des pouvoirs locaux, la gestion des aspects temporels des cultes reconnus, ainsi que la coopération internationale et la recherche scientifique se rapportant aux matières régionales ainsi définies.
Pour les Régions comme pour les Communautés, la compétence générale en matière de coopération internationale passe par la capacité à conclure des traités et accords internationaux. C’est pourquoi les entités fédérées doivent elles aussi mettre en œuvre des procédures de ratification pour les accords internationaux conclus par l’État belge et relatifs à des matières communautaires ou régionales. C’est pourquoi, également, la Belgique met en œuvre un système très particulier de représentation au Conseil de l’Union européenne : en premier lieu, la représentation du Royaume de Belgique est assurée, selon la formation du Conseil, par le gouvernement fédéral ou par un gouvernement de Région ou de Communauté, assisté ou non par un assesseur ; en deuxième lieu, une rotation est prévue entre représentants des entités fédérées au fur et à mesure des différents Conseils ; en troisième lieu, la position officielle du Royaume de Belgique est définie dans le cadre d’un processus formel de coordination entre le niveau fédéral et les niveaux fédérés.
L’État fédéral exerce, d’une part, toutes les compétences qui n’ont pas été attribuées aux autres niveaux de pouvoir et, d’autre part, les compétences qui lui sont expressément attribuées par la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, sous forme d’exceptions aux matières régionales et communautaires :
– au titre des compétences propres, on doit relever : la justice, la sécurité sociale (gestion et normes), la défense et le maintien de l’ordre, la politique étrangère, les communications, les règles régissant la nationalité et l’état civil, l’accès au territoire, le séjour et l’établissement des étrangers, une grande partie de la fiscalité, etc.
– au titre des compétences « retenues » aux entités fédérées : l’emploi des langues dans la région de Bruxelles-Capitale et dans les communes à facilités, divers dispositifs de garantie de revenus, la législation organique relative aux hôpitaux, les règles essentielles relatives aux normes et infrastructures de santé, la sécurité de la chaîne alimentaire, l’énergie nucléaire, les entreprises publiques autonomes fédérales (comme la Société nationale des chemins de fer belges), la politique financière et de protection de l’épargne, la politique des prix et des revenus, le droit de la concurrence, le droit commercial et le droit des sociétés, les conditions d’accès aux professions réglementées, etc.
Le système institutionnel est, par ailleurs, fortement asymétrique. D’une part, la Communauté flamande exerce les compétences de la Région flamande, ce que l’on désigne généralement sous le nom de « fusion des institutions régionale et communautaire flamandes ». Il en résulte l’apparition d’une entité politique flamande unique, dotée d’un Parlement et d’un gouvernement, qui exerce à la fois des compétences communautaires et régionales, étant entendu que ces dernières ne trouvent à être exercées que sur le territoire de la Région flamande et que les décrets (38) portant sur ces compétences régionales ne sont votés que par les députés élus dans la région flamande et non à Bruxelles (39).
D’autre part, dans la Région de Bruxelles-Capitale, qui constitue un pont entre les deux Communautés, une organisation particulière a été définie :
– les élections au Parlement bruxellois s’effectuent dans le cadre de collèges électoraux linguistiques distincts, comme pour le Parlement fédéral ;
– la constitutionnalité des ordonnances adoptées par le Parlement bruxellois peut être contrôlée par les tribunaux ;
– la Région ne dispose pas du pouvoir d’auto-organisation, à l’inverse des deux autres Régions ;
– sur le territoire de la Région, les compétences communautaires sont limitées aux organismes entrant dans le champ d’intervention des Communautés (organismes culturels, établissements d’enseignement, etc.), et non aux populations elles-mêmes ; en effet, les Bruxellois demeurent libres de s’adresser aux institutions communautaires de leur choix et ne sauraient se voir enfermer dans une « sous-nationalité » flamande ou francophone ;
– sur le territoire de la Région, les compétences communautaires sont exercées par des institutions spécifiques : du Parlement bruxellois émanent, respectivement, une Commission communautaire française (COCOF), qui exerce les compétences de la Communauté française, une Commission communautaire flamande (VGC), qui exerce les compétences de la Communauté flamande (40), et une Commission communautaire commune (COCOM), compétente pour les matières dites « bi-communautaires », à savoir les matières bi-personnalisables (matières sociales et de santé intéressant les deux communautés) et les matières d’intérêt commun dans le secteur de la culture et de l’enseignement.
Au sud du pays, la configuration géographique des institutions régionales et communautaires empêche de les « fusionner ». Cependant, des liens organiques existent entre la Communauté française, la Région wallone et la Région Bruxelles-Capitale : d’une part, les gouvernements respectifs de ces entités fédérées sont, de plus en plus, constitués autour des mêmes ministres ; d’autre part, le parlement de la Communauté française n’est pas élu directement mais constitué des 75 élus du Parlement wallon auxquels se joignent les 19 premiers des 72 élus francophones au Parlement bruxellois. Par ailleurs, la Communauté française a confié l’exercice de certaines de ses compétences à la Région wallonne et à la Commission communautaire française (41). Enfin, la Région wallonne a confié à la Communauté germanophone certaines de ses compétences, à exercer sur le territoire de ladite Communauté (42) ; à la suite de la conclusion de l’accord de gouvernement fédéral, en décembre 2011, la Communauté germanophone et la Région wallonne ont repris les discussions pour accroître, à l’avenir, l’étendue des compétences transférées.
b) Des modalités de financement qui procurent déjà un certain degré d’autonomie et de responsabilité
• Les ressources les plus importantes des régions proviennent des recettes fiscales prélevées au niveau fédéral et rétrocédées aux entités fédérées, ainsi que des recettes des impôts régionaux. Les budgets des entités fédérées ne permettent cependant pas de juger de l’importance des recettes liées à la fiscalité régionale car une partie d’entre elles sont directement affectées à des organismes publics ; cela est particulièrement vrai pour les recettes de la Flandre.
Les régions reçoivent tout d’abord une partie du produit de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ; cependant, le législateur fédéral conserve toutes les compétences normatives sur cet impôt. La part attribuée d’IRPP est une recette composite, dont la principale partie, dénommée « montant initial » est en fait une quasi-dotation dont la masse est répartie selon une clef à caractère fiscal. En effet, le « montant initial » attribué une année est calculé par application au montant attribué l’année précédente d’un taux d’évolution combinant l’indice des prix à la consommation et le taux de croissance réelle de l’économie. En 1989, date à laquelle a été mis en place ce dispositif, le montant initial a été déterminé sur la base des crédits budgétaires précédemment consacrés aux compétences transférées à cette date. Le « montant initial » est ensuite réparti entre les trois régions en fonction du principe dit « du juste retour » : chaque région reçoit une part de la dotation égale à sa part dans le rendement de l’impôt localisé sur son territoire. Une région dont le dynamisme fiscal s’accroît par rapport à celui des autres régions se voit donc attribuer une part croissante du « montant initial ».
La part attribuée d’IRPP comprend aussi des montants correspondant aux transferts de nouvelles compétences (en 1993 et en 2001), dont les règles d’indexation sont identiques à celles du « montant initial » mais dont la clef de répartition échappe au principe du « juste retour ».
La part attribuée d’IRPP comprend également une partie au titre du mécanisme de solidarité nationale. Celui-ci a été établi en faveur des régions dont le produit de l’IRPP par habitant est inférieur à la moyenne correspondante pour l’ensemble du Royaume. Initialement conçu pour améliorer les recettes de la région wallonne, le mécanisme bénéficie à Bruxelles depuis 1997. Il est « calé » sur une base initiale déterminée par référence aux données de l’année 1988, indexée et ajustée en fonction du nombre d’habitants effectifs de chaque région. En 2010, la Région wallonne a perçu à ce titre près de 840 millions d’euros et la Région Bruxelles-Capitale près de 300 millions d’euros. La charge financière du mécanisme de solidarité est assurée par l’État fédéral : c’est un mécanisme de redistribution verticale et non une redistribution directe entre les trois Régions.
Enfin, la part attribuée d’IRPP est affectée d’un « terme négatif » destiné à assurer la neutralité budgétaire, pour l’État fédéral, d’une régionalisation de plusieurs impôts décidée en 2001.
Les Régions disposent aussi de dotations, par exemple de l’État fédéral au titre de chaque chômeur complet indemnisé placé dans un programme de remise au travail dans le cadre d’un contrat de travail, ou de la Communauté française à la Région wallonne au titre des compétences exercées par la seconde pour le compte de la première.
Les Régions bénéficient également d’un pouvoir fiscal propre, qui est ouvert soit par la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989, soit par la Constitution. Le pouvoir fiscal prévu par la loi spéciale de financement se compose d’impôts régionaux et de la possibilité d’instaurer des centimes additionnels régionaux à l’IRPP ou d’accorder des remises. Sur les impôts régionaux (taxe sur les jeux et paris, droits d’enregistrement, eurovignette, redevance radio-télévision, précompte immobilier, etc.), les régions disposent d’une compétence fiscale presque totale : elles peuvent, en général, modifier la base et le taux d’imposition, ainsi que les remises et exonérations. En matière de centimes additionnels à l’IRPP, la marge de manœuvre totale des régions, toutes mesures confondues, est limitée à 6,75 % du produit total de l’impôt localisé dans la région. Le pouvoir fiscal prévu par la Constitution est a priori général et universel : les régions ont théoriquement la capacité de créer n’importe quel impôt ; mais la Constitution prévoit aussi que ce pouvoir peut être limité par le législateur fédéral et celui-ci a fait usage de cette capacité en prévoyant que les entités fédérées ne peuvent lever d’impôt que dans les matières non encore imposées par l’État fédéral. Cette restriction a ensuite été assouplie et les régions se sont vues attribuer un monopole des impôts en matière d’eau et de déchets, domaines qui doivent être entendus dans un sens large : taxe sur les logements abandonnés, redevance visant à combattre et prévenir l’abandon et la désaffection de sites industriels, etc.
L’appréciation du degré d’autonomie fiscale des régions est un sujet sensible dans le débat communautaire. Il s’agit, de plus, d’une notion sujette à de multiples approches donc difficile à appréhender. On peut, dans un premier temps, évaluer l’autonomie de décision dont les régions disposent sur leurs recettes fiscales. En 2001, à l’occasion de la dernière réforme de la loi spéciale de financement, le Conseil supérieur des finances a estimé que l’autonomie fiscale des régions était complète sur 40 % de leurs recettes fiscales et portait sur les taux pour 60 % des mêmes recettes. En 2006, l’OCDE a estimé que les entités fédérées belges bénéficient d’une autonomie fiscale sur 63,8 % de leurs recettes fiscales, le solde correspondant à des impôts partagés. Une étude du ministère des finances publiée en 2009 estimait que le degré d’autonomie des régions belges était supérieur à celui des régions espagnoles et nettement plus élevé que celui des Länder allemands.
L’autonomie fiscale peut également être évaluée en rapprochant le montant total potentiel des recettes fiscales régionales – donc en comptabilisant la recette potentielle correspondant aux impôts allégés ou supprimés – du montant total des ressources des régions. Une étude conduite par le Centre de recherches en économie régionale et politique économique des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix (Namur) en 2011 montre que la Région wallonne a une autonomie fiscale sur 49,3 % de ses recettes totales, la Région Bruxelles-Capitale a une autonomie fiscale de près de 63 % et la Région flamande de 62,3 %. Comme l’indiquent MM. Benoît Payenet et Giuseppe Pagano : « La confusion dans le débat est que la Flandre, pour sa part, réalise ce calcul en tenant compte également des recettes de la Communauté flamande, ce qui dans ce cas ramène l’autonomie fiscale à 29 % pour la Communauté et la Région flamande réunies. Cette estimation est certes arithmétiquement correcte mais dénuée de tout fondement puisque, depuis 2001, les Communautés ne disposent plus de recettes fiscales propres » (43).
• Alors qu’elles sont les entités dont les budgets sont les plus importants, les Communautés sont, paradoxalement, privées de tout pouvoir fiscal. En effet, elles sont construites autour des personnes et des institutions créées pour les servir et elles ne peuvent donc revendiquer un territoire exclusif sur lequel elles pourraient, à la fois, mener leurs politiques et asseoir des recettes fiscales. En conséquence, la loi spéciale de financement exclut la fiscalité de la liste des recettes communautaires, même si la Constitution prévoit l’existence d’impôts communautaires.
Le financement des Communautés repose entièrement sur l’État fédéral, par le biais de parts attribuées des recettes d’IRPP et de TVA, ainsi que de dotations. La partie de l’IRPP et de la TVA attribuée aux Communautés a été initialement calculée à partir des dépenses qui, dans le budget fédéral, couvraient les diverses compétences transférées au cours des différentes réformes. Leur évolution est ensuite gouvernée par des règles d’indexation qui les rendent indépendantes du produit effectif de l’impôt concerné : indice des prix à la consommation et taux de croissance réel de l’économie pour la part attribuée de l’IRPP, indice des prix et coefficient démographique pour la part attribuée de la TVA (44). La répartition des montants indexés se fait sur la base du principe du « juste retour » pour la part attribuée de l’IRPP et sur la base d’une clef correspondant au nombre d’élèves de 6 à 17 ans scolarisés dans les écoles relevant de chaque communauté pour la part attribuée de TVA. Les montants attribués au titre du mécanisme spécifique de refinancement instauré en 2001 sont cependant répartis selon la règle du juste retour (45).
Les dotations de l’État fédéral concernent divers chefs de dépenses, comme la couverture des charges résultant de l’accueil des étudiants étrangers, le financement du Jardin botanique national de Meise et la compensation de la régionalisation de la redevance radio-télévision en 2001.
La Communauté germanophone a des modalités de financement très spécifiques, qui reposent essentiellement sur des dotations de l’État fédéral.
• Comment apprécier la place des entités fédérées dans les finances publiques ? La mission doit tout d’abord relever que, malgré le pouvoir fiscal conféré aux régions, l’État fédéral collecte la majorité des impôts, y compris une partie du produit de la fiscalité régionale (46). Cependant, une grande partie du produit fiscal est affecté : 60 % des rentrées fiscales sont versées à d’autres institutions, Régions, Communautés, Sécurité sociale, Union européenne ; 15 % servent à régler les intérêts de la dette publique. En 2010, la capacité d’action discrétionnaire de l’État fédéral a été estimée à environ 6,5 % du PIB pour les recettes et 10,5 % du PIB pour les dépenses.
La même année, les recettes totales des entités fédérées ont représenté environ 12 % du PIB et leurs dépenses environ 12,5 % du PIB. Le poids des entités fédérées est donc supérieur à celui du niveau fédéral. Cela a conduit l’OCDE à s’interroger sur la capacité de celui-ci à assumer le redressement financier rendu nécessaire par la crise européenne des finances publiques et par le poids du vieillissement dans les années à venir : l’institution parle ainsi d’un « écart de viabilité des finances publiques » entre l’État fédéral et les entités fédérées. Les milieux politiques belges sont bien conscients de l’enjeu et la viabilité des finances publiques fédérales s’est d’ailleurs imposée en filigrane des négociations lors de la crise de 2010-2011. En 2010, un accord avait été conclu par le gouvernement d’affaires courantes et les entités fédérées, qui prévoyait que la charge du redressement budgétaire de 2010 à 2012 serait partagée entre l’État fédéral, à hauteur des deux tiers, et les entités fédérées, à hauteur d’un tiers. Les débats sur le partage de l’effort après 2012 ont commencé.
Il faut aussi noter que le fédéralisme financier belge fait une large place à la solidarité. Pour les régions, la solidarité est explicitement organisée par la loi spéciale de financement, grâce à un mécanisme spécifique ; ce mécanisme a parfois engendré un « paradoxe des recettes », c’est-à-dire une inversion, entre les régions, du montant des recettes par habitant après mise en œuvre du mécanisme, d’où il découle que les régions qui bénéficient de la solidarité nationale parce que leur rendement à l’IRPP est inférieur à la moyenne nationale ont un financement total ex post supérieur à la moyenne nationale. C’est pourquoi ce mécanisme est vivement contesté par les autorités flamandes, qui y voient une désincitation des régions wallonne et bruxelloise à leur redressement économique. De tels effets potentiellement désincitatifs ont été confirmés par diverses études, qui constatent qu’un accroissement autonome du PIB en Wallonie devrait se traduire par une réduction des recettes globales de la région car les pertes résultant de la moindre intensité de la solidarité seraient supérieures aux gains directs résultant de l’augmentation de la base fiscale.
Inversement, il n’existe pas de mécanisme explicite de solidarité entre les Communautés, alors même que l’application de la clef de répartition du juste retour au refinancement de 2001 est défavorable à la Communauté française et que les Communautés n’ont aucun pouvoir fiscal. La solidarité est implicite, dans le mode de répartition de la part attribuée de TVA, puisque celle-ci est répartie en fonction du nombre de d’élèves de chaque Communauté, ce qui traduit une approche par les besoins et non une approche par les capacités financières.
2. Un équilibre institutionnel introuvable ?
Le fédéralisme financier belge est, en fait, le reflet fidèle de l’évolution institutionnelle qui s’est engagée en 1970 : il en hérite la complexité et participe des compromis globaux relatifs à la structure de l’État. Comme elle, il est marqué par une forte stratification des dispositifs adoptés au fil du temps. La fédéralisation de la Belgique est, en effet, une construction progressive qui ne répond pas à un schéma préétabli et qui a contribué à créer un fédéralisme très particulier.
a) Une construction progressive qui ne répond pas à un schéma préétabli
L’idée fédérale naît à la fin du XIXe siècle dans le giron du mouvement wallon qui se crée en réaction aux succès initiaux du mouvement flamand et à l’adoption des premières lois linguistiques. Il semble que ce soit Julien Delaite, fondateur en 1897 de la Nouvelle ligue wallonne de Liège, qui soit à l’origine du premier projet de séparation administrative de la Belgique, élaboré en 1898, qui prévoyait la création de trois régions (Wallonie, Flandre et région brabançonne), gérées par trois conseils provinciaux. Par la suite, Jules Destrée écrit, en 1912, sa fameuse Lettre au Roi sur la séparation de la Wallonie et de la Flandre, se faisant l’interprète à la fois de cercles wallons, qui se sentaient menacés dans leurs perspectives d’emploi par le développement de l’usage du néerlandais, et d’une majorité parlementaire anticléricale progressiste wallonne, dont les options étaient contrecarrées par une majorité cléricale plus importante encore en Flandre. La même année, une coopération parlementaire structurée est mise en place, une Assemblée wallonne, appelée à fonctionner comme un parlement autour de 9 sénateurs et 32 députés. L’idée d’une scission administrative est reprise par des flamingants radicaux, mais rencontre un mouvement flamand peu réceptif : pour les catholiques, l’unité de la Belgique est vue comme le moyen d’exercer le pouvoir par l’intermédiaire de la Flandre et de son vote catholique ; pour les socialistes et les libéraux, l’unité est vue comme le moyen de parvenir à constituer des majorités alternatives et d’éviter la minorisation politique permanente.
Dans les années 1920, le fédéralisme est une revendication présentée de façon ponctuelle par le Parti du Front, qui anime le courant « maximaliste » du mouvement flamand. Au tournant des années 1930, les débats autour des lois sur l’emploi des langues en matière administrative ancrent le thème de la décentralisation administrative : les Wallons souhaiteraient dédoubler les fonctions administratives pour ne pas léser les fonctionnaires unilingues, les Flamands souhaiteraient renforcer la hiérarchisation administrative pour favoriser l’application correcte des lois linguistiques en Flandre.
Les années 1930 voient une certaine radicalisation du mouvement flamand autour du maximalisme ainsi que l’affirmation d’une tendance fédéraliste et d’une tendance bruxelloise au sein du mouvement wallon. C’est en 1936 que le gouvernement Van Zeeland crée le Centre d’études pour la réforme de l’État, convaincu que ses structures doivent être rénovées, notamment pour accorder à la Flandre l’autonomie culturelle qu’elle réclame. En 1938 sont créés les Conseils culturels néerlandais et français, que l’on peut considérer comme les précurseurs des futures Communautés.
Après la Seconde guerre mondiale, la revendication fédéraliste s’amplifie au sein du mouvement wallon (47) et reçoit le soutien de la FGTB, le syndicat lié au parti socialiste. 1948 voit la création du Centre de recherche pour la solution nationale des problèmes sociaux, politiques et juridiques en régions wallonne et flamande, dirigé par Pierre Harmel, qui rendra public son rapport final en 1958. La « grève du siècle », à l’hiver 1960-1961, donne l’occasion à André Renard, secrétaire général adjoint de la FGTB, de poser à nouveau le principe du fédéralisme comme solution au déclin économique de la Wallonie.
La réforme institutionnelle de 1970 engage le processus qui va conduire à la création de l’État fédéral et en pose certains fondements. Elle tire son origine de la volonté des partis traditionnels de réduire l’essor des partis régionalistes, qui devient menaçant et a été accéléré par les controverses nées des lois Gilson (48) et de la scission de l’Université catholique de Louvain. Elle vise également à conjuguer les revendications wallonnes – qui visent à donner à la Wallonie des leviers économiques qui lui permettraient d’engager son redressement – et les revendications flamandes – qui visent à obtenir une autonomie culturelle institutionnelle – car, selon les termes employés à la tribune de la Chambre des représentants par le Premier ministre de l’époque, M. Gaston Eyskens, « l’État unitaire est dépassé par les faits » (18 février 1970).
La loi constitutionnelle du 24 décembre 1970 crée trois Communautés culturelles compétentes pour la culture, l’emploi des langues et quelques matières relatives à l’enseignement, ainsi que trois Régions ; toutes doivent être dotées d’un parlement et d’un exécutif ; des commissions culturelles opèrent à Bruxelles. Parallèlement, la réforme permet aux communes de se regrouper en agglomérations ; seule Bruxelles se saisit de cette possibilité, en 1971, en créant l’Agglomération bruxelloise. Des dispositifs de protection de la minorité francophone au parlement et au gouvernement sont introduits. Enfin, les lois Gilson sont « confirmées » au plan constitutionnel.
La réforme de 1970 est, en fait, très partielle et suscite d’emblée des appréciations mitigées. Elle n’a fait qu’un tout petit pas vers le fédéralisme puisque les Régions et Communautés n’ont pas d’exécutif propre et pas de financement propre. La création effective des Régions, qui était renvoyée à une loi spéciale, ne peut intervenir en raison de l’opposition flamande sur le statut qu’aurait une Région bruxelloise ; c’est le cœur de la revendication wallonne qui est ainsi privé d’effet, alors que les Flamands ont réalisé leur souhait de créer une institution à vocation culturelle.
Une nouvelle réforme est donc rapidement mise en chantier. L’impulsion vient d’une alliance circonstancielle entre les nationalistes flamands et l’aile wallonne du parti socialiste, traditionnellement ouverte à l’idée fédéraliste, qui veut briser l’essor du Rassemblement wallon. Le Pacte d’Egmont, conclu en 1977 entre les principales forces politiques du pays, prévoit l’exécution des accords de 1970, avec la création de trois Régions, l’extension des compétences des Communautés, la réduction du rôle des provinces, la scission de BHV et un droit d’inscription électorale à Bruxelles pour les francophones de BHV. Mais l’avis négatif rendu par le Conseil d’État sur les projets de lois, la montée des résistances internes au parti social-chrétien et l’agitation flamande contre les concessions faites aux francophones (notamment le droit d’inscription) provoquent des tensions au sein de la coalition gouvernementale. Malgré les précisions apportées dans le cadre des accords du Stuyvenberg, le parti social-chrétien refuse finalement d’apporter son soutien aux projets de loi traduisant l’accord politique qu’il a conclu avec ses partenaires.
Le processus reprend à l’issue de la crise gouvernementale, porté par l’enjeu d’apaiser les tensions communautaires pour se consacrer aux sujets socio-économiques. Il faut aussi surmonter la divergence fondamentale entre les Flamands, qui souhaitent un régionalisme à deux, et les francophones, qui souhaitent un régionalisme à trois (avec Bruxelles) ; la question de Bruxelles est donc « mise au frigo », selon l’expression consacrée en pareil cas.
Les lois spéciales des 8 et 9 août 1980 étendent les compétences des Régions et, surtout, des Communautés. Elles organisent les parlements de ces entités, qui sont formés de députés et sénateurs nationaux, ainsi que leurs exécutifs, dont les membres sont des ministres « détachés » du gouvernement national (ministres à portefeuille spécialisé en complément de leur portefeuille national). Elles prévoient que les deux catégories d’entités édicteront leurs normes juridiques par des décrets qui auront une valeur égale à celle de la loi fédérale.
La réforme de 1980 donne donc une substance institutionnelle aux Régions et aux Communautés. Elle a également des conséquences politiques importantes : la Communauté flamande décide immédiatement d’exercer les compétences de la Région flamande ; l’unité renforce le socle institutionnel flamand et la Flandre peut l’utiliser pour afficher sa préférence pour le niveau communautaire. Au plan politique, l’approbation du Pacte d’Egmont par le parti régionaliste flamand, la Volksunie, provoque des tensions en son sein, qui se traduisent par la scission d’une frange radicale ; elle va bientôt former le Vlaams Blok, formation placée à l’extrême droite sur l’échiquier politique.
En 1988, la configuration de la coalition gouvernementale change : les libéraux quittent le gouvernement, les socialistes y entrent ; en conséquence, le dossier communautaire revient sur l’agenda. C’est aussi le temps où la crise des Fourons est réglée et ne pèse donc plus sur la vie des gouvernements. La loi spéciale du 12 janvier 1989 étend les compétences des Régions (travaux publics, transports, gestion des ex « secteurs économiques nationaux » : sidérurgie, charbon, textile, verre, etc.) et des Communautés (enseignement). Surtout, elle établit Bruxelles comme Région quasi normale : celle-ci ne dispose pas de l’autonomie constitutive, légifère par ordonnances dont la valeur juridique est inférieure à celle des décrets et de la loi, abrite les commissions communautaires évoquées précédemment, etc. ; la loi prévoit également que le parlement bruxellois sera élu au suffrage universel direct, l’élection devant avoir lieu pour la première fois en juin 1989. La loi spéciale du 16 janvier 1989 instaure des mécanismes de financement des Régions et des Communautés, à base de dotations et de quelques impôts propres.
A l’issue de la réforme, le dispositif institutionnel est à la fois complété (la Région de Bruxelles-Capitale a été créée) et déséquilibré (seule la Région de Bruxelles-Capitale verra son parlement élu directement) ; ce déséquilibre appelle une réforme complémentaire. La création de la Région Bruxelles-Capitale rend plus complexe l’expression du clivage communautaire puisqu’elle « officialise » deux façons différentes de caractériser la population : néerlandophones et francophones d’une part, Flamands, Bruxellois et Wallons d’autre part. Le combat francophone ne peut plus exactement recouper le combat régionaliste. Enfin, la Communauté française est très vite confrontée à des difficultés financières importantes, malgré un soutien des Régions wallonne et bruxelloise, ce qui crée une pression pour un ajustement des mécanismes financiers où les francophones sont placés en position de demandeurs.
A la suite des accords de la Saint Michel, la réforme de 1993 crée officiellement l’État fédéral, dans un contexte où l’échec du « dialogue de communauté à communauté », engagé par le Premier ministre Jean-Luc Dehaene, nourrit l’expression du nationalisme flamand. Par la loi constitutionnelle du 5 mai 1993 et la loi spéciale du 16 juillet 1993, la Belgique est donc consacrée comme État fédéral et les différentes entités qui le constituent doivent respecter un principe de « loyauté fédérale ». Le pouvoir législatif est refondu : le cumul entre les mandats de parlementaire et les fonctions de ministre, ainsi que le cumul entre le mandat de parlementaire fédéral et celui de parlementaire régional ou communautaire sont supprimés ; les effectifs des chambres sont réduits et le rôle du Sénat redéfini. Tous les parlements fédérés seront désormais élus au suffrage universel. Les compétences des Régions et des Communautés sont élargies. La province du Brabant est scindée entre Brabant flamand et Brabant wallon ; les communes de la Région de Bruxelles-Capitale ne dépendent plus d’une province et les compétences provinciales sont reprises par la Région dans le ressort de ces communes. Les Communautés obtiennent un refinancement partiel.
La réforme de 1993 fait aboutir les revendications fédéralistes des francophones, qui ne voient désormais plus d’intérêt à une nouvelle réforme institutionnelle. Au contraire, la Flandre affiche rapidement sa volonté d’aller plus loin. Le refinancement des Communautés est insuffisant pour régler les difficultés de la Communauté française, ce qui conduit celle-ci à inventer un dispositif de refinancement indirect avec la Région wallonne (par transfert à cette dernière de diverses compétences sans transfert intégral des budgets correspondants) ; cela affaiblit la position des francophones dans le débat avec les Flamands.
La réforme de 2001 peut être lue comme un approfondissement limité de la fédéralisation du pays. Les accords du Lambermont sont traduits dans la loi spéciale du 13 juillet 2001, qui prévoit un refinancement progressif des Communautés, une plus grande autonomie fiscale des Régions par la possibilité de lever des centimes additionnels ou soustractionnels sur l’IRPP ainsi que la régionalisation de certaines impositions. Parallèlement, la loi communale et la loi provinciale (organisation de la tutelle et droit électoral) sont régionalisées. Les accords du Lombard donnent lieu à la loi spéciale du 13 juillet 2001 sur Bruxelles, qui instaure un refinancement spécifique des commissions communautaires et, parallèlement, fixe à 17 le nombre d’élus néerlandophones au parlement bruxellois (pour 72 francophones, ce qui donne à la représentation flamande à Bruxelles un poids nettement supérieur à celui de sa population de langue néerlandaise).
b) Un fédéralisme très particulier
Si la Belgique répond bien au schéma classique des États fédéraux fondés sur une logique de dévolution et non d’agrégation, qui, souvent, mettent en place des institutions « à la carte », elle manifeste pourtant des traits particuliers.
La fédération belge est, à l’évidence, une fédération par défaut, puisque le processus de fédéralisation n’a jamais été conçu que comme un moyen d’apaiser les tensions entre les deux grandes communautés du pays, et non comme un projet politique en tant que tel. La fédéralisation a consisté à « déshabiller » progressivement l’État central de ses compétences en matière culturelle et économique au profit des Communautés et des Régions et à leur confier les moyens correspondants. Il s’agit d’un fédéralisme de « délitement », selon le mot de M. Jean-Pol Baras, Délégué général de Wallonie-Bruxelles en France.
C’est donc aussi une fédération inachevée, qui reflète l’absence d’accord politique entre les communautés sur l’essence de la fédération. En témoignent les débats et désaccords sur les limites des entités fédérées, avec la revendication de certaines forces francophones pour un élargissement de Bruxelles qui ne compte par pour rien dans la radicalisation des positions flamandes.
C’est également une fédération instable et propice aux tendances centrifuges, notamment en raison de l’absence de partis nationaux et des possibilités de blocage du pouvoir central. Cela conduit à orienter les évolutions toujours dans le même sens, d’autant que chaque communauté se vit comme menacée par l’autre et par l’État central, qu’elle pense être sous la domination de l’autre. La fédéralisation apparaît alors comme un refuge contre les empiètements toujours possibles du partenaire-adversaire.
La mission doit aussi relever que la Belgique est un État fédéral qui présente déjà de nombreux traits d’un État confédéral. Certes, la Belgique n’est pas une construction de droit international entre des États indépendants désireux de s’associer dans des domaines déterminés. Elle n’a pas non plus accordé le droit de sécession aux entités fédérées. Elle conserve un lien direct entre le citoyen et le niveau fédéral, à travers la portée de la nationalité belge et le vote pour les deux assemblées représentatives. L’État fédéral dispose encore de compétences étendues. Enfin, le niveau fédéral dispose d’une totale autonomie de décision et l’unanimité des entités fédérées n’est pas requise pour lui permettre de fonctionner.
Pour autant, il faut convenir que le lien entre le citoyen et les institutions fédérales est, en certains lieux, distendu. Le système politique est fréquemment organisé autour des blocs linguistiques, qui introduisent comme un filtre entre l’électeur et l’institution. C’est ainsi que les élections au Sénat sont organisées dans le cadre de deux collèges électoraux linguistiques, que la polarisation communautaire est très forte pour les élections à la Chambre, ou encore qu’une « double majorité » (au sein du groupe francophone et du groupe néerlandophone) est requise par la tradition (mais pas par les textes) pour l’approbation de la déclaration de politique générale et pour l’adoption des lois ordinaires.
De même, les entités fédérées jouissent d’une quasi-souveraineté normative : il n’y a pas de hiérarchie des normes entre la loi fédérale et les décrets des entités fédérées, qui ont la même valeur juridique (sauf pour quatre matières à Bruxelles). Les compétences dévolues à chaque entité composant la Belgique sont mutuellement exclusives, même si l’imbrication des compétences est parfois importante. De ce fait, le gouvernement fédéral et les gouvernements des entités fédérées sont amenés à conclure des accords de coopération intergouvernementale. Si un conflit de compétences survient, il est porté devant la Cour constitutionnelle, composée de six juges néerlandophones et de six juges francophones. Le règlement d’un conflit de substance est recherché dans le cadre d’un accord entre les deux communautés linguistiques, avec l’intervention d’une commission de conciliation composée du Premier ministre, de cinq ministres fédéraux et de six ministres des Régions et Communautés ; la saisine de la commission suspend les débats parlementaires pendant 60 jours.
Enfin, au niveau fédéral comme au niveau bruxellois, la minorité linguistique bénéficie de mécanismes de protection qui conduisent à lui conférer un quasi droit de veto sur certains domaines. La première de ces protections est la parité au niveau de l’exécutif, sachant que le Premier ministre est considéré comme un « asexué linguistique », selon l’expression consacrée. La deuxième protection est le mécanisme de la « sonnette d’alarme » : si lors de la discussion d’une proposition ou d’un projet de loi ou d’ordonnance, une motion motivée signée par les trois quarts au moins des membres d’un groupe linguistique déclare que les dispositions du texte qu’elle désigne sont de nature à porter atteinte aux relations entre les communautés, la procédure parlementaire est suspendue et la question est déférée au Conseil des ministres fédéral (ou au gouvernement bruxellois), organe paritaire, qui émet un avis motivé dans les 30 jours et invite le parlement à se prononcer soit sur cet avis, soit sur le projet ou la proposition éventuellement amendé. Cette procédure ne peut être appliquée qu’une seule fois par les membres d’un groupe linguistique à l’égard d’un même projet ou d’une même proposition de loi.
La troisième protection résulte des modalités de vote des lois spéciales, qui requièrent une majorité spéciale pour être adoptées. La majorité spéciale est la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés.
Le fédéralisme belge fait donc une large place aux mécanismes qui permettent de gérer les tensions intercommunautaires et qui l’apparentent d’ores et déjà à une confédération (49). Le niveau fédéral a été structurellement affaibli et il pâtit désormais d’une concurrence des légitimités avec les entités fédérées. Comme un symbole, d’ailleurs, l’article 1er de la Constitution, qui dispose que « La Belgique est un État fédéral qui se compose des communautés et des régions. », ne fait pas référence au niveau fédéral. Le passage par des responsabilités politiques au sein d’une Région ou d’une Communauté n’est plus considéré comme une relégation et, au contraire, le schéma de promotion du personnel politique semble s’être inversé au fil des années.
La fédéralisation de la Belgique, à travers sa dimension institutionnelle et le transfert progressif des compétences de l’État central vers les entités fédérées, a peu à peu déplacé le centre de gravité des institutions vers les Régions et les Communautés. C’est pourquoi le fédéralisme belge, dont la complexité peut être considérée aujourd’hui comme un problème, est aussi un « fédéralisme de résilience » qui, tout à la fois, permet au pays de supporter une longue crise politique et n’offre pas de réelle incitation à sortir rapidement de la crise.
La mission tient ici à rappeler que, pendant toute la crise de 2010-2011, la Belgique avait un parlement fédéral élu et un gouvernement fédéral en état de marche, bien qu’il ne fût pas responsable devant le parlement et que sa composition ne reflétât pas le résultat des élections de juin 2010 – ce qui pose un réel problème au regard des principes traditionnels de la démocratie représentative. La notion d’« affaires courantes » avait été élargie au fil du temps : le budget 2011 avait été élaboré, présenté au Parlement et adopté ; l’engagement militaire en Libye avait été décidé par le gouvernement ; le roi avait invité celui-ci à « faire le maximum pour préserver le bien-être économique et social », appelant ainsi à engager quelques réformes socio-économiques jugées indispensables ; le gouvernement avait mis en œuvre par voie législative l’accord interprofessionnel signé par les organisations patronales et les organisations de salariés, mais rejeté par les bases de celles-ci.
De même, grâce à la fédéralisation, le pays disposait de cinq parlements et cinq gouvernements totalement fonctionnels, dont l’activité n’a été que faiblement perturbée par la crise au niveau fédéral et qui ont pu remplir sans problème majeur les missions qui leur étaient confiées par la loi au profit de la population.
C – Un système des partis bousculé par l’émergence de la N-VA
En Belgique, les partis politiques ne sont pas seulement des institutions de mobilisation citoyenne, de canalisation du vote et de structuration des élections ; ce sont aussi des nébuleuses contrôlant de nombreuses organisations économiques, sociales et culturelles, tout au moins pour les partis « classiques ». Les partis politiques ont donc un rôle d’encadrement social, dans le cadre de ce que la science politique appelle les « piliers », réseau dense d’organisations qui, au profit d’un même groupe culturel, enclosent plus ou moins totalement leurs membres. Les partis ont également un rôle politique majeur, y compris dans le contrôle de l’action du gouvernement, puisqu’il arrive que des ministres soient obligés de recueillir l’aval de leur parti avant de prendre certaines décisions importantes dans le cadre de leurs attributions ministérielles.
C’est pourquoi la situation intérieure en Belgique dépend si fortement de la configuration du système des partis. Dans un paysage politique aussi fragmenté que celui qui prévaut depuis quelques années, l’émergence subite d’un parti séparatiste qui, en peu de temps, parvient à recueillir près de 30 % des voix de l’électorat flamand, est un phénomène capital.
1. Un paysage politique fragmenté
Si le paysage politique s’est fragmenté, c’est parce que les trois familles traditionnelles ont vu leur place progressivement s’éroder, bien qu’elles aient plutôt bien résisté aux vagues successives du régionalisme. Les années 1990, en revanche, ont vu l’installation durable de nouveaux acteurs.
a) La place des trois familles traditionnelles s’est progressivement érodée
M. Pascal Delwit rappelait à la mission que l’unionisme qui prévalait dans l’enceinte parlementaire dans les premières années suivant la révolution de 1830 a été forgé par les besoins de la lutte contre les Pays-bas du Nord et que cette entente entre les sensibilités libérale et catholique s’est affaiblie au fur et à mesure de la consolidation du régime, notamment à partir de la reconnaissance de la Belgique par les Pays-Bas en 1839.
Les premiers partis naissent de l’opposition croissante entre les tenants des positions de l’Église et les partisans d’une séparation entre l’Église et l’État. Ce clivage donne naissance aux partis libéral et catholique, le premier dès 1846 et le second en 1884, à l’issue d’un processus plus progressif. Par la suite, un autre clivage, né de la « question sociale », fait naître le « Parti ouvrier belge » en 1885. De 1830 à la Première guerre mondiale, les trois partis occupent seuls la scène politique ; ils recueillent ensuite plus de 90 % des suffrages jusqu’aux élections de 1961, sauf dans l’entre-deux-guerres. Leur déclin véritable débute vers 1970 : les trois familles politiques traditionnelles obtiennent environ 75 % des suffrages aux élections qui ont lieu dans les années 1970 et 1980 ; leur score descend aux environs de 70 % par la suite et ils obtiennent seulement 57 % des suffrages aux élections de 2010.
La famille libérale, la plus ancienne, a su se renouveler pour reconquérir une place éminente sur l’échiquier partisan. Initialement rivale du parti catholique, elle avait aussi souffert de l’émergence du parti ouvrier. Son implantation sur le territoire national étant assez diffuse, elle avait subi des défaites importantes du fait de l’effet amplificateur du scrutin majoritaire. L’instauration du scrutin proportionnel, en 1899, lui permet de rester une force politique importante, un allié privilégié du parti catholique pour les coalitions gouvernementales dans les années précédant la Seconde guerre mondiale. En déclin après 1945, le parti libéral abandonne son identité anti-cléricale à l’issue de la dernière guerre scolaire (1954-1958), au profit du libéralisme économique. Le parti se rebaptise en Parti de la liberté et du progrès (PLP-PVV). L’aile flamande (PVV) et l’aile francophone (PLP) se séparent en 1971, à la fois parce que l’échec électoral de 1968 a été attribué à la campagne unitaire menée par le parti et parce que les tensions internes se sont accrues sur la question bruxelloise.
Le PVV devient VLD en 1992 (« parti libéral et démocrate flamand »). Pendant 30 ans, les scores électoraux du PVV puis VLD ont oscillé entre 17,3 % et 22,6 % des suffrages en Flandre ; il est tombé à 15 % aux élections régionales de 2009 et 13,7 % aux élections fédérales de 2010. Du côté francophone, la famille libérale est représentée par le Mouvement réformateur, une fédération composée, jusqu’à la conclusion du volet institutionnel de l’accord de gouvernement, par quatre formations dont deux seulement ont une réelle importance politique : le pôle libéral, en fait absorbé par la structure fédératrice, et le pôle des francophones bruxellois, le FDF (Fédéralistes démocrates francophones), qui a quitté le MR en octobre 2011 sur fond de désaccord avec le traitement réservé à BHV dans l’accord institutionnel. Depuis le milieu des années 1990, les positions du MR sont très inspirées par le libéralisme social, même si les activités de son centre d’études délivrent des messages relevant d’un libéralisme plus classique. En matière électorale, ses résultats sont très fluctuants : en Wallonie, le MR a été capable d’obtenir 31,1 % des suffrages aux élections fédérales de 2007, alors qu’il n’y a recueilli que 24,3 % et 23,4 % respectivement aux élections régionales de 2004 et 2009. Cependant, sur le long terme, les élections successives témoignent de l’installation durable du MR à un niveau qui lui a permis de contester au parti social-chrétien la place de deuxième parti, puis de s’approprier cette position, puis, en 2007, de devenir le premier parti en Wallonie ; cette performance n’a pu être prolongée ni aux élections régionales de 2009, ni aux élections fédérales de 2010. A Bruxelles, l’alliance avec le FDF a donné des résultats également fluctuants, même si une tendance à la baisse se dessine nettement depuis les années 1980.
La famille démocrate-chrétienne a longtemps formé le pivot de tous les gouvernements. Successeur des diverses formations issues du parti catholique originel, le parti social-chrétien (PSC-CVP) est créé en 1945 ; il se scinde en 1968 dans les déchirements de l’affaire de Louvain, les deux branches devenant totalement indépendantes en 1972. Le courant démocrate-chrétien connaît un déclin quasi continu depuis le début des années 1950 ; ce déclin se traduit par une sévère défaite aux élections fédérales de 1999, qui envoie les deux partis flamand et francophone dans l’opposition pour deux législatures. C’est l’heure des remises en question : le parti francophone, le Centre démocrate humaniste, créé en 2002 sur les décombres du parti social-chrétien, adopte une orientation de centre-gauche qui en fait un partenaire privilégié du parti socialiste ; le parti flamand, le CD&V, adopte une orientation nationaliste et intègre d’ailleurs dans son nom la référence à la Flandre (« V » pour « Vlaams » : « parti chrétien-démocrate et flamand »). S’agissant de la réforme de l’État, le CD&V retient dans son programme politique la notion de confédéralisme, que l’on doit entendre comme tendant à conférer des compétences plus importantes aux Régions et aux Communautés mais pas nécessairement comme visant à transformer la Belgique en un État confédéral au sens classique du terme.
En termes électoraux la performance du CDH est stable depuis 1999 et oscille entre 15 % et 17 % des suffrages en Wallonie ; les élections de juin 2010 ont marqué un léger recul à 14,8 %. La défaite de 1999 avait ramené le CD&V (alors CVP) à un score de 22,2 % des suffrages en Flandre. Cette performance a été stabilisée entre les élections législatives de 2003 et les élections régionales de 2009 ; le cartel avec la N-VA a recueilli 26,3 % des suffrages aux régionales 2004 et 29,6 % aux législatives 2007. En revanche, le CD&V n’a obtenu que 17,6 % des suffrages en 2010 alors qu’il se présentait à nouveau seul sous ses propres couleurs.
La famille socialiste est restée la seconde force dominante du pays. Elle est celle qui a essayé de résister le plus longtemps possible à la division linguistique, mais après avoir instauré une double présidence en 1970, le parti socialiste belge se scinde en un parti francophone, le PS, et un parti flamand, le SP, qui devient ensuite SP.A. Le parti socialiste belge était, à l’origine, un parti d’organisations ouvrières ; malgré l’ouverture aux adhésions individuelles en 1944, le PSB, puis la famille socialiste a gardé des liens étroits avec les organisations syndicales, surtout en Wallonie. Le socialisme est la force politique dominante en Wallonie (environ 35 % des suffrages) alors qu’en Flandre, le mouvement ouvrier a été largement intégré au sein de la démocratie chrétienne. Le PS francophone a peu évolué au plan idéologique alors que le SP.A flamand a fait preuve de souplesse pour élargir ses alliances et peser sur ses partenaires flamands pour la constitution de coalitions ; cet effort d’élargissement n’a trouvé de conclusion positive qu’avec l’aile gauche du parti nationaliste Volksunie, après la scission de celui-ci en 2001, à travers la constitution d’un cartel pour les élections de 2003, 2004 et 2007. Le SP.A est également influencé par l’orientation globalement plus à droite du paysage politique flamand ; il recueille aux élections régionales des scores qui oscillent entre 15 % et 20 % des suffrages.
b) Les trois familles traditionnelles ont cependant résisté aux premières vagues des partis régionalistes
Parenthèse dans la phase de monopolisation du pouvoir par les trois familles traditionnelles réunies, l’entre-deux-guerres voit l’émergence d’un régionalisme politique. Celui-ci se nourrit tout d’abord des conséquences de la Première guerre mondiale, en particulier en Flandre. La surreprésentation des francophones chez les officiers et des Flamands chez les hommes de troupe de l’infanterie apparaît comme le signe de la violence de la domination francophone au sein de l’État belge et assure le succès du Frontpartij (« parti du front ») aux élections de 1919 puis dans les années 1920.
Puis, dans les années 1930, le régionalisme est accaparé par les partis d’extrême droite. Le VNV flamand (« Vlaams Nationaal Verbond » : « Ligue nationale flamande ») remporte des succès dans des zones rurales à forte dominance catholique et très peu sur l’axe métropolitain Malines-Anvers ; représentant d’un fascisme catholique anticlérical en rébellion contre l’épiscopat, il obtient plus de 15 % des suffrages aux élections de 1936, compte 29 parlementaires, 300 élus communaux et 30.000 membres, puis s’abîme dans la collaboration avec l’occupant allemand. En Wallonie, le parti rexiste conclut, en octobre 1936, un accord secret avec le VNV pour fédéraliser la Belgique ; cet accord est cependant suspendu dès septembre 1937 et ne représente guère autre chose qu’une rencontre ponctuelle entre un nationalisme flamand et un nationalisme belge obligé de composer avec la dualité foncière du pays. Au demeurant, cet épisode intervient alors que les partis concernés ne sont pas des acteurs majeurs du système partisan.
Les années 1960 et 1970 marquent l’âge d’or d’un régionalisme qui apparaît comme une réponse pertinente à l’exacerbation des tensions communautaires. Celles-ci « absorbent » en partie le clivage philosophique, et l’opposition entre le parti catholique et les partis laïques est aussi traduite en termes d’opposition entre la Flandre et la Wallonie.
Avec la Question royale (mars-août 1950) et le dernier épisode de la guerre scolaire (1950-1958), c’est le décalage entre une Flandre catholique et une Wallonie laïque qui se voit confirmé. De plus, la Question royale montre aux Wallons qu’ils sont minorisés au plan politique dans l’État unitaire et aux Flamands que les mécanismes démocratiques classiques au sein de l’État unitaire peuvent être contrecarrés.
La Question royale (1950) est née du désaccord entre le roi Léopold III et ses ministres sur la capitulation de l’armée en 1940, de son attitude neutraliste pendant l’occupation, de sa volonté de négocier avec l’Allemagne un statut comparable à celui de la France sous l’Occupation et, accessoirement, de son mariage controversé pendant la guerre et de son « emprisonnement » au château de Laeken.
En juin 1940, le Parlement a constaté l’impossibilité de régner et a confié la régence du royaume au prince Charles, frère cadet du roi. A la fin de la guerre, la famille royale a été emmenée en Allemagne et, à la Libération, le roi exprime son souhait de rentrer en Belgique, ce qui crée des tensions au gouvernement entre les ministres catholiques et les ministres des partis non confessionnels. Le parlement adopte alors une loi qui interdit le retour du roi tant que le Parlement ne se sera pas prononcé sur la fin de l’impossibilité de régner ; le débat parlementaire révèle le même clivage entre des élus sociaux-chrétiens qui souhaitent le retour du roi, des élus libéraux qui souhaitent son effacement et des élus socialistes et communistes (50) qui souhaitent son abdication.
En mars 1950, le gouvernement organise une « consultation populaire » portant sur le retour du roi sur le trône ; près de 60 % des électeurs se déclarent en faveur du retour du roi, mais en Wallonie, le non l’a emporté à hauteur de 60 %. A la suite des élections de juin 1950, un gouvernement homogène social-chrétien est constitué, qui fait voter par sa majorité la fin de l’impossibilité de régner. Des troubles et des grèves éclatent alors en Wallonie, ainsi que des actions insurrectionnelles (attentats contre des voies de chemin de fer et des centrales électriques). Léopold III cède aux conseils de son entourage et délègue ses pouvoirs à son fils Baudouin (août 1950) puis abdique à son profit (juillet 1951).
Dix ans plus tard, à l’hiver 1960-1961, la « grève du siècle » voit la renaissance et la popularisation du mouvement wallon, qui reçoit l’appui des forces syndicales et s’affirme dans un fédéralisme décomplexé.
Dans les années 1960, les forces régionalistes font preuve d’une nouvelle vigueur dans le Nord du pays et émergent réellement dans le Sud. Elles deviennent des acteurs importants du système politique belge car elles réussissent à inscrire leurs demandes sur l’agenda politique et obligent les partis traditionnels à les intégrer. Elles s’alimentent aussi au fait que les partis traditionnels n’ont pas pu empêcher l’émergence de vues différentes entre néerlandophones et francophones sur l’avenir du pays.
En Flandre, la Volksunie est créée en 1954 mais connaît d’abord un démarrage assez lent, recueillant environ 3,5 % des voix. Son essor débute aux élections de 1961, où elle rassemble près de 6 % des voix. La Volksunie profite, en fait, de l’apaisement du clivage confessionnel, à la suite de la pacification scolaire, et de celui du clivage économique, en raison de l’essor des années 1960 ; le clivage communautaire peut donc revenir au premier plan. La Volksunie représente une union de courants idéologiques variés et a une base électorale assez interclassiste. En 1971, la Volksunie réalise son meilleur score (18,8 % des voix et 21 élus) et ravit aux libéraux du PVV la place de troisième parti de Flandre. La possibilité lui est ouverte de participer à un gouvernement, ce qui crée une vive tension interne entre les flamingants radicaux, qui ne souhaitent pas faire les compromis associés à une participation gouvernementale, et les flamingants modérés, qui y sont prêts. Elle participe au gouvernement entre 1977 et 1979, mais un virage à gauche amorcé au début des années 1970 conduit son aile droite à entrer en dissidence pour former le Vlaams Blok. L’intégration des préoccupations flamandes dans les programmes des partis classiques, la scission de ces mêmes partis, les progrès de la réforme de l’État et des interrogations persistantes sur son identité et sa stratégie provoquent son déclin électoral et la poursuite d’un débat interne, où les plus radicaux veulent aller au-delà du fédéralisme.
En 2001, la Volksunie se scinde à la suite d’un référendum interne : son aile droite et radicale forme la N-VA, qui présente des listes propres aux élections fédérales de 2003 puis se constitue en cartel avec le CD&V ; son aile gauche et modérée forme le mouvement Spirit, qui conclut une alliance électorale avec le SP.A, laquelle connaît un succès important aux élections fédérales de 2003 (avec 23,5 % des suffrages, le cartel devient le deuxième parti de Flandre), mais décline aux élections suivantes. En 2009, Spirit se fond dans le parti écologiste flamand, Groen.
Dans la région bruxelloise, le milieu des années 1960 est marqué par l’apparition du FDF (« Front démocratique des Francophones » jusqu’en janvier 2010, « Fédéralistes démocrates francophones » depuis). Ce parti axe son action sur la défense des intérêts des francophones à Bruxelles et dans sa périphérie ; depuis 2009, il tente de s’implanter dans toute la Wallonie. Le FDF a bénéficié d’un glissement de l’électorat libéral dans les années 1970, période pendant laquelle il a eu son influence maximale sur la scène politique nationale. Son déclin électoral depuis le début des années 1980 a incité à un rapprochement structurel avec les libéraux francophones. Auparavant, le FDF avait souvent collaboré avec le Rassemblement wallon.
Créé en 1968, celui-ci naît de la volonté de dissidents du parti socialiste belge de refuser l’unitarisme des partis traditionnels afin de faire progresser la cause de la Wallonie. Le parti obtient 20 % des votes en Wallonie et 35 % à Bruxelles aux élections législatives de 1974 et entre dans le gouvernement, où il prépare la mise en place du premier conseil régional wallon, dans le cadre de la réforme institutionnelle adoptée en 1970. Le Rassemblement wallon disparaît au milieu des années 1980, notamment en raison d’une réorientation idéologique ; il ressuscite en juin 2010 à partir d’un assemblage de petits partis régionalistes, mais son audience reste pour l’heure confidentielle.
c) Les années 1990 ont vu l’installation durable d’autres acteurs
L’extrême droite a une présence forte et durable en Flandre. Le Vlaams Blok, né d’une scission de la Volksunie en 1979, abandonne au milieu des années 1980 un discours axé sur les questions linguistiques pour se transformer en parti d’extrême droite classique. Il remporte alors quelques succès à Anvers, notamment aux élections communales de 1988. Mais ce sont les élections de 1991 qui créent la rupture, en ce « dimanche noir » où le Vlaams Blok triple sa performance électorale antérieure et recueille plus de 10 % des suffrages. Cette victoire permet de professionnaliser le parti et de lui donner accès au financement public, mais les partis démocratiques décident de dresser autour de lui un « cordon sanitaire ». Le Vlaams Blok continue néanmoins sa percée et obtient 24,1 % des suffrages en Flandre aux élections fédérales de 2007. Il entame alors un déclin sensible, son score passant à 18,9 % aux élections régionales de 2009 et 15,3 % aux élections fédérales de 2010. Il reste cependant particulièrement bien implanté à Anvers, son bastion. Le Vlaams Blok, transformé en Vlaams Belang à la suite d’une condamnation judiciaire en 2004, garde pour objectif principal la création d’une Flandre indépendante dont il convient d’ores et déjà de renforcer l’homogénéité ethnique.
En Wallonie, l’extrême droite est faible et fluctuante. Un Front national, créé en 1984, est quasiment inaudible en dehors des périodes électorales, même s’il parvient parfois à y conquérir entre un et quatre sièges dans les assemblées fédérales ou régionales. Il ne dispose pas d’une forte base électorale et d’organisations de terrain.
Les partis écologistes affirment leur présence depuis les élections européennes de 1979 ; leur succès croissant les conduit à être en position de participer à des coalitions gouvernementales en 1999 et le parti francophone (Ecolo) comme le parti flamand (Agalev, puis Groen) font le choix de devenir des partis de gouvernement. Ce n’est pas sans quelque difficulté idéologique, puisque Ecolo invente à ce propos le néologisme « participopposition »… Les deux partis connaissent cependant des revers électoraux en 2003 puis stabilisent (Ecolo) ou améliorent légèrement (Groen) leurs performances : aux élections de juin 2010, Ecolo a recueilli 12 % des suffrages et Groen 7 %.
Les écologistes sont la seule famille à conserver des liens institutionnels et politiques étroits : ils forment en effet un groupe parlementaire commun à la Chambre des représentants, qui transcende ainsi la répartition des élus en deux groupes linguistiques.
2. La N-VA s’est imposée comme un acteur-clef de la crise de 2010
C’est donc dans ce paysage fragmenté que le dernier-né des partis nationalistes flamands a fait son apparition. Son succès peut être analysé de multiples façons, mais il apparaît tout d’abord que la N-VA est le parti qui a su tirer profit du sur-place du différend communautaire pendant quasiment une décennie. Il a cherché à capitaliser cet acquis en adoptant, pendant la crise et les négociations associées, une attitude intransigeante et bénéficie pleinement du charisme de son leader, M. Bart De Wever.
a) La N-VA a tiré profit du sur-place du différend communautaire pendant près d’une décennie
Le gouvernement fédéral « arc-en-ciel » formé à la suite des élections du 13 juin 1999 (51) ne fait pas des problèmes communautaires son cheval de bataille, mais il ne peut ignorer pour autant la pression qui se manifeste du côté flamand pour de nouvelles réformes institutionnelles. Celle-ci s’est manifestée, dès avant les élections, en mars 1999, par l’adoption par le Parlement flamand de cinq résolutions qui dressaient un programme complet de réformes.
Le gouvernement Verhofstadt I (1999-2003) travaille essentiellement à la résolution du problème le plus urgent, le refinancement des Communautés, auquel il joint un accroissement de l’autonomie fiscale des régions. Les accords du Lambermont et du Lombard scellent une réforme d’ampleur limitée (52). Confronté à de pressantes revendications sur la scission de BHV, le gouvernement imagine un dispositif relevant du droit électoral qui aboutit à ce que l’on appelle une « scission horizontale » de BHV ; mais ce dispositif est annulé par la Cour constitutionnelle, ce qui laisse ouvert le dossier BHV (53). En mars 2003, vingt-huit bourgmestres des communes de la périphérie bruxelloise exigent qu’aucun parti flamand n’entre dans le prochain gouvernement fédéral si ce dernier ne prévoit pas la scission de la circonscription électorale de BHV ; ils relaient un appel lancé par plusieurs associations flamingantes aux partis flamands.
Même si cette fronde des bourgmestres ne rencontre guère d’écho, le gouvernement Verhofstadt II (2003-2007) doit répondre à une pression flamande croissante réclamant la scission de BHV. L’accord de gouvernement prévoit qu’un Forum sera chargé de travailler certains sujets communautaires (régionalisation de la sécurité routière, autonomie constitutive de la région Bruxelles-Capitale, etc.), mais, si la régionalisation de l’octroi des licences d’exportation, d’importation et de transit des armes est effectivement discutée et adoptée, la décision est très vite prise de reporter le Forum au-delà des élections régionales de 2004.
A l’approche des élections régionales, les bourgmestres flamands déclenchent une nouvelle fronde : ils menacent de boycotter l’organisation du scrutin européen, qui a lieu le même jour. Les trois partis traditionnels flamands convergent vers une revendication de règlement du dossier BHV partagée avec les partis séparatistes et, à la veille du scrutin, tous les partis flamands ont pris l’engagement solennel d’obtenir la scission de BHV à bref délai, bien avant les élections fédérales de 2007.
Après les élections, les partis flamands développent leur stratégie sur deux fronts. Sur le front de la réforme de l’État, ils s’appuient sur un cahier de revendications construit publiquement et repris dans des déclarations approuvées par un maximum de partis, comme l’accord de gouvernement flamand de 2004 ; il revient alors aux partis présents à la fois dans la majorité régionale et dans la majorité fédérale de créer les conditions permettant d’impliquer les francophones dans un processus de négociations. Sur le front de BHV, les partis flamands accroissent la pression sur les francophones par le dépôt de propositions de loi portant scission de BHV, qui sont susceptibles d’être adoptées avec les seules voix flamandes. Les deux dossiers sont en étroite interaction : à la fin de l’année 2004, le débat entre les partis flamands porte sur la question de savoir si cela vaut la peine de bloquer le pays et de risquer la chute du gouvernement en essayant d’imposer la scission de BHV sans concertation avec les francophones. Le CD&V, dans l’opposition fédérale mais dans la majorité régionale flamande, fait pression sur ses partenaires du gouvernement flamand en menaçant de retirer sa confiance au gouvernement.
Pour sa part, le gouvernement crée plusieurs instances de travail – dont le Forum précité – dans des délais rapprochés et sur des thématiques parfois peu claires étant entendu que chacun sait que le sujet prioritaire est le dossier BHV. Il revient à la dernière de ces instances, un groupe de travail informel réuni par le Premier ministre et rassemblant quatre partis ou cartels, d’élaborer un projet d’accord communautaire global, dont la teneur est connue en mai 2005. Ce projet prévoit la scission de BHV avec préservation des droits électoraux des électeurs francophones des 6 communes à facilités et un régime extinctif préservant les droits des électeurs francophones inscrits en 2007 dans 17 autres communes de Hal-Vilvorde ; les compétences de la Communauté française seraient élargies aux communes à facilités pour l’ensemble des matières personnalisables ; les contraintes relatives à l’emploi des langues à Bruxelles seraient assouplies ; l’arrondissement judiciaire BHV verrait ses tribunaux dédoublés et son parquet scindé ; un refinancement de la région bruxelloise serait mis en place, en tenant compte du programme de désendettement de la Belgique au regard des normes européennes.
Cependant, le 10 mai 2005, le parti Spirit refuse de continuer à discuter le projet d’accord, car il n’accepte pas l’extension territoriale des compétences de la Communauté française. C’est l’échec du processus car, compte tenu du retrait de Spirit et de l’opposition du CD&V, il n’est pas possible d’obtenir la majorité des deux tiers nécessaire à l’adoption du projet. En conséquence, le gouvernement « met au frigo » le dossier BHV jusqu’à la fin de la législature.
Le dialogue communautaire se tend encore au cours de la législature 2007-2010. Pendant la campagne électorale, les partis flamands font de la scission de BHV une priorité. Le CD&V adopte sur ce sujet des positions particulièrement fermes, dans le cadre de revendications poussées sur la réforme de l’État (54). A l’été qui suit, chargé de former un gouvernement, M. Yves Leterme tente de créer les conditions d’une « solution négociée », c’est-à-dire une scission de BHV moyennant des compensations aux francophones. Mais il s’enlise et ne peut empêcher plusieurs députés flamands de déposer à la Chambre des propositions de loi scindant BHV sans concessions. M. Leterme essaye de construire une majorité dite « orange-bleue », c’est-à-dire composée des partis sociaux-chrétiens et libéraux, qui ne disposait pas de la majorité des deux tiers indispensable pour faire aboutir tout projet de réforme institutionnelle. Les francophones s’étant déclarés « demandeurs de rien », la démarche retenue par le formateur conduit à offrir un « droit de veto » sur le principe même de la réforme aux partis qui y sont hostiles. C’est notamment le cas du CDH, dont la président, Mme Joëlle Milquet, est bientôt surnommée « Madame non » par les négociateurs flamands.
Le gouvernement sortant, dirigé par G. Verhofstadt, reste en affaires courantes de juin à décembre 2007. Une coalition réunissant le cartel CD&V / N-VA, le CDH, le MR, le VLD et le PS (mais pas le SP.A) est ensuite investie comme gouvernement de plein exercice, mais pour une durée de 3 mois seulement avec pour objectif prioritaire de trouver les moyens de débloquer le dialogue communautaire.
Entre-temps, en novembre 2007, la commission de l’Intérieur de la Chambre des représentants a adopté une proposition de loi portant scission de BHV, ce qui accroît la pression sur les tentatives de formation du gouvernement, puis sur les travaux entrepris sous son égide.
Le gouvernement transitoire met en place un groupe de travail autour de huit partis, le groupe Octopus. Celui-ci travaille en janvier et février 2008 et parvient à préparer un projet d’accord portant premier « paquet » de réformes institutionnelles, qui est immédiatement traduit en proposition de loi ; il est prévu qu’un second « paquet », d’une portée plus grande car incluant la régionalisation du marché de l’emploi et de la fiscalité, sera finalisé pour le 15 juillet au plus tard.
Le 18 mars 2008, le gouvernement transitoire, ayant rempli son office, cède sa place au gouvernement d’Yves Leterme. Mais le dialogue communautaire se grippe peu à peu. L’accord portant deuxième paquet de réformes prévu par le projet Octopus ne peut être élaboré avant la date limite du 15 juillet. L’idée que les entités fédérées doivent devenir le moteur de la négociation dans le cadre d’un « dialogue interinstitutionnel » fait son chemin pendant l’été. Cependant, déçue de l’absence de progrès et dépitée d’entendre le président du MR affirmer qu’aucun accord n’est envisageable avant les élections régionales de juin 2009, la N-VA décide de retirer le 21 septembre son soutien au gouvernement fédéral. La rupture du cartel est entérinée par le CD&V le 27 septembre. M. Kris Peeters, ministre-président flamand, s’efforce de faire démarrer le dialogue interinstitutionnel, mais ses efforts sont contrecarrés par les demandes du gouvernement fédéral relatives aux modalités de l’assainissement budgétaire ainsi que par une dégradation du climat politique relatif à la périphérie bruxelloise. M. Yves Leterme démissionne à la suite de l’affaire Fortis (55), et M. Herman Van Rompuy le remplace le 30 décembre 2008. Le dialogue interinstitutionnel s’enlise et il y est mis fin à la mi-février 2009. M. Van Rompuy ayant été nommé président du Conseil européen, M. Leterme retrouve ses fonctions de Premier ministre en novembre 2009. M. Jean-Luc Dehaene, ancien Premier ministre, est nommé à cette occasion Commissaire Royal aux affaires institutionnelles. Il achève sa mission le 20 avril 2010 en formulant des propositions qui « pourraient constituer la base d’un accord sur BHV ». Mais le 22 avril 2010, le parti libéral flamand VLD annonce son intention de quitter le gouvernement et le Premier ministre remet sa démission au roi le même jour.
b) La N-VA veut s’affirmer le seul vrai défenseur des intérêts des Flamands
Neuf ans après les accords du Lambermont et du Lombard, le dossier communautaire n’a donc enregistré aucune évolution, malgré la forte pression flamande exercée tout au long de la période. Cela crée un contexte favorable pour la N-VA, tant pour la préparation des élections de juin 2010 que pour les négociations qui suivront en vue de la constitution du gouvernement fédéral.
La N-VA profite tout d’abord d’une radicalisation générale du discours flamand sur les enjeux communautaires, qui en accroît la légitimité et ouvre un espace à l’expression de revendications plus poussées que celles qui sont portées par les partis traditionnels.
Depuis plusieurs années, cette radicalisation touche d’abord le CD&V (56). Celui-ci, après la défaite de 1999 ressentie comme une injustice temporaire, a dû encaisser le choc d’une nouvelle défaite en 2003, qui a porté à 8 années la durée de son passage dans l’opposition. L’ex premier parti de Flandre a donc vu un recours dans Yves Leterme, ministre-président de Flandre depuis 2004, et une opportunité dans la conclusion d’un cartel avec la N-VA, alors petit parti issu des décombres de la Volksunie dont l’avenir électoral n’était pas assuré en raison de l’existence d’un seuil de 5 % des suffrages pour obtenir une représentation parlementaire. Après le « calme communautaire » observé sous les gouvernements Verhofstadt, l’alternative politique devait nécessairement s’afficher « flamande ».
Le CD&V a également connu ce que l’on peut appeler le pouvoir libérateur de l’opposition. Pendant plusieurs décennies, le parti social-chrétien, principal parti de Flandre et force majeure à l’échelle du pays, a porté les intérêts supérieurs de l’État et incarné le compromis à la belge. S’il a toujours abrité en son sein une tendance flamingante parfois virulente, son rôle central sur l’échiquier politique belge l’obligeait à établir d’abord des compromis internes en vue d’aboutir ensuite à des compromis externes, avec les partenaires de coalition. La cure d’opposition que le CD&V connaît de 1999 à 2007 permet une certaine libération des tensions internes, qui oriente finalement les positions du parti.
Enfin, les hasards du calendrier électoral font que la première victoire du cartel CD&V / N-VA intervient aux élections régionales de 2004. Le CD&V rénové est ainsi amené à se couler dans un moule flamand et ses principaux leaders s’y forgent une vision essentiellement flamande des rapports entre entités fédérées et État fédéral.
L’évolution du discours communautaire du VLD est moins claire, mais force est de constater que c’est bien ce parti qui quitte le gouvernement en avril 2010, estimant qu’il n’est plus possible de reculer une nouvelle fois les perspectives d’aboutissement d’un accord. Au demeurant, si le VLD est resté relativement modéré sur ce dossier pendant la législature 2007-2010, il s’est inscrit dans un certain « suivisme » du CD&V, peut-être pour éviter d’être accusé de soutenir trop mollement la coalition orange-bleue ou par désir de se démarquer de l’immobilisme communautaire de son ancien leader, M. Verhofstadt.
Par ailleurs, même si tous les partis présentent aux électeurs des programmes globaux, chacun sait, en juin 2010, que les élections se font pour l’essentiel sur l’enjeu communautaire, qui est justement le terrain de prédilection de la N-VA. Le parti aborde une échéance électorale taillée sur mesure pour sa plate-forme politique.
La N-VA profite aussi de l’affaiblissement de la crédibilité du CD&V sur le dossier communautaire, car, comme l’on dit plusieurs interlocuteurs de la mission, le ministre-président flamand a beaucoup promis lors de la campagne électorale de 2007 mais n’a obtenu aucun résultat une fois devenu Premier ministre. Dans ce domaine, la N-VA apparaît donc comme un parti « neuf », à la fois parce que, dans un premier temps, il n’a pas participé au gouvernement Leterme tout en lui accordant son soutien, et parce que, dans un deuxième temps, il n’a pas hésité à rompre avec le CD&V au moment où il lui est apparu que les objectifs justifiant ce soutien ne pourraient être réalisés.
Les partis francophones ont eux aussi usé leur crédibilité en restant confinés dans une inertie insupportable à leurs partenaires flamands. M. Armand De Decker, sénateur, ancien ministre, indiquait ainsi à la mission que « les francophones n’ont pas su répondre à la demande croissante d’autonomie des partis flamands qui a émergé depuis une décennie : ils n’ont pas réagi aux résolutions votées par le Parlement flamand en 1999, ils se sont affirmés “demandeurs de rien” sur la réforme de l’État et se sont arc-boutés sur un statu quo dans les débats sur BHV ». Ce qui a pu apparaître aux Flamands comme une crispation francophone, notamment pendant la législature 2007-2010, pouvait alors légitimer le choix de postures rigides, tant pendant la campagne électorale que lors des négociations qui s’ensuivraient.
Dans une large mesure, les blocages de 2007 introduisent les blocages de 2010. A l’issue d’une législature de rendez-vous manqués et d’échéances non tenues, les partis flamands se sont sentis comme grugés par leurs partenaires francophones : la logique politique voulait que les élections de 2007 se traduisent rapidement par la conclusion d’un accord communautaire et que le gouvernement concentre ensuite ses efforts sur les autres dossiers de la vie nationale ; trois ans plus tard, les partis flamands font le constat que des gouvernements ont été constitués et ont travaillé mais que les francophones ont réussi à bloquer toute avancée du dossier communautaire. La leçon pour les négociations post-électorales de 2010 est claire : il n’est pas question, pour les partis flamands, d’accepter la formation d’un quelconque gouvernement tant qu’un accord sur la réforme de l’État n’aura pas été préalablement conclu. Or, pour la première fois dans l’histoire de la Belgique, les élections de juin 2010 mettent à la place centrale de la table des négociations un parti ouvertement séparatiste.
De fait, la N-VA assume pleinement une intransigeance rigoureuse. Elle s’affiche comme le parti qui n’a pas vocation à trahir les intérêts des Flamands, qui ne fait pas de la politique pour convoiter des maroquins ministériels, qui place la défense de ses convictions plus haut que la recherche du compromis à tout prix. Comme l’indiquait un interlocuteur de la mission, « Bart De Wever et la N-VA représentent une réelle lame de fond, qui veut une fois pour toutes s’affirmer contre des francophones longtemps dominants et qui, pour cela, adhère totalement au message des flamingants : “ne bougez pas, ne concédez rien !” ». Pour sa part, M. Martin Buxant expliquait que l’« accomplissement politique » de M. De Wever consistait à se positionner comme le nationaliste flamand et qu’il ne pouvait donc quitter son rôle de négociateur et accepter de gouverner qu’à la seule condition que la feuille de route de la N-VA soit intégralement suivie ; il en concluait que M. De Wever aurait du mal à sortir de sa posture et que la N-VA ne pourrait pas bouger.
La N-VA pouvait effectivement se satisfaire du rétrécissement structurel de l’espace de négociation que l’on peut observer depuis quelques années. Les sondages effectués pendant les négociations post-électorales, en 2010 puis en 2011, n’ont jamais montré qu’elle aurait pâti de son intransigeance ; au contraire, alors que le parti a recueilli 29,5 % des suffrages aux élections à la Chambre des représentants, les intentions de vote en faveur de la N-VA se sont élevées rapidement jusqu’à 40 % environ et sont restées à ce niveau pendant les longs mois de la négociation.
Pour autant, la N-VA n’est pas à elle seule à l’origine du rétrécissement précité : il s’agit bien plutôt d’une tendance partagée au sein de la plupart des partis. Revenant sur quinze mois de crise politique, en août 2011, M. Vincent de Coorebyter, directeur du Centre de recherches et d’informations socio-politiques, estimait par exemple : « On a rarement vu […] la plupart des partis aussi attachés à l’une ou l’autre priorité qu’ils semblent défendre à tout prix. Il n’y a là aucun reproche à leur faire : on a suffisamment déploré que les partis concluent des compromis improbables qui n’honorent qu’une maigre part de leurs promesses. Mais l’exigence de voir tel ou tel engagement d’un parti respecté coûte que coûte est source de blocage » (57). Ces propos viennent rappeler ceux de M. Jean-Luc Dehaene à l’issue de sa mission de conciliation sur BHV, en avril 2010, qui disait : « J’ai rarement vécu une illustration plus claire de la philosophie de base […], à savoir que pour comprendre la logique de ses partenaires de discussion, il faut accepter leurs prémisses. Dans ce cas-ci, cela signifie que chaque communauté croit détenir la vérité en se basant sur son propre point de départ. Une communauté part du principe de territorialité ; l’autre du principe de personnalité. Les deux sont en opposition totale. Un compromis n’est possible que si chaque partie est disposée à se départir en partie de sa propre logique ».
Dans un système tel que celui de la Belgique, avec un scrutin proportionnel et un paysage politique fragmenté entre neuf partis principaux susceptibles de participer à des négociations de coalition, la volonté farouche de tenir les engagements pris auprès de ses électeurs risque effectivement de conduire à des blocages. Mais elle apparaît aux partis comme le meilleur moyen de se protéger d’une éventuelle sanction électorale. Mme Béatrice Delvaux indiquait d’ailleurs à la mission que « tous les partis flamands qui ont essayé de s’engager vers un compromis ont été laminés aux élections suivantes ».
Depuis quelques années, le débat communautaire est conduit comme si le compromis devait être pour chaque protagoniste une défaite idéologique, mesurée à l’aune des concessions rendues aux partenaires–adversaires, plutôt qu’une construction collective permettant de répondre, au moins pour un temps, aux besoins du pays.
Au demeurant, la N-VA était-elle capable de conclure in fine un compromis et en avait-elle réellement la volonté ? Plusieurs interlocuteurs de la mission ont exprimé de profonds doutes à cet égard. M. Armand De Decker estimait que la N-VA avait été « prise de court » par son succès électoral et que son dirigeant n’avait pas encore l’expérience qui lui permettrait d’« assumer ses responsabilités et de prendre les décisions nécessaires ». M. Pascal Delwit disait « douter de plus en plus » de la bonne foi de M. De Wever, rejoignant ainsi les propos de M. Marc Eyskens, ancien Premier ministre CD&V, en avril 2011, qui affirmait que le comportement de M. De Wever négociateur créait la « méfiance » en raison de ses revirements incessants (58).
Par delà le compromis impossible, la force de la N-VA vis-à-vis de l’opinion publique flamande vient aussi de ce qu’elle actionne en tant que de besoin les deux registres de son discours politique : tantôt elle se veut être le seul parti capable d’arracher aux francophones la profonde réforme de l’État que les Flamands appellent de leurs vœux ; tantôt elle se veut être le seul parti capable de préserver le Flamand laborieux du « cauchemar fiscal » préparé par le parti socialiste.
Elle doit en effet tenir compte du caractère composite de son électorat et, en premier lieu, satisfaire un noyau dur de nationalistes directement issus de la défunte Volksunie ou conquis ultérieurement. A cet égard, la N-VA tient pour son « but final une Flandre indépendante en tant qu’État membre européen », l’indépendance de la Flandre étant inscrite dans l’article 1er de ses statuts. Pour M. Paul Buysse, d’ailleurs, « Bart De Wever est un séparatiste avec un “S” aussi grand que la Tour Eiffel », qui souhaite, comme le veut l’expression très souvent employée par M. De Wever lui-même, « l’évaporation de la Belgique », un processus dans lequel « le niveau fédéral disparaît progressivement » et se dissout dans les régions et dans l’Europe. M. Christian Laporte indiquait pour sa part à la mission que M. De Wever « est convaincu que le pays ne vaut pas un sacrifice ». Le processus doit cependant respecter les voies démocratiques et M. De Wever a indiqué à la mission, comme il l’a déjà fait souvent par le passé, que la N-VA veut une évolution et non une révolution. De façon très significative, MM. Karl Vanlouwe et Frank Boogaerts ont présenté à la mission la N-VA comme un parti « régionaliste et nationaliste » ; en effet, « son but actuel est d’obtenir plus de compétences pour les régions et son but ultérieur est la séparation du pays avec une adhésion directe à l’Union européenne ». M. De Wever a cependant précisé à la mission qu’à son sens, l’indépendance de la Flandre n’est envisageable qu’à la condition que l’Europe se renforce ; à défaut, la N-VA se contenterait de réduire le niveau fédéral à une « coquille vide », tout en le conservant.
La N-VA doit également fidéliser les électeurs qui ont pour la première fois voté pour elle en juin 2010. Une enquête de la Katholieke Universiteit Leuven publiée en juin 2011 a montré que le vote N-VA de 2010 est motivé par deux aspirations différentes : la plus importante est la réforme de l’État, mais les « nouveaux » électeurs de la N-VA sont beaucoup moins préoccupés par la question flamande que les « anciens » électeurs (ceux qui ont déjà voté pour la N-VA aux élections régionales de 2009) ; la seconde motivation est la volonté de changement politique dans le domaine socio-économique, qui apparaît surtout chez les « nouveaux » électeurs. Ceux-ci seraient issus principalement du VLD et dans une moindre mesure du CD&V.
L’enquête montre aussi que seuls 17 % des électeurs de la N-VA veulent une scission de la Belgique et que 63 % d’entre eux veulent une Belgique fédérale avec une régionalisation approfondie. Pour M. Dave Sinardet, « Bart De Wever sait qu’il a un problème dans le positionnement communautaire de son parti car le clivage électoral le plus intense est le clivage gauche-droite ». Selon lui, « beaucoup d’électeurs de la N-VA ne savent pas que ce parti est séparatiste ».
C’est pourquoi au cours de la crise 2010-2011, la N-VA a peu à peu mis en sourdine son discours indépendantiste pour « enfourcher le cheval libéral », selon le mot de Mme Mia Doornaert, même si, aux yeux de M. Philippe Van Parijs, « les grands sujets socio-économiques n’étaient pas résolus dans la note d’octobre 2010 » établie par M. De Wever à l’issue de sa mission de « clarification ». De son côté, M. Martin Buxant indiquait à la mission que le discours économique de la N-VA ne correspond pas à la réalité, mais que M. De Wever « sent parfaitement les aspirations de la classe moyenne flamande : son programme pourrait être repris par le VLD ».
Si la N-VA assume sans difficulté sa position sur la partie droite de l’échiquier politique, elle refuse, en revanche, d’être assimilée à l’extrême droite et ne veut entretenir aucun lien avec le Vlaams Belang. La N-VA n’envisage pas de remettre en question le « cordon sanitaire » établi par les partis démocratiques qui confine le Vlaams Belang hors de l’exercice du pouvoir. M. De Wever s’est exprimé très clairement sur ce sujet devant la mission, tout en regrettant qu’un parallèle soit encore trop souvent établi entre son parti et le Vlaams Belang, notamment dans la presse et l’opinion publique francophone.
M. De Wever a estimé, à cet égard, que le vote Vlaams Belang est un « vote de désespoir » pour un changement survendu par le parti d’extrême droite, alors que le vote N-VA est « un vote d’espoir pour les gens tranquilles que sont les Flamands. La N-VA montre que l’on peut vouloir une réforme communautaire sans être extrémiste ». Il a également présenté la réduction du score du Vlaams Belang comme l’un des principaux objectifs de la N-VA pour les élections communales qui auront lieu en octobre 2012.
Mme Béatrice Delvaux convient que la N-VA est un parti démocratique même si les francophones insistent sur ce qu’ils pensent être un extrémisme latent. Pour elle, l’essor de la N-VA a « cassé l’extrême droite » et « les Flamands estiment que la N-VA a rendu un grand service à la Flandre ». Pourtant, rappelait M. Christian Laporte, M. De Wever est « disqualifié » aux yeux des francophones en raison des multiples dérives dont il est l’auteur. M. De Wever a, par exemple, créé une émotion certaine lorsqu’en novembre 2007, il a reproché au maire d’Anvers d’avoir présenté des excuses à la communauté juive de sa ville pour le comportement de l’administration et de la police municipale pendant la Seconde guerre mondiale, et estimé que la communauté juive instrumentalisait l’Holocauste ; M. De Wever s’est excusé deux jours après cette déclaration.
On peut pareillement relever qu’en octobre 2011, après la conclusion de la partie d’accord portant sur le règlement du dossier BHV, et plus précisément sur son volet judiciaire, M. De Wever a réagi par une exclamation surprenante : « Des magistrats francophones à Hal-Vilvorde ! Pourquoi pas des magistrats turcs à Gand ou marocains à Anvers ? »
Un interlocuteur de la mission indiquait, pour sa part, que la N-VA « veut préserver la Flandre comme entité pure et non cosmopolite », dans le cadre d’une conception « fermée » de l’étranger et à l’opposé de l’idée européenne. C’est pour lui une « négation de l’histoire car les villes comme Bruges, Anvers et Gand se sont construites aussi grâce aux élites étrangères, banquiers portugais ou italiens par exemple. Si la Flandre veut occuper une position internationale, elle devra accueillir des populations extérieures ».
Certains observateurs voient enfin dans les controverses surgies entre M. De Wever et la presse ou les milieux culturels flamands – dont grand nombre s’opposent aux orientations actuelles du mouvement flamand – des signes inquiétants de tendances autoritaires et d’une proximité intellectuelle avec les méthodes de l’extrême droite.
La mission n’a pas recueilli d’éléments qui lui permettraient d’adhérer à une telle vision. Elle est en revanche consciente que le positionnement de la N-VA la place dans une situation délicate vis-à-vis notamment des électeurs déçus du Vlaams Belang qui trouvent chez elle un havre nouveau. L’électorat flamand est, en effet, extrêmement volatil et la grande « porosité élective » constatée depuis plusieurs années conduit à d’importants basculements de suffrages entre les partis. Dès lors que la N-VA revendique être le principal facteur de l’affaiblissement du Vlaams Belang, elle prend le risque de voir son discours et ses actions analysés à l’aune d’une dérive extrémiste dont elle conteste la réalité.
II – UN ACCORD DE GOUVERNEMENT QUI A MIS FIN À LA CRISE MAIS QUI NE MET PAS LA BELGIQUE À L’ABRI D’UNE NOUVELLE CRISE
Lorsqu’au soir du 13 juin 2010 se dessinent les résultats des élections, il apparaît clairement que les négociations pour la formation du gouvernement vont être difficiles. Les élections confirment le contraste électoral entre le Nord et le Sud du pays : au Nord, l’ancrage conservateur de la Flandre est consolidé autour de la N-VA ; au Sud, le parti socialiste redevient le premier parti francophone.
Aux élections de 2007, le cartel CD&V / N-VA avait obtenu 31 sièges de députés, dont 8 pour la N-VA et 23 pour le CD&V. En 2010, la N-VA fait élire sous ses propres couleurs 27 députés, soit 19 de plus que précédemment. Ce succès s’accompagne d’une recomposition au sein des formations flamandes, l’ex-partenaire du cartel, le CD&V, perdant notamment 6 sièges et voyant son effectif ramené à 17 députés.
Résultats des élections pour les partis flamands (88 députés)
Parti |
2007 |
2010 |
écart |
N-VA |
8 |
27 |
+ 19 |
CD&V |
23 |
17 |
– 6 |
Open-VLD |
18 |
13 |
– 5 |
SP-A |
14 |
13 |
– 1 |
Vlaams Belang |
16 |
12 |
– 4 |
Groen ! |
4 |
5 |
+ 1 |
Lijst Dedecker |
5 |
1 |
– 4 |
Le parti socialiste avait été durement sanctionné aux élections de 2007, réalisant alors son plus mauvais score historique et étant dépassé pour la première fois en Wallonie par le parti libéral ; il améliore fortement son score aux élections de 2010 et gagne 6 députés. Cette performance est accomplie aux dépens du Mouvement réformateur ; les autres formations sont quasiment stables, comme le CDH (Centre démocrate humaniste), qui ne perd qu’un siège après en avoir gagné trois aux élections de 2007.
Résultats des élections pour les partis francophones (62 députés)
Parti |
2007 |
2010 |
écart |
PS |
20 |
26 |
+ 6 |
MR |
23 |
18 |
– 5 |
CDH |
10 |
9 |
– 1 |
Écolo |
8 |
8 |
0 |
Parti populaire |
0 |
1 |
+ 1 |
Front national |
1 |
– |
– 1 |
Il revient donc aux deux vainqueurs des élections, la N-VA et le PS, d’animer les négociations.
La première phase se situe dans le schéma classique des processus de formation de gouvernement : le roi désigne d’abord un « informateur », chargé de faire le point sur les coalitions possibles et les grandes lignes de ce que pourrait être le compromis global nécessaire ; sur la base du rapport de l’informateur, le roi nomme ensuite un « formateur », promis à devenir Premier ministre, qui négocie un accord gouvernemental avec les partis retenus pour constituer la coalition.
Mais il apparaît d’emblée que, malgré la bonne volonté des deux acteurs principaux, la N-VA et le PS, le processus de formation du gouvernement patine. M. Bart De Wever est nommé informateur le 17 juin 2010 ; il achève sa mission le 8 juillet en expliquant, dans une courte déclaration, avoir trouvé des convergences entre les sept partis qui entrent en considération pour former un gouvernement (59) sur les trois domaines explorés : l’assainissement des finances publiques, les sujets socio-économiques et la réforme de l’État. Il estime cependant qu’une bonne base de discussion doit être trouvée avant d’entamer des négociations sur la composition d’une coalition et recommande au roi de prendre une initiative pour approfondir les convergences trouvées. C’est pourquoi, le même jour, M. Elio Di Rupo est nommé non pas « formateur », mais « pré-formateur » ; au demeurant, il explique lui-même que les conditions ne sont pas réunies pour envisager à ce stade l’élaboration d’une coalition.
Le climat des négociations se dégrade pendant l’été 2010 : la N-VA semble craindre que le PS ne cherche en fait à la rejeter hors des négociations ; le PS commence à douter de la réelle volonté de la N-VA de trouver un accord. Les tensions s’accroissent lorsqu’on apprend que, le 31 août, le président de la N-VA a rencontré en toute discrétion une délégation du parti libéral francophone, le MR, alors que celui-ci n’est pas assis à la table des négociations. Il est vrai que, dès après les élections, la N-VA n’avait pas fait mystère de son souhait de voir les libéraux (notamment francophones) revenir dans le jeu : le parti flamand se sentirait très seul dans une coalition des sept partis pressentis, qui pencherait trop à gauche à son goût. Le 3 septembre, les sept partis constatent l’échec des discussions : ce sera la dernière fois qu’ils se réuniront tous ensemble.
La deuxième phase de la crise est placée sous le signe d’une double recherche : d’une part, il faut rétablir une confiance minimale entre les deux principaux partis qui sont censés former l’armature du futur gouvernement ; d’autre part, il faut continuer à rapprocher les points de vue et élaborer une base de négociation acceptable par tous dans les trois domaines sur lesquels les partis devront se prononcer, la réforme de l’État et le dossier BHV, les réformes socio-économiques et l’assainissement financier.
Une mission de « médiation » est confiée dès le 4 septembre 2010 aux présidents de la Chambre (M. André Flahaut, PS) et du Sénat (M. Danny Pieters, N-VA) ; après un mois de travail, elle constate l’impossibilité de relancer les négociations. Une mission de « clarification » est alors confiée à M. De Wever, le 8 octobre ; la note qu’il établit est rejetée par les partis francophones au motif qu’elle ne rapproche pas assez les points de vue des différentes formations politiques, c’est-à-dire qu’elle reste, en fait, trop « flamande ».
Puisqu’il n’apparaît plus possible que les négociations soient pilotées par l’un ou l’autre des partis vainqueurs de l’élection, c’est désormais au tour des partis outsiders de se voir confier des missions royales. Le 21 octobre, le roi désigne M. Johann Vande Lanotte (SP.A) pour conduire une mission de « conciliation » ; celui-ci élabore une note globale portant sur l’autonomie fiscale, la loi de financement des régions et communautés, les transferts de compétences, le financement de Bruxelles, le sort de BHV et la modernisation de la vie politique ; le 5 janvier 2011, la note est acceptée comme base de négociations par cinq partis mais rejetée par le CD&V et la N-VA ; M. Vande Lanotte démissionne le 26 janvier, non sans avoir cherché à relancer le processus en retouchant sa note.
Le 2 février 2011, les libéraux reviennent dans la partie : M. Didier Reynders (MR) est nommé « informateur » sur les questions institutionnelles (transferts de compétences, financement des entités fédérées et de l’État fédéral, refinancement de Bruxelles, dossier BHV), ce qui est le signe de la profondeur des désaccords puisque le volet des réformes socio-économiques n’est pas inclus dans le mandat de la mission royale. Alors qu’à la fin du mois de février, M. Reynders se dit certain d’avoir créé les conditions d’une reprise des négociations, les partis estiment, en majorité, qu’aucune avancée significative n’a été enregistrée sur les dossiers de la mission.
Le 2 mars 2011, M. Wouter Beke, président du CD&V, est nommé « négociateur royal ». Tout en négociant avec les neuf partis, il revendique une concertation privilégiée avec le PS et la N-VA, conformément au discours sur leur responsabilité éminente tenu par le CD&V depuis les élections.
Peu à peu, l’idée s’impose chez les négociateurs que la N-VA n’est pas prête à accepter de compromis suffisamment équilibré. Dans ces conditions, l’attitude du CD&V devient essentielle pour la suite du processus : le CD&V acceptera-t-il de se démarquer de la N-VA et de quitter le rôle second dans lequel il s’est placé à l’issue des élections ? décidera-t-il d’abandonner le discours selon lequel il ne peut aller contre le résultat de l’élection, qui fait de la N-VA un partenaire gouvernemental obligé ? Alors que M. Beke poursuit son travail, ces questions non-dites s’installent en arrière-plan des discussions.
Le 12 mai, M. Beke remet au roi un rapport (non public) portant sur BHV et Bruxelles, les transferts de compétences et la loi de financement, et incluant une proposition complète sur BHV assortie de neuf projets de loi.
Le 15 mai, une troisième phase de la crise commence, lorsque M. Elio Di Rupo est nommé « formateur » : si l’heure n’est pas encore à l’optimisme, les progrès enregistrés seraient donc suffisamment substantiels pour que la formation d’un gouvernement soit désormais une perspective crédible. De fait, après quinze mois de négociations, l’ensemble des paramètres est sur la table (pistes ouvertes et « lignes rouges » à ne pas franchir) et tout est désormais question de dosage. Pour autant, en acceptant non seulement la fonction, mais le titre de « formateur », M. Di Rupo a pris le risque de s’exposer. Il annonce qu’à la suite d’une série d’entretiens bilatéraux sur les dossiers institutionnels, puis d’entretiens bilatéraux sur les dossiers socio-économiques, il rédigera une « note de base » ayant trait au programme du futur gouvernement et à la réforme de l’État, sur laquelle chaque parti devra se positionner et dire s’il veut poursuivre les négociations socio-économiques et / ou institutionnelles. Se dessine donc la possibilité que la majorité qui soutiendra les réformes institutionnelles ait un périmètre différent de celle qui soutiendra le programme socio-économique du futur gouvernement.
La « note de base » est publiée le 4 juillet 2011. C’est un texte de formateur, quasi unanimement salué pour son courage (M. Di Rupo s’éloigne très sensiblement des positions de son parti) et son équilibre : chacun peut y trouver des motifs de satisfaction et des invitations à renoncer à certains de ses tabous. L’avis général est que la note ne peut pas être rejetée en bloc et constitue donc une base de négociation valable. D’ailleurs, sept partis acceptent la note : les libéraux, les écologistes, les socialistes et le CDH.
Pourtant, le 7 juillet, la N-VA rejette la note, dont aucun chapitre ne trouve grâce à ses yeux. La virulence de la réaction du parti nationaliste étonne les observateurs : le volet budgétaire de la note est critiqué en évoquant un « tsunami fiscal » ; sur la loi de financement et l’autonomie fiscale, la N-VA dit que « le fédéralisme de consommation est intégralement maintenu » ; sur la réforme de l’État, le contenu de la note est qualifié de « bric-à-brac » ; quant aux réformes portant sur Bruxelles et sa périphérie, elles sont tout simplement « désastreuses ».
Une fois la position de la N-VA annoncée, le CD&V indique qu’il ne lui est pas possible de participer à des négociations auxquelles la N-VA ne serait pas partie prenante ; il ne se prononce pas explicitement sur la note elle-même et critique tout à la fois la N-VA, qui « n’y croit pas, mais ne formule pas d’alternative », et le formateur, qui aurait sciemment placé dans sa note des éléments dont il savait qu’ils seraient rejetés par la N-VA.
Le CD&V est en fait très divisé depuis de nombreux mois, entre une aile ouverte au compromis, dans la tradition historique du parti social-chrétien, et une aile radicale, où le ministre-président flamand Kris Peeters joue un rôle éminent. L’aile radicale parvient donc à faire prévaloir ses vues, par conviction mais aussi par réalisme : elle sait que les réformes demandées dans l’accord de gouvernement flamand, inspirées par la note Octopus, qui constituent sa « bible » politique, vont bien plus loin que la « note de base » de M. Di Rupo et que leur éventuelle adoption nécessiterait les voix de la N-VA.
Le 21 juillet 2011, le CD&V accepte finalement d’entrer dans des négociations sans exiger la présence de la N-VA. Le processus est enfin débloqué.
La quatrième phase de la crise commence alors, après trois semaines de vacances accordées aux protagonistes. Le 16 août, les négociations s’engagent entre huit partis : les socialistes, les libéraux, les chrétiens-démocrates et les écologistes. Le 15 septembre, un compromis est conclu sur BHV ; le 25 septembre, c’est au tour d’un accord sur la loi de financement des Régions et Communautés ; le 11 octobre, les négociations institutionnelles s’achèvent. Six partis s’engagent ensuite dans les négociations socio-économiques (réformes structurelles et budget 2012) : les socialistes, les libéraux et les chrétiens-démocrates ; les écologistes ne feront donc pas partie du gouvernement. Les négociations socio-économiques s’achèvent le 27 novembre, non sans connaître quelques brusques poussées de tensions, dues notamment aux deux partis libéraux.
La constitution du gouvernement proprement dit nécessite encore quelques jours et le 6 décembre, le gouvernement prête serment devant le roi.
Le pays est donc sorti de la crise. En ce sens, on peut dire que l’accord de gouvernement a soulagé l’ensemble du monde politique. Pour autant, l’avenir de la Belgique reste plus qu’incertain.
A – L’accord de gouvernement a soulagé l’ensemble du monde politique
La tâche du gouvernement ne fait que commencer. Résultat de négociations qui se sont déroulées sur environ dix-sept mois, l’accord de gouvernement est un texte très détaillé, tant dans sa dimension institutionnelle que dans sa dimension socio-économique. Il est appelé à être mis en œuvre sous de fortes contraintes.
1. Un accord détaillé, à la mesure des difficultés rencontrées
• L’accord prévoit tout d’abord une « solution communautaire durable » pour BHV et Bruxelles. La circonscription électorale pour les élections à la Chambre des représentants est scindée de façon à s’inscrire dans la logique de la loi électorale de 2002, avec des circonscriptions dont les limites sont alignées sur celles des provinces. Seront donc créées une circonscription de Bruxelles, une circonscription du Brabant flamand et une circonscription du Brabant wallon. Les électeurs de la partie « Hal-Vilvorde » sont donc amenés à perdre leur droit actuel de voter pour une liste bruxelloise, à l’exception des électeurs des six communes à facilités, qui pourront donc voter soit pour une liste bruxelloise, soit pour une liste se présentant dans le Brabant flamand. Le régime électoral applicable aux six communes périphériques sera constitutionnellement garanti et ne pourra être modifié que par une loi adoptée à la majorité spéciale.
Dans le cadre de l’équilibre global recherché par l’accord, les mêmes modifications seront apportées mutatis mutandis au niveau de la composition des circonscriptions électorales pour les élections au Parlement européen. La mission rappelle que l’arrêt de la Cour constitutionnelle de 2003 ne portait que sur la circonscription électorale pour les élections à la Chambre des représentants ; les négociateurs de l’accord ont donc voulu purger l’intégralité du différend politique.
L’arrondissement judiciaire de BHV est également réformé. Il subsiste en tant que tel, mais le tribunal de première instance, le tribunal de commerce, le tribunal du travail et le tribunal d’arrondissement seront dédoublés en un tribunal francophone et un tribunal néerlandophone compétents sur tout l’arrondissement judiciaire, dont le ressort reste celui des 54 communes actuelles de BHV. Le tribunal de police de Bruxelles sera dédoublé. Un tiers des magistrats des tribunaux francophones et un tiers des magistrats des tribunaux néerlandophones seront bilingues (connaissance fonctionnelle). Les chefs de corps des tribunaux devront avoir une connaissance approfondie de l’autre langue.
Afin d’améliorer la garantie des droits des habitants des six communes à facilités, tout le contentieux administratif y afférant doit désormais relever de la compétence de l’Assemblée générale du Conseil d’État, qui est une instance bilingue.
Un nouveau mode de nomination des bourgmestres des six communes à facilités de la périphérie de Bruxelles est défini. Il prévoit qu’à compter de la réception de l’acte de présentation du bourgmestre voté par le conseil communal, le gouvernement flamand aura 60 jours pour exercer sa compétence de nomination. Son silence vaudra nomination. En cas de refus, le bourgmestre désigné aura un délai de 30 jours pour introduire un recours devant l’Assemblée générale du Conseil d’État. Si ce délai n’est pas respecté ou si le Conseil d’État confirme la décision du gouvernement flamand, un nouvel acte de présentation devra être adopté par le conseil communal dans les 30 jours.
L’accord améliore donc les garanties apportées aux échevins désignés bourgmestres par leur conseil communal ; il oblige également ceux-ci à prendre leurs responsabilités, en cas de refus de nomination par l’autorité de tutelle, en fixant un délai bref pour déposer leur recours devant le Conseil d’État. Le sort des bourgmestres actuels est laissé en suspens puisque l’accord prévoit également que la nouvelle procédure entrera en vigueur à partir des prochaines élections communales.
S’agissant de Bruxelles, une « communauté métropolitaine » sera créée afin d’améliorer les relations de la Région avec son hinterland. Sans modifier ni l’architecture institutionnelle des entités fédérées, ni les frontières de celles-ci, l’accord amorce donc un processus permettant d’« ouvrir » Bruxelles sur son environnement immédiat. Il prévoit également une simplification dans la répartition des compétences entre les multiples institutions locales bruxelloises, avec pour ligne de force le renforcement du rôle de la Région Bruxelles-Capitale. Les domaines concernés sont très divers et touchent à l’urbanisme, au logement, à la mobilité, au stationnement, à la propreté urbaine, aux infrastructures sportives, à la sécurité, à la formation professionnelle, etc.
Il doit être noté que le sport, le tourisme et la formation professionnelle sont des matières relevant de la compétence des Communautés. Pour la région de langue française, la Communauté française a depuis plusieurs années transféré l’exercice de ces compétences à la Région wallonne. L’accord de gouvernement, qui prévoit l’intervention directe de la Région Bruxelles-Capitale, fait donc un pas vers une harmonisation encore plus grande entre le statut de la Région wallonne et celui de la Région Bruxelles-Capitale ; il renforce également la substance de cette dernière Région au détriment de celle de la Communauté.
• L’accord prévoit de nombreux transferts de compétences en direction des entités fédérées, pour un montant total de 17 milliards de d’euros.
Pour la politique de l’emploi, les Régions acquièrent pleine compétence pour le contrôle des chômeurs et les sanctions y afférentes, le placement des bénéficiaires d’un revenu d’intégration sur le marché du travail, l’autonomie d’utilisation des budgets transférés notamment pour mettre en place des politiques de « groupes cibles » ou des mesures portant sur les coûts salariaux, etc.
S’agissant des soins de santé et d’aide aux personnes, l’accord prévoit le transfert aux Communautés (à la COCOM, à Bruxelles) des aides à la mobilité des personnes handicapées, de l’allocation d’aide aux personnes handicapées, de la compétence en matière de normes hospitalières, de certains éléments du financement des hôpitaux, de diverses compétences en matière de personnes âgées, de la politique de prévention, etc. Afin de préserver la solidarité interpersonnelle qui implique l’égalité d’accès pour tous aux soins de santé remboursés, l’autorité fédérale continuera à exercer la tutelle sur l’INAMI, institution fédérale qui organise, gère et contrôle les assurances sociales obligatoires en Belgique.
Les allocations familiales, les allocations de naissance et les primes d’adoption seront transférées aux Communautés. À Bruxelles, c’est la COCOM qui sera compétente à l’exclusion des deux Communautés, afin d’éviter que les Bruxellois ne soient « catalogués » en deux sous-nationalités : il s’agit en effet ici de la perception d’une prestation sociale à caractère personnel et non de l’accès à une prestation ou un service délivré in situ par un organisme public.
L’accord prévoit également des transferts de compétences dans des domaines très divers, comme la sécurité routière (limites de vitesse sur la voie publique, réglementation en matière de sûreté du chargement, de masse maximale autorisée entre les essieux des véhicules sur la voie publique, de transport des matières dangereuses, etc.). A une époque où les États tentent, sous l’impulsion de l’Union européenne, de progresser vers une certaine harmonisation normative en vue de favoriser l’approfondissement du marché unique, ce fractionnement programmé de l’espace normatif belge peut susciter des questions.
Neuf pages de tableaux détaillent les autres transferts décidés en matière de politique économique (par exemple contrôle des prix dans les matières qui relèvent de la compétence de chaque entité fédérée), d’énergie, d’agriculture, d’urbanisme, de logement, d’aménagement du territoire, d’administration locale.
Les Régions reçoivent également une compétence exclusive pour les réductions ou crédits d’impôt afférents à la maison d’habitation, aux dépenses de sécurisation contre le vol ou l’incendie, aux dépenses faites pour l’entretien et la restauration des propriétés classées, pour la rénovation des logements dans le cadre de la « politique des grandes villes », etc.
Les transferts de compétences touchent aussi à une matière régalienne, la justice pénale :
– les entités fédérées se voient dotées d’un « droit d’injonction positive » en matière de politique des poursuites et d’application des peines, dans les matières relevant de leurs compétences ; il est prévu que le ministre délégué de l’entité fédérée adressera sa demande au ministre fédéral de la Justice qui en assurera « l’exécution immédiate » ;
– dans les matières relevant de leurs compétences, les entités fédérées concluront avec l’autorité fédérale un accord de coopération qui portera notamment sur la politique de poursuites du ministère public et l'établissement de directives en matière de politique criminelle ;
– les Communautés (la COCOM à Bruxelles) disposeront de compétences en matière de droit pénal des mineurs ; elles pourront, par exemple, définir les mesures qui peuvent être prises à l’égard de mineurs ayant commis des infractions ou les règles de placement en établissement fermé ;
– les entités fédérées seront représentées au sein du Collège des procureurs généraux (autorité supérieure du ministère public en Belgique).
Synthèse budgétaire des transferts
Domaine |
Montant |
Allocations familiales |
5,9 |
Marché du travail |
4,3 |
Soins de santé |
4,2 |
Dépenses fiscales |
1,9 |
Autres domaines |
0,5 |
Total |
16,9 |
• La loi de financement des entités fédérées est sensiblement réformée et l’accord institutionnel rappelle, à cet égard, les principes qui entendent guider et borner cette réforme.
Le modèle de réforme de la loi de financement proposé vise à permettre aux entités fédérées de mieux gérer leurs compétences, dont celles issues de la sixième réforme de l’État.
Il est proposé d’accroître l’autonomie financière des entités fédérées, notamment en augmentant leurs recettes propres de manière significative, et de tenir compte de plusieurs principes :
• éviter une concurrence déloyale;
• maintenir les règles de progressivité de l’impôt des personnes physiques;
• ne pas appauvrir structurellement une ou plusieurs entités fédérées;
• assurer la viabilité à long terme de l’État fédéral et maintenir les prérogatives fiscales de ce dernier en ce qui concerne la politique de redistribution interpersonnelle;
• renforcer la responsabilisation des entités fédérées en lien avec leurs compétences et la politique qu’elles mènent, compte tenu des différentes situations de départ ainsi que de divers paramètres de mesure;
• tenir compte des externalités, de la réalité sociologique et du rôle de la Région de Bruxelles-Capitale;
• prendre en compte des critères de population et d’élèves;
• maintenir une solidarité entre entités, exonérée d’effets pervers;
• assurer la stabilisation financière des entités;
• tenir compte des efforts à accomplir par l’ensemble des entités pour assainir les finances publiques;
• vérifier la pertinence des modèles proposés à travers des simulations
Les Régions verront un très sensible accroissement de leur autonomie fiscale : le montant de leurs ressources fiscales « autonomes » passera ainsi de 8,8 milliards d’euros à près de 20 milliards d’euros ; l’autonomie supplémentaire portera pour l’essentiel sur la part attribuée d’IRPP (60) et sera acquise par le biais de centimes additionnels à l’IRPP, qui pourront être modulés selon la tranche d’imposition. L’accord prévoit cependant des règles ayant vocation à encadrer l’autonomie fiscale afin de préserver la progressivité de l’impôt et d’éviter le risque de concurrence fiscale entre les régions, préoccupation constante des partis francophones.
Le financement des Communautés est rééquilibré : le financement des compétences actuelles est ajusté pour réduire progressivement la part de la clef « IRPP » au profit de la clef démographique ; le système d’un « financement selon les moyens » est ainsi abandonné au profit d’un « financement selon les besoins ». Par ailleurs, les moyens attribués au titre des compétences nouvelles sont répartis entre les Communautés uniquement en fonction de clefs démographiques.
Deux mécanismes de responsabilisation financière sont introduits :
– les Régions et les Communautés verseront à l’État fédéral une contribution au titre du financement des pensions de leurs fonctionnaires ; les entités fédérées devront donc supporter le poids de leurs décisions en matière d’emploi public (sachant que les transferts de compétences se traduiront aussi par des transferts de personnel en direction des entités fédérées) ;
– les Régions se verront imposer un mécanisme de « responsabilisation climat », introduit à l’initiative des écologistes, signataires de l’accord institutionnel ; ce mécanisme consiste en un bonus-malus déterminé en fonction de l’écart à une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des bâtiments.
Répondant aux vœux des partis flamands, l’accord prévoit un ajustement du mécanisme actuel de solidarité afin de supprimer la « surcompensation » qui existe actuellement (61).
Répondant aux vœux des partis francophones, l’accord prévoit l’introduction d’un « mécanisme de transition » dont l’objectif est de garantir que, l’année où seront mis en place les nouveaux dispositifs de financement, aucune entité ne sera gagnante ou perdante. Par la suite, le montant d’égalisation sera maintenu constant pendant dix ans puis diminuera de façon linéaire pendant dix années supplémentaires jusqu’à disparaître complètement.
La Région Bruxelles-Capitale reçoit un financement complémentaire, en vue de parvenir à un « juste financement des institutions bruxelloises », d’un montant de 134 millions d’euros en 2012 et qui progressera jusqu’à atteindre 461 millions d’euros en 2015 ; au-delà de 2015, le financement complémentaire de la Région (à l’exclusion des pouvoirs locaux et des commissions communautaires) sera organisé afin de ne pas dépasser 0,1 % du PIB. Une part significative de cette enveloppe est affectée à des emplois précis : sécurité, primes linguistiques (qui visent à développer le bilinguisme parmi les fonctionnaires), soutien à la mobilité, etc.
• L’accord comprend également un chapitre consacré au « renouveau politique ». Au-delà de diverses mesures visant, notamment, à renforcer « l’éthique politique », la mission retient deux éléments significatifs.
En premier lieu, le statut et le fonctionnement des chambres sont réformés. Le Sénat devient une assemblée non permanente composée :
– de 50 élus indirects, qui représentent les entités fédérées (29 néerlandophones, 20 francophones et un élu pour la Communauté germanophone) ; afin de tenir compte de l’asymétrie institutionnelle entre le sud du pays et la Flandre, il appartiendra à chaque groupe linguistique de déterminer la répartition et les modalités de la représentation des parlements des entités fédérées qui le concerne ;
– 10 élus cooptés (6 néerlandophones et 4 francophones) répartis en fonction des voix émises à la Chambre : pour les francophones, au sein des circonscriptions du Hainaut, de Namur, de Liège, du Luxembourg, de Brabant wallon, de Bruxelles et des cantons de Hal Vilvorde ; pour les néerlandophones, au sein des circonscriptions de Flandre orientale, de Flandre occidentale, de Limbourg, d’Anvers, du Brabant flamand et de Bruxelles.
Cette dernière disposition vise à compenser, pour les néerlandophones, la perte de deux sièges de députés qui résultera de la scission de BHV : en effet, à la suite de cette scission, les listes néerlandophones de Bruxelles ne pourront plus recueillir les suffrages d’électeurs néerlandophones émis dans la partie « HV » de l’actuelle circonscription électorale.
Les missions du Sénat sont limitées et une commission parlementaire spécifique prolongera les modifications d’ores et déjà prévues par l’accord en examinant notamment la question d’une circonscription électorale fédérale unique à la Chambre.
En second lieu, l’organisation des élections connaît des ajustements sensibles. La durée de la législature passe de 4 à 5 ans et la Chambre est en tout état de cause renouvelée tous les cinq ans. En effet, l’accord prévoit, d’une part, que les élections fédérales ont lieu le même jour que les élections européennes (62) et, d’autre part, qu’en cas de dissolution anticipée, la durée de la nouvelle législature fédérale ne pourra excéder le jour des élections du Parlement européen qui suivent cette dissolution. Il reste à découvrir quelles pourraient être les conséquences, sur le fonctionnement du système politique, d’un dispositif qui, en cas de dissolution anticipée au bout de trois ans ou trois ans et demi de législature, n’offrira à la majorité issue des urnes qu’un délai d’un an et demi ou deux ans (au mieux) pour réaliser son programme…
Les entités fédérées se voient par ailleurs accorder leur autonomie constitutive, entendue comme la compétence pour régler, par décret spécial ou ordonnance spéciale (63) la durée de la législature et la date d’élection de leur assemblée. L’autonomie constitutive élargie sera aussi instaurée au profit de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Communauté germanophone. Les garanties des francophones et néerlandophones de Bruxelles (parité, représentation garantie, etc.) resteront cependant du ressort du législateur fédéral spécial.
Le volet socio-économique de l’accord – qui n’est soutenu que par les partis socialistes, libéraux et sociaux-chrétiens, mais pas par les écologistes – s’organise autour des dispositions relatives au redressement budgétaire et de celles relatives aux réformes socio-économiques.
L’accord fixe pour cible le retour à l’équilibre budgétaire structurel (au sens du Pacte de stabilité et de croissance) à l’horizon 2015. Il programme à cette fin un effort de 11,3 milliards d’euros en 2012, soit 3,2 % du PIB. La répartition de l’effort obéit à une présentation singulière puisqu’elle fait apparaître une augmentation des recettes à hauteur de 35 % du total, une réduction des dépenses à hauteur de 40 % du total et un ensemble de « mesures diverses », à hauteur de 25 % du total, dont la plupart sont des mesures de recettes. En définitive, en 2012, le déficit du budget de l’État fédéral devra être limité à 2,4 % du PIB et celui des entités fédérées à 0,4 % du PIB.
Les réformes économiques et de société sont nombreuses et l’accord de gouvernement en détaille les principaux linéaments. En matière de marché du travail, on peut noter l’introduction d’une dégressivité accrue des allocations de chômage, le resserrement de la notion d’« emploi convenable », le resserrement du dispositif des préretraites. En matière de réforme des retraites, plusieurs mesures d’âge sont prévues (relèvement de l’âge effectif de départ à la retraite anticipée, allongement de certaines carrières, relèvement du nombre d’années prises en compte pour le calcul de la pension dans le secteur public, etc.)
L’accord prévoit aussi une réforme de l’asile et de l’immigration, avec notamment une accélération de la procédure d’asile, une politique de promotion du retour, « volontaire si possible, forcé si nécessaire », le renforcement des contrôles pour lutter contre les fraudes et les abus en matière de regroupement familial, etc.
D’autres domaines sont concernés : la politique des soins de santé, la politique économique générale (protection du consommateur, protection du pouvoir d’achat, soutien aux entreprises et à l’activité, etc.), transition de l’économie vers un modèle de croissance durable, renforcement de la police de proximité, réforme de la justice (modernisation de la procédure civile, ajustement de l’aide juridique, etc.).
2. Une mise en œuvre sous contraintes
La première tâche du gouvernement consiste à traduire en textes de loi ce qui n’est encore, selon le mot de M. Paul Buysse, qu’un « accord de la nuit ». L’écriture des projets de texte définitifs pourrait, en effet, faire émerger des tentations de renégociation de certains points de l’accord, d’autant que d’ores et déjà les partis politiques commencent à se placer en configuration de campagne pour les élections communales d’octobre 2012 et que les élections régionales et fédérales de 2014 se dessinent à l’horizon. Pour M. Buysse, on entre donc dans « une période dangereuse ».
Les tentations de rouvrir les négociations pourraient être attisées par le fait que l’accord est parfois peu précis. La mission rappelle que le sujet de la scission de l’arrondissement judiciaire de BHV est revenu sur la table des négociateurs pendant quelques jours, au début du mois d’octobre 2011, alors qu’il avait été approuvé quelques jours auparavant, suscitant une inquiétude certaine chez les observateurs de la vie politique. On a su ultérieurement que des incertitudes étaient apparues quant à l’interprétation et la portée à donner à certains passages du projet d’accord, qui ont nécessité une nouvelle explication de texte mutuelle entre les négociateurs.
Pour autant, les interlocuteurs de la mission ont affirmé ne pas craindre que l’équilibre global du volet socio-économique de l’accord de gouvernement soit remis en cause. Aux yeux de M. Baudouin Velge, directeur du Cercle de Lorraine, l’accord socio-économique a été difficile à conclure et le gouvernement de M. Di Rupo est « condamné à s’entendre » et à faire les compromis nécessaires.
La deuxième tâche du gouvernement consiste à élaborer et faire adopter rapidement quelques lois essentielles. L’objectif est de montrer aux Flamands que la bonne réponse à leurs aspirations résidait bien dans l’acceptation de la négociation et non pas dans le repli sur une intransigeance stérile ; il faut faire passer le message que la N-VA n’est pas indispensable à la réforme de l’État.
L’horizon de la réforme est double, calqué sur les deux prochaines échéances électorales : en octobre 2012 auront lieu les élections communales ; en juin 2014 auront lieu les élections régionales et fédérales. Les deux sont des échéances majeures : en 2014, ce sera le test en grandeur nature du succès ou de l’échec de la stratégie de compromis retenue par les partis francophones et flamands de la coalition ; en 2012, ce sera pour chacun l’occasion de confirmer ou d’amplifier son implantation locale, ou de tenter de limiter une éventuelle perte d’influence. Les élections communales sont, en Belgique, des scrutins très importants. Les interlocuteurs de la mission ont, unanimement, indiqué à la mission que les mandats locaux sont la meilleure source de légitimité politique et que la maîtrise des pouvoirs locaux est le fondement de la puissance des partis.
Le monde politique belge s’interroge donc pour savoir si, d’une part, le CD&V parviendra à maintenir les fortes positions qu’il détient traditionnellement en Flandre et si, d’autre part, la N-VA parviendra à transformer au niveau local les performances qu’elle a si subitement obtenues au niveau régional (en 2009) et fédéral (en 2010).
MM. Herman De Croo et André Flahaut se sont rejoints pour indiquer à la mission que la N-VA est tout à fait consciente de l’enjeu d’octobre 2012 quant à son ancrage local. Ils diffèrent, en revanche, sur ses perspectives à un horizon plus lointain.
Pour M. Flahaut, la N-VA sera présente longtemps dans le paysage politique si elle passe avec succès le test électoral de 2012 ; c’est pourquoi les partis de la coalition sont d’accord pour « barrer la route » à la N-VA, en constituant des cartels locaux. Pour autant, M. Flahaut estime que les cibles à long terme de la N-VA sont l’ancrage local et l’ancrage régional : pour lui, la N-VA ne sera jamais réellement intéressée par des responsabilités au niveau fédéral.
Pour M. De Croo, même si elle réalise de bons scores en octobre 2012, la N-VA ne durera qu’une à deux législatures, car « Bart De Wever est habile et charismatique, mais il a surtout surfé sur la faiblesse du gouvernement Leterme ».
M. De Wever a précisé à la mission que son parti se fixait deux objectifs pour 2012 : ramener le Vlaams Belang à 15 % en moyenne (alors que ce parti a attiré 33 % des suffrages à Anvers aux élections de 2006), ce qui conduit la N-VA à mettre l’accent sur les villes grandes et moyennes – car, a indiqué M. De Wever, la N-VA est un parti jeune qui a grandi rapidement et il n’est pas facile pour lui de constituer des listes concurrentielles dans l’intégralité des 308 communes de Flandre.
Le deuxième objectif que se fixe la N-VA est de participer à la gestion de certaines communes, car M. De Wever s’est dit devant la mission désireux d’éviter une « trop forte polarisation » entre les partis politiques. Il a précisé à cet égard que la situation n’est pas facile car les partis traditionnels sont partenaires en Flandre mais « en état de guerre » au niveau fédéral. Il annonce cependant 2014 comme « une bataille à mort » et estime que, même si la N-VA gagne ces élections-là, « il sera difficile de pacifier le paysage politique ».
D’ores et déjà, la bataille a commencé au Parlement fédéral et les premiers traits ont été échangés à l’occasion de la déclaration de politique générale du gouvernement, à la mi-décembre 2011. La N-VA a commencé, par exemple, à distiller le message selon lequel « le gouvernement de M. Di Rupo n’a pas la majorité en Flandre » et manquerait de fait de légitimité politique. C’est oublier que dans un État fédéral, il y a un Parlement fédéral et des parlements fédérés, qui sont distincts et procèdent de légitimités différentes. Il est vrai que les élus de la coalition gouvernementale ne constituent pas la moitié au moins des élus de la Flandre ; mais il n’en est pas moins vrai que les six partis de la coalition ont une majorité simple au sein de chacune des chambres fédérales et que les huit partis qui soutiennent l’accord institutionnel réunissent la majorité spéciale prévue par le Constitution pour adopter les lois spéciales. Le discours de la N-VA est cohérent avec sa vision de la Belgique comme juxtaposition de deux démocraties ; il ne correspond pas à la réalité juridique et politique d’un État fédéral.
La N-VA est donc en embuscade, tant au niveau fédéral qu’au niveau régional, même si Mme Helga De Baets, conseillère de M. Kris Peeters pour les réformes institutionnelles, a estimé que sa double qualité d’opposant fédéral et de partenaire régional ne posait pas de problème. Il est vrai que M. Peeters a déclaré à plusieurs reprises que l’accord institutionnel n’entrait pas en contradiction avec l’accord de gouvernement flamand.
Dans le laps de temps qui le sépare du mois d’octobre, le gouvernement veut faire adopter par le Parlement les lois sur la scission de BHV et le refinancement de Bruxelles (qui constituent un « paquet » politique indissociable). M. Servais Verherstraeten, secrétaire d’État aux réformes institutionnelles, adjoint au Premier ministre, a précisé à la mission que cela nécessitera deux révisions constitutionnelles.
Dans un premier temps, le gouvernement devrait faire adopter une révision de l’article 195 de la Constitution définissant les modalités de révision de la Constitution. Il s’agit tout simplement d’éviter de devoir organiser de nouvelles élections législatives dans les semaines qui viennent. L’accord institutionnel prévoit en effet que plusieurs dispositions constitutionnelles seront modifiées. Or, l’article 195 de la Constitution dispose que « Le pouvoir législatif fédéral a le droit de déclarer qu’il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu’il désigne. Après cette déclaration, les deux Chambres sont dissoutes de plein droit. »
Toute modification de la Constitution doit donc se passer en trois temps : d’abord, le Parlement doit adopter une « déclaration de révision de la Constitution » qui désigne les articles qu’il est proposé de réviser ; dans un deuxième temps, les chambres sont dissoutes et de nouvelles élections organisées ; dans un troisième temps, le Parlement nouvellement élu peut se saisir des textes, unique ou multiples, simultanés ou différés, portant modification des articles de la Constitution qui ont été ouverts à la révision. L’objectif de ce dispositif complexe est qu’aucune modification constitutionnelle ne soit adoptée sans que le peuple ait été appelé à faire valoir ses vues, sans pour autant priver les institutions représentatives de leur monopole législatif, y compris en matière constitutionnelle.
Selon les informations recueillies par la mission, l’article 195 a été lui-même ouvert à la révision par une déclaration de révision du 7 mai 2010. Le gouvernement se propose donc d’y introduire des dispositions transitoires visant à établir un régime spécifique pour les révisions constitutionnelles nécessitées par l’accord d’octobre 2011, régime dont l’objectif premier sera de ne pas exiger de dissolution préalable des chambres.
Pour leur part, les entités fédérées doivent elles aussi se préparer à « recevoir » les compétences qui seront transférées dans les mois à venir. Mme Helga De Baets a indiqué à la mission que le gouvernement flamand a fait un inventaire de tout ce qui, dans son fonctionnement, est concerné par la réforme et qui nécessite des ajustements et veut également se concerter avec les Régions wallonne et Bruxelles-Capitale pour définir des stratégies communes.
Car 2014 n’est pas si loin et, si le gouvernement veut éviter que la campagne électorale soit excessivement orientée sur des sujets communautaires, il doit avoir procédé à des transferts substantiels suffisamment longtemps avant les élections pour que les citoyens aient eu le temps d’« apprécier » les nouvelles conditions d’exercice des compétences transférées aux Régions et Communautés. Selon les observateurs, un tel calendrier ne fait pas l’affaire des partis libéraux qui, actuellement dans les oppositions régionales, verraient d’un bon œil les transferts de compétence être effectués plus tard afin que les partis membres des coalitions actuelles ne puissent pas se prévaloir seuls du succès de la réforme devant les électeurs régionaux.
b) Les incertitudes résultant de la situation économique et sociale
Si le travail de fond a commencé sur le volet institutionnel, sans texte publié à la date de rédaction du présent rapport, mais sans indication que soient apparus des obstacles ou des difficultés, les premiers nuages sont d’ores et déjà présents sur le front économique et social.
La Belgique a tout d’abord été, au tournant de l’année, confrontée comme nombre de pays européens à la révision à la baisse de ses perspectives de croissance. De plus, dans un courrier adressé au gouvernement au début du mois de janvier 2012, la Commission européenne a critiqué les perspectives budgétaires retenues par l’accord de gouvernement. Elle a estimé que la croissance était surestimée, car les mesures d’assainissement auraient un impact récessif d’environ 0,15 point de PIB, et que le montant des recettes nouvelles et des économies était mal évalué, l’incertitude portant sur 0,3 point de PIB. Le gouvernement était invité à trouver 1,2 à 2 milliards d’euros d’économies supplémentaires.
En réponse, celui-ci a décidé de geler 1,3 milliard d’euros, estimant qu’il n’était pas possible de trouver dans le délai imparti par la Commission des économies à hauteur des sommes demandées. L’exercice proprement dit de « contrôle budgétaire » devrait avoir lieu à la fin de l’hiver ou au tout début du printemps.
Il pourrait conduire à dégrader le climat social, puisque de nouvelles économies ont vocation à être annoncées. Or, les syndicats ont peu goûté la rapidité avec laquelle le gouvernement a élaboré, puis fait adopter par le Parlement la réforme des retraites, en décembre dernier. La concertation sociale, dont la tradition reste vive en Belgique malgré l’échec des deux derniers Accords interprofessionnels (en 2009 et 2011), n’a en fait été lancée qu’en janvier 2012 et les syndicats regrettent qu’elle ne concerne que les mesures d’application de la loi et qu’elle ne puisse donc déboucher sur un ajustement substantiel des modifications apportées par la réforme.
La grève du 20 décembre 2011 et la grève générale (la première depuis 1993) du 30 janvier 2012 n’ont pas fait plier le gouvernement, mais la combativité syndicale pourrait trouver un regain de vigueur si, poussé par la nécessité d’approfondir les mesures de redressement, le gouvernement décidait de toucher à « l’index », le dispositif d’indexation des salaires sur l’inflation. Celui-ci est régulièrement dénoncé par le patronat comme défavorable à la compétitivité de l’économie belge, fréquemment mentionné dans les recommandations du FMI ou de la Commission européenne au titre des dispositifs à supprimer, et, surtout, il a donné lieu à quelques tensions, venant notamment des libéraux flamands, pendant les négociations du volet socio-économique de l’accord de gouvernement.
L’accord de gouvernement indique explicitement qu’il fait le choix du « maintien du mécanisme d’indexation automatique des salaires et des allocations tant pour soutenir la demande intérieure (la consommation) que pour préserver le pouvoir d’achat des citoyens », mais si le dossier venait à être rouvert, la cohésion de la coalition gouvernementale pourrait être fragilisée.
B – L’avenir de la Belgique reste cependant incertain
« La Belgique a bien un gouvernement, mais avec quel équilibre ? » s’interrogeait M. Jan Peumans, président du Parlement flamand, devant la mission. Lorsqu’il a fallu autant de temps pour construire l’accord qui a mis fin à la crise, cette question trouve un écho tout particulier. M. Paul Buysse estimait que l’accord par lui-même sera durable, qu’il va faciliter le dialogue et donner aux forces politiques « le temps de réfléchir ».
Pour autant, le consensus est général parmi les interlocuteurs de la mission sur le fait que le processus d’éloignement n’est probablement pas arrivé à son terme. Diverses pistes pour reconstruire un espace politique national ont pourtant été avancées, ces dernières années, sans recueillir cependant une adhésion suffisante. Dans ce contexte, Bruxelles reste un ciment solide.
1. Le processus d’éloignement n’est probablement pas arrivé à son terme
Par sa durée, sa profondeur et les modalités de sa conclusion, la crise de 2010-2011, qui a succédé à une crise similaire intervenue à l’ouverture de la législature précédente, a ouvert des portes que l’on aurait pu croire fermées : le débat institutionnel n’est pas clos par les avancées inscrites dans l’accord de gouvernement. D’ailleurs, celui-ci ne mettra pas un terme aux dynamiques d’affirmation nationale qui irriguent les évolutions politiques de la Belgique depuis des décennies.
a) Les conséquences de la crise
Il est bien loin le temps de 1993 où les francophones voulaient croire que la réforme institutionnelle serait la dernière et avaient obtenu que la loi spéciale du 16 juillet 1993 ait pour titre « loi […] visant à achever la structure fédérale de l’État ». Au contraire, tous les interlocuteurs de la mission ont souligné que la sixième réforme de l’État serait suivie d’une septième réforme dont personne, cependant, ne se hasarde aujourd’hui à dessiner les contours.
Tout au plus M. André Flahaut a-t-il estimé qu’une période de stabilité d’une dizaine d’années était désormais ouverte, bien que cette décennie soit ponctuée de scrutins. Une dizaine d’années, c’est le laps de temps donné à la Wallonie par l’accord institutionnel pour redresser son économie avant de voir le mécanisme de solidarité entamer sa décroissance programmée. Pour M. Verherstraeten, la sixième réforme de l’État est un « point de départ pour trouver un nouvel équilibre institutionnel », qui dépendra en particulier de la mise en œuvre des réformes en Wallonie : celle-ci « a des atouts » et M. Verherstreaten s’est dit convaincu qu’une réduction du différentiel économique entre la Wallonie et la Flandre entraînerait une réduction des tensions communautaires.
L’ensemble du monde politique est conscient que la Wallonie est au pied du mur et qu’il va lui falloir poursuivre les efforts qu’elle a entrepris depuis une dizaine d’années. La région a en effet défini, depuis 1999, plusieurs programmes politiques d’ensemble axés sur son redressement économique, avec notamment le Contrat d’avenir pour la Wallonie lancé en 1999 par M. Di Rupo, alors chef du gouvernement wallon, et, surtout, le Plan Marshall lancé en 2006, qui concentre les efforts financiers sur cinq axes prioritaires, mettant fin à la tradition du « saupoudrage » que nombre d’observateurs signalaient comme étant une composante intégrale du « mal wallon » (64). Le Plan Marshall a été prolongé en 2009 par un Plan Marshall 2.0 Vert qui s’inscrit dans la même logique : concentration des moyens sur un nombre limité de secteurs et appel à des ressources financières uniquement régionales. A la suite de la conclusion de l’accord institutionnel, qui prévoit la révision de la loi de financement, la Wallonie se prépare désormais à mettre en œuvre une stratégie à l’horizon 2020.
L’action des autorités wallonnes commence à porter ses fruits : une étude du Service public fédéral de l’économie a montré, en décembre dernier, que le revenu par tête des Wallons reste inférieur à celui des Flamands, mais a augmenté plus vite pendant la dernière décennie. La part de la Wallonie dans les exportations de la Belgique augmente régulièrement depuis plusieurs années et, si la Flandre reste encore une terre d’accueil privilégiée pour les investissements étrangers en Belgique, la proportion de ceux qui se dirigent vers la Wallonie a sensiblement augmenté depuis plusieurs années. La région reste cependant très vulnérable, comme le montrent les inquiétudes suscitées par la décision d’Arcelor-Mittal de fermer la phase à chaud de ses installations sidérurgiques à Liège, à l’automne dernier.
L’avenir de la Belgique ne dépend cependant pas que de la Wallonie. Des facteurs proprement communautaires continueront à orienter la vie politique. La périphérie de Bruxelles, par exemple, pourrait rester source de tensions, comme le suggère M. Verherstraeten. Celui-ci estime, en effet, que s’il est heureux que le dossier de BHV ait enfin été réglé (« c’est un problème du XIXe siècle qui n’avait pas été résolu au XXe siècle »), il serait illusoire de croire que la scission de l’arrondissement électoral supprimera le processus de « francisation » des communes périphériques, au-delà même du périmètre des seules communes à facilités. M. André Flahaut s’est dit certain que les revendications flamandes continueraient. Selon M. Paul Buysse, « la Belgique est une holding et le sera encore plus ». Jusqu’à quel point ? Car s’il est une conséquence de la crise dont il est difficile de mesurer l’impact, c’est bien le fait que le tabou de la scission a été définitivement levé.
Certes, les prises de position sur un éclatement du pays ne datent pas d’hier. Elles constituent à la fois le fondement du discours des partis séparatistes et des hypothèses d’école évoquées régulièrement par les observateurs de la vie politique. Ce qui apparaît aujourd’hui est que le thème de la séparation est devenu une hypothèse de travail crédible pour les acteurs de la vie politique.
Au tournant de l’été 2010, au moment où la dynamique de négociation engagée au sortir des élections s’affaiblit définitivement, des responsables du PS commencent à évoquer un « plan B » pour la Belgique : il faut commencer à réfléchir à l’après-Belgique. Il est, bien sûr, difficile de faire le départ entre ce qui pouvait être à l’époque un instrument de pression sur certains partenaires flamands et ce qui pouvait relever d’une conviction profonde. Mais le thème a été peu à peu lancé dans l’espace public.
Lors de son premier déplacement à Bruxelles, en juillet 2011, la mission a également pu entendre M. Francis Delpérée, sénateur, confier un certain désarroi et affirmer : « il y a encore cinq ans, je ne pouvais pas concevoir une Belgique séparée » ; M. Philippe Busquin, ancien ministre, ancien commissaire européen chargé de la recherche scientifique, jugeait quant à lui que cette extrémité n’était « pas pensable il y seulement deux ans ». Ces propos, il est vrai, étaient tenus le lendemain du jour où la N-VA avait rejeté la « note de base » de M. Di Rupo, créant un choc dans l’opinion et le monde politique. Ce contexte explique aussi que M. Charles Picqué ait affirmé que « le rejet de la note de M. Di Rupo est une nouvelle étape dans le démantèlement de la Belgique ». La note a finalement vécu au-delà de son rejet par la N-VA, mais, si la perspective d’un « démantèlement » s’est éloignée, celle d’un « distanciement » semble devoir s’imposer, selon le mot de M. Flahaut.
b) La Flandre ne cesse de s’affirmer comme nation
Au fil de l’histoire contemporaine récente de la Belgique, la Flandre s’est construite peu à peu autour des attributs de l’État-nation : elle a combattu – et combat encore – pour définir un territoire propre intangible ; elle a conjugué ses forces à celles du fédéralisme wallon pour transformer l’État unitaire en État fédéral ; elle a profité d’une configuration favorable pour réunir en une entité politique unique les deux institutions flamandes qui résultaient de la fédéralisation ; elle a tiré parti d’un combat linguistique séculaire pour faire de la langue un principe unificateur.
Sur ce dernier point, force est de reconnaître que, dans le chef de la plupart des formations politiques flamandes, c’est une conception linguistique de la communauté nationale flamande qui prévaut, et non une conception ethnique : est Flamand celui qui parle le néerlandais en Flandre ; d’où une politique active d’intégration, dont certains aspects délicats ont été évoqués précédemment dans ce rapport, mais dont l’orientation est incontestablement assimilatrice.
La Flandre a aussi ses symboles, son drapeau, sa fête, comme d’ailleurs la Wallonie et les autres entités fédérées. Mais il faut bien constater que, compte tenu de l’importance des formations nationalistes en Flandre, la gestion politique des symboles nationaux y prend une acuité toute particulière. Sans même parler du pèlerinage de l’Yser, qui a lieu chaque année au pied de la tour de l’Yser, et qui est à la fois une manifestation contre la guerre et pour l’autonomie de la Flandre, les interventions des responsables politiques lors de la fête flamande (le 11 juillet) sont suivies avec une grande attention.
Certaines initiatives du gouvernement flamand soulèvent d’ailleurs des polémiques. Il en est ainsi, par exemple, du programme décidé par les autorités pour célébrer le centenaire de la Première guerre mondiale ; des voix se sont élevées ailleurs en Belgique pour dénoncer une présentation excessivement flamande du conflit et contester ce qui serait une tentative de récupération d’une mémoire qui devrait appartenir à tous les Belges. La « politique extérieure » dynamique de la Flandre, qui cherche à développer son réseau de représentations à l’étranger, suscite également des interrogations. Un interlocuteur de la mission a pu dire que la Flandre dispose déjà d’un territoire, d’une population et d’institutions ; si elle dispose aussi d’une « reconnaissance internationale », elle aura alors tous les attributs d’un État.
Aux yeux de la mission, une interrogation subsiste pourtant sur le projet politique final des forces flamandes. Le Vlaams Belang et la N-VA ne font pas mystère de leurs ambitions séparatistes, M. Armand De Decker ayant à cet égard évoqué le fait que la N-VA est un élément majeur d’une « internationale séparatiste » ayant des liens avec des partis similaires en Catalogne et en Écosse. Toutes les enquêtes d’opinion montrent cependant qu’une fraction significative de leur électorat reste attachée à la Belgique.
Les partis traditionnels semblent ouvertement plus attachés au maintien de la Belgique, mais peuvent se comporter comme s’ils souhaitaient sa disparition et cultivent parfois une certaine ambiguïté quant à leur vision du pays. Le discours du CD&V sur le projet d’une Belgique confédérale ne peut que renvoyer, par exemple, à la conception classique d’une confédération en science politique, qui consiste en l’association volontaire et essentiellement précaire d’États indépendants dotés de tous les attributs de la souveraineté. Le CD&V veut-il que la Belgique passe par un « moment confédéral » qui verrait une Flandre enfin débarrassée du carcan belge tendre la main en toute liberté à ses partenaires wallons et germanophones ? Rien ne permet de l’affirmer.
Deux lectures sont possibles du nationalisme flamand. La première y voit la manifestation d’un nationalisme classique, « romantique », tendant à la formation d’un État-nation et dont la perspective ultime ne peut être que l’indépendance de la Flandre. La seconde y voit l’expression d’un nationalisme « post-national », dénué de toute dimension affective et tendant uniquement à l’optimisation du système institutionnel. Cette dernière permet de multiples appartenances et n’empêche pas le maintien du cadre belge.
Deux lectures possibles, donc, pour un nationalisme dont les acteurs peuvent parfois se plaire à brouiller les pistes. Si M. Kris Peeters, ministre-président de la Flandre, affirme son positionnement flamingant et « vit la Flandre comme une vraie nation », selon M. Christian Laporte, le discours de la N-VA se fait parfois post-national. C’est une approche très dépassionnée qu’a retenue M. De Wever lors de son entretien avec la mission : l’histoire de la Belgique montre que les problèmes sont de plus en plus complexes et que les réponses apportées dans le cadre de l’État unitaire, puis dans le cadre de l’État fédéral tel qu’il existe aujourd’hui, ne sont pas efficaces. « L’avenir se lit dans une perspective coûts-bénéfices. Or la Belgique est un petit pays, qui procure des avantages trop peu nombreux. La Belgique paie un prix énorme pour les différences entre ses deux démocraties ». Nulle passion et nul emportement dans cette analyse, mais une illustration parfaite de « l’idéologue froid » que Mme Mia Doornaert décrivait à la mission, celui qui parle au portefeuille de l’électeur flamand plutôt que de chercher à faire vibrer une fibre identitaire.
La crise de 2007 peut aussi être lue rétrospectivement à travers ce prisme : lorsque les Flamands réclamaient une réforme de l’État, les francophones répondaient qu’ils ne voulaient pas de la fin de la Belgique. Était-ce la bonne façon de poser le débat ? 2010 a suivi…
2. La (re)construction d’un espace politique national reste pour l’heure hypothétique
C’est au début du XXe siècle que se confirme l’impuissance des élites francophones à bâtir une « âme belge » et à souder une nation belge. L’historien Henri Pirenne pouvait bien avancer, dans sa monumentale Histoire de Belgique (1900-1932) le concept novateur de « civilisation nationale » (absence de luttes à caractère ethnique entre Flamands et Wallons, fusion des civilisations française et germanique, pouvoir des villes, etc.), qui serait née au cœur du Moyen Âge, et affirmer que l’unité nationale belge a précédé l’unité de gouvernement. Cette vision n’a pas résisté à l’influence corrosive des décennies suivantes.
Plutôt que de chercher à retrouver une âme belge originelle qui se serait perdue dans les vicissitudes de l’histoire, il revient aux élites d’aujourd’hui de faire vivre en bonne harmonie deux communautés dont les différences font la richesse de la Belgique comme les différences nationales font la richesse de l’Europe. M. Rik Torfs, Flamand lui-même, regrettait ainsi que depuis près de quatre décennies, les élections en Flandre se fassent toujours sur la base d’une critique des francophones : c’est une « erreur » et il faudrait désormais retrouver des « points de contacts » entre francophones et Flamands. Dans le champ purement institutionnel, deux projets tendant à (re)construire un espace politique national ont été évoqués dans la période récente.
a) L’introduction de mécanismes de démocratie directe doit être vue comme une piste peu opportune
Sans pour autant avoir vraiment acquis droit de cité dans le débat politique, l’introduction de mécanismes de démocratie directe en Belgique n’est pas une lubie de philosophes en mal de publicité. En janvier 2011, alors que M. Johann Vande Lanotte tentait d’amender sa note pour convaincre les sept partis alors en discussion de s’engager dans des négociations, M. Didier Reynders, alors président du MR, regrettait que les sept partis concernés n’aient pas la lucidité de reconnaître le blocage du processus ; il indiquait surtout qu’il ne fallait pas hésiter à consulter la population par référendum.
Un groupe d’universitaires réunis au sein de l’Initiative Re-Bel (65) s’est penché sur cette idée, dans le cadre d’une réflexion collective dont les résultats ont été publiés en 2009 (66). Le point de départ de la réflexion, matérialisé dans un texte introductif confié à un maître de recherche en politique comparée de l’université de Zurich, est le constat d’un « paradoxe suisse » : la démocratie directe en Suisse n’empêche pas le pays de fonctionner harmonieusement et semble être un facteur de cohésion nationale, malgré des inconvénients bien connus.
Au nombre de ceux-ci, on peut recenser le fait que les citoyens n’ont, en général, qu’une faible compétence sur les sujets complexes qui doivent être tranchés, que les démagogues et les lobbyistes peuvent manipuler l’opinion et que la démocratie directe entre en concurrence avec le système représentatif.
Pour l’auteur du texte, la démocratie directe recèlerait cependant des éléments favorables à la stabilité politique, qui pourraient être utiles dans le cadre de la Belgique. Les modalités de déclenchement du processus référendaire peuvent être suffisamment ouvertes pour que les « minorités » aient la possibilité de créer leur débat politique et mettre leurs préoccupations à l’agenda commun. La multiplicité des référendums, sur des sujets très divers, fait obstacle à l’émergence de discours ethnolinguistiques fondés sur les stéréotypes et sur l’opposition entre « eux » et « nous » ; cela permet à des majorités et des minorités politiques multiples de se former en fonction des circonstances. Le référendum organisé sur un plan national structure une conscience et un espace politique communs, par nature, et permet donc de rendre visible le « peuple » comme entité politique. Enfin, la démocratie directe favorise le dialogue interlinguistique et le partage des opinions entre les régions linguistiques.
En réponse, les intervenants belges ont fait valoir les obstacles qui, selon eux, rendent peu opportune l’introduction de tels mécanismes au sein du système politique belge. Deux idées forces s’en dégagent :
– la démocratie directe pose un problème de principe car elle suppose l’adhésion à un système de décision de type majoritaire. Or, les rares expériences majoritaires de la Belgique dans les dernières décennies ne constituent pas d’excellentes références : la « consultation populaire » organisée dans le cadre de la Question royale a débouché sur des grèves insurrectionnelles et sur des frustrations profondes en Flandre comme en Wallonie ; l’exercice majoritaire du pouvoir par un gouvernement social-chrétien (1950-1954) puis une coalition socialistes-libéraux (1954-1958) a ranimé puis attisé la « guerre scolaire » ;
– il y a peu de chances de voir émerger en Belgique des majorités à géométrie variable, car les opinions publiques francophone et néerlandophone sont plus homogènes et plus antagoniques qu’en Suisse, cet antagonisme ayant des racines historiques anciennes ; le risque est donc grand que toute consultation populaire soit conçue et lue d’emblée à travers un prisme communautaire, quand bien même ce ne serait pas son objet.
Les répondants au texte introductif estiment donc que la démocratie directe serait un facteur de perturbation plutôt que d’apaisement des tensions communautaires. Au demeurant, il est difficile d’affirmer qu’il y aurait un « vide démocratique » en Belgique, qui nécessiterait d’être comblé par le recours à la démocratie directe.
Des conclusions similaires se dégagent des échanges que la mission a eus à Bruxelles. M. Philippe Van Parijs est ainsi convenu que la vie politique suisse est bien animée par les référendums, même si le taux de participation est en général assez faible. Pour autant, remarquait-il, les partis politiques sont restés nationaux et il est plus facile d’avoir un système « fluide » entre 23 cantons qu’entre deux communautés linguistiques. Mme Mia Doornaert relevait, pour sa part, que le système suisse de démocratie directe fonctionne plutôt bien mais qu’il s’agit d’une « mécanique très délicate ».
b) Le projet d’une circonscription électorale unique a progressé sans aboutir
Il y a plusieurs années déjà que le projet de créer une circonscription électorale unique en Belgique a été formulé. Il semble que l’on puisse faire remonter son origine à une proposition de M. Leo Tindemans, alors Premier ministre, qui avait suggéré en 1979 de faire élire les députés européens belges dans une circonscription unique.
L’idée a été reprise au début des années 1990, évoquée par des personnalités politiques de tous horizons et, surtout, mûrie au sein du « groupe Pavia », qui rassemble une douzaine d’universitaires de Flandre, de Wallonie et de Bruxelles. Une proposition complète a été mise au point et portée sur la place publique en 2007.
Le cœur de la proposition consiste à prévoir l’élection de 15 députés sur 150 au total dans la circonscription fédérale unique. L’idée est que le nombre de députés élus dans la circonscription unique et le nombre de députés élus selon les modalités de droit commun doivent être dans un rapport d’environ un pour dix, suffisamment élevé pour que le système politique bénéficie des avantages attendus de cette innovation, suffisamment modéré pour ne pas perturber profondément les ressorts classiques de l’élection à la Chambre des représentants, notamment l’ancrage territorial des élus.
Neuf sièges seraient destinés à des élus néerlandophones et 6 sièges à des élus francophones. Chaque électeur aurait deux voix : la première lui permettrait de voter, comme actuellement, pour une liste provinciale ; la seconde lui permettrait de voter pour une liste fédérale. La proposition prévoit également les modalités de répartition des élus entre groupes linguistiques, des sièges entre les candidats, la possibilité d’apparentements, etc.
Pour les auteurs de la proposition, il faut attendre de celle-ci deux avantages : d’une part, le niveau fédéral du pouvoir y trouverait une légitimité propre ; d’autre part, la capacité du système politique à dégager des compromis en serait accrue.
S’ils souhaitent récolter des voix de l’autre côté de la frontière linguistique, les partis seraient ainsi tentés de modérer leur discours et leur programme. Idéalement, les partis francophone et néerlandophone d’une même « famille politique » établiraient un programme commun ou, au moins, un rapprochement de leurs projets politiques. Pour les responsables les plus importants, la circonscription unique constituerait une alternative intéressante aux deux grands collèges électoraux du Sénat qui, jusqu’à présent, leur permettent de mesurer leur popularité à large échelle (67). Enfin, la proposition favoriserait le bilinguisme des dirigeants, puisque les candidats devraient mener campagne « de Knokke-Heist à Aubange ».
La proposition a cependant été critiquée. Tout d’abord parce qu’il est difficile de concevoir comment une campagne où 90 % de l’enjeu, en sièges, continuerait d’être « communautarisé » pourrait être influencée par la circonscription électorale unique. De plus, l’instauration d’un quota de sièges serait contraire à la logique intégrative du projet.
Enfin, il n’est pas certain que les partis joueraient le jeu et accepteraient de s’adresser, via une liste fédérale, aux électeurs de l’autre communauté. En fait, le pari est d’autant plus risqué qu’il joue sur une corde sensible : la représentation parlementaire des partis. Tout parti craignant d’y perdre des sièges pourrait se refuser à apporter ses voix à l’adoption de telles nouvelles règles du jeu. Or la logique de confrontation intercommunautaire, largement instrumentalisée par les formations politiques, a mené à la construction réciproque d’images très négatives des partis de l’autre communauté, et particulièrement des partis dominants. Le CD&V et le PS pourraient reculer face au rejet de la part de l’autre communauté qu’ils peuvent craindre. Enfin, il va de soi que la création d’une circonscription électorale unique est aux antipodes du projet politique que la N-VA nourrit pour la Belgique.
La mission relève, pour sa part, que l’instauration d’une telle circonscription irait à l’encontre du principe de territorialité tel qu’il a été et est encore revendiqué par les Flamands, notamment dans la périphérie bruxelloise. En un sens, instaurer une circonscription fédérale unique revient à étendre à toute la Belgique le dispositif actuel de BHV, dont l’accord institutionnel prévoit justement la disparition et qui a été pendant des décennies une pomme de discorde entre Flamands et francophones.
C’est peut-être pour cela que l’accord institutionnel du 6 octobre 2011 a mis le projet comme en retrait de l’agenda politique. Certes, il l’a en quelque sorte consacré, mais sous une forme édulcorée puisqu’il renvoie à une commission parlementaire spécifique le soin d’examiner notamment « la question d’une circonscription électorale à la Chambre ». La note de base de M. Di Rupo était plus ambitieuse puisqu’elle prévoyait qu’« une circonscription fédérale représentant dix élus à la Chambre des Représentants sera dès lors créée selon des modalités à débattre pour permettre aux Belges, qu’ils soient domiciliés en Wallonie, à Bruxelles ou en Flandre, de voter pour la femme ou l’homme politique qu’ils souhaitent. »
3. Bruxelles reste un ciment solide
Si les tensions sont aujourd’hui atténuées, mais latentes et prêtes à resurgir, si les moyens de construire un espace politique national restent encore incertains, la Belgique doit chercher quels sont les ciments qui la tiennent aujourd’hui.
La mission ne peut passer sous silence le rôle de la monarchie et du roi actuel, Albert II. Elle estime cependant qu’elle n’a pas à prendre position sur les actions du chef de l’État d’un État ami, proche, dans le cadre de questions politiques uniquement intérieures. Qu’il soit donc entendu que les quelques développements qui suivent ne sont que la synthèse des éléments recueillis par elle auprès de ses interlocuteurs de Bruxelles.
L’action d’Albert II au cours de la crise de 2010 n’est pas sérieusement contestée. Il est allé au bout des possibilités offertes au souverain, dont les actes, en la matière, ne peuvent faire autrement que de respecter et refléter le résultat des élections. Sa première préoccupation a donc été de permettre la formation d’un gouvernement qui puisse gouverner réellement et être contrôlé par le Parlement. Tout au long de la crise, le roi a cherché à faire en sorte que les acteurs continuent à se parler et que le fil ne soit jamais rompu.
Quelques critiques ont cependant été émises à son encontre pour les appels lancés au gouvernement en affaires courantes à élargir son périmètre d’intervention. Mais le roi a toujours pris soin de placer ces interventions sous le signe de la protection du bien-être de la population.
Au plus fort de la crise, dans la période si critique qui a suivi le refus par la N-VA de la note de base de M. Di Rupo, le roi a fait usage de la plénitude de ses pouvoirs constitutionnels. Dans son discours traditionnel prononcé à l’occasion de la fête nationale, le 21 juillet, il a lancé un « nouvel appel à tous les citoyens et en premier lieu aux responsables politiques. Un célèbre constitutionaliste anglais, Walter Bagehot, précisait les prérogatives de la monarchie constitutionnelle comme suit : le droit d'être informé, le droit d'encourager et le droit de mettre en garde. Ces derniers mois, dans mes audiences, j'ai beaucoup utilisé les deux premières prérogatives : être informé et encourager. Avec vous, je voudrais à présent faire usage publiquement, en toute transparence, de la troisième prérogative : le droit de mettre en garde. »
Dans ce qui restera peut-être comme un moment fort de la crise, le roi a voulu rappeler « solennellement les risques qu’une longue crise fait courir à tous les Belges » et exhorter « à nouveau tous les hommes et toutes les femmes politiques, et ceux qui peuvent les aider, à se montrer constructifs et à trouver rapidement une solution équilibrée à nos problèmes ». Il a aussi appelé les citoyens à « s’efforcer de favoriser une meilleure entente entre nos communautés en faisant des pas concrets vers l’autre, en parlant sa langue, en s’intéressant à sa culture, en essayant de mieux le comprendre. »
La crise passée, l’avenir de la monarchie pourrait passer par une réduction des pouvoirs constitutionnels du roi. L’attachement à la monarchie est, lui aussi, marqué par le clivage communautaire : le roi serait « pris au sérieux » par les francophones et « pas populaire » en Flandre, même si seuls la N-VA et le Vlaams Belang sont des partis républicains. Certains responsables politiques considèrent cependant que le roi est essentiel car il est le seul personnage de l’État qui soit au-dessus des partis et, quoiqu’en disent certains, au-dessus du clivage communautaire. De ce fait, les dirigeants des partis peuvent lui parler en confiance au cours du « colloque singulier », dont plusieurs observateurs ont regretté que la confidentialité ait été quelquefois transgressée dans les récentes périodes de crise.
Le principal ciment de la Belgique est aujourd’hui Bruxelles, à la fois sujet de discorde et pont entre les communautés linguistiques. « Lien et otage de la Belgique » disait M. Martin Buxant.
Bruxelles est tout d’abord le cœur d’une Belgique métropolisée. Jusque dans les années 1960, elle comptait parmi les centres industriels majeurs du pays, sa situation s’étant ensuite dégradée. Bruxelles est marquée par l’expansion de ses fonctions internationales : première ville des fonctions européennes, deuxième ville mondiale pour l’organisation de congrès internationaux, comptant au nombre des villes européennes de référence en compagnie de Milan, Francfort, Madrid ou Amsterdam, nœud majeur des réseaux des firmes de services avancés, etc. C’est par elle que se diffuse la richesse et l’impulsion économique dans le « losange flamand » constitué autour de Bruxelles, Anvers, Gand et Louvain. La position de Bruxelles est excellente en termes d’insertion dans les réseaux, voire de localisation de sièges régionaux de firmes transnationales ; elle est en revanche médiocre en matière de localisation de sièges sociaux de firmes de niveau mondial. Ceci rend compte de l’affaiblissement du capitalisme belge, qui s’est très largement « dénationalisé ».
Bruxelles connaît cependant des difficultés économiques sérieuses provoquées notamment par des recettes fiscales très insuffisantes par rapport à ses besoins. D’une part, près de 55 % des emplois sont occupés par des non-résidents (près de 200.000 « navetteurs » flamands et 100.000 « navetteurs » wallons) qui produisent de la richesse sur le territoire bruxellois mais sont imposés sur leur lieu de résidence ; les Brabant wallon et flamand en sont les principaux bénéficiaires puisque limitrophes de la région. D’autre part, l’importance des fonctions internationales conduit à de nombreuses exonérations d’impôts au profit des organisations implantées sur le territoire bruxellois ou de leur personnel, alors même que le statut de ville internationale génère des contraintes et appelle des dépenses qui doivent être assumées par les pouvoirs locaux du pays hôte.
Enfin, Bruxelles souffre, comme d’autres métropoles ouvertes vers l’international, d’une forte dispersion des revenus et de contrastes importants. M. Charles Picqué indiquait ainsi à la mission que « Bruxelles est une machine à recycler la pauvreté », avec des quartiers où le taux de chômage atteint 35 % et un niveau moyen de revenu très bas alors que la région produit près de 20 % du PIB belge. Le paradoxe de Bruxelles est qu’elle est « une ville prospère peuplée de populations pauvres ou fragilisées ».
Bruxelles est surtout la capitale de la Belgique, celle de la Flandre et de la Communauté française, alors que la Région wallonne a fait le choix de fixer le siège de sa capitale à Namur. C’est la seule région bilingue de Belgique et la seule où les deux Communautés sont simultanément compétentes.
Bruxelles est donc un enjeu politique majeur, à la fois « lien fédérateur et pierre d’achoppement », selon le mot de M. Picqué. Elle est désirée par la Flandre, qui se pose en protectrice des néerlandophones bruxellois et en gardienne vigilante du caractère bilingue des institutions ; elle reste pourtant suspecte car la ville est majoritairement peuplée de citoyens déclarés francophones et, qui plus est, elle échappe largement à la séparation binaire entre néerlandophones et francophones.
Plusieurs interlocuteurs de la mission ont d’ailleurs estimé que M. De Wever « n’accepte pas le fait bruxellois » et qu’un débat a traversé la N-VA quant à l’éventualité de troquer un jour Bruxelles contre la séparation de la Flandre, quitte à implanter la capitale de celle-ci à Anvers.
Les partis flamands (sauf le Vlaams Belang) considèrent que Bruxelles ne doit pas être une région à part entière, égale aux autres, car son état de capitale de la Belgique interdit qu’elle se coupe des deux communautés linguistiques majeures du pays : celles-ci doivent exercer leur droit de regard sur la ville commune, qui est d’ailleurs située en terre flamande. Bruxelles est une ville partagée entre les deux communautés, qui doivent y bénéficier de droits égaux. La gestion paritaire de la capitale, où les néerlandophones sont minoritaires, est conçue comme le contrepoids de la gestion paritaire de l’État fédéral, où les francophones sont minoritaires.
Le positionnement des forces politiques est plus dispersé du côté francophone. Certains mettent l’accent sur la revendication d’une région Bruxelles-Capitale comme région à part entière et sur l’affaiblissement de la Communauté française qui permettrait aussi un repli wallon jugé salvateur. D’autres sont partisans d’un lien étroit entre Bruxelles et la Wallonie, autour du partage du français, et mettent l’accent sur l’importance de la Communauté française. Celle-ci a d’ailleurs été rebaptisée symboliquement Fédération Wallonie-Bruxelles au printemps 2011, appellation qui exprime tout à la fois la force supposée de la relation entre la Wallonie et Bruxelles et la reconnaissance de deux identités propres.
Car, justement, la décennie écoulée a vu un phénomène qui n’a pas encore de répercussions politiques majeures mais qui commence à perturber les schémas classiques de la politique belge : l’identité bruxelloise s’affirme de plus en plus. Cela fait longtemps, disait à la mission M. Quentin Dickinson, que les néerlandophones de Bruxelles sont peu attachés à la Flandre, car Bruxelles, encore aujourd’hui, est bien plus brabançonne que flamande. De même, les francophones de Bruxelles n’ont pas de lien réel avec la Wallonie. « Les seuls vrais Belges sont les Bruxellois » affirmait M. Jean Quatremer, rejoint en cela par M. Charles Picqué, qui estimait que « les Bruxellois se définissent comme Belges ou Bruxellois, mais jamais comme Flamands ou Wallons ».
Ce mouvement identitaire commence à trouver sa place dans l’espace public. En 2003 est apparu ce que les observateurs appellent aujourd’hui le « nouveau mouvement bruxellois ». Celui-ci est né de la rencontre de citoyens francophones et néerlandophones autour d’un Manifeste bruxellois qui dénonce l’inadéquation des institutions politiques à la réalité multilingue et multiculturelle de Bruxelles. Reprenant la formule employée par M. Gaston Eyskens à la tribune de la Chambre en 1970, les rédacteurs du Manifeste affirment que le clivage communautaire « est maintenant dépassé par les faits » et demandent à l’ensemble des responsables du pays de mieux prendre en compte les spécificités de Bruxelles et les besoins des Bruxellois.
Le mouvement du Manifeste bruxellois a eu une certaine postérité : des associations sont nées, comme Aula Magna ou bruXsel Forum, qui ont porté ses aspirations et ont engagé des initiatives concrètes, comme l’organisation des États généraux de Bruxelles, en 2009.
Ces actions n’ont pas (ou pas encore ?) réussi à faire bouger les lignes qui structurent le positionnement des forces politiques sur la question bruxelloise. Elles manifestent cependant clairement que les Bruxellois voudront avoir leur mot à dire sur l’évolution institutionnelle de leur région et n’accepteront pas d’être cantonnés dans le rôle de citoyens minorisés, soumis à un condominium wallo-flamand ou résidents d’un District of Columbia belge.
Les institutions belges sont en débat depuis quarante ans. Le pays a cherché le moyen de surmonter des situations de domination et de minorisation sur l’intensité desquelles les historiens pourront débattre mais dont la réalité ne peut être contestée. D’une part, il s’est engagé dans une distanciation toujours plus grande entre deux communautés qui se sont forgées une identité tantôt bien affirmée, comme en Flandre, tantôt inachevée, comme du côté francophone, où l’articulation entre les mondes wallon et francophone est tout sauf évidente. D’autre part, il a instauré des mécanismes de protection de la minorité qui ont fait peu à peu de la Belgique une « conférence de diplomatie permanente », selon le mot de M. Karel de Gucht, commissaire européen au Commerce, ancien président du VLD.
La Belgique a ainsi appliqué dans le domaine des institutions les principes de ce que la science politique appelle la « démocratie consociative », qui consiste, dans les sociétés profondément divisées, à neutraliser les conflits grâce à la combinaison de trois éléments : la segmentation de la société, la coopération des élites et le partage du pouvoir. La répétition des crises et leur allongement suggèrent que, peut-être, les mécanismes de la démocratie consociative ont épuisé leur pouvoir pacificateur.
Pourtant, l’option de la séparation ne rassemble aujourd’hui que 15 % à 20 % de l’électorat en Flandre. Il faut donc voir l’avenir de la Belgique dans la continuation de son État central, fût-ce au prix de nouvelles adaptations, de nouvelles réformes. Mais jusqu’où faudra-t-il déconstruire pour pouvoir reconstruire ? Nul ne saurait prétendre ranimer une « âme belge » qui n’apparaît plus que par éclipses. Il revient ainsi aux forces qui ne souhaitent pas la disparition du pays de trouver quels peuvent être le principe intégrateur dont aura besoin la Belgique, le point d’équilibre entre les diverses composantes de l’État et le processus nécessaire pour parvenir à cet état d’équilibre.
A ceux qui, nombreux, dénoncent une décennie d’affaiblissement de l’esprit européen et de renationalisation des politiques européennes, la Belgique peut alors apparaître comme un « laboratoire de l’Europe », de son renforcement ou de sa désunion. C’est dire si ce pays mérite bien plus que l’indifférence dans laquelle on le tient bien souvent. Partenaire de l’aventure européenne depuis ses débuts, la Belgique nous donne peut-être certaines clefs de notre avenir.
La Commission examine le présent rapport d’information au cours de sa réunion du mercredi 15 février 2012 à 17h00.
Après l’exposé des co-rapporteurs, un débat a lieu.
M. Michel Terrot. Est-ce un appel de sa part à l’Europe des régions ?
M. Jean-Pierre Kucheida, co-rapporteur. Absolument. Dans la vision de Bart De Wever, la Flandre ne devra être rattachée à aucun État. Pour faire progresser son projet, il peut s’appuyer sur les tensions communautaires qui sont nées des différends non réglés dans les années 2000.
Quel avenir peut-on entrevoir pour la Belgique ? Mon sentiment est que ça va durer ce que ça va durer… Le principal message de la plupart de nos interlocuteurs était : « on va bien voir ». La crise de 2010-2011 a fait de grands gagnants, les Flamands, et un grand perdant, Elio Di Rupo, qui a dû consentir des concessions majeures par rapport au programme politique de son parti sur les sujets socio-économiques. Il commence d’ailleurs à être confronté à la pression des syndicats, qui sont normalement un allié. L’aboutissement des négociations et la constitution du gouvernement constituent à mon sens une victoire à la Pyrrhus et font peser une lourde hypothèque sur l’avenir politique du Premier ministre.
Les élections communales constituent la prochaine échéance. Ces élections ont une portée politique bien plus importante qu’en France. Si leur résultat montre que la situation se décante dans le sens souhaité par Bart De Wever, on peut être certain que de nouveaux problèmes, de nouvelles revendications, vont apparaître.
J’ai l’intime conviction que les Flamands ne seront jamais satisfaits dans le cadre actuel de la Belgique ; ils ne pourront être satisfaits que si le cordon belge est coupé ou, tout au moins, largement distendu. J’en veux pour preuve la critique permanente qu’ils adressent aux Wallons, en oubliant que la prospérité passée de la Wallonie a été bénéfique pour la Flandre.
L’avenir de la Belgique est donc fait de questions plus que de réponses.
Bruxelles y occupe une place majeure. Bruxelles, c’est tout à la fois une ville dont 85% de la population est francophone, la capitale de la Belgique et de la Flandre (la Wallonie a assurément pris une mauvaise décision en choisissant Namur pour capitale), la capitale de l’Union européenne, le siège de multiples organisations internationales… et une ville pauvre. Pourtant, personne ne peut l’abandonner, ni la rejeter, ni l’accaparer : cela crée une situation impossible. Selon toute vraisemblance, rien ne changera de longtemps autour de Bruxelles.
L’égoïsme flamand se nourrit de la réussite économique de la Flandre. Peut-être faudrait-il que, pendant la prochaine législature, la Commission des Affaires étrangères se penche sur les fondements du développement économique de la Flandre. J’ai interrogé sur ce point M. Nic Vandermarliere, délégué du Gouvernement flamand en France – c’est-à-dire quasi-ambassadeur de la Flandre ; celui-ci a répondu que dans les années 1950, les autorités flamandes avaient consenti un effort considérable sur l’éducation, la formation et la recherche. Il serait particulièrement utile d’étudier comment la Flandre a pu aller vers l’excellence dans de si nombreux domaines.
Mme la présidente Martine Aurillac. Dans le paysage politique belge, quelle est la place des écologistes ?
M. Robert Lecou. Les écologistes sont présents des deux côtés : il y a le parti « Ecolo » chez les francophones et le parti « Groen » chez les Flamands. Ils ont recueilli environ 5% des voix à l’élection de la Chambre des Représentants. Fait notable et unique, ils forment un groupe commun au Parlement.
M. Jacques Myard. Lorsqu’on parle de l’Orient compliqué, il faut raisonner avec des idées simples. C’est pareil avec la Belgique, laquelle est une nation artificielle voulue par les Anglais. La Wallonie est une population celtique qui, en 1815, après le Congrès de Vienne, s’est retrouvée dans le giron des Pays-Bas. A ce problème se greffe le fait que la Wallonie, riche par le passé, est en crise sur le plan économique. De même, la démographie flamande a connu une très forte poussée. La situation est donc explosive. J’ai assisté à un congrès du mouvement rattachiste. Cette idée n’est pas encore très répandue mais figurez-vous que des maires de communes françaises limitrophes de la Wallonie avaient été invités et déclarèrent que si le rattachement avait un jour lieu, ils demanderaient à rejoindre la Wallonie devenue française. Je souhaite aussi dénoncer certaines méthodes fascistes utilisées, aujourd’hui, en Flandre, s’agissant notamment de la langue. Enfin, Bruxelles est un problème majeur et nul doute que ça va mal se passer lorsque sera abordé le sort de cette ville. En tout cas, ça fait 30 ans que les rapports de fin de mission des ambassadeurs de France en Belgique nous disent que « la Belgique n’existe plus ». La question que l’on doit se poser, c’est : que fera la France ? Ignorer le problème ou accepter la Wallonie, quand bien même ça ne plairait pas au Royaume-Uni ? Et puis, il faudra aussi tenir compte de l’enclave germanophone d’Eupen-Malmedy. Quoiqu’il en soit, la Belgique est condamnée, c’est une construction artificielle qui ne tiendra pas et la seule question qui compte c’est comment la France traitera ce problème.
M. Christian Bataille. J’ai une vision intime de la Belgique puisqu’une partie de ma famille vit près de Tournai et que ma circonscription est presque frontalière avec ce pays. Le Nord et la Belgique, c’est la même chose ! C’est le même pays ! Il n’y a aucune différence entre Valencienne et Mons, par exemple. Je suis d’accord avec notre collègue Jaques Myard lorsqu’il a invoqué l’histoire et, notamment, le Congrès de Vienne où Talleyrand, malgré son talent, n’a pu empêcher de rattacher la Belgique à la France. La Suisse a sans doute réussi là où la Belgique a échoué en raison d’un enracinement beaucoup plus ancien. Je ne suis pas allé au congrès des rattachistes mais je pense que la Belgique ne durera pas et que la France devra accueillir à bras ouverts la Wallonie. De tout ça, il faut tirer une leçon : notre période n’aime pas les solidarités. A l’échelle européenne, les Allemands ne veulent pas payer pour la Grèce. En Italie, Milan ne veut pas payer pour Naples. Et en Belgique, les Anversois ne veulent pas payer pour les Wallons qui passent à leurs yeux pour être tous paresseux, chômeurs et au crochet de la sécurité sociale. Et puis se pose aussi le problème de Bruxelles qui n’évoluera pas, je pense, sur le modèle de Washington DC, c’est à titre d’un territoire fédéral européen. Car un Bruxelles indépendant serait un Bruxelles francophone et, de ça, les Flamands ne veulent pas. Permettez-moi, pour conclure, de dire que j’ai trouvé les rapporteurs bien indulgents vis-à-vis de Bart De Wever. Car une des composantes du NVA est bel et bien fasciste !
M. Robert Lecou. N’oubliez pas qu’il y a aussi le Vlaams Belang qui, lui, est ouvertement d’extrême droite.
M. Christian Bataille. Certes mais je vous trouve indulgents. Cela me fait penser à la fable du loup devenu berger.
M. Michel Terrot. Je partage totalement l’opinion de M. Jaques Myard sur le fait qu’un assemblage artificiel de différents peuples ne peut pas marcher. Les Rapporteurs n’ont pas cité la colonisation. La Belgique est un petit Etat mais son empire colonial, constitué de l’ex-Congo Belge, aujourd’hui RDC, et aussi du Rwanda et du Burundi, était immense. Le Congo Belge a d’abord été une possession personnelle du roi Léopold II. Wallons et Flamands y étaient présents mais l’administration s’est faite en français. Est-ce que cela n’a pas masqué une vérité qu’on ne peut plus cacher aujourd’hui ? Je crois que la question coloniale ne doit pas être écartée lorsqu’on se penche sur la Belgique.
M. Jean-Pierre Kucheida, co-rapporteur. Vous avez parfaitement raison de mentionner les comportements parfois inacceptables, proches de l’exaction, dont sont victimes les francophones en Flandre.
La France doit-elle ignorer les difficultés des Wallons ou offrir de les accueillir ? Nous avons posé cette question à nos interlocuteurs wallons, qui n’ont pas exprimé le souhait de rejoindre la France.
Le Congo a effectivement beaucoup pesé sur l’histoire de la Belgique, parfois pour le meilleur, souvent pour le pire. Mais aucune des personnes que nous avons rencontrées ne l’a mentionné.
M. Robert Lecou, co-rapporteur. Ouvrir largement les bras aux Wallons ne me semble pas envisageable. Je tiens à souligner que, lorsqu’il nous a reçus, le représentant de la Flandre à Paris avait invité son homologue de Wallonie, et que les deux hommes semblaient bien s’entendre. Une offre de la France en direction des Wallons ne pourrait qu’aggraver la situation.
Puis la commission autorise la publication du rapport d’information.
LISTE DES PERSONNALITÉS RENCONTRÉES
1. Entretiens à Paris
• M. Laurent Wauquiez, Ministre chargé des affaires européennes (15 juin 2011)
• M. Philippe Moreau-Defarges, chercheur à l’IFRI (13 décembre 2011)
• M. Jean-Pol Baras, Délégué général Wallonie-Bruxelles en France (20 décembre 2011)
• M. Jean-Yves Camus, chercheur associé à l’IRIS (31 janvier 2012)
• M. Nic Vandermarliere, Délégué du Gouvernement flamand en France (31 janvier 2012)
• M. Dries Willems, Délégué adjoint du Gouvernement flamand en France (31 janvier 2012)
• M. Roger Hotermans, conseiller à la Délégation générale Wallonie-Bruxelles en France (31 janvier 2012)
2. Mission à Bruxelles (7-8 juillet 2011)
• S. Exc. Mme Michèle Boccoz, Ambassadeur de France
• Mme Florence Cormon-Veyssière, Premier conseiller, Ambassade de France
• M. Emmanuel Tuchscherer, Second conseiller, Ambassade de France
• MM. Karl Vanlouwe (N-VA), président de la commission des Relations extérieures et de la Défense du Sénat, et M. Frank Boogaerts (N-VA), sénateur
• M. Armand De Decker (MR), ancien président du Sénat, sénateur, Ministre d’État
• M. Rik Torfs (CD&V), sénateur
• M. Jean-Pierre Stroobants, correspondant du journal Le Monde
• M. Jean Quatremer, correspondant du journal Libération
• M. Quentin Dickinson, représentant à Bruxelles de RFI
• M. Francis Delpérée, (CDH), sénateur
• M. Philippe Busquin (PS), ancien ministre, ancien commissaire européen chargé de la recherche scientifique, bourgmestre de Seneffe (Hainaut)
• Mme Béatrice Delvaux, rédactrice en chef du journal Le Soir
• M. Martin Buxant, chroniqueur, La Libre Belgique
• M. Christian Laporte, chroniqueur, La Libre Belgique
• M. Charles Picqué (PS), ministre-président, Région Bruxelles-Capitale
• M. André Flahaut (PS), président de la Chambre des représentants et de la commission de Révision de la Constitution et de la réforme des institutions, Ministre d’État
• Mme Mia Doornaert, conseillère, cabinet de M. Yves Leterme, Premier ministre (CD&V)
• M. Pascal Delwit, professeur de science politique à l’Université libre de Bruxelles, membre du Centre d’études de la vie politique (Université libre de Bruxelles)
• M. Philippe Van Parijs, professeur à l’Université catholique de Louvain (chaire Hoover d'éthique économique et sociale), à la Katholieke Universiteit Leuven et à Harvard
• M. Dave Sinardet, politologue, professeur à l’Université libre de Bruxelles et à la faculté des sciences économiques et sociale d’Anvers
• M. Jean Faniel, politologue, CRISP (Centre de recherche de d’information socio-politiques, Bruxelles)
3. Mission à Bruxelles (18 janvier 2012)
• M. Servais Verherstraeten (CD&V), secrétaire d’État aux réformes institutionnelles et M. Benjamin Dalle, directeur de cabinet
• M. Herman De Croo (Open-VLD), député
• M. Bart de Wever, président de la N-VA (Nieuw Vlaamse Alliantie) et M. Karl Vanlouwe (N-VA), président de la commission des Relations extérieures et de la Défense du Sénat
• M. Paul Buysse, président du conseil d’administration de Bekaert SA
• M. Baudoin Velge, directeur du Cercle de Lorraine
• Mme Françoise Masai, vice-gouverneur de la Banque Nationale de Belgique
• M. André Flahaut (PS), président de la chambre des Représentants et de la commission de Révision de la Constitution et de la réforme des institutions, Ministre d’État
• Mme Helga De Baets (CD&V), conseillère pour les réformes institutionnelles de M. Kris Peeters, ministre-président de Flandre
• M. Jan Peumans (N-VA), président du Parlement flamand
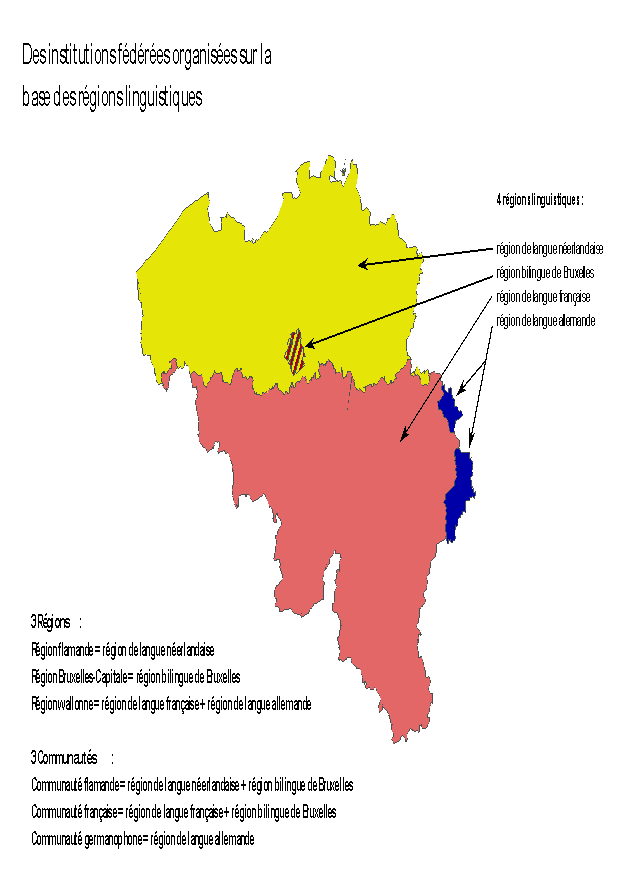
CARTE DES RÉGIONS LINGUISTIQUES
ET DES ENTITÉS FÉDÉRÉES

1 () Dave Sinardet, « Le compromis à la belge. Brrrrr ! », Le Vif – Vu de Flandre, n° 41, 14 octobre 2011.
2 () Cité dans Marie-Madeleine Martin, Baudoin Ier et la Belgique, Flammarion, 1964.
3 () « Time to call it a day », The Economist, 6 septembre 2007.
4 () Le Royaume-Uni des Pays-Bas est créé au Congrès de Vienne (1815) et réunit les actuels territoires des Pays-Bas et de la Belgique (à l'exception des cantons de l’Est). Élevé au rang de grand-duché indépendant, le Luxembourg a cependant le même souverain que le Royaume-Uni des Pays-Bas, dans le cadre d’une union personnelle.
5 () Le territoire des Dix-sept Provinces recouvre approximativement le territoire actuel des Pays-Bas, de la Belgique (à l’exception de la principauté de Liège, indépendante depuis 980), du Luxembourg, du Nord-Pas-de-Calais et quelques territoires à l'ouest de l'Allemagne.
6 () Les Provinces-unies avaient proclamé leur indépendance en 1581 et celle-ci avait été « reconnue de fait » par la Trêve de Douze ans conclue avec l’Espagne en 1609. La maison d’Orange-Nassau y acquiert une place centrale, exerçant la fonction de stathouder, c’est-à-dire de chef militaire chargé des relations internationales, au sein de la plupart des sept provinces.
7 () Les Pays-Bas du Sud recouvrent approximativement les territoires actuels du Nord-Pas-de-Calais, de la Belgique (à l’exception de la principauté de Liège) et du Luxembourg.
8 () Celui-ci va régner sous le nom de Guillaume Ier des Pays-Bas.
9 () Territoires rattachés à la Belgique en 1919 au titre de dommages de guerre en application du traité de Versailles, les cantons de l’Est sont au nombre de trois : Eupen et Saint-Vith abritent la communauté germanophone de Belgique alors que Malmédy a été inclus dans la partie francophone de la Wallonie.
10 () Ce faux reportage était intitulé « Bye Bye Belgium ! ».
11 () G. Fonteyn, « La presse francophone et la Flandre », Septentrion, n° 2007-1.
12 () C. Laporte, « La presse flamande et la Belgique francophone », Septentrion, n° 2007-1.
13 () M. Leterme a été député fédéral de 1999 à 2004 avant de devenir ministre-président de la Flandre de 2004 à 2007, puis Premier ministre de 2007 à 2011.
14 () Voir la présentation du dossier BHV en page 28.
15 () Voir les développements de la partie B à partir de la page 42.
16 () Sources : Julien Dohet et Jean Faniel, « Belgique 1960-2010. Grève du siècle et crise multiforme », Savoir/Agir, n° 16, juin 2011 ; Els Witte, Jan Craeybeckx et Alain Meynen, Histoire politique de la Belgique depuis 1830, Academic and Scientific Publishers, Bruxelles, 2009, cité dans « La grève générale de l’hiver 1960-1961 », La Revue Toudi, novembre 2010.
17 () E. Witte et H. Van Velthoven, Langue et politique – La situation en Belgique dans une perspective historique, VUB University Press, Bruxelles, 1999.
18 () L’unification de la langue écrite donne lieu à d’intenses débats entre 1839 et 1844, date à laquelle le gouvernement fait le choix de l’orthographe néerlandaise standardisée plutôt que celui de la création d’une langue flamande spécifique, qui aurait dû tenir compte des particularités des quatre familles de dialectes parlés dans les régions flamandes.
19 () Comme l’indiquent Mme Witte et M. Van Velthoven, « Petit à petit, on commença à exiger la connaissance du néerlandais pour obtenir un emploi dans les services provinciaux flamands mais cela se limita souvent à un examen superficiel. Les candidats flamands par contre devaient avoir une connaissance approfondie du français, ce qui explique le nombre élevé d’échecs. Il n’était donc nullement question d’une égalité des deux langues en Flandre, ni lors du recrutement ni lors de promotions. Au contraire, la connaissance obligatoire du néerlandais visait uniquement ceux qui étaient en contact avec le public. Un premier pas avait cependant été franchi et au cours des décennies suivantes, les fonctionnaires unilingues wallons firent l’objet de pressions en Flandre. » (op. cit.)
20 () Chaque électeur pouvait disposer de une à trois voix, en fonction de ses biens et de ses « aptitudes ».
21 () Cette dernière loi prévoit, par exemple, que les ordres doivent être donnés dans la langue des hommes de troupe et que des contingents unilingues doivent être progressivement constitués au sein des unités militaires.
22 () Cependant, l’administration est tenue de fournir une traduction officielle sur simple demande.
23 () Les provinces ne sont pas concernées par cette « menace » en raison de leur dimension démographique.
24 () A l’issue du recensement de 1947, quatorze communes évoluent vers le français alors qu’une seule évolue vers le néerlandais.
25 () Au demeurant, le mouvement flamand cherche aussi à faire aboutir les avancées des lois de 1921 et 1932 : constatant la persistance des déséquilibres linguistiques dans l’administration centrale et à Bruxelles, l’absence de contrôle effectif des exigences de la loi de 1932 et l’inefficacité des examens de langue proposés aux candidats fonctionnaires, il réclame le développement d’un réel bilinguisme interne et externe de l’administration (qui ne peut que contrarier les intérêts des fonctionnaires francophones unilingues), le bilinguisme individuel de tous les cadres dirigeants et des personnels en contact avec le public, le renforcement des prérogatives des instances de contrôle et le remplacement des examens de langue par la prise en compte de la langue du diplôme pour l’inscription des fonctionnaires sur les rôles linguistiques.
26 () De très nombreux bourgmestres flamands indiquent qu’ils ne distribueront pas les formulaires linguistiques associés au recensement organisé en 1960 ; des marches flamandes sur Bruxelles sont organisées en 1961 et 1962.
27 () Comme l’indique M. Rudi Janssens dans une étude sur « L’usage des langues à Bruxelles et la place du néerlandais. Quelques constatations récentes » (Brussels Studies, n° 13, janvier 2008), « l’indisponibilité de chiffres officiels relatifs au contexte linguistique a donné lieu à de nombreuses discussions, dans le meilleur des cas, reposant sur du matériel et des données partiels, et dans le pire, alimentées par des suppositions et des mythes sans aucun fondement. »
28 () André LAMBERT et Louis LOHLE-TART, Combien de bruxellois flamands aujourd’hui et demain dans la région de Bruxelles-Capitale ?, Association ADRASS, juillet 2010.
29 () Comité des droits de l’homme, Projet d’observations finales du Comité des droits de l’homme, doc. CCPR/C/BEL/CO/5, Genève, novembre 2010.
30 () Banque nationale de Belgique, Comptes régionaux 2003-2010, février 2012.
31 () Conseil économique et social de la région wallonne, Regards sur la Wallonie 2010, mai 2011.
32 () Ibid.
33 () Ibid.
34 () A cet égard, la Société générale de Belgique occupe pendant plusieurs décennies une place centrale dans le fonctionnement du capitalisme industrialo-financier belge.
35 () Conseil économique et social de la région wallonne, 50 ans d’histoire économique de la Wallonie, 2004.
36 () La note Octopus est une note rédigée par le gouvernement flamand pour être présentée devant le groupe de travail Octopus (qui rassemblait huit partis politiques). Ce groupe avait été constitué sous l’égide du gouvernement fédéral Verhofstadt III (installé en décembre 2007) et chargé de négocier un « Pacte en faveur d’un État fédéral renouvelé », c’est-à-dire une nouvelle réforme de l’État (janvier-février 2008).
37 () On retrouve dans cette dernière demande la thématique de l’opposition entre une Wallonie qui serait trop complaisante vis-à-vis des chômeurs et une Flandre qui, au contraire, veillerait à utiliser au mieux les instruments de la politique de l’emploi.
38 () Les Régions wallonne et flamande et les Communautés française et flamande adoptent des décrets ; la Région Bruxelles-Capitale adopte des ordonnances.
39 () Ceci est possible sans difficulté majeure car, sur les 124 sièges du Parlement flamand, 118 sont pourvus par élection dans la Région flamande et 6 seulement sont pourvus par élection à Bruxelles.
40 () En fait, la Communauté flamande n’a délégué aucune matière à la VGC, qui ne dispose donc d’aucun pouvoir législatif et n’est qu’un organe décentralisé de la Communauté flamande.
41 () Il s’agit notamment des compétences en matière d’infrastructures sportives, de tourisme, de promotion sociale et de formation professionnelle, ainsi que le transport scolaire.
42 () Il s’agit notamment des compétences en matière de monuments, sites et fouilles, de tutelle sur les pouvoirs subordonnés, de transport scolaire, de télécommunications et de politique de l’emploi.
43 () B. Payenet et G. Pagano, Le financement des entités fédérées : un système en voie de transformation, CRISP, juin 2011.
44 () La population bruxelloise est « affectée » à hauteur de 80 % à la Communauté française et à hauteur de 20 % à la Communauté flamande.
45 () A hauteur de 80 % du montant total à répartir jusqu’en 2011 et à hauteur du montant intégral à partir de 2012.
46 () La Flandre a décidé de percevoir elle-même directement certains impôts.
47 () Le Congrès national wallon organisé à Liège les 20 et 21 octobre 1945 adopte une motion défendant l'autonomie dans un cadre confédéral, à la suite de laquelle des parlementaires wallons soutinrent – sans succès – au parlement belge une proposition instaurant le fédéralisme.
48 () Les lois Gilson (1962-1963) ont fixé la frontière linguistique et ont été adoptées par des votes majorité flamande contre minorité francophone.
49 () Même si, par certains côtés, il ne va pas aussi loin que le fédéralisme américain, puisque la justice reste une compétence uniquement fédérale en Belgique alors que le pouvoir judiciaire est en partie exercé par les États fédérés aux États-unis.
50 () L’immédiat après-guerre est la seule période où le parti communiste belge a une importance politique non négligeable.
51 () La coalition « arc-en-ciel » regroupe les deux partis libéraux, les deux partis socialistes et les deux partis écologistes.
52 () Voir les développements consacrés à la réforme de 2001 en page 54.
53 () Voir les développements consacrés à la loi électorale de 2002 en page 28.
54 () Il demande par exemple que de nouvelles compétences soient régionalisées : la santé, la famille, l'emploi, la fiscalité (tant pour les particuliers que pour les sociétés), la justice et la sécurité. Il demande aussi une révision de la Constitution pour transformer la Belgique en un État confédéral qui fonctionnerait autour de deux centres de gravité – la Flandre et la Wallonie – et dans lequel la Communauté germanophone serait dotée d'un statut spécifique.
55 () L’affaire Fortis est un scandale politico-judiciaire qui a contraint à la démission le gouvernement Leterme le 19 décembre 2008. Cette démission fait suite aux déclarations du président de la Cour de cassation qui affirmait avoir « des indications importantes » que le gouvernement aurait tenté de faire pression sur la justice dans le dossier de démantèlement de la banque Fortis, au bord de la faillite.
56 () Même si celui-ci a fait une campagne « très modérée » en 2010 sur le sujet communautaire, selon M. Pascal Delwit (La Libre Belgique, 8 juillet 2011).
57 () V. de Coorebyter, « Les contradictions de la démocratie », Le Soir, 30 août 2011.
58 () Le Soir, 19 avril 2011.
59 () Les deux partis sociaux-chrétiens, les deux partis socialistes, les deux partis écologistes et la
N-VA. Les deux partis libéraux sont hors du périmètre des coalitions envisagées.
60 () Voir la présentation du dispositif de la part attribuée d’IRPP en page 46.
61 () Voir la présentation du dispositif de solidarité fiscale régionale en page 50.
62 () La « note de base » de M. Di Rupo prévoyait que les élections régionales auraient également lieu le même jour ; mais cette disposition a été contestée au motif qu’il convenait de préserver l’autonomie politique des différents niveaux de pouvoir, donc de bien distinguer les élections.
63 () C’est-à-dire un décret ou une ordonnance adoptée à la majorité spéciale définie par l’article 4 de la Constitution, à savoir la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique et la majorité des deux tiers des suffrages dans l’assemblée, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie.
64 () Évoquant le Plan Marshall, l’hebdomadaire Le Vif – L’Express affirme : « pour la première fois, on pense Wallonie et non plus Liège + Charleroi + Mons + Tournai + Namur » (27 septembre 2011).
65 () Re-Bel, abréviation de « Rethinking Belgium’s institutions in the European context ». Le groupe Re-Bel se fixe pour objectif de repenser en profondeur, de façon ouverte, rigoureuse et non partisane ce à quoi les institutions de l’État fédéral belge pourraient et devraient ressembler à long terme, en prenant en compte les évolutions du contexte européen. Il a adopté l’anglais comme langue de travail.
66 () Is Democracy viable without a unified Public Opinion ? The Swiss experience and the Belgian case, Re-Bel e-book n° 3, juin 2009.
67 () Par l’intermédiaire des « voix de préférence ».
© Assemblée nationale
