______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 février 2012.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
sur « les printemps arabes »
et présenté par
M. Axel PONIATOWSKI,
Président
___
INTRODUCTION 7
CONTRIBUTIONS DES GROUPES POLITIQUES 15
Contribution du groupe Union pour un mouvement populaire 17
Contribution du groupe Socialiste, radical citoyen et divers gauche 23
Contribution du groupe Nouveau Centre 33
Contribution du groupe Gauche démocrate et républicaine 39
COMPTES RENDUS DES TRAVAUX DE LA COMMISSION 45
1.- Mardi 18 janvier 2011, séance de 10 heures 45, compte rendu n° 27 : audition de Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes, sur la situation en Tunisie (ouverte à la presse) 47
2.- Mardi 18 janvier 2011, séance de 17 heures, compte rendu n° 29 : audition de M. Xavier Driencourt, ambassadeur de France en Algérie 59
3.- Mercredi 16 février 2011, séance de 9 heures 45, compte rendu n° 37 : table ronde sur les évolutions politiques au Maghreb et au Proche-Orient, en présence de M. Patrice Paoli, directeur d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient au ministère des affaires étrangères et européennes, et de M. Denis Bauchard, conseiller spécial pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient à l’Institut français des relations internationales. 68
4.- Mardi 8 mars 2011, séance de 16 heures 45, compte rendu n° 41 : audition de M. François Gouyette, ambassadeur de France en Libye, sur les événements en Libye 90
5.- Mardi 15 mars 2011, séance de 16 heures 45, compte rendu n° 43 : extraits de l’audition de M. Alain Juppé, ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et européennes (ouverte à la presse) 105
6.- Mercredi 30 mars 2011, séance de 9 heures 45, compte rendu n° 45 : compte rendu de la mission effectuée en Tunisie par M. le président Axel Poniatowski, Mme Chantal Bourragué, M. Dino Cinieri, M. Jean-Paul Lecoq et M. François Loncle. 115
7.- Mercredi 6 avril 2011, séance de 10 heures 30, compte rendu n° 49 : audition de Son Exc. M. Yossi Gal, ambassadeur d’Israël en France 125
8.- Mercredi 4 mai 2011, séance de 17 heures, compte rendu n° 56 : extraits de l’audition de M. Alain Juppé, ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et européennes (ouverte à la presse) 138
9.- Mardi 10 mai 2011, séance de 10 heures, compte rendu n° 57 : audition de M. Mouldi Kefi, ministre des affaires étrangères de Tunisie 151
10.- Mardi 10 mai 2011, séance de 17 heures 15, compte rendu n° 58 : audition de M. Fouad Siniora, ancien président du Conseil libanais. 167
11.- Mercredi 18 mai 2011, séance de 9 heures 30, compte rendu n° 61 : audition M. Hael Al Fahoum, chef de la mission de Palestine en France 177
12.- Mercredi 25 mai 2011, séance de 9 heures 45, compte rendu n° 64 : table ronde sur la situation en Syrie, en présence de Mme Elizabeth Picard, directrice de recherches émérite au CNRS (Institut de Recherches et d’Études sur le Monde Arabe et Musulman), et M. Patrice Paoli, directeur d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient au ministère des affaires étrangères et européennes 192
13.- Mardi 7 juin 2011, séance de 17 heures, compte rendu n° 67 : audition de M. Mounir Fakhry Abdel Nour, ministre du tourisme de la République arabe d’Egypte 208
14.- Mercredi 15 juin 2011, séance de 16 heures 45, compte rendu n° 71 : audition, commune avec la commission des affaires européennes, de M. Laurent Wauquiez, ministre auprès du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, en charge des affaires européennes, sur le partenariat euroméditerranéen (ouverte à la presse) 218
15.- Mardi 5 juillet 2011, séance de 17 heures 30, compte rendu n° 75 : extraits de l’audition de M. Alain Juppé, ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et européennes (ouverte à la presse) 228
16.- Mercredi 5 octobre 2011, séance de 9 heures 45, compte rendu n° 2 : examen du rapport de la mission d’information « L’Iran après 2008 » 242
17.- Mercredi 12 octobre 2011, séance de 9 heures 30, compte rendu n° 3 : audition de M. Burhan Ghalioun, président du Conseil national syrien, et Mme Bassma Kodmani, membre du bureau exécutif du Conseil national syrien 256
18.- Mercredi 16 novembre 2011, séance de 9 heures 45, compte rendu n° 17 : réunion sur les monarchies du Golfe et les printemps arabes, en présence de Mme Fatiha Dazi-Héni, politologue spécialiste du monde arabe, et M. Nabil Mouline, enseignant-chercheur à l’Institut d’études politiques de Paris (ouverte à la presse). 268
19.- Mercredi 7 décembre 2011, séance de 9 heures 45, compte rendu n° 23 : audition de M. Mourad Medelci, ministre des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire (ouverte à la presse) 280
20.- Mercredi 21 décembre 2011, séance de 9 heures 30, compte rendu n° 29 : réunion sur la situation en Egypte en présence de M. Peter Harling, directeur du projet Moyen-Orient à l’International Crisis Group, et Mme Sophie Pommier, enseignante à l’Institut d’études politiques de Paris, spécialiste de l’Egypte. 297
21.- Mardi 10 janvier 2012, séance de 17 heures, compte rendu n° 31 : audition de M. Alain Juppé, ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et européennes (ouverte à la presse) 315
22.- Mercredi 15 février 2012, séance de 9 heures 30, compte rendu n° 40 : compte-rendu du déplacement en Egypte d’une délégation de la commission 329
CHRONOLOGIE DES PRINTEMPS ARABES 341
CARTE 363
Mesdames, Messieurs,
Le présent rapport d’information a pour objet de présenter les travaux que la commission des affaires étrangères a entrepris à propos de ce que l’on appelle les « printemps arabes » et de permettre aux groupes parlementaires d’exprimer leurs positions et analyses sur ces événements.
Les grands tournants historiques sont rarement prévisibles, surtout lorsqu’ils prennent la forme de révolutions populaires : c’est presque toujours un événement apparemment insignifiant qui les déclenche, dans un contexte dont il est facile d’expliquer a posteriori combien il y était favorable.
Aussi est-il particulièrement injuste de reprocher à la diplomatie française de n’avoir pas vu venir le soulèvement populaire tunisien qui a conduit, en moins d’un mois, à la fuite du président Ben Ali. Il faut reconnaître que la surprise était générale.
Depuis, la France a joué à plusieurs reprises un rôle décisif en faveur des populations qui ne demandaient que le respect des principes démocratiques et de leurs droits fondamentaux.
Début mars, une semaine après son entrée en fonction, M. Alain Juppé a effectué un déplacement au Caire où il s’était entretenu avec le maréchal Tantaoui, le chef du Conseil suprême des forces armées, et avec le secrétaire général de la Ligue arabe, mais aussi avec des membres de la Coalition des jeunes pour la démocratie. Il y a affirmé le soutien de la France à la transition politique en cours et sa disponibilité pour l’accompagner dans cette voie, tout en appelant les jeunes révolutionnaires à faire preuve de courage et de détermination.
A la mi-avril, le ministre d’Etat s’est rendu en Tunisie pour faire part à la société tunisienne et aux acteurs de la transition démocratique de l’admiration de la France pour la révolution courageuse qu’ils avaient conduite, y voyant « une chance et un espoir pour nous tous » et annonçant une aide bilatérale substantielle.
Au lendemain du début de la répression violente menée par le général Kadhafi contre ceux qui s’opposaient à lui, la France a mobilisé la communauté internationale pour obtenir des sanctions contre le général et son régime : elle a largement contribué à l’adoption de la résolution 1970 du Conseil de sécurité des Nations unies, dès le 26 février 2011, puis de la résolution 1973, le 17 mars, avant de jouer un rôle de premier plan dans la conduite des opérations militaires visant à protéger la population civile contre les violences du régime. Dès le 10 mars, elle avait reconnu le Conseil national de transition comme le seul représentant légitime du peuple libyen.
Bien que la situation en Syrie présente bon nombre de différences par rapport à celle qui existait en Libye, les autorités françaises ont très tôt souhaité que le Conseil de sécurité des Nations unies se saisisse du dossier syrien et condamne aussi clairement que possible la violence de la répression conduite par le régime de Bachar el-Assad contre son peuple. Après que le Conseil de sécurité a adopté une déclaration présidentielle condamnant les violations des droits de l’homme et l’emploi de la force contre des civils par les autorités syriennes, le 3 août 2011, la diplomatie française a travaillé sans relâche à l’adoption par le Conseil d’une résolution contraignante. Un projet de résolution, élaboré notamment par la France, par lequel le Conseil de sécurité aurait condamné la violence et indiqué sa disposition à envisager d’autres options, y compris des sanctions, si son appel n’était pas entendu, a été rejeté le 4 octobre, la Russie et la Chine ayant opposé leur veto. Le 4 février 2012, le même sort a été réservé à un projet de résolution soutenant le plan de sortie de crise de la Ligue arabe. Les efforts de la diplomatie française n’ont pu venir à bout de l’opposition de la Russie et de la Chine, alors même que le nombre de victimes de la répression en Syrie dépassait les 6 000. Ils se poursuivent néanmoins, dans l’intérêt du peuple syrien. Ils ont notamment conduit à l’adoption de plusieurs trains de sanctions européennes contre le régime de Bachar el-Assad.
Notre pays est aussi à l’origine du lancement du partenariat de Deauville. Exerçant la présidence du G 8, il a décidé d’inviter l’Egypte et la Tunisie au sommet qui s’est tenu à Deauville en mai 2011, et a pris l’initiative de ce partenariat qui vise à soutenir la transformation politique et économique en Tunisie, en Egypte, en Jordanie et au Maroc. En septembre dernier, le Koweït, le Qatar, l’Arabie saoudite, la Turquie et les Émirats arabes unis ont rejoint les membres fondateurs du partenariat, auquel participent aussi neuf institutions financières internationales et régionales. Le montant total disponible pour appuyer les efforts de réforme dans les quatre pays dits « du partenariat » a ainsi été porté à 38 milliards de dollars américains. La Libye pourrait prochainement y être aussi associée.
Les bouleversements dans le monde arabe n’ont pas remis en cause les projets initiés dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée, qui conservent toute leur pertinence, leurs objectifs étant aussi de promouvoir l’intégration économique et les réformes démocratiques dans les pays du sud de la Méditerranée.
Pour des pays dont l’activité économique, notamment touristique, a fortement ralenti en 2011, alors que les besoins et les attentes des populations sont immenses, le temps nécessaire à la mise en route de ces instruments de financement apparaît inévitablement trop long : leur impatience est légitime, mais les choses avancent. Notre Parlement vient d’autoriser la ratification du traité élargissant le mandat de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement aux pays du sud de la Méditerranée. Autre exemple : fin janvier, le conseil d’administration de l’Agence française de développement a accordé à l’Egypte un prêt concessionnel de 300 millions d’euros pour la deuxième phase de la ligne 3 du métro du Caire, dans le cadre d’un paquet global de 900 millions d’euros octroyé par l’Union européenne.
Bien entendu, de nombreuses incertitudes subsistent.
La première série d’incertitudes porte sur l’avenir des régimes politiques confrontés aux aspirations de leurs peuples. A l’origine, on pouvait penser que seuls les régimes des pays les plus pauvres seraient sérieusement menacés et que les bénéficiaires de la rente pétrolière seraient épargnés, mais en fait tous, même les plus traditionnels, doivent prendre en considération l’aspiration au changement. Le monde arabe n’est pas un bloc homogène ; rapidement, il est apparu qu’il n’y avait pas « un » printemps arabe mais plusieurs et que les révolutions connaîtraient des fortunes diverses. Il apparaît également que le processus est infiniment plus complexe dans les pays traversés par des clivages ethniques ou religieux, que les monarchies peuvent faire preuve d’une plus grande souplesse d’adaptation que les dictatures en place, que des régimes comme par exemple la République d’Algérie sont protégés par la mémoire encore vive de la guerre civile. Bref, rien n’est encore écrit et l’avenir nous réserve sans doute bien des surprises.
En dépit de ces incertitudes, un optimisme raisonnable paraît fondé. De la Tunisie à l’Egypte, en passant par la Libye, la transition démocratique est en cours, et les difficultés qu’elle rencontre sont parfaitement normales ; elle s’amorce au Yémen, enfin libéré du président Saleh. Plusieurs pays, dont les régimes ont subsisté, se sont lancés dans des réformes afin de satisfaire les revendications populaires : tel est le cas, à des degrés divers, de la Mauritanie, de l’Algérie, du Maroc, de l’Arabie saoudite, de la Jordanie. Là encore, beaucoup reste à faire, mais un mouvement allant dans la bonne direction est enclenché. On peut espérer que la chute, dans plusieurs pays de la région, de dictateurs sourds aux aspirations populaires servira d’aiguillon aux autorités de ces Etats pour poursuivre ces réformes. L’exemple de Bahreïn, où les manifestations des opposants au régime reprennent, montre que ni la répression, ni quelques gestes symboliques ne sauraient annihiler ou satisfaire la volonté de changement.
La seconde série d’incertitudes tourne naturellement autour de la question de l’islam politique. Il ne fait guère de doute que les partis islamiques sont – et seront, dans les pays où ni la révolution ni la réforme n’ont encore triomphé – les grands bénéficiaires du changement. La question est de savoir maintenant ce qu’ils feront de leur victoire.
Il est exclu d’enfermer l’islam dans un déterminisme culturel qui le supposerait radicalement étranger aux valeurs de la démocratie, mais le passé tout comme certains positionnements ou ambiguïtés présents justifient que l’on s’interroge. Les forces politiques qui émergent sont encore mal connues ; de nombreux analystes insistent sur les clivages internes qui les traversent. Il conviendra de les juger à leurs actes. Un élément devrait toutefois tempérer les inquiétudes : la revendication commune à tous les peuples qui se sont soulevés au cours de l’année écoulée, de la Mauritanie à la Jordanie, en passant par les Etats du Golfe, portait sur le respect de la démocratie. Les forces les plus réticentes à l’égard de ces valeurs devront compter avec l’ampleur de cette aspiration.
Certes, même dans les pays ayant une très longue tradition démocratique, les retours en arrière sont toujours possibles, aussi les avancées observées dans les pays arabes devront elles être consolidées et confirmées. Dans ce domaine, c’est la Tunisie qui a franchi le plus grand nombre d’étapes vers l’établissement d’un système démocratique : une assemblée constituante a été élue le 23 octobre, laquelle a adopté une loi sur l’organisation provisoire des pouvoirs début décembre et a élu un nouveau président de la République. En Egypte, la chambre basse du Parlement a été élue et le processus d’élection des membres de la chambre haute est en cours : lorsque le Parlement sera entièrement constitué, il lui appartiendra de désigner les membres du comité constitutionnel chargé d’élaborer une constitution pour le pays ; un président de la République devra aussi être élu. Pour l’heure, la plus grande incertitude règne quant au calendrier, la rue faisant pression pour que l’élection présidentielle, initialement prévue en juin, intervienne le plus tôt possible afin que le Conseil suprême des forces armées cesse d’exercer le pouvoir exécutif.
Deux constats peuvent néanmoins être faits : dans ces deux pays, les élections se sont déroulées dans des conditions correctes, et les résultats n’ont pas été contestés ; elles ont été un succès pour les partis islamistes, alors que les partis fondés par les révolutionnaires n’ont pas obtenu des résultats à la hauteur de leurs espérances. La manière dont les vainqueurs des élections vont diriger leur pays est aujourd’hui un objet d’interrogation majeur : dans quelle mesure auront-ils à cœur de donner à la religion une place marquée, dans les règles constitutionnelles et/ou dans la société ? Seront-ils tentés de remettre en cause les principes démocratiques et les droits fondamentaux des citoyens, notamment des femmes, pourtant au cœur des revendications révolutionnaires ? Quelle sera leur attitude vis-à-vis de ceux qui appartiennent à une autre communauté religieuse ? Les mêmes questions se poseront bientôt en Libye, où une assemblée constituante devrait être élue avant la fin du printemps 2012, et en Syrie, si Bachar el-Assad quitte finalement le pouvoir.
L’un des premiers effets concrets des révolutions arabes sur les populations est la dégradation des conditions de vie, déjà très difficiles pour beaucoup. L’aspiration à une répartition plus juste des fruits du développement économique, longtemps détournés par les élites liées aux anciens régimes, a joué un rôle considérable dans les printemps arabes : elle doit être satisfaite, ce qui suppose la relance des économies des pays concernés. Les pouvoirs nouvellement élus devront relever ce double défi de relance économique et de justice sociale, et ont besoin de l’aide internationale pour réussir.
Les conséquences géopolitiques des printemps arabes sont un autre sujet de préoccupation. Comment une Egypte dirigée par les Frères musulmans, avec des ministres salafistes, va-t-elle réorienter sa politique étrangère, en particulier à l’égard d’Israël et des Territoires palestiniens ? Si la dénonciation du traité de paix israélo-égyptien de 1979 semble exclue, du moins à court terme, il ne fait guère de doute que, dans un proche avenir, les autorités du Caire, majoritairement issues du mouvement des Frères musulmans, se montreront bienveillantes à l’égard du Hamas, que le régime de Moubarak combattait et qui partage l’idéologie des Frères. La volonté égyptienne de jouer un rôle régional semble en tout cas entière : les efforts en faveur de la réconciliation inter-palestienne se sont poursuivis, non sans succès. Il faut aussi s’attendre à ce que Le Caire lance un processus de normalisation de ses relations avec Téhéran, sans que la constitution d’un nouvel axe entre les deux capitales soit réellement à craindre.
Quelles seront les conséquences de la ligne adoptée par Israël face aux printemps arabes ? Alors que ce mouvement aurait dû inciter l’Etat d’Israël à prendre des initiatives afin de relancer le processus de paix, rien de positif n’a été annoncé, tandis que les responsables palestiniens, poussés à l’action par une jeunesse galvanisée par les printemps arabes, se sont engagés sur la voie, semée d’embûches, de la reconnaissance de leur Etat par l’ONU.
Depuis le début des printemps arabes, l’Arabie saoudite a joué un rôle déterminant, principalement par l’intermédiaire du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe et de la Ligue arabe. Après avoir acheté le retour au calme sur la scène nationale, elle a aidé les autorités de Bahreïn à rétablir l’ordre chez elles, avant de prendre le parti des opposants au régime de Bachar el-Assad, dont elle n’a jamais été proche. L’un des enjeux de son bras de fer avec la Syrie pourrait être le Liban, actuellement dirigé par une majorité pro-syrienne, qui aura du mal à se préserver des effets de la guerre civile en cours en Syrie.
Parallèlement, la Turquie entendra exploiter toutes les opportunités qui se présenteront pour gagner en prestige et en influence dans le monde arabe tandis que l’Iran, autre acteur stratégique majeur de la région, pourrait jouer un rôle extrêmement néfaste – voire destructeur.
Si l’évolution du positionnement géopolitique des différents Etats de la région sera progressive, certains effets des printemps arabes sont déjà très sensibles en matière de sécurité, particulièrement dans la zone sahélienne. La chute du régime de Kadhafi a été suivie par le départ de Libye d’un nombre important de combattants touaregs qui y avaient trouvé refuge, souvent depuis plusieurs décennies : rentrés armés dans leurs pays d’origine, ils ont contribué à la reprise de la rébellion touarègue dans le nord du Mali. Parallèlement, le stock d’armes accumulé par le général Kadhafi a été pillé et disséminé dans le voisinage immédiat de la Libye mais aussi au Nigeria et au Proche-Orient.
La plus grande inquiétude concerne désormais la Syrie, victime d’un régime autoritaire, devenu sanguinaire. La situation en Syrie est décisive pour la stabilité d’une zone particulièrement complexe, mais le président el-Assad a définitivement perdu toute légitimité en utilisant la force la plus brutale contre son peuple : le point de non-retour a été franchi depuis longtemps. Il est urgent que lui-même et ses alliés en tirent les conséquences. Point de doute que la France poursuivra ses efforts pour les en persuader, tout comme elle continuera à soutenir, dans tous les pays arabes, ceux qui se battent courageusement pour la démocratie.
On le voit, il serait présomptueux de vouloir dresser d’ores et déjà un bilan des printemps arabes, qui sont loin d’être achevés et n’ont pas encore révélé toutes leurs conséquences sur la stabilité de cette région.
Ce rapport d’information n’a donc pas pour objet de proposer une analyse de ces événements mais, au travers des auditions que la commission des affaires étrangères leur a consacrées au fil de l’actualité, de contribuer à la réflexion.
Depuis la chute de Ben Ali, le 14 janvier 2011, la commission a tenu vingt-deux réunions en relation directe avec cette actualité. Huit d’entre elles étaient des auditions de représentants du Gouvernement ou d’ambassadeurs de France, huit autres des auditions de personnalités étrangères, tandis que quatre étaient des tables rondes avec la participation de chercheurs, spécialistes de la région, et deux des comptes rendus des déplacements de délégations de la commission en Tunisie et en Egypte. Dans le même temps, la commission a en outre reçu à huis clos les ambassadeurs de France en Egypte, en Arabie saoudite, en Syrie et en Jordanie, ainsi que l’ambassadeur de Bahreïn en France.
Bien entendu, les comptes rendus des réunions de la commission n’épuisent pas, loin s’en faut, tous les sujets et les situations de certains pays n’ont pas pu être traitées avec toute l’attention qu’elles méritaient. Les circonstances et l’actualité ont souvent commandé l’ordre du jour de la commission. Certaines personnalités sollicitées pour témoigner devant la commission n’ont pu répondre à son invitation. Il est regrettable, par exemple, qu’aucune réunion n’ait pu être consacrée au Maroc. La crise libyenne, en revanche, a occupé une part importante de ces travaux pour des raisons qu’il n’est pas nécessaire de rappeler.
Ces comptes rendus cependant, ainsi que les contributions des groupes qui les précédent, peuvent enrichir la réflexion et témoignent des travaux de la commission dans leur double dimension : le contrôle de l’action du Gouvernement et la diplomatie parlementaire, les auditions de personnalités étrangères et les missions de la commission en Tunisie et en Egypte participant à l’entretien de nos relations bilatérales.
La commission des affaires étrangères, sous la prochaine législature, aura certainement à cœur de poursuivre ce travail et l’on peut parier, sans injurier l’avenir, que ce sujet restera à son ordre du jour pendant encore plusieurs années. Ce rapport se garde de tirer des conclusions définitives un an à peine après le début de cette mutation qui promet encore bien des péripéties.
Cependant, il est une conclusion, je crois, qu’il est possible d’avancer. Les pays occidentaux, et la France en particulier malgré les liens étroits qui l’unissent à certains pays arabes, ne peuvent empêcher le cours de l’histoire et ne doivent pas le craindre, mais au contraire l’accompagner et le soutenir.
La démocratisation du monde arabe va sans doute, au moins dans un premier temps, se traduire, pour ces pays, par une affirmation de leur culture et de leur civilisation dont certains aspects peuvent heurter nos propres principes. Il est possible aussi que certains de ces nouveaux régimes aient des relations plus compliquées avec les pays occidentaux que leurs prédécesseurs, encore que rien aujourd’hui ne permette de l’affirmer si l’on en juge par exemple par l’accueil chaleureux qui a été réservé aux deux délégations de la commission lors de leurs visites en Tunisie et en Egypte. Est-on d’ailleurs si sûr que des régimes « islamiques » seraient plus retors ou plus dangereux que les régimes « laïcs » de Kadhafi et de Bachar el-Assad ?
Ces risques, réels, ne doivent pas nous conduire à regretter l’ordre ancien. Les risques que les changements en cours débouchent sur l’émergence de régimes comparables à celui des mollahs iraniens ou talibans et contribuent à élever le niveau de la menace terroriste sont faibles. A la dictature des anciens satrapes, nous devons préférer sans hésiter le verdict des urnes, même s’il ne correspond pas toujours à ce qui nous paraît le plus souhaitable pour les peuples concernés.
*
* *
La commission a autorisé la publication de ce rapport d’information au cours de sa réunion du mercredi 22 février 2012.
CONTRIBUTIONS DES GROUPES POLITIQUES
Contribution du groupe Union pour un mouvement populaire
Le Printemps arabe
Un an après la « révolution de Jasmin » en Tunisie qui a conduit à la chute de Ben Ali et à des bouleversements sans précédent dans une grande partie du monde arabe (Egypte, Libye et Syrie), le processus de transformation de ces peuples trop longtemps opprimés est en marche.
Ce « printemps des peuples arabes » a fait se lever une immense espérance et un vent de liberté dans des populations étouffées par les régimes autoritaires en place depuis plusieurs décennies. L’aspiration légitime à la liberté, à la participation à la vie politique de ces classes moyennes naissantes et de cette jeunesse moderne et instruite nous impose « une obligation morale et politique ».
Le soulèvement de cette jeunesse, ayant mis à profit les nouveaux outils de communication tels les réseaux sociaux et le web 2.0 a mis en avant l’usure du pouvoir et des autocraties corrompues et accaparant les richesses des pays.
A ce titre, la France a pris acte de cette nouvelle donne, et s’est montrée volontariste et déterminée à apporter son soutien à la transition démocratique dans une logique de dialogue et d’écoute. Il s’agit d’accompagner le processus de paix et de contribuer à l’émergence d’une zone stable, prospère et démocratique, sans toutefois imposer les standards occidentaux. Outre le soutien à la transition démocratique, les problèmes économiques et sociaux avec des taux de chômage importants et le fort coût des produits alimentaires doivent être au cœur des préoccupations des partenaires européens.
C’est un défi que notre diplomatie a su relever en adaptant son action aux spécificités de chaque pays.
L’Union pour la Méditerranée à l’initiative du président de la République Nicolas Sarkozy
Consciente de l’importance du partenariat européen avec le sud méditerranéen, la France avait appelé dès 2007 à une Union pour la Méditerranée mise en œuvre lors de la présidence française en juillet 2008. Celle-ci doit notamment permettre le développement de projets concrets tels qu’un Office méditerranéen de la jeunesse, une banque d’investissement pour l’Afrique du Nord ou le développement de l’énergie solaire dans le pourtour méditerranéen. Tirant les leçons de Fernand Braudel concernant la Méditerranée la prospérité de l’Europe a systématiquement été liée à la richesse de sa relation avec la Méditerranée, en particulier avec sa rive Sud, la France a eu un rôle de premier plan dans la promotion, dans un cadre européen, de l’Union pour la Méditerranée, un projet plus que jamais pertinent.
Il existe actuellement un consensus au niveau européen concernant l’importance de la création d’une Union pour la Méditerranée dans le cadre de la politique européenne de voisinage, afin de permettre une plus grande proximité avec la rive sud de la Méditerranée.
A l’heure d’aujourd’hui, le haut fonctionnaire d’origine marocaine, M. Youssef Amrani, désigné à l’unanimité et avec le soutien de la France au poste de Secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée depuis plus d’un an, est entré au gouvernement marocain. La France est déterminée à redonner un élan au processus de l’UpM, dans un cadre européen et en partenariat étroit avec la Tunisie en trouvant un successeur à M. Amrani.
Par ailleurs, l’UMP a été le premier parti à s’engager en faveur de l’organisation des formations politiques dans la jeune démocratie égyptienne en recevant les 14 et 15 avril 2011 une délégation de jeunes responsables politiques et de blogueurs égyptiens pour deux demi-journées de formation. La Fondation Robert Schuman s’est également associée à cette initiative du Secrétariat national de l’UMP en charge des relations avec les think-tanks et partis étrangers, dans l’optique de favoriser l’émergence d’une classe politique renouvelée dans les nouvelles démocraties arabes. L’UMP choisit ainsi de prendre le parti de la jeunesse et de la démocratie dans le monde arabe et a agi en ce sens comme relais de l’action menée par le président de la République en faveur des nouvelles démocraties.
Le rôle crucial de la France dans l’intervention de l’ONU en Libye
Conformément à sa ligne de politique étrangère, la France a tenu à inscrire son action dans un cadre européen avec les partenaires de l’Union européenne mais aussi de l’OTAN et à obtenir un accord au niveau des Nations unies pour le lancement d’une opération militaire en Libye.
Le succès de la coalition franco-britannique dans l’offensive libyenne sous l’égide de l’ONU et de l’OTAN est le symbole de l’Europe, déterminée à être aux côtés des peuples qui se battent pour la démocratie et le progrès économique.
Il faut souligner la position française, en première ligne lors du « Printemps libyen » et dont le partenariat étroit avec la Grande-Bretagne a permis de lancer une impulsion décisive pour venir en aide aux insurgés libyens et mettre fin à la répression sanglante du Colonel Kadhafi.
Premier Etat à avoir reconnu le CNT comme « seul représentant légitime du peuple libyen » dès le 10 mars 2011 avant qu’un grand nombre de pays ne fasse de même, la France a mené l’initiative qui a conduit aux résolutions 1970 et 1973 de l’ONU du 17 mars 2011 autorisant le recours à la force pour protéger les populations civiles menacées par les raids des forces spéciales dirigées par Mouammar Kadhafi.
En affirmant que « la France ne faiblira pas en Libye », le Président de la République a tenu ses engagements et la France, deuxième contributeur en terme de forces après les Etats-Unis a participé à 35 % des frappes offensives. L’engagement des forces et la pression militaire au sein de la coalition ont permis l’interruption du siège de certaines villes et d’apporter un soutien décisif aux forces d’opposition. Par ailleurs, le parachutage d’équipements, de médicaments, de nourriture et d’armes d’autodéfense conformément à la résolution de l’ONU, promue par la France, a été déterminant pour la protection des populations civiles.
Outre l’engagement militaire aérien au sein de la coalition, la France s’est attachée à chercher une solution politique à la crise en apportant son soutien au CNT, maintes fois accueilli à Paris. La France a fortement œuvré à la mise en place d’un mécanisme financier d’aide au CNT par le biais du Groupe de contact pour la Libye et au dégel de fonds libyens.
A cet égard, l’action de la France pour mettre fin à la terreur en Libye a été triple et doit être saluée : le dialogue permanent avec les partenaires européens et internationaux comme les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la Russie, mais aussi l’Union africaine, la médiation étroite avec l’envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies, M. al-Khatib et les missions préparatoires françaises menées en concertation avec les partenaires européens pour permettre au CNT d’appréhender dans les meilleures dispositions « l’après-crise ».
Le processus politique visant à l’émergence d’une Libye libre et démocratique a été activement soutenu par la France, mais l’accompagnement de cette transition doit désormais être maintenu et encouragé afin de permettre aux Libyens de choisir démocratiquement leurs gouvernants.
La question de l’immigration
S’agissant de la question des flux migratoires générés par ces soulèvements populaires, le printemps arabe n’a pas entraîné d’afflux massif en Europe en dehors du cas isolé de l’île de Lampedusa, comme l’a révélé l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Les tristement célèbres « bateaux de la mort » sont des situations que l’Europe ne devrait plus avoir à connaître, compte tenu de l’espérance nouvelle pour la jeunesse du monde arabe.
La signature d’accords entre les autorités tunisiennes et l’Italie et la mise en place du CNT en Libye ont permis de réduire l’afflux d’immigrés clandestins en provenance d’Afrique du Nord. Les efforts doivent être poursuivis pour permettre à cette jeunesse instruite de contribuer à la mutation économique et politique de son pays et le traitement des clandestins doit être effectué dans la dignité et dans le respect des droits de l’homme.
L’avenir du printemps arabe est encore incertain
Si une nouvelle ère s’est ouverte dans les pays du monde arabe, les suites du printemps arabe n’en demeurent pas moins incertaines et les acquis de ce soulèvement populaire doivent être protégés.
Les peuples égyptien, tunisien, libyen ont mené leur révolution, il leur appartient par conséquent d’engager eux-mêmes leur processus démocratique sans aucune ingérence extérieure. A ce titre, il convient de saluer la tenue dans un contexte pacifique d’élections démocratiques en Tunisie et en Egypte, qui ont conduit à la victoire des partis Ennahda et des Frères Musulmans. Ces forces ont été élues pour donner corps aux aspirations des peuples à la liberté, à la démocratie et au respect des droits de l’homme et de la femme et doivent maintenant en faire la preuve.
La France est cependant déterminée à accompagner ces transitions en maintenant des relations bilatérales étroites avec certains pays et a conscience de l’importance d’un soutien financier à ces pays, touchés par ailleurs par la crise économique mondiale.
Le ministre des affaires étrangères s’est rendu début janvier 2012 en Tunisie et s’est dit optimiste au vu des assurances données par les représentants du parti majoritaire Ennahda. Le ministre a plaidé pour « un partenariat d’égal à égal » entre les deux pays et a assuré du plein soutien et de la confiance de la France dans le déroulement du processus démocratique, fondé sur des valeurs communes entre les deux pays. Le président Marzouki a quant à lui qualifié la relation franco-tunisienne « d’indéchirable ». La France a tenu ses engagements financiers annoncés en avril 2011 : près de 180 millions d’euros sur les 350 promis ont déjà été versés et le montant restant sera décaissé en 2012.
Les réformes courageuses initiées au Maroc pour la mise en place d’une monarchie constitutionnelle vont également dans le bon sens et le chef de l’Etat a félicité le souverain marocain pour le « bon déroulement de cette étape majeure dans la mise en œuvre des réformes institutionnelles dont il a pris l'initiative et que le peuple marocain a très largement approuvé par référendum le 1er juillet dernier ».
La France doit poursuivre son accompagnement de la transition dans les pays concernés en particulier sur le plan économique et social : l’accès à l’emploi et à l’éducation des jeunes constitue en effet la plus grande garantie de l’enracinement durable de la démocratie et de la lutte contre les extrémismes. A cet égard, le partenariat de Deauville, initié en 2008, lors de la réunion du G8, est désormais opérationnel et permettra un appui financier à de nombreux projets concrets, qui doivent être proposés par les pays eux-mêmes. Le partenariat vise à soutenir la transformation politique et la modernisation économique de plusieurs pays (Tunisie, Egypte, Jordanie, Maroc et la Libye) ayant engagé un processus tangible et crédible de transformation vers une société libre. Le Partenariat compte ses membres fondateurs mais aussi des pays du Moyen-Orient, déterminés à soutenir financièrement les transitions des pays voisins et également neuf institutions financières internationales. A la dernière réunion du partenariat de Deauville, à Marseille en septembre 2011, près de 80 milliards de dollars ont été mobilisés pour aider les pays concernés, dont 38 milliards de dollars par les institutions financières internationales et des participations bilatérales importantes. Le Partenariat encourage des progrès dans les domaines suivants : renforcement de l’Etat de droit, soutien à la société civile, amélioration de l’éducation et de la formation professionnelle, renforcement du développement économique et soutien à l’intégration régionale et mondiale.
Ces mouvements révolutionnaires sont porteurs d’espoirs, ils constituent une chance pour la mise en place de la démocratie, d’Etats de droit et pour la défense des libertés que la France et l’Europe doivent soutenir sans relâche, conformément aux valeurs communes chères à l’Union européenne.
Ces bouleversements représentent aussi un enjeu stratégique pour la coopération de la France : les nouvelles institutions issues des révoltes populaires ont besoin d’assistance technique globale. En situation de post-crise, la priorité est le rétablissement primaire de l’Etat de droit avec ses fonctions régaliennes. Ce qui implique concrètement de mettre en œuvre des actions de coopération en matière d’outils statistiques, de rétablissement des finances publiques, des douanes, de la sécurité et de la justice….
De la qualité de notre coopération technique dépendra également l’efficacité de la lutte contre l’immigration clandestine en provenance de ces pays.
Des opportunités économiques et commerciales que la France saura ou non exploiter, dépendra le développement de nos entreprises à l’international ainsi que notre place dans le bassin méditerranéen.
S’agissant des évènements actuels en Syrie mais aussi au Yémen, la France est entièrement mobilisée et appelle à des sanctions onusiennes contre Bachar el-Assad pour mettre fin à la répression qui aurait déjà fait près de 7 000 morts. En plus du dialogue au sein du Conseil de sécurité de l’ONU et du soutien à la Ligue arabe, la France maintient ses contacts avec les différentes composantes de l’opposition syrienne, afin de l’aider à se structurer et à préparer l’avenir.
Les leçons tirées de ces soulèvements populaires doivent nous inciter à renforcer nos partenariats avec les pays du monde arabe et nous associer davantage à l’avenir aux processus de transition démocratique en cours, dans un esprit de dialogue et d’échange.
Contribution du groupe Socialiste, radical citoyen et divers gauche
Les députés socialistes, radicaux et citoyens se félicitent du suivi accordé par la commission des affaires étrangères, son président et son bureau aux événements qui depuis plus d’un an bouleversent les sociétés arabes. Les personnalités auditionnées ont apporté un éclairage utile à la compréhension des faits. Ce rapport d’information en établit avec fidélité le relevé. Il donne à chaque groupe parlementaire l’opportunité de tirer les enseignements de ces événements et de les confronter aux orientations et initiatives prises par les plus hautes autorités de l’Etat.
Le monde arabe vit à l’heure du changement. Parti de Tunisie en décembre 2010, un mouvement revendicatif en quelques semaines est passé du Maghreb au Machrek. Deux gouvernements autoritaires, ceux de Tunisie et d’Egypte, sont tombés. Une alternance difficile est sur le point d’aboutir au Yémen. Le Maroc a engagé une réforme institutionnelle. La Syrie est au bord de la guerre civile. Les indignés de Bahreïn ont été écrasés par l’armée locale appuyée par l’Arabie. En Libye c’est l’intervention des forces de l’OTAN qui a ouvert la voie du pouvoir à différents courants opposés au régime. La Mauritanie subit le contre coup des changements survenus en Libye. Un certain nombre de pays, Algérie, Jordanie, Oman, sont pour l’instant restés à l’écart. Ces mutations ne doivent pas faire oublier que d’autres situations porteuses d’instabilité régionale perdurent et restent en attente de règlement. L’Irak qui peine à se relever des retombées de l’intervention militaire des Etats-Unis vit à l’heure de l’incertitude et des attentats. Les Palestiniens, face à Israël, divisés politiquement et territorialement, sont en attente depuis 1948 d’un Etat. Le contentieux du Sahara occidental perturbe la coopération algéro-marocaine et les potentialités démocratiques de ces pays.
Il est difficile de trouver un fil conducteur et un dénominateur commun à cette succession d’événements et de situations. Les unes ont suivi des logiques conflictuelles purement autochtones. Ailleurs, Arabie, Etats-Unis, OTAN, ont joué un rôle actif et décisif dans le déroulé des événements. Si le rejet de l’existant est à l’origine de la plupart des bouleversements en cours, la multiplicité des acteurs aspirant à une autre gouvernance, la diversité des intérêts ne facilitent pas l’émergence de consensus partagés sur l’avenir. La paix en tous les cas est l’un des paramètres de ces dynamiques politiques.
Ces événements interpellent la France et l’Europe pour plusieurs raisons. Les unes concernent le regard que l’on porte sur le monde arabe et sur les personnes résidant en France originaires de ces pays. Les autres portent sur la politique méditerranéenne et arabe de la France. Les unes et les autres exigent de la part du gouvernement, et des partis politiques représentés au parlement, un diagnostic et des propositions. L’approche proposée par les députés membres du groupe socialiste, radical et citoyen prétend combiner la compréhension et le dialogue avec ceux qui sont les voisins immédiats de l’Europe dans un esprit de coopération seul à même de préserver la paix.
Pendant longtemps une sorte de commodité morale et intellectuelle considérait qu’il y avait une hiérarchie entre civilisations. Le ministre de l’intérieur, Claude Guéant, a réactualisé de façon insolite et inadéquate cette appréciation cristallisatrice de lieux communs et de conflits. Le monde arabe serait voué par une sorte de fatalité, jamais expliquée, aux dictatures et à la tyrannie. Les révoltés de Tunis et du Caire sont venus utilement rappeler en 2011 que justice et liberté sont des revendications universelles. Ceux qui ont été contraints de fuir pour préserver leur intégrité physique ont un droit à l’accueil et à l’asile. Les mesures d’endiguement prises par la France et l’Italie ont été critiquées à juste titre par le HCR. Les députés SRC rappellent qu’il n’y a pas et il ne saurait y avoir de déclaration des droits pour l’Europe et l’Occident différente de celle qui serait applicable aux peuples exotiques et orientaux. Les révoltés de la place Tahrir comme ceux de Tunis n’exigent rien de plus, mais rien de moins que ce qu’attendent les Français et les Européens de leurs institutions.
Cette vérité d’évidence a été trop souvent oubliée. La complaisance à l’égard de chefs d’Etat égoïstes et prédateurs a été trop souvent la règle. Il convient de procéder à un examen critique de la parole et des initiatives de la France dans cette région du monde, afin de corriger les erreurs commises et d’éviter leur répétition. L’accueil réservé par les plus hautes autorités de la République au colonel Kadhafi, comme à Bachar el-Assad est allé au-delà de ce que l’intérêt national demandait. Etait-il nécessaire d’accepter une sorte de connivence avec le dirigeant de la Libye en le laissant monter une tente d’apparat dans les jardins de l’Elysée ? La proposition de livraison de matériel de maintien de l’ordre au régime Ben Ali aux abois était indécente et totalement inappropriée. Il y a là une attitude que nous avons condamnée par principe. Il convient de garder la mesure en diplomatie comme en toute chose. Prendre en compte la réalité et la complexité des relations internationales, la nécessité d’avoir un rapport avec les dirigeants de pays peu ou non démocratiques, ne justifie pas le cynisme éthique. Il convient de préserver ce que nous sommes, une dignité démocratique. Cela n’a pas été le cas, avec la Libye de Kadhafi pas plus qu’avec la Tunisie de Ben Ali.
Le principe de réalité, les choses étant consommées, a conduit le gouvernement de la France à faire un brutal tête-à-queue diplomatique, porteur d’incertitudes et de déséquilibres. Nous payons en février 2012, concernant la Syrie, les glissements diplomatiques commis au printemps 2011 en Libye. En session de rattrapage démocratique, la France s’est lancée dans une diplomatie militarisée à haut risque. D’abord celui de geler la capacité de décision du Conseil de sécurité. En interprétant de façon excessivement large la résolution 1973 qui autorisait la seule protection des populations civiles de Benghazi, la France a pris un risque diplomatique lourd de conséquences. On en mesure les retombées sur l’affaire syrienne aujourd’hui. Le peuple syrien paye aujourd’hui le non-respect du cadre fixé par le Conseil de sécurité pour protéger les Libyens de Benghazi.
C’est la raison pour laquelle les députés socialistes, radicaux et citoyens ont regretté le retard mis par la France à manifester sa solidarité avec les démocrates arabes. C’est la raison pour laquelle ils appellent à respecter le verdict d’élections quand elles sont organisées de manière correcte.
Le groupe SRC et le PS ont, dès le mois de décembre 2010, publiquement condamné la violation des droits individuels et des droits fondamentaux chaque fois qu’ils en ont eu connaissance. Le groupe SRC et le Parti socialiste ont soutenu l’exigence populaire en faveur de la liberté, de la démocratie et de la justice. Ils ont rappelé le gouvernement français à un devoir de solidarité envers les démocrates arabes qu’il tardait à manifester.
Ces prises de position ont concerné selon les circonstances Bahreïn, l’Egypte, la Libye, la Syrie, la Tunisie et le Yémen. Elles ont pu être exprimées par voie d’articles de presse, de communiqués, de questions, de lettres au ministre des affaires étrangères, ou de missions sur le terrain. On en trouvera ci-après le relevé :
Bahreïn : communiqués du PS, 15 mars 2011 (condamnation de l’intervention de troupes d’Arabie) ; 23 juin 2011 (demande de libération d’opposants) ; 30 septembre 2011 (libérer les prisonniers d’opinion) ; 21 octobre 2011 (soutien à la commission indépendante et à l’opposition) ; 25 novembre 2011 (soutien aux conclusions des travaux de la commission indépendante, attente de réformes institutionnelles)
Egypte : communiqués du PS du 26 janvier 2011 (appel aux réformes et à des élections libres) ; 28 janvier 2011 (soutien aux revendications légitimes des forces démocratiques) ; 6 février 2011 (condamnation de la répression) ; 10 février 2011 (solidarité avec les Egyptiens en lutte pour la démocratie) ; 11 février 2011 (saluant le départ de Hosni Moubarak) ; 18 avril 2011 (rencontre avec de jeunes acteurs de la révolution égyptienne) ; 10 octobre 2011 (condamnation des tensions confessionnelles) ; 21 novembre 2011 (dénonciation de la répression contre les manifestants) ; 2 février 2012, communiqué de Pierre Moscovici (condoléances aux familles des victimes du drame de Port Saïd)
Libye : 25 février 2011 (Martine Aubry demande la mise en place d’une zone d’exclusion aérienne pour protéger les populations opposées au régime) ; lettre de Jean-Marc Ayrault au premier ministre le 2 mars 2011 (Libye, situation des personnes déplacées) ; 22 mars 2011 intervention de Jean-Marc Ayrault en séance publique (Nous approuvons une opération que nous avons souhaitée, dans le cadre que nous voulions, celui des Nations unies… Nous ne sommes pas en guerre contre la Libye. Nous œuvrons à la demande de son peuple, à la protection des populations civiles… La ligne adoptée à l’ONU doit être notre seul cap… la résolution 1973 repose sur une recherche de solution collective même si les moyens mis en œuvre sont essentiellement ceux de la France, des Etats-Unis et du Royaume uni… La liberté gagne de nouveaux territoires. Nous devons accompagner le monde arabe… La démocratie, la liberté, et le développement économique sont le meilleur rempart contre le fanatisme et le terrorisme) ; 5 juillet 2011, position du Bureau national (la France doit dire clairement que l’action militaire ne suffira pas à elle seule à donner à la Libye la paix et à l’engager sur la voie de la démocratie ) ; 22 août 2011, communiqué du PS (après la Tunisie et l’Egypte, la perspective d’une Libye libre et démocratique est un formidable espoir pour tous les peuples de la région) ; 23 août 2011, communiqué du PS (Après les fautes commises lors des révolutions tunisiennes et égyptiennes, la France doit être en première ligne … pour accompagner le peuple libyen) ; 24 octobre 2011, communiqué de Martine Aubry (les déclarations du président du CNT sur la charia ne peuvent qu’inquiéter)
Syrie : 17 mars 2011, communiqué du PS (soutien aux aspirations à la démocratie, la justice et la liberté) ; 19 mars 2011, communiqué de Martine Aubry (le PS se félicite de la mise en œuvre de la résolution 1973) ; 31 mars 2011 communiqué du PS (soutien à la lutte de l’opposition) ; 13 avril 2011, communiqué de Martine Aubry (les autorités doivent mettre fin à l’usage de la force) ; 10 mai 2011, communiqué du PS (condamnation de la répression) ; 31 mars 2011, communiqué du PS (solidarité avec l’opposition, appel à manifester) ; 27 avril 2011, communiqué du groupe PS de Sénat (la France doit présenter un projet de résolution à l’ONU) ; 17 mai 2011, question d’Elisabeth Guigou (la France doit prendre une initiative à l’ONU) ; 29 mai 2011, communiqué du PS (la France doit faire preuve d’une détermination plus forte) ; 8 juin 2011, communiqué de Martine Aubry (il ne faut pas abandonner le peuple syrien, saisir la Cour pénale internationale ) ; 31 juillet 2011, communiqué du PS (attente d’une initiative de l’ONU et de la saisine de la CPI) ; 13 septembre 2011, communiqué du PS (appel à l’ONU et à la Ligue arabe) ; 5 octobre 2011, communiqué du PS (nouvel appel au Conseil de sécurité) ; 13 octobre 2011, communiqué du PS (visite d’une délégation de l’opposition syrienne au siège du PS, créer une zone d’exclusion humanitaire) ; 17 novembre 2011, communiqué de Martine Aubry (les pressions portent leurs fruits, libération de Rafah Nached) ; 27 décembre 2011, communiqué de François Hollande (les atrocités doivent cesser, le Conseil de sécurité ne peut garder plus longtemps le silence) ; 11 janvier 2012, communiqué de François Hollande (hommage au journaliste Gilles Jacquier, tué en Syrie) ; 30 janvier 2012 : communiqué du PS (demande de mise en place d’une zone d’exclusion humanitaire) ; 14 février 2012, François Hollande, communiqué (une action forte de la communauté internationale s’impose) ; 17 février 2012, communiqué de François Hollande (l’appel de l’Assemblée générale de l’ONU doit être suivi d’effet) ; 18 février 2012, communiqué de Martine Aubry (attente d’une intensification des efforts diplomatiques) ; communiqué de François Hollande, 22 février 2012 (hommage aux journalistes tués à Homs) ; 23 février 2012, François Hollande (appel à une position commune sur la Syrie) ; 23 février 2012, Jean-Marc Ayrault (lettre au président de l’Assemblée nationale et aux présidents de groupe pour une initiative commune sur la Syrie)
Tunisie : 30 décembre 2010, communiqué du PS (condamnation de la répression) ; 11 janvier 2011, question de Gaëtan Gorce (déception à l’égard des déclarations de la ministre française des affaires étrangères) ; 12 janvier 2011, communiqué du PS (condamnation de la répression, regret du silence français) ; 14 janvier 2011, communiqué du PS (participation à un meeting de solidarité) ; 18 janvier 2011, question de Jean-Marc Ayrault, (les prises de position de la France la disqualifient aux yeux du monde et des Tunisiens) ; 19 janvier 2011, communiqué des députés européens socialistes français (appel à la suspension des négociations de partenariat avancé CEE-Tunisie) ; 19 janvier 2011, question de Gaëtan Gorce (Est-il acceptable au cœur d’une crise de proposer la coopération policière de la France ?) ; 20 janvier 2011, lettre de Jean-Marc Ayrault au président de l’Assemblée nationale (plan de soutien de l’Assemblée nationale au processus électoral) ; 25 janvier 2011, questions de Gaëtan Gorce et Bruno Le Roux (coopération policière avec la Tunisie) ; 26 janvier 2011, question de George Pau-Langevin (livraison d’armes à la Tunisie) ; 31 janvier et 4 février 2011, communiqués du PS (délégation en Tunisie : Harlem Désir et Pouria Amirshahi) ; 3 février 2011, Moustapha Ben Jaafar, invité du Bureau national du PS ; 9 février 2011, le groupe SRC reçoit Mahmoud Ben Romdhane, (secrétaire général adjoint du parti Ettajdid) ; 16 février 2011, question d’Alain Vidalies (voyage d’affaires en Tunisie de la ministre des affaires étrangères) ; 17 février 2011, les sénateurs PS boycottent une audition de la ministre des affaires étrangères ; 15 avril 2011, communiqué du PS (offrir des possibilités d’accueil temporaire aux Tunisiens) ; 18 avril 2011, communiqué du PS (la Tunisie montre le chemin à suivre vers l’égalité des droits politiques entre hommes et femmes) ; 24 octobre 2011, communiqué du PS (le PS salue le bon déroulement des élections) ; 26 octobre 2011, communiqué de Martine Aubry (encouragements du PS à l’Assemblée constituante) ; 15 novembre 2011, communiqué du PS (le PS réitère sa satisfaction après les élections et exprime sa solidarité aux forces progressistes)
Yémen : 18 janvier 2011, communiqué du PS (condamnation de la répression) ; 28 avril 2011, communiqué du PS (solidarité avec le peuple du Yémen et le PS) ; 19 septembre 2011, communiqué du PS (demande de la démission immédiate du Président et l’organisation d’élections) ; 17 octobre 2011, communiqué du PS (appel au Conseil de sécurité pour le départ du président Ali Al Saleh) ; 14 novembre 2011, communiqué de Martine Aubry (satisfaction après la libération de trois otages français)
Le groupe SRC a rappelé tout au long de ces événements le caractère central du conflit du Proche-Orient. Non résolu depuis plus soixante ans, il pèse sur la stabilité et la paix de toute la région tout en interférant sur les situations intérieures des Etats. Il y a plus de soixante ans, le 14 mai 1948, prenait fin le mandat accordé le 24 juillet 1922 au Royaume uni par la Société des Nations sur la Palestine. Un conflit sur le partage de ce territoire a immédiatement opposé populations juives et arabes. En dépit d’efforts engagés par les Nations unies, un compromis porteur de paix n’a toujours pas, en 2012, été trouvé. Au contraire on assiste à un cycle combinant violences, pauses humanitaires et retour aux violences. Le statu quo sur la terre interdit toute autre évolution. Il empêche durablement la mise en œuvre d’une politique active et effective de coopération en Méditerranée. Le drame de Gaza, au-delà du spectacle absurde et moralement inacceptable de la mort, a rappelé qu’au Proche-Orient, deux peuples se disputent le même territoire depuis près d’un siècle. L’absence de compromis négocié sur le partage du sol a jusqu’ici empêché de construire la confiance préalable à tout accord de paix. La guerre seule reste à l’ordre du jour.
Le groupe SRC considère que la recherche d’un dialogue porteur de paix au Proche-Orient devrait pour toutes ces raisons être considérée comme une priorité diplomatique par la France et l’Europe. Il a rappelé la nécessité de privilégier et réactualiser la voie d’un compromis en quatre points : la reconnaissance de l’État d’Israël et le droit à la sécurité derrière des frontières sûres et reconnues (...), le droit à une patrie pour les Palestiniens (...) ; la nécessité pour la France d’avoir un seul langage : dans les pays arabes, les Palestiniens abandonnent l’idée de détruire Israël. En Israël, les Israéliens doivent accepter l’idée d’un État palestinien (...). On ne peut parler d’autodétermination des Palestiniens sans rappeler le droit à l’existence de l’état d’Israël. L’action diplomatique de la France devrait enfin pouvoir se développer dans le cadre européen et travailler avec la nouvelle administration américaine pour trouver ensemble une solution internationale pérenne.
Sur toutes ces questions le groupe SRC a pris, au sein de l’Assemblée nationale, ses responsabilités. Il a accueilli avec satisfaction la proposition faite en 2009, par le président de l’Assemblée nationale, de participer à une mission à Gaza, en Israël et en Palestine. Mais il regrette que les propositions qu’il a pu faire en cours de législature n’aient pas été prises en compte. Le Parlement peut en effet en plus d’auditions et de missions sur le terrain aller au-delà de l’écoute et de l’information. Jean-Marc Ayrault a en particulier, le 7 janvier 2011, écrit au président de l’Assemblée nationale pour lui demander d’élever le statut des rapports qu’elle entretient avec la Palestine. Les députés SRC, faute de réponses, ont déposé le 28 septembre 2011 une proposition de résolution (n°3779) demandant au gouvernement de reconnaître l’existence internationale d’un Etat palestinien.
La coopération entre les deux rives de la Méditerranée est malmenée par l’actualité. Elle est pourtant inscrite dans l’histoire. Les derniers bouleversements du monde arabe, comme la non-résolution du conflit israélo-palestinien en ont confirmé l’urgence et la nécessité. La Méditerranée historiquement a tout autant uni que séparé les peuples et pays riverains. Espace commun à l’époque de l’antiquité romaine, elle est devenue depuis le lieu d’échanges pacifiques tout autant que belliqueux. La décolonisation, puis la fin de la guerre froide, ont remis à l’ordre du jour les projets de coopération. Un Dialogue euro-arabe a été mis en place ente CEE et Ligue arabe en 1984. Après la constitution d’une Union du Maghreb arabe la France avait proposé (discours de François Mitterrand à Marrakech en 1983) la création d’une structure réunissant les pays de la Méditerranée occidentale, élargie ultérieurement (en 1990 à Rome) en 5+5 (Europe du sud-Maghreb, Libye comprise). Ces projets ont connu une période propice en 1991-1992 au moment où un espoir concret de paix a paru pouvoir se concrétiser au Proche-Orient avec la conférence de Madrid et les accords d’Oslo. Le Processus dit de Barcelone (27 novembre 1995) a pris corps à ce moment-là. Il s’est enlisé.
Mais l’attente de dialogue et de coopération est toujours aussi attendue et souhaitée pour des raisons tenant à l’économie, au commerce, aux échanges entre les hommes et les collectivités territoriales, ainsi qu’à l’histoire. Mais l’erreur commise par les plus hautes autorités de l’Etat consiste à penser que ces attentes se suffisent à elles-mêmes et qu’elles peuvent permettre de contourner les difficultés diplomatiques et politiques. L’initiative dite Union pour la Méditerranée a prétendu la réactiver en 2008 avec le Tunisien Ben Ali et l’Egyptien Moubarak. Ce projet naissait mort né. Il s’est effectivement perdu dans les sables faute de prise en compte des réalités politiques intérieures des Etats, de l’aspiration au changement et des contentieux intergouvernementaux, du Sahara à la Palestine.
Seule la prise à bras le corps de ces problèmes, la recherche de solutions négociées, reposant sur le dialogue, peut dégager les possibilités de coopérations renforcées et organisées entre nord et sud de la Méditerranée. A juste titre dans son intervention à Grenade (Espagne) le 4 juillet 2007 devant la CRPM (Conférence des régions périphériques maritimes), Michel Vauzelle a posé comme préalable à « une nouvelle alliance euro-méditerranéenne », la paix, parce que « l’urgence est politique ».
La répétition d’initiatives, bénéficiant de soutiens collectifs sur les deux rives, systématiquement achevées en impasse interpelle. La répétition de ces initiatives doit être comprise comme répondant à un besoin partagé de complémentarités, d’une organisation mutuellement profitable de flux économiques et humains qui pourraient être bonifiés. La répétition de situations d’échec révèle la sous-estimation d’obstacles diplomatiques et politiques bien connus, que manifestement l’optimisme coopérateur et économique est incapable par lui-même de résoudre. Ces obstacles sont bien identifiés et connus :
Ø Le conflit du Proche-Orient qui oppose Israël à ses voisins arabes, tous riverains de la rive sud de la Méditerranée. Ce conflit ouvert en 1948 est toujours sans solution. Sa non-résolution a jusqu’ici constitué un obstacle insurmontable à la mise en œuvre de coopérations entre pays de la rive sud et Europe.
Ø Le conflit du Sahara occidental, qui oppose Algérie et Maroc interdit toute coopération confiante et toute institutionnalisation de coopérations au Maghreb. Ouvert en 1975, il est à ce jour également bloqué. Ce blocage à l’ouest de la rive sud est tout aussi dissolvant que le précédent.
Ø La place de la Turquie dans cet ensemble n’a jamais été tranchée. La Turquie ne s’est jamais vraiment impliquée, parce qu’elle considère que France et Allemagne essaient de lui vendre un Ersatz de coopération en lieu et place de l’adhésion à l’Union européenne à laquelle elle aspire.
Ø Il y a aussi des divergences traditionnelles entre pays de la rive nord qui n’ont pas facilité la mise en place de ce type de coopération. A l’époque du processus de Barcelone, les convergences n’ont pas été faciles à mettre en place entre France et Espagne. La naissance ultérieure de l’UpM a généré des incompréhensions entre France et Allemagne. D’autre part, les nouveaux membres de l’Union, les ex-PECO, comme les pays scandinaves, se sentent moins concernés par ces coopérations nord-sud.
Ø L’intervention militaire de l’OTAN en Libye à l’initiative d’une France qui a parrainé l’UpM, enfin, ajoute dans la période la plus récente un élément d’incertitudes supplémentaires. Il se situe dans le prolongement des conflits irakiens, d’Afghanistan et de l’ex-Yougoslavie porteurs des mêmes ambiguïtés et contradictions. Ces considérations supposeraient une réflexion critique concernant la gestion des crises et contentieux. Le recours récurrent à la force par les pays de l’OTAN, à quelques uns ou collectivement, pour régler leurs différends quels qu’en soient les motifs, fait courir au monde, c’est-à-dire aussi à nous-mêmes un risque exagéré. Un risque pour nos valeurs en dévoyant le droit de secourir des populations en détresse. Le droit du plus fort en effet est-il encore le droit ? Un risque pour la paix qui doit être un horizon absolu. La guerre détruit les biens et les cœurs. La guerre génère les haines et la déraison. La guerre réduit le champ du dialogue, de la négociation et finalement de la diplomatie. La France aurait-elle oublié que les modalités de prise de décision à l’ONU nécessitent, pour être efficaces et universelles, la concertation la plus large possible ? Cela n’a malheureusement pas été le cas dans l’affaire libyenne. Ceux qui en Syrie aspirent au changement en payent actuellement le prix. N’oublions pas, dans nos démêlés avec l’Iran, les leçons de ce fiasco onusien. La voie de la négociation avec l’Iran ne doit être abandonnée ni par la France, ni par l’Europe. Alors que les rumeurs de mobilisation guerrière s’accentuent, il convient de rappeler avec insistance et détermination à tous nos alliés et amis, en particulier aux Etats-Unis comme à Israël, les vertus du compromis négocié parce que seul il est porteur de solutions pérennes. Les retombées d’une militarisation de la question iranienne, par qui que ce soit, auraient des conséquences déstabilisatrices dont il conviendrait dès aujourd’hui de mesurer l’impact. Le monde arabe et ses aspirations au changement seraient gravement bousculés. Nos pays, dans leurs économies comme dans la division de leurs opinions publiques, seraient tout aussi lourdement affectés.
Le monde arabe bouge. Il est traversé de contradictions reflétant la diversité d’appartenances multiples. Mais les populations arabes, en dépit ou à cause de cet éventail idéologique et religieux, exigent le départ de ceux qui les dirigeaient sans consulter personne. L’expression de cette exigence a mobilisé des millions de personnes dans la rue et de plus en plus par le vote. Les responsables occidentaux devraient s’en féliciter. Ils devraient aller à la rencontre de ceux qui, quels qu’ils soient, s’en remettent à la loi de la majorité, et au dialogue pour changer la vie. L’Europe de façon plus particulière, et la France, devraient considérer qu’une opportunité est ainsi offerte par cette émergence démocratique. Ce pari démocratique peut en effet ouvrir la voie d’une nouvelle relation entre le nord et le sud de la Méditerranée. L’enjeu est historique. Il convient de ne pas manquer un rendez-vous inédit entre les deux rives de la Méditerranée. Rompons, quand il est encore temps, avec le messianisme armé, « cette politique menée au nom du bien et du juste, simples instruments aux mains des puissants, et qui dessert l’un et l’autre. L’ordre international » a rappelé récemment Tzvetan Todorov, « n’est pas amélioré quand on laisse un groupe de pays imposer sans restriction leur volonté à tous les autres » (1) . L’heure est au dialogue, dans la confiance mutuelle, pour construire collectivement un nouveau contrat de paix, affrontant dans la clarté et un esprit de compromis tous les obstacles et contradictions. Telle est la position et telles sont les convictions des députés socialistes, radicaux et citoyens.
Contribution du groupe Nouveau Centre
Lorsque l’on observe la chronologie du « Printemps arabe », on est frappé par la vitesse avec laquelle s’enchaînent les événements. Il y a un peu plus d’un an, le 17 décembre 2010, en Tunisie, un jeune vendeur ambulant, Mohamed Bouazizi, s’immolait par le feu, à Sidi Bouzid, pour protester contre la saisie de sa marchandise par la police. Une vague de contestation sans précédent en résultait et le 14 janvier 2011 le président Ben Ali, au pouvoir depuis 1987, s’enfuyait vers l’Arabie saoudite. Le 7 mars, un nouveau gouvernement provisoire était formé.
En Egypte également, le mouvement se développa rapidement. Le 25 janvier 2011, se déroulait la première manifestation sur la place Tahrir. Dès le 11 février 2011, le président Moubarak quittait le pouvoir.
En Libye, alors que les premières émeutes éclataient à Benghazi le 15 février 2011, l’ONU intervenait, sous mandat des Nations unies, le 27 mars et le quartier général du colonel Kadhafi tombait le 23 août 2011 aux mains des rebelles.
Les événements en Orient se sont enchaînés à grande vitesse. Néanmoins, la façon dont se sont déroulées ces révoltes diffère d’un pays à l’autre, de par leurs causes et leurs origines, mais également de par la nature des manifestations et les résultats qui en ont découlé.
***
En premier lieu, il convient de s’interroger sur l’origine du printemps arabe, sur les spécificités et les points communs de chacun des pays qui ont connu ce soulèvement. Plutôt que de parler de printemps arabe au singulier, on retiendra la notion de printemps arabes au pluriel, tant les mouvements qui ont pris naissance dans ces pays diffèrent les uns des autres.
En premier lieu, les Etats touchés par le printemps arabe sont des Etats qui se définissent eux-mêmes comme arabes : ils appartiennent tous à la Ligue arabe qui fut créée en 1945 et partagent l’usage de la langue arabe. Pays aux situations démographiques disparates, ils ont en commun d’avoir une population jeune puisque les moins de 15 ans représentent dans ces pays le quart de la population totale. S’ils ont en général un bon niveau de scolarisation et d’alphabétisation, une grande part des jeunes de moins de 25 ans est au chômage (le taux de chômage moyen des moins de 25 ans est dans ces pays de 23 %).
Devant ces différences et ces points communs qui font les spécificités du monde arabe, il peut être intéressant de s’interroger sur l’origine d’un tel mouvement. Comment le printemps arabe, parti de la révolution du jasmin en Tunisie, a-t-il pu se propager en un temps si limité à tous ces Etats aux régimes identiques différents ? Comment expliquer la simultanéité de ce mouvement, qu’il s’agisse de monarchies comme au Maroc et en Jordanie, de républiques ou de régimes à parti unique comme en Libye et en Syrie ?
En Tunisie et en Egypte, l’origine des révoltes est de nature à la fois économique, sociale et politique. En effet, c’est la cherté de la vie, le chômage croissant chez les jeunes, l’absence de progrès, le fossé creusé entre un peuple pauvre et une caste de dirigeants richissimes, la lassitude d’un pouvoir autoritaire qui ont conduit la foule à descendre dans la rue. Ces dictatures, en vieillissant, sont devenues des régimes de plus en plus intolérants, étouffants, irrespirables. Les effectifs de la police en Egypte se montaient ainsi à plus d’1,2 million de personnes.
La situation présente quelques différences dans des pays comme la Libye où les insurrections furent avant tout causées par une rébellion de type tribal et régional contre le régime de Tripoli.
Tous ces Etats présentent des régimes politiques qui refusent la démocratie et dont les chefs d’Etat, au pouvoir depuis de nombreuses années, s’obstinent à rester au pouvoir, à l’image de Kadhafi. Alors que l’économie est aux mains de clans restreints, proches du pouvoir, ils s’appuient tous sur des organes de sécurité omniprésents, au mépris des droits et des libertés individuelles. A cela s’ajoute le niveau important de corruption qui affecte à la fois les administrations publiques et la classe politique.
En définitive, ces Etats sont unis par une réalité commune : l’opposition provenant du peuple se trouve systématiquement muselée. Ce sont ces facteurs qui, à terme, ont généré un mouvement de révolution qui, parfois écrasé par les autorités, s’est mué en véritable guerre civile. C’est notamment le cas en Syrie où pas un jour ne passe sans que l’insurrection ne se heurte à la sauvagerie et à la férocité du pouvoir en place.
***
Le rôle des militaires, révélateur des types de sociétés dans lesquels se sont déroulés les événements, diffère sensiblement d’un pays à l’autre.
En Egypte, l’armée est, depuis Nasser et plus encore depuis l’assassinat d’Anouar el Sadate, le pivot du régime. Omniprésente, l’armée pèse par son poids démographique, elle pèse également dans l’économie égyptienne puisqu’elle a conservé d’importantes participations dans l’industrie. Disposant de vastes réserves dans les zones désertiques qui bordent la vallée du Nil, elle est aussi le premier propriétaire foncier de la capitale où ses terrains, casernes, résidences et clubs sont particulièrement nombreux. Depuis 1952 et le renversement de la monarchie, seuls des officiers issus de ses rangs ont accédé à la présidence de la République arabe d’Égypte.
Cependant, un an après le départ du pouvoir d’Hosni Moubarak, les Egyptiens sont inquiets du pouvoir pris par l’état-major de l’armée.
L’an dernier, les manifestants appelaient l’armée à leurs côtés, en chantant « L’armée. Le peuple. Une main ». Les militaires étaient alors considérés comme de véritables héros. En janvier 2011, le chef d’état-major de l’armée de terre, le général Rachid Ammar, déclarait lors d’une intervention improvisée à Tunis devant les manifestants : « l’armée nationale se porte garante de la Révolution. L’armée a protégé le peuple et le pays ». Pourtant, aujourd’hui ils inspirent plutôt chez les populations la crainte que ces derniers refusent de quitter le pouvoir.
En effet, les tensions entre les opposants de la place Tahrir qui avaient obtenu le départ de Moubarak et les militaires sont grandissantes. Cela peut s’expliquer par l’ambiguïté propre à l’Egypte sur laquelle s’est bâtie la révolution dans ce pays. L’armée, chargée d’assurer la transition politique après le départ d’Hosni Moubarak le 11 février 2011, prit alors le pouvoir et appela, dès le mois de mars, les Égyptiens à se prononcer sur des amendements à la Constitution. Ce vote fut approuvé par 77 % des électeurs et ouvrit la voie à la tenue d’élections présidentielle et législatives.
Il faut noter cependant que l’autorité militaire s’est engagée à quitter le pouvoir avant le 30 juin de cette année, et cet engagement sera sûrement tenu, probablement même dès le mois de mai.
A la différence de la situation en Egypte, le poids de l’armée en Tunisie est négligeable. Il n’a donc pas eu d’effets ni d’entraînement ni de blocage sur le mouvement. De tous les pays du Maghreb et du Proche-Orient, la Tunisie est sans aucun doute la société la plus occidentalisée où l’opinion publique a donc joué un rôle primordial, empêchant toute réaction par la force de Ben Ali et de sa famille.
***
Plusieurs mois après le déclenchement du printemps arabe, alors que l’heure est à l’analyse et au bilan d’événements qui ont marqué tant l’Orient que l’Occident, la question principale est de savoir quel fut et quel sera pour l’avenir le rôle des islamistes. En d’autres termes, le printemps arabe a-t-il laissé place à un hiver islamiste ?
De la Tunisie à l’Egypte en passant par la Libye, les partis religieux ont été les premiers à bénéficier de la chute des dictatures.
C’est le cas des Frères musulmans. Les peuples, voyant monter les difficultés, recherchent des solutions rassurantes. Et les Frères musulmans, parce qu’ils ont l’image d’un mouvement pieux et conservateur, et parce qu’ils ont beaucoup soutenu sur le plan social les populations au cours de la période précédente, ont désormais acquis une réelle autorité.
En Egypte, le rôle des Frères musulmans fut très actif, y compris dans la participation, l’organisation et l’encadrement des manifestations.
Les mouvements religieux, étant organisés, à la différence des partis dits libéraux, c’est-à-dire en réalité laïcs, qui sont inorganisés et sans ancienneté, aussi bien en Egypte qu’en Tunisie, ont pu récolter des succès. S’ils ne sont pas à l’origine du mouvement, ils ont su en tirer un intérêt politique qui s’est largement traduit dans les urnes à l’occasion des élections législatives du 28 novembre 2011. Ce phénomène se retrouve en Tunisie et en Libye.
Quant aux salafistes, il s’agit d’un mouvement religieux beaucoup plus extrême, qui suscite en Egypte des inquiétudes du côté de la population laïque comme du côté de la communauté internationale.
Le 23 octobre 2011, pour la première fois de leur histoire, les Tunisiens ont voté librement lors d’élections reconnues par tous comme honnêtes et transparentes. Ces élections ont fait de Ennahda, parti islamiste, la principale force de la coalition parlementaire qu’ils ont formée avec deux partis laïcs. Le parti Ennahda a ainsi obtenu, avec 41,5 % des voix, 90 sièges, aux côtés notamment du Congrès pour le République et du parti Ettakatol.
Désormais, les islamistes tunisiens doivent justifier la confiance que de nombreux Tunisiens leur ont accordée. Une lourde responsabilité repose sur leurs épaules car les attentes sont grandes. A ce jour, la situation économique de la Tunisie n’a jamais été aussi préoccupante : l’économie est en chute libre, le chômage est en hausse et le pouvoir d’achat est en baisse. Devant cette situation, le mécontentement social grandit alors que le pouvoir en place a présenté un budget qui ne semble pas à même de redresser l’économie du pays.
A première vue, cette captation démocratique des révolutions modernistes par les islamistes a semblé donner raison aux plus pessimistes qui craignaient que les révoltes ne puissent donner lieu à l’instauration d’une véritable démocratie. Nous devons pourtant nous résoudre à accepter le verdict des urnes et ce d’autant plus que les élections ont été soigneusement observées par la communauté internationale. Elles présentaient par ailleurs toutes les caractéristiques d’une élection conforme aux principes démocratiques.
Beaucoup de facteurs peuvent expliquer cette victoire, qu’il s’agisse d’un désir de changement, de la légitimité acquise par un parti depuis longtemps dans l’opposition et de la division des autres partis dits laïcs. Néanmoins, nous devons rester vigilants quant à l’avenir du processus démocratique qui devra se poursuivre avant d’aboutir à un véritable Etat de droit en Tunisie.
Pour autant, il n’existe rien de commun entre la situation tunisienne et celle de l’Egypte ou encore de la Libye où il convient d’être vigilant quant à l’évolution de ces deux régimes.
A ce titre, l’annonce par le conseil national de transition (CNT) d’instaurer la Charia en Libye est de ce point de vue symptomatique et inquiétante.
***
Aujourd’hui, nous disposons du recul nécessaire pour nous interroger sur ce que fut la position française et ce que fut l’implication de notre diplomatie dans cette région.
La France a compris, et y a attaché une grande importance, que les jeunes manifestants du printemps arabe ne criaient pas « À bas l’Occident, à bas l’Amérique, à bas Israël ». Ils exigeaient la liberté et la démocratie montrant que les attentes des peuples étaient les mêmes au sud et au nord.
La France est toujours regardée dans le monde arabe avec une certaine suspicion, parce qu’elle n’a pas senti venir la force des mouvements populaires qui étaient en gestation.
L’intervention de la France en Libye a été motivée en grande part par la conviction que ce sont les peuples qui font l’histoire, qu’eux seuls peuvent prendre leur destin en main. La diplomatie française, prenant intelligemment ses distances avec les théories néo-conservatrices, a adopté comme principe que le mouvement vers les libertés et la démocratie ne peut être provoqué de l’extérieur.
On peut d’ailleurs dresser un parallèle pertinent entre la Libye et la Côte d’Ivoire, en montrant que dans les deux cas, la France a eu le mérite d’agir, y compris militairement, mais qu’elle l’a fait à la demande des peuples concernés et avec un mandat international.
Par ailleurs, il faut souligner que l’intervention de la France en terre libyenne a justifié la décision prise par notre pays de réintégrer l’OTAN. On pourrait quasiment considérer que, même si la France a pu coopérer dans le passé avec les autres membres de l’OTAN sans y être totalement réintégrée, pour la première fois depuis 1949 l’OTAN s’était mise au service d’une coalition emmenée par deux pays européens déterminés : la France et le Royaume-Uni.
Le printemps arabe et l’intervention franco-anglaise justifient d’ailleurs une idée qui se développe actuellement dans les diplomaties européennes, selon laquelle l’Europe risque de se trouver en danger de rétrécissement stratégique du fait de la diminution de l’effort de défense et de l’invocation de soft power, qui « sert de paravent au renoncement », comme l’a déclaré le Président de la République lors de son discours devant la 19ème Conférence des ambassadeurs en septembre 2011.
Enfin, on peut considérer que le printemps arabe rend encore plus urgent le règlement du conflit du Proche-Orient : la paix pourra être obtenue d’abord par la création d’un État palestinien, tout autre chose serait une folie. Il est souhaitable que les 27 pays de l’Union européenne s’expriment d’une seule voix et qu’ensemble ils assument leurs responsabilités ; la France doit y travailler.
Enfin, alors que les regards se sont tournés avant tout vers les pays arabes au cours des derniers mois, il est indispensable que la France surveille avec attention la situation politique, économique, sociale et géopolitique de l’Iran et en particulier le dossier nucléaire dans un contexte nouveau, marqué par l’élection présidentielle manifestement frauduleuse de 2009, les manifestations et la répression qui l’ont suivie. Le « printemps arabe » pourrait évidemment bousculer les équilibres géopolitiques de la région. Dans un Iran sans boussole, comme notre Commission des Affaires étrangères en faisait le constat dans le rapport de la mission d’information sur l’Iran après 2008 : Face au printemps arabe, l’Iran sans boussole, publié en octobre dernier, où les luttes pour le pouvoir ont pris une acuité sans précédent et se déroulent dans un champ clos, vit une société qui évolue, elle, au diapason du monde actuel et aspire à une ouverture du pays — tandis qu’il apparaît qu’il n’y a, par ailleurs, pas de doute que l’Iran poursuit son programme nucléaire à visée militaire.
Après le printemps arabe, la France appelle de ses vœux un printemps perse.
Contribution du groupe Gauche démocrate et républicaine
Sur quelques leçons du Printemps arabe
Il est légitime de parler d’un « Printemps arabe » au sens d’une rupture positive, d’un moment décisif de l’histoire politique du monde arabe. C’est un soulèvement des peuples et des sociétés civiles. C’est un « réveil » du politique jusqu’ici étouffé dans le carcan de dictatures féroces et de régimes despotiques.
Le Printemps arabe est d’abord une grande leçon générale : lorsque des peuples ne supportent plus les politiques qu’on leur impose, ils ont le choix de se révolter, de se rassembler dans l’action pour exprimer leur volonté de changement et imposer d’autres choix, d’autres dirigeants, d’autres institutions… Les soulèvements et les mouvements populaires du monde arabe montrent aussi le courage et la détermination d’une jeunesse, d’hommes et de femmes, de militant-e-s qui, dans des circonstances nationales diverses, osent affronter des régimes violents et corrompus aux pratiques à la fois brutales et sophistiquées dans leur capacité de manipulation politique et institutionnelle. C’est ce qu’a illustré des années durant la mise en scène caricaturale et savamment calculée de ce que l’on n’ose appeler des « élections » en Tunisie. On pense aussi à la répression massive et particulièrement cruelle mise en œuvre par le régime criminel de Bachar el-Assad en Syrie.
Rien ne sera plus comme avant dans le monde arabe. Il n’y aura pas de retour en arrière. L’exigence de dignité, de démocratie et de justice sociale a provoqué un basculement politique : elle a ouvert un autre avenir et – enfin – de l’espoir. C’est probablement cela la leçon la plus essentielle de ce Printemps arabe : des peuples, au-delà de leurs diversités, et des complexités inhérentes à toute société, ont choisi de changer leur destin par leur action et leur mobilisation propres, en toute conscience. Ils ont décidé d’être des acteurs politiques et sociaux majeurs dans leur pays. C’est ce qui constitue le « réveil » du politique.
On comprend ce qui surgit. Mesurons ce qui se meurt : une longue période historique issue de la décolonisation et des nationalismes arabes ou panarabes marqués par des idéologies dites « socialistes » et par la prééminence de courants baasistes et nassériens… Les régimes autoritaires, aujourd’hui figés et à bout de souffle, qui sont les produits de cette période, s’effondrent ou se trouvent ébranlés ou contestés parce qu’ils sont devenus incapables d’offrir un avenir aux peuples concernés. C’est aussi pour cela que le mot révolution a été employé pour désigner ce qui s’est passé en Tunisie et même en Égypte.
Ce constat, cependant, n’épuise pas les causes du Printemps arabe. La longue période qui se clôt est marquée par l’échec : échec du développement, échec des ambitions nationales et singulièrement sur cette grande cause arabe qu’est la question de Palestine, échec des pouvoirs en place dans l’affirmation d’une identité et de souverainetés arabes réelles. C’est aussi le refus de cette somme d’humiliations qui est à l’origine de ce basculement du monde arabe.
La France et ses partenaires européens, et plus généralement les puissances occidentales, doivent poser la question de leur propre responsabilité. Les plans d’ajustement structurel imposés par le FMI et la Banque mondiale ont aggravé la dépendance et la crise sociale. La Tunisie, par exemple, fut mise sous « ajustement » dès le milieu des années 80. Ce n’est pas un hasard si le soulèvement tunisien est parti des régions parmi les plus déshéritées du pays, après plusieurs années de luttes sociales intenses en particulier dans le bassin minier de Gafsa.
La politique euro-méditerranéenne engagée avec le processus dit de Barcelone en 1995 a poussé les pays de la rive Sud à la mise en œuvre de politiques néo-libérales, de pressions sur les salaires, de diminution des budgets publics et sociaux. Ce fut très nettement le cas en Égypte, où là aussi des luttes sociales au sein d’entreprises ont marqué le mouvement.
La responsabilité européenne – et donc française – dans la crise, la pauvreté, les difficultés économiques et sociales des pays du monde arabe est un fait indéniable et incontournable. Le discours sur les vertus et les apports du partenariat euro-méditerranéen ne résiste pas au constat : partout où ces politiques de régression sociale sont mises en œuvre, elles cassent les ressorts de la croissance et du développement dans toutes leurs dimensions.
L’échec est donc aussi celui de l’Europe et de la France. C’est une autre leçon du Printemps arabe : toute la politique de coopération avec le Sud et singulièrement avec les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée, mais aussi les pays d’Afrique des Caraïbes et du Pacifique, est à refonder dans ses méthodes, ses pratiques et ses objectifs. Il faut définir pour l’Union européenne et pour la France une véritable ambition de co-développement dans le rejet des politiques de domination qui ont prévalu jusqu’ici et qui ont conduit la France à soutenir jusqu’au bout, de façon consternante, les régimes et les dictateurs honnis de leur peuple en Tunisie et en Égypte.
Il est aujourd’hui indispensable de tirer les enseignements qui s’imposent de ce constat primordial. Si une période historique s’achève pour le monde arabe, une autre commence aussi à se terminer pour les puissances capitalistes occidentales en crise. Un certain type de rapports et d’échanges issu du néo-colonialisme est en train de s’épuiser. L’exigence d’un nouvel ordre international commence à poindre à travers les soulèvements du monde arabe mais aussi avec les expériences de gauche en Amérique latine. C’est probablement la troisième grande leçon de ce Printemps arabe : l’ensemble des relations internationales est en cause, l’existence même des rapports de puissance et les politiques dictées par les organisations financières internationales… Ce Printemps ne nous renseigne pas que sur les contradictions aiguës du monde arabe. Il souligne à sa façon l’irrépressible besoin de changement qui caractérise notre période de crise structurelle profonde et de mutations sociales de grandes dimensions. Il est donc crucial de ne pas fermer les yeux sur le sens et la portée politique générale de cette rupture dans l’histoire politique du monde arabe.
Il faut enfin interpréter l’évolution des faits eux-mêmes, la nature des évènements dans leur chronologie. Après ou avec la chute des régimes tunisien et égyptien, on peut dire qu’aucun pays du monde arabe – du Maroc eu Yémen – n’est resté à l’écart de ce qui apparaît comme un processus d’ensemble aux causes convergentes. Pourtant, chacun des soulèvements et des mouvements populaires a ses caractéristiques nationales propres. Les résultats et les enchaînements politiques qui en sont les produits directs traduisent l’état des sociétés, les rapports de force, l’acuité et la nature particulière des crises internes, la forme des ingérences extérieures ou, pour la Libye et peut être pour la Syrie demain, l’ampleur des interventions militaires étrangères (sans oublier le Bahreïn – base de la 5ème flotte américaine – où l’Arabie saoudite et le Qatar ont pu étouffer militairement le mouvement populaire sans réaction internationale).
C’est avec la conscience de cette diversité qu’il faut apprécier ce que bien des commentateurs appellent la « montée » de l’islamisme politique, alors qu’il s’agit certainement plutôt d’une expression des réalités existantes. Les processus électoraux et politiques en cours révèlent ce que sont les sociétés arabes, leurs configurations politiques internes, la faiblesse des forces politiques qu’on appelle laïques, modernistes, de gauche ou simplement libérales au sens des libertés civiles et politiques… Chaque situation nationale doit être examinée avec rigueur et précision pour comprendre, pour éviter tout jugement global approximatif, et pour mesurer que le Printemps arabe dans chacune de ses déclinaisons nationales est une transition, un processus qui s’inscrit dans la durée et dans une accumulation de contradictions. Le pire serait de rejeter de nouveaux pouvoirs politiques qu’on estimerait trop marqués par le poids de l’islamisme politique. Le pire serait aussi de compter sur ces mêmes courants de l’islamisme politique, sur les forces armées et sur les décombres de partis politiques appartenant aux anciennes dictatures, afin d’espérer mettre un terme aux soulèvements et aux mouvements démocratiques et conserver ainsi une influence dominante, conforme aux intérêts occidentaux. Les deux options – non contradictoires dans les faits – semblent avoir la faveur de dirigeants d’Europe et des États-Unis. Avec ses partenaires européens, la France doit adopter de toutes autres orientations, dans le respect des choix démocratiques et souverains des peuples de chacun des pays arabes… lorsque de tels choix peuvent s’exprimer. Cela n’interdit en rien l’attention que tout gouvernement doit accorder au respect des droits humains et des valeurs universelles. Les autorités françaises ont d’ailleurs, en la matière, un déficit de crédibilité à rattraper.
Enfin, ni notre pays, ni l’Union européenne n’échappent aux changements de dimension régionale et internationale que le Printemps arabe est susceptible de produire. Ceux qui se sont soulevés en Tunisie et en Égypte n’ont pas pointé du doigt Washington et Tel Aviv, dit-on. Mais l’exigence d’indépendance et l’espoir vivant d’obtenir la réalisation des droits nationaux du peuple palestinien, comme un élément de la dignité des peuples arabes, sont un déterminant essentiel et permanent dans la conscience politique de ces peuples. L’anti-américanisme latent et parfois violent que l’on constate est une réalité qui prend sa source dans un rejet complet de la stratégie américaine dans le monde arabe et au Moyen-Orient : guerre en Irak, soutien à la politique israélienne d’occupation et de colonisation de la Palestine, soutien unilatéral, et dans la durée, à tous les régimes pro-occidentaux arabes, en particulier les plus réactionnaires comme ceux d’Égypte, de l’Arabie saoudite, des Émirats du Golfe… Les raisons d’un tel rejet populaire des États-Unis et de leur politique irriguent les motivations profondes des acteurs du Printemps arabe. Toute avancée démocratique, toute prise d’autonomie dans le monde arabe contribuera ainsi à modifier la donne géopolitique. Les dirigeants israéliens s’inquiètent d’ailleurs de ce qu’ils perçoivent comme des bouleversements peu favorables à la stabilité régionale dont ils ont pu bénéficier.
Rien n’est décidé par avance. C’est un formidable bras de fer qui est engagé dans une très grande complexité. Les puissances capitalistes occidentales – France, Grande-Bretagne, États-Unis, en tête – défendent des intérêts pétroliers, stratégiques et politiques considérés comme majeurs, au point où ces pays n’ont pas hésité à manipuler le Conseil de sécurité afin d’obtenir le vote d’une résolution légitimant à l’avance une guerre en Libye, pour ensuite se repartager les marchés et ses dividendes… On se souvient des propos d’un militaire français de haut rang (2) sur Radio France Internationale le 21 mars 2011, soit trois jours seulement après le vote de la résolution 1973 aux Nations unies : « … in fine, a-t-il affirmé sans être démenti, la chute du régime est l’objectif réel de cette opération même s’il n’est pas avoué. Il y a eu des frappes sur le Bunker de Kadhafi. On a essayé d’éliminer directement Kadhafi ». Ces propos signifient que la France et ses alliés ont fait voter un texte au nom de « la responsabilité de protéger » en sachant à l’avance que ce qui allait se passer sous leur responsabilité serait totalement différent des engagements formulés dans cette résolution : une opération militaire offensive de grande envergure. C’est-à-dire une guerre.
Cette dramatique aventure libyenne, on n’en connaît pas encore ni toutes les conséquences, ni l’issue politique finale véritable, tellement elle aura provoqué de chaos interne dans une vraie guerre civile. On constate, de plus, qu’elle a provoqué une fracture politique dans les relations internationales. La Russie, la Chine, le Brésil, l’Afrique du Sud, l’Inde qui avaient choisi de laisser passer la résolution sur la Libye à l’ONU, ont bloqué des mois durant la possibilité d’une initiative sur la Syrie au nom du refus de toute nouvelle instrumentalisation du Conseil de sécurité pouvant conduire à une intervention militaire... que les logiques politiques en cours semblent préparer.
La France et quelques autres puissances se font ainsi contrer fermement, y compris par les pays émergents, dans leur conception inacceptable des relations internationales et dans cette manipulation du droit international. Cette crise, car c’en est une, soulève des questions majeures, en particulier celles des règles et des pratiques du multilatéralisme, celle du respect que l’on doit aux Nations unies et à sa Charte, celle des principes et des objectifs de la politique étrangère de la France.
La politique étrangère française est encore à l’épreuve avec la crise syrienne. La proposition de couloir humanitaire (pour quel usage réel ?), soutenue par la France, comme celle d’une zone sécurisée en territoire syrien, à la frontière syro-turque, font inévitablement appel à un dispositif d’appui militaire. Au nom d’une prétendue protection des populations civiles et des militaires opposés au régime, l’idée d’une opération armée commence ainsi à faire son chemin alors qu’en parallèle, la perspective d’une guerre civile n’est plus à exclure. De quoi réjouir Bachar el-Assad et son régime, qui verraient dans une telle confrontation une légitimation de la répression et de sa politique de force.
Les risques d’une telle situation sont énormes y compris pour le Liban où se cristallisent toutes les tensions et les contradictions régionales. Ce qui sera entrepris concernant la Syrie pèsera lourd pour l’avenir du Proche-Orient dans son ensemble, pour les rapports de force entre les pays occidentaux, Israël, l’Iran et ses alliés. Une solidarité très forte doit se manifester pour le peuple syrien et pour l’ensemble des démocrates et progressistes qui veulent la fin du régime de Bachar el-Assad et un progrès décisif de la démocratie. Des sanctions lourdes et convergentes de l’Union européenne, des pays de la Ligue arabe, de tous les pays qui veulent y contribuer peuvent être efficaces et décisives à condition qu’elles soient ciblées et qu’elles visent le régime.
Le Printemps arabe n’est pas qu’un épisode dans l’histoire du monde arabe. C’est un processus durable qui a déjà transformé des sociétés et ouvert un nouveau contexte régional et international. C’est un défi de haut niveau pour la France et pour l’Europe. Ce Printemps arabe appelle à une reconstruction des conditions économiques, sociales et politiques d’un véritable partenariat entre les rives Nord et Sud. Il n’y a pas d’Europe possible, en effet, sans une grande ambition de coopération avec le Sud.
Cependant, si la France et ses partenaires de l’Union européenne veulent réellement avancer dans cette voie, ils ne pourront le faire que s’ils contribuent effectivement à un règlement de la question de Palestine mais aussi, en parallèle, à une avancée dans la non-prolifération nucléaire avec, en perspective, l’établissement d’une zone dénucléarisée dans l’esprit d’un désarmement multilatéral et contrôlé impliquant tous les pays concernés, y compris Israël et l’Iran. L’échec de l’Europe vis-à-vis du monde arabe est aussi et peut être surtout l’incapacité d’agir ou la volonté, au-delà des discours, de ne rien faire qui puisse entraver si peu que ce soit la politique de Tel Aviv et la diplomatie structurellement pro-israélienne de Washington. Ce suivisme atlantiste et cette carence béante, qui signent l’inconsistance politique et stratégique des Européens, sont une des raisons de leur fiasco dans le monde arabe.
Pour marquer par un acte déterminant et positif une volonté de dépasser cette situation grave et d’assumer sa responsabilité, la France devrait reconnaître maintenant l’État de Palestine et soutenir les démarches de l’OLP aux Nations unies, tout en entraînant ses partenaires de l’Union européenne à faire de même.
Le groupe de la Gauche démocrate et républicaine, les députés communistes appellent les autorités françaises à prendre sans attendre une telle décision qui aurait un grand écho dans tout le monde arabe.
COMPTES RENDUS DES TRAVAUX DE LA COMMISSION
1.- Mardi 18 janvier 2011, séance de 10 heures 45, compte rendu n° 27 : audition de Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes, sur la situation en Tunisie (ouverte à la presse)
M. le président Axel Poniatowski. Madame la ministre d’État, merci d’avoir accepté, dans un délai si bref, l’invitation de la Commission des affaires étrangères, pour une courte audition qui sera exclusivement consacrée à la Tunisie.
Le changement radical que ce pays a connu en quelques jours n’avait été anticipé par aucun observateur. Vingt-trois journées de manifestations sont venues à bout d’un président en place depuis vingt-trois ans ; lâché par son armée, le président Ben Ali n’a pu résister à la pression de la rue. Alors que la France pariait sur une évolution à long terme de la Tunisie vers la démocratie, l’Histoire s’est accélérée.
Madame la ministre, votre audition doit être l’occasion de faire le point sur la situation au lendemain de ces événements, ainsi que sur la manière dont la France peut aider le processus de démocratisation annoncé par les autorités.
Il y a quelques jours encore, le principe de non-ingérence et la crainte que la crise ne se termine par un bain de sang justifiaient que la France s’exprime avec retenue. Aujourd’hui, pour l’avenir de la Tunisie, celui de nos relations bilatérales avec elle mais aussi celui du monde arabe, notre pays doit répondre aux demandes du peuple tunisien et soutenir sa transition. Cette révolution ouvre peut-être une nouvelle ère historique. Il n’est pas exclu que la révolution tunisienne fasse des émules dans les pays voisins : un cinquième jeune Algérien s’est immolé hier par le feu et la rue arabe se réveille dans les pays du Proche et du Moyen-Orient.
Si la révolution tunisienne est résolument démocratique, les fondamentaux économiques et sociaux ne risquent-ils pas un jour d’ouvrir la voie au fondamentalisme ?
Après votre intervention, madame la ministre, je donnerai la parole à un représentant de chaque groupe, pour deux minutes,…
M. Nicolas Dupont-Aignan et M. Jacques Myard. Uniquement à eux ? C’est scandaleux !
M. le président Axel Poniatowski. … après quoi vous répondrez globalement. Cette organisation permettra de terminer un peu avant onze heures trente, de sorte que l’audition suivante – une audition commune avec la Commission de la défense, consacrée aux événements de Côte-d’Ivoire et du Niger, à laquelle vous participerez avec M. Alain Juppé – puisse se dérouler à l’heure convenue.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes. Dans un monde de plus en plus mobile et globalisé, la représentation nationale doit pouvoir être informée le plus rapidement et le plus exactement possible des événements au fur et à mesure de leur déroulement.
Après cinquante-cinq ans pendant lesquels elle n’a connu que deux présidents, la Tunisie vit aujourd’hui une période historique.
Eu égard à la force des liens entre la France et la Tunisie, il est tout à fait naturel que, dans ces moments décisifs, la France se tienne aux côtés du peuple tunisien. Le grand nombre de Tunisiens en France, de Français en Tunisie, de Franco-Tunisiens, les échanges de toute nature entre nos deux pays rendent très étroites les relations entre nos peuples et nos États. Nous voulons d’abord, dans toute la mesure du possible, aider un peuple ami, mais tout en étant respectueux de celui-ci, c’est-à-dire sans interférer dans sa vie interne. C’est là une attitude conforme aux principes constants de notre politique internationale : non ingérence ; respect de l’État de droit ; appel à la démocratie et à la liberté, et soutien de celles-ci. La Tunisie étant un ancien protectorat, nous sommes plus encore tenus à une certaine réserve. Munis de ces principes, il nous faut aborder la situation avec calme et lucidité.
Je fais confiance à l’esprit de responsabilité du peuple tunisien – que nous voyons se manifester même au milieu des difficultés actuelles – pour permettre à celui-ci de retrouver la voie de l’apaisement et du dialogue, éléments essentiels pour une transition réussie.
Nous devons tous faire preuve de modestie. Formuler des interprétations après coup est facile. Ni la France ni les autres pays n’avaient vu venir les événements de Tunisie, ou, tout au moins, leur accélération. Certes, nous avions tous pu constater l’insatisfaction de la jeunesse tunisienne, l’une des plus éduquées et des plus cultivées de la région, et pourtant fortement frappée par le chômage. Lors de nos déplacements, nous avions aussi pu ressentir, les uns et les autres, une exaspération de la population devant l’accaparement de l’économie tunisienne par un clan – plus ou moins discret. Nous avions aussi vu, ces dernières semaines, le mouvement débuté par l’immolation du jeune Mohamed Bouazizi laisser progressivement place à un mécontentement politique. Pour autant – soyons honnêtes – nous avons tous, hommes politiques, diplomates, journalistes, chercheurs même, été surpris par la rapidité de cette révolution désormais dénommée « révolution de jasmin ».
Plus qu’ailleurs dans la région, le fossé s’était creusé entre un développement économique et social soutenu, que tous citaient en exemple, et un sous-développement des libertés et des droits politiques.
La force d’Internet et des réseaux sociaux a libéré la parole. Dans l’avenir, nous aurons à prendre en compte ce constat. Par rapport au passé, cette force a donné une ampleur nouvelle à la contestation.
L’usage excessif de la force à l’encontre des manifestants a aussi été l’un des déclencheurs essentiels des événements. Il a plus que jamais montré la réalité tunisienne, tant aux yeux du monde que des Tunisiens. Les images de la répression violente conduite par les forces de l’ordre ont exacerbé la détermination du peuple tunisien, et donc, certainement, accéléré le cours des événements.
Mardi dernier, lors des questions d’actualité, vous m’avez interrogée – vous-même, je crois, monsieur le président – sur les manifestations. Je souhaite profiter du délai plus long dont nous bénéficions aujourd’hui pour revenir sur ma réponse.
Mes propos, nécessairement brefs, ont peut-être été mal interprétés, et parfois déformés. S’ils ont été mal compris, je ne peux que le regretter ; ils ne visaient qu’à exprimer ma sensibilité aux souffrances du peuple tunisien dans ces manifestations. J’avais en effet, comme vous, vu ces images où des tirs ont entraîné des morts.
Je suis scandalisée par le fait que certains aient voulu déformer mes propos, qu’on les ait coupés, qu’on les ait sortis de leur contexte pour leur faire dire à des fins purement polémiques le contraire de ce que je voulais dire, notamment le contraire de ce que je pouvais ressentir face aux souffrances du peuple tunisien. J’ai fini par douter de moi. Après tout, en deux minutes il peut arriver qu’on s’exprime mal, d’autant que je venais de passer une nuit dans un avion ! Si bien que j’ai relu mes propos pour vérifier que ce que j’avais dit correspondait bien à ce que je pensais, et non pas à ce que j’entendais et aux interprétations de certains.
Je vous remercie de l’occasion que vous me donnez de préciser quelle est l’analyse que je faisais et que j’ai toujours faite.
J’ai été bouleversée par les tirs à balles réelles contre un certain nombre de manifestants, et par les victimes qui en ont résulté, parmi lesquelles un professeur franco-tunisien et un photographe franco-allemand. En substance, j’ai dit que je déplorais l’usage disproportionné de la force contre des manifestants. Gérer des manifestations, même violentes, sans ouvrir le feu et sans faire de morts est possible. Nous savons le faire en France ; or tel n’est pas le cas dans tous les pays du monde. Depuis une vingtaine d’années, des manifestations d’ampleur ont eu lieu dans notre pays – j’ai eu à gérer moi-même des événements comme ceux de Villiers-le-Bel ou ceux qui ont entouré la réunion de l’OTAN à Strasbourg – et il n’y a pas eu de mort. C’est la raison pour laquelle j’ai indiqué que nous étions prêts – dans l’avenir bien sûr, puisqu’il s’agit de formation – à transmettre par le biais de la formation notre savoir-faire en matière de gestion des foules sans usage disproportionné de la force : les gens doivent avoir le droit de manifester sans que leur vie risque d’être mise en jeu par des tirs de police.
Il est évidemment inenvisageable que la France prête un concours direct aux forces de l’ordre d’un autre pays. C’est contraire à nos lois et à toute légitimité. Je ne peux pas comprendre que certains aient voulu faire une interprétation malveillante en ce sens de mes propos. Je connais la législation et les règles dans ce domaine : j’ai été ministre de la défense, de l’intérieur, de la justice ! Que certains essaient d’énoncer des contrevérités de ce type me choque profondément : on peut faire de la politique, vouloir faire du sensationnel, mais on n’a pas le droit de déformer des propos à ce point ! Je le répète, jamais il n’a pu être dans les intentions de quiconque d’envoyer des forces de l’ordre dans un autre pays ; je ne vois du reste pas du tout dans quelles conditions cela serait possible.
Les événements en Tunisie se déroulent très vite. Aujourd’hui, la situation de la sécurité y est contrastée. D’après les informations dont nous disposons – j’ai été en contact durant toute la période non seulement avec le ministre des affaires étrangères de Tunisie, mais aussi avec le nouveau président et l’actuel Premier ministre –, des milices fidèles au président déchu se livrent à des tirs et à des tentatives d’envahissement de bâtiments publics. Le Premier ministre de transition, M. Mohammed Ghannouchi, a annoncé qu’il n’y aurait aucune tolérance pour ces bandes criminelles.
À Carthage, l’armée régulière a repris le contrôle du palais présidentiel en en délogeant la garde présidentielle qui s’y était retranchée. À Sfax, une ressortissante française qui était sortie dans la rue pendant le couvre-feu et qui aurait refusé d’obtempérer aux ordres des forces de police a été touchée par une balle ; elle est aujourd’hui hospitalisée. Après plusieurs jours d’agitation, la situation est redevenue relativement calme dans cette ville. Elle reste en revanche assez tendue à Bizerte, où, hier encore, des tirs ont été entendus et des hélicoptères sont intervenus.
Néanmoins, dans nombre de cas, un retour à la normale peut être noté. L’Union générale des travailleurs tunisiens et un certain nombre de mosquées ont appelé la population à reprendre le travail. De même, des magasins qui avaient fermé pour éviter la dévastation et le pillage rouvrent progressivement.
J’ai proposé à la fois au nouveau président de la République et au ministre des affaires étrangères une aide éventuelle en ravitaillement et en biens de première nécessité, en particulier pour les enfants et les personnes démunies. Tout en me remerciant de cette offre, le président de la République comme le Premier ministre m’ont répondu que le rythme de retour à une situation normale ne rendait pas cette démarche nécessaire. Il est à noter que, depuis hier, le marché de gros a rouvert et serait en cours de réapprovisionnement – l’insécurité avait en effet empêché les livraisons d’avoir normalement lieu –, et que les administrations ont aussi rouvert leurs portes.
M. Mohammed Ghannouchi a également annoncé la libération de tous les prisonniers d’opinion. En revanche, le couvre-feu demeure, eu égard à la crainte des exactions, qui perdure. Certains quartiers se sont même organisés pour se protéger, avec l’accord, semble-t-il, du gouvernement. Aux dires mêmes des autorités, avec lesquelles je me tiens en liaison en permanence, la situation de la sécurité est encore un peu tendue. Notre cellule de crise reçoit néanmoins beaucoup moins d’appels depuis hier qu’au cours des premiers jours.
Le paysage et la vie politiques sont en train de se réorganiser. Ainsi, la composition du nouveau gouvernement a été annoncée hier matin par le Premier ministre. C’est un gouvernement d’union nationale, qui comporte plusieurs personnalités – non visées par les critiques – de l’ancien parti au pouvoir. C’est ainsi que, pour assurer la continuité du service public, les titulaires des grands portefeuilles régaliens ont conservé leur poste. Ce nouveau gouvernement comprend également trois personnalités d’opposition : M. Ahmed Brahim, du parti Ettajdid, est ministre de l’enseignement supérieur ; M. Néjib Chebbi, du parti démocratique progressiste, est ministre du développement local et régional ; enfin, M. Mustapha Ben Jaafar, du Forum démocratique pour le travail et les libertés, est ministre de la santé – ces deux dernières personnalités étaient jusqu’alors en butte à des attaques renouvelées du pouvoir en place.
En revanche, le nouveau gouvernement ne comprend de représentants ni du parti communiste des ouvriers de Tunisie, ni du mouvement islamique Ennahda. Se positionnant comme « la vraie opposition », ces deux partis ont en effet refusé d’y participer.
Le nouveau gouvernement va devoir affronter trois défis : rétablir l’ordre public, indispensable à la vie quotidienne ; persuader le peuple tunisien de sa crédibilité ; enfin, préparer les élections. Dans chacun de ces trois domaines, les enjeux sont considérables.
Que va devenir l’appareil du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD) ? Ce parti, qui comprenait deux millions d’adhérents, monopolisait aussi des postes dans l’administration.
Quel sort réserver à la centaine de milliers de policiers sur lesquels reposait le régime précédent ? Il n’est pas indifférent de noter qu’après avoir disparu le vendredi soir – ce qui a sans doute aussi favorisé un certain nombre d’exactions et la mise en place de milices –, la police a réapparu à partir du samedi matin, aux côtés de l’armée, pour stabiliser la situation, notamment à Tunis.
Quelle place aussi pour les partis islamistes ?
Quelle place enfin pour l’armée, dont le rôle a été essentiel dans la chute du régime ?
La Tunisie entre dans une phase de transition. Pour elle, pour le peuple tunisien, pour la stabilité de cette partie du monde et de la Méditerranée, il est indispensable qu’elle la réussisse.
La France a indiqué très fermement que l’aspiration des Tunisiens à plus de démocratie et de liberté ne pourra se réaliser que si des élections libres sont tenues dans les meilleurs délais. Aux termes de la Constitution, l’élection du futur président de la République devrait intervenir au plus tard dans les deux mois suivant la constatation de l’empêchement définitif de M. Ben Ali, qui est intervenue le 15 janvier. L’opposition estime ce délai trop court et demande son extension. C’est donc au nouveau gouvernement d’union nationale qu’il revient de déterminer comment faciliter la participation du plus grand nombre à ces élections libres, alors que les partis sont aujourd’hui grandement désorganisés. Le Premier ministre a annoncé que l’organisation des élections aurait lieu au plus tard dans les six mois. Il se garde donc une marge de manœuvre.
Voilà ce qui peut être dit aujourd’hui de la situation en Tunisie.
M. Nicolas Dupont-Aignan. L’organisation de ce débat est inadmissible. C’est scandaleux !
M. le président Axel Poniatowski. Notre temps est extrêmement limité. Nous aurons l’occasion de débattre à nouveau de la Tunisie. Nous entendrons bientôt l’ambassadeur de France dans ce pays. Aujourd’hui même, nous entendons, sur le Maghreb l’ambassadeur de France en Algérie.
M. Jean-Paul Lecoq. Monsieur le président, permettez moi de partager la réaction de nos collègues. La démocratie à deux minutes par groupe est le début de la dictature de la seconde.
M. Nicolas Dupont-Aignan. En effet, c’est indigne !
M. Jean-Paul Lecoq. Elle peut être aussi l’amorce d’autre chose : dans notre Parlement, à force de chronométrer le temps de parole, c’est la démocratie qu’on étouffe.
M. Éric Raoult. Parlez-nous plutôt du Goulag !
M. Jean-Paul Lecoq. Madame la ministre, celle de vos réponses qui a suscité la polémique était adressée non pas au président Poniatowski mais à moi-même. Soit vous l’avez mal relue, soit vous n’énoncez pas la totalité de la vérité. J’invite ceux qui s’y intéressent à consulter le compte rendu intégral des débats, où elle figure in extenso. Ils pourront juger par eux-mêmes de son contenu, et donc de la justesse de votre propos.
Le groupe GDR est fier de pouvoir regarder le peuple tunisien en face. Personne n’aurait vu venir les événements ? Mais nous n’avons cessé de dénoncer, depuis des années, la situation en Tunisie. Le chef du parti communiste tunisien avait dû entrer en clandestinité. Lorsqu’il en est sorti, il a été quasi-immédiatement arrêté.
Au cours du dernier trimestre de l’année dernière, nous sommes allés, avec Marie-George Buffet, rencontrer les démocrates tunisiens, de différents partis. Nous avons considéré qu’il était urgent de prévenir la diplomatie française de leurs réactions. Nous avons fait part à l’ambassadeur de France à Tunis du ressentiment des partis d’opposition et du peuple face à ce que l’on semble découvrir aujourd’hui, le système Ben Ali et l’organisation de la société tunisienne. Pendant des années, nous n’avons cessé d’expliquer, ici ou au Conseil de l’Europe, que le régime tunisien était une dictature, avec laquelle le gouvernement français était pour le moins complaisant.
M. Éric Raoult. Parlez-nous de Cuba !
M. Jean-Paul Lecoq. Savoir qui prend ses vacances en Tunisie et dans quelles conditions serait intéressant...
La leçon d’aujourd’hui vaut pour toutes les dictatures : un jour, la justice et les peuples savent relever la tête.
M. Jacques Myard. Vous parlez d’expérience !
M. Jean-Paul Lecoq. Cette leçon vaut aussi pour le gouvernement français, qui, jusqu’à la dernière minute, a été solidaire de Ben Ali. Elle vaut également pour l’Union européenne, laquelle va devoir réviser ses critères de coopération. Enfin, elle vaut pour notre Parlement : c’est pourquoi notre groupe demande l’organisation à l’Assemblée nationale d’un débat sur la nature des relations que la France entretient avec les pays du continent africain.
M. Hervé de Charette. Je partage sur le fond les critiques émises sur la tenue de cette réunion : un temps d’expression de deux minutes par groupe me semble contraire au fonctionnement normal de notre commission et du Parlement.
La Tunisie est à la fois le pays le plus proche de nous dans le monde arabe, le plus développé au sein de sa zone et enfin un verrou stratégique et politique dans l’espace du monde arabe méditerranéen.
Je retiens volontiers vos explications, madame la ministre. Que celui qui n’a jamais péché jette la première pierre. La réaction du président Mitterrand lors de la chute du mur de Berlin montre que ce n’est pas la première fois que des gouvernants ont du mal à comprendre la survenue d’événements qui se préparent depuis de longues années.
Mme Élisabeth Guigou. Cela n’a rien voir !
M. Hervé de Charette. Au fil du temps, une certaine distance s’est créée entre nous et le peuple tunisien – et non entre nous et les autorités tunisiennes. Quelles sont, madame la ministre, vos idées pour reprendre contact ?
Monsieur le président, je propose qu’une mission parlementaire, composée de membres des quatre groupes de l’Assemblée, se rende assez rapidement en Tunisie pour montrer l’intérêt que nous portons à ce pays ainsi que pour nous aider nous-mêmes à comprendre le processus en cours et en mesurer la solidité.
M. Jacques Myard. Très bien !
M. Hervé de Charette. Quelle est l’action entreprise par les voisins arabes de la Tunisie ? Quelles peuvent être ses conséquences sur le déroulement du processus en cours ?
Enfin, nous avons entendu l’Union européenne moins encore que la France. Outre les communiqués dont elle a le secret, envisage-t-elle d’aider les Tunisiens ? Aussi solide que soit la capacité du peuple tunisien à gérer cette crise, le soutien et la capacité d’écoute de l’Union européenne et de la France constituent un élément décisif de la stabilité de la Tunisie.
M. Gaëtan Gorce. Je voudrais d’abord, au nom de mon groupe, rendre hommage aux victimes des événements qui viennent de se dérouler en Tunisie. Il en est temps.
Je voudrais également apporter au peuple tunisien mon appui, et, je pense, celui de mon groupe et de la représentation nationale, dans la lutte qu’il a engagée pour la mise en place d’une véritable démocratie. C’est le rôle de la France, je crois, de montrer combien elle est vigilante et attachée à la construction de celle-ci.
Il ne s’agit pas là de commentaires après coup, madame la ministre. Je crois parler dans la continuité de nos observations de ces dernières semaines, notamment de la semaine dernière lors des événements.
Pour nous – et c’est particulièrement préoccupant – le président de la République et le gouvernement ont affaibli, en une succession surprenante et condamnable de bévues, la position de la France dans le monde, en Afrique, et auprès du peuple tunisien.
C’est d’abord de la complaisance qu’a manifestée l’exécutif. J’en veux pour preuve les propos tenus il y a une dizaine de jours par le ministre de l’agriculture – qui n’était sans doute pas, ès qualités, le mieux qualifié pour s’exprimer sur le sujet –, ou encore ceux du président de la République lors de son voyage en Tunisie en 2008 : il y présentait le président Ben Ali comme un homme auquel on pouvait faire confiance et le félicitait pour avoir supprimé la peine capitale dans son pays ! Ces félicitations prennent un relief tout particulier aujourd’hui.
Il y a là une logique. C’est pourquoi je ne vous jetterai pas la pierre, madame la ministre : c’est cette complaisance qui a conduit à l’erreur d’appréciation que vous avez commise en proposant à l’Assemblée nationale de privilégier les formes de coopération policière en réponse à la crise dans laquelle la Tunisie était plongée.
Vous avez le choix entre regretter vos propos – et, à la limite, vous en excuser – et les assumer ; mais, dans ce cas, vous devez les assumer en totalité. Le compte rendu des débats de l’Assemblée nationale ne fait apparaître nulle condamnation des violences dans votre déclaration. À aucun moment vous n’avez employé les termes d’« usage disproportionné » de la force. Vous avez juste déploré ces violences. Vous n’avez pas cité une fois le gouvernement tunisien pour regretter ses méthodes. En réponse aussi bien au président Poniatowski qu’à M. Lecoq, vous avez fait état très concrètement, à plusieurs reprises, d’une proposition de coopération policière. Ces propos, complètement déplacés et choquants, ont donc normalement choqué. Si vous souhaitez les assumer, comme aujourd’hui – ce qui est faire preuve de cohérence –, assumez-les en totalité.
L’exécutif est ensuite passé de la complaisance et de l’erreur d’appréciation au désarroi, voire à l’indifférence. Phénomène très particulier dans le fonctionnement de notre République, alors que le président Ben Ali avait quitté le pouvoir vendredi à 17 heures et que la crise en Tunisie atteignait son apogée, le président de la République a été dans l’incapacité de réunir un comité interministériel : le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l’intérieur – et accessoirement le porte-parole du gouvernement – étant absents de Paris. Vous devez vous en expliquer devant le Parlement et l’opinion publique.
Enfin, sur quels éléments vous êtes vous fondé pour commettre une telle erreur d’appréciation ? Quelles informations vous permettaient de penser que la réponse était dans la coopération policière ? Sur quels éléments le gouvernement s’est-il appuyé pour tarder à réagir à ce point ? Pourquoi est-ce l’administration américaine qui a exprimé le plus directement sa condamnation, et ce sans juger utile d’en référer au gouvernement français, contrairement à l’habitude ?
M. Renaud Muselier. Je vous remercie, monsieur le président, d’avoir organisé cette réunion.
Nous sommes très attentifs aux événements en cours en Tunisie, pays frère, pays ami, avec qui nos relations diplomatiques sont très anciennes, maintenues quel que soit le gouvernement en place, et où nombre d’entre nous se rendent régulièrement en vacances en toute sécurité. En termes économiques et sur le plan de la laïcité, la Tunisie est le pays de la région le plus proche de l’Europe.
Je salue la position de Mme la ministre d’État. Ses explications sur les positions de la France sont claires et précises. Dans une situation si difficile, compte tenu des 25 000 Français qui vivent en Tunisie et des très nombreux Tunisiens qui vivent en France, le langage qui doit être utilisé doit être celui de la retenue, et c’est celui qu’a employé Mme la ministre.
En même temps, le monde attend que la France, pays des droits de l’Homme, s’exprime. Quelle position doit-elle prendre envers des pays à la fois situés dans un contexte régional délicat et où l’opposition est plus ou moins muselée ?
La vitesse à laquelle le régime Ben Ali est tombé est surprenante. La détermination de la jeunesse qui s’est levée en est la cause. La rapidité du ralliement de l’armée, qui a réorganisé son dispositif pour permettre la chute du président Ben Ali et de toute sa famille, constitue une autre surprise.
Nous devons aussi souligner la référence incessante à la constitution dans la presse tunisienne. Voilà une révolution qui chasse un dirigeant avec le soutien de l’armée tout en respectant la Constitution.
Madame la ministre, quelles peuvent être les conséquences de la chute du régime Ben Ali sur les pays voisins, dont les travers sont à peu près les mêmes que ceux qui ont provoqué cette chute, pays que nous soutenons depuis toujours ? Un effet de domino se produira-t-il ? Risque-t-il d’entraîner une expansion de l’islamisme ?
Mme la ministre d’État. Je sais, monsieur le président, que je dois répondre rapidement. Cependant, la brièveté empêche parfois de fournir des indications de nature à permettre à chacun de bien comprendre le sens des propos tenus, et à éviter des polémiques inutiles sur des interprétations erronées. En tout état de cause, je reviendrai devant la Commission pour évoquer plus longuement la situation de la Tunisie.
Monsieur Lecoq, en matière de relations internationales, la France a pour premier principe de travailler avec des États et des peuples, et non simplement avec des personnes. Dialoguer avec un État reconnu par la communauté internationale, c’est appliquer le principe du respect de l’état de droit. Tel a été le cas, pour tout le monde, en ce qui concerne la Tunisie.
Notre deuxième principe d’action, je le répète, est celui de la non ingérence. Une fois en présence d’un État reconnu par la communauté internationale, nous n’avons pas à nous ingérer dans son fonctionnement, et ce d’autant moins que certaines relations anciennes – c’est le cas du protectorat – peuvent entraîner un regard particulier du pays concerné sur notre propre action.
Enfin, nous nous attachons à la défense de la démocratie et des droits. Reconnaître un État ne nous empêche pas de lui tenir notre discours sur ces points. Monsieur Gorce, si, en 2008 le président de la République a en effet exposé que des progrès avaient été réalisés en Tunisie en matière de droits, il a aussi indiqué qu’il restait du chemin à parcourir pour que ceux-ci soient totalement respectés. Ses propos doivent être analysés en entier, et non de façon tronquée.
Monsieur de Charette, c’est non seulement pour reprendre mais aussi pour amplifier les contacts avec le peuple tunisien que, compte tenu des échos qui nous parvenaient sur les difficultés que rencontrait la Tunisie, notamment en matière de ravitaillement, j’ai proposé aux autorités de ce pays de contribuer – si elles le souhaitaient – à répondre à des besoins qui étaient ceux non pas de l’État, mais du peuple tunisien.
Les réactions des États voisins face aux événements de Tunisie ont été diverses. Elles n’ont cependant pas été très nombreuses.
La France est en première ligne pour la mise en place d’un partenariat renforcé entre la Tunisie et l’Union européenne. Nous avons été à l’origine d’une étude et d’une déclaration de l’Union en ce sens lors du huitième conseil d’association Union européenne-Tunisie.
Nous approfondissons nos relations avec la Tunisie selon trois volets principaux. D’abord, le volet politique, qui inclut le renforcement du dialogue et de la coopération. Celle-ci porte notamment sur le rapprochement des législations entre nos deux pays – j’en ai été en charge en tant que ministre de la justice – ou sur la lutte contre le terrorisme, qui est une préoccupation de nos deux pays. Cela dit, nous conduisons autant de coopérations qu’il est possible.
Ensuite, nous considérons qu’il est essentiel de travailler, ensemble et à l’échelle européenne, pour une meilleure intégration des économies tunisienne et européenne.
Enfin, plusieurs coopérations sectorielles sont conduites, notamment dans les domaines de l’énergie et des transports.
L’ensemble de ces coopérations, nombreuses, touche aux conditions de vie du peuple tunisien dans toutes leurs acceptions.
Monsieur Gorce, vous avez apporté – comme nous tous – votre soutien au peuple tunisien. Vous avez aussi évoqué le rôle prétendument complaisant du président de la République en 2008 lors de son voyage officiel en Tunisie en ne citant que le début d’une phrase prononcée par celui-ci, mais en omettant d’énoncer la suite dans laquelle le président indiquait, comme je vous l’ai déjà rappelé, que, en matière de respect total des droits, des progrès restaient à accomplir. Au reste, M. Dominique Strauss-Kahn, en voyage en Tunisie à la même période, a amplement loué la situation, notamment économique, de ce pays. Ne soyez pas hémiplégique ! Les propos, de qui que ce soit, doivent être cités in extenso !
Plusieurs députés de la majorité. Très bien !
Mme la ministre d’État. Au-delà des polémiques de la vie politique, nous nous devons, en Commission des affaires étrangères, de nous attacher à la dignité de la politique étrangère de la France et à l’intérêt de notre pays.
Vous vous demandez, monsieur Gorce, pourquoi les ministres n’étaient pas présents à Paris vendredi après-midi ? Je vais donc vous l’expliquer.
J’avais moi-même fait à treize heures le point de la situation avec non seulement notre ambassade mais aussi les autorités tunisiennes : les manifestations qui s’étaient tenues le matin s’étaient bien déroulées, et si nous savions que la situation était relativement instable, nous pensions que le week-end se passerait normalement. Cela dit, comme vous, mesdames et messieurs les députés, le ministre de l’intérieur, le porte-parole du gouvernement et moi-même sommes des élus locaux, ce qui nous impose de nous rendre là où nous sommes élus pour remplir nos obligations. Toutefois, informée à cinq heures et demie des événements en cours, j’ai alors pris le premier avion pour Paris.
Pourquoi la première réaction a-t-elle eu pour auteur l’administration américaine ? Êtes-vous sûrs que si des tels événements s’étaient déroulés au Mexique, l’administration américaine aurait réagi ainsi et aussi vite ? Beaucoup d’Américains résident dans ce pays ! La présence de milliers de nos concitoyens au cœur d’une situation pour le moins confuse sur le plan de la sécurité impliquait de notre part, tout en organisant le soutien nécessaire, de ne réagir qu’avec retenue et prudence.
Monsieur Muselier a souligné à juste titre la rapidité du basculement des événements. Eu égard aux informations dont nous disposions, nous pensions que, quoi qu’il arrive, la situation allait évoluer. Cependant, entre mercredi et vendredi les événements se sont précipités. Si l’action de l’armée a sans doute été un facteur déclenchant, je continue à penser que les morts dus à la répression, ainsi qu’Internet et les réseaux sociaux, ont contribué également à la rapidité de l’évolution.
J’ai été aussi beaucoup frappée par la référence faite à la Constitution, pourtant critiquée par certains. Cette démarche donne une grande confiance dans la suite des événements, et nous allons les surveiller avec attention.
Même s’ils ont parfois conduit des tentatives de récupération, les mouvements islamistes n’ont pas été à la tête du mouvement. Il reste que de tels mouvements, plus ou moins radicaux, plus ou moins organisés, sont présents dans tous les pays de la région. Cette situation justifie une grande attention de notre part envers tous les événements qui s’y produisent, dans le cadre du respect de nos principes d’action. Compte tenu de nos relations historiques avec ces pays, nous devons à la fois être très proches de leurs peuples et faire preuve de retenue et de réserve dans notre expression : la France ne peut pas prêter le flanc à de – faciles – accusations d’intervention dans leurs choix. Ce qui m’intéresse dans l’action que je mène aujourd’hui, c’est la défense de l’image, de l’action et des valeurs de la France.
M. le président Axel Poniatowski. Merci, madame la ministre, pour vos réponses et votre analyse claire et sincère.
2.- Mardi 18 janvier 2011, séance de 17 heures, compte rendu n° 29 : audition de M. Xavier Driencourt, ambassadeur de France en Algérie
M. le président Axel Poniatowski. Lorsque l’audition de M. l’Ambassadeur de France en Algérie – que je remercie vivement d’avoir donné son accord – a été décidée, les autorités d’Algérie et de Tunisie étaient confrontées à des manifestations de grande ampleur. Cependant, rien ne permettait alors de supposer qu’elles seraient fatales à M. Ben Ali, et qu’elles déclencheraient en Tunisie un processus de démocratisation.
M. l’Ambassadeur nous exposera l’état de la situation en Algérie et les causes des émeutes qui y ont eu lieu. En dépit de l’évidente singularité algérienne et de la difficulté d’établir des pronostics, deux questions surgissent d’emblée : d’une part, le scénario tunisien est-il susceptible de se répéter en Algérie et, de l’autre, comment les événements tunisiens ont-ils été accueillis à Alger et dans le reste du pays ? L’audition de M. l’Ambassadeur sera l’occasion de faire le point sur l’état des relations bilatérales entre la France et l’Algérie, avant et depuis ces événements. En effet, en Algérie plus qu’ailleurs, le passé pèse lourdement sur ces relations – comme ne cessent de le répéter les autorités algériennes. Dans les périodes de tension intérieure, en particulier, la rhétorique anti-française connaît une recrudescence soudaine. Cet état de fait entrave l’expression d’une position française sur la politique intérieure de l’Algérie. La France est-elle en mesure de peser d’une quelconque manière sur l’évolution du pays ?
M. Xavier Driencourt, ambassadeur de France en Algérie. En effet, depuis que vous m’avez invité à cette audition, les graves mouvements sociaux que connaissaient l’Algérie et la Tunisie ont rapidement évolué, notamment en Tunisie. En Algérie, ces mouvements ont eu lieu entre le 7 et le 11 janvier. Partis de la capitale, ils se sont largement étendus à l’ensemble des villes du pays, grandes et moyennes, qui ont connu manifestations et saccages : Oran, Annaba, Tiaret, Batna, Biskra, et même Ouargla et Hassi Messaoud.
D’autre part, le mouvement fut très spontané, soudain mais aussi très bref. Dès le 11 janvier, le ministre de l’intérieur déclarait que « la page était tournée ». En outre, dans toutes les villes précitées, les émeutes n’ont touché que certains quartiers précis – notamment, à Alger, les quartiers de Belcourt, Bab El Oued ou encore El Biar, pour prendre l’apparence d’une sorte de « vol de sauterelles » se déplaçant d’un lieu à un autre de manière très concentrée.
Les principaux acteurs de ce mouvement sont de jeunes garçons âgés de 14 à 18 ans environ, qui se sont attaqués à des cibles symboliques : les bijouteries – deux d’entre elles ont été saccagées à El Biar, précisément – et les magasins d’articles de sport, Adidas par exemple, mais aussi les magasins de téléphonie et les garages, y compris Renault et Peugeot. Les classes moyennes, en revanche, n’ont pas participé au mouvement : le samedi 8 et le dimanche 9 janvier, les rues d’Alger étaient désertes.
Officiellement, les manifestations ont fait six morts en Algérie et 863 blessés, policiers pour l’essentiel, ainsi qu’un millier d’arrestations.
Quelles sont les causes de ces manifestations ? Tout d’abord, les prix des produits de base tels que le sucre, la farine et surtout l’huile ont beaucoup augmenté, en raison des événements climatiques des derniers mois. Autre explication : le gouvernement a décidé d’instaurer la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 17 % à compter du 1er avril prochain, ainsi qu’une taxe sur les produits intérieurs de 3 %. Par ailleurs, dans le cadre de sa politique économique visant à lutter contre l’économie informelle, le gouvernement a décidé d’imposer le paiement par chèque pour les montants supérieurs à 500 000 dinars, soit 5 000 euros. Naturellement, cette mesure a, elle aussi, suscité de nombreuses réactions.
A ces causes économiques s’ajoute une toile de fond plus générale : le phénomène de la mal-vie, le désoeuvrement de la jeunesse, frappée par un taux de chômage élevé, le problème crucial du logement dans les grandes villes, notamment la capitale, et la part considérable du logement et de l’alimentation dans le budget des ménages.
Au plan sécuritaire, les autorités ont rapidement répondu aux manifestations en employant une tactique policière de grande retenue. Le nouveau directeur général de la police, qui a succédé à M. Tounsi, est un ancien général de gendarmerie, M. Hamel. D’autre part, la lutte antiterroriste menée pendant une quinzaine d’années a permis aux forces de police et de gendarmerie de disposer de moyens importants, d’acquérir une expérience bien supérieure à celle de la police tunisienne et d’augmenter leurs recrutements, au point que les deux corps comprennent aujourd’hui environ 150 000 hommes, pour une population de 37 millions d’habitants.
Au plan politique, les manifestations n’ont fait l’objet jusqu’à ce jour d’aucune tentative de récupération par les partis politiques, ni par les mouvements religieux. Les prêches du vendredi 9 janvier ont appelé la population à rester calme. Les autorités politiques sont demeurées silencieuses. En revanche, le ministre de l’intérieur, M. Ould Kablia, a été très présent dans les médias.
Venons-en aux différentes interprétations de ce mouvement social. Une interprétation est que les manifestations en Algérie n’auraient rien à voir avec les événements de Tunisie. A preuve : les émeutes n’ont pas duré plus d’une semaine. Elles furent le fait de casseurs motivés par la hausse des prix. Le gouvernement tient à démontrer aux classes moyennes que le calme est revenu, et qu’il maîtrise la situation.
Autre explication possible que l’on entend : ces émeutes reflètent l’âpreté de la politique économique de lutte contre l’informel. Toutes sortes de théories de manipulation et de conspiration circulent aussi, qu’il faut cependant aborder avec la plus grande prudence.
Comment faut-il envisager les manifestations algériennes au regard des événements de Tunisie ? Les deux pays partagent plusieurs points communs, largement médiatisés. Tout d’abord, l’Algérie et la Tunisie sont tous deux dirigées par les mêmes dirigeants depuis un certain temps bien que depuis des dates différentes. Ensuite, dans ces pays, le débat politique est monopolisé par le ou les parti(s) au pouvoir. Enfin, même si le niveau de vie est nettement plus élevé en Tunisie, on observe dans les deux pays des problèmes de logement et de précarité, ainsi qu’un phénomène de mal-être social, aggravé en Algérie par une longue guerre civile, qui pousse d’innombrables haragas, ou migrants clandestins, à traverser la Méditerranée.
N’oublions pas aussi les contacts très denses entre les deux pays par l’intermédiaire des communautés algériennes et tunisiennes en France.
Cela étant, plusieurs différences démarquent l’Algérie de son voisin oriental. Premièrement, le pouvoir algérien est plus diffus et complexe qu’en Tunisie, où le régime était de nature clanique, et même familiale. En Algérie, le pouvoir se partage entre plusieurs cercles ; c’est un système à la fois égalitariste et éclaté dans lequel différents cercles interviennent. Le mécanisme du pouvoir est donc plus compliqué qu’en Tunisie.
Deuxièmement, l’Algérie dispose depuis 1991 d’une presse qui fait preuve d’une étonnante liberté de ton. Si certaines limites ne doivent pas être franchies, la liberté de la presse instaurée voici vingt ans est une réalité. Aujourd’hui, plus de 80 journaux quotidiens paraissent, certains tirant jusqu’à 600 000 exemplaires. Dilem, le Plantu algérien, ne se prive pas, dans ses caricatures, d’attaquer le système.
Troisièmement, les émeutes de Tunisie ont associé de nombreuses catégories de la population : jeunes, avocats, syndicalistes, fonctionnaires ou autres. En Algérie, la plupart des manifestants étaient de jeunes garçons âgés de moins de 18 ans. D’autre part, les revendications des manifestants tunisiens ont d’emblée été d’ordre politique, alors qu’elles n’ont porté que sur la hausse des prix des produits de base en Algérie, sans se transformer à ce jour en revendications politiques. Ajoutons qu’en Algérie, l’émeute est un phénomène assez courant.
Enfin, la principale différence entre les deux pays tient à ce que l’Algérie a connu une guerre civile de quinze années. De ce fait, la population éprouve une réserve, et même une crainte face aux mouvements de rue. Les forces de police et de gendarmerie, fortes d’une longue expérience de la lutte antiterroriste dont elles continuent de payer le prix aujourd’hui, adoptent sans doute une approche sécuritaire plus « subtile » qu’en Tunisie.
On peut donc envisager, partant de là, différents scénarios allant du statu quo à l’« imitation » tunisienne. En tout état de cause, beaucoup dépendra de l’évolution de la situation tunisienne dans les prochaines semaines. De deux choses l’une : soit la Tunisie, d’émeute en émeute, tombe dans le chaos jusqu’à l’élection présidentielle, ce qui effrayera les classes moyennes en Algérie, soit elle opère une transition pacifique vers la démocratie, ce qui aura des conséquences en Algérie, mais il est trop tôt pour savoir lesquelles.
M. le président Axel Poniatowski. Je vous remercie pour cette analyse très intéressante. Vous n’avez pas dit quelles mesures ont été prises par le gouvernement pour que le calme revienne : est-il revenu sur tout ce qui avait été annoncé ou un certain nombre d’augmentations ont-elles subsisté ? Par ailleurs, les troubles en Algérie ont débuté pour des raisons économiques et les augmentations de prix de tous ordres, mais quelle est la raison fondamentale ? Le pays est riche, dispose de réserves importantes, n’est pas endetté. La politique d’autarcie économique qu’il a lancée il y a un an et demi était quelque peu suicidaire. Qu’est-ce qui justifie de telles augmentations des prix et la suppression du crédit à la consommation qui revient à annihiler l’économie ?
M. Jean-Marc Roubaud. Les pillages et les saccages ont touché de nombreux intérêts français. Ceux d’autres pays ont-ils également été touchés ? A votre avis, la crise risque-t-elle de s’étendre au Maroc ? Dans les circonstances actuelles, comment voyez-vous l’avenir de l’Union pour la Méditerranée ?
Mme Marie-Louise Fort. Des critiques ont été formulées contre la France, jugée attentiste en ce qui concerne la Tunisie. Notre pays ne veut pas être accusé d’ingérence ou de néocolonialisme. Quel est le regard de la presse algérienne libre sur la position de la France en Tunisie ? Par ailleurs, quel est le rôle d’Internet et des réseaux sociaux sur la jeunesse algérienne ? Comment comparez-vous la jeunesse algérienne par rapport à la jeunesse tunisienne ?
M. Henri Plagnol. J’associe à ma question M. François Loncle, avec lequel j’effectue une mission d’information sur la sécurité des Français au Sahel. L’Algérie a payé un lourd tribut au terrorisme dans les années 1980 et 1990. Qu’en est-il de la coopération en matière de terrorisme entre les services français et algériens ? Quel est le regard de l’Algérie sur les événements tragiques qui viennent de se produire au Niger et sur le fait qu’AQMI a déclaré que la France était son ennemi principal ? L’Algérie est-elle totalement engagée avec la France ou y a-t-il des arrière-pensées ?
M. Jacques Myard. Vos explications sont conjoncturelles mais l’Algérie a des problèmes structurels de long terme. L’augmentation de la démographie a bouleversé les structures économiques. Encore récemment, 80 % des étudiants diplômés étaient au chômage. Il y a une grave crise de logement qui pèse particulièrement sur la jeunesse ; tout cela constitue le terreau de la radicalisation et de l’extrémisme. Les émeutes vont reprendre et il n’y a pas de solutions à court terme. Il s’agit d’un problème économique structurel de long terme : la libéralisation entraînera la radicalisation. Que pensez-vous de cette analyse ?
M. Paul Giacobbi. Vous avez parlé de statu quo. On a l’impression que ce pays vit une succession de statu quo ante, d’une situation bloquée à une autre, d’années en années. On pourrait très bien à nouveau déclarer le président de la République malade et en profiter pour l’écarter. Combien de temps cela peut-il durer ? Par ailleurs, sur le plan de la sécurité, je me rappelle un voyage effectué il y a quatre ans dans la région de Tizi Ouzou où l’on avait l’impression d’un pays occupé par les forces de sécurité. Qu’en est-il aujourd’hui ? Enfin, une dernière question sur le projet de gazoduc entre l’Algérie et l’Italie, auquel pourrait être connectée la Corse. Savez-vous où en est ce dossier ?
M. Jean-Claude Guibal. Vous avez parlé d’un système de pouvoir à la fois égalitariste et éclaté. Y a-t-il une composante qui exerce plus de pouvoir que les autres ou qui assure l’équilibre ? Qu’en est-il de l’influence des islamistes ? Enfin en ce qui concerne les réserves de change, pourquoi l’Algérie n’arrive-t-elle pas à transformer sa rente en emplois ?
M. Xavier Driencourt. Lors d’un conseil interministériel du 11 janvier, le gouvernement algérien a annoncé le report au 31 août de la création de la TVA à 17 % et de la taxe sur les produits intérieurs de 3 %. En revanche, aucune des autres mesures prises lors des lois de finances complémentaires, notamment la suppression du crédit à la consommation, n’a été retirée.
Le pouvoir d’achat des Algériens a donc subi une forte baisse du fait, à la fois, d’une hausse des prix et de nouvelles taxes. Il faut se souvenir que le salaire de base est seulement de 150 euros par mois, le salaire moyen se situant autour de 300 euros.
Les saccages d’entreprises, perpétrés lors des mouvements sociaux récents, n’ont pas concerné que les sociétés françaises bien évidemment. Ainsi, des garages Ford et Suzuki, de nombreux magasins de sport et d’articles de grande consommation ont été victimes de pillages et pas uniquement des marques françaises.
Je ne connais pas la situation au Maroc mais je crois qu’elle est encore différente de la Tunisie et de l’Algérie.
Sur le projet d’Union pour la Méditerranée, l’Algérie, traditionnellement peu favorable à cette idée, risque de ne pas s’y investir davantage au vu des récents événements.
L’appréciation par la presse algérienne de la réaction française aux événements tunisiens a été critique.
Concernant la jeunesse algérienne, il faut préciser que, certes, 1,5 million de jeunes Algériens sont étudiants mais se pose aussi la question de leur insertion sur le marché du travail, qui reste difficile.
A la question de l’importance des réseaux sociaux et d’Internet pour le mouvement de contestation, je répondrais qu’il s’agit là d’un des facteurs par lesquels les Algériens suivent la situation en Tunisie. Ils soulignent encore davantage l’importance, que j’ai déjà mentionnée, du rôle que pourraient jouer les communautés algérienne et tunisienne en France.
Concernant les raisons structurelles des mouvements actuels en Algérie, il est clair que le phénomène de malaise social est réel.
Toutefois, à la différence des autres pays touchés par ce malaise, l’Algérie a connu quinze années de terrorisme. La société civile algérienne, dès lors peu encline à considérer positivement les phénomènes politiques nés dans la rue, craint de voir le tissu social se déchirer à nouveau, ouvrant la voie au retour du terrorisme.
Au sujet du risque terroriste, il y a eu, en effet, une baisse importante de l’intensité des actions violentes, même s’il y a encore des attentats régulièrement, dans le Nord notamment.
Sur le projet GALSI, je n’ai pas d’information particulière, mais il y a une nouvelle inconnue majeure depuis les changements importants à la tête de la SONATRACH en 2010.
Enfin, concernant l’équilibre des pouvoirs, il y a plusieurs cercles.
M. Jean-Pierre Kucheida. Il y aurait, en Algérie, environ 9 000 émeutes par an : sur quelle période ce niveau a-t-il été atteint ? Quel était leur degré de gravité ? Les entreprises françaises ont-elles été particulièrement visées par les émeutes du début de l’année ? Les islamistes ont-ils été impliqués dans ces mouvements ?
A-t-on une idée – officielle ou officieuse – du nombre de prisonniers politiques en Algérie ? Sait-on combien de personnes fuient chaque année le pays ?
Avez-vous perçu en Algérie des échos de la situation en Tunisie depuis que vous êtes en poste ? Avez-vous été amené à en rendre compte auprès de l’administration centrale ?
M. Robert Lecou. Dans la mesure où la presse est, selon vous, libre en Algérie, dénonce-t-elle l’incapacité des autorités à utiliser la rente gazière au profit de la population ? Comment réagirait-elle si la France donnait des conseils aux dirigeants algériens, notamment en faveur de la libération des prisonniers politiques ?
M. Jean-Michel Boucheron. Trois pays, la Tunisie, l’Algérie et l’Egypte, me semblent actuellement dans une phase historique comparable, ayant chacun à leur tête un dictateur « en fin de course ». Je pense que la Tunisie n’est pas menacée par un risque islamiste, contrairement à l’Egypte. Qu’en est-il, selon vous, de l’Algérie ? Les intégristes vous semblent-ils exercer une influence sur la nombreuse jeunesse algérienne ?
M. Jean-Paul Baquet. Les récents « événements » étaient-ils concentrés dans le nord du pays ou ont-ils touché toutes les régions ? Le pays ne connaît-il pas surtout un choc générationnel, sa population étant composée de jeunes de moins de 25 ans à hauteur de plus de 50 % ? Dans ces conditions, pourra-t-on à nouveau trouver un homme providentiel, alors que, jusqu’ici, ceux qui se sont succédé étaient toujours issus de la lutte pour l’indépendance ?
Vous avez évoqué l’influence que les Tunisiens et les Algériens de France pourraient exercer sur leurs concitoyens restés au pays. N’existe-t-il pas, parallèlement, le risque que les événements au Maghreb aient des conséquences au sein des communautés installées en France ?
Je suis souvent étonné de la capacité des peuples à avoir une mémoire sélective. Ainsi, au Vietnam, les jeunes portent des vêtements exprimant une fascination des Etats-Unis ou de la France, comme si l’histoire avait été oubliée. Qu’en est-il en Algérie ? La mémoire a-t-elle été entretenue auprès des jeunes ?
M. Jean-Paul Lecoq. Il ne faut pas donner plus de signification qu’ils n’en ont aux slogans inscrits sur les vêtements portés par les uns et les autres !
L’intégration des minorités à la société et à la vie politique algériennes a toujours posé problème et ce n’est pas un hasard si le siège de l’AQMI est situé en Kabylie. La jeunesse kabyle a-t-elle eu un rôle particulier pendant les récentes émeutes ?
Dans quelles conditions les entreprises françaises peuvent-elles s’implanter en Algérie ? Quelles contreparties doivent-elles fournir en échange de la possibilité d’exploiter les richesses algériennes ?
M. Jacques Remiller. Etant président du groupe d’étude à vocation internationale sur le Saint-Siège, je sais que, par le passé, les autorités algériennes ont poursuivi et condamné des musulmans convertis au christianisme. Est-ce encore le cas, alors que le phénomène prend plus d’ampleur sous l’influence de missionnaires évangélistes ?
Un certain nombre de cathédrales ont été restaurées récemment, parfois avec l’aide de collectivités locales françaises : la restauration de celle d’Alger a bénéficié de l’aide de la commune de Marseille, Beaune a soutenu le chantier de la cathédrale d’Annaba. Y a-t-il d’autres projets du même type en prévision ?
Enfin, où en est la mise en œuvre du programme visant à restaurer et regrouper les cimetières français d’Algérie ?
M. Xavier Driencourt. Lorsque certains groupes citent le chiffre de 9 000 émeutes, il s’agit d’une moyenne annuelle ; même si ce chiffre est très incertain, l’émeute constitue un phénomène courant. Les entreprises françaises n’ont pas été particulièrement visées pendant les émeutes du début de l’année. Des salariés algériens de plusieurs groupes français sont même intervenus pour protéger les installations de l’entreprise. Il n’y a pas eu de phénomène de récupération par les islamistes : Ali Belhadj, l’un des chefs historiques du Front islamique du salut algérien (FIS), a tenté de se mêler à une manifestation à Alger, mais les jeunes manifestants ne le connaissaient pas !
Les tentatives de départs vers l’Europe dans des embarcations de fortune sont estimées autour d’un ordre de grandeur de 1 000 par an et on constate régulièrement des arrestations et des décès en mer. Les bateaux partent d’Oran vers Alicante et d’Annaba en direction de la Sicile.
Ces derniers jours, la presse a beaucoup commenté les événements en Tunisie, tandis que le gouvernement restait silencieux. Mais ni l’une ni l’autre n’avaient senti venir la chute du président Ben Ali ; tout le monde a été pris de court.
Très régulièrement, la presse francophone mais aussi une partie de la presse arabophone contestent l’utilisation de la rente pétrolière. Les médias sont très sensibles à tout ce qui peut ressembler à une intervention de la France dans les affaires algériennes.
L’attitude des autorités vis-à-vis des Harkis est bien connue.
La question d’un éventuel retour des islamistes sur le devant de la scène est difficile à trancher. Même si les figures du FIS ont été écartées des émeutes récentes, le gouvernement inclut un parti dit « islamiste » en son sein.
Les émeutes ont touché toutes les villes, pas seulement celles de la côte.
Le choc générationnel ne fait aucun doute. La population est très jeune.
Intuitivement, on peut penser que les événements d’Algérie et de Tunisie peuvent avoir des conséquences en France.
La mémoire de la colonisation et de la lutte pour l’indépendance fait partie intégrante du discours politique
Les investissements étrangers en Algérie font l’objet de discussions plus âpres avec les nouvelles mesures adoptées ces dernières années. M. Jean-Pierre Raffarin a été chargé d’une mission visant à faciliter les projets d’investissements français en Algérie.
On observe un phénomène, au demeurant limité, de prosélytisme par des groupes évangéliques, mais l’Eglise catholique, qui constitue l’énorme majorité des Chrétiens en Algérie, ne le soutient nullement.
En décembre dernier, se sont achevés les travaux de restauration de la cathédrale Notre Dame d’Afrique et la restauration de la cathédrale d’Annaba est effectivement en cours. Il n’y a pas, à ma connaissance, d’autres chantiers en projet. Quant à la restauration des cimetières français, un programme franco-algérien prévoyant d’y consacrer 300 000 euros sur cinq ans a été mené à bien et un nouveau programme, de moindre ampleur, va être lancé.
3.- Mercredi 16 février 2011, séance de 9 heures 45, compte rendu n° 37 : table ronde sur les évolutions politiques au Maghreb et au Proche-Orient, en présence de M. Patrice Paoli, directeur d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient au ministère des affaires étrangères et européennes, et de M. Denis Bauchard, conseiller spécial pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient à l’Institut français des relations internationales.
M. le président Axel Poniatowski. Je vous remercie, Messieurs, de bien vouloir tenter avec nous de dresser une analyse prospective de la situation politique au Maghreb et au Moyen-Orient.
L’ampleur et la rapidité des évènements de ces dernières semaines ont surpris. Les diplomaties étrangères ont, pour la plupart, fait preuve de retenue en face de mouvements indiscutablement endogènes. Mais le moment de leur décryptage arrive. Leurs acteurs et les intentions de ceux-ci suscitent des interrogations. Il nous faut aussi analyser les effets et les capacités des gouvernements de transition à répondre aux aspirations de leurs populations.
La question de « l’après » est maintenant posée.
Elle vise d’abord les conditions dans lesquelles une transition politique s’organise en Tunisie et en Egypte, selon quel calendrier et autour de quelles forces politiques. Les autorités de transition font des annonces que l’on ne peut que saluer. Il convient, en face de la pression et de l’impatience populaires, de maîtriser les risques du processus et d’éviter toute dégradation sécuritaire comme, et peut-être surtout, économique.
L’attention se porte aujourd’hui sur les autres États de la région. Sont-ils déstabilisés ? Existe-t-il, ou non, un effet de dominos ? Des protestations s’intensifient dans de nombreux pays, encouragées par le succès des mouvements de Tunisie et d’Egypte. On rappellera aussi la crise politique concomitante dans les territoires palestiniens. Chacun de ces pays présente des caractéristiques propres. Les régimes en place accepteront-ils d’évoluer et sauront-ils le faire ? Quelques signes d’ouverture politique sont à relever en Algérie, au Yémen, en Jordanie et au Maroc. L’opposition iranienne se remobilise pour intégrer le mouvement régional de démocratisation.
Une recomposition géopolitique semble s’amorcer. Quels équilibres régionaux pourraient résulter des changements en cours ?
Les aspirations afférentes au niveau de vie, à la répartition des richesses, à l’emploi et à la sécurité alimentaire sont à l’origine des revendications. Quelles sont les perspectives dans une région qui apparaît aujourd’hui en mal d’avenir ? A cet égard, comment l’aide de la France et de l’Union européenne doit-elle se déployer ?
M. Denis Bauchard, conseiller spécial pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient à l’Institut français des relations internationales. Je m’exprime, bien sûr, à titre personnel. A partir du séisme qui semble se propager, depuis la Tunisie et l’Egypte, à l’ensemble de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, je voudrais d’abord livrer quelques réflexions sur ces deux pays avant d’essayer de répondre à la question de savoir s’il existe, ou non, un effet de dominos.
On relève plusieurs ingrédients communs à la situation de ces deux pays. Un mélange détonnant a brutalement explosé. Il se composait du rejet d’un autocrate vieillissant chargé de tous les maux dont souffrait le pays, chômage, pauvreté, corruption ; de soulèvements spontanés ; d’une classe politique laminée dont il subsistait seulement quelques partis complaisants à l’égard du pouvoir en place ou bâtis autour d’une personnalité, seuls étant structurés les mouvements islamistes – Ennahda en Tunisie et les Frères musulmans en Egypte – ; enfin d’une jeunesse victime du sous-emploi ou cantonnée à des emplois sous-qualifiés alors qu’elle possède souvent des diplômes de l’enseignement supérieur.
Au cours d’un entretien, en juin dernier, avec le ministre de l’industrie tunisien, j’avais été frappé par son inquiétude devant ce phénomène : chaque année, 70 000 jeunes arrivent sur le marché du travail dont 30 000 ne trouvaient pas d’emploi et s’ajoutaient aux chômeurs des années précédentes.
Il faut aussi signaler l’influence des nouvelles technologies de la communication, qui représentent non seulement des moyens d’information en temps réel et hors du contrôle du gouvernement, mais aussi des moyens de mobiliser la population et d’organiser les manifestations.
On notera cependant des différentes importantes entre les deux pays. En Tunisie, le mécontentement de la population s’est focalisé sur le président Ben Ali, son clan familial et son régime, tandis qu’en Egypte, il s’est concentré sur la personne du président, sans remettre en cause le régime, sauf partiellement vers la fin de l’occupation de la place Tahrir.
Les mouvements islamistes sont également différents. En Egypte, les Frères musulmans constituent une organisation ancienne et bien structurée, disposant de relais importants, notamment de réseaux sociaux, de dispensaires, de systèmes d’aides quadrillant le territoire, ce qui n’est pas le cas d’Ennahda.
Enfin, l’armée ne joue pas du tout le même rôle. En Tunisie, il s’agit plutôt d’une gendarmerie, aux effectifs modestes, alors qu’en Egypte, elle est au cœur du pouvoir, disposant d’effectifs très importants – près de 500 000 hommes –, détenant tous les leviers politiques et les postes sensibles, la plupart des leviers administratifs – les deux tiers des gouverneurs sont d’origine militaire – ainsi qu’un certain nombre de leviers économiques, dans le secteur public et plus récemment dans le secteur privé.
Le déroulement des récents évènements a obéi à deux scénarii distincts. En Tunisie, celui d’un basculement brutal, intervenu en quarante-huit heures, encore mal expliqué, assorti d’une épuration et de la construction d’un nouveau régime, dans un contexte de troubles sociaux et politiques qui se poursuivent. Il en va tout différemment en Egypte : l’armée contrôle la situation. L’armée souhaitait que le président Hosni Moubarak puisse se maintenir jusqu’à la fin de son mandat, en septembre. Sous la pression de la population et, peut-être aussi des États-Unis, le scénario s’est accéléré. La constitution a été suspendue. L’armée a pris officiellement le pouvoir, sous la forme d’un Conseil suprême des forces armées. Nous en sommes encore au stade des promesses, avec un calendrier encore incertain.
Dans les deux cas, spécialement en Egypte, la population s’inquiète du risque de confiscation de sa révolution.
Peut-on parler d’effet de dominos ? Le monde arabe compte 22 pays, avec des différences de situation considérables. De la Mauritanie au Qatar, en passant par le Soudan, les disparités sont immenses, en termes de régime politique, de liberté d’expression et de niveau de vie. L’écart de revenu par habitant est ainsi de l’ordre de 1 en Mauritanie à 40 au Qatar. De nombreux pays de cette zone sont déjà fragiles pour bien des raisons : certains servent de champ de bataille ou connaissent des crises plus profondes, tels que le Liban, l’Irak et les Territoires palestiniens. D’autres souffrent de graves problèmes de politique intérieure : ainsi de Bahreïn, où la majorité de la population est chiite alors que les dirigeants sont sunnites ; du Yémen, en proie à des risques de sécession, à une implantation du terrorisme par Al-Qaida et à la révolte de tribus contestant le pouvoir central ; de l’Algérie, où depuis 20 ans, et après une guerre civile, l’armée continue d’assurer le contrôle de la situation sans que les problèmes sociaux aient été résolus ; enfin du Maroc, qui mène activement des réformes économiques et, dans une moindre mesure, politiques.
Nous sommes face à une nouvelle donne. La double crise, tunisienne et égyptienne, a fait ressortir l’ampleur du problème de l’emploi des jeunes dans cette zone. La Banque mondiale évalue à 100 millions le nombre d’emplois qu’il faudrait créer d’ici à 2030. La jeunesse est imprégnée par la politique, avec une nouvelle génération à la fois plus éduquée et mondialisée, très à l’aise dans le maniement des outils numériques comme internet.
La politique américaine a retrouvé ce qu’on appelle « le syndrome du shah » : son soutien à certains régimes n’est pas indéfectible. C’est surtout vrai de l’Egypte : le président Obama a personnellement – ce qui est très étonnant –accompagné et commenté le mouvement. Il a envoyé sur place le chef d’état-major des armées ainsi que de hauts responsables du département d’État afin d’exercer des pressions sur les militaires égyptiens. Dans quelle mesure ces interventions ont-elles été efficaces ? La réponse doit être nuancée.
Nulle part, ou presque, dans le monde arabe, il n’existe d’opposition politique structurée. Seuls les mouvements islamistes sont organisés. Les Frères musulmans sont présents dans plusieurs pays : en Egypte, dans les Territoires palestiniens, en Syrie et, plus généralement, au Proche-Orient. En Irak, les mouvements islamistes sont également influents qu’il s’agisse des sadristes ou du Conseil supérieur islamique.
Dans tous les pays arabes, l’armée et, plus spécialement, les services de renseignement, jouent un rôle essentiel. Toute solution à un problème politique passe par l’armée, soit qu’elle laisse faire les choses, soit qu’elle maintienne son propre pouvoir, comme ce sera probablement le cas en Egypte.
Mais partout s’organise aussi une société civile, avec un développement considérable des associations, dans les domaines caritatif, humanitaire et plus récemment politique. Les professions libérales – avocats, médecins – tiennent une place importante. Une classe moyenne se met en place, importante en Tunisie, moindre en Egypte, presque inexistante dans des pays comme le Yémen. Mais la tendance de fond existe.
Les récents événements auront des répercussions géopolitiques. Dans une région déjà caractérisée par de fortes turbulences, certains pays ont raison de s’inquiéter. Israël a signé des traités de paix avec deux de ses voisins mais, conclus entre États, ceux-ci ne bénéficient pas de l’appui des populations tant jordaniennes qu’égyptiennes, qui continuent de considérer l’État hébreu de façon hostile. Toute évolution dans le sens de la démocratisation risque de refléter cet état d’esprit.
Quels scenarii pour l’avenir ? Les prévisions sont difficiles dans des régions aussi instables que l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient. La seule certitude réside dans la poursuite de la pression exercée par les populations. Va-t-on assister à un printemps arabe généralisé, faisant tomber les autocrates les uns après les autres et installant des régimes démocratiques ? On peut en douter. La démocratie résulte d’un long apprentissage et comporte plusieurs éléments : des élections libres, un État de droit, des libertés fondamentales. Dans la plupart des pays considérés, nous sommes encore loin du compte.
Pourrait-on, à l’inverse, assister à un renforcement des autocrates qui, par le jeu de la carotte et du bâton, entre promesses et répression, se maintiendraient au pouvoir ? C’est possible et déjà observé dans certains pays comme en Irak.
Un autre scénario serait l’instauration de l’ordre islamiste : grâce à la démocratie, leurs mouvements obtiendraient la majorité des voix, ou du moins une partie importante des suffrages, et participeraient au gouvernement. Je ne crois pas à une formule générale mais il s’agit d’un risque à assumer.
Le dernier scénario serait celui du chaos généralisé, s’ajoutant à celui déjà constaté dans certains pays.
Les aspirations démocratiques et l’ouverture au monde représentent une tendance lourde mais la route sera longue et probablement à l’ombre des armées.
M. le président Axel Poniatowski. Nous sommes en train de préparer une mission parlementaire en Tunisie, que je conduirai avec un représentant de chacun des groupes, soit cinq membres au total. Elle devrait se dérouler avant la fin mars.
M. Patrice Paoli, directeur d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient au ministère des affaires étrangères et européennes. Je me réjouis de cette initiative car nous devons manifester notre soutien à cette démocratie en gestation.
Pouvait-on prévoir les évènements ? Non. Nous connaissions les ingrédients de la situation en Tunisie, notamment le contexte économique : nous savions que les débouchés manquaient aux jeunes diplômés, qu’un écart de développement existait entre les côtes et l’intérieur du pays, enfin qu’une insatisfaction politique existait face à un régime qui était l’un des plus policiers de la région. Mais, précisément, avec un policier tous les dix mètres, nous ne pouvions imaginer que les éléments précités se cristalliseraient dans un tel mouvement de révolte. Nous avons affaire à un phénomène nouveau : le soulèvement n’est pas venu des forces hostiles au régime, il n’existait ni opposition islamiste ni opposition politique, le syndicat unique était aux ordres du gouvernement. Le mouvement, extrêmement rapide, a utilisé des moyens nouveaux : les sites officiels furent pris d’assaut par des internautes. Nous avons donc vu sauter le bouchon de champagne là où l’on estimait qu’il ne pouvait pas sauter, en raison du quadrillage du pays.
Le message est donc extraordinairement subversif : dans un pays où il n’existait aucune possibilité d’expression, aucun relais pour les mécontentements, aucun véritable syndicat – même si, depuis lors, l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) s’est divisée en deux – et aucun parti politique, une révolution cependant s’est produite. L’évènement peut se comparer avec la révolution iranienne de 1979.
La révolution tunisienne a, pour toile de fond, un certain nombre de phénomènes qu’il va nous falloir prendre en compte.
En premier lieu, l’augmentation du prix des produits de première nécessité, compte tenu de la pénurie générale de produits alimentaires. Devons-nous répondre à ce phénomène par des subventions ? Pourrons-nous procéder à des ajustements structurels ? Comment traiter politiquement les crises sociales ?
En second lieu, l’accélération de l’information, qui touche tous les pays dans le monde : Internet sert aujourd’hui d’instrument de mobilisation rapide d’acteurs qu’on ne connaissait pas et qu’on ne connaît pas encore très bien, comme on l’a vu au centre de la place Tahrir au Caire et dans l’avenue Bourguiba à Tunis : des personnes immatérielles qui, néanmoins, pèsent sur l’évènement sans induire de rapport de forces physique.
Contribuent au même phénomène les télévisions par satellite. Al Jazeera, chaîne militante, n’a cessé de mentir sur la réalité de la situation, aggravant les choses en diffusant des zooms, par exemple, sur la place Tahrir pour augmenter l’impression de masse, tandis que Al Arabiya, plus modérée, présentait une vision en grand angle montrant que la place n’était pas toujours pleine. On ne peut nier qu’il y ait eu manipulation.
Cette réalité nous contraint à reconsidérer notre propre politique audiovisuelle, notamment en direction du Maghreb.
« Effet de dominos » est une mauvaise expression : facile pour poser la question, elle ne permet pas d’y répondre. Nous nous trouvons plutôt en présence d’un « effet tâche d’huile » : la révolution tunisienne est déjà dans tous les esprits. Chacun a désormais conscience que le mur de la peur est tombé, qu’on peut s’exprimer et que, avec des moyens encore hier inenvisageables, voire inexistants, on peut changer les choses en se mobilisant.
Les mécanismes qui ont joué en Egypte sont différents de ceux qui ont joué en Tunisie. Des éléments économiques et politiques s’étant cependant conjugués, quels éléments permettraient de produire un résultat analogue dans d’autres pays ? Les structures n’étant pas partout similaires, les mêmes causes ne produisent pas nécessairement les mêmes effets. Les monarchies paraissent mieux armées car leur légitimité est, généralement, moins facile à remettre en cause que celle des républiques. Ainsi, dans le débat qui se déroule au Maroc, le régime n’est pas contesté en lui-même. En Jordanie, on note cependant quelques premières atteintes à la dignité de la monarchie mais à travers des attaques contre le comportement de la reine, épouse d’Abdallah II. Au royaume de Bahreïn, où l’activité politique est intense, le criant déficit de démocratie suscite le mécontentement des chiites qui, démographiquement majoritaires, restent minoritaires au Parlement. Car les peuples ne se mettent pas forcément en mouvement parce qu’ils ont faim ou pour des raisons économiques. Il nous faut donc appréhender leurs aspirations en sachant les doser.
Nous ne pouvons pas prévoir ce qu’il adviendra demain dans tel ou tel pays. Nous pouvons seulement dire quels sont les éléments d’analyse et identifier les moyens de résistance des gouvernements et des sociétés. Mais nous ignorons si des systèmes d’alerte sont plausibles.
Pour notre part, quelle politique mener ? La Tunisie a ouvert un débat que l’on croyait fermé : oui, il est possible de changer de régime. On l’a vu autrefois avec la révolution islamique en Iran, montrant à tous les musulmans du monde qu’on pouvait se débarrasser du syndrome Mossadegh, c’est-à-dire d’un régime imposé par des puissances étrangères, États-Unis et Grande-Bretagne. Les sunnites se sont donc posé la même question : pouvons-nous suivre le même chemin que les chiites et restaurer notre dignité ?
On ne peut considérer les révolutions tunisienne et égyptienne en dehors du contexte régional. Au Liban, la récente éviction de Saad Hariri et la mise en place d’un nouveau gouvernement, avec Najib Mikati, représente la victoire d’un camp. Elle paraît de nature à modifier l’équilibre trouvé à Doha en 2008, cette fois au profit du Hezbollah, de l’Iran et de la Syrie.
Ainsi, bien qu’indépendants l’un de l’autre, deux facteurs se conjuguent : ce qui est perçu comme une défaite des Occidentaux au Liban et la mise à l’écart de deux responsables politiques considérés comme leurs alliés, Ben Ali et Moubarak.
Quelle démocratie voulons-nous dans ces pays ? Sommes nous prêts à en jouer pleinement le jeu ? Le spectre de l’islamisme, souvent brandi par les journaux, tend à stopper net le débat. Or, les islamistes ne sont pour rien dans la révolution tunisienne, pas plus d’ailleurs que les autres partis. Doit-on alors faire confiance aux véritables acteurs de la révolution, les encourager et considérer qu’ils sont politiquement mûrs ? Les Tunisiens ne demandent pas qu’on leur procure un Bourguiba plus jeune et débarrassé du clan Trabelsi, pas plus que les Egyptiens ne veulent d’un Moubarak junior. Ils réclament l’instauration de la démocratie. Est-ce possible ? Peut-on intégrer les islamistes ? Doit-on se débarrasser du syndrome algérien de 1992, quand nous fûmes soulagés, peut-être lâchement, peut-être à juste titre, par l’annulation d’élections qui auraient amené une majorité islamiste au pouvoir ? C’était le syndrome turc, celui d’une armée qui défend les institutions. Entre temps, la Turquie a changé de politique. Elle fournit dorénavant l’exemple d’un pouvoir directement inspiré par les Frères musulmans, et pourtant capable de jouer le jeu de la démocratie. Nous devons donc nous mettre en état de parler avec l’ensemble des acteurs et, par exemple en Tunisie, de faire confiance à une société civile qui, déjà apparue au temps de Bourguiba, peut faire la preuve qu’il existe une autre alternative que celle de la dictature et de l’islamisme.
L’Europe veut-elle mener une politique de voisinage tournée vers le Sud, alors même que son balancier l’oriente aujourd’hui vers l’Est ? Le débat est important. Sans doute, et sans négliger bien sûr notre frontière orientale, faudra-t-il accorder une part substantielle de notre action à la zone méditerranéenne et proche-orientale.
Toutes ces idées sont actuellement en discussion au sein du ministère des affaires étrangères.
Si la Tunisie et l’Egypte deviennent de véritables démocraties, nos interlocuteurs seront moins dociles. Longtemps, nous nous sommes abstenus de considérer la nature des régimes politiques, dès lors que nos intérêts politiques et économiques se trouvaient protégés. Demain, comme nous le vivons déjà avec la Turquie ou le Brésil, des démocraties nouvelles pourraient se montrer plus malcommodes, un peu comme des ennemis de classe potentiels. Il faut en prendre conscience.
Cela nous amène à considérer la position d’Israël, seule nation démocratique de la région et sans doute appelée à revoir sa stratégie pour tenir compte des évolutions à venir.
M. Jean-Paul Lecoq. M’étant rendu à Tunis en octobre dernier, j’ai rencontré les partis d’opposition – car il en existait, y compris un parti communiste clandestin – et indiqué à notre ambassadeur que des forces s’organisaient. On ne s’attendait pas pour autant à une révolution mais on percevait tout de même un désir de démocratie, et l’amorce d’un mouvement qui englobait l’opposition tolérée par le régime.
Ces partis essaient aujourd’hui de mettre en place des institutions qui permettent, selon leur expression, d’éviter un nouveau Ben Ali. Pour eux, la démocratie française est un exemple.
Comment s’opère aujourd’hui l’analyse du gouvernement français sur la situation en Méditerranée ? Quel rôle doit tenir l’Europe vis-à-vis du Maghreb ? Allons-nous jouer « d’égal à égal » avec les nouvelles démocraties ?
Il semblerait qu’en Egypte, les citoyens doivent dorénavant assumer des missions qui relevaient jusqu’ici de l’État, comme l’école ou l’hôpital. Dans ces conditions, des organisations telles que les Frères musulmans, ne vont-elles pas prendre le relais, créant un autre type d’économie et de pouvoir, comme une sorte d’État parallèle, brouillant les responsabilités collectives ?
M. Robert Lecou. Il semblerait que les États-Unis, et le président Obama, aient exercé une très forte pression en Egypte. Pouvez-vous apporter des précisions sur ce point ?
Que devient l’Europe dans cette affaire, continent voisin et pourtant inexistant ?
Que devient, dans ce contexte, l’Union pour la Méditerranée, que nous avions regardée comme un projet d’avenir ? Il fut bloqué par le problème des relations d’Israël avec les pays arabes. Ne faut-il pas réanimer cette démarche ?
M. Patrice Paoli. Les populations tunisienne et égyptienne, en dehors des partis, ne veulent pas voir leur révolution confisquée. Elles attendent un changement d’institutions, et non un simple réaménagement. En Égypte, les Frères musulmans se sont assis, avec les autres organisations politiques, à la table des négociations. Les seuls absents sont les acteurs de la place Tahrir, qui ne se contenteront pas de demi-mesures.
Dans quels délais se feront les changements de constitutions ? Une commission a été mise en place à cet effet en Egypte comme en Tunisie. La France et l’Europe doivent soutenir le processus, mais sans se poser en donneurs de leçons apportant des formules toutes faites.
Les États-Unis se sont trouvés aussi désemparés que nous devant l’accélération des événements. Ils ont tenté de s’adapter aux réalités. Un des dangers de la vie politique internationale, c’est de faire des déclarations trop rapides de peur d’être dépassé par l’actualité. Le discours tranché de Barak Obama n’est intervenu qu’après coup.
Au sein de l’Union européenne, les positions étaient diverses. Le Royaume-Uni militait fortement en faveur du changement. Il faut aujourd’hui que l’Europe trouve sa place. Elle est d’ailleurs déjà présente : Mme Ashton, Haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, s’est rendue à Tunis et a fait une tournée dans la région. Mais il serait dangereux de se manifester trop visiblement à un moment où nos interlocuteurs changent.
Des ministres français vont prochainement se rendre en Tunisie, mais il faut se garder de toute précipitation.
D’autre part, on connaît très mal l’armée égyptienne. Lorsque ses hommes reviennent de formation aux États-Unis ou dans d’autres pays occidentaux, ils deviennent inaccessibles, démontrant une forte cohésion et une grande opacité de l’institution militaire, appelée à jouer un rôle fondamental.
Présidence de Mme Martine Aurillac, vice-présidente.
M. Jean-Marc Roubaud. Notre réseau diplomatique ne s’est-il pas trouvé en faute en ne prévoyant pas ce qui allait se passer en Tunisie et en Egypte ?
Existe-t-il un risque de propagation des révoltes au territoire français et européen ?
M. Jacques Remiller. L’armée est, bien entendu, au centre du pouvoir en Egypte. Son chef, Hussein Tantaoui, présidant le conseil supérieur des forces armées, s’est exprimé hier soir. Il a demandé à la commission chargée de la réforme des institutions de rendre sa copie dans les dix jours et annoncé que cette réforme serait soumise à referendum dans les deux mois suivants.
Pouvez-vous nous fournir des précisions sur la situation en Algérie ? Son régime risque-t-il de subir le même sort que ceux de la Tunisie et de l’Egypte ?
Pouvez-vous enfin nous parler de ce qui se passe au Sahara occidental ?
M. Denis Bauchard. Au cours de ces événements, Les États-Unis ont assuré une forte présence médiatique qui avait aussi, et peut-être surtout, une finalité de politique intérieure. Leur pression fut réelle mais, du côté égyptien, la réaction nationaliste a été très vive, à hauteur de l’esprit de corps de l’armée que nous avons évoqué. Les États-Unis ont-ils contribué à accélérer le processus ? Peut-être, mais c’est la pression de la population qui a été décisive.
L’armée égyptienne avait souhaité un départ plus ordonné du président Moubarak, qui vient de ses rangs. Toutefois, il ne s’est pas déroulé dans les mêmes conditions que celui du président Ben Ali. Et il n’est pas question pour le moment d’engager des poursuites contre lui.
L’inexistence de la diplomatie européenne constitue un réel problème, mais dans un contexte aussi mouvant, il était très difficile à Mme Ashton de trouver le mot juste sans un minimum de concertation préalable avec les principaux États membres, difficile à organiser.
L’Union pour la Méditerranée est, en effet, bien malade. Mais elle l’était déjà : le conflit israélo-palestinien reste pour elle un abcès de fixation. Il a suffi de l’intervention israélienne à Gaza puis de l’arrivée d’un nouveau gouvernement beaucoup moins conciliant pour que sa mission devienne très difficile. Le sommet prévu a été reporté sine die.
Le calendrier de la mise en place des nouvelles institutions en Tunisie et en Egypte reste imprécis malgré les assurances qui ont été données. Dans ce dernier pays, certaines forces estiment qu’il leur faut au moins un an pour s’organiser. Demeure également une incertitude sur le référendum, à tout le moins sur la responsabilité de la préparation de la révision de la Constitution. Le comité qui en est chargé intégrera-t-il des éléments de l’opposition ? On peut craindre que les militaires cherchent à conserver le processus en vase clos, sans véritable dialogue avec les éléments les plus représentatifs de la population.
M. Patrice Paoli. Je ne pense pas que les services diplomatiques aient commis une faute par imprévision. Comme chacun sait, il est plus facile de prédire le passé que l’avenir. Nous connaissions, je le répète, les éléments de la situation en Tunisie mais leur combinaison a eu des conséquences tout à fait inattendues, dans un pays où la police elle-même n’a rien vu venir, et dont toute l’opposition était réfugiée en France ou dans d’autres pays occidentaux. Depuis lors, notre analyse s’est orientée vers des données nouvelles, inconnues à l’époque précédant la révolution.
En Algérie, les ingrédients sont différents. La capacité de mobilisation populaire paraît assez faible. Les mouvements restent locaux, touchant surtout la Kabylie. Les policiers sont plus nombreux que les manifestants. Les quelques personnes arrêtées ont été relâchées.
En Egypte, on a observé une privatisation de la demande sociale : l’État ne répondant pas aux besoins collectifs, la société les prend directement en charge, notamment dans les domaines de l’enseignement et de la santé. Ce qui explique d’ailleurs la faible participation aux élections dans ce pays : on ne demande rien à l’État, du coup, on ne vote pas. En Algérie, au contraire, l’État apporte beaucoup : la répartition sociale va très loin, même pour des sommes modiques, comme la pension servie aux moudjahid.
La dernière grande révolte en Algérie remonte à octobre 1988. Peut-elle se reproduire en regroupant tous les facteurs de mécontentement ? Le pays connaît des émeutes presque quotidiennes mais très ponctuelles : on manifeste, par exemple, contre un programme local de logements jugé insuffisant. Dispersées, les différentes demandes ne s’agrégent pas dans une demande sociale et politique forte, même si ce potentiel existe. De plus, l’État algérien est riche grâce au niveau atteint par le prix du baril de pétrole. Ses disponibilités s’élèveraient à environ 150 milliards d’euros. Il peut donc, comme en janvier dernier, apporter une réponse financière à certaines revendications.
À la suite des évènements de 1988, des réformes, notamment sociales, avaient été demandées à l’Algérie : elles ont été arrêtées en 1993 avec la vague terroriste et oubliées par la suite. Le régime algérien, clientéliste, empêche l’éclosion d’activités privées car celles-ci représentent, d’une façon ou d’une autre, une contestation du pouvoir. Il en résulte une certaine forme d’infantilisation du citoyen. Que peut-il se passer ? Une agrégation des revendications, comme celle de 1988, n’est pas à exclure mais elle me paraît peu probable à court terme. On voit cependant fleurir de nouveaux slogans politiques.
La situation au Sahara occidental n’évolue pas. Le blocage est total entre le Maroc et l’Algérie. On voudrait parvenir à un compromis mais aucune des deux puissances ne fera le premier pas, le Maroc estimant qu’une concession de sa part n’entraînerait aucune contrepartie du côté algérien. M. Christopher Ross, envoyé par le Secrétaire général de l’ONU, a beau évoquer la nécessité d’incorporer les notions de droits de l’homme ou de démocratie dans le territoire sous contrôle marocain, nous sommes en face d’un mur bilatéral.
M. Michel Destot. Vous avez souligné l’influence de la question économique, notamment le chômage massif des jeunes, dans l’explosion en Tunisie et en Egypte. Peut-on dire qu’au sein de l’armée et dans la société civile, il existe, au-delà des revendications démocratiques, une préoccupation d’ordre économique et social ?
Quel type de coopération suggérez-vous de développer entre, d’une part, la France et les autres pays européens, d’autre part les pays du Maghreb ?
M. Michel Vauzelle. Les dirigeants européens, de droite comme de gauche, vont souvent passer leurs vacances dans des pays du sud de la Méditerranée, ce qui ne porte guère chance à leurs régimes, comme on l’a vu avec M. Ben Ali et avec M. Moubarak. Notre président de la République s’est rendu au Maroc mais, heureusement, le roi occupe là-bas une position solide. Il faudrait donc demander à nos gouvernants de ne plus se rendre dans des pays auxquels nous voulons du bien.
La préoccupation de l’Europe, exprimée par sa « ministre des affaires étrangères », est apparue bien tardive, surtout par rapport à une UpM qui, pour la deuxième fois, a gâché les espérances placées dans le premier puis dans le second processus de Barcelone. Avec les pays du sud de la Méditerranée, nous ne sommes pas « en voisinage » mais bien en cohabitation lorsque la moitié d’une famille vit à Alger tandis que l’autre habite à Marseille. Ce qui se passe aujourd’hui chez eux se passera un jour en France. Il ne faudrait pas regarder la région comme une banlieue de l’Europe et se préparer à riposter par la violence comme nous le faisons parfois dans les banlieues de nos villes, en postant des canonnières dans les détroits méditerranéens.
Si nous ne voulons pas intervenir dans les affaires de pays indépendants, comme par exemple au Mexique, il faut disposer d’un plan de coopération économique et sociale permettant aux jeunesses de ces pays de trouver des emplois, sans que nous nous ingérions dans leurs cheminements nationaux vers la démocratie. Je regrette donc que l’UpM ait sombré et que nous en soyons à rechercher, tardivement, un troisième processus de Barcelone.
M. Jean-Louis Christ. Une délégation parlementaire s’est récemment rendue au Maroc afin d’évaluer la situation du pays, et de renforcer le partenariat avec la France. Le Premier ministre, Abbas El Fassi, nous a indiqué que des réformes étaient en cours afin de moderniser le royaume mais il a précisé que celui-ci perdait 2 % de croissance en l’absence d’intégration économique du Maghreb. Quelle analyse faites-vous de l’actuelle situation du Maroc ? Des facteurs de révolution y sont-ils repérables ?
Mme Marie-Louise Fort. Au cours d’une période récente, la Turquie a manifesté quelque velléité de jouer un rôle dans la résolution de conflits régionaux. La révolution égyptienne a-t-elle eu des incidences sur la position turque ?
La révolution tunisienne, notamment, semble avoir exalté des valeurs de liberté et de progrès. Mais un nombre élevé de jeunes sans emploi continue de quitter le pays, pour un sort souvent aléatoire, alors que l’espérance nouvelle devrait les inciter à y rester afin de le reconstruire. Pourquoi la révolution ne parvient-elle pas à les retenir chez eux ?
M. Denis Bauchard. La Turquie joue un rôle politique croissant au Moyen-Orient, mais ses intérêts ne coïncident pas forcément avec ceux de l’Occident. Elle intervient dans plusieurs dossiers, notamment ceux de l’Iran et des rapports israélo-palestiniens. Elle occupe aussi des positions économiques très fortes, particulièrement en Irak où elle comble pour partie le vide laissé par les autres pays. Cette politique va se poursuivre. Concernant l’Egypte, le Premier ministre, Tayyip Erdoģan, avait clairement pris parti en faveur des manifestants et demandé le départ de Moubarak.
Le Maroc se caractérise par la coexistence d’éléments de vulnérabilité et de force. C’est d’abord un des pays arabes où les inégalités de revenus sont les plus grandes, avec des poches de pauvreté non seulement dans le sud mais aussi dans les grandes agglomérations, y compris à Casablanca où des bidonvilles jouxtent presque le centre de la ville. Le taux d’alphabétisation de la population est très faible mais, paradoxalement, se pose aussi le problème du chômage des jeunes diplômés. En revanche, la politique du roi, et de son gouvernement, traduit un dynamisme certain et sa légitimité, reconnue même par le parti islamiste, le PJD, joue en faveur de la stabilité des institutions.
M. Patrice Paoli. Il faut être conscient de ce qui nous échappe quand nous nous interrogeons sur la politique à mener : on ne peut faire le bien des Algériens contre l’action de leur gouvernement. C’est ce qui explique que notre politique algérienne ne soit pas propice à l’expansion de l’initiative privée. D’ailleurs, en l’absence de système bancaire, il est difficile d’y créer une entreprise. Le problème est de savoir comment compenser éventuellement la défaillance de l’État et comment définir notre demande, au-delà de celle de l’Union européenne, à l’égard de ce pays.
Nos programmes sont souvent excellents. Pour peu qu’ils s’articulent avec un pouvoir plus acceptable, ils seront tout à fait adaptés, puisqu’ils portent sur l’emploi et la formation des jeunes, notamment au métier d’ingénieur. Notre action n’est peut-être pas suffisante, mais nous n’avons pas à en rougir. Pour faire plus, l’Union européenne, qui manque de visibilité, doit trouver en face d’elle un interlocuteur qui réponde à ses questions, car son propos n’est pas d’imposer une solution. Si elle ne fait pas assez entendre sa voix, c’est parce qu’elle doit encore mettre au point son système de gouvernance. Le service européen pour l’action extérieure n’est pas à pied d’œuvre, bien que Mme Ashton prenne peu à peu sa place et, même si l’UpM reste un projet d’avenir, elle reste inexistante.
À propos du Maroc, vous avez évoqué ce que les chercheurs nomment le « coût du non-Maghreb ». L’intégration régionale favoriserait la croissance, mais les pays restent tributaires d’une vision Nord-Sud et, faute d’une vision Sud-Sud, ne travaillent que très peu ensemble.
Le mouvement qui se dessine au Bahreïn est essentiellement politique. De même, les aspirations des manifestants de la place Tahrir étaient moins économiques que politiques : ils ont d’abord voulu changer le régime et les règles du jeu. Quant au régime marocain, qui a sa légitimité, il a su mettre en place des garde-fous.
S’il ne nous appartient pas de trouver le moyen de retenir les jeunes dans leur pays, nous devons éviter que nos consulats ou nos ambassades deviennent des forteresses d’où l’on jetterait de l’huile bouillante à l’approche des Sarrasins. Pour cela, il faut trouver un équilibre entre notre politique et celle des pays concernés. Le départ en masse vers Lampedusa tient à ce que les policiers tunisiens ont cessé de contrôler les frontières, offrant à une population attirée par l’extérieur le moyen d’émigrer.
M. Jean-Paul Dupré. Le désir d’accéder à la liberté d’expression en même temps qu’à un emploi ne risque-t-il pas, en cas de déception, de glisser vers le chaos ou vers une forme de radicalisation ?
M. Jean-Luc Reitzer. À l’euphorie de la révolution risquent de succéder des revendications sociales. Quelle est à présent l’attitude de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), qui a participé activement à la chute de Ben Ali ? Ce syndicat s’en tiendra-t-il à une vision sociale ou cherchera-t-il à transformer l’essai en devenant acteur de la vie politique ?
Pour éviter l’effet de tache d’huile, l’Autorité palestinienne a annoncé des élections législatives et présidentielles en septembre, mais le Hamas, qui n’entend pas y participer, refusera de les organiser sur son territoire. Que penser de son attitude ? En Cisjordanie, tiendra-t-il en face d’une population qui pourra s’exprimer démocratiquement et qui connaît, comme celle de la bande de Gaza, d’importantes difficultés sociales ?
M. Hervé de Charette. Quelles sont les conséquences prévisibles des récents événements sur les relations entre Israël et la Palestine ?
Quelle est la situation de Bahreïn, premier pays du Golfe auquel se soit étendue la crise ?
Enfin, la nouvelle politique dont la France a besoin dans la région se décidera-t-elle dans les bureaux de l’Élysée, avec le concours éventuel du ministère des affaires étrangères ? Dans ce vase de plus en plus clos, notre commission et celle du Sénat auront-elles leur place ou sont-elles condamnées à n’être que des académies diplomatiques ?
M. Michel Terrot. M. Paoli a laissé entendre que la propagation des événements serait moins importante dans les monarchies que dans les républiques, mais qu’en est-il en Libye, où des manifestations se sont déroulées hier ? La militarisation du régime est-elle de nature à le protéger ? Par ailleurs, à terme, les éléments déstabilisateurs peuvent-ils avoir une influence sur la bande sahélienne où s’est implanté le terrorisme ?
M. Patrice Paoli. L’UGTT s’est scindée lors de la révolution, créant ainsi un relais qui faisait défaut. Certains de ses membres entendent structurer leur action autour d’un nouveau parti. D’ailleurs, on a probablement sous-estimé l’influence des partis en Tunisie. Ceux de gauche ont pu faire alliance avec des éléments islamistes, lesquels, n’étant l’apanage ni de la droite ni de la gauche, sont entrés en relation avec tous les partenaires ouverts au débat. Nous devons observer attentivement ces recompositions. L’UGTT pourrait être amenée à jouer un rôle, tandis que les personnalités que nous considérions autrefois comme les porte-voix de l’opposition ont été balayées : les Tunisiens leur demandent où ils étaient pendant la révolution.
La question de l’avenir de la Palestine et du Hamas doit être posée de manière plus politique qu’électorale. Que donner à ceux qu’on soutient pour leur permettre de prouver qu’ils ont fait le bon choix ? Sommes-nous capables d’aider Mahmoud Abbas à montrer qu’il a bien fait d’opter pour la modération et la paix ? Les Israéliens ont-ils pris la mesure de ce qu’il faut accorder à leur partenaire pour la paix, afin de le crédibiliser ? Les élections risquent d’ouvrir une crise de légitimité, au moment où, Al Jazeera organise des fuites qui mettent en cause le pouvoir de Mahmoud Abbas et du Premier ministre Salam Fayyad.
Cependant, on peut aussi imaginer que l’évolution de la situation n’ait aucun effet sur les rapports entre Israël et la Palestine. La pression américaine qui s’exerce sur les différents acteurs tend vers zéro, et aucun interlocuteur arabe de poids n’est en mesure d’intervenir. La balle est donc dans le camp des Israéliens. Mais ceux-ci ont-ils compris qu’un accord politique avec la Palestine, sur le modèle de celui d’Oslo, servirait leurs intérêts à long terme ?
Dans le Golfe, plusieurs pays semblent instables. À Bahreïn, qui n’est pas une monarchie constitutionnelle au sens fort, la majorité se sent discriminée tant politiquement qu’économiquement. Dans le contexte actuel, les irruptions de violence, qui se produisent régulièrement, peuvent aller plus loin. En Arabie saoudite, une demande sociale pourrait se manifester, ce qui n’est pas le cas ailleurs : quand les Émirats arabes unis ont organisé des élections directes, il a presque fallu forcer les électeurs à aller voter. Par ailleurs, les chiites de la province orientale se sentent exclus. Ainsi, les lignes de fracture sociale, politique et religieuse peuvent se recouper.
Je terminerai par la Libye. L’âge des dirigeants est un des ingrédients fondamentaux de la révolte des opinions publiques. À l’image de Ben Ali, demeuré 24 ans au pouvoir et de Moubarak, qui y est resté 30 ans, Kadhafi gouverne depuis 42 ans. Les Omanais, qui viennent de célébrer le quarantième anniversaire de l’accession du sultan au pouvoir, doivent se demander s’ils ont eu raison de le faire avec autant d’éclat, même si celui-ci reste une figure populaire et charismatique.
M. Denis Bauchard. Un des problèmes du Golfe tient au fait que les chiites peuvent être frustrés de ne pas être associés au pouvoir. Ils forment la majorité de la population de Bahreïn et représentent une part importante du Hasa, province orientale d’Arabie saoudite et siège de la production pétrolière et gazière. D’ailleurs, il est probable que les manifestations n’ont pas eu lieu sans soutien de l’Iran, ce qui pose le problème plus général de la stratégie de ce pays dans tout le Moyen-Orient. Il est loin d’être inactif. Le Guide suprême s’est réjoui de la révolution en Égypte, en évitant naturellement de balayer devant sa porte.
Israël est actuellement en proie à l’embarras et à l’inquiétude. Depuis des années, la question palestinienne a cessé d’y être une priorité pour devenir un conflit de faible intensité, géré par des mesures de caractère policier, le principal problème étant l’Iran. Les événements récents risquent de remettre la question palestinienne au premier plan. On voit mal comment le statu quo pourrait être maintenu : quelle que soit l’évolution politique de l’Égypte, Israël connaîtra une pression croissante de la part de ses voisins, en particulier s’ils ont des régimes démocratiques : ce qui ne manquera pas de poser des problèmes très concrets. On peut se demander par exemple si l’Égypte, qui participe au blocus de la bande de Gaza, continuera à contrôler son passage sud.
M. Patrice Paoli. Pour traiter la question du Sahel, il faut des partenaires. C’est pourquoi nous n’avons rien à espérer de l’affaiblissement des États. La France, qui se heurte au fait que l’Algérie ne veut pas multilatéraliser le problème, a tout intérêt à avoir des interlocuteurs stables et forts, capables d’imposer l’ordre et d’assurer la sécurité dans les zones qu’ils contrôlent.
M. Philippe Cochet. Qu’en est-il des intérêts économiques de la France ? Quels sont les risques et les perspectives dans ce domaine ? Par ailleurs, même si je conviens qu’il était difficile de prévoir ce qui s’est passé, ne faut-il pas remettre en cause certaines de nos méthodes et s’appuyer davantage sur la diaspora, qui dispose souvent de meilleures informations que les sources officielles des pays, condamnées à la langue de bois ?
M. Jean-Michel Boucheron. Je regrette que les médias aient fait l’impasse sur l’omniprésence et l’interventionnisme des services secrets américains, qui ont mis en œuvre en Tunisie, une politique d’inspiration Obama et en Égypte, plutôt la politique de Clinton. Ils ont contrôlé le déroulement des opérations, conseillé les chefs d’état-major des différentes armées et organisé les rendez-vous entre les hommes politiques pour former un gouvernement accepté par la foule. Ce rôle majeur supposait un prépositionnement de longue date. Comment avons-nous pu être aussi absents dans ce domaine précis, surtout en Tunisie, pays voisin et de surcroît francophone ?
M. Patrick Labaune. M. Bauchard a isolé quatre causes des mouvements intervenus en Tunisie et en Égypte : rejet d’un autocrate vieillissant, absence d’organisation politique et d’opposition structurées, jeunesse éduquée mais sans emploi ou sous-employée, utilisation des nouvelles technologies. Si l’on s’en tient à ces critères, on doit conclure que l’Algérie et la Libye vont tomber, à la différence de la Jordanie et du Maroc, dont les dirigeants autocrates ne sont pas encore assez vieux, ou du Yémen, où il existe une opposition parlementaire tribale, sudiste et socialiste. Mais j’émets quelques réserves à l’égard de cette grille de lecture, tant l’automaticité est rare en science politique.
À mon sens, il faut prendre en compte un changement essentiel. L’armée, en osmose avec Ben Ali et Moubarak, qui en étaient issus, a contribué à les déstabiliser, alors que la religion a eu un effet stabilisateur, surtout dans les monarchies religieuses comme l’Arabie saoudite, les émirats, le Koweït, le Maroc, la Jordanie et Oman. En Égypte même, les Frères musulmans ont consenti à ne pas mettre d’huile sur le feu. En somme, tandis que l’armée a joué un rôle déstabilisateur, la religion, que tout le monde craignait, notamment l’Occident, a été facteur d’apaisement.
M. Jean-Pierre Kucheida. En Égypte, la misère peut-elle déboucher sur un autre pouvoir que celui de l’armée ou des islamistes ?
On compte en Algérie 9 000 émeutes par an, généralement d’origine économique. Ne risquent-elles pas de s’étendre et de prendre une dimension politique et démocratique ?
Les diplomates français, dont vous dites qu’ils ne pouvaient pas prévoir l’explosion, ont-ils au moins réfléchi à ses conséquences et au moyen pour la France de jouer un rôle dans ce contexte ?
Je regrette enfin que vous n’ayez pas répondu à la question de M. de Charette : la diplomatie au Maghreb et au Moyen-Orient est-elle une chasse gardée du Quai d’Orsay ou peut-elle être le fait des parlementaires, qui ne partagent pas toujours ses vues ?
M. Jean-Michel Ferrand. Les forces de la place Tahrir, qui ont fait tomber le pouvoir en place, sont-elles organisées et responsables politiquement, ou nées d’un mouvement spontané et passionné, qui n’a pas d’avenir politique ? Certaines figures représentatives de la contestation ont-elles surgi, qui pourraient s’asseoir à la table des négociations ?
M. Henri Plagnol. Si l’on ne peut reprocher à notre système diplomatique de n’avoir pas prévu ce qui est arrivé, nous sommes nombreux à déplorer son manque d’empathie très préjudiciable à l’image de la France dans cette partie du monde. Ce sont pourtant de nos valeurs que se réclamaient les foules, surtout en Tunisie : respect des droits de l’homme, principes de 1789, droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Avons-nous cessé de croire à leur universalité, paralysés par je ne sais quel complexe d’ingérence coloniale, alors que les Américains y adhèrent encore ?
Je regrette que, depuis des années, notre système diplomatique ne se soucie pas assez des associations de défense des droits de l’homme. Leurs membres, peu nombreux, parfois très âgés, ont mené avec courage les manifestations, après avoir milité pendant des années. Ils maintiennent le cap qui devrait être le nôtre.
Je déplore enfin l’insuffisante réactivité de notre système médiatique, comparé à Al Jazeera et aux chaînes anglo-saxonnes. Seuls RFI, quelques segments de notre système audiovisuel extérieur et l’AFP se sont fait entendre. Nous devons rassembler nos forces et investir dans le net. Le retard de notre diplomatie est affligeant, à l’heure où la France doit faire entendre sa voix et affirmer ses valeurs, en s’appuyant sur les communautés nationales présentes sur son territoire.
M. Jean-Pierre Dufau. Si gouverner c’est prévoir, c’est aussi agir, comme le notait Pierre Mendès-France. Or, on ne peut pas dire qu’en matière de réactivité ou d’accompagnement, le temps perdu ait été rattrapé. La diplomatie européenne et nationale, comme l’UpM, sort terriblement abîmée de ces événements. Les valeurs françaises, devenues universelles, ne sont plus portées par la France. Notre pays a-t-il disparu, alors que nos idées continuent à faire leur chemin ?
Peut-on penser que l’onde de choc atteindra la Libye ?
Pour le Sahara occidental, je ne récuse pas votre analyse sur les deux pays encadrants, Maroc et Algérie, mais les peuples eux-mêmes ne peuvent-ils pas prendre d’initiative ?
Enfin, peut-on espérer une adéquation entre les gouvernements qui vont se mettre en place et les peuples qui les ont portés au pouvoir ?
M. Denis Bauchard. Beaucoup de questions s’adressent au pouvoir politique, et je me garderai bien d’y répondre.
Il n’est pas nouveau que, sous la Ve République, la politique étrangère de la France se décide à l’Élysée, même si le ministre des affaires étrangères et ses services y apportent leur contribution.
En amont, le premier rôle des diplomates est d’informer. Tout laisse penser que notre ambassadeur à Tunis a décrit la situation dans les mêmes termes que son homologue américain. Le second rôle des diplomates est de nouer des contacts. C’est en ce sens qu’on peut parler d’un manque d’empathie. Un ambassadeur peut ne pas avoir les bons contacts au bon moment, mais ce problème délicat ne relève pas seulement de sa personnalité : il est impossible de s’entretenir avec un interlocuteur « sensible » sans autorisation du ministère. Quand j’étais en poste en Jordanie, j’avais été sollicité par les représentants du Hamas, mais le Quai d’Orsay s’était opposé à ce que je les rencontre.
En aval, les ambassadeurs défendent la politique définie par le président. Le rôle de chacun est strictement délimité. J’ai connu une époque où s’exerçait une véritable interaction entre le ministère des affaires étrangères et l’Élysée, et où l’on attendait de nous des suggestions sur tel voyage ou telle thématique. En cas de déplacement, le discours du président de la République était préparé au ministère et relu en équipe à l’Élysée. Toutefois, je me garderai de porter un jugement sur ce qui se passe maintenant.
De manière générale, il faut éviter de surestimer l’influence américaine au Moyen-Orient, même si les États-Unis disposent de services de renseignement nombreux et bien placés. Rappelons-nous la manière dont ils ont subi des rebuffades de la part de personnalités réputées proches d’eux comme le Premier ministre Netanyahou, le président Karzai, le Premier ministre irakien al-Maliki ou le général Musharaff, preuve qu’on constate au Moyen-Orient « l’impuissance de la puissance ». Dans cette région du monde, l’influence américaine décline, comme celle de l’Europe, au profit de celle des pays émergents. En Iran, profitant de la politique de sanction, la Chine s’est substituée à l’Europe en devenant son premier partenaire commercial.
Je n’ai donné aucun caractère absolu aux éléments dont j’ai indiqué qu’ils avaient joué un rôle dans la crise tunisienne ou égyptienne, et qui peuvent caractériser d’autres pays. Pour autant, l’armée ne me semble pas toujours un facteur d’instabilité ni la religion, une force de cohésion.
L’armée a permis à l’Égypte d’échapper à une anarchie totale. Si elle n’est pas parvenue à maintenir Moubarak jusqu’en septembre, elle a du moins contribué à préserver un ordre. On peut seulement craindre qu’elle ne soit pas suffisamment sensible aux aspirations démocratiques de la population. Les prochaines semaines montreront ce qu’il en est.
Certaines monarchies religieuses sont stables. Le roi du Maroc, qui descend du Prophète et porte le titre de commandeur des croyants, en tire une légitimité, mais des forces déstabilisatrices peuvent jouer contre lui. De même, le roi d’Arabie saoudite est gardien des lieux saints, sa dynastie s’est alliée au XVIIIème siècle avec la famille Abd al-Wahhab. A l’inverse, la confrérie des Frères musulmans a accompagné le mouvement en Égypte comme dans d’autre pays. S’ils ne l’ont pas provoqué, ils ont été obligés de suivre leurs troupes. Sans doute, quand des élections législatives seront organisées en Égypte, seront-ils assez prudents. S’ils ont déjà annoncé qu’ils demanderaient la création d’un parti indépendant, tout laisse penser qu’ils éviteront de se mettre en avant. D’ailleurs, ils ont déclaré qu’ils ne présenteront pas de candidats à l’élection présidentielle.
M. Patrice Paoli. Notre action dépend en grande partie des moyens qu’on nous alloue. En tant que fonctionnaire, je n’ai pas à voter le budget, mais je regrette qu’il baisse alors qu’on nous demande d’accomplir des tâches de plus en plus importantes. Notre métier a considérablement changé en trente ans. Il n’est pas toujours facile d’expliquer à la représentation nationale le travail discret qu’accomplissent les ambassades. Les contacts avec des associations ou des mouvements d’opposition, la lutte contre la peine de mort et la défense de nos valeurs n’appellent pas nécessairement de publicité. Mais, puisque la loi organique relative aux lois de finances renforce le contrôle des assemblées sur le budget, j’aimerais qu’elles se manifestent en donnant au Quai d’Orsay les moyens d’agir. Nous préparons actuellement un plan sur la Tunisie en raclant les fonds de tiroirs. Que ferons-nous pour l’Égypte, quand les moyens manquent cruellement ?
L’Élysée et le ministère travaillent en interaction pour définir une ligne. Les fonctionnaires formulent des propositions, mais la décision incombe aux politiques. Chacun, à sa place, doit assumer ses choix. Cependant, il faut garder un regard acéré sur le rôle que l’on veut voir jouer aux experts. L’expertise du Quai d’Orsay est forte et légitime. Le réseau est organisé et structuré. Il travaille bien. On doit le reconnaître pour ce qu’il est, et le défendre.
Certains d’entre vous éprouvent le sentiment amer que nous ne défendons pas certaines valeurs. Posons la question de manière non polémique mais technique : quand une mission parlementaire se rend dans un pays, par exemple en Syrie, son premier rôle est-il de se battre pour les droits de l’homme, au risque d’hypothéquer tout le bénéfice qu’une visite d’amitié pourrait avoir en termes d’influence ? Nous consacrons nombre de démarches aux prisonniers politiques. Il est déjà important d’écrire ce que nous pensons. C’est ainsi que nous manifestons notre intérêt pour cette blogueuse de dix-huit ans que les autorités locales accusent absurdement d’espionnage. Le problème du positionnement de tout visiteur reste posé, et dépasse largement le cadre de la diplomatie. Une mission, qu’elle soit le fait de parlementaires, d’hommes politiques ou d’hommes d’affaires, n’a pas à porter en premier lieu un message subversif. Il n’est pas facile de trouver un équilibre entre le principe de non-ingérence, auquel nous sommes attachés, et la défense de nos valeurs.
La diaspora peut être un prisme déformant. En Irak, les Américains ont eu tort de s’appuyer sur Ahmed Chalabi, notoirement corrompu, dont la banque a fait faillite en Jordanie. La diaspora, qui a son mérite, a aussi ses inconvénients. Ceux que la presse française présente comme les porte-parole de l’opposition tunisienne sont considérés par les acteurs de la révolution comme non représentatifs et non légitimes.
Si nous ne rendons pas publics tous nos contacts, nous nous entretenons avec certains opposants tant à Paris qu’en poste. Mais, sur place, le pouvoir tunisien avait mis en place un système extrêmement inhibant. Il se manifestait chaque fois que nous rencontrions quelqu’un. Ce travail de sape a porté ses effets.
Je partage le point de vue de M. Bauchard sur les services américains. Si ceux-ci étaient aussi bons qu’on le prétend, les politiques auraient agi plus tôt et non a posteriori.
En Tunisie, nous avons eu la chance que l’armée se dissocie du pouvoir. C’est ce qui lui a permis de prendre ses distances vis-à-vis d’un régime policier et de jouer un rôle important.
Il est douloureux pour nous que l’Union ait du mal à trouver sa voie, en dépit de réformes successives. Il faut rester vigilant en la matière, car le Parlement européen a un rôle important à jouer pour maintenir l’attention sur la rive sud de la Méditerranée. Ce que nous ne pourrons pas faire dans le cadre de l’UpM, nous le tenterons avec les moyens que nous avions prévu de lui allouer. Argent, structures et programmes existent. Les États doivent les faire fonctionner. Le rôle d’orientation du Parlement européen s’est développé. Nous disposons d’un laboratoire, mais il faut trouver une voie.
Nous devons aussi modifier notre regard sur le rapport entre l’armée et les forces religieuses. Longtemps, nous avons soutenu des dictatures qui se présentaient comme le meilleur rempart contre l’islamisme, dont elles ont en fait favorisé le développement en le dispensant de se positionner de manière politique. Les Frères musulmans continuent à prétendre que l’islam est la solution sans décliner un vrai programme. Voici venue l’épreuve de vérité. Sommes-nous prêts à considérer que les pays ont acquis une maturité suffisante pour ne pas leur donner de leçons ? Les Tunisiens et les Égyptiens de la place Tahrir nous disent qu’ils vont se colleter avec les Frères musulmans. Ne soyons pas naïfs : les islamistes sont plus structurés que les autres, mais devrait-on leur préférer un Ben Ali sans la famille Trabelsi ou un Moubarak plus jeune ? Il faut trouver un nouveau positionnement, en considérant qu’il n’y a pas de fatalité.
L’armée n’est pas non plus un garant, et les manifestants qui lui font une confiance aveugle pèchent par naïveté. Il n’est pas certain que cette force qui avait maintenu Moubarak au pouvoir puisse se réformer. Comme l’ensemble de l’état-major, le maréchal Tantaoui est très âgé. La jeune génération prendra-t-elle le relais ? L’armée jouera-t-elle en Égypte le rôle qu’elle avait tenu en Turquie ? Nous savons peu de chose à son sujet.
Les Américains ne sont pas mieux informés que nous à cet égard. D’ailleurs, dans bien des pays, ils se sont montrés incapables d’orienter la situation dans le sens de leurs intérêts – à moins qu’on ne considère qu’ils ont fait exprès de s’en remettre à des êtres aussi insaisissables que M. Karzai en Afghanistan ou M. Maliki en Irak.
La force politique des manifestants de la place Tahrir reste un sujet d’interrogation. Six mouvements sont apparus, représentatifs du monde des blogueurs, des internautes et de certains jeunes Frères musulmans. Ils tentent de s’agréger pour créer un parti représentant différents courants, mais les Égyptiens eux-mêmes ne voient pas le mouvement se cristalliser.
On n’explique pas davantage le miracle tunisien de ce chœur d’internautes invisibles mais suffisamment présents pour affirmer que le gouvernement ne convient pas et l’amener à changer. Les décisions ont été prises sans qu’un rapport de force matériel ou physique ait été créé. L’ancien système a été balayé grâce à une ouverture, un esprit bon enfant qu’on ne rencontre pas en Égypte où l’armée reste aux commandes.
M. Philippe Cochet. Quelle répercussion aura la situation sur nos intérêts économiques ?
M. Patrice Paoli. Les entreprises françaises n’auront probablement pas à souffrir des bouleversements, car la présence économique ne dépend pas toujours du politique. Souvent, elles voudraient qu’on intervienne politiquement, alors que les contrats dépendent d’abord de leur compétitivité. Seule la vente d’un satellite ou d’un avion de combat, qui a trait à la souveraineté, concerne le pouvoir politique.
En Tunisie, on attend un appel d’air très important pour répondre à la demande en tourisme ou en investissements. Nous devrons envoyer un signal très fort. La semaine prochaine, la mission que Mme Lagarde et M. Wauquiez mèneront sur place permettra d’exprimer notre confiance dans la Tunisie de demain. La France est le premier investisseur, le premier acheteur, le premier vendeur et le premier fournisseur d’aide à la Tunisie, alors que les Britanniques, si prompts à donner des leçons, n’ont aucun intérêt sur place.
Notre pays sera un acteur majeur de la transition. Nous devrons faire preuve d’empathie et mobiliser les moyens dont nous disposons. Les entreprises joueront un rôle fondamental dans la région, où nos investisseurs sont plus présents que les commerçants. Les Français sont les premiers investisseurs étrangers en Syrie, en Jordanie et au Yémen, où Total est le premier acteur du projet gazier. Nous devons faire prévaloir nos intérêts. Nos entreprises devront également s’acquitter du travail de formation auquel elles se consacrent. La France est le premier employeur étranger au Maroc et en Tunisie.
Compte tenu de l’importance des enjeux, nous devons être vigilants, user de tous les moyens dont nous disposons, comme la caisse de l’UpM et les fonds multilatéraux, et encourager l’investissement dans les démocraties naissantes. Ce sont des marchés qu’il ne faut pas négliger. Nous l’avons dit, Denis Bauchard et moi-même, à la Chambre de commerce franco-arabe. À l’heure de la mondialisation, il n’y a pas de mauvais moment. Je regrette que nos entreprises ne soient pas suffisamment agressives dans le Golfe. Peut-être ne mesurent-elles pas le risque qu’il y a à arrêter la carte du monde à l’Iran en oubliant que la Chine, l’Inde ou l’Afrique du Sud investissent ces marchés.
Mme Martine Aurillac, présidente. Je vous remercie.
4.- Mardi 8 mars 2011, séance de 16 heures 45, compte rendu n° 41 : audition de M. François Gouyette, ambassadeur de France en Libye, sur les événements en Libye
M. le président Axel Poniatowski. Monsieur l’ambassadeur, je vous remercie d’avoir répondu aussi rapidement à notre invitation. Après avoir assuré le rapatriement de tous nos ressortissants présents sur place, vous êtes rentré en France le 26 février, date à laquelle notre ambassade à Tripoli a été fermée. Depuis votre départ, la Libye est passée d’une situation d’insurrection à une guerre extrêmement violente. Le colonel Kadhafi demeure insensible tant à la révolte populaire qu’aux pressions de la communauté internationale.
Cette dernière a manifesté un front uni, puisque le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté à l’unanimité des sanctions sévères. Ainsi, la résolution du 26 février prévoit notamment une saisine de la Cour pénale internationale. En outre, la Libye a été suspendue du Conseil des droits de l’homme et de la Ligue arabe, mesures symboliques, mais qui témoignent du complet isolement de Kadhafi et de la profonde réprobation qu’il suscite à travers le monde entier.
Comme ses alliés, la France estime que toutes les options sont sur la table. Elle a fait savoir qu’elle examinait les conditions de mise en œuvre d’une zone d’exclusion aérienne.
Afin d’éclairer notre réflexion, peut-être pourriez-vous analyser les événements auxquels vous avez assisté pendant la dizaine de jours qui ont précédé votre départ, et nous exposer, avec votre connaissance du terrain, ce que pourrait être le futur paysage politique de la Libye dans l’hypothèse d’un départ de Kadhafi. Les forces d’opposition sont mal connues, tout au moins ici. Doit-on considérer par exemple que l’ancienne division qui oppose la Cyrénaïque et la Tripolitaine a joué un rôle important dans le déclenchement de la révolte et dans ses suites ? Faut-il craindre le développement de l’islamisme dans ce pays ? Peut-on parler, dans l’état actuel des choses, d’un risque de scission ? Quelle politique la France conduit-elle, qu’il s’agisse des moyens humanitaires actuellement déployés ou de son action au niveau international, notamment à l’occasion du conseil européen extraordinaire qui se tiendra vendredi prochain et des discussions à propos de la création d’une zone d’exclusion aérienne ?
M. François Gouyette, ambassadeur de France en Libye. Permettez-moi de revenir un peu plus loin en arrière et de remonter à la révolution tunisienne, car elle a constitué un facteur déclenchant pour les événements survenus en Égypte, puis en Libye. L’honnêteté force cependant à reconnaître que personne ne s’attendait à ce que les choses se passent ainsi dans ce dernier pays. Un des meilleurs experts du monde arabe et du Moyen-Orient, Robert Baer, ancien analyste de la CIA, a déclaré le jour de notre retour à un quotidien français que, si on lui avait posé la question un mois auparavant, jamais il n’aurait affirmé que la Libye allait être touchée.
La révolution tunisienne a donc pris de court le colonel Kadhafi : on le voit à sa réaction, décalée par rapport au reste de la communauté internationale. Il a compris la situation avec retard, après avoir sans doute caressé dans un premier temps l’espoir d’un retour de Ben Ali. De même, lorsque la vague de démocratisation a touché l’Égypte, il a manifesté une incompréhension des événements, en décalage avec la réaction des autres dirigeants, y compris dans le monde arabe.
Dans les deux cas, tunisien comme égyptien, on a beaucoup évoqué le rôle tenu par internet et les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Une telle influence ne pouvait qu’être atténuée en Libye, où le développement de la société civile a été considérablement freiné par le système mis en place depuis 40 ans par le colonel Kadhafi. Ce dernier n’hésitait d’ailleurs pas à dire, l’année dernière encore, qu’une telle notion ne pouvait avoir de sens en Libye : dans un pays où le peuple détient le pouvoir, il ne peut exister une société civile s’opposant à lui. De fait, les organisations qui pouvaient en relever étaient très peu nombreuses, sauf à se placer sous l’égide de la Fondation Kadhafi pour le développement, présidée par le fils du Guide le plus emblématique, Saïf al-Islam. Ce dernier était apparu à partir de 2003 comme un moderniste, incarnant l’espoir d’une ouverture de la Libye, mais ses dernières déclarations montrent qu’il fait bloc avec son père et avec les dirigeants actuellement retranchés à Tripoli.
Peu à peu, la pression est cependant montée dans les blogs et les réseaux sociaux : des appels à manifester ont été lancés, sur le modèle de ce qui s’était pratiqué en Tunisie et en Égypte. Ils ont bientôt été relayés par des centaines, puis des milliers de signataires. Leur impact a certes été réduit dans un pays où l’usage d’internet n’est pas aussi développé que chez ses voisins, mais ils ont suffi à inquiéter le régime libyen, d’autant qu’ils ont été repris par les chaînes satellitaires, notamment arabes. Celles-ci sont beaucoup plus regardées que les chaînes nationales, qui usent d’une langue de bois des plus rigides. Assez vite, Al Jazeera est donc devenue la bête noire du gouvernement, en dépit des bonnes relations que la Libye entretient traditionnellement avec le Qatar.
La couverture des événements de Libye par les chaînes satellitaires arabes – et notamment Al Jazeera – appelle toutefois quelques observations critiques. Nous avons certes vécu, entre le 16 et le 26 février, jour de notre départ, une dizaine de jours de fortes tensions et d’affrontements – non pas tant à Tripoli que dans les autres régions –, mais leur relation a fait l’objet d’exagérations, voire de désinformation. Ainsi, l’information, reprise par les médias occidentaux, selon laquelle l’aviation aurait bombardé Tripoli est parfaitement inexacte : aucune bombe n’est tombée sur la capitale, même si des affrontements sanglants ont eu lieu dans certains quartiers.
La genèse de ces affrontements réside dans la conjonction d’un contexte régional, celui des révolutions tunisienne et égyptienne, accompagné d’appels à manifester pour obtenir davantage de libertés, et d’une situation spécifique à la Libye, et plus particulièrement à sa partie orientale. À Benghazi, dans une région, sinon irrédentiste, du moins réfractaire au pouvoir en place depuis 40 ans, soumise à l’influence de l’ancienne monarchie Senussi comme à celle de la confrérie des Frères musulmans – et même, j’y reviendrai, à une forme d’islamisme radical –, des manifestations avaient lieu régulièrement depuis des années, auxquelles participaient les familles des victimes d’une tuerie survenue en 1996 dans une prison de Tripoli. La répression violente d’une mutinerie de détenus appartenant à la mouvance islamiste, dont beaucoup étaient originaires de Benghazi, avait alors fait plusieurs centaines de morts – certains parlent même de 1 200 victimes. Bien des années plus tard, lorsque le pays a commencé à s’ouvrir et à solder les comptes du passé, le régime a entrepris de proposer des formules d’indemnisation, sur le modèle de ce qu’il avait fait pour les attentats contre l’avion d’UTA et celui de Lockerbie, mais les familles ne les ont pas acceptées. À la suite de l’arrestation de leur avocat par la sécurité libyenne, elles ont à nouveau manifesté le 15 février – soit deux jours avant la manifestation à laquelle appelaient les réseaux sociaux en Libye. Le résultat a été dramatique : si le premier jour, la répression a eu lieu sans usage excessif de la force, dès le deuxième jour, les forces de l’ordre ont tiré sur la foule, et le troisième, les tirs étaient manifestement destinés à tuer. Il y a eu des morts et de nombreux blessés, comme les médecins français opérant à l’hôpital de Benghazi ont pu en témoigner.
Avec le recul, je pense que cet usage de la force totalement disproportionné – et d’ailleurs condamné dès ce moment par les autorités françaises – a été un facteur déclenchant de la vague qui menace aujourd’hui l’édifice construit par le régime. Il a contribué au fait que la zone échappant au contrôle des autorités de Tripoli s’étende de la frontière égyptienne à toute la Cyrénaïque, jusqu’à Misurata, à l’exception de Syrte.
La composition de l’insurrection est très diverse : elle regroupe de nombreux jeunes civils et des éléments de l’armée traditionnelle ralliés à l’opposition. Pour autant que nous puissions l’évaluer, faute de représentation sur place – d’autant que, même en temps normal, la Libye n’est pas un pays facile à comprendre –, l’armée libyenne compte environ 45 000 à 50 000 hommes, mais seulement 5 000 hommes sont vraiment bien entraînés, équipés, correctement payés et motivés. Ces derniers composent les forces les plus loyales au régime. Le reste de l’armée est moins bien doté en équipement. Si d’un point de vue quantitatif, le rapport de forces joue en faveur de l’insurrection, qualitativement, ce n’est pas le cas : les équipements les plus modernes et les plus sophistiqués sont détenus par le régime. Par ailleurs, l’emploi de mercenaires recrutés dans certains pays où l’influence libyenne est traditionnellement forte semble avéré, puisque certains ont été capturés.
Jusqu’à notre départ, le 26 février, l’insurrection a bénéficié d’une dynamique favorable : non seulement elle atteignait Misurata, qui n’est qu’à 220 kilomètres de Tripoli, mais certaines localités de l’Ouest de la Tripolitaine, comme Zaouïa – située à moins de 50 kilomètres de la capitale –, étaient tombées entre ses mains. Kadhafi tente de reprendre la main en assiégeant ces deux villes qui verrouillent, à l’est et à l’ouest, l’accès à Tripoli. En outre, la prise de contrôle de Misurata par l’opposition menace directement la ville de Syrte, située plus à l’est, et qui est le fief de Kadhafi. Sa chute serait donc un signal très fort. Le régime tente également de contenir l’avancée des insurgés à Ras Lanouf, terminal pétrolier, et à Ben Jawad, dont la position, près de Syrte, est stratégique.
Depuis une dizaine de jours, la dynamique en faveur de l’opposition s’est ralentie, pour ne pas dire qu’elle a été stoppée. Le pouvoir essaie de reprendre la main, sans y parvenir de manière décisive. Ainsi, après cinq jours de siège, Zaouïa n’est pas tombée. Il en est de même pour Misurata. L’utilisation de l’aviation, comme celle des blindés, est certes un élément pouvant jouer en faveur du pouvoir. Mais après de nombreuses années d’embargo, les capacités de l’armée de l’air semblent réduites. Les frappes sur Ras Lanouf, par exemple, n’ont pas été d’une grande précision.
Au final, la situation reste très mouvante et le rapport de forces n’est pas définitivement fixé. On peut donc esquisser trois hypothèses s’agissant du dénouement du conflit. Tout d’abord, Kadhafi pourrait reprendre le contrôle de toute la Libye, mais compte tenu du contexte, notamment international, cela reste peu plausible. Inversement, il est peu probable que le régime soit menacé à court terme, comme on aurait pu encore le penser récemment encore. Enfin, la troisième hypothèse est celle d’une division du pays plus ou moins durable, entre la partie située à l’est de Syrte, contrôlée par la rébellion, et la partie occidentale, qui resterait sous l’autorité du pouvoir – sachant que celui-ci contrôle également le Sud, dont on ne parle jamais, mais qui compte également des villes importantes comme Sebha ou Ghadamès.
M. Jean-Louis Christ. Que pensez-vous, monsieur l’ambassadeur, du silence de l’Union africaine sur les événements libyens ?
La France est déjà présente et délivre une assistance humanitaire. Ne pourrait-elle pas jouer un rôle de premier plan, notamment auprès du Conseil national de transition, pour soutenir l’opposition dans sa recherche d’une transition démocratique ? Dans cette hypothèse, quelles actions pourrait-elle mener ?
M. Henri Plagnol. Je tiens à vous féliciter pour la façon dont l’évacuation de nos compatriotes a été gérée.
Avec François Loncle, nous effectuons une mission dont les données changent tous les jours sur les dangers du terrorisme au Sahel et sur l’islamisme. Jusque récemment, la Libye était plutôt un allié dans la lutte contre l’islamisme radical – ce qui n’empêche pas de souhaiter que la carrière du colonel Kadhafi se termine au plus tôt. Pensez-vous que puisse se constituer en Cyrénaïque – je caricature à dessein – un « émirat islamique » ? La situation de guerre civile en Libye peut-elle entraîner une contagion au Sahel ?
M. Jean-Michel Boucheron. Je me demande comment nous gérons nos ambassadeurs. Le représentant de la France en Tunisie aurait dû être rappelé, parce qu’il n’est pas fait pour ce métier et nous ridiculise dans ce pays. Inversement, monsieur l’ambassadeur, pourquoi vous a-t-on fait revenir en France ? Il est très important, aujourd’hui, que la France dispose d’une représentation diplomatique en Libye – quitte à l’installer à titre provisoire à Benghazi. Si ce rappel s’explique par la dangerosité de la situation, pourquoi n’en faisons-nous pas autant pour nos ambassadeurs à Kaboul ou à Islamabad ?
Par ailleurs, je suis clairement opposé à une intervention militaire en Libye, d’une part parce que l’aviation, contrairement aux blindés légers, ne joue pas un grand rôle tactique dans le conflit, et de l’autre parce que nous ne devons pas voler leur révolution aux Libyens. Il faut éviter tout réflexe d’autorité impériale. Les plus grandes révolutions ont leurs martyrs, c’est ainsi. Cette histoire appartient aux Libyens ; ce n’est pas à nous – et certainement pas à l’OTAN – d’intervenir militairement et de peser sur leur destin.
M. Michel Vauzelle. Pour ma part, monsieur l’ambassadeur, je ne souhaite pas vous voir rester dans une ville risquant d’être bombardée.
Vu d’ici, nous comprenons mal ce qui se passe. Vous l’avez dit : la situation libyenne, déjà complexe en temps de paix, l’est davantage encore en temps de guerre. Il n’existe pas véritablement de ligne de front, mais plutôt des poches de combats. : certaines villes de l’Ouest sont aux mains de l’opposition ; le combat reste incertain autour de Misurata ; Syrte reste une position forte pour Kadhafi… Plutôt que d’envisager des bombardements, dont on voit en Afghanistan les risques qu’ils font peser sur la population civile, ne pourrait-on pas trouver d’autres moyens pour aider les révoltés libyens ? Vous avez dit que, contrairement aux forces fidèles à Kadhafi, ces derniers étaient peu formés et peu équipés. Ne faudrait-il pas les armer et les conseiller, plutôt que de leur envoyer l’OTAN, contre qui tout le monde se retournerait aussitôt au nom du patriotisme ?
M. François Gouyette. Le silence de l’Union africaine (UA) n’est pas vraiment surprenant : Kadhafi a présidé cette institution et y compte un certain nombre d’amis, voire d’obligés. Il se passera donc du temps avant que l’UA se prononce sur un conflit de cette nature. Certes, des pays comme l’Afrique du Sud ou le Nigeria, traditionnellement plutôt en froid avec le pouvoir libyen, seraient sans doute disposés à prendre des positions plus vigoureuses, mais un grand nombre de pays africains ne sont pas prêts à condamner le colonel Kadhafi.
En matière d’assistance humanitaire, vous connaissez les actions menées par la France : envoi d’une mission à Benghazi, dispositif mis en place pour rapatrier les Égyptiens regroupés à la frontière tunisienne, etc. Par ailleurs, une partie des vingt médecins français présents depuis longtemps à l’hôpital de Benghazi, et qui avaient été rapatriés, est retournée sur place.
Des contacts ont été pris avec le Conseil national de transition, instance qui se veut représentative de l’insurrection, en tout cas en Cyrénaïque. La France a salué sa création et exprimé une appréciation positive sur les objectifs qu’il s’est assignés. Ces contacts devraient se poursuivre.
En ce qui concerne le danger terroriste au Sahel et le risque de contagion, M. Plagnol a eu raison de rappeler la coopération étroite entre la Libye et l’ensemble des services de renseignement occidentaux pour lutter contre la menace représentée par Al-Qaida. Celle-ci a d’ailleurs fait du colonel Kadhafi un ennemi à abattre : son numéro deux, Ayman al-Zawahiri, le désignait encore l’année dernière comme une cible prioritaire de l’organisation. Par ailleurs, il existe en effet une résilience de l’islamisme radical en Cyrénaïque. C’est d’ailleurs ce qui a conduit les autorités libyennes à agiter, avec un succès relatif, le chiffon rouge de la menace islamiste, comme elles l’ont fait pour la menace migratoire.
Même si la ficelle est un peu grosse, les deux discours recouvrent des réalités. Ainsi, à la faveur du beau temps, on voit déjà se manifester un afflux de migrants subsahariens : en l’espace de 72 heures, près de 5 000 d’entre eux ont abordé les côtes italiennes. Les Libyens disposent donc d’un argument pour menacer l’Europe d’une invasion dans le cas où le régime tomberait.
À l’est du pays, et plus particulièrement à Derna – ville de Cyrénaïque tombée assez rapidement sous le contrôle de l’insurrection –, il existe incontestablement des foyers d’islamisme radical. C’est d’ailleurs de cette ville que sont originaires des centaines de combattants libyens partis combattre sur les théâtres d’opérations extérieurs du djihad, en Afghanistan ou en Irak. Certains sont depuis revenus en Libye.
Par ailleurs, des islamistes radicaux du GICL – le groupe islamique combattant libyen –, emprisonnés depuis de nombreuses années, ont été récemment libérés à la suite de négociations entreprises par le pouvoir, sous l’influence de Saïf al-Islam, pour tenter de les neutraliser. Près de 800 ont ainsi été libérés contre la promesse de renoncer à la violence, et beaucoup ont rejoint les zones « libérées ». Cela pourrait poser un problème.
Enfin, dans la mesure où, avant le mois de février, la Libye contribuait à endiguer, aux frontières du Sahel, la pression d’Al-Qaida au Maghreb islamique, les événements actuels pourraient être une source d’inquiétude si AQMI en profitait pour étendre son action plus à l’est. Certes, la menace de la constitution d’un « émirat islamique », notamment à Derna et Beida, est avant tout destinée à effrayer les pays européens, mais au-delà de la propagande, on ne peut nier qu’il existe des éléments de préoccupation.
Quant à la suspension provisoire de l’activité de l’ambassade de France en Libye – qui n’est pas une rupture des relations diplomatiques –, elle résulte d’une décision politique prise au plus haut niveau, pour, notamment, des raisons de sécurité. Certes, Tripoli n’était pas dans une situation de guerre civile, ce n’était ni Beyrouth, ni la Somalie, mais quelque chose de plus insidieux, étrange, inquiétant. La ville était très calme le matin, mais la tension était perceptible le soir : les policiers disparaissaient, et il n’existait alors plus aucun dispositif de sécurité, y compris pour protéger les ambassades.
Vous évoquez, monsieur Boucheron, l’éventualité de mon installation à Benghazi, mais je reste ambassadeur de France en Libye, accrédité auprès des autorités de Tripoli…
M. Jean-Michel Boucheron. En période révolutionnaire, tout cela n’a plus grande importance !
M. François Gouyette. La situation est néanmoins ambiguë.
Par ailleurs, personne, à l’heure actuelle – et en tout cas pas le gouvernement français –, ne songe à une intervention militaire au sol.
Enfin, il est exact, monsieur Vauzelle, qu’il n’existe pas de ligne de front définie. En quittant Tripoli en direction de la Tunisie, on passe par Zawiyah, tombée aux mains des rebelles, par Sorman, fief d’un des compagnons de Kadhafi et qui est manifestement sécurisée par le pouvoir, puis par Sabratha et Zouwarah, qui étaient contrôlées par la rébellion. De même, à l’est, tant que Syrte reste aux mains du guide – et je pense que des moyens militaires considérables sont concentrés là-bas –, la continuité géographique n’est pas assurée.
M. Michel Terrot. Avez-vous des informations sur les éventuelles relations pouvant exister entre les Frères musulmans libyens et égyptiens ? Existe-t-il des échanges, une coopération de part et d’autre de la frontière ?
M. Philippe Cochet. Comment la rébellion est-elle organisée ? Existe-t-il une coordination entre les différents groupes, ou n’assiste-t-on qu’à une addition de révoltes ?
La Libye était un verrou important pour les flux de migration vers l’Europe. Elle avait notamment signé avec l’Italie des accords très efficaces sur ce plan. Qu’en est-il aujourd’hui ?
M. Jean-Claude Guibal. Pour ma part, monsieur l’ambassadeur, je suis content de vous voir ici, bien vivant !
Vous avez évoqué la genèse des événements. Les phénomènes classiquement à l’origine d’épisodes révolutionnaires, comme la baisse du pouvoir d’achat ou l’absence de représentation des classes moyennes, peuvent-ils également être observés en Libye ? Autrement dit, les motivations de cette révolution sont-elles principalement politiques – aspiration à la démocratie, à davantage de libertés – ou sont-elles aussi d’ordre économique ? Le pétrole joue-t-il un rôle ?
Dans ce pays, il n’existe pas réellement de force d’opposition, à part le Conseil national. Quelles sont les forces qui le composent ? L’une d’elle peut-elle jouer un rôle pilote ?
M. Hervé Gaymard. L’antique division ottomane entre Tripolitaine, Cyrénaïque et Fezzan a-t-elle toujours une pertinence ? Autrement dit, le pays a-t-il été unifié sous la férule de Kadhafi, ou n’est-il qu’un conglomérat de provinces diverses pouvant se séparer à la faveur des événements actuels ?
Par ailleurs, quelles sont les relations entre la Libye d’une part, la Chine et la Russie de l’autre ?
M. François Gouyette. En ce qui concerne les relations avec les Frères musulmans égyptiens, je dispose de peu d’éléments. Il existe incontestablement une communauté de pensée et une proximité idéologique, politique et géographique entre les confréries : les Frères musulmans libyens sont traditionnellement implantés dans l’Est, en Cyrénaïque. Benghazi est tournée vers l’Égypte comme Tripoli l’est vers la Tunisie.
J’en viens à l’organisation de la rébellion. Le CNT, le Conseil national de transition, n’a été créé qu’il y a quelques jours. Il est composé de personnalités dont un certain nombre sont elles-mêmes issues du régime de Kadhafi. Ainsi, son président, Mustapha Abdejalil, était ministre de la justice il y a encore quelques semaines. Son responsable des affaires étrangères, M. Ali Essaoui, était ministre du commerce et de l’économie, puis ambassadeur en Inde, avant de démissionner et de rejoindre l’opposition. D’anciens responsables de la sécurité y siègent également, mais pas l’homme fort de la Cyrénaïque, l’ancien ministre de l’intérieur et général Abdel Fattah Younès al Abidi. Cet homme puissant et respecté dans l’armée, créateur des forces spéciales en Libye, ex-officier libre, compagnon de Kadhafi, a été pourtant l’un des premiers à faire défection, et il est devenu une figure de la rébellion.
M. Guibal m’a interrogé sur les causes de la révolte. En Tunisie, le mécontentement social a joué un grand rôle, l’immolation de Mohamed Bouazizi servant de déclencheur à un mouvement plus vaste dirigé contre l’emprise du clan du président Ben Ali. De même, en Égypte, les problèmes économiques et sociaux ont une importance majeure. Mais en Libye, tout le monde pensait que le régime avait, grâce aux recettes pétrolières, la capacité de gérer la contestation. Je rappelle que le pays produisait avant la crise environ 1,5 million de barils par jour – même si, depuis, la production a diminué au moins de moitié. Ses avoirs sont estimés à près de 150 milliards de dollars, pour une population très limitée de 6 millions de personnes. On aurait donc pu croire que la redistribution de la rente, certes inégalitaire, serait un moyen « d’acheter » la paix sociale. Les causes sociales ne semblent donc pas déterminantes dans la crise. En revanche, le caractère disproportionné de la répression à Benghazi a eu pour effet de révulser l’opinion et de lancer un mouvement devenu incontrôlable pour le pouvoir.
En ce qui concerne les flux migratoires, les accords passés avec l’Italie avaient porté leurs fruits, puisque les arrivées de migrants ont diminué de 90 %, notamment grâce aux moyens de contrôle – des vedettes, par exemple – mis à la disposition des Libyens par l’Italie. À la faveur des événements actuels, le flux vers Lampedusa a toutefois repris, ce qui donne au pouvoir des arguments pour se présenter en dernier rempart contre une invasion de l’Europe. Il existe des éléments objectifs de préoccupation : la pression migratoire en provenance du Sahel et du Sud de l’Afrique va se poursuivre quelle que soit l’évolution de la situation intérieure en Libye. Plus tôt les choses se stabiliseront, mieux ce sera.
La Libye était le seul État méditerranéen à ne pas avoir signé d’accord de partenariat avec l’Union européenne. Depuis 2008, la Commission avait donc reçu du Conseil un mandat pour négocier un accord-cadre global comportant un volet consacré aux migrations. Une aide était prévue pour aider les Libyens à faire face à cette pression. Le moment venu, les discussions pourront reprendre.
En ce qui concerne la pertinence de la division antique entre les trois provinces, je ne peux que donner un avis personnel : les 40 années de pouvoir de Kadhafi ont permis de cristalliser un sentiment national. Bien sûr, les Libyens se reconnaissent dans leur appartenance tribale – la répartition entre tribus est le socle de la société, et ce facteur très important distingue fortement le pays de ses deux voisins tunisien et égyptien –, et dans leur appartenance régionale, mais avec le temps, un sentiment national a fini par se forger. Il devrait survivre aux bouleversements en cours.
M. Jean-Pierre Kucheida. Si je comprends bien, vous ne pensez pas que la Libye risque d’éclater même si M. Kadhafi perd le pouvoir.
Quel est l’impact réel du Guide sur le monde arabe ?
J’ai pu lire que Kadhafi gardait près de lui – en otage, en quelque sorte – des membres de certaines tribus afin de les museler. Est-ce vrai ?
Quels sont les dispositifs civils et humanitaires qu’il nous serait possible de déployer en Libye pendant la période actuelle ?
Mme Chantal Bourragué. Pouvez-vous nous parler de l’action des femmes et de leur présence avant et pendant la crise ? Quel est leur rôle dans le fonctionnement des institutions ?
Par ailleurs, avez-vous des informations récentes sur les personnes qui tentent de gagner la Tunisie ? Le Haut comité aux réfugiés a-t-il engagé des moyens pour protéger cette population ?
Présidence de Mme Martine Aurillac, vice-présidente.
M. Jacques Bascou. Une réponse européenne pourrait être apportée à la question des mouvements migratoires. Qu’en pensez-vous ? L’Italie, qui avait passé des accords privilégiés avec la Libye – non seulement sur l’immigration, mais également en matière d’investissements croisés – ne risque-t-elle pas d’y faire obstacle ? Quelles sont les relations entre les deux pays ?
M. Michel Destot. À long terme, la Libye, qui n’est pas le pays le plus pauvre du monde, dont la démographie est maîtrisée, et qui dispose d’importantes ressources en hydrocarbures, ne pourrait-elle pas se développer sur le plan économique et social, et renvoyer aux calendes grecques les menaces agitées aujourd’hui en matière d’islamisme ou d’immigration ?
M. André Schneider. Mme Ashton a envoyé dimanche en Libye une mission humanitaire. Dirigée par Agostino Miozzo, directeur du Service européen pour l’action extérieure, chargé des réponses aux crises et de la coordination opérationnelle, elle doit évaluer la situation et estimer ce que pourrait faire ou ne pas faire l’Union européenne. Pouvez-vous nous donner plus d’informations à ce sujet ? Que pourrait faire l’Union pour mieux coordonner son aide ?
M. François Gouyette. Je reviens sur la question de M. Gaymard, à laquelle je n’ai pas encore répondu. La Chine et la Russie sont deux partenaires historiques du colonel Kadhafi depuis les années 1970. L’influence de la première est surtout économique : alors qu’elle ne figurait même pas parmi les six premiers partenaires de la Libye quand je suis arrivé à Tripoli au début de 2008, elle était en seconde position dès 2010 !
Quant à la Russie, elle entretient une relation traditionnellement forte avec la Libye. De nombreux cadres de l’armée y ont été formés, au point que l’on peut parler d’un « parti russe » au sein de l’appareil politico-militaire libyen. La Russie n’a jamais négligé la Libye. Ainsi, une semaine avant de quitter le Kremlin, en avril 2008, Vladimir Poutine a effectué la première visite en Libye d’un chef d’État russe. Cela montre l’importance qu’il accordait à ce pays, dans un contexte où tout le monde venait courtiser le Guide libyen. On a beaucoup parlé de la visite de Kadhafi en France, mais dès 2004, les dirigeants de toutes les grandes démocraties européennes ont fait le voyage de Tripoli : Aznar, Schröder, Blair, Jacques Chirac, Romano Prodi, etc. Quant à Silvio Berlusconi, il avait noué des liens avec le colonel Kadhafi dès 2003.
C’est d’ailleurs à l’ambassade de Russie – dont le personnel est sérieux et respecté des Libyens – que nous avons demandé de représenter nos intérêts pendant la période de fermeture provisoire de l’ambassade de France.
M. Kucheida s’est interrogé sur le risque d’éclatement de la Libye. Il existe un risque de partition provisoire entre l’Est, contrôlé par l’opposition, et l’Ouest, contrôlé par le gouvernement. Mais je ne pense pas qu’une telle situation puisse durer. Quelle que soit l’issue de la crise, l’unité devrait être préservée, le cas échéant dans une organisation de type fédéraliste.
L’influence du dirigeant libyen sur le monde arabe est difficile à évaluer. Il a certes présidé la Ligue arabe l’an dernier, mais le fait que celle-ci se prononcerait en faveur d’une zone d’exclusion aérienne en Libye – comme son secrétaire général, Amr Moussa, l’a affirmé à Alain Juppé – traduit bien l’isolement du Guide, d’autant que le Conseil de coopération du Golfe et l’Organisation de la conférence islamique ont adopté la même position.
Des discussions sont en cours sur la mise en place d’un dispositif civil et militaire. Les mesures peuvent être d’ordre bilatéral ou prises au niveau européen. Notons que la mission de contact décidée par Mme Ashton concerne les autorités de Tripoli, avec lesquelles il faut bien discuter, ne serait-ce que pour régler la question de l’afflux de réfugiés à la frontière. La France a insisté pour que le Conseil européen au sein duquel tous ces thèmes doivent être discutés se réunisse le plus rapidement possible. Si l’ordre du jour concerne avant tout les relations avec la rive sud de la Méditerranée, le dossier libyen fera partie des sujets brûlants.
Il est vrai que la relation est étroite entre l’Italie et la Libye, et que le président du conseil italien a mis un certain temps avant de prendre ses distances à l’égard du Guide libyen. Cependant, je ne crois pas qu’il existe une différence majeure d’appréciation entre l’Italie et les autres pays européens. Les Italiens se sentent en première ligne, notamment pour ce qui concerne la question migratoire. Nous devons donc manifester notre solidarité et trouver ensemble les mécanismes adéquats.
Si l’on se projette dans l’avenir, monsieur Destot, on constate que la Libye est un pays riche et qui a vocation à le rester. La production pétrolière devrait augmenter, même si l’objectif initial de passer à 2 millions de barils par jour est désormais irréaliste. Le pays a donc un formidable potentiel de développement, au service d’une population très limitée : un peu plus de 6 millions de Libyens, et 2,5 millions d’immigrés, dont on connaît la détresse actuelle. Si les choses évoluent dans le bon sens, la Libye, pays déjà objectivement important, devrait l’être encore plus à l’avenir.
J’en viens au rôle des femmes en Libye, qui reste méconnu. C’est une société assez conservatrice dans ses mœurs et dans son observance des prescriptions de l’islam, sans toutefois être fanatique. Si on voit peu de femmes dans les rues, et si celles-ci sont généralement voilées, toutes ne portent pas le hidjab. Quant au port du voile intégral, il reste très limité. Le paradoxe est que Kadhafi a plutôt joué, en la matière, un rôle progressiste, du moins dans les années 1970 : à sa manière, il a veillé à favoriser une forme d’émancipation de la femme libyenne, qui était très soumise à la tradition sous la monarchie. Par exemple, il a créé des académies militaires féminines. Des femmes jouaient un rôle dans le système de Kadhafi, de même qu’une femme siège au Conseil national de transition. Cependant, dans un pays où la société civile joue un rôle très limité, les associations féminines sont très encadrées par le système.
M. François Loncle. Vous n’êtes pas en cause, mais je rejoins la remarque de mon collègue Jean-Michel Boucheron : où allons-nous si nos ambassadeurs font leurs valises dès qu’un problème survient dans un pays ? Une telle politique est regrettable et dommageable pour les intérêts de la France. Je souhaite donc qu’elle ne soit pas poursuivie.
Dans le domaine de la coopération franco-libyenne en matière d’industrie, d’énergie nucléaire et d’armement, la libération des infirmières bulgares a constitué un tournant. Nous avons d’ailleurs appris beaucoup de choses dans le cadre de la commission d’enquête sur cette libération. Des promesses ont été faites, des engagements ont été pris, notamment en faveur d’Areva. Avant votre départ, avez-vous réalisé une évaluation de l’état de cette coopération ?
M. Jacques Myard. J’ai sous les yeux un document publié par notre commission et par l’IFRI, l’Institut français des relations internationales : daté du 22 décembre 2010, à un moment où le monde arabe s’enflammait, il ne contient pourtant pas un mot sur ces événements. Or, la conférence portait sur « l’état du monde en 2010 » ! Ma question est donc simple : avez-vous senti venir les choses ?
M. Jean-Paul Bacquet. Existe-t-il une diaspora libyenne, et quel rôle joue-t-elle ?
Par ailleurs, vous avez parlé d’une menace en matière d’immigration, mais je n’ai pas compris si des mouvements migratoires avaient réellement lieu.
M. Robert Lecou. Vous avez évoqué une possible partition, tout en estimant que l’unité libyenne n’était pas menacée. Or, d’après la carte, les puits de pétrole sont plutôt situés dans la partie contrôlée par les insurgés.
M. François Gouyette. En partie seulement.
M. Robert Lecou. De plus, l’économie libyenne est riche, mais fondée à 97 % sur le pétrole. Plutôt que d’envisager une solution militaire, ne faudrait-il pas assurer une présence diplomatique à l’Est ? Sinon, comment le pays pourra-t-il sortir de la situation actuelle ?
M. Claude Gatignol. Quel pourrait être l’avenir des institutions du pays, telles que le gouvernement ou le Parlement ? Récemment, à la radio, le nom d’un dirigeant pouvant succéder au colonel Kadhafi a été mentionné. Qu’en pensez-vous ?
Par ailleurs, la Libye jouait un rôle important dans les pays voisins, en particulier au sud. La disparition du système Kadhafi pourrait-elle avoir des conséquences pour le Niger, le Tchad, le Soudan, voir le Sud algérien ?
En dehors des missions humanitaires, quelle présence l’Occident conserve-t-il sur place ?
Quelles sont les sociétés qui maintiennent la production de pétrole dans ce contexte de troubles ?
Enfin, qu’en est-il des contrats signés par des sociétés françaises ? J’évoquerai notamment les Constructions mécaniques de Normandie, qui devaient remettre à niveau des vedettes rapides – les fameuses « vedettes de Cherbourg ».
M. François Gouyette. Tout d’abord, monsieur Loncle, ce n’est pas seulement l’ambassadeur, mais l’ensemble du personnel diplomatique français qui s’est retiré de Tripoli – y compris ceux que l’on appelle les « amis de la France », c’est-à-dire tous nos employés africains, dont certains travaillent à notre service depuis quinze ou vingt ans, et qui auraient pu courir un vrai danger en restant. La France n’est d’ailleurs pas la seule à avoir pris cette décision : les Américains, les Britanniques, les Espagnols, les Portugais sont partis également. Les pays de l’Union européenne qui ont maintenu une représentation – réduite – sont les Pays-Bas, l’Italie, Chypre, Malte, la Croatie, la Roumanie et la Grèce.
En ce qui concerne la coopération bilatérale, un certain nombre d’accords ont été signés en 2007 dans différents domaines. En octobre 2010, à l’occasion de la visite de M. Estrosi, ministre de l’industrie, une déclaration d’intention a été signée pour relancer cette coopération. En matière de nucléaire, peu a été réalisé, notamment parce que de nombreuses conditions préalables étaient exigées en termes de réglementation et de sûreté. Les Libyens ne disposaient d’aucun arsenal juridique, et tout était à faire. Des contacts ont été pris avec l’Agence France nucléaire international, laquelle a envoyé à l’automne une mission destinée à jeter les bases d’une coopération. Mais les échanges se sont limités à des problèmes juridiques, et on n’a pas vu beaucoup de visiteurs d’Areva en Libye.
En matière de coopération militaire, la Libye était un client possible pour la vente du Rafale, mais c’est l’industriel qui gère la négociation – laquelle n’a connu aucune percée spectaculaire. Par ailleurs, deux bateaux libyens ont fait escale à Toulon en mai, l’envoi de stagiaires de ce pays dans nos écoles militaires, notamment navales, a été envisagé, mais dans ce domaine non plus, on n’a pas observé de grande avancée.
Il en est de même dans le domaine industriel, même si des contrats ont été signés, par exemple par Alstom pour la fourniture de sous-stations électriques. Tout cela est normal au regard de la relation que nous entretenions avec la Libye. Je me souviens que M. Gatignol était venu en 2008 avec RTE, et qu’un accord avait été passé avec l’entreprise d’électricité libyenne dans le cadre du projet de boucle méditerranéenne.
M. Jean-Michel Boucheron. Qu’en est-il de la rénovation des Mirage F1 ?
M. François Gouyette. Un accord spécifique avait été en effet conclu pour leur remise en vol. Mais seuls quatre ont été rénovés par les équipes de Dassault, sur un total d’une douzaine.
Dans le domaine industriel, on peut encore citer Alcatel, un des acteurs importants du marché des télécoms en Libye – mais qui se heurte sur ce créneau à une concurrence chinoise féroce – ou Nexans, pour la fourniture de câbles. Airbus a également signé des contrats pour la fourniture de 41 avions aux deux compagnies libyennes, Libyan airlines et Afriqiyah. Une partie – notamment des Airbus A 330 – a déjà été livrée entre 2008 et 2010. L’aéronautique représente donc un gros poste dans le commerce extérieur de la France avec la Libye, avec l’énergie, les télécommunications et les transports.
Cela étant, sur les grands contrats, la concurrence est extrêmement vive. J’ai mentionné les Chinois, mais les Turcs ont également fait une percée spectaculaire, au point de devenir le troisième partenaire du pays, alors que la Turquie ne faisait même pas partie des six premiers il y a quelques années. Quant à la France, elle se maintient entre la quatrième et la neuvième place – elle était sixième en 2009.
A-t-on senti venir les choses, demande Jacques Myard ? Je l’ai dit : personne ne s’attendait à ce que les choses se passent comme elles se sont passées. Pour autant, au-delà du mécontentement social, qui était gérable avec la redistribution de la rente pétrolière, il existait chez beaucoup de Libyens un sentiment de frustration devant la situation de blocage dans laquelle se trouvait le pays. Depuis deux ans, rien ne se passait, la réforme patinait, et les perspectives d’ouverture tracées par le fils de Kadhafi tendaient à s’éloigner. On sentait même un retour à une forme de nationalisme économique qui n’était pas de très bon augure pour l’investissement étranger. Il existait donc un mécontentement diffus. Cela étant, personne ne pouvait imaginer la suite des événements : ni les Américains, ni les Russes, ni aucun pays arabe.
Même si je comprends, monsieur Lecou, que l’on puisse y voir une forme de contradiction, l’hypothèse d’une division du pays entre plusieurs régions contrôlées par des autorités différentes n’empêche pas que le sentiment d’unité nationale soit un facteur durable susceptible de survivre à l’actuel régime.
Par ailleurs, il existe bien une diaspora libyenne. Dans les années 1950, la Libye était un pays pauvre, et nombre de ses habitants émigraient dans d’autres pays africains pour gagner leur vie, en Tunisie, par exemple. Aujourd’hui, ceux qui partent le font surtout pour fuir un régime autoritaire. De nombreux Libyens sont allés faire des études aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, puis y sont restés. Certains sont toutefois rentrés à la faveur de la libéralisation relative du pays dans les années 2000. Saïf al-Islam, qui pouvait incarner il y a encore quelques années le modernisme et l’ouverture – il montre aujourd’hui un visage bien différent –, avait fait revenir beaucoup d’exilés, qui étaient censés l’aider à mettre en œuvre la réforme. L’un d’entre eux, le docteur Mahmoud Jebril, est maintenant un des responsables du gouvernement de transition à Benghazi.
En ce qui concerne la question migratoire, la menace est celle d’un flux incontrôlé de migrants subsahariens qui profiteraient de l’anarchie ambiante et de la météo clémente pour traverser la Méditerranée jusqu’à Lampedusa. Le phénomène est réel, et il existe un risque qu’il perdure si les autorités libyennes, quelles qu’elles soient, ne sont pas en mesure de contrôler les flux. Les candidats à l’émigration viennent non seulement du Sud, mais aussi de l’Afrique de l’Est – Somalie ou Érythrée.
Enfin, les institutions libyennes ont été façonnées par Kadhafi. Lui survivront-elles si celui-ci devait partir ? C’est très improbable. Dans le cas où un nouveau pouvoir s’installerait à Tripoli, l’architecture institutionnelle qu’il mettrait en place serait assurément très différente de celle que nous avons connue jusqu’à aujourd’hui.
Mme Martine Aurillac, présidente. Monsieur l’ambassadeur, je vous remercie pour toutes ces précisions.
5.- Mardi 15 mars 2011, séance de 16 heures 45, compte rendu n° 43 : extraits de l’audition de M. Alain Juppé, ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et européennes (ouverte à la presse)
M. le président Axel Poniatowski. Merci, monsieur le ministre d’État, d’avoir accepté l’invitation de notre commission, deux semaines après votre prise de fonction. Comme l’a dit le président de la République lors de son allocution du 27 février, les révolutions arabes en cours ouvrent une ère nouvelle des relations entre la France et les pays concernés. Vous avez été choisi pour conduire notre diplomatie sur cette voie : la tâche est aussi capitale que délicate.
Ayant effectué un passage remarqué dans ce ministère entre 1993 et 1995, vous êtes déjà au fait des enjeux. Soyez assuré que notre commission suivra avec attention cette nouvelle ère de la diplomatie française.
Bien qu’elle ne se limite pas, loin s’en faut, à ces événements, l’actualité internationale est dominée par le formidable réveil démocratique que connaît le monde arabe depuis le mois de décembre dernier, ainsi que par l’évolution dramatique de la guerre en Libye. Sur ces deux points, nous sommes intéressés par votre analyse. Quelles sont les initiatives de la France ? Où en sont les discussions avec nos partenaires européens ? S’agissant de la Libye, comment interprétez-vous la déclaration de la Ligue arabe, samedi dernier, en faveur d’une zone d’exclusion aérienne ?
[…]
M. Alain Juppé, ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes. Merci de me donner cette première occasion de m’exprimer devant votre commission en qualité de ministre des affaires étrangères et européennes. Je ne pourrai pas vous consacrer beaucoup plus d’une heure, car le président de la République organise, en fin d’après-midi, une réunion consacrée à la situation internationale. Nous nous reverrons cependant aussi souvent que vous le souhaiterez.
Je suis très heureux de retrouver ce ministère, et me réjouis qu’il ait conservé son dynamisme et son sens de l’intérêt général : notre pays dispose d’une belle machine pour mettre en œuvre sa politique étrangère. Je reviens néanmoins avec d’autant plus d’humilité que le monde est plus imprévisible que jamais. Je limiterai mon propos à trois zones géographiques : le Japon, la rive Sud de la Méditerranée – notamment la Libye – et la Côte d’Ivoire.
[…]
Je veux à présent évoquer la rive Sud de la Méditerranée. La révolution du jasmin en Tunisie et la journée du 25 janvier en Égypte ont ouvert la voie à une série de bouleversements sans précédent, que l’un de mes collègues du G8 n’hésitait pas à comparer à la chute du mur de Berlin. On nous a beaucoup reproché de ne pas les avoir anticipés ; mais, s’il est des sciences prospectives, il en est d’autres qui sont rétrospectives : peut-être la diplomatie appartient-elle à cette seconde catégorie.
Les causes de ces événements sont multiples. La première est la remise en cause de la légitimité des régimes politiques autoritaires arabes, républiques ou monarchies, notamment par des classes moyennes naissantes, instruites et modernes, qui aspirent à participer davantage à la vie politique et expriment leur désir de liberté. Ainsi, en Tunisie, les efforts consentis depuis des années pour élever le niveau de formation ont fait naître chez les jeunes une conscience politique aiguë, alors que, dans le même temps, ils ne trouvaient pas d’emplois.
La deuxième raison tient à l’usure du pouvoir – certains règnes ayant duré plusieurs décennies – et le sentiment de frustration des populations face à l’accaparement des richesses, à la corruption et aux brimades quotidiennes imposées par les forces de l’ordre.
Il y a encore les problèmes économiques et sociaux, comme le chômage ou la hausse des prix des produits de première nécessité, en particulier alimentaires, tous phénomènes liés à la crise économique mondiale de ces deux dernières années.
On peut enfin évoquer le rôle amplificateur des médias : la chaîne Al Jazeera et, sur internet, des réseaux sociaux tels que Facebook, dont l’un des membres du groupe de la coordination du 25 janvier que j’ai rencontré place Tahrir était d’ailleurs spécialiste.
Ces éléments sont communs à tous les pays de la zone qui s’étend du Maroc à l’Iran ; à travers les mouvements de contestation qu’ils ont déclenchés, ils portent en eux un immense espoir de changement pour l’ensemble de la région. Ce nouveau « printemps arabe » ne doit pas nous faire peur. Trop longtemps, nous avons cru que les régimes autoritaires étaient les seuls remparts contre l’extrémisme dans les sociétés arabes. En Tunisie et en Égypte, les peuples ont balayé ce cliché en exprimant avec une grande maturité leur aspiration à la démocratie. En Égypte, les autorités ont répondu de manière responsable, sans céder à la tentation de la violence : l’armée pilote désormais la transition en concertation avec les représentants de la place de la Libération – place Tahrir –, que j’ai rencontrés lors de ma visite au Caire le 6 mars dernier. Plusieurs problèmes restent néanmoins posés : le calendrier électoral, mais aussi les espoirs suscités au sein de la population, qui attend les bénéfices de la révolution, autrement dit des augmentations de salaire et des avantages sociaux. Or, en Égypte, la machine économique se grippe : le taux de fréquentation des hôtels est tombé à 10 ou 15 %, et plusieurs centaines de milliers de réfugiés de Libye, qui envoyaient de l’argent, sont rentrés ou vont le faire. Cette situation ne fait que renforcer notre devoir d’aide.
Au Maroc, le Roi a prononcé un discours visionnaire et courageux que je veux saluer : il est le premier, à ma connaissance, à lancer l’idée, qui pourrait servir d’exemple, d’une monarchie constitutionnelle. Cette réforme devrait être élaborée en concertation avec les partis politiques et la société civile.
Nous devons prendre acte de cette nouvelle donne dans notre approche de la région du Sud méditerranéen, non pour donner des leçons ou exporter nos standards, mais pour accompagner nos partenaires dans leur transition démocratique, dans un esprit de confiance, d’amitié et d’écoute. Il s’agit également de favoriser l’émergence d’une zone stable et prospère, en aidant les pays concernés à résoudre leurs difficultés économiques et sociales : c’est non seulement notre responsabilité mais aussi notre intérêt. Il est totalement illusoire de vouloir maîtriser les flux migratoires en érigeant des murs : d’autres ont essayé de le faire, avec le résultat que l’on sait, à la frontière du Mexique. Même si, dans l’immédiat, nous devons faire preuve d’une grande vigilance sur l’immigration illégale, la seule solution, à plus long terme, est la diminution des inégalités de développement entre le Nord et le Sud.
C’est dans cet esprit que nous devons aussi refonder l’Union pour la Méditerranée (UpM). Même si cette initiative s’est heurtée à plusieurs obstacles, à commencer par le blocage du processus de paix entre Israéliens et Palestiniens, les événements actuels montrent qu’elle était prémonitoire. Nous allons donc la relancer en rappelant, d’une part, qu’elle repose sur un partenariat équilibré entre le Nord et le Sud, et, de l’autre, qu’elle consiste à développer des projets concrets, qu’il s’agisse de l’énergie solaire, de la dépollution de la Méditerranée ou de l’Office méditerranéen de la jeunesse, qui permettra d’organiser le flux des étudiants.
Dans l’immédiat, et pour répondre à l’urgence, nous pouvons nous appuyer sur les outils existants, comme la Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat (FEMIP) ou la Banque européenne d’investissement (BEI), dont le Conseil européen a décidé, la semaine dernière, de relever le plafond des mandats d’intervention en Méditerranée. Pour aller plus loin, la France propose de créer une véritable facilité méditerranéenne d’investissement, en s’appuyant notamment sur la FEMIP.
Nous devons également poursuivre nos efforts en faveur du processus de paix. Les aspirations du peuple palestinien ne sont pas moins légitimes que celles des autres peuples de la région : il nous faut y répondre en œuvrant à l’établissement d’un État palestinien démocratique, viable, continu, vivant en paix et en sécurité au côté de l’État d’Israël. Cet objectif est aujourd’hui agréé par tous. Le statu quo n’est pas tenable. Une nouvelle donne s’est créée autour d’Israël : nous devons en convaincre nos partenaires du Quartet afin de progresser dans la définition des paramètres d’un accord sur le statut final. L’année 2011 doit être celle de la reconnaissance d’un État palestinien, conformément à la feuille de route que nous nous sommes fixée : tous les partenaires du G8 partagent ce sentiment, même si nos amis américains le font avec quelques nuances.
Enfin, nous devons veiller à adapter les grandes lignes de notre action aux spécificités de chaque pays. L’urgence est évidemment la Libye, notre premier souci étant de protéger les populations civiles. Le dossier est évidemment très sensible, dans la mesure où le rapport de forces entre le régime de Tripoli et l’opposition établie à Benghazi, est en train d’évoluer. Sans vouloir m’attarder sur le passé récent, je ne résiste pas à l’envie de rappeler que la France a été le premier pays, avec la Grande-Bretagne, à dire qu’il fallait empêcher le colonel Kadhafi d’utiliser la violence pour tenter de rétablir son autorité. C’est possible, car peu d’aéroports permettent le décollage d’avions de guerre ; de surcroît, si la Libye a peut-être acheté quelque 400 avions de chasse depuis quarante ans, il n’est pas vrai, comme l’ont soutenu certains de nos partenaires, qu’ils soient tous opérationnels : moins d’une vingtaine le sont, et guère plus d’hélicoptères. La France ne défendait pas l’idée d’une zone d’exclusion aérienne, difficile sur un territoire aussi vaste, mais, sur la base d’un mandat du Conseil de sécurité de l’ONU, des frappes ciblées sur des objectifs militaires ; car ce sont bien les bombardements aériens qui ont permis au colonel Kadhafi de renverser le rapport de forces avec la rébellion. Certains de nos partenaires, au premier rang desquels mon collègue allemand, se sont opposés à tout recours à la force. La Russie, quant à elle, n’était guère enthousiaste, et les États-Unis ont mis beaucoup de temps à définir leur position.
Que faire face à la progression des troupes du colonel Kadhafi ? J’ai eu beaucoup de mal à mettre d’accord les participants au G8, qui, sans être un organe de décision, regroupe tout de même quatre membres du Conseil de sécurité. Un consensus a été trouvé pour que celui-ci adopte, dans les plus brefs délais, des mesures destinées à exercer une pression suffisante sur le colonel Kadhafi : l’idée d’une zone d’exclusion aérienne est l’une d’entre elles, même si certains membres y sont hostiles ; pour notre part, nous la jugeons dépassée. Second point d’accord : la nécessaire implication des pays arabes. Entrer en Libye sous la bannière de l’OTAN serait la meilleure façon de braquer les opinions arabes. La Ligue arabe a demandé une zone d’exclusion aérienne, mais nos amis russes ont fait observer que cette déclaration était un peu ambiguë et assortie de réserves ; quant à l’Union africaine, elle n’est pas tout à fait sur la même ligne. Le président de la République travaille à l’organisation d’un sommet entre l’Union européenne, l’Union africaine et la Ligue arabe.
[…]
M. le président Axel Poniatowski. Une mission que je dirige se rendra à Tunis lundi et mardi prochains : beaucoup de rencontres sont prévues.
Nous en venons aux questions.
M. Rudy Salles. Hier, à Tunis, j’ai été reçu par le président Mebazaa en ma qualité de président de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée. Si le processus de démocratisation recueille un large assentiment de la population, la situation économique et sociale s’est aggravée depuis la révolution. Les activités touristiques ont cessé, et les autorités s’inquiètent des positions de l’Europe, qui à leurs yeux abandonnent le Sud au profit des pays de l’Est. Les Tunisiens se tournent vers la France pour que la Tunisie ne soit pas oubliée. Qu’en pensez-vous ?
M. Jean-Michel Boucheron. Sous quel mandat de l’ONU l’Arabie saoudite intervient-elle au Bahreïn ? Quelle est la position de la France à ce sujet ? Cela paraît malheureusement clair.
La position du gouvernement français sur le dossier libyen me paraît la bonne : je regrette qu’elle n’ait pas été suivie. Il est tout aussi impossible de laisser les massacres se poursuivre que d’intervenir sous la bannière de l’OTAN, ne serait-ce qu’en raison du veto de la Turquie. Cependant, on ne peut rester sans rien faire. Les pays européens ont-ils vraiment besoin de diverses autorisations pour agir ? Ne pourrait-on, à tout le moins, armer la résistance libyenne à Benghazi ? Cela me semblerait conforme à la morale.
M. Dominique Souchet. Hier, à Beyrouth, une grande manifestation a été organisée contre le Hezbollah, que l’on accuse d’avoir renversé le gouvernement Hariri par un coup d’État et d’enrayer les travaux du tribunal spécial. Comment interprétez-vous ces événements ? Quelle est votre analyse de la situation au Liban ?
M. Robert Lecou. Il y a quinze jours, lors d’un débat dans l’hémicycle, nous exprimions nos espoirs d’une démocratisation de l’Afrique du Nord ; la semaine dernière, lors de l’audition de l’ambassadeur de Libye, nous évoquions une possible partition entre l’Est et l’Ouest, et même l’installation de représentations diplomatiques à Benghazi. Au rythme où vont les choses, ces échanges me semblent déjà lointains.
J’approuve la position du président de la République, qui a reconnu le Conseil national de transition et proposé des frappes ciblées. Des femmes libyennes avaient alors brandi le drapeau français, mais, depuis, les mercenaires de Kadhafi ont progressé vers Benghazi. Le prix de l’inaction et la victoire odieuse du dictateur seraient dramatiques pour les combattants de la liberté, sans parler de la perte de crédit de l’Occident et de l’inadaptation des organisations internationales, notamment de l’Union européenne, qui se montre incapable de définir une politique commune. La France peut-elle prendre des initiatives pour éviter une tuerie sanglante et faire en sorte que la démocratie soit une force agissante ?
M. Jean-Paul Lecoq. Nous avons toujours manifesté notre hostilité au colonel Kadhafi, notamment lors de sa réception par l’Assemblée nationale et les plus hautes autorités de l’État. Cependant, l’attitude du gouvernement sur l’utilisation de la force en Libye ne nous apparaît pas comme une bonne réponse et de manière générale l’utilisation de la force armée ne nous semble pas la bonne réponse. Les problèmes auraient pu se régler politiquement ; le peuple libyen paie aujourd’hui le prix de notre passivité d’alors.
Vous avez évoqué le contexte social de la révolution tunisienne ; il semble que la situation soit un peu différente en Libye. Avez-vous des précisions, notamment sur la répartition des richesses dans ce pays ?
Enfin, la répression marocaine au Sahara occidental, où sont nés les premiers mouvements de résistance, reste très dure. J’ai bien noté les dernières déclarations du roi du Maroc, mais je souhaiterais que notre pays ne reste pas silencieux sur ce point.
M. le ministre d’État. Il n’y a pas lieu de craindre, monsieur Salles, que l’Europe abandonne le Sud méditerranéen, auquel, selon le vœu de la France, un Conseil européen a été intégralement consacré. La déclaration finale, sans ambiguïté, indique que le colonel Kadhafi doit quitter le pouvoir, que les sanctions et l’aide humanitaire doivent être renforcées, que l’Europe doit s’investir fortement dans l’aide aux pays du Sud et que le Conseil de sécurité de l’ONU doit étudier tous les moyens – en d’autres termes, y compris une zone d’exclusion aérienne. Sur les 12 milliards d’euros alloués au titre de la politique de voisinage entre 2007 et 2013, les deux tiers vont aux pays méditerranéens, contre un tiers aux pays d’Europe orientale. À Budapest, la présidence hongroise m’avait d’ailleurs fait part d’une inquiétude inverse de celle que vous avez évoquée.
Rien n’interdit à un pays de venir en aide à un autre qui le lui demande, monsieur Boucheron : l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis n’ont donc pas besoin d’un mandat international pour intervenir au Bahreïn. Nous avons néanmoins rappelé qu’une telle intervention n’exonérait pas les gouvernements de tenir compte des aspirations démocratiques des peuples. Notre discours est le même que pour le Yémen : la force ne peut se substituer au dialogue avec les populations.
Quant à la Libye, tout dépend de ce que nous obtiendrons du Conseil de sécurité de l’ONU. Un embargo maritime, par exemple, priverait le colonel Kadhafi de frégates. Je n’ai pas de réponse explicite à vous faire sur la livraison d’armes.
J’ai bien noté, monsieur Souchet, les manifestations au Liban où un gouvernement est en cours de constitution. Nous lui avons clairement indiqué que le tribunal spécial devait avoir les moyens de travailler ; dans le cas contraire, nous reverrions notre position. Nous mettons en garde contre toute ingérence étrangère.
Il est d’usage, monsieur Lecou, de dénoncer l’incapacité de l’Union européenne. Mais celle-ci n’a ni la légitimité ni les moyens de rétablir l’ordre au Bahreïn ou ailleurs ; au demeurant, si elle le faisait, elle provoquerait des réactions très hostiles. Nous devons soutenir les pays concernés, non leur imposer notre modèle de démocratie en y envoyant nos troupes.
Quant aux initiatives de la France, elles n’ont pas cessé : Conseil européen sur la Libye ; prochaine tenue, sans doute à Paris dans le cadre du G8 – ce qui nous permettra d’inviter les pays européens qui y siègent – d’une réunion entre l’Union africaine, la Ligue arabe et l’Union européenne ; proposition du président de la République de réunir les ministres du G20 sur l’énergie et la sécurité nucléaire ; sans oublier nos préconisations sur une intervention aérienne en Libye. Mais, sur ce dernier point, la France ne peut s’engager seule : elle doit le faire dans le cadre d’une coalition internationale associant les pays arabes.
Monsieur Lecoq, c’est lorsque le président Chirac a menacé de riposter par la force que le processus de paix s’est déclenché dans les Balkans ; la même menace, formulée par la France et les États-Unis, avait d’ailleurs permis de mettre fin au bombardement de Sarajevo. Comme dit l’adage, si vis pacem, para bellum. Je ne partage donc pas votre refus a priori du recours à la force.
M. Jean-Paul Dupré. Faut-il conclure, à l’issue de la réunion des ministres des affaires étrangères du G8 hier, qu’il n’y aura pas de résolution pour une zone d’exclusion aérienne en Libye, au risque de voir les insurgés se faire massacrer par l’armée ?
[…]
M. Jacques Myard. L’UpM était peut-être prémonitoire, mais elle est devenue une usine à gaz amalgamant tous les problèmes, notamment celui des relations entre Gaza et Israël. Il faut revenir à ce que j’appellerais un « multi-bilatéralisme ».
Deuxième point : pourquoi ne pas prendre l’initiative de reconnaître un État palestinien ? Cela permettrait de débloquer les choses : ayons le courage d’un nouveau discours de Phnom Penh.
En Égypte, les Frères musulmans tiennent des discours variés. Qu’en pensez-vous ?
À propos de la Libye, on constate l’impuissance de l’Union européenne. Toutefois, il y a peut-être une solution si les rebelles se constituent en gouvernement autonome et démocratique, puis font appel à la Ligue arabe.
Enfin, n’oubliez pas de vous préoccuper du budget de votre ministère.
M. Michel Destot. La Tunisie est le pays le plus avancé dans la transition démocratique ; et c’est celui qui, par son histoire, sa culture et sa langue, est le plus proche du nôtre. Il est donc essentiel qu’il réussisse aussi sa transition sur le plan économique et social.
La France a une responsabilité particulière à cet égard. Ne peut-on faire appel à certaines de nos entreprises, développer une coopération décentralisée vers les collectivités territoriales tunisiennes, ou même suggérer à nos concitoyens de prendre leurs prochains congés à Djerba plutôt qu’à Arcachon ?
M. Henri Plagnol. Vous avez comparé à juste titre les révolutions du monde arabe avec la chute du mur de Berlin. Source de beaucoup d’espoirs, ce printemps des peuples peut aussi entraîner des désordres. Vous vous étiez rendu au Niger et au Sahel en tant que ministre de la défense : ne craignez-vous pas, au vu notamment des événements en Libye et des possibles soubresauts en Algérie, une recrudescence de l’islamisme radical dans cette région ? AQMI ne risque-t-il pas de faire son miel de la situation ? Quelles initiatives la France et l’Europe peuvent-elles prendre pour empêcher des conséquences désastreuses à cet égard ?
M. le ministre d’État. Ce n’est pas sans mal que nous avons arraché au G8 une déclaration d’intention commune, monsieur Dupré. Sur cette base, nos représentants à l’ONU travaillent à un projet de résolution avec nos partenaires, incluant l’hypothèse d’une zone d’exclusion aérienne.
Il est vrai sans doute que la prise de Benghazi par le colonel Kadhafi serait non seulement un désastre en termes de vies humaines, mais aussi un échec politique pour tous ceux qui réclament son départ depuis des semaines – les Européens, mais également les Américains –, sans parler du risque de « somalisation », car je n’imagine pas que M. Kadhafi puisse rétablir un pouvoir autoritaire sans provoquer des réactions très hostiles ; cela pourrait en effet, monsieur Plagnol, augmenter les risques liés à Al-Qaida.
[…]
Il faut peut-être simplifier le fonctionnement de l’UpM, monsieur Myard, mais elle a au moins le mérite de proposer des projets concrets, tels qu’un Office méditerranéen de la jeunesse ou une banque d’investissement pour l’Afrique du Nord. Quant à reconnaître un État palestinien, cela ne sert à rien de le faire seul – pardon de vous rappeler, sur ce point, les vertus de la coopération européenne. Nous n’en sommes pas encore là, mais nous devons, je pense, garder cette hypothèse à l’esprit.
S’agissant des Frères musulmans en Égypte, tout est possible, le pire comme le meilleur. Parmi les jeunes que j’ai rencontrés, qui m’ont beaucoup impressionné par leurs qualités intellectuelles, quatre disaient appartenir aux Frères musulmans – l’un se qualifiait de « musulman libéral » –, et leur référence commune était l’AKP en Turquie, parti islamique mais démocratique. Nous devons, je pense, faire le pari de la confiance, tout en aidant ces pays, y compris économiquement.
Je veux bien que l’on parle d’impuissance européenne en Libye, mais où est la puissance américaine, russe, chinoise ? Le blocage actuel ne tient pas à une impuissance de l’Europe, mais au refus de la Chine de toute ingérence internationale. La Russie est en train d’évoluer et les Américains, dont on a tant vanté la lucidité sur la Tunisie et l’Égypte, n’ont pas défini de position ; pour le coup, si nous n’avons pas anticipé tous les événements en Libye, du moins avons-nous agi avant les autres.
Je ne suis pas venu pour défendre le budget de mon ministère, mais le fait est que la situation n’est pas satisfaisante. Le Quai d’Orsay effectuant ses recrutements en décalage par rapport à l’année civile, il a anticipé, dans le budget de 2009, les suppressions de postes de 2010, allant même au-delà de ce que prévoyait la RGPP. Or, on nous demande aujourd’hui de respecter le quota initialement prévu pour 2010 sans tenir compte des anticipations de l’année précédente. On ne peut réclamer des personnels diplomatiques disponibles dans les situations de crise tout en continuant de supprimer des emplois comme on le fait depuis dix ans : nous sommes désormais à l’os ; il s’agit de savoir si notre pays entend conserver ses moyens diplomatiques.
Il faut effectivement mobiliser davantage de moyens pour la Tunisie, monsieur Destot. Nous avons demandé à l’Agence française de développement d’augmenter les crédits consacrés aux missions d’entreprises. Et nous prévoyons d’organiser dans les prochains mois en Tunisie, où je me rendrai dès que possible, des assises de la coopération décentralisée. Un plan d’urgence est indispensable, de même que pour l’Égypte.
S’agissant du tourisme, notre pays est l’un des seuls à ne pas déconseiller de se rendre en Égypte ou en Tunisie.
M. Didier Julia. Je salue votre voyage en Égypte, qui a donné une image sympathique et moderne de la diplomatie française.
Sur la Libye, vous avez formulé une proposition : reste à la faire appliquer. A Sarajevo, le président de la République s’était souvenu qu’il était chef des armées, et il n’avait sollicité l’avis ni de la Chine, ni de la Russie. Si l’on veut éviter un génocide en Libye, la seule solution, dont vous avez dit qu’elle n’était pas difficile à mettre en œuvre, est de neutraliser l’aviation du colonel Kadhafi, puis les deux bâtiments militaires qui tirent sur les populations civiles.
Nous avons observé, dans l’hémicycle, une minute de silence pour les victimes japonaises ; il nous serait insupportable de le faire un jour pour celles de Benghazi. La crédibilité de notre pays et de son chef d’État en serait gravement affectée.
M. le ministre d’État. Il est possible, mais non facile, de détruire la force aérienne du colonel Kadhafi : n’oublions pas que la Libye dispose de défenses anti-aériennes.
La comparaison avec les Balkans a ses limites : le conflit était européen et des forces étaient déjà sur place. Vous nous confiez la lourde responsabilité d’arrêter le massacre : nous ferons tout pour cela.
M. Lionnel Luca. La voix des États-Unis, flamboyante au début des révolutions arabes, semble s’éteindre comme une bougie. Avez-vous des explications ?
J’aimerais également que vous nous disiez un mot sur la mise au pas de Bahreïn par l’Arabie saoudite, dans l’indifférence médiatique générale et le mutisme des États-Unis. Y aurait-il une odeur de pétrole ?
M. le ministre d’État. Le président Obama a clairement indiqué que le colonel Kadhafi devait partir et Mme Clinton, que nous avons rencontrée hier soir dans le cadre du G8, soutient notre démarche en posant une condition que nous partageons, à savoir l’implication des pays arabes. Les Américains sont tout à fait conscients qu’une intervention sous la bannière de l’OTAN serait contre-productive. Si nous décidons une intervention aérienne, les pays arabes doivent s’y associer.
M. Didier Julia. Ils n’ont pas d’avions !
M. le ministre d’État. Si : les Émirats arabes unis ont une flotte, de même que l’Arabie saoudite – nous avons même formé leurs pilotes.
Quant au Bahreïn, je vous renvoie à mon propos liminaire. La clé est moins le pétrole que la rivalité entre chiites et sunnites.
[…]
6.- Mercredi 30 mars 2011, séance de 9 heures 45, compte rendu n° 45 : compte rendu de la mission effectuée en Tunisie par M. le président Axel Poniatowski, Mme Chantal Bourragué, M. Dino Cinieri, M. Jean-Paul Lecoq et M. François Loncle.
M. le président Axel Poniatowski. La mission que j’ai conduite, composée de Mme Chantal Bourragué et MM. François Loncle, Jean-Pierre Lecoq et Dino Cinieri, s’est rendue à Tunis du 20 au 22 mars. Nous avons rencontré des représentants de trois partis de centre gauche : le Forum démocratique et des libertés, présidé par M. Ben Jaffar, le parti démocrate progressiste, fondé par M. Chebbi et le « Tadjid », issu du parti communiste tunisien et dirigé par M. Brahim. Ces trois personnalités seraient probablement candidats à une présidentielle. Nous avons également eu des entretiens avec des représentants d’Ennahda, le parti religieux, et avec le fondateur d’El Watan, émanation de l’ancien parti de Ben Ali, et des représentants des syndicats. Outre une audience avec le ministre des affaires étrangères, nous avons entendu le président de la haute instance en charge de préparer les élections de l’assemblée constituante, qui est probablement l’instance politique la plus importante aujourd’hui, ainsi que le président de la commission chargée de lutter contre la corruption et un responsable de la commission d’établissement des faits sur les abus commis durant les événements, commissions qui ont des difficultés à fonctionner. La mission a également rencontré des journalistes et divers représentants de la société civile ainsi que des représentants de la communauté française.
De ces entretiens très riches, je tirerai deux conclusions principales. Tout d’abord, les changements politiques en Tunisie devraient avoir, à terme, des effets positifs sur les relations bilatérales à condition que la France sache répondre aux attentes qui se sont exprimées. D’autre part, la transition politique en Tunisie est bien engagée, mais il subsiste encore des incertitudes et des inquiétudes.
Tous nos interlocuteurs nous ont confirmé que la relation franco-tunisienne demeurait essentielle et que la France était le premier partenaire de la Tunisie. Ils estiment dans l’ensemble que les problèmes qui étaient apparus pendant les événements sont maintenant aplanis et regardent tous davantage vers l’avenir que vers le passé. Nous avons pu constater également que la prise de position française dans la crise libyenne était plutôt très bien perçue en Tunisie sous réserve bien entendu qu’il n’y ait pas d’envoi de troupes au sol.
Je rappellerai quelques éléments s’agissant des liens traditionnels qui nous unissent. Sur le plan humain : 30 000 Français vivent en Tunisie et 600 000 Tunisiens en France dont 420 000 binationaux. Sur le plan économique, la France est le premier partenaire de la Tunisie ; les 1250 entreprises françaises représentent 110 000 emplois et avec 3,4 milliards d’exportations françaises vers la Tunisie contre 3,5 d’importations, les échanges sont équilibrés. Par ailleurs, l’AFD verse 100 millions d’euros par an.
Les nombreuses visites ministérielles qui se sont succédé à Tunis ont donc permis de rétablir rapidement le contact ; d’autres vont suivre, celle de M. Alain Juppé étant particulièrement attendue.
La France est également perçue comme le meilleur avocat de la Tunisie auprès de l’Union européenne. Le gouvernement va adresser des memoranda à ses interlocuteurs. Il est probable qu’elle adressera un mémorandum à l’Union plutôt qu’à chacun des Etats membres. Par ailleurs, un accord donnant à la Tunisie un « statut avancé », à l’instar de celui conclu avec le Maroc, doit être conclu dans les meilleurs délais. Ce statut prévoit d’achever l’instauration du libre-échange par la libéralisation des échanges agricoles et une harmonisation poussée des législations économiques. La Tunisie pourrait aussi participer à certaines agences européennes, comme Europol, l’agence européenne des médicaments, ou les opérations européennes de gestion des crises.
On ne doit pas se cacher que ce discours ouvert est conditionné à la capacité de la France d’aider la Tunisie – directement ou via l’Union européenne – à sortir de ses difficultés économiques. En 2010, le taux de croissance de l’économie était de 3,7 % mais en 2011 la croissance sera proche de zéro, voire négative. Le taux de chômage qui était déjà de 13 % en 2010 et même de 23 % chez les moins de 25 ans, va augmenter. Les mouvements sociaux sont nombreux et récurrents; les chefs d’entreprise ont dû consentir des augmentations de salaires importantes, 15 % peut-être en moyenne, ce qui constitue un élément inflationniste d’autant qu’une course aux augmentations de salaires s’est engagée. Le déficit budgétaire devrait augmenter, probablement jusqu’à atteindre 5 % du PIB, ainsi que celui de la balance des paiements. La Tunisie aura un besoin de financement complémentaire de 2,3 milliards d’euros.
S’agissant de la transition politique, elle nous a paru bien engagée mais de fortes incertitudes et des inquiétudes subsistent.
Le spectre d’un retour de l’ancien régime semble conjuré et la liberté d’expression et de manifestation est totale, les Tunisiens en usant sans crainte. Mais le gouvernement a une légitimité toute relative, limitée à la période de transition. Le ministre des affaires étrangères nous a déclaré qu’il n’entendait pas discuter de ce qui se passerait après cette période. Le gouvernement gère les affaires courantes et il appartient exclusivement à la haute instance de conduire les débats entre les partis politiques qui y sont représentés et dont le nombre ne cesse de croître. Le soir de notre arrivée, 44 partis étaient reconnus ; ils étaient 49 le mardi suivant…
La police est déconsidérée et l’armée assure principalement la tâche de maintenir l’ordre public. Le RCD a été dissous alors qu’il comprenait 6 000 cellules et 2 millions de membres. L’administration locale n’exerce aucune autorité réelle dans les provinces. Le président de la République par intérim aurait dû cesser d’exercer ses fonctions le 17 mars puisque la constitution limite cet intérim à deux mois. Le gouvernement de transition gouverne par décrets-lois et le parlement est en sommeil. Nous n’avons d’ailleurs pas souhaité rencontrer de parlementaires puisque ceux-ci sont tous de l’ancien RCD.
Les syndicats disposent d’une certaine influence mais peinent à maîtriser le jeu social. Le principal, l’UGTT, a une image trouble car certains de ses dirigeants se sont compromis sous Ben Ali, et a pris en marche le train de la révolution. Un deuxième syndicat s’est constitué récemment – la CGTT, émanation du premier.
Le gouvernement Ghannouchi a tenté de mettre en oeuvre une sortie de crise rapide mais a dû céder la place à un nouveau gouvernement, conduit par M. Essebsi, composé de technocrates qui se sont tous engagés à ne pas se présenter aux prochaines élections afin de donner un gage à la population extrêmement méfiante. Une assemblée constituante devrait être élue le 24 juillet et des élections législatives devraient suivre d’ici la fin de l’année, mais on peut douter que ces échéances seront respectées.
Le débat principal porte sur le choix du mode de scrutin pour l’élection de la constituante qui sera sans doute également celui retenu pour les élections suivantes. Le président de la haute instance avance difficilement. La composition de cette instance sera élargie. Son président a proposé deux modes de scrutin : la proportionnelle sur la base de listes régionales ou un scrutin uninominal à deux tours par circonscription. La préférence des partis politiques semble se porter sur la proportionnelle car le scrutin uninominal favoriserait les notables et les chefs de clan.
Il convient également de relever que la principale incertitude, soulignée par la plupart de nos interlocuteurs, réside dans la difficulté de cerner le poids et la nature du parti Ennahda Les représentants de ce parti nous ont tenu des propos modérés mais la société civile et les autres partis sont très réservés à leur égard. Lorsque nous les avons interrogés sur le statut des femmes, leurs réponses nous ont paru ambiguës.
En conclusion, la principale interrogation à propos de la situation politique concerne la durée de la période de transition. Les attentes sont fortes et le peuple a le goût de la liberté mais une transition trop longue serait aventureuse. Les élections de la constituante risquent d’être retardées ; certains partis le souhaitent pour avoir le temps de se faire connaître. Ces élections peuvent aboutir à une assemblée sans majorité et les travaux de la constituante peuvent eux aussi traîner en longueur. A priori, cette assemblée constituante devrait aussi investir un nouveau gouvernement qui sera plus légitime que l’actuel, mais cette période sera très incertaine.
Néanmoins, la Tunisie dispose de certains atouts qui fondent un optimisme raisonnable : une cohésion nationale forte, une classe moyenne nombreuse et éduquée, un statut de la femme que personne ne semble vouloir remettre en cause et une classe politique et une élite économique et administrative de qualité.
La situation économique dépendra beaucoup de la capacité des entreprises françaises à investir en Tunisie et dans le sort de la prochaine saison touristique qui paraît pour le moment très compromis par les événements en Libye.
M. François Loncle. J’approuve le compte rendu de notre mission que le président Poniatowski vient de faire et j’y ajouterai seulement quelques remarques brèves.
Ce déplacement en Tunisie était une excellente idée, d’autant que la manière dont les Tunisiens ont fait leur révolution sert de modèle aux autres pays arabes, en dépit des différences souvent importantes entre leurs situations. On peut observer trois phases : la première, entre le suicide du jeune Mohamed Bouazizi le 17 décembre 2010 et le départ du président Ben Ali, le 14 janvier ; la deuxième, actuellement en cours, qui s’achèvera avec la tenue de l’élection de l’assemblée constituante, prévue le 24 juillet ; une troisième, qui s’ouvrira ensuite et sera certainement la plus délicate.
Il me semble que le risque le plus important aujourd’hui est celui de l’enlisement dans un débat institutionnel qui n’intéresse que les élites politiques, au détriment du traitement des questions sociales et économiques qui sont d’autant plus essentielles que l’économie s’est effondrée et que les revendications sociales, souvent exprimées sur un mode « soixante-huitard » sont très pressantes. On assiste à une forme de course de vitesse entre ces deux processus, qui reflète le clivage entre des élites politiques âgées et la jeunesse de ceux qui ont fait la révolution.
En ce qui concerne les relations franco-tunisiennes, j’observe l’extrême proximité des deux pays, à tous les points de vue. La France doit absolument suivre de près tout ce qui touche à la Tunisie. De toute la polémique qui a entouré l’attitude de Mme Michèle Alliot-Marie en lien avec les événements récents, c’est le fait qu’elle ait proposé l’aide de la police française au régime de Ben Ali qui a le plus choqué les Tunisiens. Son remplacement par M. Alain Juppé est une bonne chose. Il est urgent que notre pays investisse en Tunisie et soutienne la reprise économique. Il faudrait peut-être lancer une campagne médiatique dans ce sens.
Mme Chantal Bourragué. Nous avons eu des rencontres directes et franches avec nos interlocuteurs tunisiens. Nous avons rencontré des représentantes des Femmes démocrates et elles ne nous ont pas caché leurs inquiétudes face aux positions défendues par le parti Ennahda, dont le discours est tantôt apaisant tantôt agressif. Il est vrai que la condition des femmes est meilleure en Tunisie que dans nombre d’autres pays de la région, mais les femmes continuent à ne compter que pour la moitié d’un homme en matière successorale, même si les familles peuvent contourner ce principe.
Il est important que soit rapidement clarifié ce qu’il se passera après le 24 juillet et que les nombreux partis commencent à se rassembler pour préparer un nouveau départ pour le pays.
M. Jean-Paul Lecoq. Pendant que mes collègues avaient d’autres rendez-vous, j’ai pu rencontrer M. Hamma Hammami, secrétaire général du parti communiste des ouvriers de Tunisie, qui est sorti très récemment de la clandestinité et estime avoir une influence sur environ 30 % de la population. Ses dirigeants considèrent que le principal handicap de leur parti est la présence du mot communiste dans son nom, non pas pour des questions de programme, mais à cause du lien qui est fait entre communisme et athéisme dans un pays où la population se sent profondément musulmane. Ils pourraient essayer de constituer un parti de masse avec une autre dénomination.
Aujourd’hui, le parti Ennahda se présente comme ouvert et va jusqu’à proposer une séparation de la religion et de l’Etat, mais il existe un autre parti islamiste proche du salafisme dont les positions sont beaucoup plus dures et qui est très actif auprès de la jeune génération.
Les Tunisiens attendent beaucoup des entreprises françaises : le soutien de la France à la Tunisie pourrait se traduire par une hausse des salaires et des investissements des entreprises françaises implantées dans le pays.
Les événements en Tunisie ont des conséquences importantes en Libye, à travers l’afflux de réfugiés et l’interruption de toutes les relations commerciales et touristiques entre la Libye et le sud-est tunisien, qui s’en trouve très fortement pénalisé.
M. Dino Cinieri. Je n’ai pas beaucoup d’éléments à ajouter à la présentation faite par le président. J’insisterai sur quelques points. D’abord sur l’importance des attentes de la Tunisie vis-à-vis de la France et de l’Union européenne : sous le régime de Ben Ali, le pays ne demandait pas à bénéficier du statut avancé accordé au Maroc à cause de ses retards en termes de droits de l’Homme ; aujourd’hui, il souhaite au contraire l’obtenir dès que possible.
Les jeunes Tunisiens n’ont jamais connu que le régime de Ben Ali et l’absence de liberté d’expression. Il est donc logique qu’ils attendent énormément des nouvelles autorités et que de nombreux partis politiques voient le jour.
Comme il ne peut y avoir de redistribution des richesses sans production de ces richesses, il est essentiel que les chefs d’entreprises étrangers, français en particulier, développent leurs investissements dans les secteurs économiques où ils peuvent être propriétaires majoritaires. Pendant la révolution, il n’était pas rare que des salariés protègent leur outil de production. Ils ont déjà obtenu des augmentations de salaires à hauteur de 16 % et une deuxième phase de négociation salariale s’ouvrira en octobre prochain.
M. Michel Destot. Je me demande si le temps joue en faveur de la révolution. Il est évident que la stabilisation politique prendra plusieurs années, comme ce fut le cas dans l’Europe de l’Est libérée des régimes communistes. Or, pendant ce temps, la situation économique se dégrade et il n’y aura pas d’investissements directs étrangers sans stabilité politique retrouvée, même si le tourisme reprend. J’estime que seules des mesures économiques fortes prises par l’Union européenne pourront permettre à la Tunisie de franchir cette période délicate.
Par ailleurs, s’oriente-t-on vers une certaine décentralisation du pouvoir ? Ce serait une excellente chose, en particulier eu égard à la coopération décentralisée.
M. Robert Lecou. Les relations de la Tunisie avec la France n’ont apparemment pas été affectées par la révolution. Cette mission a eu le mérite de témoigner de la volonté de la France de maintenir une relation privilégiée avec ce pays.
Le rendez-vous du 24 juillet est exclusivement institutionnel, et ne règlera pas les problèmes économiques et sociaux à l’origine de la révolution. Néanmoins, ne faut-il pas craindre une aggravation de la situation si l’élection de l’assemblée constituante devait être reportée ?
M. Rudy Salles. Parmi la cinquantaine de partis politiques, cerne-t-on déjà les contours de possibles coalitions ?
On crédite souvent les partis islamistes de 25 à 30 % des voix, ce qui est beaucoup mais ne leur permettrait pas d’exercer le pouvoir à eux seuls. La comparaison avec l’AKP turc est-elle pertinente ?
M. Jean-Paul Dupré. La Tunisie est un pays francophone et désireux de le rester, ce qui est rare dans le bassin méditerranéen et doit être soutenu.
Il ne faut pas décevoir les fortes attentes sociales et risquer que l’absence de redémarrage économique n’entraîne de nouveaux soubresauts politiques.
M. Jean-Michel Ferrand. Au sein des nouveaux partis, voit-on émerger quelques personnalités politiques charismatiques ?
En cas de conclusion d’un accord conférant à la Tunisie un statut privilégié, les produits agricoles tunisiens obtiendront la liberté de circulation vers l’Union européenne. J’attire l’attention de tous sur la nécessité d’établir un calendrier pour cette ouverture et de fixer des quotas pour les différents produits, sans quoi cela aura des conséquences désastreuses sur les producteurs agricoles français, comme en a eu l’octroi d’un tel statut au Maroc. Sans ces précautions, il ne faudra pas s’étonner de la progression du vote extrémiste dans certains départements du sud de la France !
M. Jean-Michel Boucheron. Je m’interroge sur la sortie du processus révolutionnaire. Quel est l’état psychologique des Tunisiens ? Y a-t-il toujours des tensions fortes, des forces centrifuges vers une forme de nihilisme ou vers des références à la Charia ? Ou bien y a-t-il dans la population tunisienne une fierté sur le fait d’avoir eu le leadership dans les révolutions arabes ?
M. Gaétan Gorce. Tout cela est très intéressant et il serait souhaitable d’en dégager une vision et des lignes politiques globales pour une action dans la région. Il ne faut pas perdre de vue une approche stratégique et diplomatique nécessaire, et le gouvernement doit réaffirmer des axes clairs, autour du soutien à la démocratie, d’une part, à relayer notamment en Syrie aujourd’hui et, d’autre part, du soutien au développement économique et social, en prenant des initiatives rapides pour aider la Tunisie en augmentant notre aide, peut-être.
Le parlement français ne pourrait-il être à l’origine d’une résolution vis-à-vis de l’Union européenne en ce sens, pour inciter à la réévaluation de l’aide européenne, pour soutenir aussi la monnaie qui risque d’être menacée et d’entraîner des problèmes économiques sérieux. Enfin, des initiatives devraient également être prises en direction des entreprises françaises en Tunisie pour les soutenir. Une stratégie est-elle envisagée et un dialogue peut-il être engagé sur ces aspects ?
Mme Marie-Louise Fort. Quel est le sentiment des Tunisiens sur la question de l’immigration des jeunes ? Quel est le regard porté sur l’Europe et comment l’intervention en Libye est-elle jugée ? Quant à la Turquie, y a-t-il des rapports directs avec le gouvernement provisoire et les nouveaux partis politiques. Enfin, qu’en est-il de l’UpM ?
M. Jean-Paul Bacquet. Beaucoup d’entreprises françaises ont annoncé des augmentations de salaires de 15 à 20 %. Y a-t-il des risques de relocalisations ?
M. Philippe Cochet. Ma question porte sur un aspect politique. Qu’en est-il des représentants des partis politiques exilés en France ? Quel regard portent les diasporas sur l’évolution de la situation et quelle peut être leur influence sur les futures institutions ?
M. Jean-Claude Guibal. Je voudrais savoir quel regard portent les Tunisiens aujourd’hui sur le Printemps arabe et sur ce qui se passe en Libye en particulier. Que sont devenus les 2 millions de membres du RCD ? En matière d’immigration, le gouvernement provisoire envisage-t-il un partenariat avec l’Union européenne sur la maîtrise des flux ? Qu’en est-il enfin de l’UpM et du statut avancé dont pourrait bénéficier la Tunisie après le Maroc ?
M. Lionnel Luca. A la suite de Jean-Claude Guibal, je voudrais savoir ce qu’il est advenu des 2 millions de militants du RCD et de la police qui encadraient la population tunisienne. Une mise en cause des acteurs de la dictature et des procès sont-ils envisagés ? Je lie cette question à celle de l’immigration, dans la mesure où l’on dit que les affidés de l’ancien régime émigreraient actuellement en nombre, en France précisément, pour éviter des mesures de rétorsion.
M. Michel Terrot. Ce qui se passe en ce moment même à Lampedusa doit nous interroger : il y a une arrivée massive d’immigrants, bien plus en provenance de Tunisie que de Libye.
M. Serge Janquin. Nous nous sommes réjouis de la Révolution du Jasmin et du Printemps arabe, mais qu’en sera-t-il de l’été, sur lequel il reste quelques incertitudes ? Nous devons quand même accompagner cette aspiration populaire. Le gouvernement et le président de la République soutiennent aujourd’hui cette aspiration des peuples arabes et nous devons nous en féliciter. Il y a là un grand changement par rapport à leur attitude d’il y a seulement deux mois. Ces changements doivent aussi nous inciter à réfléchir sur le cas d’autres dirigeants, comme le président Déby ou d’autres pays dans lesquels nous avons appuyé des transitions quasi monarchiques, comme pour les familles Eyadema ou Bongo.
Mme Elisabeth Guigou. Les risques économiques et sociaux de la situation actuelle sont importants. Une révolution a été déclenchée, avec ses risques de désordre et leurs conséquences. L’Union européenne a fait des propositions le 11 mars pour la région, mais qui ne répondent pas à l’urgence. On pourrait essayer de proposer quelque chose de neuf, à l’instar des programmes PHARE et TACIS qui avaient été inventés en leur temps pour aider l’Europe de l’est et qui ont permis une augmentation considérable de l’aide. Ici aussi, il faut soutenir les réformes politiques, économiques et institutionnelles.
Il faudrait que nous auditionnions Mme Sarah Ben Achour, présidente de l’association des femmes démocrates et son frère, M. Ben Achour, président de la haute instance, ainsi que M. Pierre Vimont, Secrétaire général du SEAE, qui a commencé à beaucoup réfléchir sur ces questions.
M. le président Axel Poniatowski. L’audition de M. Pierre Vimont est prévue et la mission a rencontré Mme Sarah Ben Achour et M. Ben Achour qui sont effectivement des personnalités des plus intéressantes.
Mme Martine Aurillac. La mission a-t-elle pu percevoir le degré de confiance de la population tunisienne sur le Printemps arabe ? Quel regard est porté sur la transition ? Quel crédit est porté à El Watan ? Enfin, qu’en est-il de la Libye et de la situation au Maroc ?
M. François Rochebloine. Quelles sont les conséquences de la révolution sur la vie économique et quelle est l’attitude des chefs d’entreprise ? Quelles sont également les conséquences sur l’enseignement du Français, les lycées, etc. ?
M. François Asensi. La question sociale a été le premier élément déclencheur de la révolution et la question des libertés politiques vient en second plan. Ne pensez-vous pas qu’il y a une hiérarchisation dans les objectifs fondamentaux de la constituante, compte tenu du rôle phare de la révolution tunisienne sur les pays arabes. Le rôle de la constituante sera en effet de définir la nature du régime tunisien et cela aura un impact considérable sur l’ensemble de la région.
M. Jean-Pierre Kucheida. Quel est l’impact dans la population des événements en Libye et de la politique algérienne telle qu’elle est menée ?
M. le président Axel Poniatowski. Je ne répondrai pas aux commentaires et appréciations relatifs aux initiatives que l’exécutif ou les autorités européennes devraient prendre.
Pour le reste, nous avons senti une inquiétude quant à la situation économique et sociale à moyen terme, compte tenu des événements. Nous avons été aussi frappés par l’immense fierté du peuple tunisien qui est très conscient du rôle historique qu’il a joué et de l’exemplarité pour le monde arabe de sa révolution. Son enthousiasme est palpable ; en revanche, il n’est pas certain qu’il mesure toute la gravité des problèmes. Le gouvernement actuel en a certes bien conscience, mais il ne devrait plus être en fonctions au-delà du 24 juillet. M. Cinieri, qui a accompagné Pierre Lellouche pourra revenir sur les aspects plus économiques.
Quant à la francophonie, une équipe de France 24 nous a accompagnés tout au long de notre déplacement et cette chaîne a été la plus regardée durant les événements et a accru spectaculairement son audience au Maghreb, davantage via sa diffusion en Arabe qu’en Français, il est vrai.
Il y a à ce jour peu de personnalités nouvelles qui émergent et qui soient déjà vraiment connues de la population tunisienne. M. Néjib Chebbi, par exemple, qui se situe aujourd’hui au centre droit, sera à l’évidence une personnalité du futur, mais il est encore très peu connu. C’est pour cette raison que certains partis politiques demandent le report des élections à l’automne, après le ramadan, d’où un risque de dérapage de la transition.
Quant à l’augmentation de l’APD, la réponse appartient à l’Exécutif. Cette demande tunisienne figurera dans le mémorandum que le gouvernement nous adressera. La question du statut avancé sera abordée et pour revenir sur le commentaire de Jean-Michel Ferrand, l’accord prévoit des quotas et un calendrier car il posera des problèmes à notre agriculture, si l’on en juge par ce qui se passe avec le Maroc.
Il y a une immigration d’opportunisme et la plupart de ceux qui vont à Lampedusa ont comme destination finale la France. Or, la Tunisie n’accepte que le retour de 4 Tunisiens par jour. Nous sommes donc loin du compte.
Les partis politiques exilés sont en train de rentrer en Tunisie, peu à peu. Pour ce qui est du RCD et de ses 2 millions de membres, ils se sont fondus dans la population. El Watan est le seul à se déclarer émanation du RCD et n’a aucune chance de faire un score significatif demain.
La situation du Maroc et celle des autres pays n’ont pas été évoquées à l’exception de la Libye. L’intervention dans ce pays est approuvée pour autant qu’elle ne se traduise pas par une intervention terrestre.
Nos interlocuteurs qui ont évoqué l’UpM ont surtout manifesté le souhait d’un renforcement des sous-groupes régionaux et des relations bilatérales.
M. Gilles Cocquempot. Les Tunisiens attendent-ils quelque chose de la diaspora ?
M. le président Axel Poniatowski. Cette question n’a pas été abordée par nos interlocuteurs ce qui laisse à penser que ce n’est pas une préoccupation majeure au-delà du soutien économique que la diaspora peut représenter. En revanche, notre délégation a régulièrement souligné l’importance de celle-ci en France eu égard à son dynamisme notamment.
M. François Loncle. Cette mission nous a permis de recueillir des informations sur l’ampleur colossale de la corruption sous la présidence Ben Ali qui dépasse tout ce que l’on pouvait imaginer. Ces faits ne resteront pas sans suite.
M. le président Axel Poniatowski. Les différentes malversations et faits de corruption font actuellement l’objet d’une commission d’enquête présidée par M. Abdelfattah Amor. Celui-ci nous a confié ses difficultés pour mener à bien son travail tant le niveau atteint par la corruption rend la tâche immense. En outre, la commission, dont le rôle se limite à constituer des dossiers et à les transmettre à la justice, se heurte aux pesanteurs judiciaires.
M. Dino Cinieri. Les entreprises françaises en Tunisie se portent très bien. Je peux citer en exemple Danone qui a investi 20 millions d’euros et créé 150 emplois. Si les salaires ont été augmentés de 16 %, ils feront l’objet d’une renégociation en octobre. Les investisseurs français ont confiance dans la Tunisie.
7.- Mercredi 6 avril 2011, séance de 10 heures 30, compte rendu n° 49 : audition de Son Exc. M. Yossi Gal, ambassadeur d’Israël en France
M. le président Axel Poniatowski. Nous accueillons maintenant le nouvel ambassadeur d’Israël en France, M. Yossi Gal, que je remercie d’avoir accepté notre invitation. Elle s’inscrit dans le cadre des rencontres régulières que nous organisons avec, d’une part, le représentant d’Israël et, d’autre part, celui de l’Autorité palestinienne, afin de faire le point sur le processus de paix et, plus généralement, sur la situation au Proche-Orient.
Successeur de M. Daniel Shek, vous occupiez auparavant, monsieur l’ambassadeur, le poste stratégique de directeur général du ministère des affaires étrangères à Jérusalem. Au cours de votre carrière diplomatique, vous avez notamment participé aux négociations de paix avec les Palestiniens et les Jordaniens au début des années quatre-vingt-dix, mais aussi contribué à l’entrée d’Israël à l’OCDE et au renforcement des liens avec l’Union européenne.
Alors que le monde arabe traverse une période de forts bouleversements, le peuple et le gouvernement israéliens ont donné l’impression d’être partagés entre le soutien à des mouvements favorables à la démocratie et la peur de voir tomber des dirigeants dont l’attitude vis-à-vis d’Israël était modérée. Quant au processus de paix israélo-palestinien, il semble bel et bien au point mort depuis le début de l’automne, essentiellement à cause du refus israélien de prolonger le moratoire sur la colonisation en Cisjordanie. Cependant, la tension est remontée après le sauvage assassinat dont a été victime une famille de colons israéliens, l’intensification des tirs sur le territoire israélien à partir de la bande de Gaza, mais aussi la reprise des bombardements israéliens en représailles.
M. Yossi Gal, ambassadeur d’Israël en France. Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, je suis très honoré de m’exprimer pour la première fois devant la prestigieuse commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale en qualité d’ambassadeur d’Israël, et je vous remercie de votre invitation.
Dès mon arrivée en France en novembre dernier, j’ai assisté à la mobilisation rapide et efficace du gouvernement français pour nous aider à lutter contre le terrible incendie du mont Carmel, et j’y ai vu la première manifestation de la relation d’amitié et de solidarité entre nos deux pays, qui se caractérise par des liens anciens, sincères et chaleureux. En témoignent notamment des rencontres bilatérales de plus en plus nombreuses et d’une qualité exceptionnelle. J’ai constaté un fort désir, côté français et côté israélien, de développer nos relations bilatérales et de travailler ensemble pour approfondir nos relations politiques. Ainsi, le ministre de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique, M. Éric Besson, a déclaré à son retour d’Israël que le volume des échanges entre nos deux pays n’était pas suffisant. Plus tard, il a annoncé que la France ambitionnait de doubler le volume des échanges d’ici à cinq ans. Israël considère cet objectif comme tout à fait légitime et le fait sien. Cette volonté se traduira par la tenue des premières journées franco-israéliennes de l’innovation à Bercy à la fin de l’année 2011. La relation franco-israélienne n’est pas seulement politique et diplomatique, elle aussi économique, judiciaire, universitaire, scientifique, culturelle et affective.
Mesdames et messieurs les députés, vendredi dernier, le Washington Post a publié une tribune intitulée « Reconsidérer le rapport Goldstone sur Israël et les crimes de guerre », qui mérite d’être lue avec la plus grande attention par chacun d’entre vous. Elle est signée du juge Goldstone – auteur éponyme du rapport sur l’opération « Plomb durci » menée par Israël à Gaza – qui fait part de ses réflexions, dix-huit mois après l’adoption de son rapport par le conseil des droits de l’homme des Nations unies. Au moment de sa publication, en 2009, j’étais directeur général du ministère israélien des affaires étrangères. Durant de longues semaines, je me suis battu jour et nuit contre cette odieuse campagne diffamatoire contre Israël. En effet, l’accusation de crime de guerre à l’encontre de mon pays a apporté un soutien de poids aux tentatives de « délégitimation » menées depuis le conseil des droits de l’homme à Genève. Dans cet article, Goldstone déclare que s’il avait su, à l’époque, ce qu’il sait maintenant, le rapport aurait été différent. Il ajoute qu’Israël a le droit et l’obligation de défendre son État et ses citoyens, et que des moyens importants ont été consacrés à enquêter sur les allégations de mauvaise conduite lors de l’opération à Gaza. Il mentionne qu’Israël avait mis en œuvre de nombreuses mesures pour protéger les populations civiles lors des combats en milieu urbain. Le juge Goldstone reconnaît également qu’avoir demandé au Hamas d’enquêter sur ses propres comportements ait pu constituer une erreur. Il précise que la partialité du conseil des droits de l’homme à l’encontre Israël ne fait aucun doute et que cette instance devrait condamner les actes odieux du Hamas contre Israël dans les termes les plus forts. Je me permets, mesdames et messieurs, de vous rappeler que la Libye de Kadhafi a été membre du conseil des droits de l’homme, aux côtés de quelques autres champions des droits de l’homme que je ne citerai pas. J’espère seulement que ceux, en Europe, qui se sont hâtés d’accuser Israël auront le courage intellectuel de reconnaître leur erreur car mon pays a énormément souffert de ces accusations qui ont eu pour conséquences de diaboliser Israël. Je connais personnellement le juge Goldstone et j’ai dirigé les travaux de notre gouvernement pour répondre à ses investigations. Jusqu’à la parution de cette tribune, ces accusations ont été très difficiles à supporter et, aujourd’hui, je peux dire ce que je disais alors : « Je suis extrêmement fier des normes morales de notre armée ».
Les événements dans le monde arabe ont suscité des centaines de commentaires, d’analyses et de prédictions. Permettez-moi d’y ajouter la mienne, non sans avoir fait quelques observations préalables. Tout d’abord, il n’y a aucun lien, direct ou indirect, entre Israël et ces événements. La Tunisie, l’Égypte, la Libye, le Yémen, Bahreïn et la Syrie n’ont strictement rien à voir avec les Palestiniens ou les Israéliens. Même si les médias se focalisent sur Israël de manière excessive, il existe d’autres sources d’instabilité plus profondes. Les partis politiques organisés ne sont pas à l’origine de ces révolutions au cours desquelles des milliers d’hommes et de femmes ont manifesté contre la tyrannie, la corruption – pas contre l’Amérique, l’Occident, ou Israël.
Cela étant dit, nous devons rester très prudents même si, comme dans le reste du monde démocratique, nous nous réjouissons de l’introduction de valeurs démocratiques de liberté, de fraternité, dans notre voisinage. Soixante-trois ans après son indépendance, Israël demeure une oasis de démocratie et de pluralisme. Nous qui respectons tous les jours la suprématie de la justice, la liberté d’expression, la valeur de l’éducation, la liberté des hommes et des femmes, le droit des minorités, nous accueillons favorablement et nous respectons assurément le droit des autres à disposer d’eux-mêmes. Toutefois, satisfaire toutes les attentes est un défi immense. Dans cinq ou six mois, les manifestants se demanderont ce qui a changé dans leur vie et, si les nouveaux mouvements n’atteignent pas leurs buts, la frustration risque de prévaloir. L’on sait comment de tels événements commencent mais pas où ils mènent. La démocratie, si chère à nos cœurs, mesdames et messieurs, est le seul système que nous désirons, mais l’histoire enseigne qu’elle ne s’établit pas en une journée. Israël espère que le monde arabe trouvera le moyen de promouvoir la paix et la démocratisation, et accueille très favorablement la détermination du monde libre à agir contre les tyrans qui massacrent leur peuple. Malheureusement, il en reste un certain nombre dans notre partie du monde.
En ce qui concerne la question israélo-palestinienne, Israël est convaincu qu’il n’y a pas d’alternative aux négociations directes, qui, seules, peuvent conduire à la paix. Durant les deux dernières années, Israël a déployé de nombreux efforts pour inciter les Palestiniens à revenir à la table des négociations. Le Premier ministre d’Israël, M. Netanyahou, a adopté le principe de deux États pour deux peuples. C’était pour Israël un choix courageux et stratégique. Le gouvernement d’Israël a profondément modifié sa politique envers les territoires contrôlés par l’Autorité palestinienne. En 2010, soixante-trois points de passage ont été supprimés et il n’en reste plus que quelques-uns. Israël mène également une politique d’encouragement de l’économie palestinienne et soutient les efforts de la communauté internationale. Tous ces efforts conjoints ont contribué aux excellents chiffres de la croissance de l’économie palestinienne ces deux dernières années – plus de 8 % en 2009 et 9 % en 2010. Par ailleurs, Israël a consenti à alléger le blocus de Gaza. Enfin, le gel des constructions en Cisjordanie pour une durée de dix mois en novembre 2009 a été un geste fort, qu’aucun gouvernement israélien n’avait accompli par le passé.
Malgré ces améliorations significatives, les Palestiniens refusent toujours de revenir à la table des négociations. Certains d’entre eux pensent qu’une solution sera imposée de l’extérieur ou encore que les discussions ne pourraient pas débuter avant que ne soient obtenus certains points d’accord, au sujet des implantations par exemple. Cet espoir est vain et inutile. Malheureusement, nous assistons aujourd’hui à la reprise par le Hamas de ses activités terroristes – et il n’est pas seul en cause. Le terrorisme a frappé à nouveau en Israël et en Cisjordanie. Il y a trois semaines, un horrible massacre a eu lieu à Itamar : attaqués dans leur sommeil, les parents Fogel et trois de leurs enfants ont été tués, dont une petite fille de trois mois poignardée à mort. Quelques jours plus tard, Jérusalem a de nouveau été frappée par un acte terroriste qui a brisé des vies. Et, avant-hier, un grand artiste arabe israélien a été assassiné par des terroristes à Jenine. Ces attaques sont inspirées par l’incitation officielle à la haine contre Israël.
Dans le passé, Israël a prouvé sa capacité à faire des compromis et à conclure la paix, avec l’Égypte et avec la Jordanie. Les négociations ont été directes, sans conditions, et ont conduit Israël à la paix avec ses deux voisins. J’ai eu la chance de participer à ces négociations bilatérales et je suis certain que la paix ne serait jamais advenue si l’une des deux parties avait, avant de parler avec l’autre, imposé des conditions préalables. C’est pourquoi nous disons aujourd’hui à nos partenaires palestiniens qu’il est temps de revenir à des négociations directes pour construire, de nos mains réunies, notre avenir commun.
M. Didier Julia. C’est de la propagande !
M. Yossi Gal. Ensemble, nous devons unir nos efforts pour promouvoir les valeurs démocratiques, et pour que la liberté et la tolérance s’enracinent dans ce nouveau Moyen-Orient.
Monsieur le président, nous n’oublions pas que la principale menace qui pèse aujourd’hui sur la paix dans le monde est l’Iran. Le régime actuel diffuse son influence néfaste dans toute la région. Israël est le seul pays au monde à être ouvertement menacé de destruction par un dirigeant qui cherche par tous les moyens à se doter du feu nucléaire. Nous ne sous-estimons pas le danger et nous apprécions les efforts de la communauté internationale pour contrecarrer de tels projets. Les discours des dirigeants iraniens sont habités d’un fanatisme apocalyptique très inquiétant et l’Iran alimente de façon régulière un trafic important de contrebande d’armes destinées aux groupes terroristes qui menacent Israël à ses frontières. Il y a trois semaines, la marine israélienne a intercepté un navire transportant des armes destinées à la bande de Gaza et qui venaient d’Iran. Cet incident rappelle encore une fois la nature du régime iranien et les intentions des extrémistes à Gaza. Le Hezbollah a accumulé des stocks d’armes importants au Liban : plus de 60 000 roquettes et missiles. Parallèlement, l’Iran cherche à séduire de nouveaux partenaires et à étendre son influence en Afrique et en Amérique du Sud. Mesdames et messieurs, les griefs contre l’Iran sont déjà très nombreux, mais ils ne doivent pas faire oublier que ce régime ajoute l’insulte à la menace en niant la Shoah.
Aujourd’hui, la communauté diplomatique internationale est mobilisée contre la menace que représente l’Iran pour Israël et pour le monde. Les sanctions adoptées par le conseil de sécurité des Nations unies font certainement peser une pression économique forte sur ce pays mais elles n’ont pas encore conduit à l’arrêt de son programme nucléaire. Il est donc important de continuer à accentuer la pression par des sanctions économiques renforcées et d’autres mesures de façon à accroître l’isolement de l’Iran.
Mesdames et messieurs, je conclurai en évoquant le sort du jeune Franco-israélien Gilad Shalit, toujours prisonnier du Hamas depuis juin 2006 et dont la famille est sans nouvelle. Nous apprécions la position de la France et les propos du président de la République qui a rappelé qu’il voyait Gilad Shalit comme un Français et que toucher à sa personne, c’était s’attaquer à la France.
M. Jean-Luc Reitzer. Comme beaucoup de Français, j’ai beaucoup de respect pour le peuple israélien et je crois à son droit à l’existence et à la sécurité. Nous condamnons tous le terrorisme. Néanmoins, entre amis, certaines choses doivent être dites. La colonisation est devenue un abcès particulièrement virulent. Pas plus tard que lundi dernier, le gouvernement israélien aurait approuvé le développement de quatre colonies, après avoir donné, le 12 mars, son accord à la construction de près de 500 nouveaux logements dans quatre autres colonies israéliennes situées elles aussi en Cisjordanie. Toutes ces colonies se trouvent à la périphérie des plus grandes agglomérations du territoire autonome palestinien. Parallèlement, et de source israélienne, le nombre d’habitations palestiniennes détruites par Israël en Cisjordanie a triplé en 2010 par rapport à 2009. N’est-ce pas précisément cette politique de colonisation, monsieur l’ambassadeur, qui justifie le refus de négocier de l’Autorité palestinienne ?
Par ailleurs, les rapports internationaux relèvent des défaillances marquées des services publics – assainissement, collecte des ordures, écoles – à Jérusalem-Est par rapport à Jérusalem-Ouest. S’agit-il de propagande anti-israélienne ou du reflet de la réalité ?
M. Jean-Marc Roubaud. L’arrivée de dirigeants plus démocrates dans les pays arabes voisins d’Israël pourrait-elle aider à la reprise des négociations directes avec les Palestiniens ? Les sanctions internationales qui frappent l’Iran parviendront-elles à le faire renoncer à ses projets que nous condamnons tous ?
M. François Asensi. Au nom de l’amitié sincère que j’éprouve pour le peuple israélien, je m’exprimerai avec franchise. À l’occasion d’une mission parlementaire, j’ai rencontré les autorités israéliennes et palestiniennes, et, avec Didier Mathus, nous avons été consternés de l’enlisement du processus de paix. L’Autorité palestinienne a fait le choix d’une solution politique – et non armée – pour résoudre le conflit. C’est un geste important qu’il faut saluer. Ne pensez-vous pas que la poursuite d’implantations de colonies qui réduisent le futur État palestinien à la portion congrue soit de nature à déstabiliser l’Autorité palestinienne et à encourager les éléments les plus extrémistes ?
Une flottille internationale, portée par de nombreuses associations, notamment des ONG françaises, va prochainement appareiller à destination de la bande de Gaza. Les autorités israéliennes ont demandé au secrétaire général de l’ONU de dissuader les responsables de l’expédition, au motif qu’elle était illégale. Ne serait-ce pas plutôt le blocus de Gaza qui est illégal, monsieur l’ambassadeur, puisque la liberté de circulation est la règle dans les eaux internationales ?
M. Jean-Michel Boucheron. Je vous confirme, monsieur l’ambassadeur, que des liens affectifs unissent la France à Israël. Le jeune militant que j’étais à vingt ans est allé travailler dans un kibboutz car c’était pour lui le seul endroit du monde qui expérimentait le socialisme réel.
M. Jacques Myard. Il avait vingt ans…
M. Jean-Michel Boucheron. Depuis, il s’est passé beaucoup de choses, surtout en Israël, et je considère que le gouvernement israélien ne veut pas du processus de paix.
M. Hervé de Charette. Évidemment !
M. Jean-Michel Boucheron. Les souffrances du peuple israélien sont bien réelles, mais Gaza est encerclée, assiégée, et le sort de sa population qui subit à la fois la misère et l’humiliation est insupportable. Dans de telles conditions, il y en aura toujours qui seront convaincus que la résistance armée est plus efficace que la négociation ; il en sera ainsi tant qu’il n’y aura pas de processus de paix et, même s’ils sont encore trop nombreux, je m’étonne qu’ils soient si peu.
Une question de fond : y a-t-il quelqu’un en Israël pour penser que l’avenir soit dans l’apartheid ?
Une remarque de forme : je souhaite qu’il y ait entre nous un vrai dialogue, où chacun écoute l’autre.
M. Rudy Salles. Vous avez à juste titre, monsieur l’ambassadeur, insisté sur la tribune de M. Goldstone car il en va pour Israël comme pour les élus : quand ils sont mis en examen, la presse y consacre une pleine page, contre trois lignes à peine quand ils sont relaxés. Il faudrait en effet que l’information soit diffusée largement auprès des parlementaires, d’autant qu’elle met en cause le conseil des droits de l’homme des Nations unies. Quelles initiatives l’État d’Israël entend-il prendre pour donner une suite à cette affaire ?
M. Jean-Paul Lecoq. Je partage les remarques faites à propos du traitement des Palestiniens et du développement des colonies. Israël mène une véritable politique d’apartheid à l’encontre des Arabes israéliens qui n’ont guère la capacité d’occuper des postes de responsabilité, d’investir dans la terre et les logements. Je pense également que le blocus de Gaza est illégal et qu’il est heureux que des flottilles soient organisées. D’ailleurs, j’en ferai partie et je verrai bien quel accueil nous sera réservé. (Exclamations.)
J’ai visité Gaza juste après l’opération « Plomb durci » et j’ai expliqué en tête-à-tête au Premier ministre Ehoud Olmert que j’avais vu ce qu’était le terrorisme d’État. J’ai même exprimé le souhait qu’il puisse, s’il foulait le sol français, répondre de ses actes – en l’occurrence des crimes de guerre – devant la justice.
Que penser, monsieur l’ambassadeur, des campagnes internationales menées par des jeunes, y compris en France, pour qu’il ne soit plus possible de critiquer Israël et sa politique ? Pourquoi Israël serait-il le seul État du monde dont la politique serait au-dessus de toute critique ? C’est en tout cas le sens de la motion votée par l’OSCE à l’initiative d’un délégué allemand.
Enfin, monsieur l’ambassadeur, quelle est votre attitude envers le Franco-palestinien Salah Hamouri qui est détenu par Israël et en faveur duquel nous intervenons régulièrement auprès du président de la République ?
Mme Martine Aurillac. Le pourtour sud de la Méditerranée est le théâtre de révoltes qui, même si elles ne sont pas dues au conflit israélo-palestinien, même si elles restent inachevées, bouleversent profondément les repères géostratégiques. Ainsi, l’Égypte peut être tentée de lever le blocus de Gaza, ce qui ne sera pas sans conséquences, puisqu’un tel geste devrait renforcer la position du Hamas. De même, les relations entre l’Iran et les États-Unis pourraient en être modifiées. Quel regard Israël porte-t-il sur ces événements en gestation ?
M. Philippe Cochet. D’après les informations dont vous disposez, où en est la capacité nucléaire de l’Iran ?
Les initiatives des mouvements d’extrême gauche qui incitent à prendre des sanctions économiques à l’égard d’Israël se font-elles sentir négativement sur les échanges entre nos deux pays ?
M. Hervé de Charette. En écoutant un ambassadeur, nous espérons toujours mieux comprendre la politique du pays qu’il représente. À cet égard, votre intervention a été d’une brutalité éclairante.
La colonisation en Cisjordanie et à Jérusalem dure depuis des dizaines d’années. Elle constitue un obstacle dirimant à l’ouverture de négociations sérieuses avec les autorités palestiniennes car celles-ci risqueraient de perdre toute autorité aux yeux de leurs mandants si elles acceptaient de négocier pendant que leurs interlocuteurs autorisent, voire encouragent, l’installation d’Israéliens dans des territoires qui sont à l’évidence palestiniens.
Le sort fait à la population de Gaza est franchement odieux, et la responsabilité des autorités israéliennes, sans être exclusive, est majeure. Des milliers de Palestiniens sont détenus en violation des lois internationales par les autorités israéliennes. La situation entre Israël et la Palestine est un des obstacles les plus importants à la paix internationale. Elle paralyse notamment le projet français d’Union pour la Méditerranée et elle encourage le terrorisme international. Votre point de vue, nous le connaissons par cœur, mais cette audition pourrait être utile si vous pouviez seulement mesurer que, si le gouvernement français est souvent favorable aux positions israéliennes, le peuple français, lui, les conteste.
M. Yossi Gal. Je me félicite de vos nombreuses questions sur les colonies parce qu’il faut connaître les faits avant de juger.
Premièrement, savez-vous combien de nouvelles implantations ont vu le jour en Israël ces quinze dernières années ? Eh bien, pas une seule : ce sont seulement des constructions dans les implantations existantes.
Deuxièmement, à l’occasion de l’évacuation de Gaza sous le Premier ministre Sharon, Israël a démantelé vingt-trois implantations – dix-neuf à Gaza et quatre dans la partie nord de la Cisjordanie, provoquant le départ de 9 000 colons. Nous avons démontré que, lorsqu’il le faut, nous pouvons prendre des mesures.
Troisièmement, nous aurions pu, nous aussi, poser des conditions préalables, en particulier refuser d’aller à la table des négociations avant l’arrêt du terrorisme. Pourtant, nous n’avons rien fait de tel. C’est pourquoi nous appelons nos amis palestiniens à nous rejoindre à la table des négociations.
Quatrièmement, si la colonisation est une question si essentielle pour les Palestiniens, c’est une raison supplémentaire pour reprendre la discussion le plus rapidement possible et tout mettre sur la table, de façon à pouvoir enfin aller de l’avant.
Cinquièmement, la seule chose qu’il y ait lieu de faire pour trouver une solution, c’est que les Palestiniens et les Israéliens se rencontrent pour débattre de tout : les colonies, Jérusalem, la sécurité, les frontières, les réfugiés,… L’expérience de nos négociations avec la Jordanie et l’Égypte nous a appris qu’il faut une direction forte pour prendre des décisions. Ainsi, le Premier ministre israélien a fait le choix stratégique de deux États, et la majorité du peuple israélien soutient la création d’un État palestinien. Il est temps aussi pour les Palestiniens d’arrêter leur choix, mais ils doivent comprendre que les négociations exigent, par définition, des compromis. Les deux camps doivent faire des concessions. Vous devez savoir que j’ai participé à ces négociations et, sous le gouvernement précédent, nous étions très proches d’aboutir, sur nombre de dossiers. Mais si quelqu’un pense que la paix peut être imposée de l’extérieur ou que quelqu’un va mettre la pression sur Israël, il se trompe. La seule chose à faire, c’est de s’installer et de tout mettre sur la table pour arriver à un compromis.
À propos de Gaza, il faut aussi revenir aux faits. Nous avons pris la décision de nous retirer de la bande de Gaza et nous l’avons fait. Nous avons restitué à l’Égypte chaque millimètre carré du territoire de Gaza. Pourtant, à l’époque, les doutes étaient nombreux. Cette étape devait constituer le point de départ de la création de l’entité palestinienne qui pourrait vivre en paix avec Israël. Mais le Hamas, ce mouvement extrémiste et fanatique, a fait un coup d’État sanglant et chassé l’Autorité palestinienne pour établir un mini-Iran qui a commencé à bombarder Israël. Comment auriez-vous réagi, monsieur le député, si vos citoyens s’étaient retrouvés sous un tapis de bombes et de roquettes ? Toutefois, afin de faciliter le retour des Palestiniens à la table des négociations, nous avons complètement changé de politique à l’égard de Gaza. Nous avons laissé entrer toutes les marchandises à Gaza, à l’exception des matériels qui peuvent servir à fabriquer des armes. Je n’ai pas connaissance de la moindre cargaison de denrées alimentaires ou de médicaments qui ait été arrêtée par les Israéliens. Nous avons également autorisé les exportations de Gaza à destination de l’Europe et d’ailleurs. Les Palestiniens n’ont pas grand-chose à exporter mais, avec notre aide et celle du gouvernement néerlandais, ils produisent des fraises et des fleurs qui entrent en Europe par les ports de Marseille et de Sète. Nos personnels agricoles aident les gens de Gaza à commercialiser leurs produits.
En ce qui concerne la flottille, il n’y a aucune raison aujourd’hui d’en envoyer une. La seule motivation des organisateurs est d’ordre politique. Toute personne ou organisation qui veut envoyer de l’aide – denrées alimentaires ou médicaments – peut le faire par les circuits habituels.
Le processus de paix a besoin surtout de temps, plus que de changements dans le monde arabe. Il est urgent que les Palestiniens reprennent les discussions et qu’ils se décident quant à l’avenir qu’ils souhaitent pour leur futur État : un État moderne, avancé, lié à l’Ouest, laïc, comme à Ramallah ; ou bien un État de type Hamas, lié à l’Iran, avec, à sa tête, des dirigeants fanatiques. Mais le temps joue contre ceux qui veulent la paix. Et les dernières évolutions rendent plus nécessaire encore la négociation.
À ceux qui doutent de notre volonté de paix et parlent d’apartheid, je dois répéter que je n’ai d’autre objectif, pour mes enfants et mes petits-enfants, que la paix. C’est à elle que nous aspirons. Ne sous-estimez pas le discours prononcé le 14 juin 2009 par le Premier ministre, sur la solution des deux États. Il marque un infléchissement notable de la politique d’Israël, et je n’ai rien vu de tel chez nos homologues. Il ne s’agit pas de minimiser les difficultés des Palestiniens, mais ce ne sont pas des déclarations unilatérales qui permettront d’avancer. Plus tôt nous serons assis autour de la table pour examiner nos différends, mieux ce sera pour tout le monde. Des négociations avec l’Égypte et la Jordanie, nous avons appris que seuls des dirigeants forts – Anouar el-Sadate et le roi Hussein, le Premier ministre Rabin, le Premier ministre Begin – peuvent prendre des décisions stratégiques, et que la paix doit venir des populations elles-mêmes, même si d’autres acteurs ont un rôle à jouer.
S’agissant de l’Iran, il en est des sanctions comme des antibiotiques : il faut poursuivre le traitement jusqu’au bout, même s’il y a des améliorations. Les sanctions sont efficaces et il faut persévérer dans cette voie. Les Iraniens continuent à défier ouvertement les résolutions du Conseil de sécurité et à produire de l’uranium faiblement enrichi. Ils en disposent en quantité suffisante pour franchir le seuil fatidique et réaliser leurs ambitions.
En examinant les travaux du conseil des droits de l’homme, un extraterrestre en conclurait que le seul pays à violer les droits de l’homme ici-bas, c’est Israël. Mais nous devons faire avec cette institution et ses membres qui votent automatiquement contre Israël.
M. Jean-Michel Ferrand. La Turquie a longtemps été un partenaire privilégié d’Israël, avec lequel vous organisiez des manœuvres communes. L’année dernière, elles ont été gelées après les événements à Gaza. Qu’en est-il de vos relations avec ce pays devenu un acteur incontournable au Moyen-Orient ?
M. Dominique Souchet. Que les peuples arabes s’en soient pris uniquement aux carences de leurs dirigeants nationaux aura-t-il, ou non, une influence sur les conditions de reprise des négociations directes entre Palestiniens et Israéliens ? Les événements en Syrie peuvent-ils déboucher sur des changements majeurs dans les équilibres actuels ?
M. Jean-Paul Dupré. Quelles sont les conditions concrètes pour qu’une paix durable s’installe dans toute la région ?
M. Jacques Myard. Au Proche-Orient, chacun accuse l’autre de terrorisme. L’objectif d’Israël est de se faire accepter comme un État de la région. Cela passe par la création d’un État palestinien viable, que vous dites accepter, mais vos arguments à propos des colonies ne nous convainquent pas entièrement. Il ne suffit pas de ne pas créer d’implantation nouvelle car, en densifiant celles qui existent, vous obtenez le même résultat. Qu’on le veuille ou non, on est obligé de parler avec ses adversaires. Vous l’avez fait avec le Fatah qui est devenu raisonnable, vous le ferez avec le Hamas et l’Iran.
Si votre choix stratégique est de vous faire accepter de vos voisins, comment expliquez-vous que, sur la scène médiatique, Israël fasse l’unanimité contre lui ? Il ne peut pas avoir raison contre tout le monde.
M. Didier Mathus. Votre intervention, monsieur l’ambassadeur, est inquiétante pour les amis du peuple israélien et de la paix, en particulier à cause de l’analyse de la situation. Comment la création de 900 logements dans la colonie de Gilo autorisée par le gouvernement ne contribuerait-elle pas à augmenter les implantations ? Vous êtes-vous déjà rendu en personne à Gaza ? Pensez-vous que puissent cohabiter longtemps une telle poche de misère où la densité de population est la plus élevée du monde et des îlots de prospérité ?
M. Daniel Garrigue. Vous vous êtes dit prêt à reconnaître deux États et à mettre tous les sujets sur la table. Mais, pour qu’il y ait négociations, il vous faut un interlocuteur. En mettant fin au moratoire sur les constructions, n’affaiblissez-vous pas l’Autorité palestinienne ? Vous demandez également aux représentants palestiniens de vous dire quel type d’État ils veulent ; or, c’est au peuple d’en décider. Ce qui peut faire l’objet des discussions, ce sont les garanties qui peuvent être données de part et d’autre, mais pas l’orientation politique du futur État palestinien.
M. Éric Raoult. Monsieur l’ambassadeur, vous êtes le bienvenu. Je vous le dis, parce que vous risquez, en sortant d’ici, de vous demander si nous pensons tous de la même façon. Eh bien non ! Mon collègue Boucheron est allé dans un kibboutz à la découverte du socialisme ; moi aussi j’y suis allé mais parce que Drancy est dans mon département et que je voulais rencontrer les rescapés qui vivaient là-bas. J’y suis même allé trois fois, ce qui m’a permis de mieux connaître Israël. Et je suggère à certains de mes collègues qu’avant de porter un jugement qui relève un peu d’un réflexe pavlovien, ils aillent sur place. Nous devons faire beaucoup mieux connaître votre État, parce que l’ensemble du pays est loin de l’image d’apartheid que donnent certaines déclarations.
Il y a quelques années, il était de coutume, dans mon département, où les villes sont rarement jumelées avec des villes israéliennes, que l’ambassadeur d’Israël vienne à la rencontre des maires. Je vous invite donc, monsieur l’ambassadeur, à venir constater par vous-même que les positions qui y sont exprimées ne sont pas toujours celles qui sont défendues ici.
Quant à la flottille chère à notre collègue Lecoq, elle n’a rien du cuirassé Potemkine !
M. François Rochebloine. Le jour où le mur de Berlin a été détruit, monsieur l’ambassadeur, je faisais partie de ceux qui ont pleuré de joie. Alors, je ne peux que déplorer la construction d’un nouveau mur pour séparer les populations, ce qui me paraît très dangereux. Quand je suis allé à Gaza, avec le consul général de France, nous avons eu les pires difficultés à passer le checkpoint. Ne pensez-vous pas que la personnalité du ministre des affaires étrangères, M. Lieberman, qui est un dirigeant d’extrême droite, complique les négociations ?
Le départ de Moubarak n’aura-t-il pas des conséquences sur la situation dans la région ?
Enfin, le sort préoccupant de Gilad Shalit ne doit pas faire oublier celui de Salam Hamoudi.
M. Robert Lecou. La France est liée à des États par des accords bilatéraux de coopération en matière de sécurité intérieure, et un tel accord avec Israël attend l’approbation du Parlement français. Le caractère international de nombreuses formes de criminalité justifie pleinement cette démarche avec les pays avec lesquels nos échanges humains et économiques sont développés car ces accords facilitent les transferts d’information et de bonnes pratiques. Des actions de coopération existent déjà entre la France et Israël mais elles ont besoin d’un cadre normatif pour être intensifiées. Conclure un tel accord avec Israël s’impose donc comme une évidence. Toutefois, les articles relatifs à la question de la protection de la sécurité publique posent question. Quelles précisions utiles pourriez-vous apporter pour éclairer notre réflexion ?
M. Patrick Labaune. La chute de Moubarak a mis fin au blocus égyptien de Gaza. Les trafics qui fleurissent dans le Sinaï aujourd’hui ne vont-ils pas obliger Israël à imposer un blocus ?
M. Jacques Bascou. Les révoltes dans le monde arabe ne sont certes pas dirigées contre Israël, mais le chemin sera long jusqu’à la démocratie et au bien-être économique. Dans l’intervalle, pour détourner les mécontentements, les États de la région ne risquent-ils pas de faire d’Israël une sorte de bouc émissaire et de l’obliger à s’adapter à cette nouvelle donne, même s’il ne veut pas se faire dicter sa loi par l’extérieur ?
M. Jacques Alain Bénisti. Il faut, monsieur l’ambassadeur, excuser les propos qui viennent d’être tenus par certains parlementaires car ils ne sont pas allés en Israël pour essayer de comprendre ce qui se passait. Ils n’ont d’autre source d’information que les médias français, qui ne sont malheureusement pas pro-israéliens.
En apprenant que le blocus de Gaza avait été assoupli, nous avons craint, et à juste titre, que les attentats ne recommencent parce que les Iraniens ont pu faire entrer des missiles. Nous avons visité des villes comme Ashdod qui sont pilonnées, et dont les crèches et les écoles ne sont pas épargnées. Nous qui sommes allés en Israël, nous savons, mais il ne faut pas compter sur la presse internationale pour relater les réalités du terrain.
M. le président Axel Poniatowski. Je vous rappelle que chacun parle en son nom propre, et seulement en son nom propre.
Plusieurs questions, monsieur l’ambassadeur, vous demandent d’approfondir vos réponses, et je m’associe à ceux qui voudraient savoir si, à votre avis, les nouveaux régimes dans le monde arabe, et tout particulièrement en Égypte, sont une chance pour la paix.
M. Yossi Gal. Je vous demande non pas d’être pro-israélien, mais d’être pour la vérité, et je peux seulement vous inciter à aller constater de vos propres yeux la taille réduite du pays – à peine 23 000 kilomètres carrés dont 60 % sont un désert – qui a été donné aux Juifs pour en faire leur patrie. Et ne vous fiez pas à ce que vous voyez à la télévision parce que, par définition, les médias ne s’intéressent qu’au spectaculaire. Vous découvrirez un peuple épris de paix, qui ne veut rien d’autre que ce que chacun d’entre vous veut pour sa propre famille : vivre en paix avec ses voisins.
Depuis deux ans, les Palestiniens ne sont plus disposés à revenir à la table des négociations. J’ai accompagné le processus de paix depuis Madrid, lorsqu’il a démarré. Il y a deux ans, à l’issue d’élections, un gouvernement d’union nationale a été mis en place, le type même de gouvernement nécessaire pour prendre des décisions lourdes de conséquences. Malheureusement, les Palestiniens ont persisté dans leur refus. En 2009, notre gouvernement a gelé toute activité de construction dans les implantations et le Premier ministre a été très critiqué pour ce geste qui était destiné à amener les Palestiniens à négocier. Je regrette qu’il n’ait pas été pris au sérieux.
Quant aux révoltes du monde arabe, bien sûr, nous sommes pour la démocratie ; elle est dans notre ADN. Les pays démocratiques ne versent pas dans la guerre. Le président israélien a d’ailleurs salué le printemps arabe. Nous espérons des évolutions positives de l’Iran, de la Syrie, du Hamas, du Hezbollah et autres extrémistes qui ne veulent pas que le Moyen-Orient évolue vers la démocratie et l’ouverture. Mais il faut être très prudents. Nous sommes très heureux que l’Égypte ait clairement annoncé son intention de respecter le traité de paix avec Israël, qui reste la pierre angulaire de notre stratégie pour bâtir la paix dans la région.
La Syrie, elle, doit être jugée à l’aune de ses relations avec l’Iran, avec le Hezbollah, avec les extrémistes palestiniens ; or elles sont fortes comme jamais. Le flux d’armes de l’Iran vers le Liban passe par la Syrie, et Damas est le quartier général des organisations les plus extrémistes du monde arabe. Cela étant dit, nous restons à l’affût de la moindre inflexion.
En tant qu’Israélien qui recherche la paix pour ses enfants, je n’ai pas attendu les révoltes arabes pour œuvrer à la paix. Je vous ai d’ailleurs cité une liste de mesures prises par Israël pour encourager les Palestiniens à venir à la table des négociations, mais ils sont restés sourds à nos appels. Les événements dans le monde arabe sont une raison supplémentaire pour négocier. Quand deux États européens ont un différend, ils ne se battent pas, ils discutent. C’est la seule méthode que les sociétés du XXIème siècle devraient connaître. Nous attendons que nos amis Palestiniens fassent de même.
Nous souhaitons ardemment poursuivre nos contacts étroits avec la Turquie, en raison de sa proximité et de l’influence qu’elle exerce sur d’autres pays de la région. Nous avons toujours l’espoir que les choses s’arrangent. Ce qui s’est passé l’année dernière avec la flottille est très regrettable, et j’y reviens parce qu’une nouvelle flottille est prévue. Je serai très clair à ce sujet : quiconque participe à cette flottille le fait pour des raisons exclusivement politiques. Si vous jugez que Gaza a besoin d’approvisionnements, toutes les voies vous sont ouvertes pourvu qu’il ne s’agisse ni d’armes, ni de produits chimiques qui servent à fabriquer des explosifs. Pour venir en aide aux populations nécessiteuses, il est inutile de provoquer des incidents dans les eaux de la Méditerranée.
M. le président Axel Poniatowski. Il ne me reste plus, monsieur l’ambassadeur, qu’à vous remercier du temps que vous nous avez consacré pour répondre précisément à toutes nos questions sur un sujet qui, vous l’avez vu, nous préoccupe beaucoup.
8.- Mercredi 4 mai 2011, séance de 17 heures, compte rendu n° 56 : extraits de l’audition de M. Alain Juppé, ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et européennes (ouverte à la presse)
M. le président Axel Poniatowski. Cette audition sera consacrée à l’actualité internationale, particulièrement riche en ce moment, et à la politique étrangère de la France, très active sur presque tous les fronts ouverts au cours des derniers mois. Notre pays est ainsi en première ligne en Libye et en Côte d’Ivoire et demeure engagé en Afghanistan.
De façon plus générale, la diplomatie française est confrontée à l’effervescence qui s’est emparée de la quasi-totalité des pays arabes depuis le début de l’année. Aucun régime n’échappera à la nécessité de répondre à la demande de réforme et de démocratie. Les pays d’Afrique du Nord, avec lesquels nous entretenons des relations privilégiées, sont particulièrement concernés.
Ces événements ont déjà des conséquences importantes sur les relations israélo-palestiniennes : on peut considérer que la signature, au Caire, d’un accord entre le Fatah et le Hamas sur la formation d’un gouvernement transitoire est une conséquence directe, majeure, de ce « printemps arabe ».
La mort d’Oussama Ben Laden constitue, par ailleurs, une victoire importante dans la lutte contre le terrorisme. Il convient d’évaluer ses conséquences potentielles sur l’avenir d’Al-Qaida et sur le risque terroriste.
Je vous propose, monsieur le ministre, de vous exprimer sur les principaux sujets d’actualité, après quoi nous en viendrons aux questions des membres de la Commission.
M. Alain Juppé, ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes. Je suis heureux de poursuivre avec vous le dialogue que j’avais été obligé d’abréger lors de notre précédente rencontre afin de me rendre à l’Elysée.
La mort d’Oussama Ben Laden, à la suite d’une opération de commandos américains au Pakistan, est un événement essentiel dans le combat universel contre le terrorisme auquel participe la France, aux côtés des Etats-Unis et de ses différents alliés. Bien qu’il soit tôt pour apprécier toutes les conséquences de cet événement, je tiens à rappeler que Ben Laden était une figure majeure du terrorisme, voire une sorte de symbole. C’était le plus souvent sous sa signature que des menaces terroristes étaient adressées à nos démocraties, notamment après le 11 septembre 2001. Sa mort revêt donc une forte valeur symbolique. C’est une victoire pour la démocratie et un coup très dur porté à l’échelon central d’Al-Qaida.
Est-ce à dire que la menace terroriste a disparu ? A l’évidence, non, et nous ne devons pas baisser la garde. Les branches régionales d’Al-Qaida, telles que l’AQMI, sont en grande partie autonomes, même si elles ne le sont pas entièrement – le retrait des forces françaises d’Afghanistan fait ainsi partie des revendications d’AQMI en échange de la libération de nos otages. Ces branches d’Al-Qaida demeurent actives et dangereuses. A cela s’ajoutent les réactions que pourraient avoir des individus isolés, par nature incontrôlables. Nous avons donc adressé des consignes de vigilance redoublée à nos ambassades et aux communautés françaises, notamment au Sahel, où nous sommes particulièrement exposés. Je renouvelle les conseils de prudence à nos compatriotes qui imagineraient que l’on peut continuer à faire du tourisme au pays dogon ou dans d’autres régions du Sahel.
[…]
J’en viens à l’attentat perpétré, le 28 avril, à Marrakech. Le bilan est lourd : 16 morts, dont 8 Français, et 23 blessés, dont 9 compatriotes. Notre pays paie donc un tribut très douloureux. Sous la conduite du président de la République, nous avons accueilli les corps des victimes en présence des familles. Ce fut un moment d’intense émotion. Les familles, qui sont bouleversées, ont témoigné unanimement de la disponibilité extraordinaire des autorités marocaines, qui ont veillé à faciliter leurs démarches dans cette période difficile. Elles ont aussi rendu hommage à notre service diplomatique, en particulier au consul général à Marrakech et à notre ambassadeur. Je rappelle que nous avons mis en place une cellule de crise au consulat général et à l’ambassade à Rabat, et que le centre de crise du ministère a immédiatement dépêché une équipe médicale et de soutien psychologique pour les proches des victimes. Le Quai d’Orsay a organisé toutes les opérations de rapatriement des dépouilles et de retour des familles, afin de soulager autant que possible ces dernières.
Pour le moment, l’attentat n’a pas été revendiqué. On sait, en revanche, qu’il n’a probablement pas été commis par un kamikaze isolé. L’enquête semble avancer rapidement, et nous espérons qu’elle permettra de faire toute la lumière sur ce crime révoltant et lâche. Le président de la République a promis que les responsables seraient identifiés, poursuivis, jugés et punis. Une excellente coopération prévaut entre les équipes marocaines et les fonctionnaires de police que nous avons envoyés sur le terrain pour participer à l’enquête.
Nous apportons, en outre, tout notre soutien aux autorités marocaines, qui se sont engagées dans des réformes politiques courageuses. Nous espérons de tout cœur que la violence aveugle ne portera pas un coup d’arrêt à ce mouvement exemplaire : le roi Mohammed VI a tracé la voie d’une évolution vers une véritable monarchie constitutionnelle.
S’agissant de la Libye, je ne reviens pas sur les conditions dans lesquelles nous avons été conduits à engager nos forces aériennes : je me suis déjà exprimé à plusieurs reprises sur ce sujet, devant cette Commission et en séance publique. Où en sommes nous aujourd’hui ?
En premier lieu, Kadhafi a perdu toute légitimité. Ce disant, je n’exprime pas seulement le point de vue de la France, mais aussi celui des 27 États-membres de l’Union européenne, des Etats-Unis et de la Ligue arabe, qui s’est récemment prononcée sans ambiguïté. Ce point de vue est donc partagé par la quasi-totalité de la communauté internationale. Kadhafi ment et il massacre son peuple. Par conséquent, il doit partir. Cette conclusion ne figure pas dans la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, qui n’organise pas un changement de régime, mais rien ne nous interdit d’adopter cette position dans le cadre de nos politiques étrangères respectives.
J’observe, en second lieu, que le Conseil national de transition, qui représente pour nous les forces de libération de la Libye, gagne en légitimité politique et se structure peu à peu, même s’il lui reste du travail à faire. C’était à l’origine une force « spontanée » et désorganisée, notamment au plan militaire. Nous sommes en train de l’aider à se structurer.
Sur le terrain, la situation reste confuse et préoccupante : la population continue à être attaquée par les forces de Kadhafi, en particulier à Misrata et à Zintan ; en outre, les affrontements entre les deux camps ne donnent lieu à aucune avancée significative dans un sens ou dans l’autre.
Dans ce contexte, notre priorité est de maintenir une forte pression sur le régime de Tripoli, afin d’obtenir une pleine application des résolutions 1970 et 1973 du Conseil de sécurité. Conformément aux conclusions de la réunion du groupe de contact qui s’est tenue à Doha le 13 avril, nous accentuons l’effort militaire en attaquant la machine de guerre de Kadhafi, aujourd’hui sur la défensive. Comme nous le souhaitions, l’Alliance a intensifié ses frappes, qui touchent de plus en plus les installations militaires à l’Ouest, à Tripoli et à Zintan. Par ailleurs, de nouveaux pays ont annoncé leur intention de participer à ces opérations, notamment l’Italie – elle l’a confirmé à l’occasion du sommet franco-italien organisé la semaine dernière.
Je voudrais insister sur un point en particulier : le commandement de l’OTAN a très clairement indiqué que la récente frappe sur Tripoli, qui a vraisemblablement conduit à l’élimination d’un des fils de Kadhafi, Saif al-Arab, et peut-être aussi à la mort de trois enfants – les siens ou d’autres enfants de sa famille –, était ciblée sur un objectif militaire, à savoir un bunker de commandement installé dans ce quartier, avec les effets collatéraux que l’on sait.
Parallèlement à l’action militaire, nous sommes déterminés à poursuivre tous les efforts visant à isoler le régime et à assécher ses ressources. Cela implique que les sanctions soient pleinement respectées, que l’on élargisse la liste des entités et individus concernés par le gel des avoirs financiers, et que l’on refuse toute opération de commercialisation ou de transport d’hydrocarbures dont pourrait encore bénéficier le régime de Kadhafi.
J’ajoute que les responsables des crimes commis devront en répondre devant la justice. Nous nous réjouissons, à ce titre, que le Conseil de sécurité reçoive aujourd’hui le procureur de la Cour pénale internationale, qui doit informer les membres du Conseil sur la mise en œuvre de la résolution 1970. Il devrait vraisemblablement annoncer l’inculpation de Kadhafi.
D’autre part, nous soutenons un processus politique visant à l’émergence d’une nouvelle Libye, libre et démocratique. Cela doit permettre aux Libyens de fixer, eux-mêmes, leur système politique et de choisir démocratiquement leurs gouvernants. Mais le représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies, M. Khatib, doit jouer un rôle central à cet égard. Nous sommes, en effet, préoccupés par la multiplication des initiatives : tout le monde veut parler à tout le monde, et des médiateurs s’auto-désignent. Nous souhaitons qu’il revienne au représentant du Secrétaire général de coordonner les médiations. J’espère que la prochaine réunion du groupe de contact, prévue demain à Rome, permettra de consacrer son rôle.
Le lancement du processus démocratique passe aussi par un renforcement du Conseil national de transition, qui doit servir de pivot à un dialogue national largement ouvert. Ce Conseil a adopté une charte politique démontrant sa volonté d’instaurer un État de droit et des institutions démocratiques dans le respect de l’unité et de l’intégrité du territoire libyen. Ces principes ont été réaffirmés par le président de cette instance, Moustafa Mohamed Aboud al-Djeleil, qui est venu en France le 20 avril. Nous avons reçu une feuille de route établissant un processus de transition politique, ordonné en plusieurs étapes, notamment dans le domaine électoral, en vue d’instaurer une Libye libre et démocratique après le départ de Kadhafi.
Le Conseil national de transition, dont la crédibilité s’est affirmée, a aujourd’hui besoin d’aide. D’une aide politique d’abord : cette instance doit être reconnue. Elle l’a déjà été par un certain nombre d’États, et nous essayons de convaincre d’autres partenaires d’en faire autant. Beaucoup l’ont d’ailleurs reconnue de facto : le fait de l’inviter à Luxembourg, à Doha, et demain à Rome, constitue une marque de reconnaissance. Le Conseil de transition a besoin, en second lieu, d’un appui économique et financier : la réunion de demain devrait être décisive, car nous avons demandé à la présidence italienne de proposer un mécanisme financier permettant de dégager des fonds pour le Conseil de transition, lequel doit payer ses fonctionnaires et ses salariés, et se procurer certains objets de nécessité. Une première solution consistait à utiliser les fonds gelés en application des sanctions décidées par le Conseil de sécurité. Plus d’un milliard de dollars a ainsi été bloqué à Londres, mais la justice britannique est très tatillonne : elle considère que ces montants n’appartiennent pas au Conseil national de transition. Nous sommes donc à la recherche d’autres mécanismes.
J’en viens à la Syrie. J’entends dire que nous aurions deux poids et deux mesures, car nous ferions preuve d’une plus grande indulgence à l’égard de la Syrie. C’est inexact. Nous avons commencé par conseiller à Bachar el-Assad de tenir compte de l’expression populaire, qui se manifestait dans un certain nombre de villes, et d’engager un véritable processus de réformes répondant à ces aspirations. Son premier discours a été très décevant ; le deuxième constituait une sorte de retour en arrière, puis il s’est engagé, sous sa responsabilité propre ou sous l’emprise du parti Baas, dans une répression sanglante : des tanks ont tiré sur la foule à Deraa, et ailleurs dans le pays. On estime qu’il y aurait eu 400 morts, ce qui est absolument intolérable. Nous avons donc condamné ce comportement sans la moindre ambiguïté, en indiquant que Bachar el-Assad perdrait petit à petit sa légitimité, comme d’autres dirigeants l’ont fait, s’il persévérait dans cette voie.
Comme nous n’avons pas été entendus, nous avons décidé d’agir. Cela n’implique pas de reproduire à l’identique la solution adoptée pour la Libye : les conditions sont différentes, et je m’étonne que certains, après nous avoir reproché d’engager des moyens militaires en Libye, nous reprochent maintenant de ne pas le faire en Syrie. Il faut garder notre raison, et voir ce qui est possible.
Le 27 avril, lors d’une séance publique du Conseil de sécurité, nous avons souhaité l’adoption d’une résolution condamnant la Syrie. Nous n’y sommes pas parvenus, et la menace d’un veto russe et d’un veto chinois reste forte. Vous savez que les Russes critiquent vivement les conditions de notre intervention en Libye, ce qui renforce leur opposition. Nous ne réunissons d’ailleurs pas les neuf voix nécessaires à l’adoption d’une résolution, même en l’absence de veto. Nous ne désespérons pas pour autant, et le Royaume-Uni reste très engagé à nos côtés. Nous allons continuer à oeuvrer au sein des Nations unies.
Nous nous sommes également mobilisés dans le cadre du Conseil des droits de l’homme, qui a consacré, le 29 avril, une session spéciale à la Syrie. Nous avons obtenu qu’il adresse un message très ferme, condamnant avec vigueur les violations massives des droits de l’homme commises par le régime syrien. Une enquête du Haut-commissaire aux droits de l’homme a été lancée, et nous plaidons contre la candidature syrienne à l’élection au Conseil du Droit de l’Homme qui doit avoir lieu le 20 mai prochain. L’élection de la Syrie enverrait un signal incompréhensible alors que la Libye vient d’être exclue du Conseil des droits de l’homme.
Nous nous sommes, par ailleurs, mobilisés au sein de l’Union européenne, où nous avons plaidé, vendredi dernier, pour l’instauration de sanctions visant individuellement les responsables de la répression. Il s’agit d’interdire la délivrance de visas, afin d’empêcher les déplacements à l’extérieur de la Syrie, et de geler certains avoirs personnels. La France a proposé d’inclure le président Bachar el-Assad dans la liste des personnes sanctionnées : le responsable suprême, qui cautionne les événements actuels, doit figurer sur la liste. Nous souhaitons, par ailleurs, un embargo sur les armes. La coopération de l’Union européenne avec la Syrie sera certainement affectée, même si nous avons à cœur de maintenir les projets en faveur de la société civile.
Je crois donc pouvoir affirmer qu’il n’existe pas de double standard dans notre approche du printemps arabe. En Syrie comme en Libye, nous ne transigeons ni sur nos valeurs ni sur nos principes. L’utilisation de la violence maximale contre la population syrienne, marquée par l’utilisation de chars et d’armes lourdes, appelle exactement le même jugement que celui porté sur l’attitude de Kadhafi. La différence est que les conditions ne sont pas réunies pour voter une résolution inspirée, en tout ou partie, de la résolution 1973.
[…]
M. François Asensi. Le processus de paix israélo-palestinien se trouve dans une impasse. M. Abbas souhaite faire reconnaître l’État palestinien par l’assemblée générale de l’ONU en septembre prochain, et il a demandé à notre diplomatie de le soutenir dans cette entreprise. La France peut-elle prendre l’initiative forte qui consisterait à reconnaître l’État palestinien dans les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale ?
J’observe, par ailleurs, que le Hamas est proche des Frères musulmans, lesquels sont intégrés au processus démocratique en Egypte. Ils participent à la refondation de la constitution de ce pays, et ils semblent reconnaître les traités entre l’Egypte et Israël, même s’il faut être prudent sur ce point. Pensez-vous qu’on peut s’attendre à des évolutions de même nature avec le Hamas ? Peut-on envisager de l’intégrer dans le processus de paix ?
Enfin l’ONU vient de publier un rapport épouvantable sur les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité commis par le gouvernement du Sri Lanka à l’encontre des Tamouls. La France peut-elle prendre une initiative pour traduire les dirigeants sri lankais devant la Cour pénale internationale ?
M. Didier Julia. L’accord entre le Fatah et le Hamas ne permettrait-il pas au gouvernement français de prendre l’initiative de reconnaître l’État palestinien ou de participer à sa reconnaissance ? Ne serait-ce pas un facteur important pour la pacification de la région ?
Ma deuxième question concerne la Syrie : compte tenu des violences épouvantables qui ont été commises et du nombre des victimes, la France ne devrait-elle pas annoncer qu’elle poursuivra les responsables syriens pour crimes contre l’humanité ? Ils savent pour l’instant qu’ils bénéficient de la sympathie mal placée d’Israël, pour n’avoir jamais entrepris de reconquérir le Golan.
J’en viens à l’Algérie, dont la société est actuellement en ébullition. Vous avez rappelé, à juste titre, que les Frères musulmans sont un mouvement centriste, modéré, malgré la présence de quelques excités. Ils ont déjà remporté deux scrutins en Algérie : les élections municipales et les élections législatives, avec 87 % des voix. Puis ils ont été physiquement éliminés par l’armée, au motif qu’ils étaient des fondamentalistes. Etes-vous prêt à affronter un printemps algérien, monsieur le ministre ?
M. Jean-Paul Lecoq. Vous avez répondu à la question que je voulais poser sur les critères de la diplomatie française, mais il reste une certaine ambiguïté : on dit « Kadhafi », mais « Monsieur Bachar el-Assad ». Je ne sens pas chez vous la même détermination pour la Syrie que pour la Libye.
La richesse de l’actualité nous conduit malheureusement à passer très vite d’un événement à un autre. Que devient la Côte d’Ivoire ? Est-elle enfin pacifiée ? Nous avons eu des échos de crimes commis, aujourd’hui encore, par certaines factions, dont certaines sont proches du nouveau président. La diplomatie reste-t-elle attentive à l’évolution de la situation ? Quel témoignage les forces françaises, qui accompagnent les forces ivoiriennes, vous apportent-elles ?
Je vous ai entendu hier chanter les louanges du roi du Maroc, que vous venez de réitérer devant cette Commission. Il faut espérer que les déclarations officielles seront vraiment suivies d’effet. Mais je vous invite à la modération : il y a encore des atteintes aux droits de l’homme dans les territoires occupés du Sahara occidental. On ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. Il faut aider le Maroc à avancer sur le chemin de la démocratie, mais il faut aussi avoir le courage de dire ce qui ne va pas.
Mme Marie-Louise Fort. Ma première question concerne la réponse de l’Union européenne à la demande conjointe des présidents français et italien sur l’espace Schengen. Quels sont les derniers rebondissements dans cette affaire ? Où en est, par ailleurs, la préparation des élections en Tunisie ? Les forces démocratiques sont-elles parvenues à mieux s’organiser ?
[…]
M. Serge Janquin. Que pensez-vous, monsieur le ministre, de l’accord intervenu au Caire entre le Fatah et le Hamas ?
Le gouvernement de M. Netanyahou a clairement exprimé son hostilité en indiquant que les 60 millions d’euros de taxes qui reviennent à l’Autorité palestinienne ne seraient plus reversés. Dans la perspective de la prochaine conférence des pays donateurs, qui aura lieu en juin, quelle appréciation portez-vous sur la réaction israélienne ? Faudra-t-il verser à l’Autorité palestinienne les sommes dues par Israël ?
Que pensez-vous, par ailleurs, de la demande de reconnaissance de l’État palestinien ? Vous l’aviez évoquée, le 30 mars, dans votre discours sur l’Union pour la Méditerranée. Les perspectives se concrétisent-t-elles davantage qu’hier ?
M. Jean-Michel Boucheron. Le bilan de la diplomatie française depuis quatre ans comporte des aspects positifs, et d’autres qui le sont moins. Je pense en particulier au suivisme de la France et de l’Europe à l’égard des Etats-Unis sur le dossier palestinien.
L’Europe a eu tort, il y a quelques années, de ne pas considérer le Hamas comme un interlocuteur : sa constitution n’était pas très différente de celle de l’OLP quinze ans plus tôt ; il me semble que nous devons discuter avec tous les acteurs.
Compte tenu du changement majeur qui vient de se produire, la France compte-t-elle prendre une initiative pour aller un peu plus loin et un peu plus vite que les Etats-Unis et le reste de l’Europe ? Les Américains avaient annoncé qu’ils réviseraient leur aide si le récent accord intervenait. Or, on ne peut pas faire l’impasse sur la présence du Hamas. Nous devons montrer le chemin, comme nous l’avons fait par le passé, en particulier sous votre autorité. J’ai donc quelque espérance de voir la situation bouger.
M. Jacques Myard. Il est évident que le terrorisme va continuer : ce n’est pas M. Ben Laden qui l’a engendré, mais le fanatisme religieux. Or, celui-ci perdure. Nous devons donc poursuivre la lutte.
La France est membre du Conseil de sécurité, et elle est une puissance importante, mais elle ne peut pas tout faire. Ne faut-il donc pas hiérarchiser les priorités ? Nous devons nous occuper de la Méditerranée, du Sahel, de l’Afrique et du Proche et Moyen-Orient. Ce qui se passe en Afghanistan est d’une autre nature. Nous n’avons pas de prise sur les événements – pas plus d’ailleurs que les Américains, car l’enjeu est essentiellement pakistanais. J’aimerais d’ailleurs vous entendre sur ce sujet.
S’agissant du Proche-Orient, il me semble que le moment est venu de reconnaître l’État palestinien. Il faut avancer : ça n’est pas une position anti-israélienne ; c’est même une nécessité pour garantir la sécurité d’Israël.
Je m’interroge, moi aussi, sur les contrôles américains réalisés sur le territoire national. Un tel accord aurait dû être autorisé par le Parlement.
[…]
M. Jean-Christophe Cambadélis. Je ne reviens pas sur la Palestine, ni sur l’Afghanistan, dont j’espère que nous allons sortir. Vous avez indiqué, à juste titre, que M. Kadhafi avait perdu toute légitimité en tirant sur son peuple, mais vous êtes plus nuancé quant à M. el-Assad : vous avez indiqué qu’il se mettrait « petit à petit » en porte-à-faux avec la communauté internationale s’il continuait. Pouvez-vous nous expliquer cette différence sémantique ?
M. le ministre d’État. […] J’en viens maintenant au processus de paix et aux conséquences de l’accord entre le Fatah et le Hamas. Nous sommes des amis d’Israël. Nous sommes très attachés à la sécurité de ce pays, à son intégrité territoriale et à la reconnaissance de sa légitimité sur cette terre, qui est celle du peuple juif. Cela dit, le statu quo est intenable. Le gouvernement israélien va vers de graves difficultés s’il ne prend pas conscience des conséquences potentielles des changements géostratégiques actuels. L’Egypte d’aujourd’hui n’est plus celle de Moubarak. Ses dirigeants se sont certes engagés à respecter les traités de paix, mais le contexte n’est plus le même. Des événements se passent aussi en Syrie, avec des répercussions sur la situation au Liban. Nous appelons donc le gouvernement israélien à revenir à la table pour discuter avec les Palestiniens, sur la base des critères que vous savez, notamment pour les frontières.
Pour l’instant, les Américains ont échoué. L’Union européenne est considérée, au Proche-Orient, moins comme un acteur que comme un tiroir-caisse. Les Européens tentaient de définir une politique commune, fondée sur une plus grande fermeté, pour appeler les protagonistes à discuter, quand est survenue la signature de l’accord entre le Fatah et le Hamas. D’aucuns y voient la marque de la crainte du Hamas de perdre des soutiens. Mais nous ne pouvons pas être hostiles a priori à une réconciliation entre Palestiniens, tout en nous demandant ce qu’elle cache. Le Hamas est-il prêt à renoncer au terrorisme et à la violence ? À reconnaître les traités internationaux ainsi que l’existence d’Israël ? L’accord qui sera signé aujourd’hui au Caire est ambigu. C’est pourquoi nous nous sommes contentés d’envoyer un témoin.
La France ne saurait rester passive en attendant le rendez-vous de septembre. Elle va, dans l’intervalle, prendre l’initiative pour déclencher de nouvelles discussions. L’idée serait de transformer la conférence des donateurs de fin juin en véritable conférence politique. M. Netanyahou est à Paris demain ; le président de la République le recevra et lui exprimera ce que je viens de dire. Aujourd’hui, il est à Londres, où on lui tient le même discours. Quelle va être notre capacité à le faire évoluer ? Vous connaissez l’homme, son caractère et sa détermination. Ce n’est pas un jugement de valeur que je porte. Du côté américain, il y a peu d’initiative aujourd’hui. Notre idée, c’est de tenter l’initiative de la dernière chance de façon qu’en septembre, quand la question de la reconnaissance se posera, l’on puisse se dire que l’on a tout essayé. Nous ne sommes pas décidés à reconnaître l’Etat palestinien en septembre avant d’avoir vu ce qui se passera d’ici là. Cela étant, il ne faut pas se bercer d’illusions : la reconnaissance ne réglera pas tout, même s’il s’agit d’un symbole très fort.
[…]
À propos de l’immigration, la réponse de M. Barroso à M. Berlusconi et à M. Sarkozy est très positive. Pour la première fois, la Commission entre dans notre logique, à savoir que l’immigration illégale est un fléau pour tout le monde, pour les pays d’origine comme pour ceux de destination, et pour les migrants eux-mêmes qui sont traités comme du bétail par certains réseaux. Il faut donc se donner les moyens de l’enrayer grâce à de meilleurs contrôles aux frontières extérieures de l’Union, et en coopération avec les pays d’origine eux-mêmes.
La révolution survenue en Tunisie a eu pour effet d’y faire disparaître la police, donc les contrôles. Il faut aider ce pays à remettre en place un corps des douanes, et il est disposé à signer avec la France un accord de réadmission comme il l’a fait avec l’Italie. Nous réclamons aussi le renforcement de Frontex. Monsieur Myard, le Parlement français a ratifié les accords de Schengen et les traités internationaux prévalent, vous le savez bien, sur la règle nationale. Enfin, M. Barroso accepte l’idée d’une clause de sauvegarde au cas où un État ne serait plus en mesure d’assurer les contrôles à la frontière Schengen.
Au Maroc, les initiatives de la monarchie méritent d’être soutenues. Dès son arrivée au pouvoir, le roi Mohammed VI a fait preuve d’un grand esprit d’ouverture. D’ailleurs, les manifestations n’ont donné lieu de part et d’autre à aucun dérapage. Ensuite, l’attentat de Marrakech montre que des terroristes veulent à tout prix bloquer le processus engagé. La résolution du Conseil de sécurité, qui prolonge la mission des Nations unies au Sahara occidental tient compte des efforts accomplis sur le terrain des droits de l’homme : un conseil des droits de l’homme a été créé, et le Maroc s’est déclaré prêt à accepter des observateurs.
Concernant l’Algérie, la prudence est de mise. Il est difficile d’imaginer que les aspirations de la population n’y soient pas les mêmes que chez ses voisins. Tous les ingrédients sont réunis : une jeunesse nombreuse et désœuvrée, un régime en place depuis longtemps. J’espère que le régime algérien aura la sagesse d’évoluer. Cependant, souvenez-vous, monsieur Julia, que, quand ils ont gagné les élections municipales en 1992, les Frères musulmans n’avaient rien de modéré ce qui explique que nous ayons approuvé tacitement la décision du gouvernement algérien de ne pas tenir compte de ces élections. Le terrorisme a fait 200 000 victimes en Algérie, et ce traumatisme explique peut-être les réactions propres à ce pays.
Quelque interprétation que vous donniez à ce que j’ai dit à propos de la Libye et de la Syrie, il n’y a pas deux poids et deux mesures. Nous réclamons l’inscription de Bachar el-Assad lui-même sur la liste des personnes faisant l’objet de sanctions de l’Union européenne, après avoir espéré qu’il évoluerait. Faute d’avoir été entendus, nous avons adopté une position plus stricte, conforme à celle prise à l’égard d’autres pays.
[…]
De mon récent voyage en Tunisie, j’ai retiré l’impression que les élections s’annonçaient plutôt bien – la commission électorale a élaboré un code électoral qui doit être approuvé par le gouvernement. Une soixantaine de partis politiques entendent y participer, ce qui entraînera un grand émiettement des voix, et sans doute une prime aux sortants, c’est-à-dire à ce qui reste du parti de Ben Ali, et aux Frères musulmans avec le parti Ennahda, dirigé par M. Ghannouchi. Quelle confiance accorder à ces derniers ? Au cours du colloque organisé par l’Institut du monde arabe, j’ai expliqué que l’on ne pouvait ignorer le mouvement de fond qui se manifeste partout dans les pays arabes, pourvu qu’il renonce au terrorisme, et s’engage à ne pas confisquer la démocratie. Comment exclure ceux qui ont accepté ces conditions sous le seul prétexte qu’ils se disent islamiques ? Nous dialoguons bien avec l’AKP. Nous prenons un pari sur la bonne foi des islamistes et sur leur volonté de respecter la démocratie, même si, j’en conviens, les jeunes de Tunis m’ont mis en garde contre la rémanence des vieilles tendances théocratiques. Nous sommes donc ouverts au dialogue, sans être naïfs.
[…]
M. Jacques Remiller. La mort de Ben Laden aura-t-elle des conséquences sur la libération de nos otages retenus au Sahel et en Afghanistan ? En Libye, après plusieurs mois, aucune force n’a pris l’ascendant sur l’autre et Kadhafi est toujours là. Quelle peut-être l’issue du conflit ? […]
M. Pascal Clément. […] Est-il vrai que Kadhafi garde une certaine popularité à Tripoli ?
M. Jean-Paul Bacquet. Y a-t-il, en Libye, des militaires français au sol ? Si oui, combien sont-ils ? Et quelle est leur mission ? Enfin, quel est le coût de notre intervention ?
M. Jean-Pierre Dufau. Savez-vous quelle était la cible exacte de l’attentat de Marrakech qui, je le précise à toutes fins utiles, a précédé l’élimination de Ben Laden ?
Mme Martine Aurillac. Nous saluons tous la démarche éclairée et courageuse du roi du Maroc. Avez-vous des précisions sur le calendrier des réformes ?
M. Robert Lecou. Il était du devoir et de l’honneur des Nations unies et de la France de défendre les civils libyens innocents pris sous le feu des forces de Kadhafi. Nous souhaitons tous un retour le plus rapide possible à la paix civile, condition d’une évolution démocratique. Mais que penser du service européen d’action extérieure dont s’est dotée l’Union européenne pour tenir sa place dans la diplomatie internationale ?
M. Jean-Claude Guibal. Le « printemps arabe » contribuera-t-il à la relance de l’Union pour la Méditerranée ? L’affrontement historique entre les tribus de Cyrénaïque et de Tripolitaine peut-il conduire à une partition de la Libye ?
Mme Nicole Ameline. La meilleure réponse à l’immigration est le développement. Alors que son avenir est en jeu, l’Europe est-elle prête à accompagner dès maintenant, et massivement, les pays méditerranéens ? Que penser de l’interopérabilité des forces de l’Europe et de celles de l’OTAN en Libye ? Enfin, notre politique étrangère connaît-elle une inflexion durable en se fondant sur des concepts radicalement nouveaux qui prennent en compte les populations civiles et les droits de l’homme ?
[…]
M. le ministre d’État. J’ignore quelles seront les conséquences de l’élimination de Ben Laden sur le sort de nos otages. Elle peut susciter des représailles – et nous devons rester extrêmement vigilants en France comme à l’étranger – ou bien, au contraire, fragiliser les mouvements terroristes et les inciter à se montrer plus ouverts à la négociation, ce qui pourrait débloquer la situation de nos deux journalistes en Afghanistan, de nos quatre otages au Mali, de notre otage en Somalie. Il ne reste qu’à souhaiter que Gérard Longuet ait raison.
Au sujet de la Libye, j’ajoute seulement que le président de la République veut organiser une conférence des amis de la Libye, pour réunir tous les acteurs qui vont reconstruire le pays : le Conseil national de transition, mais aussi les autorités traditionnelles – les tribus dont une cinquantaine ont lâché Kadhafi – et, le plus difficile, les officiels qui ont fait défection.
[…]
Oui, Kadhafi est populaire à Tripoli – auprès de ceux qui sont sous sa coupe. Il arrive qu’un dictateur soit acclamé un jour et conspué le lendemain. Ne prêtons donc pas trop d’importance à l’enthousiasme des foules tripolitaines.
Il n’y a sur le sol libyen que des instructeurs, une dizaine d’officiers de liaison qui aident le Conseil national de transition à s’organiser. Je n’ai pas en tête le coût de l’opération en Libye, mais M. Longuet vous a précisé qu’elle restait à l’intérieur de l’enveloppe OPEX.
À Marrakech, l’enquête avance. Des enquêteurs français sont venus en soutien des enquêteurs marocains. On semble avoir identifié deux suspects mais il n’y a pas eu de revendication. On a sans doute ciblé les touristes, comme en Indonésie ou ailleurs, pour déstabiliser l’économie. Il se trouve que beaucoup d’entre eux sont français mais il n’y a aucune raison de penser que la France était visée.
Le roi du Maroc a affiché un calendrier et mis en place une commission de réforme constitutionnelle qui rendra son rapport en juin. Sur cette base, il engagera ensuite rapidement une réforme limitant les pouvoirs du roi et instituant un pouvoir exécutif de plein exercice. C’est pourquoi j’ai parlé de monarchie constitutionnelle.
J’ai beau tendre l’oreille depuis plusieurs jours, je n’entends guère le service européen pour l’action extérieure. Mon collègue suédois a infligé une volée de bois vert à notre Haute représentante. Le service d’action extérieure n’est pas très ancien ; il faut qu’il apprenne à réagir en temps réel.
Le printemps arabe est une occasion de relancer l’UpM qui correspond à une vision stratégique. L’immigration clandestine est un fléau mais il n’est pas question de construire un mur au milieu de la Méditerranée. La seule solution à long terme, c’est de permettre aux jeunes, qu’ils soient égyptiens, tunisiens ou marocains, de vivre au pays dans la liberté. Et c’est pour nous un enjeu vital puisqu’en 2050, l’Afrique comptera 2 milliards d’habitants. L’UpM peut bénéficier de tous les mécanismes de l’Union européenne : le fonds de voisinage et de proximité, les facilités diverses et la BEI. Nous souhaitons aussi que la BERD étende ses compétences aux pays du Sud. L’Europe a un énorme effort d’accompagnement à faire, nos partenaires en sont conscients. La création d’un office méditerranéen de la jeunesse aurait un impact positif. En tant que président du G8, le président de la République a invité la Tunisie et l’Égypte dans le but de sensibiliser les grandes puissances économiques et d’élaborer un plan d’action.
Entre l’OTAN et l’Union européenne, il n’y a pas beaucoup d’interopérabilité parce que la seconde n’opère pas. Mais je ne me résigne pas à cette situation. Il faut relancer la politique commune de sécurité et de défense. Nous avons écrit en ce sens à Mme Ashton qui doit faire des propositions au conseil des ministres des affaires étrangères des 23 et 24 mai. Mais il n’y a pas que des échecs : l’opération Atalante est une réussite, comme celle menée au Congo.
Quant à la politique étrangère de la France, ce n’est pas d’aujourd’hui qu’elle défend les droits de l’homme même si nous nous sommes laissé intoxiquer par des dictateurs qui expliquaient qu’ils étaient le meilleur rempart contre l’islamisme. Nous avons eu tort et nous devons être aujourd’hui plus exigeants que jamais en matière de démocratie. Il n’y a pas, à l’exception peut-être de la Chine, de développement économique sans liberté.
[…]
9.- Mardi 10 mai 2011, séance de 10 heures, compte rendu n° 57 : audition de M. Mouldi Kefi, ministre des affaires étrangères de Tunisie
M. le président Axel Poniatowski. Nous avons le plaisir de recevoir M. Mouldi Kefi, ministre des affaires étrangères de la République de Tunisie, que je remercie d’avoir accepté notre invitation.
Au mois de février dernier, une délégation de la Commission des affaires étrangères que je conduisais s’est rendue à Tunis où vous aviez eu l’amabilité de nous recevoir, monsieur le ministre, et au cours de laquelle nous avions pu constater que les relations franco-tunisiennes étaient toujours aussi solides. Au cours de l’entretien que vous nous aviez accordé, vous aviez d’ailleurs déclaré : « Avant le 14 janvier, ces relations étaient fondées sur des intérêts communs mais pas sur les mêmes valeurs. Aujourd’hui, la France et la Tunisie partagent aussi les mêmes valeurs. »
La visite du ministre français des affaires étrangères les 20 et 21 avril derniers a permis de réaffirmer que la France soutenait pleinement la Tunisie. Parce que votre pays est confronté à une crise économique sévère, Alain Juppé a notamment annoncé un plan de soutien de 350 millions pour 2011 et 2012, anticipant ainsi le programme de soutien qui devrait être adopté par le G8 le 26 mai prochain.
Notre délégation avait également pu mesurer toutes les difficultés et incertitudes de la transition politique en cours. Depuis, la commission présidée par M. Ben Achour, composée de représentants de douze partis politiques, a proposé que l’élection de l’Assemblée constituante se déroule à la proportionnelle et que les candidats respectent la parité entre les hommes et les femmes. Tous les problèmes, cependant, ne sont pas encore surmontés comme en témoignent notamment les émeutes qui se sont produites cette fin de semaine. Vous nous expliquerez sans doute ce qui les a motivées et nous direz s’il vous paraît toujours possible que les élections se tiennent le 24 juillet prochain. Le Premier ministre et M. Ben Achour ont déclaré récemment qu’il appartiendrait à la commission électorale de décider s’il est techniquement possible de respecter cette échéance. Si le Premier ministre paraît déterminé, il dénonce également des entreprises de déstabilisation visant à empêcher que les élections aient lieu à cette date. Quelles sont donc les forces qui demandent leur report à l’automne ?
Enfin, la révolution tunisienne se déroule dans un contexte régional extrêmement agité. La Tunisie, en particulier, étant directement concernée par la situation en Libye, votre appréciation sur cette crise nous intéresse au premier chef.
M. Mouldi Kefi, ministre des affaires étrangères de la République de Tunisie. C’est pour moi un plaisir et un honneur de m’adresser aujourd’hui, quelques mois seulement après la révolution tunisienne du 14 janvier 2011, aux représentants élus du peuple français. J’espère que, dans quelque temps, la Tunisie disposera également de ses propres représentants démocratiquement élus et que nous pourrons vous recevoir, mesdames et messieurs, à l’Assemblée et au Sénat, vos collègues tunisiens pouvant quant à eux venir à votre rencontre à Paris pour discuter avec vous.
Je vous remercie, monsieur le président, pour les propos aimables de solidarité et de soutien que vous avez prononcés à l’égard de mon pays, lequel vit une nouvelle étape, inédite, de son histoire. Je me félicite des nombreux témoignages d’amitié de la classe politique française. Si M. Alain Juppé était à Tunis voilà trois semaines, où j’ai eu l’honneur et le plaisir de le rencontrer et de discuter avec lui des relations tuniso-françaises, nous avons aussi reçu de nombreux membres du gouvernement français. Votre pays est celui qui, parmi tous les pays amis, a envoyé le plus grand nombre de hauts dignitaires et de responsables pendant ces trois derniers mois. La France est en effet notre premier partenaire et notre plus grand ami, non seulement en Europe, mais dans le monde. J’ajoute que la Tunisie a aussi reçu de hauts responsables du monde entier, de l’Australie aux États-Unis en passant par la Chine et le Japon, car notre petit pays où la révolution a eu lieu suscite aujourd’hui une curiosité sympathique : tout le monde souhaite voir ce qui s’y est passé !
Je vous remercie également, monsieur le président, ainsi que M. Cinieri, pour la visite que vous avez effectuée et qui a été perçue par le peuple tunisien comme un signe d’encouragement et d’amitié.
Le 14 janvier 2011, le peuple tunisien a donc décidé de tourner la page de vingt-trois ans de privations et de mensonges sous la férule d’un dictateur absolu. Le chômage et l’absence de libertés ont finalement porté le coup de grâce à un régime corrompu, haï, voué aux gémonies. Cette révolution de la liberté et de la dignité, unique en son genre, a été portée par le peuple tunisien, les jeunes et les vieux, les hommes et les femmes, qui ont décidé de secouer leur joug. Nous sommes convaincus qu’elle nous rendra notre place au sein de la communauté internationale parmi les pays fiers de leur patrimoine civilisationnel, ouverts sur le monde et défenseurs des valeurs universelles de démocratie, de justice, des droits de l’homme, et de la liberté de culte.
Je vous l’avais dit à Tunis, monsieur le président, et je le répète aujourd’hui : avant le 14 janvier, nous avions des intérêts communs ; aujourd’hui, nous sommes fiers de pouvoir partager les valeurs communes nées de la Révolution française de 1789.
Révolution n’est pas pour autant synonyme de démocratie, comme en témoigne d’ailleurs l’histoire de votre pays. Le processus de transition de la dictature vers une démocratie ouverte et transparente est un long chemin semé d’embûches – vous venez d’en mentionner certaines –, qui, fort heureusement, ne sont ni structurelles ni insurmontables. La Tunisie commence ainsi une phase nouvelle de son histoire marquée par les aspirations légitimes de son peuple à instaurer un État de droit démocratique respectant l’universalité des libertés fondamentales et des droits de l’homme et assurant un partage équitable des richesses ainsi que des fruits de la croissance.
Dans cet esprit, le gouvernement transitoire s’est donné deux objectifs principaux.
Il s’agit, tout d’abord, de préparer l’avenir politique du pays. Le peuple a choisi la voie de l’élection d’une Assemblée constituante le 24 juillet prochain. Celle-ci sera chargée de réfléchir sur le type de régime à instaurer, de rédiger une nouvelle constitution et de préparer les futures échéances présidentielles et législatives. La Haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution a quant à elle élaboré et présenté au gouvernement un nouveau code électoral qui ouvrira la voie aux prochaines élections, auxquelles près de soixante-dix partis politiques participeront. Les Tunisiens sont fermement et solidairement engagés pour la réussite de ce processus irréversible et montrent par la maturité dont ils font preuve qu’ils sont à la hauteur de leurs ambitions démocratiques. Il est certain que la Tunisie dispose des principaux ingrédients pour réussir, et éviter les écueils de l’extrémisme : les droits des femmes, qui datent de 1956, un niveau d’alphabétisation supérieur à 90 % de la population, un esprit de tolérance et d’ouverture.
La réussite du projet démocratique en Tunisie – c’est là le deuxième objectif fondamental du gouvernement provisoire – appelé à avoir un impact au-delà de ses frontières, repose également sur une ambition de développement et sur une croissance économique durable et forte, créatrice de richesses et d’emplois, fondée sur la transparence et une bonne gouvernance. Il s’agit ainsi de redonner à tout un peuple l’espoir de la réussite, surtout dans les régions défavorisées, là où la révolution a commencé. La prospérité économique confortera ainsi le processus politique démocratique et constituera un bouclier face aux courants extrémistes et anti-démocratiques. Réinstaurer la confiance dans les secteurs économiques et financiers, améliorer l’environnement des affaires et relancer les investissements ainsi que l’initiative privée sont autant d’objectifs essentiels. Les régions intérieures, où le taux de pauvreté et de chômage dépasse la moyenne nationale, demandent un surcroît d’efforts eu égard à leurs besoins spécifiques en termes d’emploi et d’amélioration des conditions de vie.
Sur le plan social, le chômage constitue l’un des problèmes urgents auquel nous devons faire face. Le nombre de chômeurs est estimé à 700 000, dont 170 000 détiennent un diplôme de l’enseignement supérieur. Ces chiffres sont en hausse constante en raison des revendications sociales qui se sont produites après la révolution, de la baisse attendue de la croissance et de l’investissement, de la fermeture de certaines unités de production, mais aussi du retour forcé des Tunisiens travaillant en Libye. Afin de surmonter ces difficultés et de limiter leur portée, le gouvernement de transition a adopté un programme de relance économique et sociale pour accélérer la croissance et stimuler les investissements, créer plus d’emplois et sauvegarder la cohésion sociale, facteur déterminant pour la réussite et la pérennité du processus de transition démocratique.
Les relations entre la France et la Tunisie ne datent pas d’hier. Forgées par des décennies et même des siècles, elles demeureront toujours amicales pour faire face à toutes les tempêtes ou à toutes les vaguelettes qui, parfois, apparaissent, mais qui sont heureusement conjoncturelles et s’évanouissent rapidement grâce à nos efforts communs. La France a pris immédiatement la mesure des événements qui se sont produits dans mon pays à la suite de la révolution du 14 janvier, même s’il a fallu attendre un peu pour que le premier membre de votre gouvernement – en l’occurrence Mme Christine Lagarde – se rende chez nous. L’ont alors suivie de nombreux ministres, comme M. Wauquiez, M. Juppé, M. Mitterrand, Mme Kosciusko-Morizet, M. Lellouche, et d’autres encore, ainsi que des parlementaires comme vous, messieurs Poniatowski et Cinieri, accompagnés d’une délégation du groupe d’amitié France-Tunisie.
Nous avons également reçu de nombreux engagements et promesses d’appuis en cette période si décisive de notre histoire. Nous souhaiterions les voir se concrétiser très rapidement compte tenu du contexte prévalant dans notre pays et sa région. Des gestes d’amitié seront toujours les bienvenus. Je pense également au rôle primordial que peuvent jouer la coopération décentralisée et les liens établis entre les régions, départements et villes de France avec leurs homologues tunisiens afin de soutenir la transition démocratique, notamment dans les régions et les zones les plus défavorisées.
Aujourd’hui, nous sommes en train de jouer en Tunisie une « symphonie inachevée » qui, forte de votre soutien, se transformera en une « ode à la joie ».
Ce qui se passe chez nous, j’y insiste, dépasse le cadre de notre petit pays. Lorsque l’on voit le printemps tunisien gagner d’autres pays de la région et bien au-delà, cette expérience qui a commencé le 14 janvier se doit d’être un succès, non seulement pour le peuple tunisien, mais aussi pour tous les amis de la Tunisie. Faillir à notre mission serait un coup dur pour la région et pour le reste du monde. L’Histoire ne nous pardonnerait pas l’échec de cette expérience démocratique qui autoriserait toutes les dictatures à avoir le dernier mot.
Je ne doute pas que tous les peuples épris de liberté et les élus de votre honorable Assemblée se tiendront aux côtés de la Tunisie et nous aideront à traverser cette période critique.
M. le président Axel Poniatowski. Monsieur le ministre, êtes-vous en mesure de confirmer avec certitude que les élections du 24 juillet visant à mettre en place une Assemblée constituante se tiendront effectivement à ce moment-là, ou risquent-elles de ne pas avoir lieu ? Quelles sont les forces de déstabilisation dont a parlé M. le Premier ministre en envisageant le report des élections, d’ailleurs souhaité par un certain nombre de partis politiques qui estiment ne pas être suffisamment connus des Tunisiens ? Si elles devaient avoir lieu à l’automne, après le ramadan, ne craignez-vous pas que la population ne se montre extrêmement sceptique ?
M. Mouldi Kefi. Un grand débat a lieu en ce moment en Tunisie, comme nous avons pu encore le constater lors de la dernière interview du Premier ministre. Ces dernières semaines, des frictions se sont produites entre le gouvernement et la Haute instance présidée par M. Ben Achour autour de l’article 15 du projet de loi visant à préparer les élections, lequel interdit aux anciens membres du parti unique de se présenter. Si la seconde y était favorable, le premier a considéré que c’était abusif parce qu’au-delà des prochaines élections c’est à la réconciliation nationale qu’il faut tendre. Selon le gouvernement, si l’ancien président, sa famille, certains hauts responsables doivent être exclus d’un tel processus, la généralisation d’une telle interdiction à l’ensemble des membres du parti serait antidémocratique et pourrait même poser des problèmes devant les instances internationales. Les droits de l’homme, en effet, garantissent à tout un chacun le droit de voter et de se présenter aux élections. La durée de cette discussion a donc influé sur le calendrier électoral jusqu’à ce qu’un modus vivendi ait finalement été trouvé mercredi dernier : une liste sera établie par la Haute instance et soumise au gouvernement, sur laquelle figureront les noms des quelques milliers de personnes exclues.
Certains partis ont en effet demandé le report des élections, arguant de leur impréparation – ni leurs programmes, ni leurs leaders ne sont connus –, mais le président, le Premier ministre, l’ensemble du gouvernement ont quant à eux pris des engagements solennels et, au premier chef, celui de ne pas se présenter aux élections et de quitter le pouvoir le 24 juillet. L’alternative devant laquelle nous nous trouvons est donc la suivante : ou le gouvernement tient parole et les élections se dérouleront – mais sera-ce dans de bonnes conditions ? –, ou les partis politiques parviennent à influencer l’opinion publique de manière à imposer le report d’une consultation jugée ni démocratique, ni fiable, ni transparente. C’est l’avenir de notre pays qui, alors, se décidera et le gouvernement sera obligé de rester jusqu’au mois d’octobre. Cela dit, il ne faut pas qu’une telle décision soit perçue comme un recul ou un reniement gouvernemental et il convient d’éviter que la situation ne dégénère au point de faire descendre la population dans la rue.
Nous serons donc confrontés à un exercice d’équilibre, mais je suis persuadé que, si la commission électorale commence à travailler, les huit semaines qui nous séparent du 24 juillet suffiront largement pour préparer ce processus électoral. Je suis naturellement optimiste mais je considère que ce peuple, qui a réussi un tel miracle en se débarrassant du joug de l’ancien régime, est également capable de réussir à organiser des élections durant cette brève période.
M. Dino Cinieri. En ma qualité de président du groupe d’amitié France-Tunisie à l’Assemblé nationale – lequel compte une centaine de membres représentatifs de toutes les sensibilités politiques –, je tiens à vous souhaiter à mon tour, monsieur le ministre, la bienvenue.
Après la révolution intervenue dans votre pays qui, comme l’a dit M. le ministre des affaires étrangères Alain Juppé, constitue une chance et un espoir pour tous, j’ai souhaité que les membres de notre groupe d’amitié puissent avoir un échange de vues avec M. le ministre conseiller chargé d’affaires à votre ambassade. Vous avez voulu, monsieur le ministre, participer personnellement à cet échange et nous en sommes particulièrement honorés. J’ai donc souhaité donner à l’événement qu’est votre venue en France tout le retentissement qu’il mérite et je remercie le président Poniatowski d’avoir accepté que cette rencontre se déroule au sein de notre prestigieuse commission des affaires étrangères, et non plus dans le cadre de notre modeste groupe d’amitié.
Au nom de la solide amitié qui unit nos deux pays, j’exprimerai sans ambages quelques brèves interrogations.
Parmi les conditions de réussite de la transition démocratique figure ce qu’il est convenu d’appeler la réconciliation nationale. Si les abus passés doivent être évidemment sanctionnés, l’objectif est de parvenir rapidement à l’établissement d’une société apaisée. Il nous paraît également souhaitable que des processus électoraux justes, démocratiques et transparents soient mis en place pour permettre une transition ordonnée et pacifique vers la démocratie. Qu’en est-il, à cet égard, dans votre pays ?
Notre amitié est fondée sur une grande proximité culturelle, résultant notamment de la pratique, en Tunisie, d’un islam modéré, d’un statut de la femme qui a délivré celle-ci du port du voile, de l’ignorance et du confinement domestique, mais aussi de la politique active de la francophonie menée depuis l’indépendance ainsi que d’importants efforts de formation, notamment universitaire, de la jeunesse. Nous sommes très attachés au développement de cet acquis. Quelles sont donc, en la matière, les orientations du gouvernement tunisien ?
Plus de 1 200 entreprises françaises employant plus de 110 000 personnes sont implantées en Tunisie, la France étant le premier investisseur étranger dans votre pays. Les chefs d’entreprise qui investissent à l’étranger redoutant par-dessus tout l’incertitude, pouvez-vous nous éclairer sur l’attitude des autorités tunisiennes à l’égard des investissements ?
La France est particulièrement attachée au processus de paix au Proche-Orient. Le président Bourguiba, en son temps, a joué un rôle important en œuvrant pour une responsabilisation de l’OLP. Quelle contribution la Tunisie vous paraît-elle en mesure d’apporter aujourd’hui ?
Le tourisme français en Tunisie, favorisé par le partage d’une langue commune et la qualité de l’hospitalité tunisienne, constitue un élément important des relations qui unissent nos deux pays. Je ne vous cacherai pas les craintes de nos concitoyens quant à la sécurité dans votre pays. Pourriez-vous faire le point de la situation ?
S’agissant de l’immigration, la France s’est montrée ouverte à l’égard de la Tunisie en proposant notamment, voilà quelques années, d’accueillir 9 000 diplômés par an. À l’inverse, l’immigration clandestine est préoccupante et il nous semble que la lutte contre celle-ci doit constituer un impératif commun. Si cet objectif est partagé, quels moyens les autorités tunisiennes mettent-elles en œuvre pour contribuer à sa réalisation ?
Je tiens à vous assurer, monsieur le ministre, que les députés français, et particulièrement les membres de notre groupe d’amitié soutiendront activement l’engagement de la France voulu par le Chef de l’État et le gouvernement afin d’aider le peuple tunisien à concrétiser ses aspirations et à construire une Tunisie démocratique et prospère, élément d’équilibre indispensable au sud de la Méditerranée.
M. Mouldi Kefi. Je suis ici pour rencontrer les véritables amis de la Tunisie et répondre aux préoccupations qu’ils expriment.
Plusieurs expériences de réconciliation nationale ont eu lieu dans le monde. Certaines ont réussi, d’autres ont échoué. Un processus de dénazification s’est produit en Allemagne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale mais, si tous les anciens nazis avaient été éliminés ou mis de côté, ce pays serait-il parvenu à se remettre ? Je me souviens d’un certain Kurt Waldheim qui aurait été officier pendant la Seconde Guerre mondiale, puis ministre des affaires étrangères et président de son pays et, enfin, secrétaire général des Nations unies. En Irak, en revanche, la « débaasification » a entraîné d’énormes problèmes, l’armée et l’administration ayant été décapitées. La réconciliation nationale, en Afrique du Sud, a quant à elle été réussie grâce au leader charismatique Nelson Mandela qui a créé une commission pour la vérité et la réconciliation capable de remettre politiquement et économiquement ce pays sur les rails, au point qu’il compte désormais parmi les fameux « BRICS ».
C’est parce que nous avons à l’esprit tous ces exemples qu’en Tunisie nous ne voulons pas insulter l’avenir. L’ancien parti, l’ancienne police, l’ancien régime ont causé beaucoup de dégâts et l’émotion est encore palpable. Si nous ne pouvons pas faire comme s’il ne s’était rien passé, il convient également de ne pas dramatiser la situation. Nous sommes encore confrontés à un exercice d’équilibre entre les membres de la Haute instance, qui souhaitent rompre absolument avec le passé et se débarrasser de tous les membres de l’ancien parti, et le gouvernement qui, lui, essaie de ménager la chèvre et le chou dans un esprit de réconciliation. Une fois l’Assemblée constituante élue, il me semble que tous les Tunisiens, de tous bords, y compris ceux qui se seront repentis de leurs actions passées, devront participer à la construction de la Tunisie du futur et contribuer au succès de la transition démocratique ainsi qu’au développement économique et social.
Je suis certain que cette Assemblée et le prochain gouvernement ne reviendront pas sur les acquis que la Tunisie a réalisés durant les cinquante dernières années. Après tout, le tableau n’est ni tout blanc, ni tout noir : les droits des femmes, l’éducation, la solidarité nationale sont autant de réalités. Certes, beaucoup de gens ont été trompés, qu’ils soient Tunisiens ou étrangers. À certains égards, l’ancienne Tunisie me rappelle la Russie de Catherine II, où le véritable état dans lequel se trouvait Moscou était masqué, le long des chemins, par des tableaux idylliques. J’exagère un peu, mais la côte tunisienne – Hammamet, Tabarka, Monastir, Sousse ou Djerba – était un peu une vitrine pour les touristes, les hauts responsables étrangers et les hommes d’affaires. Combien d’entre eux accédaient au pays profond dont je suis, moi, issu ? Originaire de la région montagneuse du Kef, à la frontière avec l’Algérie, je puis attester qu’il y avait en quelque sorte deux pays. Si 80 % du budget étaient jusqu’ici consacrés à la côte et 20 % à ces régions défavorisées, la situation, grâce au gouvernement, a été inversée. À ce propos, nous remercions la France et le président Sarkozy de nous avoir invités au prochain sommet du G8, où nous espérons pouvoir présenter le nouveau visage de notre pays.
Heureusement que les entreprises françaises, dont vous avez rappelé avec raison l’importance de la présence en termes d’emplois notamment, n’ont jamais songé à quitter la Tunisie ces dernières semaines. Leurs responsables savent combien nous avions besoin d’eux. Et leur nombre augmentera encore parce que certaines pratiques faisaient peur à de nombreux investisseurs étrangers. Le nouveau climat fait de transparence, d’honnêteté et d’ouverture ne manquera pas de les encourager.
Quels qu’aient été ses défauts, Bourguiba était un visionnaire qui, en matière de politique étrangère, a posé les fondamentaux qui sont encore les nôtres aujourd’hui. Nous avons reçu le président Abou Mazen il y a deux semaines environ et nous avons discuté avec lui comme nous l’avions fait dans le passé avec Yasser Arafat. Le dialogue américano-palestinien puis américano-israélo-palestinien et, enfin, israélo-palestinien a commencé à Tunis. Nous avons continué à nous entretenir du processus de paix au point qu’une réconciliation est intervenue dans les jours qui ont suivi et qu’une reprise du processus lui-même est envisageable. Nous avons toujours milité pour le rapprochement entre les peuples palestinien et israélien comme le fait, à son niveau, le grand chef d’orchestre israélien Daniel Barenboïm en réunissant des jeunes musiciens originaires des deux pays. J’espère que demain, au-delà de la musique, des jeunes issus de tout le Moyen-Orient se retrouveront. Après tout, Martin Luther King avait un rêve et, aujourd’hui, Barack Obama est président des Etats-Unis. Moi aussi, j’ai un rêve, celui de voir Israël, la Palestine et la Jordanie former une sorte de Benelux. Les rêves nous permettent aussi de vivre !
M. Serge Janquin. Comme tous mes concitoyens et mes collègues, je me suis réjoui de ce Printemps de jasmin, dont le parfum s’est répandu dans d’autres pays arabes grâce à la Tunisie qui a su convaincre de la justesse de son engagement et qui parviendra à emporter l’adhésion de ceux qui n’ont pas encore franchi le pas. Pour autant, des questions se posent.
Outre le problème de la cohésion sociale, vous avez souligné l’importance de l’inégalité territoriale dont, en tant que familier du Kef, je puis également témoigner. Estimez-vous donc que l’aide française et européenne au processus de reconstruction et de développement économique soit à la hauteur des besoins de votre pays ? Sur quels axes précis envisagez-vous d’engager cet effort ?
De plus, des manifestations de journalistes ont eu lieu la semaine dernière, qui ont été assez sévèrement réprimées. Sachant que la liberté de la presse est emblématique de la démocratie, je vous en prie, dites-nous ce qu’il en est et gardez le gouvernement tunisien de toute hostilité à l’endroit de cette liberté fondamentale !
M. Jean-Marc Nesme. Quelle est la position de votre gouvernement à l’égard de l’Union pour la Méditerranée (UpM) ? Diffère-t-elle de celle de l’ancien régime ?
En outre, peut-on considérer que la Tunisie soit favorable à la création d’un État palestinien souverain ?
Enfin, comment appréciez-vous l’évolution de la situation en Libye ?
M. Jean-Paul Lecoq. J’ai eu la chance de poser des dizaines de questions sur la révolution tunisienne dans votre pays, monsieur le ministre, et l’on m’a répondu avec une liberté de ton remarquable qui m’a réjoui.
La révolution tunisienne, pour nous, constitue une leçon permanente. Il suffit de lire chaque jour la presse francophone pour se souvenir des débats philosophiques et politiques qui ont alimenté la Révolution française. J’ai l’impression de me retrouver dans une période importante de l’histoire de mon propre pays.
Je m’associe à l’appel de mon collègue s’agissant de la liberté de la presse et de la liberté d’expression : elles sont toujours gage de victoire même si elles semblent parfois rendre les choses plus difficiles dès lors qu’il ne s’agit plus de vaincre mais de convaincre – il est vrai que c’est aussi cela, la force d’une démocratie.
Considérez-vous que votre pays pourra récupérer l’ensemble des actifs financiers qui ont été détournés par l’ancien régime ? Dans l’affirmative, quand et comment ?
Des Français ont investi en Tunisie en acceptant d’être rackettés par le pouvoir et tous veulent aujourd’hui soutenir la révolution. Des discussions sont-elles possibles afin que les sommes récoltées indûment soient aujourd’hui consacrées à votre cause ?
M. Jacques Remiller. Des réponses ont déjà été apportées à certaines questions que j’envisageais de poser concernant notamment le report éventuel des élections et, au-delà, les sujets évoqués par M. Cinieri, mais je souhaiterais tout de même avoir quelques éclaircissements.
Vous avez dit, monsieur le ministre, que vous souhaitiez que le peuple ne redescende pas dans la rue. Or, selon la presse française, il semble que le peuple n’ait pas à le faire puisqu’il y est toujours. Pourquoi les manifestations sont-elles quotidiennes ?
J’ai rencontré hier des Français qui se préparent à se rendre en Tunisie par l’intermédiaire de leur agence de voyages et ils me disaient que seuls 25 % des hôtels fonctionnent – qui plus est, de façon aléatoire. Sachant que le tourisme constituait la première activité économique de votre pays, quelles mesures globales votre gouvernement entend-il prendre afin de faire redémarrer votre économie ?
M. Mouldi Kefi. Un peuple, monsieur Janquin, doit d’abord compter sur lui-même. La première mesure prise par le gouvernement tunisien a été la mise en place immédiate d’un programme de sauvegarde de l’économie. C’est dans ces conditions que notre budget, je vous l’ai dit, a été révisé notamment afin de réallouer les investissements vers les zones défavorisées. Mais parce qu’il n’est pas possible d’applaudir avec une seule main, dans ce moment crucial de la révolution, nous avons fait appel à nos amis et à nos partenaires. Ainsi avons-nous pu apprécier les manifestations de bonne volonté ainsi que les gestes d’amitié, les promesses qui ont été faites et les décisions qui ont été prises, dont, notamment, celles de la France à l’occasion de la venue de M. Juppé, lequel a annoncé le déblocage d’une somme de 350 millions. Nous espérons qu’elle pourra être utilisée le plus rapidement possible, sur les deux ou trois prochaines années. MM. Berlusconi et Frattini ont également annoncé un investissement comparable, tout comme les États-Unis et l’Union européenne nous ont aussi promis une aide substantielle – les commissaires Füle et Malmström ont évoqué une somme entre 120 et 140 millions. Encore faut-il que cet argent soit disponible le plus tôt possible afin que nous puissions créer des emplois et désenclaver certaines régions.
En ce qui concerne le G8, nous avons préparé un petit mémorandum mentionnant l’ensemble des requêtes de la Tunisie pour les cinq prochaines années. Pour reprendre la distinction marxiste, la superstructure démocratique est belle et bonne, mais l’infrastructure doit être également solide : la démocratie et la liberté ne seront effectives que si l’économie fonctionne. Nous formulerons donc des demandes précises au cours de cette réunion et nous espérons que les grandes puissances répondront à notre appel.
Notre pays a connu un calme relatif après la partie de ping-pong entre le gouvernement et la Haute instance à propos de l’exclusion des membres de l’ancien parti unique, le RCD. Un ex-ministre de l’intérieur, ignorant de son devoir de réserve, a alors été piégé ou manipulé – à moins qu’il n’ait été convaincu de la véracité de ses propos – et a fait sauter une bombe médiatique en se livrant à de la désinformation : « Il me semble que… Peut-être… » Supputations, conjectures, ragots accusant le général Rachid Ammar, chef d’état-major interarmées, ou le Premier ministre de s’être rendus en Algérie pour préparer un coup d’État militaire au cas où le parti Ennahda arriverait au pouvoir se sont alors répandus comme autant de balivernes sans fondement. Certains n’attendent que ces occasions-là pour descendre dans la rue et demander des éclaircissements au gouvernement. Parmi eux, des casseurs et des pilleurs ont profité de ce climat d’insécurité pour s’attaquer aux marchés et aux grandes surfaces – je rappelle que le magasin Géant, du groupe Carrefour, est toujours sous la protection de l’armée. Au cours de la manifestation sur l’avenue Bourguiba, quelques journalistes étaient présents, mais certains d’entre eux, et ils l’ont d’ailleurs reconnu, avaient leur badge dans leur poche et ne pouvaient être identifiés comme tel. Les policiers ont également poursuivi quelqu’un à l’intérieur de l’immeuble du quotidien La Presse de Tunisie parce qu’ils avaient pensé, à tort, qu’il avait jeté une brique sur la tête d’un de leurs collègues.
Nous sommes en train d’apprendre la démocratie, mais dans tous les pays du monde les journalistes portent des signes extérieurs qui les distinguent quand les journalistes tunisiens, eux, ne disposent pas de gilet sur lequel le mot « presse » soit inscrit ! À la suite de ces malheureux incidents, le ministère de l’intérieur a donc décidé qu’il en irait autrement et que les journalistes devraient être désormais immédiatement identifiables.
En outre, il est vrai que certains agents des forces de l’ordre n’ont pas changé de mentalité : pour eux, tabasser un journaliste fait, si j’ose dire, partie de leur formation professionnelle. Heureusement, ils ont été identifiés et ils sont en train d’être jugés, le ministre de l’intérieur ayant lui-même présenté aux journalistes et à l’opinion publique ses plus plates excuses en assurant qu’il œuvrerait à faire changer les mentalités parmi les forces de l’ordre : un journaliste, lorsqu’il rapporte la vérité, fait son travail – et, aujourd’hui, personne n’a peur de la vérité – pour lequel il doit être protégé et non passé à tabac. Un policier, quant à lui, doit protéger l’ordre public. Tout cela constitue un long apprentissage et il faut donner du temps au temps. Inch Allah !
Nous avons applaudi à la proposition de création de l’UpM par le président Sarkozy. Après le départ de Moubarak et la démission du secrétaire général jordanien, les événements actuels doivent nous inciter à réfléchir à un nouveau départ pour cette structure à partir de nouvelles bases tenant compte de l’émergence des démocraties tunisienne et égyptienne. Nous soutenons ce projet car l’UpM joue un rôle important à travers ses actions, qu’elles soient centralisées ou décentralisées, et nous souhaitons que ce partenariat régional gagnant-gagnant puisse aboutir.
La Tunisie a toujours soutenu la création d’un État palestinien libre et indépendant – après tout, l’existence du Kosovo ou de Vanuatu a bien été reconnue – aux côtés de l’État d’Israël car cela constituerait un facteur de stabilité dans la région. Une fois ce problème résolu, les peuples de cette contrée envisageront ensemble leur avenir. Je suis sûr qu’Israéliens et Palestiniens sont très proches l’un de l’autre et qu’ils parviendront à travailler la main dans la main pour leur bien commun.
Nous suivons les événements en Libye depuis le début, mais ils ne relèvent pas tant, pour nous, de la politique étrangère que de la politique intérieure tant les liens entre nos deux peuples sont étroits, y compris d’ailleurs sur le plan dialectal. Nous avons donc ouvert notre frontière afin d’accueillir l’ensemble des réfugiés, qu’ils soient libyens ou non – ils sont plus de 300 000 aujourd’hui dont presque la moitié ont quitté notre territoire après avoir transité quelques jours ou quelques semaines avec l’aide de nombreux pays, dont la France, mais aussi du Haut commissariat aux réfugiés et de l’Organisation internationale pour les migrations. Ce sont 50 000 Égyptiens et 30 000 Bangladais qui, parmi beaucoup d’autres, ont ainsi pu revenir chez eux. Le problème le plus important, aujourd’hui, est celui des familles libyennes qui fuient les combats. Nous comptons sur notre territoire 130 000 Libyens qui ne peuvent être renvoyés chez eux. C’est en l’occurrence le peuple tunisien seul, sans aide extérieure, qui s’efforce de les prendre en charge. Nous espérons que cette tragédie se terminera le plus tôt possible afin que ces personnes puissent retourner chez elles.
Le régime corrompu de Ben Ali a saigné à blanc l’économie et le peuple tunisiens. Selon les experts, nous avons réalisé une croissance de 5 % qui aurait pu être supérieure de deux points sans les dilapidations et la corruption ; et, avec 7 %, le chômage aurait disparu. Cette famille a fait au peuple tunisien un mal incommensurable. Grâce à l’appui de nombreux pays et organisations internationales, y compris TRACFIN, ses avoirs ont été gelés. Ce n’est pas toutefois à la diplomatie tunisienne de récupérer cet argent, mais aux juges, au ministère de la justice. Cependant, ces derniers ne pourront présenter des dossiers bien ficelés qu’après que toutes les preuves auront été réunies : il n’est pas question de revenir aux anciennes pratiques consistant à accuser n’importe qui de n’importe quoi ! Aujourd’hui, la justice indépendante tient à ce que la transparence règne. Quand les preuves nécessaires et suffisantes auront été rassemblées, nous présenterons les dossiers à une sorte de commission rogatoire qui comportera des juges et des avocats. J’espère, bien entendu, que les sommes spoliées pourront être récupérées le plus rapidement possible.
J’insiste : les manifestations en cours n’ont aucun caractère politique. Des jeunes, y compris âgés de dix ou onze ans, profitent du climat actuel pour descendre dans la rue. Ou il s’agit d’écervelés qui ne savent pas ce qu’ils font, ou ils sont manipulés et payés. Derrière eux se cachent en fait des pilleurs et de nombreux repris de justice qui parviennent à semer le trouble un peu partout dans le pays. Les forces de l’ordre, avec les moyens dont elles disposent, essaient quant à elles de ramener le calme.
M. Lionel Tardy. « Tunisie : de la révolution 2.0 à la démocratie 2.0 ? » : tel pourrait être le titre de ma brève intervention.
La véritable caisse de résonance de la colère des Tunisiens, en effet, a été internet et les réseaux sociaux, lesquels ont joué un rôle central dans la chute du président Ben Ali. Les témoignages, les photos et les vidéos de Sidi Bouzid – en particulier – diffusés sur Facebook, Twitter et Youtube ont permis de relayer le vent de la contestation et d’enflammer le pays en quelques semaines. La censure du régime n’est jamais parvenue à stopper le flux d’informations malgré les piratages répétés des comptes Gmail et Facebook des bloggers et des dissidents. La révolte tunisienne s’est ensuite rapidement étendue à l’Égypte, à la Libye, au Yémen, au Bahreïn, au Maroc, à la Syrie. Si la situation, dans ces pays, est encore incertaine, nous savons que rien ne sera plus jamais comme avant dans le monde arabe et que les relations internationales seront différentes.
Si ces outils électroniques ont permis aux Tunisiens de se coordonner et de développer un mouvement de fond, au lendemain de la chute du régime et dans l’attente de l’élection d’une Assemblée constituante au mois de juillet prochain, pourraient-ils également favoriser la transition démocratique et la construction de la Tunisie de l’après-Ben Ali ? Venons-nous d’assister à la première révolution issue d’internet ? Quel rôle jouent les réseaux sociaux et les nouveaux médias dans le processus de transition démocratique alors que plus de soixante-dix partis ont besoin de s’exprimer ?
Enfin, la Tunisie pourrait-elle devenir le laboratoire de l’e-democracy et de l’open gouvernance ?
M. Jacques Bascou. Quelle est l’influence des islamistes ? Ne risque-t-elle pas de s’accroître avec les difficultés inhérentes à la mise en place du processus démocratique et les problèmes économiques ? L’armée serait-elle en position de jouer un rôle ?
M. Pierre-Christophe Baguet. M. Cinieri l’a dit : vous comptez au moins une centaine de députés amis dans notre pays. Cependant, la présidence de M. Ben Ali ayant semble-t-il contribué à isoler la Tunisie, je souhaite de tout cœur que vous parveniez à trouver les soutiens dont vous avez besoin au sein du G8. Je suis tout de même un peu inquiet.
Que se passe-t-il dans les communes de votre pays, où les maires ont tous été destitués ?
Par ailleurs, je suis très choqué par la campagne que mènent les voyagistes français en bradant les prix des séjours en Tunisie. Le secteur du tourisme étant littéralement saigné à blanc, que peut-on faire afin de vous aider face à une dérive aussi malsaine ? Attendez-vous que la France intervienne directement ? Le président de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale doit-il faire passer un message fort ?
M. le président Axel Poniatowski. Nous entendons souvent dire, en effet, que les voyagistes profitent de la situation que connaît actuellement votre pays, monsieur le ministre.
M. Jean-Claude Guibal. Comment expliquez-vous le printemps arabe ? Pourquoi une telle simultanéité – Michelet disait qu’en histoire la même heure sonne au salon et à la cuisine ? Quels sont les points communs entre la Tunisie, l’Égypte et la Syrie ? Sans doute Internet n’explique-t-il pas tout même si son rôle a été réel.
De plus, qui sont les migrants de Lampedusa dont on dit qu’ils auraient profité de l’effondrement des contrôles policiers ?
M. Mouldi Kefi. En effet, monsieur Tardy, « révolution.com » et « démocratie.com » sont aujourd’hui des réalités. La Tunisie a abrité voilà quelques années le sommet mondial sur la société de l’information (SMSI). Elle avait alors demandé aux Nations unies de faire de 2010 l’année de la jeunesse. La conjugaison de ces deux éléments a contribué à notre révolution. Grâce aux nouveaux moyens de communication, mais aussi, à France 24, Al Jazeera, Al Arabia, l’opinion publique tunisienne et internationale a vécu les événements en direct. Les prises de position de certains pays amis, dont les États-Unis, ont également permis de faire cesser la censure et, devant une telle détermination, le gouvernement tunisien a été contraint de fléchir.
Nous espérons, de surcroît, que cette révolution technologique contribuera à promouvoir l’esprit et les mentalités démocratiques mais, si notre télévision, qui est libre et qui sait s’opposer, les journaux et les radios développent une véritable pédagogie de la démocratie, on ne peut hélas en dire autant de Facebook et d’autres supports électroniques qui, aujourd’hui, colportent plutôt des rumeurs et désinforment : on y trouve tout et n’importe quoi ! De la même manière, j’ignore pour qui roulent les journalistes professionnels qui ont piégé, manipulé ou utilisé l’ancien ministre de l’intérieur mais ils doivent bien travailler pour des personnes dont les arrière-pensées sont évidentes.
Il convient donc que ces nouveaux instruments soient utilisés à bon escient, au profit de la démocratie et non de la zizanie et du chaos.
L’influence des islamistes, quant à elle, est relative. Il ne faut pas en avoir peur car l’islamisme radical appartient au passé, hors les quelques groupes terroristes ou salafistes, l’AQMI ou les reliquats d’Al-Qaida qui n’ont aucun projet politique et dont les attentats ne visent qu’à faire parler d’eux, les enlèvements dont ils se rendent coupables ne tendant par ailleurs qu’à extorquer des rançons. Ennahda, en revanche, est un parti politique bien structuré et organisé qui s’est, certes, parfois montré violent dans les années 1980, mais qui, aujourd’hui, d’après ce que disent ses responsables – tiennent-ils un double langage ? L’avenir le dira –, est recommandable, favorable à la démocratie et s’inspire du modèle turc. Leur leader, Rached Ghannouchi, s’est d’ailleurs rendu à Ankara pour rencontrer M. Erdogan, dont il a affirmé vouloir suivre l’exemple. Pourquoi pas ?
Un gouvernement de coalition avec des islamistes espérons-le modérés et respectant la démocratie est possible. La situation ne sera pas comparable avec celle de l’Algérie dans les années 1989 et 1990, où le Front islamique du salut (FIS) d’Ali Belhadj voulait utiliser la démocratie afin d’arriver au pouvoir, et la supprimer une fois son objectif atteint.
J’espère, enfin, que l’armée qui n’a pas obéi à Ben Ali avant le 14 janvier et qui n’a pas tiré sur le peuple ne sera pas tentée par le pouvoir en faisant un coup d’État ou en rétablissant l’ordre brutalement. Elle devra laisser les politiques se débrouiller comme en ce moment même, alors que se déroulent des manifestations, et où elle veille à protéger la République et non à mâter les populations. Je gage qu’elle veillera à maintenir sa mission républicaine.
La Tunisie, en effet, a été isolée car, comme je l’ai dit, si nous avions des intérêts communs, il n’en était pas de même des valeurs. Aujourd’hui, mon pays adhère à ces valeurs universelles que sont la démocratie, les libertés d’expression, de réunion, de la presse. Nous voulons faire partie de ce club des démocraties anciennes ou récentes – la Tchéquie, la Pologne ou la Hongrie ne sont démocratiques que depuis une vingtaine d’années, ne l’oublions pas, quand l’Indonésie qui, à l’instar de la Turquie, compte parmi les pays membres du G9, n’est quant à elle démocratique que depuis moins de dix ans. Ces deux derniers pays témoignent que l’islam et la démocratie sont compatibles, et j’espère qu’il en ira de même en Tunisie.
Les communes ont été dissoutes et ce sont des notables locaux ou villageois connus pour leur sagesse qui ont été choisis pour gérer les affaires courantes en attendant les élections qui auront lieu dans les prochains mois.
Le ministre du tourisme de mon pays a assisté à plusieurs salons du tourisme et m’a confié que les voyagistes étrangers profitent de la situation et se livrent presque à du chantage auprès des hôteliers tunisiens : « Si nous n’obtenons pas ceci ou cela, nous ne viendrons pas. » Si chacun recherche son profit, qu’au moins celui-ci soit raisonnable ! Il n’est pas possible de revenir à la loi d’airain du XIXème siècle lorsque les ouvriers étaient saignés à blanc : « Ou tu travailles seize heures par jour pour 10 sous ou quelqu’un te remplacera ! » Une politique de sensibilisation auprès des élus français mais, également, d’autres pays, de la presse, des faiseurs d’opinion, devrait permettre d’attirer l’attention des touristes de manière qu’eux-mêmes fassent pression auprès des voyagistes pour soutenir l’expérience que nous menons. Des touristes canadiens ont ainsi refusé de se rendre dans les hôtels de Hammamet ou de Sousse pour aller à la rencontre des familles de Sidi Bouzid et de Kasserine afin de vivre au plus près des habitants. Des jeunes de bonne volonté sont prêts à les rejoindre.
Expliquer le printemps arabe, monsieur Guibal, nécessiterait une séance de plusieurs heures tant la philosophie de l’histoire est une discipline passionnante. Formé à l’université de Strasbourg, j’aurais tendance à mobiliser Zénon, Socrate, Hegel, Nietzsche, Arendt, Heidegger, mais nous n’avons pas le temps !
Quoi qu’il en soit, l’éclosion de ce printemps impliquait un certain nombre de conditions qui étaient présentes à l’état latent. La révolution tunisienne n’a pas surgi ex nihilo mais il fallait une étincelle pour qu’elle s’enclenche. En 1989, c’est la chute du Mur de Berlin qui a permis la révolution de velours en Tchécoslovaquie ou la victoire de Solidarność en Pologne. En Tunisie, il a fallu attendre que tombe le mur de la peur. Alors, sans peur, des jeunes ont désigné leur poitrine aux fusils parce que leur dignité avait été bafouée. Les révolutionnaires, en effet, ne voulaient pas seulement du pain : ils avaient faim de dignité. Les autres peuples, alors, ont pu se dire : « Pourquoi pas nous ? » J’ajoute que les armées égyptienne et tunisienne ont en l’occurrence joué un rôle extraordinaire en se rangeant du côté du peuple au service duquel elles se sont mises, ce qui, malheureusement, n’est pas le cas dans d’autres pays, dont j’espère malgré tout que la situation s’améliorera !
M. le président Axel Poniatowski. Je vous remercie, monsieur le ministre, pour nous avoir accordé cette audition et pour vos réponses détaillées et précises à chacune de nos questions, dont vous n’avez éludé aucune. Nous vous en sommes tous reconnaissants et nous souhaitons le meilleur à la Tunisie. Nous espérons, en particulier, que le gouvernement que vous représentez pourra mener à bien sa tâche en conduisant le pays jusqu’aux élections du 24 juillet.
Nous vous souhaitons bon courage, monsieur le ministre.
10.- Mardi 10 mai 2011, séance de 17 heures 15, compte rendu n° 58 : audition de M. Fouad Siniora, ancien président du Conseil libanais.
M. le président Axel Poniatowski. Je souhaite la bienvenue à M. Fouad Siniora, ancien président du Conseil libanais, que je remercie d’avoir répondu à notre invitation.
Point n’est besoin de rappeler l’étroitesse des liens humains, historiques, culturels et politiques qui existent entre le Liban et la France, ni les grandes étapes d’une éminente carrière politique qui vous a conduit, monsieur le Premier ministre, à occuper diverses fonctions ministérielles depuis 1992 avant de devenir président du Conseil des ministres entre juillet 2005 et novembre 2009. Cette période a été particulièrement délicate pour le Liban ; le pays a été au bord d’une nouvelle guerre civile au printemps 2008, la crise ayant finalement été résolue grâce à l’accord de Doha.
Membre du Courant du futur et très proche collaborateur du président du Conseil assassiné Rafic Hariri, vous avez néanmoins toujours été à la tête de gouvernements d’union nationale comprenant des membres du Hezbollah – ce qui constituait une première en juillet 2005. C’est le fils de Rafic Hariri, M. Saad Hariri, qui vous a succédé en novembre 2009 après la victoire électorale de la Coalition du 14-Mars aux élections législatives de juin 2009. Mais ce nouveau gouvernement d’union nationale n’aura duré qu’un peu plus d’une année. Il a démissionné le 13 janvier dernier, à la suite du retrait des ministres de l’opposition. M. Najib Mikati, désigné nouveau président du Conseil le 25 janvier avec les voix de la coalition pro-syrienne « du 8-Mars » et une partie de celles du groupe du parti de M. Walid Joumblatt, n’est pas encore parvenu à former un gouvernement.
Nous sommes heureux de vous recevoir aujourd’hui afin que vous nous donniez votre sentiment sur les perspectives d’évolution de la situation politique libanaise et sur les événements de plus en plus dramatiques que connaît la Syrie, pays voisin, à la fois grand frère et co-parrain de fait du Liban. Vous nous direz aussi votre analyse de l’impact de ces événements sur la vie politique libanaise.
M. Fouad Siniora, ancien président du Conseil libanais. C’est un plaisir et un honneur pour moi de m’adresser à vous et de répondre à vos questions sur le Liban et le Moyen-Orient mais aussi sur le Printemps arabe dont le souffle traverse la région. C’est de ce bouleversement et de ses implications que je vous entretiendrai pour commencer, au moment où des régimes qui ont gouverné pendant des décennies d’une main de fer s’écroulent d’un seul coup alors que s’effondrent les murs de silence et de peur qu’ils avaient érigés. Des populations hier terrifiées par leurs dirigeants les terrifient à leur tour. Ce mouvement met fin à « l’exception arabe », ce troc par lequel des populations avaient renoncé à leur liberté pour prix de la stabilité.
En Occident, le Printemps arabe a entièrement remis en cause le concept selon lequel les dirigeants du monde arabe se diviseraient entre « modérés » et « non modérés » en fonction de leur position à l’égard d’Israël. Cette terminologie a résonné de manière négative au sein des populations arabes, les dirigeants dits « modérés » en venant à être considérés comme des marionnettes aux mains de l’Occident, ce qui faisait le jeu des extrémistes. Or, il n’y a pas des dirigeants arabes « modérés » et « non modérés » mais des dirigeants légitimes et des dirigeants illégitimes. La légitimité vient du peuple et s’exprime par des mécanismes démocratiques ; après le Printemps arabe, elle sera nécessairement synonyme de modération. On a bien vu que les courageux jeunes gens et jeunes femmes qui manifestaient place Tahrir, au Caire, ne s’exprimaient pas contre l’Occident et qu’ils ne se sont pas particulièrement fait les avocats d’un islam politique. Ce qu’ils voulaient, c’était faire entendre leur voix, participer à la quête commune de progrès et de développement pour vivre dans la dignité, sans étiquette politique revendiquée. Aussi, il est important que l’Occident ne répète pas ses erreurs passées ; il ne doit pas s’essayer à affronter les islamistes qui, à ce jour, ont envoyé des signaux montrant leur intérêt pour un modèle de société islamique ouverte et tolérante plutôt que pour un modèle à l’iranienne.
Pendant très longtemps, le Liban a été la seule démocratie du Moyen-Orient, mais cette ouverture lui a coûté très cher : notre pays, quatre décennies durant, a payé le prix des conflits entre les Américains et les Soviétiques, les Arabes et les Israéliens, les Syriens et les Irakiens, les Américains et les Iraniens, les Iraniens et les Arabes… Tout cela s’est traduit par une guerre civile qui a commencé en 1975, six invasions israéliennes depuis lors et une multitude de chocs et d’assassinats visant à ébranler les fondements du Liban souverain, resté malgré tout fermement établi même s’il a été considérablement affaibli.
Un Printemps libanais avait éclos en 2005, au point que certains observateurs estiment que le Printemps arabe n’est pas né en Tunisie en 2011 mais au Liban cette année-là, quand, horrifiés par l’assassinat de l’ancien Premier ministre Rafic Hariri, l’homme à qui l’on doit la reconstruction du pays après la guerre civile, des centaines de milliers de Libanais de toutes confessions et de toutes origines ont défilé dans les rues de Beyrouth pour exiger le retrait des troupes syriennes, la liberté, la justice et la souveraineté nationale. Las ! Le Printemps libanais n’a duré qu’un moment, les forces réactionnaires usant de tous moyens, dont la force des armes, pour reprendre le pouvoir politique, au prétexte, toujours, de combattre Israël.
Ce retour de balancier a à nouveau exposé le Liban aux néfastes influences qui traversent la région mais aussi transformé une nation modèle en matière d’ouverture et d’intégration en un État paralysé, où les tensions sont permanentes. En effet, la République islamique d’Iran exerce une influence grandissante dans le monde arabe où, profitant du vide créé par le retrait de l’Égypte de la scène arabe depuis les années 1980, il s’est introduit en brandissant le drapeau de l’islam et de la cause palestinienne. L’Iran a attisé les tensions sectaires au Liban, à Gaza et en Irak, créant des troubles en prétextant de la cause palestinienne. Ses objectifs réels sont tout autres : exporter la révolution islamique et se poser en grande puissance nucléaire régionale. L’ironie mauvaise de l’histoire, c’est que les dirigeants de la République islamique prétendent être au côté des révolutionnaires du monde arabe alors qu’ils persécutent férocement les démocrates en Iran. D’évidence, l’Iran n’est pas un modèle de démocratie, de progrès et de développement économique pour les démocraties émergentes dans le monde arabe.
L’Occident a un rôle de premier plan à jouer dans la recherche urgente d’une solution globale au conflit entre Israël et les pays arabes, car il faut éviter une prise en otage par les extrémistes des deux bords. La déclaration du « guide suprême » iranien, affirmant que les bouleversements politiques du monde arabe signalaient « une irréversible défaite » pour les États-Unis et « un éveil islamique » au Moyen-Orient, se passe de commentaires. L’Occident, notamment la France et les Etats-Unis, a une responsabilité éminente : faire appliquer l’Initiative de paix arabe, qui promet une paix globale et durable à Israël et aux États arabes en échange de la reconnaissance d’un État palestinien dans les frontières de 1967, avec Jérusalem Est comme capitale. Même des anciens officiers israéliens de haut rang – dont d’anciens chefs des services de sécurité – ont admis, en présentant une nouvelle initiative de paix, que la paix ne sera pas atteinte par des opérations militaires !
Le premier sondage librement mené en Egypte, publié juste avant l’exécution de Ben Laden, doit être entendu comme un message très clair à Israël et au monde occidental : 54 % des personnes interrogées se sont déclarées favorables à l’annulation du traité de paix avec Israël signé à Camp David, 36 % seulement souhaitant son maintien, et 69 % ont exprimé leur défiance à l’égard du président Obama, dont le discours du Caire avait pourtant été très apprécié. Ces sondages reflètent le fossé entre Israël et l’Occident d’une part, l’opinion publique arabe d’autre part ; si la prise de conscience ne se fait pas qu’un accord de paix équitable et durable doit être trouvé, le problème ne fera qu’empirer.
L’élimination de Ben Laden est un succès pour les États-Unis, pour le monde occidental, pour le monde arabe et pour l’humanité. Pour autant, il serait naïf de croire que cette mort signifie la fin du terrorisme. En plus des opérations militaires ciblées, une offensive diplomatique d’envergure est indispensable pour mettre fin à l’un des grands prétextes utilisés par Ben Laden et ses acolytes, qui se servent des souffrances du peuple palestinien comme outil de propagande. L’Occident ne doit pas laisser passer l’occasion historique qui lui est donnée. La France doit convaincre ses alliés qu’il faut tirer parti de la récente réconciliation inter-palestinienne pour traiter des problèmes de la région afin d’aboutir à une paix réelle et juste.
M. le président Axel Poniatowski. Je vous remercie pour cet exposé très éclairant. Pouvez-vous nous dire quels blocages empêchent la formation d’un gouvernement au Liban ? La démission du gouvernement Hariri ayant été déclenché par un nouveau désaccord relatif au Tribunal spécial pour le Liban, pouvez-nous préciser les demandes de l’opposition à ce sujet ? De nombreuses rumeurs laissent entendre que le Tribunal spécial mettrait en cause des membres du Hezbollah dans la mort de Rafic Hariri. Quel est votre sentiment à ce sujet ?
M. Michel Terrot. Que pensez-vous de la répression qui s’exerce en Syrie et quelles en sont les répercussions sur la société libanaise ? Par ailleurs, que pensez-vous de l’accord passé entre le Fatah et le Hamas ? Quelles conditions permettraient, selon vous, de créer dans un délai raisonnable un État palestinien indépendant ?
M. Michel Destot. Vous avez plaidé en faveur de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États arabes. Comment, alors, l’Europe et la France en particulier peuvent-elles intervenir, notamment pour ce qui concerne la Syrie ? Quel impact pourrait avoir sur la vie politique libanaise la déstabilisation, voire la destitution, du président syrien? Quelles sont vos relations avec le gouvernement israélien ? Enfin, qu’en est-il du désarmement du Hezbollah ?
Mme Chantal Bourragué. Pouvez-vous nous en dire plus sur la situation des chrétiens au Liban, ces chrétiens si maltraités au Moyen-Orient ?
M. Fouad Siniora. Le renversement du gouvernement libanais a eu lieu sous la pression des armes, en dépit des promesses faites par les différents partis, dont le Hezbollah et ses alliés, lors de la signature de l’accord de Doha, qui interdit le recours aux armes pour régler les différends internes et exclut tout blocage institutionnel. Ces belles promesses n’ont pas été tenues et une sorte de coup d’État a eu lieu, plusieurs députés transfuges se ralliant à un autre parti au mépris de leurs électeurs. Ceux qui ont ainsi retourné leur veste rendent impossible la formation d’un nouveau gouvernement, car ils ont sous-estimé les difficultés qui les attendaient : une nouvelle majorité théorique s’est formée, à cela près que chaque composante a son propre programme et que les partis ne s’accordent pas sur la répartition des portefeuilles ministériels.
Entre temps, les bouleversements intervenus en Tunisie, en Égypte, en Libye et maintenant en Syrie ont radicalement modifié le paysage politique dans le monde arabe et les renégats sont plus que jamais incapables de constituer un gouvernement. Surtout, la Syrie est réticente à l’idée de voir se former pour l’instant un nouveau gouvernement au Liban, car elle n’est pas certaine que ce gouvernement irait dans son sens et dans celui du Hezbollah. D’autre part, la formation d’un gouvernement libanais télécommandé par le Hezbollah ne serait pas sans répercussion, au-delà du Liban, sur le monde arabe et le monde occidental. Une certaine circonspection se fait donc sentir et même si des promesses répétées laissent entendre qu’un gouvernement sera formé rapidement, tout pousse à croire qu’il n’en sera rien. Selon moi, M. Najib Mikati, le Premier ministre désigné, devrait constituer un gouvernement de technocrates chargé de gérer les affaires courantes sans s’attaquer aux questions épineuses, en attendant que le calme revienne dans le pays et que la situation politique dans la région soit moins confuse. Avec un gouvernement technique, le Liban s’éviterait bien des soucis ; mais cette solution n’ayant pas reçu l’aval du Hezbollah, lié par l’accord qu’il a passé avec le général Aoun, je doute que M. Mikati soit en mesure de former un cabinet dans un avenir proche.
Mon groupe parlementaire, le plus important de l’opposition, est résolument favorable à une réforme en Syrie. L’ensemble du monde arabe a besoin qu’une démocratie réelle s’instaure dans ce pays, mais le Liban, singulièrement, aurait tout à gagner de l’avènement de la démocratie chez son voisin pour relever les défis politiques auxquels il se trouve confronté. Alors que ma formation politique a souligné qu’il fallait éviter toute intervention dans les affaires internes du pays, nous avons été accusés d’ingérence. Cette allégation est mensongère. Nous-mêmes ne voudrions pas que des forces étrangères se mêlent de nos affaires ; pourquoi donnerions-nous des verges pour nous faire fouetter ? On a prétendu que nous aurions envoyé vers la Syrie des navires chargés d’armes, ou que nous financerions des factions syriennes ; mais ces accusations, inventées de toutes pièces, ont dû être retirées. Nous souhaitons que les aspirations du peuple syrien soient satisfaites mais, je le répète, nous ne voulons en aucun cas nous ingérer dans les affaires syriennes. Notre espoir est que les relations entre la Syrie et le Liban soient les meilleures, et pour cela fondées sur le respect réciproque.
Nous nous félicitons de la réconciliation intervenue entre le Hamas et le Fatah, tout en notant un curieux paradoxe. Jusqu’à présent, les Israéliens expliquaient qu’ils ne pouvaient négocier faute d’interlocuteur palestinien. Maintenant, ils ne veulent plus parler à personne, au motif que l’un des membres de la nouvelle coalition ne leur plaît pas – autrement dit, quoi qu’il se passe, rien ne va jamais ! Pour notre part, nous pensons que la réconciliation inter-palestinienne contribuera à l’instauration d’une paix globale, durable et viable au Moyen-Orient. Les soulèvements en cours dans plusieurs pays arabes et l’avènement de la démocratie qui en résultera donnent une occasion inestimable d’appliquer le plan de paix global dont les contours sont bien connus. L’exécution de Ben Laden est une opportunité supplémentaire ; un contexte politique particulier s’est noué dont les États-Unis, l’Europe et notamment la France doivent se saisir. Ne pas le faire serait une erreur grave, car le statu quo pousserait les mouvements révolutionnaires arabes en cours vers l’extrémisme.
Au cours des événements qui se sont déroulés récemment dans le monde arabe, la France a toujours été fidèle aux valeurs de la démocratie, de l’ouverture, de la tolérance, de la justice et de l’indépendance des États arabes. Nous savons que, telle qu’en elle-même, elle ne tombera pas dans le piège du double langage, ne songera pas à se mêler des affaires intérieures d’un pays ou d’un autre et qu’elle marquera son attachement à la très noble cause de la réforme dans le monde arabe.
Le Tribunal spécial pour le Liban a un rôle capital à jouer. Depuis trente ans, au Liban, une longue série de personnalités ont été assassinées : deux présidents de la République, trois Premiers ministres, nombre de députés et de ministres, des directeurs de journaux, des religieux… Jamais les assassins n’ont été identifiés, si bien que le Liban est devenu, au fil du temps, une terre d’impunité. Cette situation intolérable nous a conduits à demander la constitution d’un Tribunal international spécial, non par vengeance mais pour mettre un terme à une impunité qui n’a que trop duré. Cette mission a été confiée à la communauté internationale et nous espérons qu’elle parviendra à mettre en accusation les responsables de ces assassinats. Des rumeurs courent sur les personnes qui seraient mises en accusation : des membres du Hezbollah ? Des Syriens ? D’autres ? Je ne me perdrai pas en conjectures, car j’ai toute confiance dans le jugement du Tribunal, auquel a été confié le soin de déterminer la vérité. Nous voulons la justice, et rien que la justice.
Vous m’avez interrogé sur notre position relative au désarmement du Hezbollah. Que vous dire à ce propos sinon que, comme dans toute démocratie, c’est à l’État libanais que revient le monopole de la détention des armes, et à l’armée régulière celui de son usage ? L’État libanais a subi plusieurs tentatives de déstabilisation. Au lieu d’être dirigées contre Israël, les armes ont été tournées contre des populations civiles désarmées, ce qui est inacceptable. Grâce au Hezbollah, nous le reconnaissons, Israël a mis fin, dans le passé, à l’occupation de certains territoires libanais. Mais la situation ayant beaucoup évolué depuis l’an 2000, il est maintenant indispensable que les armes soient exclusivement aux mains des autorités légitimes de l’État, à qui il revient d’obtenir l’entière libération des territoires encore occupés par Israël au Liban – les fermes de Chebaa et la partie septentrionale du village de Ghajar.
Vous m’avez interrogé sur la situation des chrétiens du Liban. Je considère que le respect de la diversité est l’une des valeurs phares de la société libanaise. Notre société est une mosaïque – et chacun conviendra que les couleurs chatoyantes d’une mosaïque sont bien plus plaisantes à l’œil qu’un bloc monochrome ! On me fera sans doute observer que bien d’autres pays ont des populations diverses, ce qui vrai ; mais dans la société libanaise, aucune couleur de la mosaïque ne l’emporte sur une autre. Nous souhaitons préserver cette ouverture qui implique l’acceptation de l’autre et de son opinion, ce que reflète l’accord de Taëf, signé par les représentants de tous les Libanais. L’unanimité s’est faite pour dire que les plus hautes responsabilités devaient être réparties pour moitié entre les communautés, ce qui figure dans notre Constitution. Nous souhaitons voir respecté et préservé cet esprit d’ouverture qui a fait dire au pape que le Liban constitue « un message de liberté, de respect et de coexistence ». En Irak et en Syrie, certains ont tenté de créer des conflits en polarisant la société sur les questions confessionnelles. Nous condamnons ces pratiques et nous préconisons la tolérance entre les communautés chrétiennes et musulmanes. Nous condamnons absolument les tentatives visant à diviser les sociétés arabes, et avec la plus grande énergie les événements tout récemment intervenus en Égypte ; nous nous félicitons de constater que le gouvernement égyptien est décidé à agir avec la plus grande fermeté pour contrecarrer de tels agissements. En clair, les chrétiens doivent avoir les mêmes droits que les autres.
M. Henri Plagnol. M. Alain Juppé, le ministre des affaires étrangères français, a rendu hommage au Liban, soulignant que, sans lui, l’adoption de la résolution du Conseil de sécurité relative à la Libye aurait été beaucoup plus compliquée. Au regard des difficultés que connaît la communauté internationale dans son intervention en Libye, quel est à présent le point de vue du Liban à ce sujet ? Par ailleurs, le Printemps arabe signe aussi le réveil dans la péninsule arabique des membres des minorités chiites, qui n’acceptent plus d’être traitées en citoyens de seconde zone. Cette évolution ne risque-t-elle pas de compliquer encore l’insertion du Hezbollah dans la communauté libanaise ?
M. Didier Mathus. À ce jour, les réfugiés palestiniens qui vivent dans des camps au Liban ne jouissent pas des mêmes droits que les citoyens libanais au motif que leur présence est « provisoire ». On imagine mal que ces réfugiés puissent retourner un jour en Palestine ; quel sera alors leur avenir ?
M. Jean-Claude Guibal. Quelle opinion avez-vous des prises de position du général Aoun ? Par ailleurs, l’Iran continue-t-il d’avoir une influence sur la politique intérieure et extérieure du Liban ?
M. Gérard Bapt. Comment le Liban pourrait-il contribuer à l’accord de paix que nous souhaitons entre Israël et le futur État palestinien ? D’autre part, quel est le retentissement sur le Liban de la situation en Syrie – on entend dire que des réfugiés syriens se pressent aux postes frontières ? Enfin, est-il exact que la minorité chrétienne reste neutre car elle craint de subir les conséquences d’un renversement brutal du parti Baas ?
M. Fouad Siniora. J’ai eu aujourd’hui même une réunion avec M. Alain Juppé, qui a effectivement rendu hommage au rôle joué par le Liban lors de l’adoption de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies relative à la Libye. Si le Liban s’est prononcé de la sorte, ce n’est pas tant parce que nous sommes en conflit avec le régime libyen au sujet de la disparition – demeurée inexpliquée – de Moussa Sadr en 1979 en Libye, mais parce que nous sommes fermement convaincus qu’une réforme est indispensable dans ce pays. Comme le reste du monde, nous avons été choqués par la violence exercée par un régime en place depuis 42 ans contre la population, et c’est pourquoi nous avons soutenu l’initiative du Conseil de sécurité visant à mettre un terme à cette situation dramatique.
Outre que la situation qui prévaut actuellement en Libye est cause de morts, de souffrances et de destructions, elle aura un impact durable sur l’unité du pays et, si les choses se prolongent, elle compromettra l’évolution du Printemps arabe dans d’autres pays. Nous sommes convaincus que le Conseil de sécurité a pris la bonne décision et nous sommes toujours d’accord avec l’interprétation qui a été faite de la résolution, qui tend à mettre fin, le plus vite possible, à une situation catastrophique.
S’agissant des minorités à Bahreïn et dans d’autres pays du Golfe, nous avons clairement indiqué être favorables à une réforme. Rien ne peut justifier que, où que ce soit, certains soient considérés comme des citoyens de seconde zone ; c’est la position que nous avons toujours défendue. L’ingérence iranienne rend la situation à Bahreïn très délicate, mais il n’empêche qu’une réforme s’impose dans ce pays aussi, qu’il est de la responsabilité de l’État de mettre en œuvre. Nous ne souhaitons pas le renversement du régime bahreïnien ; nous souhaitons une réforme, mais nous savons que la situation est compliquée et qu’il faut en tenir compte.
Nous souhaitons que les relations entre les pays arabes et l’Iran soient les meilleures possible mais, pour cela, l’Iran doit en finir avec ses ingérences et cesser de chercher à exporter la « révolution iranienne ». L’absence de l’Égypte sur la scène politique arabe a créé un vide au moment même où se déroulait la révolution iranienne ; ses instigateurs ont alors entrepris d’exporter leur idéologie au-delà de leurs frontières. Manipulant l’opinion, ils ont argué de la défense des intérêts des Palestiniens et de l’Islam. L’établissement de bonnes relations avec l’Iran suppose la non-ingérence réciproque et le respect mutuel.
Le Liban, qui compte treize camps de réfugiés palestiniens, a payé un très lourd tribut au crime commis en 1948 contre les Palestiniens, contraints à l’émigration. Le Liban, parce qu’il soutient l’idée d’une paix globale au Moyen-Orient, a accueilli à Beyrouth le sommet de la Ligue arabe qui, en 2002, a approuvé l’Initiative de paix arabe. Nous restons attachés à ce plan de paix et nous ferons tout pour qu’il soit mis en œuvre, conformément aux critères définis par les parties. Nous souhaitons que les Palestiniens puissent revenir sur leur terre, mais quoi qu’il en soit, le Liban ne pourra les naturaliser. Leur nombre est considérable, et notre pays est trop petit ; ce serait remettre en cause le délicat équilibre entre les communautés libanaises auquel nous sommes très attachés et qui est inscrit dans notre constitution. L’ensemble de la population libanaise est contre une naturalisation massive des Palestiniens.
Cela étant, particulièrement depuis le retrait, en 2005, des troupes syriennes de son territoire, le Liban a multiplié les efforts en faveur des réfugiés palestiniens, faisant de son mieux pour assouplir les relations entre eux et les autorités. J’ai moi-même, lors de mon arrivée au pouvoir, cherché à rapprocher les points de vue en créant une Commission pour le dialogue national qui a permis de progresser, bien que les choses aient été rendues très difficiles par l’invasion israélienne et par les attentats terroristes perpétrés contre l’armée libanaise par le Fatah al Islam, dont les membres se sont réfugiés dans le camp de Nahr El Bared. Récemment, le Parlement a adopté une loi qui permet aux réfugiés palestiniens d’exercer certains emplois dans le secteur privé, exception faite des professions réglementées. De grands efforts sont donc réalisés pour favoriser leur intégration dans la société libanaise et, avec la participation de la communauté internationale, nous avons entrepris de reconstruire le camp de Nahr El Bared. Notre groupe parlementaire est très attaché à ce que les Palestiniens du Liban soient traités de manière équitable jusqu’au moment où ils pourront revenir sur leurs terres.
Le général Michel Aoun est un acteur de la démocratie libanaise que je respecte à ce titre, même si nous sommes en désaccord sur de nombreux points. Il a sa propre vision des choses et une approche parfois populiste. Il se présente à tort comme le seul défenseur des chrétiens, alors même que la coalition du 14-Mars compte 34 députés chrétiens et la majorité à laquelle il appartient 30 seulement. Il ne peut donc revendiquer le monopole de la défense des chrétiens du Liban. Pourtant, il s’efforce toujours de s’attirer le soutien exclusif de la communauté chrétienne, alors que nous devrions plutôt œuvrer ensemble pour établir un consensus entre chrétiens et musulmans, en évitant toute exacerbation des différences entre les deux communautés et en s’abstenant des présentations caricaturales dont le général Aoun est coutumier. De plus, il est très obstiné et il insiste pour obtenir certains portefeuilles ministériels alors même que notre constitution établit les choses de la manière la plus claire : c’est la prérogative du président de la République et du Premier ministre désigné de proposer un gouvernement au Parlement, auquel il revient de voter la confiance. Vouloir procéder autrement, comme on le voit aujourd’hui, c’est empiéter sur les prérogatives constitutionnelles du président et du Premier ministre.
L’influence de l’Iran est très forte sur le Hezbollah, acteur armé de la politique libanaise. Ce parti a le droit de participer à la vie politique libanaise puisqu’il représente une partie de la population. Toutefois, la violence ne mène pas à grand-chose : il faut parfois recourir à la force, mais l’expérience nous a montré que cela ne produit pas les effets escomptés. Nous avons besoin du soutien de la communauté internationale, qui doit répondre aux attentes des pays arabes en démontrant que la diplomatie et le dialogue, contrairement à la force, donnent des résultats. Il ne suffit pas de condamner la violence, il faut faire preuve de volontarisme et montrer que la paix peut être atteinte par une autre voie.
Nous demandons à la France que, fidèle à ses principes, elle fasse progresser les belligérants sur le chemin d’une paix juste et durable au Moyen-Orient. L’influence de l’Iran est réelle, mais l’on note, ces derniers jours, des tensions croissantes dans ce pays. Nous souhaitons le meilleur à la population iranienne. Nous souhaitons que la paix prévale en Iran et qu’elle vaille aussi dans les relations entre l’Iran et le reste du monde. L’Iran n’est pas le seul pays qui représente les musulmans, qui ne devraient pas sembler en conflit permanent avec le reste du monde. Nous voulons vivre en bonne intelligence avec le reste du monde tout en gardant notre identité de musulmans. La politique de la confrontation n’est pas la bonne. L’Iran doit défendre toutes les valeurs démocratiques : la paix, l’ouverture et la tolérance, ces valeurs que nous souhaitons voir s’appliquer partout dans le monde.
Avec la Syrie, nous souhaitons établir des relations de voisinage fondées sur le respect mutuel. La réforme politique est dans l’intérêt de tous les pays arabes, et elle devrait avoir lieu en Syrie aussi. Les relations entre la Syrie et le Liban sont très délicates : alors que le Liban a gagné son indépendance en 1943, il nous aura fallu attendre 2009, soit plus de soixante-cinq ans, pour établir des relations diplomatiques avec notre voisin… Nous souhaitons maintenir de bonnes relations avec lui, mais nous ne pouvons approuver le recours à la violence par le régime syrien contre son peuple. Nous continuons de défendre le dialogue, comme nous l’avons toujours fait. Plus de la moitié de la population de tous les pays arabes est âgée de moins de 25 ans. Cette jeunesse descend dans la rue en exigeant la liberté, la dignité, la justice, une plus grande qualité de vie, de meilleures conditions de travail et plus d’emplois. Pour répondre à ces attentes, la violence ne règlera rien. J’ai entendu dire que les autorités syriennes cherchent à convaincre les chrétiens de Syrie de soutenir le gouvernement en place par la menace, en leur laissant entendre qu’ils se trouveraient dans une situation périlleuse si les islamistes prenaient le pouvoir. Le même langage serait tenu aux Turcs, aux Kurdes et aux alaouites de Syrie. On tend ainsi à susciter des conflits intercommunautaires alors qu’il faudrait réformer par le dialogue pour instaurer la démocratie, dans l’intérêt de tous.
M. le président Axel Poniatowski. Je vous remercie, monsieur le Premier ministre, pour ces réponses précises et franches à des questions dont vous n’avez éludé aucune.
11.- Mercredi 18 mai 2011, séance de 9 heures 30, compte rendu n° 61 : audition M. Hael Al Fahoum, chef de la mission de Palestine en France
M. le président Axel Poniatowski. Je souhaite la bienvenue à M. Hael Al Fahoum, que nous entendrons pour la première fois. Le gouvernement français ayant relevé en juin dernier le niveau de la représentation de l’Autorité palestinienne, ce qui me semble approprié, c’est aussi la première fois que nous recevons un chef de la mission de Palestine en France.
Vous êtes biochimiste, monsieur l’ambassadeur, et vous avez notamment étudié à Paris, mais vous avez consacré toute votre carrière professionnelle à la diplomatie, notamment en France au début des années 1980. Après avoir été délégué général de la Palestine en Allemagne pendant cinq ans, vous êtes de retour à Paris.
Notre commission reçoit régulièrement le représentant de l’Autorité palestinienne et celui de l’Etat hébreu. Nous avons entendu M. Yossi Gal, ambassadeur d’Israël en France, le 6 avril dernier, et nous avions prévu de vous recevoir la semaine suivante mais l’intervention militaire en Libye nous a obligés à remettre cette réunion. Ce report s’est avéré une bonne chose, un pas important, attendu depuis longtemps, ayant été franchi depuis lors : le Fatah et le Hamas ont conclu un accord de réconciliation dont la signature a eu lieu le 4 mai au Caire.
Cet accord, qui a immédiatement suscité des réactions négatives en Israël, ouvre pour les Palestiniens une nouvelle phase, qui devrait conduire à la tenue d’élections présidentielle et législatives au printemps 2012. Mais il suscite aussi de nombreuses questions, qu’il s’agisse de la constitution d’un gouvernement intérimaire ou de l’impact de l’accord sur le processus de paix.
On sait aussi que l’Autorité palestinienne demandera en septembre à l’Assemblée générale des Nations unies de reconnaître un Etat palestinien souverain, dans ses frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale.
Nous entendrons avec grand intérêt votre analyse de la situation.
M. Hael Al Fahoum, chef de la mission de Palestine en France. C’est pour moi un plaisir et un insigne honneur de m’adresser à vous, honneur qui rejaillit sur mon pays, la Palestine, et sur le peuple palestinien qui résiste depuis plus d’un demi-siècle avec ténacité et une remarquable créativité à une agression multiforme et continue, aux déplacements, à l’occupation, à la colonisation et à la dépossession. Je ne ferai pas l’historique de notre tragédie et de notre résistance, que vous connaissez parfaitement : elles font partie de notre histoire et de notre mémoire partagées. Je vous inviterai plutôt à une réflexion commune sur l’avenir de notre région, et plus particulièrement des rives orientales et méridionales de la Méditerranée que nous avons en partage avec l’Europe et plus particulièrement avec la France.
Les peuples arabes sont en train d’écrire l’histoire. En se soulevant, ils disent qu’aucun diktat ne peut entraver le désir de liberté, que l’usage de la force brutale ne pourra jamais réprimer les aspirations des populations opprimées à la dignité, et finalement que la volonté de résister est supérieure à toutes les tentatives de destruction. Les événements considérables qui agitent aujourd’hui le monde arabe démontrent qu’il n’est pas possible d’ignorer les appels des populations oppressées, de prétendre régler le problème en détournant le regard.
J’appellerai votre attention sur la situation palestinienne, en analysant les raisons du blocage actuel et les conditions du progrès sur la voie d’une paix juste et durable, cette paix tant désirée mais constamment différée dont l’absence mine la stabilité de la région et dont la réalisation contribuerait à une transformation constructive de l’ensemble des relations internationales.
Sur le terrain, la descente aux enfers de notre peuple se prolonge. L’occupation militaire de la Cisjordanie, avec son cortège de violences et de destructions, de brutalités, d’enlèvements et d’exécutions extrajudiciaires avec leur lot de « dommages collatéraux », se poursuit. La colonisation continue de grignoter le territoire palestinien, peau de chagrin que le Mur morcelle plus encore en dépit d’une réprobation quasi-universelle. La Bande de Gaza reste soumise à un blocus cruel et dévastateur, auquel le récent « allégement » ne met nullement un terme. À Jérusalem-Est, les expulsions et expropriations des Palestiniens, qui procèdent de l’intention israélienne délibérée et non dissimulée de vider la ville de sa population arabe pour se l’approprier intégralement et exclusivement, rendent la vie quotidienne de plus en plus difficile, annonçant un avenir sombre.
D’évidence, le gouvernement israélien ne veut pas parvenir avec nous à un accord de paix suffisamment juste et équitable et exprimant une volonté réelle de réconciliation pour être durable. Le discours israélien officiel, qui a pour arrière-plan une politique de colonisation accrue et accélérée, se résume pour l’essentiel à faire porter à l’OLP et à l’Autorité palestinienne la responsabilité du blocage, parce qu’elles refusent de s’autodétruire et d’accepter le diktat de l’occupant.
Nous n’avons cessé de proclamer depuis plus de deux ans que la poursuite de la colonisation est incompatible avec toute tentative d’engager des négociations fructueuses puisque, en violation du processus engagé à Madrid il y a bientôt vingt ans, cette politique systématique vise à faire disparaître le territoire qui constitue l’objet même des négociations.
L’actuelle administration américaine, héritière du rôle de médiateur assumé depuis deux décennies par ses prédécesseurs, avait soutenu notre point de vue avec éclat dès son intronisation. Mais elle a, hélas, fini par renoncer à exiger l’arrêt de la colonisation, tout en continuant à la condamner car elle contredit le droit international, les accords signés et les engagements pris et constitue un évident obstacle à tout progrès vers la paix. De plus, les tentatives faites par la Maison Blanche d’échanger des largesses financières et militaires contre un moratoire de la colonisation, au demeurant partiel et limité dans le temps, se sont heurtées à une fin de non-recevoir.
Le veto américain opposé à une résolution votée par les quatorze autres membres du Conseil de sécurité, dont la France, et pourtant formulée dans le langage même du président Obama, signifie de manière évidente que les États-Unis ont, hélas, cédé face à l’obstination, pourtant suicidaire à long terme, des dirigeants israéliens. Ce dernier épisode ayant pratiquement sonné le glas du processus de paix dans son architecture actuelle, nous sommes aujourd’hui requis d’engager une réflexion novatrice sur les manières possibles de continuer à avancer malgré tout.
Les contours de l’unique solution possible à l’interminable conflit sont connus : établir un État palestinien indépendant, démocratique, pacifique et viable dans les territoires occupés en 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale ; trouver une solution équitable au problème des réfugiés, fondée sur la Résolution 194 votée en décembre 1948 mais toujours inappliquée ; libérer tous les prisonniers politiques. Cette solution, faut-il le rappeler, est en tout point conforme au droit international, aux termes de référence des accords déjà signés et à la substance du Plan de paix arabe. Mais, alors qu’elle fait l’objet d’un consensus international, la politique israélienne vise à la rendre impraticable.
Pourtant, l’établissement de cet État n’est pas seulement une exigence palestinienne : elle relève d’une nécessité absolue. L’administration américaine n’y a-t-elle pas reconnu un impératif pour sa propre sécurité ? N’est-il pas incongru que la communauté internationale reste passive, voire complaisante, alors que ses propres intérêts sont menacés ?
Mesdames et messieurs les représentants élus du peuple de France, gardiens des valeurs fondatrices de la République, vous devez savoir que le peuple palestinien ne nourrit aucun dessein agressif, négateur ou dominateur à l’égard de quiconque. Nous avons exclu par principe tout recours à la violence et nous souhaitons créer les conditions d’une réconciliation historique durable entre les peuples israélien et palestinien. Le peuple palestinien qui, dans un compromis historique, ne revendique pour territoire que 22 % de sa patrie originelle, n’aspire qu’à l’exercice de son droit fondamental à disposer de lui-même.
Nous voulons la démocratie, la séparation des pouvoirs, la transparence des institutions. La liberté, l’égalité et la fraternité sont les valeurs cardinales que nous sommes fiers de partager avec vous. Notre peuple appelle de ses vœux l’établissement de l’État de droit ; mais comme il n’y a pas d’État de droit possible sans État tout court, dans notre cas, la réalisation de ce souhait implique l’arrêt total et définitif de la colonisation et la fin d’une occupation commencée en 1967.
Un ensemble de raisons géopolitiques fait que l’Europe, au sein de laquelle la France a toujours joué un rôle moteur, est la mieux placée pour prendre une initiative et engager une action décisive permettant de remettre le processus politique sur les rails et de ramener Israël à la table des négociations sur la base de ces termes de référence.
Pour ce qui nous concerne, notre action doit suivre quatre axes principaux. Le premier est de construire l’économie et les institutions de l’État palestinien – qui est aujourd’hui reconnu par 120 nations et qui dispose de représentations à divers niveaux dans 27 autres pays -, pour être prêts à assumer nos responsabilités dans tous les domaines, la période transitoire de deux ans prévue par les accords déjà conclus venant à son terme en septembre 2011. En ce domaine, la coopération des États membres de l’Union européenne en général, de la France surtout, est capitale. Nous avons besoin d’approfondir le partenariat, l’action intergouvernementale commune et le dialogue paritaire.
Nous devons aussi reconstituer l’unité territoriale et juridictionnelle de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza et permettre la tenue de nouvelles élections législatives et présidentielles, notamment grâce à l’accord politique signé le 4 mai entre le Fatah et le Hamas. Cet accord ouvre la voie à la formation d’un gouvernement provisoire de technocrates indépendants, qui aura pour responsabilités premières de préparer les élections présidentielles et législatives et celles du Conseil national palestinien, de réunifier les institutions palestiniennes entre la Cisjordanie et la Bande de Gaza, et de traiter de la reconstruction de la Bande de Gaza, en dépit du blocus. Là encore, la France et l’Europe peuvent jouer un rôle décisif en œuvrant pour que soit mis un terme au blocus imposé à Gaza, un blocus dont tout le monde s’accorde à reconnaître qu’il a été parfaitement contre-productif.
Il nous reviendra encore de rechercher par tous les moyens à ramener le gouvernement israélien à la table de négociation, non pas pour redessiner les frontières de l’État palestinien mais pour définir les procédures et les mécanismes de la coexistence pacifique entre les deux États, ce qui suppose de traiter de la sécurité, de l’eau, des réfugiés bien sûr, et du sort des colonies israéliennes disséminées sur le territoire palestinien. C’est la solution que nous avons acceptée et à laquelle nous demeurons attachés ; il ne faut pas laisser le désespoir s’emparer de notre peuple et la rendre caduque.
Il nous incombe enfin de poursuivre la résistance non-violente et la protestation contre l’occupation et la colonisation, tout en organisant la solidarité internationale avec cette mobilisation.
La dernière série de reconnaissances officielles de l’État palestinien dans ses frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale, inaugurée par le Brésil qui a été suivi par une dizaine de pays d’Amérique latine, ouvre la voie à un progrès véritable. Elle rétablit les termes de référence du processus de paix, rendant la discussion sur l’État et ses frontières obsolète et futile. L’intégralité du territoire palestinien, dans ses frontières de 1967, est occupée : ce n’est pas un territoire « disputé » qu’il conviendrait peut-être de soumettre à un nouveau partage mais le lieu légitime, au regard du droit, de l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Aussi ces reconnaissances ne constituent-elles pas une alternative à la négociation : elles expriment au contraire la volonté d’en permettre la reprise sur des bases constructives. Elles envoient également au gouvernement israélien le signal clair de la détermination de la communauté internationale à ne pas baisser les bras, à ne pas épargner ses efforts pour contribuer à la paix.
Nous sommes confiants que la France, ayant constamment manifesté son engagement pratique en faveur de nos droits, depuis Charles de Gaulle, continuera d’agir avec la constance que nous lui connaissons pour les voir respecter. Son rôle moteur au sein de l’Union européenne, son histoire inscrite dans le cadre méditerranéen et dans le dialogue avec les pays arabes font de la France un partenaire privilégié et incontournable dans les efforts déployés pour recomposer un authentique processus de paix au Proche Orient.
Dans cette continuité, la France a récemment mené plusieurs démarches de front. Ainsi de la rencontre officielle entre les présidents Sarkozy et Abbas, précédée d’une rencontre entre les premiers ministres, ou de la préparation de la Conférence internationale sur la Palestine prévue en juin 2011 à Paris – dont j’espère qu’elle se tiendra effectivement en dépit des multiples obstacles qui demeurent –, conçue comme une véritable plateforme politique et économique pour notre État.
La reconnaissance formelle de l’État de Palestine est la pierre angulaire de cette stratégie. La France se doit de jouer un rôle pionnier dans l’action pour la reconnaissance européenne de l’État palestinien au cours des mois à venir. Il y va de notre intérêt partagé, pour permettre à tous les enfants de cette région trop longtemps martyrisée de sortir du cercle infernal de la violence et de la haine, et d’envisager l’avenir avec espoir et confiance.
M. le président Axel Poniatowski. Monsieur l’ambassadeur, je vous remercie, et je vous remercie aussi d’avoir accepté de répondre aux questions des commissaires.
M. François Rochebloine. Comment les événements qui sont en train de modifier la vie politique et sociale de nombreux pays du Moyen-Orient, dont votre puissant voisin, l’Égypte, peuvent-ils affecter, positivement ou négativement, les relations des pays considérés avec l’Autorité palestinienne ? Avez-vous noté une évolution de l’attitude des autorités égyptiennes à l’égard des habitants de la Bande de Gaza ? Le rééquilibrage en cours dans les autres pays de la région modifie-il l’attitude du gouvernement israélien à l’égard de la Palestine ? Si oui, comment ? Si non, pourquoi ?
M. Jean-Paul Lecoq. Les membres de notre commission ont, pour l’essentiel, une vision partagée de l’avenir de l’État palestinien et ils approuvent les objectifs de l’Autorité palestinienne. Mais il n’y a pas d’avenir possible sans justice. À ce sujet, quelles suites faudra-t-il donner aux conclusions du rapport Goldstone consacré à l’opération israélienne « Plomb durci » ? Par ailleurs, la solidarité à l’égard des Palestiniens se traduit en particulier, en France, par le boycott des produits israéliens ; cette initiative vous paraît-elle favorable ou défavorable à la population palestinienne ? Enfin, quel est votre sentiment sur la deuxième flottille européenne, au sein de laquelle il y aura un bateau français, qui appareillera en juin avec l’objectif de faire lever le blocus de Gaza ?
M. Jean-Luc Reitzer. La croissance économique a été particulièrement dynamique en Cisjordanie, et même dans la Bande de Gaza, au cours des derniers mois : elle est estimée à 15 % ; dans quels domaines en particulier ? Je sais, pour avoir fait partie de la délégation qui a accompagné M. Christian Estrosi à l’inauguration de la première zone industrielle franco-palestinienne, que la France a contribué à ce développement.
En ma qualité de député gaulliste, je soutiens sans réserve la création d’un État palestinien. Cependant, la première mission d’un État est d’assurer la sécurité de ses citoyens. Or, Juliano Mer-Khamis, directeur du Théâtre de la liberté de Jénine, a été assassiné en mars. Comment l’Autorité palestinienne compte-t-elle asseoir le respect du droit et de la justice dans les territoires qu’elle administre ? Peut-elle s’imposer face à des groupuscules armés qui font malheureusement régner leur ordre dans certaines zones ?
M. Didier Mathus. L’accord qui a été conclu entre l’Autorité palestinienne et le Hamas signifie-t-il que le Fatah entérine l’idée d’un partage des territoires, ou envisage-t-il de concourir aux élections pour regagner les faveurs de l’opinion à Gaza ? Si, à l’automne prochain, l’État palestinien était reconnu, ce que je souhaite ardemment, quelle viabilité aurait-il en Cisjordanie, espace malheureusement largement mité et sans continuité territoriale ?
M. Rudy Salles. Un dialogue s’étant engagé entre le Fatah et le Hamas, que pense l’Autorité palestinienne de la réaction du Hamas au lendemain de la disparition de Ben Laden ? Que dit l’accord passé entre les deux formations des obligations mises en avant par le Quartet – l’arrêt des violences, la reconnaissance de l’État d’Israël et celle des accords signés par l’Autorité palestinienne ?
M. Dominique Souchet. Vous avez évoqué l’évolution préoccupante de la position américaine. À ce sujet, comment interprétez-vous la démission de M. George Mitchell, envoyé spécial des Etats-Unis au Moyen-Orient ? Symbolise-t-elle l’impasse dans laquelle s’est mise la diplomatie américaine, avec l’abandon, par l’administration de M. Obama, de l’exigence du gel des colonisations comme préalable à la reprise des négociations, et le risque pour les Américains de ne plus pouvoir parler avec l’Autorité palestinienne dès lors qu’un accord est intervenu entre le Fatah et le Hamas ? Quelles conséquences aura cette évolution ?
Mme Élisabeth Guigou. Quelle influence ont et auront les révolutions en cours dans les pays arabes sur Israël d’une part, sur l’attitude du Hamas d’autre part ? Au-delà d’une aide économique qui existe depuis longtemps, qu’attendez-vous de l’Union européenne sur le plan politique ? Comment peut-elle contribuer à la reconnaissance de l’État palestinien ? Quelle analyse faites-vous de la position des différents pays européens ?
M. Daniel Garrigue. Parce qu’il rétablit l’unité, l’accord qui s’est fait entre le Fatah et le Hamas était un préalable nécessaire à la reconnaissance d’un État palestinien. Mais comment peut-il conduire à la reprise des pourparlers de paix si, comme j’ai cru le comprendre, chaque formation garde sa liberté d’expression en matière de politique étrangère ?
M. Alain Juppé, ministre français des affaires étrangères, a proposé de transformer la prochaine conférence des donateurs prévue en juin à Paris en une conférence de relance du processus de paix. Qu’attendez-vous de cette initiative ? La conférence devrait-elle traiter du processus de paix en général ou de sujets précis ? Devrait-elle être ouverte à toutes les composantes politiques palestiniennes ?
M. Jacques Myard. Le revirement soudain qui a conduit à la signature d’un accord entre le Fatah et le Hamas n’a pas manqué de surprendre. Certains estiment que c’est la crainte d’une contagion des mouvements en cours dans d’autres pays arabes qui a poussé à la réconciliation ; est-ce votre sentiment ?
Je serai très favorable à la création d’un État palestinien viable, et je souhaite que si cette création a lieu, la France reconnaisse le nouvel État même si les frontières n’en sont pas encore exactement définies – après tout, celles de la France ne le sont pas non plus ; l’important, c’est qu’un État palestinien soit reconnu. Mais quelle est maintenant la position du binôme Autorité palestinienne-Hamas sur la reconnaissance de l’État d’Israël ?
M. André Schneider. La reconnaissance internationale d’un État palestinien n’a de chance d’aboutir en septembre que si les négociations entre Israël et l’Autorité palestinienne reprennent. Le Premier ministre israélien a déjà fixé les objectifs à atteindre pour qu’il y ait consensus. Selon vous, les négociations de paix vont-elles reprendre prochainement et si oui, sous quelle forme ? Pensez-vous que le Fatah et le Hamas sauront trouver un consensus acceptable, susceptible d’entrer en application rapidement ?
M. Jean-Marc Roubaud. De nombreux pays veulent contribuer à la résolution du conflit israélo-palestinien. Outre la France, quels autres pays seraient susceptibles d’intervenir ? Pensez-vous que la Turquie ait aussi un rôle à jouer ? Pour m’être rendu deux fois à Ramallah à cinq ans d’intervalle, j’ai pu constater les extraordinaires mutations intervenues ; j’ai noté aussi que la France ne fait pas partie des premiers fournisseurs de la Palestine. Pourquoi, à votre avis ?
M. Hael Al Fahoum. L’influence du Printemps arabe ne peut être que bénéfique car, jusqu’à présent, la cause palestinienne a été instrumentalisée par certains régimes, arabes ou autres, qui se sont saisis de ce prétexte pour maintenir pendant des décennies leur pouvoir sur leur population. Le mouvement de la rue arabe ne peut donc avoir que des retombées positives pour la cause palestinienne, notamment en Égypte. Chacun aura noté que, lors des soulèvements en Tunisie et en Égypte, aucun drapeau américain ou israélien n’a été brûlé. On apercevait épisodiquement un drapeau palestinien brandi ici ou là, mais c’est la semaine dernière seulement qu’un million de personnes se sont rassemblées place Tahrir, au Caire, pour soutenir la cause palestinienne. Cela s’explique : chaque Arabe est blessé dans sa dignité par ce qui se passe en Palestine depuis soixante-trois ans. Le Printemps arabe permettra l’établissement de relations d’État à État, sur la base d’intérêts communs, entre la Palestine et l’Égypte, la Tunisie et d’autres pays arabes.
Le gouvernement égyptien a joué un rôle très discret mais crucial dans la réconciliation entre le Fatah et le Hamas, que les événements ont accélérée. La jeunesse palestinienne a demandé avec insistance à ses dirigeants d’éradiquer le virus de la division au sein de la société palestinienne, une division qui a nui aux intérêts de l’ensemble des Palestiniens.
Malheureusement, les autorités israéliennes au plus haut niveau semblent frappées d’aveuglement. Le gouvernement Netanyahou ne paraît pas avoir pris la mesure des mutations géopolitiques fondamentales en cours dans la région. J’espère qu’il se réveillera, et qu’il verra la réalité en face et se rendra compte que le moment est idéal pour lancer un processus de paix réel et aboutir à la réconciliation historique entre Israéliens et Palestiniens, sur la base de la reconnaissance de deux États distincts – solution qui est la meilleure garantie de sécurité pour l’État d’Israël pour les mille ans à venir. Si la chance historique qui s’offre est saisie, comme elle doit l’être, les énergies négatives actuellement à l’œuvre se mueront en une dynamique constructive pour les deux peuples considérés, pour la région et pour la paix et la stabilité internationales. J’espère donc que les autorités israéliennes en finiront avec l’arrogance et s’impliqueront activement en faveur d’une paix durable au lieu de chercher tous les prétextes pour accuser l’OLP d’être à l’origine du blocage actuel.
Le rapport Goldstone est entre les mains de l’ONU. Nos représentants qui siègent dans les instances compétentes ont engagé les démarches nécessaires pour que la réalité des faits soit exposée à tous, de manière que les actes commis ne se reproduisent pas.
L’Autorité palestinienne soutient le boycott des produits provenant des colonies israéliennes considérées comme illégales au regard du droit international. Nous n’avons jamais appelé au boycott de l’État d’Israël ; en revanche, nous demandons que l’aide illimitée accordée à Israël par ses alliés ne soit pas utilisée pour détruire la société palestinienne et pour assassiner des femmes, des enfants et des vieillards palestiniens car, dans ce cas, il y aurait en quelque sorte complicité. Tout dépend donc des termes des accords passés entre Israël et ses partenaires, qu’ils soient ou non européens. Nous ne demandons pas la fin des partenariats avec Israël, mais un rééquilibrage qui devrait se traduire par d’autres partenariats avec l’Autorité palestinienne.
J’ai des contacts réguliers avec les groupes qui manifestent leur solidarité au peuple palestinien. Chacun est favorable à la levée du blocus de Gaza, qui a des conséquences désastreuses pour ses 1 500 000 habitants. Il est anormal que la communauté internationale ne réagisse pas, et nous soutenons toute mobilisation contre le blocus avec d’autant plus de vigueur que nous engageons la reconstruction de tout ce qu’a détruit l’armée israélienne à Gaza. À cet effet, nous avons demandé l’aide du secteur privé palestinien et arabe. Il faut savoir qu’actuellement, 60 % du budget de l’Autorité palestinienne sont consacrés aux écoles, à l’Université et aux hôpitaux de la Bande de Gaza.
Vous aurez noté que le gouvernement de M. Salam Fayyad, qui est lui-même un économiste distingué, a montré une très grande créativité. C’est ainsi qu’après la première conférence des donateurs, nous avons réussi, en dépit des obstacles dus à l’occupation israélienne et avec l’aide de la communauté internationale, à dynamiser la croissance économique. Chacun comprendra toutefois qu’elle ne peut être durable si l’occupation persiste.
Pour assurer la viabilité du futur État palestinien, la communauté internationale a un rôle éminent à jouer. Aux partis arabo-palestiniens, elle doit faire comprendre que la création de l’État palestinien mettra un terme à la spirale de désespoir et de frustrations, ce qui permettra de se débarrasser des groupuscules extrémistes qui cherchent à détruire le processus de paix. Plus grand sera l’espoir que la situation s’améliore, plus facilement on mobilisera l’opinion publique palestinienne et arabe. La communauté internationale doit donc dire fermement à Israël que la seule solution viable est celle des deux États : l’État de Palestine dans ses frontières de 1967 et l’État d’Israël. A la suite de quoi, une négociation devra s’ouvrir pour définir les mécanismes permettant de résoudre les questions en suspens, dont celle de la sécurité de toutes les parties. Quelle meilleure garantie y a-t-il pour Israël que la normalisation de ses relations avec 48 pays arabes ou musulmans ? Comme je vous l’ai dit, nous sommes ouverts à la négociation sur de multiples sujets – l’eau, les réfugiés, les colonies israéliennes – mais il ne s’agit pas de redessiner les frontières de l’État.
Depuis mon arrivée à Paris, j’ai multiplié les contacts institutionnels, avec l’objectif de modifier la nature des relations franco-palestiniennes. Nous avons besoin de la France comme partenaire stratégique, dans un intérêt commun. La viabilité de l’État palestinien ne dépend pas seulement de ses ressources naturelles ; elle dépend aussi de la qualité de ses ressources humaines, qui est grande. Ce qui nous fait défaut, ce sont les transferts de technologie dont bénéficie Israël et sans lesquels il ne pourrait continuer d’exister. Aujourd’hui, 85 % des centres de recherche israéliens dépendent des transferts de technologies depuis les pays occidentaux. La même interdépendance doit valoir avec la Palestine ; on ne peut se limiter à une coopération qui n’établit pas des relations suffisamment fortes, il faut des partenariats. Nous avons besoin d’une implication directe de la France dans les processus de reconstruction de nos institutions, de notre économie et de notre recherche scientifique. M. François Fillon a été invité à se rendre dans les territoires palestiniens. D’ici le début de l’été aura lieu le premier séminaire intergouvernemental franco-palestinien ; j’espère qu’à cette occasion un accord-cadre de partenariat entre les deux pays sera conclu.
La sécurité est une question très complexe. Nous avons déjà fait des pas de géant dans le rétablissement de la sécurité civile et d’un appareil judiciaire efficace. Malheureusement, nous sommes empêchés d’aller au bout de notre démarche car des infiltrations de l’armée israélienne ont lieu à chaque progrès réalisé. Nous ne sommes donc pas complètement libres de mener à terme notre politique sécuritaire et judiciaire, et le déplorable assassinat de Juliano Mer-Khamis comme celui de Vittorio Arrigoni ont été des chocs terribles pour le président Abbas et pour toute la population. Nous mènerons à terme notre programme visant à assurer la sécurité et le respect du droit pour tous sur notre territoire.
L’impact du Printemps arabe sur l’accord intervenu entre le Hamas et le Fatah ne peut être mésestimé. Oui, la jeunesse palestinienne a fait pression sur le Fatah, sur le Hamas et sur le président pour que l’union prévale. Cette jeunesse pleine d’énergie souhaite que nous parvenions à avancer, ce qui me donne du courage dans la poursuite d’une tâche difficile.
Un porte-parole du Hamas a fait savoir immédiatement que la déclaration de M. Ismaël Haniyeh, après la mort de Ben Laden, exprimait une position personnelle et non celle du Hamas. Pour notre part, nous ne considérons pas Ben Laden comme un combattant de l’islam ou un martyr de la cause palestinienne ; au contraire, il a donné d’eux une très mauvaise image. Il a été un élément destructeur, responsable du massacre de nombreux musulmans et Arabes. Les extrémistes sont des virus dangereux qui détruisent le corps arabe de l’intérieur ; il convient donc de créer les anticorps qui permettront de s’en débarrasser. Nous n’avons absolument rien à voir avec ce mouvement qui nuit à la juste cause palestinienne.
Pour ce qui est des relations entre l’Union européenne et la Palestine, le président Sarkozy a dit la nécessité d’un changement de méthode. Soulignant l’absence de progrès, il a souligné que l’Europe ne peut se satisfaire d’être seulement un bailleur de fonds et qu’elle doit avoir un rôle politique innovateur, conduisant à la conclusion d’un accord de paix qui renforcera la stabilité au Proche-Orient, autour de la Méditerranée et dans le monde. La deuxième conférence des donateurs avait originellement été conçue pour compléter les promesses faites lors de la première conférence, et une réunion préparatoire a eu lieu à Bruxelles. Mais quand ils se sont rencontrés, les présidents Sarkozy et Abbas sont convenus que les problèmes en suspens n’étant pas seulement d’ordre économique, la conférence devrait traiter de sujets plus larges. Elle combinera donc des thèmes politiques et économiques, avec l’objectif d’un progrès politique réel. Nous approuvons cette approche.
Revenant sur l’accord intervenu entre le Fatah et le Hamas, vous m’avez interrogé sur leur position respective quant à la reconnaissance de l’État d’Israël. La reconnaissance d’un État incombe à une entité politique et non à un parti, et le président Abbas a déclaré hier encore que tout gouvernement palestinien respecterait les accords signés avec Israël et avec la communauté internationale. Comme il est prévu par les accords d’Oslo, c’est l’OLP et elle seule qui, pour la Palestine, est habilitée à négocier la paix. L’État qui, à ce jour, ne respecte pas les accords signés, c’est l’État d’Israël, qui refuse de nous reconnaître. Le Hamas n’est pas l’OLP – qui a reconnu l’État d’Israël dans les frontières de 1967 – mais un parti politique palestinien. Dois-je rappeler que certains partis politiques de la majorité israélienne ne reconnaissent pas l’existence du peuple palestinien et que d’autres désignent les Arabes comme des cafards à écraser ?
Je rappelle à nouveau que l’on traite, en cette matière, entre États et non entre partis politiques. À ce jour, il n’y a pas d’État palestinien mais, dès 1988, c’est-à-dire avant les accords d’Oslo, le Conseil national palestinien a accepté, par souci de compromis, de reconnaître l’existence de l’État d’Israël dans ses frontières de 1967, une concession considérable. Pour sa part, M. Netanyahou s’emploie à multiplier les conditions. Pourquoi exige-t-il maintenant de nous que nous reconnaissions Israël comme « l’État-nation du peuple juif » ? S’il souhaite que son pays change de nom, qu’il en fasse la demande à l’ONU, certainement pas à l’Autorité palestinienne ! En réalité, le Premier ministre israélien invente prétexte sur prétexte pour prétendre que l’Autorité palestinienne est à l’origine du blocage des négociations. C’est très regrettable. Je suis moi-même issu d’une famille musulmane, j’ai été élève d’une école chrétienne, j’ai fait mes études supérieures dans une université juive et je considère que ma religion est mon affaire privée, qui ne regarde que moi. Que veut-on ? Préparer une guerre de religions dans la région ? Nous ne pouvons accepter une telle évolution, qui devrait être tout aussi intolérable à la France, pays laïc.
La Turquie joue en effet un rôle très important dans la région, mais nous ne serions pas défavorables à l’intervention d’autres États. C’est pourquoi, lors de leur rencontre, les présidents Sarkozy et Abbas ont évoqué l’idée d’un groupe de pays « amis du processus de paix », dans lequel figureraient l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine ou encore l’Inde.
M. le président Axel Poniatowski. L’accord entre le Fatah et le Hamas a pris tous les observateurs par surprise. Pourriez-vous préciser les raisons qui ont poussé le Fatah et le Hamas à le conclure à cet instant ?
M. Hael Al Fahoum. La pression de la jeunesse palestinienne, en Cisjordanie, à Gaza, dans les camps de réfugiés en Jordanie et au Liban, a contraint les partis politiques à aller de l’avant, le Hamas pouvant difficilement refuser l’offre faite par le président Mahmoud Abbas de se rendre à Gaza. Des contacts entre les deux partis se sont alors engagés très discrètement, sous l’égide de l’Égypte, et le Hamas a finalement accepté de signer un accord.
M. le président Axel Poniatowski. C’est donc la révolution arabe qui a poussé à la conclusion d’un accord.
M. Hael Al Fahoum. En effet.
M. François Asensi. Confirmez-vous la rumeur de l’entrée du Hamas au sein de l’OLP ? Une telle évolution signifie-t-elle de facto la reconnaissance de l’État d’Israël ou, du moins, les débuts d’un processus de reconnaissance ?
M. Jean-Michel Boucheron. On peut multiplier les efforts diplomatiques pendant des siècles, ils resteront vains si la volonté politique manque ou si l’évolution des rapports de forces ne permet pas qu’ils aboutissent. L’Autorité palestinienne ayant, à très juste titre, abandonné la lutte armée, il faut passer à autre chose. On sait qu’aux frontières d’Israël des foules palestiniennes tentent de franchir les barrages. Appelez-vous de vos vœux un mouvement semblable en Cisjordanie, qui rendrait la situation intenable pour Israël et qui serait la seule manière de faire que les choses avancent ? Soutiendriez-vous des manifestations pacifiques de la jeunesse palestinienne ?
M. Michel Vauzelle. Chacun connaît la position américaine à l’égard d’Israël et son soutien à la colonisation, et l’on voit que l’Union européenne souhaite un autre rôle que celui du banquier réparant les dégâts commis dans les territoires palestiniens. La Tunisie et l’Égypte sont actuellement plus préoccupées de résoudre leurs problèmes internes que de la cause palestinienne. En Libye, c’est la guerre, et en Syrie, la guerre civile. Dans ce contexte, quel appui attendez-vous des pays arabes dits « modérés » ? L’avenir de la Palestine ne repose-t-il que sur l’Europe et sur une autre partie de la communauté internationale qui n’est pas immédiatement dépendante de l’influence américaine ?
M. Jean-Pierre Dufau. Le rapprochement entre le Hamas et l’Autorité palestinienne a fait naître l’espoir, mais existe-t-il une volonté réelle de reconnaître l’État d’Israël dans des frontières sûres et de créer un État palestinien viable parce que capable d’assurer sa survie politique, économique et sécuritaire ? Des engagements fermes ont-ils été pris qui permettront la coexistence de deux États souverains, seule solution pour parvenir à une paix durable ?
M. Jean-Claude Guibal. Vous avez dit souhaiter un partenariat entre la Palestine et l’Union européenne, mais aussi avec la France. Vos préférences vont-elles à un partenariat au niveau européen ou à des partenariats bilatéraux ? Par ailleurs, privilégiez-vous les partenariats économiques ou les partenariats stratégiques ? Comment faire pour que l’Europe, directement ou par le truchement de certains de ses membres, participe au processus de paix ? Enfin, faites-vous un préalable du statut de Jérusalem ?
M. Hervé de Charette. Monsieur le président, notre commission ne devrait-elle pas prendre position sur la reconnaissance de la Palestine comme État palestinien ?
À M. Hael Al Fahoum, je me dois de dire que la période actuelle me paraît bien peu propice à une recherche effective de la paix. Il faut, pour commencer, reconstituer l’unité palestinienne ; le processus est en cours et c’est un progrès très important. Mais il faut aussi que le gouvernement israélien veuille la paix, ce qui signifie pour Israël choisir la paix contre les territoires, et ce n’est pas la position du gouvernement actuel. Ensuite, les États-Unis doivent vouloir s’engager puisque, d’une manière ou d’une autre, la paix sera imposée par la communauté internationale. Or je ne pense pas que le gouvernement américain soit en mesure d’agir. Enfin, il faudrait que l’Union européenne ait envie de s’imposer comme un partenaire nécessaire, mais elle est divisée. Vous comprendrez mon scepticisme.
M. le président Axel Poniatowski. Vous pouvez si vous le souhaitez, monsieur de Charrette, déposer une résolution relative à la reconnaissance de la Palestine comme État palestinien.
M. Serge Janquin. Je viens de plaider en faveur de la reconnaissance d’un État palestinien devant l’Assemblée de l’Union interparlementaire réunie à Panama. Cependant, il y a loin de la coupe aux lèvres et je partage pour beaucoup le sentiment de M. de Charette. Vous avez, à juste titre, fait une distinction entre États et partis politiques. Malgré tout, la communauté internationale n’acceptera pas d’aller plus loin si elle n’a pas la garantie que l’Autorité palestinienne incarne l’unité nationale à ce sujet. Quelles concessions nouvelles le Hamas est-il prêt à faire avant la conférence de Paris prévue en juin et en tout cas avant septembre ?
M. Étienne Pinte. Pourquoi est-il presque aussi difficile de pénétrer à Gaza par l’Égypte que par Israël ? D’autre part, comment envisagez-vous la coexistence entre un État palestinien indépendant et les habitants des 140 colonies israéliennes de Cisjordanie ?
M. Hael Al Fahoum. Je suis d’accord avec l’analyse de M. de Charette. Pour ce qui nous concerne, nous nous sommes engagés dans le processus de réconciliation et le Hamas a commencé de s’aligner sur la position de l’OLP : M. Khaled Mechaal n’a-t-il pas évoqué un État palestinien dans les territoires occupés en 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale ? C’est une évolution notable pour un parti qui, jusqu’alors, a toujours revendiqué de recouvrer la Palestine étendue de la vallée du Jourdain jusqu’à la Méditerranée. Par cette déclaration, la direction du Hamas fait sienne pour la première fois la position adoptée par le Conseil national palestinien en 1988. La convergence des points de vue est donc amorcée.
Le gouvernement israélien cherche tous les prétextes pour esquiver le processus de paix tout en accusant les Palestiniens d’être les auteurs du blocage et, malheureusement, l’administration américaine pratique le double langage en ne soumettant le gouvernement israélien à aucune pression réelle pour l’obliger à se plier à la volonté de la communauté internationale.
S’agissant de la reconnaissance de l’État d’Israël par le Hamas, je vous ai fait part d’une évolution ; de plus, comme je l’ai indiqué, cette question relève des États et non des formations politiques. En Israël, M. Avigdor Lieberman et avec lui la majorité du gouvernement israélien ne reconnaissent même pas l’existence du peuple palestinien. Pour intégrer l’OLP, le Hamas devra reprendre à son compte tous les engagements conclus par le Conseil national palestinien – dont le principe de la coexistence de l’État palestinien et de l’État d’Israël. Pour l’heure, le Hamas n’est pas encore une composante de l’OLP ; de plus, il y aura des élections au Conseil national palestinien dans un an.
La population palestinienne n’acceptera pas l’idée d’un État palestinien qui n’aurait pas Jérusalem-Est pour capitale. Elle tiendrait pour aussi inacceptable un État aux frontières provisoires. C’est pourquoi les propositions de M. Netanyahou en ce sens ont été rejetées.
On constate actuellement une mutation positive au sein des mouvements de jeunesse du Hamas. Le désespoir peut parfois avoir une incidence sur le discours d’un parti politique ; si l’on voit qu’un mouvement s’amorce qui tend à confirmer l’identité palestinienne par la création d’un État, les approches politiques peuvent se modifier, même au sein de partis qui étaient considérés jusqu’alors comme des partis négatifs dans la société palestinienne. C’est pourquoi il faut passer aux actes. L’accumulation des frustrations et des souffrances a été telle depuis soixante-trois ans qu’il faut du concret, maintenant.
Vous m’avez interrogé sur ce que devrait être le rôle de l’Union européenne. À dire vrai, je m’étonne que l’Union européenne, grande puissance économique, doive demander l’autorisation de quiconque pour prendre une initiative concernant le Proche Orient, alors même que les questions en suspens ont une incidence directe sur sa propre sécurité – au point que la question peut être considérée comme un problème interne à l’Union ! Si tous les efforts sont conjugués, l’Europe parviendra à imposer sa vision au moment où des forces se mobilisent dans le monde arabe mais aussi en Israël : Mme Livni n’a-t-elle pas dit hier tout le mal qu’elle pense de la politique suivie par M. Nétanyahou, qu’elle accuse d’isoler Israël sur la scène internationale ? Le président Abbas a lui-même rencontré deux cents personnalités israéliennes de tous bords, avec lesquelles il a eu des discussions très franches. Un terreau existe pour la négociation ; il faut le labourer.
La Palestine a besoin de partenariats bilatéraux. Nous souhaitons créer un partenariat expérimental avec la France, qui montrerait que la coopération peut être autre qu’uniquement budgétaire. Nous avons besoin que des groupes privés français, avec le soutien des autorités, s’engagent auprès de nous en tant que partenaires stratégiques de leurs homologues palestiniens. Par ailleurs, j’entretiens des contacts avec les ambassadeurs des pays arabes pour mettre au point des partenariats triangulaires associant la France, la Palestine et des pays arabes. Nous entendons ainsi préparer la normalisation qui interviendra entre le monde arabe et l’État d’Israël lorsqu’un progrès politique réel aura permis de mener à son terme le processus de paix.
Enfin, le gouvernement égyptien a promis de faciliter les déplacements entre l’Égypte et Gaza et a déjà pris des dispositions en ce sens ; peut-être allons-nous demander le retour des observateurs européens aux frontières avec l’Égypte.
M. le président Axel Poniatowski. Je vous remercie, monsieur l’ambassadeur, pour ces réponses précises.
12.- Mercredi 25 mai 2011, séance de 9 heures 45, compte rendu n° 64 : table ronde sur la situation en Syrie, en présence de Mme Elizabeth Picard, directrice de recherches émérite au CNRS (Institut de Recherches et d’Études sur le Monde Arabe et Musulman), et M. Patrice Paoli, directeur d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient au ministère des affaires étrangères et européennes
M. le président Axel Poniatowski. Nous recevons aujourd’hui Mme Élizabeth Picard, directrice de recherches émérite à l’Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman du CNRS, et M. Patrice Paoli, directeur d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient au Ministère des Affaires étrangères et européennes, que je remercie d’avoir répondu à notre invitation. Ils nous feront part de leur analyse de la situation en Syrie.
Le mouvement populaire en faveur de la démocratisation que l’on qualifie de « printemps arabe » s’est propagé assez tardivement à la Syrie, où la première manifestation d’importance s’est déroulée au milieu du mois de mars, trois mois après les premiers événements en Tunisie. Depuis, la contestation politique et sociale s’est intensifiée de semaine en semaine. Après quelques concessions, le pouvoir a très nettement durci le ton et la répression devient de plus en plus violente.
L’intérêt de notre Commission pour la Syrie ne date pas du déclenchement de ce mouvement de protestation : elle a créé en mai 2009 une mission d’information présidée par Mme Elisabeth Guigou, qui a présenté son rapport en juin 2010. Ce travail, auquel M. Patrice Paoli avait naturellement participé, avait été l’occasion de faire le point sur le processus de retour de la Syrie dans la communauté internationale après plusieurs années de mise à l’écart. Nous avions alors estimé que ce processus avait porté ses premiers fruits, notamment en ce qui concernait l’ouverture économique et la stabilité du Liban, et qu’il devait être poursuivi, parallèlement au renforcement de nos exigences sur les points durs que constituent en particulier le respect de la souveraineté libanaise et des droits de l’homme.
Si la récente démission du gouvernement libanais dirigé par M. Rafic Hariri à la suite du retrait de ses membres appartenant au Hezbollah n’est pas un signe positif pour la normalisation des relations libano-syriennes, c’est évidemment la violence de la répression conduite par l’armée syrienne contre les manifestants pacifiques qui nous inquiète le plus.
Le ministre des affaires étrangères et européennes a récemment souligné devant la Commission les différences importantes qui distinguent la situation en Syrie de celle qui a justifié l’intervention armée internationale en Libye. Nous sommes parfaitement conscients des efforts de la diplomatie française visant à obtenir une condamnation forte de cette répression par le Conseil de sécurité des Nations unies, et nous savons les difficultés qu’elle rencontre en raison de la position de certains pays tels la Chine et la Russie.
Nous souhaitons, Madame, Monsieur, que vous nous fassiez part de votre analyse de la situation en Syrie aujourd’hui et que vous nous donniez votre sentiment sur la manière dont elle pourrait évoluer.
Mme Élizabeth Picard, directrice de recherches émérite au CNRS. La révolte syrienne participe de la vague des révoltes arabes observée au Moyen-Orient depuis quelques mois, mais elle présente aussi des spécificités. Sur le plan socio-économique, on note, comme dans les autres pays, l’extrême jeunesse des manifestants ; mais la population de la Syrie, qui est pour moitié composée de jeunes âgés de moins de 18 ans, a subi de plein fouet les conséquences très brutales de l’ouverture économique, assortie d’une libéralisation sauvage, définie dans le plan quinquennal 2006-2010 et qui a eu de violentes conséquences sur le secteur public et sur le taux d’emploi. A cela s’est ajouté l’effet de sécheresses exceptionnelles qui ont provoqué des migrations internes depuis les régions périphériques vers les banlieues et le Sud du pays, dont la ville de Deraa.
On note une certaine similitude avec les soulèvements dans les autres pays arabes pour ce qui est de l’identité des insurgés – les jeunes, les couches sociales pauvres et moyennes inférieures –, de la spontanéité et de l’inorganisation, de l’extrême importance des solidarités familiales et tribales ; au moment de réfléchir au changement possible il ne faudra pas mésestimer que ces solidarités se trouvent aussi du côté du régime. Une autre similitude tient à l’absence ou la quasi absence des partis politiques traditionnels, soit qu’ils aient été cooptés par le régime dans le cadre du Front dirigé par le parti Baas, soit que, tels les partis de gauche et les partis islamistes, ils aient été laminés et déclarés illégaux. Se conjuguent donc l’absence d’organisation politique des mobilisés et l’absence de programme politique. On entend certes évoquer la Déclaration de Damas de 2005, qui en appelle au respect des droits politiques et des droits de l’homme, mais elle est très générale.
Comme dans les autres pays arabes en révolte, on constate le très grand rôle joué par l’information en images dans le conflit syrien. J’appelle toutefois votre attention sur la fragilité de ces informations, souvent reçues sans assez d’esprit critique. D’une part, le régime ferme les frontières nationales de l’information ; d’autre part, l’opposition procède à des manipulations des bribes d’informations en images diffusées sur Facebook et sur Youtube, dont l’utilisation s’est développée de manière exponentielle en Syrie.
Dans cette révolte, les intrusions et les téléguidages de l’extérieur existent, mais de manière très marginale. Certes, quelques armes sont apparues, ce que le régime ne s’est pas privé de souligner, mais dans la majorité des cas on voit dans la rue des foules désarmées dont l’un des mots d’ordre principaux est « Nous agissons paisiblement ». A cet égard, l’agitation des exilés, à Londres, en Allemagne et à Washington, semble à la fois vaine et dangereuse pour les manifestants.
Comment s’articulent la révolte et la mouvance des Frères musulmans, que le régime a voulu éradiquer par une violente répression entre 1979 et 1982 ? Les Frères musulmans qui ont évolué, qui se sont remobilisés et dont la direction a changé récemment, font incontestablement l’objet d’un intérêt particulier du gouvernement turc.
On constate aussi que le régime autoritaire syrien a su s’adapter à la vague de protestation en agissant dans trois registres. D’une part en jouant sur la fibre nationale, non pas tant la fibre nationale arabe que la fierté syrienne, qui s’était manifestée pendant la phase d’isolement de la Syrie entre 2003 et 2008. D’autre part, le régime agite avec un certain succès l’épouvantail de la guerre civile, faisant planer la menace que dans une Syrie religieusement et ethniquement plurielle, la poursuite des protestations contre la présidence pourrait provoquer des scissions au sein de la société, de l’appareil politique et éventuellement de l’armée, qui conduiraient à des affrontements entre villes, voire entre régions du pays, avec des conséquences plus sanglantes encore que n’en eurent la guerre civile de 1979-1982 et le massacre de Hama. Par cette menace, et par l’entremise d’agitateurs qui provoquent des affrontements entre communautés confessionnelles et ethniques, le régime tient en otage les minorités kurde, druze et chrétiennes mais aussi les intellectuels laïcs qui pencheraient vers une démocratie. Cela rend très difficile la mobilisation de la société civile.
Le dernier élément de perfectionnement de l’autoritarisme, c’est l’exercice de la violence. En s’appuyant sur certains textes, le régime procède arbitrairement à des arrestations indiscriminées, et des milliers de jeunes manifestants sont emprisonnés, puis relâchés après qu’ils ont été torturés et leurs familles menacées. Miliciens et groupes armés des services de sécurité, agissant dans une complète impunité, peuvent exercer une violence sans limites, en dépit de la prétendue levée de l’état d’urgence. De cette violence extrême, la nomination de certains membres du nouveau gouvernement, le ministre de l’intérieur en particulier, donne le ton. Les termes utilisés par le régime sont parlants : en décrivant les insurgés comme des « terroristes », des « mercenaires » ou des « comploteurs », la classe politique au pouvoir dit son refus d’entendre et son isolement. Cela ne laisse pas présager une ouverture, sinon dans des conditions très difficiles.
Dans ce contexte, les prévisions sont hasardeuses, mais l’on peut formuler quelques remarques pour réfléchir au futur. La première est que la crise évoluera vers une double détérioration. Dégradation économique d’abord, car l’économie syrienne, très fragile, dépendait des investissements étrangers – le prochain plan quinquennal tablait sur plus de 10 milliards de dollars. Les couches populaires souffrent déjà durement de la situation et les couches moyennes risquent elles aussi de sentir l’effet de cette politique toute répressive. On peut s’attendre aussi à une détérioration de la situation sécuritaire, le mouvement faisant tache d’huile à mesure que la mobilisation s’élargit aux familles des jeunes manifestants. Le retour en arrière paraît donc difficile, sinon impossible.
En effet, consentir aux réformes reviendrait à passer la main et ceux qui y perdraient sont plus nombreux que les quelques dizaines de militaires, de membres de la famille du président Bachar el-Assad et de membres du clan alaouite qui tiennent le régime. Ainsi, la holding d’investissement de plusieurs centaines de millions de dollars créée en 2007 par Rami Makhlouf, cousin germain du président, rassemble plus de soixante-dix jeunes hommes d’affaires qui prospèrent à l’ombre du régime.
On constate par ailleurs que le président Bachar el-Assad ne veut ou ne peut contenir la violence de ses services. Les quelques mesures cosmétiques prises à ce jour ne sont que tactiques, et destinées à répondre aux pressions occidentales.
Quelqu’un est-il, alors, prêt à céder au sein du régime ? Peut-on imaginer une rupture au sein du groupe dirigeant, principalement composé de militaires de la famille du président ? Un éclatement de l’armée et des forces sécuritaires est-il concevable ? Si les unités militaires les plus proches du pouvoir, qui sont aussi les plus armées, sont à quelque 70 % composées d’alaouites, y compris dans la troupe, il n’en va pas de même dans les unités plus marginales, constituées d’appelés, où les sunnites sont les plus nombreux. En d’autres termes, il y a en Syrie des forces de sécurité à deux vitesses, et une rupture au sein du commandement militaire signifierait plutôt que certains jugent que leur contrôle est en danger et qu’il convient de durcir la réaction pour reprendre en main un pouvoir qui vacille.
Enfin, on ne sache pas que le président el-Assad ait réussi à attirer des interlocuteurs permettant d’ouvrir un dialogue national.
Pour finir, il est important de tenir compte des réactions des pays voisins, ou des répercussions que la crise syrienne peut avoir sur eux. Je citerai particulièrement l’Iran, allié privilégié de la Syrie mais qui est actuellement en danger, ainsi que la Turquie, dont les intérêts en Syrie sont si puissants qu’elle ne peut rester neutre et qui fait déjà fortement pression sur le régime. D’autre part, au Liban, les forces politiques auraient dû trouver dans la paralysie syrienne une opportunité inégalée d’engager un dialogue intérieur. Malheureusement, le cheikh Nasrallah, responsable du Hezbollah, a commis l’erreur majeure de jeter de l’huile sur le feu, et la coalition du 14-Mars, en durcissant le ton, ne facilite pas la construction d’une politique libanaise indépendante en cette période exceptionnelle.
M. Patrice Paoli, directeur d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient au ministère des affaires étrangères et européennes. Je pense, comme Mme Elizabeth Picard, que la révolte en cours en Syrie n’est pas un mouvement communautaire ou structuré par un parti politique mais un mouvement citoyen : une vague de fond, partie de Tunisie, avance. Mais, à la différence de ce qui vaut en Tunisie, en Égypte et en Libye, sociétés homogènes, les pays situés à l’Est de Suez – Syrie, Bahreïn, Yémen – connaissent des lignes de fracture communautaires, et les régimes concernés ont intérêt à instrumentaliser cette situation en se posant en garants de l’unité nationale, de la stabilité et de la sécurité des communautés. C’est ainsi que le régime syrien joue sur les peurs des minorités kurde, chrétienne et alaouite.
Loin de s’essouffler, alors même que l’armée investit des villes entières dans lesquelles elle exerce une répression brutale, la révolte s’étend. Tant de sang a coulé – il y a eu davantage de morts en Syrie que dans les autres pays où ont eu lieu des événements similaires – que l’on peut penser qu’un point de non-retour a été atteint. Le régime légitimait son pouvoir en se disant garant de la stabilité, en se faisant le héraut de la résistance à Israël sur le plateau du Golan et en misant sur le développement de l’économie, s’inspirant en quelque sorte du modèle chinois : ne rien céder sur le plan politique mais opérer une réforme bénéficiant à la population. Or, les slogans apparus remettent en cause la légitimité du pouvoir, l’invitant à s’occuper du Golan plutôt que de réprimer les aspirations de la population et expliquent que les manifestants n’ont pas faim mais qu’ils veulent des libertés.
Notre politique à l’égard de la Syrie est inspirée par les mêmes principes que ceux qui fondent notre action à l’égard de la Libye, mais leur application dans des conditions différentes ne produit pas les mêmes résultats. La France se heurte, au Conseil de sécurité, à l’opposition résolue de la Chine et de la Russie à l’adoption d’une résolution condamnant la répression en Syrie qui, à la différence de la Libye, ne fait pas l’objet d’une dénonciation officielle de la Ligue arabe. Nous sommes toutefois parvenus à éviter que la Syrie maintienne sa candidature au Conseil des droits de l’homme des Nations unies. D’autre part, l’action que nous avons menée auprès de l’Union européenne a porté ses fruits et, il y a quelques jours, le Conseil des affaires étrangères de l’Union européenne a étendu à la personne de Bachar el-Assad les sanctions qui frappaient d’autres responsables du régime.
Il est extrêmement difficile de prédire l’évolution de la situation. Rien ne permet d’affirmer qu’une guerre civile soit inéluctable. On ne doit pas non plus surestimer la menace que représenteraient les Frères musulmans, qui ne semblent pas jouer un rôle fondamental dans la contestation, comme cela a pu être le cas au début des années 1980. Même si des armes peuvent circuler en Syrie, il n’y a pas de mouvements d’opposition armés. L’évaluation de la situation demande donc prudence et pondération. Dans un contexte de bouleversement des équilibres régionaux et de forte contestation intérieure, la Syrie n’est plus perçue par tous comme une puissance du statu quo interne et régional, garante de la stabilité régionale.
En Syrie même, les perceptions sont variables. Nombreux sont sans doute les chrétiens qui redoutent une remise en cause des équilibres actuels. Le « scénario irakien » est d’évidence dans bien des esprits. A un degré peut-être moindre, ceci est vrai aussi pour les Druzes. Ces craintes sont présentes aussi parmi les alaouites qui ne sauraient être perçus pour autant comme un groupe homogène. Il est difficile de faire la part, dans ces craintes, de l’instrumentalisation. Si ces « réflexes conservateurs » qui induisent une préférence pour le statu quo existent, ils ne sauraient masquer l’aspiration grandissante de la majorité de la population à la liberté et à la dignité. Parce qu’elles n’ont pas été tenues, les Syriens ne croient plus aux promesses de réforme. Ils exigent un arrêt immédiat de la répression et une transition ordonnée et rapide vers un régime démocratique respectueux des droits de l’homme. L’inconnue réside précisément dans la forme que pourrait prendre cette transition.
Une inconnue est liée à l’opposition syrienne. D’évidence, quarante années consécutives de vide politique ne favorisent pas l’émergence de structures clairement identifiables, même si certaines personnalités d’opposition sont connues depuis le « printemps de Damas ». La contestation en Syrie a ceci de particulier qu’elle est, comme hier en Egypte ou en Tunisie, sans leader identifiable. Elle n’est pas encadrée par une organisation particulière. Elle témoigne d’une profonde dynamique sociale allant au-delà des oppositions traditionnelles qui, du fait de la répression, n’ont pu développer un ancrage social ni se structurer. C’est la grande différence avec le « printemps de Damas » de 2000, resté confiné à certaines élites.
Des contacts suivis que nous entretenons avec de nombreux interlocuteurs syriens, nous retenons le constat partagé qu’un point de non-retour a sans doute été atteint : la Syrie ne reviendra plus jamais à la situation précédente et il faut maintenir la pression sur le régime.
M. le président Axel Poniatowski. Qui, en Syrie, a la réalité du pouvoir ? Est-ce un clan, et dans ce cas quelles sont les relations de ses membres, ou le président el-Assad a-t-il une position prééminente au sein de ce clan ?
M. Hervé Gaymard. Quels sont les décideurs, au-delà du président el-Assad ? Quelle est la situation dans la province de Kamechliyé, au-delà de l’Euphrate, et quelles sont les relations transfrontalières avec le Kurdistan ?
M. Dominique Souchet. On peut penser que l’attitude des chrétiens – qui constituent 10 % de la population syrienne – à l’égard de la contestation du régime en cours s’explique par le précédent irakien. Dans le même temps, on constate l’absence d’affrontements interreligieux en Syrie ; cela peut-il durer ? Au nombre des quelque 1 500 000 Irakiens réfugiés en Syrie, on compte des familles chrétiennes ; considèrent-elles la Syrie comme une escale, ou envisagent-elles de s’y établir ? Enfin, les chrétiens continuent-ils de jouer un rôle au sein du parti Baas qu’ils ont contribué à fonder ?
M. François Rochebloine. Le Patriarche grec catholique d’Antioche s’inquiète de la sécurité des chrétiens de Syrie au cas où le régime du président el-Assad chuterait. Il dit ne rien attendre de bon des notables sunnites et redouter un exode de la population chrétienne. Qu’en pensez-vous ?
En dépit des critiques qui leur sont adressées pour leur participation à la répression des insurrections populaires, les forces armées sont souvent présentées comme un facteur de stabilisation des sociétés, notamment après des périodes de remise en cause des pouvoirs établis. Ce scénario vaut-il pour la Syrie, ou existe-t-il un risque de connivence de l’armée syrienne avec une force politique tentée par une autre forme d’intransigeance, voire d’intégrisme ?
M. Jean-Paul Lecoq. Les Syriens avec lesquels nous sommes en contact commencent de s’organiser sous forme d’associations, sans étiquette politique définie. Ils nous disent attendre de l’Etat français des réactions fortes et rapides. Or, nous avons eu à connaître d’une lettre de l’ambassade de Syrie en France demandant à la diaspora syrienne de dénoncer les Syriens de France potentiellement opposés au régime actuel. Le ministère des affaires étrangères n’a-t-il pas l’obligation de faire savoir à l’ambassade de Syrie que ces appels à la délation ne sont pas tolérables sur notre territoire ? Plus largement, les relations diplomatiques entre la France et la Syrie sont-elles maintenues ? Si elles le sont, ne devraient-elles pas être rompues en signe de soutien à la révolte de la population ?
M. Jean-Pierre Kucheida. Comment définiriez-vous la laïcité à la syrienne ? Par ailleurs, quelles actions, visibles et moins visibles, mène la Turquie, pour ou contre l’insurrection ?
M. Patrick Labaune. Les révolutions arabes ne servent-elles pas d’alibi, en Syrie, à la revanche de la majorité sunnite contre la minorité alaouite ? Par ailleurs, ne semble-t-il pas que si la révolution a été rapide dans les pays qui, tels l’Égypte et la Tunisie, présentent une homogénéité religieuse, la contestation ne parvient pas à prendre le pouvoir dans les pays tels la Syrie et le Yémen où existent des clivages confessionnels ?
M. Michel Terrot. La Syrie a accueilli de nombreux chrétiens irakiens, maintenant installés dans les quartiers populaires des grandes villes. Quel sera leur sort si le président el-Assad est renversé ? Ne passe-t-on pas sous silence le désir de revanche des sunnites de Syrie, majoritaires en nombre, un élément qui ne manque pas d’inquiéter toutes les minorités syriennes ?
M. Patrice Paoli. L’idée que l’on ne pourra revenir en arrière se diffuse en raison du nombre de morts et de la persistance des manifestations, mais je ne puis être certain que le point de non-retour a effectivement été atteint. Pour répondre aux questions portant sur la nature du régime, je rappelle qu’après son accession au pouvoir, Hafez el-Assad s’est appuyé sur une partie de la communauté alaouite : un groupe a pris le pouvoir puis a élargi son emprise dans le pays. Il y a là un point commun avec les autres révolutions arabes, qui ont rejeté l’appropriation de l’État et de l’économie par un clan. C’est donc bien à une réaction citoyenne que l’on assiste et non à une révolte des sunnites qui voudraient prendre leur revanche. Les manifestations ont commencé en Syrie après que des adolescents, qui avaient écrit sur un mur de Deraa, une ville que l’on n’envisageait pas comme un foyer de contestation, le slogan des révolutions arabes – « le peuple veut la chute du régime » – ont été arrêtés et torturés, et que les familles venues demander des comptes ont été renvoyées dans leur foyer. La colère a éclaté et elle s’est propagée.
Nous sommes donc confrontés à une question de politique générale, longuement évoquée par M. Alain Juppé le 16 avril dernier, lors du colloque consacré au « Printemps arabe » à l’Institut du monde arabe : devons-nous, dans les sociétés civiles qui sont en train de s’ouvrir, ne traiter qu’avec certains interlocuteurs ? Alors qu’une transition s’amorce en Tunisie comme en Egypte, des mouvements ouvertement fondés sur la religion se font entendre ; mais n’est-il pas normal que des partis musulmans s’expriment dans les pays musulmans, comme des partis chrétiens le font ailleurs ? Nous n’avons pas à choisir nos interlocuteurs et nous devrons parler à tous – ce qui ne signifie pas les soutenir. Devons-nous nous empêcher a priori de parler avec des composantes politiques importantes d’un pays au motif qu’elles représenteraient un danger ? Si des mouvements renoncent à la violence et acceptent les principes démocratiques, nous devons en finir avec le dogme de l’impossibilité d’élections libres dans les pays arabes.
Au Proche Orient, les communautés chrétiennes sont souvent plus protégées que les autres communautés minoritaires. Si l’Irak est en proie à une guerre civile menée par des gens qui ont intérêt à attiser les haines confessionnelles, tel n’est pas le cas en Syrie, où la situation des chrétiens est plutôt bonne, comme en Jordanie et au Liban. En Égypte, quelques manifestations anti-chrétiennes ont eu lieu, mais il n’y a pas eu de violences systématiques. Nous devons en même temps nous abstenir de distinguer une communauté des autres, ce qui traduirait une approche communautariste, et nous élever contre toute atteinte à la liberté de culte et d’expression religieuse, ce que nous faisons. Je ne pense pas que la situation des chrétiens se dégrade actuellement en Syrie.
Nos contacts diplomatiques avec la Syrie se poursuivent mais le dialogue est difficile car nos appels à la réforme ne sont pas entendus. Notre ambassadeur à Damas, avec ses homologues européens et d’autres pays alliés, transmet ces messages aux autorités syriennes, rencontre régulièrement des représentants de la société civile syrienne et de l’opposition. Pour l’instant, nous souhaitons maintenir ce canal de communication ouvert. Je m’enquerrai au plus tôt du courrier de l’ambassade de Syrie à ses ressortissants en France mentionné par M. Lecoq.
La Turquie, qui a sans doute joué un rôle stabilisateur dans la région, est certainement inquiète de ce qui peut se produire en Syrie et des répercussions possibles d’un changement de régime, notamment pour ce qui concerne la population kurde. Sa diplomatie est fortement mobilisée pour demander un changement, dont on ignore les formes qu’il pourrait prendre.
Mme Élizabeth Picard. Il me paraît indispensable, pour appréhender la situation en Syrie et dans la région, de ne plus se laisser obnubiler par la question confessionnelle, comme nous l’avons fait trop longtemps. Pour analyser le régime syrien et sa très solide coalition, il ne suffit pas de dire qu’il s’agit d’alaouites. L’explication est réductrice car au sein de cette communauté la diversité des situations est très grande, qu’il s’agisse de la richesse des individus ou de la possibilité d’accession au pouvoir. Le pouvoir est aux mains d’un clan, d’un cartel qui s’est constitué avec des alliés – au nombre desquels des sunnites et des chrétiens – et où la détention du pouvoir militaire donne la garantie du monopole du pouvoir économique. Voilà pourquoi le président Bachar el-Assad est solidaire de sa famille maternelle et aussi de sa belle-famille, riches entrepreneurs sunnites de Homs. Ainsi s’est constitué le noyau dur qui aurait tout à perdre du changement et qui risque de donner la main aux plus exigeants des militaires.
Au nom de la laïcité du parti Baas, une place très proche du régime a été faite aux chrétiens, et aussi bien Hafez el-Assad que son fils ont toujours eu l’habilité de se poser en protecteurs des églises chrétiennes et des chrétiens, dont ils ont favorisé l’accès au pouvoir économique. Mais il s’agit pour beaucoup de manipulation, le discours tenu aux chrétiens étant à peu près de cet ordre : « Sans nous votre perte est certaine et vous devrez quitter la Syrie comme ont dû s’exiler les chrétiens d’Irak ». Or, les situations diffèrent. En Syrie, les relations entre musulmans et chrétiens sont pacifiques depuis des années et les échanges socio-économiques nombreux ; l’amenuisement qui menace les communautés chrétiennes syriennes tient à la démographie et au problème général de l’attraction de l’Occident. La proximité linguistique et culturelle nous amène à grossir à la fois notre proximité avec les chrétiens de Syrie et la dangerosité de leur situation et, à l’inverse, à diaboliser tous les sunnites syriens. Or, les sunnites, qui représentent 75 % de la population syrienne, ne sont pas tous des salafistes djihadistes armés jusqu’aux dents décidés à renverser le pouvoir par vengeance ; pour une large majorité, ce sont de paisibles quiétistes qui étaient disposés à profiter de l’ouverture économique et qui étaient très tentés par le modèle turc. La Turquie a d’ailleurs beaucoup développé les échanges avec les commerçants et les entrepreneurs syriens, à Alep en particulier.
Bien sûr, le plus structuré des partis politiques de l’étranger est celui des Frères musulmans, mais ils ont beaucoup évolué depuis trente ans, et une situation intérieure plus ouverte pourrait les amener à penser en termes de pluralisme politique.
Si la situation à l’Est de la Syrie est aussi étrangement paisible, c’est en raison de la tactique d’ouverture du régime, qui avait enfin offert aux Kurdes la nationalité syrienne qui leur était déniée depuis les années 1960, et aussi parce que la Turquie, qui s’inquiète de la forte présence dans ces provinces du parti qui a succédé au PKK, mène en sous-main des négociations actives. Ce que souhaite par-dessus tout la Turquie, c’est la stabilité régionale, et qu’aucun problème ne se pose à ses frontières.
M. Rudy Salles. Quelles formes prend le soutien de l’Iran au régime syrien ? Les insurgés demandent-ils le soutien de l’Occident et notamment de l’Union européenne ? Enfin, vous avez indiqué que le régime syrien fait état de la situation au Golan pour souder la population ; pensez-vous qu’Israël soit au nombre des préoccupations des insurgés ?
M. Jean-Claude Guibal. Vous avez, Madame, évoqué la libéralisation des échanges et ses effets sur les classes moyennes comme cause principale de la révolution arabe, notamment en Syrie ; quel régime, alors, peut émerger qui permettrait de corriger les effets de cette situation ? D’autre part, vous avez évoqué les réactions de l’Iran et de la Turquie, et appelé l’attention sur les répercussions possibles de la situation en Syrie sur le Liban. Étant donné l’évolution en cours au Moyen-Orient, avec la réconciliation entre le Fatah et le Hezbollah d’une part, le discours du président Obama appelant à la reprise des négociations de paix sur la base des frontières de 1967, quelles conséquences peuvent avoir pour Israël la chute du régime syrien et le fait que la Syrie ne soit plus un pôle de stabilité au Proche Orient ?
Mme Marie-Louise Fort. Alors que les révolutions font tache d’huile dans le monde arabe, la Turquie qui est, des pays de la région le plus avancé sur la voie de la démocratie et de la laïcité, ne peut-elle servir de modèle ? À l’inverse, les pays considérés pourront-ils lutter contre la tentation de devenir des démocraties sous l’emprise des Frères musulmans, de tous les partis le plus structuré ?
M. Philippe Cochet. Jusqu’à quand les militaires syriens pourront-ils continuer de tirer sur la foule ? Par ailleurs, quelle est l’activité diplomatique actuelle entre l’Iran et la Syrie ? Enfin, quel bilan le citoyen syrien peut-il tirer des présidences successives de Hafez et de Bachar el-Assad pour sa vie quotidienne ?
M. André Schneider. Combien de temps encore la communauté internationale demeurera-t-elle l’observatrice passive de la répression brutale qui s’abat sur la population syrienne ? Les diplomates font leur travail, mais cela ne suffit pas à faire cesser la violence. D’autre part, Mme Elizabeth Picard a exprimé des doutes sur la véracité des informations diffusées. Dans ces conditions, que faire ?
Mme Chantal Bourragué. Je m’associe aux questions posées par mes collègues à propos de l’Iran d’une part, d’Israël d’autre part.
M. Didier Julia. Je pense, comme Mme Picard, que l’origine des révoltes dans les pays arabes s’explique par une demande de liberté et de dignité et non par des tensions interconfessionnelles. Vous avez évoqué la faible crédibilité des informations diffusées de part et d’autre, et notamment sur les réseaux sociaux ; soit, mais la chaîne de télévision Al Jazeera a montré des images de la troupe syrienne brûlant les pieds des manifestants au chalumeau et cassant à coups de masse le crâne de manifestants à terre ! Je sais que la diplomatie française fait ce qu’elle peut, mais il n’empêche que cette révolution est celle qui aura fait le plus de morts et le moins de bruit. N’avez-vous pas le sentiment que, plutôt qu’une armée, sont à l’œuvre des milices dénuées de sentiment national fort mais qui sont plutôt au service d’objectifs politiques ? Enfin, il existe au moins deux ou trois milices en Syrie, qui semblent agir de manière autonome ; le président el-Assad a-t-il vraiment la main ?
M. Jean-Paul Dupré. Existe-t-il, à votre avis, un risque de récupération ou de remise en cause des révolutions arabes par les islamistes ?
Mme Élizabeth Picard. Les relations entre le régime iranien et le régime syrien sont fondées sur un « donnant-donnant ». Le soutien de l’Iran se manifeste d’une part sur le plan financier par la vente à la Syrie d’un pétrole bon marché et, dans cette crise, par un appui technologique à la répression – l’entraînement des forces de répression syriennes ayant eu lieu dans les pays d’Europe orientale. Ces relations sont très difficiles à rompre, mais la situation intérieure iranienne est actuellement très mouvante, ce qui pourrait changer la donne.
Il est possible que si un régime à composante majoritairement sunnite s’installe en Syrie, il souhaite reprendre sur un autre pied les négociations avec Israël demeurées inabouties depuis des décennies. Dans un nouveau contexte politique, les demandes nationalistes tendant à la récupération des territoires perdus en 1967 pourraient s’exprimer plus fortement. Jusqu’à présent, la population syrienne n’a entendu à ce sujet que des discours, le front du Golan étant resté parfaitement calme depuis 1974.
Dans le cadre du rééquilibrage régional illustré par le changement des relations entre le Hamas et l’Autorité palestinienne et par la redéfinition du rôle de l’Égypte, le rôle central de la Syrie dans l’opposition à Israël peut être quelque peu affaibli, et le dossier du Golan pourrait devenir secondaire au regard de la question palestinienne.
Le rôle de la Turquie est très important en raison de la présence des Kurdes, qui représentent quelque 20 % de la population syrienne, et qui sont pour l’essentiel regroupés à l’Est du pays. Cependant, le « modèle turc » peut être invoqué et manipulé dans un sens ou dans un autre : soit pour inciter à plus de laïcité et de pluralisme, soit pour inciter à plus de religiosité – la question reste ouverte en Turquie même. Cela dit, le modèle n’est pas l’influence car il existe une barrière culturelle effective entre le monde turc et le monde arabe. L’influence que peut avoir la Turquie est celle d’une puissance moyenne régionale et à cet égard, la Syrie, qui a mille kilomètres de frontières communes avec la Turquie, a quelques soucis à se faire, qu’il s’agisse de l’eau, de la sécurité ou même de la domination du territoire syrien si la crise se prolonge.
S’agissant de l’évaluation par les Syriens de l’action des présidences successives, il faut garder en mémoire que la moitié de la population, très jeune, ne peut juger de l’évolution du régime depuis Hafez el-Assad jusqu’à son fils. Pour les jeunes gens, la connaissance de la mondialisation par le biais des moyens de communication modernes et les attentes qu’elle suscite sont plus importantes que la mémoire de ce qu’était le régime autoritaire et très étatisé de Hafez el-Assad. En Syrie, le problème tient moins à l’ouverture économique en soi, souvent louable, qu’à la sauvagerie avec laquelle elle a été mise en œuvre, conduisant à la perte de l’Etat social, à la fin des couvertures scolaire et sanitaire, et laissant la société syrienne nue face à un pouvoir dont chacun voit qu’il profite à plein de l’ouverture.
Il faut distinguer les conscrits et l’armée de métier, qui composent des unités différentes. L’armée de métier – les Forces spéciales et la désormais fameuse quatrième division commandée par Maher el-Assad, le frère du président – est un groupe majoritairement alaouite, gâté par le régime et entraîné à exercer librement le contrôle social et sécuritaire sans que la justice ait à en connaître. Les unités plus traditionnelles, composées d’appelés sunnites, pourraient rechigner beaucoup plus vite à l’accomplissement des besognes sécuritaires extrêmement violentes qui leur sont assignées. Jusqu’à présent, les unités qui participent directement à la répression sont restées fidèles aux caciques du régime. Usure, divisions entre les chefs d’unités ? Peut-être, mais je n’en sais pas plus.
M. Patrice Paoli. On peut concevoir le sentiment d’insécurité des Israéliens face à la perte des repères que constituaient l’Égypte et la Syrie jusqu’à maintenant, mais les aspirations du peuple palestinien ne sont pas moins légitimes que celles des peuples du pourtour méditerranéen auxquelles nous tentons de répondre et l’instabilité régionale ne doit pas nous conduire à ralentir nos efforts pour parvenir à une solution de paix durable. Il y a urgence : un compte à rebours est engagé, l’Autorité palestinienne ayant dit son intention de demander à l’Assemblée générale des Nations unies de reconnaître un État palestinien à l’automne. Notre diplomatie doit contribuer à rouvrir un chemin permettant de reprendre des négociations crédibles et M. Alain Juppé se rendra bientôt au Proche-Orient à cette fin. La tâche est ardue, mais nous ne perdons pas cette question de vue. En contrepoint, dans ce climat d’incertitude, notre très fort engagement en faveur de la sécurité d’Israël, notamment face à l’Iran, n’est pas négociable et ne se relâchera pas.
Je le redis, la politique étrangère de la France a été conduite selon les mêmes principes pour la Libye et pour la Syrie. Devant le Conseil de sécurité des Nations unies, nous avons cherché à obtenir la condamnation du régime syrien ; au Conseil des droits de l’homme de l’ONU, nous avons bataillé pour obtenir le retrait de la candidature syrienne, qui a eu lieu ; enfin, l’Union européenne vient de sanctionner la présidence syrienne en ajoutant la personne de Bachar el-Assad à la liste des personnalités syriennes déjà visées. Nous maintenons nos pressions sur le régime syrien pour qu’il procède à des réformes, comme il en avait pris lui-même l’engagement ; au-delà, nous nous heurtons à une limite.
S’agissant du risque de récupération des révoltes arabes par les islamistes, il ne nous appartient pas de dicter des règles de conduite aux populations ; c’est à nous de nous adapter. Nous ne sommes pour rien dans les révolutions en cours dans les pays arabes et nous n’avons aucun droit de nous immiscer dans les choix des peuples. Il faut en finir avec l’idée de ce que Samir Kassir décrivait comme le « malheur arabe », la thèse de l’impossibilité de la démocratie dans les pays arabes. Que notre approche soit ouverte ne signifie pas que nous soyons naïfs : nous ne sommes pas pour tel mouvement ou tel autre, mais favorables à un dialogue avec toutes les composantes des sociétés civiles.
M. Jacques Myard. A vous entendre, on comprend qu’en réalité personne ne sait où l’on va : on condamne et on donne des conseils mais la répression suit son cours ; la réforme pourrait avoir lieu mais on en doute car une grande tribu alaouite ne lâchera rien ; personne n’interviendra de l’étranger, la Turquie pas davantage qu’un autre pays, et nous n’avons pas les moyens diplomatiques de forcer le destin... En résumé, la société syrienne est une société bloquée, et personne ne sait comment la situation évoluera.
S’agissant des chrétiens, vous me semblez bien optimiste. En effet, de très nombreux témoignages nous sont parvenus, avant le déclenchement des événements en Syrie, qui soulignaient la pression sociétale inquiétante à laquelle les chrétiens sont soumis par les Frères musulmans.
M. Serge Janquin. On a l’habitude de traiter des problèmes de la région par référence au péril iranien, en le surestimant parfois. Depuis l’effondrement de l’Irak dû à M. Bush, la digue irakienne par rapport à l’Iran n’existe plus. La réévaluation de la politique française à l’égard de la Syrie partait du principe que la Syrie pouvait être, même dans l’ambiguïté, un pays de contention des ambitions iraniennes. Démonstration est faite qu’il n’y a plus rien entre l’empire perse et l’empire ottoman, ce qui explique l’inquiétude de la Turquie. Dans ce contexte, la France ne doit-elle pas réexaminer sa position au sujet de l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne ?
M. Jean-Michel Boucheron. Je ne partage pas l’analyse selon laquelle la communauté internationale ne faisant rien, le carnage va continuer en Syrie : je suis certain que, par un jeu de dominos, le lendemain de la chute de Kadhafi, Bachar el-Assad sera contraint de lâcher du lest. D’une manière générale, c’est, me semble-t-il, faire fausse route que d’agréger les révoltes arabes – qui sont des révolutions populaires liées à la diffusion des nouveaux moyens de télécommunications face auxquels les dictatures sont impuissantes – et des considérations géopolitiques qui ne leur sont aucunement liées.
M. Jean-Jacques Guillet. Je partage le point de vue de M. Boucheron. Il nous a été dit que le régime n’est pas réformable. Le paradoxe, c’est que depuis quelques années, nous faisions comme s’il l’était. La doctrine française était que si l’on s’ouvrait à la Syrie, des réformes y auraient lieu, et nous avons manifesté une très grande confiance en M. el-Assad pour agir en ce sens, ce pourquoi, depuis 2008, M. Sarkozy a noué des relations personnelles avec le président syrien. Qu’en penser, à la lumière des événements intervenus depuis lors ?
Alors qu’aucun incident n’avait eu lieu sur la ligne d’armistice du Golan depuis 1974, il y en a eu un tout récemment. Je considère qu’il a été provoqué pour faire pression sur Israël – et indirectement sur les États-Unis – pour faire comprendre que l’équilibre trouvé depuis 1974 était satisfaisant et que mieux valait donc ne pas pousser au changement de régime ; certains y ont vu la main de l’Iran. Qu’en pensez-vous ?
Les États-Unis ont un ambassadeur en Syrie depuis janvier dernier seulement, le poste ayant été laissé longtemps vacant. Le récent discours du président Obama sur le Moyen-Orient a relativement déçu ; la politique américaine se limite-t-elle à suivre la politique européenne et notamment la politique française sur ces questions ?
M. Patrice Paoli. Sans prétendre savoir exactement comment évoluera la situation en Syrie, je vous ai livré nos clés d’analyse, en vous disant d’emblée que nous considérions les soulèvements en cours comme des révolutions citoyennes irréversibles. La Libye est effectivement un facteur clé, et le renversement de M. Kadhafi changerait complètement la donne dans la région.
M. Jacques Myard. Oui, mais en Libye, nous avons tapé, et tapé fort. Qui tapera sur le régime syrien ?
M. Patrice Paoli. Nous renforçons les pressions sur la Syrie, dans la mesure où nous pouvons le faire.
A propos des chrétiens, nous ne sommes pas « optimistes » : nous disons qu’ils ont été protégés par le régime syrien dans le cadre d’un pacte fallacieux, la politique du régime ayant dans le même temps conduit au développement des courants islamistes à travers le pays. Nous savons que les chrétiens de la région perçoivent comme une menace la montée du salafisme et nous en tenons compte. Nous n’ignorons pas qu’ils émigrent en masse, singulièrement depuis l’Irak où la violence à leur encontre s’est exercée de manière spectaculaire. Mais nous devons dans le même temps ne pas encourager le départ des chrétiens, qui vivaient dans ces pays bien avant tous les autres. Un très difficile équilibre est à trouver, notamment dans le cas de l’Irak – car si des chrétiens sont menacés, il faut les protéger -, mais il faut garder le sens des proportions.
Je ferai l’impasse sur l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne, question qui n’est pas de mon ressort. Je dirai seulement que la Turquie veut la stabilité, mais que cet impératif de stabilité ne passe pas obligatoirement par une perpétuation des régimes en place dans les pays voisins.
La politique française à l’égard de la Syrie n’était pas fondée sur une « grande confiance » quant à la mise en œuvre de réformes. En Syrie comme en Égypte et en Tunisie, nous avions misé sur une sorte de « transition permanente » décrite dans nombre d’ouvrages savants, avec son lot d’avancées et de reculs. La donne a maintenant changé en Égypte et en Tunisie, dont les représentants seront invités au G8 : un mouvement d’espoir s’est levé, et ce serait faillir à nos responsabilités que ne pas le soutenir collectivement. L’Union européenne doit pour sa part mettre en œuvre une politique méditerranéenne d’accompagnement de la transition – sachant que si cette transition échoue, notre sécurité sera menacée.
L’administration Obama s’est mobilisée dès la première semaine de son mandat en faveur de la reprise de processus de paix au Proche-Orient, mais cette mobilisation s’est malheureusement traduite par un échec. Mais après le bon discours du président Obama, qui ouvre des perspectives, l’heure est venue de rebattre les cartes.
Mme Élizabeth Picard. Espérons que Kadhafi tombe bientôt, car pour l’instant « l’effet libyen » est plutôt contraire : la clique au pouvoir en Syrie est encline à montrer les dents pour que de tels événements ne se produisent pas dans le pays.
Vous m’aviez interrogée sur ce que la population insurgée attend de l’étranger. Les manifestants ne réclament pas des armes, car il y aurait alors un pourrissement de la situation qui ternirait leur image, mais un soutien moral et des prises de position au nom du droit international et du respect des droits de l’homme, pour exercer une pression continue sur le régime syrien. Une intervention armée serait un désastre pour le soulèvement syrien.
La manifestation qui a eu lieu le 15 mai sur la ligne d’armistice du Golan n’avait rien de spontané et elle s’est terminée de manière tragique, vingt des Palestiniens amenés en autobus pour entrer sur le territoire du Golan occupé ayant été tués – le tout à des fins de politique intérieure. Profitant de l’évolution en cours dans la région sur la question palestinienne, le régime a tenté de se poser à nouveau, sur la scène intérieure, en militant de la restitution des territoires du Golan, d’une manière à la fois cruelle et inutile.
Depuis deux siècles, des phénomènes démographiques, socio-économiques et culturels poussent les chrétiens du Proche-Orient arabe à émigrer. En Syrie, je le redis, la variété des situations est très grande et, notamment au Nord du pays, des chrétiens ont excellemment profité de l’ouverture économique. Étant donné la situation économique actuelle de l’Europe, ceux-là se disent de plus en plus qu’ils feraient mieux de chercher à rester enracinés dans leur pays, la Syrie, plutôt que de risquer l’émigration catastrophique dans les pays occidentaux qu’ont connue tant de chrétiens irakiens.
Enfin, nous devons prêter une oreille pareillement attentive à toutes les composantes de la société syrienne, par exemple aux militants sunnites traditionnels, conservateurs, religieux et pas particulièrement insurgés, qui ont été systématiquement pourchassés, emprisonnés, torturés, exilés, exclus par le régime de la famille el-Assad depuis une trentaine d’années. Tous les Syriens ont également droit à la dignité et à la liberté. Tel est le message que nous devons adresser, très fermement, au pouvoir actuel, qui est un pouvoir minoritaire.
M. le président Axel Poniatowski. Madame, Monsieur, je vous remercie.
13.- Mardi 7 juin 2011, séance de 17 heures, compte rendu n° 67 : audition de M. Mounir Fakhry Abdel Nour, ministre du tourisme de la République arabe d’Egypte
Mme Martine Aurillac, présidente. Nous avons le grand plaisir d’accueillir M. Mounir Abdel Nour, ministre du tourisme égyptien, que je remercie d’avoir accepté notre invitation. Vous êtes, monsieur le ministre, l’un des responsables du parti laïque et libéral Al Wafd, l’un des plus anciens partis politiques d’Égypte, et vous avez été nommé à un poste clé pour l’économie égyptienne dès le mois de février en tant que l’une des figures de l’opposition à l’ancien régime. Votre témoignage nous intéresse aussi, même si là n’est pas l’essentiel, parce que vous êtes de confession copte.
Sur le volet politique tout d’abord, nous souhaitons vous entendre faire le point sur le rythme et les modalités de la transition. Une frange de la population s’impatiente et réclame le retour rapide à un pouvoir civil, le renvoi des responsables de l’ancien régime toujours en place et l’arrestation des personnalités coupables de corruption ou de violences. D’autres estiment que les échéances électorales, législatives en septembre puis présidentielle d’ici la fin de l’année, ne permettront sans doute pas au paysage politique de se recomposer.
Sur le volet économique, votre ministère est directement concerné par les engagements pris il y a dix jours par le G8 lors de son sommet de Deauville. Selon vos estimations, l’Égypte a perdu 2,27 milliards de dollars de recettes touristiques depuis fin janvier. Les moyens mobilisés par la communauté internationale – plus de 20 milliards de dollars pour la Tunisie et l’Égypte -, doivent aussi permettre l’application à moyen terme de réformes profondes, renforçant l’intégration économique en faveur d’une croissance plus équitable et créatrice d’emplois. Cet effort vous paraît-il à la hauteur des attentes ? Quelles sont vos priorités dans l’utilisation des moyens mobilisés ?
Enfin, l’Égypte joue un rôle actif au Proche-Orient, avec une nette inflexion de sa politique étrangère qui s’est traduite notamment par la signature au Caire de l’accord de réconciliation entre le Hamas et le Fatah et la réouverture du point de passage de Rafah. La France a proposé la tenue à Paris d’une conférence en juillet pour relancer le processus de paix israélo-palestinien. Comment le gouvernement égyptien conçoit-il une telle relance ?
M. Mounir Fakhry Abdel Nour, ministre du tourisme de la République arabe d’Égypte. C’est un grand honneur pour moi d’être parmi vous. Je suis à Paris pour donner un coup de pouce au tourisme vers l’Égypte, dont je me félicite qu’il ait déjà repris. Le fait que les voyageurs reviennent vers nos plages et vers la vallée du Nil nous réconforte car le tourisme est l’un des piliers de notre économie : c’est notre principale source de revenus en devises, il représentait l’année dernière 11,5 % de notre PIB et un travailleur égyptien sur sept dépend directement ou indirectement de cette industrie.
La période de transition nous place dans une situation difficile : il nous faut en effet résoudre les problèmes économiques et sociaux que connaît le pays afin que la transition elle-même se fasse sans surprises et sans accidents. Le calendrier de la transition, tel que proposé par le Conseil suprême des forces armées, prévoit la tenue d’élections législatives en septembre prochain puis l’élection présidentielle, en décembre 2011 ou en janvier 2012 au plus tard. Ces deux élections seraient suivies de la promulgation de la nouvelle constitution rédigée par une Assemblée constituante composée de cent parlementaires. Le maréchal Mohammed Hussein Tantaoui, qui est à la tête du Conseil suprême des forces armées, insiste pour que ce calendrier soit respecté, en dépit du grand débat qui anime l’Égypte à ce sujet.
Le débat porte sur deux questions, et en premier lieu sur le calendrier lui-même. Certains s’interrogent sur la brièveté des délais prévus et singulièrement sur le bien-fondé d’élections législatives dès septembre ; ils proposent de reporter ces élections à une date ultérieure, non définie. Les avantages et les inconvénients des deux options sont évidents. Organiser des élections en septembre présente l’avantage de mettre l’Égypte en mesure de construire le plus vite possible un État de droit où se déroulera une vie normale et d’éviter les problèmes économiques qui risquent de se poser si l’incertitude politique demeure : ne pas savoir de quelle tendance sera la future majorité peut retarder les décisions des investisseurs, de quelque nationalité qu’ils soient. Le report des élections législatives a pour avantage de donner aux nouveaux partis politiques issus de la révolution du 25 janvier le temps de formuler leur programme d’action et de constituer la base populaire qui leur servira d’assise électorale. Le Conseil suprême des forces armées insiste pour céder le pouvoir le plus tôt possible à un gouvernement civil librement élu ; je crois en la sincérité des militaires, dont je pense qu’ils veulent effectivement se défaire dans les meilleurs délais d’un pouvoir qui leur est échu sans qu’ils aient vraiment voulu le prendre.
Le débat fait aussi rage sur l’ordonnancement proposé. Certains pensent en effet qu’il conviendrait de l’inverser, et de commencer par définir quel régime – présidentiel ou parlementaire – adoptera le nouvel État et quel doit être le rôle du président qui sera élu : un arbitre entre les différents pouvoirs ou la tête de l’exécutif ? Ceux-là considèrent qu’il faut commencer par adopter une nouvelle constitution avant de procéder aux élections.
Dans le débat qui bat son plein, les libéraux demandent le report des élections législatives à une date qu’ils souhaitent la plus lointaine possible ; en revanche, les partis politiques organisés – en l’occurrence les Frères musulmans – insistent pour voir le calendrier proposé par le Conseil suprême des forces armées maintenu. Mais qu’en est-il de la jeunesse qui a mené la révolution, réussissant là où les partis politiques égyptiens ont échoué au cours des trente dernières années ? Les jeunes sont pressés de parvenir à leurs fins : ils veulent que les élections se tiennent au plus vite, que tous les collaborateurs du régime précédent soient renvoyés et que toute personne accusée, à tort ou à raison, de corruption, soit conduite devant les tribunaux pour y être jugée. À moins de 130 jours du tremblement de terre politique qui a secoué l’Égypte, ce débat démocratique est sain. J’espère que les forces majoritaires du pays sauront s’imposer pour trancher.
L’Égypte connaît des difficultés économiques certaines. Mercredi dernier, le Conseil des ministres a approuvé un budget qui prévoit un déficit effrayant d’un peu plus de 10 % du PIB. C’est que le gouvernement a dû prendre des mesures propres à répondre aux attentes de l’opinion publique, notamment pour améliorer les services publics dont la qualité s’est dégradée à vue d’œil au cours des cinq dernières années, en dépit d’un taux de croissance annuel moyen de 7 % et de l’augmentation continue des réserves en devises étrangères. La mauvaise distribution des revenus et la tout aussi mauvaise répartition de la dépense publique ont fait que l’instruction publique, l’Université, la santé, le logement et les transports sont défaillants. Aussi, pour répondre aux attentes de la jeunesse et de ceux qui ont fait la révolution précisément à cause de ces déficiences, le budget adopté la semaine dernière prévoit de consacrer 30 milliards de livres égyptiennes, par tiers, à l’instruction publique, à la santé et au logement.
L’Égypte est en passe d’obtenir des prêts du Fonds monétaire international, de l’Arabie saoudite et du Qatar pour combler le déficit qui se creuse. Mais notre objectif n’est pas seulement celui-là. Notre vrai défi est de construire l’Égypte de demain et, pour cela, de gagner la confiance des investisseurs égyptiens, arabes et d’autres pays, de manière que l’économie égyptienne puisse absorber les 750 000 jeunes qui frappent chaque année à la porte du marché du travail. Malheureusement, le taux d’investissement local n’y suffit aucunement. C’est pourquoi nous devons ouvrir de nouveaux marchés aux exportations égyptiennes et augmenter notre production – et ainsi les possibilités de créations d’emplois. Ce défi considérable concerne, au-delà de l’Égypte, toute la région et l’entier pourtour de la Méditerranée. En effet, la sécurité des pays riverains du Nord de la Méditerranée dépend de la stabilité économique des pays du Sud. Nous devons donc essayer de résoudre ces problèmes la main dans la main, dans les plus brefs délais.
Vous m’avez interrogé sur la politique de l’Égypte concernant le Moyen-Orient. Le vent de fronde souffle très fort sur les pays de la région. En Libye, heureusement, le régime de M. Kadhafi vit ses derniers moments et il en est probablement de même au Yémen. Mais l’histoire ne s’arrêtera pas là, car la jeunesse arabe aspire partout à la démocratie et au respect des droits de l’homme ; le mouvement né en Tunisie continuera d’inspirer les jeunes partout dans la région. Des changements profonds sont donc en gestation et il faut aider les pays du monde arabe à réussir des transitions dont l’échec serait dangereux pour tous.
Je suis optimiste pour l’Égypte, qui offre des opportunités économiques extraordinaires. Je suis convaincu que le tourisme va reprendre car le marché mondial ne peut se déprendre d’un pays qui offre à lui seul ce que très peu d’autres pays peuvent offrir en même temps : le tourisme culturel, le tourisme balnéaire, le tourisme d’aventures dans le désert… Et tant de lieux demeurent encore inexplorés en Égypte que beaucoup reste à faire.
Sur le plan économique, l’Égypte, avec ses 85 millions d’habitants – qui seront bientôt 100 millions –, devrait attirer les investisseurs intéressés dans tous les secteurs : l’industrie, l’agriculture, l’industrie agroalimentaire, le tourisme et les services financiers. C’est d’évidence un marché obligé pour ceux qui s’intéressent au monde arabe. Voilà pourquoi je suis optimiste quant à l’avenir de l’Égypte, à court et à moyen terme. Permettez-moi enfin de rappeler les liens affectifs historiques qui unissent la France et l’Égypte. L’Égypte a besoin de la France sur le plan politique et sur le plan économique. Nous comptons sur votre soutien.
Mme Martine Aurillac, présidente. Monsieur le ministre, je vous remercie, et je vous sais gré d’avoir accepté de répondre à nos questions. La situation des coptes nous préoccupe, notamment après le dernier attentat qui a fait vingt-et-un morts. Comment évaluez-vous les risques qui pèsent sur cette minorité ? Par ailleurs, quel rôle l’Égypte peut-elle jouer dans le processus de paix entre Israël et la Palestine ?
M. Hervé Gaymard. C’est en ma qualité de président du groupe d’amitié France-Égypte que j’ai le plaisir de vous interroger. Selon quel système électoral les futurs députés égyptiens seront-ils élus ? Par ailleurs, quelle devrait être, selon vous, la mission du parti Wafd dans l’Égypte nouvelle ?
M. Jean-Marc Roubaud. Je me réjouis que le G8 réuni à Deauville par la présidence française ait pris d’importantes décisions en faveur de l’Égypte et de la Tunisie. Les aides qui vont vous être accordées et les réserves en devises que vous avez mentionnées permettront-elles à l’économie égyptienne de se reprendre rapidement ? D’autre part, vous avez dit souhaiter une transition « sans surprises et sans accidents » ; à ce sujet, le report des élections législatives ne conduirait-il pas à une instabilité persistante ?
M. Michel Terrot. Je vous remercie, monsieur le ministre, pour cet exposé prononcé dans un français parfait. Le parti des Frères musulmans, qui vient d’être légalisé, pourra présenter les candidats aux prochaines élections. Mais, alors que Liberté et justice se décrit comme un parti non théocratique, une figure de premier plan de ce mouvement a récemment déclaré que le parti maintenait son opposition à l’éligibilité des chrétiens et des femmes à la présidence de la République égyptienne ; qu’en pensez-vous ? Ce parti a-t-il formulé d’autres discriminations à l’égard des chrétiens et des femmes ?
M. Mounir Fakhry Abdel Nour. Des heurts interconfessionnels se sont effectivement produits, souvent méchants ; chacun a en mémoire l’attentat commis devant une église copte d’Alexandrie dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier dernier. Mais, outre que je vois dans cet événement l’une des raisons principales de ce qui s’est produit le 25 janvier, je considère que ces affrontements meurtriers ont aussi eu des retombées positives. En premier lieu, ils ont permis d’aborder de front la question confessionnelle, un tabou qui jusqu’alors n’était jamais évoqué franchement. Aujourd’hui, on en parle ; or, le premier pas vers la solution d’un problème, c’est la reconnaissance qu’il existe. C’est fait, et l’on s’efforce désormais de le résoudre.
La deuxième conséquence positive, c’est que ces confrontations violentes ont poussé les coptes à sortir des églises et à agir en citoyens. Avant le 1er janvier 2011, les coptes, lorsqu’ils manifestaient, le faisaient « en coptes », c’est-à-dire devant une cathédrale ou une église, jamais devant le Parlement ou la présidence de la République. À présent, ils manifestent dans les rues et commencent à participer à la vie sociale et politique du pays ; je m’en félicite.
La troisième retombée positive de ce qui s’est passé, c’est que demain, le 8 juin, le conseil des ministres adoptera un texte régissant la construction de tous les lieux de culte en Égypte. On parlait de cette loi depuis une quinzaine d’années mais, sous le régime précédent, il était pratiquement inconcevable qu’une loi soit adoptée un jour par laquelle le permis de construire une mosquée, une église ou un temple serait accordé selon des critères uniformes. Cette loi sera promulguée demain, et c’est un progrès considérable.
Enfin, l’église d’Imbaba, brûlée il y a un mois au cours de heurts interconfessionnels, a été restaurée dans des délais record et de la plus belle manière. Elle sera officiellement inaugurée ce soir : une messe y sera dite en présence du Premier ministre et de deux ministres. C’est un message très fort, qui confirme la volonté du gouvernement de mettre l’accent sur l’égalité entre les citoyens égyptiens indépendamment de leur appartenance confessionnelle.
Certes, les coptes s’inquiètent de la montée des extrémismes et de la force des Frères musulmans sur l’échiquier politique égyptien. Ils ont raison d’avoir peur, et ils ne sont pas les seuls : comme s’inquiètent tous ceux qui croient au principe de l’égalité des citoyens devant la loi. De fait, les Frères musulmans disent tout et son contraire : par exemple qu’ils sont favorables à un État civil – sans pour autant le définir – et à l’égalité entre les citoyens mais, dans le même temps, certains d’entre eux se disent contre l’octroi de droits aux femmes et aux non-musulmans. À titre personnel, je considère que ce double langage constant découle d’une règle érigée en principe par Hassan al-Banna, le fondateur des Frères musulmans, qui a encouragé ses partisans à mentir pour préserver leurs intérêts politiques, économiques ou sociaux. Le point de vue que j’exprime ainsi n’est pas nécessairement celui de l’ensemble du gouvernement auquel j’appartiens, mais c’est celui de tout libéral égyptien, de toute personne croyant aux valeurs d’une citoyenneté caractérisée par des droits égaux pour tous.
L’Égypte, qui a signé le traité de paix, qui respectera ses engagements internationaux et qui a tout intérêt à voir la paix régner à ses frontières de l’Est, de l’Ouest et du Sud, entend continuer de jouer un rôle de médiateur entre la Palestine et Israël. Elle continuera de promouvoir la paix au Moyen-Orient.
Pour ce qui est des relations égypto-israéliennes, je tiens à souligner que quand il a été question de « normalisation », l’objectif était d’établir avec Israël des relations normales et non pas des relations privilégiées. Aussi longtemps qu’Israël ne sera pas promoteur de la paix dans la région, il ne devrait pas profiter d’un traitement préférentiel. Je le dis de la manière la plus catégorique : les Israéliens doivent en finir avec le double langage.
Le Conseil suprême des forces armées a proposé un système électoral mixte, mais la question n’est pas encore tranchée. Un tiers des députés serait élu à la proportionnelle et deux tiers par des élections individuelles directes, ou l’inverse ; le débat reste ouvert. Beaucoup pensent que la proportionnelle bénéficiera aux nouveaux partis politiques. C’est vrai en théorie mais je ne suis pas certain que cela se réalise dans les faits. L’Égypte a usé par deux fois de la proportionnelle, en 1984 et en 1987. Pour avoir personnellement participé à ces élections, je sais qu’il est très difficile de constituer une liste électorale, surtout quand sont en lice des partis naissants, sans chef dont l’emprise soit telle qu’elle lui permette de prendre des décisions qui seront toutes acceptées par la base. Les nouveaux partis égyptiens n’étant pas bien structurés, je ne vois pas comment ils pourraient établir des listes électorales acceptées par leurs membres respectifs.
J’ai été secrétaire général du parti Wafd jusqu’à mon entrée au ministère, auquel je consacre à présent tout mon temps. Je pense que le Wafd a rendez-vous avec l’Histoire, à condition qu’il parvienne à réunir tous les partis libéraux qui sont en train de se créer en Égypte pour constituer un front uni contre le défi – ou le danger – que représentent les Frères musulmans. J’espère que le Wafd ne ratera pas ce rendez-vous.
Les réserves de l’Égypte, qui s’élevaient à l’équivalent de 32 milliards de dollars le 25 janvier 2011, ne sont plus que de 26 milliards. Elles s’épuisent donc rapidement, parce que nous devons combler le très fort déficit de la balance commerciale et aussi le déficit budgétaire, qui croît pour les raisons dites. Les réserves dont nous disposons encore et les aides que nous sommes en train de recevoir seront-elles suffisantes pour nous permettre de remonter la pente ? Tout dépendra de notre capacité à convaincre les investisseurs et à gagner la confiance des pays fournisseurs et de ceux qui importent des produits égyptiens.
Je ne suis pas contre la tenue d’élections législatives en septembre, car je pense que la force des Frères musulmans est surfaite. J’espère ne pas être trop optimiste. Il n’y a pas eu d’élections libres en Égypte depuis plus de cinquante ans, non plus que d’enquêtes d’opinions faites sur des bases correctes, mais mon estimation, toute personnelle qu’elle soit, est celle d’un homme averti : en ma qualité d’ancien secrétaire général d’un parti politique, ayant moi-même participé à de nombreuses élections législatives au Caire et en Haute Égypte, je crois connaître le paysage et les clivages politiques de mon pays et je pense que les Frères musulmans ne représentent pas plus d’un quart de l’échiquier politique égyptien. Encore faut-il toutefois que face à eux s’établisse un front commun uni et capable de former un gouvernement qui aura l’approbation du Parlement. Voilà pourquoi je préfère que l’Égypte soit rapidement en mesure de bénéficier d’un système politique stable. Notre but, je le répète, est d’instituer un État démocratique, laïque, juste et moderne.
M. François Rochebloine. Le retour des touristes est-il réellement perceptible ? Par ailleurs, vous avez souligné les aspects positifs des mutations en cours, mais la situation de la population chrétienne d’Égypte n’en demeure-t-elle pas quelque peu inquiétante ? S’agissant de la Bande de Gaza, je me réjouis que l’Égypte ait rouvert le passage de Rafah ; pensez-vous aller plus loin pour aider la population de cette partie des territoires palestiniens à vivre plus normalement ? Enfin, quel est votre sentiment sur la situation en Libye ?
M. Jean-Claude Guibal. Alors que, au cours de la dernière décennie, le monde arabe s’est principalement manifesté sur la scène internationale par l’action d’intégristes, des révolutions s’y déroulent soudainement. Comment expliquez-vous leur simultanéité ? Que signifient-elles ? Est-ce une façon, pour le monde arabe de s’adapter au monde après avoir tenté d’exister par une forme d’intégrisme subversif ? Pensez-vous que l’Union pour la Méditerranée peut aider les pays du Sud de la Méditerranée à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés ? Dans un autre domaine, qui élaborera la nouvelle constitution ? Je suppose enfin que la découverte de nouvelles pyramides est un atout pour l’Égypte.
M. Jean-Pierre Dufau. Pendant cinquante ans, les présidents qui se sont succédé ont marqué l’Egypte. Le calendrier proposé par le Conseil suprême des forces armées prévoit l’organisation d’élections législatives, puis l’élection présidentielle. L’ordre choisi tend-il à signifier la prééminence du législatif sur l’exécutif ? Par ailleurs, le président sera-t-il élu au suffrage universel ?
M. Rudy Salles. Vous avez soutenu le rapprochement entre le Hamas et le Fatah, et vous nous dites que l’Égypte veut continuer de tenir une position équilibrée au Moyen-Orient, cette position si utile pour permettre un dialogue entre Israël et la Palestine et trouver une solution. Faites-vous alors pression sur le Hamas pour qu’il reconnaisse les propositions du Quartet – l’arrêt de la violence, la reconnaissance d’Israël et celle des accords passés par l’Autorité palestinienne?
M. Didier Julia. Le tourisme ne fournit de travail qu’à un Égyptien sur sept. Pour absorber le grand nombre de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail, dans quels secteurs précis pensez-vous que l’on puisse développer l’économie égyptienne ? Miserez-vous sur l’agriculture, comme la Tunisie, ou avez-vous une préférence pour la transformation de produits agricoles ou pour certains secteurs industriels ?
Mme Marie-Louise Fort. Comment jugez-vous le rôle que peut jouer la Turquie, soit comme modèle pour les révolutions, soit comme acteur majeur de la résolution des problèmes du Moyen-Orient ?
M. Mounir Fakhry Abdel Nour. Le tourisme reprend effectivement : nous étions à moins 80 % en février, moins 60 % en mars et moins 35 % en avril. La courbe est donc ascendante. Lorsque je suis arrivé au ministère, le 21 février dernier, la très grande majorité des gouvernements du monde déconseillaient formellement à leurs ressortissants de se rendre en Égypte ; maintenant, ils les y encouragent. Je tiens à souligner que la sécurité, en Égypte, est totale. Malheureusement, cela n’est pas clairement perçu, alors même que, depuis le 25 janvier, pas un seul touriste n’a connu le moindre incident. La saison d’été sera ce qu’elle sera – l’été n’a jamais été le point fort du tourisme en Égypte – mais nous savons déjà que les Russes, les Ukrainiens, les Allemands et les Britanniques continueront de venir. De même, les ressortissants de certains pays arabes – Jordaniens, Koweïtiens et Saoudiens par exemple – viendront en force. Comme je vous l’ai dit, je vois l’avenir avec optimisme. L’année dernière, l’Égypte a accueilli 14,8 millions de touristes. Pour 2011, mes estimations, qui peuvent paraître ambitieuses, me font tabler sur 10,5 millions de touristes et peut-être 11 millions, ce qui n’est pas mal, compte tenu des pertes que nous avons enregistrées en début d’année.
Je reviens sur la situation des coptes. Il y avait un abcès ; cet abcès a été crevé, c’est déjà ça. Le problème est maintenant reconnu et débattu, et nous trouverons une solution à l’intérieur de la famille égyptienne. Coptes et musulmans ont vécu ensemble dans la paix pendant quatorze siècles ; ils vivront dans la paix quatorze autres siècles ! Je sais, pour avoir lu la presse française et européenne, l’intérêt que vous portez aux chrétiens du Moyen-Orient. Vous avez raison de vous intéresser à ce problème déchirant, à la situation des chrétiens d’Irak, de Palestine, du Liban et aussi de Syrie – un pays dans lequel ils sont passés, en peu d’années, de 26 % de la population à 8 % à peine, si forte a été l’émigration. Mais je ne pense pas qu’il faille mettre sur le même plan les chrétiens du Moyen-Orient et les coptes d’Égypte. Ces derniers sont pour la plupart des paysans, de ces fellahs qui n’émigreront jamais car ils resteront attachés à leur paroisse, à leur pope, celui dont ils baisent la main et qui est leur maître à penser.
Vous m’avez interrogé sur la politique de l’Égypte à propos de la Bande de Gaza. Permettez-moi de souligner que l’on ne fait pas la paix dans la misère. Il faut donc résoudre les problèmes économiques que connaissent tant les Palestiniens que les autres peuples de la région. Je reviens un instant sur les heurts interconfessionnels dont nous avons parlé : ils ont eu lieu à Imbaba, un quartier pauvre du Caire dans lequel les services publics sont pratiquement inexistants, et dans le village de Soul, où règnent la pauvreté et l’ignorance. Je le redis, on ne rapproche ni les peuples ni les citoyens de confessions différentes dans la misère.
En Libye, nous espérons un changement. Il faut que Kadhafi s’en aille !
J’ai entendu dire que le monde arabe serait intégriste. N’est-ce pas là une généralisation abusive ? Que l’on veuille bien penser au Maroc, au Liban ou à la Syrie : on peut parler de manque de démocratie, parfois de dictature, mais pas d’intégrisme !
M. Jean-Claude Guibal. Je me suis mal exprimé. Je m’interrogeais sur les raisons du basculement soudain du monde arabo-musulman dans la révolution.
M. Mounir Fakhry Abdel Nour. Je citerai à ce sujet le journaliste Thomas Friedman, selon lequel la montée des révolutions arabes a signé la première mort de Ben Laden. Les aspirations à des régimes démocratiques respectueux des droits de l’homme sont en train de mettre fin à la distinction entre le monde arabe et le reste du monde, vous avez raison. C’est d’ailleurs pourquoi nous n’avons pas encore vu la fin de l’histoire : le vent qui s’est levé est très fort et il soufflera très loin.
M. Jean-Claude Guibal. Comment expliquer la simultanéité des mouvements révolutionnaires ?
M. Mounir Fakhry Abdel Nour. Parce qu’il y a eu tache d’huile. Je ne suis pas panarabiste, mais le fait est que le monde arabe est culturellement uni. Nous dialoguons de pays à pays, nous lisons la même presse et nous suivons les informations sur les mêmes médias. De ce fait, nous nous influençons très rapidement. Je puis d’ailleurs vous dire que de nombreux régimes arabes ne considèrent pas d’un bon œil ce qui s’est passé en Égypte ; ils nous aident parce qu’il le faut, mais je ne pense pas que tous le fassent de bon cœur…
S’agissant de la Méditerranée, vous devez comprendre que nous sommes tous partenaires. Ce disant, je ne cherche pas à vous rendre responsables de quelque chose, je me limite à décrire la situation telle qu’elle est. Si l’ordre et la stabilité sociale, économique et politique ne sont pas établis dans les pays du Sud de la Méditerranée, votre sécurité n’est pas assurée. Nous devons donc œuvrer ensemble pour résoudre les problèmes économiques que connaissent les pays du Sud car, je le redis, on ne fait pas la paix dans la misère. L’Union de la Méditerranée est une idée ingénieuse, mais elle n’aboutira que si l’on trouve une solution au problème israélo-arabe.
Le Conseil suprême des forces armées a proposé que la nouvelle constitution soit élaborée par une Assemblée constituante composée de cent députés. Il ne s’agit pour l’instant que d’une proposition et, quelle que soit la composition de l’Assemblée constituante, la nouvelle constitution sera soumise à référendum.
Toute nouvelle découverte d’une pyramide est un atout pour le tourisme égyptien. En Égypte, partout où l’on creuse, on découvre un trésor. À ce jour, nous n’avons pas dû découvrir plus du quart du patrimoine archéologique que nous ont laissé les pharaons. Nous devons continuer de creuser, et nous le ferons.
Si le calendrier de transition proposé par le Conseil suprême des forces armées place les élections législatives avant l’élection présidentielle, c’est pour donner plus de sens à la démocratie, plus de pouvoir à l’homme de la rue, et lui faire comprendre qu’il est devenu un acteur de la vie politique égyptienne – pour mettre fin, en bref, au « complexe de pharaon ».
M. Jean-Pierre Dufau. Il s’agira donc d’un régime parlementaire plutôt que d’un régime présidentiel.
M. Mounir Fakhry Abdel Nour. C’est possible, et j’y suis favorable, mais je ne saurais dire à ce stade si c’est ce à quoi nous parviendrons. Faire des pressions sur le Hamas ? Oui, mais il faut aussi faire pression sur Israël, que l’on aimerait entendre répondre positivement aux demandes faites par le président Obama. Si l’on veut la paix, les deux parties doivent mettre de l’eau dans leur vin ; si l’on ne trouve pas de compromis, la paix ne sera pas durable. Point n’est besoin de vous rappeler les conséquences d’une paix injuste : le Traité de Versailles a-t-il duré beaucoup plus longtemps que ce que durent les roses ?
Tous les secteurs économiques peuvent être développés en Égypte, qui comptera demain 100 millions d’habitants, un pays riche de son agriculture, de sa capacité de transformation des produits agroalimentaires, de ses réserves de pétrole, de gaz et de minerais inexploités, de son potentiel touristique. L’Égypte a malheureusement été mal gérée. Serait-elle bien gérée qu’elle s’en sortirait très facilement, j’en suis persuadé.
À propos de la Turquie, je commencerai par souligner qu’il existe une très grande différence entre le parti politique de M. Erdogan, qui se veut « islamiste islamisant », et les autres partis de ce type dans le monde arabe. La Turquie a eu une pratique réelle de la laïcité pendant soixante années de kémalisme et cette laïcité est ancrée dans la Turquie d’aujourd’hui. Ce n’est pas le cas ailleurs ; par exemple, il en va très différemment avec les Frères musulmans en Égypte. La Turquie, qui est en train de s’imposer comme force régionale économique et militaire, peut jouer un rôle dans la région, comme elle l’a déjà fait. Elle se voit rejetée par l’Union européenne et elle cherche une autre voie. La Turquie peut regarder vers le Nord et jouer un rôle dans les républiques islamistes d’Asie ; elle peut aussi jouer un rôle au Moyen-Orient. Je vois d’un bon œil la coopération entre l’Égypte et la Turquie pour maintenir un équilibre économique et modérateur au Moyen-Orient.
Mme Martine Aurillac, présidente. Je vous remercie vivement, monsieur le ministre, pour ces propos sincères et optimistes et je vous dis les vœux que nous formons pour votre pays que nous aimons.
14.- Mercredi 15 juin 2011, séance de 16 heures 45, compte rendu n° 71 : audition, commune avec la commission des affaires européennes, de M. Laurent Wauquiez, ministre auprès du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, en charge des affaires européennes, sur le partenariat euroméditerranéen (ouverte à la presse)
M. le président Axel Poniatowski. Nous avons le plaisir d’accueillir M. Laurent Wauquiez, ministre auprès du ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes, chargé des affaires européennes, pour cette audition consacrée à la politique méditerranéenne de l’Union européenne.
Celle-ci a engagé la redéfinition de sa politique de voisinage avec les pays méditerranéens, dans le sens d’une conditionnalité de l’assistance aux avancées de la transition démocratique, avec des stratégies différenciées en fonction des situations particulières à chaque pays.
Je souhaiterais, monsieur le ministre, que vous nous présentiez les décisions prises tout récemment à cet égard. Comment cette redéfinition de la politique de voisinage est-elle appréhendée par nos partenaires européens, dont certains semblent redouter que le partenariat oriental n’en fasse les frais et insistent sur la nécessité de maintenir – et même d’accroître – les moyens consacrés à l’Est de l’Europe ?
Si l’on ajoute à cela une situation économique et budgétaire peu propice à des politiques dispendieuses, comment évolueront, selon vous, les discussions au sein de l’Union ?
M. Pierre Lequiller, président de la commission des affaires européennes. Il semble que le rapport de deux tiers à un tiers des moyens consacrés respectivement à la politique de voisinage au sud et à l’est de l’Union européenne fasse aujourd’hui l’objet de débats, la Commission européenne donnant le sentiment de vouloir revenir sur cette clé de répartition pour attribuer l’aide en fonction des progrès démocratiques. Cette conditionnalité ne risque-t-elle pas de fortement modifier l’équilibre entre les deux politiques de voisinage ? D’autre part, comment veiller à l’indispensable cohérence entre la conditionnalité à l’égard de la rive sud de la Méditerranée et les grands projets structurants de l’Union pour la Méditerranée (UpM) ?
M. Laurent Wauquiez, ministre auprès du ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes, chargé des affaires européennes. Si elle se justifie par les champs de compétence respectifs de vos deux commissions, l’organisation de cette audition commune me semble également très riche de sens, à un moment où cherche à s’affirmer une politique étrangère de l’Union, avec des avancées mais aussi des désillusions – et le sujet qui nous occupe est particulièrement bien choisi à cet égard. En effet, ce que nous voyons se faire devant nos yeux est l’Histoire même – ce qui rend d’ailleurs difficile d’en deviner les aboutissants et d’affirmer avec certitude que notre action est à la hauteur des enjeux. C’est là, pour des responsables politiques, une école de modestie.
Lorsqu’il est question de la Méditerranée, il ne faut jamais oublier la leçon de Fernand Braudel : la prospérité de l’Europe a systématiquement été liée à la richesse de sa relation avec la Méditerranée, en particulier avec sa rive sud.
Notre politique en la matière doit éviter autant la naïveté que le défaitisme. Lors du dernier sommet européen organisé au titre du Dialogue Europe-Asie (ASEM), j’ai mesuré à quel point, face à la défiance qu’éprouvent les pays d’Asie devant les révolutions arabes, dont ils peuvent redouter l’impact sur leurs régimes, l’Europe est porteuse d’un message optimiste. Ce message ne doit cependant pas être naïf, car la réussite d’une transition démocratique n’est jamais facile – que l’on songe aux balbutiements de la démocratie en France ou aux difficultés de l’instauration d’une démocratie constitutionnelle allemande après le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, en dépit de l’apport massif du Plan Marshall. Les révolutions arabes représentent donc à la fois une formidable chance et un formidable défi.
Ni l’Union européenne ni la France ne s’attendaient à ce qui s’est produit et la Révolution de jasmin a pris tout le monde par surprise. Cette surprise passée et quelles qu’aient été les premières réactions, l’Union européenne a eu une attitude dont elle n’a pas à rougir. Son action diplomatique n’est pas négative et a été très constante. Tout d’abord, elle a été la première à prendre des sanctions contre tous les régimes qui ont utilisé la violence contre leur population civile. Cette position, devenue la pierre de touche de notre attitude diplomatique, a été appliquée à la Tunisie, à l’Égypte et à la Libye et nous sommes les premiers à l’appliquer à la Syrie et au Yémen, en allant souvent au-delà des mesures restrictives décidées par les Nations unies – je pense en particulier à la désignation nominative du président Assad et de son entourage, qui font l’objet de sanctions très larges allant de l’interdiction de visa au gel des avoirs.
En deuxième lieu, l’Union européenne et la France continuent de maintenir une forte pression politique, notamment sur les régimes libyen et syrien. Je souligne à cet égard qu’il n’y a pas une unique révolution arabe, mais une diversité de pays cherchant chacun une voie différente. Au Maroc, la transition tente de s’inscrire le plus possible dans la continuité des réformes réalisées antérieurement. En Tunisie, la réforme a été portée par la détresse économique liée à l’explosion du coût des céréales. En Libye, les affrontements et les équilibres entre les différentes tribus ont considérablement contribué à l’affaissement du régime de Kadhafi. En Égypte, pays que je connais bien pour y avoir vécu à deux reprises, la révolution est venue de l’incapacité du régime à structurer les classes moyennes qui auraient assuré son efficacité et sa solidité. Soyons humbles dans notre diagnostic : il ne s’agit pas d’une révolution unique, mais de pays ayant des histoires différentes et voyant en même temps les contradictions qui sous-tendaient leur développement se tendre au-delà du supportable.
L’Europe est mobilisée dans la bataille engagée pour la Syrie au Conseil de sécurité des Nations unies et les deux autres membres européens du Conseil soutiennent la France et le Royaume-Uni pour permettre l’adoption d’une résolution à ce propos.
Enfin, l’Europe n’abandonne pas les populations affectées par ces mouvements de fond. Ainsi, je le rappelle, elle a été la première à organiser les opérations qui ont permis aux réfugiés égyptiens en Tunisie de regagner l’Égypte et aux Tunisiens qui avaient fui vers l’Égypte d’être rapatriés en Tunisie.
L’Europe a incontestablement été la première zone géopolitique à réagir et, bien que nous ayons été pris par surprise, nous n’avons pas, je le répète, à rougir de cette réponse, qui s’est élaborée à l’abri des compromissions.
Ces événements doivent nous amener à revoir en profondeur notre politique de voisinage. Ils nous donnent, en premier lieu, une leçon de modestie : ces pays se sont soulevés seuls et nous devons être attentifs à leurs priorités et à leurs attentes, pour nous efforcer de leur fournir les outils nécessaires, en évitant à tout prix de leur donner le sentiment que nous saurions mieux qu’eux ce qui leur convient. Il nous faut notamment contribuer à l’appropriation de cette révolution par la société civile, dans un processus de stabilisation progressive. À cet égard, nous assistons à une formidable libération de la parole dans la presse tunisienne, pour laquelle le moment est venu de domestiquer cette liberté. Il nous faut donc trouver comment l’aider à constituer des groupes de presse, à exercer un travail de critique et à prendre de la distance. L’attente et la demande sont fortes en la matière et nous devons être aux côtés des Tunisiens pour accompagner la transition démocratique.
Pour ce qui est des outils, nos moyens ne sont pas ceux dont a bénéficié la transition démocratique allemande avec le Plan Marshall. Le défi n’est pourtant pas impossible à relever si nous nous montrons quelque peu imaginatifs. Tout d’abord, il doit être clair – notamment face à la Pologne, qui va prochainement assurer la présidence de l’Union européenne – que le voisinage méditerranéen n’est pas en concurrence avec le partenariat oriental, car les deux relations ne sont pas de même nature. Mais, j’ai pu le constater la semaine dernière, nos interlocuteurs polonais ont évolué dans un sens très positif. Les tensions qui ont pu se faire sentir précédemment du fait d’intérêts géopolitiques perçus comme divergents sont désormais surmontées et, face à un enjeu historique, chacun comprend qu’il n’y a pas de place pour des querelles de chapelle. Il semble donc qu’émerge la conscience commune d’un intérêt général européen, qui est plutôt à l’honneur de la réflexion dont l’Europe est capable.
Nous sommes ainsi parvenus à maintenir inchangée la répartition des moyens affectés à nos priorités et à sanctuariser la proportion des deux tiers destinés au Sud de la Méditerranée. Nous nous sommes également efforcés d’être imaginatifs, en élargissant aux pays du Sud de la Méditerranée le mandat de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et en permettant que soient réinjectés les retours sur crédits de la Banque européenne d’investissement (BEI). Pour ce faire, l’Union européenne a mobilisé des moyens considérables – plus de 1,2 milliard d’euros – et, pour la période 2011-2013, elle apportera aux pays du voisinage Sud une aide de 3,6 milliards d’euros avec, en réunissant les efforts de la BERD et de la BEI, des prêts d’un montant de 8,5 milliards d’euros. En outre, lors du sommet de Deauville, l’Union européenne s’est efforcée de s’affirmer comme la colonne vertébrale de l’aide internationale – ce qui est conforme à sa vocation.
Nous devons veiller à ne pas accorder de prime aux pays qui ont le plus attiré l’attention des médias. On ne saurait en effet ignorer le Maroc et la Jordanie, qui se débattent pour mener à bien des réformes difficiles – comme celle du code civil marocain, que connaît bien M. Pascal Clément, visant à renforcer le statut de la femme –, au seul prétexte qu’ils n’ont pas connu de révolution ou fait la une des médias. La France a plaidé pour que le Maroc et la Jordanie ne soient pas les oubliés de notre politique de voisinage Sud et figurent dans le spectre de nos priorités au même titre que la Tunisie, l’Égypte et la Libye.
Quant à l’Union pour la Méditerranée, le fait qu’elle n’ait jusqu’à présent pas su répondre aux enjeux par anticipation ne condamne nullement la validité du projet politique, qui n’a jamais été aussi actuel. Il convient cependant de dépasser le stade des grandes déclarations pour se consacrer à des projets concrets et tangibles. Je n’en citerai que deux exemples.
Le premier est l’Office euro-méditerranéen de la jeunesse, projet porteur d’un message très positif sur notre approche de l’immigration et sur lequel nous pouvons tous nous entendre : une partie de la jeunesse méditerranéenne serait formée chez nous et ces jeunes seraient ensuite accompagnés pour mettre en œuvre chez eux des projets concrets, avec des clés de financement et des aides destinées notamment au montage d’initiatives, à la création d’entreprises, d’associations et d’ONG, à des initiatives locales… Un tel office entrerait dans une logique d’échanges équilibrés, favorisant la formation des forces vives des pays de la Méditerranée, au lieu de vendre des illusions ou de pomper à notre profit les énergies du Sud.
Le deuxième projet consiste en l’installation de gigantesques fermes solaires sur la rive sud de la Méditerranée. Des investissements de long terme sont nécessaires, car la durée d’amortissement en est souvent de vingt ans, de telle sorte qu’en finançant les premiers projets, nous pourrions produire un effet de levier considérable. Ce projet, qui suppose des infrastructures permettant de transporter l’énergie vers la rive nord, peut contribuer à notre équilibre énergétique et être, pour les pays de la rive sud, une source de profit économique.
Les opportunités sont donc nombreuses. Il nous faut trouver le bon équilibre entre la très forte attente d’Europe qui s’exprime sur la rive sud de la Méditerranée et que nous n’avons pas le droit de décevoir, et la conscience que, ces pays ne nous ayant pas attendus pour se libérer eux-mêmes, nous n’avons pas de leçons à leur donner. Une telle position, faite à la fois de responsabilité et d’écoute, est le meilleur chemin à tracer pour ce partenariat.
M. Jacques Myard. Monsieur le ministre, votre enthousiasme bien connu ne se dément pas au service de cette cause. Il ne faut cependant pas oublier que la crise qu’ont connue les pays arabes est d’abord une crise économique, liée à la crise mondiale : les économies de la Tunisie et de l’Égypte, très sensibles aux variations des flux touristiques, sont en panne. Nous mobiliser pour relancer ces économies et stabiliser la zone est, j’en conviens avec vous, un objectif primordial.
Mais il faut être efficace. Or, des mécanismes multilatéraux tels que le processus de Barcelone ou l’Union pour la Méditerranée sont très lourds et ne peuvent fonctionner que si tous les partenaires ont atteint un niveau comparable et s’entendent entre eux, ce qui ne me semble pas être le cas. Il faut donc revenir aux conceptions beaucoup plus simples d’un multi-bilatéralisme : les sommes employées à l’échelle européenne seraient bien plus efficaces dans le cadre des actions bilatérales de la France.
Relevons le défi de l’Office euro-méditerranéen de la jeunesse – chiche ! –, mais il faut surtout créer un Institut franco-méditerranéen, car la France est en train de se faire tailler des croupières par l’Allemagne et par certains autres pays qui consacrent des moyens à de telles actions. Nous devons réinvestir intellectuellement toute la Méditerranée, car nous perdons des positions dans la formation des élites et nous allons le payer très cher.
Mme Chantal Bourragué. Un calendrier a-t-il été arrêté pour la réalisation du plan solaire méditerranéen, projet très important pour l’UpM ?
D’autre part, quelle action l’Europe mène-t-elle en Méditerranée en faveur des passagers des « bateaux de la mort » et pour secourir les populations ?
M. Hervé Gaymard. Compte tenu du rôle que jouait l’Égypte dans le processus de l’Union pour la Méditerranée, comment évaluez-vous les effets sur ce processus des évolutions survenues dans ce pays ?
M. André Schneider. Certains pays d’Europe ne voient pas de la même manière que nous les relations avec les pays du sud de la Méditerranée. Pouvez-vous nous apporter encore quelque éclairage sur ce point ?
M. Jean-Pierre Dufau. Tous les partenaires européens n’ont pas la même sensibilité quant à l’Union euro-méditerranéenne, en effet. Vous avez souligné à juste titre que l’intérêt de l’Europe pour la Méditerranée ne signifie pas qu’elle se désintéresserait des pays d’Europe orientale. Or des questions se posent à leur égard aussi.
La Serbie a été dépouillée du Monténégro et du Kosovo. Son président, M. Tadić, s’est exprimé en faveur de l’adhésion à l’Union européenne et a fait acte de « repentance » pour les crimes commis durant la guerre de Bosnie. En outre, le général Mladić a été arrêté et extradé. Or, l’accord de stabilisation et d’association (ASA) nécessaire à l’adhésion de la Serbie a été ratifié par 19 pays, mais pas encore par la France, alors que nos deux pays ont de nombreux points communs et une histoire commune. Il serait paradoxal que la France ne suive pas de plus près le dossier de l’ASA de la Serbie, alors que d’autres pays soutiennent la démarche de la Croatie, qui a pourtant eu des positions et des alliés différents à certains moments de l’histoire de l’Europe.
M. le président Axel Poniatowski. Bien que les deux tiers de l’aide soient destinés à la Méditerranée et un tiers aux pays d’Europe orientale, la différence de population entre ces pays a pour effet que, pour un euro par habitant attribué à l’Égypte, ce sont 28 euros par habitant que perçoit la Moldavie. Sans doute la répartition devrait-elle donc être revue.
D’autre part, bien que le fait de commencer par des projets crédibles, comme le plan solaire ou les autoroutes de la mer, soit une excellente stratégie, ne va-t-on pas continuer de se heurter à une difficulté qui a entravé le démarrage de l’UpM : le conflit israélo-palestinien ?
M. le ministre. Monsieur le président Poniatowski, les États membres de l’Union européenne proches de la Méditerranée et partageant une sensibilité euro-méditerranéenne ne représentent pas un poids négligeable, en particulier si on compte parmi ces pays la Roumanie et la Bulgarie, ainsi que la Hongrie, qui considère qu’elle a un débouché quasi-naturel sur la Méditerranée via les Balkans. À ce socle solide s’ajoutent des pays très lucides sur l’intérêt économique de cette union et sur la sphère d’influence qu’elle leur ouvre, comme l’Allemagne ou le Royaume-Uni. Quant aux pays nordiques, dont l’approche est fortement fondée sur les droits de l’homme, ils sont conscients que c’est le moment d’investir dans la démocratie. Contrairement donc à ce que nous pourrions penser, il existe un consensus assez stable au sein de l’Union européenne pour défendre l’idée d’une proximité avec la rive sud de la Méditerranée. Les Polonais ont d’ailleurs parfaitement compris qu’ils ne peuvent attaquer de front ce projet.
Il ne serait, en revanche, pas raisonnable d’aller au-delà de la répartition actuelle d’un tiers/deux tiers. La seule possibilité d’accroître les investissements consiste à réorienter les flux financiers de la BERD et de la BEI de l’est vers le sud.
Madame Bourragué, monsieur Dufau, ce sont en effet les projets concrets qui permettent de sortir des débats d’esthètes. Chercher à constituer l’UpM en rapprochant des entités géopolitiques conduit à un échec assuré, mais la création d’une ferme solaire en Tunisie ou celle d’un Office euro-méditerranéen de la jeunesse sont des projets qui peuvent aboutir.
Il est en outre évident que l’UpM ne peut fonctionner indépendamment de la politique de voisinage européenne. De fait, c’est à ce niveau que se situent les moyens et nous plaidons pour que les trois quarts au moins de l’enveloppe des programmes de coopération régionale de l’Instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP) soient consacrés aux programmes concrets de l’UpM.
Monsieur Myard, à défaut de partager une même vision des problèmes, nous avons au moins en commun l’enthousiasme avec lequel nous exprimons nos convictions. Je partage votre souci de réinvestir intellectuellement la Méditerranée. Parlant arabe, je suis convaincu que nous avons besoin de « passeurs » qui reprennent cette vision du voisinage euro-méditerranéen.
À la fin de la monarchie de Juillet, les Saint-simoniens, conscients que les lumières de l’Antiquité nous avaient été transmises par les pays arabes et méditerranéens, ont considéré qu’il était temps d’agir en retour et ont entrepris des projets de développement du côté sud de la Méditerranée, se trouvant ainsi à l’origine du percement du canal de Suez et de la modernisation de l’Égypte de Méhémet-Ali. Nous nous trouvons dans une situation comparable : sommes-nous capables d’accompagner les pays de la rive sud dans leur transition ? Il nous faut retrouver, dans nos relations avec ces pays, la ferveur des saint-simoniens.
Monsieur Gaymard, la réponse à votre question est dans la question même. Vous connaissez parfaitement l’Égypte et ses contradictions vertigineuses : songeons que l’essentiel des forces de ce pays se concentre dans l’équivalent d’une bande de vingt kilomètres de part et d’autre du Rhône entre Lyon et Marseille, tout le reste du territoire étant occupé par le désert, hormis quelques zones dans le Sinaï ou la Nouvelle Vallée projetée par le président Moubarak. L’équilibre de ce pays est très fragile et il a été sage de confier le poste de secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée à M. Youssef Amrani. L’Égypte se concentre sur ses problèmes intérieurs ; elle n’en est pas moins, sur la durée, l’un des pôles d’appui très importants de la diplomatie internationale au sud de la Méditerranée, comme elle l’a montré dans le passé par des décisions courageuses. Je ne doute pas qu’elle reprenne rapidement son rôle pivot.
Monsieur Dufau, l’ASA avec la Serbie devrait être adopté par le Sénat en juillet et, je l’espère, être examiné le plus vite possible, en fonction de l’ordre du jour, par l’Assemblée nationale.
M. Philippe Cochet. Pourriez-vous indiquer nommément quels sont les pays du sud de la Méditerranée qui expriment une véritable demande d’Europe ? Il ne sera pas possible, en effet, de travailler avec tous et il importe donc d’en privilégier deux ou trois. Cela est d’autant plus vrai que l’on a vu, dans la crise libyenne, l’Italie se démarquer assez nettement de la position d’autres pays européens – comme du reste la France l’aurait peut-être fait elle-même si elle avait été confrontée à un pays avec lequel elle avait des relations historiques aussi fortes.
M. Christophe Caresche. L’UpM s’est largement ensablée. Il ne me semble pas que la France ait, dans cette affaire, été trop européenne, mais plutôt qu’elle ne l’ait pas été assez. Les députés du Bundestag que nous avions rencontrés avaient d’ailleurs assez largement exprimé leur incompréhension face à ce projet perçu comme une initiative de la France. Le seul moyen de relancer ce processus est d’insérer l’UpM dans un cadre plus européen pour lever ces incompréhensions – vos réponses à cet égard, monsieur le ministre, me semblent aller dans ce sens.
Où en sont les discussions avec la Commission européenne, qui souhaitait que la présidence de l’UpM échoie à la Haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et a produit un document dans lequel elle revient sur les principes qui organisent la politique de voisinage, s’écartant de la clé de répartition de l’aide aux pays d’Europe orientale et aux pays du Sud. Quelle est la position de la France et comment entend-elle assurer la compatibilité entre sa vision de l’UpM et les propositions de la Commission ?
Mme Marie-Louise Fort. Tout en frappant avec une insistance d’ailleurs variable à la porte de l’Europe, la Turquie joue un rôle de plus en plus marquant dans cette région de la Méditerranée. Après les élections de dimanche dernier, comment voyez-vous les relations avec ce pays, s’agissant notamment des projets de la France et de l’Europe au sein de l’UpM ?
Mme Odile Saugues. Ni Allah, ni maître, film de la cinéaste Nadia El Fani tourné durant la révolution tunisienne et projeté à Cannes, montre les Tunisiens – dont beaucoup de femmes – portant des pancartes réclamant à la fois la démocratie et un État laïc : c’est à juste titre, monsieur le ministre, que vous jugez que nous n’avons pas de conseils à leur donner. Vont-ils réussir malgré la pression exercée par les islamistes ? Si nous devons être des « passeurs », que pouvons-nous leur apporter, et sous quelle forme ?
Mme Pascale Gruny. Je suis très favorable à la transmission de compétences aux jeunes des pays de la rive sud mais, une fois formés, les jeunes de ces pays voudront-ils retourner chez eux – et y seront-ils bien accueillis ?
M. le ministre. Madame Bourragué, un pays a très bien géré la question des bateaux de la mort : c’est l’Espagne, qui est l’exemple à suivre en la matière, car elle a accompagné sa politique de fermeté d’une politique de coopération avec le Maroc et le Sénégal, en vue de régler le problème à la racine. Il est en effet déjà trop tard lorsque les bateaux arrivent à proximité des rives européennes. Outre qu’il faut montrer aux migrants qu’ils peuvent construire leur avenir dans leur pays, il convient également de les arrêter avant leur départ, afin de leur éviter toute prise de risques, y compris mortels, et de mettre fin à l’exploitation de leur détresse.
La solution réside, je le répète, dans une politique de coopération très étroite avec les pays de départ. L’Espagne a donné un message d’espoir : quand on se rappelle les images très dures d’affrontements communautaires dans le sud du pays, ou dans le sud du Portugal, il y a encore cinq ou six ans, il s’agit là d’une belle réussite.
Monsieur Philippe Cochet, votre question est délicate car il est difficile de faire un choix. N’oublions pas que le premier pays du Maghreb auquel l’Union européenne a accordé un statut avancé, c’est le Maroc. C’est lui qui entretient les relations les plus étroites avec l’Europe.
La Tunisie présente, quant à elle, un double intérêt. Elle a tout d’abord immédiatement demandé à l’Union européenne d’accélérer les négociations sur le statut avancé et c’est un devoir pour la France d’insister auprès des services de la Haute représentante, Catherine Ashton, et de la Commission européenne, pour que l’Europe respecte sa promesse de boucler les négociations avant la fin de l’année. La Tunisie a pour second avantage d’être un pays de taille modeste : les euros que nous y investissons y ont un véritable effet de levier. C’est donc là que les révolutions arabes ont la meilleure chance de réussir la transition démocratique. Il faut, indépendamment de nos liens historiques, approfondir le partenariat avec ce pays pour construire une réussite collective. Du reste, un grand nombre de nos partenaires européens – l’Italie, l’Espagne, la Grèce… – entretiennent avec lui des liens très forts.
Monsieur Caresche, les propos que j’ai déjà tenus vous auront convaincu, j’en suis certain, que, s’agissant de l’Union pour la Méditerranée, je suis favorable au renforcement de l’appareillage européen. La Haute représentante et la Commission ont donc vocation à assurer la coprésidence « nord » de l’UpM. Nous avons également intérêt à miser sur la dimension européenne en matière de financement. Toutefois, cette vocation et cette dimension européennes n’excluent nullement, comme a eu raison de le rappeler M. Myard, le maintien de notre approche bilatérale, qui est très forte notamment avec le Maroc et la Tunisie. Nous n’allons pas renoncer à notre histoire !
Il n’en reste pas moins que l’UpM, pour convaincre, ne doit pas être perçue comme un outil antieuropéen mais comme un outil profondément proeuropéen. Le temps nous a d’ailleurs permis de lever certaines incompréhensions initiales.
Madame Fort, nous avons intérêt à discuter avec la Turquie et à développer avec elle une analyse convergente. Nous ne pouvons par exemple tenir pour rien le souvenir de l’Empire ottoman, qui s’étendait jusqu’à la moitié de l’Algérie. L’histoire a donc créé des liens importants entre la Turquie et toute la rive sud de la Méditerranée. Il est vrai, cependant, que ce pays joue parfois sa propre partition et que nos analyses peuvent diverger. C’est la raison pour laquelle il faut tout faire pour que son action s’inscrive le plus possible dans une vision commune. Le fait pour lui de proclamer son attachement à la démocratie va dans la bonne direction.
Madame Saugues, j’ai apprécié votre question, qui était très directe. J’y répondrai qu’en matière de droits, tout compte : les partenariats des collectivités locales comme la mobilisation du mouvement associatif, notamment des associations qui œuvrent pour la promotion des femmes. Il ne faut pas oublier non plus l’action des parlementaires et je suis heureux que vos deux commissions montrent l’exemple. Vous avez un rôle décisif à jouer dans l’apprentissage de la démocratie. Nous sommes nous-mêmes l’aboutissement de nombreuses années d’un tel apprentissage. Il est décisif, dans cette période, de développer des liens et d’entretenir des partenariats avec les Tunisiens.
Je tiens également à insister sur le rôle du Conseil de l’Europe, que son secrétaire général essaie de conduire dans la bonne direction. Le Conseil pourrait devenir le bras armé de ce partenariat visant à favoriser les transitions démocratiques des pays arabes et je l’encourage à s’engager en ce sens. D’ailleurs, de nombreux parlementaires français en sont membres.
M. François Rochebloine. Encore faudrait-il leur donner des moyens financiers.
M. le ministre. Ils doivent également savoir les employer judicieusement.
Je crois beaucoup à cette vocation du Conseil de l’Europe, qui peut y trouver un bien utile surcroît de légitimité et de visibilité.
Enfin, madame Gruny, il faut clairement informer dès le départ les jeunes du Sud qu’il s’agit pour nous de construire un Erasmus euroméditerranéen et que nous accompagnerons leur retour au pays après leur formation. À cette fin, des crédits devront permettre à ceux qui seront passés par l’Office euroméditerranéen de la jeunesse de devenir les forces vives qui contribueront, dans leur pays, à la transition démocratique. Si, dans le cadre d’une formation dédiée, ces crédits les aident à créer des entreprises et à mener à bien des projets, alors la réussite pourra être au rendez-vous, dans le cadre d’un partenariat équilibré et respectueux où chacun trouvera sa place.
M. le président Axel Poniatowski. Je vous remercie, monsieur le ministre, d’avoir répondu à nos questions.
M. le président Pierre Lequiller. Je tiens moi aussi à vous remercier, monsieur le ministre, pour cette audition sur un sujet sur lequel nous aurons certainement à revenir, la situation ne pouvant qu’évoluer au cours des prochains mois.
15.- Mardi 5 juillet 2011, séance de 17 heures 30, compte rendu n° 75 : extraits de l’audition de M. Alain Juppé, ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et européennes (ouverte à la presse)
M. le président Axel Poniatowski. Nous avons le plaisir de recevoir M. Alain Juppé, ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes, pour une audition, ouverte à la presse, consacrée à l’actualité internationale.
Nous sommes convenus que votre propos liminaire porterait sur trois sujets : la Libye, la Syrie et l’Afghanistan. Naturellement, d’autres dossiers pourront être abordés à l’occasion des questions qui suivront votre intervention.
En Libye, Kadhafi est encore en place et les perspectives de solution militaire ou politique paraissent incertaines. Alors que notre assemblée sera conduite à voter la semaine prochaine sur la prolongation de notre intervention militaire, il est évidemment utile que vous vous exprimiez sur ce sujet.
En Syrie, on peut craindre que le point de non-retour ait été atteint et notre diplomatie peine, malgré ses efforts, à mobiliser la communauté internationale pour obtenir au moins une résolution a minima de condamnation de ce qui s’y passe.
[…]
M. Alain Juppé, ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes. Je reviens de Barcelone, où j’assistais à l’installation de M. Youssef Amrani comme secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée (UpM). Il était important que la France soit présente à cette occasion. M. Amrani a été désigné à l’unanimité : ce haut fonctionnaire d’origine marocaine est considéré comme tout à fait compétent et engagé. Nous allons avec lui redonner un élan au processus de l’UpM, qui est plus pertinent que jamais, en l’orientant vers des projets concrets.
J’en ai notamment cité quatre. Le premier concerne la mobilité des jeunes entre le Nord et le Sud de la Méditerranée, avec le projet d’office méditerranéen pour la jeunesse, qui a déjà pris corps, mais que nous allons essayer de faire grandir et d’intégrer dans les procédures de l’UpM. Le deuxième a trait à l’énergie, au travers, en particulier, d’un plan solaire méditerranéen – les Allemands ont un immense projet dénommé Desertec pour équiper le Sahara de panneaux solaires afin d’alimenter l’Europe du Nord et nous avons de notre côté des projets en matière d’interconnexion. Le troisième porte sur la protection civile, avec un projet assez avancé de prévention et de lutte contre les incendies autour de la Méditerranée, et le quatrième sur le premier projet labellisé par l’UpM, relatif à une usine de dessalement d’eau à Gaza.
En ce qui concerne la Libye, depuis que notre pays a engagé des forces dans ce pays, des progrès ont été accomplis.
Sur le plan militaire, l’étau se resserre autour de Kadhafi, qui dit lui-même être « le dos au mur ». Benghazi a été libérée. Le siège de Misrata a été interrompu. Les forces d’opposition continuent de gagner du terrain dans l’Ouest et dans le Sud, notamment dans le djebel Nefoussa. Mais les forces de Kadhafi poursuivent leurs attaques contre les populations civiles. C’est la raison pour laquelle la coalition a décidé de maintenir sa pression militaire dans le cadre de la résolution 1973, qui vise à protéger les civils.
Je sais que ce point prête à contestation. J’ai eu l’occasion de m’en entretenir il y a quelques jours avec mon collègue russe Sergueï Lavrov. Nous considérons que les livraisons d’équipements, de médicaments, de nourriture et d’armes d’autodéfense aux populations du djebel Nefoussa sont conformes aux résolutions des Nations unies – la résolution 1973, dans son paragraphe 4, prévoit que l’on peut déroger à la résolution 1970 instaurant un embargo sur la fourniture des armes dès lors que la protection des populations civiles est en jeu.
Sur le plan politique, Kadhafi est de plus en plus isolé. Les défections se multiplient dans les rangs des responsables du régime, qu’il s’agisse des civils ou des militaires. Sur la scène internationale, la Russie, la Chine et de nombreux pays africains considèrent désormais qu’il n’a plus aucune légitimité et doit partir. Le mandat d’arrêt pour crimes contre l’humanité délivré le 27 juin par la Cour pénale internationale contre lui, son fils Saif al-Islam et le chef des services de renseignements Abdallah al-Senoussi le confirme : aujourd’hui, l’ensemble de la communauté internationale a tourné la page de l’ère Kadhafi.
Même si elle ne le proclame pas publiquement, l’Union africaine a bien compris que la question n’était plus de savoir si Kadhafi devait partir, mais quand et comment ; elle y travaille.
Dans le même temps, le Conseil national de transition (CNT), que la France avait été la première à reconnaître comme le seul titulaire légitime de l’autorité gouvernementale pour l’État libyen, s’affirme de plus en plus comme un interlocuteur politique central. Il est maintenant reconnu par près d’une trentaine de pays, dont la Turquie il y a quelques jours, et par l’Union européenne, qui a ouvert un bureau à Benghazi. Il se structure et s’est doté d’une feuille de route politique prévoyant les étapes d’établissement d’un État de droit démocratique.
Dans ce contexte, nous devons aller de l’avant pour mettre un terme aux souffrances du peuple libyen.
D’abord, en apportant un soutien financier au CNT, qui en a cruellement besoin – chaque fois que ses responsables viennent à Paris, comme ce fut encore le cas la semaine dernière, ils nous appellent au secours. Nous nous sommes fortement mobilisés pour que le Groupe de contact pour la Libye crée un mécanisme spécifique. Celui-ci existe juridiquement depuis la semaine dernière. Il faut maintenant que des fonds soient versés pour l’abonder. Pour notre part, nous travaillons à la mobilisation d’avoirs libyens gelés en France. Nous avons d’ores et déjà pu obtenir le dégel de fonds détenus par la banque centrale, afin de continuer à payer les boursiers libyens qui poursuivent leurs études supérieures en France, comme le CNT nous l’a demandé. Nous sommes par ailleurs en train d’essayer de dégeler les 290 millions de dollars prévus. Cela est, pour des raisons juridiques, beaucoup plus compliqué qu’on ne le pensait, mais nous allons y parvenir.
Ensuite, en trouvant une solution politique à la crise.
Je rappelle les quatre conditions fixées par le Groupe de contact, l’Union européenne et la coalition : un cessez-le-feu véritable, avec un retour des forces de Kadhafi dans leurs casernes et la garantie de l’intégrité territoriale de la Libye sous contrôle international ; une renonciation publique de Kadhafi à tout pouvoir civil ou militaire ; la tenue d’une convention nationale sous l’égide du Conseil national de transition, ouverte à d’autres partenaires, y compris des responsables de Tripoli qui se sépareront de Kadhafi ; enfin, la mise en œuvre de la feuille de route du CNT : adoption d’une constitution, élections législatives et développement de la démocratie.
Les initiatives pour avancer dans ce sens se multiplient – ce qui constitue un de nos problèmes. Le premier ministre libyen, Mahmoud Jibril, a notamment été reçu la semaine dernière par le président de la République, qui lui a dit l’urgence pour le CNT d’agir de manière décisive sur le plan militaire et d’engager ce processus de transition politique.
En ce qui nous concerne, nous poursuivons nos efforts selon trois axes.
En premier lieu, continuer notre travail de conviction auprès de ceux qui peuvent contribuer à faire émerger une solution politique. Je pense à la Russie, où je me suis rendu la semaine dernière. Il me semble que nous pouvons travailler avec les Russes qui, depuis le sommet du G8, ont adopté une attitude plus constructive et plus claire sur la Libye. Quand je suis arrivé à Moscou, j’avais des raisons de penser que mon entretien avec Sergueï Lavrov serait rude : nous nous sommes dit nos vérités respectives, en particulier nos différences d’appréciation sur la partie militaire de l’intervention, mais nous sommes tout à fait en phase sur l’objectif, à savoir la mise à l’écart de Kadhafi et l’application de la feuille de route du CNT. Le médiateur russe, Mikhaïl Marguelov, qui s’est rendu à Benghazi et à Tripoli, est en contact avec nous.
Il en est de même avec l’Union africaine. Le sommet de Malabo l’a montré : les dirigeants africains évoluent peu à peu vers le constat d’un départ inéluctable de Kadhafi. Ils ne le disent pas tous publiquement, mais tous le pensent. Nous espérons que l’Union africaine, qui a un rôle éminent à jouer pour résoudre l’affaire libyenne, saura faire les derniers pas qui nous séparent de la solution. À cet égard, la réunion du Groupe de contact à Istanbul le 15 juillet pourrait être déterminante. Nous insistons beaucoup pour que l’Union africaine participe à cette réunion – M. Ping, président de la Commission de cette organisation, avait d’ailleurs pris part à de précédentes rencontres.
Deuxième axe : faciliter le travail de l’envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies, M. al-Khatib, qui centralise les efforts de la communauté internationale, car la multiplication des canaux de médiation politique affaiblit la pression sur Kadhafi et lui permet de gagner du temps.
Enfin, troisième axe : préparer le « jour d’après » la chute de Kadhafi au sein des différents groupes de travail internationaux, car il y a une forte inquiétude à cet égard et sur la capacité du CNT à éviter des difficultés dans le pays ainsi libéré. La construction de la Libye nouvelle relèvera d’abord de la responsabilité des Libyens eux-mêmes, mais nous sommes naturellement prêts à les accompagner. C’est dans cet esprit que les missions préparatoires françaises se succèdent à Benghazi, dans tous les domaines de la sécurité et de la reconstruction, et que nous organisons des déplacements d’entreprises volontaires pour aller prendre des contacts sur place, comme d’autres pays le font activement, en particulier l’Italie et la Grande-Bretagne.
S’agissant de la Syrie, la situation devient chaque jour un peu plus préoccupante.
Vous disiez, monsieur le président, que la diplomatie française était à la peine, mais je n’en connais aucune qui ne le soit pas !
Depuis le premier jour, comme nous l’avons fait pour la Libye, nous condamnons fermement le refus des réformes et la spirale de la violence. Depuis le premier jour également, nous condamnons la fuite en avant d’un régime qui réprime les aspirations de son peuple à la démocratie, a causé la mort d’au moins 1 300 civils et, avec des dizaines de milliers de Syriens fuyant leur pays, menace désormais la stabilité de la région tout entière.
Nous avons été les premiers à demander des sanctions contre Bachar el-Assad et son entourage proche, notamment au sein de l’Union européenne, qui a adopté trois trains de sanctions contre des responsables syriens impliqués dans la répression et des entités finançant le régime. Ces sanctions sont mises en œuvre par de nombreux pays en dehors de l’Union, notamment par les États-Unis.
Nous nous sommes aussi mobilisés contre la candidature syrienne au Conseil des droits de l’homme, ce qui a abouti à son retrait au bénéfice du Koweït. C’est également grâce à nos efforts que ce Conseil a adopté le 29 avril une résolution condamnant les violations des droits de l’homme exercées par la Syrie et décidant l’envoi d’une mission d’enquête.
Enfin, nous travaillons pour que le Conseil de sécurité prenne position sur la crise de ce pays. Avec nos partenaires européens, nous avons préparé un projet de résolution condamnant les violences, demandant la fin de la répression et appelant le régime à ouvrir des perspectives politiques et à faire des réformes – c’est dire si ce projet est équilibré.
Je pense que le point de non-retour est franchi et que la capacité de Bachar el-Assad à entreprendre celles-ci est aujourd’hui quasiment nulle compte tenu de tout ce qui s’est passé. Il n’en reste pas moins que, pour faciliter l’émergence d’un consensus au sein du Conseil de sécurité, nous avons accepté de nous adresser à nouveau à lui en l’invitant à s’engager dans un processus de réformes. Mais notre projet se heurte toujours à la menace d’un veto de la Russie, que soutient la Chine, au nom du refus d’ingérence dans les affaires intérieures syriennes.
Je n’ai pas pu faire beaucoup évoluer mon collègue russe sur ce sujet. Celui-ci, de même que d’autres pays émergents, a la hantise de la résolution 1973 et le sentiment qu’en ne faisant pas obstacle à celle-ci, ils se sont laissés embarqués plus loin qu’ils ne l’auraient voulu. Ils craignent qu’une résolution sur la Syrie n’ait les mêmes conséquences. J’ai eu beau faire remarquer à mon collègue russe qu’il n’y avait rien dans le projet de résolution qui de près ou de loin ressemble au paragraphe 4 de la résolution 1973, je ne l’ai pas encore convaincu. Cela étant, la Russie commence à se poser des questions, car elle apparaît d’une certaine manière comme responsable de l’inertie du Conseil de sécurité.
Par ailleurs, le Brésil, l’Inde et l’Afrique du Sud restent tout à fait réticents, toujours au nom du refus d’ingérence dans les affaires intérieures d’un État, ce qui n’est pas tout à fait conforme avec le principe de la responsabilité de protéger adopté par les Nations unies.
Le Conseil de sécurité ne peut pas continuer à fermer les yeux sur cette situation intolérable. Il en va de sa crédibilité. J’ai évoqué le précédent du Rwanda ou celui de l’ex-Yougoslavie. Le moment approche où chacun devra prendre ses responsabilités. Pour notre part, nous y sommes prêts et, si nous parvenons à réunir onze voix au Conseil de sécurité, nos intentions, avec les États-Unis et la Grande-Bretagne, est de mettre le projet aux voix pour que chacun soit mis devant les siennes.
[…]
Présidence de Mme Martine Aurillac, vice-présidente.
M. Hervé de Charette. Que pouvez-vous dire aujourd’hui au sujet des otages d’Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) ?
À l’Assemblée générale de l’ONU, en septembre, va se poser la question de la reconnaissance de la Palestine comme État indépendant. Vous avez dit voici quelques semaines que la position française dépendrait du point de savoir si l’on relançait le processus de paix – lequel paraît aujourd’hui condamné malgré vos efforts. Cette position a-t-elle évolué depuis lors ou la France réserve-t-elle encore son point de vue ?
Mme Chantal Bourragué. Une des préoccupations porte sur la place réservée aux femmes à l’issue des conflits : la prendrez-vous en compte en Libye, où celles-ci ont largement participé à la révolution ?
Vous avez par ailleurs souligné la forte participation au référendum qui s’est tenu au Maroc et vous vous êtes réjoui de la marche de ce pays vers une transition. Quel rôle la France pourra-t-elle jouer, si le Maroc la sollicite, dans la mise en place de cette nouvelle gouvernance ?
[…]
M. Jean-Paul Lecoq. Je faisais partie des passagers présents sur un des bateaux français récemment retenus à Athènes. On a l’impression qu’Israël a utilisé un gouvernement grec très affaibli pour lui faire bloquer une flottille, pourtant composée exclusivement de civils et n’ayant pour objectif que de briser le blocus de Gaza. Pourquoi n’êtes-vous pas intervenu pour aider ce gouvernement à éviter d’être pris en otage sur ce point ? Bernard Accoyer a déclaré il y a deux ans et demi à Gaza que la France reconstruirait l’hôpital sur place et qu’il reviendrait un an plus tard avec le président de notre commission. Depuis, nous n’avons pu y aller. J’étais porteur d’un convoi transportant du ciment et des médicaments pour tenir cette promesse. Pourquoi n’avez-vous pas accompagné cette démarche ?
M. François Rochebloine. […] Quelle est l’action du gouvernement concernant Salah Hamouri ? […]
M. Dominique Souchet. Quelle est votre analyse de la situation au Maroc au lendemain du référendum sur la réforme constitutionnelle, alors que les manifestations organisées par le mouvement du 20 février se poursuivent ? Les opposants à la réforme, qui continuent à exiger une véritable monarchie parlementaire, représentent-ils encore une force suffisante pour entretenir un climat durable d’instabilité ou la réforme qui vient d’être adoptée permet-elle à Mohammed VI de reprendre la main ?
M. Michel Vauzelle. S’agissant de la Libye, on a du mal à comprendre que nous soyons toujours dans le cadre de la résolution 1973 et on peut craindre de découvrir par la suite des dégâts collatéraux préjudiciables à l’image de la France et à son rôle dans cette région du monde.
Quelle est la qualité des renseignements que nous avons eus sur la réalité du printemps arabe, lequel a apporté beaucoup d’espoir, de la Tunisie au Moyen-Orient ?
N’a-t-on pas fait preuve de précipitation dans l’intervention en Libye lorsqu’on voit que la guerre dure plus longtemps que prévu et qu’elle a peut-être changé de nature depuis l’adoption de la résolution 1973 ?
Enfin, qui est à Benghazi ? On a l’impression qu’au-delà de révolutionnaires hostiles à Kadhafi, on a affaire à un mélange de kadhafistes et d’islamistes contraires aux intérêts de la démocratie telle que nous l’envisageons.
[…]
M. le ministre d’État. Sur les otages d’AQMI au Sahel, je ne peux vous apporter beaucoup d’informations. Nous avons obtenu la libération d’une otage, Mme Larribe, et nous continuons par les mêmes canaux à discuter pour obtenir celle des quatre autres otages.
Sur la Palestine, je suis moins pessimiste que vous : les efforts de la diplomatie française, loin d’être condamnés, ont assez prospéré. Le raisonnement que nous avons tenu, dans la ligne de ce qui a été dit lors du G8, fait aujourd’hui l’objet d’un consensus, à savoir que le statu quo est la pire des solutions, aussi bien pour les Palestiniens que pour les Israéliens. Autres points de consensus : la reprise des négociations est le seul moyen d’en sortir et ces dernières doivent être menées sur la base de principes et de paramètres équilibrés et mutuellement agréés – notre diplomatie a fait sur ce point un effort de proposition salué par beaucoup.
Après ce que MM. Medvedev et Poutine ont dit au président de la République, M. Lavrov m’a confirmé que la Russie soutenait notre démarche. Le Conseil européen de la semaine dernière a endossé l’approche et les propositions de la France, fondées sur le discours du président Obama. Enfin, ce matin même, Tony Blair, qui est le haut représentant du quartet, est venu me dire qu’il soutenait complètement notre démarche et d’autres pays nous apportent également leur soutien, notamment dans le monde arabe.
Le 11 juillet prochain, le quartet se réunira à Washington. Obtiendrons-nous de lui un appel aux parties à renégocier sur la base des principes et paramètres faisant l’objet d’un consensus ? Il y a de bonnes raisons de le penser. Je rappelle que le quartet est constitué de la Russie, qui est d’accord avec nous, de l’Union européenne, qui a reçu un mandat clair à ce sujet, des Nations unies, qui sont également en phase avec nous, et des États-Unis – je dois faire le point demain avec Hillary Clinton sur ce sujet, la diplomatie américaine, qui travaille en étroite liaison avec la diplomatie israélienne, n’étant pas fermée. Notre principal souci est que ne sorte pas du quartet une série de principes ou de paramètres déséquilibrés, alors que ceux-ci sont aujourd’hui équilibrés.
Ces principes sont : la renonciation au terrorisme et à la violence, l’acceptation des accords de paix antérieurs, l’abandon de toute autre réclamation après la conclusion de l’accord et, surtout, l’objectif de deux États nations pour deux peuples. Les paramètres portent sur la frontière de 1967 et les garanties de sécurité, puis dans un second temps, dans le cadre d’un accord global, sur la question des réfugiés de Jérusalem.
Si cet appel est lancé, nous passerons à une deuxième phase. Les parties accepteront-elles de se mettre autour de la table ? Une conférence des donateurs dans la première quinzaine de septembre serait en toute hypothèse utile, car l’Autorité palestinienne a besoin de fonds. Cette conférence pourrait-elle être celle de paix et de négociation que nous avons envisagée ? Il est trop tôt pour le dire.
Nous sommes donc au milieu du gué, mais notre initiative a des chances d’aboutir. Le moment venu, nous prendrons nos responsabilités.
Madame Bourragué, nous serons bien entendu attentifs à la présence des femmes dans le système démocratique de la nouvelle Libye : il revient aux Libyens d’en décider, mais nous les accompagnerons dans la reconstruction de leur pays et nous veillerons au respect des droits de l’homme et du principe d’égalité entre les genres.
En ce qui concerne le Maroc, je me suis entretenu il y a quelques heures à Barcelone avec mon homologue marocain et l’ai félicité. La France s’est en effet réjouie du résultat du référendum, avec 73 % de participation – alors que certains partis d’opposition ou islamistes avaient appelé au boycott et que le taux habituel se situe au-dessous de 50 % – et 98 % de oui. Cela prouve un réel élan populaire.
Le schéma proposé par le roi est audacieux. Reste à le mettre en œuvre, ce qui suppose l’adoption d’une série de lois organiques et de décisions.
Il est vrai qu’il y a encore des manifestations, encore qu’elles aient plutôt eu tendance à se calmer, mais elles sont pacifiques et elles ne donnent pas lieu à des répressions violentes. Il s’agit donc d’un phénomène naturel dans un régime évoluant vers la démocratie.
Le roi peut donc garder la main et nous devons le soutenir dans ce processus.
Parallèlement, il convient d’éviter que les difficultés économiques ne viennent contrarier ce dernier. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons inclure le Maroc dans le partenariat de Deauville qui a été proposé à la Tunisie et à l’Égypte. Le président de la République vient de confier à Édouard Balladur une mission pour se rendre dans les pays du Golfe et ceux du Maghreb afin d’essayer de sensibiliser leurs gouvernements à la mise en œuvre d’un plan d’action dans l’esprit de ce partenariat.
[…]
Monsieur Lecoq, la décision prise par les autorités grecques est souveraine : elle repose sur le droit grec et non sur le droit international maritime !
De toute façon, la participation de bateaux français à cette flottille ne nous est pas sympathique. Je l’ai dit publiquement, y compris à Jérusalem : cela ne constitue pas une bonne méthode pour acheminer l’aide humanitaire vers Gaza, dans la mesure où cela fait courir à tous ceux qui sont sur ces bateaux des risques inutiles et peut être interprété comme une provocation. La bonne méthode consiste au contraire à demander au gouvernement israélien de faciliter cet acheminement par les voies existantes à destination de Gaza : nous le lui avons dit avec beaucoup de fermeté.
[…]
Monsieur Rochebloine, j’ai reçu les parents de Salah Hamouri lorsque je suis allé à Jérusalem – ce qui m’a valu des reproches de la communauté juive de New York qui se demandait pourquoi on le traitait de la même manière que Gilad Shalit. Je ne les traite pas du tout de la même manière : ce dernier est otage dans des conditions scandaleuses, en violation de tous les principes internationaux. Nous exigeons sa libération immédiate et demandons aux différentes parties de faire tous les efforts nécessaires à cette fin. Salah Hamouri est dans une situation différente : il a été condamné par la justice israélienne. On peut certes estimer que la justice militaire israélienne n’est pas une justice, mais je laisse la responsabilité de cette affirmation à ceux qui la soutiennent ! Il est en prison et nous sommes intervenus auprès des autorités israéliennes pour qu’elles fassent preuve d’indulgence à son égard et le libèrent : il devrait être libre dans quatre ou cinq mois. J’ai tenu à manifester ma compassion à sa famille et à lui dire que nous souhaitons cette libération au plus vite.
[…]
Monsieur Vauzelle, Kadhafi et son entourage dénoncent régulièrement des dégâts collatéraux – je dirais même qu’ils en rajoutent : on ne sait jamais si les cadavres qu’ils montrent sont tombés sous les balles de leurs propres forces ou du fait des frappes de l’OTAN. À notre connaissance, il y a eu très peu de dégâts collatéraux, même si ceux-ci sont toujours trop nombreux. Un cas semble particulièrement sensible, portant sur neuf morts, et l’OTAN fait une enquête pour déterminer s’ils ont été provoqués par l’une de ses frappes. Une forte attention est portée à la détermination des cibles pour que celles-ci soient exclusivement militaires et comportant le moins de risques possibles de dégâts pour les civils. Si nous avons utilisé des hélicoptères, c’est aussi pour déterminer plus précisément ces cibles.
Vous me demandez : qui est à Benghazi ? Je suis tenté de vous répondre : qui est dans l’opposition à Bachar el-Assad en Syrie ? Qui figure dans les forces politiques du Caire ? Les Frères musulmans sont-ils ou non des partenaires convenables ? Faut-il faire confiance au parti Ennahda en Tunisie ? On peut donc se poser la question dans les autres pays : lorsqu’un système politique explose et que la tyrannie s’effondre, il y a forcément un moment d’ébullition. M. Moussa, l’ancien secrétaire général de la Ligue arabe, aujourd’hui candidat à l’élection présidentielle en Égypte, me disait : en France, combien de temps avez-vous mis entre le 14 juillet 1789 et le moment où vous avez eu une démocratie policée ? au moins soixante-dix ans !
La Libye va donc connaître une période d’évolution, mais nous pensons qu’il y a dans le CNT beaucoup de gens responsables ayant une vision claire de l’avenir de leur pays et une feuille de route précise. Nous allons les accompagner et leur faire confiance, sans sous-estimer le risque qu’il y ait ici ou là, dans cette mouvance, des extrémistes qu’il appartiendra aux Libyens de maîtriser.
[…]
M. Gaëtan Gorce. […] S’agissant de la Libye, nous avons salué le rôle du gouvernement français dans la décision d’intervenir dans ce pays. Nous en mesurons aujourd’hui les difficultés, dont celle de la France – et de certains de ses partenaires européens – à assumer l’ensemble des engagements que nous prenons aujourd’hui à l’étranger, lesquels sont très souvent en contradiction avec les objectifs du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Avons-nous la défense de notre diplomatie ou la diplomatie de notre défense ?
[…]
M. Jean-Michel Boucheron. La presse a fait état de divergences entre certains pays de l’OTAN, notamment la France et la Grande-Bretagne, concernant les livraisons de matériels : qu’en est-il exactement ? Ces différends ont-ils été aplanis et, si oui, dans quelles conditions ?
Nous avons des informations d’origine américaine selon lesquelles, à la suite de l’élimination de Ben Laden, un certain nombre de cadres importants d’Al-Qaida, dont peut-être son premier dirigeant, sont en train de se déplacer vers le Sud Sahara. Par ailleurs, des armes de l’ancienne armée libyenne se disperseraient dans le désert et se retrouveraient également dans cette région. Ces informations sont-elles exactes ? Ne suscitent-elles pas une nouvelle inquiétude sur la puissance dont pourrait disposer AQMI dans cette zone ?
M. Robert Lecou. […] S’agissant de la politique européenne de voisinage, vous avez évoqué les espoirs de relancer l’Union Pour la Méditerranée. Or la Pologne préside l’Union européenne : on connaît son attraction pour la frontière est. Pensez-vous qu’elle puisse être un partenaire, avec l’ensemble des pays du Nord et de l’Est, pour faire en sorte que la nécessaire politique en faveur de l’Union de la Méditerranée prenne corps ?
[…]
M. Jacques Myard. A-t-on une idée précise des pertes civiles dans les conflits actuels de la Libye et de la Syrie ?
Quel est l’impact du conflit libyen sur le Sahel, l’Égypte et l’Europe – qui est à nu, la preuve de l’incapacité totale de ce « machin » à exister venant d’être apportée ? Quelle est la conséquence de la situation en Syrie sur Israël – laquelle constitue un élément important dans l’attitude de ce pays vis-à-vis du processus de paix que vous soutenez à juste titre ?
M. Jean-Claude Guibal. Quelle est l’influence de la Turquie, dont le parti dominant et le président ont été renforcés récemment, sur la Libye ? Constitue-t-elle un modèle pour elle ?
Concernant l’Union Pour la Méditerranée, où en est le projet d’un Erasmus méditerranéen permettant de former les étudiants du pourtour méditerranéen à une culture commune ?
Les principaux obstacles au développement de cette union se situent en Méditerranée orientale, principalement du fait du conflit israélo-palestinien : est-il envisageable d’avoir des coopérations renforcées sur un plan géographique et, notamment, de renforcer le dialogue « 5+5 » pour prendre davantage en compte la Méditerranée occidentale ?
M. Jacques Bascou. Concernant la Libye, les pays africains ont eu l’impression d’être un peu écartés puisque lorsqu’ils envisageaient une mission à Benghazi ou à Tripoli, la Grande-Bretagne et le France les ont laissés de côté. Par ailleurs, le président de l’Afrique du Sud a critiqué l’OTAN et d’autres dirigeants ont dit que la mise en examen de Kadhafi devant la Cour pénale internationale pouvait être un obstacle à une médiation.
Quel peut, dans ces conditions, être le rôle des pays de l’Union africaine ?
N’y a-t-il pas eu un changement de position de la diplomatie française, sachant que, pour certains conflits, on disait qu’il fallait laisser les pays africains se débrouiller eux-mêmes et que l’on a marqué une certaine prudence vis-à-vis de la Tunisie et de la Côte d’Ivoire ? Ce changement ne risque-t-il pas d’être préjudiciable à l’émergence d’une solution politique, à laquelle doivent être associés les pays africains ?
Quel peut être enfin le rôle de l’Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne, qui est peu connue, mais s’est réunie régulièrement avec des représentants de la Palestine et d’Israël ? Les pays du Sud demandent aujourd’hui que les parlements soient associés à ce dialogue, l’Union Pour la Méditerranée s’étant vue reprochée de s’appuyer essentiellement sur des relations entre États et non des membres de la société civile ou des élus.
M. Jean-Jacques Guillet. Lors d’une tribune récente dans Le Monde, vous avez appelé à ne pas oublier l’Iran. Ce pays a accru son intervention politique en Syrie ces dernières semaines, avec des conseillers des Gardiens de la révolution – même si l’ambassadeur d’Iran que j’ai rencontré dernièrement disait qu’il essayait de modérer son allié syrien. De même, ce pays interviendrait en Libye : la présence de membres importants de la force Al-Qods et des Gardiens de la révolution à Tripoli semble être un fait nouveau. Enfin, il fait pression sur le gouvernement égyptien pour renouer des relations interrompues à l’époque d’Anouar el-Sadate.
Comment interprétez-vous l’action de ce pays, sachant par ailleurs que le pouvoir iranien connaît en son sein une lutte d’influence très importante ?
M. le ministre d’État. […] Monsieur Boucheron, la Grande-Bretagne a estimé qu’elle n’avait pas à livrer de matériels aux populations du djebel Nefoussa et ne l’a pas fait, contrairement à nous – cette opération est d’ailleurs terminée.
Je n’ai aucune information permettant de dire que des cadres d’Al-Qaida se transfèrent vers AQMI, mais, au début de la crise, on ne peut exclure qu’il y ait eu des transferts d’armements entre la Libye et le Sahel.
Cela a eu peut-être un effet bénéfique, en provoquant une prise de conscience de tous les pays riverains du Sahel, notamment l’Algérie. Celle-ci s’est engagée dans un processus de coopération régionale avec la Mauritanie et le Niger – qui sont déterminés – ainsi que le Mali pour mener ensemble des opérations militaires contre la pénétration du terrorisme d’AQMI. La France apporte son soutien au travers de son système de renseignement et de formation. Mais il revient aux puissances sahéliennes de s’engager en première ligne, ce qu’elles font de façon plus volontariste depuis quelques mois.
[…]
Sur la politique européenne de voisinage, nous avons clairement dit et obtenu que les instruments financiers restent destinés pour les deux tiers au Sud de la Méditerranée et pour le tiers restant au Partenariat oriental.
Il est évident que la présidence polonaise attachera de l’importance à ce dernier – un sommet du Partenariat oriental est prévu fin septembre –, mais cela ne veut pas dire que la priorité accordée au Sud de la Méditerranée sera mise en cause.
[…]
Monsieur Myard, l’évaluation des pertes civiles en Syrie est de l’ordre de 1 300 à 1 500 morts et, en Libye, d’au minimum 10 000, vraisemblablement beaucoup plus.
Je me réjouis par ailleurs de votre conversion soudaine à l’Europe de la défense ! Vous semblez en effet regretter que nous n’ayons pas de quartier général pour conduire les opérations européennes ni une politique de sécurité et de défense communes plus efficace…
Il est vrai que nous sommes en retard à cet égard. Dans la lettre des membres du Triangle de Weimar que nous avons adressée au Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, nous avons notamment demandé qu’il y ait en Europe un système de planification et de commandement. Lorsque nous sommes intervenus en Libye, il a fallu faire appel aux États-Unis puis à l’OTAN. Je cherche, pour ma part, à combler cette carence européenne.
La situation en Syrie a bien sûr des conséquences préoccupantes sur Israël. Il y a eu des incidents sur le plateau du Golan, sans doute manipulés par Damas. Nous faisons valoir cet argument auprès des autorités israéliennes et leur rappelons qu’elles sont dans un univers mobile et imprévisible, qui appelle à prendre des initiatives pour sortir du blocage actuel des négociations.
Monsieur Guibal, la Turquie veut jouer un rôle en Libye et nous en sommes d’accord. Elle peut avoir beaucoup d’influence dans la région ; elle a reconnu le CNT et elle organise à Istanbul le 15 juillet la prochaine réunion du Groupe de contact. Nous comptons beaucoup sur son soutien. Il est vrai que l’AKP, qui est le parti majoritaire, sert parfois de référence à nombre de pays, qui y voient un parti d’essence islamiste mais démocratique – en tout cas aujourd’hui.
Le projet d’Erasmus méditerranéen est toujours à l’ordre du jour. Nous essayons de le mettre au point dans le cadre de la politique de voisinage de l’Union européenne. On voit la différence d’approche avec l’office méditerranéen de la jeunesse : Erasmus est un système européen proposé aux pays du Sud, alors que cet office est un projet partagé, le principe même de l’UpM étant l’égalité de responsabilité, avec un secrétaire général venant du Sud et un siège situé au Nord. Au sein des instances dirigeantes de cette organisation, siègent de fait côte à côte un Israélien et un Palestinien.
Le dialogue « 5+5 » est certainement utile, sauf que dans les « 5 » du Sud figure la Libye ; le dialogue est donc un peu en sommeil pour l’instant.
Monsieur Bascou, nous n’avons pas cherché à écarter l’Union africaine. Nous l’avons même invitée dès le départ dans les réunions du Groupe de contact. Le problème est qu’elle est divisée. En son sein, certains chefs d’État et de gouvernement souhaitent et ont dit que Kadhafi devait partir, alors que d’autres ont eu à cet égard, au moins au départ, une attitude différente.
Aujourd’hui, les choses ont évolué. Dans l’Union africaine, on ne se demande plus si Kadhafi doit partir, mais quand et comment. On recherche le moyen de lui permettre de le faire dans la dignité. Nous sommes ouverts à toute suggestion, mais nous disons clairement que Kadhafi doit s’écarter du processus politique de construction de la nouvelle Libye.
Je rappelle que dès le départ, trois pays africains ont voté en faveur de la résolution 1973 : l’Afrique du Sud, le Nigeria et le Gabon.
Quant à l’Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne, elle a certainement un rôle à jouer. Elle se réunit régulièrement et peut prendre des initiatives décisives pour mobiliser les opinions publiques et les peuples.
Monsieur Guillet, notre souhait est que l’Iran ne joue plus un rôle négatif dans l’ensemble du Proche-Orient et du Moyen-Orient.
D’abord, l’Iran continue à exercer une répression très sévère contre tous les partis d’opposition – les principaux opposants sont en résidence surveillée ou en prison – et tous ceux qui veulent exprimer leur aspiration à la liberté.
De plus, son rôle apparaît néfaste au Liban dans son soutien au Hezbollah et en Palestine dans celui apporté au Hamas. On met aussi en cause son intervention à Bahreïn, selon les autorités de ce pays. Cet interventionnisme est très préoccupant.
Je n’ai en revanche pas d’information sur une éventuelle présence iranienne à Tripoli.
L’Iran est incertain face au printemps arabe. Sa ligne de conduite est avant tout de savoir quelles sont les communautés en cause. Certains de mes amis des pays de la région me disent que nous sous-estimons en Europe la guerre de religions existant sur place entre chiites et sunnites, laquelle explique souvent l’intervention de cet État, autant que les considérations géopolitiques.
Enfin, la France reste extrêmement ferme et souhaite une attitude dure de la communauté internationale vis-à-vis de l’accès de l’Iran à l’arme nucléaire. Cet accès constituerait un véritable séisme politique pour l’ensemble de la région. Nous sommes déterminés à tout faire, par le dialogue, voire par des sanctions accrues – celles-ci commencent à produire des effets sur la situation en Iran –, pour dissuader ce pays de continuer à vouloir accéder à cette arme.
Mme Martine Aurillac, présidente. Merci, monsieur le ministre d’État, pour ce tour d’horizon précis et intéressant
16.- Mercredi 5 octobre 2011, séance de 9 heures 45, compte rendu n° 2 : examen du rapport de la mission d’information « L’Iran après 2008 »
M. Jean-Louis Bianco, président. Je voudrais d’abord saluer la pertinence de la démarche qui a été adoptée pour la création de cette mission d’information, qui visait à faire le point, deux ou trois ans après, de l’évolution d’une situation décrite dans un premier rapport présenté devant la Commission fin 2008, dont le thème était « Iran et équilibre géopolitique au Moyen-Orient ».
Je tiens à remercier les membres de la Mission qui, en dépit d’agendas chargés, ont assisté à nos travaux, ainsi que les diplomates du ministère des affaires étrangères et européennes qui ont été très disponibles et efficaces, à Paris comme dans les pays où nous nous sommes rendus.
Je rappellerai rapidement les conclusions du rapport de décembre 2008 : l’Iran nous était apparu comme une puissance moyen-orientale disposant de voies d’influence multiples, mais qui souffrait de faiblesses structurelles ; nous n’avions pas de doutes sur l’existence d’un programme nucléaire ayant des visées militaires mais nous nous interrogions sur l’effet des sanctions.
Je dois dire que les événements qu’a connus l’Iran depuis lors ont largement confirmé les analyses que nous avions faites. Je vais laisser au Rapporteur le soin de présenter l’évolution de la situation intérieure au cours des dernières années, évolution qui a été particulièrement forte.
M. Jean-Jacques Guillet, rapporteur. Dans ce rapport, nous avons souhaité aller au-delà des questions nucléaires et géopolitiques, qui sont elles aussi traitées, naturellement, en approfondissant l’étude de la situation politique, économique et sociale de l’Iran. Contrairement à la Mission précédente, nous n’avons pas effectué de déplacement dans le pays, craignant que l’accueil des autorités iraniennes ne soit doublé d’un encadrement de notre programme qui nous aurait empêchés de mener des investigations utiles. Nous avons donc tiré nos informations de nombreuses auditions à Paris et dans les villes où nous nous sommes rendus, Moscou, New York et Washington, Londres et Vienne. Nous sommes arrivés à la conclusion que l’Iran avait des forces et des faiblesses, mais que ces dernières l’emportaient actuellement, tant au plan politique qu’au plan économique.
La situation intérieure iranienne peut être qualifiée de « bipolaire » au sens où elle est marquée par la conjonction d’un champ politique clos issu de la révolution islamique et d’une société qui a beaucoup changé au cours des dernières décennies, la distance entre les deux étant apparue au grand jour à l’occasion des événements de juin 2009, même si les manifestations étudiantes de 1999 puis les mouvements sociaux actifs pendant la présidence de M. Khatami en étaient les premiers témoignages.
Depuis la révolution islamique et surtout depuis la fin de la guerre Iran-Irak, le pays a connu une urbanisation rapide, s’éloignant rapidement de la société rurale que le Chah voulait moderniser par sa « révolution blanche », et la société présente désormais des caractéristiques occidentales, en matière d’éducation (le taux d’alphabétisation est très élevé, le pays compte 2 200 universités, le nombre d’étudiants a explosé et la part des femmes atteint 60 % parmi eux), de place de la femme (éduquées, les femmes ont acquis une place importante dans le monde du travail, représentent 30 % des fonctionnaires, ont développé des mouvements féministes et une presse féminine), d’utilisation des techniques de l’information (38 % des Iraniens sont des internautes, contre 28 % des Turcs, dont le pays est pourtant plus développé économiquement), de modes de vie (qui sont « mondialisés », sinon occidentalisés).
Mais, dans le même temps, la classe politique est restée fermée sur elle-même, animée par des luttes de pouvoir déconnectées à la fois des aspirations de la société et de la réalité du monde extérieur. Il est clair que l’accession à la fonction de guide suprême de l’ayatollah Khamenei, dont la légitimité religieuse et politique est très inférieure à celle de l’ayatollah Khomeiny, a contribué à attiser les luttes pour le pouvoir, qui étaient déjà très visibles sous la présidence de M. Khatami et le sont plus encore depuis l’arrivée au pouvoir de M. Ahmadinejad. Ce dernier a été réélu en juin 2009 dès le premier tour, à l’issue d’un scrutin entaché de fraudes massives, mais il aurait très bien pu être élu au deuxième tour si le scrutin s’était déroulé normalement. Les fraudes visaient certainement à conférer une légitimité incontestable à sa réélection ; elles ont eu l’effet inverse, sapant encore plus la position du Guide, qui en étaient à l’origine, et accentuant les luttes entre clans. Celles-ci ont atteint une visibilité nouvelle depuis le printemps dernier, autour de nominations de ministres, en particulier celle du ministre en charge du pétrole, mais aussi sur des questions de fond, comme le rôle de l’Iran dans le monde.
Le pouvoir repose actuellement sur trois pieds : le Guide, qui est à la tête de l’armée, des Gardiens de la révolution et de la politique étrangère du pays, le président de la République, qui utilise régulièrement son pouvoir de désignation pour placer des proches aux postes clés du régime, et le corps des Gardiens de la révolution, dont la légitimité s’est forgée pendant la guerre Iran-Irak, qui contrôle la quasi-totalité de l’économie, en dirigeant à la fois les entreprises publiques et celles qui ont été privatisées et forme ainsi une classe de privilégiés très attachés au maintien du système. Des experts nous ont indiqué que, en cas de décès du Guide, les Gardiens de la révolution obtiendraient probablement la nomination d’un homme de faible envergure qui se contentera de servir leurs intérêts.
Progressivement, la République islamique issue de la révolution de 1979, qui avait des attributs démocratiques réels, s’est transformée en un régime proche de l’Union soviétique de Léonid Brejnev, entré dans une phase de glaciation à l’issue incertaine car menacé d’implosion par le centre.
Au plan économique, l’Iran est un pays riche dont les atouts sont peu exploités. Deuxième producteur mondial de pétrole, il tire 70 % de ses revenus de la rente pétrolière. Ses autres produits d’exportation sont encore les tapis et les pistaches, ce qui témoigne de son faible degré d’industrialisation, qui contraste avec le développement industriel de la Turquie. Les industries sont rares, même si certaines sont françaises ! Les exportations de pétrole sont nécessaires à la survie du régime : le budget de l’Etat repose actuellement sur un baril de brent à 80 dollars ; comme celui-ci est actuellement à 100 dollars, le pays, qui est en équilibre budgétaire, garde des marges de manœuvre, mais son développement est lent. Alors qu’il possède les deuxièmes réserves mondiales de gaz, il en est importateur net, faute d’investissements suffisants dans ce secteur. L’ensemble du secteur des hydrocarbures aurait besoin de 150 milliards de dollars d’investissement au cours des cinq prochaines années, niveau qui ne pourra être atteint en l’absence des grandes compagnies occidentales, que les sanctions des Nations unies empêchent d’intervenir en Iran ; les compagnies chinoises, qui ne sont pas aussi respectueuses de ces sanctions, ne sont pas très pressées d’investir en Iran et elles ne détiennent pas toutes les technologies, comme celle du gaz naturel liquéfié (GNL) dont le pays a besoin. Je signalerai le récent raccordement au réseau électrique de la centrale nucléaire de Busher, la première du pays : un parc nucléaire civil contribuerait aussi à mettre l’Iran en position d’exporter du gaz.
Le pays est en outre confronté à la question de l’utilisation de sa rente pétrolière, et de sa redistribution. Comme souvent dans les pays pétroliers, l’Iran a longtemps pratiqué le subventionnement des produits de première nécessité et de l’énergie. Le président Ahmadinejad a engagé un programme de réformes économiques qui incluait la création d’une taxe sur la valeur ajoutée, la hausse de la taxe sur le commerce et la suppression des subventions en cinq ans. La pression des bazaris a conduit à l’abandon du premier chantier et à la limitation de la taxe sur le commerce, mais le désubventionnement a commencé, même si le régime a eu la prudence d’accorder au préalable une aide directe aux personnes les plus modestes. Cette aide ne compensera pas intégralement les surcoûts et les conséquences sociales de la mesure sont incertaines, bien qu’elle soit rationnelle du point de vue économique. On peut aussi légitimement s’interroger sur l’utilisation qui sera faite de l’économie (de plusieurs dizaines de milliards de dollars) que cette réforme va générer : alimentera-t-elle la corruption si répandue dans le régime ? financera-t-elle l’aide de l’Iran à des mouvements étrangers comme le Hezbollah ? contribuera-t-elle à l’accélération du programme nucléaire ?
Avant de conclure sur la situation intérieure, je dirai un mot de la présence des entreprises françaises en Iran : Peugeot, dont l’Iran est le deuxième marché mondial après la France, Renault, Carrefour, qui y emploie 1 200 personnes, Systra, Legrand sont implantés en Iran et en sont satisfaits. Dans la mesure où leurs activités restent à l’écart du champ des sanctions (c’est-à-dire les technologies ou produits d’usage dual et le secteur des hydrocarbures), leur maintien est souhaitable, notamment pour préparer l’avenir.
Au final, alors que le président de la République est vivement critiqué, en particulier sur le faible rythme de la croissance, qui reste inférieur à 1 %, et que le risque social est important, la situation est très fragile dans ce pays déchiré entre une société prête à l’ouverture et des systèmes politiques et économiques qui n’ont pas évolué avec elle.
M. Jean-Louis Bianco, président. Concernant le dossier nucléaire et les relations internationales, auxquels je vais consacrer mon intervention, notre rapport de décembre 2008 s’achevait sur la recommandation suivante : ouvrir un véritable dialogue avec l’Iran en levant toute condition préalable, c’est-à-dire sans poser comme condition l’arrêt des activités liées au retraitement et à l’enrichissement de l’uranium, dans la mesure où l’Iran avait systématiquement refusé cette voie.
Force est de constater que le président Obama a accompli cette démarche d’ouverture, y compris dans son discours du Caire, et il a, entre autres choses, évoqué par deux fois la « République islamique », signifiant que son intention ne serait pas un changement de régime, au contraire de l’administration précédente. Pour résumer, les Iraniens n’ont pas saisi cette main tendue.
Il est patent, lorsque l’on discute avec des responsables de l’AIEA de différentes époques ou avec des négociateurs français et étrangers, que les Iraniens n’ont fait que gagner du temps. Quelques pseudo avancées ont été enregistrées, des hésitations ont pu traverser la classe dirigeante, mais dans l’ensemble le régime poursuit imperturbablement un programme nucléaire qui a évidemment des visées militaires.
Il est frappant de constater le relatif consensus qui existe au sein de la classe politique iranienne sur le dossier nucléaire, y compris ses visées militaires. La différence réside sans doute dans le fait que certains le placent plus bas que d’autres dans l’agenda. C’est le cas des conservateurs autour des Gardiens de la révolution, pour qui la priorité serait l’ouverture économique, en vue d’un développement du pays et des gains qu’ils pourraient en tirer. Au sein de la population, il existe un consensus sur le droit de l’Iran au nucléaire civil, mais sans bien distinguer les visées militaires du programme des visées civiles.
Les Iraniens ont connu des difficultés dans la conduite de leur programme. Les experts débattent de l’ampleur des retards. Indiscutablement, les virus informatiques, les pressions, les enlèvements et les assassinats, dont on devine l’origine, ont compliqué la tâche. Cependant les Iraniens avancent, avec des quantités d’uranium enrichi qui leur permettraient, quoiqu’ils ne disposent pas de toutes les étapes de la technologie, de fabriquer à échéance de deux ou trois ans des têtes nucléaires. Ils développent par ailleurs un programme balistique devant notamment permettre d’emporter des têtes nucléaires.
Il nous semble, comme à nos interlocuteurs, que l’Iran n’a pas forcément, à ce jour, décidé la fabrication d’une arme nucléaire, mais il se dote des moyens de pouvoir la fabriquer. Cela constituerait pour l’Iran, qui a la mémoire du conflit avec l’Irak, un facteur de dissuasion et cette possibilité lui fournit une arme politique lui permettant d’exercer une influence sur les affaires de la région et au-delà.
L’AIEA a confirmé dans ses différents rapports le fait que les Iraniens ne répondent pas à de nombreuses interrogations. Des documents, provenant probablement des services secrets, font état d’instructions précises sur le développement de l’uranium métal à partir de l’hexafluorure d’uranium et sur le développement du programme balistique. L’ambassadeur d’Iran auprès de l’AIEA à Vienne, dans cette façon typique de mentir qu’ont les responsables iraniens, m’a fait la remarque selon laquelle ces documents sont des faux puisqu’ils ne portent pas la mention « confidentiel défense ». Je ne suis pas sûr qu’une telle mention serait portée pour attirer l’attention de tout le monde…
On ne voit donc pas d’avancées dans les négociations mais le temps passe. Je rappelle brièvement l’épisode autour du réacteur de recherches à Téhéran produisant des radio-isotopes radioactifs, pour lesquels les Américains avaient proposé que l’uranium soit enrichi à l’étranger, en Russie et en France. Les Iraniens ont refusé. La Turquie et le Brésil ont ensuite formulé une proposition analogue mais avec deux différences majeures : il n’était pas prévu de contrôles et il était demandé la levée des sanctions. Cette proposition n’était évidemment pas recevable pour le groupe des Six.
Concernant le rôle régional de l’Iran, la société iranienne est plus ouverte, plus moderne, notamment dans la sphère privée qui constitue un espace de refuge. Cette société iranienne n’est en aucun cas antisémite ni antisioniste. Le « mouvement vert » a été le précurseur des révolutions arabes, avec 2 millions de personnes dans la rue, mais le régime a été particulièrement brutal et sophistiqué dans la répression en ciblant les personnes, les familles, les enfants, sans être nécessairement obligés de tirer sur les manifestants. Des conseils en ce sens au régime syrien ont probablement été prodigués au cours des derniers mois.
L’Iran a été embarrassé par les révolutions arabes et a tenté de récupérer ces mouvements. Mais nulle part, ni en Tunisie, ni en Libye, ni même à Bahreïn et au Yémen, les manifestants n’ont fait référence au modèle de régime iranien. Bien au contraire. L’Iran n’a pas pesé sur les évènements, sauf peut-être en Syrie en donnant des conseils « techniques » en matière de répression et sans doute quelques conseils de modération ou d’ouverture au régime. A Bahreïn, le soulèvement a une dimension chiite, mais ce n’est pas une dimension chiite pro-iranienne. Les Iraniens n’ont été que des spectateurs.
Le jeu iranien est subtil et marqué par une volonté de puissance. Ce pourrait être un rôle positif compte tenu de son influence en Afghanistan, en Irak, au Liban et Palestine ; mais tel n’est pas le cas. L’Iran a acquis un pouvoir politique et économique important en Irak et en Afghanistan, au moins dans la région de Herat, ce qui est à relier avec le rôle croissant des Gardiens de la révolution, dans le pays comme à l’extérieur.
En réponse à la situation, la communauté internationale a accentué les sanctions. La résolution 1929 qui les durcit a été votée – c’est important de le noter – avec le soutien de la Russie et de la Chine, mais l’opposition du Brésil et de la Turquie et l’abstention du Liban. S’y ajoutent des sanctions unilatérales, sans base juridique internationale, de l’Union européenne, des Etats-Unis et de plusieurs autres pays, qui ont une certaine efficacité économique mais n’ont pas fait bouger le régime d’un pouce dans sa détermination à poursuivre son programme nucléaire.
On est donc assez désarmé. Mais n’est-ce pas une illusion prométhéenne de croire que grâce à notre génie et nos valeurs nous forcerons les évolutions du monde ? On peut comprendre, accompagner des évolutions, mais pas les forcer. Un certain nombre d’initiatives peuvent toutefois être prises.
D’abord, de nouvelles sanctions nominatives pourraient être adoptées concernant le gel des avoirs ou l’interdiction de visa. Elles ont certes un effet moindre qu’en Syrie car il n’y a pas la même communauté d’hommes d’affaires souhaitant développer leurs activités à l’international. Les Iraniens sont cependant gênés par ces sanctions, brimés et irrités au point par exemple d’avoir envisagé des mesures de rétorsion contre des Américains. Il s’agit de cibler des ministres, des chefs de la police, des chefs de prison qui prennent part à la répression de toute opposition.
Par ailleurs, un certain nombre d’associations, notamment des ONG américaines, travaillent pour permettre aux internautes d’échapper à la police d’internet, qui est en Iran aussi forte qu’en Chine. De la même manière, les autorités brouillent en Iran les émissions qui proviennent du reste du monde, notamment de France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis. Il n’y a pas de moyens juridiques de demander à Eutelsat, le principal diffuseur, d’exiger qu’il soit mis un terme au brouillage des émissions étrangères. Cependant, il s’agit d’une question politique : peut-on accepter que des entreprises profondément connectées au monde occidental se fassent complices d’un régime qui brime sa population en matière d’accès à l’information ?
Telles sont donc les pistes – modestes – proposées : continuer d’abord à être attentif, sur le dossier nucléaire, sachant que l’AIEA, avec une nouvelle équipe, fait très sérieusement son travail ; ensuite poursuivre une politique de sanctions nominatives et, enfin, mettre tout en œuvre pour accroître la liberté d’information que ce soit sur internet ou par l’accès aux télévisions non iraniennes.
M. le président Axel Poniatowski. L’Iran exporte du pétrole brut et importe une partie importante de son essence. La croissance du pays n’est pas supérieure à 1 %. Le système de raffinage est dans un état de délabrement avancé. Considérant que les sanctions empêchent les groupes étrangers d’investir dans les structures d’extraction, avez-vous pu mesurer à partir de quel moment l’exploitation chutera très fortement ? Avez-vous une estimation de l’impact économique que cela aura sur le pays dont les matières premières représentent 70 % des revenus ?
M. Jean-Jacques Guillet, rapporteur. Une évaluation sur la durée est difficile à faire. Le pays importe effectivement une partie de son essence. Le président Rafsandjani avait fait le choix politique, lors de la guerre Iran-Irak, de privilégier l’industrie de transformation du pétrole sur le raffinage, malgré le risque que pouvait faire peser un embargo sur les importations d’essence. C’est pourquoi les infrastructures de raffinage en Iran sont relativement limitées. Actuellement, une raffinerie est en cours de construction avec l’aide des Chinois, dans les environs de Téhéran. Il y a donc une volonté de s’équiper dans ce domaine.
De plus, la politique de désubventionnement entreprise par le président Ahmadinejad va dans le sens d’une meilleure efficacité énergétique, ce qui montre que le régime est sensible à la dépendance du pays. Avec la fin des subventions, les Iraniens auront certainement plus le souci d’économiser l’essence.
Les besoins en investissements pour les infrastructures s’élèvent de 150 à 200 milliards de dollars mais, malgré leur vétusté, les infrastructures fonctionnent encore, bien que de manière non optimale. La Compagnie nationale iranienne du pétrole, la NIOC (National Iranian Oil Company) fonctionne, avec des ingénieurs compétents, même s’ils ne disposent pas toujours d’une formation de pointe.
Il est intéressant de noter à ce sujet la différence entre la nature des sanctions américaines et européennes. Par exemple, Total ne peut plus faire venir en France des ingénieurs iraniens pour les former, ce qui aurait l’avantage de créer un flux d’informations, de connaissances et une ouverture pour ce milieu particulièrement éduqué, alors que les Américains le peuvent car les sanctions n’ont pas la même portée pour leurs entreprises. Les Américains invitent donc, et c’est paradoxal, des ingénieurs iraniens pour se former aux Etats-Unis.
Le principal problème des infrastructures iraniennes se pose pour le gaz, qui ne peut être exploité que de façon insuffisante. Le pays n’a pas la capacité d’exploiter ses très importants gisements et il ne peut produire de gaz naturel liquéfié (GNL). L’Iran a signé avec l’Indonésie un contrat d’exportation de GNL, qui doit être mis en oeuvre à partir de 2013, mais il ne dispose pas des capacités pour construire les infrastructures de production, très coûteuses et complexes, de GNL. En réalité, seuls les Occidentaux maîtrisent cette technologie, que ni les Russes, ni les Chinois, ne peuvent fournir aux Iraniens.
Pour répondre directement à votre question, l’extraction d’hydrocarbures en Iran peut durer encore assez longtemps, même si elle déclinera progressivement.
Pour revenir aux sanctions et à leurs effets, une véritable économie des frontières a émergé depuis quelques années. C’est le cas avec la contrebande à la frontière afghane, notamment le trafic de drogue. D’ailleurs, les ravages de la drogue en Iran sont importants notamment au sein de la jeunesse, ce qui explique que les trafiquants de drogue soient passibles de la peine capitale.
Mais il y a également une économie des frontières avec l’Irak, notamment un gazoduc entre les deux pays, qui constitue un lien autant politique qu’industriel. Enfin, la contrebande avec la Turquie est un problème ancien qui perdure.
M. Jean-Marc Roubaud. L’Iran est un pays important pour la stabilité de la région et son évolution est extrêmement inquiétante. Deux évènements importants sont intervenus depuis la précédente mission d’information : l’élection présidentielle iranienne et l’élection du président américain. Depuis lors, constate t-on une volonté des Iraniens de s’engager davantage dans la politique intérieure de leur pays ? Le taux de participation au scrutin de juin 2009 était nettement supérieur à celui de 2005. L’opinion publique iranienne s’est ensuite mobilisée et aspire à un changement. Peut-on assister aux mêmes évènements qu’en Tunisie et en Egypte ?
Enfin, les sanctions sont-elles efficaces ? Lors du précédent rapport, nous avions conclu que leurs effets étaient limités mais le rapporteur a semblé nous dire que leurs conséquences étaient désormais importantes.
M. Jean-Louis Bianco, président. Il faut en effet souligner le taux de participation considérable à cette élection, même si les sources officielles sont sujettes à caution. Il y a un désir de cette société à se diriger vers un système plus démocratique. Cela rejoint l’interprétation de certains chercheurs que nous avons rencontrés. Avant d’être brouillée, la BBC avait diffusé des programmes en persan informant les citoyens iraniens sur les candidats et leurs positions. Il semblerait qu’à la suite de cette initiative, la télévision iranienne ait voulu faire de même dans le but d’orienter le vote. Mais cela a déclenché, au contraire, une grande attente de la part des électeurs.
Sur l’évolution future, nous avons rencontré des militants courageux et déterminés mais qui n’ont pas d’espoir à court terme. L’opposition ne dispose pas d’un chef reconnu, M. Moussavi n’étant qu’un leader par défaut, et la répression reste très efficace. Le développement d’un nouveau mouvement de rue en Iran est, à notre sens, peu probable.
Il existe des contradictions à l’intérieur même du système, donc l’équilibre peut durer ou se rompre à tout moment. Mais là encore, il paraît difficile d’imaginer l’avènement d’un réformateur issu du système, à l’instar du rôle joué par Mikhaïl Gorbatchev en Union soviétique.
Concernant les sanctions, celles-ci n’ont pas atteint la détermination du régime et le programme nucléaire continue. Tant que le prix du pétrole restera au niveau actuel, l’Iran poursuit à peu près son développement à un rythme lent et bien qu’il accumule un retard important sur la modernisation nécessaire des infrastructures pétrolières et gazières.
M. Jean-Michel Ferrand. Il a été dit qu’il n’y avait pas d’antisémitisme de la part de l’Etat iranien mais nous n’avons pas abordé l’attitude de l’Etat vis-à-vis des minorités chrétiennes. Y a-t-il une minorité chrétienne et quel est le statut des chrétiens dans ce pays ?
M. Jean-Jacques Guillet, rapporteur. Je reviens sur la question de M. Roubaud. Il y aura des élections législatives en 2012 et des élections présidentielles en 2013. Nous verrons comment se manifeste la société iranienne en retenant bien que le système est très contrôlé : les candidatures sont filtrées, les bureaux de vote sont mobiles, il n’y a pas de bulletins de vote imprimés, pas de listes électorales. Il est difficile d’estimer la participation, même s’il semblerait effectivement qu’elle ait été forte en 2009.
Concernant les minorités en Iran, celles-ci sont en général opprimées, mais il faut distinguer entre plusieurs types de minorités. Comme vous le savez, le chiisme est religion d’Etat en Iran. Les sunnites représentent 10 % de la population, ce qui n’est pas négligeable, mais sont marginalisés. Ils sont localisés principalement dans le Sud et dans le Baloutchistan, où il existe une rébellion baloutche, qui suscite la crainte du régime.
Les Kurdes sont une deuxième minorité qui a posé des problèmes, à l’époque du Chah et restent brimés. Ils ont des liens avec le Kurdistan irakien et le Sud-est de la Turquie.
Les Azéris représentent, eux, une partie significative de la population, et sont plus un groupe qu’une simple minorité.
Enfin, les chrétiens se composent de deux catégories : les Arméniens, qui sont bien implantés et intégrés – je rappelle que les relations de l’Iran avec l’Arménie sont excellentes – et les convertis récents, qui sont, eux, largement persécutés.
M. Jean-Michel Boucheron. Il n’y a pas d’antisémitisme en Iran, je le confirme. Il suffit par exemple de rappeler qu’il y a trois ans, deux députés juifs au parlement iranien ont obtenu l’interdiction de la diffusion d’un feuilleton antisémite à la télévision. C’est un signe.
Cela étant, je suis d’accord sur le fait que l’Iran travaille sur l’arme atomique, il n’y a aucun doute là-dessus. Mais le véritable danger nous vient du lobby américain qui nous fait croire à un risque balistique iranien ! Il faut en être bien convaincu ! Il s’agit pour les Etats-Unis de vendre aux Européens leur système antimissile et leur technologie, rien d’autre. Le danger missilien iranien ne fait peur à personne et nous sommes les dindons de la farce ! N’oublions pas que les entreprises américaines n’ont rien perdu des sanctions contre l’Iran, puisqu’elles n’avaient plus de relations économiques avec lui depuis 1979. Alors que nous, Européens, avons beaucoup perdu, et nous Français, en particulier !
On a dit à juste titre que les Iraniens ne pouvaient plus exporter beaucoup de gaz et de pétrole, faute de technologie et d’ingénieurs, qu’ils ne peuvent plus former. Mais nous sommes, nous, les véritables victimes de cette situation, car nous ne pouvons pas utiliser le gazoduc Nabucco qui nous donnerait une autonomie par rapport à la Russie de Poutine. Il faut donc sortir de ce jeu enfantin, d’autant plus que l’embargo renforce clairement le régime qui craint de s’ouvrir sur le monde occidental.
M. le président Axel Poniatowski. Votre position a le mérite de la cohérence, et je voudrais avoir les mêmes absolues certitudes que vous !
M. Jean-Michel Boucheron. Laissez-moi vous emmener à Washington !
M. Robert Lecou. On a l’impression d’un vase clos. Comment le couvercle
va-t-il sauter ? L’économie est artificielle, le système politique archaïque, les pressions n’aboutissent pas. L’ouverture viendra-t-elle du pouvoir législatif ? De la pression populaire ?
M. Jean-Louis Bianco, président. Les ingrédients sont effectivement réunis pour que ça saute, mais quand ? Et comment ? Personne ne le sait. Il faudra suivre ce qui se passera au moment des prochaines élections. Si le poids des Gardiens de la révolution diminue, il y aura sans doute une ouverture économique, et peut-être une évolution sur le dossier nucléaire aussi. Je ne crois pas vraiment à l’effet des mouvements de la rue, compte tenu de l’efficacité de la répression et du manque de leaders. On ne sait pas vraiment par quoi tout cela va passer. Il y a une « désislamisation » certaine de la société, le poids des religieux diminue et la religion, comme nous l’a dit un chercheur, glisse sur les jeunes comme l’eau sur les plumes d’un canard. Le statu quo est intenable.
M. Jean-Jacques Guillet, rapporteur. Des experts disent que les Gardiens de la révolution seront peut-être un des éléments de l’évolution, mais il est impossible d’être affirmatif.
Mme Marie-Louise Fort. Comment le « printemps arabe » est-il perçu en Iran ? De quelle manière la montée en puissance de la Turquie, sa démocratie sont-elles vues ? Est-ce que cette comparaison importe en Iran ?
M. Jean-Jacques Guillet, rapporteur. En ce qui concerne le « printemps arabe », la principale préoccupation des dirigeants iraniens, c’est l’Arabie saoudite. Et vice-versa, d’ailleurs ! Ils observent les choses : il ne faut pas oublier qu’il s’en passe beaucoup, comme l’octroi récent du droit de vote aux femmes, par exemple. Quant à la Turquie, il n’y a pas de comparaison avec l’Iran. Ce sont deux pays dont les dirigeants se rencontrent et qui font des affaires ensemble, mais cela ne se pose pas en termes de comparaison.
M. Jean-Louis Bianco, président. Wikileaks a montré à quel point les pays du Golfe étaient totalement paniqués par la perspective d’un Iran nucléaire. Et ce qui passe dans les pays arabes se traduit par un peu d’espoir pour la société civile. Quant à la Turquie, dans la mesure où elle se sent rejetée par l’Union européenne, elle s’affirme comme une puissance géostratégique dans la région et elle est plus ouverte à l’Iran. D’autre part, il y a eu des gestes forts en direction de l’Egypte, dont le gouvernement de transition est moins hostile à l’Iran que le régime d’Hosni Moubarak. Il est néanmoins peu probable que les Egyptiens deviennent de proches alliés des Iraniens. D’une manière générale, l’Iran comme Israël d’ailleurs, s’inquiète de tout changement.
M. Jacques Remiller. Qu’en est-il de l’opposition entre le président de la République et les mollahs ? Il semble que les relations se soient aggravées depuis l’été entre le président et les autres autorités.
M. Jean-Jacques Guillet, rapporteur. Oui, il est effectivement dans une situation fragile, mais c’est une situation où tout le monde se tient par la barbichette et où chacun a besoin des autres. L’équilibre est fragile. Le Guide est lui-même inquiet pour sa position ; il a été mis en minorité en 2006 à l’élection du Conseil des experts. On est dans une lutte de clans. Le parlement a récemment convoqué le président de la République pour lui demander des explications sur la croissance, entre autres choses, et notamment sur ses relations avec la Guide. On est dans un équilibre totalement instable, comme on a pu le voir aussi lors de l’épisode de la nomination de ministres où le Guide et les fondamentalistes du parlement se sont opposés.
M. Jean-Pierre Kucheida. Votre rapport est extrêmement intéressant. J’aurais aimé savoir quelles sont les relations entre l’Iran et les taliban afghans ou avec ceux qui se trouvent au Baloutchistan, qu’ils soient iraniens ou pakistanais ?
M. Jean-Louis Bianco, président. Lors de la mission précédente, les Iraniens avaient insisté sur le fait qu’ils étaient victimes des taliban. On n’entend plus ce discours aujourd’hui et on se situe désormais davantage dans la logique « les ennemis de nos ennemis deviennent nos amis ».
M. Jacques Myard. Sur le programme nucléaire, l’Iran n’est entouré que de puissances nucléaires et il y a un consensus national sur la volonté d’arriver au seuil nucléaire. Il faut se garder d’anathème hâtif et ne pas céder à la propagande en croyant que l’Iran nucléaire est une menace pour la région. Sur l’antisémitisme, ce pays est certainement plus antisunnite qu’antisémite. Il n’y a qu’un député juif au Parlement iranien, que j’ai rencontré à Paris, et qui m’a affirmé qu’Ahmadinejad lui-même avait subventionné l’hôpital juif de Téhéran, ce que n’ai pas pu vérifier. Je rappelle que la communauté juive compte seulement 30 000 personnes dans le pays.
Je voulais vous interroger sur le déclin de la religiosité. En conclusion, j’estime que la meilleure sanction est l’ouverture. Plus on sanctionne ce pays, plus il se va refermer sur lui-même et plus la cohésion nationale va primer. En définitive, pour l’équilibre de cette région, les Anglais ne se seraient-ils pas lourdement trompés en disant qu’il fallait « nourrir les Arabes et affamer les Perses » ?
M. Jean-Louis Bianco, président. Je ne reviens pas sur la question de l’antisémitisme mais je rappelle les propos scandaleux et inacceptables du président Ahmadinejad, au point même que le Guide s’est senti obligé de les modérer. Deuxièmement, nous ne jetons pas l’anathème sur l’Iran : j’ai rappelé les raisons logiques de leur position sur la question nucléaire et notamment l’importance de dissuasion pour eux. Troisièmement, ils ne veulent pas de l’ouverture car ils savent que cela remettrait en cause l’équilibre du système. Ce serait une manière de défendre les intérêts légitimes français et européens mais le régime ne l’accepterait pas, même si nous levions les sanctions.
M. Jacques Myard. Où en est M. Halliburton dans le commerce avec l’Iran à travers les sociétés « soviétiques », pour parler français ?
M. Jean-Louis Bianco, président. On nous a expliqué qu’il y avait eu des progrès dans la détection et l’élimination des sociétés offshore. Cela continue à exister, malgré des résultats sensibles. Je ne sais pas ce qu’il en est pour Halliburton en particulier.
M. Jean-Paul Lecoq. Je trouve regrettable le parallèle avec l’Union soviétique, ça nous rappelle une histoire du siècle dernier. Pourriez-vous préciser les relations économiques ? Vous dites que Peugeot et Renault sont présents en Iran. Est-ce qu’ils produisent en Iran et vendent ensuite leur production en France ? Dans ce cas, la sanction serait pour les travailleurs français et pas pour l’Etat iranien !
Sur les questions liées au nucléaire, je partage ce qu’a dit Jacques Myard. La question n’est pas nucléaire. Je rappelle qu’il y a trois ou quatre ans, nous étions au bord de la guerre et la commission des Affaires étrangères a eu la sagesse de faire une mission pour examiner la situation plus en détail.
J’aimerais en savoir plus sur le rôle de Total. Quelles sont ses activités en Iran ? Total prétend qu’il était juste de rester dans le pays, sinon les Américains ou les Britanniques auraient pris la place.
J’aimerais enfin savoir qui sont ces Moudjahidins du peuple qui essaient de nous faire signer des pétitions devant l’Assemblée ou au Conseil de l’Europe et nous envoient leur documentation. Comment sont-ils perçus par le peuple iranien et quel rôle jouent-ils ?
M. le président Axel Poniatowski. Je vous encourage à vous méfier de ces personnes.
M. Jean-Jacques Guillet, rapporteur. Sur la présence industrielle française, Renault et Peugeot produisent des voitures sur place, principalement pour le marché intérieur et un peu pour les exportations vers l’Asie. Total n’est plus du tout présent, à part un représentant sur place, et a dû abandonner le travail accompli au cours des trente dernières années en Iran. Les Chinois sont relativement peu présents et n’ont pas autant profité du vide occidental qu’on pouvait le craindre ; ils sont davantage intéressés par l’Afrique.
En ce qui concerne les Moudjahidines du peuple, ils n’ont aucune implantation en Iran et ont une très mauvaise image. Ils avaient en effet fomenté des attentats au lendemain de la révolution islamique. Ils étaient alliés du premier président de la République islamique et sont ensuite entrés dans l’opposition violente. Ils ont également été alliés de l’Irak lors de la guerre Iran-Irak. Les Iraniens ne l’ont pas oublié. Pour eux, il s’agit d’une organisation terroriste. Je suis donc plus que réservé sur l’action qu’ils mènent en France et ailleurs. Lorsque nous étions au département d’Etat à Washington, ils manifestaient devant les bureaux.
M. Jean-Louis Bianco, président. Cette organisation n’est en aucun cas démocratique. Ils se présentent à l’Assemblée et aux congrès des partis politiques. Méfiez-vous car des collègues ont donné leur signature de bonne foi à ces gens.
M. Jacques Myard. Leur seule action a été de fournir les premiers renseignements sur le programme nucléaire.
M. le président Axel Poniatowski. Je dirais même que leur fonctionnement s’apparente à celui d’une secte. La personne à la tête de cette organisation a poussé au suicide un certain nombre de gens qui l’entouraient.
M. Jean-Claude Guibal. Ma question porte sur les relations entre l’Iran et l’Arabie saoudite, c’est-à-dire entre les deux écoles du monde musulman, les chiites et les sunnites. Est-ce que la prégnance moindre de la religion, en particulier en Iran, risque à terme de modifier cet antagonisme d’adversaires préférés ou y a-t-il d’autres raisons à cet antagonisme ?
M. Jean-Jacques Guillet, rapporteur. Il y a des raisons géographiques. Chacun est sur une rive du Golfe arabo-persique. Mais il ne faut pas oublier qu’en Arabie saoudite, le sunnisme prend une forme particulière, le wahhabisme, complètement étranger au chiisme, qui est sur le fond assez libéral. Cette opposition existera toujours. Il y a incontestablement un recul de la pratique religieuse chez la jeunesse iranienne, qui ne profite pas au sunnisme mais correspond bien à une société chiite assez libre au fond, si on excepte les excès révolutionnaires. La société saoudienne est plus rigoriste. Il ne faut pas oublier non plus qu’il y a une minorité chiite en Arabie saoudite, en particulier dans la région pétrolière.
17.- Mercredi 12 octobre 2011, séance de 9 heures 30, compte rendu n° 3 : audition de M. Burhan Ghalioun, président du Conseil national syrien, et Mme Bassma Kodmani, membre du bureau exécutif du Conseil national syrien
M. le président Axel Poniatowski. Je suis heureux d’accueillir M. Burhan Ghalioun, président du Conseil national syrien (CNS), et Mme Bassma Kodmani, membre du bureau exécutif du Conseil national syrien (CNS), pour une audition sur la situation de la Syrie.
Cette audition est, pour notre commission, l’occasion de saluer la création du Conseil national syrien et, à travers lui, de rendre hommage au courage de ceux qui, en ce moment même et depuis le mois de mars, se dressent contre la dictature en dépit d’une répression féroce qui a tué plus de 3 200 personnes, pour l’essentiel des civils.
La création du Conseil national a été saluée par tous ceux qui déploraient que l’opposition syrienne demeurât fractionnée. Votre mouvement rassemble, je crois, la quasi-totalité des partis d’opposition et comprend des nationalistes, des libéraux et des islamistes. Il réunit des courants qui structurent la résistance à l’intérieur du pays et l’opposition en exil.
Votre audition est aussi l’occasion de mieux comprendre ce qui se passe en Syrie et de mieux appréhender son avenir. Quelles sont les chances que le régime en place, qui ne donne pour le moment aucun signe d’assouplissement, finisse par accepter de nouer un vrai dialogue et s’engage sur la voie de la transition démocratique ?
Mme Bassma Kodmani, membre du bureau exécutif du Conseil national syrien. Je souhaite évoquer les principales préoccupations actuelles du CNS.
Celui-ci a vu le jour après plus de deux mois de consultation. Tout au long de sa formation, les forces politiques traditionnelles de Syrie, qui s’entredéchirent habituellement, ont suivi le mouvement de la rue : lorsque les jeunes, c’est-à-dire les comités de coordination sur le terrain, ont indiqué qu’ils voulaient le rejoindre, les autres forces ont suivi. Cela est très intéressant pour l’avenir et explique sans doute le succès du CNS, qui semble avoir rallié environ 80 % de l’opposition.
La situation politique dans le pays, qui est très mouvante, repose sur ces deux composantes principales : les forces politiques traditionnelles, qui sont présentes dans le CNS – élément important car signe d’unité –, mais ne sont pas forcément les plus importantes sur le terrain, et le mouvement de révolte proprement dit.
Il reste toujours des personnes critiques à l’égard du CNS, mais notre porte leur reste ouverte pour qu’ils nous rejoignent. Cette instance est un cadre national alternatif, à l’intérieur duquel toutes les forces politiques peuvent entrer, même si elles ont entre elles des différends.
Concernant la révolte, je m’exprimerai à titre personnel, en tant qu’analyste. Si le CNS s’est énergiquement employé à rassembler toutes les composantes de l’opposition, ses positions sur les grandes questions en cours ne sont pas encore arrêtées, même si des groupes de réflexion y travaillent.
Deux questions fondamentales se posent. D’abord, soutenons-nous la révolte armée ? La réponse est non, mais face à la situation sur le terrain et la répression qui radicalise la rue, il faut trouver les arguments et les actes qui donnent de l’espoir aux manifestants et permettent d’éloigner la tentation du recours aux armes. Deuxièmement, souhaitons-nous une intervention militaire ? Le Conseil demande la protection des populations civiles et celle-ci passe par divers moyens possibles dont aucun n’a encore pu être mis en œuvre
Cela étant, plusieurs éléments de consensus se dégagent à la fois au sein du CNS et sur le terrain : l’absence de dialogue possible avec le pouvoir en place ; le soutien à la révolte pacifique ; le refus de statuer sur une intervention militaire sans une longue discussion préalable – sachant que la population demande une protection internationale et nous presse de cesser de dire que nous ne voulons pas d’intervention.
Cela constitue pour nous un défi, car il n’y a pas au sein du CNS de soutien à l’intervention militaire, à supposer que celle-ci nous soit proposée. La réponse à cette question est retardée de quelques semaines, tant que nous n’avons pas la garantie d’obtenir une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU en ce sens et des mesures plus sévères à l’égard du pouvoir. Il y a donc une tension importante entre le terrain qui appelle à cette intervention et le CNS.
Nous devons examiner comment appliquer le principe de la responsabilité de protéger sans que cela ne se traduise par un scénario de type libyen, que personne ne souhaite au sein du CNS. Certains sont en faveur de l’envoi d’observateurs internationaux sur place, mais nous doutons que le pouvoir les accepte. Nous sommes donc pour l’instant en décalage par rapport à la demande et aux besoins de la population civile.
M. le président Axel Poniatowski. On a l’impression que la minorité chrétienne est restée en marge du mouvement de contestation par crainte de subir les mêmes problèmes que ceux observés en Irak il y a quelques mois ou en Égypte au cours des derniers jours. Pensez-vous que cette minorité rejoindra un jour le mouvement ?
M. Jean-Paul Lecoq. Ce mouvement recouvre-t-il certains foyers ou l’ensemble des provinces et des villes de Syrie ?
Pourquoi 20 % des forces de l’opposition ne sont-elles pas associées au CNS, alors que certains aimeraient l’être ?
M. Robert Lecou. La France, en tant que pays des droits de l’homme, n’est pas restée silencieuse à l’égard de la tragédie et de la répression sanglantes dans lesquelles est plongée la Syrie : elle a salué la création du CNS.
Mais notre pays est aussi celui de la laïcité, fondée sur la séparation entre le politique et le religieux et la tolérance vis-à-vis des cultes. Quelle est la position du CNS à l’égard de ce principe ? Ne peut-on craindre une islamisation du mouvement de contestation ?
M. François Rochebloine. Lors de son audition par notre commission il y a quelques années, Bachar el-Assad m’avait répondu qu’il n’y avait pas de prisonniers libanais en Syrie. Quelle appréciation portez-vous sur les relations syro-libanaises ? Comment voyez-vous leur avenir ?
M. Jean-Louis Bianco. Qu’est-ce que la France, l’Europe et la communauté internationale peuvent faire, en dehors de la question de la protection des populations civiles ? Le durcissement des sanctions évoqué par certains a-t-il un sens ? Serait-il efficace pour infléchir l’attitude du régime à l’égard du mouvement de contestation ?
M. Michel Terrot. La présence d’islamistes ou de fondamentalistes au sein du CNS suscite une certaine inquiétude : dans quelle mesure est-elle justifiée ?
M. Jean-Claude Guibal. Quelles sont les causes principales de la révolte contre le régime ? Sur quels soutiens le CNS envisage-t-il de s’appuyer en matière de politique étrangère ?
Mme Bassma Kodmani. La position des chrétiens est frustrante pour le mouvement de révolte, car cette minorité n’a jamais été menacée en Syrie. Nous avons d’ailleurs eu des premiers ministres chrétiens ; cette communauté a été très présente dans la vie politique comme dans la vie économique et elle n’a jamais subi de discrimination jusqu’ici.
Mais il est incontestable que le communautarisme s’est développé, ne serait-ce que parce que le pouvoir s’appuie sur une confession. Cela a engendré une dynamique communautaire : la résistance pacifique au régime de la famille du président syrien – en raison de son caractère autoritaire – et à la communauté qui monopolise le pouvoir a suscité à la fois une plus grande religiosité – vécue comme un refuge chez les musulmans – et un sentiment plus vif d’isolement dans la communauté chrétienne.
Le pouvoir prétend protéger celle-ci, mais au début de la révolte, elle était tétanisée. Ceux qui se sont engagés dans le mouvement de contestation – les jeunes pour l’essentiel – ou ceux qui étaient politisés ont compris le caractère parfaitement démocratique et areligieux du mouvement.
Mais ceux qui sont moins politisés, surtout ceux dont les intérêts sont liés au pouvoir, c’est-à-dire les familles ayant prospéré sous sa protection, ont peur pour ceux-ci. Ce qui se passe dans les pays voisins, que ce soit en Irak hier ou en Égypte aujourd’hui, nourrit également une inquiétude.
On assiste à une fragilisation des relations intercommunautaires : la communauté chrétienne ne craint pas d’être chassée mais les risques de revanche ou de conflit interconfessionnel impliquant la communauté alaouite qui est au pouvoir ne peuvent être écartés et nécessitent un traitement vigilant.
Le CNS, conscient de ces inquiétudes, a pour priorité d’accorder une place privilégiée aux communautés – lesquelles sont représentées au sein de son Bureau exécutif, qu’il s’agisse des chrétiens, des alaouites, des Druzes ou des Kurdes – sans tomber dans ce qu’on appelle le partage intercommunautaire : la confessionnalisation de la vie politique syrienne reste honnie de toutes les communautés.
Nous nous dirigeons vers la publication d’un texte qui constituerait une charte nationale entre les communautés, affirmant la neutralité de l’État vis-à-vis de la religion – principe qui est pour nous la meilleure garantie de l’égalité entre les citoyens.
M. Burhan Ghalioun, président du Conseil national syrien. Je voudrais tout d’abord m’excuser de mon retard. Nous préférons le terme de sécularisme à celui de laïcité, parce que dans la culture politique arabe, syrienne notamment, celui-ci est trop attaché au modèle français, c’est-à-dire à un État perçu essentiellement comme anticlérical et antireligieux. Depuis le début du soulèvement, tout le monde, y compris les islamistes, a adopté l’expression d’État civil, qui fait l’objet d’un consensus inconscient et désigne un État séculier, sans attache religieuse particulière et neutre à l’égard des convictions religieuses et politiques. Cela constitue une grande réussite et montre l’évolution des mentalités depuis quelques années.
Entre l’intervention militaire, qui nous est interdite jusqu’ici – à la fois du côté du Conseil de sécurité et d’une grande partie de l’opinion publique –, et l’immobilisme, il existe d’autres voies. Je suis en faveur d’un élargissement des sanctions pour toucher davantage les hommes d’affaires finançant les escadrons de la mort et la répression, notamment le responsable de la chambre de commerce.
Par ailleurs, une action politique collective de la communauté internationale, telle une conférence internationale sur la répression sévissant en Syrie, pourrait être utile. De même, j’espère, dans quelque temps, une reconnaissance officielle par l’Union européenne du CNS qui pourrait constituer un acte politique de première importance, susceptible de faire pression sur le régime et de conduire à son isolement.
La révolution actuelle couvre l’ensemble du pays, hormis quelques quartiers centraux d’Alep, qui font l’objet d’un quadrillage plus important et sont occupés par une classe bourgeoise ayant profité, lors des dernières années, de l’ouverture vers la Turquie ou d’autres pays. Ces quartiers ne sauraient tenir en otage tout un peuple ! Dans toutes les villes et les villages, la contestation s’étend, malgré une répression sans merci.
La révolte a commencé, dans la foulée du printemps arabe, par un petit événement : des enfants de dix à quatorze ans ont écrit sur les murs de Deraa, une ville du sud de la Syrie, « À bas le régime ! », répétant ce qui avait été fait en Égypte et en Tunisie. Quinze ont été arrêtés et torturés, et aux parents qui sont venus demander leur libération, le préfet, qui est de la famille du président de la République, a répondu : « il faut les oublier, vous n’avez plus d’enfants, et si vous tenez à en avoir d’autres, envoyez-nous vos femmes et on va vous en faire ! ». Le lendemain, toute la ville est descendue dans la rue…
Cela témoigne de tout un style de gouvernement, qui n’accepte que la soumission, utilise tous les moyens pour terroriser la population et agit de façon totalement arbitraire, au mépris de toute règle de droit.
Le peuple se révolte parce qu’il ne peut plus accepter d’être traité en esclave par la terreur et l’humiliation – d’où les slogans les plus importants du mouvement : « Dignité » et « Liberté ». Sans espoir ni existence politique, il s’est lancé dans cette révolution, de façon définitive.
On assiste aujourd’hui à une escalade dans la violence et la répression ainsi que dans la détermination du peuple syrien à aller de l’avant.
Quant au Liban, il est très sensible à ce qui se passe en Syrie. Si le régime syrien disparaît, comme je l’espère, certaines forces politiques seront confortées et le Hezbollah verra son influence limitée, voire marginalisée. Beaucoup d’échanges existent entre Syriens et Libanais et on trouvera toujours les moyens de maîtriser la situation et d’éviter la guerre.
M. Jean-Paul Dupré. Comment fonctionne le système éducatif, à la fois dans le primaire, le secondaire et à l’université ?
Par ailleurs, où en est aujourd’hui l’outil économique ?
M. Jacques Myard. L’inquiétude des chrétiens résulte principalement de ce qui s’est passé en Irak.
Je connais des Syriens installés en France, sunnites, commerçants ou salariés, qui n’appuient pas toujours votre action. On assiste incontestablement à une forte contestation contre des atrocités inacceptables, mais est-ce une révolution ou une révolte ? S’agit-il d’un mouvement profond dans tout le pays ? Le régime est-il véritablement isolé ?
Mme Chantal Bourragué. Quelle protection peut-on offrir aux populations civiles en dehors de l’exil ?
Quelle est la participation des femmes à votre mouvement ?
M. Hervé Gaymard. Quelles sont la situation du Parti Baas aujourd’hui et son empreinte sur la société syrienne ? Quel est le degré d’intrication de ce parti avec l’armée ?
M. Didier Julia. Tout le monde ici est d’accord pour vous aider au maximum. Pourriez-vous communiquer une liste, aussi complète que possible, des personnes qui soutiennent actuellement le pouvoir à Damas et sur lesquelles il faudrait exercer une pression ?
On peut vous aider aussi en obtenant que vous ayez une reconnaissance internationale. Au Conseil de sécurité, c’est très difficile, mais cela est possible en Europe, notamment dans le cadre de l’Union européenne. Avez-vous fait le tour des capitales européennes à cette fin, du moins celles qui sont encore un peu réticentes à cet égard ?
La société syrienne a toujours été laïque, au sens français du terme, et civile, au sens syrien, ce qui revient au même. Pourtant, je rencontre moins de femmes habillées à l’européenne à Damas – ce qui traduit une évolution. Je ne suis pas pour autant inquiet des problèmes liés à l’islamisation, qui ont été mis en avant pendant des années : souvent les Frères musulmans ont eu la majorité aux élections et ont renoncé au pouvoir, montrant que ce n’est pas celui-ci qui les attire.
Cela étant, je suis relativement pessimiste au sujet de la reconnaissance internationale. En Égypte, personne n’est intervenu pour faire la révolution : c’est le peuple qui l’a conduite. Cela n’empêche pas l’armée de se livrer à des provocations insensées, n’hésitant pas à massacrer des coptes, voire des chrétiens d’autres confessions, pour créer des clivages entre les communautés…
Mme Bassma Kodmani. Nous avons des défaillances considérables dans la conception, l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. Le système éducatif, qui en est une des victimes, présente deux défauts principaux. D’une part, comme dans la plupart des pays de la région, il s’est détérioré du fait de l’explosion démographique, en raison de la difficulté de fournir un enseignement de qualité à une population toujours plus nombreuse. D’autre part, il fait l’objet d’un endoctrinement, le programme d’enseignement étant très imprégné de l’idéologie du Parti Baas, sous une forme caricaturale. L’université est en très mauvais état : un ingénieur me disait que pendant vingt ans, elle n’avait pas produit un seul ingénieur capable de concevoir le moindre plan de construction et qu’aujourd’hui cela n’était possible que grâce à la possibilité de télécharger des programmes sur Internet !
L’outil économique est confronté à un problème majeur : les affaires sont concentrées sur les grandes villes et les régions rurales sont oubliées. Les plans quinquennaux ne font que satisfaire des représentants du parti Baas qui n’ont aucun pouvoir. En outre, prévaut un pillage systématique de l’ensemble de l’État : tous les gouverneurs, douaniers ou responsables régionaux sont des agents du trafic organisé par le pouvoir. Un gouverneur n’a pas d’autre rôle que de spécifier la commission qu’il doit toucher pour lui-même ou le compte d’un tiers ! Quiconque s’y oppose ne peut faire d’affaires en Syrie. Le système de corruption y est profondément ancré.
Monsieur Myard, les commerçants syriens en France ne souffrent pas de la répression ! Tant qu’on ne se mêle pas de politique et qu’on ne demande rien, on peut être tranquille en Syrie – nous connaissons d’ailleurs beaucoup de gens non politisés disant qu’il est fou de se révolter parce que cela déstabilise le pays. Il n’empêche que le prix payé par le peuple et le pillage systématique de l’État montrent la nécessité d’en finir avec le régime.
M. Burhan Ghalioun. Je comprends les inquiétudes de la communauté chrétienne, mais à la différence de l’Irak où les États-Unis ont voulu reconstruire l’État après l’avoir anéanti, nous souhaitons préserver celui-ci ainsi que les institutions.
La situation est également différente en Égypte, où les coptes ont toujours souffert d’une discrimination. En Syrie, au contraire, l’élite chrétienne a joué un grand rôle depuis le XIXème siècle dans la renaissance politique et le premier ministre syrien nommé après l’indépendance était chrétien. Il n’y a jamais eu chez nous, dans l’histoire moderne, d’affrontements entre chrétiens et musulmans : l’harmonie a toujours régné entre eux.
Nous demandons qu’un effort exceptionnel soit fait par la communauté internationale pour appliquer la disposition relative à la responsabilité de protéger les civils. Si la situation est bloquée au niveau du Conseil de sécurité, des démarches peuvent être menées au niveau européen et international.
Cela étant, je ne suis pas pessimiste sur l’évolution de la position de la Russie : nous devons dialoguer avec ce pays, ainsi qu’éventuellement avec la Chine.
Madame Bourragué, les femmes, même celles qui sont voilées, sont très présentes dans cette révolution – laquelle ne se réduit pas à une révolte. Elles le sont aussi, toutes confessions confondues, au sein du CNS, de son Bureau exécutif, du secrétariat général et de l’assemblée générale. Nous souhaitons renforcer cette participation dans nos instances comme dans la vie politique syrienne.
Le Parti Baas a été utilisé comme un instrument idéologique, un paravent, pour un pouvoir dépendant essentiellement des services de sécurité et de renseignement. Il n’y a pas d’espace politique en Syrie, ni de politique tout court : celle-ci a été éradiquée ; seuls existent ces services, qui manipulent les hommes politiques – y compris le président de la République, qui a été nommé par eux, même s’il les dirige aujourd’hui – et contrôlent l’armée.
Le parti Baas participe à la répression dans la mesure où il couvre ce pouvoir sécuritaire.
Monsieur Julia, nous essayerons de vous fournir la liste que vous demandez, mais l’administration de l’Union européenne et les chambres de commerce pourraient sans doute nous aider à cette fin.
Nous sommes en train de prendre contact avec toutes les capitales européennes – ainsi qu’avec l’Inde ou la Chine – pour favoriser la reconnaissance internationale. Je me suis notamment rendu à Stockholm et je dois aujourd’hui rencontrer un ministre britannique.
Il est vrai qu’à cause de l’arbitraire et du despotisme qui ont prévalu dans la région, la culture a changé et conduit les gens à se replier sur eux-mêmes et les valeurs traditionnelles. Mais aujourd’hui, avec une réelle ouverture politique et républicaine, cette culture conservatrice, qui a dominé les trente dernières années, devrait progressivement disparaître au profit d’une culture moderne.
M. Jean-Louis Christ. Il y a quelque temps, le premier ministre turc Recep Erdogan a dit, lors d’une visite au Caire, qu’il ne croyait plus en Bachar el-Assad, alors qu’il l’appelait son ami quelques mois auparavant. Compte tenu des relations historiques de la Syrie avec la Turquie, qu’attendez-vous de ce pays ? Soutient-il le CNS ?
M. Patrick Labaune. L’armée syrienne connaît aujourd’hui d’importantes désertions, qui auraient plutôt rallié la résistance sunnite : est-ce effectivement le cas ? N’assiste-t-on pas au retour du vieux clivage syrien entre alaouites, druzes et chrétiens d’un côté et les sunnites constituant 80 % de la population de l’autre ? La position que vous exposez n’est-elle pas un peu contradictoire avec la réalité du terrain ?
M. Dominique Souchet. La Russie apparaissait jusqu’ici comme le soutien le plus inconditionnel du régime de Bachar el-Assad, notamment au Conseil de sécurité. Or, les dernières déclarations du président Medvedev semblent marquer une première hésitation. Le CNS a-t-il déjà tenté d’engager un dialogue direct avec ce pays ou envisage-t-il de le faire ? Si oui, comment ?
M. Alain Bocquet. Madame Kodmani, vous avez dit être en décalage par rapport à la demande de la population civile. Or si le mouvement de contestation veut aller plus loin que vous ne le souhaitez, cela pourrait poser problème. Quel est votre point de vue à cet égard ?
M. Rudy Salles. Comment le CNS et vous-même voyez l’évolution des relations entre la Syrie et Israël après les événements actuels et la mise en place éventuelle d’un nouveau pouvoir dans votre pays ?
M. Michel Vauzelle. Pourquoi, alors que la conscription prévaut dans l’armée syrienne, ne constate-t-on pas davantage de désertions de la part des soldats envoyés tirer sur la population ?
Pourquoi une grande ville comme Alep est-elle si peu engagée dans le mouvement de contestation ?
M. Jean-Jacques Guillet. On peut être étonné, après plusieurs mois de révolution et de manifestations massives dans les rues, que le régime résiste à ce point. Je ne pense pas que le soutien de pays étrangers soit suffisant pour l’expliquer, qu’il s’exprime de manière publique – s’agissant des Russes et des Chinois, même si la présence de ceux-ci est faible en Syrie – ou pratique – le régime iranien ayant par exemple intérêt à ce que le pouvoir en place perdure. Quelles sont les capacités réelles de résistance du régime ? Comment parvient-il à tenir ?
On a par ailleurs fait une erreur d’analyse sur les capacités réformatrices de Bachar el-Assad. Y a-t-il au sein de sa famille une véritable unité ?
M. le président Axel Poniatowski. Comment fonctionne en réalité le pouvoir au sein du régime, entre le président Bachar el-Assad et son environnement immédiat ?
M. Jean-Luc Reitzer. Je me suis rendu au Liban au printemps dernier, où j’ai rencontré l’ancien président du Conseil Fouad Siniora, le Général Aoun et l’ancien président Amine Gemayel. Ce dernier m’a dit : « Si j’avais en face de moi le président Assad, je l’étranglerais parce qu’il a tué mon fils, mais aujourd’hui, dans la situation actuelle, je souhaite qu’il puisse rester parce que les conséquences de son échec seraient terribles pour l’équilibre de la région ». Comment se fait-il que le régime tienne malgré le mouvement de révolte ? N’y a-t-il pas parmi ceux qui le condamnent un double jeu, consistant à s’y opposer en apparence en dénonçant les exactions et les crimes, tout en le soutenant, en raison d’un certain nombre d’intérêts, y compris économiques ?
Quelle est votre position vis-à-vis du Liban, dont on a dit qu’il était un peu une colonie de la Syrie ? Je rappelle que le régime syrien s’était fortement impliqué dans la composition du gouvernement de ce pays, ce qui l’avait d’ailleurs retardée. Êtes-vous prêt, en cas de victoire de votre mouvement, à redonner au Liban une véritable indépendance pour lui permettre d’exister sur le plan national et international ?
Mme Bassma Kodmani. La Turquie a perdu espoir dans la capacité du régime à se reformer. Elle a essayé une ou deux fois de l’inciter à engager des réformes, mais elle n’a obtenu que des menaces de déstabilisation, ce qui l’a mise en rage. Ce pays soutient fortement l’opposition et le CNS. Il est engagé assez fermement en faveur d’une action conduisant au départ du pouvoir en place. Il se considère en première ligne à cet égard et a d’ailleurs pris des sanctions, qui sont coûteuses pour lui.
Ankara est par ailleurs favorable à une reconnaissance rapide du CNS. Nous avons souhaité commencer plutôt par solliciter l’appui des pays arabes, dans la mesure où il est important pour la société syrienne de savoir que l’environnement arabe reste la priorité, mais la Turquie va très vite manifester son soutien.
Concernant les relations syro-libanaises, il y a quelques années, a été signée la déclaration Beyrouth-Damas. Ses auteurs, qui ont été emprisonnés pour une durée d’un à trois ans, sont aujourd’hui les principaux acteurs de la révolution.
Nous sommes convaincus que, sans le départ du pouvoir en place, le Liban ne retrouvera pas son indépendance. Ce pays est un État souverain, qui a eu des relations privilégiées avec le nôtre, même si cette expression a été dévoyée de façon insupportable, au travers d’une mise sous tutelle syrienne.
Il reste dans notre espace stratégique : la Syrie peut légitimement demander à s’intéresser à ce qui s’y passe car cela a un impact sur sa sécurité immédiate. Cela étant, on peut en discuter.
Dans cette révolte, Israël a été totalement absent du débat jusqu’à ce jour : ce n’est pas notre problème. Mais quand il faudra engager le dialogue sur cette question, je pense que la position syrienne ne changera pas beaucoup.
Il y a un large consensus au sein de la société syrienne : une partie de notre territoire est occupée ; s’il est entièrement rendu à la Syrie dans des conditions convenables, une paix juste est possible. Si les résolutions du Conseil de sécurité sont appliquées, le prix en sera le même. Le pouvoir syrien n’a certes pas été très sérieux dans la recherche de négociations, mais le pouvoir israélien est tout autant responsable à cet égard.
Si Israël souhaite véritablement bâtir à l’avenir une paix avec la Syrie, il trouvera rapidement dans ce pays les interlocuteurs pour ce faire.
M. Burhan Ghalioun. Au sein de l’armée, il y a aussi des divisions, que le pouvoir utilise pour conduire la répression. Le régime a élaboré ses propres outils dans ce domaine, avec la garde républicaine, qui est une armée dans l’armée, et des unités spéciales, dont trois ou quatre participent directement aux actions punitives. Mais la majeure partie des unités de l’armée reste à l’écart de celles-ci.
Cela explique que les désertions soient limitées, même si elles représentent tout de même 15 000 personnes, parmi lesquelles des officiers et des alaouites soutenant la révolution.
Je pense aussi que la position russe va évoluer. L’attitude de Moscou me paraît intenable sur le long terme si les massacres et la répression se poursuivent. Il faut donc continuer à négocier avec la Russie. Une invitation indirecte nous a d’ailleurs été adressée à cet égard, puisqu’on m’a demandé si j’acceptais de dialoguer avec elle ; j’ai répondu que nous y étions tout à fait favorables.
Les réticences observées au Liban vis-à-vis de la révolution s’expliquent par le fait que les Libanais se sont habitués – surtout le général Aoun – à l’équilibre existant.
Mais il est irréaliste de la part d’une partie de l’opinion syrienne et libanaise de penser que le régime en place va pouvoir maintenir la stabilité de la région, laquelle n’est pas tenable – la révolution le prouve – et n’a rien produit de positif – la zone n’ayant pas connu de véritable développement et ayant été confrontée à des conflits permanents et à la violation constante des droits de l’homme. Je suis persuadé que nous pourrions trouver une entente avec le général Aoun – que j’ai connu lorsqu’il était anti-syrien – et nos amis libanais.
La transformation démocratique de la région garantira mieux les droits des chrétiens et créera des conditions de développement meilleures, attendues par les jeunes générations syriennes comme libanaises. Il y a encore une certaine inertie intellectuelle et politique comme il y a de l’inertie géographique. L’essentiel est maintenant de prouver qu’un espoir est possible et que notre révolution va l’emporter.
Selon moi, le régime s’effondrera d’un seul coup. C’est une machine de guerre construite depuis 48 ans, fondée sur des services de renseignement et des appareils contrôlant toutes les unités. Au sein de l’armée, par exemple, le chef d’une division ne peut ordonner seul le déplacement de ses hommes : il lui faut l’ordre préalable de quatre services de renseignement. Mais sous la pression intérieure de la révolution et extérieure de la communauté internationale, le régime se délitera, ce qui devrait conduire à un effondrement de l’appareil de répression et du pouvoir.
Mis à part le quadrillage strict des quartiers, Alep a bénéficié des dix dernières années de coopération et d’échange avec la Turquie. La bourgeoisie locale avait des perspectives, à la différence des autres villes, surtout les villes moyennes, où tout était bloqué et où il n’y avait pas d’espoir de développement.
Mme Bassma Kodmani. Le décalage que nous avons avec la population civile est dû au fait que celle-ci continue à subir des morts et des victimes. Son impatience est forte, d’autant que l’opposition a mis du temps à s’unifier. Dès l’instant où cette unification s’est produite, elle a suscité une attente énorme, qui ne peut naturellement être satisfaite en quelques jours.
Nous devons gérer cette pression de la rue. Certains prennent les armes pour défendre leur famille et leurs biens : ils n’acceptent pas que l’on continue à appuyer un mouvement pacifique, car ils ne peuvent plus tenir.
Le CNS constitue un espoir important sur le terrain pour ce mouvement. Celui-ci était jusqu’à présent soutenu par les médias et les organisations des droits de l’homme. Mais il restait à porter un message politique : le CNS va s’y employer.
Nous devons obtenir des résultats dans un laps de temps assez bref, notamment sur le plan diplomatique, pour préserver le caractère pacifique de notre action.
M. Jacques Myard. À combien chiffrez-vous les victimes de la répression ?
M. Burhan Ghalioun. Selon les dernières informations des observateurs syriens, il y aurait plus de 10 000 morts, plus de 20 000 disparus – lesquels sont considérés pratiquement comme morts aussi –, 115 000 personnes arrêtées, 3 000 morts sous la torture et près de 300 enfants tués.
Pour éviter une intervention militaire très risquée dans ce pays – dont la situation géopolitique est délicate –, il faut des réalisations politiques. Nous comptons sur vous et la communauté internationale dans son ensemble pour nous aider à avancer rapidement dans ce domaine.
M. le président Axel Poniatowski. Madame, Monsieur, je vous remercie.
18.- Mercredi 16 novembre 2011, séance de 9 heures 45, compte rendu n° 17 : réunion sur les monarchies du Golfe et les printemps arabes, en présence de Mme Fatiha Dazi-Héni, politologue spécialiste du monde arabe, et M. Nabil Mouline, enseignant-chercheur à l’Institut d’études politiques de Paris (ouverte à la presse)
M. le président Axel Poniatowski. Nous recevons deux experts – M. Nabil Mouline et Mme Fatiha Dazi-Héni – pour une réunion sur la situation intérieure des monarchies du Golfe et sur la manière dont elles réagissent à la déstabilisation de leurs voisins du fait des printemps arabes.
Sur le plan intérieur, sans doute parce que leurs caractéristiques ne sont pas homogènes, les monarchies du Golfe ont été très diversement affectées par le Printemps arabe. Des manifestations très suivies se sont déroulées à Bahreïn, où des troupes saoudiennes et émiriennes ont été déployées pour éviter que le mouvement ne conduise à la chute du régime. En revanche, les peuples des autres monarchies sont restés relativement à l’écart de l’élan de revendications. Pourtant, quelques réformes ont été annoncées qui indiquent que les régimes en place ont pris conscience que l’immobilisme n’était probablement plus tenable au sein des monarchies.
Vis-à-vis de leurs voisins, les monarchies ont eu tout d’abord une attitude conservatrice et attentiste et forment une sorte de « Sainte Alliance ». Il est clair que leurs dirigeants sont inquiets et redoutent en particulier que l’Iran ne tire profit de ces évolutions. Paradoxalement, ces pays peuvent se montrer actifs comme le montrent leurs prises de position lors de la crise libyenne, celles sur les crises syrienne et yéménite ou encore leur soutien financier à leurs voisins engagés sur la voie du changement.
La situation de l’Arabie saoudite nous intéresse aussi particulièrement. Le prince héritier vient d’être désigné : c’est à nouveau un frère du roi ; le saut de génération n’a donc pas été effectué, ce qui montre l’aspect conservateur du régime.
Si vous en êtes d’accord, M. Mouline, vous pourriez commencer par nous dresser un rapide panorama de la situation intérieure des différentes monarchies du Golfe.
M. Nabil Mouline, enseignant-chercheur à l’Institut d’études politiques de Paris. Je vous remercie. Je vais présenter brièvement la situation dans le Golfe, en particulier en Arabie saoudite, pays pivot de la région qui influence par sa taille, par sa population et par son caractère central l’ensemble des pays du Golfe voire du monde arabe. On l’a vu avec la décision récente de la Ligue arabe de suspendre la Syrie, qui a été soutenue par l’Arabie saoudite et le Qatar.
La contestation dans la péninsule arabique et notamment en Arabie saoudite ne date pas de 2011. C’est une constante de l’histoire de cette région depuis l’époque prémoderne. Le XXème siècle, surtout sa seconde moitié, constitue une parenthèse ; la population a été démobilisée pour trois raisons principales : le choc de la modernité, l’émergence d’un Etat centralisé et le boom pétrolier.
Cela dit, dans les années 1950-1960, plusieurs mouvements de contestation panarabistes, affiliés soit au nassérisme, soit au baasisme, ont été très actifs dans la région mais ont été finalement réprimés. Ce n’est qu’à la fin de la guerre du Golfe qu’un mouvement de contestation moderne va naître dans la région et notamment en Arabie saoudite. Il est la conséquence de l’émergence d’une nouvelle génération, formée dans le système scolaire saoudien mis en place essentiellement par les Frères musulmans, et des changements structurels tels que l’urbanisation, la démocratisation de l’éducation et une ouverture relative sur le monde.
Des pétitions sont apparues entre 1991 et 1993 réclamant l’instauration d’une sorte d’Etat de droit. On ne demande pas encore d’instaurer la démocratie mais de limiter le pouvoir monarchique avec la mise en place d’une assemblée consultative plus ou moins élue et l’écriture d’une constitution. Si l’Etat saoudien, déstabilisé par les conséquences de la guerre du Golfe, va céder sur quelques points, notamment la rédaction d’une loi fondamentale et la création d’un conseil consultatif, il va rapidement remettre la main sur l’espace social grâce au soutien de l’establishment religieux, très puissant en Arabie saoudite, et au soutien américain. Le phénomène est similaire dans d’autres pays du Golfe.
Après le 11 septembre 2001, les pétitions et les manifestations vont renaître à cause de la pression américaine et de la menace d’Al-Qaida. Les mêmes revendications vont se concrétiser et vont prendre corps avec les demandes de mise en place d’une monarchie constitutionnelle. Il ne s’agit toujours pas d’une demande de démocratie, à l’exception notoire du Koweït et du Bahreïn, mais de rationaliser, de partager le pouvoir et de limiter l’hégémonie de la famille régnante.
De 2003 à 2006, les monarchies du Golfe vont un peu céder à cette pression en mettant en place des mécanismes sociaux et politiques : des instances de dialogue national pour fonder de nouvelles bases de légitimité, des instances de dialogue interreligieux, l’ouverture à des chercheurs étrangers, la mise en place d’élections municipales et législatives, l’élargissement des pouvoirs des assemblées déjà existantes, etc. Mais ce mouvement n’a pas été très sérieux ; il s’agissait d’une acclimatation de ces pouvoirs aux pressions internationales et à la menace d’Al-Qaida.
L’échec de la politique américaine dans la région, l’affaiblissement d’Al-Qaida et la hausse du prix du pétrole vont faire revenir l’Arabie saoudite, et les régimes qui suivent son exemple, sur ces acquis. Tout va être gelé entre 2005 et 2011.
En écho aux soulèvements populaires dans les autres pays arabes à partir de février-mars 2011, les monarchies vont réagir. En effet, certains pays vont connaître des manifestations, notamment les pays dont les ressources pétrolières sont les plus pauvres, à Oman et à Bahreïn où le taux de chômage est élevé. Le chômage est de 15-20 % à Oman et d’environ 25 % au Bahreïn ; il est de 20-25 % en Arabie saoudite mais seulement de 10 % si on ne compte que les hommes, les femmes ne participant que partiellement au marché du travail. Ces deux pays connaissent les manifestations les plus violentes, en raison de ces facteurs sociaux et, dans le cas de Bahreïn, en raison du clivage religieux ; certains mouvements iront même jusqu’à prôner la chute de la monarchie et l’instauration d’un pouvoir républicain.
Ailleurs, les manifestations, notamment en Arabie saoudite, restent sectorielles et marginales. Elles ne concernent que des minorités religieuses, en particulier les chiites qui militent pour plus de droits et d’intégration, et les femmes qui veulent plus de droits. La plus grande partie de la base sociale, influencée par des appartenances tribales et l’idéologie officielle, est restée très calme. La plupart des monarchies vont mettre en place à plusieurs niveaux, dès mars 2011, une stratégie originale de « contre-révolution » préventive à court terme, car elles savent qu’à moyen et long terme, les choses doivent changer. Sur le plan socio-économique, elles annoncent des créations d’emplois (50 000 emplois dans le sultanat d’Oman, 20 000 à Bahreïn, 60 000 en Arabie saoudite), la création de logements, d’indemnités chômage, des augmentations de salaires – + 100 % au Qatar, + 20 % en Arabie saoudite – des distributions de primes : environ 300 dollars américains par citoyen à Oman, 3 000 dollars au Koweït et 2 500 dollars à Bahreïn.
Au niveau politique, les régimes vont réduire la pression en promettant des réformes : élections municipales en Arabie saoudite, élection de l’assemblée fédérale aux Emirats, promesse de l’élection d’une assemblée consultative au Qatar, élections à Oman. En Arabie saoudite, le roi a octroyé le droit de vote et d’appartenance à l’assemblée consultative aux femmes pour améliorer son image à l’étranger et faire diversion sur le plan intérieur. Au lieu de s’affronter sur les questions de réforme, les libéraux et les conservateurs s’affrontent sur le droit de vote de la femme.
Au niveau médiatique, les autorités des pays du Golfe ont verrouillé les médias quant aux informations sur leur propre pays. On a peu vu d’images sur Bahreïn, Oman ou les manifestations chiites, en revanche l’accent a été mis sur la guerre révolutionnaire héroïque en Libye ou les drames de Syrie pour détourner l’attention. Au niveau régional, on met en place une « contre-révolution » régionale médiatique, diplomatique ou financière en octroyant des dons, notamment 7 milliards de dollars à la Jordanie et 4 milliards à l’Egypte.
La population locale demande, non pas la démocratie, à l’exception du Koweït qui a plus ou moins une trajectoire originale, mais un partage du pouvoir. L’élite locale se sent bloquée. Il n’y a pas eu d’alliance objective entre ceux qui veulent gouverner, ceux qui veulent penser et ceux qui veulent manger. La population a été tellement isolée durant les trente dernières années qu’elle a une sous-culture politique qui ne lui permet pas de formuler ses aspirations politiques.
Cependant, la nature des régimes politiques dans le Golfe peut changer. Les monarchies du Golfe sont des multidominations. Le pouvoir est distribué horizontalement : chaque prince gouverneur, prince ministre ou prince PDG a un fief indépendant. L’Etat est divisé de manière horizontale et il n’y a pas de hiérarchie dans le pouvoir. Le roi, le sultan ou l’émir n’est qu’un primus inter pares ; il doit former une alliance pour avoir une large marge de manœuvre.
En Arabie saoudite, la faction du roi Abdallah est très affaiblie ; la faction des Sudairi a pu contrôler la plus grande partie des rouages de l’Etat : ministères de l’intérieur et de la défense, les gouvernorats de Riyad, de la région pétrolifère orientale, de Tabouk. Cela leur a permis de contrôler le pouvoir et d’arriver à la quasi-régence du prince Nayef.
A côté de ce problème de l’organisation horizontale du pouvoir, l’autre problème fondamental est celui de la succession. Il se pose au niveau biologique car les souverains sont très âgés et malades et le système de succession n’est pas très clair. Le pouvoir se transmet au sein de toute une génération avant de passer à la génération suivante. Dans les périodes de transition générationnelle, cela génère des conflits énormes, qui ont provoqué l’affaiblissement voir les chutes des dynasties locales par le passé et ont permis à des forces tribales ou religieuses de s’introduire dans le jeu politique et d’impulser des changements. Cela sera peut-être le cas dans ces monarchies car la transition générationnelle va intervenir à court ou moyen terme.
Un autre enjeu est l’émergence d’une identité nationale qui va obliger les monarchies en place à fonder un nouveau pacte de légitimité, car les dirigeants ne sont plus au centre du pouvoir et de la construction nationale. C’est maintenant le pays, la patrie et la nation qui émergent comme une sorte de corps mystique des pays en question.
Mme Fatiha Dazi-Héni, politologue spécialiste du monde arabe. M. Mouline a parlé des dynamiques internes et je voudrais aborder le thème des réactions des monarchies du Golfe aux printemps arabes. La chute de Ben Ali a été accueillie calmement. En revanche, lorsque les révoltes ont touché l’Egypte, la réaction a été très défensive. Moubarak était la colonne vertébrale des alliances régionales et sa chute a été un traumatisme. Même si elles sont très florissantes sur le plan économique, dans le monde arabe et même au-delà, les monarchies se sont retrouvées désemparées car n’ont pas de réelle capacité régionale autonome. Leur première réaction a donc été de panique et ensuite défensive.
On assiste aujourd’hui à un mouvement en faveur d’une plus grande cohésion entre les monarchies. Cela a été visible lors de la crise à Bahreïn. Le Conseil de coopération du Golfe promeut aujourd’hui une politique de sécurité, ce qu’il n’avait pas réussi à faire jusque-là. Ces pays ne forment pas un bloc homogène ; leurs perceptions ne sont pas identiques. En ce qui concerne l’Iran, il y a une très grande diversité d’approches, quant à la menace qu’il représente. L’Arabie saoudite, les Emirats et Bahreïn sont les pays les plus anti-iraniens de la région ; en revanche, Oman a une attitude plus modérée et médiatrice.
Les deux réactions successives vis-à-vis du printemps arabe ont été la panique puis le renforcement de la cohésion au sein du Conseil de coopération. Pour la première fois, les monarchies se sont unies pour conduire une intervention militaire. Cependant, la situation interne au Conseil de coopération du Golfe n’est pas très claire. On a dit par exemple que l’émir du Koweït n’était pas au courant de la volonté du roi Abdallah d’y intégrer le Maroc et la Jordanie. Tout ce qui se passe à Bahreïn ayant des répercussions en Arabie saoudite, la réaction a été très forte et l’on sent une très grande fébrilité. La réaction a été plus concertée au Yémen. Une solution pacifiée a été trouvée au sein du Conseil qui a eu des répercussions à l’ONU et une solution régionale pourrait émerger au niveau de cette instance multilatérale.
Je suis cependant assez optimiste quant à l’avenir de la coopération régionale. Même si l’intervention à Bahreïn était une réaction de panique, une politique régionale concertée pourrait émerger. Je ne crois pas trop à l’intégration de la Jordanie et du Maroc car la cohésion du Conseil de coopération du Golfe repose sur six monarchies soudées et cohérentes : par ailleurs, les élites critiquent cette intégration pour ses conséquences économiques. L’emploi des jeunes est une préoccupation majeure, d’autant que la croissance démographique est toujours très forte.
Il me semble que nous sommes au début d’une dynamique, d’un cycle qui pourrait durer dix ans. Plutôt que de parler d’un « printemps arabe », je parlerais plus volontiers d’un « moment arabe ».
M. le président Axel Poniatowski. L’Arabie saoudite est le pays le plus influent et le plus important de la région. Sa déstabilisation entraînerait celle de toute la région et, inversement, si elle reste stable, toute la région en bénéficiera. Le pays est fermement tenu par la famille royale et le printemps arabe a peu de chance de s’y étendre. Mais qu’en est-il de l’opinion publique, des aspirations de la jeunesse ? Comment le pouvoir est-il soutenu par la population ? Y a-t-il un début de revendications au-delà des questions sociales, sur les aspects constitutionnels, par exemple ?
M. André Schneider. Vous avez évoqué l’Iran, au centre de tensions fortes avec l’Occident et avec Israël, et qui est un gros problème pour ses voisins du Golfe. Quelle est votre opinion sur l’issue possible de cette crise ? Y a-t-il un risque de conflit alors que l’Iran est en train de mettre au point l’arme atomique ?
M. Jean-Paul Lecoq. Je partage l’idée que nous en avons pour des années. Dans tout le monde arabe, d’El Alayoun à Damas, il y a des revendications, une exigence populaire, profonde, qui se manifeste notamment quant aux droits de l’homme, au sens le plus large. On sent que la religion commence à s’y adapter, j’en veux pour preuve ce qui se passe en Tunisie. Qu’en est-il en ce qui concerne l’Arabie saoudite ? Qu’en est-il aussi de la manière dont le problème israélo-palestinien imprègne ces questions ?
M. Philippe Cochet. En ce qui concerne la Ligue arabe, qui commence à s’exprimer, quels sont les pays qui y sont les plus influents ?
Mme Marie-Louise Fort. Qu’en est-il du positionnement des monarchies vis-à-vis de la Turquie qui se sent pousser des ailes du fait des printemps arabes et cherche à s’imposer dans les conflits moyen-orientaux ?
M. Jean-Michel Ferrand. Y a-t-il des oppositions structurées et des figures charismatiques qui émergent pour exercer un leadership ? La Turquie jouant un rôle de plus en plus important au Moyen-Orient, assiste-t-on au retour de la diplomatie ottomane ?
M. Nabil Mouline. En ce qui concerne les revendications en Arabie saoudite, ce sont les questions sociales – l’emploi, l’habitat – qui restent aujourd’hui dominantes. Les thématiques politiques sont encore très marginales, elles sont depuis longtemps le fait des Frères musulmans et des partis politiques sécularistes.
L’opportunité, sur cet aspect, viendra de la transition générationnelle. Nous devrions avoir des surprises au moment du passage à la troisième génération car l’un des prétendants aura besoin des « roturiers » pour asseoir sa légitimité et consolider son pouvoir. Il n’y aura pas encore de démocratie mais nécessairement plus de fluidité dans la chaîne de commandement. D’un gouvernement horizontal, on passera à un gouvernement vertical avec moins de figures de la famille royale. Il y a aura des revendications vers la sphère politique et vers plus de modernité politique.
Quant aux droits de l’homme, la question est évidemment devenue fondamentale, mais pas universelle. Les populations et les élites locales conçoivent les droits de l’homme en y intégrant les préceptes religieux. Paradoxalement, il y aura un véritable changement grâce à la salafisation du monde arabo-musulman car celle-ci va permettre une « resécularisation » du pouvoir politique. Le XXème siècle n’aura été qu’une parenthèse avec l’instrumentalisation du religieux et la théocratisation du politique. La salafisation de la population va peut-être jouer en faveur d’une séparation relative du religieux et du politique qui permettra d’introduire les droits de l’homme, adaptés à la situation locale. Car il ne faut pas oublier que l’islam a sa propre vision des droits de l’homme.
A l’exception du Koweït, où l’opposition est puissante, et de Bahreïn, dans les autres pays de la région, les oppositions ne sont ni très structurées ni présentes dans l’espace social. Elles pourraient néanmoins émerger à court terme. Il y a des idéologies dormantes, supra ou infra-étatiques, qui peuvent être réactivées avec leurs propres leaders qui peuvent sortir, soufis, chiites ou Frères musulmans, tribaux, par exemple, selon les régions, comme l’illustre ce qui s’est passé dans le cas irakien.
Mme Fatiha Dazi-Héni. Vis-à-vis de l’Iran, certains parlent d’une quasi « guerre froide ». Un conflit régional serait catastrophique et les élites des Etats du Golfe en ont parfaitement conscience. Il faut souligner que ceux-ci se préoccupent moins de la menace nucléaire en tant que telle que de la capacité de nuisance de l’Iran dans les pays arabes, et du fait que la détention de l’arme nucléaire l’accroîtrait encore. En effet, ils considèrent que si l’Iran détenait une arme nucléaire, il n’en ferait qu’un usage dissuasif. Le roi d’Arabie saoudite a néanmoins affirmé à deux reprises que son pays se doterait d’armes nucléaires si l’Iran en possédait. Le risque en termes de prolifération nucléaire dans la région est donc énorme.
Depuis quelque temps, certains dirigeants israéliens expriment leur souhait de voir effectuer des frappes ciblées contre les sites nucléaires iraniens. Mais il n’y a pas de consensus dans le pays sur cette orientation, à laquelle le Mossad et l’armée sont très hostiles. Elle pourrait en effet être très contre-productive en accentuant la radicalisation du régime, déjà très perceptible, alors que la population est fortement touchée par l’effet des sanctions internationales. Ces dernières restent en revanche sans résultat sur le positionnement du régime, désormais bicéphale, mais qui apparaît toujours solide. Le discours des pays du Golfe vis-à-vis de l’Iran reste nuancé. Les Emirats arabes unis ont une tendance à la surenchère verbale, mais leur économie est très liée à celle de l’Iran et des familles qui en sont originaires exercent une grande influence, en particulier à Dubaï.
L’Arabie saoudite et l’Iran constituent deux puissances qui s’opposent. Traditionnellement, la première est hostile à toute intervention du second dans les affaires arabes, mais cette nervosité s’est accentuée depuis que la guerre en Irak a permis à l’Iran d’y exercer une influence marquée, ce qui est absolument inacceptable pour les Saoudiens. A Bahreïn, on a assisté à une instrumentalisation de la menace iranienne par les monarchies du Golfe, alors que les sources des tensions sont locales : les populations chiites de Bahreïn, qui y sont implantées bien souvent depuis plusieurs siècles, voient la dynastie régnante comme une usurpatrice et subissent de graves discriminations, ils ont un statut de seconde zone ne pouvant prétendre à certaines fonctions dans le secteur public (police, armée) alors que des immigrés sunnites originaires de pays de la région obtiennent la nationalité bahreïnienne et tous les droits dont bénéficient les sunnites. Le principal parti chiite a saisi l’occasion de l’effervescence du « printemps arabe » pour exprimer les revendications de cette partie majoritaire de la population. Il faut garder à l’esprit que le Conseil de coopération du Golfe a envoyé des troupes à Bahreïn sans demander leur avis aux Etats-Unis, pour éviter qu’un renversement du régime ne conduise à un renforcement de l’influence chiite. Ce faisant, il a contribué à accélérer un inquiétant phénomène de communautarisation dans la région.
Je voudrais compléter l’analyse de mon collègue en signalant que la « salafisation » des sociétés, qu’il a mentionnée, s’accompagne d’une montée en puissance des Frères musulmans dans les systèmes politiques, ce qui est source de nouvelles tensions dans cette région.
La Ligue arabe semble en effet jouer désormais un rôle dynamique. L’Egypte sera certainement très influente en son sein lorsqu’elle aura achevé sa transition, qui traverse actuellement une phase difficile. Elle a vocation à exercer son influence aussi bien sur le règlement du conflit israélo-palestinien, qu’en Syrie et en Libye, où elle a des intérêts importants à faire valoir. Un nationalisme égyptien est en train de renaître, qui s’exprimera à la fois dans le cadre de la Ligue arabe et à l’extérieur de celle-ci. Pour le moment, la puissance dominante de la Ligue arabe est l’Arabie saoudite, mais, contrairement au Qatar qui aime se mettre en avant, elle évite de prendre ouvertement des initiatives en son nom propre, à cause d’un état d’esprit très anti-interventionniste qui la rapproche beaucoup de la Chine.
M. Nabil Mouline. Cela ne l’a néanmoins pas empêché de mener le jeu pour obtenir l’exclusion de la Syrie de Bachar el-Assad de la Ligue arabe, sans respecter strictement les règles de l’institution.
Mme Fatiha Dazi-Héni. La Turquie mène une politique très pro-active au Moyen-Orient, qui est perçue par les Etats du Conseil de coopération du Golfe comme une réaction aux atermoiements des membres de l’Union européenne quant à son éventuelle adhésion. Mais cet activisme a atteint ses limites : la Turquie est apparue embarrassée d’être montrée comme un modèle pour les Frères musulmans et a mené une politique fluctuante à l’égard de la Syrie. Il faut aussi se souvenir que, à l’exception du Maroc et d’une partie de l’Arabie saoudite, tous les pays du sud du bassin méditerranéen ont fait partie de l’Empire ottoman. Les Turcs restent perçus comme les anciens colonisateurs ; partenaires du Conseil de coopération depuis le début des années 2000, ils sont parfaitement acceptés comme partenaires commerciaux et admirés pour leurs succès économiques, mais l’idée qu’ils exercent une influence politique donne lieu à débats. S’il n’y a pas réellement de tensions avec l’Arabie saoudite, celle-ci est vigilante, notamment sur le rôle que la Turquie pourrait vouloir jouer en Syrie. Néanmoins, la Turquie est pour l’heure en tant que puissance musulmane à dominante sunnite perçue par les pays du CCG comme un acteur régional influent pouvant contrebalancer l’Iran.
Mme Chantal Bourragué. J’ai l’impression que les ambitions politiques des monarchies du Golfe se doublent d’ambitions culturelles. Exercent-elles d’ores et déjà une influence dans ce domaine ?
Comment la place de la femme dans ces sociétés évolue-t-elle ?
Après avoir accueilli le président Ben Ali fuyant son pays, l’Arabie saoudite n’a-t-elle pas apporté un certain soutien, notamment financier, à des structures sociales tunisiennes ?
M. Jean-Paul Dupré. Selon vous, quel est le niveau de probabilité d’une remise en cause des pouvoirs en place dans les monarchies du Golfe ? Hors secteur des hydrocarbures, quelles sont leurs perspectives de développement économique ?
M. Jean-Claude Guibal. Merci pour cette présentation passionnante des acteurs, des dynamiques et des enjeux qui animent cette zone.
Pourriez-vous nous préciser le rôle actuellement joué par Al-Qaida dans la péninsule arabique ? Qu’en est-il du Qatar, dont les médias parlent souvent mais que vous n’avez que peu mentionné ? Dans quelle mesure, les « printemps arabes » modifient-ils l’approche des Etats du Golfe sur le conflit israélo-palestinien ?
M. Jean-Michel Boucheron. Le roi Abdallah d’Arabie saoudite a rompu avec les positions de ses prédécesseurs sur les questions de société, mais le nouvel héritier en titre est réputé obscurantiste. A-t-il des chances d’arriver sur le trône, compte tenu de son âge et de son état de santé ? Si c’est le cas, n’existe-t-il pas un risque de retour en arrière sur ces thèmes ?
M. Alain Cousin. Existe-t-il bien une police religieuse en Arabie saoudite ? Dans l’affirmative, remplit-elle les fonctions d’un véritable contre-pouvoir ? Les Frères musulmans y sont-ils liés ? Leur influence s’accroît-elle ?
M. Patrick Labaune. Plus que dans les idéologies, ne faut-il pas voir dans les clivages régionaux, tribaux, ethniques ou sociaux les principales explications de la situation, calme ou troublée, qui règne dans les différents pays de la zone ?
M. François Rochebloine. Quel rôle les Etats du Golfe jouent-ils dans le conflit israélo-palestinien ?
M. Michel Terrot. Comment l’ouverture d’une base française à Abou Dabi est-elle perçue dans la région ? En particulier, qu’en est-il de la clause qui prévoit un soutien automatique de la France en cas d’attaque extérieure contre les Emirats arabes unis, alors que de telles clauses ont été supprimées des accords de défense avec les pays africains ?
M. Jacques Myard. Un ambassadeur d’Arabie saoudite au Royaume-Uni m’a expliqué un jour que la démocratie posait un problème théologique. Pensez-vous que le wahhabisme puisse s’adapter conceptuellement au suffrage universel ?
Les petites monarchies du Golfe abritent des populations étrangères nombreuses, très largement majoritaires dans certains Etats comme le Qatar, dont la population indigène est limitée. Comment cette situation peut-elle évoluer ? Ne constituent-elles pas des « marmites explosives » ?
M. Nabil Mouline. Concernant la remise en cause des pouvoirs en place, à l’exception du Bahreïn, elle n’est pas d’actualité du fait des clivages tribaux et ethniques. La monarchie constitue une puissance supra-tribale, un tiers séparateur à « égale distance », du moins en théorie, de toutes les forces en place. D’un point de vue sociologique et organisationnel, les familles régnantes sont si puissantes, si intégrées dans la société à travers le clientélisme et les alliances matrimoniales, le contrôle des ressources notamment, qu’elles ne seront pas remises en cause à court ou moyen terme. Cette possibilité n’est envisageable que si des conflits au sein des familles conduisaient à leur affaiblissement.
Concernant les perspectives économiques des pays du Golfe, elles sont réduites en dehors du pétrole et du gaz. Les seules perspectives sont éventuellement l’agriculture séculaire et surtout le développement du tourisme. Pour l’Arabie saoudite, il s’agit du pèlerinage, qu’on tend à développer avec la construction d’infrastructures entre la Mecque, Médine et Jeddah pour pouvoir créer une sorte circuit religieux complet et recevoir des millions de personnes avec toute la panoplie d’activités les incitant à dépenser et à rester sur place le plus longtemps possible après l’accomplissement des rituels religieux.
S’agissant du prince héritier Nayef, il est déjà, de facto, le roi. C’est la raison principale qui explique la décision rapide de la Ligue arabe : il n’y a pas eu de diplomatie parallèle créant des dissensions mais au contraire convergence autour de Nayef qui contrôle la quasi-totalité du pouvoir avec l’affaiblissement du roi Abdallah. Nayef n’est pas un conservateur. L’idée qu’il serait sous l’emprise des forces obscurantistes est erronée. D’abord elles sont faibles en Arabie saoudite contrairement à une idée reçue, ensuite Nayef est avant tout un pragmatique. Une fois roi, il nous étonnera car cette fonction le conduira vraisemblablement à transmettre le pouvoir à l’un de ses fils. Il fera tout pour lui faciliter la tâche, notamment en mettant en place des réformes et en renforçant la présence saoudienne dans le domaine régional.
La police religieuse est un des grands mythes de l’Arabie saoudite. J’ai pu avoir accès aux statistiques des interventions, du budget et des effectifs du Comité du commandement du bien et de l’interdiction du mal, le véritable nom de ce qu’on appelle en Occident police religieuse, et il apparaît qu’ils ne sont que 5 000 personnes pour une population de 27 millions d’habitants, soit un rapport de 0,01 agent pour 1 000 habitants. Ils sont donc quasiment absents de l’espace public. C’est un phénomène virtuel à travers lequel le pouvoir espère maintenir l’ordre mais surtout la cohésion de la classe dominante. Cette police morale n’intervient massivement que dans les régions où le wahhabisme est majoritaire, c’est-à-dire le Nadjd dont sont originaires plus de 70 % des élites saoudiennes. Elle est en outre sous le contrôle de l’Etat. Il n’y a pas d’infiltration des Frères musulmans dans ses rangs. Ces derniers sont d’ailleurs marginalisés depuis la seconde moitié des années 1990, malgré la réhabilitation des repentis.
Concernant le lien entre hétérogénéité des populations et révolutions, c’est en général plutôt l’homogénéité des populations qui crée les révolutions. Les révolutions naissent souvent de l’homogénéisation d’une partie de la population qui se soulève contre un corps mystique qui l’unissait. Le conflit à Bahreïn est un conflit social qui est traduit en problème religieux. Il n’est pas dû à l’hétérogénéité. Cette dernière est plutôt stabilisante. Le Roi Abdallah utilise ainsi sur les clivages de la société pour monter les uns contre les autres et jouer les arbitres.
Le wahhabisme est une des doctrines musulmanes les plus adaptables à la réalité. C’est une religion individuelle et malléable, comme en attestent les changements intervenus au XXème siècle. La position à l’égard des femmes a beaucoup évolué. Sur la question de la conduite par exemple, des oulémas parmi les plus importants ont dit qu’il s’agissait d’une question sociale et non pas religieuse ; c’est la famille royale qui est à l’origine des blocages. Les oulémas peuvent être favorables à la démocratie en tant que mécanisme permettant l’alternance, mais pas en tant qu’idéologie libérale.
Concernant enfin les populations étrangères, il est exact qu’il s’agit d’une question explosive dans les petits émirats. Deux processus sont à venir : la hausse des revendications de ces populations et l’augmentation de la population saoudienne, estimée de 27 à 40 millions de personnes, qui se traduira par une exportation de main-d’œuvre dans la région au détriment des populations étrangères établies.
Mme Fatiha Dazi-Héni. En réponse à Mme Bourragué, je ne crois pas que l’Arabie saoudite ait été très interventionniste dans la révolution tunisienne, à l’exception de l’accueil du président Ben Ali présenté comme un devoir en qualité de protectrice des lieux saints.
En revanche, l’Arabie saoudite est à la pointe du mouvement contre-révolutionnaire, comme c’est particulièrement visible à Bahreïn. Au Yémen, la situation est chaotique depuis plusieurs années et je ne pense pas, pour ma part, que l’Arabie saoudite ait toutes les clés en main pour trouver une solution. Cela fait six mois que le Conseil de coopération du Golfe négocie difficilement. Le Yémen est une société complexe. Néanmoins l’Arabie saoudite reste le pays le plus influent et déterminant pour trouver en partie une solution au problème de l’après-Saleh.
Al-Qaida a été expulsée d’Arabie saoudite sous la main de fer du prince héritier Nayef. Son fils, chargé de la lutte anti-terroriste, a été particulièrement efficace et a conduit Al-Qaida à se repositionner au Yémen, Etat quasi désintégré. Al-Qaida dispose de moyens beaucoup plus limités qu’auparavant mais continue à disposer d’un pouvoir de nuisance. Le grand perdant du printemps arabe est le djihadisme, mais le désenchantement des transitions qui se mettent en place pourrait favoriser la restructuration des mouvements djihadistes comme on le voit avec AQMI au Sahel.
Pour l’Arabie saoudite, le conflit israélo-palestinien est essentiel. L’incompréhension est totale vis-à-vis de la politique de Barack Obama. Des conseillers politiques m’ont dit que les discussions sur le sujet étaient quasiment inexistantes, dans l’attente du résultat des élections présidentielles américaines. La Ligue arabe aura-t-elle pour sa part un rôle dans l’évolution du conflit ? L’Arabie saoudite devrait en tous les cas être de plus en plus influente dans l’organisation.
M. Nabil Mouline. Le dossier palestinien n’avancera pas avant la stabilisation de l’Egypte.
Mme Fatiha Dazi-Héni. La perception des différents pouvoirs en place de l’installation des bases française aux EAU a été consensuelle, sauf à Oman qui considère qu’elles contribuent à envenimer les tensions avec l’Iran. Les autres pays y voient plutôt une diversification positive par rapport au partenariat américain. La question demeure de savoir si la présence française constitue une alternative au « tout-américain » ou un prolongement. Sur la question iranienne, certains interlocuteurs saoudiens ont été perturbés par la dureté de la position française, qui apparaissait jusqu’alors comme sensiblement différente de celle des Américains. Le président de la République est perçu comme beaucoup plus pro-actif sur les questions de sécurité dans la région que ses prédécesseurs, mais aussi beaucoup plus atlantiste.
Enfin, concernant le Qatar, petit pays grand comme la Corse, l’activisme qu’il déploie, notamment sur le plan financier est important. Son pro-activisme en Libye pose question, de même que ses soutiens à divers mouvements islamistes dans le Golfe et en Occident. Sa chaîne satellitaire Al Jazeera a été très présente en couverture des révolutions arabes au Maghreb et Moyen-Orient mais muette sur les événements à Bahreïn. Le Qatar est donc de plus en plus discipliné à mesure qu’il s’agit d’informer que la distance avec sa frontière se réduit et il prend désormais bien garde de ne pas froisser son voisin saoudien, après de nombreuses frictions entre les deux pays. Tant que l’activisme du Qatar ne concerne pas les pays du Golfe, l’Arabie saoudite doit se délecter de le voir, en quelques sortes, « griller » toutes ses cartouches, sachant que la diplomatie ambivalente du Qatar fait l’unanimité contre elle au sein du monde arabe.
M. le président Axel Poniatowski. Il me reste à vous remercier, Mme Dazi-Héni et M. Mouline, pour cette audition très intéressante et pour avoir répondu très directement à nos questions.
19.- Mercredi 7 décembre 2011, séance de 9 heures 45, compte rendu n° 23 : audition de M. Mourad Medelci, ministre des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire (ouverte à la presse)
M. le président Axel Poniatowski. Nous avons le plaisir et l’honneur d’accueillir M. Mourad Medelci, ministre des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire, que je remercie d’avoir accepté notre invitation.
Cette audition est l’occasion de faire le point sur nos relations bilatérales. Depuis 2000, elles se caractérisent par un rapprochement, marqué par la relance de la coopération et la construction d’un partenariat d’exception. Nous nous réjouissons que les visites ministérielles se succèdent et que les initiatives fleurissent pour renforcer la coopération – je songe, en particulier, à la mission confiée par le président de la République à Jean-Pierre Raffarin pour relancer les relations économiques.
Dans le contexte du « printemps arabe », nous souhaiterions également vous entendre sur les importantes réformes annoncées par le président Abdelaziz Bouteflika en avril et en mai, après la levée de l’état d’urgence au mois de février : la constitution algérienne doit être révisée en 2012, et plusieurs lois tendant à réformer le fonctionnement des institutions sont en cours d’examen. Pourriez-vous faire le point sur l’avancement de ces réformes et sur l’accueil qui leur est réservé par la population algérienne ?
M. Mourad Medelci, ministre des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire. Le 20 novembre 2007, vous m’avez fait l’honneur de me convier à une première audition dont je garde un excellent souvenir. Je suis heureux d’être de nouveau ici pour m’entretenir avec vous sur les évolutions enregistrées depuis quatre ans. Je crois que nous serons d’accord pour reconnaître qu’elles sont importantes dans la région méditerranéenne à laquelle l’Algérie et la France appartiennent.
Même si l’exercice n’est pas toujours simple, il faut essayer de faire une lecture objective de la situation. Dans un premier temps, je me propose d’aborder les évolutions qu’a connues l’Algérie, avant d’en venir aux relations bilatérales, si importantes pour nos deux pays.
Pour ce qui est des réformes, qui sont souvent l’angle sous lequel les observateurs envisagent les évolutions, je constate que votre pays s’est engagé dans une nouvelle étape dont l’objectif est d’améliorer les systèmes de gouvernance, notamment en affermissant les solidarités européennes ; de son côté, l’Algérie a bien changé depuis les années 2000 : de profondes réformes ont été engagées dans des domaines aussi importants que l’école, la justice, l’économie et les finances. Même notre constitution a connu des évolutions : la plus remarquable d’entre elles a été l’adoption, en 2008, du principe selon lequel la femme doit participer davantage aux assemblées élues.
Je vous ai remis, en 2007, un rapport établi dans le cadre du mécanisme africain d’évaluation par les pairs. Depuis cette date, nous avons bien avancé dans l’application du projet d’actions qui avait été annoncé, et nous présenterons un deuxième rapport d’étape lors du prochain sommet de l’Union africaine, qui aura lieu à Addis-Abeba, au mois de janvier prochain. Je me réjouis à l’avance de vous transmettre ce rapport dès qu’il aura été présenté.
Le début de la décennie actuelle, qui est marqué par des évolutions exceptionnelles au plan régional, a été l’occasion pour l’Algérie d’engager une nouvelle étape en matière de réformes, conformément à ce qu’avait annoncé, le 15 avril dernier, M. le président de la République. Il s’agit d’instaurer plus de liberté et plus de transparence, d’élargir la participation au développement, de renforcer l’ouverture au plan politique et au plan économique, tout en améliorant les réponses aux attentes citoyennes.
Le processus est quasiment achevé au plan législatif. Au terme d’une large consultation préalable, nous avons enregistré des avancées qui sont indiscutables, même si elles restent, bien sûr, perfectibles. Le nouveau cadre législatif offrira ainsi de meilleures conditions pour préparer les élections législatives, prévues au printemps 2012.
Dès le second semestre de l’année qui vient, le processus de réformes sera consolidé par une révision de la constitution : des dispositions nouvelles devraient permettre de consacrer au plus haut niveau les orientations annoncées en avril par le président Bouteflika, qui a souhaité consacrer son troisième mandat au renforcement des institutions républicaines et de l’Etat de droit, maintenant que la paix, la stabilité et la croissance sont rétablies – les résultats sont très encourageants et très clairement perceptibles par les Algériens.
Trois lois ont déjà été adoptées sur un total de six. Une quatrième loi, relative aux partis politiques, a été votée hier, et le Parlement devrait avoir adopté, avant la fin de l’année, l’ensemble des textes programmés : une loi électorale, une loi sur les incompatibilités avec le mandat parlementaire, une loi sur la participation des femmes aux assemblées élues, une loi sur les partis politiques, une loi sur l’information et une autre sur les associations.
S’agissant des femmes, l’objectif principal est de fixer des quotas en matière de participation. Un texte consensuel, adopté à l’issue de débats passionnés, prévoit que leur participation aux assemblées élues doit être comprise entre 20 % pour les petites communes et 50 % pour la communauté algérienne à l’étranger. Ces nouvelles dispositions prendront leur plein effet à l’occasion des prochaines élections législatives.
En ce qui concerne la transparence et la surveillance des élections, il est notamment prévu que les commissions électorales seront exclusivement composées de magistrats au niveau local, au niveau des wilayas et au niveau national. Le processus de consultation a montré qu’il s’agissait là d’une attente de la société civile.
Quant au renforcement de la liberté d’expression, le projet de loi du gouvernement comporte deux dispositions principales : une ouverture au privé du secteur des médias lourds, dont de nombreux observateurs se réjouissent, et une dépénalisation des délits de presse, elle aussi souhaitée par les journalistes.
Pour ce qui est de la loi sur la liberté d’association, qui date de 1990 et grâce à laquelle plus de 90 000 associations ont pu être constituées, les évolutions consistent à instaurer une plus grande souplesse et une plus grande liberté en matière d’agrément et de fonctionnement.
Si vous le souhaitez, je reviendrai sur d’autres aspects de ces textes qui constituent le volet politique des réformes actuelles, à côté d’un certain nombre de mesures de nature économique – nous avons aussi engagé une consolidation du cadre juridique et organisationnel afin d’améliorer le climat des entreprises, algériennes comme françaises. Ces dernières sont de plus en plus nombreuses, ce dont nous nous réjouissons.
J’en viens maintenant aux relations entre l’Algérie et la France.
Au niveau politique, on observe une remarquable intensification des visites. Il y a trois jours, M. Guéant était ainsi à Alger, où il a pu apprécier l’ampleur des réformes engagées et la volonté du gouvernement algérien de bâtir pas à pas, mais résolument, le partenariat d’exception souhaité dès 2007 par M. le président de la République. A cela s’ajoutent des échanges interparlementaires. Il y a trois jours, j’ai d’ailleurs été chargé par le Conseil de la nation de vous transmettre ses sentiments de considération et d’amitié.
L’augmentation de la fréquence des consultations ministérielles et parlementaires constitue, à nos yeux, un signe particulièrement encourageant. J’ai ainsi rencontré plusieurs fois M. Juppé depuis sa nomination, notamment à Alger et à New York, et j’aurai le plaisir de le revoir ce midi au Quai d’Orsay. Nos échanges sur les crises qui secouent le monde et sur les mutations auxquelles nous assistons aujourd’hui, en particulier autour de la Méditerranée, sont l’occasion de renforcer nos convergences et de mieux comprendre nos positions respectives sur certains sujets qui demeurent d’actualité, comme celui de la mémoire.
Au plan économique, la mission réussie de M. Raffarin et le travail remarquable engagé par M. Benmeradi et d’autres membres du gouvernement algérien ont permis de débloquer plusieurs projets qui sont aujourd’hui entièrement finalisés dans le secteur des assurances et dans celui de l’industrie, notamment en ce qui concerne les matériaux de construction. La voie a également été ouverte à de nouveaux partenariats dans les domaines de l’automobile, de la pétrochimie et des industries pharmaceutique et agroalimentaire. Nous formons le vœu que le premier semestre 2012 soit l’occasion de conduire à leur terme les négociations en cours. Elles concernent des projets d’autant plus importants pour nous qu’ils s’inscrivent dans le cadre de l’objectif stratégique de diversification de l’économie algérienne, aujourd’hui trop dépendante du secteur des hydrocarbures, lequel représente plus de 40 % du PIB.
Le commerce bilatéral se porte bien – les chiffres l’attestent. Nos échanges sont depuis très longtemps supérieurs à dix milliards de dollars, et nous ne sommes pas travaillés par l’angoisse d’un déséquilibre bilatéral de la balance commerciale : contrairement à d’autres pays européens, avec lesquels les exportations des hydrocarbures sont supérieures aux importations, la France atteint plus ou moins l’équilibre, année après année. Les services, dont le poids ne cesse de croître dans nos échanges, offrent des exemples très emblématiques. Je pense, en particulier, au métro d’Alger, qui était très attendu et qui fonctionne à la satisfaction des Algérois et des Algériens avec le concours d’une entreprise française bien connue.
Présentes depuis toujours en Algérie, les entreprises françaises bénéficient des opportunités offertes par les plans de développement qui se succèdent : elles sont aujourd’hui plus nombreuses et plus actives, et elles réalisent de meilleures affaires. Nous sommes maintenant presque à mi-parcours du plan quinquennal 2010-2014, plus important que l’addition des deux plans précédents – je rappelle que les projets entièrement financés par le budget de l’État algérien représentent 300 milliards de dollars.
La coopération est également active et dense dans d’autres domaines, tels que la culture, la formation, la recherche scientifique et les solidarités actives, lesquelles sont malheureusement trop souvent dictées par les objectifs de sécurité régionale, en particulier au Sahel.
En dernier lieu, je tiens à rappeler que l’Algérie et la France ont en commun un atout très important, qui est le produit d’une histoire commune et en perpétuel mouvement : la communauté algérienne, dont je tiens à saluer l’importance, le dynamisme et l’engagement dans nos efforts de développement.
M. François Asensi. Vous avez presque implicitement répondu à la première question que je souhaitais vous poser : comment analysez-vous l’absence, en Algérie, de mouvements de contestation et de bouleversements semblables à ceux que le reste du monde arabe a connus ?
En second lieu, quel regard portez-vous sur les élections qui ont vu la victoire de certains partis religieux au Maroc et en Tunisie ? Dans le contexte actuel, pensez-vous qu’un tel courant pourrait devenir majoritaire dans votre pays lors des prochaines élections ?
M. Michel Vauzelle. Vous avez évoqué le « printemps arabe ». Comment le caractériseriez-vous ? L’Algérie pourrait être touchée par ce mouvement, qui est également susceptible d’avoir des répercussions sur l’Union pour la Méditerranée (UpM), dont nous avions accueilli la création comme une bonne nouvelle.
L’Algérie a-t-elle le sentiment que l’UpM existe toujours, ou bien votre pays est-il d’avis qu’il faudrait suivre une autre méthode ? On pourrait envisager une conférence sur la sécurité et la coopération en Méditerranée, solution sans doute plus souple pour remplacer la photo de famille des dictateurs renvoyés par leur peuple.
S’agissant de la Syrie, quel rôle l’Algérie pourrait-elle jouer ?
J’en viens à la visite de M. Guéant dans votre pays : le ministre de l’intérieur aurait demandé une réduction de 10 % de l’immigration légale. Quel accueil votre pays a-t-il réservé à cette demande ?
M. Lionnel Luca. En tant que vice-président du groupe d’études sur les rapatriés, je voudrais vous faire part des préoccupations d’un certain nombre de nos concitoyens au sujet des cimetières français en Algérie, qui souffrent de problèmes de conservation et parfois de profanations. Je pense, en particulier, à la région d’Oran. Quels éléments d’information pourriez-vous nous transmettre ?
L’année 2012 marquera le cinquantième anniversaire de l’indépendance algérienne. Le gouvernement auquel vous appartenez envisage-t-il un geste d’ouverture et de réconciliation nationale envers ceux qui ont été du côté de la France ? Je rappelle qu’ils ne peuvent toujours pas revenir en Algérie.
Enfin, dans l’hypothèse où serait adoptée une proposition de loi visant à autoriser le droit de vote des étrangers aux élections locales, l’Algérie pourrait-elle envisager des dispositions semblables pour les Français vivant en Algérie ?
M. Jean-Paul Lecoq. Merci, monsieur le ministre, d’avoir présenté en détail les principes selon lesquels l’Algérie est appelée à évoluer. Je crois que nous sommes nombreux à attendre que votre pays prenne place parmi les grandes nations démocratiques. Les différentes lois que vous avez évoquées vont dans ce sens. Membre du Conseil de l’Europe, j’espère que l’Algérie demandera aussi à être reconnue comme « partenaire avancé pour la démocratie », suivant l’exemple du Maroc, et qu’elle remplira les nombreuses obligations liées à ce statut.
Par ailleurs, je souhaiterais connaître votre avis sur l’évolution de la situation au Sahara occidental. Pensez-vous que le peuple sahraoui pourra enfin exercer le droit à l’autodétermination sur lequel l’ONU s’est engagée ? Quel rôle votre pays compte-t-il continuer à jouer pour accompagner cette demande légitime ? D’autres territoires, tels que le Kosovo, demandent à être reconnus comme des États. Il me semble que cela pourrait être aussi le cas du Sahara occidental.
S’agissant de l’Union pour la Méditerranée, quel rôle l’Algérie peut-elle jouer, grâce à son positionnement, à sa superficie et à ses moyens, pour assurer un lien entre l’Europe et le développement de l’Afrique ? Dans quelle mesure votre pays pourrait-il se retourner vers le continent pour l’accompagner ?
Mme Chantal Bourragué. Merci, monsieur le ministre, de nous avoir présenté la situation actuelle de l’Algérie et ses évolutions.
Vous avez récemment indiqué qu’une délégation du conseil de transition libyen venait de se rendre en Algérie et qu’il y avait des échanges permanents entre les autorités algériennes et libyennes. Comment accompagnez-vous la transition en Libye et quelles relations comptez-vous développer avec ce pays ?
Par ailleurs, quel regard portez-vous sur les événements en Syrie ? Continuez-vous à penser que les autorités finiront par répondre positivement aux propositions de la Ligue arabe pour rétablir la paix, la sécurité et le dialogue ?
En dernier lieu, que pouvez-vous nous dire sur la situation dans les camps de Tindouf ? Quelles évolutions peut-on envisager ?
M. Jean-Paul Bacquet. Nous avons été particulièrement sensibles à vos déclarations sur le partenariat d’exception et sur notre « histoire commune », dont vous avez dit qu’elle était « en perpétuel mouvement ».
Ce mouvement pourrait-il conduire à envisager, à l’occasion du cinquantième anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, une réciprocité pour les Français d’origine algérienne, dits « harkis » ?
M. Hervé de Charette. L’année 2012 sera très importante pour l’Algérie et pour l’histoire commune de nos deux pays. Nous ne devons surtout pas manquer cette échéance. Pouvez-vous nous dire dans quelles dispositions d’esprit se trouve l’Algérie ? Il conviendrait non seulement de tourner des pages anciennes, à propos desquelles plusieurs questions vous ont été posées, mais aussi de donner plus de corps au « partenariat d’exception », dont le contenu reste encore à construire.
Nous savons à quel point l’accueil des investissements importe à votre pays : vous souhaitez des partenariats permettant de créer des emplois chez vous, plutôt que des exportations françaises. Or, cet objectif est en partie contrarié par l’adoption, il y a trois ans, de dispositions qui imposent aux entreprises investissant dans votre pays d’être majoritairement constituées de capitaux algériens. Malgré certaines conséquences utiles, cette règle est un frein. Afin d’assouplir le dispositif et d’encourager les investissements français, pourrait-on imaginer une diversification des règles selon les secteurs ou les pays ?
M. Jean-Louis Christ. La guerre en Libye a fait refluer des armes en grand nombre vers le Sahel, et l’on peut craindre qu’elles ne servent à des organisations terroristes. Une conférence de haut niveau s’est tenue à Alger, au mois de septembre, en vue d’établir un partenariat en matière de sécurité et de développement entre votre pays, le Mali, la Mauritanie et le Niger. Pouvez-vous nous dire quelles ont été les avancées réalisées dans la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel et quels objectifs de développement vous vous fixez ?
M. Mourad Medelci. M. Asensi m’a interrogé sur les événements qui se produisent depuis quelques mois dans la zone constituant le voisinage de l’Algérie, et il m’a demandé pour quelles raisons notre pays reste stable alors que d’autres connaissent des intifadas, des révolutions et des mutations très profondes. Je tiens à préciser que nous ne sommes pas les seuls à conserver une telle stabilité : c’est aussi le cas du Maroc, ce dont nous nous réjouissons, car nous souhaitons une zone stable. Par ailleurs, même s’il y a peut-être une insistance plus grande depuis le printemps dernier, les Algériens ne font que continuer à revendiquer ce qui leur semble faire partie de leurs droits.
Fort heureusement, les causes du « printemps arabe » n’étaient pas réunies à Alger : les pays concernés avaient un système centralisé en matière de pouvoir politique, ils ne reconnaissaient pas la liberté de la presse et ils n’avaient pas pris très au sérieux la question de l’équilibre régional et, dans certains cas, ethnique. Dans ces pays, qui vont de la Tunisie au Yémen, la pression exercée s’est trouvée mise à nu à cause de la conjoncture économique et sociale ou, parfois, à cause d’un simple événement. Les populations ont alors voulu renverser cette pression à la faveur d’une révolution ou d’une révolte.
En Algérie, le pluralisme politique existe depuis 1988 : des dizaines de partis sont représentés à l’Assemblée, et le gouvernement rassemble, depuis 2000, entre trois et cinq partis politiques, dont un est de tendance islamiste. Nous sommes donc très loin d’un système centralisateur. En outre, je tiens à rendre hommage à la liberté de la presse exceptionnelle de l’Algérie – même si les membres du gouvernement apprécient diversement les pointes d’humour auxquels ils sont soumis, celles-ci sont désormais entrées dans les mœurs. Si notre situation est différente, c’est aussi parce que nous avons engagé des réformes depuis dix ans, notamment en ce qui concerne l’école et la justice, et parce que notre situation s’est très sensiblement améliorée au plan économique et social. Le PIB par tête, le taux de chômage et le taux d’inflation montrent que l’Algérie a réalisé des avancées très positives au cours des dernières années.
En revanche, les Algériens n’ont pas changé : ils restent des frondeurs qui en veulent toujours plus, et ils ont bien raison. Ils ont donc saisi l’occasion du « printemps arabe » pour sortir plus souvent, parfois en faisant plus de bruit, mais la qualité des rapports entre le gouvernement et la population a permis de traiter les doléances en apportant, le plus souvent, des solutions raisonnables et consensuelles, même s’il y a un coût budgétaire qu’il faudra assumer.
Selon nous, l’UpM présente une valeur ajoutée par rapport au processus de Barcelone que l’on peut résumer à la question suivante : comment faire de l’UpM une somme de projets concrets et opérationnels permettant de prendre en charge de manière plus économique et plus efficiente des demandes qui peuvent venir de chacun des pays concernés ?
Depuis 2008, nous n’avons pas eu l’impression de passer du domaine des idées à des projets concrets qui seraient en cours de développement. Pour sa part, l’Algérie apportera son appui à tout projet s’inscrivant dans une dynamique de résultats et d’efforts conjointement réalisés par les États, les opérateurs économiques et, dans certains cas, la société civile – je pense en particulier à la question de la formation. Nous sommes désireux de voir l’UpM avancer sur cette voie. En revanche, si elle s’engage dans les questions politiques en se dotant d’un secrétariat qui ne serait pas technique, économique ou opérationnel, elle en souffrira – c’est malheureusement le cas aujourd’hui. J’espère que les premiers projets vont naître en 2012 grâce à la nomination d’un nouveau secrétaire général, de nationalité marocaine, que nous avons soutenue, et grâce à l’expérience acquise au cours des dernières années. De toute façon, il n’y a pas d’autre choix possible pour les Méditerranéens que nous sommes. Nous n’avons pas d’autre salut que de travailler ensemble, mais il faut poser les règles du jeu et faire en sorte que la discipline soit consensuelle. C’est pourquoi nous croyons en une UpM revue et corrigée, et éventuellement boostée par une nouvelle conférence.
La Syrie est une source de préoccupation majeure pour les pays arabes et pour tous ceux qui s’intéressent à la situation de ce grand pays dont la profondeur historique est exceptionnelle et qui se trouve aujourd’hui – j’utilise des termes prudents – dans une situation de pré-guerre civile. La Ligue arabe a très rapidement porté une initiative appuyée par la communauté internationale malgré les difficultés et même si c’est parfois du bout des lèvres. Je profite de cette audition pour demander à nos amis français de continuer à nous aider à faire en sorte que cette initiative atteigne un point de non-retour. Pour aller dans cette direction, nous aurons aussi besoin que les Syriens eux-mêmes nous aident – je veux bien l’admettre.
Membre du comité ministériel chargé de promouvoir l’initiative de la Ligue arabe, l’Algérie s’efforcer d’exercer, d’une main, une pression positive sur les autorités, et de tendre l’autre main au gouvernement et à l’opposition pour créer les conditions d’un dialogue en dehors duquel nous sommes persuadés que la transition, attendue par les uns et par les autres, ne pourra pas avoir lieu. Nous essayons donc de donner autant de chances que possible à cette initiative arabe dont les principes sont l’arrêt des violences, la libération des détenus, l’ouverture d’un dialogue et une meilleure connaissance de ce qui se passe sur le terrain.
Ce dernier objectif est particulièrement important, car il nous semble que les informations en provenance de la Syrie ne sont pas toujours frappées du sceau de l’objectivité. Nous avons besoin qu’une commission, composée de représentants des États de la Ligue arabe ou de leurs sociétés civiles, se rende sur le terrain pour procéder à des vérifications et restituer l’information afin de nous permettre d’intervenir plus efficacement en faveur de la préservation des vies humaines. Le bilan augmente chaque jour, même si nous ignorons quelle est la part des civils, notamment des enfants, eux aussi touchés en grand nombre alors qu’ils ne sont pas parties au conflit, et celle des membres des forces de sécurité. Nous espérons parvenir à éviter l’internationalisation du conflit et les solutions extrêmes à l’œuvre dans d’autres pays.
M. Guéant aurait proposé une baisse de l’immigration légale de 10 % à son homologue algérien : merci, monsieur Vauzelle, de cette information que j’essaierai d’utiliser au mieux. De mon côté, je peux vous dire qu’il n’est pas interdit de se fixer des objectifs. Celui de la réduction de l’immigration peut ne pas être porté seulement par l’Europe ou par la France, mais aussi par l’Algérie, surtout quand il s’agit de personnes que nous formons à grands frais et qui nous quittent trop souvent par la suite.
Je concède, monsieur Luca, que nous devons accorder toute notre attention, et même plus que cela, à la question des rapatriés et à la situation des cimetières en Algérie. Sur ce point, des efforts sont déjà réalisés, même s’ils ne sont pas suffisants. C’est une question de dignité et peut-être même un aspect central pour la mémoire. Comme tout ce que nous pourrons faire, d’un côté comme de l’autre, pour la dignité des êtres chers qui nous ont quittés sera toujours insuffisant, nous devons continuer notre travail.
Comme tous les anniversaires, celui des cinquante ans de notre indépendance sera l’occasion de former des vœux. Cela étant, je ne peux pas affirmer que des décisions seront prises le 5 juillet prochain : ce n’est pas ce que l’on attend d’un anniversaire, qui est plutôt l’occasion de faire un bilan. En quoi avons-nous fauté ? Dans quelle mesure avons-nous bien fait ? Comment nous améliorer ? Toutes les directions que vous avez indiquées sont à explorer, sans exception. Pourquoi ne pas envisager, par exemple, la question du droit de vote s’il existe une réciprocité ? Nos pays évoluent à une vitesse parfois surprenante, comme en témoigne le « printemps arabe », et il n’y a pas de limite à la pensée, ni à l’action, si nous adoptons progressivement une même acception de la démocratie.
Quant au statut de partenaire avancé, je répondrai là aussi : pourquoi pas ? Si l’Algérie n’a pas encore adhéré à la politique européenne de voisinage (PEV), c’est parce qu’elle n’avait pas bien compris qu’on pouvait être un pays associé sans être concerné par cette politique. D’autres pays se sont trouvés dans le même cas et le fait est que la PEV a été rénovée. Elle nous paraît désormais plus sympathique, plus claire et plus souple. Je peux donc vous annoncer que nous avons décidé d’entamer des négociations exploratoires pour adhérer à cette politique. Si nous avançons sur cette voie, pourquoi ne pas passer aussi au statut de partenaire avancé ? Je crois que l’Algérie en a les moyens et qu’elle n’a pas vocation à se singulariser systématiquement en reculant ou en se marginalisant : compte tenu de son importance, elle doit, au contraire, aller de l’avant avec les autres pays, en partageant les profits.
En ce qui concerne le peuple sahraoui, nous n’avons jamais cessé de souhaiter qu’il bénéficie du droit à l’autodétermination. Il n’en demeure pas moins que c’est la communauté internationale qui gère le dossier, et non l’Algérie. Nous avons certes plus intérêt que d’autres pays à voir le problème réglé, mais il ne nous revient pas nécessairement d’être les premiers à alimenter la machine, même si les « conditions d’ambiance » font partie des objectifs de Christopher Ross. A cet égard, je rappelle que nous avons développé une coopération bilatérale avec le Maroc dans des secteurs très sensibles, en particulier pour les populations concernées, et que nous sommes convenus de continuer dans la même direction.
S’agissant de l’UpM et du développement africain, nous devons assurer, dans les deux cas, la rencontre entre des projets transversaux concernant l’Europe, la Méditerranée et l’Afrique. Pour sa part, l’Algérie porte plusieurs projets pour lesquels elle n’a pas attendu la création de l’UpM. Nous avons ainsi terminé la partie de la Transsaharienne qui nous concerne et nous avons aidé nos amis du Niger et du Mali à réaliser une partie des travaux dans leur pays. Les efforts étant achevés au Niger, entre 85 et 90 % de la transsaharienne sont aujourd’hui utilisables, la jonction avec l’Europe se faisant grâce à un port réalisé par l’Algérie, à Djen Djen. Tous les spécialistes reconnaissent que le transport de marchandises entre l’Europe et l’Afrique trouvera là le meilleur des débouchés. Le gazoduc qui doit relier le Nigeria à l’Europe, en traversant le Niger, est un second projet, porté de concert avec les Européens. Plus généralement, je rappelle que nous avons tracé les principales étapes de la jonction entre l’Europe, la Méditerranée et l’Afrique dans le cadre du NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique : nous devons travailler de manière solidaire avec le continent européen et la Méditerranée, tout en impulsant un mouvement plus franc d’intégration au plan continental.
Pour ce qui est de la Libye, le président Abdeljalil viendra probablement en Algérie avant la fin de l’année. Nos contacts avec les ministres libyens et avec le président Abdeljalil, que j’ai rencontré à Paris puis à New York, sont très encourageants. Du reste, l’Algérie et la Libye n’ont pas d’autre choix que de travailler ensemble et de renforcer leur solidarité. La situation demeure, en effet, très préoccupante, même si la page de Kadhafi est tournée : il faut veiller à préserver l’unité, mettre en place des institutions républicaines et reconstruire le pays. A cet égard, la Libye a des atouts financiers, mais il faudra l’aider au plan humain. Ce pays nous est très cher, comme à vous, il présente une dimension historique remarquable, et sa nouvelle vocation républicaine devrait donner des chances supplémentaires à l’UMA, l’Union du Maghreb arabe – cela pourrait être un effet insoupçonné du « printemps arabe ».
Quant aux Sahraouis présents à Tindouf, ils vont aussi bien que possible dans cette situation. L’Algérie aide beaucoup les Sahraouis, mais elle n’est pas seule à agir : tous ceux qui travaillent sur ce dossier, en particulier de nombreuses associations françaises, méritent notre considération.
L’histoire est effectivement en perpétuel mouvement, monsieur Bacquet, mais je crois m’être suffisamment exprimé sur la question des « harkis » en répondant à la question de M. Luca.
Comme à l’accoutumée, l’esprit dans lequel M. de Charette m’a posé ses questions l’honore. L’année 2012 sera importante, et nous allons faire en sorte qu’elle nous permette d’avancer ensemble – j’en parlerai tout à l’heure avec M. Juppé. Nous préparons un programme qui débutera le 5 juillet, dans un esprit qui n’est pas revanchard : ce sera plutôt l’occasion de nous évaluer nous-mêmes. Nous devrons non seulement veiller à ce que la dimension historique de ce mouvement révolutionnaire qu’a été la révolution algérienne n’échappe pas aux générations montantes, mais aussi adresser un message d’amitié et de coopération. Nous élaborons donc un programme sans tambour ni trompette, mais serein. Il me semble que nous devons nous demander, en France comme en Algérie, si nous ne pouvons pas essayer de faire avancer un certain nombre de projets pour marquer cet anniversaire. J’ai quelques idées que je soumettrai à M. Juppé.
Dans ce domaine très complexe qu’est l’économie, certaines dispositions peuvent sembler en contradiction avec l’objectif général. C’est en partie lié au fait que la communication n’a pas été suffisante. Cela étant, les investissements directs étrangers sont presque symboliques dans notre pays, compte tenu de son potentiel : on ne peut donc pas dire que les nouvelles mesures adoptées à l’occasion de la loi de finances complémentaire de 2009 ont freiné un flux. Par ailleurs, si ces dispositions ont pu être mal comprises, c’est moins le cas aujourd’hui. Je rappelle que nous discutons sur cette base avec Renault et de nombreuses autres entreprises européennes.
Pour autant, nous sommes conscients que rien n’est jamais acquis dans le domaine économique, comme dans le domaine politique : nous devons sans cesse nous évaluer et changer si nécessaire. C’est pourquoi les réformes concernent aussi le secteur des affaires, qui fait l’objet d’un groupe de travail. Le gouvernement, les opérateurs économiques et les syndicats travaillent en ce moment à l’amélioration du climat des affaires, car nous savons que la bureaucratie est trop lourde : nous devons réaliser un effort de simplification pour exploiter tous nos atouts. On pourrait se demander si cette situation n’est pas liée à l’héritage colonial, mais c’est peut-être un argument un peu facile.
Monsieur Christ, les questions de sécurité au Sahel, notamment celles qui concernent les armes et les extrémismes dits religieux, nous préoccupent beaucoup. Si certains phénomènes sont plus visibles et plus audibles aujourd’hui, ils existaient déjà avant les événements qui ont eu lieu en Libye. Cela fait deux ans que nous travaillons avec les « pays du champ » : nous avons réussi à développer un certain nombre de synergies avec eux depuis la première conférence des ministres des affaires étrangères, qui s’est déroulée en mars 2010. Nous avons ainsi créé un centre d’état major conjoint, qui est opérationnel et dont la présidence tourne chaque année. C’est la preuve que nous pouvons nous approprier la question de sécurité de la zone dans le cadre des « pays du champ », mais cela ne signifie pas, pour autant, que nous sommes en mesure de régler seuls tous les problèmes. Sur ce point, la conférence organisée en septembre dernier à Alger a permis de poser les jalons d’un partenariat très sérieux avec les pays européens, notamment la France, et avec les Etats-Unis. Nous avons, en effet, des besoins en matière de formation, d’équipements spécialisés et de renseignement, domaine dans lequel un travail commun s’impose. Après la conférence d’Alger, qui a permis de dégager un consensus sur ces sujets, deux autres réunions ont été organisées, d’abord à Washington puis à Bruxelles, aujourd’hui même. Nous sommes donc en train de transformer en cadre opérationnel de coopération les intentions formulées au mois de septembre.
M. Dominique Souchet. Pouvez-vous nous dire où en est l’Union du Maghreb arabe ? Estimez-vous que ce processus peut avancer indépendamment de la question du Sahara occidental ?
En second lieu, je rappelle que vous avez déclaré dimanche dernier, devant le Conseil de la nation, qu’un « nouveau départ de l’action maghrébine » était possible du fait des nouvelles conditions économiques et politiques. Pourriez-vous préciser votre pensée ?
M. Jean-Claude Guibal. Les récentes élections dans les pays du Maghreb et du Machrek qui ont connu le « printemps arabe » ont vu une poussée des partis islamistes. Pensez-vous que l’on pourrait assister à une contagion du phénomène en Algérie ?
Estimez-vous, par ailleurs, qu’il existe une compatibilité entre la démocratie telle qu’elle est pratiquée dans votre pays et la charia appliquée par les pays islamistes ?
Ma dernière question concerne la position de l’Algérie sur l’ensemble de la problématique du Moyen-Orient, notamment le conflit israélo-palestinien et l’Iran.
M. Jean-Louis Bianco. Vous avez indiqué que la place de la femme dans les assemblées élues avait fait l’objet de débats passionnés qui ont conduit à un consensus. Pouvez-vous revenir sur ces débats et nous expliquer comment le consensus s’est dégagé ?
Vous avez également dit que la présence exclusive de magistrats au sein des commissions électorales correspondait à un souhait de la société civile, qui a été consultée sur ce sujet. Comment cette consultation a-t-elle eu lieu ?
M. Jacques Myard. Le cinquantenaire de l’indépendance de l’Algérie est une date importante. Les relations bilatérales ont toujours été marquées par un certain « je t’aime, moi non plus » entre nos peuples, qui présentent de nombreuses similitudes : les Algériens ont toutes les qualités des Français et tous leurs défauts, et vice-versa. Il y aura donc une forte émotion au moment du cinquantième anniversaire de l’indépendance. A cette occasion, on pourrait souhaiter quelques gestes montrant qu’on va de l’avant au lieu de toujours regarder en arrière.
J’en viens à la question de la croissance démographique, qui reste assez soutenue en Algérie. Cela fait-il partie des sujets sur lesquels le gouvernement algérien travaille ? Avez-vous adopté des mesures dans ce domaine ?
S’agissant de la question de la sécurité sur le flanc sud, que vous avez évoquée, je rappelle que l’émir dirigeant AQMI pourrait avoir son siège chez vous.
M. André Schneider. Pourriez-vous nous apporter, monsieur le ministre, quelques éclaircissements sur la loi relative aux partis politiques qui vient d’être votée par l’Assemblée algérienne ?
Je m’associe, par ailleurs, à la question de M. Guibal sur la force des islamistes dans votre pays.
M. François Rochebloine. Vous avez évoqué la visite du ministre de l’intérieur, Claude Guéant, qui est aussi en charge des cultes. Pouvez-vous nous dire où en sont les relations avec les chrétiens en Algérie ? Je rappelle que nous facilitons la construction des lieux de culte dans notre pays.
M. Henri Plagnol. De même que François Loncle, j’ai gardé un excellent souvenir de notre rencontre avec vous à Alger, juste après la conférence sur le terrorisme, qui a été un succès.
Vous avez indiqué que l’Algérie allait entrer dans une phrase préparatoire à son adhésion à la politique européenne de voisinage. Qu’en attendez-vous précisément ? Demandez-vous que l’Europe fasse davantage d’efforts pour accélérer l’initiative en faveur du Sahel ? Je rappelle que son développement est un élément clef dans la lutte contre AQMI.
M. Hervé Gaymard. Ancien rapporteur de la convention de partenariat entre l’Algérie et la France, je me félicite des propos que vous venez de tenir, monsieur le ministre.
L’Algérie consacrant une part très importante de sa richesse nationale à l’armée, j’aimerais savoir quelle est l’évolution de sa politique militaire. Des grands programmes d’équipement sont-ils prévus ?
M. Gérard Voisin. La diplomatie concerne aussi l’économie – vous êtes d’ailleurs économiste et expert en énergie. Dans ce domaine, un accord de coopération pour le développement et les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire a été signé par votre pays, le 21 juin 2008. Que pensez-vous de l’avenir de l’énergie électrique d’origine nucléaire ?
M. Bernard Derosier. Président du groupe d’amitié entre la France et l’Algérie, je fais partie des défenseurs de la notion de diplomatie parlementaire, qui peut accompagner la diplomatie des États. A cet égard, je rappelle que le président de notre Assemblée, Bernard Accoyer, et celui de l’Assemblée algérienne, Abdelaziz Ziari, ont décidé de constituer une grande commission. Nous souhaiterions qu’elle se réunisse une deuxième fois, si possible avant les élections qui auront lieu dans votre pays comme dans le nôtre. C’est un point sur lequel nous souhaiterions vivement que vous puissiez influencer le Parlement algérien, en particulier l’Assemblée populaire nationale.
M. Mourad Medelci. Tout d’abord, je rappelle que nous venons de lancer une Banque maghrébine pour le commerce et le commerce extérieur. Cette banque, attendue depuis longtemps, est désormais dotée d’un capital. Installée à Tunis, elle débutera ses opérations sur le terrain dès l’année prochaine. C’est là un symbole de l’action que nous entendons mener dans le cadre de l’UMA : nous avons déjà réduit les différences systémiques entre nos pays, qui sont tous libéraux au plan économique ou très avancés sur cette voie, et dont le droit économique est de plus en plus cohérent – c’était notamment une nécessité pour le développement de nos liens avec l’Europe.
Au plan politique, les événements en Libye et en Tunisie nous font espérer la possibilité de donner une plus grande cohérence à notre volonté de construction commune dans le cadre du Maghreb. Avec le Maroc, nous devons certes gérer le problème du Sahara occidental, mais nous avons décidé de considérer que cette question ne devait pas gêner le développement de l’UMA. Lorsqu’elle a été créée, il y a 21 ans, la question du Sahara occidental se posait déjà. Nous aurons naturellement beaucoup de travail à réaliser dans les prochains mois, et nous attendons avec beaucoup d’intérêt l’installation du gouvernement tunisien et du gouvernement marocain, après celui de la Libye. Les ministres des affaires étrangères doivent se réunir dès le début de l’année prochaine pour évaluer la situation et continuer à avancer – tel était l’état d’esprit de mes homologues, il y a quelques jours encore, et la relève qui vient ne m’inquiète pas. Je rappelle, au demeurant, que la politique diplomatique est suivie, à ce niveau, par les chefs d’Etat, notamment Sa Majesté le roi du Maroc.
L’émergence de mouvements islamistes en Tunisie et en Egypte peut-elle aussi concerner l’Algérie ? Nous avons montré la voie : depuis l’indépendance, le substrat juridique algérien contient de nombreux éléments empruntés à la charia, notamment dans le domaine du droit de la famille. Par ailleurs, nous avons cassé le parti unique depuis l’intifada de 1988 : il y a de nombreux partis islamistes à l’Assemblée, et l’un d’entre eux est représenté au gouvernement depuis onze ans, y compris à des postes très importants. Le ministre des travaux publics, qui constituent le principal poste du budget d’équipement, est aujourd’hui issu de la mouvance islamique. Nous n’avons donc pas attendu les récents événements pour ouvrir la porte à tous ceux qui souhaitent travailler dans le cadre du respect de l’alternance et de l’ordre républicain, et non prendre le pouvoir par les armes.
Nous avons, en revanche, fermé la porte aux autres. De même que la précédente loi sur les élections, le texte adopté hier ne permettra pas à ceux qui sont convaincus de crime de sang de créer des partis politiques ou d’exercer un rôle dirigeant en leur sein. Le nouveau texte ne fait que préciser ce principe, conformément aux lignes rouges fixées par le référendum de 2005, dont la valeur est supérieure à la loi.
Les questions concernant le Moyen-Orient et l’Iran sont souvent croisées : le problème de la Palestine et d’Israël, auquel les pays arabes s’efforcent de trouver une solution, s’accompagne ainsi d’interférences dans le domaine du nucléaire, un des pays disposant de capacités que d’autres souhaiteraient également obtenir. De son côté, l’Algérie milite pour la réduction de l’armement nucléaire, en particulier dans le cadre de la conférence de Genève. Nous espérons, par ailleurs, que l’organisation d’une conférence visant à faire du Moyen-Orient une zone exempte d’armes nucléaires permettra de grandes avancées en 2012.
Pour ce qui est de l’Iran, nous considérons que ce pays a le droit d’utiliser le nucléaire à des fins pacifiques, comme tous les pays, notamment l’Algérie. Nous faisons d’ailleurs usage de ce droit en travaillant avec nos amis français dans le domaine de la formation, indispensable pour que l’énergie nucléaire puisse s’inscrire sans risque dans notre paysage énergétique. Je rappelle que nous travaillons actuellement à la création d’un institut supérieur de formation – c’est la première et la plus importante conséquence de l’accord signé avec la France en 2008.
Pour ce qui est des femmes, le quota est de 20 % lorsque le nombre de sièges est inférieur ou égal à quatre dans une commune, de 30 % à partir de cinq sièges, de 35 % à partir de quinze et de 40 % au-delà de trente-deux, ce qui permet de coller à la sociologie du terrain. Le projet initial du gouvernement prévoyait un taux de 30 % dans tous les cas, mais les débats intenses qui ont eu lieu à l’Assemblée ont conduit à un éventail plus large, compris entre 20 et 40 %, et même 50 % pour la communauté algérienne votant à l’étranger.
Comment avons-nous procédé aux consultations concernant la composition des commissions électorales ? Dans sa volonté de réforme, le président de la République n’a pas seulement sollicité le gouvernement, mais il a aussi chargé le président du Sénat, deuxième personnalité de l’État, d’écouter le plus grand nombre possible de partis politiques, d’associations et de responsables. Il s’agissait de procéder, non à des négociations, mais à une écoute sur le fondement de laquelle le gouvernement a été chargé de faire des propositions. S’agissant de la composition des commissions électorales, il a suivi la demande de la société civile.
Nous devons réfléchir aux gestes souhaités par M. Myard. Sur ce point, je rappelle que nous cherchons, depuis quinze ans, un terrain à Paris pour l’Ecole internationale qui doit voir le jour. Ce serait l’occasion de se souvenir du rôle joué par les étudiants algériens, notamment dans le cadre de l’UGEMA, l’Union générale des étudiants musulmans algériens. Mais ce n’est qu’un exemple des projets que l’on pourrait réaliser pour le cinquantième anniversaire de notre indépendance.
Il est vrai que nous devons maîtriser la croissance démographique. Outre les techniques contraceptives, déjà assez développées dans notre pays, deux autres facteurs agissent : l’éducation des femmes, domaine dans lequel nous avons connu une évolution remarquable – les femmes sont ainsi plus nombreuses que les hommes à l’université – et la pression exercée par l’habitat. Quand ce dernier est trop étriqué, le taux de natalité diminue, car l’âge du mariage est plus tardif. Avec tous les efforts en cours de réalisation en matière de logement, nous avons sans doute poussé à la hausse la pression démographique, mais celle-ci reste dans des limites raisonnables.
Monsieur Myard, je ne suis malheureusement pas en mesure de fournir l’adresse de l’émir que vous avez évoqué. Je croyais qu’il s’était expatrié depuis longtemps, mais nous serons heureux d’apprendre, par le canal qui vous siéra, les éléments dont vous disposez.
Dans le domaine du culte, la loi ne doit être discriminatoire ni France ni en Algérie : les conditions doivent être les mêmes pour les musulmans et pour ceux qui ne le sont pas. Il faut être vigilant et pro-actif sur ce point. Des demandes ont été exprimées par la communauté algérienne en ce qui concerne les mosquées, mais aussi par des Algériens désireux d’embrasser un autre culte. Afin d’éviter les difficultés, il faut éviter qu’il y ait trop de pesanteur : nous sommes pour le dialogue des civilisations et nous souhaitons que le cinquantième anniversaire de l’indépendance apporte le témoignage que l’Algérie, qui a tant souffert et qui n’oublie pas ses souffrances, est une terre d’amitié, de fraternité et de coopération avec tous, en particulier les Français.
De plus, j’aurai certainement l’occasion de rappeler à nos amis de Bruxelles qu’il n’y a pas plus européen que l’Algérie. Si l’histoire avait été différente, nous serions d’ailleurs membres de l’Union européenne depuis longtemps – nous étions encore français au moment du traité de Rome. C’est là un simple rappel historique que je fais en réponse à M. Jean-Paul Lecoq.
J’en viens à l’armée : là aussi, il a fallu investir pour moderniser l’équipement et la formation. En 2008, nous avons conclu un accord de coopération avec la France. Il n’est pas encore ratifié, mais nous ne désespérons pas qu’il le soit avant la fin de l’année ou au début de l’année prochaine.
Pour ce qui est du nucléaire, nous appliquons avec beaucoup d’intérêt l’accord de 2008, en particulier dans le domaine de la formation. Je tiens également à préciser que nous n’envisageons pas d’investir dans le nucléaire avant une dizaine, voire une quinzaine d’années, car on ne s’improvise pas producteur d’électricité dans un tel domaine. Nous nous trouvons, pour le moment, dans une phase de préparation. J’ajoute que l’Algérie ne doit pas se contenter d’exporter du pétrole et du gaz : elle doit aussi développer des partenariats pour produire de l’électricité grâce à l’énergie solaire – c’est là notre avenir.
La question de la grande commission concernant les parlementaires, je me ferai auprès d’eux le messager et l’avocat de la proposition formulée par M. Derosier. J’appellerai M. Ziari et M. Bensalah dès mon retour à Alger et, si vous m’invitez à la réunion que vous appelez de vos vœux, je serai très volontiers des vôtres.
M. le président Axel Poniatowski. Je vous remercie, au nom de tous mes collègues, d’avoir répondu de façon aussi approfondie et intéressante à nos questions. J’observe, par ailleurs, que c’est votre audition qui a réuni le plus grand nombre de députés au sein de notre Commission depuis le début de la législature.
20.- Mercredi 21 décembre 2011, séance de 9 heures 30, compte rendu n° 29 : réunion sur la situation en Egypte en présence de M. Peter Harling, directeur du projet Moyen-Orient à l’International Crisis Group, et Mme Sophie Pommier, enseignante à l’Institut d’études politiques de Paris, spécialiste de l’Egypte.
M. le président Axel Poniatowski. J’ai le plaisir d’accueillir M. Peter Harling, directeur du projet Moyen-Orient à l’International Crisis Group, et Mme Sophie Pommier, enseignante à l’Institut d’études politiques de Paris, spécialiste de l’Égypte, que je remercie d’avoir accepté de venir partager avec nous leur analyse de la situation de ce pays.
Notre réunion porte à la fois sur la situation intérieure de l’Égypte, qui sera présentée par Mme Pommier, et sur les interactions entre les évolutions que connaît ce pays et celles qui ont cours dans toute la région, dont traitera M. Harling.
Sur le plan intérieur, les élections législatives ont commencé. Les résultats de la première phase font apparaître des scores très élevés pour le Parti Liberté et Justice des Frères musulmans (37 %), mais aussi pour Al Nour (24 %) regroupant les forces salafistes, ce qui constitue une relative surprise. Les résultats provisoires de la deuxième phase confortent cette tendance.
Dans le même temps, des affrontements violents se poursuivent depuis maintenant plusieurs jours au Caire et posent la question du rôle de l’armée dans le processus de démocratisation engagé. La nomination de Kamal El Ganzouri à la tête du gouvernement n’a pas provoqué l’apaisement souhaité.
Or, les événements qui se déroulent en Égypte sont à la fois partie intégrante d’un mouvement d’ensemble et un cas particulier qui, compte tenu du rôle de premier plan de cet État, affecte nécessairement les autres pays et les équilibres géopolitiques. On pense naturellement au devenir du régime syrien, à la montée en puissance des partis islamistes et au conflit israélo-palestinien. C’est aussi dans cette perspective régionale que la gestion de la transition post-Moubarak est très attentivement suivie.
Je rappelle qu’une mission de notre commission conduite par Hervé Gaymard se rendra au Caire à la fin du mois de janvier 2012.
Mme Sophie Pommier, enseignante à l’Institut d’études politiques de Paris, spécialiste de l’Égypte. Il convient d’abord de dissiper un malentendu sur la prise en charge du pouvoir par l’armée au début du mouvement de contestation égyptien.
Depuis le départ d’Hosni Moubarak le 11 février dernier, le Conseil suprême des forces armées (CSFA) concentre tous les pouvoirs : il a suspendu la Constitution, procédé à la dissolution du Parlement et s’est octroyé la possibilité de légiférer par décret.
À la différence de la Tunisie où elle joue un rôle mineur, l’armée constitue en Égypte un pilier essentiel du régime, d’où l’ambiguïté du mouvement, qui a consisté à la faire passer pour une alternative ou, en tout cas, un élément extérieur au système politique de l’ancien président Moubarak.
Avant le mouvement de janvier dernier, l’armée était déjà critique sur l’avenir du pays et très réticente vis-à-vis du scénario de transition dynastique préparé par le président Moubarak depuis le début des années 2000 – elle lui en avait d’ailleurs fait part. D’abord, elle ne voulait pas de son fils, Gamel Moubarak, en raison du caractère dynastique de cette transition et parce que celle-ci aurait profité à un civil. Deuxièmement, elle était hostile aux groupes d’hommes d’affaires et de réformateurs économiques entourant le fils du président, dont l’action, notamment économique, lui paraissait dangereuse dans la mesure où elle pouvait déstabiliser la société en créant des tensions sociales. Enfin, cette action se singularisait par des abus en matière de corruption qui semblaient aux militaires susceptibles de générer des troubles que Gamel Moubarak, à leur sens, n’aurait pas été capable de contenir.
Aussi, lorsque la situation s’est emballée, l’armée a saisi la balle au bond pour se débarrasser de celui-ci et de son entourage, quitte à devoir, au moins dans un premier temps, exercer le pouvoir – ce qui n’est sans doute pas au départ l’option qu’elle aurait privilégiée, les militaires préférant être en seconde place.
Elle a souhaité garder le contrôle de la situation, le temps de négocier avec un pouvoir civil la garantie de trois priorités essentielles, faute desquelles elle n’acceptera probablement pas de céder le pouvoir et de retourner dans ses casernes. Il s’agit d’abord de conserver ses prébendes et l’énorme empire économique sur lequel elle a la main – les militaires détiennent en effet une partie importante des terres, possèdent un réseau industriel de distribution, sont les premiers bénéficiaires de l’aide annuelle octroyée par les États-Unis – soit 1,3 milliard de dollars sur un total de 1,7 milliard – et disposent d’une part conséquente du budget.
Deuxième priorité : éviter une escalade avec Israël, en liaison avec les États-Unis, avec lesquels elle entretient une relation privilégiée. D’autant que la disparité des forces avec ce pays serait à son désavantage.
Dernière priorité : s’assurer que les militaires échappent à toute procédure judiciaire et bénéficient d’une immunité pour leurs exactions passées et actuelles.
Le problème est que les militaires n’avaient pas l’intention de gérer directement les affaires de l’État : ils se sont donc trouvés dans la situation inconfortable d’assurer l’ordre public tout en cherchant à garder cette aura de soutien à la révolution dont ils avaient su habilement se parer au début des événements. Ils ont par ailleurs été confrontés à la dégradation de la situation économique et à un noyau de jeunes activistes très déterminés qui, ayant compris que la révolution n’avait pas abouti et qu’il fallait aller de l’avant, n’ont cessé de formuler de nouvelles revendications. Les militaires y ont cédé au cas par cas et de manière assez maladroite, car avec un temps de retard, sans enrayer véritablement la contestation.
La façon dont ces jeunes ont été perçus par la population a alors changé : au moment du déclenchement des troubles, on a vu une véritable adhésion populaire autour de leur mouvement, lequel a été ensuite rejoint par les islamistes et des gens ordinaires exprimant leur rejet du système existant.
Mais ce n’est plus du tout le cas aujourd’hui : les troubles restent très circonscris et la population, qui demeure attachée aux forces armées, voit d’un œil critique ces agitateurs, auxquels elle reproche d’entretenir le pays dans l’instabilité en empêchant un redémarrage économique.
Alors que la situation s’est dégradée au fil des mois entre les militaires et les jeunes activistes, ceux-ci sont de plus en plus isolés et, en dépit de la violence de la répression relayée par les médias, leur cause semble perdue au moins dans l’immédiat.
Il sera en revanche plus difficile pour les militaires de contrôler les islamistes, qui ont une capacité de mobilisation beaucoup plus importante. C’est d’ailleurs l’implication des Frères musulmans et des salafistes qui avait fait basculer le mouvement au début de l’année. Or les islamistes se sont retirés de ce mouvement pour laisser se dérouler le processus électoral, dont ils savaient qu’il leur serait largement favorable. Plutôt que d’entrer dans une confrontation directe avec les militaires, avec le risque de bloquer les élections dans un scénario du type de celui qu’a connu l’Algérie, ils ont préféré adopter une stratégie de profil bas.
Les militaires ont compris que les Frères musulmans constituaient pour eux le principal danger, d’où leur volonté de leur opposer plusieurs contre-feux.
D’abord, en laissant se multiplier les formations politiques islamistes concurrentes : ils ont non seulement accepté la création d’un parti des Frères musulmans – Liberté et Justice – mais aussi laissé se constituer plusieurs partis salafistes et un parti soufi.
D’autre part, ils ont essayé de faire adopter plusieurs articles « supra-constitutionnels » dans le cadre d’un calendrier politique assez complexe, jalonné de plusieurs étapes : les élections législatives, la constitution d’un comité chargé de rédiger la prochaine constitution, l’élection du Conseil consultatif – qui équivaut à peu près à notre Sénat –, la rédaction de la constitution dans les six mois suivants, puis l’élection du président de la République. On comprenait tacitement que si l’on devait attendre les élections pour mettre en place un comité constituant, c’est que ce dernier devait être une émanation du futur parlement.
Les militaires ont fait passer des articles qui « détricotaient » progressivement cet agencement. Il s’est d’abord agi d’affirmer la nature civile d’un État respectant le multipartisme et garant des droits des minorités, tout en récupérant l’article 2 de la précédente Constitution, qui dispose que la loi islamique est la principale source de la législation – sachant que cette disposition n’est pas nouvelle puisqu’elle prévaut depuis Anouar el-Sadate. Cette première série de mesures avait déjà suscité une certaine agitation dans les rangs des activistes.
Quant à la deuxième série d’articles « supra-constitutionnels », présentée début novembre, elle constituait clairement une entrave aux prérogatives du futur parlement. Elle comportait deux volets.
Le premier consistait à définir la composition du comité chargé de rédiger la future constitution : il prévoit que sur les 100 membres que celui-ci comportera, 20 seulement seront issus du prochain parlement, les 80 autres étant nommés par les militaires. Pour les islamistes, cela a constitué un casus belli, dans la mesure où cela revenait à saboter leur capacité à influer sur la vie politique et à les priver de leur victoire électorale.
Le second volet tendait à retirer au Parlement le droit de contrôler le budget des militaires et à délimiter les conditions de la déclaration de guerre – celle-ci devant préalablement être approuvée par l’armée.
Alors que le premier volet a provoqué la colère des islamistes, le second a suscité celle des jeunes révolutionnaires, qui ne veulent pas entendre parler de prérogatives spécifiques pour l’armée – qui leur apparaissent comme un prolongement de la situation actuelle, laquelle s’apparente pour eux davantage à un coup d’État qu’à une transition démocratique en bonne et due forme. D’où le déclenchement des affrontements actuels.
Mais, en se retirant des confrontations de rue, les islamistes, privilégiant le processus électoral, ont entraîné l’isolement des jeunes activistes à l’origine du mouvement.
Cela étant, en l’état actuel des choses, les islamistes et les militaires ont plutôt intérêt à s’entendre. Les premiers, parce qu’ils ne peuvent s’attirer l’opposition ouverte de l’armée, qui pourrait être tentée de réaliser un coup d’État, et qu’ils ont besoin d’elle pour assurer le maintien de l’ordre. Les seconds, pour préserver le processus démocratique engagé depuis un an et par peur de la capacité de mobilisation des Frères musulmans – qui pourrait donner au mouvement de contestation une tout autre dimension.
Le plus vraisemblable est donc que ces deux acteurs arrivent à trouver un accord. Il s’agit en fait du scénario le plus positif : il permettrait d’aller de l’avant et de sortir du processus électoral actuel par le haut.
Deux évolutions de ce scénario « démocratique » sont possibles. Dans un premier temps, si on leur laisse accéder au pouvoir après les élections, les Frères musulmans joueront la carte de l’ouverture en s’alliant avec les partis libéraux, de manière à rassurer la communauté internationale, à préserver un certain consensus au sein de la population et à rasséréner les coptes et les libéraux. Mais si la situation socio-économique continuait à se dégrader, les salafistes feraient figure de véritables opposants – ils auraient en quelque sorte gardé leur virginité politique. Les Frères musulmans pourraient alors être tentés de changer de stratégie et de radicaliser leurs positions en se lançant dans une surenchère dans le domaine de la moralité islamique.
Un deuxième scénario consisterait en un coup d’État effectif de l’armée. Le troisième, improbable compte tenu de la présence de l’armée, dans l’instauration d’une République islamiste. Enfin, on ne peut écarter le scénario du chaos, marqué par une situation totalement incontrôlée, des troubles récurrents et l’incapacité d’un système politique cohérent à se mettre en place.
M. Peter Harling, directeur du projet Moyen-Orient à l’International Crisis Group. La situation en Égypte est caractérisée par un haut degré d’incertitude, ce qui peut paraître étonnant après une période de transition de onze mois. Les milieux les plus informés ont du mal à faire des projections et les acteurs les plus influents sur le terrain sont réduits à une grande part d’improvisation : même s’ils définissent relativement bien leurs intérêts et leurs objectifs, ils peinent à déterminer comment les défendre ou les atteindre.
Cet état de fait appelle une grande prudence : si les médias tendent à conclure qu’on passe d’un printemps arabe à un hiver islamique ou d’un avortement du processus de transition en faveur d’un retour en force des réactionnaires, l’avenir de la région est largement indéterminé : de multiples évolutions sont possibles. Il conviendra de suivre très attentivement la situation complexe de chacun de ces pays, d’autant plus complexe qu’existent de fortes interactions entre eux.
Une particularité de l’Égypte tient au mythe d’une société homogène, qui est profondément ancré dans les perceptions du pays, mais aussi dans la façon dont sa société a de se concevoir, alors qu’elle est fondamentalement divisée selon une logique de classes, de confessions, d’identités régionales, de corporatismes ou de courants de pensée religieux.
Le pays est à cet égard marqué par un déni et une volonté de reporter l’expression, et donc la résolution, des conflits qui en dérivent, contrairement à la plupart des autres États de la région, qui ont dû faire face d’emblée à leurs démons. Ainsi, en Tunisie, l’enjeu essentiel est le sécularisme de l’État, en Libye, les identités régionales, à Bahreïn, le principe d’un régime proche de l’apartheid dominé par les sunnites au détriment d’une vaste majorité chiite, et en Syrie, le sectarisme et la position du pays dans les rapports de forces régionaux.
Les militaires au pouvoir ont remporté un succès assez ambigu à cet égard, en parvenant à contenir la manifestation de toutes ces divisions ou tensions, mais en reportant leur expression toujours plus loin dans l’avenir. Cela peut faire craindre le risque d’une explosion à terme, lorsque chacune de ces tensions parviendra à maturité.
Les trois acteurs principaux vivent dans un certain fantasme d’unanimisme. Ainsi, l’armée prétend incarner la volonté populaire quels que soient les résultats électoraux. Les islamistes voient, de leur côté, le processus de transition comme une mise en conformité avec leurs propres valeurs, dont une société où l’islam s’exprime sur un mode très normatif
– confinant à une forme de « bigoterie » –, allant bien au-delà de ce que l’on observe ailleurs dans la région, les monarchies du Golfe exceptées. Ils sont, par exemple, incapables de conceptualiser la question des coptes, qui représentent environ 10 % de la population et qu’ils essaient au fond d’exclure de leur pensée. Enfin, les libéraux vivent dans le fantasme hérité de la révolution de février, ce moment de grâce, d’union nationale, qu’ils cherchent constamment à réveiller et à reproduire au travers d’un imaginaire et d’une esthétique nationalistes, qui ne touchent que des cercles assez restreints.
On assiste donc à une polarisation autour de trois acteurs et, par conséquent, de trois lectures de la révolution. Les militaires ont perçu celle-ci comme une réaction à la question de la succession – le passage du pouvoir du père au fils – avec toutes ses implications, notamment le modèle économique que Gamel Moubarak cherchait à introduire et l’émergence de nouvelles élites autour de ce modèle faisant concurrence aux intérêts de l’armée. Pour les islamistes, cette révolution représentait l’occasion de faire sauter un verrou permettant enfin l’expression de leur doctrine : ils se situent aujourd’hui dans la continuité de leurs perspectives antérieures, soit une volonté d’islamisation de la société sur le mode de la prédication, mais sans programme politique clair à ce stade. Quant aux libéraux, ils conçoivent la révolution comme l’occasion d’une transformation radicale du système politique, sans définir précisément le contenu qu’ils entendent donner à celui-ci. Ils sont donc perçus comme une jeunesse plutôt anarchiste buttant contre le système hérité de l’ancien régime et s’enfermant dans une certaine nostalgie du moment de grâce de février.
Une autre particularité de la situation en Égypte tient à la nature hybride du processus de transition. Il ne s’agit ni d’un processus démocratique – dans la mesure où les militaires aimeraient autant que possible contenir les conséquences d’un vote islamiste –, ni d’un phénomène de restauration d’un ordre antérieur – même si les militaires en avaient l’envie, un tel projet s’avérerait rapidement impossible –, ni d’une guerre ouverte entre les trois principaux acteurs. Il s’agit plutôt d’un conflit larvé, dont les conséquences peuvent inquiéter, notamment au vu d’une autre particularité : le gigantisme de la société égyptienne.
Ainsi, les libéraux sont relativement peu nombreux, notamment au regard des résultats électoraux, mais un pourcentage minime de la société suffit à avoir un impact considérable : pour remplir la place Tahrir, il faut 200 000 personnes, soit 1 % de la population du Caire !
Bien que les libéraux soient décrits par le pouvoir comme une frange de trublions n’ayant rien à proposer, les militaires n’apportent pas de réponse à la question de la mobilisation. Or celle-ci peut prendre forme très rapidement au sein de ce courant – avec les conséquences tragiques que l’on a pu constater au cours des derniers jours. Le gouvernement ne peut donc ignorer ce dernier.
Les islamistes et les militaires sont au contraire de grands acteurs, hégémoniques, avec de profondes racines sociales, dont les programmes respectifs sont difficiles à concilier. L’issue des rapports de force entre ces deux colosses n’est pas facile à prévoir.
Enfin, l’Égypte est marquée par une autre particularité : un stress économique plus important que dans des pays comme la Libye, la Tunisie ou la Syrie, sans parler des pays du Golfe. Beaucoup doivent travailler pour gagner de quoi manger le jour même. Cette tension économique ne s’est pour l’instant pas exprimée. Cependant, si la société a fait preuve d’une certaine retenue, on peut s’attendre en 2012 à ce que la crise économique vienne s’ajouter à – voire prenne le dessus sur – des considérations politiques.
L’Égypte avait en février une image de bon élève, en raison de sa prétendue homogénéité et de l’existence d’institutions fortes, notamment l’armée, et d’une société civile, mais on peut aujourd’hui se demander si elle deviendra un modèle pour la région ou au contraire un repoussoir.
Deux questions méritent par ailleurs une attention particulière : la politique étrangère du pays et l’islamisme.
En ce qui concerne la politique étrangère, on observe d’abord, s’agissant du conflit central israélo-palestinien, que la société égyptienne est relativement peu mobilisée, en dépit d’une frontière commune avec Israël. Jusqu’à présent, on n’a pas assisté à quelque mobilisation que ce soit à ce sujet. Lorsque l’ambassade d’Israël a été prise d’assaut il y a quelques semaines, c’était en réaction à des tirs israéliens sur des soldats égyptiens.
Il existe, au sein de la société égyptienne, un consensus sur deux points : le rejet de toute remise en question de l’accord de paix avec Israël, ou de tout retour à une dynamique de conflit avec ce pays – dont les Égyptiens connaissent bien le prix –, et le refus de toute normalisation des relations avec lui. Entre ces deux bornes, il y a toute une gamme de postures possibles, que tout système politique émergent devra explorer, sachant que les positions auront tendance à être plus dures en période de crise.
À cet égard, la région a été marquée par le fait que les régimes pouvant jouer le rôle de tampon et contenir l’expression de l’opinion publique dans ce type de période ont disparu. Si Israël devait lancer une opération majeure à Gaza comme en fin 2008-début 2009, les répercussions seraient beaucoup plus importantes.
On assiste pour l’instant à un mouvement d’émancipation progressive, avec une Égypte qui fait preuve d’une capacité d’initiative qu’elle avait perdue au cours de ces dernières années. On a pu le constater à l’occasion des négociations sur l’échange de nombreux prisonniers palestiniens contre le soldat Gilad Shalit et des efforts de réconciliation entre le Fatah et le Hamas, qui avaient butté jusqu’à présent sur une certaine volonté de conciliation vis-à-vis des États-Unis et d’Israël – l’Égypte faisant sur ces questions plutôt le jeu de ces pays qu’elle ne défendait sa propre politique. Aujourd’hui, émerge au contraire une capacité à définir des intérêts égyptiens et à mettre en œuvre des politiques à leur service.
On observe aussi une évolution au sein de la Ligue arabe, qui retrouve une étonnante capacité à agir après des années d’inertie.
S’agissant de l’islamisme, on peut dire que s’il n’a pas remporté la partie – laquelle se déroulera en de nombreuses manches –,il a gagné le droit de jouer.
Il bénéficie à cet égard de plusieurs avantages, à commencer par la situation léguée par les régimes à travers la région, qui n’ont autorisé l’émergence d’aucune alternative politique ni permis la consolidation d’une société civile – n’existait pour l’essentiel qu’une société civile islamiste prenant en charge un certain nombre de fonctions sociales délaissées par des gouvernements recentrés autour des intérêts prosaïques d’une élite restreinte. Ils n’ont pas non plus permis l’émergence d’un corps bureaucratique autonome. La quasi-absence de personnalités technocratiques crédibles est à cet égard particulièrement frappante dans les processus de transition de la région, même s’il existe quelques figures d’exception – tel Mohamed el-Baradei en Égypte, Moncef Marzouqi en Tunisie ou Burhan Ghalioun en Syrie –, qui ont le plus souvent acquis une réputation à l’étranger avant de se constituer une quelconque base sociale sur le terrain.
Mais ils ont aussi de nombreux handicaps. D’abord, les échecs qu’ils ont connus dans la région : en Algérie, au Soudan, en Irak ou, dans une certaine mesure, à Gaza ; à cet égard, le modèle saoudien n’est pas plus tentant pour l’opinion publique arabe que le modèle iranien. Reste le modèle turc, qui est séduisant précisément parce que tout le monde se passe de bien le définir.
Deuxième handicap : la difficulté des islamistes à se couler dans la nouvelle ère qui vient de s’ouvrir : ils évoluent peu dans leur façon de penser et en restent pour l’instant à une notion de triomphe sans bien définir ce qu’ils comptent en faire concrètement.
Je pense par ailleurs qu’ils vont très rapidement se laisser rattraper par leurs divisions, que ce soit celles entre les sunnites et les chiites, une fracture que l’on voit se renforcer de manière spectaculaire ces dernières semaines, ou entre les différents courants de pensée de l’islam sunnite, comme les Frères musulmans et les salafistes en Égypte.
M. Michel Terrot. La percée électorale des islamistes est inquiétante pour l’économie du tourisme, qui est essentielle pour le développement de l’Égypte. Quelles peuvent être les conséquences du marasme économique que vous avez évoqué sur l’avenir du pays ? Pourrait-il conduire au scénario du chaos que vous avez mentionné ?
Mme Sophie Pommier. L’instabilité politique ainsi que l’insécurité qui peut s’en suivre pénalisent gravement l’économie. La paralysie gagne. Les opérateurs étrangers sont tétanisés, contraints de changer d’interlocuteur au fil des différents remaniements ministériels. L’activité touristique et les investissements étrangers ont très fortement chuté. Les deux seuls postes de ressources à n’avoir pas été affectés sont les revenus retirés du canal de Suez et les devises envoyées par les expatriés. Les fortes solidarités familiales qui existent dans la société égyptienne, comme d’ailleurs dans l’ensemble des sociétés arabes, ont joué un rôle d’amortisseur dans les premiers temps de la crise. Mais cette capacité d’amortissement s’épuise. Et on n’est nullement à l’abri d’un nouveau vent de révolte, davantage lié à la situation sociale, avec des personnes et des familles n’arrivant tout simplement plus à subvenir à leurs besoins, comme lors des émeutes de la faim en 1977 ou encore celles consécutives aux difficultés d’approvisionnement en pain en 2008 – les Égyptiens sont les premiers consommateurs de pain au monde, d’où d’ailleurs l’attention portée par les autorités au prix et à la disponibilité de cette denrée.
Si les Frères musulmans accèdent aux affaires, ils auront sans doute beaucoup de mal à faire redémarrer l’économie et résorber la pauvreté. Cela pourrait faire le jeu des salafistes qui, eux, continueront d’incarner une alternative, même s’ils n’ont pas de véritable programme économique. L’hypothèse du chaos, que j’évoquais, pourrait naître d’une situation sociale explosive, à l’instar de ce qui s’était passé en 1977 et avait été difficilement maîtrisé.
M. Jean-Marc Roubaud. Comme l’a souligné M. Harling, il est très difficile de discerner l’avenir dans cette région du monde. Au-delà de l’Égypte, pensez-vous que les pays arabes soient aptes à une démocratie apaisée ? On s’interroge depuis longtemps.
Quel rôle pourrait jouer la Turquie dans la zone ?
Mme Sophie Pommier. Comme la plupart de mes collègues spécialistes de la région, je ne crois pas à un déterminisme culturel qui exclurait que ces pays puissent accéder à la démocratie. En dépit des difficultés et des incertitudes, il y a des signaux tout à fait positifs. Les élections actuellement en cours en Égypte se déroulent bien. Alors qu’auparavant, la vie politique était inexistante dans ce pays et que les Égyptiens boudaient les urnes, avec des taux de participation ne dépassant pas 15 %, ils se sont cette fois fortement mobilisés et le paysage politique s’est diversifié. Qu’on les aime ou non, les islamistes représentent une force politique incontestable et il était normal qu’ils puissent entrer dans le jeu politique. Cela, à soi seul, constitue un progrès. Il ne faut pas mésestimer leur capacité à jouer le jeu de la démocratie. On les considère trop hâtivement comme un bloc uniforme, alors qu’il existe parmi eux une pluralité de sensibilités et de positionnements vis-à-vis de la démocratie. Et même les salafistes, qui en théorie dénoncent les élections et les partis, ont souhaité entrer dans le jeu politique, dont, à l’heure de la mondialisation, il n’est plus possible de s’exclure. La population aspire vraiment à la démocratie : j’en veux pour preuve le taux de participation aux élections en cours.
M. Peter Harling. Il faudra attendre des années avant de pouvoir vraiment juger du résultat des processus engagés. Cette région du monde avait accumulé un retard considérable en matière de démocratie, n’en ayant jamais eu l’expérience. A l’ère ottomane, durant laquelle elle a subi un véritable pillage par des élites cooptées ou non par les Ottomans, a en effet succédé la période coloniale, dévastatrice pour la plupart des pays de la région, où elle a nui à la construction d’États-nations possédant des institutions fortes. Puis la période révolutionnaire, qui s’est ouverte en réaction à la période coloniale, s’est assez rapidement close, les régimes choisissant de se ranger dans tel ou tel camp dans le jeu des grandes puissances, externalisant en quelque sorte leur légitimation, pour mieux se passer de rendre compte à leurs populations.
Certaines des expériences actuelles pourraient constituer des précédents déterminants. Ainsi la Tunisie pourrait-elle donner le premier exemple d’une transition démocratique réussie.
J’en viens à la Turquie. Le processus d’intégration à l’Union européenne a contribué à moderniser l’économie et le système politique turcs, en même temps qu’à faire émerger de nouvelles élites. Et le pays constitue un modèle d’émancipation économique d’une population conservatrice, auparavant marginalisée. Mais sous le leadership de Recep Tayipp Erdogan, le style de gouvernement est aussi devenu plus autoritaire, la corruption s’est développée, les richesses se sont concentrées aux mains d’une élite plutôt restreinte, autant de facteurs qui ont précisément été à l’origine des révolutions dans le monde arabe. Par certains aspects, et toutes proportions gardées, le modèle turc évoque donc davantage le passé du monde arabe que son avenir. Bien que la Turquie soit au faîte de sa popularité dans la rue arabe, ce succès demeure fragile.
Toutes ces dernières années, la Turquie a conduit une politique étrangère, adroite et complexe, visant à établir des relations constructives avec l’ensemble de ses voisins. Elle était ainsi parvenue à dialoguer avec des pays parfois aux prises les uns avec les autres. Après les révolutions arabes, elle a progressivement modifié cette politique : elle a ainsi rompu ses liens avec le régime syrien, sa rivalité avec l’Iran s’est de nouveau exacerbée, ses relations avec l’Irak se sont compliquées. Alors que le processus de son adhésion à l’Union européenne patine, il lui sera plus que jamais difficile de résoudre la question chypriote. Dans le même temps, elle doit faire face sur le front intérieur à une remobilisation des Kurdes. La vague de popularité sur laquelle surfe aujourd’hui la Turquie l’abuse elle-même. Les problèmes auxquels elle va se trouver confrontée se multiplient.
M. Dominique Souchet. L’émigration des membres de la communauté copte aurait beaucoup augmenté depuis les événements de février dernier. Est-ce confirmé ? Il se dit aussi que cette communauté organise son autodéfense parce que la police ne jouerait pas son rôle. Qu’en est-il ? Enfin, que représente sur l’échiquier politique le Bloc Égyptien, sur lequel semblent s’être concentrées les voix de la communauté ?
Mme Sophie Pommier. La communauté copte est extrêmement inquiète. D’une manière générale en Égypte, les clivages communautaires s’exacerbent dans les périodes de troubles, y compris au sein d’une même religion, comme parmi les musulmans entre sunnites et chiites, a fortiori entre confessions, comme entre chrétiens et musulmans. La montée en puissance du salafisme a aussi accru les tensions. Le repli communautaire, à l’œuvre depuis plusieurs années, touche également la communauté copte. D’un côté, elle ne se sent plus protégée par l’armée, les militaires ayant par exemple réprimé dans le sang l’une de ses manifestations en octobre dernier. D’un autre côté, elle est extrêmement inquiète de la montée en puissance des islamistes. L’inquiétude, déjà vive, qu’elle avait éprouvée en 2005, lorsque les Frères musulmans avaient remporté 88 sièges au Parlement, est aujourd’hui décuplée. D’où un important mouvement d’émigration, notamment au Canada et aux États-Unis, où certains de ses membres ont déjà de la famille. Comme l’on trouve des coptes dans toutes les catégories de la population, la dégradation de la situation économique et sociale accentue bien sûr le phénomène.
Leur radicalisation, pour sa part, est antérieure à la révolution de janvier. La jeunesse copte, bien décidée à ne pas se laisser faire, s’était déjà organisée et divers mouvements plus ou moins extrémistes, confinant parfois à des milices, s’étaient constitués. Cette jeunesse se heurte d’ailleurs à la hiérarchie religieuse qui a toujours été très légaliste et faisait plutôt profil bas. Les jeunes tiennent d’ailleurs sa passivité pour partie responsable des malheurs actuels de la communauté. Ce clivage entre générations est très marqué.
Au sein du Bloc Égyptien, lequel n’est pas en lui-même un parti mais regroupe divers partis de gauche et partis libéraux, la composante qui attire le plus les coptes est le parti des Égyptiens libres, créé par l’homme d’affaires Naguib Sawiris, qui est à la tête d’un empire dans le domaine des télécommunications, et a créé ce parti, qu’il ne préside pas, dans l’objectif de fédérer l’ensemble des courants libéraux.
M. Jean-Michel Boucheron. Quels liens percevez-vous aujourd’hui entre Washington et l’armée égyptienne ? Aux débuts de la révolution, les États-Unis ont très vite laissé tomber Hosni Moubarak, convaincus que ce fusible suffirait.
Quelles relations le Hamas entretient-il avec les Frères Musulmans d’une part, avec les salafistes d’autre part ?
Mme Sophie Pommier. Vous avez raison, les États-Unis ont très vite lâché Hosni Moubarak en pensant que son départ du pouvoir suffirait à garantir la stabilité. Il est d’ailleurs intéressant de comparer les déclarations du département d’État à l’époque et aujourd’hui : en février dernier, les États-Unis demandaient que la transition démocratique se passe « dans l’ordre » et commence « maintenant », alors qu’ils souhaitent seulement aujourd’hui qu’elle ait lieu « aussi vite que possible ». Ils n’ont pas du tout la même attitude vis-à-vis de l’armée aujourd’hui que vis-à-vis de l’ancien président Moubarak. La concertation est permanente, même si, d’après les révélations de Wikileaks, ils doutent des capacités des militaires égyptiens et ne les portent pas en très haute estime, les jugeant extrêmement conservateurs et passéistes. De fait, les militaires n’ont pas apporté la preuve qu’ils étaient en mesure de tenir le pays, d’y rétablir la sécurité comme d’en gérer la situation politique. Ils naviguent plutôt à vue, comme en témoigne l’évolution de leur position à propos du Comité constituant. J’ai le sentiment que les Etats-Unis sont beaucoup plus inquiets depuis quelque temps qu’ils ne l’étaient au début des événements.
M. Peter Harling. Les Etats-Unis ont perdu beaucoup de leurs leviers d’influence dans la région. Plusieurs de leurs alliés traditionnels, comme l’Arabie saoudite, les ignorent désormais, ou en tout cas minimisent leur rôle. C’est aussi le cas des militaires égyptiens, sur lesquels les Etats-Unis reconnaissent eux-mêmes n’avoir pas beaucoup d’influence. L’armée égyptienne est loin de leur être inféodée. La rente d’un milliard de dollars qu’ils lui versent chaque année et qu’elle utilise essentiellement pour acheter des armes américaines, sert surtout leur économie en retour.
Pour ce qui est du Hamas, il n’entretient pas de liens étroits avec les islamistes égyptiens, en tout cas pour l’instant. D’une part, parce que l’ancien régime avait veillé à éviter que ces liens ne se resserrent par trop : jusqu’à présent, le Hamas fait preuve de prudence et ne veut pas provoquer l’appareil de renseignement égyptien, qui demeure puissant. D’autre part, parce que les acteurs de la scène islamiste sont très divers et qu’il y existe de profondes différences de sensibilité. Il y a loin des islamistes de l’AKP, au pouvoir en Turquie, du Hamas, d’Ennahda en Tunisie ou de ceux du Qatar, dont la sensibilité s’exprime sur Al Jazeera, aux islamistes égyptiens, qui en sont, pour beaucoup, restés à la prédication – la dawa –, d’où un certain décalage dans leur perception des événements dans la région. Il n’en reste pas moins que le Hamas voit d’un très bon œil l’émergence des islamistes partout dans la région, quelle que soit leur sensibilité, et mise sur la durée.
Les salafistes, pour leur part, demeurent méconnus, y compris des Frères musulmans, notamment parce qu’ils ont toujours jusqu’ici rejeté toute politisation. Un temps d’ajustement sera nécessaire.
Mme Sophie Pommier. Le Hamas est la branche palestinienne des Frères musulmans, d’où des liens historiques forts. Les Frères musulmans sont un mouvement beaucoup plus politique que les salafistes, novices en politique.
M. Peter Harling. Le Hamas, qui était à l’origine un mouvement de prédication, s’est transformé dans les années 80 en mouvement de résistance armée puis, ces dernières années, en véritable parti politique. Il conjugue donc les trois facettes alors que les Frères musulmans égyptiens ne sont encore qu’un mouvement de prédication.
M. Jean-Michel Ferrand. La contestation violente à laquelle on assiste ces derniers temps en Égypte est-elle organisée ? Si oui, par qui ? Ou au contraire est-elle spontanée et sans avenir ?
Y a-t-il en Égypte un leader charismatique susceptible de tirer profit du flou de la situation et de confisquer le pouvoir ?
Voyant la situation actuelle en Égypte, on ne peut s’empêcher de songer à ce qui s’est passé en Turquie. Il a suffi d’une dizaine d’années à l’AKP pour étouffer progressivement l’armée turque et l’éliminer du jeu du pouvoir, alors qu’elle était garante de la laïcité. Pour le reste, s’agissant de la Turquie, je ne suis pas aussi pessimiste que M. Harling. Sa croissance économique est en plein boom, avec un PIB en augmentation de 11 % cette année.
Mme Sophie Pommier. Il n’y a pas d’organisation derrière les événements actuels. On ne peut pas dire non plus que le mouvement est spontané, car c’est le même noyau de jeunes militants très déterminés qui l’anime depuis les tous débuts et qui ne s’est jamais démobilisé. Le mouvement est aujourd’hui plus violent car il est plus composite. Les jeunes activistes ont été rejoints par des jeunes désoeuvrés originaires des quartiers les plus défavorisés qui viennent en découdre avec les forces de l’ordre. La violence se nourrit aussi de la surenchère entre contestation et répression.
Il faut avoir présent à l’esprit qu’en Égypte, tout peut très vite, par une série d’enchaînements, prendre une ampleur considérable et devenir hors de contrôle, dans la mesure où tout a une immense portée affective. Mais le mouvement actuel me paraît, en tout cas pour l’instant, condamné car il est largement désavoué par la population.
Quant à un leader charismatique dans la classe politique égyptienne, s’il y en avait un, depuis dix mois cela se saurait ! Il manque à l’évidence dans le pays une personnalité capable de fédérer.
M. André Schneider. Madame, Monsieur, vous nous avez décrit un pays figé, où aucun véritable processus de transition n’a encore commencé, où chacun observerait l’autre et où du coup rien ne se passerait. Mais précisément puisque rien ne se passe aujourd’hui, que se passera-t-il demain ?
M. Peter Harling. 2011 aura été l’année où auront été campés les personnages de l’action. Celle-ci viendra en 2012 – je ne parle pas seulement de l’Égypte mais de la région en général. Il est certain qu’au cours de l’année prochaine s’exprimeront au grand jour tous ces conflits qui se sont au fil du temps accumulés et dont la solution a toujours été reportée. C’est vrai des questions sociales comme des clivages politiques et des conflits stratégiques, qui s’organisent autour de la place à donner respectivement à Israël et à l’Iran. En Egypte, il y a de fortes chances que se conjugueront en 2012 quantité de questions encore pendantes – place de l’armée, rôle à donner aux libéraux, axes de la politique étrangère, situation de l’économie… – et que s’ouvrira une crise beaucoup plus profonde.
M. Hervé de Charette. En Europe et en France plus particulièrement, l’opinion est extrêmement angoissée par ce qui se passe dans cette région du monde. La profonde méconnaissance du monde arabe par les populations européennes contribue à creuser un fossé grandissant entre les pays de la rive Nord et ceux de la rive Sud de la Méditerranée, ce qui risque de conduire à de graves déboires.
Existe-t-il aujourd’hui une coordination internationale entre le parti tunisien Ennahda, les Frères musulmans égyptiens et les mouvements similaires en Libye et dans d’autres pays ? Si oui, où ont lieu les réunions ? A quel niveau se tiennent-elles ? Qui y participe et de quels sujets y traite-t-on ?
M. Peter Harling. Je suis d’accord avec vous sur la dérive Nord-Sud. Je suis choqué par la très mauvaise connaissance du monde arabe par les Européens, voisins de longue date et anciennes puissances coloniales.
M. Hervé de Charette. Elle est très dangereuse sur le plan politique.
M. Peter Harling. En effet, cela sera très coûteux pour l’Europe.
Ce qui se passe aujourd’hui dans le monde arabe donne une occasion unique de mieux connaître ces sociétés, parce que tout s’y trouve mis à nu. Il faudrait relever le défi, en profiter pour mettre en place des politiques à long terme et surtout viser à la cohérence. Or, les États-Unis par exemple, convaincus que les processus de transition démocratiques rapprochent à terme ces sociétés de leurs propres valeurs, entendent surfer sur cette vague démocratique et en tirer profit, sans pour autant revoir, de quelque façon que ce soit, leurs relations avec Israël. Comment serait-ce possible ? La plupart des acteurs sont ainsi prisonniers de leurs contradictions et ont du mal à intégrer la nouvelle donne.
Pour ce qui est de votre seconde question, oui, il existe un réseau d’acteurs islamistes qui se rencontrent et échangent au niveau international. Les islamistes, qui dans la région se voyaient par le passé comme une alternative radicale aux pouvoirs en place, se conçoivent aujourd’hui davantage comme un acteur parmi d’autres dans un processus dont il leur faut comprendre les mécanismes. Ils devraient être encouragés dans cette voie. Or, en Égypte, ce qui n’est pas sans inquiéter, l’armée fait tout pour limiter les effets de leurs résultats électoraux, alors que tout l’enjeu est de les intégrer dans un cadre institutionnel et politique capable de survivre à leur éventuelle volonté de subversion. Se met, hélas, en place en Égypte un système politique à la légitimité assez faible, que les islamistes pourront d’autant plus facilement remettre en cause, de l’intérieur comme de l’extérieur, pour peu qu’ils le souhaitent.
M. Robert Lecou. Notre impatience à l’égard des pays arabes si peu de temps après le début des révolutions est quelque peu indécente. Acceptons de leur donner un peu de temps. A vous entendre, madame, monsieur, on peut être optimiste. Mais il faut que nous changions notre perception de ces pays.
En Égypte, les tensions perdurent, le risque d’explosion est grand avec la pauvreté, le « stress économique » comme vous l’avez dit, qui sévissent dans le pays. Mais qui tient l’économie ? Est-elle concentrée ou éclatée ? Quel est le poids respectif des autres secteurs que le tourisme – agriculture, industrie, services ?
Mme Sophie Pommier. L’économie égyptienne est une économie de rente reposant sur cinq piliers : le tourisme, les hydrocarbures, essentiellement le gaz, les revenus du canal de Suez, les devises des expatriés et l’aide américaine. Elle a beaucoup de mal à se doter d’un véritable secteur manufacturier et à se diversifier. Ce problème demeure. S’y ajoutent aujourd’hui la chute des investissements et l’instabilité politique.
L’armée est un important prédateur économique, même si les contours de son empire économique, ne serait-ce que son patrimoine foncier, restent mal connus. Une certaine libéralisation économique avait été enclenchée dans les années 90, qui s’était accélérée à partir de 2004. Un gouvernement de réformateurs, composé de proches de Gamal Moubarak, avait alors réussi à restructurer l’économie et obtenu des résultats assez encourageants sur le plan macro-économique. Le taux de croissance avait ainsi atteint 7,3 % en 2008. Mais le problème de la redistribution n’avait en rien été résolu. La population n’avait ressenti aucun effet bénéfique de la croissance dans sa vie quotidienne et les produits de première nécessité lui demeuraient inabordables du fait d’une très forte inflation. La richesse nouvellement produite restait largement captée par un petit nombre. Aujourd’hui, on est dans le flou total, l’économie étant bloquée.
M. Jacques Myard. Il nous faut absolument investir dans le monde arabe sur le plan intellectuel. C’est l’arabe, et non l’anglais, qui devrait être aujourd’hui la première langue enseignée en France !
Pour ce qui est de l’Égypte, la croissance démographique, avec 1,2 million d’habitants supplémentaires par an, y obère toute possibilité de décollage économique.
Pour le reste, l’armée n’y est pas monolithique. En osmose avec la société, elle en est le reflet dans toute sa diversité. N’est-elle donc pas elle aussi sensible à son « islamisation » ?
M. Peter Harling. Un mot sur le tourisme. Alors que l’on voit poindre un groupe parlementaire salafiste, on n’a pas encore assisté à l’émergence d’un lobby touristique qui pèse pourtant à peu près autant dans l’économie que les salafistes au Parlement. Leurs intérêts respectifs sont pourtant radicalement contraires.
Les caractéristiques socio-économiques des militaires sont très semblables à celles des Frères musulmans et leurs bases sont très semblables, majoritairement provinciales et conservatrices. L’armée a néanmoins toujours cherché à s’en démarquer. Aucun membre d’une famille qui a choisi la voie militaire ne fera jamais partie des Frères musulmans. Ceux-ci comprennent une élite économique, qui possède beaucoup d’intérêts, toutefois assez distincts de ceux de l’armée, qui est attachée à un modèle de redistribution étatique et centralisé remontant à Nasser. Les Frères musulmans, conservateurs sur le plan social, sont beaucoup plus libéraux sur le plan économique.
L’armée est arrivée au pouvoir avec un capital politique considérable, qu’elle est en train de dépenser inconsidérément. Pour continuer de bénéficier du soutien des masses, l’armée doit assurer une transition pacifique débouchant sur un système démocratique. Je ne crois pas que la société égyptienne la soutiendra si cette transition échoue ou si une dérive autoritaire se produit.
M. Serge Janquin. Notre collègue Hervé de Charette a raison, l’opinion publique européenne, et plus généralement occidentale, s’éloigne dangereusement de celle des pays arabes. J’ai été surpris que M. Harling relativise à ce point la question du conflit israélo-palestinien, beaucoup plus importante dans la vie égyptienne qu’il ne le dit. Certes, on en parle peu en Égypte, c’est même le non-dit de la vie politique du pays. Au-delà de la retenue apprise des expériences nassériennes, la fracture entre les générations est considérable au sein des familles sur ce sujet. J’ai rencontré de jeunes Égyptiens de tous milieux prêts à se ceindre d’explosifs pour la Palestine si on le leur demandait. S’il y a un sujet sur lequel peuvent se rejoindre la jeunesse révoltée de la place Tahrir et les mouvements islamistes, c’est bien celui-là. La situation pourrait alors devenir très critique. Qu’en pensez-vous ?
M. Peter Harling. Vous connaissez mieux la société égyptienne que moi. Pour bien connaître la société syrienne, je trouve saisissant le contraste entre la Syrie et l’Égypte. La société syrienne est profondément anti-américaine et méfiante, si ce n’est hostile, à l’égard d’Israël. En Égypte, au contraire, m’a par exemple frappé ces dernières années une grande indifférence au sort de la bande de Gaza, bien que l’Égypte ait participé, avec Israël et les Etats-Unis, à son étranglement. Le sujet était peu abordé dans le pays et n’y mobilisait presque pas. Ce qui est sûr est que, sans avancée sur le conflit israélo-palestinien, en Égypte comme dans les autres pays arabes, des réactions populaires plus vigoureuses se feront jour, surtout en période de crise, et qu’il ne sera pas possible de contenir.
Mme Sophie Pommier. Il y a une certaine ambiguïté en Égypte quant à la relation avec Israël. Ainsi l’important contrat de vente de gaz conclu en 2005 avec Israël n’a-t-il cessé de faire depuis lors l’objet d’attaques récurrentes dans la presse. Et depuis janvier dernier, le gazoduc a déjà été saboté dix fois !
Le sujet de la Palestine est aussi l’occasion de postures sur la scène politique. Les images d’Al Jazeera ont un fort impact sur l’opinion publique et la rue égyptienne, très émotive, réagit toujours vivement. Lors de l’offensive israélienne au Liban en 2006, le Hezbollah était devenu extrêmement populaire en Égypte. Mais pour l’heure, les préoccupations de politique intérieure l’emportent clairement sur les questions régionales.
M. Jean-Pierre Kucheida. Au-delà de l’armée et des partis politiques, sait-on ce que pense véritablement le peuple égyptien ?
Que penser du comportement de l’Europe depuis un an, en particulier de celui de Londres et Paris, les deux anciennes puissances qui ont par le passé joué un rôle majeur en Égypte ?
Enfin, je partage l’avis de notre collègue Serge Janquin sur la position de l’Égypte par rapport à Israël. La moindre étincelle est susceptible de provoquer une explosion majeure.
Mme Sophie Pommier. Il est difficile de connaître le sentiment véritable de la population égyptienne. Il n’y a pas dans ce pays de sondages dignes de ce nom ! Ce qui me paraît aujourd’hui préoccuper en priorité les Égyptiens est de savoir ce qu’ils vont manger, comment ils vont se soigner ou faire faire des études à leurs enfants. Leurs difficultés matérielles quotidiennes sont prioriaires. D’après le PNUD, 40 % de la population égyptienne vivraient en dessous du seuil de pauvreté.
Pour ce qui est des relations avec l’Europe, en 2009 déjà, les relations commerciales avaient été passablement affectées par la crise financière et l’Égypte avait pris la mesure de sa dépendance à l’égard de l’économie européenne. Aujourd’hui, l’Europe risque doublement de rater le coche. Sur le plan économique, avec les difficultés actuelles qui sont les nôtres, nous aurons du mal à nous impliquer financièrement dans la reconstruction, ce qui laisse place à d’autres acteurs, notamment les pays du Golfe, d’ailleurs les seuls à avoir fait des promesses sur ce point lors du dernier G 20 de Deauville. Marginalisés sur le plan économique, les Européens risquent de se trouver marginalisés aussi sur le plan politique s’ils stigmatisent les évolutions politiques en expliquant à la population qu’elle n’a pas fait le bon choix.
M. François Loncle. Y a-t-il de profondes différences entre les Frères musulmans en Égypte, en Syrie ou en Tunisie ou existe-t-il au contraire une sorte d’Internationale du mouvement ?
Enfin, que peut-on entendre dans le contexte régional par « démocratie apaisée » ?
M. Peter Harling. Il est un critère simple de démocratie : dans un pays démocratique, on accepte le résultat des élections. Que pourrait être un processus démocratique dont on voudrait contrôler les résultats ? Il faut par exemple accepter que les islamistes puissent gagner et qu’eux-mêmes acceptent de perdre un jour. Pour moi, le meilleur gage d’une démocratie réside dans la solidité du système politique mis en place.
M. François Loncle. On ne peut juger d’une démocratie au seul déroulement des consultations électorales. Ces dernières années, quantité d’élections en Afrique sub-saharienne ont donné lieu à des fraudes massives, comme encore récemment en République démocratique du Congo. Faudrait-il que ceux qui ont perdu du fait de fraudes l’acceptent ?
M. Peter Harling. Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit. Il faut accepter les résultats des élections pour autant que celles-ci se soient déroulées dans des conditions satisfaisantes. Si, cette condition étant remplie, les islamistes l’emportent, il faut l’accepter. Les dernières élections en Tunisie par exemple ont été tout à fait libres et démocratiques.
Il existe une structure pouvant s’apparenter à une Internationale des Frères musulmans, dont le poids est limité. Son leader, Mohammed Badi, ne donne pas de consignes qui seraient suivies par les différentes branches nationales.
Mme Sophie Pommier. En ce moment, chaque composante des Frères musulmans est d’abord préoccupée par les considérations nationales dans son pays.
M. le président Axel Poniatowski. Madame, Monsieur, au nom de l’ensemble de nos collègues, je vous remercie.
21.- Mardi 10 janvier 2012, séance de 17 heures, compte rendu n° 31 : audition de M. Alain Juppé, ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et européennes (ouverte à la presse)
M. le président Axel Poniatowski. Nous avons le plaisir de recevoir M. Alain Juppé, ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, pour une audition, ouverte à la presse, consacrée à l’actualité internationale.
Monsieur le ministre, permettez-moi tout d’abord de vous adresser, au nom de la Commission, nos meilleurs vœux pour une année 2012 qui s’annonce aussi dense et riche que l’année qui l’a précédée.
Cette audition sera l’occasion de procéder à un tour d’horizon des principaux sujets qui vont nous occuper dans les prochains mois et même, pour certains d’entre eux, les prochaines années.
L’Europe, tout d’abord, traverse une crise de gouvernance qui appelle des décisions majeures dans le sens d’une plus grande convergence des politiques économiques et budgétaires.
Nous sommes également à quelques jours du premier anniversaire de la chute de Ben Ali qui a marqué le début de ce que l’on a appelé le « printemps arabe ». Depuis, le monde arabe est entré dans une phase de mutation qui se révèle complexe et, dans certains cas, violente.
Les évènements dramatiques qui frappent le Nigeria et les récentes élections en République démocratique du Congo indiquent que la situation du continent africain demeurera encore cette année au cœur de nos préoccupations.
Plus ponctuellement, les relations, déjà tendues, entre l’Iran et les pays occidentaux se sont à nouveau détériorées.
Nous sommes également intéressés par les conséquences sur les relations franco-turques du vote par l’Assemblée nationale de la proposition de la loi visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi.
M. Alain Juppé, ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes. Mesdames et messieurs les députés, je vous présente à mon tour mes vœux les plus chaleureux pour vous-mêmes et tous ceux qui vous sont chers.
Je vous remercie de me donner l’occasion d’avoir de nouveau avec vous un échange qui sera comme toujours libre, franc et constructif.
Quelles seront les grandes priorités de la diplomatie française en 2012 ?
Première priorité : l’adoption rapide des nouveaux traités européens. Nous plaidons tout d’abord pour l’adoption à « Dix-sept plus », peut-être à Vingt-six du projet de traité sur l’union économique renforcée. Celui-ci complétera la panoplie des outils de gouvernance économique, de solidarité et de responsabilité budgétaire mis en place depuis le plan d’aide à la Grèce. Nous devons tout faire pour que l’Europe surmonte la crise de la dette. Notre objectif est que ce traité soit finalisé en vue du Conseil européen du 30 janvier. Nous le souhaitons équilibré autour de trois volets essentiels.
Tout d’abord, la mise en place d’un véritable gouvernement économique de la zone euro, lequel fait défaut depuis la création de l’euro. Cela signifie des sommets réguliers de la zone – lors du sommet européen du 9 décembre dernier, Mme Merkel était allée jusqu’à envisager des sommets mensuels au pic de la crise –, et une présidence stable de la zone.
Ensuite, une convergence accrue des politiques en faveur de la croissance. Nous ne sortirons en effet de la crise de la dette par une bonne maîtrise des déficits que si nous retrouvons le chemin d’une croissance soutenue, ce qui implique la mobilisation des fonds européens, des coopérations renforcées et une harmonisation fiscale.
Enfin dernier volet, sans doute le plus connu : la règle d’or d’équilibre budgétaire à inscrire dans les lois fondamentales des États, avec un contrôle de sa transposition par la Cour de justice européenne, et l’application de sanctions financières en cas de dépassement des critères de déficit budgétaire – sauf si une majorité qualifiée s’y oppose au Conseil des ministres.
Nous souhaitons également achever au plus vite la révision du traité sur le mécanisme européen de stabilité financière (MESF), celui-ci devant, conformément aux décisions prises le 9 décembre, remplacer le 1er juillet prochain le Fonds européen de stabilité financière (FESF). Ce mécanisme, permanent, préfigurera un véritable fonds monétaire européen, pouvant agir comme pare-feu pour l’ensemble de la zone euro. Il sera doté de 500 milliards d’euros de capacités effectives de prêts. L’Allemagne lui apportera sa garantie à hauteur de 27 %, la France de 20 %. Notre objectif est que ce traité puisse être signé en marge de la réunion du Conseil Ecofin du 24 janvier. Enfin, le Président Sarkozy et la Chancelière Merkel ont discuté hier d’une contribution franco-allemande en vue du Conseil européen du 30 janvier, dans laquelle nous proposerons des mesures concrètes en faveur de la croissance et de l’emploi.
Deuxième priorité de notre diplomatie en 2012 : soutenir les transitions démocratiques dans le monde arabe. L’urgence absolue est la Syrie, où le régime reste sourd aux appels de la communauté internationale et continue de perpétrer de véritables crimes contre l’humanité. Face à cette situation, nous ne nous résignons pas au silence du Conseil de sécurité des Nations unies. Certes, la Russie bloque toujours nos initiatives mais nous continuons à œuvrer avec nos partenaires en vue de lever ce blocage. Nous maintenons également nos contacts avec les différentes composantes de l’opposition syrienne, pour l’aider à se structurer et à préparer l’avenir. Nous soutenons également l’initiative de la Ligue arabe, y compris la décision qu’elle a prise dimanche dernier de reporter les conclusions finales de sa mission d’observation au 19 janvier. Ce report est certes frustrant car dix jours en Syrie, même en présence d’observateurs étrangers sur le terrain, ce sont des dizaines de morts supplémentaires, puisque la répression comme les actes de violence perdurent. Malgré nos doutes sur cette mission qui n’a pas fait cesser la répression, nous continuons de soutenir les efforts de la Ligue arabe. Mais nous l’avons clairement dit : le 19 janvier est le dernier délai. A cette échéance, la Ligue doit être en mesure de dire clairement si et comment le régime syrien respecte les quatre engagements qu’il a pris lors de la signature de l’accord qu’elle lui a proposé : l’arrêt des violences, la libération des prisonniers, le retrait de l’armée des villes et l’ouverture du territoire syrien aux observateurs et médias internationaux. Aucun de ces engagements n’a pour l’instant été tenu. Si les conclusions du rapport de la mission d’observation sont négatives, nous souhaitons qu’elle en rende compte au Conseil de sécurité.
Nous continuerons d’apporter notre soutien aux pays dans lesquels la transition est désormais bien engagée : la Tunisie, le Maroc, l’Égypte où des élections libres se sont tenues pour la première fois. Je n’ignore pas que le résultat de ces élections suscite des interrogations. Beaucoup redoutent que les valeurs au nom desquelles les peuples se sont soulevés ne soient pas au fondement des futurs régimes. Mais, comme je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, nous ne pouvons pas refuser à des citoyens dont la voix a été si longtemps étouffée le droit d’exprimer leur choix. Nous ne pouvons pas davantage accepter l’idée selon laquelle les peuples arabes seraient condamnés à n’avoir le choix qu’entre dictature et fondamentalisme ou qu’islam et démocratie seraient incompatibles. Gardons-nous des procès d’intention et laissons aux nouveaux gouvernements le temps de faire leurs preuves. Ils ont été élus pour donner corps aux aspirations des peuples à la liberté, à la démocratie, au respect des droits de l’homme et de la femme. S’ils s’éloignent de ce chemin, la France leur rappellera cette exigence.
Lors de mon déplacement la semaine dernière en Tunisie, j’ai pu constater qu’il y avait de bonnes raisons d’espérer. Les déclarations du leader d’Ennahda qui a condamné les déclarations anti-israéliennes faites la semaine dernière à Tunis à l’occasion du voyage de M. Haniyeh, responsable du Hamas à Gaza, paraissent également de bon augure. Cela étant, la situation est compliquée, et en dépit des assurances données par les responsables d’Ennahda, il subsiste de la méfiance de part et d’autre. Lors de ma visite, j’ai rencontré des représentants de l’opposition et de plusieurs membres d’associations, notamment de femmes. J’ai ainsi participé à un dîner auquel avaient été conviées cinq femmes. Tandis que l’une d’entre elles, vice-présidente de l’assemblée constituante, membre d’Ennahda, possédant la double nationalité française et tunisienne, élue en France, plaidait la cause de son parti, on percevait chez les autres, actrices de la société civile, dont une chef de service au CHU de Tunis, et responsables d’associations, une méfiance certaine.
La situation en Égypte est encore plus compliquée avec la percée, inattendue, des salafistes.
Les enjeux sont également économiques et sociaux. Nous devons aider les pays arabes à améliorer l’accès des jeunes à l’éducation et à l’emploi, qui constitue la meilleure garantie d’un enracinement durable de la démocratie et la meilleure protection contre les extrémismes. Nous pourrons nous appuyer sur les relations privilégiées que nous entretenons avec tous ces pays. Je pense à la Libye, où je me suis rendu en décembre dernier, à la Tunisie où j’ai partout reçu un excellent accueil. Le président Marzouki m’a redit à quel point la relation entre la France et la Tunisie était pour lui « indéchirable » – c’est le terme qu’il a lui-même employé. Si certaines de ses déclarations avaient pu susciter des inquiétudes, il y a là une affirmation sans ambiguïté. Le Premier ministre tunisien, ainsi que le président de l’Assemblée nationale, se sont exprimés dans le même sens.
Pour cet accompagnement économique et social, nous pourrons nous appuyer sur le partenariat de Deauville, désormais pleinement opérationnel. Nous avons déjà dans ce cadre, en lien avec les organisations de la société civile, identifié de nombreux projets à soutenir. Il me faut toutefois dire que si nous sommes disposés à aider ces pays, encore faut-il qu’ils s’aident eux-mêmes. L’argent est là, le processus est en place – je me suis employé à le débloquer à Koweït en novembre dernier avant de passer le flambeau du G 20 aux Etats-Unis. Mais on a, en Égypte notamment, beaucoup de mal à obtenir des propositions concrètes d’actions. Ce n’est pas le cas en Tunisie.
Nous devons tout faire également, parce que c’est la condition sine qua non d’une paix durable dans le monde arabe, pour que reprennent les négociations entre Israéliens et Palestiniens et que le processus de paix soit relancé. La France ne ménage aucun effort en ce sens. Voyons dans la récente rencontre à Amman entre représentants palestiniens et israéliens l’augure d’un dégel de la négociation.
La troisième priorité de notre diplomatie en 2012 sera le développement de la paix et de la démocratie en Afrique. Je pense tout d’abord à la République démocratique du Congo où les élections présidentielle et législatives se sont tenues le 28 novembre dernier. La commission électorale a proclamé la victoire du président sortant, M. Kabila. Les missions d’observation électorale de l’Union africaine comme de l’Organisation internationale de la francophonie ont fait état de graves irrégularités. Nous les avons vivement déplorées. Nous demandons que la compilation des résultats des législatives et leur publication s’opèrent dans la plus grande transparence et appelons à ce que, sans attendre ces résultats, les autorités en place et l’opposition travaillent ensemble dans un esprit de dialogue démocratique. Nous craignions de violents affrontements. Ils ont pour l’instant été évités. En étroite concertation avec les organisations africaines, la France continue d’appuyer toutes les initiatives pouvant favoriser le dialogue.
Au Sénégal, l’élection présidentielle se tiendra dans deux mois. Il y a certes dans ce pays une tradition démocratique fortement ancrée mais la tension actuellement perceptible nous préoccupe. Nous sommes attachés au plein respect du processus démocratique. Je tiens à redire que la France n’a aucun candidat et n’a pas à se prononcer sur la validité de telle ou telle candidature. Comme dans toute démocratie, le passage de témoin entre générations devra bien avoir lieu un jour.
Au Soudan, de grandes avancées ont eu lieu en 2011, avec la proclamation de l’indépendance du Sud-Soudan et l’accord de paix de Doha pour le Darfour. La situation n’en demeure pas moins très fragile, sinon explosive. Le conflit entre le Nord et le Sud a repris et s’aggrave. Nous invitons toutes les parties au dialogue et maintenons le contact avec tous les acteurs. Nous sommes prêts à coopérer avec le Nord sur la dette et avec le Sud pour l’aider à se développer. Encore faut-il que chacun nous donne des signes de bonne volonté.
En Somalie enfin, la Mission des Nations unies (MISSOM) effectue un travail remarquable. Je salue l’engagement de l’Ouganda, du Burundi ou encore de Djibouti, dont nous avons contribué à former les troupes qui participent désormais à cette Mission. Nous sommes convaincus que l’intervention du Kenya peut aider à lutter contre l’influence des milices Chebab. C’est d’ailleurs pourquoi, après que le Premier ministre kenyan nous a expliqué la démarche de son pays lors de sa visite à Paris, nous avons, à deux reprises, appuyé cette intervention. Nous sommes également convaincus que les efforts militaires permettront de créer un contexte plus favorable au processus politique. Nous souhaitons que toutes les parties somaliennes, y compris les régions, soient associées. Tout doit être fait pour aider le gouvernement fédéral de transition.
La quatrième priorité de notre diplomatie sera de répondre aux grands défis de la sécurité dans le monde. Je commencerai sur ce sujet par la situation en Iran. Les autorités iraniennes mettent en danger la stabilité du monde en développant un programme nucléaire, à la finalité militaire chaque jour plus manifeste. Pour du nucléaire civil, point n’est besoin d’enrichir de l’uranium à 20 % ! Outre le risque patent d’escalade, l’Iran multiplie les provocations, depuis le sac de l’ambassade britannique à Téhéran jusqu’aux menaces proférées concernant la circulation des navires dans le Golfe.
Notre message est clair : nous ne tolérerons pas la poursuite du développement de capacités nucléaires, en violation des résolutions du Conseil de sécurité. Nous veillerons au strict respect du droit international, en particulier de la liberté de navigation dans les eaux internationales et le détroit d’Ormuz. Je continue à croire à une solution diplomatique. Le dialogue reste ouvert, sur la base de la lettre que Mme Ashton a adressée au gouvernement iranien, mais des sanctions fortes seront appliquées si l’Iran contrevient aux exigences posées par le Conseil de sécurité. Après le dernier rapport de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et la nouvelle provocation que constitue la mise en service du site enterré de Fourdou, nous devons faire preuve de toute la détermination nécessaire, ne serait-ce que pour prévenir l’option militaire, dont les conséquences ne pourraient qu’être cataclysmiques. C’est le sens des propositions faites par le président de la République à nos partenaires américains et européens. Le 23 janvier, le Conseil européen Affaires étrangères sera en mesure de prendre des mesures très fermes. Les discussions sont en bonne voie. Nous avons proposé un embargo sur les achats de brut iranien, qui a fait l’objet d’un assez large accord parmi les Vingt-sept, à l’exception de la Grèce et de l’Italie, qui s’approvisionnent en pétrole en Iran. Nous leur faisons actuellement valoir qu’il existe d’autres sources d’approvisionnement. Le second volet des sanctions consisterait en un gel des avoirs de la banque centrale iranienne. Il suscite certaines réticences de la part de pays qui font beaucoup d’affaires avec l’Iran : nous travaillons à les lever. Les États-Unis, pour leur part, viennent, sous la pression du Congrès, d’adopter de fermes sanctions, de même inspiration.
Autre dossier majeur pour la sécurité et la stabilité dans le monde : l’Afghanistan. Nous poursuivons à la fois le retrait de nos troupes selon le calendrier fixé et participons à la stabilisation du pays dans le cadre d’une stratégie concertée avec l’ensemble de nos partenaires. La stabilité de ce pays repose sur trois piliers.
Tout d’abord, la maîtrise de leur souveraineté par les Afghans eux-mêmes avec le transfert progressif de la responsabilité de la sécurité aux forces afghanes. Cette stratégie donne des résultats. Les zones d’ores et déjà transférées représentent près de la moitié de la population afghane. L’un des deux secteurs dont nous avons la charge, le district de Surobi, en fait partie. Je tiens ici à rendre hommage au courage et au professionnalisme de nos forces présentes sur le terrain. Je salue la mémoire des deux légionnaires tombés au combat le 29 décembre dans la vallée de Tagab.
Ensuite, la communauté internationale devra se mobiliser aux côtés de l’Afghanistan bien au-delà de 2014. Lors de la conférence qui s’est tenue à Bonn le 5 décembre dernier, un engagement a été réaffirmé en ce sens. La France montre la voie avec le traité d’amitié et de coopération que le Président de la République avait évoqué lors de son déplacement à Kaboul il y a quelques mois et qui vient d’être proposé aux Afghans. Nous avons travaillé d’arrache-pied à ce texte. Celui-ci pourra, je l’espère, être signé le 27 janvier, à l’occasion de la visite à Paris du président Karzaï. C’est un traité de long terme sur vingt ans, qui comporte un programme opérationnel pour une première période de cinq ans, avec des objectifs ciblés en matière de santé, d’éducation, d’infrastructures et un effort financier important de la part de notre pays. Nous veillerons à ce que les Nations unies restent impliqués par l’intermédiaire de leur Mission d’assistance dans le pays (MANUA), notamment pour le renforcement de l’État de droit, la mise en place d’une gouvernance démocratique et l’appui au processus de réconciliation.
Troisième pilier de notre stratégie pour l’Afghanistan : une solution politique inter-afghane la plus inclusive possible, que nous soutenons au travers d’une paix durable et équitable. L’annonce de la création d’un bureau des Talibans à l’étranger, probablement au Qatar, est de ce point de vue une étape positive. Le succès de ce processus passe aussi par une coopération régionale pour la sécurité et la stabilité de l’Afghanistan. La France a fortement soutenu cette idée, qui a été validée lors de la conférence d’Istanbul. Espérons que ce soit là l’assise d’une sécurité collective dans la région, en associant les pays voisins.
En matière de sécurité, nous redoublons également d’efforts pour faire progresser la politique européenne de sécurité et de défense commune (PESD). En dépit des difficultés et bien que nous ayons mesuré les limites de cette politique en 2011 au moment de l’intervention en Libye, je n’ai pas renoncé. Lors du Conseil Affaires étrangères du 1er décembre, nous sommes parvenus à débloquer la situation et à nous doter d’une feuille de route qui prévoit notamment le lancement de nouvelles opérations au Sahel et en Libye, le développement de projets capacitaires en mutualisant les moyens, notamment avec l’Agence européenne de défense, le renforcement des structures européennes d’anticipation et de gestion des crises. Le blocage qui existait avec nos partenaires britanniques a pu être levé. Comme ils ne voulaient pas entendre parler d’un quartier général européen, une solution de transition a été trouvée consistant à réactiver le centre d’opérations existant. Nous pouvons désormais avancer dans deux directions. D’un côté, des opérations sur le terrain, au Sahel avec le renforcement des capacités régionales de lutte contre Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI), et dans la Corne de l’Afrique, avec celui des capacités maritimes régionales de lutte contre la piraterie ; d’un autre côté, des projets concrets de mutualisation des moyens avec l’Agence européenne de défense.
La cinquième priorité de notre diplomatie, elle de plus long terme, consiste à poser les fondements d’un mode de développement soutenable, respectueux de l’environnement. Ce sera l’enjeu de la conférence Rio + 20 qui marquera le vingtième anniversaire de la Conférence de Rio et qu’avec Nathalie Kosciusko-Morizet, nous préparons activement. Nous nous sommes fixé trois objectifs.
Le premier est la création d’une Organisation mondiale de l’environnement : la France porte ce projet depuis la conférence Citoyens de la terre organisée en février 2007 par le président Chirac. La gouvernance de l’environnement n’est, hélas, en effet toujours pas à la hauteur des défis. Nous avons besoin d’une organisation mondiale spécialisée, s’appuyant sur le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE). Basée comme celui-ci à Nairobi, ce qui rassurerait nos partenaires africains, celle-ci aurait pour tâche de piloter la politique environnementale mondiale, de renforcer les liens entre scientifiques et décideurs, comme cela a été fait pour le climat, de faciliter la mobilisation des ressources et les transferts de technologies au profit des pays les plus vulnérables et les plus pauvres. Elle répondrait aux attentes des pays développés comme des pays en développement car, intégrant mieux la dimension environnementale dans l’approche économique, elle permettrait de lutter à la fois contre le dumping et contre le protectionnisme verts. De nombreux États soutiennent aujourd’hui ce projet de création – l’Union européenne en a même fait une priorité. L’honnêteté exige de dire que d’autres, hostiles à toute idée d’organisation environnementale internationale, le combattent. Nous continuons à travailler et organisons, avec Nathalie Kosciusko-Morizet, le 31 janvier à Paris, une conférence visant à mobiliser la société civile autour de ce projet.
Deuxième ambition pour Rio + 20 : la promotion d’une économie plus sobre en carbone et en ressources naturelles. C’est une nécessité car ces ressources ne sont pas inépuisables. C’est aussi une chance car l’économie verte constitue un gisement de croissance pour nos économies et une clé de compétitivité future pour nos entreprises.
Dernière ambition pour Rio + 20 : l’énoncé d’objectifs du développement durable, prolongeant les Objectifs du millénaire pour le développement, adoptés en 2005 pour l’horizon 2015. Nous souhaiterions que ces objectifs, comme ceux du millénaire, deviennent une référence et un aiguillon pour la communauté internationale.
M. le président Axel Poniatowski. Nous en venons aux questions.
M. Jean-Jacques Guillet. S’agissant des sanctions à l’encontre de l’Iran, le Conseil européen doit maintenant prendre rapidement des décisions. Deux types de sanctions sont envisageables, vous l’avez dit. Tout d’abord, le gel des avoirs de la banque centrale iranienne à l’étranger. Le Royaume-Uni s’est déjà engagé dans cette voie et il est probable que cette paralysie des flux financiers sera efficace. Je suis en revanche plus sceptique quant à l’embargo sur le brut iranien. Je me demande même s’il ne contribuerait pas à renforcer le régime. En effet, entraînant une hausse des prix du pétrole, il pourrait enrichir l’Iran, dont le budget est aujourd’hui fondé sur une hypothèse de prix de seulement 80 dollars le baril. En effet, en dépit de cet embargo, l’Iran trouvera toujours des débouchés pour son pétrole en Chine, en Corée du Sud, en Inde et en Indonésie.
[…]
M. le ministre d’État. Est-il efficace de prendre des sanctions commerciales ou financières à l’encontre de certains pays ? On peut en discuter à l’envi. Le problème est qu’il n’existe pas une infinité de solutions. Si on écarte l’option militaire, dont vous savez ce que je pense, il faut bien recourir à des sanctions, les plus fermes possible. Certaines ont déjà été prises à l’encontre de l’Iran par certaines entreprises ou personnalités. Il nous est apparu qu’il fallait aller plus loin, tout d’abord en gelant les avoirs de la banque centrale. Les Etats-Unis ont pris une décision en ce sens, de portée de surcroît extraterritoriale : tous les organismes, fût-ce à l’extérieur des Etats-Unis, utilisant les circuits financiers passant par la banque centrale seront touchés, ce qui peut être extrêmement pénalisant pour l’Iran.
Sur les exportations de brut, je ne partage pas votre pessimisme. D’une part, d’autres pays producteurs sont disposés à augmenter leur production pour éviter une hausse des prix. Nous avons déjà pris des contacts. Les pays concernés souhaitent la discrétion mais se tiennent prêts. Nous intervenons également auprès de certains clients de l’Iran comme la Corée ou le Japon pour les dissuader d’augmenter leurs importations en provenance de ce pays. Les recettes retirées des exportations de produits pétroliers représentent de 17 à 20 % du budget iranien : un embargo peut donc faire très mal au pays.
[…]
M. Hervé de Charette. […]
Ma question porte sur la Turquie. Dans cette zone du monde – je relève que vous n’avez pas parlé non plus de l’Union pour la Méditerranée –, la Turquie joue un rôle très important, surtout en cette période de confrontation avec l’Iran et de graves problèmes en Syrie. Vous aviez cherché à développer nos relations avec la Turquie et des résultats prometteurs avaient déjà été obtenus. Puis la proposition de loi que nous savons est arrivée « comme un cheveu sur la soupe », si je puis m’exprimer ainsi. Quelque intérêt que puisse présenter ce sujet du point de vue historique, l’adoption de ce texte a, dans les circonstances présentes, profondément perturbé notre politique étrangère dans la région. Qu’en pensez-vous, monsieur le ministre d’État, et pouvez-vous nous dire où on en est exactement ?
M. le ministre d’État. Ce qu’avait un jour dit Jean-Pierre Chevènement : « Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça s’en va. » me revient souvent à l’esprit ces temps-ci… Je n’en dirai pas davantage sur le cas particulier.
Chacun connaît le point de vue qui était le mien sur le sujet que vous évoquez. C’était celui du ministre des affaires étrangères. Je pense avoir été dans mon rôle en signalant les inconvénients – le mot est faible – qu’une telle initiative parlementaire risquait de provoquer. Il faut souligner qu’une proposition de loi ayant le même objet était en préparation au Sénat, émanant d’un autre groupe politique que celui qui l’a présentée à l’Assemblée nationale. Je n’y reviens pas. Reste à gérer les conséquences de ce vote, et c’est loin d’être terminé puisque le texte va être prochainement examiné au Sénat. Nos amis turcs ont réagi comme on pouvait s’y attendre. Bien que je les aie invités à ne pas « surréagir », ils n’ont pu s’en garder. Nos diplomates tentent maintenant de raccommoder les choses. Mon déplacement il y a quelques mois en Turquie avait été extrêmement positif. Nous avons beaucoup d’intérêts communs avec ce pays. Nos échanges commerciaux avoisinent déjà 12 ou 13 milliards d’euros – pour un objectif de 15 milliards. Beaucoup d’entreprises françaises sont présentes dans le pays et il y a beaucoup d’opportunités à y saisir dans le domaine des services, industriel mais aussi agricole – nous exportons beaucoup de viande ovine et bovine en Turquie. La coopération culturelle entre nos deux pays est également importante. Il existe une tradition d’enseignement francophone séculaire en Turquie et le lycée de Galatasaray, établi en 1868, a formé de nombreuses générations de responsables turcs. L’université Galatasaray, où l’on enseigne également en français, a, quant à elle, été créée par un traité international, signé en 1993 sous la présidence de François Mitterrand, et à l’élaboration duquel j’avais moi-même participé. Et j’ai succédé à Raymond Barre à la présidence du Haut comité de parrainage de cette université francophone, aujourd’hui l’une des universités turques les plus prisées par les étudiants du pays.
Nous allons donc tout faire pour que nos relations avec la Turquie s’apaisent. Je vous indique que, comme l’avait suggéré la France en novembre dernier et comme la Turquie vient de l’accepter, le ministre turc des affaires étrangères, M. Davutoglu, sera présent au Conseil européen Affaires étrangères du 23 janvier.
Pour le reste, monsieur de Charette, si je n’ai pas évoqué l’Union pour la Méditerranée (UpM), c’est tout simplement qu’on ne peut traiter de tout dans un propos introductif. Mais nous n’avons en rien renoncé à ce projet. J’en ai encore parlé il y a quelques jours en Tunisie. Les Tunisiens sont très partants. Une difficulté ponctuelle tient à ce que le secrétaire général de l’UpM, en poste depuis un an, M. Youssef Amrani, vient d’entrer au gouvernement marocain, ce dont on se réjouit pour lui et pour nos relations avec le Maroc. Mais il faut lui trouver un successeur.
[…]
M. François Loncle. […] Enfin, traitant des révolutions arabes, vous avez passé sous silence la Libye. Or, le désordre dans ce pays demeure considérable. Le pillage des armes et leur dispersion ont fait qu’il existe désormais au Sahel de véritables arsenaux à ciel ouvert et que les trafics d’armes y ont quintuplé depuis les actions militaires en Libye. Quel est votre sentiment sur cette situation extrêmement préoccupante ?
[…]
M. Jacques Myard. […] On a cru à l’Europe, vous-même y croyez encore. C’est pourquoi vous en parlez, mais votre exposé lui-même en atteste, et vous avez raison, le regard se porte désormais davantage sur la rive Sud de la Méditerranée avec la Syrie, la Turquie, le continent africain où le Nigeria est au bord de la guerre civile – ce n’est d’ailleurs, hélas, pas nouveau : les massacres y étaient déjà courants il y a dix ou vingt ans, je le sais pour y avoir été en poste. Dans ce contexte, ne faudrait-il pas dresser un bilan lucide de ces évolutions et réorienter nos efforts pour les faire porter au Sud et laisser l’Europe à ce à quoi elle est aujourd’hui réduite, à savoir un marché commun, sinon unique ?
M. Jean-Michel Boucheron. Je n’aurai pas la cruauté, monsieur le ministre d’État, de m’étendre sur le dossier turc, si ce n’est pour dire que je m’honore de faire partie des députés, de gauche comme de droite, ayant voté contre la proposition de loi que l’on sait, aux motivations démagogiques et aux fondements absurdes.
Ma question porte sur l’Iran. Je suis convaincu que ce pays veut la bombe atomique et qu’il l’aura. Mais je suis également convaincu qu’il ne fera pas d’expérimentation nucléaire et que la zone ne sera pas déstabilisée. Imaginons que nos services secrets vous apportent demain la preuve que l’Iran dispose de tous les éléments de l’arme nucléaire. Et cela arrivera tôt ou tard, c’est inéluctable. Que ferons-nous ? A mon avis, rien. Quelle est donc la logique des sanctions envisagées ? N’est-ce pas seulement un suivisme de l’administration américaine à la veille d’élections ? Ces sanctions ne peuvent aboutir à rien et je ne comprends vraiment pas ce que fait notre pays en cette affaire.
M. Jean-Claude Guibal. Quel rôle joue l’Arabie saoudite dans l’initiative lancée par la Ligue arabe en Syrie ? Quelle est la position de l’Algérie sur ce qui se passe actuellement dans ce pays ?
La victoire d’Ennahda en Tunisie et la poussée salafiste en Égypte lors des dernières élections marquent une entrée des partis religieux dans la vie politique de ces pays. Les conséquences pouvant en résulter dans la politique étrangère de ces États vous paraissent-elles maîtrisables ?
M. le ministre d’État. […] La situation en Libye demeure très préoccupante, j’en ai parlé en évoquant toute l’utilité du partenariat de Deauville. Mes entretiens avec le président du Conseil national de transition (CNT), M. Abdel Jalil, et avec le Premier ministre, M. Rahim al-Kib, lors de ma visite le mois dernier, m’ont en partie rassuré. Le nouveau Premier ministre mesure parfaitement les défis à relever. Nous allons continuer à aider le pays. Je vous mentirais si je prétendais que la tâche sera facile. Nous ne sous-estimons pas le problème des armes qui circulent dans l’ensemble du Sahel. La menace terroriste dans cette zone demeure une grave préoccupation. Nous nous efforçons de la contrer avec les pays riverains.
[…]
Pour le reste, parler de l’Europe n’empêche en rien de considérer qu’il est capital d’être présent au Sud de la Méditerranée, ce que nous faisons d’ailleurs avec l’Union pour la Méditerranée, le partenariat de Deauville qui est lui aussi une initiative française, et nos politiques bilatérales.
Monsieur Boucheron, je ne reviens pas sur la Turquie. Pour ce qui est de l’Iran, je ne comprends pas bien votre position. Faudrait-il ne rien dire et laisser faire ? Ne devrions-nous rien tenter pour dissuader ce pays de fabriquer une bombe atomique ?
M. Jean-Michel Boucheron. Nous ne le pourrons pas.
M. le ministre d’État. Je peux comprendre votre scepticisme, d’ailleurs partagé par d’autres. Peut-être avez-vous même raison. Mais, pour ma part, je souhaite que l’on tente tout pour empêcher l’Iran de fabriquer la bombe atomique car la contagion serait catastrophique. La Turquie voudrait alors s’en doter également, et cette prolifération serait extrêmement dangereuse non seulement pour la région mais pour l’équilibre même du monde.
Monsieur Guibal, l’une des difficultés que rencontre la Ligue arabe pour agir, notamment en Syrie, tient à ce qu’elle ne constitue pas – pas plus que l’Europe des Vingt-sept ! – un ensemble homogène. Si l’Arabie saoudite est plutôt motrice dans l’initiative lancée pour placer le régime syrien au pied du mur, l’Algérie a une attitude plus mouvante.
Pour ce qui est de la place de la religion dans l’espace politique, je ne vous cache pas qu’il est difficile dans tous ces pays, où l’islam est religion officielle, de faire comprendre ce que nous entendons en France par laïcité. Ils ne comprennent pas la séparation étanche que nous opérons entre champ politique et champ religieux et font d’ailleurs valoir que certains pays européens en ont aussi une – la reine d’Angleterre n’est-elle pas le chef de l’église anglicane ? La conception française de la laïcité n’est pas facilement « exportable ». Ce qui doit être absolument garanti est le respect de la liberté d’expression religieuse pour toutes les religions et le respect des minorités – je pense aux minorités chrétiennes d’Orient, à d’autres aussi. C’est là une ligne rouge à ne pas franchir.
M. Rudy Salles. Monsieur le ministre d’État, je partage totalement votre réponse à M. Myard.
L’option militaire fait-elle partie des options envisagées pour répondre à la crise iranienne ?
[…]
M. Jean-Paul Bacquet. La question que je souhaitais vous poser sur le Nigeria l’a déjà été. Je n’y reviens donc pas.
Notre Commission a reçu en décembre le ministre algérien des affaires étrangères, M. Mourad Medelci. Lorsque je lui ai, à cette occasion, demandé si des mesures étaient envisagées afin de permettre aux harkis de retourner en Algérie à l’occasion du cinquantenaire de la fin de la guerre, j’ai cru comprendre que ce n’était pas à l’ordre du jour. Dialoguez-vous avec l’Algérie à ce sujet ?
M. Jean Glavany. Je souhaite revenir sur le printemps arabe. Comme vous, monsieur le ministre d’État, je pense qu’il faut se garder de tout amalgame : le monde arabo-musulman est divers, les cultures politiques et l’implication religieuse sont très différentes selon les pays. Je pense également comme vous que nous ne pouvons accepter que ces pays soient condamnés à n’avoir le choix qu’entre dictature et intégrisme. A ceux qui s’inquiètent de la place de la religion, je rappellerai que la démocratie en Europe a émergé dans le sillage de la religion chrétienne. On ne s’est pas inquiété que des partis comme le MRP en France, Démocratie chrétienne en Italie ou encore aujourd’hui la CDU en Allemagne aient de profondes racines religieuses. On peut faire le pari, qui est le vôtre et que je juge le seul possible, que le printemps arabe permettra l’affirmation d’un islam des Lumières ou d’un islam laïc. Pour le reste, je ne pense pas que la laïcité soit une valeur purement française. Protection de cette liberté fondamentale qu’est la liberté de conscience, je la crois au contraire une valeur universelle.
Que ce soit en Tunisie, en Égypte ou en Libye, les autorités religieuses étaient toutes au fond hostiles au printemps arabe. Très inquiètes de ses conséquences potentielles, elles ont freiné des quatre fers le mouvement. Et ce n’est pas le moindre des paradoxes après l’inquiétude, voire l’hostilité alors manifestée, que ce soient aujourd’hui les partis islamiques – je préfère ce terme à « islamistes » – qui aient tiré le bénéfice de ce printemps arabe. Comment expliquez-vous ce paradoxe ?
M. le ministre d’État. Certains envisagent-ils une option militaire en Iran ? Clairement oui, on sait aujourd’hui qu’il y a débat parmi les dirigeants israéliens autour de cette solution. Nous pensons, pour notre part, qu’elle pourrait conduire à l’irréparable. C’est pourquoi nous faisons tout pour l’éviter, en suivant une double piste. D’un côté, nous restons ouverts au dialogue, de l’autre, nous sommes prêts à durcir les sanctions à l’encontre du pays, précisément pour éviter le recours à cette solution extrême.
[…]
M. Bacquet me demande si j’ai évoqué avec mon homologue algérien la possibilité d’un retour des harkis en Algérie à l’occasion de la célébration du cinquantenaire de l’indépendance du pays. Nous étions convenus l’année dernière avec le président Bouteflika que cet anniversaire devrait être célébré dans un esprit de modération, en se gardant des extrémismes de tous bords. J’espère que cette ligne continuera de prévaloir, comme l’engagement en avait été pris, et que l’on tournera le regard vers l’avenir plutôt que le passé. Cela ne signifie nullement fermer les yeux sur le drame auquel vous faites allusion. Nous évoquons des situations individuelles au cas par cas. Faut-il voir un signe positif dans le fait que Jeannette Bougrab, fille de harkis, ait été très bien accueillie lors de son récent déplacement en Algérie ?
Monsieur Glavany, qu’il n’y ait aucune ambiguïté. Je suis extrêmement attaché au principe de laïcité, dont je pense moi aussi qu’il a une valeur universelle. N’oublions pas toutefois que dans notre histoire nationale, la laïcité a d’abord été un combat contre l’Église catholique qui refusait de reconnaître la séparation du spirituel et du temporel et contestait même les fondements de la République. Les choses ont évolué. C’est aujourd’hui en tant que respect de la liberté religieuse et des minorités religieuses que le principe a valeur universelle.
S’agissant de la position des autorités religieuses vis-à-vis des révolutions en Tunisie et en Égypte, force est de constater qu’il existe toujours une certaine « connivence » entre les pouvoirs en place et certaines autorités religieuses. Le plus fervent soutien du Premier ministre turc et de l’AKP n’est-il pas le Patriarche œcuménique Bartolomeo Ier, qui joue un rôle très important ?
Enfin, et c’est par cela que je voudrais conclure, l’extrémisme n’existe pas seulement dans la religion musulmane. On observe aujourd’hui, de nouveau, des manifestations extrémistes dans la religion chrétienne et dans la religion juive. Gardons nous donc de tout amalgame et ne stigmatisons pas une religion au motif de certaines dérives fondamentalistes. Nous avons intérêt à développer un dialogue interculturel et interreligieux avec l’islam comme avec les autres religions.
Pour être très attaché à la laïcité, je n’en organise pas moins chaque année à Bordeaux une réunion informelle où se rencontrent pour débattre l’évêque, le recteur de la mosquée, le grand rabbin, le chef des protestants, la représentante des bouddhistes – le thème de la prochaine rencontre sera mondialisation et religions. Je n’ai pas, faisant cela, l’impression de trahir le principe de laïcité. Je ne privilégie aucune des grandes religions, que je respecte toutes d’égale façon. Je pense simplement que leurs représentants peuvent nous apporter un éclairage utile sur le monde actuel.
[…]
22.- Mercredi 15 février 2012, séance de 9 heures 30, compte rendu n° 40 : compte-rendu du déplacement en Egypte d’une délégation de la commission
M. Hervé Gaymard, président de la délégation. Nous avons effectué, il y a deux semaines, une mission de 48 heures en Egypte. Je tiens à remercier l’ambassadeur de France, M. Jean Félix-Paganon, ainsi que ses collaborateurs, pour leur accueil et le programme qu’ils ont organisé pour nous, qui nous a permis de rencontrer l’ensemble des forces politiques représentées à la chambre basse du Parlement, y compris les salafistes, ainsi que le grand imam de la mosquée al Azhar et des acteurs économiques et sociaux. Nous avons ainsi eu un panorama assez complet de la situation.
Ceci dit, nous devons absolument faire preuve d’humilité devant les faits : les signes « avant-coureurs » sont souvent reconnus comme tels a posteriori ! Absolument personne n’avait prévu que le régime du président Moubarak s’effondrerait aussi rapidement, tout comme l’ampleur du raz-de-marée islamiste aux élections législatives a surpris l’ensemble des observateurs. Depuis un an, nous assistons à un processus révolutionnaire, même s’il a été relativement peu sanglant, mais ce processus ne fait probablement que commencer et il est impossible de prédire comment il va se poursuivre.
Mon exposé s’organisera autour de trois pôles : l’histoire parallèle de l’Egypte et de ses mouvements islamistes, depuis deux siècles ; les caractéristiques des acteurs d’aujourd’hui ; les questions pour l’avenir.
L’Egypte moderne naît avec la campagne de Bonaparte. Mohamed Ali s’affranchit alors de la tutelle de la Porte ottomane et fonde un régime moderne. Il se lancera dans une politique de conquête qui le conduira jusqu’à l’actuelle Arabie saoudite, avant de devoir réfréner ses ambitions. Le pouvoir est ensuite dans la main de khédives, plus ou moins ouverts vis-à-vis de l’extérieur, certains étant même franchement xénophobes. Une nouvelle période s’ouvre en 1882 avec le bombardement d’Alexandrie par les Britanniques, qui imposent leur main mise sur le pays, laquelle va durer jusqu’à la crise de Suez en 1956, en dépit de la proclamation de l’indépendance égyptienne. Après la première guerre mondiale, le pays connaît une période de démocratie libérale : l’agitation conduit à la création du Wafd, le parti issu de la délégation qui plaide pour l’indépendance à l’occasion de la conférence de Versailles. Une première constitution est établie en 1923, directement inspirée de la constitution belge. En 1952, le général Néguib conduit un coup d’Etat ; il est rapidement supplanté par Nasser qui, à partir de 1956, met en place un Etat policier, renforce les liens avec l’Union soviétique et exproprie largement les propriétaires privés. Après sa mort, en 1970, Sadate lui succède jusqu’à son assassinat en 1981. Moubarak arrive alors au pouvoir, qu’il conserve pendant trente ans. Mais les soixante années de pouvoir militaire ne sont pas uniformes : les acteurs sont très différents les uns des autres et la situation géopolitique évolue beaucoup. Après la défaite humiliante contre Israël en 1967 et la restauration de la dignité égyptienne en 1973, Sadate fait le choix de la paix, conclue en 1979. Mais, pendant toute cette période, le pays a connu la stabilité : avec la chute du président Moubarak, il a donc fait un saut dans le vide.
Pour ce qui est de l’histoire des mouvements islamistes en Egypte, il faut rappeler que les Egyptiens ont toujours eu des relations délicates avec les habitants de la péninsule arabique car leurs conceptions de la religion islamique diffèrent profondément et car le peuple égyptien a toujours eu un certain mépris pour les bédouins de la péninsule. Dans les années 1810, Mohamed Ali a guerroyé contre les wahhabites. Aujourd’hui, ce sont les interprétations de la doxa émanant de la mosquée al Azhar qui influencent les sunnites du monde entier, même si l’Egypte n’est que le quatrième pays musulman pour la population. On observe actuellement que le Qatar apporte son soutien, notamment financier, aux Frères musulmans, tandis que l’Arabie saoudite aide les salafistes.
C’est en 1928, dans une Egypte qui compte une important minorité copte et où l’islam est très modéré, qu’Hassan al-Banna crée la confrérie des Frères musulmans, en réaction au système monarchique, à l’emprise britannique, à l’occidentalisation, voire au cosmopolitisme que connaît alors le pays, où vivent un grand nombre d’occidentaux, de Levantins, de juifs. Ses relations avec le pouvoir politique vont varier dans le temps. Comme le Palais veut affaiblir le Wafd, il favorise les Frères musulmans dans les années 1930 puis au lendemain de la deuxième guerre mondiale. Mais, en 1949, Hassan al-Banna est assassiné par la police secrète ; il devient un martyr et la confrérie rompt avec le roi Farouk. Elle se rapproche alors des militaires. En effet, pendant la guerre, comme il le raconte dans ses mémoires, Sadate a tenté de s’appuyer sur elle pour soutenir les forces de l’Axe aux dépens des Britanniques. Si un ancien membre des Frères musulmans l’assassine en 1981, c’est parce que son ouverture en direction d’Israël est très mal vécue. En 1952, donc, l’arrivée au pouvoir des militaires satisfait les Frères musulmans, mais, dès 1954, un grand nombre d’entre eux est arrêté et enfermé dans ce qui ressemble à des camps de concentration. Sayed Qotb, l’auteur du Signe de la piste, la référence des extrémistes islamistes contemporains, est l’un d’eux : il est pendu en 1966 et devient le deuxième grand martyr de la confrérie.
La répression connaît de nouveaux pics en 1971 puis en 1974. Sadate effectue son voyage à Jérusalem en 1977 et est assassiné à l’automne 1981. Toute cette période est celle d’une répression très forte du régime contre les Frères musulmans. Sous Moubarak, la situation empire encore, les militaires en profitant pour réenraciner leur pouvoir, mais de façon ni univoque ni uniforme. En effet, si la branche armée des Frères est sévèrement réprimée, les autres, vis-à-vis desquels le pouvoir est moins répressif, sont les sous-traitants du pouvoir dans le domaine social ; c’est par cette voie que se fera l’islamisation de la société. Ce sont les Frères musulmans qui assurent la gestion de tout ce qui est caritatif depuis trois décennies.
J’ai oublié de dire que la guerre du Golfe n’avait pas eu d’incidence sur la diplomatie égyptienne : il y avait beaucoup d’expatriés égyptiens en Irak, en butte à un racisme fort et l’on n’a assisté à aucune réaction ou manifestation contre l’Occident car les Egyptiens ont du ressentiment contre les Irakiens.
Dans les années 1992-1993, beaucoup de djihadistes d’Afghanistan, dont de nombreux Egyptiens et Algériens, lancent une campagne de terrorisme contre les touristes et le pouvoir mène alors une véritable guerre interne contre les Frères musulmans, parallèle à celle qui se joue en Algérie, très violente et soutenue par la population. Cela va durer 10 ans. Moubarak est alors populaire ; les Frères musulmans continuent leurs actions caritatives, mais sans écho ni sur le plan militaire ni sur le plan politique. C’est l’époque où le régime est légitime car il s’oppose à Al-Qaida.
Par la suite, la situation a profondément changé : la menace terroriste s’est réduite, le népotisme, la corruption, sont devenus insupportables, et les classes moyennes islamistes se sont détachées du régime. En d’autres termes, tous les éléments se sont peu à peu mis en place, avec des facteurs divers qui ont joué dans le même sens : l’islamisme armé a cessé d’être une option ; les réseaux sociaux ont joué également un rôle certain. Par ailleurs, le pouvoir a perdu toute mesure : en dépit de l’opposition de l’armée, Moubarak a tenté de promouvoir son fils, Gamal, à sa succession ; à l’automne 2010, une véritable mascarade électorale a donné la presque totalité des voix au PND, ce qu’on n’avait pas connu en Egypte depuis très longtemps. La déconnexion entre le pouvoir et la réalité a été manifeste. A la fin de l’année 2010, le Noël copte a été marqué par des violences à Alexandrie, à Assiout et au Caire, qui ont conduit à des manifestations en faveur de la liberté religieuse et au soutien des chrétiens par les musulmans. Ces manifestations annonçaient ce qui allait se passer sur la place Tahrir en janvier 2011 et allait provoquer la chute de Moubarak. Des forces profondes et des éléments plus conjoncturels se sont donc conjugués.
Aujourd’hui, quels sont les acteurs en jeu ?
L’armée est la colonne vertébrale du régime depuis 1952 et fabrique les élites. Elle a poussé Moubarak à quitter le pouvoir et elle ne s’est pas compromise dans le maintien de l’ordre, à la différence de la police qui est honnie et s’est désintégrée en quelques jours. L’armée au contraire avait gardé une très bonne image. Il faut souligner que la désorganisation du système policier a des effets importants sur la sécurité des citoyens, dans un pays où, jusqu’à présent, il n’y avait pas de vols. C’est donc aujourd’hui un problème nouveau, grave surtout pour ceux qui n’ont pas les moyens de se protéger.
Toute la stratégie des militaires, c’est de gérer la transition. Certains disent qu’ils veulent garder la mainmise sur le pouvoir ; ils ont sacrifié le Premier ministre en novembre 2011 pour nommer quelqu’un de plus respectable. Il est certain que le Conseil suprême des forces armées (CSFA) joue un rôle ambigu : il ne communique pas, reste opaque, mais est évidemment central.
Je ne reviens pas sur les Frères musulmans dont j’ai déjà parlé. Les salafistes sont apparus au début des années 1970 à Alexandrie. Ils sont très extrémistes, avec un discours officiel très ambigu. Leur succès a été très important aux élections, mais ils marquent une certaine retenue avec les étrangers, tiennent un discours très prudent.
Les libéraux, pour leur part, socio-démocrates, du Néo-Wafd ou indépendants, n’ont toujours pas compris qu’ils avaient perdu les élections législatives. Ils sont dans une sorte de déni de réalité. Ils sont divisés, ont des positions parfois différentes de celles des manifestant de la place Tahrir. Bref, il s’agit d’une nébuleuse dont le discours nous est spontanément sympathique, mais qui ne pèse pas vraiment dans le jeu aujourd’hui.
Enfin, il ne faut pas oublier la mosquée al Azhar, dont le grand imam joue un rôle très important qu’il est souhaitable qu’il garde, car l’interprétation modérée de l’islam qu’il fait est différente de celles des Frères musulmans et des salafistes. Al Azhar a toujours une très grande autorité morale et spirituelle, qui va dans le sens de la rénovation de la démocratie et de la lutte contre l’obscurantisme.
Pour finir, trois grandes questions se posent, qui touchent aux aspects institutionnels, économiques et au rapport de l’islamisme au pouvoir.
La question des institutions n’est pas le cœur du sujet, mais elle a néanmoins son importance. Sans revenir sur l’année 2011, très complexe, disons qu’après les élections de la chambre basse du Parlement, les prochaines échéances seront les élections à la chambre haute, qui sont en cours, puis l’adoption de la constitution et l’élection présidentielle, fin mai-début juin. Certains disent qu’il faudrait modifier ce calendrier et organiser tout de suite l’élection présidentielle. Il y a donc un certain flou quant à ce calendrier, mais la présidentielle se tiendra avant l’été, sans qu’on sache encore très bien qui sera candidat. M. el-Baradei a finalement renoncé à se présenter. Qu’en est-il d’Amr Moussa, l’ancien secrétaire général de la Ligue arabe ? C’est un bon diplomate, respectable aux yeux des Occidentaux, mais on ne sait pas s’il est populaire.
Quoi qu’il en soit, cette question est évidemment liée à la constitution. Après avoir envisagé que le parlement soit constituant, on a finalement opté pour la création d’un comité constitutionnel, de 100 membres, inspiré du comité consultatif constitutionnel de 1958. Nous avons d’ailleurs entendu dire beaucoup de bien de la constitution française de la Vème République, qui pourrait servir de modèle. Il y a évidement certaines ambiguïtés et l’on peut se douter que la position des Frères musulmans sur le soutien à tel ou tel candidat à la présidentielle pourra changer en fonction des pouvoirs qui seront conférés au Président de la République.
La question économique est majeure. L’économie égyptienne repose sur trois piliers : les revenus du canal de Suez, ceux du tourisme et les fonds transférés par les migrants. Ces deux dernières sources sont aujourd’hui presque taries. Seuls les revenus du canal continuent de rentrer. La situation du tourisme est catastrophique, celle des envois de fonds par les immigrés aussi, sachant qu’ils étaient en grand nombre en Irak, au Yémen et en Libye. Par ailleurs, le pétrole et le gaz rapportent peu de ressources, d’autant que la consommation interne augmente, comme le coût des importations.
Pour sa part, l’aide militaire américaine représente 1,4 milliard de dollars par an depuis des décennies. Il n’y a pas de changement pour le moment et les Etats-Unis entretiennent de bonnes relations avec les Frères musulmans. Ce sera un des paramètres importants pour le futur.
Nous avons rencontré des hommes d’affaires français, qui étaient optimistes avant la révolution, quant à la croissance, à l’amélioration des infrastructures. L’avenir dépend désormais des soubresauts politiques. Il risque même d’y avoir une crise des paiements extérieurs à très court terme : les réserves de change chutent et il pourrait y avoir un grave problème avant l’été. Cela étant, il n’y a pas de raison d’être trop pessimiste pour le moyen terme.
Reste enfin la question de l’islamisme à l’épreuve du pouvoir, pour reprendre la distinction de Léon Blum entre conquête et exercice du pouvoir. On ne sait pas ce qu’il en sera. Les islamistes sont aujourd’hui intéressés par les secteurs de la santé, de l’éducation et les collectivités locales ; le reste ne les intéressent pas. Ils n’ont pas réfléchi à la question de l’économie mais seraient d’ailleurs plutôt libéraux, voire même ultralibéraux, à l’instar des Soudanais proches d’al-Tourabi autrefois, à la fois très rigoristes et véritables émules de l’école de Chicago.
Qu’en sera-t-il enfin au plan diplomatique ? Beaucoup de questions se posent aussi. Les Frères musulmans sont bien sûr solidaires des Palestiniens, plus proches du Hamas que du Fatah, mais ils donnent l’impression de ne pas être obsédés par cette question. Les relations israélo-égyptiennes seront inévitablement modifiées, mais il ne faut pas non plus se voiler la face : depuis 1979, elles n’étaient pas si bonnes au quotidien, et la rencontre entre Sadate et Begin à Jérusalem n’a pas tout changé. Est-ce que cela sera pire ?
Au final, nous avons le sentiment que l’ensemble des acteurs égyptiens veulent que la transition se passe bien. S’y ajoute le fait que le pays n’est fondamentalement ni violent ni expansionniste.
M. Serge Janquin. Je n’ai pas l’érudition historique et culturelle d’Hervé Gaymard sur l’Egypte et je serai donc plus direct, même si nos conclusions sont très voisines. Ce que l’on appelle « les printemps arabes », qui recouvrent des réalités différentes, ce sont en Egypte les attentes exprimées place Tahrir par les jeunes et les classes moyennes. Qu’en reste-t-il ? Il y a un processus révolutionnaire, mais on ne peut parler de révolution. Les acteurs actuellement au premier plan ne sont pas ceux de la place Tahrir. Est-ce une révolution avortée ou une révolution en devenir ? Je ne saurais répondre.
Les Frères musulmans ont été portés sur le devant de la scène au-delà de ce qui était attendu et la poussée salafiste a surpris plus encore. Tout est a priori en place pour l’établissement d’une théocratie islamiste mais ils se méfient les uns des autres et le Conseil supérieur des forces armées tient les rênes du pouvoir jusqu’en juin. Le calendrier est controversé et les procédures le sont tout autant, si bien que le flou est complet sur les étapes à venir d’ici le mois de juin.
La rue rejette de plus en plus le pouvoir des militaires, mais ces derniers ne sont pas pour autant prêts à renoncer à leurs intérêts. Ils disposent d’un statut particulier, avec un budget propre, et contrôlent une partie importante de l’économie. Les islamistes restent disposés pour le moment à maintenir leur pacte avec les militaires. Ils n’ont pas intérêt à exercer seuls le pouvoir et doivent donner des gages à la communauté internationale et aux bailleurs de fonds. Les Frères musulmans souhaitent une alliance avec les libéraux pour ne pas se trouver seuls face aux salafistes au Parlement, d’une part, et face aux militaires, d’autre part. Tout le monde observe tout le monde et attend la faute de l’autre.
Par ailleurs, la situation économique est désastreuse. Il n’est pas sûr que le pouvoir puisse continuer à subventionner l’essence et les produits de première nécessité. L’abandon de cette politique serait explosif. La classe politique est prête à mener une guerre d’observation et d’usure jusqu’en juin, mais la rue a ses attentes et ses impatiences. Le scénario du pire est-il envisageable ? L’affaire du stade de Port-Saïd montre qu’une étincelle suffit pour conduire à l’embrasement, dont le seul bénéficiaire serait l’armée, seule capable de rétablir l’ordre, sauf si les Frères musulmans trouvaient dans l’intervalle un candidat à la présidence qui reste pour l’instant introuvable. L’armée ne veut pas gérer le pouvoir mais le conserver. Les Frères musulmans veulent bien d’un nouveau pharaon civil à condition qu’ils en tirent les ficelles. Al-Nour, le principal parti salafiste, veut faire la démonstration de leur collusion et de leur échec.
Pour terminer, je veux dire combien j’ai apprécié la contribution de l’ambassadeur et de ses services.
M. Jean-Louis Bianco. Presque tout ayant été dit, je serai bref. Je voudrais m’associer aux observations de M. Janquin et en formuler quatre. Premièrement, il y a un processus révolutionnaire. La roue tourne. Par exemple, les Frères musulmans soutenaient il y a quelques mois la candidature de M. el-Baradei, ce qui paraît aujourd’hui surréaliste. La communauté copte, après l’élan de solidarité qui a fait suite aux attentats, est aujourd’hui partagée et inquiète. Deuxièmement, la percée des salafistes s’explique pour les mêmes raisons que celle d’Ennahda en Tunisie : figure d’opposition, patient travail de terrain, influence autour des mosquées. Troisièmement, j’ai beaucoup d’interrogations au sujet de l’armée. Je me demande si le CSFA est encore uni et si les violences de Port-Saïd ne sont pas la première manifestation de la division de l’armée, dont une partie resterait pro-Moubarak. Dernier point, que veulent et que vont pouvoir faire les équipes au pouvoir ? Je m’interroge sur leur sincérité. Tout le monde exprime une volonté de consensus pour gérer le pouvoir. J’ai des doutes, et plus encore s’agissant de certains salafistes. Il y aura bien sûr le rapport de forces. Les libéraux et les jeunes de la place Tahrir sont en dehors de la réalité, comme l’a souligné M. Gaymard. Il y aura l’épreuve de l’exercice du pouvoir et de l’économie, pas au sens doctrinal, mais au sens de comment faire lorsque l’économie va mal. L’islamisme est déjà rampant dans la société égyptienne depuis des années et pour moi le plus révélateur est que la seule demande des députés salafistes était d’obtenir la présidence de la commission de l’éducation et qu’ils l’ont eue. La moitié des Egyptiens ayant un baccalauréat ou un équivalent l’on obtenu dans des écoles religieuses.
M. Jean-Paul Lecoq. Je pense que nous avons été l’objet d’une grande opération de séduction. Tous avaient envie de nous rassurer et de nous signifier que tout irait bien. On a peu parlé aujourd’hui de cette question de l’article 2 de la constitution qui fait référence à la Charia. Il fait l’objet de débats qui portent cette fois sur la société. Des questions ont été posées. Il est important de connaître le positionnement des acteurs sur les grandes questions de société, que sont les femmes, la peine de mort ou l’homosexualité.
Si les salafistes ont demandé la présidence de la commission de l’éducation, c’est qu’ils souhaitent réduire le poids d’al Azhar et cela augure d’une vraie bataille idéologique vis-à-vis du monde arabe dans son ensemble. Il faudra être attentif à ces questions.
Concernant l’armée, j’ai été frappé de constater que ce n’est pas seulement une armée, mais le premier acteur économique du pays, un trust, qui imprègne toutes les facettes de la société et il me semble qu’on n’a pas encore fait le tour de son rôle.
On a beaucoup parlé sur place des pratiques religieuses. Tous ont fait valoir qu’il y aura liberté des pratiques et que nous devions être rassurés sur ce point. Je ne pense pas que ce sera simple.
Enfin, à l’égard de Gaza, les islamistes ont tous fait savoir que rien ne changerait sur la frontière : elle ne sera pas ouverte et les tunnels seront combattus. On peut en être étonnés par rapport à leur solidarité naturelle avec les Palestiniens.
M. Jean-Michel Boucheron. Il y a des milliards de dollars américains.
M. Jean-Paul Lecoq. Effectivement.
Je reste perplexe à l’issue du déplacement. Nous n’avons pas rencontré directement de personnes qui sont sur la place Tahrir, mais je pense qu’ils vont encore jouer un rôle et qu’il faut y être attentif. Ce qui s’est passé à Port-Saïd n’est peut-être pas qu’une péripétie. Tout peut aller très vite.
M. Jean-Jacques Guillet. J’émettrai quelques observations. J’ai été frappé par le fait que la constitution égyptienne impose, lors des consultations électorales, d’avoir un quota de 50 % d’ouvriers et de paysans, ce qui a largement contribué aux résultats. Un des débats en cours est de savoir s’il sera supprimé ou non. Il le sera probablement. Cela modifierait les choses.
Ensuite, j’ai été frappé par ce que nous a dit le ministre du tourisme actuel, issu du Wafd et qui est copte, Mounir Fakhry Abdel Nour, qui considère que les Frères musulmans sont une survivance du passé. On peut se demander, quelle que soit la structuration très importante des Frères musulmans, s’il n’y a pas un risque d’éclatement à l’exercice du pouvoir, avec d’un côté la connivence réelle et obligatoire avec les militaires et une certaine tendance à jouer le jeu des institutions démocratiques, et de l’autre la tentation de se rapprocher des salafistes. Cette possibilité de fracture en deux branches ne doit pas être écartée.
J’ai aussi été frappé par les salafistes. C’est un mouvement qui n’est pas nouveau. Il a des racines assez anciennes en Egypte, où il existe depuis les années 1950 et 1960. Il avait été un peu occulté et il était peu pris en considération dans les analyses. Or il est fort aussi en Syrie, en Jordanie, en Libye et au fond dans l’ensemble du monde musulman. L’appui de l’Arabie saoudite et du Qatar, qui a été souligné à plusieurs reprises au cours de nos rencontres, n’est pas totalement désintéressé.
Concernant l’armée, on a officieusement rencontré un général. L’armée paraît un peu impuissante ou n’a pas envie de bouger. D’un autre côté, ce général a bien insisté sur le fait qu’ils avaient tous été élevés dans la haine des Frères musulmans et de l’islamisme et que, si jamais la situation tournait mal, l’armée se réservait le droit d’intervenir. Que faut-il entendre par là ? Difficile de le savoir.
Sur le plan économique, nous avons rencontré des entrepreneurs que j’ai trouvés confiants. France Télécom vient de racheter le principal opérateur de téléphonie égyptien, Mobinil, Total est engagé dans des démarches de prospection pour un gisement de gaz en Méditerranée. Il ne faut donc pas voir tout en noir.
Enfin, en matière de politique étrangère, le guide supérieur des Frères musulmans nous a dit qu’il avait conseillé au Hamas de se mettre sous le couvert de l’OLP. C’était très clair.
M. François Rochebloine. Je confirme l’intérêt exclusif des salafistes pour l’éducation, la religion et les collectivités locales. Au Parlement, la présidence de la commission de l’éducation est en effet la seule qu’ils aient revendiquée. Il faut rappeler que 40 % des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté et que la même proportion est illettrée.
L’optimisme des hommes d’affaires me paraît surprenant au regard de la situation actuelle ; apparemment, les personnes plutôt privilégiées s’interrogent sur leur avenir en Egypte.
M. Michel Terrot. Malgré la victoire écrasante des islamistes, le courant libéral peut-il espérer peser sur la rédaction de la future constitution ? Alors que l’élection présidentielle interviendra avant l’application de la nouvelle constitution, sait-on quels seraient selon cette dernière les pouvoirs du Président, notamment héritera t-il des prérogatives du Conseil suprême des forces armées ?
M. Jean-Paul Dupré. Prolongeant les interrogations sur le devenir politique et économique de l’Egypte, je souhaiterais savoir comment le peuple survit au quotidien et s’il se tourne volontiers vers les Frères musulmans ou les salafistes.
M. Jacques Myard. Le salafisme n’a pas pour ambition de gouverner mais d’imprégner la société. Ce dessein, inscrit dans leur ADN, explique leur intérêt pour l’éducation. Cela correspond à la démarche habituelle des intégristes : ce fut le cas lors de la guerre civile en Algérie dans laquelle les instituteurs des madrasas ont joué un grand rôle.
Vous n’avez pas évoqué la croissance démographique pourtant rédhibitoire pour l’avenir du pays. Il me semble que toute solution en faveur du développement économique butera sur ce problème.
M. Philippe Cochet. Quels sont aujourd’hui les pays qui cherchent à nouer des relations étroites avec l’Egypte, notamment par le biais de l’armée ?
M. Jean-Claude Guibal. Cet exposé passionné a largement abordé les questions de politique intérieure mais insuffisamment, il me semble, le rôle de l’Egypte au Moyen-Orient. Quel peut-il être à l’avenir ? Par ailleurs, qui tient les rênes économiques du pays, outre l’armée ?
Mme Marie-Louise Fort. Je regrette que la délégation n’ait comptée aucune femme. Il me semble que nous devrions donner l’exemple et montrer que les femmes doivent tenir leur rôle dans toute société démocratique. Ma question concerne le regard que porte l’Egypte sur la Turquie, son rôle régional et le possible modèle qu’elle représente.
M. Jean-Michel Boucheron. La conjugaison de plusieurs éléments doit retenir notre attention : d’abord, les révolutions arabes ne sont pas abouties mais se trouvent dans une phase intermédiaire qui pourrait déboucher sur quelque chose de plus fort ; du fait de la crise économique et financière, le scénario grec va se reproduire dans d’autres pays ; une attaque d’Israël sur l’Iran semble programmée ce qui ne manquera pas de mobiliser encore la rue arabe. Cette conjonction de facteurs n’est-elle pas annonciatrice d’un mouvement historique de grande ampleur ?
M. Michel Vauzelle. Vous avez souligné la puissance des Frères musulmans et des salafistes en même temps que celle de l’armée qui semble s’être débarrassée du président Moubarak pour conserver son pouvoir. Cela ressemble plus à un coup d’Etat qu’à une révolution. Comment cette armée qui conserve le pouvoir politique mais aussi économique – le mot de trust a été prononcé à son sujet – et qui est soutenue par les Etats-Unis, se positionne t-elle sur l’échiquier politique face aux deux forces précitées ?
M. Jacques Remiller. L’avenir de l’Egypte ne risque t-il pas d’être troublé par le sort judiciaire d’Hosni Moubarak ? Quelles seraient les conséquences d’une intervention israélienne contre l’Iran pour le pays ?
M. Paul Giacobbi. Il ne faut pas sous-estimer la force du wahhabisme qu’il tire de son antériorité, de son universalité, de sa simplicité et de ses moyens infinis mais aussi des circonstances économiques et diplomatiques idéales. Les wahhabites ont obtenu 25 % aux élections malgré l’existence d’un parti islamiste très organisé.
M. Hervé Gaymard. Nous sommes dans le brouillard absolu concernant la constitution. Sa rédaction donne lieu à des discussions entre militaires et islamistes dont on ignore ce qu’il sortira. Je ne peux pas vous répondre sur son contenu. Je ne pense pas néanmoins que le courant libéral pourra peser sur celui-ci.
Sur la nature des pouvoirs du président, il me semble que la conception minimaliste devrait s’imposer. Les islamistes sont plus intéressés par l’exercice d’un pouvoir informel plutôt qu’institutionnel et identifié.
M. Janquin a résumé la situation de la population, qui est victime de la pauvreté du pays malgré l’émergence d’une classe moyenne depuis vingt ans. La population parvient à vivre grâce aux biens subventionnés que sont le sucre, l’huile, le pain et le butagaz. Tant que cette subvention demeurera, tant que l’Etat en aura les moyens, cet amortisseur social qui s’ajoute aux solidarités familiales permettra de sauvegarder une situation qui est néanmoins préoccupante.
Ce pays de 80 millions d’habitants semble vivre un début de transition démographique. Il est vrai que cette transition ne réglera pas ce problème crucial à court terme mais à moyen terme seulement.
L’Egypte est aujourd’hui autocentrée. Elle ne manifeste pas d’intérêt pour le reste du monde. Le pays est en quelque sorte en apesanteur. Sur l’Iran, je rappelle que le Shah a obtenu l’asile politique après son éviction du pouvoir et est enterré au Caire. Les deux pays n’entretiennent pas de relations compliquées qui se caractérisent plutôt selon moi par une forme de négligence. Il n’y a pas d’interférence confessionnelle. L’un étant persan, l’autre arabe, ils ne partagent pas le même jardin. Ils sont deux pôles importants du grand Moyen-Orient. Ce n’est pas une question majeure.
Les Egyptiens n’aiment pas les Turcs. Ils n’ont jamais été fascinés par le kémalisme et je ne suis même pas sûr qu’ils soient intéressés par la politique de M. Erdogan. Ils regardent de loin ce qui se passe en Turquie. Le nom du pays n’a été cité à aucun moment lorsque nous étions en Egypte. Ce sont deux univers différents.
Je partage l’interrogation de M. Boucheron sur ce qui se trame à l’égard de l’Iran.
L’armée détient directement et indirectement un tiers du PIB du pays. Il s’agit d’une institution complexe qui a noué depuis longtemps des liens forts avec les Frères musulmans sur lesquels l’opacité règne. Les militaires semblent hésiter sur l’attitude à adopter car ils ne veulent pas perdre le pouvoir. Dans le débat constitutionnel sur le rôle futur de l’armée et le contrôle de celle-ci, les réponses qui nous ont été apportées relèvent toutes de la langue de bois. Chacun convient de l’importance d’un contrôle mais le plus grand flou entoure sa traduction constitutionnelle. Les militaires sont affaiblis car ils ne possèdent pas une figure politique susceptible de les représenter. Ils ne sont plus les fringants et ambitieux jeunes hommes d’antan mais des notables ayant bâti des fortunes.
Enfin, le wahhabisme est en effet très ancien et très implanté. Il faut donc surveiller de près les agissements des tenants de celui-ci.
CHRONOLOGIE DES PRINTEMPS ARABES
Date |
Pays du Maghreb/Machrek |
Pays du Proche-Orient |
Pays du Golfe |
17 décembre 2010 |
Mohamed Bouazizi, jeune diplômé tunisien, s’immole par le feu suite à la confiscation de sa marchandise par les autorités à Sidi Bouzid |
||
27 décembre 2010 |
un millier de jeunes diplômés au chômage manifestent à Tunis et sont dispersés à coups de matraque. |
||
28 décembre 2010 |
premières manifestations en Algérie |
||
29 décembre 2010 |
le président tunisien, Zine el-Abidine Ben Ali, tente de répondre à la pression de la rue en nommant un nouveau ministre de la jeunesse et des sports. |
||
5 janvier 2011 |
mort de Mohamed Bouazizi. |
||
13 janvier 2011 |
Bouterfif Mohsen, un Algérien de 27 ans, s’immole à Boukhadra, après n’avoir pas réussi à trouver un emploi et un appartement. |
||
le président tunisien Ben Ali annonce le limogeage du gouvernement, des élections législatives anticipées dans les six mois et qu’il ne se représentera pas en 2014. |
|||
14 janvier 2011 |
fuite du président Ben Ali vers l’Arabie saoudite avec toute sa famille. Le général Ali Seriati, ancien chef de la sécurité présidentielle, est arrêté à l’aéroport militaire de l’Aouina. |
premières manifestations en Jordanie. |
|
Mi-janvier 2011 |
Sanaa est le théâtre de manifestations visant à mettre un terme aux 33 ans d’exercice du pouvoir du président yéménite, Ali Abdallah Saleh. | ||
premières manifestations pacifiques à Oman : le peuple omanais réclame plus de libertés et de démocratie, une meilleure répartition des richesses et une politique de l’emploi. | |||
17 janvier 2011 |
immolation de Yacoub Ould Dahoud devant la présidence de la République en Mauritanie. |
||
un gouvernement provisoire dit d’Union nationale est constitué en Tunisie, composé d’anciens opposants et de partisans de Ben Ali. |
|||
18 janvier 2011 |
le parti islamiste tunisien Ennahda sort de la clandestinité. |
||
21 janvier 2011 |
premières manifestations en Arabie saoudite | ||
25 janvier 2011 |
début de la révolution égyptienne et occupation de la place de la Libération (place Tahrir). Cette journée est baptisée « journée de la colère » en réponse à la « journée de la police » organisée le même jour et destinée à rendre hommage aux forces de l’ordre égyptiennes. |
||
26 janvier 2011 |
un mandat d’arrêt international est émis par la justice tunisienne contre Ben Ali et son épouse pour « transferts illicites de devises à l’étranger » et « acquisition illégale de biens mobiliers et immobiliers ». |
||
27 janvier 2011 |
le Premier ministre tunisien Mohamed Ghannouchi annonce le remaniement de son gouvernement. |
Mohammed el-Baradei, prix Nobel de la paix en 2005, revient en Egypte pour soutenir les manifestants. |
mouvement de contestations lancé par les étudiants à l’université de Sanaa. |
28 janvier 2011 |
après trois jours de troubles au Caire, à Suez et Port Saïd, « vendredi de la colère » contre le régime d’Hosni Moubarak. Ce dernier décrète le couvre-feu et appelle l’armée en renfort. En fin de soirée, il annonce la démission du gouvernement, la formation d’un nouveau cabinet et la nomination d’un vice-président. |
||
manifestations à Amman pour des réformes politiques. |
|||
29 janvier 2011 |
Omar Souleiman est nommé au poste de vice-président, poste vacant depuis l’arrivée au pouvoir d’Hosni Moubarak en 1981 |
||
un rassemblement de solidarité avec les manifestants en Egypte a lieu à proximité de l’ambassade égyptienne à Beyrouth. |
|||
30 janvier 2011 |
le chef du parti islamiste tunisien Ennahda, Rached Ghannouchi fait son retour à Tunis après vingt ans d’exil et annonce qu’il se présentera à la prochaine élection présidentielle. |
||
premières manifestations au Maroc |
|||
31 janvier 2011 |
l’armée égyptienne se rallie aux manifestants en déclarant que leurs revendications sont légitimes. Elle s’engage à ne pas faire usage de la force. |
||
1er février 2011 |
suite aux manifestations répétées à Amman depuis un mois, le roi Abdallah II dissout son gouvernement et nomme un nouveau Premier ministre, Maarouf Bakhit, en remplacement de Samir Rifaï, en le chargeant de mettre un terme à la corruption et de préparer des réformes politiques. |
||
Hosni Moubarak déclare qu’il ne briguera pas un sixième mandat. |
|||
2 février 2011 |
le président yéménite Saleh renonce à se présenter pour un autre mandat présidentiel en 2013. | ||
3 février 2011 |
« jour de colère » au Yémen. | ||
4 février 2011 |
« jour du départ », journée la plus importante de la contestation égyptienne. Omar Souleiman annonce que Gamal Moubarak ne sera pas candidat à la succession de son père. |
||
6 février 2011 |
dissolution de l’ancien parti gouvernemental RCD (Rassemblement constitutionnel démocratique) en Tunisie. |
||
7 février 2011 |
le nouveau gouvernement égyptien annonce une augmentation de 15 % des salaires et des pensions de retraite pour essayer de ralentir la contestation. |
||
10 février 2011 |
dix activistes islamistes annoncent la création du premier parti d’Arabie saoudite, le parti de l’Oumma islamique. | ||
11 février 2011 |
naissance en Tunisie du Conseil national pour la protection de la révolution (CNPV). |
le président égyptien Hosni Moubarak quitte le pouvoir. Le Conseil suprême des forces armées (CSFA), sous la direction de Mohammed Hussein Tantaoui, assure l’intérim du pouvoir. |
|
13 février 2011 |
manifestations interdites et violemment réprimées à Alger ainsi que dans d’autres villes algériennes contre la corruption et le régime en place. |
le CSFA dissout les deux chambres du Parlement et la constitution égyptienne est suspendue |
|
14 février 2011 |
les manifestants bahreïniens occupent la place de la Perle à Manama malgré l’interdiction de manifester. | ||
15 au 25 février 2011 |
les premières manifestations et émeutes contre le régime syrien éclatent après l’arrestation d’un militant des droits de l’homme. |
||
17 février 2011 |
« jour de la colère » en Libye, le mouvement de protestation contre le régime est violemment réprimé à Benghazi |
||
20 février 2011 |
au Yémen, l’opposition parlementaire se joint à la contestation étudiante | ||
21 février 2011 |
manifestations pacifiques à Tanger, Casablanca, Marrakech et Rabat qui réunissent près de 40 000 personnes |
||
22 février 2011 |
la Ligue arabe suspend la participation de la Libye à ses réunions ; dans sa première apparition publique depuis le début des troubles, le colonel Kadhafi accuse les manifestants de vouloir faire de la Libye un califat islamiste. |
||
23 février 2011 |
trois pétitions en Arabie saoudite exigent des réformes et un partage plus juste du pouvoir dans le but de parvenir à établir dans le pays une véritable monarchie constitutionnelle. | ||
24 février 2011 |
le président algérien Abdelaziz Bouteflika lève l’état d’urgence en vigueur depuis 1992. |
||
les insurgés libyens s’emparent progressivement des villes de l’Est du pays et avancent vers Tripoli. |
|||
25 février 2011 |
début des manifestations qui dureront deux mois et sit-in à Nouakchott sur la « place des Blocs » sous la bannière de la Coordination de la jeunesse appelant au départ du président Aziz. |
deux manifestants yéménites sont tués par balles près de l’université de Sanaa ; intensification des manifestations. | |
26 février 2011 |
le Conseil de sécurité des Nations unies adopte la résolution 1970 qui impose le gel des avoirs du colonel Kadhafi et de cinq membres de sa famille et un embargo sur la vente d’armes. |
||
27 février 2011 |
Mohamed Ghannouchi démissionne de ses fonctions de Premier ministre de la Tunisie. Il est remplacé par Beji Caïd Essebsi. |
deux manifestants sont tués dans le sultanat d’Oman après des heurts avec les forces de l’ordre à Sohar | |
création par les insurgés du Conseil National de Transition (CNT) libyen à Benghazi. |
|||
28 février 2011 |
la Libye est exclue du Conseil des droits de l’homme à la suite d’un vote du Conseil de sécurité ; un embargo sur la vente d’armes à la Libye est décrété par l’Union européenne, qui gèle également tous les avoirs du clan Kadhafi |
||
1er mars 2011 |
les manifestations se durcissent à Oman : 200 à 300 personnes assiègent le port de la ville de Sohar et bloquent une route conduisant à Mascarate, la capitale, mais la manifestation est dispersée par des blindés. Le même jour, 300 personnes font un sit-in devant le Conseil consultatif de la Choura. | ||
au Bahreïn, démission des députés de la principale force politique de l’opposition chiite Al-Wifaq, qui demandent l’instauration d’une monarchie constitutionnelle. | |||
3 mars 2011 |
manifestations à Beyrouth pour réclamer l’abolition du confessionnalisme politique mis en place à titre provisoire par la Constitution de 1926, système responsable, d’après les manifestants, de la corruption, des blocages politiques et des troubles civils que connaît le pays. |
||
4 mars 2011 |
Essam Charaf est nommé au poste de Premier ministre par le CSFA en Egypte. |
||
5 mars 2011 |
Le CNT se déclare « le seul représentant de la Libye ». |
||
7 mars 2011 |
le sultan d’Oman procède à un remaniement majeur de son gouvernement en congédiant plusieurs ministres controversés | ||
les manifestations publiques sont interdites en Arabie saoudite. | |||
9 mars 2011 |
la justice tunisienne dissout le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), le parti de l’ex-président Ben Ali, à la demande des nouvelles autorités. |
||
le roi Mohamed VI se prononce en faveur d’une réforme institutionnelle globale (renforcement des pouvoirs du Premier ministre et élargissement des libertés individuelles) et d’une modernisation des structures de l’Etat. Le projet de constitution devra être débattu par les partis politiques et soumis à un référendum. |
|||
10 mars 2011 |
la France reconnaît le CNT comme seul représentant légitime du peuple libyen et reçoit à Paris deux émissaires ; le gouvernement de Kadhafi suspend ses relations diplomatiques avec la France. |
le président Saleh annonce une nouvelle constitution et des élections pour le début de l’année 2012. | |
11 mars 2011 |
l’opposition jordanienne refuse de participer à une commission de dialogue national. |
« jour de la colère » violemment réprimé en Arabie saoudite : les Saoudiens avaient appelé à se rassembler pour exiger l’élection du dirigeant du pays, plus de droits pour les femmes et la libération des prisonniers politiques. | |
12 mars 2011 |
la Ligue arabe vote à l’unanimité une résolution demandant au Conseil de sécurité de l’ONU d’autoriser la mise en place d’une zone d’exclusion aérienne pour protéger le peuple libyen des attaques perpétrées par les partisans du colonel Kadhafi. |
||
13 mars 2011 |
des manifestations sont réprimées au Maroc. |
le roi du Bahreïn charge le prince héritier d’entamer un dialogue avec l’opposition, dominée par le Wefaq chiite, mais celle-ci pose des conditions préalables, au premier rang desquelles la démission du gouvernement. | |
le sultan d’Oman propose de céder à un conseil partiellement élu, certains pouvoirs législatifs et promet l’emploi de 50 000 fonctionnaires et une augmentation des pensions de retraite grâce à une aide financière de 10 milliards de dollars du Conseil de coopération du Golfe (CCG). | |||
14 mars 2011 |
les Emirats arabes unis et l’Arabie saoudite dépêchent des troupes et des policiers au Bahreïn. | ||
15 mars 2011 |
manifestations à Deraa, à Damas et dans quatre autres villes de Syrie. |
instauration de l’état d’urgence à Manama. | |
16 mars 2011 |
début de la répression des opposants au régime au Bahreïn (évacuation dans le sang de la place de la Perle). | ||
mille grévistes omanais bloquent la zone industrielle de Rusayl à 45km au Nord de Mascarate en réclamant un salaire minimum de 300 riyals omanais, la semaine de 5 jours et des congés payés. | |||
17 mars 2011 |
le Conseil de sécurité de l’ONU, par la résolution 1973, autorise les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les populations et zones civiles menacées d’attaque en Libye, y compris Benghazi, tout en excluant le déploiement d’une force d’occupation. Cinq pays se sont abstenus lors du vote (Russie, Chine, Inde, Brésil et Allemagne). |
||
18 mars 2011 |
l’arrestation d’enfants de Deraa provoque une vague de manifestations dans toute la Syrie, violemment réprimées. Bachar el-Assad évoque un complot de l’étranger. |
le président yéménite déclare l’état d’urgence alors que son ministre du tourisme a annoncé sa démission et s’est retiré du parti gouvernemental pour protester contre les actions des forces de sécurité. | |
le roi Abdallah II de Jordanie promet de nombreuses réformes dans les domaines de l’emploi, du logement et une hausse de salaire des fonctionnaires. |
|||
19 mars 2011 |
la coalition menée par les Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne et la force de soutien de la Ligue arabe passe à l’offensive en bombardant par air et par mer des objectifs militaires libyens dans une opération baptisée « Aube de l’Odyssée ». |
les Egyptiens sont appelés à se prononcer par référendum sur des amendements constitutionnels (limitation du mandat présidentiel, supervision des élections…) proposés par les autorités militaires. |
|
20 mars 2011 |
le chef de l’Etat yéménite limoge son gouvernement. | ||
21/22 mars 2011 |
au Yémen, défection d’un des principaux chefs de l’armée, de diplomates, et ralliement d’officiers à la contestation. | ||
23 mars 2011 |
la répression s’accentue à Deraa. |
le président Saleh propose un référendum constitutionnel, des élections législatives et présidentielles avant la fin de l’année 2011. Le Parlement approuve l’instauration de l’état d’urgence dans le pays. | |
24 mars 2011 |
l’opération « Protecteur unifié », sous l’égide de l’OTAN, débute officiellement pour imposer, au-dessus de la Libye, une zone d’exclusion aérienne, à l’exception des vols humanitaires ou d’acheminement d’une assistance. |
« Mouvement du 24 mars » : des manifestants se rassemblent au Cercle intérieur à Amman. |
|
25 mars 2011 |
des loyalistes arrivent à Amman et tentent de disperser les manifestants avec des jets de pierre. |
||
premières manifestations à Homs, Hama, Alep et Lattaquié. |
|||
27 mars 2011 |
l’OTAN prend officiellement le commandement des opérations militaires menées en Libye. |
||
29 mars 2011 |
le roi Abdallah II de Jordanie s’engage à ne pas s’opposer au processus de réformes. |
||
le gouvernement syrien présente sa démission et des partisans du régime manifestent leur soutien à Bachar el-Assad. |
|||
29 mars au 1er avril |
vague de répression et d’arrestations des manifestants à Oman | ||
30 mars 2011 |
Moussa Koussa, ancien ministre des affaires étrangères libyen, annonce depuis Londres sa défection. D’autres hauts dignitaires du régime le suivent. |
le président Bachar el-Assad sort de son silence dans un discours au Parlement retransmis à la télévision et dénonce une conspiration internationale contre son régime. |
|
31 mars 2011 |
des personnalités marocaines d’horizons politiques différents appellent à la « formation d’un gouvernement de coalition nationale ». |
l’émir du Koweït accepte la démission du gouvernement, présentée sous la pression de députés de l’opposition qui réclament un nouveau Premier ministre. | |
en Libye, l’OTAN prend le relais des Etats-Unis pour les frappes aériennes contre les forces pro-Kadhafi. |
|||
7 avril 2011 |
un homme s’immole par le feu devant les bureaux du Premier ministre en Jordanie. |
le président yéménite rejette une offre de médiation (prévoyant son départ immédiat) des monarchies arabes du Golfe. | |
10 avril 2011 |
Kadhafi accepte les propositions de l’Union africaine destinées à mettre fin à la crise. Dès le lendemain, les insurgés libyens rejettent ce plan, qui n’intègre pas leur revendication première, à savoir, le départ du pouvoir de Kadhafi. |
la répression armée continue en Syrie, notamment à Deraa et à Banias. |
|
11 avril 2011 |
le président Saleh se dit prêt à un « transfert pacifique du pouvoir ». | ||
13 avril 2011 |
Hosni Moubarak et ses deux fils sont placés en détention pour quinze jours dans le cadre d’une enquête sur l’usage de la violence contre les manifestants. |
||
14 avril 2011 |
le gouvernement de Bahreïn annonce vouloir engager des procédures judiciaires pour faire interdire les deux principaux groupes d’opposition chiites. | ||
15 avril 2011 |
le président algérien Bouteflika annonce qu’il va réformer certains secteurs suite aux grèves massives des fonctionnaires (plus de 80 % d’entre eux étaient en grève le 6 avril). |
||
16 avril 2011 |
dans son discours retransmis à la télévision, Bachar el-Assad exprime sa « peine » pour les personnes mortes ou blessées, civils ou militaires. Il énumère une série de problèmes (chômage et corruption) auxquels il devra remédier. |
||
21 avril 2011 |
publication de trois décrets relatifs à la levée de l’état d’urgence en Syrie, mis en place le 8 mars 1963, l’abolition de la Cour de sûreté de l’Etat et la modification des règles relatives aux manifestations. |
||
23 avril 2011 |
le mufti de Deraa et deux députés syriens, Nasser Hariri et Khalil Rifaï, donnent leur démission pour protester contre le recours à la force à l’encontre des manifestants syriens. |
le président yéménite accepte le plan proposé par le CCG prévoyant sa démission dans un délai de 30 jours en échange de son immunité et la tenue une élection présidentielle dans les 60 jours qui suivent ; pendant cette période, un gouvernement d’union nationale devra être formé, le pouvoir sera transmis au vice-président et les manifestations devront cesser ; aucune date n’est précisée quant à la mise en œuvre du plan. | |
25 avril 2011 |
des manifestations violentes opposent des manifestants favorables et opposés au régime du président Aziz. |
||
25/26 avril 2011 |
le gouvernement syrien envoie des chars dans plusieurs villes du pays (Deraa, Homs, Banias, Tafas). |
||
28 avril 2011 |
attentat à Marrakech (16 morts). |
||
29 avril 2011 |
un protocole d’accord est signé au Caire par le Hamas et le Fatah, qui prévoit la formation d’un gouvernement de transition composé de personnalités indépendantes, en vue d’élections présidentielles et législatives simultanées dans un délai d’un an en Palestine. |
||
30 avril 2011 |
le président Saleh refuse finalement de signer le plan de sortie de crise proposé par CCG | ||
Mai 2011 |
le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) demande aux juges de délivrer des mandats d’arrêt internationaux contre Mouammar Kadhafi, son fils Seif al-Islam et le chef des services de renseignements Abdallah al-Senoussi pour crimes contre l’humanité commis en Libye depuis le 15 février. |
||
6 mai 2011 |
« jour du défi » en Syrie. |
||
7 mai 2011 |
le gouvernement de transition décrète un couvre-feu à Tunis et dans sa banlieue pour une période indéterminée. Des manifestations demandant la démission du gouvernement sont violemment réprimées depuis trois jours dans la capitale. |
||
8 mai 2011 |
manifestations à Marrakech pour dénoncer l’attentat du 28 avril et réclamer que les réformes démocratiques promises ne soient pas éclipsées par la lutte contre la violence |
||
9 mai 2011 |
des sanctions contre treize responsables syriens et un embargo sur les armes sont formellement adoptés par l’Union européenne. |
||
12 mai 2011 |
après avoir refusé de tirer sur la foule, certains soldats syriens sont exécutés par leurs supérieurs hiérarchiques. |
||
13 au 15 mai 2011 |
face à la détérioration de la situation en Libye, à la répression sanglante en Syrie et au blocage politique au Yémen, les ministres des affaires étrangères de la Ligue arabe se réunissent au Caire pour tenter de dégager les principes d’une politique commune et de « prendre des mesures appropriées ». | ||
18 mai 2011 |
27 manifestants arrêtés en avril et en mai comparaissent pour la première fois devant un tribunal omanais. Ils sont notamment accusés de banditisme, incendies de bâtiments de l’Etat et outrage aux représentants de l’Etat | ||
19 mai 2011 |
les Etats-Unis décident de sanctionner directement le président syrien Bachar el-Assad et six autres des principaux chefs du régime pour leur rôle dans la répression sanglante de la révolte dans ce pays. |
||
23 mai 2011 |
les ministres européens des affaires étrangères décident d’interdire de visa et de geler les avoirs de Bachar el-Assad, en raison de la répression du mouvement de contestation de son régime. |
||
29 mai 2011 |
des manifestations sont vivement réprimées au Maroc. |
||
31 mai 2011 |
Bachar el-Assad décrète une amnistie générale. |
||
2 juin 2011 |
le roi du Bahreïn appelle au dialogue national après la levée de l’état d’urgence. | ||
3 juin 2011 |
attentat perpétré dans la mosquée du palais de Sanaa contre le président Saleh, qui part se faire soigner à l’étranger | ||
6 juin 2011 |
47 médecins et infirmières sont arrêtés au Bahreïn pour avoir soigné des manifestants. | ||
8 juin 2011 |
les élections pour la nouvelle assemblée constituante tunisienne sont reportées au 23 octobre. |
||
14 juin 2011 |
huit opposants chiites sont condamnés à la prison à perpétuité au Bahreïn. | ||
17 juin 2011 |
le nouveau texte constitutionnel du Maroc est adopté en Conseil des ministres. |
||
20 juin 2011 |
nouvelle intervention publique de Bachar el-Assad qui promet encore une fois des réformes. |
||
21 juin 2011 |
Ben Ali et son épouse sont condamnés à 35 ans de prison et 45 millions d’euros d’amendes pour détournement de fonds. |
||
27 juin 2011 |
la CPI émet un mandat d’arrêt pour crimes contre l’humanité commis en Libye en février 2011 contre Mouammar Kadhafi, son fils Seif al-Islam Kadhafi, et le chef des services de renseignements libyens Abdallah al-Senoussi. |
||
1er juillet 2011 |
référendum au Maroc sur un projet de réforme de la constitution qui donne plus de pouvoir au Premier ministre qui aura désormais la possibilité de dissoudre la Chambre des représentants. Le scrutin recueille 98,5 % de oui. |
||
21 juillet 2011 |
Essam Charaf, sous la pression des manifestants, remanie le gouvernement égyptien. |
||
1er août 2011 |
le chef de l’Etat mauritanien reçoit une délégation de jeunes protestataires au palais présidentiel et leur demande de soumettre des propositions de réformes. |
||
3 août 2011 |
le CNT publie la « déclaration constitutionnelle » visant à garantir les libertés publiques en Libye et à affirmer le caractère pluraliste de son futur régime. Le CNT s’engage, dans un délai compris entre un et trois mois après son installation dans la capitale libérée, à constituer un gouvernement chargé d’organiser sous huit mois les élections à une assemblée constituante d’environ 200 membres. |
début du procès de l’ancien président égyptien Hosni Moubarak, finalement reporté au 15 août. |
|
7 août 2011 |
le roi Abdallah d’Arabie saoudite annonce le rappel de son ambassadeur à Damas pour « consultations » et exhorte le président syrien dans un communiqué à « arrêter le massacre ». | ||
10 août 2011 |
fin du procès des 23 proches de l’ancien président tunisien Ben Ali et de son épouse, ainsi que de son chef de la sécurité Ali Seriati |
||
21 août 2011 |
les insurgés sont aux portes de Tripoli, que des milliers de personnes cherchent à fuir. Kadhafi appelle ses partisans à « nettoyer » la capitale. |
||
23 août 2011 |
après plus de 6 mois d’affrontements, Tripoli tombe aux mains des insurgés ; Mouammar Kadhafi demeure toutefois introuvable durant les semaines qui suivent la chute du régime. |
||
26 août 2011 |
report des élections législatives, sénatoriales et municipales en Mauritanie pour permettre la tenue d’un débat politique avec l’opposition. |
||
Septembre 2011 |
de nombreux projets de lois réformateurs sont discutés à l’Assemblée populaire nationale algérienne (ouverture du champ audiovisuel, dépénalisation du délit de presse, nouvelle loi sur les partis politiques). |
||
la Conférence internationale réunie à Paris par la France et la Grande-Bretagne pour engager la transition démocratique et la reconstruction en Libye décide de la levée du gel des avoirs du régime déchu au profit des nouvelles autorités libyennes. |
|||
2 septembre 2011 |
l’Union européenne décrète un embargo sur les importations de pétrole syrien. |
||
9 septembre 2011 |
rassemblement des Egyptiens sur la place Tahrir pour dénoncer la lenteur des réformes promises par le CSFA |
||
10 septembre 2011 |
près de 3 000 manifestants égyptiens issus d’un rassemblement sur la place Tahrir attaquent l’ambassade d’Israël au Caire. |
||
12 septembre 2011 |
le CSFA adopte un décret qui étend l’état d’urgence. |
||
17 septembre 2011 |
le siège libyen à l’ONU est attribué au CNT ; il en sera de même à l’Union africaine le 20 septembre. |
||
le président mauritanien ouvre formellement le « dialogue national » entre les partis de la majorité et quatre partis de l’opposition ; il porte principalement sur le renforcement de la démocratie et des libertés publiques. |
|||
23 septembre 2011 |
la télévision d’Etat yéménite annonce que le président Saleh a regagné le pays après trois mois d’absence et reprend ses fonctions, ce qui entraîne de nouvelles manifestations dans les rues de Sanaa, sévèrement réprimées par la police. | ||
25 septembre 2011 |
le roi Abdallah annonce l’octroi aux Saoudiennes du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales de 2015 ; elles pourront également siéger au Conseil consultatif de la Choura à partir de 2013. | ||
3 octobre 2011 |
le CNT a annoncé la formation d’un nouvel exécutif provisoire. |
||
5 octobre 2011 |
la Chine et la Russie opposent leur veto à une résolution du Conseil de sécurité sur la Syrie estimant « inacceptable » que le texte menace de sanctions le régime de Damas. |
||
7 octobre 2011 |
le président russe Medvedev déclare que les autorités syriennes doivent, soit mettre en œuvre les réformes promises, soit partir. |
la yéménite Tawakkul Karman reçoit le prix Nobel de la paix 2011 conjointement avec Mmes Ellen Johnson Sirleaf (présidente du Libéria) et Leymah Gbowee (libérienne) pour leur lutte non violente pour la sécurité et les droits des femmes. | |
8 octobre 2011 |
le président yéménite Saleh fait diffuser un nouveau message par le biais de la télévision d’Etat yéménite, déclarant qu’il démissionnera « dans les prochains jours ». | ||
15 au 18 octobre |
manifestations violemment réprimées au Yémen. | ||
17 octobre 2011 |
le roi Abdallah II de Jordanie nomme Aoun Khassawneh, juge à la Cour internationale de justice depuis 2000, au poste de Premier ministre. |
||
19 octobre 2011 |
conclusion en Mauritanie d’un accord sur les réformes constitutionnelles au terme d’un mois de « dialogue national ». La création d’une commission électorale indépendante et la criminalisation des coups d’Etat en Mauritanie en sont deux des propositions essentielles. |
||
20 octobre 2011 |
Mouammar Kadhafi est tué lors de sa capture à proximité de sa ville natale, Syrte, tombée aux mains des combattants du CNT quelques heures plus tôt. |
||
21 octobre 2011 |
par la résolution 2014, le Conseil de sécurité des Nations unies appelle le gouvernement yéménite à mettre fin immédiatement aux violations des droits de l’homme (y compris les attaques contre les civils perpétrées par les forces de sécurité) et exhorte le président Saleh à céder le pouvoir en vertu de l’accord négocié avec le CCG. | ||
23 octobre 2011 |
Election de l’assemblée constituante en Tunisie. Le parti islamiste Ennahda obtient 89 sièges sur les 217 sièges. Le taux de participation est de 54,1 %. |
||
Mustapha Abdeljalil, président du CNT, proclame la « libération » de l’ensemble de la Libye et déclare que « la Charia sera la principale source de la législation ». |
|||
24 octobre 2011 |
l’ambassadeur des Etats-Unis à Damas est rappelé. |
||
25 octobre 2011 |
un accord de cessez-le-feu est signé au Yémen. entre la première division blindée de l’armée, ralliée à la contestation, et le bureau du chef tribal cheikh Mohsen al-Ahmar (deux parties engagées dans les combats contre les troupes du chef de l’Etat) | ||
27 octobre 2011 |
le Conseil de sécurité de l’ONU met fin au mandat autorisant l’intervention en Libye. |
||
31 octobre 2011 |
Abdel Rahim al-Kib devient Premier ministre du gouvernement de transition de Libye. |
premier discours public du sultan d’Oman depuis les manifestations de janvier 2011 : il promet d’écouter les jeunes, de respecter la liberté d’expression, de lutter contre le chômage et la corruption. | |
6 novembre 2011 |
un communiqué de la Ligue arabe accuse Damas de ne pas avoir tenu ses engagements, notamment celui de faire cesser la répression contre le mouvement de contestations. |
||
8 novembre 2011 |
le Haut-commissariat de l’ONU aux droits de l’homme indique que la répression syrienne fait plus de 3 500 morts depuis le début de la contestation. |
||
12 novembre 2011 |
la Ligue arabe suspend la participation à ses réunions de la Syrie et la menace de sanctions, déclenchant des manifestations violentes pro-Assad. |
||
14 novembre 2011 |
le roi Abdallah II de Jordanie appelle le président syrien Bachar el-Assad à quitter le pouvoir. |
||
17 novembre 2011 |
assaut du Parlement du Koweït par des manifestants réclamant des réformes politiques et un changement de régime. | ||
19 novembre 2011 |
Seif al-Islam Kadhafi est interpellé dans le Sud du pays alors qu’il était en fuite. |
||
22 novembre 2011 |
le Premier ministre libyen dévoile la composition de son nouveau gouvernement, qui sera en charge de la reconstruction et de l’unification du pays. |
après la démission du gouvernement égyptien, le 21, un accord sur la formation d’un gouvernement de « salut national » est conclu. |
|
23 novembre 2011 |
Ali Abdallah Saleh signe enfin le plan de sortie de crise des pays du CCG et renonce ainsi au pouvoir. Il s’engage à remettre le pouvoir effectif au vice-président qui doit former un gouvernement d’union nationale et élaborer une nouvelle constitution. A l’issue d’une période intérimaire de deux ans, le vice-président devra organiser des élections législatives et présidentielles. Le président obtient l’immunité pour lui, ses proches et ses collaborateurs. | ||
25 novembre 2011 |
élections au Maroc : le parti islamiste Justice et Développement (PJD) remporte 107 sièges des 395 de la chambre des Représentants. |
||
27 novembre 2011 |
la Ligue arabe adopte au Caire des sanctions économiques contre le régime syrien en raison de la poursuite de la répression des manifestations. |
Mohamed Basindawa, figure de l’opposition yéménite, est chargé de former un gouvernement d’entente nationale | |
28 novembre 2011 |
démission du gouvernement du Koweït | ||
28/29 novembre 2011 |
première phase des élections législatives égyptiennes. Un tiers des gouvernorats du pays, soit 9 circonscriptions et 17 millions d’électeurs, est appelé à désigner ses députés (principalement Le Caire et Alexandrie). |
||
29 novembre 2011 |
le président tunisien par intérim, Fouad Mebazaa, décide de prolonger une troisième fois jusqu’à la fin de l’année l’état d’urgence en Tunisie. |
Tawakkul Karman, prix Nobel de la paix en 2011, remet au procureur de la CPI le dossier sur les crimes commis par Ali Abdallah Saleh contre les protestataires pacifiques durant les neuf mois de contestation au Yémen. | |
6 décembre 2011 |
l’émir du Koweït dissout le Parlement et annonce des élections anticipées qui doivent intervenir dans un délai de soixante jours. | ||
7 décembre 2011 |
lors d’une interview à la chaîne américaine ABC, le président syrien revendique le soutien de la population mais reconnaît que des erreurs ont été commises par « certains responsables ». |
||
11 décembre 2011 |
l’assemblée constituante adopte une loi sur l’organisation provisoire des pouvoirs. |
||
12 décembre 2011 |
élection à la présidence de la République tunisienne, par l’assemblée constituante, de l’ancien opposant au régime Ben Ali Moncef Marzouki. |
organisation par le régime syrien d’élections municipales dans un contexte de désobéissance civile et de grève générale |
|
13 décembre 2011 |
le Haut-commissaire aux droits de l’homme des Nations unies estime le nombre de victimes de la répression syrienne a plus de 5 000 personnes. |
||
21 décembre 2011 |
deuxième phase des élections législatives en Egypte |
||
3 janvier 2012 |
dernière phase des législatives égyptiennes dans le dernier tiers du pays (le Sinaï, des gouvernorats de Haute et Moyenne-Egypte) où 15 millions d’Egyptiens sont appelés à voter |
||
5 janvier 2012 |
un Tunisien de 48 ans au chômage s’immole devant le gouvernorat de Gafsa, en Tunisie. |
||
15 janvier 2012 |
le roi du Bahreïn annonce une réforme constitutionnelle donnant davantage de pouvoirs au Parlement. Ce dernier pourra désormais demander des comptes aux ministres et refuser sa confiance au gouvernement. | ||
17 janvier |
reprise du procès de l’ancien président Hosni Moubarak |
||
21 janvier 2012 |
le Parlement yéménite approuve à l’unanimité un projet de loi accordant l’immunité totale au président Saleh, qui annonce le lendemain son départ aux Etats-Unis pour des soins de santé et demande pardon à ses compatriotes pour ses erreurs. | ||
22 janvier 2012 |
le siège du CNT, critiqué par une partie de la population pour son manque de transparence, est saccagé par des manifestants libyens. Son vice-président, Abdelhafidh Ghoga, démissionne. |
l’Arabie saoudite retire ses observateurs de la mission de la Ligue arabe, le gouvernement syrien n’ayant respecté aucune des clauses du plan arabe de sortie de crise. |
|
23 janvier 2012 |
au terme des élections législatives, le Parti de la liberté et de la justice (PLJ) et ses alliés remportent 235 sièges sur les 498 à pourvoir et le parti salafiste Al-Nour et ses alliés 123 sièges. le secrétaire général du PLJ, Saad al-Katatni, est élu président de l’Assemblée du peuple. |
||
le gouvernement syrien oppose une fin de non recevoir à la feuille de route de la Ligue arabe, qui propose un plan en quatre phases (le départ du président, la formation d’un gouvernement d’union nationale, l’organisation d’élections et l’appel à l’ONU pour soutenir cette feuille de route). |
|||
24 janvier 2012 |
la Syrie accepte la prolongation d’un mois de la mission de la Ligue arabe ; mais les six Etats du Conseil de coopération du Golfe décident de retirer leurs observateurs. |
||
25 janvier 2012 |
rassemblement des manifestants égyptiens sur la place Tahrir pour la célébration du premier anniversaire de la révolte égyptienne ; le maréchal Tantaoui, chef du CSFA, annonce la fin de l’état d’urgence. |
||
27 janvier 2012 |
manifestations de la « dignité » dans plusieurs grandes villes d’Egypte |
||
28 janvier 2012 |
le CNT annonce l’adoption de la loi électorale qui régira les élections de l’assemblée constituante en juin 2012. Le quota de 10 % de femmes prévu lors des travaux préparatoires est abandonné. |
la Ligue arabe suspend sa mission d’observation en Syrie en raison de la recrudescence des violences. |
le président yéménite Saleh arrive aux Etats-Unis. |
29 janvier 2012 |
Première phase des élections de la chambre haute égyptienne, la Choura ; le taux de participation est très faible, cette chambre étant probablement appelée à disparaître. |
début d’une grève de la faim de détenus et militants condamnés pour avoir participé aux manifestations anti-gouvernementales en 2010 au Bahreïn | |
Ban Ki Moon appelle Bachar el-Assad à « stopper le bain de sang ». |
|||
30 janvier 2012 |
l’armée syrienne prend le contrôle de la banlieue est de Damas. |
||
1er février 2012 |
des violences à la fin d’un match de football font 74 morts à Port-Saïd. |
||
2 février 2012 |
Début de trois jours d’affrontements au Caire, les manifestants dénonçant l’incapacité du pouvoir militaire à assurer la transition démocratique |
les islamistes remportent 34 des 50 sièges du Parlement koweitien lors des élections législatives anticipées ; aucune femme n’est élue | |
3 février 2012 |
nouveau gouvernement au Maroc, dirigé par l’islamiste Abdelilah Benkirane. |
||
4 février 2012 |
deuxième veto sino-russe en quatre mois au Conseil de sécurité des Nations unies concernant la situation en Syrie |
||
7 février 2012 |
La France rappelle une deuxième fois son ambassadeur à Damas « pour consultation » (après l’avoir fait mi-novembre). |
||
9 février 2012 |
annonce du président algérien Abdelaziz Bouteflika de la tenue d’élections législatives le 10 mai prochain |
la Ligue arabe renvoie des observateurs en Syrie. |
|
10 février 2012 |
affrontements à Tripoli entre Libanais favorables et hostiles au régime syrien |
||
12 février 2012 |
un projet de résolution de la Ligue arabe appelle l’ONU à envoyer des casques bleus en Syrie, demande la suspension de toute forme de coopération diplomatique avec elle et le renforcement des sanctions économiques. |
||
14 février 2012 |
bombardements violents à Homs |
||
15 février 2012 |
l’Organisation de la coopération islamique (OCI) se prononce en faveur d’une pression diplomatique accrue sur le régime de Bachar el-Assad pour le contraindre à négocier avec la communauté internationale et l’opposition dans son pays. |
||
CARTE
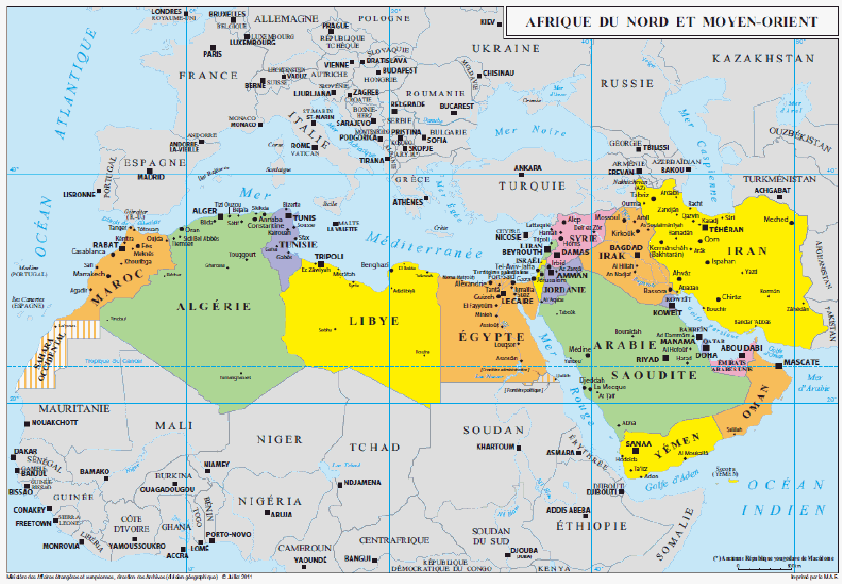
1 () Tzvetan Todorov, Les ennemis intimes de la démocratie », Paris, Robert Laffont - Versilo, 2012
2 () Il s’agit du Colonel Michel Goya, directeur d’études du domaine « nouveaux conflits » à l’Institut de Recherche stratégique de l’Ecole militaire, enseignant à l’Ecole pratique des Hautes études et aux Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan
© Assemblée nationale