![]()
N° 4485
——
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 mars 2012.
RAPPORT D’INFORMATION
déposé
en application de l’article 146-3 du Règlement
au nom du COMITÉ D’ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE
DES POLITIQUES PUBLIQUES
sur le bilan d’activité du Comité d’évaluation et de contrôle
des politiques publiques de 2009 à 2012
et présenté
par M. Bernard ACCOYER,
Président de l’Assemblée nationale
——
AVANT-PROPOS 5
INTRODUCTION 11
A.- LE CEC IMPLIQUE L’ENSEMBLE DES COMMISSIONS, TOUT EN ASSOCIANT ÉTROITEMENT MAJORITÉ ET OPPOSITION 12
1. Une activité mobilisant l’ensemble des commissions permanentes 12
2. Des travaux qui associent étroitement la majorité et l’opposition 13
B.- UNE RICHE BOÎTE À OUTILS À LA DISPOSITION DES RAPPORTEURS 16
1. De puissants outils juridiques 16
2. Un travail sur le terrain, en France, et à l’étranger 16
3. L’assistance de la Cour des comptes 17
4. La mobilisation d’expertises et de compétences externes, en complément des moyens des rapporteurs et du secrétariat du CEC 18
C.- QUELS RÉSULTATS DES TRAVAUX MENÉS ? 20
1. Des sujets caractérisés par leur diversité 20
2. Un travail de suivi systématique 23
3. Une discussion organisée avec le Gouvernement 24
4. Les premières suites données aux travaux du CEC 25
SYNTHÈSES ET RECOMMANDATIONS DES RAPPORTS, PRÉSENTÉES PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE DE PUBLICATION 29
– Principe de précaution : un acquis à améliorer 31
– Quartiers défavorisés ou ghettos inavoués : la République impuissante 43
– Les autorités administratives indépendantes : pour une indépendance sous la garantie du Parlement 57
– L’aide médicale de l'État : mieux gérer un dispositif nécessaire 71
– Évaluer le « Travailler plus pour gagner plus » 85
– Une médecine scolaire renforcée et rénovée au service de l'enfant 101
– Une évaluation de la RGPP : méthode, contenus, impacts financiers 107
– S’inspirer des meilleures pratiques européennes pour améliorer nos performances sociales 119
– Pour un service public efficace de l'hébergement et de l'accès au logement des plus démunis 133
– Territoires ruraux, territoires d'avenir 141
– Les leçons de la stratégie de Lisbonne : accélérer l'effort en matière de recherche et associer davantage les citoyens européens et les parlements nationaux aux décisions 155
Au rang des nombreuses avancées issues, au profit du Parlement, de la révision de la Constitution du 23 juillet 2008 (1), la moindre n’est pas celle qui a consisté, dans son nouvel article 24, à compléter expressément les deux missions traditionnelles du Parlement que sont le vote de la loi et le contrôle de l’action du Gouvernement, par l’évaluation des politiques publiques.
Cette révision constitutionnelle a, ce faisant, constitué une forme de couronnement juridique d’une démarche initiée antérieurement, soit de manière pragmatique, soit dans le cadre de textes de niveau moindre dans la hiérarchie des normes, qu’ils soient organiques ou ordinaires. Le Parlement avait ainsi adopté une proposition de loi instituant un Office mixte d’évaluation des politiques publiques dès 1996 (2). L’Assemblée nationale a ensuite créé la Mission d’évaluation et de contrôle (MEC) au sein de sa commission des Finances en 1999, à la suite des conclusions du groupe de travail sur le contrôle parlementaire et l’efficacité de la dépense publique. L’article 59 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 a introduit dans le droit budgétaire la notion de « mission de contrôle et d’évaluation ». Enfin, la Mission d’évaluation et de contrôle de l’exécution des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) a institué le pendant de la MEC dans le domaine social dès 2004, avant que la réforme de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale du 2 août 2005 ne lui confère un fondement organique (3). Plus généralement, les commissions permanentes, dans le cadre de leurs missions d’information, voire les commissions d’enquêtes sur des sujets plus ponctuels, ont pu réaliser des évaluations de politiques publiques, même sans qualifier ainsi leurs travaux.
C’est dans le prolongement de ces premiers jalons que j’ai eu l’honneur de proposer la création d’un organe parlementaire nouveau, ad hoc, le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC), en inscrivant les règles destinées à régir son fonctionnement dans la proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale, déposée à l’issue de travaux associant l’ensemble des groupes parlementaires, adoptée le 27 mai 2009 et entrée en vigueur le 26 juin suivant.
À l’évidence, il ne s’agissait ni de faire table rase d’un passé déjà riche d’expériences, ni de faire fi des compétences sectorielles propres à chaque commission permanente, dont le nombre avait au demeurant pu être porté de six à huit à la suite de la révision constitutionnelle de 2008. Aussi a-t-il été proposé que le CEC procède à des évaluations de politiques publiques dont le champ dépasserait la compétence d’une seule commission.
Le dispositif adopté a également fait une place importante à l’opposition en lui conférant un rôle doublement enrichi :
– dans l’initiative des sujets : sous réserve de s’inscrire dans la compétence du Comité, chaque groupe politique a été doté du droit de choisir un sujet à engager durant chaque session ordinaire. Au terme de la XIIIe législature, trois des quatre groupes parlementaires de l’Assemblée nationale, dont les deux appartenant à l’opposition (SRC et GDR), ont demandé et obtenu l’inscription au programme de travail du Comité de sujets de leur choix. Il n’échappera à personne que les thèmes retenus à la demande de l’opposition étaient en l’espèce caractérisés par une dimension politique réelle, puisqu’il s’agissait d’évaluer la révision générale des politiques publiques (RGPP), les dispositifs de promotion des heures supplémentaires et les incidences sur l’économie française de la stratégie de Lisbonne ;
– dans le mode de réalisation des évaluations : chaque sujet, conformément aux dispositions de notre nouveau Règlement, a été confié à deux co-rapporteurs, dont un appartenant à un groupe de l’opposition, chacun d’eux jouant exactement le même rôle.
Cette organisation a permis l’émergence d’une pratique parlementaire nouvelle, fondée sur le consensus, du moins pour dresser des constats objectifs des résultats des politiques menées. Ainsi, la totalité des onze sujets inscrits au programme de travail du CEC ont abouti à la présentation d’un rapport cosigné, unique, présenté au Comité, à la presse et dans quatre cas à l’Assemblée dans son ensemble lors de débats en séance publique en semaine de contrôle, en commun par les deux co-rapporteurs. De rares exceptions ont donné lieu à l’expression d’un positionnement différent quant à certaines recommandations proposées sur la base de ce constat partagé.
La constitution systématique car réglementaire de tels « binômes » de rapporteurs a représenté une avancée, tant interne au sein de l’Assemblée nationale, que vis-à-vis du Gouvernement, de l’administration, et des parties prenantes de la société civile. Nombre de rapporteurs ont indiqué, lors de la présentation de leurs travaux, avoir constaté que, sur le terrain comme lors des auditions, la présence simultanée de deux co-rapporteurs de sensibilité politique différente apparaissait comme un gage de distanciation et d’objectivité dans l’appréhension des sujets, en excluant les prises de position polémiques ou les postures souvent inhérentes à la démocratie parlementaire.
Ainsi que l’indique M. Pierre Avril, cette organisation structurellement équilibrée s’inscrit dans une conception renouvelée du contrôle parlementaire, « (…) œuvre commune de la majorité et de l’opposition, qui sont ensemble les interlocuteurs naturels du Gouvernement dans l’examen critique des politiques publiques ; ce contrôle manifeste ainsi l’identité de la représentation nationale en tant qu’institution face au Gouvernement et il désigne sa fonction spécifique au regard de l’exécutif » (4).
Dans le même sens, bien que la composition du CEC fût demeurée majoritaire (5), aucun rapport n’a donné lieu à un partage des voix au sein du Comité pour en autoriser la publication. De même, certains sujets, au-delà du droit de tirage des groupes, ont été choisis par consensus – j’en veux pour exemple le travail effectué sur les autorités administratives indépendantes, dont la multiplication suscite de légitimes interrogations, voire des inquiétudes, chez de nombreux parlementaires de toute sensibilité.
Telle est la force des rapports d’évaluation publiés par le CEC : exprimant des positions communes à la majorité et à l’opposition, associant dans ses travaux les différentes commissions compétentes concernées qui ont la possibilité de désigner des membres pour accompagner les rapporteurs, ces rapports constituent l’émanation d’une volonté parlementaire rassemblée, susceptible de peser face à l’exécutif.
La variété de la nature des onze sujets traités par le CEC a également démontré la souplesse et l’adaptabilité du dispositif. Ont ainsi été réalisées des évaluations de grandes politiques publiques plurisectorielles, telles que la politique de la ville ou de l’aménagement du territoire en milieu rural, ces évaluations ayant vocation à faire référence dans la durée ; mais aussi des évaluations de processus ou d’organisations administratives (Autorités administratives indépendantes, médecine scolaire, RGPP), de programmes plus délimités (aide médicale de l’État, dispositifs en faveur des heures supplémentaires, hébergement d’urgence), de législations (mise en œuvre du principe de précaution), de comparaisons internationales (performance comparée des politiques sociales en Europe), ou de déclinaisons nationales de politiques communautaires (évaluation des incidences de la stratégie de Lisbonne).
La mise en place du Comité s’est également accompagnée de la possibilité de faire appel à des moyens nouveaux : au-delà des services de l’Assemblée, les rapporteurs du Comité peuvent ainsi, selon les sujets, bénéficier de l’assistance de la Cour des comptes, ainsi que du concours d’experts ou de prestataires externes susceptibles de réaliser des études lourdes dans un délai court, en mobilisant moyens et compétences nécessaires.
En premier lieu, l’assistance de la Cour des comptes est prévue par le nouvel article 47-2 de la Constitution. Son principe a été précisé par l’article L. 132-5 du code des juridictions financières, issu de la loi du 3 février 2011 tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques, dont j’ai pris moi-même l’initiative. À la demande du Comité, deux évaluations ont été produites par la Cour en 2011. Je veux ici remercier son Premier président, M. Didier Migaud, pour son implication personnelle, ainsi que les deux chambres qui ont réalisé les travaux en question. Ces deux évaluations ont porté successivement sur la médecine scolaire et sur l’hébergement des personnes sans domicile.
Deux autres sujets ont fait l’objet d’une demande du CEC à la Cour, au profit du nouveau Comité qui sera mis en place au début de la XIVe législature. Les sujets retenus par le Comité, qui ont recueilli l’accord de la majorité et de l’opposition, ont été voulus consensuels et susceptibles d’intéresser toutes les composantes de l’Assemblée, dans des domaines différents. C’est ainsi qu’il a été proposé à la Cour de procéder à des évaluations des politiques de lutte contre le tabagisme et des politiques en faveur de la création d’entreprises. Il appartiendra au nouveau CEC de désigner ses rapporteurs le moment venu.
Pour quatre autres sujets traités, les rapporteurs ont souhaité bénéficier du concours de prestataires retenus dans le cadre de procédures de marché public, sur appel d’offres. Sept études ont ainsi pu être réalisées en 2010 et 2011, permettant aux rapporteurs du Comité de bénéficier de ressources humaines allant au-delà de la petite équipe des administrateurs du secrétariat du CEC et de compétences spécifiques sur le fond comme sur la méthode.
Ces outils constituent autant de moyens pour traiter de sujets, parfois très larges. Trop larges peut-être même quelquefois pour être traités dans leur intégralité dans le délai d’un an imparti par le Règlement, délai pourtant long à l’aune du temps parlementaire. Il conviendrait, pour éviter de mobiliser une part excessive de ces douze mois à définir les contours du sujet qu’il est effectivement possible, sinon pertinent, d’étudier, que les intitulés des demandes formulées par les groupes politiques ou les commissions précisent plus les objectifs des études. Dans certains cas, le Comité n’échappera cependant pas à la nécessité d’une première étape consistant à demander à deux rapporteurs de réaliser une étude de faisabilité, de sorte que le travail s’engage ensuite sur un terrain bien défini. Cette option a été mise en œuvre pour le premier sujet proposé par le principal groupe de l’opposition au titre de son droit de tirage, initialement intitulé « Politiques publiques et évolution des inégalités sociales », qu’il est apparu difficile de retenir tel quel dans le cadre du Comité. L’étude de faisabilité a permis aux deux rapporteurs désignés à cet effet de proposer d’un commun accord un sujet aux ambitions plus limitées, susceptible d’être effectivement traité dans le délai prévu, avec un intitulé devenu « l’évaluation des mesures fiscales et sociales en faveur des heures supplémentaires », confié aux deux mêmes rapporteurs.
C’est également dans une approche consensuelle et constructive qu’ont été diffusés les résultats des travaux réalisés aux organes compétents de l’Assemblée. Non seulement le Comité associe, dans sa composition, l’ensemble des présidents des organes institutionnels de l’Assemblée, garantissant ainsi la prise en considération de toutes les sensibilités thématiques, mais, au surplus, l’habitude a commencé à se prendre de demander aux rapporteurs du Comité de présenter leurs travaux aux commissions les plus concernées au fond. Cinq présentations ont ainsi déjà eu lieu, devant quatre commissions. Cette orientation pourrait utilement être poursuivie, amplifiée voire systématisée dès lors que le sujet s’y prête.
Au-delà de la présentation des rapports, j’ai personnellement veillé à ce que soit respectée l’impérieuse obligation d’un suivi attentif, précis et exhaustif de la mise en œuvre des recommandations qui concluent ces rapports. Car il n’est pas de travail plus contreproductif que celui de – trop nombreux – remarquables rapports parlementaires qui, une fois la vague médiatique passée, restent lettre morte, ne faisant l’objet d’aucune suite parlementaire, jusqu’au prochain rapport sur le même sujet, quelques années plus tard… lequel redécouvrira immanquablement la richesse des travaux et l’opportunité des conclusions présentés dans le précédent rapport.
Le chemin avait été montré avec l’introduction dans notre règlement des rapports d’application de la mise en œuvre des lois (6). Ce suivi était et reste en revanche beaucoup moins fréquent s’agissant des autres travaux de l’Assemblée (7).
Or la revalorisation effective du Parlement, au-delà des textes, passe par l’exercice de tous les pouvoirs, outils, moyens mis à sa disposition par la révision constitutionnelle de 2008, et tient surtout à la ténacité des parlementaires impliqués : aussi ai-je souhaité que le suivi de chaque rapport du Comité, dont le principe a été inscrit dans le Règlement de notre Assemblée, soit effectivement réalisé de manière systématique par le binôme des rapporteurs du rapport originel. Compte tenu de l’existence encore récente du Comité – la conclusion de ses premiers travaux datant seulement de l’été 2010 –, seuls les cinq premiers des onze rapports d’évaluation publiés ont pu faire l’objet d’un premier rapport de suivi publié et transmis au Gouvernement. Ce suivi a d’ailleurs permis de relever que plusieurs recommandations, et non des moindres, ont été retenues spontanément par le Gouvernement, dans le cadre notamment des projets de lois de finances ou de financement de la sécurité sociale, par l’Assemblée seule lorsqu’elle a adopté sans opposition une proposition de résolution inscrite à l’ordre du jour d’une semaine de contrôle, ou par le Parlement dans son ensemble, sous la forme d’amendements parlementaires, devenus articles de lois en vigueur.
Certes, l’apprentissage de l’évaluation parlementaire n’est pas le fait que du Parlement : il incombe également au Gouvernement de se plier à cet exercice démocratique, peut-être nouveau, mais essentiel : qu’il s’agisse de répondre aux sollicitations et aux interrogations des rapporteurs dans leurs investigations initiales ou dans la phase de suivi des rapports, des améliorations restent en l’espèce possibles. Certaines administrations et ministres se sont pliés de bonne grâce à cet exercice contraignant, sachant au demeurant qu’ils bénéficieraient tout autant que le Parlement des résultats de ces travaux, réalisés dans un cadre innovant qui exclue préjugés et a priori. D’autres moins, sans doute. La pratique, le temps et la volonté politique d’appliquer la Constitution révisée dans toutes ses dimensions permettront, j’en suis certain, de progresser.
À l’issue de la législature, demeurent six rapports, examinés et publiés entre le mois de novembre 2011 et de février 2012, qui n’auront matériellement pu faire l’objet d’un suivi de leurs conclusions. Il me semble hautement souhaitable que, au-delà du changement de législature et quelles que soient la majorité et l’opposition qui se dégageront des élections, ces six rapports retiennent l’attention du nouveau Comité qui sera constitué après celles-ci, pour en organiser le suivi. Certains des premiers rapports du CEC, qui ont déjà fait l’objet d’un rapport de suivi, devraient en outre également continuer à faire l’objet de revues régulières, tant leur objet, vaste, nécessite du temps pour leur mise en œuvre, et parce qu’ils constituent des documents et des constats de référence pour l’avenir : j’en veux notamment pour exemple les travaux réalisés au sujet de la politique de la ville.
Je voudrais, à l’usage de ceux qui auront en mains ce bel outil qu’est le CEC, résumer mes prescriptions sous forme d’une brève ordonnance :
• limiter le nombre d’études d’évaluation et le champ de chacune,
• suivre l’application des recommandations à intervalles réguliers et questionner à ce sujet le Gouvernement autant de fois que nécessaire,
• mener ces tâches dans un esprit de coopération entre la majorité et l’opposition et de dialogue avec l’Exécutif.
C’est ainsi que le sillon tracé par les deux premières années du Comité pourra prouver son utilité pour le Parlement de demain, pour le plus grand profit des citoyens, et pour répondre aux attentes d’une République moderne.
Bernard ACCOYER,
Président de l’Assemblée nationale,
Président du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques
Le CEC, dont la création résulte de l’adoption le 27 mai 2009 de la résolution n° 1546 tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale, validée par la décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2009, a tenu sa réunion constitutive le 2 juillet 2009.
Il a connu ensuite une phase de démarrage progressive de son activité, avec 4 réunions en 2009, 8 en 2010, 9 en 2011, et 3 en janvier et février 2012. Ce total de 25 réunions plénières correspond à un rythme approximativement mensuel. Toutes ces réunions, sauf deux, se sont tenues sous la présidence du Président de l’Assemblée nationale, président de droit du Comité.
Durant cette période d’activité, le CEC a publié onze rapports d’évaluation de politiques publiques ou de législation, cinq rapports de suivi, et deux rapports ayant un objet un peu différent puisque portant l’un sur l’analyse des études d’impact accompagnant obligatoirement les projets de loi depuis le 1er septembre 2009, et l’autre sur le bilan des mesures prises pour l’application des recommandations du rapport de la Commission pour la libération de la croissance française, présidée par M. Jacques Attali.
En limitant l’analyse de l’activité du CEC aux onze évaluations de politiques publiques, correspondant à sa mission principale prévue par l’article 146-3 du Règlement, il apparaît que, sur les trente-deux mois courant de juillet 2009 à février 2011, le Comité a :
– publié plus de 2 601 pages (hors annexes, études commandées et contributions demandées à la Cour des comptes),
– procédé à 237 auditions et tables rondes,
– réalisé 32 missions, à raison de 23 en France métropolitaine et 9 à l’étranger,
– demandé l’assistance de la Cour des comptes pour deux évaluations et fait réaliser sept études par des prestataires externes.
A.- LE CEC IMPLIQUE L’ENSEMBLE DES COMMISSIONS, TOUT EN ASSOCIANT ÉTROITEMENT MAJORITÉ ET OPPOSITION
1. Une activité mobilisant l’ensemble des commissions permanentes
L’article 146-3 du Règlement dispose que « chaque commission concernée par l’objet d’une étude d’évaluation désigne un ou plusieurs de ses membres pour participer à celle-ci. Le comité désigne parmi eux, ou parmi ses propres membres, deux rapporteurs, dont l’un appartient à un groupe d’opposition ».
Les onze rapports publiés par le CEC entre 2010 et 2012 ont mobilisé 22 rapporteurs différents, aucun rapporteur n’ayant été chargé de plus d’une évaluation. Les rapporteurs ont représenté l’ensemble des commissions permanentes, à l’exception de la commission des Affaires étrangères. La commission des Affaires sociales a désigné le plus de rapporteurs (à raison de six), les autres commissions ayant désigné entre 1 et 3 rapporteurs du CEC parmi leurs membres.
Ces 22 rapporteurs ont été entourés dans leurs travaux par 61 autres députés (8) désignés par les commissions ou par le Comité. Le nombre total de membres des groupes de travail désignés par chaque commission permanente est variable : la commission en ayant désigné le plus étant la commission des Affaires sociales (17 membres), puis celles des Affaires culturelles et des Affaires économiques (14 membres chacune), la commission des Finances (11 membres), et les autres moins de dix membres. La commission des Affaires étrangères n’a désigné aucun membre compte tenu de la nature des sujets traités.
En moyenne, entre sept et huit députés ont été désignés pour suivre chaque sujet, avec un minimum de quatre pour quatre évaluations, et un maximum de 15 députés pour l’évaluation de la RGPP (soit 7 commissions (9)), suivi de 12 (soit 6 commissions) pour l’évaluation des politiques d’aménagement du territoire en milieu rural et le rapport sur les autorités administratives indépendantes, et 11 (soit 6 commissions) pour la stratégie de Lisbonne.
Après la présentation du rapport devant le CEC, plusieurs rapports ont fait l’objet d’une présentation par les mêmes rapporteurs devant la ou les commission(s) la plus compétente au fond. Tel a été le cas :
– de l’évaluation des autorités administratives indépendantes devant la commission des Lois, en 2010 ;
– et en janvier et février 2012 :
– du rapport sur la performance comparée des politiques sociales en Europe, devant la commission des Affaires sociales puis la commission des Affaires européennes ;
– de l’évaluation de la politique de l’hébergement d’urgence devant la commission des Affaires sociales ;
– de l’évaluation des politiques d’aménagement du territoire en milieu rural devant la commission du Développement durable.
Enfin, les commissions permanentes ont pu donner suite à certaines recommandations issues de rapports du Comité, en particulier s’agissant de travaux déclinant, dans leur champ de compétences respectif, certaines préconisations formulées par le CEC à un niveau transversal (cf. infra).
2. Des travaux qui associent étroitement la majorité et l’opposition
Ainsi que le prévoit le Règlement, chacune des évaluations inscrites au programme de travail du CEC en application de l’article 146-3 du Règlement a été confiée à deux rapporteurs, de la majorité et de l’opposition, jouant exactement le même rôle institutionnel, soit 11 rapporteurs de la majorité, et 11 de l’opposition.
L’article 1er de la loi du 3 février 2011 a d’ailleurs complété l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaire pour préciser dans le II de son article 5 ter que « lorsque les instances permanentes créées au sein de l’une des deux assemblées parlementaires pour contrôler l’action du Gouvernement ou évaluer des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d’une seule commission permanente disposent (…) des prérogatives mentionnées à l’article 6 [pouvoirs d’enquête], les rapporteurs qu’elles désignent exercent leur mission conjointement ». C’est d’ailleurs pour cette raison que le Comité a décidé que les noms de ses rapporteurs apparaîtraient dans les rapports dans un ordre exclusivement alphabétique.
L’ensemble des membres des groupes de travail s’est également avéré politiquement équilibré, sinon paritaire, en comptant 41 membres de la majorité et 42 de l’opposition. Le nombre de membres de l’opposition a été légèrement supérieur à celui de la majorité dans trois cas, légèrement inférieur dans deux cas, et égal dans les six autres cas. En tout état de cause, les conclusions des rapports ont été présentées par les rapporteurs à leur groupe de travail respectif, mais dans aucun cas n’ont donné lieu à un vote, les rapporteurs privilégiant la recherche du consensus. De même, les décisions d’inscription au programme de travail et d’autorisation de publication des travaux par le Comité lui-même n’ont dans aucun cas donné lieu à un vote mais ont été prises par consensus.
S’agissant du choix des sujets, sur les onze rapports, quatre ont été proposés par l’opposition, dont trois au titre du « droit de tirage » annuel des groupes (évaluation des dispositifs en faveur des heures supplémentaires et RGPP pour le groupe SRC au titre respectivement des sessions 2009-2010 et 2010-2011, évaluation des incidences de la stratégie de Lisbonne sur l’économie française pour le groupe GDR en 2011), et un par consensus avec la majorité (autorités administratives indépendantes, proposé par le groupe SRC).
Cinq autres sujets ont été choisis sur proposition du groupe UMP (dans l’ordre chronologique : quartiers défavorisés, aide médicale de l’État et hébergement d’urgence au titre de la session 2009-2010, performance des politiques sociales en Europe et aménagement du territoire en milieu rural au titre de la session 2010-2011).
Les deux derniers sujets ont été proposés par le Président de l’Assemblée nationale, président du Comité, soit seul (médecine scolaire, en 2010-2011) soit conjointement avec un président de commission (mise en œuvre du principe de précaution inscrit à l’article 5 de la Charte de l’environnement au titre de la session 2009-2010, avec le président de la commission des Affaires économiques).
Enfin, s’agissant du contenu des rapports et des recommandations qui les concluent, la totalité des rapports a donné lieu à la publication d’un document unique, présentant un constat entièrement partagé par les deux rapporteurs. Dans trois cas seulement, des conclusions et points de vue différents ont été exprimés par les deux rapporteurs sur des sujets particulièrement politiques (aide médicale de l’État, RGPP, incidences de la stratégie de Lisbonne sur l’économie française).
Sujet / organe désignant des membres des groupes de travail |
Affaires culturelles |
Affaires économiques |
Affaires étrangères |
Affaires sociales |
Développement durable |
Défense |
Finances |
Lois |
Affaires européennes |
CEC |
total | |||
Principe de précaution |
2 |
2 |
4 | |||||||||||
Quartiers défavorisés |
2 |
2 |
1 |
2 |
7 | |||||||||
Autorités administratives indépendantes |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
12 | |||||||
Aide médicale d’État |
2 |
2 |
4 | |||||||||||
Dispositif en faveur des heures supplémentaires |
2 |
1 |
1 |
4 | ||||||||||
Médecine scolaire |
3 |
2 |
5 | |||||||||||
RGPP |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
15 | |||||
Performance des politiques sociales en Europe |
1 |
1 |
2 (dont 1 membre désigné aussi par la commission des Affaires culturelles) |
2 |
5 | |||||||||
Hébergement d’urgence |
2 |
2 |
4 | |||||||||||
Aménagement du territoire en milieu rural |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
12 | |||||||
Stratégie de Lisbonne |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
11 | |||||||
|
||||||||||||||
total |
14 |
14 |
0 |
17 |
8 |
2 |
11 |
6 |
4 |
8 |
83 |
B.- UNE RICHE BOÎTE À OUTILS À LA DISPOSITION DES RAPPORTEURS
1. De puissants outils juridiques
En application de l’article 1er de la loi n° 2011-140 du 3 février 2011 tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques, qui a introduit un nouvel article 5 ter dans l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires (10), les rapporteurs du Comité ont la faculté de demander à l’Assemblée de leur accorder des pouvoirs d’enquête identiques à ceux des rapporteurs des commissions d’enquête.
Cette faculté a été introduite dans le droit en vigueur au cas où l’accès des rapporteurs du Comité à certaines informations nécessaires mais sensibles ou confidentielles, s’avérerait impossible. Elle permettrait en effet aux rapporteurs, exerçant leur mission sur pièces et sur place, pour une durée maximale de six mois et pour un objet déterminé, d’obtenir que tous les renseignements de nature à faciliter cette mission leur soient obligatoirement fournis. Les rapporteurs seraient alors « habilités à se faire communiquer tous documents de service, à l’exception de ceux revêtant un caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l’État, et sous réserve du respect du principe de la séparation de l’autorité judiciaire et des autres pouvoirs ».
Grâce à la coopération active du Gouvernement, qui a permis l’accès aux informations demandées, y compris dans des domaines a priori régaliens – parfois après un courrier du président du CEC –, il n’a pas été nécessaire à ce jour de mobiliser ce droit de communication.
2. Un travail sur le terrain, en France, et à l’étranger
Les rapporteurs du Comité ont effectué 24 missions en France (10 en Île-de-France, 14 en province) et 9 à l’étranger (dans 6 pays différents (11), un seul se trouvant en dehors de l’Union européenne), et ce pour huit des onze évaluations réalisées.
L’ensemble des sujets pour lesquels une comparaison internationale a paru nécessaire a donné lieu à l’élaboration d’un questionnaire adressé, suivant les cas, soit à nos postes et missions diplomatiques, soit aux parlements des pays concernés.
Le thème de la comparaison des performances des politiques sociales en Europe appelle un commentaire particulier : les comparaisons qu’il requérait dans les différents pays retenus (en l’espèce un ensemble de cinq pays, outre la France, constitué de l’Allemagne, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni et de la Suède), ont été réalisées de manière complémentaire dans le cadre des études confiées à des prestataires et de questionnaires adressés aux postes diplomatiques français et aux parlements des pays concernés, ainsi que par des visites sur place, permettant aux rapporteurs de rencontrer des représentants des parties prenantes.
3. L’assistance de la Cour des comptes
La révision de la Constitution de 2008 a inscrit dans son article 47-2 le principe selon lequel « la Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement (…) dans l’évaluation des politiques publiques ».
Cette disposition constitutionnelle a été précisée par l’article 3 de la loi du 3 février 2011 précitée, qui a introduit dans le code des juridictions financières un nouvel article L. 132-5 ainsi rédigé :
Art. L. 132-5 du code des juridictions financières
Au titre de l’assistance au Parlement dans le domaine de l’évaluation des politiques publiques prévue par l’article 47-2 de la Constitution, la Cour des comptes peut être saisie d’une demande d’évaluation d’une politique publique par le président de l’Assemblée nationale ou le président du Sénat, de leur propre initiative ou sur proposition d’une commission permanente dans son domaine de compétence ou de toute instance permanente créée au sein d’une des deux assemblées parlementaires pour procéder à l’évaluation de politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d’une seule commission permanente.
Les demandes formulées au titre du premier alinéa ne peuvent porter ni sur le suivi et le contrôle de l’exécution des lois de finances ou de financement de la sécurité sociale, ni sur l’évaluation de toute question relative aux finances publiques ou aux finances de la sécurité sociale.
L’assistance de la Cour des comptes prend la forme d’un rapport. Ce rapport est communiqué à l’autorité qui est à l’origine de la demande, dans un délai qu’elle détermine après consultation du premier président de la Cour des comptes et qui ne peut excéder douze mois à compter de la saisine de la Cour des comptes.
Le président de l’Assemblée nationale ou le président du Sénat, lorsqu’il est à l’initiative de la demande d’assistance de la Cour des comptes, et, dans les autres cas, la commission permanente ou l’instance permanente à l’origine de la demande d’assistance de la Cour des comptes statue sur la publication du rapport qui lui a été transmis.
Sur le fondement de ce nouveau dispositif, le président du CEC a demandé à la Cour des comptes d’assister les rapporteurs du Comité pour deux évaluations, portant respectivement, sur la médecine scolaire et sur la politique d’hébergement des personnes sans domicile.
Chacun de ces deux rapports a fait l’objet d’une audition publique du Premier président, M. Didier Migaud, par le Comité, le rapport du Comité ayant été présenté ensuite dans un délai court grâce à la coordination entre la Cour et les rapporteurs du Comité durant le déroulement des travaux de la juridiction financière.
Les rapports de la Cour des comptes ont été publiés en intégralité, sous la forme d’annexes au rapport du Comité, accompagnés du compte rendu de l’audition du Premier président. Ils sont également accessibles directement dans les pages internet de l’Assemblée nationale consacrées au CEC.
4. La mobilisation d’expertises et de compétences externes, en complément des moyens des rapporteurs et du secrétariat du CEC
Faisant application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 146-3 du Règlement qui prévoit que « pour conduire les évaluations, les rapporteurs peuvent également bénéficier du concours d’experts extérieurs à l’Assemblée », plusieurs binômes de rapporteurs du CEC ont souhaité faire réaliser des études par des prestataires externes, sur des aspects particuliers de la mission qui leur avait été confiée. Ces études ont été commandées avec l’accord du Comité, sollicité systématiquement à l’occasion de points d’étape pour valider ces démarches nouvelles.
Les prestataires proposés au collège des Questeurs ont été retenus dans tous les cas par un accord à la fois des deux rapporteurs concernés et des deux vice-présidents du Comité délégués à cette mission.
Ont ainsi été réalisées, entre juin et septembre 2010, deux études commandées par les rapporteurs de l’évaluation des politiques en faveur des quartiers défavorisés, dans le cadre de marchés publics :
– une synthèse des travaux d’évaluation publiés dans le domaine de la politique de la ville, confiée à deux universitaires spécialistes de ce domaine (MM. Thomas Kirszbaum et Renaud Epstein) ;
– une synthèse des travaux d’évaluation effectués par environ 25 communes au titre de leur contrat urbain de cohésion sociale (Cucs), confiée à un cabinet spécialisé notamment dans l’évaluation de la politique de la ville (ECs).
Pour réduire les délais de procédure tout en préservant le principe d’une mise en concurrence systématique, le CEC a ensuite pu s’inscrire dans un accord-cadre pour des évaluations de politiques publiques, passé selon une procédure d’appel d’offres ouvert (12).
Les rapporteurs du Comité ont ainsi pu bénéficier de cinq études commandées à des prestataires externes, réalisées durant l’année 2011, pour trois thèmes d’évaluation :
– l’évaluation de la RGPP, avec une étude confiée à Ernst & Young, pour deux évaluations concernant la nouvelle procédure de réalisation et de distribution respectivement des passeports biométriques et des certificats d’immatriculation des véhicules ;
– l’évaluation de la performance des politiques sociales en Europe, avec deux études confiées au groupement KPMG-Sciences Po et Euréval, pour respectivement :
• une étude sur les politiques d’articulation entre vie familiale et vie professionnelle et les politiques envers les familles monoparentales dans plusieurs pays européens (Allemagne, France, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède), réalisée par Sciences Po expertise et conseil / OFCE, CEE, Liepp, et qui a mobilisé des experts français des politiques considérées connaissant les pays concernés ;
• une étude comparée concernant la politique de l’emploi dans plusieurs pays européens (Allemagne, France, Portugal, Royaume-Uni et Suède) réalisée par le cabinet Euréval avec le concours d’experts étrangers des pays considérés ;
– l’évaluation des politiques publiques d’aménagement du territoire, avec deux études confiées au groupement Kurt Salmon-Edater, portant respectivement sur :
Ces études ont toutes fait l’objet d’une présentation aux rapporteurs, ainsi qu’aux membres du groupe de travail. Dans un cas, l’étude produite (relative à la comparaison de certaines politiques familiales en Europe) a donné lieu à un séminaire de travail parlementaire, organisé à l’initiative des deux rapporteurs, ouvert à des experts du domaine et aux membres du Comité, du groupe de travail et de la commission compétente concernée.
En application du principe de transparence, toutes ces études ont été publiées en annexe aux rapports au titre desquels elles ont été demandées. Pour des raisons matérielles et de coût, certains documents complémentaires ont été publiés uniquement au sein des pages internet du CEC (13).
En 2010, 352 pages d’études extérieures (cf. supra) constituaient une annexe au rapport sur les quartiers défavorisés. En 2011, 375 pages publiées correspondent à des études extérieures (149 pages pour l’étude Ernst & Young pour la RGPP, 226 pages pour les études Euréval et Sciences Po pour le rapport sur la performance des politiques sociales en Europe). Enfin, en 2012, 302 pages ont été publiées au titre des deux études annexées au rapport sur l’évaluation de l’aménagement du territoire en milieu rural. Au total, les sept études réalisées entre 2010 et 2012 auront donc représenté 1 029 pages publiées.
L’accord-cadre évoqué supra a été renouvelé en décembre 2011 pour une durée d’au moins un an et constituera un outil immédiatement disponible pour le nouveau CEC, le moment venu.
C.- QUELS RÉSULTATS DES TRAVAUX MENÉS ?
1. Des sujets caractérisés par leur diversité
Dans l’ordre chronologique de leur publication, le CEC a autorisé la publication des onze rapports d’évaluation suivants :
• Principe de précaution : un acquis à améliorer (rapport d’information n° 2719, présenté le 8 juillet 2010 par MM. Alain Gest et Philippe Tourtelier) ;
• Les autorités administratives indépendantes : pour une indépendance sous la garantie du Parlement (rapport d’information n° 2925, présenté le 28 octobre 2011 par MM. René Dosière et Christian Vanneste) ;
• Quartiers défavorisés ou ghettos inavoués : La République impuissante (rapport d’information n° 2853, présenté le 21 octobre 2011 par MM. François Goulard et François Pupponi) ;
• L’évaluation de l’aide médicale de l’État : mieux gérer un dispositif nécessaire (rapport d’information n° 3524, présenté le 9 juin 2011 par MM. Claude Goasguen et Christophe Sirugue) ;
• Évaluer le « travailler plus pour gagner plus » (rapport d’information n° 3615, présenté le 30 juin 2011 par MM. Jean-Pierre Gorges et Jean Mallot) ;
• Une médecine scolaire renforcée et rénovée au service de l’enfant (rapport d’information n° 3968, présenté le 17 novembre 2011 par M. Gérard Gaudron et Mme Martine Pinville) ;
• Une évaluation de la RGPP : méthode, contenus, impacts financiers (rapport d’information° 4019, présenté le 1er décembre 2011 par MM. François Cornut-Gentille et Christian Eckert) ;
• S’inspirer des meilleures pratiques européennes pour améliorer nos performances sociales (rapport d’information n° 4098, présenté le 15 décembre 2011 par MM. Michel Heinrich et Régis Juanico) ;
• Territoires ruraux, territoires d’avenir (rapport d’information n° 4301, présenté le 2 février 2012 par MM. Jérôme Bignon et Germinal Peiro) ;
• Pour un service public efficace de l’hébergement et de l’accès au logement des plus démunis (rapport d’information n° 4221, présenté le 26 janvier 2012 par Mme Danièle Hoffman-Rispal et M. Arnaud Richard) ;
• Les leçons de la stratégie de Lisbonne : accélérer l’effort en matière de recherche et associer davantage les citoyens européens et les parlements nationaux aux décisions (rapport d’information n° 4364 présenté le 16 février 2012 par MM. Philippe Cochet et Marc Dolez).
La diversité des sujets traités, tant par leur objet que par leur périmètre, montre la souplesse du dispositif, qui a pu répondre aux besoins. Ces rapports traitent en effet, selon les cas :
– de politiques publiques très transversales (quartiers défavorisés, aménagement du territoire en milieu rural) ou de programmes plus resserrés (aide médicale de l’État, dispositifs de promotion des heures supplémentaires, hébergement d’urgence),
– de politiques comme d’organisations publiques, uniques (médecine scolaire) ou multiples (autorités administratives indépendantes, RGPP),
– de législations (mise en œuvre du principe de précaution inscrit dans la charte de l’environnement, article 1er de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite loi « Tepa »),
– de comparaisons internationales de certaines politiques et de leurs performances (performance des politiques sociales en Europe),
– ou encore de l’impact sur l’économie française d’un outil communautaire (évaluation des incidences de la stratégie de Lisbonne).
S’agissant de la méthodologie, la durée des travaux des rapporteurs a pu sensiblement varier en fonction de l’ampleur de la tâche qui leur était impartie, avec une moyenne de 10 mois, un minimum de 5 mois – pour l’évaluation du dispositif de promotion des heures supplémentaires, dont les rapporteurs avaient cependant bénéficié antérieurement d’une longue période de préparation d’une étude de faisabilité – et un maximum de 14 mois – cette durée tenant compte de la nécessité de disposer préalablement du rapport demandé à la Cour des comptes (hébergement d’urgence).
Le Comité a procédé à la discussion d’un point d’étape pour 7 sujets, après un délai moyen de 4 mois.
Les rapporteurs ont procédé au total à 237 auditions (correspondant à un nombre substantiellement plus élevé de personnes entendues puisque les auditions ont concerné de une à dix personnes), soit une moyenne de 21 auditions par évaluation.
Dans tous les cas, une attention particulière a été portée à la prise en compte de la perception des dispositifs par leurs bénéficiaires, sous la forme d’auditions, de tables rondes, de questionnaires, ou même de sondages (notamment dans le cas de l’hébergement d’urgence et de l’évaluation de mesures spécifiques issues de la RGPP affectant directement les usagers de l’administration) ainsi que, pour orienter les démarches à entreprendre, à la consultation d’experts du domaine considéré.
De même, les travaux ont systématiquement associé les diverses catégories de parties prenantes, qu’il s’agisse des usagers personnes physiques et morales, comme évoqué précédemment, des organisations et administrations en charge de ces politiques, de leurs partenaires institutionnels…
Par ailleurs, le CEC a publié deux rapports différant par leur nature de ses autres travaux d’évaluation :
– le premier rapport du CEC (n° 2094 du 19 novembre 2009, présenté par MM. Claude Goasguen et Jean Mallot) a porté sur les critères de contrôle des études d’impact accompagnant les projets de loi depuis le 1er septembre 2009 en application de l’article 15 de la loi organique du 15 avril 2009 prise sur le fondement de l’article 39 de la Constitution dans sa rédaction issue de la révision de 2008. Ce premier travail découlait de l’introduction, à l’article 146-5 du Règlement de l’Assemblée nationale, de la faculté ouverte aux présidents des commissions permanentes saisies au fond d’un projet de loi ou au Président de l’Assemblée de demander au CEC de donner un avis sur la conformité des études d’impact aux règles organiques ;
– le deuxième rapport du CEC (n° 2492 du 5 mai 2010, présenté par MM. Jean Gaubert et Louis Giscard d’Estaing) a mobilisé l’ensemble des commissions permanentes pour réaliser un bilan de la mise en œuvre des propositions formulées en janvier 2008 par la Commission pour la libération de la croissance française présidée par M. Jacques Attali. Seul le CEC, par son caractère transversal, était en mesure de collecter et de synthétiser ces éléments s’inscrivant dans tous les domaines de l’action publique.
2. Un travail de suivi systématique
Conformément aux dispositions de l’article 146-3 du Règlement, « les recommandations du comité sont transmises au Gouvernement. Les réponses des ministres sont attendues dans les trois mois et discutées pendant la semaine prévue à l’article 48, alinéa 4, de la Constitution. » Les rapports et les recommandations qui les concluent ont en conséquence été transmis, immédiatement après leur publication, par le Président de l’Assemblée nationale au Premier ministre et aux ministres compétents. Les réponses ont substantiellement varié, tant par leur rapidité que par leur contenu.
S’agissant notamment du rapport sur les autorités administratives indépendantes, les rapporteurs ont ainsi été destinataires à la fois d’une réponse d’ensemble très développée du Premier ministre au titre des autorités dont le financement est assuré par le programme 308 « Protection des droits et libertés » au sein de la mission « Direction de l’action du Gouvernement », et de réponses des ministres concernant les autorités de leur domaine sectoriel de compétences respectif.
D’autres réponses ont été plus limitées, voire, dans quelques cas, n’ont pas été transmises.
Au-delà, à l’issue de la XIIIe législature, parmi les onze évaluations réalisées par les rapporteurs du CEC, les cinq premiers rapports publiés ont déjà fait l’objet du rapport de suivi prévu par le huitième alinéa (cf. supra) de l’article 146-3 du Règlement, et confié aux deux rapporteurs du rapport d’origine :
• suivi des conclusions du rapport sur l’évaluation des aides aux quartiers défavorisés (rapport de suivi n° 3969, présenté le 17 novembre 2011 par MM. François Goulard et François Pupponi) ;
• suivi des conclusions du rapport sur l’évaluation de la mise en œuvre du principe de précaution (rapport de suivi n° 3970, présenté le 17 novembre 2011 par MM. Alain Gest et Philippe Tourtelier), et proposition de résolution (n° 4008) sur ce sujet, adoptée le 1er février 2012 (texte adopté n° 837) ;
• suivi des conclusions du rapport sur les autorités administratives indépendantes (rapport de suivi n° 4020, présenté le 1er décembre 2011 par MM. René Dosière et Christian Vanneste) ;
• suivi des conclusions du rapport sur l’évaluation des dispositifs en faveur des heures supplémentaires (rapport d’information n° 4220, présenté le 26 janvier 2012 par MM. Jean-Pierre Gorges et Jean Mallot) ;
• suivi des conclusions du rapport sur l’évaluation de l’aide médicale de l’État (rapport d’information n° 4363, présenté le 16 février 2012 par MM. Claude Goasguen et Christophe Sirugue).
Ces rapports de suivi ont été publiés dans un délai de 7 à 16 mois après la publication du rapport d’évaluation, avec une moyenne de 11 mois et demi, ce délai variant en fonction de la nature du sujet et des recommandations dont il s’agissait d’examiner la mise en œuvre.
Il demeure donc six rapports, publiés depuis le 15 novembre 2011, à n’avoir pas encore fait l’objet d’un tel travail de suivi, compte tenu de leur parution récente. Dans l’ordre chronologique de leur présentation devant le CEC, il s’agit des évaluations portant sur les sujets suivants :
– la médecine scolaire ;
– la RGPP ;
– les performances des politiques sociales en Europe ;
– la politique d’hébergement d’urgence ;
– les politiques d’aménagement du territoire en milieu rural ;
– les incidences de la stratégie de Lisbonne sur l’économie française.
3. Une discussion organisée avec le Gouvernement
Dans le prolongement de l’article 47 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la révision de 2008, dont le quatrième aliéna dispose que : « une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l’ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques », l’article 146-7 du Règlement prévoit que « le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques peut faire des propositions à la Conférence des présidents concernant l’ordre du jour de la semaine prévue par l’article 48, alinéa 4, de la Constitution. Il peut, en particulier, proposer l’organisation, en séance publique, de débats sans vote ou de séances de questions portant sur les conclusions de ses rapports ».
Parmi les 35 débats de contrôle organisés depuis 2009 dans l’hémicycle ou en « petit hémicycle » (salle Lamartine), quatre ont été demandés par le CEC dans le prolongement de ses premiers rapports d’évaluation. Les débats inscrits à la demande du CEC se sont tous tenus en « petit hémicycle », dont la configuration est plus propice à une discussion « interactive ». En effet, après l’exposé des rapporteurs et l’intervention des ministres, les députés posent des questions, les ministres y répondent et les mêmes députés peuvent répliquer aux réponses, de sorte qu’un échange est possible.
Le premier débat en séance publique a eu lieu le 22 juin 2010, et a porté sur la mise en œuvre du principe de précaution. Il a associé trois ministres (ministre d’État, chargé notamment de l’écologie, de l’énergie et du développement durable et secrétaire d’État chargée de l’écologie ; ministre chargée de la recherche). Ce premier débat a précédé la publication du rapport final du CEC, auquel le compte rendu de la séance a d’ailleurs été annexé : en effet, le débat en séance avait vocation à examiner avec le Gouvernement et les députés intéressés les réponses à apporter aux questions soulevées par le rapport d’étape présenté en premier lieu au CEC par ses rapporteurs en avril, après un séminaire parlementaire le 1er juin 2010, public et ouvert à la société civile (administrations, chercheurs, associations environnementalistes).
Deux débats en séance publique en semaine de contrôle ont eu lieu en 2011, portant sur le rapport sur les autorités administratives indépendantes (17 mai 2011), en présence de deux représentants du Gouvernement (chargés, d’une part, de la fonction publique et, d’autre part, du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation) et sur le rapport sur la politique en faveur des quartiers défavorisés (1er février 2011) en présence du ministre de la Ville nouvellement nommé.
Un quatrième débat a eu lieu le 31 janvier 2012, portant sur le rapport sur l’évaluation des performances des politiques sociales en Europe, publié en 2011, en présence de deux représentants du Gouvernement (chargés de la famille, ainsi que de l’apprentissage et de la formation professionnelle).
Enfin, une proposition de résolution (n° 4008) déposée en commun par les rapporteurs du CEC sur l’évaluation de la mise en œuvre du principe de précaution a été inscrite à l’ordre du jour du 1er février 2012, en semaine de contrôle, et adoptée.
Par ailleurs, les recommandations et problématiques des rapports portant sur l’aide médicale de l’État et sur les dispositifs en faveur des heures supplémentaires ont fait l’objet de discussions en séance publique, donc avec le Gouvernement, à l’occasion du débat budgétaire et de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.
Cinq des six rapports présentés le plus récemment, c’est-à-dire depuis novembre 2011, n’ont pu, en revanche, faire matériellement l’objet d’une inscription à l’ordre du jour d’une semaine de contrôle ou d’une discussion en séance, l’Assemblée ayant suspendu ses travaux le 7 mars 2012 en raison de la campagne électorale.
4. Les premières suites données aux travaux du CEC
La finalité de l’évaluation des politiques publiques est l’amélioration de l’efficacité, voire de l’efficience des dispositifs existants. Les synthèses et recommandations de l’ensemble des onze rapports d’évaluation déposés par le CEC sont présentées ci-après, dans leur ordre chronologique. Les suites données à ces travaux sont recensées dans les rapports de suivi, auquel le lecteur est renvoyé pour les cinq qui ont déjà été publiés (cf. supra). Pour les six autres, leur suivi ne pourra être effectué qu’après les élections.
À titre d’illustration, il y a toutefois lieu d’indiquer que tous les instruments à la disposition des rapporteurs et de l’Assemblée nationale ont été mobilisés :
– certaines recommandations ont été retenues directement par le Gouvernement, sous forme d’amendements (par exemple, amendement du Gouvernement au projet de loi de finances rectificative pour 2011 mettant progressivement fin à la tarification des soins dispensés aux bénéficiaires de l’aide médicale de l’État par tarif journalier de prestation, pour une économie estimée à 150 millions d’euros sur trois ans) ou d’articles de projets de loi (par exemple, article 11 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, qui a réintégré les heures supplémentaires et complémentaires dans le calcul de la réduction générale de cotisations sociales bénéficiant aux entreprises, pour une économie de l’ordre de 600 millions d’euros) ;
– certaines recommandations ont fait l’objet d’amendements conjoints des rapporteurs, dont une partie substantielle a été adoptée. Peuvent ainsi être évoqués à titre d’exemples : des amendements prévoyant des plafonds d’emplois annuels pour les autorités publiques indépendantes (API) disposant de la personnalité morale et les autorités administratives indépendantes (AAI) dont les effectifs ne figurent dans aucun plafond d’autorisation d’emplois ministériel, devenus articles 72 et 106 de la loi de finances initiale pour 2012 ; des amendements relatifs au fonctionnement du Défenseur des droits, instaurant l’irrévocabilité des mandats de ses adjoints, la présence dans les collèges de personnalités désignées par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat (et non la présence de parlementaires) et l’obligation d’assiduité des membres des collèges, intégrés dans l’article 16 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ; l’introduction par amendement à l’article L. 621-30 du code monétaire et financier de la possibilité pour le président de l’Autorité des marchés financiers de déposer un recours contre les décisions de sa commission des sanctions ; dans le même cadre, l’introduction par voie d’amendement à l’article L. 612-12 du même code de l’obligation pour l’Autorité de contrôle prudentiel de déposer un rapport annuel au Président de la République et au Parlement publié au Journal officiel ;
– une proposition de résolution déposée conjointement par les deux rapporteurs sur l’évaluation de la mise en œuvre du principe de précaution a été inscrite à l’ordre du jour de la séance publique du 1er février 2012, en semaine de contrôle, et adoptée, avec le soutien des deux groupes parlementaires principaux et l’avis favorable du Gouvernement. Cette résolution (texte adopté n° 837 du 1er février 2012) décrit une procédure rationalisée pour l’application du principe de précaution en matière environnementale et sanitaire, correspondant aux conclusions du rapport présenté au CEC.
De telles résolutions permettront à la fois d’éclairer le juge sur la volonté du législateur et d’orienter l’action du Gouvernement en posant des jalons certes non normatifs, mais néanmoins susceptibles de se substituer, au moins partiellement, à l’édiction de circulaires émanant des bureaux de l’administration.
Dans le cas d’espèce, il conviendra de s’assurer de sa mise en œuvre effective après les élections ;
– le CEC a également bénéficié du concours des commissions permanentes pour compléter les travaux qu’il avait pu mener à une échelle transversale. Tel a été le cas notamment avec les travaux menés : par la commission des Lois (rapport d’information n° 3405, déposé le 11 mai 2011), sur la mise en œuvre des recommandations du rapport du Comité sur les autorités administratives indépendantes, présenté par M. Charles de La Verpillière ; par la commission des Affaires sociales avec la présentation par M. Yves Bur d’un rapport d’information (n° 3276, déposé le 6 juillet 2011) en conclusion d’une mission sur les agences sanitaires demandée par le CEC ; ou encore par la commission des Finances, qui, s’appuyant sur une enquête qu’elle a demandée à la Cour des comptes portant sur les modalités de mise en place de l’Autorité de contrôle prudentiel instituée par la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière a publié un rapport d’information sur ce thème présenté par M. Jérôme Chartier (n° 4032, déposé le 7 décembre 2011).
SYNTHÈSES ET RECOMMANDATIONS DES RAPPORTS, PRÉSENTÉES PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE DE PUBLICATION, DANS LEUR VERSION PUBLIÉE EN TÊTE DE CHAQUE RAPPORT
PRINCIPE DE PRÉCAUTION : UN ACQUIS À AMÉLIORER
Rapport d’information n° 2719, présenté le 8 juillet 2010,
par MM. Alain Gest et Philippe Tourtelier, rapporteurs
Synthèse
Ce rapport d’information constitue le premier travail d’évaluation d’une législation réalisé à la demande du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée nationale, créé en juillet 2009 et issu de la révision constitutionnelle de juillet 2008, qui a conféré expressément au Parlement la mission d’évaluer les politiques publiques.
*
* *
La plupart des observateurs considèrent que le principe de précaution, dans la gouvernance des politiques publiques, est né en Allemagne il y a environ quarante ans. Exclusivement relatif à des problématiques environnementales, il constitue alors un engagement à la vigilance de la part des autorités publiques, même quand aucun danger n’est encore clairement identifié.
Inspirée par diverses considérations philosophiques contemporaines, cette règle nouvelle de gouvernance publique a aussi trouvé sa source dans le constat de l’impact des activités humaines massives, notamment industrielles et agricoles, sur certains éléments de l’environnement, notamment l’air, l’eau et les aires naturelles comme les forêts. C’est donc logiquement pour ces problématiques que l’idée d’un devoir de précaution que les États s’imposent à eux-mêmes va se diffuser dans le droit international dans le courant des années 1980 : en matière d’environnement, il convient que les États agissent avec prudence et vigilance en toutes circonstances, sans attendre que les dangers soient identifiés de manière indubitable.
Cette diffusion dans le droit international, à l’état de déclaration solennelle d’intention, prend une dimension planétaire à l’occasion de la déclaration qui fait suite au Sommet de la Terre à Rio en juin 1992. Cette diffusion n’a cependant pas abouti à l’avènement d’un principe de précaution juridiquement établi en droit international, un certain nombre d’États demeurant en effet réticents à la reconnaissance d’un principe de précaution opposable en droit.
Pour sa part, à partir du Traité de Maastricht, la Communauté européenne a érigé, le principe de précaution en norme juridique générale et opposable. La jurisprudence communautaire a ensuite dégagé un principe général du droit, applicable à toutes les politiques publiques dès lors que celles-ci ont pour objectifs la protection de la santé humaine et de l’environnement et la sécurité des consommateurs. Cette jurisprudence a par ailleurs considérablement précisé le rôle des institutions publiques, des experts scientifiques et des acteurs économiques, ainsi que les devoirs qui leur incombent, dans la mise en œuvre du principe. Les institutions publiques communautaires se sont ensuite approprié le principe de précaution, en se fixant des règles de conduite en la matière.
L’ensemble de ce mouvement international et communautaire concernait en tout état de cause directement la France à au moins deux titres : en premier lieu, les déclarations d’intention internationales sur la nécessité de la vigilance en matière environnementale constituaient des engagements pris par la France, au moins à un niveau politique. En second lieu, le droit communautaire pouvant être d’application directe dans notre ordre juridique interne, le principe de précaution, évoqué par les traités et précisé par la jurisprudence, était applicable, directement ou non selon la nature des textes, en droit français.
Cet impact juridique du droit communautaire a été complété, en France, par une jurisprudence autonome relative à la précaution en matière sanitaire, fixée par le juge administratif français. Par ailleurs, les autorités publiques françaises ont cherché à tenir compte dans notre législation nationale de l’évolution internationale en matière de précaution. Ainsi, la loi relative à la protection de l’environnement du 2 février 1995, dite loi « Barnier », a inséré dans notre législation une première définition du principe de précaution. La formule élaborée à cette occasion s’inspire à la fois de la volonté d’inscrire dans la loi française le témoignage de l’engagement de la France dans le cadre de l’appel international à la vigilance et à la prudence en matière environnementale et du souhait d’encadrer juridiquement le principe sur un plan national.
Sous cet angle, et sans faire abstraction des différences entre la définition du principe de précaution prévue par la loi « Barnier » et l’article 5 de la Charte de l’environnement entrée en vigueur, dix ans après, en mars 2005, ces deux textes sont analogues : ils s’inscrivent tous les deux dans une tentative de concilier à l’échelle nationale la résolution des autorités publiques à bien faire et la définition d’un cadre juridique.
En tout état de cause, l’article 5 de la Charte de l’environnement est désormais un dispositif juridique à part entière. À ce titre, le Conseil constitutionnel et les juges administratifs et judiciaires ont commencé à établir un contrôle des textes et litiges qui leur sont soumis sur la base du principe de précaution constitutionnalisé. La jurisprudence qui en est résultée, encore modeste, considère en général que l’article 5 de la Charte de l’environnement « oblige » les autorités publiques, mais la question de savoir en quoi consistent précisément ces obligations n’a, pour l’instant, reçu qu’une réponse partielle.
Au-delà de ces considérations juridiques, la question est de savoir si l’article 5 de la Charte est devenu une référence pratique pour les acteurs de la recherche et du monde économique.
S’agissant des chercheurs, leurs témoignages relatifs au principe de précaution montrent, par l’absence de référence à la constitutionnalisation du principe, que les problématiques antérieures à celle-ci sont demeurées inchangées jusqu’à aujourd’hui. Au demeurant, les chercheurs font le constat du peu d’impact du principe de précaution sur le volume et la nature de leurs recherches, hormis le cas des biotechnologies pour lequel il a été drastique. Les chercheurs reconnaissent que l’émergence de la problématique de la précaution dans les débats sociétaux les conduit à s’interroger sur le sens et la portée de leurs activités, ce qui les a amenés, au sein de leurs organismes et instituts respectifs, à développer des outils censés leur permettre de mieux appréhender ces débats et de s’y insérer. Ils font part, enfin, d’une certaine inquiétude quant à un usage effectif du principe par les autorités publiques, en tant qu’outil de bonne gouvernance.
S’agissant des entreprises, la consécration constitutionnelle du principe de précaution ne semble pas s’être traduite par une étape véritablement décisive dans les rapports du monde de l’entreprise à ce principe. Les opérateurs économiques ont de facto tendance à intégrer, « apprivoiser » et s’approprier le principe de précaution comme élément d’un contexte économique général. Ils témoignent néanmoins du fait qu’il s’agit d’une modification qui n’est pas anecdotique quant à leur image auprès du public et aux relations qu’ils entretiennent avec leurs clients. Les entreprises s’inquiètent par ailleurs, comme les scientifiques, d’un éventuel usage inapproprié et excessif du principe par les autorités publiques, susceptible, sans appel, de les empêcher d’exercer leurs activités. Elles perçoivent aussi une certaine évolution du droit applicable en matière de responsabilité civile, renforçant leurs obligations, au point, le cas échéant, de les dérouter quant à la définition même de ces obligations, ce qui s’ajoute à l’incapacité dans laquelle certaines entreprises se trouvent de s’assurer pour leurs activités potentiellement concernées par le principe de précaution.
D’un point de vue plus thématique, la liste des domaines aujourd’hui « saisis » par le principe de précaution fait écho, d’une certaine façon, aux préoccupations originelles sur les risques globaux, propres aux temps modernes, qui ont conduit à l’élaboration du principe de précaution ; si, du point de vue de la précaution, les impacts des activités industrielles et agricoles classiques sur l’environnement sont passés au second plan, il s’agit aujourd’hui de considérer les effets sanitaires et environnementaux d’activités et de procédés technologiques contemporains et sophistiqués, d’ores et déjà massivement utilisés et diffusés dans l’alimentation, la communication ou encore dans l’équipement courant des ménages : nanomatériaux, biotechnologies (OGM), ondes électromagnétiques notamment associées à la téléphonie mobile et, plus récemment, perturbateurs endocriniens. Chacun de ces domaines fait l’objet aujourd’hui d’une démarche de précaution alliant l’analyse et l’évaluation du risque, la mise en œuvre de mesures de précaution parfois législatives et l’accompagnement du débat scientifique par des modalités de participation des citoyens à des questionnements d’ordre sociétal.
La mise en œuvre effective du « régime de précaution », et des mesures de précaution proprement dites, par les autorités publiques est structurée par trois séquences, dont l’organisation en France n’est pas aujourd’hui systématique et varie parfois selon le domaine concerné : en premier lieu, les autorités publiques devraient pouvoir disposer d’une revue des études scientifiques les plus récentes et de toutes informations susceptibles de la compléter, afin d’être en mesure d’identifier un risque déterminé et hypothétique en matière environnementale ou sanitaire. En deuxième lieu, les autorités publiques devraient pouvoir passer commande d’études scientifiques, à tout le moins les susciter, évaluant le risque ainsi identifié, afin de mesurer la pertinence des mesures de précaution mises en œuvre et, le cas échéant, de les réviser. En troisième lieu, les autorités publiques devraient pouvoir évaluer le rapport entre les bénéfices et les risques des mesures de précaution envisageables, en envisageant ce rapport sous un angle sociétal global, c’est-à-dire en replaçant la gestion du risque dans l’ensemble de l’action publique.
Au-delà de ces considérations organisationnelles, il apparaît que le pilotage du « régime de précaution » s’inscrit nécessairement dans un contexte émotionnel collectif sensible, fondé sur la représentation d’une menace naissante aux contours indéfinis, qui, au total, peut conduire à des inquiétudes plus intenses que les craintes relatives à des risques bien identifiés et avérés, fussent-ils graves. Dans ce contexte, prendre une mesure de précaution tend mécaniquement à légitimer l’hypothèse du risque et rend plus difficile d’expliquer au public que l’on gère un risque qui demeure malgré tout hypothétique. Dans le même ordre d’idée, il est difficile de revenir sur une décision présentée et donc appréhendée comme susceptible d’avoir empêché la survenue d’un risque, même si l’actualisation de l’évaluation de ce risque pourrait ne plus justifier cette décision.
*
* *
Avant de conclure, il a été considéré utile de poser clairement les principales questions soulevées et de présenter les différentes réponses qui pourraient leur être apportées. Ce « questionnement », conclusion initiale du rapport d’étape, avait vocation à être soumis à une discussion élargie, de façon à identifier les solutions les plus adaptées.
S’agissant de la détermination du principe de précaution, les questions portaient, en premier lieu, sur d’éventuelles modifications à apporter à l’article 5 de la Charte et à l’article L. 110-1 du code de l’environnement issu de la loi dite « Barnier », y compris en évoquant l’opportunité de leur abrogation. En second lieu, était posée la question de savoir si une action opportune des pouvoirs publics ne devait pas, dans le contexte actuel, s’appuyer avant tout sur une clarification des modalités de mise en œuvre du principe de précaution tel qu’il est défini par la Constitution et la loi, en envisageant les deux hypothèses d’une initiative législative et de l’adoption d’une résolution.
S’agissant de l’organisation de la mise en œuvre du principe de précaution, les questions portaient sur la procédure de pilotage en régime de précaution, sur l’expertise scientifique dans ses fonctions d’alerte et d’évaluation du risque, sur l’organisation du débat sociétal auquel les citoyens ont vocation à participer et sur les régimes de responsabilité des parties prenantes, publiques et privées, dans le cadre du régime de précaution.
*
* *
Suite aux travaux du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques du 18 mai et 8 juillet 2010, au séminaire du 1er juin 2010 et au débat en séance publique le 22 juin 2010 sur la base du rapport d’étape, des conclusions ont été élaborées. S’appuyant sur le constat qu’il serait inopportun et inutile de modifier l’article 5 de la Charte de l’environnement, elles proposent notamment de mieux organiser le « régime » de précaution autour de quatre axes : les modalités de la constatation de la plausibilité des risques hypothétiques ; les expertises scientifiques ; le débat public et la décision politique.
Recommandations
La présente étude a dans un premier temps conduit les rapporteurs à poser une série de questions soumises au Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques réuni le 18 mai 2010, examinées ensuite à la fois par un certain nombre d’experts et par leurs collègues intéressés dans le cadre du séminaire parlementaire du 1er juin, et débattues enfin en séance publique le 22 juin 2010 avec le Gouvernement. S’appuyant sur ces trois étapes successives de débats et de consultations, les rapporteurs proposent les conclusions suivantes.
S’agissant de la question de l’abrogation ou de la modification de l’article 5 de la Charte de l’environnement, aucune voix ne s’est explicitement manifestée, suite au rapport d’étape, pour s’engager dans une telle entreprise. Au demeurant, ce constat confirme celui fait tout au long des auditions préparatoires au rapport d’étape. Ainsi, les rapporteurs considèrent comme acté le fait que, si des difficultés demeurent quant à la mise en œuvre du principe de précaution, aucune solution ne résulterait réellement d’une modification de la définition prévue par l’article 5 de la Charte de l’environnement, ou a fortiori de son abrogation. Il en va de même, d’ailleurs, s’agissant de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, en tant qu’il prévoit lui aussi une définition du principe de précaution, quand bien même celle-ci n’est pas parfaitement identique à celle prévue par la Charte de l’environnement.
Il n’en demeure pas moins qu’en règle générale la situation actuelle a été considérée comme insatisfaisante par de nombreux intervenants du séminaire et du débat en séance publique, tenus sur la base du rapport d’étape. Ont en particulier été évoquées deux catégories de difficultés ; en premier lieu, le principe de précaution, applicable en cas d’incertitudes sur l’existence d’un risque en l’état des connaissances scientifiques, est invoqué et utilisé, dans des cas, souvent très médiatisés, éloignés de cette définition et le plus fréquemment dans le domaine sanitaire. Par ailleurs, le principe de précaution, quand il doit être mis en œuvre en matière environnementale ou sanitaire, ne l’est pas systématiquement de façon raisonnée, réfléchie et organisée, conduisant notamment à des difficultés dans un secteur sensible de la recherche, comme celui des biotechnologies, dans le contexte d’une forte concurrence internationale. En somme, on constate une carence à la fois en matière de pédagogie et d’organisation.
Les rapporteurs considèrent insuffisante l’idée simple selon laquelle, pour surmonter ces difficultés, il pourrait suffire de s’en tenir à une pédagogie générale sur la définition du principe, à destination du grand public, en laissant les autorités publiques gérer la mise en œuvre effective du principe sur les bases actuelles, c’est-à-dire de façon très empirique et peu organisée. Les rapporteurs ont au contraire la conviction, au terme de la présente mission, qu’une meilleure organisation, un modus operandi posant certaines balises dans la gestion des risques incertains, sont susceptibles, non seulement d’améliorer la qualité de cette gestion, mais aussi de contribuer de façon décisive à la pédagogie de la précaution. Le flou des pratiques a ainsi contribué à la confusion des concepts. Aussi une organisation procédurale globale doit-elle être dessinée et mise en œuvre, dont le contrôle du respect sera au cœur de la mission du juge en matière de précaution, et qui doit contribuer à éviter toutes les réponses excessives sur le sujet, qu’il s’agisse des précautionnismes ou des scientismes irraisonnés.
––––––––––––––––––––
1.– Il s’agit en premier lieu de mettre en œuvre une fonction d’identification de l’émergence d’un risque ; il est nécessaire qu’une instance ait pour rôle de dire si l’hypothèse d’un risque pour l’environnement ou la santé, s’agissant d’un procédé ou d’un produit, peut être considérée comme plausible. À ce stade, cette instance d’identification aurait la charge, une fois l’émergence d’un risque hypothétique analysée comme plausible, de désigner un référent totalement indépendant, identifiable par le public et les parties prenantes, qui piloterait, sur un sujet donné, la mise en œuvre du « régime » de précaution dans chacune de ses phases et en rendrait publiquement compte, à l’instar des présidents des commissions particulières du débat public. Cette instance d’identification aurait par ailleurs la faculté de susciter l’expertise scientifique contradictoire et indépendante nécessaire à l’évaluation du risque, ainsi que l’expertise scientifique sociétale permettant à l’évaluation de l’utilité collective du procédé ou du produit considéré.
S’agissant de la question de savoir quelle pourrait être cette instance, il convient d’éviter la création ex nihilo d’une ou a fortiori de plusieurs nouvelles structures. Le Comité de la prévention et de la précaution, aujourd’hui placé spécifiquement auprès du seul ministre chargé de l’environnement tout en bénéficiant d’une composition large et diversifiée, constitue sans doute aujourd’hui l’organisation la plus proche de ce que pourrait être une telle instance. En effet, ce comité a su ces dernières années identifier et analyser les principaux enjeux concrets relatifs à la précaution, sans se substituer ni aux instances en charge de l’expertise scientifique proprement dite, c’est-à-dire les agences de sécurité sanitaire, ni aux autorités publiques en charge de veiller à l’adoption éventuelle de mesures de précaution. En tout état de cause, s’il fallait renforcer le rôle de vigie publique des risques environnementaux et sanitaires incertains du Comité de la prévention et de la précaution, un réexamen et un renouvellement de ses missions, de sa composition et de son statut seraient sans doute nécessaires, en envisageant notamment son élargissement interministériel ou son rattachement officiel auprès du Premier ministre.
2.– La deuxième étape est celle des expertises scientifiques. Par l’intermédiaire du référent, le public et les parties prenantes doivent en effet pouvoir accéder, en premier lieu, à l’état de l’évaluation du risque. Cette évaluation, qui devrait constituer une synthèse claire et honnête des informations et des résultats des recherches scientifiques disponibles présentant et pondérant les différents positionnements scientifiques constatés, est au cœur du métier de la nouvelle agence de sécurité sanitaire unique, comme du comité scientifique du Haut conseil des biotechnologies dans son champ de compétences. Ce travail doit s’appuyer sur un jugement étayé et contradictoire de la qualité scientifique des travaux disponibles, qui tiennent compte de l’appréciation, dans la plus grande transparence, de leur indépendance au regard d’éventuels conflits d’intérêts concernant leurs auteurs, notamment avec des intérêts non-scientifiques.
Les rapporteurs sont convaincus que doit être mis en place et organisé un second « compartiment » de l’expertise scientifique – outre, naturellement, celle de la discipline scientifique concernée pour permettre l’évaluation du risque – dans le domaine et avec les techniques des sciences économiques et sociales. Cette seconde expertise, qui ne doit pas être une simple consultation de la société civile dans la diversité de sa représentation, doit permettre au référent de présenter au public les avantages et les inconvénients comparés, de tout ordre, du procédé ou du produit auquel est associé un risque incertain mais plausible relevant de la précaution. À défaut d’envisager la création d’une structure ad hoc nouvelle, un tel conseil scientifique sociétal pourrait notamment être institué comme nouvelle composante d’un Comité de la prévention et de la précaution « reconfiguré » et enrichi dans le sens des propositions figurant dans le 1° supra.
En tout état de cause, si les deux catégories d’expertises scientifiques doivent être distinguées, le dialogue entre ces deux « compartiments » doit être possible et organisé, sur le modèle des échanges existants entre le comité scientifique et le comité éthique, économique et social du Haut conseil des biotechnologies.
3.– Dans une troisième étape, doit être livré au débat public l’ensemble des informations issues des deux premières étapes, porté par le référent et constitué notamment des deux types d’expertises scientifiques. Le débat public a pour objet de consulter les citoyens, les représentants de la société civile et, parmi eux, bien entendu, les parties prenantes plus particulièrement impliquées s’agissant de la commercialisation et de l’usage du produit ou du procédé considéré. Le débat public doit être le moment où, face à ce qui est scientifiquement établi ou non par les deux « compartiments » de l’expertise scientifique, sont exprimés de façon pluraliste des valeurs, des choix de société, des priorités sociétales. Il est en effet opportun qu’une décision portant sur un risque à prendre, quand bien même il serait hypothétique, soit précédée d’une réflexion collective portant sur l’utilité sociale, le coût économique et les enjeux éthiques et ontologiques des choix qui découleront de cette décision. Il s’agit d’ailleurs d’éléments indispensables à la mesure de la proportionnalité de cette décision.
Il existe aujourd’hui des instances susceptibles d’organiser ces débats publics ou d’y procéder. On peut évoquer notamment la Commission nationale du débat public (CNDP) ou le Conseil économique, social et environnemental. Il existe d’autres procédures et d’autres enceintes susceptibles d’être mobilisées en la matière, par exemple les auditions publiques organisées par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST). Il appartiendra au référent de faire, pour chaque cas d’espèce, des propositions adaptées à la situation considérée.
4.– La dernière étape du processus est bien entendu le moment de la décision publique. Il revient in fine aux autorités publiques, saisies par le référent de l’ensemble des matériaux scientifiques et des débats publics, de procéder aux décisions qui s’imposent dans chacun des deux champs d’action « classiques » du principe de précaution : la promotion de la recherche afin de mieux cerner le risque ; la détermination et la mise en œuvre de mesures, proportionnées et provisoires, de limitation du risque hypothétique.
Une fois les décisions des autorités publiques mises en œuvre s’agissant des mesures de précaution elles-mêmes, limitant ou interdisant temporairement, le cas échéant, l’usage d’un procédé ou d’un produit, et des commandes scientifiques devant conduire à une meilleure évaluation du risque – les autorités publiques devant être en mesure de passer ces commandes, ce qui nécessite manifestement un effort particulier pour développer une recherche de pointe en toxicologie et en éco-toxicologie –, un suivi public de ces mesures doit être mis en œuvre. Les autorités publiques, détentrices de la légitimité politique, sont bien entendu compétentes pour effectuer cette tâche, même si le référent devrait pouvoir, à ce stade aussi, entretenir un lien en principe établi avec le public depuis le début du processus du « régime » de précaution.
*
* *
S’inscrire demain dans une telle démarche procédurale n’exclut pas qu’elle soit ponctuellement accompagnée de mesures d’urgence, si les autorités publiques les estiment nécessaires, au regard d’une première évaluation ou perception du risque qui le justifierait.
En tout état de cause, cette démarche nécessite a priori des décisions relatives à son organisation et, le cas échéant, de se doter d’outils nouveaux. Les missions de certaines instances doivent être explicitées, leurs statuts doivent être adaptés et précisés ; l’articulation des rôles des acteurs et parties prenantes dans le régime de précaution doit être éclaircie.
À ce stade, les rapporteurs souhaitent que le Gouvernement se prononce, y compris de façon pratique en initiant le cas échéant certaines décisions, s’agissant des voies et moyens qui lui paraissent appropriés pour, lucidement et résolument, mettre effectivement en œuvre cette organisation. Ce dialogue pratique conduira à trancher in fine la question de savoir si la mise en œuvre de l’organisation que nous préconisons s’appuiera sur une initiative parlementaire.
*
* *
Au-delà de ces considérations relatives à l’organisation, une telle initiative est en tout état de cause nécessaire au regard du panorama normatif et pratique actuel relatif à la précaution : constitutionnalisé dans le domaine environnemental, le principe est, en règle générale, invoqué et mis en œuvre en matière sanitaire. Or, il apparaît non seulement que certains concepts de la Charte sont d’une utilisation malaisée en matière strictement sanitaire mais aussi qu’il serait utile de replacer explicitement la mise en œuvre du principe de précaution dans cette matière dans le contexte normatif qui lui est propre, c’est-à-dire le droit communautaire – y compris sa jurisprudence –, et notre législation relative à la santé publique.
Cette initiative doit aussi permettre de traiter les difficultés, exposées dans le présent rapport, rencontrées par certaines entreprises pour assurer leurs activités liées à certains risques émergents. Agir en la matière nécessite en tout état de cause une analyse affinée de cette problématique spécifique, dont l’une des manifestations possibles est la délocalisation, à l’étranger, de certaines activités de recherche liées à cette catégorie de risques.
QUARTIERS DÉFAVORISÉS OU GHETTOS INAVOUÉS :
LA RÉPUBLIQUE IMPUISSANTE
Rapport d’information n° 2853, présenté le 21 octobre 2010
par MM. François Goulard et François Pupponi, rapporteurs
Résumé
Les moyens et les actions en faveur des quartiers en difficulté
L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé) gère la quasi-totalité des crédits d’intervention du programme budgétaire 147 « Politique de la ville » (406 millions d’euros en 2009, soit 0,11 % des crédits de paiement du budget général dans la loi de finances pour 2009). L’Acsé, qui finance de nombreux opérateurs locaux, notamment associatifs dans les quartiers défavorisés, agit dans le cadre des contrats urbains de cohésion sociale (Cucs) qui lient l’État et les collectivités territoriales. Elle finance ainsi les principaux dispositifs historiques de la politique de la ville (le programme de réussite éducative, les contrats d’adultes relais, les ateliers santé ville, le programme ville, vie, vacances…), qui, pour la plupart d’entre eux, sont antérieurs à la création de l’agence.
L’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru), créée en 2003, contribue à la réalisation du Programme national de rénovation urbaine (PNRU), qui prévoit la restructuration de plusieurs centaines de quartiers dans l’ensemble du pays. Si une incertitude demeure quant à son financement au niveau national dans les prochaines années, le PNRU est aujourd’hui presque totalement programmé et engagé (environ 1 milliard d’euros par an sur un peu plus de dix ans). Les crédits gérés par l’Anru jouent un rôle de levier effectif : le PNRU est majoritairement financé par les bailleurs sociaux et les collectivités territoriales.
La politique de la ville s’appuie aussi sur certaines dépenses fiscales et sociales (693 millions d’euros en 2009, soit environ 0,4 % de l’ensemble des dépenses fiscales et sociales applicables aux entreprises). D’importantes exonérations de charges sociales et d’impôts sur l’activité économique sont applicables dans les zones franches urbaines (ZFU), afin d’y densifier le tissu d’entreprises et d’y créer des emplois. D’autres dépenses fiscales ont pour objet d’inciter à l’accession à la propriété dans les quartiers en rénovation urbaine et de soutenir les bailleurs sociaux dans les zones urbaines sensibles (ZUS).
Des dispositifs de péréquation aident les communes qui ont des quartiers prioritaires sur leur territoire à compenser les charges correspondantes et la faiblesse de leurs ressources (1 399 millions d’euros en 2009). Il s’agit notamment de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU-CS – 1 163,7 millions d’euros en 2009, soit environ 5 % de la DGF du bloc communal), de la dotation de développement urbain (DDU) et du Fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF).
Ces moyens nationaux sont censés venir en complément d’une mobilisation des différents ministères de « droit commun » (notamment l’Éducation nationale, le logement, l’emploi, la sécurité publique…) en faveur des quartiers prioritaires. Leur investissement dans la politique de la ville et ces quartiers est très hétérogène, ce qui limite l’intérêt et la portée d’un chiffrage global traduisant cet engagement (3,62 milliards d’euros en 2009, soit 0,96 % des crédits de paiement du budget général dans la loi de finances pour 2009), dont l’établissement se heurte à d’importantes difficultés techniques.
Ces moyens nationaux dédiés ont par ailleurs vocation à mobiliser les crédits locaux, notamment des collectivités territoriales, dans le cadre territorialisé des Cucs. L’ampleur de cet « effet levier » est aujourd’hui mal connue.
Le zonage et la gouvernance
Les zones urbaines sensibles (ZUS) avaient vocation à constituer l’assise territoriale de mise en œuvre des aides en faveur des quartiers défavorisés. Au fil du temps, d’autres « géographies prioritaires » se sont ajoutées aux ZUS, en leur sein (les zones de redynamisation urbaine – ZRU, les ZFU) ou, le cas échéant, en couvrant des zones nouvelles (les quartiers concernés par les Cucs, les quartiers Anru). La géographie prioritaire, devenue complexe, n’en est pas pour autant satisfaisante. Elle laisse sans doute des quartiers très défavorisés hors de tout zonage et en inclut d’autres dont les difficultés économiques et sociales sont moindres. Surtout, le zonage, comme ressort des aides en faveur des quartiers défavorisés, ne va pas sans stigmatisation, parfois implicite, à l’intérieur comme à l’extérieur de la zone concernée ; il peut aussi conduire à des « effets de frontière » dans une même zone, attribuant une priorité à un lieu et pas à un autre, pourtant analogue au premier.
Le zonage doit avoir pour objet la connaissance des quartiers en difficulté, c’est-à-dire d’en dresser la liste et de définir, sur la base de critères objectifs, la nature et l’intensité des problèmes économiques et sociaux qu’y subissent leurs habitants. Cette connaissance doit être mise au service d’une contractualisation renouvelée entre l’État et les collectivités territoriales, notamment les communes et les EPCI, dont les ressorts territoriaux doivent être les cadres d’action des politiques en faveur des quartiers défavorisés.
Une telle démarche implique un pilotage efficace au niveau national, qui puisse promouvoir une réelle interministérialité et dépasser une dichotomie aujourd’hui trop prononcée entre l’action sur le bâti (par l’Anru) et l’action sociale (par l’Acsé). Au niveau local, l’État doit par ailleurs réellement s’implanter dans les quartiers, par une représentation effective et opérationnelle dont il est dépourvu aujourd’hui. Il pourra alors engager un partenariat exigeant avec les élus locaux, qui sont les maîtres d’œuvre des aides en faveur des quartiers défavorisés. Si, à cette fin, les élus locaux doivent pouvoir exercer, au moins à titre expérimental, des compétences étendues à la mesure des problèmes à traiter (éducation, police, emploi…), l’État aurait pour tâche, dans un tel contexte, d’aider à l’émergence d’un projet local de territoire (dont la politique de la ville serait une dimension) et d’organiser le débat public local sur l’évolution des quartiers prioritaires.
Quelle situation dans les quartiers, quels effets des actions de la politique de la ville ?
Évaluer la politique de la ville est un exercice complexe ; deux études synthétisant respectivement les résultats d’évaluation de 22 Cucs et les travaux universitaires d’évaluation en matière de la politique de la ville ont été réalisées dans le cadre de la présente mission. Celle-ci a donné lieu à de nombreuses auditions de responsables administratifs, d’élus et d’acteurs de la politique de la ville ; trois visites sur des sites de la politique de la ville ont été organisées à Clichy-sous-Bois et Montfermeil, à Orléans et dans la communauté urbaine de Lyon ; un déplacement aux Pays-Bas a permis d’y observer les actions mises en œuvre en la matière.
La connaissance de la situation objective des quartiers prioritaires, de la territorialisation des actions et des moyens mis en œuvre demeure néanmoins lacunaire, malgré des progrès statistiques incontestables en la matière depuis quelques années. Le risque peut être d’imputer à la politique de la ville des constats dont les facteurs d’explication dépassent de loin la portée de ces actions et ces moyens.
Les objectifs de la politique de la ville ont-ils au demeurant été bien définis ? S’il s’agit de « réduire les écarts », cela passe-t-il par une « mixité sociale » accrue s’appuyant sur un « brassage » organisé des populations ou faut-il s’appuyer sur une distribution des moyens privilégiant les populations les moins bien dotées ? La politique de la ville consiste-t-elle à intensifier l’aide en direction de zones de concentration de la pauvreté ou doit-elle contribuer à briser cette « concentration », source endogène de problèmes accrus ?
Si l’on considère les objectifs de la loi du 1er août 2003, formulés en termes de réduction des inégalités sociales et des écarts de développement, il faut admettre que la situation actuelle n’est dans l’ensemble pas meilleure qu’en 2003. La pauvreté et le chômage demeurent dans les quartiers sensibles à des niveaux élevés, sans amélioration réelle par rapport au reste du pays. Les résultats scolaires en ZUS accusent un retard important par rapport aux moyennes nationales, qui n’a pas été pas comblé, même partiellement, ces dernières années ; certaines données peuvent même être interprétées comme la preuve d’un « effet quartier » négatif : pour un environnement social et culturel donné, un élève résidant en ZUS aurait moins de chance de réussir qu’un élève résidant hors ZUS. Par ailleurs, les écarts de « pouvoir d’achat » entre les communes, exprimés en termes de potentiel financier, n’ont pas été réduits ces dernières années et ont même connu un léger accroissement.
Certains résultats paraissent plus favorables : quelques signes de reflux du chômage et de la pauvreté dans les ZFU auraient pour origine les exonérations de charges et d’impôt qui y sont applicables ; ces signes demeurent cependant fragiles et l’interprétation de ces éléments comme des impacts du dispositif fiscal et social des ZFU demeure discutée.
S’agissant de la rénovation urbaine, l’amélioration est aisément vérifiable en termes de dignité de l’habitat et de restructuration des quartiers. La satisfaction des habitants, largement observée, ne va pas cependant sans certaines difficultés concrètes (évolution du taux d’effort financier des ménages locataires, conditions du relogement sur les marchés tendus…) et sans interrogations sur l’avenir (maintien de l’acquis sur le bâti, retard ou absence de certains équipements structurants en matière de transport…).
Pourraient ainsi être mis à l’actif de la politique de la ville, dans un contexte assez sombre de maintien à des niveaux préoccupants de la pauvreté, du chômage et du retard scolaire dans les quartiers urbains sensibles, quelques évolutions et résultats en matière de développement économique et de rénovation urbaine ; on peut aussi lui attribuer par ailleurs une amélioration du « lien social » au sens large dans ces quartiers, par une pratique renouvelée de l’action publique et associative auprès et avec la participation des habitants.
Synthèse
Dans le cadre de la mission que le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques nous a confiée sur « les aides en faveur des quartiers défavorisés : combien pour quels résultats ? », nous avons en premier lieu dressé un panorama de l’ensemble des dispositifs concernés, notamment en entendant et questionnant les administrations centrales spécifiquement chargées de les mettre en œuvre.
Le Secrétariat général du Comité interministériel des villes (SG-CIV), ainsi que les deux établissements publics sur lesquels il exerce sa tutelle (l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances - Acsé et l’Agence nationale pour la rénovation urbaine - Anru) ont contribué à ce que nous puissions dresser un état des lieux en la matière. À l’occasion de ces échanges, ils nous ont par ailleurs transmis leurs travaux évaluatifs en matière de politique de la ville. De façon générale, nous avons toujours pu compter sur les collaborateurs de ces organismes pour répondre aux questions que nous leur posions.
Nos travaux et notre réflexion se sont appuyés sur de nombreuses auditions, souvent doublées d’un questionnaire à l’attention des personnes entendues, se poursuivant le cas échéant par de nouveaux échanges. Nous avons souhaité la réalisation d’une étude synthétisant les travaux universitaires évaluatifs en matière de politique de la ville ; nous avons aussi souhaité disposer, auprès d’un bureau d’étude spécialisé, d’une synthèse des évaluations sur un échantillon de contrats urbains de cohésion sociale (Cucs). Nous nous sommes rendus sur le terrain, pour rencontrer les élus locaux, les représentants de l’État, les associations et les habitants de certains quartiers prioritaires de la politique de la ville. Nous avons choisi de nous rendre aux Pays-Bas qui mettent en œuvre une politique de la ville semblable à la nôtre dans ses thématiques, selon une organisation différente de la nôtre. Nous avons fait part de nos impressions sur l’ensemble de ces travaux à un certain nombre d’élus nationaux et locaux et d’experts pour qu’ils nous éclairent par leur point de vue et leur expérience.
Les éléments actuels d’évaluation, notamment issus des rapports annuels de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles (ONZUS), conduisent à constater que les écarts en termes de pauvreté, de chômage, d’accès aux soins et de résultats scolaires ne se sont pas réduits depuis la loi du 1er août 2003, qui avait fixé des objectifs en la matière et qu’ils demeurent à des niveaux parfois très préoccupants, les situations et évolutions étant hétérogènes selon les quartiers. Au demeurant, ces éléments, scientifiquement établis et crédibles, demeurent assez rares, ce qui peut étonner s’agissant d’un domaine, la politique de la ville, soumis à de nombreuses évaluations locales.
*
* *
L’organisation des administrations centrales, très récente encore dans sa forme actuelle puisque la DIV a été remplacée par le SG-CIV il y a un peu plus d’un an, ménage aujourd’hui l’autonomie de chaque acteur. La tutelle du Secrétariat général sur les deux agences ne peut être que légère ; il n’est qu’une composante de leur conseil d’administration respectif. À l’Anru comme à l’Acsé, la direction générale et les personnels qui l’entourent assurent effectivement la gestion opérationnelle et quotidienne de leur agence.
Les ressemblances entre les deux agences s’arrêtent là. L’Anru, après environ sept années d’existence, ne semble plus avoir qu’un seul problème d’importance, qui n’est d’ailleurs pas vraiment le sien : le financement des engagements pris avec les porteurs locaux des projets de rénovation urbaine. Cette hypothèque est étrangement bien vécue, car les praticiens nationaux de la rénovation urbaine ne doutent pas que la solidarité nationale se manifestera, le moment venu, malgré l’incertitude du moment. Comment en effet les pouvoirs publics pourraient-ils laisser ces engagements ne pas être honorés, alors que l’élaboration du Plan national de rénovation urbaine (PNRU) a mobilisé à travers tout le pays beaucoup d’élus locaux et le mouvement « HLM », et que les travaux, ou leur poursuite, sont attendus par les populations ? Comment pourrait-on inviter ces acteurs à désormais patienter, eux qui furent sommés d’élaborer des projets, parfois dans l’urgence, sous peine de ne pas avoir accès à l’enveloppe de la rénovation urbaine ? Il convient effectivement de donner à l’Anru les moyens de ne pas être victime de son succès, elle qui a su faire l’effort, de son côté, de limiter, certes parfois de façon encore insuffisante, les inconvénients liés à son caractère centralisé et parisien en « banalisant » un peu plus l’épreuve de son comité d’engagement pour les porteurs de projet et en réduisant ses délais de paiement.
Si la question du financement du PNRU reste à régler, et si les impacts globaux et particuliers de ce plan demeureront à évaluer puisqu’une très grande partie des chantiers ne sont pas achevés, son opportunité nous semble indiscutable. Nous avons entendu des questions et critiques légitimes à son égard. A-t-il permis la sélection des meilleurs projets, alors que les élus et bailleurs locaux ont parfois été tenus de faire vite, contraints par la menace de rater « un train » qui ne repasserait plus ? Satisfait-il à son objectif légal de mixité sociale, alors qu’il peut être une occasion pour les plus mobiles et sans doute les plus aisés des habitants d’un quartier jusqu’alors stigmatisé de le quitter ? Inversement, quels seront les résultats effectifs des dispositifs tendant à attirer dans les quartiers rénovés des populations plus aisées que celles qui y résidaient jusqu’alors ? Plus généralement, ne se satisfait-on pas à bon compte de la réalisation, qui n’est pas la plus complexe pourvu qu’il soit financé, d’un plan de travaux urbains quand la question de départ était de mettre fin à la relégation de ces quartiers sur les plans économique et social ?
Il faut faire justice à l’intérêt de ces questions et rien ne doit empêcher à l’avenir de tenter d’y répondre sereinement. Il convient cependant, selon nous, de saluer un plan ambitieux, mais qui n’est que la moindre des choses. Nous considérons que redonner une dignité à l’habitat des quartiers urbains populaires était une obligation matérielle et morale. L’intérêt du PNRU va bien au-delà de l’amélioration de l’image des quartiers pour ses habitants ; certaines familles de ces quartiers vivaient et vivent encore dans des conditions et un environnement humainement inacceptables, ce dont certaines de nos visites sur place nous permettent de témoigner. Le PNRU, tout critiquable et interrogeable qu’il soit, a le mérite primordial de leur apporter une réponse réelle. Par ailleurs, si on considère économiquement légitime de mener une politique de grands travaux, le PNRU en constitue sans discussion une forme socialement utile. En conséquence, compte tenu du fait que le PNRU ne traite qu’une part, certes substantielle, des besoins en matière de rénovation urbaine, nous sommes favorables à un « PNRU II » à l’issue du plan actuel, pour la renforcer et l’achever.
*
* *
Aussi indispensable qu’il soit, le PNRU n’est en tout état de cause pas la panacée. La politique de la ville doit s’appuyer à la fois sur la nécessaire rénovation urbaine et sur une politique spécifique d’interventions sociales au sens large. Car au-delà de la dignité de l’habitat, se jouent dans ces quartiers l’effectivité de la promesse républicaine et donc une partie de l’avenir du pays ; être né, avoir grandi, vivre quelque part sur le territoire national ne saurait sceller un destin social. Si chacun a droit à la dignité aujourd’hui, il doit aussi avoir la chance effective de faire valoir ses mérites et de tenter de satisfaire ses ambitions. C’est pourquoi, dans nos quartiers urbains difficiles, là où se concentrent la pauvreté, le chômage, l’échec scolaire et là, où, sans doute, il est plus difficile d’échapper à l’horizon du territoire, il est légitime d’y organiser « sur mesure » l’action des pouvoirs publics et d’y apporter des moyens supplémentaires et suffisants pour l’éducation, l’emploi, le développement économique et la santé.
Face à un tel enjeu qui, s’appuyant sur la mesure des écarts, consiste à donner à chaque personne la chance d’avoir une prise sur son sort et celui de ses enfants, il est évidemment nécessaire de mobiliser harmonieusement toutes les forces thématiques de l’État, mises en musique par un pilotage fort exerçant une réelle autorité. Nous avons l’impression que l’organisation actuelle n’est pas à la hauteur de ces exigences.
Comment peut-il en être autrement alors que l’agence qui a en charge les moyens d’intervention de la politique de la ville n’a inspiré à peu près aucun des dispositifs et des actions qu’elle est chargée de mettre en œuvre ? Alors qu’elle n’a pas vraiment achevé la tâche primordiale de savoir à quoi et où précisément les fonds publics nationaux de la politique de la ville sont affectés ? Alors que l’instrument contractuel de mobilisation des moyens nationaux et locaux, le contrat urbain de cohésion sociale (Cucs), n’a pas relevé de son initiative, pas plus que sa mise en œuvre ne relève de sa compétence ? Alors que cet outil contractuel, qui devait être basé sur un diagnostic approfondi et circonstancié d’une situation urbaine locale, a consisté, dans un nombre de cas non négligeable, en un exercice de style sous contrainte de temps, destiné à « ouvrir » les financements, souvent en reconduisant ceux qui étaient pratiqués antérieurement ? Alors qu’un tel théâtre d’ombres conduit inévitablement sur le terrain à la routine et à la démotivation ?
La loi du 1er août 2003, en érigeant légitimement la rénovation urbaine en priorité nationale, a par ailleurs sans doute renforcé le questionnement sur l’utilité et l’efficacité du volet « social » de la politique de la ville. Il y a pu avoir une tentation à la facilité, consistant à cantonner désormais la politique de la ville au nombre de logements sociaux démolis, reconstruits, résidentialisés ou rénovés. Or, tenter d’oublier les situations de précarité sociale et de santé, la relégation économique, l’isolement géographique, c’est prendre le risque de mettre en danger les acquis réels de la rénovation urbaine. Tous les praticiens de la politique de la ville, y compris les plus impliqués dans la rénovation urbaine, l’ont confié à vos rapporteurs : l’investissement que la France a consenti pour rénover ses quartiers urbains difficiles ne sera rentabilisé que si les questions « sociales » au sens large y sont mieux traitées qu’aujourd’hui.
*
* *
Ce tableau contrasté des forces et faiblesses de l’organisation nationale de la politique de la ville doit être complété par un panorama des modalités et de l’intensité de l’implication des ministères de « droit commun ». Vos rapporteurs ont entendu et questionné à ce titre les responsables administratifs de l’éducation nationale, de l’emploi, du logement, de la police nationale et des collectivités territoriales. Quand le document de politique transversale sur la politique de la ville affiche plus de trois milliards d’euros de contributions interministérielles aussi nombreuses que diverses en faveur des quartiers prioritaires, qu’en est-il dans les faits ?
Vos rapporteurs n’insisteront pas sur les modalités de calcul de ces contributions, parfois obscures, souvent approximatives parce que forfaitaires, dont l’hétérogénéité et l’imprécision privent de sens toute tentative d’en faire la somme.
Le cadre d’action premier des ministères de droit commun est qu’un élève en difficulté, un demandeur d’emploi, une famille à la recherche d’un logement ou la victime d’un délit appellent légitimement une réponse en terme d’action publique, partout sur le territoire. La prise en compte de la géographie prioritaire de la politique de la ville constitue dans ce contexte une approche parmi d’autres dans la mise en œuvre d’une politique nationale.
Vos rapporteurs ont ressenti la proximité naturelle de certaines politiques de droit commun avec la politique de la ville. L’éducation prioritaire partage le même esprit et la même philosophie que la politique de la ville, sans que leurs cadres territoriaux respectifs d’action se recoupent totalement. Le champ d’action en matière de sécurité publique contre le trafic de stupéfiants, l’économie souterraine et certaines incivilités recoupe largement aussi les territoires urbains concernés par la politique de la ville.
Au demeurant, si le SG-CIV ne ménage pas sa peine en matière d’organisation de l’interministérialité de la politique de la ville, il n’a d’influence qu’à l’aune de la capacité d’influence de ses autorités politiques de tutelle, qui elle-mêmes sont tributaires des équilibres et priorités politiques de tout un gouvernement. Nous avons entendu Mme Fadela Amara, dont nous avons apprécié l’engagement personnel et la lucidité, y compris dans l’examen de la réalité de ses marges de manœuvre politiques. Le rapport de force politique et institutionnel, peu en faveur des instances nationales pour lesquelles la politique de la ville est la priorité d’action, n’a pas été modifié par la dynamique « espoir banlieues » (dont il est trop tôt pour évaluer les impacts) : les ministères de droit commun sont responsables des principaux dispositifs, dans un cadre interministériel dont il est difficile de voir la réalité.
*
* *
Nous considérons que ce contexte national, conjoncturel, peu favorable à la prise en compte prioritaire de la politique de la ville, se double aujourd’hui d’une déficience structurelle de l’État déconcentré. Représentant de l’État et de l’ensemble du Gouvernement, délégué territorial de l’Anru et de l’Acsé, le préfet, en charge de toutes les politiques publiques de l’État, ne peut être en mesure, dans chaque quartier prioritaire, d’avoir la proximité suffisante pour traiter efficacement des réalités et des enjeux. Les créations successives des sous-préfets à la ville, des préfets délégués à l’égalité des chances, ou, plus récemment, des délégués du préfet en sont d’ailleurs le témoignage. Les délégués du préfet constituent sans doute un « format » de représentation de l’État adapté car propre à chaque quartier prioritaire. Mais ce « symbole » de la présence de l’État ne peut gagner en épaisseur et en efficacité que s’il dispose, dans le contexte d’un rôle accru des collectivités territoriales, de prérogatives réelles, de services et d’une place effective dans le fonctionnement de l’État. Nous avons constaté que l’on est loin du compte en la matière.
Nous avons eu l’impression lors de certains de nos déplacements d’un État appauvri, secoué par les différentes vagues de RGPP, en difficulté pour faire entendre son rôle, ses réalisations et les principes dont il est le garant. En crise d’identité et de légitimité, l’État déconcentré semble justifier son existence par, au mieux, le rappel des crédits nationaux versés dans le cadre des Cucs et, le cas échéant, une tendance au contrôle tatillon et formaliste. Alors que nous avons besoin d’un État local garant de l’éthique et des principes républicains, facilitateur des initiatives locales, présent, avec ses personnels, au sein même de nos quartiers urbains difficiles, au service d’une politique nationale de la ville pilotée par les collectivités territoriales.
*
* *
Car nous avons la conviction que le maire est la seule autorité locale susceptible de traiter des problèmes territoriaux urbains dans leur globalité, en s’appuyant, le cas échéant, sur une approche et des solidarités intercommunales. Nos déplacements à Clichy-sous-Bois et Montfermeil, à Orléans et à Lyon, Bron et Vénissieux nous ont confirmé que relèvent du maire et de son équipe municipale l’engagement quotidien, l’enthousiasme, l’attachement intime à la ville dans toutes ses facettes, ainsi que la connaissance et la vision de l’ensemble urbain et de ses détails ; le maire est la clé de voûte d’une possible réussite de la politique de la ville.
Encore faut-il qu’il dispose des moyens adéquats. Nous considérons que malgré les efforts réels de ces dernières années concernant la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU-CS) et la dotation de développement urbain (DDU), le compte n’y est pas. La réalité aujourd’hui est encore pour certaines communes le cumul de faibles ressources et des charges et difficultés urbaines les plus lourdes. L’invention des dispositifs de péréquation postérieurs à la suppression de la taxe professionnelle doit être l’occasion d’une évaluation rationnelle et globale des besoins de péréquation et de la mise en œuvre pérenne des dispositifs correspondants, y compris, si nécessaire, en allant plus loin qu’aujourd’hui dans la remise en cause des situations acquises en matière de dotations nationales, afin de concentrer les moyens là où ils sont indispensables et y atteindre le seuil critique d’efficacité, plutôt que d’effectuer un saupoudrage qui ne satisfait personne.
Les moyens à imaginer demain sont certes financiers ; en la matière, il convient selon nous d’au moins stabiliser les crédits d’intervention à la disposition de l’Acsé pour les actions et initiatives locales ; de maintenir demain une aide spécifique à l’activité économique et de soutien à l’emploi à hauteur du coût actuel des exonérations applicables dans les ZFU, peut-être sous une autre forme ou dans un autre cadre géographique (car si le coût d’un emploi dans ces quartiers peut être élevé comme l’indique l’une des rares évaluations sur le dispositif des ZFU, certains de ses emplois n’ont pas de prix pour la vie des quartiers concernés, notamment dans les petits commerces) ; de permettre une péréquation à hauteur des enjeux ; et, bien entendu, de financer le PNRU au rythme de l’avancée des travaux dans les quartiers. Nous ne pensons pas que la politique de la ville dispose aujourd’hui de trop de moyens ; nous ne sommes d’ailleurs pas certains que leur niveau actuel ne devrait pas être augmenté, s’agissant des crédits d’intervention. Il est vraisemblable qu’ils ne sont pas suffisamment concentrés sur un nombre restreint de territoires délimités de façon objective.
Mais nous pensons aussi que les moyens à prévoir pour demain sont d’un autre ordre ; nous sommes favorables à mettre dans les mains du maire, dans un premier temps à titre expérimental, sur une base contractuelle et dans le cadre de la politique de la ville, d’autres leviers et facultés : signer les conventions d’emploi aidé en lieu et place de l’État ; organiser l’emploi et l’implantation des forces de sécurité publique ; affecter les effectifs de l’éducation nationale… Il ne peut y avoir de mauvaises idées qu’une fois les avoir réellement envisagées, et de préférence après les avoir testées. L’État, dans une décentralisation approfondie qui fait réellement confiance aux acteurs locaux, aurait alors un rôle effectif et primordial à jouer : élaboration conjointe avec la commune ou l’intercommunalité concernée du projet de territoire préalable à la contractualisation envisageant l’exercice local de nouvelles compétences ; rôle de garant en dernier recours des principes républicains et de la sécurité publique ; mesure et évaluation des résultats localisés à une échelle très fine à l’intérieur du quartier, dans un cadre national ayant, pourquoi pas, une fonction d’émulation des acteurs locaux (par exemple par l’organisation annuelle d’un débat public local sur le fondement des éléments d’évaluation actualisés disponibles).
Nous avons été surpris lors de notre visite aux Pays-Bas par la liberté et la simplicité avec laquelle les moyens de la politique de la ville sont pensés et organisés au service d’un projet local global, au plus près des quartiers, des commerçants et des habitants ; sans référence obligée et contraignante à des principes abstraits et théoriques sur les compétences des uns et des autres. Aujourd’hui en France, imaginer qu’un agent public puisse être concrètement à la fois sous l’autorité du maire et de l’État implique un parcours juridique dont le promoteur n’est pas certain de sortir gagnant, obligé qu’il est de justifier juridiquement et en opportunité une telle initiative.
*
* *
L’ensemble de nos travaux nous a amenés par ailleurs à nous poser certaines questions plus larges sur les objectifs de la politique de la ville. Nous sommes convaincus qu’il existera demain comme aujourd’hui des quartiers populaires. Si on vit mal aujourd’hui en France dans un certain nombre d’entre eux, il nous semble qu’une politique de la ville ambitieuse peut se donner l’objectif simple que leurs habitants y vivent mieux demain ; pour autant, nous semble-t-il, que chacun puisse y résider de façon digne et apaisée et qu’il n’y ait pas, sur le chemin que chaque personne conçoit pour sa propre vie et pour celles de ses enfants, d’obstacles liés au lieu de résidence, par le peu de ressources concrètes dont on y disposerait ou par la discrimination dont ce lieu serait à l’origine. Il s’agit simplement de permettre, dans ces quartiers comme ailleurs, l’accès à l’emploi, à un habitat digne et à un parcours scolaire qui valorise les capacités et le mérite ; à vrai dire, c’est bien ainsi que l’on pourra constater statistiquement, in fine, la réduction des « écarts à la moyenne », en matière de revenus notamment, ou de chômage, dont l’ampleur actuelle mériterait sans doute d’être plus largement rendue publique tant nous avons l’intuition que chacun n’en a pas pris l’exacte mesure.
Nous ne souhaitons pas remettre en cause certains moyens mis en œuvre dans un objectif de mixité sociale, y compris dans les communes et quartiers plus aisés. Il serait d’ailleurs judicieux d’éviter sur ce point une certaine contradiction des politiques nationales ; les quartiers urbains dans lesquels se concentre la précarité sociale en France n’ont pas bien entendu pas vocation à être le lieu d’accueil prioritaire des bénéficiaires du droit au logement opposable. Nous pensons cependant que l’objectif d’une amélioration des conditions et perspectives de vie des habitants de nos quartiers urbains les plus en difficulté est primordial, même si cet objectif est plus modeste que celui d’une « mixité sociale » qu’il serait possible de susciter par une politique ambitieuse des peuplements.
Que l’atteinte d’un objectif centré sur l’amélioration des situations des habitants des quartiers prioritaires se traduise par des mobilités résidentielles et professionnelles allant ou en provenance de ces quartiers, est alors plus accessoire, même si l’étude de ces mobilités reste à faire, notamment pour conforter l’hypothèse que ces quartiers assureraient, dans certains cas, une fonction bénéfique de « sas » dans une trajectoire sociale « ascendante », ce qui reste d’ailleurs à prouver. Dans la même perspective, devient plus secondaire la bonne manière d’envisager une réforme de la géographie prioritaire de la politique de la ville, même si cette réforme est nécessaire et doit s’appuyer sur des critères plus objectifs et plus précis qu’aujourd’hui, s’agissant notamment des ZUS, en resserrant sans doute leur nombre et leurs contours autour des quartiers urbains qui concentrent les plus grandes difficultés économiques et sociales.
Il est un dernier point, en guise de conclusion, que vos rapporteurs souhaiteraient aborder : chaque acteur, chaque praticien de la politique de la ville sait que le « public » de la politique de la ville est composé plus qu’ailleurs de personnes étrangères, de compatriotes d’origine étrangère et de jeunes « issus des minorités visibles », pour employer une expression un peu étrange, qui doit nous interroger sur notre incapacité collective à dire ce qu’il en est de la diversité des couleurs qui composent aujourd’hui le visage de la France. Une République ambitieuse pour ses quartiers urbains en difficulté n’a rien à perdre à parler franchement et à assumer clairement cette réalité. Au-delà des moyens humains, techniques et juridiques mis en œuvre pour réussir la politique de la ville, ce serait sans doute un atout pour l’exercice d’une parole publique républicaine efficace contre les racismes, les discriminations et les communautarismes.
LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES :
POUR UNE INDÉPENDANCE SOUS LA GARANTIE DU PARLEMENT
Rapport d’information n° 2925, présenté le 28 octobre 2010
par MM. René Dosière et Christian Vanneste, rapporteurs
Synthèse
Le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC) a décidé, en octobre 2009, de consacrer une étude aux autorités administratives indépendantes (AAI), s’interrogeant en particulier sur l’efficacité de leur action par rapport à celle des administrations traditionnelles et des juridictions.
Par un mouvement quasiment à sens unique, il existe maintenant plus de 40 AAI, la première création d’une AAI en tant que telle (Commission nationale de l’informatique et des libertés - CNIL) datant de 1978. Ces créations ont concerné deux secteurs principaux : la protection des libertés publiques et la régulation des activités économiques. La création d’agences indépendantes ou autonomes fait certes partie d’un mouvement constaté dans tous les pays démocratiques. Cependant, alors que dans les autres pays on constate un dégradé progressif du niveau d’autonomie des agences, la particularité du système français est une dichotomie très nette entre les 42 AAI et les quelque 650 autres « opérateurs de l’État », disposant d’une simple autonomie.
Les justifications légitimes de la création des AAI sont multiples : impartialité, directives européennes, régulation, médiation en équité, pouvoir de sanction, professionnalisme, réactivité, souplesse, association des parties prenantes... Cependant, il s’agit parfois surtout de pallier l’inefficacité de l’administration ou un manque de courage politique (« un problème, une commission »), voire de procéder à une simple opération de communication.
La multiplication des AAI pose maintenant un risque de lisibilité, de complexité institutionnelle (chevauchement de compétences entre AAI, doublons avec les services des ministères) et de démembrement de l’État, alors qu’in fine c’est le ministre qui est responsable politiquement devant le Parlement. Les AAI ne disposent pas de la légitimité qu’assurent l’élection et la responsabilité politique. On peut craindre qu’elles échappent à tout contrôle et aillent au-delà de leurs compétences en empiétant sur les pouvoirs exécutifs (pouvoir règlementaire délégué), législatifs (« droit mou ») et judiciaires (sanctions).
Le poids des AAI reste modeste au regard du budget de l’État. Seules 16 AAI sur 42 emploient plus de 20 agents. Elles employaient 3 126 personnes (ETPT) en 2007, selon la direction du Budget, et prévoyaient d’employer 3 651 ETPT en 2010 (soit une croissance annuelle moyenne de 5,3 %.). Toujours selon la direction du Budget, les crédits consommés par les AAI s’élevaient à 387,1 millions d’euros en 2009 par rapport aux 303,8 millions d’euros consommés en 2006, soit une croissance annuelle moyenne de 8,4 %. Ces chiffrages sont sans doute sous-évalués. Il ressort des réponses à un questionnaire envoyé aux AAI que, si l’on inclut les coûts supportés par d’autres organismes publics et mis gracieusement à disposition des AAI, les dépenses des AAI s’élèveraient à plus de 600 millions d’euros en 2009, soit une majoration de 50 % par rapport aux statistiques sur les coûts directs calculées par la direction du Budget. De plus, entre 2009 et 2010, l’augmentation des dépenses des AAI serait supérieure à 11 %.
Au début 2010, la fusion de trois AAI au sein de l’Autorité de contrôle prudentielle (ACP), adossée à la Banque de France, s’est accompagnée d’une croissance des effectifs et des dépenses. Plusieurs AAI envisagent une croissance importante de leurs effectifs dans les années à venir. Sauf missions nouvelles, les AAI devraient être astreintes aux mêmes disciplines que les autres administrations d’État, qui doivent réduire leurs frais de fonctionnement de 10 % en trois ans. De même leur masse salariale à missions constantes devrait rester stable pendant trois ans.
Un effort de rationalisation est indispensable. Il passe par des regroupements permettant d’atteindre une taille critique et de générer des gains d’échelle :
– le Défenseur des droits regrouperait le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants et la HALDE ;
– un « Contrôleur général » de la sécurité regrouperait la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), avec à terme, une fusion au sein du Défenseur des droits ;
– les quatre AAI chargées de la surveillance de la vie politique devraient être regroupées, au sein d’une Haute autorité de la transparence de la vie politique dont la compétence s’étendrait au redécoupage électoral ;
– ARCEP, CSA et HADOPI seraient rapprochés (convergence numérique) ;
– de même, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) et le Médiateur national de l’énergie ;
– un regroupement des différentes autorités en charge de la concurrence devrait être envisagé à terme (Autorité de la concurrence, CRE et Autorité de régulation des activités ferroviaires – ARAF)
– les AAI les plus modestes devraient faire l’objet de regroupements géographiques permettant des synergies de fonctionnement.
Le rapport propose également la suppression de certaines AAI qui ont d’ores et déjà perdu leur justification, voire leur utilité : Commission des participations et des transferts (CPT) et Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) ; les compétences de la Commission nationale du débat public (CNDP) pourraient également être transférées, après une période transitoire.
Indépendance ne saurait signifier irresponsabilité. Le contrôle exercé jusque là sur les AAI par le Parlement est insuffisant. Le mode de désignation du président et des autres membres du collège est caractérisé en France par une prédominance de l’exécutif. Seule l’élection, ou la validation, par une majorité « positive » qualifiée des trois cinquièmes au Parlement est à même d’assurer au président d’une AAI une forte autorité et une indépendance réelle, avec un mandat non renouvelable suffisamment long (6 à 7 ans). L’existence d’un collège et son bon fonctionnement sont des gages d’indépendance (règles de quorum, transparence…). Un équilibre doit être assuré dans la composition du collège entre sa représentativité suffisamment large et son nécessaire caractère resserré. L’irrévocabilité des membres des collèges doit être assurée, sous réserve de la mise en place de règles d’incompatibilités et d’une charte de déontologie.
Certaines AAI ne disposent pas de moyens financiers et humains suffisants pour remplir les missions qui leur sont assignées, ainsi la CNIL ou l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). Il convient d’envisager, quand cela est possible, le financement des AAI par une contribution supportée par le secteur régulé, en contrepartie des services dont il bénéficie. Il convient également d’assurer aux AAI une liberté de gestion et de choix des recrutements.
L’évaluation des AAI reste embryonnaire. Des constats plutôt encourageants sont dressés par les parties prenantes : indépendance reconnue, expertise saluée, proximité réelle et réactivité. Une meilleure garantie des droits de la défense serait souhaitable dans les procédures de sanction, en application de l’article 6 de la CEDH, relatives au caractère équitable d’un procès. La possibilité d’adopter des mesures alternatives aux sanctions, notamment sur les affaires comportant de faibles enjeux, devrait être envisagée, afin de permettre aux autorités de se concentrer sur les dossiers les plus importants. Enfin, toute décision de sanction doit être rendue publique.
Le manque de transparence des budgets et des effectifs des AAI cache une forte croissance tendancielle. Plusieurs AAI ne présentent pas de budget consolidé, même de façon analytique ; certaines ne connaissent pas même leur coût global. De manière générale, les rémunérations, tant des membres des collèges que des services administratifs, manquent de cohérence au regard des responsabilités.
L’immobilier constitue un point noir de la gestion des AAI, avec un ratio de 17,6 m2 (SUN) par poste de travail, supérieur de près de 50 % à la cible retenue de 12 m2 pour l’État. Les AAI concentrent leur implantation dans les arrondissements les plus chers de Paris ; une seule se trouvant en banlieue proche (Haute autorité de santé - HAS), une autre en province (l’ARAF). Il convient de procéder immédiatement à un réexamen de tous les baux conclus par les AAI.
Pour améliorer leur contrôle, la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) doit être déclinée à l’égard des AAI, sous réserve des aménagements imposés par leur indépendance. En particulier, elles doivent définir une stratégie de performance avec objectifs et indicateurs, dans les documents budgétaires et surtout dans leurs rapports annuels. Les autorités publiques indépendantes (API) financées par des ressources propres doivent être intégrées dans les documents budgétaires, sous le contrôle d’un rapporteur spécial de la commission des Finances. Leurs effectifs doivent être soumis à un plafond d’autorisation des emplois. Plus généralement, il conviendrait de systématiser l’audition annuelle du président de chaque AAI par les commissions compétentes des Assemblées, éventuellement sous une forme adaptée pour les AAI de taille modeste
Le rapport se conclut par 27 recommandations, regroupées sous trois thèmes :
– la rationalisation des structures (recommandations 1 à 11),
– une meilleure garantie de l’indépendance des AAI (12 à 16),
– un contrôle approfondi des AAI, notamment parlementaire (17 à 27).
RATIONALISATION
Recommandation n° 1 : Élargir l’initiative et la publication des avis des AAI.
– permettre aux commissions permanentes des Assemblée, au même titre que le Gouvernement, de demander un avis aux AAI entrant dans leur champ de compétence respectif ;
– généraliser à l’ensemble des AAI qui ont le pouvoir d’émettre des avis, la publication de leurs avis sollicités par le Gouvernement sur les projets de loi.
Recommandation n° 2 : Limiter et encadrer le pouvoir règlementaire des AAI.
– définir précisément dans la loi pour chaque AAI qui en est dotée l’ampleur et les limites de leur pouvoir réglementaire délégué ;
– ouvrir la possibilité de saisine du Conseil d’État par les AAI pour solliciter un avis sur leurs projets d’actes règlementaires, voire sur des questions plus générales de leur domaine de compétences propre ;
– permettre au commissaire du Gouvernement de solliciter une seconde délibération sur les projets d’actes règlementaires des AAI ;
– permettre au Gouvernement d’homologuer les actes règlementaires des AAI.
Recommandation n° 3 : Encadrer l’élaboration des lignes directrices émises par les AAI.
– assurer la prise en considération suffisante de l’ensemble des parties prenantes des AAI par l’établissement de groupes de travail ou de consultations associant publics, partenaires et usagers ; assurer en particulier les conditions d’une consultation préalable des parties prenantes et une transparence suffisante lors de l’élaboration par les AAI de leurs lignes directrices ;
– permettre au commissaire du Gouvernement de solliciter une seconde délibération sur les projets de lignes directrices des AAI ;
– s’assurer que ces lignes directrices ne soient pas créatrices de règles empiétant sur le domaine de la loi et du règlement en prévoyant par exemple un mécanisme par lequel le commissaire du Gouvernement puisse déférer devant le juge administratif les actes des AAI à portée générale qu’il estimerait excéder leur champ de compétences.
Recommandation n° 4 : Unifier les compétences des juridictions pour les recours contre les actes individuels des AAI.
– définir dans chaque loi créant une AAI la compétence juridictionnelle pour les recours contre leurs actes individuels, en l’unifiant soit au sein de l’ordre administratif, soit au sein de l’ordre judiciaire.
Recommandation n° 5 : Évaluer la création et le maintien des AAI.
– mieux définir les cas dans lesquels la création d’une AAI se justifie ;
– créer les nouvelles AAI pour une durée limitée a priori, par exemple cinq ans ;
– faire réévaluer périodiquement par les commissions permanentes des Assemblées la justification des AAI existantes ;
– utiliser une grille d’analyse commune pour la création et la réévaluation périodique des AAI.
Recommandation n° 6 : Regrouper certaines AAI pour optimiser la répartition des compétences et réduire les dépenses de fonctionnement.
– regrouper au sein du Défenseur des droits, prévu par la Constitution, le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants et la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) ;
– regrouper la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) pour créer un « Contrôleur général de la sécurité » ;
– intégrer le « Contrôleur général de la sécurité » dans le Défenseur des droits à l’issue du mandat de l’actuel Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) prévu en juin 2014 ;
– intégrer à terme la Commission nationale du débat public (CNDP) dans le Défenseur des droits, selon les modalités décrites dans la recommandation n° 9 ;
– regrouper la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) pour créer une autorité unique en charge du traitement des données ;
– regrouper dans le cadre de la convergence numérique le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI), en lien avec le Forum de l’Internet ; pour ne pas entraver les travaux en cours, cette fusion pourrait intervenir après le 30 novembre 2011, date du passage de la télévision hertzienne au numérique ;
– regrouper les deux AAI intervenant dans le domaine de l’énergie, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) et le Médiateur national de l’énergie ;
– regrouper à terme au sein de l’Autorité de la concurrence les autorités de régulation économique sectorielles (CRE, Autorité de régulation des activités ferroviaires - ARAF…) actuellement chargées d’assurer la transition entre un monopole d’État et un marché concurrentiel ; procéder tous les cinq ans à un réexamen de la justification de ces autorités sectorielles ;
– procéder au regroupement géographique des autorités intervenant dans des domaines proches ou connexes ; mutualiser les moyens logistiques des AAI de petite taille (immobilier, gestion des ressources humaines, gestion comptable, informatique, salles de réunion, marchés publics, achats, logistique, transports…).
Recommandation n° 7 : Créer une Haute autorité chargée de la transparence de la vie politique.
– créer une Haute autorité chargée de la transparence de la vie politique qui regrouperait la Commission nationale des comptes de campagne et financements politiques (CNCCFP), la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale relative à l’élection du Président de la République (CNCCEREPR), la Commission des sondages, la Commission pour la transparence financière de la vie politique (CTFVP) ; confier à cette autorité une compétence consultative en matière de redécoupage électoral en lui confiant les tâches actuellement exercées par la commission prévue par l’article 25 de la Constitution ; préconiser que son président soit élu par le Parlement à la majorité qualifiée des trois cinquièmes.
Recommandation n° 8 : Supprimer les AAI qui ont d’ores et déjà perdu leur justification, voire leur utilité.
– supprimer la Commission des participations et des transferts (CPT) en confiant les missions qu’elle accomplit à une autre AAI de nature financière ;
– supprimer la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) en réintégrant l’urbanisme commercial dans l’urbanisme général.
Recommandation n° 9 : Transformer et intégrer à terme la Commission nationale du débat public (CNDP) dans le Défenseur des droits.
– transformer la Commission nationale du débat public (CNDP) en scindant ses activités en deux : l’organisation des grands débats d’ampleur nationale serait confiée au Parlement ; la CNDP resterait compétente pour l’organisation des seuls débats d’intérêt local (infrastructure de transport…) ;
– intégrer à terme la CNDP au sein du Défenseur des droits, avec la création d’un adjoint au débat public doté d’un collège spécifique.
Recommandation n° 10 : Préciser les missions des AAI, notamment pour éviter les recouvrements entre elles.
– déterminer avec précision dans la loi les missions des différentes AAI pour éviter les chevauchements de compétences ; organiser dans la loi les relations des AAI qui doivent agir de concert sur des domaines communs.
Recommandation n° 11 : Clarifier les compétences des AAI et des services des ministères.
– définir clairement le partage des compétences entre chaque AAI et les autres administrations d’État du même domaine de compétence, afin de supprimer les doublons ;
– en particulier intégrer au sein des AAI les services ministériels qui travaillent exclusivement pour elles, par exemple la partie de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) qui travaille pour l’Agence de sûreté nucléaire (ASN), ainsi que le Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, ou encore la petite partie des services des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) qui travaillent pour l’Agence de française de lutte contre le dopage (AFLD) dans le cadre d’une convention prévue par la loi.
INDÉPENDANCE
Recommandation n° 12 : Améliorer la légitimité et la représentativité des collèges.
– assurer un meilleur équilibre entre les pouvoirs du Gouvernement et du Parlement dans la désignation des membres du collège des AAI ; prévoir notamment pour toutes les AAI une désignation de leur président à la majorité qualifiée des trois cinquièmes des membres des commissions compétentes des deux Assemblées ; permettre dans chaque collège la nomination d’au moins une personnalité qualifiée par les présidents de chaque Assemblée ;
– assurer les conditions d’un bon fonctionnement des collèges, la collégialité étant considérée comme un gage d’indépendance ; doter en particulier chaque AAI d’un collège proportionné à sa taille ; en contrepartie, instaurer des règles de quorum, avec démission d’office en cas d’absence répétée non justifiée ;
– préconiser que, compte tenu de l’importance du choix des présidents des collèges, des dispositions de nature législatives établissent précisément les caractéristiques des personnes appelées à présider ou à siéger dans les collèges ;
– assurer dans la composition des collèges la représentation équilibrée de la diversité des points de vue et des expériences professionnelles ; instaurer pour ce faire un mécanisme de désignation de certains membres des collèges par le Conseil économique, social et environnemental.
Recommandation n° 13 : Améliorer le fonctionnement des collèges.
– assurer dans les dispositions législatives créant les AAI l’irrévocabilité des fonctions de président, sauf empêchement défini par décret en Conseil d’État ;
– généraliser – sauf exception justifiée – les mandats non renouvelables et jouissant d’une durée suffisante (5 à 7 ans) ;
– prévoir dans les dispositions législatives créant les AAI un régime d’incompatibilité des membres du collège qui garantisse leur indépendance ; compléter ces dispositions législatives par des dispositions d’application à prendre par chaque AAI pour assurer le respect de règles strictes en matière de déontologie, tant pour les membres du collège que pour les personnels des services ; assujettir en particulier les membres des collèges des AAI de régulation économique à une obligation de déclaration de patrimoine en début et en fin de mandat ;
– adapter la notion de membres des collèges à temps plein ou à temps partiel aux besoins des autorités.
Recommandation n° 14 : Généraliser, sauf exception justifiée, la présence d’un commissaire du Gouvernement dans chaque AAI.
Recommandation n° 15 : Assurer un financement pérenne des AAI.
– veiller à ce que, lors de leurs auditions régulières par les commissions permanentes des Assemblées (présentation du rapport annuel et examen du projet de loi de finances), les moyens financiers et humains des AAI soient assurés au regard des missions qui leur sont confiées.
– envisager, quand cela est possible, le financement des AAI par une contribution dont la charge serait supportée par le secteur régulé en contrepartie des services ainsi rendus.
Recommandation n° 16 : Préserver l’autonomie de gestion des AAI.
– assurer les conditions d’une réelle autonomie de gestion de chaque AAI, notamment en termes d’utilisation des crédits dans le cadre d’un budget global et de choix de recrutement ;
– permettre aux AAI sans personnalité morale de recruter des CDI pour améliorer la permanence de leurs effectifs.
CONTRÔLE
Recommandation n° 17 : Encadrer le pouvoir de sanction des AAI.
– garantir, en conformité avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, les conditions d’une procédure juste et équitable assurant le respect des droits de la défense ;
– étudier, en liaison avec le Conseil d’État, la possibilité d’édicter un code des procédures commun à toutes les AAI disposant du pouvoir de sanction ;
– assurer la séparation des fonctions d’instruction et de jugement en permettant des modalités d’applications comportant ou non la création d’une commission des sanctions ;
– établir le principe de la publication systématique des décisions de sanction, sauf dans les cas dûment motivés où leur publication perturberait gravement les marchés ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause ;
– accroître la présence de magistrats dans les commissions des sanctions ;
– permettre un recours du collège contre les décisions de la commission des sanctions ;
– développer plus largement la possibilité ouverte aux AAI d’adopter des mesures alternatives aux sanctions, notamment sur les affaires comportant de faibles enjeux, afin de leur permettre de se concentrer sur les dossiers les plus importants.
Recommandation n° 18 : Stabiliser la masse salariale des AAI et supprimer les doublons entre services des ministères et AAI.
– stabiliser pour les trois prochaines années la masse salariale au niveau de 2010 à missions constantes ; en cas d’accroissement des missions, une dérogation à cette règle ne pourrait être envisagée qu’après une étude d’impact présentée préalablement au Gouvernement et au Parlement.
– veiller à ce que soient effectivement supprimés les services des ministères qui doublonneraient dans les domaines de compétence où une AAI a été créée.
Recommandation n° 19 : Instaurer des grilles de rémunération au sein des AAI.
– instaurer, en fonction de leurs pouvoirs et de leurs responsabilités, des grilles de rémunération des présidents d’AAI, des membres des collèges et des personnels de direction.
Recommandation n° 20 : Assurer la transparence des budgets des AAI.
– présenter pour chaque AAI un budget global incluant tous les coûts, y compris ceux supportés par le budget d’autres organismes publics, le cas échéant en pratiquant une comptabilité analytique – en particulier pour les immeubles et les personnels mis gracieusement à disposition, sur une base forfaitaire en fonction du grade et de l’emploi.
Recommandation n° 21 : Réduire les dépenses immobilières des AAI.
– procéder avec le service France Domaine à un réexamen immédiat des implantations immobilières de toutes les AAI, afin d’arbitrer entre une occupation locative ou domaniale, de rationaliser l’occupation et de réduire les coûts ;
– soumettre toutes les AAI, pour la négociation des baux et l’acquisition et la construction d’immeubles, en particulier par le recours à l’emprunt ou l’utilisation d’un fonds de roulement abondant, à la procédure de l’avis domanial rendu par le service France domaine ;
– publier sur une base annuelle pour chaque AAI les deux indicateurs de performance immobilière relatifs au loyer annuel par m2 et à la surface utile nette occupée par agent ; respecter à cet égard les objectifs de performance immobilière que l’État a fixés pour ses services.
Recommandation n° 22 : Réduire les autres dépenses de fonctionnement des AAI.
– appliquer aux AAI, à missions constantes, les mêmes disciplines que l’État impose à ses services en matière de réduction des dépenses de fonctionnement, avec une attention particulière pour les dépenses de communication et de transports.
Recommandation n° 23 : Décliner pour les AAI la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).
– conclure une charte de gestion entre le responsable de programme de rattachement et le président de chaque AAI, en vue de son insertion dans le cadre budgétaire prévu par la LOLF, sous réserve d’aménagements garantissant l’indépendance de l’AAI ;
– veiller à préserver le principe consistant à créer une action (au sens budgétaire) par AAI dans chaque programme budgétaire, avec la possibilité de regroupement pour les plus petites d’entre elles ; appliquer en particulier ce principe à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), dont les crédits budgétaires sont répartis dans quatre programmes ;
– créer un budget opérationnel de programme (BOP) propre à chaque AAI afin d’assurer son autonomie de gestion ;
– établir, d’un commun accord entre le responsable du programme de rattachement et le président de chaque AAI, le dispositif d’évaluation de la performance présenté dans les projets et rapports annuels de performances annexés aux projets de loi de finances ;
– organiser des conférences budgétaires spécifiques directement avec la direction du Budget (ministère du Budget) ;
– subordonner la fongibilité avec les crédits des AAI à un accord préalable entre le responsable de programme de rattachement et le président de l’AAI ;
– établir une régulation budgétaire de telle sorte que la mise en réserve des crédits dédiés à chaque AAI soit strictement limitée au taux appliqué au programme de rattachement ;
– maintenir l’exemption systématique des AAI du contrôle financier a priori.
Recommandation n° 24 : Assurer le contrôle des autorités publiques indépendantes (API) dotées de la personnalité morale.
– proposer de faire désigner par la commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale un rapporteur spécial pour les autorités indépendantes financées sur ressources propres ;
– créer une annexe générale au projet de loi de finance comportant, pour chaque autorité publique indépendante, une présentation stratégique avec la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance, une présentation des actions, une présentation des crédits et des emplois, une justification des crédits au premier euro et une évaluation des ressources propres perçues ;
– fixer chaque année dans le projet de loi de finances un plafond des autorisations d’emplois pour les autorités publiques indépendantes ;
– constituer dès la création d’une autorité publique indépendante un fonds de roulement initial, qui ne devrait pas dépasser une norme fixée en fonction des besoins réels de trésorerie de l’organisme.
Recommandation n° 25 : Présenter au Gouvernement et au Parlement un rapport annuel d’activité.
Recommandation n° 26 : Élaborer des objectifs et des indicateurs de performance.
– prévoir pour toutes les AAI, dans leurs rapports annuels d’activité, un dispositif d’évaluation de la performance qui, au–delà des indicateurs d’activité par ailleurs nécessaires, construise des indicateurs de performance présentant un équilibre entre les indicateurs d’efficacité socio-économique, de qualité de service et d’efficience de gestion ;
– instaurer une méthodologie commune aux AAI effectuant des missions comparables pour les indicateurs mesurant notamment le coût de traitement d’un dossier ou le nombre de dossiers traités par agent et par an ;
– calculer pour les AAI les plus importantes les indicateurs de fonction support (immobilier, bureautique, gestion des ressources humaines) selon la méthodologie commune suivie par les autres administrations d’État.
Recommandation n° 27 : Systématiser au moins une fois par an l’audition du président de chaque AAI par les commissions compétentes des Assemblées, au besoin en en adaptant les modalités à la taille de l’autorité.
*
* *
Suivi du rapport : Les rapporteurs transmettent aux commissions permanentes concernées les documents qu’ils ont recueillis au cours de leurs travaux.
Un bilan du suivi des recommandations pourra être effectué par les différentes commissions permanentes pour leurs AAI respectives. Une synthèse de ce bilan pourra alors être présentée par les rapporteurs au Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC) au titre du suivi du présent rapport
L’AIDE MÉDICALE DE L’ÉTAT :
MIEUX GÉRER UN DISPOSITIF NÉCESSAIRE
Rapport d’information n° 3524, présenté le 9 juin 2011
par MM. Claude Goasguen et Christophe Sirugue, rapporteurs
Synthèse
Compte tenu de la démarche d’évaluation suivie par le CEC, la première partie du présent rapport vise à rappeler les objectifs initiaux du dispositif de l’AME, qui comporte des enjeux humanitaires, économiques, juridiques et de santé publique. Elle rappelle l’historique des soins apportés aux personnes en situation irrégulière, les circonstances de la création de l’AME sous sa forme actuelle en 1999 puis les modifications intervenues par la suite, notamment à la fin de l’année 2010. Après un rappel des conditions d’accès au dispositif, les niveaux de prestation assurées aux bénéficiaires de l’AME, de la CMUc et d’un assuré du régime général sont comparés. Il est enfin procédé à un comparatif européen des législations relatives à l’accès aux soins des personnes en situation irrégulière, qui permet de conclure que la France dispose d’un système assez protecteur, au moins en théorie.
La deuxième partie se concentre sur l’application et l’évaluation du dispositif. Abordant d’abord les questions relatives au dépôt et à l’instruction des demandes, elle note les difficultés rencontrées « sur le terrain », en exploitant les réponses fournies par les CPAM au questionnaire envoyé par la mission. Cette partie relate aussi les difficultés d’accès au dispositif et aux prestations que peuvent rencontrer les demandeurs et bénéficiaires de l’AME. Elle décrit le problème de l’évaluation de la réalisation des objectifs du dispositif compte tenu d’une part de la fiabilité réduite des statistiques relatives à la gestion de l’AME et d’autre part de l’absence de données relatives à la santé des personnes en situation irrégulière, même si des études de nature disparate permettent de s’en approcher. La partie se conclut sur le contrôle et l’évaluation parlementaire de l’AME, en décrivant de manière critique la « lolfisation » insuffisante du dispositif.
La troisième partie se penche sur les coûts croissants du dispositif et les explications de cette croissance. La hausse des dépenses est irrégulière, mais vérifiée sur longue durée. S’attachant à retrouver les causes de cette évolution, cette partie exclut certaines causes (la fraude, la croissance de la consommation moyenne, l’augmentation du nombre d’ayants droit par ouvrant droit). Les causes sont plutôt dues sur le long terme, à la croissance du nombre de bénéficiaires de l’AME et aux modalités de la facturation hospitalière.
La quatrième partie dresse une liste de recommandations communes aux deux rapporteurs visant à améliorer les modalités de gestion. Il s’agit de proposer des instruments d’un meilleur pilotage et des outils d’une meilleure maîtrise des dépenses, notamment grâce à une tarification hospitalière modifiée. La nécessité d’une budgétisation correcte des besoins en loi de finances initiales, gage d’un meilleur contrôle parlementaire, est soulignée. Il est également proposé d’instaurer une visite de prévention obligatoire.
La cinquième partie comporte les recommandations spécifiques à chaque rapporteur.
*
* *
I.– LES RECOMMANDATIONS COMMUNES DES RAPPORTEURS, SANS REMETTRE EN CAUSE LE PRINCIPE DE L’AIDE MÉDICALE D’ÉTAT, VISENT À EN AMÉLIORER LES MODALITÉS DE GESTION
Au terme de cette démarche d’évaluation du dispositif de l’aide médicale d’État, les rapporteurs ont pu établir un constat commun et formuler ensemble quelques recommandations. Certaines recommandations spécifiques à chacun des rapporteurs font l’objet de développements particuliers dans la partie V du présent rapport (cf. infra).
A.– LA NÉCESSITÉ DU MAINTIEN DE L’AME S’ACCOMPAGNE DE CELLE DE RÉFORMES DE GESTION
1. La nécessité du maintien d’un système spécifique d’accès aux soins, sous conditions, pour les personnes en situation irrégulière
Il est remarquable de constater que deux motivations totalement opposées peuvent conduire à vouloir remettre en cause l’AME en tant que dispositif juridique particulier. Ainsi, certains, estimant son coût démesuré, jugeant le dispositif trop « généreux » ou prompt à susciter des flux d’immigration ou de « tourisme médical », préconisent sa suppression ; d’autres, se fondant sur des conceptions humanitaires et sanitaires, considèrent que la distinction entre l’AME et la CMU est dépassée et appellent à une fusion des deux dispositifs.
S’agissant d’un sujet comme celui de l’AME, parvenir à un constat commun était important. Les rapporteurs souhaitent donc souligner à ce stade que le principe même de l’AME doit être préservé.
Les rapporteurs estiment notamment que compte tenu de la population concernée, très spécifique, une fusion du dispositif dans celui de la CMU, qui aurait peut-être un sens du point de vue de la politique de santé publique, serait inopportune. Le régime de l’AME semble adapté aux caractéristiques de cette population, peut limiter certains excès grâce à ses conditions d’accès et enfin permet de maintenir une distinction administrative et symbolique entre les personnes en situation irrégulière et les étrangers disposant d’un titre de séjour.
Les rapporteurs soulignent que des considérations humanitaires comme des impératifs de politique de santé publique imposent le maintien de l’accès aux soins à ces personnes et que les coûts correspondants, bien qu’en hausse, ne suffisent pas à motiver une suppression dont les conséquences sanitaires et financières pourraient être contre-productives.
Se fondant sur ce constat commun et la conclusion du maintien du dispositif de l’AME, les rapporteurs formuleront donc des propositions, également communes, relatives à la gestion du dispositif.
2. Des recommandations de gestion
La conclusion commune de l’opportunité du maintien du dispositif de l’AME dans son principe ne doit pas empêcher – et bien au contraire – de mettre en place les moyens d’en améliorer le fonctionnement. Ces recommandations ont pour ambition de tirer les leçons de l’évaluation et de mettre en place les conditions d’une amélioration des conditions de gestion de cette prestation sociale. Les rapporteurs estiment nécessaire d’explorer toutes les pistes permettant d’imprimer plus de rigueur à l’administration du dispositif, tout en se rapprochant à moindre coût de son but ultime, l’amélioration de la santé des personnes en situation irrégulière. Il s’agit principalement de déployer l’action publique dans trois directions différentes :
– appliquer progressivement une tarification de droit commun aux soins hospitaliers délivrés aux patients bénéficiaires de l’AME ou de soins urgents ;
– améliorer la connaissance de la population des personnes en situation irrégulière concernées, à la fois d’un point de vue statistique et sanitaire, ce qui doit aller de pair avec une budgétisation correcte des besoins en loi de finances initiale et enfin
– mettre en place un suivi médical d’aval efficace des patients bénéficiaires de l’AME ainsi qu’une première visite de prévention lors de la première année du bénéfice de la prestation.
B.– ADOPTER PROGRESSIVEMENT UNE TARIFICATION DE DROIT COMMUN PAR GROUPE HOMOGÈNE DE SÉJOUR (GHS) AFIN DE SE RAPPROCHER D’UNE « VÉRITÉ DES COÛTS »
1. Abandonner le tarif journalier de prestation pour l’AME
Il semble aux rapporteurs qu’une des premières décisions à prendre consiste à changer le mode de tarification des soins hospitalier en abandonnant le tarif journalier de prestation (TJP) pour adopter la tarification de droit commun par groupe homogène de séjour (GHS) pour les patients relevant de l’AME au sens strict ou du régime des soins urgents.
Les rapporteurs, en la matière, rejoignent les conclusions de la mission conjointe IGAS IGF de 2010, qui estiment que le TJP est devenu « une variable d’ajustement des recettes de l’hôpital dans des conditions manquant de transparence ». La solution passerait donc par la modification de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 afin d’aligner la facturation des soins dispensés aux patients relevant de l’AME sur celle des soins dont bénéficient les bénéficiaires de la CMUc.
Ce changement permettra de substantielles économies s’agissant des dépenses de l’État sans changement majeur de la qualité de la prise en charge sanitaire des personnes en situation irrégulière. En effet, les GHS sont forfaitaires, ne dépendent pas de la durée d’hospitalisation et sont nationaux.
Cet ajustement ne peut pas, au risque de déséquilibrer excessivement les équilibres financiers des comptes des hôpitaux, être réalisé brusquement, sur une période trop courte ou sans accompagnement financier. Il ne faut pas sous-estimer la difficulté de la réforme. Elle pourrait constituer un choc financier pour l’hospitalisation publique, particulièrement pour les grands groupes (AP-HP, AP-HM, Hospices civils de Lyon). Elle pourrait aussi conduire à des transferts de charge entre établissements d’une même zone. Il importe donc d’adopter, après les nécessaires étapes de concertation, une démarche aussi pragmatique que progressive, dans une perspective pluriannuelle.
La proposition, qui recueille un certain consensus dans son principe, serait d’aboutir à un passage à une tarification par GHS en deux ou trois ans, en accompagnant ce passage par des mesures financières visant notamment à abonder les ressources perçues par les hôpitaux au titre des missions d’intérêt général et d’aides à la contractualisation (MIGAC), sous la supervision des agences régionales de santé.
2. L’exigence de vérité des coûts et de transparence
Il faut à ce stade nuancer l’intérêt intrinsèque de cette proposition en termes de maîtrise des dépenses publiques considérées dans leur ensemble. L’AME est financée sur crédits d’État ; la tarification par GHS, si les efforts de productivité souhaitables ne sont pas au rendez-vous, pourrait conduire à accroître significativement le déficit des hôpitaux, ou les charges de l’assurance maladie.
Cela pourrait peser sur les comptes de l’assurance maladie et ne pas permettre une maîtrise globale de la dépense publique considérée dans son ensemble. Il serait en effet envisageable que la charge financière ne soit plus inscrite dans le périmètre du budget de l’État mais vienne, sans réduction notable, alourdir les dépenses de la branche de l’assurance maladie. Au regard des engagements de la France vis-à-vis de l’Union européenne, ce transfert serait alors neutre (14).
Cette réforme mérite cependant d’être soutenue car elle permettra de répondre à une exigence de transparence démocratique et de tendre vers une « vérité des coûts », qui pourrait être le moteur éventuel d’un accroissement de productivité supplémentaire dans les hôpitaux publics, notamment par la diminution de la durée de séjour des bénéficiaires de l’AME, lorsque celle-ci est possible, ou par le développement de soins réalisés en ambulatoire.
C.– SORTIR DU FLOU STATISTIQUE EN AMÉLIORANT LA CONNAISSANCE DE LA POPULATION EN CAUSE ET EN BUDGÉTISANT CORRECTEMENT LES BESOINS
Les rapporteurs estiment que des efforts restent à faire afin d’améliorer la connaissance statistique et sanitaire des bénéficiaires de l’AME.
De plus, la situation dans le département de la Guyane exige des mesures spécifiques.
Enfin, il est nécessaire que les dotations des lois de finances initiales prévoient correctement les besoins.
1. Suivi sanitaire : donner plus de profondeur aux données de l’assurance maladie
Il est impératif d’améliorer la connaissance statistique des conditions de gestion de cette prestation et de l’état de santé des bénéficiaires de l’AME.
Cela exige notamment de constituer des séries longues, ce qui conduit à souligner l’intérêt de la remise en cause du plafond de 24 mois (plus l’année en cours) de conservation des données de l’assurance maladie contenues dans la base de données ERASME (15) de l’assurance maladie (régime général), ces données étant ensuite anonymisées au sein du SNIIRAM (tous régimes). La base de données est assez riche puisqu’elle permet de disposer des données suivantes : âge, sexe, ALD, localisation, date de décès et des informations sur la consommation de soins en ville et dans les établissements.
Il s’agit d’un problème récurrent soulevé par d’autres acteurs de la politique de santé publique. En effet, d’autres acteurs de la politique de santé publique, notamment les épidémiologistes, pharmacologues et cancérologues recherchent plus de profondeur dans ces statistiques. Selon les informations recueillies auprès des services de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), une demande de prolongation d’un an pourrait être déposée auprès de l’autorité administrative : les données pourraient être consultées sur une période s’étendant de l’année en cours n à l’année n-3. Cependant, cette prolongation d’une année par rapport au droit en vigueur pourrait s’avérer insuffisante. Il serait sans doute préférable d’aboutir à une durée significativement plus longue.
2. Améliorer les connaissances publiques sur l’accès aux soins et l’état de santé des bénéficiaires de l’AME
La démarche d’évaluation a mis en évidence le manque de données relatives à l’accès aux soins et à l’état de santé des bénéficiaires de l’AME. Or, cet accès aux soins et l’amélioration de cet état de santé sont les deux principaux objectifs de l’AME. L’expertise associative est riche et intéressante, mais elle ne saurait se substituer à l’expertise publique. Sans méconnaître la difficulté de mener ce type d’enquêtes, les rapporteurs estiment nécessaire d’entreprendre un travail d’investigation en la matière. Cela pourrait notamment passer par une mission, ponctuelle ou permanente, confiée à l’InVS afin de développer sur ce sujet une compétence spécifique.
3. Moderniser l’instruction des demandes : mettre en place une base de données nationale des refus de demandes d’AME
Il est indispensable d’améliorer le suivi statistique des bénéficiaires de l’AME et de leur consommation, au-delà des améliorations significatives constatées depuis quelques années. Un effort substantiel de fiabilité est donc demandé aux gestionnaires du dispositif, particulièrement les CPAM et les hôpitaux.
Il conviendrait également de généraliser un dispositif actuellement applicable uniquement en Île-de-France : une base de données recensant les personnes auxquelles le bénéfice de l’AME a été refusé. Cette base de données permettrait de faciliter le travail d’instruction des CPAM. Cette bonne pratique gagnerait donc à être étendue sur tout le territoire. Il appartient à la direction de la CNAMTS d’organiser ce déploiement qui pourrait prendre comme base l’architecture déjà testée dans la région Ile-de-France.
La mise en place et l’extension de cette base de données devra respecter la législation relative aux données personnelles et les dispositions de la loi « informatique et libertés » (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée).
4. L’application du dispositif dans le département de la Guyane : à situation exceptionnelle, régulation exceptionnelle ?
La Guyane présente des difficultés particulières en matière d’AME. Département français disposant de frontières avec des pays en voie de développement, notamment avec le Surinam, pays victime d’une guerre civile, sa situation est unique. Elle concentre près d’un sixième des bénéficiaires de l’AME. Il est à noter que l’incidence de la tuberculose y est particulièrement élevée, supérieure en 2008 à celle enregistrée en Île-de-France. La définition de la « personne en situation irrégulière » y est particulièrement problématique. Les données fournies par les associations indiquent que le nombre de personnes en situation irrégulière serait de 50 000, dont la moitié serait bénéficiaire de l’AME.
Les rapporteurs ont pris connaissance des développements intéressants du rapport de l’IGAS et de l’IGF sur la Guyane. Il est ainsi pour le moins inquiétant que les données en provenance de Guyane soient considérées comme pratiquement inexploitables.
L’urgence en la matière serait donc d’améliorer significativement et rapidement la fiabilité des statistiques afin de pouvoir porter un véritable diagnostic sur la situation en Guyane.
Les rapporteurs souhaitent également alerter le gouvernement sur les difficultés de gestion du dispositif en Guyane. Il ne fait pas de doute que les particularités de la situation exigent une régulation spécifique associant, sur le terrain, toutes les administrations responsables, les associations pouvant aussi contribuer, le cas échéant, à l’élaboration d’une action adaptée.
5. Une budgétisation exacte des besoins en loi de finances initiale
Les rapporteurs estiment regrettables les phénomènes de sous-budgétisation intervenus dans la décennie 2000-2010. Jusqu’en 2008, les dotations insuffisantes ont suscité la création d’une dette de l’État à l’égard de la CNAMTS.
Ces sous-dotations ont brouillé l’appréciation parlementaire de l’évolution des dépenses. Un terme a été mis à ces pratiques en 2008. Cependant, les rapporteurs souhaitent souligner la nécessité, à l’avenir, que les lois de finances initiales budgétisent précisément les besoins au titre de l’AME pour l’exercice à venir.
D.– ORGANISER UNE VISITE DE PRÉVENTION OBLIGATOIRE LORS DE LA PREMIÈRE ANNÉE DU BÉNÉFICE DE L’AME
Une proposition complémentaire à la précédente serait d’instaurer une visite de prévention obligatoire pour les personnes obtenant le bénéfice de l’AME pour la première fois.
Cette consultation, à réaliser auprès d’un médecin généraliste, ou auprès d’un dispensaire, permettrait de procéder à un premier check-up d’ensemble, afin de diagnostiquer toute pathologie grave et de mettre en place des actions simples de dépistage et de prévention.
Cette proposition aurait un intérêt sanitaire, mais aussi économique, afin d’éviter les hospitalisations coûteuses (cas du VIH, des hépatites, de la tuberculose et des pathologies cardio-vasculaires…). Enfin, en termes de santé publique, elle permettrait d’améliorer les connaissances sur l’état de santé des demandeurs de l’AME. Elle pourrait s’étendre à un examen bucco-dentaire.
Cette recommandation avait également été préconisée par la mission commune de l’IGAS et de l’IGF de 2007 dans un objectif de promotion de la santé publique. Comme cela a été expliqué aux rapporteurs dans le cadre du déplacement à la CPAM de Bobigny, elle a fait actuellement l’objet d’une expérimentation dans le département de la Seine-Saint-Denis.
E.– AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE D’AVAL DES BÉNÉFICIAIRES HOSPITALISÉS
L’évaluation a permis de souligner le coût important des séjours dans les établissements hospitaliers, coût provoqué par une tarification hospitalière inadaptée, partiellement responsable de séjours parfois particulièrement longs. Cet état de fait, bien documenté par le rapport des inspections de 2010, doit trouver une solution. Il faut en effet mettre fin à cette situation coûteuse et dont le bénéfice médical, pour les patients concernés, est peu élevé.
Il s’agit donc, compte tenu des différences de coûts relatifs à un séjour respectivement en soins aigus ou en soins de suite ou de réadaptation, de favoriser le placement dans un service ou un lit d’aval dès lors que la situation de la personne, appréciée d’un point de vue médico-social, le permet. La réforme proposée en matière de tarification hospitalière (passage à une tarification forfaitaire) permettra d’inciter les établissements à effectuer ces placements en aval, dès lors que des places sont disponibles, notamment en maisons d’accueil spécialisées (MAS).
Cette recommandation revêt en fait trois dimensions différentes : l’augmentation nécessaire du nombre de places dans les services concernés, particulièrement en maisons d’accueil spécialisé, la prise en charge financière des dépenses afférentes et les dispositions normatives à modifier.
F.– PRENDRE EN COMPTE LE CAS PARTICULIER DU DÉPARTEMENT DE MAYOTTE
Mayotte présente des caractéristiques spécifiques. En effet, cette petite île est située non loin de l’archipel des Comores. De nombreuses personnes en situation irrégulière y résident. Les structures hospitalières y sont encore peu développées et conduisent régulièrement à des évacuations sanitaires sur La Réunion.
Depuis la mise en place effective de la départementalisation le 31 mars dernier, Mayotte est régie par l’article 73 de la Constitution de 1958, dont l’alinéa 1er dispose : « Dans les départements et régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités ». Les lois et règlements adoptés depuis le 1er mars dernier sont donc applicables à Mayotte, sans qu’il soit besoin de le préciser. Le principe est donc celui de l’identité législative (application sauf dérogation expresse). Les textes qui s’appliquent spécifiquement aujourd’hui à Mayotte demeurent en vigueur après l’instauration, dans cette collectivité, du régime d’identité législative, tant qu’ils ne sont pas modifiés ou abrogés.
En ce qui concerne l’AME, aucune évolution n’est prévue à court terme. En matière de prestations sociales et de cotisations de sécurité sociale, l’étude d’impact jointe au projet de loi relatif à Mayotte indique que le rapprochement avec le droit commun se fera sur une période de vingt à vingt-cinq ans, délai qui tient compte des écarts actuels de niveau de vie entre Mayotte et la métropole, mais aussi entre Mayotte et les autres départements d’outre-mer. Toutefois, la mise en place du revenu de solidarité active est envisagée dès 2013, avec un montant inférieur au montant métropolitain.
En matière d’aide médicale aux personnes en situation irrégulière, la récente décision d’un tribunal aux affaires sociales ayant condamné la France pour non-respect de la Convention internationale des droits de l’Enfant et demandé à la Caisse de Sécurité sociale de Mayotte de procéder à l’affiliation directe de l’enfant, afin que son droit à la santé soit garanti, montre que la situation exige des solutions particulières.
Les rapporteurs souhaitent donc attirer l’attention du gouvernement sur la situation de Mayotte, qui appelle des décisions rapides et adaptées.
Recommandations spécifiques
du co-rapporteur M. Claude Goasguen
Le pilotage du dispositif de l’AME, en plus des recommandations communes, nécessite une réforme structurelle plus vaste, par la mise en place de lignes budgétaires stabilisées et par une approche plus conforme avec les politiques pratiquées par les autres pays de l’UE.
1. Il convient de faire gérer le dispositif de l’AME par une caisse d’assurance maladie dédiée. Cette gestion concentrée, qui est courante dans le domaine de l’assurance maladie, permettra de limiter les gaspillages budgétaires, unanimement établis, et les distorsions entre les différentes caisses, justement critiquées. Cette caisse dédiée permettra de contrôler les besoins et d’ajuster les procédures de contrôle, notamment informatisées, qui pourraient être plus efficaces que les contrôles aléatoires et répartis sans véritable efficacité sur le territoire.
2. Il convient d’éviter les procédures fragilisées sur le plan budgétaire, dans le cadre du projet de loi de finances. Les crédits alloués sont en effet constamment dépassés et ces dépassements « épongés » par les projets de loi de finances rectificative. Ce dispositif sans limite budgétaire opérante constitue un appel d’air, contraire à une authentique rigueur budgétaire globale fondée sur des enveloppes fixes.
Il convient donc de promouvoir l’existence d’une enveloppe fixe, sauf dérogation justifiée par un rapport préalable, présenté et explicité devant le Parlement pour des situations exceptionnelles. Le montant de l’enveloppe sera strictement arrêté et les documents budgétaires relatifs au programme concerné détailleront la ventilation des crédits en fonction d’une grille de soins. Cette procédure plus rigoureuse devra être précédée d’un avis de la Haute autorité de santé qui veillera à la justification technique des crédits ainsi ventilés en fonction de l’état sanitaire des populations accueillies. Cet avis précédera la délibération du Parlement pour le vote du budget ainsi dédié à l’AME.
3. Après avoir examiné les procédures du dispositif sanitaire en faveur des immigrés illégaux dans les autres pays européens, il convient de souligner que la nature du panier de soins universel fait de la France une exception. Cette exception se justifie uniquement par des motifs « vertueusement » idéologiques mais qui sont difficilement explicables et acceptables pour les immigrés légaux et les populations socialement fragiles, qui ne disposent pas de droits aussi étendus et vivent l’AME comme un avantage injustifié par rapport à leur situation. Il n’est pas facile d’expliquer qu’une population en situation quasi délictuelle puisse bénéficier, même au nom d’une politique humanitaire, d’une situation plus favorable que ceux qui sont dans une situation légale, et tout aussi difficile. Pour ces raisons, la mise en place de niveaux de protection gradués s’impose.
Le premier niveau de protection concernera les soins indispensables au maintien de la santé de la population concernée, et notamment ce qui relève :
– des soins urgents,
– des efforts de prévention et de prophylaxie (16),
– des soins relatifs aux femmes enceintes, et
– tous les soins aux mineurs.
Pour ce premier niveau de soins, seuls les hôpitaux publics et les dispensaires seront compétents pour recevoir les bénéficiaires. En l’absence d’hôpitaux publics ou de dispensaires dans la zone géographique immédiate, des centres médicaux, des cliniques privées ou des médecins libéraux accueilleront les personnes concernées sous réserve qu’elles disposent d’un agrément spécifique. Il faut souligner à cet égard l’urgence de relancer la création de dispensaires publics dans le maillage territorial, bien trop insuffisants actuellement.
Le deuxième niveau de soins concernera un panier de soins supplémentaires, composé des soins dentaires, des dispositifs médicaux, de masso-kinésithérapie et d’optique. Le troisième niveau de soins s’étendra aux soins dits de confort, dont la prise en charge doit rester exceptionnelle. Pour ces deux derniers niveaux de soins, la médecine libérale et les cliniques privées pourront intervenir. Ces soins seront soumis à entente préalable et à l’autorisation expresse de la caisse dédiée.
4. La disposition relative au paiement préalable du droit de timbre doit être maintenue. En effet, l’effort financier que ce paiement nécessite de la part des bénéficiaires de l’AME reste faible par rapport à l’importance des crédits finançant l’AME. Les premières applications de ce dispositif montrent en effet qu’il n’a pas soulevé dans les populations concernées beaucoup de résistance ou de refus.
La faiblesse du montant du droit de timbre rend le système parfaitement opérant. Il est accompagné d’une connotation symbolique qui permet d’éviter que des individus en situation irrégulière soient dispensés de tout effort à la participation de leur couverture sociale, qui nécessite également un effort national de solidarité.
Recommandations spécifiques
du co-rapporteur M. Christophe Sirugue
À l’issue de cette démarche d’évaluation, plusieurs recommandations particulières peuvent être formulées.
Il paraît essentiel de réaffirmer la nécessité du maintien d’une même caisse pour les assurés du régime social et les bénéficiaires de l’AME et de dissuader tout projet de mise en place d’une caisse à part.
La suppression du timbre de 30 euros mis en place le 1er mars 2011 et conditionnant l’accès au dispositif est une priorité.
Il est indispensable de rappeler aux CPAM leur obligation d’accepter les domiciliations chez autrui, conformément à la circulaire de la DGAS. De même, il est nécessaire de souligner auprès du réseau de l’assurance maladie qu’il est tenu d’appliquer de manière uniforme le dispositif sur le territoire, notamment en ce qui concerne les demandes de pièces justificatives. Les justificatifs ne figurant pas sur les textes applicables n’ont pas à être exigés.
Pour des raisons sanitaires, économiques et éthiques, il paraît essentiel de signifier par voie de communication à l’ensemble des acteurs de la mise en œuvre du dispositif de l’AME que le danger n’est pas la fraude mais bien l’absence de recours à ce régime.
Il faut absolument parvenir à une dotation budgétaire plus sincère en loi de finances initiale qui prenne en compte toutes les lois de finances rectificatives nécessaires depuis quelques années et les dettes contractées auprès de l’assurance maladie.
Maintenir une couverture territoriale correcte des structures de dépôt et d’instruction des dossiers permettra de ne pas dissuader les bénéficiaires potentiels de l’AME pour qui des déplacements trop importants représentent déjà un obstacle. Il est donc inopportun de chercher à les regrouper.
Il faut que le gouvernement publie rapidement le décret permettant l’application de l’article 54 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, qui organisera la mise en place d’une procédure ad hoc et d’une commission mixte de conciliation.
Enfin, il est nécessaire d’accélérer l’application du dispositif de l’AME à Mayotte devenu département français le 31 mars dernier.
ÉVALUER LE « TRAVAILLER PLUS POUR GAGNER PLUS »
Rapport d’information n° 3615, présenté le 30 juin 2011
par MM. Jean-Pierre Gorges et Jean Mallot, rapporteurs
L’article premier de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite « loi Tepa », visait à promouvoir la réalisation d’heures supplémentaires. Les gains de revenus ainsi suscités et l’augmentation du temps de travail des salariés devaient provoquer un surcroît de croissance, permettant de lutter contre le chômage. Il s’agissait de mettre en pratique la formule « travailler plus pour gagner plus ».
Le présent rapport est le fruit de la démarche d’évaluation de cette disposition, menée, à la demande du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée nationale (CEC) par deux rapporteurs, l’un issu de la majorité et l’autre de l’opposition.
L’étude s’est concentrée, d’une part, sur l’estimation de l’efficience du dispositif (son efficacité ramenée à ses coûts) et, d’autre part, sur les conditions d’élaboration de la décision publique.
L’article premier de la loi Tepa est une mesure incitative, augmentant les revenus des salariés et diminuant le coût de l’heure supplémentaire pour l’employeur. Ce dispositif, de structure complexe, repose sur cinq piliers distincts : exonération fiscale, exonération de cotisations sociales salariale et employeur, réforme de l’allègement sur les bas salaires et majoration de la rémunération des heures supplémentaires pour les entreprises de vingt salariés au plus.
Cette mesure emblématique, marquée par le contexte économique et politique de l’année 2007, décidée sans réelle étude ex ante, a connu une application rapide et massive. Le dispositif a bénéficié à plus de neuf millions de salariés, pour un gain moyen annuel d’environ 500 euros et un gain médian d’environ 350 euros.
*
Malgré les difficultés de l’évaluation, notamment liées à l’absence de recensement fiable des heures supplémentaires avant l’adoption de la réforme et à l’intensité de la crise économique de 2008-2009, les deux rapporteurs ont mis en évidence un faisceau d’indices soulignant que le « travailler plus » n’est pas identifiable : le nombre annuel d’heures supplémentaires n’a pas connu de hausse significative et la durée moyenne effective du travail n’a pas substantiellement augmenté. L’application du dispositif est marquée par un fort effet d’aubaine, un certain nombre d’heures supplémentaires effectuées mais non déclarées comme telles avant la réforme ayant bénéficié des allègements fiscaux et sociaux.
Le dispositif a certes permis de gratifier certains salariés. Il a aussi, voire peut-être surtout, facilité les restructurations dans l’administration de l’État. Son application dans les hôpitaux publics a également entraîné une meilleure rémunération des personnels particulièrement sollicités et affectés par les modalités de la réduction du temps de travail.
Conçue en partie comme un instrument destiné à pallier certains inconvénients des lois portant réduction du temps de travail, la mesure a contribué à « cristalliser » la durée du travail à 35 heures, employeurs comme salariés ayant un intérêt commun à déclarer des heures supplémentaires.
Le « gagner plus » est effectivement identifié et a contribué à maintenir le pouvoir d’achat de certains salariés grâce au surcroît de revenus ainsi distribués. La mesure a entraîné des gains très variables : le dispositif n’a bénéficié ni aux non-salariés ni aux salariés n’effectuant pas d’heures supplémentaires. Il a peu bénéficié aux salariés à temps partiel. Seuls les foyers imposables ont pu effectivement bénéficier de la totalité du dispositif, le gain fiscal – non plafonné – étant par ailleurs fonction du taux marginal d’imposition. De même, l’effet de la mesure diffère sensiblement selon les secteurs et les régions.
Le coût total de la mesure est évalué à plus de 4,5 milliards d’euros. Son absence de financement par des prélèvements supplémentaires ou des redéploiements de dépense a permis, à court terme, de stimuler la demande intérieure et donc de contribuer à lutter contre la récession de 2009. Cependant, à moyen et à long terme, cette dépense peu efficace, financée par un surcroît de dette publique – dont les intérêts correspondant à la dépense annuelle atteignent environ 140 millions d’euros – ne manquera pas d’alourdir les prélèvements obligatoires futurs.
*
Compte tenu de ce constat, les deux rapporteurs formulent plusieurs propositions communes. Ils insistent d’abord sur la nécessité de l’évaluation préalable approfondie de ce type de décision, ainsi que sur l’adaptation indispensable de telles mesures de politique économique lorsque les modifications de contexte l’imposent.
Le choix de subventionner les contributions dues par l’employeur au titre de la rémunération de l’heure supplémentaire suscite des interrogations. Cette heure supplémentaire est en effet l’heure où la marge de l’entreprise est généralement maximale. Dans un contexte de sous-emploi persistant, plutôt que de subventionner la « dernière heure », ne conviendrait-il pas de faciliter l’embauche de salariés supplémentaires – la « première heure » ?
Une proposition réunit l’accord des deux rapporteurs. Sous réserve d’une évaluation préalable, ils recommandent la suppression des avantages bénéficiant aux employeurs au titre des heures supplémentaires. Cette mesure, dont l’enjeu financier s’élève à près de 1,3 milliard d’euros, permettra de mettre fin aux effets d’aubaine les plus marqués.
Le rapport examine ensuite les différentes options envisageables et se conclut sur des considérations plus générales visant, d’une part, à dresser les grandes lignes d’une réglementation du temps du travail qu’il conviendrait de fonder davantage sur la négociation sociale au niveau de la branche et, d’autre part, à envisager la suppression graduelle des aides publiques versées aux entreprises pour accompagner la réduction du temps de travail.
Recommandations et réflexions
Les recommandations des rapporteurs concernent deux domaines distincts : les modalités d’élaboration de la décision publique (I) et l’opportunité d’apporter des aménagements au dispositif de l’article premier de la loi Tepa (II).
I. LA NÉCESSITÉ DES ÉTUDES D’IMPACT PRÉALABLES ET DE
L’ADAPTABILITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES
Une partie des propositions des rapporteurs, tirant les conclusions des modalités d’élaboration du dispositif de l’article premier de la loi Tepa, concerne les modalités de préparation des politiques publiques par l’exécutif et les relations entre l’exécutif et le Parlement.
A. DE LA NÉCESSITÉ DE LA RÉALISATION DES ÉTUDES D’IMPACT ET DE LEUR TRANSMISSION AU PARLEMENT
1.– L’absence de réponse du Gouvernement ne permet pas de conclure à l’existence d’une étude d’impact ex ante
Les auditions auxquelles les rapporteurs ont procédé démontrent qu’un important travail de conception, exigeant une concertation interministérielle substantielle, a bien présidé à l’élaboration du processus, en amont et en aval des débats parlementaires. En particulier, des prévisions de coûts budgétaires, même marquées par une certaine imprécision (17), ont bien été effectuées. Les textes d’application, de grande qualité, ont été adoptés dans des délais très brefs, quelques semaines après la date de publication de la loi.
Cependant, rien n’indique formellement qu’une véritable étude d’impact ex ante ait bien été réalisée. Une telle étude permet de recenser les effets probables de la mesure dont l’adoption est projetée, et d’apprécier ainsi son efficacité et son coût. Ce type d’étude exhaustive, généralement réalisée de manière approfondie par les exécutifs des collectivités territoriales en cas de projet d’investissement ou par la Commission européenne, semble pourtant nécessaire en raison du montant de la dépense publique.
Compte tenu de l’absence de communication des documents préparatoires et des éventuelles études d’impact ex ante, les rapporteurs ne peuvent apprécier avec la rigueur nécessaire les conditions dans lesquelles la mesure a été élaborée. Cette absence de communication des documents aux rapporteurs, éminemment regrettable, souligne les progrès que doit effectuer l’administration dans la valorisation de l’activité de l’évaluation des politiques publiques, qu’elle soit réalisée ex ante ou ex post.
Le droit en vigueur issu de la réforme organique de 2009 (18) prévoit qu’une étude d’impact est jointe aux projets de lois déposés sur le bureau de la première assemblée saisie depuis le 1er septembre 2009. En application de la décision du Conseil constitutionnel sur la loi organique du 15 avril 2009, il convient de noter qu’en revanche, n’entrent pas dans le champ de l’obligation organique les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale, dont les dispositions non exclusives font l’objet d’une « évaluation préalable », qui figure dans une annexe aux projets.
Même si l’article premier de la loi Tepa ne relève pas, en tout état de cause et à ce jour, du domaine exclusif des lois de finances (19), l’absence de transmission d’évaluation préalable transmise au Parlement donne matière à réflexion. Il souligne la nécessité, pour les parlementaires, de disposer d’études d’impact de qualité.
Ainsi, les rapporteurs soulignent la nécessité que les « évaluations préalables » jointes aux dispositions « exclusives » des projets de loi de finances et de financement fassent bien l’objet de travaux approfondis. En la matière, il serait peu approprié de se satisfaire d’un respect uniquement formel d’une obligation destinée à améliorer la transparence démocratique et la qualité de la législation.
2.– Comment renforcer l’expertise économique du Parlement ?
L’évaluation du dispositif de l’article premier de la loi Tepa a mis en évidence la nécessité d’une amélioration de l’expertise du Parlement, notamment lorsqu’il discute d’un projet de loi de nature économique.
Cette expertise devrait d’abord passer par une transparence accrue des informations et analyses détenues par le Gouvernement sur le dispositif dont l’adoption est proposée au Parlement. À cet égard, il serait opportun de rendre publics les rapports du Conseil d’analyse économique (CAE) le plus rapidement possible, après leur présentation au Premier ministre ou au ministre ayant commandé l’étude.
Le cas échéant, compte tenu de sa relative indépendance, de la qualité des membres et des travaux du Conseil d’analyse économique, il pourrait être proposé de rapprocher le CAE du Parlement en instaurant un « droit de tirage » sur les travaux du Conseil. À un rythme à déterminer, les parlementaires pourraient demander au CAE de travailler sur un thème précis. Les travaux du CAE pourraient ainsi enrichir directement les travaux parlementaires. Le cas échéant, il serait intéressant d’envisager que le Parlement puisse formellement demander au CAE une évaluation préalable des coûts et des avantages des mesures proposées par le Gouvernement.
B. ADAPTER RAPIDEMENT LES POLITIQUES PUBLIQUES AUX CHANGEMENTS OBSERVÉS
1.– Stabilité de la norme législative et nécessaire adaptabilité
S’agissant des textes législatifs, il y a un compromis à trouver entre, d’une part, la nécessaire stabilité de la norme, exigence soulignée auprès des rapporteurs par certaines personnes auditionnées, et, d’autre part, son adaptabilité indispensable aux changements de contexte et de circonstances.
Les représentants des employeurs, particulièrement des artisans et des petites entreprises, entendus par les rapporteurs, ont insisté sur les coûts d’ajustement aux nouvelles normes et ont souligné la nécessité d’une certaine visibilité en la matière. Cependant, l’impératif de stabilité, cher aux acteurs économiques, doit également se conjuguer avec la nécessité de l’évaluation et donc de l’ajustement indispensable des politiques publiques aux changements de situation. Cet ajustement rapide est d’autant plus nécessaire lorsque l’évaluation rend compte d’une efficience réduite de la dépense publique.
Ainsi, le déclenchement de la profonde récession intervenue en 2008-2009 aurait dû inciter le gouvernement à s’interroger sur le maintien en l’état du dispositif de l’article premier de la loi Tepa, mécanisme conçu et adopté dans un contexte macro-économique différent.
2.– Procéder régulièrement à une revue des dispositifs d’exonération fiscale et sociale
Il faut donc procéder à un réexamen régulier et approfondi de l’opportunité des mesures fiscales et sociales, particulièrement des mesures d’exonération, de manière à évaluer rapidement la nécessité d’adapter ces mesures aux changements macro-économiques. Cette mesure permettrait de lutter contre le processus de sédimentation législative qui caractérise les dispositifs des « niches » fiscales et sociales.
Ainsi, les rapporteurs souhaitent souligner l’intérêt des conclusions de la mission d’information commune sur les exonérations sociales de l’Assemblée nationale. Le rapport préconisait en effet de borner dans le temps la portée des exonérations ou des niches créées par la loi. Le rapporteur de cette mission estimait qu’une durée de trois ans pourrait constituer la norme générale à appliquer à une mesure d’exonération ou d’exemption d’assiette. Il était proposé que le cas échéant, ces mesures ne soient adoptées que pour un nombre limité d’exercices, leur reconduction formelle étant subordonnée au dépôt d’une évaluation précise des coûts et des avantages du dispositif considéré.
II. COMMENT AMENDER LE DISPOSITIF ?
Cette partie comporte les développements relatifs aux recommandations des rapporteurs concernant le dispositif.
À titre liminaire, il convient de noter qu’il n’y a pas lieu de proposer de revenir sur l’une des dispositions de l’article premier de la loi Tepa : la fin anticipée du régime dérogatoire de la majoration des heures supplémentaires des salariés d’un certain nombre d’entreprises.
A. LES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION SOULIGNENT LA DIFFICULTÉ À SUPPRIMER UNE MESURE DE REVENUS
1.– Les salariés et les entreprises se sont approprié la mesure
L’article premier de la loi Tepa a introduit un dispositif innovant. Les salariés et les entreprises se sont approprié la mesure : ce dispositif est maintenant, au bout de près de quatre années d’application et malgré la relative complexité qu’il a apportée, complètement intégré au comportement des employeurs et des salariés. Leurs décisions économiques individuelles prennent bien en compte les incitations de la mesure. Malgré ses inconvénients, ses coûts et ses ambiguïtés, la mesure de défiscalisation et d’exonération de cotisations sociales fait bien partie, depuis l’automne 2007, de « l’équation comportementale » des agents économiques concernés, employeurs (publics et privés), salariés et agents publics.
2.– Un contexte défavorable à une suppression brutale
Les rapporteurs n’ignorent pas la difficulté politique majeure à remettre en cause un tel dispositif dans une période marquée par trois évolutions principales :
– la progression du pouvoir d’achat des ménages semble insuffisante à une proportion grandissante de Français, en particulier des salariés ;
– un des moteurs de la croissance du PIB français est la consommation privée, alimentée partiellement par les revenus issus des salaires ;
– dans certaines branches ou entreprises, les rémunérations des salariés ne progressent que très peu en volume et il leur est difficile d’obtenir des revalorisations conséquentes.
Un raisonnement similaire s’applique aux pans de l’économie affrontant une concurrence internationale : la mesure de l’article premier de la loi Tepa a pu, même marginalement et à court terme, diminuer le coût du travail et donc améliorer légèrement la compétitivité des entreprises. Cette affirmation est à nuancer en fonction des branches, dont une grande partie ont utilisé la loi Tepa sans avoir à faire face, directement, à la compétition internationale (exemple des hôtels, cafés et restaurants).
Enfin, le caractère assez massif de l’application de la mesure (plus de neuf millions de bénéficiaires) rend sa modification, et a fortiori sa suppression brutale, particulièrement délicate à réaliser.
L’intérêt de la mesure renvoie moins à une solution – complexe – aux éventuels problèmes posés par la réduction du temps de travail qu’à l’insuffisante rémunération nette perçue par les salariés. Ce point est particulièrement important s’agissant des personnels de la fonction publique d’État et hospitalière : le dispositif s’y est appliqué, sans avantage financier pour l’employeur, avec un succès sans doute partiellement imputable à l’insuffisante reconnaissance des efforts individuels effectués en matière de temps de travail.
3.– Des modifications pourtant nécessaires
Néanmoins, il semble aux rapporteurs que la démarche d’évaluation a mis en évidence des problèmes importants et qu’il est nécessaire de modifier la mesure considérée. Certains effets positifs du dispositif mentionnés plus haut pourraient sans doute être atteints par d’autres moyens ou politiques publiques présentant une complexité moindre, avec des effets indésirables moins importants ou à des coûts minorés. Compte tenu du coût de la mesure pour l’État, de son caractère peu efficient, des inégalités qu’elle suscite et de l’état dégradé des finances publiques, le statu quo ne semble donc pas possible.
Pour autant, une suppression complète, telle que préconisée par le Conseil des prélèvements obligatoires, pourrait emporter des effets négatifs brutaux et surtout induire des coûts d’ajustement importants pour les acteurs. Elle pourrait bouleverser à nouveau les relations de travail.
Compte tenu de ces contraintes, les rapporteurs ont préféré identifier une « proposition-socle » minimale qui leur semble susceptible de recueillir le consensus le plus large : la suppression des avantages sociaux forfaitaires bénéficiant aux employeurs. Ce volet du dispositif leur paraît en effet le moins fondé en opportunité.
Cette proposition centrale est complétée par un certain nombre de développements ayant vocation à alimenter le débat et exposant les avantages et les inconvénients des autres modifications possibles du dispositif.
B. LA SUPPRESSION DES EXONÉRATIONS DE COTISATIONS SOCIALES PATRONALES ET LA MODIFICATION DU CALCUL DE L’ALLÈGEMENT GÉNÉRAL SUR LES BAS SALAIRES (FILLON)
1.– La subvention du coût de l’heure supplémentaire s’est révélée peu efficiente
a) La subvention de la « dernière » heure du travail du salarié se justifie-t-elle encore aujourd’hui ?
Du point de vue de l’employeur, le volet du dispositif relatif à la déduction de cotisations sociales patronales s’apparente à la subvention par l’État d’une heure d’activité où la marge de l’entreprise est la plus élevée. Généralement, les coûts fixes de l’employeur (équipements et dépenses de formation des salariés par exemple) sont économiquement amortis sur les « heures normales » ; la marge est donc forte sur ces heures supplémentaires. Subventionner le coût des heures où la marge est particulièrement élevée ne peut donc que susciter des interrogations.
Ce point est cependant légèrement à nuancer compte tenu des effets différenciés de la mesure sur le coût de l’heure supplémentaire, notamment sur les entreprises de 20 salariés au plus. Ce dispositif dérogatoire de majoration des heures supplémentaires, dont la suppression (passage d’une majoration de 10 % à 25 %) pouvait justifier partiellement la déduction forfaitaire, devait en tout état de cause prendre fin au 31 décembre 2008. De plus, cette suppression est maintenant bien prise en compte par les entreprises visées.
b) Ne faudrait-il pas privilégier la lutte contre le sous-emploi ?
L’objectif de promotion de l’emploi et de lutte contre le chômage était un objectif de deuxième ou de troisième rang du dispositif, qui visait avant tout à augmenter la durée du travail et à accroître le pouvoir d’achat de certains salariés. La mesure reposait sur le double constat, effectué en 2007, d’une durée moyenne du travail des salariés jugée insuffisante et d’un pouvoir d’achat à augmenter.
Ne peut-on pas considérer que le diagnostic a changé en 2011, notamment en raison de la croissance du nombre de demandeurs d’emploi observée depuis 2008 ? En effet, dans un contexte de sous-emploi persistant, est-il encore fondé de continuer à subventionner les heures supplémentaires, heures sur lesquelles la marge de l’employeur est maximale ?
Afin de favoriser l’entrée dans l’entreprise de personnes sans emploi, il serait sans doute plus opportun de subventionner les « premières heures », ou du moins les premières embauches, plutôt que les heures supplémentaires. Cette politique est déjà partiellement mise en place via le contrat unique d’insertion (CUI), qui cible les personnes à l’employabilité réduite, mais ces mesures mériteraient sans doute d’être étendues à une population plus large.
*
Compte tenu des risques d’optimisation liés à la substitution « d’heures supplémentaires » à des « heures normales », des effets massifs d’aubaine observés ainsi que du faible impact de la mesure sur la durée du travail considérée dans son ensemble, les rapporteurs estiment raisonnable de remettre en cause ce volet du dispositif. Cette remise en cause de l’avantage consenti aux employeurs se décline en deux volets distincts :
– d’une part, la suppression de la déduction forfaitaire des cotisations sociales dues par les employeurs ;
– d’autre part, la réintégration des heures supplémentaires au calcul du montant des allègements généraux sur les bas salaires.
Si ces mesures étaient envisagées, elles devraient faire l’objet d’une évaluation préalable approfondie afin d’en apprécier tous les coûts et tous les avantages. L’adoption de ces deux mesures permettrait, en première analyse, une économie d’environ 1 300 millions d’euros pour le budget de l’État.
2.– Supprimer la déduction forfaitaire de cotisations sociales dues par l’employeur
La suppression éventuelle de la déduction forfaitaire aurait un rendement correspondant au montant de la dépense, soit environ 700 millions d’euros. Afin d’éviter un choc d’adaptation subi par les employeurs – certes peu probable compte tenu des montants relativement faibles – il serait possible d’envisager une suppression graduelle, au risque cependant de renforcer la complexité du dispositif. L’économie correspondant à la suppression de cette dépense pourrait soit contribuer à la réduction du déficit du budget de l’État, soit être réaffectée au financement de mesures jugées plus aptes à promouvoir les objectifs poursuivis par la mesure : l’augmentation du temps de travail, du PIB et du niveau de l’emploi par la réduction du coût du travail pour les entreprises.
Une autre voie pourrait être le conditionnement du bénéfice de cette aide à un certain nombre d’obligations. Elle réduirait le rendement de la mesure de la suppression mais permettrait d’orienter les décisions des employeurs de manière à favoriser des buts d’intérêt général, comme l’embauche de jeunes sans qualification ou la conclusion d’accords sur des thèmes à déterminer.
3.– Réintégrer les heures supplémentaires au calcul du montant des allègements généraux sur les bas salaires
Les rapporteurs proposent également de réintégrer la rémunération des heures supplémentaires dans le calcul du montant de l’allègement général sur les bas salaires. La réintégration de ces rémunérations majorées diminuera mécaniquement le montant de l’allègement et donc la dépense qu’il constitue pour les finances publiques.
Une telle mesure permettrait à l’État d’économiser environ 600 millions d’euros.
Le rapport précité du CPO sur les niches sociales bénéficiant aux entreprises considère cette mesure comme l’« ajustement le plus modéré » du dispositif de l’article premier de la loi Tepa : « l’exclusion des heures supplémentaires du calcul de l’allègement Fillon accroît (…) le caractère attractif du régime des heures supplémentaires, et donc les risques d’optimisation résidant dans la substitution nominale des heures supplémentaires au salaire correspondant au temps de travail normal. (…) Cette mesure pourrait toutefois pénaliser le recours aux heures supplémentaires pour les niveaux de salaires inférieurs à 1,6 smic ».
C. L’EXONÉRATION SALARIALE ET L’EXONÉRATION FISCALE : LES OPTIONS POSSIBLES
Les développements infra présentent les avantages et les inconvénients des éventuelles modifications des autres volets du dispositif. Ces analyses ont vocation à alimenter le débat, les rapporteurs ne se prononçant pas formellement sur l’opportunité de ces mesures.
a) La suppression complète du dispositif fiscal ?
Le CPO suggère de cibler la mesure sur les contribuables aux revenus les plus modestes en supprimant l’exonération de l’impôt sur le revenu.
En effet, alors que cette exonération fiscale accroît le coût du dispositif, elle est moins incitative que l’exonération de cotisations salariales en raison du décalage d’un an entre la réalisation de l’heure supplémentaire et la perception du gain fiscal correspondant. De plus, elle peut être considérée comme « anti-redistributive » dans l’hypothèse où des personnes non imposables, par le truchement des impôts indirects, contribuent au financement d’une mesure bénéficiant, dans des proportions non négligeables, à des foyers percevant des revenus plus élevés. Par ailleurs, la suppression du volet fiscal du dispositif n’aurait pas d’impact sur le coût du travail et elle emporterait certainement un impact très modéré sur l’offre de travail par les ménages.
L’estimation du rendement de cette suppression correspondrait à la dépense fiscale, soit un montant d’environ 1,360 milliard d’euros.
b) Le plafonnement de l’avantage fiscal ou du montant de son assiette ?
Il pourrait être envisagé de limiter la portée de l’avantage fiscal afin, d’une part, de réduire la dépense et, d’autre part, de diminuer les inégalités afférentes.
Certes, le dispositif est bien encadré par les dispositions applicables du code du travail limitant le recours aux heures supplémentaires. De plus, l’article premier de la loi Tepa dispose également que les « surmajorations » résultant d’un accord d’entreprise ne sont pas prises en compte.
Cependant, les rapporteurs estiment qu’il ne serait pas illégitime que les gains fiscaux résultant de la mesure ne soient pas excessifs. À la demande des rapporteurs, la DLF a travaillé sur les effets du plafonnement du montant de l’avantage fiscal et du plafonnement du montant des revenus tirés de la rémunération des heures supplémentaires.
• Le plafonnement du montant de l’avantage fiscal serait difficile à mettre en œuvre
La DLF indique qu’un éventuel plafonnement de l’avantage fiscal serait délicat : il obligerait à une double liquidation du montant de l’impôt dû, avec et sans l’exonération. La solution présenterait en outre un inconvénient pour les salariés, qui seraient incapables de savoir si les heures supplémentaires qu’ils accomplissent feront effectivement l’objet d’une exonération.
• Le plafonnement du montant des revenus tirés des heures supplémentaires
Ce plafonnement serait plus facile à mettre en œuvre. Il pourrait être réalisé soit en valeur absolue, soit en proportion du revenu fiscal de référence. L’articulation de ce plafonnement avec l’exonération de cotisations sociales et la déduction de cotisations sociales devrait également, dans ce cas, faire l’objet d’arbitrages. La mesure présenterait cependant l’inconvénient d’introduire une complexité supplémentaire dans le dispositif.
c) Réduire l’assiette de l’avantage fiscal à la partie majorée de la rémunération de l’heure supplémentaire ?
Une autre possibilité consisterait à limiter la subvention publique à la partie majorée de la rémunération de l’heure supplémentaire, à l’instar de plusieurs pays européens. À la demande des rapporteurs, en prenant l’hypothèse d’une rémunération majorée à un taux de 25 %, la DLF a ainsi estimé que le coût de l’exonération fiscale atteindrait 362 millions d’euros (contre 1 360 millions d’euros, coût du volet fiscal de la mesure au titre des revenus 2009). Cette mesure permettrait donc de réduire la dépense de près d’un milliard d’euros.
2.– L’exonération des cotisations salariales
La mise en cause de l’exonération des cotisations salariales serait la plus difficile à appliquer compte tenu de son impact direct et immédiat sur le pouvoir d’achat des salariés concernés.
Compte tenu de son coût, elle pourrait être complètement ou partiellement supprimée, le cas échéant, graduellement. Elle pourrait aussi être sensiblement réduite en ne portant que sur la partie majorée de la rémunération. Le coût de la mesure pourrait alors être ramené à environ 800 millions d’euros contre 3,1 milliards d’euros actuellement.
La question des conditions de son maintien éventuel pour certains fonctionnaires et agents publics pourrait être posée.
III. UNE RÉFLEXION À ENGAGER SUR LES POLITIQUES PUBLIQUES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL
A. LE TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS : PRIVILÉGIER UNE LOI-CADRE, UNE NÉGOCIATION PAR BRANCHE ET UNE STABILITÉ DE LA NORME
1.– Une mesure de contournement de la législation relative au temps de travail qui a généré ses propres effets indésirables
Le dispositif de l’article premier de la loi Tepa a pu être envisagé comme une mesure de contournement du dispositif de réduction du temps de travail, que le Gouvernement jugeait trop rigide. Dans cette perspective, le mécanisme adopté présentait un « coût politique » réduit comparé à la remise en cause complète du dispositif de la réduction du temps de travail.
L’article premier de la loi Tepa s’est plutôt révélé comme une disposition complexe et générant ses propres effets pervers. Il a contribué à institutionnaliser le dispositif dont l’assouplissement était souhaité. De plus, la complexité juridique qui en résulte est préjudiciable aux petites entreprises.
Les rapporteurs estiment qu’en matière de temps de travail, il serait opportun de mettre fin à la succession de mesures et de contre-mesures. L’effet global sur la croissance et l’emploi de la succession de ces mesures, qui désorientent les agents économiques et emportent à chaque réforme des coûts d’ajustement parfois substantiels, devient par trop difficile à identifier.
2.– Aborder différemment les politiques relatives aux temps de travail des salariés ?
Les rapporteurs préconisent que la réglementation du temps de travail soit, pour l’essentiel, réalisée au niveau de la branche.
Il serait plus efficient et plus lisible que la loi fixe les grands principes de la définition du temps de travail, dont une « durée-repère » (35 heures) ainsi que les différents plafonnements destinés à protéger les salariés et leur santé. Cette loi serait, le cas échéant, complétée par un accord national interprofessionnel.
Des négociations menées au niveau de la branche, au plus près des besoins des entreprises et des préoccupations des salariés concernés, permettraient de déterminer les modalités précises du temps de travail, les majorations applicables aux heures supplémentaires, les modes de décompte ainsi que les éventuels repos compensateurs.
Cette mesure introduirait de la diversité dans le paysage normatif, compte tenu du nombre actuel de branches, qui est certes excessif (plus de mille selon la Direction générale du travail). Si les agents économiques sont aujourd’hui habitués à plus d’uniformité juridique en la matière, le droit élaboré suivant ces nouvelles prescriptions deviendrait plus lisible et plus stable, permettant aux acteurs économiques de s’engager dans des relations durables, favorisant ainsi la croissance économique de long terme.
L’élaboration de la réglementation du temps de travail au niveau de la branche préserverait un certain équilibre dans les négociations entre représentants des employeurs et des salariés. La réduction concomitante du nombre de branches pourrait garantir l’expertise des négociateurs.
B. RÉFLÉCHIR À LA SUPPRESSION DES AIDES PUBLIQUES SUPPOSÉES ACCOMPAGNER L’APPLICATION DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Près de dix ans après l’adoption des lois portant réduction du temps de travail, il serait légitime de considérer que les entreprises ont eu le temps de s’organiser pour absorber le réel surcoût correspondant, grâce la modération salariale, la hausse de la productivité horaire et l’introduction de dispositifs innovants de modulation du temps de travail des salariés.
Des aides publiques, sous la forme d’allègements de cotisations, ont également significativement contribué à cette adaptation. Ces aides se sont ajoutées à celles visant, depuis 1993, à favoriser l’emploi de personnes à faibles rémunérations. Le montant des dépenses correspondantes constitue aujourd’hui une charge conséquente pour les finances publiques tout en contribuant à générer des effets indésirables substantiels :
– un phénomène de « trappes à bas salaires » via un barème des cotisations sociales devenu progressif pour les rémunérations comprises entre 1 et 1,6 smic,
– une insuffisante spécialisation de l’économie française sur les secteurs économiques à forte valeur ajoutée employant des salariés à haut niveau de qualification et à rémunération élevée,
– et enfin une complexité accrue des relations entre l’État et les régimes de la sécurité sociale.
Ces sommes, tous dispositifs confondus, dépassent 20 milliards d’euros par an (dont environ 12 milliards d’euros destinés à accompagner la réduction du temps de travail), montant auquel s’ajoute le coût du dispositif de l’article premier de la loi Tepa destiné, lui, à augmenter la durée du travail.
Compte tenu, d’une part, des dispositions ayant assoupli le dispositif de la réduction du temps de travail et, d’autre part, de la durée de dix ans ayant permis l’adaptation des employeurs, ne conviendrait-il donc pas de diminuer graduellement les aides correspondantes afin d’aboutir à leur suppression ?
Les rapporteurs estiment qu’il est nécessaire d’évaluer ex ante les conséquences d’une diminution des aides publiques versées aux entreprises et supposées les aider à appliquer ces lois de réduction du temps de travail. Cette remise en cause devrait être graduelle et annoncée préalablement afin que les entreprises concernées puissent, le cas échéant, se réorganiser en conséquence.
UNE MÉDECINE SCOLAIRE RENFORCÉE ET RÉNOVÉE
AU SERVICE DE L’ENFANT
Rapport d’information n° 3968, présenté le 17 novembre 2011
par M. Gérard Gaudron et Mme Martine Pinville, rapporteurs
Synthèse
Depuis sa fondation en 1945, la médecine scolaire a traversé plusieurs crises. Idée généreuse autant que républicaine, la médecine scolaire, initiée dans le contexte de redressement national qui a marqué l’après-guerre, s’est trouvée à plusieurs reprises confrontée à une pénurie de moyens, conduisant à s’interroger sur le sens profond de ses missions, qui sont nombreuses, et sur les attentes de la société à son égard. En 1989, le Pr Jean-Pierre Deschamps, qui fut un des pionniers de la santé publique française, s’écriait ainsi dans un éditorial « Oui, il faut sauver la médecine scolaire ! » (20).
La médecine scolaire est à nouveau à la croisée des chemins. L’écart n’a jamais été aussi grand qu’aujourd’hui entre les missions qui lui sont confiées, de plus en plus nombreuses, et ses ressources, qui, après avoir connu un renforcement au début des années 2000, connaissent désormais une phase de décrue démographique majeure.
Pour comprendre les raisons d’une telle crise, le Comité d’évaluation et de contrôle de l’Assemblée nationale a décidé d’inscrire ce thème à son programme de travail et a sollicité sur ce sujet l’assistance de la Cour des comptes, dans le cadre prévu par l’article 472 de la Constitution.
Au vu des conclusions de l’évaluation rendue par la Cour des comptes, confortées par leurs propres investigations sous la forme d’auditions, de questionnements écrits et de missions sur le terrain, les rapporteurs ont constaté que la médecine scolaire, prenant acte de l’évolution du champ de la santé à l’école, avait su se mobiliser massivement pour permettre à l’éducation nationale de relever au cours de la décennie qui vient de s’écouler, deux grands défis : la scolarisation des enfants handicapés ou souffrant de maladie chronique et la détection des troubles du langage et de l’apprentissage. De plus, la mission a constaté qu’en leur qualité de professionnels de santé, les personnels infirmiers de l’éducation nationale occupaient aujourd’hui un rôle majeur dans le dispositif d’éducation à la santé et dans la prise en charge des situations de souffrance psychiques dans les établissements du second degré.
Toutefois, cette réussite, obtenue sans l’octroi de moyens supplémentaires, a nui à l’atteinte des objectifs officiellement assignés à la médecine scolaire, en particulier à la réalisation de bilans de santé systématique en milieu scolaire. De plus, si la mission parlementaire a pu vérifier que l’intervention des personnels de santé s’inscrivait dans le cadre de plusieurs politiques publiques qui sont toujours au cœur des préoccupations des pouvoirs publics, elle a aussi constaté que les textes qui régissent cette action sont anciens et ne sont plus en mesure de replacer les tâches attendues de la part de ces personnels dans une architecture d’ensemble.
Ce phénomène de dilution des enjeux est particulièrement perceptible dans le domaine de la politique sanitaire, qui, bien qu’elle ait fait l’objet d’un renforcement par le Législateur en 2007, est souvent perçue par le ministère de l’Éducation nationale comme une simple politique d’appui à la politique éducative menée par celui-ci.
Par ailleurs, la mission parlementaire a mis en évidence que la profession de médecin scolaire était menacée par des perspectives démographiques encore plus défavorables que pour le reste des professions médicales. La cause réside dans l’insuffisante attractivité de la carrière proposée au sein du ministère de l’Éducation nationale, notamment aux yeux des jeunes médecins. Malgré les spécificités d’un exercice médical dont tous soulignent la variété et l’intérêt, les signes, relevés par la mission parlementaire, d’une désaffection à l’égard des conditions de travail proposées montrent l’urgence de mesures correctives, sous peine d’enregistrer une baisse très rapide des effectifs dans les cinq prochaines années.
Enfin, la mission parlementaire a relevé, à l’instar de la Cour des comptes, que les fonctions de pilotage de la médecine scolaire étaient assumées par un système trop centralisé qui ne donnait pas à celle-ci l’autonomie nécessaire et la capacité de s’adapter à la nature des enjeux de santé actuels. L’analyse menée par la Cour des comptes a en effet montré que le pilotage assuré par l’administration centrale de l’éducation nationale s’avère déconnecté de la réalité des besoins sanitaires tandis que les services rectoraux, concentrés autour de l’objectif de réussite scolaire assigné à l’école, mobilisent peu de moyens pour les activités qui ne concourent pas directement à cet objectif.
Au moment où l’affirmation d’une politique de prévention conduit à donner une place plus grande à la coordination des acteurs de santé et à la prise en compte du caractère pluridisciplinaire des questions de santé, la responsabilité de l’école à l’égard de la santé des élèves scolarisés, bien que subsidiaire par rapport à la responsabilité parentale, demeure essentielle dans trois aspects :
– en liaison avec l’objectif de réussite scolaire de l’école, dont la santé est un déterminant, l’école a la mission de dépister les problèmes de santé des élèves susceptibles d’entraver leur scolarité et de faciliter l’insertion des enfants souffrant d’une maladie ou d’un handicap dans l’école ;
– la mission éducative de l’école intègre l’objectif de rendre les enfants autonomes et responsables à l’égard de leur propre santé ;
– institution publique, l’école est non seulement un relais mais surtout un acteur à part entière des politiques de santé menées par l’État en direction des élèves dont elle a la charge.
Les personnels de santé scolaire sont des acteurs indispensables à la réalisation de ces missions et, s’interrogeant sur les moyens de garantir leur avenir, les rapporteurs ont la conviction, même si la présence en France d’une quinzaine services municipaux de santé scolaire montre l’intérêt de formes d’organisation alternatives, que c’est au sein des services de l’État que la médecine scolaire sera le plus à même de relever ces défis.
Face au constat que la situation dégradée dans laquelle la médecine scolaire est aujourd’hui trouve sa cause profonde dans les carences de la prévention sanitaire autour de l’enfant – insuffisance des moyens mis en œuvre et coordination des acteurs sanitaires globalement médiocre –, les rapporteurs considèrent que les solutions à la crise actuelle sont à replacer dans le cadre d’une politique globale de renforcement de la prévention autour de l’enfant, qui se développerait selon les axes suivants :
● l’amélioration du pilotage de la politique de santé et de prévention en faveur des enfants et des adolescents ;
● l’inscription de la promotion de la santé dans le code de l’éducation comme une mission à part entière de l’école ;
● le renforcement de la lutte contre les inégalités de santé ;
● une réforme du pilotage ministériel de la médecine scolaire ;
● le renforcement de la coordination entre les médecins de prévention par le développement de leurs liens professionnels au travers d’un cadre statutaire commun.
Le renforcement de la prévention autour de l’enfant ne peut cependant produire pleinement ses effets sans s’appuyer sur un dispositif de médecine scolaire dont l’efficacité ne soit garantie et la pérennité assurée. Des mesures urgentes sont nécessaires pour revaloriser la profession de médecin scolaire en vue de reconstituer très rapidement un vivier de candidats à cette carrière, dans le respect du cadre très contraint qui s’impose aujourd’hui à nos finances publiques.
Ces recommandations s’appuient notamment sur les conclusions de la contribution de la Cour des comptes à l’évaluation de la médecine scolaire demandée par le Comité d’évaluation et de contrôle.
Le renforcement du système de prévention à l’égard des enfants et des adolescents comme première priorité :
• Installer un organe d’experts en santé publique chargé de conseiller le Parlement et le Gouvernement sur les modalités de la politique de santé physique et psychique en direction des enfants et des adolescents
• Doter la médecine de prévention d’un cadre statutaire commun pour les personnels médicaux au sein de la fonction publique
L’affirmation de la place de la santé au sein de l’école :
• Clarifier le contenu de la mission de promotion de la santé confiée à l’école
• Adapter en conséquence les modalités du programme budgétaire 230 « Vie de l’élève » dans le sens d’une meilleure intégration des enjeux de la promotion de la santé
• Permettre une meilleure prise en compte des enjeux de l’éducation à la santé au sein de l’institution scolaire, allant de l’école élémentaire au lycée, en ciblant en priorité une mise à niveau de la formation initiale et continue des enseignants dans ce domaine
Des moyens garantissant à la médecine scolaire l’efficacité de son action sanitaire :
• Instituer des organes décisionnaires de pilotage de la médecine scolaire au sein du ministère de l’Éducation nationale, aux niveaux national et rectoral
• Améliorer les conditions du pilotage régional de la politique de santé en faveur des enfants et des adolescents par les agences régionales de santé grâce à la création d’observatoires régionaux d’épidémiologie scolaire
• Confirmer la faculté des médecins scolaires de prescrire des examens diagnostiques, et notamment des bilans orthophoniques
• Affirmer la continuité des actions de dépistage et des soins, en développant les fonctions d’« accompagnement santé » des familles dans les zones prioritaires sur le plan médico-social
Le choix de modalités d’interventions adaptées aux enjeux actuels de la santé publique :
• Saisir le Haut conseil de la santé publique sur la pertinence d’actions de dépistage systématiques lors de la 9e, 12e et 15e année
• Saisir le Haut conseil de la Santé publique sur la place des services de santé scolaires dans la détection et la prise en charge des troubles du langage et de l’apprentissage
Un service de santé scolaire dont l’avenir soit préservé
• Assurer la pérennité du service de santé scolaire par la reconstitution d’un vivier de candidats potentiels aux concours de médecin et d’infirmiers scolaires
UNE ÉVALUATION DE LA RGPP :
MÉTHODE, CONTENUS, IMPACTS FINANCIERS
Rapport d’information n° 4019, présenté le 1er décembre 2011
par MM. François Cornut-Gentille et Christian Eckert, rapporteurs
Principaux constats et recommandations
Justifiée selon le Gouvernement par la nécessité de réformer l’État et la relative inefficacité des méthodes précédemment mises en œuvre dans cet objectif, la RGPP s’est caractérisée, dès son lancement puis dans sa mise en œuvre, par un portage politique inédit au plus haut niveau, ainsi qu’un périmètre élargi, mais sans une véritable implication et consultation des agents et des usagers du service public. En outre, le Parlement lui-même n’a pas été associé à la démarche et, de son côté, n’a pas véritablement cherché à s’en saisir
De ces choix découlent le succès et les limites – ou échecs – de la RGPP. Ainsi la RGPP marque un indéniable tournant vers une plus grande efficacité du fonctionnement de l’État. Mais, dans le même temps, ses modalités d’applications ont suscité de telles réactions des agents et des usagers que, sans évolution, le processus est intenable à terme.
Le lancement de la RGPP a été marqué par une commande hiérarchique ignorant agents publics et usagers du service public.
Le Parlement n’a été informé qu’au travers d’une vision comptable, essentiellement lors des sessions budgétaires. Un débat sur les missions que l’État se doit de conserver, d’externaliser ou de déléguer, aurait permis de légitimer et de clarifier les objectifs et les moyens.
Le fort portage politique de la RGPP a largement contribué à la rapidité de sa mise en œuvre, ainsi qu’à son caractère général, durable et opérationnel.
Ce portage politique de la RGPP a cependant souffert de n’être relayé que par des rapports publics « anonymes », incapables d’engendrer un réel débat public, a fortiori au-delà du périmètre de l’administration.
La RGPP a mis en mouvement de façon inédite l’état-major des ministères au service d’une réflexion organisationnelle pourvoyeuse de résultats non négligeables.
Le rôle d’accompagnateur des réformes tenu par la direction générale de la modernisation de l’État (DGME) a globalement été apprécié par les ministères.
En outre, la DGME a mis en place et fait vivre des méthodes de consultations des usagers, certes perfectibles, sur l’image et l’évaluation du service public.
Quoique initialement strictement confinée et descendante, la RGPP a pu néanmoins conduire, dans certains secteurs, à une responsabilisation accrue et opportune d’états-majors administratifs déconcentrés dans les choix de gestion.
La communication officielle sur la RGPP (notamment les rapports publics accompagnant les CMPP et d’étape) est caractérisée par une forme d’« hagiographie » peu crédible, un simplisme de la présentation et une ergonomie de lecture déficiente.
Le suivi de la RGPP a été fortement axé sur le respect des agendas et des jalons temporels, négligeant ne serait-ce qu’un début d’évaluation réelle des impacts des mesures.
La RGPP a accru le recours à des cabinets privés d’audit pour accompagner la réforme de l’État, systématisant l’approche par des audits de modernisation, alternative aux initiatives antérieurement fondés sur des rapports administratifs.
Le lancement de la RGPP n’a pas incarné et n’a pas porté un projet mobilisateur pour les agents publics en matière de définition de service public.
À l’exception notable du secteur de la défense, elle n’a en outre que très rarement été l’objet de mesures d’accompagnement des personnels, que ce soit en terme de mobilité, de formation ou de conditions financières
À tort ou à raison, elle correspond aujourd’hui et de manière durable, pour un grand nombre d’agents publics et toutes les organisations syndicales, à un « repoussoir » ou à ce qu’il ne faut pas faire, malgré un consensus désormais acquis sur la nécessité de réformer l’État.
La mise en œuvre de la RGPP a négligé la réflexion sur la conduite du changement, sur les missions à exercer et les conditions de leur exercice.
La réforme de l’État pourrait utilement continuer à s’appuyer sur un portage politique au plus haut niveau de l’exécutif, garant de l’efficacité de la prise des décisions et de leur mise en œuvre.
Les décisions en matière de réforme de l’État doivent opérer un retour à une décision publique réellement motivée, s’appuyant sur une concertation impliquant les usagers et les agents publics.
Les principales orientations et décisions de la réforme de l’État doivent faire l’objet d’un débat public, notamment, au Parlement.
La réforme de l’État doit demain s’appuyer sur les acquis de la RGPP que sont l’implication et le dynamisme des états-majors des administrations centrales et déconcentrées.
La réforme de l’État doit également s’appuyer sur la responsabilisation des échelons plus déconcentrés d’encadrement dans les choix de gestion (le « comment pouvons-nous faire » ?), mais en veillant à na pas transférer à ce niveau la définition des missions du service public (le « que devons-nous faire » ?).
L’implication des personnels, sous la forme d’un « pilotage en mode projet » aurait pu faire gagner à la fois en efficacité et en acceptabilité. L’usager ressentirait mieux l’évolution des services publics ainsi directement portée par les agents.
Une réflexion doit être menée sur l’opportunité de placer la DGME auprès du Secrétariat général du Gouvernement, pour renforcer encore l’interministérialité de la réforme de l’État et mieux identifier ses dimensions fonctionnelle et budgétaire.
La DGME doit encourager les ministères à progresser davantage dans la prise en compte des attentes des usagers du service public.
Le suivi de la réforme de l’État doit conserver un caractère général, via un suivi commun, accessible dans un seul document, pour toutes les réformes mises en œuvre.
Le suivi de la réforme de l’État doit, de façon plus précise qu’aujourd’hui, relater les impacts des réformes achevées et reposer sur une documentation lisible, complète et accessible au grand public.
La réforme de l’État doit retrouver un équilibre dans la conduite du changement entre l’instruction adressée aux personnels et leur implication dans sa mise en œuvre.
La RGPP n’a pas conduit à la revue et la réflexion, d’ensemble et de détail, pourtant annoncées à son lancement, sur l’opportunité des missions de l’État.
La RGPP a constitué une réelle mise en œuvre dans l’administration de l’État du « faire mieux avec moins », qui la définissait en partie lors de son lancement.
La RGPP a constitué une révision générale substantielle de l’organisation des services centraux et déconcentrés de l’État, au demeurant partiellement masquée par l’incarnation de la RGPP comme processus de réalisation d’économies.
La RGPP a permis le lancement effectif de nombreuses réformes administratives parfois bloquées depuis plusieurs années.
L’adossement de la RGPP à une baisse des moyens a, à la fois, contraint à des choix rapides et, pour une part, pertinents en termes d’efficience, mais conduit à l’assimilation, peut-être durable, de la réforme de l’État à une simple recherche d’économies.
La réforme de l’État doit impérativement reprendre la question de la définition des missions de l’État, le « faire mieux avec moins » à missions quasi inchangées ayant désormais sans doute atteint ses limites.
Afin d’ouvrir une période de stabilité, y compris pour les agents publics, il serait opportun de stabiliser à moyen terme les nouvelles organisations de l’administration centrale et déconcentrée de l’État issues de la RGPP, nonobstant d’éventuels ajustements ponctuels.
III.– LES IMPACTS FINANCIERS DE LA RGPP
Le bilan budgétaire de la RGPP (personnel, intervention et fonctionnement) demeure dans l’ensemble une énigme, tant les informations, difficiles à obtenir sur ce sujet, semblent discutables et parcellaires.
La sincérité du bilan budgétaire de la RGPP est parasitée par une volonté de justifier les chiffres globaux initialement affichés et d’éluder les coûts associés aux réformes.
Il est néanmoins incontestable, – mais malheureusement difficilement évaluable avec précision – que la RGPP a contribué à la maîtrise de la masse salariale de l’État et conduit, pour la première fois, dans le PLF 2012 à une inflexion correspondant à une légère baisse de son montant en valeur.
Le bilan budgétaire de la RGPP ne s’appuie pas sur une méthode de suivi homogène des impacts financiers de chacune des ses mesures.
Les suppressions d’effectifs correspondant à la mise en œuvre de la « règle du un sur deux » ont été effectives et constantes depuis le lancement de la RGPP (par rapport à 2008, baisse des effectifs de la fonction publique de l’État de 4,1 % en 2011 et, en programmation, de 5,6 % en 2012).
Le retour catégoriel des économies issues de la « règle du un sur deux » a été mal maîtrisé (car sans nul doute supérieur à 50 % de ces économies) et mal réparti entre fonctionnaires. Ce « retour » a très souvent servi à honorer des engagements catégoriels indépendants voire antérieurs à la RGPP. Il prétend aussi compenser le gel du point d’indice mis en œuvre de façon prolongée.
La baisse des effectifs enseignants a été partiellement compensée par l’augmentation du nombre des heures supplémentaires effectuées, pour un coût important dont la détermination sur les court et long termes prête à discussion entre les rapporteurs : pour Christian Eckert, ce coût est probablement élevé, et à court terme pour l’État supérieur à leur conversion en postes, eu égard à la majoration et à la défiscalisation de ces heures supplémentaires ; pour François Cornut-Gentille, ce coût à court terme au bénéfice des agents doit être mis en perspective avec les économies opérées par l’État sur le long terme sur la masse salariale et les pensions.
Le suivi budgétaire global de la réforme de l’État doit s’appuyer sur la mesure méthodique de l’efficience de chacune des mesures mises en œuvre.
Il doit évidemment prendre en compte la dépense fiscale engendrée par l’augmentation des heures supplémentaires.
Une réflexion doit être menée sur l’opportunité et la réelle faisabilité d’associer à la réforme de l’État des objectifs macro-budgétaires pluriannuels.
Le retour catégoriel, ou toute autre forme de « récompenses » salariales, ne constituent pas des éléments suffisants pour un dialogue social à la hauteur des enjeux de la réforme de l’État ; ce dialogue doit porter sur la définition des objectifs du service public, des obligations de service et des conditions de travail.
La réforme de l’État et le contrôle parlementaire qui doit lui être associé gagneraient à s’appuyer sur les outils de la LOLF (indicateurs de résultats et objectifs définis pour chaque programme budgétaire, correspondant aux différentes politiques de l’État).
PRINCIPAUX TABLEAUX DU RAPPORT
NOMBRE DES MESURES DE LA RGPP
Phase 1 de la RGPP |
Phase 2 de la RGPP | ||||
CMPP du 12 décembre 2007 |
CMPP du 4 avril 2008 |
CMPP du 11 juin 2008 |
CMPP du 30 juin 2010 |
CMPP du 9 mars 2011 | |
Nombre des mesures |
97 |
166 |
69 |
141 |
44 |
Total par phase |
332 |
185 | |||
Total pour la RGPP |
517 | ||||
NOMBRE DES MESURES DE LA RGPP PAR MINISTÈRE
SELON LA CATÉGORIE D’ACTION QU’ELLES PRÉVOIENT
Optimiser - optimisation |
Rationaliser - rationalisation |
Mutualiser - mutualisation |
Fusionner - fusion |
Moderniser - modernisation | |
Services |
0 |
2 |
5 |
0 |
1 |
Affaires étrangères et européennes |
3 |
1 |
1 |
1 |
0 |
Défense et anciens combattants |
17 |
4 |
1 |
1 |
3 |
Écologie, développement durable, transports et logement |
4 |
1 |
1 |
0 |
1 |
Justice et libertés |
2 |
4 |
3 |
1 |
2 |
Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration |
5 |
8 |
7 |
1 |
2 |
Économie, finances et industrie |
3 |
7 |
1 |
2 |
0 |
Travail, emploi et santé |
1 |
3 |
2 |
2 |
0 |
Éducation nationale, jeunesse et vie associative |
3 |
4 |
2 |
1 |
0 |
Budget, comptes publics, fonction publique et Réforme de l’État |
2 |
3 |
0 |
1 |
3 |
Enseignement supérieur et recherche |
2 |
5 |
0 |
0 |
0 |
Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire |
1 |
8 |
2 |
0 |
0 |
Culture et communication |
0 |
3 |
1 |
0 |
3 |
Solidarité et cohésion sociale |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
Ville |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sports |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Total (151 mesures) |
44 |
54 |
28 |
10 |
15 |
HISTORIQUE DES SIGNIFICATIONS SUCCESSIVES
DES COULEURS DE FEU ATTRIBUÉES AUX MESURES DE LA RGPP
Feu vert |
Feu orange |
Feu rouge | |
Rapport d’étape du 3 décembre 2008 |
La mesure concernée remplit toutes les conditions d’un avancement satisfaisant |
Des travaux sont encore nécessaires pour définir un plan d’action détaillé et des indicateurs opérationnels, alors que la cible générale a bien été définie |
La mesure est encore dans une phase antérieure à la mise en œuvre, car sa cible n’est pas encore assez définie |
Rapport d’étape du 13 mai 2009 |
Projet de réforme pour lequel toutes les conditions sont réunies pour atteindre les résultats escomptés dans les délais prévus |
Projet de réforme en cours d’exécution, mais dont le calendrier n’est pas totalement respecté, ou dont la mise en œuvre présente des difficultés techniques, qui appellent des décisions correctrices |
Projet de réforme dont la phase de mise en œuvre n’a pas encore été engagée |
Rapport d’étape du 16 février 2010 |
Toutes les conditions sont réunies pour atteindre les résultats escomptés dans les délais prévus |
Projet de réforme en retard ou présentant des difficultés techniques qui appellent des mesures spécifiques |
La réussite d’une mesure est compromise et appelle aussi des mesures correctrices. |
Rapport accompagnant les CMPP des 30 juin 2010 et 9 mars 2011 |
La réforme progresse au rythme prévu |
La réforme satisfait la plupart des exigences mais nécessite des actions correctrices* |
La réforme connaît un retard important et doit faire l’objet d’actions correctrices à mettre en œuvre rapidement. |
* La signification que le rapport accompagnant le CMPP du 30 juin 2010 associe à la couleur orange est plus précisément la suivante : « la réforme satisfait la plupart des exigences mais nécessite des actions correctrices pour être menée à bien. »
CONSTATS ET PROGRAMMATIONS ACTUALISÉS
DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DE LA RGPP SELON LE GOUVERNEMENT
(en milliards d’euros)
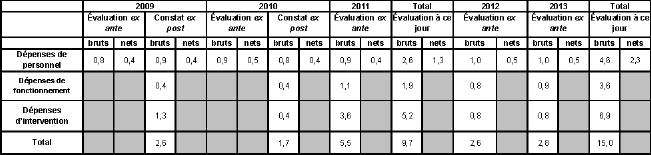
Source : direction du budget
SUPPRESSIONS D’EMPLOIS PAR MINISTÈRE DEPUIS 2008
Ministères |
Schémas d’emplois | ||||||||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Évolution des effectifs 2008/2011 |
2012 |
Évolution des effectifs 2008/2012 | |||||
Plafond des autorisations d’emplois 2008 |
Loi de finances initiale |
Rapport annuel |
Loi de finances initiale |
Rapport annuel |
Loi de finances initiale |
Projet de loi de finances | |||||
en ETPT |
en % |
en ETPT |
en % | ||||||||
Affaires étrangères et européennes |
16 056 |
–190 |
–392 |
–255 |
–271 |
–160 |
–823 |
–5,1 % |
–140 |
–963 |
–6 % |
Alimentation, agriculture et pêche |
35 430 |
–650 |
–804 |
–730 |
–683 |
–650 |
–2 137 |
–6 % |
–653 |
–2 790 |
–7,9 % |
Budget |
151 006 |
–2 812 |
–2 101 |
–3 020 |
–3 249 |
–3 127 |
–8 477 |
–5,6 % |
–2 870 |
–11 347 |
–7,5 % |
Culture et communication |
11 755 |
–103 |
–108 |
–125 |
–71 |
–93 |
–272 |
–2,3 % |
–93 |
–365 |
–3,2 % |
Défense |
326 705 |
–8 250 |
–6 700 |
–8 250 |
–8 368 |
–8 250 |
–23 318 |
–7,1 % |
–7 462 |
–30 780 |
–9,4 % |
Écologie, énergie, développement durable |
70 569 |
–1 400 |
–344 |
–1 294 |
–1 322 |
–1 287 |
–2 953 |
–4,2 % |
–1 309 |
–4 262 |
–6 % |
Économie, industrie et emploi |
16 089 |
–287 |
–162 |
–324 |
–335 |
–273 |
–770 |
–4,8 % |
–245 |
–1 015 |
–6,3 % |
Éducation nationale |
991 363 |
–13 500 |
–9 989 |
–16 000 |
–14 551 |
–16 000 |
–40 540 |
–4,1 % |
–14 000 |
–54 540 |
–5,5 % |
Enseignement supérieur et recherche |
115 959 |
–450 |
–217 |
0 |
0 |
0 |
–217 |
–0,2 % |
0 |
–217 |
–0,2 % |
Immigration |
616 |
–3 |
–38 |
–13 |
–4 |
–42 |
–6,8 % |
nd |
nd | ||
Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales |
289 794 |
–2 953 |
–4 564 |
–3 450 |
–2 368 |
–1 597 |
–8 529 |
–2,9 % |
–3 621 |
–12 150 |
–4,2 % |
Justice et libertés |
72 237 |
+512 |
+926 |
+400 |
+1 103 |
+400 |
+2 429 |
+3,4 % |
+515 |
+2 944 |
+4,1 % |
Services du Premier ministre (dont Conseil et contrôle de l’État, AAI, SGDSN) |
7 856 |
+40 |
+319 |
+69 |
+35 |
+54 |
+408 |
+5,2 % |
+49 |
+457 |
+5,8 % |
Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville, santé et sport |
34 956 |
–483 |
–568 |
–501 |
–930 |
–443 |
–1 941 |
–5,6 % |
–429 |
–2 370 |
–6,8 % |
Total (Budget général) |
2 110 810 |
–30 529 |
–24 742 |
–33 493 |
–31 014 |
–31 426 |
–87 182 |
–4,1 % |
–30 258 |
–117 440 |
–5,6 % |
Total schémas d’emplois 2008-2012 (5 exercices) par rapport à 2007 (compte tenu d’un schéma d’emploi de – 28 000 ETPT en 2008 par rapport en 2007 non détaillé ci-dessus) : –145 440 ETPT | |||||||||||
SCHÉMAS D’EMPLOIS, DÉPARTS À LA RETRAITE ET TAUX DE REMPLACEMENT
DANS CERTAINS MINISTÈRES PAR CATÉGORIES A, B ET C D’AGENTS PUBLICS*
Administrations financières |
Défense |
Écologie |
Ministères sociaux | ||
Catégorie A |
Schémas d’emplois |
– 357 |
+ 1 572 |
– 972 |
– 882 |
Nombre de départs à la retraite |
– 4 615 |
– 787 |
– 2 471 |
– 1 869 | |
Taux de remplacement |
92,3 % |
100 % |
60,7 % |
52,8 % | |
Catégorie B |
Schémas d’emplois |
– 1 640 |
– 1 303 |
– 3 351 |
– 665 |
Nombre de départs à la retraite |
– 7 339 |
– 1 041 |
– 4 587 |
– 1 062 | |
Taux de remplacement |
77,6 % |
0 % |
26,9 % |
37,4 % | |
Catégorie C |
Schémas d’emplois |
– 10 446 |
– 3186 |
– 3654 |
– 1 130 |
Nombre de départs à la retraite |
– 7 529 |
– 2 261 |
– 5 336 |
– 1 284 | |
Taux de remplacement |
0 % |
0 % |
31,5 % |
12 % |
*Par construction, quand le nombre de suppressions d’ETPT est supérieur à celui des départs à la retraite, le taux de remplacement est de 0 % ; quand le schéma d’emplois correspond à une augmentation des effectifs, le taux de remplacement est de 100 %.
Source : ministères concernés.
S’INSPIRER DES MEILLEURES PRATIQUES EUROPÉENNES
POUR AMÉLIORER NOS PERFORMANCES SOCIALES
Rapport d’information n° 4098, présenté le 15 décembre 2011
par MM. Michel Heinrich et Régis Juanico, rapporteurs
Synthèse
En octobre 2010, le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC) a décidé d’inscrire à son programme de travail l’évaluation de la performance des politiques sociales en Europe. Essentielle pour l’amélioration du pilotage de l’action publique, cette évaluation n’en constituait pas moins un véritable défi, pour le moins ambitieux, sinon audacieux. Pour y répondre, le présent rapport comporte, tout d’abord, plusieurs éléments d’analyse transversale sur la performance des politiques sociales en Europe, ainsi qu’un second volet, thématique, ayant pour objet l’évaluation de la performance comparée des politiques d’accompagnement des demandeurs d’emploi, d’une part, et de deux politiques sociales à destination des familles, d’autre part.
Il est appuyé sur deux études comparatives, portant sur cinq pays européens (21) outre la France, réalisées par des prestataires externes, sur appel d’offres. Le groupe de travail a par ailleurs auditionné plus de 80 personnes, au cours de 40 auditions et tables rondes. Les rapporteurs se sont également rendus à Stockholm, à Bruxelles, à Londres et à Berlin, où une quarantaine de représentants des différentes parties prenantes ont été entendus. Parallèlement, des questionnaires ont été adressés par les rapporteurs aux ambassades et aux parlements dans quinze pays européens.
Première partie :
Éléments d’analyse transversale
LA PERFORMANCE DES POLITIQUES SOCIALES EN EUROPE :
QUELS ENJEUX, QUELLES RÉPONSES POLITIQUES ?
● La performance a tout d’abord été définie comme la capacité à atteindre des objectifs préalablement fixés, en termes notamment d’efficacité socio-économique (pour le citoyen), d’efficience (pour le contribuable) et de qualité de service (pour l’usager). Il est également apparu nécessaire d’inscrire son évaluation dans une temporalité suffisamment longue pour prendre en compte, par exemple, les économies qu’une réforme peut être susceptible de générer, à plus ou moins long terme. Le suivi de la performance des politiques sociales constitue aujourd’hui un impératif pour améliorer leur gestion et éclairer la décision publique. Dans cet objectif, de nombreux enseignements peuvent être tirés de l’observation de bonnes pratiques dans d’autres pays, même si les comparaisons internationales appellent certaines précautions, par exemple sur l’interprétation des différents indicateurs.
● Par rapport aux autres pays européens, la France se caractérise par un niveau particulièrement élevé de dépenses sociales, qui représentent aujourd’hui plus de 31 % du PIB (produit intérieur brut), mais aussi par leur augmentation sensiblement plus marquée que la moyenne des pays de l’OCDE au cours des dernières décennies.
Dans le domaine social, les performances françaises sont le plus souvent au-dessus de la moyenne de l’OCDE. Le dynamisme démographique de la société française, l’espérance de vie à la naissance, la durée de la vie en retraite ou encore l’efficacité redistributive du système fiscalo-social dans son ensemble apparaissent comme des points forts du modèle français en comparaison internationale. D’autres résultats moins favorables posent question : en particulier, la faiblesse des taux d’emploi par rapport à d’autres pays et par rapport aux objectifs européens. Même dans les domaines où les performances françaises sont bonnes, les évaluations soulignent que des progrès sont possibles : en particulier, dans le domaine de la santé, des progrès dans la lutte contre les inégalités de santé, la coordination des soins et la réduction des frais administratifs. Enfin, une analyse fine à partir des indicateurs français et européens – élaborés pour leur part dans le cadre de la nouvelle stratégie « Europe 2020 » qui a fait de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion un des objectifs phares de l’Union européenne – montre une tendance à l’aggravation des inégalités et de l’exclusion en France, même si les inégalités de revenus en France sont plus faibles que dans la moyenne des pays de l’OCDE. Alors que le taux de pauvreté relatif au seuil de 60 % du revenu médian s’établit à 13,5 % selon l’Insee (2009), l’indicateur européen, plus complet, qui tient également compte de la pauvreté en conditions de vie et des ménages dont aucun membre ne travaille, révèle qu’avec 18,4 % des Français concernés par le risque de pauvreté ou d’exclusion en 2009, la France est plus performante que la moyenne de l’Union européenne mais seulement à la 9e place après la République Tchèque, les Pays-Bas et la Suède, notamment.
● Pour renforcer la performance des politiques sociales, le rapport préconise tout d’abord d’améliorer leur pilotage et leur évaluation, au regard notamment de pratiques observées dans plusieurs pays européens, et de :
→ organiser chaque année un débat au Parlement sur l’efficacité des politiques sociales, qui porterait par exemple sur des thèmes correspondant à certains des objectifs des programmes de qualité et d’efficience (PQE), et dont le choix serait partagé entre la majorité et l’opposition ;
→ développer le recours à l’expérimentation dans le champ social, en définissant un programme pluriannuel d’expérimentations, soumis pour avis à la commission des Affaires sociales et en organisant régulièrement des débats en séance publique à l’Assemblée nationale sur les résultats des expérimentations ; et d’améliorer l’évaluation des politiques et d’en tirer tous les enseignements pour une conduite pragmatique des réformes dans la durée, fondée sur une démarche d’amélioration en continu des dispositifs ;
→ renforcer l’évaluation des politiques locales et favoriser les échanges de bonnes pratiques par la création d’un tableau de bord commun pour la comparaison de l’action sociale décentralisée et d’un fonds de « recherche et développement » des politiques sociales locales, financé conjointement par l’État et les collectivités territoriales.
Le rapport propose également de s’appuyer sur les outils de l’« Europe sociale », encore trop souvent négligée et de :
→ redéployer le Fonds social européen, en fonction de l’objectif européen de sortir 20 millions d’Européens de la pauvreté et de l’exclusion d’ici 2020, et en France, faciliter l’accès des associations innovantes dans le domaine social à ces financements ;
→ conserver un programme européen d’aide alimentaire aux plus démunis après 2014, dans le cadre des engagements de l’Union européenne exprimés dans la stratégie Europe 2020.
Seconde partie : Analyse de la performance comparée de différentes politiques publiques dans cinq pays européens
LES FACTEURS DE PERFORMANCE DES POLITIQUES DE L’EMPLOI EN EUROPE
● Des enjeux transversaux s’attachent à l’évaluation des politiques de l’emploi : le poids des cotisations sociales sur le travail en France rend aujourd’hui nécessaire une réflexion sur le financement de la protection sociale et sur le système fiscal. De plus, l’efficacité de la politique de l’emploi est intrinsèquement liée à la croissance économique, appelant une politique volontariste de développement industriel et d’innovation.
À la demande des rapporteurs, le cabinet Euréval a réalisé une comparaison des politiques de l’emploi dans cinq pays européens (Allemagne, France, Portugal, Royaume-Uni, Suède) et une synthèse des travaux d’évaluation consacrés, dans ces pays, à l’efficacité de l’accompagnement et des dispositifs censés favoriser le retour à l’emploi.
● Par rapport à ses voisins européens, la France se caractérise par la complexité et l’éclatement des structures d’accompagnement des demandeurs d’emploi, par la faiblesse des effectifs du service public de l’emploi affectés au placement et par une adaptation moindre des ressources humaines et financières. Les autres pays européens étudiés paraissent plus réactifs que la France dans l’ajustement des moyens à la conjoncture. Les conseillers du service public de l’emploi y ont plus d’outils, de prestations ou d’aides sociales à leur disposition et plus d’autonomie que les conseillers français. Les rapporteurs préconisent de :
→ lancer une expérimentation avec des collectivités territoriales volontaires sur le rapprochement des acteurs de l’Emploi, de l’Entreprise et de la Formation professionnelle sous une direction commune pour identifier et promouvoir les meilleures pratiques.
● La synthèse des travaux de recherche réalisés dans le domaine des politiques de l’emploi a mis en évidence des enseignements peu nombreux mais robustes sur l’efficacité des politiques de l’emploi. Les exonérations de charges sociales sur les salaires des moins qualifiés se sont révélées efficaces mais pourraient constituer une trappe à bas salaire et limiter la progressivité des carrières. Le renforcement et la personnalisation de l’accompagnement des demandeurs d’emploi ont un impact favorable sur le retour à l’emploi, susceptible de générer des économies pour l’assurance chômage. Plusieurs dispositifs doivent être mieux ciblés : la formation professionnelle doit être encouragée en période de récession, en privilégiant les formations en alternance, et pour augmenter la qualité de l’emploi à plus long terme. Les contrats aidés sont utiles pour les publics structurellement éloignés de l’emploi ou pour donner un « coup de pouce » temporaire. Enfin, les évaluations européennes montrent de façon convergente que les prestataires privés ne sont pas plus efficaces que l’opérateur public pour les mêmes missions. Les rapporteurs insistent sur la nécessité de :
→ mettre un terme à l’instabilité juridique et financière relative aux contrats aidés, qui nuit à l’efficacité de ces dispositifs, et veiller à des durées de contrat suffisantes pour permettre un accompagnement, une formation et une insertion durable des bénéficiaires.
Pour améliorer les performances du service public de l’emploi français, les rapporteurs proposent les mesures suivantes :
→ renforcer et personnaliser l’accompagnement des demandeurs d’emploi, en organisant rapidement un premier entretien consacré à l’indemnisation, suivi d’un second sur l’accompagnement professionnel et en intensifiant les contacts ;
→ adopter une approche globale du demandeur d’emploi, en renforçant la coordination entre les professionnels du retour à l’emploi et ceux de l’insertion sociale, en utilisant plus fréquemment et plus efficacement les aides à la reprise d’activité (aide au permis de conduire, aide à la garde d’enfants) et en intervenant le plus en amont possible de la fin des dispositifs temporaires comme les contrats aidés ;
→ renforcer les compétences, l’expertise et l’autonomie des conseillers de Pôle Emploi, en renonçant à la généralisation du métier unique tout en encourageant la polyvalence pour ceux qui le souhaitent, en renforçant la formation des conseillers et leur autonomie ;
→ adapter les moyens de Pôle Emploi à la conjoncture et au niveau de chômage, en augmentant le nombre de conseillers pour maintenir le niveau de service en période de crise et pour cela, en permettant un recours accru aux CDD ;
→ être plus à l’écoute des usagers, en confirmant le rôle et l’importance des lieux d’échanges entre les usagers et Pôle Emploi et en confiant au Médiateur la responsabilité d’un rapport annuel plus complet sur la satisfaction des bénéficiaires.
L’ARTICULATION ENTRE VIE FAMILIALE ET VIE PROFESSIONNELLE :
UN DÉFI PERSONNEL, UN ENJEU COLLECTIF
Le rapport comporte une analyse de deux politiques sociales à destination des familles, qui s’est appuyée sur une étude comparative réalisée, à la demande des rapporteurs, par Sciences Po/le Centre d’études européennes (CEE), le Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques (LIEPP) et l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE).
● Des enjeux majeurs s’attachent aux politiques visant à favoriser l’articulation entre vie familiale et vie professionnelle, en termes économiques, sociaux et sociétaux. En effet, au regard des difficultés parfois rencontrées dans ce domaine, qui peuvent être plus aiguës encore pour des parents seuls, ces politiques sont susceptibles de favoriser l’augmentation des taux d’activité des parents, et particulièrement des mères, ainsi que la qualité de l’emploi et l’égalité entre les hommes et les femmes. Elles peuvent également contribuer à la consolidation des systèmes de protection sociale et à la performance des entreprises.
La France se place au premier rang des pays de l’OCDE pour les différentes aides apportées aux familles, qui représentent 3,7 % du PIB ; des moyens importants sont en particulier alloués aux mesures visant à favoriser la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, qui constitue aujourd’hui un objectif clairement identifié des politiques publiques.
● L’analyse comparée des politiques d’articulation fait tout d’abord ressortir plusieurs spécificités françaises, notamment un système socio-fiscal moins individualisé que dans certains autres pays, et un congé parental très féminisé, plus long et moins bien rémunéré que dans certains pays, en particulier la Suède et l’Allemagne. Par ailleurs, on constate en France une très bonne prise en charge des enfants de trois à six ans, mais, a contrario, un manque de places d’accueil pour les moins de trois ans, les besoins non couverts étant estimés à environ 350 000 places. En tout état de cause, l’accès à des modes de garde de qualité présente des enjeux importants en termes d’égalité des chances, de réussite scolaire et de lutte contre les inégalités sociales.
Dans l’analyse de la performance des politiques d’articulation, la France se distingue par de bons résultats dans certains domaines, en particulier la natalité et l’insertion professionnelle des femmes, qui se fait plutôt à temps plein. Il existe néanmoins des voies d’amélioration afin de favoriser l’égalité des genres, l’accès ou le retour à l’emploi des mères et de mieux répondre aux difficultés parfois exprimées par les parents en matière de conciliation.
Il convient également de souligner la persistance d’écarts salariaux entre les hommes et les femmes : une étude récente de l’OFCE montre ainsi qu’une cohorte d’hommes, dans la tranche des quarantenaires, gagnent 17 % de plus qu’une cohorte de femmes disposant des mêmes caractéristiques (même âge, ayant des enfants, aucune interruption de carrière pour les élever, diplômes et expériences égaux, voire supérieurs pour les femmes), et que l’essentiel de cette différence (70 %) reste inexpliqué.
● Pour créer les conditions d’un meilleur équilibre des temps professionnels et familiaux, le rapport préconise en conséquence :
→ d’aller progressivement vers un congé parental plus court, de quatorze mois, en incluant deux « mois d’égalité » non transférables, qui seraient réservés à celui des parents n’ayant pas pris le reste du congé, et mieux rémunéré qu’aujourd’hui, par exemple à hauteur des deux tiers du salaire antérieur, en s’inspirant des dispositifs mis en place en Suède et en Allemagne ;
→ de poursuivre le développement de l’offre de garde de la petite enfance, en particulier en accueil collectif, qui est très développé dans les pays nordiques, tels que la Suède, et en maintenant au moins au niveau actuel la scolarisation des enfants de moins de trois ans ;
→ de favoriser le développement de la négociation collective et des bonnes pratiques en milieu professionnel en matière d’articulation entre le travail et les responsabilités familiales, au regard notamment de l’implication des entreprises dans ce domaine en Allemagne. Les directeurs des ressources humaines de l’entreprise (DRH) des entreprises doivent penser l’organisation du travail (horaires, prise en compte des modes de garde des enfants…), en fonction d’un objectif de meilleure conciliation travail/famille, qui vise à favoriser une paternité active et un véritable partage des tâches familiales, y compris ménagères dans le couple, par une meilleure implication des hommes (double journée de travail pour les femmes).
Les rapporteurs souhaitent ainsi offrir de meilleures opportunités de carrières aux mères et plus de temps de famille aux pères.
LES FAMILLES MONOPARENTALES : ENTRE CIBLAGE ET UNIVERSALISME,
DES RÉPONSES ADAPTÉES AUX SITUATIONS PARTICULIÈRES
DE VULNÉRABILITÉ
● En France comme en Europe, les familles monoparentales sont particulièrement exposées au risque de pauvreté et de précarité et il s’agit très majoritairement de mères seules. Le taux d’emploi des parents isolés est plus élevé en France que dans la moyenne des pays de l’OCDE, contrairement au taux de pauvreté qui lui est nettement inférieur. Toutefois, dans les cinq pays européens étudiés, y compris en France, le taux de chômage des mères seules est partout supérieur à celui de l’ensemble des mères.
● Dans les cinq pays sous revue, les politiques publiques en direction des familles monoparentales se caractérisent par une certaine diversité, illustrant les différentes figures contemporaines de l’État social. Certains pays, comme la France ou le Royaume-Uni ont ainsi adopté des dispositifs spécifiques en faveur des parents isolés, contrairement à d’autres pays, tels que la Suède, qui ont adopté une approche dite universaliste. Par ailleurs, des réformes ont été mises en place dans plusieurs pays afin de favoriser l’accès à l’emploi et lutter contre la pauvreté des parents isolés, les formes de protection sociale évoluant ainsi progressivement du « maternalisme » à l’activation.
● De l’évaluation de la performance comparée des différentes politiques publiques, il ressort tout d’abord l’absence d’un réel modèle de réussite, même si la Suède, puis la France, apparaissent plutôt mieux positionnées par rapport aux principaux indicateurs socio-économiques. Cette analyse comparative permet également d’identifier plusieurs leviers de l’action publique de nature à lutter contre la pauvreté et à soutenir l’accès à l’emploi des parents isolés, notamment : le caractère rémunérateur de la reprise d’un emploi, l’importance d’un accompagnement adapté et de la prise en compte des frais et des difficultés liées à la garde des enfants ainsi que l’accès à des emplois de qualité. Parallèlement, il convient également de déployer des politiques volontaristes et universalistes visant à promouvoir l’emploi des mères en général.
● Afin d’améliorer l’accompagnement social et professionnel des parents isolés en situation de vulnérabilité, les rapporteurs proposent :
→ d’améliorer l’information concernant les aides aux familles et le dispositif du revenu de solidarité active (RSA) ;
→ de procéder à une évaluation de l’accompagnement par les travailleurs sociaux et des conditions d’accès aux établissements d’accueil des jeunes enfants pour les bénéficiaires de minima sociaux. ;
→ de renforcer la coordination entre les acteurs, de sensibiliser les agences de l’emploi à la question des parents isolés et d’engager des expérimentations visant à proposer un accompagnement spécifique des parents isolés, sur la base du volontariat, en s’inspirant des bonnes pratiques observées notamment au Royaume-Uni et en Allemagne.
Recommandations et réflexions
Recommandation n° 1 : Conforter les instruments de l’Europe sociale
– Poursuivre les négociations dans le sens d’un redéploiement du Fonds social européen en faveur des nouveaux objectifs de la stratégie Europe 2020, en particulier celui visant à « sortir » 20 millions d’Européens de la pauvreté et de l’exclusion d’ici à 2020, et de l’expérimentation sociale.
– Conserver un dispositif d’aide alimentaire pour les plus démunis après 2014 et encourager les réflexions dans le sens d’un financement de cette aide par le Fonds social européen, à l’occasion des négociations actuelles sur les perspectives budgétaires 2014-2020.
En France :
– Renforcer l’information et l’accompagnement juridique des associations françaises candidates aux financements FSE dans les Direccte, par la création d’un groupe de travail impliquant des associations bénéficiaires et notamment chargées de proposer des mesures de simplification ;
– Encourager l’expérimentation sociale en apportant un appui financier aux projets innovants susceptibles d’être cofinancés par le FSE.
Recommandation n° 2 : Organiser un débat au Parlement en semaine de contrôle, par exemple au printemps, sur l’efficacité des politiques sociales, qui pourrait s’appuyer sur certains objectifs des programmes de qualité et d’efficience (PQE), dont le choix serait partagé entre la majorité et l’opposition, ainsi que sur un rapport du Gouvernement au Parlement.
Recommandation n° 3 : En s’inspirant notamment des pratiques observées en Suède, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni :
– définir un programme pluriannuel d’expérimentations sociales, qui pourrait être soumis pour avis à la commission des Affaires sociales ;
– organiser des débats au Parlement sur les résultats d’expérimentations, par exemple dans le cadre des semaines de contrôle de l’Assemblée nationale ;
– aller vers une exigence d’expérimentation préalable systématique, au moins pour les grandes réformes sociales ;
– améliorer l’évaluation in itinere et ex post des politiques sociales afin de pouvoir les adapter, en tant que de besoin, par exemple en prévoyant a priori un budget pour l’évaluation, même limité en proportion des dépenses, et en veillant à associer les parties prenantes, ainsi que des chercheurs, éventuellement d’autres pays européens.
Recommandation n° 4 : Encourager la mise en place d’une « méthode ouverte de coordination » entre conseils généraux, en promouvant l’exemple suédois
– Encourager une évolution de l’Observatoire de l’action sociale décentralisée (ODAS) dans le sens d’un renforcement de ses capacités d’évaluation.
– Susciter l’adoption d’un tableau de bord commun pour la comparaison de l’action sociale décentralisée.
– Créer un fonds de « recherche, développement et évaluation » sur les politiques sociales locales financé conjointement par l’État et les collectivités territoriales.
Recommandation n° 5 : Lancer une expérimentation avec des collectivités territoriales volontaires sur le rapprochement des acteurs de l’Emploi, de l’Entreprise et de la Formation professionnelle sous une direction commune pour identifier et promouvoir les meilleures pratiques.
Recommandation n° 6 : Mettre un terme à l’instabilité juridique et financière relative aux contrats aidés, qui nuit à l’efficacité de ces dispositifs et veiller à des durées de contrat suffisantes pour permettre un accompagnement, une formation et une insertion durable des bénéficiaires.
Recommandation n° 7 : mettre en œuvre un accompagnement renforcé
– Programmer deux entretiens très rapprochés au début du parcours personnalisé, l’un sur l’indemnisation, l’autre sur le projet professionnel.
– S’inscrire effectivement dans l’objectif d’organiser le premier entretien cinq jours après l’inscription à Pôle Emploi.
– Intensifier les contacts avec les demandeurs d’emploi.
Recommandation n° 8 : adopter une approche globale du demandeur d’emploi
– Renforcer la coordination entre les acteurs de l’aide sociale et ceux du retour à l’emploi, grâce à un pilotage de haut niveau associant préfets, directeurs locaux de Pôle Emploi et présidents de conseils généraux.
– Préserver les moyens consacrés aux aides à la reprise d’activité comme l’aide au permis de conduire B ou les aides à la garde d’enfants pour lutter efficacement contre les freins au retour à l’emploi et donner plus de marges de manœuvre aux conseillers et travailleurs sociaux dans l’attribution de ces aides.
– Accompagner les bénéficiaires de contrats aidés en amont de la fin de leur contrat.
Recommandation n° 9 : renforcer les compétences et l’autonomie des conseillers de Pôle Emploi
– Renoncer à la généralisation du métier unique tout en encourageant la polyvalence pour ceux qui le souhaitent.
– Renforcer la formation initiale et développer l’expertise des conseillers sur les bassins d’emploi.
– Accorder une plus grande autonomie aux conseillers en favorisant les échanges de bonnes pratiques.
Recommandation n° 10 : l’adaptation des moyens de Pôle Emploi à la conjoncture et au niveau de chômage
– Adapter les moyens de Pôle Emploi aux besoins résultant de la conjoncture économique en permettant l’augmentation rapide du nombre de conseillers lorsque le chômage augmente.
– Dans cette perspective, permettre un recours accru aux CDD à Pôle Emploi.
Recommandation n° 11 : être à l’écoute des usagers
– Confirmer le rôle et l’importance des lieux d’échanges entre les associations de chômeurs et Pôle Emploi (comités de liaison) aux niveaux local et national.
– Confier au Médiateur la responsabilité d’un rapport annuel plus complet sur la satisfaction des bénéficiaires.
Recommandation n° 12 : En s’inspirant des dispositifs mis en place en Suède et en Allemagne notamment :
– aller progressivement vers une allocation de congé parental (CLCA) d’un montant plus élevé et proportionnel au salaire antérieur, à hauteur des deux tiers, jusqu’à un montant maximum, et sur une période plus courte, de 14 mois ;
– prévoir une période non transférable réservée à l’un des parents au sein du congé parental (« mois d’égalité »), de 2 mois, et organiser parallèlement des campagnes de sensibilisation concernant la parentalité masculine.
Recommandation n° 13 : Metttre en place un accompagnement renforcé vers l’emploi et la formation des bénéficiaires du CLCA, et accroître la coopération entre Pôle Emploi et les Caf, en prévoyant en particulier la transmission par ces dernières des listes des allocataires du CLCA à Pôle Emploi, pour lui permettre de proposer une offre de services dédiée.
Recommandation n° 14 : Au regard notamment des pratiques observées dans les pays nordiques, en particulier en Suède, poursuivre le développement de l’offre de garde de la petite enfance, et :
– atteindre les objectifs fixés par le Gouvernement en termes de création de places, soit 200 000 places supplémentaires, dont la moitié en accueil collectif ;
– définir des objectifs ambitieux dans ce domaine dans la prochaine convention d’objectifs et de gestion (Cog) entre l’État et la Cnaf ;
– afin qu’il s’agisse bien d’une création nette de nouvelles places d’accueil, maintenir au moins au niveau actuel la scolarisation des enfants de moins de trois ans.
Recommandation n° 15 : Améliorer les connaissances et réaliser une étude permettant d’évaluer finement les besoins ainsi que les disparités territoriales concernant la qualité et l’offre des modes de garde, en particulier dans les départements et territoires d’outre-mer, et développer les données sur l’accueil périscolaire.
Recommandation n° 16 : Afin d’encourager le développement de la négociation collective concernant l’équilibre entre vie familiale et vie professionnelle, dans le prolongement des préconisations du rapport de Mme Brigitte Grésy de juin 2011 :
– inscrire la question de l’articulation dans le champ de la négociation triennale de branche sur l’égalité professionnelle ;
– définir en conséquence les indicateurs pertinents, concernant la question de l’articulation, pour la négociation triennale de branche sur l’égalité professionnelle (par voie réglementaire), et améliorer le suivi des actions en faveur de l’articulation dans le cadre du bilan annuel de la négociation collective.
Recommandation n° 17 : En s’inspirant notamment de l’implication des entreprises dans le champ de la conciliation entre famille et travail en Allemagne, soutenir le développement des bonnes pratiques et :
– procéder à une évaluation approfondie du crédit d’impôt famille (Cif) en faveur des entreprises qui réalisent certaines dépenses pour aider leurs salariés à mieux articuler vie familiale et vie professionnelle ;
– confier à l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact) une mission de diffusion des bonnes pratiques et d’accompagnement des entreprises dans le domaine de l’articulation ;
– veiller à la formation et la sensibilisation de l’encadrement aux questions relatives à l’équilibre entre vie familiale et vie professionnelle ; les directeurs des ressources humaines (DRH) de l’entreprise doivent penser l’organisation du travail (horaires, prise e compte des modes de garde des enfants…), en fonction d’un objectif de meilleure conciliation travail/famille, qui vise à favoriser une paternité active et un véritable partage des tâches familiales ;
– favoriser la mixité au sein des instances de direction des entreprises, en envisageant de préciser explicitement que la délibération annuelle des conseils d’administration sur la politique d’égalité au sein de l’entreprise doit notamment porter sur la question de la mixité au sein des comités de direction, et de prévoir la transmission du rapport de situation comparée entre les hommes et les femmes à l’assemblée générale des actionnaires.
Recommandation n° 18 : Pour améliorer l’information et l’accès aux droits :
– organiser une campagne d’information sur le revenu de solidarité active (RSA), en direction des bénéficiaires potentiels mais aussi du grand public, et étudier finement les raisons du recours limité au RSA chapeau ;
– renforcer l’information des familles sur l’ensemble des aides existantes, par exemple en diffusant un guide sur les aides en faveur des familles monoparentales ;
– généraliser les pratiques consistant à simplifier les formulaires et les courriers administratifs en associant systématiquement les représentants des bénéficiaires.
Recommandation n° 19 : Pour mieux évaluer les pratiques actuelles afin d’améliorer l’accompagnement des allocataires du RSA, notamment des parents isolés :
– faire le bilan de l’application des dispositions législatives prévoyant un accès préférentiel aux établissements d’accueil des jeunes enfants pour les bénéficiaires de minima sociaux et en particulier les parents isolés disposant de faibles ressources ;
– procéder à une étude sur le nombre des travailleurs sociaux, leur formation et les pratiques actuelles en matière d’accompagnement.
Recommandation n° 20 : Concernant les politiques en direction des parents isolés, soutenir l’emploi des mères en général, et parallèlement, en vue d’améliorer l’accompagnement des parents isolés pour répondre aux situations particulières de vulnérabilité :
– renforcer les coopérations entre les services sociaux, les collectivités locales et les acteurs de l’emploi (plus développées par exemple en Norvège et au Royaume-Uni) ;
– envisager des expérimentations pour proposer un accompagnement renforcé aux parents isolés, sur la base du volontariat, avec par exemple un parcours intégré d’insertion comprenant notamment des aides accrues pour la garde d’enfants et le retour à l’emploi, voire d’autres options ou droits spécifiques, tels qu’un accès renforcé à la formation ou à un mode d’accueil (en s’inspirant de certains aspects du dispositif d’accompagnement mis en place au Royaume-Uni) ;
– mettre en place un comité national d’évaluation des expérimentations, en associant largement les parties prenantes et les associations, et en prévoyant l’examen des résultats de l’expérimentation par le Parlement ;
– sensibiliser les agences de l’emploi à la question spécifique des parents isolés, et, en concertation avec les organisations syndicales, en étudiant les possibilités de fixer des objectifs aux agents du service public de l’emploi dans ce domaine (en s’inspirant de certaines pratiques observées en Allemagne).
POUR UN SERVICE PUBLIC EFFICACE DE L’HÉBERGEMENT
ET DE L’ACCÈS AU LOGEMENT DES PLUS DÉMUNIS
Rapport d’information n° 4221, présenté le 26 janvier 2012
par Mme Danièle Hoffman-Rispal et M. Arnaud Richard, rapporteurs
Synthèse
On ne peut éluder le fait que des dizaines de milliers de personnes dorment chaque nuit à la rue dans notre pays. À l’issue de nos travaux, et sur le fondement des travaux de la Cour des comptes réalisés à la demande du CEC, nous considérons que le déficit du nombre des places d’hébergement au regard du nombre des personnes sans domicile (80 000 places pour environ 150 000 personnes sans domicile) implique l’ouverture d’un certain nombre de places nouvelles dans les zones tendues.
Ce processus d’ouverture de places nouvelles doit être mis en œuvre au regard d’une analyse préalable et approfondie des besoins manquants dans chaque territoire. Afin d’engager l’effort nécessaire, devrait cependant être mise à l’étude sans délai la pérennisation tout au long de l’année des places supplémentaires ouvertes l’hiver.
L’action publique ne doit en aucune manière baisser les bras s’agissant de la prévention, en tentant d’agir positivement sur le flux des « canaux d’alimentation » de la population des personnes sans-abri. Il convient, autant que faire se peut, de maintenir dans le logement un ménage en difficulté financière, par une action publique préventive mise en œuvre dès le premier impayé de loyer. Car le « logement d’abord », c’est peut-être, au préalable, maintenir dans un logement, quitte à ce que soit dans un autre. Le caractère crucial de ces questions invite à un questionnement collectif : jusqu’où doit aller l’action publique en la matière ? Quels sont les coûts comparés d’un maintien dans le logement sur fonds publics et d’un accueil en hébergement d’urgence après l’expulsion ?
La « refondation » de la politique de l’État en matière d’hébergement et d’accès au logement consiste en premier lieu, par l’édification d’un service public, en une réorganisation d’ampleur du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion géré par les opérateurs associatifs sous la direction de l’État ; et, en second lieu, à concevoir et procéder à cette réorganisation pour la mise en œuvre du « logement d’abord », c’est-à-dire l’accès, dès que possible, à un logement adapté ou de droit commun – notamment social – en faveur des personnes sans domicile. Si un certain scepticisme s’est parfois installé – en raison d’un bilan jugé faible, à ce stade, de cette refondation – nous souhaitons cependant que toutes ces réformes soient menées à leur terme. Car nous considérons que la refondation est une réforme positive et bien conçue.
Nous notons que la refondation a été menée dans un contexte administratif complexe. Sans attendre l’achèvement de la refondation, il nous semble logique et opportun de mettre à l’étude l’intégration des compétences de l’hébergement et du logement au sein d’une seule administration centrale, à l’instar de l’innovation prometteuse que constitue la création en Île-de-France de la direction régionale interdépartementale de l’hébergement et du logement (Drihl).
Eu égard au contexte de la réforme de l’administration territoriale, à laquelle ont notamment correspondu à la fois une baisse des effectifs de l’État local et un profond renouvellement des équipes administratives déconcentrées, nous estimons qu’il convient de conserver la nouvelle organisation territoriale de l’État ; ce qui ne constitue pas une approbation sans réserve de la façon dont sont désormais dissociées les compétences respectivement relatives à l’hébergement, au logement, ainsi qu’aux éléments portant sur les champs sanitaire et médico-social.
Au-delà, s’agissant des opérateurs quotidiens de cette politique, il nous apparaît nécessaire d’aborder le sujet de l’organisation du tissu associatif, qui fondera demain – comme aujourd’hui – le maillage des opérateurs de terrain dans les domaines de l’hébergement et de l’accès au logement des personnes sans domicile ou mal logées. L’engagement associatif est source d’innovations et s’appuie sur une motivation de l’action tournée vers les plus démunis. Il convient de conjuguer ces atouts avec les axes d’un service public définis à un niveau politique. Ces enjeux nous semblent appeler, sous une forme qui reste à imaginer, un dialogue dédié, public, et sans doute déconcentré, entre l’État et le monde associatif.
Nous considérons que beaucoup d’arguments militent pour ne pas procéder, à ce stade, à la décentralisation de la compétence de l’État en matière d’hébergement d’urgence et d’accès au logement des personnes sans domicile ou mal logées, bien que les conseils généraux exercent une compétence légale de droit commun en matière d’aide sociale. La question de la « domiciliation » des personnes sans domicile constituerait une difficulté juridique et technique pour la prise en charge de leur hébergement par une collectivité territoriale. Au-delà, la politique d’hébergement a en tout état de cause des dimensions nationales, telles que son lien avec la politique migratoire, ou la garantie d’une prise en charge inconditionnelle et équitable sur l’ensemble du territoire des personnes sans domicile. Pour le succès de la refondation, il importe néanmoins d’améliorer la coopération entre l’État et les collectivités territoriales, qui participent substantiellement à cette politique.
S’agissant des réformes qui composent la refondation, nous appelons l’État à continuer de privilégier la constitution d’un service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO – outil quotidien de régulation mettant en regard l’offre et la demande d’hébergement et de logement au bénéfice des personnes sans domicile) unique par département et regroupant tous les opérateurs départementaux concernés, là où il ne fonctionne pas encore. Nous appelons également à l’accélération de la mise en place des plans départementaux dit « accueil, hébergement, insertion » (PDAHI), au risque, le cas échéant, de révéler publiquement, dans les zones tendues, un manque de places d’hébergement ou en logements adaptés.
Les PDAHI constituent un préalable au conventionnement pluriannuel entre l’État et chaque opérateur associatif, qui doit permettre de concilier l’organisation d’un réel service public et le financement pluriannuel et donc lisible sur le moyen terme, des opérateurs associatifs. Outre le référentiel des prestations (déjà en vigueur), un autre préalable est l’élaboration du référentiel national des coûts des prestations servies par ceux-ci. Il faut désormais, dans des délais rapprochés, que les services de l’État disposent d’un outil fonctionnel en la matière, qui suscite la confiance des opérateurs associatifs.
Réussir la stratégie du « logement d’abord » – consistant, en faveur des personnes sans domicile, en l’accès, accompagné socialement et dès que possible, au logement de droit commun ou adapté – nécessite que des logements adaptés, sociaux ou en intermédiation locative soient rendus disponibles, à des prix accessibles.
Outre la reconquête des « contingents préfectoraux » d’attribution de logements sociaux, nous proposons que soit envisagée une modification de la loi dite « SRU », par le relèvement du taux de 20 % en zones tendues, ainsi que la bonification, pour le calcul de ce taux, des logements sociaux construits en prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI) et des places de pensions de famille.
Le « logement d’abord » doit en outre s’appuyer sur l’accompagnement social dans le logement ; à cette fin, nous sommes favorables à la création de « plateaux techniques » constitués de travailleurs sociaux des CHRS ayant vocation à procéder à l’accompagnement social – « hors les murs » du centre – des personnes logées au titre du « logement d’abord ».
Notre étude sur l’hébergement nous conduit enfin à estimer nécessaire un exercice de lucidité dans la sérénité, en ce qui concerne la situation des personnes sans papier et plus particulièrement des personnes en demande d’asile ou déboutées du droit d’asile. Nos travaux nous ont amenés à constater que des personnes étrangères en situation irrégulière, souvent déboutées du droit d’asile, sont hébergées durablement, notamment dans des hôtels quand il s’agit de familles avec des enfants, au titre de la politique publique objet de cette étude.
Ces parcours – nombreux, banalisés, accompagnés et financés sur fonds publics – reflètent-ils un « équilibre » au regard des débats qui traversent notre société quant aux principes et conditions de l’accueil des étrangers ? Nous souhaitons, sur la base d’une évaluation parlementaire préalable, qu’un débat public soit mené sereinement en la matière, ne serait-ce que pour apprécier, évaluer et constater quel est le « prix à payer » de cet « équilibre » respectivement pour les personnes concernées et pour l’État.
En conclusion, nous souhaitons replacer les questions évoquées dans cette synthèse, parfois techniques, dans leur contexte humain. L’enjeu de la refondation, orientée vers le « logement d’abord », est de porter une politique publique à la hauteur des besoins, sinon des projets des personnes sans domicile. La réinsertion des personnes sans domicile et, plus largement, très précarisées ne peut réussir que si la société est ouverte et considère que ces personnes n’en sont pas exclues, ne sont pas des « exclus ». Il s’agit d’une question à la fois culturelle et de priorité politique.
La discussion et l’adoption, dès le début de la prochaine législature, d’un projet de loi d’orientation et de programmation pluriannuelle pourraient contribuer non seulement à accélérer et amplifier la mise en œuvre de la refondation dans l’optique du « logement d’abord », mais aussi à mettre en place une série de dispositions et d’engagements traduisant concrètement une priorité collective nouvelle accordée au sort des personnes sans domicile et les plus précarisées.
Propositions
Les rapporteurs, conformément aux conclusions de leur évaluation, approuvent l’ensemble des recommandations proposées par la Cour des comptes dans son rapport. Ils souhaitent y ajouter les propositions ci-après, afin de contribuer à la mise en place d’un service public de l’hébergement et de l’accès au logement des personnes sans domicile ou mal logés, qui leur garantisse l’égalité de traitement, l’inconditionnalité de l’accueil et l’absence de rupture de la prise en charge.
1° Envisager la pérennisation de tout ou partie des places supplémentaires ouvertes chaque hiver, afin de contribuer à l’ouverture de places nouvelles d’hébergement dans les zones les plus tendues.
2° Prévoir la modification des obligations qui s’imposent aux communes par la loi SRU, en augmentant le taux de logements sociaux à atteindre dans les zones les plus tendues ; sous réserve que soient bonifiées dans le calcul de ce taux les constructions en PLAI, ainsi que les places de maisons relais et en pensions de famille.
3° Mobiliser l’expertise, le savoir-faire et les moyens des bailleurs sociaux pour la construction de places nouvelles en hébergement d’urgence et d’insertion.
4° Orienter résolument – le cas échéant en leur attribuant une feuille de route définie par la loi – l’activité des Ccapex vers l’étude des dossiers individuels d’impayés de loyer, notamment les plus complexes et les plus susceptibles de conduire à la mise à la rue des ménages concernés.
5° Lancer une étude sur l’effectivité du bénéfice par les personnes hébergées de certains dispositifs spécifiques d’aide sociale ou de prise en charge médicale auxquels elles ont droit ; et sur les raisons pour lesquelles le bénéfice de ces dispositifs n’empêche pas, dans certains cas, le recours à un hébergement d’urgence.
6° Faire en sorte qu’à court terme une seule direction d’administration centrale soit chargée de la conception et de la mise en œuvre de la politique d’hébergement et d’accès au logement des personnes sans domicile ou mal logées.
7° Faciliter et organiser l’échange d’informations utiles – entre les départements et les opérateurs associatifs chargés de l’hébergement d’urgence, via notamment les SIAO et pour autant que les jeunes concernés y consentent – concernant les jeunes majeurs pris en charge par ces opérateurs et relevant antérieurement, durant leur minorité, de l’aide sociale à l’enfance (Ase).
8° Inciter à la constitution dans des délais rapides, dans chaque département, d’un SIAO unique (urgence et insertion) par coopération des opérateurs départementaux et non pas seulement par délégation à l’un d’entre eux de la gestion de la veille sociale.
9° Mettre en place des lieux de dialogue et d’échange rassemblant, aux niveaux national et déconcentré, les opérateurs associatifs et l’État, afin d’envisager les meilleures modalités d’organisation et de mise en œuvre du service public de l’hébergement et de l’accès au logement des personnes sans domicile ou mal logées.
10° Procéder à la création de « plateaux techniques » constitués notamment de travailleurs sociaux des actuels centres d’hébergement afin de mettre en œuvre l’accompagnement social dans le logement des personnes bénéficiaires de la stratégie du « logement d’abord ».
11° Relancer la mise en place – prévue par la refondation – des « référents personnels », en prévoyant que ceux-ci puissent être des volontaires au titre du service civique.
12° Envisager la création d’un produit d’épargne réglementé – ou aménager à cet effet un produit d’épargne réglementé existant – dont les dépôts seraient consacrés au moins partiellement aux investissements, portant notamment sur des expérimentations, des associations et bailleurs sociaux œuvrant dans le secteur de la prise en charge des personnes les plus démunies.
13° Soumettre au Parlement dès le début de la prochaine législature un projet de loi d’orientation et de programmation pluriannuelle tendant a) à accélérer et amplifier la mise en œuvre de la refondation dans l’optique du « logement d’abord » – notamment en programmant la construction de places nouvelles en pensions de famille et en centre d’accueil des demandeurs d’asile – et b) à adopter une série de dispositions et d’engagements traduisant une priorité collective accordée au sort des personnes sans domicile et les plus précarisées ; ce texte serait défendu par un ministre de plein exercice, le cas échéant directement rattaché au Premier ministre. Compte tenu de la complexité du sujet de l’hébergement, on pourrait aussi imaginer un nouveau mode de management gouvernemental par projet. C’est-à-dire qu’un ministre pourrait recevoir des compétences transversales au titre d’un projet.
14° Organiser des états généraux – suite à une évaluation parlementaire transpartisane – sur la réalité des conditions d’accueil et de vie sur notre territoire des personnes étrangères en demande d’asile ou en situation irrégulière, et sur les coûts publics associés notamment pour l’État et les collectivités territoriales.
TERRITOIRES RURAUX, TERRITOIRES D’AVENIR
Rapport d’information n° 4301, présenté le 2 février 2012
par MM. Jérôme Bignon et Germinal Peiro, rapporteurs
Synthèse
Dans un monde de plus en plus urbanisé, les territoires ruraux constituent une richesse essentielle de notre pays : foncier, patrimoine, culture, mais aussi savoir-faire et intelligences locales. L’image du monde rural change avec un regain démographique qui ne se démentit pas depuis les années quatre-vingt-dix et avec la montée en puissance des valeurs environnementales. De nouvelles populations rurales sont issues d’un transfert en provenance des villes. La sociologie du milieu rural s’en trouve profondément affectée.
Au-delà des divergences politiques, les deux rapporteurs partagent la même passion du rural, du territoire, l’un et l’autre étant élus locaux depuis une trentaine d’années. Ils marquent tous deux le même attachement aux hommes, aux traditions, à l’identité rurale : terroirs, pays, langues. L’utilité et la nécessité d’une politique d’aménagement du territoire ne sont pas remises en cause en France. L’État joue ainsi son rôle de gardien de l’égalité républicaine sur l’ensemble du territoire national, de l’équilibre du développement en ses différents endroits et de péréquation financière.
Force est de constater le sentiment largement répandu d’abandon du monde rural par l’État : réorganisation des services publics et au public, raréfaction de l’offre de soins, enclavement des territoires, retard dans l’équipement en communications électroniques, inquiétudes sur l’avenir de la politique agricole commune (PAC), désindustrialisation, logements insalubres ou inadaptés… Le présent rapport tente de dresser un état des lieux et avance des recommandations.
Tout au long de ces douze mois de travail, les rapporteurs ont successivement : effectué un bilan critique des évaluations antérieures ; recensé les objectifs de cette politique publique ; envoyé un questionnaire aux dix ministères concernés sur les dispositifs publics qu’ils mettent en œuvre ; procédé à treize auditions sous forme de tables rondes à Paris ; et visité quatre territoires ruraux choisis en raison de leur profil et de leurs spécificités contrastées. Deux études ont été confiées à des consultants extérieurs, le consortium Kurt Salmon – Edater, après une procédure d’appel d’offre.
L’évaluation réalisée concerne tous les dispositifs de l’État en matière d’aménagement du territoire en milieu rural : services publics et au public, services sociaux et de santé, soutien aux activités économiques (agriculture, industrie, services), transports, communications électroniques et logement. Ces politiques nécessitent une action coordonnée de plusieurs ministères. La Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale (Datar), placée sous l’autorité du Premier ministre, est chargée d’assurer cette coordination interministérielle, notamment en assurant le secrétariat du Comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire et d’attractivité régionale (CIADT).
Les rapporteurs s’interrogent sur la raison qui a conduit à confier l’aménagement du territoire au ministre de l’Agriculture, de l’alimentation, de la pêche et de la ruralité, M. Bruno Lemaire, alors qu’en 2009 et 2010 il était confié à un ministre de l’Espace rural et de l’aménagement du territoire, M. Michel Mercier. Ils souhaitent que l’aménagement du territoire soit à nouveau confié à un ministère de plein exercice directement rattaché au Premier ministre. Il s’agit ainsi d’assurer le caractère réellement interministériel de l’aménagement du territoire, sa dilution dans le domaine de compétence de tel ou tel ministère ne pouvant au contraire que l’affaiblir. Le rapport recommande la création d’un mécanisme de suivi avec tableau de bord permettant une mesure et une évaluation des effets des dispositifs de l’État en matière d’aménagement du territoire en milieu rural.
Les deux structures territoriales les plus actives en milieu rural sont en profonde évolution : intercommunalités et pays. L’étude des consultants conclut qu’il n’y a pas de taille idéale pour un territoire de projet, ni en surface, ni en population. Elle montre la nécessité de définir des territoires de projet souples et adaptés aux contextes locaux. La réforme de la carte intercommunale traduit une montée en puissance des regroupements de communes, avec l’élaboration de schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI). Le délai imparti à la réforme, un temps calé sur le calendrier électoral, était trop court. Il convient d’appuyer le développement préalable d’une identité et d’une culture communes de la population et des acteurs locaux. Le rôle des pays, qui ne disparaissent pas mais dont le statut législatif a été supprimé, reste à clarifier. L’étude des consultants montre l’apport des pays au niveau du rapprochement et de la mobilisation des acteurs locaux. Les intercommunalités en cours de regroupement, appelées à prendre le relais, sont perçues par les élus locaux comme des structures administratives de gestion ; ce transfert ne semble possible qu’à la condition d’une évolution culturelle significative.
La décision prise en avril 2008 dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP) de renoncer à la mission d’ingénierie publique de l’État en direction des collectivités territoriales a été souvent perçue par les élus locaux comme un abandon par l’État. Les collectivités ont perdu les repères qu’elles avaient avec les anciennes directions départementales et régionales. Le rapport montre l’importance de l’ingénierie publique pour la définition d’une stratégie de territoire, avec en particulier la réponse aux procédures d’appels à projet et l’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale (Scot).
Les dernières années ont vu une profonde réforme des administrations territoriales de l’État : réforme de l’administration territoriale de l’État (RéATE), réforme de la carte judiciaire, fusion des réseaux du Trésor et de la comptabilité publique, avec une réduction des effectifs selon la règle du non remplacement d’un fonctionnaire partant à la retraite sur deux. Le ressenti immédiat de nombre d’élus, comme de nos concitoyens, est celui d’un recul du service public. Pourtant personne ne nie la nécessité d’une modernisation de nos administrations, qui doivent s’adapter aux mutations de notre société, dans le contexte tendu des finances publiques. D’ores et déjà la RéATE a entraîné une meilleure coordination interministérielle dans les nouvelles directions départementales et régionales. Les rapporteurs estiment qu’il faut définir une masse critique de services de l’État présents sur tous les territoires, constituée autour des grandes fonctions comme la sécurité, l’éducation et la justice.
Dans l’éducation, la crainte est réelle concernant les fermetures de classes et d’écoles, avec les regroupements pédagogiques. Les regroupements de brigades dans la gendarmerie sont mieux acceptés. Dans le contexte de réduction des effectifs, les gendarmes se recentrent sur leur cœur de métier. La réforme de la carte judiciaire a donné le sentiment général d’avoir été menée sans concertation préalable suffisante avec les élus locaux, contrairement à ce qu’affirme le ministère de la Justice. Certains ruraux renoncent à recourir à la justice, y compris en matière pénale, car le tribunal est devenu trop lointain. Le ministère de la Justice met en place des solutions alternatives de proximité (maisons de la justice et du droit, points d’accès au droit, audiences foraines…) ou dématérialisées.
La création de la direction générale des finances publiques (DGFiP) a permis de regrouper les réseaux de la direction générale de la comptabilité publique (DGCP) et de la direction générale des impôts (DGI). Le ministère du Budget estime qu’il n’y a pas eu de programmation de fermeture des petites trésoreries, mais plutôt un étiolement dû au défaut d’attractivité auprès des agents. Il reste que depuis 2004 les fermetures ont été très nombreuses et qu’elles peuvent poser des problèmes d’accessibilité dans certaines zones rurales. Le ministère indique que la réforme s’est effectuée à missions constantes pour les collectivités locales, mais certains élus craignent une diminution de l’ingénierie financière qui leur est ainsi fournie.
Tout en faisant évoluer son réseau vers de nouvelles formes, La Poste conserve 17 000 points de contacts sur l’ensemble du territoire. La fusion de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) et des associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic) est généralement bien acceptée. Sur le terrain, l’action de Pôle emploi est cependant sous tension en raison de la montée du chômage.
Face aux problèmes croissants de démographie médicale, la question de l’accès aux soins apparaît comme la première attente des habitants des territoires ruraux. Pour enrailler le mouvement de désertification médicale, différents types d’aides financières ou dispositifs incitatifs ont été mis en place et le numerus clausus a été augmenté. La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (dite « HPST ») comporte plusieurs dispositions visant à corriger les déséquilibres territoriaux dans la répartition des professionnels de santé, au premier rang desquels la création des Agences régionales de santé (ARS). Les rapporteurs ont fait le constat que l’exercice de la médecine de façon isolée n’était plus adapté aux conditions prévalant dans les territoires ruraux. L’exercice pluridisciplinaire et regroupé des professionnels de santé doit être recherché. Il existe un continuum entre santé et social : face au coût et aux inconvénients du placement en maison spécialisée, il convient de favoriser le maintien à domicile, notamment des personnes âgées.
La préservation et le développement d’une base économique équilibrée constituent une condition nécessaire au maintien de l’emploi, et donc à une évolution démographique favorable dans les territoires ruraux. Les territoires ruraux disposent d’un potentiel économique diversifié très important. Il faut considérer les zones rurales dans le débat actuel visant à favoriser la relocalisation de la production et la réindustrialisation. Les dispositifs publics sont nombreux : zones de revitalisation rurale (ZRR), pôles d’excellence rurale (PER), grappes d’entreprises, prime à l’aménagement du territoire (Pat), Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (Fisac)… Or les dispositifs d’exonération de charges sociales et fiscales dans les ZRR ne sont ni mesurés ni évalués. Le rapport recommande de définir dans chaque territoire une stratégie de développement économique reposant sur un diagnostic partagé entre les directions régionales des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) et les collectivités territoriales, en partenariat avec les milieux économiques eux-mêmes.
Comment faire pour que les retours en France de 10 milliards d’euros au titre de la politique agricole commune (Pac) bénéficient mieux aux exploitations et à l’emploi agricoles ? Les solutions passent notamment par le développement de filières à valeur ajoutée, de circuits courts et d’une meilleure rémunération des services environnementaux rendus par les agriculteurs. Le rapport recommande en outre une action forte pour la préservation du foncier, pour lutter contre l’artificialisation des terres.
Les espaces ruraux français disposent d’un potentiel touristique très riche. Le constat généralement établi montre que 80 % de la population fréquente de façon touristique 20 % seulement du territoire (littoral, montagne, stations touristiques classées…), alors que 70 % du territoire national est rural. Il s’en suit une saturation des zones touristiques, avec des conséquences négatives en termes de développement durable, et une paupérisation des territoires ruraux environnants. Il s’agit donc de mieux organiser et renforcer les capillarités entre les zones touristiques et leur arrière-pays rural, dans un contexte où tout le monde est gagnant : désengorgement des stations et développement des zones rurales.
Dans le monde rural, les communications électroniques sont devenues des services de première nécessité. La localisation d’activités économiques ou l’établissement de résidences de particuliers en dépend souvent. La couverture du territoire en téléphonie mobile de 2e génération reste encore à achever. L’Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste (Arcep) demande que les opérateurs couvrent en téléphonie mobile de 4e génération simultanément les zones denses, où ils ont tendance à aller en priorité, et les zones rurales. La France est le pays au monde où l’accès à l’Internet haut débit a été le plus précoce, le plus généralisé et au moindre coût pour l’usager. Le passage à l’Internet très haut débit s’avère plus complexe. Les opérateurs commenceront sans doute par câbler les territoires les plus denses, là où le retour sur investissement sera le plus rapide. Une action coordonnée des opérateurs privés, des collectivités territoriales et de l’État sera nécessaire. L’objectif de couvrir la France entière en 2025 représente un investissement global estimé à 23,5 milliards d’euros. Les 2 premiers milliards du fonds constitué à cet effet devront être complétés. Le sénateur Hervé Maurey propose un financement au travers d’une contribution sur les abonnements d’accès Internet fixe et téléphonie mobile et d’une taxe sur les produits électroniques grand public (téléviseurs et consoles de jeux).
Le maintien d’une desserte de transports de qualité représente un enjeu prioritaire pour les territoires ruraux, compte tenu de ses répercussions multiples sur l’attractivité et le dynamisme résidentiel et économique de ces territoires. L’enjeu porte sur les liaisons ferroviaires, sur l’amélioration de certaines liaisons routières ou autoroutières et sur les liaisons aériennes internes. Il s’agit de désenclaver les territoires qui le sont encore. En outre les habitants des territoires ruraux ont de plus en plus besoin d’une offre de transport multimodale adaptée à la fois à l’évolution des modes de vie et aux spécificités des zones rurales, qui combine transports individuels et transports collectifs. Le maintien et l’entretien des trains d’équilibre du territoire (TET) et des trains express régionaux (TER) ne doivent pas être délaissés au profit du développement des seules lignes à grande vitesse (LGV). L’effort de solidarité effectué par l’État pour le financement des lignes aériennes d’aménagement du territoire (LAT) doit être maintenu. Le schéma national des infrastructures de transport (Snit), en cours d’élaboration, constitue un effort de planification pluriannuelle des investissements publics en matière de transports.
Le parc de logements en milieu rural est plus vétuste, largement individuel et plus inconfortable qu’en milieu urbain. Il nécessite des travaux qui peuvent parfois se révéler incompatibles avec le niveau de revenus souvent faible des habitants des territoires ruraux, ce qui peut entraîner une difficulté pour les propriétaires occupants à se maintenir à domicile. La première caractéristique des logements ruraux est la prédominance des propriétaires occupants (70 % des ménages en zone rurale). On constate un déficit de logements sociaux locatifs en milieu rural : 7 % seulement des logements sont des logements HLM, contre 20 % en milieu urbain. Les rapporteurs confortent la réorientation de l’action de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) vers la lutte contre le logement insalubre et la précarité énergétique et l’adaptation des logements à la dépendance. Ils soutiennent également les efforts de l’Agence en faveur d’un meilleur repérage des situations les plus difficiles. Enfin, il convient d’insister sur la nécessaire cohérence entre la localisation des nouvelles zones résidentielles et les modalités de transports et l’offre de services correspondantes.
Recommandation n° 1 sur l’aménagement du territoire :
– Maintenir une politique d’aménagement du territoire ambitieuse, qui fasse partie intégrante du pacte républicain.
– Soutenir le développement équilibré des villes et des campagnes, dans un contexte où les zones rurales sont non pas en déclin mais en mutation, en situation de regain démographique et riches de leur patrimoine naturel, historique et culturel, ainsi que de leur capacité d’innovation.
Recommandation n° 2 sur la coordination interministérielle :
– Améliorer la coordination interministérielle des politiques d’aménagement du territoire en milieu rural ; rattacher l’aménagement du territoire à un ministre de plein exercice dépendant directement du Premier ministre, pour s’assurer que les politiques de développement rural couvrent tous les secteurs économiques ; renforcer le rôle de la Datar ; restructurer le document de politique transversale « Aménagement du territoire » pour bâtir de nouveaux indicateurs synthétiques, renforcer son intérêt stratégique et constituer ainsi un outil de pilotage de cette politique.
– Pallier l’insuffisance des données financières sur les dispositifs d’État affectés aux territoires ruraux ; créer un dispositif de suivi avec tableau de bord permettant une mesure et une évaluation des effets de ces dispositifs.
– Organiser une concertation régulière des principaux intervenants sur le monde rural, par exemple en réunissant annuellement la Conférence de la ruralité.
– Concevoir l’attractivité des territoires ruraux de manière transverse en intégrant toutes ses dimensions (activités économiques, services publics et au public, offre de santé et de services sociaux, infrastructures de transports et de communications électroniques, logement…).
Recommandation n° 3 sur les fonds européens :
– Veiller, dans la prochaine programmation budgétaire européenne 2013-2020, à ce que les actions financées par le Feader bénéficient, au-delà des activités agricoles, à l’ensemble du monde rural.
– Mieux intégrer dans cette nouvelle programmation les orientations stratégiques françaises relatives au Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), au Fonds européen pour la pêche (Fep) et aux fonds structurels (Fonds européen de développement régional - Feder, et Fonds social européen - FSE).
Recommandation n° 4 sur les pays :
– Clarifier l’avenir des pays, après la suppression de leur fondement législatif dans la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, afin d’éviter de porter un coup d’arrêt brutal aux dynamiques créées par les pays, dans un contexte où les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ne sont pas encore structurés pour l’animation de projet et la participation de la société civile.
Recommandation n° 5 sur les intercommunalités :
– Réaffirmer la nécessité d’une réforme de l’intercommunalité, mais dans le respect de la concertation, de la volonté de « vivre ensemble » des collectivités ; souligner que ces regroupements doivent résulter d’un rapprochement progressif et s’ancrer dans la durée pour créer une dynamique.
– Favoriser la constitution de territoires porteurs d’une « identité propre » partagée, avec l’émergence d’un sentiment d’adhésion et d’appartenance fondé sur des données historiques, géographiques, culturelles, sociales ou économiques.
– Souligner la nécessité de l’implication des « parties prenantes » par l’équivalent d’un conseil de développement, dont la pérennité serait assurée au-delà des renouvellements de personnes.
– Souhaiter l’émergence de « territoires de projet » organisés de façon souple à l’échelle de bassins de vie, sans référence à une « taille critique » définie de manière normée, mais avec une dimension déterminée de façon ad hoc selon des modalités d’organisation adaptées à la diversité des situations locales et des thématiques d’intervention.
– Insister sur la nécessité d’un portage politique des nouvelles entités, avec une stratégie de développement pertinente de long terme et tissant les liens porteurs d’une « vision partagée » pour le territoire.
– Encourager la coopération entre territoires, complémentaire des fusions en cours, avec des mises en réseau, même sur des territoires non contigus, par exemple sur des filières économiques, et avec une mise en commun de l’ingénierie publique locale.
Recommandation n° 6 sur les structures supérieures de gouvernance locale :
– Reconnaître le rôle des structures supérieures de gouvernance locale (départements, régions, massifs et parcs naturels) pour assurer une plus grande solidarité financière, pour planifier et pour apporter un appui en termes de ressources humaines en ingénierie publique.
Recommandation n° 7 sur les schémas de cohérence territoriale (Scot) :
– Généraliser rapidement l’élaboration de Scot, porteurs d’une stratégie territoriale globale de développement (urbanisme, mobilité, logement, « agenda 21 »).
– Articuler leur périmètre avec les territoires de projet présents sur la même zone géographique.
– Inciter les communes à transférer aux intercommunalités les pouvoirs de décision en matière d’urbanisme et à se doter de documents d’urbanisme.
Recommandation n° 8 sur l’ingénierie publique locale :
– Réorienter les ressources des communes et de leurs groupements vers l’ingénierie publique locale (ressources humaines et compétences), en raison de l’importance du facteur humain dans le développement des territoires.
– Mettre en commun ces ressources à l’échelle du territoire ou par une coopération entre plusieurs territoires en fonction de leurs tailles.
Recommandation n° 9 sur les liens entre villes et campagnes :
– Concevoir l’aménagement du territoire de façon globale en prenant en compte les liens entre villes et campagnes, dans une logique accentuée de complémentarité et de continuité ; souligner à cet égard l’importance des villes petites et moyennes pour le développement des campagnes environnantes.
– Éviter une concentration excessive de l’action publique, des activités économiques et des constructions de logements dans les grandes métropoles.
Recommandation n° 10 sur les modalités de mise en œuvre de la politique d’aménagement du territoire en milieu rural :
– Assurer une complémentarité entre les dispositifs prioritaires (zonages) et les procédures sélectives (appels à projet).
– Maintenir au-delà de 2013 le zonage des aides à finalité régionale (AFR).
– Assurer une révision régulière des zonages (zones de revitalisation rurales – ZRR et zones d’aides à finalité régionales – AFR).
Recommandation n° 11 sur l’information relative aux dispositifs publics et leur simplification :
– Renforcer l’information et la communication sur les dispositifs de l’État, avec une animation par les préfectures, par exemple par une mise en réseau des développeurs économiques des collectivités territoriales par les unités territoriales des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).
– Simplifier les procédures d’accès aux dispositifs publics, souvent complexes et empilés, notamment dans les domaines où coexistent des dispositifs de droit commun et des dispositifs spécifiques aux territoires ruraux.
Recommandation n° 12 sur la maîtrise du foncier :
– Assurer la maîtrise du foncier, contre le « mitage » et l’artificialisation des terres, afin de préserver les paysages du milieu naturel, les terres agricoles et le patrimoine historique et culturel.
– Évaluer avant la fin de l’année 2013 l’efficacité des dispositions de la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche (« LMAP ») relatives à la protection du foncier agricole.
Recommandation n° 13 sur les services publics et au public :
– Maintenir un socle de services publics sur l’ensemble du territoire ; respecter la charte des services publics en milieu rural de 2006 pour la concertation et la consultation des élus avant toute décision de modification d’implantation ; favoriser les regroupements d’offre de services publics et au public.
– Réaffirmer le rôle de la Datar dans l’évaluation des conséquences de la réforme de l’administration territoriale de l’État (RéATE) sur l’aménagement du territoire, en particulier l’accessibilité aux services publics (temps d’accès, distance géographique, regroupement des points d’accès et accès à distance…) ; prendre en compte une vision territoriale des restructurations administratives basée sur un diagnostic local, pour éviter un empilement de logiques sectorielles.
– Assurer le respect de la directive nationale d’orientation (DNO) du ministère de l’Intérieur prévoyant de mettre les sous-préfectures au service des collectivités, pour compenser l’abandon de l’ingénierie publique concurrentielle décidée dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP) ; maintenir une coordination interministérielle de proximité au niveau des sous-préfets.
– Veiller à procéder à une profonde mutation professionnelle des personnels des services déconcentrés de l’État pour accomplir les nouvelles tâches qui leur sont dévolues dans le cadre de la réforme ; maintenir l’assistance technique de l’État pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire (Atesat) pour les intercommunalités à taille réduite.
– Faire un effort de lisibilité et de visibilité des nouvelles directions départementales et régionales interministérielles, à destination des collectivités territoriales, des acteurs économiques et sociaux et des citoyens.
Recommandation n° 14 sur l’offre de soins et de services sociaux :
– Assurer les conditions d’une offre de santé équilibrée sur l’ensemble du territoire (hôpitaux, médecins et professions paramédicales), dans le contexte d’une évolution démographique défavorable des praticiens dans les zones rurales ; considérer que les agences régionales de santé (ARS), chargées de l’organisation de l’offre de soins en fonction des besoins de la population, ont une responsabilité particulière en la matière et doivent en rendre compte au Parlement.
– Favoriser la mise en réseau de tous les acteurs de santé sur chaque territoire ; prévoir pour ce faire une animation par un ou des élus permettant d’intégrer un volet santé dans chaque projet de territoire, en utilisant tous les outils disponibles ; soutenir les actions favorisant l’exercice regroupé des professionnels de santé, par exemple les maisons de santé pluriprofessionnelles, afin notamment de répondre à l’isolement des médecins de campagne.
– Établir dans les projets de santé de territoire un lien nécessaire avec les services médico-sociaux ou sociaux (structures d’accueil de personnes âgées médicalisées ou non, services aidant au maintien à domicile et autres services à la personne…).
- Conclure des contrats locaux de santé (CLS) dans l’ensemble du territoire national avant la fin de l’année 2015.
Recommandation n° 15 sur l’attractivité économique et l’emploi :
– Définir dans chaque territoire une stratégie de développement économique reposant sur un diagnostic partagé entre les directions régionales des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), les régions, les départements et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), en partenariat avec les milieux économiques eux-mêmes.
– Porter un effort particulier au maintien et au développement en milieu rural des filières artisanales et industrielles, traditionnelles ou nouvelles.
– Développer et rendre plus visibles les labels d’origine française ou régionale pour les produits industriels.
– Développer le secteur des services à la personne dans le cadre d’une « économie résidentielle » reposant sur le regain démographique des zones rurales.
Recommandation n° 16 sur l’agriculture :
– Renforcer et réorienter la contribution de l’agriculture vers le développement des territoires ruraux ; favoriser la réappropriation par les agriculteurs de leur responsabilité historique de promoteurs et gestionnaires de l’identité rurale ; maintenir et développer, à côté d’une agriculture industrialisée compétitive correspondant à la vocation exportatrice de la France, des filières territorialisées avec des productions de qualité, des niches à valeur ajoutée, des circuits courts et des activités de transformation sur place.
– Maintenir après 2013 une politique agricole commune (PAC) forte en soutenant et réorientant sa contribution vers le développement des territoires ruraux.
– Mieux rémunérer les services environnementaux rendus par les agriculteurs.
Recommandation n° 17 sur le tourisme rural :
– Favoriser le développement de toutes les formes de tourisme rural (pédestre, équestre, cycliste, nautique, œnologique, gastronomique, à la ferme, gîtes ruraux…) en soulignant l’importance du tourisme rural pour limiter l’engorgement des stations touristiques sur le littoral, dans les zones de montagne et dans les sites remarquables.
– Développer la visibilité et la lisibilité de l’offre française de tourisme rural, par une mise en réseau des acteurs et une politique de labels adaptée ; atteindre une taille critique permettant, dans chaque territoire, de mettre en commun les équipements et les moyens et de définir une stratégie touristique attractive, avec l’appui d’Atout France et des autres partenaires associatifs ou privés.
Recommandation n° 18 sur les communications électroniques :
– S’assurer tout au long des processus de déploiement de la téléphonie mobile (jusqu’à la quatrième génération) et de l’internet haut et très haut débit (fibre optique) d’un équilibre entre zones denses et peu denses sur l’ensemble du territoire national.
– Prévoir le financement du déploiement de la fibre optique pour l’ensemble de la population française, par exemple au moyen des contributions proposées par le sénateur Hervé Maurey.
– Utiliser les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) pour favoriser dans les zones rurales le développement du télétravail, de la télémédecine ou des différentes formes d’enseignement à distance.
Recommandation n° 19 sur les transports :
– Développer les infrastructures de transport et des services de transports en commun (ferroviaire, aérien et routier) pour la desserte des territoires ruraux ; assurer dans le schéma national des infrastructures de transport (Snit) en cours d’élaboration un développement équilibré des transports dans les territoires urbains et ruraux, notamment pour les plus enclavés d’entre eux.
– Assurer une meilleure coordination des différentes autorités organisatrices de transports (AOT) que sont les régions, les départements et les communes et leurs regroupements, afin de disposer sur les territoires d’une offre de transport cohérente.
– Favoriser le développement des transports innovants sous toutes leurs formes (transport à la demande, intermodalité, covoiturage…).
Recommandation n° 20 sur le logement :
– Réorienter la politique de rénovation de l’habitat vers la lutte contre le logement insalubre et la précarité énergétique et vers l’adaptation des logements à la dépendance ; intensifier en la matière les efforts de repérage entrepris par tous les acteurs pouvant y contribuer (travailleurs sociaux, professionnels de santé, aides ménagères…).
– Développer le logement social locatif en zone rurale, trop souvent délaissé au profit des grandes agglomérations.
– Assurer la cohérence des différentes planifications des sols (urbanisme, transports, services publics…), notamment les schémas de cohérence territoriale (Scot), lors du choix d’implantation des nouvelles zones résidentielles.
– Introduire un élément de souplesse dans les politiques de l’État en matière de logement, par trop standardisées, en particulier dans la délimitation des zonages.
LES LEÇONS DE LA STRATÉGIE DE LISBONNE :
ACCÉLÉRER L’EFFORT EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET ASSOCIER DAVANTAGE LES CITOYENS EUROPÉENS ET
LES PARLEMENTS NATIONAUX AUX DÉCISIONS
Rapport d’information n° 4364, présenté le 16 février 2012
par MM. Philippe Cochet et Marc Dolez, rapporteurs
Synthèse
Les 23 et 24 mars 2000 s’est tenue une réunion extraordinaire du Conseil européen à Lisbonne (Portugal), « afin de définir pour l’Union un nouvel objectif stratégique dans le but de renforcer l’emploi, la réforme économique et la cohésion sociale dans le cadre d’une économie fondée sur la connaissance ». Ces objectifs, par la suite précisés et complétés, sont devenus la Stratégie de Lisbonne, à laquelle a succédé en 2010 le programme Europe 2020.
Par un courrier adressé à M. Bernard Accoyer, Président de l’Assemblée nationale et à ce titre Président du CEC, le Président du groupe « Gauche démocrate et républicaine » (GDR) a demandé à ce que le CEC inscrive à son programme de travail pour la session 2011-2012 « un rapport d’évaluation sur la Stratégie de Lisbonne ».
Le CEC a décidé d’inscrire à son agenda « l’évaluation des incidences de la Stratégie de Lisbonne sur l’économie française ». Ce sujet correspond donc à la première demande formulée par le groupe GDR au titre de l’article 146-3 du Règlement, qui aménage un « droit de tirage » par session ordinaire au bénéfice de chaque groupe parlementaire.
Les rapporteurs ont été désignés en juin 2011 ; en raison du calendrier institutionnel particulier de l’année 2012, les travaux des rapporteurs se sont déroulés dans un délai réduit, du mois de septembre 2011 au mois de février 2012.
Au fil des auditions réalisées et grâce à un déplacement à Bruxelles, les rapporteurs se sont efforcés de travailler sur toutes les dimensions de cet agenda, objet politique singulier. Ils se sont interrogés sur tous ses aspects, qu’il s’agisse de sa justification économique et politique, de son efficacité finale, de sa gouvernance ou de son appropriation nationale.
*
* *
Le rapport rappelle tout d’abord les objectifs de cet agenda européen pluriannuel. Ces objectifs, certes formulés de manière très générale, ont suscité un certain consensus en Europe. Cet agenda pluriannuel visait en effet à jeter les bases d’une croissance reposant sur les piliers suivants :
– l’Union européenne devait devenir une économie de la connaissance, notamment en dépensant 3 % de son produit intérieur brut en dépenses de recherche et développement ;
– elle devait connaître une forte croissance économique (l’Union devait devenir l’économie « la plus compétitive et la plus dynamique du monde ») ; ainsi, son produit intérieur brut devait croître de 3 % en moyenne sur la décennie 2000-2010 ;
– cette croissance devait présenter un caractère « durable » ;
– elle devait être dotée d’un volet social relatif à l’emploi et la cohésion sociale en visant une « amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale ».
Les travaux des rapporteurs ont par la suite consisté à décrire les grandes étapes de la mise en œuvre de cet agenda pluriannuel, marquée, après une certaine phase caractérisée par la profusion d’objectifs et d’indicateurs, par le recentrage intervenu en 2005 sur les problématiques de croissance et d’emploi. L’année 2005 a également conduit à une importante réforme de la gouvernance du dispositif, conduisant les États membres à transmettre des programmes nationaux de réforme (PNR) aux institutions européennes.
Les rapporteurs ont ensuite cherché à identifier et analyser l’impact de la Stratégie de Lisbonne sur l’économie française.
Rapportés aux objectifs initiaux, les indicateurs de la Stratégie rendent compte d’une application plutôt décevante, notamment sur les trois points fondamentaux de la croissance économique, du taux d’emploi global et de l’intensité en recherche et développement. Ainsi, en 2010, si le taux d’emploi féminin atteint en France la cible fixée, le taux de dépenses de recherche et développement n’atteint que 2,26 % du PIB, loin de la cible de 3 % initialement fixée.
La Stratégie de Lisbonne a pu exercer une influence indirecte sur le contenu des politiques publiques, notamment en soulignant le caractère nécessaire d’une transition vers « l’économie de la connaissance » et en mettant en avant le concept, pourtant très ambigu, des « réformes structurelles ». La mesure de cette influence sur les politiques publiques nationales, assez diffuse, reste délicate à apprécier avec précision.
Les rapporteurs se sont ensuite attachés à identifier les causes des résultats décevants de la Stratégie de Lisbonne. Si les conséquences négatives de la crise économique et financière née en 2008 n’ont pas contribué à faciliter la mise en œuvre de cette stratégie, les facteurs ayant abouti à l’insuccès de la Stratégie sont multiples.
Ils sont notamment liés à une gouvernance insuffisante, manquant à la fois d’incitations et de sanctions et qui a échoué à susciter une authentique coopération politique. Alors que l’élargissement de l’Union européenne a accru l’hétérogénéité politique, économique et sociale de l’Union européenne, cette gouvernance n’a pas empêché les comportements de concurrence entre États membres, au détriment du bien-être de tous les citoyens européens.
L’implication propre des institutions européennes, de plus, s’est révélée insuffisante dans l’application de la Stratégie de Lisbonne. En particulier, la « lisbonnisation » des fonds structurels a été trop tardive.
Surtout, l’articulation insuffisante des politiques à caractère microéconomique inspirées par la Stratégie avec les conséquences de l’application du mécanisme du Pacte de stabilité et de croissance n’a pas permis d’aboutir à une croissance économique dynamique en Europe.
Enfin, cet agenda n’a pas fait l’objet d’une appropriation nationale suffisante, à la fois par les administrations et par les citoyens européens. La Stratégie de Lisbonne, pourtant présentée comme un agenda de croissance pour tous, est toujours restée étrangère aux peuples européens.
*
* *
Les recommandations des rapporteurs sont organisées autour de deux axes principaux concernant le fond et la forme de ces agendas pluriannuels européens :
– le premier axe de propositions concerne le contenu d’Europe 2020, qui a succédé en 2010 à la Stratégie de Lisbonne, et son financement : il s’agit de proposer de revenir à l’esprit originel de la Stratégie de Lisbonne, en engageant un effort sans précédent en matière de recherche, d’innovation et d’éducation, grâce à un financement nouveau, le produit, total ou partiel, d’une taxe sur les transactions financières ;
– le second axe de propositions s’appuie sur le constat d’une insuffisante appropriation nationale et concerne donc les moyens à engager afin de l’améliorer : seule l’intervention des parlements nationaux, émanation du peuple souverain, pourra garantir son caractère authentiquement démocratique et mieux associer les citoyens aux décisions européennes qui les concernent
1 () Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.
2 () Loi du 14 juin 1996.
3 () Cette mission, initialement prévue par l’article 38 de la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, traduit maintenant la mise en œuvre des articles L.O. 111-9, L.O. 111-9-1, L.O. 111-9-3 et L.O. 111-10 du code de la sécurité sociale.
4 () Le contrôle. Exemple du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, Jus Politicum, intervention présentée par M. Pierre Avril dans le cadre de la journée organisée à l’Assemblée nationale le 23 juin 2011 par le Centre d’études constitutionnelles et politiques (CECP) de l’Université Panthéon-Assas (Paris II) sur « Le Parlement et le nouveau droit parlementaire après la révision constitutionnelle de 2008 ».
5 () Ses 32 membres sous la XIIIe législature, avec quatre groupes parlementaires, comprennent 17 membres appartenant à l’UMP et 2 au groupe Nouveau Centre, soit 19 membres de la majorité, et 11 membres appartenant au groupe SRC et 2 au groupe GDR, soit 13 membres de l’opposition.
6 () Article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale, introduit par la résolution modifiant le Règlement de l'Assemblée nationale, adoptée le 7 juin 2006.
7 () Bien qu’il soit également prévu par l’article 145-8 du même Règlement, pour ce qui concerne les commissions d’enquête depuis la révision précitée de 2006, et les missions d’information depuis la révision de 2009.
8 () En réalité un peu moins, car quelques députés ont été désignés par leur commission pour plusieurs sujets successifs.
9 () En incluant la commission des Affaires européennes, dont les membres sont également membres d’une commission permanente.
10 () Le I de l’article 5 ter dispose : « Les (…) instances permanentes créées au sein de l'une des deux assemblées parlementaires pour contrôler l'action du Gouvernement ou évaluer des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d'une seule commission permanente peuvent demander à l'assemblée à laquelle elles appartiennent, pour une mission déterminée et une durée n'excédant pas six mois, de leur conférer, dans les conditions et limites prévues par cet article, les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête par l'article 6 ci-dessous. »
11 () Canada (et Québec) hors Europe ; Allemagne, Pays-Bas, Suède (deux fois), Royaume-Uni (deux fois), Belgique pour les institutions européennes (deux fois).
12 () 34 offres ont été reçues, émanant de 17 candidatures, certaines portant sur plus d’un des trois lots.
13 () Par exemple les dix monographies par État concernant les politiques sociales en Europe, ou les résultats détaillés d’une enquête sur un échantillon de la population réalisée pour l’étude commandée à Ernst & Young au titre du rapport sur la RGPP.
14 () Les dépenses publiques sont toutes regroupées dans un agrégat puis comparées aux ressources publiques pour définir le solde des administrations publiques (capacité ou besoin de financement des administrations publiques ou « APU ») souvent exprimé en points de PIB.
15 () Extraction, Recherches, Analyses pour un Suivi Médico-Economique.
16 () Moyens engagés en vue de prévenir l'apparition et/ou la propagation d'une maladie.
17 () En raison de la surestimation initiale du montant des heures supplémentaires.
18 () Loi organique du 15 avril 2009 prise sur le fondement du nouvel article 39 de la Constitution issu de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008.
19 () Le projet de loi constitutionnelle en cours de navette a prévu, dans sa version originelle le « monopole » des lois de finances pour les mesures fiscales. La circulaire du Premier ministre du 4 juin 2010 en vigueur impose également ce monopole s’agissant de la pratique du Gouvernement.
20 (1) Oui, IL FAUT SAUVER LA SANTÉ SCOLAIRE. JEAN-PIERRE Deschamps, Médecine et enfance 1989 : 179-82.
21 () Allemagne, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède.
© Assemblée nationale