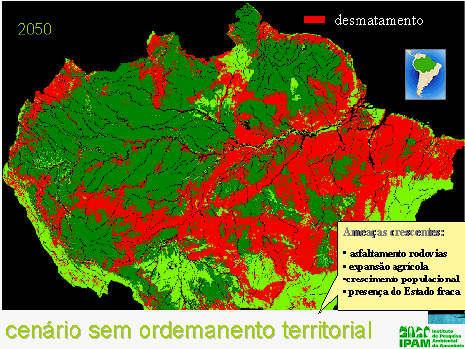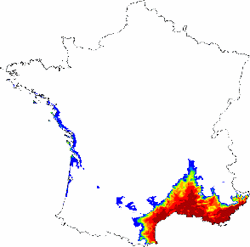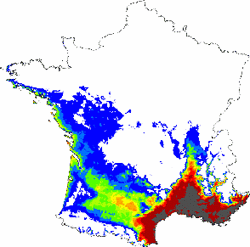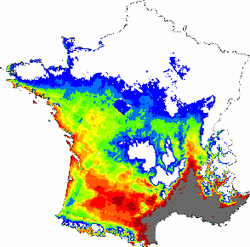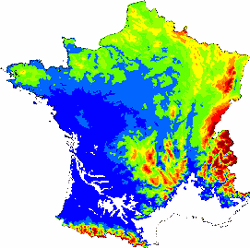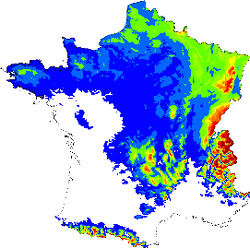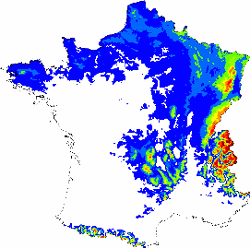OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION
DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES
RAPPORT
sur
« Les apports de la science et de la technologie au développement durable »
Tome II :
« La biodiversité : l’autre choc ? l’autre chance ? »
par MM. Pierre LAFFITTE et Claude SAUNIER,
Sénateurs.
Déposé sur le Bureau de l'Assemblée nationale par M. Claude BIRRAUX Premier Vice-président de l'Office |
Déposé sur le Bureau du Sénat par M. Henri REVOL Président de l'Office | ||||
SOMMAIRE
Pages
AVANT-PROPOS 11
INTRODUCTION 15
première partie - la biodiversité : une réalité mal connue et gravement menacée 17
I. des mondes qui restent à explorer 18
A. L’ÉVOLUTION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE DE LA FIN DU XXÈME SIÈCLE 18
1. La biologie moléculaire 18
2. Le perfectionnement des technologies d’exploration a bouleversé nos évaluations de la richesse des espèces non bactériennes 18
a) L’exploration du fond des océans 18
b) La découverte des mondes de la canopée 21
3. La naissance de l’écologie 21
B. LE RENFORCEMENT DES CHAMPS DE CONNAISSANCE DE LA BIODIVERSITÉ DES ESPÈCES ET DES ÉCOSYSTÈMES 22
1. La découverte des nouvelles espèces 22
a) La réévaluation du nombre d’espèces 22
b) La poursuite des découvertes 24
2. L’exploration de la diversité bactérienne 25
a) La diversité du monde bactérien 25
b) Les fonctionnalités bactériennes 26
3. Les recherches sur les écosystèmes 26
a) La complexité du problème 26
b) Des processus expérimentaux particuliers 27
II. Des menaces croissantes 29
A. UN BILAN TRÈS INQUIÉTANT 29
1. Le rythme général d’extinction des espèces s’accélère 29
2. Tous les biotopes sont atteints 30
3. Mais certains types d’écosystèmes sont plus touchés 33
a) Une localisation géographique inégale de l’érosion de la biodiversité 33
b) Des biotopes sont plus particulièrement menacés 37
B. L’ACCROISSEMENT DES PRESSIONS TRADITIONNELLES 40
1. La recherche d’un indice global d’atteinte à la biodiversité 41
2. Les pressions de prédations 43
a) La pêche et l’aquaculture 43
(1) La pêche industrielle conduit à la surexploitation des espèces halieutiques et à la destruction des écosystèmes marins. 43
(2) Le développement de l’aquaculture en milieu ouvert 46
b) L’exploitation forestière non contrôlée s’accélère du fait de la hausse de la demande mondiale 48
(1) Une demande en hausse satisfaite en partie par des coupes illégales 48
(2) Un équilibre de marché qui aboutit à des aberrations 50
3. Les pressions d’anthropisation des espaces 51
a) L’occupation des espaces 51
b) La destruction d’espaces 52
4. L’accroissement des échanges internationaux renforce les invasions biologiques 56
a) Un phénomène qui n’est pas récent 56
b) L’amplification du fait de la croissance des échanges maritimes et aériens 57
C. LA NOUVELLE MENACE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 58
III. l’acquisition et la gestion des connaissances sur la biodiversité 61
A. LES CONTRAINTES DE L’ACQUISITION DES CONNAISSANCES DANS LE DOMAINE DE LA BIODIVERSITÉ 61
1. Gérer l’espace et le temps 61
a) La multilocalisation de la recherche 61
b) Des temps différents 62
2. Maintenir les modes traditionnels d’exploration de la biodiversité et faire appel à des moyens nouveaux 62
a) Les modes traditionnels d’exploration 62
b) Mettre en œuvre des moyens d’investigation et d’analyse nouveaux 63
(1) La création d’indices liés à la biodiversité 63
(2) Le développement de concepts de classification nouveaux : 65
c) La scénarisation : 66
3. Généraliser l’usage des nouvelles technologies 66
a) L’utilisation à grande échelle des nouvelles technologies d’information 66
b) Les méthodes de systématique intégrante 67
c) L’utilisation des techniques d’identification biologique 68
B. LA GESTION DES CONNAISSANCES 68
deuxième partie - l’urgence des initiatives 72
I. Réduire les pressions d’anthropisation 73
A. LES PRESSIONS DE PRÉDATION 73
1. Les forêts tropicales et équatoriales 75
a) La nécessité et les limites des politiques de conservation 77
(1) La poursuite des actions de conservation 77
(2) Les limites 78
b) Faire le lien entre la conservation et l’exploitation économique des forêts tropicales 80
(1) Rétablir une transition géographique 80
(2) Rationaliser l’exploitation forestière 81
(a) L’exploitation des produits ligneux 81
(b) L’exploitation des produits non ligneux 84
(3) La réinsertion d’une économie forestière raisonnée dans la mondialisation 86
(a) Vers l’organisation de la rareté ? 86
(b) L’inclusion des forêts tropicales dans le cycle de Kyoto 88
2. La surexploitation des océans 89
a) La nécessité et les limites de l’aménagement de réserves marines 90
b) La gestion des milieux côtiers 90
c) Vers une aquaculture raisonnée 91
d) La limitation des prises connexes 92
e) Encourager la labellisation d’une pêche et d’une aquaculture responsables et durables 94
f) L’évolution de la gouvernance mondiale de la pêche 94
B. LUTTER CONTRE LES DESTRUCTIONS D’ESPACES 97
1. Mieux gérer l’occupation directe des espaces 97
a) La redéfinition du développement urbain 98
b) La compensation des occupations d’espaces 99
(1) Les législations existant à l’étranger 99
(2) La législation française 99
c) La gestion de l’espace rural 102
2. Freiner le fractionnement des territoires 102
3. Les occupations indirectes d’espace : mieux gérer les eaux continentales 103
a) Les conséquences de la pollution 104
b) La captation de l’eau par l’agriculture 104
4. Limiter les introductions d’espèces invasives 105
II. anticiper les menaces 106
A. PRÉVENIR LES EFFETS À LONG TERME DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 106
1. La vitesse acquise 107
a) Les changements phénologiques 107
b) Les changements d’aires de distribution 107
c) L’évolution de l’équilibre des écosystèmes 110
2. Des menaces très préoccupantes 113
a) Les écosystèmes terrestres 113
b) Les écosystèmes océaniques 120
3. L’organisation des capacités de réponse au changement climatique 121
a) La nécessité de multiplier et de coordonner les actions de surveillance 121
b) Anticiper les évolutions 123
c) La conservation des semences 125
d) Le débat sur la sélection génétique 126
B. LES CONCURRENCES FUTURES D’OCCUPATION D’ESPACES 127
1. La montée de la demande en biocarburants 127
2. Nourrir 9 milliards d’hommes en 2050 ? 128
TROISIème partie - Valoriser durablement la biodiversite 133
I. La valorisation des services ecologiques 134
A. DES SERVICES DIVERSIFIES 134
1. Les services sanitaires 135
2. Les services agronomiques 136
a) La pollinisation 136
b) Les autres apports agronomiques 138
(1) Un facteur de productivité agricole 138
(2) Un facteur de dépollution 140
(3) Un support de résistance aux modifications de l’environnement 140
(4) Un mécanisme de limitation des ravageurs 140
3. Les services hydrologiques 140
4. L’ingénierie écologique 141
B. DES SERVICES INSUFFISAMMENT RECONNUS PAR L’ÉCONOMIE 142
1. La réinsertion des services écologiques dans le calcul économique 142
a) Des économies externes très importantes 142
b) Des caractéristiques qui ne correspondent pas au fonctionnement du marché 143
2. La réorientation des politiques publiques 145
a) Le renforcement des inflexions de la politique agricole commune (PAC) en faveur de la protection des écosystèmes 145
(1) La politique agro-environnementale de l’Union. 145
(2) Les marges de renforcement et d’amélioration 147
b) La politique hydrologique 149
(1) Le principe pollueur-payeur 149
(2) La gestion des conflits d’usage 150
(3) La constitution de parcs hydrologiques naturels 151
II. Une des boites a outils de la quatrieme revolution indstrielle 151
A. LES PRODUITS BIO-TECHNIQUES ET BIO-INSPIRES 152
1. Des matériaux aux propriétés complexes. 153
2. Le biomimétisme 154
3. La bioinspiration 156
B. LA NOUVELLE USINE DU VIVANT 157
1. Les avantages des biotechnologies industrielles 157
2. Les premières utilisations 158
a) Les bioproductions et les bioconversions 158
b) Les réalisations et les perspectives 159
(1) Les réalisations 159
(2) Les perspectives 159
C. LES INTERROGATIONS SUR LA BIOPROSPECTION 161
1. Des potentialités partiellement exploitées 161
2. Des interrogations nouvelles 163
a) Une équation économique incertaine 163
b) La lutte contre le biopiratage 164
dix propositions pour aller plus loin que le "grenelle de l'environnement" 145
I. intégrer la biodiversité dans la mondialisation 172
A. UNIFIER LES GESTIONS INTERNATIONALES DE LA BIODIVERSITÉ 172
B. VALORISER LA BIODIVERSITÉ DANS LES MÉCANISMES DE LA MONDIALISATION 173
II. Activer les efforts de l’Union européenne 176
A. PROCLAMER UN MORATOIRE SUR LES BIOCARBURANTS 176
B. RENFORCER LE PILIER ENVIRONNEMENTAL DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE 177
C. AMPLIFIER L’EFFORT DE RECHERCHE SUR LES CONSÉQUENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 177
D. METTRE EN PLACE UNE LABELLISATION EUROPÉENNE DES PRODUITS ISSUS DE LA BIODIVERSITÉ 178
E. ENGAGER UNE RÉFORME DE LA POLITIQUE EUROPÉENNE DES PÊCHES 178
III. mettre en phase la parole et les pratiques de la france 180
1. Mieux recenser et protéger la biodiversité ultramarine de la France 180
2. Appliquer les accords internationaux conclus par la France 181
3. Renforcer notre effort dans certains domaines de coopération internationale 182
4. Etayer et élargir notre dispositif de conservation des ressources génétiques cultivables 182
a) Etayer le dispositif 182
b) Elargir le dispositif 183
IV. Eriger la biodiversité en priorité de recherche 184
A. RENFORCER L’IDENTIFICATION DE LA BIODIVERSITÉ DES ESPÈCES ET DES ÉCOSYSTÈMES. 184
B. ACTIVER LA MISE EN œUVRE DES TECHNOLOGIES ET LE CONTRÔLE DE LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ 184
C. VALORISER L’ENJEU SCIENTIFIQUE ET ÉCONOMIQUE DE LA BIODIVERSITÉ 185
V. adapter la fiscalité à la valorisation de la biodiversité 187
VI. Insérer les services rendus par les écosystèmes dans le calcul économique 189
A. RÉMUNÉRER LES ÉCONOMIES EXTERNES PRODUITES PAR LES ÉCOSYSTÈMES ET SANCTIONNER LEURS DESTRUCTIONS 189
1. Rémunérer les services écologiques 189
2. Instaurer progressivement le principe pollueur-payeur 190
B. CRÉER UN MARCHÉ DE LA COMPENSATION DES ATTEINTES AUX MILIEUX NATURELS. 191
1. L’amélioration de la loi de juillet 1976 sur l’environnement 191
2. Créer un marché de la compensation des atteintes aux milieux naturels 192
VII. Aménager durablement le territoire 194
VIII. Lancer un programme de redensification urbaine 195
IX. Anticiper le changement climatique 196
X. définir un nouveau contrat social avec les agriculteurs 198
A. LA MISE EN OEUVRE D’UNE AGRICULTURE DE PRÉCISION 198
B. ACCROÎTRE LE RÔLE DES AGRICULTEURS DANS LA PROTECTION DES ÉCOSYSTÈMES 199
Adoption par l’office 202
ANNEXE - Liste des personnes auditionnees 204
A. ALLEMAGNE 212
B. COMMISSION EUROPÉENNE, BRUXELLES (BELGIQUE) 213
C. BRÉSIL 213
D. COSTA RICA 214
E. ETATS-UNIS 215
F. FINLANDE 218
G. INDE 218
H. ITALIE 219
I. ROYAUME-UNI 221
L’Eté et l’Automne 2007 resteront marqués en France par le « Grenelle de l’environnement ».
La crise environnementale fait aujourd’hui l’objet d’un consensus scientifique mondial, qui nourrit une prise de conscience générale. Le développement durable est un concept qui sort de cénacles restreints pour devenir un paradigme affiché des politiques publiques.
En quelques mois, en France et au-delà, des idées considérées avec condescendance sont établies comme les repères d’une époque en crise. Cette conscience de l’ampleur de la rapidité, de la brutalité de la crise environnementale annoncée depuis des années par de multiples signaux nous a conduits en 2005 à initier une proposition d’étude de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sur le développement durable.
Notre propos était triple :
- introduire de la rigueur et de la clarté dans une notion aux contours incertains ;
- asseoir les convictions et les intuitions sur une connaissance précise des faits ;
- dessiner dans la durée les perspectives de scenarii de la crise et des réponses technologiques.
Enfin, nous avions l’ambition d’introduire avec vigueur le dossier environnemental dans le débat présidentiel. Ce que nous vivons depuis quelques mois répond donc pleinement à nos espoirs, même si nous mesurons chaque jour la brutalité croissante de la crise et les pesanteurs de notre société pour la dépasser.
Nous avons aussi la lucidité d’apprécier à sa juste valeur la place d’un simple rapport parlementaire dans l’ensemble des initiatives qui ont fait bouger la conscience de nos concitoyens.
Nous voulons dire que notre intuition a été bien accueillie par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui nous a soutenus et mandatés pour conduire les enquêtes et rédiger des rapports.
Tel est le cadre dans lequel se situe le présent rapport.
Il constitue le deuxième tome d’une étude menée sur l’apport de la science et de la technologie au développement durable.
L’idée directrice de cette étude était de mettre en parallèle les défis d’ensemble auxquels l’humanité sera confrontée dans les cinquante prochaines années et les réponses que la science et la technologie pouvaient y apporter.
En d’autres termes, il s’agissait d’analyser la façon dont l’offre scientifique pouvait contribuer à une novation de notre modèle de développement que la crise climatique, la raréfaction des ressources fossiles et les coûts conjugués de ces deux phénomènes rendent, dès maintenant, inévitable.
Sur ces bases, le premier tome du rapport : « Changement climatique et transition énergétique : dépasser la crise » a été approuvé par l’Office le mardi 27 juin 2006 ; sa publication a été accompagnée d’un colloque, tenu le jeudi 29 juin 2006, au cours duquel la plupart des intervenants ont apporté leur soutien aux propositions, concrètes et sans concessions, du rapport.
Parmi d’autres, ce travail a probablement été de ceux qui ont renforcé la perception par l’opinion publique de la nécessité de mettre en œuvre un développement plus durable ; mouvement qui s’est traduit dans le débat politique, lors des élections du printemps, puis à l’occasion du Grenelle de l’environnement.
On peut se féliciter que plusieurs propositions du Tome I aient été reprises aussi bien par les groupes de travail du « Grenelle de l’environnement » que par le rapport conclusif.
*
* *
Ce second tome est consacré à la biodiversité, thème moins présent dans l’opinion que le changement climatique et la crise énergétique, mais qui a tout autant d’importance pour notre société car une valorisation durable de la biodiversité peut être un des ressorts de la transformation de notre mode de développement.
Nous avons réalisé la plus grande partie de nos enquêtes et de nos auditions avant le « Grenelle de l’environnement ».
Nous avons cependant intégré les résultats des travaux du Grenelle dans nos propres constats et repris bien des propositions officialisées lors de ces assises.
Mais usant de notre liberté d’appréciation de parlementaires, non contraints par les nécessaires équilibres liés à une négociation, nous avons, sur bien des points, dépassé les conclusions du Grenelle et affirmé quelques positions plus tranchées et ouvert de nouvelles pistes.
C’est dire que ce rapport intègre, mais aussi dépasse les conclusions du « Grenelle de l’environnement » qui, en tout état de cause, constitue un jalon majeur dans notre prise de conscience collective.
L’homme a étayé son développement, économique et culturel, grâce à ce « tissu vivant1 » de la planète que constitue la diversité de la biosphère.
L’évaluation du millénaire (le « Millenium Assessment »), conduite en 2000 à la demande de l’ONU, a mis en évidence cette relation de l’homme et de la nature et a recensé dix-sept catégories de services écologiques que la biodiversité fournit à l’homme.
Ce réservoir de ressources vivantes, d’une importance comparable à celles fournies par les matières minérales, est actuellement menacé. Mais cette menace est beaucoup moins bien perçue par l’opinion que celles que portent le changement climatique et la crise énergétique.
Pourquoi la perspective de ce choc biologique frappe-t-elle moins les mentalités collectives que le constat des dérèglements climatiques et les tensions sur les prix du fuel ou de l’essence à la pompe ?
Le thème est pourtant présent dans les médias qui se sont fait fidèlement l’écho des préoccupations de la communauté internationale, réitérées depuis le Sommet de Rio, qui s’est tenu en 1992.
Mais la biodiversité est à la fois de plus en plus éloignée du quotidien des hommes, complexe et donc peu lisible.
L’homme, qui a assis sa maîtrise de la nature par un apprentissage qui a duré des millénaires, s’en éloigne et s’en distancie très rapidement. Le regard porté sur le siècle qui vient de s’écouler et, plus précisément, sur les cinquante dernières années permet de percevoir l’amplification du mouvement acquis. La croissance des occupations d’espaces naturels (routes, équipements, conurbations géantes) témoignent de l’éloignement de l’homme de la nature.
Les mesures de compensation de cet éloignement géographique, en particulier en matière éducative, sont insuffisantes pour réduire l’écart qui s’est creusé entre l’homme et la connaissance qu’il a de la biosphère.
Moins présente physiquement qu’auparavant, dans la vie quotidienne la complexité de la biodiversité la rend peu lisible par les citoyens.
A lui seul, le nombre des espèces identifiées qui approche les deux millions rend la tâche difficile. L’opinion identifie généralement la défense de la biodiversité à celle de quelques espèces phares menacées, comme le tigre, l’éléphant ou l’ours polaire. Mais elle ignore les richesses potentielles des génomes et les interactions complexes des écosystèmes. Dès lors, comment s’étonner que les services rendus en matière d’eau ou de pollinisation par ces écosystèmes soient peu perçus par l’opinion ?
L’un des objectifs de ce rapport est de contribuer à consolider le lien entre les acteurs scientifiques du secteur et une opinion publique française et européenne qui ignore trop souvent les véritables enjeux du maintien de la biodiversité des écosystèmes de la planète.
Notre démarche visera à examiner comment il est possible d’approfondir notre connaissance, encore très imparfaite, de la biodiversité, à exposer les conditions de l’amélioration rapide de sa protection, à distinguer les processus de sa valorisation durable, puis à avancer des propositions contribuant à chacun de ces objectifs.
PREMIÈRE PARTIE
LA BIODIVERSITÉ : UNE RÉALITÉ MAL CONNUE
ET GRAVEMENT MENACÉE
La diversité du vivant, observée ou imaginée, a toujours fasciné les esprits, des divinités antiques à la description de chimères – mi-hommes, mi-bêtes – d’Hérodote, ou à leur représentation en pierre sur le tympan du narthex de Vézelay. Mais ce n’est qu’à partir du XVIIIème siècle que l’on est passé du « cabinet de curiosité » ou de la ménagerie à une tentative de classification botanique et zoologique du vivant, la taxonomie.
Ce premier inventaire a été complété par les naturalistes – en particulier grâce à l’achèvement de l’exploration de la planète aux 19e et 20e siècles.
Une rupture scientifique est intervenue à la fin des années soixante-dix lorsque le renouvellement des outils d’observation de la biodiversité a permis de s’apercevoir qu’un corpus de connaissance, qui était jugé presque définitif, était très incomplet : la diversité du vivant restait, pour l’essentiel, à découvrir. L’univers du vivant s’élargissait à l’infini.
Mal connue, la biodiversité est, dans le même temps, l’objet de menaces qui s’amplifient : le bilan dressé à l’occasion de l’évaluation précitée du millénaire était déjà très préoccupant. Il serait catastrophique que l’accélération des tendances que l’on discerne pour le demi-siècle à venir soit confirmée.
Mais la course au savoir qu’implique ce double constat suppose aussi que l’on rénove les modes d’acquisition et de gestion des connaissances sur la biodiversité.
DES MONDES QUI RESTENT À EXPLORER
Les progrès des années soixante-dix/quatre-vingt ont ouvert de nouveaux champs de recherche sur la diversité du vivant.
L’ÉVOLUTION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE DE LA FIN DU XXÈME SIÈCLE
Depuis une trentaine d’années, la certitude que la description de la biodiversité de la planète était achevée a fortement vacillé sous l’impact d’une triple évolution : l’essor de la biologie moléculaire, le perfectionnement des technologies d’exploration et d’investigation, et la naissance d’une nouvelle discipline, l’écologie.
La biologie moléculaire a ajouté à la définition des espèces par leur morphologie et leur physiologie leur caractérisation par le capital génétique.
Un exemple de cette nouvelle exploration du vivant est la « pêche aux bactéries » menée depuis les États-Unis par le Venter Institute qui prélève tous les 200 miles nautiques des échantillons océaniques sur la ligne des tropiques, les caractérise et essaie d’établir la phylogénie – c’est-à-dire l’arbre généalogique de ces espèces de bactéries.
Des explorations du même ordre sont effectuées au Génoscope d’Évry afin d’approcher la biodiversité des bactéries du sol.
Il va de soi que ces techniques de biologie moléculaire ne sont pas appliquées qu’aux bactéries ; elles sont employées couramment en botanique et en zoologie, où leur usage l’emporte très largement sur les descriptions morphologiques et physiologiques antérieures.
LE PERFECTIONNEMENT DES TECHNOLOGIES D’EXPLORATION A BOULEVERSÉ NOS ÉVALUATIONS DE LA RICHESSE DES ESPÈCES NON BACTÉRIENNES
L’exploration du fond des océans
Le fond des océans est un monde de 307 millions de km² (600 fois la France) où la lumière ne pénètre pas. C’est un désert, mais un désert peuplé.
Les modules d’exploration océaniques à grande profondeur, qui se sont développés depuis la première plongée de l’Alcyon sur la dorsale des Galápagos en 1977, ont permis de découvrir des écosystèmes survivant dans des conditions de température, de lumière, de pression et de transformations chimiques tout à fait différentes de ce que la science avait observé jusqu’ici.
Ces systèmes se développent autour des sources thermales chaudes de l’océan ou des sources froides de méthane et d’hydrogène sulfuré situées sur la jonction de certains plateaux continentaux :
- Source thermale de la dorsale des Galápagos
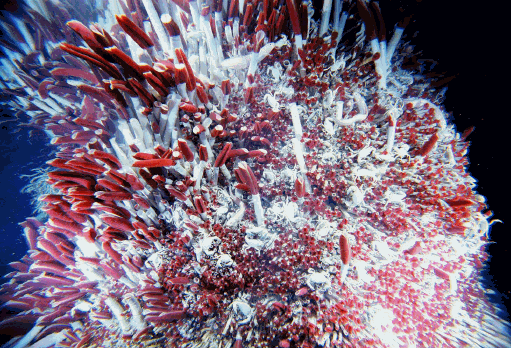
Source : IFREMER Brest, Daniel Desbruyères
- Sources froides du plateau continental Zaïre-Angola

Source : IFREMER Brest, Daniel Desbruyères
Ces premières indications d’une forte biodiversité océanique ont été confirmées par des campagnes et des sondages ultérieurs : sur 21 m² entre 1 500 et 2 500 m de profondeur (New Jersey), on a prélevé, il y a quelques années, 798 espèces de multicellulaires (de plus de 300 μ), dont 58 % d’espèces nouvelles.
Les estimations les plus basses fondées sur le nombre d’espèces supérieures estiment que les fonds océaniques contiennent entre 100 000 et un million d’espèces non bactériennes.
Or, au milieu du XIXème siècle, Edward Forbes avait bâti une théorie : la faune se raréfiait de façon linéaire en fonction de la profondeur – ce qui aboutissait à une zone azoïque (sans faune) à partir de 600 m. Même si la pose des premiers câbles télégraphiques en 1861 avait permis d’infirmer en partie cette thèse, ce n’est que dans les années cinquante que des chalutages par 1 000 m de fond avaient ramené des invertébrés.
La surprise consécutive aux explorations subocéaniques des dernières décennies n’a donc pas été constituée par la découverte d’une vie dans les grands fonds mais par :
- la très grande diversité des espèces, corrélée avec la diversité des habitats (évents, canyons, plateaux rocheux ou volcaniques, fonds sableux, microsystèmes des cadavres des animaux pélagiques2, etc.),
- la variété des échelles de taille de ces environnements,
- la substitution d’une chimiosynthèse à la photosynthèse,
- et la saisonnalité faunique et floristique de ces milieux.
La découverte des mondes de la canopée
L’épandage d’insecticides à des fins scientifiques sur les canopées des forêts tropicales et équatoriales, le « fogging », a révélé qu’il existait sur chaque arbre des dizaines d’espèces qui n’avaient pas été répertoriées jusqu’ici et qui étaient différentes d’autres espèces non identifiées implantées sur un arbre situé à quelques dizaines de mètres du premier lieu de prélèvement.
Les naturalistes du XIXème siècle s’étaient préoccupés des relations entre les espèces et leur chaîne alimentaire, ainsi que des pressions de sélection générées par les changements d’environnement.
Les botanistes, les zoologues, les spécialistes des bactéries ont depuis développé des recherches sur les relations entre espèces au sein du milieu vivant et, en particulier, les phénomènes d’association des espèces3 (mutualisme, parasitisme, symbiose, commensalisme, etc.).
Les lichens, par exemple, sont le résultat d’une symbiose entre les champignons et une algue. On connaît les exemples de mutualisme à base de cueillette de feuilles dont la décomposition permet aux fourmis qui pratiquent cette cueillette de cultiver des champignons leur assurant une source continue de nourriture, ou les relations nutrition-protection comme celle de cette grenouille d’Amérique centrale qui a besoin de manger un certain type de fourmi pour produire le poison cutané qui décourage ses prédateurs.
Au-delà des relations immédiates des espèces avec leur milieu, l’étude systématique des écosystèmes ne s’est réellement développée que dans les trente dernières années4. Elle a pour objet d’analyser les interactions complexes qui s’établissent entre tous les éléments d’un écosystème.
Mais, dans la mesure où les objets d’étude de cette discipline sont presque illimités, celle-ci se concentre souvent sur la mise en évidence des fonctionnalités de tel ou tel écosystème. Par exemple, quelle est la biomasse produite par une prairie en fonction de la biodiversité des herbages, quelle en est la biodiversité faunistique sous-jacente ou – dans un autre domaine – quel sera le degré de résistance aux ravageurs en fonction de la biodiversité d’un champ ou des haies qui l’entourent ?
LE RENFORCEMENT DES CHAMPS DE CONNAISSANCE DE LA BIODIVERSITÉ DES ESPÈCES ET DES ÉCOSYSTÈMES
Les perspectives nouvelles dégagées par les progrès scientifiques du dernier quart de siècle concernent les trois domaines principaux d’exploration de la biodiversité : la poursuite de l’identification de nouvelles espèces, le progrès de la connaissance sur la diversité génétique ainsi que la diversité des fonctionnalités et du génome et la détermination des interrelations entre espèces au sein des écosystèmes.
LA DÉCOUVERTE DES NOUVELLES ESPÈCES
La réévaluation du nombre d’espèces
Nous sommes les héritiers des naturalistes du XIXème siècle qui avaient assez bien exploré le catalogue du vivant chez les vertébrés, dont on connaît plus de 95 % des espèces, et des plantes, dont on estime avoir découvert de l’ordre de 350 000 espèces sur 450 000.
Mais d’autres taxons, plus petits ou moins accessibles, n’ont pas été identifiés aussi complètement ; les nouveaux moyens d’investigation dont dispose la science ont conduit à en réévaluer le nombre :
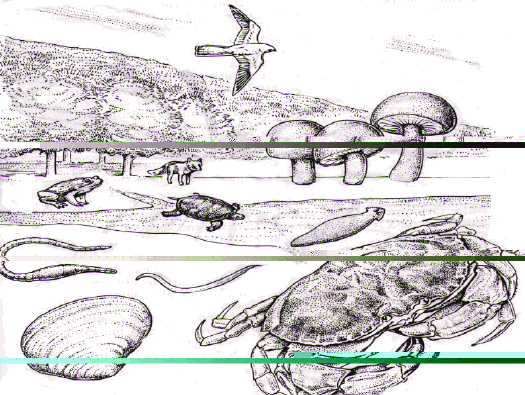
Source : Serge Morand, CNRS
Pour ne reprendre que deux des catégories visées par ce tableau, les potentialités de découvertes sont immenses :
- on a, jusqu’ici, décrit un million d’insectes et de myriapodes. Or, l’on estime qu’il en reste sept millions à identifier ;
- de même, on n’a pu identifier que moins d’une centaine de milliers de champignons sur un effectif estimé de près d’un million et demi d’espèces ; on donnera une seule illustration de la variété du vivant dans ce domaine en indiquant qu’une seule espèce de fougère en Amérique centrale peut héberger jusqu’à 600 espèces de champignons.
Les découvertes de nouvelles espèces s’effectuent à un rythme soutenu.
Par exemple, en moyenne sur 2002-2003, on a découvert 1635 espèces marines par an, dont 439 espèces de crustacés et une baleine de plus de 10 m. de long !
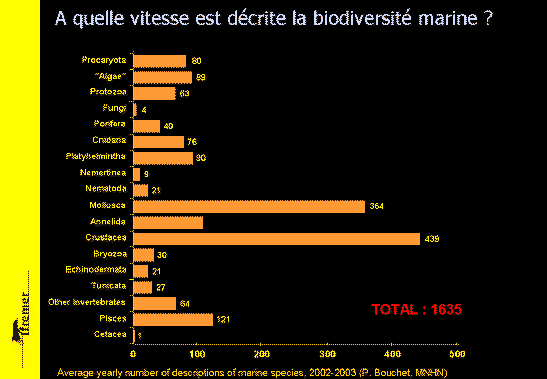
Source : IFREMER
Mais, au regard du « thesaurus » non identifié des espèces à découvrir, ce rythme de découvertes est relativement lent, comme en témoignent quelques données :
- au rythme actuel, il faudrait 250 ans pour identifier l’ensemble des espèces d’angiospermes (arbres à graines enfermées dans un fruit) de la seule Amérique centrale qui est – il est vrai – un point chaud de la biodiversité floristique mondiale,
- en 150 ans, on a décrit 50 000 nématodes alors que l’on estime qu’il en existe près de 800 000,
- et, s’agissant de la biodiversité des espèces océaniques, les contraintes physiques d’exploration demeurent démesurées : depuis 40 ans, on a exploré 80 km² de fonds d’océan sur plus de 300 millions de km² ; à ce rythme, en 2050, on n’aura exploré que 200 km² et il ne faudra plus qu’une dizaine de millions d’années pour finir de quadriller les fonds de l’océan.
En elle-même, la lenteur de la progression de notre maîtrise de la biodiversité des espèces pose problème : on mettra plus d’un millénaire à identifier une toute petite majorité d’espèces, alors que cette identification sous forme taxonomique classique n’aura probablement plus aucune signification scientifique d’ici plusieurs centaines d’années.
Ce constat renvoie à d’autres sources, et à d’autres méthodes d’identification – celles inspirées des progrès de la génétique.
L’EXPLORATION DE LA DIVERSITÉ BACTÉRIENNE
La diversité du monde bactérien
On avait identifié 2 500 espèces de bactéries en 1980 ; on en a identifié 7 300 aujourd’hui. Mais on évalue le nombre d’espèces de bactéries5 dans une fourchette comprise entre 600 000 et 6 milliards. Un seul prélèvement de 30 g. de sol contient 2 000 types de communautés bactériennes et 50 000 génomes différents.
Or, cette variété recouvre des facteurs communs extrêmement intéressants :
- les bactéries réagissent en permanence aux sollicitations de l’environnement,
- cette faculté d’adaptation repose sur une très grande plasticité d’échange entre les communautés bactériennes car les bactéries sont porteuses de ce que l’on appelle des séquences d’insertion des génomes provenant d’autres bactéries qui cohabitent avec les séquences chargées des fonctions essentielles de la bactérie hôte.
Les fonctionnalités bactériennes
Les champs des recherches sur les fonctionnalités bactériennes ne sont pas récents (usages alimentaires, antibiotiques, etc.) mais ils ont tendance à se diversifier parallèlement aux progrès de la génomique fonctionnelle :
- rôle écologique des rhizobactéries dans la croissance et de la résistance des plantes - par exemple on a démontré que certaines de ces bactéries associées aux semences stimuleraient fortement la croissance des plantes (développement de la fixation de l’azote et accroissement de l’activation des phytohormones) ou les aideraient à activer des résistances aux agressions fongiques (par exemple, elles renforcent l’inhibition du striga qui est un parasite du sorgho ou du maïs),
- capacités sanitaires – certaines bactéries du sol sont capables de dégrader le prion des carcasses de moutons atteints de l’ESB ou d’attaquer le virus de la grippe aviaire,
- possibilités industrielles permettant de substituer les processus biochimiques à des processus chimiques.
LES RECHERCHES SUR LES ÉCOSYSTÈMES
L’évaluation du millénaire a identifié 14 grands biomes (grands types d’écosystèmes terrestres) : savanes, forêt tropicale humide, toundra, toundra boisée, forêt tempérée, forêt tropicale sèche, désert, etc.
Mais chacune de ces grandes aires de répartition qui s’étendent sur des millions de km² peut contenir des milliers d’écosystèmes particuliers dont les conditions et problématiques d’étude ne sont pas nécessairement identiques.
De plus, ces écosystèmes ne sont pas nécessairement facilement localisables (les difficultés d’accès à certains de ces biotopes peuvent être importantes), ni facilement identifiables : dans certaines zones de forêt tropicale, il peut y avoir, dans un rayon de quelques centaines de mètres, plusieurs écosystèmes avec des faunes et des flores originales et des interactions particulières. Une autre difficulté d’étude réside dans le fait que dans la forêt, dans de nombreux cas, on ne connaît que de 10 % à 30 % des espèces d’un système.
Des processus expérimentaux particuliers
Cette complexité explique que les recherches sur les écosystèmes doivent utiliser une pluralité de méthodes qui s’apparentent plus à la recherche de faisceaux d’indices qu’aux méthodes expérimentales traditionnelles.
S’agissant, par exemple, de la localisation des écosystèmes, l’Institut national de la biodiversité (INBIO), ONG costaricaine, a entrepris une identification des écosystèmes en mettant en évidence des typologies de végétation afin d’établir une première cartographie élémentaire.
Un autre aspect essentiel de l’étude des écosystèmes est l’observation dans la durée. D’où la nécessité de faire vivre des placettes d’observation, comme le fait l’Office national des forêts (ONF) ou comme le propose le programme européen LifeWatch.
Ce projet concernerait 50 observatoires terrestres et 50 observatoires marins (à établir entre 2008 et 2014) pour un coût prévisionnel de 370 millions d’euros et un coût annuel de fonctionnement de l’ordre de 70 millions d’euros et permettrait de mesurer les évolutions des écosystèmes européens pour les trente prochaines années.
• D’autres procédés expérimentaux originaux sont également mis en œuvre, reposant soit sur l’observation comparée, soit sur « l’artificialisation fonctionnelle » permettant de mettre en évidence les gradients d’évolution de certains rôles assurés par les écosystèmes.
- L’observation comparée est pratiquée en matière d’exploitation forestière. Le CIRAD entretient depuis une trentaine d’années, en Guyane et dans l’État brésilien d’Amazonas, deux zones forestières où l’on compare, en les référant à des parcelles témoins, les conséquences sur plusieurs décennies d’une exploitation forestière différenciée (coupe faible, coupe moyenne, coupe forte).
- L’artificialisation fonctionnelle consiste à recréer des écosystèmes pour étudier les effets des modifications de leur environnement. L’Écotron qui est en voie de réalisation à Montpellier vise à permettre des études d’impact du forçage climatique et anthropique sur les flux de matière et d’énergie des différents écosystèmes, à différentes échelles.
- Dans le même ordre d’idée, on peut citer les expériences de prairies artificielles menées aux Etats-Unis, en Europe et en Afrique afin d’étudier les corrélations fonctionnelles qui existent entre la croissance de la biomasse et la biodiversité des plantations d’herbacées.
Paradoxalement, le développement de nouveaux instruments de connaissance de la biodiversité et d’évaluation de ses fonctions se confond avec un moment où les menaces qui pèsent sur elle s’aggravent.
Car au cours des cinquante dernières années, l’homme a modifié l’équilibre des écosystèmes de la planète de manière plus extensive que sur toute autre période de l’humanité.
La présence des espèces vivantes sur Terre n’est que transitoire. Celles qui y vivent actuellement ne représentent que 2 % de celles qui y ont vécu jusqu’ici.
La biosphère a connu 5 crises d’extinction spectaculaire dont la plus connue est celle qui a entraîné la disparition des dinosaures, il y a soixante-cinq millions d’années, mais la plus dévastatrice, celle du permien, il y a deux cent cinquante millions d’années, qui a supprimé 50 % des familles d’animaux terrestres et 95 % des espèces océaniques.
Mais chacune de ces crises d’extinction s’est déroulée sur des centaines de milliers d’années.
Le problème qui se pose à nous est de savoir si nous ne vivons pas un sixième cycle d’extinction massive et si ce spasme d’extinction ne va pas se produire dans des délais très brefs au regard des temps géologiques, de l’ordre du siècle.
Il serait probablement prématuré d’apporter une réponse tranchée à cette question – et annoncer une extinction de l’ampleur de celui du permien. Mais on doit ici se faire l’écho d’un constat unanime de la communauté scientifique : le bilan du demi-siècle passé est très préoccupant et pour le proche avenir les pressions traditionnelles s’accroissent, alors même qu’une nouvelle menace se profile – celle du changement climatique.
LE RYTHME GÉNÉRAL D’EXTINCTION DES ESPÈCES S’ACCÉLÈRE
Avant d’évoquer les évaluations portant sur l’amplification de la disparition de la biodiversité des espèces, on doit tempérer l’exposé de ces projections, bien que leurs tendances soient incontestables.
Car on conçoit aisément la difficulté de l’exercice qui consiste à évaluer le rythme de collapsus d’une donnée, la biodiversité, dont on ne connaît pas tous les éléments (à l’exception des mammifères) et en fonction d’événements dont l’ampleur et donc les conséquences ne sont pas non plus connus. C’est pourquoi ces méthodes reposent sur l’idée6 qu’il existe une relation linéaire entre la surface d’un biome et le nombre d’espèces naturelles de ce biome : quand la surface diminue 10 fois, le nombre d’espèces se réduit de moitié. Ce mode de projection est robuste mais élémentaire.
Ces difficultés méthodologiques expliquent qu’on aboutit à des estimations très différentes ; suivant les cas, entre 40 000 et 250 000 espèces par an.
On peut également rappeler que ce type d’approche repose sur une relation de linéarité qui n’est pas évidente et s’applique à des échelles du vivant qui n’ont pas le même degré de vulnérabilité : le risque de disparition de l’éléphant d’Afrique est probablement plus élevé que les risques d’extinction qui existent chez certaines espèces d’insectes ou d’invertébrés.
Mais, pour l’essentiel, la communauté scientifique s’accorde sur le fait que sur les deux derniers siècles, le rythme de disparition des espèces a été, suivant les espèces considérées, de 10 à 100 fois supérieur au tempo naturel d’extinction7 (une espèce sur 50 000 par siècle).
La projection faite par la communauté scientifique internationale à la demande de l’ONU à l’occasion du millénaire estime que d’ici 2050, ce rythme d’extinction sera multiplié par 10, soit, suivant les espèces considérées, un tempo de 100 à 1 000 fois supérieur au rythme d’extinction normal.
En clair, l’humanité détruit à une vitesse accélérée non seulement la biodiversité qu’elle connaît, mais celle qu’elle n’a pas encore découvert.
TOUS LES BIOTOPES SONT ATTEINTS
Sur la base d’observations effectuées depuis 1970, le WWF publie un indice dit « de planète vivante » (IPL), qui mesure l’évolution de la diversité biologique sur la Terre à l’aide de tendances de population de 1313 espèces de vertébrés de toutes familles et de toutes les parties du monde.
Entre 1970 et 2003, cet indice général de biodiversité a diminué de 30 %.
Cette donnée générale est décomposée en 3 sous-divisions représentatives de l’évolution de la biodiversité dans les milieux terrestre, marin et d’eau douce.
La convergence de l’érosion de la biodiversité pour chacun de ces indices est frappante :
- 31 % pour les espèces terrestres,
- 27 % pour les espèces marines,
- 28 % pour les espèces d’eau douce.
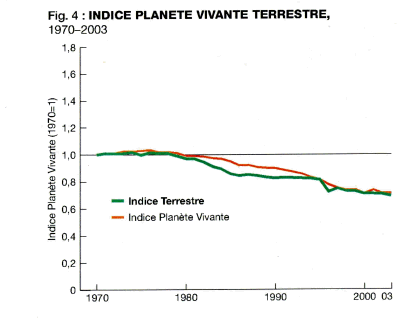
Source : WWF
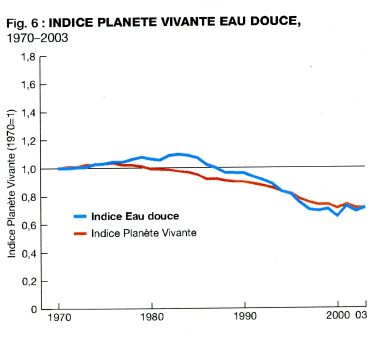
Source : WWF
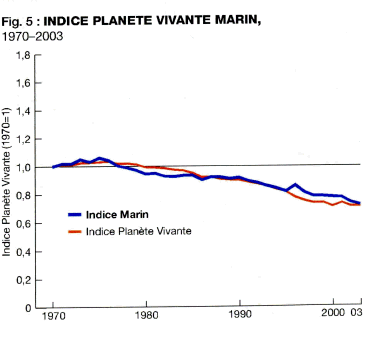
Source : WWF
MAIS CERTAINS TYPES D’ÉCOSYSTÈMES SONT PLUS TOUCHÉS
Une localisation géographique inégale de l’érosion de la biodiversité
La biodiversité n’est pas également répartie sur la planète. Par exemple, les forêts tropicales qui ne constituent que 7 % de surface émergée représentent 50 % de la biodiversité faunistique et floristique de la Terre. L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) identifie (en rouge sur le planisphère ci-après) les points chauds de la biodiversité planétaire terrestre.
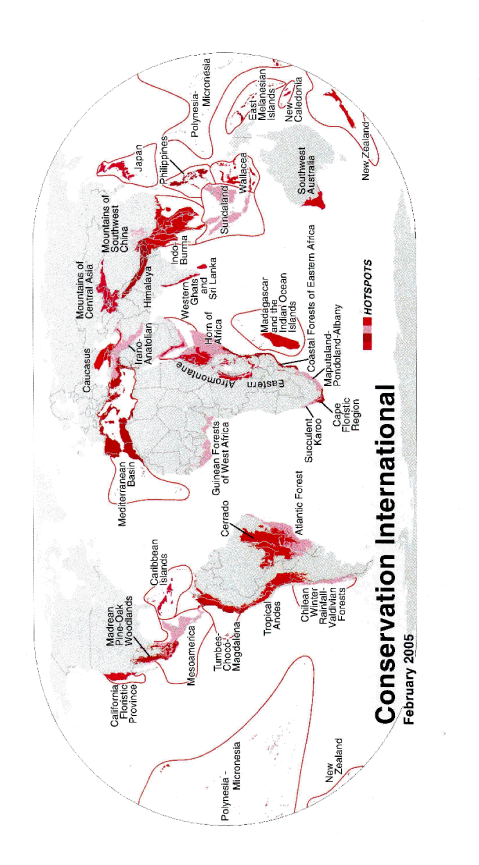
Source : Conservation International
Or, ces points chauds de la biodiversité planétaire sont ceux qui subissent les pertes les plus fortes.
A titre d’illustration, l’indice précité du WWF sur l’érosion de la biodiversité terrestre indiquait une perte moyenne de 31 % sur l’ensemble de la planète, mais cet indice d’affaiblissement atteint 64 % dans les régions tropicales et est encore supérieur dans le domaine géographique Inde-Malaisie de l’Asie du Sud-est :
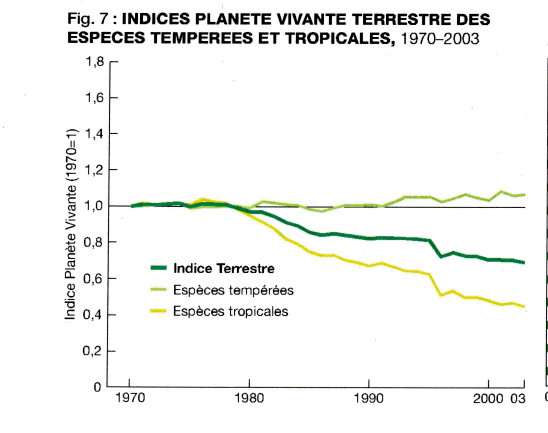
Source : WWF
De même, si on reprend l’indice marin du WWF, sa perte moyenne n’est que de 27 %, mais elle atteint 60 % pour la zone océan Indien/Sud-est asiatique :
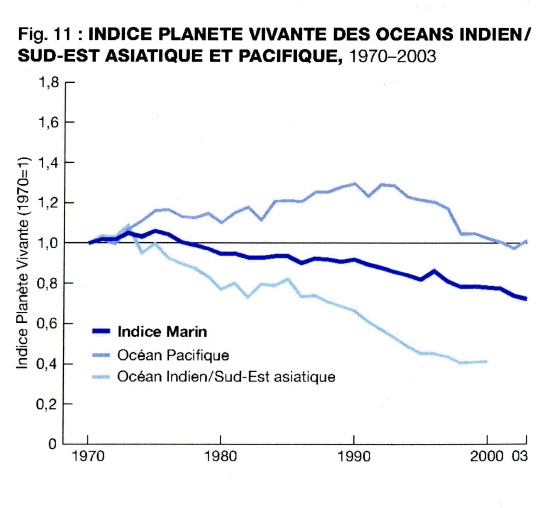
Source : WWF
Des biotopes sont plus particulièrement menacés
- La perte de biodiversité dans les milieux humides et des eaux continentales a atteint 37 % entre 1970 et 2000,
- les biotopes marins et côtiers sont très affectés :
¬ 60 % des coraux sont exposés à l’activité humaine et 20 % ont disparu en trente ans,
¬ depuis 10 ans, le quart des mangroves d’Asie et près de la moitié des mangroves d’Amérique latine ont disparu,
¬ l’interdiction de la pêche à la morue dans les eaux canadiennes en 1992 n’a pas permis de reconstituer le gisement8,
¬ en 40 ans, la surface de la Mer d’Aral est passée de 66 000 km² à 16 000 km².
- Les milieux forestiers sont très touchés :
¬ même si la situation est stabilisée, les forêts méditerranéennes, qui sont un des points chauds de la biodiversité mondiale, avaient perdu 70 % de leur habitat initial en 1950,
¬ la réduction du périmètre des forêts tropicales sèches se poursuit (Madagascar, Mata Atlantica brésilienne dont il ne reste plus que 7 à 10 %),
¬ la déforestation des forêts tropicales humides (Afrique, Asie, Amérique du Sud) se poursuit au rythme de 13 millions d’hectares par an9 alors que ce milieu héberge 50 % de la flore mondiale.
La carte ci-dessous montre (en rouge) les pertes à venir dans la plus grande forêt du monde, l’Amazonie, si la tendance constatée jusqu’en 2000 se poursuivait jusqu’en 2050 :
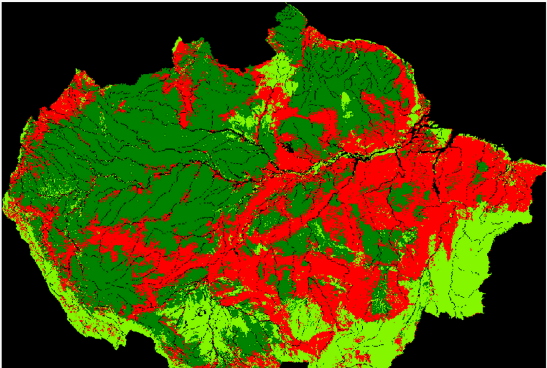
Source : WWF
• La biodiversité des pays développés, déjà très anthropisée, continue à être atteinte :
¬ les eaux continentales subissent le contrecoup d’usages excessifs de polluants et des usages de l’eau pour l’agriculture ; ces ressauts de consommation excèdent les possibilités normales d’adaptation des espèces aquatiques aux variations des cycles hydrologiques,
¬ l’Union européenne a établi que, hors les zones protégées par les directives « Natura 2000 », les pertes de biodiversité de la faune aviaire pouvaient atteindre 70 % pour certaines espèces10 ; aux Etats-Unis, les pertes de biodiversité sur les vingt espèces d’oiseaux les plus répandues atteignent 50 %.
¬ l’appauvrissement du sol, et donc de la biodiversité associée, s’accentue. En trente ans, la Beauce a perdu plus de 30 % des composés organiques de son sol,
¬ en France, de 3 à 5 espèces de céréales couvrent les besoins en protéines végétales contre plusieurs dizaines avant 1939 ; de même, sur la même période, 750 espèces animales domestiques ont disparu,
¬ l’accroissement de l’utilisation de l’eau par l’agriculture produit :
- des phénomènes de ruissellement qui augmentent la turbidité des eaux continentales,
- et un développement de la salinité des estuaires qui menace les écosystèmes côtiers,
¬ enfin, on constate, à la suite du développement des normes d’hygiène, que la biodiversité des bactéries lactiques utilisées dans la fabrication du fromage a diminué de plus de 30 % en vingt ans.
*
* *
L’ACCROISSEMENT DES PRESSIONS TRADITIONNELLES
Le bilan qui précède n’est pas étonnant si l’on considère qu’entre 1960 et 2000 :
- la population mondiale a doublé,
- la production agricole a été multipliée par 2,5,
- l’usage de l’eau pour l’agriculture a doublé,
- la coupe de bois pour la production de pâte à papier a triplé,
- la capacité hydroélectrique installée a doublé,
- 35 % des superficies de mangrove ont disparu,
- la qualité d’eau piégée derrière des digues ou barrages a quadruplé et il y a de trois à six fois plus d’eau dans ces barrages que dans les fleuves.
- les quantités de prise d’eau dans les fleuves et les lacs ont doublé. Près de 70 % de cette eau sont utilisés pour les besoins agricoles.
- les écoulements d’azote biologiquement réactifs dans les écosystèmes terrestres ont doublé. Les flux de phosphore ont triplé.
La poursuite de la croissance de la population mondiale d’ici 2050 et la perspective d’une multiplication du PIB mondial par un facteur de 2 à 4 ne peuvent qu’amplifier les pressions portant sur la biodiversité de la planète.
LA RECHERCHE D’UN INDICE GLOBAL D’ATTEINTE À LA BIODIVERSITÉ
Un des problèmes d’étude de la biodiversité est lié à la mesure de son état puisque souvent – et uniquement pour la part de la biodiversité que l’on connaît – l’on est contraint de mesurer son évolution à l’aide d’espèces anciennes puis de juxtaposer ces mesures dans un « catalogue » par milieux (marin, terrestre, etc.).
Compte tenu du caractère planétaire du problème, il est donc nécessaire de bâtir des indices plus synthétiques mesurant le degré de gravité des pressions qui s’exercent sur la biodiversité.
La notion d’empreinte écologique dégagée par le WWF peut y contribuer.
Partant de l’idée que la biodiversité est affectée lorsque la production de la biosphère n’arrive plus à suivre la consommation humaine et les déchets qu’elle produit, l’empreinte écologique mesure en surface de terre et d’eau le niveau nécessaire pour fournir les ressources écologiques en biens et services utilisés annuellement par l’humanité (nourriture, bois, terrains, surfaces de forêt absorbant le CO2, etc.).
Il est difficile de se prononcer sur la pertinence de cet indice, mais ce qui est intéressant, c’est sa tendance sur une trentaine d’années.
La situation se dégrade :
- depuis 1990, l’empreinte écologique de l’humanité dépasse les capacités de reconstitution de la biosphère,
- en 2003, cette empreinte a dépassé la biocapacité de la Terre de 25 %,
- un scénario de simple poursuite de cette tendance suggère qu’en 2050 la demande de l’humanité sera deux fois plus forte que la capacité productive de la biosphère.
En d’autres termes, l’homme a commencé à vivre sur son capital et à transformer la ressource en déchets plus vite que la biosphère ne peut transformer ses déchets en ressource.
Cette surutilisation des ressources de la biosphère se manifeste par le maintien à un niveau élevé des pressions de prédation et de croissance d’occupation des habitats mais aussi par l’accélération de l’introduction d’espèces invasives du fait de la mondialisation.
La pêche industrielle conduit à la surexploitation des espèces halieutiques et à la destruction des écosystèmes marins.
L’impact de la pêche industrielle, mesurée par la biomasse des prises, s’est renforcé à compter des années 50 :
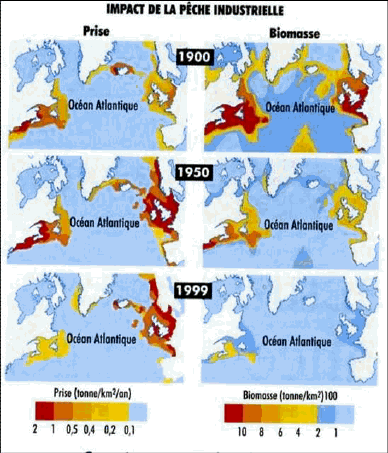
Source : MNHN, Guy Boucher
L’exemple précité de la morue au large des côtes canadiennes n’est pas isolé. La surexploitation a conduit à des tensions sur les capacités de renouvellement des stocks et à des perturbations profondes dans des écosystèmes océaniques.
Le dernier rapport (septembre 2006) publié par la FAO montre que, sur les 600 espèces halieutiques étudiées :
- 52 % sont pleinement exploitées tandis que 25 % sont soit surexploitées11 (17 %), soit en voie de reconstitution (1 %),
- et que sept des dix espèces de poissons les plus pêchés sont surexploitées.
Dans ces conditions, l’article publié en novembre 2006 dans Science par Boris Worm et 13 coauteurs12 a pu, à juste titre, prévoir la fin de la pêche océanique en 2048, en extrapolant les tendances actuelles - c’est-à-dire si aucune mesure de redressement n’est prise.
Ce qui reviendrait à ôter à l’humanité une source de protéines animales capitale, correspondant aux 85-90 millions de tonnes pêchées annuellement.
Mais cette pression de pêche a également des effets indirects désastreux :
- elle se traduit par l’importance des prises connexes rejetées à la mer qui est de l’ordre du tiers des prises utiles – qui peut atteindre jusqu’à 80 % de la biomasse pêchée (pour la pêche à la crevette en eaux tropicales),
- elle détruit les fonds par un chalutage meurtrier (plus de 30 % des pêches s’effectuent par chalutage sur les fonds et dans certaines zones de la mer du Nord, certains fonds sont raclés deux fois par an),
- du fait du plafonnement des prises habituellement pêchées, la pêche industrielle s’est attaquée aux espèces vivant sur les talus du plateau continental, à des profondeurs situées entre 300 et 700 m13. Cette pêche est relativement récente : le rapport publié en 2003 par l’Académie des sciences sur « Exploitation et surexploitation des ressources marines vivantes » note, par exemple, que la chasse à l’empereur en Atlantique Nord-est n’a commencé qu’en 1993.
Elle s’apparente à l’exploitation jusqu’à épuisement d’un gisement de pétrole. Car elle détruit les équilibres de renouvellement des écosystèmes des fonds moyens qui reposent sur des systèmes beaucoup plus longs que ceux de surface : la durée de vie de l’empereur est de 125 ans, et sa maturité sexuelle est tardive. La durée de vie du capitaine est de l’ordre de 60 ans. On est loin du cycle du hareng ou de l’anchois.
La pression de pêche peut également revêtir des formes très choquantes, comme celle qui consiste à capturer les requins, à découper leurs ailerons et à les rejeter à la mer.
Le développement de l’aquaculture en milieu ouvert
Indirectement, le plafonnement des prises depuis 20 ans et l’accroissement de la demande en produits marins a eu comme conséquence le développement rapide des aquacultures marines en milieu ouvert.
En 1980, 9 % de l’aquaculture fournissant des poissons étaient consommés par l’humanité. Aujourd’hui, ce pourcentage atteint 45 %, étant précisé que l’aquaculture d’eau douce, notamment en Chine, demeure encore prédominante.
Or, le développement de l’aquaculture en milieu marin ouvert a des conséquences de plus en plus préoccupantes :
- le nourrissage des poissons carnassiers s’effectue majoritairement à l’aide d’huiles ou de farines de poissons. Rappelons que les pêches minotières représentent un peu moins du quart des prises annuelles (22 millions de tonnes sur 90 millions de tonnes). Antérieurement, les huiles et farines issues de ces pêches étaient très majoritairement utilisées dans les élevages, principalement avicoles ; aujourd’hui 53 % de l’offre de farine et 87 % de l’offre de l’huile sont destinées à l’aquaculture. Ces farines sont généralement produites à l’aide de prélèvements massifs d’alevins,
- le fermage, comme celui du thon en Méditerranée, est assis sur le prélèvement de juvéniles qui n’ont pas le temps de se reproduire,
- les effluents naturels de ces élevages polluent très fortement les milieux naturels. Dans le monde, le phosphate ne représente que 0,1 % en moyenne des pollutions des estuaires en milieu marin ; en Norvège, principal producteur mondial de saumons aquacoles avec le Chili, ce pourcentage est de 55 %,
- afin d’éviter la transmission de maladies, les élevages sont traités à l’aide de doses massives d’antibiotiques et de fongicides qui ne peuvent pas être sans effets sur les milieux naturels ambiants,
- enfin, on estime de 600 000 à 2 millions par an (soit entre le tiers et la totalité des effectifs de saumons sauvages de l’Atlantique Nord) le nombre de saumons qui s’évadent des élevages de la façade atlantique et qui peuvent être un facteur de modification génétique des espèces sauvages et un vecteur de transmission de parasites (comme le pou de mer) qui prolifèrent dans les élevages.
L’exploitation forestière non contrôlée s’accélère du fait de la hausse de la demande mondiale
Les forêts denses humides sont inégalement réparties dans le monde :
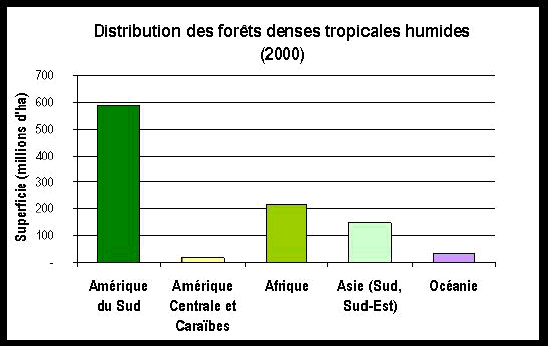
Source : CIRAD, Robert NASI
Elles hébergent une très grande biodiversité floristique (de 100 à 200 espèces à l’hectare en Amazonie brésilienne et jusqu’à 300 espèces à l’hectare en Equateur, contre 20 espèces à l’hectare dans les forêts européennes) et faunistique (80 % des insectes, 84 % des reptiles, 91 % des amphibiens et 90 % des primates).
Ces forêts sont très menacées par la hausse de la demande mondiale et l’organisation du marché.
Une demande en hausse satisfaite en partie par des coupes illégales
La production annuelle de bois de coupe s’élève à 3 milliards de m3 dont environ 60 % de bois d’œuvre et 40 % de bois de chauffe (mais 80 % des coupes en forêts tropicales et équatoriales sont utilisées comme bois de chauffe14).
La déforestation annuelle atteint 13 millions d’hectares par an, soit 28 hectares par minute ou, annuellement, la surface de la Grèce.
Cette offre est appelée à subir une pression de demande croissante de la part des pays émergents : par exemple, de 1995 à 2005, les importations de bois de la Chine, ont triplé en volume15. Il est à noter que la Chine, qui ne représente que 7 % des importations mondiales, représente 40 % des importations du bois de zones à haut risque pour l’illégalité des coupes, comme la Malaisie ou l’Indonésie, et qu’elle commence à importer du bois des marchés africains et sud-américains.
Le danger qui en résulte est bien résumé par les estimations ci-après des coupes illégales suivant les pays :
Estimation des coupes illégales | ||
Pays |
Coupes illégales |
Source |
Afrique | ||
Bénin |
80 |
SGS, 2002 |
Cameroun |
50 |
Commission européenne, 2004 |
Ghana |
Au moins 66 |
Birikorang, G. 2003 |
Mozambique |
50-70 |
Del Gatto, 2003 |
Asie | ||
Cambodge |
90 |
Global Witness, 1999 |
Indonesie |
Jusqu’à 66 % 73-88 |
World Bank 2006a, Schroeder-Wildberg and Carius, 2003 |
Malaisie |
Jusqu’à 33 |
Dudley, Jeanrenaud et Sullivan, 1995 |
Amérique latine | ||
Bolivie |
80 |
Contreras-Hermosilla, 2001 |
Colombie |
42 |
Contreras-Hermosilla, 2001 |
Equateur |
70 |
Thiel, 2004 |
Honduras |
75-85 de bois de coupe 30-50 de bois de chauffe |
Richards et al, 2003 |
Nicaragua |
40-45 |
Richards et al, 2003 |
Source : OCDE
Selon une étude de la Banque mondiale de 2002, le commerce de bois illégal atteindrait 23 milliards de $ et causerait des pertes estimées à 15 milliards de $ aux pays qui en sont victimes.
Un équilibre de marché qui aboutit à des aberrations
L’absence de régulation et de transparence du marché des bois tropicaux et équatoriaux encourage la déforestation sauvage et décourage l’exploitation durable.
Puisque la progression de la demande est assurée par des fournitures parallèles provenant de coupes illégales, il n’y a pas de frein économique à la poussée de la déforestation.
Avec une double conséquence :
- comme la forêt vaut peu (au Brésil, 1 m3 de grumes coûte 1 $), il n’y a pas d’intérêt économique à la conserver,
- et, comme la ressource semble abondante, il n’existe aucun intérêt à mener une exploitation rationalisée. A titre d’illustration, seulement de 15 % à 20 % du volume des bois tropicaux abattus sont utilisés, alors que les experts admettent que l’on pourrait porter ce pourcentage à 40-50 % suivant les espèces et les milieux de coupes (cf. Deuxième Partie).
Ajoutons, pour conclure sur ce point, qu’émerge un phénomène pervers de contournement de protection de la biodiversité : certains pays émergents protègent leurs essences mais recourent à des importations plus ou moins légales qui proviennent de points chauds de la biodiversité.
LES PRESSIONS D’ANTHROPISATION DES ESPACES
Cette anthropisation des espaces peut comporter des inconvénients d’un degré de gravité divers, de l’occupation simple à la destruction.
Celle-ci peut résulter soit de l’urbanisation, soit de l’implantation d’équipements qui minéralisent les sols ou facilitent la pénétration en milieux sauvages.
A titre d’illustration :
¬ près de 100 hectares par jour de milieux naturels sont détruits en Allemagne du fait de l’implantation d’habitations et d’équipements,
¬ au Brésil, la construction d’une route en milieu forestier intact aboutit peu à peu à la destruction de la biodiversité du milieu, jusqu’à 50 km de part et d’autre de cette route (évaluation WWF). Dans ce domaine, l’action d’équipement de la Banque mondiale en routes et barrages hydroélectriques – qui est par ailleurs bénéfique – a été, dans les années soixante-dix, un des vecteurs privilégiés de l’anthropisation et donc de la destruction de la biodiversité.
Cette pression d’occupation d’espaces naturels est très menaçante à terme, surtout si l’on considère l’expansion urbaine dans les pays en voie de développement et l’envol à venir des taux d’équipements automobiles (et donc des besoins en équipements routiers).
Mais les effets négatifs de cette emprise sur les espaces naturels ne se limitent pas aux destructions d’habitats ; ils ont aussi pour résultat de cloisonner et d’isoler les écosystèmes, ce qui constitue généralement un préalable à leur disparition.
Cette destruction prend des proportions inquiétantes lorsqu’il s’agit de substituer des cultures ou de l’élevage à la forêt. Le temps des essartages progressifs du Moyen-âge est passé et la grande agriculture industrielle a contribué à détruire en quelques décennies des surfaces supérieures à celle de la France ; c’est le cas de la culture du soja dans le Cerrado brésilien.
Mais cette destruction ne se limite pas nécessairement à une substitution totale du milieu anthropisé à un milieu sauvage, elle peut aussi avoir des conséquences directes sur les espaces environnants :
- la creveticulture en Thaïlande a été la cause directe de destruction de 50 % des mangroves de ce pays ;
- l’exploitation minière :
▪ Les sables bitumineux en Alberta :

A l’heure où s’annonce la pénurie des énergies fossiles conventionnelles, l’utilisation de nouveaux gisements d’hydrocarbures se développe.
Ces gisements promettent des réserves équivalant aux gisements d’Arabie saoudite.
Mais l’exploitation de ces ressources en milieu sensible, celui de la forêt boréale, pose avec brutalité la question de la préservation de l’environnement.
En effet, à la différence de l’exploitation du pétrole traditionnel par des forages, l’extraction des sables bitumineux se fait aujourd’hui par des techniques de carrières classiques.
Après destruction de la forêt boréale, puis décapage du sol végétal, commence l’exploitation des sables par la création de carrières gigantesques.
Sur des centaines de kilomètres carrés, la forêt est détruite, durablement, car sa reconstitution, lente, exigera plus d’un siècle.
A la destruction de la forêt boréale s’ajoute le risque de pollution massive d’un des grands fleuves de l’ouest américain, l’Athabaska, dont les gorges, somptueuses, sont situées à quelques centaines de mètres de lacs artificiels d’eau polluée.
▪ L’exploitation minière dans les DOM-TOM français :
o Les territoires ultramarins de la France en font une des nations les plus riches en biodiversité. Malheureusement notre pays, qui essaie de fédérer les efforts de respect de la biodiversité à l’échelon mondial, prend assez peu garde à la protection de celle qu’elle héberge sur son territoire.
On en donnera deux illustrations :
o L’exploitation du nickel en Nouvelle-Calédonie :
La Nouvelle-Calédonie recèle une des flores endémiques les plus riches du monde et héberge des récifs coralliens uniques.
Cette flore endémique est caractérisée par l’existence de communautés de plantes peu nombreuses et fixées sur des aires de répartition très étroites, donc très vulnérables.
Actuellement, 250 espèces sont menacées par l’extension des mines de nickel dont les remblais stériles sont simplement rejetés à côté de l’exploitation ; le ruissellement aidant, ces rejets sont également la source d’une hypersédimentation qui porte atteinte aux récifs coralliens.
o L’orpaillage en Guyane :
Le parc de Guyane, créé en février 2007, se compose de deux types d’espaces : une zone « cœur » et une zone dite d’« adhésion » où sont autorisées les activités industrielles et, par voie de conséquence, l’orpaillage. Ce parc héberge 2500 habitants mais 10 000 orpailleurs, dont 9 000 il-légaux. La Guyane est, dans ce domaine, une zone de non-droit.
Non seulement les enquêtes publiques exigées par la loi pour les autorisations d’exploitation (PEX) ne sont pas menées préalablement à l’attribution de permis mais, par surcroît, les exploitations illégales se multiplient.

A l’occasion d’un vol de 100 km au-dessus de la forêt guyanaise, un de vos rapporteurs a dénombré plus d’une dizaine de zones d’exploitation aurifères dont aucune n’était légale.
L’orpaillage non seulement dévaste les espaces forestiers, mais il détruit les lieux de cultures indiennes, épand du mercure dans le fleuve16 et en augmente fortement la turbidité, ce qui trouble les systèmes piscicoles.
Avec un bénéfice économique et social qui reste à mesurer car une grande partie de l’or est évacuée clandestinement vers le Surinam ou le Brésil…
L’ACCROISSEMENT DES ÉCHANGES INTERNATIONAUX RENFORCE LES INVASIONS BIOLOGIQUES
Un phénomène qui n’est pas récent
Qu’elles soient spontanées ou consécutives à l’intervention humaine, les invasions biologiques sont une des causes importantes de réduction de la biodiversité.
Ces invasions ne sont pas récentes et l’homme en a souvent été le principal responsable.
Entre 1600 et aujourd’hui, plusieurs études convergentes montrent que ces introductions d’espèces par l’homme sont à l’origine de l’extinction documentée de :
- 90 % des 30 espèces de reptiles et d’amphibiens disparus,
- 93 % des 176 espèces ou sous-espèces d’oiseaux (particulièrement en milieu insulaire),
- et de 81 % des 65 espèces de mammifères disparus.
Une étude menée en 2005 par des chercheurs de l’INRA montre que le taux séculaire d’invasions de vertébrés en France depuis le début de l’holocène (fin de la dernière glaciation), très faible jusqu’en 1600 – s’est accéléré au cours du XXème siècle.

Source : INRA Rennes
L’amplification du fait de la croissance des échanges maritimes et aériens
Ce mouvement est actuellement amplifié par le développement du commerce international, maritime et aérien.
En particulier, les déballastages maritimes sont porteurs d’invasions biologiques qui peuvent complètement bouleverser les écosystèmes :
- la moule zébrée et la moule quagga (originaires du bassin du Dniepr), introduites dans les Grands lacs américains, étouffent les espèces locales, entrent en concurrence alimentaire avec d’autres éléments du biotope, et favorisent les développements des algues bleues-vertes toxiques, qu’elles rejettent, alors qu’elles se nourrissent d’autres algues dont le développement inhibait celui de ces algues toxiques ;
- dans la Manche, les crépidules apportées, en 1944, par les péniches de débarquement, prolifèrent ;
- dans le même milieu, le mille-feuille d’eau eurasien et la lentisque de Floride ont pratiquement supprimé les plantes aquatiques autochtones ;
- toujours dans les Grands lacs, la lamproie de mer introduite dans ce milieu à partir de 1920 a failli détruire la truite autochtone,
- dans la mer Baltique, la puce d’eau, originaire de la mer Caspienne, se nourrit de zooplancton au détriment des alevins de sprat et de hareng,
- enfin, on relèvera qu’une espèce continentale de cormoran a récemment immigré vers l’Europe à partir de l’Est du bloc continental européen et menace une partie de la diversité piscicole européenne (anguilles, saumons sauvages, etc.), on évalue leur nombre en Europe à un million de couples. Mais cette espèce est protégée par la Directive « oiseaux » de l’Union européenne qu’il conviendrait de modifier sur ce point.
Les invasions biologiques imputables au développement du trafic aérien portent plutôt sur les insectes, comme l’introduction récente en Europe du frelon asiatique, contre lequel les abeilles autochtones ne peuvent pas lutter.
LA NOUVELLE MENACE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Sur des échelles de temps longues, le changement climatique, qui isole les espèces et leur permet de diverger est plutôt favorable à l’enrichissement de la biodiversité17.
Mais, à l’échelle de quelques décennies, l’évolution climatique, dont les premières conséquences sont détaillées en seconde partie de ce rapport, pose des questions préoccupantes :
- sur son intensité (une augmentation moyenne de la température de 1° C à 3° C à l’horizon 2050 recouvre des variations locales de température beaucoup plus fortes),
- sur la localisation de ses effets sur l’hydrosphère. Par exemple, si beaucoup de modèles prévoient un stress hydrique sur la zone méditerranéenne et subméditerranéenne, les zones prévisionnelles d’impact de ce stress varient de 10° de latitude (c’est-à-dire la distance de Paris à Madrid).
- sur ses effets sur les sols : en 2050 on prévoit des réductions d’humidité du sol pouvant aller jusqu’à 50 % :
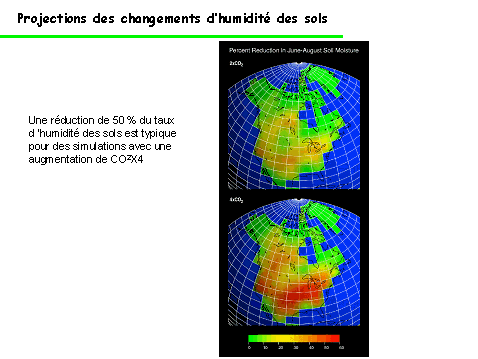
Source : Serge Morand, CNRS
- sur l’accélération des effets de ce changement cumulés avec ceux de l’anthropisation (conjugaison du changement climatique et de l’arrivée d’espèces invasives ; conjugaison du changement climatique et des fragmentations d’espaces qui limitent les migrations),
- sur les capacités d’adaptation non seulement des espèces, mais également des écosystèmes symbiotiques dans lesquels elles vivent,
- sur les temps de réaction des écosystèmes au changement. Les possibilités d’évolution des organismes à cycle rapide de reproduction (exemple : les drosophiles, dont des études ont constaté qu’elles s’adaptent au réchauffement) ne sont pas les mêmes que les massifs forestiers dont la durée de réaction relève de plusieurs décennies, voire de plusieurs siècles.
La mesure des effets concrets, déjà constatés, de ce changement climatique, sera détaillée en seconde partie de ce rapport, mais relevons simplement, pour donner une idée de l’échelle des problèmes, que les 6°C de température moyenne supplémentaire que certaines modélisations envisagent pour la fin du siècle nous renverraient au climat du crétacé, au temps où les dinosaures prospéraient…
L’ACQUISITION ET LA GESTION DES CONNAISSANCES SUR LA BIODIVERSITÉ
L’élargissement des connaissances dans la sphère du vivant et de l’accroissement des menaces qui pèsent sur la biodiversité, source de ces connaissances, implique que ce domaine de recherches fasse l’objet d’une priorité.
L’amélioration du rythme d’identification des espèces, de leur génomique et des relations au sein des écosystèmes est une urgence.
Cette urgence est d’autant plus patente pour notre pays qu’il a une responsabilité particulière vis-à-vis de l’ensemble de ses territoires ultramarins (deuxième domaine maritime mondial, endémisme de la Nouvelle-Calédonie et de La Réunion, récifs coralliens du domaine Pacifique, richesse floristique et faunistique de la Guyane).
Mais cette priorité de recherche ne pourra être mise en œuvre que si elle respecte les particularités de l’acquisition du savoir dans le domaine de la biodiversité et que l’on en améliore la gestion des connaissances.
LES CONTRAINTES DE L’ACQUISITION DES CONNAISSANCES DANS LE DOMAINE DE LA BIODIVERSITÉ
La multilocalisation de la recherche
Par définition, les recherches sur la biodiversité ne sont pas cantonnées. Elles s’effectuent sur toute la planète. Ce qui signifie qu’une gestion efficace de l’acquisition des connaissances devrait être coopérative pour éviter les redondances.
Il est donc essentiel que ces recherches puissent être coordonnées à l’échelon mondial.
D’où l’urgence de la mise en place de deux institutions internationales :
¬ le réseau IMOSEB qui doit être le pendant, pour la biodiversité, de ce qu’est le GIEC pour la surveillance du climat,
¬ et une organisation des Nations-unies dédiée à l’environnement et au développement durable qui jouerait, entre autres, le rôle d’une agence de moyens pour coordonner les recherches sur la biodiversité.
On rappellera sur ce point que la structuration des organismes internationaux est devenue cahotique et n’est plus tenable compte tenu des enjeux liés à la préservation de la biodiversité : il existe plus de 500 accords multilatéraux sur l’environnement gérés de façon non coordonnée par une multitude d’organismes internationaux : le PNUE, la FAO, le PNUD, la Banque mondiale, l’OCDE, l’UNESCO, etc.
Mais cette cohérence de la recherche à l’échelon mondial devrait pouvoir être déclinée à l’échelon régional. Un renforcement de la coordination des initiatives européennes déjà actives dans le domaine de l’acquisition des connaissances est, par exemple, nécessaire.
Une des caractéristiques des recherches sur la biodiversité est qu’une partie d’entre elles ne peut s’effectuer que sur des temps longs.
Observer l’évolution naturelle ou forcée d’un écosystème introduit des temps expérimentaux qui peuvent être de l’ordre de la décennie ou plus.
Il est donc essentiel que les procédures d’aides à la recherche dans ce domaine puissent prendre en considération ce facteur.
A titre d’illustration, les contrats actuels de l’ANR, dont la durée ne dépasse pas trois ans, ne sont pas adaptés à la spécificité du secteur.
MAINTENIR LES MODES TRADITIONNELS D’EXPLORATION DE LA BIODIVERSITÉ ET FAIRE APPEL À DES MOYENS NOUVEAUX
Les modes traditionnels d’exploration
L’exploration naturaliste de la biodiversité doit être poursuivie.
Et à cet égard, il convient d’insister sur deux points :
• La structuration des réseaux d’observation bénévoles (papillons, flores, faunes avicoles18) est doublement importante : elle apporte une dimension quantitative indispensable et elle encourage une forme d’approche « à la base » des milieux naturels qui est une des conditions de leur appropriation et donc de leur protection.
• Le renouveau de la taxonomie traditionnelle : les disciplines « naturalistes » traditionnelles, botanique et zoologie, sont en voie de régression depuis la montée de la biologie moléculaire à la fin des années soixante-dix.
On ne forme plus assez de taxonomistes (sauf au titre d’une action sur les disciplines en voie de disparition !). Cette érosion disciplinaire n’est pas le seul fait de la France. Par exemple, au Muséum à Londres, la section consacrée aux insectes regroupe 5 chercheurs qui ont 150 ans d’expérience cumulés et pas de successeurs.
Or, le maintien à un niveau raisonnable du recrutement de ces spécialistes demeure une des conditions de l’amélioration de la connaissance de la biodiversité des milieux vivants.
Pour deux raisons.
D’une part, parce qu’il existe encore un champ de découvertes sur les espèces vivantes. Et, d’autre part, parce que la compréhension des écosystèmes dépend, en partie, du savoir sur les espèces qui les composent.
Mettre en œuvre des moyens d’investigation et d’analyse nouveaux
La course « à la connaissance » qui caractérise l’exploration de la diversité du vivant et qui a pour résultat que les espèces disparaissent plus vite qu’on n’arrive à les identifier implique de développer de nouveaux instruments d’investigation et d’analyse.
La création d’indices liés à la biodiversité
Si l’unité de base permettant de mesurer le changement climatique est la tonne de CO2, la mesure de l’évolution de la biodiversité est plus complexe.
Toutefois, une série de progrès ont été accomplis dans ce domaine. Par exemple :
- les indices avicoles : entre autres, l’indice des oiseaux liés à l’agriculture (Farmland Birds Index) permet de mesurer l’impact des pratiques agricoles sur la faune sauvage ;
- dans les milieux aquatiques continentaux – dont la « bonne qualité écologique » en 2015 est un des objectifs de l’Union européenne -, toute une série d’indices biologiques permettent de compléter les mesures chimiques en nitrates et en métaux lourds.
L’unité de recherche de l’INRA de Rennes, « Ecobiologie et qualité des hydrosystèmes continentaux » travaille sur des biomarqueurs représentatifs de la qualité écologique de l’eau :
- indice biologique global qui résulte de prélèvements sur les communautés de micro-vertébrés dans 8 microhabitats différents (sable, gravières, mousse, etc.) ;
- indice biologique macrophytique en rivière, qui repose sur l’analyse des communautés ou végétaux de grande taille, et qui permet notamment de suivre sur un cours d’eau les différentes zones d’apport de matériaux organiques (nitrates, phosphates) ;
- indice biologique diatomique assis sur l’étude de l’état de 209 taxons, qui permet d’évaluer la polluosensibilité des micro-organismes aquatiques ;
- indice poisson-rivière qui mesure l’écart entre la composition du peuplement sur une station donnée et le peuplement en situation de référence (peu ou pas modifié par l’homme). Cet indice permet d’avoir un aperçu d’ensemble sur la situation piscicole des cours d’eau français19.
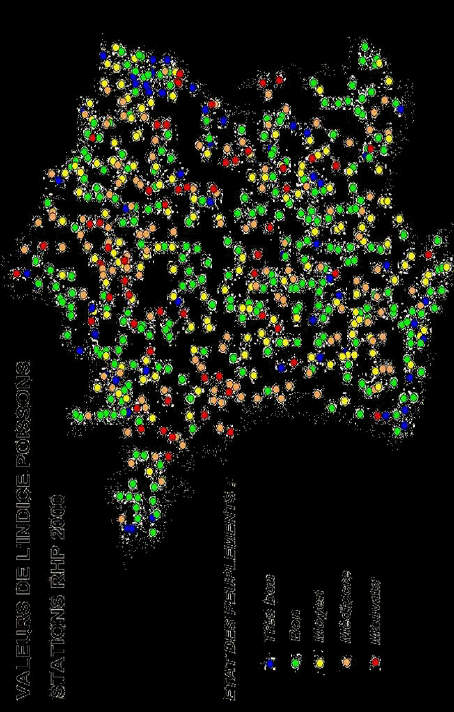
Source : INRA Rennes
Le développement de concepts de classification nouveaux :
La classification traditionnelle des espèces, fondée sur des critères morphologiques et physiologiques, est nécessaire mais elle n’informe qu’imparfaitement sur la place de ces espèces dans les écosystèmes.
S’impose donc la recherche de nouveaux concepts de classification qui reposent sur les relations phylogénétiques d’une espèce, sur leurs relations fonctionnelles avec le milieu et sur leur signification écologique.
Cela peut supposer de changer les démarches d’inventaire et, par exemple, d’effectuer simultanément les inventaires forestiers et botaniques, ou fauniques et floristiques dans un biotope donné.
Cela peut également impliquer que l’on n’identifie plus complètement les espèces mais uniquement de façon rudimentaire – en particulier afin de déterminer combien d’espèces cohabitent dans un écosystème pour disposer d’un aperçu de l’organisation fonctionnelle de cet écosystème.
En fonction des atteintes portées aux milieux et aux incertitudes sur les conséquences du changement climatique, il devient important de faire des recherches sur les dynamiques de populations en situation de forçage climatique et anthropique. Comme en matière d’étude du climat, ces scénarios devront être assis sur la modélisation du passé et rectifiés en fonction du retour d’expérience20.
GÉNÉRALISER L’USAGE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
L’utilisation à grande échelle des nouvelles technologies d’information
Le filet à papillons du naturaliste conserve son utilité mais d’autres méthodes peuvent être employées pour différencier les écosystèmes sur des surfaces importantes, en particulier dans des milieux peu accessibles.
A titre d’illustration, l’IRD emploie un faisceau de technologies en forêt guyanaise :
- le satellite parle peu (un pixel sur une photo de la Guyane correspond à 1 km²), mais permet, grâce aux différences de densité de réflection, de pointer des phénomènes de changement d’écosystèmes à grande échelle,
- la télédétection (sur photos aériennes) permet d’évaluer ce qu’on appelle la rugosité de la canopée (c’est-à-dire la taille de la couvrance des arbres). Recoupée avec des observations au sol, c’est un facteur d’identification de zones de biodiversité différentes,
- l’altimétrie laser permet d’évaluer (grâce à la densité de rayons qui atteignent le sol) le relief de ce sol et la densité de la végétation.
Les méthodes de systématique intégrante
En milieu tropical, au fur et à mesure que les échelles diminuent, la biodiversité augmente :
- sur une surface de 12 000 km², on trouve par sondage de 50 à 2 400 espèces,
- en Guyane (84 000 km²), on dénombre de 1 300 à 1 500 espèces,
- dans des sous-blocs d’un hectare en Guyana, on trouve de 140 à 200 espèces21 (80 espèces d’arbres de toute l’Europe),
- entre deux sous-blocs d’un hectare contigus, la moitié des espèces diffèrent,
- dans une même espèce, on estime qu’une diversité génétique intraspécifique pouvant atteindre 30 % du génome s’établit à partir d’une distance de 150 mètres.
En d’autres termes, plus on se rapproche, plus la biodiversité se multiplie et se complexifie.
Or, ces difficultés de changement d’échelle sont accrues par ce qu’on appelle le « verrou floristique » qui multiplie les difficultés d’identification des espèces :
- les changements morphologiques (développement des feuilles, floraison, croissance des fruits) qui ne correspondent pas nécessairement au moment de l’exploration font que la flore de base est encore mal connue.
- les espèces connues sont mal décrites :
- du fait de l’hybridation, les limites entre les espèces ne sont pas très nettes,
- la plupart des espèces sont rares et donc les échantillons de référence sont peu nombreux,
- seuls 2 % des échantillons collectés sont fertiles.
Compte tenu de l’ensemble de ces problèmes, il faut aller vers une systématique intégrative :
- revitaliser la systématique tropicale en intégrant les approches « classiques » (morphologique) et « moléculaire » (génétique) :
- valoriser les connaissances de terrain en prenant en compte les caractères végétatifs et leur variabilité, afin d’établir une meilleure définition des espèces,
- cette démarche suppose l’utilisation de nouvelles technologies, comme les flores électroniques (textes + images) ou l’identification assistée par ordinateur.
L’utilisation des techniques d’identification biologique
Il existe un projet international « Barcode of Life » qui a pour objet l’identification des espèces à l’aide d’une carte séquence génétique prélevée et analysée sur le terrain.
Scientifiquement, cette possibilité repose sur l’isolement d’une zone comprenant 648 nucléotides dont la variabilité diffère d’une espèce à l’autre.
Le projet « Barcode of Life » qui a démarré en 2004 regroupe actuellement 150 organisations et entreprises privées (en France, l’INRA et le Muséum d’histoire naturelle) originaires de 45 pays.
Ce type d’initiative pourrait accélérer notre connaissance rudimentaire de la diversité des espèces cohabitant dans un écosystème (cf. supra).
Compléter l’inventaire du vivant suppose à la fois de gérer les flux nouveaux de connaissances mais aussi de dynamiser la gestion des connaissances acquises au fil des prélèvements naturalistes des siècles précédents.
Le flux de connaissances nouvelles est important :
- chaque année, on dénombre de 16 000 à 17 000 espèces nouvelles (en majeure partie des insectes),
- en France, chaque année, des millions d’observations sont effectuées.
Par ailleurs, le stock de spécimens répertoriés dans les collections publiques est impressionnant :
- 125 millions de spécimens pour le Muséum d’histoire naturelle américain,
- 70 millions de spécimens pour le Muséum d’histoire naturelle de Londres,
- 43 millions de spécimens pour le Muséum d’histoire naturelle à Paris,
- 7,5 millions de planches d’herbier à Kews gardens, au Royaume-Uni,
- 11 millions de planches d’herbier au Muséum d’histoire naturelle à Paris.
Or, dans les deux cas (apports nouveaux, collections existantes), ces connaissances sont dispersées, insuffisamment mémorisées et très peu accessibles. Hors les échanges d’herbier qui se raréfient22, le principal mode de consultation de ces données reste la visite sur place.
Cette situation, qui pouvait être admissible dans un monde où les menaces à la biodiversité étaient moins présentes et surtout moins perçues, ne l’est plus dans un monde où la connaissance des écosystèmes et de leur évolution devient un enjeu de société fort.
La généralisation de l’outil Internet ouvre parallèlement de nouvelles possibilités pour coordonner et harmoniser la gestion de ces flux et de ces stocks de connaissances sur la biodiversité, mais également pour les rendre plus accessibles aux acteurs de terrain, qu’il s’agisse des botanistes ou zoologues bénévoles ou des intervenants des pays en voie de développement.
Plusieurs consortiums se sont constitués pour mettre en œuvre la standardisation et l’interopérabilité informatique des inventaires sur la biodiversité :
- le GIBIF (Global Biodiversity Facility) est chargé auprès de l’OCDE de l’établissement de standards à destination des producteurs de bases de données sur la biodiversité du vivant. En dépit d’un budget assez faible (3 millions de $ par an de moyens opérationnels), le GIBIF a amorcé une démarche intéressante puisque ses normes débordent du cadre de l’OCDE et sont utilisées par des pays en voie de développement à haut niveau de biodiversité (comme le Costa Rica) ;
- l’« European Distributed Institute of Taxonomy » (EDIT), réseau d’excellence européen regroupant 27 institutions et dont l’objectif est d’intégrer la recherche et les infrastructures de recherche en taxonomie à l’échelon européen (rappelons que les pays de l’Union européenne possèdent la moitié des collections mondiales). Ce réseau, qui est copiloté par le Muséum national d’histoire naturelle, a été doté de 12 millions d’euros au cours du 6e PCRD ;
- le « Barcode of Life » précité ;
- le « Consortium of Marine Life », qui vise à structurer, d’ici 2012, l’inventaire des connaissances acquises par les biologistes marins sur la flore et la faune des océans ;
- l’« Encyclopedia of Life », consortium américano-britannique lancé au printemps 2007, dont l’objectif est de mettre en accès libre sur Internet l’intégralité de la description des 1,8 million d’espèces animales et végétales identifiées. Ceci en prévoyant plusieurs niveaux d’accès aux données, le public pouvant consulter plusieurs types de données décrivant l’espèce, sa morphologie, son habitat, son séquençage ADN.
Malheureusement, si la France est associée à la plupart de ces consortiums et de ces réseaux au travers de ses organismes et de ses chercheurs, elle consacre extrêmement peu de moyens opérationnels à ses actions. Cet état de fait est regrettable, à plus d’un titre :
- du fait de la position de pointe de notre pays sur les problèmes de développement durable,
- du fait de la richesse de son appareil de recherche et des collections dont elle dispose,
- et du fait de la responsabilité particulière que lui confèrent la gestion de son domaine ultramarin et la présence, en métropole même, de la façade méditerranéenne qui est un des « points chauds » de la biodiversité planétaire.
*
* *
DEUXIÈME PARTIE
L’URGENCE DES INITIATIVES
L’accroissement préoccupant des atteintes à la biodiversité enregistrées depuis une trentaine d’années et surtout les perspectives très inquiétantes qui se profilent à l’horizon 2030-2050, impliquent de mener des initiatives de préservation d’une tout autre ampleur que celles menées actuellement.
C’est d’ailleurs un des paradoxes des décennies qui viennent de s’écouler d’avoir été, à la fois, le moment où les politiques de protection de l’environnement se sont fortement développées et le moment où les menaces à la biodiversité ont pris une ampleur inégalée jusque là. Ce simple constat renvoie à une interrogation.
Pourquoi les efforts déployés par les organisations internationales, les politiques publiques menées par les Etats et la sensibilisation croissante des opinions n’ont-ils pas permis d’endiguer l’érosion de la biodiversité ?
C’est aussi bien une question de degré que de nature.
De degré, parce que la multiplication des hommes amplifiée par le développement économique acquis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ont eu des effets indirects dévastateurs sur la biodiversité de la planète.
De nature aussi, parce que les politiques traditionnelles de préservation de la biodiversité ont été trop tournées vers la conservation des milieux naturels. Cela répondait à une nécessité mais comportait l’inconvénient d’établir une coupure entre les écosystèmes et l’anthropisation qui les menaçait. En quelque sorte, entre des « musées naturels » plus ou moins sanctuarisés et des zones où tout restait permis.
De plus, ces politiques de conservation ont rarement posé le problème de la protection dynamique de la biodiversité ; il s’agissait plutôt de rectifier les atteintes passées à la biodiversité que de parer aux menaces futures. Le défi est donc d’essayer d’établir des politiques de protection de la biodiversité moins déconnectées du développement économique et de son évolution dans les décennies à venir.
Ceci passe par la réduction des pressions qui altèrent la biodiversité du vivant mais également par l’anticipation de menaces dont la réalisation pourrait aboutir à un appauvrissement sévère des écosystèmes de la planète.
RÉDUIRE LES PRESSIONS D’ANTHROPISATION
L’on sait que, depuis le néolithique, l’homme a profondément remanié les milieux naturels. En Europe comme aux États-Unis, la plupart des plantes cultivées ou des animaux élevés sont d’origines extérieures et se sont substitués aux espèces autochtones.
Dans le même ordre d’idées, l’expansion coloniale européenne (ou celle, intérieure, de la Chine à partir du XVIIème siècle) ont contribué à peser sur les milieux naturels, cette fois à l’échelon planétaire.
Mais, depuis quelques années, la pression des activités humaines sur la biodiversité s’est fortement accrue, qu’il s’agisse des pressions de prédation, de celles qui résultent de la poursuite des destructions d’espaces ou de celles plus indirectes qui facilitent la propagation des espèces invasives.
Les perspectives de développement démographique et économique de l’humanité incitent à penser que ce poids des hommes sur la nature va s’accroître. Il est donc urgent de retrouver des modes de développement plus durables, ménageant des ressources qui ne seront renouvelables que si on ne les épuise pas.
L’accélération des ponctions de l’homme sur les milieux naturels concerne aujourd’hui, prioritairement, deux des biomes les plus riches en biodiversité, et deux des milieux les moins explorés dans ce domaine : les forêts des zones intertropicales et les milieux aquatiques.
Les pressions de prédation traditionnelles sur ces milieux étaient limitées, d’un côté par la demande et de l’autre par la technologie disponible, clef de l’accessibilité et l’extraction.
Or, dans ces deux domaines la donne s’est modifiée : le développement mondial stimule la demande en produits naturels et les améliorations technologiques d’exploitation ont rendu accessibles une très grande partie des ressources naturelles disponibles. De ce fait, les ponctions que l’économie mondiale exerce actuellement sur les milieux naturels excèdent dans de nombreux cas leur possibilité de renouvellement.
Le problème est donc de savoir si et comment le développement humain peut continuer à utiliser les milieux naturels que sont les forêts tropicales et équatoriales et les océans, sans que cette utilisation compromette la durabilité de ces ressources.
LES FORÊTS TROPICALES ET ÉQUATORIALES
« Les forêts précèdent les peuples, les déserts les suivent. »
L’aphorisme de Chateaubriand qui s’applique déjà aux forêts tropicales sèches (Madagascar, « Mata Atlantica » brésilienne) pourrait, sous peu, devenir tout aussi pertinent pour les forêts tropicales et équatoriales humides.
Ces milieux, rappelons-le, subissent des ponctions brutes de l’ordre de 13 millions d’hectares annuels, dont 6 millions portent sur des forêts primaires. On a dit, en première partie de ce rapport, que ces déforestations étaient aussi bien le fait d’une exploitation non raisonnée de ces gisements que de l’avancement de « fronts pionniers » destinés à libérer des surfaces au bénéfice de l’élevage et de l’agriculture industrielle, y compris les cultures destinées aux biocarburants.
Or ces déboisements, non compensés, ont un effet cumulatif. Pour ne prendre que l’exemple de la forêt amazonienne brésilienne, on est passé en 1975 d’une amputation de 0,6 % de la surface boisée (estimée à plus de 4 millions de km² soit huit fois la France) à un déboisement évalué en 1998 à 13,5 % de cette surface23) :
Etats |
Surface totale de forêt *(km2) |
Pourcentage de la surface de l’Etat |
Déforestation (%)** | ||||||
1975 |
1978 |
1988 |
1990 |
1995 |
1998 |
1998 (km2) | |||
Pará |
1.183.600 |
93,8 |
0,7 |
4,5 |
11,1 |
12,2 |
14,3 |
15,9 |
188.372 |
Amazonas |
1.531.100 |
97,2 |
0,05 |
0,1 |
1,3 |
1,4 |
1,7 |
1,9 |
28.866 |
Amapá |
137.400 |
98,4 |
0,1 |
0,1 |
0,6 |
0,9 |
1,3 |
1,4 |
1.962 |
Romaima |
172.400 |
76,4 |
? |
0,1 |
1,6 |
2,2 |
3 |
3,4 |
5.791 |
Maranhão |
145.800 |
55,7 |
? |
43,8 |
62,3 |
64,1 |
67,1 |
69 |
100.590 |
Tocantins |
30.300 |
10,9 |
? |
10,6 |
71,2 |
75,5 |
82,9 |
87,1 |
26.404 |
Mato Grosso |
527.600 |
58,6 |
1,1 |
3,8 |
13,6 |
15,8 |
21,3 |
25 |
131.808 |
Rondônia |
212.200 |
89,1 |
0,3 |
2 |
14,1 |
15,8 |
21,7 |
25,1 |
53.275 |
Acre |
152.400 |
99,7 |
0,8 |
1,6 |
5,8 |
6,8 |
8,7 |
9,7 |
14.714 |
Région amazonienne |
4.092.800 |
81,3 |
0,6 |
3,7 |
9,2 |
10,1 |
12,1 |
13.5 |
551.782 |
* Données de Skole et Tucker (1993), Tableau 2, p. 1906
** Données de l’INPE (1998, 2000) d’après Kohlhepp (2000)
L’effet de ces ponctions doit s’apprécier au regard des temps de reconstitution des biotopes forestiers. Même dans le cas le plus « favorable », celui d’une exploitation sauvage laissant subsister une partie des massifs (qui s’oppose ici à la déforestation totale) les délais de résilience du milieu dépassent l’horizon d’une génération.
En témoignent, deux expériences parallèles menées par le CIRAD depuis près de vingt-cinq ans en Guyane et au Brésil24. Les modélisations fondées sur ces observations de longue durée montrent qu’en cas de coupe sévère (plus des 2/3 des fûts exploitables à l’hectare), les essences se reconstituent sur un siècle et les écosystèmes associés sur plus de deux siècles. La protection de ces milieux forestiers qui, répétons-le, abritent des ressources en biodiversité botanique et zoologique dont nous commençons à peine à mesurer la complexité, est donc une urgence.
Mais, compte tenu de l’échelle des problèmes, les réponses traditionnelles de conservation du milieu par constitution de réserves – aussi nécessaires qu’elles demeurent – ont trouvé leurs limites.
L’ensemble des personnes entendues sur cette question s’accordent à estimer que la protection des forêts tropicales et équatoriales passe aujourd’hui par un faisceau de mesures de gestion les réintégrant dans le tissu des économies locales et infléchissant les règles de la mondialisation visant à une exploitation durable.
La nécessité et les limites des politiques de conservation
La poursuite des actions de conservation
L’idée de constituer des réserves naturelles soit totalement, soit partiellement protégées de l’intervention humaine, n’est pas neuve : le Parc de Yellowstone a été fondé en 1872 par le président Grant et l’India Biological Survey date de 1890.
Mais, à l’exception des Etats-Unis et pour partie des Indes notamment grâce aux Instituts à l’origine britannique mais poursuivis et modernisés depuis lors, ces actions de recherche, conservation et utilisation intelligente ne se sont réellement généralisées qu’avec la vague environnementaliste des années soixante-dix.
Le bilan de la part de ces politiques pour la seule conservation in situ peut être contesté. Mais on peut également imaginer en négatif ce qu’aurait pu être ce bilan si elles n’avaient pas été mises en œuvre. Sur ce point, on doit ajouter que, par essence, les réserves territoriales ne peuvent occuper qu’une partie très limitée des zones potentiellement protégeables. Et que dans beaucoup de pays émergents ou en voie de développement, ces politiques n’ont pas été complètements poursuivies, soit du fait de la pression démographique qui a limité l’extension des zones protégées, soit simplement parce qu’elles ne sont pas respectées, faute de volonté politique.
Aussi doit-on se réjouir qu’un pays comme le Brésil ait renforcé sa politique dans ce domaine :
- en créant 25 millions d’hectares de réserves fédérales forestières sur les quatre dernières années, et en prévoyant d’en créer 25 autres millions dans les années à venir – auxquels s’ajouteront une trentaine de millions d’hectares créés par les états brésiliens ;
- et en amplifiant la lutte contre la déforestation illégale : annulation des appropriations illégales, saisine en 2006 de 750.000 m3 de grumes illicites (représentant le chargement de 20.000 camions). Il est à noter qu’à l’échelle du demi-continent qu’est le Brésil, l’utilisation de l’observation satellite en continu, associée à la programmation des images25 très développée aux Indes, pourrait être un outil très précieux – mais dans des conditions économiques qui restent à définir – de la lutte contre la déforestation illégale.
Mais l’ensemble de ces actions de conservation, dont on répètera qu’elles sont nécessaires, a montré certaines limites :
- traçant une frontière claire, sinon toujours respectée, entre la nature à protéger et celle qui ne l’était pas, elles ont pu encourager à accélérer les atteintes à la biodiversité dans les zones non protégées en raison des pressions économiques et démographiques. Par exemple, les autorités costaricaines se sont aperçues que la constitution d’importants parcs nationaux forestiers, à compter des années soixante-dix, a amplifié la déforestation des milieux non protégés ;
- sauf cas particuliers des réserves transfrontalières, les espaces de conservation in situ sont des espaces nationaux qui peuvent générer des effets pervers [déjà mentionnés]. De même, la protection par un gouvernement de ses essences forestières peut entraîner la surexploitation de celles de pays où les systèmes de protection sont faibles ou inexistants26 ;
- les réserves forestières, qu’elles reposent sur des interdictions partielles ou totales d’exploiter n’associent pas assez les populations locales :
- soit en ne prenant pas en compte l’augmentation de celles-ci. Par exemple, une étude menée par l'Université du Michigan a montré qu’une des zones de protection des pandas chinois ne donnait pas les résultats escomptés car l’on avait sous-estimé les populations humaines et surestimé les contraintes de protection de la réserve sans offrir à ces populations de compensation économique,
- soit en les faisant insuffisamment profiter des ressources, en particulier touristiques, qui gênent ces espaces.
- enfin, un des problèmes des grandes réserves forestières est qu’elles constituent peu à peu des isolats coupés les uns des autres par la déforestation et les grands équipements (barrages hydrauliques, routes transcontinentales, extensions urbaines).
A titre d’illustration de ce constat, une étude menée en Inde sur la préservation des tigres a établi que les territoires de protection de ces animaux étaient suffisants mais que leur isolement pouvait avoir pour résultat un appauvrissement génétique des félins. La décision de développer des corridors s’est imposée.
Dans le même ordre d’idées, c’est ce qui conduit aujourd’hui le Brésil à établir une continuité entre les dizaines de millions d’hectares de réserves amazoniennes qu’il constitue peu à peu.
*
* *
L’ensemble de ces facteurs restreignent l’efficacité des politiques de protection de la biodiversité in situ. Ceci conduit les chercheurs et certains Etats à affiner la conception de ces actions, principalement en les réinsérant dans les économies locales, ce qui ne dispense pas de poser également la question de la protection de la biodiversité dans le cadre plus général de la mondialisation de l’économie.
Faire le lien entre la conservation et l’exploitation économique des forêts tropicales
La coupure trop tranchée entre les zones d’interdiction d’exploitation et celles où tout est permis a largement déconnecté les politiques de protection in situ des réalités économiques de leur zone d’implantation, exception faite des apports touristiques qui sont loin d’être négligeables27. Il est donc nécessaire, à la fois, de tempérer les ruptures géographiques qui existent entre les espaces protégés et les espaces non protégés, et de mettre fin au « tout ou rien économique » qui consiste, soit à ne pas exploiter les forêts tropicales, soit à les détruire.
Rétablir une transition géographique
Deux types de mesures peuvent y contribuer : la création de corridors de reforestation et l’agroforesterie.
La première de ces actions consiste à reforester pour établir continuité entre les réserves tout en posant les bases d’une exploitation rationalisée de ces espaces de reforestation, ce qui est le gage de leur maintien.
La seconde, l’agroforesterie, concourt à la première mais a également le mérite de créer des zones de médiation biologique plus dense entre les réserves et les espaces anthropisés. La voie est très prometteuse.
Rappelons qu’un pourcentage non négligeable de la population mondiale, 500 millions d’hommes, vivent dans les forêts et dans leurs abords.
L’agroforesterie permet à la fois de fixer ces populations et de leur donner une assise économique qui les associe à la protection des alentours des sanctuaires forestiers.
Ces systèmes d’exploitation peuvent être traditionnels comme en Indonésie (1,5 millions d’hectares) où les populations indigènes pratiquent un mélange d’agriculture et une cueillette forestière qui n’excède pas les capacités de renouvellement du biotope.
Ils peuvent également revêtir des formes plus sophistiquées comme l’agroforesterie ordonnée mise en œuvre au Costa Rica. Sur la base d’une structure de propriétés petites et moyennes, coexistent dans les exploitations :
- des arbres de 20 à 30 mètres destinés à l’exploitation forestière ;
- des arbres de 10 mètres porteurs de fruits tropicaux dont certains sont commercialisés sur les marchés locaux ou sur le marché mondial, en particulier par la voie d’Internet ;
- et des cacaoyers de 4 mètres de haut.
L’ensemble constitue un couvert moins continu que la forêt mais assez dense pour ménager des transitions pour les plantes et les animaux.
Rationaliser l’exploitation forestière
L’exploitation des produits ligneux
Hors zones sanctuarisées, lorsque la forêt tropicale n’est plus exploitée, elle ne vaut rien28 : elle est donc détruite afin de préfinancer, soit des zones d’élevage, soit des plantations industrielles (palmier à huile ou culture tropicale).
Il est donc nécessaire d’encourager une rationalisation de l’exploitation.
Or, les techniques correspondant à cette exploitation forestière rationalisée en milieu tropical sont disponibles :
- préalablement à l’exploitation d’une parcelle ; on sait aujourd’hui cartographier informatiquement les essences exploitables et les chemins de débardage ce qui permet d’anticiper l’évolution de l’exploitation et d’en diminuer les coûts :
- on n’exploite que 20 % du bois coupé, les recherches opérationnelles montrent qu’il est possible de porter, suivant les cas, ce pourcentage à 40-50 %,
- les tombées d’arbres et les chemins de débardage détruisent sur un seul secteur de 12 à 13 % des juvéniles ; des recherches menées par l’IRD montrent qu’une exploitation rationalisée pourrait faire baisser ce pourcentage à 3 %,
- l’exploitation est concentrée sur quelques essences principales – en vue de la coupe desquelles on détruit (routes d’accès, débardages), une grande partie d’un milieu ; un accroissement d’essences exploitées pourrait limiter les dégâts de ce type (en Amazonie, par exemple, on n’exploite que 150 espèces d’arbres sur près de 3 500),
- les recherches précitées menées en parallèle par le CIRAD, en Guyane et en forêt amazonienne, montrent qu’avec une exploitation fondée sur des coupes légères (5 à 6 fûts coupés à l’hectare), l’ensemble de la forêt se reconstitue en trente ans – ce qui correspond à une exploitation durable à l’horizon d’un peu plus d’une génération.
Mais ces technologies de rationalisation de l’exploitation forestière sont, suivant les cas, peu ou pas du tout employées.
Pourquoi ?
Pour des raisons qui tiennent à la fois à la gouvernance politique et aux données économiques de leur exploitation.
• la nécessité de la gouvernance politique
Une politique de développement durable suppose une action dans la durée, accompagnée de politiques de formation aux changements de techniques et de pratiques qu’elle suppose. L’exemple du Costa Rica où une politique de cette nature a été menée avec des moyens assez faibles et avec succès sur deux décennies, c'est-à-dire indépendamment des alternances gouvernementales, en est la preuve.
• les données économiques de l’exploitation
A l’échelon local, la rentabilité d’une exploitation forestière peut dépendre de plusieurs facteurs :
- la comparaison avec la rentabilité en culture et en élevage d’un espace forestier :
La Banque mondiale évalue cette rentabilité à 50 $/ha. Mais pour égaliser réellement cette équation, il est aussi nécessaire de prendre en compte – et donc de rémunérer – les services écologiques rendus par la forêt (filtration et régulation de l’eau, contrôle des ravageurs, apports touristiques).
Le Costa Rica qui mène une politique de ce type (cf. troisième partie) évalue ces services écologiques à 10 $/ha. La rémunération de ces services permet alors d’assurer la rentabilité de l’exploitation forestière.
- l’organisation et la transparence du marché, notamment par des systèmes d’enchères ouverts, permet d’augmenter la rémunération des exploitants forestiers au lieu qu’ils soient confrontés à des conditions d’achats non publiques défavorables29 ;
- et, enfin l’intérêt pour agir.
A gouvernance égale, la ligne de crête entre l’utilisation durable de la forêt et sa destruction se confond souvent avec le régime de propriété ou d’exploitation de la forêt.
Un pays de petits ou moyens propriétaires est sur ce point beaucoup mieux armé pour défendre ses forêts qu’un pays où les droits sur l’exploitation sont flous et l’appropriation des biens collective ou coutumière.
Mais cet intérêt pour agir peut aussi dépendre des régimes juridiques des concessions d’exploitation.
L’exemple du Brésil où, en principe, 65 % des forêts sont publiques et interdites à l’exploitation mais, jusqu’il y a peu, ouvertes à toutes les appropriations illégales est, à ce titre, intéressant.
Le régime des réserves forestières constituées ou en voie de constitution au Brésil a évolué.
Partant du constat que la protection forestière doit reposer sur une exploitation raisonnée, l’Etat fédéral attribue dans les réserves forestières publiques des concessions d’exploitation sur 40 ans sous réserve d’une rationalisation de l’exploitation soumise à certification. Ce délai correspondant à peu près à la durée de reconstitution de la biomasse exploitable en cas d’exploitation durable, il attribue au concessionnaire une durée d’exploitation qui doit l’inciter à gérer le milieu « en bon père de famille ».
L’exploitation des produits non ligneux
L’exploitation par les habitants des forêts ou de leurs abords des produits non ligneux (fruits, faune, etc.) et la recherche de débouchés locaux contrôlés sont probablement les assises les plus prometteuses d’une meilleure protection forestière, puisque ces habitants trouvent intérêt au maintien d’un milieu qui leur apporte des ressources.
Mais ces usages non ligneux pourraient également faire l’objet d’une rationalisation.
A titre d’illustration, on utilise l’écorce du prunus africain pour traiter l’adénome bénin de la prostate. On en récolte 3 tonnes par an en incisant 40 000 arbres dans des conditions qui leur laissent peu de chances de survie, alors que des techniques d’incision existent qui permettent des pertes moins élevées.
*
* *
La mise en place d’une politique de conservation plus dynamique, faite de constitution de réserves contigües reliées entre-elles par des corridors et reposant sur une exploitation rationalisée de la forêt, pourrait avoir des effets forts sur la limitation des atteintes à la biodiversité forestière tropicale d’ici 2050.
Pour en donner une illustration, on juxtaposera l’état prévisionnel de la forêt amazonienne brésilienne en 2050 sans politique de protection (transparent déjà présenté en première partie) et avec politique de protection :
• état de la forêt amazonienne brésilienne en 2050 sans protection
Source : WWF La forêt amazonienne couvre 90 % de sa surface d’origine. La carte ci-dessus montre que sa destruction pourrait s’accroître fortement d’ici 2050 si aucune mesure spécifique de protection n’était prise. |
• état de la forêt amazonienne brésilienne en 2050 avec protection
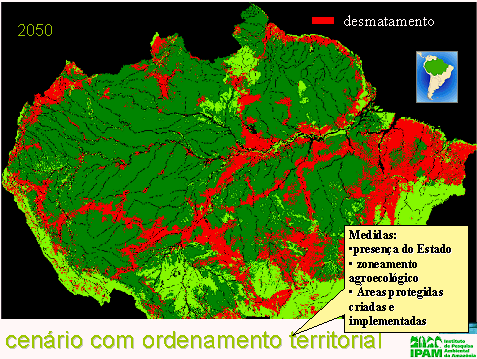
La réinsertion d’une économie forestière raisonnée dans la mondialisation
Vers l’organisation de la rareté ?
Avant d’examiner la façon dont l’évolution de l’économie mondiale pèse sur la biodiversité des forêts tropicales, il est nécessaire de rappeler qu’une partie de ce problème doit trouver des solutions dans des cadres nationaux, car la déforestation ou la surexploitation des forêts tropicales résulte en premier lieu de la satisfaction des demandes locales :
- au Brésil, 80 % des grumes sont utilisés dans le pays (dont près de la moitié pour produire du charbon de bois !) ;
- et sur une offre mondiale de 3,4 milliards de m3 (y compris les forêts des pays développés) 55 % sont consommés sous forme de bois de feu (dont 90 % dans les pays en voie de développement) mais 45 % sous forme de bois d’œuvre (dont 70 % dans les pays développés).
Mais, dans le même temps, les deux aspects de la question sont liés, car il ne servirait à rien que l’exploitation locale de la forêt tropicale s’améliore alors que coexisteraient et s’amplifieraient les ventes illégales de bois sur le marché international. On peut affirmer que la persistance de cette situation aura des effets indirects fâcheux sur les équilibres locaux de gestion de l’exploitation forestière.
Or, le principal ressort économique de l’exploitation illégale réside dans le fait que face à une demande mondiale croissante, l’offre peut paraître illimitée et aboutit à des prix qui encouragent fortement la déforestation (au Brésil, 1 m3 des grumes tropicales coûte 1 $).
Comment casser cette mécanique économique qui sanctionne l’exploitation durable de la forêt tropicale, au bénéfice d’une économie forestière de prédation ?
Il est possible de peser sur une partie de l’offre en refusant dans les pays développés et émergents, les bois d’œuvre qui ne seraient pas issus d’une exploitation durable.
Les technologies RFID (identification par radio-fréquence) largement utilisées dans d’autres domaines, permettent d’asseoir une traçabilité mondiale des grumes.
Mais, pour progresser dans ce domaine, il faudrait aller vers une unification des droits en matière de définition d’exploitation et de commerce illégal du bois. Par exemple, l’Union européenne s’efforce de lutter contre l’exploitation forestière illégale et le commerce qui s’y attache. En même temps, l’association des nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN) privilégie la baisse des tarifs douaniers sur les produits agricoles transformés (et donc sur le bois) ce qui encourage la déforestation illégale, tout en appauvrissant les pays d’origine.
En outre, cette difficulté à harmoniser les accords de commerce régionaux et la prohibition des ventes illégales du bois, est doublée par la multiplication des organismes qui œuvrent dans ce domaine : organismes régionaux de certifications et de délivrance de labels30, ITTO (International Tropical Timber Organization) qui regroupe 59 Etats et s’efforce de promouvoir l’exploitation durable des bois tropicaux, action de la FAO, etc.
Une remise en ordre du droit et des propositions de labellisation serait donc nécessaire. Cela renvoie, dans ce secteur comme dans d’autres secteurs de protection de la biodiversité, à souligner la pertinence qu’il y aurait à créer une organisation sous l’égide de l’ONU qui aurait, entre autres, vocation à unifier le droit et les actions de préservation des forêts. Une autre solution, compte tenu de la qualité des équipes de la FAO consisterait à étendre les objets sociaux de cette organisation se préoccupant principalement d’alimentation et d’agriculture en y associant des organismes veillant à la biodiversité.
L’inclusion des forêts tropicales dans le cycle de Kyoto
Jusqu’il y a peu, on estimait que le stockage du CO2 était assuré concomitamment par les océans et les forêts des hautes latitudes ; les modélisations estimaient que le bilan carbone des forêts tropicales était équilibré.
De récentes publications scientifiques31 fondées sur des mesures des flux de CO2 au dessus des forêts conduisent à remettre en cause cette vision des choses : les forêts tropicales absorbent un milliard de tonnes de CO2 par an.
Ce constat – qui mérite probablement confirmation – incite à penser que l’action contre la déforestation et pour une exploitation plus durable des forêts tropicales devrait être intégrée au cycle de Kyoto.
Actuellement, des entreprises dont les pays ont ratifié le protocole de Kyoto peuvent acquérir des droits carbone en reforestant, y compris en milieu tropical. Mais compte tenu de l’importance des déforestations dans cette zone, un marché réellement mondialisé des émissions de CO2, devrait prendre en considération les capacités de stockage des forêts tropicales existantes.
Deux voies permettraient d’y parvenir :
- l’application d’une taxe carbone mondiale (par exemple sur les transports maritimes transcontinentaux) dont le reversement contrôlé aux pays concernés permettrait à la fois de leur fournir un intérêt pour limiter effectivement la déforestation et des ressources pour le faire ;
- l’évolution des règles de Kyoto, en particulier, sur les mécanismes de développement propre (MDP) qui concernent les pays en voie de développement. Aux termes des dispositions qui gouvernent ces MDP, ne sont visés par le protocole – et donc éligibles au marché des émissions – que les actes professionnalisés de déboisement/reboisement. Il serait hautement souhaitable que les projets portant sur la conservation des forêts existantes puissent être éligibles à ce marché. Cela permettrait, par exemple, à des entreprises de pays développés de financer des actes de conservation des forêts tropicales.
Demeure que toute amélioration des dispositions de l’annexe 1 du protocole de Kyoto n’aura de conséquences fortes qu’en fonction de l’adhésion des grands émetteurs qui ne l’ont pas ratifiée.
Il serait assez paradoxal de faire financer la protection des forêts tropicales par les entreprises japonaises et européennes tout en laissant la Chine continuer à déforester le Sud-Est asiatique.
La consommation de produits aquatiques océaniques atteint 100 millions de tonnes par an, soit 6 fois plus qu’en 1950. L’océan fournit 20 % des protéines animales de l’humanité.
La seule production halieutique (c'est-à-dire à l’exclusion des pêches minotières) a crû de 1,5 million de tonnes en 1850, à 18 millions de tonnes en 1940, pour atteindre et stagner autour de 60 millions de tonnes au milieu des années 1980.
Cette stagnation de la biomasse pêchée ne se mesure pas uniquement à l’importance des prises utiles ; elle doit aussi comptabiliser les prises connexes rejetées à la mer, la destruction des fonds par chalutage, l’augmentation des captures en deçà de 400 m, la dégradation de la taille des prises, et la progression d’une aquaculture dévastatrice de beaucoup de milieux naturels.
Dans le seul Atlantique Nord, 60 % des stocks sont exploités à fond, 22 % surexploités et 18 % épuisés. Sur la seule base des déclarations des Etats, la FAO estime que la moitié des stocks mondiaux sont exploités au maximum de leurs possibilités et qu’un quart est surexploité ou épuisé.
Enfin, l’exemple de la morue – dont l’interdiction de pêche dans les eaux canadiennes depuis 1992 n’a pas permis la reconstitution des stocks – incite à rechercher une gestion des ressources marines plus durable. En effet, la chaîne alimentaire s’est réorganisée sur des cycles plus courts incluant une prédominance d’invertébrés et de nécrophages.
Organiser un prélèvement halieutique mondial durable est indispensable mais plus difficile que de promouvoir une exploitation forestière raisonnée. Le contrôle des eaux internationales qui sont libres, malgré les conventions portant sur la pêche de certaines espèces, est loin d’être réglé.
En toute hypothèse, la réussite d’une politique dans ce domaine dépend d’un faisceau de mesures à prendre, tant à l’échelon national, régional qu’à l’échelon de la planète.
La nécessité et les limites de l’aménagement de réserves marines
Actuellement, les aires marines protégées ne constituent que 0,6 % de la surface totale des océans car elles sont situées sur les côtes et ne s’étendent que rarement aux limites des plateaux continentaux. Et ces aires n’assurent pas une protection absolue. Celle-ci va de 0,1 % d’un écosystème côtier à 100 % (interdiction quasi-totale de pêche comme sur certains points de la barrière de corail australienne).
Ces réserves sont efficaces lorsqu’il s’agit de protéger des populations sédentaires comme celles des récifs coralliens ou mi-sédentaires (établies 10 à 15 ans plus tôt, la zone d’interdiction de pêche à la morue à Terre Neuve aurait probablement pu être efficace).
Mais s’agissant des populations migratoires, comme le saumon ou le thon, l’efficacité de ce type de mesure ne peut être que limité, même si la protection des zones de frai et de nourricerie permet d’élever le taux de survie lorsque ces espèces atteignent l’âge de la reproduction32.
Il serait donc souhaitable d’étendre les surfaces unitaires de ces zones de protection, ce qui présenterait l’avantage supplémentaire de maintenir des écosystèmes sur des surfaces plus cohérentes écologiquement.
La gestion des milieux côtiers
Le maintien d’une biodiversité océanique ne procèdera pas uniquement d’une modification de la pression de pêche.
Les milieux aquatiques côtiers – rappelons que l’on prévoit qu’en 2050, 80 % de la population mondiale habiteront sur les côtes – sont extrêmement sensibles aux apports ou aux variations d’apports de la terre, et en particulier à deux phénomènes, les effluents d’azote et de phosphates et la salinisation des estuaires, directement imputables aux sécheresses et à la croissance des besoins agricoles en irrigation.
Par exemple, dans les pertuis charentais où les zones irriguées ont été multipliées par 5 en 20 ans, ces phénomènes ont entraîné, par exemple sur la façade atlantique de la France :
- une augmentation de la turbidité des eaux qui diminue les manœuvres d’évitement des juvéniles de base, et donc leur taux de survie,
- une difficulté de recrutement, c’est-à-dire de fixation, des naissains d’huîtres,
- une diminution par 3 des flux d’eau douce qui apportent 90 % des nutriments nécessaires à la production première d’huîtres,
- et une modification des cycles planctoniques qui a des effets très négatifs sur les nourriceries de sol.
Des constats de même type ont été faits dans le Golfe du Mexique par l’autorité compétente américaine (NOAA), de même que par l’observation scientifique de la Réserve de la Baie de St-Brieuc, en Bretagne.
La gestion de ces milieux où des intérêts divergents existent, devrait faire l’objet de mesures de concertation spécifiques entre les différents acteurs.
Vers une aquaculture raisonnée
Compte tenu de l’épuisement des stocks et de la progression (2 % par an) de la demande mondiale en produits aquatiques, l’aquaculture est une réponse de substitution à la surpêche.
Les recherches appliquées menées actuellement par l’IRD sur les crevettes, par l’IFREMER et l’université de Maryland sur les espèces nobles, laissent augurer que l’on pourra éviter les principaux inconvénients de l’aquaculture actuelle (effluents très polluants, nourrissage des espèces carnivores à l’aide de farines de poissons faites à l’aide d’alevins).
Ces recherches ont abouti à une aquaculture «hors sol » en circuit fermé, dont les poissons ne consomment plus ou peu de farines de poissons.
Déjà, des progrès considérables dans la composition des aliments de l’aquaculture ont été accomplis et sont appliqués industriellement.
Par ailleurs, des expériences prometteuses d’aquaculture de repeuplement sont entreprises (morue au Canada ou au sud ouest du Japon (Kinshu)) ou conduites à terme (crabe bleu de la baie de Chesapeake avec un taux de survie 30 fois supérieur aux conditions naturelles). Plus récemment, une opération identique vient d’être lancée pour repeupler en esturgeon la Dordogne et la Gironde.
L’intensification de ces expériences et leur extension à l’échelle planétaire pourront être un des moyens de restaurer une partie des écosystèmes océaniques côtiers.
Mais on devra aborder rapidement aussi la question des espèces consommées et changer les habitudes alimentaires privilégiant les espèces carnivores.
La limitation des prises connexes
Le « moissonnage » des océans avec des technologies de plus en plus perfectionnées aboutit à multiplier les prises connexes et donc les rejets multiples de juvéniles ou d’espèces non commerciales qui contribuent à l’altération des ressources maritimes et l’épuisement des écosystèmes océaniques. Mais ces prises connexes sont très variables suivant les types de pêche : de 20 à 40 % et jusqu’à 80 % pour la pêche à la crevette33.
L’exemple qui suit montre la variété de ces rejets pour les seuls chalutiers artisans en Bretagne Nord :
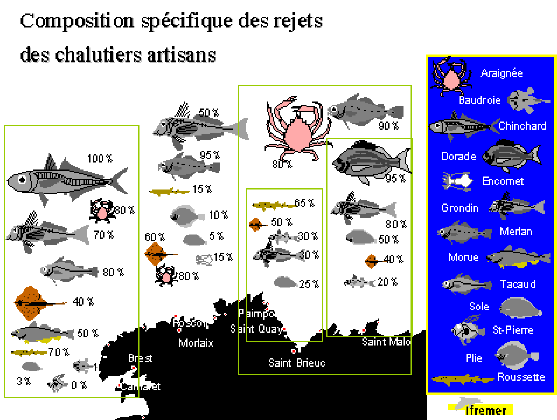
Réduire ces prises connexes dépend donc d’améliorations technologiques très différentiées.
L’Union européenne34 envisage d’agir indirectement en interdisant progressivement les rejets et en obligeant les chalutiers à rapporter ces rejets à terre, avec l’espoir que cette restriction graduelle pèsera sur les coûts des pêcheries et pourra être l’amorce permettant d’encourager des progrès technologiques dans ce domaine.
Le recyclage et la valorisation des rejets ainsi que des déchets issus de la transformation des produits de la pêche doivent être aussi explorés.
Encourager la labellisation d’une pêche et d’une aquaculture responsables et durables
Il serait souhaitable de progresser – comme cela se fait dans d’autres domaines de protection de la biodiversité – dans le domaine de la labellisation d’une pêche et d’une aquaculture durables. L’Union européenne pourrait être un cadre de cohérence pertinent dans ce domaine.
S’agissant de la labellisation durable, il existe un écolabel de la FAO, le MSC qui ne recouvre que 7 % des prélèvements mondiaux. Une action de promotion de ce label par l’Union européenne serait souhaitable dans la mesure où il ne semble pas indiqué de multiplier les labellisations pour des raisons de visibilité.
Mais les pêches dites responsables sont tout aussi importantes ; elles tendent à écarter de la commercialisation des prises illégales (de l’ordre de 15 à 25 % en moyenne, qui peuvent atteindre 100 % pour le thon méditerranéen) et pour certaines entreprises « responsables » .
L’entreprise FINDUS a, par exemple, engagé depuis cinq ans une action qui vient à terme et qui lui a permis d’atteindre un objectif de 100 % avec des méthodes analogues à celles du commerce équitable vis-à-vis de fournisseurs responsables, excluant toute prise illégale. Cet objectif a été atteint grâce à un cahier des charges passé avec les fournisseurs qui font l’objet de contrôles stricts.
Il serait souhaitable que ce type d’action puisse être clairement labellisé et, le cas échéant, harmonisé à l’échelon européen et encouragé par une fiscalité appropriée.
L’évolution de la gouvernance mondiale de la pêche
S’agissant de la haute mer, le droit international de la pêche n’est pas inexistant :
- convention des Nations Unies sur les stocks de poisson chevauchants et sur les stocks de poissons de grandes migrations,
- code de pêche responsable élaboré par la FAO ou,
- convention de Montego Bay qui fixe les droits et les devoirs riverains, CICTA, organisation regroupant 43 pays et chargée depuis 40 ans de la gestion partagée des stocks de thonidés, commission des pêches pour la méditerranée, politique de l’Union européenne, etc.
Cette gestion internationale permet d’avancer dans la prise en charge du problème posé par les eaux internationales, comme en témoignent :
- l’accord récent de la commission internationale pour la conservation des thonidés (CICTA) pour limiter la taille des prises et réduire, encore trop faiblement, les tonnages de prises ;
- l’interdiction depuis le 30 septembre 2007 du chalutage des thonidés dans le Pacifique Sud.
Mais ce droit et sa gouvernance doivent évoluer car cette architecture naissante est fragile :
- du fait de l’intervention tardive de ces accords, lorsque les ressources et les écosystèmes qui les supportent sont très altérés ou en voie d’altération ;
- du fait de la multiplicité des accords sur lesquels il repose, en l’absence d’une organisation internationale spécifiquement dédiée au problème ; est donc posé à nouveau le problème de la création d’une institution internationale traitant des problèmes planétaires de l’environnement ;
- du fait que ces accords ne sont pas généraux et que leur application repose le plus souvent sur le bon vouloir et le degré de contrôle des états signataires ;
- du fait que ces accords ne sont pas toujours respectés par les états signataires. Le cas des thons en Méditerranée est tristement illustratif. La commission des pêches en Méditerranée estime que les prises réelles sont deux fois plus élevées que les quotas fixés par les États (y compris par les États membres de l’Union européenne comme la France ou l’Italie) ;
- et, parce que cette addition de conventions et de normes internationales repose sur une conception du droit au prélèvement qui ne répond plus à l’état de la ressource disponible :
• la politique de quotas de prise a abouti au suréquipement technologique des flottes et au report des prises vers d’autres espèces, ce qui a abouti à l’érosion de beaucoup d’écosystèmes océaniques ;
• les accords et notamment ceux qui établissent les quotas annuels de prise ne prennent pas en compte l’évolution à long terme des écosystèmes, en particulier au regard des modifications qui pourraient être indirectes par le changement climatique.
C’est pourquoi, outre les problèmes institutionnels que l’on ne pourra longtemps éluder (création d’un organisme des Nations Unies dédié au développement durable, effectivité des contrôles, adhésion de l’ensemble des pays concernés à des pratiques de pêches durables, prescription des pratiques consistant à signer les accords mais à développer des activités de pêche océanique dans des zones de complaisance), la gouvernance mondiale de la pêche devrait reposer sur une capacité de planification stratégique à long terme incorporant la notion d’écosystème.
Mais, comme le soulignait M. Philippe GROS, directeur de recherche à l’IFREMER, à l’occasion de l’audition publique organisée le 28 mars dernier par vos rapporteurs, cette évolution implique de remettre en cause – à l’échelon international – les droits à produire, en passant d’une ressource commune à une ressource encadrée et régulée.
Le choix est le suivant :
- limiter par des dispositions de contrôle de l’outil de production (mailles, chaluts, etc.) et/ou par une politique très stricte de quotas un droit de pêche gratuit ;
- ou mettre ces droits de pêche sur le marché.
La première solution ne peut être efficace que sur des milieux marins très restreints permettant à la fois un contrôle par la puissance publique et un certain autocontrôle de la profession : c’est le cas de la coquille Saint-Jacques en baie de Saint Brieuc.
Mais dès que l’on s’adresse à des stocks halieutiques, la politique des quotas aboutit au suréquipement des chalutiers35, à une montée des prises accessoires et au report des pêches vers d’autres espèces.
La seconde solution, l’attribution aux enchères de quotas individuels de pêche transférables et rétrocessibles, pourrait faire passer les flottes du statut de prédateur à celui de gestionnaire d’un fonds naturel assis sur la durabilité et qui permettrait de valoriser le capital engagé à l’occasion de l’obtention du droit de pêcher.
Au surplus, la concession de ces droits pourrait être assortie de sujétions (quotas, limitation progressive des prises accessoires).
On ne doit pas se dissimuler les difficultés d’application de cette remise en cause du statut des eaux européennes et internationales :
– nécessité de faire la part entre les attributions respectivement réservées, aux artisans pêcheurs et aux flottes plus capitalistiques,
– problème des préfinancements de l’acquisition des droits de pêche par les artisans pêcheurs qui doivent également supporter des charges d’équipement importantes,
– répartition entre pays dans les zones de pêche de l’Union européenne,
– contradiction entre le droit de la concurrence européenne et la mise aux enchères des quotas individuels de pêche...
Adoptés, en particulier en Islande et en Nouvelle Zélande, ces quotas individuels transférables ont marqué en première approche un progrès vers une pêche plus durable.
Il serait souhaitable qu’à l’échelon de l’Union européenne, des expériences de ce type soient mises en œuvre sur certains stocks de poisson.
LUTTER CONTRE LES DESTRUCTIONS D’ESPACES
Sur terre, en Europe, les experts estiment que près de 80 % des atteintes à la biodiversité sont imputables à des concurrences d’occupation d’espaces entre les activités humaines et les milieux naturels.
Compte tenu des perspectives du développement économique et démographique à l’horizon 2050, la pression anthropique sur les espaces naturels est appelée à s’accroître, aussi bien du fait de l’occupation directe des territoires que du cloisonnement de ceux-ci et que des effets indirects des activités humaines sur les eaux continentales.
MIEUX GÉRER L’OCCUPATION DIRECTE DES ESPACES
L’extension continue de la périphérie des villes, le développement des réseaux routiers et des parkings aboutissent à une minéralisation progressive des territoires.
En Chine, en 2007, on aura construit 7.000 km d’autoroutes. En France se sont 60 000 ha par an des espaces naturels qui disparaissent, soit 164 ha par jour. En Allemagne, 100 hectares par jour sont soustraits aux espaces naturels pour implanter des équipements et des logements.
Les autorités allemandes, conscientes de ce phénomène, se sont fixé des objectifs très contraignants : réduire la minéralisation des territoires à 30 hectares par jour en 2020 et supprimer toute occupation supplémentaire du territoire en 2050. L’état du Bade Wurtenberg est même plus sévère (0 en 2020).
Deux types d’actions pourraient concourir à réfréner le grignotage : la redéfinition des conditions du développement urbain et des mesures de compensation aux occupations d’espaces naturels.
La question de la gestion durable de l’espace devient cruciale dans la plupart des pays européens. Le droit de l’urbanisme qui pourtant par nature doit prévoir et organiser l’avenir en est-il conscient ?
La redéfinition du développement urbain
Aussi bien en matière de lutte contre l’effet de serre que de préservation des espaces naturels, la redéfinition de développement urbain devient indispensable.
La prise de conscience de la nécessité de protéger les milieux naturels doit prendre racine dans l’action au quotidien des autorités locales.
A cet égard, les structures urbaines des siècles passés sont un exemple qui ne semble pas être suivi. L’extension urbaine sous forme d’habitat individuel avec un maillage routier étendu et des équipements collectifs dispersés est une des causes principales de destruction d’espaces naturels dans les pays développés comme dans les pays en voie de développement.
Une politique d’aménagement protectrice de la biodiversité implique donc que soient mises en œuvre des mesures favorisant à nouveau la concentration urbaine. Au demeurant, cet objectif qui a été repris par le groupe de travail n° 2 du Grenelle sur l’environnement faisait déjà partie des propositions de vos rapporteurs sur le changement climatique (cf. Tome I : « Changement climatique et transition énergétique : dépasser la crise »).
L’ensemble des documents d’urbanisme (SCOT, PLU) doivent se focaliser sur cette nécessité en prévoyant les conséquences à long terme sur les milieux naturels des occupations d’espaces qu’ils organisent.
La compensation des occupations d’espaces
Les législations existant à l’étranger
De très nombreux pays – et en France même, certaines municipalités et la population –, ont pris conscience des problèmes posés par l’érosion des espaces naturels.
Sans être exhaustif, on citera :
- les Etats-Unis dont le « Clean Water Act » de 1972 prévoyait qu’en cas de destruction d’une zone humide, cette zone devrait être remplacée. Sur cette base ont été créées les « Mitigations Banks » (ou banque de compensation), institutions privées ou mixtes qui assument cette compensation sur un marché de l’ordre de 1 milliard de dollars.
Suivant le même principe, des Conservations Banks visant à la protection des espèces et de leur habitat ont suivi l’adoption de la loi sur les espèces menacées (Endangered Species Act du 1973).
- Aux Indes, des corridors reliant des massifs forestiers et des programmes de reforestations de zones de bidonvilles autour de métropoles témoignent des préoccupations des autorités.
- les Pays-Bas avaient dès 1962 voté une loi forestière pour relier entre eux les espaces forestiers du pays. En 2005, ils ont adopté une « Stratégie nationale spatiale » qui établit que tout projet ne peut affecter la biodiversité que s’il est d’intérêt général et que sur des options alternatives n’existent pas. Dans ce cas une compensation financière est due.
- en France, la notion de trame verte fait partie des conclusions du Grenelle de l’environnement.
– Le dispositif existant :
La loi de juillet 1976 sur l’environnement a établi pour les projets d’un montant prévisionnel supérieur à 1,9 millions d’euros et au-dessus de seuils de surface variables, l’obligation « d’éviter, d’atténuer et de compenser » les atteintes à l’environnement.
Le mécanisme est le suivant.
Les maîtres d’ouvrage doivent faire expertiser les atteintes à l’environnement consécutives à la réalisation des projets qu’ils présentent ; cette expertise est, alors, soumise à l’administration qui évalue les compensations proposées – celles-ci variant suivant les milieux considérés et l’ampleur des atteintes à ces milieux.
Ce système dont le coût est de l’ordre de 1 % du coût des projets concernés marque un progrès, mais il est susceptible d’être amélioré sur de nombreux points.
– Les voies d’amélioration de cette législation pourraient être les suivantes.
- l’ampleur et la réalité du contrôle
Pour les projets dont l’ampleur les situe sous le seuil de déclenchement des offres de compensation, comme les SCOT et les PLU, ne sont soumises à appréciation que les conséquences les plus lourdes des aménagements qu’ils prévoient. Ce qui signifie que l’on ne compense pas les amputations d’espaces naturels faites de l’addition de multiples petits projets (lotissement, parking, etc.) et ce d’autant plus que l’administration, faute de moyens, se concentre sur les plus gros projets36.
- l’autorité d’évaluation des compensations est le ministre de l’environnement pour les projets nationaux, mais c’est le préfet pour les projets régionaux. Or, dans leurs circonscriptions, ceux-ci doivent souvent concilier des intérêts contradictoires, ce qui ne les porte pas toujours à arbitrer en faveur des espaces naturels.
- l’évaluation des compensations
Peu à peu – notamment sous l’impulsion de la Caisse des dépôts – se construit une grille de compensation qui devrait graduellement pouvoir être déclinée à l’échelon régional, avec une palette de compensation assez fine. Par exemple, il ne s’agira pas de compenser la perte d’un espace forestier par un autre, mais d’insister sur la variété de la palette des essences à replanter.
Quand cette grille sera finalisée, il serait intéressant de pouvoir la rendre opposable juridiquement.
- la durée de la compensation
Le maître d’ouvrage ne conserve en portefeuille l’actif représentatif de la compensation (forêt, champs pour protéger un marais, etc.) que jusqu’à la bonne fin de l’ouvrage – en général environ cinq ans. Une modification de la législation doit être envisagée :
- soit en prévoyant l’affectation des biens offerts en compensation à un conservatoire ;
- soit en allongeant la durée de conservation en l’alignant, quand c’est possible sur la durée des concessions.
- La gestion de la compensation
Par exemple, si l’on constitue des zones humides en compensation de la destruction d’un espace de même type, il sera nécessaire de gérer cette zone en évitant qu’elle soit l’objet d’introduction d’espèces invasives. Il serait possible d’inclure le coût de cette gestion dans le calcul de la compensation.
- La création d’un marché
A terme, l’activation de ces compensations introduira la notion de marché et pose le problème de la structuration de ce marché. Dans un premier temps sur territoire français et, ultérieurement, à l’échelon européen.
A l’aide des grilles de compensation, évoquées ci-dessus, on pourra constituer des « unités de biodiversité » qui pourront être échangées sur le marché de compensation.
L’émergence d’un tel marché présenterait l’avantage de clarifier les transactions, de permettre aux entreprises – éventuellement à titre de mécénat – de faire figurer des certificats de biodiversité dans leurs actifs et de poser les bases d’une gestion future de la biodiversité dans la perspective du changement climatique.
Comme l’a justement établi le groupe de travail n° 2 « Préserver la biodiversité et les ressources naturelles » du Grenelle de l’environnement, la gestion des espaces ruraux est une question centrale de la lutte contre l’érosion du vivant. Elle touche à la fois aux compensations d’occupation d’espace qui viennent d’être évoquées, et aux politiques de l’eau et de l’agriculture qui seront évoquées ultérieurement par ce rapport.
Aussi, ne peut-on qu’approuver l’ensemble des dispositions adoptées par ce groupe de travail sur la trame verte (cadre de référence national, compétence régionale spécifique, opposabilité des cartographies régionales d’occupation d’espaces aux SCOT et PLU, introduction d’un critère biodiversité dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement).
Ces propositions n’appellent que deux observations.
D’une part, si les acteurs locaux doivent être une pièce maîtresse du dispositif, le maintien d’une cohérence nationale du dispositif de trame verte est important pour éviter qu’il n’y ait trop de disparités entre les choix des autorités régionales concernées.
D’autre part, si l’inclusion d’un critère biodiversité dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement est intéressante, ce critère l’est encore plus pour le calcul de la dotation globale d’investissement qui est destiné à des infrastructures dont l’implantation n’est pas toujours positive sur le maintien des écosystèmes.
Plus généralement, les rapporteurs estiment nécessaire la prise en cause des clauses environnementales dans l’ensemble des contrats liant l’Etat aux collectivités territoriales. L’écoconditionnalité doit être la règle.
FREINER LE FRACTIONNEMENT DES TERRITOIRES
Les grands réseaux d’équipements collectifs – notamment routiers, ferroviaires et hydrauliques – tronçonnent et isolent les habitats nécessaires au maintien de la biodiversité.
Ceci est vrai dans les pays développés, le devient dans les pays émergents mais l’est aussi dans les pays en voie de développement. En particulier, parce que l’effort d’équipement encouragé par la Banque mondiale dans ces pays (barrages, routes, etc.) a été un des vecteurs de fractionnement et d’isolement des espaces indispensables au maintien de la biodiversité.
S’agissant des pays développés, la lutte contre ce fractionnement, implique que les études d’impact des très grands réseaux d’équipement incorporent leurs effets à long terme sur les espaces naturels ; il en est de même pour les plans d’aménagement à long terme (cf. infra la création de corridors pour lutter contre le changement climatique).
Dans les pays en voie de développement, il est possible et souhaitable de créer des corridors de communication entre les espaces naturels protégés et d’aménager, comme cela se fait au Costa Rica, des zones tampons grâce au développement de l’agroforesterie (cf. supra I).
La Banque mondiale est, depuis le début des années quatre-vingt-dix, consciente des problèmes posés par ses interventions et a développé un portefeuille d’aide au maintien de la biodiversité.
Mais ces investissements sont relativement limités37 (de l’ordre de 200 millions de $ par an auquel il convient d’ajouter 150 millions de co-financement) et cette action reste relativement déconnectée des autres actions d’investissements de la Banque.
La Banque a adopté en 2004 un « code de bonnes pratiques environnementales », mais les obligations concrètes de celui-ci ne sont pas strictes. Si la Banque ne finance plus les projets qui impliquent une dégradation accentuée des espaces naturels rares, elle peut financer les projets qui prévoient des occupations d’espaces naturels quand il n’y a pas d’autres solutions et que le rapport avantage social/coût environnemental lui semble favorable.
LES OCCUPATIONS INDIRECTES D’ESPACE : MIEUX GÉRER LES EAUX CONTINENTALES
Deux menaces affectent la biodiversité des eaux continentales : la pollution directe et les captations de l’eau pour les besoins de l’agriculture.
Les conséquences de la pollution
Les milieux aquatiques continentaux se trouvent en fin de circuit des opérations polluantes.
Or, ces espèces sont parmi les plus vulnérables. Par exemple, la moule perlière a disparu des eaux françaises depuis 1930 car ses larves ne résistent pas à une teneur en nitrate de 1 mg/l, taux très inférieur aux normes actuellement admises.
Les « living planet index » (LPI) montrent que les pertes de biodiversité les plus accentuées depuis 30 ans, sont celles qui concernent les poissons.
De façon plus insidieuse, la pollution, par une accumulation de micropolluants suscite des phénomènes d’intersexualité (gardons de la Seine).
L’Union européenne essaie actuellement de remplacer les normes actuelles de pollution de l’eau (teneur en nitrates et métaux lourds) par la notion de « bon état écologique du milieu ». On a vu en première partie de ce rapport que des indices biologiques convergents permettront de mesurer la réussite de cet objectif en 2015.
La captation de l’eau par l’agriculture
Suivant un rapport récent de l’Académie des Sciences, l’irrigation agricole est responsable de plus de 70 % des extractions d’eaux et conduit, suivant les cas, à une concentration des pollutions, à une altération des nappes et de leurs écosystèmes ou à une salinisation des eaux.
Du fait de leur accroissement récent, qui s’additionne à des épisodes de sécheresse, ces prélèvements dépassent les capacités de résilience des écosystèmes aquatiques qui sont pourtant habitués aux variations du cycle hydrologique.
De manière plus insidieuse, les effets cumulés de l’irrigation – et des désherbants – aboutissent à des ruissellements d’argile qui menacent les gravières dont les poissons migrateurs ont besoin pour se reproduire (l’agence Seine-Normandie a perdu 40 % de ses gravières en 40 ans).
Dans ces deux cas, pollution et captation des eaux, il sera nécessaire de trouver des territoires pertinents de gestions et d’intégrer cette gestion écologique aux équilibres économiques et sociaux afin que les acteurs s’approprient cette gestion.
LIMITER LES INTRODUCTIONS D’ESPÈCES INVASIVES
On a évoqué en première partie de ce rapport l’accélération inquiétante que la mondialisation de l’économie a donné aux phénomènes multiséculaires d’introduction d’espèces invasives.
Rappelons deux données sur ce point : aux Etats-Unis le nombre de plantes introduites est passé de 100 au XVIIIème siècle à plus de 2000 au XXème siècle ; en Europe, le nombre d’insectes introduits et installés dépasse les 1000 espèces et le nombre de poissons plus de 270 espèces, dont plus d’un tiers est arrivé dans les trente dernières années.
Notons également que les coûts indirects de ces invasions biologiques sont très importants. M. Philippe Clergeau, l’un des chercheurs. intervenant à l’audition publique du 28 mars 2007, a exposé que le coût de ces invasions aux Etats-Unis avait été évalué à 130 milliards de dollars.
Comment protéger les biodiversités autochtones contre ces invasions ?
Un consensus se dégage autour de la nécessité d’éradication de ces espèces avant qu’elles ne deviennent trop importantes et d’un renforcement de la surveillance de ces espèces invasives au moment de leurs phases d’arrivée. L’exemple de l’Australie et de la Nouvelle Zélande, très sensibilisées à ce problème compte-tenu des dégâts causés par les espèces invasives à la faune et à la flore endémique de ces pays montre qu’une politique énergique permet d’obtenir des résultats dans ce domaine.
Plus concrètement il s’agit :
- d’investir scientifiquement dans la connaissance de l’implantation de ces espèces et dans la mesure des conséquences de ces invasions. Par exemple, en France l’étude des impacts écologiques et socio-économiques n’a porté que sur le quart des 185 espèces allochtones de vertébrés ;
- de faire largement circuler l’information dans ce domaine, en particulier auprès du grand public dont les importations d’espèces captives (faune et flore) sont assez fréquemment le vecteur de ces invasions ;
- de mobiliser rapidement des fonds pour des actions ciblées d’éradication ;
- et d’appliquer les conventions internationales qui existent dans ce domaine, comme celle conclue en 2004, dans le cadre de l’OMC, auprès de l’organisation maritime internationale sur les déballastages.
Cette surveillance des espèces invasives deviendra de plus en plus nécessaire au fur et à mesure que les effets du changement climatique accélèreront l’introduction et l’acclimatation de plus en plus d’espèces exogènes.
En fonction de cette perspective, il pourrait être envisagé de créer une structure dédiée à cette surveillance, coordonnant les efforts des organismes concernés et dotée d’un fond d’intervention. Les coûts de fonctionnement induits par la création et le fonctionnement de cet organisme seront moins élevés que les dommages économiques et sanitaires que génèrent les invasions biologiques.
La contention des pressions anthropiques qui pèsent actuellement sur la biodiversité n’est qu’un aspect de la protection de celle-ci.
La préservation de la diversité biologique du vivant dépendra également de notre capacité à anticiper les menaces à venir et, en particulier, les effets à long terme du changement climatique et l’aggravation de la pression anthropique sur les espèces.
PRÉVENIR LES EFFETS À LONG TERME DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
La vitesse du changement climatique a des effets déjà perceptibles sur la biodiversité, mais l’extrapolation de cette tendance à l’horizon d’un demi-siècle est forte de menaces beaucoup plus inquiétantes. Il faut donc mettre en place des politiques capables de les prévenir.
Le réchauffement moyen enregistré depuis trente ans dans l’hémisphère nord (de l’ordre de 0,7C°) a eu des effets non négligeables tant sur la physiologie des espèces animales et végétales que sur leur aire de répartition ; il crée également les conditions d’une modification de l’équilibre des écosystèmes.
Le tableau qui suit donne un assez bon aperçu des évolutions déjà enregistrées sur la floraison, la fructification et la période de reproduction d’espèces animales et végétales de l’hémisphère Nord.
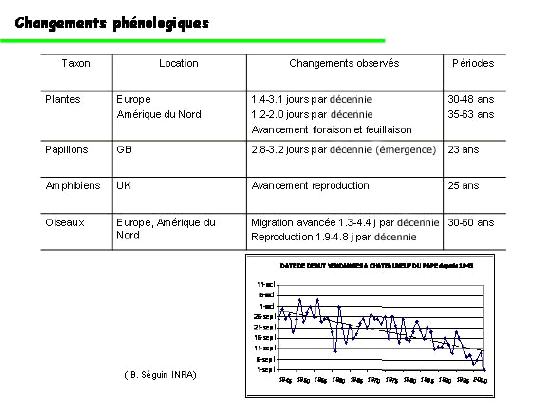
Les changements d’aires de distribution
Ces changements sont bien documentés :
▪ Pour les espèces terrestres
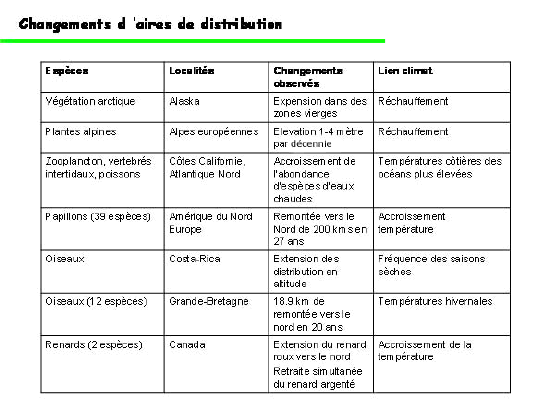
▪ Pour les espèces océaniques
On constate depuis un demi-siècle une remontée de plus de 1 000 km vers le Nord des espèces tropicales. Les données qui suivent, fournies par l’IFREMER montrent que deux espèces de poissons tropicaux que l’on ne trouvait dans les années soixante qu’en dessous de 40° de latitude Nord (environ celle de Lisbonne) ont été recensées dans les années quatre-vingt-dix entre 50° et 55° de latitude Nord (entre le Sud et le Nord de l’Irlande).
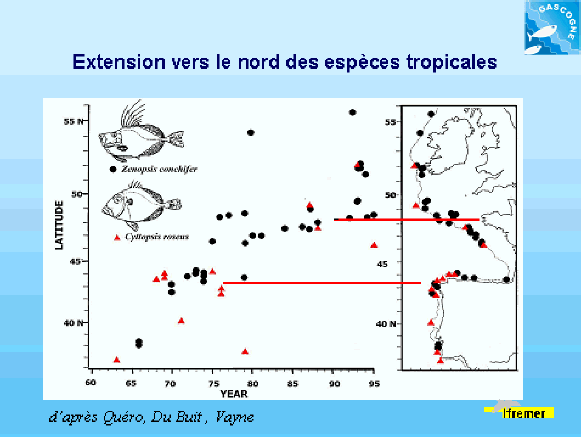
Ce qui est valable pour les poissons l’est également pour les espèces planctoniques : en 40 ans les espèces recensées sur les côtes Sud de la façade Atlantique de l’Europe sont remontées de 10° de latitude vers le Nord.
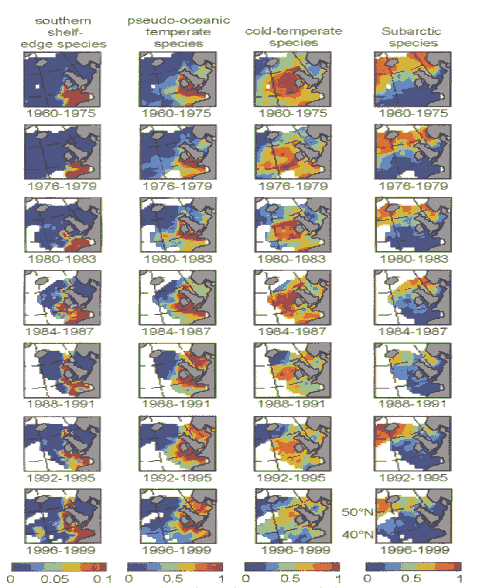
Source : IFREMER
L’évolution de l’équilibre des écosystèmes
Le changement climatique aura des effets très importants sur l’équilibre des écosystèmes.
Un très intéressant colloque tenu par l’ONF et l’INRA en octobre a analysé les conséquences de ce changement sur les interactions entre espèces38 dans les écosystèmes forestiers.
On reproduira ci-après des extraits de ces conclusions qui ont le mérite de donner un aperçu de la complexité des effets du changement climatique sur les écosystèmes forestiers.
« Le changement climatique peut avoir un effet direct sur les pathogènes ou les insectes phytophages en affectant leur biologie ou leur répartition, ou indirect, en affectant la biologie ou la répartition de leurs plantes-hôtes, de leurs ennemis ou compétiteurs.
Ainsi, une augmentation même minime de la température tend à accélérer les processus physiologiques, en permettant un développement plus rapide des insectes, l’augmentation du nombre de générations par saison, l’augmentation des déplacements, et en réduisant la mortalité due aux facteurs abiotiques : par exemple, avec une augmentation des températures hivernales et printanières de 2° C, on prévoit d’observer 4 à 5 générations supplémentaires par an pour certains pucerons (Harrington et al., 2001).
Mais les effets du réchauffement ne peuvent être considérés à partir de simples moyennes globales et vont se différencier selon la saison et le cycle biologique des insectes.
- Impacts potentiels du réchauffement estival
ü Les insectes eux-mêmes peuvent être affectés directement : positivement (par exemple en leur permettant un développement plus rapide, permettant une meilleure survie), ou négativement (par dépassement de seuils létaux de chaleur) ;
ü les plantes-hôtes elles-mêmes peuvent être affectées : par exemple leur affaiblissement par la sécheresse peut diminuer leur résistance aux insectes ou pathogènes. Ainsi l’émergence de Sphaeropsis sapinea (champignon pathogène des pins) en Europe en cours des 20 dernières années a pu être facilitée par des stress répétés : sécheresse ou problèmes de nutrition liés à des excès d’azote d’origine anthropique.
Enfin, les relations mêmes entre insectes et plante-hôte peuvent être modifiées. Ainsi, le synchronisme du développement des insectes avec celui de leur plante-hôte peut se trouver altéré : un tel effet de décalage a été observé aux Pays-Bas, entre 1975 et 2000, pour l’éclosion printanière des œufs de la géométride Operophtera brumata et le débourrement des chênes aux Pays-Bas (Visser et Holleman, 2001). Cependant, ce décalage peut n’être que transitoire et être rattrapé par l’adaptation ou la migration des populations de l’insecte. (...)
- Impacts potentiels du réchauffement hivernal
Ils sont a priori plus importants et plus univoques : le déplacement des isothermes correspondant aux seuils léthaux minimaux vers le Nord et en altitude peut induire une expansion des insectes. Ainsi, une avancée vers le Nord a été observée au XXème siècle pour 65 % des espèces de papillons européens de jour, de 35 à 240 km selon les cas, concomitante à un déplacement de 120 km des isothermes vers le pôle.
L’établissement d’espèces exotiques peut être rendu possible (cas observé pour le Palmier en provenance d’Amérique du Sud et pour le Lycène du géranium en provenance d’Afrique du sud). De même un certain nombre de pathogènes forestiers émergents sont des espèces thermophiles, en particulier des espèces introduites comme le chancre du châtaignier (Phythophtora cinnamomi), ou l’oïdium (Erisiphe alphitoïdes). »
Ces perturbations climatiques ont aussi pour résultat des désynchronisations dont la plus spectaculaire affecte le gobe-mouche qui revient d’Afrique pour pondre en Europe.
L’avancée de la date d’apparition des chenilles dont cet oiseau nourrit ses nichées a abouti à une chute de 90 % de la population de gobe-mouche. Cet effondrement de population s’est produit malgré l’avancée de 10 jours de la date de ponte de cette espèce. Ce qui montre à la fois l’extrême sensibilité des équilibres écosystèmiques et l’existence de capacité d’adaptation des espèces (constatée par ailleurs sur les mésanges et charbonnières aux Pays Bas).
Ces exemples montrent l’intérêt qu’il y aura à ménager des temps et des zones de transition permettant aux espèces menacées d’activer les capacités de résilience face aux évolutions de leur environnement.
DES MENACES TRÈS PRÉOCCUPANTES
Compte-tenu de l’acquis déjà mesurable des modifications apportées à la biodiversité par le changement climatique acquis lors des dernières décennies, la perspective d’une poursuite, et plus probablement d’une accélération de ce phénomène est extrêmement préoccupante.
Pour cadrer l’échelle du problème, on rappellera ces deux évaluations du rapport Stern39 :
- 15 à 40 % des espèces sont menacées par le changement climatique,
- une hausse de 3°C de la température moyenne pourrait affecter le maintien de la forêt amazonienne.
Certes, comme on l’a souligné en première partie de ce rapport, beaucoup d’interrogations subsistent sur l’ampleur et sur la localisation de ces évolutions climatiques futures.
Mais les modélisations effectuées dont certaines bénéficiant déjà des confirmations des retours d’expériences montrent que la biodiversité des écosystèmes terrestres et marins pourrait être fortement perturbée par la poursuite du réchauffement climatique.
Si on ne prend que le cas de la France – et sous réserve de la fiabilité des modèles prédictifs – le changement risque d’être très brutal d’ici la fin du siècle, qu’il s’agisse :
- des variations de précipitations :
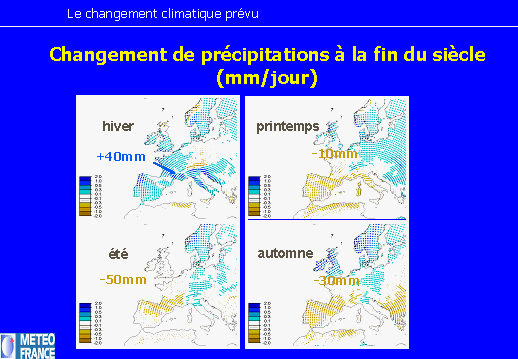
- de la teneur en eau dans le sol :
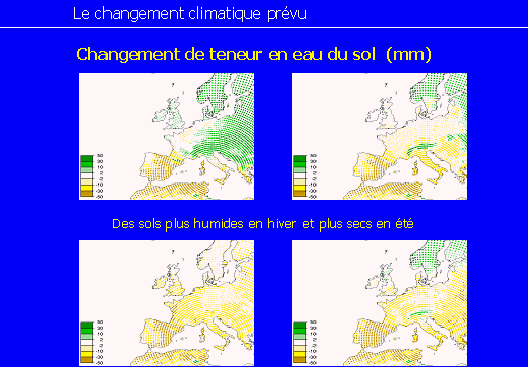
- ou de la fréquence des épisodes caniculaires :
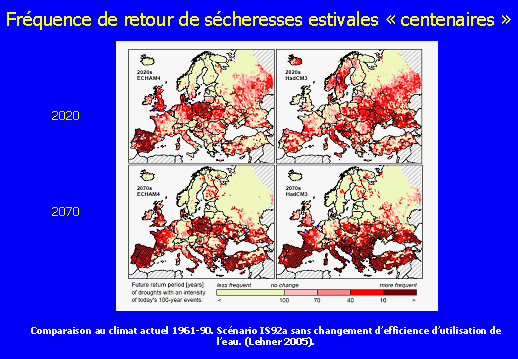
Quelles pourraient être les conséquences des phénomènes qui approcheront par leur ampleur la sortie de l’ère glaciaire il y a 10 000 ans ?
Les principales études dans ce domaine ont été effectuées sur les arbres et les plantes. Mais les modifications très importantes que l’on prévoit sur ces espèces affecteront l’ensemble des écosystèmes qui y sont associés.
En 2004, une équipe de l’INRA de Nancy40 a effectué une projection de l’implantation en 2050 et 2100 de près de 67 espèces éparses réparties en 13 grands groupes d’espèces en se référant au scénario moyen du GIEC.
Les résultats de ces projections montrent, en particulier pour le chêne-liège et le hêtre, des modifications de répartitions spectaculaires :
Cas du chêne vert
Répartition actuelle
Modélisée |
Aire potentielle future
En 2050 |
En 2100 |
Cas du hêtre
Répartition actuelle
Modélisée Le modèle retenu pour le hêtre fait intervenir les déficits pluviométriques des mois de juin et juillet et la température maximale du mois d’octobre |
Aire potentielle future
En 2050 |
En 2100 |
Les résultats de cette projection doivent être à la fois confirmés et tempérés par des constats faits sur les placettes d’observation de l’ONF :
- ces observations montrent que les essences seraient très sensibles aux épisodes de grande chaleur (les traces de stress hydriques consécutifs à la canicule de l’été 1976 sont encore observables41),
- il faut cependant relativiser le « mécanisme » de ces projections. En effet :
L’ONF a constaté que la qualité des sols constituait un facteur très important de résistance des espèces à la canicule.
Par ailleurs, la variété génétique intraspécifique des essences est comparable (elle peut atteindre 30 % pour deux fûts situés à quelques dizaines de mètres l’un de l’autre) et laisse présager des possibilités d’adaptation que les projections ne peuvent pas mesurer. Pour en donner une illustration, il faut rappeler qu’il existe dans l’Orne un isolat de conifères qui a résisté aux changements climatiques consécutifs à la fin de la dernière glaciation.
Mais les essences menacées par le changement climatique auront-elles le temps de s’adapter ?
Une étude conduite par l’Union européenne permet d’en douter :
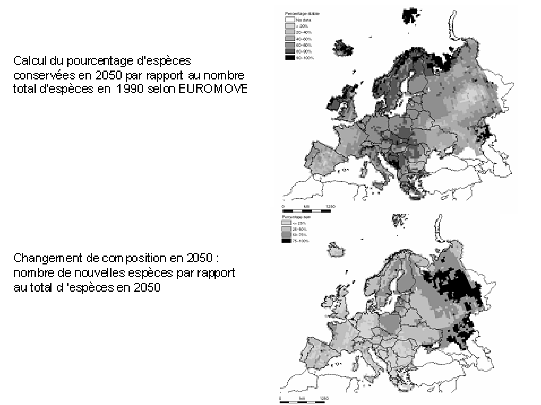
Cette étude met en évidence que le pourcentage d’espèces de plantes qui subsisteraient, en 2050, en cas de poursuite du changement climatique serait quelquefois inférieure à 60 %, la Péninsule Ibérique, le Sud de la France et l’Est de l’Europe étant les zones les plus menacées par cette déperdition.
Des modélisations effectuées sur cette base ont, en outre, montré que dans 19 % des cas, les espèces (et donc les biotopes associés) devraient se déplacer d’un kilomètre par an vers le Nord pour subsister.
Rappelons que cette vitesse a été celle de la recolonisation du chêne à la fin de l’ère glaciaire.
Mais notons que les infrastructures anthropiques (urbanisation routes, autoroutes, voies ferrées n’existaient pas à cette époque).
Les milieux océaniques pourraient être gravement perturbés par la poursuite du changement climatique.
En premier lieu, la chaine alimentaire qui est déjà menacée par la surpêche42 pourrait être vulnérable aux variations de croissance de phytoplancton qui est la base de cette chaîne.
Les efflorescences de phytoplancton ne sont pas aussi régulières depuis 20 ans.
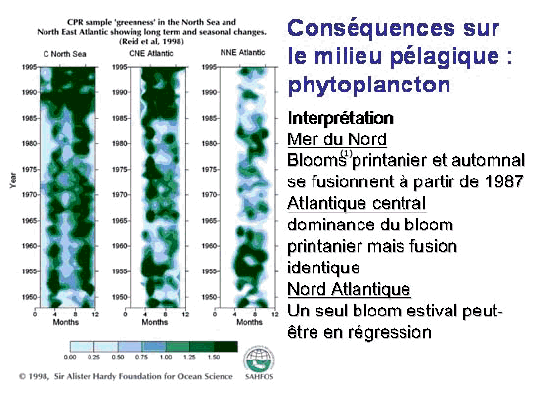
(1) Bloom : poussée de croissance du phytoplancton
Ce phénomène peut avoir des conséquences de grande ampleur jusqu'au sommet de la chaîne alimentaire. On a ainsi constaté, en Mer du Nord, des changements de période d’efflorescence faisant varier les disponibilités des zooplanctons et donc introduisant des décalages avec les fenêtres de nourrissage des alevins de morue.
Par ailleurs, un autre phénomène dont on ne mesure pas encore les conséquences directes sur la biodiversité est envisagé par certains scénarios.
L’augmentation de la teneur en Co2 de l’océan aurait pour conséquences de ralentir les échanges entre les couches d’eaux des océans, et d’augmenter les stratifications entre celles-ci.
Ce phénomène pourrait avoir un effet sur les remontées planctoniques et en aura certainement sur le PH des océans en 2050 (diminution de 8,15 à 7,91 (Co2 X 2) ou à 7,76 (Co2 X 3) ce qui rendrait difficiles les processus biologiques des calcifications de certains organismes marins (mollusques, diatomées, ….)
L’ORGANISATION DES CAPACITÉS DE RÉPONSE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
D’ores et déjà, l’inertie des systèmes climatiques planétaires fait que la vitesse acquise par le phénomène amplifiera d’ici 2050 les conséquences que l’on observe dès maintenant sur l’équilibre des écosystèmes.
Cela revient à rappeler que la façon la plus sûre de lutter contre les effets du changement climatique sur la diversité du vivant est de réduire fortement nos émissions de gaz à effet de serre, au lieu, comme nous le faisons, de les augmenter.
Mais même si ce mouvement de lutte contre l’effet de serre se mondialise et prend de l’amplitude, cela ne dispense pas de mettre en place des politiques ménageant l’avenir de la biodiversité du vivant.
La nécessité de multiplier et de coordonner les actions de surveillance
Les différences de réactions aux pressions de l’environnement de tous les éléments de chaque écosystème supposent que l’on puisse mesurer de façon assez détaillée les réactions d’un maximum de ces écosystèmes au changement climatique.
A l’échelon de la planète, ce constat renvoie à la nécessité de mettre en place une structure capable de centraliser les observations et les recherches dans ce domaine.
L’établissement d’un tel réseau qui serait l’équivalent du groupe d’experts intergouvernementaux sur le climat (GIEC) pour l’observation de l’évolution climatique, a été proposé sous le nom d’IMOSEB par la diplomatie française.
Le principe de sa mise en œuvre pourrait être acquis, en 2008, à la conférence de Bonn sur la biodiversité.
Mais cette surveillance à l’échelle planétaire requiert aussi l’intervention d’une organisation spécifique de l’ONU dédiée à l’environnement, dont l’établissement a été également plusieurs fois souhaité dans ce rapport.
Car si les réseaux de surveillance des pays développés et de quelques pays émergents sont constitués ou en voie de constitution, cette surveillance est sporadique ou partielle dans beaucoup de pays en voie de développement.
Former des scientifiques dans ces pays et les doter des moyens pour contrôler l’évolution de la biodiversité est la condition de la création d’un système d’observation planétaire complet.
Cette observation doit notamment être organisée au niveau des grands ensembles régionaux. Dans l’union Européenne le réseau « Lifewatch » qui a été évoqué par ailleurs doit être mis en place.
En France même, la politique volontariste de placettes d’observation menées par l’ONF doit trouver un répondant dans la surveillance systématique de l’évolution de la biodiversité des prairies et des zones adjacentes aux cultures.
Demeure le problème des milieux côtiers et océaniques. La France, qui possède le deuxième espace maritime mondial du fait de son implantation outre-mer, a également la chance de posséder un organisme de recherche de niveau mondial, l’IFREMER.
Cet institut mène des actions d’étude et de surveillance de la biodiversité, à la fois sur le domaine côtier et dans les océans.
Or, il se trouve que les crédits de l’IFREMER connaissent depuis plusieurs années une stabilisation qui menace la poursuite de cette politique, alors même qu’elle devrait être systématisée tant par les eaux côtières que par les milieux océaniques.
Si, comme cela est probable, le réchauffement climatique se poursuit d’ici 2050, il va être nécessaire d’anticiper ses conséquences et, en particulier, sur les aires d’extension des essences et des biotopes forestiers.
Les espèces - c'est-à-dire les essences – et les biotopes associés pourront-ils assurer cette migration ?
Et si oui, comment ?
Deux types d’actions publiques pourraient y contribuer : la lutte contre le fractionnement des territoires et la mise au point de scénarios de réponse.
▪ Les corridors climatiques
La constitution de corridors qui a déjà été évoquée précédemment devient d’autant plus nécessaire qu’il faut donner aux espèces atteintes par le changement climatique la possibilité de migrer. Or, sur le territoire de la métropole, très anthropisé, cette migration devra s’effectuer aux travers d’espèces consacrées à la culture, aux sols appauvris. Les fonds du deuxième pilier dans la politique agricole commune devrait être utilisé de façon plus systématique dans ce but et les plans d’aménagement de l’espace rural, support de la trame verte proposée par le groupe de travail « biodiversité » au « Grenelle de l’environnement » devront prendre en considération l’établissement de couloirs climatiques.
▪ Les scénarios de réponses
La mise au point de scénarios de réponses est un objectif majeur dont la validation suppose que l’on puisse déterminer si et comment le changement climatique risque d’éradiquer certains écosystèmes forestiers.
Le succès de cette capacité de réponse dépendra aussi, comme le colloque précité tenu par l’ONF et l’INRA le propose, de la mise au point de modèles de fertilité par essence en fonction de l’évolution des variables climatiques.
Ces modèles devraient également être complétés par des modèles de fertilité des sols qui sont un élément fort de résistance au stress hydrique.
Ces scenarios de réponse permettront d’asseoir des politiques de choix des essences et des modes de renouvellement.
« Les choix des essences :
A court et moyen terme, pour augmenter la résilience des peuplements, il faut privilégier les mélanges d’essences, notamment dans les zones où l’espèce principale en place devrait régresser sous l’effet du changement climatique.
A plus long terme, l’ampleur des changements environnementaux annoncés imposera probablement de recourir à des déplacements volontaires d’espèces. Il faut d’ores et déjà s’y préparer en maintenant et valorisant les essais de provenance et arboreta mis en place il y a quelques décennies dans un objectif de création de variétés nouvelles : ces essais peuvent en effet nous apporter de précieuses informations sur les essences de reboisement utilisables en cas de dépérissements massifs.
Les modes de renouvellement :
La régénération naturelle, lorsque l’essence principale en place n’est pas menacée à court terme, offre l’avantage de permettre l’adaptation in situ des peuplements aux évolutions de leur environnement.
Lorsque la régénération artificielle est nécessaire, un certain brassage des populations à moyenne distance pourrait être favorable à une adaptation plus rapide des peuplements, en élargissant la variabilité adaptive des individus. »43
In fine, on ajoutera qu’une attention particulière devrait être accordée à la façade méditerranéenne qui est à la fois le plus grand réservoir de biodiversité de la métropole et la zone où le changement climatique aura eu le plus d’effets sur les biotopes si on se réfère aux modélisations qui y prévoient une forte réduction des précipitations.
Face aux menaces climatiques de disparition ou d’altération de la biodiversité des espèces, plusieurs problèmes de conservation des semences in-situ et ex-situ se posent.
En premier lieu, pour les espèces cultivées en France dont la biodiversité s’est beaucoup érodée.
Dans ce domaine, comme dans d’autres secteurs du développement durable, il y a un écart entre le discours officiel et la pratique politique administrative :
- le Bureau des ressources génétiques chargé de cette conservation a subi des diminutions de ressources,
- la France n’a toujours pas décidé quel organisme devrait piloter la mise en œuvre de la convention sur la diversité biologique (CDB) et le traité de la FAO sur les ressources phytogénétiques qu’elle a ratifié,
- notre pays, qui est un des contributeurs importants de la FAO, ne participe pas non plus au Fonds fiduciaire pour la diversité des cultures qui finance des actions de conservation – in et ex situ – de la biodiversité des semences culturales dans le monde.
Par ailleurs, il pourrait être souhaitable que la France puisse s’associer à une initiative du jardin botanique britannique de Kew Gardens qui a pour objet de stocker, dans des conditions de reproductibilité, plusieurs milliers de graines d’espèces des pays arides ou semi-arides qui pourraient être affectées par un accroissement de la fréquence et de la durée de période de sécheresse.
De même, il devrait s’impliquer dans la conservation par le froid, au Spitzberg, de la biodiversité végétale, à l’initiative de la Norvège.
Une association des pays méditerranéens qui sont parmi les plus menacés par le changement climatique pourrait être pertinente dans le domaine.
Enfin, il paraît difficile de ne pas poser la question de la conservation et de la disponibilité des espèces cultivées anciennes et qui n’apparaissent plus depuis 1961 au catalogue officiel.
Certes, il existe un catalogue simplifié (dont les critères de distinction, et d’homogénéité et de stabilité sont moins stricts que le catalogue officiel), mais qui n’est ouvert qu’au « jardinier du dimanche » à l’exclusion des professionnels44.
Actuellement, un conflit juridique oppose l’association Kokopelli qui propose à la vente des espèces anciennes et les semenciers qui se revendiquent de la protection des consommateurs garantie par le caractère stricte du catalogue officiel et de la biodiversité, non phénotypique, mais génotypique de l’offre de leur catalogue.
Il n’est pas de l’objet de ce rapport d’entrer dans ce type de controverse, mais l’intérêt de pouvoir cultiver en plein champ ces espèces anciennes pour obtenir leur coévolution sous la triple approche du changement climatique, de la résistance aux ravageurs et de la biodiversité du vivant ne se discute pas.
Il devrait donc être possible de faire gérer par l’État un répertoire de ces espèces anciennes, librement accessibles à tous et utilisable par les professionnels.
Le débat sur la sélection génétique
Les problèmes d’interférence entre les cultures génétiquement modifiées et la biodiversité des écosystèmes qui y cohabitent, où les environnent, sont connus.
Mais sans vouloir trancher ce débat, la question se pose de savoir si le recours à des transgénèses permettant, par exemple, de développer la résistance des espèces à la sécheresse ne devrait pas être encouragé, assorti de toutes les précautions nécessaires.
Des expériences faites il y a quelques temps par une équipe russo-canadienne, dans un domaine parallèle, celui de la résistance des céréales au froid, montrent qu’il y a une voie de recherche intéressante à explorer dans ce domaine.
Parallèlement, le recours à une sélection génétique traditionnelle plus poussée – en particulier par sélection d’expression génomique – devrait être activé dans la perspective du changement climatique.
Cet axe de recherche permettrait d’utiliser le réservoir que constitue la variation génétique intra spécifique (qui peut atteindre 30 % à 40 % chez les plantes) et qui a, dans le passé, joué le rôle d’une « ceinture de sécurité biologique » face aux pressions de sélection des changements d’environnement.
LES CONCURRENCES FUTURES D’OCCUPATION D’ESPACES
La pression sur les espaces naturels est la principale cause de la perte de la biodiversité du vivant. Des mesures énergiques peuvent atténuer le niveau actuel de ces pressions, mais les concurrences futures d’occupation de l’espace planétaire et, principalement, la montée de la demande en biocarburants et la croissance de la population mondiale constitueront des menaces de grande ampleur pour la biodiversité.
LA MONTÉE DE LA DEMANDE EN BIOCARBURANTS
En l’état, l’accroissement de la demande en biocarburants est un des vecteurs les plus puissants de la déforestation en particulier en Asie du Sud-Est (Malaise, Indonésie) au détriment de biotopes qui sont parmi les plus riches en biodiversités.
Quelle pourrait être l’évolution de cette demande au cours du prochain demi-siècle ?
Les scénarios disponibles tablent sur un besoin en biocarburants se situant dans une fourchette entre 3,7 Gtep 5 6 Gtep en 2050, avec un accroissement en fin de période.
Ces estimations se fondent sur une amélioration des technologies d’extraction portant le rendement moyen à hauteur de 5/tep/h/an.45.
Ce qui signifie qu’en 2050 il faudrait mettre en culture 10 millions de km² supplémentaires pour satisfaire ce ressaut de demande en biocarburants. Cela correspond à 20 fois la surface de la France, ou au cumul de la surface de l’Amazonie et du bassin du Congo où encore à 1,2 fois la surface de l’Australie.
Pourra-t-on éviter ce grignotage progressif d’espace naturel qui devra se cumuler avec l’accroissement de la demande en produits agricoles ?
A l’exception des mesures d’interdiction indirectes d’importations46 qui ne résolvent que partiellement le problème puisqu’elles ne font que le reporter, la limitation de cette croissance de la demande en biocarburants ne peut résulter que de deux types d’actions :
- celles qui s’efforcent de changer notre mode de développement et notre degré de dépendance des carburants. Il s’agit d’une politique d’ensemble et de long terme décrite dans les propositions du Tome I de cette étude (« Changement climatique et transition énergétique : dépasser la crise ») et dont certaines ont été reprises dans les conclusions du « Grenelle de l’environnement ».
- et celles qui améliorent les technologies d’extraction des biocarburants. Ces technologies dites de 2ème génération, fondées sur la catalyse enzymatique de la filière agrocellulosique, ne sont pas encore mûres mais pourraient apporter après 2015 des améliorations significatives. Des technologies dites de 3ème génération fondées sur les potentiels des micro-algues semblent encore plus prometteuses.
Aussi, en l’attente du mûrissement de ces technologies, il serait pertinent d’établir un moratoire sur l’accroissement du pourcentage de biocarburants dans les carburants utilisés.
NOURRIR 9 MILLIARDS D’HOMMES EN 2050 ?
Les projections démographiques pour le prochain demi-siècle sont difficilement contournables.
Elles prévoient qu’en 2050 la population mondiale s’élèvera à 8,7 milliards – 9 milliards d’habitants, soit une augmentation à venir de 2,5 milliards d’hommes.
Les simples tensions enregistrées depuis un an sur le prix des céréales du fait de la poussée de la demande et des phénomènes climatiques donnent une idée de l’ampleur de ce problème.
Ces projections démographiques indiquent également que cette croissance s’effectuera très majoritairement au bénéfice du milieu urbain47.
Ce qui aura une double conséquence sur l’occupation des espaces :
- la ville est un lieu de transformation des comportements alimentaires (accroissement des quantités consommées, développement de la consommation de viande qui exige de 3 à 6 fois plus d’espaces agricoles par habitant que les céréales et qui consomme beaucoup d’eau : 100 grammes de viande de bœuf correspondent à 1 300 l d’eau)
- la ville incite à un mode de vie encore trop centré sur la mobilité automobile et qui nécessite une voirie à fort maillage. En 2050, si un Chinois sur deux avait une voiture, ces 640 millions d’automobiles supposeraient de neutraliser 13 millions d’hectares de terres) – un chiffre à comparer avec les 29 millions d’hectares déjà occupés pour produire le riz dans ce pays.
On ajoutera que le développement urbain s’effectue autour des villes déjà existantes et que très souvent celles-ci ont été bâties autour des terrains les plus fertiles que ce développement sature peu à peu.
Comment parviendra-t-on, alors, à nourrir 2,5 milliards d’hommes supplémentaires, sans porter atteinte aux espaces naturels terrestres alors même que l’on n’arrive pas à éradiquer la sous-alimentation, puisque selon la FAO, depuis 15 ans le nombre de personnes sous-alimentées s’est stabilisé autour de 850 millions ?48
Dans un ouvrage très intéressant49, Michel Griffon s’est efforcé, sinon de répondre à cette question, du moins de mesurer les contraintes qu’implique la solution.
Et ces contraintes sont lourdes.
Face à la croissance mondiale de la demande alimentaire, les solutions offertes par notre mode de développement pour satisfaire cette demande sont limitées50.
Les espaces disponibles ne sont pas extensibles sauf à amputer fortement les dernières grandes réserves de biodiversité des forêts tropicales51, les ressources de l’océan stagnent, et les incertitudes sur la pluviométrie future font que l’extension des zones irriguées – déjà potentiellement limitée – ne peut constituer une réponse.
On ajoutera que les pertes entre la récolte et la consommation qui d’après le FAO s’établissent pour les céréales entre 10 et 15 % de la production initiale (battage, transport, stockage) sont difficiles à limiter.
Demeure alors l’option traditionnelle d’amélioration du rendement qui a contribué à accroître la production agricole du XIXème siècle dans les pays développés et a constitué l’un des supports de la « révolution verte » dans le Tiers Monde : l’accroissement des rendements.
Le problème est que l’ensemble de ces techniques d’artificialisation des sols, indépendamment des coûts sociaux externes qu’il génère en termes de pollution et de santé publique, se situent maintenant dans des zones de rendements décroissants, compte-tenu de l’appauvrissement des sols et de l’accoutumance progressive des ravageurs aux produits phytosanitaires.
Quelle serait alors la solution ?
Michel Griffon, dans l’ouvrage précité, note qu’actuellement le système « climat-sols-planète » fonctionne comme une « boite noire » que l’on force à l’aide d’engrais et de pesticides.
Il est nécessaire de sortir progressivement de ce système assis sur le tout chimique pour s’orienter vers une agriculture de précision reposant sur la biologie.
Cette agriculture à haut contenu scientifique et technologique viserait à maximiser les conditions de production en épousant très étroitement des processus naturels.
Passer à une agriculture de précision qui serait un jour le pendant de ce qu’est devenue en grande partie l’industrie impliquerait un fort investissement scientifique ou technologique.
D’une part, en modifiant les finalités de la sélection génétique des plantes. Par exemple pour passer de 10 tonnes de riz à l’hectare – ce qui est déjà élevé - à 20 tonnes l’hectare, on s’efforce, dans certaines stations de recherches à modifier l’architecture de la plante, pour accroître sa surface de captage solaire afin de maximiser la production du grain par photosynthèse. De même, on vise à limiter la formation des tiges au profit des feuilles et à multiplier le chevelu racinaire afin que la plante utilise un maximum de surface au sol.
D’autre part, cette optimisation du potentiel des plantes suppose de pouvoir maîtriser avec précision les interventions au cours du processus de production, qu’il s’agisse du moment de l’intensité ou de la localisation d’épandage d’engrais ou de produits phytosanitaires.
Mais si ces perspectives offrent de réelles sources d’augmentation des rendements, leur systématisation ne pourra s’effectuer que très progressivement, compte tenu de l’inertie des acquis culturels et des intérêts croisés qui existent dans le monde agricole.
A cet égard, une question va se poser : quel pourrait être l’effet d’un maintien – et même d’une amplification à terme – de l’augmentation du prix des céréales ?
Deux types de réponses sont possibles :
- soit cette augmentation pourrait donner une marge financière pour pouvoir assurer une transition vers une agriculture de plus grande précision,
- soit elle confortera le modèle agricole actuel de forçage des cultures en en renforçant les comportements acquis.
Par voie de conséquence, il est probable que le changement de modèle de production agricole ne pourra s’effectuer sans intervention de la puissance politique dans un domaine dont beaucoup de secteurs sont largement subventionnés.
TROISIÈME PARTIE
Valoriser durablement la biodiversite
Il est parfois utile de reconsidérer les vérités d’évidence.
Si l’on s’attache au développement de l’humanité depuis 10 000 ans – ce qu’on a appelé la civilisation –, on doit constater que ce développement s’est fait au détriment des espaces naturels et de la biodiversité du vivant.
Faut-il alors préserver la biodiversité ?
Ne pourrait-on pas se contenter de limiter les excès de la pression anthropique à venir et de continuer à arbitrer, le plus souvent possible, en faveur des activités humaines chaque fois qu’elles conduisent à modifier ou à faire disparaître les écosystèmes ?
Cette façon de faire n’est plus pertinente parce qu’au-delà de l’attachement de chacun pour le patrimoine émotionnel de la biodiversité, celle-ci est d’abord un atout pour l’humanité.
La proximité d’une crise énergétique majeure liée à la raréfaction des ressources énergétiques fossiles et la nécessité d’atténuer les effets du changement climatique impose une forte inflexion de notre modèle de développement économique.
Dans cette perspective, l’utilité de la biodiversité des écosystèmes doit être considérée dans une double approche.
Ÿ L’une, traditionnelle, qui consiste à garder à l’esprit qu’il est nécessaire de faire un usage durable des biens et services qu’elle nous propose,
Ÿ L’autre, plus novatrice, qui consiste à faire de la biodiversité un des supports du nouveau modèle de développement auquel – les crises climatiques et énergétiques aidant – on ne pourra pas se soustraire.
Sur ce dernier point, deux axes de recherche se profilent : l’identification et la rémunération des services rendus par les écosystèmes et l’exploration d’un réservoir de biens qui pourrait être une des boîtes à outils de la quatrième révolution industrielle.
La valorisation des services ecologiques
Les services écologiques sont comme une « main invisible » qui a permis le développement de l’humanité52.
Dans un article devenu depuis célèbre53, l’économiste R. Costanza a répertorié 17 grandes fonctionnalités produites par les écosystèmes de la planète, de la régulation du climat et de l’atmosphère à la production de nourriture et de matières premières.
Dans le même ordre d’idées, « l’évaluation du millénaire » qui s’efforçait, par ailleurs, de mesurer les risques d’appauvrissement de ces fonctionnalités les a regroupées en quatre grandes catégories de services (la logistique du système, les flux d’approvisionnement du système, la régulation du système et les services culturels).
Les écosystèmes de la planète dispensent à l’humanité des services qui sont autant d’économies externes indispensables.
Mais si ces apports sont très diversifiés, ils sont très insuffisamment reconnus.
Par définition, les services écologiques qui s’expriment dans un environnement naturel ne se distinguent pas des manifestations de cet environnement, leurs fonctions essentielles ne sont donc pas toujours perceptibles.
Par exemple, les services de régulation de l’atmosphère de transformation du méthane et du Co2 assurés par les plantes et les micro-organismes sont invisibles mais essentiels. Un article récemment paru dans Nature (19 octobre 2006) a établi qu’au Svalbard, des micro-organismes recyclent le méthane émis par des volcans à 1250 mètres de fond.
Cela donne une idée de l’offre très diversifiée des services écologiques.
On mentionnera trois types d’exemples de ces services écologiques : les services sanitaires, agronomiques et hydrologiques.
Des expériences convergentes effectuées au Brésil par l’Institut Oswaldo Cruz et aux Etats-Unis par le National Institut of Health Service ont prouvé expérimentalement que la biodiversité des milieux joue un rôle d’inhibiteur de pathologies graves pour l’homme (leishmaniose, maladie de Chagos, maladie de Lyme)
On a constaté à l’opposé que la destruction des milieux54 était un facteur favorisant la propagation de ces maladies :
- d’une part, les vecteurs porteurs de ces affections peuvent se transporter dans les milieux fréquentés par les hommes sans que leur ravageurs le fassent (c’est le cas de la punaise en Indonésie dans les palmeraies à huile plantées à la suite d’une déforestation),
- et, d’autre part, la destruction des milieux naturels peut entraîner celle de mammifères porteurs du pathogène mais ayant peu de contact avec l’homme, ce qui encourage les vecteurs à se fixer sur des mammifères qui ont plus de contact avec l’homme (chien, chat, rat).
Cette contention des pathogènes est très importante. Mais on en découvre la valeur lorsque les écosystèmes correspondants sont détruits.
Cette fonction d’inhibition assurée par les écosystèmes pourrait jouer un rôle capital dans la perspective du changement climatique.
On doit rappeler que les agents pathogènes pour l’homme sont 300 fois plus nombreux dans les zones tropicales que dans les régions tempérées.
Or, le changement climatique aidant, une partie d’entre eux pourrait connaître une translation vers des zones plus tempérées. On a déjà constaté que les épisodes de poussée d’El Niño, qui correspondent à un réchauffement, créent dans l’hémisphère sud une montée des épidémies.
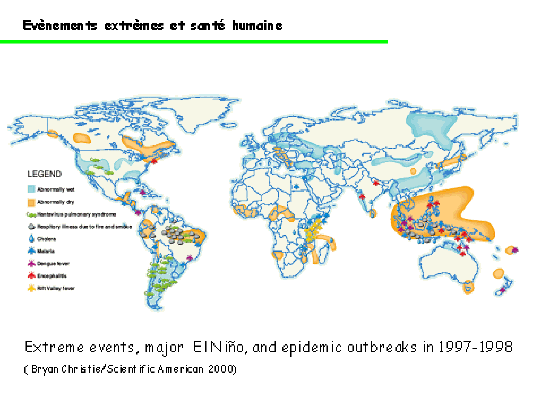
Il va donc de soi que la limitation de l’extension de ces pathogènes sera d’autant plus forte qu’elle pourra s’adosser à des écosystèmes variés.
Dans les pays développés, les abeilles, domestiques et sauvages, sont les sentinelles de la dégradation progressive des écosystèmes.
Le collapsus actuel de leurs colonies est donc un signe très préoccupant.
Victimes des espèces invasives comme le frelon asiatique et de l’accroissement de l’usage de pesticide, elles sont aussi affaiblies – et donc rendues plus sensibles aux agressions de leurs pathogènes – par l’appauvrissement des biotopes agricoles, la suppression des haies et la généralisation des courtes périodes de floraison.
Or, ces apidés – il existe près de 20 000 espèces apparentées aux abeilles – contribuent à la survie de plus de 80 % des espèces de fleurs et à la production de 35 % de la nourriture végétale de l’homme (arboriculture, tomates, etc.) ; elles ont également un rôle très important dans le développement des cultures destinées au bétail (luzerne, trèfle) et des cultures oléagineuses (colza, tournesol).
Mais cet apport n’est maximal que lorsqu’il existe une biodiversité de milieu propice aux abeilles ou aux bourdons faute de quoi ils ne remplissent qu’imparfaitement ces fonctions.
L’exemple qui suit, tiré de travaux présentés par J.C. Lefeubvre, est une bonne illustration des effets d’une modification des écosystèmes sur la pollinisation et indirectement des pertes de rendement qui résultent de l’affaiblissement de la biodiversité des écosystèmes :
« Des légumineuses comme le trèfle sont essentiellement pollinisées par des insectes hyménoptères regroupés au sein de la superfamille des apoïdes et des bourdons.
La comparaison entre abeilles et bourdons donne un net avantage à ces derniers. Par rapport à une abeille, une reine de bourdon pollinise 5 fois plus de fleurs par minute, tandis que les ouvrières de bourdon à langue longue sont 2,5 fois plus efficaces et celles à trompe courte 1,5 fois plus que les abeilles. Par ailleurs, les bourdons travaillent par tous les temps alors que les abeilles sont de bons agents pollinisateurs uniquement par beau temps.
On conçoit dès lors que lorsque les agriculteurs producteurs de graines de trèfle dans le Val d’Authion ont vu leur rendement décliner fortement au fil du temps dans les années 1970, un regard particulier a été porté aux bourdons. Dans les conditions « normales », l’ensemble des bourdons présents, à trompe longue ou courte, associés parfois à des abeilles, permettent d’obtenir des récoltes de graines variant de 600 à 800, voire 1250 kg/ha.
(...) Les chutes de rendement constatées l’étaient dans les zones soumises au remembrement caractérisé par des arasements de talus boisés et se traduisant par des chutes importantes de densité de bourdons aux 100 m2 (inférieure à 20). Cela s’explique par le fait que les reines fondatrices de colonies ne peuvent hiverner dans les champs soumis au labour ; elles se réfugient sur les talus (sous la mousse, dans la terre ou le terreau des arbres creux). Au printemps, elles bénéficient pour nourrir leur colonie du nectar des plantes sauvages à floraison précoce telles que : les saules, le bugle rampant, le merisier, etc. que l’on trouve sur les talus à un moment où aucune plante domestique ne fleurit sur les champs. La destruction des talus se traduisant donc par une chute importante des populations de bourdons, la densité de ces insectes étant trop faible, bien des fleurs ne pouvaient être fécondées, d’où des rendements se situant autour de 200 kg/ha.
Mais les données se sont compliquées avec l’arrivée de nouvelles variétés de trèfle, en particulier d’un trèfle tétraploïde. En effet, si ce trèfle est intéressant en raison de sa production de biomasse, on avait négligé le fait que si les feuilles s’accroissent, il en est de même de la longueur de la corolle. Cette élongation élimine bien sûr les abeilles mais aussi tous les bourdons à trompe courte ; une seule espèce est alors capable de polliniser les fleurs. Résultat encore plus catastrophique : les bourdons à trompe courte développent un comportement spécifique, le « robbing » qui lui fait percer des trous à la base des fleurs pour aller chercher le nectar, se transformant d’auxiliaire en ravageur de culture. C’est ainsi que dans les conditions d’une zone remembrée, avec seulement 10 bourdons/100m2, la production chute à 80kg/ha, soit d’un facteur 10 par rapport à la « productivité » d’un écosystème intact. »
Les autres apports agronomiques
Outre sa contribution au processus d’enrichissement des sols, la biodiversité des milieux agricoles est à la fois un facteur de productivité globale agricole, un moyen de limiter la pollution, un support de résistance aux modifications environnementales et un milieu de contention des ravageurs.
Un facteur de productivité agricole
Cette faculté des écosystèmes peut s’approcher de deux façons :
- au regard de la productivité totale des facteurs employés.
Un article paru il y a peu55 dans « Science » établit que les biocarburants issus de prairies à grande biodiversité et cultivées avec peu d’insecticide avaient une efficacité de lutte contre l’effet de serre plus de 200 % supérieure à celles des grandes monocultures de maïs, produisant de l’éthanol avec beaucoup d’intrants.
- en fonction de la biomasse produite.
Plusieurs études établissant une corrélation positive entre le nombre d’espèces herbacées dans un espace et la biomasse produite.
Une étude européenne faite dans plusieurs pays établit cette corrélation :
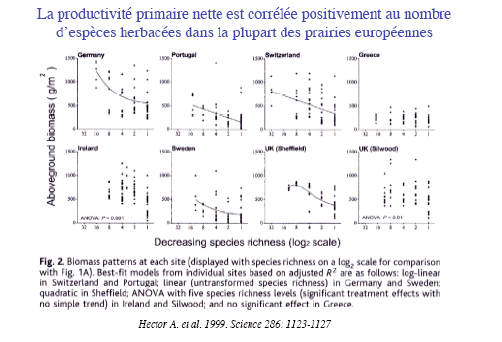
Cette étude confirme une expérimentation de même nature faite aux Etats-Unis, dont les résultats sont proches, à cette réserve près que cette dernière fait apparaître un plateau de productivité au-delà de 15 espèces.
Cette augmentation de la productivité, en relation avec le degré de biodiversité, peut s’expliquer par différents phénomènes de complémentarité :
§ entre les végétaux manquant d’azote et ceux le fixant mieux dans le sol,
§ entre les végétaux qui injectent plus de flux carbonés dans le sol et ceux qui en injectent moins.
Des études, menées en Europe et aux Etats-Unis, ont montré que l’accroissement de la biodiversité d’une parcelle affecte négativement la présence de nitrate dans le sol.
Un support de résistance aux modifications de l’environnement
La biodiversité des écosystèmes est « une mémoire de réussite » puisqu’elle est la résultante, dans l’hémisphère Nord, de l’évolution d’écosystèmes qui ont réussi à résister aux variations de l’environnement depuis la dernière glaciation.
Conserver cette mémoire est donc essentiel dans la perspective du changement climatique.
Un mécanisme de limitation des ravageurs
L’INRA de Rennes a montré que la destruction des zones bocagères a eu un effet sur la montée des pucerons ravageurs des cultures. En open field, ces ravageurs ne sont plus contrôlés, alors qu’en zone bocagère ils subissent un double contrôle – assez raffiné puisque variable suivant les conditions hygrométriques – soit d’un champignon, soit d’un hémisphère.
Des expériences similaires effectuées également par l’INRA, mais en milieu forestier, ont montré que l’insertion de feuillus dans une plantation industrielle de conifères faisait baisser l’impact des ravageurs, probablement parce que ceux-ci hébergent deux fois plus de prédateurs de ces ravageurs que la monoculture forestière de pins.
Malgré ces études, la destruction du bocage, des talus et haies se poursuit, aux limites du Poitou et de la Vendée notamment, car la grande presse, la presse quotidienne régionale et la presse professionnelle en font trop peu état et véhiculent encore le productivisme, de même que les modalités d’application de la politique agricole commune.
Les zones humides – dont plus de la moitié ont disparu un France depuis 50 ans – les forêts, les talus, constituent autant d’écosystèmes qui jouent un rôle essentiel dans la distribution hydrologique.
Le rôle des marais en matière de prévention des crues que l’on avait oublié, est revenu au premier plan à l’occasion de la crue de la Vilaine qui a particulièrement atteint la ville de Redon il ya quelques années, et dont l’ampleur était imputable au fait que l’on avait asséché les zones humides situées en amont de la ville.
Mais ces zones jouent également un rôle dans l’élimination des nitrates du sol grâce à un double processus de rétention et d’élimination par les micro-organismes.
De même, l’hydrologie des systèmes bocagers permet d’éviter la rapidité d’écoulement des eaux, ce qui permet à la fois d’endiguer les effets des crues et de limiter, en saison sèche le niveau des étiages.
Cet effet biologique est conforté par un phénomène physique car le bocage crée l’obligation d’avoir des sillons perpendiculaires aux pentes alors qu’en open field les sillons sont souvent parallèles aux pentes, ce qui amplifie l’écoulement des eaux et l’érosion des sols.
Dans le même esprit :
- les micro écosystèmes mixtes arbres-enherbage le long des ruisseaux ont des effets de filtration forts des effluents agricoles :
- les bordures arborées permettent de capter une partie des éléments fertilisants, nitrates et phosphorés.
Ainsi, d’après une étude menée par Arvalis, une bordure enherbée de 6 mètres de large permet de neutraliser 85 % des pesticides s’écoulant par ruissellement56.
L’identification de plus en plus précise des économies externes que les écosystèmes nous fournissent gratuitement, prouve l’intérêt d’une nouvelle discipline depuis deux décennies : l’ingénierie écologique.
Celle-ci utilise notre connaissance des fonctionnalités des écosystèmes, en les artificialisant afin de mettre au point des processus de production ou de restauration plus durables.
Par exemple, la phytoremédiation utilise aussi amplement que possible l’ensemble des possibilités d’actes de plantes à des fins de dépollution (rhizofiltration dans les milieux humides, phytoextraction des métaux lourds, phytodégradation enzymatique de certains composés polluants, etc.).
Autre exemple, la restauration récente des berges de l’Isle grâce à des travaux de génie écologique est moins coûteuse et plus durable que les techniques classiques de génie civil.
DES SERVICES INSUFFISAMMENT RECONNUS PAR L’ÉCONOMIE
Un constat s’impose : l’étude des externalités positives fournies par les écosystèmes reste un domaine qui n’a pas été complètement exploré par la recherche économique.
C’est lié au fait que les services rendus par les écosystèmes étaient abondants et disponibles. Il s’agissait de facteurs de production indispensables – mais indirects et gratuits – qui n’étaient pas pris en compte dans le calcul économique.
Or, l’affaiblissement progressif des écosystèmes entraîne l’érosion de la disponibilité des services qu’ils rendent, et la montée des conflits d’appropriation consécutifs à cette raréfaction57.
Il est donc nécessaire de réinsérer les services écologiques dans le calcul économique et de tirer les conséquences de cette réinsertion en modifiant les politiques publiques qui les concernent directement.
LA RÉINSERTION DES SERVICES ÉCOLOGIQUES DANS LE CALCUL ÉCONOMIQUE
Des économies externes très importantes
Quelle est la mesure financière des services que les écosystèmes fournissent presque gratuitement à l’économie mondiale ?
Le principal chiffrage a été effectué par l’économiste Costanza58 qui a calibré l’ensemble des biens et des services fournis par la biodiversité à 33 000 milliards en 1995 et non comptabilisés (donnée à comparer avec le PIB mondial actuel qui est de l’ordre de 35 000 milliards de dollars)
Cette évaluation est assez rudimentaire mais elle met en perspective l’importance des services rendus par les écosystèmes, puisque ce n’est qu’au terme de deux siècles de développement industriel accéléré que l’humanité arrive à produire une valeur de PIB de même ordre.
En d’autres termes, les services rendus par les écosystèmes nous fournissent gratuitement l’équivalent d’un produit intérieur brut mondial.
Cette mise en parallèle constitue un avertissement salutaire et une incitation économique à user plus durablement de ces ressources.
Des caractéristiques qui ne correspondent pas au fonctionnement du marché
Les services fournis par la biodiversité des écosystèmes sont utilisés par le marché mais ne correspondent pas à sa logique de fonctionnement :
- ils reposent sur des temps longs de constitution ou de reconstitution après usage,
- ils fournissent des utilités collectives qui ne sont pas clairement appropriables par des acteurs individuels,
- à l’opposé, les conditions de leur maintien s’opposent régulièrement à des appropriations privatives,
- enfin, lorsque ces services se dégradent, cette altération n’apparaît pas clairement en termes de niveau de vie car elle n’est pas intégrée au PIB. Au contraire, l’accroissement du fait de la dépollution pour l’eau semble accroître le PIB.
Pourtant des instruments qui permettent de quantifier financièrement, et donc de les réintégrer dans les équations de prix, existent :
- Les coûts comparatifs de maintien.
A titre d’illustration, on peut référer le coût de l’érection de barrages réservoirs de rétention de l’eau et le coût de maintien d’une surface de zones humides rendant les mêmes services.
C’est également une des méthodes choisie par les Costaricains qui alignent le rapport économique d’une forêt sur le rapport d’une surface cultivée ou mise en pâture fixée par la Banque mondiale (environ 50 dollars/hectare) et en déduisent une part (de l’ordre de 10 dollars/hectare) pour rembourser les services écologiques rendus par la forêt.
- Les coûts comparatifs de remplacement.
Ce type de calcul qui s’apparente au précédent consiste à mettre en parallèle le coût de maintien d’un écosystème et les coûts indirects de remplacement fournis par sa disparition ou son altération.
Cette méthode peut être appliquée, par exemple, au rôle des haies dans la contention et dans le maintien de la pollinisation des ravageurs, le coût de comparer leur maintien et celui de leur disparition.
- L’organisation de la rareté
Si leur affaiblissement se poursuit, les services écologiques deviendront rares. D’où l’idée qu’il peut être possible d’organiser par anticipation une rareté permettant de réintégrer ces services dans le calcul économique.
On a vu, en seconde partie de ce rapport, qu’il serait envisageable de recourir à cette solution pour limiter les pressions sur certains éléments des biotopes mondiaux, comme les ressources halieutiques ou les bois tropicaux.
Mais, on voit bien que l’utilisation de l’ensemble de ces instruments économiques qui permettraient de donner une valeur marchande aux services fournis par la biodiversité, peut être limitée par la nature collective des biens qu’ils permettent de délivrer – comme l’eau – et par le fait que le maintien des écosystèmes relève de durées longues peu adaptées à l’instabilité des transactions marchandes.
Il est donc clairement du ressort de la puissance publique d’organiser par anticipation la prise en compte de ces services par l’économie, avant que la raréfaction n’en renchérisse excessivement les coûts. Cela suppose une réorientation des politiques publiques.
LA RÉORIENTATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
La réintégration progressive des économies externes produites par la biodiversité des écosystèmes, concerne les pays émergents dont certains sont le domaine d’élection d’une agriculture industrielle étroitement corrélée à la destruction des écosystèmes et à l’appauvrissement de leur fonctionnement du fait des forts taux d’engrais et de pesticides employés dans ce type de cultures.
Mais cette réintégration est tout aussi nécessaire et urgente dans les pays développés.
Parce que l’intensification des techniques de forçage des milieux naturels y a atteint un plafond.
Et aussi parce que la sensibilisation des populations à ces questions y est plus avancée et que la richesse de ces économies leur confère une marge d’évolution.
Ceci est particulièrement valable pour l’Union européenne et pour la France qui devront peu à peu s’inspirer du constat que l’on ne pourra plus produire, d’ici 2030-2050, des biens agricoles sur le même mode qu’aujourd’hui.
Les contraintes qui pèseront à terme sur nos économies impliquent une réorientation de nos politiques dans ces domaines.
Le renforcement des inflexions de la politique agricole commune (PAC) en faveur de la protection des écosystèmes
La politique agro-environnementale de l’Union.
Le mouvement actuel de hausse des prix des céréales produit par une poussée de la demande mondiale dans le long terme pourrait avoir des effets contradictoires sur la politique agricole commune et sur la biodiversité.
D’une part, il peut inciter l’Union européenne à réduire les jachères et à augmenter les quotas de production.
Mais, d’autre part, s’il se maintient, ce mouvement diminuera de facto de coût des soutiens aux prix agricoles et pourra offrir une marge financière pour le développement des mesures agro-environnementales (MAE) dites du « second pilier ».
La politique menée par l’Union dans ce domaine depuis 1992, et surtout après le sommet de Berlin de 1999 et l’accord agricole du Luxembourg de 2003, repose sur plusieurs principes :
- le découplage des aides qui compense la baisse des dépenses de soutien aux marchés par l’allocation d’aides aux exploitants. Cette formule est d’ailleurs socialement souhaitable, car le soutien aux marchés aide surtout les très grandes exploitations sans tenir compte des multiples petites exploitations plus adaptées au maintien de la biodiversité et de la gestion environnementale du territoire.
- l’attribution d’aides directes sous condition de respect de l’environnement. Les exploitants bénéficiaires sont tenus de :
▪ respecter des obligations environnementales fondamentales telles la directive nitrate ou les directives Natura 2000, ou la directive sur l’utilisation des produits phyosanitaires ;
▪ maintenir la proportion de pâturages permanents au sein de la surface agricole utilisée en 2003 ce qui permet de conserver, au niveau national, la part des surfaces en pâturages permanents qui sont des écosystèmes aux effets positifs multiples (eau, sol, biodiversité) ;
▪ et d’entretenir les terres selon les bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE).
- la compétence des États membres pour la définition des mesures agro-environnementales et le système d’allocation des crédits (dont l’enveloppe a évoluée de 1 milliard d’euros en 1999 à 2 milliards d’euros en 2006)
En France, la mise en œuvre de cette politique repose sur deux types d’actions :
- une mesure nationale – la prime à l’herbe pour le maintien des élevages extensifs.
- des contrats régionaux dont le dispositif a évolué dans le temps. 1999 : contrats territoriaux d’exploitation ; 2002 : contrats d’agriculture durable ; 2007 : mise à disposition d’une boîte à outils nationale de 48 mesures (au lieu de 170 antérieurement) parmi lesquelles les exploitants peuvent choisir.
- l’aide par les organismes publics tels l’INRA ou la FAO à la culture des plantes traditionnelles et d’espèces autres que celles du répertoire en France pour sauvegarder les semences de variétés anciennes, et éventuellement expérimenter des plantations ayant un intérêt nutritif certain tels les amarantes qui constituaient l’essentiel de la nourriture amérindienne et dont la richesse en protéines est reconnue59.
Les marges de renforcement et d’amélioration
Le regard que l’on peut porter sur la première application de cette politique dessine les voies de son amélioration.
Cette amélioration est d’autant plus nécessaire que la biodiversité des écosystèmes européens liés à l’agriculture se détériore.
Les mesures agro-environnementales révèlent à la fois une carence de conception et des défauts d’application :
Ÿ La carence de conception résulte de la déconnexion profonde qui existe entre le soutien aux prix agricoles et la politique d’encouragement à l’agriculture raisonnée.
Le soutien au prix des céréales ne prend que rarement en compte les possibilités de réinsertion d’espèces de céréales plus résistantes aux ravageurs, et sollicitant moins d’intrants et d’apports en irrigation.
Avec le résultat que la filière agroalimentaire n’est volontairement pas incitée à opérer des adaptations qui seraient possibles.
On en donnera deux illustrations :
- L’INRA a montré que planter du sorgho à la place du maïs aboutissait à des résultats comparables pour nourrir le bétail tout en économisant largement les ressources en eau. L’aval de la filière ne s’est pas intéressé à cette politique, alors même que la possibilité d’une réduction des précipitations de printemps, indispensables à la croissance des végétaux, dans le Sud de la France ne peut être écartée.
- L’INRA, de Rennes, a développé des recherches sur les blés rustiques à bas niveau d’intrants en créant des génotypes cumulant :
• productivité et teneur en protéines en conditions de fertilisation N contingentée,
• résistance diversifiée (gènes et mécanismes) aux maladies,
• résistance à la sécheresse de fin de cycle (évitement par précocité ou meilleur enracinement),
• compétitivité vis-à-vis des adventices (pouvoir couvrant),
• biomasse totale plus importante pour valorisation non alimentaire,
• farines de meilleure valeur nutritionnelle.
Les premiers résultats des expériences en plein champ menées avec ces blés rustiques montrent, à qualité nutritionnelle égale, des indices de fréquence de traitement (IFT) inférieurs à 50 % par rapport à une exploitation traditionnelle.
Or, la profession, qu’il s’agisse des semenciers, des coopératives ou des meuniers, demeure réticente à s’engager dans cette voie.
Ÿ Les défauts d’application
Ces défauts sont de plusieurs ordres :
- La biodiversité à protéger n’est pas définie avec suffisamment de précision.
Les prairies permanentes sont subventionnées de la même façon suivant qu’elles aient cinq ou cinquante ans d’âge, ce qui correspond à des états de biodiversité différents.
Les haies (dont le maintien fait l’objet d’importants concours financiers du deuxième pilier) ne sont définies ni en hauteur ni en épaisseur. De fait, certains conseils généraux ont accordé des subventions pour les plantations de haies qui, trop basses, n’ont pas été pérennes et ont été détruites en fin de contrat.
Or, des études de l’INRA montrent que, même sur de très grandes parcelles, la constitution de haies hautes et épaisses contribue fortement au maintien d’une biodiversité de l’écosystème agro-environnemental.
- La cohérence finale du système est menacée par les conditions de sa mise en œuvre.
D’une part celui-ci repose sur le volontariat, ce qui renvoie à la difficulté de créer des effets de seuil car ils dépendent du degré de participation des exploitants dans une zone.
A titre d’illustration, si 30 % des haies sur une aire de 10 km² sont traitées aux pesticides, la fonction écosystémique des haies de cette zone diminue fortement.
D’autre part, l’émiettement de l’application territoriale est renforcé par l’émiettement des mesures. Par exemple en matière de protection de la qualité de l’eau, les agriculteurs peuvent choisir entre une douzaine de mesures dont la mise en œuvre leur rapporte plus ou moins de subventions.
- La complexité du système entraîne des coûts de transaction trop élevés (de l’ordre de 30 % de l’aide à la charge de la collectivité et des agriculteurs).
Enfin, on ajoutera que l’encouragement au maintien de la biodiversité n’exclue pas, par ailleurs, que celle-ci soit détruite : on peut planter des haies dans certaines zones, mais rien n’interdit de les détruire dans d’autres.
Les mesures agro-environnementales édictées en vue de restaurer les écosystèmes liés à l’agriculture devraient, à terme, avoir pour résultats à la fois d’accentuer les disponibilités en eau et de limiter la destruction des systèmes aquatiques continentaux qui sont parmi les plus affectés par l’anthropisation.
Mais, au-delà, se profilent les conséquences des changements de l’hydrosphère, et donc des biotopes qui y sont associés, qui pourraient résulter du changement climatique.
Et on perçoit déjà que les épisodes de canicule ou même d’alerte de sécheresse aiguisent les conflits d’attribution dans ce domaine.
C’est pourquoi, outre le renforcement de l’efficacité des MAE évoquées plus haut, trois pistes doivent être explorées.
L’application de ce principe progresse très lentement à l’échelle européenne : un compromis intervenu au mois de juin 2007, sur le projet de directive concernant la responsabilité environnementale vise, dans certains secteurs, à encourager, mais non à obliger, les industriels à s’assurer contre les dommages environnementaux liés à leur activité.
Cette timidité emporte un double inconvénient lorsqu’il s’agit des activités agricoles :
- elles font supporter aux utilisateurs finaux le coût des pollutions imputables aux utilisateurs intermédiaires,
- elle n’incite pas ces derniers à opérer des investissements technologiques et des mutations de pratiques industrielles ou culturales qui deviendront indispensables dans les deux décennies qui viennent.
Pourtant le seul pays en Europe qui impose ce principe, le Danemark, obtient des résultats probants.
On comprend bien les motifs économiques qui poussent à retarder cette échéance, mais il serait plus que souhaitable d’établir des règles et de fixer des délais pour une application progressive du principe pollueur-payeur.
A défaut de quoi le niveau de pollution des écosystèmes aquatiques continentaux juste tolérable pour une ressource qui demeure abondante, ne le sera plus pour une ressource qui va se raréfier dans certaines régions.
La gestion des conflits d’usage
La sur-utilisation de l’eau par l’agriculture a des conséquences en situation de pénurie ; elle en a également en cas de pluviosité normale.
Indépendamment même des pollutions en pesticides et insecticides imputables aux activités agricoles, le simple fait de peser sur les ressources des nappes phréatiques, aboutit à des conflits d’usage entre l’utilisation agricole de cette eau, les besoins des populations tout comme ceux des industries ou de services comme le tourisme, et les équilibres des écosystèmes qui supportent eux-mêmes des activités comme la conchyliculture.
Il est donc nécessaire de trouver une structure de gestion de la ressource, pertinente à l’échelon de la totalité d’un bassin versant, qui assurerait politiquement le rôle technique que jouent les agences de bassins.
La constitution de parcs hydrologiques naturels
Le problème qui se pose est celui de la restauration à grande échelle d’écosystèmes, comme les marais ou les zones humides qui jouent un rôle dans la captation, la purification, la rétention et l’écoulement des eaux.
On a cité l’exemple de la zone humide de la Bassée en amont de Paris dont l’existence permet d’économiser 200 millions d’euros, qui en son absence auraient été consacrés à l’édification de barrages réservoirs. De même en achetant et en aménageant des zones marécageuses dans le New-Jersey, la municipalité de New-York a dépensé un milliard de dollars mais économise 300 millions de dollars par an.
Il est possible d’inciter les agences de bassin à mettre en œuvre une politique de ce type. Il suffit de le vouloir.
Cette politique pourrait être confortée par l’établissement de parcs hydrologiques naturels, dont les coûts de constitution et d’entretien pourraient être supportés par tous les usagers de l’eau.
UNE DES BOITES A OUTILS DE LA QUATRIEME REVOLUTION INDSTRIELLE
La mise en parallèle à l’horizon 2050, de la croissance du nombre d’hommes, de l’augmentation de leurs besoins, et de la raréfaction des ressources mises à notre disposition nous contraindra à modifier assez rapidement l’assise de notre développement économique.
Or, notre mode de développement est largement l’héritier de la révolution industrielle et des nombreux acquis technologiques du dernier siècle et repose sur un postulat de disponibilité de ressources qui vont se raréfier. Certes, on peut estimer que le passage progressif à une société numérisée permettra d’optimiser graduellement certains de nos processus industriels.
Mais, pour l’essentiel, beaucoup de procédés industriels que nous mettons en œuvre sont dispendieux en matières premières, coûteux en énergie et insuffisamment sélectifs.
A l’opposé de ces procédés industriels physicochimiques, l’évolution a produit des solutions biologiques, beaucoup plus sophistiquées que les artéfacts humains pour répondre aux pressions de sélection.
Cette « mémoire de réussite » que constitue la biodiversité du vivant doit conduire à une montée de l’industrie basée sur la biologie et la biotechnologie qui jointe à la montée des nanotechnologies, sera un des ressorts de la prochaine révolution industrielle.
Deux grands chantiers scientifiques et technologiques vont y contribuer : la bio-inspiration et les biotechnologies.
LES PRODUITS BIO-TECHNIQUES ET BIO-INSPIRES
Le mythe d’Icare, les planches de Léonard de Vinci ou la « chauve-souris » de Clément Ader témoignent du fait que, dans le passé, la biodiversité du vivant a été une source d’inspiration du progrès technologique.
Plus proche de nous, on peut mentionner l’invention du Velcro en 1941 par un ingénieur Suisse, Georges de Mestral, qui s’est interrogé sur les données physiques qui permettaient aux chardons de rester accrochés à la fourrure de son chien.
Dans les dernières années, on a assisté à un rapprochement dans la démarche de certains physiciens ou chimistes avec les modes de fonctionnement du vivant.
Les exemples de la structure autonettoyante de la feuille de lotus, du placement de la punaise d’eau sur un liquide, ou de l’utilisation des liaisons de Van der Waals qui permet aux millions de poils des pattes du gecko de s’accrocher aux parois verticales, sont connus.
On peut aussi citer pour l’aérodynamique et l’hydrodynamique la bio-inspiration en nautisme et aéronautique.
Mais la démarche scientifique et industrielle devient plus systématique sur ce point : elle vise à analyser les propriétés complexes des matériaux et des processus biologiques du vivant et de les détourner à des fins industrielles en utilisant soit le biomimétisme, soit la bio-inspiration.
DES MATÉRIAUX AUX PROPRIÉTÉS COMPLEXES.
Par rapport aux produits issus de l’activité industrielle, les matériaux du vivant ont des qualités particulières.
En premier lieu, ils se fabriquent généralement sous thermisation faible et donc avec une grande économie d’énergie.
Ensuite, ils possèdent des propriétés complexes :
- ils sont autonomes ; ils s’auto-organisent, se reconfigurent et s’auto-régénèrent.
- ils possèdent un degré très élevé d’optimisation des structures composites.
On peut donner deux exemples de cette optimisation. La coquille d’ormeau est un matériau très dur (les physiciens disent qu’il a une très grande ténacité). Faite d’aragonite (CaCo3), cette coquille a une résistance propre plus de dix fois supérieure à celle de son composant.
Pourquoi ? Parce que, dans cette structure, les plaques d’aragonite sont maintenues entre elles par une colle organique (elle-même formée à partir de protéines qui ont servi à la croissance de la coquille de carbonate de calcium) :
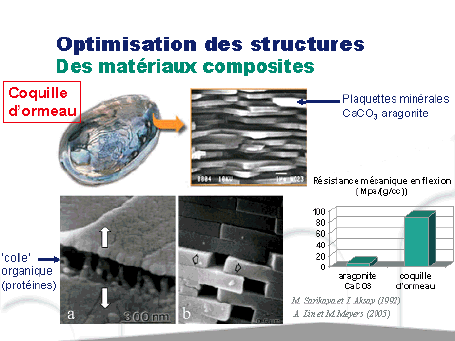
Autre illustration, l’organisation multi-échelles des matériaux. Le bois composé de celluloses se caractérise par les typologies d’organisation très différentes de cette cellulose, au sein d’une espèce entre la fibre et l’arbre, ou entre espèces ligneuses, en quelque sorte du chêne au roseau.
- ils mettent en œuvre des combinaisons sophistiquées entre le biologique et le minéral qui donnent à certains organismes vivants :
Ÿ des propriétés optiques, car le minéral est stable à la lumière et permet de la focaliser (comme le font, par exemple, les calamars géants pour voir leurs proies, ou les bactéries extrêmophiles des évents marins qui utilisent cette capacité pour concentrer la lumière).
Ÿ des propriétés magnétiques, comme celles de ces bactéries qui contiennent de l’oxyde de fer qui leur permet de s’orienter en fonction du champ magnétique terrestre.
Cette formation des matériaux par les êtres vivants aboutit à deux voies de recherche originales, par rapport aux biotechnologies traditionnelles, le biomimétisme et la bio-inspiration.
La démarche biomimétique vise à :
- repérer un comportement remarquable dans la fabrication de matériaux par le vivant,
- comprendre la relation qui s’établit entre le comportement de fonctionnement et la structure de fabrication,
- et à répliquer cette structure pour élaborer des matériaux durables, selon des processus préindustriels, c’est à dire de façon rapide, standardisée, en recherchant le moindre coût.
Dans les faits, les recherches biomimétiques, qui doivent être fortement encouragées sur le plan académique, ont déjà débouché sur de nombreuses applications :
▪ la chimie douce :
- élaboration de silice dans l’eau à température ambiante (hydrolyse + polycondensation) au lieu de la fabriquer dans des fours à 2000°C.
▪ les matériaux adaptatifs :
- verres photochromes qui peuvent varier de couleur en fonction des ultra-violets,
- matériaux à changement de phase ; par exemple les vitrocéramiques (plaques auto-cuisantes),
- les alliages à mémoire de forme, dont les matériaux présentent des formes différentes suivant la température (application en médecine pour les supports de vaisseaux sanguins destinés à prendre une forme différente une fois en place dans le corps),
- l’auto-assemblage pour imiter l’auto-organisation : on organise la matière à l’échelle de quelques microns sans manipuler les objets (silice microporeuse utilisée dans le marché du traitement de l’air avec des filtres d’un diamètre de 100 µ à quelques dizaines de nanomètres)
▪ les matériaux industriels reproduisant les propriétés des matériaux issus du vivant.
La liste qui suit n’est pas exhaustive mais elle illustre bien sa variété d’application, la valeur potentielle que la biodiversité peut offrir à l’adaptation de nos modes de développements.
On trouve des exemples industriels achevés de l’application de cette démarche biomimétique :
- la diminution de poids et l’augmentation de la résistance des structures d’ailes de l’A 380 grâce à l’imitation des structures osseuses des ailes d’oiseaux,
- les cristaux photoniques en latex, « calés » sur les longueurs d’onde de la lumière qui permettent de faire varier les effets optiques des matériaux,
- les pare-brise anti-pluie qui reposent sur les angles de contact des gouttes d’eau avec la pluie et sur l’imitation de la structure (en picot hydrophobe) de la feuille de nénuphar,
- un ruban adhésif très collant inspiré de la structure des pattes du gecko (en multipliant les mini-structures collantes de 2 µ),
- ou les composites laminés comme le blindage léger en aluminium-titane.
Cette démarche a pour objet d’utiliser les molécules impliquées dans la fabrication des matériaux par le vivant ou d’identifier ou de synthétiser des analogues de ces molécules pour produire des artéfacts que le vivant ne produit pas parce que l’évolution ne l’a pas commandé.
Ce champ scientifique qui demeure très en amont de l’application industrielle est probablement un des plus prometteurs du siècle à venir.
Cette discipline peut utiliser des croisements de technologie :
- en fusionnant deux facteurs biologiques pour obtenir des matériaux nouveaux (par exemple une molécule fabricant du fil d’araignée et une molécule tirée des diatomées pour fabriquer de la silice) ;
- en déterminant les processus biologiques de fabrication des matériaux des êtres vivants pour en obtenir d’autres (on utilisera « l’usine » à fabriquer de la silice que sont les diatomées pour produire du titanate de baryum) ;
- en construisant des activités biologiques de fabrication d’un matériau (il est possible en laboratoire de piéger des bactéries dans des gels de silice et d’en utiliser pour produire des molécules à vocation thérapeutique : de même, on peut utiliser ces mélanges minéral-biologique pour piéger des parasites responsables de maladies dans ces matériaux afin de produire des tests de diagnostics ;
- en utilisant les processus biologiques pour produire des micro et nanostructures, qui seront, à terme, en plus demandées dans les processus industriels.
*
* *
S’agissant de ces deux disciplines, dans lesquelles notre pays avait une avancée non négligeable, on ne peut que regretter qu’elles souffrent des maux chroniques de la recherche française :
- un sous-financement habituel des disciplines émergentes,
- un manque de liens entre la recherche, le développement technologique et l’industrie.
La mission menée par vos rapporteurs en Allemagne montre le développement accéléré du réseau bionique dans ce pays (biomimétique-bioinspiration) ; ce réseau qui ne regroupait que 6 laboratoires en 2001, en comptait 52 en novembre 2006.
C’est un exemple à méditer.
Une très grande partie du débat public sur les biotechnologies se concentre sur les domaines de cette activité liés à des problèmes éthiques (transgénèse agricoles, clonage, utilisation des cellules souches à des fins thérapeutiques).
Cela occulte un fait majeur pour le demi-siècle à venir : les biotechnologies vont sortir des laboratoires et entrer à l’usine ; elles deviendront peu à peu un secteur de la production industrielle, avec des applications aussi variées que le sont celles de l’industrie actuelle.
Ce mouvement, on doit le noter, s’est amorcé en dépit d’une connaissance très insuffisante des espèces et des fonctions de la biodiversité qui sont les matériaux de ces biotechnologies. Cela est vrai des bactéries, cela l’est tout autant des champignons. Cette méconnaissance est encore plus marquée pour les organismes marins que pour les organismes terrestres.
Cela signifie qu’il existe un thesaurus potentiel très important pour le développement de la biotechnologie industrielle.
LES AVANTAGES DES BIOTECHNOLOGIES INDUSTRIELLES
Les propriétés des bactéries sont utilisées depuis l’aube de la civilisation – notamment celles qui portent sur les fermentations alimentaires.
Mais leur utilisation massive comme substitut ou comme appui à la chimie ouvre des horizons nouveaux.
Par rapport à la chimie traditionnelle, les biotechnologies offrent plusieurs avantages :
- elles sont beaucoup plus économes en énergie puisqu’elles ne nécessitent pas de thermisation et utilisent des matériaux renouvelables,
- elles sont beaucoup plus précises :
régio-sélectivité (les enzymes peuvent n’intervenir que sur un seul alcool d’un sucre à transformer),
stéréo-sélectivité (l’implantation des produits biologiques peut être senestro ou dextro orientée, à la demande – ce qui présente des avantages dans les productions de composants asymétriques),
directivité (les enzymes ne vont faire qu’un seul produit alors que les produits chimiques vont générer des déchets collatéraux plus ou moins importants selon le cas).
Les bioproductions et les bioconversions
L’utilisation des biotechnologies dans l’industrie repose sur un détournement du fonctionnement du vivant qui consiste à utiliser l’énergie que produisent les micro-organismes à des fins industrielles.
Cette utilisation peut s’effectuer, soit sous la forme bioproduction directe, soit par le truchement d’une bioconversion qui permettra d’accomplir une partie d’un processus chimique.
La plus connue des bioproductions directes est la fabrication de pénicilline. Mais ces bioconversions deviennent de plus en plus sophistiquées : par exemple, on essaiera de faire produire à des bactéries des analogues du terpène des plantes, qui est un alcaloïde aux vertus thérapeutiques. Dans le cas très connu de la pervenche de Madagascar dont on extrait un produit anticancéreux, la vinblastine, des expériences visent à accélérer le développement de cette production en insérant dans des plants de pervenche de Madagascar des précurseurs de la vinblastine.
Les bioconversions constituent déjà un élément de la chimie industrielle puisqu’environ 15 % des processus de cette industrie emploient des bioconversions enzymatiques.
Mais seulement 1 300 de ces bioconversions sont utilisées sur 5 000 identifiées, alors que l’on utilise 10 000 réactions chimiques.
Les réalisations et les perspectives
Dès maintenant, les biotechnologies sont passées au stade industriel.
Dupont de Nemours a installé une usine de production de molécules de synthèse, où les biotechnologies interviennent à plusieurs stades de la production chimique pour produire 500 000 tonnes par an de propanediol (utilisés dans la fabrication du tergal).
Dans certains marchés pharmaceutiques ou agroalimentaires, les processus des biotechnologies se substituent aux processus chimiques. Par exemple :
- pour la production de bêtacarotène sur un marché mondial de 2 milliards de dollars,
- ou, pour la production d’un acide aminé utilisé dans l’alimentation du bétail, sur un marché de 1,5 milliards d’euros.
Les perspectives d’extension d’emploi des biotechnologies dans l’industrie sont vastes.
Sans pouvoir être exhaustif, au-delà de l’investissement progressif des procédés chimiques de transformation industrielle qui sera peu à peu favorisé par la hausse du prix des carburants fossiles, des avancées fortes sont à attendre dans le domaine de la biotechnologie : l’utilisation des extrêmophiles, et l’emploi des biotechnologies dans le domaine de la fabrication de l’énergie.
Les bactéries extrêmophiles fabriquent des molécules dites « extrêmolytes » pour protéger leurs cellules des environnements agressifs dans lesquels elles vivent, la production en série d’extrêmolytes ou analogues est déjà utilisée dans les cosmétiques (crème solaire) ; la recherche actuelle porte sur des molécules qui permettront de limiter les effets des chimiothérapies ou d’être employées dans le traitement de maladie de peaux.
Dans le secteur central de l’énergie, beaucoup de recherches biotechnologiques portent sur les énergies nouvelles. On peut donner deux illustrations de mouvement :
- l’INRA de Marseille mène des recherches sur le génome d’un champignon60 qui dégrade la biomasse de façon accélérée et pourrait accroître fortement les rendements des biocarburants de deuxième génération.
- l’Université de Humboldt à Berlin conduit un programme sur les bactéries hydrogénases permettant de produire de l’hydrogène par biocatalyse, etc..
A un terme plus lointain, d’une dizaine d’années, va émerger un champ de recherches biotechnologique sur lequel on peut s’interroger éthiquement où l’on utilisera la biodiversité pour se couper de la nature.
Maintenant que l’on sait fabriquer de l’ADN synthétique, on peut reprogrammer les processus biologiques d’une bactérie.
L’institut Venter a tout récemment mis en œuvre cette biologie synthétique en transplantant la totalité de l’ADN d’une bactérie dans une autre.
A Boston, les start-up biotechnologiques, détectées par des « business angels » et dotées par de sociétés de capital-risque de centaines de millions de dollars, ne sont pas rares.
On voit l’implication de ce champ de recherches.
Car, si on sait fabriquer de l’ADN synthétique – si l’on sait réécrire le génome entier d’une bactérie, ce qui n’est pas encore fait –, on pourra en modifiant ce génome obtenir des artéfacts nombreux fonctionnant sur des catégories réactionnelles (c’est-à-dire des modes de reconnaissance entre atomes) inconnues sur terre.
Ces recherches qui pourraient déboucher d’ici une dizaine d’années devraient en tout état de cause respecter des cahiers des charges très rigoureux (artéfacts non invasifs, non délétères et contrôlés). On mesure ici l’importance de conduire ces recherches dans un cadre éthique rigoureux et sous contrôle de la communauté humaine.
LES INTERROGATIONS SUR LA BIOPROSPECTION
Même si elle débouche sur les biotechnologies industrielles, la démarche de bioprospection se situe en amont ; elle est aussi très antérieure au développement des biotechnologies.
Scientifiquement, on peut la dater de 1820, date à laquelle Pelletier et Caventou ont extrait la quinine de l’écorce du quinquina.
La bioprospection offre aujourd’hui des potentialités importantes, mais fait également problème, tant du fait d’une équation économique qui n’est pas toujours facile à valoriser, que du biopiratage des ressources auquel elle peut donner lieu.
DES POTENTIALITÉS PARTIELLEMENT EXPLOITÉES
Il n’est pas du ressort de ce rapport d’établir un catalogue des réussites de la bioprospection.
Mais les produits qui en sont issus sont très nombreux dans des domaines industriels comme la cosmétique, l’agroalimentaire, les actions phytosanitaires. Dans le domaine phare de l’industrie pharmaceutique, on estime que 50 % de notre pharmacopée provient de la diversité du vivant (de la pervenche de Madagascar au taxol extrait originellement de l’if américain, les exemples abondent dans ce domaine précis). Mais ces potentialités ne sont encore que très insuffisamment exploitées, leur degré de mise en œuvre reflétant, en négatif, notre faible connaissance de la biodiversité.
Cela est vrai de la biodiversité terrestre et, en particulier, des espèces tropicales. Cela l’est encore plus de la biodiversité marine.
Par exemple si l’on prend un bilan établi en 2004 par l’ « US Committee on Ocean Policy », on observe qu’il y a peu de médicaments issus de la bioprospection océanique, mais qu’il y a beaucoup de projets en cours :
Médicaments liés à la mer
Application |
Source originelle |
État d’avancement |
Pharmacopée |
||
Médicaments antiviraux |
Eponge |
Disponible dans le commerce |
Médicaments anticancéreux |
Eponge |
Disponible dans le commerce |
Médicaments anticancéreux |
Bryozoan |
Essais cliniques en phase II |
Médicaments anticancéreux |
Lierre de mer |
Essais cliniques en phase I |
Médicaments anticancéreux |
Tunïcie |
Essais cliniques en phase III |
Médicaments anticancéreux |
Tunïcie |
Essais précliniques avancés |
Médicaments anticancéreux |
Gastropode |
Essais précliniques avancés |
Médicaments anticancéreux |
Eponge |
Essais cliniques en phase I |
Médicaments anticancéreux |
Eponge |
Essais précliniques avancés |
Médicaments anticancéreux |
Actinomycete |
Essais précliniques avancés |
Médicaments anticancéreux |
Tunïcie |
En cours |
Médicaments anticancéreux |
Eponge |
En cours |
Agent anti-inflammatoire |
Champignon marin |
En cours |
Agent antifungique |
Eponge |
En cours |
Agent anti-tuberculinique |
Corail |
En cours |
Agent anti-HIV |
Ascidie (tunïcie) |
En cours |
Agent antipaludique |
Eponge |
En cours |
Agent anti-dingue |
Échinoderme |
En cours |
(Matériaux biologiques issus d’organismes marins en cours de traitement ou déjà utilisés. Source : rapport. Comité sur la politique océanique des Etats-Unis.)
Cette poussée des actions de bioprospection dans le domaine océanique se reflète également dans les projets menés par l’IFREMER.
Cet institut travaille directement ou en liaison avec des PME technologiques sur :
- les exopolisaccharides produits par les bactéries océaniques qui ont des activités biologiques anticancéreuses, une action cardiovasculaire et de régénération tissulaire ;
- les enzymes extraits de micro-organismes marins qui sont à la fois thermostables et capables de résister à de fortes pressions et présentent donc des potentialités industrielles intéressantes.
Dans le domaine de l’exploitation de la biodiversité marine, l’entreprise Goëmar à Saint-Malo a produit une molécule tirée des algues qui est à la fois un biostimulant et un « vaccin » activant les résistances de certaines plantes cultivables aux pathogènes.
Le Muséum d’histoire naturelle a mis en évidence dans la baie de Concarneau un système symbiotique (éponge – micro-organisme) qui héberge une dizaine de bactéries très actives contre les staphylocoques.
Le Centre de valorisation des algues (CEVA) de Pleubian, en Bretagne, a produit un saccharide non sucrant qui est un additif pour des confitures produites à destination des diabétiques.
Le développement de la bioprospection marine concerne également d’autres domaines industriels. La chitine extraite de la carapace des crustacés peut être utilisée comme absorbant des matières organiques des eaux de piscine, diminuant autour de 80 % l’emploi des désinfectants.
Une équation économique incertaine
La valorisation de la biodiversité repose sur des retours d’investissement de plus en plus incertains, tout au moins dans le domaine pharmaceutique61.
A cela, deux raisons.
L’industrie pharmaceutique a exploité les produits les plus immédiatement accessibles, en extrayant des molécules de plantes dont les vertus thérapeutiques étaient connues (c’est avec des moyens beaucoup plus importants la démarche d’extraction de la quinine au début du XIXème siècle). Or, actuellement, la démarche de bioprospection, ouverte et aléatoire, s’oppose aux protocoles habituels de l’industrie pharmaceutique qui consistent à faire du ciblage moléculaire guidé à grande échelle.
Par ailleurs, il existe un problème de coûts qui résulte des précautions dont sont légitimement entourées les autorisations de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques.
Pour fabriquer commercialement des molécules pharmaceutiques, il est nécessaire :
- d’en manipuler 100 000 en recherche initiale pour en obtenir 5 ;
- pour un coût qui peut atteindre un milliard d’euros ;
- et, sur des durées de l’ordre de 7 à 10 ans, auxquelles il faut ajouter de 2 à 4 ans lorsqu’il s’agit de molécules extraites de substances naturelles. Par exemple, dans le cas précis du taxol, entre la découverte des vertus anticancéreuses de l’écorce de l’if américain en 1962 et la production d’une molécule de synthèse en 1995, il s’est écoulé 33 ans.
Ce rapport avantage/coût rend compte en partie du retrait de certaines multinationales pharmaceutiques vis à vis des actes de bioprospection. Mais ce retrait est également commandé par l’insécurité juridique qui peut résulter des actes de défense de certains états contre le biopiratage.
La lutte contre le biopiratage
La convention sur la biodiversité conclue au sommet de Rio en 1992 et signée par 168 pays dès novembre 1993 a essayé d’établir un équilibre entre le droit à la bioprospection internationale assorti d’un droit à breveter et la souveraineté des états sur les ressources tirées de la biodiversité qu’ils hébergent.
Elle posait également le principe d’un droit à rétribution des communautés indigènes détentrices du savoir lié à l’exploitation de la biodiversité, ce droit restant toutefois à définir.
Sur cette base juridique qui demeure très générale62, les nations concernées ont développé trois types d’attitudes :
- une attitude de laisser-aller par manque de gouvernance qui facilite le biopiratage ;
- une attitude d’interdiction stricte.
C’est le cas du Brésil qui, jusqu’il y a peu, interdisait même à ses chercheurs de publier sur certains aspects de la biodiversité brésilienne. L’attitude des autorités brésiliennes (justifié par des souvenirs anciens comme le pillage de l’hévéa ou des abus plus récents) s’est récemment assouplie vis-à-vis de ses propres chercheurs, mais pas vis-à-vis des chercheurs étrangers. Par exemple, les muséums européens d’histoire naturelle ont rapporté que les Brésiliens refusaient dorénavant les échanges d’herbiers qui sont pourtant une pratique courante entre botanistes.
- une démarche plus originale développée par le Costa-Rica qui a adopté au début des années 90 une loi sur la biodiversité reposant sur deux principes : il est légal d’utiliser les ressources de la biodiversité (et, en particulier, leurs propriétés biochimiques et génétiques).
Mais cette exploitation doit donner lieu à une demande de prospection de ressource qui doit reposer sur un plan de répartition des bénéfices éventuels.
Les négociations ont été confiées à l’INBIO (ONG d’origine gouvernementale) et ont donné lieu à plusieurs accords dans des domaines aussi différents que l’agroalimentaire, la cosmétique, le parfum, les plantes ornementales ou la pharmacie. Le modèle de ces accords est celui qui a été passé avec la multinationale pharmaceutique Merck qui prévoyait :
- des recherches menées sur une aire et sur un nombre d’espèces délimitées ;
- un transfert des technologies de prospection à l’INBIO ;
- un financement des recherches menées par l’INBIO, dont 10 % préfinancées ;
- et, un partage des royalties résultant d’éventuelles utilisations des écosystèmes exploités.
On notera que l’INBIO ne passe des conventions qu’avec des entreprises implantées dans des pays où la situation juridique est assez nette pour lui permettre, le cas échéant, de faire valoir ses droits devant les tribunaux.
Le modèle costaricain paraît assez stable pour être donné en exemple, sur un sujet où l’absence de sécurité juridique – dans un sens comme dans l’autre – nuit à l’extension de la bioprospection et donc, indirectement, à la protection de la biodiversité que cette bioprospection peut financer.
Demeure un point de la convention de Rio qui n’est pas en application au Costa Rica où la population indienne représente moins de 1 % de la population totale : celui de la participation des communautés détentrices des traditions d’utilisation dans la biodiversité tropicale.
Mais cette rémunération des savoirs indigènes est du ressort des états. Par exemple, jusqu’ici la législation brésilienne n’a pas prévu de répartition des ressources financières qui seraient éventuellement fournies par l’utilisation de sa propre diversité.
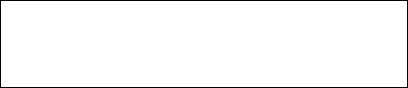
Dix propositions pour aller plus loin que
le « Grenelle de l’environnement »
I. intégrer la biodiversité dans la mondialisation
II. Activer les efforts de l’Union européenne
III. mettre en phase la parole et les pratiques de la france
IV. Eriger la biodiversité en priorité de recherche
V. adapter la fiscalité à la valorisation de la biodiversité
VI. Insérer les services rendus par les écosystèmes dans le calcul économique
VII. Aménager durablement le territoire
VIII. Lancer un programme de redensification urbaine
IX. Anticiper le changement climatique
X. définir un nouveau contrat social avec les agriculteurs
Avant-Propos
En matière de biodiversité, il est temps d’agir.
Et les moyens existent aussi bien pour continuer, peu à peu, à stopper la dégradation des écosystèmes de la planète que pour valoriser durablement la biodiversité afin d’en faire un des leviers de l’évolution de notre mode de développement vers la durabilité.
C’est pourquoi les dix propositions qui suivent ont pour objet d’aller plus loin que le « Grenelle de l’environnement ».
Car les conclusions du Grenelle se sont, assez normalement, concentrées sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre63, en minorant les effets de la crise de la biodiversité.
Et, parce que trois dimensions très importantes de la préservation des écosystèmes de la planète n’ont pas été clairement mises en évidence :
- l’aspect international de la question,
- la réinsertion des services et utilités fournis par la biodiversité dans le calcul économique,
- et le rôle de la science et de la technologie pour identifier, protéger et valoriser les écosystèmes de la planète et en faire un support de l’évolution de notre mode de développement vers la durabilité.
C’est l’objet des dix propositions qui suivent et qui seront soumises par vos rapporteurs aux groupes de suivi que le Parlement a créé pour veiller à la préparation de la future loi sur l’environnement.
INTÉGRER LA BIODIVERSITÉ DANS LA MONDIALISATION
Cette exigence prioritaire a deux facettes.
L’une, qui consiste à mettre fin au paradoxe qui fait qu’une réalité planétaire prioritaire manque de structures de gestion internationales unifiées, alors que toutes les autres problématiques mondiales en sont dotées (FAO, PNUD, OMC, OMS, etc.).
L’autre, qui repose sur le constat que la mondialisation de l’économie rendra de plus en plus insupportable la juxtaposition d’ensembles économiques vertueux, s’efforçant d’exploiter durablement la biodiversité des écosystèmes et de zones de non-droit la détruisant consciemment, au mépris des règles concurrentielles.
UNIFIER LES GESTIONS INTERNATIONALES DE LA BIODIVERSITÉ
La biodiversité n’a pas de porte-parole international.
Actuellement, plus de 500 accords multilatéraux traitent de l’environnement ; de nombreuses organisations agissent dans le domaine de façon non coordonnée (Programme de l’environnement des Nations-Unies, Organisation pour l’agriculture et l’alimentation (FAO), le programme des Nations-Unies pour le développement, Banque Mondiale, l’OCDE, l’UNESCO, etc.).
Il est donc nécessaire, comme la diplomatie française le propose, de créer une organisation des Nations-Unies spécialisée dans les problèmes de l’environnement. Il pourrait être proposé de confier à la FAO, dont les activités (agriculture, pêche, forêt) sont très liées au monde du vivant, de prendre en charge au moins dans un premier temps cet organisme nouveau.
Celui-ci aurait trois tâches principales :
1. établir une évaluation systématique et coordonnée de l’évolution des écosystèmes de la planète.
Il s’agirait d’assurer la gestion du futur réseau IMOSEB, qui serait l’équivalent pour la biodiversité du Groupe d’experts intergouvernementaux (GIEC) pour l’observation du changement climatique.
Relier le futur réseau IMOSEB à cet organisme aurait le double mérite de créer des interfaces claires entre science, d’une part, et politique et opinion mondiale, de l’autre.
2. mener une action d’unification du droit international de la biodiversité et du contrôle des normes dans ce domaine.
Cette mission a une double vocation :
- unifier et faire progresser le droit international sur la biodiversité et activer le contrôle de l’application de ces conventions ;
- coordonner, promouvoir et attester l’ensemble des labels qui concourent à une exploitation durable de la biodiversité.
3. agir comme une agence de moyens en fédérant l’ensemble des actions internationales menées en faveur de la biodiversité, en particulier dans les pays en voie de développement. Cette action pourrait s’appuyer de façon plus systématique sur les grandes ONG internationales qui seraient garantes de la bonne fin des projets.
VALORISER LA BIODIVERSITÉ DANS LES MÉCANISMES DE LA MONDIALISATION
La biodiversité (forêt, océans, agriculture, biocarburants) produit des biens proposés à l’échange international. Ces ressources constituent un produit intérieur brut mondial gratuit de même ampleur (environ 35 000 milliards de dollars) que celui généré par les activités humaines.
Mais aucune des règles qui gouvernent le commerce international n’incorpore dans le calcul économique les coûts des externalités négatives qu’entraine la dégradation des espaces et des ressources naturelles qui permettent de fournir ce produit intérieur brut gratuit.
Au contraire même, la mécanique de la mondialisation fondée sur l’échange des facteurs de production aux prix les plus bas possibles pousse ici à la surutilisation de ressources naturelles dont la disponibilité n’est plus totalement acquise et le sera de moins en moins.
Trois voies pourraient être explorées pour freiner cette mécanique de prédation.
1. Activer la protection de la forêt tropicale dans les mécanismes de Kyoto II
La protection des forêts tropicales procède d’une double exigence : conserver les puits à carbone qu’elles constituent et préserver la biodiversité qu’elles hébergent.
Actuellement, les mécanismes de Kyoto y contribuent, mais partiellement, par les « mécanismes de développement propre » (MDP) destinés aux pays en voie de développement. Ceux-ci ne rendent éligibles au marché des émissions que les actes professionnalisés de déboisement/reboisement. Mais ces MDP excluent les actions portant sur la conservation des forêts existantes. L’éligibilité de ces actions au mécanisme de Kyoto permettrait aux entreprises des pays adhérents de financer des projets de conservation de la forêt tropicale.
Il serait même possible d’affiner le dispositif en affectant des coefficients plus importants aux projets de protection des zones forestières plus particulièrement menacées (Sud-Est asiatique, ensemble des forêts tropicales sèches, ...).
2. Création d’une taxe sur les échanges internationaux de produits non certifiés
Sous réserve de création de labels certifiés avec des garanties de traçabilité (ce que permettraient les RFID pour le bois), il serait souhaitable de créer une taxe internationale sur le transport de produits issus de la biodiversité et non-certifiés.
On ne peut dissimuler les difficultés concrètes de mise en œuvre de cette mesure qui exige une organisation internationale unifiée de la labellisation, le consensus de pays très réticents et, probablement, une modification des règles de l’OMC. Cette initiative pourrait cependant constituer une première étape de valorisation significative du respect de la biodiversité dans les échanges économiques internationaux.
3. Multiplier les échanges dette/nature.
Les remises de dettes accordées aux pays en voie de développement se font généralement sans contrepartie.
Le mécanisme dit de l’échange « dette-nature » permettait d’utiliser ces remises à des actions de préservation de la diversité.
Le mécanisme est le suivant. En contrepartie de la remise de dette accordée, le pays débiteur réserve une partie de celle-ci en monnaie locale à un fonds, géré par une ONG et dédié à des actions de protection sur son territoire.
Sur la base d’un texte relativement récent (le « Tropical Forest Conservation Act » de 1998), les Etats-Unis mènent déjà une action de ce type.
ACTIVER LES EFFORTS DE L’UNION EUROPÉENNE
L’Union européenne mène des actions intéressantes dans le domaine de la biodiversité : directives sur l’eau, directives « Natura 2000 », programme de recensement de la flore européenne, deuxième partie de la politique agricole commune, etc.
Mais, ces politiques, utiles, doivent être amplifiées.
PROCLAMER UN MORATOIRE SUR LES BIOCARBURANTS
L’objectif européen d’inclure, d’ici 2012, 5,75 % de biocarburants dans les combustibles automobiles partait d’une excellente intention. Mais s’appliquant à des technologies dont le bilan carbone reste très discutable, sa réalisation a eu des effets pervers tant sur la biodiversité européenne que sur la biodiversité mondiale.
En Europe, cette politique a eu pour conséquence d’activer le forçage des sols et, dans certains cas, d’aboutir à la suppression des mesures qui avaient été établies pour préserver la biodiversité des milieux agricoles. Ainsi, en France, on a supprimé l’obligation de maintenir les bandes enherbées aux abords des champs de colza situés près des ruisseaux, pour accroître les surfaces destinées à la production de biocarburant.
A l’extérieur de l’Europe, cette poussée de demande de biocarburants a été un des facteurs d’accélération de la déforestation tropicale, en particulier dans le Sud-Est asiatique.
Il semble donc souhaitable de proclamer un moratoire européen sur la progression de l’utilisation des biocarburants après 2012, en attendant la maturité des biocarburants de deuxième génération (catalyse enzymatique de la filière ligno-cellulosique) ou de troisième génération (micro-algues).
RENFORCER LE PILIER ENVIRONNEMENTAL DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE
Les mesures environnementales, dites du deuxième pilier, ne représentent actuellement que 10 % du montant de la politique agricole commune.
Face à la perspective d’une réduction des sommes consacrées à la politique agricole commune, il sera nécessaire de consolider le volume consacré aux dépenses agro-environnementales de l’Union européenne.
A cet égard, le mouvement de hausse durable du prix des matières premières agricoles qui s’amorce pourrait être l’occasion d’accroître ce volume d’aide, en raison de la réduction du coût des soutiens aux marchés.
On doit même souhaiter qu’à l’occasion du bilan de la réforme de la PAC qui sera effectuée sur 2008-2009, on puisse réaffecter, au second pilier, une partie des excédents budgétaires créés par l’actuelle baisse de coût des soutiens au marché.
AMPLIFIER L’EFFORT DE RECHERCHE SUR LES CONSÉQUENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
L’effort de recherche sur les conséquences du changement climatique sur les équilibres de la biodiversité faunique et floristique européenne devra être amplifié à l’occasion du 8ème PCRD et notamment :
- en mettant en œuvre le programme « Lifewatch » déjà mentionné, qui vise à installer, de la période 2014-2032, 50 observatoires terrestres et 50 observatoires marins de surveillance de la biodiversité européenne ;
- en appuyant les projets de recherche sur la scénarisation des effets du changement climatique et d’adaptation des écosystèmes à ce changement ;
- et, en lançant un programme de recherche complet sur les conséquences du changement climatique sur la façade méditerranéenne de l’Europe, dont on rappellera qu’elle constitue à la fois un « point chaud » de la biodiversité mondiale et la zone de l’espace européen la plus menacée par la désertification qui s’annonce dans les prochaines décennies.
METTRE EN PLACE UNE LABELLISATION EUROPÉENNE DES PRODUITS ISSUS DE LA BIODIVERSITÉ
Dans deux domaines où la biodiversité est particulièrement menacée, les bois tropicaux et la pêche océanique64 (rappelons que 7 % seulement des pêches océaniques sont certifiées durables), il serait souhaitable que l’Union européenne assure la promotion d’une unification des labels.
Ces labels pourront ultérieurement faire l’objet de négociations auprès de l’OMC pour valoriser l’exploitation durable de la biodiversité dans le commerce mondial (cf. supra proposition I.B).
ENGAGER UNE RÉFORME DE LA POLITIQUE EUROPÉENNE DES PÊCHES
La politique de quotas de prise par espèces mise en œuvre par l’Union européenne patine.
D’une part, elle est très peu respectée par l’ensemble de la filière.
D’autre part, elle a abouti à un suréquipement des flottes, à une course à la ressource disponible, à une montée des prises accessoires et à une prédation accentuée des espèces non réglementée.
Il serait souhaitable qu’un infléchissement fort de cette action soit conduit. Principalement dans quatre directions :
- encourager un effort de recherche sur le développement d’une aquaculture en circuit fermé et faiblement dépendant d’un nourrissage issu des pêches minotières ;
- mettre en place un programme technologique permettant de limiter les prises accessoires ;
- développer et promouvoir les labels de pêches durables (qui permettent à la ressource de se renouveler) et de pêches responsables (dont les cahiers des charges contrôlés interdisent aux flottes les prises illégales).
- faire l’expérimentation sur quelques espèces halieutiques de systèmes de quotas de pêche mis aux enchères et rétrocessibles qui inciteront les attributaires à gérer les ressources en « bon père de famille », sans remettre en cause le principe global de gestion par pêcherie.
METTRE EN PHASE LA PAROLE ET LES PRATIQUES DE LA FRANCE
La parole internationale de notre pays sur le problème de protection de l’environnement est forte dans l’affirmation des principes (cf. « la maison brûle » du sommet de Johannesburg) ; elle porte aussi des propositions concrètes intéressantes (réseau mondial d’observation de la biodiversité, création d’un organisme spécialisé de l’ONU dédiés aux problèmes de protection de l’environnement).
Sa pratique interne est plus faible.
L’écart qui existe entre nos intentions et notre pratique devra donc être rectifié pour que notre pays soit irréprochable afin d’être crédible.
Sans que la liste qui suit soit exhaustive, plusieurs actions pourraient y contribuer.
MIEUX RECENSER ET PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ ULTRAMARINE DE LA FRANCE
La richesse du domaine ultramarin de la France (deuxième domaine maritime mondial, richesse de la Guyane, endémisme de La Réunion et de la Nouvelle-Calédonie) confère à notre pays une responsabilité particulière dans ce domaine.
Trois types d’actions doivent être poursuivies :
- activer le recensement et la conservation in et ex situ des espèces ultramarines qui font partie des points chauds de la biodiversité, du fait de leur variété et de leur endémisme ;
- prendre des mesures de protection de ces milieux. Cette action devrait concerner :
– l’extension des réserves côtières qui existent,
– et, la suppression des excès de l’exploitation minière en Nouvelle Calédonie et en Guyane. Sur ce point, les propositions du « Grenelle de l’environnement » qui visent à rendre l’activité minière de l’outre-mer exemplaire (élaboration de schémas d’aménagement minés avec mise aux normes des installations classées, éradication de l’orpaillage illégal) vont dans le bon sens mais doivent se traduire sur le terrain.
Il reviendra au Parlement de surveiller cette évolution.
- utiliser le Fond français pour l’environnement mondial. Ce fonds doté de 15 millions d’euros sur quatre ans joue un rôle utile ; il a permis d’infléchir les pratiques de l’association française pour le développement (AFD) vers des projets d’aide plus centrés sur la durabilité.
Mais le paradoxe est qu’il ne peut pas être utilisé pour des projets soutenant les biodiversités dans notre domaine ultramarin, alors que celui-ci est un des plus riches au monde.
Il serait nécessaire de rectifier cet état de fait, en abondant ce fonds – ce qui peut être fait en dérivant par une partie des sommes quatre fois plus importante que nous consacrons par ailleurs au « Global environmental facility fund » de la Banque mondiale.
APPLIQUER LES ACCORDS INTERNATIONAUX CONCLUS PAR LA FRANCE
Sur un certain nombre de secteurs, la France a conclu des conventions internationales qu’elle n’applique pas.
Une mise au net semble indispensable dans les domaines suivants :
- l’application des accords sur les thonidés signés au sein de la commission des pêches en Méditerranée installée auprès de la FAO. Les scientifiques estiment – mais la France n’est pas le seul pays défaillant – que les prises effectives sont deux fois plus fortes que les prises autorisées65 ;
- l’introduction en droit interne des dispositions de la convention de 2004 de l’OMI sur le déballastage. Les textes d’application de cette convention, dont l’objet est de limiter la diffusion des espèces invasives marines, sont en attente ;
- la désignation d’autorités chargées d’appliquer certaines conventions. Il en est ainsi :
– de la convention sur la biodiversité ;
– de la convention de 2004 sur les ressources génétiques pour l’agriculture et l’alimentation de la FAO.
RENFORCER NOTRE EFFORT DANS CERTAINS DOMAINES DE COOPÉRATION INTERNATIONALE
La France devrait ainsi :
- augmenter de façon significative le montant de sa participation au Gibif, organisme installé auprès de l’OCDE qui mène une action très importante pour l’harmonisation et l’accessibilité des connaissances sur la biodiversité floristique mondiale,
- participer au fond fiduciaire de la FAO, destiné à la conservation de la diversité culturale des semences dans le monde.
ETAYER ET ÉLARGIR NOTRE DISPOSITIF DE CONSERVATION DES RESSOURCES GÉNÉTIQUES CULTIVABLES
La nécessité de conserver des ressources cultivables variées est un des corollaires d’une agriculture plus durable et une sécurité biologique en raison du changement climatique.
Cette tâche, en partie assurée par le secteur privé, l’est aussi par les Bureau des ressources génétiques (BRG), créé en 1983. Celui-ci est chargé de constituer des réseaux entre les obtenteurs de variétés végétales, les recherches publiques et les collectionneurs privés pour :
- identifier le patrimoine,
- faciliter les échanges entre tous les réseaux de conservation ;
- et améliorer la conservation de ces ressources pour constituer des collections nationales mises à la disposition de tous les acteurs.
Mais les ressources du BRG diminuent, alors même que l’apport de l’INRA est en régression sur ce point.
Avec une double conséquence :
- pour certaines espèces, comme la pomme de terre, il n’y a pas de catalogue national,
- la convention de la FAO sur les ressources génétiques pour l’agriculture et l’alimentation nous fait obligation de répertorier les ressources génétiques pouvant faire l’objet d’un échange international. Faute de référent national et de moyens, cette disposition reste inappliquée.
Le catalogue qui regroupe l’offre des obtenteurs de variétés végétales de plantes cultivables ne comprend plus, depuis 1961, les espèces anciennement cultivées en France.
Cette évolution s’explique par la protection du consommateur, car ces espèces ne correspondent pas toujours aux trois critères d’inscription au catalogue officiel (Distinction – Homogénéité – Stabilité).
Certes, un catalogue d’espèces anciennes, reposant sur une critérologie moins exigeante, est ouvert aux « jardiniers du dimanche ». Mais il demeure interdit aux cultivateurs professionnels qui doivent, paradoxalement, acheter ces semences anciennes à l’étranger.
Il serait donc souhaitable de faire gérer par le BRG un répertoire de semences anciennes, hors certification d’obtention végétale, et ouvert à tous.
ERIGER LA BIODIVERSITÉ EN PRIORITÉ DE RECHERCHE
La recherche et les chercheurs ont été insuffisamment impliqués et sollicités par le « Grenelle de l’environnement » consacré au développement durable.
Cette absence est regrettable car la science et la technologie sont un des leviers du passage de nos économies à la durabilité.
Au-delà de cette observation générale, on fera observer que, si le développement durable constitue une des priorités de recherche de notre pays, l’effort de recherche sur l’identification, la protection et la valorisation de la biodiversité n’est probablement pas assez systématisé dans la mise en œuvre de cette priorité de recherche.
RENFORCER L’IDENTIFICATION DE LA BIODIVERSITÉ DES ESPÈCES ET DES ÉCOSYSTÈMES.
Celle-ci est largement le fait de nos organismes de recherche (Muséum national d’histoire naturelle, Génoscope d’Evry, CIRAD, IRD, IFREMER), qui bénéficient d’une réelle reconnaissance internationale.
Nos moyens opérationnels doivent être maintenus sur ce plan. Y compris ceux de l’IFREMER qui joue un rôle essentiel de l’observation des milieux côtiers et océaniques. Or, les moyens opérationnels de cet organisme sont l’objet d’une érosion depuis plusieurs années.
Par ailleurs, il est nécessaire de renforcer, en particulier dans la perspective du changement climatique, notre effort de connaissances des interfonctionnalités des écosystèmes. Or, il apparaît que, dans beaucoup de cas, les réponses aux appels d’offres de l’ANR sur la biodiversité sont plus centrées sur l’identification des espèces que sur le fonctionnement des écosystèmes. Une réorientation devra être opérée sur ce point.
ACTIVER LA MISE EN œUVRE DES TECHNOLOGIES ET LE CONTRÔLE DE LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ
La mise en place progressive à l’échelle internationale des certifications d’exploitations durables de la biodiversité devra reposer sur une efficacité des contrôles.
Le progrès technologique peut fortement contribuer à l’efficacité de ces contrôles :
- traçabilité des grumes de bois grâce à un étiquetage RFID,
- observation en temps réel par photographies satellitaires des grands ensembles forestiers pour localiser les actions de déforestation illégales,
- systèmes d’observation, dont l’un est mis en place par la société Findus pour surveiller l’application des cahiers des charges de pêche responsable qu’elle a conclus avec les pêcheurs, permettant de tracer les flottes de chalutiers, d’estimer leur temps et leur processus de pêche.
Compte tenu du succès commercial potentiel de ces actions de labellisation, les technologies de contrôle vont devenir un enjeu économique non négligeable.
La question se pose donc de trouver des modes de préfinancement du développement de ce type de programmes. Cela pourrait s’effectuer par le lancement d’appels d’offres conjoints de l’Agence nationale de la recherche et de l’Agence pour l’innovation industrielle – éventuellement en coopération avec les états qui pourraient être intéressés par le développement de ces technologies.
VALORISER L’ENJEU SCIENTIFIQUE ET ÉCONOMIQUE DE LA BIODIVERSITÉ
Comme cela a été souligné en troisième partie de ce rapport, la valorisation de la biodiversité des écosystèmes sera un des ressorts de la quatrième révolution industrielle.
Accompagner dans certains cas, anticiper ce mouvement dans d’autres est donc essentiel pour l’avenir.
Trois types d’actions devraient y contribuer :
– Développer l’ingénierie écologique
En fonction des objectifs de réinsertion dans l’économie des services écologiques rendus par les écosystèmes, d’anticipation des effets du changement climatique et de mise en place d’une agriculture plus durable (cf. infra Proposition X), il serait souhaitable de poursuivre les expériences menées sur les fonctionnalités des écosystèmes (comme celles effectuées sur les prairies à l’INRA de Clermont Ferrand) et d’intensifier un effort d’équipement (du type de l’Ecotron de Montpellier) tourné vers le développement de l’ingénierie écologique ;
– Consolider les recherches en biomimétisme et bioinspiration
Les recherches menées en biomimétique et en bioinspiration dont beaucoup sont encore au stade précompétitifs devraient être fédérées en réseau : de 9 implantations en 2001, l’Allemagne est passé à un réseau réunissant 42 implantations en 2006. Une action forte de l’ANR serait souhaitable dans ce domaine, préalablement à la constitution d’un pôle de compétitivité dans ce domaine.
– Créer un institut Carnot scientifique aux biotechnologies
Les biotechnologies industrielles qui seront une des assises de la prochaine révolution industrielle font l’objet des recherches de plusieurs pôles de compétitivité dont le principal est installé à Lyon.
Il serait intéressant afin d’assurer une transversalité de ces recherches, de fonder un institut Carnot chargée d’établir des synergies de développement entre ces pôles.
ADAPTER LA FISCALITÉ À LA VALORISATION DE LA BIODIVERSITÉ
La fiscalité n’est pas neutre vis-à-vis de la biodiversité.
Par exemple, taxer au même taux le foncier non bâti, le foncier bâti et les activités professionnelles alors que la rentabilité est plus faible, constitue une distorsion de traitement. L’instrument fiscal a été utilisé pour encourager l’activité plutôt que pour promouvoir le respect des écosystèmes.
Il serait souhaitable d’entamer maintenant une réflexion sur l’environnement fiscal des milieux naturels. Compte tenu du caractère toujours délicat des modifications des équilibres fiscaux, en particulier locaux, on pourrait nommer un parlementaire en mission pour faire des propositions sur ce point.
A titre indicatif, les pistes suivantes pourraient être explorées :
- réexaminer les encouragements fiscaux à l’artificialisation des milieux naturels,
- réduire la pression fiscale sur les milieux naturels. Par exemple, il devrait être possible de mettre en œuvre des exonérations totales ou partielles :
– sur les zones humides ;
– sur les espaces naturels à statut de protection strict ;
– sur les espaces dévolus à l’agriculture biologique ;
– sur les prairies naturelles.
- favoriser l’utilisation et la fiscalité locale pour ralentir l’étalement urbain ;
- inciter, en utilisant l’impôt sur le revenu et, éventuellement, l’impôt sur la fortune, à la restauration des espaces naturels,
- utiliser les dotations de financement des collectivités locales dans un sens favorisant les biodiversités. L’inclusion d’un critère biodiversité dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement (DGF), proposée par le groupe de travail n° 2 du Grenelle de l’environnement va dans ce sens. Mais, il faut aller plus loin en considérant la constitution d’espaces protégés par les collectivités locales comme un investissement au même titre que la rénovation d’un lycée ou la construction d’une route; c’est pourquoi la dotation globale d’investissement (DGI) devrait aussi inclure un critère « biodiversité ».
INSÉRER LES SERVICES RENDUS PAR LES ÉCOSYSTÈMES DANS LE CALCUL ÉCONOMIQUE
Du fait de leurs caractéristiques, les services rendus par les écosystèmes (utilité collective et temps long de reconstitution qui s’opposent aux appropriations particulières et aux temps cours du marché) ne sont pas ou peu intégrés au calcul économique.
Deux types de propositions pourraient contribuer à cette intégration : rémunérer les économies externes que produisent les écosystèmes des écosystèmes et sanctionner leurs destructions, et, créer un marché de la compensation des atteintes aux milieux naturels.
RÉMUNÉRER LES ÉCONOMIES EXTERNES PRODUITES PAR LES ÉCOSYSTÈMES ET SANCTIONNER LEURS DESTRUCTIONS
Le paradoxe des services rendus par les écosystèmes est que leur appropriation collective n’est pas rémunérée – ou peu – et que leur destruction à des fins particulières n’est pas – ou peu – sanctionnée. L’insertion de ces services dans le calcul économique suppose une rectification sur ces deux points.
RÉMUNÉRER LES SERVICES ÉCOLOGIQUES
Hors les puits à carbone, deux grandes catégories de services rendus par les écosystèmes pourraient faire l’objet d’une rémunération directe : les services agronomiques et les services hydrologiques66.
La reconnaissance du rôle des services agronomiques des écosystèmes peut s’effectuer dans le cadre d’une évolution vers une agriculture plus durable (cf. infra Proposition X).
En revanche, l’ensemble des services hydrologiques rendus par les écosystèmes naturels (zones humides, forêts de bassins versants, système bocages) pourraient faire l’objet d’une rémunération directe par les bénéficiaires ou les utilisateurs de l’eau.
L’utilité de la rétention, de la filtration et de la régulation du débit des eaux que fournissent les milieux naturels (au-dessus naturellement d’un certain seuil de superficie – le bois plutôt que le bosquet, le pays bocager plutôt que le bois) doit être quantifiées et rémunérées par les agences de bassin.
A cette fin, on peut s’appuyer sur le bilan économique positif des réserves de biodiversité protégeant les zones de captage d’eau, évitant le coût de traitements onéreux.
On peut ainsi citer le rôle que joue, en amont de Paris, des zones humides dont le remplacement par des barrages réservoirs occasionnerait des dépenses d’équipement de l’ordre de 200 millions d’euros.
De même, compte tenu du coût des inondations que la croissance des évènements climatiques extrêmes risque de multiplier, la reconstitution de zones humides en amont des sites inondables pourrait être financée par une taxe sur les contrats d’assurance conclus pour compenser ce type de risques.
Les sommes ainsi perçues pourraient permettre d’amorcer l’intégration des services écologiques dans le calcul économique et de reconstituer les milieux naturels, notamment en contribuant à l’installation de parcs hydrologiques situés en amont des bassins versants.
INSTAURER PROGRESSIVEMENT LE PRINCIPE POLLUEUR-PAYEUR
La destruction des milieux naturels à ces fins économiques privées limite les services d’utilité collective qu’ils rendent.
L’instauration progressive d’une taxe pollueur-payeur (assise notamment, mais pas exclusivement, sur la production de produits chimiques, d’engrais et de produits phytosanitaires) valoriserait, a contrario, le respect de la biodiversité dans le calcul économique.
Cette mise en œuvre d’une dose de fiscalité, aurait en outre l’intérêt d’être un aiguillon financier en vue d’une mutation des processus de production, agricoles et industriels vers plus de durabilité.
CRÉER UN MARCHÉ DE LA COMPENSATION DES ATTEINTES AUX MILIEUX NATURELS.
Depuis la loi de juillet 1976 sur l’environnement, les projets d’aménagement doivent prévoir, au-delà d’un certain seuil financier, des compensations aux atteintes aux milieux naturels que leur réalisation entraîne.
Mais, en dépit de la force de ce principe, l’application de ces dispositions n’a pas donné le résultat escompté.
D’une part, parce que le texte de référence demeure incomplet ; d’autre part, parce que ces compensations s’opérant au coup par coup, il manque un mécanisme d’interface permettant de regrouper celles-ci. Il est donc nécessaire à la fois d’améliorer la loi de 1976 sur l’environnement et de créer un marché de la compensation des atteintes aux milieux naturels.
L’AMÉLIORATION DE LA LOI DE JUILLET 1976 SUR L’ENVIRONNEMENT
A l’expérience, le dispositif législatif de compensation applicable a montré certaines insuffisances qu’il conviendra de rectifier :
- il ne s’applique qu’aux projets d’une certaine ampleur et ne prend pas en considération le mitage des milieux naturels qui résulte de la multiplication de microprojets ;
- l’autorité chargé d’apprécier les compensations proposées par les aménageurs est le préfet de région, à l’exception de projets de dimension nationale qui relèvent du ministre chargé de l’environnement. Or, dans sa circonscription, le préfet doit gérer des intérêts contradictoires qui ne le portent pas toujours à arbitrer en faveur des milieux naturels ;
- les délais de la compensation sont circonscrits à la durée de réalisation du projet d’aménagement considéré. Postérieurement à cette durée, l’aménageur est libre de l’affectation du bien offert en compensation (zone humide, espaces de reforestation) qui peut alors être détruit par un nouvel acquéreur.
- la compensation ne prévoit pas la prise en charge de la gestion des biens offerts en compensation. Or, les milieux naturels doivent être surveillés et gérés.
Sur chacun de ces points, une évolution de la loi est souhaitable.
CRÉER UN MARCHÉ DE LA COMPENSATION DES ATTEINTES AUX MILIEUX NATURELS
Ce marché ne peut constituer à lui seul un instrument de gestion de la biodiversité. Des mécanismes réglementaires rigoureux sont indispensables. Pour autant, il ouvre une perspective qui doit être explorée.
Ce type de marché existe aux Etats-Unis, en particulier dans le domaine de la restauration des zones humides où des chambres de compensation (« Mitigation Banks ») gèrent un marché de l’ordre d’un milliard de dollars chaque année.
Les modifications proposées ci-dessus de la loi de 1976 permettraient d’activer un tel marché pour obtenir une véritable neutralité écologique du développement (c’est à dire en éliminant les pertes nettes d’espaces naturels, au lieu que 60 000 ha disparaissent chaque année en France).
A l’aide de la mise au point de grilles de compensation opposables juridiquement et fondées sur l’établissement d’une unité de compte ayant un équivalent financier, « l’unité de biodiversité67 », ce marché présenterait l’intérêt :
- de mutualiser des moyens sur des enjeux clés pour permettre des actions de plus grande envergure et de plus grande cohérence écologique, le système d’unité de compte permettant d’intégrer les plus petits projets qui ne sont pas l’objet de compensation ;
- de garantir un financement à long terme pour la restauration et la conservation des milieux naturels dans la durée ;
- de permettre aux entreprises d’inclure, les coûts de biodiversité dans leurs actifs, ce qui pourrait être le levier d’un véritable mécénat privé dans ce domaine ;
- et, de faire financer à l’avance des projets de compensation des atteintes aux milieux naturels, compensations qui seraient ultérieurement revendues, en tout ou partie, à des maîtres d’ouvrage dont les projets devront faire l’objet d’une compensation écologique.
La Caisse des dépôts qui est le principal opérateur du marché des émissions de CO2 pourrait être chargée de l’organisation de ce marché dans le cadre d’une mission inspirée par l’intérêt général à long terme.
AMÉNAGER DURABLEMENT LE TERRITOIRE
Introduire dans le quotidien de l’aménagement des territoires les dimensions de la biodiversité en stabilisant la consommation sociale d’espaces naturels est une exigence.
Sur ce point, les propositions du « Grenelle de l’environnement » consistant à doter l’Etat et les collectivités d’un instrument juridique nouveau permettant d’atteindre cet objectif semblent pertinentes :
- élaborer un plan de « trame verte » national à l’horizon 2009-2012 ;
- construire un cadre de référence nationale : cartographie des grands ensembles écologiques, établissement de méthodes d’élaboration régionale, pilotage concerté avec les régions ;
- instaurer une compétence spécifique des régions en matière de planification écologique de l’aménagement du territoire ;
- rendre opposable aux documents d’urbanisme cette planification écologique du territoire ;
- et introduire un critère de biodiversité et de réalisation de la trame verte dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement.
Mais ce dispositif de caractère presque uniquement juridique ne peut prendre une dimension dans la durée que s’il est accompagné de dispositions permettant de reconsidérer la conservation de biodiversité dans l’économie (cf. supra Proposition V « insérer les services rendus par les écosystèmes dans le calcul économique » et infra Proposition X « poser les bases d’un nouveau contrat social avec l’agriculture »).
Il faut aller plus loin. Nous proposons d’intégrer la prise en compte de la biodiversité dans l’ensemble des dispositifs contractuels entre les collectivités locales, mais aussi entre l’Etat et ces dernières. Nous préconisons à cet effet la mise en place de la « conditionnalité environnementale » dans l’établissement des contrats impactant l’aménagement du territoire. Nous proposons de même la prise en compte de la préservation de l’environnement et singulièrement de la biodiversité, dans le calcul des fonds d’Etat destinés aux collectivités territoriales, DGF et DGE.
LANCER UN PROGRAMME DE REDENSIFICATION URBAINE
L’opposabilité future des cartographies régionales d’aménagement du territoire aux documents d’urbanisme (SCOT, PLU) permettra de limiter le mitage des espaces naturels par le développement urbain.
Mais, aujourd’hui, des facteurs démographiques et sociaux impriment une poussée à la demande de construction de logements neufs.
Ce qui signifie, a contrario, que ces deux objectifs contradictoires ne peuvent trouver une solution commune que dans un programme de redensification urbaine.
Une loi d’orientation devra en fixer les voies et les moyens.
Et notamment :
- prévoir que les documents d’urbanisme comprennent des indicateurs environnementaux dont la consommation d’espaces naturels ou non;
- inclure dans ces documents d’urbanisme des zones de densification prioritaire,
- y faire figurer des projets d’utilisation des friches urbaines,
- et infléchir l’environnement financier de l’urbanisme opérationnel dans un sens favorable à la densification urbaine :
– lier la délivrance des aides des régions et des départements et la densification urbaine,
– favoriser fiscalement les programmes de reconstruction permettant de redensifier les milieux urbains,
– supprimer les versements pour dépassement de coefficients d’occupation des sols.
Anticiper le changement climatique
Le changement climatique dont on commence à percevoir les effets aussi bien sur les milieux naturels que sur les variétés cultivables aura des conséquences beaucoup plus lourdes dans les prochaines décennies.
L’impact d’une hausse de températures moyennes est un des aspects de la question. Le régime et la localisation des précipitations automnales et surtout vernales (ces dernières conditionnant la maturation des plantes) en est un autre. On rappellera, par exemple, que les observations effectuées par l’ONF ont montré que beaucoup d’essences forestières avaient fortement subi les conséquences de la sécheresse de 1976. La reproduction en fréquence de ce type de phénomènes fait malheureusement partie des hypothèses retenues par les experts.
Comment pourra-t-on anticiper ces phénomènes et en tempérer les effets ?
Plusieurs propositions pourront y concourir :
a) La nomination auprès du ministre du développement durable, d’un délégué au changement climatique qui aurait pour charge de faire prendre en compte par les administrations concernées les mesures d’adaptations et d’anticipations nécessaires.
b) Le lancement de programmes d’études in situ et de modélisations prédictives pour mesurer l’évolution des écosystèmes au regard des évènements climatiques qui se préparent.
c) L’établissement de corridors de migration pour faciliter la trame verte proposée par ailleurs.
Cette action doit également être mise en œuvre en milieu urbain et périurbain en généralisant une initiative déjà appliquée dans certaines villes de Bretagne, le maintien de friches libres dans le tissu d’espaces verts urbains, y compris les jardins privatifs68.
d) L’expérimentation d’implantation artificielle des essences forestières menacées par le changement climatique – en portant une attention particulière à l’état des sols qui est un des facteurs de stimulation de la résistance des arbres aux pressions de l’environnement.
e) La mise en place d’une capacité d’identification et d’éradication rapide des espèces invasives dont l’extension va être facilitée par le changement climatique. La mission de gérer ce réseau pourrait être confiée à l’Institut française de la biodiversité (IFB).
f) La création d’un conservatoire in et ex situ des essences de la zone méditerranéenne qui est à la fois une réserve mondiale de biodiversité et un des espaces les plus menacés par les troubles de l’hydrosphère.
définir un nouveau contrat social avec les agriculteurs
L’agriculture a répondu, avec les conséquences que l’on mesure aujourd’hui, aux missions que lui a confiées notre société. Aujourd’hui, il est indispensable de faire évoluer ces missions.
Les dégâts infligés aux écosystèmes terrestres et aquatiques par une agriculture fondée sur le forçage du sol sont évidents. Mais il serait souhaitable qu’à un terme des deux décennies, ce type d’agriculture évolue car l’assise de son développement n’est pas solide et risque d’être remis en cause : appauvrissement progressif des sols, développement des biorésistances aux ravageurs, augmentation à venir du prix des nitrates parallèlement à celle du gaz naturel dont ils sont extraits.
Dans le même temps, on doit souligner que l’effort de productivité agricole de notre pays a été nécessaire et qu’il convient de maintenir un haut niveau de production agricole face à la croissance annoncée de la démographie mondiale, faute de quoi la destruction de la seule réserve planétaire de terre utilisable (les forêts tropicales), serait inéluctable.
Ces deux exigences sont en apparence contradictoires, mais elles peuvent être conciliées en passant un nouveau contrat social avec l’agriculture française portant simultanément sur deux évolutions : la mise en œuvre d’une agriculture de précision et la conciliation de la production agricole et de la protection des écosystèmes.
L’évolution récente de l’opinion publique et la perception des enjeux environnementaux par les agriculteurs ouvrent des perspectives réelles au débat et à la réorientation volontariste des missions de l’agriculture.
LA MISE EN OEUVRE D’UNE AGRICULTURE DE PRÉCISION
Un des regrets que l’on peut concevoir, a posteriori, des structures d’organisation du « Grenelle de l’environnement », est la quasi-absence des chercheurs.
Cette lacune est d’autant plus déplorable que la recherche et la technologie sont un des ressorts de l’évolution de notre modèle de développement vers la durabilité.
Il ne suffit pas d’établir un plan de limitation de l’emploi des nitrates et des pesticides, ou d’aller vers une taxation de ceux-ci pour asseoir le principe pollueur-payeur, comme le suggère par ailleurs ce rapport, il est également nécessaire de proposer une alternative à cet emploi.
L’agriculture de précision est un substitut au forçage agricole de la nature.
Elle constitue à épouser et à optimiser les processus naturels.
Aussi bien en privilégiant par sélection les aspects phénotypiques des plantes qui conditionnent leur productivité (développement des feuilles au détriment de la tige, afin de favoriser la photosynthèse, recherche d’un chevelu racinaire plus touffu, étoffé et plus étendu pour le nourrisage par le sol), qu’en recherchant des pratiques culturales plus précises (mélange d’espèces pour mieux capter l’azote du sol ou pour accroître les résistances aux ravageurs, prévisions plus fines pour engager des intrants ou des pesticides, arrosage sélectif, etc.).
Beaucoup de recherches existent dans ce domaine, mais pour que l’agriculture de précision soit mise en œuvre de façon progressive et généralisée dans le système productif français, il serait nécessaire de systématiser ces recherches.
C’est pourquoi, il est proposé que l’INRA et le CEMAGREF rendent conjointement un rapport sur l’état des recherches dans ce domaine, sur les expériences qu’il conviendrait de mener et sur les étapes d’une généralisation de l’agriculture de précision.
ACCROÎTRE LE RÔLE DES AGRICULTEURS DANS LA PROTECTION DES ÉCOSYSTÈMES
Les mesures agro-environnementales (MAE) dites de second pilier de la politique agricole commune (PAC) ont initié une participation des agriculteurs à la protection des écosystèmes.
Mais ce premier pas demeure insuffisant :
– Son volume demeure faible.
Les MAE ne concernent que 10 % du montant de la PAC, ce qui aboutit dans les faits à plus subventionner les agriculteurs qui mettent à mal l’environnement que ceux qui essayent de le préserver. Et ceci du fait même de la façon dont la France applique les mesures agro-environnementales.
Une possibilité d’accroissement de cette enveloppe existe cependant. Si le mouvement de hausse des matières premières agricoles se poursuit sous la poussée de la demande mondiale, les dépenses de soutien aux marchés sont appelées à diminuer. Elles dégagent, d’ores et déjà, d’importants excédents d’exécution. Il serait souhaitable de diriger– fut-ce dans le cadre d’une diminution des ressources consacrées à la politique commune – une partie de ces disponibilités vers une politique agro-environnementale plus soutenue.
– Sa mise en œuvre est à éclipse.
L’application des MAE, qui est de la compétence des Etats, a plutôt été conçue comme un substitut aux pertes de revenus qui découlaient de la diminution des dépenses de soutien aux marchés.
Il en résulte :
- une dispersion excessive des mesures (même si on est passé en 2003 d’un catalogue de 170 mesures à une liste de 49 mesures),
- des imprécisions quant à la définition de l’objet des mesures (par exemple, les haies ne sont pas définies ni en hauteur, ni en largeur),
- des fluctuations d’application (à titre d’illustration on a peu à peu réduit le volume de la prime herbagère essentielle au maintien des prairies naturelles ou peu artificialisées),
- une absence d’encouragement à la modification des rythmes des assolements qui permettent à la biodiversité du territoire agricole de subsister, et un manque d’incitations au maintien de couverts en herbe pour éviter les ruissellements pendant les pluies de basse saison, etc.
Au surplus, cette politique était fondée sur le volontariat des agriculteurs, ce qui a eu pour résultat de morceler l’application sur les territoires agricoles et de diminuer son efficacité (si 30 % d’un territoire est dépourvu de haies, l’effet de la reconstitution de celles-ci dans le reste du biotope agricole est quasi-nul).
On ajoutera que les MAE génèrent des coûts de transaction qui deviennent très élevés aussi bien que les collectivités attributrices de l’aide et par les agriculteurs bénéficiaires.
Il est donc nécessaire de redéfinir cette politique :
- en réduisant les insuffisances et lacunes de leur conception évoquées ci-dessus ;
- et en conditionnant l’attribution individuelle des aides à l’adhésion à des contrats sur la base de contrats collectifs passés avec des regroupements d’agriculteurs, sur une durée plus longue que les cinq années actuelles.
Ce dispositif nouveau aurait un triple avantage :
- assurer une continuité territoriale et une cohérence d’application des MAE ;
- diminuer les coûts individuels de transaction de ces MAE,
- et regrouper les aménités environnementales obtenues sur un territoire (haies, couverts herbeux, prairies résultant d’une généralisation aux assolements, maintien d’une zone herbeuse, etc.) en « unité de biodiversité », négociables sur le marché des compensations qu’il est par ailleurs proposé d’instaurer.
Il va de soi également que cette politique, qui dépend de la redéfinition du règlement agricole après 2013-20, ne pourra avoir d’efficacité d’ensemble, qu’à la condition que l’attribution des aides de toute nature prohibe la destruction des milieux naturels par l’agriculture ou, pour le moins, prévoit que cette destruction soit compensée par une restauration de milieux (éventuellement négociable en crédits biodiversité).
![]()
Lors de sa réunion du 11 décembre 2007, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques a adopté, à l’unanimité des membres présents, les conclusions des rapporteurs et leurs dix propositions pour « aller plus loin que le Grenelle de l’environnement ».
LISTE DES PERSONNES AUDITONNEES
Page
A. ALLEMAGNE 212
B. COMMISSION EUROPÉENNE, BRUXELLES (BELGIQUE) 213
C. BRÉSIL 213
D. COSTA RICA 214
E. ETATS-UNIS 215
F. FINLANDE 218
G. INDE 218
I. ROYAUME-UNI 221
LISTE DES PERSONNES AUDITONNEES
a) Agence nationale de la recherche
• M. Michel GRIFFON, Responsable du département écosystèmes et développement durable
• M. Raoul JACQUIN-PORRETAZ, Responsable
• Me MARGARINOS-REY, Avocate de l’association
c) Caisse des dépôts et consignations
• M. Philippe THIEVENT, Directeur du Projet mission biodiversité
d) Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD)
• M. Philippe FELDMANN, Département Biodiversité et Ressources biologiques (AMIS)
• Mme Sylvie GOURLET-FLEURY, Responsable de l’UPR « Dynamique des forêts naturelles »
• M. Robert NASI, Responsable de l’UPR « Ressources forestières »
• Mme Marie-Noëlle de VISSCHER, Écologue, UPR Gestion intégrée de la faune sauvage, département d’élevage et de médecine vétérinaire
e) Centre national de la recherché scientifique (CNRS)
• M. Serge MORAND, Directeur de recherche IRD
• M. Jean-Pierre FONBAUTIER, Membre du comité national
• M. Jacques PASQUIER, Secrétaire général
g) École des mines de Paris
• Mme Dominique DRON, Professeur
• Pr. Luc ABBADIE, Valeur fonctionnelle de la biodiversité – ingénierie écologie
i) Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles
• Mme Christiane LAMBERT, Vice-présidente
j) Findus France
• M. Matthieu LAMBEAUX, Directeur général
k) Florimond Desprez
• M. François DESPREZ, Président
l) Génopole Evry
• M. Jean WEISSENBACH, Directeur
m) Groupement national interprofessionnel des semences et plants
• M. Philippe GRACIEN, Directeur général
n) Laboratoire Goëmar
• M. Simon BERTAUD, Président
o) Institut français de la biodiversité (IFB)
• M. Jean-Claude LEFEUVRE, Président
• M. Jacques WEBER, Directeur
p) Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER)
• M. Loïc ANTOINE, Directeur adjoint
• M. Jean BOUCHER, Chercheur en écologie halieutique
• M. Bernard BOYER, Directeur général
• M. Daniel DESBRUYÈRES, Responsable du Département « Etudes des écosystèmes profonds »
• M. Philippe GOULLETQUER, Responsable du Programme national « Durabilité des systèmes de productions aquacoles » et Coordinateur national « Biodiversité marine et côtière »
• M. Philippe GROS, Responsable du thème « Ressources halieutiques, exploitation durable et valorisation »
• M. Dominique HAMON, Responsable du Laboratoire Benthos
• M. Michel LUNVEN, Responsable de l'action « Instrumentation embarquée en milieu côtier »
• M. Philippe MARCHAND, Directeur du Centre de Brest
• M. Alain MENESGUEN, Chef du projet « Modèles génériques des écosystèmes marins »
• M. Jean-Yves PERROT, Président-Directeur général
• M. Joël QUERELLOU, Responsable du Laboratoire microbiologie des environnements extrêmes
• M. Yann-Hervé de ROECK, Responsable du Département « Dynamiques de l'environnement côtier »
q) Institut national de la recherche agronomique (INRA)
• M. Jean-Luc BAGLINIERE, Directeur de recherche
• M. Jacques BAUDRY, Directeur de recherche à l’unité Sad-Paysage
• M. Jean-Éric CHAUVIN, Ingénieur de recherche à l’UMR «Amélioration des plantes et biotechnologies végétales »
• M. Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS, Directeur de recherche
• Mme Solène CROCI, Chercheuse-doctorante à l’unité Scribe
• M. Pierre DUPRAZ, Économiste
• M. Pierrick HAFFRAY, Ingénieur Sysaaf
• Mme Florence LE GAC, Directeur de recherche à l’unité Scribe
• Mme Sylvie LORTAL, Directrice de l’UMR « Science et technologie du lait et de l’œuf »
• M. Gérard MAISSE, Président du centre de Rennes
• M. Dominique OMBREDANE, Professeur à Agrocampus
• M. Michel PASCAL, Directeur de recherche à l’unité Scribe
• M. Michel RENARD, Directeur de UMR « Amélioration des plantes et biotechnologies végétales »
• M. Bernard ROLLAND, Ingénieur de recherche à l’UMR « Amélioration des plantes et biotechnologies végétales »
• M. Jean-François SOUSSANA, Directeur de l’unité agronomique du site de Crouël
• M. Pierre STENGEL, Directeur scientifique
r) Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)
• Pr. Laurent GUTMANN
s) Institut de recherche et développement (IRD)
• M. Patrice CAYRÉ, Directeur du département ressources vivantes
• M. Bernard DREYFUS, Directeur de recherche
• Mme Geneviève MICHON, Directrice de recherche, Unité « Dynamiques environnementales entre forêt, agriculture et biodiversité »
• M. Jean-François MOLINO, Département « Botanique et Bio-informatique de l’architecture des plantes »
• M. Christian MORETTI, Directeur de recherche, Unité Biodival
t) Institut de recherche Pierre Fabre
• M. Georges MASSIOT, Directeur
u) Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
• M. Didier HOFFSCHIR, Conseiller auprès de la Direction générale de la Recherche et de l’Innovation
v) Muséum national d’histoire naturelle
• M. Guy BOUCHER, Professeur (biologie des organismes marins et écosystèmes)
• Mme Marie FLEURY, Maître de conférences et ethnobotaniste
• M. Pierre-Michel FORGET, Département Écologie et gestion de la biodiversité
• Mme Sylvie REBUFFAT, Professeur (chimie des substances naturelles)
• M. Simon TILLIER, Chef de projet
w) Office national des forêts (ONF)
• M. Pierre-Olivier DRÈGE, Président-directeur général
• M. Jacques LE HÉRICY, Directeur scientifique
• M. Paul-Joël DERIAN, Directeur Recherche-développement
• M. Hervé ARRIBART, Directeur scientifique
• M. Claude TABEL, Directeur du centre de recherches
aa) Université Claude Bernard I
• M. René BALLY, Directeur de l’UMR « Écologie microbienne »
ab) Université Pierre et Marie Curie
• M. Robert BARBAULT, Directeur du laboratoire Écologie, biodiversité, évolution et environnement
• M. Ghislain de MARSILY, Professeur émérite
• M. Thibaud CORADIN, Directeur du programme « produits biomimétiques et bio inspirés »
• Dr. Rudolf BANNASCH, Vorstandsvrsitzender
• Dr. Ingo KLEIN, Geschäftsführer
• Dr. Matthias GERHARDT, Directeur general
• Mr. Vincent PELENC, Bioverfahrenstechnik
• Dr. Georg LENTZEN, Leiter Forschung und Entwicklung
d) Botanischer garten und botanisches museum
• Prof. Dr. Werner GREUTER, Leitender Direktor
e) Federal ministry of education and research
• Mr. Jochen FLASBARTH, Head of Directorate Général, Nature Conservation and Sustainable Use of Natural Resources
• Dr. Christian MÜLLER, Assistant Head of Division, Biological Research and Technology
f) Genome analysis of the plant biological system (GABI)
• Dr. Jens FREITAG, Head of the Managing Office
g) Technische Universität Berlin
• Prof. Dr. Baebel FRIEDRICH
• Prof. Dr.-Ing. Peter GÖTZ
h) UBA (Office fédéral de l’environnement)
• Dr. Christiane MARKARD, Directeur du service de l’eau
• Frau Birgit MOHAUPT-JAHR, chargée de mission « Effets sur les écosystèmes terrestres »
a) DG Environnement de la Commission européenne
• M. Patrick MURPHY, chef d’unité « Nature et biodiversité »,
b) DG Recherche de la Commission européenne
• M. Pierre MATHY, unité « Gestion des ressources naturelles »,
• M. Placido DOMINGUEZ
c) Bureau de la politique scientifique fédérale belge
• Mme Nicole HENRY, chef du service de recherche
• M. Jürgen TACK, directeur de la plate-forme biodiversité
• M. Philippe PETITHUGUENIN, Directeur regional
• Dr. Plinio SIST, Embrapa Recursos Geneticos e Biotecnologia
b) Governo do estado do amazonas
• Mme Marilene CORREA DA SILVA FREITAS, Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia
• M. Liszt VIEIRA, Directeur
d) Ministere de l’agriculture et de l’alimentation
• M. Gilberto GONÇALVES LEITE, Directeur adjoint du département du Commerce et de la Communication
e) Ministerio da ciencia e tecnologia
• M. Luiz Antonio BARRETO DE CASTRO
f) Ministerio do meio ambiente
• M. Paulo José KAGEYAMA, Secretario
g) Ministerio da sauda, Instituto oswaldo cruz
• Mme Tania ARAUJO-JORGE, Directrice de l’Instituto Oswaldo Cruz
• Dr. Marcel BURSZTYN, Directeur du CDS
• Prof. Laila DARVENNE, Laboratorio de Farmacognosia, Faculdade de Medicina
• M. Leonardo VIEIRA LACERDA, Superintendente de Conservação
• M. Hernan ANDRADE, expert du CIRAD
• M. Jacques AVELINO, expert du CIRAD, Docteur en pathologie végétale, Département des cultures pérennes
• M. John BEER, Director, Departamento de Agricultura y Agroforesteria
• M. Olivier DEHEUVELS, expert du CIRAD
• Dr. Pedro FERREIRA, Director General
• Mr. Olivier ROUPSARD, expert du CIRAD
• M. Carlos Manuel RODRIGUEZ ECHANDI, Regional Vice-President, CBC Director
c) Fondo nacional de financiamiento forestal (FONAFIFO)
• M. Jorge Mario RODRIGUEZ ZUŪŇIGA, Director Ejecutivo
• M. Pedro GONZALEZ, Directeur des Opérations à Sarapiqui
• M. Carlos HERRERA ARGUEDAS, Subdirector
• Mme Cornelia MILLER GRANADOS, Departamento de Planificación y Desarrollo
• M. Franz TATTENBACH, Director
e) Instituto nacional de biodiversidad (INBIO)
• Dr. Rodrigo GĀMEZ L., Presidente
f) Ministère de l’environnement
• M. Jorge RODRIGUEZ, Vice-ministre de l’environnement
• Mme Ana Isabel ESTRADA, Institutional Strengthening Officer
• Mme Silvia MARIN, Représentante pour l’Amérique centrale
a) Center of Marine Biotechnology (COMB), Baltimore
• Dr. Frank ROBB, Directeur
b) Conservation International, Washington
• M. Gustavo DA FONSECA, Conservateur en chef et Directeur scientifique
• M. Claude GASCON, Vice-président
• M. Olivier LANGRAND, Vice-président
• M. Jorgen THOMSEN, Vice-président et Directeur général
• M. Sébastien TROENG, Directeur de la stratégie marine régionale
c) Great Lakes Environmental Research Laboratory (NOAA), Ann Arbor
• M. Michael A.QUIGLEY, Directeur de la recherche et de l’information
• Mme Cynthia E. SELLINGER, Directeur adjoint
• Mme Rochelle STURTEVANT, Responsable du réseau d’enseignement
• M. Henry A. VANDERPLOEG, Directeur du laboratoire
d) Great Lake Fishery Commission, Ann Arbor
• M. Gavin CHRISTIE
• M. GLOUTEN
e) John Craig Venter Institute, Baltimore
• M. Robert FRIEDMAN, Vice President
f) Massachussets Institute Technology, Cambridge
• Mme Kristala JONES PRATHER, Département de chimie industrielle
• Dr. Sarah O’CONNOR, Département de la chimie
g) Michigan State University, East Lansing
• M. Stuart GAGE, Professeur
• M. Richard LENSKI, Professeur émérite
• M. Jianguo LIU, Professeur émérite
• M. David SKOLE, Professeur
• Dr. Richard BAILEY, Président
• M. Peter HECHT, Directeur général
• M. Michael J. HIGGINS, Directeur financier
• M. James O’MARA, Directeur du développement
i) National Institute of Health, Bethesda
• Dr. John DALY, Chercheur émérite
• Dr. Elizabeth Ann DAVIS, Directeur des programmes pour l’Union européenne et l’Europe (division des relations internationales)
• Dr. Flora KATZ, Directeur des programmes (division de la formation internationale et de la recherche)
• Dr. Joshua ROSENTHAL, Directeur du programme biodiversité
j) National Marine Fisheries Service (NMFS), NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), Silver Spring
• M. Reginald BEACH, Directeur de recherche
• Mme Barbara MOORE, Directeur des programmes sous-marins
• M. Steve MUROWSKI, Directeur scientifique
• M. Jean-Pierre PLÉ, Directeur-adjoint
k) Smithsonian, National Museum of National History, Washington
• Dr. Christian SAMPER, Directeur
l) SynBERC, Boston
• M. Randy RETTBERG
m) Université de Harvard, Cambridge
• Dr. James HANKEN, Muséum de zoologie comparée
o) Université du Massachussetts, Boston
• Dr. Benjamin B. NORMARK, Département des plantes, du sol et de la science des insectes
a) Commission de protection de l’environnement de la Baltique
• Mr. Kaj FORSIUS, Secrétaire de la Helcom (Commission de protection de l’environnement de la Baltique)
b) Université d’Helsinki
• Mr. Ilkka HANSKI, Professeur
• Prof. B. B. BHATTACHARYA, Vice Chancellor of Jawaharlal Nehru University
• Mr. P. P. BHOJVAID, Senior Fellow, TERI
• Dr. Sas BISWAS, Scientist, Forest Research Institute, Botany Division
• Mr. A. K. DIXIT, Manager, Himalaya Drug Company, Dehradun
• Dr. P. L. GAUTAM, Vice Chancellor, G.B. Plant University of Agriculture and Technology, Uttarakhand
• Prof. Aneeta GOKHALE-BENNINGER, Executive Director, Center for Development Studies & Activities, Pune
• Dr. Rajendra P. JAGDALE, Director General of Science and Technology Park of Pune
• Mr. Y. V. JHALA, Project Tiger Directorate, Government of India, New Delhi
• Dr. P. K. JOSHI, TERI University
• Mr. Bhuwan Chandra KHANDURI, Chief Minister, Uttarakhand
• Dr. Suman LAKHANPAUL, Delhi University
• Pr. Vinod B. MATHUR, Doyen, Faculty of Wildlife Sciences, Dehradun
• Sh. Namo Narain MEENA, Minister of State for Environment & Forests
• Dr. S. S. NEGI, Director, Forest Research Institute, Dehradun
• Mr. R. K. PACHAURI, Director General, TERI, President of GIEC
• Prof. Yash PAL, Chancellor of Jawaharlal Nehru University
• Mr. D. P. PANDEY, Director General, Forest Survey of India
• Shri Sharad PAWAR, Hon’ble Union Minister for Agriculture
• Mr. Deepak PENTAL, Vice Chancellor of Delhi University
• Sh. A. RAJA, Union Minister of Environment & Forests
• Mr. T. RAMASAMI, Ph. D. Secretary to the Government of India, Department of Science and Technology
• Dr. P. S. RAMAKRISHNAN, School of Environmental Sciences, Jawaharlal Nerhu University
• Mr. Sundeep SARIN, Joint Director, Department of Biotechnology, Ministry of Science & Technology
• Mr. Vivek SAXENA, Director, Ministry of Environment & Forest
• Shri Kapil SIBAL, Hon’ble Union Minister of Science & Technology and Earth Sciences
• Dr. Paramjit SINGH, Joint Director, Uttaranchal Technical University, Dehradun
• Mr. P. R. Sinha, Wildlife Institute of India, Dehradun
• Pr. Vinay K. TEWARI, Ph. D., Vice Chancellor, Uttarakhand Technical University
a) Food and agriculture organization of the United Nations (FAO), Rome
• Badi BESBES, Animal production officer, Animal genetic resources group, Animal production and health division
• Alain BONZON, Fonctionnaire principal de liaison (pêches), Secrétaire de la CGPM, Division des politiques halieutiques et de la planification, Département des pêches
• Vincent Castel, Manager of LEAD francophone platform
• J.-P. CHIARADA-BOUSQUET, Senior legal officer, Legal Office
• Dominique DI-BIASE, Chargée de programme, Service du développement du Programme de terrain, Division de l’assistance aux politiques et de la mobilisation des ressources, Département de la coopération technique
• Marguerite FRANCE-LANORD, Associate Professional Officer (International Arrangement on Forests – NFP Facility), Forestry policy and information division, Forestry department
• Samuel C. JUTZI, Director, Animal production and health division, Agriculture and consumer protection department
• Dominique LANTIERI, Environment and natural resources service, Research, extension and training division, Sustainable development department
• Hervé LEVITE, Fonctionnaire Principal (Gestion de l’eau), Programme international pour la recherche et la technologie en irrigation et drainage (IPTRID), Division des terres et des eaux, Département de la gestion des ressources naturelles et de l’environnement
• Florence POULAIN, Fishery Liaison Officer, International institutions and liaison service (FIEL), Fisheries and aquaculture economics and policy division (FIE), Fisheries and aquaculture department
• Jean-François PULVENIS DE SELIGNY-MAUREL, Directeur, Division de l’économie et des politiques de la pêche et de l’aquaculture, Département des pêches et de l’aquaculture
• Marc TACONET, FIGIS Officer (Fisheries global information système project), Fishery information, data and statistics unit, Fisheries department
• Tesfai TECLE, Sous-Directeur general, Département de la coopération technique
• Daniel RENAULT, Fonctionnaire principal, Gestion des périmètres irrigués, Division de la mise en valeur des terres et des eaux
• Marcela VILLAREAL, Ph. D., Director, Gender, equity and rural employment division, Economic and social development department
b) Global crop diversity trust
• Julian LAIRD, Director of development and communications
• Mr. Mark CHASE, Directeur du laboratoire de génomique
• Mr. Simon OWEN, Conservateur de l’herbier
b) Muséum d’histoire naturelle
• Dr Gillian STEVENS, UK Biodiversity Manager
• Mr. Johannes VOGEL
c) Royal Botanic Gardens, Wakehurst Place
• Dr Simon LIMINGTON, Head of Seed Conservation
1 Selon l’expression de Robert Barbault.
2 Un cadavre de cétacé peut nourrir des communautés opportunistes pendant un siècle.
3 Cf. Claude Combes « Les associations du vivant ».
4 Quoique le terme écologie apparaisse dès 1904 dans la langue française (de l’allemand « oekologie » [18e]).
5 Des constatations identiques pourraient être opérées sur les virus, en particulier dans les milieux océaniques et aquatiques terrestres : par exemple, on évalue de 1 million à 1 milliard les séquences virales contenues dans un millilitre.
6 Mise en évidence par le botaniste britannique Watson, au 19e siècle.
7 C’est-à-dire hors des grandes crises d’extinction.
8 Ce gisement reposait sur des cycles lents et a été remplacé par des écosystèmes à cycle plus rapide (nécrophages, méduses, etc.).
9 Données FAO 2007.
10 Et même 80 % à 90 % pour les hirondelles.
11 D’autres estimations, issues de l’article de B. Worm (cf. infra), publié dans « Science », considèrent que 25 % des espèces sont au seuil d’effondrement (c’est-à-dire que les pêcheurs ne ramènent plus que 10 % de ce que prenait la génération précédente).
12 « Impacts of biodiversity loss on ocean ecosystem service »
13 En 20 ans, la profondeur moyenne des chalutages est passée de 100 m. à plus de 300 m.
14 En 2003, seulement 2 % du bois de chauffe ont fait l’objet d’échanges internationaux.
15 Table ronde sur le développement durable, OCDE, janvier 2007.
16 Quoiqu’une partie de ce mercure soit naturellement présente dans le bouclier géologique guyanais.
17 C’est ce que les biologistes appellent les « pompes à biodiversité » car le changement climatique crée des isolats en altitude qui développent de nouvelles solutions d’adaptation aux contraintes de l’environnement.
18 Les Anglais disposent, grâce aux sociétés de « Bird Watchers » de séries d’observations qui dépassent le siècle et demi pour certaines espèces.
19 Un indice européen regroupant 25 régions hydrauliques est en voie de constitution.
20 Par exemple, comme cette étude menée par l’IRD comparant les prélèvements actuels et les spécimens d’herbier datant de plus d’un siècle afin de mesurer l’effet du changement climatique sur les stomates des feuilles.
21 300 espèces par hectare dans certaines zones du Pérou et de l’Équateur.
22 Cuba et le Brésil, par exemple, s’y refusent.
23 Plinio Sist « le point sur la déforestation et l’exploitation forestière en Amazonie brésilienne ».
24 Consistant à l’aide de parcelles témoins, à mesurer les effets de coupe faible, moyenne, ou forte sur la reconstitution du milieu forestier.
25 Qui permet, par exemple, de localiser en temps réel les tentatives de défrichage et d’appropriation privée des forêts.
26 Un rapport récent de l’ONG « Global Witness » établissait que les exportations illégales de Birmanie représenteraient 70 % des exportations légales dont 95 % à destination de la Chine.
27 Une des personnes entendues au Costa Rica faisait à juste titre valoir que les touristes ne visitent que 3 % de la surface des parcs nationaux – ce qui est d’un très bon rapport qualité de protection/financement de la protection.
28 On ajoutera qu’une exploitation rationalisée est la « meilleure façon de maximiser le puits à carbone que constitue ce milieu. Puisqu’au-delà de la période de croissance de l’arbre, beaucoup d’essences ne stockent plus de carbone additionnel. C’est ce qu’on appelle l’effet de saturation.
29 Des actions de ce type menées au Costa Rica par des fondations gouvernementales et par le WWF dans d’autres pays d’Amérique Centrale ont permis une hausse de 50 % du prix des grumes.
30 Dont le plus ancien est le FSC (Forest Stewardship Council ou Conseil de bonne gestion forestière) mais dont certains ont été créés sans aucun contrôle par des exploitants forestiers pour faire pièce à ceux proposés par les ONG.
31 Compte-rendu de l’Académie des Sciences des Etats-Unis (avril 2007) ; Britton et Stephens (Science 22 juin 2007).
32 C’est, au demeurant, une des méthodes employées pour la protection des oiseaux migrateurs.
33 Dans ce domaine, des solutions techniques commencent à être mises en œuvre permettant de réduire ce pourcentage.
34 Communication du 22 mars 2007.
35 Sur la période 1980-2000, les capacités de capture de la flotte mondiale ont été multipliées par 3 et le volume déclaré des débarquements par 1,3.
36 Ceci renvoie à la proposition (cf. supra a)) visant à faire mieux prendre en compte la biodiversité par l’ensemble des documents d’urbanisme.
37 Mais quelquefois très utiles. Les prêts de la Banque mondiale ont permis de préfinancer la politique de rémunération des services écologiques menés au Costa Rica.
38 Les dossiers forestiers N°16. Synthèse de l’atelier ONF/INRA (Myriam Legay-Frederic Mortier).
39 Une étude récente de la Royal Society anglaise fait un parallèle, qui peut être contesté, entre la hausse de température qui nous est promise en fin de siècle (6° C en hypothèse haute) et celle constatée lors de la crise du permien au cours de laquelle 95 % des espèces ont disparu.
40 Jean-Luc Dupouy et V. Badeau
41 S’agissant de la forêt méditerranéenne la canicule de 2003 s’est avérée catastrophique, puisqu’elle est intervenue après plusieurs années de sécheresse. Et le défaut pluviométrique qui a suivi a atteint plusieurs espèces dont le pin sylvestre et surtout le pin maritime.
42 Par la prise excessive d’alevins et par la concentration des prises sur les espèces de grandes tailles (celle-ci créant un phénomène cumulatif puisque les espèces de grandes tailles attaquent moins les juvéniles des espèces plus petites, celles-ci, à l’âge adulte, pouvant attaquer les alevins des espèces de grandes tailles).
43 Cf. colloque ONF/INRA « la forêt face aux changements climatiques » Opcit
44 Ceux-ci sont contraints de se procurer ces semences dans d’autres pays de l’Union européenne.
45 Ce rendement moyen se situe dans la zone haute des rendements actuels (1 tep/h/an pour le colza, 2 2/tep/h/an pour le blé, 2-3 tep/h/an pour le palmier à huile, 3-4 tep/h/an pour la canne à sucre).
46 Le gouvernement fédéral allemand envisage d’interdire à l’importation les huiles extraites du palmier à huile, dont l’exportation ne serait pas certifiée.
47 Aujourd’hui, on se trouve à un croisement, la population mondiale se répartissant pour moitié entre villes et campagnes.
48 Avec de grandes variétés de situations quant à l’état de la sous-alimentation et à ses causes.
49 « Nourrir la planète » - Odile Jacob.
50 Alors qu’elles l’ont été – car si la révolution verte des années soixante - soixante-dix n’avait pas eu lieu, multipliant les rendements céréaliers par plus de deux, on aurait dû déforester les forêts tropicales existantes à populations égales.
51 Sur ce point l’équation de l’équilibre de l’offre et de la demande de nourriture en 2050 peut se résumer à la destruction des forêts tropicales d’Amérique latine et d’Afrique pour nourrir l’Asie.
52 On peut même affirmer, comme le fait J.C. Lefeubvre, que l’économie industrielle au XIXème siècle a pris son essor grâce à la constitution de gisements de charbon dans les zones humides du carbonifère. En quelque sorte, un service écologique à retardement.
53 R. Costanza et al. « The Value of the worlds’ ecosystem services ». Nature 1997 – vol.387.
54 Notamment dans les zones intermédiaires entre les campagnes et les villes où les biotopes sont déséquilibrés et favorables aux insectes vecteurs de transmission (mouches, moustiques, tiques)
55 David Tilman – Science - Décembre 2006
56 Ce qui ne règle pas le sort des 25 % à 70 % de produits phytosanitaires volatilisés dans l’atmosphère.
57 Une étude qui serait menée sur l’évolution du prix de l’eau potable en France sur les quarante dernières années montrerait le coût de la dégradation des services écologiques hydrologiques.
58 Cf. l’article précité
59 L’interdiction de mettre en vente des semences ne figurant pas au catalogue officiel est une atteinte à la liberté ainsi qu’une mesure contraire à la protection de la biodiversité et au souci de qualité gustative. Les actions judiciaires engagées contre l’Association Kokopelli paraissent anormales aux rapporteurs qui estiment qu’il faut changer la loi.
60 Ce champignon, le Trichoderma reesei, avait été identifié au Vietnam par les Américains car il dégradait de façon accélérée les uniformes des troupes.
61 Des secteurs comme la cosmétique ou la parapharmacie ne sont pas soumis aux mêmes contraintes.
62 Notamment en matière de brevets : si les statuts juridiques du produit et de la molécule extraite de ce produit sont clairs, le statut juridique d’un analogue de cette molécule préserve insuffisamment les états détenteurs de ressources en biodiversité.
63 Reprenant, à cette occasion, des propositions avancées dans le Tome I de ce rapport : « Changement climatique et transition énergétique : dépasser la crise ».
64 et de leurs substituts aquacoles.
65 La France a très récemment entamé une évolution sur ce point.
66 Ce qui n’exclut pas qu’à terme, on puisse trouver des méthodes pour rémunérer les services sanitaires.
67 Qui serait l’homologue de la tonne de CO2 pour le marché des émissions de carbone.
68 L’association Vivarmor a ainsi créé, dans le Grand Ouest, 432 ha de refuges sur les terrains des collectivités et dans les jardins particuliers.
© Assemblée nationale