Accéder au tome II : annexes
N° 4469 N° 476
____ ___
ASSEMBLÉE NATIONALE SÉNAT
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2011 - 2012
____________________________________ ___________________________
Enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale Enregistré à la présidence du Sénat
le 13 mars 2012 le 13 mars 2012
________________________
OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION
DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES
________________________
L’IMPACT ET LES ENJEUX DES NOUVELLES TECHNOLOGIES D’EXPLORATION ET DE THÉRAPIE DU CERVEAU
![]()
Annexes sur
Par MM. Alain Claeys et Jean-Sébastien Vialatte, Députés.
__________ __________
Déposé sur le Bureau de l’Assemblée nationale Déposé sur le Bureau du Sénat
par M. Claude BIRRAUX, par M. Bruno SIDO,
Premier Vice-Président de l'Office Président de l’Office
_________________________________________________________________________
Composition de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques
Président
M. Bruno SIDO, sénateur
Premier Vice-Président
M. Claude BIRRAUX, député
Vice-Présidents
M. Claude GATIGNOL, député M. Roland COURTEAU, sénateur
M. Pierre LASBORDES, député M. Marcel DENEUX, sénateur
M. Jean-Yves LE DÉAUT, député Mme Virginie KLÈS, sénatrice
|
DÉputés |
SÉnateurs |
M. Christian BATAILLE M. Claude BIRRAUX M. Jean-Pierre BRARD M. Alain CLAEYS M. Jean-Pierre DOOR Mme Geneviève FIORASO M. Claude GATIGNOL M. Alain GEST M. François GOULARD M. Christian KERT M. Pierre LASBORDES M. Jean-Yves LE DÉAUT M. Michel LEJEUNE M. Claude LETEURTRE Mme Bérengère POLETTI M. Jean-Louis TOURAINE M. Philippe TOURTELIER M. Jean-Sébastien VIALATTE |
M. Gilbert BARBIER Mme Delphine BATAILLE M. Michel BERSON Mme Corinne BOUCHOUX M. Marcel-Pierre CLÉACH M. Roland COURTEAU Mme Michèle DEMISSINE M. Marcel DENEUX Mme Chantal JOUANNO Mme Fabienne KELLER Mme Virginie KLES M. Jean-Pierre LELEUX M. Jean-Claude LENOIR M. Gérard MIQUEL M. Christian NAMY M. Jean-Marc PASTOR Mme Catherine PROCACCIA M. Bruno SIDO |
SOMMAIRE
___
Page
Chapitre I : Les pathologies du cerveau : ENJEU de santÉ publique 13
1- Le taux élevé de suicides 19
1- Le projet Blue Brain ou Human Brain Simulation Project (HBSP) 22
4- Le projet Virtual Brain et la modélisation partielle des fonctions 25
1- L’effort de l’Allemagne en neuroimagerie 26
2- Les options de la recherche en neurosciences au Japon 29
2- La création de grands pôles de recherche en France 40
3- Les financements au titre des investissements d’avenir 46
4- Le rôle de l’Agence nationale de la recherche (ANR) 53
5- Les interrogations des chercheurs en France 53
Chapitre II : Les progrès de la neuroimagerie et le développement des neurosciences 59
1- L’électroencéphalographie (EEG) 60
2- La magnétoencéphalographie (MEG) 62
1- L’imagerie par résonance magnétique (IRM) 63
2- La spectroscopie par résonance magnétique (SMR) 66
3- La tomographie par émission de positrons (TEP) 67
1- La stimulation magnétique transcrânienne (SMT) 68
2- La stimulation cérébrale profonde 69
1- L’interface cerveau/machine (ICM) 72
2- L’immersion dans une réalité virtuelle 73
2- La photoactivation de molécule : utilisation de nanoscope 77
Chapitre III : La maÎtrise des technologies de neuroimagerie et la protection des personnes 79
1- Le cadre législatif strict des données sensibles 80
2- Des ambiguïtés liées à la prédictivité de l'imagerie médicale 82
1- La difficile limitation de l’accès aux données médicales 84
2- Le dossier médical personnel (DMP) 84
3- La télémédecine et la traçabilité des échanges 86
1- Le dispositif équilibré de la nouvelle loi du 5 mars 2012 87
2- Le contrôle du traitement des données par la CNIL 90
3- La nécessité du recours à de grandes cohortes 91
1- L’encadrement des hébergeurs de données de santé 94
2- Le « cloud computing » et la nécessité d’une protection internationale 95
A- Les réserves de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) 97
B- La nouvelle directive européenne plus satisfaisante sur les champs électromagnétiques 100
1- L’impact des apprentissages sur le cerveau 104
2- La tentation des stéréotypes 106
3- Les possibilités de compensation du handicap 107
B- La fiabilité des interprétations 107
C- La variabilité des données et l’interprétation des résultats 108
1- Quelles représentations de quelles images ? 109
2- Les sources de la variabilité 111
Chapitre IV : Applications potentielles et enjeux éthiques et sociétaux 113
1- La faible implication des grands groupes pharmaceutiques 114
2- Réexaminer les conditions d’autorisation de mises sur le marché ? 114
2- La prise en charge coûteuse et insuffisante des maladies mentales 117
1- Quel sens donner au diagnostic de maladies du cerveau ? 121
1- L’avis du Groupe européen d’éthique 127
2- L’avis n°71 du Comité consultatif national d’éthique 127
2- L’augmentation des capacités : la « cyborgisation » 132
3- L’utilisation par les armées des potentialités d’augmentation 133
1- Les objectifs de la neuroéconomie 136
2- L’analyse des circuits de la décision 136
3- Les risques de dévoiement : « le neuromarketing » 136
1- L’utilisation ancienne dans des procès aux États-Unis 138
2- Les autres tentatives d’utilisation en justice et le débat en France 140
3- Les interrogations suscitées par loi du 7 juillet 2011 141
4- Les améliorations possibles 145
1- La diversité des approches 146
2- Les recommandations du CAS 147
Examen du rapport par l’Office 157
Composition du comitÉ de pilotage 167
liste des personnes rencontrÉes 169
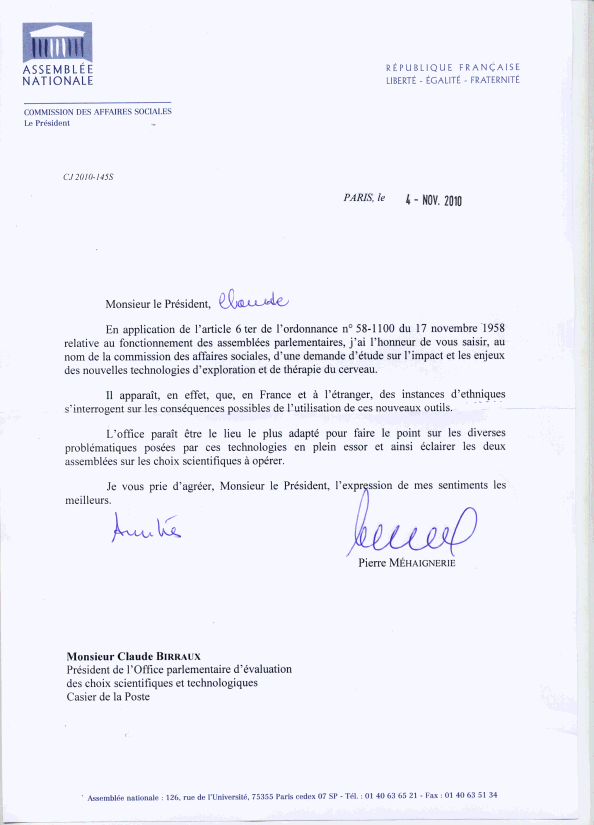
Mesdames, Messieurs,
Depuis une quinzaine d'années, les progrès en neuroimagerie ont permis d'extraordinaires avancées dans le domaine des neurosciences. Grâce aux nouvelles technologies d'exploration cérébrale, il est désormais possible d'obtenir des images anatomiques et fonctionnelles du cerveau en activité. La neuroimagerie permet en particulier de distinguer les groupes de neurones et les processus neurologiques impliqués dans le langage, la mémoire, l'apprentissage, les émotions et le développement cérébral. Que ce soit sur le plan anatomique ou sur le plan fonctionnel, ces techniques révolutionnent notre compréhension du cerveau, tant dans le domaine médical que dans celui de la recherche fondamentale. Les images cérébrales font aujourd'hui partie de notre univers social, elles fascinent les médias qui se font quasi quotidiennement l’écho de telle ou telle expérience à l’aide d’images ou de vidéos, ce qui frappe le public, suscitant engouement, crainte ou espoir.
Ces technologies lancent un défi et provoquent des tensions d’ordre éthique, philosophique, juridique et social, car elles répondent partiellement aux interrogations métaphysiques que l’homme s’est posé tout au long de son histoire sur la pensée, la conscience, la mémoire, les émotions, la liberté, la responsabilité et le libre arbitre. L’histoire de l’exploration du cerveau est inhérente à l’histoire de l’humanité. Hervé Chneiweiss1 a rappelé que l’on a trouvé, dans des fouilles préhistoriques, des traces de crânes avec des trépanations et des sutures.
Dès l’antiquité, Alcméon de Crotone au VIème siècle avant J.C. plaçait dans le cerveau le siège de la raison. Hippocrate et Platon le suivirent. À Alexandrie, au IIIème siècle avant JC, l’on assiste à une explosion des recherches sur le système nerveux. Cette quête s’est poursuivie tout au long de l’histoire de l’humanité suscitant des controverses sur le siège de l’âme ou de l’esprit. Controverses entre « continuistes » comme Camillo Golgi, pour qui le réseau cérébral était continu, expliquant ainsi que l’âme puisse passer plus facilement d’une cellule à l’autre, et Santiago Ramón y Cajal, qui démontrait que le cerveau est constitué de neurones, en contact les uns avec les autres, au niveau de synapses où les membranes cellulaires des cellules en contact sont en contiguïté et non en continuité.
Depuis la fin du XXème siècle, les technologies de plus en plus performantes permettant d’observer et d’analyser in vivo le cerveau se sont multipliées. Pour autant le cerveau garde encore, de l’avis de tous les experts rencontrés, une grande part de son mystère. Cet organe-clé constitué d’un réseau extraordinairement complexe de près d’une centaine de milliards de neurones et d’environ un million de milliards de contacts synaptiques dans le cortex cérébral est, selon Jean-Pierre Changeux2, « l’objet physique, peut-être le plus complexe, existant dans la nature, même parmi les objets conçus par les physiciens et les informaticiens ». Cette immense complexité et cette diversité lui confèrent des propriétés exceptionnelles que l’on découvre progressivement au risque d’un réductionnisme, dont nous nous garderons.
Comme l’ont souligné Alain Ehrenberg3 et Pierre-Henri Castel4, « le cerveau a acquis une valeur sociale qui n’existait pas il y a encore peu. Ce succès repose sur l’idée qu’une authentique « biologie de l’esprit » serait à portée de main. » Or il n’en est rien, les progrès dans la connaissance démontrent combien l’environnement et le contexte culturel interagissent avec le développement cérébral ; Jean-Pierre Changeux l’a d’ailleurs souligné : « il faut concevoir notre cerveau comme synthèse d’un ensemble d'évolutions internalisées qui incluent l’évolution des espèces, le développement embryonnaire, le développement postnatal et qui continuent à se produire au stade adulte où une certaine forme de plasticité cérébrale persiste.»
L’enjeu des recherches sur le fonctionnement du cerveau, que permettent désormais des technologies de plus en plus performantes, est immense ; à mesure que les connaissances progressent, des avancées concrètes dans le traitement de maladies plus ou moins invalidantes, qui affectent un quart de la population mondiale, sont fortement souhaitées.
En effet, l'impact social et économique des maladies neuropsychiatriques est considérable, car elles atteignent l’intégrité physique, et souvent l’intégrité mentale des patients, affectant aussi le mode de vie de leurs proches, ce qui questionne la société toute entière. Comment adapter les structures de soins en respectant la dignité des patients, alors que d’un côté, grâce à la neuroimagerie, la connaissance des mécanismes complexes de ces pathologies progresse, mais que leur traitement avance à pas comptés ? Comment maîtriser la tentation de détourner ces avancées de leur vocation scientifique et médicale ?
Sensible à ces enjeux, la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a saisi l’OPECST, en novembre 2010, d’une demande d’étude sur l’impact et les enjeux des nouvelles technologies d’exploration et de thérapie du cerveau. Cette saisine s’est inscrite assez naturellement dans le cadre de débats initiés par l’OPECST, lors d’une audition publique du 26 mars 2008, « Exploration du cerveau, neurosciences : avancées scientifiques, enjeux éthiques», organisée dans le cadre de l’évaluation de la loi de bioéthique par l’OPECST5.
Cette audition avait démontré que les progrès considérables de la neuroimagerie ouvraient des perspectives nouvelles qui dépassaient le cadre scientifique et médical et concernaient la société toute entière. Elle révélait combien les possibilités d’intervention sur le cerveau se multipliaient, touchant à l’intimité individuelle des personnes. Les technologies à l’œuvre induisaient des interrogations sur leurs potentialités d’investigation du cerveau en fonctionnement. Nous les avions formulées ainsi : que lit-on, que dépiste-t-on, que soigne-t-on ? Peut-on attribuer un sens ou un contenu aux images ainsi produites, en déduire les causes biologiques d’un comportement ou d’une maladie mentale ? Quel sera leur impact ? Ces interrogations demeurent.
Les personnalités que nous avions alors auditionnées, ainsi que les visites et missions effectuées au Royaume-Uni et en Espagne dans le cadre de cette mission d’évaluation nous avaient conduits à formuler, dans notre rapport sur l’évaluation de la loi de bioéthique6, une recommandation précise concernant les neurosciences et la neuroimagerie. Nous préconisions notamment d’évaluer périodiquement l’impact de ces recherches sur le plan médical, mais aussi social et environnemental, de protéger les données issues de ces techniques et d’interdire l’utilisation en justice de la neuroimagerie. L’entrée des neurosciences et de la neuroimagerie dans le champ de la future loi nous paraissait nécessaire ; nous avons partiellement été entendus. C’est ainsi que la loi relative à la bioéthique du 7 juillet 2011 a introduit des dispositions concernant l’imagerie cérébrale et les neurosciences pour prendre en compte certains défis que lance leur essor constant.
Les progrès dans la connaissance et le traitement du cerveau sont prioritaires, car les pathologies du cerveau, qu’elles relèvent de la neurologie ou de la psychiatrie, constituent un problème grave de santé publique à l’échelon mondial (Chapitres I et II). Cependant, ces avancées doivent s’accomplir au bénéfice des populations et du « mieux vivre ensemble », en maîtrisant les technologies et les risques de détournement de leur finalité (Chapitres III et IV).
CHAPITRE I :
LES PATHOLOGIES DU CERVEAU : ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE
Qu’elles relèvent de la neurologie ou de la psychiatrie - distinction qu’opère la France, mais qui est moins nette ailleurs ; les pathologies neuropsychiatriques constituent, dans la plupart des pays du monde, un enjeu de santé publique. Les progrès dans la connaissance de leur mécanisme n’ont pas encore abouti à la découverte de traitement pharmacologique efficace.
Or, pour une grande partie d’entre elles, et malgré leur diversité, ces pathologies sont souvent invalidantes tant pour le patient lui-même, que pour ses proches qui doivent assumer leur caractère chronique, et les difficultés d’insertion sociale qu’elles entraînent.
I- LA FORTE PRÉVALENCE DES PATHOLOGIES NEUROPSYCHIATRIQUES
Les données statistiques concernant les pathologies neuropsychiatriques sont inquiétantes : une personne sur quatre serait concernée, le poids économique et social de ces pathologies est considérable dans le monde entier. La publication d’atlas statistiques comme celui de l’OMS, ou les données statistiques au niveau européen, l’attestent.
A- LES STATISTIQUES DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS) 7
L’OMS estime à 400 millions le nombre de personnes aujourd’hui atteintes de troubles mentaux ou neurologiques, voire souffrant de problèmes psychosociaux, associés notamment à l’alcoolisme ou à la toxicomanie. Les études épidémiologiques dont on dispose chez l’adulte témoignent de la forte prévalence des affections psychiatriques. Selon une étude de l’École de santé publique réalisée par l’Université d’Harvard, à l’initiative de l’OMS, les pathologies mentales représentent aujourd’hui cinq des dix principales causes médicales de handicap dans le monde, et un cinquième des DALYs (Disabilities Adjusted Life Years)8, toutes maladies confondues. D’après ces statistiques, la schizophrénie affecte 7‰ (sept pour mille) de la population adulte, pour un total de 45 millions de personnes atteintes dans le monde. Des traitements existent et peuvent être efficaces aux premiers stades de la maladie, cependant plus de 50 % des malades dans le monde ne reçoivent pas de soins appropriés.
D’après le département de santé mentale de l’OMS, la dépression touche 130 millions de personnes dans le monde et serait actuellement la cinquième cause de mortalité et de handicap ; elle devrait atteindre la deuxième place d’ici 2020. On compte chaque année 10 millions de tentatives de suicides, dont 10 % s’avèrent fatales.
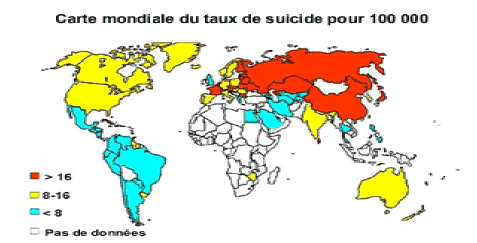
Sources OMS : Atlas 2011
Entre 40 et 50 millions de personnes dans le monde, dont 85 % vivent dans les pays développés, sont atteintes d’épilepsie. On estime que deux millions de nouveaux cas apparaissent chaque année dans le monde, mais 70 à 80 % des épileptiques peuvent retrouver une vie tout à fait normale s’ils reçoivent un traitement adapté. 24 millions de personnes sont frappés par la maladie d’Alzheimer et autres démences.
Pour sensibiliser les États et les donateurs potentiels, l’OMS mène des actions ciblées comme le programme d’action « combler les lacunes en santé mentale », programme phare de l’OMS lancé en 2008. Ce programme s’est concrétisé par un guide d’intervention à destination de tous les personnels de santé des pays affiliés à l’OMS en 2010, dont l’objectif est d’améliorer le service et les soins primaires.
Lors de l’entretien de la mission avec le Dr Shekkar Saxena9, ce programme a fait l’objet de longs développements. Le deuxième point abordé lors de cette réunion a concerné la révision de la liste des maladies mentales requérant la révision du processus de classification. La mission a tenu à se faire l’écho de critiques concernant cette nomenclature, tout en comprenant l’utilité d’un cadre international pour décrire des pathologies complexes.
B- L’ÉTAT DES LIEUX EN EUROPE : UN CONSTAT INQUIÉTANT
L’étude, publiée en septembre 2011 par le Collège européen de neuro psycho pharmacologie (ECNP)10 et l’European Brain Council, citée d’emblée par Jean-Pierre Changeux11, et à laquelle la plupart des experts auditionnés se sont référés, présente la situation de la santé mentale et neurologique en Europe sous un jour sombre. Certes, cette étude fait l’objet de critiques, car elle mêle les pathologies lourdes à d’autres qui le sont bien moins, mais elle démontre que les maladies neurologiques et psychiatriques sont devenues l’enjeu de santé majeur de l’Europe du 21ème siècle.
L’étude porte sur les 27 pays de l’Union européenne, auxquels s’ajoutent la Suisse, l’Islande et la Norvège, et donc sur une population de 514 millions d’individus. Elle répertorie plusieurs maladies neurologiques et toutes les maladies mentales majeures des enfants et adolescents (2 à 17 ans), des adultes (18 à 65 ans) et des personnes âgées (65 ans et plus). Ainsi chaque année, 38,2% de la population de ces 30 pays, soit 164,8 millions de personnes souffrent d’une maladie mentale. Celles-ci se retrouvent dans tous les groupes d’âge et les jeunes sont affectés autant que les personnes âgées, bien qu’il y ait des différences quant aux diagnostics les plus fréquents.
Les maladies les plus fréquentes sont les troubles anxieux (14,0%), l’insomnie (7%), la dépression majeure (6,9%), les troubles somatoformes (6,3%), la dépendance à l’alcool et aux drogues (plus de 4%), le trouble de déficit d’attention avec hyperactivité (5% chez les jeunes) et la démence (1% chez les personnes âgées de 60 à 65 ans, 30% chez les personnes âgées de 85 ans et plus).
En outre, plusieurs millions de patients souffrent de maladies neurologiques : ictus apoplectique, traumatismes cérébraux, maladie de Parkinson et sclérose en plaque. À l’évidence, ces cas devraient être ajoutés aux estimations ci-dessus. Ainsi les maladies du cerveau, mesurées en années de vie perdues pondérées par l’invalidité (DALYs), apportent la contribution la plus grande à la charge de morbidité totale dans ces pays, atteignant 26,6 % de la morbidité totale. Les quatre pathologies isolées les plus invalidantes (exprimées en DALYs) seraient la dépression, les démences, l’abus d’alcool et l’ictus apoplectique.
II- LE POIDS ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
DES MALADIES DU CERVEAU
Comme l’ont souligné toutes les personnalités rencontrées tant en France que lors des missions à l’étranger, les dysfonctionnements du cerveau sont l'une des premières causes de maladie ou de handicap. Leurs répercussions, directement ou indirectement, touchent de manière importante toute la société.
A- UN IMPACT CONSIDÉRABLE SELON L’OMS
Ainsi, selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, les maladies du cerveau seraient à l'origine de 35 % des dépenses liées à la maladie en général. Mais certains coûts ne sont pas évaluables, tels ceux liés à l’impact indirect sur la famille du patient, ou encore la baisse de productivité d'affections n'entraînant pas de handicap permanent.
L’OMS souligne le manque d’investissements dans les soins de santé mentale au niveau mondial. Les dépenses moyennes mondiales pour la santé mentale sont encore inférieures à 3 dollars par habitant et par an. Selon L’Atlas de la santé mentale 201112 qu’elle a publié à l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, dans les pays à faible revenu, les dépenses peuvent être d’à peine 0,25 dollar par personne et par an. Une personne sur quatre aura besoin de soins de santé mentale à un moment ou à un autre de sa vie, mais la plupart des pays ne consacrent que 2% des ressources du secteur de la santé aux services dédiés à la santé mentale. Le rapport constate que l’essentiel de ces ressources est souvent affecté à des services qui ne touchent que relativement peu de gens : « à l’heure actuelle, près de 70% des dépenses de santé mentale vont aux institutions psychiatriques. Si les pays dépensaient davantage au niveau des soins primaires, ils pourraient atteindre davantage de gens et commencer à s’attaquer aux problèmes suffisamment tôt pour réduire les besoins en soins hospitaliers plus coûteux.»
L’Atlas met en lumière plusieurs déséquilibres : le manque de soins psychosociaux par rapport à l’usage des médicaments, l’inaccessible accès aux services de santé mentale les plus élémentaires dans les pays à revenu faible ou moyen.
En 2008, l’OMS a lancé son Programme d’action mondiale pour la santé mentale (mhGAP) pour aider les pays à développer les services de prise en charge des troubles mentaux, neurologiques et liés à l’abus des substances psychoactives, ce qui a permis à certains pays de faire des progrès notables en développant leurs services avec l’aide de l’OMS.
Le coût des maladies neuropsychiatriques a augmenté très rapidement en Europe. Le coût total des maladies du cerveau, était estimé en 2004 par l'European Brain Council (EBC) à 386 milliards d'euros, et a atteint 798 milliards d'euros par an en 2010. Au total, le coût de la prise en charge de ces troubles est de 1.550 euros par personne et par an, soit le double de l'estimation faite par l'EBC lors de son étude de 2004, qui l’estimait à 829 euros. Les chiffres de l'étude réalisée par l'EBC concernent 12 des principales pathologies qui affectent le cerveau. À savoir, dans le domaine neurologique : les épilepsies, les migraines et céphalées, la sclérose en plaque, la maladie de Parkinson, les accidents vasculaires cérébraux, les traumatismes crâniens, les tumeurs du cerveau ; dans le domaine psychiatrique : les addictions (alcool et drogues illicites), les troubles anxieux (agoraphobie, attaques de panique, phobies, phobies sociales, troubles anxieux généralisés et troubles obsessionnels compulsifs), les dépressions et les troubles de l'humeur, incluant les troubles bipolaires, les psychoses. Les démences dégénératives auxquelles appartient la maladie d'Alzheimer, ont été considérées comme relevant à la fois de la neurologie et de la psychiatrie. Leur coût a été affecté pour moitié aux dépenses neurologiques, pour moitié aux dépenses psychiatriques.
L'allongement de l'espérance de vie renforce ce phénomène qualifié par les experts13 de défi économique numéro un pour le système de santé européen. Le coût de ces affections est substantiellement plus élevé que celui des autres pathologies longues comme le cancer ou les maladies cardiaques. Le coût annuel induit par le traitement du cancer est estimé entre 150 et 250 milliards d'euros. Un accroissement des fonds alloués à la recherche afin de faire face à cette menace est demandé. Des efforts de recherche sur le cerveau et ses maladies sont encouragés au niveau européen, à l’instar du 7ème PCRD (Programme cadre de recherche et de développement technologique, 2007-2013) de l’Union européenne. Des actions de coordination européenne des programmes nationaux sont également en cours dans le domaine des maladies neurodégénératives et des maladies mentales. Ainsi, la Direction générale de la santé et des consommateurs a mis en œuvre un pacte européen pour la santé mentale articulé autour de cinq sujets prioritaires : la prévention du suicide et de la dépression ; la santé mentale chez les jeunes et l’éducation ; la santé mentale sur le lieu de travail ; la santé mentale chez les personnes âgées et la lutte contre la stigmatisation et l’exclusion sociale.
Estimation de la prévalence des maladies mentales,
et du nombre de personnes affectées (en millions)
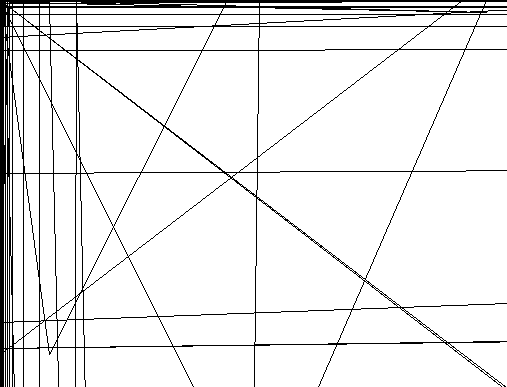
Source : Collège européen de neuro psycho pharmacologie (ECNP)
III- UNE SITUATION DIFFICILE EN FRANCE
Une des spécificités de la France est la séparation de la neurologie et de la psychiatrie, reflet d’une conception dualiste des maladies du cerveau. Cette séparation fait débat ; elle entraîne des controverses encore très vives mettant en cause parfois, de manière pertinente, les classifications de l’OMS ou les modalités de prise en charge de telle ou telle pathologie. Les débats très actuels sur la prise en charge de l’autisme en témoignent.
Les rapporteurs ne peuvent que le regretter car les patients sont littéralement pris en otage par de virulentes querelles d’école qui ont parfois de graves retentissements sur les traitements.
La communauté scientifique a depuis longtemps pris conscience de l’ampleur de la progression des maladies neurodégénératives, des besoins en psychiatriques et des conséquences en termes de santé publique, et elle le rappelle chaque année lors de la semaine du cerveau qui a lieu dans toutes les grandes villes d’Europe, la troisième semaine de mars. La plupart des grandes villes de France y participent en organisant des colloques et des débats, initiatives des plus louables.
A- UNE PROGRESSION LIÉE AU VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION14
En France, la maladie d’Alzheimer et les démences apparentées concerneraient globalement de 650 000 à 950 000 personnes, selon les estimations. L’incidence augmente très fortement avec l’âge (de 1,5 % pour la population âgée de 65 ans, elle double tous les trois ans pour atteindre 30 % à l’âge de 80 ans). Ces démences engendrent rapidement une dépendance physique, intellectuelle et sociale majeure. C’est la principale cause de dépendance lourde et de placement en institution (40 % des malades sont en institution).
Les pathologies du mouvement concernent environ 500 000 personnes en France : 300 000 personnes sont atteintes de tremblement essentiel, 120 000 de la maladie de Parkinson, 6 000 de la maladie de Huntington. La sclérose latérale amyotrophique, la plus fréquente des maladies du neurone moteur dont l'issue est fatale, a une prévalence de 6/100 000 habitants. La maladie de Gilles de la Tourette concerne 1/1 000 à 10/1 000 habitants. Les maladies des canaux, dont l'épilepsie, atteignent environ 500 000 personnes. La sclérose en plaque (SEP), première cause de handicap non traumatique de l’adulte jeune, concerne 80 000 patients. Les leucodystrophies, qui sont à l’origine de handicaps moteurs et intellectuels importants, ont une incidence globale de 1/2 000 naissances.
B- LA PRÉVALENCE DES MALADIES NEUROPSYCHIATRIQUES
La prise en charge et le traitement des maladies mentales font l’objet de débats vifs en France : le clivage entre psychiatrie et neurologie qui tend à se réduire au plan de la recherche reste prégnant dans les pratiques courantes. En outre, même si statistiquement ces maladies sont fréquentes, 1 Français sur 5 a été ou est atteint d’une maladie mentale (18.8 %), il reste encore difficile de faire admettre la nécessité d’une prévention, d’un suivi et d’un traitement au long cours.
Les maladies neuropychiatriques seraient responsables en France de 11 500 morts annuelles par suicide, auxquelles s’ajoute la surmortalité non suicidaire (accidentelle, consommation d’alcool, de tabac et de drogues). La France reste l’un des pays européens dans lequel la mortalité par suicide est la plus forte. Chaque année en France, un peu moins de 200 000 personnes font une tentative de suicide. Il existe une sous-déclaration du phénomène estimée entre 20 et 25 %. Les pays du Nord ont des taux de suicide plus élevés que les pays du Sud (c’est le cas de la Finlande et de la Hongrie par exemple). Les principales victimes sont les hommes (représentant environ 80 % des morts par suicide), les femmes et les jeunes étant les plus nombreux à faire des tentatives de suicide. La proportion de suicides augmenterait avec l'âge. La catégorie la plus touchée reste les personnes âgées car ce sont elles qui meurent le plus souvent du suicide.
Cependant, en 2005, l’Institut national de la recherche médicale relevait une augmentation des tentatives de suicide chez les 15-24 ans et un rajeunissement des sujets « suicidants ». Le suicide des adolescents est un problème de santé publique majeur ; en 2008, il était la première cause de décès des 25-34 ans, la deuxième cause de mortalité en France dès 15-24 ans (entre 600 et 800 décès par an, 16,6 % des causes de décès) après les accidents de la route, et représentait, 3,8 % des causes de décès chez les 5-14 ans. La multiplication et la médiatisation de ces suicides a amené les pouvoirs publics à se pencher sur ce phénomène. Le Dr Boris Cyrulnik15 a remis en septembre 2011 un rapport sans concession à ce sujet à la Secrétaire d’État à la jeunesse.
On estime qu’il y a une tentative de suicide toutes les 3 minutes environ et un mort par suicide toutes les 40 minutes. La récidive pose un problème grave du point de vue préventif, car 10 à 15 % des suicidants finissent par se tuer. La récidive intervient dans plus de la moitié des cas au cours de l’année qui a suivi la première tentative.
La prévalence des dépressions est évaluée à 2 880 000 individus ; celle des troubles anxieux à 4 510 000, celle des addictions (tabac non inclus) à un peu plus de 460 000. L’étude SMPG (Santé mentale en population générale : images et réalités) a évalué la prévalence des troubles de l’humeur (épisodes dépressifs, dysthymies, épisodes maniaques) à 11 % des hommes, 16 % des femmes, celle des troubles anxieux généralisés (anxiété généralisée, agoraphobie, phobie sociale, troubles paniques et stress post-traumatique) à 17 % des hommes, 25 % des femmes, celle de la dépendance ou consommation abusive d’alcool à 7 % des hommes, 1,5 % des femmes.
Les démences sont considérées comme une pathologie psychiatrique et neurologique et concerneraient, selon ces estimations, près de 630 000 individus. Quant aux psychoses, essentiellement représentées par la schizophrénie, elles atteindraient près de 300 000 individus en France, selon l’European Brain Council, 400 000 selon l’INSERM. Selon Marie-Odile Krebs16, les troubles psychotiques atteindraient près de 3% de la population.
Les affections psychiatriques des enfants concernent surtout les troubles envahissants du développement (TED) et notamment l’autisme, dont les études les plus récentes évaluent la prévalence entre 27/10 000 et 60/10 000. Les troubles déficitaires de l’attention/hyperactivité (TDAH) atteignent entre 3,5 et 5 % d’enfants entre 6 et 12 ans. 5 à 10 % des enfants d’âge scolaire seraient dyslexiques, 5 à 7 % des enfants de 5 à 11 ans dyspraxiques, selon le Haut Comité de Santé Publique. Par ailleurs, selon une enquête menée par le Réseau Sentinelle Aquitaine, publiée en 2003, plus d'un enfant de moins de 13 ans sur 10 présenteraient un trouble dépressif. La prévalence en population adolescente atteindrait 5 %.
C- LE COÛT DE LA SANTÉ MENTALE EN FRANCE
Les maladies mentales ont un coût élevé : 107 milliards d’euros (équivalent à 1/3 des dépenses de l’État répartis en 20 milliards d’euros de dépenses directes et 78 milliards d’euros de dépenses indirectes, tels les arrêts de travail et la perte de qualité de vie. Or seulement 2 % du budget de la recherche biomédicale, soit 25 millions d’euros sont consacrés à ces pathologies, comparés à 20 % pour le cancer17.
En réalité, en France comme ailleurs, il est impossible de rendre compte du poids direct ou indirect sur le plan individuel ou collectif de tous les dysfonctionnements cérébraux. En effet, certains coûts ne sont pas évaluables, tels ceux liés au retentissement indirect sur la famille du patient, ou encore la baisse de productivité d'affections n'entraînant pas de handicap permanent. Comme le soulignent Olivier Lyon-Caen et Etienne Hirsch dans l’ouvrage précité18 : « le cerveau est en relation avec tout l'organisme. On est bien loin de recenser, de connaître, voire d'imaginer le rôle que joue cet organe capital dans l'ensemble de nos pathologies, bien au-delà du champ circonscrit de la neurologie et de la psychiatrie. »
Il reste que l’on ne dispose pas d’enquête et d’évaluation sociologique des traitements et des pratiques, comme l’ont souligné Alain Ehrenberg19 et Pierre-Henri Castel20 lors de leur audition, ce que vos rapporteurs regrettent.
Comme dans la plupart des pays développés, les autorités ont conscience du défi lancé par ces pathologies du vieillissement car elles touchent peu ou prou directement ou indirectement chacun. Comme l’on connaît tous dans nos entourages une personne atteinte de maladie d’Alzheimer, l’on se sent concerné, et l’on redoute ce type de pathologies qui touchent à l’intégrité mentale de l’individu, et réduisent les liens affectifs et sociaux.
IV- LA MOBILISATION DE LA RECHERCHE
Face aux défis lancés par les maladies neuropsychiatriques, on assiste à l’échelon mondial à une internationalisation des grands programmes de recherches auxquels les équipes françaises participent, ce que l’on ne peut qu’encourager, même si cela conduit aux financements de projets très ambitieux et coûteux. La coopération internationale entre les équipes et les échanges entre elles sont constants, comme vos rapporteurs ont pu le constater lors de leurs déplacements en France et à l’étranger. Les recherches concernent l’amélioration des outils et des connaissances, et procèdent d’initiatives et de financements internationaux.
A- LES GRANDS PROJETS INTERNATIONAUX
Parmi les projets internationaux de grande ampleur, le projet Blue Brain semble le plus ambitieux par son but, la création d’un cerveau artificiel, par le degré de mobilisation internationale qu’il entraîne, par l’accumulation des données qu’il exige et par son coût.
1- Le projet Blue Brain ou Human Brain Simulation Project (HBSP)
Le Human Brain Simulation Project a été initié en 2007 par Henri Markram, fondateur du Brain and Mind Institute dans le cadre d'une collaboration entre l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et la firme IBM. Cet institut a pour but de mieux comprendre les fonctions du cerveau sain ou malade en associant différentes méthodes d'analyse du comportement des neurones, y compris la simulation sur ordinateur.
Le projet vise à créer un cerveau artificiel à partir de données en provenance du monde entier et ainsi, à parvenir pièce par pièce, à modéliser l'ensemble du cerveau d'un rat. C’est une approche microscopique pour reconstruire le cerveau de façon verticale, en partant des molécules et des synapses vers la géométrie des cellules. Le Blue Brain Project a déjà simulé le fonctionnement d’une fraction de cerveau de rat, reconstitué neurone par neurone.
Les équipes comptent développer de nouvelles techniques d'analyse in vivo, et une automatisation plus rapide résultant de l'augmentation de la puissance de l'ordinateur avec de nouveaux algorithmes travaillant en simultanéité. Une fois obtenu un cerveau global, il serait, selon Henry Markram21, relativement aisé d'étudier son fonctionnement à une échelle elle-même globale, en le soumettant à des entrées/sorties analogues à celles que le corps vivant impose au cerveau vivant.
Lors de son entretien avec la mission, Henry Markram a longuement insisté sur le caractère inédit de la méthode qui sera appliquée à la modélisation d'une mini-colonne du cortex humain, puis, pourquoi pas, vers 2030, à celle du cerveau entier. Selon lui, cette approche épistémologique originale nécessite la mise en réseau de nombreuses bases de données et implique des développements informatiques majeurs. Le cerveau humain pourrait être comparé à un ordinateur immensément puissant, autodidacte, capable de se reconfigurer en permanence au gré des expériences vécues, d’utiliser efficacement l’énergie dont il dispose, de s’auto-régénérer.
Comprendre le fonctionnement cérébral, être capable de le mimer, permettrait donc, selon lui, une avancée déterminante tant dans le domaine de la santé que dans celui du traitement de l’information. Ce projet, qui vise à simuler dans le détail les processus mis en œuvre par le cerveau pour traiter l’information, apprendre, ressentir, réparer les dommages cellulaires etc…, pourrait avoir des retombées décisives en médecine. Les promoteurs du projet espèrent qu’en modélisant le fonctionnement du cerveau, on arrivera à développer de nouveaux outils diagnostiques, de nouveaux traitements pharmacologiques pour certaines maladies neurologiques ou psychiatriques, et un nouveau type de prothèse pour faciliter le quotidien des handicapés. Une meilleure connaissance des modes opératoires utilisés par le cerveau pourrait inspirer la conception de futurs ordinateurs ou robots plus performants et mieux adaptés.
L’ampleur et le degré de complexité des modélisations en jeu suppose de créer les logiciels informatiques ad hoc, de développer des modèles et des technologies de type « supercalculateurs ». Les applications potentielles de ce projet sont de deux ordres, d’une part une meilleure classification des connaissances des maladies du cerveau, facilitant la mise en place de thérapies, et d’autre part le développement de nouveaux ordinateurs performants basés sur des aspects fonctionnels du cerveau, avec une basse consommation énergétique.
Grâce à une collaboration internationale impliquant spécialistes des neurosciences, médecins, physiciens, mathématiciens, informaticiens et éthiciens, ce projet constituerait une étape décisive dans la compréhension du cerveau humain. Son caractère transdisciplinaire est un atout.
La méthodologie de ce projet a fait l’objet d’un débat lors de l’audition publique du 30 novembre 2011. Pour Yehezkel Ben-Ari22, ce n’est pas un modèle : « De quoi s’agit-il ? D’un neurone du cortex, déconnecté de son milieu naturel, mis dans une tranche, où l’on identifiera tous ses courants. Ce n’est pas un modèle, or en réalité, il existe des centaines de neurones différents, dans un cerveau adulte normal, ou dans un cerveau immature ». Il ajoute : « Le projet Blue Brain, est un projet d’un milliard pour construire un cerveau à partir de neurones de cortex de souris dont les courants sont totalement identifiés. C’est pour le moins aberrant. »
Pour Yves Agid23 et Grégoire Malandain24, le projet Blue Brain témoigne d’une approche originale, mais il ne prend pas assez en compte la plasticité cérébrale. Cependant il a l’avantage de permettre une convergence des financements. Selon Jean-Claude Ameisen25, « on fait la même confusion entre développement d’outils technologiques et véritable avancée des connaissances… Les grandes entreprises technologiques, si elles peuvent être utiles, ne conduisent jamais, ou presque jamais, en elles-mêmes, à des révolutions scientifiques. »
Les promoteurs du projet Blue Brain ont décidé de le prolonger dans un projet élargi étendu à d'autres partenaires, le Human Brain Project, qu’ils ont proposé au financement de la Commission européenne à Budapest en mai 2011, lors de la conférence sur les technologies du futur en le présentant comme relevant du domaine FET (Future and Emerging Technologies). Ce domaine est un élément essentiel du programme Cordis de l'Union européenne consacré au financement de la recherche scientifique et technologique communautaire.
L'Union européenne l’a retenu dans le cadre des programmes phare du FET avec un financement à hauteur de 100 millions d’euros par an sur 10 ans. En l’état, le projet implique des partenaires dans le monde entier et fédère actuellement 13 universités et institutions de recherche de 9 États membres européens et États européens associés. Il est piloté par l’École Polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse (EPFL). Il implique pour la France, l’unité de recherche CEA-Inserm de neuroimagerie cognitive expérimentale intégrée au centre NeuroSpin du CEA, et de nombreux scientifiques français. Comme l’a souligné Yezekiel Ben Ari26 : « Il faut distinguer le Human Brain Project, du Blue Brain Project, qui est coordonné à Lausanne ; le Human Brain project a une autre envergure, et d’autres objectifs. »
Les rapporteurs s’interrogent sur les finalités de ce projet et l’ampleur des moyens financiers mobilisés à cet effet.
Ce projet, déjà financé par le FET, vise à développer une représentation multi-échelle d'un cerveau aussi complète que possible. Les chercheurs utilisent pour cela des données provenant de l'observation biologique pour construire un modèle computationnel du cerveau. Celui-ci fait appel à l'architecture des réseaux de neurones. Il est donc capable par définition de se construire en tenant compte de l'expérience.
Brainscales est associé à Blue Brain et à un autre projet européen, Brain-i-Nets qui explore les capacités offertes, notamment pour simuler l'apprentissage des aires cérébrales en utilisant de grands ensembles de réseaux neuronaux artificiels.
4- Le projet Virtual Brain et la modélisation partielle des fonctions
D’après son directeur, Victor Jirsa27, le Virtual Brain Project consiste en un logiciel qui permettra de télécharger les données obtenues, par imagerie cérébrale, d’un cerveau particulier, et de reconstruire ses connexions en trois dimensions. L’idée est de simuler la dynamique du cerveau, et l’oxygénation du sang liée à l’activité cérébrale pour tester des hypothèses médicales, ou de recherche fondamentale : augmenter l’excitabilité de quelques aires, accélérer la communication entre elles, ou effacer une aire pour simuler une lésion, puis observer ce que cela engendre. De nombreuses études mathématiques montrent que cela est possible. Pour ce faire, il faut une puissance informatique, qui existe au campus médical de la Timone, à Marseille. Ce simulateur devrait être lancé en septembre 2012.
Par ailleurs, d'autres recherches menées principalement aux États-Unis, visent à rassembler dans de vastes atlas, l'ensemble des observations relatives au fonctionnement du cerveau, de ses composantes et plus généralement du système nerveux, faites sur des sujets vivants, en bonne santé ou atteints de troubles divers. Ces méthodologies observationnelles visent à conjuguer les approches de détail et les approches d’ensemble.
B- DES TENTATIVES POUR RELEVER LE DÉFI EN ALLEMAGNE ET AU JAPON
Conscients que le vieillissement de leur population entraînant une prévalence accrue de maladies neurodégéneratives et de handicap liés à l’âge, ces deux pays développent des politiques de compensation du handicap très actives, visant à conférer le plus d’autonomie possible aux personnes atteintes.
En Allemagne, outre les équipements visant à intégrer les handicapés dans la ville (trottoirs, équipements des lieux publics), des recherches sont menées pour équiper les véhicules de capteurs permettant d’accroître la vigilance des conducteurs.
Au Japon, quelque 28 millions de personnes ont plus de 65 ans, dont 13 millions plus de 75 ans, sur une population totale de quelque 127 millions d'habitants. La part des plus de 65 ans pourrait grimper à 45% d'ici 2060 au rythme actuel. Les Japonais anticipent ce phénomène à défaut de parvenir à enrayer la baisse de la natalité. Ils continuent à développer des systèmes de robots sophistiqués et d’exosquelettes qui viennent aux secours des personnes âgées dans la vie quotidienne et les soins. Des transports sont organisés à leur intention afin qu’elles puissent bénéficier de soins appropriés tout en continuant à vivre à leur domicile. Les constats effectués par l’OPECST en 200828 sont toujours d’actualité s’agissant de l’usage de la robotique dans la compensation du handicap au Japon.
Outre les recherches que ce pays développe en neurosciences et neuroimagerie, des systèmes spécifiques d’aides aux soins, tels des exosquelettes de rééducation fonctionnelle s’adressant aux personnes atteintes de séquelles de maladies neurodégénératives, sont mis au point et seraient déjà utilisés dans les hôpitaux.
Ces démarches qui participent d’une volonté collective d’insertion des patients souffrant de pathologies neurodégéneratives doivent servir d’exemple; il ne s’agit pas à proprement parler de traitements innovants offrant une guérison inespérée, mais de systèmes de soins et de prises en charge visant à redonner une vie sociale et à permettre une intégration que vos rapporteurs soutiennent, car le bénéfice social pour les patients et les aidants est immédiat.
Tous les pays étant touchés par les maladies neuropsychiatriques de manière diverse, chacun s’efforce d’y remédier selon sa culture et son degré d’acceptation des maladies du cerveau. La France tente d’y faire face avec des tentatives louables, mais avec des résultats insuffisants notamment dans la prise en charge des troubles du comportement29, quelle qu’en soit l’origine.
1- L’effort de l’Allemagne en neuroimagerie
Avec près d’un million de personnes atteintes de démence (un chiffre qui pourrait doubler d’ici à 2050) et près de 200 000 nouveaux cas recensés chaque année, l’Allemagne a fait de l’imagerie médicale un axe fort du diagnostic in vivo pour les maladies neurodégénératives. Par ailleurs, constatant que l’incidence des cancers du cerveau reste stable mais que le taux de survie demeure toujours aussi faible, les chirurgiens considèrent l’imagerie pré-chirurgicale comme un outil fondamental pour traiter ces cancers.
a- Une recherche centrée sur l’amélioration des techniques d’imagerie
L’Allemagne conduit plusieurs programmes de recherche pour décoder le cerveau humain qui passent par l’imagerie pour visualiser de manière précise les tissus cérébraux, leurs métabolismes et les mécanismes de certaines pathologies comme la maladie d’Alzheimer. De façon générale, les scientifiques allemands cherchent à améliorer la résolution, la sensibilité et la spécificité des images en augmentant la puissance des champs magnétiques. Les chercheurs rencontrés par la Mission30 ont présenté l’imagerie comme un outil fondamental pour la chirurgie ; le degré de résolution des images permet selon eux, d’améliorer la précision et l’exactitude des gestes pour guider les biopsies. Ils y voient aussi un potentiel important dans la détection précoce de tumeurs, l’évolution de leur croissance et leur degré de réponse à un traitement, ce qui ouvre la voie à un pan entier de la médecine personnalisée. L’augmentation du degré de résolution pourrait à terme permettre de définir des profils pour les différentes formes de démences et, parallèlement, d’affiner le diagnostic des différents stades de la maladie d’Alzheimer, sur lesquels des recherches sont menées par un suivi de grandes cohortes.
En outre, les signatures moléculaires pour la détection précoce de la maladie d’Alzheimer sont à l’étude. La recherche pharmacologique par l’analyse de l’efficacité de nouveaux traitements, utilise la puissance de résolution de l’imagerie au niveau moléculaire (modulation des neurotransmetteurs et récepteurs par des médicaments) pour quantifier le degré de succès des traitements. Le développement de marqueurs spécifiques de ces pathologies constitue l’un des enjeux de la R&D en Allemagne, pour faciliter la reconnaissance des tumeurs et déterminer le stade métabolique dans lequel se trouvent les cellules tumorales. Les recherches concernent particulièrement les maladies de dégénérescence du système nerveux central pour lesquelles un diagnostic basé sur l’utilisation d’images précises des premiers signes permettrait d’envisager des stratégies thérapeutiques précoces, et de ralentir la progression de la maladie.
L’imagerie constitue donc l’un des points clef du diagnostic in vivo. La palette des machines développées couvre pour l’imagerie par résonance magnétique (IRM), 80 % de machines à 1,5T, quelques-unes à 3T et une ou deux à 7T, spécifiquement dédiées aux activités de R&D. Siemens est aussi impliqué dans la construction de l’IRM de 9,4T à Jülich, en partenariat avec un fabricant d’aimant du Royaume-Uni.
Partie fondamentale du « cluster Medical Valley », Siemens Healthcare souhaite couvrir l’ensemble du marché de la santé. Ouvert en 2005, l’Imaging Science Institute de l’Université d’Erlangen est l’un des centres de recherche appliquée créé en partenariat avec Siemens pour analyser et optimiser sur les patients les dernières innovations en imagerie ainsi, que pour former les employés et clients de Siemens à l’utilisation d’appareils d’imagerie en conditions réelles.
La diminution des doses appliquées aux patients est un des enjeux actuels de Siemens, qui s’est notamment traduit par le développement du scanner à double source permettant de réduire le temps d’exposition. Tout comme la France, l’Allemagne a choisi de développer la voie de l’imagerie par résonance magnétique en champ intense (7Teslas, 9,4T et, pour la France, 11,7T) dans le but d’explorer le cerveau du pré clinique au clinique. Parallèlement, les Allemands, en partenariat avec leur industrie, ont décidé de développer un outil directement applicable à la clinique couplant l’imagerie par résonance magnétique et la tomographie à émission de positrons (IRM-TEP) ou PET, selon l’acronyme anglais, sur un seul et même appareil. Ils ont ainsi combiné les avantages des deux approches, c’est-à-dire la résolution anatomique, temporelle et spatiale de l’IRM avec la sensibilité et la spécificité de l’imagerie moléculaire du TEP. L’objectif est de permettre à la fois la localisation et l’analyse de mécanismes neuronaux complexes (IRM) et l’analyse au niveau moléculaire du fonctionnement du cerveau (TEP). L’appareil permet aussi de réduire le temps d’observation et d’exposition. Ainsi pour la recherche, le centre de recherche de Jülich a développé, en partenariat avec Siemens, un TEP-IRM à 9,4T qui constitue un appareil d’imagerie unique au monde pouvant combiner la visualisation du métabolisme des cellules nerveuses (TEP) au sein de structures tissulaires précises visualisées par le procédé IRM. Toutefois l’interprétation des données ainsi recueillies exige des compétences particulières et une formation idoine.
Avec les avancées technologiques récentes permettant une image plus précise du cerveau, de son métabolisme et de ses pathologies, l’industrie de l’imagerie considère que le secteur est un marché à fort potentiel. Les experts rencontrés par la mission n’ont cependant pas confirmé que ces nouveaux appareils d’imagerie cérébrale pourraient être utilisés en procédures routinières et que cette technologie serait efficace sur la base d’un rapport coût/bénéfice pour la santé ; cela demandera une analyse complexe nécessitant du temps. Ces nouveaux outils exigeront un personnel formé à l’interprétation des données qu’ils génèrent.
b- Le soutien du gouvernement fédéral et des Länders
Le ministère de la recherche et de l’enseignement (BMBF) est très impliqué dans le soutien au développement des technologies d’imagerie médicale. Il a permis l’installation d’un IRM-TEP de 9,4T à Jülich pour un montant de 20 millions d’euros en partenariat avec Siemens Healthcare et a installé trois IRM-TEP de 3T dans les cliniques universitaires de Munich, Essen et Leipzig pour un montant de 11 millions d’euros. Le ministère avait aussi investi 4 millions d’euros en 2008 pour l’achat d’un appareil IRM à très haut champ magnétique (7T) au centre de recherche sur le cancer de Heidelberg.
La formation en imagerie, et de façon plus générale en neurosciences, nous a été présentée dans le cadre du Centre de neurosciences de Munich « Cerveau et esprit » (MCN), centre pluridisciplinaire localisé dans la métropole bavaroise, qui comprend les départements de chimie, de neurosciences et de philosophie des deux universités d’excellence, l’université Ludwig Maximilian et l’université technique de Munich, les instituts du Max Planck (psychiatrie, neurobiologie), les instituts de la Helmholtz (cellules souches, génétique du développement…), les hôpitaux universitaires de la région… Le MCN a notamment mis en place un centre compétent en éthique impliqué dans l’évaluation des conséquences des technologies de neurosciences. Par ailleurs, les facultés de philosophie des deux universités munichoises forment et accompagnent les chercheurs en neurosciences dans leur réflexion éthique.
Le centre de neurosciences de Munich a développé un cursus intégré qui inclut les étudiants dès le niveau licence/maîtrise jusqu’au niveau post-doctoral. Ce montage se fait en partenariat avec des industriels (Amgen, Roche), l’État de Bavière, des universités étrangères (université de Harvard, Queensland Brain Institute) et les écoles doctorales internationales du Max Planck. Le centre bénéficie de l’ensemble des initiatives conduites par le gouvernement fédéral : centres nationaux de recherche sur la santé, centres hospitalo-universitaires labellisés au niveau mondial, et appels d’offre de l’Initiative d’Excellence.
c- Les partenariats public/privé
Reconnaissant l’importance des technologies médicales, le ministère de la recherche et de l’enseignement a sélectionné en 2008 Medical Valley comme cluster de pointe (partenariat technologique public/privé) basé sur l’excellence de la recherche universitaire, 40 hôpitaux... Le financement global pour les 5 prochaines années s’élève à 81 millions d’euros. L’objectif est de développer une palette de technologies médicales (diagnostic, imagerie, ophtalmologie, senseurs intelligents) pour créer le premier pôle européen en ce qui concerne la qualité et l’efficacité du secteur de santé. Le cluster entend aussi aider au développement de nouvelles start-ups dans le domaine de la technologie médicale (dont l’imagerie) et de la pharmacie avec son incubateur d’entreprise, proposant à cette fin de nombreux services : support au dépôt de brevets, à la recherche de fonds, à la gestion d’entreprise, à la commercialisation…
L’Allemagne, sur la base de la cohorte nationale allemande de 200 000 sujets (2011-2012), entend constituer une population de 40 000 sujets pour lesquels des scans de tout le corps seront effectués. On sait statistiquement que 1 % des sujets développeront la maladie d’Alzheimer, et il sera alors possible de retracer les principales étapes de la maladie sur la série d’images et de découvrir des biomarqueurs spécifiques des différents stades de la maladie.
2- Les options de la recherche en neurosciences au Japon31
Frappé par le vieillissement de sa population (voir supra), le Japon investit dans la recherche sur les maladies neuropsychiatriques avec un grand souci d’efficacité et des recherches de pointe.
a- Un programme volontariste pour promouvoir la recherche en neurosciences
Le Ministère de l'éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie (MEXT) a institué un Comité des neurosciences de 23 membres avec pour mission de réfléchir aux futures stratégies gouvernementales concernant les recherches en neurosciences. Le comité comprend des scientifiques en neurosciences et en biologie cérébrale, tel Hideyuki Okano, professeur de physiologie à la faculté de médecine de l'Université Keio, qui conduit des travaux sur le développement et la régénération du système nerveux grâce aux cellules souches, des spécialistes de bioéthique, des juristes, tels Akira Akabayashi32, des industriels, une journaliste... Un programme a été lancé en avril 2008 par le MEXT afin de promouvoir les recherches en neurosciences. Il a été décrit à la mission par le Pr Shigetada Nakanishi, directeur de l’institut de biosciences d’Osaka et le Pr Norio Nakatsuji, directeur de l’Institute for Frontier Medical Sciences. La durée du projet est de 4 ans (2008-2012) avec un budget d’environ 37 millions d'euros en 2010, quelques 30 structures de recherche et 200 scientifiques y participent.
Ce programme stratégique de recherche, Program for Brain Sciences, comprend six projets : les projets A et B visent à développer une interface cerveau-machine pour la recherche fondamentale sur les mécanismes cérébraux et sur l'interprétation des données physiologiques par des systèmes informatiques. Le projet C vise à élaborer des modèles animaux innovants pour l'étude du cerveau. Le projet D a pour but de découvrir des biomarqueurs spécifiques du comportement social par l’étude des caractéristiques biologiques liées à des processus cognitifs, notamment ceux déterminant le comportement social. L’objectif du projet E est la compréhension des bases moléculaires et environnementales de la santé cérébrale, et celui du projet F la lutte contre les troubles psychiques et nerveux.
Les scientifiques japonais rencontrés au cours de notre mission au Japon sont satisfaits de ce cadre de recherche. Ils mènent une coopération bilatérale active avec les chercheurs du monde entier, et en particulier avec les Français.
b- Le rôle des universités
L’Université de Tokyo
Fondée en 1877 en tant que première université impériale, l'Université de Tokyo dispose d’un budget de 227 milliards de yens, soit environ 2,3 milliards d'euros. Il existe 36 accords établis entre des universités françaises et l'Université de Tokyo dans de nombreux domaines d'expertise avec notamment l'Institut d'études politiques de Paris, l'École polytechnique, l'École centrale de Paris, l'École des mines de Nantes.
Au sein de l’Université de Tokyo, la faculté de médecine privilégie une approche pluridisciplinaire en associant les sciences médicales fondamentales, les sciences médicales cliniques et l'ingénierie biologique, dans le but notamment de développer de nouveaux domaines scientifiques polyvalents.
La faculté de médecine de l'Université de Tokyo comprend deux départements spécialisés dans les thématiques liées au cerveau. Le département de radiologie et d’ingénierie biomédicale comprend un laboratoire de radiologie capable d'observer l'intérieur de l'ensemble du corps humain ; il dispose de matériel de pointe pour l'exploration du cerveau ; le département de neuroscience étudie l'ensemble de la biologie, de la chimie, de la pathologie et de la neuropsychiatrie du cerveau, et explore également les mécanismes cognitifs régissant cet organe. La mission a visité ce département et s’est entretenue avec le Pr Nobuto Saito, neurochirurgien, le Dr Naoto Kunii, neurochirurgien, le Pr Takeshi Araki, psychiatre, le Pr Kazuya Iwamoto, psychiatre également. Il ressort de ces entretiens que la détection précoce des troubles pouvant donner lieu à des maladies mentales est une préoccupation des experts japonais qui ont mis au point un programme de sensibilisation et d’étude. Ils tentent de prendre en compte les risques de stigmatisation que cela implique. La recherche de nouvelles molécules contre ces troubles est active.
La faculté de médecine comprend également quatre centres d'excellence mis en place dans le cadre d'un programme de la Japan Society for the Promotion of Science (JSPS). Les thèmes de recherche portent notamment sur l’éducation à la bioéthique. En s’entretenant avec le Pr Akira Akabayashi, directeur du Centre d’éthique biomédicale, éthique et droit, le Dr Yoshinori Hayashi, maitre de conférence, et le Dr Shimon Tashiro, assistant dans ce département, la mission a mesuré l’étendue des points de convergence entre les spécialistes d’éthique biomédicale japonais et français, avec d’ailleurs, côté japonais, une conception plus ouverte des recherches sur les cellules souches.
L'Université Keio de Tokyo
C’est la première université privée du Japon. Les frais de scolarité figurent parmi les plus élevés du pays. Il existe 26 accords établis entre des universités françaises et l'Université Keio dans des domaines d'expertise variés.
La faculté de médecine comprend deux organisations dédiées à l'enseignement et un hôpital complètement intégré dans le dispositif hospitalier japonais, qui dispense donc des soins au grand public. Ces deux établissements qui assurent la formation des futurs médecins, sont organisés en divisions correspondant aux diverses spécialités de la médecine générale. L'hôpital universitaire de Keio dispose de 1000 lits, et plus de 4000 patients se rendent quotidiennement dans ses 26 services spécialisés. Il comprend des laboratoires spécifiques en médecine régénératrice et biologie du développement : l'Institute for Advanced Medical Research, le Center for Integrated Medical Research (médecine translationnelle). Le centre Tsukigase a été l'un des premiers établissements à proposer une médecine de rééducation à la suite d'accidents vasculaires cérébraux, d'atteinte du système nerveux central ou d'attaques cardiaques, ce qui est assez rare.
Les études réalisées sur le cerveau se concentrent sur l'aspect cellulaire, l'interaction entre neurones et le fonctionnement du système nerveux. Cette université dispose d'un département de biosciences et informatique très développé. Le laboratoire de recherche Tomita et Ushiba Laboratory, spécialisé dans la physiologie du cerveau, les mécanismes cognitifs et l’interface cerveau/machine travaille sur les interfaces homme/machine par ondes cérébrales. Cette structure de recherche collabore activement avec le département de médecine rééducative de l'hôpital universitaire afin d'intégrer les technologies développées dans les programmes de soins.
Dans le cadre du programme Global Center of Excellence, deux divisions de recherche de la faculté ont été constituées : d’une part, le Center for Human Metabolomic Systems Biology qui vise à explorer des mécanismes du métabolisme dans certaines conditions physiologiques pathologiques, où les stratégies de recherche se basent sur des expériences sur l'homme et l'animal ; et d’autre part, l’Education and Research Center for Stem Cell Medicine, où l'application des protocoles expérimentaux concerne notamment la réparation de certains tissus par transplantation de cellules souches directement au sein des zones présentant des lésions. La mission s’est entretenue avec le Pr Hiroyuki Okano, directeur de recherche et développement, le Pr Michisuke Yuzaki, professeur au département de physiologie et le Dr François Renault-Mihara, post-doctorant français menant des recherches au département de physiologie. Les études sur les primates ont été présentées ; elles portent sur la modélisation de maladies neuropsychiatriques. L’importance de la recherche sur les primates non humains dans ce domaine a été soulignée, et le Japon se veut pionnier dans ce secteur.
L'Université de Kyoto
Elle dispose de son propre centre de recherche spécifique sur le cerveau le Human Brain Research Center. L'université de Kyoto est le centre d'excellence mondial sur les cellules souches pluripotentes induites, iPS découvertes par le professeur Yamanaka. L’université compte huit départements explorant les aspects du cerveau tels que la plasticité, la pathophysiologie, la neurologie, la neurochirurgie ou encore l'imagerie médicale.
Au sein de cet établissement créé en avril 2000, de nombreux travaux de recherche en imagerie sont menés grâce à l'emploi de techniques non invasives ; le très récent Kokoro Research Center s'y emploie à décrypter les mécanismes cognitifs et l'effet des émotions sur le cerveau, voire sur l'organisme. Au sein de la faculté de médecine, le Human Brain Research Center (HBRC), que son directeur, le Pr Hidenao Fukuyama, a présenté à vos rapporteurs, est consacré à l'ensemble des sciences et des techniques d'exploration non invasives du cerveau. Le Pr Fukuyama s’est interrogé sur les limites des modèles animaux s’agissant de la maladie d’Alzheimer, pour laquelle on bute sur les difficultés d’arrêter la production de plaques amyloïdes. L'établissement comprend trois départements fortement liés à l’étude des mécanismes cognitifs et à la rééducation cérébrale en tant que médecine régénérative pour les déficiences ou les troubles mentaux aigus.
Le centre dispose d'un nombre important d’équipements permettant la réalisation d'examens tels que l'imagerie par résonnance magnétique (IRM), la tomographie par émission de positons (TEP ou PET) et par émission mono-photonique, la magnétoencéphalographie (MEG), la stimulation magnétique transcrânienne. Il collabore activement avec la France et notamment avec le centre NeuroSpin et son directeur, Denis Le Bihan.
L’Université d'Osaka
De nombreux départements de cette université étudient les aspects cellulaires du cerveau et des neurones : pathologies, interactions, protéomique, génétique. La Graduate School of Frontier Biosciences est une faculté de huit départements spécialisés dans l'innovation biotechnologique. Au sein du département de neurosciences, six thématiques de recherche sur le cerveau sont étudiées: les neurosciences visuelles, les neurosciences du développement et du fonctionnement cérébral, les sciences cognitives, la biologie des neurones à l'échelle cellulaire et moléculaire, la plasticité des synapses, la dynamique du réseau cérébral.
c- Les Instituts de recherche du Ministère de l'Education, de la Culture, du Sport, de la Science et de la Technologie (MEXT).
Le Riken
Le Riken est l'un des grands instituts de recherche établi en 1917 sous la forme d'une fondation privée ; il devient une entreprise publique en 1958, puis une institution administrative indépendante sous tutelle du MEXT en 2003. Il disposait d’un budget d’environ 876 millions d'euros en 2010 financé en majeure partie par l’État. Il jouit d’un grand prestige : son Président, le professeur Ryôji Noyori, fut lauréat du prix Nobel de chimie en 2001. Il accueille environ 3000 personnes, incluant à la fois personnel administratif et chercheurs, et autant de chercheurs invités. Il a une mission de recherche dans tous les domaines scientifiques et technologiques liés aux sciences exactes (physique, chimie, médecine, biologie, ingénierie) et de diffusion de ses résultats auprès du public. Le Riken est considéré comme l’un des organismes les plus importants de recherche publique en sciences de la vie. 30 chercheurs français y sont présents, la Mission en a rencontré plusieurs au cours de sa visite.
Les travaux du Riken s'étendent de la recherche fondamentale à la mise au point d'applications pratiques. Il dispose de plusieurs centres de recherche dans le domaine biomédical. Le budget de ces différents centres représente 23,6 milliards de yens, soit près d'un quart du budget total. La médecine et la biologie constituent donc une part majeure de l'activité du Riken, et notamment l’étude et le traitement du cerveau.
Le Riken Brain Science Institute à Tokyo est l’un des plus grands centres d'étude du cerveau au Japon. Son directeur Toshihiko Oguru, le Dr Tadaharu Tsumoto, directeur de recherche du laboratoire de plasticité corticale et le Dr Kang Cheng, directeur de recherche du centre d’IMR fonctionnelle ont présenté aux rapporteurs les grands axes des recherches menées dans cet institut. La mission a visité le centre de neurocybernétique moléculaire dirigé par un Français le Dr Thomas Launey.
Etabli en 1997, dans une volonté de comprendre les mécanismes qui régissent le fonctionnement du cerveau par une approche interdisciplinaire, cet établissement comporte quatre grands départements de recherche : Mind and Intelligence Research Core ; Neural Circuit Function Research Core ; Disease Mechanism Research Core; Advanced Technology Development Core. Il dispose également du Neuroinformatics Japan Center et de deux centres de collaboration scientifiques avec les entreprises Olympus et Toyota. En partenariat avec Toyota, il a développé un prototype de fauteuil roulant contrôlable par la pensée. Les recherches menées dans ces centres concernent aussi bien la neurobiologie moléculaire que les sciences cognitives et les neurosciences computationnelles.
À Kobe le Riken Center for Molecular Imaging Science concentre ses recherches sur la dynamique de molécules in vivo. Il regroupe neuf laboratoires spécialisés dans la création de sondes moléculaires, de technologies d'imagerie et de développement de molécules pharmaceutiques. Les scientifiques ont à leur disposition des dispositifs parmi les plus perfectionnés en termes de résolution. La mission s’est entretenue avec son directeur le Dr Yasuyoshi Watanabe, le Dr Hirotaka Onoe du Functional Probe Research Laboratory, et le Dr Yosky Kataoka du Cellular Function Imaging Laboratory .
d- La participation des centres de recherches privés
Hitachi
Il dispose de son propre centre de recherche dans ce dernier secteur avec notamment une thématique, Brain Science Applications, et développe de très nombreux appareils d'imagerie et de diagnostic utilisés dans des établissements de soins et de recherche : échographie, IRM, scanners. Il met au point également des robots dédiés aux actes chirurgicaux, notamment les laparoscopies avec l'endoscope robotisé Naviot.
Cyberdyne
Cyberdyne est une entreprise de technologie robotique fondée en 2004 par le Pr Yoshiyuki Sankai, professeur de l'université de Tsukuba. Elle est à l'origine de l'exosquelette Human Assistive Limb (HAL), actuellement employé pour certains travaux pénibles dans la région de Fukushima et dans quelques hôpitaux pour la rééducation de patients. La technologie développée par Cyberdyne permet d'exploiter les influx nerveux et de transmettre l'information sous forme d'excitation motrice aux membres inférieurs robotisés. Ceux-ci déclenchent alors la marche assistée par l'exosquelette.
Advanced Telecommunications Research Institute International (ATR)
Établi en mars 1986 dans la région de Kyoto, ATR est un institut de recherche privé et indépendant qui mène des travaux de recherche fondamentale et appliquée dans le domaine des télécommunications à l'aide de financements publics ou privés, japonais et internationaux. L'ATR se trouve dans la Kansai Science City, ville fondée dans les années quatre-vingt-dix pour promouvoir les sciences et la recherche, qui rassemble des universités et des instituts de recherche tels que le National Nara Institute of Science and Technology et l’ATR que vos rapporteurs ont visité.
Sur 220 employés, 188 sont chercheurs. En avril 2010, 14% des scientifiques étaient étrangers. L'Institut est composé de deux centres de recherche : le Social Media Research Laboratory Group dédié au développement de systèmes automatisés, aux robots humanoïdes, aux ondes radios et à la téléphonie et le Brain Information Communication Research Laboratory Group, qui concerne le développement de l'interface neuronale directe ou interface cerveau/machine, permettant d'agir sur une machine par la pensée.
La mission s’est entretenue avec le Dr Mitsuo Kawato, directeur de ce laboratoire ainsi qu’avec le Dr Hiroshi Imamizu, directeur du laboratoire dédié aux mécanismes de la cognition et le Dr Noriko Yamagishi, chercheur dans ce laboratoire. D’après ces experts, le but des interfaces cerveau/machine et de la robotique est l’analyse et la récupération des fonctions perdues. Ils développent des systèmes de prothèses les plus perfectionnées possibles et les moins invasives.
Il existe trois laboratoires dédiés à l’étude des fonctions cérébrales et à leur traduction en instructions informatiques. Des prototypes d'appareils de mesure des signaux cérébraux sont également mis au point. L'objectif des travaux effectués est de comprendre les mécanismes cognitifs et les processus physiologiques d'apprentissage à l'aide d'une approche computationnelle et psychologique. L'amélioration de la résolution et de la qualité des images obtenues grâce aux différents types de scanners constitue également une thématique clé des recherches.
Depuis 2005, la société Honda et l'ATR conduisent des études conjointes sur l’interface homme/machine afin de connecter les hommes aux machines. En 2009, l'ATR a ainsi réalisé en collaboration avec les sociétés Honda et Shimadzu, un prototype d’interface cerveau machine combinant les technologies de spectroscopie à infrarouge et d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle afin de capter les ondes cérébrales et les variations de circulation sanguine. Les informations récoltées par l'interface avec la machine permettent au robot ASIMO (société Honda) d'agir en accord avec les pensées de l'utilisateur selon un taux de réussite évalué à 90%.
C- LA MOBILISATION DES ORGANISMES DE RECHERCHE ET DES FONDATIONS AUX ÉTATS-UNIS33
Les États-Unis sont en pointe dans les recherches et la mise au point d’outils et de programmes de recherche dans le domaine des neurosciences et de la neuroimagerie depuis les années quatre-vingt, même si les développements de la neuroimagerie ne font l'objet ni d’un pilotage étatique, ni d'un encadrement juridique, ni de réflexion politique au Congrès, comme la mission l’a constaté. Les chercheurs bénéficient d’une approche disciplinaire et multidisciplinaire de la recherche, grâce au système de financement sur projets par le National Institute of Health (NIH), les universités et les fondations.
a- Le NIH : l'organisme de financement et de recherche de référence
Le NIH consacre 17% de son budget aux neurosciences (soit plus de 5 milliards de dollars) et finance des projets de neuroimagerie au sein de ses programmes de recherche intramuros et extramuros. Les 6 instituts principalement impliqués dans les programmes de recherche en neuroimagerie sont le NIMH ("National Institute for Mental Health"), le NINDS ("National Institute for Neurological Disorders and Stroke" - l’Institut national des maladies et troubles neurologiques), le NICHD ("National Institute of Child Health and Development"), le NIBIB ("National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering"), le NCI ("National Cancer Institute") et le NIAAA ("National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism"). Un plateau exceptionnel d'équipements impressionnants est mis à disposition des chercheurs, une plateforme technologique constituée de 10 IRM (imagerie par résonance magnétique), 1 MEG (magnétoencéphalographie) et 1 EEG (électroencéphalographie) ainsi qu’une antenne d'imagerie moléculaire dotée de 6 TEP (tomographie à émission de positron) et 1 SRM (spectoscopie à résonance magnétique).
Les recherches menées au NIH portent sur l’utilisation de l'IRM fonctionnelle en neuroimagerie pédiatrique, l’étude de la neuroanatomie fonctionnelle des différents systèmes de mémoire, de la plasticité corticale. Elles portent également sur les troubles psychiatriques, tels les états émotionnels dans les troubles de l'humeur et de l'anxiété, les aspects physiologiques, neurochimiques, neuropharmacologiques de la schizophrénie et de ses facteurs de risque, les mécanismes de l'addiction. Comme l’a expliqué à la Mission le Pr Alan Koretsky, directeur du NINDS, le NIH vise à accroitre l’apport de la neuroimagerie en psychiatrie.
b- Le rôle moteur des fondations et des centres d'excellence alliant public et privé
L’impact des fondations dans la recherche et le traitement des maladies neuropsychiatriques est considérable en termes d’investissement financier et d’accompagnement des projets. Elles font preuve d’une grande ouverture tant vers les États-Unis que vers l’étranger.
La Fondation Dana Farber
Avec un budget de près de 250 millions de dollars, la Fondation Dana Farber soutient activement la recherche sur les innovations en neuroimagerie. Les financements sont destinés à des études pilotes visant à tester de nouvelles hypothèses en utilisant soit des techniques conventionnelles d'imagerie cérébrale, soit les technologies d'imagerie cellulaire et moléculaire, soit une combinaison des deux. Les données obtenues peuvent ensuite être utilisées comme résultats préliminaires lors de demandes de financement à plus grande échelle. Les études tendent à se concentrer sur la manière dont l'imagerie peut accroître la compréhension du fonctionnement normal du cerveau, améliorer le diagnostic, élargir la compréhension des processus pathologiques ou des lésions, et aider à évaluer les effets des traitements. En outre, les études visant à affiner les techniques d'imagerie existantes, ou à poursuivre le développement de nouvelles techniques pour répondre à des questions cliniques, sont également prises en charge.
Nous avons été reçus par Edward F. Rover, président du conseil d’administration de la Fondation qui a expliqué que chaque année un appel à projets est lancé auprès des différents instituts de recherche et écoles de médecine. Chaque institution est chargée de sélectionner le programme qu'elle souhaite soutenir, et ce programme passe par un processus d'évaluation animé par un comité d'experts dans le domaine. Les projets portés par de jeunes responsables d'équipes sont soutenus en priorité, pour compenser leur difficulté à obtenir le premier financement du NIH qui commande en général l’avenir du projet. La Fondation dédie la plus grande part de ses ressources aux recherches de neuropsychiatrie.
Le "Martinos Center for Biomedical Imaging" de Boston
Le "Martinos Center for Biomedical Imaging" de Boston, visité par les rapporteurs, est un exemple de partenariat public-privé au sein de la faculté de médecine de Harvard. Le Centre Athinoula A. Martinos est un des centres de recherche en imagerie biomédicale les plus réputés des États-Unis. Il développe des projets de recherche innovants basés sur des techniques d'imagerie biomédicale très sophistiquées ; il fut un des bénéficiaires du plan de relance du Président Obama en 2009 avec une contribution représentant 18% de son budget, 57% provenant du NIH, 12% de fondations privées et 1% de partenaires privés. Le laboratoire de fabrication de prototypes d'antennes qui permet d'optimiser l'acquisition des images IRM et leurs résolutions (antennes cérébrales et cardiaques), met au point des prototypes qui sont ensuite développés par Siemens, avec lequel un partenariat pour les commercialiser est établi. Des post-doctorants français y font des recherches dans de bonnes conditions, selon eux.
Le centre regroupe un ensemble de plateformes techniques de niveau exceptionnel : imagerie de diffusion optique (IDO), IRM, EEG, magnétoencéphalographie (MEG), TEP, et stimulation magnétique transcranienne. Ce centre possède son propre cyclotron pour la production d'isotopes.
Le "Brain Mapping Center", le "Brain Research Institute" et le "Laboratory of Neuro Imaging" à Los Angeles.
À l’Université de Californie (UCLA), sont regroupés sur un même site un centre d'imagerie performant le "Brain Mapping Center", le "Brain Research Institute", et un centre impressionnant de stockage et d'analyse de données le "Laboratory of Neuro Imaging" (LONI) que nous avons visités. Les thématiques étudiées concernent le développement du cerveau, sa plasticité et ses capacités de récupération suite à un accident vasculaire cérébral, les étapes d’apparition de la chorée d’Huntington. Les origines génétiques et/ou épigénétiques de la maladie de Parkinson font l’objet d’un programme de recherche impressionnant mené sous la direction du professeur Marie-Françoise Chesselet dans le centre de recherche dédié à cette pathologie.
Le stockage centralisé des données permet d'améliorer la sécurité des informations, de favoriser les collaborations scientifiques et d'utiliser les outils d'analyse informatique disponibles dans le centre. Les plateformes techniques des centres d'imagerie de UCLA comportent des équipements d'une performance de 3 à 7 Teslas, avec un système combiné TEP- IRM. Le LONI héberge non seulement les données issues du centre d'imagerie local mais également des données provenant du monde entier. Les scientifiques référents contrôlent les autorisations d'accès, et un protocole strict de l'anonymat des personnes a été mis en place. D’après Roger Woods, directeur du "Brain Mapping Center", la majorité des utilisateurs du "Brain Mapping Center" et du LONI sont des chercheurs académiques financés par le NIH. Étant donné la durée limitée de ce type de financement, le problème de l'archivage et du maintien de la confidentialité des données dans le temps se pose, d’autant que les chercheurs multiplient les systèmes d’archivage parallèles, semble-t-il.
La France dispose d’atouts importants en neurosciences et en neuroimagerie, disciplines dans lesquelles les scientifiques français furent pionniers ; les infrastructures de haut niveau ont presque toutes moins de cinq ans, les équipes y sont motivées. Dans ce domaine, la recherche française jouit d’une place importante et d’une grande visibilité au sein d’une recherche très internationale, vos rapporteurs ont pu le constater lors de leurs missions à l’étranger.
Le regroupement d’instituts au sein de l’Alliance pour les sciences de la vie et de la santé (AVIESAN) et l’apport financier des investissements d’avenir devraient accroître ce potentiel, à condition de favoriser l’interdisciplinarité.
1- Le rôle de l’Institut thématique multi organisme (ITMO) sciences cognitives, neurologie, psychiatrie
Selon Bernard Bioulac34, l’AVIESAN a pour double rôle de rapprocher les différents opérateurs, qu’ils soient des établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST), des universités, des centres hospitalo-universitaires (CHU), des instances comme l’Institut Pasteur, l’Institut de recherche sur le développement (IRD), et « d’essayer de coordonner ce qui a été souvent une certaine faiblesse dans la recherche française, c'est-à-dire les objectifs en matière de recherche scientifique et de recherche translationnelle. » L’AVIESAN vise surtout à assurer la cohérence des grands projets en matière de thématiques et d’infrastructures en promouvant la transdisciplinarité. Elle favorise la coopération européenne et internationale.
L’Alliance a regroupé dix instituts thématiques recouvrant les grands champs disciplinaires de la recherche, et les neurosciences représentent l’un de ces instituts thématiques : sciences cognitives, neurologie, psychiatrie. Les missions des instituts multi-organismes (ITMO) déclinent au niveau opérationnel les missions de l’AVIESAN : faire émerger une vision stratégique nationale; coordonner l’action des opérateurs; valoriser la recherche, et organiser la transdisciplinarité et la transversalité. Le périmètre de chaque institut couvre à la fois la recherche fondamentale et la recherche clinique.
Cependant, la recherche dans le domaine des sciences de la vie et de la santé, très fortement implantée en Ile-de-France, regroupe presque 50% des forces de recherche (EPST, universités et CHU). Il existe un certain nombre de sites plus ou moins importants, car la dispersion n’est pas facile à gérer en termes budgétaires. Les centres d’investigation cliniques (CIC) associent chaque fois l’INSERM et un CHU, où est pratiquée la recherche clinique. Leur répartition est assez cohérente dans le domaine des neurosciences, et plus particulièrement des mouvements anormaux et de la psychiatrie. Les neurosciences occupent entre 20 et 22% des domaines de recherche.
D’après Bernard Bioulac, l’ITMO sciences cognitives, neurologie, psychiatrie essaie d’animer, et de coordonner les efforts et « de servir de bras de levier » avec l’exécutif de l’AVIESAN et des instances comme l’Agence nationale de la recherche (ANR), pour faire inscrire des programmes de recherche. Grâce à cette action, cette année, une ligne de crédit directement liée à la recherche sur les maladies mentales a été obtenue, à l’ANR.
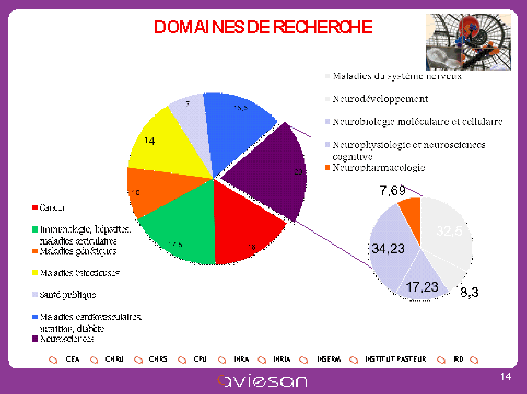
Source : AVIESAN
2- La création de grands pôles de recherche en France
La France se dote progressivement de grands pôles de recherche fondamentales et translationnelles dont les équipements sont tous très récents. Vos rapporteurs en ont visité plusieurs et en ont apprécié le dynamisme, l’ouverture à l’international et la créativité. La plupart sont reconnus à l’étranger.
NeuroSpin est un centre de recherche en neuroimagerie très récent; il fait partie de la direction des sciences du vivant du CEA, et fonctionne depuis le 1er janvier 2007. NeuroSpin repose sur une plateforme d’imagerie importante, ouverte à ses équipes et aux équipes externes, nationales ou internationales, académiques ou industrielles. Elle est dirigée par Denis Le Bihan, membre de l’Académie des Sciences et membre de l’Académie des Technologies, que la mission a rencontré lors de sa visite dans ce centre.
La recherche à NeuroSpin est organisée en six programmes scientifiques visant à repousser les limites de l’imagerie par résonance magnétique à très haut champ magnétique. Il s’agit d’étudier l’architecture fonctionnelle du cerveau à différentes échelles, de comprendre et de mettre en relation la variabilité phénotypique et génétique de l’architecture et du fonctionnement du cerveau, de faire progresser les connaissances sur le développement du cerveau et sa plasticité, d’élucider les codes cognitifs (langage, calcul, conscience), et de développer une recherche translationnelle pour faire progresser les connaissances et les méthodes diagnostiques sur certaines affections psychiatriques et neurologiques.
NeuroSpin s’appuie sur cinq laboratoires qui combinent une activité de recherche et développement et une activité de support de la recherche au sein de la plateforme : le laboratoire de recherche en résonnance magnétique nucléaire, le laboratoire de neuroanatomie, le laboratoire d’imagerie cognitive, le laboratoire de recherche biomédicale, le laboratoire de biologie intégrée.
La plateforme de recherche de NeuroSpin comporte une aile clinique pour l’accueil de volontaires sains et de patients, enfants, adultes ou seniors avec 8 lits d’hospitalisation de jour, des salles de tests et d’examens cliniques, une infirmerie, une IRM factice pour préparer les volontaires aux examens d’IRM, et une unité de soins intensifs pour les explorations de la conscience. La plateforme comporte une aile dédiée aux études précliniques.
L’objectif est de réunir en un même lieu les méthodologistes de l’imagerie et du traitement de signal, et les neurobiologistes pour développer en synergie les outils et les modèles permettant de comprendre le fonctionnement du cerveau normal et pathologique. Le couplage entre la méthodologie et la recherche fondamentale ou appliquée laisse espérer des retombées dans le domaine de l’intelligence artificielle, en sciences sociales, dans la prise en charge des patients et en matière industrielle.
Le regroupement d’équipes sur une plateforme d’imagerie de pointe dédiée à l’imagerie chez l’homme et à l’imagerie chez l’animal permet une recherche translationnelle.
Bénéficiant de l’expertise du CEA dans le domaine des aimants supraconducteurs, NeuroSpin s’est équipé et s’équipera dès 2012 de systèmes d’imagerie par résonance magnétique à très haut champ encore non disponibles ailleurs dans le monde. Le centre sera le seul à disposer d’un IRM à 11,7 Teslas. dans le cadre du projet franco-allemand Iseult de construction d’un imageur par résonance magnétique IRM de 11,75 T, avec une ouverture de 90 cm de diamètre permettant le passage du corps entier d’un patient, et garantissant la meilleure homogénéité du champ magnétique dans la zone ciblée.
Ce programme de recherche ambitieux (200 millions d’euros), effectué en collaboration avec des industriels franco-allemands du secteur (Guerbet, Siemens et Alstom), co-financé du côté français par Oséo et du côté allemand par le ministère de la recherche, devrait permettre de repousser les frontières actuelles de l’imagerie, et notamment de voir en détails les plaques amyloïdes de la maladie d’Alzheimer, car il s’agit d’atteindre une résolution spatiale suffisamment élevée pour descendre à l’échelle de la colonne corticale autour de la centaine de micromètres. NeuroSpin dispose pour le petit animal du premier prototype au monde à 17 Teslas pour établir les modèles de la structure et du fonctionnement du cerveau et des modèles de pathologies cérébrales. Selon Cyril Poupon36, quand une souris transgénique a des plaques amyloïdes, on commence à les deviner à 7 Teslas, tandis qu’à 17 Teslas, la résolution est bien meilleure.
L’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM)37
L’Institut du cerveau et de la moelle épinière a été inauguré en 2010 ; les rapporteurs ont eu l’occasion de suivre l’évolution de l’installation des laboratoires. Cet institut de recherche, dont le bâtiment a été conçu par l’architecte Jean-Michel Wilmotte, dispose de 22 000 m2 de laboratoires et de services techniques. Equipé de quatre IRM dont 2 à 3 Teslas, un à 7 T, un à 11,7 T pour le petit animal, doté d’un centre de ressources biologiques, de plateformes techniques performantes et d’un centre d’investigation clinique, l’ICM est un projet ambitieux de 68 millions d’euros d’investissements. 600 chercheurs français et internationaux, ingénieurs et techniciens, travailleront en permanence sur le site.
L’ICM est une fondation privée reconnue d’utilité publique (décret du 13 septembre 2006), implantée sur un domaine public, le Centre hospitalo-universitaire de la Pitié-Salpêtrière. Soutenu financièrement par des partenaires institutionnels, l’ICM bénéficie également de fonds privés, ce qui lui confère des possibilités plus étendue de financement, et une plus grande latitude de fonctionnement. L’objectif de l’ICM est de réparer les lésions du cerveau et de la moelle épinière, sa mission porte sur la recherche par pathologie (la sclérose en plaque, la maladie d’Alzheimer, etc…), et le développement d’une recherche "transversale" sur l’ensemble des lésions dégénératives et traumatiques du cerveau et de la moelle épinière.
L’originalité de l’ICM réside dans son immersion au sein du groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière ce qui permet de regrouper dans un même lieu les malades, les chercheurs et les médecins au bénéfice à la fois de la recherche clinique et de la recherche fondamentale. Ainsi dès leur mise au point, les traitements pour les lésions du système nerveux peuvent être appliqués aux patients dans les meilleurs délais.
La recherche y est décloisonnée, multidisciplinaire, et très ouverte aux chercheurs étrangers et aux échanges. Comme l’a souligné à maintes reprises Yves Agid38, pour constituer et développer ses équipes de recherche, l’ICM a mis en place un Comité scientifique international chargé de repérer et recruter des talents de haut niveau. Cette sélection rigoureuse constitue l’une des principales garanties de son haut niveau scientifique. Les équipes de recherche (une quarantaine) sont indépendantes, mais alliées entre elles par des programmes transversaux de recherche favorisant la mutualisation des compétences.
L’équipe de l’ICM que les rapporteurs ont rencontrée, a constaté que les approches dans les différents domaines de la recherche (biologie moléculaire et cellulaire, neurophysiologie, sciences de la cognition, thérapeutique) étaient menées de façon trop cloisonnée en France, aussi a-t-elle décidé, à juste titre, de promouvoir une recherche multidisciplinaire.
La plateforme biomédicale CLINATEC à Grenoble
Visité par vos rapporteurs39, CLINATEC est un centre de recherche biomédicale pluridisciplinaire multi-projets orienté sur l’élaboration de traitements innovants pour les maladies cérébrales et neurodégénératives. Il s'inscrit dans le prolongement des travaux du professeur Alim-Louis Benabid, neurochirurgien des hôpitaux, ancien chef de service de neurochirurgie au CHU de Grenoble et inventeur de la stimulation cérébrale profonde pour corriger les effets de la maladie de Parkinson, au sein de la direction de la recherche technologique du CEA. Les recherches continuent et sont toujours menées en partenariat avec le CHU Grenoble, l’INSERM et l’Université Joseph Fourier (UJF).
CLINATEC a trois axes de recherche : le développement de dispositifs médicaux pour la neurostimulation et pour l'administration localisée de médicaments, ainsi que le développement de neuroprothèses pour la suppléance fonctionnelle. Concernant l’amélioration de la technique de stimulation cérébrale profonde à haute fréquence, comme l’a expliqué François Berger40, à l’heure actuelle, malgré son efficacité avérée, cette technique doit encore être améliorée. Les équipes de CLINATEC souhaitent développer de nouvelles thérapies et des outils de diagnostic efficaces en diminuant la taille des nanotubes de carbone constituant les électrodes, pour effectuer des thérapies plus ciblées et moins invasives. Le recours aux micro-nanotechnologies pourrait permettre de diminuer fortement la taille, la forme, la configuration des électrodes, leur consommation en énergie, et le dispositif d’alimentation pour améliorer la qualité de vie du patient implanté.
Le développement de neuroprothèses pour la suppléance fonctionnelle des déficits moteurs, auditifs et visuels a pour but de compenser les handicaps des tétraplégiques ou les troubles sensoriels de la vision ou de l’audition. L'administration localisée de médicaments a pour objectif de focaliser les effets de ces substances dans les sites d’action, et de diminuer les effets indésirables liés à une diffusion étendue à l’organisme. CLINATEC complète deux autres plateformes du CEA dédiées aux recherches sur les maladies du cerveau : le centre NeuroSpin de Saclay, la plateforme MirCen (CEA-INSERM) de Fontenay-aux-Roses ; nous avons eu l’occasion de visiter ces deux centres à plusieurs reprises.
Comme l’ont expliqué, lors de la visite à Grenoble, Dominique Grand, adjoint au directeur du CEA Grenoble, et Jean-Louis Amans, responsable des programmes, le concept de CLINATEC est celui d’un hôtel à projets visant à rassembler des cliniciens, des chercheurs en neurosciences et des biologistes ; c’est une incitation à interagir avec des experts en micro-nanotechnologies, pour permettre aux médecins et chirurgiens de mettre en œuvre leurs propres procédures médicales et chirurgicales, tout en participant, par leur compétence de soins, à l’amélioration des équipements techniques nécessaires aux avancées de leurs pratiques.
L’apport du Grenoble Institut des Neurosciences (GIN)
Le Pr. Claude Fuerstein41, a expliqué que le Grenoble Institut de neurosciences (GIN) dont sont parties prenantes, l’INSERM, le CEA, le CHU de Grenoble, et l’Université Joseph Fourier, s’appuie sur un partenariat local avec CLINATEC. C’est dans le cadre du GIN que les chercheurs et les cliniciens mettent en œuvre les modèles animaux expérimentaux des pathologies pour permettre l’expérimentation des prototypes de CLINATEC avant passage chez l’homme. Sur les dix équipes que compte le GIN, trois sont impliquées dans les recherches menées à CLINATEC, notamment celles qui portent sur le mouvement et les prothèses de bras.
Le Gipsa-lab (Laboratoire grenoblois Images, Parole, Cognition Signal)
Le Gipsa-lab est une unité de recherche mixte du CNRS, de l'Université Joseph Fourier et de l'université Stendhal ; elle est conventionnée avec l'Institut national de la recherche en informatique et automatique (INRIA), l’Observatoire de Grenoble et l’Université Pierre Mendès-France. Sa démarche scientifique s'appuie sur des méthodes avancées en automatique, traitement de la parole, signal et images, et intègre des notions de réseau, de contrôle-commande, de modélisation, d'analyse. Gipsa-lab est constitué de 13 équipes organisées en trois départements : Automatique, Images et signal, Parole et cognition. Parmi ses 13 équipes, une équipe-projet est commune avec l’INRIA en Rhône-Alpes, une équipe de recherche est reconnue par l'Observatoire des sciences de l'Univers de Grenoble (SygmaPhy) et 5 équipes sont membres de l'UFR "Neurosciences et RMN Biomédicale".
Fort de 300 personnes dont plus d’une centaine de doctorants, le Gipsa-lab est un laboratoire pluridisciplinaire développant des recherches fondamentales et finalisées sur les signaux et systèmes complexes. Il est reconnu pour ses recherches dans ce domaine. Il effectue des expériences sur l’apprentissage de la parole chez l’enfant, et développe des projets dans les domaines de l’énergie, de l’environnement, de la communication, des systèmes intelligents, de la santé et de l'ingénierie linguistique.
Le Centre de recherche en neurosciences de Lyon42 (CRNL)
Depuis janvier 2011, le Centre de recherche en neurosciences de Lyon (CRNL) rassemble l'expertise multidisciplinaire de 11 équipes, 350 chercheurs issus de laboratoires de l'INSERM, du CNRS et de l'Université Lyon I. Il s’agit de créer de nouvelles synergies dans l'étude du cerveau et des pathologies associées allant de la cellule au comportement, et de la paillasse au patient.
D’après le Dr Olivier Bertrand, directeur du CRNL, il s’agit de relier les différents niveaux de compréhension du cerveau, et de renforcer la recherche translationnelle grâce à des échanges permanents entre les avancées conceptuelles de la recherche fondamentale et les défis cliniques. En 2014, la plupart des équipes du Centre devrait être localisée sur le NeuroCampus, au voisinage immédiat des hôpitaux neurologiques femme mère enfant, et psychiatrique. Sur ce site unique, combinant recherche fondamentale, recherche clinique et plateformes de haute technologie, un bâtiment de 6000 m2 sera dédié au Centre de recherche en neurosciences de Lyon.
Pour l’instant le centre dispose de plates-formes situées à proximité les unes des autres dans le grand campus des Vinatiers. La plate-forme d'exploration du mouvement chez l'Homme est équipée d'un système d'analyse tridimensionnelle du mouvement multiarticulaire (Optotrak), d'un système d'analyse binoculaire « temps réel » (Eyelink2), qui permet de connaître instantanément la direction de chaque œil dans l'espace. La plateforme NeuroChem propose ses compétences à l'intérieur du Centre ou à l'extérieur (organismes de recherche, hôpitaux, industrie pharmaceutique), dans le cadre de prestations ou de collaborations de recherche. Le plateau d’optogénétique met également à disposition des équipes du centre un outil adapté à l'injection en intra-cérébrale de virus vecteurs de transgène, ainsi que des lasers bleus (excitation) et jaunes (inhibition) pour l'optogénétique.
Le pôle 3C à Marseille
Inauguré en 2005, le pôle 3C, du nom de ces trois unités constitutives : Comportement-Cognition-Cerveau, a pour objectif une recherche fondamentale en psychologie cognitive et en neurosciences intégratives. Ces trois unités constitutives offrent un environnement scientifique dont le périmètre correspond en majeure partie à celui de la section 27 (Comportement-Cognition-Cerveau) du CNRS.
L’activité scientifique du pôle est adossée à une recherche fondamentale en psychologie cognitive et en neurosciences intégratives ; elle s’enrichit de l’approche clinique et du recours à des techniques extrêmement diverses, depuis celles de la biologie moléculaire jusqu’à celles impliquées par l’expérimentation humaine et animale en contexte social. Ce regroupement résulte d’un effort de longue durée pour structurer des forces jusqu’alors dispersées en matière de recherches sur le comportement, le cerveau et la cognition. Le pôle a acquis en 2010 le statut de département de recherche ; il intègre près de 180 personnes au total (dont 75 doctorants ou post-doctorants) et s’est doté d’un conseil de gestion dirigé par Pascal Huguet , avec Thierry Hasbroucq pour directeur adjoint. Il est installé à Marseille dans le site Saint-Charles, Université d'Aix-Marseille.
3- Les financements au titre des investissements d’avenir
Selon Bernard Bioulac43, « il est important d’avoir présent à l’esprit la façon dont se sont répartis les programmes liés au Grand emprunt : la répartition des différents éléments qui le constituaient, les concours, les réponses aux appels d’offre : Cohortes, Equipements d’Excellence (Equipex), les Instituts hospitalo-universitaires (IHU), les infrastructures et les Laboratoires d’excellence (Labex), est faite au niveau du territoire national. Il y a un seul IHU en neurosciences, il est parallèle à l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM) de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. En revanche, il existe plusieurs Labex ». Comme le montre la carte ci-après, de nombreux projets recherche en neurosciences, en neuropsychiatrie, et en imagerie bénéficieront de financements importants au titre des investissements d’avenir, lesquels ont encouragé les regroupements de partenaires. Les projets retenus donnent une idée assez précise des voies de recherches en France.
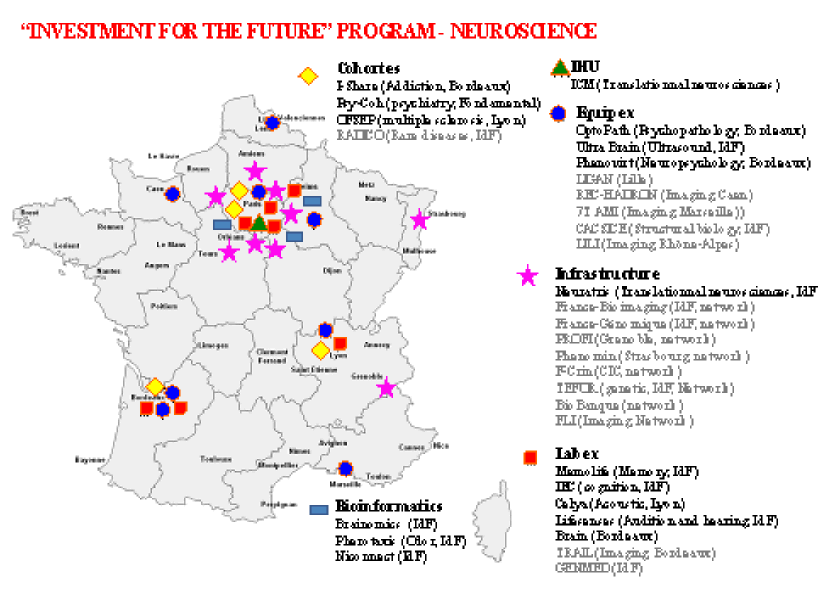
a- Au titre de la constitution de cohortes
Au cours des auditions publiques l’importance de la constitution des cohortes a été soulignée car elles sont indispensables à la recherche sur les maladies neurologiques et psychiatriques. Elles permettent de mesurer sur la durée les facteurs de risque, et l’évolution de la santé.
Le projet i Share, réunissant l’Université de Bordeaux, l’INSERM, l’Université de Versailles Saint-Quentin, est financé à hauteur de 8 911 664 euros. Cette cohorte est destinée à explorer les facteurs de risque des maladies dans une population d’adultes jeunes (30 000 étudiants suivis sur au moins 10 ans), tranche d’âge pour laquelle peu d’informations sont disponibles.
Le projet Psy-COH porté par la Fondation FondaMental est financé à hauteur de 1 955 053 euros. Le but est de suivre sur 10 ans une cohorte de 2000 patients jeunes, atteints de trois maladies psychiatriques majeures : schizophrénie, psychose maniacodépressive (ou trouble bipolaire), syndrome d’Asperger.
Le projet Ofsep, réunissant l’Université Claude Bernard Lyon 1, les Hospices civils de Lyon et l’INSERM, est financé à hauteur de 10 341 968 euros. Ce projet vise à consolider et développer la cohorte française de patients porteurs de sclérose en plaque (SEP).
Le projet Radico, porté par l’INSERM, financé à hauteur de 10 072 118 euros, fédère des cohortes de patients atteints de maladies rares dont les activités seront centralisées à l'hôpital Trousseau. Cette cohorte permettra la sélection de données pour les études épidémiologiques, et ainsi d'assurer l’émergence de programmes de recherche.
b- Les équipements d’excellence (EQUIPEX), premier appel à projet
L’objectif est de financer l’achat d’équipements dans des domaines de recherche s’inscrivant dans les priorités nationales définies par la stratégie nationale de recherche et d’innovation. Chaque institut hospitalo-universitaire associe autour d'une spécialité, une université, un établissement de santé et des établissements de recherche.
Le projet OptoPath qui réunit le Neurocentre Magendie, le pôle de recherche et enseignement supérieur (PRES) de l’Université de Bordeaux, Imetronic, l’Institut de recherches IRIS, Fluofarma dispose d’un financement de 6 000 000 euros. Il propose de réaliser une plateforme d’innovations instrumentales et procédurales en psychopathologie expérimentale chez le rongeur pour étudier l’activité du cerveau in vivo, et de comparer différents modèles comportementaux de pathologies psychiques.
Le projet Phenovirt, porté par le PRES de l'Université de Bordeaux/CNRS doté de 2 100 000 euros, a pour but de développer une plateforme neuro psycho pharmacologique permettant d’étudier les troubles de l’attention et les effets de la fatigue chez des sujets normaux ou des patients âgés atteints de troubles cognitifs, dans des conditions virtuelles : simulateurs de vol ou de conduite par exemple, système de supervision de la conduite automobile.
Le projet ultrabrain, porté par la fondation Pierre Gilles de Gennes-Institut Langevin (espci-paristech) et le CNRS, est financé à hauteur de 2 800 000 euros. Le projet vise à l’acquisition d’équipements permettant de générer et d’utiliser des ultrasons pour détruire, par la chaleur, sans ouvrir la boite crânienne, des cibles limitées comme des tumeurs cérébrales ou pour stimuler de façon non-invasive des structures cérébrales.
Le projet rec-hadron, porté par Gip Cyceron, le laboratoire de physique corpusculaire, le laboratoire accueil et recherche avec les ions accélérés, le centre d’imagerie-neurosciences et d’applications aux pathologies, est doté de 1 280 000 euros. Ce projet vise à contribuer au développement d’une installation expérimentale d’hadronthérapie destinée au traitement des cancers.
c- Les équipements d’excellence (EQUIPEX, deuxième appel à projet)
Le projet 7T AMI porté par l’Université de la Méditerranée Aix-Marseille II, le CNRS et Siemens SAS est doté d’un financement de 8 000 000 euros. Il se propose de développer une plateforme d'imagerie par résonance magnétique sur des corps entiers afin de progresser dans l'exploration non-invasive du cerveau, de la moelle, du coeur, du muscle et du cartilage sur l'homme.
Le projet CACSICE (Centre d'analyse de systèmes complexes dans les environnements complexes) porté par de nombreux partenaires, est doté d’un financement de 7 500 000 euros. Il vise à créer une plateforme d'analyse pour la biologie structurale composée d'une série d'équipements (microscopie électronique, cristallographie aux rayons X, résonance magnétique nucléaire à l'état liquide et solide, diffusion des rayons X aux petits angles et la spectrométrie de masse structurale). L'objectif est de pouvoir développer de nouvelles cibles thérapeutiques, à l'aide de ces données et de simulations numériques.
Le projet LILI Lyon Imagerie Intégrée du Vivant, coordonné par l’Université de Lyon, le Centre d’étude et de recherche multimodale et pluridisciplinaire en Imagerie du vivant (GIE CERMEP), le centre de recherche en acquisition et traitement de l'image pour la Santé (CREATIS), le centre de recherche en neurosciences de Lyon, Cardiovasculaire, Métabolisme, Diabétologie et Nutrition (CarMeN), la Fondation Neurodis, les Hospices civils de Lyon, Siemens Healthcare, est doté d’un financement de 4 000 000 euros. Ce projet consiste à développer une plateforme d'imagerie innovante composée d'un système hybride de tomographie et d'imagerie par résonance magnétique pour l’exploration structurelle et fonctionnelle du vivant de manière simultanée.
d- Les Instituts hospitalo-universitaires (IHU)
Institut de Neurosciences Translationnelles de Paris
Le projet A-ICM, porté par l’Université Pierre et Marie Curie, l’INSERM, le CHU de la Pitié-Salpêtrière, financé à hauteur de 55 000 000 euros, rassemble une masse critique de compétences de recherche, de formation et de soin dans le domaine des maladies du système nerveux, pour comprendre leur mécanisme et développer des outils de diagnostic, de prévention et de traitement (maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, sclérose en plaque, crises d'épilepsie). Ce projet s'appuie sur la construction d'une infrastructure de recherche translationnelle pour transformer les résultats des recherches en nouveaux procédés et outils thérapeutiques. Largement ouvert aux partenariats industriels, il permettra d'accroître la visibilité de la France sur le plan international dans les neurosciences.
e- Les infrastructures nationales en biologie et santé
Le projet NeurATRIS est coordonné par le CEA. Il est financé à hauteur de 28 000 000 euros, et vise à renforcer l'infrastructure de recherche translationnelle de l'IHU A-ICM dans le domaine des biothérapies en neurosciences. NeurATRIS est composé de différents sites apportant des compétences en neuroimagerie, en pharmacologie préclinique, en biothérapie. La plateforme permettra de renforcer la recherche fondamentale en neurosciences avec une meilleure compréhension des mécanismes du système nerveux, pour alimenter les futurs développements cliniques fondés sur les biothérapies.
Le projet Tefor est coordonné par le CNRS ; il est financé à hauteur de 12 500 000 euros. Il propose de développer une plateforme innovante pour deux modèles animaux alternatifs, le poisson-zèbre et la drosophile, pour étudier le transfert de gènes ou la mutation de gènes, avec des avancées espérées dans le traitement de la maladie d’Alzheimer et de la maladie de Huntington.
Le projet France-BioImaging, coordonné par le CNRS, est financé à hauteur de 26 000 000 euros. Il vise à appliquer à la biologie cellulaire et à l’étude du développement des organismes biologiques, les nouveaux moyens d’imagerie, notamment des techniques optiques permettent d’interagir avec le vivant comme l’optogénétique qui permet de modifier expérimentalement le génome en utilisant un rayon lumineux.
Le projet France-Génomique, coordonné par le CEA (avec le CNRS, l'INRA, l'INSERM), financé à hauteur de 60 000 000 euros, vise à intégrer à l’échelon national les capacités d’analyse du génome et de traitement bioinformatique des données à haut débit ainsi générées.
Le projet ProFI est coordonné par le CNRS. Il est financé à hauteur de 15 000 000 euros, et réunit en une infrastructure nationale, les trois groupes leaders français en protéomique (analyse de l’ensemble des protéines d’un système vivant). Il a deux objectifs : atteindre rapidement le niveau des meilleurs groupes internationaux dans ce domaine et mettre ses compétences au service de la communauté scientifique française.
Le projet Phenomin coordonné par le CNRS, est financé à hauteur de 27 000 000 euros. Il vise à développer une infrastructure permettant de produire, d’analyser et de conserver des modèles murins pour créer des modèles animaux permettant de tester de nouvelles thérapies, développer des nouvelles techniques de transferts de gènes.
Le projet F-CRIN est coordonné par l’INSERM, et financé à hauteur de 18 000 000 euros. Il représente la composante nationale de l’infrastructure européenne ECRIN, destinée à renforcer la compétitivité de la recherche clinique française dans l’initiation et la conduite de grands essais cliniques multinationaux.
Le projet Biobanques, coordonné par l’INSERM, est financé à hauteur de 17 000 000 euros. Il vise à intégrer à l’échelon national les capacités de recueil et de stockage des échantillons biologiques d’origine humaine et les collections microbiennes, à assurer la qualité des collections et des annotations cliniques associées, et à faciliter l’accès à ces collections pour les projets de recherche.
Le projet FLI France Life Imaging, coordonné par le CEA, est financé à hauteur de 37 590 000 euros. C’est une infrastructure nationale qui regroupe six grandes plateformes d'imagerie pour la recherche en imagerie préclinique et clinique, incluant l'archivage et le traitement des images. La disponibilité des données provenant de techniques différentes permettra de progresser dans le domaine du diagnostic. FLI constitue la composante française, avec France Bio Imaging, dans l'infrastructure européenne ESFRI Euro Bio Imaging.
Le projet Institut d'étude de la cognition porté par l'école normale supérieure vise à étudier les fonctions mentales supérieures (perception, mémoire, raisonnement, langage, etc). Il articule les sciences humaines et sociales, les données de la psychologie expérimentale et de l'imagerie cérébrale, pour contribuer au développement en France de secteurs aujourd'hui émergents, comme la neuro-décision et l'analyse empirique de la décision et du comportement stratégique, grâce à l'étude des neurosciences cognitives, ou encore de la linguistique et de la philosophie. On espère une meilleure compréhension des mécanismes cognitifs individuels et sociaux, et des progrès prévisibles dans les pathologies du langage et de l'audition.
f- Les laboratoires d’excellence LABEX
Le soutien aux laboratoires d’excellence est apporté d’une part sous la forme d’une dotation consommable, d’autre part sous la forme de montants versés annuellement, sur la base des revenus d’une dotation non consommable. Ces financements sont planifiés pour la durée de la convention État/ANR comprenant une évaluation intermédiaire. Ces financements peuvent être reconduits à l’issue de cette période, après une évaluation qui confirme la dynamique du laboratoire.
Le projet MemoLife - Les Mémoires du vivant, porté par l’École normale supérieure (ENS), permet de constituer le premier laboratoire français destiné à traiter tous les aspects liés à la notion de mémoire dans les systèmes vivants, depuis la molécule jusqu'aux structures complexes, telles que le cerveau. Trois organismes joignent leurs compétences: l'Institut de biologie de l'ENS, le Centre interdisciplinaire de recherche en biologie (CIRB) du Collège de France et le Laboratoire de neurobiologie de l'École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris (EPSCI).
Le projet CELyA Centre Lyonnais d'Acoustique, porté par l’Université de Lyon, se propose de réunir des spécialistes de l'ensemble des domaines de l'acoustique, pour des applications médicales, dans le handicap auditif.
Le projet LIFESENSES - des sens pour toute la vie, porté par la Fondation de coopération scientifique « Voir et Entendre », vise à aborder tous les aspects de recherche fondamentale et appliquée concernant les déficits visuels et auditifs, et à permettre une amélioration du traitement et de la prévention des déficits auditifs et visuels.
Le projet BRAIN - Bordeaux-Région Aquitaine - Initiative pour les neurosciences, porté par le pôle de recherche et d'enseignement supérieur (PRES)/ Université de Bordeaux, fédère cinq instituts en neurosciences à Bordeaux ; il est pluridisciplinaire et repose sur des développements technologiques en biotechnologie et nano-biotechnologie appliquées au fonctionnement du système nerveux et à la compréhension de maladies neurodégénératives et des troubles psychiatriques.
Le projet TRAI Laboratoire pour la recherche translationnelle et l'imagerie avancée, porté par le PRES/l’Université de Bordeaux, a pour objectif de faciliter la recherche inter et multidisciplinaire en imagerie, en proposant des innovations diagnostiques et de nouvelles stratégies pour évaluer les traitements, développer la thérapeutique guidée par l'image et la délivrance de médicaments. Il propose aussi d'évaluer les impacts de ces recherches sur la prise en charge des patients, la santé publique, et les aspects socioéconomiques.
Le projet GENMED Génomique médicale, porté par la Fondation Jean Dausset (Paris), vise à la mise à niveau d'une plateforme de génomique pour développer de nouvelles technologies et méthodologies pour la génomique à grande échelle, et à les appliquer à l'étude génomique des pathologies humaines.
g- Bioinformatique
Le projet brainomics, porté par le CEA, financé à hauteur de 860 000 euros, vise à progresser dans la connaissance de la structure et du fonctionnement du cerveau humain par l'intégration de données de génétique, de génomique et de neuroimagerie. Le projet propose une plateforme très originale comprenant des partenaires académiques, des industriels du domaine du logiciel, et des cliniciens pour évaluer les avancées du projet. Il s'agit de se positionner dans les futurs grands projets européens dans le domaine comme le projet Human Brain.
Le projet pherotaxis, porté par l’INRA, est financé à hauteur de 740 000 euros. Il propose d'explorer l'émission d'odeurs et la localisation des sources d'odeurs afin de les modéliser et de créer des robots (nez artificiel) via une étude concernant la communication par les phéromones chez les papillons.
Le projet NiConnect, porté par l’INRIA, est financé à hauteur de 753 543 euros. Il propose de développer de nouvelles techniques de traitement d'images et de données en s'intéressant plus particulièrement à l'intégrité des réseaux cérébraux. L'un des partenaires est une infrastructure nationale dédiée à la prise en compte des données de neuroimagerie au sein du Plan Alzheimer.
4- Le rôle de l’Agence nationale de la recherche (ANR)
Par ailleurs, l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), en partenariat avec la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), a lancé la première édition du programme Santé Mentale et Addictions (SAMENTA). Le montant est de 200 000 euros. L’appel à projet a pour objectifs de stimuler les recherches en psychiatrie et/ou dans le domaine des addictions, ainsi que les recherches multidisciplinaires (sciences humaines et sociales, sciences cognitives, neurosciences) en psychiatrie et en addictologie, en favorisant les partenariats. Les experts ont noté que c’était le premier programme lancé par l’ANR en psychiatrie.
Par ailleurs, l’ANR a lancé un cinquième appel à projet transnational dans le domaine des neurosciences en 2012 dans le cadre de l'ERA-NET NEURON "Nouvelles méthodes et approches pour l’étude des maladies du système nerveux central". L’appel à projets associe treize pays : l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique (Flandres), le Canada (Québec), l'Espagne, la Finlande, la France, Israël, l'Italie, le Luxembourg, la Pologne, le Portugal, la Roumanie. Sont fortement encouragés les projets pluridisciplinaires avec des approches intégrées, ainsi que les projets de recherche translationnelle associant de la recherche fondamentale et de la recherche clinique. Le financement sera attribué pour une durée de trois ans maximum.
Un autre appel à projet concerne la maladie d’Alzheimer il s’inscrit dans le cadre des projets précédents. Par ailleurs, l’appel à projet sur les déterminants sociaux de la santé pourrait avoir un impact sur les maladies du cerveau.
5- Les interrogations des chercheurs en France
Les experts entendus par la mission ne nient pas les efforts faits en France, pour autant ils formulent trois séries de critiques.
a- La pérennité des financements
Comme l’a souligné Hervé Chneiweiss,44 « il est impossible dans le cadre de simples contrats ANR, de 2 ou 4 ans, d’assurer la pérennité de plates-formes, ou de ressources ou de cohortes. Il faut réfléchir au financement de longue durée de ces ressources »…. « Rappelons qu’on compte 500 équipes en France de niveau international classées A ou A+ par l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES), et que l’Agence nationale de la recherche (ANR) attribue 23 lignes de crédits chaque année en neurosciences pour une valeur moyenne de 400 k€ sur trois ans. Il y a donc un problème ».
Ce point a été également relevé par les scientifiques rencontrés dans les centres dotés de grands appareils, qui nous en ont fait part.
Il apparaît clairement que la recherche en neurosciences est mondiale et implique des collaborations internationales. Elle ne peut être ni lisible, ni efficace sans un financement pérenne associant institutions publiques et entités privées.
b- La lisibilité et la réactivité du système de financement
Philippe Vernier45 a observé que « la recherche sur le cerveau est aujourd’hui principalement internationale et c’est une dimension que notre pays ne prend pas assez en compte. Les chercheurs travaillent en réseau avec leurs collègues étrangers, et beaucoup de projets sont en réalité transnationaux. Notre recherche est connue et reconnue, mais notre pays n’est pas assez attractif ».
En général, la plupart des experts français rencontrés relèvent que le système en France n’est pas en mesure de faire des offres concrètes (packages) combinant d’un côté, conditions de salaires, et de l’autre, conditions et moyens de recherches, comme en proposent les pays anglo-saxons. C’est l’une des raisons pour lesquelles les chercheurs français sont attirés par l’étranger, qui offre souvent de meilleures conditions d’exercice, des salaires plus élevés, surtout pour les chercheurs confirmés. Nous avons eu l’occasion de le vérifier dans toutes nos missions à l’étranger.
Dans les grands centres de recherche visités en Allemagne, en Suisse comme au Japon et aux États-Unis, les équipes étaient multinationales avec une mobilité assez marquée des chercheurs, et une présence notable de chercheurs français.
Vos rapporteurs ont ainsi rencontré de nombreux post-doctorants, chercheurs, voire directeurs d’institutions, qui, ont tenté, en vain semble-t-il, de revenir en France. Les organismes français ne semblent pas assez réactifs.
Le retour en France de post-doctorants ou de chercheurs confirmés n’est pas évident, d’autant que l’organisation de la recherche en France est, d’après les chercheurs, incompréhensible hors de nos frontières : sa complexité la rend illisible et son financement est trop fragmenté. Pour attirer de jeunes chercheurs, il faut rassembler des fonds en provenance de sources très diverses.
Cela n’est pas simple, car en France, dans le domaine des pathologies du cerveau, la séparation reste encore forte entre la psychiatrie et la neurologie, ce qui peut être très paralysant. Les débats récents sur le traitement de l’autisme l’ont démontré. L’interdisciplinarité que chacun appelle de ses vœux semble se heurter à une forte incompréhension au détriment des patients, mais aussi de la lisibilité du système vu de l’étranger.
Recommandations :
- Simplifier les systèmes de financement pour attirer les meilleurs chercheurs étrangers ;
- Encourager le retour des post-doctorants en France par des offres concrètes incluant des précisions sur les conditions et moyens de recherches offerts et un salaire en rapport avec leur qualification ;
- Accroître la lisibilité de l’organisation de la recherche en France ;
- Encourager les projets de recherches pluridisciplinaires incluant clairement des chercheurs en neurosciences, en psychiatrie et en sciences humaines et sociales ;
- Assurer des financements récurrents pour la maintenance des grands appareils, et pour les projets à long terme exigeant la mise en place de cohortes.
c- Les contraintes de la législation européenne et l’importance des modèles animaux
La recherche en neurosciences se fait chez l’animal. Les animaleries bien organisées, régulées pour comprendre les mécanismes fondamentaux de fonctionnement du cerveau sont indispensables. On dispose aujourd’hui de modèles animaux (souris, poisson zèbre, mouche drosophile) qui permettent d’appréhender cette complexité dans ses dimensions spatiales (du nanomètre au centimètre) et temporelle (de la milliseconde à l’année). Pouvoir analyser simultanément, et en temps réel, l’effet de molécules sur des organismes vivants est essentiel pour en comprendre les effets chez l’homme.
L’effet de certaines molécules à visée thérapeutique doit être testé d’abord chez l’animal. La législation européenne recommande de se passer des animaux lorsque c’est possible, c’est-à-dire tant qu’on peut obtenir les mêmes résultats in vitro, mais l’organisme, par ses propriétés émergentes, n’est pas réductible à des molécules ou à des cellules.
Selon Philippe Vernier46 et d’autres experts, la question des modèles animaux est essentielle parce que les méthodes de la biologie évoluent. Il n’y a que chez l’animal que l’on peut mener l’intégralité des investigations permettant de passer de l’échelle cellulaire à l’échelle des comportements globaux, voire de l’animal entier, ce qui est nécessaire à la compréhension des phénomènes biologiques. La modélisation des phénomènes chez l’animal permet aussi de les corréler aux images obtenues chez l’homme par IRM fonctionnelle.
Selon eux, les problèmes éthiques sont relativement peu importants lorsqu’on travaille sur des poissons ou des souris, ce qui est fort différent lorsqu’on utilise des primates non humains, qui sont pourtant des intermédiaires essentiels pour pouvoir passer des modèles d’animaux « simples » comme la souris, à l’homme. La recherche sur les primates non humains est absolument indispensable.
« Aujourd'hui, il est essentiel que nos politiques se rendent comptent de cela et que ces types de recherche puissent être défendus et maintenus » a plaidé Philipe Vernier. Bernard Bioulac47 a ajouté : « La recherche en primatologie expérimentale doit être particulièrement sauvegardée par la représentation nationale et par l’exécutif, parce que l’on est en grande difficulté en Europe. Jusque-là, la France était un peu protégée, mais véritablement on sent que cela deviendra très difficile. Aujourd'hui, des chercheurs français vont faire des expériences en Chine. Il faut y prendre garde. L’approche en primatologie expérimentale est irremplaçable, que ce soit sur les fonctions cognitives au plan strictement fondamental, mais aussi pour toute la modélisation animale.»
En effet, comme l’ont constaté vos rapporteurs, une partie de l’attrait des centres de recherche au Japon en neurosciences et neuroimagerie est liée à des possibilités de créer des modèles animaux et des animaux transgéniques, y compris des primates non humains, sans de fortes contraintes. Selon la directive européenne 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, l'utilisation des animaux à ces fins devra être aussi limitée que possible et la souffrance des cobayes évitée. La directive européenne sur l'expérimentation animale s'articule autour de la célèbre règle des 3R qui n'avait jamais été transcrite dans le droit européen : Remplacement des animaux quand cela est possible, Réduction de leur nombre dans chaque procédure et «Raffinement», c'est-à-dire limitation, tant que faire se peut, des dommages causés à l'animal. L'objectif n'est pas de réduire de manière drastique le nombre d'expériences, mais de rationaliser le recours à l'expérimentation en reconnaissant la souffrance animale et la «valeur intrinsèque» des cobayes. L'expérimentation animale reste nécessaire aujourd'hui, car les méthodes de remplacement sont encore trop peu nombreuses, notamment en toxicologie, en pharmacologie ou en recherche fondamentale.
Sur le plan pratique, c'est la mise en place obligatoire de comités d'éthique qui doit permettre de mieux contrôler les traitements infligés aux animaux. Ces comités auront notamment la charge d'autoriser, ou non, les projets avant leur mise en œuvre et de vérifier que la classification de l'expérience en douleur «nulle à légère», «modérée» ou «sévère», est justifiée. En France, ces comités existent déjà dans la plupart des organismes de recherche.
Grâce à la règlementation de 1986, le nombre d'animaux cobayes a été divisé par deux entre 1980 et 2000, avant de se stabiliser. Selon les derniers chiffres publiés par le ministère de la recherche, 2,3 millions de vertébrés, dont 1,5 millions de souris, 400.000 rats et 2500 macaques, ont fait l'objet d'une expérimentation animale en France en 2004.
Cependant, d’après les chercheurs du domaine des neurosciences et de neuroimagerie, lors de la transposition de la directive, qui doit intervenir avant le 1er janvier 2013, et qui globalement ne devrait pas poser trop de problèmes, on n’évitera pas le débat sur les primates non humains qui participent à des expériences dans les laboratoires. L'interdiction complète de l'utilisation de singes humanoïdes n'est pas en cause ; en revanche, le texte recommande pour les autres primates de n'utiliser que des spécimens captifs depuis au moins deux générations.
Vos rapporteurs comprennent l’importance des modèles animaux, voire de celui des primates non humains pour la recherche sur les maladies neurodégénératives, et ils ont constaté avec quel soin et souci éthique, ils étaient traités dans les centres qu’ils ont visités.
Recommandation :
Veiller à ce que la transposition de la directive européenne, 2010/63/UE du 22 septembre 2010, relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, concilie la protection des primates non humains et les nécessités de la recherche.
.
CHAPITRE II :
LES PROGRÈS DE LA NEUROIMAGERIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES NEUROSCIENCES
Il ne se passe pas une semaine sans une information plus ou moins bien étayée ou relayée sur telle ou telle nouvelle possibilité, découverte, voire thérapie concernant le cerveau et la neuroimagerie. Un public fasciné en est avide, pour autant les chercheurs demeurent réservés quant aux applications et se gardent de pronostics à court terme sur le traitement des maladies neuropsychiatriques, même s’ils admettent des progrès sensibles dans la connaissance des mécanismes et des causes de certaines d’entre elles.
Pendant longtemps, les seules méthodes d’exploration du cerveau «vivant» étaient basées sur l’électroencéphalographie (EEG), les rayons X et les premiers scanners. Le premier bouleversement, est la découverte du scanner dans les années soixante-dix par Sir Godfrey Hounsfield, prix Nobel 1979. Didier Dormont48 rappelle que « les premiers appareils mettaient plusieurs minutes pour faire une coupe et ne permettaient d’explorer que le cerveau. Aujourd'hui, les scanners de dernière génération permettent d’explorer le corps entier, depuis l’extrémité des orteils jusqu'à la partie supérieure du crâne en quelques secondes ». À la fin des années soixante-dix, la neuropsychiatrie tentait d’établir des corrélations entre les symptômes observés chez des patients atteints de maladie mentale sévère et la dissection post-mortem de leur cerveau. Ce n’est qu’au début des années quatre-vingts, qu’un certain nombre de centres de recherche ont commencé à utiliser la tomographie par émission de positrons (TEP ou PET en anglais) afin de mesurer l’activité du cerveau grâce à des traceurs radioactifs de plus en plus spécifiques.
À la fin des années quatre-vingts, le développement d’outils informatiques et mathématiques sophistiqués a permis la reconstruction d’images à partir de l’enregistrement des signaux électriques, magnétiques ou radioactifs détectés par les équipements. Le début des années quatre-vingt dix a ainsi vu le développement de la cartographie cérébrale utilisant l’imagerie par résonance magnétique (IRM) suivie de l’IRM fonctionnelle (IRMf) qui permet d’étudier une activité dans sa durée réelle. « Il faut se souvenir que pour obtenir une image, cela prenait trente minutes » ajoute Didier Dormont.
Ainsi en moins d’une quarantaine d’années, des avancées extraordinaires réalisées grâce au développement des techniques d’imagerie cérébrale couplées à la psychologie cognitive et expérimentale, et aux neurosciences, permettent d'observer la structure et l’activité du cerveau « vivant », et ainsi de visualiser les zones cérébrales sollicitées par différents processus cognitifs, décisionnels ou pathologiques.
Les progrès technologiques les plus récents consistent dans la mise au point de techniques permettant d’augmenter la résolution, d’améliorer la fiabilité de l’analyse des données et les conditions de leur stockage. On assiste actuellement à une transition de l'imagerie de la structure vers l'imagerie moléculaire du cerveau qui permet, lorsque les mécanismes moléculaires à l'origine d'une maladie sont identifiés, un diagnostic plus précoce.
Toutefois selon Hervé Chneiweis49 « il n’y a pas une seule méthode à utiliser, mais une combinatoire de différentes méthodes d’exploration du fonctionnement cérébral.». Différentes approches et diverses technologies sont utilisées, elles sont complémentaires et souvent associées. Certaines ne sont pas récentes mais sont utilisées différemment ou ont été grandement améliorées, d’autres sont très récentes et encore au stade de l’expérimentation.
Les scientifiques disposent ainsi d’une palette d’outils et de techniques sophistiqués pour étudier le système nerveux. Certaines techniques, non invasives et non interventionnelles, permettent d'étudier le cerveau d'un point de vue anatomique et fonctionnel, dans sa globalité, d’autres à visée thérapeutique nécessitent d’intervenir de manière invasive sur le tissu nerveux lui-même.
I- L’UTILISATION NOVATRICE DES TECHNIQUES NON INTERVENTIONNELLES
Les données issues de l’analyse de l’activité cérébrale sont précieuses dans l’étude et le diagnostic de diverses pathologies. Une technologie toujours plus efficace permet la numérisation des signaux EEG, mais aussi leur couplage à des enregistrements vidéo, et accroît la finesse des analyses.
A– L’ANALYSE DE L’ACTIVITÉ CÉRÉBRALE
Analyser l’activité cérébrale, c’est pouvoir suivre le comportement du cerveau au cours du temps, avec une grande précision temporelle, et donc être capable de surveiller l’activité neuronale à l’échelle de la milliseconde, voire même à une durée moindre.
1- L’électroencéphalographie (EEG)
L’invention de l’électroencéphalographie est généralement attribuée au physiologiste allemand Hans Berger, qui enregistra le premier signal d’activité cérébrale en 1929. Ses travaux furent repris et complétés par le britannique Edgar Douglas Adrian, qui obtint en 1932 le Prix Nobel de physiologie. C’est une méthode d'exploration qui mesure l'activité électrique du cerveau par des capteurs placés sur le cuir chevelu. Comparable à l'électrocardiogramme qui permet d'étudier le fonctionnement du cœur, l'EEG est un examen indolore et non-invasif qui renseigne sur l'activité neurophysiologique du cerveau et en particulier du cortex cérébral au cours du temps, soit dans un but diagnostique en neurologie, soit dans un but de recherche en neurosciences cognitives.
Le signal électrique à la base de l'EEG est la résultante de la somme des potentiels d'action post-synaptiques synchrones issus d'un grand nombre de neurones. Cette technique offre une excellente résolution temporelle. Le cerveau n’étant jamais inactif, la technique consiste à répéter une même stimulation un grand nombre de fois ; puis à extraire la séquence des évènements électriques entraînés par cette stimulation, c’est ce qu’on appelle le potentiel évoqué.
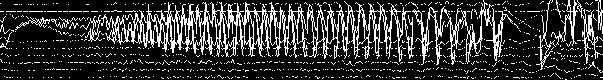
Un tracé d’encéphalogramme
L’EEG étudie à quel moment et sur quel capteur les évènements électriques se produisent. L’analyse mathématique du signal permet d’en reconstruire les sources et ainsi de visualiser les régions d'où sont émis les potentiels évoqués. La résolution temporelle de l’EEG est de l’ordre de la milliseconde; c’est une technique non invasive ne nécessitant pas la coopération du sujet, mais sa résolution spatiale est limitée.
En neurologie, la principale application de l’EEG est l’épilepsie, mais elle est aussi utilisée pour étudier de nombreuses autres pathologies telles que les troubles du sommeil, les déficits sensoriels... Comme l’a montré Vincent Navarro50, l’intérêt de l’électrophysiologie par rapport à l’imagerie, réside dans la possibilité de suivre le comportement du cerveau au cours du temps, avec une grande précision temporelle, et donc d’être capable de suivre l’activité des neurones à une échelle de la milliseconde, voire inférieure à cette durée. « Aujourd'hui l’électroencéphalogramme (EEG) de scalp a bien évolué, grâce non seulement à la technologie, la numérisation des signaux EEG, mais aussi au couplage de ces signaux à des enregistrements vidéo, ce qui permet des analyses beaucoup plus fines ».
La technique de l’EEG est très présente dans les interfaces homme/ machine, et dans les pratiques invasives d’approches intracérébrales, pour le traitement de patients épileptiques qui ne peuvent pas être traités par des médicaments. Il existe près de 500 000 patients en France, dont 30% résistent au traitement. Il est donc nécessaire de disposer de stratégies thérapeutiques différentes, et donc d’aller chercher les zones du cerveau qui sont responsables des crises, et d’essayer d’opérer de manière très ciblée chez ces patients quand tous les traitements échouent. On a donc besoin, pour y arriver, de disposer de tout un panel de technologies nouvelles, qui permettent de définir quelle est la zone à opérer.
L’EEG est également utilisée en neurosciences cognitives pour étudier les corrélations neuronales de l’activité mentale, depuis les processus moteurs jusqu’aux processus complexes de la cognition (attention, mémoire, lecture). Le centre de recherche en neuroscience de Lyon51 a développé ces dernières années une technique basée sur les variations d'énergie spectrale de l'EEG induites par des processus cognitifs simples, comme la perception visuelle, l'oculomotricité, l'attention visuelle spatiale, la lecture, la mémoire verbale de travail et la mémoire sémantique. Vos rapporteurs ont assisté à une expérience de lecture, fort intéressante, utilisant en partie cette technique sans système invasif. Il s’agissait de transcrire un mot par le mouvement des yeux sur des lettres.
2- La magnétoencéphalographie (MEG)
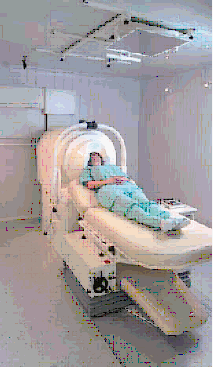
![]()
La magnétoencéphalographie (MEG) permet de suivre l’évolution de l’activité magnétique du cerveau. La MEG mesure les champs magnétiques induits par l'activité cérébrale. Son intérêt réside dans le fait que, contrairement aux champs électriques, les champs magnétiques ne sont quasiment pas déformés par leur passage au travers des tissus organiques (notamment l'interface entre le liquide céphalo-rachidien et le crâne). Tout comme avec l'EEG, il est possible, via une analyse mathématique, de reconstruire les sources du signal électromagnétique. Celle-ci permet alors de reconstituer les régions d'où sont émis les potentiels évoqués. Sa résolution temporelle, qui est de l’ordre de la milliseconde, avec une meilleure résolution spatiale que l’EEG (de l’ordre de 2 à 3 mm), constitue un avantage, mais le temps de traitement des données est considérablement allongé. L’EEG et la MEG mesurent l’activité électrique et magnétique générée par le cerveau avec une résolution temporelle inégalée. Elles donnent donc des informations directes sur l’activité neuronale en cours.
La MEG est plus aisée à utiliser que l’EEG puisqu’elle n’exige pas de coller des électrodes. Les principaux inconvénients de la MEG, par rapport à l’EEG, sont sa faible accessibilité principalement liée à son coût très élevé (achat du système, consommation importante d’hélium liquide). De plus, elle a une plus grande sensibilité aux mouvements de la tête que l’EEG puisque les senseurs ne sont pas attachés sur la tête du sujet.
En neurologie, l’un des avantages de la MEG est de permettre la localisation des sources électriques à l’origine des champs magnétiques, ce qui nécessite d’enregistrer, de pair, données MEG et données structurelles obtenues par IRM. La combinaison de la MEG et de l’IRM s’appelle l’imagerie par source magnétique (ISM, « Magnetic Source Imaging »). L’ISM est de plus en plus utilisée en clinique pour localiser les foyers épileptiques ou les régions cérébrales fonctionnellement importantes en vue d’une intervention chirurgicale.
Elle est également utilisée en recherche (neurosciences, psychiatrie) pour déterminer le temps d’activation des réseaux neuronaux impliqués dans des tâches diverses psychomotrices, car elle est totalement silencieuse et cependant précise. Selon Stanislas Dehaene52, elle joue un rôle essentiel dans la caractérisation de l’activité cérébrale de l’enfant et du nourrisson, notamment dans l’analyse des processus d’apprentissage.
B- LA VISUALISATION DE L’ACTIVITÉ CÉRÉBRALE
1- L’imagerie par résonance magnétique (IRM)
La possibilité de voir le cerveau en fonctionnement a radicalement contribué à l’évolution de l’approche du cerveau tant sur le plan philosophique, qu’au niveau de la recherche scientifique et des approches thérapeutiques.

![]()
La technologie de l’IRM repose sur l’utilisation des propriétés magnétiques des noyaux atomiques. Soumis à une onde électromagnétique de fréquence adaptée, ceux-ci changent d’orientation et émettent un signal électromagnétique lorsqu’ils retrouvent leur position d’origine. L’examen d’IRM consiste à appliquer des champs magnétiques de puissance et d’incidence variables, et à enregistrer le signal émis. Grâce à des outils mathématiques puissants de traitement du signal, des images en 2 ou 3 dimensions, sont recréées. En faisant varier les paramètres d’acquisition des données, il est possible d’améliorer le contraste des images. L’IRM fournit des coupes virtuelles montrant les détails anatomiques avec une précision millimétrique, ce qui permet de repérer les modifications anatomiques du cerveau. C’est une technologie sans danger pour le patient, contrairement aux techniques qui utilisent les rayons X (rayonnement ionisant), elle autorise la répétition d’examens sur un même patient et confère une bonne résolution spatiale bi et tridimensionnelle avec une précision de l’ordre du millimètre, et la possibilité de générer une grande quantité de contrastes pour une même image.
Cependant, c’est une technique proscrite sur les sujets porteurs de dispositifs métalliques (pacemarkers, implants...), et qui nécessite la coopération du patient, lequel doit rester immobile plus d’un quart d’heure minimum, dans un bruit assourdissant. C’est en outre une technique coûteuse exigeant une installation lourde et une haute technicité.
D’après Didier Dormont53, les progrès de l’IRM portent sur la rapidité, la résolution, et la multi-modalité, par le développement de nombreuses applications différentes (la spectroscopie qui donne des informations biochimiques in vivo, l’IRM fonctionnelle, l’IRM de diffusion, l’IRM de perfusion, etc).
En neurosciences, l’IRM est utilisée pour cartographier les différentes zones du cerveau de sujets en bonne santé et de personnes atteintes d’affections neurologiques. En pratique médicale, elle est utilisée pour distinguer les tissus pathologiques des tissus sains, notamment les tumeurs du cerveau.
a) L’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf)
L'Imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) exploite le mécanisme concrétisé par le signal BOLD (Blood Oxygen Level Dependant) : elle détecte l’augmentation locale et transitoire du débit sanguin par aimantation de l’hémoglobine contenue dans les globules rouges. Dans les régions du cerveau où l’activité neuronale est stimulée, l’augmentation de débit sanguin s’accompagne d’une augmentation du taux d’oxygène dans le sang. L’oxygène est porté par l’hémoglobine dans les globules rouges, et l’hémoglobine contient un atome de fer susceptible de s’aimanter ou non en fonction de la présence d’oxygène. Cela se traduit par une modification hémodynamique faible, mais détectable par l’IRM, des propriétés d’aimantation des molécules d’eau autour et dans les vaisseaux sanguins.
Images de l’activité du cerveau (IRMf)
pendant une opération mentale ou en réponse à une stimulation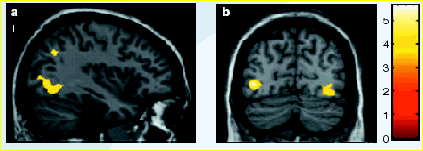
La méthode appelée IRMf Bold consiste ainsi à mesurer l’évolution des propriétés d’aimantation des molécules d’eau autour des vaisseaux sanguins quand le sujet accomplit une tâche, et à les comparer à ces propriétés quand la personne est au repos. On en déduit ainsi les zones du cerveau qui s’activent durant ces tâches.
Par reconstruction mathématique, l’IRMf permet de localiser les régions du cerveau spécialement actives lors d'une pensée, d’une action ou d’une expérience, d’en observer les changements au cours du temps, et de mettre en évidence les différences d’activité entre des individus sains et ceux atteints de pathologies. C’est donc l’une des techniques les plus appropriées pour étudier des processus cognitifs humains sur des groupes de sujets sains ou malades. Elle peut être utilisée conjointement avec les études comportementales, l’EEG et la MEG.
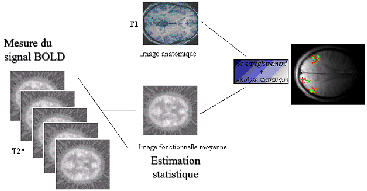
Traitement logiciel de l’ensemble des images avec une estimation statistique
En neurologie et en psychiatrie, l’IRMf est utilisée aujourd’hui pour comprendre les pathologies du cerveau, en espérant à terme pouvoir les diagnostiquer de manière précoce et en effectuer le suivi de manière fiable. Le développement de la technique de l’IRMf en temps réel permet d’effectuer le suivi en temps réel de l’efficacité thérapeutique d’un traitement (médicament ou stratégie comportementale) ; cela pourrait accélérer la mise au point de traitements à visée neurologique et ouvrir l’accès à la thérapie personnalisée.
b) L’Imagerie par résonance magnétique de diffusion
L’IRM de diffusion est une nouvelle méthode d’imagerie reposant sur la diffusion de l’eau dans les tissus cérébraux qui améliore la précision de l’IRM fonctionnelle classique. Elle nous a été décrite par Denis Le Bihan, qui en est l’un des concepteurs54. Elle s’appuie sur le degré de diffusion des molécules d’eau dans les tissus à une échelle microscopique, bien inférieure à l’échelle millimétrique usuellement obtenue avec les images IRM. C’est la seule méthode qui permet de visualiser un accident ischémique55 dans les premières heures, car dans la région en train de mourir, le mouvement spontané de diffusion des molécules d’eau se ralentit de 30 à 50% dans les toutes premières minutes ; si ce phénomène est détecté grâce à l’imagerie médicale, le médecin peut établir un diagnostic très précoce, dans les six premières heures, et donner au malade un traitement actif qui débouchera l’artère.
c) L’IRM à très haut champ magnétique
Selon Cyril Poupon56, l’IRM à très haut champ magnétique permettra de visualiser le manteau cortical, mais grâce à une image acquise à 7 T, l’on sera en mesure de visualiser les couches corticales. L’amélioration de la résolution au niveau du cortex permet, d’une part, de mieux en analyser la structure, d’en observer d’éventuelles atrophies, et de mieux localiser une fonction en jeu à l’aide de l’imagerie fonctionnelle. Il sera alors envisageable de détecter quelle couche du cortex s'est activée, et cette information pourra être mise à profit au niveau de l'étude des réseaux fonctionnels.
Pour Denis Le Bihan57, l’imagerie à très haut champ offre de nombreux avantages : le rapport signal à bruit des images augmente de manière quasi proportionnelle avec l’intensité du champ magnétique. Ce gain peut être exploité pour améliorer la résolution spatiale et/ou temporelle des images au-delà de la résolution actuelle des IRM ou pour réaliser un meilleur compromis entre durée d’acquisition et résolution spatiale. Ces imageurs permettent aussi d’explorer de nouveaux types de contraste pour accéder à des structures ou des traits fonctionnels du cerveau jusqu’alors inobservables in vivo. Enfin, les champs intenses permettent d’obtenir beaucoup plus facilement des informations sur d’autres molécules que l’eau, comme les métabolites ou les neurotransmetteurs. Cela justifie pleinement la poursuite du projet franco-allemand Iseult de construction d’un imageur par résonance magnétique IRM.
2- La spectroscopie par résonance magnétique (SMR)
La spectroscopie par résonance magnétique nucléaire (SRM) fournit une méthode non invasive d’étude de la biochimie et du métabolisme du système nerveux central. Elle permet la quantification précise de plusieurs dizaines de molécules et est basée sur le même principe que l’IRM. Elle est utilisée pour identifier certains métabolites tissulaires impliqués dans des processus physiologiques ou pathologiques. En neurosciences, la visualisation du métabolite recherché peut être utilisée pour diagnostiquer certains désordres métaboliques pouvant caractériser certaines maladies du cerveau, ce qui permet de donner des informations sur le métabolisme de tumeur.
3- La tomographie par émission de positrons (TEP)
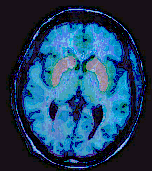
![]()
La tomographie par émission de positrons est une technique d’imagerie nucléaire qui détecte les rayons émis par un traceur radioactif injecté au sujet. La TEP implique de disposer de traceurs, émetteurs de positons, ce qui suppose l’accès à un cyclotron (accélérateur de particules). Le tomographe a l’aspect d’un scanner ou d’une IRM, il est constitué de plusieurs couronnes ou cylindres de cristaux. Il possède également des sources radioactives (césium, germanium, etc.) pour réaliser l’image de transmission. De l’eau rendue radioactive à l’aide d’un cyclotron est injectée dans la circulation sanguine du volontaire ou du patient examiné. Sous réserve de disposer du radiotraceur spécifique, la TEP permet le ciblage des zones à étudier. Elle a été développée pour mesurer différents aspects de la physiologie des fonctions cérébrales en fonction du type de traceur radioactif utilisé. Le métabolisme glucidique, la synthèse des récepteurs des protéines et la distribution des récepteurs sont des exemples de fonctions étudiées par la TEP.
Dans les régions activées par une tâche sensori-motrice ou cognitive, l’augmentation de débit sanguin se traduit par une augmentation locale de la radioactivité dans le tissu cérébral, laquelle est détectée par la caméra TEP. Le radiotraceur est fixé sur une molécule physiologiquement active, elle-même capable de se fixer sélectivement par exemple sur les neurorécepteurs ou des protéines spécifiques. De nombreux radiomarqueurs capables de se lier à des neurorécepteurs spécifiques sont développés pour la TEP, certains permettent de visualiser les neurorécepteurs impliqués. Ils servent de balise pour suivre, à l’aide d’outils de détection appropriés, le cheminement d’une molécule préalablement marquée dans l’organisme. Les images de la concentration en radiotraceurs dans certaines parties du cerveau sont alors reconstruites par traitement informatique des données. Les valeurs ainsi recueillies sont ensuite analysées et transformées à l’aide d’un modèle mathématique afin de permettre la reconstruction à l’écran d’une image représentant la position du radiotraceur dans l’organisme. La TEP produit une image fonctionnelle de certaines zones du cerveau avec une précision de niveau moléculaire.
En neurologie et en psychiatrie, la TEP est aujourd’hui largement utilisée pour des études physiologiques et physiopathologiques de la cognition et du comportement, ainsi que pour l’étude de différentes pathologies affectant le système nerveux central telles que l’épilepsie, l’ischémie cérébrale, les accidents vasculaires cérébraux et les maladies neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson, Huntington).
L’évolution récente de la TEP est le couplage de cette technique avec le scanner à rayons X (TEP-scan) dans le but de permettre un repérage anatomique précis des anomalies métaboliques révélées par la TEP. L’imagerie de transmission est réalisée par le scanner.
En Allemagne58, les chercheurs ont fait le choix d’associer l’IRM et la TEP sur un seul et même appareil pour combiner les avantages des deux approches : résolution anatomique, temporelle. Les scientifiques cherchent à augmenter la résolution des images obtenues par IRM en augmentant la puissance en Tesla (T) des champs magnétiques (traditionnellement 1,5 ou 3T) pour atteindre la valeur de 7T, et même 9,4T. Un IRM d’une puissance de 9,4T a été installé au centre de Jülich en 2009.
L’objectif est de permettre la localisation et l’analyse de mécanismes neuronaux complexes et l’analyse au niveau moléculaire du fonctionnement du cerveau. Depuis novembre 2010, 5 prototypes de ces appareils d’une puissance de 3T ont été installés en Allemagne et aux États-Unis. De l’avis des chercheurs, ces appareils accroissent la précision du diagnostic par une résolution plus grande au sein des tissus, et réduisent le temps d’exposition et d’observation. Ils sont très performants pour cibler avec précision les tumeurs et analyser les plaques amyloïdes dans la maladie d’Alzheimer.
II- LES TECHNOLOGIES INTERVENTIONNELLES UTILISANT LA NEUROIMAGERIE
Ces technologies combinent l’usage de la neuroimagerie et l’intervention sur le cerveau de manière plus ou moins invasive, elles posent bien des questions éthiques dans la mesure où certaines d’entre elles peuvent avoir un impact direct sur le comportement.
A- LES TECHNIQUES DE STIMULATION
Il existe plusieurs méthodes permettant la stimulation du cerveau utilisant la neuroimagerie.
1- La stimulation magnétique transcrânienne (SMT)
La Stimulation magnétique transcrânienne (SMT, plus connue sous son acronyme anglais TMS) permet de modifier l'excitabilité du cortex cérébral localement et transitoirement. Une bobine de stimulation, placée contre le cuir chevelu, produit une dépolarisation neuronale par l'intermédiaire d'un champ magnétique focalisé. On déplace à la surface du crâne une sonde générant des micro-impulsions magnétiques de forte intensité. Pour être efficace, il faut déplacer et orienter la sonde de manière précise afin de suivre les sillons corticaux ciblés, qui sont détectables à l’aide d’une reconstruction en 3D du cerveau à partir d’images IRMf. Le suivi des sillons corticaux à la surface du crâne est possible grâce à l’utilisation de techniques de navigation à partir d’images préopératoires, et d’un système de mesure en temps réel des déplacements de la tête utilisant des caméras infra rouge.
Les recherches portent sur des méthodes de guidage de la bobine couplé à de l’imagerie pour cibler au mieux une région cérébrale précise. La SMT est fréquemment utilisée dans les cas de dépression résistante. Chez les sujets sains, la SMT appliquée sur une région particulière du cerveau (aire temporo-pariétale de Wernicke) améliore les performances lors d'une tâche auditive de détection des mots, démontrant le lien entre cette aire de Wernicke et le traitement auditif de la perception du langage et des variations de performances, selon la fréquence de stimulation (basse ou haute fréquence). Ces informations peuvent être utiles pour l'étude de pathologies sollicitant le langage.
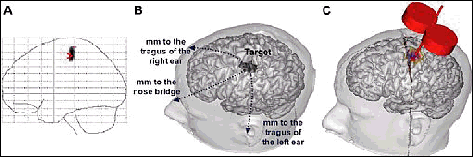
Installation d’un système de stimulation transcrânienne
L’utilisation de cette technique dans le traitement de douleurs intenses et résistantes au traitement médicamenteux par le Dr Luis Garcia Lorrea, est à l’essai à Lyon en liaison avec le centre de neurosciences de Lyon59. Elle peut se pratiquer en hôpital de jour.
2- La stimulation cérébrale profonde
Cette méthode exige une intervention chirurgicale, elle consiste à implanter dans une région profonde du cerveau, une électrode de stimulation à haute fréquence dont l’activation est contrôlée par le malade. Elle utilise la stéréotaxie : on définit pour cela au préalable un espace de référence, et l’on fixe un système de contention sur le crâne du patient. Au moyen de l’imagerie cérébrale en général de l’IRM, on extrait des repères dans l'espace à partir du cadre entourant le crâne du patient. Ces points permettent de déduire un système de coordonnées relatif au cadre et d'obtenir la position de la cible sur laquelle l’électrode sera implantée. Les informations obtenues sont reportées sur le dispositif mécanique fixé solidement sur la tête du patient.
Le ciblage fait également l’objet d’un repérage électro-physiologique pendant l’opération, la technique permettant que les patients demeurent éveillés. Ensuite, ces électrodes sont reliées par un câble sous-cutané à un stimulateur générateur d’impulsions. Le chirurgien utilise des guides montés sur le système pour atteindre la zone cible. L’électrode est reliée à un stimulateur placé en général près de la clavicule. Celui-ci émet de petites secousses électriques qui transmises à l'électrode désactivent les cellules nerveuses hyperactives. Les électrodes ne détruisent pas le tissu. Les signaux électriques peuvent être modulés, voire arrêtés s'ils sont inutiles ou entraînent des effets secondaires neurologiques. En principe, les patients repartent avec un stimulateur qui délivre un courant généralement à haute fréquence de façon chronique.
![]()
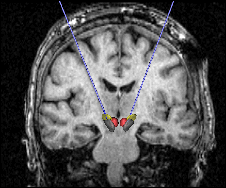
Cette technique a été mise au point dans les années quatre-vingts par le Professeur Louis-Alim Benabid qui a observé qu’une neurostimulation à haute fréquence entraînait la disparition du tremblement chez les patients atteints de maladie de Parkinson. Jusqu’en 1987, les tremblements résistants aux traitements médicamenteux étaient traités par électrocoagulation du noyau ventral intermédiaire du thalamus. En ciblant d’autres noyaux, comme le noyau sous-thalamique, on a pu étendre cette stratégie à tous les symptômes de la maladie de Parkinson et à d’autres pathologies, notamment les dystonies.
Plus de 100 000 patients dans le monde à ce jour ont été implantés pour des maladies du mouvement, dont environ 80 000 parkinsoniens. L’efficacité du traitement est considérée comme majeure, dans un contexte de handicap très lourd, car comme toute technique opératoire cette technique présente des risques. Toutefois, un peu moins de 1% des patients ainsi traités ont eu une hémorragie intracérébrale. En outre, une mauvaise localisation de l’électrode risque aussi de provoquer des rires ou, au contraire, des états de tristesse, voire des troubles du comportement, mais ces effets sont réversibles.
Des essais utilisant la stimulation cérébrale profonde sont en cours pour traiter des pathologies comme les troubles obsessionnels compulsifs, la maladie de Gilles de la Tourette, la dépression cérébrale profonde. Cependant, cette méthode induit à juste titre des débats éthiques60. Pour Luc Mallet61, les observations sur les erreurs d’implantation ont montré, de façon décisive, la possibilité d’agir sur des comportements, des affects, des cognitions, en modulant de façon très précise de toutes petites zones au cœur du cerveau, les « ganglions de la base », alors que jusqu'à présent, on mettait en avant le rôle de ces petites structures dans la motricité. « La stimulation de zones très précises, par exemple, dans une petite zone qui s’appelle « noyau sous-thalamique », qui est toute petite (à l’échelle des millimètres), peut induire un état d’excitation et d’euphorie. »
Il a expliqué qu’un protocole de recherche avait été construit, grâce à des observations faites sur des patients parkinsoniens chez lesquels on avait observé la disparition de troubles psychiatriques associés ou préexistants à la maladie de Parkinson. Ce protocole fut une première en France ; sa mise en place a été contemporaine de la saisine par le Professeur Benabid du Comité consultatif national d’éthique62, pour réfléchir sur la possibilité de mettre en place cette technique de stérotaxie fonctionnelle dans les maladies psychiatriques. C’était une précaution prise pour que la chirurgie ne retombe pas dans les excès de la psychochirurgie du passé. Luc Mallet a précisé : « Nous avons donc pu construire un protocole vraiment innovant et passionnant, pour lequel on a montré qu’il y avait une efficacité d’une partie du noyau sous-thalamique dans le traitement des troubles obsessionnels compulsifs. Les patients à qui s’adressent ces techniques sont des gens profondément handicapés, qui sont absolument incapables d’avoir une vie normale. Avec ce type de patients, nous avons des résultats tout à fait importants suite à la stimulation. » Il ajoute : « Nous avons aussi obtenu des résultats dans d’autres maladies, telles la maladie des tics ou de Gilles de la Tourette. Avec une stimulation du globus pallidus interne, on constate sur ces tics un résultat de 75% à 80% d’amélioration chez ces patients extrêmement handicapés. Beaucoup plus récemment, nous avons pu mettre en évidence le fait qu’il y avait des caractéristiques électrophysiologiques des neurones qui étaient prédictives de la réponse des patients au traitement.»
D’après le Dr Charles-Ambroise Valéry63, ce concept neurochirurgical inventé par un neurochirurgien suédois dans les années cinquante, Lars Leksell, combine la notion de ciblage précis et la notion de dose unique. Il évite de recourir à la trépanation. Il nécessite la pose d’un cadre fixé de façon invasive sur le crâne du patient sous anesthésie locale. Plusieurs modalités sont effectuées afin de repérer au mieux une cible que le bistouri du radio-chirurgien utilise ; cet instrument est constitué de mini-faisceaux de quelques millimètres, produits par de petits collimateurs qui convergeront sur la cible qui a été choisie.
La dernière forme du Gamma-Knife est plus évoluée : 192 mini-faisceaux, produits par des sources de cobalt, convergent en un point au centre de l’appareil. On place la cible à traiter exactement au point de convergence des 192 mini-faisceaux. L’efficacité observée est significativement supérieure à celle des traitements de la chirurgie ou de l’irradiation classiques. Le taux de récidive locale est de 10% contre 50% pour la chirurgie classique ; on observe une préservation de la qualité de vie des patients, avec une absence de complications chirurgicales, et une durée d’hospitalisation courte.
B- L’ÉVOLUTION DES INTERFACES HOMME/MACHINE
La pensée peut-elle commander le mouvement sans l’intermédiaire du corps, et diriger une machine ? Ce qui était jadis un thème de science-fiction est devenu une réalité avec les interfaces homme/machine grâce à la simulation en trois dimensions (3D) d’un environnement particulier dans lequel le sujet a l'impression d'évoluer et au sein duquel on l’immerge. Ainsi on peut agir sur ses perceptions, son comportement pour le meilleur, le soin, ou pour le pire, le contrôle et la manipulation. Selon Angela Sirigu,64 « Les interfaces utilisées en neurosciences, font appel à peu de technologie, mais fonctionnent très bien. Lorsqu’on plonge l’individu dans la réalité virtuelle et la simulation, le sujet porte un casque et se retrouve dans un environnement complexe. Même si cet environnement est irréel, cet environnement peut être réel pour le cerveau ».
1- L’interface cerveau/machine (ICM)
Une interface cerveau/machine (ICM), ou BCI pour l’acronyme anglais, désigne un système de liaison directe entre un cerveau et un ordinateur, permettant à un individu de communiquer avec son environnement sans passer par l’action des nerfs périphériques et des muscles. L’idée est déjà ancienne, puisque le concept a été proposé en 1973, et que les premiers essais cliniques sur l’homme ont été menés en 1980 par l’équipe de Thomas Elbert.
La structure d’une ICM comprend un système d’acquisition et de traitement des signaux cérébraux, un système de classification et traduction de ces signaux dans un ordinateur, un système de commande mécanique d’un élément de l’environnement (un clavier sur écran, un fauteuil roulant, une prothèse, etc.), et une boucle finale d’apprentissage par rétroaction, permettant à l’utilisateur de progresser dans la maîtrise de l’ICM, et à l’ICM d’affiner l’interprétation des activités cérébrales du patient (biofeedback).
Les signaux proviennent de l’activité électrique des neurones. Leur acquisition peut être invasive : une électrode unique ou une grille d’électrodes est alors implantée dans le cortex, avec une excellente résolution spatiale (sensibilité au neurone ou au micro réseau de neurones). Une grille d’électrodes est parfois posée sous ou sur la dure-mère, permettant de produire un électrocorticogramme. Les techniques non invasives consistent à placer les électrodes sur le cuir chevelu, afin de produire un électroencéphalogramme. Mais la résolution spatiale est alors faible et la durée d’enregistrement est limitée.
Les signaux de l’activité cérébrale du patient sont plus ou moins complexes à traiter, selon qu’il s’agit du potentiel d’action d’un seul neurone ou de l’activité de plusieurs millions d’entre eux. La difficulté réside aussi dans le processus d’apprentissage réciproque entre l’individu et le système. On distingue les ICM asynchrones (le patient modifie volontairement son activité cérébrale et la variation neurale correspondante est traitée), et les ICM synchrones (le patient reçoit des stimuli à haute cadence et le système analyse sa réponse neurale).
Au Centre de neurosciences de Lyon, la mission a pu assister à une expérience sur un sujet en bonne santé. La personne équipée d’un casque EEG focalise son attention sur une lettre qu’elle veut épeler. Lorsque cette lettre est flashée, une onde cérébrale particulière est générée ; elle est ensuite récupérée, détectée et interprétée par la machine. Cette application permet ainsi d’écrire du texte par la pensée.
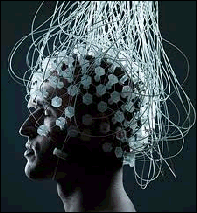
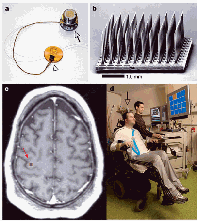
Les outils nécessaires à l’ICM
La médecine est bien sûr une des applications majeures des ICM, et de nombreux patients sont concernés quand certains accidents vasculaires cérébraux dans le tronc cérébral provoquent une paralysie complète, à la seule exception des paupières, alors même que le sujet est parfaitement conscient, avec un syndrome d’enfermement (locked-in syndrom). Les ICM permettent de proposer des solutions aux patients souffrants de scléroses latérales amyotrophiques (maladie de Lou Gehrig ou de Charcot) qui se caractérisent par une paralysie et une amyotrophie progressives, qui les prive de leur capacité à communiquer et à se mouvoir. Les lésions de la moelle épinière privent pareillement certaines victimes de l’usage de leurs membres supérieurs et inférieurs. Un ICM ferait-il marcher un individu ? s’interroge François Berger65 : « Pour l’heure, aucune équipe internationale n’est capable d’atteindre cet objectif, sachant qu’une bonne interface cerveau/machine associée à des prothèses robotiques performantes peut améliorer de façon significative le handicap d’un patient ayant peu de degrés de liberté. »
2- L’immersion dans une réalité virtuelle
L'idée de recourir à l'immersion dans la réalité virtuelle est apparue dans les milieux comportementalistes américains au milieu des années quatre-vingt-dix. Le sujet est exposé à un environnement virtuel : l'objectif est que celui-ci ait l'illusion d'y être présent. Le but de la réalité virtuelle est de faire percevoir à un utilisateur un monde artificiel (créé numériquement) ressemblant à un monde réel pour lui conférer la possibilité d'interagir intuitivement et naturellement avec ce monde. L'intérêt est de mettre le sujet dans un environnement impossible à reproduire dans le monde réel, ou qui est trop onéreux ou trop risqué à créer.
La réalité virtuelle utilise essentiellement des informations visuelles et sonores, elle vise à créer l'illusion de présence en s'appuyant sur le fait que l'être humain ne peut traiter simultanément qu'un nombre limité d'informations et qu'il peut remplir, par l'interprétation, les failles de sa perception. Une plateforme de réalité virtuelle permet une perception visuelle avec la profondeur de l'environnement virtuel, grâce au port de lunettes 3D et à des images 3D en stéréo projetées sur de grands écrans. Un tel système visuel donne à l'utilisateur l'illusion de se sentir présent dans un « espace 3D ».
Le sujet interagit avec l'environnement grâce à un système de capture de mouvement composé de caméras infrarouges qui mesurent les mouvements de marqueurs posés sur l'utilisateur. La capture de ses mouvements génère des interactions proches de celles connues dans le domaine des jeux vidéo ou de l'informatique, comme le fait de saisir un objet avec sa main et le déplacer, ou de marcher sur place pour se déplacer dans le monde virtuel.
Le sujet doit participer à l'expérience comme si elle était réelle, il est équipé d'un visiocasque comportant deux mini-écrans et d'un capteur de position de la tête. L'angle de vision peut aller de 50° à 180°, en suivant les mouvements de la tête. Les informations concernant le déplacement de sa tête sont envoyées à une station graphique qui modifie les images de l'environnement virtuel en fonction de ses déplacements réels. Les déplacements de l'environnement sont donc couplés avec les siens avec un décalage de l'ordre de 50 à 150 millisecondes. Cet environnement virtuel peut exposer le sujet à des conflits.
a- L’utilisation dans les thérapies comportementales
Outre des applications industrielles ou dans les jeux vidéo, le domaine le plus exploré pour tester les interfaces de réalité virtuelle sont les thérapies comportementales. Les effets positifs des interfaces ont été validés dans certaines phobies spécifiques, car l'exposition est modulable à souhait, ce qui permet une maîtrise progressive de la situation redoutée. Ainsi, pour la phobie de voyager en avion qui est assez répandue, les résultats avec la réalité virtuelle sont encourageants. Le patient est immergé dans une scène virtuelle dont on peut moduler le scénario : il entre dans un avion, s'assied. Il peut se déplacer dans l'espace virtuel de l'avion et ressentir des vibrations correspondant aux turbulences et à la sensation visuelle d'ascension et de descente. Des bruits réalistes d'intérieur d'avion ajoutent à l'illusion. Cependant, les personnes anxieuses ressentent une plus forte illusion de présence dans le monde virtuel que les personnes ne souffrant pas de phobie. Mais, revers de la médaille, elles risquent aussi de ressentir plus fortement des conflits sensoriels, un décalage entre le son et l'image, par exemple.
La réalité virtuelle a été également utilisée en Suède dans les centres de grands brûlés, pour lesquels les changements de pansements sont très douloureux ; les plonger dans un environnement qui simule une réalité de froid peut rendre ces opérations supportables pour le patient et très faciles à faire pour le médecin. Ce type de technique, il faut le souligner, est plus efficace et mieux supporté que la morphine. Cette expérience a été rappelée au Centre de neurosciences de Lyon, lors de la visite de la mission.
Selon Angela Sirigu66, un système comparable peut venir à bout des douleurs fantômes de patients amputés. Ces douleurs ne sont pas périphériques, mais strictement centrales et très handicapantes. Elle explique : « Nous avons utilisé une interface très simple. Chez un patient amputé par exemple du coté gauche, nous avons enregistré les mouvements de la main droite et on les a projetés sur un écran d’ordinateur en les faisant apparaître du coté amputé ; le patient les visualise ainsi comme s’il s’agissait de sa main gauche qui bouge. Soumis à l’expérience, les patients ont l’impression d’une sensation de mouvement réel du coté amputé. Pour leur cerveau, le mouvement se déroule de manière bien réelle au point d’éprouver des sensations d’effort. Le patient peut être ainsi fatigué de faire des mouvements, alors qu’il ne fait rien. Plus intéressant, avec l’IRM, après un entraînement de huit semaines à cette illusion du mouvement, on constate que le cortex moteur, qui ne s’activait pas avant l’entraînement, s’active de façon très importante après. Qui plus est, l’activation du cortex moteur est bien corrélée avec l’abaissement de la douleur dans le membre (amputé) fantôme. »
Par une simple illusion visuelle, une simple visualisation des mouvements que des sujets amputés ne sont plus capables de faire, on les immerge dans des situations au cours desquelles leur cerveau pense que leur membre amputé bouge. On restaure ainsi l’activité fonctionnelle du cortex moteur, région importante pour le mouvement, et on influence très fortement le ressenti de la douleur. Il existe donc des représentations du mouvement qui persistent dans le cerveau, en dépit du fait que l’organe permettant d’effectuer le mouvement a disparu.
b- Le pilotage de prothèses
À partir de cette expérience, les chirurgiens pourraient modifier la trajectoire des nerfs qui contrôlaient les muscles du membre amputé, et les greffer dans différentes parties des muscles pectoraux. Lorsque le patient active dans le cortex moteur les représentations correspondant aux mouvements de la main, une commande est envoyée vers les muscles restants (par exemple les biceps ou les pectoraux) et ceux-ci, à leur tour, activent le bras mécanique. Dans ce cas, le cerveau « croit » effectuer des mouvements de la main, même si en réalité les muscles correspondants ne sont pas ceux qui normalement bougent la main. Seuls deux patients ont participé à cette expérience, qui fait appel à un équipement extrêmement lourd. Il faut noter que le degré de liberté de mouvement que cette prothèse peut exécuter est assez limité, puisqu’elle ne permet que d’ouvrir et fermer la main.
c- La modification du soi
C’est une thérapie particulière et quelque peu troublante67 qui consiste à piloter son avatar ; elle est utilisée dans des phénomènes de dépersonnalisation ; il se dégage de l’expérience une grande étrangeté. Il s’agit d’utiliser la technique du biofeedback ou neurofeedback (rétroaction biologique), ensemble de techniques relatives à la mesure de fonctions organiques, basées sur la visualisation, avec des appareils électriques, des signaux physiologiques d'un sujet conscient de ces mesures.
d- La réalité augmentée
La réalité augmentée est une image vraie, complétée en temps réel par des données affichées par un ordinateur. Par exemple, un pilote d’avion regarde devant lui à travers un écran transparent présentant des informations : les noms des villes semblent flotter au-dessus de leur image aérienne, et un autre appareil volant dans les parages est entouré par des nombres indiquant sa vitesse, son altitude et son cap. Lorsque cet écran transparent est installé sur le tableau de bord d'un avion ou d'un véhicule, on parle d'afficheur tête haute. Un tel écran peut aussi être intégré dans une paire de jumelles, procédé utilisé par les armées.
L'optogénétique est née en 2002 de l'observation d'une protéine sensible à la lumière découverte dans une algue, la channelrhodopsine (ChR2). La présence ou l'absence de lumière influe sur ces protéines, et modifie le comportement des cellules vivantes et des organismes. Les chercheurs ont donc eu l'idée d'introduire les gènes responsables de la fabrication de ces protéines (via un virus par exemple, qui infectera le cerveau et y greffera les séquences d'ADN nécessaires) dans des cellules précises, afin de pouvoir les contrôler avec de la lumière.
Lorsque la cellule cible est un neurone, le fait d'y faire s'exprimer des protéines photosensibles permet d'en contrôler l'activité électrique. Une lumière bleue pourra spécifiquement activer un neurone contenant les protéines photosensibles, tandis que le neurone voisin ne sera pas activé. À l'inverse, une lumière jaune inhibera spécifiquement les neurones contenant d'autres protéines, les halorhodopsines.
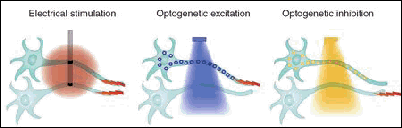
Processus d’inhibition et d’activation en optogénétique
Or un neurone (ou un circuit neuronal spécifique), en fonction de sa localisation, peut intervenir dans la motricité, les sentiments, l'apprentissage, le sommeil, l'anxiété, la respiration, l'expression d'une pathologie, etc. Cette technologie a franchi des caps décisifs en 2010, grâce à l’amélioration de l'insertion de gènes dans des zones spécifiques, et à des technologies de mesure des effets biologiques. Les expériences in vivo permettront d'étudier très précisément le rôle de chaque groupe de neurones, et éventuellement d’agir dessus, alors que jusqu'à présent l'analyse des actions cérébrales se faisait par aires, par petites surfaces du cerveau.
Des expériences ont été menées sur une souris, une mouche et un ver en 2010 ; des chercheurs de l'université de Stanford (Californie) ont réussi à tester ce principe sur des souris en leur insérant au niveau cérébral les gènes nécessaires, codant pour la ChR2. Ces gènes ont entraîné l'expression de la protéine photosensible au niveau de certains neurones chargés de la motricité. Une mini-fibre optique a ensuite été "greffée" sur le cerveau des rongeurs. Lorsque cette fibre envoie de la lumière bleue, les protéines cibles sont "excitées", et commandent alors aux circuits neuronaux modifiés d'enclencher un mouvement circulaire vers la gauche. Lorsque la lumière s'éteint, la souris s'arrête.
D’après Philippe Vernier68, « cette méthode, très simple et peu agressive, est surtout utilisée chez l’animal comme une sorte d’alternative à la stimulation par les électrodes. Mais le transfert de ce type de molécules chez l’homme n’est pas impossible, via des cellules que l’on peut greffer, qui peuvent s’intégrer dans les réseaux de neurones. Et il y a, à l’heure actuelle, des recherches sur le primate qui ont commencé dans divers centres, y compris en France. Ce sont des possibilités de stimulation nouvelles qui nécessiteront sans doute des encadrements. » Il nous appartiendra de suivre ces développements.
2- La photoactivation de molécule : utilisation de nanoscope
De nouvelles technologies d'imagerie basée sur la photoactivation de molécules au delà de la limite de la barrière de diffraction (PALM, "Photoactivated Localization Microscopy") se développent pour observer des mécanismes biologiques, notamment au niveau du cerveau. Ainsi le microscope de super-résolution, qui fait partie d’une nouvelle génération de microscopes, appelés nanoscopes, permet de visualiser des objets à une résolution inférieure au micromètre, passant alors à l’échelle nanométrique.
Ces microscopes utilisent un faisceau de lumière, dont la diffraction empêche une résolution inférieure à 0,2 micromètre. Il permet l’observation d’une seule molécule isolée à la fois, qu’il est alors possible de localiser précisément au centre de la tâche de lumière reçue. Les microscopes de super-résolution sont optimisés pour observer des structures subcellulaires dont certaines protéines ont été rendues fluorescentes.
Après ce tour d’horizon vos rapporteurs rappellent la mise en garde d’Hervé Chneiweiss69 sur la fascination des images : « Même si je suis le premier à m’en émerveiller, il faudra toujours se rappeler dans quelles conditions ces images ont été obtenues. Le cerveau ne fonctionne pas en couleurs. Ce sont des couleurs qui sont codées par des scientifiques au laboratoire. Cela nécessite des répétitions de tâches, des conditions de paramétrage. C’est l’ensemble du cerveau qui fonctionne. Certaines régions fonctionnent plus particulièrement que d’autres, mais le danger serait de remettre au goût du jour une certaine phrénologie, comme l’avait fait Gall avec "la bosse des maths" ou "la bosse de l’amour maternel". »
CHAPITRE III :
LA MAÎTRISE DES TECHNOLOGIES DE NEUROIMAGERIE ET LA PROTECTION DES PERSONNES
Présentées comme non invasives, certaines des technologies de neuroimagerie font l’objet de réserves quant à leur innocuité et à la fiabilité des données qu’elles génèrent. Dans son avis n° 98 sur la biométrie, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) constatait : « Les trois questions les plus angoissantes sont donc celles du glissement du contrôle de l'identité à celui des conduites, celle de l'interconnexion des données et de leur obtention à l'insu des personnes concernées. » Il émettait de vives craintes sur ces risques. Lors de leur évaluation de la loi relative à la bioéthique70, comme au cours des débats sur la loi du 7 juillet 2011, vos rapporteurs se sont inquiétés des problèmes soulevés par la circulation de neuroimages.
I- LA PROTECTION DES DONNÉES DE NEUROIMAGERIE ET L’INTIMITÉ DES PERSONNES
La génétique et l'imagerie médicale ont envahi le droit et la vie quotidienne. On observe une véritable fascination dans la presse et dans le public pour ces belles images colorées que nous offrent les nouvelles technologies de l'imagerie cérébrale qui ont révolutionné les diagnostics et les suivis médicaux. On peut se demander, comme le soulignait Yves Agid,71 si l'IRM ou le scanner cérébral ne deviendraient pas aussi courants et systématiques dans quelques années que la radio des poumons au siècle dernier, mais à la différence de la radio qu'on emportait tout simplement chez soi, les résultats des nouveaux examens ne figurent pas seulement sur le CD et les clichés qu'on emmène avec soi. Ils restent conservés dans l'ordinateur qui a enregistré et traité les données. De plus, la complexité des images et les difficultés de leur interprétation font qu’elles sont régulièrement échangées par voie informatique entre professionnels, ce qui n’est pas sans risques.
Ce passage obligé par l'informatique a amené à repenser entièrement la question de la protection de la confidentialité des données personnelles informatisées figurant sur ces nouveaux supports, ainsi que leur mode de transmission et d'échange. Vos rapporteurs se demandent comment améliorer le cadre juridique actuel pour que le patient ne perde pas la maîtrise de son propre dossier médical et de la conservation de ses données, et comment sécuriser l’accès à ces données.
La loi du 7 juillet 2011 a, pour la première fois, prévu un encadrement des applications des neurosciences. Son article 45 indique : «Les techniques d'imagerie médicale cérébrale ne peuvent être employées qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique, ou dans le cadre d'expertises judiciaires ». La loi exige en outre le consentement préalable exprès écrit et dûment informé du patient. Le nouvel article L. 1134-1 du code de la santé ajoute : « un arrêté du ministre chargé de la santé définit les règles de bonnes pratiques applicables à la prescription et à la réalisation des examens d'imagerie cérébrale à des fins médicales. Ces règles tiennent compte des recommandations de la Haute Autorité de santé ». Au jour de la présentation du présent rapport, cet arrêté n'a pas encore été pris.
A- LA SPÉCIFICITÉ DES DONNÉES D’IMAGERIE
Les données d’imagerie sont à l’évidence des données sensibles qui bénéficient d’un cadre juridique strict de protection. Cependant, les ambiguités liées au caractère prédictif de certaines données limitent l’impact de la réglementation.
1- Le cadre législatif strict des données sensibles
Les alinéas 1 et 2 de l’article L. 1110-4 du code de la santé, résultant de la loi modifiée du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, garantissent au malade le secret médical et le respect de la confidentialité de ses données de santé : « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. »
L’étendue du secret médical imposé par la loi aux professionnels de santé est précisée à l’article R. 4127-4 du code de santé publique : « Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.»
La rupture du secret médical par le médecin est passible des sanctions pénales prévues à l’article 226-13 du code pénal (un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende). C’est donc bien le médecin qui a suivi le malade, lui a fait éventuellement passer des examens d’imagerie médicale, qui est responsable de la confidentialité des informations contenues dans le dossier du patient, et de la traçabilité des échanges médicaux qui pourraient s’en suivre. La loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée à de nombreuses reprises, considère les données de santé comme des données sensibles dont le traitement et la collecte sont par principe interdits, selon les prescriptions de son article 8 : « Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci. »
Plusieurs dérogations à ce principe sont prévues dans ce même article pour :
- les traitements pour lesquels la personne a donné un consentement exprès ;
- les traitements nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine ;
- les traitements nécessaires aux fins de suivi médical des personnes, de prévention, de diagnostic, d’administration de soins ou de traitements ou de gestion des services de santé mis en œuvre par les professionnels de santé astreints au secret médical. Ces types de traitements doivent en fait être déclarés à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), sauf si l’organisme médical ou le service hospitalier dispose d’un correspondant informatique et libertés (chapitres IX de la loi) ;
- les traitements statistiques réalisés par un service statistique ministériel,
- les traitements nécessaires à la recherche médicale qui font l’objet d’un encadrement très particulier résultant des lois de bioéthique et sont soumis à une stricte procédure d’autorisation de la CNIL (voir ci -après) ;
- les traitements de données de santé à des fins d’évaluation ou d’analyse des pratiques ou des activités de soins de prévention, dans les conditions prévues au chapitre X de la loi ;
- les données qui sont appelées à faire l’objet, à bref délai, d’un procédé d’anonymisation ;
- les traitements justifiés par l’intérêt public et autorisés par la CNIL.
La CNIL se montre particulièrement vigilante sur la protection des données de santé. Elle intervient dans le cadre des avis qu’elle rend sur les règlements de sécurité, par les fréquents contrôles qu’elle diligente dans les établissements de soins et les hébergeurs de systèmes de santé, en étroite collaboration avec l’Agence des systèmes d’information partagés de santé (ASIP santé), qui pilote les systèmes de santé partagés et élabore des référentiels.
Pour assurer ses contrôles et vérifications, la CNIL se fonde sur une grille d’analyse basée sur six principes-clés figurant aux articles 6 et 7 de la loi informatique et libertés : l’examen de la finalité des projets de traitements de données, la pertinence des données collectées, la limitation de leur durée de conservation, le respect de la sécurité et de la confidentialité de ces données, le respect des droits d’information des malades et de leur droit de rectifier les informations les concernant, et de s’opposer à leur utilisation.
2- Des ambiguïtés liées à la prédictivité de l'imagerie médicale
La loi du 7 juillet 2011 utilise les termes de « fins médicales » pour définir une des trois finalités autorisant le recours aux techniques d’imagerie cérébrale. Comment faut-il l’interpréter ? S’agit-il seulement du diagnostic médical ? Jusqu’où peut-on utiliser les résultats de l’imagerie dans une médecine prédictive ? Une compagnie d’assurance pourrait-elle refuser d’assurer une personne au vu des éléments médicaux fournis par une IRM ou un scanner ?
Par ailleurs, l’article 10 de la loi informatique et libertés proscrit toute décision prise sur la base du seul fondement d’un traitement informatique destiné à évaluer le profil d’une personne ou certains aspects de sa personnalité : « Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d’une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité.
Aucune autre décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l’intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité.»
Avec les techniques d’imagerie médicale, ne risque-t-on pas d’aboutir à des prises de décision par ordinateur sur la base de résultats qui précisément auraient défini le profil ou la personnalité d’un individu, ce que la loi proscrit clairement ? Plus généralement, Bernard Bioulac,72 faisait remarquer que, « si on en arrive bientôt à une situation où la médecine prédictive devient une réalité quotidienne, il faudra déterminer si on continuera à s’en remettre seulement à l’éthique de la pratique médicale, à l’éthique des médecins, ou si un encadrement minimal législatif ne deviendra pas indispensable ». C’est un débat récurrent, qui a déjà été abordé lors de la première loi sur la bioéthique, qui a fait entrer les dossiers médicaux dans le champ de la loi informatique et libertés. Doit-on rester purement pragmatique, en laissant le médecin face à sa conscience, ou bien fait-on le choix d’un encadrement minimal ou maximal, avec l’utilisation des données nominatives ?
Vos rapporteurs estiment que les résultats de données d’imagerie cérébrale sont sensibles, et doivent être protégées de toute utilisation visant à caractériser un comportement, ou un profil psychologique. La mission de veille que la loi du 7 juillet 2011 confie à l’Agence de la biomédecine, devrait être mise en œuvre en liaison avec la CNIL s’agissant de la protection des données.
Recommandation :
Organiser une veille conjointe de l’Agence de la biomédecine et de la CNIL, sur l’utilisation de données d’imagerie cérébrale dans le but de définir par ordinateur les caractéristiques d’une personne.
B- LE DÉFI DE LA SÉCURITÉ DE LA TRANSMISSION DES DONNÉES
L'imagerie cérébrale est de nature à rendre de grands services, notamment en matière de diagnostic, dans le domaine de la télémédecine. Elle offre des outils qui permettront de pallier des problèmes de pénurie médicale, de profiter de l'expertise de professionnels situés à distance, de partager des informations, de mieux prendre en charge les patients. Si l'intérêt des patients est clair, il convient en revanche d'être très vigilant sur la confidentialité, la sécurité et l'intégrité des données dès que des informations sont partagées, surtout à distance avec des accès via Internet. Or, précisément quelles sont les garanties qui permettent d'assurer cette transparence et de vérifier que les résultats d'un examen d'imagerie ne risquent pas d'être diffusés à l'extérieur, y compris par exemple à un autre service hospitalier ou un autre médecin que celui du malade, sans que celui-ci en ait été informé ?
La garantie première est bien sûr le secret professionnel médical auquel sont astreints tous les professionnels de la médecine. Mais quid de la sécurité de la télétransmission des données médicales et de l'intervention de nombreux acteurs de santé non médecins qui ont en fait accès à ces données médicales, parfois même à distance, tels les ingénieurs et personnels chargés de la maintenance d'appareils médicaux sophistiqués, de l'archivage et de l'hébergement des données de santé ? Les intermédiaires en tous genres sont de plus en plus nombreux, et la protection de la circulation des informations devient de plus en plus complexe, avec Internet notamment.
C’est essentiellement la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) qui est chargée du contrôle de la sécurité des transmissions ; cela représente non seulement une tâche immense, mais un véritable défi technologique avec les divers outils informatiques qui ne cessent de se développer et d’embrasser tous les secteurs de l’activité humaine. Ses services d’expertise informatique ont d’ailleurs dû être largement étoffés récemment par un recrutement d'ingénieurs spécialisés notamment en cryptologie.
1- La difficile limitation de l’accès aux données médicales
Le médecin exerçant à titre libéral ou le directeur de clinique ou d’hôpital doit assurer la sécurité des informations figurant dans les dossiers médicaux de ses patients. Il lui appartient de prendre toutes dispositions pour cela et pour que les données soient conservées en bon état, inaccessibles aux tiers non autorisés et disponibles pour les personnes concernées. L’article 34 de la loi informatique et libertés prévoit que : « Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. »
La négligence ou l’absence de mesures de sécurité peuvent être sanctionnées de 300 000 euros d’amende et de 5 ans d’emprisonnement (article 226-17 du code pénal). Selon Yves Agid73, la multiplication de l’accessibilité à l’IRM, accroît le problème de l’accès aux banques de données des cliniques privées, des hôpitaux, et pose la question cruciale de la suppression des sources et surtout de la nécessité d’anonymiser des données ce qui, de son point de vue, n’a pas toujours été acquis. Pour son collègue Didier Dormont74, il est désormais impossible à un individu mal intentionné d’accéder de l’extérieur à la banque de données des hôpitaux publics, du fait de la grande amélioration de la sécurité dans les hôpitaux et de la mise en place de nombreuses procédures de certification pour assurer le respect de la confidentialité ; les banques de données informatisées y sont anonymisées.
Mais il est vrai que certains centres privés, au lieu de remettre un CD sur lequel se trouvent les données, offrent la possibilité au médecin prescripteur d’accéder aux données de l’IRM de leur patient. De plus, nous avons constaté que parfois les personnels de certains établissements donnaient des informations précises, sans être en mesure de vérifier l’identité des personnes qui les leur demandaient, et donc violaient sans même s’en rendre compte le secret médical.
2- Le dossier médical personnel (DMP)
Créé par la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance-maladie, le dossier médical personnel (DMP) a vu sa mise en place retardée par suite de multiples complications administratives et techniques75 ; il est aujourd’hui progressivement déployé sur toute la France. Objet d’expérimentations depuis 2006, le DMP s’est trouvé confronté à des difficultés liées à son environnement : systèmes d’information non communicants, développement insuffisant des systèmes d’information de production de soins à l’hôpital, organisation des soins cloisonnée, offre industrielle dispersée et non cohérente, gouvernance éclatée sous la forme d’acteurs multiples, etc.
Accessible sur Internet, le DMP est un dossier médical, informatisé et sécurisé créé pour chaque bénéficiaire de l’assurance-maladie qui le souhaite. Il est hébergé par le groupement d’entreprises solidaires ATOS-La Poste, qui a été agréé par le ministre de la santé le 10 novembre 2010, après avis de la CNIL et du comité d’agrément des hébergeurs. Il est conçu comme un ensemble de services permettant au patient et aux professionnels de santé autorisés, de partager, sous forme électronique, partout et à tout moment, les informations de santé utiles à la coordination des soins du patient.
Le DMP peut ainsi centraliser des informations telles que les antécédents et les allergies, les prescriptions médicamenteuses, les comptes-rendus d'hospitalisation et de consultations, ou encore les résultats d'examens complémentaires. Chaque patient doit donner son consentement à sa création et peut ensuite le consulter directement tout en conservant l'entier contrôle : lui seul autorise son accès aux professionnels de santé. Le patient garde à tout moment la possibilité de le fermer, de supprimer tout ou partie des documents qu'il contient, ou de masquer certaines données de santé. De ce point de vue, le DMP, qui est à la fois personnel et partagé, garantit le respect des droits fondamentaux des patients : l'information, le consentement et la confidentialité.
Lors de la phase d’expérimentation du DMP, la CNIL a conduit six contrôles chez les hébergeurs qui ont été fort utiles et ont permis de remédier à diverses défaillances de sécurité, notamment des absences de chiffrement des données sauvegardées. Désormais, la CNIL estime que ce chiffrage est solide dans le DMP tel qu’il a été autorisé en 2010. Les professionnels de santé peuvent créer un DMP à partir de leur logiciel rendu préalablement DMP-compatible, ou à partir du site www.dmp.gouv.fr.
Les informations contenues dans le DMP sont couvertes par le secret professionnel et ne sont consultables que moyennant l’utilisation d’une carte de professionnel de santé. Une trace de tous les accès et consultations est gardée. Cela dit, l'Académie nationale de médecine76« regrette que, à la suite des restrictions d'accès et possibilités de modifications de son contenu, le DMP ne puisse être l'un des outils utilisables pour la surveillance et la recherche épidémiologique ».
La CNIL a également veillé à ce que le patient soit clairement informé des spécificités du DMP et mis en mesure d’apprécier les conséquences de l’accord qu’il donne. Une copie papier du document électronique par lequel le personnel habilité à ouvrir un DMP atteste avoir procédé à l’information du patient, et recueilli son consentement exprès, est systématiquement remise au patient.
En plus du DMP, les réseaux de santé, généralement centrés sur une pathologie (diabète, cancer…), une population spécifique (personnes âgées, femmes enceintes…), une zone géographique déterminée, ont pour objet de faciliter l’intervention des différents acteurs du système de santé, la transmission des informations entre eux et d’assurer une meilleure prise en charge des patients qui y consentent. Là encore, le contrôle par la CNIL est de rigueur, puisque son autorisation préalable est requise pour la création d’un réseau par un professionnel de santé utilisant un dossier médical partagé entre plusieurs acteurs.
La CNIL vérifie que les données échangées font l’objet d’un haut niveau de sécurité (chiffrement, traçabilité, identification et authentification des professionnels…) et aussi que le patient a été clairement informé par une note d’information ou par une charte de fonctionnement du réseau. Le consentement exprès écrit, révocable et modifiable du patient à la constitution d’un dossier médical partagé au sein d’un réseau, doit être recueilli préalablement à sa mise en œuvre.
3- La télémédecine et la traçabilité des échanges
Selon l'article L. 6316-1 du code de la santé, « la télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Elle met en rapport, entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure nécessairement un professionnel médical et, le cas échéant, d'autres professionnels apportant leurs soins au patient.
Elle permet d'établir un diagnostic, d'assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée préventive ou un suivi post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes, ou d'effectuer une surveillance de l'état des patients ».
Le décret codifié du 19 octobre 2010 en définit les conditions de mise en œuvre, et l'article R. 6316-2 dispose que « les actes de télémédecine sont réalisés avec le consentement libre et éclairé de la personne ».
Afin de garantir que le transfert de données d'imagerie par exemple ne puisse se faire à l'insu du patient, le décret prévoit des mesures de sécurité fortes (authentification des professionnels, chiffrement des données, traçabilité des connections, archivage sécurisé...), appréciées au cas par cas par la CNIL, puisque celle-ci doit donner son autorisation à la mise en place de chaque réseau de formalités de télé expertise. Selon la CNIL, tous les accès sont tracés et c'est bien le praticien qui garde l'entière responsabilité de la décision prise au final et de la traçabilité des échanges.
Vos rapporteurs se sont néanmoins interrogés sur la question de la télétransmission des feuilles de soins de la sécurité sociale, dont la nomenclature peut permettre de faire connaître le résultat des examens médicaux, et notamment l’analyse de neuroimagerie puisque les codes diffèrent en fonction des maladies traitées. La CNIL, tout en assurant avoir obtenu une amélioration du codage des informations, reconnaît ne pas être sûre de la sécurité des procédés de chiffrement.
Recommandations :
- Renforcer les procédures de codage et de sécurisation des bases de données de l’assurance-maladie et des autres banques de données médicales ;
- Assurer une traçabilité de l’accès des personnels habilités à connaître ces données ;
- Améliorer la formation et la sensibilisation des personnels médicaux au respect du secret médical et à la délivrance de données médicales ;
- Accroître les moyens d’expertise de la CNIL.
C- L’ENCADREMENT DES PROTOCOLES DE RECHERCHE
Les chercheurs français77 en neuroimagerie et neurosciences ont fait part aux rapporteurs, à de nombreuses reprises, des multiples difficultés qu'ils rencontraient vis-à-vis de leurs collègues étrangers pour se hisser au meilleur niveau de la concurrence internationale, en raison des contraintes et limitations imposées par l'arsenal législatif et règlementaire français en matière de protection des libertés individuelles et d'utilisation des bases de données médico-administratives. Ils déploraient le manque de clarté des notions de recherches observationnelles et interventionnelles, et l’obligation de la présence d’un médecin pour des recherches purement observationnelles.
Une refonte législative de l'ensemble des dispositifs concernant les recherches sur la personne humaine vient précisément d'être adoptée par le Parlement et répond largement à ces doléances tout en clarifiant les procédures.
1- Le dispositif équilibré de la nouvelle loi du 5 mars 2012
Les dispositions légales et réglementaires encadrant les recherches sur la personne humaine trouvaient leur fondement dans la loi du 20 décembre 1988 relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales (dite loi Huriet-Sérusclat), codifiée aux articles L. 1121-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis, un véritable millefeuille législatif s'était constitué avec l'intégration de plusieurs directives européennes et diverses lois successives, rendant l’encadrement de la recherche biomédicale de plus en plus complexe.
Parallèlement, la recherche observationnelle, notamment en neurosciences, est devenue une véritable recherche, source de réelles avancées, ce qui rendait d'autant plus nécessaire une évolution législative. La proposition de loi déposée en 2009 par le député de la Somme, Olivier Jardé, relative aux recherches impliquant la personne humaine, qui a été adoptée définitivement par le Parlement en février 201278, a procédé au toilettage complet du dispositif en vue d'en améliorer la cohérence, d'en simplifier le régime juridique, et de concilier protection des personnes et amélioration des conditions de la recherche et de l'innovation. Cette réforme devrait donc faciliter le travail des chercheurs français et répondre à leurs attentes.
Le nouveau texte institue un cadre légal commun à tous les types de recherches impliquant la personne humaine, qu’il s’agisse de recherches interventionnelles, de recherches avec des risques et des contraintes minimes, ou de recherches observationnelles. Á ces trois niveaux de recherche, correspondent trois niveaux de consentement, proportionnés aux risques et contraintes subis par les personnes qui s'y prêtent.
Le texte, à la discussion duquel a largement participé l’un de vos rapporteurs, a recueilli l'accord de la majorité comme de l'opposition, et a cherché à établir un régime juridique équilibré, favorisant le développement de la recherche, tout en garantissant la sécurité et le respect des personnes. Tous les projets de recherches impliquant la personne humaine doivent désormais recueillir l'avis favorable d'un Comité de protection des personnes (CPP) tiré au sort afin d'éviter tout risque de conflit d'intérêt éventuel avec les responsables de l'équipe de recherche.
Les CPP sont institués par la loi et agréés par le ministre chargé de la santé. Ils examinent les conditions de validité de la recherche, notamment au regard de la protection des personnes, l'adéquation, l'exhaustivité et l'intelligibilité des informations écrites à fournir, ainsi que la procédure à suivre pour obtenir le consentement éclairé, et la justification de la recherche sur des personnes incapables de donner leur consentement éclairé. La nouvelle loi institue auprès du ministre chargé de la santé une Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine, chargée de la coordination, de l’harmonisation et de l’évaluation des pratiques des CPP. Elle peut désigner un second CPP en cas d'avis défavorable donné par le premier.
L'élargissement du champ d’action des CPP aux recherches non interventionnelles est une nouveauté essentielle qui vient combler un vide juridique, car la France était le seul pays à ne reconnaître, que la recherche biomédicale, à la différence de ses partenaires européens et des États-Unis. Le développement des recherches observationnelles, très utiles en neurosciences, est tout à fait récent ; celles-ci étaient jusqu’à présent ignorées de la loi.
Les chercheurs français étaient demandeurs d’un cadre légal plus solide, car les grandes revues scientifiques internationales n’acceptent de publier les résultats d’une étude que si celle-ci a été contrôlée par un comité d’éthique. La nouvelle définition permettra à la France d'être mieux armée pour prendre sa place dans la compétition internationale et démontre bien, s'il était nécessaire, que l'intérêt des chercheurs et la protection des personnes ne sont pas contradictoires.
Aux trois niveaux de recherche correspondent trois niveaux de consentement, repris de la gradation très claire découlant de la convention d’Oviedo sur la biomédecine (que la France à ratifié en décembre 2011). La convention d’Oviédo prévoit un consentement écrit pour les recherches avec des risques, un consentement « libre et éclairé » pour les recherches avec des risques minimes, et la délivrance d’une information et un droit d'opposition pour les recherches observationnelles.
Olivier Oullier a bien précisé79 les bonnes pratiques mises en œuvre à cet égard : « lorsque nous soumettons les protocoles expérimentaux au comité d’éthique de l’organisme promoteur de la recherche, puis au Comité de protection des personnes (CPP) et à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), il est écrit, dans les formulaires de consentement éclairé, que les volontaires ne peuvent participer aux expériences qu’à la condition d’accepter d’être informés en cas de découvertes d’anomalies sur les images cérébrales anatomiques. Cela nous est imposé par le CPP. »
Par ailleurs, l'article L.1121-3 stipulant que les recherches impliquant la personne humaine ne peuvent être effectuées que si elles sont réalisées sous la direction et sous la surveillance d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée, qui alourdissait les procédures de certaines recherches observationnelles en neurosciences, a été complété et précisé : les recherches à risques minimes et les recherches non interventionnelles en sont dispensées, et peuvent être effectuées sous la direction et la surveillance d’une personne qualifiée, sous réserve de la vérification par le CPP de l’adéquation entre la qualification du ou des investigateurs et les caractéristiques de la recherche.
C'est une simplification des textes et de la procédure, qui devrait répondre aux critiques de certains chercheurs pour des recherches leur paraissant ne comporter aucun risque médical pour le patient. Ils éprouvaient des difficultés à respecter l'exigence de la présence d'un médecin responsable. Auparavant les recherches dispensées de surveillance médicale devaient figurer sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat, qui n'a jamais été publié...
Olivier Jardé, député80, rapporteur et auteur de la proposition de loi a ainsi résumé l’esprit et les avancées du nouveau texte : « J’ai la ferme conviction que cette proposition de loi marquera une étape très importante dans l’évolution du droit de la recherche. Ce droit est issu de la loi fondatrice de Claude Huriet du 20 décembre 1988. Mais cette loi avait été modifiée par de nombreux textes, si bien que nous étions parvenus à un millefeuille, un texte difficile à appliquer, voire complètement déconnecté de la recherche actuelle. Notre proposition de loi étend le champ d’application de la loi Huriet et en met certains aspects à jour. Toutefois, elle ne cherche pas à déplacer l’équilibre qui avait été obtenu en 1988, à savoir promouvoir la recherche sans laquelle il n’y a pas de progrès pour l’homme tout en protégeant les personnes qui se prêtent à ces recherches. Cet équilibre a été maintenu, ce qui est une excellente chose ».
Jean-Louis Touraine81 a également exprimé sa satisfaction à la fin du long examen de la nouvelle loi : « la rédaction que nous nous proposons de valider a le mérite de concilier la protection des personnes et la nécessité de la recherche et de l'innovation, indispensable au progrès médical. Nous avons trouvé un équilibre entre la recherche tous azimuts et l'interdiction de tout progrès. L'aléa qui demeure est limité et très encadré : on avancera sans prendre de risques. »
Vos rapporteurs considèrent que la nouvelle loi clarifie les conditions de la recherche sur la personne humaine, et concilie la protection des personnes et la promotion de la recherche. Sa mise en œuvre dans de brefs délais devrait répondre aux difficultés des chercheurs menant des recherches non interventionnelles, telles que ceux-ci l’avaient souligné à plusieurs reprises.
Recommandations :
- Publier les dispositions règlementaires nécessaires, en vue d’une application rapide de la nouvelle loi du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine ;
- Installer dans les plus brefs délais la Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine, instituée par la-dite loi.
2- Le contrôle du traitement des données par la CNIL
« Les traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé » font l'objet du chapitre IX de la loi informatique et libertés, et donc d'un encadrement spécifique introduit par les lois de bioéthique. Tous les fichiers comportant des données personnelles à des fins de recherche médicale sont soumis à une autorisation préalable de la CNIL. La loi de 2012 vient d'apporter un assouplissement important de la procédure en supprimant un échelon administratif : désormais, l'avis d'un comité scientifique dépendant du ministère de la recherche, le Comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé (CCTIRS), n'est plus requis pour les recherches observationnelles, dès lors qu'elles ont déjà reçu l'avis favorable d'un CPP. Cette obligation était jugée souvent redondante par les chercheurs et allongeait les délais d'autorisation de recherche.
Lors de son examen, la CNIL contrôle notamment le bon respect du secret médical afin que seules des personnes soumises au secret médical, au secret professionnel, puissent avoir accès à des données sous une forme directement nominative, puisque la notion de données personnelles inclut non seulement des données directement nominatives, c’est-à-dire l’enregistrement du nom du patient dans le traitement, par exemple, mais également des données indirectement nominatives, ainsi le numéro qui renvoie à l’identité du patient, conservé dans une table de correspondance dans un fichier séparé.
Ainsi elle vérifie que l'unité destinataire des informations contenues dans la recherche n'a pas communication des noms des patients. Elle n’a les données, et notamment les images, que sous forme associée à un numéro et seul l’investigateur principal dispose de la correspondance entre les noms et les numéros. C’est particulièrement important, cela ne veut pas dire que le traitement est anonyme, mais c’est une mesure de confidentialité que la CNIL essaie, de façon systématique, de faire respecter dans les projets de recherche qui lui sont soumis.
La CNIL vérifie également avec soin les techniques d'anonymisation et de transcodage des identités, de chiffrement, de journalisation des accès, mais elle déplore que ces techniques informatiques restent fort coûteuses et insuffisamment développées dans le domaine de la recherche médicale. Elle a élaboré plusieurs guides de bonnes pratiques avec des consignes précises à l'usage des professionnels de santé.
3- La nécessité du recours à de grandes cohortes
a- La justification des besoins
Certains projets sensibles sont d'une telle ampleur qu'ils posent bien des questions éthiques qui dépassent sans aucun doute les possibilités matérielles et humaines des instances de contrôle. C’est le cas de l’utilisation des données générées par les grandes cohortes de personnes acceptant de faire partie d’un vaste projet d’étude. Cependant toute personne qui entre dans une cohorte a la possibilité de se retirer de cette cohorte à tout moment. Cette question est d’autant plus sensible que l’on compte quatre projets de constitution de grandes cohortes financés au titre des investissements d’avenir pour les neurosciences et la psychiatrie.
Cyril Poupon,82 a rappelé les raisons de l'exigence de recherches de cette dimension dans le domaine de l'étude du cerveau humain : « Quel est le futur au niveau de l’analyse des données ? Dans le passé, les études en neurosciences cognitives ou cliniques reposaient sur de petites cohortes d’une vingtaine ou d’une trentaine de sujets sains, ou d’une vingtaine de patients. Il est fondamental de changer d’échelle. Nous avons besoin de constituer de très larges cohortes qui apporteront la puissance statistique nécessaire pour mieux comprendre l’évolution du cerveau dans toutes ses dimensions, en couvrant toutes les étapes d'évolution du cerveau de son développement in utero jusqu'à sa phase de vieillissement normale ».
Selon lui, la très forte variabilité structurelle et fonctionnelle du cerveau humain rend les petites bases de données insuffisantes. Ainsi, « si l’on s’intéresse à un supposé patient, pour définir des biomarqueurs d’imagerie qui permettent de pronostiquer une pathologie, il faut que la variabilité de mesure du biomarqueur ne soit pas supérieure à la variabilité interindividuelle de la structure chez l’ensemble des sujets ». Une puissance statistique relativement élevée qui repose essentiellement sur la constitution de larges cohortes est nécéssaire.
Pour Hervé Chneiweiss et la plupart des experts rencontrés à l’étranger, l’utilité de ces cohortes ne fait pas de doute. Hervé Chneiweiss, 83a précisé : « la question de la recherche de données sur les cohortes est très importante, que ce soient les cohortes évoquées par Cyril Poupon, que ce soit l’une des plus grandes au monde dont on dispose en France, la cohorte 3C (environ 10 000 personnes), constituée depuis 1966 sur trois cités, Dijon, Montpellier et Bordeaux, et qui a suivi les personnes agées de plus de 65 ans au cours du temps afin d’étudier les liens entre les facteurs de risques vasculaires et neurodégératifs sur la survenue de plusieurs événements morbides (maladie coronaire, accidents vasculaires cérébraux et démences.) »
Selon lui, cette cohorte est une mine de découvertes à une échelle supérieure à l’étude de Framingham qui, dans le domaine cardiovasculaire, a complètement changé la façon de faire de la médecine à partir des années cinquante. L’étude de Framingham, c’était 40 000 personnes d’une ville suivies pour leurs risques cardiovasculaires. Aujourd'hui, les chercheurs considèrent que de telles cohortes sont nécessaires dans le domaine des maladies neurologiques et des maladies psychiatriques.
Ils estiment qu’au nom de la sécurité, ou de la protection de la vie privée des personnes, il ne faut pas élever des barrières telles que l’utilité des cohortes, la recherche et l’impact que cela peut avoir sur la santé publique, en soient perturbés. Il faut donc respecter l’anonymat des patients, parce qu’ils deviennent un échantillon de l’étude, et être capable d’annoter les échantillons et d’effectuer un suivi.
b- L’exemple de la cohorte Elfe
La cohorte Elfe est constituée de 18 500 enfants nés en 2011 qui seront suivis au moins jusqu’à leur majorité ; c’est la première étude longitudinale française consacrée au suivi des enfants, de la naissance à l’âge adulte, qui aborde les multiples aspects de la vie de l’enfant sous l’angle des sciences sociales, de la santé et de la santé-environnement. Lancée auprès de 500 familles pilotes en 2007, elle est généralisée en France métropolitaine depuis avril 2011. Soutenue par les ministères en charge de la Recherche, de la Santé, et du Développement durable, ainsi que par un ensemble d’organismes de recherche et d’autres institutions, l’étude Elfe mobilise plus de 60 équipes de recherche, soit 400 chercheurs, avec plus de 90 sujets spécifiques84. Une étude du même ordre existe en Grande-Bretagne pour les enfants nés depuis mars 1958, qui ont aujourd'hui 54 ans et sont toujours suivis.
L'étude est pilotée par un groupement d'intérêt scientifique (GIS) regroupant tous les grands acteurs de la recherche épidémiologique, médicale et statistique : Institut de veille sanitaire (InVS), Institut national d'études démographiques (INED), Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), INSEE, direction générale de la santé... La Caisse nationale d'allocations familiales participe également à l'étude, et d'autres organismes devraient rejoindre prochainement le GIS.
L'objectif est de suivre ces enfants de la naissance à l’âge adulte afin de mieux comprendre comment leur environnement affecte, de la période intra-utérine à l’adolescence, leur développement, leur santé, leur socialisation et leur parcours scolaire. Cet objectif sera décliné en une vingtaine de thèmes particuliers, qui feront chacune l'objet d'études spécifiques : démographie et famille, socialisation et éducation, développement psychomoteur, alimentation et nutrition, croissance physique et puberté, périnatalité, maladies respiratoires, santé mentale, accidents et traumatismes, exposition aux polluants de l'environnement, activité physique...
Recrutés sur une base volontaire, les familles et les enfants seront suivis durant vingt ans. Le recueil des informations se fera sous diverses formes : enquêtes en face-à-face avec la mère, enquêtes téléphoniques, questionnaires remplis par les parents et les médecins traitants, questionnaires sur la nutrition... D'autres modalités sont également prévues, comme des prélèvements biologiques ou sanguins (à la naissance, à trois ans et à six ans), utilisation de "pièges à poussière" par les parents (lingettes électrostatique captant la poussière ambiante dans le logement), tests psychomoteurs, bilans de compétences scolaires... Les données sont "anonymiséess" et les familles participantes seront, par ailleurs, régulièrement informées de l'avancement de l'étude et de ses résultats.
Parmi les résultats attendus de ce vaste projet figurent notamment l'établissement de nouvelles courbes de croissance physique, la mesure de l'impact de l'environnement sur la santé et le développement des enfants et adolescents, la mesure de l'impact des inégalités sociales, ou encore une meilleure compréhension des éléments qui peuvent influer sur les trajectoires scolaires.
Lors de la présentation du rapport sur la « situation et perspectives de développement de l'épidémiologie en France en 2011 » de l'Académie nationale de médecine examiné en réunion de l'OPECST, le 25 janvier 2012, Alfred Spira85, a eu l'occasion de rappeler que seules de telles cohortes portant sur la vie entière des individus peuvent permettre d'étudier le déclenchement de maladies à l'âge adulte, ce qui permet ensuite la mise en place d’un dépistage extrêmement précoce et d’une médecine personnalisée préventive.
Mais, il est évident qu'une recherche d'une telle ampleur, portant au surplus sur des enfants, pose de multiples problèmes éthiques qui dépassent certainement les possibilités techniques des organes de contrôle, et de la CNIL notamment : fiabilité de tous les enquêteurs, de l’anonymisation, vérification des donneurs de consentement, intrusion dans la vie privée des enfants et des familles, risques de diffusion à l'extérieur d'informations personnelles et de stigmatisation de certains, droit individuel à connaître les résultats, transmission correcte et sécurité des données.
Ainsi qu'on l'a expliqué plus haut, la CNIL estime qu'il sera certainement nécessaire de prévoir un système d'agrément analogue à celui que doit obtenir le prestataire d'hébergement de données de santé pour les enquêteurs et organes de recherche amenés à alimenter et héberger les vastes bases de données identifiant des cohortes sensibles.
Recommandation :
Soumettre à des conditions strictes d’agrément les hébergeurs de données de recherches sur de grandes cohortes.
D- LES DANGERS DU « CLOUD COMPUTING » OU HÉBERGEMENT OPAQUE
1- L’encadrement des hébergeurs de données de santé
Vos rapporteurs se sont inquiétés auprès des représentants de la CNIL du grand nombre de professionnels, qui, en dehors des acteurs de santé, autour du corps médical, ont accès aux données, notamment les ingénieurs, les personnes chargées de la maintenance des appareils et en particulier à distance, par Internet, les sociétés non médicales qui ont un accès au cœur des machines ; comment être certain que les informations ne peuvent pas être diffusées à l'extérieur sans que le patient en soit informé ? Comment assurer la protection de ces données contre d’éventuels piratages ?
Il existe une législation stricte et précise sur les hébergeurs de ces données, applicable à tout détenteur, producteur ou conservateur de ces données. L'article L.1111-8 du code de la santé publique en organise le cadre général. Il dispose dans ses deux premiers alinéas que : « Les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée peuvent déposer des données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l'occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Cet hébergement de données, quel qu'en soit le support, papier ou informatique, ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès de la personne concernée.
Les traitements de données de santé à caractère personnel que nécessite l'hébergement prévu au premier alinéa, quel qu'en soit le support, papier ou informatique, doivent être réalisés dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La prestation d'hébergement, quel qu'en soit le support, fait l'objet d'un contrat. Lorsque cet hébergement est à l'initiative d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, le contrat prévoit que l'hébergement des données, les modalités d'accès à celles-ci et leurs modalités de transmission sont subordonnées à l'accord de la personne concernée ».
Le décret du 4 janvier 2006 détermine les conditions de l'agrément, organise la procédure et fixe le contenu du dossier qui doit être fourni à l'appui de la demande. L'article R.1111-13, résultant de ce décret, définit les clauses minimales que doivent contenir les contrats d'agrément, passés avec l'organisme hébergeur.
Selon les responsables de la CNIL86 auditionnés par vos rapporteurs, un effort assez novateur a été fait avec ce dispositif, puisque le prestataire qui devient responsable d'un traitement doit obtenir un agrément du ministre, pris après avis de la CNIL, puis d'un comité d'agrément des hébergeurs placé auprès du ministre de la santé, qui se prononce sur la conformité du dossier au regard des dispositions du décret du 4 janvier 2006.
La CNIL estime que la multiplication des contrôles effectués chez les hébergeurs de santé ces dernières années, a eu un effet pédagogique et a produit une progression dans l'élévation des niveaux de sécurité. En concertation avec l'Agence des systèmes d'information partagés de santé (ASIP Santé), elle a élaboré des référentiels de sécurité et d'interopérabilité et considère qu'« un véritable ordre public propre à garantir la sécurité des données de santé est ainsi en cours de construction ».
2- Le « cloud computing » et la nécessité d’une protection internationale
Cependant, selon la CNIL, ce cadre législatif sécurisant se trouve aujourd'hui sérieusement menacé par un développement inquiétant de l'informatique avec ce que l'on appelle le « cloud computing », c'est-à-dire des offres de service consistant à héberger des données sur des serveurs dont on ignore où ils sont installés, et qui deviennent donc difficilement contrôlables. On commence à voir par exemple une gestion des rendez-vous médicaux effectuée depuis l'étranger, et notamment dans des pays qui n'ont pas forcément le même niveau de protection de la confidentialité des données que le nôtre. C'est un phénomène très inquiétant. S’y ajoutent des systèmes privés de banque de données, utilisés par les chercheurs tels le LONI87 à Los Angeles.
L'ensemble des pays de l'Union européenne s'est doté d'une législation de protection des données de santé et la directive européenne en vigueur est actuellement en cours de révision. Il existe un groupe européen des autorités de santé, appelé G29, qui se réunit tous les deux mois pour arrêter des positions communes et influer sur la position des acteurs. Le G29 réfléchit aussi actuellement à un futur dossier médical européen partagé, le projet EPSOS.
Avec les États-Unis, un accord est intervenu entre la Federal Trade Commission (FTC) et la Commission européenne pour créer les accords de Safe Harbor, qui ont pour objet d'encadrer les transferts de données, notamment dans le secteur de la santé, avec les entreprises qui déclarent adhérer volontairement à ces accords, ce qui est loin d'être totalement satisfaisant.
La législation européenne prévoit que des transferts de données à l'extérieur de l'UE sont possibles uniquement avec les pays disposant de lois offrant un niveau de protection adéquat résultant soit d'une loi de protection des données, soit de clauses contractuelles, soit d'un accord tel que ceux du Safe Harbor; dans ce dernier cas, il s'agit plutôt d'échange d'informations. Mais, en dehors de l'Europe, il n'existe malheureusement aujourd'hui aucun texte international qui permette de contrôler la sécurité de l'hébergement et du transfert des données médicales.
La CNIL souhaite ardemment l'adoption d'une convention internationale pour encadrer la circulation de ces informations, mais il semble qu'on en soit encore loin. Elle estime qu'on se trouve actuellement à une période charnière, car, d’une part, une révision de la directive européenne sur la protection des données est en cours, et d'autre part, d’autres modèles apparaissent dans la région Asie-Pacifique à l'instigation des États-Unis, qui veulent développer leur propre modèle de transmission des données, qui ne sera pas forcément au même niveau de protection que le modèle européen. On se trouve là face à un défi international important, d'autant plus que les acteurs-clés, tels que Google et Facebook, sont américains.
La CNIL reconnaît en outre qu'aujourd'hui l'agrément que doit obtenir le prestataire d'hébergement de données de santé concerne uniquement l'externalisation des dossiers médicaux vivants, ceux qu'on utilise pour traiter les patients. Elle estime qu'il sera nécessaire, à terme, d'étendre cette réglementation non seulement aux bases de données de l'assurance-maladie, mais aussi aux recherches contenant de vastes bases de données qui permettent d'identifier des cohortes sensibles.
Recommandations :
- Assurer la sécurité de l’hébergement et du transfert des données d’imagerie cérébrale ;
- Soumettre à des conditions strictes d’agrément les hébergeurs de données de recherches sur de grandes cohortes ;
- Participer activement à la négociation et à l'adoption d'une convention internationale pour encadrer la circulation des informations médicales.
II- LES DÉBATS SUR L’INNOCUITÉ DES TECHNIQUES
Ces débats portent sur l’impact des rayonnements ionisants sur la santé et sur celui des champs magnétiques. Ils se doublent en France d’une difficulté d’accès aux IRM qui sont en nombre insuffisants par rapport aux besoins. Vos rapporteurs ont constaté que l’on utilise le scanner au lieu de l’IRM pour nombre d’explorations du cerveau, faute d’IRM.
A- LES RÉSERVES DE L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE (ASN)
L’autorité de sûreté nucléaire (ASN) assure depuis 2007 le contrôle des applications médicales des rayonnements ionisants : sûreté des appareillages, protection des patients et des travailleurs. Elle constate que le risque des rayonnements ionisants prend une place particulière du fait de la répétition des examens, et d’un phénomène émergeant de radiosensibilité individuelle.
L’augmentation des doses en imagerie médicale, plus particulièrement du fait du scanner, constitue un souci majeur pour l’ASN. Michel Bourguignon,88 a exposé les préoccupations de l’ASN. « En France, on utilise le scanner au lieu de l’IRM pour nombre d’explorations du cerveau, faute d’IRM à notre disposition. C’est un problème propre à la France, qui dispose de 8 appareils par million d’habitants, contre 35 aux États-Unis et 40 au Japon. Une étude publiée en 2010 par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et l’Institut national de veille sanitaire (InVS) a mis en évidence une augmentation de 47 % en cinq ans des doses médicales.
On ne dispose pas de beaucoup de statistiques françaises, mais des statistiques mondiales établissent que, entre 1993 et 2008, le nombre d’examens de radiodiagnostic et de médecine nucléaire a été multiplié par 2,5 et 2 respectivement, et que la fréquence des examens augmente rapidement, passant de 0,8 par patient et par an à 1,3. Cette tendance à l’augmentation des doses s’explique par le développement des dispositifs les plus performants, qui sont les plus irradiants. Les actes les plus utiles dans tous les domaines (scanner du corps entier, coloscopie virtuelle, coroscanner, radiologie interventionnelle…) sont aussi les plus dosants.
La radiosensibilité est plus grande pour l’embryon et l’enfant, mais aussi pour la femme. La sensibilité du cerveau aux rayonnements ionisants est assez faible comparée à celles d’autres organes. Encore n’y a-t-il pas que le cerveau dans le champ d’investigation lorsqu’on explore la tête, mais aussi le cristallin de l’œil, qui est sensible. Les cataractes détectées de plus en plus précocement sont-elles liées aux rayonnements ?
La radiosensibilité individuelle est un phénomène nouveau, qui commence à être largement exploré et qui est bien connu en radiothérapie pour les fortes doses. La radiosensibilité individuelle entraîne des défauts de signalisation cellulaire et de réparation des lésions de l’ADN, en particulier dans un contexte où le cycle cellulaire n’est pas bien contrôlé. On vient de démontrer récemment qu’elle peut exister à faibles doses. C’est une préoccupation majeure, qui concerne entre 5 et 10 % de la population, l’intensité de l’effet pouvant aller de 1 à 10.
Il apparaît donc que les risques sont liés à la progression des doses dans les expositions médicales et à la répétition des examens chez un même patient. La radiosensibilité plus grande de certains patients fait que le risque peut-être en ce cas plus élevé, mais on ne sait l’évaluer ni individuellement, ni collectivement. Or, si l’on ne réagit pas, d’ici 15 à 20 ans, l’épidémiologie montrera sûrement des effets qui ne sont pas souhaitables.
L’imagerie médicale a une place centrale et indiscutable pour l’exploration du cerveau en neurologie et en psychiatrie. Elle fournit un diagnostic préalable aux soins ou à des fins de de recherche. Le scanner permet une exploration rapide en urgence, raison pour laquelle on l’utilise beaucoup, notamment si on ne dispose pas d’IRM. L’IRM a une place particulière, vitale et décisive, pour différencier le ramollissement de l’hémorragie cérébrale.
La tomographie par émissions de positons (TEP) s’est répandue très fortement en France, et son utilisation est de plus en plus fréquente pour l’exploration biochimique du cerveau. Sans doute est-elle plus utile pour la recherche que pour l’application de routine. Mais le scanner et la TEP sont des technologies irradiantes. La justification médicale de l’examen est donc centrale. Avec ces outils, il ne faudrait réaliser que des examens utiles, des examens dont le résultat positif ou négatif modifie la prise en charge, ou conforte le diagnostic du clinicien.
On devrait donc toujours se poser des questions avant de réaliser un examen d’imagerie médicale irradiant. L’examen a-t-il déjà été effectué ? En a-t-on besoin ? En a-t-on besoin maintenant ? Est-ce bien l’examen indiqué ? Est-ce que l’on peut en faire un autre, non irradiant, comme une IRM ? A-t-on bien posé le problème ? Il faut prêter une attention particulière aux patients les plus radiosensibles, comme les enfants et les femmes, les personnes ayant une hyper-radiosensibilité individuelle ou une susceptibilité particulière au cancer.
Dans son communiqué de presse du 6 juillet 2011, l’ASN89 considère que l’augmentation des doses de rayonnements ionisants délivrées par l’imagerie médicale (principalement en scanographie et en radiologie interventionnelle) devient préoccupante et doit être maîtrisée. Elle appelle les acteurs de la santé à se mobiliser pour :
- le développement des techniques alternatives, au premier rang desquelles l’IRM ;
- la mise en œuvre plus rigoureuse des principes de la radioprotection ;
- le renforcement de la formation à la radioprotection ;
- l’implication plus forte dans le champ de l’imagerie médicale des radiophysiciens ;
- l’augmentation de la disponibilité des personnes compétentes et des moyens qui leur sont alloués.
Lors d’un séminaire organisé en septembre 2010 avec les professionnels du secteur, l’ASN a émis douze recommandations, parmi lesquelles :
• favoriser l’intervention du radiophysicien dans l’optimisation des procédures, le suivi et l’évaluation de la dose délivrée et la qualité de l’image ;
• développer, ou mieux encadrer, la formation des utilisateurs et notamment des manipulateurs en électroradiologie lors de la réception de nouveaux équipements ou de nouvelles versions de logiciels ;
• mettre en place, au moins au niveau national, une démarche d’évaluation des technologies d’imagerie innovantes, sur la base du retour d’expérience des utilisateurs ;
• informer et impliquer les patients sur les bénéfices de l’imagerie médicale, et sur les doses associées ;
• améliorer la précision du dispositif d’évaluation, au niveau national, des doses délivrées aux patients (dose moyenne par acte, dose à l’organe, …).
Vos rapporteurs ont eu l’occasion d’auditionner Jean-Luc Godet,90 qui a souligné l’utilité pour le patient de pouvoir connaître la dose annuelle de radiations à laquelle il a déjà été soumis, ce qui n’est guère aujourd’hui possible, car les comptes rendus d’examens ne font pas toujours apparaître le dosage subi. Il a également insisté sur l’insuffisante formation des manipulateurs de nouvelles machines qui permettent de diminuer les dosages.
Recommandations :
- Accroître le nombre de radio-physiciens et améliorer leur formation ;
- Informer les patients du dosage annuel de radiations et de rayonnements subis et établir en conséquence des règles d’optimisation des procédures de suivi, d’évaluation et de publication des doses délivrées ;
- Augmenter substantiellement le parc français d’IRM, afin de limiter le recours substitutif excessif à la technique irradiante du scanner et assurer un égal accès de tous aux techniques les mieux adaptées.
B- LA NOUVELLE DIRECTIVE EUROPÉENNE PLUS SATISFAISANTE SUR LES CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
L’attention des rapporteurs a été attirée par Denis Le Bihan91 et Stanislas Dehaene92, sur la transposition de la directive européenne sur les champs électro-magnétiques. Ils estimaient que l'adoption du texte en l'état rendrait impossible la réalisation de leur projet.
En effet, adoptée en 2004, la directive européenne 2004/40/CE sur les champs électromagnétiques (CEM), dont la transposition avait été prévue pour le 30 avril 2008, puis repoussée au 20 avril 2012, a pour objectif de restreindre l’exposition professionnelle aux CEM de 0 à 300 GHz, en raison des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, dus aux effets secondaires connus à court terme dans le corps humain. Cette directive a finalement été remplacée par un nouveau projet de directive COM (2011) 348 en date du 14 juin 2011, dont la date de transposition a été repoussée au 30 avril 2014 par une nouvelle directive du 25 janvier 2012.
La nouvelle proposition de directive, tout en abrogeant et remplaçant la directive 2004/40/CE, en conserve l’essentiel des dispositions et principes, mais actualise les limites d’exposition pour prendre en compte les nouvelles données scientifiques, en particulier pour les limites d’exposition à l’IRM dans les hôpitaux.
Dès 2006, la communauté médicale avait fait part à la Commission européenne de ses préoccupations concernant la mise en œuvre de la directive de 2004, faisant valoir que les valeurs limites d’exposition fixées réduiraient, de façon disproportionnée, l’utilisation et le développement de la technique d’IRM, considérée aujourd’hui comme un instrument indispensable pour le diagnostic et le traitement de plusieurs maladies. D’autres secteurs industriels avaient aussi exprimé, par la suite, leurs préoccupations relatives à l’incidence de la directive sur leurs activités.
Le nouveau texte proposé s’efforce de trouver un équilibre entre protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, d’une part, et flexibilité et proportionnalités adaptées, d’autre part, afin de ne pas entraver inutilement les activités industrielles et médicales et leur développement. Il introduit notamment une flexibilité réduite, mais appropriée, grâce à un système de dérogations limitées, délivrées à l’industrie pour les valeurs déclenchant une action et les valeurs limites.
La proposition prévoit deux dérogations spécifiques : l’une pour les forces armées, l’autre pour les applications médicales IRM. Le paragraphe 4 nouveau de l’article 3, qui a trait aux valeurs limites d’exposition et aux valeurs déclenchant l’action, prévoit ainsi une exemption aux limites d’exposition pour le secteur de l’IRM médicale et ses activités connexes, ce secteur restant soumis à toutes les autres obligations prévues par la directive.
La Commission européenne estime avoir ainsi pris en compte les préoccupations de la communauté scientifique et évité une situation de grande incertitude juridique dans la mesure où la plupart des États-membres n’avaient pas encore transposé la directive initiale. Le Conseil et le Parlement européens ont longuement examiné le cas spécifique de l’IRM avec les experts de nombreux pays-membres (Institut national de recherche et de sécurité -INRS- pour la France) et la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (CIPRNI), organisme mondialement reconnu comme autorité dans le domaine de l’évaluation des effets sur la santé de ce type de rayonnements
Le nouveau report du délai de transposition de la directive et l’absence de fixation de valeur limite d’exposition pour les champs magnétiques statiques, qui constituent une composante essentielle de la technologie d’IRM, devrait apaiser les craintes des chercheurs.
Cependant, la Confédération européenne des syndicats (CES), tout en rappelant son soutien au principe d'une législation contraignante visant à protéger les travailleurs face aux risques liés à l'exposition aux champs électromagnétiques, a émis plusieurs réserves quant au contenu de la proposition, qu'elle juge insuffisamment protectrice93 : « la proposition de directive ne couvre que les effets à court terme de l'exposition. Les effets à long terme sur la santé des travailleurs sont donc négligés, alors même que dans un avis du 31 mai dernier, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) suggère de classer les radiofréquences comme cancérogènes possibles pour l'homme (groupe 2B). En ce qui concerne ce dernier secteur, la CES estime que les progrès dans le domaine du diagnostic médical ne peuvent se dérouler au détriment de la protection de la santé du personnel médical, et plus spécifiquement des opérateurs utilisant des appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM) ».
Aujourd’hui, aucune preuve de nocivité certaine des ondes radiofréquence n’a pu être encore démontrée et il est clair qu’un consensus sur la totalité des effets sur la santé des champs électromagnétiques n’est pas pour demain. Il est pourtant reconnu par les instances internationales et nationales que les CEM peuvent avoir des effets qui risquent de porter préjudice à la santé des travailleurs.
A ce jour il n’existe pas, ou peu, de données sur les niveaux d’exposition dans de nombreuses situations de travail réelles. L’adoption de normes communes d’évaluation de l’exposition reste donc un objectif essentiel pour l’application des dispositions de la directive et pour la réalisation des études épidémiologiques.
Vos rapporteurs estiment que le nouveau projet de directive constitue un bon compromis et offre un dispositif mieux équilibré au regard de la prise en compte du progrès scientifique et de la protection médicale des travailleurs exposés aux champs électromagnétiques. Il leur paraissait en effet impensable de prendre aujourd'hui le risque de se priver de la technologie essentielle de l’IRM, qui a besoin d'être plus développée en France et dont l'absence aurait pour conséquence de favoriser la technique concurrente du scanner, qui comporte elle, des effets sanitaires de radiations ionisantes bien connus.
III- L’INTERPRÉTATION DES DONNÉES ET
LA PLASTICITÉ CÉRÉBRALE
L’étude du système nerveux, de statique, est devenue dynamique. Jusqu’à très récemment les résultats des expériences se traduisaient par des images fixes, qu’il s’agisse de données biochimiques, anatomiques ou physiologiques. Cependant chaque image est un artefact. Quelle qu’en soit la qualité, elle n’est qu’une « représentation de la représentation » par le truchement d’une modélisation mathématique.
Quand on mesure l’activité cérébrale, on n’enregistre pas du simple bruit, mais une dynamique cohérente. De façon transitoire, on observe l’activation de réseaux mis en fonctionnement normalement par différents comportements. Le cerveau revisite ainsi ses activations précédentes. C’est un premier pas vers la compréhension de sa nature : ce n’est pas une machine qu’on peut éteindre et redémarrer, car il fonctionne toujours.
Lorqu’on modélise un cerveau en essayant de créer artificiellement des réseaux, on essaie d’en comprendre la dynamique. On fabrique en quelque sorte un cerveau virtuel. L’on a ainsi procédé à des simulations du cerveau quand il voit ou entend quelque chose, mais cela ne répond pas à la question de savoir comment cela fonctionne dans un environnement complexe. De toutes façons, le cerveau virtuel ne va pas fonctionner comme celui d’un humain : pour l’instant, ce n’est qu’un outil ponctuel, une fenêtre expérimentale pour tester de nombreuses variations. C’est aux théoriciens de développer leurs modèles, de formuler des hypothèses à tester, et d’interpréter les résultats de la simulation. Ainsi, les données recueillies pour générer des images produisent du sens par rapport à un modèle qui reste virtuel, alors que le cerveau in vivo est en constante évolution.
Or si un point mérite qu’on s’y attarde, c’est bien la contradiction entre la plasticité cérébrale dont toutes les recherches témoignent, et la modélisation utilisée pour interpréter les données. Aussi les scientifiques auditionnés n’ont-ils pas éludé cette interrogation ; la plasticité cérébrale conduit à la prudence quant à la validité d’une image produite, à un temps donné sur un appareil donné. Ils ont rappelé94 le mot de Clausewitz, « la carte n’est pas le territoire », et chaque image doit être interprétée pour pouvoir en corréler les données avec une réalité biologique.
Aujourd’hui, les techniques permettent de voir et de manipuler in vivo, en temps réel, les molécules, les cellules, les tissus. La valeur des interprétations dépend de la richesse des modèles de représentation utilisés. Si, à l’observation d’une image, on constate une certaine activité sur une certaine zone du cerveau, lorsque le patient est soumis à une certaine circonstance, l’incertitude sur la nature de la relation observée (fortuite ou récurrente) entre la zone du cerveau et la circonstance vécue par le patient, est très grande. Cette relation est surtout de nature statistique, et ne devrait jamais être déterministe.
A- LA PLASTICITÉ CÉRÉBRALE ET LA MODÉLISATION
On utilise le terme de plasticité cérébrale pour qualifier cette capacité du cerveau à se modeler et à se façonner en fonction de l’expérience vécue. Comme l’a rappelé Jean-Pierre Changeux, le cerveau est constitué de 100 milliards de neurones, connectés entre eux par un million de milliards de synapses, 90% des connexions synaptiques s’effectuant après la naissance.
Longtemps, les scientifiques ont cru que le cerveau, une fois mature, se caractérisait par la stabilité de ses connexions, jugées immuables. Depuis une trentaine d'années, cette vision de la structure et du fonctionnement cérébral a volé en éclats. L’un des apports majeurs de l’imagerie cérébrale est d’avoir démontré les capacités de plasticité cérébrale et d’avoir mis en évidence que le cerveau se remanie en fonction de l’expérience vécue, à tous les âges de la vie. Tout projet de modélisation doit prendre en compte cette capacité, ce qui rend l’entreprise complexe et devrait limiter l’impact sociétal de la neuroimagerie, ce qui est loin d’être le cas.
Catherine Vidal95 a illustré l’importance de la plasticité par l’évocation d’un patient, homme de 44 ans, marié, père de deux enfants, menant une vie professionnelle normale, qui se plaignait d’une légère faiblesse de la jambe gauche. À l’hôpital de la Timone, à la suite d’une IRM, on s’est aperçu que son crâne était empli de liquide et que son cerveau était réduit à une mince couche collée sur les parois du crâne. Cette personne souffrait à la naissance d’hydrocéphalie. « À l’époque, les médecins lui ont posé un drain à la base du cerveau, pour évacuer le liquide en excès. Le drain s’est bouché. Progressivement, la pression du liquide a fini par refouler le cerveau sur les parois du crâne, processus qui s’est effectué sans entraîner aucune gêne dans la vie de cette personne ».
Grégoire Malandain96 a expliqué comment les équipes de chercheurs de l’INRIA construisaient des modèles pour comprendre, expliquer, mais aussi prédire en manipulant des objets mathématiques. Ils mettent au point des modèles de cerveau, de neurone, d’assemblée de neurones, mais aussi de réseau d’aires corticales, chacune avec sa fonction. Il a ainsi résumé les limites de ces exercices : « Modéliser totalement un cerveau ? En matière de défis scientifiques, la complexité est de plus en plus grande dans les modèles, mais aussi dans les données. De fait, on dispose de plus en plus de données, hétérogènes et multimodales. Nous sommes confrontés à des problèmes liés à la validation des modèles, à la personnalisation. La dimension éthique doit être prise en compte avec les interfaces cerveaux/ordinateurs non invasives, en raison de l’apport éthique pour les handicapés : comment réaliser les études ? Il faut de la réactivité par rapport à l’actualité, les avancées étant très rapides. Comment parvenir à construire des consortiums pluridisciplinaires et interdisciplinaires pour répondre aux enjeux ? »
Il exprime cette tension bien connue et difficile à résoudre entre le temps long de la recherche et de sa validation, et les attentes qu’elle suscite, ce qui se plie mal aux incertitudes de la modélisation.
1- L’impact des apprentissages sur le cerveau
On a constaté des variations notables dues à l’éducation et aux apprentissages, telle celle de l’hippocampe des chauffeurs de taxis londoniens plus développé en raison de leur mémorisation obligée des rues de Londres. L’apprentissage de la musique dans le cerveau provoque un épaississement du cortex dans les régions qui contrôlent la coordination des doigts et l’audition chez les pianistes. Ainsi comme le notait Stanislas Dehaene97 : « L’effet de l’éducation qu’a reçue une personne se traduit directement par des changements d’organisation de ces circuits. Ce que nous observons en imagerie est le contraire du déterminisme. Très souvent, nous observons le résultat de contraintes conjointes de la génétique et de l’éducation. » Il arrive donc que l’effet d’un apprentissage soit éphémère ; dans certains cas, les changements d’épaisseur du cortex peuvent être réversibles quand la fonction n’est plus sollicitée.
Selon Stanislas Dehaene98, certaines régions du cerveau jouent un rôle fondamental parce qu’elles sont modifiées par l’apprentissage de la lecture ; grâce à l’IRM, on a pu concevoir des expériences pour déterminer que telle région s’intéressera à la syntaxe de la phrase, telle autre à l’orthographe. Il a montré qu’à partir des résultats obtenus dans un cerveau normal, on peut produire des images compréhensibles de ce qu’il advient dans le cerveau d’un enfant qui connaît des difficultés de lecture. Celles-ci peuvent être mises en relation avec des activations insuffisantes de certaines régions du circuit de la lecture, notamment des régions liées au code phonologique et au code orthographique.
Certaines anomalies anatomiques commencent également à être détectées chez ces enfants. Il est possible grâce à des statistiques un peu plus poussées, avec des imageurs très performants, d’observer des anomalies particulières qui se concentrent dans certaines régions des circuits de la lecture, chez certains dyslexiques. Cependant il ne s’agit pas de produire des images de la pathologie et de condamner ces enfants. Il est possible d’obtenir des images de la rééducation, pour en suivre les progrès. On observe ainsi la réactivation de nouveaux circuits dans l’hémisphère droit en fonction du degré et du type de rééducation.
Ces recherches ont conduit Stanislas Dehaene à créer des logiciels d’entraînement à l’apprentissage de la lecture et du calcul présentés à vos rapporteurs lors de leur visite à NeuroSpin. La présence de différences cérébrales entre individus n’implique pas que ces différences soient inscrites dans le cerveau depuis la naissance, ni même qu’elles y resteront gravées. L’IRM apporte un cliché instantané de l’état du cerveau. En d’autres termes, détecter des variations d’épaisseur du cortex ne permet pas d’expliquer le passé, ni de prédire le devenir d’une personne.
Olivier Houdé99, a effectué des recherches sur l’apprentissage des enfants ; elles mettent en évidence les mécanismes de plasticité qui, de l’enfant à l’adulte, peuvent être provoqués par l’apprentissage, la pédagogie et l’éducation au sens général. Selon lui, les modèles actuels de développement de la cognition contestent la dimension linéaire du progrès cognitif chez l’enfant, tel que l’a décrit Piaget en son temps. Le cerveau fonctionne de façon beaucoup plus dynamique et aussi de manière non linéaire, avec plusieurs stratégies cognitives à tout âge du développement, selon les enfants, les contextes. On peut observer le cerveau des mêmes individus avant et après la correction d’une erreur de raisonnement. On constate que spontanément, le cerveau ne fonctionne pas de manière logique, mais par bricolage perceptif visuo-spatial.
« Un effet d’apprentissage et de pédagogie peut-il entraîner une reconfiguration ? » se demande Olivier Houdé. C’est l’enjeu de la psychopédagogie expérimentale, utilisant l’imagerie médicale. On peut voir si telle ou telle intervention pédagogique entraîne non seulement un changement des comportements, mais, simultanément, une reconfiguration des réseaux neuronaux impliqués. Selon les régions, on trouve une stratégie plutôt visuo-spatiale ou logico-sémantique. On découvre aussi le rôle des fonctions exécutives, les capacités de contrôle du comportement, les stratégies grâce auxquelles on peut inhiber une réponse impulsive, inadéquate dans un cas, adéquate dans l’autre.
Il rappelle que les neurosciences ont un devoir d’humilité et de service à l’égard de l’éducation et de la pédagogie. Quand tout va bien, la pédagogie naturelle n’a pas besoin d’être éclairée et aidée par les neurosciences. Comme la médecine guidée par les évidences scientifiques, il pourrait y avoir une pédagogie guidée par certaines évidences scientifiques. Ces observations ont été relayées par Pascal Huguet, directeur du pôle et Thierry Hasbroucq, directeur adjoint, lors des entretiens des Rapporteurs au Pôle 3C Cerveau Comportement Cognition à Marseille100.
Vos rapporteurs souhaitent que les travaux et les découvertes des neurosciences cognitives qui renforcent le concept de plasticité cérébrale puissent avoir un écho et un impact plus grand sur la communauté éducative en France car ils pourraient contribuer à une meilleure qualité des apprentissages de bases, et à la réduction de l’échec scolaire.
2- La tentation des stéréotypes
Pour Catherine Vidal, le concept de plasticité cérébrale permet de lutter contre les stéréotypes sexistes, tel celui énoncé par le président de l’Université de Harvard, Larry Summers, qui a déclaré : « la faible représentation des femmes dans les matières scientifiques s’explique par leur incapacité innée dans ces domaines. » L’existence de la plasticité cérébrale devrait limiter la propension au localisme, au réductionnisme dans les interprétations. La complexité du fonctionnement cérébral conduit à s’interroger sur la nature des relations entre la structure et le fonctionnement du cerveau. Edouard Zarifan101 déclare que « voir le cerveau penser est une métaphore poétique. On ne voit d’ailleurs que des listes de chiffres qui sortent des machines et que l’on transpose avec des codes de couleur pour représenter la silhouette d’un cerveau. Seule la parole du sujet qui s’exprime permet d’avoir accès au contenu de sa pensée. »
3- Les possibilités de compensation du handicap
Jean-Didier Vincent102 a souligné l’impact de la plasticité dans la réduction possible de certains handicaps : « étant administrateur du Centre d’handicapés La Force, endroit où l’on trouve le plus d’handicapés mentaux, cérébraux, n’ayant jamais parlé de leur vie, je sais que cela peut aider à améliorer leur état. En effet, s’ils ont conservé une petite fonction motrice avec un muscle, on peut, grâce à un ordinateur, leur faire déclencher des lexigrammes, pour qu’ils puissent communiquer par une parole visuelle avec leur entourage, et dialoguer. Alors qu’on pensait qu’ils étaient des légumes et qu’ils étaient oubliés sur une chaise, ils ont pu grâce à ces techniques acquérir un statut social. » Il en conclut que la plasticité du cerveau, lorsqu’on joue dessus à l’aide d’ordinateurs, permettra de remédier à bien des troubles du fonctionnement du cerveau.
B- LA FIABILITÉ DES INTERPRÉTATIONS
« La question de la fiabilité du matériel, des données et des interprétations qui peuvent être faites en neurosciences est centrale. J’appartiens à une génération qui a toujours connu l’imagerie cérébrale » explique Olivier Oullier103 ; et de souligner que ses attentes et exigences sont élevées en ce qui concerne la qualité du signal et la reproductibilité des données : « l’exigence de qualité des données vaut autant pour le diagnostic médical et la recherche qui se nourrissent mutuellement ».
Or les bases de données se multiplient, de véritables bibliothèques d’images et de modèles se constituent au fil d’expériences très médiatisées, telle celle de Jack Gallant : chaque image est liée à un objet visualisé, afin de reconstituer ce que voit le sujet. La tentation est grande de percevoir ce que l’on souhaite.
Comme l’a rappelé Sylvain Ordureau104, l’IRM produit des images en coupe contenant des pixels colorés en dégradés de gris. Chaque pixel (Picture Element) est une information sur la qualité du signal capté dans sa zone spatiale donnée. Ensuite, l’assemblage des coupes permet de recréer un volume, et par voie de conséquence, le corps du patient. Cette représentation est donc une abstraction mathématique qui dépend de celui qui la constitue.
La précision dépend de la machine, de l’opérateur et de la préparation du patient. L’échelle de mesure est souvent insuffisante avec les IRM à 1,5T (les plus courantes). Aussi, est-il tentant d’augmenter la puissance du champ magnétique pour obtenir des images plus fines, ce que la mission a constaté dans la plupart des laboratoires de recherche. Cependant il faut prendre garde aux risques potentiels de toxicité magnétique décrits plus haut.
Sylvain Ordureau explique que suivant le seuil choisi par l’observateur pour effectuer la mesure, les résultats sont différents, induisant des risques de biais et d’erreur dans l’évaluation de la mesure. « Si l’on suit l’exemple de l’image d’un corps calleux, se posent les questions suivantes : l’épaississement du corps calleux est-elle due à la diminution du nombre de neurones, ou à une modification de la vascularisation, ou à l’augmentation des fibres nerveuses ? Pour donner une signification au résultat, il faudrait soit recourir à des prélèvements, soit utiliser des machines encore plus précises. On est encore très loin du compte ».
Vos rapporteurs ont constaté le grand intérêt des chercheurs mais aussi des cliniciens pour des outils performants extrêmement sophistiqués et fort coûteux. Ils comprennent ce souci mais ils s’interrogent pour savoir qui pourra y accéder. Qui a la capacité de maintenance ? Qui a la capacité d’analyser les données de ces prototypes si ce n’est le constructeur lui-même ?
C- LA VARIABILITÉ DES DONNÉES ET L’INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
Il n’est pas rare que pour une personne donnée, en utilisant le même appareil, l’on constate après très peu de temps d’intervalle une variation inexplicable de l’image. Cette variabilité peut constituer une source d’information autant pour le cerveau lui-même que pour le chercheur qui analyse les données, ce qui doit être pris en considération dans les interprétations.
Pour Lionel Naccache105, le développement de ces techniques ne s’accompagne pas d’un appauvrissement de l’expertise clinique…Plus on développe ces outils, plus les besoins d’expertise se font sentir. « Avec une IRM, on observe beaucoup de choses. Or la relation entre ce que l’on voit sur une image et ce que le patient présente est encore plus difficile à comprendre que lorsque l’on ne disposait pas du tout d’images ou bien d’images de moins bonne qualité, comme avec le scanner. Le développement de ces techniques présuppose un développement d’une expertise de compétence clinique ». Selon lui, mettre en relation des images avec ces symptômes n’a rien d’évident. Il ajoute « bien souvent, les tests fonctionnels n’ont de valeur que s’ils sont positifs. Si un test est négatif, on ne peut bien souvent pas en dire grand-chose ».
En IRMf, par exemple on mesure un changement de signal, ce qui n’est pas une mesure directe de l’activité cérébrale, mais une estimation indirecte de la consommation d’énergie, induite par des modifications du champ magnétique. Ces estimations, souvent calculées par contraste, postulent que plus un réseau cérébral travaille, plus il consomme d’oxygène. Selon Yves Agid106, « On mesure un débit sanguin central dans des capillaires qui reflètent une activité neuronale et non l’inverse. Les neurones étant, pour moi, des routes : un neurone comprend des terminaisons nerveuses, des dendrites, un corps cellulaire, et des cellules gliales, qui sont plus représentées dans le cerveau que les neurones. L’autre problème lié à la machine est celui du signal sur un bruit de fond.»
La plupart des spécialistes observent que, s’agissant des biais et des limites liés à l’utilisation de la neuroimagerie, il faut savoir que celle-ci ne représente qu’un reflet (un corrélat), très éloigné du fonctionnement neuronal. On mesure des voxels107, (pixel en trois dimensions) par informatique. Des interprétations sont effectuées en fonction des différents stades de l’utilisation de l’outil mathématique. La responsabilité de l’utilisateur est donc majeure. Olivier Oullier108 note que de nombreuses études utilisant l’IRMf portent sur des échantillons de moins de quarante personnes recrutées dans des campus nord-américains. Les résultats de psychologie et de neurosciences cognitives souvent généralisés, sont généralement obtenus sur des populations d’étudiants qui ne sont donc pas forcément représentatifs de la population globale. Ce manque de représentativité vaut pour des tâches aussi différentes que la perception visuelle, la catégorisation, l’induction ou le raisonnement moral. On réalise ainsi que certains traits psychologiques, que beaucoup considèrent comme universels ou invariants, sont en fait particuliers à un groupe de sujets et non généralisables sur la seule base d’une expérience de laboratoire.
1- Quelles représentations de quelles images ?
Certes l’IRM et de l’IRMf sont toutes les deux des modalités qui permettent de « voir » à l’intérieur du corps humain, mais pour reprendre la métaphore utilisée par Sylvain Ordureau109, l’IRM peut être assimilée à une vue aérienne diurne qui renseigne sur la topographique c'est-à-dire l’anatomie du cerveau. L’IRMf, qui informe sur l’activité des zones survolées produit une vue nocturne, comparable à la « fonction ». Ainsi « Un manque d’éclairage peut montrer que le terrain est inhabité ou qu’il y a une absence d’activité. Les lumières générées par une circulation d’automobiles peuvent donner une indication sur la densité du trafic. C’est le propre de l’IRMf que de visualiser les activités cérébrales ainsi que certaines déficiences dans les cas de pathologies du cerveau ».
Selon Yves Agid : «s’agissant des biais particuliers de l’IRMf, se pose la question de l’illusion pour mesurer ce qu’est une pensée. Si on lit les philosophes, les psychologues, les médecins et les scientifiques, on s’aperçoit que chacun a sa définition. On peut mesurer ce qui se produit au sein des routes neuronales, dans les cellules nerveuses, mais on n’a pas accès au contenu sémantique. De plus, on ne parle pas des autres cellules nerveuses.
Enfin, ce n’est pas parce qu’un comportement se traduit par une image que la mise en évidence de cette image traduit un comportement. De surcroît, ce n’est pas nécessairement l’endroit qui est le plus activé dans le cerveau qui traduit l’importance fonctionnelle. Comme il s’agit de réseaux de neurones qui sont topographiquement organisés, mettant en jeu l’ensemble du cerveau, l’important sur le plan fonctionnel peut être ce qui se trouve à distance, de manière indirecte et atténuée. Cela se passe comme dans les journaux : vous faites part d’une information, certains journalistes s’emparent du plus apparent, alors que tel n’est pas le sens du message, qui apparaît de manière plus discrète.
En résumé, la neuroimagerie reflète ce qui se passe dans le cerveau au niveau des routes cérébrales, que sont les neurones, mais ne met pas en évidence la sémantique. Le fantasme est là. Il faut être très prudent. Cela dit, « images don’t lie but people lie ».
Cependant des expériences récentes dont la presse s’est faite l’écho, laissent entrevoir des possibilités non pas de caractériser des comportements, mais de visualiser des images reconstruites par l'ordinateur après décryptage de leur activité cérébrale par décodage des signaux cérébraux. Une étude publiée dans la revue scientifique américaine "Current Biology"110, explique comment l’équipe de Jack Gallant111 a scanné l'activité cérébrale de trois individus, pendant que ceux-ci visionnaient des vidéos. L'activité des flux sanguins dans le cortex visuel des volontaires, soit dans la partie du cerveau qui traite les images, a ensuite été convertie en modèles informatiques. Les modèles informatiques reconstruisant en retour des reproductions floues des images visionnées.
Comment l’équipe de Jack Gallant a-t-elle procédé ? D’après les explications qu’il a lui-même transmises à vos rapporteurs, ce travail fait suite à des expériences plus anciennes. La « reconstruction » s’opère en plusieurs étapes. Les volontaires ont dû regarder des vidéos de 10 à 20 secondes, et ce pendant une à deux heures, le temps qu'un scanner IRM enregistre leur activité cérébrale. Un dictionnaire est construit en fonction des signaux relevés, permettant d’établir une corrélation entre un schéma cérébral donné et des formes, contours ou mouvements apparaissant dans les vidéos. Celui-ci est scindé en des milliers de sections, pour chacune des zones cérébrales mesurées. Le dictionnaire est testé sur un nouvel échantillon de plusieurs heures de vidéo pour confirmer sa pertinence. Une bibliothèque constituée d’environ 18 millions de secondes de vidéo (plus de 6 mois de film), est constituée en récupérant des vidéos aléatoirement sur You Tube. Grâce au dictionnaire prédictif créé avant l’expérience, un échantillon des 100 séquences vidéo les plus proches est sélectionné. Une opération de superposition donne alors la « reconstruction » correspondante. Malgré des défauts évidents, cette première approche est un moyen de montrer que le système fonctionne, mais on s’interroge cependant sur l’interprétation des images. D’après Jack Gallant, les limites du système proviennent seulement de celles des outils de mesure utilisés, incapables pour le moment d’observer directement l’activité des neurones (seule la pression sanguine, en corrélation, bien que moins précise, avec cette activité, est mesurée). La capacité de décodage est-elle seulement freinée par ce que l’on comprend de ces informations ? Toujours est-il que cette expérience semble être une avancée.
2- Les sources de la variabilité
D’après Olivier Oullier112, une première source de variabilité peut tenir à l’appareil lui-même, une autre à des interférences pendant la collecte des données (signal, rapport signal/bruit, dérives temporelles, artéfacts, ...). S’y ajoutent les éventuels mouvements du sujet dans l’appareil ainsi que le bruit, l’inconfort du sujet. Il souligne par ailleurs que l’on observe « un changement de signal qui, en IRMf, n’est pas une mesure directe de l’activité cérébrale proprement dite, mais une estimation de la consommation d’énergie, elle aussi indirecte suite à des modifications du champ magnétique. De plus, ces estimations, souvent calculées par contraste, s’effectuent sur la base du postulat suivant : un « réseau cérébral qui travaille plus, consomme plus d’oxygène », et du droit de comparer cette consommation entre deux parties du cerveau –qui ont de forte chances de ne pas avoir la même concentration de neurones, par exemple ».
Dès lors, rechercher le centre d’une activité ou d’un comportement dans le cerveau reviendrait, selon lui, à faire l’hypothèse que le cerveau fonctionnerait de manière très localisée et spécialisée. Il décrit une étude où cinq volontaires ont été scannés par neuf scanners IRMf différents dans lesquels ils ont réalisé la même tâche, un jour donné puis le lendemain. Les résultats révèlent une variabilité pouvant être élevée d’un appareil à l’autre dans la qualité des données brutes113. Une recherche bibliographique sur les questions de reproductibilité et de variabilités des mesures d’IRMf montre, selon lui, l’absence de consensus dans un sens comme dans l’autre : les résultats sur la variabilité inter- et intra-sujet étant eux aussi très variables ! Or tout mouvement influe sur le signal. Olivier Oullier de s’étonner : « Bien qu’elles soient centrales, ces questions n’ont pas été traitées au même niveau dans la littérature (neuro)scientifique que les éventuels liens entre activité cérébrale et comportement, par exemple. Cela n’est pas sans conséquence dans l’appréhension sociétale des applications, effectives ou fantasmées, de l’utilisation au quotidien de l’imagerie cérébrale ».
La capacité d’adaptation du cerveau à court terme grâce aux processus d’apprentissage peut induire une différence d’activité cérébrale enregistrée quand un individu effectue une tâche au temps T ou au temps T+1.
Vos rapporteurs n’en concluent pas que les mesures ne sont pas fiables, mais il convient de prendre la variabilité constatée en compte dans les modèles et dans les interprétations, surtout quand ces dernières sont généralisées. Il s’agit d’évaluer les pratiques en tenant compte des limites des appareils utilisés et d’informer le public, car la plus grande prudence s’impose quant aux extrapolations hasardeuses fondées sur des expériences limitées à un échantillon trop restreint ; chaque individu doit être appréhendé dans sa singularité.
Recommandations :
- Établir des guides de bonnes pratiques médicales sur le fonctionnement et l’utilisation des appareils d’imagerie incluant les limites de ces technologies ;
- Mettre en place, au moins au niveau national, une démarche d’évaluation des technologies d’imagerie innovantes, sur la base du retour d’expérience des utilisateurs ;
- Informer clairement le public sur les possibilités et limites de l’imagerie médicale et sur l’indispensable recours aux seuls praticiens médicaux pour garantir une lecture et une interprétation correctes des résultats.
CHAPITRE IV :
APPLICATIONS POTENTIELLES ET ENJEUX ÉTHIQUES ET SOCIÉTAUX
Où en sommes-nous concrètement au XXIème siècle ? Comment ces recherches aux enjeux multiformes qui suscitent les interrogations des scientifiques eux-mêmes interagissent-elles avec les attentes d’une société espérant à juste titre des traitements pour des pathologies lourdes et difficiles à vivre ? Dans quelle mesure les neurosciences rendent-elles compte des conduites humaines ? Comment gérer la gourmandise technologique qui s’est emparée pour le meilleur et pour le pire d’une partie de la société face à des avancées susceptibles d’étendre artificiellement des capacités cognitives, de réguler l’humeur mais aussi d’accroître le contrôle économique et social des individus ? Comment définir la frontière entre soin et amélioration, entre homme réparé, et homme augmenté ? Comment les législateurs que nous sommes doivent-ils gérer les dérives possibles tout en sauvegardant la liberté de la recherche ? Comment réguler sans entraver ?
I- DES APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES EN GESTATION
Les nouvelles technologies utilisées ces dernières années ont certes permis à la médecine de faire des progrès considérables, mais demeurent encore largement au stade des premières applications, souvent expérimentales, et sont appelées à connaître d'importants développements. Il est d'autant plus nécessaire d'y réfléchir que le législateur ne peut pas simplement se contenter de s'adapter aux évolutions de la science, mais doit s'efforcer d'en prévenir les dérives éventuelles.
A- LA DIFFICILE RECHERCHE DES CAUSES DES MALADIES
Grâce aux nouvelles technologies, l'étude du système nerveux passe par de multiples approches qui suivent deux grandes directions : une approche ascendante (ou bottom-up) qui étudie les éléments de base du système nerveux pour essayer de reconstituer le fonctionnement de l'ensemble, et une approche descendante (top-down) qui, en étudiant les manifestations externes du fonctionnement du système nerveux, tente de comprendre comment il est organisé et comment il réagit. On s’efforce donc d’analyser pour mieux soigner les mécanismes intimes de la vision, de l’audition, du langage, mais aussi ceux de la mémoire, de la cognition, de la décision etc …aussi bien chez les sujets sains que les sujets malades.
Les possibilités offertes par les techniques décrites nourrissent la recherche sur les causes majeures et les origines des maladies neuropsychiatriques. Elles contribuent pour certaines à en atténuer les effets délétères, grâce aux possibilités de stimulation et /ou d’interface homme/machine, cerveau/machine. Mais comme le reconnaissait Yehezkel Ben-Ari114 « en neurologie, on ne disposera pas demain d’une molécule type aspirine .. Il convient d’accepter nos limites, d’éviter les communications intempestives qui dominent et ont la durée de vie d’un soupir. Le problème est compliqué et prend du temps ».
Selon Jean-Pierre Changeux,115 il est nécessaire « de poursuivre l'identification des composants chimiques universels du cerveau de l’homme, afin de concevoir et construire des agents pharmacologiques ciblés sur ces composants élémentaires. » Or, on le constate malgré la mobilisation mondiale contre certaines maladies neurodégénératives, telles que la maladie d’Alzheimer, le remède n’est pas pour demain. La neuroimagerie performante, quand elle rend compte de l’évolution de certaines maladies neurodégénératives, voire en prédit l’apparition, n’a pas encore permis la mise au point de molécules nouvelles.
1- La faible implication des grands groupes pharmaceutiques
Vos rapporteurs ont noté combien les recherches sur les causes neurobiologiques de la maladie d’Alzheimer et de la maladie de Parkinson mobilisent les équipes de par le monde. Les recherches se poursuivent pour comprendre les mécanismes de ces pathologies et en bloquer les effets. Pour autant, les grands groupes pharmaceutiques ne semblent pas très impliqués, à la différence des industriels de l’imagerie et de la robotique.
Pour Jean-Pierre Changeux : « Si on examine comment s’effectue actuellement la recherche de nouveaux médicaments par les grandes sociétés pharmaceutiques (d’abord motivées, selon moi, par le profit immédiat sans intérêt autre que financier pour les besoins de santé à court et à long terme de nos sociétés), on constate malheureusement un déclin de la synthèse de nouveaux médicaments et de leur mise sur le marché. Pour des pathologies comme la maladie d’Alzheimer, la schizophrénie ou la dépression qui concernent un très grand nombre de personnes, il n’y a pas ou très peu de médicaments nouveaux. Il n’en existe aucun pour la maladie d’Alzheimer. Pour la schizophrénie, les neuroleptiques existants, sont insuffisants ». Il ajoute « À cet égard, ce qui se passe en ce moment, est catastrophique pour la qualité de vie de nos sociétés ». Ce constat est partagé par la plupart des experts rencontrés en France et à l’étranger.
2- Réexaminer les conditions d’autorisation de mises sur le marché ?
Jean-Pierre Changeux estime que cette situation induit des interrogations sur la relation bénéfice/risque, car l’action de nouveaux médicaments agissant sur le système nerveux s’accompagne d’effets secondaires indésirables, lesquels sont acceptés pour les médicaments anticancéreux utilisés en chimiothérapie, mais pas lorsqu’il s’agit d’agents pharmacologiques actifs sur le cerveau. Selon lui, « il devient nécessaire pour les maladies neuropsychiatriques très invalidantes de réexaminer, avec toutes les précautions éthiques nécessaires les risques d’effets secondaires éventuels, au-delà d’un inadéquat « principe de précaution ».
Vos rapporteurs s’interrogent sur les suggestions de Jean-Pierre Changeux : faut-il reconsidérer la notion de bénéfice/risque inadéquate dans le traitement des pathologies neurodégénératives, mais aussi dans certaines pathologies psychiatriques très invalidantes ? La proposition mérite débat car il s’agit en réalité, d’établir des conditions spécifiques d’essais de développement de nouvelles molécules susceptibles d’être efficaces, avec des effets secondaires potentiels, sur des personnes dont le consentement peut ne pas être éclairé. Néanmoins, ils estiment utile de rappeler cette suggestion émanant d’un ancien président du CCNE.
Propositions de Jean-Pierre Changeux :
- Établir des conditions raisonnables et éthiques de développement de la recherche, dans la conception des nouveaux médicaments et de leur mise sur le marché.
- Mettre en place une Grande Fondation Internationale de droit privé et reconnue d’utilité publique, consacrée à la conception, au développement et à la mise effective sur le marché de médicaments ciblés sur les pathologies du cerveau de l’homme.
Dès lors en l’absence de nouvelle molécule que soigne-t-on, et comment soigne-t-on ?
B- QUE SOIGNE-T-ON ? LES PATHOLOGIES CONCERNÉES
En France, une amélioration de la prise en charge des maladies neurodégénératives, se dessine lentement grâce à quelques découvertes comme le traitement de la maladie de Parkinson par stimulation cérébrale profonde, le développement des biomarqueurs. Toutefois a admis Bernard Bioulac,116 des efforts sont nécessaires et indispensables pour lutter contre les pathologies psychiatriques. On note des avancées louables qu’il faudra pérenniser.
Pour lutter contre la maladie d’Alzheimer et certaines pathologies neurodégénératives, le Président de la République a lancé le 1er février 2008, le Plan national maladie d’Alzheimer et maladies apparentées. En novembre 2007, il a été décidé de faire de cette pathologie une grande cause nationale, un enjeu de santé publique majeur. Quatre grands axes de ce plan ont été déterminés : mieux connaître la maladie, mieux prendre en charge les malades et leur famille lors du choc de la survenue de la maladie, améliorer la qualité de vie des patients et des aidants dans la durée, satisfaire une exigence éthique, en privilégiant l’intégration des patients. Les moyens financiers sont ambitieux : 1,6 milliard d’€ sur 5 ans dont 1,2 milliard d’euros pour le médico-social, 200 millions d’euros pour la recherche, 200 millions d’euros pour les soins.
Le plan contient 44 mesures dont une dizaine de mesures phares applicables à d’autres pathologies. Ainsi on relève : la mesure n°1 développement et diversification des structures de répit ; la mesure n°8 : élaboration et mise en œuvre d’un dispositif d’annonce et d’accompagnement, la mesure n°6 : renforcement du soutien à domicile, en favorisant l’intervention de personnels spécialisés, la mesure n°10 : promouvoir une réflexion et une démarche éthique avec la création d’un espace de réflexion éthique sur cette maladie, le lancement d’une réflexion sur le statut juridique de la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer, avec l’organisation régulière de rencontres autour de la thématique de l’autonomie de la personne, la mesure n°41 : information des malades et de leurs proches sur les protocoles thérapeutiques en cours en France, la mesure n°16 : création ou identification, au sein des établissements d’hébergement hospitaliers pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), d’unités adaptées pour les patients souffrant de troubles comportementaux, la mesure n°19 : identification d’un « centre national de référence pour les malades Alzheimer jeunes » pour aider plus et mieux, la mesure n°21 : création d’une fondation de coopération scientifique pour stimuler et coordonner la recherche scientifique
C’est ainsi que le Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a créé en juin 2008, la « Fondation Plan Alzheimer », fondation de coopération scientifique à but non lucratif reconnue d’utilité publique conformément à la loi de programmation de la recherche de janvier 2006.
L’objectif de la Fondation est de coordonner et d’animer l’effort de recherche, tant public que privé. Elle assure la programmation de la recherche sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées, et affiche des objectifs ambitieux : créer une dynamique nationale et internationale de recherches collaboratives du fondamental aux prises en charge, densifier le réseau des chercheurs publics et privés par une politique attractive, installer des infrastructures de recherche fondamentale, clinique et para clinique performantes, favoriser les interactions avec les industries de la santé pour réduire les temps de développement des traitements.
Elle dispose de 40 millions d’euros en pilotage direct, de 25 millions d’euros en partenariat privé, de 5 millions d’euros par an de l’Agence nationale de la recherche au titre des programmes maladies neurologiques, maladies psychiatriques, de 3 à 6 millions d’euros par an au titre du programme universitaire de recherche clinique (PHRC). La Fondation est hébergée par l’AVIESAN et rattachée à l’Institut thématique multi organismes (ITMO) « Neurosciences, Sciences cognitives, Neurologie, Psychiatrie ».
Depuis Mai 2011, la Fondation est dirigée par Philippe Amouyel117, qui a été entendu par les rapporteurs. Son constat sur la situation en France est d’un optimisme relatif. Selon lui, la maladie d’Alzheimer reste toujours difficile à diagnostiquer, les prises en charge sont limitées, il y a pas de traitement curatif et peu de voies préventives validées. Ce constat est le même dans chacun des pays visités par la mission. Or on comptait en 2008 : 850 000 malades en France dont 6% de plus de 65 ans, 20 % de plus de 80 ans, une famille sur trois concernée, des prises en charge limitées avec un coût social et humain lourd. En 2020 on en compterait 1,3 millions, 16 millions au total dans les plus grand pays industrialisés.
Philippe Amouyel souligne le caractère massif du plan et de la programmation conjointe des recherches avec les pays européens pendant la présidence française de l’Union avec un appel à projet de 14, 5 millions d’euros. Ainsi 125 projets ont été financés en 3 ans et demi pour 100 millions d’euros et 149 chercheurs ont été recrutés. Comme au Japon, en Allemagne et aux EÉÉtats-Unis, le bilan de la mobilisation est positif, mais pour l’instant n’a pas abouti à des progrès décisifs. Cependant, les rapporteurs notent avec satisfaction que ce plan prend en considération les enjeux sociétaux, juridiques et éthiques induits par cette pathologie ; en cela il constitue un cadre de référence important qui humanise la prise en charge de cette maladie et place le patient et ses aidants au centre du dispositif. Ce plan constitue une base de référence adaptable pour d’autres maladies neuropsychiatriques.
2- La prise en charge coûteuse et insuffisante des maladies mentales
Pour Marie-Odile Krebs118 et Marion Leboyer119, comme pour la plupart des scientifiques, la psychiatrie est un enjeu majeur de santé publique en France, mais les financements qui lui sont dédiés sont dérisoires. Aussi les recherches en psychiatrie sont-elles peu financées par les organismes publics ou par la générosité du privé. L’absence d’institut français de recherche en psychiatrie à la différence du Maudlsey à Londres, du Karolinska en Suède, démontre que cette recherche est méconnue et oubliée du milieu hospitalo-universitaire, de celui de la communication et de l’information, et du monde politique.
Marion Leboyer a dressé un tableau contrasté et sans concession de la psychiatrie en France. Elle a rappelé que mal connues des Français, ces maladies engendrent peur, rejet et stigmatisation. Elles sont associées à la folie et à la violence : 74 % des Français considèrent qu’un schizophrène est dangereux alors que seulement 0,2% des schizophrènes peuvent l’être pour les autres. Leur représentation est fausse car 70 % des Français pensent que ces pathologies ne sont pas des maladies comme les autres. Cependant leurs attentes sont fortes, en termes de dépistage et diagnostic plus précoces, 70 % des Français trouvent que les diagnostics sont portés trop tardivement. Aussi, la recherche, la communication et l’information dans ce domaine sont-elles une priorité de santé publique d’autant que la prise en charge des patients en ville est tardive et insuffisante, induisant des ruptures de traitements nocives.
Ainsi, on ne dispose en France, ni d’épidémiologie psychiatrique, ni de données médico économiques ou de santé publique. De ce fait, on ne bénéficie d’évaluation précise ni sur l’organisation des soins, ni sur leur coût, ni sur les modifications à réaliser. L’absence d’évaluation au niveau sociétal des pratiques a été déplorée par Alain Ehrenberg120 et Pierre-Henri Castel121. Cette carence n’est pas sans incidence sur les violents débats qui agitent actuellement la psychiatrie sur l’autisme. En outre, comme l’a souligné Philippe Vernier122 la dichotomie entre la psychiatrie d’un côté et la neurologie de l’autre, en France ou dans d’autres pays du monde, a fait du tort à ces disciplines, en introduisant une frontière artificielle entre les approches des pathologies cérébrales.
Selon Marie-Odile Krebs, « la diversité des tableaux cliniques et les frontières nosographiques encore incertaines rendent nécessaire, plus que dans tout autre domaine médical, de s’orienter vers une médecine individualisée, tant pour l’estimation des risques évolutifs et que pour la définition des schémas thérapeutiques. C’est l’une des attentes de l’adaptation des nouvelles technologies au champ psychiatrique. »
Elle constate pourtant que des programmes de prévention de la psychose fleurissent dans différents pays, en Europe, en Amérique du Nord et en Australie, et vos rapporteurs l’ont constaté aussi au Japon. La France accuse selon elle dix à vingt ans de retard. Elle suggère de promouvoir ce champ crucial tant sur le plan clinique et de santé publique, qu’en termes de recherche et augmentation des connaissances sur le fonctionnement cérébral et l’amélioration des soins. Cependant elle souligne la difficulté de disposer de critères objectifs pour définir les pathologies pour la psychiatrie. Les travaux de génétique en psychiatrie sont complexes, car rarement répliqués, leur valeur prédictive est faible, certaines anomalies génétiques sont associées à 30 % de troubles psychotiques, mais elles ne permettent pas des programmes de soins, de prévention de santé publique, sans compter que la valeur diagnostique est sujette à caution.
Pour Marion Leboyer, relayée par d’autres experts, on communique mal sur les facteurs de risques quand ils sont connus. La prévention des troubles psychiatriques est donc inexistante. En témoigne l’absence d’action de prévention ciblée sur l’impact de l’usage du cannabis dans la survenue de délires schizophréniques. Or les recherches montrent qu’une prise en charge précoce évite l’aggravation du trouble et sa chronicité, d’autant que des sujets jeunes qui en souffrent, faute d’une prise en charge précoce, voient leur avenir compromis par une maladie chronique, invalidante, et stigmatisante.
Selon Marion Leboyer et Bernard Bioulac123, la France dispose d’atouts avec la création du réseau national thématique de recherche et de soin de santé mentale (FondaMental) en 2007. C’est une fondation de coopération scientifique, qui fédère, sur l’ensemble du territoire, plus de 60 services hospitaliers et laboratoires de recherche avec des centres experts FondaMental. Ses missions portent sur l’amélioration des soins, le développement de la recherche en psychiatrie, la création de formations innovantes pour amplifier le transfert des connaissances et des compétences entre la recherche et le soin, ainsi que sur l’information du grand public et des décideurs pour déstigmatiser les maladies mentales et aider à leur prise en compte à la mesure de l’enjeu de santé publique qu’elles représentent.
La Fondation FondaMental propose un nouveau regard sur les maladies mentales. Elle vise à améliorer la compréhension, le soin et la prévention des maladies. Ses travaux portent prioritairement sur les maladies psychiatriques parmi les plus invalidantes : les troubles bipolaires, la schizophrénie, l’autisme de haut niveau (ou syndrome d’Asperger), les dépressions résistantes, les conduites suicidaires et les psychotraumas. Malgré ces difficultés, des résultats encourageants ont été obtenus en psychiatrie génétique et neuroimagerie avec l’utilisation de nouveaux biomarqueurs.
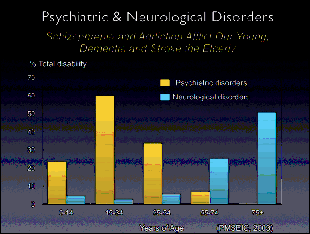
Age d’apparition des troubles psychiatriques
Le réseau FondaMental, réseau national de chercheurs et cliniciens soutenu par le Ministère de la recherche dans le cadre des Réseaux thématiques de recherche et de soins (RTRS)
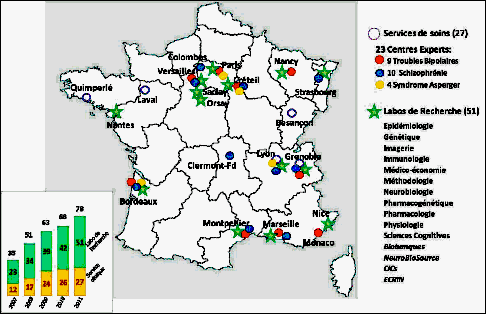
Les rapporteurs considèrent qu’il faut renforcer à tous les niveaux la prise en charge des patients atteints de maladies mentales et neurodégénératives en France en premier lieu en luttant contre la stigmatisation dont ils font l’objet par des actions d’information et de prévention ciblées. Cela implique que les associations de patients, centrées sur une pathologie spécifique, unissent leurs efforts, même si les problématiques de chaque pathologie sont différentes.
Recommandations :
- Mener des études statistiques systématiques sur les pathologies concernées et procéder à une large diffusion de ces données ;
- Développer de nouvelles modalités de prise en charge non stigmatisantes, en particulier par la promotion de centres de référence ;
- Favoriser l’interdisciplinarité dans l’approche de ces pathologies complexes afin d’assurer une meilleure coordination entre la recherche et la clinique ;
- Accroître l’organisation institutionnelle des interactions de la communauté des chercheurs avec celle du monde associatif, représentant les patients et leurs familles ;
- Créer un Institut multidisciplinaire dédié à la recherche sur les maladies mentales pour favoriser la recherche en psychiatrie.
C- QUE DÉTECTE-T-ON ? SAVOIR OU NE PAS SAVOIR
Le décalage de plus en plus grand entre les possibilités de diagnostic précoce et les capacités de traitement entraîne une interrogation sur le sens même de la prédiction et son intérêt. Ce décalage génère de multiples tensions.
1- Quel sens donner au diagnostic de maladies du cerveau ?
Comme l’a souligné Andreas Kleinschmidt124 : « On se trouve donc face à un problème éthique important, qui tient à la dissociation entre notre capacité de diagnostic et nos moyens de traitement. N’est-il pas problématique de s’orienter vers une médecine prédictive ? Ainsi, si l’on peut, grâce à l’étude génétique ou avec d’autres biomarqueurs, prédire les risques de survenue de certaines maladies, on n’est pas en mesure d’offrir les moyens de les prévenir.»
Anne Fagot-Largeault 125 pose radicalement la problématique : Elle indique « J’ai lu récemment dans un excellent article du journal américain Hastings Center Report, qui est selon moi, le meilleur journal pour l’information et la réflexion bioéthique, que, si l’on est en mesure de faire de bons et fiables diagnostics précoces sur les maladies neurodégénératives, alors on doit prévoir l’augmentation des demandes de suicide assisté ». Elle ajoute que « si on veut éviter une épidémie de suicides tout en continuant d’améliorer la performance diagnostique, il faut réfléchir aux problèmes de société qui résulteront de ces diagnostics à la fois plus fins et plus précoces ».
Quel sera le devenir de sociétés démocratiques dans lesquelles une partie de la population âgée sera consciente de vivre avec une maladie dégénérative ? Elle suggère de réfléchir à la manière d’inclure ces personnes dans la vie démocratique.
Selon Hervé Chneiweiss126, « on se trouve encore dans une incertitude scientifique, or les appareils deviendront de plus en plus disponibles fournissant des diagnostics plus sûrs. Aujourd'hui, ils sont en nombre restreint, et l’on se trouve encore dans une dimension aléatoire, avec une potentialité. Est-ce qu’on mettra toute la population sous surveillance ou sous examen ? » C’est bien en cela que, comme la génétique, la neuroimagerie, en ce qu’elle peut révéler la survenue de maladies neurodégénératives, risque d’entraîner des situations de grande détresse.
Par ailleurs, les tests de dépistage précoce suscitent également de nombreuses interrogations. Selon Jean-Pierre Changeux127, « Le problème central devient la prise en charge précoce de l’enfant chez lequel le déficit a été identifié très tôt. Un diagnostic précoce est particulièrement important si l’on veut arriver à une meilleure prise en charge. Cela se vérifie pour le traitement de la dyslexie, mais cela est également plausible dans le cas de la schizophrénie pour laquelle la pharmacologie de l’adulte est insuffisante du fait d’une prise en charge trop tardive. Pour progresser, il faudrait effectuer, des diagnostics génétiques précoces, afin de concevoir de nouveaux agents pharmacologiques qui puissent agir très tôt sur le développement synaptique lui-même, mais ceci reste un problème considérable à la fois scientifique et éthique. Bien des troubles du cerveau adulte se développent en effet au cours des dix premières années de la vie ». Cet avis est partagé par Marion Leboyer128 et Stanislas Dehaene129, et par les experts japonais rencontrés par vos rapporteurs.
Cependant comment dépister précocement des risques de troubles mentaux sans stigmatiser ? Cela ne peut se faire qu’en dédramatisant certaines pathologies mentales par une information appropriée vis-à-vis du public.
2- Comment procéder lors de la découverte fortuite d’une pathologie sur une personne en bonne santé?
Comment procède-t-on quand on découvre fortuitement une pathologie chez une personne en bonne santé qui est dans un protocole de recherche ? Comme l’a expliqué Yves Agid130 : dès que les personnes ont donné leur consentement, on se retrouve face à quatre situations :
- L’IRM cérébrale est normale ; à ce moment-là, il ne se passe rien de spécial.
- On trouve une petite anomalie, dont on sait qu’elle n’est pas évolutive. La proposition est de ne rien dire.
- On découvre une anomalie sur laquelle on hésite un peu. Elle a l’air bénigne, elle n’a pas l’air grave, mais cela demanderait peut-être une exploration. À ce moment-là, on rassure le patient. On lui explique: « écoutez, il vaudrait peut-être mieux faire une IRM de comparaison, je vous conseille d’aller voir votre médecin ».
- On trouve par exemple un gliome, une tumeur potentiellement évolutive. À ce moment-là, et ce doit être écrit dans le consentement, on prévient le patient, on organise une visite médicale. Mais comment agir si l’on trouve trace d’une maladie incurable, et que le sujet de l’expérience refuse expressément de savoir ?
On retrouve les débats qui ont eu lieu sur la génétique et la question de l’information du malade : faut-il l’informer que, grâce à l’imagerie cérébrale, on a pu détecter une maladie neurologique qui se développera peut-être de nombreuses années après l’examen subi ? Quels sont les traitements et la prévention possibles ? S’ils existent, il faut sans aucun doute l’en informer. Comment les diagnostics prédictifs pour certains troubles sont-ils reçus par les patients et leurs familles, alors qu’aucun traitement n’existe ?
Quid des effets du dépistage précoce quand il n’y a pas de remède (maladie d’Alzheimer par exemple) et qu’un risque de stigmatisation existe ? Quelle information donner au malade et à sa famille ? Existe-t-il un droit de ne pas savoir, de ne pas être mis au courant d’un mal qui vous frappera peut-être dans plusieurs années, alors qu'on n’a aucune certitude sur le développement futur de la maladie, car des facteurs environnementaux, comportementaux ou autres peuvent intervenir ? Ces questions d'éthique médicale et sociétale sont très délicates à trancher pour le médecin dans sa relation individuelle avec le malade. Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) s’est penché à diverses reprises sur ces problèmatiques, et vos rapporteurs ont été fréquemment en contact avec plusieurs de ses membres pendant l’étude.
a- L’avis du Comité consultatif national d’éthique CCNE n° 25
Le Comité consultatif national d’éthique a rendu en juin 1991 un avis n° 25 fort nuancé à ce sujet. « Il faut tenir chaque sujet au courant des éventuels résultats et l'informer clairement de leur signification. Mais la connaissance peut limiter l'autonomie de l'individu. Ce peut être la connaissance d'être porteur du gène muté, donc d'être atteint dans l'avenir (chorée de Huntington). Il peut donc refuser d'avoir connaissance des résultats. Plus complexe pourra être la connaissance d'une probabilité, c'est le cas des gènes de "susceptibilité". Un sujet chez lequel est mis en évidence un gène de susceptibilité à un cancer ou à une maladie neuropsychiatrique, sans autre conséquence que des examens systématiques pour transformer, éventuellement et après combien de temps, la probabilité en certitude, sera-t-il autonome ? Il peut se poser la question de l'opportunité de communiquer les résultats d'un caractère du génome qui conduirait seulement à une évaluation probabiliste d'un risque d'une affection grave sans qu'aucune conduite préventive efficace ne puisse être conseillée et entreprise.»
b- La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
La CNIL a eu l’occasion de se prononcer sur ce type de questionnement dans le cadre de l'examen d'un projet de collecte des données des patients transfusés de la base FranceCoag, qui est sous la responsabilité de l'Institut de veille sanitaire (InVS) et qui collecte l’ensemble des informations recueillies sur les patients ayant subi une transfusion sanguine. Les responsables de la base ont interrogé la CNIL pour savoir s’ils pouvaient collecter les données relatives aux lots de sang, qu’auraient pu recevoir des patients, émanant de malades qui auraient développé par la suite la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Il n'est pas sûr que cette maladie soit transmissible à l’homme et il n'existe aucun traitement préventif ni curatif. Finalement, la CNIL a non seulement autorisé la collecte et le traitement des données, mais elle a aussi accordé une dérogation à l’information individuelle des patients ; elle a en revanche exigé qu'une information collective soit faite par voie de presse et média pour permettre aux patients transfusés qui le souhaitent de venir poser la question individuellement sur leur cas.
c- La loi du 7 juillet 2011
La loi relative à la bioéthique du 7 juillet 2011 règle en partie le problème délicat du droit de savoir ou de ne pas savoir et de l’information de la parentèle en cas de découverte d’une anomalie génétique. Le texte tente de concilier les droits et devoirs de chacun, il devrait pouvoir servir de référence.
Le nouvel article L. 1131-1-2 du code de santé publique dispose : « Préalablement à la réalisation d'un examen des caractéristiques génétiques d'une personne, le médecin prescripteur informe celle-ci des risques qu'un silence ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés si une anomalie génétique grave dont les conséquences sont susceptibles de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins était diagnostiquée. Il prévoit avec elle, dans un document écrit qui peut, le cas échéant, être complété après le diagnostic, les modalités de l'information destinée aux membres de la famille potentiellement concernés afin d'en préparer l'éventuelle transmission. Si la personne a exprimé par écrit sa volonté d'être tenue dans l'ignorance du diagnostic, elle peut autoriser le médecin prescripteur à procéder à l'information des intéressés dans les conditions prévues au quatrième alinéa.
En cas de diagnostic d'une anomalie génétique grave, sauf si la personne a exprimé par écrit sa volonté d'être tenue dans l'ignorance du diagnostic, l'information médicale communiquée est résumée dans un document rédigé de manière loyale, claire et appropriée, signé et remis par le médecin. La personne atteste de cette remise. Lors de l'annonce de ce diagnostic, le médecin informe la personne de l'existence d'une ou plusieurs associations de malades susceptibles d'apporter des renseignements complémentaires sur l'anomalie génétique diagnostiquée. Si la personne le demande, il lui remet la liste des associations agréées en application de l'article L. 1114-1.
La personne est tenue d'informer les membres de sa famille potentiellement concernés dont elle ou, le cas échéant, son représentant légal possède ou peut obtenir les coordonnées, dès lors que des mesures de prévention ou de soins peuvent leur être proposées.
Si la personne ne souhaite pas informer elle-même les membres de sa famille potentiellement concernés, elle peut demander par un document écrit au médecin prescripteur, qui atteste de cette demande, de procéder à cette information. Elle lui communique à cette fin les coordonnées des intéressés dont elle dispose. Le médecin porte alors à leur connaissance l'existence d'une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner et les invite à se rendre à une consultation de génétique, sans dévoiler ni le nom de la personne ayant fait l'objet de l'examen, ni l'anomalie génétique, ni les risques qui lui sont associés.
Le médecin consulté par la personne apparentée est informé par le médecin prescripteur de l'anomalie génétique en cause.
Art. L. 1131-1-3.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 et à l'article L. 1111-7, seul le médecin prescripteur de l'examen des caractéristiques génétiques est habilité à communiquer les résultats de cet examen à la personne concernée ou, le cas échéant, aux personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 1131-1. »
Il reste que cette disposition est complexe car elle tend à un équilibre entre secret médical, droit de savoir ou de ne pas savoir, et information possible de la parentèle quand cela est utile et nécessaire ; elle ne résout pas totalement le problème des découvertes fortuites que permet l’imagerie et des répercussions éventuelles sur la parentéle.
Par ailleurs l’article L. 1134-1 du code de la santé publique introduit par la loi précité prévoit qu’ « un arrêté du ministre chargé de la santé définit les règles de bonnes pratiques applicables à la prescription et à la réalisation des examens d'imagerie cérébrale à des fins médicales. Ces règles tiennent compte des recommandations de la Haute Autorité de santé. »
Les rapporteurs souhaitent que cet arrêté soit publié rapidement et prenne en compte les questionnements décrits.
Recommandations :
- Publier rapidement l’arrêté mentionné à l’article L.1134-1 du code de la santé publique (loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique) qui prévoit la définition de bonnes pratiques applicables à la prescription et à la réalisation des examens d'imagerie cérébrale à des fins médicales ;
- Établir des guides de bonnes pratiques médicales visant à assurer une information adaptée des patients et personnes acceptant de se soumettre à des traitements ou recherches par imagerie ;
- Aider les médecins dans l’éthique de la pratique médicale (droit de savoir ou non, à qui communiquer les résultats, comment …).
D- LES INTERROGATIONS INDUITES PAR CERTAINS TRAITEMENTS
Le chercheur raisonne d'abord en micro-éthique, au cas par cas, et le juriste doit raisonner sur un système de valeurs, un encadrement, qui doit respecter l'égalité d'accès aux nouvelles technologies. Jean-Didier Vincent131, a rappelé les problèmes posés par le traitement par électrochocs : « En mai 1968 on condamnait violemment les psychiatres qui le pratiquaient alors que c'est la seule façon de calmer les souffrances immenses de certains patients déprimés et suicidaires. A l'époque, on ignorait la façon dont cela agissait, quelques hypothèses étaient avancées. Aujourd'hui, on commence à savoir à quel niveau de transduction, quels enzymes et quels gènes sont sollicités. La neurogénèse du cerveau offre aussi une explication... Ces lacunes dans la connaissance ont de bons côtés : tant qu'on ne trouve pas grand-chose, on ne risque rien, hormis quelques dérives momentanées. Mais il est probable que la science arrivera à un stade que nous ne pouvons pas concevoir actuellement et où l'on disposera de moyens d'intervention sur le cerveau dont nous ne pouvons avoir idée. C'est alors qu'il faudra faire très attention. »
C'est là encore reposer la question de la frontière entre actions de rétablissement et améliorations des fonctions. C’est aussi poser la question de la modification des comportements. C’est également s’interroger sur la valeur du consentement éclairé dans des cas limites. Didier Sicard132 a évoqué le consentement éclairé en psychiatrie : « Il est le concept le plus difficile qui soit… La guérison d’un symptôme par une neurostimulation est source d’un bénéfice considérable pour un grand nombre de personnes mais peut créer des états dépressifs chez d’autres... Il faut se méfier d’une sorte de réparation générale de tous les symptômes qui seraient toujours suivis d’un réel soulagement. Si, pour les troubles moteurs, on peut imaginer qu’on est dans la bienfaisance, quand on approche de la psychiatrie, cela s’avère plus compliqué. »
Dans le domaine de la stimulation cérébrale profonde qui a permis des progrès considérables dans le traitement de certaines pathologies, au premier rang desquelles la maladie de Parkinson, Bernard Bioulac133, reconnaît que des questions éthiques essentielles méritent d’être posées : « Par la stimulation, nous savons que nous interagissons sur la dynamique du réseau, mais nous ignorons ce qui se passe exactement. Il faut approfondir les connaissances par la recherche fondamentale avec des modèles et des préparations simplifiées pour arriver à une meilleure compréhension de l'écoulement du courant électrique dans les réseaux du système nerveux. Le courant est vraisemblablement distribué parallèlement dans l'ensemble du système nerveux, agissant de façon prévalente sur un réseau particulier mais également ailleurs. Cette question me préoccupe beaucoup, car elle a obligatoirement des interférences éthiques et bioéthiques. Il est important de comprendre ce que l'on fait lorsque l'on accomplit des progrès dans le traitement de l'humain. Comment ces éléments expliquent-ils les progrès ? »
1- L’avis du Groupe européen d’éthique
Dans son avis n° 20 portant sur les implants et tout particulièrement les neuroprothèses, le Groupe européen d’éthique (GEE) soulignait également des risques d’atteinte à la dignité humaine, évidents pour des dispositifs implantés à but professionnel ou d’amélioration de la performance (militaires par exemple), mais également pour les dispositifs à buts médicaux (implants cochléaires chez les enfants sourds).
Le GEE propose d’interdire les implants cérébraux qui pourraient être utilisés « comme fondement d’un cyber-racisme » ; pour modifier l’identité, la mémoire, la perception de soi et la perception d’autrui, pour améliorer la capacité fonctionnelle à des fins de domination et pour exercer une coercition sur les personnes qui n’en sont pas dotées.
2- L’avis n°71 du Comité consultatif national d’éthique
Dès 2002, le CCNE a rendu un avis n° 71 sur la neurochirurgie fonctionnelle d’affections psychiatriques sévères. Cet avis, rendu à la demande du président de la Commission départementale des hospitalisations psychiatriques du Haut Rhin et du Pr Louis-Alim Benabid, portait également sur les implications éthiques liées au développement de nouvelles méthodes de stimulation cérébrale.
Le CCNE a émis un avis favorable à l’utilisation de cette méthode dans la maladie de Parkinson, mais aussi dans les troubles obsessionnels compulsifs résistant aux thérapeutiques habituelles et particulièrement invalidantes.
Toutefois, il souligne la dimension mixte, recherche et soin, de la méthode, « une thérapeutique expérimentale entrant dans le cadre d'un protocole de recherche », et le problème du consentement « d'autant plus facilement obtenu que la souffrance de certains malades peut conduire à une certaine audace non seulement acceptée mais requise (…) Cette facilité paradoxale d'obtention du consentement pourrait se révéler dangereuse d'un point de vue éthique, d'où la nécessité d'un certain encadrement ». Le Comité consultatif national d'éthique préconise l'approbation des protocoles de cette thérapeutique expérimentale par un comité particulier, qui ne serait pas composé seulement d'experts psychiatriques, et dont les décisions nécessiteraient une unanimité absolue. Il ajoute que la psychochirurgie fonctionnelle ne devrait pas être accessible aux troubles psychiatriques dans lesquels l'auto ou l'hétéro-agressivité est importante. « Il ne peut s'agir que d'un soin dont l'intrication avec la recherche implique une notion de consentement très spécifique, validé par un regard extérieur.» Le CCNE décrit les conditions et limites du consentement éclairé dans certains contextes.
À mesure que la stimulation cérébrale profonde semble efficace au stade des essais cliniques pour le traitement de troubles obsessionnels compulsifs majeurs, de dépression cérébrale profonde, ou de syndrome de Gilles de La Tourette, les chercheurs eux-mêmes, tels François Berger134 ou Yves Agid135 s’interrogent ; ils souhaitent connaître leur degré de responsabilité et celui de patients dont le comportement peut être affecté par le traitement. Ils ont dans certains des cas le sentiment d’agir sur la personnalité des patients qui ont accepté le protocole d’essai clinique.
Recommandations :
- Préciser la notion de consentement éclairé pour les patients atteints de troubles légers du comportement ;
- Établir un guide de bonnes pratiques en terme éthique sur l’usage des implants cérébraux ;
- Mettre rapidement en mesure l’Agence de la biomédecine d'effectuer la veille sur les neurosciences que lui confie la loi du 7 juillet 2011.
II- L’AUGMENTATION ARTIFICIELLE DES PERFORMANCES DE L’HOMME RÉPARÉ À L’HOMME AUGMENTÉ
L’amélioration des performances cognitives individuelles (attention, mémoire) semble envisageable. À partir de découvertes sur le traitement des démences, il est concevable d’augmenter la mémoire des individus normaux, de même qu’il est imaginable de diminuer la mémoire négative liée au stress post traumatique, avec un intérêt potentiel pour les soldats ou les secouristes par exemple. Certains médicaments développés pour la dépression ou les troubles du sommeil pourraient être détournés de leur usage primaire en vue, par exemple, d’améliorer « chimiquement » la coopération entre les individus au sein d’un groupe ou d’augmenter les périodes d’éveil en maintenant les capacités d’attention et de concentration.
Ce glissement quelque peu barbare, surfant sur la profonde ambiguïté qui réside entre les notions de santé et de performance, amène à s’interroger. Une culture de l’amélioration se développe et construit ses propres mythologies. On assiste à des entreprises de « cyborgisation » qui remettent en question le devenir de l’homme.
A- LE DOPAGE COGNITIF OU LA NEUROAMÉLIORATION136
À l’heure actuelle, les progrès se poursuivent dans le domaine de la pharmacologie, et les récentes avancées en génétique et en neurosciences étendent le champ des possibles grâce à des technologies telles que la stimulation cérébrale profonde, la transplantation de prothèses neurales. Bien qu’elles soient encore trop invasives pour bénéficier à des individus en bonne santé, ces technologies sont prometteuses et incarnent l’avenir de la neuroamélioration. Intéressant à la fois nos facultés cognitives et affectives ; peut-être serait-il d’ailleurs plus juste de parler de dopage « psychique ».
Dans son ouvrage « L’homme réparé »137, Hervé Chneiweiss dresse un état des lieux alarmant de l’usage détourné de médicaments à des fins d’amélioration cognitive pour accroître la performance artificiellement : une enquête menée auprès d’étudiants américains de 16-17 ans évalue à 20% le nombre de ceux qui utilisent des médicaments destinés à augmenter la vigilance, limiter le sommeil et la résistance au stress.
Ce constat est partagé par Antonio Rangel138 qui estime que ces produits circulent, et que, comme ils sont performants, leur utilisation se généralise sur les campus, et notamment le sien, au risque de modifier les comportements. Les autorités américaines n’ont pas pris conscience des enjeux du développement de l’accès aux drogues pouvant modifier les performances cérébrales de façon ciblée, phénomène en pleine expansion aux États-Unis, notamment dans le milieu étudiant et qui suscite une forte inquiétude chez les experts.
En effet comme l’observe Emilie de Paw « L’état de passivité auquel condamne le neurotraitement, interdit de qualifier le soldat qui est sans peur, de courageux, ou l’élève qui connaît par cœur sa matière, de consciencieux. À l’heure où l’on envisage l’apparition sur le marché de neurotraitements plus invasifs, il y a lieu de s’interroger sur l’hybridation de l’homme avec la technique et sur les conséquences de telles perspectives sur la définition de l’humain. »
Or, comme le souligne Hervé Chneiweiss dans l’ouvrage précité139 : « finalement, contrairement au dopage sportif où le tricheur cherche à gagner, il faut ici améliorer ses performances simplement pour être normalement intégré à sa communauté. Dans cette société de la performance, la norme est assimilée à la normalité. Tout ce qui s’en écarte devient en conséquence anormal et donc, en biologie, pathologique. »
Il démontre que la médicalisation d’un comportement génère un effet pervers en banalisant l’usage de certaines molécules comme les traitements au méthylphénidate, amphétamine dont l’usage s’est banalisé pour traiter l’hyperactivité chez l’enfant.
De nombreux chercheurs ont attiré l'attention des rapporteurs sur les dégâts causés en France par la surconsommation de psychotropes et la dépendance qui s'en suit. Ainsi, Jean-Pierre Changeux140, estime que « le problème des drogues et de la toxicomanie n’est pas traité de manière convenable par le législateur : c’est un point négatif. Par exemple plusieurs drogues toxiques majeures comme l’alcool ou le tabac sont tolérées, alors que d’autres parfois moins toxiques sont hors la loi... Il existe une demande pressante et constante d'utilisation de drogues anxiolytiques comme, par exemple, contre l'hyperactivité et autres troubles du comportement des enfants. Il faut être attentif au risque d’une éventuelle hyper médicalisation, toxicomaniaque de l’enfant ».
L'Agence de la biomédecine a été chargée par la loi du 7 juillet 2011 de veiller à élaborer une information à destination du Parlement et du Gouvernement, sur les neurosciences et leurs évolutions, ainsi que sur les problèmes éthiques qu’elles pourraient soulever. Il lui est aussi demandé que cette information fasse l’objet d’un point spécifique dans le rapport annuel de l’Agence.
Vos rapporteurs considèrent que seule une information idoine et une veille sanitaire par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et l’Agence de la biomédecine peuvent éviter la généralisation de ces pratiques qu’une société de la performance encourage.
Recommandation :
Renforcer la veille sanitaire et l’infomation sur tout procédé ayant pour objectif d’agir sur les capacités cognitives des individus.
B- LES DÉFIS DU TRANSHUMANISME
Comme le rappelle Jean-Michel Besnier141 dans son ouvrage « Demain les posthumains », c’est Peter Sloterdijk qui, dès 1999, a donné une crédibilité philosophique à la question du posthumanisme. Au cours d’un colloque consacré à Heidegger et à la fin de l’humanisme, il a postulé que le développement des technosciences imposait d’envisager un nouveau système de valeurs accompagnant la production d’êtres nouveaux et légitimant le pouvoir de ceux qui bénéficieront des technologies d’augmentation de l’être humain.
Les idéologies posthumanistes trouvent leurs racines dans une contre-culture des années soixante percevant dans la technologie un nouveau vecteur de rupture. Elles affirment que l’humanité devra s’élargir au non humain (cyborgs, clones, robots, tous les objets intelligents), l’espèce humaine perdant son privilège au profit d’individus inédits, façonnés par les technologies.
Selon Peter Sloterdijk la différence entre le posthumanisme et le transhumanisme n’est guère fixée. Le second désigne souvent une phase de transition vers le premier. Le mouvement mondial du transhumanisme, World Transhumanist Association (devenue depuis Humanity+) est apparu en 1998, représenté en France par l'association française transhumaniste « Technoprog! ».
Les transhumanistes prônent la transition vers le posthumanisme ou vers l’hyperhumanisme un «H+», et défendent l’idée d’une utilisation des biotechnologies pour améliorer la condition humaine, notamment par l’élimination du processus de vieillissement, et de la mort involontaire liée au vieillissement et aussi par l’amélioration du potentiel humain cognitif, émotionnel et physique. Le transhumain évoque un monde nouveau, alors que le progrès est une notion accrochée au monde ancien, un monde qui croit à l'humain et à sa pérennité.
Les fantasmes d’immortalité qui traversent ce courrant reposent selon Jean-Michel Besnier « sur un préjugé non seulement scientiste, mais aussi très archaïque ». Cela supposerait que le cerveau et la conscience soient une seule et même chose, et que sauvegarder le cerveau donnerait les moyens d’immortaliser la conscience, sans prendre en considération l’épigénétique, c’est-à-dire le contexte environnemental nécessaire au fonctionnement du cerveau. Or, pour les neurobiologistes, il n’y a pas de cerveau isolé. De tels fantasmes relèvent d’un schéma d’explication et d’une rhétorique qui supposent que le cerveau est isolable ». Selon Jean-Michel Besnier : « ce qui rend possible ce genre d’illusions est la simplification de la représentation de l’humain, qui résulte de la fascination avec laquelle nous cédons aux technologies lorsqu’elles nous donnent à voir. Ces technologies ont un privilège sur les autres : elles facilitent cette simplification de l’humain, en l’exposant à être réduit à l’élémentaire d’un fonctionnement quasi mécanique. »
L’intervention de Jean- Didier Vincent142, en mars 2008, dans laquelle il avait exposé ses interrogations et ses inquiétudes face au développement de mouvements transhumanistes avait interpellé vos rapporteurs. Il faisait état d’un vaste programme de recherche consacré à la convergence des technologies, engagé en 2002 principalement aux États-Unis, avec quatre voies technologiques convergentes vers le « posthumain », ce qui permettrait à l’homme de faire mieux que ce que la nature a su faire. « Les biotechnologies seraient les premières à ouvrir la porte de la post-humanité. Les nanotechnologies tireraient l’attelage, complétées par les technologies de l’information et les sciences cognitives. Le gouvernement fédéral des États-Unis a doté ce programme couramment appelé NBIC – nano, bio, info, cogno – de plusieurs milliards de dollars. On peut considérer le projet comme la première pierre officielle de ce que ses adeptes conviennent de nommer transhumanisme et qui n’est rien d’autre qu’un état intermédiaire vers le post-humanisme ».
Il précisait : « Le rapport de la National Science Foundation (NSF) américaine sur la convergence des technologies pour améliorer les performances humaines (Converging technologies for improving human performance) reste cependant prudent lorsqu’il conjoncture que l’humanité pourrait devenir comme un cerveau unique dont les éléments seraient distribués par des liens nouveaux parcourant les sociétés. …Les propos de savants devenus prophètes, abolissant les frontières entre utopie et projet scientifiques, ne doivent pas faire oublier le sérieux d’une entreprise que pourrait résumer la devise : « Rendre l’impossible possible, et l’impensable pensable. »
Conscients de l’impact et des défis potentiels de la convergence NBIC sur la société, vos rapporteurs ont souhaité rencontrer des défenseurs de ces thèses nombreux et influents aux États-Unis lors de leur déplacement dans ce pays. Le dialogue s’est avéré extrêmement difficile avec Natascha Vita-More, présidente de Humanity + 143 car chaque question directe semblait l’offenser, elle ne paraissait pas concevoir qu’on ne soit pas complètement conquis par son désir d’éternité et sa croyance en la toute-puissance de la technique.
La rencontre avec Wendell Wallach144 fut plus feutrée car il s’agissait d’une table ronde au Yale interdisciplinary center for Bioethics. Certes il semblait être plus réservé que les autres intervenants sur la nécessité de s’interroger sur des techniques qui prônent la « cyborgisation » de l’humain.
Aussi, pour vos rapporteurs, cette dimension des interfaces homme/ machine prônée par ces mouvements, doit-elle être examinée. À cet égard, les descriptions des entretiens de Jean-Didier Vincent145 avec des experts respectés croyant à immortalité possible ou les expériences cyborgisation de chercheurs originaux s’appliquant à eux-mêmes leur théorie, en s’agrémentant de puces électroniques ou de bras supplémentaires ne prêtent pas forcément à sourire.
2- L’augmentation des capacités : la « cyborgisation »
Selon Jean-Didier Vincent, le transhumain n'est qu'une étape transitoire sur le chemin qui mène au posthumain. Chaque innovation entraînant une augmentation exponentielle des capacités d'action, on ne sait absolument pas combien de temps peut durer la transition. Le séquençage du génome humain devait durer vingt ans, il en a pris deux ou trois. Les partisans du transhumanisme rêvent d'un monde nouveau, alors que le progrès est une notion accrochée au monde ancien, un monde qui croit à l'humain et à sa pérennité. L'idée d'une victoire sur la mort est opérante.
James Hughes146 croit que le développement des possibilités du transhumanisme va créer une grande compatibilité entre la métaphysique, la théologie, la sociologie et l'eschatologie. Il croit que les visions limitées par la religion, par la spiritualité vont être dépassées par une nouvelle forme de trans-spiritualité. Selon lui, le futur s'ouvrira sur de nouvelles lois biologiques, vers des capacités biotechnologiques et cybernétiques incroyables.
Et le philosophe, Jean-Michel Besnier147 de relever : « les spéculations post-humanistes passent tantôt du côté de l’animalisation, tantôt de celui de la machinisation, oubliant dans les deux cas, la spécificité de l’humain. Les spéculations post-humanistes en tirent facilement argument. Elles se représentent les technologies comme l’instrument qui devrait aider l’homme à fusionner avec les machines, et ce d’autant plus facilement qu’elles trouveront dans les neurosciences les arguments d’une mécanisation de l’esprit, tel est le fantasme de base ».
3- L’utilisation par les armées des potentialités d’augmentation
À deux reprises Jean-Didier Vincent148 a attiré l’attention des rapporteurs sur l’utilisation des technologies convergentes par les armées car ces technologies augmentent artificiellement les capacités des militaires, et permettent un essor considérable de la robotique.
Le nouveau soldat n’aura pas d’armure mais un exosquelette pour alléger ses charges et divers systèmes d’écoute et de capteurs, et la guerre sera de plus en plus robotisée. Selon Jean-Didier Vincent, « les technologies convergentes et les mécanismes d’intelligence artificielle intéressent les armées, il s’agit de travailler au service du complexe militaro-industriel, le plus fournisseur de crédits pour ces recherches dans les technologies convergentes ».
Il est vrai que comme le relevait Nathalie Guibert149, la robotisation du champ de bataille s’accélère. La technologie bouleverse la guerre car la perspective, désormais à portée, est celle d’une automatisation de l’usage de la force, voire de l’acte de tuer. Les milieux de la défense en ont débattu, lors d’un colloque international aux Écoles de Saint-Cyr, les jeudi 9 et vendredi 10 novembre 2011, à Coëtquidan : « Il ne s’agirait plus seulement de donner la mort à distance, ce que font déjà de nombreux soldats, pilotes de chasse, opérateurs de drones ou de missiles guidés, il s’agit de protéger le combattant et d’améliorer le renseignement de contact, de déminer des mines et explosifs, de renforcer les capacités de destruction du combattant, de l’alléger. » Le risque est de mettre au point des robots pour tuer de façon autonome. Quelles lois de la guerre leur seraient applicables ? Il faudra bien établir un cadre ou les interdire ?
Et Jean-Didier Vincent de noter150 « l’expérimentation se passe in vivo, en Afghanistan ou ailleurs, où l’on utilise des cyber-soldats, d’une efficacité redoutable, puisqu’ils tuent ennemis et civils tout en étant pratiquement invincibles, grâce à la progression des avancées des technologies convergentes (nanotechnologies, technologies de l’information, biotechnologies et technologies du cerveau). Elles ont permis de totalement modifier la structure du soldat qui s’avance dans le désert, avec de petits nanorobots, fabriqués avec des nouveaux matériaux, capteurs de tous les organes des sens qui apportent toute une série d’informations géographiques et autres. Elles permettent au soldat, par une interconnexion entre son cerveau et les bras exécutifs, de déclencher automatiquement l’envol de petits avions qui ne manqueront pas leur cible et y compris quelques centaines de personnes autour ».
La convergence des technologies est appelée à s’étendre. La loi relative à bioéthique de juillet 2011 ne fait qu’une brève allusion aux technologies convergentes en demandant à l’Agence de la biomédecine d’exercer une veille.
Vos rapporteurs estiment que les aspects éthiques et les impacts sociétaux des technologies convergentes doivent être étudiés à nouveau par l’OPECST, qui s’est déjà penché sur ce sujet à plusieurs reprises dans ses divers travaux sur les nanotechnologies. Il y a deux raisons à cela : la rapidité d’évolution des outils dans ce domaine, et leur utilisation de plus en plus étendue.
III- L’UTILISATION DE L’IMAGERIE CÉRÉBRALE HORS DE LA SPHÈRE MÉDICALE
Selon Jean-Michel Besnier, « les techniques d’exploration et de visualisation du cerveau ont eu un résultat sur le plan des représentations mentales que l’on s’en fait au sein du public : elles ont banalisé le cerveau, au point que, chez un grand nombre de nos contemporains, le cerveau apparaît de plus en plus comme un organe comme un autre, dont les signaux chimiques d’interactions sont de mieux en mieux identifiés, et comparables à ceux de n’importe quel autre organe. C’est un effet de désenchantement, qui explique sans doute une certaine tolérance aux réductionnismes dans la façon dont les résultats des neurosciences sont présentés au public. »151
Pourtant, le cerveau est le support d'informations propres à chacun, il est le siège de la conscience, de l'identité personnelle. La connaissance de l'information cérébrale et des caractéristiques neurales de l'individu, entraîne une forme de transparence car elle touche à son intimité. Comme l’ont montré les débats lors des auditions publiques organisées par vos rapporteurs152, la révolution scientifique à l’œuvre dans le domaine de la recherche sur le cerveau suscite de multiples interrogations. Détournée, elle peut servir de support à des théories réductionnistes et déterministes dangereuses pour les libertés individuelles. Mal comprise ou mal utilisée, elle risque d’induire des discriminations dénoncées par la communauté scientifique elle-même.
Les connaissances issues de ces technologies incitent à une régulation et une précision des normes concernant les éventuelles utilisations de la neuroimagerie hors de la sphère scientifique et médicale. Cela pose la question de l'utilisation de la neuroimagerie par des sociétés d'assurance (santé, risque, sinistres, etc.) qui peuvent désormais utiliser les données pour profiler la nature des risques portés par les candidats à l'assurance, et ainsi mieux optimiser les primes ; les employeurs pourraient aussi envisager d’y recourir pour tester un candidat à l’embauche par exemple (mensonges, antécédents, loyauté, etc.).
Les avancées en neuroimagerie, particulièrement grâce à l’IRM fonctionnelle, font émerger la capacité sans précédent de corréler l’activité du cerveau avec les états psychologiques (de nombreux travaux ont été menés sur le mensonge), les grands traits de la personnalité (incluant l’extraversion, le pessimisme, la capacité à l’empathie, l’obstination, voire les attitudes racistes inconscientes, la prédisposition au crime violent...) et certains désirs (préférences sexuelles ou pour certains objets, exploitées en neuromarketing).
Les travaux visant à améliorer la compréhension du comportement criminel font envisager d’autres interprétations de la notion de responsabilité individuelle qui, dès lors, ne dépendrait pas exclusivement du libre-arbitre.
A- LE STATUT DE LA NEUROÉCONOMIE ET DU NEUROMARKETING
La neuroéconomie, permettrait d’identifier des aptitudes de décision, avec leur corrélat anatomique, ou des capacités de motivation, et ce, avec une certaine précision, ce qui n’est pas sans risque au plan éthique.
Résultat d'une alliance disciplinaire, à l'intersection de la micro-économie, des sciences du vivant et de l'imagerie, la "neuroéconomie" correspond à un concept radicalement nouveau qui régulièrement fait le délice des médias et des communicants, notamment des publicitaires. « Le neurone est un « bon client » médiatique, particulièrement lorsque sa connaissance semble éclairer des comportements ordinaires, comme l’acte d’achat, les pratiques financières profanes ou expertes, ou encore les sources du « bonheur » - et, pas très loin, le jeu, le pouvoir, la sexualité, c’est-à-dire des domaines de la vie ordinaire qui sont présentés sous un angle totalement nouveau « de l’intérieur du cerveau », remarquait Frédéric Lebaron153.
1- Les objectifs de la neuroéconomie
Le but de la neuroéconomie est de comprendre les processus, les sensations et l'action dans une situation où l'on doit prendre une décision. La naissance de la neuroéconomie vient de l'observation d'un paradoxe contredisant les théories habituelles de prises de décision développées par les économistes. Ceux-ci avaient défini à chaque prise de décision, un critère d'utilité correspondant à la probabilité de gagner en faisant un choix plutôt qu'un autre. Or on observe que les choix ne sont pas vraiment effectués en fonction de la probabilité de gagner. Lorsque l'on doit en faire un, chaque possibilité dispose d’une certaine proportion de gain qui ne correspond pas réellement à ce que cela pourrait apporter, mais le gain qu'on pense en tirer. Néanmoins, les personnes tiennent différemment compte de cette dimension, notamment quand il y a ambiguïté, que le degré de risque est incertain ; cette situation intéresse les économistes en temps de crise ou d’incertitude.
2- L’analyse des circuits de la décision
Nous nous sommes entretenus à New York avec Paul Glimcher154 qui enseigne l'économie, la psychologie et les sciences neuronales, et dirige un institut dédié à la psychologie de la décision qu’il applique à l’économie. Peu financé par l'industrie, mais en revanche bien soutenu par les organismes fédéraux de financement de la recherche, son institut revisite les concepts économiques, essentiellement micro-économiques (utilité, maximisation, élasticité, bien-être, etc.), et les théories des jeux (prises de décision, stratégies) en y introduisant les récentes découvertes en matière de fonctionnement du cerveau. Il en ressort des modèles de prévision d’un caractère prédictif plus élevé qui permettent de mieux cerner le comportement du consommateur lorsque celui-ci est face à des choix multiples ou des données exogènes. Selon Paul Glimcher, ce caractère prédictif n’est pas sans conséquence au plan éthique.
3- Les risques de dévoiement : « le neuromarketing »
Le neuromarketing applique les techniques et savoirs issus des neurosciences notamment de la neuroéconomie, au comportement du consommateur, et s’appuie essentiellement sur l’imagerie par résonance magnétique (IRM) pour analyser ce qui advient dans le cerveau lorsque l’on goûte un produit, que l’on visionne une publicité ou que l’on prend une décision d’achat. Une expérience connue menée par une équipe de chercheurs en neurosciences de Houston en révèle les principes.
Ces chercheurs ont étudié les préférences d’individus pour les deux sodas les plus connus : le Pepsi et le Coca Cola. Lorsque les cobayes goûtent les deux boissons en aveugle, les préférences se répartissent équitablement entre les deux boissons. Mais lorsque l’identité du produit est affichée, les sujets expriment une nette préférence pour le Coca. L’IRM a montré que les deux situations n’activaient pas le cerveau de la même manière, et en conclut que les préférences du consommateur peuvent s’affirmer selon deux circuits différents et indépendants, selon qu’elles se fondent uniquement sur des perceptions, ou qu’elles prennent en compte des influences culturelles (gains et pertes). Par ailleurs, dans la phase d’achat, on assiste, selon les chercheurs, à la désactivation de la zone d’anticipation de la perte.
L’intérêt principal des expériences à base d’IRM pour le marketing est de pouvoir se passer du verbal. Les critiques sur les dangers du neuromarketing sont nombreuses au sein de la communauté scientifique. Outre l’étroitesse des échantillons et les conditions d’études irréalistes (des individus enfermés dans le scanner, coupés de leur environnement), de nombreux experts critiquent la faible validation scientifique reçue par ces travaux, rarement publiés dans des revues à comité de lecture.
Dès l’audition publique du 26 mars 2008 Olivier Oullier155 avait mis en garde contre les risques de confusion avec la neuroéconomie. : « Si le marché du neuromarketing existe, il ne faut absolument pas, et je n’insisterai jamais assez là-dessus, faire l’amalgame avec la neuroéconomie qui est une discipline universitaire rigoureuse dont les finalités ne sont nullement commerciales. Mieux comprendre comment nos émotions peuvent intervenir dans les décisions économiques et morales peut avoir un impact positif y compris pour vaincre les mécanismes d’addiction, par exemple, afin de savoir pourquoi les gens prennent la décision de replonger »
Il reconnaissait sans ambages que certains charlatans essaient de profiter des découvertes en neurosciences. En effet, les expériences fournissent toujours des résultats ex post, qui éclairent la dimension neurale des comportements qui viennent d’avoir lieu. Elles ne permettent en aucun cas de savoir comment agir sur le cerveau pour induire ces mêmes comportements. De fait, les recommandations marketing tirées de ces travaux restent relativement vagues.
Or les expériences de neuromarketing en vue de campagnes publicitaires sur des produits mobilisent des sujets pendant des heures, des appareils d’IRM, des techniciens et voire des neurologues, et peuvent se dérouler dans des lieux dédiés aux soins ; certes, les machines sont louées, mais il n’empêche que cela est choquant pour une discipline controversée dont les buts avérés sont clairement la manipulation des esprits à des fins commerciales.
A la lumière de la nouvelle loi, on peut se demander comment sera interprétée l’action d'une société de marketing qui veut réaliser, en France, une expérience d'IRM fonctionnelle sur une décision d'achat de consommateurs ? Une fois toutes les autorisations obtenues, cette société ne possédant pas d’IRMf devra faire appel à un laboratoire public qui en possède un et payer une prestation pour l'utilisation de l'IRMf, l'examen médical des sujets et le traitement des données. Les finalités de l'expérience sont bien commerciales, mais l'expérience a été réalisée au sein d'un laboratoire de recherche scientifique. Comment caractériser les résultats obtenus ? Dès lors il convient de lever toute ambiguïté et d’interdire clairement cette pratique.
Recommandation :
Interdire la validation de campagnes publicitaires ou d’expériences de neuromarketing par le recours à des IRM dédiées au soin et à la recherche scientifique et médicale.
B- L’UTILISATION DE LA NEUROIMAGERIE EN JUSTICE
Le droit peut être amené à prendre en compte de nouveaux modes de preuves fondées sur des images ou sur des données issues d’imagerie cérébrale, et des acteurs économiques et sociaux peuvent en banaliser l’usage, ce qui n’est pas sans poser problème, comme on l’a déjà vu.
1- L’utilisation ancienne dans des procès aux États-Unis
a- L’état de la réflexion aux États-Unis
En 1991 à New York, Herbert Weinstein, soixante-cinq ans, étrangla sa femme, puis maquilla le meurtre en suicide en jetant le corps du douzième étage d'un immeuble de Manhattan. Lors de son procès en 1992, il reconnut les faits, mais plaida l'irresponsabilité au motif qu'un kyste, niché dans son cerveau, expliquait son comportement agressif, étayant sa thèse par la production de clichés d'imagerie cérébrale. Depuis cette date, l'imagerie cérébrale a été utilisée comme élément de preuve dans des centaines de procès aux États-Unis, afin d'éviter à certains accusés la peine capitale, ou de prouver l'irresponsabilité d'un accusé, l'immaturité neuronale des adolescents, de détecter le mensonge, voire d'identifier les éventuels biais cognitifs des jurés ou des juges.
Yves Agid156 a estimé d’ailleurs que le kyste en question n’avait eu aucune incidence sur le comportement de cette personne. Christian Byk157 a rappelé qu’aux États-Unis, la loi « excuse » les comportements pour lesquels les circonstances font disparaître le caractère blâmable de l'acte incriminé; ainsi l'aliénation mentale et la minorité sont « les excuses individuelles » les plus concernées par l'utilisation des neurosciences.
La fiabilité limitée des techniques de neuroimagerie incite peu la justice américaine à s'en servir comme preuve de l'accusation ; elles sont plutôt utilisées comme soutien aux moyens de défense de l'accusé dans certains États. À ce jour, 614 cas ont été répertoriés aux États-Unis pour lesquels des images obtenues par IRM fonctionnelle ont été introduites au niveau pénal comme "preuve". La commission présidentielle sur la bioéthique met en place un groupe de réflexion intitulé « la neuroimagerie et le soi » qui devrait démarrer fin mars 2012. Les juristes américains expriment une certaine réserve à l’égard de l’usage de la neuroimagerie dans les procès et demandent que l'utilisation de cette technique reste soumise à des critères juridiques d'admission de la preuve scientifique.
En raison de l'augmentation de ces démarches au niveau des cours de justice, par l'intermédiaire d'entreprises dont l'expertise et la déontologie sont sujettes à caution, un manuel guide destiné aux juges d'instruction a été rédigé sous la direction du juge Jed Rakoff158. Celui-ci est une véritable autorité en la matière. Lors de notre entretien avec lui, il a insisté sur l’importance de l’imagerie cérébrale dans les procès mettant en cause des personnes jeunes dont la neuromagerie pouvait laisser apparaître une certaine immaturité.
Le document dont il a dirigé la mise au point ne prétend pas fournir une ligne de conduite uniforme et constante. Il est le fruit d'une étroite collaboration entre neuroscientifiques et juges d'instruction et tente de répondre aux différentes questions qui se posent aux praticiens de la justice ; il a bénéficié du soutien financier de la Fondation Mac Arthur, très impliquée dans ce domaine, notamment par le biais du financement de plusieurs projets: Il s’agit de définir les critères qui, au regard de la loi, définissent l'état mental d'un accusé ou d'un témoin, d’évaluer la capacité d'un accusé à l'auto-régulation de son comportement, et de déterminer dans quelles circonstances et par quels moyens les preuves neuroscientifiques doivent être admises et analysées. À ce jour, il n'existe aucune réponse uniforme, on procède au cas par cas, ce qui préoccupe le juge Jed Rakoff.
b- L’utilisation de l’IRM et du polygraphe dans la détection du mensonge
Alors que la recherche dans ce domaine est encore lacunaire, deux sociétés américaines proposent d’ores et déjà un service spécialisé dans la détection de mensonge par IRM fonctionnelle : « Cephos corporation » et « No Lie MRI ». Nous nous sommes entretenus avec Stephen Raken159, et nous avons visité le « laboratoire » de la Cephos. Nous avons été surpris pour ne pas dire choqués de la manière dont se déroulaient les détections de mensonge, par leur coût élevé de 4000 dollars et par les certitudes exprimées quant à la validité du procédé. L’activité de ces sociétés semble pour le moins faiblement encadrée déontologiquement et commercialement, elle concerne surtout le mensonge dans la sphère privée (couples, enfants, emploi, etc.). Cette pratique est inquiétante car elle vise des affaires privées qui vont des conflits conjugaux à l’embauche, voire la souscription d’assurances.
A terme, il faut s’attendre à une utilisation plus grande de cette technique par d’autres clients (employeurs, assureurs, etc.) voire par des autorités (police, tribunaux, etc.), car aux États-Unis, l’usage du détecteur de mensonge est habituel, et parfois obligatoire dans certains États. C’est ainsi que pour accéder à certains emplois, notamment comme agent du FBI160, il faut accepter de passer au traditionnel test du polygraphe, lequel a été admis en 2007 par la loi dans dix-neuf États et est laissé à l'appréciation du juge dans les cours fédérales.
2- Les autres tentatives d’utilisation en justice et le débat en France
L’utilisation de la neuroimagerie en justice semble gagner d’autres pays comme l’Inde et l’Italie. En Inde, une Indienne de 24 ans a été condamnée à la prison à perpétuité pour avoir empoisonné son fiancé. Elle niait les faits mais un examen d’imagerie cérébrale a montré que son cerveau traitait le mot « cyanure », le poison utilisé, comme un terme familier. Le tribunal a considéré l’expérience comme une preuve à charge. Elle a été acquittée en appel. Un des derniers cas rendus publics a eu lieu en Italie, où une personne, qui a reconnu avoir tué sa sœur, avait dans un premier temps été condamnée à perpétuité. Sur la base d’une méthode qui permet de comparer l’évolution des volumes cérébraux et des tests génétiques, certains experts admis par les tribunaux italiens, ont estimé que le condamné n’était pas totalement responsable de ses actes. Sa peine a ainsi été commuée de perpétuité à vingt ans d’emprisonnement, sur la base de la combinaison des tests génétiques et d’IRM161.
Le débat en France a été initié en grande partie par vos rapporteurs, dès l’audition publique précitée du 26 mars 2008 et le rapport que nous avions présenté dans le cadre de l’évaluation de la loi de bioéthique. C’est ainsi qu’à la suite de nos travaux, le Centre d’analyse stratégique (CAS) a organisé un séminaire en 2009162, et publiera au premier trimestre 2012 un rapport à ce sujet, fruit de plus d’un an de travail avec des experts français et internationaux issus des neurosciences, de la psychiatrie, de la psychologie, du droit, des politiques publiques, de la philosophie et de la psychiatrie. (Voir en annexe 4 du rapport la note transmise par le centre et supra).
Héléne Gaumont-Prat163 a rappelé que le droit antérieur à la loi du 7 juillet 2011 n'ignorait pas la protection de « l'information cérébrale », même si elle n'était pas nommée. D'une part, s'agissant de préserver des droits fondamentaux comme les droits de la personne (dignité, intégrité, vie privée), il a toujours été possible de se référer aux dispositions du code civil, issues des lois dites de bioéthique du 29 juillet 1994, ainsi que de celles de l'article 9 du code civil, aux déclarations internationales à vocation universelle ou aux conventions du Conseil de l'Europe ou de l’Union européenne. D'autre part, le droit interne traitait « l'information cérébrale » au travers du droit médical, du droit de la recherche lorsque se rencontraient des problèmes spécifiques se présentant alors comme une régulation générale.
Cependant, le rapport de Jean Léonetti164, faisait mention de cette finalité judiciaire, en invoquant l’expertise judiciaire et le fait que l’imagerie cérébrale pouvait s’adjoindre, comme dans toute expertise, au rapport de l’expert, en vue, par exemple d’apprécier l’irresponsabilité pénale. Le rapport indiquait bien qu’il ne s’agissait en aucun cas d’en faire un détecteur de mensonge. Ainsi, une technique si complexe, sujette à des interprétations différentes (selon les réglages techniques et les logiciels utilisés), et dont la fiabilité reste très incertaine devra-t-elle être utilisée avec précaution lors de l’expertise judiciaire.
S'inspirant des articles 16-10 et 16-13 du code civil encadrant l'utilisation des techniques d'examen des caractéristiques génétiques des individus, le rapporteur de la commission spéciale de l'Assemblée nationale avait proposé un amendement, créant des articles 16-14 et 16-15 dans le code civil, applicables aux techniques d'imagerie cérébrale tout en prévoyant qu'une information sur les limites actuelles des neurosciences soit privilégiée.
Dans son article intitulé « la loi 2011 relative à la bioéthique et l'encadrement des neurosciences », Héléne Gaumont Prat165 note que l'analyse de la genèse des débats met en évidence « l'absence de divergences sur les enjeux éthiques ainsi que sur la nécessité d'un encadrement des neurosciences. Cette unité dans la réflexion s'est doublée de complémentarité et d'échanges au fil des débats parlementaires ». Elle relève que « la plupart des principes établis pour la génétique valent pour n'importe quel champ de la recherche sur les sciences du vivant, et particulièrement pour les neurosciences »
3- Les interrogations suscitées par loi du 7 juillet 2011
La loi de bioéthique du 7 juillet 2011, à l’élaboration et aux débats de laquelle nous avons tous deux participé activement tout au long de l’année 2011166, introduit dans le code civil un nouveau chapitre intitulé « De l'utilisation des techniques d'imagerie cérébrale ». Un nouvel article167 est inséré dans le code civil qui encadre l’utilisation de ces techniques et dispose : « les techniques d'imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique, ou dans le cadre d'expertises judiciaires. Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'examen. Il est révocable sans forme et à tout moment.»
a- La régulation de l’usage de l’imagerie cérébrale
La nouvelle loi crée un titre nouveau, dans le code de la santé publique intitulé quant à lui « Neurosciences et imagerie cérébrale » et une disposition nouvelle168 prévoit qu’« un arrêté du ministre chargé de la santé définit les règles de bonnes pratiques applicables à la prescription et à la réalisation des examens d'imagerie cérébrale à des fins médicales. Ces règles tiennent compte des recommandations de la Haute Autorité de santé. »
En outre, la loi inclut spécifiquement, les neurosciences dans le domaine de compétence de l’Agence de la biomédecine désormais chargée « d'assurer une information permanente du Parlement et du Gouvernement sur le développement des connaissances et des techniques dans le domaine des neurosciences »169.
Ainsi les techniques d'imagerie médicale sont autorisées mais expressément circonscrites au domaine médical, au domaine de la recherche scientifique ainsi que dans le cadre d'expertises judiciaires. Le régime juridique de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 définit l’encadrement des applications des neurosciences en réglementant l’accès aux techniques de l’imagerie cérébrale170 afin de créer un cadre protecteur des droits de la personne, et en les soumettant aux grands principes bioéthiques inscrits au code civil. La loi en circonscrit le domaine d’accès en fonction de trois finalités reconnues comme légitimes, (finalité médicale, de recherche scientifique et judiciaire) afin de limiter les conséquences potentiellement graves pour l’homme.
La limitation au domaine médical rappelle Héléne Gaumont-Prat171 implique « la protection de l'intimité de l'information cérébrale, donnée personnelle et médicale (qui englobe à la fois le concept de confidentialité et le droit de maîtriser les informations relatives à sa propre personne), a automatiquement pour contrepartie des limitations en matière de collecte, d'exploitation et de divulgation des informations à caractère personnel. La licéité des outils d'investigation est appréciée en considération de sa finalité qui va en délimiter l'utilisation et l'exploitation », analyse que partagent vos rapporteurs. C’est la raison pour laquelle ils se sont penchés sur la protection des données issues de l’imagerie.
b- Quelle utilisation en justice ?
Vos rapporteurs considèrent que la finalité judiciaire introduite et limitée à l’expertise judiciaire pourrait être prématurée au regard du manque de fiabilité des techniques.
Certes, il est possible que ce moyen de preuve soit utile, comme l’a observé Christian Byk172« Depuis une dizaine d’années, on émet des doutes sérieux sur les aspects trop subjectifs des analyses faites par la psychologie et la psychiatrie et il est sûr que l’apparence d’une discipline qui objectivise (avec de belles photos en couleur) peut apparaître comme un complément d’approche pour mieux cerner la personnalité et le comportement en termes de culpabilité, de responsabilité et surtout pour la question centrale aujourd’hui de la dangerosité. Les experts psychiatriques se refusent la plupart du temps à parler de dangerosité sociale. Par rapport aux expertises classiques psychiatriques et médico-psychologiques obligatoires en matière criminelle, des examens (scanners, IRM) qui permettraient d’apporter des éléments tangibles ne serraient pas interdits dans certaines circonstances pour des individus atteints de certaines maladies à interprétation difficile ».
Il observe d’ailleurs que ni la doctrine, ni le législateur ne sont encore allés jusqu’à suggérer le recours à ces techniques en justice en complément des expertises traditionnelles. Selon lui, la loi du 7 juillet 2011 a éclairci la possibilité de les utiliser comme expertise dans le système judiciaire et a en quelque sorte légitimé les techniques des neurosciences notamment à des fins judiciaires, mais elle n’a pas défini de cadre spécifique, ni changé les règles en vigueur. C’est donc à la jurisprudence que reviendra l’interprétation éventuelle. Cependant cette disposition suscite le débat et semble contreproductive aux rapporteurs ; elle vise à assimiler la neuroimage à la preuve ADN.
Ainsi, Jean-Claude Ameisen173 a rappelé que « la réflexion éthique, en science, doit avoir une dimension épistémologique. Que signifie la découverte scientifique dont on veut tirer des applications ? Que signifie détecter, au niveau des activités cérébrales, quelque chose qui traduirait un mensonge ? C’est une question scientifique fascinante. Mais cette démarche éthique ne s’arrête pas à cette seule dimension épistémologique. Quand bien même dans des domaines restrictifs précis, il y aurait une possibilité d’interpréter dans le cadre d’une procédure judiciaire des résultats sur le mensonge, la sincérité, le sentiment de culpabilité ou d’innocence d’une personne, devrions-nous les utiliser sous prétexte que la science soudain le rend possible ? C’est une question éthique qui dépasse la dimension épistémologique. »
De même Olivier Oullier174, qui a travaillé sur le thème de l’utilisation des neurosciences en justice à l’étranger, se montre très sceptique : vos rapporteurs lors de l’évaluation de la loi relative à la bioéthique,175 avaient plaidé pour l’entrée de la neuroimagerie et des neurosciences dans le champ de la loi. Ils estimaient qu’il fallait développer les recherches dans le domaine de la neuroimagerie et les neurosciences, évaluer périodiquement l’impact de ces recherches au plan médical, mais aussi social et environnemental, assurer un accès équitable à ces nouvelles technologies, protéger les données issues de ces techniques afin d’éviter l’interconnexion des fichiers, mais ils préconisaient clairement d’interdire l’utilisation en justice de la neuroimagerie.
Comme Christan Byk, Olivier Oullier considère qu’existe une certaine demande sociétale pour de nouvelles techniques permettant d’analyser avec plus de précision le comportement des personnes impliquées dans un procès, qu’il s’agisse des juges, des témoins, des accusés ou des jurés. Mais il ajoute qu’une demande, aussi pressante soit-elle, ne justifie pas la précipitation et ce malgré la récente crise de l’expertise psychiatrique dans l’appareil judiciaire qui constitue un terrain fertile pour l’utilisation des neurosciences dans les tribunaux. « Aujourd’hui, l’état de nos connaissances en imagerie cérébrale ne devrait pas nous permettre de statuer sur la culpabilité, les prédictions, et le pourcentage de récidives éventuelles d’un individu sur la seule base de données de neurosciences. » Il se demande : « Dans de tels cas, qui serait l’expert auprès du tribunal, alors que nous avons peine parfois à nous mettre d’accord, entre acteurs des neurosciences, sur les seuils de significativité, la variabilité des signaux et l’interprétation des données ? Comment former de tels experts ? Et former les acteurs du procès à ces nouvelles connaissances ? » C’est bien sur ces points que se situent les réserves de vos rapporteurs.
L’expertise en la matière risque donc de fournir plus de questions que de réponses. Il reste que le pouvoir de simplification et de fascination des images, leur caractère scientifique peuvent influencer et leur conférer une valeur probante supérieure à ce qu’elles sont. Selon Olivier Oullier176 l’introduction des neurosciences en justice est problématique. Il explique : « Parmi toutes les questions soulevées par ce thème de travail, permettez-moi de revenir sur la force des explications neuroscientifiques. Des expériences de psychologie expérimentale ont en effet montré la force de persuasion du recours à des images ou à du vocabulaire issus des neurosciences177 ». Il relate une expérience, récente, réalisée sur 300 jurés, qui devaient statuer sur la culpabilité d’une personne dont on leur disait qu’elle mentait178. Les jurés étaient divisés en quatre groupes. Un groupe possédait une information qui provenait du détecteur de mensonge « classique », celui qui mesure la réponse électrodermale, électro-physiologique, un autre groupe recevait les données d’analyse faciale thermique et un troisième les données obtenues grâce à l’IRMf. Un quatrième groupe contrôle ne disposait d’aucune information sur une quelconque méthode d’aide à la détection de mensonge. Sans surprise, c’est le groupe qui possédait les images obtenues par IRMf qui a prononcé le plus de verdicts de culpabilité.
Cependant, à partir du moment où ces jurés ont reçu l’information pertinente sur les limites des scanners IRM et de leur utilisation dans les tribunaux, la proportion de jurés ayant déclaré l’accusé coupable est revenue au niveau du groupe contrôle. Olivier Oullier en déduit « qu’une information délivrée de manière efficace par des personnes compétentes peut arriver à changer la perception, donc contrer certains biais de cette attraction pour les images cérébrales. Pour autant, savoir que nous nous trompons et que quelque chose ne fonctionne pas, n’a jamais été un gage pour éviter de renouveler les erreurs ».
4- Les améliorations possibles
Comme l’observait Hélène Gaumont-Prat, entre le régime juridique, consacré aux empreintes génétiques et aux tests génétiques, et le régime actuel encadrant l’imagerie cérébrale, la similitude n’est pas totale, car la loi du 7 juillet 2011 ne prévoit pas de sanctions pénales spécifiques en cas de mésusage de la technique d’imagerie cérébrale ; ensuite, la loi a ignoré le risque de discrimination spécifique lié à l’utilisation de données cérébrales, bien que ceci ait été évoqué lors des travaux parlementaires et qu’un projet d’article 16-15 du code civil envisageait que « nul ne peut faire l’objet de discriminations sur le fondement des techniques d’imagerie cérébrale », projet d’article supprimé par la suite.
Pourtant il aurait été facile, selon elle, de s’inspirer de l’article 16-13 du code civil prévoyant que « Nul ne peut faire l’objet de discriminations en raison de ses caractéristiques génétiques », l’atteinte à ces dispositions étant visée à l’article 225-1 et sanctionnée à l’article 225-2 du code pénal.
Vos rapporteurs estiment que ces points doivent être éclaircis ; en effet dès lors que l’on accepte la possibilité d’utiliser l’imagerie cérébrale dans l’expertise judiciaire, on confère à cette technique une force probante forte, et on accroît les risques de dérives tels l’usage à l’embauche ou par les compagnies d’assurances. Il convient donc de renforcer la protection des personnes contre ces dérives par un régime de sanctions appropriées.
Recommandations :
- Préciser, voire supprimer, la possibilité d’utiliser l’imagerie cérébrale en justice ;
- Renforcer la protection des personnes contre les discriminations fondées sur les techniques d’imagerie cérébrale par une disposition du code pénal ;
- Clarifier le régime juridique des sanctions pénales applicables en cas de non respect de ces dispositions.
C- L’APPLICATION DES NEUROSCIENCES DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES : LES TRAVAUX DU CENTRE D’ANALYSE STRATÉGIQUE EN FRANCE (CAS)
(Extraits de la note du Centre d’analyse stratÉgique figurant en annexe).
Le centre d’analyse stratégique a été l’une des premières institutions à s’intéresser aux travaux sur l’exploration du cerveau que vos rapporteurs avaient menés lors de l’évaluation de la loi relative à la bioéthique en 2008 et à s’emparer du sujet de manière interdisciplinaire, ce qui est remarquable, et mérite d’être salué car cela contribue à éclairer le public et à nourrir le débat.
a- La neuroéthique
La première publication du CAS sur les neurosciences fut la note d’analyse n°128 sur les questions d’éthique liées à l’utilisation des neurosciences hors des laboratoires de recherche scientifique et médicale. Une deuxième publication a ensuite abordé plus précisément les questions d’interfaces cerveau-machine, et par là même, celles liées à l’humain potentiellement « augmenté » par les neurosciences.
b- Le neurodroit
L’utilisation des neurosciences dans l’appareil judiciaire représente à l’heure actuelle l’un des domaines dans lequel les avancées en sciences du cerveau pourraient engendrer le plus de changements au sein de notre société. Le législateur français n’est pas resté insensible à ce fait, proposant un droit d’exception dans la loi du 7 juillet 2011 à l’utilisation des neurosciences dans le cadre des expertises judiciaires, alors qu’il restreint l’utilisation de l’imagerie cérébrale aux seules applications scientifiques et médicales.
Courant 2012, le CAS publiera un rapport circonstancié sur le sujet qui proposera une analyse critique éclairée par des spécialistes français et internationaux venus du droit, de la psychiatrie, des neurosciences, de la psychologie et de la criminologie.
c- La prévention en santé publique
En 2010, le CAAS a publié le premier rapport proposant l’apport des neurosciences, des sciences cognitives et des sciences comportementales dans la mise en place de politiques préventives et incitatives en santé publique.
d- La décision économique
La décision économique a été le thème de la première manifestation organisée dans le cadre de ce programme. Son but était de montrer comment les données des sciences comportementales et du cerveau peuvent enrichir les débats d’actualité, à l’image de ceux relatifs à la crise financière. Les points de vue de trois experts, un économiste, un neurophysiologiste et un spécialiste de la finance comportementale, ont permis de faire le lien entre la théorie et la réalité des marchés.
e- Le vieillissement cognitif
Le CAS a également travaillé sur le thème du vieillissement cognitif. La notion de vieillissement cognitif a alors été introduite afin de définir l’évolution des performances cognitives avec l’âge. Si l’intégralité des facultés intellectuelles est affectée lors du processus naturel de vieillissement, elles ne le sont pas toutes de façon équivalente et homogène.
2- Les recommandations du CAS179
Les questions qui ont dès lors animé la réflexion du CAS pendant le processus de révision de la loi de bioéthique ont été les suivantes : les régulations existantes sont-elles suffisantes ? Est-il prématuré de mettre en œuvre des régulations spécifiques ? Celles-ci doivent-elles porter sur la recherche ou sur ses applications ?
IV- LA NÉCESSITÉ D’UNE MEILLEURE INFORMATION
DES CITOYENS
Les nombreuses personnalités auditionnées par les rapporteurs ont toutes souligné la nécessité d’apporter au public une information plus scientifique et de meilleure qualité sur les apports des neurosciences et l’évolution des traitements possibles des maladies neurologiques et psychiatriques. Toutes insistent sur les effets pervers d’informations sensationnelles laissant croire à des découvertes ouvrant à des traitements. Les scientifiques et le monde politique doivent répondre aux sollicitations des médias, si friands de toute explication neuroscientifique imagée de nos comportements et exposer le plus souvent possible l’état des connaissances réelles auprès de nos concitoyens.
Olivier Oullier180 a insisté lors des auditions publiques de mars 2008 et de juin et novembre 2011 sur la réflexion à mener sur la « façon de communiquer sur les bonnes pratiques scientifiques, mais aussi sur les résultats qui peuvent être exploitables et transférables hors des laboratoires »… Il a réaffirmé aux rapporteurs que « la recherche, la connaissance et le débat contradictoire, tout comme la diffusion la plus efficace et la plus posée possible des résultats scientifiques, restent les meilleurs remparts contre les dérives inexorables de l’utilisation et du détournement de certaines de nos pratiques en neurosciences. Ces dérives peuvent nous paraître inéluctables mais nous avons nombre d’arguments et de techniques pour les contrer et faire valoir les bonnes pratiques à commencer par faire entendre nos voix dans la littérature scientifique et en dehors. Je vous remercie à travers vos auditions parlementaires de nous y aider. »
Hervé Chneiweiss181 suggérait que la France qui participe activement à une action internationale, la semaine du cerveau, la troisième semaine de mars, utilise ce moment « pour décrire les merveilles de ce qu’est la découverte du cerveau, mais aussi pour réfléchir, comme nous le dit Hannah Arendt, à penser ce que nous faisons. Quelles que soient les révélations scientifiques, il faut penser cela dans un contexte humain ».
Marie-Agnès Bernadis182, coordinatrice de la délibération citoyenne Meeting of Minds à la Cité des sciences et de l’industrie organisée en 2006 sur les neurosciences à l’échelle européenne a relaté en détails l’organisation de ces débats et les recommandations auxquelles ils avaient abouti. Celles du panel français portaient sur la prise en charge des maladies neurodégénératives et sur l’utilisation de l’argent public, sur l’annonce du diagnostic au cas par cas, sur la nécessité de l’accompagnement du patient et de son entourage, sur un meilleur accès aux structures de soins, sur la nécessité de ne pas catégoriser les individus à partir d’une information obtenue en imagerie cérébrale, sur les dérives de l’utilisation des données d’imagerie dans le monde professionnel. Les citoyens français avaient bien identifié la différence entre intervention sur un handicap et augmentation des possibilités humaines et tout un débat avait porté sur le traitement des enfants hyperactifs par la ritaline. Le panel français, tout comme le panel européen, avait souligné avec force la nécessité d’un investissement plus fort dans la recherche fondamentale sur le cerveau, malade ou non.
Cet intérêt démontre aussi qu’un enseignement de ces problématiques dans le secondaire serait utile. En fait, ainsi que l’avait remarqué en conclusion François Berger183 : « Ce qui ressort des débats citoyens dont il vient d’être question est une très belle leçon de démocratie. J’y étais plus ou moins opposé. Or les recommandations sont très rigoureuses. Elles ont réussi à intégrer la complexité du sujet et à se démarquer des lobbies et des discussions habituelles. J’ai l’impression que, lorsqu’un sociologue ou un philosophe discute avec un représentant des neurosciences, ils n’arrivent pas à communiquer. Or le citoyen a complètement résolu le problème. Ceci doit nous rendre vraiment optimistes »
Donc, une fois de plus, vos rapporteurs, tout comme leurs collègues de l’OPECST qui viennent de présenter en février 2012 deux rapports, l'un sur « l’innovation à l’épreuve des peurs et des risques184 », l'autre sur « les enjeux de la biologie de synthèse185 » recommandent l’organisation de débats publics et un effort des pouvoirs publics pour l’information des citoyens et des médias sur les progrès et les limites de la recherche scientifique.
L’Office parlementaire y prendra sa part en poursuivant son travail d’étude et d’alerte par l'organisation de nouvelles auditions publiques sur toutes les préoccupations évoquées au long de ce rapport et qui recoupent parfaitement celles exprimées par le débat citoyen de 2006.
Recommandations :
- Mettre en place un enseignement de bioéthique dans le secondaire ;
- Organiser dans un cadre pluridisciplinaire des débats citoyens afin de permettre aux scientifiques de faire partager leurs découvertes et leurs interrogations ;
La rapidité avec laquelle les neurosciences et l’imagerie cérébrale ont surgi non seulement dans le champ des sciences sociales mais également dans la vie quotidienne soulève des interrogations. Cette rapidité apparait très décalée par rapport à la prudence des neuroscientifiques eux-mêmes.
Les neurosciences ont la vertu d’être rapidement assimilées par l’esprit de nos contemporains. On ne s’étonne presque plus des conséquences que l’on peut en tirer. On est frappé de voir à quel point les effets d’annonce, fréquents en la matière, pénètrent très facilement le grand public.
L’accélération des recherches sur le fonctionnement du cerveau, fait naître des tensions particulièrement vives entre espoirs et émerveillement d’une part, et interrogations et inquiétudes, voire désenchantement, d’autre part. La connaissance de l’information cérébrale et des caractéristiques neurales de l’individu peut être perçue comme une intrusion dans l’intimité de chacun pour le meilleur et pour le pire.
Pour le meilleur, parce qu’elle intéresse la médecine, la recherche dans la perspective de traitement des maladies neuropsychiatriques invalidantes ; pour le pire, parce qu'elle peut être détournée de son objectif premier, et servir des théories réductionnistes et déterministes, dangereuses pour les libertés individuelles.
Certains experts redoutent qu’une banalisation du cerveau, facilitée par les technologies de modélisation, de simulation et de visualisation, accrédite une représentation simplifiée de l’humain. « De plus en plus, les technologies développent chez nos contemporains une représentation d’eux-mêmes simplifiée. La technologie est en général efficace, quand elle opère une simplification de l’objet à comprendre, simplification sans doute plus grave dans le domaine de l’imagerie cérébrale. Au fond, on pense que même si le cerveau est complexe, même si son exploration exige une infrastructure technique considérable, il n’est pas davantage que l’embrouillamini de milliards de neurones reliés entre eux par un immense réseau de câbles et de connexions, dans lesquels circulent des impulsions électriques ou chimiques. La complexité n’empêche pas qu’on projette sur elle de la simplicité » explique Jean-Michel Besnier186.
Selon Jean-Claude Ameisen187, cette crainte est renforcée par la nature même des neurosciences et de l’imagerie cérébrale qui conduisent à s’interroger sur les déterminants de leur propre activité, sur les déterminants biologiques de la démarche éthique ; la démarche éthique s’interrogeant à son tour sur les implications, en termes humains, d’une telle approche réductionniste. « Rarement, sans doute, réflexion scientifique et réflexion éthique n’ont été aussi intriquées. »
Rarement aussi des avancées scientifiques et technologiques ont suscité une telle fascination et des réactions aussi contradictoires. On découvre grâce aux progrès des neurosciences et de l’imagerie cérébrale le sens concret de la plasticité cérébrale et combien les apprentissages, le langage, la pensée et les interractions de chacun avec autrui, combien l’environement social retentit sur l’activité cérébrale et le cerveau de chacun.
Face à ces avancées et aux attentes quelles suscitent, il importe surtout d’informer et de débattre.
I- RENFORCER LA RECHERCHE SUR LES MALADIES DU CERVEAU
- Simplifier les systèmes de financement pour attirer les meilleurs chercheurs étrangers.
- Encourager le retour des post-doctorants en France par des offres concrètes incluant des précisions sur les conditions et moyens de recherches offerts et un salaire en rapport avec leur qualification.
- Accroître la lisibilité de l’organisation de la recherche en France.
- Encourager les projets de recherches pluridisciplinaires incluant clairement des chercheurs en neurosciences, en psychiatrie et en sciences humaines et sociales.
- Assurer des financements récurrents pour la maintenance des grands appareils et pour les projets à long terme exigeant la mise en place de cohortes.
- Veiller à ce que la transposition de la directive européenne, 2010/63/UE du 22 septembre 2010, relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, concilie la protection des primates non humains et les nécessités de la recherche.
II- GARANTIR LA PROTECTION DES PERSONNES ET LA SÉCURITE DE LEURS DONNÉES MÉDICALES
- Organiser une veille conjointe de l’Agence de la biomédecine et de la CNIL, sur l’utilisation de données d’imagerie cérébrale dans le but de définir par ordinateur les caractéristiques d’une personne.
- Renforcer les procédures de codage et de sécurisation des bases de données de l’assurance-maladie et des autres banques de données médicales.
- Assurer une traçabilité de l’accès des personnels habilités à connaître ces données.
- Améliorer la formation et la sensibilisation des personnels médicaux au respect du secret médical et à la délivrance de données médicales.
- Assurer la sécurité de l’hébergement et du transfert des données d’imagerie cérébrale.
- Soumettre à des conditions strictes d’agrément les hébergeurs de données de recherches sur de grandes cohortes.
- Accroître les moyens d’expertise de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
- Participer activement à la négociation et à l'adoption d'une convention internationale pour encadrer la circulation des informations médicales.
- Publier les dispositions règlementaires nécessaires, en vue d’une application rapide de la nouvelle loi du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine.
- Installer dans les plus brefs délais la Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine, instituée par la-dite loi.
- Accroître le nombre de radio-physiciens et améliorer leur formation.
- Informer les patients du dosage annuel de radiations et de rayonnements subis, et établir en conséquence des règles d’optimisation des procédures de suivi, d’évaluation et de publication des doses délivrées.
- Augmenter substantiellement le parc français d’IRM, afin de limiter le recours substitutif excessif à la technique irradiante du scanner, et assurer un égal accès de tous aux techniques les mieux adaptées.
- Établir des guides de bonnes pratiques médicales sur le fonctionnement et l’utilisation des appareils d’imagerie incluant les limites de ces technologies.
- Mettre en place, au moins au niveau national, une démarche d’évaluation des technologies d’imagerie innovantes, sur la base du retour d’expérience des utilisateurs.
- Établir un guide de bonnes pratiques en terme éthique sur l’usage des implants cérébraux.
- Renforcer la veille sanitaire et l’information sur tout procédé ayant pour objectif d’agir sur les capacités cognitives des individus.
IV- AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS ATTEINTS DE MALADIE MENTALE ET LUTTER CONTRE LES STIGMATISATIONS
- Développer de nouvelles modalités de prise en charge non stigmatisantes, en particulier par la promotion de centres de référence.
- Favoriser l’interdisciplinarité dans l’approche de ces pathologies complexes afin d’assurer une meilleure coordination entre la recherche et la clinique.
- Accroître l’organisation institutionnelle des interactions de la communauté des chercheurs avec celle du monde associatif, représentant des patients et de leurs familles.
- Créer un Institut multidisciplinaire dédié à la recherche sur les maladies mentales pour favoriser la recherche en psychiatrie.
V- MIEUX INFORMER LES CITOYENS SUR LES RÉSULTATS A ATTENDRE DE L’IMAGERIE CÉRÉBRALE
- Publier rapidement l’arrêté mentionné à l’article L.1134-1 du code de la santé publique (loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique) qui prévoit la définition de bonnes pratiques applicables à la prescription et à la réalisation des examens d'imagerie cérébrale à des fins médicales.
- Établir des guides de bonnes pratiques médicales visant à assurer une information adaptée des patients et personnes acceptant de se soumettre à des traitements ou recherches par imagerie.
- Aider les médecins dans l’éthique de la pratique médicale (droit de savoir ou non, à qui communiquer les résultats, comment …).
- Préciser la notion de consentement éclairé pour les patients atteints de troubles légers du comportement.
- Informer clairement le public sur les possibilités et limites de l’imagerie médicale et sur l’indispensable recours aux seuls praticiens médicaux pour garantir une lecture et une interprétation correctes des résultats.
- Mettre rapidement en mesure l’Agence de la biomédecine d'effectuer la veille sur les neurosciences que lui confie la loi du 7 juillet 2011.
- Mettre en place un enseignement de bioéthique dans le secondaire.
- Organiser dans un cadre pluridisciplinaire des débats citoyens afin de permettre aux scientifiques de faire partager leurs découvertes et leurs interrogations.
- Préciser, voire supprimer, la possibilité d’utiliser l’imagerie cérébrale en justice.
- Renforcer la protection des personnes contre les discriminations fondées sur les techniques d’imagerie cérébrale par une disposition du code civil.
- Clarifier le régime juridique des sanctions pénales applicables en cas de non respect de ces dispositions.
EXAMEN DU RAPPORT PAR L’OFFICE
Le 6 mars 2012, l’OPECST a procédé à l’examen du rapport sur « l’impact et les enjeux des nouvelles technologies d’exploration et de thérapie du cerveau », à partir de l’exposé de ses deux co-rapporteurs, MM. Alain Claeys et Jean-Sébastien Vialatte, députés.
M. Bruno Sido, sénateur, président de l’Office : Nous allons entendre les conclusions d’Alain Claeys et Jean-Sébastien Vialatte sur « l’impact et les enjeux des nouvelles technologies d’exploration et de thérapie du cerveau ».
Nous avons abordé une partie de cette question lors de notre récente visite à l’INSERM, mais le rapport présenté par nos collègues élargit considérablement les perspectives.
Il s’agit d’un sujet central de santé publique, lié au vieillissement des populations, mais aussi d’une préoccupation économique car les enjeux industriels qui s’y rattachent sont considérables.
Et, au fond, peuvent se reposer à nouveau, dans ce cas, des questions récurrentes :
- la mise en cohérence de notre appareil de recherche est-elle suffisamment assurée compte tenu du grand nombre d’intervenants ?
- le transfert éventuel des avancées scientifiques et technologiques vers l’aval est-il pris en considération dans la gouvernance de demain ?
M. Alain Claeys, député, rapporteur. En introduction, je rappellerai que depuis une quinzaine d'années, les progrès en neuroimagerie ont permis d'extraordinaires avancées en neurosciences. Ces techniques qui révolutionnent notre compréhension du cerveau, dans le domaine médical et dans celui de la recherche fondamentale, provoquent des tensions d’ordre éthique, philosophique, juridique et social. Elles répondent partiellement aux interrogations métaphysiques que l’homme s’est posées tout au long de son histoire sur la pensée, la conscience, la mémoire, les émotions, la liberté, la responsabilité et le libre arbitre. Pour autant, le cerveau garde encore une grande part de son mystère.
Ainsi, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les pathologies du cerveau restent un problème de santé publique inquiétant qui concerne une personne sur quatre. D’après cette organisation, les pathologies mentales représentent aujourd’hui cinq des dix principales causes médicales de handicap, et seraient à l'origine de 35 % des dépenses liées à la maladie en général. Mais certains coûts ne sont pas évaluables, tels ceux liés à l’impact indirect sur la famille du patient, ou encore la baisse de productivité résultant d'affections n'entraînant pas de handicap permanent. Pourtant, les dépenses moyennes mondiales pour la santé mentale sont encore inférieures à 3 dollars par habitant et par an. En Europe, chaque année, 38,2% de la population, soit 164,8 millions de personnes, souffrent d’une maladie mentale. Le coût total des maladies du cerveau y était estimé en 2004 par l'European Brain Council (EBC) à 386 milliards d'euros et a atteint 798 milliards d'euros par an en 2010. Les dysfonctionnements du cerveau constituent l'une des premières causes de maladie ou de handicap, et retentissent, directement ou indirectement, de manière importante sur la société.
En France, la prise en charge, et le traitement des maladies mentales font l’objet de débats vifs : un Français sur cinq a été ou est atteint d’une maladie mentale (18.8 %) ; il reste encore difficile de faire admettre la nécessité d’une prévention, d’un suivi et d’un traitement au long cours. En outre, la séparation de la neurologie et de la psychiatrie, entraîne des controverses très vives et regrettables car les patients sont littéralement pris en otage par de virulentes querelles d’école ayant parfois de graves retentissements sur les traitements.
Face aux défis lancés par les maladies neuropsychiatriques, on assiste à l’échelon mondial à une internationalisation des grands programmes de recherches auxquels les équipes françaises participent. C’est le cas du projet Blue Brain qui vise à créer un cerveau artificiel, et dont la méthodologie et le coût font débat, l'Union européenne le finançant à hauteur de 100 millions d’euros par an sur 10 ans. Les États-Unis, le Japon, l’Allemagne se mobilisent fortement contre les maladies neurodégénératives en raison du vieillissement de leur population ; il en va de même en France où l’on dispose d’atouts importants en neurosciences. Dans ce domaine, la recherche française jouit d’une d’une grande visibilité au sein d’une recherche très internationale. Le regroupement d’Instituts au sein de l’Alliance pour les sciences de la vie et de la santé (AVIESAN), et le programme d’investissements d’avenir en neurosciences, devraient accroître ce potentiel, à condition de favoriser l’interdisciplinarité.
Les grands pôles de recherche en France sont tous très récents ; NeuroSpin, l’Institut du cerveau et de la moelle épinière, le Campus de CLINATECH à Grenoble, le Centre de neurosciences de Lyon, le Pole 3 C et l’Hôpital de la Timone à Marseille sont reconnus à l’étranger. Les scientifiques se montrent satisfaits de la part faite aux neurosciences dans les investissements d’avenir, mais relèvent que l’organisation, et surtout le financement des projets de recherche, manque de visibilité. De nombreux post-doctorants, chercheurs, voire directeurs d’institutions ont tenté en vain, semble-t-il, de revenir en France. Les organismes français ne semblent pas assez réactifs. Ceci fait donc l’objet de recommandations. Par ailleurs, les chercheurs de ce domaine sont inquiets des retombées possibles de la directive européenne du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, dont la transposition, qui devrait intervenir avant le 1er janvier 2013, risquerait de ralentir certains projets de recherche ; aussi recommandons-nous de concilier la protection des primates non humains et les nécessités de la recherche, lors de cette transposition.
M Jean-Sébastien Vialatte, député, rapporteur. Je dresserai rapidement un tableau des progrès technologiques les plus récents de la neuroimagerie, lesquels consistent dans la mise au point de techniques permettant d’augmenter la résolution, d’améliorer la fiabilité de l’analyse des données et les conditions de leur stockage. Différentes approches et technologies sont utilisées, car elles sont complémentaires et souvent associées.
Une utilisation novatrice de techniques non interventionnelles comme l’électroencéphalographie (EEG) couplée à des enregistrements vidéo accroît la finesse des analyses, ce qui est particulièrement utile dans la détection et le traitement des crises d’épilepsie. La possibilité de voir le cerveau en fonctionnement grâce à l’imagerie par résonance magnétique (IRM) a radicalement contribué à l’évolution de l’approche du cerveau tant au plan philosophique, qu’au niveau de la recherche scientifique, et des approches thérapeutiques. Les progrès de l’IRM portent sur la rapidité, la résolution, et la multi-modalité, par le développement de nombreuses applications différentes (la spectroscopie qui donne des informations biochimiques in vivo, l’IRM fonctionnelle, l’IRM de diffusion, l’IRM de perfusion, etc). L’imagerie multimodale est utilisée dans la prise en charge des tumeurs malignes et des cancers du cerveau. ![]()
L’IRM de diffusion, nouvelle technique, est la seule méthode d’imagerie qui permet de visualiser un accident ischémique dans les premières heures. Dans le futur, l’IRM à très haut champ magnétique devrait améliorer la résolution au niveau du cortex pour mieux en analyser la structure, en observer d’éventuelles atrophies.
La tomographie à émission de positrons (TEP) produit une image fonctionnelle de certaines zones du cerveau avec une précision de niveau moléculaire ; elle est largement utilisée pour des études physiologiques et physiopathologiques de la cognition et du comportement, ainsi que pour l’étude de différentes pathologies affectant le système nerveux central. L’évolution récente consiste à coupler cette technique et le scanner à rayon X (TEP-scan, ou PET-scan en anglais) avec l’IRM dans le but de permettre à la fois la localisation et l’analyse de mécanismes neuronaux complexes (IRM) et l’analyse au niveau moléculaire du fonctionnement du cerveau (TEP) pour réduire le temps d’observation et d’exposition. Toutefois, l’interprétation de données ainsi recueillies exige des compétences particulières et une formation idoine.
Des technologies combinent l’usage de la neuroimagerie et l’intervention sur le cerveau de manière plus ou moins invasive, et génèrent des interrogations éthiques dans la mesure où certaines d’entre elles peuvent avoir un impact direct sur le comportement, telle la stimulation cérébrale profonde qui consiste à implanter, dans une région profonde du cerveau, une électrode de stimulation à haute fréquence dont l’activation est contrôlée par le malade. La pensée peut-elle commander le mouvement sans l’intermédiaire du corps, et diriger une machine? Ce qui était jadis un thème de science-fiction est devenu une réalité avec les interfaces homme/machine, grâce à la simulation en trois dimensions (3D) d’un environnement particulier dans lequel le sujet a l'impression d'évoluer. L’interface cerveau/machine (ICM), système de liaison directe entre un cerveau et un ordinateur, permet à un individu de communiquer avec son environnement sans passer par l’action des nerfs périphériques et des muscles. Les effets positifs des interfaces ont été validés dans certaines phobies spécifiques et dans le pilotage de prothèses.
S’agissant de la protection des personnes, les débats portent sur l’impact des rayonnements ionisants sur la santé et sur celui des champs magnétiques. L’autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui assure depuis une dizaine d’années le contrôle des applications médicales des rayonnements ionisants (sûreté des appareillages, protection des patients et des travailleurs), constate que ce risque s’accroît en raison de l’augmentation des doses en imagerie médicale, plus particulièrement du fait du scanner, de la répétition des examens, et du phénomène émergent de la radiosensibilité individuelle. Cela se double en France d’une difficulté d’accès aux IRM qui sont en nombre insuffisant ; aussi utilise-t-on le scanner au lieu de l’IRM pour nombre d’explorations du cerveau : la France dispose de 8 appareils par million d’habitants, contre 35 aux États-Unis et 40 au Japon. Ceci nous conduit à recommander d’accroître le nombre de radio-physiciens en améliorant leur formation, d’informer les patients du dosage annuel de radiations et de rayonnements subis, et d’augmenter substantiellement le parc français d’IRM.
Concernant les recherches sur la personne humaine, la proposition de loi d’Olivier Jardé adoptée par le Parlement fin février, qui a été publiée le 5 mars 2012, clarifie de façon satisfaisante les conditions de la recherche. Sa mise en œuvre dans de brefs délais, que nous demandons, devrait répondre aux difficultés des chercheurs menant des recherches non interventionnelles.
Dès l’évaluation de la loi relative à la bioéthique et au cours des débats sur la loi du 7 juillet 2011, nous nous sommes inquiétés des problèmes soulevés par la protection du stockage des données d’imagerie, qui sont régulièrement échangées entre professionnels, pour obtenir des avis aidant à surmonter les difficultés d’interprétation, ou dans le cadre de la télémédecine. Ainsi l’ouverture de l’accès à l’IRM pose la question cruciale de la suppression des sources et surtout de la nécessité de l’anonymisation des données, car il arrive que des personnels donnent des informations précises, sans vérifier l’identité des personnes qui les leur demandent, et donc violent sans s’en rendre compte le secret médical.
De même, la télétransmission des feuilles de soins de la sécurité sociale pose problème, car la nomenclature peut révéler le résultat des examens médicaux, notamment dans le cadre de l’analyse de neuroimagerie, puisque les codes diffèrent en fonction des maladies traitées. La Commission de l’informatique et des libertés (CNIL), tout en assurant avoir obtenu une amélioration du codage des informations, reconnaît ne pas être sûre de la sécurité des procédés de chiffrement. Aussi proposons-nous de renforcer les procédures de codage et de sécurisation des bases de données, d’assurer une traçabilité de l’accès par les personnels habilités à y accéder, d’améliorer la formation et la sensibilisation des personnels médicaux au respect du secret médical, de renforcer les moyens d’expertise de la CNIL. De même, convient-il de soumettre à des conditions strictes d’agrément les hébergeurs de données de recherches sur de grandes cohortes nécessaires aux recherches sur les maladies neuropsychiatriques, et d’assurer la sécurité de l’hébergement et du transfert des données d’imagerie cérébrale en cas de recours à des hébergeurs de données à l’étranger.
M. Alain Claeys, député, rapporteur. Malgré la mobilisation mondiale, la neuroimagerie performante, quand elle rend compte de l’évolution de certaines maladies neurodégénératives, voire en prédit l’apparition, n’a pas encore permis la mise au point de molécules nouvelles, car les grands groupes pharmaceutiques ne semblent pas très impliqués, à la différence des industriels de l’imagerie et de la robotique. Il n’y a pas ou très peu de médicaments nouveaux. Cette situation induit, selon Jean-Pierre Changeux, des interrogations sur la relation bénéfice/risque : faut-il reconsidérer cette notion inadéquate dans le traitement des pathologies neurodégénératives, mais aussi dans certaines pathologies psychiatriques très invalidantes ? La proposition de l’ancien président du CCNE mérite débat, car il s’agit d’établir des conditions spécifiques d’essais de développement de nouvelles molécules susceptibles d’être efficaces ; du fait des effets secondaires potentiels, le consentement des personnes doit être éclairé.
En France, une amélioration de la prise en charge des maladies neurodégénératives, se dessine lentement grâce à quelques découvertes, tel le traitement de la maladie de Parkinson par stimulation cérébrale profonde, ou le développement de biomarqueurs. Toutefois des efforts sont nécessaires et indispensables pour lutter contre les pathologies psychiatriques qui, mal connues des Français, engendrent peur, rejet et stigmatisation. Elles sont associées à la folie et à la violence : 74 % des Français considèrent qu’un schizophrène est dangereux, alors que seulement 0,2% des schizophrènes peuvent l’être pour les autres. On ne dispose en France, ni d’épidémiologie psychiatrique, ni de données médico-économiques, ou de santé publique. Des programmes de prévention de la psychose existent dans différents pays, en Europe, en Amérique du Nord, en Australie et au Japon, mais la France accuse dix à vingt ans de retard ; la prévention des troubles psychiatriques y est donc inexistante. En témoigne l’absence d’action de prévention ciblée sur l’impact de l’usage du cannabis dans la survenue de délires schizophréniques.
Aussi, suggérons nous de renforcer à tous les niveaux la prise en charge des patients atteints de maladies mentales en France, en luttant contre la stigmatisation dont ils font l’objet par des actions d’information et de prévention ciblées, en menant des études statistiques systématiques sur les pathologies concernées, en procédant à une large diffusion de ces données, en favorisant l’interdisciplinarité dans l’approche de ces pathologies complexes, en renforçant les liens entre la communauté des chercheurs et des associations de patients, et en créant un Institut multidisciplinaire dédié à la recherche sur les maladies mentales pour favoriser la recherche en psychiatrie.
Le décalage entre les possibilités de diagnostic précoce et les capacités de traitement est de plus en plus grand, entraînant une interrogation sur le sens même de la prédiction et son intérêt. Ce décalage génère de multiples tensions. Quel sens donner au diagnostic des maladies du cerveau ? Comment procéder lors de la découverte fortuite d’une pathologie sur une personne en bonne santé ? La loi relative à la bioéthique du 7 juillet 2011 règle en partie le problème délicat du droit de savoir ou de ne pas savoir, et de l’information de la parentèle en cas de découverte d’une anomalie génétique. Le texte tente de concilier les droits et devoirs de chacun, il devrait pouvoir servir de référence, encore faut-il, comme le prévoit la loi précitée, publier rapidement l’arrêté sur la définition des bonnes pratiques applicables à la prescription et à la réalisation des examens d'imagerie cérébrale à des fins médicales. Il est, en outre, nécessaire d’établir des guides de bonnes pratiques visant à assurer une information adaptée des patients et personnes acceptant de se soumettre à des traitements ou recherches par imagerie, à sensibiliser à l’impact potentiel de la communication des résultats, et à aider les médecins dans l’éthique de la pratique médicale (droit de savoir ou non, à qui communiquer les résultats, comment …).
Les techniques de neuroimagerie amènent à s’interroger sur la frontière entre actions de rétablissement et améliorations des fonctions, sur les risques de modification des comportements, et sur la valeur du consentement éclairé dans des cas limites. Aussi faut-il préciser la notion de consentement éclairé pour les patients atteints de troubles légers du comportement, et établir un guide de bonnes pratiques en terme éthique sur l’usage des implants cérébraux, donner rapidement à l’Agence de la biomédecine les moyens d’exercer les compétences nouvelles de veille et de contrôle sur les neurosciences, que lui confie la loi précitée. Certains médicaments développés pour la dépression ou les troubles du sommeil semblent être détournés de leur usage primaire en vue d’améliorer «chimiquement» la coopération entre les individus au sein d’un groupe, ou d’augmenter les périodes d’éveil en maintenant les capacités d’attention et de concentration. Nous considérons que seule une information idoine et une veille sanitaire par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, et l’Agence de la biomédecine, peuvent éviter la généralisation de ces pratiques qu’une société de la performance encourage.
Un vaste programme de recherche consacré à la convergence des technologies a été engagé en 2002 principalement aux États-Unis, avec quatre voies technologiques convergentes. Le gouvernement fédéral des États-Unis a doté ce programme couramment appelé NBIC -nano, bio, info, cogno- de plusieurs milliards de dollars. Nous estimons que les aspects éthiques et les impacts sociétaux des technologies convergentes doivent être actualisés par l’OPECST, qui s’est déjà penché sur ce sujet à plusieurs reprises dans ses travaux sur les nanotechnologies. Il y a deux raisons à cela : la rapidité de l’évolution des outils dans ce domaine, et leur utilisation de plus en plus étendue.
Hors de la sphère scientifique et médicale, le développement du neuromarketing pose problème, car il procède d’un dévoiement de la neuroéconomie, discipline qui se situe à l'intersection de la micro-économie, des sciences du vivant et de l'imagerie, et qui vise à comprendre les processus, les sensations et l'action dans une situation où l'on doit prendre une décision. Le neuromarketing applique les techniques et savoirs issus des neurosciences au comportement du consommateur, et s’appuie essentiellement sur l’imagerie par résonance magnétique (IRM) pour analyser ce qui advient dans le cerveau quand on visionne une publicité, ou que l’on prend une décision d’achat. Ces expérimentations commerciales mobilisent, pendant des heures, des sujets, des IRM, des techniciens, voire des neurologues ; c’est pourquoi nous recommandons d’interdire la validation de campagnes publicitaires par le recours aux IRM dédiées au soin et à la recherche scientifique et médicale.
Quant à l’utilisation de la neuroimagerie en justice, fréquente aux États-Unis, elle semble gagner d’autres pays comme l’Inde et l’Italie. Toutefois la fiabilité limitée des techniques de neuroimagerie incite peu la justice américaine à s'en servir comme preuve de l'accusation ; elle est plutôt utilisée comme soutien aux moyens de défense de l'accusé. À ce jour, on compte 614 cas pour lesquels des images obtenues par IRM fonctionnelle ont servi de preuve au pénal. Alors que la recherche dans ce domaine est encore lacunaire, deux sociétés américaines proposent un service spécialisé dans la détection de mensonge par IRM fonctionnelle. L’activité de ces sociétés semble pour le moins faiblement encadrée déontologiquement et commercialement. Cette pratique est inquiétante car elle vise des affaires privées qui vont des conflits conjugaux à l’embauche, voire à la souscription d’assurances pour un coût élevé.
En France, la loi de bioéthique du 7 juillet 2011, à l’élaboration et aux débats de laquelle nous avons tous deux participé activement tout au long de l’année 2011, encadre les applications des neurosciences en réglementant l’accès aux techniques de l’imagerie cérébrale Elle crée un cadre protecteur des droits de la personne en les soumettant aux grands principes bioéthiques inscrits dans le code civil. La nouvelle loi circonscrit le domaine d’utilisation en fonction de trois finalités reconnues comme légitimes : finalité médicale, de recherche scientifique et d’expertise judiciaire.
La finalité judiciaire introduite et limitée à l’expertise judiciaire parait prématurée au regard du manque de fiabilité des techniques. Cette disposition suscite le débat et nous semble contre-productive en l’état des connaissances en imagerie cérébrale. On ne devrait pas permettre de statuer sur la culpabilité, les prédictions, et le pourcentage de récidives éventuelles d’un individu sur la seule base de données de neurosciences. L’expertise en la matière risque donc de poser plus de questions que de fournir de réponses. Il reste que le pouvoir de simplification et de fascination des images, et leur caractère scientifique, peuvent influencer, et leur conférer une valeur probante supérieure à ce qu’elles sont en mesure d’offrir. En outre, la loi précitée ignore le risque de discrimination spécifique lié à l’utilisation de données cérébrales, alors qu’il aurait été facile de s’inspirer des sanctions pénales édictées pour discrimination en raison de caractéristiques génétiques. Nous estimons que ces points doivent être éclaircis, et qu’il faut renforcer la protection des personnes contre ces dérives par un régime de sanctions appropriées.
S’il appartient au Parlement de faire des propositions de réforme, nos concitoyens doivent pouvoir être informés de ces questions par l’organisation de débats publics, car la rapidité avec laquelle les neurosciences et l’imagerie cérébrale ont investi non seulement le champ des sciences sociales, mais également la vie quotidienne, suscite des peurs.
En conclusion, M. Jean-Sébastien Vialatte, député, rapporteur, rappelle que les nombreuses personnalités auditionnées ont toutes souligné la nécessité d’apporter au public une information plus scientifique et de meilleure qualité sur les apports des neurosciences et l’évolution des traitements possibles des maladies neurologiques et psychiatriques. Toutes insistent sur les effets pervers d’informations sensationnelles laissant croire à des découvertes ouvrant à des traitements. On en est encore loin, comme le démontre la prudence des neuroscientifiques eux-mêmes, et ceux-ci insistent sur le fait que le cerveau ne fonctionnant pas en couleur, les images ne sont que des artefacts colorisés résultant de modèles mathématiques.
C’est pourquoi nous recommandons d’une part, la mise en place d’un enseignement de bioéthique dans le secondaire, et d’autre part, l’organisation de débats publics pour informer les citoyens sur les progrès et les limites de la recherche en neurosciences, et de donner à l’Agence de la biomédecine les moyens d’exercer ses nouvelles missions de veille.
M. Bruno Sido, sénateur, président. Je remercie beaucoup les rapporteurs pour leur présentation passionnante. J’ai noté les recommandations de prudence de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) concernant le recours au scanner. Quels sont les impacts respectifs sur la santé de l’utilisation des différentes technologies d’exploration du cerveau ?
M. Jean-Sébastien Vialatte, député, rapporteur. Les inconvénients du scanner sont liés à la dose de radiation délivrée, même si les nouveaux appareils sont plus rapides et délivrent des doses moindres. De plus, la répétition des examens au long de l’année devrait être évitée. Mais la France manque d’IRM. L’IRM, qui utilise les champs magnétiques, présente moins de risques, comme le montre la modification récente de la directive européenne à ce sujet. Toutefois, il est préférable d’utiliser des appareils de puissance faible pour les traitements et de réserver les autres à la recherche.
M. Claude Birraux, député, premier vice-président. J’observe que les équipements sont de plus en plus puissants : comment l’industrie française se positionne-t-elle dans ce secteur d’équipement ?
L’augmentation du nombre de radiophysiciens et l’amélioration de leur formation avaient été préconisées par l’Office après les accidents de Toulouse et d’Epinal. Pour autant, très peu de Français s’inscrivent à l’Ecole européenne de physique médicale rattachée au CERN, qui dispense un enseignement de qualité à de nombreux étudiants venus du monde entier.
Quant à la réduction des doses délivrées au patient, les médecins ne l’appliquent pas à eux-mêmes, et ne se protègent que depuis qu’ils font de la radiochirurgie.
Faute de nouvelles molécules, on assiste à des restructurations dans l’industrie pharmaceutique, on change donc les emballages mais les médicaments n’évoluent guère et on embauche plus volontiers des cadres commerciaux que des chercheurs, ce qui est regrettable. Il faudra bien trouver et développer de nouvelles molécules.
Quant à l’organisation d’un débat citoyen, je suis réservé. Ne faut-il pas inventer un autre type de débat afin d’éviter les face à face stériles ? Des expériences menées par l’INSERM et par l’université de Lausanne ont montré l’intérêt d’une mobilisation des sciences humaines et sociales, des chercheurs, et des associations de patients pour adapter les angles d’analyse et permettre une réflexion plus approfondie.
M. Jean-Sébastien Vialatte, député, rapporteur. Il est vrai qu’il n’y a pas de constructeurs français de grands équipements tels que des IRM à 11, voire 14 Teslas. Cependant, pour la construction d’appareils à aimant puissant, des partenariats industriels ont été mis en œuvre entre le CEA qui en est le concepteur, et les industriels étrangers comme Siemens etc... Toutefois, les équipes de recherche qui ont obtenu les crédits nécessaires à l’implantation et à l’achat de ces outils craignent de ne pas disposer des financements récurrents nécessaires à leur maintenance ; nous proposons d’ailleurs une recommandation sur ce point.
Concernant l’organisation d’un débat citoyen, il s’agit surtout d’insister sur la nécessité d’informer pour éviter les mêmes déceptions que celles induites par la thérapie génique et la thérapie cellulaire ; les traitements ne seront pas prêts demain. L’introduction des associations de patients n’est pas toujours aisée, car chacune est spécialisée sur une pathologie et défend son pré carré ; on aimerait les fédérer pour parvenir à un dialogue constructif.
M. Bruno Sido, sénateur, président. Quel est l’intérêt du dépistage précoce de certaines pathologies présentes de façon latente mais qui peut-être ne se développeront pas ? Comment procède-t-on lorsqu’il s’agit d’une pathologie pour laquelle on ne dispose d’aucun traitement efficace ?
M. Jean-Sébastien Vialatte, député, rapporteur. En effet avec des appareils de plus en plus puissants, l’on peut détecter par exemple des plaques amyloïdes, mais l’on ne sait que faire de ce résultat ; faut-il alerter les patients alors qu’il n’y a aucune consigne ? Leur présence ne signifie pas que la personne développera obligatoirement la maladie. Or, avec les recherches sur de grandes cohortes, cette question sera récurrente, et l’on découvrira de plus en plus de maladies potentielles.
M. Bruno Sido, sénateur, président. Je propose d’adopter les recommandations du rapport et d’en autoriser la publication.
À la suite de ce débat, l’OPECST a adopté à l’unanimité les recommandations du rapport dont il a également autorisé la publication.
COMPOSITION DU COMITÉ DE PILOTAGE
Hervé Chneiweiss, directeur de recherche, groupe « Plasticité gliale et tumeurs cérébrales » au Centre de psychiatrie et neurosciences de la faculté de médecine Paris-Descartes, membre du Conseil scientifique de l’OPECST.
Anne Fagot-Largeault, professeur au Collège de France, membre de l’Académie des sciences.
Hélène Gaumont-Prat, professeur de droit à l’Université Paris VIII, directrice du laboratoire de droit médical.
Jean-Michel Besnier, professeur de philosophie à l’Université de Paris IV-Sorbonne, chercheur au Centre de recherche en épistémologie appliquée (CREA), (CNRS/École Polytechnique).
LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES
Auditions et missions en France
Mardi 30 mars 2011 : Paris
Ê Visite de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM) de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière et entretiens
- Pr Gérard Saillant, professeur de chirurgie orthopédique et traumatologique, président de l’ICM
- Pr Bertrand Fontaine, professeur de neurologie, directeur scientifique de l’ICM
- Pr Yves Agid, membre fondateur de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM), professeur de neurologie, membre de l’Académie des sciences, membre du membre du Comité consultatif national d’éthique (CCNE).
- Pr Bertrand Fontaine, professeur de neurologie et de neurosciences, directeur scientifique
- Mme Alexandrine Maviel-Sonet, directrice adjointe administration et finances
- M. Alexis Génin, directeur de la valorisation
- M. Stéphane Lehéricy, médecin/chercheur, responsable de la plateforme de neuroimagerie
Mardi 14 juin 2011 : Grenoble
Ê Le CEA Grenoble dans l’écosystème grenoblois
- M. Dominique Grand, adjoint au directeur du CEA Grenoble
- Pr François Berger, professeur de médecine, directeur général et exécutif de CLINATEC-CEA, Institut des neurosciences de Grenoble
- M. Jean-Louis Amans, responsable ligne programme
- Mme Françoise Lartigue, responsable programme d’investissement infrastructures CLINATEC et Nanobio
- M. Bruno Million-Frémillon, chef du service de communication du CEA Grenoble
- M. Jean-Pierre Vigouroux, chef du service des affaires publiques du CEA
- Mme Geneviève Fioraso, députée, membre de l’OPECST
Ê Imagerie au Département des micros Technologies pour la Biologie et la Santé (DTBS) CLINATEC
- Présentation de CLINATEC par le Pr François Berger, professeur de médecine, directeur général et exécutif de CLINATEC-CEA, Institut des neurosciences de Grenoble
- Visite du bâtiment (magnétoencéphalographie animalerie de l’extérieur…)
Ê Institut des neurosciences de Grenoble (GIN)
- Pr François Berger, professeur de médecine, directeur général et exécutif de CLINATEC-CEA, Institut des neurosciences de Grenoble
- Pr Claude Fuerstein, professeur de physiologie et de neurosciences à l’université Joseph Fourier de Grenoble
- Visite d’une plate-forme avec un échange avec des praticiens
Ê Campus St Martin d’Hères
- Visite du GIPSA-lab (Grenoble Images Parole Signal Automatique (Département Parole et Cognition) avec :
- M. Pierre Baconnier, professeur des universités, spécialiste des modélisations et notamment en physiologie, vice-président valorisation de l’université scientifique et médicale Joseph Fourier (UJF)
- M. Éric Saint Aman, professeur des universités, biochimiste, vice-président recherche en santé de (UJF)
- M. Thierry Menissier, vice-président valorisation et communication, directeur de la spécialité de master « Sciences et Innovation »
Vendredi 2 septembre 2011 : Toulon
Ê Cadre du partenariat OPECST-Académie des Sciences
– Mme Margaret Buckingham, membre de l’Académie des Sciences - section de biologie intégrative - directeur de recherche au CNRS et professeur à l’Institut Pasteur
– M. Frédéric Relaix, directeur de recherche à l’INSERM
– M Yves Agid, membre fondateur de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM), professeur de neurologie, membre de l’Académie des sciences, membre du membre du Comité consultatif national d’éthique (CCNE).
– Dr Claire Wyart, chef d’équipe Centre de Recherche de l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière, CRICM
Mardi 20 septembre 2011 : Marseille
Ê Pôle 3C Cerveau Comportement Cognition sur le site de Saint Charles
Visite sur site d'un IRM petit animal, de multiples systèmes d'électro-encéphalographie (dont un double pour les neurosciences sociales), des laboratoires comportementaux, de la stimulation magnétique transcrânienne
– M. Pascal Huguet, directeur du pôle,
– M. Thierry Hasbroucq, directeur adjoint,
– M. Olivier Oullier, professeur de psychologie à l’Université Aix-Marseille, conseiller scientifique, Centre d’analyse stratégique (CAS)
– Mme Sandrine Basques, coordinatrice du pôle
Ê Hôpital de la Timone
– Visite du Centre d'imagerie fonctionnelle IFR 131 (installations d'IRMf et de magnétoencéphalographie)
– M. Jean-Luc Anton, ingénieur de recherche CNRS,
– M. Éric Berton, doyen de la faculté des sciences du sport, directeur de l’institut des sciences du mouvement (présentation des questions de perceptions).
– Entretiens
– Dr Viktor Jirsa, directeur de recherche, Institut des Sciences du Mouvement, Neurosciences théoriques (modèles mathématiques et fiabilité)
– Dr Laurent Vinay, directeur du laboratoire Plasticité et physio-pathologie de la motricité (P3M) (présentation du futur institut des neurosciences)
– Pr Yehezkel Ben-Ari, fondateur et directeur honoraire de l’Institut de neurobiologie de la Méditerranée (INMED)
Mardi 13 décembre 2011 : Paris
Ê Visite à l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM) de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière
– Discussion informelle sur les questions d’éthique
– Pr Alain Grimfeld, professeur de médecine, président du Comité consultatif national d’éthique (CCNE),
– Pr. Jean-Claude Ameisen, professeur de médecine, président du Comité d’éthique de l’INSERM, membre du CCNE,
– Pr Yves Agid, membre fondateur de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM). Professeur de neurologie, membre de l’Académie des sciences, membre du membre du Comité consultatif national d’éthique (CCNE).
Mercredi 18 janvier 2012 : Gif –sur-Yvette
Ê Visite à NeuroSpin
– Pr Denis Le Bihan, directeur de NeuroSpin, membre de l’Académie des sciences
– Pr Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France, membre de l’Académie des sciences, directeur de l’unité INSERM-CEA de neuroimagerie cognitive
– M. Gilles Bloch, directeur des sciences du vivant au CEA
– M. Yves Caristan, directeur du Centre de Saclay et des sciences de la matière
– Dr Andreas Kleinschmidt, conseiller scientifique auprès du directeur de l’Institut d’imagerie biomédicale du CEA, NeuroSpin/Laboratoire de neuroimagerie cognitive
– M.Jean-François Mangin, directeur du laboratoire de neuroimagerie
– M. Jean-Pierre Vigouroux, chef du service des affaires publiques du CEA
– Dr Ghislaine Dehaene, pédiatre, chercheur CNRS, les apprentissages chez l’enfant avec IRM 7T :
– Dr Cyril Poupon, chef du laboratoire de résonance magnétique nucléaire, l’IRM haute résolution et nouveaux contrastes
Mardi 14 février 2012 : Lyon
Ê Centre de recherches en neurosciences de Lyon (CRNL)
Présentation du CRNL et de certains de ses domaines de recherche
– Dr Olivier Bertrand, directeur du CRNL, directeur de recherches Introduction générale du CRNL
– Dr Luis Garcia-Larrea, directeur de recherches, Unité INSERM intégration centrale de la douleur Neurostimulation (TMS) et étude de la douleur par le
– M. Alessandro Farné, chercheur INSERM Réalité Virtuelle et plate-forme Neuroimmersion
Interface Cerveau-Machine (ICM)
– M. Jérémie Mattout, chercheur INSERM
– M. Karim Jerbi, chercheur INSERM
– M. Jean-Philippe Lachaux, directeur de recherches dans l’unité dynamique cérébrale et cognition de l'INSERM:
Démonstration ICM EEG (Jérémie Mattout, Emmanuel Maby, chercheurs INSERM)
Démonstration TMS (Luis Garcia-Larrea et Alessandro Farné) à l'hôpital neurologique
AUDITIONS PUBLIQUES À L’ASSEMBLEE NATIONALE SALLE LAMARTINE
Mercredi 29 juin 2011
- 14h-18h30 « Les nouvelles technologies d’exploration et de thérapie du cerveau : état des lieux »
Ê Ouverture
– M. Alain Claeys , député de la Vienne
– M. Jean-Sébastien Vialatte, député du Var
Ê Propos introductifs
– M. Hervé Chneiwess, directeur de recherche, groupe « Plasticité gliale et tumeurs cérébrales » au Centre de psychiatrie et neurosciences de la faculté de médecine Paris-Descartes, membre du Conseil scientifique de l’OPECST
– M. Bernard Bioulac co-directeurs de l’Institut thématique multi-organismes : neurosciences, sciences cognitives, neurologie et psychiatrie neurosciences de l’Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé (AVIESAN)
Ê L’exploration du cerveau : quelles avancées technologiques ?
– M. Didier Dormont, professeur des universités, praticien hospitalier, spécialiste en neuroimagerie, chercheur au centre de recherche de l’ICM
– M. Cyril Poupon, chef du Laboratoire de résonance magnétique nucléaire (NeuroSpin/Laboratoire d’imagerie et de spectroscopie - LRMN) au CEA
– M. Vincent Navarro, praticien hospitalier, neurologue, chercheur au centre de recherche de l’ICM
– M. Sylvain Ordureau, fondateur de usefull progress
Ê L’impact des avancées sur l’exploration et le traitement
– M. Philipe Vernier, professeur de neurologie, directeur de recherche, président de la société française de neurosciences
– M. Luc Mallet, psychiatre, chercheur au centre de recherche de l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM)
– M. Andréas Kleinschmidt, conseiller scientifique auprès du directeur de l’Institut d’imagerie biomédicale du CEA-NeuroSpin/Laboratoire de neuroimagerie cognitive (LCOGN)
– Mme Marie Vidailhet, professeur des universités, praticien hospitalier, neurologue, chercheur au centre de recherche de l’ICM
– M. Charles Ambroise Valery, neurochirurgien, directeur médical de l'unité de radiochirurgie, gamma-knife, hôpital de la Pitié-Salpêtrière
Ê Les interrogations scientifiques et techniques
– Mme Anne Fagot-Largeault, professeur au Collège de France, membre de l’Académie des sciences
– M. Yves Agid, membre fondateur de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM). Professeur de neurologie, membre de l’Académie des sciences, membre du membre du Comité consultatif national d’éthique (CCNE).
– M. Bertrand Fontaine, professeur des universités, praticien hospitalier, neurologue, directeur scientifique de l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM)
– M. Olivier Oullier, professeur de psychologie à l’Université Aix-Marseille, conseiller scientifique, Centre d’analyse stratégique (CAS)
Mercredi 30 novembre 2011 : « Exploration et traitement du cerveau : enjeux éthiques et juridiques »
Ê Propos introductifs
– M. Alain Claeys, député de la Vienne
– M. Jean-Sébastien Vialatte, député du Var
– M. Hervé Chneiweiss, directeur de recherche, groupe « Plasticité gliale et tumeurs cérébrales » au Centre de psychiatrie et neurosciences de l’Université Paris-Descartes, membre du Conseil scientifique de l’OPECST
Ê Que doit-on soigner ? Possibilités et limites
– M. Grégoire Malandain, directeur scientifique adjoint à l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)
– M. Andréas Kleinschmidt, conseiller scientifique auprès du directeur de l’Institut d’imagerie biomédicale du CEA - NeuroSpin/Laboratoire de neuro-imagerie cognitive (LCOGN)
– M. Lionel Naccache, professeur de médecine, neurologue, chercheur en neurosciences cognitives à l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM)
– M. Yehezkel Ben-Ari, fondateur et directeur honoraire de l’Institut de neurobiologie de la Méditerranée (INMED)
– Mme Marie-Odile Krebs, professeur des universités, directrice adjointe du Centre de psychiatrie et neurosciences de l’hôpital Sainte-Anne, co-responsable de l'équipe physiopathologie des maladies psychiatriques
– M. Michel Bourguignon, professeur de biophysique, Université de Paris Île-de-France Ouest, commissaire de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN)
Ê Quelles implications éthiques et juridiques ?
– M. Jean-Claude Ameisen, professeur de médecine, président du Comité d’éthique de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), membre du Comité consultatif national d’éthique (CCNE)
– Mme Hélène Gaumont-Prat, professeur de droit à l’Université Paris VIII, directrice du laboratoire de droit médical
– M. Yves Agid, membre fondateur de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM). Professeur de neurologie, membre de l’Académie des sciences, membre du membre du Comité consultatif national d’éthique (CCNE).
– M. Paolo Girolami, professeur à l’Université de Turin, chercheur laboratoire d'éthique médicale de l'Université Paris-Descartes
Ê Interface homme/machine : réparation ou augmentation ?
– M. Jean-Didier Vincent, professeur à l’Université Paris-sud Orsay, directeur de l’Institut Alfred Fessard, membre de l’Académie des Sciences et de l’Académie nationale de Médecine
– M. Jean-Michel Besnier, professeur de philosophie à l’Université de Paris IV-Sorbonne, chercheur au Centre de recherche en épistémologie appliquée (CREA), (CNRS/École Polytechnique)
– M. François Berger, professeur de médecine, directeur général exécutif de CLINATEC-CEA, Institut des neurosciences de Grenoble, INSERM
– Mme Angela Sirigu, neuropsychologue, directrice de recherche, Institut des sciences cognitives de Lyon (CNRS/Lyon I)
– M. Pierre Le Coz, professeur de philosophie, (département des sciences humaines - faculté de médecine de Marseille), président du comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, vice-président du CCNE
Ê Quels impacts sur la société ?
– Mme Catherine Vidal, neurobiologiste, directrice de recherche à l’Institut Pasteur
– M. Olivier Oullier, professeur de psychologie à l’Université d’Aix-Marseille, conseiller scientifique au Centre d'analyse stratégique
– M. Olivier Houdé, professeur de psychologie à l’Université Paris-Descartes et directeur de l’équipe développement et fonctionnement cognitifs
– M. Ali Benmaklouf, professeur de philosophie, membre du CCNE, président du comité consultatif de déontologie et d'éthique de l'institut de recherche pour le développement (IRD).
AUDITION DES RAPPORTEURS
Mardi 31 mai 2011 : Pr Yves Agid, membre fondateur de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM), professeur de neurologie, membre de l’Académie des sciences, membre du membre du Comité consultatif national d’éthique (CCNE).
Jeudi 30 juin 2011 : participation au 2ème Colloque annuel ITMO neurosciences, sciences cognitives, neurologie et psychiatrie
Mardi 19 octobre 2011 : M. Jean-Luc Godet, directeur des rayonnements ionisants et de la santé de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN)
Mardi 15 novembre 2011 : Pr Jean-Pierre Changeux, ancien directeur de l’unité de neurobiologie moléculaire à l’Institut Pasteur, professeur honoraire au Collège de France et à l’Institut Pasteur
Mercredi 23 novembre 2011 : Mme Sophie Vuillet-Tavernier, directrice de la direction des études, de l’innovation et de la prospective, Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et Mme Frédérique Lesaulnier, juriste en charge du secteur santé CNIL
Mercredi 7 décembre 2011 : M. Christian Byk, magistrat à la Cour d'appel de Paris, secrétaire général de l'association internationale de droit, éthique et science
Mardi 13 décembre 2011 : Pr Philippe Amouyel, professeur des universités, praticien hospitalier en épidémiologie, économie de la Santé et prévention, président de la fondation Plan Alzheimer
Mardi 17 janvier 2012 : Pr Marion Leboyer, professeur des universités, praticien hospitalier, responsable du pôle de psychiatrie (CHU Créteil Groupe hospitalier Chenevier-Mondor, directrice de la Fondation « FondaMental »)
Mardi 17 janvier 2012 : Pr Olivier Lyon-Caen, chef du service neurologie de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, professeur des universités, etDr. Etienne Hirsch, neurobiologiste, directeur de recherches au CNRS
Mardi 24 janvier 2012 : M. Alain Ehrenberg, sociologue, directeur de recherche au CNRS, fondateur du Centre de recherche psychotropes, santé mentale, société CNRS–INSERM et Université Paris-Descartes et M. Pierre-Henri Castel, psychanalyste, directeur de recherches au CNRS, responsable de l'équipe Cesames Cermes3/Cesames, Centre de recherche Médecine, Sciences, Santé, Santé mentale, Société, de l’Université Paris Descartes
Missions Á l’Étranger
En Allemagne du 12 au 15 septembre 2011
Lundi 12 Septembre : Jülich et Frankfort
– Pr N. J. Shah, directeur de l'Institut de neuroscience et médecine (INM-4) et de son groupe de physique de l'imagerie médicale Jülich
– Pr Gilles Laurent, directeur du Max Planck Institute for Brain Research
Mardi 13 Septembre : Erlangen
Ê Visite de la Medical Valley (cluster spécialisé dans le secteur de la santé : recherche, production de grands outils nécessaires au secteur santé)
– M. Jörg Trinkwalter directeur de Medical Valley EMN e.V. Erlangen Raum K2
– Visite de Artemis Imaging (start up)
– Visite de CT Imaging (start up)
– Visite du Fraunhofer Allianz (start up)
Ê Siemens Healthcare
– Dr Wolfgang Kunstmann, directeur des relations publiques
– Dr. Bernd Hofmann, neurochirurgien
– Dr Udo Zikeli, expert en biomédecine
Mercredi 14 Septembre : Munich
Ê Visite du centre de neurosciences de Munich (MCN),et du Centre de neurosciences de l’université Ludwig Maximilians de Munich (LMU)
– Pr Dr Oliver Behrend, directeur du centre
– Pr Benedikt Grothe, directeur de recherche, neurobiologie
– Pr Hans Straka, professeur de neurosciences systémiques
– Déjeuner de travail offert par le Consul Général de France à Munich, M. Emmanuel Cohet avec Pr Oliver Behrend, Pr Benedikt Grothe, Pr Hans Straka, Pr Alexander Drzezga
– Visite de l’Hôpital Rechts der Isar « Service spécialisé dans l’imagerie pour la sélection, la surveillance et l'individualisation des thérapies anticancéreuses » : Pr Alexander Drzezga, médecin, spécialiste d’imagerie multimodale
– Visite de l’Institut d’imagerie médicale et biologique de la Helmholtz
En Suisse le mercredi 21 septembre 2011
Ê Entretiens à l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne EPFL
– M. Henry Markram, coordinateur du Human Brain Project
– M. Sean Hill, directeur de pilier au Human Brain Project et du Centre international de neuro-informatique à Stockholm
– M. Pierre Magistretti, directeur du Brain and Mind Institute à l’EPFL
Ê Entretiens à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève
– Dr Shekhar Saxena, directeur du Departmental Health and Substance Abuse
– M. Menno van Hilten, External Relation Officer
– Mme Geneviève Chedeville-Murray, Représentation permanente de la France à l’ONU Genève
Ê Entretiens aux Hôpitaux Universitaires / Centre Médical Universitaire de Genève
– Pr Patrick Vuilleumier, directeur du Centre de Neurosciences de Genève.
En Belgique le mercredi 28 septembre 2011
Ê Commission européenne Bruxelles
– M. Philippe Cupers, chef de secteur pour les neurosciences
– Mme Joana Namorado, responsable de projets scientifiques et techniques direction générale de la recherche et de l'innovation
– M. Gilles Laroche, chef de l'unité éthique et genre, direction générale de la recherche et de l'innovation
– M. Éric-Olivier Pallu, conseiller en charge de la recherche à la Représentation permanente française auprès de l'Union européenne
Ê Hôpital Universitaire Érasme (Université Libre de Bruxelles)
– Pr Jacques Brotchi, chef de service honoraire et professeur émérite en neurochirurgie de Bruxelles, président d'honneur de la Fédération mondiale des sociétés de neurochirurgie
Aux États-Unis - du 10 au 14 octobre 2011
Lundi 10 octobre : Washington
Ê Johns Hopkins Berman Institute for Bioethics
– Mme Debra Mathews, Ph.D., M.A., Berman Institute, directeur adjoint pour les programmes sciences
– Mme Eléonore Pauwels chercheur (Woodrow Wilson Center)
Ê Conférences téléphoniques à l’ambassade de France avec
– M. James Gee, professeur adjoint de radiologie à l’Université de Pennsylvanie)
– Mme Martha J. Farah, PhD, professeur de sciences naturelles, directrice du Centre neuroscience et société (Université de Pennsylvanie)
– Mme Nita A. Farahany, professeur associé de droit et philosophie à la Vanderbilt Université, Nashville, membre de la Commission présidentielle de bioéthique
– Entretien avec M. François Delattre, ambassadeur de France aux États-Unis
Mardi 11 octobre : Washington
Ê National Institute of Health, NIH
– M. Alan Koretsky, directeur du National Institute of Neurological Disorders and Stroke NINDS
Ê Réunion au FBI
Ê Réunion à la société de neurosciences
– Dr Jeffrey Rothstein, PhD, professeur Brain Science Institute, Johns Hopkins University
– Dr Debra Speert, PhD, Society of Neuroscience
– M. Marty Saggese, directeur exécutif de la société de neurosciences
– M. Mark Storey, directeur des programmes de la société de neurosciences
Ê Congrès des États-Unis
– Dr John O’Shea and M. Clay Alspach, Chairman Pitts’ professional staffs of the Subcommittee on Health, US House Committee on Energy and Commerce
Mercredi 12 Octobre : Boston
Ê Cambridge Innovation Center
– Dr Nicolas R Bolo, Psychiatre, Center, Massachusetts Mental Health Center
– Visite au Athinoula A. Martinos Center for Biomedical Imaging
Framingham
– M. Stephen Raken, directeur de Cephos Corporation
Jeudi 13 Octobre : New Haven
Ê Yale Interdisciplinary Center for Bioethics
– M. Mike Treder, directeur de l’Institut d’éthique et de technologies émergentes
– M. Wendell Wallach, président du Technology and Ethics Research Group, Yale University Institution for Social and Policy Studies
– Pr Stephen Latham, directeur du Yale Institute for Bioethics
New York
Ê Fondation Dana Farber
– M. Edward Rover, président de la Fondation Dana Farber
– Mme Barbara Gill, vice-Présidente, directrice exécutive
– M. Burton Mirsky, directeur financier
– M. Guy McKhann, M.D., directeur scientifique, Johns Hopkins University
Ê Centre de neuroéconomie, New York University
– M. Paul W. Glimcher, PhD, professeur de neuroéconomie, et psychologie
Ê Cour fédérale de justice
– Juge Jed Rakoff, magistrat
Vendredi 14 Octobre : Los Angeles
Ê Ahmanson-Lovelace Brain Mapping Center
– Dr Roger Woods, chaire du département de neurologie, directeur de l’UCLA Ahmanson-Lovelace Brain Mapping Center
Ê Brain Research Institute
– Mme Marie-Françoise Chesselet, professeur de neurologie, directrice du centre de recherche sur la maladie de Parkinson
Ê California Institute of technology Caltech
– M. Julien Dubois, Christof Koch, Division of Biology
– M. Antonio Rangel, professeur de neuroéconomie
– M. Richard Andersen professeur de neuroscience
Ê Conférences téléphoniques au Consulat général de France
– M. Jack Gallant, professeur, de psychologie et neuroscience (Université de Californie – Berkeleley)
– Mme Natasha Vita-More, présidente, Humanity+
Au Japon - du 6 au 8 février 2012
Lundi 6 février : Kyoto
Ê Université de Kyoto - « Humain Brain Research Center - HBRC »
– Pr Hidenao Fukuyama, directeur de l’HBRC, visite des laboratoires
– Pr Makino, vice-président, directeur du centre d’innovation
Keihanna Science City
Ê Advanced Telecommunication Research Institute
« Brain Information Communication Research Laboratory Group »
-Visite et entretien avec Dr Mitsuo Kawato, directeur du laboratoire
-Dîner de travail offert par M. Philippe Janvier-Kamiyama, consul général de France à Kyoto avec : Pr Shigetada Nakanishi, directeur, Osaka Bioscience Institute, Pr Norio Nakatsuji, directeur et professeur, Institute for Frontier Medical Sciences, iCeMS
Mardi 7 février: Kobe
Ê Riken Center for Molecular Imaging Science CMIS
– Pr. Yasuyoshi Watanabe, directeur du centre
Tokyo
Ê Tokyo University, Graduate School of Medicine
– Département de neurosciences
– Pr Nobuto Saito, professeur de neurochirugie,
– Dr Naoto Kunii, neurochirurgien
– Dr Takeshi Araki, psychiatre,
– Pr Kazuya Iwamoto,
– Pr Chihiro Tsuneuchi, département de neurosciences (Psychiatrie)
– Centre d’éthique biomédicale et de droit
– Pr Akira Akabayashi, directeur.
– Dr Yoshinori Hayashi, maître de conférence
– Dr Shimon Tashiro, assistant
Mercredi 8 février:
Ê Keio University, Graduate School of Medicine
– M. Hiroyuki Okano, directeur de la recherche et du développement
– Pr Michisuke Yuzaki, professeur au département de physiologie
– Dr François Renault-Mihara, post-doctorant français menant des recherches au département de physiologie.
Ê Riken Brain Sciences Institute – BSI
– Pr Toshihiko Oguru, directeur du BSI
– Dr Tadaharu Tsumoto, directeur de recherche du laboratoire de plasticité corticale
– Dr Kang Cheng, directeur de recherche du centre d’IMR fonctionnelle
– Dr Thomas Launey, directeur du centre de neurocybernétique moléculaire
Ê Résidence de France
Entretiens suivi d’un dîner de travail, offert par M. Christian Masset, ambassadeur de France au Japon, avec M. Hirobumi Niki, député ; M. Tsunehiko Yoshida, député ; Pr Katsuhiko Mikoshiba, directeur de projet au Riken Brain Institute ; Pr Hiroyuki Okano, directeur de la recherche et du développement à l’Université de Keio ; Dr Masago Minami, journaliste à la Yomiuri Shimbun.
1 Directeur de recherche, groupe « Plasticité gliale et tumeurs cérébrales » au Centre de psychiatrie et neurosciences de la faculté de médecine Paris-Descartes, membre du Conseil scientifique de l’OPECST (Audition publique du 29 juin 2011)
2 Ancien directeur de l’unité de neurobiologie moléculaire à l’Institut Pasteur Professeur honoraire au Collège de France et à l’Institut Pasteur (Audition des Rapporteurs du 15 novembre 2011).
3 Sociologue, directeur de recherche au CNRS, fondateur du centre de recherche psychotrope, santé mentale société. Audition des Rapporteurs le 24 janvier 2012 et audition publique du 26 mars 2008.
4 Psychanalyste, directeur de recherche au CNRS, Centre de recherche médecine Sciences Santé mentale Société. Audition des Rapporteurs du 24 janvier 2012 et Audition publique du 26 mars 2008.
5 Rapport de l’OPECST (n°1325, AN ; n°107, Sénat) d’Alain Claeys et Jean-Sébastien Vialatte «La loi bioéthique de demain ».
6 Idem.
7 Données statistiques ci-après.
8 L'OMS se sert d'une mesure appelée « années de vie corrigées du facteur invalidité » pour représenter le coût pour la santé et l'économie. Cela correspond à la somme du nombre d'années de vie perdues, et du nombre d'années de vie vécues, avec un handicap.
9 Directeur du département de la santé mentale et des abus de drogues à l’OMS (Mission des Rapporteurs à Genève le 21 septembre 2011).
10 H. U. Wittchen et al. Eur. Neuropsychopharmacol. 21, 655–679; 2011. the size and burden of mental disorders and other disorders of brain in Europe 2010
11 Ancien directeur de l’unité de neurobiologie moléculaire à l’Institut Pasteur, Professeur honoraire au Collège de France et à l’Institut Pasteur (Audition des Rapporteurs du 15 novembre 2011)
12 http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9799241564359_eng.pdf.
13 Visite des Rapporteurs à la Commission Européenne à Bruxelles le 28 septembre 2011.
14 Sources principales : Colloque « priorité cerveau » organisé le 16 septembre 2010, l’ouvrage d’Olivier Lyon-Caen, PUPH, chef de service à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière et Etienne Hirsch, neurobiologiste, directeur de recherche au CNRS « priorité cerveau : des découvertes au traitement », et l’audition des Rapporteurs le 17 janvier 2012.
15 « Quand un enfant se donne la mort » - Editions O. Jacob 2011.
16 PUPH, directrice adjointe du Centre de psychiatrie et neurosciences de l’hôpital Sainte-Anne, co-responsable de l'équipe physiopathologie des maladies psychiatriques (Audition publique du 30 novembre 2011).
17 Source : Fondation “FondaMental”
18 Olivier Lyon-Caen et Etienne Hirsch « priorité cerveau : des découvertes au traitement (Editions O Jacob septembre 2010)»
19 Sociologue, directeur de recherche au CNRS, fondateur du centre de recherche psychotrope, santé mentale société. Audition des Rapporteurs le 24 janvier 2012 et audition publique du 26 mars 2008.
20 Psychanalyste, directeur de recherche au CNRS, Centre de recherche médecine Sciences Santé mentale Société. Audition des Rapporteurs du 24 janvier 2012 et Audition publique du 26 mars 2008.
21 Directeur et coordonnateur du projet (Mission des Rapporteurs à l’École Polytechnique fédérale de Lausanne le 21 septembre 2011).
22 Fondateur et directeur honoraire de l’Institut de neurobiologie de la Méditerranée (IMED), (Audition publique du 30 novembre 2011).
23 Membre fondateur de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM). Professeur de neurologie, membre de l’Académie des sciences, membre du membre du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) - (Audition publique du 30 novembre 2011).
24 Directeur scientifique adjoint à l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA). (Audition publique du 30 novembre 2011).
25 Professeur de médecine, président du Comité d’éthique de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), membre du CCNE (Audition publique du 30 novembre 2011).
26 Fondateur et directeur honoraire de l’Institut de neurobiologie de la Méditerranée (INMED). (Audition publique du 30 novembre 2011).
27 Visite des Rapporteurs à Marseille 20 septembre 2012.
28 Rapport de l’OPECST n°1010 AN sur les apports de la science et de la technologie à la compensation du handicap de Berengère Poletti, députée.
29 Audition des Rapporteurs de Marion Leboyer, PUPH, psychiatre, directrice de Fondamental, le 17 janvier 2012, de Pierre-Henri Castel, psychanalyste, directeur de recherche au CNRS, et d’Alain Ehrenberg, sociologue, directeur de recherche, le 24 janvier 2012.
30 Mission des Rapporteurs en Allemagne du 12 au 14 septembre 2011.
31 Mission des Rapporteurs au Japon du 5 au 9 février 2012.
32 Professeur de bioéthique médicale à l'université de Tokyo.
33 Mission des Rapporteurs du 9 au 15 octobre 2011.
34 Co-directeur de l’Institut thématique multi-organismes (neurosciences, sciences cognitives, neurologie et psychiatrie) de l’Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé (AVIESAN) - (audition publique du 29 juin 2011).
35 Visite des Rapporteurs le 18 janvier 2012.
36 Chef du Laboratoire de résonance magnétique nucléaire (NeuroSpin/Laboratoire d’imagerie et de spectroscopie - LRMN) au CEA.
37 Visite des Rapporteurs le 14 mars 2011 et le 13 décembre 2011.
38 Membre Fondateur de l’ICM, professeur de neurologie et neurosciences, membre de l’Académie des Sciences et du Comité consultatif national d’éthique (CCNE).
39 Visite des Rapporteurs le 14 juin 2011.
40 Professeur de médecine, directeur général et exécutif de CLINATEC (CEA), Institut des neurosciences et CHU de Grenoble, INSERM.
41 Professeur de physiologie et de neurosciences à l’université Joseph Fourier de Grenoble.
42 Visite des Rapporteurs à Lyon le 14 février 2012.
43 Co-directeur de l’Institut thématique multi-organismes : neurosciences, sciences cognitives, neurologie et psychiatrie neurosciences de l’Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé (AVIESAN) -Audition publique du 29 juin 2011.
44 Directeur de recherche, groupe « Plasticité gliale et tumeurs cérébrales » au Centre de psychiatrie et neurosciences de la faculté de médecine Paris-Descartes, membre du Conseil scientifique de l’OPECST - Auditions publiques du 29 juin et 30 novembre 2011.
45 Professeur de neurologie, directeur de recherche, président de la Société française de Neurosciences, (Audition publique du 29 juin 2011).
46 Professeur de neurologie, directeur de recherche, président de la Société Française de neurologie (Audition publique du 29 juin 2011).
47 Co-directeur de l’Institut thématique multi-organismes : neurosciences, sciences cognitives, (AVIESAN) (Audition publique du 29 juin 2011).
48 Professeur des universités, praticien hospitalier, spécialiste en neuroimagerie, chercheur au centre de recherche de l’ICM (Audition publique du 29 juin 2011).
49 Directeur de recherche, groupe « Plasticité gliale et tumeurs cérébrales », Centre de psychiatrie et neurosciences de la faculté de médecine Paris-Descartes, membre du Conseil scientifique de l’OPECST (Audition publique du 29 juin 2011).
50 Praticien hospitalier, neurologue, chercheur au centre de recherche de l’ICM. (Audition publique du 29 juin 2011).
51 Mission des Rapporteurs au centre de neurosciences de Lyon, le 14 février 2012.
52 Professeur au Collège de France, membre de l’Académie des sciences, directeur de l’unité de neuroimagerie cognitive à Neurospin (unité INSERM CEA) - (Visite des Rapporteurs à NeuroSpin, le 18 janvier 2011).
53 Professeur des universités, praticien hospitalier, spécialiste en neuroimagerie, chercheur au centre de recherche de l’ICM (Audition publique du 29 juin 2011)
54 Directeur de NeuroSpin, membre de l’académie des Sciences (audition publique du 26 mars 2008 et visite des Rapporteurs à Neurospin, le 18 janvier 2012).
55 Anémie locale, arrêt ou insuffisance de la circulation du sang dans un tissu ou un organe.
56 Chef du Laboratoire de résonance magnétique nucléaire (NeuroSpin/Laboratoire d’imagerie et de spectroscopie - LRMN) au CEA (audition publique du 29 juin 2011).
57 Visite des Rapporteurs à NeuroSpin, le 18 janvier 2011.
58 Mission des Rapporteurs en Allemagne du 12 au 15 septembre 2011.
59 Mission des Rapporteurs à Lyon le 14 février 2012.
60 Visite des rapporteurs au site CLINATEC à Grenoble, le 14 juin 2012.
61 Psychiatre, chercheur au centre de recherche de l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM) -(Audition publique du 29 juin 2011).
62 Voir Supra avis n° 73 du CCNE.
63 Neurochirurgien, directeur médical de l’unité de radiochirurgie de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Audition publique du 29 juin 2011.
64 Neuropsychologue, directrice de recherche, Institut des sciences cognitives de Lyon (CNRS/Lyon I) - (audition publique du 30 novembre 2011).
65 Professeur de médecine, directeur exécutif de CLINATEC-CEA, Institut des neurosciences et CHU de Grenoble, INSERM) - (Audition publique du 30 novembre 2011).
66 Précité (Audition publique du 30 novembre 2011).
67 Visite des Rapporteurs au Centre de neurosciences de Lyon, le 14 février 2012.
68 Professeur de neurosciences, directeur de recherches, président de la Société française de neurosciences - (Audition publique du 29 juin 2011).
69 Directeur de recherche, groupe « Plasticité gliale et tumeurs cérébrales » au Centre de psychiatrie et neurosciences de la faculté de médecine Paris-Descartes, membre du Conseil scientifique de l’OPECST (audition publique du 29 juin 2011).
70 Rapport de l’OPECST (n°1325, AN ; n°107, Sénat) d’Alain Claeys et Jean-Sébastien Vialatte «La loi bioéthique de demain ».
71 Membre fondateur de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM). Professeur de neurologie, membre de l’Académie des sciences, membre du membre du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) - (Audition publique du 29 juin 2011).
72 Co-directeur de l’ITMO neurosciences, sciences cognitives, neurologie et psychiatrie (AVIESAN) - (Audition publique du 29 juin 2011).
73 Membre fondateur de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM). Professeur de neurologie, membre de l’Académie des sciences, membre du membre du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) - (Audition publique du 29 juin 2011).
74 Professeur des universités et praticien hospitalier, spécialiste en neuroimagerie, chercheur au centre de recherches de l’Institut du cerveau et de la moëlle épinière (ICM) de l'hôpital de la Salpêtrière.
75 Voir l’audition publique organisée par M. Pierre Lasbordes, député, au nom de l’OPECST le 30 avril 2009 «Le dossier médical personnel (DMP) : quel bilan d’étape ?» http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-off/i1847.asp.
76 Rapport « Situation et perspectives de développement de l'épidémiologie en France en 2011 » de l'Académie nationale de médecine, examiné en réunion de l'OPECST, le 25.janvier 2012.
77 Visite des Rapporteurs à Grenoble le 14 juin 2011, au Plateau de Saclay au NeuroSpin du CEA le 18 janvier 2012 et à Lyon au Centre de recherches en neurosciences le 14 février 2012.
78 Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine.
79 Professeur de psychologie à l'Université d’Aix-Marseille et conseiller scientifique du Centre d'analyses stratégiques. (Audition publique du 29 juin 2011).
80 Compte-rendu de la séance publique du 25 janvier 2012.
81 Député, membre de l’OPECST
82 Chef du laboratoire de résonance magnétique nucléaire (NeuroSpin/Laboratoire d'imagerie et de spectroscopie) du CEA - (Audition publique du 29 juin 2011).
83 Directeur de recherche, groupe « Plasticité gliale et tumeurs cérébrales » au Centre de psychiatrie et neurosciences de l'Université Paris-Descartes, membre du Conseil scientifique de l’OPECST - (Audition publique du 29 juin 2011).
84 Elfe, l'une des plus importantes études épidémiologiques jamais lancée (http://www.elfe-france.fr/).
85 Ancien chef du service de santé publique et d’épidémiologie de l’Hôpital de Bicêtre, professeur de santé publique à l’Université Paris Sud-XI.
86 Sophie Vuillet-Tavernier, directrice des études de l’innovation et de la prospective de la CNIL et Frédérique Lesaulnier, service des Affaires juridiques - (Audition des Rapporteurs du 23 novembre.2011).
87 "Laboratory of Neuro Imaging", mission des Rapporteurs aux États-Unis.
88 Professeur de biophysique à l’Université de Paris Île-de-France Ouest, commissaire de l’ASN (Audition publique du 30 novembre 2011).
89 http://www.asn.fr/index.php/S-informer/Actualites/2011/Doses-de-rayonnements-ionisants-delivrees-par-l-imagerie-medicale
90 Directeur des rayonnements ionisants et de la santé à l’ASN (Audition des Rapporteurs du 17octobre 2011).
91 Directeur de NeuroSpin au CEA, membre de l’Académie des sciences, professeur au Collège de France, visite des Rapporteurs au centre de NeuroSpin le 18 janvier 2012.
92 Directeur de l’unité INSERM-CEA de Neuroimagerie cognitive, Professeur au Collège de France, visite des Rapporteurs à Neurospin le 18 janvier 2012.
93 http://www.etui.org/fr/Themes/Sante-et-securite/Actualites/Directive-Champs-electromagnetiques-une-proposition-jugee-insatisfaisante-par-la-CES 17/10/2011
94 Audition publique du 30 novembre 2011.
95 Neurobiologiste, directrice de recherche à l’Institut Pasteur (Audition publique du 30 novembre 2011.
96 Directeur scientifique adjoint à l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) (Audition publique du 30 novembre 2011).
97 Directeur de l’unité INSERM-CEA de neuroimagerie cognitive - Visite des Rapporteurs à NeuroSpin le 18 janvier 2012).
98 Directeur de l’unité INSERM-CEA de neuroimagerie cognitive - Visite des Rapporteurs à NeuroSpin le 18 janvier 2012).
99 Professeur de psychologie à l’Université Paris-Descartes, directeur du Laboratoire de Psychologie du Développement et de l’Éducation de l’enfant (LaPsyDÉ), CNRS - (Audition du 30 novembre 2011).
100 Visite des Rapporteurs à Marseille le 20 septembre 2011
101 Le Monde, avril 2004.
102 Professeur à l’Université Paris-Sud Orsay, directeur de l’Institut Alfred Fessard, membre de l’Académie des sciences et de l’Académie nationale de médecine - (Audition publique du 30 novembre 2011).
103 Professeur de psychologie à l’Université d’Aix-Marseille, conseiller scientifique, Centre d’analyse stratégique (CAS) - (Audition publique du 29 juin 2011).
104 Directeur de « Usefull Progress » (Audition publique du 29juin 2011).
105 Professeur de médecine, neurologue, chercheur en neurosciences cognitives à l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM). (Audition publique du 30 novembre 2011).
106 Membre fondateur de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM). Professeur de neurologie, membre de l’Académie des sciences, membre du CCNE (Audition publique du 29 juin 2011).
107 Contraction de « volumetric pixel », le voxel est un pixel en 3D.
108 Professeur de psychologie à l’Université d’Aix-Marseille, conseiller scientifique au Centre d’analyse stratégique (Audition publique du 29 juin 2011).
109 Directeur de « Usefull Progress ».
110 Septembre 2011.
111 Professeur de psychologie et neurosciences à l’Université de Californie de Berkeley (Mission des Rapporteurs aux États-Unis, du 11 au 14 octobre 2011).
112 Professeur de psychologie à l’Université d’Aix-Marseille, conseiller scientifique au Centre d’analyse stratégique - (Audition publique du 29 juin 2011).
113 Friedman L. et al. (2006) Reducing inter-scanner variability of activation in a multicenter fMRI study: Role of smoothness equalization. Neuroimage, 32(4), 1656-1668.
114 Fondateur et directeur honoraire de l’Institut de neurobiologie de la Méditerranée (Audition publique du 30 novembre 2011).
115 Directeur honoraire de l’unité de neurobiologie moléculaire à l’Institut Pasteur, professeur honoraire au Collège de France et à l’Institut Pasteur - (Audition des Rapporteurs du 14 novembre 2011).
116 Co-directeur de l’ITMO neurosciences, sciences cognitives neurologie, psychiatre de l’AVIESAN - (Audition publique du 29 juin 2011).
117 PUPH, directeur Général de La Fondation nationale de coopération scientifique maladie d’Alzheimer et maladies apparentées - (Audition des Rapporteurs 13 décembre 2011).
118 PUPH, co-directrice adjointe du Centre de psychiatrie et neurosciences de l’hôpital Sainte-Anne, (Audition publique du 30 novembre 2011).
119 PUPH, directrice du réseau FondaMental (Audition des Rapporteurs du 17 janvier 2012).
120 Sociologue, directeur de recherche - (Audition des Rapporteurs du 24 janvier 2012).
121 Psychanalyste, directeur de recherche au CNRS - (Audition des Rapporteurs du 24 janvier 2012).
122 Professeur de neurologie, directeur de recherche, président de la Société française de Neurosciences -(Audition publique du 29 juin 2011).
123 Co-directeur de l’ITMO neurosciences, sciences cognitives, neurologie, psychiatrie (AVIESAN) - (Audition publique du 29 juin 2011).
124 Conseiller scientifique auprès du directeur de l’Institut d’imagerie biomédicale du CEA – NeuroSpin /Laboratoire de neuro-imagerie cognitive (LCOGN) (Audition publique du 29 juin 2011)
125 Professeur au Collège de France, membre de l’Académies des Sciences (Audition publique du 29 juin 2011)
126 Directeur de recherche, groupe « Plasticité gliale et tumeurs cérébrales » au Centre de psychiatrie et neurosciences de l’Université Paris-Descartes, membre du Conseil scientifique de l’OPECST. (Audition publique du 29 juin 2011)
127 Professeur honoraire au Collège de France et à l’Institut Pasteur - (Audition des rapporteurs du 15 novembre 2011).
128 PUPH Directrice du réseau FondaMental (Audition des Rapporteurs du 17 janvier 2012).
129 Professeur au Collège de France, membre de l’Académie des sciences, directeur de l’unité de neuroimagerie cognitive à Neurospin (unité INSERM CEA) - (Visite des Rapporteurs à NeuroSpin, le 18 janvier 2011).
130 Membre fondateur de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM). Professeur de neurologie, membre de l’Académie des sciences, membre du membre du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) - (Audition publique du 30 novembre 2011).
131 Professeur à l’Université Paris-sud Orsay, directeur de l’Institut Alfred Fessard, membre de l’Académie des Sciences et de l’Académie nationale de Médecine (Audition publique du 26 mars 2008).
132 Professeur de médecine, président honoraire du CCNE (Audition publique du 26 mars 2008).
133 Co-directeur de l’Institut thématique multi-organismes (neurosciences, sciences cognitives, neurologie et psychiatrie) de l’Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé (AVIESAN) - (audition publique du 29 juin 2011).
134 Professeur de médecine, directeur général et exécutif de CLINATEC (CEA), Institut des neurosciences et CHU de Grenoble, INSERM.
135 Membre fondateur de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM). Professeur de neurologie, membre de l’Académie des sciences, membre du membre du Comité consultatif national d’éthique (CCNE)- (Audition publique du 30 novembre 2011).
136 Emilie de Paw le dopage cognitif, Journal international de Bioéthique - 2012.
137 Plon janvier 2012 p 184
138 Professeur de neuroéconomie California Institute of Technology (Caltech) - (Mission des Rapporteurs aux États-Unis du 11 au 14 octobre 2012).
139 p. 185
140 Ancien directeur de l’unité de neurobiologie moléculaire à l’Institut Pasteur Professeur honoraire au Collège de France et à l’Institut Pasteur (Audition des Rapporteurs du 15 novembre 2011).
141 Professeur de philosophie à l’Université de Paris IV-Sorbonne, chercheur au Centre de recherche en épistémologie appliquée (CREA), (CNRS/École Polytechnique (Audition publique du 30 novembre 2011)
142 Professeur à l’Université Paris-sud Orsay, directeur de l’Institut Alfred Fessard, Membre de l’Académie des Sciences et de l’Académie nationale de Médecine - (Auditions publiques des 26 mars 2008 et 30 novembre 2011).
143 Echange téléphonique avec Natascha Vita-More - (Mission des Rapporteurs aux États-Unis du 11 au 14 octobre 2011).
144 Président du Technology and Ethics Research Group, Yale University Institution for Social and Policy Studies - (Mission des Rapporteurs aux États-Unis du 11 au 14 octobre 2011).
145 Geneviève Ferronne, Jean-Didier Vincent « Bienvenue en transhumanie », (Grasset 2011).
146 Directeur exécutif de l'Institut pour l'éthique et les technologies émergentes, bioéthicien et sociologue Trinity College, Hartford.
147 Professeur de philosophie à l’Université de Paris IV-Sorbonne, chercheur au Centre de recherche en épistémologie appliquée (CREA), (CNRS/École Polytechnique).
148 Auditions publiques du 26 mars 2008 et du 30 Novembre 2011.
149 Le monde 13 novembre 2011.
150 Audition publique du 30 novembre 2011.
151 Audition publique du 30 novembre 2011.
152 Voir les comptes rendus des auditions publiques des 29 juin et 30 novembre 2011 en annexe.
153 26 Novembre 2010 dans Analyses
154 Professeur de neuroéconomie, et psychologie Center for Neuroeconomics, New York University - (Mission des Rapporteurs aux États-Unis du 11 au 14 octobre 2011).
155 Professeur de psychologie à l’Université d’Aix-Marseille, Conseiller scientifique au Centre d’analyse stratégique.
156 Membre fondateur de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM). Professeur de neurologie, membre de l’Académie des sciences, membre du membre du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) - (Audition publique du 30 novembre 2011).
157 Magistrat à la Cour d'appel de Paris, secrétaire général de l'association internationale de droit, éthique et sciences - (Audition des Rapporteurs du 7 décembre 2011).
158 Juge à la Cour du district de New York- (Mission des Rapporteurs aux États-Unis du 11 au 14 octobre 2011).
159 Directeur de Cephos Corporation - (Mission des Rapporteurs aux États-Unis du 11 au 14 octobre 2011).
160 Entretien au FBI - (Mission des Rapporteurs aux États-Unis du 11 au 14 octobre 2011).
161 http://blogs.nature.com/news/2011/09/italian_court_reduces_murder_s.html
162 « Perspectives scientifiques et légales sur l’utilisation des sciences du cerveau dans le cadre des procédures judiciaires », séminaire organisé par le Département Questions sociales du Centre d’analyse stratégique, le 10 décembre 2009, Paris. Actes (73 p.) :
163 Professeur de droit à l’Université Paris VIII, directrice du laboratoire de droit médical. Ancien membre du CCNE- (Audition publique du 30 novembre 2011).
164 Rapport n°3111 de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la bioéthique, par M. J. Leonetti, AN 26 janvier 2011).
165 Petites Affiches 21 novembre 2011 n°231.
166 Alain Claeys présida la Commission spéciale Jean-Sébastien Vialatte fut vice-président de cette Commission.
167 Article 16-4.
168 Article L. 1134-1.
169 Article L. 1418-1 13° du code de la santé publique.
170 Art. 45, Titre VIII, Neurosciences et imagerie cérébrale), de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique.
171 Article Petites Affiches n° 231.
172 Magistrat à la Cour d’Appel de Paris, président de l’Association internationale éthique et sciences - (Audition des Rapporteurs du 7 décembre 2011).
173 Professeur de médecine, président du Comité d’éthique de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), membre du Comité consultatif national d’éthique (CCNE)- (Audition publique du 30 novembre 2011).
174 Professeur de psychologie à l’Université d’Aix-Marseille, conseiller scientifique au Centre d'analyse stratégique - (Audition publique du 30 novembre 2011).
175 Rapport précité relatif à l’évaluation de la loi relative à la bioéthique.
176 Professeur Aix-Marseille Université, Conseiller scientifique, Centre d’analyse stratégique (Audition publique du 30 novembre 2011).
177 McCabe D. P., Castel A. D. (2008) « Seeing is believing: The effect of brain images on judgments of scientific reasoning », Cognition, 107(1), 343-352 ; Weisberg D. S., Keil F. C., Goodstein J., Rawson E., Gray J. R. (2008) « The seductive allure of neuroscience explanations », Journal of Cognitive Neuroscience, 20(3), 470-477.
178 McCabe D., Castel A., Rhodes M. (2011). « The influence of fMRI lie detection evidence on juror decision-making ». Behavioral Sciences and the Law, 29, 566–577
179 Voir la note en annexe.
180 Professeur de psychologie à l'Université d’Aix-en-Provence et conseiller scientifique du Centre d'analyses stratégiques. (Audition publique du 29 juin 2011).
181 Directeur de recherche, groupe « Plasticité gliale et tumeurs cérébrales » au Centre de psychiatrie et neurosciences de l’Université Paris-Descartes, membre du Conseil scientifique de l’OPECST - (Audition du 29 novembre 2011).
182 Audition publique du 26 mars 2008.
183 Professeur de médecine, directeur général et exécutif de CLINATEC (CEA), Institut des neurosciences et CHU de Grenoble, INSERM.
184 Rapport du 18 janvier 2012 sur "L'innovation à l'épreuve des peurs et des risques" par M. Claude Birraux, député, Premier vice-président de l'OPECST, et M. Jean-Yves Le Déaut, député, Vice-président de l'OPECST.
185 Rapport du 8 février 2012 sur "les enjeux de la biologie de synthèse" par Mme Geneviève Fioraso, députée
186 Professeur de philosophie à l’Université de Paris IV-Sorbonne, chercheur au Centre de recherche en épistémologie appliquée (CREA), (CNRS/École Polytechnique) - (Audition publique du 30 novembre 2011).
187 Professeur de médecine, président du Comité d’éthique de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), membre du Comité consultatif national d’éthique (CCNE)
© Assemblée nationale