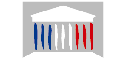
N° 1431
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 octobre 2013
AVIS
PRÉSENTÉ
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2014 (n° 1395),
TOME V
ECOLOGIE, DEVELOPPEMENT ET MOBILITE DURABLES
PAR M. Jean-Marie LE GUEN
Député
——
Voir le numéro 1428 (annexe n° 13)
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION 7
I. UNE COOPÉRATION EUROPÉENNE PRISE EN DÉFAUT PAR LES CONTRAINTES ET LES LIMITES DU TOURNANT ÉNERGÉTIQUE EN ALLEMAGNE 11
A. UN CONTEXTE INTERNATIONAL DÉJÀ BOULEVERSÉ PAR LA RÉVOLUTION AMÉRICAINE DU GAZ DE SCHISTE ET L’EFFONDREMENT DU PRIX DU CHARBON À L’EXPORTATION 11
1. La nouvelle compétitivité énergétique américaine du gaz de schiste 11
2. Des excédents charbonniers exportés, notamment vers l’Europe, et la reprise de la consommation de charbon au niveau mondial 13
B. UNE EUROPE DE L’ÉNERGIE ET DU CLIMAT AUX FAIBLESSES AGGRAVÉES PAR LES CHOIX NATIONAUX DE L’ENERGIEWENDE 14
1. Un cadre européen insuffisant et une absence de vision commune des Vingt-huit 15
a. Trois orientations successives : le marché, puis le climat et, maintenant, la compétitivité 15
b. Une juxtaposition des approches confirmée par le traité de Lisbonne qui laisse en outre aux Etats la pleine souveraineté sur le mix énergétique 17
c. Une absence patente de vision commune sur les principaux sujets 18
2. Une stratégie allemande de développement des renouvelables purement nationale, engagée dès 2000 et dont les paramètres ont été durcis avec la confirmation, en 2011, de la sortie du nucléaire, dès le début de la décennie 2020 19
a. Une décision prise par le Gouvernement du Chancelier Schröder 19
i. Le choix du développement subventionné de l’énergie renouvelable et de la sortie du nucléaire 19
ii. Un complément gazier rarement cité : l’approvisionnement direct de l’Allemagne en Russie, à travers la Baltique, par la construction du gazoduc Nord Stream 20
b. Une confirmation par le Gouvernement de la Chancelière Angela Merkel après Fukushima, en 2011 21
i. L’intermède de l’Energiekonzept de 2010 : la prolongation du nucléaire pour financer le développement des renouvelables 21
ii. Le retour, dès 2011, au retrait du nucléaire, après Fukushima 22
c. L’absence de réaction européenne 22
3. Des difficultés de mise en œuvre en Allemagne 23
a. Des coûts importants et croissants, réellement supportés par les seuls particuliers 23
i. La montée en puissance du compte EEG 23
ii. Un coût significatif et croissant pour les particuliers 25
iii. Des exonérations de surcharge pour garantir la compétitivité industrielle, notamment des électro-intensifs, dans des conditions parfois à la limite de la légalité européenne 26
iv. Un débat public sur le niveau du coût et sa répartition 28
b. Une régulation de la production très difficile en raison de la montée en puissance de deux sources intermittentes de production d’électricité : l’éolien et le solaire 29
c. Une sécurité énergétique à l’épreuve des insuffisances des réseaux actuels 30
d. L’insuffisance des gains d’efficacité énergétique en dépit des efforts réalisés 32
e. Une mise en œuvre parfois problématique : l’exemple des retards du projet d’éolien offshore en Mer du Nord 32
f. Davantage d’électricité d’origine thermique et d’émissions de CO2 33
i. Un recours accru au charbon et au lignite pour équilibrer le vent et le soleil 33
ii. Un écart par rapport à la trajectoire de long terme de réduction des émissions prévue par l’Allemagne 34
g. Appréciation d’ensemble sur l’Energiewende : un pari qui n’atteint pas en l’état les objectifs de la transition énergétique 35
4. L’amplification des faiblesses de l’actuelle Europe de l’énergie et du climat 36
a. Une stratégie allemande jugée non coopérative car impossible à mettre en œuvre par l’ensemble des États membres ou même certains d’entre eux 36
b. L’exportation dans les pays voisins des difficultés de régulation et des perturbations de réseaux liées à l’intermittence de l’afflux des renouvelables 36
c. Des écarts entre les prix de gros et les prix de consommation qui perturbent le modèle économique de la production électrique 37
d. Une mobilisation de certains financements européens pour des infrastructures d’intérêt davantage allemand qu’européen 39
e. Une mise en échec des instruments européens de réduction des émissions de CO2 39
i. Un accroissement des déséquilibres du marché du CO2 39
ii. Une défense par l’Allemagne de certaines émissions de CO2 directement liées à ses intérêts industriels : l’échec récent de la proposition de directive sur les automobiles 41
f. L’hypothèse parfois relayée d’un agenda caché de l’Allemagne 42
5. Une coopération franco-allemande réduite et essentiellement technique sur les énergies renouvelables 44
6. Une convergence franco-britannique sur le rôle du nucléaire dans le mix énergétique 46
7. Cinq pistes pour relancer, sur des bases clarifiées, l’Europe de l’énergie et du climat 49
a. Une communauté européenne de l’énergie 49
b. Un pacte franco-allemand de respect mutuel sur le nucléaire conforme aux dispositions du traité sur le mix énergétique 49
c. Une reconnexion de la production d’électricité renouvelable et du marché, compte tenu de la maturité du secteur 50
d. La sécurisation des paramètres pour favoriser la réalisation des investissements économes en carbone 50
e. Une véritable gouvernance européenne en matière d’énergie-climat 51
f. Trois exemples de coopération technique 53
II. LA PRÉPARATION DE LA COP 21 PRÉVUE POUR 2015 À PARIS 57
A. L’ETAT DES LIEUX DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE ET DE LA MISE EN œUVRE DU PROTOCOLE DE KYOTO 57
1. Les émissions 57
a. Les émissions par pays et les tendances longues sur 20 ans 57
b. Les émissions par habitant 57
c. Les émissions par secteur ou type d’utilisation 58
2. Les contraintes inégales et les résultats variables de la mise en œuvre du protocole de Kyoto 58
B. UN PROCESSUS DÉJA ENGAGÉ EN VUE DE L’OBJECTIF AMBITIEUX D’UN ACCORD D’APPLICATION UNIVERSELLE POUR L’APRÈS 2020 59
1. Les résultats de la conférence de Doha de 2012 59
a. Une conférence de consolidation et transition 59
b. Une deuxième période d’engagement pour le protocole de Kyoto pour assurer la transition jusqu’en 2020 60
c. La spécificité de l’engagement européen 61
2. Deux rendez-vous auparavant : Varsovie en 2013, ainsi que Caracas et Lima en 2014 62
a. La COP 19 62
b. Le sommet des chefs d’Etat et de Gouvernement en marge de l’Assemblée des Nations Unies en 2014 64
c. La COP 20 de Lima et la conférence préparatoire de Caracas 65
3. Les perspectives de la COP 21 65
a. L’organisation de la conférence 65
b. Un travail de fond déjà engagé au niveau du Gouvernement 66
c. Une société civile et des acteurs économiques mobilisés ou sensibilisés 68
d. Le relais essentiel des collectivités locales et des villes 69
e. Une coordination, à prévoir, de l’agenda parlementaire international et européen 69
4. L’émergence progressive des grands paramètres pour le futur accord 70
a. Les principaux éléments 70
b. Le rôle moteur de l’Union européenne 72
c. La diversité des situations pour les pays tiers 72
d. Quelques pays clefs 74
5. Un impératif régional : organiser autour des Etats-Unis, de la Chine et de l’Union européenne la coopération internationale pour assurer le développement et la transition énergétique de l’Afrique 79
Mesdames, Messieurs,
Il y a exactement quarante ans, la question énergétique et son corollaire, le développement durable, ont fait leur entrée au plus haut de l’agenda politique international et des préoccupations des Gouvernements. Ils n’en sont jamais sortis depuis.
La décision des pays arabes membres de l’OPEP de soumettre à embargo pétrolier, le 16 octobre 1973, les États-Unis et les Pays-Bas pour les punir de leur soutien à Israël pendant la guerre du Kippour et de réduire leur production, a été suivie quelques semaines plus tard du quadruplement du prix du pétrole, porté de 2,80 dollars à 11,80 dollars le baril, et a provoqué le premier « choc pétrolier ».
Contrairement à l’embargo de 1956, lors de la crise de Suez, cette décision politique a profondément affecté le modèle antérieur de croissance et d’économie de plein emploi des pays occidentaux : nous le constatons encore aujourd’hui.
Pour autant, montrant toute la difficulté de la question énergétique, aucune des prévisions les plus pessimistes de l’époque sur les limites de la planète en la matière, ne s’est réalisée :
– la perspective d’un épuisement complet des réserves pétrolières en trois décennies a été démentie par les découvertes de nouveaux champs, par la mise au jour d’importantes réserves de gaz et, dernièrement, par la révolution des hydrocarbures non conventionnels ;
– les anticipations du Club de Rome, dont le « rapport Meadows », publié en 1972, annonçait un futur inquiétant avec la fin de la croissance, en raison d’un épuisement des ressources énergétiques et des conséquences du développement industriel sur l'environnement, ne se sont heureusement pas réalisées. Bien au contraire, la fin du sous-développement a été constatée dans la majeure partie de l’ancien Tiers Monde avec les économies émergentes, dans le contexte d’une forte augmentation de la population mondiale de plus 3 milliards de personnes, passant de 4 milliards à plus de 7 milliards, qui plus est ;
– les prix de l’énergie eux-mêmes ont connu des variations aussi importantes que spectaculaires, liées à des facteurs non seulement économiques, mais aussi géopolitiques : le contre-choc pétrolier des années 1980, fondé sur une augmentation de la production saoudienne, a été l’un des outils qui a mis fin à la Guerre froide en provoquant l’effondrement des prix du pétrole et par conséquent des ressources d’exportation soviétiques ; à la fin des années 1990, de simples facteurs d’offre et demande dans le contexte des crises financières répétées dans les pays émergents (Mexique, Russie, Corée) ont conduit à un prix du pétrole extrêmement bas, atteignant en valeur nominale celui des années 1970. Dans le contexte déjà favorable de la révolution Internet¸ la croissance économique en a été très favorisée. C’est d’ailleurs pour la France les dernières années connues de réelle croissance ;
– les énergies renouvelables se sont développées, mais sont restées cantonnées dans un rôle de complément ;
– en revanche, la question énergétique est restée au centre de la géopolitique. La Russie l’a illustré dans les années récentes avec la politique du prix du gaz vis-à-vis de certaines des anciennes républiques soviétiques, dont l’Ukraine, et plus particulièrement en janvier 2009, avec l’interruption des livraisons de gaz qui a affecté 11 États européens dont l'Autriche, la Roumanie, la République tchèque, la Bulgarie et l'Italie.
Pour autant, les termes dans lesquels la question se pose n’en sont pas resté immuables. Au contraire, ils ont été profondément transformés et renouvelés.
D’abord, les concepts de développement durable et d’empreinte écologique se sont imposés, faisant ainsi du Club de Rome un précurseur.
Ensuite, à partir du milieu des années 1980, la question de fond des limites de la planète ne s’est plus uniquement posée en termes de ressources naturelles, notamment de ressources en matières premières, ou de niveau de pollution, mais aussi de capacité globale de la terre, avec le changement climatique et les travaux sur la modification pérenne des paramètres régulateurs de la température et des précipitations sur terre.
C’est en 1988 qu’est créé sous l’égide de l'ONU (plus précisément de l’Organisation météorologique mondiale et du Programme des Nations unies pour l’environnement), le Groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) dans le but de faire une synthèse des études scientifiques réalisées en la matière.
Les gaz à effet de serre au premier rang desquels le gaz carbonique, le CO2, ont alors été identifiés comme responsables du changement climatique.
En juin 1992, la Conférence de Rio marque le début d’un vaste programme de lutte mondiale contre les changements climatiques, ainsi que contre l’érosion de la biodiversité, la désertification et l’élimination des produits toxiques dangereux.
Est alors adoptée la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) : son objectif est de stabiliser les concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre en prenant en compte la responsabilité différenciée des pays industrialisés et des pays en développement.
À la suite du deuxième rapport du GIEC, en 1995, s’ouvrent en 1997 au Japon les négociations qui aboutissent au protocole de Kyoto, premier instrument de limitation des émissions de gaz à effet de serre.
Celui-ci prévoit une réduction moyenne de 5,2% des émissions de gaz à effet de serre dans les pays industrialisés d’ici à 2012 (-8% pour les pays de l’Union européenne et -6% pour le Japon).
Enfin, les pays de l’Union européenne, parmi lesquels quatre des principales puissances économiques et donc quatre des principaux acteurs en matière de consommation d’énergie, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie et la France, ont amorcé une politique commune en matière d’énergie et de climat d’abord avec une ouverture des marchés nationaux de l’énergie, dans le cadre de la réalisation du marché intérieur, puis avec la définition en 2007 de l’objectif des 3 fois 20 à l’horizon 2020, suivie en 2008 du paquet « énergie-climat » pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et sécuriser l’approvisionnement en énergie.
Pour autant, la question de l’énergie et du climat est loin d’être réglée au niveau international comme au niveau européen. Si l’objectif ultime est celui d’une économie largement décarbonée vers 2050, avec la perspective en 2100 d’une énergie propre et illimitée, comme le rappelle dans un entretien du 11 mai dernier au Journal du Dimanche, Mme Laurence Tubiana, présidente de l’Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI), les étapes et maillons intermédiaires sont loin d’être clairs.
Aussi, la Commission des Affaires étrangères s’étant saisie pour avis, comme chaque année, des crédits de l’écologie et du développement durable, intitulés cette année « écologie, développement et mobilité durables », votre rapporteur estime-t-il opportun de se concentrer sur les deux enjeux majeurs dont le règlement conditionne notre futur commun :
– d’une part, l’Europe de l’énergie et du climat, avec notamment son manque de cohérence et de consistance, ainsi que les difficultés posées par le caractère profondément national, en l’état, de la transition énergétique allemande dans le cadre de l’Energiewende et de l’Energiekonzept 2050 ;
– d’autre part, les négociations climatiques internationales, avec en perspective la préparation de la vingt-et-unième conférence des parties, la COP 21, prévue pour se réunir à Paris à l’automne 2015, et au cours de laquelle doit être défini l’instrument international multilatéral, universel et contraignant de limitation des gaz à effet de serre et de maîtrise de l’évolution des températures terrestres pour l’après-2020.
Préalablement, votre rapporteur indique cependant qu’il est favorable à l’adoption des crédits de la mission Ecologie, développement et mobilité durables pour 2014, dont les crédits de paiement passeront de 7,7 milliards d'euros en 2013 à 7,16 milliards d'euros en 2014, mais à 9,4 milliards si l’on tient compte du programme d’investissement d’avenir.
Sur ces crédits, 2,3 milliards sont directement consacrés à la transition écologique et assurent ainsi la visibilité de notre action dans les domaines qui sont directement l’objet des enjeux européens et internationaux précités.
I. UNE COOPÉRATION EUROPÉENNE PRISE EN DÉFAUT PAR LES CONTRAINTES ET LES LIMITES DU TOURNANT ÉNERGÉTIQUE EN ALLEMAGNE
A. UN CONTEXTE INTERNATIONAL DÉJÀ BOULEVERSÉ PAR LA RÉVOLUTION AMÉRICAINE DU GAZ DE SCHISTE ET L’EFFONDREMENT DU PRIX DU CHARBON À L’EXPORTATION
Les Etats-Unis devraient redevenir cette année, en 2013, le premier producteur mondial d’hydrocarbures, pétrole et gaz naturel réunis, à raison de 25 millions de barils équivalent pétrole par jour, contre 22 millions pour la Russie et 12 millions pour l’Arabie saoudite.
Ils l’étaient déjà dans la première partie du XXème siècle, jusque dans l’immédiat après-guerre.
Le boom du gaz de schiste est pour le moment un phénomène uniquement américain. La production américaine a été multipliée par 6 entre 2007 et 2012, passant de 45 à 264 milliards de mètres cubes (Gm3). Le gaz de schiste a représenté, en 2012, 39% de la production gazière américaine (681 Gm3), contre seulement 3% en 2002.
Ce développement rapide est le résultat de la conjonction de quatre facteurs favorables :
- le contexte du marché gazier américain, qui bénéficie d’une forte consommation tandis que la production conventionnelle est sur le déclin ;
- la maîtrise des technologies nécessaires à leur exploitation (forages horizontaux et fracturation hydraulique) avec des coûts de moins en moins élevés, au fur et à mesure du développement des techniques. Il faut cependant souligner l’incertitude quant à la rentabilité des installations américaines au regard des prix de marché, dont le faible niveau résulte d’un excès d’offre. En effet, plusieurs acteurs ont manifesté leurs inquiétudes face au maintien actuel des prix à un niveau jugé bas ;
- un droit à la propriété des particuliers s'étendant au sous-sol et donnant droit à des redevances (royalties) substantielles, incitant ainsi les propriétaires des terrains à accepter ce type d'exploitation ;
- une législation environnementale jusqu’à récemment peu contraignante.
En raison de la forte croissance de la production, les Etats-Unis ont connu une baisse spectaculaire des prix du gaz, lesquels ont atteint un niveau particulièrement bas en 2012. Le prix Henry Hub est ainsi passé de 12 dollars par million d’unité thermique britannique ($/MBtu) (soit 30 euros par mégawatt heure (€/MWh) environ) fin 2008 à 1,9 $/MBtu (soit 4,75 €/MWh environ) en avril 2012, pour s’établir en moyenne sur l’année à 2,75 $/MBtu (soit 7,3 €/MWh). A ce niveau, la rentabilité de la production gazière n’est d’ailleurs plus assurée, ce qui a poussé les industriels à se tourner vers les gisements gaziers riches en liquides de gaz naturel et les gisements pétroliers. Si l’effort de production a diminué (notamment le nombre de forages), les progrès techniques et la rentabilité accrue des activités de forage ont permis que la production continue d’augmenter, malgré le faible niveau des prix. Ces derniers sont légèrement remontés en 2013, évoluant entre 3 et 4 $/MBtu, et devraient à court terme, selon l’Agence internationale de l’’énergie (AIE), retrouver un équilibre à environ 4 $/MBtu.
La baisse du prix du gaz due à l’exploitation du gaz de schiste n’a eu d’impact qu’aux Etats-Unis.
Le cloisonnement des marchés gaziers, avec trois grandes zones aux logiques d’approvisionnement et aux tendances différentes (Amérique du Nord, Europe, Asie), explique l’absence de convergence des prix au niveau mondial.
Les différences entre les niveaux de prix du gaz sur les marchés régionaux se sont d’ailleurs amplifiées en 2012. Les contrats indexés sur le pétrole, dominants dans l’approvisionnement de l’Asie et de l’Europe, ont subi la hausse des prix du pétrole depuis 2010.
Les niveau élevé des prix asiatiques est également dû à la demande croissante du marché asiatique, qui fait face, d’une part, à l'essor tendanciel des marchés émergents, d’autre part, aux effets de la catastrophe de Fukushima, laquelle a conduit le Japon à un usage accru de gaz naturel liquéfié (GNL), à la suite de l’indisponibilité de son parc électronucléaire.
Au niveau européen, la forte baisse de la consommation ces deux dernières années n’a pas eu d’impact à la baisse sur les prix, en raison du poids des contrats gaziers de long terme dans l’approvisionnement et de la remontée des prix spot, avec un prix moyen passé de 22 €/MWh environ en 2011 à 25 €/MWh en 2012. Les prix spot restent toutefois sensiblement plus bas (30% environ en 2012) que le prix des contrats long terme, malgré une indexation croissante sur les marchés gaziers de gros, en raison d’un mouvement de renégociation des formules tarifaires amorcé depuis environ deux ans et tendant à réduire l’indexation sur le pétrole.
A moyen-terme, le marché gazier mondial pourrait voir arriver une nouvelle source d’offre, avec l’exportation de GNL en provenance des Etats-Unis. Le gouvernement américain n’a pas tranché sur sa stratégie concernant une telle exportation dans les années à venir, en raison notamment des réserves exprimées par certains membres du Congrès, qui estiment que ces exportations pourraient entraîner une hausse des prix du gaz sur le marché intérieur. A ce jour, seuls trois projets de terminaux d’exportation ont reçu l’autorisation d’exporter vers des pays n’ayant pas d’accord de libre-échange avec les États-Unis : une autorisation a été délivrée en 2011, et deux autorisations en 2013.
Les promoteurs de projets d’exportation de GNL à partir des Etats-Unis cherchent à tirer parti des possibilités d’arbitrage sur les écarts de prix entre les principaux marchés du gaz (Amérique du nord, Europe, Asie). Toutefois, le futur GNL américain devrait avoir un impact macroéconomique limité pour les pays importateurs en Europe. En effet, aux niveaux de prix actuels (3,5-4 $/MBtu sur le Henry Hub), si l’on ajoute le coût de liquéfaction (3 $/MBtu soit 7,5 €/MWh, prix proposé par le terminal Cheniere), ainsi que de transport vers l'Europe (autour de 1,5 $/MBtu soit 3,75 €/MWh) et de regazéification à l'arrivée du gaz (autour de 0,5$/MBtu soit 1,25 €/MWh), soit au total 8$/MBtu (20 €/MWh), le prix de livraison du gaz en Europe devrait avoisiner 10-11 $/Mbtu, soit 25-27,5 €/MWh, ce qui correspond à un prix proche des prix actuels sur les marchés spot européens. Il n’y aurait donc pas d’avantage compétitif significatif du GNL américain sur le marché européen, et d’autant moins si le prix au Henry Hub venait à croître. En revanche, le GNL américain pourrait devenir une nouvelle source d’approvisionnement du marché asiatique, où les prix sont plus élevés qu’en Europe et la demande à venir en forte croissance. Il y a toutefois de nombreuses incertitudes sur la tendance à moyen-terme du prix du GNL.
Le faible prix du gaz est à même de peser sur les évolutions du mix énergétique américain, comme le note l’AIE, en réduisant la compétitivité de l’éolien, également pénalisé par la fin du crédit d’impôt en 2012, en constituant un frein au développement de l’énergie nucléaire, ou encore en faisant du gaz un substitut intéressant dans les transports, notamment pour l’alimentation des poids lourds ou la fabrication de pétrole synthétique (procédé Gas-To-Liquids), lesquels représenteraient, en 2040, 6% de la consommation gazière américaine. Toutefois, au-delà des considérations de prix, l’évolution de la consommation de gaz, aux États-Unis, comme ailleurs, a une forte sensibilité aux évolutions du cadre réglementaire et de la politique énergétique, en particulier aux objectifs que les pays se fixeront en termes de réduction des gaz à effet de serre.
On observe également, mais cela ne relève pas du champ du présent rapport, que la baisse du prix du gaz a donné un élan à l’industrie chimique américaine en lui offrant une nouvelle compétitivité.
2. Des excédents charbonniers exportés, notamment vers l’Europe, et la reprise de la consommation de charbon au niveau mondial
La croissance de la production gazière, ainsi que la baisse du prix du gaz, aux États-Unis ont favorisé le développement du recours au gaz au détriment du charbon, notamment pour la production électrique : le taux d’utilisation des centrales électriques américaines au charbon est tombé à 57% en 2012, contre une moyenne de 70% entre 2002 et 2008.
Cette diminution de la consommation de charbon aux Etats-Unis a mécaniquement entraîné une augmentation des exportations américaines de charbon (passées de 59,2 millions de tonnes (Mt) en 2007 à 107,3 Mt en 2011), notamment à destination de l’Europe (53,9 Mt en 2011 contre 27,1 Mt en 2007), où le prix du gaz est resté élevé et où le prix du quota d’émission de CO2 s’est effondré, renforçant la compétitivité du charbon.
Les termes économiques du mix énergétique ont été modifiés, notamment en Allemagne, où le charbon ainsi que le lignite connaissent une nouvelle expansion dans le contexte du tournant énergétique et de la sortie du nucléaire.
Sur le long terme, depuis 40 ans, la part du charbon dans le mix énergétique mondial n’a pas diminué, mais a au contraire augmenté : elle est passée de 24,6% cette année-là à 28,8% en 2011 selon les données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
Pour ce qui concerne la production d’électricité, la progression est plus marquée : 41,3% en 2011 contre 38,3% en 1973. Cette évolution est le fait des pays émergents, puisque la part du charbon a chuté dans le mix énergétique des pays développés : 22,6% en 1973 ; 19,5% en 2011. C’est notamment le cas de la Chine, qui représente 47,5% du total de la consommation mondiale, selon l’annuaire statistique de BP, devant les États-Unis (13,4%) et l’Union européenne (11,6%). Pour cette dernière, le charbon est prépondérant dans le mix énergétique de la Pologne (55%) et important en Allemagne (25%) et au Royaume-Uni (19%).
Conséquence notable, la part du charbon a progressé dans les émissions de CO2, passant de 35% il y a quarante ans à 44% en 2011, selon l’AIEA.
B. UNE EUROPE DE L’ÉNERGIE ET DU CLIMAT AUX FAIBLESSES AGGRAVÉES PAR LES CHOIX NATIONAUX DE L’ENERGIEWENDE
Le tournant énergétique allemand, l’Energiewende, a fait l’objet d’une étude très complète de la part de l’IFRI, de M. Michel Cruciani, diffusée en juillet dernier (Notes de l’IFRI : le tournant énergétique allemand : année N+2).
Ont ainsi été complétés les éléments communiqués à votre rapporteur par le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, ainsi que par le poste économique de l’Ambassade de France à Berlin.
Une image précise des enjeux allemands et européens de l’Energiewende et de l’Energiekonzept 2050 a ainsi pu être établie.
Il est l’un des éléments au prisme duquel les faiblesses intrinsèques de l’Europe de l’énergie et du climat se révèlent dans toute leur ampleur.
La politique européenne de l’énergie et du climat s’est construite, à défaut de se structurer, en trois vagues successives.
La première a été consécutive à la réalisation du marché intérieur avec la mise en œuvre, à partir du 1er janvier 1993, de l’Acte unique de 1986. Elle correspond à la politique de libéralisation conduite sous l’égide de la DG Concurrence, qui s’est ouverte avec la première directive sur l’ouverture du marché de l’électricité, en 1996, laquelle a été suivie par le deuxième paquet énergie en 2000 et le troisième paquet en 2007, pour une ouverture qui doit s’achever le 1er janvier 2014. L’objectif est de réduire les prix et de favoriser l’allocation optimale des capacités de production.
Sous l’effet de la concurrence, le poids des opérateurs historiques a diminué. Selon Eurostat, la part du premier producteur n’est d’au moins 85% de la production d’électricité que dans quelques pays, dont l’Estonie, la Lettonie, la France, le Luxembourg et la Grèce. Dans 13 des 24 États membres, le plus grand producteur fournit moins de 50 % du total de l’électricité produite, la part la plus faible (17,4 %) étant observée en Pologne.
La deuxième orientation a été d’ordre climatique, dès lors que la lutte contre le changement climatique a été inscrite au premier rang des priorités de l’agenda politique européen. Elle a été placée sous l’égide de la DG Climat.
Les objectifs généraux dits des 3 fois 20 pour 2020 ont été fixés par le Conseil européen de mars 2007, sous Présidence allemande : une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre, une amélioration de l’efficacité énergétique de 20%, une augmentation à 20% de la part des renouvelables. De plus, en cas d’accord international, l’objectif de réduction des émissions de CO2 a été prévu pour passer à 30%. Cet ensemble était cohérent avec la démarche de l’Energiewende alors en cours de mise en œuvre et que le Gouvernement allemand de grande coalition n’avait pas remis en cause. Le dispositif du paquet énergie-climat a été ensuite été adopté en 2008.
Par ailleurs, a été mis en place, à partir de 2004, le système européen d’échange de quotas d’émission (ou ETS pour Emission Trading Scheme en anglais) pour les installations fortement émettrices. Pour les secteurs non couverts par ce dispositif, les États ont pris des engagements individuels (-14 % pour la France par rapport à 2005).
Le système communautaire d’échange de quotas d’émissions – EU ETS
le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, qui constitue la pierre angulaire de la politique européenne de lutte contre le changement climatique, a débuté le 1er janvier 2005 par une période de trois ans (phase I : 2005-2007). Cette période a été suivie par une période de 5 ans (phase II : 2008-2012).
L’EU ETS impose donc depuis 2005 un plafond d’émissions à près de 12 000 installations industrielles, responsables de près de 50 % des émissions de CO2 de l’Union européenne, soit environ 2 milliards tCO2. Ces installations doivent restituer tous les ans autant de quotas que leurs émissions vérifiées de l’année précédente (1 quota = 1tCO2eq émise). Depuis 2008, elles ont également la possibilité d’utiliser des crédits Kyoto pour effectuer leur conformité.
Pour la troisième période d’échanges (phase III : 2013-2020), un nouveau dispositif a été mis en place pour étendre le champ d’application de la directive et modifier le système d’allocation de quotas. La directive 2009/29/UE du 23 avril 2009 modifie la directive 2003/87/CE et apporte de profonds changements sur la période 2013-2020 :
– un élargissement du périmètre du système d’échange : à de nouveaux secteurs notamment chimie et aluminium) et à de nouveaux gaz à effet de serre (protoxyde d’azote et perfluorocarbone) ;
– un passage progressif à un mode dominant d’allocation des quotas par mise aux enchères et non plus par allocation gratuite (comme en phases 1 et 2) : une partie des entités assujetties devront ainsi acheter les quotas nécessaires pour couvrir leurs émissions de gaz à effet de serre ;
– la conservation du principe d’allocation gratuite de quotas pour certains secteurs industriels, cette allocation se faisant au niveau communautaire de manière harmonisée : 170 secteurs exposés à un risque important de concurrence internationale (1) continueront donc à recevoir 100% de quotas gratuits sur la base de référentiels correspondant aux 10% d’installations les moins émettrices dans l’Union européenne ;
– une diminution progressive de quantité de quotas alloués gratuitement aux secteurs non exposés à un risque important de concurrence internationale de 80% en 2013 à 30 % en 2020. Par ailleurs, la génération d’électricité ne bénéficie plus de quotas alloués gratuitement.
Deux textes doivent être mentionnés :
– la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique, dont l'article 7 prévoit que chaque Etat membre doit se fixer un objectif contraignant d’économies d’énergie correspondant à 1,5 % de l’ensemble des ventes annuelles d’énergies, hors transports, et l’article 8 instaure des audits énergétiques obligatoires dans les grandes entreprises ;
– la directive 2009/28/CE sur les énergies renouvelables, qui impose à la France un objectif de 23% d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie à l’horizon 2020. La trajectoire prévue par la France pour atteindre cet objectif est présentée dans le plan national d’action (PNA) en faveur des énergies renouvelables. En 2011, la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie atteint 13,1% contre une part de 13,5% prévue par la trajectoire. En 2012, elle atteint 13,7 % contre 14 % prévue.
La troisième démarche européenne a été récemment engagée. Elle relève de la DG Entreprises.
Elle est liée au souci de compétitivité des entreprises consommatrices d’énergie, notamment des électro-intensifs, dans le contexte de la crise économique, et à la crainte de provoquer dans la seule Europe un désavantage comparatif. De même, il s’agit d’apporter une réponse au constat des producteurs d’énergie et des entreprises qui leur fournissent les technologies, d’une absence de visibilité à long terme pour leurs investissements.
b. Une juxtaposition des approches confirmée par le traité de Lisbonne qui laisse en outre aux Etats la pleine souveraineté sur le mix énergétique
Entretemps est intervenu le traité de Lisbonne qui a introduit un nouveau chapitre dans les compétences européennes, mais sans apporter de cohérence d’ensemble.
L’article 194 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne reprend ainsi les éléments déjà définis : le marché ; la sécurité d’approvisionnement ; l’efficacité énergétique et les économies d’énergie ; les énergies nouvelles et renouvelables ; les infrastructures d’interconnexion de réseau.
Il prévoit textuellement que, pour le bon fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte de l'exigence de préserver et d'améliorer l'environnement, la politique de l'Union dans le domaine de l'énergie vise, dans un esprit de solidarité entre les États membres, quatre objectifs :
– assurer le fonctionnement du marché de l'énergie ;
– assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union ;
– promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables ;
– promouvoir l'interconnexion des réseaux énergétiques.
En revanche, les Etats membres conservent leur pleine compétence, c'est-à-dire leur pleine souveraineté, sur leur choix entre les différentes sources d’énergie, le mix énergétique, qui est le cœur de la problématique, sans même qu’une concertation ou un dialogue, ou une consultation, ne soient prévues.
Le point 2 de ce même article précise textuellement que les interventions de l’Union européenne n’affectent pas le droit d'un État membre de déterminer les conditions d’exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique, sans préjudice de l'article 192, paragraphe 2, point c) (c'est-à-dire de la faculté pour l’Union d’adopter à la seule unanimité du Conseil des mesures de la politique de l’environnement ayant des effets sur ces éléments).
Cette absence de position commune de la part des Etats membres de l’Union européenne se constate d’abord sur la grande question des différentes sources d’énergie.
Sur le gaz, et aussi le pétrole, de schiste, la loi de juillet 2011, dont le Conseil constitutionnel vient de confirmer la constitutionnalité et ainsi la validité, interdit en France le recours à la fracturation hydraulique tant pour l’exploration que l’exploitation, ce qui gèle le dossier.
A l’opposé, la Pologne, en dépit d’une récente révision à la baisse des réserves estimées, et le Royaume-Uni sont favorables à leur exploitation sous réserve du résultat des explorations.
Le nucléaire a fait l’objet d’une sortie sans concertation de la part de l’Allemagne, alors même que les autorités européennes procédaient à une évaluation de la sécurité des centrales en cours d’exploitation, ce qui était la première démarche à entreprendre.
Il y a les pays du charbon, notamment la Pologne, l’Allemagne et le Royaume-Uni, et les pays sans charbon ou presque, dont la France.
On constate ainsi que pour s’en tenir aux principaux pays, la diversité des orientations énergétiques entre Etats membres de l’Union européenne est comparable à celle du reste du monde, comme l’indique le tableau suivant :
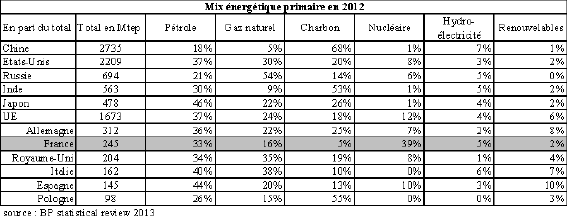
Il n’y a pas davantage d’accord, et même des oppositions de blocs, sur des enjeux plus réduits, comme le montrent les deux dossiers de la limitation des émissions industrielles polluantes et de celle des émissions de CO2 par les véhicules.
La directive dite IED 2010/75/UE du 24 novembre 2010 sur les émissions industrielles a en effet montré la capacité de pragmatisme des pays qui disposent d’importantes centrales à charbon, notamment l’Allemagne, de même que le Royaume-Uni et la Pologne.
Des dérogations ont, en effet, été prévues pour éviter la mise aux normes ou la fermeture des centrales les plus polluantes à l’horizon 2016 comme le proposait la Commission européenne.
Or, pour des raisons techniques, ces mêmes centrales ne sont pas seulement les plus polluantes : ce sont également celles qui engendrent les plus fortes émissions de CO2.
Cette même défense de ses intérêts industriels par l’Allemagne, alliée avec d’autres pays notamment la Pologne et le Royaume-Uni, sur ce dossier, a pu être constatée sur la question de la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre lors de la négociation sur la proposition de directive sur la limitation des émissions de CO2 par les véhicules automobiles.
C’est l’opposition de certains pays autour de l’Allemagne qui a fait échec à la norme de 95 grammes au kilomètre prévue pour 2020 (contre 135 en 2015).
La presse a fait état des difficultés BMW et Daimler (Mercedes Benz) face à cette nouvelle norme. Ce résultat est d’autant plus regrettable que, compte tenu de son importance, le secteur des transports est essentiel pour la réussite de la décarbonation.
Dans ce contexte, les décisions sont ainsi prises sans concertation.
En définitive, la politique européenne est constituée d’éléments divers qui ont chacun leur légitimité, mais qui à défaut de pilotage, relèvent actuellement d’une logique sectorielle en « silo » doublée d’une logique par pays ou, dans le meilleur des cas, par blocs de pays n’assurant pas la cohérence d’ensemble.
Dans ce contexte, la voie allemande de la transition énergétique a mis au grand jour ces faiblesses et a profondément perturbé le fonctionnement du marché de l’énergie en Europe.
2. Une stratégie allemande de développement des renouvelables purement nationale, engagée dès 2000 et dont les paramètres ont été durcis avec la confirmation, en 2011, de la sortie du nucléaire, dès le début de la décennie 2020
Après la réunification pour la décennie 90, la transition énergétique ou plutôt le tournant énergétique (Energiewende) a été le grand projet de l’Allemagne. Il a été initié en 2000 lors de la coalition entre le SDP et les Verts, et l’adoption sur l’initiative du Gouvernement du Chancelier Schröder, de deux lois essentielles.
Il s’agit d’abord de la loi du 29 mars 2000 sur les énergies renouvelables, dite loi EEG (Erneuerbare Energien Gesetz), qui crée un cadre favorable à la production d’électricité d’origine renouvelable, avec un dispositif de tarif d’achat garanti sur 15 à 20 ans. Le surcoût fait l’objet d’un décompte précis sur un compte dit EEG et fait l’objet d’une répercussion au consommateur. Antérieurement, une taxation de l’énergie a été opérée dès 1999 selon le principe de l’écotaxe.
Ensuite, la loi sur la sortie du nucléaire (Atomaustieg) a été adoptée le 22 avril 2002, fixant un plafond cumulé pour les réacteurs alors en service et prévoyant que le dernier réacteur serait arrêté en 2021.
ii. Un complément gazier rarement cité : l’approvisionnement direct de l’Allemagne en Russie, à travers la Baltique, par la construction du gazoduc Nord Stream
Au moment même de l’entrée dans le tournant énergétique, l’Allemagne a été engagée dans le projet de gazoduc Nord Stream la reliant directement aux gisements de gaz russes à travers la mer baltique.
Le projet a été lancé en 1997 et c’est en 2001 que Ruhrgas et Wintershall, énergéticiens allemands, ainsi que Fortum (énergéticien finlandais) et Gazprom ont adopté le rapport de faisabilité. En 2005, une société ad hoc, Nord Stream AG, a été créée en Suisse, à Zoug, en l’absence de l’opérateur finlandais, qui s’est retiré. Gazprom en a été majoritaire à 51%. Elle a bénéficié d’une garantie de crédit d’un milliard d’euros de la part du Gouvernement allemand au titre des prêts consentis par deux établissements financiers allemands, dont la KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau ou Établissement de crédit pour la reconstruction, qui est l’homologue de la Caisse des dépôts).
Après recomposition, l’actionnariat est au moment de l’inauguration du gazoduc, en 2011, le suivant : Gazprom (51 %), les deux consortiums allemands E.ON et BASF (15,5 % chacun), le français GDF Suez et le hollandais Gasunie (9% chacun).
La dimension géostratégique n’est pas absente, puisque le tracé permet de contourner l’Ukraine et, également, de tirer parti des avantages économiques de la liaison directe avec la Russie.
L’Allemagne bénéficie ainsi dans sa relation sans intermédiaire géographique avec la Russie d’une situation plus favorable qu’auparavant au moment même où elle va devoir envisager un substitut au nucléaire. On peut comparer cette situation nouvelle à une réassurance.
Nord Stream a été fortement contesté par la Pologne et les Etats baltes, particulièrement avertis du rôle de la diplomatie du gaz dans la politique étrangère russe.
i. L’intermède de l’Energiekonzept de 2010 : la prolongation du nucléaire pour financer le développement des renouvelables
Cette trame n’a pas été remise en cause lorsque Mme Angela Merkel est devenue Chancelière en 2005, dans le cadre de la grande coalition.
Elle l’a été uniquement à partir de 2009, lorsque les élections ont permis à la CDU de faire alliance avec le parti libéral, le FDP, et de manière prudente dans le cadre de l’Energiekonzept 2050, adopté en 2010, et qui a offert une perspective de décarbonation de l’économie à l’horizon 2050 grâce à :
– des objectifs ambitieux de réduction des gaz à effet de serre de -80% à -95% à cet horizon;
– une réduction sensible de la consommation d’énergie : -25% pour la consommation brute d’électricité par rapport à 2008 ; -40% dans le secteur des transports ;
– une hausse tout aussi sensible de la part des renouvelables dans la production d’électricité qui doit atteindre 80% ;
– une élévation à 60% de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale.
En contrepartie toutefois, cet effort était financé par le report de la sortie du nucléaire avec une prolongation de la durée de vie des centrales allant, selon leur âge, de 8 ans à 14 ans, au-delà de 2021.
Le schéma et les éléments de ce financement étaient les suivants :
– une taxe sur le combustible nucléaire ;
– une contribution au fonds « énergie et climat » permettant de financer les incitations en faveur des renouvelables ;
– le maintien avec le nucléaire d’une source décarbonée de production d’électricité, le temps que les techniques utilisant ces mêmes renouvelables arrivent à maturité.
Doublement rationnelle, tant sur le plan économique (la prolongation du nucléaire finance le développement des renouvelables) que sur le plan climatique (une source d’énergie sans émission de gaz à effet de serre est temporairement maintenue en activité), cette construction s’est heurtée à une autre rationalité d’ordre politique qui ne peut être comprise qu’au prisme des spécificités culturelles et politiques allemandes sur fond d’un attachement particulièrement fort, ancien et précoce de l’opinion à certains aspects de la dimension environnementale du développement.
À la suite de l’accident de Fukushima, dès 2011, le Gouvernement de la Chancelière Angela Merkel a décidé d’accélérer la sortie du nucléaire avec d’une part, l’arrêt immédiat de huit réacteurs et, d’autre part, l’arrêt progressif des neuf autres entre 2015 et 2022. Cette décision a été prise sur la base des recommandations d’une commission d’éthique mise en place après l’accident. C’est au niveau éthique que la question a donc été soulevée.
Le Gouvernement s’est engagé à compenser intégralement cette sortie par de nouvelles capacités de production nationales pour éviter d’avoir recours aux importations d’électricité.
Pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté, les objectifs définis en 2010 ont été rendus obligatoires par le Gouvernement fédéral.
Les deux composantes de la transition énergétique allemande ont alors été fixées : décarbonation et sortie du nucléaire.
Ce retour à la solution antérieure résultant du consensus SPD-Verts a coïncidé avec une période électorale favorable aux Verts, et très défavorable au FDP, faisant ainsi remarquer à de nombreux commentateurs l’intérêt de la démarche sur le plan politique : la suppression d’un élément faisant obstacle à un éventuel renversement d’alliance pour la CDU (le nucléaire) ; l’implication de l’ensemble des partis alors dans l’opposition dans une dynamique faisant consensus et impliquant l’ensemble de la société sur la base d’une dimension éthique très forte et prenant parfois un caractère lyrique compte tenu de l’importance du pari tel que présenté : un saut dans le renouvelable et des objectifs très ambitieux de réduction des émissions de CO2 sans le filet de sécurité du maintien du nucléaire. En avril 2012, le ministère FDP de l’économie, M. Philipp Rössler, a ainsi comparé la démarche allemande à celle de Marco Polo partant vers l’Asie inconnue et mis en avant les qualité de courage, résolution et persévérance qui ont permis au découvreur de surmonter incertitudes et difficultés.
Les choix énergétiques allemands ont été décidés de manière purement nationale comme on vient de le voir.
Ils n’ont donné lieu ni en 2000 ni plus récemment à aucune réaction officielle, ni de la part des autorités de l’Union européenne, ni aussi de la part des pays partenaires.
Cette inertie est regrettable.
Pour ce qui concerne la dimension européenne, il n’est pas neutre d’observer que lorsque le commissaire allemand M. Günther Oettinger s’est vu attribuer le portefeuille de l’énergie en 2010, au moment de la composition de la Commission européenne, le poste n’a pas été estimé mineur pour l’Allemagne par les observateurs avertis.
Le développement des énergies renouvelables en Allemagne repose sur un système de soutien, dont une toute première version a été mise en place en 1991, et qui a été révisé en 2000. Ce dispositif est fondé sur deux éléments :
– une garantie d’achat à un tarif préférentiel, octroyée aux producteurs d’électricité renouvelable, pour vingt ans ;
– un accès prioritaire au réseau.
Ce dispositif est nécessairement générateur d’un surcoût qui n’est pas assumé par les professionnels, mais comptabilisé à part sur un compte spécifique dit EEG.
Le coût global de ce mécanisme a fortement augmenté depuis 2009 pour atteindre cette année un total de 20 milliards d’euros. Les prévisions ont été dépassées. Le système semble s’être emballé.
Les résultats de la comptabilisation sur le compte EEG sont en effet les suivants :
EVOLUTION DES SURCOÛTS DU SOUTIEN À L’ÉLECTRICITÉ D’ORIGINE RENOUVELABLE (LOI EEG)
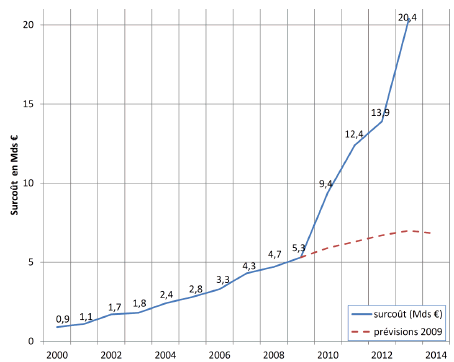
Source : Ambassade de France en Allemagne.
Ces coûts sont d’autant plus préoccupants qu’ils s’accumulent pendant 20 ans, pour toute la durée des tarifs d’achat garantis. Ils devraient atteindre 150 milliards d’euros d’ici 2032, pour les seules installations mises en fonction avant 2013. Ils continueront d’augmenter inéluctablement, avec le développement de nouvelles sources d’énergies renouvelables, et ne pourront être maîtrisés qu’avec d’importants développements technologiques.
Une telle situation pose clairement la question de la soutenabilité du modèle économique de la transition énergétique allemande.
Elle ne tient qu’en raison de la répartition inégale des coûts entre les agents économiques : les industriels bénéficient d’allégements, afin de préserver leur compétitivité, ce qui renchérit de facto la facture des ménages, notamment les plus modestes.
La question du partage de l’avantage EEG sur le plan économique
Les avantages du dispositif EEG pour l’électricité d’origine renouvelable profitent semble-t-il non seulement aux producteurs d’électricités, aux détenteurs des équipements, et développeurs de projets, mais également aux professionnels de la filière : fabricants, installateurs et importateurs.
Comment néanmoins se partage cet avantage, ou cette « rente » sur le plan économique, entre ces différents intervenants ?
Faute d’étude précise sur un tel partage portée à la connaissance de votre rapporteur, on peut mentionner les éléments suivants.
Une étude de l’Institut Klaus Novy, situé à Cologne, de 2011, sur les acteurs du marché de l’électricité renouvelable (Marktakteure Eneuerbare-Energien-Anlagen in der Stromerzeugung) montre que plus de la moitié des équipements sont propriété soit de particuliers, soit d’exploitants agricoles. Les seuls particuliers représentent 36% pour les éoliennes et 40% pour les installations solaires.
Cette démarche citoyenne fait que le marché est réparti entre plusieurs catégories de propriétaires. Pour le solaire, 40% pour les particuliers, 11% pour les exploitants agricoles, 6,5% pour les grandes entreprises énergétiques, 7% pour les énergéticiens de petite taille, 11% pour les fonds d’investissement bancaires et 9% pour les professionnels, pour l’essentiel.
Selon un professionnel du secteur, développeur de projets sur les installations photovoltaïques et éoliennes, les prix des équipements sont fixés lors de négociations entre équipementiers et développeurs de projets. Ces négociations se fondent sur les marges prévisibles des projets. Celles-ci reposent sur différents critères objectifs, outre le tarif d’achat garanti. Par exemple, le régime du vent pour les installations éoliennes.
Il semblerait donc que la répartition de l’avantage se fasse davantage au niveau microéconomique, et que les fabricants en bénéficient aussi.
Pour le secteur photovoltaïque, la forte baisse des tarifs garantis a d’ailleurs mis en cause la rentabilité des projets en Allemagne, et a provoqué des faillites de producteurs, dans le contexte qui plus est de la concurrence chinoise.
De même, la forte demande d’éoliennes en Allemagne au début des années 2000 a conduit les constructeurs d’éoliennes à investir dans des capacités de production, d’où des prix plus élevés. Mais cette demande s’est tassée et les prix se maintiennent.
Les producteurs d’électricité verte semblent donc disposer d’une marge de négociation vis-à-vis des équipementiers, mais il n’est cependant pas interdit de penser qu’une baisse ou une suppression progressive des tarifs d’achats garantis ne conduise à une diminution des prix des équipements.
Intégralement répercuté sur les ménages, le montant de la transition est estimé à 20,4 milliards d’euros en 2013 (soit 53€/MWh), en hausse de près de 50% par rapport à 2012.
Le prix de l’électricité payé par un foyer allemand (263 €/MWh en 2013) est ainsi près de deux fois plus élevé qu’en France (les ménages allemands consomment pourtant 30% de moins d’électricité - différence liée au moindre rôle du chauffage électrique - si bien que leur facture totale d’électricité est en réalité 1,5 fois plus élevée).
Le prix acquitté par les ménages allemand est ainsi au troisième rang en Europe, selon les statistiques d’Eurostat, comme le montre le diagramme suivant :
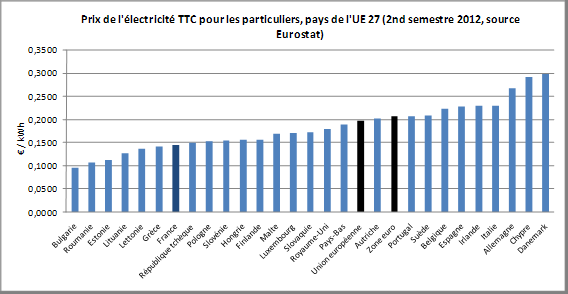
Source : Eurostat
L’écart de l’Allemagne par rapport à la moyenne va encore augmenter.
A partir de 2014, le surcoût sera pour les ménages allemands de 6,3 centimes d’euro par kilowattheure consommé, soit une hausse de 18%.
Ce surcoût est en partie imputable aux exonérations en faveur des entreprises.
iii. Des exonérations de surcharge pour garantir la compétitivité industrielle, notamment des électro-intensifs, dans des conditions parfois à la limite de la légalité européenne
L’Allemagne fait preuve d’une grande capacité de pragmatisme en faveur de la compétitivité de son industrie, notamment sur les électro-intensifs, même lorsqu’il s’agit d’énergie verte.
Plusieurs dispositions permettent de diminuer considérablement la charge pour les industriels. Leur détail est mentionné dans l’article précité de M. Michel Cruciani :
– la dégressivité de la surcharge EEG pour l’industrie manufacturière : la surcharge EEG n’est appliquée qu’à hauteur du premier Gigawatt heure (Gwh) consommé ; ensuite, de 1 à 10 Gwh, elle n’est appliquée qu’à hauteur de 10% puis au-delà qu’à hauteur de 1%. Au-delà de 100 GWh, la surcharge est plafonnée à 0,05 centime d’euro par kilowattheure. En contrepartie, les entreprises qui consomment plus de 10 GWh par an doivent démontrer avoir mis en œuvre leur potentiel d’économies d’énergie ;
– un abattement spécial est prévu pour les entreprises qui produisent leur propre électricité.
En 2013, les entreprises bénéficiaires de la surcharge EEG sont au nombre de 1 638, soit un avantage de 4,3 milliards d’euros impliquant selon les calculs mentionnés par M. Michel Cruciani une surcharge de 1,05 centime d’euro par kilowattheure pour les ménages.
C’est pourquoi dans l’ensemble le prix de l’électricité est resté proche de la moyenne européenne pour les professionnels, comme le confirme le graphique suivant établir par Eurostat :
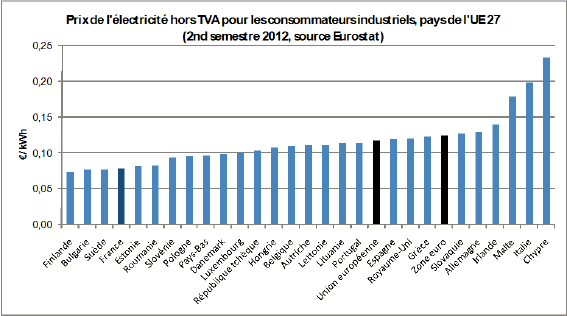
Source : Eurostat
Par ailleurs, pour éviter la dégradation de leur compétitivité en raison de l’augmentation du coût de l’électricité, l’article 19 du règlement fédéral sur les tarifs d’accès aux réseaux d’électricité (Stromnetzentgeltverordnung) a dispensé les grands consommateurs d’électricité de payer des droits de réseau. Cette exonération, estimée à environ 300 millions d'euros pour l’année 2012, est financée par les consommateurs d'électricité finaux, qui doivent, depuis cette même année, payer une taxe spéciale, dite «surtaxe article 19».
Ce dispositif d’aide a dû être révisé et modifié en raison des risques d’incompatibilité avec les règles européennes sur les aides d’État.
En effet, ces exonérations allemandes relatives aux tarifs d’accès au réseau, mais également sur la contribution au soutien des énergies renouvelables, pour les consommateurs électro-intensifs (de l'ordre de 700 entreprises), ont suscité au niveau européen des interrogations au regard de la réglementation sur les aides d’État.
Plusieurs plaintes ont par ailleurs été déposées contre le régulateur allemand au motif que ces dispositions violeraient le principe constitutionnel de l'égalité devant l'impôt et les charges, ce qui a été confirmé le 6 mars 2013 par le tribunal de Düsseldorf.
Un recours a également été formé auprès de la Commission européenne contre ce mécanisme, notamment par des associations de défense des consommateurs allemandes. Une enquête approfondie afin de déterminer si ces exonérations constituent des aides d’État a été lancée par la Commission le 6 mars 2013.
A la suite de la décision du tribunal de Düsseldorf et face aux préoccupations exprimées par la Commission européenne, l’exonération totale a été remplacée, pendant l'été 2013, par une tarification progressive de l’accès au réseau : les entreprises prélevant plus de 7000 heures d’électricité par an paieront 20 % du tarif d’accès, celles prélevant plus de 7500 heures, 15 % et celles prélevant plus de 8000 heures, 10 %.
Ce dispositif est rétroactif pour les années 2012 et 2013 ; il évoluera au 1er janvier 2014 afin de mieux prendre en compte, dans l’exonération partielle accordée à une entreprise, sa faculté à diminuer, par ses usages, les coûts des réseaux.
Sur un plan politique, cette décision peut aussi être vue comme un pas vers une réallocation des coûts de la transition énergétique allemande.
La question des coûts de la transition fait en tout état de cause l’objet d’un débat public, en raison de la répartition inégale des coûts entre les agents économique, et même d’une controverse : les industriels bénéficient d’allégements, afin de préserver leur compétitivité, ce qui renchérit de facto la facture des ménages, notamment les plus modestes.
Dans ce contexte, le Ministre fédéral de l’Environnement, Peter Altmaier, a annoncé une profonde réforme du système de soutien. L’idée d’un projet de loi, visant à limiter conjoncturellement la hausse des prix de l’électricité a cependant été rejetée par la Chancellerie fédérale avant les élections législatives.
C’est l’un des éléments sur lequel il va falloir suivre les conditions de la composition du Gouvernement de coalition.
b. Une régulation de la production très difficile en raison de la montée en puissance de deux sources intermittentes de production d’électricité : l’éolien et le solaire
L’énergie éolienne et l’énergie photovoltaïque sont par définition intermittentes : elles dépendent l’une du vent, l’autre de l’ensoleillement, par nature variables.
L’accès prioritaire des renouvelables au réseau implique par conséquent que la régulation de la production, la couverture de l’écart entre la consommation et la production des renouvelables, soit assurée par des centrales électriques conventionnelles et le soit dans des conditions de délais très brèves.
L’absence actuelle de faculté de stockage entre la production et la consommation exige que l’une soit toujours égale à l’autre. A défaut, le réseau ne peut correctement fonctionner.
Les sources conventionnelles les plus adaptées à ces variations, rapides, de puissance sont les barrages hydrauliques, les turbines à combustibles, les centrales à gaz et, dans une moindre mesure, les centrales au charbon. Les centrales nucléaires participent aussi à cette régulation.
A défaut d’une capacité hydraulique suffisante et d’un recours au nucléaire (11 GW) et la question du stockage de l’électricité n’étant, comme on l’a vu, pas résolue, l’Allemagne recourt aux centrales à gaz ou à fioul (30 GW) et surtout aux centrales à charbon, dans des conditions difficiles.
L’intermittence entraîne en effet une réduction de la durée d’utilisation de ces équipements et compromet leur rentabilité, sachant par ailleurs que le faible coût mondial du charbon entraîne pour sa part, en l’état, en Europe un retrait de centrales à gaz dites « mises sous cocon ».
Ces difficultés ne sont pas d’ordre théorique.
La gestion de la pointe électrique a ainsi été critique durant l’hiver 2011-2012 et les tensions devraient perdurer les prochains hivers. Lors de situations climatiques extrêmes (pas de vent ni de soleil), la puissance électrique garantie pourrait être insuffisante pour assurer les pics de consommation (les experts prévoient une très légère marge de capacité à +0,1 GW pour l’hiver 2013-2014). Ils s’inquiètent notamment de l’insuffisance de nouvelles capacités de production dans le sud du pays et dans la région d’Hambourg (déficit de 6 GW).
Plusieurs projets y ont pris du retard à cause de problèmes techniques (notamment la centrale de Moorburg), d’autres ont été arrêtés prématurément, leur rentabilité n’étant plus assurée. Par ailleurs, plusieurs nouveaux projets de centrales à charbon, pourtant nécessaires à la sécurité du système électrique, font l’objet d’une forte opposition des populations locales pour des raisons environnementales.
Les installations à gaz, qui sont nécessaires pour lisser les fluctuations de la production renouvelable, ne disposent pas de conditions économiques favorables : leur durée d’exploitation annuelle est limitée (à cause de la montée en puissance des énergies renouvelables) et le prix de l’électricité sur le marché est insuffisamment incitatif (à cause de la baisse des prix du charbon et des certificats de CO2). Plusieurs acteurs du secteur énergétique, notamment les nouveaux entrants, demandent la mise en place d’un nouveau mécanisme, qui encourage les investissements dans ces capacités de production flexibles.
Deux décrets (surnommés Wintergesetz par l’administration, c’est-à-dire « lois hivernales ») ont par conséquent été adoptés par le gouvernement fédéral afin de renforcer la sécurité du système électrique et d’atténuer les tensions sur le réseau, en particulier en période de pointe hivernale :
- le premier décret introduit un mécanisme de rémunération de l’interruption industrielle (permettant aux grands consommateurs de délivrer, aux gestionnaires de réseaux, des capacités d’effacement en contrepartie d’un dédommagement financier) ;
- le second oblige les producteurs à maintenir en opération des anciennes centrales fossiles, aujourd’hui non-rentables, mais jugées nécessaires à la stabilité du système électrique, en contrepartie d’un dédommagement financier.
Au-delà, les autorités fédérales et le secteur énergétique allemand estiment que le marché électrique pourrait nécessiter, dès 2017, une refonte globale, afin d’assurer la rentabilité des investissements dans les capacités de pointe.
A ce stade, les positions restent néanmoins prudentes vis-à-vis de l’introduction, demandée par les énergéticiens, d’un « mécanisme de capacité » rémunérant les capacités de production au titre de leur seule disponibilité.
Les autorités redoutent que ce mécanisme bouleverse profondément le libre fonctionnement du marché électrique (déjà mis à mal par l’injection prioritaire des énergies renouvelables) en incitant à la multiplication des capacités.
L’intermittence de l’énergie éolienne et l’énergie photovoltaïque a une autre conséquence majeure, sur les réseaux actuels. Elle les met doublement à l’épreuve.
D’abord, les facteurs de charge, c'est-à-dire la durée annuelle de production à pleine puissance, dépassent à peine 23% pour l’éolien terrestre et 10% pour le photovoltaïque.
Il s’ensuit que pour un niveau de production souhaité, il est essentiel de prévoir des installations d’une capacité supérieure à la puissance des installations requises.
Cette volatilité de la production éolienne et photovoltaïque impose par conséquent à l’Allemagne de renforcer ses réseaux électriques (avant naturellement, à terme, de développer des capacités de stockage, d’investir dans le domaine des réseaux intelligents (afin de mieux contrôler la demande, de sorte qu’elle s’adapte aux variations de production) et de développer les interconnexions (notamment vers la Norvège, afin de bénéficier des capacités de stockage de ce pays).
Ensuite, l’implantation de la majorité des éoliennes terrestres dans le Nord et l’Est de l’Allemagne et la fermeture de centrales nucléaires dans les grandes zones de consommation que sont l’Ouest et le Sud, a engendré un découplage entre les zones de production d’électricité et les zones de consommation.
La production des éoliennes étant prioritaire, le réseau national n’a plus seulement un rôle de sécurité, mais aussi et, au contraire, un rôle essentiel et permanent de transport et de répartition de la production d’électricité.
Le besoin de ligne à haute tension entre le Nord-Est et le Sud-Ouest en a été augmenté.
Le réseau actuel est en effet congestionné, notamment sur l’axe Nord-Sud, ce qui limite le transfert de la production intermittente.
Cette situation abîme les lignes à hautes tensions, qui n’ont pas été créées pour des échanges si fréquents, menace la stabilité du réseau allemand et contraint les opérateurs à intervenir toujours davantage sur les lignes, par des mesures de « redispatching ».
Notamment, les voisins de l’Allemagne (dont les Pays-Bas, la Pologne et la République Tchèque) récupèrent d’importants surplus de production renouvelable allemande, qui fragilisent également leurs propres réseaux nationaux.
Pour surmonter ces difficultés, les gestionnaires allemands de réseaux envisagent donc de construire 2 900 kilomètres de nouvelles lignes à haute tensions prioritaires d’ici 2022. Ces projets risquent néanmoins d’être freinés par des problèmes d’acceptation des populations locales. Par ailleurs, l’Agence fédérale des réseaux a estimé qu’au moins 135 000 km de nouvelles lignes de distribution (moyenne et basse tension) étaient nécessaires d’ici 2030.
Pour accélérer les procédures et la réalisation des travaux, la loi NABEG (Netzausbaubeschleunigunggesetz) d’accélération des extensions de réseau, du paquet législatif de 2011, a eu pour objectif de ramener à 4 ans les délais de réalisation de nouvelles lignes à haute tension, contre 10 ans auparavant (ce même délai est en général de 10 ans dans les autres États membres).
L’Agence fédérale des réseaux a également été chargée d’établir un plan de développement des réseaux à 10 et à 20 ans.
Les efforts d’amélioration de l’efficacité énergétique de l’Allemagne, mesurée par le rapport entre le PIB et la consommation d’énergie, qui s’établissent à +1,6% par an sur la période 1991-2011, sont insuffisants pour atteindre les objectifs de 2020.
Une amélioration de +2,6% par an serait en effet nécessaire.
En particulier, les progrès sont lents dans le domaine des bâtiments anciens et des transports. La baisse de la consommation d’énergie primaire dans ces secteurs diffus est pourtant indispensable à la réussite de la transition énergétique.
Le Gouvernement a donc renforcé de 300 millions d’euros par an le programme de la KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau ou Établissement de crédit pour la reconstruction, qui est l’homologue de la Caisse des dépôts), pour la rénovation énergétique des bâtiments (qui accorde des prêts à taux préférentiels et des subventions directes), portant le montant annuel du soutien à 1,8 milliard d’euros en 2013.
e. Une mise en œuvre parfois problématique : l’exemple des retards du projet d’éolien offshore en Mer du Nord
Le projet d’éoliennes offshore en Mer du Nord est particulièrement complexe, car situé loin des côtes (100 km) et en eaux profondes. Le raccordement des parcs offshore, à la charge des entreprises TenneT et 50 Hertz, a pris beaucoup de retard, à cause de difficultés techniques (en particulier en ce qui concerne l’installation des transformateurs de type courant continue haute tension (CCHT ou HVDC en anglais) en haute mer), réglementaires (les procédures d’autorisation sont lourdes) et financières. Dans ce contexte, le gouvernement fédéral a adopté un nouveau système de dédommagement afin de sécuriser les investisseurs (en reportant une partie de la charge financière sur les consommateurs) mais les objectifs gouvernementaux ne pourront être tenus dans les temps (seuls 245 MW étaient installés fin 2012, pour un objectif de 10 000 MW en 2020). L’industrie allemande, en particulier Siemens, a enregistré d’importantes pertes financières dans le cadre de ces premiers projets. Les effets d’apprentissage devraient néanmoins bénéficier aux projets futurs (plusieurs parcs offshore devraient être connectés cette année).
La production d’électricité en Allemagne repose largement sur le charbon, la houille, et le lignite.
En 2012, 47% en est résulté, contre 12% pour le gaz et 23% pour le renouvelable, dont l’hydroélectricité, comme l’indique le diagramme suivant publié dans l’article précité de M. Michel Cruciani :
![]()

De plus, les statistiques de l’Agence internationale de l’énergie montrent que, dans un contexte d’augmentation de la production, pour les sept premiers mois de l’année 2013, la production d’électricité allemande a reposé sur une augmentation de la production thermique.
Celle-ci a compensé la baisse de la production nucléaire et l’insuffisance de la production d’électricité renouvelable, elle aussi en diminution, en raison non pas d’une diminution des équipements, mais du caractère par définition variable de leur production.
PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ SELON LES SOURCES D’ÉNERGIE EN ALLEMAGNE
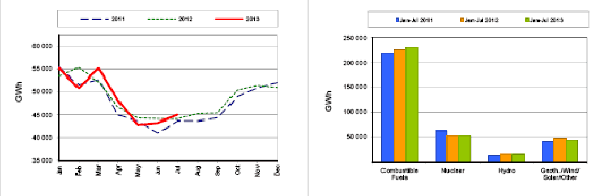
Source : AIEA – Monthly Electricity Statistics July 2013
Cette augmentation de l’électricité d’origine conventionnelle a notamment reposé sur le charbon et le lignite.
Ce retour de l’Allemagne sur le charbon et le lignite a été largement commenté avec notamment la destruction de plusieurs villages, pour permettre au géant de l'énergie RWE d'agrandir l'immense mine à ciel ouvert de Garzweiler près de la Ruhr.
Par conséquent, les émissions de CO2 des installations allemandes assujetties au système européen des émissions ont augmenté de 0,5% en 2012, atteignant 452 MtCO2.
Cette hausse s’explique, d’une part, par la reprise industrielle allemande, qui a entraîné une hausse globale de la consommation d'électricité du pays (618 térawatt heure (TWh) en 2012, en hausse de +0,8% par rapport à 2011), et d’autre part, par la progression de la production électrique des centrales à charbon (267 TWh, en augmentation de +4% par rapport à 2011) aux dépens du gaz (70TWh, en baisse de 16% par rapport à 2012).
En effet, pour des raisons techniques, les centrales à charbon émettent pour une même quantité d’énergie davantage de CO2 que les centrales à gaz.
ii. Un écart par rapport à la trajectoire de long terme de réduction des émissions prévue par l’Allemagne
Au titre du Protocole de Kyoto, l’Allemagne s’était engagé à réduire sur 2008-2012 de 21% ses émissions par rapport à l’année 1990, année de référence.
Cet engagement a été tenu : sur l’ensemble de la période de cinq ans 2008-2012, l’Allemagne disposait d’un crédit d’émission de 4 868 millions de tonnes équivalent CO2, et elle n’en a émis que 4 672.
Au titre du paquet énergie-climat, les engagements de réduction allemands pour les secteurs non couverts par le mécanisme de quota, sont de 15% d’ici 2020 et ils seront vraisemblablement tenus.
C’est néanmoins lorsque l’on examine les objectifs propres à la transition énergétique de l’Allemagne que le problème se pose : au-delà de ses engagements européens et internationaux, l’Allemagne vise, en effet, une réduction de 40% de ses émissions par rapport à 1990.
Cette réduction implique une réduction annuelle des émissions de 2,7%.
Or, celle-ci est supérieure au rythme constaté des émissions depuis 2000 et jusqu’en 2012 (-0,9% par an) et même au rythme de réduction constaté pour les années 1990 (-0,8% par an), lequel a pourtant bénéficié, les premières années, de la rupture avec les pratiques en vigueur dans l’ex-Allemagne de l’Est, particulièrement consommatrices d’énergie et polluantes.
Le tournant énergétique ne permet donc pas à l’Allemagne d’atteindre les objectifs qu’elle s’est elle-même donnée.
g. Appréciation d’ensemble sur l’Energiewende : un pari qui n’atteint pas en l’état les objectifs de la transition énergétique
Les objectifs de la transition énergétique sont aussi clairs que partagés : conduire à une économie moins carbonée, avant d’être décarbonée, dans des conditions de technique, de sécurité énergétique et de coût qui ne soient pas insurmontables.
Force est de constater que l’Energiewende ne les atteint pas : la sécurité énergétique n’est pas assurée, les coûts sont prohibitifs et la maîtrise des émissions de CO2 pour le moins incertaine.
Il ne peut donc s’agir d’un modèle à imiter, en l’état.
En outre, et c’est la raison pour laquelle votre rapporteur a souhaité aborder la question : les modalités allemandes de la transition énergétique mettent à rude épreuve l’Europe de l’énergie et du climat.
La notion de contre-exemple n’est donc pas loin.
C’est en effet un paradoxe que celui d’un développement à marche forcée du renouvelable qui conduit à la perte de crédibilité des objectifs globaux de cette option.
a. Une stratégie allemande jugée non coopérative car impossible à mettre en œuvre par l’ensemble des États membres ou même certains d’entre eux
L’Energiewende et l’Energiekonzept ont été définis par les Gouvernements allemands seuls, sans consultation de leurs partenaires européens. Si tel n’avait pas été le cas, ils n’auraient pas vu le jour sous cette forme.
Il s’agit en effet d’une stratégie non coopérative et donc contraire à l’esprit de la construction européenne. Elle n’est pas reproductible par d’autres États membres : tous les pays européens ne peuvent pas exporter au même moment à leurs voisins leurs excédents d’électricité solaire ou éolienne.
En l’état, l’Allemagne déverse ses excédents sur ses voisins à certaines heures, ce que naturellement eux-mêmes ne pourraient se permettre de faire sur elle sans provoquer de black out complet.
Le caractère profondément national, au sens de local, de la démarche est un élément préoccupant au regard de l’esprit de la construction européenne.
On ne peut qu’avoir à l’esprit la déclaration de l’ancien ministre des affaires étrangères allemand, M. Joschka Fischer, à la veille des élections européennes de 2009, suivant laquelle l’Europe n’est plus pour l’Allemagne une fin, mais davantage un moyen.
b. L’exportation dans les pays voisins des difficultés de régulation et des perturbations de réseaux liées à l’intermittence de l’afflux des renouvelables
Actuellement, les excédents allemands de production éolienne ou photovoltaïque sont déversés sur les pays voisins de manière assez aléatoires et entraînent des perturbations à la fois techniques et de marché.
C’est le constat des gestionnaires de réseau de tous les pays voisins, à savoir la France, mais aussi la Suisse, la République tchèque et la Pologne.
L’ampleur des difficultés a même conduit certains à envisager d’interrompre les liaisons avec l’Allemagne.
Les critiques qui en découlent sont d’autant plus fondées que la panne générale du 4 novembre 2006, partie d’Allemagne, a failli provoquer un black out général en Europe. Il a même affecté la sécurité des liaisons entre la péninsule ibérique et le Maroc.
En outre, sur le plan technique, les échanges d’électricité sont beaucoup plus fréquents, dans les deux sens, puisqu’ils deviennent quotidiens et même infra-quotidiens.
Plusieurs gestionnaires indiquent que ces réseaux n’ont pas été créés pour cela, qu’ils sont mis à l’épreuve, et ils qualifient, en outre, l’électricité d’origine renouvelable d’électricité de « mauvaise qualité ».
Un avertissement a d’ailleurs été lancé lors du congrès annuel de VGB à Maastricht (Pays-Bas), les 25, 26 et 27 septembre derniers. VGB PowerTech e.V. est une association technique européenne pour la production d’électricité et de chaleur. Elle regroupe surtout des compagnies allemandes, mais aussi des industries connexes comme celle de la chimie, fortement consommatrice d’énergie.
Son message d’alerte a d’autant plus de crédibilité qu’il émane d’ingénieurs.
Il a été indiqué que le système européen de l’énergie n’a pas été conçu pour un tel afflux massif de renouvelables. Les centrales électriques conçues pour fonctionner à plein rendement tournent à charge partielle et émettent dès lors davantage de carbone.
Les subventions aux énergies renouvelables augmentent le prix de l’électricité pour l’utilisateur final, ce qui est mauvais pour la compétitivité.
Et comme les renouvelables « inondent » le marché avec de l’énergie peu chère, les centrales à combustibles fossiles censées les contrebalancer peinent à atteindre un seuil de rentabilité, ce qui est néfaste pour la sécurité d’approvisionnement.
C’est l’exportation au niveau européen des problèmes constatés en Allemagne.
c. Des écarts entre les prix de gros et les prix de consommation qui perturbent le modèle économique de la production électrique
Comme l’indique M. Michel Cruciani dans la note précitée de l’IFRI, le modèle économique de la production d’énergie est profondément affecté par l’afflux soudain de renouvelable.
Depuis, le milieu de l’année 2010 et, surtout depuis 2011, avec l’arrivée de la production des équipements photovoltaïques, on constate une baisse du prix du courant sur le marché de gros de l’électricité en Allemagne.
Le graphique suivant le montre.
![]()
![]()
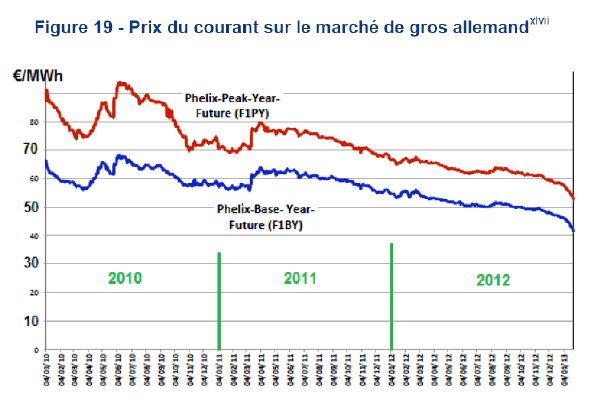
Cet effondrement s’explique par trois mécanismes économiques de base :
– le premier tient au modèle économique de l’énergie solaire et de l’énergie éolienne : seul l’investissement engendre un coût, ensuite, la production d’électricité est gratuite. Dès lors, le producteur n’a aucune limite à la livraison de sa production. Tant qu’il dispose d’un prix garanti, élevé qui plus est, il est même incité à livrer ;
– le second tient à la situation de l’opérateur, gestionnaire du réseau de transport : l’obligation d’achat qui lui incombe et l’impossibilité de stocker le conduit à vendre à un prix inférieur à celui d’achat, ce qui provoque l’effondrement du prix de gros et, en contrepartie, l’augmentation du compte EEG ;
– le troisième élément tient, en effet, à l’impossibilité de répercuter la baisse des prix de gros sur le consommateur, sauf à mettre en péril l’ensemble de la filière de production d’énergie, de même que le fondement de la stratégie de la transition énergétique, qui repose sur l’acquisition graduelle d’une sobriété énergétique et sur la répercussion au consommateur d’un coût aussi complet que possible (ce qui interdit de fait la solution alternative de la prise en charge du surcoût par le contribuable).
d. Une mobilisation de certains financements européens pour des infrastructures d’intérêt davantage allemand qu’européen
Dans le schéma initial, le réseau électrique et les interconnexions entre les réseaux nationaux répondent à une logique de marché.
Ce sont en effet la capacité d’échange aux frontières et ainsi les infrastructures d’interconnexion qui contribuent à la formation du marché : les lignes interétatiques à très haute tension sont alors des corridors de marché.
Avec la déconnexion des lieux de production et de consommation d’énergie liée à l’expansion à marche forcée des renouvelables, notamment le solaire et l’éolien, les infrastructures de transport d’énergie souhaitées par l’Allemagne et pour lesquelles des financements européens sont envisagés sont davantage des corridors verts permettant d’éliminer les excédents de production éoliens du Nord et de l’Est ou photovoltaïques du Sud vers les pays voisins.
Il y a donc divergence d’objectifs sur les infrastructures essentielles.
Certains observateurs font même remarquer que l’on atteint ici la limite de la volonté allemande de supporter le coût de ses propres choix, puisqu’il s’agit ni plus ni moins que de le mutualiser sur fonds européens, entre les différents États membres, en « européanisant » des corridors verts à défaut de pouvoir verdir des corridors de marché.
Par ailleurs, les fonds de la Banque européenne d’investissement (BEI) sont également mis à contribution pour le financement de l’Energiewende : quelque 560 millions d’euros ont été affectés en 2012 au secteur des énergies renouvelables en Allemagne, alors que dans le même temps une enveloppe de 3,3 milliards d’euros a été prévue pour l’ensemble des Vingt Sept.
Certes la BEI doit agir sans exclusive dans tous les États membres, mais au regard de l’asymétrie entre ses moyens et ceux annoncés par la KfW (20 milliards par an en moyenne pour les renouvelables), on ne peut que s’interroger sur la pertinence de ses financements en faveur d’un secteur et d’un pays qui n’a de toute évidence pas besoin d’elle pour poursuivre ses objectifs.
Le système d’échange de quotas d’émissions de CO2 est la pierre angulaire de la politique climatique européenne. Or, ce marché du CO2 ne fonctionne pas selon le schéma prévu initialement lorsqu’a été mis en place en 2005. Il connaît même une crise sans précédent qui menace son existence et sa crédibilité. Le cours du quota carbone s’est effondré.
En novembre 2012, la Commission européenne a ainsi estimé, à la lumière des projections des principaux analystes du marché faites en juin et septembre précédents, que les cours du quota seraient en moyenne de 5 € par tonne de CO2 (€/t) de 2013 à 2015.
Le 16 avril 2013, le prix du quota a atteint son plus bas niveau historique depuis 2008 (début de la phase II) avec une cotation intraday à 2,63 €/t. Depuis le début des enchères de quotas de phase III, fin octobre 2012, le prix d'adjudication est passé de 8 €/t à 4 €/t, soit une baisse de près de 50 %.
Avec le prix du CO2 atteint, les incitations à investir dans les technologies propres sont faibles, ce qui met en péril la trajectoire de décarbonation de l’économie européenne à horizon 2050. Les investissements non réalisés aujourd’hui conduiront à des coûts supplémentaires dans les décennies à venir.
On estime en effet en général que le prix de la tonne doit être de l’ordre de 20 à 25 euros pour permettre les investissements de long terme qu’exige cette décarbonation. La Norvège a d’ailleurs mis en place un mécanisme de prix fixe de 25 euros la tonne.
Les raisons de l’effondrement des cours des actifs carbones sont plurielles.
Tout d’abord, la dégradation du contexte économique, entamée courant 2008, a contribué à une chute des prix du quota. Ainsi le marché carbone européen fait-il aujourd’hui face à un fort déséquilibre entre l’offre et la demande : celui-ci est estimé entre 1,5 milliard et 2 milliards de quotas en début de phase III soit l’équivalent d’un an d’émissions, et autour de 1,4 milliard en fin de phase III pour 2020. Le manque de perspective quant aux objectifs de réduction d’émissions a également participé à une perte de confiance des acteurs du marché quant à la volonté politique de pérenniser l’outil après 2020. En l'absence d'action des pouvoirs publics sur le marché, le prix d’équilibre du quota se maintiendrait vraisemblablement à son niveau actuel de 4 €/t (Thomson Reuters).
La question de la coordination des outils de politique énergie-climat a également un effet sur les anticipations des acteurs. Bien que se complétant, les politiques d’efficacité énergétique et de déploiement technologique d’énergies sobres en carbone ont un impact sur les réductions d’émissions des secteurs qui sont couverts par le système d’échange de quotas et donc sur le prix du carbone. La cohérence initiale des mesures composant le paquet énergie – climat peut ne plus être assurée au fil du temps.
Ainsi, les politiques de développement des énergies renouvelables accentuent mécaniquement les réductions d’émissions du secteur électrique, ce qui diminue la demande pour les quotas de CO2 et fait baisser leur prix. Le signal envoyé au secteur électrique via le marché carbone pour baisser ses émissions devient alors moins fort.
C’est notamment ce qui se produit en Allemagne.
Une réforme du marché des quotas est donc nécessaire.
Lors des débats sur le projet de directive efficacité énergétique, au premier semestre 2012, le Parlement européen a proposé un amendement permettant un « retrait » de quotas (set aside). Cette solution a ensuite été abandonnée, la Commissaire au Climat, Mme Connie Hedegaard, ayant annoncé le 19 avril 2012 qu’elle proposerait une revue du règlement sur les enchères de quotas comme première étape avant des réformes plus structurelles.
Depuis le mois de juillet 2012, la Commission européenne a publié une série de documents visant à modifier le calendrier des enchères de quotas (backloading) : un projet d’amendement au règlement enchères visant à reporter en 2019 et 2020 la mise aux enchères de 900 Mt prélevés en début de phase ainsi qu’une étude d’impacts associée au projet et une proposition de modification de la directive quotas visant à clarifier les bases légales de la modification du calendrier des enchères.
Depuis le vote positif du Parlement européen en juillet, la question a été bloquée en raison de l’opposition de M. Philipp Rössler, ministre allemand des affaires économiques.
Selon les derniers éléments publiés par l’agence de presse Europolitique le 21 octobre dernier, ce blocage devrait cesser, car l’Allemagne devrait vraisemblablement se prononcer en faveur de la réforme du système européen d’échange de quotas d’émissions. Cela permettrait de sortir de l’impasse au Conseil.
Sur le fond, le SPD est favorable au report, mais certains secteurs de l’industrie allemande y sont opposés et considèrent qu’il s’agit là d’une question de principe.
ii. Une défense par l’Allemagne de certaines émissions de CO2 directement liées à ses intérêts industriels : l’échec récent de la proposition de directive sur les automobiles
La directive dite IED 2010/75/UE du 24 novembre 2010 sur les émissions industrielles a montré comme on l’a vu la capacité de pragmatisme des pays qui disposent d’importantes centrales à charbon, notamment l’Allemagne, de même que le Royaume-Uni et la Pologne. Des dérogations ont, en effet, été prévues pour éviter la mise aux normes ou la fermeture des centrales les plus polluantes à l’horizon 2016 comme le proposait la Commission européenne. Or, pour des raisons techniques, ces mêmes centrales ne sont pas seulement les plus polluantes : ce sont également celles qui engendrent les plus fortes émissions de CO2.
Cette même défense de ses intérêts industriels par l’Allemagne contre l’objectif global de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre a été très récemment perceptible dans le cadre de la négociation sur la proposition de directive sur la limitation des émissions de CO2 par les véhicules automobiles.
Alors même qu’un accord de principe était intervenu entre le Conseil et le Parlement européen, sous présidence irlandaise, en juin dernier, pour appliquer la norme de 95 grammes au kilomètre prévue pour 2020 (contre 135 en 2015), l’Allemagne a organisé une remise en cause de cet accord et l’a obtenue, aidée par certains pays susceptibles de créer une minorité de blocage.
Cédant aux pressions de l’Allemagne, le Conseil Environnement, réuni le 17 octobre à Luxembourg, a accepté de reporter leur décision entérinant l’accord conclu en juin, ce qui rouvre le dossier.
La presse a fait état des difficultés BMW et Daimler (Mercedes Benz) face à cette nouvelle norme.
Ce scénario organisé par l’Allemagne est d’autant plus regrettable que, compte tenu de son importance, le secteur des transports est essentiel pour la réussite de la décarbonation.
Pleine d’allant pour les énergies renouvelables, mais particulièrement attentive à ses propres atouts pour ce qui concerne les secteurs productifs, même s’ils sont émetteurs de CO2, la stratégie allemande d’ensemble nourrit chez certains observateurs l’idée d’un agenda caché, totalement non coopératif, dont certains commentateurs se font l’écho et que votre rapporteur ne saurait par conséquent s’abstenir de mentionner sans occulter un pan essentiel du débat.
Pour résumer, l’Allemagne favoriserait la production d’électricité renouvelable car c’est un secteur créateur d’emploi et où elle dispose d’entreprises performantes de taille mondiale, telles que Siemens pour les turbines d’éoliennes, et où elle est en Europe en situation favorable.
L’encadré suivant propose un récapitulatif de ces secteurs.
Cartographie des secteurs de production d’installations renouvelables en Allemagne
Eolien terrestre : le pays dispose d’une industrie très mature, qui s’appuie sur une douzaine de grands fabricants, dont plusieurs leaders internationaux (notamment Enercon et Siemens, respectivement 5ème et 8ème producteurs éolien au niveau mondial) et environ 80 fournisseurs de composants et de systèmes. Cette industrie a réalisé un chiffre d’affaire de près de 5,96 Mds en 2011, dont 66% à l’export, et détient près de 16% des parts du marché mondial. L’industrie éolienne allemande est confrontée aujourd’hui à une demande interne stationnaire (+2GW par an), qui devrait progressivement se tasser (avec la saturation du potentiel éolien). La demande européenne et internationale sera donc déterminante pour assurer un relais de croissance suffisant. Dans ce contexte, la surcapacité de production chinoise et la baisse de la demande américaine sont des facteurs préoccupants pour l’avenir de l’industrie allemande.
Eolien en mer : le chiffre d’affaires de l’industrie éolienne offshore allemande atteint 750 M€, en hausse de 27% par rapport à 2010. Cette croissance est essentiellement tirée par les exportations vers l’UE (notamment au Royaume-Uni), les projets allemands ayant pris beaucoup de retard à cause de problèmes techniques et de financement.
Photovoltaïque : l’Allemagne compte aujourd’hui environ 200 entreprises productrices de panneaux, modules et composants photovoltaïques, dont plusieurs sociétés de dimension internationale (Solar World, Aleo Solar, Centro Solar, Conergy, respectivement 14ème, 19ème, 21ème et 22ème producteurs mondiaux, derrière plusieurs producteurs chinois et américains). L’industrie photovoltaïque allemande traverse néanmoins une crise profonde, dans un contexte mondial particulièrement mouvementé. Ses parts de marché ne représentent plus que 18% du marché mondial (contre 63% en 2006). Son chiffre d’affaires, qui atteint 10,7 Mds € en 2011, est en baisse de 12% par rapport à 2010.
La concurrence asiatique (qui fait chuter les prix, dans un contexte de surcapacité de production au niveau mondial) et la baisse des aides gouvernementales européennes (qui limite les débouchés) ont renforcé la pression sur les principaux producteurs photovoltaïques allemands, qui ont vu leurs marges fondre et leur capitalisation boursière s’effondrer. Q-Cells a déposé le bilan début 2012, avant d’être repris par le coréen Hanwha Chemical Corporation. Plusieurs autres groupes ont fait faillite, notamment Solon (première entreprise photovoltaïque allemande à être entrée en bourse en 1998) et Solar Millenium, ou abandonné leurs activités dans ce secteur (Bosch, Siemens). Dans ce contexte, les entreprises allemandes ont engagé une stratégie de réduction des coûts (à l’image du groupe Schott Solar, qui a fermé son site de production de Jena, 290 emplois concernés), ou de délocalisation.
Si la demande allemande reste aujourd’hui très dynamique, elle devrait baisser avec la réduction des tarifs. Ce contexte devrait accélérer le mouvement de consolidation du secteur photovoltaïque mondial, certains experts tablant sur la disparition de 60% des entreprises existantes.
Solaire thermique : l’industrie allemande du solaire thermique a réalisé un chiffre d’affaire d’environ 1 Md € en 2011 (dont 200 M€ dans le secteur des centrales thermodynamiques CSP). Les principales entreprises du secteur sont Bosch, Viessmann Group, Schott Solar.
Biomasse : l’Allemagne compte environ 80 entreprises qui fabriquent des installations de biogaz ou des composants industriels, pour un chiffre d’affaires de 2,14 Mds € en 2011 (en hausse de +42% par rapport à 2010), dont 20% à l’export. Le tissu industriel est dominé par des PME et quelques grands groupes (MT Energie avec un chiffre d’affaires de 200 M€, EnviTec Biogas AG, chiffre d’affaires de 120 M€, Schmack Biogas/Viessmann Group).
Géothermie : En 2011, le chiffre d’affaires de l’industrie géothermique allemande s’élève à 770 M€, en hausse de 7% par rapport à 2010. Ce secteur de niche est dominé par deux grands groupes, Bosch Thermotechnik et Viessmann Werke, et plusieurs petits acteurs.
Hydraulique : Le marché allemand de la petite hydraulique est dominé par trois PME, Voith Hydro, Wasserkraftvolk AG et Ossberger GmbH.
Source : Ambassade de France en Allemagne
Selon une étude du ministère allemand de l’environnement, le nombre actuel des emplois dans le secteur des renouvelables aurait été de quelque 360 000 en 2011, dont les trois quarts dans la production d’électricité.
C’est un secteur en croissance puisque l’on attend 100 000 emplois de plus en 2020.
En outre, la filière, particulièrement bien représentée dans les Länder de l’Est, joue un rôle essentiel d’aménagement du territoire.
Par ailleurs, et c’est le second volet, la stratégie du développement des renouvelables contribue comme on l’a vu à un faible prix du quota de CO2, ce qui permet à l’industrie manufacturière allemande soumise aux quotas de maintenir sa compétitivité.
Ainsi, cette approche allemande duale serait avant tout une défense de ses intérêts industriels et, par voie de conséquence, de l’un des éléments clefs de sa prépondérance économique en Europe.
Une telle stratégie n’exclut cependant pas un certain pragmatisme dans certains domaines précis, comme l’illustre l’absence de soutien à la filière solaire en 2011-2012, qui a conduit à la disparition ou à la cession de près de 40 entreprises allemandes.
Il est vrai que c’est le secteur où la concurrence chinoise était la plus importante, et celui pour lequel les coûts de l’Energiewende ont été les plus élevés de 2008 à 2012, à raison de 100 milliards d’euros sur cinq ans, contre un peu plus de 20 pour l’éolien, selon les chiffres cités par M. Michel Cruciani. Le coût de la tonne de CO2 évitée a atteint des sommets, à raison de 716 euros.
5. Une coopération franco-allemande réduite et essentiellement technique sur les énergies renouvelables
Les coopérations franco-allemandes au niveau industriel se multiplient en matière d’équipements de production d’énergie renouvelable, notamment dans les domaines solaire et éolien, mais elles restent très limitées et ne correspondent ni par leur teneur ni par leur ampleur à ce que l’on est en droit de s’attendre face aux enjeux de la transition énergétique.
Les éléments communiqués à votre rapporteur par le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en sont une illustration.
Dans le domaine solaire, la coopération vise l’élaboration de cellules solaires à 4 jonctions. L’Institut Fraunhofer pour les systèmes énergétiques solaires (Fraunhofer ISE) développe, en coopération avec la société française Soitec, une nouvelle technologie de production de cellules photovoltaïques à jonctions multiples et à haut rendement.
Dans le domaine éolien, l’éolienne offshore Haliade 150 d’Alstom fabriquée à Saint-Nazaire et installée en mer allemande. Des négociations sont actuellement en cours avec plusieurs opérateurs et développeurs pour différents projets allemands offshore.
S’agissant du raccordement de parcs éoliens offshore allemands, l’opérateur de réseaux TenneT a attribué fin février à Alstom le raccordement de 900 MW de projets éoliens offshore allemands au continent, comprenant la construction et la fourniture des stations de conversion onshore et offshore, et les systèmes de câbles de raccordement.
Sur la fabrication de mâts d’éoliennes, Siemens France et Francéole ont signé en juin 2013 un accord permettant à Francéole de fabriquer les mâts d’éoliennes terrestres Siemens pour de futurs projets de parcs. Le groupe allemand a déjà livré en France une quinzaine de parcs éoliens terrestres pour une puissance de plus de 300 MW.
Areva dispose par ailleurs aujourd’hui d’un site d’assemblage de nacelles et d’un site de fabrication de pales d’éoliennes dans le nord de l’Allemagne.
Enfin, plus du quart des éoliennes installées en France sont des éoliennes Enercon, présent en France depuis huit ans, et le plaçant ainsi à la première place des fabricants d’éoliennes sur le marché français. Enercon a installé plus de 1 000 éoliennes pour une puissance installée supérieure à 1 900 MW en France. La société emploie aujourd’hui plus de 500 personnes en France et dispose de 25 centres de maintenance sur le territoire français. En octobre 2012, Enercon a inauguré une nouvelle usine de production de mâts béton dans le département de l’Oise.
GDF Suez exploite 14 parcs éoliens terrestres et une centrale biomasse en Allemagne. L’entreprise dispose par ailleurs de centrales hydrauliques et de centrales de pompage-turbinage permettant une augmentation de la flexibilité dans le réseau électrique.
Dans le domaine de la biomasse, Siemens a été retenu par la société française Inova pour fournir le groupe turboalternateur qui équipera la nouvelle centrale de Brignoles dans le Var. D’une puissance de 21,5 MW, le groupe turboalternateur produira de l’électricité à partir de la vapeur issue de l’incinération de la biomasse. La mise en service de la centrale est prévue pour fin 2014.
Quant à l’Office Franco-Allemand pour les Energies renouvelables, il fait suite au Bureau de coordination énergies renouvelables (BCER), initiative de la fin de l’année 2006, en vue de la promotion des énergies éolienne et solaire en France et en Allemagne, sous l’égide du ministère délégué à l’Industrie et du Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.
Initialement cantonné à la promotion de l’éolien, il a élargi ses activités en 2011 à l’énergie solaire photovoltaïque et a désormais vocation à embrasser, à terme, l’ensemble du champ des énergies renouvelables.
Les objectifs du Bureau de coordination sont la promotion des transferts de connaissances, la mise en réseau des acteurs et le dépassement des barrières linguistiques.
Il a été décidé le 7 février 2013 de transformer le BCER en un Office franco-allemand pour les énergies renouvelables, pour renforcer la coopération entre les gouvernements, les acteurs publics, et les entreprises des deux pays. Les domaines d’intervention sont notablement élargis. L’Office traitera désormais de l’ensemble des thèmes liés aux énergies renouvelables : éolien, photovoltaïque, biomasse, énergies marines, autres énergies renouvelables, mais aussi de leur intégration sur le réseau électrique, du stockage de l’énergie, et de leur impact sur le marché de l’électricité.
Les ressources de l’Office se composent à environ 45% de subventions publiques et à 55% de ressources propres (cotisations des adhérents, frais de participation aux conférences). L’Office compte aujourd’hui environ 60 entreprises adhérentes, parmi lesquelles des développeurs de projet, des industriels ou des cabinets d’avocats.
Il agit comme un facilitateur. Il permet la mise en réseau d’acteurs allemands et français et l’échange de bonnes pratiques. Il organise chaque année des conférences, généralement introduites par les responsables des administrations chargées de l’énergie en France et en Allemagne.
En contrepoint de la divergence franco-allemande se dessine une convergence franco-britannique sur le mix ou bouquet énergétique.
Dans une tribune publiée dans Les Echos le mardi 22 octobre dernier, et intitulée Pourquoi le Royaume-Uni croit au nucléaire, le ministre de l’énergie et du changement climatique du Royaume-Uni, M. Edward Dawey, expose les raisons du retour de son pays vers le nucléaire ou, pour être plus exact, d’un maintien du recours au nucléaire avec la construction d’un nouveau parc électro-nucléaire en remplacement des centrales qui fermeront.
Ce sont les suivantes :
– une électricité stable, sobre en carbone et respectueuse du climat, alimentant 6 millions de foyers et fournissant 7% de la production électrique du Royaume-Uni ;
– un prix de facturation au consommateur inférieur de 11% par rapport à un scénario non nucléaire ;
– un renforcement de la sécurité énergétique du Royaume-Uni.
Cet investissement dans le nucléaire prend la forme de l’accord entre EDF et le Gouvernement britannique pour la construction de deux centrales nucléaires de type EPR, selon la technologie d’Areva, sur le site de Hinkley Point C, dans le Somerset.
L’un des principaux points de la négociation a été le prix d’achat de l’électricité nucléaire ainsi produite, qui a été établi au niveau fixe de 89,5 livres sterling le mégawatt/heure, soit 109 euros environ, pour une période de 35 ans, sans préjudice naturellement des règles sur les aides d’Etat, le cas échéant. Cette durée correspond à 60% de la durée totale d’exploitation de la centrale.
Ce prix est deux fois plus élevé que les actuels prix du marché, mais il correspond à la mise en application du principe de contracts for difference, fondé sur un prix déterminé pour les productions d’électricité sobres en carbone. Il est déclaré par le ministre compétitif, d’après les projections actuelles, avec celui des énergies renouvelables déployées à grande échelle et celui des centrales à gaz.
Le prix global du projet est de l’ordre de 14 milliards de livres, soit 16 milliards d’euros.
Un consortium est créé avec participation d’Areva, qui fournit les chaudières et le contrôle commande, et aussi des deux groupes nucléaires chinois CGN et CNNC.
Cet accord renforce la position d’EDF qui est déjà le premier producteur d’électricité au Royaume-Uni, après l’acquisition de British Energy en 2009, laquelle est devenu EDF Energy depuis, et qui exploite quinze centrales nucléaires sur place.
Cette convergence n’est cependant pas ponctuelle, mais au contraire profonde et apporte à l’Europe en matière d’énergie une visibilité certaine.
Le plan carbone du Royaume-Uni, destiné à baisser de 80% les émissions de CO2 à l’horizon 2050 par rapport à 1990, repose notamment sur le nucléaire.
Ce choix n’est pas contesté et fait l’objet d’un consensus politique.
Ce recours au nucléaire représente un élément de convergence franco-britannique, mais les mix énergétiques sont, en l’état, assez différents entre les deux pays, comme on l’a déjà vu.
Les choix nucléaires dans le monde après Fukushima
Des décisions de désengagement du nucléaire ont été prises ou réaffirmées suite à l’accident sur la centrale nucléaire de Fukushima Dai-Ichi en 2011 par trois pays disposant de capacités nucléaires :
- l’Allemagne : le Gouvernement allemand a accéléré sa décision de sortir du nucléaire (actée dans la loi de 2002 organisant l’arrêt progressif des centrales nucléaires) à la suite de l’accident de Fukushima en décidant l'arrêt immédiat des 7 centrales les plus anciennes du pays et l’arrêt accéléré des 8 autres centrales du pays d’ici 2022 ;
- la Belgique : le Gouvernement fédéral belge a confirmé en juillet 2013 la décision de sortie du nucléaire, actée par la loi de janvier 2003, qui prévoit l'arrêt puis le démantèlement des 7 centrales nucléaires belges et l'interdiction de construction de nouvelle centrale. Le projet de loi actant la sortie définitive du nucléaire et définissant le calendrier de sortie doit être soumis au Parlement belge en septembre et octobre 2013 ;
- la Suisse : le Conseil fédéral suisse a pris en 2011 une décision de principe de sortie du nucléaire qui s’est traduite sous la forme d’un avant-projet de loi prévoyant l’interdiction de l’octroi d’autorisations pour la construction de nouvelles centrales.
Par ailleurs, en 2011, les 54 réacteurs nucléaires japonais ont été mis à l’arrêt. Toutefois, le Japon envisage un redémarrage progressif de son parc de production. Alors que deux d’entre eux ont d’ores et déjà redémarré, la remise en service du parc sera examinée au cas par cas par l’autorité de sûreté japonaise, en fonction des critères de sûreté qu’elle a définis.
L’énergie nucléaire est considérée par de nombreux pays, et notamment les cinq pays faisant partie des « BRICS » (Brésil, Russie, Inde, Chine, et Afrique du Sud), comme une source d’énergie à même de répondre à la forte croissance de leurs besoins énergétiques dans les prochaines années, à un coût maîtrisé et en limitant leurs émissions de gaz à effet de serre. Les mises en chantier de nouveaux réacteurs ont ainsi connu une forte augmentation ces dernières années. Au total, sept centrales nucléaires ont été mises en chantier en 2012 : 4 en Chine, une en Corée du Sud, une en Fédération de Russie et une aux Émirats arabes unis. A l’heure actuelle, environ 70 nouveaux réacteurs sont en construction dans 14 pays, parmi lesquels figurent essentiellement :
- la Chine, qui à elle seule comptabilise une trentaine de réacteurs en chantier (dont les réacteurs EPR à Taishan), pour des mises en service échelonnées entre 2013 et 2016 ;
- la Russie, qui compte 10 réacteurs en construction ;
- L’Inde, qui compte 7 réacteurs en construction ;
- La Corée du Sud, avec 5 réacteurs en construction.
La perspective d’un volume important de mises en chantier devrait se maintenir à l’avenir, alors que l’AIEA (Agence Internationale pour l’Energie Atomique) anticipe une hausse de la capacité électronucléaire d’ici à 2030 comprise entre 23 % dans sa projection basse et de 100% dans sa projection haute. Les nouveaux réacteurs de puissance prévus ou en construction seront essentiellement concentrés en Asie (et notamment en Chine).
De nombreux pays « primo-accédants » travaillent également à l’élaboration de projets de production électronucléaire. Parmi les plus avancés figurent notamment la Pologne, la Turquie, le Vietnam et l’Arabie Saoudite.
Source : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Comme l’a rappelé à votre rapporteur le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, M. Philippe Martin, la France est favorable à une coopération étroite entre les Etats membres dans le cadre d’une communauté européenne de l’énergie.
L’objectif serait d’y coordonner la transition énergétique et d’organiser un dialogue sur le mix énergétique, ainsi que d’y traiter notamment les questions relatives à l’efficacité énergétique, les infrastructures et la tarification, ainsi que les objectifs de réduction des gaz à effet de serre.
La France défend de ce point de vue le partage de ses objectifs de 40% d’émissions en moins à l’horizon 2030 et 60% à l’horizon 2040, de manière à atteindre la décarbonation en 2050, selon les objectifs annoncés lors de la conférence environnementale de 2012.
Le Conseil européen de juin dernier a retenu plusieurs éléments sur l’énergie dont le suivi sera présenté d’ici la fin de l’année.
Il faut observer que ses conclusions ont inscrit la question essentielle de la structure des prix et des coûts de l'énergie dans les États membres, ainsi que des facteurs qui les déterminent, et leurs conséquences pour les ménages, les PME et les industries grandes consommatrices d'énergie, à l’ordre du jour du Conseil européen de février prochain au titre de la compétitivité.
b. Un pacte franco-allemand de respect mutuel sur le nucléaire conforme aux dispositions du traité sur le mix énergétique
La différence entre l’Allemagne et la France sur la question ô combien sensible du nucléaire exige une clarification et, dans le respect du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, un pacte de respect mutuel entre les deux partenaires, ou, comme l’a indiqué Mme Cécile Maisonneuve dans un article du quotidien Les Echos le 24 juillet dernier, un « pacte de neutralité sur le nucléaire ». « La France doit accepter la politique a-nucléaire de l'Allemagne. Celle-ci doit renoncer à exporter en Europe sa politique énergétique qui n'est possible que parce que ses voisins ne la suivent pas », estime-t-elle fort justement.
S’agissant des autres pays, l’Allemagne doit également respecter leur choix et éviter de faire pression comme elle est régulièrement mentionnée l’avoir fait sur la Pologne et la Turquie.
C’est la seule position réaliste. Il est en effet clair que l’Allemagne ne reviendra pas sur sa décision, et que la France ne s’écartera pas de l’actuel point d’équilibre tel qu’il a été arbitré par le Président de la République.
c. Une reconnexion de la production d’électricité renouvelable et du marché, compte tenu de la maturité du secteur
L’expérience de la transition énergétique allemande montre les perturbations produites par un mécanisme d’encouragement et de subvention pérenne qui a été surcalibré.
Ce mécanisme permettait certainement de développer un secteur naissant qui en avait besoin, mais, d’une certaine manière, la « machine s’est emballée » victime de son succès et surtout faute pour les autorités d’avoir correctement anticipé les effets déstabilisateurs d’une arrivée massive, à certaines périodes uniquement, d’une électricité au coût marginal de production nul.
Comme l’ont exprimé le mois dernier devant le Commissaire européen à l’énergie, M. Günther Oettinger, et de nombreux députés européens, des énergéticiens européens, il convient de « reconnecter la politique énergétique de l’Union Européenne aux challenges énergétiques de l’Europe ».
Cette reconnexion passe clairement par une approche pragmatique et non idéologique des capacités de production électrique : celles-ci doivent assurer dans des conditions de prix acceptables et de manière compatible avec les objectifs climatiques la sécurité, c'est-à-dire la stabilité et la continuité de l’approvisionnement énergétique. Il n’y a donc plus lieu de continuer à considérer comme fonctionnant hors marché des techniques dont l’ampleur du développement et le niveau des coûts des nouvelles installations montrent qu’elles sont arrivées à maturité.
Seule une telle reconnexion est de nature à garantir que la production d’électricité renouvelable trouve toute sa place dans la transition énergétique, sans entraîner de défi technologique d’une teneur et d’un coût aussi incertains qu’a priori insurmontables.
d. La sécurisation des paramètres pour favoriser la réalisation des investissements économes en carbone
L’un des autres enjeux de l’agenda européen en matière d’énergie et de climat est le sauvetage du marché du quota carbone.
Les mesures précitées de première urgence, de report de quotas, proposées par la Commission européenne, pour le rétablir sont nécessaires, pour restaurer un certain équilibre entre l’offre et la demande.
Au-delà, la Commission européenne a publié, dans une perspective structurelle, le 14 novembre 2012, un rapport sur le fonctionnement du marché carbone ouvrant la voie à une série de mesures de long terme. Ce rapport propose plusieurs pistes pour des réformes dont une partie revient à renforcer le plafond d’émissions à horizon 2020.
Une telle stratégie globale est indispensable non seulement pour des questions techniques, mais également face aux enjeux politiques et économiques, avec la mise en place d’objectifs 2030 et 2040, de manière que l’ensemble des secteurs émetteurs de CO2,puissent disposer de la visibilité pour réaliser les investissements nécessaires qui sont des investissements lourds et donc de long terme.
Les mesures structurelles de rééquilibrage du marché des quotas de CO2 proposées par la Commission européenne sont notamment : l’inclusion de nouveaux secteurs dans le système d’échange de quotas tels que le transport ou les bâtiments ; la modification des règles d’accès aux crédits internationaux ; la mise en place d’un mécanisme discrétionnaire de gestion des prix.
Une consultation publique a par ailleurs été lancée par la Commission européenne sur la base du livre vert sur le cadre de la politique énergie – climat à horizon 2030 le 27 mars 2013.
Les réformes structurelles du marché carbone, notamment en matière de gouvernance et de coordination des politiques énergie-climat, pourraient s’inscrire dans ce cadre. Le Conseil Européen du 22 mai dernier a accueilli positivement le livre vert, et fait part de son intention de réexaminer le sujet en mars 2014, après la formulation de propositions plus concrètes de la Commission européenne attendues pour la fin de l’année.
Ces orientations sont nécessaires, mais elles devraient intervenir dans le cadre d’une réflexion stratégique globale : ce n’est pas le seul marché qui permettra d’assurer dans des conditions optimales la transition énergétique ; ce n’est pas non plus la seule réglementation, mais une combinaison des deux avec également la mise en place d’une certaine harmonisation des taxes sur les produits énergétiques.
Cette combinaison ne peut non plus de toute évidence être posée une fois pour toute par différents textes, mais exige une surveillance constante de manière à pouvoir l’ajuster autant que nécessaire.
Est ainsi posée la question de la gouvernance commune.
Lorsque l’on résume la manière dont s’est élaborée, selon trois orientations successives (le marché, le climat, la compétitivité), dépendant de trois directions générales fonctionnant selon des logiques verticales, en silo, et dépendant elles-mêmes de trois commissaires européens différents, la politique européenne pour un domaine aussi important que l’énergie et le climat, on mesure clairement les carences de l’Union européenne en matière de gouvernance.
C’est clairement un tabou, mais votre rapporteur estime qu’il est indispensable de poser la question.
La définition d’une politique aussi autonome et peu coopérative que l’Energiewende et l’Energiekonzept n’a été possible qu’en l’absence d’orientations européennes : l’Allemagne a agi aussi librement que permis par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en menant sa propre politique énergétique, tout en se conformant aux quelques orientations définies par l’Union européenne et en influant comme on l’a vu, lorsque c’était le sens de ses intérêts sectoriels et industriels, sur la teneur des directives adoptées.
Il y a clairement une carence de gouvernance à combler.
Il faut en matière d’énergie et de climat une impulsion politique qui ne peut être menée qu’au niveau de la Commission européenne, de son président, en coordination avec le Conseil européen, pour faire sortir les questions énergétiques du champ technique ou purement économique où elles se trouvent actuellement confinées.
Un tel rehaussement de l’énergie et du climat dans l’Agenda politique de l’Union européenne aurait, en outre, un deuxième mérite, celui de permettre le développement d’une politique de sécurité et d’approvisionnement commune vis-à-vis des pays tiers.
Cette question est un autre tabou de la non gouvernance européenne, mais il faut là-encore la poser.
Faute d’avoir défini une politique commune vis-à-vis des fournisseurs extérieurs, les pays membres de l’Union européenne n’obtiennent pas les meilleures conditions qui soient et, en outre, bénéficient chacun de conditions différentes.
C’est clairement ce qui s’est passé vis-à-vis de la Russie et notamment de Gazprom. Les relations directes entre la Russie et l’Allemagne, avec la construction du gazoduc d’approvisionnement direct Nord Stream par la Baltique, permettent à l’Allemagne de bénéficier de conditions tarifaires plus avantageuses que ses voisins, et notamment la Pologne, en gaz russe.
Lorsque l’on se rappelle le rôle essentiel qu’a joué et que joue encore Gazprom comme instrument de politique étrangère russe, on mesure l’insuffisance de la coordination européenne ainsi révélée.
De même, une approche commune aurait certainement permis un autre scénario dans l’industrie nucléaire, lorsqu’en 2009, Siemens a décidé de cesser de coopérer avec Areva, sauf sur des projets précis en cours, et a annoncé se rapprocher de l’opérateur russe Rosatom pour ensuite réduire considérablement le champ de cette coopération dès 2011 avec le renoncement à ses projets nucléaires (consécutif à la décision du Gouvernement fédéral d’abandonner la filière) et l’abandon du projet initial de co-entreprise.
L’efficacité énergétique est l’un des éléments sur lequel une coopération européenne est essentielle.
D’une part, les gains en la matière ont été définis en commun par la directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012, sur l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.
Ce texte prévoit les mesures d’économie d’énergie qu’appliqueront tous les États membres. La mesure la plus importante consiste en un objectif contraignant de réduction de 1,5 % par an de l’ensemble des ventes d’énergies, hors transports. Des flexibilités seront possibles pour les États membres, mais leur utilisation est limitée à 25 % de l’ambition initiale.
La directive introduit également un objectif de 3 % de rénovation annuelle des bâtiments publics. En France seuls sont concernés les bâtiments des administrations centrales, pas ceux des collectivités locales. De plus, les Etats devront développer une stratégie de réduction des consommations de l’ensemble du parc bâti existant à long terme, au-delà de 2020.
Une série de mesures comprend aussi la systématisation des audits énergétiques dans les grandes entreprises, la transparence des factures et le soutien à la cogénération.
Il y a clairement dans ce domaine matière à agir, même si l’AIE tempère certes l’évaluation des performances des Etats membres en matière d’efficacité énergétique, que vient de publier l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), laquelle mettait en évidence, le 9 octobre, les faibles résultats des Vingt Huit dans ce domaine.
Dans un rapport rendu public le 16 octobre, l’AIE chiffre en effet à 300 milliards de dollars (221 milliards d’euros) les investissements en efficacité énergétique pour l’année 2011 dans le monde, ce qui équivaut, en ampleur, à la production d’électricité à base de renouvelables ou de combustibles fossiles.
Elle estime que ces investissements se sont traduits par de fortes réductions de la consommation et de la demande d’énergie. Dans onze pays membres de l’AIE (dont huit Etats membres de l’Union européenne) tels que le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et l’Italie, la consommation énergétique économisée a représenté 570 millions de tonnes équivalent pétrole sur 5 ans jusqu’en 2010.
Le rapport cite deux Etats en exemple : l’Allemagne et la France. Il met ainsi en évidence les dépenses publiques françaises sur l’efficacité énergétique dans le secteur résidentiel, qui étaient de 473 millions de dollars (environ 350 millions d’euros) en 2011, et le total des dépenses associées à son système de « certificat blanc » pourrait déclencher des dépenses privées de 20 fois ce chiffre en fonction de la performance des années précédentes. En Allemagne, l’Energiekonzept de 2010 pourrait éviter 42 milliards de dollars (quelque 31 milliards d’euros) en coûts d’énergie en 2020. Un taux de rénovation de 2 % exigé pour les bâtiments sera source de mises à niveau plus économes en énergie et de sécurité pour les investisseurs du marché.
Néanmoins, l’AIE conclut à l’importance et à la croissance des besoins, avec comme vecteur principal le prix et les aides publiques, l’investissement privé prenant le pas sur l’investissement public direct.
L’efficacité énergétique est avant tout une question d’investissement et de capacité des pouvoirs publics à les provoquer, soit par des aides, soit en maintenant à un niveau particulièrement bas le niveau de l’intérêt.
En l’Allemagne, la KfW est particulièrement active dans ce secteur. Elle collecte notamment auprès du Fonds énergie climat alimenté par les ventes de quotas de CO2, un montant qui lui permet d’accorder des subventions et des prêts à taux préférentiels. Les banques locales accordent des prêts dont le taux est peu élevé grâce aux fonds prêtés par la KfW.
Dans son rapport de 2012, la KfW a indiqué qu’elle apporterait 100 milliards d’euros sur cinq ans pour le financement du tournant énergétique allemand. Qu’il s’agisse de l’éolien offshore ou du biogaz, on trouve des projets ainsi financés à 1,7%.
La réalisation des objectifs définis en 2012 et plus généralement du gain d’efficacité exigé par ceux du paquet Energie-climat conduisent certains interlocuteurs à proposer de manière opportune de renforcer le rôle de la Banque européenne d’investissement (BEI) en la matière, de telle sorte qu’elle joue davantage qu’elle ne le fait, un rôle moteur en matière de financement du tournant énergétique, notamment pour l’efficacité énergétique dans le bâtiment, dans les Vingt Huit.
Selon les éléments publics, la BEI a prêté en 2012 plus de 1,1 milliard d’euros en faveur de l’efficacité énergétique. Les projets financés ont porté généralement sur la rénovation et l’extension d’infrastructures et de services sociaux et urbains existants et ont concerné les réseaux de chauffage et de refroidissement urbains, les installations de cogénération, la remise en état et la modernisation de bâtiments et l’amélioration de procédés industriels, ainsi que l’amélioration et la mise à niveau de la performance énergétique dans les transports collectifs et les systèmes de gestion des déchets et de l’eau.
On est à l’échelle européenne loin d’un effort comparable à celui de l’Allemagne.
De même, pour la France, la Caisse des dépôts pourrait certainement prendre exemple sur la KfW.
Le deuxième domaine sur lequel la coopération européenne est aussi essentielle qu’inéluctable est celui des nouvelles technologies, notamment sur les deux éléments clefs que sont le stockage de l’énergie électrique et le stockage ou captage du CO2.
Le premier constitue la solution pour une véritable domestication de l’énergie renouvelable, notamment du solaire et de l’éolien.
Actuellement, la seule technique éprouvée qui soit applicable demeure le stockage hydraulique avec le pompage-turbinage : l’eau est pompée d’un réservoir aval vers un réservoir amont en période de stockage. En période de production, le dispositif fonctionne comme un barrage hydroélectrique : l’eau s’écoule d’amont vers l’aval par des turbines.
La technique exige que la géographie s’y prête, ce qui est essentiellement le cas des pays montagneux. L’Allemagne a ainsi passé des accords avec la Suisse et l’Autriche, ainsi que la Norvège, grâce à un câble sous-marin.
En tout état de cause, les capacités naturelles disponibles en la matière ne répondent pas aux besoins.
D’autres techniques sont nécessaires avec deux voies : d’une part, le stockage de l’électricité proprement dite dans des batteries, dont le coût doit être suffisamment abordable et la taille suffisamment réduite, ce qui n’est pas encore le cas ; d’autre part, le stockage de l’énergie sous forme d’un combustible. Des espoirs sont régulièrement nourris par les perspectives annoncées pour l’hydrogène et le méthane.
Actuellement, les rendements sont cependant trop médiocres et les perspectives ne semblent pouvoir être concrétisées qu’avec un très important effort de recherche.
Le même raisonnement vaut pour l’autre question essentielle qui est celle du stockage du CO2.
C’est en effet l’une des clefs de l’avenir énergétique, car de sa réalisation dépend le statut des gaz et pétroles conventionnels une fois que la question de l’acceptabilité politique des futures techniques d’extraction aura été résolue : s’agit-il uniquement d’une souplesse qui permet de faire la transition énergétique sans affronter le scénario le plus catastrophique, celui du pic pétrolier, à brève échéance ; s’agit-il au contraire d’une ressource plus pérenne qui permet de conserver en parallèle aux développements technologiques sur l’électricité, la souplesse de l’hydrocarbure pour les utilisations les plus individuelles de l’énergie ?
Plusieurs pays européens ont des sites pilotes, notamment l’Espagne à Hontomin (Castille-Leon) et la Norvège.
L’AIE et le GIEC estiment que 20% à 40% des émissions industrielles de CO2 pourraient ainsi être piégées.
La sûreté nucléaire fait partie des éléments sur lesquels une certaine coopération européenne s’est établie.
Une série de « stress tests » (tests de résistance) a été menée à la demande de la Commission européenne sur l’ensemble des réacteurs électronucléaires de l’Union européenne au lendemain de l’accident de Fukushima. Ses modalités en ont été validées et serviront désormais de référence internationale. Un protocole d’entente en ce sens a été signé le 17 septembre par le commissaire européen à l’Energie, M. Günther Oettinger, et le directeur général de l’Agence internationale de l’Energie Atomique (AIEA), M. Yikiya Amano.
C’est une contribution au Plan d’Action de l’AIEA sur la sûreté nucléaire, demandé en juin 2011 par la Conférence ministérielle sur la sûreté nucléaire, après la catastrophe de Fukushima, et approuvé à l’unanimité par les États membres de l’AIEA en septembre 2011. Il comprend notamment une analyse des retours d’expérience de la catastrophe de Fukushima, de la gestion de cette crise, avec l’ambition d’une coopération internationale renforcée.
La transparence mutuelle de la sûreté est également un domaine où la coopération peut avancer.
A. L’ETAT DES LIEUX DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE ET DE LA MISE EN œUVRE DU PROTOCOLE DE KYOTO
Prises dans leur ensemble, les émissions de gaz à effet de serre s’élevaient à 47 milliards de tonnes équivalent CO2 (teqCO2) en 2010, soit 32 % de plus qu’en 1990, d'après le World Resource Institute (WRI).
La part des émissions des pays dits « développés » est désormais inférieure à celle des pays en développement, notamment du fait d’une croissance soutenue et fortement consommatrice en énergies fossiles dans les pays émergents. Les émissions ont presque triplé en Chine et doublé en Inde depuis 1990, compensant largement la baisse opérée dans certains pays développés comme en Europe et en Russie. Ainsi, en 2010, la Chine est le premier pays émetteur de GES (21% en 2010, contre 9 % en 1990), devant les États-Unis (14 % en 2010), l’Union européenne (10%), la Russie et l’Inde (5%). La France quant à elle ne représente « que » 1 % des émissions en 2010.
La moyenne mondiale des émissions par habitant s’élève à 6,8 tonnes en incorporant les émissions induites par l'usage des terres et leur changement d’affectation.
On trouve différents Etats du Golfe Persique dans les Etats aux émissions par habitant parmi les plus élevées au monde : le Koweït 80 avec teqCO2 par habitant et par an, en augmentation de 128% depuis 1990, le Qatar et les Émirats Arabes Unis.
Cependant, parmi les pays où les des émissions par habitant sont très élevées, on trouve aussi certains pays développés comme l’Australie, les Etats-Unis et le Canada, avec une moyenne générale d’environ 23 teqCO2 par personne et par an pour ces 3 pays, en 1990 comme en 2010. A titre de comparaison, en 2010, les émissions par habitant de l’Union européenne sont d'environ 10 tonnes par habitant et par an, celles de la France se situant autour de 8 teqCO2 par personne et par an.
Dans l’ensemble, les chiffres restent bien plus élevés pour les pays développés que pour les pays en développement, malgré la forte croissance des émissions observée chez ces derniers. Mais la moyenne mondiale reste stable, car l’augmentation des émissions dans les pays en développement a compensé la baisse observée dans certains pays développés.
Plusieurs pays émergents sont quasiment à des niveaux européens, avec plus de 10 tonnes pour l'Afrique du Sud et le Brésil (notamment en raison des émissions induites par la déforestation tropicale), sachant que la Chine a dépassé les 7,5 tonnes par habitant et par an en 2010. Les émissions par habitant de ce pays sont aujourd'hui voisines de celles de la France. La Corée dépasse par exemple les 13 tonnes. L’Inde fait figure d'exception avec des niveaux très faibles à 1,9 tonne par habitant et par an. Le Mexique, l’Indonésie, sont à des niveaux intermédiaires avec respectivement 6 et 5 tonnes par habitant et par an (les émissions induites par la déforestation tropicale comptent fortement pour cette dernière).
C’est le domaine de la production et de l’utilisation de l’énergie qui émet le plus de GES, et cette prédominance a continué à s’accroître depuis les années 1990.
Ce secteur de l’énergie recouvre en fait plusieurs domaines d’activité : les transports (17,3 % en 1990), l’électricité et le chauffage (37,1%), l’industrie (19,7%). À côté de l’énergie, les deux principales causes d’émissions de GES en 1990 étaient l’agriculture (16 % des émissions en 1990) et le changement d’affectation des sols (10,3%).
La croissance des émissions de CO2 induites par la consommation de combustibles fossiles et la production de ciment a atteint 3,1 % par an en moyenne entre 2000 et 2012. Entre 1990 et 2010, ces émissions ont cru de 58%, principalement à cause de l’électricité et du chauffage, alors que la population mondiale a cru de 34%. La progression de la part de l’énergie (70 % des émissions en 2010) explique que celle du secteur agricole baisse à 13,5 % alors même que l’on observe une augmentation de ses émissions en valeur absolue (+6%). En revanche, les émissions liées au changement d’affectation des terres ont de leur côté nettement diminué (-40%), et de ce fait la part de ce secteur tombe à environ 6 %.
Adopté en 1997, le Protocole de Kyoto à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) est entré en vigueur le 16 février 2005 à la suite de la réception des instruments de ratification de la Fédération de Russie. L'Afghanistan l’a ratifié en 2013, portant le nombre de Parties à cet instrument à 193. Seules deux Parties à la CCNUCC n'ont pas ratifié le Protocole : l'Andorre et les États-Unis.
Les pays développés Parties au Protocole de Kyoto se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 5% par rapport à 1990 sur la première période d’engagement de 2008 à 2012.
Selon les inventaires effectués en 2009, ces derniers sont parvenus à réduire collectivement leurs émissions de 21% à cette date, les pays en difficulté pour remplir leur objectif respectif étant alors le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Islande et le Liechtenstein.
L’Union européenne, liée par un objectif de réduction commun de - 8% dans le cadre de la bulle européenne, dépasse son objectif en réduisant de 12% ses émissions. Engagée à stabiliser ses émissions sur la première période, la France parvient à 8,1 % de réduction en 2009, ses émissions étant égales à 517 millions de tonnes équivalent CO2.
La conformité des Parties aux engagements qu’ils s’étaient fixés ne sera définitivement arrêtée qu’en 2015, à l’issue d’une période d’examen des derniers inventaires soumis.
B. UN PROCESSUS DÉJA ENGAGÉ EN VUE DE L’OBJECTIF AMBITIEUX D’UN ACCORD D’APPLICATION UNIVERSELLE POUR L’APRÈS 2020
Pour éviter le renouvellement du scénario de la conférence de Copenhague en 2009, où un accord universel et contraignant, tenant naturellement compte des différences de situation, n’a pas été atteint, la conférence de 2015, qui est celle où un tel accord devrait être fixé pour l’après 2020 de manière à limiter à 2° l’élévation des températures à l’horizon 2100, fait l’objet d’une préparation progressive.
La dix-huitième conférence des Parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), qui s’est tenue à Doha, au Qatar, du 26 novembre au 8 décembre 2012, a été jugée comme une conférence de consolidation et de transition.
Elle a permis, dans la continuité des conférences de Copenhague (2009), Cancún (2010) et Durban (2011), de poursuivre la mise en place des bases juridiques du futur régime international de lutte contre le changement climatique, en complétant les instruments établis dans le cadre de la CCNUCC et du Protocole de Kyoto. Un an après la conférence de Durban, où l’ensemble des pays avaient pour la première fois souscrit à une feuille de route menant à l’adoption d’un accord applicable à tous en 2015, les 195 Parties à la CCNUCC ont travaillé à Doha à l’élaboration du futur régime international. L’élaboration de cet accord, qui entrera en vigueur à partir de 2020, sera guidée par l'objectif politique acté à Cancun de limiter à 2°C l’augmentation moyenne des températures mondiales d’ici 2100 visant à éviter de graves dérèglements.
Plusieurs avancées ont été enregistrées :
- un amendement au Protocole de Kyoto, exposé ci-après, a été adopté ;
- l’accord obtenu a permis de clore le cycle de négociations ouvert en 2007 à Bali, afin de se concentrer dorénavant sur la mise en œuvre des décisions adoptées pour la période allant de 2013 à 2020 et d’initier la transition vers un nouveau régime international de lutte contre le changement climatique pour l'après-2020 ;
- un programme de travail a été adopté qui planifie les négociations d’ici à 2015. Des travaux sont en cours pour relever avant 2020 le niveau d’ambition des réductions d’émission de gaz à effet de serre, sans attendre l’entrée en vigueur du futur accord ;
- les Parties ont décidé que les efforts en vue de mobiliser 100 milliards de dollars par an pour financer la lutte contre le changement climatique à l’horizon 2020 feront l’objet de nouveaux travaux. Le besoin de renforcer la coopération et l’expertise pour comprendre et réduire les pertes et dommages causés par les impacts des changements climatiques a par ailleurs été reconnu et les Parties ont été invitées à identifier des stratégies en ce sens.
La France était représentée par le ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius, la ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, Mme Delphine Batho, et le ministre délégué chargé du Développement, M. Pascal Canfin.
b. Une deuxième période d’engagement pour le protocole de Kyoto pour assurer la transition jusqu’en 2020
Le Protocole de Kyoto à la CCNUCC, adopté en décembre 1997 et prévoyant une réduction ou une limitation des émissions de GES par les pays industrialisés et les pays à économie en transition, a prévu une première période d’engagement allant de 2008 à 2012, par rapport aux niveaux des émissions de 1990.
L’amendement adopté à Doha prévoit la poursuite de cet instrument pour une deuxième période d’engagement qui durera 8 ans, de 2013 à 2020.
Néanmoins, les pays ayant adopté un objectif de réduction ou de limitation de leurs émissions de GES pour cette période (les vingt-huit Etats membres de l’Union européenne, l’Islande, l’Australie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, la Suisse et l’Ukraine) représentent seulement 15% des émissions mondiales.
Le Canada (qui a décidé de se retirer du Protocole de Kyoto le 15 décembre 2011, cette décision ayant pris effet au 15 décembre 2012), la Fédération de Russie, le Japon et la Nouvelle-Zélande n’ont pas souhaité se réengager.
Néanmoins, cette deuxième période d’engagement joue un rôle clef de transition vers le futur accord mondial qui entrera en vigueur en 2020.
L’engagement européen vis-à-vis des émissions de gaz à effet de serre présente une spécificité. Dans le cadre de cette deuxième période, l’Union européenne et ses États membres se sont en effet engagés à réduire collectivement dans le cadre de la « bulle européenne » leurs émissions de 20 % d’ici 2020 par rapport à 1990.
Au milieu de l’année 2013, l’ordre de grandeur des réductions constatées était d’environ 17%, ce qui laisse entrevoir que l’objectif européen sera probablement dépassé.
Les conclusions du Conseil datant de mars 2012 précisent que cet engagement collectif de l’Union européenne et de ses États membres se fonde sur les modalités prévues dans le cadre du Paquet énergie-climat.
Au sein de l’Union européenne, la ratification de cette deuxième période d’engagement requiert deux procédures distinctes et interdépendantes : la ratification de l’amendement au Protocole de Kyoto par chaque État membre selon leur procédure nationale respective et la ratification par l’Union elle-même, via l’adoption par le Conseil d’une décision portant conclusion de l’accord après avoir obtenu l’accord ou l’avis du Parlement européen selon la procédure législative choisie. Étant donné la nature collective et solidaire de cet engagement, les États membres et l’Union européenne doivent, en amont de ces deux processus de ratification, déterminer les modalités de gestion relatives à la bulle européenne.
La ratification de l’amendement de Doha au protocole de Kyoto
Adopté lors de la conférence de Doha en 2012, l’amendement au Protocole de Kyoto acte la poursuite de cet instrument juridiquement contraignant durant 8 ans, de 2013 à 2020. La décision adoptée à Doha souligne l’urgence de le ratifier en raison de son application dès le 1er janvier 2013.
Son entrée en vigueur dépend de sa ratification par les trois quarts au moins des Parties au Protocole (144 sur 192). En l’état, trois pays seulement l’ont fait : les Emirats arabes unis, la Barbade et Maurice.
En France, le projet de loi en cours de préparation est prévu pour être bientôt présenté au Conseil d’Etat.
Pour l’Union européenne, il est prévu comme pour la première période d’engagement que les vingt-huit Etats membres et l’Union elle-même déposent en même temps leurs instruments de ratification.
La dix-neuvième conférence des Parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), la COP 19, aura lieu à Varsovie du 11 au 22 novembre 2013.
Il s’agit de la première d’une série de trois conférences devant mener à l’adoption du nouvel accord international de lutte contre le changement climatique en 2015, qui devra être applicable à tous les pays et devra entrer en vigueur au plus tard en 2020.
La COP19 devra, d’une part, consolider les progrès réalisés lors de la précédente Conférence des Parties qui s’est tenue à Doha fin 2012 (mise en œuvre des institutions créées et des décisions adoptées) et, d’autre part, définir les prochaines étapes et les prémices du futur accord. Cette conférence devra, en particulier, décider des grands équilibres qui structureront l'accord de 2015, qui doit être adopté lors de la 21ème Conférence des Parties.
La mise en œuvre des décisions adoptées aura une place centrale dans les négociations. L’infrastructure institutionnelle élaborée au cours des deux dernières années doit désormais prendre forme et produire ses premiers résultats. Le renforcement de la confiance mutuelle entre les Parties passera par la mise en œuvre des engagements pris lors des précédentes conférences. A Varsovie, un accent particulier doit être mis sur la mobilisation des financements pour le climat ainsi que sur l’adaptation au changement climatique (pertes et dommages). A cet égard, il est indispensable que le Fonds vert parvienne à déterminer son modèle économique, afin que le processus d’abondement de ce fonds puisse être engagé à Varsovie.
Le Fonds vert
La création du Fonds vert pour le climat a été décidée au sommet climat de Copenhague en 2009. Il constitue, aux côtés du Fonds pour l’Environnement Mondial, le mécanisme financier de la Convention climat. Il pourrait à terme constituer un acteur essentiel de l’architecture du financement de la lutte contre le changement climatique, tout en contribuant à sa rationalisation.
Afin de définir les principes et objectifs qui guideront la création du Fonds, la Conférence des Parties a décidé en 2010, à Cancun, de créer un comité transitoire chargé de définir les principes et modalités de fonctionnement du Fonds. Ce comité a ainsi élaboré un texte fondateur (« governing instrument ») pour le Fonds vert, adopté par la COP fin 2011, à Durban. Ce texte constitue un compromis équilibré et permet de consacrer un modèle de fonds décentralisé conforme à la vision française : le fonds serait doté de la personnalité juridique, devrait s’appuyer sur un grand nombre d’agences d’exécution (nationales, bilatérales et multilatérales) et notamment des institutions financières, et son instrument prévoit explicitement qu’il pourrait devenir le « principal fonds international pour le financement du climat ».
Sur cette base, le Conseil du Fonds vert, dans lequel siège la France, s'est réuni à quatre reprises depuis la nomination de ses membres. L’année 2013 est une année charnière pour le Fonds Vert car elle doit en principe permettre au Conseil du Fonds de définir plus précisément son « business model ». Les différentes réunions ont permis de faire avancer l’opérationnalisation du Fonds avec des décisions mettant en place ses fondations organisationnelles et notamment la sélection du pays hôte, la Corée, ainsi que la nomination d’une Directrice exécutive, de nationalité tunisienne, Hela Cheikhrouhou.
Les pays en développement souhaitent avoir de la visibilité sur la mobilisation des ressources et la tenue éventuelle d’une conférence des donateurs, alors que les pays développés souhaitent avoir au préalable des assurances sur la valeur ajoutée du fonds et l’organisation de ses opérations.
Les financements en faveur de la lutte contre le changement climatique seront une composante centrale des négociations pour un futur accord sur le climat d’ici 2015 à Paris. Dans ce cadre, l’évolution du Fonds Vert sera déterminante, des avancées concrètes étant indispensables pour asseoir la crédibilité de l’engagement collectif des pays développés de mobiliser 100 milliards de dollars par an (flux publics et privés) pour le climat à partir de 2020.
Dans le même temps, les pays partenaires attendront de la part des pays s’étant réengagés dans une deuxième période du Protocole de Kyoto (2013-2020) des progrès dans le processus de ratification de l’amendement à ce Protocole adopté à Doha. Au sein de l’organe subsidiaire de mise en œuvre (SBI), il conviendra enfin de composer avec les préoccupations exprimées par la Russie, la Biélorussie et l’Ukraine au sujet des règles d’adoption des décisions par les Conférences des Parties, et de parvenir à rattraper le retard accumulé lors de la session intermédiaire de juin en raison de la suspension de l’ensemble des travaux sous cet organe.
La COP19 devra aussi aborder les éléments clés et les points d'équilibre du futur accord à adopter en 2015.
Si le débat actuel reste majoritairement exploratoire, la définition des principes et l’identification des points de convergence et de divergence sont primordiales. Les Parties ont mis à profit l’année 2013 pour consolider leur compréhension mutuelle des positions défendues, explorer des idées nouvelles autour des concepts et principes centraux du futur accord, et ainsi parvenir à une première ébauche de sa structure. Après cette phase d’échanges informels, il est désormais nécessaire d’entrer dans une phase de négociation plus structurée et ciblée. Afin d’organiser les négociations formelles en groupes de travail, les Parties doivent chercher à cristalliser à Varsovie les grandes questions qui structureront le débat d’ici 2015 : manières d’encourager l’ambition et de capter les engagements dans l’accord, structuration du processus pour relever le niveau d’ambition par revues périodique et itérations, intégration de l’adaptation et du financement dans l’accord.
Des avancées concernant le renforcement du niveau d’ambition des réductions d’émission de gaz à effet de serre avant 2020 doivent également être réalisées, en ne se focalisant pas uniquement sur les objectifs nationaux, ni sur les seuls pays développés, mais en travaillant également à la mise en œuvre d’actions parallèles et d’initiatives sectorielles concrètes. Certains sujets devront être décidés – tels que l’intégration au cadre du Protocole de Montréal de la suppression progressive des hydrofluorocarbures (HFC) ou les émissions des transports aérien et maritime internationaux – afin d’afficher la volonté collective de progresser.
Une décision relative au renforcement de la prise en compte des actions des acteurs de la société civile est aussi à rechercher (collectivités territoriales mais aussi entreprises, comme le souhaite la présidence polonaise de la COP19).
Face au risque de manque d’ambition, en raison d'un contexte économique peu favorable au renforcement des objectifs nationaux, la publication des premiers volumes du 5e rapport du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) vient alimenter les négociations en données scientifiques.
La COP19 devra également acter les étapes clés de la préparation de ce futur accord.
La planification des travaux doit progresser, afin de déterminer des jalons concrets permettant d'opérationnaliser l’engagement d’avoir des éléments pour un texte de négociation fin 2014.
Pour que l'année 2014 soit « l’Année de l’ambition », il convient par ailleurs de convaincre dès 2013 l'ensemble des États de la nécessité de consentir des efforts significatifs et d'avoir une discussion sur leurs engagements possibles au sein de cet accord en 2014 et 2015. Une articulation avec les calendriers scientifique (publication du 5e rapport du GIEC), et diplomatique est nécessaire.
Aussi le Secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-Moon, a-t-il prévu d’organiser, dans un an, au moment de l’Assemblée générale des Nations Unies, sous la forme d’un sommet, la « mobilisation des Chefs d’Etat et de gouvernement », de manière que 2014 l’année au cours de laquelle les Etats doivent être convaincus, au plus haut niveau, l’importance de l’échéance.
En 2014, la COP 20 se tiendra au Pérou, à Lima, et s’inscrira dans la perspective de celle de Varsovie. Une conférence préparatoire interviendra auparavant à Caracas.
Le Président de la République a annoncé lors de l’Assemblée générale des Nations unies en septembre 2012 la disponibilité de la France pour accueillir la vingt-et-unième Conférence des Parties (COP21) à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) qui aura lieu fin 2015.
Cette conférence constitue une échéance importante puisqu’elle doit voir l’adoption d’un nouvel accord international sur le climat. Cet accord devra être applicable à tous les pays, à la différence du Protocole de Kyoto qui est aujourd’hui le seul instrument international juridiquement contraignant de réduction des émissions de gaz à effet de serre des pays industrialisés et des pays à économie en transition.
Le ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius, a confirmé cette annonce lors de la COP18 à Doha en décembre 2012. La conférence a pris note de la candidature française qui a été endossée par son groupe régional à l’ONU, le WEOG (Groupe de l’Europe occidentale et autres Etats - Western European and Others Group), le 12 avril dernier, ce qui ouvre la voie à une désignation officielle lors de la COP19 à Varsovie.
Comme la France est le seul pays candidat, il n’y a plus guère de doute à la date de la rédaction du présent rapport.
La France est actuellement dans la phase préliminaire de préparation de cet événement tant sur le plan des moyens (constitution des équipes, évaluations financières et logistiques) que sur le plan diplomatique.
Trois ministère sont concernés : les affaires étrangères ; l’écologie, le développement durable et l’énergie ; le développement.
Un comité de pilotage comprenant les trois ministres concernés a donc été créé. Il réunit, autour de M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères, M. Philippe Martin, ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, et M. Pascal Canfin, ministre délégué chargé du Développement, ainsi que M. Nicolas Hulot, envoyé spécial du président de la République pour la protection de la planète, et M. Jacques Lapouge, ambassadeur chargé des négociations sur le changement climatique.
Ce comité de pilotage veille à recueillir l'avis des experts issus de la société civile, dont l'association à la préparation de la conférence sera une des conditions du succès en 2015.
Pour ce qui concerne l’organisation matérielle de la conférence, l’ambassadeur Pierre-Henri Guignard a été nommé Secrétaire général de la préparation et de l’organisation de la COP21.
Le site de Paris-Le Bourget a été identifié pour l’accueillir.
La France a choisi de placer cette conférence sous le signe de l’exemplarité environnementale et de mettre en œuvre un programme d’action permettant de réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre et la consommation de ressources (eau, énergie).
Selon la réponse écrite communiquée à votre rapporteur, « plus de deux ans avant la tenue de la COP21, le coût global de la conférence est encore difficile à évaluer. A cet égard, des échanges avec les autorités polonaises qui organisent la prochaine COP seront particulièrement utiles pour élaborer un budget prévisionnel. »
En l’état, une somme de 3 millions d’euros a été prévue sur les crédits de 2014. Cette somme n’apparaît pas dans les documents budgétaires : elle résulte d’une évaluation récente. Cette absence de fléchage et de lisibilité sont regrettables.
Cette enveloppe serait selon les éléments communiqués imputée pour moitié sur les programmes du ministère de l’écologie et du développement durable, et pour moitié sur les programmes du ministère des affaires étrangères.
Sur le fond, l’objectif de la COP21 est de parvenir à l’adoption en 2015 d’un nouvel accord répondant aux exigences à long terme de la décarbonation de l’économie, pour s’appliquer au-delà de 2020, au-delà de la seconde période d’engagement de Kyoto.
Sans préjuger de la teneur définitive de cet accord, plusieurs points semblent déjà acquis.
– d’abord, cet accord devra être global car il devra soumettre tous les émetteurs de gaz à effet de serre à des objectifs de réduction à partir de 2020 afin de limiter à 2°C l’augmentation des températures moyennes mondiales d’ici 2100 ;
– ensuite, cet accord devra prévoir les éléments relatifs à la comptabilisation, à la transparence et au contrôle ;
– enfin, il est très clair que les engagements devront être fonction des capacités de chacun, particulièrement de chaque groupe de pays : les pays anciennement industrialisés, les émergents, les pays en développement.
Il est donc impératif comme l’a fait le Gouvernement, de débuter au plus tôt la préparation de l’échéance de 2015.
Comme toute négociation complexe, celle-ci doit faire l’objet d’une préparation en amont de manière qu’elle intervienne ensuite dans une atmosphère positive et de telle sorte que l’accord global soit le résultat de la coordination de plusieurs éléments partiels qui auront été dégagés plus ou moins en amont.
Un partenariat étroit a ainsi été mis en place avec les présidences des deux prochaines conférences qui précèderont celles de Paris, à savoir, comme on l’a vu, la Pologne en 2013 (COP19) et le Pérou en 2014 (COP 20). Il en est de même avec le Venezuela qui organise la réunion préparatoire à la conférence de 2014. Cette coordination est opérée dans un esprit de transparence, d’écoute et d’ouverture envers les acteurs de la négociation.
La nomination dès janvier 2013 de M. Jacques Lapouge, ambassadeur chargé des négociations internationales sur le changement climatique, a par ailleurs permis d’engager le processus de consultations avec nos partenaires. Ses déplacements dans des pays tels que l’Inde, la Chine et les Etats-Unis ont été l’occasion d’échanges utiles avec les acteurs clefs de la négociation sur le climat. Les contacts avec la Pologne, organisatrice de la COP19 de Varsovie de 2013, mais aussi le Pérou, sont engagés, notamment en association avec l’Envoyé spécial du Président de la République pour la protection de la planète, M. Nicolas Hulot.
Enfin, les équipes ministérielles sur lesquelles s’appuie l’Ambassadeur chargé des négociations internationales sur le changement climatique ainsi que le Secrétaire général de la préparation et de l’organisation de la COP21 se renforcent et se mettent en ordre de marche pour assurer la réussite de cette échéance environnementale majeure.
Par ailleurs, une concertation est organisée avec le secrétariat de la Convention climat et avec le Secrétaire général des Nations Unies.
L’un des axes consiste à travailler sur la convergence entre l’agenda climat et celui issu de la conférence de Rio+20 sur les objectifs du développement durable, avec un temps fort en septembre 2015, lors du Sommet des Nations Unies sur l’agenda du développement, quelques semaines avant la COP 21
Comme on l’a vu, le Secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-Moon, a prévu d’organiser, dans un an, au moment de l’Assemblée générale des Nations Unies, la « mobilisation des Chefs d’Etat et de gouvernement », de manière que 2014 soit « l’Année de l’ambition », celle au cours de laquelle les Etats doivent être convaincus, au plus haut niveau, de la nécessité de consentir des efforts significatifs et chiffrés en matière de réduction d’émissions.
Enfin, la question climatique est inscrite à l’agenda du sommet de l’Elysée sur la paix et la sécurité en Afrique qui aura lieu les 6 et 7 décembre prochains.
Un accord n’est possible en 2015 que si la société civile et les milieux économiques ont été étroitement associés à l’indentification des enjeux et à l’émergence des solutions.
La transition énergétique et la décarbonation de l’économie ne peuvent pas réussir si elles s’inscrivent dans une logique imposée de nature punitive, alors qu’elles peuvent parfaitement relever d’une démarche positive d’ouverture et de perspectives vers une économie plus efficace et aux fondements renouvelés.
Il faut bannir toute idée d’un blame game, mais au contraire faciliter l’ambition.
Comme l’a notamment confirmé Mme Laurence Tubiana, présidente de l’Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI), à votre rapporteur, la réflexion de la société civile et des acteurs économiques n’a pas diminué depuis la conférence de Copenhague. L’état de préparation est même considéré comme assez avancé.
Pour ce qui concerne les milieux économiques, une journée sur le climat est prévue au Forum de Davos en janvier.
Par ailleurs, certaines dimensions sectorielles font déjà l’objet de travaux, notamment les villes et quelques activités industrielles. Ce sont autant d’initiatives positives qui figurent déjà à l’agenda.
Enfin, une nouvelle commission représentant les milieux gouvernementaux, de la finance et de l’économie a été mise en place pour réaliser un nouveau « rapport Stern » : la commission mondiale sur l’économie et le climat (Global Commission on the Economy and the Climate.)
Elle a lancé le projet d’économie du nouveau climat (New Climate Economy), pour examiner le scénario à long terme de la décarbonation de l’économie. Des travaux sont également prévus en liaison avec les grands émetteurs.
Ce projet de 8,9 millions d’euros représente une importante contribution au débat. Il a été monté sur l’initiative de plusieurs pays : le Royaume-Uni et la Suède, ainsi que la Colombie, l’Ethiopie, l’Indonésie, la Corée et la Norvège.
Des partenariats ont été conclus avec des instituts de recherche sur les cinq continents.
La commission est présidée par M. Felipe Calderon, ancien président du Mexique, et comprend 14 membres, dont Lord Nicholas Stern, professeur à la London School of Economics.
Enfin, en parallèle à l’initiative précitée du secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki Moon, quelques grandes initiatives des acteurs économiques sont prévues.
Le salon Ecocity, organisé à Nantes en septembre dernier, a été un succès. C’est la première fois que ce sommet mondial de la ville durable a été organisé dans l’un des pays membres de l’Union européenne.
Le niveau des participations de même que les thèmes abordés (réduire l’empreinte écologique (eau, air, sols, déchets,biodiversité), relever les défis énergétiques de la ville (décarboner, réduire la consommation, gérer la transition), renforcer les solidarités (solidarités entre villes, entre quartiers, entre personnes), organiser la ville durable (mobilité, aménagement du territoire, prise de décision, planification), mobiliser et réunir les conditions du changement (conditions sine qua non pour la transition, dans les registres sociaux, politiques, culturels et économiques) ont montré d’importance des échelons territoriaux pour réussir de manière très concrète la transition énergétique.
La mobilisation des collectivités locales, leur sensibilisation est clairement l’un des facteurs essentiels pour contribuer à un accord en 2015.
Aussi faut-il se féliciter de la mission confiée en juin dernier par le Premier ministre à MM. Michel Delebarre et Ronan Dantec, sénateurs, sur le rôle des collectivités territoriales dans les négociations climatiques, dans la perspective de 2015, en vue de formuler des propositions.
De fait, la conférence de 2015 est d’ores et déjà inscrite à l’agenda parlementaire.
Tel est le cas non seulement en France, mais aussi dans les pays étrangers, notamment pour ce qui concerne nos partenaires de l’Union européenne.
De la même manière que le Gouvernement a prévu une préparation aussi minutieuse qu’exigée par les circonstances de la conférence de Paris, votre rapporteur estime qu’une coordination doit aussi être opérée au sein du Parlement, et notamment de l’Assemblée nationale, sous l’autorité de son président et des présidents des deux commissions permanentes concernées, la commission du développement durable et la commission des affaires étrangères, en association naturellement avec la commission des affaires européennes.
Cette coordination devra être aussi large que possible de manière à couvrir l’ensemble des instances parlementaires européennes et internationales à l’agenda desquels les questions énergétiques et climatiques sont inscrites ou peuvent opportunément l’être, notamment l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, l’Assemblée parlementaire de l’OSCE (les questions environnementales font partie de la deuxième corbeille) et l’Union interparlementaire.
Le niveau et l’intensité des relations parlementaires bilatérales conduisent également à suggérer l’inscription systématique de ce sujet à l’ordre du jour des réunions de commissions dans un cadre bilatéral (réunions conjointes avec des commissions homologues des parlements étrangers) ou trilatéral (tel est le cas des réunions du Triangle de Weimar), ainsi que des réunions annuelles organisées dans le cadre de la Grande commission France-Chine, de la Grande commission France-Russie et de la Grande commission France-Algérie.
La COP 21 s’annonce comme une échéance dont les résultats sont encore difficiles à cerner avec précision.
D’abord, elle vise à un accord mondial, alors que pour l’instant la réduction des émissions de gaz à effet de serre ne concerne que l’Europe et quelques autres pays, mais laisse à l’écart les principaux émetteurs, notamment les Etats-Unis et la Chine.
Ensuite, elle intervient dans un contexte climatique lui-même difficile. Le dernier rapport du GIEC publié récemment juge désormais « extrêmement probable » – c'est-à-dire avec une probabilité supérieure à 95 % – que l'élévation de la température terrestre relevée depuis le milieu du XXe siècle est bel et bien le fait de l'accumulation des gaz à effet de serre d'origine humaine.
En fonction des scénarios de développement, selon le niveau des émissions de gaz à effet de serre, les modèles climatiques prévoient une élévation de température comprise entre 0,3 °C et 4,8 °C pour la période 2081-2100, par rapport à la période 1986-2005. Seul le scénario le plus favorable est associé à une probabilité supérieure à 50 % d'éviter de dépasser le seuil de 2 °C au-dessus des températures pré-industrielles.
En revanche, le rapport mentionne une fourchette plus large qu’auparavant pour ce qui concerne l'élévation de température en cas de doublement du CO2 : de 2 °C à 4,5 °C en 2007, on passe à 1,5 °C à 4,5 °C.
Enfin, on constate que les positions des différents pays sont encore assez divergentes voire opposées.
À l’arrière-plan, trois éléments sont essentiels.
D’abord, certains États sont par principe très attachés à leur souveraineté, mais leur réticence à entrer dans une logique d’engagement international ne signifie pas nécessairement une volonté de ne rien faire en la matière.
Toute la difficulté, pour éviter l’écueil de la conférence de Copenhague, consiste ainsi à dégager le point d’équilibre entre les souverainetés nationales et le cadre international.
Par conséquent, l’intérêt d’un accord fédérateur sans être unificateur ne doit pas être a priori méconnu.
Ensuite, il faut rappeler qu’est invoqué le principe de différenciation, pour tenir compte des capacités et de l’état de développement des pays, et aussi de l’argument avancé par les pays émergents de la prise en compte du passé.
Ainsi peut s’esquisser l’idée d’un accord ambitieux, hybride qui prend comme base les propositions des parties selon le principe dit bottom up mais en associant un processus itératif et dynamique pour relever l’ambition avec utilisation d’indicateurs, de règles communes et d’un calendrier prédéfini.
Le principe de responsabilités communes mais différenciées pourrait être reflétée à travers un spectre d’engagements permettant à chacun de s’engager sur sa propre transformation.
L’architecture devra évoluer pour refléter l’évolution du monde : la distinction actuelle annexe I/non annexe I ne pourrait être qu’un point de départ pour le débat à venir. Il convenait de mettre en avant un agenda positif tenant compte des opportunités d’une croissance verte et de faciliter les synergies entre actions d’atténuation et d’adaptation.
Enfin, l’une des clefs de la négociation tient aux attentes des pays en développement, dont le ministre des affaires étrangères, M. Laurent Fabius, a indiqué le 30 septembre dernier, lors de la présentation du rapport du GIEC, qu’elles étaient « centrales ».
Le financement de l’engagement retenu à Copenhague d’un montant de 100 milliards de dollars que les pays riches devraient consacrer chaque année, à partir de 2020, pour aider les pays en développement à réduire leurs émissions et s'adapter aux dérèglements climatiques en est l’un des points essentiels.
La clarification de la notion d’adaptation en est un autre, de manière à identifier très précisément l’aide au développement qui en relève.
Pour ce qui concerne les positions actuelles des différentes parties prenantes, l’Union européenne joue clairement par l’importance de son engagement un rôle moteur.
Reconnaissant que le futur accord devra contenir des engagements contraignants pour l'ensemble des pays, ceux-ci pourront être de nature et niveau différenciés pour permettre à chacun d'engager sa transformation (trajectoire de « pic, plateau, déclin » des émissions) à un rythme compatible avec ses exigences de développement, elle défend aussi fortement le principe d’un accord renforçant la transparence des actions de chacun. Il est pour cela nécessaire que le futur dispositif s'appuie sur un socle commun de règles (notamment en matière de comptabilisation des émissions et des efforts).
L'élément actuellement le plus débattu entre les États membres concerne la définition des engagements chiffrés européens pour le futur régime. Deux tendances de fond émergent, entre ceux plus favorables à un rôle d'avant-garde et prônant la définition le plus en amont possible - dès 2014 - d'un objectif quantifié de réduction d'émission à l'horizon 2030, afin d'inciter les autres partenaires de la négociation à faire de même (Royaume-Uni, France, Danemark notamment) et ceux, plus sensibles aux enjeux de croissance domestique et de compétitivité, qui restent convaincus que l’Union européenne sera plus forte si elle attend les discussions et les engagements des autres pays avant de faire sa propre proposition (Groupe de Visegrad dont la Pologne, ainsi que Italie).
Par ailleurs, le débat porte sur le niveau de l’effort supplémentaire que pourrait prévoir l’Union européenne en cas d’accord général en terme de réduction des émissions.
Enfin, pour ce qui concerne l’après 2020, avec le cadre énergie climat européen pour 2030 voire 2040, il faut attendre les propositions qui seront issues de la consultation lancée par le livre vert publié le 27 mars dernier et intitulé « Un cadre pour les politiques en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 », et pour lequel la période de consultation s’est achevée en juillet dernier.
Pour ce qui concerne les pays tiers, la situation reste très diverse, mais on observe cependant une certaine convergence, partielle, des positions et objectifs des grands pays émetteurs avec ceux de l’Union européenne, au moins dans certains domaines.
Ainsi, sur la nécessité d'agir, la majorité des pays a désormais la volonté de lutter contre le changement climatique au niveau domestique, comme l’illustrent la loi sur le climat adoptée par le Mexique l’an passé, les plans d'action nationaux indiens et les plans quinquennaux chinois. Néanmoins, les États-Unis et le Canada restent des exceptions parmi les pays développés par leur difficulté à traiter de la question de la transition énergétique.
S’agissant des outils domestiques, la plupart des grands pays se retrouvent autour des moyens d'atteindre les réductions d'émission nécessaires. L'importance de donner un prix au carbone (système de quotas et taxes) et de favoriser l'efficacité énergétique (États-Unis, Chine) ainsi que le rôle des politiques publiques (Afrique du Sud, Chine), et de l'innovation sont autant d'éléments largement reconnus. Il en va de même pour l'électricité propre, le développement de la voiture électrique, la place accordée aux biocarburants (États-Unis, Inde notamment) ou du rôle attendu du stockage de carbone dans les approches bas-carbone de ces pays (Etats-Unis, Chine).
Des divergences notables entre pays demeurent toutefois et expliquent les difficultés à progresser vers un accord international. Certains pays doivent encore faire face à des courants politiques influents qui ne sont pas fermement convaincus du besoin d'agir (notamment les États-Unis et la Russie), rendant complexe leur positionnement interne et leur politique étrangère.
Si les pays du BASIC (Brésil, Afrique du Sud, Inde, Chine) restent hésitants à s’imposer des contraintes carbone trop fortes, la Chine est néanmoins de plus en plus poussée par sa société civile à agir du fait de la pollution croissante. Des visions différentes sur la notion de l’équité sont encore prégnantes, entre les grands émergents pour lesquels les contraintes juridiques de réduction des émissions doivent porter uniquement sur les pays développés afin d'honorer leur « dette carbone » passée, et des pays comme la Russie, le Canada ou les États-Unis qui demandent aux émergents de s'engager juridiquement comme les pays développés en fonction de leur part dans les émissions actuelles et à venir. Enfin, des divergences subsistent quant à la manière de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le changement climatique, comme l'illustrent les différences de position sur l'inclusion de l'aviation dans le système d’échange de quotas européen.
A la suite de la conférence de Copenhague, une nouvelle coalition (« Dialogue de Carthagène » emmené par le Royaume-Uni, l’Australie et la Colombie) s'est construite contre les pays « difficiles » et a fait émerger des consensus nord-sud structurants. On y retrouve l’Union européenne, la Norvège et la Suisse, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ainsi qu'une grande partie de l'Amérique latine sans les pays de l'ALBA ni l’Argentine, ni les BASIC (Brésil, Afrique du Sud, Inde, Chine).
Les îles en développement (AOSIS) et les pays les plus vulnérables (PMA) y sont également présents. Ces deux derniers groupes, ainsi que plusieurs pays d'Amérique latine, se sont alliés à l’Union européenne lors de la conférence de Durban pour porter une ambition élevée dans les négociations et plaider en faveur d'un futur accord juridiquement contraignant. L’Union européenne cherche à consolider et renforcer cette coalition, car des clivages importants se sont faits jour depuis Durban, notamment sur les questions liées au niveau d’ambition pré-2020.
La situation évolue aux Etats-Unis sur les questions énergétiques et climatiques. Le président américain Barack Obama souhaite en effet mettre son deuxième mandat à profit pour agir dans ce domaine, comme l'attestent ses discours récents et le lancement d’axes de coopération avec la Chine dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).
Le discours du 25 juin dernier du Président Obama, à l’Université de Georgetown, a laissé entrevoir la possibilité d’un véritable plan d’action de lutte contre le changement climatique fondé sur des normes plus efficaces pour les habitations et les appareils électriques, un déploiement plus aisé des énergies renouvelables sur les terres publiques, des mesures de préparation du pays aux événements climatiques extrêmes et, surtout, des normes d'émissions de CO2 des centrales électriques à charbon qui produisent encore les deux tiers de l’électricité du pays, mais dont le recul est comme on l’a vu en cours en raison de l’expansion du gaz de schiste.
Le 20 septembre, l’EPA (US Environmental Protection Agency) a publié les nouvelles règles visant à réduire les émissions de GES (gaz à effet de serre) des centrales électriques nouvellement construites dans le cadre du Clean Air Act. Ces nouvelles règles, qui font la distinction entre centrales à gaz et centrales au charbon, marquent une étape importante vers un mix énergétique moins émetteur de carbone. Elles favorisent une forte substitution du charbon par le gaz dans la production d’électricité.
En 2007, la Chine est devenue le premier pays émetteur de CO2 (environ un quart des émissions mondiales) et est aujourd’hui le premier consommateur d’énergie mondial.
Le Deuxième rapport national d’évaluation sur le changement climatique réalisé par des scientifiques chinois et publié par le gouvernement en janvier 2012 démontre que Pékin considère avec le plus grand sérieux ce phénomène qui menace sa prospérité. D’importantes pénuries d’eau d’ici 2050 et une augmentation de la température atmosphérique de 2,5 à 4,6°C en 2100 par rapport à la moyenne des années 1961-1990 sont à prévoir. La montée du niveau de la mer, en particulier sur le littoral de Shanghai, et la pollution croissante de l’air sont d’autres facteurs d’inquiétude.
Dans son 11ème plan quinquennal (2006-2010), la Chine avait déjà adopté des objectifs contribuant à limiter les émissions de gaz à effet de serre. Pour sa part, le 12ème plan quinquennal (2011-2015) fixe un objectif de réduction de l’intensité énergétique de 16% tandis qu’un objectif de réduction de l’intensité carbonique (émissions de gaz à effet de serre par unité de PIB) de -17% apparaît pour la première fois et doit contribuer à atteindre l’objectif national de réduction de 40% à 45% de l’intensité carbonique entre 2005 et 2020.
La politique d’efficacité énergétique, centrée sur l’impératif de croissance, semble être l’un des principaux moyens par lesquels elle entend atteindre ses objectifs en terme d’atténuation des émissions. De plus, la mise en place de projets pilotes de marchés carbone est prévue dans deux provinces (Hubei et Guangdong) et dans cinq municipalités (Pékin, Tianjin, Shanghai, Chongqing, Shenzhen). Le premier marché carbone a été lancé à Shenzhen en juin 2013.
La pollution intense du mois de janvier 2013, qui découle en grande partie de l’utilisation de charbon (souvent de mauvaise qualité), a entraîné une prise de conscience en Chine et a contribué à faire de la pollution atmosphérique une priorité. Alors que le président Xi Jinping a récemment mis en avant le concept de « civilisation écologique » qui doit orienter le processus d’urbanisation chinois, le besoin impératif de prendre des mesures se fait de plus en plus ressentir.
Cependant, des recherches récentes indiquent que les émissions de gaz à effet de serre chinoises auraient été très largement sous-estimées.
En effet, une étude parue dans Nature Climate Change en juin 2012 arrive à cette conclusion en se basant sur les données publiées par 30 provinces du pays pour évaluer le volume global d'émissions sur la période 1997-2010. Le total obtenu en cumulant les émissions des provinces est sensiblement supérieur aux données officielles du Bureau national des statistiques (NBS). La différence s'élèverait à 1,4 milliards de tonnes de CO2 en 2010, soit l'équivalent des émissions du Japon ou encore 5% des émissions mondiales. La fiabilité et la transparence des données chinoises doivent par conséquent être améliorées.
Partie à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et au Protocole de Kyoto, la Chine, en tant que pays en développement, n’est pas soumise à des obligations quantifiées de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. Dans le cadre de la CCNUCC, la Chine a pris des engagements à Copenhague en termes de réduction de l’intensité carbonique du PIB (- 40 à 45% en 2020 par rapport à 2005).
À Durban en décembre 2011, la Chine a adopté une position d’ouverture qui a permis de parvenir à un compromis dessinant la voie vers un accord universel en 2015. Elle s’est officiellement montrée satisfaite des résultats obtenus et a estimé avoir fortement contribué à l’émergence du consensus en faisant preuve d’une grande souplesse. Pékin s’était montré ouvert à des engagements de réduction des émissions juridiquement contraignants dans le futur accord, y compris pour les pays en développement. Les négociateurs chinois avaient toutefois souligné leur intention de veiller à ce que le principe des responsabilités communes mais différenciées soit respecté.
Depuis la session de négociations de mai 2012 (à Bonn), la Chine a adopté des postures relativement défensives. Avec l’Inde et l’Arabie Saoudite, la Chine a réussi à entraîner dans son sillage plusieurs pays très revendicatifs au sein d’un nouveau groupe de pays durs (Like-Minded Developing Countries on Climate Change – LMDC), notamment sur les questions financières.
Comme les autres pays émergents du groupe BASIC (Brésil, Afrique du Sud, Inde), la Chine rappelle régulièrement la responsabilité historique des pays développés dans le changement climatique. Selon elle, la CCNUCC repose sur la dichotomie entre pays développés et pays en développement et aucun changement n’est souhaitable si l’on ne souhaite pas ralentir le processus de négociation.
La Chine souhaite que les pays développés renforcent leur niveau d'ambition de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre et qu’ils atteignent au moins le même niveau de financement en faveur du climat sur la période 2013-2015 que la moyenne de la période 2010-2012. Pékin insiste aussi pour que les « questions non résolues » telles que les droits de propriété intellectuelle, qui seraient un frein aux transferts de technologies sobres en carbone, soient discutées dans le cadre de l’élaboration de l’accord de 2015.
L’Afrique du Sud compte parmi les 20 plus gros émetteurs de gaz à effet de serre (GES) en raison d’un secteur industriel fortement consommateur d’énergie, d’une utilisation prépondérante de charbon, et de la faible efficacité énergétique des secteurs clés (industrie, bâtiment, transports, électricité).
Au plan national, l’Afrique du Sud poursuit cependant une politique ambitieuse de lutte contre le changement climatique. Le pays s’est fixé des objectifs en matière de lutte contre le changement climatique, en s'engageant à Copenhague, par la voix du président Zuma, à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 34% en 2020 et de 42% en 2025, par rapport au scénario de croissance de base, de manière à plafonner puis à réduire ses émissions annuelles.
L’Afrique du Sud entend respecter ses engagements – à la condition de recevoir des soutiens financiers et technologiques. Le gouvernement sud-africain a ainsi lancé plusieurs exercices :
– un plan stratégique pour l’énergie (Integrated Ressource Plan 2010) définit le scénario de production de l’électricité pour les 20 ans à venir : le doublement de la capacité de production continuera de faire la part belle au charbon, mais fera une large place aux énergies renouvelables (42% des nouvelles capacités en énergies renouvelables, un secteur où nos entreprises sont présentes – Soitec et Tenesol ont été sélectionnés sur des projets solaires) et veut développer sa filière nucléaire, en construisant plusieurs nouvelles centrales (pour lesquelles AREVA et EDF sont candidates) ;
– le plan cadre de la politique nationale sur le climat (climate change response white paper) ;
– une taxe verte sur les automobiles a enfin été introduite et le National Treasury réfléchit à l’introduction d’une taxe carbone.
L’Afrique du Sud a ratifié le Protocole de Kyoto en 2002. Elle est un acteur considéré comme progressiste de la lutte contre le changement climatique et a organisé la COP17 à Durban en 2011, qui sert de cadre à la négociation actuelle qui conduira à Paris en 2015. Elle fait partie du Groupe des 77 (G77), et du Groupe Afrique, en lien avec l’Union Africaine.
Le pays est fortement dépendant du charbon pour sa production d’électricité (95 % de la production électrique contre 4% pour le nucléaire). La production électrique actuelle est insuffisante pour répondre aux besoins d’une économie en pleine croissance. D’ici 2025, on estime que 40 000 MW devraient être construits pour satisfaire la demande nationale, soit un doublement de la capacité installée et un investissement de près de 100 milliards €.
Pour faire face à cette situation, le pays a décidé de développer de nouvelles unités de production. Le charbon devrait continuer à jouer un rôle majeur : Pretoria s’est engagée en 2010 dans la construction de deux nouvelles centrales à charbon, Kusile et Medupi, pour un total de 10 000 MW. La part du nucléaire et des énergies renouvelables devraient également être appelée à croître dans le mix énergétique sud-africain.
Face à cette dépendance au charbon, le développement des technologies de séquestration du carbone (CCS) constitue un enjeu majeur pour l’Afrique du Sud qui a créé une agence de séquestration du carbone (SA CCS center) en 2009.
Le climat a été un thème dominant pour l'Afrique du Sud en 2011, culminant avec la présidence de la COP17. La conférence de Durban est perçue comme un succès politique en ce qu’elle a fixé deux dates importantes : 2015 pour l’accord, 2020 pour son entrée en vigueur.
Le rôle de pont joué par l’Afrique du Sud, de par son appartenance au G77, ainsi qu’au groupe des BASIC, n’est probablement pas étranger non plus au résultat de la COP 17.
Depuis Durban, l’Afrique du Sud s’est montrée soucieuse de maintenir une position reflétant les préoccupations et les contraintes d’un pays émergent soucieux de préserver les conditions de son développement lorsque l’accord juridique universel sera mis en œuvre en 2020.
Le Brésil appartient au groupe des BASIC (avec l’Afrique du Sud, l’Inde et la Chine) qui s’est imposé, depuis la Conférence des Parties de Copenhague en 2009, comme un groupe clef dans les négociations. Ces pays n’ont pas d’objectif de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le cadre du Protocole de Kyoto. Attachés au principe des responsabilités communes mais différenciées, les BASIC souhaitent que le futur régime international du climat prenne en compte leurs besoins de développement. Selon eux, les pays développés ont accumulé une « dette historique » envers les pays en développement en sur-occupant l’espace carbone qui leur était attribué. Ceci devrait donc être compensé par des transferts financiers d’une grande ampleur, mais également par des transferts de technologies sobres en carbone des pays développés vers les pays en développement.
La décision de 2011 sur la plateforme de Durban qui doit aboutir à un nouvel accord mondial sur le climat en 2015 a été évaluée positivement par les autorités brésiliennes.
À Doha, en 2012, le Brésil a également joué un rôle moteur lors des négociations visant à définir les modalités de mise en œuvre de la deuxième période d’engagement du Protocole de Kyoto. Celle-ci va s’appliquer de 2013 à 2020 et joue un rôle de transition d’ici l’entrée en vigueur du futur accord mondial.
Sur le volet financement des négociations, le Brésil craint que le Fonds vert pour le climat ne reste vide et critique les pays développés qui ne seraient pas assez engagés. Il se dit prêt à discuter de toutes les sources de financement, y compris des mécanismes de marché. En ce qui concerne les financements innovants, le Brésil reste ouvert mais considère que, pour un grand nombre de pays en développement, le financement de la lutte contre le changement climatique ne peut venir que de l’aide publique au développement des pays développés.
Lors de la dernière session de la CCNUCC à Bonn (3-14 juin 2013), le Brésil a critiqué le manque d’ambition des pays développés pour lutter contre le changement climatique. Il a rappelé qu’il sera essentiel de rétablir la confiance entre les Parties durant la conférence sur le climat de Varsovie en novembre prochain.
Afin de contribuer à l’élaboration de l’accord de 2015, le Brésil a présenté de nouveau en juin 2013 sa proposition sur la responsabilité historique des pays développés (nommée « proposition brésilienne »). Présentée pour la première fois en 1997, elle vise à déterminer l’effet des émissions de gaz à effet de serre de chaque pays sur l’augmentation de la température mondiale moyenne. La communauté internationale ayant adopté en 2010 l’objectif d’une limitation du réchauffement mondial à 2°C, le Brésil considère que sa proposition est plus que jamais pertinente. Les pays développés ont toutefois accueilli cette proposition avec peu d’enthousiasme, en raison notamment des difficultés méthodologiques pour attribuer à chaque pays sa part du réchauffement climatique.
Le Brésil est l’un des pays parfois jugé comme « difficile ».
5. Un impératif régional : organiser autour des Etats-Unis, de la Chine et de l’Union européenne la coopération internationale pour assurer le développement et la transition énergétique de l’Afrique
En comparaison à son poids démographique l’Afrique, qui représente dans sa dimension subsaharienne l’essentiel des pays les plus vulnérables, consomme peu d’énergie, mais elle le fait dans des conditions très peu optimale.
Il y a donc pour elle le double défi du développement et de la transition énergétique à relever.
En effet, en Afrique subsaharienne, la consommation par habitant et par an (hors Afrique du Sud) est de l'ordre de 100 kilos d'équivalent pétrole contre 4 000 dans les pays OCDE. Plus de 60 % de la population africaine n'a pas accès à l'énergie commerciale et doit se contenter de bois de feu. Cette situation est paradoxale dans la mesure où l’Afrique est riche en ressources naturelles, et tout particulièrement en pétrole, gaz et charbon.
Globalement, avec 14% de la population mondiale, l’Afrique ne consomme que 3% de l’énergie utilisée dans le monde. Cette situation cache des disparités importantes entre une Afrique du Nord, une Afrique du Sud et une l’Afrique sub-saharienne. L’Afrique du Nord et l’Afrique du Sud représentent 75% de l’énergie consommée par l’ensemble du continent :
– au Nord (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte), gaz et pétrole abondants sont les principales énergies consommées ;
– en Afrique du Sud, la consommation s’appuie essentiellement sur le charbon, sur les produits dérivés de sa liquéfaction et sur les produits pétroliers ;
– le reste de l’Afrique qui abrite pourtant près des trois-quarts de la population du continent, ne représente que le tiers restant de la consommation continentale. Dans cette zone, une véritable fracture sépare également le monde urbain et le monde rural. Alors que le relatif bon équipement des plus grandes villes africaines permet l’accès à des sources d’énergie conventionnelles, les infrastructures de distribution sont quasi-inexistantes dans les campagnes d’Afrique centrale, occidentale et orientale. Ainsi, la biomasse, et tout particulièrement le bois de feu (en moyenne 86% de l’énergie consommée par les populations rurales dans l’Afrique sub-saharienne) reste la principale source d’énergie.
Ce n’est pas un problème de production, mais un problème lié au développement.
L’Afrique produit beaucoup d’énergie mais en consomme peu.
POIDS DE L’ÉNERGIE AFRICAINE SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE (2009)
Pétrole |
Gaz naturel |
Charbon | |
Réserves |
10 % |
7,9 % |
3,8 % |
Production |
12 % |
7 % |
4,3 % |
Consommation |
3,4 % |
3,1 % |
0,5 % |
Source : ministère de l’écologie et du développement durable
La situation par source d’énergie permet de bien mesurer la fracture énergétique.
Le pétrole : Au niveau mondial, le pétrole ne représente que 35 % de la consommation d’énergie alors qu’en Afrique subsaharienne, cette source couvre 60 %, hors bois de feu, de la production d’énergie. Les réserves de pétrole en Afrique correspondent en moyenne à 33 ans de production. Si certains pays ont des réserves pour seulement une vingtaine d'années de production, l’Algérie et l’Angola par exemple, d’autres, la Libye, le Nigeria ou le Soudan, ont une autonomie de 40 ans voire davantage.
Le gaz naturel : Utilisé tant pour les usages domestiques qu’industriels ou pour la production d'électricité, le gaz naturel est abondant en Afrique du Nord (Algérie, Égypte, Libye), de même qu’en Afrique de l'Ouest et en Afrique Centrale. Dans ces régions, son utilisation se cantonne, soit à une production – encore modeste, d'électricité, soit à l'alimentation d'unités de liquéfaction. Ainsi, le Nigeria et la Guinée équatoriale exportent leur production vers l'Europe ou l'Amérique. Quelques rares cas d'utilisation du gaz pour des usages industriels sont à noter en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Nigeria ...
Le charbon : Le charbon est essentiellement produit en Afrique du Sud. Le tiers de la production est exporté. Le reste est utilisé sur place pour la production électrique. Les réserves sont abondantes dans la République d'Afrique du Sud et également dans le Botswana.
L’électricité : Le continent africain est le moins électrifié au monde. Plus de six Africains sur dix n’ont pas accès à cette source d’énergie. Les inégalités régionales sont grandes. Les pays d’Afrique du Nord profitent du tiers de la consommation, l’Afrique du sud d’environ 45%. L’Afrique subsaharienne se suffit d’un peu plus de 20%. Depuis 1970, le taux d'électrification de l'Afrique est passé de 14 à 38 %. Il n'est encore que de 23 % en Afrique subsaharienne qui consomme moins de 1% de l'électricité produite dans le monde. L’infrastructure électrique est globalement vétuste et vulnérable aux variations de la demande. Selon la Banque Mondiale, les pertes en ligne dues à la vétusté des installations de distribution peuvent atteindre 2% du PIB dans de nombreux pays d‟Afrique subsaharienne.
L'électricité est produite à partir de gaz et de fuel en Afrique du Nord, de charbon en Afrique du Sud, de produits pétroliers surtout en Afrique subsaharienne. Au niveau mondial, l'électricité est majoritairement produite à partir de charbon (40 %), de gaz (20 %) de nucléaire (20 %) et d'énergie hydraulique. En Afrique du Nord le gaz naturel est largement utilisé pour produire l'électricité et en Afrique du Sud le charbon couvre l'essentiel des besoins. En revanche en Afrique subsaharienne, le pétrole est l'énergie dominante pour produire l'électricité. La majorité des pays africains ont une capacité de production inférieure à 1000 MW, taille unitaire d’une seule centrale dans les pays de grande taille.
Les ENR : La principale source d’énergie renouvelable est la biomasse avec le bois de chauffe et le charbon de bois. Son utilisation massive est la source de graves problèmes de déforestation.
L’Afrique est le continent qui renferme le plus grand potentiel hydroélectrique non exploité au monde. Celui-ci représente 12% du potentiel mondial ; il est essentiellement localisé en Afrique centrale, mais des potentiels très importants existent sur le Nil, en Guinée-Conakry et au Mozambique. Pourtant, en termes de production, le continent reste à la marge. Il ne produit, en effet, qu’une part infime de l’énergie hydroélectrique mondiale, et n’utilise que 5% de son important potentiel.
Le potentiel solaire dans certaines régions d’Afrique, et en particulier en Afrique du Nord est très important. Dans l’état actuel de la technologie, l’exploitation de l’énergie solaire reste néanmoins une alternative très lourde en termes d’investissement. Cette alternative ne peut ainsi être raisonnablement considérée que dans certaines zones spécifiques, et appuyée par un véritable volontarisme politique.
Certaines régions africaines, proches des côtes notamment, bénéficient d'une bonne exposition aux vents. Cependant l’Afrique occupe le dernier rang en termes de production éolienne. Elle ne représente, par exemple, que 0,5% de la production mondiale d’énergie éolienne et cette production est le fait de trois pays principalement : la Tunisie, le Cap Vert et l’Afrique du Sud.
L’efficacité énergétique : L’efficacité énergétique reste globalement absente des politiques nationales : les institutions qui mettent en place les politiques d’efficacité énergétique ont peu de moyens et peu de légitimité. Les actions d’économie d’énergie sont vécues comme moins prioritaires que les investissements en installations de production, dont l’insuffisance est criante.
Au-delà de ces éléments, il faut également tenir compte que les prix de l’énergie ne sont pas en Afrique des prix de marché et que dans certains pays, est en place d’un véritable système de subvention aux sources d’énergie fossiles. Les subventions servent notamment à atténuer le prix du pétrole lampant, substitut à l'électricité dans les villages.
L’Afrique est donc un continent de fractures énergétiques et également le continent dont le retard en matière d’énergie va devoir se combler au moment même où les autres pays vont entrer dans la transition énergétique.
On estime en effet qu’environ la moitié de l’écart de niveau de développement dont pâtit l’Afrique est lié au retard d’accès à l’énergie.
Dans ce contexte, il est impératif de prévoir pour l’Afrique subsaharienne un programme international spécifique de modernisation et de transition pour permettre à ces Etats de passer directement de l’état actuel de sous-développement énergétique à celui d’une situation conforme aux impératifs du futur.
Cette aide internationale, trois acteurs ont vocation à la structurer : l’Europe, en raison de l’ancienneté des liens entre les deux continents et de la proximité géographique, mais aussi la Chine et les Etats-Unis en raison de leur présence économique.
Cet objectif et le programme correspondant sont éminemment liés au contenu de l’accord qui sera conclu en 2015.
Par conséquent, c’est tout naturellement qu’ils s’inscrivent à l’Agenda de la COP 21.
La mention de la question climatique à l’ordre du jour du prochain sommet de l’Elysée pour la paix et la sécurité en Afrique, en décembre, constitue une étape essentielle.
Sur le plan pratique, la présence sur le continent africain d’opérateurs extérieurs importants tels qu’EDF, mais pas seulement, apparaît comme la garantie d’une faculté de mise en œuvre assez rapide et efficace.
L’audition en commission élargie de M. Philippe Martin, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, et de M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, a eu lieu le 7 novembre 2013 (2). Lors de sa réunion du mardi 12 novembre, la Commission des Affaires étrangères a émis un avis favorable à l’adoption des crédits de la mission Ecologie, développement et mobilité durables pour 2014.
LISTE DES AUDITIONS DU RAPPORTEUR
– M. Philippe Martin, ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ainsi que M. Paul-Bertrand Barets, conseiller fiscalité et budget, Mme Aurore Gillmann, conseillère parlementaire
– Mme Claire Thuaudet, conseillère au cabinet du ministre des affaires étrangères pour l’ONU, le G8, le changement climatique et les droits de l’Homme
– M. François Croquette, directeur de cabinet de M. Pascal Canfin, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé du Développement
– M. Laurent Michel, directeur général énergie et climat, ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
– M. Philippe Geiger, directeur par intérim des affaires européennes et internationales, ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, ainsi que Mme Marine de Carné, sous-directrice du changement climatique et du développement durable et M. Benoît Piguet, conseiller du secrétaire général
– Mme Laurence Tubiana, présidente de l'Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI)
– M. Bruno Tertrais, Fondation pour la recherche stratégique (FRS)
– Mme Cécile Maisonneuve, directrice du centre énergie de l’Institut français des relations internationales (IFRI)