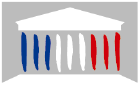
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 octobre 2014.
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION SUR LE PROJET DE LOI de finances pour 2015,
RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET VIE ÉTUDIANTE
Par Mme Sandrine DOUCET,
Députée.
___
Voir les numéros : 2234, 2260 (annexe n° 38).
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION 5
I. LES CRÉDITS PROPOSÉS POUR 2015 7
A. LES MOYENS DES ÉTABLISSEMENTS 7
1. La prise en compte de nos priorités scientifiques et sociales 7
2. La situation financière des universités 8
B. LA VIE ÉTUDIANTE 9
II. LA RÉNOVATION DES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES COURTES : QUELS NOUVEAUX ÉQUILIBRES POUR LES STS ET LES IUT ? 13
A. DES FILIÈRES INNOVANTES ET EFFICACES CONFRONTÉES À UN TRIPLE ENJEU 14
1. De réels atouts 14
2. Un accès à démocratiser pour les bacheliers professionnels et technologiques 18
a. Des quotas qui commencent à produire leurs effets mais qui restent contestés 19
b. Une mesure qui devrait conduire à fixer des objectifs en termes de types de bacheliers formés 23
3. Des IUT soumis à la contrainte budgétaire 26
4. Un nombre insuffisant de cadres industriels intermédiaires formés 28
B. DE NOMBREUX DÉFIS EN « AMONT » ET EN « AVAL » 29
1. L’orientation et le niveau des nouveaux bacheliers 29
a. Un dispositif APB source d’anxiété et de confusion 29
b. Des STS et des IUT confrontés à l’arrivée des « bacs rénovés » 32
2. Le positionnement des diplômes du DUT et du BTS 34
a. Des poursuites d’études de plus en plus fréquentes 34
b. Un diplôme universitaire de technologie à repenser entièrement ? 36
c. Un risque de « décrochage » pour le brevet de technicien supérieur 37
3. La carte des formations : jouer la proximité de l’offre ou la mobilité étudiante ? 38
TRAVAUX DE LA COMMISSION 41
ANNEXE : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA RAPPORTEURE POUR AVIS 67
Le présent rapport pour avis porte sur deux des neuf programmes de la mission interministérielle « Recherche et enseignement supérieur ». Intitulés « Formations supérieures et recherche universitaire » et « Vie étudiante », ils mobiliseront, l’année prochaine, respectivement 12,787 et 2,497 milliards d’euros.
Ces crédits étant examinés, de manière détaillée, par le rapporteur spécial de la Commission des Finances, M. François André, la rapporteure pour avis a axé son travail sur un thème précis : la rénovation des filières technologiques courtes de l’enseignement supérieur – « courtes » car elles délivrent des diplômes de niveau « bac+2 » : les sections de technicien supérieur (STS) et les instituts universitaires de technologie (IUT).
Ces formations sont en effet directement concernées par l’une des mesures les plus emblématiques et les plus discutées de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche (loi « ESR ») : la fixation de « quotas » pour les bacheliers professionnels et technologiques dans un double but, la régulation des choix d’orientation et la démocratisation de l’accès à ces filières sélectives qui permettent une transition en douceur entre le lycée et le supérieur
– les STS étant d’ailleurs implantées dans les lycées.
En outre, les sections et les instituts concentrent un grand nombre de problématiques qui, à des degrés divers, « questionnent » l’efficacité et le devenir de notre système d’enseignement supérieur. On citera, en particulier, la place de l’innovation pédagogique et des dispositifs permettant d’assurer la réussite de publics hétérogènes de bacheliers, le lien entre formation initiale et besoins des entreprises, l’orientation des élèves et la qualité de la transition entre le secondaire et les études supérieures postulée par le « bac-3, bac+3 », ce continuum qu’a consacré la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République.
À bien des égards, les filières qui forment les techniciens et les cadres intermédiaires de nos industries et de nos services ont fait leurs preuves, notamment en préservant, malgré la crise économique et financière, les conditions d’emploi de leurs diplômés. Mais elles doivent relever de très nombreux défis, tout en étant confrontées à d’importants enjeux.
La présente contribution sur la situation de ces réseaux d’excellence, qui s’appuie sur les propos des quarante-quatre personnes entendues par la rapporteure pour avis, vise donc à expliciter ce contexte de fortes « turbulences ».
L’article 49 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 201 relative aux lois de finances fixe au 10 octobre la date butoir pour le retour des réponses aux questionnaires budgétaires. À cette date, 71,6 % des réponses étaient parvenues.
Le budget de l’enseignement supérieur pour 2015 s’inscrit dans la continuité de la priorité donnée par le gouvernement à la réussite des étudiants ainsi que dans la dynamique de site impulsée par la loi « ESR » du 22 juillet 2013, qui vise à regrouper des universités, des écoles et des organismes de recherche autour d’un projet partagé.
Sur un plan « macroéconomique », à structure constante par rapport à 2014 et en tenant compte des fonds de concours et des attributions de produits, l’enseignement supérieur est doté, pour 2015, de 15,211 milliards d’euros en autorisations d’engagement et de 15,289 milliards d’euros en crédits de paiement. L’évolution par rapport à la loi de finances initiale pour 2014 est donc de + 215,7 millions d’euros en autorisations d’engagement et de + 40 millions d’euros en crédits de paiement, soit respectivement + 1,44 % et + 0,26 %.
RÉCAPITULATION DES CRÉDITS PAR PROGRAMME*
(en euros)
Numéro et intitulé du programme et du titre |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement | ||
Ouvertes en LFI pour 2014 |
Demandées pour 2015 |
Ouverts en LFI pour 2014 |
Demandés pour 2015 | |
150 – Formations supérieures et recherche universitaire |
12 548 786 765 |
12 701 869 312 |
12 793 108 432 |
12 787 743 476 |
231 – Vie étudiante |
2 446 168 721 |
2 505 525 973 |
2 455 754 721 |
2 497 950 973 |
Source : Projet annuel de performances 2015 de la mission « Recherche et enseignement supérieur ».
* Hors fonds de concours et attributions de produits.
En 2015, les moyens des établissements (somme des crédits de titre 2 et de titre 3) augmenteront de 234,7 millions d’euros en crédits de paiement. Ceux-ci incluront notamment :
– les crédits liés aux 1 000 créations d’emplois pour 2015 (57,8 millions d’euros), conformément aux engagements contenus dans l’annexe de la loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l’école de la République. Leur répartition indicative est la suivante : 585 emplois d’enseignants-chercheurs, 85 emplois de professeurs agrégés (PRAG) et 330 emplois de personnels administratifs ;
– 23,2 millions d’euros destinés à couvrir le surcroît de cotisation au compte d’affectation spéciale des pensions lié à la titularisation d’agents contractuels au titre de la loi « Sauvadet » du 12 mars 2012 ;
– 22,9 millions d’euros pour financer la réforme des grilles de rémunération des personnels des catégories B et C.
L’utilisation des emplois créés depuis 2013
À ce jour, dans les 82 établissements ayant accédé aux compétences élargies prévues par la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités (« loi LRU »), 466 emplois de personnel enseignants ont été créés sur un total de 1 682 emplois attribués en 2013 et 2014.
Par ailleurs, sur la période 2013-2017, au terme d’une concertation menée avec la Conférence des présidents d’université et la Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs et en accord avec ces deux associations, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a décidé que les deux tiers (65 %) des emplois créés seront répartis dans un souci d’équité, le tiers restant (35 %) devant accompagner la politique de coordination territoriale des politiques de formation et de recherche des établissements.
Ainsi, lors de l’année 2013-2014, 731 créations de postes ont participé au rééquilibrage des dotations entre établissements, soit 681 pour les universités, 36 pour les écoles d’ingénieurs et 10 pour les instituts d’études politiques de province. 139 autres postes ont été déployés au titre des contrats ou politiques de site, en lien avec les 5 projets de fusion d’universités, les 21 projets de communautés d’universités et établissements et les 5 projets d’association en cours. En 2014-2015, sur les 1 000 emplois prévus, 529 seront consacrés au premier objectif, 451 au second et les 20 emplois restants seront destinés à l’enseignement supérieur agricole.
La situation des universités reste fragile, notamment en raison des charges salariales liées aux compétences élargies qu’elles exercent depuis la loi « LRU ». En 2013, 7 d’entre elles, sur un total de 74, ont constaté un déficit, contre 16 en 2012 et 11 en 2011, et 16 avaient un fonds de roulement inférieur au seuil prudentiel de trente jours de fonctionnement. Cette année, les données du ministère de l’enseignement supérieur tendent à monter que 10 universités encore devraient avoir un déficit prévisionnel.
Le décret n° 2014-604 du 6 juin 2014 relatif au budget et au régime financier des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche instaure de nouvelles règles en cas de déficit constaté. Il prévoit un dispositif gradué d’accompagnement des établissements par le recteur qui se caractérise, dans les cas de « double déficit », c’est-à-dire lorsqu’un déficit est constaté deux années de suite, par le maintien des compétences budgétaires du conseil d’administration sous réserve de l’avis conforme du recteur sur un plan de rétablissement de l’équilibre financier. À défaut de vote du conseil conforme à l’avis, le recteur arrête le budget. Par ailleurs, dès le constat de la première perte au niveau du compte de résultat, l’établissement est dans l’obligation de présenter au conseil d’administration une délibération, soumise à l’avis préalable du recteur, déterminant les conditions de retour à l’équilibre sans attendre le budget initial de l’année suivante.
Le programme « Vie étudiante » bénéficie, à périmètre constant, d’un abondement significatif de + 61,4 millions d’euros d’autorisations d’engagement (+ 2,51 %) et de + 44,2 millions d’euros en crédits de paiement (+ 1,80 %) par rapport à la loi de finances initiale pour 2014. Cette majoration de crédits porte essentiellement sur les bourses sur critères sociaux (+ 42,3 millions d’euros en crédits de paiement) et traduit la poursuite de la réforme engagée à la rentrée 2013.
On rappellera qu’à cette occasion, deux nouveaux échelons de bourses (réparties de 0 à 6 échelons jusqu’à la rentrée 2012) ont été créés :
– l’échelon « 0bis » permettant de percevoir une aide de 1 000 euros annuels ;
– l’échelon « 7 » permettant aux étudiants les plus modestes de l’échelon « 6 » de bénéficier d’une aide annuelle de 5 500 euros.
Cette première phase de la réforme a permis d’octroyer environ 55 000 bourses à l’échelon 0bis et 37 400 bourses à l’échelon 7.
Dans le cadre de la seconde phase de cette réforme, le bénéfice du nouvel échelon 0bis a été étendu, à la rentrée universitaire 2014, à 77 500 nouveaux étudiants des classes moyennes aux revenus modestes. Au total, ce sont plus de 132 000 étudiants d’une classe d’âge qui bénéficieront ainsi de ce nouvel échelon.
S’ajoute au dispositif des bourses sur critères sociaux celui des aides d’urgence versées par le fonds national d’aide d’urgence (FNAU) et destinées à la fois aux étudiants, qu’ils soient boursiers ou non, qui rencontrent momentanément de graves difficultés et peuvent prétendre à une aide ponctuelle (39 484 bénéficiaires en 2013) et à ceux qui doivent faire face à des difficultés plus durables comme la rupture familiale ou la situation d’indépendance avérée et qui relèvent, dans ce cas, d’une aide annuelle (5 915 bénéficiaires en 2013).
Pour 2014-2015, un nouveau contingent de 1 000 allocations annuelles d’un montant compris entre 4 000 et 5 500 euros s’ajoutera aux 1 000 allocations mises en place en 2013 pour des jeunes en situation d’autonomie avérée.
La tentative de suppression de l’aide au mérite
La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche s’est appuyée sur la réforme des bourses pour décider, par la circulaire n° 2014-0010 du 2 juillet 2014, que plus aucun nouvel étudiant boursier entré en première année d’enseignement supérieur ou en première année de master ne serait bénéficiaire de l’aide au mérite, tout en la maintenant pour les seuls étudiants qui en étaient déjà bénéficiaires pour l’année 2013-2014.
On rappellera qu’au titre de l’année universitaire 2013-2014, plus de 31 500 étudiants boursiers ont bénéficié de ce dispositif destiné à récompenser l’étudiant titulaire d’une mention « très bien » au baccalauréat ou l’étudiant inscrit à la préparation d’un master qui figure sur la liste des meilleurs diplômés de licence. Cette aide se présente sous la forme d’un complément de bourse d’un montant annuel de 1 800 euros pour les étudiants bénéficiaires d’une bourse sur critères sociaux.
Le projet annuel de performances de la mission justifie la mise en extinction de cette aide par le fait que « l’augmentation continue du nombre bacheliers ayant obtenu la mention "très bien" en a fait une aide de moins en moins ciblée », tandis que l’appréciation du mérite des étudiants de licence est « inégalitaire car elle dépend des modalités de notation et d’évaluation de chaque UFR », la non-inscription sur la liste des meilleurs licenciés d’une promotion étant d’ailleurs une source régulière de contentieux (1).
Pour un motif de pure forme, le Conseil d’État a ordonné, à titre provisoire, le 17 octobre 2014, la suspension de l’exécution de la circulaire. Le gouvernement a donc rétabli l’aide au mérite pour les étudiants qui n’en bénéficiaient pas à la rentrée 2013, dans l’attente de la décision définitive du juge administratif.
En 2012, 48 575 logements avaient été réhabilités et 22 473 logements avaient été construits à la suite des plans « Anciaux 1 » et « Anciaux 2 » mis en œuvre à compter de 2004. De fait, les objectifs annuels fixés dans ce cadre
– 7 000 réhabilitations puis 8 200 à partir de 2009 et 5 000 chambres nouvelles – n’ont été respectés qu’en 2010, et seulement en matière de réhabilitations.
En 2013 encore, on ne comptait que 4 096 réhabilitations et 4 034 nouveaux logements livrés.
Annoncé par le Président de la République, le « Plan 40 000 », lancé en 2013, prévoit la construction de 40 000 logements étudiants sur cinq ans, soit 8 000 logements par an. Pour la réalisation de ce plan, trois contingents ont été comptabilisés, les logements construits et/ou gérés par les CROUS, les logements construits par les organismes d’HLM et gérés en régie ou par des associations et les logements conventionnés à loyer plafonné construits par des opérateurs privés. En outre, ces opérations identifiées bénéficient, dans une large mesure, des prêts aidés de l’État (PLS et PLUS notamment), les collectivités territoriales pouvant de surcroît apporter leur concours sur le foncier ou sur le financement.
Dans chaque région, le préfet et le ou les recteurs d’académie ont été invités par une circulaire interministérielle du 31 janvier 2014 à mettre en place une instance de pilotage afin d’organiser la mutualisation des informations sur l’offre existante et la production de logements pour les étudiants.
Au 31 mars 2014, le potentiel recensé par la mission « Plan 40 000 » était de 42 916 places principalement dans 11 académies (Aix-Marseille, Bordeaux, Créteil, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Toulouse, Versailles), qui créeront 37 065 places sur la durée du plan.
Dans le cadre de ce plan, le parc des résidences universitaires des CROUS est sollicité pour 30 000 de ces nouveaux logements, qui se répartiront géographiquement en priorité dans les six régions où le déficit de logements par rapport au nombre d’étudiants est le plus fort : Ile-de-France, Aquitaine, Provence-Alpes-Côte-D’azur, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes et Nord-Pas-de-Calais. À cet effet, 4 034 nouveaux logements ont été livrés en 2013.
Le développement du logement modulaire
L’accord-cadre pour la réalisation de logements par procédés industrialisés, dits modulaires, a porté ses premiers fruits et deux livraisons ont d’ores et déjà été réalisées. À la rentrée 2013, la nouvelle résidence de Bondy (CROUS de Créteil) a ouvert ses portes. Cent logements de qualité ont été ainsi livrés dans un délai réduit puisque 12 mois seulement se sont écoulés entre la notification du marché et la livraison des logements, la construction étant réalisée en 8 mois. Simultanément était inaugurée la résidence At’Ome à Toulouse.
Les cinq groupements retenus par l’accord-cadre ont concouru pour des résidences à livrer à la rentrée 2015. Les meilleurs projets ont été retenus sur les sites d’Illkirch à Strasbourg (200 logements), de Valrose à Nice (200), d’Oniris à Nantes (280), d’Heinleix à Saint-Nazaire (78), de l’Agroparc de Technolac à Grenoble (120), d’Avignon (170), de Lens (100), d’Arras (150), de La Colombière à Montpellier (180 logements) et de Cuques à Aix-en-Provence (350).
Un objectif de construction de 3 459 logements en supplément des projets « traditionnels » est visé pour des livraisons échelonnées entre les rentrées universitaires 2013 et 2015.
Cet engagement est complété par la généralisation – après une période d’expérimentation dans les régions les plus en tension – de la caution locative étudiante (CLé) qui permet de proposer rapidement une caution aux étudiants qui, en raison de leur situation familiale et personnelle, ne peuvent en fournir. Pour en bénéficier, ces derniers doivent être âgés de moins de 28 ans, sans caution familiale, bancaire ou amicale et s’acquitter d’une cotisation équivalente à 1,5 % du montant du loyer plafonné (500 euros en région, 600 euros en Île-de-France et 700 euros à Paris pour une personne seule). Ce dispositif est mis en œuvre par les CROUS et financé par un fonds doté de 600 000 euros par l’État et la Caisse des dépôts et consignations et abondé par les régions partenaires à hauteur de 100 000 euros par région.
II. LA RÉNOVATION DES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES COURTES : QUELS NOUVEAUX ÉQUILIBRES POUR LES STS ET LES IUT ?
Les filières courtes, parfois qualifiées, de manière assez condescendante, de « petit supérieur » car elles diplôment à bac + 2, constituent l’une des originalités de notre système d’enseignement supérieur.
Elles constituent aussi l’un de ses principaux atouts, comme le montre le bilan, sur longue période, des sections de technicien supérieur (STS) et des instituts universitaires de technologie (IUT), créés respectivement en 1959 et 1966.
Ces deux filières sélectives ont en effet assuré la formation des cadres intermédiaires de notre industrie et de nos services, en répondant à leurs besoins de compétences. Ce faisant, elles ont joué un véritable rôle d’ascenseur social, qui reste vrai encore aujourd’hui. Ainsi, 37 % des étudiants en STS sont issus d’un milieu défavorisé, tandis que part des boursiers sur critères sociaux en IUT s’élève à 43 % (2). Les enfants d’ouvriers sont d’ailleurs surreprésentés en STS (20 %) et IUT (15 %), comparativement aux autres filières, notamment les écoles normales supérieures (3,1 %) et les écoles de commerce et de gestion (2,7 %).
Bien entendu, chacun de ces réseaux de formation possède son identité propre – ne serait-ce qu’en termes de positionnement puisque les STS sont implantées en lycée et les IUT font partie des universités –, mais tous deux partagent un certain nombre de traits communs. En particulier, ainsi que l’ont souligné les représentants de la direction générale de l’enseignement supérieur, ils dispensent des formations « professionnalisantes et professionnalisées », qui ont des relations étroites avec les professionnels du secteur auquel elles préparent. En outre, ces formations, qui proposent un suivi individualisé de leurs étudiants, sont très demandées. Depuis la généralisation de l’application « Admission Post-Bac » (APB) à toutes les académies en 2009, les STS sont en tête des filières demandées en termes de nombre de « vœux n° 1 » exprimés par les bacheliers (plus de 220 000 chaque année), les IUT se classant en troisième position, avec environ 100 000 « premiers vœux » chaque année. À l’inverse, et de façon symétrique pourrait-on dire, si l’université est mécaniquement très demandée en raison du « poids » de son offre, elle attire peu, comme le montre un récent sondage selon lequel seuls 4 lycéens de terminale sur 10 (39 %) souhaitent y faire leurs études supérieures (3).
L’histoire des STS et des IUT est donc celle d’un succès, mais celui-ci est aujourd’hui soumis à de fortes tensions, de nature diverse.
Un fait doit être souligné : les STS et les IUT ont acquis la confiance des milieux professionnels comme celle des familles. Ces deux filières proposent en effet des formations de proximité, non pas uniquement au sens géographique, mais surtout en raison du fait qu’elles sont proches des entreprises et des étudiants qu’elles ont le souci d’accompagner tout au long de leurs deux années de formation. Ces atouts ne seront pas de trop pour les aider à affronter un triple enjeu : démocratique, budgétaire – pour les instituts – et industriel.
• Des formations « co-construites »
Le programme de formation des STS est régulièrement remis à jour, grâce à la réflexion menée au sein des commissions professionnelles consultatives (CPC) où professionnels (employeurs et salariés) et formateurs construisent les référentiels de compétences pour la certification du diplôme. Celui des IUT fait l’objet d’une procédure similaire, qui implique les commissions pédagogiques nationales (CPN) et la Commission consultative nationale des IUT (CCN-IUT) où les professionnels sont représentés au travers des branches. C’est dans ce cadre que les derniers programmes pédagogiques nationaux (PPN), entrés en vigueur en 2013, ont été élaborés.
Dans les deux cas, ce mode d’élaboration a été qualifié de « rassurant » par les représentants de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), car il permet de définir, selon eux, un niveau de qualification qui « correspond » aux besoins de recrutement des PME.
Le cadre de référence de ces formations
Le brevet de technicien supérieur (BTS) est un diplôme national de l’enseignement supérieur attestant d’une qualification professionnelle et conférant à ses titulaires le titre de technicien supérieur breveté (article D. 643-1 du code de l’éducation).
L’horaire hebdomadaire moyen de la formation est de 33 heures, composé de cours, travaux dirigés et travaux pratiques. La répartition entre enseignements fondamentaux (français, mathématiques, langue vivante étrangère, économie, etc.) et enseignements professionnels est de l’ordre du tiers pour deux tiers. Un ou plusieurs stages d’une durée totale de huit à douze semaines sont effectués en entreprise en fin de première année et/ou en deuxième année.
On compte 88 spécialités de BTS, soit 31 dans le secteur des services et 57 dans celui de la de la production. À la rentrée 2013, 255 000 étudiants étaient inscrits dans 2 234 établissements (publics et privés) disposant de STS, soit 10 % de plus qu’en 2003.
La vocation du diplôme universitaire de technologie (DUT) que proposent les 691 IUT (398 dans le secteur secondaire et 293 dans le tertiaire) est de délivrer un enseignement supérieur destiné « à préparer aux fonctions d’encadrement technique et professionnel dans certains secteurs de la production, de la recherche appliquée et des services » (article D. 643-59 du même code).
Les formations comprennent une « majeure » (80 à 85 % du volume global de la formation), qui garantit l’identité du DUT et le « cœur de compétences » dans le domaine professionnel visé, ainsi que des modules complémentaires.
Les unités d’enseignement acquises par l’étudiant sont capitalisables et donnent lieu à l’attribution de crédits européens ECTS. L’obtention du DUT emporte ainsi l’acquisition de 120 ECTS, à raison de 30 crédits par semestre validé en vertu de l’arrêté du 3 août 2005 relatif au diplôme universitaire de technologie (4). Ce texte précise également le nombre total d’heures de formation pour chacune des spécialités, regroupées en secteur « production » (1 800 heures pour chacune) et en secteur « services » (1 620 heures).
À la rentrée 2013, on comptait 116 652 étudiants inscrits dans cette filière.
• Une large place accordée à l’innovation pédagogique
Les STS accordent une place importante à la pédagogie de projet – qui permet de sortir du « face à face » du cours magistral –, ainsi qu’au travail pluridisciplinaire de l’équipe enseignante.
Dans le même temps, la déclinaison des référentiels de compétences dans les enseignements, qui laisse peu de marges de manœuvre pour l’aménagement d’horaires destinés à l’accompagnement des élèves en difficulté, tout comme le fait que le BTS est délivré à la suite des épreuves nationales de l’examen, limitent, par construction, les possibilités d’innovation, cette relative rigidité étant accrue par le fait que cette formation n’est pas toujours « semestrialisée ».
C’est pourquoi, afin de donner plus de souplesse à ce dispositif, deux types d’expérimentation sont menées depuis la rentrée 2011. Inspirées des travaux de la commission pilotée par le recteur Jean Sarrazin, elles prennent la forme d’une modularisation de la formation dans cinq spécialités de BTS (commerce international, transports et prestations logistiques, conception et réalisation de systèmes automatiques, bâtiment, travaux publics) ou d’actions novatrices plus ciblées, notamment pour favoriser l’accompagnement personnalisé des étudiants ou l’accueil en réorientation.
Les IUT, quant à eux, se caractérisent par leur forte capacité d’innovation pédagogique, constitutive de leur identité d’« école professionnalisante ». En effet, chaque institut peut définir des modalités d’adaptation de la formation à son environnement, notamment économique, dans la limite de 20 % du volume horaire attaché à chaque spécialité (article 15 de l’arrêté du 3 août 2005 relatif au DUT). Et, de fait, cette liberté a été largement exploitée.
• Un réel souci de professionnalisation des cursus
Autre point fort, tout est fait, au sein des STS comme des IUT, pour faciliter l’insertion professionnelle de leurs diplômés. Deux exemples, cités par les représentants étudiants, permettront d’illustrer cet atout.
– Le premier concerne les projets personnels et professionnels (PPP) mis en œuvre par les instituts. Ce module « tutoré » permet à un binôme d’étudiants de rencontrer, dès le premier semestre, des professionnels qui présentent les spécificités de la formation. En deuxième année, l’étudiant est amené à rencontrer des professionnels du secteur qui l’intéresse pour affiner le choix du stage qu’il doit effectuer lors du dernier semestre, tout en bénéficiant d’une formation dans les domaines de la rédaction de CV et de la recherche d’emploi.
– Le second exemple concerne le « passeport de compétences » mis en œuvre dans plusieurs BTS. Selon Mme Cindy Pétrieux, présidente de la Fabrique étudiante, ce nouvel outil permet à l’étudiant de « repérer » et de « qualifier » celles qu’il a acquises en formation et en stage. Les entretiens d’embauche en sont par la suite facilités, car le jeune diplômé et l’employeur potentiel peuvent parler un « langage commun ».
• La réussite au diplôme : avantage au DUT
69 % des inscrits en première année de DUT en 2008 ont obtenu leur diplôme en deux ans et 12 % en trois ans, soit 81 % de diplômés au total. Cette réussite reste toutefois corrélée au profil du bachelier puisque près de trois quarts des bacheliers généraux ont obtenu le DUT en deux ans, contre 63 % des bacheliers technologiques (5).
60 % des inscrits en première année de STS ont obtenu le BTS en deux ans et 9 % en trois ans. Cette réussite est encore plus « ségrégative » qu’en IUT : seule la moitié des bacheliers professionnels inscrits en STS a obtenu un BTS en trois ans, ce qui nettement moins que les bacheliers technologiques (73 %) et les bacheliers généraux (85 %) (6).
Quant au taux de réussite à l’examen du BTS, en 2013, il était en moyenne de 74 %, les résultats, là aussi, variant sensiblement selon le baccalauréat du candidat. Celui des bacheliers généraux atteint ainsi les 85 %, ce qui est très supérieur à celui des bacheliers technologiques (77 %) et surtout à celui des bacheliers professionnels (60 %) (7).
Enfin, il y a lieu de noter que les étudiants « décrochent » beaucoup plus souvent en STS qu’en DUT : selon le Centre d’études et de recherches sur les qualifications, dans la première filière, 22 % des étudiants avaient décroché sans atteindre le diplôme contre 12 % des jeunes entrés en IUT (8).
• Les conditions d’insertion professionnelle
Les conditions d’insertion professionnelle des titulaires d’un BTS et d’un DUT restent, malgré la crise, relativement avantageuses.
– En ce qui concerne le taux d’emploi, au 1er février 2013, 61,4 % des sortants de lycée ayant obtenu un BTS à la session 2012 avaient un emploi ; cette part était de 67,1 % un an auparavant. À titre de comparaison, l’an dernier, le taux d’emploi des sortants de lycée titulaires d’un baccalauréat professionnel n’était que de 46,5 %.
Ce taux dépend cependant fortement du secteur et de la spécialité. Ainsi, le taux d’insertion des titulaires d’un BTS du domaine de la production atteint 81,2 %, alors qu’il n’est que de 75,2 % dans les spécialités de services, mais les disparités sont fortes à l’intérieur des spécialités des deux domaines. À titre d’illustration, les écarts vont de 90,5 % en « santé » et de 87 % en « structures métalliques » à 73,3 % en « hôtellerie-restaurant » et 65,2 % en « secrétariat ».
Quant aux titulaires de DUT qui ne poursuivent pas leurs études, 88 % des diplômés de 2010, interrogés trente mois après l’obtention de ce diplôme, avaient un emploi. Cette proportion atteignait 95 % en « réseaux et télécommunications » et 94 % en « génie civil » et en « génie industriel et maintenance ». Elle était la plus faible en « services et réseaux de communication » (68 %) et en « hygiène-sécurité-environnement » (79 %) (1).
– En ce qui concerne les conditions d’emploi des titulaires de BTS ou de DUT, celles-ci sont restées stables en dépit d’une conjoncture économique difficile : ces diplômes bac+2 ont réellement joué leur rôle « protecteur ».
Les enquêtes du Centre d’études et de recherches sur les qualifications montrent ainsi que 70 % des diplômés de BTS et DUT en 2010 ont accédé rapidement à l’emploi (en moins de trois mois), même s’ils sont moins souvent en situation d’emploi que leurs homologues sortis en 2004 (le taux de chômage de ces jeunes atteint 14,4 % contre 8,5 % auparavant) (9). En outre, après trois ans, le taux des emplois à durée indéterminée est resté inchangé entre les diplômés 2004 et les diplômés 2010, c’est-à-dire égal à 78 %. Il en est de même pour la part des emplois de niveau cadre ou profession intermédiaire (58 %) et le salaire net médian, à dix euros près (1 460 euros pour les diplômés 2010 et 1 470 euros pour les diplômés 2004) (10).
Les données les plus récentes communiquées à la rapporteure pour avis par le ministère de l’enseignement supérieur, qui ne concernent que les BTS, semblent toutefois attester d’un recrutement de plus en plus précaire de ces diplômés. Ainsi, en février 2013, parmi les titulaires d’un BTS en situation d’emploi, 37,4 % avaient un emploi à durée indéterminée, 38,8 % un emploi à durée déterminée, 11,5 % étaient en intérim et 12,3 % bénéficiaient d’un emploi aidé.
• Les vrais gagnants face à la crise : les ex-apprentis
Le Centre d’études et de recherches sur les qualifications montre, à travers ses enquêtes « Génération », que trois ans après la sortie de formation initiale, la part des ex-apprentis disposant d’un emploi est supérieure à celle des « ex-scolaires », à tous les niveaux ou diplômes de sortie. L’avantage est un peu moins marqué pour les diplômés de l’enseignement supérieur, mais il existe toujours. Ainsi, en 2010, la part des BTS « ex-apprentis » et « ex-scolaires » ayant un emploi était respectivement de 89,2 % et 83,4 %.
Par ailleurs, outre le fait que les diplômés ex-apprentis sont beaucoup moins souvent au chômage, il convient de souligner que ceux-ci occupent des emplois « plus rémunérateurs que les non-apprentis : en 2013, quel que soit le diplôme, leur salaire net médian est supérieur de 200 euros » (1).
Le caractère « protecteur » de cette modalité de formation est d’ailleurs de plus en plus connu des étudiants : les effectifs des apprentis dans l’enseignement supérieur ont en effet progressé, sur les sept dernières années, de 71,5 %, tandis que 23 % des diplômés de BTS ou DUT sont passés par cette voie (11).
Les BTS et les IUT sont en principe destinés à accueillir des bacheliers qui se destinent à suivre des études supérieures courtes pour s’insérer immédiatement après sur le marché du travail. Ces formations ont donc vocation à accueillir des bacheliers professionnels et technologiques.
Or une grande partie de ces bacheliers sont de facto « évincés » de ces formations en vertu d’un « scénario » bien rodé de notre système d’enseignement, où le baccalauréat le plus valorisé – celui de la filière générale – tend à piloter tout le processus d’orientation et de sélection. Ainsi, les bacheliers généraux se sont « emparés » des IUT pour s’en servir comme d’un tremplin pour poursuivre leurs études, ce qui a conduit un certain nombre de bacheliers technologiques à s’orienter vers la filière STS, ce choix réduisant d’autant les places qui peuvent être proposées à leurs condisciples de la voie professionnelle.
La loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche a adopté des mesures correctrices à l’égard de ces phénomènes de « détournement ». Il faut s’en féliciter tout en soulignant que celles-ci ne régleront pas la question, essentielle pour notre pays, de l’accès d’un plus grand nombre de jeunes à un diplôme de l’enseignement supérieur.
• La situation de départ : des distorsions de flux qui s’accompagnent d’un gâchis humain
– À la rentrée 2013, l’origine scolaire des étudiants inscrits en première année de DUT était la suivante : 65,7 % étaient titulaires d’un baccalauréat général, 28,8 % d’un baccalauréat technologique et 3 % d’un baccalauréat professionnel. La situation se caractérise donc par une grande stabilité puisque ces chiffres étaient, à la rentrée 2007, de respectivement 66,6 %, 28,9 % et 1,7 % (12). Ce quasi-immobilisme prouve que les cinq millions d’euros engagés chaque année, sur les exercices budgétaires 2008 à 2011, pour inciter les IUT à accueillir plus de bacheliers technologiques n’ont eu absolument aucun effet sur ce phénomène de « détournement » même s’ils ont pu financer des actions d’accompagnement de « bacs technos » utiles.
– Parmi les étudiants inscrits en première année de STS à la rentrée 2013, 34 % avaient obtenu un baccalauréat technologique, 19 % un baccalauréat général, 27 % un baccalauréat professionnel et 20 % n’étaient pas dans l’enseignement secondaire l’année précédente, ce dernier chiffre laissant penser que pour beaucoup d’étudiants ayant échoué en première année de licence, les sections constituent une « voie consacrée » pour reprendre leurs études car l’encadrement y est plus rassurant. Par ailleurs, contrairement à la situation qui prévaut dans les IUT, cette répartition a considérablement évolué depuis 2007 : si les bacheliers technologiques restent majoritaires, leur part a tout de même diminué de 15 points entre les rentrées 2007 et 2013. Inversement, la part des bacheliers professionnels s’est accrue de 15 points entre 2007 et 2013, passant ainsi de 12,3 % à 27,4 % (1).
– Le déséquilibre des flux n’en reste pas moins patent. Or celui-ci a un effet direct sur le devenir des bacheliers professionnels : faute d’avoir obtenu une place en STS, ceux-ci sont souvent orientés par défaut vers la première année de licence pour laquelle ils ne sont pas « armés », sauf exceptions. En évoquant leur situation, le président de la Conférence des présidents d’université, M. Jean-Loup Salzmann, a estimé que ces diplômés « "échouent" – dans les deux sens du terme – à l’université » : à l’image du naufragé qui aborde une île inhospitalière, ces jeunes « atterrissent », bien malgré eux, dans un univers qui leur réserve des déconvenues. Résultat : le taux de réussite à la licence en trois ans des bacheliers professionnels est de 3,1 % seulement. En comparaison avec les étudiants issus d’un « bac » scientifique, leur chance de réussite est presque 10 fois moins élevée. De façon corollaire, en 2012-2013, le taux de passage en deuxième année de licence des bacheliers professionnels n’était que de 5,7 %, tandis que leur taux de sortie de l’université demeurait élevé (58,7 %). Or la part des primo-arrivants en première année de licence qui sont diplômés du baccalauréat professionnel ne cesse d’augmenter : elle a en effet progressé de quatre points par rapport à 2009-2010 pour s’établir à 10,3 % en 2012-2013 (13).
– La situation présente ne peut qu’être jugée avec sévérité, comme l’a fait le comité mis en place par le ministère de l’enseignement supérieur pour rédiger la stratégie nationale de l’enseignement supérieur prévue par la loi « ESR » du 22 juillet 2013. Ce dernier a en effet estimé que « la situation actuelle, où des lycéens professionnels qui souhaitent poursuivre des études supérieures dans le cadre d’une STS et se voient refusés, se retrouvent à l’université sans motivation ni pré-requis, est préjudiciable pour tous. Elle génère de la souffrance pour ces jeunes qui se retrouvent en échec à l’université, et de la colère devant l’hypocrisie d’un système où des filières plus adaptées pour la réussite de ces bacheliers les refusent car elles considèrent qu’ils ne sont pas au niveau, tandis que des filières moins adaptées leur offrent un droit d’accès qui n’est qu’un droit à l’échec » (14). Le baccalauréat professionnel étant surtout « réservé » aux milieux défavorisés
– on compte trois fois plus de titulaires de ce diplôme que du baccalauréat général chez les ouvriers (34,3 % contre 11,4 %) et un rapport inverse chez les cadres (10 % contre 36,1 %) –, on peut estimer, comme l’a fait le Syndicat général de l’éducation nationale-CFDT lors de son audition, que le contrat social proposé par la Nation à ces jeunes est totalement « faussé ».
– Il est d’autant plus faussé que la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République a réformé les dispositions encadrant le baccalauréat pour préciser que les trois types de « bac » – et non plus seulement sa version « générale » – sanctionnent « une formation équilibrée qui ouvre la voie à la poursuite d’études supérieures » (article L.333-4 du code de l’éducation). Si ces mots ont un sens, la porte ainsi ouverte aux bacheliers professionnels ne devrait pas se transformer en chausse-trappe.
• Le choix d’un outil directif, celui des « quotas »
Pour lutter contre ces phénomènes d’éviction, la loi « ESR » du 22 juillet 2013 dispose que le recteur d’académie, en tenant compte de la spécialité du diplôme préparé et des demandes enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription, prévoit « pour l’accès aux sections de techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de technologie, respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels et un pourcentage minimal de bacheliers technologiques ainsi que des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes ». Elle ajoute que « les pourcentages sont fixés en concertation avec les présidents d’université, les directeurs des instituts universitaires de technologie, les directeurs des centres de formation d’apprentis et les proviseurs des lycées ayant des sections de techniciens supérieurs » (article L. 612-3 du code de l’éducation).
L’autre « droit d’accès » prévu par la loi du 22 juillet 2013
La loi « ESR » a prévu un second dispositif de quotas. Elle dispose en effet que, sur la base de leurs résultats au baccalauréat, « les meilleurs élèves par filière de chaque lycée bénéficient d’un droit d’accès dans les formations de l’enseignement supérieur public où une sélection peut être opérée » – les STS et les IUT étant de fait concernés. Elle a en outre précisé que le pourcentage des élèves bénéficiant de ce droit d’accès est fixé chaque année par décret – soit 10 % pour l’année 2014 en vertu du décret n° 2014-610 du 11 juin 2014 –, le recteur réservant dans ces formations un contingent minimal de places au bénéfice de ces bacheliers (article L. 612-3-1 du code de l’éducation).
La mise en œuvre de ce dispositif a été précisée par le décret n° 2014-791 du 9 juillet 2014 et la note aux recteurs d’académie du 23 janvier 2014.
Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche n’a pas fourni de tableau récapitulatif des « quotas » arrêtés par les recteurs, au motif que ceux-ci varient fortement d’une académie à l’autre et d’une spécialité à l’autre. Cependant, il semble que la politique d’orientation privilégiée des bacheliers professionnels et technologiques ait effectivement donné lieu à de « bonnes pratiques ». À titre d’exemples, on peut citer :
– la fixation des pourcentages par territoire, sur la base d’un diagnostic fondé sur l’observation des flux au cours des trois dernières années, et la définition de cibles à échéance de deux ou trois ans en fonction des spécialités et des spécificités territoriales (académie de Grenoble) ;
– la définition de pourcentages minimum à partir 1° de tableaux de bord élaborés par spécialité, 2° d’un « tableau de correspondance » entre « bacs pros » et STS établi par les corps d’inspection et retenant trois catégories – bonne correspondance, correspondance possible et correspondance non recommandée ou inexistante – pour tenir compte de la spécificité de chaque site et 3° des pourcentages de bacheliers professionnels effectivement présents à la rentrée 2013 dans chaque spécialité ;
– la réalisation de travaux sur les déterminismes psycho-sociaux et les déterminismes géographiques pour définir le public visé, à savoir les élèves qui vivent dans des milieux peu « porteurs » d’un point de vue socio-économique ou géographique pour lesquels une action volontariste est nécessaire (cas du service statistique du rectorat de Clermont-Ferrand en association avec l’INSEE) ;
– l’élaboration d’un outil numérique « STS » qui gère les informations sur les places vacantes, sur les entrées et parcours en STS et permet de repérer les possibilités d’accueil de bacheliers professionnels en STS (académie de Nice).
Corrélée à l’adoption d’une communication ciblée en direction des lycéens des voies technologique et professionnelle, cette politique commence à produire ses effets « correcteurs », comme le montrent les données de la session 2014 d’APB. Ainsi, sur les 101 198 candidats titulaires d’un baccalauréat professionnel (86 097 en 2013), 79 537 (soit 79 %) ont fait porter leur premier vœu sur un BTS ou un BTS agricole (70 092 en 2013). Le nombre de propositions d’admission en BTS/BTSA faites aux candidats d’une terminale professionnelle s’est en outre accru de 12,5 % (+ 4 761). Par ailleurs, sur les 126 832 candidats titulaires d’un baccalauréat technologique (125 032 en 2013), 24 823 (soit 20 %) ont fait porter leur premier vœu sur un DUT (contre 22 518 en 2013, soit 18 %). Le nombre de propositions en DUT faites aux candidats d’une terminale technologique s’est également accru, mais de 6 % seulement (+ 878) (15).
Parallèlement à ces mesures, un travail sur les passerelles entre la licence et les STS et IUT a été engagé dans certaines académies au profit des étudiants en échec en première année à l’université. À cet égard, deux dispositifs ont suscité l’intérêt de la rapporteure pour avis : d’une part, l’organisation d’une rentrée décalée en STS, au second semestre de cette formation, afin d’obtenir le BTS en dix-huit mois ; d’autre part, la mise en place d’un semestre d’adaptation à l’entrée de l’IUT pour que l’étudiant puisse préparer, sur 2,5 ans, et donc de façon sereine, le diplôme. Ils gagneraient, s’agissant des BTS, à être développés dans le cadre des conventions que la loi « ESR » du 22 juillet 2013 impose de conclure entre chaque lycée public disposant au moins d’une formation d’enseignement supérieur et une ou plusieurs universités, d’autant que ce nouvel outil a pour but de « prévoir des rapprochements dans le domaine pédagogique » et de « faciliter les parcours de formation des étudiants » (article L. 612-3 du code de l’éducation).
• Les critiques formulées devant la rapporteure pour avis
Déjà fort débattu au moment de l’examen du projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche, l’outil des « quotas » reste contesté, à des degrés divers :
– Le volontarisme des recteurs conduit parfois à retenir des pourcentages de bacheliers professionnels « calqués » sur ceux des candidats souhaitant intégrer telle ou telle spécialité de STS : comme le quota « suit » la demande, cela permet d’afficher, dans certains cas, un pourcentage de « bac pro » égal à 100. Or, en empêchant la mixité des publics de bacheliers ou même seulement en la freinant, cette politique peut conduire à une surreprésentation, au sein de la formation, de l’apprentissage par le geste, que connaissent bien les étudiants issus de la voie professionnelle, au détriment d’une approche plus conceptuelle à laquelle ont été habitués les élèves des filières technologiques. Certaines compétences pourraient être ainsi « désapprises » pour reprendre le terme employé par l’Association des professeurs techniques chefs de travaux.
– Le « remplissage » des « quotas » de bacheliers technologiques en IUT se heurtera à un réel problème de vivier dans plusieurs spécialités industrielles. Dans certains cas, il est en effet matériellement impossible d’aller au-delà d’un objectif de 40 % de bacheliers technologiques, ce problème pouvant être aggravé dans les zones rurales : ainsi, dans un département comme l’Allier, selon le président de l’Union nationale des présidents d’IUT, M. Jean-Paul Vidal, le vivier n’existe tout simplement pas… Le rééquilibrage des flux entrants de « bacs généraux » et « technos » dans les instituts demandera donc du temps, ne serait-ce que pour effacer les effets de la baisse des effectifs de ces derniers bacheliers, qui sont passés de 140 700 en 2006 à 125 000 en 2012.
– À plus long terme, une politique rigide de quotas pourrait avoir des effets déstabilisants sur la structure sociale et le marché du travail. C’est en tout cas l’analyse des représentants du MEDEF pour qui une augmentation massive des « bac+2 » pourrait créer des problèmes de recrutement au niveau des emplois d’ouvrier qualifié, tout en retirant, pendant la durée de la formation, autant de cotisants pour notre régime de protection sociale. Cette observation rejoint une problématique plus large, apparue lors des auditions et qui concerne la cohérence des objectifs que se fixe la Nation en termes de qualification de ses jeunes.
À la suite de l’adoption de la Stratégie de Lisbonne, la France s’est fixée, en 2005, puis de nouveau en 2013, un objectif de 50 % d’une classe d’âge diplômée de l’enseignement supérieur. Elle s’approche assez rapidement de cette cible car le pourcentage d’une classe d’âge obtenant un tel diplôme en formation initiale était égal en 2012 à 45,9 % contre 38 % en 2003 (16).
Cependant, le « score » de notre pays doit être relativisé. Il n’intègre pas seulement les diplômés du niveau licence (bac + 3) – le palier de référence du système européen de l’enseignement supérieur – mais aussi les diplômés à bac + 2 qui suivent des formations technologiques ou paramédicales. En outre, la politique de montée en gamme de l’économie, le développement de l’industrie de la transition écologique et énergétique et l’expansion du numérique nous conduisent, comme l’a reconnu le comité pour la stratégie nationale de l’enseignement supérieur, « à anticiper des besoins peut-être encore supérieurs de diplômés de haut niveau » (17). Ainsi, France Stratégies, le Commissariat général à la stratégie et à la prospective, a retenu comme objectif un taux de titulaires d’un diplôme de niveau bac + 5 égal à 21,5 % en 2020, contre 17,6 % en 2010. De même, la Conférence des directeurs d’écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI) a identifié un besoin de formation de 13 000 diplômés supplémentaires par an.
Or l’objectif, affirmé dès 1989 et confirmé par loi « Fillon » de 2005 puis par la loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l’école de la République, d’amener 80 % d’une classe d’âge au niveau du baccalauréat contredit cette ambition (18). En effet, la progression de l’accès à ce diplôme, depuis les années 1990, s’est faite essentiellement par l’augmentation des bacheliers professionnels et la stagnation des bacheliers généraux, comme le montre le graphique ci-dessous.
ÉVOLUTION DE LA PROPORTION DE BACHELIERS
DANS UNE GÉNÉRATION SELON LE TYPE DE « BAC » DEPUIS 1970
(en %)
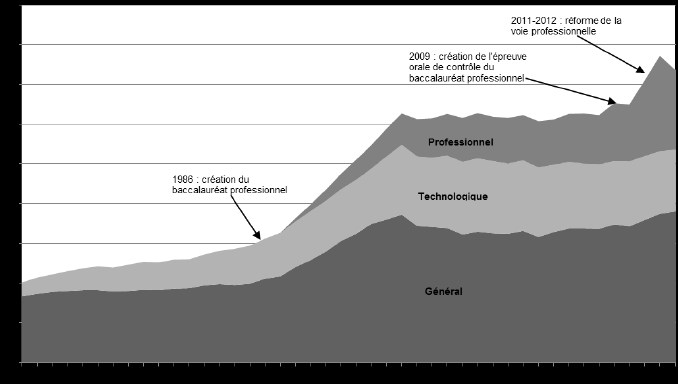
Sources : MENESR DEPP / système d’information OCEAN et enquête n° 60 sur les résultats définitifs du baccalauréat ; système d’information du ministère en charge de l’agriculture ; MENESR-INSEE / estimations démographiques.
Autrement dit, nous atteindrons certainement l’objectif des 80 % mais sans que cette évolution, en raison de l’échec massif des bacheliers professionnels dans l’enseignement supérieur, nous aide à accroître le niveau de qualification de la population et à atteindre la cible des 50 % de diplômés du supérieur.
Pour le président de la commission de la formation de la Conférence des présidents d’université, M. Gilles Roussel, tel qu’il est mis en œuvre depuis de longues années, l’objectif des « 80 % » est, de ce fait, en inadéquation avec nos ambitions scientifiques et industrielles.
Mais il y a plus grave : la démocratisation – toute relative on l’a vu – du baccalauréat a pu faire croire qu’elle entraînerait celle de l’enseignement supérieur long – alors que celui-ci « réserve » ses diplômes aux bacheliers généraux et voue les bacheliers professionnels à l’échec. En ce sens, l’objectif des 80 % a pu « leurrer » certains jeunes quant à leurs chances de réussite à l’université alors que celle-ci n’est aucunement préparée à les accueillir.
C’est pourquoi les quotas ne suffiront pas à régler le double problème d’un accès démocratisé aux études supérieures et de l’élévation du niveau de qualification. Ces mesures – nécessaires mais insuffisantes – devraient être complétées par trois politiques de long terme, formant un tout :
– une politique d’accroissement du nombre de bacheliers technologiques et généraux. Pour ce faire, il conviendrait, selon le Syndicat général de l’éducation nationale-CFDT, de se fixer des objectifs en termes de types de bacheliers formés et d’augmenter, à partir de là, la part des bacheliers généraux issus des milieux sociaux les plus exclus de ce diplôme ;
– une politique d’assouplissement des parcours de formation à l’université pour les bacheliers technologiques et professionnels motivés, ainsi que le préconise le comité pour la stratégie nationale pour l’enseignement supérieur. Les expériences réussies d’allongement des cursus (étalement de la première année de licence sur deux ans), qui permettent d’offrir des compléments de formation pour ceux qui en ont besoin pour réussir, devraient être, en conséquence, étendues à l’ensemble des établissements ;
– une politique d’encouragement à la reprise d’études, qui favoriserait ainsi la mobilité sociale à moyen ou long terme, en convainquant les familles que tout n’est pas joué à l’âge dix-huit ans, vingt ans ou vingt-cinq ans. Le MEDEF a cité, à titre d’illustration, les parcours visant à préparer le BTS proposés par l’ANFA, le formateur de la branche services de l’automobile, aux bacheliers professionnels ayant deux années d’expérience en entreprise. De même, les responsables du réseau des IUT entendus par la rapporteure pour avis ont fait part de leur souhait de redéfinir les DUT par « blocs de compétences » afin que ces diplômes puissent être obtenus plus facilement dans le cadre de la formation tout au long de la vie.
En prévoyant l’institution de quotas pour les bacheliers technologiques en IUT, le législateur a implicitement fixé à ces composantes universitaires une mission d’accompagnement de ces jeunes. Or, depuis le vote de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités (dite loi « LRU »), les moyens des instituts sont de plus en plus contraints.
Les IUT ont longtemps bénéficié d’une position privilégiée au sein des universités. La loi « Savary » du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur a reconnu que les instituts et écoles faisant partie de l’université disposent, « pour tenir compte des exigences de leur développement, d’une autonomie financière » (article L. 713-9 du code de l’éducation). Ces dispositions n’ont pas été modifiées par la loi « LRU » de 2007, mais les conditions de leur mise en œuvre ont été profondément modifiées.
En effet, jusqu’en 2007, au titre de cette autonomie de gestion, les IUT recevaient de la part de l’État des crédits « fléchés ». Depuis lors, ces crédits ont disparu dans le « budget global » dont sont dotées, sur le fondement de la loi « LRU », les universités ayant accédé aux responsabilités et compétences élargies, ces établissements pouvant désormais redistribuer librement les moyens qui leur sont alloués entre leurs différentes composantes. Dans certains cas, ce contexte nouveau a incité des présidents d’université à « rogner » sur les budgets des IUT au profit des unités de formation et de recherche (UFR). L’adoption le 20 mars 2009 d’une circulaire du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche invitant les universités à conclure des contrats d’objectifs et de moyens (COM) avec leurs IUT n’a pas suffi à apaiser toutes les tensions qui au plan local se sont faites jour – en raison, il est vrai, du peu d’empressement de certaines universités à « jouer le jeu ».
Les IUT ont donc été contraints de mobiliser une partie de leurs ressources propres pour être en mesure d’assurer le financement des heures d’enseignement qui correspondent à leurs programmes pédagogiques nationaux (PPN), soit 1 800 heures par an dans les spécialités industrielles et 1 620 heures dans celles des services. Or, malgré ces efforts, beaucoup d’instituts, selon l’Assemblée des directeurs d’IUT, ne parviennent pas à respecter les volumes horaires de leurs maquettes pédagogiques. Dans l’exemple d’un IUT de la région parisienne cité par M. Rachid Zouhhad de SupAutonome FO, cette composante n’arrive à « couvrir » que 77 % de son programme.
En outre, les IUT étant contraints à des arbitrages serrés depuis 2007, ils peuvent être amenés à réduire les moyens consacrés à l’accompagnement des étudiants – c’est le cas par exemple des heures « tutorées » mises en œuvre à l’IUT de Rouen d’après le témoignage de Mme Estelle Yven du Mouvement des étudiants –, voire à supprimer de tels dispositifs. Ainsi, l’IUT de la région parisienne déjà mentionné a dû renoncer à donner à certains étudiants la possibilité de préparer le DUT en trois ans ou d’effectuer des rentrées décalées.
Pour la Conférence des présidents d’université, cette situation tient au fait que les établissements sont placés dans une situation budgétaire difficile qui n’a pas été assez prise en compte par les IUT au moment de la dernière réforme des programmes pédagogiques nationaux.
La gestion intelligente de ressources plus rares suppose donc un dialogue plus structuré, qui anticipe sur les besoins de financement liés à l’accueil d’un plus grand nombre de « bacs technos ». Celui-ci devrait pouvoir s’appuyer sur les outils mis en place sur le fondement de la loi « ESR » du 22 juillet 2013.
La loi « ESR » du 22 juillet 2013 dispose que le président de l’université, selon des modalités fixées par les statuts, « conduit un dialogue de gestion avec les composantes, afin que soient arrêtés leurs objectifs et leurs moyens » et précise que ce dialogue peut prendre la forme d’un contrat d’objectifs et de moyens (COM) conclu entre l’établissement et ses composantes.
Sur cette base juridique, deux décrets ont été adoptés l’été dernier pour préciser les modalités d’élaboration des COM et donner ainsi aux instituts l’assurance que leur point de vue sera bien pris en compte.
– D’une part, le décret n° 2014-604 du 6 juin 2004 relatif au budget et régime financier des établissements d’enseignement supérieur et de recherche prévoit que lorsqu’un tel contrat est conclu entre l’université et un institut ou une école interne disposant d’un budget propre, celui-ci « porte au moins, pour l’ensemble des formations dispensées, sur les emplois alloués par l’établissement, les ressources de la composante, les dépenses de fonctionnement générées par son activité, ses charges d’enseignement et sa participation aux charges communes de l’établissement ».
– D’autre part, le décret n° 2014-825 du 21 juillet 2014 précise que le COM est passé entre chaque établissement public d’enseignement supérieur et chacun de ses IUT et qu’en outre, ce contrat est pluriannuel et modifiable chaque année par avenant, en cohérence avec le dialogue de gestion et les grandes orientations budgétaires de l’université. Il dispose en outre que ce contrat « concourt à la réalisation des programmes pédagogiques nationaux » du DUT.
Pour les représentants de l’Assemblée des directeurs d’IUT, ces textes constituent des « garde-fous » car ils seront « opposables » aux universités et renforceront, de ce fait, leur capacité de négociation. Ils ont donc « l’espoir » que ces nouveaux outils leur permettront de « remonter » le nombre d’heures d’enseignement pour atteindre les volumes définis par les maquettes pédagogiques et d’organiser un accompagnement renforcé des bacheliers technologiques.
Les quelque 50 000 DUT et 120 000 BTS délivrés chaque année permettent-ils de satisfaire les besoins de recrutement de cadres techniques de nos entreprises ? Dans le domaine de l’industrie, il semble que ce ne soit plus le cas, alors même que les perspectives d’emploi y sont favorables.
Les jeunes se détournent en effet d’un secteur économique dont le déclin est jugé définitif et dont les métiers sont souvent associés au travail manuel. Sur ce dernier point, une enquête de l’IFOP publiée en 2013 a montré que les « préjugés liés à l’industrie restent tenaces » chez les 18-25 ans puisqu’on retrouve, parmi les qualificatifs qu’ils lui associent, les mots « travail à la chaîne », « pénibilité » (81 %) et « saleté » (55 %). De même, d’après un sondage de l’Association française pour le développement de l’enseignement de la formation technique publié la même année, plus de 40 % des collégiens de quinze ans associent les termes « ouvrier » et « employé » aux métiers industriels, ce qui conduit seulement 14 % de ces jeunes à envisager de s’orienter vers les métiers de l’industrie (19).
Or, contrairement aux idées reçues, ce secteur ne cessera pas, à court comme à moyen terme, d’être un vivier d’emplois qualifiés. Ainsi, selon un rapport de la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère du travail et de l’emploi, les trois « familles » professionnelles que constituent les ingénieurs de l’informatique, les personnels d’étude et de recherche, les ingénieurs et les cadres techniques de l’industrie pourraient offrir, au total, 200 000 créations nettes d’emplois sur les dix prochaines années. En outre, les professions intermédiaires devraient bénéficier de nombreuses créations de postes, « nettes » et liées au remplacement des départs en retraite, notamment pour les techniciens et agents de maîtrise de l’industrie et de la maintenance (20).
Pourtant, ce sont précisément ces métiers qui connaissent aujourd’hui des difficultés de recrutement. Le Conseil d’orientation en emploi en a d’ailleurs dressé la liste, sur laquelle figurent les techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques (dessinateurs en mécanique et travail des métaux, agents de maîtrise et assimilés en fabrication mécanique), les techniciens et agents de maîtrise de l’électricité et de l’électronique (dessinateurs en électricité et mécanique) et les techniciens et agents de maîtrise de la maintenance (21). C’est ce constat qui a fait dire aux représentants du MEDEF que le secteur de la métallurgie ne serait pas en mesure de recruter, d’ici 2020, les 20 000 jeunes dont cette branche a besoin pour occuper des emplois intermédiaires.
Par ailleurs, la faible attractivité des métiers de l’industrie se conjugue au phénomène des poursuites d’études, qui sera évoqué plus loin, pour aggraver ce qui s’apparente à une véritable « crise du recrutement » au niveau bac + 2 pour les entreprises. En effet, pour les représentants du Syndicat national des professeurs chefs de travaux, la proportion croissante d’étudiants poursuivant leurs études réduit le vivier de diplômés disponibles pour occuper des emplois de ce niveau de qualification et tend à remettre en cause la cohérence globale entre les formations de BTS et les besoins de compétences des acteurs économiques.
Pour répondre à la demande de nos entreprises, il faudrait, comme l’a souligné le président de la Conférence des présidents d’université, M. Jean-Loup Salzmann, que notre système d’enseignement puisse « mettre le paquet » sur la formation d’un plus grand nombre de bacheliers technologiques, en persuadant les élèves qu’ils pourront exercer, à l’issue de cette formation, des métiers d’avenir, à forte composante numérique. À cet effet, le travail accompli par les différents observatoires prospectifs des métiers et des qualifications devrait être plus largement diffusé, en lien avec les analyses des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et des conseils paritaires interprofessionnels régionaux pour l’emploi et la formation.
Confrontés à trois enjeux lourds de conséquences pour leur avenir, les filières technologiques courtes doivent, de surcroît, relever, « en amont » et « en aval », d’importants défis. Certains d’entre eux conduisent à s’interroger sur le positionnement et la qualité des BTS et des DUT.
Une meilleure régulation des « flux » de bacheliers technologiques et professionnels vers les STS et les IUT implique, par-delà le recours aux quotas, la mise en œuvre une politique d’orientation plus fine de ces élèves. Celle-ci devrait être, en principe, facilitée par les procédures de préinscription et d’orientation active définies par la loi « LRU » du 10 août 2007.
Cette loi a en effet imposé aux candidats à une première inscription dans un établissement d’enseignement supérieur d’accomplir préalablement une formalité administrative : la préinscription dans le ou les établissements de leur choix, laquelle doit leur permettre de bénéficier du « dispositif d’orientation et d’information dudit établissement établi en concertation avec les lycées » (article L. 612-3 du code de l’éducation).
Cette formalité a pour but de permettre aux établissements d’informer et orienter les candidats ayant exprimé un vœu d’inscription. Il s’agit, d’une part, de donner aux candidats les éléments pertinents leur permettant d’apprécier l’intérêt d’une inscription dans l’établissement et l’adaptation de la formation demandée à leur projet personnel et à leurs capacités et, d’autre part, de faire connaître les capacités d’accueil de l’unité de formation, les modalités de déroulement du cycle et les débouchés ouverts par un tel choix d’orientation.
Or, alors que la procédure d’orientation pouvait reposer, avant la loi « LRU », sur des entretiens individuels entre les élèves et des représentants des filières – on observera, à cet égard, que 63 % des lycéens de terminale aimeraient rencontrer des enseignants du supérieur pour évoquer leurs choix (22) –, celle-ci, pour de nombreux jeunes, se confond désormais entièrement avec l’application APB, le portail national de coordination des admissions dans l’enseignement supérieur.
Le fonctionnement de ce dispositif est le suivant, en prenant comme exemple le calendrier prévu pour l’année 2015 : ouverture du site d’information pour les candidats en décembre 2014 ; formulation des vœux par les candidats de janvier à mars 2015 ; phase d’orientation active par les établissements à partir du 20 janvier 2015 ; début avril 2015, date limite de modification des dossiers, de validation et d’impression des fiches de vœu puis envoi des dossiers « papier » par les candidats ; consultation par les candidats de l’avis des établissements sur leur dossier début mai 2015 ; classement des vœux des candidats du 20 janvier au 31 mai 2015.
Cette « mécanique » a été critiquée sur plusieurs points par les représentants étudiants entendus par la rapporteure pour avis. Tout d’abord, selon le témoignage de la présidente de la Fabrique étudiante, Mme Cindy Pétrieux, il semble que les dates butoirs ne soient pas toujours communiquées suffisamment à l’avance aux lycéens de terminale pour que ceux-ci puissent affiner leurs choix. Ensuite, les professeurs de ce niveau d’enseignement se font les « ambassadeurs » de leur discipline et n’informent pas assez leurs élèves sur la variété des filières du supérieur. Surtout, ils ne disent pratiquement rien sur l’importance de la hiérarchie des vœux alors que celle-ci joue un rôle décisif dans le classement établi par les établissements et, par la suite, dans l’affectation dans une filière qui n’était que souhaitée « par défaut ». Cette méconnaissance conduit les élèves à ne pas définir de réelles priorités mais à multiplier le nombre de vœux – jusqu’à une vingtaine – pour être sûrs d’être pris dans une formation.
En outre, comme de nombreux lycées ne « travaillent » pas assez la question de l’orientation, ses enjeux, aux yeux d’un grand nombre d’élèves, d’enseignants et de parents d’élèves, se résument, de fait, à l’« inscription » sur APB. Et au final le mauvais usage qui peut en être fait nourrit de l’anxiété au début du processus – quand il faut cocher de nombreuses cases – et du dépit lorsque celui-ci s’achève sur un choix de cœur qui n’est pas retenu. Ce dispositif est d’ailleurs perçu par les représentants étudiants non comme un réel outil d’orientation mais comme un outil de gestion des flux par les établissements.
Le caractère insatisfaisant de cette situation a conduit le président de la Conférence des présidents d’université, M. Jean-Loup Salzmann, à préconiser, lors de son audition, l’instauration d’une procédure « prescriptive » entre le lycée et l’université, à l’image de ce qui existe pour le passage entre la première et la terminale.
Une évolution aussi radicale, qui remettrait en cause le principe de la liberté d’inscription dans l’établissement d’enseignement supérieur de son choix, ne serait sans doute pas acceptable d’un point de vue social. Mieux vaut donc expliciter le fonctionnement du dispositif APB et diffuser les « bonnes pratiques » d’orientation dans les lycées, dont certaines sont reprises dans l’encadré ci-dessous. Mais cela suppose que les professeurs du secondaire s’emparent de la mission d’orientation qui leur a été confiée par le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service des personnels enseignants. En effet, ce texte, tout en confirmant les maxima hebdomadaires de service définis en mai 1950, reconnaît l’existence – c’est une première – de « missions liées au service d’enseignement » qui comprennent « les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d’enseignement, l’aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d’orientation en collaboration avec les personnels d’éducation et d’orientation, les relations avec les parents d’élèves, le travail au sein d’équipes pédagogiques » (23) .
Exemples de bonnes pratiques en matière d’orientation
– Travail sur l’orientation dès la seconde, en seconde professionnelle, par la mise en place d’une période de détermination de quelques semaines, au cours de laquelle les élèves découvrent des spécialités relevant du même champ professionnel ou de champs professionnels différents.
– Recours au numérique pour toucher, par Web conférence ou Web TV, le plus grand nombre de lycéens et leur présenter les formations offertes dans l’enseignement supérieur. C’est le cas du programme ESCAPADE, qui vise à faire découvrir l’université aux lycéens d’établissements ruraux.
– Organisation de visio-conférences sur l’enseignement supérieur : initié à la demande d’une faculté de médecine, le principe de visioconférences destinées aux lycéens de première et terminale s’est progressivement développé pour couvrir l’essentiel du champ des formations supérieures proposé en région.
– Développement d’une application « Objectif’Sup » qui s’adresse aux élèves de première et les aide à définir leur projet d’orientation.
– Création d’un outil proposé aux lycées pour les élèves de première et de terminale : la fiche APRES (Accompagner le Parcours vers la Réussite des Études Supérieures) qui balise le parcours de recherche d’information du lycéen et met en évidence les étapes incontournables.
– Développement d’une application académique « CAP SUP », outil de mise en relation du secondaire et du supérieur au service des lycées, qui permet aux établissements accueillant des formations supérieures de proposer des périodes d’immersion, individuelles ou collectives, des moments d’informations, des conférences.
– Organisation de forums d’information et d’orientation à travers un maillage géographique plus fin que l’académie pour toucher tous les territoires et présenter l’offre de STS, classes préparatoires et de filières universitaires.
Le lycée professionnel et le lycée technologique ont connu, sous la précédente législature, deux grandes réformes. Intervenue à la rentrée 2009, la rénovation de la voie professionnelle a raccourci de quatre à trois ans la durée de formation nécessaire à l’obtention d’un baccalauréat professionnel dans le but de « l’aligner » sur celle des autres baccalauréats. Quant à la réforme de la filière technologique, qui s’est étalée sur plusieurs années, elle a consisté à réorganiser les spécialités proposées autour de grands « champs » de connaissances – la classe de première comporte désormais huit séries depuis la rentrée 2012 – pour renforcer l’attractivité de la filière « industrielle », qui subissait un effondrement de ses effectifs, et mieux différencier le « bac techno » du « bac pro », le premier étant plus clairement identifié comme un passeport vers la poursuite d’études.
Le moins qu’on puisse, au sujet de la qualité de ces nouveaux « bacs », est que celle-ci ne fait pas l’unanimité. L’accueil de leurs titulaires demandera donc, de la part des STS et IUT, un important effort d’accompagnement.
• Une appréciation contrastée
Le point de vue des responsables de STS à l’égard des « flux » accrus de bacheliers professionnels attendus dans la filière est nuancé. Si certains se félicitent de leur arrivée qui permettra de « rentabiliser » les plateaux techniques des lycées, souvent sous-utilisés en raison du manque d’étudiants dans le domaine industriel et de la réduction des heures d’atelier liée à la réforme des lycées (24), d’autres, comme les représentants de la Fédération de l’enseignement privé (FEP)-CFDT, s’inquiètent de leur niveau, au motif que le nouveau « bac pro » leur aurait fait perdre « l’habitude du travail » pour reprendre leurs propos. Cette situation est due au fait que le jeu actuel des coefficients rend possible l’obtention de ce diplôme en concentrant les efforts sur les matières professionnelles et les stages et en délaissant les matières générales telles que le français, les langues étrangères, les mathématiques et l’histoire-géographie. L’entrée en STS peut donc constituer une « rupture qualitative » pour ces bacheliers, d’autant que la « déperdition » entre la première et la deuxième année peut concerner jusqu’à 30 % des effectifs. À l’inverse, les représentants de FO ont considéré que la mixité des compétences résultant de la cohabitation des « bacs pratiques » et « conceptuels » créait une dynamique positive dans les classes.
Le jugement porté sur les « bacs technos », en particulier sur ceux de la nouvelle série STI2D (sciences et technologies de l’industrie et du développement durable), censée former les techniciens de notre industrie, est-il plus favorable ? On ne dispose pas d’assez de recul pour se prononcer de manière définitive car les premières promotions de ce « bac rénové » accueillies en IUT ne sont entrées que l’année dernière. En revanche, le « ressenti » des interlocuteurs de la rapporteure pour avis est dénué de toute ambiguïté. Ainsi, l’impression qui prévaut est celle d’un affaiblissement des compétences technologiques. Pour les responsables de l’Assemblée des directeurs d’IUT, le « profil » de ces bacheliers s’approche de celui des titulaires de baccalauréat général, la maîtrise du geste ayant cédé le pas à une approche plus conceptuelle. Les représentants du Syndicat national des personnels de la recherche et de l’enseignement supérieur-FO ont eu une opinion beaucoup plus tranchée, en considérant que le baccalauréat technologique est un « bac sans technologie ».
• Des mesures à généraliser pour favoriser la réussite des publics fragiles en STS et IUT
La palette des aides proposées aux étudiants « fragiles » de STS et d’IUT devrait être élargie pour éviter que la politique des « quotas » ne favorise, au final, l’échec ou le décrochage des « bacs rénovés » dans ces filières.
En ce qui concerne les STS, une politique d’accompagnement renforcé de ces bacheliers pourrait reposer sur les quatre piliers suivants :
– le recours à des bilans de compétences en fin de premier semestre pour identifier les étudiants en difficulté ;
– l’institution de « modules-passerelles » entre les lycées et les STS et d’un tutorat des primo-arrivants dans ces sections. Présentées par Mme Christine van Lerenberghe, la vice-présidente de l’Union nationale de l’enseignement technique privé, ces mesures se complètent en effet utilement. La première consiste à accompagner le jeune sur la durée de la terminale professionnelle et la première année de BTS, ce soutien pouvant représenter, par exemple, une à deux heures par semaine pendant le second semestre de l’année de terminale. Une version plus élaborée de ce dispositif, intitulée « Bac Pro + », propose un tel accompagnement sur les trois années qui vont de la terminale à la deuxième année du brevet. La seconde mesure consiste à confier le tutorat du nouveau bachelier à des étudiants de deuxième année de BTS ;
– une stratégie d’orientation des bacheliers professionnels qui tienne compte du fait que le passage de l’enseignement secondaire au BTS se fait d’autant mieux que le lycée accueille les deux formations. Ainsi que l’a observé Mme van Lerenberghe, ces parcours facilitent les rencontres entre les deux équipes de professeurs qui auront à prendre en charge, en se succédant dans le temps, l’élève de la voie professionnelle ;
– de façon corollaire, le développement d’échanges de service entre les professeurs d’université et ceux de BTS en lycée. Selon le Syndicat national des personnels de direction de l’éducation nationale-UNSA, cette mesure est en effet indispensable pour favoriser la construction de « sas de formation » qui permettent aux bacheliers professionnels en échec en première année de licence de rattraper la formation commencée en STS.
La mise en œuvre d’une telle politique pourrait se heurter à l’écueil du manque de moyens horaires pour les professeurs de STS. Les référentiels de ces formations devraient donc être ajustés pour augmenter les heures consacrées aux dispositifs d’accompagnement qui peuvent, aujourd’hui, faire figure de « parents pauvres » des parcours proposés. Mais il est vrai aussi que la généralisation rapide des bonnes pratiques d’ores et déjà mises en œuvre – certains BTS, par exemple en biotechnologie, prévoient ainsi trois heures par semaine de remise à niveau – se heurte au temps nécessaire pour mener à bien le processus de refonte des formations au sein des commissions consultatives professionnelles, tous les professeurs n’étant pas encore prêts à sacrifier des heures d’atelier au prix d’un soutien accru des publics fragiles…
Du côté des IUT, les moyens consacrés au tutorat et aux dispositifs qui permettent d’obtenir le DUT en deux ans et demi ou trois ans devraient être, dans un premier temps, préservés, puis développés, un objectif qui devrait être inscrit au « menu » du dialogue de gestion entre l’université et les instituts.
• Le constat
Pour retracer l’évolution des poursuites d’études dans l’enseignement technologique court, le ministère de l’enseignement supérieur a analysé deux séries de données (25) :
– Les poursuites d’études après l’obtention d’un DUT ou d’un BTS deux ou trois ans après le baccalauréat se sont sensiblement accrues dans la période récente, en particulier grâce à la création de la licence professionnelle.
Ainsi, 87 % des lauréats d’un DUT, obtenu deux ou trois ans après le baccalauréat en 2008, continuent leurs études : la hausse est de 6 points par rapport à la précédente cohorte, celle de 1995. La part des diplômés de DUT préparant une licence professionnelle augmente de 23 % à 28 %, tandis que la licence générale perd de son attrait (27 % contre 31 % pour le précédent panel). En outre, parmi ceux qui s’inscrivent dans d’autres formations, une part plus importante rejoint une école : 20 % des diplômés de DUT au lieu de 14 % auparavant. Enfin, on observera que 26 % des lauréats d’un DUT qui poursuivent leurs études le font par la voie de l’alternance.
Si les poursuites d’études sont moins nombreuses après l’obtention d’un BTS, elles sont aussi en augmentation (+ 10 points) et concernent, aujourd’hui, plus de la moitié des lauréats (55 %). La hausse s’explique là aussi par la création de la licence professionnelle préparée par 24 % des titulaires d’un BTS en 2008 contre 20 % pour le panel précédent. Les poursuites d’études après un BTS se font par ailleurs de plus en plus (à hauteur de 38 %) par un contrat en alternance.
– La situation des entrants en STS ou en IUT après le baccalauréat en début de cinquième année d’études dans l’enseignement supérieur est la suivante : 52 % des entrants en IUT et 22 % des entrants en STS en 2008 sont diplômés de niveau bac+3. Par ailleurs, 56 % des étudiants entrés en IUT en 2008 sont toujours en poursuite d’études cinq ans plus tard, pour 38 % d’entre eux dans des écoles préparant à un diplôme de niveau bac+5, pour 37 % en master et pour 12 % en licence.
Un dernier élément d’information, extrait de l’enquête du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche sur l’insertion professionnelle des diplômés 2010 de l’université, montre qu’au 1er décembre 2012, soit trente mois après l’obtention du diplôme, 87 % des diplômés du DUT poursuivaient leurs études (26).
Ces tendances ont évidemment des répercussions sur la structure des sorties de l’enseignement supérieur par diplôme, ainsi que l’a constaté le Centre d’études et de recherches sur les qualifications : celui-ci observe un « déport de bac+2 à bac+3 », les effectifs de licenciés professionnels ayant plus que doublé entre les générations 2004 et 2010 (+ 118 %) (27) .
• Une tendance qui suscite des revendications
Le basculement de la finalité des diplômes de l’enseignement technologique d’un objectif d’insertion professionnelle immédiate à un objectif de poursuite d’études – beaucoup plus marqué dans le cas du DUT que dans celui du BTS – est symbolisé par l’existence des « classes préparatoires ATS ». Ne durant qu’une année, celles-ci accueillent des titulaires du DUT et du BTS pour les aider à préparer leur entrée dans une école d’ingénieurs.
Signe que le modèle du « cycle court technologique » est remis en cause, en tout cas aux yeux d’une partie significative de la communauté universitaire, les représentants de l’Union nationale des étudiants de France et de la Fabrique étudiante ont fait part à la rapporteure pour avis de leur souhait que l’obtention d’un DUT ou d’un BTS bénéficie d’une équivalence automatique dans le cycle de la licence, qui permette aux titulaires de ces diplômes d’entrer en troisième année. Aujourd’hui, la mise en œuvre de ces passerelles est loin d’être acquise car souvent les universités exigent de ces étudiants qu’ils justifient un niveau de moyenne générale relativement élevé – douze par exemple –, cette condition s’ajoutant à celle de l’obtention du diplôme bac+2.
De con côté, le Syndicat national de l’enseignement supérieur-FSU a préconisé la création d’une véritable filière technologique à l’université, qui soit « complète » et puisse amener des bacheliers généraux et technologiques jusqu’à la thèse. Aux yeux de la rapporteure pour avis, cette réflexion mériterait d’être engagée, tant les évolutions à l’œuvre paraissent irréversibles, et pourrait être confiée, comme l’a suggéré cette organisation, au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), le « parlement » des établissements universitaires et de recherche.
Avec un taux de poursuite d’études de ses diplômés qui culmine à 87 %, le caractère professionnalisant du DUT est fortement remis en question. Pour les représentants de la CGPME, ce phénomène, qui tend à « aspirer » la substance du diplôme, s’accélère et sans que cela réponde nécessairement aux intérêts financiers de ses titulaires. Ainsi, le taux d’insertion immédiate, qui s’approche du palier des 10 %, s’élevait encore à 20 % il y a trois ans, et ce alors même qu’une enquête de l’Assemblée des directeurs d’IUT a montré, en 2011, que le salaire d’un diplômé de la licence professionnelle était identique à celui d’un diplômé du DUT après un an de vie professionnelle…
Ces interlocuteurs ont d’ailleurs estimé que le système de formation est « dévoyé » dans la mesure où les étudiants tendent à retarder d’un an leur entrée dans la vie active, à chaque niveau de qualification. De fait, celui-ci ne peut que proposer des « débouchés décevants » aux PME, qui ne parviennent plus à recruter en nombre suffisant des cadres techniques.
Ce contexte a poussé les représentants de cette organisation à demander une clarification de la définition réglementaire du diplôme qui prévoit, comme cela a déjà été indiqué, que la formation délivrée vise à préparer les étudiants aux fonctions d’encadrement technique et professionnel.
De leur côté, les représentants de la Conférence des présidents d’université ont estimé que le DUT ne saurait plus être considéré comme un diplôme « homogène ». En effet, certains DUT se sont clairement spécialisés dans la poursuite d’études – c’est le cas en « mesures physiques », par exemple, où le taux de poursuite peut atteindre les 100 %. La question de leur transformation en classes préparatoires intégrées à l’université pour préparer les concours des écoles devrait donc être posée. À l’inverse, d’autres spécialités – « carrières sociales » ou « techniques de communication » par exemple – pourraient conserver leur statut de « filière professionnalisante courte », car leurs étudiants poursuivent un objectif d’insertion sur le marché du travail à bac+2. Les DUT devraient donc être « différenciés » selon deux finalités – la poursuite d’études ou l’insertion professionnelle immédiate.
Ce scénario est loin de faire l’unanimité. Pour ne citer qu’un exemple, le MEDEF ne souhaite pas que le cursus du DUT devienne une forme de classe préparatoire afin de préserver le statut de filière de proximité du réseau des instituts et le caractère « co-construit » du diplôme.
On voit que ce débat complexe rejoint la réflexion à mener sur la création d’une filière technologique complète à l’université. Notre collègue Mme Françoise Guégot avait, quant à elle, estimé que celui-ci ne devait pas être tranché de façon « autoritaire » mais mené « branche par branche, de manière à juger, en fonction des besoins du "terrain", de l’opportunité d’allonger d’une année les cursus de formation en IUT » (28).
Les représentants de la CPME ont considéré que le « fléchage » des bacheliers professionnels vers les STS risquait de conduire à une baisse du niveau du brevet de technicien supérieur. D’après ces interlocuteurs, ce scénario a été rendu possible par la réforme du baccalauréat professionnel, car le « bac pro » en trois ans – contrairement à son prédécesseur, qui faisait se succéder deux années de préparation du CAP et deux années de préparation du baccalauréat – a réduit « l’employabilité » de ses titulaires (29). Or comme c’est ce public de bacheliers qui devrait occuper, via le système des quotas, un plus grand nombre de places en BTS, la différence de « cote » entre le DUT et le BTS pourrait s’accentuer.
Pour la Fédération de l’enseignement-privé CFDT, le « décrochage » du BTS pourrait se vérifier rapidement si ses modalités d’obtention devaient accorder un poids plus important au contrôle continu en cours de formation, aujourd’hui limité à 50 %, au détriment des coefficients attachés aux épreuves nationales du diplôme. Toute réforme qui irait dans ce sens ne pourrait que rapprocher le brevet de technicien du baccalauréat professionnel et faire du premier une sorte de « super bac pro » pour reprendre les propos de ce syndicat.
Le niveau du BTS devrait donc faire l’objet d’une vigilance particulière. En effet, il ne faudrait pas que les bacheliers professionnels, après avoir subi le phénomène de l’orientation par défaut à l’université, intègrent en grand nombre les STS pour obtenir, au final, un diplôme dévalorisé.
Il n’est pas possible d’évoquer la situation des STS et des IUT sans mentionner leur implantation et par conséquent la carte des formations. Or cette problématique n’est pas sans susciter d’importantes tensions.
– Comme l’a souligné le président de la Conférence des présidents d’université, M. Jean-Loup Salzmann, « on ne peut pas avoir tout partout ». En effet, pour des raisons de prestige local, certains IUT ou départements d’institut sont créés alors même qu’ils sont dépourvus de toute vraie dimension « recherche » et s’apparentent, de ce fait, à une STS qu’il aurait été plus judicieux d’ouvrir. En outre, ce type d’implantations se heurte très vite à certaines réalités, comme le montrent – cet exemple ayant été cité par une étudiante – les déconvenues rencontrées par une antenne d’IUT ouverte en Normandie : l’absence de restaurant universitaire et l’éloignement du site font que les étudiants et les professeurs s’en détournent. Le MEDEF a également critiqué la multiplication des départements d’IUT – ils sont passés de 582 à 691 en dix ans –, car celle-ci s’est faite au détriment des STS alors que ces formations permettraient à de jeunes bacheliers professionnels issus de milieux défavorisés d’accéder à une qualification bac+2.
– Le choix des niveaux de formation à développer n’est rien moins qu’évident, d’autant que la carte des formations professionnelles initiales (« bac pro » et BTS) résulte d’une co-construction par l’État et les régions : celle-ci est en effet arrêtée par ces collectivités territoriales, mais après accord du recteur et en conformité avec le classement par ordre de priorité des ouvertures et fermetures de sections défini par une convention annuelle conclue entre ces deux partenaires. Or les priorités de l’un et des autres ne sont pas les mêmes. L’Inspection générale de l’éducation nationale et l’Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche ont observé, à cet égard, que les régions « arbitrent préférentiellement en faveur des formations d’enseignement supérieur alors que l’éducation nationale défend le besoin de maintenir des places aux niveaux IV et V » de formation, c’est-à-dire du CAP et du baccalauréat professionnel (30).
– Une dernière difficulté réside dans la tendance des élus, relevée par les deux inspections générales, « à ne pas assumer les fermetures de divisions ou d’établissements nécessaires, même lorsqu’il n’y a pas de débouchés pour les élèves ou que les effectifs sont devenus squelettiques » (1).
Il ne sera possible de résoudre ces dilemmes qu’en respectant certaines conditions rappelées par les corps d’inspection, en particulier la connaissance des débouchées réels des formations et une « action solidaire des deux principaux décideurs, fondée sur l’analyse objectivée des formations, de leur évolution et de leurs perspectives ».
Aux yeux de la rapporteure pour avis, ce pilotage global implique, du côté de l’éducation nationale, que les recteurs s’emparent des nouveaux outils de régulation que constituent les commissions académiques des formations post-baccalauréat chargées d’arrêter un schéma des formations « post-bac ». La circulaire n° 2013-0012 du 18 juin 2013 relative au renforcement du continuum de formation de l’enseignement scolaire à l’enseignement supérieur a d’ailleurs prévu que tout projet de modification de la carte des formations « post-bac » doit faire l’objet d’un avis de cette commission.
À condition que ces travaux soient réalisés en concertation avec les collectivités territoriales et en référence aux nouveaux contrats de plan régionaux de développement des formations et de l’orientation professionnelles (CPRDFOP) (31), la complémentarité des deux réseaux de formation de techniciens supérieurs pourrait être ainsi mieux assurée et répondre plus efficacement aux souhaits des étudiants et de leur famille et aux attentes du monde économique.
Mais sans doute faudrait-il aller plus loin dans cet effort de cohérence en jouant d’avantage, comme l’ont suggéré les représentants de la Conférence des présidents d’université, la « carte » de la mobilité géographique plutôt que de celle de la proximité : au lieu développer à l’infini l’offre de formation, il serait préférable de multiplier les logements étudiants pour favoriser, à l’échelle de l’académie, des choix pertinents de filière. Car au final, comme l’ont si bien dit les représentantes de la Fabrique étudiante, la proximité « qui compte » est celle qui se construit entre un jeune et l’équipe pédagogique qui l’encadre.
La Commission des affaires culturelles et de l’éducation procède le vendredi 31 octobre 2014, en commission élargie à l’ensemble des députés, dans les conditions fixées à l’article 120 du Règlement, à l’audition de Mme Geneviève Fioraso, secrétaire d’État chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche, auprès de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, sur les crédits pour 2015 de la mission « Recherche et enseignement supérieur » (32).
La Commission des affaires culturelles et de l’éducation procède à l’examen des rapports pour avis de Mme Sylvie Tolmont, sur les crédits pour 2015 de la mission « Enseignement scolaire », et de Mme Sophie Dion (Recherche), et Mme Sandrine Doucet (Enseignement supérieur et vie étudiante) sur les crédits de la mission « Recherche et enseignement supérieur », lors de sa séance du mardi 28 octobre 2014.
M. le président Patrick Bloche. Permettez-moi de rappeler au préalable quelques points de méthode. Comme vous le savez, l’examen des crédits comporte trois temps : nos dix rapports pour avis font l’objet d’une présentation et d’une discussion au sein de notre Commission, consacrées plus particulièrement aux thèmes que les rapporteurs ont choisi de traiter dans la seconde partie de leur travail ; les crédits des missions dont nous sommes saisis sont également examinés en commission élargie, avec nos collègues de la commission des finances et, le cas échéant, d’autres commissions ; puis arrive le temps de la discussion en séance publique.
Les trois rapports pour avis qui nous seront présentés aujourd’hui portent sur les crédits de missions relevant d’un même ministère, celui de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Nous avons déjà examiné en commission élargie les crédits de la mission « Enseignement scolaire », mais pas ceux de la mission « Enseignement supérieur et recherche ». Le bureau de la Commission a néanmoins considéré qu’il y avait une certaine cohérence à traiter globalement de crédits concernant l’intégralité du parcours des élèves, de l’école maternelle à l’enseignement supérieur.
Nos trois rapporteures, Sylvie Tolmont, Sophie Dion et Sandrine Doucet, ont chacune choisi de traiter une thématique spécifique afin de mettre l’accent sur un secteur ou un enjeu particulier des politiques publiques en faveur de l’enseignement et de la recherche. Leurs projets de rapports vous ont été adressés vendredi dernier et hier.
Je vais tout d’abord donner la parole à Sylvie Tolmont, qui, dans le cadre de la mission « Enseignement scolaire », a centré son rapport sur les structures d’enseignement adapté du secondaire, les sections d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) et les établissements régionaux d’enseignement adapté (EREA), qui sont des dispositifs souvent méconnus.
Mme Sylvie Tolmont, rapporteure pour avis des crédits de la mission « Enseignement scolaire ». Je commencerai par quelques éléments de contexte avant de présenter les pistes de réflexion développées dans ce rapport qui porte en effet, monsieur le président, sur les sections SEGPA et les EREA à l’heure de la refondation de l’école.
Les SEGPA et les EREA scolarisent, à partir de la classe de sixième, des élèves présentant des difficultés graves et durables d’apprentissage et ne maîtrisant pas toutes les compétences attendues à la fin du CE1.
Ces deux structures se distinguent toutefois sur un point essentiel. Les premières, qui accueillaient 94 384 élèves à la rentrée 2013, font partie intégrante des collèges. Les secondes, en revanche, sont des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) qui scolarisent des élèves – 10 250 l’année dernière – présentant des difficultés comparables à celles des élèves de SEGPA mais dont la situation personnelle justifie un hébergement en internat.
Le positionnement et le fonctionnement mêmes de ces structures contredisent deux grands objectifs corrélés que posait la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, à savoir la réaffirmation du collège unique et la promotion de l’école inclusive.
En outre, le nouveau cycle regroupant le CM1, le CM2 et la sixième remet en question la pertinence d’une orientation vers l’enseignement adapté à l’issue du CM2. C’est autour de cette première grande réflexion que s’articulent les questions posées dans ce rapport.
Toutefois, l’examen de la situation des SEGPA et des EREA suppose que l’on dépasse le cadre de cette première interrogation, dont les contours doivent du reste être nuancés. En effet, les objectifs poursuivis par ces structures et les bénéfices indéniables qu’elles apportent à des élèves, qui relèvent tous de la grande difficulté scolaire, sont d’une telle évidence qu’ils ne permettent pas de réduire la question à une simple contradiction avec des principes. L’organisation de dispositifs dérogatoires permet effectivement d’offrir un cadre bienveillant à ces élèves.
Comme le montre le tableau figurant en page 15 du rapport pour avis, les élèves de SEGPA sont ceux qui souffrent des plus grandes inégalités en termes d’apprentissages et de statut socio-économique. La classe de cours préparatoire (CP) a pesé très lourdement sur leur « destin scolaire » : 84 % d’entre eux ont redoublé leur CP.
Quant aux élèves des EREA, leur situation est avant tout synonyme de fragilité exceptionnelle. Pour reprendre les propos entendus lors de ma visite à l’établissement de Bonneuil-sur-Marne, les jeunes qui y sont scolarisés sont souvent « abîmés » par la vie.
Face à ces publics très particuliers, les structures adaptées disposent de réels atouts. J’en citerai trois :
– d’abord, un taux d’encadrement optimal par rapport aux conditions d’enseignement ordinaires du second degré. Pour les SEGPA, ce taux est la résultante d’une norme nationale fixant le nombre maximal d’élèves par classe à seize, ce plafond étant d’ailleurs rarement atteint. Dans les EREA, on compte en général un adulte pour deux élèves, un taux d’encadrement évidemment exceptionnel qui explique la quasi-absence de décrochage dans ces établissements ;
– ensuite, la présence d’équipes enseignantes qui comprennent des spécialistes de la grande difficulté scolaire et qui se concertent chaque semaine, ce qui permet une réelle mise en cohérence des apprentissages ;
– enfin, dans les EREA, une articulation entre les activités éducatives de l’internat et le projet pédagogique de l’établissement, qui permet de prendre en charge l’enfant ou l’adolescent dans sa globalité.
Ce cadre protecteur favorise de facto la personnalisation de la réponse apportée à la situation de chaque élève.
Malgré ces atouts, l’enseignement adapté reste critiquable ou fragile sur certains points.
Premièrement, la procédure d’orientation vers ces structures, qui repose sur les commissions départementales d’orientation vers les enseignements adaptés (CDOEA), donne trop de place aux tests psychométriques et au préjugé selon lequel il existerait un « profil d’élève de SEGPA », et prend insuffisamment en compte les acquis scolaires. En outre, une fois l’orientation vers la SEGPA établie, les dossiers des élèves ne sont plus réexaminés en cours de scolarité, ce qui empêche toute sortie de cette filière et toute réintégration dans le cursus ordinaire.
Deuxièmement, les élèves de SEGPA et ceux du collège pratiquent très rarement des activités communes alors qu’ils sont scolarisés dans le même établissement, ce qui accentue le déficit de connexion entre SEGPA et collège. Des points de rencontre réguliers entre la SEGPA et d’autres enseignants, d’autres élèves, d’autres disciplines, ne pourraient qu’encourager les possibles retours des élèves de SEGPA dans le parcours classique.
Les EREA, quant à eux, vivent trop souvent en vase clos, n’ayant que très peu de contacts ou d’échanges avec les collèges et lycées professionnels voisins.
Troisièmement, si le taux de spécialisation des enseignants d’EREA et de SEGPA est encore assez élevé, les départs en formation pour obtenir les certifications correspondantes sont en chute libre. Dans le cas des EREA, on atteint même un seuil critique en ce qui concerne les professeurs des écoles éducateurs chargés de l’internat puisque leur recrutement n’est plus ouvert depuis que le Conseil d’État a annulé, en 2002, le texte qui régissait leurs obligations de service. Leurs postes sont de plus en plus occupés par des assistants d’éducation recrutés par contrat, alors qu’il faudrait les confier à des personnels qualifiés et chevronnés.
Quatrièmement, les parcours scolaires en SEGPA ou en EREA s’apparentent à des « voies sans retour » : une fois entrés, leurs élèves n’en ressortent quasiment jamais pour rejoindre les classes ordinaires du collège ou du lycée professionnel. Cette vision « tubulaire », que révèle l’absence de passerelles avec le cursus ordinaire, est préoccupante, alors même que la refondation de l’école réaffirme le principe du collège unique.
Cinquièmement, la terminologie retenue dans le code de l’éducation – qui qualifie les difficultés des élèves concernés de « graves et permanentes » – suggère, à elle seule, le caractère immuable de leur orientation, sans autre issue possible que d’achever son parcours de formation en SEGPA ou en EREA.
Sixièmement, la configuration des plateaux techniques où sont dispensés les enseignements préprofessionnels de SEGPA réduit considérablement le champ des possibles en matière d’orientation professionnelle et ne donne pas toujours lieu à des formations adaptées au tissu économique local et aux enjeux actuels de l’emploi.
Enfin, contrairement aux objectifs fixés par les deux circulaires qui les encadrent, ces structures ne garantissent pas à tous leurs élèves un accès à une qualification de niveau 5, du type du certificat d’aptitude professionnelle (CAP).
Je tiens à dire encore une fois que les réussites humaines des SEGPA et des EREA sont incontestables et nombreuses. Mais les performances des SEGPA, dont un quart seulement des élèves arrivent à une classe terminale de l’enseignement secondaire qui les conduira à un diplôme, devraient nous interpeller. Je me félicite donc que le ministère de l’éducation nationale ait mis en place deux groupes de travail pour réfléchir à l’avenir de ces structures.
Je voudrais maintenant aborder l’autre champ de réflexion dans lequel s’inscrit cette étude. En effet, pour légitimes qu’ils soient, ces questionnements ne doivent pas conduire à sacrifier des structures qui offrent ce que l’enseignement secondaire n’est pas aujourd’hui en mesure d’apporter à ces élèves, à savoir un cadre exceptionnellement attentif à leurs besoins et qui leur permet d’apprendre autrement. La fermeture des SEGPA constituerait, de fait, une perte irréparable pour le collège d’aujourd’hui. À long terme, en revanche, lorsque des équipes pluridisciplinaires enseigneront une culture commune de la maternelle au collège – et à cette condition seulement ! –, la question de leur suppression pourra se poser.
En attendant, il convient d’adapter ces structures en tenant compte des limites du système actuel.
D’abord, l’orientation vers l’enseignement adapté devrait reposer sur des critères scolaires et donner lieu, chaque année, à un réexamen du dossier de l’élève pour faciliter les retours vers la voie ordinaire. Ensuite, cette orientation ne devrait pas être conditionnée au redoublement de l’élève en primaire, car le redoublement représente à la fois un coût pour l’éducation nationale et une souffrance pour l’enfant qui n’est pas défendable.
Parallèlement, la sixième de SEGPA devrait laisser la place, à titre expérimental dans un premier temps, à une « sixième mixte » permettant une scolarisation partielle en sixième ordinaire. Dans le même esprit, des groupes rassemblant plusieurs heures par semaine les élèves de la SEGPA et ceux du collège devraient être institués dans quelques disciplines, dont, à tout le moins, la technologie, l’éducation artistique et l’éducation physique et sportive. En outre, les échanges de service entre professeurs de SEGPA et de collège gagneraient à être développés pour inciter plus systématiquement les élèves de SEGPA à passer le brevet. De même, des liens plus étroits avec les lycées professionnels voisins permettraient de pousser les élèves des SEGPA, mais aussi ceux des EREA, à préparer le baccalauréat professionnel.
Le travail remarquable des personnels enseignants d’EREA et de SEGPA devrait être davantage valorisé. Il conviendrait notamment de permettre l’intégration des directeurs de ces structures dans le corps des personnels de direction, par le biais de listes d’aptitudes spécifiques, et de prévoir un grade de reclassement attractif.
Dans le même ordre d’idées, les EREA, en pointe en matière éducative et pédagogique, devraient devenir des établissements « supports » pour les écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE). Pour cette raison, le maintien de ces établissements m’apparaît indispensable, même dans le cadre d’une école inclusive.
Ce travail m’a permis de découvrir un aspect méconnu de l’éducation nationale qui, à bien des égards, pourrait être une source d’inspiration pour la refondation pédagogique de l’école. Les SEGPA et les EREA ne sont que la pointe émergée d’un phénomène, celui de la grande difficulté scolaire, qui concerne plus de 10 % des élèves. Ce constat me conduit à formuler un vœu : les enseignants – pas seulement ceux des SEGPA et EREA – devraient tous apprendre à faire progresser des élèves différents ayant des besoins différents. Pour l’école républicaine, dont le principe d’inclusion est une des raisons d’être, pour la richesse et la qualité de la formation délivrée dans les ESPE – un des objectifs prioritaires de la refondation –, c’est un beau défi à relever !
M. le président Patrick Bloche. La parole est maintenant à Sophie Dion, qui a choisi, pour son avis sur les crédits de la recherche, une thématique originale : « Recherche et montagne ».
Mme Sophie Dion, rapporteure pour avis pour les crédits de la recherche. J’ai en effet choisi, dans le cadre de l’examen du budget de la recherche, d’étudier un sujet qui l’est trop peu souvent : la montagne. Je ne pensais pas, du reste, que le Premier ministre confirmerait officiellement ce choix en proclamant, le 17 octobre 2014 : « La montagne est l’avenir de la France. » Avenir de la France, certainement, mais aussi incomparable laboratoire de recherche à ciel ouvert !
La montagne reste pourtant à la périphérie des sciences. Alors qu’elle couvre 29 % du territoire national, elle ne mobilise que peu de moyens de recherche : 100 millions d’euros par an seulement selon les estimations, ce qui ne paraît pas à la hauteur des enjeux.
Au plan environnemental et climatique, la montagne est un véritable laboratoire du changement global. Parce qu’elle constitue un écosystème très riche, c’est aussi un important réservoir de la biodiversité. Mais ce milieu riche est aussi un milieu fragile, plus sensible que la plaine, par exemple, au changement climatique : alors que la température du globe s’est élevée de 0,5 degré au cours du siècle dernier, celle des Alpes a crû de 1,5 degré. La montagne est donc un bon indicateur des conséquences du changement climatique. Elle concentre par ailleurs des ressources naturelles importantes, notamment en eau. Elle fournit aussi des ressources minières et pétrolières.
Il faut avoir à l’esprit tous les enjeux liés à l’anthropisation de ce milieu si particulier. Les risques naturels y sont plus prégnants qu’ailleurs, qu’il s’agisse des avalanches, des éboulements ou des crues. En tant que zone géologique active, la montagne fait l’objet d’une surveillance sismique particulière.
Elle est aussi le terrain privilégié de nombreuses activités sportives et de loisirs, donc d’enjeux relatifs à la santé et aux pathologies liées à l’altitude.
Si la montagne intéresse la médecine et la physiologie, elle intéresse également les sciences humaines et sociales. Développement du tourisme, changements intervenus dans les usages agricoles ou industriels, gestion des flux : toutes ces questions mobilisent les chercheurs en économie, en droit, en sociologie, en histoire ou en géographie.
À Grenoble, à Chambéry, à Toulouse, à Clermont-Ferrand, différents laboratoires d’écologie, de sciences de la terre et de sciences humaines et sociales conduisent des recherches passionnantes. Certains sont rattachés au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), d’autres appartiennent à de grands organismes de recherche comme l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA) ou l’Institut de recherche pour le développement (IRD). Certains ont même un statut associatif, comme le Centre de recherches sur les écosystèmes d’altitude ou, dans le domaine médical, l’Institut de formation et de recherche en médecine de montagne.
La recherche sur la montagne est relativement récente. Beaucoup de ces laboratoires sont nés dans les années 1990 et 2000. Les résultats sont néanmoins très prometteurs. Dans le domaine environnemental et écologique par exemple, on peut aujourd’hui modéliser les effets du changement climatique sur la végétation. Dans le domaine des risques, on comprend mieux les avalanches, et l’on peut limiter les chutes de blocs de pierre par une couverture forestière appropriée. Dans le domaine de la santé, on évalue mieux les effets de l’altitude et on combat mieux le mal aigu des montagnes.
Pour autant, la recherche sur la montagne a encore du mal à se fédérer. Il existe certes un laboratoire d’excellence (LABEX) qui regroupe des laboratoires de sciences humaines et sociales sur ce sujet, et un autre, dans le domaine des sciences de la vie et de la terre, qui se préoccupe en partie de ces questions. L’Alliance dans le domaine de la recherche environnementale, de son côté, réunit les principaux acteurs de la recherche en montagne, mais sous le seul aspect environnemental. Les sciences humaines et les sciences dures ne se parlent pas encore, ou trop peu.
Là plus qu’ailleurs, les financements sont difficiles à trouver. En effet, les projets de recherche sur la montagne prennent plus de temps que les autres, que ce soit en écologie, en géosciences ou en sciences humaines. Pour être valables, les recherches doivent accumuler de longues séries de données, ce qui peut s’avérer impossible dans le cadre de contrats de recherche de trois ou cinq ans.
La montagne manque également de visibilité en tant qu’objet de recherche, si bien que les chercheurs ont du mal à se positionner pour répondre à des appels à projets qui, dans la plupart des cas, sont généralistes. Comme le littoral, la montagne devrait faire l’objet d’un intérêt accru dans le cadre du financement sur projet.
Les contrats de recherche sont une bonne chose, dans la mesure où ils orientent la recherche vers des enjeux que les pouvoirs publics considèrent comme prioritaires. Mais le soutien de base est également important pour mener des recherches qui sont, à un instant donné, moins attractives. C’est pourquoi je crois qu’il est impératif à la fois de faire une place à la montagne dans les appels à projets et de permettre aux laboratoires de bénéficier de financements suffisants pour mener les recherches qu’ils estiment porteuses d’avenir.
M. le président Patrick Bloche. Notre troisième rapporteure pour avis à intervenir ce matin est Sandrine Doucet, pour les crédits de l’enseignement supérieur et de la vie étudiante ; elle a porté son attention sur la rénovation des formations technologiques courtes dispensées par les sections de technicien supérieur et les instituts universitaires de technologie.
Mme Sandrine Doucet, rapporteure pour avis des crédits de l’enseignement supérieur et de la vie étudiante. J’ai en effet choisi de centrer mon rapport sur les sections de technicien supérieur (STS) et les instituts universitaires de technologie (IUT), qui sont directement concernés par une des mesures phares de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche : l’institution de quotas d’accès en faveur des bacheliers professionnels et technologiques.
Au-delà de la question des quotas, j’ai souhaité me pencher sur l’avenir de ces filières technologiques courtes, qui sont en quête de nouveaux équilibres.
Le fonctionnement et les résultats – en termes de diplomation et d’insertion professionnelle – des STS et les IUT sont l’une des grandes réussites de notre système d’enseignement supérieur. Ces filières ont su offrir une formation professionnalisée aux futurs cadres intermédiaires de nos entreprises et de nos services, tout en étant un vecteur d’ascension sociale pour de nombreux jeunes issus de milieux modestes. Elles sont en outre appréciées des PME car leurs cursus sont le fruit d’une co-construction entre les formateurs et les employeurs. Enfin, elles sont plébiscitées par les familles : l’encadrement qu’elles proposent à leurs étudiants assure une transition « en douceur » entre le lycée et l’enseignement supérieur.
Pourtant, force est de constater que les STS et les IUT traversent aujourd’hui une zone de turbulences que j’ai tenté de cartographier dans mon rapport en l’articulant autour de deux grandes problématiques : d’une part, la démocratisation de l’accès à ces filières sélectives et de la réussite au diplôme ; d’autre part, la cohérence entre les niveaux de qualification et les besoins en compétences des entreprises.
Commençons par l’enjeu de la démocratisation. Il suppose que l’on corrige les flux de bacheliers à l’entrée des STS et IUT car ceux-ci sont devenus un facteur d’iniquité. Le processus d’orientation et de sélection dans notre système éducatif étant dominé par le baccalauréat général et la série S, les titulaires de ce diplôme prennent dans les IUT des places aux bacheliers technologiques qui, de ce fait, s’orientent vers les STS au détriment des candidatures de bacheliers professionnels. C’est ainsi que de nombreux bacheliers professionnels s’orientent par défaut vers l’université, où leur taux de réussite en trois ans à la licence est de 3,1 % seulement. Cet échec est un gâchis humain d’autant plus inacceptable qu’il pénalise des jeunes issus de milieux peu favorisés : je rappelle que l’on compte chez les ouvriers trois fois plus de titulaires du baccalauréat professionnel que du baccalauréat général.
Le contrat social proposé à ces jeunes est donc faussé. C’est bien pourquoi nous avons adopté, l’année dernière, le dispositif des quotas. Mais je ne pense pas qu’il suffise d’ouvrir la porte des IUT et des STS à certains bacheliers pour démocratiser l’accès à ces filières : il faut aussi accompagner ces bacheliers vers la réussite.
Cette politique d’accompagnement devrait mobiliser – comme c’est d’ailleurs le cas dans certains IUT et STS – une large palette d’instruments : établissement de bilans de compétences en fin de premier semestre, institution de « modules passerelles » entre la terminale et la première ou les deux années de STS, politique d’orientation des bacheliers professionnels prenant en compte le fait que ceux-ci réussissent mieux lorsque leur lycée accueille aussi des STS, recours au tutorat et développement des parcours permettant d’obtenir le diplôme universitaire de technologie en deux ans et demi ou trois ans.
Parallèlement à ces mesures, l’accueil en STS et en IUT des bacheliers professionnels et technologiques qui sont en échec à l’université devrait être facilité par la mise en place de « rentrées décalées » ou de semestres d’adaptation.
Tout ceci demande des moyens, ce qui implique que les référentiels de formation des STS accordent une large place aux heures d’accompagnement des étudiants fragiles et que les IUT et les universités jouent sans arrière-pensées le jeu des contrats d’objectifs et de moyens prévus par la loi du 22 juillet 2013 et encadré par deux décrets adoptés l’été dernier.
J’en viens maintenant à la seconde problématique, celle de la cohérence entre formation et besoins des entreprises. Dans ce domaine, je dois avouer que les interrogations, voire les tensions à l’œuvre, sont très nombreuses.
J’évoquerai notamment les inquiétudes des entreprises et des formateurs concernant le positionnement du brevet de technicien supérieur (BTS) et du diplôme universitaire de technologie (DUT) ainsi que la qualité des baccalauréats rénovés.
Premièrement, nous constatons un « déport » des sorties de l’enseignement supérieur de bac + 2 vers bac + 3, c’est-à-dire du BTS ou du DUT vers la licence professionnelle ou au-delà, ce qui complique le recrutement par les PME des techniciens dont elles ont besoin. La Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises (CGPME) a même parlé de « dévoiement » du DUT, qui est devenu un passeport pour la poursuite d’études pour 87 % de ses diplômés. Ce phénomène de grande ampleur a d’ailleurs conduit un de mes interlocuteurs à considérer que certaines spécialités d’IUT pourraient se transformer en classes préparatoires intégrées à l’université, une option vivement contestée par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF). Ces poursuites d’études ne sont pas étrangères au fait que les jeunes se détournent des métiers de l’industrie alors que toutes les études prospectives démontrent que celle-ci offrira, dans les dix prochaines années, de nombreux emplois qualifiés, souvent à forte composante numérique.
Deuxièmement, la qualité des nouveaux baccalauréats professionnels et technologiques, notamment celle du fameux baccalauréat « sciences et technologies de l’industrie et du développement durable » (STI2D), fait débat. Pour certains, le « bac pro » obtenu en trois ans a réduit l’employabilité de ses titulaires et ses modalités d’obtention relativement souples pourraient, du fait de l’afflux des bacheliers professionnels résultant des quotas, avoir des répercussions sur le niveau du BTS. En outre, le « fléchage » de ces bacheliers vers cette filière pourrait donner une forme de prépondérance aux apprentissages par le geste au détriment d’une approche un peu plus conceptuelle, ce qui entraînerait des pertes de compétences. Quant aux nouveaux « bacs techno », mes interlocuteurs ont été jusqu’à les qualifier de « bacs sans technologie ». Cette évolution suscite une certaine perplexité chez les responsables du réseau des IUT.
Troisièmement et dernièrement, nous sommes confrontés à un réel problème d’articulation des objectifs fixés par la nation concernant le pourcentage de bacheliers – 80 % d’une classe d’âge – et celui de diplômés de l’enseignement supérieur – 50 % d’une classe d’âge. Nous allons certainement atteindre les 80 % de bacheliers, mais uniquement grâce à la progression du nombre de bacheliers professionnels, et cette tendance ne nous aidera pas à accroître le niveau de qualification de la population. Tel est le constat de la Conférence des présidents d’université et du comité chargé de rédiger la stratégie nationale pour l’enseignement supérieur. Ce dernier rappelle que France Stratégies a retenu comme objectif un taux de titulaires d’un diplôme de niveau bac + 5 égal à 21,5 % en 2020 et que la Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs a identifié un besoin de formation de 13 000 diplômés supplémentaires par an.
Aussi la mobilisation autour des quotas de bacheliers professionnels ne doit-elle pas nous faire oublier qu’il est de notre intérêt d’accroître le nombre de bacheliers technologiques et généraux. Comme le suggère le Syndicat général de l’éducation nationale, affilié à la Confédération française démocratique du travail (SGEN-CFDT), nous pourrions peut-être fixer des objectifs en termes de types de bacheliers formés et augmenter, à partir de là, la part des bacheliers généraux issus des milieux défavorisés, ce qui permettrait une réelle démocratisation de l’enseignement supérieur long.
Mon travail, vous l’aurez compris, ne vise pas à proposer des recettes toutes faites : il établit une sorte de questionnaire qui appelle des réponses nuancées, loin de toute posture dogmatique. Le modèle de formation proposé par les IUT et les STS garde, certes, toute sa pertinence, mais il doit désormais concilier des exigences de plus en plus nombreuses. C’est sans doute l’occasion ou jamais de s’appuyer sur les acquis de ces deux réseaux pour réfléchir aux contours d’une filière universitaire technologique complète, qui irait du « post-bac » au doctorat et qui proposerait des parcours de formation plus souples afin d’accroître la mobilité sociale à tous les âges de la vie.
M. le président Patrick Bloche. Je vous remercie, mes chères collègues, pour le travail qui a permis l’élaboration de ces trois beaux rapports, et donne maintenant la parole aux représentants des groupes.
M. Émeric Bréhier. Je m’associe à ces remerciements.
Chacun des trois rapports traite, à sa manière, de la mise en application de textes que nous avons adoptés et donne la mesure du chemin qui reste à parcourir entre le vote de la loi et son application effective. Nous devons rester à cet égard extrêmement attentifs.
Vous mettez bien en lumière, madame Tolmont, le paradoxe qui existe entre des structures d’enseignement adapté qui résultent de la priorité donnée par l’éducation nationale à la lutte contre l’échec scolaire, et le principe d’inclusion que nous avons longuement discuté lors des débats sur la loi pour la refondation de l’école. Selon vous, à quel horizon peut-on raisonnablement envisager une disparition des SEGPA par intégration dans le dispositif global de l’éducation nationale ? Parallèlement, comment améliorer l’intégration des EREA dans le système éducatif général ?
J’espère que vous pardonnerez à un député de plaine de poser une question aussi triviale, madame Dion : dans les laboratoires dont vous soulignez la pertinence du projet de recherche, avez-vous relevé une évolution favorable des crédits pérennes, sachant que les crédits de l’Agence nationale de la recherche (ANR), chère au cœur de notre collègue Patrick Hetzel, ont, eux, diminué ?
Au-delà d’un accès aux formations dont vous avez souligné les effets parfois paradoxaux, madame Doucet, comment faire pour que les étudiants de STS et d’IUT réussissent et pour que ces diplômes contribuent véritablement à l’ascenseur social ?
M. Xavier Breton. Je remercie également les trois rapporteures.
Je concentrerai mon intervention sur l’enseignement scolaire. Votre rapport, madame Tolmont, mérite d’être salué : souvent méconnues, les structures d’enseignement adapté accomplissent dans l’ombre un travail remarquable. Votre coup de projecteur est très opportun.
Je souscris également à votre approche pragmatique : le fonctionnement de ces structures, avez-vous démontré, contredit certes les principes réaffirmés du collège unique et de l’école inclusive, mais on ne peut ignorer le travail souvent remarquable réalisé par les SEGPA et les EREA, et l’impossibilité, pour le second degré, de scolariser dans de bonnes conditions des élèves qui se situent parfois, écrivez-vous, « au-delà de la grande difficulté scolaire et psychologique ». Votre rapport souligne bien l’intérêt de ces enseignements adaptés, qu’il s’agisse des effectifs réduits ou de la personnalisation de la réponse apportée à chaque élève selon sa situation.
J’ai relevé trois propositions particulièrement intéressantes : le développement des échanges avec les collégiens et enseignants hors SEGPA ; la remise en cause de la pertinence du critère du redoublement, lequel correspond à une interprétation étroite de la circulaire du 29 août 2006 et ignore les effets négatifs du redoublement ; la mise en place d’une évaluation permettant d’assurer un meilleur suivi des élèves.
Votre rapport relève que les effectifs des SEGPA ont baissé de 17 %, passant de 113 800 élèves en 2002 à 94 400 en 2013. Quelles sont les raisons de cette baisse, sachant que le taux d’encadrement n’a pas diminué dans la même période ?
Vous regrettez par ailleurs que les plateaux techniques des SEGPA soient peu modernes et peu diversifiés. Que proposez-vous à cet égard ?
Pour ce qui est de la trajectoire des élèves concernés, tout semble joué dès l’entrée en primaire, dites-vous. La scolarité du premier cycle ne permet pas de remédier à leurs difficultés. Dès lors, ne conviendrait-il pas de s’orienter vers un repérage précoce des difficultés dès l’école maternelle ? Bien que cette question soulève toujours de vifs débats et se heurte, sur certains bancs, à une opposition culturelle, le diagnostic que vous établissez nous conduit à la poser.
Enfin, vous indiquez avoir « parfois eu la tentation, sans doute provocatrice, de croire que la réussite des EREA tenait au fait que l’administration de l’éducation nationale s’en était désintéressée ». Est-ce un plaidoyer pour une plus grande autonomie des établissements ?
En tout cas, je vous remercie encore pour ce rapport. Là où vous voyez une contradiction, je vois plutôt une interrogation sur la manière de faire vivre et de décliner les principes du collège unique et de l’école inclusive.
Mme Barbara Pompili. Madame Tolmont, je tiens à vous remercier du travail d’investigation que vous avez conduit sur des secteurs souvent mal connus et pourtant, aujourd’hui encore, malheureusement nécessaires !
Alors que la loi pour la refondation de l’école promeut l’école inclusive et que la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées reconnaît le droit à la scolarisation aux élèves en situation de handicap, l’existence de structures adaptées comme les SEGPA ou les EREA n’est pas sans nous interpeller, tout en justifiant l’intérêt de votre rapport.
Si nous prônons l’école inclusive et l’adaptation du système aux besoins de chaque élève, incluant le parcours individualisé et l’accompagnement humain, nous constatons aujourd’hui que nous sommes encore loin d’atteindre cet idéal. Oui, l’existence même des SEGPA et des EREA est la preuve que l’école inclusive n’existe pas encore. C’est pourquoi quiconque prônerait leur disparition immédiate prendrait le risque d’aggraver les difficultés scolaires et sociales de nombreux élèves qui, ne sachant vers quelles structures se tourner, seraient très mal accueillis dans le milieu dit ordinaire.
Or, c’est précisément sur le milieu ordinaire qu’il convient d’agir pour le rendre capable, à terme, d’accueillir les élèves en grande difficulté. Il n’est pas acceptable que le système scolaire continue de reproduire et d’aggraver les inégalités sociales, alors qu’il devrait servir de tremplin à ces élèves. Nous ne pouvons plus accepter que les plus fragiles soient extraits du milieu ordinaire pour être placés dans des filières vues et vécues comme des voies de garage, où l’on essaie de les oublier en limitant au maximum les relations entre milieu adapté et milieu ordinaire – c’est un point que vous soulignez. C’est comme si ces deux mondes coexistaient sans se voir, puisque, même lorsqu’ils partagent le même site, ils ne partagent pas les mêmes locaux, ce qui interdit tout mélange ou tout échange entre les élèves et les professeurs de ces deux mondes, qu’il s’agisse des cours, des activités sportives et artistiques, des voyages scolaires, des dynamiques d’établissement, voire de la cantine – il y a fort heureusement quelques exceptions. Il est donc urgent d’agir pour pallier les défaillances de notre système, qui rejette une partie des jeunes.
La loi de refondation de l’école constitue une première étape, notamment parce qu’elle redonne la priorité au primaire – les professionnels de SEGPA le soulignent : il faut s’attaquer aux difficultés dès le primaire – et qu’elle restaure la formation des enseignants. Il faut toutefois aller plus loin. Devant les difficultés spécifiques rencontrées par certains élèves, nombre d’enseignants se sentent encore aujourd’hui trop démunis. Le manque de formation de l’ensemble des équipes pédagogiques à l’accueil des élèves en situation de handicap ou en grande difficulté étant une des racines du mal, il faut tout faire pour y remédier.
Il convient également d’assouplir le système, afin de permettre à chaque élève de bénéficier d’un suivi et d’un parcours individualisés. Il devrait être possible de mieux « circuler » à l’intérieur d’un cycle et de fonctionner par petits groupes et par projets. Il faut également augmenter les moyens humains pour accompagner chaque élève et mieux ouvrir l’établissement à son milieu.
Je tiens à insister sur la nécessité d’améliorer l’existant car, de l’avis même des professionnels travaillant en SEGPA, la suppression à court terme de ces structures relève de l’utopie. En attendant que l’inclusion en milieu ordinaire puisse devenir la norme, il convient d’améliorer le fonctionnement des SEGPA et des EREA pour leur permettre de répondre aux difficultés des élèves que ces structures accueillent.
Vos préconisations, madame la rapporteure pour avis, vont dans le bon sens puisqu’elles tendent à renforcer les liens entre le milieu ordinaire et le milieu adapté pour les élèves et les enseignants, à réviser les critères d’orientation, à supprimer la condition devenue absurde du redoublement, à systématiser le réexamen des situations des élèves scolarisés en milieu adapté, à accroître les sorties d’élèves vers la voie « ordinaire », notamment grâce aux liens créés lors du réexamen des situations, à revoir les missions des EREA en les intégrant à leur environnement scolaire, à mieux valoriser le travail des personnels et à mettre l’accent sur leur formation. J’espère que vos conclusions trouveront rapidement un écho favorable et concret.
M. Rudy Salles. La France se situe seulement au dix-huitième rang de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour la performance de ses élèves. Quant au rapport de la Cour des comptes « Gérer les enseignants autrement », rendu public le 22 mai 2013, il souligne que les résultats insatisfaisants de notre école ne proviennent ni d’un excès ni d’un manque de moyens budgétaires ou d’enseignants. Il était donc indispensable d’engager une réforme d’ensemble des modalités de gestion des personnels enseignants : or cette réforme est totalement absente du projet de loi de finances.
Nous regrettons tout d’abord que ce texte ne réponde pas à la principale difficulté soulevée par la réforme des rythmes scolaires, à savoir l’absence de financement pérenne. Comptez sur nous pour le rappeler ! Le fonds d’amorçage pour la réforme des rythmes scolaires, reconduit à la rentrée 2015 au bénéfice des communes les plus fragiles, ne peut constituer une solution satisfaisante. L’inquiétude demeure particulièrement importante pour les collectivités territoriales qui doivent financer cette réforme, alors même que le gouvernement leur demande simultanément de contribuer à hauteur de 11 milliards d’euros aux 50 milliards d’euros d’économies annoncées.
L’UDI apportera par ailleurs une attention toute particulière à la lutte contre le décrochage et soutiendra le développement des expériences peu coûteuses, fondées sur la mise en confiance en soi et sur des jeux collectifs et individuels, menées de manière concluante par des associations comme Coup de Pouce Clé.
S’agissant des crédits de la recherche, notre groupe s’interroge sur les orientations prises, qui visent à faire participer la mission aux efforts partagés de rationalisation et d’économies. En matière de soutien à la recherche et à l’innovation, nous nous inquiétons notamment de la suppression du programme 410 qui porte sur la « Recherche dans le domaine de l’aéronautique », secteur d’excellence employant 320 000 personnes, qui continue de se développer en période de crise et représente le premier secteur d’exportation de notre économie. Nous déplorons également que les moyens alloués au programme 191 – « Recherche duale (civile et militaire) » –, qui vise à maximiser les retombées civiles de la recherche de la défense et à faire bénéficier la défense des avancées de la recherche civile, n’aient pas été amplifiés.
Nous regrettons enfin que la mission « Recherche et enseignement supérieur » ne préfigure pas les grandes orientations soutenues par notre groupe. Nous défendons tout d’abord la création d’écosystèmes économiques permettant de rapprocher les universités et les centres de recherche des entreprises, et de lier le développement des infrastructures à celui des bassins économiques. Nous souhaitons également affirmer le rôle stratège de l’État en matière de recherche et d’innovation au service de la compétitivité, afin de soutenir massivement les entreprises dans ces secteurs d’excellence que sont l’aéronautique, la chimie, la santé, la transition écologique et le numérique. De plus, l’enjeu de l’enseignement supérieur ne saurait, pour notre groupe, se résumer au déploiement de moyens supplémentaires, alors qu’il convient surtout de créer des liens toujours plus forts entre l’université et le monde extérieur. Si le programme promeut la coordination étroite à l’échelle d’un territoire académique des établissements publics d’enseignement supérieur, il est en revanche plus flou s’agissant des partenariats, pourtant indispensables, avec le monde économique et social. Enfin, la suppression des bourses au mérite, pour une économie de 14 millions d’euros en 2015 et de 35 millions en 2017, signe l’arrêt de la logique de recherche de l’excellence. Or celle-ci doit être poursuivie par l’enseignement supérieur s’il veut assumer son rôle essentiel, qui est de former la ressource humaine, laquelle constitue la plus grande richesse de la nation.
Mme Marie-George Buffet. Je tiens à saluer, comme vous le soulignez dans votre rapport, madame Tolmont, l’augmentation significative du nombre des enfants en situation de handicaps scolarisés, une augmentation qui impose de poursuivre le travail sur le statut et le déroulement de carrière des auxiliaires de vie scolaire (AVS).
Vous souhaitez que tous les enfants puissent un jour bénéficier d’un parcours commun et partager le même socle, au sein d’une école de la réussite débutant dès la maternelle : on ne verrait plus alors d’enfants en grande difficulté contraints de redoubler leur cours préparatoire. Vous soulignez toutefois qu’il faut tenir compte de la réalité : nul ne sait, en effet, quand l’école aura les moyens d’accueillir tous les enfants. C’est pourquoi nous devons saluer le travail effectué dans les SEGPA et les EREA.
Votre rapport évoque différents problèmes, notamment l’insuffisance des personnels qualifiés et l’absence de pilotage et de soutien académiques des enseignements adaptés, tout en s’interrogeant sur l’inclusion raisonnée et la manière dont l’école doit s’ouvrir à l’enseignement adapté, notamment par des échanges permettant aux enfants scolarisés en SEGPA de sortir d’un parcours tubulaire. Enfin, vous pointez l’absence de retour vers la voie « ordinaire », qui pose la question du suivi du parcours scolaire de ces enfants.
Madame Doucet, dans votre rapport pour avis sur l’enseignement supérieur et la vie étudiante, vous évoquez, dans le cadre du « Plan 40 000 », le fait que les CROUS soient sollicités pour 30 000 nouveaux logements étudiants : quelle est aujourd’hui la capacité de financement des CROUS ? Je suis par ailleurs étonnée des écarts existant, selon les académies, entre les loyers des chambres en cité universitaire. Il conviendrait de se pencher sur la question.
Vous évoquez également la rénovation des formations technologiques courtes. Certes, trop souvent, les jeunes ont l’impression d’être orientés vers les filières professionnelles parce qu’ils ne sont pas capables de suivre l’enseignement général. Toutefois, pourquoi semblez-vous hésiter sur la poursuite des élèves issus de la voie professionnelle au niveau universitaire ?
M. le président Patrick Bloche. Je souhaite rassurer M. Rudy Salles, ainsi que tous les membres de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation. En effet, le Premier ministre vient d’annoncer, au Sénat, que le fonds d’amorçage, destiné à soutenir les communes dans l’aménagement des rythmes scolaires, sera maintenu l’année prochaine au même niveau que cette année. Cette bonne nouvelle nous conduira sans aucun doute à corriger, en séance publique, le projet de loi de finances pour 2015. Nous avions été nombreux, sur tous les bancs, à nous inquiéter : force est de constater que le gouvernement nous a entendus, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir collectivement. Notre mobilisation n’aura pas été vaine.
Je donne maintenant la parole à ceux de nos collègues qui souhaitent poser des questions.
Mme Sophie Dessus. Mme Tolmont nous a alertés sur l’avenir des SEGPA, qui jouent un rôle important, notamment en milieu rural : je l’en remercie. Sans doute le principal défaut des SEGPA est-il le manque d’inclusion : toutefois, leur suppression aggraverait la situation des élèves concernés, ce qui arriverait s’ils étaient jetés dans le bain commun des classes de collège et ne bénéficiaient plus de l’enseignement spécifique que leur offrent des enseignements spécialisés. Leur suppression ne saurait être sérieusement envisagée tant que nous ne serons pas en mesure de les remplacer.
Madame Dion, c’est dans son intégralité que le secteur de la recherche m’inquiète. Le Président de la République avait choisi de rendre hommage à Pierre et Marie Curie le jour de son investiture, le 15 mai 2012. C’était un hommage appuyé rendu au génie français et un signal fort envoyé à tous nos savants et chercheurs.
Chacun sait que la recherche conditionne notre avenir. La France doit innover si elle veut rester à la pointe, apporter des réponses aux grands enjeux environnementaux et sanitaires et trouver les moyens de maintenir le financement de son modèle social.
Il convient de stimuler, d’un côté, la recherche privée des entreprises – le crédit impôt recherche s’y emploie – et, de l’autre, la recherche publique. Or celle-ci rencontre des difficultés. Permettez-moi de citer quelques titres récents de la presse : « Mal payés, mal équipés, mal considérés, les chercheurs dépriment » ; « Les chercheurs déprimés face aux suppressions de postes » ; « Jérôme, chercheur, dix ans d’études pour 1 800 euros nets » ; « Le Gouvernement reste ferme face aux chercheurs en colère ».
Tout élu sait qu’il ne faut pas se fier aux journaux. Toutefois, ces titres révèlent un grave problème. Quels sont les moyens alloués à la recherche, qui est une priorité ? Ne peut-on faire un geste pour les 30 000 chercheurs qui ne sont pas toujours payés à la hauteur de leurs mérites ? Comment les inciter à ne pas quitter la France ? Comment sortir de la précarité les 15 000 chercheurs qui enchaînent les CDD – l’INSERM a récemment perdu un contentieux contre l’un d’entre eux devant le tribunal administratif de Paris ? Comment assurer la simplification de la jungle administrative, où se perdent bon nombre de directeurs à la seule fin d’obtenir des crédits ? Quelle réponse apporter à la marche des chercheurs qui dure depuis plusieurs semaines ?
François Mitterrand avait organisé des États généraux de la recherche pour réfléchir à l’avenir de celle-ci. Nous devons trouver des solutions pour soutenir la recherche publique.
M. Patrick Hetzel. Monsieur le président, le gouvernement souhaite inscrire la prorogation du financement de la réforme des rythmes scolaires dans le projet de loi de finances (PLF) pour 2015 : c’est une avancée, assurément, mais quid de la pérennisation, qui est le terme clé ? Vous ne l’avez pas évoquée. Pour les communes, en effet, la dépense reviendra tous les ans. C’est pourquoi nous serons très attentifs à la question de la pérennisation du fonds d’amorçage.
Le budget accordé à la recherche par projets est en deçà du seuil critique – j’ai déjà eu l’occasion de le souligner lors de l’examen des projets de budgets pour 2013 et 2014. Le PLF pour 2015 n’améliore en rien la situation.
Quant au volet enseignement supérieur de la mission, Mme Doucet évoque de manière succincte, page 10 de son rapport pour avis, la suppression des bourses au mérite, bourses qui, je tiens à le rappeler, ne concernaient que des boursiers sur critères sociaux. Pour utiliser la terminologie gouvernementale – j’ai horreur du clivage qu’elle instaure –, il ne s’agit donc pas d’« enfants de riches ». Une fois de plus, c’est un gouvernement de gauche qui porte un coup de canif au mérite républicain, ce que nous ne pouvons que regretter car celui-ci était un ciment.
Le budget présenté par le gouvernement manque de vision et de souffle. C’est dommage pour un secteur tel que l’enseignement supérieur et la recherche, qui relève assurément de l’immatériel mais doit être considéré comme un investissement. Or le dossier de presse du gouvernement souligne que « l’optimisation de la gestion financière du secteur de l’enseignement supérieur » devrait rendre possible une nouvelle « contribution au redressement des finances publiques à hauteur de 100 millions d’euros ». Cela signifie que le gouvernement met le secteur à la diète. Il existe donc un immense décalage entre l’affirmation du gouvernement selon laquelle ce secteur est sanctuarisé et les faits, à savoir sa mise à la diète qui ne sera pas sans poser aux établissements d’enseignement supérieur un problème financier d’autant plus grave que la montée en puissance, en année pleine, de l’ordre de 45 millions d’euros, du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) creusera encore leur situation. Il manquera au bas mot 150 millions d’euros au budget des établissements d’enseignement supérieur.
De plus, le texte est muet sur le nouveau modèle d’allocation des moyens, annoncé pour 2015 par Mme Fioraso : il devrait inclure la masse salariale. Or le gouvernement a gelé ce chantier pour 2015, ce qui ne fait que confirmer le décalage entre les paroles et les actes.
Mme Isabelle Attard. Le financement des universités inquiète le monde de la recherche : suppression d’options, accueil limité des étudiants, tirage au sort dans certaines filières, gel d’emplois sont autant d’exemples glanés dans les rapports d’activité des universités. Selon la conférence des présidents d’université, les universités manqueront en 2015 de 200 millions d’euros pour financer leurs dépenses obligatoires. Si les écologistes se réjouissent du traitement, plutôt favorable, réservé aux étudiants, leur inquiétude est grande en ce qui concerne les nouvelles embauches promises par le gouvernement : celles-ci ne serviraient qu’à combler le manque de personnels administratifs. Il conviendrait donc de rétablir la situation et de se fixer l’objectif d’atteindre 3 % du PIB pour la recherche d’ici à dix ans, ce qui impliquerait d’augmenter chaque année son budget d’un milliard d’euros : nous en sommes loin !
C’est l’ensemble du modèle d’allocation qu’il convient d’ailleurs de réformer. Madame Dion, si vous avez cent fois raison d’évoquer dans votre rapport pour avis la situation de la recherche dans les zones de montagne, votre analyse vaut pour l’ensemble de la recherche. Vous concluez en soulignant que « certains domaines de recherche, qui peuvent apparaître moins attractifs à un instant donné, doivent bénéficier de moyens de financement pérennes » : le groupe écologiste réclame depuis deux ans et demi des financements ne dépendant pas de l’Agence nationale de la recherche (ANR), pour permettre aux laboratoires de travailler. Vous ajoutez qu’« il importe d’assurer aux laboratoires des soutiens de base plus conséquents » : nous sommes totalement d’accord avec vous. Le développement du financement via l’ANR s’est effectué au détriment de la subvention publique aux organismes de recherche et à leurs équipes. En 2014, les résultats des derniers appels d’offres ont déçu : 8,5 % de succès sur 8 000 demandes.
Les appels à projet contribuent à mettre en concurrence les chercheurs et les organismes, ce qui entraîne un gaspillage de temps qui serait mieux employé à la recherche elle-même : c’est ce que soulignent tous les chercheurs et tous les enseignants, ingénieurs et techniciens qui manifestent actuellement, ainsi que les 700 directeurs d’unités qui menacent de recourir à une démission administrative, comme ils l’avaient déjà fait il y a quelques années. La situation actuelle est regrettable. Madame la rapporteure, pensez-vous, comme moi, que le nécessaire relèvement des financements permanents des équipes de recherche s’impose ?
Selon les écologistes, la meilleure piste pour trouver des financements est le crédit d’impôt recherche (CIR), qui n’a pas démontré, loin de là, son efficacité à stimuler les investissements privés de recherche, n’exerçant aucun effet de levier. Avant 2012, le Parti socialiste avait demandé l’organisation d’un débat public sur le sujet : or le CIR demeure intouchable, en dépit des fortes critiques dont il fait l’objet, de toutes parts, y compris de la Cour des comptes.
M. Hervé Féron. Comment concilier, madame Doucet, l’objectif, inscrit dans la stratégie de Lisbonne, d’atteindre 50 % de diplômés du supérieur, et, plus largement, celui de répondre aux besoins de notre économie en étudiants diplômés de haut niveau, avec la promotion du BTS ou du DUT, qui sont des filières courtes ?
Depuis la publication du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service des personnels enseignants, les professeurs du secondaire se sont vu assigner une mission d’orientation à l’égard de leurs élèves, en sus de leurs obligations initiales. Or cette mission supplémentaire risque de se heurter au manque de moyens horaires. Comme vous le suggérez pour les professeurs des sections de techniciens supérieurs (STS) chargés d’accompagner les élèves en difficulté, ne pensez-vous pas nécessaire d’aménager des plages horaires spéciales pour les enseignants du secondaire afin de leur permettre de remplir ces nouvelles missions d’orientation sans alourdir leur charge de travail, qui est déjà importante ?
M. Claude Sturni. Madame Doucet, je suis très sensible à l’avenir des formations supérieures dites courtes, que vous évoquez dans votre rapport pour avis – je partage un grand nombre de vos remarques. Toutefois, ces formations risquent de se voir dévaloriser si elles ne tissent pas des liens étroits avec leur environnement économique, c’est-à-dire les employeurs potentiels. Un second risque de dévalorisation est constitué par l’inadéquation du contenu de la formation avec les attentes des acteurs économiques, c’est-à-dire, là aussi, des employeurs. Dans les régions frontalières – je pense naturellement à l’Alsace –, la maîtrise d’une langue étrangère peut décider de l’obtention d’un emploi à l’issue de la formation : cette maîtrise représente donc un enjeu capital. La région Alsace développe l’enseignement bilingue franco-allemand : c’est pourquoi les employeurs sont sensibles à la possibilité, offerte aux jeunes, de poursuivre cette formation dans l’enseignement supérieur, qu’il s’agisse, du reste, de l’allemand ou de l’anglais, qui s’impose de plus en plus dans le monde économique.
Je voudrais également vous faire part d’un regret : votre rapport pour avis n’approfondit pas suffisamment la question de l’apprentissage, alors même que, dans le cadre des filières courtes, l’alternance de périodes en entreprise et de périodes en établissement d’enseignement me paraît particulièrement pertinente.
Enfin, votre insistance sur la proximité entre un jeune et l’équipe pédagogique qui l’encadre me laisse dubitatif. À mes yeux, la proximité qui compte pour un jeune est celle qui s’établit entre lui et les perspectives d’emploi et d’insertion sociale et professionnelle qui l’attendent à l’issue de son parcours de formation. Il serait important de rappeler que l’objectif principal de la formation est de trouver un emploi.
Mme Colette Langlade. Madame Tolmont, si, à l’entrée en SEGPA ou en EREA, le choix des filières paraît assuré, tel n’est pas le cas à la sortie. Vous soulignez que c’est le dialogue, lorsqu’il est établi de façon continue, qui permet de former l’avis des familles et des élèves sur le choix des parcours qualifiants. Il ne faut pas non plus oublier l’apport que représentent le professionnalisme des équipes d’enseignants, notamment en EREA, et leur connaissance des réseaux de proximité.
S’agissant des outils qui permettent d’assurer le suivi des élèves des EREA, qu’en est-il du cahier de tutorat et du dossier de suivi ? Est-il facile aujourd’hui d’obtenir des données précises sur l’insertion sociale des élèves à la sortie des établissements, qu’ils aient obtenu ou non un CAP, ou sur leur parcours vers de nouvelles qualifications ?
Mme Martine Martinel. Les rapporteures ont eu le mérite de se pencher sur des aspects méconnus de leur mission, qu’il s’agisse du parcours des élèves en grande difficulté, de la recherche en zone de montagne ou des filières techniques ou professionnelles, trop souvent dévalorisées.
Madame Tolmont, pouvez-vous revenir sur le nécessaire maintien de la classe de sixième en SEGPA, alors que la loi de refondation de l’école vise à la consolidation du cycle formé par le CM1, le CM2 et la sixième ? Quelles précisions pouvez-vous également nous apporter sur l’inclusion raisonnée de ces structures dans le paysage éducatif ? Sans remettre en cause le professionnalisme des équipes pédagogiques, comment rompre avec l’aspect « ghetto » de ces classes ?
Madame Doucet, contrairement à M. Sturni, le développement de la proximité entre les jeunes et leurs équipes pédagogiques au sein des filières courtes me paraît un point très intéressant : pourriez-vous apporter des précisions à ce sujet ?
M. Pascal Demarthe. Au collège, les SEGPA accueillent des élèves présentant des difficultés d’apprentissage graves et durables. Or la loi de refondation de l’école, adoptée en juillet 2013, a posé deux principes qui pourraient bousculer le fonctionnement des SEGPA : il s’agit de la volonté de mettre fin au redoublement, qui est une condition actuellement indispensable à l’orientation en SEGPA, et de la création du cycle commun école-collège, qui devrait logiquement impliquer le report de l’orientation à la fin de la classe de sixième.
Les difficultés rencontrées par certains élèves ont des causes exogènes qui doivent trouver des solutions ailleurs que dans le strict cadre scolaire. Or, l’école elle-même produit des situations d’échecs : c’est pourquoi il convient de faire évoluer le système de notation, les programmes et la formation. Le fait que la difficulté scolaire soit inhérente à l’apprentissage n’est ni une fatalité ni une maladie.
La présence d’enseignants spécialisés auprès des maîtres, au sein de leurs classes, qui sont le premier lieu de la différenciation pédagogique, est indispensable. La suppression massive, sous le précédent quinquennat, des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) a ainsi eu un effet très négatif.
Le rapport sur « Le traitement de la grande difficulté au cours de la scolarité obligatoire », remis par les inspecteurs généraux Jean-Pierre Delaubier et Gérard Saurat, insiste sur l’absence de réponse apportée par le collège à la situation des élèves en grande difficulté. LA SEGPA y est présentée comme un espace de réhabilitation des élèves les plus fragiles, car ils y travaillent dans un climat de confiance et de respect propice à la réussite. Toutefois, les améliorations qui sont préconisées se révèlent difficiles à réaliser : densifier la notion de réseaux entre SEGPA et lycée professionnel ; s’ouvrir davantage vers le collège grâce à des temps d’apprentissage partagés avec les autres collégiens ; proposer des parcours plus diversifiés ; prendre en compte le nouveau cycle CM1-CM2-6e.
Pourquoi ne pas poursuivre après l’école élémentaire le travail des RASED en s’appuyant sur le cycle école-collège ? Ne pourrait-on pas également faire évoluer le travail des enseignants spécialisés de SEGPA vers une collaboration plus étroite avec les enseignants de collège, en imaginant des inclusions plus systématiques dans des classes ordinaires et en s’appuyant sur des enseignants volontaires ? Ces dispositions auraient le double avantage de lever les inquiétudes et les réticences des parents qui perçoivent trop souvent l’orientation en SEGPA comme ségrégative et de faire évoluer la représentation parfois négative des élèves entre eux, voire des adultes.
La question de l’évolution des SEGPA méritera d’être débattue dans le cadre de la réforme du collège.
Par ailleurs, la création des unités localisées pour l’insertion scolaire (ULIS), qui ont toutes pour caractéristique d’avoir un nombre d’inscrits plus élevé que celui qui est préconisé, ne doit pas se faire aux dépens des SEGPA, qui conservent toute leur pertinence pour les élèves présentant des difficultés graves et persistantes, surtout lorsqu’ils sont porteurs de handicaps.
Pouvons-nous espérer voir l’avenir des SEGPA s’inscrire dans une véritable réflexion commune, ce qui est essentiel pour lutter avec efficacité contre le décrochage et l’échec scolaire ?
M. le président Patrick Bloche. Mes chers collègues, vos différentes interventions ont bien illustré le travail de nos trois rapporteures. Je vous en remercie.
Mme Sylvie Tolmont, rapporteure pour avis. Mme Buffet a eu raison de souligner que mon rapport pour avis jette la lumière sur la grande difficulté scolaire au travers de structures qui ne devraient pas se transformer en filières.
Je ne souhaite pas la suppression des SEGPA, mais je ne suis pas ministre de l’éducation nationale. Je me félicite évidemment que Mme Vallaud-Belkacem ait annoncé la semaine dernière, en commission élargie, de nouvelles dispositions pour le collège en janvier prochain. L’objectif du rapport pour avis était non pas de critiquer les structures adaptées et les personnels qui y travaillent mais de souligner que le collège unique, décidé en 1975, doit améliorer son mode de fonctionnement. Alors qu’il a permis l’intégration de tous les élèves en son sein, force est de constater qu’il est nécessaire en 2014 de travailler à sa refonte, notamment en ce qui concerne l’adaptation de sa pédagogie à l’hétérogénéité des élèves.
Il ne faut pas se voiler la face : les SEGPA sont victimes d’une image catastrophique. Quels parents rêvent, pour leurs enfants, d’une entrée en sixième SEGPA ? Ces structures sont d’ailleurs assez mal connues, d’autant qu’elles sont souvent situées à l’écart du collège. J’ai visité dans ma circonscription un collège flambant neuf : la section SEGPA était située derrière, dans des bâtiments très anciens. Cela n’enlève évidemment rien au souci de l’équipe pédagogique d’accompagner le mieux possible les élèves mais la différence de traitement sautait immédiatement aux yeux.
La baisse des effectifs en SEGPA tient en grande partie à cette mauvaise image : elle est surtout prononcée en sixième, alors même que l’entrée au collège est particulièrement difficile pour les élèves ayant rencontré de grosses difficultés à l’école primaire. Mais peut-être cette baisse a-t-elle aussi répondu à des objectifs économiques.
Monsieur Breton, ma remarque selon laquelle la réussite des EREA tenait au désintérêt que leur manifestait l’administration de l’éducation nationale était évidemment une provocation. Nous avons pu toutefois observer que les EREA, peu connus des décideurs publics, vivent à l’écart de l’éducation nationale. Les directeurs des EREA attendent d’ailleurs un cadrage actualisé de leur action puisque leurs établissements relèvent d’une circulaire de 1995 qui n’a jamais été révisée.
Madame Langlade, nous manquons de données sur l’évolution de l’insertion des élèves de SEGPA et des EREA. Mme Moisan, qui est à la tête de la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), nous a toutefois livré des éléments précis recueillis sur un échantillon de 30 000 élèves entrés en sixième en 2007. Il est nécessaire d’améliorer encore le suivi de ces élèves.
Mme Sophie Dion, rapporteure pour avis. Il peut sembler original de se focaliser sur la montagne, mais celle-ci constitue un objet de recherche à part entière, dont les spécialistes ont au demeurant les mêmes besoins et les mêmes difficultés que leurs homologues, dans les sciences « dures » comme dans les sciences « molles » : insuffisamment payés, ils souffrent d’un manque de reconnaissance qui contribue à la fuite des cerveaux, alors même qu’il est de notre responsabilité d’encourager les vocations parmi les jeunes.
La plupart des chercheurs se plaignent aussi du formalisme administratif des appels à projet : il conviendrait de l’alléger, car le travail qu’il implique n’est assurément pas le cœur de leur métier.
Parce qu’elle représente un investissement en faveur de notre jeunesse, cette priorité gouvernementale qu’est la recherche devrait même être exclue du périmètre des dépenses budgétaires ; qu’on le déplore ou non, elle est soumise, au niveau international, à des exigences de compétitivité qui justifieraient un certain nombre de règles spécifiques.
Mme Sandrine Doucet, rapporteure pour avis. Vos questions, chers collègues, en témoignent, les étudiants en STS et en IUT méritent toute notre attention. Dans la filière STS, ils sont 37 % à être issus de milieux défavorisés et, dans les IUT, 43 % sont boursiers. Ils n’ont donc pas de temps à perdre dans leur cursus ; d’où l’importance, monsieur Bréhier, de l’encadrement. Afin de proposer la meilleure orientation aux lycéens, l’article 33 de la récente loi pour l’enseignement supérieur et la recherche a aussi fixé des quotas. Le projet de loi de finances pour 2015 institue, pour les bourses, un nouvel échelon dont bénéficieront plus de 77 000 étudiants ; ce sont ainsi, si l’on y ajoute les aides d’urgence, 453 millions d’euros supplémentaires qui seront alloués au bénéfice des étudiants dans les années à venir.
Grâce au « plan 40 000 », madame Buffet, 40 000 logements étudiants seront construits en cinq ans, soit 8 000 par an : c’est presque le double des programmes précédents.
S’agissant de l’accompagnement des élèves, monsieur Féron, des expériences ont été menées pour associer les lycées d’un côté, les IUT et les BTS de l’autre ; le budget de l’enseignement supérieur, en hausse cette année de 45 millions, contribuera à pérenniser ces expériences.
Les BTS et les IUT se heurtent d’ailleurs moins à la politique des quotas, désormais soumise à une étroite concertation entre les recteurs, les proviseurs et les présidents d’université, qu’au problème de l’accueil des nouveaux bacheliers issus des voies technologique et professionnelle, profondément réformées sous la précédente législature. En effet, ces derniers ont du mal à s’adapter aux exigences requises. Je rappelle, à cet égard, que le baccalauréat professionnel se prépare désormais en trois ans et non plus en quatre.
La réforme du baccalauréat technologique a également diminué le nombre de spécialités, et donc leur adéquation aux 88 options des IUT. La réussite passe, au-delà des quotas qui favorisent l’orientation, par l’accompagnement et le tutorat. On ne peut en effet se satisfaire d’une situation où seuls 3 % des bacheliers professionnels réussissent à l’université et où seuls 60 % des étudiants en STS obtiennent leur diplôme en deux ans.
Plusieurs autres opérateurs, madame Buffet, participent au logement étudiant : les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), les offices de HLM, mais aussi des opérateurs privés dans le cadre du plafonnement des loyers. Aux efforts consentis par ces trois opérateurs s’ajoute, depuis cette année, la généralisation de la caution locative étudiante, qui fut expérimentée en Aquitaine.
Sur les bourses au mérite, monsieur Hetzel, vous aurez tout loisir d’interroger la ministre vendredi matin. En tout cas, ce système portait le ferment de ses propres dysfonctionnements, puisque rien n’avait été prévu pour l’encadrer ; il n’est pas étonnant, dans ces conditions, que l’inflation des mentions « bien » et « très bien » ait créé des difficultés financières. L’établissement de critères sociaux profitera donc d’abord aux intéressés.
La proximité des équipes éducatives, madame Martinel, est en effet appréciée par les étudiants : leurs représentants nous l’ont confirmé. Cela permet notamment aux nouveaux bacheliers technologiques de suivre des modules d’adaptation dans certaines matières, en particulier au sein des IUT où le brassage des étudiants issus des séries technologiques et des séries générales crée une dynamique qu’il faut préserver.
Comme l’indique mon rapport, page 18, monsieur Sturni, les apprentis représentent 23 % des diplômés en BTS et en IUT. Tous appellent de leurs vœux, bien entendu, le développement de ce mode de formation, gage de réussite dans le monde professionnel.
M. le président Patrick Bloche. Mesdames les rapporteures, mes chers collègues, je vous remercie.
À l’issue de l’audition, en commission élargie, de Mme Geneviève Fioraso, secrétaire d’État chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche, auprès de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, la Commission des affaires culturelles et de l’éducation examine, pour avis, les crédits pour 2015 de la mission « Recherche et enseignement supérieur ».
M. le président Patrick Bloche. Nous sommes saisis d’un amendement AC11 de Mme Isabelle Attard.
Mme Isabelle Attard. Cet amendement concerne le crédit d’impôt recherche (CIR) dont nous venons de discuter. Il suit, comme plusieurs autres, les recommandations de la Cour des comptes en la matière. Nous demandons, par cet amendement, une réaffectation de 2,64 milliards d’euros du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » vers le programme 150 « formations supérieures et de la recherche universitaire ». Malgré ce que vient de dire Mme la ministre sur les 6 millions d’euros de crédits supplémentaires l’an prochain, nous considérons que la Conférence des présidents d’université n’exagère pas dans ses demandes.
Mme Sophie Dion, rapporteure pour avis. Cet amendement consiste à retirer 2,64 milliards d’euros du programme 172 « Recherche scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » pour les attribuer au programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire ». L’exposé des motifs précise qu’il s’agit de soustraire cette somme du CIR, qui est une dépense fiscale rattachée au programme 172.
Or, en pratique, l’amendement que vous présentez ne modifiera pas la dépense fiscale, dont le dispositif relève de l’article 244 quater B du code général des impôts.
En revanche, tel qu’il est rédigé, cet amendement prive bel et bien le programme 172 de moyens supérieurs à l’ensemble de la dotation du CNRS pour 2015, ou encore à la somme des dotations dont disposeront l’INRA, l’INSERM, l’ANR et le CEA civil par exemple.
Sur le fond, je rappelle que notre pays connait un vrai problème d’emploi scientifique ; il serait déraisonnable de se priver de quelque instrument que ce soit contribuant à le développer. La dotation du programme 172 pour la recherche publique – qui connaît déjà une inflexion négative fort contestable dans le projet de loi de finances – et le CIR pour la recherche dans le secteur privé, sont deux éléments indispensables au maintien de l’emploi scientifique.
Le CIR est essentiel pour les doctorants, comme l’a évoqué tout à l’heure M. Emeric Bréhier ; il est également essentiel pour les entreprises et Mme la ministre elle-même a insisté sur la sanctuarisation de ce crédit d’impôt.
Je donne donc un avis défavorable à votre amendement.
M. Emeric Bréhier. Cet amendement n’est pas anodin puisqu’il propose un transfert de 2,64 milliards d’euros. Je comprends bien les préoccupations de Mme Attard, qui souhaite allouer plus de moyens aux universités pour leur permettre de récupérer les réductions budgétaires des années passées. Toutefois, je ne peux soutenir cet amendement qui retire des crédits au programme 172, déjà très tendu. En outre, comme le souligne bien le rapport du rapporteur spécial de la commission des finances, M. Alain Claeys, le CIR est plutôt bénéfique pour l’emploi des chercheurs, même si son utilisation pourrait encore mieux être contrôlée.
Mme Isabelle Attard. Les sommes déplacées par notre amendement sont effectivement importantes mais je rappelle qu’au départ, le CIR ne coûtait que 2,7 milliards d’euros. Nous en sommes aujourd’hui à 4,5 milliards. J’ai bien entendu les arguments de Mme la rapporteure en faveur du CIR mais, pour d’autres, ce dispositif n’est qu’une niche fiscale. La Cour des comptes ne dit pas autre chose. Nous considérons quant à nous qu’il convient de plafonner le CIR, de le concentrer sur les PME-PMI et d’interdire le cumul avec le crédit d’impôt compétitivité-emploi (CICE). Le CIR doit être utilisé de façon plus juste pour en faire un véritable outil de soutien à la recherche.
Il n’est évidemment pas question de retirer de l’argent aux organismes de recherche et d’ailleurs l’amendement est ciblé sur les actions correspondant à la dépense fiscale du CIR.
M. François Brottes, président de la commission des affaires économiques. Je me permets d’intervenir dans ce débat pour signaler que le CIR est pour la France un élément d’attractivité internationale particulièrement important pour nombre de laboratoires de recherche et de développement. Il convient donc d’être prudent par rapport à un outil essentiel pour la création d’emploi dans le secteur.
La commission rejette l’amendement.
M. le président Patrick Bloche. Je consulte maintenant la commission sur les crédits pour 2015 de la mission « Recherche et enseignement supérieur », avec un avis défavorable de Mme Sophie Dion, rapporteure pour avis sur les crédits de la recherche, et un avis favorable de Mme Sandrine Doucet, rapporteure pour avis sur les crédits de l’enseignement supérieur et de la vie étudiante.
La commission donne un avis favorable à l’adoption des crédits 2015 de la mission « Recherche et enseignement supérieur ».
Ø Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche – Direction générale de l’enseignement supérieur – Mme Rachel Marie Pradeilles-Duval, sous-directrice des formations et de l’insertion professionnelle, et M. Amaury Ville, chef du département des formations du cycle licence
Ø Audition commune :
– Assemblée des directeurs d’IUT (ADIUT) – M. Guillaume Bordry, président, et M. Éric de Saint Léger, vice-président
– Union nationale des présidents d’IUT (UNPIUT) – M. Jean-Paul Vidal, président du conseil d’administration, et M. Jean-Pierre Lacotte, vice-président
Ø Union des professeurs de sciences et techniques industrielles (UPSTI) – M. Hervé Riou, président, et M. Sébastien Gergadier, vice-président, responsable de la filière STI
Ø Syndicat national de l’enseignement supérieur (SNESUP-FSU) – M. Marc Neveu, secrétaire général, Mme Claudina Kahane, secrétaire générale, et M. Pierre Chantelot, responsable secteur formation supérieure
Ø Conférence des présidents d’université (CPU) – M. Jean-Loup Salzmann, président et président de l’université Paris 13e, M. Gilles Roussel, président de la commission Formation et président de l’université de Marne-la-Vallée, et M. Karl Stoeckel, conseiller parlementaire
Ø Mouvement des entreprises de France (MEDEF) – Mme Sandrine Javelaud, directrice de mission formation initiale, et M. Matthieu Pineda, chargé de mission direction des affaires publiques *
Ø Syndicat général de l’Éducation nationale – Confédération française démocratique du travail (SGEN-CFDT) – Mme Brigitte Pradin, secrétaire fédérale, et M. Vincent Bernaud, secrétaire national
Ø Table ronde avec les associations étudiantes :
– Union nationale des étudiants de France (UNEF) – M. Yoro Fall, membre du bureau national de l’UNEF et référent des questions budgétaires
– Fabrique étudiante – Mme Cindy Pétrieux, présidente, et Mme Hanan Sedkaoui, membre
– Mouvement des étudiants (MET)-UNI – M. Jens Villumsen, délégué national, et Mme Estelle Yven, membre
Ø Audition commune :
– Fédération de l’enseignement privé-CFDT – MM. Pierre Houssais, Damien Bardy et Christian Douge, secrétaires nationaux
– Union nationale de l’enseignement technique privé (UNETP) –Mme Christine van Lerenberghe, vice-présidente
Ø Audition commune :
– Syndicat national des professeurs chefs de travaux (SNPCT) – M. Gilbert Derrien, secrétaire national adjoint, M. Éric Maglione, trésorier national, et M. Joël Trubuilt, secrétaire national adjoint
– Aprotect – M. Christian Ruckly, président, et M. Michel Priou, vice-président
Ø Syndicat national des personnels de la recherche et des établissements de l’enseignement supérieur (SNPREES-FO) – M. Bernard Rety, responsable du secteur enseignants, SNPREES-FO, M. Christian Inguere, responsable du secteur enseignants, SNPREES-FO, M. Rachid Zouhhad, trésorier adjoint, SupAutonome-FO, et M. Jean-Christophe Vayssette, secrétaire national, Syndicat national Force ouvrière des lycées et collèges (SNFOLC)
Ø Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) – M. Jean-Michel Pottier, président de la commission Formation, et M. Francis Petel, membre de la commission Formation
Ø Centre d’études et de recherches sur les qualifications (CÉREQ) – M. Christophe Barret, responsable adjoint du département Entrée et évolutions dans la vie active (DEEVA), et M. Boris Ménard, chargé d’études au DEEVA
Ø Audition commune :
– Syndicat national des personnels de direction de l’éducation nationale (SNPDEN-UNSA) – Mme Isabelle Bourhis, secrétaire nationale de-là commission éducation et pédagogie, et M. Éric Krop, secrétaire national de la commission éducation et pédagogie
– Sup’Recherche-UNSA – M. Jean-Georges Gasser, membre du conseil national,
– UNSA-Éducation – Mme Françoise Ducroquet, conseillère nationale éducation, culture et société
* Ce représentant d’intérêts a procédé à son inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.