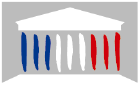______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 octobre 2015.
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION SUR LE PROJET DE LOI de finances pour 2016,
RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET VIE ÉTUDIANTE
Députée.
——
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 3096, 3110 (annexe n° 38).
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION 5
I. UN BUDGET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SANCTUARISÉ 7
II. LE PATRIMOINE IMMOBILIER DES UNIVERSITÉS 11
A. UN PATRIMOINE IMMOBILIER TRÈS IMPORTANT ET DE QUALITÉ TRÈS INÉGALE, DONT LA TAILLE GLOBALE EST SUFFISANTE POUR ACCUEILLIR LA REPRISE DE LA MASSIFICATION MAIS DONT LA QUALITÉ INÉGALE APPELLE DE PUISSANTS EFFORTS DE RÉNOVATION 11
1. Un vaste patrimoine d’une qualité inégale et parfois très dégradée 11
2. Une charge financière lourde et inéluctable 13
B. DES FINANCEMENTS COMPLEXES, TROP LONGTEMPS BIAISÉS EN FAVEUR DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS, QUI DOIVENT CONTINUER D’ÊTRE RELAYÉS PAR LES INVESTISSEMENTS D’AVENIR 15
1. La subvention au titre de la maintenance et de la logistique intégrée à la dotation globale aux universités, au risque d’en faire parfois une variable d’ajustement au détriment des besoins d’entretien du patrimoine 16
2. Les opérations de mises en sécurité assumées dans l’urgence et au coup par coup par l’État 16
3. Les opérations d’investissement assurées par les indispensables contrats de plan et par les investissements d’avenir du plan campus 17
a. Les contrats de plan 2015-2020 recentrés opportunément sur les réhabilitations dans une enveloppe budgétaire toutefois en déclin 17
b. Les opérations exceptionnelles du plan campus et des investissements d’avenir, indispensables leviers de modernisation légitimement concentrées sur les projets d’excellence dans une logique de site 19
C. UNE NÉCESSAIRE APPROPRIATION PAR LES UNIVERSITÉS DES ENJEUX IMMOBILIERS, QUI NE PROGRESSE QUE LENTEMENT ET QUE LA PERSPECTIVE DE LA DÉVOLUTION DE PATRIMOINE DOIT CONTINUER D’ENCOURAGER 23
1. Les fortes contraintes auxquelles est soumise la gestion de l’immobilier universitaire 23
2. Une prise de conscience récente, mais perfectible, de l’importante décisive de se doter d’une vision stratégique et professionnelle de la fonction immobilière 24
a. Une faiblesse persistante dans les diagnostics 24
b. L’importance d’une gouvernance cohérente intégrant pleinement l’immobilier dans la stratégie globale de formation 25
c. Le préalable indispensable de la réflexion sur les défis pédagogiques et environnementaux de l’université du XXIe siècle 26
3. De nouvelles étapes à franchir pour mieux encourager les universités à gérer avec ambition leur patrimoine immobilier 28
a. De trop faibles incitations à optimiser leur patrimoine qui impose de revoir le régime de rétrocession des produits de cession 28
b. La dévolution, une perspective nécessaire mais nécessairement éloignée en raison de l’impréparation de nombreuses universités et de son poids disproportionné pour les finances publiques 30
TRAVAUX DE LA COMMISSION 37
ANNEXE : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA RAPPORTEURE POUR AVIS 79
Le présent rapport pour avis porte sur deux des neuf programmes de la mission interministérielle « Recherche et enseignement supérieur ». Intitulés « Formations supérieures et recherche universitaire » et « Vie étudiante ».
Ces crédits étant examinés, de manière détaillée, par le rapporteur spécial de la Commission des Finances, M. François André, la rapporteure pour avis a axé son travail sur un thème précis : le patrimoine immobilier des universités.
Deuxième poste de dépenses des universités, l’immobilier constitue en effet un défi financier très important, qui prend une acuité particulière dans la reprise constatée depuis désormais deux années, du mouvement de massification de l’accès aux études supérieures avec un rythme annuel d’accroissement des effectifs de nouveaux étudiants passé de 25 000 à 40 000.
Or, s’il apparaît que la taille globale de ce patrimoine, dépassant les 18 millions d’euros de mètres carrés pour tout l’enseignement supérieur, est suffisante pour accueillir ces nouvelles vagues d’étudiants, sa qualité est toutefois très contrastée, entre 60 % de bâtiments récents et relativement efficaces et 40 % de locaux dans un état de dégradation inquiétante et même franchement préoccupante pour 12 % d’entre eux.
La remise à niveau et l’entretien optimal de ce patrimoine nécessitent de puissants efforts financiers, que les actuels circuits de financement publics, complexes, erratiques et dispersés entre les dotations récurrentes de maintenance de l’État, les investissements parfois trop focalisés sur les nouvelles constructions au détriment de la rénovation de l’existant des contrats de plan État-régions et les grands projets, limités aux sites d’excellence, du plan campus, ne suffisent pas à couvrir.
Surtout, les universités elles-mêmes doivent se doter d’une stratégie immobilière, inséparable de leur stratégie de formation et de recherche, et acquérir les réflexes de bon gestionnaire qu’impose un patrimoine aussi vaste.
Le présent rapport fait donc le point sur la situation, les forces et les fragilités du patrimoine immobilier universitaire et dessine les besoins financiers à moyenne échéance (A du II du présent rapport). Il évalue la qualité des efforts déployés au cours des récentes années par les universités pour professionnaliser leur gestion immobilière et les invite à s’engager dans l’indispensable réflexion sur l’évolution des usages induite par la rénovation pédagogique du numérique et par le défi de la transition énergétique (B du II). Il détaille enfin les diverses opportunités de réformes permettant de mieux encourager les universités à se doter de stratégies ambitieuses en confortant leurs ressources et propose que l’expérience de la dévolution du patrimoine soit poursuivie d’abord au bénéfice des universités qui ont su se regrouper et qui s’attachent à mettre en place les outils d’une gestion immobilière de qualité (C du II).
L’article 49 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances fixe au 10 octobre la date butoir pour le retour des réponses aux questionnaires budgétaires. À cette date, 83 % des réponses étaient parvenues.
Le budget de l’enseignement supérieur pour 2016 respecte la priorité donnée par la présente majorité à la réussite des étudiants, à la dynamique de site impulsée par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche et à l’accompagnement efficace des établissements supérieurs face au ressaut des effectifs étudiants, dont les flux entrants annuels sont passés de 25 000 par an entre 2005 et 2012 à plus de 40 000 par an depuis 2013.
Ces objectifs ambitieux ont en effet préservé les moyens de l’enseignement supérieur au sein de la mission « Enseignement supérieur et recherche » du mouvement général de réduction des dépenses publiques. Les crédits qui lui sont dévolus sont ainsi « sanctuarisés » dans le présent projet de loi de finances, passant de 15,21 à 15,45 milliards d’euros en autorisations d’engagement (+ 240,7 millions d’euros, + 1,6 %) et se stabilisant de 15,29 à 15,28 milliards d’euros en crédits de paiement (– 6 millions d’euros, 0 %). Compte-tenu toutefois de l’engagement pris par le Gouvernement de majorer de 100 millions d’euros les subventions aux universités lors de la 1ère lecture du projet de loi de finances à l’Assemblée nationale, ces derniers connaîtraient même une progression de 95 millions d’euros (+ 0,6 %), portant leur croissance depuis 2012 à 2,3 %.
RÉCAPITULATION DES CRÉDITS PAR PROGRAMME
(En millions d’euros)
Numéro et intitulé du programme et du titre |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement | ||
Ouvertes en LFI pour 2015 |
Demandées pour 2016 |
Ouverts en LFI pour 2015 |
Demandés pour 2016 | |
150 – Formations supérieures et recherche universitaire |
12 702,02 |
12 906,75 |
12 787,90 |
12 792,72 |
231 – Vie étudiante |
2 505,67 |
2 541,64 |
2 498,10 |
2 486,52 |
TOTAL Enseignement supérieur |
15 207,69 |
15 448,40 |
15 285,99 |
15 279,24 |
Source : Projet annuel de performances 2015 de la mission « Recherche et enseignement supérieur » hors fonds de pension.
– Les moyens des établissements d’enseignement supérieur, hors immobilier, constitués principalement des subventions pour charges de service public récurrentes versées en application du modèle d’allocation dit « SYMPA », progressent dans le projet de loi de finances de 65 millions d’euros pour atteindre 11,85 milliards d’euros, dont 10,62 milliards d’euros de masse salariale. Cette dotation inclut en outre 80 millions d’euros supplémentaires, par rapport à 2015, liés au financement des emplois nets créés en 2015 dans les établissements qui n’accèdent qu’à partir de la rentrée 2015 aux responsabilités et aux compétences élargies et intègrent ainsi en 2016 le périmètre de l’allocation globale versée par l’État.
Cette augmentation permet de financer, à hauteur de 60 millions d’euros, la création de 1 000 emplois dans les établissements, dont 330 emplois de personnels administratifs, 85 de professeurs agrégés et 585 d’enseignants chercheurs. Près de la moitié de ces postes accompagneront le dialogue contractuel en matière de regroupement et d’actions communes dans le cadre des contrats de site, tandis que 552 emplois permettront d’améliorer et de rééquilibrer entre les établissements le taux d’encadrement des étudiants.
Il importe de relever que les crédits prévus pour 2016 devront en outre financer, à hauteur de 25 millions d’euros, les contributions nouvelles aux pensions des personnels bénéficiaires de la mise en œuvre de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique.
Le présent projet de loi maintient toutefois dans sa version initiale une dotation inférieure de 100 millions d’euros à celle qu’induirait l’application automatique des règles d’allocation des moyens aux établissements de l’enseignement supérieur. Cet écart avait été compensé l’année dernière par un prélèvement sur les fonds de roulement des universités qui avaient accumulé des réserves plus de deux fois supérieures au seuil prudentiel fixé par le secrétariat d’État au budget. Dans un contexte difficile, marqué par une hausse significative des flux de nouveaux étudiants, la rapporteure pour avis se félicite que le Gouvernement ait revu sa position initiale en s’engageant à amender les crédits de l’enseignement supérieur afin de les réévaluer de 100 millions d’euros et de porter l’augmentation globale des moyens du supérieur à 165 millions d’euros. Ainsi ramené au niveau induit par le modèle pluriannuel d’allocation des moyens, le budget pour les établissements d’enseignement supérieur exclurait tout nouveau prélèvement sur les fonds de roulement.
– Ces évolutions sont compensées par un tassement conjoncturel de 62 millions d’euros des crédits de paiement consacrés aux dépenses immobilières, de 1,25 à 1,18 milliard d’euros, qui s’explique par l’achèvement progressif des chantiers engagés dans le cadre des contrats de projet État-régions (CPER) 2007-2014 tandis que ceux prévus par les nouveaux contrats 2015-2020 ne franchissent que leurs premières étapes (– 56 millions d’euros). En revanche, comme il sera vu infra, les subventions pour la maintenance et la logistique immobilière des universités et les crédits pour les mises en sécurité assumées directement par l’État demeurent stables, à respectivement 434 millions d’euros et 65 millions d’euros.
Les autorisations d’engagement pour l’immobilier connaissent cependant un mouvement inverse de progression, avec 138 millions d’euros de plus qu’en 2015 (+ 12 %) grâce principalement à la montée en puissance des CPER 2015-2020 (+ 30 millions d’euros) et au lancement de trois nouveaux contrats de partenariat public-privé (PPP) pour les opérations « cité scientifique » du campus de Lille et « biosanté Brabois » à Nancy ainsi qu’au bénéfice du campus prometteur de Paris-Est (+ 163 millions d’euros).
*
Le programme « Vie étudiante » sera quant-à-lui stable en 2016, après avoir connu une très vive progression depuis 2012 (+ 3,7 % en 2013, + 6 % en 2014 et + 1,8 % de crédits de paiement en 2015, soit + 15 % au total).
– Après un important effort d’extension et de revalorisation engagé à partir de 2013, les bourses sur critères sociaux atteignent désormais leur régime de croisière, passant de 1,94 milliard d’euros dans la loi de finances initiale pour 2015 à 1,96 milliard d’euros dans le projet de loi de finances pour 2016, soit une augmentation de près de 500 millions d’euros depuis 2012. La rapporteure pour avis rappelle à cet égard qu’au terme d’une rapide montée en puissance, les nouveaux échelons 0 bis (aide de 1 008 euros) pour les étudiants des classes moyennes aux revenus très modérés et 7 (aide de 5 545 euros) pour les étudiants les plus modestes, introduits en 2013, bénéficient désormais à respectivement 153 876 et 40 363 étudiants, dont les capacités financières à assumer les charges induites par leurs études ont ainsi été considérablement renforcées.
De même, les crédits pour les aides d’urgence versées par le fonds national d’aide d’urgence (FNAU), destinées à environ 5 500 étudiants qui rencontrent momentanément de graves difficultés ou qui doivent faire face à des besoins plus durables induits par exemple par des ruptures familiales ou des situations d’indépendance avérées, sont maintenus à 49 millions d’euros.
L’aide au mérite, préservée à hauteur de 900 euros par an pendant trois ans – et 1 800 euros jusqu’à épuisement de leurs droits pour les bénéficiaires du dispositif en vigueur jusqu’à la rentrée 2014 – pour les étudiants ayant obtenu une mention « très bien » au baccalauréat et éligibles au versement d’une bourse sur critères sociaux, sera financée par la reconduction de 51 millions d’euros de crédits permettant d’attribuer environ 35 000 aides.
– Dans un même esprit, les subventions et les dotations pour le logement étudiants, essentiellement au profit des centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS), se maintiendront au niveau élevé qu’elles ont atteint dès 2014 dans le cadre du « Plan 40 000 » lancé en 2013. Les autorisations d’engagement afférentes demeureront fixées dans le projet de loi de finances aux 419 millions d’euros votés dans la loi de finances initiale pour 2015. Ces moyens durables, qui ont permis de dépasser dès la rentrée 2015 la moitié des objectifs du plan avec 20 722 nouveaux logements livrés, crédibilisent l’ambition de construire 29 000 logements au cours de la présente législature.
A. UN PATRIMOINE IMMOBILIER TRÈS IMPORTANT ET DE QUALITÉ TRÈS INÉGALE, DONT LA TAILLE GLOBALE EST SUFFISANTE POUR ACCUEILLIR LA REPRISE DE LA MASSIFICATION MAIS DONT LA QUALITÉ INÉGALE APPELLE DE PUISSANTS EFFORTS DE RÉNOVATION
Les universités disposent d’un patrimoine immobilier considérable, mais dont la qualité très inégale, avec près de la moitié des bâtiments dans un état dégradé, impose des coûts d’entretien, de fonctionnement et surtout de renouvellement qui excèdent leurs capacités financières et les dotations dont elles bénéficient aujourd’hui.
Après une première phase de croissance directement corrélée à la massification des études supérieures (+ 3,5 millions de mètres carrés supplémentaires, + 37 % entre 1995 et 2000 dans le cadre du plan U2000), l’augmentation des surfaces à disposition de l’enseignement supérieur s’est poursuivie au cours des dix premières années du siècle sur un rythme soutenu (+ 5 millions de mètres carrés entre 2000 et 2006, soit + 9,3 %) supérieur à la croissance des effectifs étudiants (+ 5 % sur la même période) et de ceux de chercheurs (+ 4 %).
Cet accroissement, qui contredisait la priorité accordée à la restructuration et la réhabilitation plutôt qu’aux nouvelles constructions dès le plan universités du troisième millénaire (U3M) adopté en 1999 et réaffirmée avec constance depuis, notamment dans le cadre des contrats de projets État-régions 2007-2013, ne s’est atténué que très récemment (+ 1,9 % entre 2006 et 2010) avant que les livraisons prévues dans ces contrats et dans le plan campus, qui consacrent presque l’intégralité, pour les premiers, et près de 20 %, pour le second, de leurs investissements à la création de surfaces nouvelles, n’inversent cette tendance (+ 0,5 % entre 2010 et 2015 avec + 1,5 % cependant entre 2014 et 2015).
Le développement des capacités d’accueil a ainsi précédé la reprise de la croissance des effectifs d’étudiants.
Il apparaît en effet de plus en plus nettement que nous assistons depuis 2013 à une intensification de l’accès à l’enseignement supérieur avec des flux qui sont passés d’une moyenne de 25 000 nouveaux étudiants par rentrée au début des années 2000 à 40 000 par an depuis 2014 hors 15 000 nouveaux étudiants des classes préparatoires désormais obligatoirement inscrits à l’université. Les causes précises de ce ressaut sont encore mal connues, partagées entre la part prise par le contexte de fort chômage des jeunes qui les incite à retarder leur entrée sur le marché du travail et à se doter du puissant bouclier qu’est le diplôme supérieur, celle induite par la hausse importante du nombre de bacheliers professionnels dont une fraction croissante entame désormais des études supérieures et celle liée à une nouvelle appétence des jeunes adultes pour l’enseignement supérieur. En tout état de cause, ce mouvement semble durable. Il crédibilise l’objectif retenu par le Président de la République de passer de 43 à 60 % d’une classe d’âge diplômé du supérieur d’ici 2025. Mais il constitue un défi important pour les universités.
Sur le front pédagogique, se posent ainsi avec acuité la question lancinante des trop importants taux d’échec en licence et celle de l’inadéquation manifeste entre la répartition de l’offre, en particulier professionnalisante, et la demande induite notamment par l’accroissement des bacheliers professionnels que l’université précipite trop souvent dans une spirale d’échecs.
En matière d’accueil matériel cependant, il apparaît que les universités disposent aujourd’hui d’un patrimoine immobilier dont la taille globale est suffisante pour leur permettre d’accueillir les nouveaux flux d’étudiants. Les implantations atteignent 18,5 millions de mètres carrés de surface hors œuvre nette (SHON), dont 15,65 pour les seules universités, pour un peu plus de deux millions d’étudiants et près de 100 000 chercheurs.
Ce constat ne peut malheureusement pas être étendu à la qualité, à l’équilibre sur le territoire et à la durabilité des bâtiments, qui sont très inégaux.
La répartition des surfaces n’est ainsi pas homogène sur le territoire national, avec des variations allant de 3,7 étudiants par mètre carré pour l’université de Paris 2 par exemple à 15,7 pour l’université de Poitiers ou 12,8 pour celle de Cergy, autour d’une moyenne nationale de 6.
Surtout, l’état du patrimoine est très contrasté. Selon des estimations dont la rapporteure pour avis ne peut que déplorer la fragilité dans la mesure où elles reposent sur les données déclaratives fournies par des universités – dont il sera vu infra la fragilité des outils d’observation, 12 % du patrimoine immobilier est ainsi dans un état de vieillissement tel qu’une reconstruction complète serait moins onéreuse que leur réhabilitation, tandis que 27 % supplémentaires exigent des travaux lourds de remise à niveau.
ÉTAT DU BÂTI
(Selon les données déclaratives des établissements)
Année 2010 |
Année 2011 |
Année 2012 |
Année 2013 |
Année 2014 |
Année 2015 | |
État A |
28 % |
30 % |
32 % |
31 % |
30 % |
30 % |
État B |
31 % |
30 % |
30 % |
31 % |
31 % |
31 % |
État C |
28 % |
28 % |
26 % |
26 % |
26 % |
27 % |
État D |
9 % |
8 % |
8 % |
8 % |
9 % |
8 % |
État E |
4 % |
4 % |
4 % |
4 % |
4 % |
4 % |
Source : Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (MENESR).
État A : |
Bâtiment construit ou réhabilité depuis moins de 10 ans ; bâtiment sous garantie décennale. Coût des interventions de remise à neuf estimé entre 0 et 20 % du prix du neuf. |
État B : |
Interventions lourdes à prévoir exclusivement sur le clos et le couvert ; bâtiment de 10 à 20 ans dont l’utilisation reste adaptée aux activités d’enseignement et de recherche. Coût des interventions de remise à neuf estimé entre 20 et 40 % du prix du neuf. |
État C : |
Interventions lourdes à prévoir sur le clos et le couvert ainsi que sur les installations techniques ; Bâtiment dont l’utilisation reste adaptée aux activités d’enseignement et de recherche mais au caractère vétuste ; bâtiment de plus de 20 ans. Coût des interventions de remise à neuf estimé entre 40 et 60 % du prix du neuf. |
État D : |
Interventions lourdes à prévoir sur le clos et le couvert, sur les installations techniques ainsi que sur le second œuvre ; bâtiment dont l’utilisation est inadaptée aux activités d’enseignement et de recherche. Coût des interventions de remise à neuf estimé entre 60 et 80 % du prix du neuf. |
État E : |
Bâtiment à démolir ou à restructurer en totalité dans le cadre d’une opération d’investissement de type CPER. Coût des interventions de remise à neuf estimé entre 80 et 100 % du prix du neuf. |
L’ampleur et la diversité de ce patrimoine induit des coûts de fonctionnement et d’entretien d’autant plus élevés que la nette préférence pour les nouvelles constructions qui s’est affirmée jusqu’au tournant des années 2010 s’est souvent faite au détriment de la réhabilitation des bâtiments existants, dont les universités ont eu toutes les peines à empêcher la dégradation. Les constructions aux volumes les plus importants, qu’il s’agisse des immeubles des années soixante, d’une grande qualité architecturale mais aujourd’hui très dépassés technologiquement, ou des gestes architecturaux souvent spectaculaires mais parfois fragiles des années 1990, sont ainsi affectés par une usure importante et se révèlent très énergivores.
Cette dégradation d’une partie significative des bâtiments, qui affecte inégalement les universités, est d’autant plus inquiétante qu’elle tend à s’aggraver d’année en année.
On estime en effet généralement que l’effort de gros entretien et de renouvellement (GER), quel que soit le type d’immeuble, doit au moins atteindre 11 euros par mètres carrés SHON pour le préserver de toute dégradation supplémentaire et, dans l’idéal, doit se situer à des montants de l’ordre de 15 euros par mètres carrés.
Or, en moyenne, les établissements d’enseignement supérieur consacrent à l’immobilier depuis une vingtaine d’années des crédits ne dépassant pas de 6,50 euros par mètres carrés SHON, les disparités étant là encore très fortes entre les universités. En effet, si certaines universités se distinguent par des investissements élevés (30,60 euros par mètres carrés pour l’université Paris 2 ou 30,70 euros par mètres carrés pour l’ENS de Lyon), leur vaste majorité alloue en moyenne moins de 5 euros par mètres carrés à cette dépense (par exemple les universités de Grenoble, d’Aix-Marseille, d’Amiens ou de Besançon).
Pire, la maintenance immobilière programmée (MIP), qui couvre les petites adaptations, les améliorations de locaux et le maintien à niveau des bâtiments, est désormais l’une des variables d’ajustement budgétaire les plus couramment sollicitées par les établissements pour faire face à d’autres dépenses. Au prix de très fortes variations selon les exercices, elle ne dépasserait pas des niveaux de l’ordre de 2,50 euros par mètres carrés lorsqu’il faudrait raisonnablement y consacrer le double, entretenant une dangereuse fragilité du patrimoine. S’il faut se garder d’établir une corrélation trop nette entre le niveau des dépenses de maintenance et l’état du bâti (la qualité du bâti s’est par exemple améliorée entre 2012 et 2014 pour les universités de Lille II et de Montpellier III alors même qu’elles réduisaient leurs dépenses de maintenance à moins de 7 euros par mètres carrés), l’appréciation du niveau optimal de dépense étant dépendant de la position du bâtiment dans son cycle de vie, encore long pour la moitié du parc qui a été construite récemment, il n’en reste pas moins qu’une proportion très significative des bâtiments est notoirement sous-financée.
Intervenant quant à eux en dernier ressort, les plans successifs de mise en sécurité menés depuis 1996, n’ont pu que limiter les effets les plus spectaculaires de ces sous-financements, en stabilisant à 12 % les surfaces très dégradées (états D et E).
Cette situation induit deux types de dépenses auxquelles la puissance publique devra, d’une manière ou d’une autre, faire face.
D’abord, les retards d’entretien accumulés au cours des dernières années appellent un effort de remise à niveau et de renouvellement que l’on peut estimer, sur le fondement des calculs d’actualisation sur 25 ans des dépenses nécessaires appliquées aux universités qui ont bénéficié de l’expérimentation de la dévolution de leur patrimoine, à 850 millions d’euros par an.
Le ministère chargé de l’enseignement supérieur évalue ainsi à 9,5 milliards d’euros le montant actualisé qu’imposerait une réhabilitation complète des 40 % d’édifices dont l’état est le plus dégradé, auxquels s’ajoutent les besoins d’entretien lourd des bâtiments en bonne condition.
En face de ces besoins, les efforts financiers correspondants dans les contrats de plan État-régions (CPER), qui forment le principal canal de financement de ces travaux, se sont limités à 600 millions d’euros par an environ, dont, jusqu’à la nouvelle génération 2015-2020, tout au plus la moitié, soit 300 millions d’euros, a été dédiée à la réhabilitation des ouvrages existants. La quasi-intégralité des nouveaux CPER étant désormais mobilisées pour cet effort, qu’ils portent ainsi à 450 millions d’euros par an, il manque donc environ 400 millions d’euros par an pour assurer une préservation et un renouvellement optimal du patrimoine existant. Cette estimation n’inclut pas la remise et le maintien aux normes des établissements, aujourd’hui financées – pour une partie seulement des besoins – par des dotations spécifiques de l’État, pour lesquelles on ne dispose pas d’estimations mais qui, selon les enseignements livrés par les premières expériences de dévolution du patrimoine immobilier, devraient mobiliser un niveau de crédit proche du milliard d’euros, soit 50 millions d’euros annuels étalés sur vingt-cinq ans.
À cette dette implicite s’ajoutent les montants d’ores et déjà consacrés à la maintenance et à la logistique immobilière, qui se situent à des niveaux de l’ordre de 425 millions d’euros par an (400 millions d’euros de crédits de paiement « fléchés » vers l’immobilier dans la dotation globalisée aux universités auxquels il faut ajouter les 25 millions d’euros dévolus aux trois universités qui ont bénéficié du transfert de la propriété de leurs biens), stables depuis cinq ans. Ils forment désormais le deuxième poste de dépenses des établissements, après la masse salariale, mobilisant environ 10 % de leur budget global. Ces charges ont vocation à d’autant plus s’amplifier qu’elles s’appliquent pour moitié à des bâtiments aux performances énergétiques médiocres (plus de 50 % des bâtiments classés D et E à l’issue des diagnostics de performance énergétique) dont les coûts d’exploitation vont très probablement significativement s’aggraver au rythme de l’augmentation prévisible du coût des énergies et de celui du respect des objectifs globaux de réduction des consommations d’énergie de 38 % et des émissions de gaz à effet de serre de 50 % d’ici 2020.
B. DES FINANCEMENTS COMPLEXES, TROP LONGTEMPS BIAISÉS EN FAVEUR DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS, QUI DOIVENT CONTINUER D’ÊTRE RELAYÉS PAR LES INVESTISSEMENTS D’AVENIR
Les circuits de financement des dépenses immobilières des universités, par leur complexité, leur caractère erratique, la nette appétence politique pour les constructions qu’ils ont longtemps trahi et leur insuffisance pour garantir un entretien optimal du patrimoine d’ensemble, n’ont pas permis de faire face de manière optimale aux défis posés par l’entretien du patrimoine, avant qu’une réelle prise de conscience à la fin des années 2000 ne permette, lentement, d’inverser la tendance.
Trois principaux mécanismes concourent à la dépense immobilière des universités. La sollicitation des crédits du Fonds européen de développement régional (FEDER), en tout état de cause complexe, périlleuse dans la mesure où l’Union européenne peut reprendre une partie des fonds après contrôle et surtout très inconfortable pour la trésorerie des bénéficiaires compte tenu des très longs délais de paiement européens, est en effet désormais marginale pour ce type d’investissement.
1. La subvention au titre de la maintenance et de la logistique intégrée à la dotation globale aux universités, au risque d’en faire parfois une variable d’ajustement au détriment des besoins d’entretien du patrimoine
Le premier mécanisme de financement, qui est aussi le plus régulier, correspond aux subventions pour charges de service public au titre de la maintenance et de la logistique immobilière, retracées au sein de l’action n° 14 « immobilier » du programme 150. Elles regroupent les moyens versés aux établissements sous tutelle du ministère de l’enseignement supérieur pour couvrir leurs coûts d’exploitation et pour entretenir leur parc immobilier. Elles sont intégrées dans le modèle d’allocation des moyens aux établissements d’enseignement supérieur, et font donc partie de la dotation globale perçue par ces derniers, sans fléchage des fonds vers leur destination.
Il importe de souligner que ces moyens sont très stables depuis le début des années 2000 (417,27 millions d’euros en 2014, 433,97 millions d’euros dans la loi de finances initiale pour 2015 et 433,73 millions d’euros dans le projet de loi de finances pour 2016).
Calculés pour cinq ans à l’occasion des phases de contractualisation et d’agrémentation, ces crédits offrent une garantie de continuité et donc de programmation aux établissements. Ils sont désormais calculés indépendamment des surfaces et offrent ainsi à l’État, dans le cadre des négociations du plan quinquennal, l’opportunité de mieux s’assurer du développement d’une stratégie immobilière cohérente et exigeante. Leur montant est toutefois, comme il a été vu supra, insuffisant pour conférer aux universités une réelle aptitude à assurer la maintenance optimale des surfaces. En outre la durée du contrat est peu conciliable avec la mise en place d’une politique d’investissement étayée sur l’assurance de ressources pérennes à l’échéance, nécessairement longue, de la rentabilité des projets immobiliers.
Interviennent en second lieu les dépenses liées aux opérations de mise en sécurité des établissements, financées directement par le budget de l’État. Ces opérations, entreprises par l’État sur le fondement des schémas directeurs de mises en sécurité élaborés par les universités, sont décidées au coup par coup par le ministère, en fonction de l’urgence. Une partie considérable de ces dépenses a été mobilisée pour la mise en sécurité du campus de Jussieu, engagée en 1998, dont le désamiantage est achevé depuis 2011 et dont les travaux de restructuration et de mise en sécurité devraient prendre fin en 2016-2017. Le coût total de cette opération, initialement évalué à 591 millions d’euros, devrait atteindre 1,7 milliard d’euros, dont 40 millions d’euros de crédits de paiement dans la loi de finances initiale pour 2015 et 12 millions d’euros dans le projet de loi de finances pour 2016. À côté de ce projet très lourd, les crédits mobilisés pour la mise en sécurité des autres sites sont limités à 25 millions d’euros, tant en 2015 qu’en 2016, pour mener à bien des travaux de désamiantage dans les universités de La Rochelle, Toulon, Paris Panthéon-Assas, Paris Ouest-Nanterre-la-Défense, Franche-Comté, Lille 3 et Littoral Côte-d’Opale, l’IEP de Grenoble et l’université de technologie de Compiègne.
3. Les opérations d’investissement assurées par les indispensables contrats de plan et par les investissements d’avenir du plan campus
En dernier lieu, les universités bénéficient, pour leurs opérations de plus grande envergure, des fonds mobilisés dans le cadre des grands projets et des contrats de plan État-régions (CPER).
Les crédits afférents connaissent un tassement conjoncturel dans le projet de loi de finances pour 2016 en raison de l’achèvement du cycle des CPER 2007-2013 et de la montée en puissance, nécessairement lente, de celui des CPER 2015-2020.
Les crédits de paiements (CP) pour les constructions et les restructurations passent ainsi de 281 millions d’euros dans la loi de finances initiale pour 2015 à 232 millions d’euros dans le projet de loi de finances 2016. Les autorisations d’engagement (AE) connaissent en revanche le mouvement exactement inverse induit par le dégagement des premiers fonds pour les nouveaux contrats de plan, passant de 212 millions d’euros à 363 millions d’euros. Sur ces montants, 150 millions d’euros d’AE et 139 millions d’euros de CP correspondent aux contrats de plan État-région tandis que 212 millions d’euros d’AE et 92 millions d’euros de CP financent la participation de l’État aux partenariats publics/privés mis en œuvre dans le cadre de l’opération Campus.
a. Les contrats de plan 2015-2020 recentrés opportunément sur les réhabilitations dans une enveloppe budgétaire toutefois en déclin
L’expérience de l’exécution des précédents contrats de projets permet de tirer quelques enseignements qui ont très opportunément inspiré la position de l’État dans la négociation des nouveaux contrats 2015-2020.
D’abord, les CPER ont trop longtemps privilégié les constructions nouvelles, souvent plus spectaculaires et donc plus valorisantes pour les collectivités intervenantes, au détriment des indispensables efforts de réhabilitation et de rationalisation. Les opérations financées par les CPER 2000-2007 ont ainsi, en dépit des intentions contraires affirmées par l’État, presque exclusivement concerné des nouvelles implantations, qui ont mobilisé encore la moitié des investissements des CPER 2007-2013.
Surtout les crédits dévolus à l’immobilier universitaire dans les contrats de projet ont souffert d’une exécution très insatisfaisante.
Les investissements concernés dans les CPER 2000-2006 n’ont été exécutés qu’à hauteur de 70 % (pour constituer 1,7 milliard d’euros d’autorisations d’engagement de l’État et un montant équivalent des collectivités), et ceux du CPER 2007-2013 à 78 % (1,6 milliard d’euros d’autorisations d’engagement ouvertes par l’État pour 1,5 milliard d’euros pour les régions) en dépit de leur prolongation d’une année. De manière générale, le démarrage des opérations est souvent très lent avant qu’elles ne tendent ensuite à accumuler des retards d’autant plus significatifs qu’elles concernent des chantiers mal calibrés au début des négociations.
Enfin, le processus d’élaboration des CPER est longtemps resté déconnecté des priorités identifiées par les établissements. La démarche traditionnelle voulait que, si l’université établissait une liste de projets classés par ordre de priorité et si la direction générale à l’enseignement supérieur et à l’insertion professionnelle (DGSIP) au ministère de l’enseignement supérieur exprimait des orientations générales relayées par les recteurs et les ingénieurs régionaux de l’équipement, le choix définitif était dans les faits effectué par les régions, qui contribuent pour moitié aux investissements.
Les négociations qui ont présidé aux CPER 2015-2020 ont toutefois profondément évolué. D’abord, l’État a imposé une priorité claire pour la réhabilitation, proposant même un objectif de diminution du patrimoine immobilier de 3 millions de mètres carrés, cependant non étayé sur des estimations concrètes. Il a relayé en parallèle avec plus de constance les projets des universités les mieux avancées dans l’établissement de leurs schémas pluriannuels d’investissement.
Ensuite, les conseils régionaux ont mieux accepté d’endosser cet effort prioritaire pour les réhabilitations lourdes, en particulier lorsqu’elles contribuaient à l’amélioration des performances énergétiques, dès lors que les projets maintenaient des ambitions solides en termes de développement de la recherche et de la formation.
Il en résulte un calibrage sans doute mieux étayé des projets, contenu toutefois dans une enveloppe globale en diminution. Les crédits mobilisés atteindront en effet 989 millions d’euros de la part de l’État et l’équivalent de celle des régions, mais pour cinq et non six années, soit 400 millions d’euros en moyenne annuelle contre 525 millions d’euros entre 2008 et 2014.
b. Les opérations exceptionnelles du plan campus et des investissements d’avenir, indispensables leviers de modernisation légitimement concentrées sur les projets d’excellence dans une logique de site
Ces crédits sont enfin complétés par les financements dédiés au plan Campus. Lancé début 2008, ce plan est financé par une enveloppe bloquée de cinq milliards d’euros confiée à l’Agence nationale pour la recherche constituée, d’une part, produit de la vente effectuée par l’État en décembre 2007 d’une fraction de sa participation au capital d’EDF et, d’autre part, d’un crédit de 1,3 milliard d’euros ouvert par la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010. Les 202 millions d’euros d’intérêt générés annuellement devaient permettre, selon le schéma initial, de lever suffisamment de fonds pour moderniser les douze opérations labellisées « campus » au moyen de partenariats public-privé (PPP), auxquels ont été associés ensuite cinq sites « prometteurs » et quatre « innovants » financés quant à eux directement par le budget général de l’État.
Toutefois, la présente majorité a dû constater qu’à la mi-2012, quatre ans après le lancement de l’opération, seuls 156 millions d’euros avaient été débloqués pour des études et pas un seul contrat n’avait été signé. Le rapport remis à Mme Geneviève Fioraso, ministre chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche, par Roland Peylet en octobre 2012 a permis d’identifier trois points de blocages principaux : la complexité de la procédure de PPP, l’impossibilité pour les universités d’emprunter et l’exclusion des collectivités locales des discussions sur l’aménagement des sites. En conséquence, l’envergure de certains projets neufs a été réduite tandis que plusieurs PPP ont été réorientés vers de la maîtrise d’ouvrage publique (MOP). Le décret du 12 octobre 2012 a ainsi permis de créer des sociétés de réalisation associant universités, collectivités et Caisse des dépôts pour conduire des « partenariats public-public », avant que la loi de programmation des finances publiques 2012-2017 du 31 décembre 2012 ne prévoie que les universités puissent préfinancer leurs projets via des prêts à taux préférentiels de la Caisse des dépôts et de la Banque européenne d’investissement (BEI) et utiliser les fonds publics pour rembourser leurs échéances. Les interventions de ces deux financiers à long terme (25 ans) ont été formalisées en avril 2013, dans le cadre de la signature des conventions pour les campus d’@venir 2013-2018, et le 3 février 2014 pour la BEI qui s’est engagé à prêter 1,3 milliard aux treize plus grosses opérations d’ici 2017, en co-financement avec la Caisse des dépôts qui a déjà prêté plus d’un milliard pour financer le développement d’une offre sociale de logement étudiant, la rénovation énergétique, le développement des infrastructures, des services et des usages numériques ou encore le soutien à l’innovation.
Au total, le plan Campus mobilise 2,7 milliards d’euros de travaux programmés d’ici 2020 et environ 2 milliards de partenariats public-privé, auxquels il convient d’ajouter 1,3 milliard d’apports des collectivités territoriales, essentiellement en subventions, et 1,3 milliard de prêts BEI. Les sites sont désormais libres de choisir entre la maîtrise d’ouvrage publique (choisie désormais pour quarante-sept projets), les partenariats public-privé et les partenariats public-public.
Le graphique et le tableau ci-après montrent la répartition des sites « campus », qui bénéficieront ainsi de 4 milliards d’euros d’ici 2020, ainsi que des sites « prometteurs » et « innovants » abondés directement à partir du budget de l’État, à hauteur de 610 millions d’euros (dont 434 millions d’euros engagés fin 2015 auxquels s’ajoutent 209 millions d’euros d’autorisations d’engagement dans le projet de loi de finances pour 2016).
RÉPARTITION ET DOTATION DES OPÉRATIONS DU PLAN CAMPUS
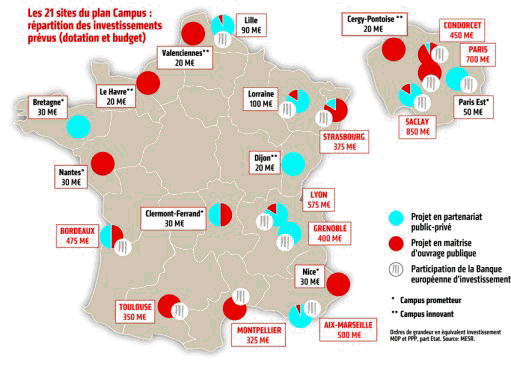
PLAN CAMPUS : DÉTAIL DES DOTATIONS
(En millions d’euros)
Site |
Dotation non consomptible |
Intérêts de la dotation en dépôt à l’ANR |
Autorisations d’engagement du programme 150 du budget de l’État | ||||
Attribuée |
Transférée |
Revenu annuel théorique dotation |
Engagés (conventions) |
Versés |
Prévues |
Déléguées fin 2015 | |
Aix-Marseille |
500 |
500 |
20,2 |
42 |
33,7 |
||
Bordeaux |
475 |
19,2 |
70,1 |
64,3 |
|||
Grenoble |
400 |
400 |
16,1 |
34,2 |
32,8 |
||
Lyon |
575 |
212 |
23,2 |
51,8 |
33,2 |
||
Montpellier |
325 |
13,1 |
32,8 |
31,5 |
|||
Strasbourg |
375 |
15,1 |
43,2 |
22,8 |
|||
Toulouse (1) |
350 |
14,1 |
35,7 |
19,2 |
175 |
202 | |
Paris-Condorcet |
450 |
18,1 |
69,5 |
64,1 |
|||
Paris-Centre |
700 |
28,2 |
155,8 |
104,7 |
|||
Saclay |
850 |
199 |
34,3 |
76,5 |
44,0 |
||
Lille |
7,5 |
2,2 |
110 |
52 | |||
Lorraine |
90 |
36,8 | |||||
Auvergne |
30 |
31 | |||||
Bourgogne |
20 |
24 | |||||
Bretagne |
30 |
41 | |||||
Cergy-Pontoise |
20 |
- | |||||
Nantes |
30 |
25,8 | |||||
Nice |
30 |
3,3 | |||||
Paris-Est |
55 |
- | |||||
Valenciennes |
20 |
18,4 | |||||
TOTAL Campus |
5 000 |
1 311 |
201,6 |
619,1 |
452,5 |
610 |
434,3 |
Saclay (2) |
1 000 |
1 000 |
|||||
(1) financement sur dotation non consomptible et sur crédits budgétaires (campus du Mirail).
(2) ligne correspondant au plan d’investissement d’avenir et qui présente la dotation consommable allouée et la dotation consommable engagée.
Source : MENESR.
PLAN CAMPUS : DÉTAIL DES FINANCEMENTS
(En millions d’euros)
Site |
Convention partenariale de site |
Financement des collectivités | ||||
Région |
Départ. |
Agglo. |
Autre |
Total | ||
Aix-Marseille |
Signée le 27/10/2010 |
33,0 |
- |
2,0 |
5,0 |
40,0 |
Bordeaux |
Signée le 20/12/2010 |
Au max 200,0 |
- |
38,0 |
- |
238,0 |
Bretagne |
Signée le 13/04/2011 |
30,0 |
- |
- |
- |
30,0 |
Clermont-Ferrand |
Signée le 16/07/2010 |
4,0 |
2,0 |
2,0 |
- |
8,0 |
Dijon |
Signée le 07/12/2009 |
21,0 |
- |
20,0 |
4,0 |
45,0 |
Grenoble |
Signée le 12/10/2011 |
85,0 |
- |
40,0 |
10,5 |
135,5 |
Lille |
Signée le 23/07/2010 |
33,0 |
- |
30,0 |
- |
63,0 |
Lorraine |
Signée le 20/10/2011 |
35,0 |
17,5 |
17,5 |
- |
70,0 |
Lyon |
Signée le 29/03/2011 |
85,0 |
35,8 |
32,0 |
- |
152,8 |
Montpellier |
Signée le 16/12/2009 |
162,0 |
- |
5,5 |
- |
167,5 |
Nantes |
Signée le 18/10/2011 |
15,0 |
- |
15,0 |
- |
30,0 |
Nice |
Signée le 15/03/2012 |
8,0 |
12,0 |
10,0 |
30,0 | |
Paris-Centre |
CPER 2015-2020 |
|||||
Paris-Condorcet |
Protocole d’accord du 9/10/2014 |
171,00 |
- |
- |
23,00 |
194,0 |
Saclay |
Discussion en cours |
- |
- |
- |
- |
- |
Strasbourg |
Signée le 21/02/2011 |
25,0 |
14,0 |
25,0 |
- |
64,0 |
Toulouse |
Signée le 08/06/2010 |
25,0 |
- |
10,0 |
17,0 |
52,0 |
Valenciennes |
Convention signée |
6,0 |
- |
7,2 |
- |
13,2 |
Total |
938,0 |
81,3 |
254,2 |
59,5 |
1 333,0 | |
Source : MENESR.
Ces sommes considérables, proches du milliard d’euros par an en autorisation d’engagement, ne doivent pas pour autant être considérées comme des ressources pérennes pour l’immobilier universitaire.
D’abord, leur objet est beaucoup plus large que la rénovation des locaux et porte de manière décisive sur des opérations nouvelles étendues au campus et aux logements étudiants.
Ensuite, elles s’inscrivent dans une logique d’excellence et d’attractivité et ne bénéficient ainsi qu’à certains sites sélectionnés pour leur impact fort sur la qualité et l’attractivité de l’enseignement supérieur et de la recherche en France.
Si elles forment l’indispensable complément des efforts réguliers fournis par l’État et les collectivités pour entretenir et rénover les universités, et doivent par conséquent être puissamment relayées par des nouvelles capacités dans le troisième plan d’investissements d’avenir annoncé par le Président de la République pour le début de l’année 2016, leur concentration sur l’innovation et l’excellence et leur répartition par essence inégale sur le territoire ne dispense par l’État d’assurer, dans son budget propre et dans les contrats de plan État-régions, un entretien optimal de toutes les universités selon les ordres de grandeur financière évoqués supra.
C. UNE NÉCESSAIRE APPROPRIATION PAR LES UNIVERSITÉS DES ENJEUX IMMOBILIERS, QUI NE PROGRESSE QUE LENTEMENT ET QUE LA PERSPECTIVE DE LA DÉVOLUTION DE PATRIMOINE DOIT CONTINUER D’ENCOURAGER
De toute évidence, l’ampleur du patrimoine et des besoins financiers qu’induisent son fonctionnement et son entretien passe d’abord par une pleine appropriation par les universités des outils nécessaires à son optimisation.
Il importe au préalable de rappeler que les universités font face, dans l’usage de leurs locaux, à des contraintes et des spécificités originales qui ne s’atténuent que très lentement.
Il y a d’abord le fort cloisonnement entre leurs composantes, en particulier les UFR, qui ont très longtemps adopté une approche étroitement patrimoniale des locaux dans laquelle les attributions de bâtiment étaient considérées comme définitives et empêchaient toute flexibilité et mutualisation dans leur usage entre UFR pour compenser les rythmes spécifiques de leurs besoins réciproques. Cette situation a atteint son paroxysme avec les Écoles supérieures du professorat et de l’éducation, qui ont hérité des anciens locaux dévolus aux IUFM – et plus anciennement encore aux écoles normales – dont les surfaces, par ailleurs utilisées très brièvement compte tenu de l’importance des stages, dépassent très manifestement, à 35 mètres carrés par étudiant, les moyennes constatées dans l’enseignement supérieur.
Ensuite, le rythme très spécifique de l’enseignement universitaire, marqué par des pics d’activité intense, concentrés en général au premier semestre universitaire avant les stages et, dans la semaine, sur les journées du mardi, du mercredi et du jeudi, mais aussi en contrepartie par de très longues périodes sans utilisation, conduit spontanément à un surdimensionnement des locaux. Les ratios d’occupation des amphithéâtres et des salles, promus en indicateur de performance, ne fournissent à cet égard qu’une indication baisée, l’inspection générale de l’administration nationale et de la recherche (1) estimant même qu’ils « tournent à peu près dans tous les cas autour des mêmes valeurs moyennes, totalement irréalistes. En revanche, il est patent, de l’aveu même des responsables universitaires, que nombre de bâtiments sont notoirement surdimensionnés, en particulier les amphithéâtres, et sur les sites éloignés de la ville centre, ou dans des secteurs spécifiques (IUT, ESPE) ». Ainsi, force est de constater que le taux cible, fixé à 70 % d’utilisation pour les salles de formation, est calculé sur un volume théorique d’occupation optimale trompeur de seulement 1 120 heures par an lorsque ces volumes optimaux atteignent 1 900 heures par ans pour les lycées et même 2 500 heures pour les administrations.
2. Une prise de conscience récente, mais perfectible, de l’importante décisive de se doter d’une vision stratégique et professionnelle de la fonction immobilière
Sous l’impulsion de l’État, notamment grâce aux efforts conjoints déployés par la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle (DGSIP), par France Domaine et par la Caisse des dépôts et des consignations et grâce aux précieux relais des organes de mutualisation formés par la Conférence des présidents des universités (CPU), l’agence de mutualisation des universités et établissements d’enseignement supérieur et de recherche (AMUE) et l’association des responsables techniques immobilières de l’enseignement supérieur (ARTIES), qui ont notamment établi un guide très détaillé d’optimisation et de rénovation du patrimoine fin 2014 à la suite d’une mission confiée au cabinet Deloitte en novembre 2013, la réflexion stratégique a beaucoup avancé au cours des trois dernières années.
La quasi-totalité des universités se sont dotées d’un schéma pluriannuel de stratégie immobilière et désormais les trois quarts d’entre elles disposent d’un schéma directeur de l’immobilier et de l’aménagement.
Un examen plus détaillé de ces documents met toutefois en évidence des faiblesses persistantes, que les nouvelles vagues d’accréditation pourront très utilement résorber.
D’abord, la partie consacrée au diagnostic, il est vrai de mieux en mieux nourrie, ne s’étend que rarement aux performances énergétiques et à l’analyse des coûts prévisionnels d’exploitation, de maintenance et d’investissement, pourtant décisifs à la programmation. Seules les universités de Paris 1, de Grenoble, de Nantes, de Paris-Est Créteil et de Marne-la-Vallée ont mené un audit énergétique complet, les universités d’Aix-Marseille, de Strasbourg et d’Amiens n’ayant engagé une démarche de cette nature qu’à l’occasion d’opérations ponctuelles.
De manière plus générale les universités sont en retard dans le déploiement des outils informatiques qui faciliteraient le pilotage de la fonction immobilière et son optimisation en fonction des besoins de la scolarité. Les logiciels, confiés aux seules directions du patrimoine immobilier qui ne disposent pas des effectifs suffisants pour accélérer la saisie des données, se diffusent lentement en dépit des initiatives conjointes du ministère et de l’association de mutualisation des universités et établissements (AMUE). Même lorsqu’ils existent, force est de constater qu’ils sont très rarement étendus à la gestion de la scolarité, préalable pourtant indispensable à la mutualisation des bâtiments en fonction des pics d’activité des différentes composantes, lesquelles persistent ainsi à garder dans leurs seules mains la gestion quotidienne des implantations. Or l’existence de tels outils est absolument indispensable à une gestion cohérente du patrimoine, comme l’illustre l’expérience réussie de l’université Lyon 3 qui utilise quotidiennement une application dénommée « système d’information décisionnel sur les heures d’enseignement », liant les données des maquettes de formation, les emplois du temps résultant de la mise en œuvre de celles-ci et les affectations de salles, et grâce à laquelle l’établissement a pu procéder, dans de brefs délais, à une réaffectation mieux opérationnelle et plus optimale des locaux, mettant en cohérence la chaîne des opérations de formation de leur conception à̀ leur réalisation en salle.
Le volet stratégique quant à lui, borné par un horizon de seulement cinq années qui s’adapte mal aux échéances nécessairement lointaines qu’impose une politique immobilière cohérente, demeure trop souvent déconnecté de ce qui lui donne sens, c’est-à-dire la stratégie de développement des formations, le cœur du métier des universités.
Il est vrai que l’exercice consistant à estimer les dépenses et recettes à cinq ou vingt ans est considérablement compliqué par l’absence de visibilité des établissements sur les niveaux de subventions d’investissement (essentiellement issues des CPER) et de maintenance (intégrées à la dotation budgétaire annuelle) nécessaires à leurs projets immobiliers ou sur leurs propres capacités à assurer un financement interne. Mais il demeure regrettable que trop de dimensions, pourtant décisives, soient encore absentes de ces documents, en particulier la rénovation énergétique, qui s’est pour l’instant limitée à quelques établissements ayant bénéficié des opérations du volet énergétique du plan Campus (Strasbourg, Paris 1 et Marne-la-Vallée) et même dans ces cas pour seulement une partie de leur patrimoine ne dépassant jamais 30 % des surfaces totales.
b. L’importance d’une gouvernance cohérente intégrant pleinement l’immobilier dans la stratégie globale de formation
L’élément décisif permettant d’apprécier la qualité de la gestion immobilière est incontestablement l’efficacité de l’organisation de la gouvernance.
De manière prometteuse, la rapporteure pour avis a pu constater que la nomination d’un vice-président responsable du patrimoine immobilier est aujourd’hui presque systématique, tandis que les directions du patrimoine se sont partout fortement étoffées, en dépit des obstacles structurels liés à la difficulté à̀ recruter des cadres, davantage attirés par les collectivités territoriales, et à l’émiettement des forces sur des sites très souvent dispersés.
Pour autant, ces progrès dans l’organisation ne portent tous leurs fruits que lorsque les missions immobilières s’imposent à l’agenda des universités, ce qui suppose dans les faits que le vice-président jouisse d’une autorité incontestable, qu’il bénéficie du soutien du président et qu’il soit étroitement associé à la construction de la stratégie d’ensemble de l’université. Or, en dépit d’évolutions rapides et réelles, on constate trop souvent un certain isolement de ces directions, parfois écartées des réunions stratégiques voire des instances de consultation.
Or, une stratégie immobilière cohérente n’a de sens que si elle décline en termes de projets immobiliers la stratégie décidée par les responsables de l’établissement pour le cœur de métier, à savoir la formation, la recherche et l’innovation.
Cela suppose en outre la réunion des importants préalables, qui existent encore trop peu, que sont les schémas stratégiques couvrant les différents champs scientifiques ou techniques, en particulier le référentiel de l’offre de formation (ROF), les objectifs de recherche et le schéma de développement du numérique (SDN).
c. Le préalable indispensable de la réflexion sur les défis pédagogiques et environnementaux de l’université du XXIe siècle
Surtout, cette démarche stratégique doit être menée concomitamment à une réflexion sur l’évolution des modèles pédagogiques qui modifient profondément les besoins en matière d’évolution des surfaces.
La dématérialisation massive de la formation, qui va bien au-delà des MOOCS, aujourd’hui encore essentiellement sollicités par les personnes déjà diplômées dans le cadre de la formation tout au long de la vie, n’implique pas nécessairement la disparition des cours présentiels, toujours décisifs dans la démarche d’apprentissage. Mais elle encourage sans ambiguïté la flexibilité des usages, permettant aux espaces traditionnellement de passage d’être très opportunément réinvestis, qu’il s’agisse par exemple des halls et restaurants universitaires désormais massivement occupés par les étudiants lorsqu’ils peuvent y connecter leur matériel informatique, et bouleversant la vocation des espaces de cours, dont la modularité devient l’exigence principale. On constate en particulier une mutation de la délivrance du cours magistral qui s’appuie de plus en plus sur la pédagogie inversée grâce à laquelle les étudiants, qui ont préalablement pris connaissance du cours mis en ligne par l’enseignant, tirent parti de la séance pour approfondir les points qu’ils maîtrisent mal.
Dans cette logique, le modèle des grands amphithéâtres apparaît en voie d’extinction, au profit d’espaces dont la configuration peut varier. Une illustration particulièrement révélatrice de cette tendance est la nouvelle organisation mise en place pour la première année commune aux études de santé (PACES) dans l’université de Grenoble où au grand amphithéâtre ont succédé deux grandes pièces modulables de 200 places et de nombreuses salles de travaux dirigées. Il n’est d’ailleurs pas indifférent de remarquer que cette évolution exemplaire a été précédée par la mise en place au sein de la communauté d’universités et d’établissements (COMUE) d’un comité de pilotage sur la pédagogie à l’ère numérique dont la démarche s’étendait bien au-delà des MOOCS pour analyser « les conditions mêmes de l’acte d’enseignement ».
Dans cette perspective, le ministère chargé de l’enseignement supérieur a mis en place une mission d’expertise et de conseil auprès des établissements (MEC) qui a publié en 2015, en relation avec la mission du numérique pour l’enseignement supérieur, un guide campus d’avenir intitulé « concevoir des espaces de formation à l’heure du numérique », destiné aux présidents d’universités et à leurs services pour les aider dans la conception de l’extension ou la réhabilitation de leurs locaux. Cette mission apporte, à la demande des universités, expertise et conseil pour la programmation de leurs locaux. La rapporteure pour avis doit cependant regretter qu’un seul établissement à ce jour, l’université de Caen, ait sollicité cette aide, dans le cadre de la rénovation intégrale d’un bâtiment de 15 000 mètres carrés.
L’autre grand enjeu stratégique est la transition énergétique. 94 % des bâtiments des établissements d’enseignement supérieur ayant fait l’objet d’un diagnostic de performance énergétique sont classés en dessous de la classe B, cible du Grenelle de l’environnement, dont une majorité en C et D. Dans une économie où l’immobilier est, à lui seul, responsable en France de 40 % de la consommation d’énergie finale et de 25 % des émissions de gaz à effet de serre, l’effet de masse du patrimoine universitaire, l’un des plus importants de l’État, ne peut être négligé. En outre, l’inflation des coûts énergétiques des bâtiments aux performances médiocres pèse comme il a été vu supra très lourdement sur les universités, pour lesquelles la rentabilité à moyenne échéance des investissements écologiques ne fait guère de doute.
Pour répondre à ces défis, à côté de montages financiers et juridiques de plus en plus innovants évoqués infra, la Conférence des présidents des universités a établi un référentiel dédié au développement durable dont l’objectif est d’évaluer l’état d’avancement et la pertinence des actions menées en matière de développement durable dans les universités. Cet outil comporte cinq axes consacrés respectivement à la « stratégie et la gouvernance », la « formation », la « recherche », la « politique sociale et l’ancrage territorial » et l’« environnement », contenant chacun des objectifs, des indicateurs et des exemples de bonnes pratiques, déclinés à un ou cinq ans. Dans ce cadre, l’établissement peut déterminer son niveau d’engagement, le degré de réalisation des actions significatives, et rédiger les documents qui tracent et accompagnent l’avancement de ses projets et actes. Cet outil, qui constitue à la fois un guide d’autodiagnostic, un tableau de bord, un guide stratégique et une base pour la certification, peut ainsi très utilement constituer la première étape d’un processus de labellisation.
Mais, là encore, en dépit de ces indéniables progrès dans l’offre de soutien et de pilotage, force est de constater que trop peu d’universités se sont pleinement investies dans cette démarche innovante, il est vrai d’autant plus complexe qu’elle exige elle-aussi des investissements préalables importants que peu d’établissements sont capables d’assumer.
3. De nouvelles étapes à franchir pour mieux encourager les universités à gérer avec ambition leur patrimoine immobilier
De manière générale, il est clair que l’incertitude sur les ressources à long terme constitue un obstacle souvent dirimant pour bâtir une stratégie immobilière à la hauteur des enjeux. Or, comme il a été vu supra, les financements assurés par l’État et les collectivités territoriales, qui sont considérables avec plus de 800 millions d’euros par an hors opérations exceptionnelles du plan Campus, ne suffisent pas à garantir une gestion optimale du patrimoine et ne comportent guère d’incitations pour les établissements à mieux assumer leurs missions immobilières. Il est donc nécessaire, à côté de la rationalisation des usages dont la rapporteure pour avis a dessiné quelques-unes des pistes les plus prometteuses, d’étendre et de conforter les ressources propres des universités tout en les responsabilisant plus directement.
a. De trop faibles incitations à optimiser leur patrimoine qui impose de revoir le régime de rétrocession des produits de cession
Les premiers points de blocage résident dans le régime de propriété de l’immobilier et les modalités de négociation des dotations qui lui sont associées.
En premier lieu, les universités, non propriétaires des locaux dont elles assument l’entretien, disposent de peu de marge de manœuvre pour réaliser des opérations d’optimisation.
Introduit par la loi du 10 juillet 1989 d’orientation pour l’éducation, l’article L. 762-2 du code de l’éducation confère en effet aux universités la responsabilité « d’exercer les droits et les devoirs du propriétaire, à l’exception du droit de disposition et d’affectation » sur les biens qui leur sont affectés ou mis à disposition. En application de la loi n° 2010-1536 du 13 décembre 2010 relative aux activités immobilières des établissements d’enseignement supérieur, elles peuvent cependant, sous réserve de l’accord préalable de l’administration, conclure des contrats conférant des droits réels à des tiers, donc louer ces biens, dès lors que ces contrats ne font pas obstacle à la continuité du service public.
Mais, puisqu’elles ne sont pas propriétaires et qu’elles ne peuvent donc pas directement vendre ces biens, les universités ne sont guère incitées à rationaliser, par des cessions ou des acquisitions, leur patrimoine. L’État, propriétaire de 87 % des locaux, n’a en effet pas su mettre en place des procédures encourageant les établissements à déployer une politique dynamique, en particulier lorsqu’ils disposent d’espaces excédants manifestement leurs besoins.
En application de l’article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, lorsqu’un bien de l’État est vendu, France Domaine alloue 30 % du produit de la cession à la réduction des déficits. Par suite, 20 % sont répartis pour l’ensemble des ministères dans un fonds mutualisé. Seuls 50 % sont donc rétrocédés au ministère de l’enseignement supérieur, sans que d’ailleurs ce dernier n’ait une quelconque obligation à reverser ces gains à l’établissement concerné.
Dans ce contexte, et de surcroît dans des délais de reversement extrêmement lents, les universités n’ont aucune incitation à vendre des éléments de patrimoine dont elles n’auraient plus l’usage. Les opérations de cession leur imposent une lourde charge, en particulier pour financer la remise aux normes et la réhabilitation des bâtiments à céder, tandis que le retour financier, limité à 50 % lorsqu’il est associé en parallèle à un projet immobilier concomitant validé par le ministère, est pour sa part incertain. En conséquence, les cessions sont devenues aujourd’hui presqu’inexistantes, ne dégageant que 1,2 million d’euros en 2014, pour un patrimoine de 16,5 millions de mètres carrés.
La dévolution de 30 % des produits de cession à l’amélioration des finances publiques, fixées dans la loi précitée, dont il est utile de rappeler qu’elle comporte des exceptions par exemple au profit du ministère de la Défense qui bénéficie de l’intégralité des produits de cession des biens qui lui sont affectés, n’est pas contestable dans le contexte budgétaire actuel.
En revanche, la rapporteure pour avis estime que l’ampleur des besoins financiers et des opportunités de rationalisation induits par l’immobilier conjugué au caractère prioritaire qu’a légitimement pris l’objectif d’élever massivement le niveau de qualification de notre population militent pour que la partie mutualisée des retours fassent l’objet d’une exception limitée aux seules universités. Cela permettrait de porter à 70 % le taux de retour sur cession. En parallèle, il serait opportun que le ministère de l’enseignement supérieur s’engage à rétrocéder ces sommes aux universités concernées, dès lors que celles-ci disposent d’un schéma d’investissement de qualité.
En second lieu, le système d’allocation des moyens permettant aux universités d’assumer les charges du propriétaire induites par ce régime, longtemps franchement inflationniste, demeure trop indifférent à la qualité de la gestion immobilière.
Négociés dans le cadre de contrat quadriennaux d’établissement, dont la signature est répartie par vague annuelle regroupant des académies, les moyens étaient calculés jusqu’en 2008 selon une classification opérée par les établissements eux-mêmes de l’état du bâti en fonction du montant des travaux nécessaires par rapport à une remise à neuf, de laquelle découlait ensuite une dotation aux mètres carrés d’autant plus importante que les universités signalaient un patrimoine vaste et dégradé, indépendamment de leur utilisation et de la qualité de la gestion patrimoniale.
Cette liaison néfaste entre surfaces déclarées et subventions a été heureusement rompue lors de la mise en place d’une dotation globalisée dans le cadre de l’accès à l’autonomie. Cette dotation comprend l’ensemble des crédits de fonctionnement négociés sur une base quinquennale, intégrant la part autrefois consacrée aux dépenses d’entretiens courants, sans lien avec le montant de mètres carrés. Pour autant, comme il a été vu supra, les enveloppes dégagées demeurent inférieures au besoin constaté. Surtout, il apparaît que la fin du fléchage des crédits vers l’investissement dans un contexte de contrainte budgétaire et de dérives des coûts énergétiques a pu parfois laisser de nombreuses universités utiliser les sommes dévolues à l’immobilier pour couvrir d’autres dépenses aux effets plus immédiatement visibles, au détriment de la durabilité du bâti, voire pour accumuler des réserves financières dont la légitimité est très contestable lorsqu’elles reposent sur l’accumulation de dotations accordées au titre du financement d’un service public. Le prélèvement de 100 millions d’euros opéré par l’État en 2015 sur les réserves accumulées par certaines universités en dépit de besoins immobiliers attestés s’inscrivait ainsi dans cette logique d’incitation des établissements à mobiliser leurs ressources, lorsqu’elles existent, pour assurer à tout le moins un entretien optimal de leur patrimoine immobilier.
Pour freiner cette dérive, la rapporteure pour avis suggère que l’État et les universités profitent des prochains renouvellements des contrats quinquennaux pour porter une attention particulière à cette question, en veillant à ce que les subventions du premier et les plans de financement présentés par les secondes soient compatibles avec la sanctuarisation des crédits dévolus à l’immobilier.
b. La dévolution, une perspective nécessaire mais nécessairement éloignée en raison de l’impréparation de nombreuses universités et de son poids disproportionné pour les finances publiques
• Une expérience très onéreuse et dont il est trop tôt pour tirer des enseignements exhaustifs
Pour radicalement modifier le régime d’intéressement des universités et déployer la logique de l’autonomie des universités, l’article L. 719-14 du code de l’éducation prévoit la possibilité de transférer aux universités la propriété du parc immobilier.
Cette accession à la pleine propriété permet aux établissements d’être maîtres d’ouvrage de leurs travaux, conçus sur la base des besoins liés à leurs missions, et de leurs moyens financiers. Elle favorise une gestion plus active du parc, en particulier la vente des locaux peu occupés. Surtout, elle est assortie d’une dotation récurrente de dévolution, calculée, à partir d’une expertise contradictoire, pour faire face aux besoins d’investissement et de maintenance à l’échelle des 25 prochaines années, qui garantit une visibilité pluriannuelle sur les recettes et donc confère aux universités la capacité d’établir une programmation cohérente et pérenne de leurs opérations.
La première phase expérimentale de dévolution a commencé en 2011. Sur une douzaine d’universités candidates, trois ont été sélectionnées sur le fondement, exigeant, de l’élaboration d’un cahier des charges-cadre défini par le ministère comportant l’obligation de réaliser un diagnostic et d’élaborer un schéma directeur de mise en sécurité, valant expertise contradictoire au sens de l’article 32 de la loi du 10 août 2007. Il a également été demandé que les schémas comportent une estimation financière des travaux à réaliser, classés par ordre de priorité, afin d’apprécier les besoins de mise en sécurité.
À l’issue du processus d’accompagnement et de sélection préalable, trois transferts de propriété ont eu lieu en 2011 avec les universités les plus avancées dans la démarche qu’ont été les universités de Clermont 1, Toulouse 1 et Poitiers. Des conventions avec les trois établissements ont permis de finaliser tous les engagements des parties, en contrepartie desquels l’État a alloué une subvention spécifique couvrant les frais d’entretien et de renouvellement fixée à partir des travaux conduits par un groupement de consultants spécialisés dans l’immobilier.
Le transfert fait ainsi l’objet d’un double financement. L’un, récurrent, est fonction de l’activité et l’autre, ponctuel, est déterminé au moment de la dévolution pour des travaux de mise en sécurité. La dotation récurrente initiale, calibrée à partir des besoins de surfaces liés à l’activité actuelle auxquels s’applique un forfait en euros par mètre carré, est susceptible d’évoluer en fonction de l’activité et des résultats de gestion obtenus.
La contribution « dévolution » annuelle pour les trois universités représente un montant global de 22 millions d’euros, auxquels s’est ajoutée la remise préalable à niveau en matière de sécurité et d’accessibilité assumée par l’État pour 27 millions d’euros. Après avoir assuré un accompagnement très proche des établissements en amont du transfert effectif de la propriété, l’État continue de suivre le bon déroulement de l’expérimentation en confiant aux contrôleurs budgétaires des rectorats l’examen des décisions budgétaires.
La DGESIP a réalisé en 2013 un bilan d’étape de cette expérimentation dont les résultats sont encourageants mais contrastés. Le bilan exhaustif lancé pour l’université Toulouse 1 dans le cadre du renouvellement de la vague contractuelle A (2016-2020) à laquelle elle appartient permettra de dégager des enseignements plus précis encore, s’appuyant sur l’évolution de l’état du bâti et l’exécution du programme pluriannuel d’investissement, l’optimisation des locaux à partir du taux d’occupation des locaux et des recettes de valorisation, et la participation des collectivités territoriales aux financements des besoins immobiliers.
D’abord, il est manifeste que dans les trois universités, les services immobiliers ont été considérablement étoffés (la direction immobilière de l’université de Poitiers rassemble par exemple désormais 70 personnes) et que la dimension immobilière s’est imposée comme un élément clairement stratégique, piloté au plus haut niveau. La visibilité financière donnée par la dotation pérenne permet aux universités de penser l’avenir de leur immobilier dans la durée, ce qui donne une force et un dynamisme nouveaux aux politiques qu’elles conduisent.
Pour autant, les effets d’optimisation induits par la dévolution, certes encore trop récente pour en tirer tous les enseignements, tardent à se manifester. Seule l’université de Poitiers a identifié des capacités de cessions importantes (53 000 mètres carrés) prévoyant d’abord de dégager 4,6 millions d’euros avant que la version 2014 de son plan de financement, mieux conscient de l’état du marché immobilier et de la difficulté particulière que recèle la cession d’éléments de patrimoine aux caractéristiques prononcées, ne ramène cette estimation à 1,8 million d’euros.
De même, l’effet des dotations récurrentes sur la progression de la qualité du bâti et sur l’optimisation des ressources semble modéré. Le pourcentage de surfaces relevant des catégories A et B a certes progressé à Clermont 1 et à Toulouse 1 et la part des surfaces ayant reçu des avis défavorables des commissions de sécurité a diminué à Clermont 1 depuis 2010, mais ces mouvements s’inscrivent dans des tendances plus anciennes et demeurent de faible amplitude. L’amélioration des taux d’occupation ne se constate qu’à Poitiers (de 41 % en 2008 à 45 % en 2013), Toulouse 1 et Clermont 1 souffrant plutôt pour leur part d’une raréfaction des ressources en surface.
Surtout, le coût de la dévolution est très élevé.
D’abord, l’État a fait le choix, compréhensible mais onéreux, de faire précéder le transfert d’une remise à niveau du parc immobilier en matière de mise en sécurité et d’accessibilité opérée sur le fondement des diagnostics réalisés par les établissements et des schémas directeurs de mise en sécurité réalisés en 2009-2010 et financée en 2009 et en 2010 dans le cadre du plan de relance. Cette opération, qui a mobilisé 27 millions d’euros, entraînerait un coût global, si elle devait être généralisée à l’ensemble des universités, proche du milliard d’euros, éventuellement lissé sur une période de 10 à 25 ans.
Ensuite, le montant de la dotation récurrente annuelle destinée à couvrir tous les coûts de maintenance et d’investissement apparaît très élevé. Elle a été calculée en multipliant les mètres carrés d’une surface cible (négociée sur la base des besoins issus des schémas directeurs immobiliers) par un coût forfaitaire, fixé à 50 euros par mètre carré, à partir des résultats d’une étude comparative nationale et internationale ayant établi le coût moyen du gros entretien et du renouvellement (GER) à 83 euros par mètres carrés auxquels ont été soustraits les financements déjà assurés par l’État comme la maintenance courante incluse dans la dotation de fonctionnement SYMPA, la masse salariale des personnels affectés à l’immobilier, la part de ressources propres pouvant y être consacrée et les financements des collectivités.
Comme il a été vu supra, l’extension à toutes les universités d’un niveau de transfert de cet ordre représenterait un coût annuel pour les finances publiques de 850 millions d’euros, auxquels il faut retrancher les crédits de CPER qu’il remplacerait, soit un coût net proche de 500 millions d’euros par an.
Il faut en outre rappeler que la vaste majorité des universités ne disposent pas aujourd’hui des moyens opérationnels, stratégiques et de gouvernance aptes à garantir leur capacité à assumer à brève échéance les responsabilités d’une dévolution complète.
Il demeure néanmoins vrai que, comme l’estime la Cour des comptes (2), « le transfert de la propriété du parc immobilier est cohérent avec le régime d’autonomie des universités et leur offre de nouvelles possibilités d’action : l’accession à la peine propriété permet à un établissement d’être maître d’ouvrage de ses travaux, conçus sur la base des besoins liés à ses missions et ses moyens financiers. Elle est de nature à favoriser une gestion plus active du parc ; la vente des locaux peu occupés peut réduire les coûts de fonctionnement et générer les ressources propres, les produits des cessions revenant en intégralité aux universités ».
Pour autant, la rapporteure pour avis, tout en partageant la conviction que la dévolution demeure un l’objectif nécessaire et cohérent à moyen terme pour garantir une pleine appropriation des enjeux immobiliers, estime que ce mouvement ne peut s’étendre que progressivement, au rythme des progrès effectués par les établissements dans leur organisation et de l’accroissement des capacités des finances publiques à en supporter le coût.
• L’importance de lier dévolution et encouragement aux politiques de site et aux regroupements des universités, pour atteindre la masse critique nécessaire à l’optimisation de la gestion immobilière
En outre, la rapporteure pour avis relève que la perspective de la dévolution doit se conjuguer à la volonté prioritaire clairement affirmée par la présente majorité d’encourager le rapprochement et la mutualisation des universités dans le cadre des politiques de site.
Une solution serait donc de réserver les prochaines dévolutions aux communautés d’universités et d’établissements (COMUE) ou aux universités fusionnées. La mutualisation des fonctions support, en particulier immobilières, est en effet la condition pour garantir la génération économies d’échelle induites par un patrimoine souvent dispersé et, on l’a vu, dont les cycles d’utilisation pourraient très utilement être intensifiés par leur usage alterné entre les différentes composantes aux calendriers divergents. Le regroupement des universités fournit aussi une solution pour accélérer la professionnalisation des pôles immobiliers confrontés à des difficultés de recrutement et au sous-dimensionnement de nombreuses directions du patrimoine au regard de la charge de travail liée aux opérations de maintenance et d’entretien. Elle permettrait aussi de tracer des perspectives d’optimisation liées à la mise en place de groupements de commande pour les marchés de maintenance ou le développement des systèmes d’information. Enfin, la meilleure aptitude des COMUE à solliciter les investissements d’avenir, dont l’accès aux universités doit absolument être préservé dans la prochaine vague par exemple au moyen de projets énergétiques, permettrait de diversifier leurs sources de financement et, par conséquent, de mieux calibrer des dotations récurrentes de l’État qui seraient ainsi relayées par des fonds complémentaires.
Quelques premières expériences vertueuses illustrent d’ailleurs le fort potentiel d’optimisation induit par les politiques de sites, qu’il s’agisse par exemple du regroupement de l’institut français d’urbanisme dans la COMUE Paris Est, des projets de regroupement d’un IUT, d’une école d’ingénieurs, du siège et de l’UFR des sciences de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines ou du déploiement du pôle immobilier centralisé de la COMUE de Lyon.
Cette logique devrait d’ailleurs utilement s’étendre au domaine des achats, notamment des fluides et des services à l’immobilier comme le nettoyage, la maintenance, les contrôles et les vérifications périodiques, ainsi qu’au développement du numérique, au moyen notamment de la création et de la diffusion des outils d’innovation pédagogiques (MOOC, learning centers, espaces de coworking) qui ne peuvent se concevoir sans impact sur les stratégies immobilières et qui offrent de surcroît l’avantage de pouvoir s’émanciper des contraintes liées aux dispersions géographiques.
• L’enjeu de l’augmentation des ressources propres des universités, en particulier grâce à leur pleine insertion dans la formation continue
En tout état de cause, l’évolution nécessairement lente du calendrier de mise en œuvre de la dévolution ne saurait épargner aux universités un effort indispensable d’optimisation de leurs ressources propres.
Au-delà des mesures d’optimisation du patrimoine induites par une analyse lucide des évolutions des apprentissages, la rapporteure pour avis souhaite insister sur trois éléments qui pourraient très utilement conforter l’assise financière des établissements.
Un premier est le recours aux emprunts, qui doit bien évidemment demeurer strictement encadré. La capacité d’emprunt des universités est aujourd’hui en effet très limitée. L’emprunt auprès des banques commerciales est interdit aux termes de l’article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 précitée. Seuls les emprunts auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) sont autorisés, mais à la condition que l’intervention de cette dernière soit limitée à 50 % du besoin total de financement ce qui, dans les faits, ferme cette voie à la majorité des établissements qui ne disposent pas des ressources formant ce levier initial. Il n’existe aujourd’hui qu’une possibilité d’emprunt à 100 % des besoins auprès de la CDC pour couvrir les investissements inférieurs à cinq millions d’euros et consacrés intégralement à la transition énergétique. S’y ajoute, pour les seuls bénéficiaires du plan campus toutefois, la couverture éventuelle de 50 % des besoins par la BEI. De toute évidence, ces possibilités sont aujourd’hui trop limitées, et la rapporteure pour avis suggère qu’à tout le moins le champ des établissements éligibles à l’enveloppe de prêt de la BEI soit étendu aux universités dont le niveau d’organisation de la stratégie immobilière apparaît satisfaisant.
Ensuite, on ne peut que regretter que les universités ne recourent que très marginalement aux opportunités que recèle leur vaste patrimoine faiblement occupé dans de longue période pour développer avec plus d’ampleur les locations temporaires, soit à des congrès, qui souffrent aujourd’hui d’une pénurie de locaux, soit à des écoles d’été, sur le modèle des summer schools dont les universités anglo-saxonnes ont fait l’un des piliers de leur modèle de financement.
Enfin, la rapporteure pour avis invite les établissements à tirer pleinement parti de leur vocation à participer à la formation professionnelle, qui mobilise des flux financiers de plus de 20 milliards d’euros dont ils ne bénéficient aujourd’hui qu’à hauteur de 300 millions d’euros, alors même que cette mission, exaltante et ambitieuse, permettrait de faire évoluer les formations et la pédagogie à l’université en la rapprochant du monde du travail, ancrerait leur légitimité sociale en y faisant accéder des personnes trop longtemps tenues éloignées du monde de l’enseignement supérieur et servirait l’objectif décisif d’accroissement du taux de qualification de notre société.
La Commission des affaires culturelles et de l’éducation procède à l’examen des rapports pour avis de Mme Barbara Pompili, sur les crédits pour 2016 de la mission « Enseignement scolaire », et de Mme Sophie Dion (Recherche) et Mme Anne-Christine Lang (Enseignement supérieur et vie étudiante) sur les crédits de la mission « Recherche et enseignement supérieur », lors de sa première séance du mercredi 14 octobre 2015.
M. le président Patrick Bloche. Nous entamons ce mercredi matin l’examen du projet de loi de finances pour l’année 2016, avec la présentation de trois rapports pour avis sur les crédits du ministère de l’éducation nationale, de la recherche et de l’enseignement supérieur.
Nos trois rapporteures ont chacune choisi de traiter une thématique spécifique afin de valoriser un secteur ou un enjeu particulier des politiques publiques en faveur de l’enseignement public et de la recherche. Dans le cadre de la mission « Enseignement scolaire », Barbara Pompili a souhaité centrer son rapport sur l’école primaire inclusive, dans le prolongement de la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République que nous avons adoptée en 2013. Sophie Dion, pour sa part, a choisi la thématique « Sport et recherche » pour son avis sur les crédits de la recherche. Quant à Anne-Christine Lang, son rapport pour avis sur les crédits de l’enseignement supérieur et de la vie étudiante porte plus précisément sur le patrimoine immobilier des universités, vaste sujet aux impressionnantes implications financières.
Mme Barbara Pompili, rapporteure pour avis sur les crédits de la mission « Enseignement scolaire ». L’un des apports les plus précieux des travaux de notre commission à la loi de refondation de l’école a été l’introduction, dans le code de l’éducation, de la mission d’inclusion qui figure désormais, aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation, parmi les missions d’un service public de l’éducation. Elle repose sur la reconnaissance du fait « que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser ».
Là réside, en effet, la principale lacune de notre système éducatif. S’il s’occupe très bien des élites et de leur formation, toutes les études internationales et nationales montrent que c’est en France que les performances scolaires sont le plus étroitement liées aux origines sociales. Notre école aggrave les inégalités et éprouve d’extrêmes difficultés à prendre en compte les difficultés particulières d’apprentissage des élèves et à les surmonter. C’est donc dans la réalité qu’il convient désormais d’inscrire le principe d’inclusion, ce qui appelle un profond changement de mentalité. Il s’agit non pas de demander aux enfants de se fondre dans une normalité fantasmée mais, au contraire, d’être en mesure de proposer à chacun des réponses appropriées, en fonction de ses besoins.
L’école inclusive postule que tout enfant peut réussir sa scolarité. Sa situation familiale et sociale, sa culture, un handicap, une difficulté ou un trouble d’apprentissage ou du comportement ne doivent plus être des obstacles. Ce sont des spécificités qu’il convient de prendre en compte pour adapter les réponses pédagogiques. La présentation de ce rapport est l’occasion de faire un point d’étape, deux ans après la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République.
J’évoquerai les nombreux outils au service de l’inclusion et les pistes d’amélioration envisageables, notamment en ce qui concerne les accompagnants d’élève en situation de handicap (les AESH), les contrats aidés et les parcours personnalisés. Je parlerai aussi du rôle essentiel que doivent jouer les réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED). Je reviendrai sur le mouvement actuel d’internalisation des unités d’enseignement et sur la nécessité de mieux articuler les unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS) et la classe ordinaire, car il importe vraiment de dépasser les cloisonnements qui demeurent. J’insisterai sur la nécessité de recourir à des partenariats innovants et des méthodes pédagogiques individualisées. Et, bien évidemment, j’insisterai sur la formation des enseignants qui est, pour moi, l’essentiel.
Je tiens à souligner la diversité des publics concernés. L’école inclusive évoque trop souvent le seul handicap, à tort. Les élèves à besoin éducatif particulier sont aussi ceux atteints de troubles spécifiques, comme les élèves « dys », les enfants précoces, les enfants confrontés à des difficultés familiales ou sociales, les enfants allophones, récemment arrivés en France, ou ceux issus de familles itinérantes. Les situations sont nombreuses et je n’ai pu les traiter toutes dans le rapport, mais ce qui compte, c’est la démarche d’inclusion, c’est l’évolution des méthodes. Par ailleurs, je me suis concentrée sur le premier degré, parce que c’est là que tout commence. En outre, le sujet est trop vaste, et ma collègue Sylvie Tolmont a évoqué l’an dernier le secondaire, dans le cadre de son très intéressant rapport consacré aux sections d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA).
Le rapport brosse, tout d’abord, un rapide tableau de la situation et des dispositifs existants.
Depuis la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la scolarisation des enfants en situation de handicap a progressé : le nombre d’enfants handicapés scolarisés dans les écoles primaires a doublé en dix ans, pour dépasser 150 000, soit 2,2 % du total des élèves. Mieux, 69 % d’entre eux ont été scolarisés dans les classes ordinaires (dont 42 % avec un auxiliaire de vie scolaire) tandis que la part des élèves en classe pour l’inclusion scolaire (CLIS) régressait pour atteindre le niveau de 30 %. L’État consacre désormais 1,5 milliard d’euros par an à ces politiques : 600 millions d’euros pour la rémunération des accompagnants d’élèves en situation de handicap – c’est le nouveau nom des auxiliaires de vie scolaire –, 700 millions d’euros pour celle des enseignants spécialisés et 200 millions d’euros pour celle des personnels d’animation et d’encadrement.
Par ailleurs, en application de la loi pour la refondation de l’école, nous assistons depuis quelques années à une réelle individualisation des parcours, en fonction des besoins des élèves et des outils que l’école peut mobiliser pour offrir une réponse adaptée aux difficultés qu’ils peuvent rencontrer. Je songe là au projet personnalisé de scolarisation (PPS), élaboré par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et l’équipe éducative pour les enfants en situation de handicap, mais aussi au plan d’accompagnement personnalisé (PAP), qui se met lentement en place depuis que la circulaire du 22 janvier 2015 permet des adaptations pédagogiques au bénéfice des élèves souffrant de troubles d’apprentissage. Enfin, le programme personnalisé de réussite éducative encourage les équipes pédagogiques à mettre en place des accompagnements différenciés pour les élèves qui risquent de ne pas maîtriser certaines compétences attendues à la fin des cycles scolaires.
Des dispositifs d’enseignement spécial demeurent encore indispensables pour accompagner temporairement les enfants dont les difficultés d’apprentissage apparaissent peu conciliables avec une scolarité dite ordinaire. Félicitons-nous cependant du rapprochement qui s’opère entre ces dispositifs et la classe ordinaire, qui a vocation à accueillir tous les élèves. Dans cet esprit, les CLIS ont été modernisées par la circulaire du 21 août 2015 qui, en les rebaptisant ULIS-écoles, signifie clairement que ces unités doivent intervenir en appui de la classe ordinaire et non, comme c’est trop souvent le cas, s’y substituer. De même, le Gouvernement a fortement accéléré l’externalisation dans les écoles ordinaires des unités actuellement situées dans les établissements médico-sociaux, avec 100 nouvelles unités ouvertes à la rentrée 2015 s’ajoutant aux 200 existantes.
Parallèlement, 100 unités autisme seront créées d’ici à la fin de la législature, pour accueillir plus de 700 élèves enfants âgés de trois à six ans dont la prise en charge était jusqu’à présent si défaillante dans notre pays. Le retard reste considérable, mais nous avançons dans la bonne direction.
Si de nombreux outils pour l’inclusion ont ainsi été forgés, en particulier à la suite de la loi de refondation, il serait illusoire de croire que, pour devenir inclusive, l’école n’a désormais plus qu’à attendre le déploiement des moyens et la diffusion des bonnes pratiques. L’école inclusive demande, en effet, une accélération des investissements. On estime ainsi que 10 000 à 30 000 enfants handicapés se trouvent aujourd’hui privés de toute solution de scolarisation. Nombreux sont ceux qui doivent se résoudre à chercher une solution en Belgique, ce qui est absolument inacceptable.
Ce manque de moyens empêche une mise en œuvre satisfaisante des parcours individualisés. Le manque, par exemple, de médecins scolaires, qui doivent valider les PAP, dont le nombre s’effondre en raison d’un déficit d’attractivité du métier – on n’en compte qu’un pour 9 000 élèves. Il y a aussi le coût prohibitif des bilans pour les enfants « dys », qui constitue une discrimination sociale dans leur accompagnement : un test ergothérapeutique non remboursé par la sécurité sociale coûte, par exemple, entre 100 et 250 euros. Les indispensables RASED, victimes d’une véritable saignée pendant la précédente législature, ont vu supprimer à bas bruit le tiers de leurs effectifs qui ne se rétablissent que très lentement depuis 2012. Un constat analogue peut être fait pour les enseignants référents, chargés de suivre les parcours individualisés : leur nombre ne dépasse pas un pour 500 élèves. Comment, dans ces conditions, suivre individuellement les élèves ? Et je n’oublie pas les précieux enseignants des unités pédagogiques pour élèves allophones arrivant (UPE2A), qui devront très bientôt faire face à l’arrivée de près de 5 000 enfants réfugiés syriens, ce qui représente une augmentation des besoins d’un quart.
Parallèlement à une augmentation des moyens, l’école inclusive exige un complet changement d’état esprit. La différence doit être envisagée, non comme un défaut à corriger ou à reléguer dans des structures extérieures, mais comme une opportunité pour l’école de changer ses méthodes et d’œuvrer à la réussite de tous. Lors des auditions et sur le terrain, enseignants et acteurs de l’éducation ont tous manifesté leur volonté de relever ce défi. Je m’en réjouis, mais ils se disent aussi démunis, parfois, face à la complexité de la tâche.
Le premier enjeu est donc de faire émerger une culture du travail en équipe qui permette de faire converger les compétences et les efforts des équipes éducatives, des équipes médico-sociales et des parents au service de l’enfant, pour surmonter ses difficultés d’apprentissage spécifiques. Il faut absolument éviter des réponses trop tardives, trop stéréotypées et trop fragmentées, et préserver l’école du piège de la médicalisation, c’est-à-dire de la relégation des enfants.
Se pose aussi la question de la responsabilité de l’école dans la détection des premiers troubles. Près de la moitié des troubles d’apprentissage sont aujourd’hui découverts à l’école maternelle. Plus les troubles sont détectés rapidement, meilleures sont les chances de les prendre en charge. Or on constate aujourd’hui, en particulier dans les réseaux d’éducation prioritaire, une baisse tendancielle du taux de scolarisation des enfants de moins de trois ans, passé de 35 % en 1999 à 11 % aujourd’hui. Dans le même esprit, il est urgent de former les enseignants à la détection et aux premiers gestes scolaires, ainsi qu’au dialogue avec les familles, essentiel pour trouver les meilleures façons d’accompagner les élèves dans leur scolarisation, qu’il s’agisse de réponses pédagogiques ou d’un nécessaire travail de médiation, notamment avec les familles les plus éloignées du milieu scolaire. Je vous renvoie, sur ce point, à l’excellent rapport rédigé par notre collègue Valérie Corre, à la suite des travaux de la mission d’information présidée par notre collègue Xavier Breton.
La culture du travail en équipe doit aussi permettre de dépasser la politique du « tout AVS » sur laquelle a longtemps été concentré l’essentiel des efforts en faveur de l’école inclusive. Entendons-nous bien : l’augmentation, par le Gouvernement, du nombre d’auxiliaires de vie scolaire, avec 28 000 AESH et 48 000 contrats aidés, est une très bonne chose. Le recours aux AVS est un élément central de l’école inclusive et ces postes doivent, sans le moindre doute, être pérennisés, et leurs personnels être mieux formés, mieux rémunérés et accéder à des statuts moins précaires ; mais il faut lutter contre le recours trop systématique aux AVS, alors que, dans certains cas, des adaptations pédagogiques seraient suffisantes pour répondre aux besoins de l’élève.
La culture du travail en équipe permettrait aussi de mettre un terme à un scandale : à la fin de l’année 2013, seuls 35 % des enfants handicapés scolarisés avaient accès aux activités périscolaires et 66 % à la cantine, alors même que, depuis le mois de février 2015, les collectivités peuvent bénéficier de soutiens financiers. Il est temps que l’État refuse de signer les projets éducatifs territoriaux (PEDT) qui méconnaissent l’une des missions essentielles de l’école, et il serait très utile que le Gouvernement envisage les modalités d’une extension des projets personnalisés de scolarisation (PPS) aux activités périscolaires.
C’est pour pallier ces difficultés que je propose de créer dans chaque circonscription scolaire des « pôles ressources inclusion » comportant une cartographie précise des acteurs et des ressources, qui permettent de dresser un premier bilan et de corriger les inégalités d’implantation, et qui offrent aux professionnels un cadre stable de dialogue et aux enseignants des interlocuteurs clairs pour les aider rapidement dans le traitement des difficultés scolaires. En miroir, je suggère d’identifier dans chaque école un « maître ressources inclusion » chargé des relations avec ce pôle. Il serait l’indispensable relais entre les compétences cumulées dans le département et les besoins que chaque enseignant rencontre dans son travail quotidien. Ce serait aussi un précieux interlocuteur pour les trop nombreuses familles qui se sentent exclues de l’accompagnement pédagogique de leurs enfants.
Cela étant, tous mes travaux m’ont convaincue qu’in fine le vrai garant de l’inclusion, celui qui détient la clef du succès des apprentissages, c’est l’enseignant de la classe ordinaire. Il doit donc nécessairement être formé à cette dimension de son métier. Or les auditions que j’ai conduites me font craindre que les écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE) ne soient, pour le moment, très décevantes de ce point de vue.
Tout d’abord, les pratiques de l’école inclusive, intégrées au tronc commun de formation, sont totalement isolées du reste de la formation et insuffisantes. En outre, les interventions d’experts extérieurs, si précieuses sur ces sujets, ne représentent pas plus de 20 à 35 % des intervenants. Ensuite, ces enjeux ne sont pas valorisés dans les parcours et interviennent peu dans les critères d’appréciation des concours, même si des efforts ont été faits, et les formations communes aux enseignants, aux personnels des établissements médico-sociaux et des MDPH et aux AESH sont, au mieux, embryonnaires. Enfin, la formation continue à l’école inclusive est, elle aussi, notoirement insuffisante.
Dès lors, il est urgent d’agir, en premier lieu pour modifier les maquettes des formations des ESPE, mais il faut aussi aller plus loin. Je propose ainsi de déplacer le moment du concours à la fin du cursus de licence, afin de libérer la première année de master du bachotage et de déployer une formation professionnelle digne de ce nom. Cette formation devra aussi mieux diffuser les pratiques de pédagogie différenciée permettant de trouver des méthodes d’enseignement adaptées à chacun dans des classes hétérogènes et, ainsi, de prévenir l’échec scolaire. Il faudra également encourager la diffusion des bonnes pratiques, où les professionnels pourront puiser leur inspiration, et l’innovation pédagogique devra être mieux valorisée dans le parcours professionnel des enseignants et les évolutions de carrière. De manière plus générale, si nous voulons que l’école inclusive devienne une réalité, nous devons redéfinir clairement le métier, la formation, la rémunération et l’évolution de carrière des enseignants, qui en sont le principal pilier.
C’est une évidence, l’école inclusive a un coût, mais ses effets en termes de réduction de l’échec scolaire, d’intégration dans la vie sociale et professionnelle, d’autonomisation, en font un investissement rentable pour toute la société. À nous d’accompagner l’école dans cette adaptation longue et nécessaire.
Mme Sophie Dion, rapporteure pour avis sur les crédits de la recherche. La recherche la plus dynamique se fait souvent aux frontières, aux interfaces, et il m’a semblé intéressant de choisir une nouvelle fois cette année un thème transversal pour examiner comment peuvent se fédérer et se coordonner les activités des nombreux organismes sur lesquels se fonde la recherche dans notre pays. L’an dernier, la montagne, comme objet de recherche transdisciplinaire, a permis de définir un nouveau « biome » sur la base d’une géographie commune et de proposer des réflexions en termes d’organisation ; cette année, j’ai choisi pour thème la recherche sur le sport, qui n’est pas moins riche d’enseignements. Par nature transdisciplinaire, elle implique le dépassement des classifications statistiques et budgétaires habituelles. Cette transversalité permet aussi d’illustrer plus largement les forces et les faiblesses de la recherche en France : ses résultats sont excellents mais leur valorisation, tant académique que pratique, reste souvent très en deçà des possibilités qu’ils ouvrent.
Les recherches publiques menées en France sur le sport sont assez dispersées mais peuvent, finalement, s’articuler autour de quatre structures principales : l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP) ; les unités de formation et de recherche de sciences et techniques des activités physiques et sportives, les STAPS ; un certain nombre d’équipes de recherche de l’INSERM et le laboratoire de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) ; des instruments de recherche dédiés ou contribuant à ces travaux de recherche en cotutelle.
Depuis sa création en 1975, les activités de recherche font partie intégrante des missions de l’INSEP. L’Institut dispose d’un laboratoire de recherche Sport, expertise et performance (SEP), équipe d’accueil universitaire, qui coordonne cinq champs disciplinaires – physiologie, biomécanique, biologie, psychologie et sociologie – afin d’accompagner les sportifs de haut niveau des pôles France de l’INSEP par son analyse de la performance, ses conseils et ses innovations. Plus largement, le ministère des sports a souhaité mieux exploiter les compétences de l’Institut en lui confiant également le pilotage de la politique de recherche sur le sport au plan national, en complément de sa propre activité dans ce domaine. Ses actions d’accompagnement scientifique de la performance consistent à donner aux athlètes de haut niveau, aux entraîneurs et aux acteurs du sport de compétition des conseils fondés sur les avancées récentes de la science. Portant sur la récupération, la nutrition, les charges d’entraînement et les programmes de renforcement musculaire et de prévention de la blessure, ses recherches pourraient évidemment, à terme, profiter, au-delà des seuls sportifs de haut niveau, à l’ensemble de la population.
Par ailleurs, depuis 2006, l’INSEP abrite dans ses locaux de Vincennes l’Institut de recherche biomédicale et d’épidémiologie du sport, l’IRMES.
La recherche dans les universités bénéficie aussi du rôle fédérateur des unités de formation et de recherche des STAPS. Au nombre de trente-sept, dont trente-deux sont des équipes d’accueil, ces structures dépendent de vingt-huit universités, ce qui traduit une présence assez homogène sur l’ensemble du territoire national. Ces unités de recherche mènent des travaux rattachés à des disciplines extrêmement variées. Cependant la faiblesse des crédits récurrents alloués aux laboratoires universitaires les oblige à chercher des contrats au moins autant pour survivre que pour élargir le spectre et l’impact de leurs recherches. Les petites structures de la taille d’un laboratoire sont obligées de faire preuve de beaucoup de dynamisme pour identifier des appels d’offres multiples et dispersés et y répondre dans des conditions satisfaisantes, ceux de l’Agence nationale de la recherche (ANR) étant devenus pratiquement inaccessibles.
Si le sport et la santé sont intimement liés, les recherches de l’INSERM dans le domaine du sport n’en couvrent pas moins des champs très variés. Elles s’intéressent aussi bien à une meilleure connaissance des mécanismes physiologiques mis en œuvre par l’activité physique qu’à celle du rapport des individus au corps et à leur santé ainsi qu’à la pratique sportive considérée comme un moyen préventif, thérapeutique ou de réhabilitation, ou comme une fin en soi en vue de l’amélioration des performances pour la compétition. Cet ensemble forme cependant un groupe hétérogène. Ainsi, la thématique « sport et santé », bien que largement traitée par l’INSERM, ne fait pas l’objet d’une organisation spécifique, tant les questions abordées et les objectifs poursuivis sont spécifiques à chaque équipe ou à chaque domaine thématique.
Enfin, quoiqu’elles soient moins connues, il faut mentionner les activités de recherche de l’Agence française de lutte contre le dopage. Elle est partagée entre différents acteurs : le comité d’orientation scientifique chargé, notamment, d’examiner les projets à subventionner, le conseiller scientifique du président de l’Agence et le département des analyses, avec sa section recherche et développement. Lors du débat d’orientation stratégique pour 2015, le collège de l’Agence a décidé de maintenir les moyens antérieurement consacrés à la recherche, afin de préserver la compétitivité de l’AFLD dans ce domaine, et ce dans un contexte de réduction des crédits. Il est, en effet, essentiel pour un laboratoire au rayonnement international de s’adapter aux techniques de détection nouvelles et aux évolutions des substances et des méthodes de dopage. De fait, avec son département des analyses, l’AFLD dispose, à Châtenay-Malabry, de l’unique laboratoire antidopage français accrédité par l’Agence mondiale antidopage.
Je voudrais également illustrer le caractère fédérateur des recherches sur le sport à travers les équipements dédiés à la recherche sportive. Si l’identification du sport dans le champ de la recherche est éminemment perfectible, réjouissons-nous de la mise en place, par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, à côté des structures que je viens de présenter, de structures interdisciplinaires ciblées qui intègrent, sur un même site, l’ensemble ou, à tout le moins, une partie très substantielle des compétences nécessaires. Mentionnons ces deux sites de référence que sont l’Institut des sciences du mouvement, à Marseille, et Euromov, à Montpellier. En effet, les conséquences économiques des recherches dans le domaine du sport, quel qu’en soit le sujet, quel que soit l’établissement qui les mène, sont particulièrement variées et importantes. Outre des impacts classiques en termes de transfert de technologie, de création de start-up ou de jeunes entreprises innovantes, de partenariats de recherche ou de financement de chercheurs, qu’elle partage avec l’ensemble des autres recherches académiques, la recherche sur le sport assume un rôle direct de dynamisation et de structuration d’un secteur économique suffisamment vaste pour mériter une meilleure approche. Ces enjeux économiques sont, bien sûr, fondamentaux en ce qui concerne la candidature de Paris à l’organisation des Jeux olympiques de 2024. De même, le fait que la France redevienne la première destination mondiale pour le ski, devant les États-Unis et l’Autriche, avec 53,9 millions de journées skieurs en 2014-2015 montre, s’il en était besoin, dans ce domaine sportif spécifique, l’importance des objectifs poursuivis et la nécessité d’investissements dans la recherche pour conforter cette position.
Enfin, les recherches sur le sport contribuent non seulement à faire progresser nos connaissances sur le bien-être et la santé, y compris la santé du sujet vieillissant, mais aussi à assurer la cohésion sociale et le rayonnement international de notre pays.
La valorisation de la recherche prend donc une importance décisive. Les grands établissements de recherche disposent, depuis assez longtemps, de structures de transfert permettant le développement de leurs recherches, mais un effort décisif a été entrepris, dans le cadre du programme des investissements d’avenir de 2009, avec la création des sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT), pour accroître les retombées sur l’économie et la société des financements en matière de recherche. La systématisation de cet instrument nouveau s’est révélée particulièrement pertinente pour valoriser la recherche universitaire menée dans les unités de formation et de recherche propres de ces établissements, y compris dans le domaine sportif.
La place des recherches sur le sport et les activités sportives reste cependant à préciser dans la nouvelle stratégie nationale de recherche définie en mars 2015. Ces recherches relèvent de facto du défi 4, « Santé et bien-être ». Ce classement a semblé naturel, puisque le sport et la santé sont étroitement associés dans l’imaginaire culturel mais aussi dans la vie quotidienne, mais les recherches menées dans ce vaste domaine conduisent à se demander si ce choix était le plus approprié. Les secteurs scientifiques qui peuvent être considérés comme des contributeurs à la recherche sur le sport et le phénomène sportif sont, répétons-le, d’une extrême variété. Dès lors, il est prévisible que la recherche fondamentale, qui a un impact sur l’ensemble des questions liées au sport, se développe, la plupart du temps, dans des laboratoires ou des structures de recherche qui ne lui sont pas expressément dédiés, voire qui ne mentionnent pas explicitement cette thématique dans leurs programmes. Une meilleure prise en compte du sport en tant que champ de recherche à part entière ne serait-elle pas nécessaire ?
L’un des trois axes de la stratégie nationale de recherche de 2009, « Santé et biotechnologie », proposait clairement un cadre transversal adapté. Il n’en va plus de même dans le cadre de la stratégie de 2013-2015. Parmi les dix défis de celle-ci, « Santé et bien-être », est trop précis ou pas assez, car il ne permet pas de traduire les aspects économiques, sociologiques et politiques du sport. Ne serait-il pas souhaitable de faire du sport un défi pour la recherche en lui-même ? Voilà qui anticiperait une déclinaison plus précise des autres défis et de leurs financements publics ou contractuels.
Mme Anne-Christine Lang, rapporteure pour avis sur les crédits de l’enseignement supérieur et de la vie étudiante. J’ai choisi de consacrer la partie thématique de mon rapport pour avis à la question du patrimoine immobilier des universités. C’est l’un des principaux enjeux financiers auquel sera confronté notre enseignement supérieur au cours des prochaines années.
Les universités disposent d’un patrimoine immobilier considérable de plus de 18,5 millions de mètres carrés. Trois phases ont caractérisé son évolution récente. À la faveur du plan Université 2000, les années 1995 à 2000 furent celles d’une vive croissance. La dynamique des constructions s’est poursuivie entre 2000 et 2006, avec près de 10 % de surfaces supplémentaires. Elle s’est finalement interrompue depuis 2010, pour ne reprendre que lentement à partir de 2014, tandis que débutait une nouvelle phase de massification. Depuis 2013, les flux de nouveaux étudiants sont passés d’une moyenne annuelle de 25 000 à 65 000
– environ 50 000 si l’on exclut les élèves de classes préparatoires aux grandes écoles qui ont une double inscription. Ce phénomène est dû à la fois au fort chômage des jeunes, qui les incite à retarder leur entrée sur le marché du travail, à la forte hausse du nombre de bacheliers professionnels et à leur désir croissant de continuer leurs études, et aussi à une plus nette appétence des jeunes pour l’enseignement supérieur. Quoi qu’il en soit, ce mouvement de fond est bienvenu et crédibilise notre objectif d’élever de 43 % à 60 % d’une classe d’âge la proportion de diplômés du supérieur d’ici à 2025.
Se pose la question de la capacité physique des établissements à accueillir ces nouveaux étudiants. Si la taille du patrimoine apparaît largement suffisante, sa qualité, son équilibre sur les territoires et son entretien sont très perfectibles. La répartition des surfaces est inégale : de 3,7 mètres carrés par étudiant à Paris 2 à 15,7 à l’université de Poitiers, la moyenne étant de 6 mètres carrés. Surtout, l’état du patrimoine est contrasté : 12 % des bâtiments sont très dégradés, 27 % supplémentaires exigent des travaux lourds de remise à niveau. La majorité des surfaces souffre d’une usure importante et est très énergivore – en termes de performance énergétique, 55 % sont classés D ou E. Le fonctionnement et l’entretien de ces bâtiments impliquent donc des charges financières importantes, qui s’alourdissent encore puisque beaucoup d’universités sont incapables de garantir ne serait-ce que le maintien en l’état des bâtiments. On estime le coût de la préservation d’un immeuble de toute dégradation supplémentaire à environ 15 euros par mètre carré. Or les universités y consacrent aujourd’hui en moyenne 6,50 euros.
Quelques chiffres permettent de prendre la mesure des enjeux financiers. Le ministère estime qu’une réhabilitation complète des 40 % de bâtiments dégradés combinée à un entretien optimal de toutes les surfaces imposerait des investissements supplémentaires d’environ 850 millions d’euros par an. Or les montants mobilisés dans le cadre des contrats de plan État-région pour répondre à ce besoin ne dépassent pas 450 millions d’euros par an. Manquent donc 400 millions d’euros par an. À cette dette implicite s’ajoutent les montants d’ores et déjà consacrés à la maintenance et à la logistique immobilière, intégrés à l’allocation globale versée par l’État aux universités : autour de 425 millions d’euros par an. J’en profite pour rappeler que le Gouvernement, dans le projet de loi de finances pour 2016, a su prendre la mesure de l’ampleur de ces besoins en augmentant de 138 millions d’euros les autorisations d’engagement pour l’immobilier (+ 12 %) et en renonçant à renouveler le prélèvement de 100 millions d’euros sur les fonds de réserve des universités qu’il avait effectué en 2015, à côté des 65 millions d’euros qui financent mille nouvelles créations de postes.
Dans ce contexte, et compte tenu des fortes tensions auxquelles les finances publiques sont soumises, il est impératif que les universités progressent dans la gestion de leur patrimoine immobilier et dégagent d’importantes marges d’économies et de rationalisation. Prenons cependant la mesure des contraintes spécifiques qui obèrent une réelle professionnalisation de la fonction immobilière des établissements d’enseignement supérieur. Tout d’abord, le fort cloisonnement qui demeure entre les composantes ralentit l’indispensable mutualisation des bâtiments, chaque composante se comportant comme le propriétaire exclusif des murs que l’histoire lui a affectés. Ensuite, le rythme original de l’enseignement universitaire, marqué par des pics d’activité intense, concentrés en général au premier semestre, avant les stages, et, dans la semaine, du mardi au jeudi, conduit spontanément à un surdimensionnement des locaux. Les ratios d’occupation de salles sont ainsi très faibles : environ 70 %.
Sous l’impulsion de l’État, une réelle prise de conscience a émergé depuis quelques années ; toutes les universités ont nommé un vice-président chargé de l’immobilier et se sont dotées de schémas pluriannuels de stratégie immobilière. Toutefois, ces progrès sont inégaux et souvent parcellaires. Seules cinq universités ont, par exemple, mené un audit énergétique complet. Les outils informatiques de gestion, qui se résument parfois à des documents Excel non mis à jour, sont très rarement étendus à la gestion de la scolarité, préalable pourtant indispensable à la mutualisation des bâtiments. Seule l’université Jean Moulin Lyon 3 utilise quotidiennement une application liant les horaires des formations et les affectations de salles. Ainsi celle-ci a-t-elle pu entreprendre une importante rationalisation de l’usage de ses surfaces. Surtout, les stratégies immobilières déployées sont le plus souvent déconnectées des stratégies de développement des formations et de la recherche. De manière générale, la qualité de la gestion immobilière dépend essentiellement de l’efficacité et de l’organisation de la gouvernance, et donc, dans les faits, de l’autorité dont jouissent le vice-président et la direction chargés de l’immobilier.
De manière plus préoccupante, j’ai constaté que les indispensables réflexions préalables sur l’évolution des modèles pédagogiques sont encore trop peu menées dans nos universités. Je pense évidemment au défi de la dématérialisation de la formation. S’il n’implique pas, contrairement à ce que l’on croit, la disparition des cours présentiels, il encourage sans ambiguïté une véritable révolution des usages. Les concepts décisifs sont ici la flexibilité et la modularité, qui peuvent, par exemple, transformer des cours magistraux en cours de pédagogie inversée. Ces mutations changent radicalement les besoins immobiliers. Il est indispensable que les universités appréhendent ces mutations avec lucidité. Il en va de même pour le défi énergétique, incontournable lorsqu’on sait que l’immobilier absorbe 40 % de la consommation d’énergie et émet 25 % des gaz à effet de serre en France.
Nous ne sommes pas parvenus à encourager efficacement les universités à prendre cette question à bras-le-corps.
En premier lieu, les financements sont souvent instables et, surtout, trop incertains pour leur permettre d’ancrer leurs stratégies immobilières dans la durée. La partie de l’allocation globale couvrant les frais d’entretien et de fonctionnement n’est garantie que pendant les cinq années du contrat d’accréditation. Par ailleurs, elle n’est plus fléchée, ce qui a pu autoriser certaines universités, confrontées à de réelles difficultés financières, à utiliser les sommes prévues pour l’immobilier pour couvrir d’autres dépenses plus voyantes.
En second lieu, les réhabilitations et les constructions nouvelles sont financées par des contrats de plan qui ont trop longtemps privilégié les constructions nouvelles, même si les contrats 2015-2020 sont l’occasion d’un opportun recentrage sur les réhabilitations. S’ajoutent à ces programmes les investissements d’avenir du plan campus, avec près de 5 milliards d’euros d’investissements d’ici à 2020, mais ces derniers s’inscrivent dans une logique d’excellence et d’attractivité substantiellement différente, qui excède la seule question des locaux, et ils ne constituent pas une ressource pérenne pour toutes les universités.
En troisième lieu, les universités n’ont pas accès aux emprunts bancaires, hors quelques programmes limités de la Caisse des dépôts et consignation.
Dès lors, au-delà de la stabilisation des financements et l’accès à la future troisième génération des contrats d’avenir, que j’appelle de mes vœux, il est urgent de conforter les ressources que les universités peuvent consacrer à l’entretien de leur patrimoine. Se pose évidemment la question de la dévolution du patrimoine qu’autorise désormais l’article L. 719-14 du code de l’éducation. Même s’il est encore un peu tôt pour en tirer tous les enseignements, l’expérimentation menée par les universités de Clermont 1, Toulouse 1 et Poitiers apparaît très prometteuse. Cependant, si cette expérience mérite d’être poursuivie, cela ne peut se faire que progressivement, car elle est extrêmement onéreuse. L’État a fait le choix, en 2011, d’accorder aux universités bénéficiaires une dotation de dévolution généreuse de 50 euros par mètre carré, précédée d’une complète remise aux normes des bâtiments. Si l’on voulait répéter cette démarche pour toutes les universités et procéder à une dévolution complète, il faudrait trouver immédiatement 500 millions d’euros pour la remise aux normes, plus 500 millions d’euros supplémentaires par an. De tels efforts étant hors de portée, je suggère plutôt de réserver les prochaines dévolutions aux seules communautés d’universités et d’établissement (COMUE) ou universités fusionnées qui auront fait l’effort préalable de mutualiser leurs pôles immobiliers.
Enfin, je pense qu’il faut encourager les universités à faire preuve d’initiative et de créativité pour dégager plus de ressources propres, notamment en tirant partie de leur vaste patrimoine, qu’elles peuvent louer temporairement pour des congrès ou des summer schools, ce qui se fait couramment en Angleterre, et, surtout, en s’engageant avec force et conviction dans la mission exaltante de la formation professionnelle, dont elles ne dégagent aujourd’hui que 300 millions d’euros, alors que c’est un marché de près de 30 milliards d’euros. Cela leur permettrait de contribuer pleinement à l’objectif d’accroissement de qualification de notre société tout entière.
M. le président Patrick Bloche. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes sur la mission « Enseignement scolaire ».
Mme Colette Langlade. Tout d’abord, madame Pompili, je salue le travail approfondi que vous avez consacré à l’élaboration de ce rapport ambitieux sur l’inclusion scolaire à l’école primaire. Vous avez dressé un bilan des investissements budgétaires du Gouvernement et des perspectives d’action. Les dix-sept auditions et tables rondes que vous avez organisées vous ont permis de brosser un paysage complet des difficultés que rencontrent les jeunes élèves : illettrisme, handicap, précocité, territoires sinistrés, les motifs d’inégalités à l’école de la République sont nombreux. Par un investissement clair et ambitieux dans le cadre du projet de loi de finances, par un accompagnement des associations qui œuvrent chaque jour sur le terrain, par une mobilisation des familles et des parents d’élèves, ces inégalités, nous pouvons tous ensemble les faire reculer.
C’est l’objectif du Gouvernement qui, pour la quatrième année consécutive, propose un budget de l’éducation nationale en hausse. Premier budget de la nation, l’école se trouve consacrée dans le projet de loi de finances pour 2016 au rang de première des priorités. Les chiffres sont éloquents. Pour l’année 2016, 517 millions d’euros supplémentaires viendront abonder le budget de l’éducation nationale ; 10 711 emplois seront créés, avec toujours pour horizon l’objectif d’atteindre 60 000 postes en 2017 ; 116 millions d’euros seront consacrés à la revalorisation de la rémunération de celles et de ceux qui se destinent au métier d’enseignant.
On pourrait énumérer longuement les avancées du budget 2016, mais il me paraît plus important d’illustrer ce que représentent concrètement ces efforts pour les élèves et leurs familles.
Parlons d’inclusion scolaire, en commençant par les enfants en situation de handicap. Depuis près de dix ans, l’école primaire a su s’ouvrir à ce public : le nombre d’élèves accueillis a presque doublé, passant de 89 000 à plus de 150 000. Il s’agit d’un effort de toute l’école, renforcé par de meilleures conditions d’accueil, grâce notamment à l’augmentation récente du nombre d’auxiliaires de vie et d’accompagnants d’élèves en situation de handicap, 350 postes ayant été encore créés cette année. Il reste toutefois un long chemin à parcourir : 30 000 enfants ne se voient toujours pas proposer une place adaptée en école primaire, comme vous le soulignez. C’est la preuve que les efforts et les investissements doivent être poursuivis, notamment à travers l’objectif des 60 000 postes d’ici à 2017.
Parce que la maîtrise complète de la langue française est indispensable à l’obtention d’un diplôme, votre rapport revient sur la problématique des enfants allophones et des élèves en situation d’illettrisme, déclarée grande cause nationale en 2013. Il faut l’affirmer – et vous le faites avec fermeté, madame Pompili –, le dispositif RASED joue depuis sa création un rôle indispensable dans l’accompagnement des enfants en difficulté. Les suppressions de postes inconsidérées du dernier quinquennat, motivées par une vulgaire démarche comptable, ont causé des dégâts désastreux pour l’inclusion de nombreux enfants.
La réduction des inégalités dès le premier cycle est une mission indispensable pour l’école de la République. Parce qu’être élève dans une école à deux vitesses est la plus cruelle des injustices, l’inclusion scolaire de tous est une priorité. Cette priorité doit mobiliser le budget de la nation – c’est indéniablement le cas dans le projet de loi de finances pour 2016 –, les énergies de tous les acteurs de l’éducation – les nombreuses auditions menées par la rapporteure en attestent – ainsi que notre engagement de parlementaires dans la sensibilisation et l’information du grand public. C’est précisément l’intérêt de votre rapport qui dépasse, par la richesse de son contenu, le cadre de ce projet de loi de finances.
M. Xavier Breton. Nous ferons part en commission élargie et en séance de nos interrogations sur les écarts entre créations de postes annoncées et effectives ainsi que sur divers chiffres, et évoquerons les réformes contestées comme celle des rythmes scolaires, du collège ou des programmes scolaires.
Je n’ai pu assister à toutes les auditions, madame Pompili, mais celles auxquelles j’ai participé se sont déroulées dans un excellent climat d’écoute et d’échange. Nous nous rejoignons sur le constat : il y a une aggravation des inégalités sociales et géographiques à l’école ainsi qu’une diminution des performances des élèves. Dans le même temps, force est de reconnaître les progrès considérables accomplis en matière de scolarisation des enfants en situation de handicap depuis la loi du 11 février 2005, qui posait comme principe que la place de tous les enfants est à l’école. En dix ans, le nombre d’enfants handicapés accueillis à l’école primaire a doublé. Le rapport contient, on peut le regretter, des éléments de polémique puisqu’il oppose la législature précédente à la législature actuelle. D’une part, je ne suis pas sûr qu’un tel sujet se prête aux polémiques ; d’autre part, la lecture des chiffres peut être retournée : les effectifs d’élèves en situation de handicap scolarisés dans les écoles du premier degré ont augmenté de 8 300 à chaque rentrée entre 2007 et 2012 mais de moins de 7 000 depuis 2012. Ce qui compte, c’est que la dynamique soit bel et bien enclenchée.
Nous partageons votre avis, la situation est loin d’être satisfaisante : 10 000 à 30 000 enfants en situation de handicap ne se voient toujours pas offrir de solution adaptée en termes de scolarité, ce qui est source de grandes difficultés ; les inégalités territoriales marquées conduisent certaines familles à s’expatrier dans des pays voisins, en Belgique notamment.
Nous retrouvons les interrogations habituelles à nos débats sur l’éducation. D’abord, sur les moyens budgétaires. On peut regretter une insuffisance de données chiffrées dans le rapport. Néanmoins, celui-ci fait bien apparaître la nécessité de poursuivre les efforts mais aussi de s’interroger sur leur répartition. Des économies peuvent être faites en réduisant le nombre de redoublements : est-ce simplement une démarche comptable ou peut-on envisager une réaffectation des sommes ainsi dégagées ? Si oui, quels dispositifs seraient privilégiés ?
La question des moyens renvoie à l’évaluation, interrogation récurrente dans le domaine éducatif. Il existe très peu d’évaluations permettant de faire le point sur les nombreux dispositifs d’aides aux élèves en difficulté. Prenons le cas des RASED : le rapport que j’avais rédigé en 2011 avec Gérard Gaudron a montré que ces réseaux n’avaient jamais fait l’objet d’évaluations objectives. Les encenser ou leur tirer dessus est un exercice qui relève davantage de l’a priori que de données étayées. Des évaluations restent à mener au sujet des postes d’accompagnants des élèves en situation de handicap. Leur statut a été amélioré et leur professionnalisation est en marche. Reste à développer et diffuser les bonnes pratiques à partir des expérimentations.
J’en viens à la formation des enseignants. Le rapport formule un jugement assez sévère, que nous partageons : « l’isolement et la modicité des volumes horaires de la formation générale consacrés aux pratiques de l’école inclusive sont une aberration ». On aurait pu penser que la mise en place des ESPE améliorerait les choses. Cela a plutôt été une occasion manquée, souligne le rapport.
La formation continue n’est pas mieux lotie : « elle est encore en jachère et ne laisse qu’une place marginale à l’enjeu de l’inclusion », toujours selon le rapport. Notons que ces enjeux de formation ne se limitent pas aux enseignants. Il faut également s’intéresser aux autres acteurs de l’école, je pense aux postes de direction, aux conseillers principaux d’éducation, aux médecins scolaires, aux personnels de secrétariat ou de restaurants scolaires qui sont chaque jour confrontés aux réalités du handicap.
Outre les questions récurrentes, le rapport soulève des interrogations spécifiques : le risque d’une trop grande médicalisation de la difficulté scolaire, l’intérêt d’une détection précoce des difficultés, l’enjeu de l’accueil des élèves allophones.
La situation est contrastée. Une dynamique est enclenchée depuis dix ans mais elle se heurte aux inerties de notre système éducatif. Trop souvent, nous entendons des enseignants démunis face aux handicaps, face aux familles mais aussi face à l’institution scolaire qui ne les accompagne pas assez. Il reste beaucoup à faire. Souhaitons que ce rapport permette d’améliorer les choses.
Mme Isabelle Attard. Je tiens d’abord à vous féliciter, madame Pompili, pour le choix du thème de votre rapport : l’inclusion scolaire, question extrêmement importante qui me tient particulièrement à cœur, constitue l’une des réussites de la loi pour la refondation de l’école.
Je souhaite revenir sur le cas des enfants qui ne peuvent être objectivement scolarisés dans de bonnes conditions. Je pense notamment aux enfants polyhandicapés souffrant de lésions cérébrales. Leur situation est trop complexe à gérer en milieu ordinaire et leurs besoins en termes d’acquisition de compétences sont trop spécifiques. Quelles solutions leur sont apportées aujourd’hui ? Je ne crois pas me tromper en répondant qu’elles résident dans les instituts médico-éducatifs (IME). Vous évoquez dans votre rapport les passerelles entre CLIS, désormais dénommées « ULIS-écoles », ULIS-collèges et le milieu ordinaire. De telles passerelles existent-elles pour les IME ? Vous signalez la relocalisation d’unités actuellement placées dans les établissements médico-sociaux en milieu ordinaire. C’est une excellente chose mais il me semble que cela reste anecdotique et surtout extrêmement compliqué à mettre en œuvre. N’y aurait-il pas d’autres solutions à inventer ?
J’ai été particulièrement touchée par les témoignages que vous avez rapportés faisant état du sentiment d’impuissance d’équipes éducatives et de familles face à certains handicaps qui nécessitent d’autres chemins pédagogiques. Il manque sans aucun doute des réponses. Je me permettrai de vous présenter une piste : l’éducation conductive. Cette méthode innovante, largement utilisée à travers le monde, peine à trouver sa place en France. Elle permet aux enfants polyhandicapés d’être accueillis dans une structure de type scolaire. Fondée sur des ateliers d’apprentissages appréhendés dans leur globalité, elle a pour but le gain d’autonomie. Elle n’oublie aucune des dimensions de l’enfant et n’en isole aucune. Tout au long de la journée, elle intègre tous les apprentissages physiques, intellectuels et sociaux nécessaires à un développement harmonieux. Elle se veut avant tout éducation et non traitement curatif. Une fois de plus, la Belgique pourrait constituer pour nous un modèle, car la méthode de l’éducation conductive y est largement utilisée. Madame la rapporteure, pouvez-vous m’indiquer si, au cours de vos auditions, cette pédagogie a été évoquée comme une solution dont la France pourrait s’emparer ?
Vous soulignez à juste titre dans votre rapport les inégalités territoriales en matière d’accès aux dispositifs CLIS et ULIS. Comme vous, je trouve insupportable que des familles soient contraintes de s’expatrier en Belgique. Comment lutter contre cette distorsion manifeste du principe d’égal accès à l’école de la République ? Question corollaire : savez-vous si l’éducation nationale est en mesure d’annoncer des remèdes à ces inacceptables inégalités ?
Après l’angoisse des familles, vous signalez ce que j’ose qualifier de désarroi des enseignants « démunis face aux troubles et handicaps, aux familles et à leur administration ». Je plaide, comme vous, pour une meilleure formation des équipes éducatives. Quelle mesure ou quel programme envisagez-vous pour les équipes éducatives, dans le cadre de la formation initiale comme de la formation continue ? Il faut, bien sûr, aller au-delà de la simple semaine d’information organisée autrefois dans les anciens IUFM.
Comme vous sans doute, madame la rapporteure, j’aimerais que plus aucune famille ne s’entende dire par un membre du personnel de l’inspection académique : « si l’école devait s’adapter à tous les handicapés, c’est elle qui finirait handicapée. »
M. Laurent Degallaix. Qu’il s’agisse du respect de la laïcité, de l’idéal démocratique ou de l’égalité des chances, l’école est au cœur de la plupart des polémiques contemporaines. À travers l’école, ce sont notre héritage, nos valeurs que nous transmettons et notre avenir que nous construisons. L’école doit, non pas se contenter de former une élite, mais offrir des perspectives d’avenir à chacun des enfants de la nation. Or, aujourd’hui, les chiffres sont accablants : 150 000 jeunes quittent chaque année l’école sans diplôme ; 20 % des élèves entrant en sixième ne maîtrisent pas les savoirs fondamentaux ; 2,5 millions de Français sont concernés par l’illettrisme, soit 7 % de la population ; 30 000 enfants en situation de handicap ne peuvent être accueillis dans des conditions adéquates à l’école. Je déplore, moi aussi, les inégalités territoriales dans l’accès aux dispositifs. Elles conduisent nombre de familles à scolariser leurs enfants dans des IME en Belgique – un phénomène que nous connaissons bien dans le Nord –, avec les impacts affectifs mais aussi économiques qu’on imagine.
Le constat est sans appel : l’ambition républicaine de l’école est aujourd’hui gravement contrariée. Le groupe UDI a toujours considéré les enjeux de l’éducation et de la formation comme fondamentaux. Nous nous réjouissons que l’éducation nationale continue à être le premier budget de la nation avec l’inscription de près de 48 milliards d’euros en crédits de paiement. La hausse globale du budget de l’enseignement scolaire masque toutefois certaines réalités. Je pense, par exemple, à la baisse des crédits destinés à la formation et à l’orientation. Or l’objectif d’amener 80 % d’une classe d’âge au baccalauréat n’a de sens que si le système éducatif est capable d’accompagner les jeunes à l’issue de leur cursus ou de les réorienter. Concernant l’apprentissage des langues, je ne comprends pas la décision de mettre fin aux classes bilangues qui permettent aux élèves d’apprendre de manière soutenue des langues étrangères et de s’imprégner de la culture d’un autre pays grâce à des partenariats privilégiés facilitant les études à l’étranger. Il apparaît que les moyens alloués ne sont pas à la hauteur pour permettre aux élèves la maîtrise des langues étrangères, un mal français encore trop présent.
Enfin, de manière plus générale, nous déplorons qu’il ne soit pas répondu à l’appel de la Cour des comptes d’une réforme en profondeur du lycée à travers une réduction de l’offre de formations, notamment en termes d’options, et une simplification du baccalauréat, d’une réforme qui remette l’impératif pédagogique et l’exigence des acquis fondamentaux au cœur de l’enseignement scolaire et qui permette à chacun de s’épanouir pleinement dans l’école de la République.
M. Jean-Noël Carpentier. J’aimerais dire ma satisfaction de voir le budget de la mission « Enseignement scolaire » encore à la hausse par rapport à l’année précédente. L’opposition, qui avait, en son temps, supprimé la formation des maîtres et des dizaines de milliers de postes d’enseignant, aura beau critiquer ce budget scolaire et s’opposer aux différentes réformes, la réalité est bien là : l’éducation est la priorité de notre majorité. Rarement l’exécutif aura fait preuve d’autant d’attention à l’égard de l’école.
En 2012, les résultats de l’enquête PISA nous ont alertés. Notre pays se déclassait régulièrement par rapport aux autres pays de l’OCDE. Notre système éducatif ne réduit pas assez les inégalités scolaires dues à l’origine sociale des élèves. Cela conduit à des résultats globaux insuffisants, même si notre école a à son actif de belles réussites, notamment grâce à un personnel enseignant qui fait preuve d’un dévouement jamais démenti.
C’est donc une réforme de fond dont nous avons besoin.
Trois ans après le vote de la loi pour la refondation de l’école, 2016 est une année décisive au cours de laquelle les effets de la réforme se feront sentir. Pour permettre la réussite de chaque élève et augmenter le niveau de tous, l’objectif est de donner la priorité au primaire. Cette priorité doit mieux entrer dans le quotidien des salles de classe. J’espère, par exemple, une amplification du dispositif « Plus de maîtres que de classes » ou encore une plus forte généralisation de l’accueil des enfants de moins de trois ans en zone d’éducation prioritaire.
S’agissant de la refonte des programmes, plusieurs couacs se sont fait entendre récemment. Il faut les éviter. Une meilleure concertation des enseignants et des parents devrait être la règle.
Pour ce qui est du plan numérique pour l’école, l’ambition est là mais il faut hâter le pas. L’ensemble du territoire doit être équipé. Cela passe par des décisions budgétaires plus importantes que celles actuellement proposées ; cela passe aussi par une meilleure coordination entre l’État et les collectivités territoriales. Pour encourager les innovations pédagogiques autour de cet outil, il importe d’accorder plus de soin à la formation des enseignants.
D’une manière générale, je me félicite de l’accroissement des crédits alloués à la formation des enseignants et de la création des ESPE. Je me permets néanmoins d’insister sur l’importance de la formation continue, qui reste malheureusement insuffisante.
Enfin, concernant l’accompagnement des élèves en situation de handicap, je tiens à dire ma satisfaction devant l’engagement du Gouvernement en faveur d’une école toujours plus inclusive. Il faut continuer : aider ceux qui en ont le plus besoin permet à tous de progresser.
Je tiens à dire à Mme la rapporteure combien j’ai apprécié son rapport, précis, humain, parfois militant. Il constitue un apport précieux pour améliorer encore la prise en compte du handicap dans notre système éducatif. Vous soulignez les avancées, vous dites les manques mais vous faites aussi des propositions, madame Pompili.
Je partage votre démonstration selon laquelle il n’y a pas suffisamment de coopération entre les différents professionnels qui agissent en faveur de l’enfant porteur de handicap. À ce sujet, j’aimerais connaître votre opinion sur les IME. Ne pensez-vous pas qu’un rapprochement beaucoup plus affirmé avec le système scolaire dit classique permettrait un enrichissement mutuel entre deux mondes de l’éducation qui ont bien du mal à se côtoyer ?
J’apprécie également votre proposition de rendre plus transparents les différents dispositifs en désignant des référents clairs et stables pour les familles.
Au sujet des AESH, je partage aussi votre constat. Il faut sans doute accélérer le processus de professionnalisation avec une formation spécifique, des contrats solides et des salaires bien plus élevés que ceux actuellement pratiqués. Parallèlement, il faut mieux former les enseignants sur la question du handicap, c’est une évidence.
Si je reste convaincu que l’objectif d’une école plus inclusive est partagé par l’immense majorité des acteurs de terrain, je considère, comme vous, que des mesures pratiques doivent être mises en place rapidement pour que les bonnes intentions trouvent une traduction concrète dans le quotidien des enfants et de leurs familles.
Mme Marie-George Buffet. Nous avons tous reçu dans nos permanences des familles confrontées au problème de l’accès à la scolarité de leur enfant touché par le handicap. Je ne peux que vous féliciter, madame Pompili, d’avoir choisi l’inclusion scolaire comme thématique.
Vous avez abordé la question des moyens, et j’aimerais insister sur la situation des auxiliaires de vie scolaire. Il faut reconnaître à l’ensemble d’entre eux un véritable statut. Cela implique un contrat de la fonction publique, une formation renforcée et un salaire à la mesure de leur contribution à l’inclusion scolaire.
S’agissant des RASED, nous ne sommes pas revenus au niveau de 2011, loin de là. Il faut donc maintenir l’effort et favoriser un travail d’équipe s’appuyant sur la mise en œuvre effective du dispositif « Plus de maîtres que de classes » de la loi pour la refondation de l’école.
J’aimerais insister sur la médecine scolaire, qui n’est presque plus présente. Dans un département comme la Seine-Saint-Denis, il n’y a plus de suivi régulier des enfants, alors qu’un fort besoin se fait sentir. Quelles seraient vos propositions pour revaloriser cette profession et accroître son attrait pour les étudiants ?
Enfin, il importe d’agir pour développer les places en IME. Certains enfants se retrouvent en ULIS alors qu’ils auraient besoin d’un passage par ces instituts.
J’en viens à la mission « Recherche ». Dans votre rapport, que j’ai beaucoup apprécié, madame Dion, vous avez insisté sur le rôle de pilotage de l’INSEP. Je regrette que des moyens lui soient retirés. Vous avez aussi souligné le rôle du laboratoire de Châtenay-Malabry. Pouvez-vous nous en dire plus sur les nouvelles molécules dopantes ?
J’aurai une question sur l’accompagnement scientifique de la performance, sujet absent de votre rapport. Cette approche peut se comprendre pour ce qui est du matériel – je lisais récemment un article sur les nouvelles performances qui pourraient résulter de la modification du poids des perches. Mais il faut prendre garde aux interventions sur l’humain. Quelles limites éthiques placer ? Nous avons vu apparaître de nouvelles méthodes, comme les cabines cryogéniques, qui ne sont pas considérées comme du dopage mais qui posent tout de même des questions déontologiques.
Enfin, madame Lang, je dois dire que la lecture de votre rapport m’a permis de mesurer l’étendue des dégâts en matière de patrimoine immobilier universitaire. Les chiffres que vous citez sont impressionnants : près de huit milliards d’euros seraient nécessaires pour sa rénovation complète. Je vous remercie de nous avoir alertés.
Votre notion de sous-occupation me laisse toutefois interrogative alors que sur les réseaux sociaux, à l’appel de l’UNEF et d’autres syndicats étudiants, circulent des images d’amphithéâtres bondés. Y aurait-il un problème de gouvernance dans la gestion du patrimoine ? Ne faudrait-il pas mettre en place un plan d’urgence associant État et régions, en fléchant bien les crédits afin qu’ils ne soient pas utilisés à d’autres fins que les nécessaires réhabilitations ?
J’ai reçu hier des représentants du syndicat national de l’éducation physique (SNEP) qui lance une grande campagne sur la pratique sportive à l’université. On sait que le sport universitaire en France est très en retard par rapport à d’autres pays. Quelle est votre appréciation sur les équipements sportifs dans l’enseignement supérieur ?
M. le président Patrick Bloche. L’intervention de Marie-George Buffet a assuré la transition : nous en venons donc maintenant aux orateurs des groupes sur la mission « Recherche et enseignement supérieur ».
M. Émeric Bréhier. Notre objectif pour l’enseignement supérieur est moins la massification, déjà atteinte – même si nous vivons aujourd’hui une nouvelle phase –, que la réelle démocratisation de l’accès à la diversité des études supérieures. Le budget qui nous est présenté permet de répondre à ces impératifs : l’éducation nationale demeure le premier budget de l’État, ce qui n’était pas chose courante ces dernières années.
Je relève, pour m’en féliciter, que nous examinons en même temps ce matin les rapports sur les missions « Enseignement scolaire » et « Recherche et enseignement supérieur ». Il n’aura échappé à personne que l’éducation nationale ne s’arrête pas au bac. Il n’est pas mauvais de montrer dans nos travaux la continuité de parcours de la maternelle aux études supérieures.
Lors de la dernière rentrée, l’université française a accueilli 65 000 étudiants supplémentaires, 50 000 hors étudiants des classes préparatoires désormais obligatoirement inscrits à l’université, ce qui a entraîné de réelles difficultés dont les réseaux sociaux se sont fait l’écho, heureusement surmontées au cours de l’été. Il importe de considérer cet afflux, non comme une menace, mais comme une opportunité dont nous devons nous féliciter.
J’aimerais insister sur l’immobilier universitaire, thème du rapport d’Anne-Christine Lang, qui s’appuie sur un travail de qualité et fournit des informations précises. Nous savons tous qu’il s’agit d’une bombe à retardement qui risque d’exploser très bientôt. Il faut toutefois se réjouir que les autorisations d’engagement augmentent en cette année de transition des contrats de plan État-région 2007-2013 à ceux pour 2015-2020.
Pour finir, j’aborderai la méthode de la pédagogie inversée, qui consiste à proposer aux étudiants, qui ont préalablement pris connaissance du cours mis en ligne, de tirer parti de la présence de l’enseignant pour approfondir des points qu’ils maîtrisent moins bien que d’autres. Cette innovation pédagogique va à l’encontre de bon nombre d’idées reçues, celle notamment de l’université comme acteur de l’indifférenciation et de l’apprentissage de masse qu’illustrent les images d’amphis bondés. Elle soulève des questions en termes d’utilisation des locaux qui, pensés pour des méthodes plus traditionnelles, se trouvent parfois inadaptés. Est-il possible d’avoir des précisions sur cette pédagogie qui offre des perspectives intéressantes tant en matière de démocratisation de notre système d’enseignement supérieur que d’utilisation des locaux universitaires ?
M. Patrick Hetzel. J’adresse tout d’abord mes remerciements aux rapporteures pour le très pertinent éclairage qu’elles ont apporté sur la recherche en sport et l’immobilier universitaire.
En introduction, j’aimerais insister sur le fait que plus que jamais, il serait nécessaire d’affirmer l’autonomie des universités. En 2007, le Gouvernement avait décidé d’aller dans cette voie en faisant voter la loi relative aux libertés et responsabilités des universités, dite loi LRU. Le gouvernement actuel va en sens inverse, hélas ! En 2015, il a décidé d’opérer des prélèvements sur les fonds de roulement de certaines universités, les plus vertueuses de surcroît, ce qui est bien une façon de reprendre la main en matière de gestion. C’est un très mauvais signal que l’on envoie à des universités qui consentent des efforts très importants. Ce faisant, on ne récompense vraiment pas la vertu. Pour que les universités soient vraiment autonomes, il faut leur donner les moyens de lever des fonds et que l’enseignement supérieur et la recherche soient considérés comme prioritaires, ce qui n’est pas le cas, contrairement à ce qu’affirme le Gouvernement.
Je regrette que les chiffres du PLF ne soient que pur affichage et communication, qu’il s’agisse de 2016 ou de l’exécution du budget pour 2015. Pour savoir ce qui se passe véritablement dans le périmètre concerné, il faut étudier la manière dont les récents budgets ont été exécutés et intégrer dans notre raisonnement les très nombreuses annulations de crédits réalisées en cours d’année. Certains crédits dûment votés par notre assemblée ne sont jamais versés au budget des universités, ni à celui des grandes écoles ou des organismes de recherche. Au nom du groupe Les Républicains, j’aimerais avoir une réponse précise sur cet aspect stratégique.
Sur un an, on constate qu’il y a eu 230 millions d’euros d’annulation de la réserve de précaution des universités qui devait financer le fameux GVT, le glissement vieillesse technicité. Quelles sont les raisons d’une telle annulation ? Il y a, par ailleurs, 123 millions de suppressions budgétaires opérées dans le cadre du système d’allocation des moyens aux universités (SYMPA) : le Gouvernement avance que cela tient à la réorganisation de ce système ainsi qu’à la modernisation et la mutualisation du fonctionnement des opérateurs – jolie formulation ! À cela s’ajoutent 90 millions de coups de rabot de dernière minute opéré par l’amendement n° 267 du Gouvernement en loi de finances rectificative et les 100 millions de prélèvements sur les fonds de roulement. Je finirai par les contrats de plan État-région : ils représentaient en 2007-2013, allongés d’une année, donc sur une période de six ans, 3 milliards d’euros, soit 480 millions chaque année. Les nouveaux contrats 2015-2020 mobilisent 2 milliards d’euros en cinq ans, soit 400 millions d’euros par an. Au total, plus de un milliard d’euros a été amputé sur le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche. Nous aimerions connaître la raison de telles coupes budgétaires, au-delà des effets de communication. Il y a un grand écart entre ce que dit le Gouvernement et les faits. Il affirme que ce secteur stratégique est préservé : cherchez l’erreur !
Pour finir, il me semble important de rappeler que la loi LRU avait pour objectif de mettre l’accent sur le transfert de la gestion directe de l’immobilier universitaire par les universités. Vous avez indiqué, madame Lang, que trois universités s’étaient emparées de ces nouvelles missions et vous avez souligné que la généralisation du dispositif représenterait 500 millions d’euros de remise aux normes, auxquels s’ajouteraient 500 millions d’euros annuels. Le processus de responsabilisation des universités enclenché par loi du 10 août 2007 était fondé sur le volontariat. Pourquoi le Gouvernement l’a-t-il interrompu ? Si cette responsabilité en matière d’immobilier n’est pas transférée aux universités, il faudra, tous les vingt ans, lancer des programmes de rénovation des locaux universitaires qui seront bien plus coûteux à financer. Je vous invite à faire les calculs consolidés depuis le fameux plan université 2000. Votre argumentation selon laquelle ces 500 millions d’euros de remise aux normes et ces 500 millions d’euros annuels sont hors de portée est discutable.
Mme Isabelle Attard. Madame Lang, votre excellent rapport sur le patrimoine immobilier de nos universités nous place, dès le début, dans le vif du sujet : « 40 % de locaux dans un état de dégradation inquiétante et même franchement préoccupante pour 12 % d’entre eux ». Ces chiffres sont éloquents, ils sont cependant trop généraux et abstraits pour que nous puissions collectivement en mesurer la portée. C’est pourquoi je vous invite, mes chers collègues, à visiter le site universiteenruines.tumblr.com. Vous y trouverez plusieurs dizaines de photos montrant le dénuement auquel l’État français condamne des centaines de milliers d’étudiants.
Vous pointez plusieurs pistes d’amélioration pour remédier à cette situation désastreuse. Première piste : le recours aux emprunts. En l’état actuel des finances des universités, j’ai du mal à percevoir l’intérêt de cette solution. Ne revient-elle pas à repousser à demain un problème qui devrait être réglé aujourd’hui ?
Deuxième piste : les opportunités offertes par la location. Il y a certes des rentrées d’argent possibles mais je m’inquiète des éventuels dévoiements auxquels pourraient conduire ces opérations. N’y a-t-il pas des risques d’abus, voire d’utilisations publicitaires nuisibles ? Et dans les universités dont les locaux sont « dans un état de dégradation inquiétante et même franchement préoccupante », les locations ont de faibles chances de se faire, voire sont à déconseiller, compte tenu des risques sanitaires.
Troisième piste : les flux financiers générés par la formation professionnelle. Je vous rejoins sur cette possibilité. Il est tout à fait souhaitable que l’université s’ouvre au plus grand nombre, donc à ceux qui envisagent une formation au cours de leur carrière professionnelle.
Quatrième piste : la dévolution de bâtiments. Comme elle implique l’inscription au bilan des opérateurs des biens transférés et de leurs amortissements, elle ne me paraît soutenable financièrement pour les universités que si la dotation aux amortissements est actualisée chaque année, ce qui est loin d’être garanti aujourd’hui.
Vous ne mentionnez pas, dans vos recommandations, la possibilité de réorienter certains budgets vers nos universités. Elles ont une activité de recherche très importante et le crédit d’impôt recherche est une niche fiscale au coût croissant et, dans de nombreux cas, sans aucun lien avec une réelle activité de recherche. Que pensez-vous de la possibilité de limiter les coûts du CIR pour mieux financer l’entretien et la rénovation des bâtiments de nos universités ?
Cette évocation de la dépense massive et inutile que constitue le CIR me fournit une transition logique vers le rapport de Mme Sophie Dion. Il revient à plusieurs reprises sur la faiblesse des dotations des laboratoires de recherche, citant entre autres le cas du laboratoire « Motricité, Interactions, Performance » dont le financement n’est assuré par sa dotation qu’à hauteur de 10 %. Comment ne pas mettre en rapport cette faiblesse dans le financement et les plaintes ciblées et répétées à l’égard du CIR ? Le rapport de la Cour des comptes en 2013, les critiques du conseil scientifique du CNRS, la lettre adressée au Président Hollande par 660 directeurs de laboratoire en 2014, le rapport de l’association « Sciences en marche » en 2015, toutes les critiques vont dans le même sens : le CIR coûte une fortune sans effet démontré, alors que l’efficacité de notre recherche publique n’est plus à prouver. J’aurais aimé ajouter à cette liste le rapport de la sénatrice Brigitte Gonthier-Maurin, mais vous savez comme moi qu’il n’a pas été publié.
M. Laurent Degallaix. La mission « Recherche et enseignement supérieur » est au cœur de la préparation de l’avenir, de la compétitivité et du rayonnement de la France à l’étranger. À ce titre, le maintien pour 2016 des crédits alloués à la mission en 2015 constitue un signal positif, mais en apparence seulement. En effet, on peut s’inquiéter des orientations qui ont été privilégiées pour faire participer la mission aux efforts partagés de rationalisation et d’économie.
Certes, les budgets augmentent, mais, ainsi que l’a rappelé Emeric Bréhier, le nombre d’étudiants augmente lui aussi : ils ont été 65 000 de plus à la rentrée de 2015, après une hausse de 30 000 en 2014. Aussi les établissements d’enseignement supérieur doivent-ils fonctionner avec des dotations toujours plus resserrées. Je veux voir, moi aussi, dans la progression du nombre d’étudiants une occasion à saisir plutôt qu’une contrainte. Mais, si les universités sont capables d’accueillir un nombre croissant d’étudiants, les conditions de cet accueil posent problème, ainsi que vous l’avez rappelé dans votre rapport, madame Lang : 40 % des locaux sont dans un état dégradé et 12 % d’entre eux dans un état très dégradé. Vous le soulignez, il est impératif que les universités se dotent rapidement d’une stratégie immobilière.
En 2007, la loi LRU a fait de l’insertion professionnelle la troisième mission de l’université. Or cette volonté d’améliorer l’accès à l’emploi de nos étudiants n’a pas été transposée dans le budget. D’après le rapport de l’Association pour l’emploi des cadres (APEC), à peine 45 % des universitaires de niveau bac + 5 sont en CDI un an après avoir obtenu leur diplôme, contre 70 % des étudiants sortis d’école de commerce ou d’ingénieurs. On constate donc que les efforts budgétaires nécessaires sur cette thématique ne sont pas réalisés aujourd’hui, ce qui obère la qualité de l’insertion professionnelle des étudiants de l’université. Nous nous dirigeons, hélas ! vers une insertion à deux vitesses pour les étudiants des écoles privées, d’une part, et ceux de l’université, d’autre part. Une politique pour l’enseignement supérieur ne peut se limiter au déploiement de moyens supplémentaires : il faut créer des liens entre le monde du travail et l’université. Car les inégalités se creusent entre établissements, entre étudiants et entre laboratoires de recherche.
Nous dénonçons également la baisse des crédits alloués au programme 192 « Recherche économique et industrielle » et à la recherche agricole. Il est paradoxal de réduire les crédits dans ces secteurs alors que notre pays est touché par une grave crise agricole et industrielle.
Enfin, je ne peux que regretter que la mission « Recherche et enseignement supérieur » ne tienne pas compte de deux grandes orientations défendues par le groupe Union des démocrates et indépendants : d’une part, au niveau de l’enseignement supérieur, la création d’écosystèmes économiques qui permettent de rapprocher les universités et les centres de recherche des entreprises, et de lier le développement des infrastructures et celui des bassins économiques ; d’autre part, l’affirmation de l’État stratège en matière de recherche et d’innovation au service de la compétitivité, afin de soutenir massivement les entreprises dans les secteurs d’excellence tels que l’aéronautique, la chimie, la santé, la transition écologique et le numérique.
M. Jean-Noël Carpentier. Avec près de 26 milliards d’euros, le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche est le troisième budget de l’État, après celui de l’enseignement scolaire et celui de la défense. Malheureusement, il ne pourra pas répondre à tous les besoins. C’est inquiétant, tant nous savons que l’enseignement supérieur et la recherche sont indispensables au dynamisme du pays. Nous regrettons que l’effort engagé sur l’enseignement scolaire ne soit pas prolongé dans cette mission. De nombreuses organisations syndicales de personnel et d’étudiants manifestent actuellement leur mécontentement : ils dénoncent un budget insuffisant pour accueillir correctement des étudiants de plus en plus nombreux ; ils souhaitent notamment plus d’enseignants et des locaux plus adaptés.
À ce sujet, madame Lang, votre rapport met en lumière la situation préoccupante du patrimoine immobilier de nos établissements d’enseignement supérieur. Au vu des chiffres, mais aussi des nombreux témoignages des étudiants et du personnel, on peut légitimement s’inquiéter et regretter l’insuffisance des crédits alloués à ce patrimoine. Vous évoquez « 40 % de locaux dans un état de dégradation inquiétante et même franchement préoccupante pour 12 % d’entre eux ». Certes, le besoin de locaux est moins prégnant à partir du second semestre universitaire, et les modèles pédagogiques évoluent vers le numérique, mais, à terme, il y aura toujours besoin de locaux. En tout cas, il s’agit aujourd’hui de trouver des solutions pour accueillir convenablement les étudiants, le flux annuel de nouveaux inscrits étant passé de 25 000 au début des années 2000 à 65 000 lors de la dernière rentrée.
Le Gouvernement vise une élévation du niveau de qualification de la population en portant à 50 % d’une classe d’âge le taux de titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur. C’est un bel objectif. En 2013, ce taux a atteint 47,5 %.
Au-delà des diplômes, il faut également permettre une meilleure insertion professionnelle des diplômés. En 2013, si 86 % des titulaires de licence, de master ou de doctorat étaient employés au niveau cadre ou profession intermédiaire, seuls 67 % d’entre eux étaient embauchés en CDI trois ans après leur sortie de formation initiale. La loi de 2013 tente de répondre à ce problème avec la refonte du cadre national des formations et une meilleure lisibilité des filières. En outre, plusieurs actions gouvernementales contribuent à une meilleure insertion professionnelle des diplômés à l’issue de leurs études : le principe de continuité entre l’enseignement scolaire et l’enseignement supérieur ; une meilleure information des étudiants sur les débouchés de chaque formation ; le développement des stages. Mais, bien entendu, c’est notre modèle économique qu’il faut repenser si l’on veut éviter la précarisation de nos jeunes.
Vous l’aurez compris, le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche suscite des interrogations au sein du groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste. Nous espérons que le débat budgétaire permettra d’y répondre.
M. le président Patrick Bloche. Je donne maintenant la parole aux membres de la commission qui souhaitent poser des questions sur l’une ou l’autre des missions.
Mme Sandrine Doucet. Merci, mesdames les rapporteures, de vos rapports très détaillés et précis. Dans l’introduction au vôtre, madame Dion, vous indiquez que « la recherche sur le sport et les pratiques sportives implique un dépassement des classifications statistiques et budgétaires habituelles ». Vous passez ainsi rapidement sur le budget de la recherche et de l’enseignement supérieur. Est-ce pour éviter de dire qu’il est en nette augmentation ? En 2016, les crédits de l’enseignement supérieur s’élèveront à plus de 12,7 milliards d’euros, dont 5,2 milliards consacrés à la recherche universitaire, et ceux de la recherche hors enseignement supérieur augmenteront de 6 millions d’euros pour s’établir à 7,7 milliards. Est-ce aussi pour éviter de dire que, sur les dix-neuf universités qui étaient en déficit en 2012, seules quatre le sont encore actuellement ? Est-ce pour éviter de dire, enfin, que 450 millions d’euros supplémentaires par rapport à 2013 sont désormais dédiés aux bourses pour les étudiants considérablement étendues et revalorisées ?
Au-delà des chiffres, il convient de relever tous les changements en cours dans le domaine de la recherche. Concernant la politique de site, que vous évoquez à la fin de votre rapport, le secrétaire d’État chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, M. Thierry Mandon, a déclaré que les instituts de recherche technologique (IRT) devraient davantage travailler en réseau. En outre, nous avons eu un aperçu des mutations actuelles lors de l’audition de M. Michel Cosnard, candidat à la présidence du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur.
Outre les chiffres et les annonces, je tiens à saluer un événement moins visible mais bien réel : lundi dernier, lors de la rentrée solennelle de l’université de Bordeaux, à laquelle j’ai assisté, les trois prix de thèse remis au titre de l’initiative d’excellence (IDEX) ont été remportés par trois jeunes femmes. À cet égard, madame la rapporteure, dans votre travail consacré à la recherche sur le sport, vous êtes-vous intéressée au lien entre le sport et les sciences humaines, notamment aux questions d’égalité ?
M. le président Patrick Bloche. Personne n’a relevé que ce sont trois rapporteures qui interviennent ce matin, sans doute parce qu’il s’agit d’une évidence dans notre commission, ce qui est une bonne chose.
Je donne maintenant la parole aux membres de la commission qui souhaitent poser des questions sur l’une ou l’autre des missions.
Mme Dominique Nachury. Merci, mesdames les rapporteures, pour vos travaux et vos présentations. Madame Lang, il est en effet intéressant de mettre l’accent sur le patrimoine immobilier des universités, mais il convient de mettre cette question en perspective avec la forte augmentation du nombre d’étudiants à chaque rentrée : comment les accueillir ? Vous avez souligné qu’une évolution était nécessaire dans l’approche des bâtiments, avec un décloisonnement des composantes, une flexibilité accrue pour s’ajuster aux différents temps de l’année universitaire et une adaptation aux nouvelles technologies. C’est nécessaire, mais ce ne sera pas suffisant, car il faudra bien affronter la réalité d’un état des lieux parfois sévère. À cet égard, plusieurs d’entre nous ont cité cette phrase marquante de votre rapport : « 40 % des locaux sont dans un état de dégradation inquiétante et même franchement préoccupante pour 12 % d’entre eux ». Il faut réhabiliter les locaux, mais aussi les adapter, sans quoi il ne pourra pas y avoir d’évolution dans la gestion et dans la maintenance. Pensez-vous sincèrement que ce budget donne un signal positif, alors même que l’augmentation des postes que vous évoquiez est financée par une baisse de 60 millions d’euros des crédits de paiement consacrés à l’immobilier ?
Mme Julie Sommaruga. Merci, madame Pompili, du travail complet que vous avez effectué sur le sujet très important de l’école inclusive. S’agissant de l’accueil des élèves en situation de handicap dans le cadre des activités périscolaires, la question de la formation des intervenants se pose. Comment faire pour améliorer encore le travail en équipe dans ce cadre ?
La formation continue des enseignants a été renforcée, mais elle reste insuffisante, ainsi que vous l’avez indiqué. Pouvez-vous préciser vos propositions à ce sujet ?
L’objectif du Gouvernement est non seulement d’accueillir les élèves en situation de handicap, mais aussi de les scolariser et de leur offrir une place réellement adaptée. Pour atteindre cet objectif, il faut aller plus loin dans les outils mis à la disposition des équipes éducatives. Vous proposez, entre autres, la désignation d’un « maître ressources inclusion ». Pouvez-vous préciser son rôle, notamment en ce qui concerne le lien avec les familles ? Rien ne se fera en effet sans ces dernières.
Grâce au Gouvernement, l’école dispose désormais de 28 000 AESH et 48 000 contrats aidés pour les élèves en situation de handicap. Là encore, la question de la formation se pose : comment l’adapter aux différents types de handicap et aux besoins éducatifs particuliers ?
Mme Claudine Schmid. Merci, mesdames les rapporteures, de vos travaux. En concluant votre présentation, madame Pompili, vous avez indiqué qu’il était nécessaire de définir l’évolution du métier d’enseignant et de revoir la rémunération, car il s’agissait d’un investissement rentable pour la société. Je n’ai pas trouvé semblable mention dans votre rapport, mais je vais tout à fait dans votre sens. S’agissant de la rémunération, reprenez-vous à votre compte les propos que M. Benoît Hamon a tenu le 11 octobre, au cours d’une émission de radio ? Comptez-vous soutenir son amendement ou le dénoncer ? Il suggère de baisser la rémunération des professeurs des classes préparatoires pour augmenter celle des professeurs des écoles. Nous ne vous suivrons pas dans cette politique des vases communicants, qui revient, selon moi, à stigmatiser une catégorie d’enseignants dont notre système scolaire a tant besoin. Tous les professeurs sont méritants, quel que soit le degré dans lequel ils exercent.
Mme Martine Martinel. Merci, mesdames les rapporteures. Dans votre rapport, madame Lang, vous soulignez toute l’importance du parc immobilier universitaire, véritable actif stratégique des établissements d’enseignement supérieur, directement lié à leurs activités académiques et scientifiques. Notre collègue Patrick Hetzel a suggéré qu’une apocalypse avait dévasté les universités à partir de 2012. L’autonomie reconnue en 2007 a-t-elle conduit les universités à investir dans l’entretien et la rénovation de leurs bâtiments ? Avez-vous pu mesurer cela au cours de l’élaboration de votre rapport ?
M. Hervé Féron. À la lecture de votre rapport, madame Pompili, on réalise que la dynamique d’inclusion est souvent bénéfique pour les élèves et qu’elle est de plus en plus efficiente. Des avancées réelles et quantifiables ont été réalisées ces dernières années s’agissant de l’école inclusive, mais il est certainement nécessaire de faire encore évoluer les dispositifs.
La CLIS était une classe distincte des autres classes, comptant un effectif maximal de douze élèves en situation de handicap reconnu par la MDPH. Les élèves de CLIS étaient inclus pour des temps plus ou moins longs dans des classes ordinaires. Depuis la rentrée de 2015, on parle désormais, comme au collège, d’ULIS ou d’ULIS-école. Les mêmes élèves, qui relèvent toujours de la MDPH, seront désormais rattachés à une classe de référence correspondant approximativement à leur âge. Ce changement pose clairement un problème d’efficacité quant à l’inclusion pratiquée, celle-ci se faisant dans des classes aux effectifs parfois très chargés. On peut s’interroger sur le bénéfice qu’en retirent les enfants concernés.
Ne pourrait-on envisager, pour les écoles dotées d’une CLIS, un statut particulier tel que celui qui existe pour les réseaux de réussite scolaire (RSS) ? Ce statut limiterait les effectifs par classe afin d’assurer une inclusion optimale des élèves. Ne pourrait-on également prévoir des temps institutionnels de concertation afin que les enseignants puissent élaborer efficacement les projets individuels de ces élèves ?
Une partie de votre rapport est consacrée aux RASED. Il s’agit d’un dispositif qui comprend au minimum deux enseignants spécialisés – un « maître E », qui fournit une aide spécialisée à dominante pédagogique, et un « maître G », qui apporte une aide spécialisée à dominante rééducative –, ainsi qu’un psychologue scolaire. Ce réseau prend en charge des élèves de classes ordinaires pour des aides qui sont plus ou moins limitées dans le temps. Or, très souvent, les RASED sont incomplets et doivent intervenir dans des zones géographiques très étendues. Après avoir presque disparu, le dispositif se reconstitue, mais trop lentement : il souffre d’un manque de maîtres G dans de très nombreuses régions et d’un déficit chronique de psychologues scolaires. La faiblesse des moyens attribués au RASED est très pénalisante pour l’aide aux élèves en difficulté. Il faudrait accélérer la reconstitution des réseaux et en améliorer le maillage sur le territoire pour redonner sa destination première à ce dispositif, qui contribue lui aussi à l’inclusion des élèves en difficulté.
Je tiens à faire remarquer que de nombreux élèves qui relèveraient de structures spécialisées, IME ou instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP), restent à l’école primaire, parfois en ULIS-école, faute de places dans lesdits établissements. Pour certains, ce maintien à l’école primaire peut être profitable, car il s’agit d’un milieu toujours stimulant et socialisant. Toutefois, pour d’autres, notamment pour ceux qui présentent des troubles graves du comportement, le maintien à l’école primaire est néfaste tant pour eux-mêmes, car ils ont besoin de soins et d’un environnement éducatif adapté, que pour les autres élèves et les enseignants. Ils se retrouvent parfois en ULIS-école alors qu’ils n’y ont pas toujours toute leur place. Trop souvent, ils sont orientés trop tardivement vers les ITEP. Ce problème pourrait être résolu en développant les capacités d’accueil de certains établissements spécialisés, notamment des ITEP.
J’insiste à nouveau sur le fait qu’aucun temps institutionnel n’est actuellement prévu pour la concertation entre les professeurs des écoles, les directeurs et les enseignants spécialisés en ULIS. Or il ne peut y avoir d’école inclusive sans préparation et concertation, en amont et tout au long du parcours inclusif de l’élève.
M. Christophe Premat. À la fin de votre rapport, madame Pompili, vous appelez de vos vœux la mise en œuvre d’une pédagogie différenciée. Vous montrez que le rôle des quelque 75 000 auxiliaires de vie scolaire est essentiel. Leur formation est donc cruciale. Peut-on envisager une professionnalisation de leur rôle avec, à la clé, la transformation de leur poste en CDI ? Cette professionnalisation est primordiale, notamment pour aider les enfants qui présentent un handicap moins visible. La question de la formation concerne aussi les professeurs des écoles, premier pilier de la refondation de l’école. À ce titre, je précise que l’amendement déposé par Benoît Hamon, que j’ai cosigné, n’incrimine en rien les professeurs de classes préparatoires : il prévoit simplement une baisse de la rémunération des colles.
Dans votre panorama de la recherche sur le sport, madame Dion, vous vous limitez au domaine de la santé publique. J’aurais aimé en savoir plus sur les possibilités de lever des fonds pour financer des recherches en matière de lutte contre les discriminations. Le Conseil national du sport, « parlement » du sport, émet des recommandations en la matière. Y a-t-il une articulation étroite entre ce conseil et les laboratoires de recherche pour affiner une véritable stratégie nationale en matière de sport ? Quid des projets européens de recherche qui pourraient justifier cette levée de fonds ?
Le diagnostic que vous portez sur le patrimoine immobilier universitaire, madame Lang, est alarmant. Votre rapport a le mérite de montrer les limites du modèle actuel. Il est d’autant plus nécessaire de rénover et d’adapter ce patrimoine que l’on affiche un objectif ambitieux en matière d’accès aux études supérieures. Force est de constater que nos locaux ne sont ni adaptés ni préparés à cette massification voulue des publics. En ce qui concerne la mise aux normes, il faut aussi tenir compte des normes énergétiques, conformément à la loi relative à la transition énergétique, et des normes en matière d’accessibilité.
Je reviens sur les limites du modèle que vous décrivez. Que pensez-vous de la proposition de faire des partenariats public-privé ? Comment lever des fonds pour créer de véritables campus, qui dynamiseraient la vie étudiante ? Les locaux sont sur-occupés à certaines périodes de la semaine, mais sous-occupés à d’autres. Les fonds de roulement sont en deçà des limites conseillées. Comment associer l’État et les collectivités territoriales à une forme de mécénat universitaire, qui reste très modeste, afin de rénover et d’adapter ce patrimoine ? Il arrive que les dépenses immobilières et de fonctionnement empêchent de véritables investissements dans la recherche et l’innovation, ce qui est toujours alarmant.
Mme Valérie Corre. Merci, mesdames les rapporteurs, de vos intéressants rapports. Je vous remercie, madame Pompili, d’avoir choisi l’inclusion à l’école primaire comme thème de votre rapport : il s’agit d’un aspect essentiel de la refondation de l’école. Je vous félicite aussi pour la richesse de ce rapport.
Parler d’inclusion, c’est parler de l’accueil de tous les élèves. Précisons, ainsi que vous l’avez fait dans votre rapport, qu’il peut s’agir non seulement d’enfants en situation de handicap, mais aussi, entre autres, d’enfants précoces, allophones ou souffrant d’un trouble « dys » – dyslexie, dysphasie, dyspraxie.
L’inclusion scolaire, qui permet d’assurer la dimension égalitaire de notre école en « donnant à tous les chances de progresser dans les apprentissages », ainsi que vous l’écrivez dans votre rapport, donne du sens aux investissements que nous réalisons depuis 2012 en matière éducative à travers les différents budgets que nous adoptons. Le budget de l’enseignement scolaire connaîtra une hausse en 2016. Pour le sujet qui nous occupe, cela se traduira par la création de plus de 350 AESH et de plus de 10 000 contrats aidés.
Au-delà de la dimension budgétaire, la réussite de l’inclusion dès l’école primaire passe par la mobilisation de tous les acteurs de l’éducation, des parents d’élèves aux enseignants. À cet égard, madame la rapporteure, vous évoquez la place insuffisante accordée à la thématique de l’inclusion scolaire dans les concours et la formation des enseignants. Les enseignants ont-ils eux-mêmes formulé des propositions à ce sujet au cours de la table ronde que vous avez organisée dans le cadre de vos auditions ?
Par ailleurs, vous proposez de désigner dans chaque école un « maître ressources inclusion », qui interviendrait en appui de l’enseignant de la classe ordinaire et comme relais entre les différents partenaires, dont les parents. On ne peut que souscrire à cette proposition sur le papier. Selon vous, l’enseignant qui assurera cette mission devra être rémunéré, voire bénéficier d’une décharge. Avez-vous pu évaluer, au moins dans les grandes lignes, le coût de votre proposition ?
Mme Martine Faure. Pour ma part, monsieur le président, j’avais bien constaté que les budgets de l’enseignement et de la recherche étaient aux mains de trois femmes, sans parler de la ministre de l’éducation nationale ! Cela nous remplit d’espoir. Merci, mesdames les rapporteures.
Merci, madame Pompili, d’avoir choisi comme sujet de votre rapport l’accueil de tous les élèves au sein de l’école de la République. Comment cet accueil a-t-il évolué depuis l’impulsion donnée par la loi pour la refondation de l’école ? Vous avez dressé un état des lieux sans concession de l’école primaire dite inclusive. Le terme « inclusive » heurtant quelque peu l’oreille, je préférerais d’ailleurs que l’on parle d’« école pour tous ». De même, il est souvent question d’écoles ou de zones « prioritaires », alors que l’éducation doit être prioritaire partout.
Pour avoir eu des enfants en inclusion ou en intégration dans ma classe, ce qui relevait à l’époque du parcours du combattant, je peux dire que beaucoup d’efforts ont été faits en matière d’accueil de ces élèves depuis quinze ans.
Vous le rappelez avec beaucoup d’énergie et de détermination, madame la rapporteure, chaque enfant doit trouver à l’école toutes les conditions pour apprendre et progresser. L’intégration, je le dis avec force, est une grande chance non seulement pour l’enfant en difficulté, mais aussi pour tous les autres élèves, qui apprennent ainsi à vivre ensemble. L’expression « s’enrichir des différences » prend ici tout son sens. Nous devons tous continuer à œuvrer sans relâche, ainsi que vous le faites ce matin, afin que l’école obtienne tous les moyens nécessaires pour que chaque enfant soit accompagné vers sa propre réussite. Merci, madame la rapporteure, et au travail, chers collègues !
M. Stéphane Travert. Je tiens à souligner, madame Pompili, la qualité de votre rapport et de vos conclusions sur l’école primaire inclusive ou « pour tous », selon la jurisprudence Martine Faure ! Je salue également le budget alloué à l’enseignement scolaire dans le projet de loi de finances pour 2016 : avec 47,99 milliards d’euros, l’éducation est le premier budget de l’État pour la deuxième année consécutive. Il est important de le rappeler.
L’objectif de l’école est de donner à chacun les chances de progresser dans les apprentissages. C’est pourquoi l’inclusion scolaire est aujourd’hui l’un des principaux défis de notre système éducatif. Plus d’enseignants, un meilleur temps scolaire, de nouveaux programmes : tels sont les chantiers que nous devons mener à bien pour remplir cet objectif majeur du quinquennat.
Dans votre rapport, vous portez votre attention sur le dispositif essentiel des RASED. Vous soulignez à juste titre que la précédente majorité a « décimé à bas bruit les effectifs » de ces équipes spécialisées. Vous parlez même de « saignée », terme auquel je souscris, puisque le nombre de poste dans les RASED est passé de 14 431 en 2007 à 9 342 en 2012.
La circulaire du 18 août 2014 a clarifié les missions de ces enseignants spécialisés et redéfini les contours de cette profession. Au regard du travail que vous avez conduit, de quelle façon les enseignants spécialisés se fondent-ils dans les équipes pédagogiques afin de soutenir les élèves en difficulté ? Comment le dispositif pourrait-il être renforcé à l’avenir ? Quel regard portez-vous sur le devenir de ces accompagnements aujourd’hui indispensables ?
M. Pascal Demarthe. Je vous remercie, madame Pompili, de votre très intéressant rapport. « C’est à l’école de s’adapter aux besoins et aux différences de l’enfant, et non à l’enfant de se fondre dans la “normalité” présupposée de l’élève tel que le rêve l’institution scolaire. » Je cite l’introduction de votre rapport avec d’autant plus d’enthousiasme que ce principe est aussi le mien. À mes yeux, le concept d’école inclusive doit être le fil conducteur de nos réflexions sur l’école et le handicap. Vous abordez ce sujet plus précisément dans un chapitre dédié et constatez que de plus en plus d’élèves en situation de handicap sont accueillis par l’école depuis 2005.
Vous connaissez mon intérêt pour la question de l’école et du handicap. Avec d’autres parlementaires, j’ai participé, le 16 juin 2015, à une table ronde sur ce sujet. Chacune et chacun d’entre nous constate, dans sa circonscription, un déficit important de places, qui compromet gravement l’accueil des enfants les plus en difficulté. Le manque de places en IME, souvent vérifié, plaide pour que les enfants qui sortent d’une CLIS poursuivent leur scolarité en milieu scolaire avec un auxiliaire de vie. En outre, certains établissements spécialisés en surcapacité risquent de perdre leur agrément pour des raisons de sécurité parfaitement compréhensibles. Selon vous, madame la rapporteure, le budget de l’enseignement scolaire pour 2016 permettra-t-il de répondre à ces problèmes et de soulager ainsi la détresse des parents, au-delà du nécessaire respect de l’égalité de toutes et de tous en matière d’éducation ?
Mme Brigitte Bourguignon. Je vous remercie, mesdames les rapporteures, pour la qualité de vos travaux. Je vous félicite, madame Pompili, d’avoir choisi le thème de l’école « pour tous » – plutôt qu’« inclusive », pour aller dans le sens de Martine Faure. L’école n’est plus épargnée par les problèmes économiques et sociaux massifs qui affectent notre pays. Vous avez su faire la part des choses entre les résultats que nous avons obtenus dans notre travail de reconstruction de l’école républicaine et les efforts qu’il nous reste à accomplir pour permettre la réussite des élèves qui rencontrent le plus de difficultés au sein de notre système scolaire.
Je souhaite mettre l’accent sur les questions de pauvreté, que vous avez vous-même évoquées. Vous avez notamment auditionné M. Jean-Paul Delahaye, qui a remis en mai dernier un rapport plus que remarquable sur la grande pauvreté et la réussite scolaire. En partant des réalités quotidiennes, il aborde la question des apprentissages et du décrochage scolaire, mais aussi l’impact de difficultés liées à la santé, au logement, à l’alimentation et même aux vêtements, que nous évoquons moins et que nous sous-estimons souvent. Ce matin même, la ministre de l’éducation nationale préside une conférence nationale destinée à mobiliser les académies pour mettre en œuvre les principales recommandations du rapport. Parmi ces mesures, nous devons être particulièrement attentifs à celles qui concernent l’école primaire.
Ainsi que vous l’avez indiqué, madame la rapporteure, nous devons consolider les dispositifs d’inclusion scolaire. Nous avons l’objectif ambitieux de scolariser 50 % des enfants de moins de trois ans dans les réseaux d’éducation prioritaire. Dans votre rapport, vous citez d’ailleurs l’exemple de mon département, le Pas-de-Calais, où l’observatoire départemental de l’école maternelle fait un très bon travail sur la question.
Je viens moi-même de remettre au Premier ministre un rapport sur le travail social. J’y préconise notamment de favoriser l’intervention des éducateurs de jeunes enfants dans les écoles maternelles, afin de faciliter la socialisation et la découverte des apprentissages, ainsi que cela se fait dans de nombreux pays européens. De la même manière, on pourrait imaginer l’intervention d’éducateurs spécialisés dans les écoles primaires. Qu’en pensez-vous ?
Mme Sylvie Tolmont. Je salue, à mon tour, le travail de nos excellentes rapporteures. Madame Pompili, votre travail très riche apporte un éclairage précieux sur l’école primaire inclusive ou « pour tous », pour reprendre les termes de Martine Faure, ou, plus précisément encore, « adaptée à tous ». C’est un sujet majeur, au cœur de l’ambition de réussite éducative pour tous défendue par notre gouvernement. Cette année encore, les crédits alloués à l’enseignement scolaire sont en hausse. Ils permettront d’accompagner l’an III de la refondation de l’école, grande réforme courageuse et nécessaire que mène notre gouvernement depuis 2012.
Votre rapport souligne que l’école peine à prendre en compte et à vaincre les difficultés scolaires et d’apprentissage de certains élèves. Ainsi que vous l’avez rappelé, j’étais l’année dernière rapporteure pour avis pour les crédits de l’enseignement scolaire. Dans ce cadre, j’avais consacré mon rapport à l’enseignement adapté dans le secondaire. J’avais notamment plaidé pour une plus grande inclusion et une meilleure formation des enseignants face à la grande difficulté scolaire. Vous faites aujourd’hui le même constat, avec autant de gravité. Je partage votre point de vue : l’inclusion s’impose comme le principal défi de l’école. La loi de 2013 a posé cette exigence associée à celle de la mixité. La construction d’une école pour la réussite de tous demeure notre premier combat. Je me réjouis de votre soutien à ces orientations, ainsi qu’aux avancées permises par la loi.
Dans ce contexte, vous rappelez que le professionnel de l’apprentissage et le garant de l’inclusion de tous les élèves est précisément le maître de la classe ordinaire. À cet égard, vous appelez à une refondation de la formation des enseignants, car vous craignez que les ESPE forment trop peu aux besoins éducatifs particuliers et déplorez que ces enjeux ne soient pas assez pris en considération dans le cadre de la formation continue. Là encore, je partage vos préoccupations, que j’avais soulignées dans mon rapport. Convaincue du caractère essentiel de la formation des enseignants et de la nécessité de développer la pédagogie différenciée – dont on parle trop peu de mon point de vue –, vous appelez également de vos vœux des évolutions institutionnelles afin d’agir sur les pratiques. Pouvez-vous nous donner des précisions sur ces évolutions ? D’autre part, quelles sont vos pistes pour inciter les ESPE à intégrer la formation concernant la difficulté scolaire au tronc commun pour tous les futurs enseignants, plutôt que d’en faire un domaine de spécialisation ?
Mme Régine Povéda. À mon tour, je salue l’excellent travail de nos collègues rapporteures. Madame Pompili, je vous remercie d’avoir choisi le sujet particulièrement important de l’école « pour tous » – j’adhère à l’opinion de Martine Faure. Je prends note des avancées en matière d’accompagnement des élèves en difficulté, en situation d’exclusion ou en situation de handicap. L’éducation nationale fait des efforts sans précédent pour améliorer la scolarisation de ces derniers en milieu ordinaire.
Dans votre rapport, vous vous concentrez sur l’école primaire. Je souhaite néanmoins vous interroger sur la situation des élèves après l’école primaire. L’accueil des élèves dans les établissements sous tutelle du ministère de la santé baisse dans le secondaire. A-t-on une explication à ce sujet ? De nombreuses familles se retrouvent sans solution. Tel est le cas dans mon village, Meilhan-sur-Garonne : les jeunes concernés ne peuvent pas être scolarisés ou rencontrent des difficultés pour être accueillis dans les IME, trop peu nombreux en Lot-et-Garonne. Dans le secondaire, le manque d’accompagnants disponibles et de places dans les structures telles que les IME est cruel. Selon vous, est-il possible d’améliorer cette prise en charge, dans l’intérêt des enfants et de leur famille ?
Mme Colette Langlade Dans votre rapport, madame Dion, vous illustrez parfaitement tout l’intérêt qu’il y a pour notre pays à accroître la recherche scientifique dans le domaine du sport. Il s’agit d’innover dans les pratiques sportives, d’améliorer les conditions d’activité pour les sportifs professionnels et amateurs ou encore de renforcer les contrôles en matière d’équité sportive. Vous montrez également comment se répartissent les unités de recherche en STAPS sur le territoire. La nouvelle grande région Aquitaine en comptera deux, une à Bordeaux et une à Poitiers. Dans le cadre de vos travaux, avez-vous pu évaluer la place de la France en matière de recherche sur le sport par rapport à ses voisins européens ?
M. le président Patrick Bloche. Mesdames les rapporteures, je vous redonne la parole pour répondre aux questions qui vous ont été posées.
Mme Sophie Dion, rapporteure pour avis sur les crédits de la recherche. Monsieur Premat, madame Doucet et madame Langlade, la vision actuelle est, en effet, réductrice : le sport est envisagé uniquement comme un facteur de bien-être, et la recherche sur le sport est rattachée, de ce fait, au défi « santé et bien-être » de la nouvelle stratégie nationale de recherche. Je suis tout à fait d’accord avec vous, il est nécessaire de passer à une approche plus globale et intégrée. Nous pourrions faire du sport un objet de recherche autonome, afin qu’il soit traité dans toute sa dimension, en particulier dans sa dimension humaniste, en effet essentielle. Tel était d’ailleurs l’objectif de mon rapport : montrer que beaucoup de choses étaient faites dans le domaine du sport, mais qu’elles étaient mal connues, car elles restaient enfermées dans des circuits trop confidentiels – je suis allée « débusquer » des informations –, et essayer de faire prévaloir une vision plus générale et intégrée du sport.
S’agissant du budget de la recherche, madame Doucet, je comprends des annonces du Gouvernement qu’il serait, au mieux, sanctuarisé en 2016. Cependant, j’ai écouté avec beaucoup d’attention les observations de mon collègue Patrick Hetzel : si l’on supprime des crédits par la suite, ces promesses, pourtant minimales, ne seront même pas tenues. Nous aurons probablement une discussion sur ce point dans le cadre de la commission élargie.
Madame Attard, nous sommes, bien sûr, tous d’accord pour renforcer les crédits récurrents. Pour autant, selon moi, il ne faut pas supprimer le crédit d’impôt recherche, car c’est grâce à lui que les laboratoires trouvent des entreprises qui leur confient des activités de recherche sur contrat. C’est très important. Il faut maintenir ce dispositif, tout à fait compatible avec le renforcement des dotations.
Madame Buffet, l’identification d’une nouvelle molécule dopante par le laboratoire de Châtenay-Malabry permet à la France d’être, encore une fois, aux avant-postes en matière de lutte contre le dopage. Quant au sport à l’université, nous pourrions en parler longuement, mais c’est un tout autre sujet.
M. le président Patrick Bloche. C’est une idée de thème pour un rapport.
Mme Barbara Pompili, rapporteure pour avis sur les crédits de l’enseignement scolaire. L’école est aujourd’hui le miroir de notre société. En France, nous avons tendance à vouloir cacher la différence, contrairement à ce qui peut se passer à l’étranger. Pendant très longtemps, l’école a eu cette tendance. Aujourd’hui, même si une vraie démarche d’inclusion est menée depuis 2005, et s’est accentuée en 2013, elle doit faire face à de lourdes résistances.
Un exemple assez révélateur est l’accessibilité des bâtiments. J’ai été sidérée d’apprendre, lors d’une audition, qu’un quart des nouveaux bâtiments scolaires construits depuis 2008 ne sont pas accessibles, alors qu’ils ont été construits trois ans après la loi de 2005. Cette aberration montre à quel point la nécessité de l’accessibilité et de l’inclusion – même si j’entends les réserves de Martine Faure sur ce terme – n’est pas encore spontanée. C’est encore quelque chose qu’il faut un peu forcer.
On le voit à l’école. De par une longue tradition, le maître y est seul face à sa classe. Quand un enfant sort de la norme, pour quelque raison que ce soit, il considère que s’en occuper n’est plus de son rôle et que cela revient à des enseignants spécialisés ou des structures. C’est tout cet état d’esprit qui est à revoir, et cela prendra du temps – je ne m’attendais pas à ce que tout change d’un coup de baguette magique. Je constate néanmoins que la volonté de changement est là, et c’est très important.
Comment faire changer les choses ? Le point absolument essentiel est d’abord la construction du travail en équipe. Les professeurs doivent apprendre à décloisonner, les systèmes médico-sociaux doivent se rapprocher de l’école, et tous les acteurs doivent travailler ensemble. Une fois encore, les habitudes de cloisonnement sont très fortes, et il faut changer cela.
Il a fallu faire accepter aux professeurs la présence des auxiliaires de vie scolaire dans les classes, les AESH aujourd’hui. S’ils sont désormais acceptés, nous avons plusieurs problèmes les concernant. Leur professionnalisation, tout d’abord. La majorité des accompagnants ne sont pas des AESH professionnels, mais des contrats aidés, qui n’ont pas eu la formation suffisante. Or nous voyons bien que l’école inclusive ne saura se passer des AESH, et des AVS de façon générale, il faudra donc bien pérenniser ces postes. Aujourd’hui, on nous répond que cela coûte trop cher, je l’entends mais je constate aussi que l’on est obligé de reconduire ces postes d’une année sur l’autre : c’est bien qu’ils sont nécessaires. Leur nombre a vocation à plafonner, et il faut maintenant pérenniser et professionnaliser ces postes.
Par ailleurs, il faut faire attention à une tendance actuelle à attribuer des AVS à tous les élèves en difficulté. Il y a des AVS absolument nécessaires : le parent d’un enfant autiste m’a dit un jour que l’AVS était comme son fauteuil roulant. Imagine-t-on de demander à un enfant non-valide de renoncer à son fauteuil roulant sous prétexte de gagner en autonomie ? Évidemment pas. Les AVS sont donc indispensables, et il faut les garder. Mais un travail de coordination, en équipe, doit être fait pour analyser les besoins spécifiques de chaque élève. S’ils montrent l’utilité d’un AVS, il faut le prendre, mais il est souvent largement suffisant de mettre en place des adaptations pédagogiques. Et pour les mettre en place, il faut ce travail en équipe.
C’est à ce stade qu’entre en compte le rôle des RASED. Leur nombre a beaucoup diminué, et, de plus, les trois catégories de personnel qui les constituent ne sont pas toujours représentées, ce qui pose de grosses difficultés pour faire travailler tout ce monde ensemble. Un professeur, même très bien formé sur le handicap ou la différence, ne va pas pouvoir répondre à tous les besoins spécifiques des enfants ; ce n’est pas possible. Si l’on veut qu’il mette en place des pédagogies adaptées, il doit le faire en partenariat avec des professionnels. Les RASED peuvent jouer ce rôle de conseil et de transfert d’expérience auprès du professeur de l’école, qui reste évidemment maître dans sa classe. Pour cela, il faudrait augmenter leur nombre, leurs effectifs sont bien insuffisants. La mise en place d’un pôle de ressources départemental et d’un « maître ressources inclusion » pour jouer le rôle de courroie de transmission, que je propose, permettrait de fluidifier tout cela. Aujourd’hui, certains professeurs qui ont dans leur classe un élève en difficulté se retrouvent démunis. C’est la fluidité du travail en équipe qu’il faut absolument améliorer.
S’agissant de la formation, je n’irai pas aujourd’hui jusqu’à dire, comme Xavier Breton, que les ESPE sont une occasion manquée. Elles pourraient le devenir, mais l’intérêt d’un rapport d’étape est justement de pointer les possibilités d’amélioration pour décider ce qu’il faut réorienter. Certaines vieilles habitudes tardent à disparaître, et particulièrement l’attachement à la discipline : un bon professeur doit avoir de bonnes bases dans les matières telles que les mathématiques, le français ou l’histoire, et il est trop jugé sur ce point. Les choses se sont un peu améliorées pour le primaire : au concours, il y a maintenant un module plus spécifique sur la pédagogie. Il n’empêche que ces apprentissages sont encore annexes. On n’apprend pas à prendre en compte le public qui nous fait face, or c’est le point nodal de la problématique de l’école inclusive. L’enseignant se retrouve complètement démuni devant des élèves en difficulté parce qu’il n’a pas été formé à faire face à la différence. Son métier, tel qu’il le perçoit, c’est de bien transmettre du français, des mathématiques, de bien apprendre à lire et à écrire à des enfants qui vont rester dans le cadre. Hors de ce cadre, beaucoup d’enseignants pensent que ce n’est plus leur métier.
C’est précisément toute la question : quel est le métier de l’enseignant ? C’est de pouvoir apporter des réponses à tous les élèves, y compris les plus éloignés. Isabelle Attard parlait du polyhandicap, qui est vraiment un cas extrême. Ce sont les situations les plus éloignées d’une scolarisation normale. Cela dit, il me semble important de rapprocher même ces enfants-là des structures scolaires.
Cela m’amène à la question des IME et des établissements médico-sociaux. Les établissements médico-sociaux ont pour habitude de travailler séparément. Un effort est en cours sur ce point, et je salue ce qui a été fait s’agissant des ULIS-écoles. Plutôt que de parler d’externalisation, je préfère employer le terme d’internalisation : cela consiste à faire venir les établissements médico-sociaux dans les écoles. Même si ces enfants ne pourront pas être intégrés dans des classes ordinaires, qu’ils soient physiquement localisés dans l’école montre qu’ils sont à leur place dans l’école de la République. Qu’on leur dispense ensuite des pédagogies très différenciées, c’est une évidence, mais il s’agit des cas extrêmes. La grande majorité des autres enfants en situation de handicap ont vocation à être intégrés dans des classes ordinaires, avec des mécanismes de sas – par exemple des ULIS, ou dans le cas des enfants allophones que l’on ne peut pas lâcher en classe sans un temps d’adaptation. Mais tout cela demande un réel travail en équipe.
Aujourd’hui, le manque de places est problématique. Tout d’abord, parce que l’on ne prend pas assez en compte le handicap de manière générale, on ne se donne pas les moyens de créer un nombre de places suffisant. C’est ainsi que l’on se retrouve dans une situation complètement aberrante, qui fait dépenser des sommes folles à notre sécurité sociale pour utiliser des places en Belgique. Je vais d’ailleurs proposer, avec certains collègues, un amendement, qui relaie une proposition de l’UNAPEI sur la question, pour sanctionner chèrement cette pratique, alors que le financement de ces places en France permettrait de créer des emplois.
De plus, parce que l’on n’a pas suffisamment adapté l’école au handicap et à la différence, on envoie dans des structures spécialisées des enfants qui n’ont pas vocation à y être. A contrario, on envoie dans des classes ordinaires, avec des AVS, des enfants qui auraient besoin d’être en IME mais qui n’y ont pas de place. On prétend qu’il s’agit d’inclusion alors que cela ne fonctionnera pas parce que la pédagogie n’est pas adaptée et que les professeurs ne sont pas formés. Les enfants se retrouvent alors très vite déscolarisés, à la charge de parents complètement désemparés.
Marie-George Buffet a soulevé la question de la médecine scolaire. C’est un vrai problème, car pour mettre en place des accompagnements personnalisés, il est aujourd’hui nécessaire d’avoir le visa du médecin scolaire. Le nombre de médecins scolaires diminue fortement, et le problème de remplacement des départs en retraite va se poser : la moitié des effectifs sera concernée dans les cinq ans à venir. Or, en 2014, un tiers des postes ouverts au concours n’a pas été pourvu faute de candidats. Il y a un problème d’attractivité et de rémunération sur lequel il faudra travailler, et une redéfinition du statut semble nécessaire : les médecins scolaires sont très absorbés par des tâches administratives, il faudrait les recentrer sur leur métier. Des expérimentations ont été mises en œuvre, notamment en Seine-Saint-Denis, pour faire venir travailler des internes en médecine dans les services de médecine scolaire. C’est une expérimentation ; nous verrons si elle produit des résultats intéressants.
La question du coût a été soulevée, et Claudine Schmid a parlé de l’amendement de Benoît Hamon. Ne l’ayant pas lu, je ne répondrai pas particulièrement sur ce point. Mais l’un des problèmes que rencontrent les professeurs est que, quelle que soit leur attitude à l’égard de l’innovation pédagogique ou de l’expérimentation, cela ne change strictement rien à leur carrière ni à leur rémunération. Or l’école inclusive demande précisément de tels efforts, et il faut valoriser les professeurs qui se donnent beaucoup de mal, réfléchir à leur carrière et à leur rémunération à l’aune de tout ce travail. Beaucoup nous ont dit lors des auditions être découragés par l’absence d’aboutissement de leurs efforts et de débouchés d’expérimentations intéressantes, et par le manque de soutien de leur administration. Ces nombreuses richesses dans nos différents établissements, il faut en tirer bénéfice. Il y a vraiment un effort à faire.
Pour la formation initiale, un travail important doit être réalisé par les ESPE. Pour la formation continue, il faut prévoir des décharges horaires pour que les professeurs puissent se former. Valérie Corre a posé une question sur les « maîtres ressources inclusion », et le coût de ce dispositif. Il n’a pas été possible de faire une évaluation précise, mais une évaluation rapide sur le fondement de deux heures de décharge horaire par semaine dans les 52 000 écoles induirait un coût de l’ordre de 150 millions d’euros.
L’école inclusive a donc indéniablement un coût, mais c’est un investissement. Toutes les prestations qu’il faudra offrir aux enfants qui, devenus adultes, ne seront pas autonomes, seront en échec, hors du système professionnel, représentent aussi des coûts à mettre en regard de ceux d’une école inclusive. Puisque l’école est le reflet de la société, je souhaite qu’elle devienne un exemple de société pour tous, une société qui fait de la place à tous les enfants, sans cacher ceux qui sont en situation de handicap, pour qu’ils ne soient pas regardés par les autres comme des extraterrestres. Ce sont des enfants comme les autres, et comme tous les enfants, ils ont leurs spécificités.
Mme Anne-Christine Lang, rapporteure pour avis sur les crédits de l’enseignement supérieur et de la vie étudiante. Je me félicite que mes collègues aient été sensibles aux forts enjeux financiers liés au thème que j’ai choisi pour mon rapport. Sur un sujet sur lequel on accumule des retards depuis des décennies, il faut se garder de toute arrogance, car chacun porte sa part de responsabilité. Nous n’allons certainement pas apporter toutes les réponses dans le cadre du projet de loi de finances pour 2016, mais j’espère que nous allons commencer à améliorer la situation.
Mme Buffet m’a interrogée sur le paradoxe qui existe entre la sous-occupation des locaux dont j’ai fait état et les photos d’amphis bondés qui circulent. C’est le résultat de la conjugaison de l’extrême diversité des situations et des pics d’activité sur la semaine et sur l’année. Les amphis sont bondés du mardi au jeudi, et entièrement vides les lundis et vendredis. La répartition sur l’année est du même ordre. C’est pourquoi le rapport souligne l’adaptation très mal pensée des locaux à l’utilisation pédagogique, et appelle à un effort de rationalisation.
Mme Buffet plaidait pour un plan d’urgence en faveur de l’immobilier universitaire ; nous préconisons, pour notre part, d’avancer, sous certaines conditions, dans la dévolution. Ainsi les besoins immobiliers seront-ils fléchés puisque la subvention ne sera plus fondue dans la dotation globale. D’une certaine façon, la dévolution répond à l’urgence.
Quelques chiffres concernant la sous-occupation : on estime que le taux d’occupation des locaux dédiés aux étudiants dans les universités est de l’ordre de 70 %, mais sur une occupation optimale calculée à 1 120 heures par an, contre 1 900 heures pour les lycées et 2 500 heures pour les administrations. Il y a donc une énorme marge de progression.
S’agissant des équipements sportifs, comme le pressentait Mme Buffet, la situation est également assez préoccupante. L’état du patrimoine sportif des universités correspond à peu près à celui du patrimoine global : 10 % du patrimoine est en état « E », c’est-à-dire très dégradé, et 31 % en état « C » et « D », mauvais.
Pour répondre à M. Bréhier sur l’inadaptation des locaux à la pédagogie, il est vrai que la modularité des locaux devient la norme. C’est une donnée importante que les universités doivent intégrer dans leur réflexion sur le devenir des salles, dans le cadre de la pédagogie inversée. Je cite dans mon rapport l’exemple de l’université de Grenoble où l’amphithéâtre de la première année commune aux études de santé a été scindé en deux salles entièrement modulables, qui permettent de faire des cours magistraux mais aussi du travail en petit groupe. Ainsi, les étudiants prennent connaissance du cours, notamment par internet, et viennent à l’université pour obtenir des explications, approfondir ou faire des exercices. De fait, le modèle de l’amphithéâtre en devient obsolète. Dans le cadre de cette réflexion sur l’adaptation de l’immobilier à l’évolution des usages, le ministère a mis en place en son sein une mission d’expertise et de conseil pour accompagner les universités dans cette stratégie immobilière de long terme. On peut regretter que, pour l’heure, une seule université y ait fait appel.
Je ne pense pas, comme l’a suggéré Mme Attard, que le rapport préconise le recours massif aux emprunts. Nous nous contentons de proposer que l’accès à l’emprunt auprès de la Caisse des dépôts et consignations soit élargi aux universités qui ne font pas partie du plan Campus. D’autant que ce sont des dépenses qui assurent un retour sur investissement, puisqu’elles sont largement consacrées aux économies d’énergie et au développement durable. Quand on voit la piètre qualité énergétique des bâtiments, c’est une nécessité.
Je conviens qu’il faudrait veiller à ne pas totalement dévoyer la vocation des locaux universitaires s’ils étaient loués. L’organisation des summer schools en Angleterre, à destination des étudiants et des élèves étrangers venus apprendre l’anglais pendant la période estivale, permet, semble-t-il, tout à la fois de préserver cette vocation et de dégager des ressources importantes. Si les universités françaises se lançaient dans des plans ambitieux pour l’enseignement du français sur ce mode, tout le monde y trouverait son intérêt.
Ce type de location reste toutefois anecdotique et ne permettra pas de faire face aux besoins considérables des universités. La piste de la formation professionnelle semble nettement plus prometteuse. On pourrait imaginer par exemple que l’intégralité de la formation continue des médecins soit organisée à l’université. Outre l’apport de recettes importantes, cela aurait un vrai sens citoyen en replaçant l’université au centre de la formation professionnelle, élargie au-delà de celle des enseignants.
Tout en renvoyant les débats approfondis sur les questions budgétaires à la commission élargie, je précise qu’une grande partie des annulations de crédits des contrats de plan concernent des projets dont la maturité était insuffisante. Il arrive souvent, pour ce type d’investissements de long terme, que les projets tardent à trouver un montage satisfaisant et accumulent du retard. Les crédits annulés de ce fait ont été reprogrammés dans le cadre du projet de loi de finances pour 2016 : 138 millions d’autorisations d’engagement supplémentaires ont été affectés à l’immobilier.
S’agissant de la dévolution que M. Hetzel appelle de ses vœux, c’est-à-dire le transfert du patrimoine de l’État aux universités, il ne concerne pour l’instant que les trois universités qui se sont portées candidates pour l’expérimentation. Actuellement, beaucoup d’universités ne sont pas prêtes à gérer ce patrimoine, car cela suppose d’avoir mené une réflexion approfondie, tant du point de vue pédagogique qu’immobilier, donc une administration et un travail extrêmement important en amont.
Quant aux 500 millions nécessaires à la remise en état, dont je fais état dans le rapport, il faut bien comprendre que, sauf à creuser immédiatement le déficit de 500 millions supplémentaires, ils ne peuvent être inscrits dès le présent projet de loi de finances. En attendant, le financement peut être assuré à travers la troisième phase du programme d’investissements d’avenir et la poursuite de la dévolution, notamment en direction des COMUE, de manière à faire entrer les universités qui ont déjà fait des efforts de rationalisation, de mutualisation et de fusion dans un cercle vertueux.
Enfin, il faut diffuser les bonnes pratiques, qui sont encore très peu répandues. L’exemple d’adaptation et de modularité des locaux à Grenoble reste exceptionnel, les efforts de mutualisation sont trop rares, et seule l’université de Caen a sollicité la mission d’expertise du ministère. Les universités peinent à rentrer dans la logique de rationalisation et de mutualisation du patrimoine immobilier, alors que, le rapport le montre, il y a urgence.
Une précision s’agissant des 100 millions d’euros prélevés dans les fonds de réserve des universités : seules ont été visées celles qui accumulaient des réserves excessives et réalisaient le moins d’investissements, donc qui entretenaient relativement mal le patrimoine. Cette ponction ne sera pas reconduite en 2016. Il faut continuer à encourager les universités à utiliser leurs réserves pour investir massivement, notamment dans les restructurations et réhabilitations immobilières, et pas seulement dans des constructions neuves, même si elles font très plaisir aux élus.
Pour finir, il est vrai, madame Martinel, qu’avant 2007 et la mise en place de l’autonomie des universités, les crédits étaient fléchés et la part réservée à l’investissement immobilier était donc sanctuarisée. La dotation globale, qui inclut les investissements immobiliers, a pour effet pervers que les universités en situation inconfortable sont tentées de consacrer ces crédits à d’autres dépenses. Mais nous savons bien que le vrai problème est que l’autonomie n’était pas financée, l’immobilier en fournit un exemple éloquent.
M. le président Patrick Bloche. Merci, mesdames les rapporteures, pour ces très intéressants rapports.
La Commission des affaires culturelles et de l’éducation procède le mercredi 21 octobre 2015, en commission élargie à l’ensemble des députés, dans les conditions fixées à l’article 120 du Règlement, à l’audition de Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, et de M. Thierry Mandon, secrétaire d’État chargé de l’enseignement supérieuret de la recherche, sur les crédits pour 2016 de la mission « Recherche, Enseignement supérieur » (3).
À l’issue de la commission élargie, la Commission des affaires culturelles et de l’éducation examine, pour avis, les crédits pour 2016 de la mission « Recherche, Enseignement supérieur ».
M. le président Patrick Bloche. Notre commission n’étant saisie d’aucun amendement, je vais mettre aux voix les crédits de la mission « Recherche, Enseignement supérieur » pour 2016, avec l’avis favorable de la rapporteure pour l’enseignement supérieur et la vie étudiante, Mme Anne Christine Lang, et l’avis défavorable de la rapporteure pour la recherche, Mme Sophie Dion.
La commission émet un avis favorable à l’adoption des crédits de la mission « Recherche, Enseignement supérieur ».
ANNEXE :
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
PAR LA RAPPORTEURE POUR AVIS
(par ordre chronologique)
Ø Agence de mutualisation des universités et établissements (AMUE) – M. Stéphane Athanase, directeur, Mme Florence Briand, chargée du domaine patrimoine
Ø Audition commune :
– Sorbonne Université – M. Barthélémy Jobert, président
– Université Pierre et Marie Curie – M. Jean Chambaz, président, M. Laurent Buisson, vice-président Moyens et ressources, et M. Daniel Melczer, directeur du patrimoine immobilier
– Université Paris 7 Diderot – Mme Christine Clerici, présidente, et Mme Nadège Cauchois-Jannot, directrice de cabinet
Ø Université de Poitiers – M. Serge Huberson, vice-président en charge du patrimoine et du développement durable, et M. Lionel Vinour, directeur de la logistique et du patrimoine immobilier
Ø Table ronde syndicats d’étudiants :
– Fabrique étudiante – M. Fabien Sannier, délégué général
– Promotion et défense des étudiants (PDE) – M. Quentin Panissod, délégué général à la représentation
– Fédération des associations générales étudiantes (FAGE) – M. Alexandre Leroy, président, M. Tarek Mahraoui, vice-président
– Mouvement des étudiants (UNI-MET) – M. Jens Villumsen, délégué national, et M. François Peguillet, délégué national en charge des questions sociales
Ø Conférence des présidents d’université (CPU) – M. Jean-Loup Salzmann, président, Mme Claire-Anne David-Lecourt, M. Michel Dellacasagrande et M. Karl Stoeckel
Ø M. Christophe Strassel, directeur de cabinet de M. Thierry Mandon, secrétaire d’État chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, auprès de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, et M. Anthony Aly, chargé de mission Relations avec les élus et le Parlement
Ø Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche – Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle – Mme Simone Bonnafous, directrice générale de l’enseignement supérieur, M. Éric Piozin, chef de service de la stratégie de contractualisation, du financement et de l’immobilier, Mme Diane Pouget, sous-directrice de l’immobilier, Mme Florence Kohler, chef de projet immobilier à la mission expertise et conseil, Mme Louisette Le Manour, chef de département du pilotage immobilier, et M. Simon Larger, chef du département de la stratégie du patrimoine