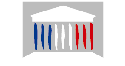______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 octobre 2015
AVIS
PRÉSENTÉ
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2016 (n° 3096),
TOME VI
ÉCONOMIE
Commerce extÉrieur
PAR Mme SEYBAH DAGOMA
Députée
——
Voir le numéro 3110
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION 7
I. LA POURSUITE DU REDRESSEMENT DU COMMERCE EXTÉRIEUR 9
A. UN MOUVEMENT DE RETOUR VERS L’ÉQUILIBRE QUI S’INSCRIT DANS LA DURÉE 9
B. LE COURT TERME : UNE AMÉLIORATION LARGEMENT DUE À LA BAISSE DE LA FACTURE ÉNERGÉTIQUE 10
C. MAIS AUSSI À LA DÉPRÉCIATION DE L’EURO 11
D. UNE NETTE REPRISE DES EXPORTATIONS DANS LES PREMIERS MOIS DE 2015 11
E. MALGRÉ UN EXCÉDENT DURABLE SUR LES ÉCHANGES DE SERVICES, UNE ÉVOLUTION PLUS MITIGÉE DES AUTRES POSTES DE LA BALANCE DES TRANSACTIONS COURANTES 12
F. DES SIGNAUX POSITIFS EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS 13
G. DES INDICATEURS STRUCTURELS ENCOURAGEANTS 14
1. Des parts de marché en voie de stabilisation 14
2. Une compétitivité-prix qui s’améliore 15
3. La compétitivité hors prix, une bataille à plus long terme 18
H. MAIS UN COMMERCE EXTÉRIEUR TOUJOURS TIRÉ PAR QUELQUES SECTEURS ET QUELQUES GRANDES ENTREPRISES 18
1. Des exportations toujours assurées essentiellement par un nombre limité d’entreprises 18
2. La poursuite du mouvement de centrage sur les « points forts » 20
3. Le cas particulier des exportations d’armement 23
I. UNE ORIENTATION GÉOGRAPHIQUE QUI N’ÉVOLUE QUE PROGRESSIVEMENT 23
II. LA POURSUITE DE L’ADAPTATION DE L’APPAREIL DE SOUTIEN À L’INTERNATIONALISATION DES ENTREPRISES 29
A. DES OPÉRATEURS DE PLUS EN PLUS INTÉGRÉS 29
1. Les débuts de Business France 29
a. La mise en place juridique de la nouvelle agence 29
b. Le contrat d’objectifs et de performance pour 2015-2017 30
c. Des moyens budgétaires en baisse 31
d. Une intégration à achever 32
e. Le rapprochement entre Business France et la Sopexa 33
2. La poursuite de l’adaptation du dispositif à l’étranger 33
a. La « diplomatie économique » en ordre de marche 34
b. La volonté réitérée de clarifier les missions respectives de Business France et du réseau consulaire 35
c. La mobilisation des conseillers du commerce extérieur de la France 36
d. Les Maisons de l’international 37
e. La disparition d’ERAI 37
f. L’amplification du programme de volontariat international en entreprise (VIE) 38
g. Un enjeu pour 2016 : la cartographie du réseau 39
3. La dimension régionale : une coordination encore en devenir 40
4. La poursuite de la réforme des financements et garanties 41
a. Les réformes menées depuis 2012 41
i. L’élargissement des dispositifs de garanties publiques 41
ii. Un plan d’action tourné vers les PME et ETI 42
b. 2015 : un accent mis sur le développement du crédit-export et le transfert de la gestion des garanties publiques 43
c. Les perspectives 44
B. L’ÉLARGISSEMENT DE LA POLITIQUE DES FAMILLES DE L’EXPORT 44
C. UNE ACTION DE PLUS EN PLUS ORIENTÉE VERS LES PME 48
D. UNE DIMENSION À MIEUX PRENDRE EN COMPTE : LE COMMERCE EN LIGNE 49
E. LA COMMUNICATION ET LA POLITIQUE D’IMAGE : UN DISPOSITIF ENCORE À CONSTRUIRE 49
III. UN EXEMPLE DE « DIPLOMATIE ÉCONOMIQUE » D’UNE NOUVELLE PUISSANCE ÉCONOMIQUE RÉGIONALE : LE CAS DE LA TURQUIE 51
A. UNE ÉCONOMIE PUISSANTE 52
1. Une croissance très forte dans les années 2000 52
2. Une économie qui domine sa région 52
3. Malgré des fragilités 54
B. UNE POSITION SOLIDE DANS LES ÉCHANGES RÉGIONAUX 56
1. Un commerce extérieur orienté d’abord vers l’Europe 56
2. Mais une forte présence commerciale dans plusieurs des pays du voisinage de la Turquie 56
3. Une place de choix pour profiter de la levée des sanctions contre l’Iran ? 57
a. Des échanges fluctuants mais tendanciellement en hausse rapide 57
b. L’enjeu pour la Turquie : l’approvisionnement énergétique 58
c. Des investissements turcs cependant assez limités 58
d. Un récent accord commercial bilatéral 58
e. Les perspectives liées à la levée des sanctions contre l’Iran 59
C. LES DÉBUTS D’UNE VÉRITABLE DIPLOMATIE ÉCONOMIQUE 59
1. Une diplomatie qui assume des objectifs commerciaux 60
2. Le dispositif turc de soutien aux exportateurs 60
a. Les structures étatiques 61
b. Un opérateur financier puissant : Eximbank 62
c. Les structures professionnelles et consulaires 62
D. UN PARTENAIRE ÉCONOMIQUE IMPORTANT POUR LA FRANCE 63
1. Un marché que les entreprises françaises ne peuvent pas négliger 63
2. Des échanges commerciaux significatifs, mais insuffisamment dynamiques 64
3. Une forte implantation des entreprises françaises 66
a. Le cas de l’automobile 66
b. L’énergie 67
c. Les autres secteurs industriels 67
d. Les services 67
e. La question de la convention fiscale 67
4. Le dispositif de soutien à nos entreprises en Turquie 68
a. Un dispositif éclaté entre Ankara et Istanbul 68
b. La prise en main par Business France de la compétence « investissement » 68
c. Un dispositif marqué par la concurrence de certains acteurs 69
d. Une difficulté particulière : le statut des volontaires internationaux en entreprise (VIE) 70
Mesdames, Messieurs,
Après avoir connu une dégradation constante durant les années 2002-2012, notre commerce extérieur poursuit depuis 2012 son redressement. Sur l’année en cours, son déficit sera très vraisemblablement inférieur à 50 milliards d’euros, soit un tiers de moins qu’en 2011, où il a approché les 75 milliards.
Ces résultats sont dus en grande partie à des facteurs exogènes, tels que la baisse des cours du pétrole et la dépréciation de l’euro face à la plupart des autres devises, mais traduisent aussi la réussite de la politique générale de compétitivité du Gouvernement. Celle-ci se lit désormais dans les données statistiques : l’INSEE a récemment relevé que, depuis 2012, le coût horaire moyen du travail augmente nettement moins vite en France qu’en Allemagne ; entre 2012 et le troisième trimestre 2014, la hausse de ce coût a été de 1,6 % en France, contre 3,9 % en Allemagne. Ce résultat a été obtenu grâce au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), qui a réduit la hausse du coût français de 2,8 points.
Ils sont également portés par un dispositif institutionnel de soutien à l’internationalisation de nos entreprises dont la mise en ordre se poursuit : la « diplomatie économique » est plébiscitée par les entreprises, qui saluent l’engagement de plus en plus important de nos ambassadeurs à leurs côtés ; l’agence Business France issue de la fusion Ubifrance-AFII est désormais opérationnelle, même si son intégration n’est pas achevée, et va bientôt reprendre les activités de service public de la Sopexa ; Bpifrance complète son offre de financement aux PME par de nouveaux produits et va reprendre également la gestion des régimes de garanties publiques aux exportateurs qui étaient confiés à la Coface ; la fédération de l’offre française dans le cadre de la politique des « familles de l’export » progresse, avec la création de nouvelles « familles » consacrées aux industries culturelles et créatives et au tourisme…
S’il reste des chantiers à ouvrir, concernant notamment le redéploiement de notre réseau de soutien aux entreprises vers les pays émergents et la construction d’une véritable politique d’image nationale (de « marque ») de la France, les progrès accomplis doivent être salués.
Les indicateurs du succès de la politique d’attractivité sont également encourageants : le nombre de visas pour visite (généralement touristique) délivrés par les consulats français dans le monde a augmenté de près de 17 % entre 2013 et 2014. En Chine, le nombre global de visas délivrés (il s’agit essentiellement de visas de tourisme) a même connu une progression de 58 % ! Le nombre de projets d’investissements directs étrangers en France ayant un impact sur l’emploi a de même augmenté de 8 % à 18 % entre ces deux années (selon que l’on prend les chiffres de Business France ou de l’agence Ernst & Young).
Le présent avis comprend enfin un développement consacré à la Turquie. Ce grand pays justifie en effet un intérêt particulier:
– d’abord parce que c’est un marché puissant et dynamique – avec une croissance annuelle moyenne de plus de 5 % durant les années 2000 et aujourd’hui un PIB global plus élevé que tout autre pays de l’Europe balkanique ou du Proche-et-Moyen-Orient – qui est d’ailleurs déjà le 6ème débouché des exportations françaises hors Union européenne et Suisse ;
– mais que notre présence économique y est insuffisante, étant inférieure à celle de nos principaux concurrents européens ;
– que la Turquie offre aussi l’exemple intéressant de la « diplomatie économique » d’un pays en forte croissance, dont les ambitions sont grandes tant sur le plan économique que sur le plan politique ;
– que, dans ce cadre, la Turquie a notamment donné une priorité à un continent où la France reste très impliquée, l’Afrique ;
– qu’enfin, sa position géographique est déterminante dans la perspective de la levée des sanctions internationales contre l’Iran et de la reprise des relations économiques avec ce pays.
L’année 2014, puis les premiers mois de l’année en cours, ont vu le redressement de notre commerce extérieur se poursuivre. Le mouvement engagé depuis 2012 s’inscrit donc dans la durée.
Depuis le déficit record de 2011, qui atteignait 74,5 milliards d’euros, le solde s’est constamment amélioré : 67 milliards en 2012 ; 61 milliards en 2013 ; 54 milliards en 2014.
Sur la dernière période glissante de douze mois dont les résultats sont connus, de septembre 2014 à août 2015, ce solde s’est encore amélioré, revenant à moins de 46 milliards d’euros.
Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous, le redressement engagé depuis 2012 se poursuit donc, après la très forte dégradation des années 2002-2008.
Évolution du solde des biens
(FAB/FAB, y compris matériel militaire)
(en milliards d’euros)
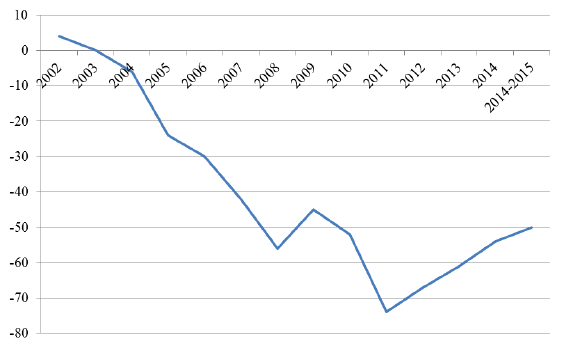
Source : Douanes.
NB : l’étiquette « 2014-2015 » correspond à la période juillet 2014 – juin 2015.
En 2014, l’amélioration du solde commercial de la France a été due essentiellement à l’allégement de la facture énergétique, du fait de la très forte chute des cours du pétrole constatée à partir du milieu de l’année. À 54,8 milliards d’euros sur l’année, le solde des importations et exportations de produits énergétiques a baissé de 10,9 milliards, soit 17 %, par rapport à 2013.
Comme le montre le graphique ci-après, notre facture énergétique est naturellement étroitement corrélée aux cours du pétrole et au change euro/dollar.
Une facture énergétique corrélée au cours du pétrole en euros
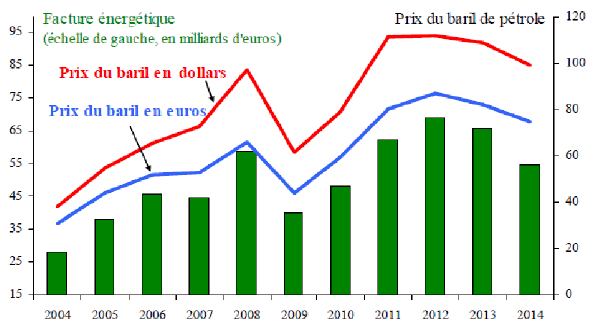
Source : « Le chiffre du commerce extérieur – Année 2014 », Douanes et INSEE.
En 2014, l’allégement de notre déficit sur les produits énergétiques a été plus fort que celui du solde commercial global : cela signifie que le solde hors énergie s’est dégradé. Hors énergie et armements, ce solde est effectivement passé de 12 à 16 milliards d’euros.
Cette évolution défavorable ne doit pas être surinterprétée, car il est évident que l’on ne peut pas tout « gagner sur les deux tableaux » : quand les cours du pétrole s’effondrent, réduisant d’autant le coût de nos importations, il est inévitable que les pays exportateurs d’hydrocarbures, mis en difficulté et souvent confrontés à des dépréciations de leur monnaie, réduisent leurs propres achats, notamment en France. On constate ainsi que nos ventes à l’Arabie Saoudite ont baissé de 14 % en 2014 par rapport à 2013 et celles à la Russie de 12 % (s’agissant de ce dernier pays, l’effet des difficultés politiques, des sanctions et contre-sanctions est également à prendre en compte).
La dépréciation relative de l’euro face aux autres devises, en particulier le dollar américain, est également un facteur très important. Au 1er semestre 2014, un euro s’échangeait contre 1,35 à 1,39 dollar selon les moments. Puis une dépréciation régulière de la monnaie européenne s’est engagée en juillet 2014, pour aboutir à des « points bas » en mars-avril 2015 aux alentours de 1,05 dollar pour un euro. Depuis lors, le taux de change oscille autour de 1,10 sans jamais avoir dépassé 1,15 dollar pour un euro. La dépréciation moyenne de l’euro en un an est donc de l’ordre de 20 %.
Or, nul n’a oublié le débat suscité par les calculs théoriques du ministère de l’économie, publiés dans un document budgétaire de 2013 (1), selon lesquels l’enjeu d’une variation de 10 % du taux de change de l’euro contre les autres devises serait, grâce à la relance des exportations qui en résulterait, de l’ordre de 0,6 point de PIB et de 30 000 emplois la première année, de 1,2 point de PIB et de 150 000 emplois deux ans plus tard. Depuis lors, d’autres évaluations ont nuancé ces résultats ; une étude récente de l’OFCE (2) chiffre plutôt les gains de PIB à 0,2 point la première année et 0,5 point deux ans plus tard, ceux d’emplois à ces échéances étant de 20 000 puis 77 000. Toujours est-il que l’impact d’une dépréciation relative de l’euro qui est finalement double ne peut qu’être significatif.
Un autre point positif qu’il faut souligner est la tendance à la reprise des exportations depuis quelques trimestres, qui est notamment liée, selon toute vraisemblance, à la baisse de l’euro susmentionnée.
En 2013, l’amélioration du solde du commerce extérieur français avait été obtenue par une double diminution concernant à la fois le montant des importations et celui des exportations : la baisse des importations étant plus rapide, le solde s’était amélioré, mais on ne pouvait pas considérer comme satisfaisant que les exportations soient également en berne. En 2014, on a constaté une stabilisation du montant des exportations, tandis que la valeur des importations continuait à reculer, permettant une nouvelle amélioration du solde.
On assiste depuis peu à une nette reprise des exportations, de sorte que celles-ci ont atteint sur l’année glissante août 2014-juillet 2015 un total de 449 milliards d’euros, contre 436 milliards sur l’année civile 2014 (+ 3 %), tandis que les importations passaient seulement de 494 à 496 milliards (+ 0,5 %).
Cette reprise des exportations est tirée par le rebond des livraisons aéronautiques et spatiales, notamment vers l’Amérique. Les ventes automobiles, qui bénéficient du raffermissement du marché européen, continuent également leur progression amorcée depuis deux ans. Les autres biens manufacturés (informatique, machines, habillement/bagagerie) et les produits agricoles affichent également de bonnes performances.
Il faut espérer que la fin de l’année 2015 confirmera ce mouvement (durant l’été, on a malheureusement assisté à un léger tassement des exportations après les bons résultats du premier semestre).
E. MALGRÉ UN EXCÉDENT DURABLE SUR LES ÉCHANGES DE SERVICES, UNE ÉVOLUTION PLUS MITIGÉE DES AUTRES POSTES DE LA BALANCE DES TRANSACTIONS COURANTES
Le solde courant d’un pays, qui traduit l’évolution de sa position patrimoniale vis-à-vis du reste du monde (les déficits doivent être compensés par de l’endettement ou la cession d’actifs par le biais de flux d’investissements), comprend, outre la balance des biens, celle des échanges de services et celle des revenus.
D’après les calculs de la Banque de France, ce solde courant global se serait légèrement dégradé en 2014 par rapport à 2013, passant de 17,1 milliards d’euros à 19,7 milliards de déficit, du fait d’évolutions négatives sur les soldes des services et des revenus qui sont plus importantes que l’amélioration sur le solde des biens, comme on le voit sur le tableau ci-après.
Les principaux soldes des transactions courantes
(en milliards d’euros)
2012 |
2013 |
2014 | |
Solde des biens |
– 54,1 |
– 43 |
– 34,6 |
Solde des services |
24,9 |
22,4 |
17,8 |
Solde des revenus |
4,3 |
3,5 |
– 2,9 |
Solde global |
– 24,9 |
– 17,1 |
– 19,7 |
Source : Banque de France, « 2014 – Rapport annuel – la balance des paiements et la position extérieure de la France ».
Effectivement, l’amélioration du solde des biens en 2014, proche d’une dizaine de milliards d’euros, est plus que compensée par des dégradations à hauteur respectivement de 4,6 milliards d’euros et 6,4 milliards d’euros sur ceux des services et des revenus.
S’agissant du solde des services, qui reste positif, le recul s’explique essentiellement par une baisse de l’excédent sur les voyages (tourisme), qui proviendrait d’une hausse des dépenses des Français à l’étranger (+ 13 %) nettement plus rapide que celle des dépenses des étrangers en France (+ 2 %).
Le solde des revenus se dégrade de nouveau en 2014 et cesse d’être positif : il enregistre un déficit de 2,9 milliards d’euros après un excédent de 3,5 milliards en 2013.
Cette évolution très défavorable rend compte d’un « accident », à savoir la pénalité versée par BNP Paribas à l’administration américaine suite à sa mise en cause pour contournement de la législation sur les embargos : la charge de cette pénalité équivalente à 6,6 milliards d’euros a été partagée entre l’entreprise mère, localisée en France, et sa filiale suisse ; la part à la charge de la société mère, soit 4,3 milliards d’euros, impacte d’autant le solde des revenus de la balance courante. Sans cet événement ponctuel, le solde des revenus s’établirait à + 1,3 milliard d’euros en 2014 et le déficit global des transactions courantes à 15,4 milliards (il serait alors moins élevé qu’en 2013).
La dégradation du solde des revenus rend cependant compte aussi d’une autre évolution, celle-là structurelle : l’endettement externe croissant de la France, avec la détention croissante de titres de dette publique par des non-résidents, pèse sur le solde des revenus de portefeuille ; déjà négatif de 16,1 milliards d’euros en 2013, il passe à – 19,7 milliards en 2014.
Les flux d’investissements étrangers ne font pas partie de la balance courante, mais doivent être évoqués au titre de la politique d’attractivité.
La quantification des flux financiers d’investissements (et de désinvestissements) présente un intérêt qui est limité par de multiples problèmes méthodologiques.
C’est pourquoi les agences spécialisées préfèrent s’efforcer de décompter les projets d’investissements directs étrangers (IDE).
L’année 2014 est à cet égard assez encourageante.
● Selon les statistiques de Business France, la France a reçu 740 projets d’investissement étranger créateur d’emploi en 2014, soit 8 % de plus qu’en 2013. Le nombre de projets est même de 1 014 si l’on prend aussi en compte ceux de moins de 10 emplois, les projets de partenariat technologique ou commercial, les projets de pérennisation ou de modernisation, les projets de prise de participation et les changements de site d’une même entreprise.
Ces opérations représentent toutefois un nombre d’emplois créés ou sauvegardés en recul : 25 500, en baisse de 14 % par rapport à 2013.
● Selon le baromètre annuel de l’agence Ernst & Young, 608 décisions d’investissement direct étranger ont été prises en faveur du site « France » en 2014, contre 515 en 2013 et 471 en 2012 (et 539 en moyenne sur les années 2005-2009). La France reste au troisième rang européen en nombre d’implantations, derrière le Royaume-Uni (887 en 2014) et l’Allemagne (763).
Seul bémol, le nombre d’emplois créés est également mesuré en baisse : environ 12 600 en 2014, contre plus de 14 000 en 2013 (3).
L’analyse des indicateurs plus structurels, à moyen terme, de notre commerce extérieur est également encourageante.
Le suivi des parts de marché de nos exportateurs au niveau mondial constitue un indicateur pertinent de notre capacité à rester compétitifs sur le moyen terme. Le tableau ci-après montre le déclin relatif de la part de marché mondiale de la France durant la décennie 2000 : en volume (ce qui neutralise les effets de prix et de taux de change), cette part a baissé de 5,1 % en 2001 à 3,6 % en 2014. On observe que ce recul a été rapide dans les années 2000, puis s’est ralenti ; on irait donc vers une stabilisation.
Parts de marché mondial en volume
(exportations en volume de biens et services du pays rapportées aux exportations mondiales)
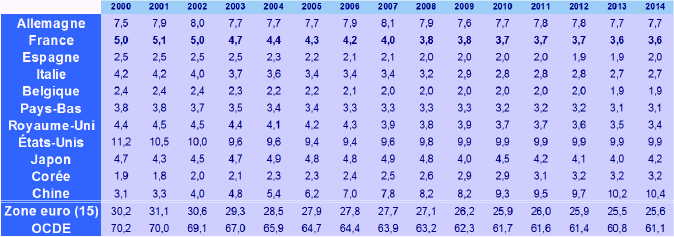
Source : questionnaire budgétaire, direction générale du Trésor.
Dans la même période, parmi les grands pays exportateurs, c’est évidemment la Chine qui a fortement progressé (avec une part de marché mondiale qui a triplé depuis 2000 et dépasse désormais 10 %), aux dépens d’à peu près tous les grands pays occidentaux. On note cependant la capacité de résistance de l’Allemagne, qui parvient à conserver une part de marché voisine de 8 % sur toute la période, mais aussi des États-Unis, dont la part de marché reste proche de 10 %. Des pays européens tels que le Royaume-Uni, l’Espagne et les Pays-Bas ont également connu des reculs relatifs de leur part de marché, mais moindres que celui de la France. Parmi les grands exportateurs, seule l’Italie a connu un recul comparable à celui de la France.
La montée en puissance des émergents, en particulier de la Chine, est un phénomène de fond qui a pour effet que, de toute façon, la part que représentent les pays développés « traditionnels », les économies matures, dans le commerce mondial et plus généralement l’économie mondiale est nécessairement en recul. Nos vrais concurrents sur le marché mondial, ce sont ces autres économies matures. Le tableau qui suit permet une comparaison des parts de marché centrée sur les pays de l’OCDE : il s’agit de voir comment évoluent les parts des uns et des autres non pas dans le total des exportations mondiales, mais dans le total de celles faites par les pays de l’OCDE.
Parts de marché relatives en volume vis-à-vis des partenaires OCDE
(exportations en volume de biens et services du pays rapportées aux exportations totales de l’OCDE)
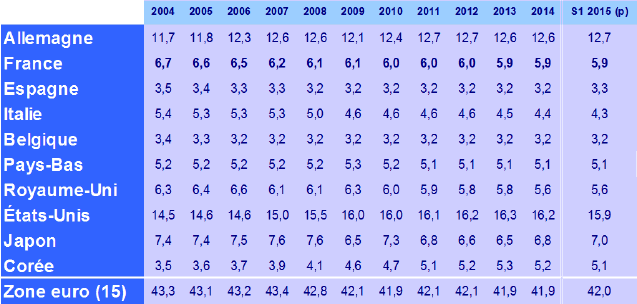
Source : questionnaire budgétaire, direction générale du Trésor.
On voit, là aussi, la capacité de l’Allemagne a rogner sur les parts de marché des autres pays développés, mais aussi le bon positionnement des États-Unis, alors que les autres grands pays européens ont vu leurs parts de marché se réduire, notamment la France – avec en ce qui nous concerne une dégradation très marquée que les années 2004-2008.
On sait que la compétitivité sur les marchés internationaux mêle des facteurs « hors prix », par nature difficiles à quantifier, et des facteurs « prix ».
S’agissant de la compétitivité-prix, que l’on mesure plus aisément, des progrès très significatifs ont été accomplis récemment, du double fait de la dépréciation relative de l’euro et de l’effet des mesures d’allégement des coûts des entreprises : crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et Pacte de responsabilité et de solidarité (suppression des charges au niveau du SMIC, réduction des cotisations familiales, suppression de la contribution sociale de solidarité des sociétés…).
L’évolution de la compétitivité prix est déterminée par plusieurs facteurs : les coûts des entreprises, dont celui du travail (mais pas seulement) ; l’effort de marge des entreprises (c’est-à-dire la compression ou non des marges qu’elles acceptent pour exporter) ; l’évolution des taux de change ; le différentiel d’inflation entre les pays (la composition des taux de change nominaux avec l’inflation permettant de déterminer des « taux de change effectifs réels »).
Effectivement, au début des années 2000, la forte appréciation de l’euro dans la période qui a précédé la crise de 2008 avait fortement dégradé la compétitivité-prix de la France par rapport à la moyenne de ses partenaires et concurrents (à la fois) de l’OCDE.
La situation s’est inversée depuis lors :
– par rapport au niveau moyen de 2009, le taux de change effectif réel de la France s’était déprécié de 8,9 % au premier semestre 2015, du fait de la baisse tendancielle de l’euro, renforcée par la faible inflation propre à notre pays (le taux de change effectif réel a évolué moins favorablement dans des pays tels que l’Espagne et l’Italie ; la dépréciation moyenne de l’euro sur la période n’a été que de 6,7 %) ;
– dans ce contexte d’évolution favorable du change, la compétitivité-prix de la France a progressé de 11,5 % au premier semestre 2015 par rapport à la moyenne de 2009 et sa compétitivité-coût de 12,1 %
Cette progression s’est accélérée dans la période la plus récente du fait de l’évolution de l’euro : le gain de compétitivité-prix par rapport à 2009 n’était encore que de 7,3 % en 2014.
Les tableaux ci-après montrent, dans ce contexte, que les situations de l’Allemagne et de la France se sont, en termes de compétitivité-prix et coût, bien améliorées par rapport à la moyenne de l’OCDE depuis 2009.
Évolution de la compétitivité-prix
(évolutions comparées, base 100 en 2009)
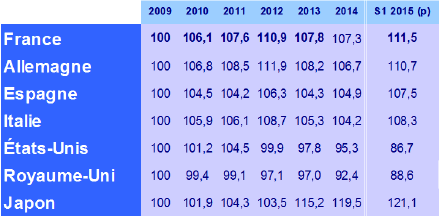
Évolution de la compétitivité-coût
(évolutions comparées, base 100 en 2009)

Source : questionnaire budgétaire, direction générale du Trésor.
On observe qu’en termes de compétitivité-coût, la situation relative de la France s’est nettement plus améliorée que celle de l’Allemagne sur la période en cause : + 12,1 % contre + 7 %. Effectivement, comme l’INSEE en a récemment rendu compte, le coût horaire de la main d’œuvre a moins augmenté en France qu’en Allemagne depuis la crise de 2008. Plus précisément, les courbes de coûts des deux pays ont commencé à diverger, au bénéfice de la France, à partir de 2012 : entre 2012 et le troisième trimestre 2014, la hausse du coût moyen du travail a été contenue à 1,6 % en France, contre 3,9 % en Allemagne, soit plus du double. Ce résultat a été obtenu grâce au CICE, qui a réduit la hausse du coût français de 2,8 points (sans le CICE, cette hausse aurait donc été légèrement plus élevée qu’en Allemagne).
L’accélération de la dépréciation relative de l’euro (notamment par rapport au dollar) depuis mi-2014 paraît donc offrir de réelles opportunités à nos exportateurs.
L’optimisme doit toutefois être tempéré par deux remarques :
– la compétitivité-prix n’est pas tout, on l’a dit. Comme on l’observe sur les tableaux ci-dessus, celle du Japon s’est considérablement améliorée ces dernières années. Pour autant, ce pays ne paraît pas sorti des graves difficultés qu’il traverse ;
– malgré l’amélioration récente, la compétitivité-prix relative de la France reste au premier semestre 2015 encore inférieure à son niveau de 2000.
L’analyse de la seule compétitivité-prix ne suffit pas à expliquer les difficultés du commerce extérieur français. Tout autant, voire plus que la compétitivité prix, c’est probablement la compétitivité hors prix qui s’est révélée insuffisante durant la décennie 2000.
L’amélioration de la compétitivité hors prix renvoie bien sûr à des politiques structurelles de long terme : augmentation des niveaux moyens de qualification de la main d’œuvre ; croissance de l’effort de recherche et développement et bonne articulation entre les efforts publics et privés dans ce domaine, afin de stimuler l’innovation ; développement des infrastructures de transport et de communication ; stabilité et qualité des réglementations (cette problématique étant loin de ne concerner que le droit du travail, qui est trop souvent mis en cause à titre exclusif)…
C’est à ces défis que le Gouvernement s’attelle en donnant la priorité à l’Éducation nationale, en appliquant le « choc de simplification » ou en faisant adopter les mesures de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
D’autres grandes caractéristiques structurelles de notre commerce extérieur évoluent peu, notamment sa dépendance vis-à-vis d’un nombre limité de secteurs et d’entreprises.
En 2014, le nombre d’entreprises exportatrices s’est élevé à 121 500, soit une hausse de + 0,5 % par rapport à 2013 (après une hausse de 1 % en 2013 par rapport à 2012). C’est toujours trois fois moins qu’en Allemagne et deux fois moins qu’en Italie.
De plus, dans ce nombre limité d’entreprises exportatrices, un nombre encore plus restreint assure la plus grande part des flux.
En 2014, les grandes entreprises, qui représentent 0,4 % du total des entreprises exportatrices, ont effectué 52 % des exportations. À l’opposé, les PME et micro-entreprises représentent 95 % des entreprises exportatrices, mais seulement 15 % des exportations. Encore les PME exportatrices dépendent-elles le plus souvent de groupes :
– les filiales de groupes français représentent plus de la moitié des montants exportés par la France ;
– celles des groupes étrangers en assurent 41 % ;
– les entreprises indépendantes, non affiliées à un groupe, ne réalisent qu’une fraction marginale des exportations françaises (2,2 %).
D’année en année, malgré tout, on observe une lente montée en puissance des entreprises moyennes et petites dans l’export. Comme on le voit sur le graphique ci-après, en 2014, les montants exportés par les grandes entreprises ont diminué de 1 %, tandis que ceux exportés par les PME et micro-entreprises progressaient de plus de 2 %.
Évolution des montants exportés et du nombre d’exportateurs par type d’entreprise de 2013 à 2014
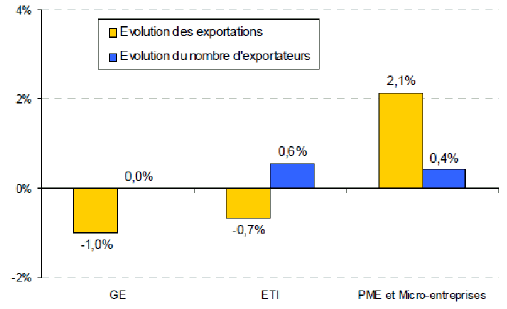
Source : « Le chiffre du commerce extérieur – Les opérateurs du commerce extérieur – Année 2014 », Douanes.
Une autre évolution progressive plutôt encourageante concerne la stabilité du tissu des entreprises exportatrices. Comme le montre le graphique ci-après, on relève d’année en année, assez régulièrement, une diminution du nombre d’entreprises qui « entrent » dans l’export ou en « sortent » (le solde entre les deux donnant l’évolution annuelle du nombre d’exportateurs) : en un peu plus d’une décennie, ce nombre annuel est tombé d’environ 38 000 à 28 000.
Évolution du nombre d’exportateurs « entrants » et « sortants »
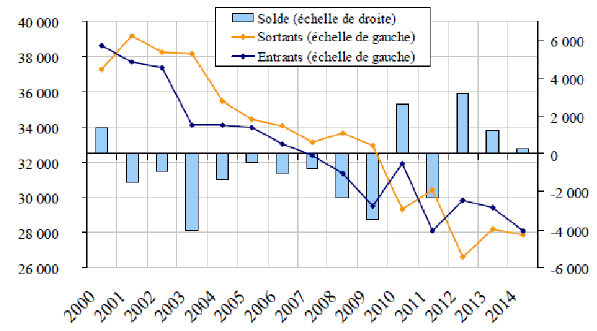
Source : « Le chiffre du commerce extérieur – Les opérateurs du commerce extérieur – Année 2014 », Douanes.
Cette réduction de la « mobilité » des exportateurs signifie qu’il y a de moins en moins d’exportateurs occasionnels, d’entreprises qui se contentent de faire de temps en temps un « coup » à l’export.
Vu les coûts et les risques de l’export, une plus grande stabilité du tissu exportateur constitue une évolution positive. L’exportation ne peut être qu’un investissement dans la durée.
Les exportations françaises se concentrent de plus en plus dans quelques secteurs économiques.
Le graphique ci-après montre qu’en une petite décennie (2005-2014), le poids du secteur aéronautique et spatial dans nos exportations a augmenté de moitié, passant de 7,6 % à 12,2 %, et ceux des secteurs agro-alimentaire, chimie-cosmétique, pharmacie et textile ont également progressé, tandis que les poids des autres secteurs diminuaient.
Répartition des exportations par grands secteurs d’activité 2005-2014
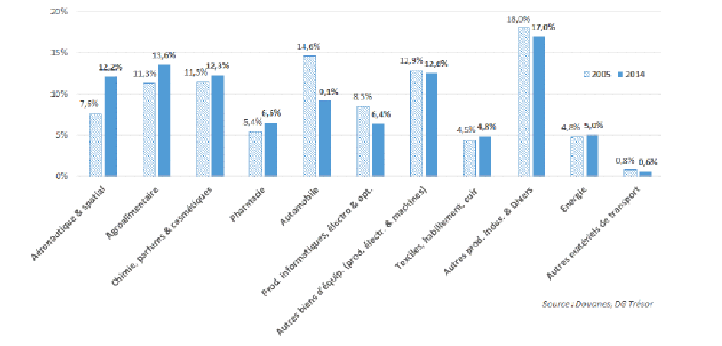
Le graphique ci-après exprime autrement la même réalité : depuis 2008, nos exportations aéronautiques ont crû de près de 40 %, mais celles de biens d’équipement ont baissé et celles d’automobiles sont en retrait de 15 %...
La dégradation constante de nos échanges dans le secteur automobile, qui a longtemps été un point fort de la France, est inquiétante. Les conséquences des choix stratégiques de nos constructeurs en termes de localisation de leurs usines et de capacité à développer leurs marchés sont lourdes.
Évolution des exportations françaises par secteur
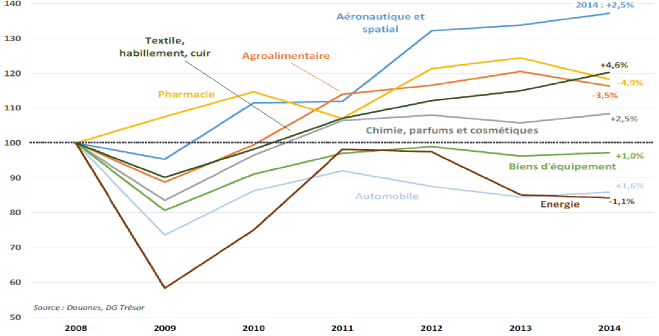
Source : gouvernement (« Résultats 2014 du commerce extérieur »).
Les secteurs où se concentrent les exportations françaises sont aussi ceux où les soldes sectoriels sont les plus positifs, nos importations restant plus diversifiées.
En 2014, l’excédent du secteur aéronautique et spatial a ainsi encore augmenté, atteignant un nouveau record à près de 24 milliards d’euros. La chimie, l’agro-alimentaire et la pharmacie restent nos autres secteurs excédentaires. Il faut toutefois souligner le recul des excédents traditionnels dans l’agro-alimentaire et la pharmacie par rapport à 2013.
À un peu plus de 9 milliards d’euros, l’excédent agro-alimentaire français a ainsi diminué de plus de 2 milliards d’euros entre 2013 et 2014. Cette évolution globale semble principalement liée à la baisse des cours mondiaux des céréales – la valeur de nos exportations de céréales a diminué de 1,4 milliard d’euros –, mais aussi à la réduction de nos exportations de viande (– 0,3 milliard d’euros). De plus en plus, le solde agro-alimentaire global combine quelques excédents massifs – sur les boissons (10,4 milliards d’euros d’excédent en 2014), les céréales (6,2 milliards d’excédent) et les produits laitiers (3,5 milliards d’excédent) – et des déficits, notamment sur les produits de la pêche, les fruits et légumes et préparations les utilisant, les viandes…
Principaux excédents et déficits sectoriels en 2013 et 2014
(en milliards d’euros, données CAF/FAB brutes)

Source : gouvernement (« Résultats 2014 du commerce extérieur »).
Les armements constituent un autre point fort du commerce extérieur français. Compte tenu de la nature de ces exportations, soumises à un régime d’autorisation, elles ne sont pas prises en compte dans la plupart des statistiques douanières. Il convient toutefois de les évoquer.
Dans un commerce de l’armement très concurrentiel et dominé par les États-Unis, qui contrôlent 48 % du marché mondial (lequel représente de l’ordre de 100 milliards d’euros par an), la France apparaît comme le quatrième exportateur mondial sur la période 2010-2014.
Le total des exportations françaises (matériels livrés) sur la période 2010-2014 est de 14,8 milliards d’euros, avec une tendance à la progression sur la période : on est passé de 3,78 milliards d’euros en 2010 à 4,05 milliards en 2014. Du fait de la progression des commandes (voir infra), les livraisons devraient continuer à augmenter à court terme, notamment en 2015.
Quinze pays ont absorbé 84 % des livraisons de matériels français à l’étranger sur la période 2010-2014 : dans l’ordre décroissant, l’Arabie Saoudite (2,56 milliards d’euros), l’Inde (1,48 milliard d’euros), les Émirats-Arabes-Unis (1,12 milliard), les États-Unis, le Brésil, le Maroc, Oman, l’Australie, la Chine, le Royaume-Uni, l’Espagne, Singapour, le Mexique, la Malaisie et le Pakistan.
Les commandes d’armement sont en croissance continue sur la période 2010-2014, à l’exception d’un « creux » en 2012. De 2010 à 2014, elles sont passées de 5,1 milliards d’euros à 8,2 milliards d’euros, soit une progression de plus de 60 %. Cette croissance a été presque entièrement réalisée dans la zone Proche-et-Moyen-Orient (+ 371 %).
Selon les prévisions, l’année 2015 pourrait être exceptionnelle, avec déjà plus de 15 milliards de commandes enregistrées, et des perspectives complémentaires sérieuses : contrats de vente d’avions Rafale passés avec l’Égypte et le Qatar, et en bonne voie avec l’Inde ; vente à l’Égypte d’une frégate et des deux bâtiments de projection et de commandement (BPC) après l’annulation du contrat les concernant avec la Russie ; contrats également en cours de finalisation avec le Koweït et la Pologne concernant des hélicoptères Caracal…
De plus en plus, la croissance, donc les opportunités commerciales, se trouvent dans les pays émergents.
Sur les cinq prochaines années, selon le Fonds monétaire international, les surplus de richesse (deltas de PIB) devraient être localisés à plus de 70 % dans les pays émergents, principalement en Asie (47 % du total), et seulement à 11 % dans l’Union européenne.
Distribution géographique des gains prévisionnels de PIB nominal de 2015 à 2020
(en parité de pouvoir d’achat)
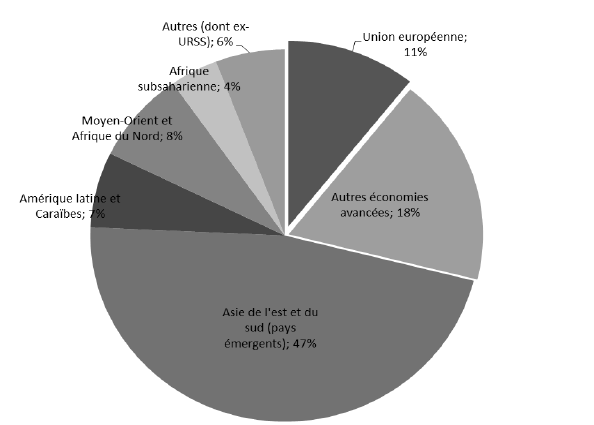
Source : graphique élaboré à partir d’extractions de World Economic Outlook Database du FMI, données d’avril 2015.
Or, le commerce extérieur de la France reste fortement « eurocentré » : l’Union européenne continue à absorber 60 % de nos exportations et sa part a même légèrement augmenté en 2014 par rapport à 2013. La seule zone euro est la destination de 47 % de ces exportations.
Répartition géographique des exportations françaises de biens en 2014
(en valeur)
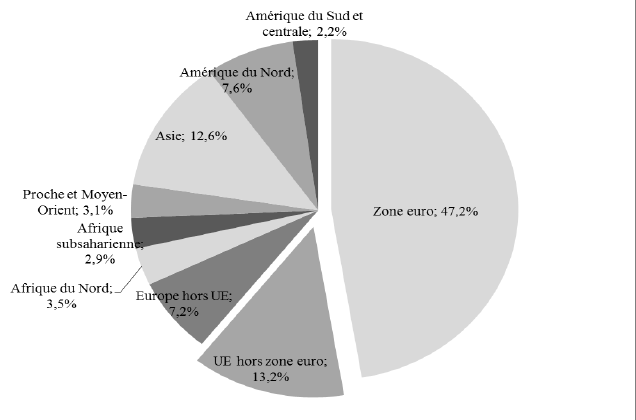
Source : graphique élaboré à partir d’extractions des « Résultats 2014 du commerce extérieur ».
En fait, en 2014, nos marchés traditionnels dans les pays anciennement industrialisés ont souvent été plus porteurs que les marchés émergents, touchés par diverses difficultés économiques (baisse des cours du pétrole et des matières premières, crises politiques et sécuritaires, dévaluations…).
Ainsi les ventes françaises ont-elles baissé en Afrique (– 0,6 %), notamment en Libye et en Tunisie, laquelle a acheté moins de céréales, de matériels de transport et de composants électroniques, en Russie et en Arabie Saoudite, en Amérique du Sud, en particulier au Brésil (baisse des cours agricoles et dépréciation du real) et en Argentine (en récession).
À l’inverse, les exportations à destination des États-Unis ont augmenté de 1,7 % dans un environnement marqué par la dépréciation de l’euro face au dollar au second semestre 2014 et par une croissance économique plus forte qu’en Europe.
Cependant, sur le moyen terme, au-delà des fluctuations annuelles, on observe bien une certaine réorientation de nos exportations vers les zones à fort potentiel : depuis 2005, les ventes françaises ont presque doublé en Amérique du Sud et ont augmenté de 35 % à 80 %, selon les cas, au Proche-et-Moyen-Orient, en Afrique et en Asie, tandis que vers l’Europe et l’Amérique du Nord, l’évolution n’était que de 10 % environ.
Évolution des exportations françaises par zone géographique
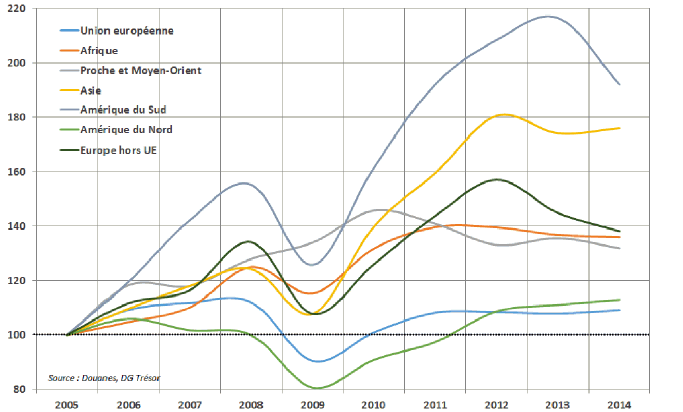
Source : gouvernement (« Résultats 2014 du commerce extérieur »).
Mais, comme on l’a vu, cette réorientation ne paraît pas assez rapide pour que notre positionnement géographique soit optimal.
Il faut pourtant souligner, à l’encontre de certains préjugés sur la concurrence « déloyale » de certains des pays du sud et sur les « délocalisations » vers les pays à bas coûts, que le monde émergent n’est pas responsable de notre déficit commercial, loin de là : comme le montrent les graphiques ci-après, si le premier déficit bilatéral de la France concerne effectivement la Chine, nos autres grands déficits résultent de nos échanges avec certains de nos voisins (Allemagne, Belgique et Italie) et avec les États-Unis. En raisonnant par zone géographique, le constat est identique : nous sommes en déficit avec l’Asie (du fait de la Chine), certes, mais aussi avec l’Europe et l’Amérique du Nord ; en revanche, nous sommes en excédent avec l’Amérique du Sud, l’ASEAN, l’Afrique, le Proche-et-Moyen-Orient…
Excédents et déficits par zone géographique et par pays
(en milliards d’euros)
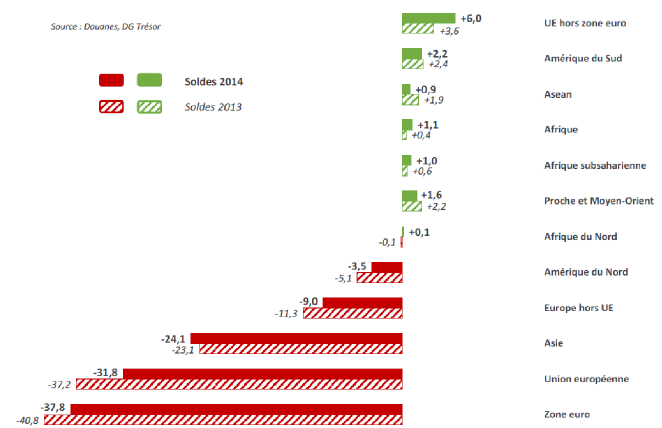
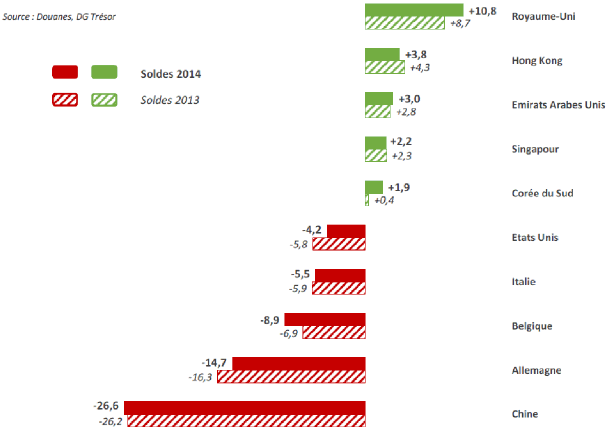
Source : gouvernement (« Résultats 2014 du commerce extérieur »).
L’année 2015 en cours et l’année 2016 devraient voir se poursuive le mouvement de mise en ordre de notre appareil de soutien à l’internationalisation des entreprises qui a été engagé depuis 2012.
Le lancement le 23 mars dernier du « comité stratégique de l’export », destiné à favoriser la concertation entre tous les acteurs, publics et privés, en charge de l’internationalisation des entreprises, est à cet égard significatif. Plusieurs des interlocuteurs de votre rapporteure ont salué cette initiative.
La nouvelle agence Business France, issue de la fusion d’Ubifrance et de l’Agence française pour les investissements internationaux (AFII), a été créée juridiquement (4) au 1er janvier 2015 et est désormais opérationnelle.
Son conseil d’administration est composé de 22 membres représentant l’État, le Parlement, les régions, les organisations professionnelles et réseaux consulaires, les entreprises étrangères en France, les conseillers du commerce extérieur de la France, enfin les personnels de l’agence. Il a été mis en place au printemps et s’est réuni pour la première fois le 7 juillet dernier.
La tutelle de l’agence est partagée entre les ministres chargés de l’économie, des affaires étrangères et de l’aménagement du territoire. Deux commissaires du gouvernement siègent à son conseil d’administration, issus respectivement de la direction générale du Trésor et de la direction des entreprises et de l’économie internationale (du ministère des affaires étrangères et du développement international). Cette co-tutelle exprime une forme d’équilibre trouvé entre les administrations de « Bercy » et du « Quai d’Orsay ».
À l’étranger, l’intégration de Business France dans la « diplomatie économique », pilotée par nos ambassadeurs, sera clairement assurée, conformément au décret n° 2014-1571 du 22 décembre 2014 : les ambassadeurs sont consultés sur les affectations des responsables des bureaux de l’agence et contribuent à leur notation (en adressant à la direction centrale de l’agence une « appréciation générale » sur leur directeur Business France).
Comme les autres opérateurs de l’État, Business France a dû formaliser ses engagements dans le cadre d’un contrat d’objectifs et de performance (COP).
Le premier COP de la nouvelle agence, qui revêt évidemment une importance particulière, a été signé cet automne. Il couvre la période 2015-2017 et lui assigne quatre objectifs :
– le développement international des entreprises – en particulier les ETI et PME – implantées en France et de leurs exportations ;
– la gestion, la promotion et le développement du volontariat international en entreprise (VIE) ;
– le développement des projets d’investissement étranger en France ;
– la promotion de l’image de la France et de ses territoires à l’international. L’agence doit notamment promouvoir une identité visuelle unique « France ».
Des indicateurs d’activité et de résultats sont associés à ces objectifs : nombre de PME et ETI bénéficiant de prestations d’accompagnement, mais aussi d’un suivi personnalisé, nombre de courants d’affaires générés… Un objectif de « simplifier la lisibilité de la chaîne de l’export au bénéfice des PME et ETI » est également posé.
L’objectif central de l’accompagnement des PME et ETI de croissance dans la durée est conservé, tout en maintenant un volume d’activité d’export pour tous à un niveau élevé (9 400 entreprises servies en moyenne par an sur trois ans).
À cet égard, il faut relever le bon déroulement de l’opération d’accompagnement dans la durée de 1 000 entreprises lancée avec Bpifrance. Fin 2014, 712 entreprises (pour un objectif de 600) avaient adhéré au dispositif d’accompagnement personnalisé à l’international et 391 démarré leur plan d’action. Fin août 2015, on en était à 957 entreprises engagées et 593 ayant lancé leur plan d’action. L’objectif de toucher 1 000 entreprises d’ici 2015 sera donc atteint. 39 chargés d’affaires issus de Business France sont déployés dans les services de la BPI en région et il est question de porter ce chiffre à 50.
S’agissant des VIE, il s’agit d’atteindre d’ici 2017 un effectif de 10 000 (avec un plancher à 9 600), le COP rappelant toutefois que cette ambition est conditionnée « au maintien, et, le cas échéant, à l’obtention d’un cadre juridique, fiscal et social compatible avec le statut du VIE ». Le document dispose en conséquence que « les services de l’État sont particulièrement mobilisés » pour obtenir ce cadre.
En matières d’investissements étrangers, il est prévu un suivi particulier, donc une priorité, pour les projets des types les plus porteurs : centres de recherche, quartiers généraux, centres logistiques, unités de production, investissements « greenfield » (création d’activités nouvelles). Le nombre annuel de projets suivis par l’agence et aboutis devrait passer de 400 actuellement à 500 d’ici 2017, générant ou maintenant annuellement au moins 15 500 emplois.
La synergie entre les activités « export » et « investissement » de la nouvelle agence est aussi un objectif, qui sera suivi à travers un indicateur sur la part des entreprises étrangères implantées en France avec le concours de l’agence ayant ensuite recours à ses services export. En effet, les filiales d’entreprises étrangères implantées en France sont très actives dans la commerce extérieur : elles assurent plus de 40 % des exportations françaises.
Business France est, dans la continuité d’Ubifrance, financé essentiellement par deux types de ressources : des subventions budgétaires ; des ressources propres commerciales provenant de la vente de ses prestations.
Les ressources budgétaires sont en diminution depuis plusieurs années : les subventions effectives (après régulation) à Ubifrance ont ainsi atteint 102,2 millions d’euros en 2011 ; 100,4 millions en 2012 ; 97,9 millions en 2013 ; 91,5 millions en 2014…
Sur les dernières années, le suivi des crédits est rendu plus compliqué par la fusion d’Ubifrance avec l’AFII, d’autant que cette dernière, traditionnellement, bénéficiait de deux sources de financement budgétaire : le ministère de l’économie, mais aussi celui en charge de l’aménagement du territoire (missions « Économie » et « Politique des territoires ») ; avec la création de Business France, la subvention « Politique des territoires » de l’AFII a été transférée à la nouvelle entité.
Lorsque l’on additionne ces différents financements, en comparaison entre lois de finances initiales et projet de loi de finances initiale – il n’est pas justifié de comparer un projet de loi de finances initiale à une exécution budgétaire, car l’on sait que le « gel » partiel de crédits qui a caractérisé cette exécution a toutes les chances de s’appliquer encore à l’avenir –, on constate que la diminution tendancielle des moyens budgétaires se poursuit : ceux affectés à l’ensemble Ubifrance-AFII devenu Business France devraient passer de 117 millions d’euros en loi de finances initiale pour 2014 à 115 millions en 2015 et 110 millions en 2016.
Évolution des crédits budgétaires affectés à Ubifrance-AFII-Business France
(en millions d’euros)
LFI 2014 |
LFI 2015 |
PLF 2016 | |
Subvention à Ubifrance |
97,11 |
||
Subvention « Économie » à l’AFII |
13,49 |
||
Subvention « Économie » à Business France |
108,77 |
103,85 | |
Subv. « Politique des territoires » à l’AFII, puis Business France |
6,6 |
6,47 |
6,33 |
Total |
117,19 |
115,24 |
110,18 |
En gestion 2015 toutefois, un report de 5 millions d’euros a pu être effectué pour financer les surcoûts liés à la fusion, ce qui avait été demandé lors du débat budgétaire d’octobre 2014. Il faut donc s’en féliciter, mais en étant conscient que cela accroît le ressaut budgétaire négatif que subira la nouvelle agence en 2016. Toutes choses égales par ailleurs, la diminution des financements publics pourrait être proche d’une dizaine de millions d’euros.
Jusqu’à présent, la réduction des ressources de subventions de ce qui était Ubifrance a été compensée par un accroissement des recettes commerciales. Ces recettes se sont élevées, en 2013, à 67,3 millions d’euros, en progression de 5 % par rapport aux résultats 2012. En 2014, elles ont atteint 73,9 millions d’euros, soit presque 10 % de progression.
L’effort de rigueur budgétaire demandé se traduira aussi l’an prochain par une réduction de 9 emplois temps plein (ETP) du plafond d’emplois applicable à Business France, qui passera de 1 524 ETP en 2015 à 1 515 ETP en 2016. Il faut être conscient que ce plafond s’applique à l’ensemble des emplois de l’établissement, alors même qu’il dispose d’une large fraction de ressources commerciales : le développement de celles-ci ne peut pas servir à des recrutements surnuméraires, ce qui est très contraignant dans une activité qui repose totalement sur les moyens humains.
Dans ce contexte budgétaire difficile, la gouvernance de Business France suscite aujourd’hui des critiques. Il est vrai que tout processus de fusion est difficile. Il est vrai également que la fusion en un seul poste des fonctions de directrice générale et d’ambassadrice aux investissements internationaux représente une lourde tâche, qui devrait peut-être pouvoir être partagée.
La direction de l’agence fait valoir qu’après la fusion juridique d’Ubifrance et de l’AFII, le processus d’intégration (des statuts sociaux, des systèmes d’information, des équipes…) est nécessairement long. C’est au bout de dix-huit mois, donc à l’été 2016, qu’il conviendra de juger de sa réussite.
Il appartient maintenant à la direction de mobiliser l’ensemble des équipes autour d’un projet d’entreprise construit avec tous et de parachever ainsi la fusion tout en faisant vivre le dialogue social.
Il faut enfin évoquer, s’agissant de Business France, la perspective de la poursuite du rapprochement des opérateurs avec l’absorption programmée des activités de service public de la Sopexa.
La Sopexa s’était en effet vue confier par le ministère de l’agriculture une délégation de service public (DSP) pour la promotion des produits alimentaires français dans le monde (accompagnement des entreprises du secteur et plus généralement valorisation de la culture alimentaire française). Le contrat actuel couvre la période 2013-2017 pour un budget annuel de 9 millions d’euros. Les activités sous DSP représentent 17 ETP.
Un rapprochement avec le pôle Agrotech de Business France a été décidé, les métiers étant similaires. Il prendra la forme d’un transfert à Business France des activités de la délégation du service public en deux temps :
– le transfert de l’activité de mise en contact d’entreprise à entreprise (B to B), des pavillons France et des mini-expos sera effectif au 1er janvier 2016 ;
– le transfert de l’activité « salons » sera quant à lui finalisé au 1er janvier 2017.
Une question reste ouverte, celle de la part financière du contrat de DSP avec le ministère de l’agriculture que récupérera Business France.
Plusieurs réseaux de soutien à l’internationalisation de nos entreprises sont déployés dans le monde :
– l’opérateur Business France emploie, on l’a dit, quelques 1 500 agents, dont environ 900 à l’étranger, répartis dans 85 implantations et 70 pays (en 2016). Il s’appuie sur un budget global de 191 millions d’euros (budget initial 2015) ;
– le réseau international de la direction générale du Trésor, constitué des services économiques de nos ambassades, représentait 726 emplois temps plein au 1er juillet 2015, avec 129 implantations dans 110 pays ;
– plus généralement, nos entreprises peuvent solliciter, dans le cadre de la diplomatie économique, les 163 ambassades françaises du monde ;
– le réseau des chambres françaises de commerce et d’industrie à l’international (CCI-FI) comprend 112 chambres réparties entre 82 pays. Elles regroupent plus de 32 000 entreprises adhérentes, emploient 971 collaborateurs à l’étranger et gèrent un budget d’un peu plus de 62 millions d’euros. En France, les CCI territoriales emploient 400 conseillers en développement international ;
– les 3 500 conseillers du commerce extérieur de la France (CCEF) actifs, qui prêtent bénévolement leur concours aux entreprises, résident à 73 % à l’étranger ;
– dans nos entreprises, parmi de nombreux autres expatriés, le soutien de la puissance publique permet la présence de près de 8 700 volontaires internationaux en entreprise (VIE) ;
– hors du champ public, nos exportateurs peuvent recourir aux services des opérateurs spécialisés du commerce extérieur : sociétés d’accompagnement à l’international, sociétés de gestion export et sociétés de commerce international. La fédération OSCI et la Confédération française du commerce de gros et international (CGI) représentent 150 entreprises d’accompagnement à l’export et plus de 2 000 sociétés de négoce.
Au-delà de la mise en place de quelques instruments institutionnels tels que les plans d’action ou les conseils économiques dans les ambassades, la démarche de promotion de la « diplomatie économique » a surtout deux intérêts :
– avec la diffusion d’un concept facile à comprendre, mieux sensibiliser les entreprises, en particulier les PME, à ce que peuvent leur apporter les services de l’État et de ses opérateurs à l’étranger ;
– mieux mobiliser l’ensemble de nos diplomates, tout particulièrement les ambassadeurs eux-mêmes, pour la promotion de nos intérêts économiques.
Cette démarche fonctionne. Lors des déplacements de votre rapporteure à l’étranger, les représentants d’entreprises françaises qu’elle rencontre mettent généralement l’accent sur la disponibilité accrue des ambassadeurs pour traiter des questions économiques et en particulier aider ces entreprises dans leurs démarches.
À l’occasion du premier Forum des PME à l’international, organisé le 11 mars 2015, des rencontres-minutes ont été proposé entre les ambassadeurs de France présents et les entreprises qui le souhaitaient. L’opération a rencontré un grand succès : il y a eu finalement 1 500 rendez-vous organisés, pour 5 000 demandes. On peut toutefois s’interroger sur les conditions de son suivi : dans les pays couverts par des bureaux de Business France, il leur a été confié, mais ailleurs, surtout dans les postes dépourvus d’un service économique, ce suivi ne peut reposer que sur les ambassadeurs eux-mêmes, qui ne sont pas nécessairement « armés » pour le faire (pour autant qu’ils en aient le temps).
Outre les ambassadeurs, les 13 représentants spéciaux qui ont été successivement nommés depuis trois ans couvrent désormais un large champ géographique, et notamment la majorité des pays émergents et de nos grands partenaires du Sud : Algérie, Afrique du Sud, Chine, ASEAN, Inde, Émirats-Arabes-Unis, Brésil, Mexique… L’Australie, le Canada, le Japon, la Russie et les Balkans sont également dotés d’un représentant spécial. Cependant, il n’y a pas de représentant spécial en Afrique subsaharienne en dehors de l’Afrique du Sud, malgré l’ampleur des liens économiques de la France avec cette région et son potentiel de croissance.
En revanche, l’offre faite aux conseils régionaux de leur mettre à disposition des « ambassadeurs » économiques en région n’a pas eu beaucoup de succès. Ces ambassadeurs en région ont été au maximum au nombre de sept et seuls trois sont encore en poste.
Ce dispositif devrait donc être remplacé par un autre, ayant une vocation plus large (pas seulement économique) et placé auprès des préfets de région et non des présidents, ce qui garantira son déploiement (à la différence des présidents de région, les préfets sont soumis à l’autorité hiérarchique et feront ce que demande l’administration centrale) : une convention entre les ministères des affaires étrangères et de l’intérieur signée le 25 août 2015 prévoit la nomination de « conseillers diplomatiques » auprès des préfets de région à partir de 2016. Cette institution pourrait notamment être très utile pour l’accueil des projets d’investissements étrangers, lequel comporte une part importante de problèmes administratifs (obtention de permis de construire, d’autorisations diverses…) et implique plus généralement de traiter en même temps un grand nombre de questions.
b. La volonté réitérée de clarifier les missions respectives de Business France et du réseau consulaire
Afin de clarifier le parcours d’accompagnement à l’export proposé aux entreprises, une convention stratégique entre Business France, CCI International et CCI France international, signée le 11 mars 2015, définit les rôles de chaque organisme dans ce parcours :
– en France, CCI International et Business France s’engagent à un programme d’accompagnement commun simplifié, en lien avec les régions, dans les premières phases du parcours à l’export des entreprises. L’objectif est que 3 000 entreprises en bénéficient. Les chambres de commerce et d’industrie (CCI) en France feront le diagnostic export et proposeront le plan d’action de l’entreprise ; Business France prendra en charge la prospection des marchés ciblés en vue de développer au moins 1 000 courants d’affaires ; les chambres de commerce et d’industrie françaises à l’international (CCI-FI), installées dans les pays visés, fourniront éventuellement des prestations plus en aval (intégration dans les communautés d’affaires, lobbying, implantation, développement commercial…).
– dans les régions et à l’étranger, le partenariat sera décliné au travers de conventions locales.
Il reste à appliquer ce nouveau dispositif, en gardant à l’esprit que la meilleure articulation des missions des réseaux consulaires, d’une part en France, d’autre part à l’étranger (chambre de commerce et d’industrie françaises à l’international), et de l’opérateur public – Ubifrance, puis maintenant Business France – n’est pas une idée neuve… Plusieurs tentatives de l’établir ont donné des résultats inégaux et le sujet reste délicat. Il faut donc espérer que la convention du 11 mars permettra de réels progrès.
Les déclinaisons locales de la convention nationale ont déjà été signées dans deux régions (Midi-Pyrénées et Pays-de-la-Loire) et dans une quinzaine de pays (qui représentent ensemble près de 30 % des exportations françaises). Les chambres de commerce françaises à l’étranger ont un statut de droit local, généralement associatif, et ne reçoivent pas de financements publics français (sauf dans le cas particulier des pays où elles bénéficient d’une délégation de service public) ; elles sont donc totalement libres d’entrer ou non dans le dispositif. L’administration centrale espère une signature prochaine dans une trentaine d’autre pays (ce qui porterait à près de 70 % la part de nos exportations en direction de pays « conventionnés »).
Enfin, dans une douzaine de pays, pour des raisons diverses (ancienneté et puissance des chambres de commerce françaises locales, enjeux pour leur chiffre d’affaires, voire leur survie, rivalités de personnes, etc.), les choses seront manifestement beaucoup plus difficiles. C’est le cas en Turquie, où votre rapporteure s’est rendue (voir infra), mais aussi dans un certain nombre de marchés majeurs (Espagne, États-Unis, Canada, Japon, Corée du Sud…). Votre rapporteure plaide donc pour une application souple du nouveau dispositif.
Une convention signée, également le 11 mars, entre le Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France (CNCCEF), Business France et l’État vise à renforcer le rôle des conseillers du commerce extérieur et leur articulation avec Business France, avec notamment la désignation parmi eux de 150 « référents PME » en France et à l’étranger. La liste de ceux-ci a affectivement été dévoilée lors de l’Assemblée générale du CNCCEF le 3 juillet 2015.
Auparavant, en janvier 2015, le secrétaire d’État chargé du commerce extérieur avait installé un groupe de travail conjoint direction générale du Trésor/CNCCEF pour réfléchir au recrutement, aux missions, aux méthodes de travail et à la déontologie des CCEF. Ce groupe de travail a remis ses propositions en juin 2015.
La volonté de rajeunissement et de féminisation du corps des CCEF se traduit dans les chiffres depuis quelques années : leur âge moyen est passé de 60 ans en 2004 à 52 ans en 2015 ; un peu plus de 20 % d’entre eux sont des femmes en 2015, contre 10 % en 2010.
Les « Maisons de l’international » ont été lancées par le Président de la République en avril 2013.
Elles visent à rapprocher dans un lieu unique les acteurs en charge de la promotion des intérêts économiques de la France à l’étranger.
Un premier prototype a été inauguré aux États-Unis en février 2014 sous un format très particulier : l’US-French Tech Hub, implanté à San Francisco et Boston, construit à partir de l’incubateur de la Région Île-de-France et bénéficiant d’un appui financier du Programme des investissements d’avenir. Son modèle économique reste cependant très centré sur l’écosystème numérique et l’enjeu pour lui est maintenant de fédérer un plus grand nombre de partenaires.
Un appel à manifestation d'intérêt a été lancé le 29 janvier 2015 pour la constitution d’un réseau mondial de French Tech Hubs qui seraient portés par des entreprises. Les French Tech Hubs de Tokyo et de Tel Aviv viennent d’être créés.
Par ailleurs, une Maison de l’international est en train de voir le jour en Chine. Ce projet vise quant à lui à réunir physiquement à Pékin certains opérateurs et à mettre en commun des outils de travail, sous un angle multisectoriel. Le projet est porté par la Chambre de commerce et d’industrie française en Chine et associe la Chambre de commerce et d’industrie de Paris-Île-de-France, des organisations professionnelles et des entreprises, ainsi que l’école HEC. Les conseillers du commerce extérieur français en Chine sont également impliqués.
L’association Entreprise Rhône-Alpes international (ERAI) avait été créée en 1987 sous l’égide de la région pour soutenir l’internationalisation de ses entreprises.
Au fil des années, ERAI était devenue une grosse structure, avec un budget de plus de 10 millions d’euros et 223 salariés à Lyon et à l’étranger. En effet, pas moins de 27 implantations avaient été effectuées à l’étranger.
Ce développement tous azimuts a été critiqué car il apparaissait hors de proportions avec la demande d’accompagnement international des entreprises rhônalpines, de sorte que, pour assurer son équilibre, ERAI prospectait la clientèle d’autres entreprises. Cette évolution posait un réel problème quant à l’utilisation des fonds publics et à la concurrence avec les autres opérateurs d’accompagnement, car de fait l’argent public de la région Rhône-Alpes, qui constituait toujours plus de la moitié des ressources d’ERAI, était utilisé en partie pour des fins étrangères aux intérêts économiques de la région…
Dans un contexte de conflits de gouvernance et de déficits chroniques, le conseil régional a finalement mis fin à l’octroi de subventions à ERAI le 6 mars 2015, entraînant en juin la liquidation de la structure.
La majorité des filiales à l’étranger ont pu être reprises, avec maintien de tout ou partie des emplois : il en est ainsi de celles en Turquie, au Vietnam, en Russie, en Allemagne, à Dubaï, en Chine et au Maroc, où plus d’une centaine d’emplois ont été conservés. Cependant, la cinquantaine de salariés du siège ont été licenciés.
Business France a identifié des solutions pour permettre l’hébergement des VIE qui étaient en poste dans les bureaux d’ERAI à l’étranger. Dans les pays où les bureaux d’ERAI n’ont pas été repris (Brésil, Canada, États-Unis par exemple), les VIE ont été transférés dans d’autres structures. Par ailleurs, Business France et les chambre de commerce françaises à l’international sont mobilisés pour offrir une continuité de service pour les PME qui étaient accompagnées par ERAI.
S’il faut regretter le coût social de la fin d’ERAI, on peut aussi considérer que cet événement s’inscrit, à sa manière, dans le processus de rationalisation du dispositif français d’accompagnement à l’international.
Le programme de volontariat international en entreprise (VIE) permet aux entreprises de bénéficier à l’étranger de l’appui de jeunes diplômés pour un coût réduit. À ces jeunes, il offre une première expérience internationale, suivie dans la très grande majorité des cas d’une embauche.
Plus de 5 600 volontaires internationaux en entreprise (VIE) ont été recrutés en 2014 et près de 8 700 étaient en poste mi-2015, pour une mission d’une durée moyenne de 18 mois.
Ils étaient au service de plus de 1 800 entreprises, dont deux tiers de PME. Ils restent cependant assez concentrés dans quelques pays : 48 % d’entre eux exercent dans cinq pays, dans l’ordre États-Unis, Belgique, Allemagne, Royaume-Uni et Chine.
La progression a été régulière – les VIE n’étaient que 6 300 en 2009 – et, ainsi qu’on l’a dit, l’objectif assigné à Business France est d’atteindre un effectif de 10 000 d’ici 2017.
Cet objectif ambitieux implique que soient réglés les problèmes de reconnaissance du statut de VIE qui existent dans de nombreux pays, ce qui entraîne des risques et des surcoûts fiscaux et sociaux. Il faut pour cela que nos ambassades en fassent une priorité, comme le contrat d’objectifs et de performance de Business France les y invite. Au niveau national, des consignes ont été données pour intégrer une « clause VIE » dans toutes les nouvelles conventions fiscales (ou révisions de conventions existantes). Des accords intéressants viennent d’être signés avec l’Inde et l’Algérie. Pour le reste, des arrangements locaux plus ou moins satisfaisants doivent être recherchés (interventions pour éviter des contrôles fiscaux ou sociaux, négociation de quotas de VIE…).
Par ailleurs, la question de la diversification des profils des jeunes qui partent en VIE reste ouverte.
Le programme « VIE pro », lancé officiellement en novembre 2013, a justement pour objectif d’élargir l’accès au VIE. Mais son expérimentation a donné des résultats limités : une cinquantaine de VIE pro sont partis en mission. Il est probable que les entreprises ont leur part de responsabilité dans ce résultat médiocre, vu la tendance des employeurs à préférer des profils « surqualifiés » pour leurs recrutements (le choix d’un VIE s’inscrivant généralement dans une logique de pré-recrutement d’un futur collaborateur). Il n’en est pas moins vrai que le programme « VIE pro » doit manifestement être réorienté pour être généralisé. Dans une réponse faite au questionnaire écrit de votre rapporteure, l’administration évoque les pistes suivantes :
– un ciblage de nouvelles filières universitaires mieux adaptées au besoin des entreprises, certaines « Licences pro » étant bien reconnues sur le marché du travail (secteur aéronautique, informatique…) ;
– la levée de l’ambiguïté de la dénomination « VIE pro », qui ferait plutôt chez les recruteurs référence aux filières professionnalisantes et non au cursus des licences professionnelles qui était la cible. Le VIE pro pourrait évoluer vers un concept plus global visant à promouvoir les filières technologiques ou techniques (bac + 2 à bac + 3) ;
– la possibilité d’étendre l’accès au dispositif à certains CAP et bacs pro.
Depuis 2010, Ubifrance, devenu Business France, a ouvert des bureaux ou des antennes dans une bonne vingtaine de nouveaux pays, particulièrement en Afrique subsaharienne (Angola, Cameroun, Côte d’Ivoire, Kenya, Nigeria, Sénégal et bientôt Éthiopie) et en Amérique latine (Argentine, Chili, Colombie et Cuba), mais aussi en Europe centrale et orientale (Bulgarie, pays Baltes et Slovénie), en Asie (Kazakhstan et Philippines) et au Proche-et-Moyen-Orient (Liban, Qatar, Koweït et Iran).
En 2016, Business France devrait en conséquence être présent directement dans 70 pays. De plus, certains de ses bureaux ont une compétence régionale, ce qui permet à l’agence de déployer en principe son activité sur 105 pays.
Cependant, dans le contexte présent de maîtrise budgétaire et de plafonnement des emplois, les créations de nouvelles implantations n’ont pas pu mobiliser de gros effectifs. Aujourd’hui, la présence de l’agence dans 7 de ses antennes est assurée par un seul agent. Votre rapporteure est parfois perplexe face à ce genre de situations : est-ce suffisant pour assurer un service satisfaisant aux entreprises ? Ne risque-t-on pas de décevoir les attentes créées par l’ouverture de ces antennes ? Ce a fortiori quand les personnels isolés qui sont envoyés sont de jeunes VIA (volontaires internationaux en administration) ?
Les redéploiements de moyens humains ont en fait été relativement limités ces dernières années et le réseau de Business France reste relativement « euro-centré », ce qui correspond certes à la réalité présente de nos flux commerciaux, mais pas aux perspectives de croissance : sur les 817 agents d’Ubifrance en poste à l’étranger en 2014, près de 34 % se trouvaient en Europe (hors ex-URSS), soit un peu plus qu’en Asie-Océanie (32 %). L’Amérique latine représentait moins de 7 % des effectifs à l’étranger de l’agence et l’Afrique subsaharienne moins de 4 %.
La réflexion sur la cartographie du réseau doit être une priorité pour 2016. Dans la situation présente de plafonnement des emplois publics, elle doit prendre en compte tous les réseaux – services économiques, Business France, mais aussi chambres de commerce et d’industrie françaises à l’international.
La direction de l’agence a indiqué à votre rapporteure qu’un exercice de détermination de la cartographie à cibler avait été effectué. Il devrait progressivement conduire à des redéploiements vers l’Afrique, l’Asie du sud-est, le Proche-et-Moyen-Orient.
Dans les territoires, l’action pour l’internationalisation repose sur plusieurs acteurs :
– le réseau développé par la Banque publique d’investissement (BPI) ;
– le réseau consulaire, qui met à disposition des entreprises environ 400 conseillers en développement international ;
– les conseils régionaux, auxquels a été confiée une mission de coordination, dans le cadre de la déclaration commune État-régions pour la croissance et l’emploi du 12 septembre 2012, dite « déclaration de l’Élysée ». Les régions ont à ce titre élaboré des plans régionaux pour l’internationalisation des entreprises (PRIE).
Cependant, la réforme régionale menée depuis a tout à la fois changé le périmètre des régions et leurs compétences.
La loi « NOTRE » (loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République) a renforcé les compétences des régions pour le développement économique en supprimant la clause de compétence générale pour les départements. Les régions seront responsables de la politique de soutien aux PME et ETI. L’instrument de leur pilotage sera le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII), qui fixera les orientations régionales pour une durée de cinq ans.
Ce SRDEII devra être mis en cohérence avec les schémas de développement des réseaux consulaires (chambres de commerce et d’industrie et chambres de métiers et de l’artisanat).
Par ailleurs, sur le territoire des métropoles, les orientations du SRDEII devront être adoptées conjointement par le conseil de la métropole concernée et le conseil régional. Les opérateurs tels que Business France devront donc trouver avec les deux niveaux de collectivité un modus vivendi sans que cela ne multiplie les conflits.
Les conséquences de ces réformes très importantes sur le soutien à l’internationalisation des entreprises n’ont sans doute pas assez été anticipées (hormis par l’institution des « conseillers diplomatiques » des préfets de région évoqués supra), ce qui aurait été – il est vrai – un exercice difficile.
L’année 2016 sera donc déterminante pour l’évolution de la dimension territoriale de cette politique. Ce à quoi il faudra surtout veiller, c’est à éviter des répétitions de la malheureuse expérience d’ERAI : les nouvelles régions pourraient être tentées, du fait de leur taille accrue et de leurs compétences élargies, de développer des agences régionales de l’export ayant des implantations à l’étranger ; il est important que les opérateurs existants, à commencer par Business France, se mobilisent pour établir avec elles des relations partenariales et éviter la constitution de nouveaux « doublons ».
L’année 2016 devrait voir la continuation du mouvement très important de réforme du système de financement public à l’export qui a été lancé en 2012.
Une première série de réformes, inscrites dans la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012, a visé à élargir les sources de financement des exportations françaises à travers trois mesures concernant le régime des garanties publiques gérées par la Coface pour le compte de l’État :
– la création d’une garantie de refinancement offrant un nouvel accès à la liquidité aux banques qui accordent des crédits-export ;
– la création d’une garantie du risque de change sur la valeur résiduelle des aéronefs, destinée à faciliter le financement en euros de ce type d’actifs ;
– l’extension du bénéfice de la garantie dite « pure et inconditionnelle » à 100 %, auparavant réservée aux seuls avions gros porteurs, à la plupart des avions et hélicoptères civils.
La loi de finances rectificative du 29 décembre 2013 a complété ces mesures en prévoyant :
– l’élargissement du champ des bénéficiaires de la garantie de refinancement, rendu nécessaire par le fait que certains refinanceurs potentiels importants n’étaient pas éligibles au mécanisme mis en place fin 2012. Les principales institutions auxquelles ce dispositif a été étendu sont la Caisse des dépôts et consignations et ses filiales, les banques centrales nationales et la Banque centrale européenne, les fonds souverains, enfin les organismes de retraite et fonds de pension français ou étrangers ;
– le relèvement de 900 millions d’euros à 2 milliards du plafond des garanties octroyées dans le cadre de la construction de navires de croisière, afin d’accompagner l’accroissement de la taille et donc du prix de ce type de navires ;
– la création d’un mécanisme d’intervention rapide de l’État sur le marché de l’assurance-crédit de court terme (durée de crédit inférieure à deux ans), destiné à être utilisé sur des zones géographiques délaissées par le marché privé.
Un tel dispositif, permettant de couvrir à 80 % les créances commerciales, a notamment été mis en place en direction de la Grèce fin 2012, puis assoupli en 2015, afin de permettre le maintien des flux commerciaux avec ce pays malgré les risques financiers croissants qu’il présentait.
Par ailleurs, un plan d’action a été présenté en mai 2013 pour développer l’accès des PME et des ETI aux soutiens financiers à l’export. Ce plan était articulé autour de trois axes :
– la simplification de l’offre de soutiens publics, via notamment la suppression des doublons existants entre les produits proposés par les différents opérateurs publics de soutien à l’exportation ;
– l’amélioration des produits existants, afin de couvrir l’intégralité des besoins des PME et des ETI (élargissement de l’accès à la garantie à 100 % de l’escompte des crédits fournisseurs, création d’enveloppes globales de garanties de préfinancement export, lancement du prêt « développement export » de Bpifrance, avec une enveloppe annuelle d’engagements de 500 millions d’euros) ;
– le renforcement de la distribution des dispositifs de soutien public à l’export, dans une logique de « guichet unique », via la création d’un label de commercialisation de l’ensemble des dispositifs publics existants (« bpifrance export ») et l’implantation de chargés d’affaires internationaux d’Ubifance et de développeurs de la Coface au sein des directions régionales de Bpifrance.
b. 2015 : un accent mis sur le développement du crédit-export et le transfert de la gestion des garanties publiques
Les réformes se sont poursuivies en 2015. Les principales mesures mises en place depuis le début de l’année sont :
– la création d’un dispositif de refinancement de crédits-exports porté par la SFIL. Annoncé par le Président de la République en février 2015, ce mécanisme a été autorisé par la Commission européenne le 5 mai dernier pour une durée de cinq ans. Il est ciblé sur les grands contrats d’exportation (d’un montant supérieur à 70 millions d’euros) et est destiné à pallier les difficultés rencontrées par les banques commerciales pour porter des engagements de long terme à leur bilan. En pratique, la SFIL reprendra le crédit-export à son bilan à hauteur de la portion assurée par la Coface, les banques conservant la responsabilité de l’apport en liquidité et une exposition à hauteur de la fraction non assurée du crédit-export ;
– la création par Bpifrance d’une offre de crédits-export de petits montants (pour financer les acheteurs à l’étranger) et de rachat de crédits fournisseur, afin de pallier la défaillance de marché observée sur ce type de produits. Bpifrance propose depuis le début de l’année aux entreprises exportatrices des financements export jusqu’à 25 millions d’euros ainsi que, en cofinancement avec des banques commerciales, des crédits pouvant atteindre 75 millions d’euros. Les premières opérations ont été lancées ;
– la création d’un dispositif de prêt souverain non-concessionnel, baptisé « prêt du Trésor », pour élargir le dispositif de prêt du Trésor concessionnel (anciennement « Réserve Pays Émergents »). Une centaine de pays sont éligibles à ce nouveau dispositif et l’exigence de non-rentabilité disparaît, permettant ainsi le financement d’un périmètre plus large de projets d’exportation.
Par ailleurs, l’année 2015 sera celle du lancement du transfert à Bpifrance de la gestion des garanties publiques à l’exportation, jusque-là assurée par la Coface pour le compte de l’État. Le principe de ce transfert a été officialisé le 29 juillet 2015 et il sera effectif en 2016. L’objectif est de créer un « guichet unique » du financement public de l’export, plus simple pour les entreprises et appuyé sur le maillage du réseau régional de la BPI. Il est prévu le versement à la Coface d’un montant de 77,2 millions d’euros correspondant à la compensation des coûts exceptionnels non récurrents et des pertes de synergies entraînés par ce transfert.
Votre rapporteure considère que cette opération doit aussi être l’occasion de s’interroger sur l’économie générale des garanties publiques. En effet, même si l’une d’entre elles, l’assurance-prospection destinée aux PME, est structurellement déficitaire, l’ensemble du dispositif dégage depuis deux décennies des résultats très excédentaires qui alimentent le budget de l’État. Certes, ces bénéfices compensent les pertes qui avaient marqué des périodes plus anciennes. Mais on est en droit de poser la question : le but d’un régime public de cette nature est-il d’être bénéficiaire (et/ou d’avoir une certitude d’équilibre sur le très long terme, à trente ans ou plus) ? Un dispositif public n’est justifié que s’il agit différemment de ce que ferait un assureur privé, que s’il fait ce que cet assureur privé ne ferait pas. Il ne peut pas être géré de la même manière. Peut-être la prise de risques et la réactivité de notre régime de garanties publiques devraient-elles être accrues.
De nouvelles initiatives destinées à poursuivre l’amélioration du dispositif public de soutien financier à l’exportation sont en préparation. Ces initiatives concernent notamment :
– la révision des modalités d’évaluation de la « part française » dans les contrats d’exportation bénéficiant d’un soutien public ;
– la rénovation de l’assurance publique des investissements français à l’étranger. Ce processus est en voie d’achèvement et doit aboutir d’ici fin 2015. Le recours à cette garantie publique a beaucoup diminué depuis plusieurs années, du fait de la capacité du marché privé à répondre aux demandes des investisseurs français, mais également à cause de la complexité du dispositif public.
Lancée en décembre 2012, la politique des « familles » prioritaires de l’export vise à mieux fédérer et rendre plus visible, à l’international, l’offre française dans des secteurs d’excellence. Des « fédérateurs » ont été désignés pour chaque famille et s’efforcent de mobiliser les entreprises et organisations de leur secteur pour monter des opérations communes, voire chercher à monter des réponses communes à des appels d’offre internationaux. Il s’agit donc non seulement de valoriser des points forts de la France, mais aussi de dépasser le reproche traditionnellement fait aux entreprises françaises de ne pas assez « chasser en meute ».
Quatre familles ont d’abord été constituées et ont donné, depuis lors, des résultats variables, l’engagement des « fédérateurs » étant inégal :
– « Mieux vivre en ville », pour promouvoir la « ville durable » à la française ;
– « Mieux se soigner » dans le domaine médical, qui ne couvre pas que la pharmacie et les équipements médicaux, mais également l’offre, par exemple, de solutions intégrées pour la mise en place et la gestion de centres hospitaliers, domaine où la France, malgré l’excellente réputation de son système de santé, a du mal à s’exporter ;
– « Mieux communiquer » dans les domaines des télécommunications, logiciels, objets connectés, équipements électroniques, etc. ;
– « Mieux se nourrir » pour valoriser un domaine incontestable d’excellence française où, pourtant, le manque d’organisation de certaines filières nuit gravement à nos performances à l’export.
S’agissant en effet des produits agricoles et agro-alimentaires, il y a un réel décalage entre la qualité et la reconnaissance internationale de l’offre française, d’une part, et les résultats à l’export, d’autre part. Les succès obtenus dans quelques sous-secteurs, comme les boissons, ne doivent pas occulter les déficits dans d’autres sous-secteurs et le recul des positions françaises.
Par ailleurs, la crise vécue par plusieurs filières de notre agriculture appelle des réponses qui sont aussi à l’international.
Face à cet état de fait, le ministre de l’agriculture Stéphane Le Foll et le secrétaire d’État au commerce extérieur Matthias Fekl ont décidé de développer une action commune, la « diplomatie des terroirs ».
Plusieurs résultats significatifs ont été obtenus, notamment :
– la levées d’embargos sanitaires injustifiés contre des produits français (viandes) dans plusieurs pays – le Vietnam, l’Afrique du sud, la Corée du sud et Singapour ;
– des avancées dans la protection internationale des indications géographiques, avec en mai 2015 l’accord de Genève étendant à celles-ci le système international d’enregistrement et de protection des appellations d’origine créé par l’« arrangement de Lisbonne », avec le progrès de la reconnaissance de nos appellations viti-vinicoles par la Chine (le « Bordeaux » a été reconnu, deux ans après le « Champagne ») ou encore la reconnaissance par le Canada, dans le cadre de l’accord de libre-échange signé avec l’Union européenne, de 42 indications géographiques françaises…
– la mise en place prochaine d’une plateforme commerciale « France Viande Export » destinée à faciliter la construction de réponses collectives à des offres et de pouvoir satisfaire des demandes de volumes importants.
Il faut par ailleurs saluer la création récente de deux nouvelles « familles » qui s’ajoutent au quatre premières.
La nouvelle famille « Mieux se divertir et se cultiver » concerne les industries culturelles et créatives (ICC). Dans son avis sur le projet de loi de finances pour 2015, votre rapporteure avait analysé les enjeux des ICC, dont elle rappellera donc juste les principaux :
– les ICC pèsent 3 % de notre PIB et un million d’emplois ; elles généreraient au moins 300 millions d’euros d’excédent commercial, ce chiffre étant sujet à caution car le commerce international dans le domaine culturel mêle, plus encore que dans d’autres secteurs, des biens matériels (livres, instruments de musiques, supports gravés…) et des services ou droits de propriété intellectuelle (droits d’édition, programmes, logiciels…) qui ne sont pas comptabilisés de la même manière. De plus il faudrait prendre en compte les effets indirects : les ICC sont les vecteurs, à l’étranger, d’une image positive de notre pays ; elles sont prescriptrices d’un mode de vie et de consommation, donc potentiellement de voyages en France, d’achats de produits français…
– ce secteur s’est organisé depuis longtemps pour l’export en créant des structures spécialisées par sous-secteur (le livre, le film, les programmes télévisés, la musique, les jeux) pour vendre ses productions à l’international. Mais ces structures très spécialisées sont forcément petites et leur segmentation ne répond pas au défi de l’évolution technologique qui, notamment, supprime les cloisonnements traditionnels entre sous-secteurs qui étaient fondés sur des supports différents (le fichier numérique acheté en ligne tend à remplacer le disque ou CD, le DVD, le livre-papier, etc.) ;
– le secteur des ICC comprend quelques groupes qui sont parfois des « champions mondiaux », mais aussi beaucoup de petites entreprises. De plus, même parmi les entreprises de taille significative, le développement international n’est pas toujours prioritaire. Ces entreprises restent souvent tournées principalement vers le marché domestique, en particulier quand existent des dispositifs « franco-français » de financement qui sont bien rôdés, par exemple pour le cinéma, pour lequel l’éventuel succès international d’un film a longtemps été perçu comme une sorte de bonus plus que comme un objectif.
Il y a donc de réels enjeux de développement et de structuration de la dimension internationale de ce secteur porteur, qui justifient l’institution d’une « famille ».
Le lancement d’une famille concernant le tourisme est justifié par le poids et les opportunités de ce secteur pour notre pays :
– son poids global, mesuré par le concept de « consommation touristique intérieure » (qu’il s’agisse de touristes étrangers ou français), est évalué en 2014 à 7,4 % du PIB ; il emploie environ un million de personnes ;
– il génère un solide excédent dans le solde extérieur des services, même si cet excédent ressort en baisse en 2014 (6,6 milliards d’euros contre 10,2 milliards en 2013), baisse qui n’est pas due à un moindre attrait des touristes étrangers pour notre pays, mais à l’attrait croissant des Français pour les voyages à l’étranger ;
– les revenus tirés du tourisme étranger en France continuent à augmenter. En 2014, on a décompté 83,8 millions d’arrivées de touristes internationaux en France (+ 0,2 % par rapport à 2013), qui ont généré des recettes en hausse de 1,4 % par rapport à 2013. Le niveau de ces recettes place la France au 3ème rang mondial derrière les États-Unis et l’Espagne.
Cela dit, il faut être conscient que, dans un monde où des destinations nouvelles se développent, la « part de marché » de la France se tasse progressivement : notre pays, qui représentait un peu plus de 11 % des arrivées en 2000, n’en représentait plus qu’environ 7,5 % en 2014.
C’est pourquoi il a été décidé de relancer notre politique d’attractivité touristique. Plusieurs axes ont été définis à cette fin lors des « Assises du tourisme » du 19 juin 2014 :
– améliorer et diversifier notre offre, en constituant des pôles d'excellence (dont la gastronomie, les sports et la montagne, l’écotourisme, les savoir-faire et le tourisme urbain) et en élaborant des « contrats de destination » ;
– améliorer l’accueil des touristes, notamment sur le segment de transport « Roissy-Gare du Nord » et, en amont, lors des procédures de demande de visa ;
– développer le numérique en lien avec les activités touristiques ;
– améliorer la formation des professionnels ;
– élargir l’accès aux vacances par des mesures sociales.
Certaines concrétisations de ces décisions sont déjà perceptibles :
– le nombre de visas pour visite (généralement touristique) individuelle ou en groupe délivrés par les consulats français dans le monde est passé de 1,86 million à 2,17 millions entre 2013 et 2014, soit 16,7 % de croissance. Cette évolution rend bien sûr compte, d’abord, de l’explosion de la demande de voyages par la nouvelle classe aisée des pays émergents. Mais elle a certainement été accélérée par les mesures de facilitation des procédures qui ont été prises. En Chine, par exemple, qui était un pays prioritaire dans ce domaine, le nombre global de visas délivrés (il s’agit essentiellement de visas de tourisme) est passé de 357 000 à 564 000, soit une progression de 58 % !
– vingt « contrats de destination » ont été sélectionnés au cours de deux appels à projets successifs organisés en juillet 2014 et janvier 2015. Ils ont pour vocation de fédérer les acteurs publics et privés autour d’une marque de destination à résonnance internationale. Le but est de rendre l’offre touristique cohérente et visible au regard des attentes des marchés étrangers.
L’opérateur Atout France a récupéré le nom de domaine « France.fr », qui abrite désormais le portail touristique de la France, et bénéficiera d’une « rallonge » budgétaire de 5 millions d’euros au titre du rendement exceptionnel des droits de visas.
Le 8 octobre dernier, la Caisse des dépôts et consignations a annoncé qu’elle allait consacrer sur cinq ans un milliard d’euros au renforcement de l’attractivité touristique française, avec :
– la création d’une société foncière dotée de 500 millions d’euros et dédiée à la rénovation et à la construction d’infrastructures hôtelières ;
– la mise en place d’un fonds doté de 400 millions d’euros pour le financement des infrastructures touristiques (ports de plaisance, parcs d’exposition, thermalisme, tourisme culturel, etc.) ;
– la création d’un fonds de capital-développement de Bpifrance pour les PME innovantes de la filière, doté de 100 millions d’euros.
Le premier Forum des PME à l’international a été organisé le 11 mars 2015. Il a réuni 420 PME et ETI et un plan d’action pour « Renforcer l’internationalisation des entreprises » y a été présenté par le secrétaire d’État Matthias Fekl. Cette manifestation est destinée à être déclinée dans les 13 futures grandes régions : cela a commencé à Bordeaux le 2 juin, à Nantes le 1er octobre et à Strasbourg le 12 octobre.
Plusieurs mesures doivent être mises en œuvre :
– la simplification du parcours à l’international et l’accompagnement dans ce cadre de 3 000 PME supplémentaires d’ici fin 2017 est l’objet, on l’a dit, d’une convention entre Business France, CCI international et CCI France international ;
– les conseillers du commerce extérieur de la France (CCEF) se sont également engagés ; 150 d’entre eux ont été désignés comme « référents PME » ;
– un guichet unique national doit être mis en place d’ici à 2016 afin de simplifier les procédures douanières. Si 85 % des procédures en douane sont dématérialisées, les autorisations nécessaires pour exporter et importer des produits présentant des risques sanitaires, sécuritaires ou environnementaux sont encore, à ce jour, délivrées sous format papier par une quinzaine d’administrations différentes. L’objectif du guichet unique est d’établir une communication directe entre les systèmes d’information des différentes administrations ;
– les PME seront systématiquement associées aux déplacements présidentiels et ministériels. Les délégations accompagnant le secrétaire d’État au commerce extérieur comporteront au moins 30 % de PME. Une procédure d’inscription en ligne a été mise en place à cet effet.
Le commerce en ligne est en développement rapide et c’est sans doute un outil très efficace de développement de l’export, qui de surcroît ne coûte aucun argent public. Les entreprises qui proposent leurs produits en ligne reçoivent en effet des commandes de l’étranger sans avoir à les solliciter et souvent sans les chercher particulièrement. Cela pose d’ailleurs, semble-t-il, des problèmes particuliers, pour le moment non pris en charge, quand ces exportateurs « malgré eux » sont des petites voire de très petites entreprises : elles n’ont souvent aucune connaissance des moyens pratiques d’expédier des produits à l’international à un coût raisonnable, ni des formalités douanières.
Les entreprises françaises sont aujourd’hui moins nombreuses que celles d’autres pays européens à vendre en ligne, voire à disposer d’un site internet. Et trop souvent, les sites existants ne sont pas traduits en anglais ou en d’autres langues.
Accroître le nombre d’entreprises vendant sur internet devrait faire partie des objectifs de la politique du commerce extérieur.
Plusieurs pays se sont lancés depuis quelques années dans des politiques délibérées de construction d’une image nationale (voire d’une marque), destinée à être mise, entre autres mais pas exclusivement, au service de leur rayonnement économique et de leurs entreprises.
S’étant rendue les années précédentes en Suède et au Royaume-Uni, deux pays en pointe dans ce domaine, votre rapporteure avait fait le constat que ce genre de politique implique :
– des moyens substantiels (se comptant en dizaines de millions d’euros) ;
– une prise en compte des différentes dimensions (pas seulement économique, mais culturelle, sociétale…) et l’association de multiples acteurs (ensemble des administrations, bien au-delà des seuls ministères des affaires étrangères ou du commerce extérieur, entreprises et personnalités du monde artistique et culturel) ;
– en conséquence une gestion interministérielle ;
– une communication multilingue.
La France a pris du retard dans ce domaine :
– la reprise du domaine « France.fr » par Atout France, pour en faire le site principal de promotion touristique de notre pays, a sans doute un intérêt direct en termes de retombées, mais peut aussi apparaître un peu réductrice. Le tourisme est très important, mais l’image internationale de la France ne peut pas se limiter à ce que l’on présente habituellement aux touristes…
– s’agissant de la présentation opérationnelle de notre système de soutien à l’internationalisation des entreprises, dévolue au portail « France International », du retard a été pris. Ce site, mis en ligne fin 2013, n’est pas à jour. Il est désormais confié à Business France, qui doit impérativement l’actualiser et l’améliorer rapidement, de même que son propre site (cela devrait être fait avant l’été 2016) ;
– un ensemble de marques (enregistrées) ou de labels sectoriels se sont développés, certains avec un succès qu’il faut saluer, comme Vivapolis, pour promouvoir l’offre française dans le secteur de la ville durable, ou la French Tech. Mais la prolifération de ces marques et labels émis par des acteurs publics nuit aussi à leur lisibilité. De l’ordre doit être mis et il faut qu’ils soient fédérés sous une ombrelle « France ».
Le Gouvernement est conscient de ces enjeux. La conduite de ces actions d’image devrait être progressivement recentrée sur Business France, qui a d’ores et déjà la propriété de plusieurs marques publiques et a la charge des campagnes internationales d’attractivité (actuellement « Créative France »).
Au-delà, une véritable politique de « marque nationale » reste sans doute à construire. La direction de Business France parie sur le succès du concept « Créative France », centré sur une valeur, la créativité, qui est communément revendiquée par les acteurs économiques français et leur est généralement reconnue : si ce concept était approprié par de nombreux acteurs, il s’imposerait de fait comme une marque nationale.
III. UN EXEMPLE DE « DIPLOMATIE ÉCONOMIQUE » D’UNE NOUVELLE PUISSANCE ÉCONOMIQUE RÉGIONALE : LE CAS DE LA TURQUIE
En France, le concept de « diplomatie économique » est assez simple : il s’agit de dire que, lorsqu’un pays dispose d’un réseau diplomatique qui reste le 3ème du monde par l’ampleur de son déploiement et d’un capital de prestige politique lié à son histoire et à son statut international (de membre du Conseil de sécurité des Nations-Unies et plus généralement de puissance militaire capable de mener des opérations lointaines), il est normal que ce réseau et ce capital servent aussi ses intérêts économiques.
Pour les plus grandes des économies émergentes, les choses sont plus ambivalentes :
– d’un côté, même si ces pays peuvent aussi avoir un prestigieux passé impérial, comme la Chine ou la Turquie, leur nouveau statut international est largement dû à leur réussite économique. La puissance économique nouvelle est donc mise au service des ambitions politiques ;
– de l’autre, les pays émergents apprennent vite à mettre leurs nouvelles capacités politiques et diplomatiques au service de leurs intérêts économiques.
Votre rapporteure a souhaité cette année faire un focus sur la Turquie, car ce pays, surtout depuis qu’il est gouverné par l’AKP (depuis 2002), apparaît comme une bonne illustration de ce double mouvement :
– de valorisation de la nouvelle puissance économique au service d’une politique d’influence ;
– de développement d’une « diplomatie économique » pour servir les intérêts économiques, même si la machine s’est quelque peu grippée depuis quelques années, la politique étrangère turque rencontrant de grandes difficultés.
La Turquie est par ailleurs un partenaire économique important pour la France, en particulier dans le contexte d’une reprise des relations commerciales avec l’Iran suite à l’accord sur le nucléaire iranien. Il faut aussi souligner le développement rapide de la présence diplomatique et économique turque dans une aire géographique traditionnellement très importante pour notre pays, l’Afrique.
Le présent avis est centré sur ces aspects économiques, sans déborder sur les multiples autres enjeux diplomatiques concernant la Turquie, que ce soit ses perspectives d’adhésion à l’Union européenne ou son implication dans le conflit syrien…
Lors du déplacement en Turquie qu’elle a effectuée au titre du présent avis, votre rapporteure a également conduit des auditions sur un sujet d’actualité incontestable, la crise des réfugiés. Elle en rendra compte dans un autre cadre, souhaitant juste, dans le présent avis, souligner l’ampleur de l’effort consenti par la Turquie pour accueillir depuis 2011 et traiter dignement plus de 2 millions de réfugiés syriens.
La Turquie a connu au cours des années 2000 une croissance économique très dynamique (5,2 % en moyenne annuelle sur la décennie 2002-2012, malgré une brève mais violente récession en 2009 du fait de la crise financière mondiale).
Les interlocuteurs de votre rapporteur ont tous souligné l’esprit d’entreprise de la population turque, son sens du commerce, son goût du risque, sa réactivité, qui permet par exemple aux entreprises turques de très rapidement se lancer sur de nouveaux marchés lorsqu’elles sont en difficulté sur leurs marchés traditionnels. Cette acceptation du risque et cette réactivité ont cependant leur revers : une instabilité des réglementations, qui s’adaptent très vite et sont tout de suite appliquées ; des taux très élevés d’accidents du travail…
L’industrie, qui pèse pour 24 % dans le PIB, s’est rapidement développée depuis la libéralisation de l’économie engagée dans la décennie 1980, du fait notamment d’un afflux d’investissements étrangers.
En effet, la Turquie est aujourd’hui très ouverte aux investisseurs étrangers, qui sont traités comme les investisseurs nationaux, avec parfois des incitations fiscales très fortes, notamment pour les implantations dans les zones encore peu développées de l’est du pays. Les entreprises étrangères recourent souvent à des joint-ventures avec des partenaires locaux, mais ce n’est pas une obligation, à la différence de nombreux autres pays émergents.
Malgré la présence de grands groupes souvent très compétitifs au plan international (par exemple dans le BTP) et très présents hors des frontières, l’économie turque reste fortement dominée par les petites entreprises, au nombre de 3,5 millions, qui représentent près de 80 % des emplois, mais seulement la moitié de la valeur ajoutée générée dans le pays.
La croissance des dernières années a fait de la Turquie un pays à revenus moyens-supérieurs : le PIB par habitant a triplé pour atteindre 10 500 dollars en 2014 (au taux de change courant ; en parité de pouvoir d’achat, on serait proche de 20 000 dollars). Il faut toutefois souligner les disparités régionales de revenus : du simple au double entre la région d’Istanbul et l’Anatolie du sud-est.
Par ailleurs, la Turquie est l’un des pays les plus peuplés de l’espace européen et proche-oriental : avec près de 78 millions d’habitants, elle n’est dépassée en Europe que par la Russie (144 millions d’habitants) et l’Allemagne (81 millions). Au Proche-et-Moyen-Orient, seuls deux pays ont des populations comparables (et même un peu supérieures) : l’Égypte, avec 88 millions d’habitants, et l’Iran, avec 79 millions d’habitants.
De plus, cette population turque est jeune – la moitié a moins de 29 ans – et augmente d’environ 1,3 % par an.
Sa taille démographique et son dynamisme économique font aujourd’hui de la Turquie la 17ème économie mondiale. Avec un PIB de 800 milliards de dollars en 2014, elle pèse certes économiquement 3,5 fois moins que la France, mais domine son voisinage géographique.
Le graphique ci-après, où figurent en comparaison les PIB de la plupart des pays voisins de la Turquie, riverains de la mer Noire et de la Caspienne ou situés au Proche-et-Moyen-Orient, permet de le constater.
Le PIB des pays de la zone géographique de la Turquie comparé à celui de ce pays
(données pour 2014 au taux de change courant : Turquie = 100)
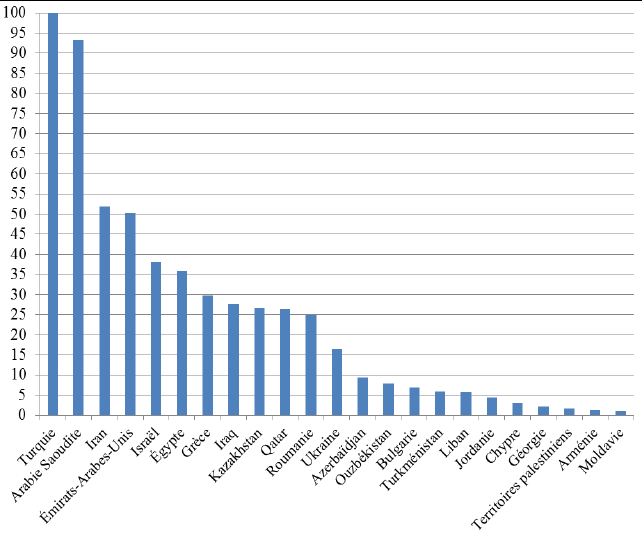
Source : graphique élaboré à partir des données de la Banque mondiale.
Deux pays sont absents de ce graphique ; l’un parce qu’il est, dans le voisinage relatif de la Turquie, le seul à peser économiquement beaucoup plus lourd (plus du double), la Russie ; l’autre parce que, malheureusement, son économie n’existe plus (et l’on a n’a donc pas de données statistiques), la Syrie.
Pour le reste, on voit que la Turquie, économiquement, domine un large environnement régional :
– dans l’ensemble Europe balkanique-Asie centrale-Proche et Moyen Orient, seule l’Arabie Saoudite fait plus ou moins jeu égal en termes de PIB ;
– si on la compare à celle des autres pays qui prétendent jouer dans la région un rôle politique déterminant, l’économie turque pèse deux fois plus que celle de l’Iran, trois fois plus que celle de l’Égypte et d’Israël, quatre fois plus que celle du Qatar…
– cette économie pèse aussi trois à quatre fois plus que celles des plus grands pays d’Europe du sud-est, la Grèce et la Roumanie, ou du principal pays d’Asie centrale, le Kazakhstan.
On peut également observer que l’économie turque, à elle seule, pèse plus de deux fois plus que celles de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie réunis.
La croissance rapide de l’économie turque et son extraversion ne doivent pas dissimuler quelques fragilités, du fait notamment d’une grande difficulté à assurer son équilibre externe et d’un niveau insuffisant d’innovation.
Après la forte croissance économique des années 2000, le rythme s’est ralenti, avec un taux de croissance de 2,1 % en 2012, 4,1 % en 2013, mais seulement 2,9 % en 2014, suite à un resserrement brutal de la politique monétaire destiné à juguler l’inflation. En 2015, l’objectif gouvernemental de croissance est de 4 %, mais la plupart des prévisions tablent plutôt sur une fourchette de 2,5 % à 3,2 %.
Le chômage est en hausse (près de 10 % en 2014, sans doute plus de 11 % cette année) et, si les finances publiques sont plutôt équilibrées (avec un déficit public représentant 1,5 % du PIB en 2014 et une dette publique équivalente à 33 % de celui-ci), les tensions inflationnistes perdurent. Avec 8,2 % d’inflation en 2014 et 7,1 % en rythme annuel en août 2015, le pays reste bien au-dessus de la cible de 5 % fixée par la banque centrale. L’inflation est nourrie par la dépréciation de la livre turque (– 25 % vis-à-vis du dollar sur les huit premiers mois de 2015) et par de fortes hausses des prix des produits alimentaires.
Surtout, la Turquie souffre d’un déficit récurrent de sa balance des transactions courantes : en moyenne sur la décennie 2005-2014, celui-ci a représenté près de 6 % du PIB. Il a atteint un niveau record en 2011, à 9,7 % du PIB, avant de se réduire pour revenir en 2014 à 5,7 % du PIB.
Ce déficit constant, ne pouvant être compensé que très partiellement par les entrées d’investissements étrangers, a été financé essentiellement par de l’endettement extérieur : la position extérieure nette négative de la Turquie représentait 53,4 % du PIB en 2014.
De plus, cet endettement est en grande partie à court terme : la dette extérieure à court terme équivalait à 16,5 % du PIB en 2014. Le financement extérieur de la Turquie dépend donc de flux de capitaux internationaux très volatils.
Enfin, l’endettement des acteurs privés est largement libellé en devises, ce qui a des conséquences potentielles redoutables lorsque la monnaie nationale se déprécie, ce qui a été le cas dans la période la plus récente.
Il faut par ailleurs observer que le niveau des réserves de change du pays est assez peu élevé : 120 milliards de dollars à la mi-2015.
La Turquie s’est fixé des objectifs très ambitieux pour 2023, année du centenaire de la République turque. Parmi ces objectifs figure l’affectation d’au moins 3 % du PIB à la recherche et développement. Mais l’on en est encore loin, même si le taux est passé en quelques années d’un niveau très faible à un niveau moyen (1,5 % à 2 %), du fait d’un investissement public massif en la matière.
La croissance turque a été fondée ces dernières années sur un modèle de « rattrapage » et d’imitation des pays les plus développés, imitation étant à prendre au sens le plus concret puisque la conception du respect de la propriété intellectuelle par les entreprises turques semble souvent élastique. La Turquie a aligné son droit de la propriété intellectuelle sur les standards européens, mais ce droit ne semble guère appliqué ; de nombreuses entreprises venues de France ou d’Europe occidentale en ont fait l’expérience désagréable, notamment quand elles s’étaient appuyés sur des partenaires locaux qui se sont avérés peu scrupuleux.
En attendant, l’économie turque reste centrée sur des productions à contenu technologique modeste ou moyen, comme le textile ou l’automobile, et ses segments les plus avancés restent souvent contrôlés par les investisseurs étrangers. Il est difficile de savoir si les grands objectifs quelque peu nationalistes fixés pour 2023 – concevoir et fabriquer une voiture « turque », un avion « turc », un satellite « turc »… – seront tenus. La capacité du pays à développer une économie reposant sur l’innovation reste à démontrer.
Le poids économique relatif de la Turquie lui permet de jouer un rôle important dans les flux commerciaux de ses voisins, même si le commerce extérieur turc n’est pas tourné principalement vers eux.
En effet, ce commerce est prioritairement orienté vers l’Union européenne, avec laquelle la Turquie a une union douanière depuis 1996. En 2014, l’Union européenne a pesé pour 43,5 % dans les exportations turques et pour 36,7 % dans les importations turques. Les exportations turques vers l’Union sont dominées par le textile-habillement (25 % du total de ces exportations en 2014) et les automobiles (19 % de ce total).
Par ailleurs, les trois quarts des investissements directs étrangers en Turquie proviennent de l’Union.
Les autres grandes puissances sont également très présentes dans le commerce extérieur turc. En 2014, les premiers fournisseurs des importations turques ont été, dans l’ordre, la Russie (10,4 %), la Chine (10,3 %) et l’Allemagne (9,2 %).
Comme le montre le graphique ci-après, le commerce de voisinage est toutefois non négligeable pour la Turquie, dont l’Iraq a été en 2014 le 2ème marché d’exportation (6,9 % de celles-ci), d’autres pays tels que les Émirats-Arabes-Unis, l’Iran, l’Égypte, l’Arabie Saoudite et l’Azerbaïdjan étant aussi des clients significatifs.
Les principaux clients de la Turquie
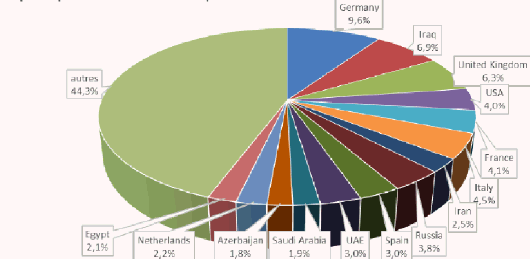
Source : « Le commerce extérieur de la Turquie en 2014 », ambassade de France en Turquie, service économique régional.
Vu les poids relatifs des économies de la Turquie et des pays de son voisinage, du point de vue de ces derniers, le commerce avec la Turquie est souvent déterminant :
– sur la base de chiffres de 2013, la Turquie apparaît comme le 1er fournisseur de l’Irak, couvrant 25 % des importations totales et 10 % des échanges globaux de ce pays ;
– elle est également le 1er fournisseur du Turkménistan, couvrant 22 % des importations de ce pays ;
– elle est le 2ème fournisseur de la Géorgie, couvrant 17 % des importations de ce pays ;
– elle est le 3ème fournisseur de l’Azerbaïdjan, couvrant près de 14 % des importations de ce pays ;
– elle pèse significativement (3 % à 4 %) dans les échanges extérieurs de pays tels que le Liban, Israël, l’Égypte, l’Ukraine et la Russie ;
– elle est enfin un partenaire très significatif de l’Iran, position intéressante dans le contexte actuel de levée prochaine des sanctions internationales et de retour de l’Iran dans le jeu économique.
Il n’échappe à personne que la Turquie et l’Iran partagent une longue frontière commune, sont l’une et l’autre des pays musulmans mais non arabophones, et également des pays dotés d’une population à la fois très nombreuse (dans la zone, seule l’Égypte fait jeu égal) et globalement souvent très éduquée.
La Turquie est donc nécessairement concernée au premier plan par la perspective de la levée des sanctions internationales contre l’Iran.
Les échanges commerciaux turco-iraniens ont connu ces dernières années d’importantes fluctuations, dues notamment à l’impact des sanctions internationales après 2012 (avec notamment une baisse de la part de l’Iran dans les exportations turques de 6,5 % à 2,5 % en deux ans).
En regardant les tendances de long terme, on relève que le volume du commerce bilatéral est passé de 1,2 milliards de dollars en 2002 (date d’arrivée au pouvoir de l’AKP en Turquie) à près de 14 milliards en 2014. Cette augmentation est liée à des facteurs structurels, les besoins d’énergie de la Turquie et les besoins de l’Iran en produits industriels.
En 2014, l’Iran a été le 10ème client de la Turquie, avec 3,8 milliards de dollars d’importations iraniennes depuis cette dernière, et son 6ème fournisseur, avec 9,8 milliards de dollars d’exportations.
En se plaçant du point de vue iranien, la Turquie était la même année le 2ème marché pour les exportations iraniennes, derrière la Chine, en en absorbant 14 %, et le 5ème fournisseur, à l’origine de 6 % des importations iraniennes.
Le commerce bilatéral entre les deux pays apparaît donc très déséquilibré au profit de l’Iran.
Les métaux précieux, principalement l’or, restent le premier poste des exportations turques en Iran. Les importations turques depuis l’Iran sont dominées par les hydrocarbures, malgré les sanctions internationales : lorsque les États-Unis ont décidé d’un embargo sur les hydrocarbures iraniens à partir de 2012, plusieurs pays qui en étaient très dépendants, dont la Turquie, ont négocié avec l’administration américaine une exemption (sous réserve d’un contingentement des volumes de pétrole iranien importé), laquelle a été ratifiée par le Congrès américain et doit être renouvelée tous les six mois.
Il est à noter qu’alors que l’Union européenne a adopté le même type d’embargo, la Turquie ne semble pas s’être préoccupée de négocier une exemption similaire avec elle : on a là un exemple éclairant de la crainte très spécifique que suscitent les réglementations américaines, du fait de leur application potentiellement extraterritoriale et de la lourdeur des pénalités qu’elles prévoient pour leurs contrevenants.
Concernant le gaz naturel, les livraisons iraniennes ont représenté en volume, en 2014, 18 % des importations de la Turquie, loin derrière celles en provenance de la Russie (55 %). L’approvisionnement en gaz iranien évite donc à la Turquie une dépendance trop exclusive vis-à-vis du gaz russe.
Pour le pétrole, l’Iran a été en 2014 le 2ème fournisseur de la Turquie, après l’Irak, malgré la baisse de sa part relative dans les importations turques de 51 % en 2011 à 30 % en 2014 (du fait des sanctions).
Les investissements directs turcs en Iran correspondraient à 1,2 milliard de dollars sur la période 1996-2014 et 134 sociétés turques seraient présentes en Iran. Les investissements iraniens en Turquie sont peu significatifs.
Un accord commercial préférentiel a été signé entre les gouvernements turc et iranien en janvier 2014 et est entré en vigueur le 1er janvier 2015.
Cet accord prévoit des préférences tarifaires mutuelles : l’Iran en bénéficiera pour ses exportations de certains produits agricoles et la Turquie pour divers produits industriels. Les exportations turques de ces produits à destination de l’Iran avaient atteint 830 millions de dollars en 2012. Suite à la mise en vigueur de l’accord, certaines sources anticipent un doublement de ce type d’exportations dans les trois années à venir.
Les deux pays se sont fixé lors des dernières visites bilatérales un objectif de 30 milliards de dollars pour le volume des échanges commerciaux bilatéraux d’ici deux ans (soit un doublement).
La signature de l’accord sur le nucléaire iranien ouvre d’évidentes perspectives compte tenu du voisinage géographique des deux pays, des liens humains (un quart des Iraniens sont des Azéris turcophones), de leurs poids économiques respectifs (l’Iran est la 2ème économie du Proche-et-Moyen-Orient derrière l’Arabie Saoudite), des relations déjà existantes, des complémentarités (notamment les besoins énergétiques de la Turquie et industriels de l’Iran), etc.
Cependant, plusieurs facteurs pourraient aussi limiter le développement des relations économiques bilatérales : les problèmes sécuritaires ; les antagonismes politiques entre les deux pays (en Syrie en particulier, surtout si l’implication iranienne aux côtés du régime de Bachar-al-Assad devait s’y accroître encore) ; l’existence de vieux litiges économiques bilatéraux (notamment sur le prix du gaz iranien, jugé trop élevé par la Turquie, qui fait l’objet d’un contentieux devant la Cour internationale d’arbitrage depuis 2012)…
Par ailleurs, le retour de l’Iran dans le jeu économique mondial pourrait aussi en faire un concurrent pour la Turquie sur certains produits (par exemple le ciment et le marbre) ou comme destination attractive pour les investissements étrangers.
En Turquie, en particulier depuis l’arrivée de l’AKP au pouvoir en 2002, on constate une plus grande importance accordée à la diplomatie mise au service des intérêts économiques.
Les mécomptes enregistrés depuis 2011 par la politique étrangère turque dans son environnement proche – renversement en Égypte du président Morsi que la Turquie soutenait, résilience du régime de Bachar-el-Assad, brouille persistante avec l’ancien allié israélien en opposition à la politique de dureté de celui-ci… – ne lui permettent guère de valoriser dans cet environnement régional son nouveau statut de puissance économique moyenne.
Mais la diplomatie économique turque sait trouver d’autres espaces, moins dramatiquement sensibles, pour se déployer, par exemple en Afrique.
La coopération entre les pouvoirs publics et le secteur privé a commencé à se développer à partir des années 1980, notamment sous la présidence de M. Turgut Özal, qui, lors des visites officielles à l’étranger, venait accompagné d’une centaine d’hommes d’affaires. Le gouvernement AKP a par la suite intensifié cette pratique. Il a aussi, dans des discours officiels, indiqué les priorités du pays en termes de commerce extérieur, visant en particulier le marché africain et, dans une moindre mesure, l’Amérique latine.
L’Afrique constitue ainsi un exemple intéressant de l’amorce de diplomatie économique turque. Le commerce bilatéral et les investissements ont été soutenus par le renforcement des relations diplomatiques :
– entre 2003 et 2013, neuf visites présidentielles et six au niveau du ministre des affaires étrangères ont été effectués en Afrique ; le premier sommet Turquie-Afrique a été organisé à Istanbul en 2008 avec la participation de 49 pays africains ; le deuxième sommet de coopération a eu lieu à Malabo, en Guinée équatoriale, en novembre 2014 ;
– le nombre d’ambassades turques en Afrique est passé de 12 en 2009 à 39 aujourd’hui (dont 26 avec des conseillers commerciaux). Celui des ambassades africaines en Turquie est parallèlement passé de 10 en 2008 à 32 aujourd’hui ;
– les visites d’État et ouvertures d’ambassades turques se sont accompagnées assez systématiquement d’ouvertures de lignes de Turkish Airlines vers les pays en cause, bien que ces lignes ne soient généralement pas rentables à court terme ;
– le volume du commerce bilatéral Afrique-Turquie a augmenté de 5,4 milliards de dollars en 2003 à 23,4 milliards en 2014 et les investissements directs turcs y atteignent près de 6 milliards de dollars ;
– d’autres indicateurs en forte hausse traduisent de même l’intérêt de la Turquie pour l’Afrique : nombre de touristes, volume d’aide humanitaire accordé aux pays africains, nombre de bourses octroyées à des étudiants africains en Turquie...
La Turquie dispose d’un ensemble de structures étatiques, paraétatiques ou professionnelles qui viennent en appui aux entreprises pour faciliter leur intégration dans le commerce international et leur implantation sur les marchés extérieurs.
Ce dispositif reste cependant celui d’un pays émergent qui n’est devenu que récemment une puissance commerciale. Il apparaît donc nettement moins puissant et moins complet et « sophistiqué » que celui d’un pays tel que la France. Mais peut-être aussi, par sa capacité à assumer des priorités politiques et des risques financiers importants, est-il parfois plus efficace…
S’agissant des structures étatiques ou para-étatiques, la Turquie ne dispose pas pour le soutien à l’export d’établissements autonomes comme Business France. Le soutien aux exportateurs repose sur un service du ministère de l’économie, la direction générale des exportations (il existe de même des directions compétentes pour l’attraction des investissements étrangers et pour le tourisme), dont les moyens humains sont modestes : environ 300 personnes, dont 128 conseillers et attachés économiques dans les ambassades turques du monde.
C’est peu si l’on compare au réseau français équivalent, dans lequel il faudrait prendre en compte à la fois les services économiques des ambassades et les personnels de Business France à l’étranger, soit environ 1 600 agents en faisant l’addition.
En dehors de l’animation de son réseau, la direction générale des exportations turque :
– délivre aux entreprises turques des informations sur les opportunités à l’exportation ;
– conduit un programme dit « Turquality » qui se présente comme un programme de construction d’une « marque nationale » (sur son site internet), mais apparaît en pratique plus centré sur la sensibilisation, le coaching et l’évaluation des entreprises turques quant aux problématiques de qualité que sur la promotion d’une « marque » nationale visible à l’étranger ;
– finance (semble-t-il généreusement) des participations turques aux foires et salons internationaux.
En revanche, la dimension d’accompagnement individualisé et dans la durée des exportateurs apparaît absente (alors qu’elle est de notre côté devenue le cœur de métier de Business France et est également pratiquée par les chambres de commerce françaises à l’international).
Des priorités géographiques sont définies avec l’élaboration annuelle d’une liste de « pays-cibles » et de pays « prioritaires » de second rang. Les premiers sont aujourd’hui 17 (dont 3 pays africains) et les seconds 28. Ce processus de fixation de priorités géographiques mêle vraisemblablement considérations économiques et politiques, les pays ciblés étant aussi ceux où des déplacements présidentiels ou ministériels seront organisés.
Créée en 1987, Eximbank est une institution publique qui a pour mission principale de fournir des crédits et des garanties aux exportateurs, constructeurs et investisseurs ayant des activités à l’étranger et d’encourager la diversification des biens et services destinés à l’exportation. Elle fournit aux exportateurs turcs à la fois des crédits (à l’export, mais aussi par exemple pour leur fonds de roulement), des garanties (y compris à moins d’un an) et des assurances : ses instruments d’intervention sont donc larges et dépassent (en champ) ceux dont dispose et disposera la BPI, même après la reprise des garanties publiques de la Coface.
En 2014, Eximbank a généré 31,1 milliards de dollars d’engagements, dont 20,1 milliards sous forme de crédits et 11 milliards sous forme d’assurance ou de garantie. Ce montant est très significatif : il correspond à près de 20 % des exportations turques totales.
Eximbank prend des risques. Elle est très présente en Afrique subsaharienne (Cameroun, Congo Brazzaville, Éthiopie, Ghana, Guinée, Sénégal…), où elle n’hésite pas, notamment, à garantir des contrats de construction décrochés par des PME turques (s’imposant seulement des plafonds d’engagements par pays et par catégories de risques sur les engagements à moyen/long terme). Elle n’est interdite d’intervention que dans quelques États comme la Corée du Nord et la Syrie, dans les pays politiquement en délicatesse avec la Turquie (Arménie et Chypre), ainsi que, « de facto » selon ses dirigeants, en Iran (faute de banques commerciales y faisant des opérations).
Il existe en Turquie de nombreuses structures qui réunissent les entreprises :
● Deux grandes organisations peuvent apparaître comme les équivalentes de nos MEDEF et CGPME :
– la TÜSIAD (Association des industriels et hommes d’affaires turcs) représente le grand patronat pro-européen. Elle agit surtout comme force de lobbying pour l’intégration européenne de la Turquie, avec un petit nombre de bureaux à l’étranger (Bruxelles, Washington, Berlin, Paris, Pékin). Elle est aussi à l’origine de la création en 2009 du think tank franco-turc Institut du Bosphore ;
– la MÜSIAD (Association des industriels et hommes d’affaires indépendants) fédère principalement des PME-PMI implantées en Anatolie. Elle n’a que 5 représentants à l’étranger mais opère dans près de 70 pays, par l’organisation de foires, congrès et conférences internationales. Elle propose de développer plutôt les échanges commerciaux avec les pays voisins pour réduire la dépendance commerciale de la Turquie vis-à-vis de l’Union européenne.
● Les chambres de commerce et d’industrie forment en Turquie un réseau puissant dont l’union nationale est connue sous l’acronyme TOBB. D’après les renseignements recueillis, ce réseau consulaire, à la différence de son homologue français, ne semble cependant pas très orienté vers la dimension internationale (peu de chambres de commerce turques à l’étranger ; pas d’action de soutien à l’internationalisation dans les chambres sur le territoire turc).
● Deux structures patronales ont une mission spécifiquement tournée vers l’internationalisation, mais, votre rapporteure, n’ayant pu rencontrer leurs représentants, n’est pas en mesure d’apprécier leur rôle réel :
– le DEIK (Conseil des relations économiques extérieures) est une organisation patronale qui a notamment pour mission de représenter les intérêts turcs à l’étranger à travers 120 conseils d’affaires thématiques et régionaux ;
– la TIM (Assemblée des exportateurs turcs) regroupe des associations d’exportateurs. Elle travaille en étroite collaboration avec la direction générale des exportations (voir supra) pour assurer la coordination entre les exportateurs et les décideurs politiques.
Le marché turc est stratégique pour plusieurs raisons :
– sa taille, puisque le PIB turc est plus élevé que celui de tout autre pays de l’Europe balkanique ou du Proche-et-Moyen-Orient ;
– son dynamisme, avec une croissance annuelle moyenne de l’ordre de 5 % sur la dernière décennie, aujourd’hui ralentie, mais pas stoppée (puisque l’on serait revenu aux alentours de 3 %) ;
– sa relative ouverture.
Cette question de l’ouverture mérite un développement.
Comme beaucoup de pays émergents, surtout lorsqu’ils ont des difficultés à équilibrer leur balance commerciale, la Turquie pratique assurément une certaine forme de protectionnisme : réglementations techniques mouvantes ; contrôles vétérinaires, sanitaires ou techniques obligatoires à l’importation, coûteux, voire impossibles faute de disponibilité des fonctionnaires compétents ; régime de prix administrés très bas pour les médicaments, qui décourage les importations ; fiscalité ciblée mais pas explicitement discriminatoire – il existe ainsi une très lourde taxe sur tous les achats de voitures neuves (la fiscalité majorerait leur prix de plus de 70 % en moyenne), laquelle n’est certes pas discriminatoire, car elle touche aussi la production locale, mais entretient en fait un énorme marché de l’occasion en réduisant les ventes de véhicules neufs, donc les importations…
Mais la Turquie est également liée par l’union douanière qu’elle a avec l’Union européenne depuis 1996, dont la révision et l’élargissement vont être engagés (5), et plus généralement par sa candidature à celle-ci, ce qui implique préalablement un alignement sur l’ensemble de l’« acquis communautaire », notamment en matière de réglementations techniques, d’ouverture et de transparence des marchés, de libre installation, etc. L’union douanière reste aujourd’hui incomplète, mais elle a pour effet que, dans certains secteurs, notamment industriels, les obstacles tarifaires et non-tarifaires semblent faibles. Dans d’autres, comme l’agriculture, non couverte par l’union douanière, ces deux catégories de barrières restent massives.
En fin de compte, le marché turc apparaît donc difficile, ne serait-ce aussi que du fait de la concurrence d’entrepreneurs locaux très dynamiques et très mobiles, mais peut-être moins fermé que ceux d’autres grandes économies émergentes comparables.
En 2014, la France a exporté pour 5,9 milliards d’euros de biens vers la Turquie et en a importé pour 6,1 milliards d’euros.
Comme dans le reste de l’Europe, les ventes turques en France sont dominées par l’automobile (1,58 milliard d’euros en 2014) et l’habillement (1,14 milliard d’euros la même année).
Le premier poste des exportations françaises en Turquie était en 2014 le secteur aéronautique et spatial (0,83 milliard d’euros), mais il faut aussi signaler un niveau élevé de ventes de produits sidérurgiques et d’équipements automobiles. Nous exportons aussi en Turquie des quantités significatives de produits chimiques et pharmaceutiques, qui sont des points forts traditionnels de la France.
En revanche, les exportations françaises de produits agricoles et agro-alimentaires vers la Turquie apparaissent décevantes, alors qu’il s’agit d’un autre point fort mondial de notre pays. Ces exportations ne représentent que 0,3 % de nos exportations mondiales dans ces domaines, alors que, globalement (tous produits), la Turquie absorbe près de 1,4 % de nos exportations mondiales. Cette situation n’est évidemment pas sans lien avec le haut niveau de protectionnisme turc en matière agricole et alimentaire. Elle conduit à un commerce bilatéral très déséquilibré : en 2014, la France n’a exporté que pour 178 millions d’euros de produits agricoles et agro-alimentaires vers la Turquie, quand le flux réciproque a été de 390 millions d’euros. Un interlocuteur au moins de votre rapporteure a déclaré qu’il dissuadait les PME françaises du secteur de se frotter au marché turc.
Pour la France, la Turquie est un partenaire commercial significatif : en 2014, elle a été notre 14ème débouché dans le monde et notre 6ème hors Union européenne et Suisse, derrière les États-Unis, la Chine, le Japon, la Russie et l’Algérie. Elle a absorbé 1,4 % de nos exportations.
Pour la Turquie, la France est un partenaire important : en 2014, notre pays a été le 7ème fournisseur de la Turquie et son 5ème client.
Cependant, nous arrivons derrière les autres grands pays européens (Allemagne, Italie et Royaume-Uni) dans les flux extérieurs turcs. De plus, notre situation relative s’est dégradée jusque récemment : la part de marché de la France en Turquie (part des importations totales du pays) est passée de 6,4 % en 2004 à 3,2 % en 2013, avant de se consolider à 3,4 % en 2014.
Ces pertes de parts de marché, bien plus fortes que l’érosion que connaissent mondialement les parts de marché françaises en raison de la montée des émergents et de nos problèmes généraux de compétitivité, ont certainement à voir avec les contingences politiques : les déclarations au plus haut niveau de l’État concernant la vocation (ou plutôt en l’espèce la non-vocation) européenne de la Turquie, notamment en 2009, puis le débat sur la pénalisation de la négation du génocide arménien, en 2011-2012, ont clairement pesé dans un pays où la fierté nationale est très grande ; il y a eu alors des appels au boycott des marques françaises qui ont, par exemple, entraîné des pertes très conséquentes de chiffre d’affaires pour la grande distribution sous enseigne française en Turquie. Heureusement, les relations politiques bilatérales se sont grandement améliorées depuis lors. En particulier, la visite d’État en Turquie du président Francois Hollande en janvier 2014 y a été très appréciée.
Suite à cette évolution, la balance bilatérale, traditionnellement excédentaire pour la France, présentait en 2014 un solde légèrement négatif pour la deuxième fois pendant la dernière décennie : les exportations françaises vers la Turquie ont diminué de 4,3 % par rapport à 2013, alors que les exportations turques vers la France augmentaient de 2,2 %.
Il semble pourtant qu’un redressement soit en cours en 2015 : sur le premier semestre de l’année en cours, comparé à la période similaire de 2014, nos exportations font un bond de 27,7 %, tandis que les importations ne progressent que de 7,1 %, permettant ainsi de passer de 150 millions d’euros d’excédent bilatéral semestriel à 831 millions. Notre part de marché en Turquie aurait remonté à 3,9 % et nous aurions gagné une place en devenant le 6ème pays fournisseur de la Turquie.
Les entreprises françaises bénéficient peut-être de la dépréciation relative de l’euro face au dollar, mais aussi, très probablement, de la « lune de miel » politique que vivent aujourd’hui la France et la Turquie grâce à la convergence de leurs positions sur la crise syrienne.
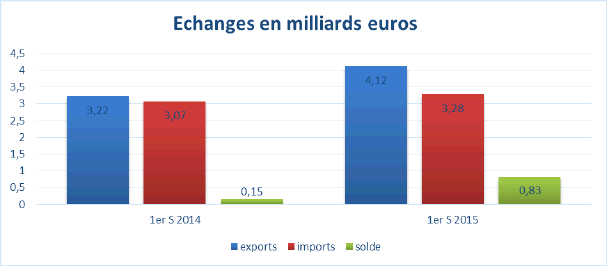 Source : douanes françaises.
Source : douanes françaises.
En termes de stock, la France ressortait en 2014 comme le 6ème pays d’origine des investissements directs étrangers (IDE) en Turquie, derrière les Pays-Bas, l’Allemagne, le Luxembourg, l’Espagne et l’Autriche.
Ce stock d’investissements français représenterait 9,2 milliards d’euros, soit 5,3 % du total des IDE en Turquie.
Près de 400 entreprises françaises sont présentes en Turquie, y employant 100 000 personnes (dont notamment 9 300 pour BNP Paribas, 7 300 pour Carrefour, 6 200 pour Renault…).
L’industrie automobile français est fortement implantée en Turquie : Renault est la troisième entreprise exportatrice du pays et assure 52 % de la production locale de véhicules passagers ; PSA Peugeot-Citroën a noué des partenariats avec des producteurs locaux pour la production de véhicules utilitaires ; 17 équipementiers français, tels Faurecia et Valeo, sont présents.
Le secteur automobile pèse lourdement dans les échanges commerciaux franco-turcs, puisqu’il a représenté en 2014 un total de 2,8 milliards de flux dans les deux sens, soit 24 % des échanges totaux de biens entre les deux pays.
Ces échanges automobiles sont de plus en plus déséquilibrés, avec un déficit pour la France de 1,2 milliard d’euros en 2014 (2 milliards d’exportations turques pour 0,8 milliard d’exportations françaises) : si les échanges de composants (équipements automobiles) restent assez équilibrés, traduisant l’intégration industrielle entre les deux pays du fait de l’implantation des constructeurs et équipementiers français, les échanges d’automobiles finies sont de plus en plus favorables à la Turquie, avec un rapport de 1 à 5 entre les flux dans les deux sens.
Dans le secteur de l’énergie, Engie (ex-GDF-Suez) a investi pour la production d’électricité et le rachat de la société de distribution du gaz dans la région d’Izmir ; ses investissements dépassent le milliard d’euros. Engie est en outre impliqué, de même qu’Areva, dans le projet franco-japonais de construction de quatre réacteurs nucléaires ATMEA à Sinop, contrat de 17 milliards d’euros dont les travaux commenceront en 2017.
EDF est surtout présente dans la filière renouvelable (8 parcs éoliens). Perenco est le principal producteur indépendant de pétrole sur le sol turc (production modeste). Alstom possède à Gebze, près d’Istanbul, l’une des plus grandes usines de fabrication de transformateurs au monde (1 000 employés).
La présence industrielle hors automobile et énergie est variée : sont notamment implantés en Turquie Thales, Lafarge-Olcim, Nexans, Airbus, Arkema, Air Liquide, Sanofi, Danone, Lactalis, Lesafre, Aromatech, Bel…
Les banquiers et assureurs français sont bien implantés en Turquie, notamment Axa (2ème compagnie d’assurance de Turquie en termes de primes souscrites), Groupama (7ème sur le marché turc), Société Générale et BNP Paribas à travers la banque TEB, qu’elle contrôle à 50 %.
Les grandes enseignes des biens de consommation (Yves Rocher, Decathlon, ou LVMH et l’Oréal pour les produits de luxe), mais aussi du tourisme et de l’hôtellerie (Accor), contribuent également à la visibilité de la présence française. Toutefois, dans le domaine de la grande distribution, plusieurs enseignes françaises tendent à réduire leur présence.
Il faut enfin signaler un obstacle au développement des investissements directs français en Turquie qui a été relevé par plusieurs interlocuteurs de votre rapporteure : la France et la Turquie sont liées par une convention fiscale ancienne (1987) qui est défavorable aux entreprises françaises implantées sur place, car les dividendes qu’elles font remonter en France sont assez lourdement taxés, surtout en comparaison des conditions obtenues par plusieurs de nos partenaires européens (la convention prévoit des taux de taxation sur les sorties de dividendes de 15 % ou 20 % selon les cas, quand des partenaires européens ont obtenu 5 %). C’est pour cette raison que certaines entreprises françaises préféreraient investir en Turquie par le biais de leurs filiales dans d’autres pays européens, voire de montages fiscaux (c’est notamment ce qui a été reproché en début d’année 2015 à Aéroports de Paris, dont les revenus de la participation dans le groupe turc TAV remontent via l’Autriche).
La diplomatie économique, au sens large, est éclatée en Turquie du fait de la coexistence d’une capitale politique, Ankara, et d’une capitale économique (et démographique) incontestable, Istanbul.
Le service économique, qui est traditionnellement constitué principalement de personnels issus de la direction générale du Trésor (et non de diplomates du Quai d’Orsay), mais dépend directement de l’ambassade, est en Turquie localisé principalement à Ankara. Sa mission est en effet orientée vers les questions plus régaliennes telles que la veille économique et l’aide à la négociation des « grands contrats ». Le service, qui comprend au total 12 personnes, a cependant un délégué à Istanbul. Ses cadres ne sont pas issus uniquement de la direction générale du Trésor, loin de là : l’une d’entre elles provient du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, un autre du ministère de l’agriculture, une dernière des services de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris.
Le bureau Business France, centré sur le service aux entreprises françaises désirant pénétrer le marché turc, en particulier les grosses PME et ETI, est pour sa part établi à Istanbul. Avec ses 14 agents, il revendique plus de deux cent accompagnements d’entreprises à l’export par an.
Parmi les autres opérateurs dépendant de l’État, l’Agence française de développement est également présente à Istanbul.
En revanche, Atout France ne l’est pas – son bureau compétent pour la Turquie étant celui de Dubaï –, malgré les perspectives qu’offre la Turquie, d’une part en tant que pays émergent dont la classe moyenne grandissante voyage de plus en plus à l’étranger, d’autre part en tant que grand pays d’industrie touristique où les professionnels français des équipements et de l’ingénierie touristiques ont des marchés à conquérir.
Dans le cadre de l’initiative « Investment month » lancée par le ministère des affaires étrangères et du développement international, un séminaire « Invest in France » s’est tenu à Istanbul, le 30 septembre 2015, au Palais de France (résidence du consulat général). Il a été organisé principalement par le bureau Business France, en présence de l’ambassadeur de France.
Quatre experts venus de grands cabinets juridiques et comptables parisiens sont intervenus sur les conditions de l’investissement en France ; il est à noter que ces cabinets ont également financé l’ensemble de la manifestation. Ces présentations ont été complétées par le témoignage de trois présidents de groupes turcs implantés en France. Près de 150 participants, représentant pas moins de 100 entreprises turques, ont assisté au séminaire.
Le suivi est assuré par Business France, qui a déjà pu mener, depuis le 30 septembre, une série de rendez-vous avec des entreprises turques ayant manifesté leur intérêt pour investir en France.
Compte tenu du potentiel actuel de développement de l’investissement turc à l’étranger, le bureau Business France a décidé de créer un poste de chargé d’affaires sur l’investissement (en redéployant un poste « export »).
On a donc là une situation où la création de Business France suite à la fusion d’Ubifrance et de l’AFII facilite effectivement le développement d’une action d’attractivité qui était auparavant peu présente à Istanbul.
Business France se retrouve par ailleurs dans une situation de concurrence avec la Chambre de commerce et d’industrie française en Turquie, qui fait partie du réseau des chambres françaises à l’international et s’appuie sur une histoire ancienne : sa fondation remonte à 1885.
La chambre a un conseil d’administration franco-turc paritaire et est traditionnellement présidée en alternance par des personnalités des deux nationalités. La majorité des entreprises adhérentes sont turques et la chambre revendique la présence de la moitié environ des entreprises françaises implantées à Istanbul.
C’est une structure modeste : elle représente 7,5 emplois et bénéficie d’un budget annuel de 400 000 euros, financé sans fonds publics. Ce budget provient principalement des cotisations des membres (42 %) et des prestations facturées aux entreprises (29 %).
La question de la déclinaison locale de la convention nationale signée entre Business France, CCI International et CCI France international le 11 mars dernier se pose à Istanbul comme ailleurs.
La chambre ne souhaite pas renoncer aux prestations d’« amont » qu’elle réalise : détection d’entreprises susceptibles de pénétrer le marché turc avec l’aide du réseau consulaire en France et accompagnement de ces entreprises dans la recherche de marchés et de partenaires en Turquie. Or, c’est ce que prévoit le texte national, qui réserve cette mission à Business France, dont c’est le cœur de métier et qui a de fait des moyens bien plus importants (en Turquie, Business France accompagne huit ou dix fois plus d’entreprises que la chambre).
La position de la chambre d’Istanbul est fondée sur deux arguments :
– les accompagnements d’entreprises sont pour elle une source substantielle de revenus – environ 50 000 euros –, vu la modestie de son budget ;
– accompagner en « amont » des entreprises serait essentiel pour nourrir en « aval » l’activité et la vitalité de la chambre, car les entreprises ainsi accompagnées ont ensuite vocation à recourir à ses prestations d’aval telles que l’hébergement dans son centre d’affaires, voire ensuite, si elles s’implantent, à devenir membres, finançant la chambre par leurs cotisations et la faisant plus généralement vivre par leur participation à ses activités.
De plus, les relations entre Business France et la Chambre de commerce et d’industrie française en Turquie sont compliquées par la présence d’un autre opérateur : ERAI disposait à Istanbul d’un bureau vers lequel, compte tenu de l’accord d’exclusivité passé un temps, au niveau national, entre Ubifrance et ERAI, le bureau Business France d’Istanbul adressait les entreprises françaises en recherche d’un hébergement (bureau provisoire), aux dépens de la chambre, qui propose la même prestation. Avec la liquidation nationale d’ERAI, son bureau stambouliote a été racheté par son directeur local et est donc devenu une entreprise turque – mais une entreprise turque ayant des liens historiques avec les opérateurs français.
La question des liens qui seront – ou non – conservés avec l’ex-ERAI fait partie de la négociation qui doit être menée pour trouver un équilibre raisonnable entre Business France et la chambre d’Istanbul. Votre rapporteure espère qu’une interprétation souple du texte conventionnel national permettra de trouver une adaptation locale acceptable par tous.
Il serait en effet dommage de perdre une part de la force vive du réseau français de soutien à nos entreprises en Turquie, car celui-ci n’est pas surdimensionné : le total des effectifs de Business France, du service économique et de la chambre locale représente en Turquie un peu plus de 30 emplois, soit environ 1,3 % des effectifs mondiaux cumulés de ces réseaux (2 600 emplois). Cette proportion apparaît en ligne avec ce que pèse la Turquie dans nos exportations (1,4 %) ou bien ce que pèse le PIB turc dans le PIB mondial (1 %).
Le nombre de volontaires internationaux en entreprise (VIE) présents en Turquie est assez limité : une cinquantaine.
L’embauche de VIE est en effet rendue plus difficile, car plus coûteuse pour les entreprises, du fait de la non-reconnaissance de leur statut par la Turquie : ils sont assimilés par l’administration turque à des salariés et assujettis à des charges sociales pleines.
Cette situation est regrettable, car les VIE présents en Turquie sont souvent des binationaux franco-turcs qui maîtrisent la langue et la culture locales, ce qui est un avantage certain pour les entreprises qui les accueillent. Votre rapporteure ne peut que se féliciter de voir dans ce cas valorisée la présence des fortes communautés d’origine étrangère qui enrichissent notre pays : cette valorisation, délibérément pratiquée par d’autres pays, notamment anglo-saxons, reste souvent insuffisante en France.
Le problème statutaire, qui se pose d’ailleurs dans de nombreux pays, pourrait sans doute être réglé en Turquie, car un projet d’accord bilatéral sur la mobilité des jeunes professionnels, qui assimilerait les VIE à des stagiaires de longue durée, a été préparé. Mais il faudra bien sûr une volonté politique forte – et sans doute une visite ministérielle…– pour aboutir sur ce dossier, d’autant que la négociation est compliquée par notre propre réticence, en France, à reconnaître des statuts dérogatoires au droit du travail. Or, la partie turque demande naturellement une forme de réciprocité.
À l’issue de l’audition, en commission élargie (6), de MM. Emmanuel Macron, ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, et Matthias Fekl, secrétaire d’État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger, et de Mme Martine Pinville, secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire, le jeudi 29 octobre 2015, la commission des affaires étrangères examine pour avis, sur le rapport de Mme Seybah Dagoma, les crédits du commerce extérieur (mission Économie) du projet de loi de finances pour 2016.
Suivant l’avis favorable de la rapporteure, elle émet un avis favorable à l’adoption de ces crédits tels qu’ils figurent à l’état B annexé à l’article 24 du projet de loi de finances pour 2016.
Ø M. Jean-François Gendron, président de la CCI de Nantes Saint-Nazaire et de CCI International, accompagné de Mme Samira Roussi
Ø M. Christian Mantei, directeur général d’Atout France
Ø Mme Agnès Romatet-Espagne, directrice des entreprises et de l’économie internationale (ministère des affaires étrangères et du développement international)
Ø M. Alain Renck, directeur de Bpifrance Export, M. Antoine Boulay, directeur des relations institutionnelles et médias de Bpifrance, et Mme Anne Guérin, directrice des financements internationaux
Ø M. Cyrille Pierre, directeur de cabinet du secrétaire d’État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des français de l’étranger
Ø Mme Sandrine Gaudin, cheffe du service des affaires bilatérales et de l’internationalisation des entreprises de la direction générale du Trésor (ministère de l’économie), et M. Charles Sarrazin, sous-directeur des financements
Ø Mme Muriel Pénicaud, directrice générale de Business France et ambassadrice aux investissements internationaux, et M. Axel Baroux, directeur du réseau international
*
À Ankara (les 14 et 15 octobre) :
Ø Son Exc. Charles Fries, ambassadeur de France en Turquie, et ses collaborateurs de la chancellerie politique, Mme Elsa Jouanolou, première secrétaire, et MM. Christophe Parisot, premier conseiller, Marc Ivarra, premier secrétaire, et Nicolas Broutin, conseiller presse
Ø M. Ahmet Canli, chef de département à la direction générale des exportations (ministère turc de l’économie), et ses collaborateurs
Ø MM. Esen Çağlar, directeur adjoint de TEPAV (think tank rattaché à l’Union des chambres de commerce turques), et Timur Kaymaz, chercheur
Ø MM. Ali Serdan Baran, directeur de Thales pour la Turquie, Nicolas de Magnienville, directeur général de Lafarge Dalsan, Samuel Herculin, directeur général de N.V. Turkse Perenco, et Vincent Rullet, associé de Novum Consulting
Ø M. Éric Plaisant, directeur adjoint du service économique régional et conseiller financier, Mme Danièle Scalisi, conseillère chargée de l’environnement, de l’énergie et des transports, Mme Maria Bonnafous-Boucher, conseillère adjointe chargée de la coopération et de l’action culturelle, et M. Pierre Autissier, conseiller agricole
*
À Istanbul (les 15 et 16 octobre) :
Ø M. Stéphan Dubost, délégué du service économique régional à Istanbul
Ø Mmes Hale Onursal Hatipoğlu, secrétaire générale adjointe de TÜSIAD (Association turque de l’industrie et des affaires), Nur Beler Levi, directrice nationale de la communication, et S. Pelen Işik, experte.
Ø M. Éric Fajole, directeur Turquie de Business France
Ø M. Bertrand Willocquet, directeur Turquie de l’Agence française de développement (AFD) en Turquie, et Mme Laetitia Dufay, directrice adjointe
Ø Mme Muriel Domenach, consule générale de France à Istanbul
Ø MM. Stéphane Hild, directeur général Turquie de la Société Générale, Thomas Dubruel, directeur de Renault Mais, José Coelho, directeur général d’Arkema en Turquie, Florence Guégan, de Groupama, et Mathieu Roy, de Gide
Ø MM. Yves-Marie Laouenan, président de la Chambre de commerce et d’industrie française en Turquie, et Raphaël Esposito, directeur
Ø MM. Alaaddin Metin, Enis Gültekin et Mesut Gürsoy, directeur généraux adjoints d’Eximbank (banque publique turque de l’export)
*
Par ailleurs, votre rapporteure, en tant que membre du groupe de travail de la commission des affaires étrangères sur les migrations, a également rencontré en Turquie des personnalités compétentes sur la question des réfugiés. Il sera rendu compte de ces rencontres dans le cadre des travaux du groupe de travail.
Votre rapporteure souhaite vivement remercier pour leur hospitalité et l’organisation de sa visite Son Exc. Charles Fries, ambassadeur de France en Turquie, Mme Muriel Domenach, consule générale à Istanbul, et toute l’équipe de l’ambassade et des services français en Turquie, notamment Mme Elsa Jouanolou et MM. Marc Ivarra, Éric Plaisant et Stéphan Dubost.